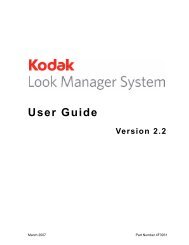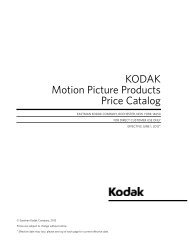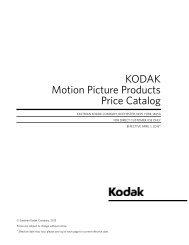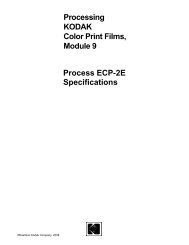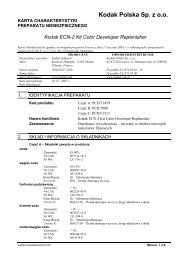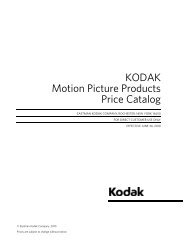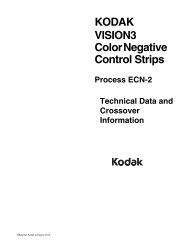archivage et conservation des films - Kodak
archivage et conservation des films - Kodak
archivage et conservation des films - Kodak
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quai <strong>des</strong> brumes de Marcel Carné (1938)<br />
Directeur de la photographie :<br />
Eugène Schüfftan © DR<br />
2 | ÉDITORIAL<br />
2 | ACTUALITÉS<br />
RENCONTRE<br />
3 | Woody Allen<br />
<strong>et</strong> le directeur de la photographie<br />
Darius Khondji, AFC, ASC<br />
Des r<strong>et</strong>rouvailles à Paris<br />
13 | Digimage Cinéma<br />
Portrait de “groupe”<br />
Denis Auboyer <strong>et</strong> Olivier Duval<br />
#34/35<br />
DOSSIER SPÉCIAL<br />
Archivage<br />
<strong>et</strong> <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong><br />
Rencontres avec...<br />
18 | Jérôme Seydoux > Pathé<br />
23 | Nicolas Seydoux > Gaumont<br />
27 | Béatrice de Pastre > Les Archives du film<br />
32 | Gwénolé Bruneau > <strong>Kodak</strong> France<br />
36 | Christian Lurin > Éclair Laboratoires<br />
40 | Jean-Pierre Boig<strong>et</strong> <strong>et</strong> Stéphane Martinie ><br />
Laboratoire LTC<br />
44 | Jean-René Failliot > Arane-Gulliver<br />
46 | Daniel Colland > CINÉ DIA
ÉDITO<br />
"L’héritage ne se transm<strong>et</strong> pas, il se conquiert."<br />
(André Malraux)<br />
À l’heure où le numérique démultiplie les possibilités de diffusion <strong>des</strong> <strong>films</strong> en<br />
suscitant de manière corrélative un besoin exponentiel de contenu, les « <strong>films</strong> de<br />
patrimoine » sont <strong>et</strong> demeurent un vivier incontournable, perm<strong>et</strong>tant au grand<br />
public de découvrir ou redécouvrir les œuvres de toute nature qui ont fait l’histoire<br />
du cinéma.<br />
Les succès grandissants <strong>des</strong> projections Cannes Classics sur la Crois<strong>et</strong>te, du Festival Lumière à Lyon<br />
<strong>et</strong> du Festival de Bologne ou encore l’immense succès de l’exposition actuelle consacrée à Stanley<br />
Kubrick à la Cinémathèque française (dont <strong>Kodak</strong> est partenaire) témoignent, s’il était besoin, de c<strong>et</strong><br />
engouement indéniable pour le patrimoine.<br />
Mais qu’est-ce qui distingue un « film de patrimoine » dont l’importance peut varier avec le temps ?<br />
Faut-il conserver de manière systématique tous les <strong>films</strong> ? Et sinon, quelles doivent être nos priorités<br />
face à l’immensité de la tâche qui reste à accomplir après plus de 115 ans de création cinématographique<br />
? Qui doit en assumer la responsabilité <strong>et</strong> en être le garant reconnu ? Enfin, de quels moyens<br />
techniques <strong>et</strong> financiers dispose-t-on aujourd’hui ?<br />
Autant de questions auxquelles « ACTIONS Le Mag » consacre sa nouvelle édition en s’intéressant<br />
aux enjeux fondamentaux que représentent la restauration <strong>et</strong> la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong>, un dossier<br />
accompagné de nombreux témoignages <strong>et</strong> points de vue pour vous aider à mieux cerner les contours<br />
de c<strong>et</strong>te problématique sur les plans culturel, économique <strong>et</strong> technique.<br />
Menée par la CST <strong>et</strong> la FICAM, une première réflexion approfondie sur le suj<strong>et</strong> a d’ores <strong>et</strong> déjà abouti<br />
à deux recommandations claires sur le plan technique en faveur :<br />
d’une numérisation en 2K minimum pour une garantie de diffusion de haute qualité sur tous les<br />
media actuels <strong>et</strong> futurs<br />
d’un r<strong>et</strong>our sur film argentique pour la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> œuvres à long terme.<br />
En eff<strong>et</strong>, face aux incertitu<strong>des</strong> actuelles concernant la fiabilité <strong>et</strong> la pérennité <strong>des</strong> solutions numériques<br />
pour la <strong>conservation</strong>, le film reste sans aucun doute la meilleure garantie. Rappelons que la<br />
durée de vie d’un film intermédiaire polyester couleur est de plus de 100 ans… <strong>et</strong> de cinq siècles<br />
dans le cas d’une séparation trichrome ! C’est pourquoi KODAK est - <strong>et</strong> continue d’être - pleinement<br />
engagé au côté <strong>des</strong> professionnels pour défendre <strong>et</strong> développer toujours davantage les solutions les<br />
mieux adaptées capables de répondre à ce défi devenu l’affaire de tous.<br />
Nos pouvoirs publics l’ont bien compris <strong>et</strong> nous saluons à sa juste mesure l’initiative du « grand emprunt<br />
» <strong>des</strong>tiné à favoriser la numérisation de nombreuses œuvres cinématographiques, ainsi que le<br />
soutien sans faille qu’ont apporté à Cannes le Directeur du CNC, Eric Garandeau, <strong>et</strong> le Ministre de<br />
la Culture <strong>et</strong> de la Communication, Frédéric Mitterrand, au r<strong>et</strong>our sur pellicule pour la <strong>conservation</strong><br />
à long terme.<br />
Nicolas Berard<br />
Directeur Général <strong>Kodak</strong> Cinéma <strong>et</strong> Télévision France, Benelux <strong>et</strong> Afrique du Nord<br />
Actions Le Mag - Juill<strong>et</strong>-août 2011 - n°34-35 - Une publication de la Division Cinéma <strong>et</strong> Télévision <strong>Kodak</strong><br />
Directeur de la publication : Nicolas Berard<br />
Rédactrice en chef : Gaëlle Tréhony -<br />
Conception <strong>et</strong> réalisation : Scope Éditions / www.scope-editions.com - Dépôt légal : septembre 2010 - ISSN 1271-1519<br />
<strong>Kodak</strong>, 26 rue Villiot 75012 Paris - Tél.: 01 40 01 35 15 - Fax: 01 40 01 34 01 - www.kodak.fr/go/cinema<br />
2<br />
Actualités<br />
DU NOUVEAU DANS LA GAMME<br />
DE FILMS NÉGATIFS<br />
Se juxtaposant au <strong>Kodak</strong> Vision3 500T 5219/7219 déjà existant<br />
sur le marché, <strong>Kodak</strong> prolonge aujourd’hui sa gamme de<br />
<strong>films</strong> négatifs de haute sensibilité avec le lancement du<br />
<strong>Kodak</strong> 500T 5230/7230 qui fait revenir du grain dans<br />
la création de l’image.<br />
Par rapport au standard Vision3 5219/7219, le <strong>Kodak</strong><br />
5230/7230 est un film moins saturé <strong>et</strong> moins contrasté<br />
qui facilite les choix créatifs dès la prise de vues, d’autant<br />
plus s’il n’y a pas de postproduction numérique prévue<br />
en bout de chaîne.<br />
Comme par ailleurs, le <strong>Kodak</strong> 5230/7230 dispose du même<br />
jeu de colorants que les <strong>films</strong> de la gamme Vision3, il présente<br />
aussi l’avantage de se marier parfaitement avec tous les autres <strong>films</strong><br />
<strong>des</strong> familles Vision2 <strong>et</strong> Vision3. On peut ainsi, <strong>et</strong> sans aucun problème, associer<br />
par exemple le 5230 <strong>et</strong> le 5213 (<strong>Kodak</strong> Vision3 200T).<br />
PROCHAIN RENDEZ-VOUS<br />
Les derniers <strong>films</strong> tournés sur pellicule <strong>Kodak</strong>, en sélection officielle au festival de Cannes 2011<br />
COLLOQUE INTERNATIONAL<br />
« Cinéma numérique : quel avenir pour les cinémathèques ? »<br />
Les 13 <strong>et</strong> 14 octobre 2011 à la Cinémathèque française<br />
Co-organisé par La Cinémathèque française<br />
<strong>et</strong> le CNC-Centre national du cinéma <strong>et</strong> de l’image animée<br />
Avec la participation <strong>des</strong> Laboratoires Éclair <strong>et</strong> de <strong>Kodak</strong><br />
TITRE RÉALISATEUR<br />
DIRECTEUR<br />
DE LA PHOTOGRAPHIE<br />
FORMAT<br />
DE PRISE DE VUES<br />
EMULSION<br />
KODAK<br />
PRIX<br />
MIDNIGHT IN PARIS (Film d'ouverture) Woody ALLEN DariusS KHONDJI, AFC, ASC 35mm 5213, 5219<br />
LA PIEL QUE HABITO (Compétition officielle) PEDRO ALMODOVAR José Luis ALCAINE, AEC 35mm 5219<br />
L'APOLLONIDE - SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE<br />
(Compétition officielle)<br />
Bertrand BONELLO Josée DESHAIES 35mm 3 perf 5219, 5201<br />
LE GAMIN AU VÉLO (Compétition officielle) Jean-Pierre <strong>et</strong> Luc DARDENNE Alain MARCOEN ,SBC 35mm 4perf 5219, 5207 GRAND PRIX<br />
LE HAVRE (Compétition officielle) Aki KAURISMÄKI Timo SALMINEN 35mm 3 perf 5207, 5219<br />
HANEZU NO TSUKI (Compétition officielle) Naomi KAWASE Naomi KAWASE Super 16 7219<br />
THE TREE OF LIFE (Compétition officielle) Terrence MALICK Emmanuel LUBERZKI, AMC 65 mm <strong>et</strong> 35 mm 5217, 5218 PALME D'OR<br />
LA SOURCE DES FEMMES (Compétition officielle) RADU MIHAILEANU GLYNN SPEECKAERT,SBC 35mm 4perf 5219, 5212, 5213<br />
THE ARTIST (Compétition officielle) MICHEL HAZANAVICIUS GUILLAUME SCHIFFMAN 35MM 5219 MEILLEUR ACTEUR<br />
HABEMUS PAPAM (Compétition officielle) Nanni MORETTI Alessandro PESCI , AIC 35mm 5207, 5219<br />
THIS MUST BE THE PLACE (Compétition officielle) Paolo SORRENTINO LUCA BIGAZZI 35mm 5213, 5219<br />
WU XIA (Séance de minuit) P<strong>et</strong>er HO-SUN CHAN Jake POLLACK, Yiu-Fai LAI 35mm 5201, 5213, 5219<br />
LA CONQUÊTE (Hors comp<strong>et</strong>ition) Xavier DURRINGER Gilles PORTE, AFC 35mm 3perf 5201, 5207, 5219<br />
THE BEAVER (Hors compétition ) Jodie FOSTER Hagen BOGDANSKI 35mm<br />
LABRADOR (Hors compétition) Frederikke ASPÖCK Magnus Nordenhof Jønck, DFF S16mm 7219,7213,7207<br />
LES BIENS AIMES (Film de clôture) Cristophe HONORE RÉMY CHEVRIN , AFC 35mm 3 perf 5219<br />
RESTLESS ( Un certain regard) Gus VAN SANT Harris SAVIDES, ASC 35mm 5229, 5201.<br />
HORS SATAN (Un certain regard) BRUNO DUMONT Yves CAPE, AFC, SBC 35mm 5219<br />
MARTHA MARCY MAY MARLENE (Un certain regard) SEAN DURKIN Jody Lee LIPES<br />
LOVERBOY (Un certain regard) CATALIN MITULESCU Marius PANDURU 35mm 5229, 5212<br />
THE YELLOW SEA (Un certain regard) HONG-JIN NA Sung-je LEE 35mm 5219, 5207<br />
OSLO, AUGUST 31ST (Un certain regard) JOACHIM TRIER Jakob IHRE 35mm 5217, 5219<br />
BÉ OMID É DIDAR (Un certain regard) MOHAMMAD RASOULOF<br />
Habemus Papam de Nanni Mor<strong>et</strong>ti,<br />
Directeur de la photographie :<br />
Alessandro Pesci, AIC<br />
ELENA (Film de clôture un certain regard) ANDREI ZVYAGINTCEV Michael KRICHMAN 5207, 5219<br />
MY LITTLE PRINCESS ( 50ème anniversaire SIC) EVA IONESCO Jeanne LAPOIRIE, AFC 35mm 5201, 5207, 5219<br />
DIRECTING PRIZE,<br />
UN CERTAIN REGARD<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
DARIUS<br />
KHONDJI AFC, ASC<br />
APRÈS « ANYTHING ELSE » EN 2003,<br />
« MIDNIGHT IN PARIS » TOURNÉ L’ÉTÉ DERNIER<br />
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE MARQUE<br />
LA DEUXIÈME COLLABORATION<br />
DU DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE<br />
DARIUS KHONDJI, AFC, ASC<br />
(« MY BLUEBERRY NIGHTS », « FUNNY<br />
GAMES U.S. », « CHÉRI ») AVEC LE<br />
RÉALISATEUR AMÉRICAIN WOODY ALLEN.<br />
3 | ACTIONS le mag’ #34-35<br />
Woody Allen <strong>et</strong> le directeur de la photographie, Darius Khondji pendant le tournage de "Midnight in Paris"
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
A. : Dans quelles circonstances avez-vous été amené à travailler avec Woody Allen ?<br />
Darius Khondji : Pendant la préparation du film Anything else en 2003,<br />
Woody Allen s’est séparé du directeur de la photographie avec qui il<br />
ne parvenait pas à s’entendre durant la préparation. Le fait de pouvoir<br />
travailler avec quelqu’un comme lui est forcément très excitant, mais à<br />
ce moment-là, je me trouvais sous contrat pour deux <strong>films</strong> publicitaires<br />
<strong>et</strong> n’étais libre que quinze jours seulement avant le début du tournage.<br />
Je me suis donc r<strong>et</strong>rouvé sur un film assez peu préparé. Anything else<br />
est un film de comédie à vocation classique sur lequel mon travail de<br />
directeur de la photographie est finalement demeuré un peu en r<strong>et</strong>rait.<br />
Woody Allen m’a d’ailleurs été reconnaissant d’avoir « interprété » son<br />
film sans poser de velléités photographiques très stylisées ou trop fortes.<br />
Venant de lui, c’est un grand – <strong>et</strong> rare – compliment.<br />
A. : Dès vos premières rencontres se sont développées <strong>des</strong> relations amicales…<br />
D.K. : Nous avons en eff<strong>et</strong> commencé à nous voir de temps en temps<br />
lorsque je venais à New York, soit pour dîner, soit pour regarder <strong>des</strong><br />
<strong>films</strong> ensemble. Un an après Anything else, il me parlait d’un film qui,<br />
avec le recul du temps, devait déjà être un peu Midnight in Paris qu’il<br />
avait sûrement en proj<strong>et</strong>. Il me disait qu’il me perm<strong>et</strong>trait c<strong>et</strong>te fois de<br />
m’exprimer davantage à la photographie. Et puis, le temps a passé. Dans<br />
l’intervalle, nous n’avons pas pu r<strong>et</strong>ravailler ensemble.<br />
A. : Vos écritures cinématographiques ne paraissent quand même pas tout<br />
à fait les mêmes…<br />
D.K. : J’ai tourné pas mal de <strong>films</strong> « à eff<strong>et</strong>s », de <strong>films</strong> noirs ou de <strong>films</strong><br />
d’horreur, en tout cas beaucoup de <strong>films</strong> très stylisés <strong>et</strong> a priori, rien ne<br />
me rapprochait de son univers, mais j’ai compris sa démarche. Lorsqu’il<br />
contacte Sven Nykvist, c’est parce que Bergman le fascine. Dans le cas<br />
de Carlo di Palma, c’est par référence à Antonioni <strong>et</strong> au cinéma européen<br />
<strong>des</strong> années 60. Aux États Unis, c’est de Gordon Willis dont Woody Allen<br />
se sentait très proche, c’est avec lui qu’il a beaucoup appris .<br />
A. : On en arrive donc à Midnight in Paris. Pour c<strong>et</strong>te deuxième collaboration<br />
avec Woody Allen, on imagine que vous intervenez c<strong>et</strong>te fois au tout début<br />
de la préparation…<br />
4<br />
Marion Cotillard <strong>et</strong> Owen Wilson<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
D.K. : Si l’on peut dire, car Woody prépare ses <strong>films</strong> de façon assez<br />
particulière <strong>et</strong> assez peu en amont. C’est quelqu’un qui travaille plutôt<br />
sur le tournage dans l’élan du film. Son excitation à faire un film est<br />
parfois si forte <strong>et</strong> si intéressante qu’elle supplée aux six semaines de<br />
préparation qui feraient défaut à d’autres. C’est curieux parce que tout<br />
semble précipité <strong>et</strong> puis Woody arrive <strong>et</strong> brusquement, on r<strong>et</strong>ombe<br />
sur nos pieds. Sur Midnight in Paris, j’ai donc eu quatre semaines de<br />
préparation seulement <strong>et</strong> trois avec le réalisateur. La grande différence<br />
pour moi entre les deux <strong>films</strong> sur lesquels j’ai travaillé pour Woody,<br />
c’est que j’aimais bien le scénario de Anything else, mais il ne me faisait<br />
pas rêver alors que l’histoire de Midnight in Paris me touche beaucoup.<br />
A. : Face à c<strong>et</strong>te méthode de travail, à quel moment <strong>et</strong> avec qui pouviez-vous<br />
partager en amont vos réflexions autour de l’image du film?<br />
D.K. : J’ai travaillé en étroite collaboration avec la « production <strong>des</strong>igner »<br />
Anne Seibel qui avait travaillé sur le film Marie-Antoin<strong>et</strong>te de Sofia Coppola<br />
<strong>et</strong> qui était, comme moi, absolument passionnée par le film. Et puis, il y<br />
avait les indications de Woody. Ce qui rendait les choses assez difficiles<br />
était surtout le fait que l’histoire se déroule sur plusieurs époques : l’époque<br />
contemporaine, la Belle Époque, 1920 <strong>et</strong> le XVII ème siècle.<br />
A. : Pour « réviser » ces différentes époques (même sommairement), comment<br />
avez-vous procédé ?<br />
D.K. : Woody m’a juste fait parvenir un mail en m’expliquant ce qu’il<br />
aimait bien dans le film de Stephen Frears, Chéri <strong>et</strong> la façon différente<br />
dont il souhaitait traiter chaque époque. Il voulait ressentir le côté<br />
« roaring twenties », « respirer » ce qui exprime vraiment les années 20.<br />
Une de mes inspirations a été les tableaux de Reginald Marsh. Mais la<br />
mise en image de la période « années 20 » le rendait particulièrement<br />
soucieux. Un moment, il a même pensé la traiter en noir <strong>et</strong> blanc pour<br />
la différencier, une idée qui ne m’excitait pas beaucoup car je n’aime pas<br />
mélanger la couleur <strong>et</strong> le noir <strong>et</strong> blanc. Après avoir longuement hésité, il<br />
ne l’a finalement pas fait. Dans son mail, il me citait aussi Le conformiste<br />
de Bernardo Bertolucci pour le traitement <strong>des</strong> couleurs, Blow-up pour les<br />
extérieurs « période contemporaine » <strong>et</strong> Annie Hall pour les tons « chair »<br />
par temps gris. C’était extrêmement évocateur pour moi, c’était une clé.<br />
Qui plus est, Le conformiste fait partie <strong>des</strong> <strong>films</strong> qui m’ont donné envie<br />
de faire du cinéma !<br />
5<br />
A. : Y avait-il d’autres « recommandations » ?<br />
D.K. : Pour les extérieurs « jour » de la période contemporaine, il voulait<br />
<strong>des</strong> nuages. Il faut savoir que Woody n’aime tourner que par temps gris.<br />
A. : … c’est pour cela qu’il a choisi de tourner à Paris en plein été !<br />
D.K. : Il ne tourne que l’été, que ce soit à New York, Barcelone, Londres<br />
ou Paris ! Je ne crois pas, durant ces dix dernières années, qu’il ait une<br />
seule fois tourné à une autre période.<br />
Woody Allen me citait Le Conformiste<br />
pour le traitement <strong>des</strong> couleurs, Blow up<br />
pour les extérieurs "période contemporaine"<br />
<strong>et</strong> Annie Hall pour les tons "chair"<br />
par temps gris. Darius Khondji.<br />
A. : En évoquant un film comme Le conformiste, voulait-il parler de couleurs<br />
« désaturées » ?<br />
D.K. : Non, il pensait plutôt au contraste <strong>des</strong> températures de couleurs<br />
assez fortes. Dès la tombée du jour, on sent les intérieurs orangés,<br />
l’utilisation de lampes tungstène très « pêche ». En fin de journée - en<br />
automne ou en hiver - l’intérieur <strong>des</strong> maisons est « orange », sauf les<br />
bureaux éclairés au néon bien sûr. Les températures de couleurs de<br />
Storaro m’ont beaucoup touché lorsque j’étais adolescent, je me souviens<br />
très bien avoir remarqué le bleu <strong>et</strong> l’orange. Si on regarde les <strong>films</strong> de<br />
Woody Allen de ces dix dernières années, ils sont tous quasiment rouge<br />
<strong>et</strong> orange.<br />
A. : Si je comprends bien, il vous indique les directions avec <strong>des</strong> références,<br />
mais c’est à vous de les interpréter…<br />
D.K. Oui, mais avec toujours très peu de références. Ensuite, c’est à<br />
nous de continuer.<br />
La mise en image de la période "années 20"<br />
rendait Woody Allen particulièrement soucieux.<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
A. : Et c<strong>et</strong>te « interprétation » a lieu en majeure partie avant qu’il n’arrive<br />
sur le plateau…<br />
D.K. : En fait, je lui pose très peu de questions, nous parlons quelquefois<br />
d’une ambiance, mais c’est tout. C’est peut-être difficile à comprendre,<br />
mais on travaille assez aisément avec lui. Il faut juste accepter de ne<br />
pas lui compliquer la vie <strong>et</strong> de ne pas le surcharger de questions en lui<br />
demandant une somme d’explications psychologiques. Avec l’expérience,<br />
on sait que les m<strong>et</strong>teurs en scène envoient tous <strong>des</strong> messages plus ou<br />
moins codés qu’il faut bien écouter pour obtenir la clé de leurs <strong>films</strong>. Les<br />
clés photographiques d’un film tiennent parfois à très peu de choses.<br />
A. : Quels ont été le format <strong>et</strong> la durée du tournage ?<br />
D.K. : Nous avons tourné en sept semaines de cinq jours <strong>et</strong> en Super 1.85<br />
trois perfs. Un mois <strong>et</strong> demi après la fin du tournage, le film était monté.<br />
A. : Vu de l’extérieur, Woody Allen donne l’impression (un peu comme Godard)<br />
d’être parfois « autiste » … <strong>et</strong> pourtant, leur cinéma à tous deux est porteur<br />
d’une très forte identité…<br />
D.K. : Leur image aussi est très forte. En quelques secon<strong>des</strong>, on reconnaît<br />
un film de Godard par la radicalité de son image. C’est la patte de certains<br />
grands m<strong>et</strong>teurs en scène, je crois.<br />
A. : Prenons par exemple le repérage d’un décor. Comment cela se passe-t-il ?<br />
À quel stade intervient-il ?<br />
D.K. : À New York, je l’avais observé travailler avec son « production<br />
<strong>des</strong>igner » sur Anything else <strong>et</strong> j’ai fait en sorte de r<strong>et</strong>rouver la même<br />
chose avec Anne Seibel sur Midnight in Paris. Je les laissais parfois parler<br />
ensemble avant même d’intervenir sur ce film entièrement en décors<br />
naturels. Avec Woody, c’est simple : il regarde <strong>et</strong> nous discutons <strong>des</strong> axes<br />
mais tout reste très ouvert. Si pour telle ou telle raison, je suggère quelque<br />
chose, il en tient compte, à moins qu’il n’en comprenne pas la raison. Dans<br />
ce cas-là <strong>et</strong> comme je suis très attaché à ce qu’il réalise son film - <strong>et</strong> à sa<br />
manière - c’est à moi de le suivre. Il est très facile de travailler avec Woody,<br />
il faut simplement faire attention de ne jamais devenir « imposant » car<br />
c’est quelqu’un qui accorde sa confiance à très peu de personnes, mais il<br />
s’agit toujours d’une confiance totale. Avec ses acteurs, il est intransigeant<br />
6<br />
XXXXX<br />
Woody Allen<br />
A. : On raconte pourtant qu’il ne leur parle pas…<br />
D.K. : Ce n’est pas vrai, il leur parle. Quand il s’entend bien avec quelqu’un<br />
comme avec Owen Wilson sur Midnight in Paris, c’est merveilleux. Woody<br />
est un réalisateur qui aime tourner, mais aussi r<strong>et</strong>ourner <strong>des</strong> scènes. Sur<br />
Midnight in Paris, nous avons nous aussi eu droit à <strong>des</strong> « r<strong>et</strong>akes », mais<br />
"C’est quelqu’un qui accorde sa confiance à très peu de personnes<br />
mais il s’agit toujours d’une confiance totale."<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
très peu, l’équivalent de deux ou trois jours (tout en finissant avec un<br />
jour d’avance sur le plan de travail) .<br />
A. : Donne-t-il chaque fois la raison précise du « r<strong>et</strong>ake » ?<br />
D.K. : Nous savons toujours un peu pourquoi même si nous ne le comprenons<br />
pas forcément. Une fois, il y avait un problème de perruque,<br />
mais la plupart du temps, c’était pour le jeu <strong>des</strong> acteurs ou un décor<br />
qui ne correspondait plus à l’histoire qu’il racontait. Ceci étant, aucun<br />
autre réalisateur n’aurait r<strong>et</strong>ourné les plans en question pour les mêmes<br />
raisons que lui. Woody, oui ! C’est son œil d’artiste, son univers. S’il a<br />
un doute, il recommence.<br />
A. : Revenons à la photographie <strong>des</strong> différentes époques du film. Comment<br />
les avez-vous abordées ?<br />
D.K. : Avec angoisse <strong>et</strong> anxiété ! Comme nous n’avions pas toujours<br />
Woody sous la main, nous avons passé <strong>des</strong> après midi entières à nous<br />
plonger avec Anne Seibel dans une volumineuse documentation à base<br />
de tableaux <strong>et</strong> de photos qu’Anne avait rassemblée, particulièrement <strong>des</strong><br />
photos d’Atg<strong>et</strong> <strong>et</strong> de Brassaï. Même si le témoignage de Brassaï porte<br />
plutôt sur les années trente, cela informe quand même sur le Paris de<br />
l’époque. On s’aperçoit par exemple que la ville était éclairée de façon<br />
minimaliste avec quelques halos de lumière <strong>et</strong> beaucoup d’ombre.<br />
Aujourd’hui, c’est l’inverse : Paris est « sur-éclairé », il y a trop de lumière<br />
sur les bâtiments, trop de mélange de couleurs. Et puis, le Paris de ces<br />
trente dernières années a été défiguré en partie par le mobilier <strong>et</strong> tous<br />
les accessoires urbains. J’ai donc décidé d’éteindre un p<strong>et</strong>it peu Paris <strong>et</strong><br />
de ré-éclairer ponctuellement ce qui m’intéressait. Woody me regardait<br />
parfois comme s’il avait à faire à un extra-terrestre. Son film était une<br />
comédie <strong>et</strong> quelque part, ce n’était pas grave si on y voyait le Paris<br />
d’aujourd’hui. Très vite, je me suis aperçu qu’il était même prêt à filmer<br />
un Paris actuel éclairé avec un mélange de sodium, de mercure, de néon,<br />
d’enseignes lumineuses <strong>et</strong> de mobilier urbain. J’exagère un p<strong>et</strong>it peu,<br />
mais en fait, il me paraissait parfois d’une modernité incroyable <strong>et</strong> je me<br />
sentais dépassé par sa vision de la comédie d’époque. À ce moment là,<br />
je le suivais aveuglement plutôt que d’essayer d’analyser le « pourquoi »,<br />
je fonctionnais davantage par confiance <strong>et</strong> avec mes « antennes ». Au<br />
final, nous avons pris un accord avec la ville de Paris pour faire éteindre<br />
« raisonnablement » le plus possible de lumières en tenant compte du<br />
7<br />
XXXXX<br />
fait que Woody Allen souhaitait que les scènes soient quand même<br />
éclairées avec un minimum de lumière. Ce qui lui importait était moins<br />
la véracité de l’ambiance du Paris de l’époque post « première guerre<br />
mondiale » que les rapports entre ses personnages <strong>et</strong> la véracité <strong>des</strong><br />
scènes qu’il avait à filmer.<br />
A. : Au résultat, c’est un compromis entre vos deux options ?<br />
D. K. : Exactement, sachant que nous avons malgré tout pas mal filmé la<br />
ville telle qu’elle est aujourd’hui, y compris pour la partie dite d’époque.<br />
Au résultat, c’est particulier, mais ce qui minimise le décalage, c’est qu’il<br />
est question dans le film de la rêverie <strong>et</strong> de l’imagination d’un personnage.<br />
Dans le scénario, il glisse vraiment dans le passé. Quand on voit le film,<br />
on est juste conscient que ce n’est pas le Paris de l’époque <strong>et</strong> que l’on n’a<br />
"Nous avons éteindre "raisonnablement" le plus possible de lumières en tenant<br />
compte du fait que Woody Allen souhaitait que les scènes soient quand même<br />
éclairées avec un minimum de lumière."<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
Ce qui est important pour Woody Allen,<br />
c’est le degré de lumière par rapport à la scène, c’est l’ambiance lumineuse.<br />
pas à faire à une reconstitution historique minutieuse. Aucun m<strong>et</strong>teur<br />
en scène ne tournerait aujourd’hui comme cela.<br />
A. : Sur le terrain, comment avez-vous « r<strong>et</strong>ravaillé » la ville ?<br />
D. K. : En 1926, c’était encore les débuts de l’électricité <strong>et</strong> pour bien faire,<br />
il aurait fallu ne quasiment rien éclairer <strong>et</strong> « réinventer » la lumière <strong>des</strong><br />
réverbères dont certains étaient déjà électriques, mais la plupart encore<br />
« à gaz ». Heureusement, l’équipe « déco », conduite de main de maître<br />
par Anne Seibel, était extraordinaire. Nous avons compensé en m<strong>et</strong>tant un<br />
peu de fumée <strong>et</strong> en créant du brouillard dans la nuit. Pour la partie « film<br />
d’époque » – <strong>et</strong> uniquement pour celle-là – nous avons fait mouiller le<br />
sol <strong>et</strong> ruisseler un peu d’eau avec <strong>des</strong> débris ou <strong>des</strong> carcasses fumantes<br />
dans le lointain. Woody avait dans la tête l’image d’un Paris romantique<br />
<strong>et</strong> il n’était pas question pour lui - <strong>et</strong> à raison - de se r<strong>et</strong>rouver avec une<br />
sorte de « Jack l’éventreur » à la française qui n’aurait correspondu en<br />
rien à l’atmosphère qu’il recherchait.<br />
A. : Si je comprends bien, ce sont d’abord les situations <strong>et</strong> les sentiments qui<br />
l’intéressent dans les époques qu’il a sélectionnées…<br />
D.K. : Ce qui est important pour lui, c’est le degré de lumière par rapport à<br />
la scène, c’est l’ambiance lumineuse. Dans certaines séquences, le « tropéclairé<br />
» peut le gêner, mais si la scène est prévue dans la pénombre, il n’y<br />
a pas de limite <strong>et</strong> on peut carrément finir dans le noir. Il peut être frustrant<br />
de ne pas disposer d’assez de temps pour préparer le tournage <strong>et</strong> de ne<br />
pas discuter comme on le ferait avec un autre m<strong>et</strong>teur en scène, mais d’un<br />
autre côté, Woody est un homme très généreux qui vous laisse vraiment<br />
<strong>des</strong> responsabilités au niveau du cadre, de la façon de voir <strong>et</strong> de filmer.<br />
A. : C’est peut-être ce qui explique la spontanéité <strong>et</strong> le décalage de ton qui lui<br />
sont propres. Ce « manque de préparation » fait aussi que rien n’est statufié,<br />
rien n’est hiératique.<br />
8<br />
D.K. : C’est sa façon de travailler, il ne peut pas tourner autrement. La<br />
seule chose qui peut l’arrêter <strong>et</strong> lui faire refaire une prise, c’est le temps<br />
en extérieur jour… s’il y a du soleil. « Trop » de soleil ! Sur Anything else, il<br />
nous est arrivé de tourner par temps ensoleillé <strong>et</strong> il n’aimait pas du tout.<br />
Même si les personnages sont la plupart du temps filmés en contre-jour,<br />
il trouve toujours la lumière trop violente.<br />
A. : Comme figure emblématique de la ville de New York, on se souvient tous<br />
de la manière dont Woody Allen a filmé « sa » ville. Au cœur de son œuvre,<br />
la ville est un vrai personnage. Quel rapport a-t-il entr<strong>et</strong>enu avec Paris ?<br />
D.K. : Il était vraiment très excité à l’idée de filmer Paris. Ce qui me frappe,<br />
c’est la fascination qu’il éprouve pour c<strong>et</strong>te ville. Les premières semaines,<br />
nous avons commencé à faire <strong>des</strong> plans le week-end en équipe réduite <strong>et</strong><br />
donc toujours par temps gris. Son rêve, c’était qu’il pleuve ! Quand c’était<br />
le cas <strong>et</strong> que nous nous r<strong>et</strong>rouvions trempés jusqu’aux os, lui était là, les<br />
mains dans les poches sous son bonn<strong>et</strong> ruisselant comme si de rien n’était.<br />
Il arborait un grand sourire <strong>et</strong> il prenait du plaisir, comme s’il écoutait de la<br />
musique. Ce qu’il fallait éviter, c’étaient les axes les plus beaux à la limite<br />
de la carte postale pour privilégier un carrefour banal <strong>et</strong> le Paris quotidien<br />
qui avait pour lui valeur de romantisme absolu (ce qui marche très bien<br />
dans le film d’ailleurs). Très curieusement, il n’était pas du tout bluffé par<br />
les endroits qu’on voulait lui montrer, mais il pouvait tomber sous le charme<br />
d’un simple immeuble. C’est vraiment un artiste. Je ne me souviens plus<br />
si le plan est demeuré dans le film, mais il m’a demandé un jour de filmer<br />
un immeuble haussmannien de l’avenue Foch qui faisait l’angle d’une rue<br />
<strong>et</strong> était quasiment dissimulé par les arbres. C’était très beau. Enfin, nous<br />
filmions un plan que nous avions envie de filmer (rires) !!! Je me souviens<br />
aussi que quand l’ambassadeur <strong>des</strong> Etats-Unis est venu nous rendre visite<br />
le dernier jour, Woody lui a dit en parlant de moi : « c’est formidable, il a filmé<br />
Paris comme Paris n’a jamais été filmé ! » Je souris en y pensant car beaucoup<br />
de plans montrent <strong>des</strong> carrefours avec <strong>des</strong> voitures <strong>et</strong> <strong>des</strong> badauds en shorts<br />
sur les trottoirs. Disons que ce n’est pas un Paris que l’on aurait envie de<br />
montrer à <strong>des</strong> étrangers. En revanche, le Paris nocturne <strong>des</strong> années 20 est<br />
demeuré très romantique, limite carte postale.<br />
" Woody avait dans la tête l’image d’un Paris romantique..."<br />
Carla Bruni-Sarkozy <strong>et</strong> Owen Wilson<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
A. : Sur Midnight in Paris, vous êtes l’un <strong>des</strong> premiers directeurs de la<br />
photographie à avoir utilisé la pellicule <strong>Kodak</strong> Vision3 200T 5213. Quelles<br />
sont vos impressions ?<br />
D.K. : Cela faisait un moment que j’avais envie de revenir aux pellicules<br />
<strong>Kodak</strong>. Autant l’ancienne 200 m’avait à l’époque laissé un peu sceptique,<br />
autant les essais réalisés avec la Vision3 200T 5213 m’ont convaincu. Il<br />
s’en dégage en eff<strong>et</strong> quelque chose de très pictural qui est parfait pour les<br />
intérieurs <strong>et</strong> les extérieurs. Son seul problème, c’est le bas de courbe dans<br />
la sous-exposition quand je n’ai pas envie d’éclairer davantage. La <strong>Kodak</strong><br />
Vision3 500T 5219, je la connais bien. C’est une très belle pellicule qui, à<br />
la fois, me perm<strong>et</strong> de poser mon négatif comme j’en ai envie <strong>et</strong> de laisser<br />
aller les noirs. Avec c<strong>et</strong>te pellicule, tout « sort » bien, c’est très agréable.<br />
Elle me perm<strong>et</strong> de sous exposer le négatif comme j’aime <strong>et</strong> sans risque.<br />
Sur Midnight in Paris, j’étais toujours à -1, -1,5 <strong>et</strong> c’est très beau. La majeure<br />
partie du film a été tourné avec la <strong>Kodak</strong> Vision3 500T 5219, exceptés les<br />
extérieurs « jour » <strong>et</strong> quelques intérieurs « jour » avec la Vision3 200T<br />
5213. Ce qui m’importe, c’est d’obtenir ce que je désire au DI <strong>et</strong> savoir que<br />
si, pour une raison ou pour une autre, je dois repasser au photochimique<br />
en post production, je n’aurai pas de gris. Plus j’avance, plus j’éclaire à<br />
l’œil, ce à quoi la Vision3 5219 se prête admirablement.<br />
A. : Comment votre manière de travailler a-t-elle évolué avec le temps ?<br />
D.K. : Aujourd’hui, travailler la lumière est devenu un plaisir palpable <strong>et</strong><br />
sensuel. C’était déjà un peu le cas avant, mais c’est devenu maintenant<br />
très organique. Beaucoup de gens pourraient être opérateurs, c’est une<br />
question de goût <strong>et</strong> de culture. Il y a longtemps, Françoise Elefantis qui<br />
travaillait à l’époque chez <strong>Kodak</strong>, me disait en me parlant de Philippe<br />
Rousselot : « Il est génial, il n’utilise qu’une seule pellicule sur tout un film ! »<br />
Je trouvais cela incroyable quand moi, j’en utilisais encore quatre ou<br />
cinq de sensibilité différente. Aujourd’hui, je suis arrivé à deux. Je me<br />
raconte <strong>des</strong> histoires avec les pellicules, chacune correspond pour moi<br />
à quelque chose de bien particulier avec son caractère, son ambiance,<br />
un peu comme <strong>des</strong> personnages finalement. J’ai besoin de leur donner à<br />
manger <strong>des</strong> choses différentes <strong>et</strong> de les nourrir pour qu’elles deviennent<br />
<strong>des</strong> animaux tantôt familiers, tantôt effrayants. Une pellicule, c’est comme<br />
un manifeste, c’est « politique » selon la façon dont on l’expose. En ce<br />
moment, j’ai envie de voyager avec la Vision3 5219.<br />
9<br />
Aujourd’hui, travailler la lumière est devenu un plaisir<br />
palpable <strong>et</strong> sensuel. C’était déjà un peu le cas<br />
avant mais c’est devenu maintenant très organique.<br />
A. : Qu’est-ce qui conditionne votre prise de risques sur un film ?<br />
D.K. : Le m<strong>et</strong>teur en scène <strong>et</strong> la confiance que j’ai en lui ! Il me faut<br />
comprendre jusqu’où il m’autorise c<strong>et</strong>te prise de risque, c’est tout.<br />
Comparé à certains m<strong>et</strong>teurs en scène avec qui j’ai eu la chance de<br />
travailler, je ne trouve pas que je prends beaucoup de risques, ce sont<br />
eux qui sont admirables, eux <strong>et</strong> certains acteurs.<br />
A. : « Prendre <strong>des</strong> risques », c’est votre « manière d’être » ?<br />
D.K. : Pour prendre <strong>des</strong> risques il faut pouvoir s’appuyer sur une équipe<br />
très solide. Sur Midnight in Paris, j’étais entouré d’une équipe caméra<br />
lumière <strong>et</strong> machinerie particulièrement formidable : (Thierry Beaucheron<br />
mon Gaffer, Cyril Kunholz mon chef machiniste <strong>et</strong> leurs équipes, mes<br />
assistants caméra : Fabienne Octobre <strong>et</strong> Julien Andre<strong>et</strong>ti <strong>et</strong> mon cadreur/<br />
steadicameur : Jan Rubens). Qui n’aimerait pas prendre <strong>des</strong> risques !<br />
Avec Michael Haneke par exemple, on se r<strong>et</strong>rouve parfois dans une<br />
rigueur extrême, on a l’impression d’être très restreint <strong>et</strong> pourtant, à sa<br />
manière, il vous pousse lui aussi à oser <strong>des</strong> choses. Sans lui, je n’aurais<br />
jamais pu oser ce que j’ai osé sur Funny Games U.S. J’ai eu besoin pour<br />
cela de son esprit, de son éveil sur la lumière <strong>et</strong> de sa connaissance de<br />
la « vérité <strong>des</strong> choses » par rapport à son récit <strong>et</strong> à ses personnages.<br />
J’ai l’impression qu’avec Woody Allen, il me faudrait encore un ou deux<br />
<strong>films</strong> pour augmenter ma prise de risques… ou alors, être quelqu’un de<br />
plus courageux, je ne sais pas. Avec Woody, tout est possible, tout le<br />
temps. C’est anecdotique, mais jamais nous n’aurions pu penser qu’il<br />
en arriverait par exemple à tourner de nuit car Woody est quelqu’un<br />
qui se couche tôt ! Sur Anything else, nous avions peu de tournage de<br />
nuit, mais Midnight in Paris est un film qui se déroule essentiellement de<br />
nuit. Pendant la préparation, sa productrice lui en a parlé une ou deux<br />
fois, moi-même j’ai plaisanté là-<strong>des</strong>sus <strong>et</strong> Woody, à chaque fois, nous<br />
regardait d’un air innocent <strong>et</strong> disait juste : « à minuit, je vais me coucher ! »<br />
Eh bien, nous avons – <strong>et</strong> il a – tourné de nuit <strong>et</strong> parfois même jusqu’à<br />
cinq heures du matin ! Il était très excité, comme un enfant, c’était une<br />
Owen Wilson <strong>et</strong> Rachel McAdams<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
grande première pour lui. Une autre grande première pour lui a été la<br />
post production numérique. C’est du moins ce que m’ont confié sa<br />
productrice <strong>et</strong> sa monteuse à New York.<br />
A. : En post production numérique – puisque vous abordez le suj<strong>et</strong> – quel sera<br />
l’axe essentiel de votre travail ?<br />
D.K. : Augmenter le contraste, doser l’ambiance entre la période<br />
contemporaine <strong>et</strong> les années 20 <strong>et</strong> travailler davantage qu’elle ne l’est<br />
actuellement l’image d’époque ! Tout cela si Woody le perm<strong>et</strong>, car encore<br />
une fois, il a un goût personnel très prononcé pour le rouge <strong>et</strong> le chaud.<br />
Pour information, ce que nous appelons nous, un film « chaud » est encore<br />
pour lui un film trop froid. Il va donc s’agir de lui faire accepter l’idée<br />
de « bousculer ses habitu<strong>des</strong> ». Si cela se trouve, ce sera l’essentiel de<br />
mon travail à New York : lui suggérer comment l’on peut éventuellement<br />
modifier certaines choses sans pour autant se r<strong>et</strong>rouver avec un rendu<br />
froid ou triste. La finalité, c’est juste qu’il se r<strong>et</strong>rouve avec le film qu’il<br />
veut. Mon souci, c’est que la production a prévu une semaine seulement<br />
d’étalonnage. Pour moi qui considère que faire un DI en deux semaines<br />
est déjà du travail bâclé, j’ai de quoi m’inquiéter !<br />
A. : Woody Allen s’intéresse-t-il aux nouvelles technologies ?<br />
D.K. : Non ! Je dis un « non » un peu radical, mais c’est ce que je pense.<br />
En fait, il aime tellement le support « film » que nous aurions peut-être<br />
dû aller vers une post production traditionnelle. Parfois, c’est vrai, il n’y<br />
a aucune raison d’aller vers le numérique.<br />
... quelques semaines plus tard<br />
A. : Vous venez de rentrer de New York. Le temps d’étalonnage qui vous était<br />
imparti a-t-il été tenu ?<br />
D.K. : Joe Gawler, le coloriste, m’a beaucoup aidé. Il avait travaillé les deux<br />
jours précédents ma venue sur un pré-étalonnage droit, sans indication de<br />
ma part, mais l’étalonnage s’est vraiment fait en sept jours chez Deluxe<br />
Digital (même si je ne recommande à personne de le faire dans de si courts<br />
délais). Nous avons fait une image « chaude » puisque Woody aime à voir<br />
ses <strong>films</strong> étalonnés très chauds, mais quand même une image « à mon<br />
goût ». Il est venu s’asseoir trois fois avec nous. La première fois, nous<br />
10<br />
avions déjà fait une journée <strong>et</strong> demie de travail <strong>et</strong> un premier passage de<br />
tout le film. En fait, Midnight in Paris ne comporte pas beaucoup de plans,<br />
il y a peu de coupes. Chaque fois, il regardait le film dans sa totalité en<br />
mu<strong>et</strong>, mémorisait tout dans sa tête <strong>et</strong> à la fin de chaque projection, bobine<br />
par bobine, passait en revue ce qu’il n’aimait pas. C’était très étonnant.<br />
Ceci étant, il était déjà content <strong>des</strong> rushes <strong>et</strong> de la copie de travail. Il a<br />
toujours été très positif, a toujours parlé avec infiniment d’attention <strong>et</strong> de<br />
gentillesse, même pour dire que telle ou telle séquence lui paraissait un peu<br />
éteinte ou bien trop dense ou encore trop triste par rapport à son envie.<br />
D’une certaine façon, j’étais toujours d’accord avec lui <strong>et</strong> ce n’était jamais<br />
<strong>des</strong> choses qui rem<strong>et</strong>taient en cause ma conception de la photographie<br />
ou mon travail. Woody était tellement content qu’il disait même parfois<br />
que si nous ne changions rien, ce n’était pas grave. Il est revenu après<br />
mon départ pour essayer de modifier légèrement une séquence mais il a<br />
renoncé <strong>et</strong> est revenu à l’étalonnage que nous avions fait.<br />
A. : De quelle séquence s’agit-il ?<br />
D.K. : C’est une séquence assez comique dans l’hôtel Bristol quand les<br />
parents arrivent en peignoir de bain.<br />
A. : Avant de partir à New York, vous disiez que vous vouliez « corriger<br />
certaines époques les unes par rapport aux autres ». Qu’en a-t-il été ?<br />
D.K. : Nous avons r<strong>et</strong>ravaillé la densité au TC en poursuivant dans le sens de<br />
ce que j’avais initié avec les objectifs Cooke. En fait, j’ai essayé de les altérer<br />
un peu comme si l’image était d’une facture plus ancienne, comme si cela<br />
avait été photographié avec <strong>des</strong> objectifs <strong>des</strong> années 50 ou 60. Cela demeure<br />
subliminal, mais j’ai injecté par exemple dans la partie « années 20 » un peu<br />
de vign<strong>et</strong>tage sur certains plans ou alors, j’ai saturé <strong>et</strong> contrasté en même<br />
temps. Tout a été fait en fonction de la prise de vues comme si l’image était<br />
plus poétique <strong>et</strong> plus ancienne. Pour la partie 1900, j’ai carrément fait très<br />
flamboyant, très chaud, très coloré. Et pour le p<strong>et</strong>it bout d’époque XVII ème<br />
siècle – il est très court – j’ai fait plus « cristallin », plus « or » (en réalité, j’ai<br />
fait jouer le décor qui était naturellement très doré). Le coloriste Joe Gawler<br />
« répondait » bien <strong>et</strong> comprenait vite ce que je voulais.<br />
A. : Il y a quelques semaines, vous espériez que Woody Allen ne revienne<br />
pas à son idée du « noir <strong>et</strong> blanc » pour le passé…<br />
Rachel McAdams, Owen Wilson <strong>et</strong> Woody Allen<br />
Owen Wilson <strong>et</strong> Rachel McAdams<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
D.K. : Il n’a même pas évoqué le suj<strong>et</strong>. Au moment de la prise de vues, il s’était<br />
aperçu que cela fonctionnait très bien, ce que le montage lui a confirmé.<br />
A. : Aujourd’hui terminé, comment le film préserve-t-il son unité photographique<br />
avec toutes ces époques au traitement chaque fois différent ?<br />
D.K. : Quand j’ai vu le film monté plusieurs semaines avant l’étalonnage,<br />
j’avais l’estomac noué parce qu’à ce moment-là, il n’y avait encore ni unité<br />
de couleurs, ni unité artistique. C’est seulement une fois l’étalonnage<br />
réalisé - <strong>et</strong> une fois que l’on a commencé à m<strong>et</strong>tre le son car nous avons<br />
étalonné en « mu<strong>et</strong> » pour ne pas être « distrait » - c’est là que j’ai<br />
vraiment commencé à l’apprécier. Les techniciens aussi, qui éclataient<br />
de rire. On sentait qu’ils étaient pris par le film, cela faisait plaisir à voir.<br />
A ce moment-là, je ne faisais plus attention à l’image, je regardais les<br />
comédiens.<br />
A. : Maintenant que vous possédez un peu plus de recul, comment a réagi<br />
la pellicule <strong>Kodak</strong> en post production ?<br />
D.K. : Un film <strong>et</strong> son image, c’est comme une voiture de formule 1, comme<br />
une Ferrari avec sa couleur <strong>et</strong> ses réglages. Une pellicule qui fonctionne<br />
bien, c’est un peu comme <strong>des</strong> pneumatiques qui répondent quels que<br />
soient les accidents de la route à affronter. Vous sentez la générosité<br />
de la pellicule à la façon dont vous pouvez la poser, à la liberté qu’elle<br />
vous accorde pour prendre <strong>des</strong> risques. C’est le cas de la <strong>Kodak</strong> Vision3<br />
500T 5219 .<br />
A. : Jusqu’à quel point l’avez-vous poussée à l’étalonnage, je pense notamment<br />
aux risques que vous évoquiez, risques liés à la sous exposition lors de la<br />
prise de vues ?<br />
D.K. : Il y a <strong>des</strong> séquences où j’ai tellement pris mon aise que je me<br />
suis parfois r<strong>et</strong>rouvé avec <strong>des</strong> images effectivement très sous-exposées.<br />
Alors, j’ai été fouiller dans les noirs pour ajouter un spectre bleu<br />
magenta ou bleu-vert selon les séquences, tout en demeurant froid en<br />
permanence. J’espérais que Woody accepte cela, ce qui a été le cas.<br />
Ceci dit, l’ensemble du film reste chaud <strong>et</strong> doré. J’ai également soutenu<br />
la structure dorée du film avec davantage encore de doré dans les tons<br />
clairs <strong>et</strong> du froid dans les tons gris <strong>et</strong> les noirs. Il est arrivé aussi qu’en<br />
m<strong>et</strong>tant du bleu dans les noirs, il n’y ait plus de signal. En ayant été trop<br />
11<br />
Woody Allen <strong>et</strong> Owen Wilson<br />
loin dans la sous-exposition, j’étais bloqué <strong>et</strong> cela ne « prenait » plus.<br />
Disons que ce serait à refaire, je m<strong>et</strong>trais malgré tout un peu plus de<br />
contours <strong>et</strong> de lumière. En fait, c’est dans les extérieurs « nuit » que j’ai<br />
été trop loin dans la sous-exposition, même si Woody ne m’a jamais<br />
fait le moindre reproche. Au contraire même, sur le plateau, il me disait<br />
« c’est bien que ce soit sombre ! » Quand j’étais limite « battu », je m<strong>et</strong>tais<br />
de la lumière là où il n’y en avait pas en trichant sur certaines choses ou<br />
en réchauffant parfois un peu plus ou bien alors en m<strong>et</strong>tant davantage<br />
de couleurs. Les extérieurs « jour » sont particulièrement difficiles à<br />
filmer, on tombe vite dans la banalité ou dans <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s de couleurs <strong>et</strong><br />
"Tourner la nuit était une grande première pour Woody Allen..."<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DARIUS KHONDJI | RENCONTRE<br />
de contraste faciles <strong>et</strong> artificiels dûs au D.I. Pour ces extérieurs « jour »,<br />
j’aimerais bien faire de nouveaux essais en film pour trouver quelque<br />
chose qui me satisfasse davantage.<br />
A. : Juste après le tournage, vous disiez : « j’aurais dû post produire en<br />
traditionnel, parfois il n’y a pas de raison de post produire en numérique ».<br />
Le pensez-vous toujours ?<br />
D.K. : Je n’aurais pas pu faire l’étalonnage de ce film en photochimique<br />
ou alors il aurait fallu que je le prépare tout autrement. Mais nous avons<br />
toujours été soucieux avec Joe Gawler de faire comme si nous travaillions<br />
un étalonnage photochimique. Par exemple, aucun <strong>des</strong> ciels du film n’est<br />
truqué. Ce qui est sûr, c’est que si j’avais un film à tourner en scope anamorphique,<br />
je me poserais vraiment la question du choix de l’étalonnage<br />
dans la mesure où le DI abîme un peu l’image, en altère la fraîcheur, la<br />
qualité <strong>et</strong> la générosité. J’en ai fait l’expérience sur The interpr<strong>et</strong>er <strong>et</strong> sur<br />
Chéri. Ce n’est pas dû à l’étalonneur, mais au procédé. Le scope apporte<br />
tellement de richesse au négatif qu’ensuite, on l’aplatit forcément. Je me<br />
souviens avoir lu un article du directeur de la photographie Robert Elswit<br />
qui avait dit cela, <strong>et</strong> je le pense aussi, sincèrement.<br />
MIDNIGHT IN PARIS<br />
Réalisateur : Woody ALLEN<br />
Production : Perdido Production / Firstep<br />
Producteur délégué : Helen Robin<br />
Directeur de la photographie : Darius KHONDJI, AFC, ASC<br />
Caméra : Arricam LT <strong>et</strong> ST<br />
Format : S 1,85<br />
Objectifs : Cooke S3 , S4 <strong>et</strong> S5<br />
Pellicules : <strong>Kodak</strong> Vision3 500T 5219 / <strong>Kodak</strong> Vision3 200T 5213<br />
Laboratoire développement : LTC<br />
Laboratoire de post-production : DeLuxe New York<br />
Etalonneur : Joe Gawler<br />
Distributeur : Mars Distribution<br />
Date de sortie : 11 mai 2011<br />
Site intern<strong>et</strong> du film :<br />
© Photos : Roger Arpajou<br />
12<br />
XXXXX<br />
"Les "extérieurs jour" sont<br />
particulièrement difficiles à tourner, on<br />
tombe vite dans la banalité."<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DIGIMAGE CINÉMA - PORTRAIT DE «GROUPE»<br />
Digimage Cinéma<br />
"LA PHOTOCHIMIE, ÇA FAIT 1OO ANS<br />
QU’ELLE EXISTE ET 1OO ANS QU’UN NÉGATIF<br />
BIEN CONSERVÉ PEUT RESSORTIR<br />
POUR ÊTRE UTILISÉ"<br />
DENIS AUBOYER<br />
PRÉSIDENT DE DIGIMAGE CINÉMA<br />
OLIVIER DUVAL<br />
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT<br />
13 | ACTIONS le mag’ #34-35
DIGIMAGE CINÉMA - PORTRAIT DE «GROUPE»<br />
Actions : Quel est l’historique de Digimage Cinéma ?<br />
Denis Auboyer : Tout s’est enchaîné assez rapidement dans la mesure<br />
où Digimage a été créé en 2000 <strong>et</strong> Digimage Cinéma seulement sept<br />
ans plus tard. Au départ, nous nous occupions uniquement de post<br />
production numérique <strong>et</strong> nous sous-traitions la photochimie auprès <strong>des</strong><br />
laboratoires Eclair ou Arane-Gulliver. Et puis l’on s’est très vite aperçu<br />
que la postproduction télévision devait être complétée d’un outil de<br />
postproduction pour le cinéma. Nos locaux étant devenus trop exigus<br />
à Boulogne, nous avons alors trouvé le site de Montrouge où nous<br />
sommes aujourd’hui, mais qui était initialement <strong>des</strong>tiné à devenir une<br />
zone de stockage. La décision du déménagement a très vite été prise<br />
<strong>et</strong> en moins de trois mois, nous avions transporté nos activités. Ce<br />
qui a fait accélérer le mouvement lié au cinéma a été la venue du film<br />
Océans pour lequel nous avons créé la salle d’étalonnage que l’on connaît<br />
équipée d’un Lustre Incinérator <strong>et</strong> d’un écran de 9 mètres de base. Puis<br />
est arrivée la postproduction de Micmacs à tire-larigot de Jean-Pierre<br />
Jeun<strong>et</strong> (pratiquement en même temps) alors que nous avions déjà<br />
dans l’idée de construire une seconde salle d’étalonnage identique à<br />
la première avec une cabine de projection commune. Les auditoriums<br />
ont tout naturellement suivi <strong>et</strong> c’est ainsi que Digimage Cinéma a pris<br />
corps. Notre idée n’a jamais été d’être plus fort que les autres, mais<br />
uniquement de pouvoir répondre à une offre complète <strong>et</strong> globale. C’est<br />
déjà dans c<strong>et</strong>te perspective qu’en 2008, nous avions repris la société<br />
d’eff<strong>et</strong>s spéciaux « Def2Shoot ».<br />
Olivier Duval (Directeur général adjoint) : À la place de « Def2Shoot »,<br />
nous aurions pu ach<strong>et</strong>er quelques stations <strong>et</strong> créer une structure de<br />
toute pièce, mais c<strong>et</strong>te société nous perm<strong>et</strong>tait de pénétrer le domaine<br />
avec un nom qui avait fait ses preuves. C’était déjà une marque reconnue<br />
qui avait traitée <strong>des</strong> <strong>films</strong> importants comme Les Rivières pourpres, La<br />
Môme ou Ennemi intime. En 2000, j’étais personnellement de « l’autre<br />
côté » 1 <strong>et</strong> je me souviens que nous avons tous ressenti qu’avec l’arrivée<br />
de Digimage, il était en train de se préparer quelque chose de très<br />
pointu dans le numérique avec une approche différente sur la manière<br />
de gérer la postproduction. Un nouvel entrant avec de nouvelles<br />
technologies n’est jamais vu d’un bon œil par ses concurrents. Mais<br />
d’un autre côté, si une société comme celle-là vient frapper à votre<br />
porte en vous proposant une collaboration, il vaut mieux accepter que<br />
la laisser partir ailleurs.<br />
14<br />
D.A. : C’est ce que le laboratoire Eclair a bien compris <strong>et</strong> c’est pour cela<br />
que nous avons commencé à sous-traiter chez eux.<br />
O.D. : À l’époque, Eclair a été effectivement le plus malin en se disant :<br />
« comme nous n’empêcherons de toute façon pas les concurrents d’exister,<br />
autant que c<strong>et</strong>te manne profite à la société ! » En revanche, quand Digimage<br />
Cinéma a été créé en 2007, cela devenait très ennuyeux pour les autres<br />
compétiteurs car nous rentrions véritablement dans leur cœur de métier<br />
sur l’ensemble de la chaîne de postproduction, mise à part la photochimie.<br />
C’est à c<strong>et</strong>te époque que nous avons démarré une sous-traitance avec<br />
Arane, ce qui constituait malgré tout pour nous une dépendance majeure.<br />
"Il faut reconnaître les compétences, avoir les bonnes<br />
personnes aux bons endroits <strong>et</strong> conserver une forme<br />
d’humilité au coeur de nos prestations".<br />
(Denis Auboyer)<br />
D.A. : En même temps, Arane était un référent, c’était un vrai label<br />
pour tout le monde ! D’une manière plus générale <strong>et</strong> quel que soit votre<br />
domaine d’activité, il est évidemment très important d’investir, mais<br />
tout autant de savoir s’entourer. Il faut reconnaître les compétences,<br />
avoir les bonnes personnes aux bons endroits <strong>et</strong> conserver une forme<br />
d’humilité au cœur de nos prestations. Notre rôle est de donner un<br />
service aux clients, il ne faut pas se tromper <strong>et</strong> c’est ce que je souligne<br />
en permanence autour de moi : nous sommes avant tout un prestataire<br />
de service qui doit fournir de la qualité <strong>et</strong> la meilleure possible.<br />
A. : Face à de gros groupes concurrents, comment définit-on son territoire ?<br />
D.A. : Le cinéma est un p<strong>et</strong>it village ; quand on entend les voisins, on<br />
comprend très vite ce qui ne va pas <strong>et</strong> ce qu’il serait possible d’améliorer.<br />
A travers les activités de CMC <strong>et</strong> surtout de LVT qui concerne exclusivement<br />
le cinéma, nous avons vite compris ce que n’apportaient pas les<br />
structures en place sur le marché. Il y avait un créneau à prendre, nous<br />
l’avons pris. Par rapport à nos concurrents les plus importants, il fallait<br />
que l’on se positionne un peu en avant avec <strong>des</strong> technologies différentes.<br />
Notre objectif était de m<strong>et</strong>tre en place les outils qui correspondent au<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DIGIMAGE CINÉMA - PORTRAIT DE «GROUPE»<br />
plus près aux deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> clients sans jamais leur imposer quoi que ce<br />
soit. Ce qui nous a permis de procéder à ces créations ou à ces rachats<br />
de sociétés, c’est bien entendu le fait que <strong>des</strong> structures comme CMC<br />
ou LVT fonctionnaient bien. Mais je demeure réticent quand on me<br />
parle d’un « groupe » parce que cela donne vite l’impression que l’on a<br />
à faire à quelque chose d’énorme, ce que je ne souhaite pas. Ma priorité<br />
est de fonctionner à une échelle « humaine ». C’est probablement ce<br />
qui explique en partie notre entente assez exceptionnelle avec Jacques<br />
Perrin qui souhaitait trouver la même chose en venant chez nous.<br />
A. : Quel est votre mode de fonctionnement ?<br />
D.A. : J’ai un principe de travail : réunir tous les cadres concernés, leur<br />
exposer une situation <strong>et</strong> leur demander leur avis concernant telle ou telle<br />
opération. Mais quand je pose une question, c’est tout de suite qu’il me<br />
faut un avis <strong>et</strong> pas le lendemain. Et si j’entends « on vous suit ! », il n’est<br />
plus question de revenir en arrière !<br />
O.D. : Ce qui nous perm<strong>et</strong> d’être performant à l’échelle « humaine » dans<br />
notre relationnel avec les clients, c’est aussi le fait d’avoir su séparer<br />
les activités <strong>et</strong> d’avoir engagé <strong>des</strong> équipes adaptées aux domaines de<br />
compétences.<br />
A. : Vous n’aimez pas que l’on parle de « groupe », mais vous êtes quand<br />
même en France le seul indépendant de c<strong>et</strong>te importance…<br />
D.A. : Ce que je fais, c’est par passion, c’est mon tempérament. J’aime la<br />
qualité de l’image, j’aime me trouver dans une salle de cinéma face à un<br />
grand écran. Rien ne me pré<strong>des</strong>tinait à entrer dans le monde du cinéma,<br />
mais à partir du moment où je m’y suis trouvé, je m’y suis intéressé. Le<br />
démarrage de CMC est du même ordre que celui de Digimage Cinéma,<br />
il a été dicté par une double passion, celle d’entreprendre <strong>et</strong> celle de<br />
l’image. Je me souviens que mon premier investissement sur CMC a<br />
été un télécinéma « Rank Cintel ».<br />
A. : Comment s’est déroulée la reprise du site photochimique de Joinville ?<br />
D.A. : J’avais déjà pensé créer un laboratoire pour traiter le négatif <strong>et</strong> les<br />
shoots <strong>et</strong> pourquoi pas sur le site de Montrouge. Je donnais à l’époque<br />
comme exemple un p<strong>et</strong>it laboratoire que j’avais découvert en allant<br />
15<br />
chez LVT à New York <strong>et</strong> qui se trouvait au 32 ème étage d’un building.<br />
Mais je me suis vite aperçu qu’il faudrait deux à trois ans pour obtenir<br />
les autorisations nécessaires, à condition même de les obtenir. J’ai donc<br />
missionné Bruno Despas, de r<strong>et</strong>our du Canada, pour qu’il trouve une<br />
solution quand, en octobre 2009, le laboratoire GTC a déposé le bilan.<br />
Pour tout vous dire, je connaissais ce dossier depuis 40 ans <strong>et</strong> je n’ai<br />
même pas cherché à le consulter à ce moment-là, mais il faut parfois un<br />
« facteur chance » pour que les choses bougent. Comme personne ne s’y<br />
est intéressé, je suis entré dans le jeu <strong>et</strong> j’ai repris les équipements, puis<br />
obtenu l’autorisation de prolongement d’activité auprès de la Préfecture.<br />
"Ce que je fais, c’est par passion, c’est mon<br />
tempérament. J’aime la qualité de l’image...".<br />
(Denis Auboyer)<br />
A. : N’était-ce quand même pas un peu « suicidaire » de reprendre à ce<br />
moment-là un laboratoire photochimique ?<br />
O.D. : A la reprise de l’activité photochimique, nous aurions très bien<br />
pu nous dire : « on va prendre notre bâton de pèlerin <strong>et</strong> faire la tournée<br />
<strong>des</strong> distributeurs ! »… sauf que les distributeurs, on ne les connaît pas<br />
vraiment ! Qui les connaît dans le groupe ? Ceux qui travaillent avec eux,<br />
donc… les gens du sous-titrage ! Comme 70% <strong>des</strong> <strong>films</strong> en distribution<br />
passent par LVT, notre levier se trouvait là. Tout le monde nous prédisait<br />
un avenir difficile <strong>et</strong> beaucoup se sont trompés. Ce pari a été gagné<br />
grâce à LVT <strong>et</strong> aux équipes du laboratoire particulièrement motivées<br />
<strong>et</strong> désireuses de revanche. Que l’on ait été client ou concurrent de<br />
GTC, nous connaissions tous les faiblesses du laboratoire. Nous avons<br />
donc voulu du neuf, de la propr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> de la rigueur… <strong>et</strong> ainsi de suite. Il<br />
n’a jamais été question de rem<strong>et</strong>tre en marche l’activité tant que nous<br />
n’avions pas un laboratoire qui réponde parfaitement à c<strong>et</strong>te charte de<br />
qualité. S’il nous avait fallu un mois de plus pour être conforme à ce<br />
que nous voulions, nous l’aurions pris. Cela fait partie de notre esprit<br />
d’indépendance.<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DIGIMAGE CINÉMA - PORTRAIT DE «GROUPE»<br />
D.A. : Ceci étant, nous n’avons pas décidé de prendre GTC sur un coup de<br />
dés, mais sommes partis sur un « business plan » de cinq ans intégrant<br />
une rénovation du site <strong>et</strong> du matériel. Nous avons tout réorganisé. La<br />
partie « préparation <strong>des</strong> bains » était bonne, mais la partie « tirage », pas<br />
du tout. Depuis que Bruno Despas a totalement repensé le cheminement<br />
<strong>des</strong> pellicules <strong>et</strong> le traitement de la poussière, les distributeurs qui<br />
viennent aujourd’hui visiter le site sont très surpris de découvrir <strong>des</strong><br />
zones où l’on ne circule plus, par exemple, qu’en blouse blanche. Nous<br />
étions bien conscients que nous n’allions pas, à nous seuls, faire repartir<br />
le laboratoire photochimique, mais nous avons quand même été assez<br />
surpris de la réactivité de nos clients <strong>et</strong> notamment <strong>des</strong> distributeurs.<br />
Nous visions <strong>des</strong> tirages de 30 à 50 copies par film mais récemment,<br />
nous avons été jusqu’à en tirer… 300 pour « Titeuf » distribué par Pathé<br />
distribution ! Et nous avons pu le faire !<br />
O.D. : Notre « business plan » a été calculé sur de la série positive pour<br />
compenser <strong>et</strong> amortir un certain nombre de coûts. Pour l’instant, cela<br />
fonctionne plutôt bien. Nous savons que dans un an ou deux, nous ferons<br />
face à une baisse extraordinaire de la demande, mais jusqu’à fin 2012, on<br />
parlera encore de positive. Ceci dit, nous n’avons pas de grande visibilité.<br />
Aujourd’hui, nous avons un beau carn<strong>et</strong> de comman<strong>des</strong>, mais ce n’était<br />
pas le cas, il y a encore trois mois. Comme l’installation du parc de salles<br />
numériques est de plus en plus rapide, la réflexion stratégique devient<br />
forcément plus complexe. Personne ne peut savoir comment le marché va<br />
évoluer, car nous sommes tous conscients que la partie « valeur » qui se<br />
trouvait dans la copie 35mm est en train d’être balayée. Il faut donc tout<br />
faire pour r<strong>et</strong>rouver de nouveaux relais de croissance afin de maintenir en<br />
France une industrie technique forte <strong>et</strong> puissante capable de continuer<br />
à offrir un travail de qualité. Des pouvoirs publics aux réalisateurs, c’est<br />
tous ensemble qu’il faut défendre c<strong>et</strong>te industrie pour que demain, les<br />
œuvres françaises puissent continuer d’être fabriquées <strong>et</strong> diffusées.<br />
A. : Face au numérique qui a une durée de vie hypothétique, le laboratoire<br />
photochimique offre-t-il une solution adaptée à la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> œuvres ?<br />
O.D. : Aujourd’hui, la pellicule a fait ses preuves, ce qui est loin d’être le<br />
cas du numérique sur la longueur. Chaque fois que l’on parle de numérique,<br />
qu’il s’agisse d’un support de sauvegarde ou d’un serveur, on se<br />
r<strong>et</strong>rouve régulièrement avec <strong>des</strong> soucis de relecture ou de données qui<br />
ont disparues. S’il n’y a pas sauvegarde <strong>et</strong> transfert de numérique tous<br />
16<br />
les trois ou quatre ans, il y a déperdition de la qualité <strong>et</strong> <strong>des</strong> données.<br />
Dans quelques années, on peut imaginer se r<strong>et</strong>rouver avec une chaîne<br />
entièrement numérique sans un seul bout de pellicule : mais que se<br />
passera-t-il alors ?<br />
D.A. : La photochimie, ça fait 100 ans qu’elle existe <strong>et</strong> 100 ans qu’un<br />
négatif bien conservé peut ressortir pour être utilisé. Pour garantir la<br />
pérennité <strong>des</strong> œuvres, les pouvoirs publics <strong>et</strong> le CNC devraient peut-être<br />
désormais subordonner l’existence d’un shoot de <strong>conservation</strong> quelque<br />
part dans un « coffre » avant de délivrer l’agrément aux productions.<br />
C’est en tout cas ce que certains producteurs nous demandent.<br />
"Chaque fois que l’on parle de numérique on se<br />
r<strong>et</strong>rouve régulièrement avec <strong>des</strong> soucis de relecture ou<br />
de données qui ont disparues".<br />
(Olivier Duval)<br />
A. : Un laboratoire photochimique aujourd’hui, quoiqu’on en dise <strong>et</strong> j’y reviens,<br />
c’est un vrai pari !<br />
O.D. : Oui, mais à la différence de nos concurrents chez qui le numérique<br />
est au service de la photochimie, nous avons choisi de bâtir un laboratoire<br />
où la photochimie est au service du numérique car nous n’avons jamais<br />
voulu être dépendants de la photochimie. C’est le numérique qui dicte<br />
notre « process » <strong>et</strong> c’est un signe : les techniciens de « Digimage le<br />
Lab » appartiennent tous à Digimage Cinéma.<br />
A. : Comment procédez-vous à la restauration du film ?<br />
O.D. : C’est toujours la même chose, il y a d’abord identification <strong>des</strong><br />
bons éléments, ce qui est finalement le plus compliqué. Doit-on partir<br />
du négatif, de l’internégatif, d’un interpositif, d’un marron ? Quels sont<br />
les sons ? C’est ce tri qui va perm<strong>et</strong>tre d’obtenir « l’élément-référence »<br />
à scanner, restaurer, étalonner <strong>et</strong> shooter. Mais ensuite, il faudra aller<br />
au bout de la démarche, car nous n’aurons pas fait tout ce travail pour<br />
laisser le film se dégrader à nouveau dans une boîte. Il faudra le conserver<br />
à bonne température <strong>et</strong> à hydrométrie constante.<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DIGIMAGE CINÉMA - PORTRAIT DE «GROUPE»<br />
A. : « Digimage le Lab » étant un laboratoire calibré pour le numérique,<br />
qu’est-ce que cela induit sur le résultat final argentique ?<br />
O.D. : Pour les productions actuelles, nous nous devons d’être totalement<br />
transparents, c’est-à-dire que l’on ne doit pas dénaturer l’œuvre,<br />
la calibration étant le point sensible de notre métier. En matière de<br />
restauration, c’est là où l’ayant-droit a un rôle important à jouer, c’est lui<br />
qui doit nous dire où doit s’arrêter la restauration <strong>et</strong> s’il faut conserver<br />
tel ou tel « défaut » inhérent au film. Il ne faut surtout pas chercher à<br />
« faire un film de 2011 »… Je me souviens de ce que Jean Luc Godard a<br />
dit un jour à un technicien à l’occasion du traitement de l’un de ses <strong>films</strong> :<br />
« ce que vous me montrez là, c’est l’affiche <strong>des</strong> Nouvelles Galeries ! »… <strong>et</strong> il<br />
avait raison. Les personnes qui s’étaient occupés de restaurer son film<br />
avaient tellement « n<strong>et</strong>toyé » l’image que d’un « vieux » film de 40 ans,<br />
ils en avaient fait un film contemporain.<br />
A. : Comment garde-t-on c<strong>et</strong>te « matière » inhérente au support ?<br />
O.D. : En laissant « vivre » le négatif, c’est ce qui s’est passé sur « Le<br />
Sauvage ». Il y a encore du bruit dans l’image <strong>et</strong> on sent que la pellicule<br />
vit alors que si nous l’avions voulu, nous aurions pu tout éliminer.<br />
Aujourd’hui, les pellicules ont évolué, il y a toujours du grain, mais il n’y<br />
a plus de bruit dans l’image <strong>et</strong> on ne r<strong>et</strong>rouve pas les défauts que nous<br />
avons tous connu avec la pellicule, il y a dix ou quinze ans. Enfin, il y a<br />
forcément une différence à cause du support, mais on ne doit pas avoir<br />
de couleurs dénaturées ou de perte de définition. Maintenant, tous les<br />
cas de figure coexistent en matière de restauration. On sait tous qu’il y<br />
aura toujours la restauration haut de gamme comme « Le Guépard » face<br />
à une restauration plus mo<strong>des</strong>te pour un film à plus faible exploitation<br />
qui vient d’être vendu à un réseau cablé.<br />
A. : Dans quel état physique se trouvait Le Sauvage ?<br />
O.D. : Le film n’était pas en bon état car un certain nombre d’éléments<br />
avaient été abimés, <strong>et</strong> le négatif original avait servi à tirer de nombreuses<br />
copies. Le Sauvage, c’est le début <strong>des</strong> années 70 <strong>et</strong> à l’époque, l’exploitation<br />
TV était encore très faible. On utilisait donc le premier élément pour<br />
tirer les copies car on savait qu’ensuite, il n’y aurait plus beaucoup de vie<br />
pour le film. Les laboratoires ont commencé à changer leur « process » à<br />
partir <strong>des</strong> années 75/80 quand les droits télévision sont devenus payants.<br />
17<br />
Disons qu’à ce moment-là, il y a eu une première prise de conscience<br />
<strong>et</strong> l’on a fait un peu plus attention qu’auparavant. Quoi qu’il en soit-il<br />
faut toujours compter avec le virement <strong>des</strong> pellicules, <strong>des</strong> éléments mal<br />
conservés ou <strong>des</strong> casses du négatif qui entrainent <strong>des</strong> synchronismes<br />
irrémédiables. On a droit à tous les cas de figure.<br />
A. : Combien de temps a duré la restauration du Sauvage ?<br />
O.D. : Plus d’un mois entre la pal<strong>et</strong>te <strong>et</strong> l’étalonnage !<br />
A. : Quels sont les grands <strong>films</strong> récemment restaurés chez Digimage Cinéma ?<br />
D.A. : Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau donc que nous avons restauré<br />
pour Studio Canal <strong>et</strong> qui vient d’être présenté à Cannes. Nous venons<br />
aussi de traiter pour les <strong>films</strong> du Losange les <strong>films</strong> d’Eric Rohmer avec<br />
un mélange de formats 16mm <strong>et</strong> 35mm <strong>et</strong> pour Pathé Boudu, sauvé <strong>des</strong><br />
eaux ou encore Obsession …<br />
A. : Comment voyez-vous l’avenir de Digimage <strong>et</strong> Digimage Cinéma ?<br />
O.D. : C’est Claude Berri qui, je crois, disait : « le risque, c’est de ne pas en<br />
prendre ! » Si vous ne prenez pas de risques, vous stagnez ou vous reculez.<br />
Ce qui est certain, c’est que <strong>des</strong> entrepreneurs comme Denis Auboyer<br />
dans l’industrie technique, il n’y en a plus. Tout comme ses métho<strong>des</strong><br />
de travail ! C’est une approche artisanale au cœur de laquelle tout est<br />
industrialisé pour dégager de quoi financer le restant de l’activité. Si<br />
on se limite à traiter le haut de gamme <strong>et</strong> le luxe, on n’atteint jamais le<br />
volume qui perm<strong>et</strong> de s’en sortir.<br />
D.A. : Il ne faut pas être trop en avant, mais surtout pas en r<strong>et</strong>ard ; il faut<br />
se trouver au bon endroit au bon moment. Aujourd’hui par exemple, nous<br />
misons sur la VOD qui explose <strong>et</strong> la restauration avec le plan numérique.<br />
Ce sont encore <strong>des</strong> très gros investissements à supporter, mais c’est ce<br />
qui entr<strong>et</strong>ient la jeunesse.<br />
"Le Sauvage" de Jean-Paul Rappeneau,<br />
Directeur de la photographie, Pierre Lhomme, AFC,<br />
Photo : DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Pathé<br />
“LA SEULE GARANTIE DONT NOUS DISPOSONS<br />
QUAND ON PARLE DE LA CONSERVATION DES<br />
FILMS, C’EST LA PELLICULE.”<br />
JÉRÔME SEYDOUX<br />
PRÉSIDENT DE PATHÉ<br />
18 | ACTIONS le mag’ #34-35<br />
Photo : © Bertrand Rindoff P<strong>et</strong>roff
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Actions : Pathé <strong>et</strong> <strong>Kodak</strong> ont une longue histoire commune…<br />
Jérôme Seydoux : Pathé a d’abord été le premier client de <strong>Kodak</strong>, puis a<br />
été son concurrent quand Pathé a créé sa propre usine de fabrication de<br />
pellicules. Ensuite, Pathé <strong>et</strong> <strong>Kodak</strong> se sont associés <strong>et</strong> finalement… l’usine<br />
Pathé est devenue une usine <strong>Kodak</strong>. Ce n’est pas rien. Il me semble aussi que<br />
Charles Pathé <strong>et</strong> George Eastman ont toujours entr<strong>et</strong>enu de bons rapports.<br />
A. : Quel est aujourd’hui le contenu du catalogue Pathé ?<br />
J.S. : Si l’on considère la période avant l’année 2000, Pathé possède 450<br />
<strong>films</strong> parlants <strong>et</strong> environ 3500 <strong>films</strong> mu<strong>et</strong>s. En réalité, il est possible qu’il<br />
en existe davantage car Pathé est une société « vieille » de plus de 110<br />
ans de cinéma <strong>et</strong> nous ne possédons pas une connaissance absolument<br />
parfaite de tout son passé. Et depuis 2000, Pathé a encore produit une<br />
trentaine de <strong>films</strong> qui s’ajoutent au Catalogue.<br />
A. : L’état de <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> est-il satisfaisant ?<br />
J.S. : Il nous arrive bien évidemment d’avoir parfois quelques mauvaises<br />
surprises, mais dans l’ensemble <strong>et</strong> si l’on se limite au « parlant », on<br />
peut dire que les <strong>films</strong> ont été plutôt bien conservés. En ce qui concerne<br />
le « mu<strong>et</strong> », il serait prématuré d’ém<strong>et</strong>tre une opinion fiable car nous<br />
venons seulement d’en débuter un inventaire compl<strong>et</strong>.<br />
A. : À quand remonte votre arrivée chez Pathé ?<br />
J.S. : La société « Chargeurs » que je dirigeais a rach<strong>et</strong>é Pathé à Giancarlo<br />
Parr<strong>et</strong>ti en 1990. J’ai donc quelque chose comme 21 ans de « maison ».<br />
A. : Quel était l’état <strong>des</strong> lieux à c<strong>et</strong>te époque ?<br />
J.S. : Il n’était pas bon du tout. En 1990, Pathé possédait encore <strong>des</strong><br />
salles de cinéma, mais ne faisait plus de <strong>films</strong> <strong>et</strong> se trouvait numéro trois<br />
en France, loin derrière Gaumont <strong>et</strong> UGC. Ayant également délaissé la<br />
distribution, Pathé ne faisait plus que de la production de télévision. On<br />
était loin de ce que l’on a appelé la « période dorée » de Pathé, comprise<br />
entre 1900 <strong>et</strong> 1914. En fait, la première guerre mondiale a coûté cher<br />
à Pathé dans la mesure où elle a brutalement interrompu les activités<br />
de la société avec le pays qui était son premier marché : les États-Unis.<br />
19<br />
XXXXX<br />
A. : À partir de quel moment vous êtes-vous intéressé à la partie patrimoniale<br />
de la société dont on peut penser que c’était celle qui était la plus problématique<br />
en matière de <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> ?<br />
J.S. : Quand je discutais de la valeur de Pathé avec son propriétaire de<br />
l’époque, Giancarlo Parr<strong>et</strong>ti, celui-ci avait beau me dire « le patrimoine,<br />
Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945). Directeur de la photographie : Roger Hubert<br />
© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé<br />
"L’un de nos <strong>films</strong> historiquement les plus importants :<br />
Les Enfants du paradis."<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
ça n’a pas de valeur tellement ça vaut cher ! », je dois dire très honnêtement<br />
que ce n’était pas ma priorité à ce moment-là. L’urgence était<br />
de redonner à c<strong>et</strong>te société de la vie <strong>et</strong> de l’énergie pour qu’elle se<br />
rem<strong>et</strong>te à faire les choses correctement. Mon objectif visait donc<br />
presque exclusivement le présent <strong>et</strong> le futur. Mon intérêt vis-à-vis du<br />
patrimoine est relativement récent. Le patrimoine est un domaine très<br />
intéressant, mais ce n’est pas une activité immédiatement rentable.<br />
Pour conserver le patrimoine, il faut se trouver dans une situation<br />
relativement confortable, c’est-à-dire pouvoir dépenser de l’argent,<br />
ce que peut aujourd’hui se perm<strong>et</strong>tre Pathé car même s’il existe tout<br />
un système d’ai<strong>des</strong> en France dont nous profitons, Pathé dépense<br />
beaucoup de fonds propres dans la restauration <strong>des</strong> <strong>films</strong>. Les Enfants<br />
du paradis de Marcel Carné qui va redevenir un film d’actualité avec sa<br />
programmation à « Cannes Classics » c<strong>et</strong>te année sur la Crois<strong>et</strong>te est<br />
ainsi une restauration 100% Pathé dont le coût avoisine les 300 000<br />
euros. Pourquoi ? D’abord, parce que c’est un film qui est long - deux<br />
fois plus long qu’un film « normal » <strong>et</strong> pour cause puisqu’il est composé<br />
de deux époques - <strong>et</strong> puis comme c’est l’un de nos <strong>films</strong> historiquement<br />
les plus importants, on ne pouvait faire autrement qu’engager une<br />
restauration exemplaire <strong>et</strong> de qualité. Quelle est la valeur d’avenir d’un<br />
film ancien, je n’en sais rien ? Ce qui est certain, c’est qu’un film non<br />
restauré ne pourra jamais être exploité dans de bonnes conditions. Si<br />
personne ne sait aujourd’hui si nous reverrons l’argent dépensé pour Les<br />
Enfants du paradis, en revanche, on sait que les grands <strong>films</strong> restaurés<br />
pourront repasser en salles. Ils ne seront certes jamais en concurrence<br />
avec Avatar 2 ou Avatar 3, mais on peut tout à fait imaginer qu’il y ait<br />
deux ou trois salles pour reprogrammer ces <strong>films</strong>-là à l’année, il suffit<br />
pour cela de disposer de suffisamment de <strong>films</strong> de manière à établir<br />
une programmation qui tourne. Il en va de l’intérêt culturel d’une ville<br />
<strong>et</strong> d’un pays. La restauration de Chantons sous la pluie présentée l’année<br />
dernière à Bologne montre par exemple que ce film n’a quasiment pas<br />
vieilli. Je dois dire d’ailleurs que pour moi, le festival de Bologne est un<br />
enchantement, c’est un moment de pur plaisir. Le public est connaisseur,<br />
le choix <strong>des</strong> <strong>films</strong> présentés est formidable, on y découvre, ou bien on<br />
y r<strong>et</strong>rouve, de p<strong>et</strong>ites <strong>et</strong> de gran<strong>des</strong> merveilles. Le Kid présenté il y a<br />
trois ans à l’opéra de Bologne <strong>et</strong> accompagné par un orchestre depuis<br />
la fosse était un moment incroyable.<br />
20<br />
XXXXX<br />
"On sait que les grands <strong>films</strong> restaurés pourront repasser en salles." La Dolce vita de Federico Fellini (1960). Directeur de la photographie : Otello Martelli © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Les Enfants du paradis a près de 70 ans d’âge, mais il y a <strong>des</strong> <strong>films</strong><br />
de vingt ou trente ans seulement qui ont aussi besoin d’être restaurés.<br />
A. : Quels ont été récemment les grands « chantiers » Pathé visant la<br />
<strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> ?<br />
J.S. : Le Guépard, La dolce vita, Boudu sauvé <strong>des</strong> Eaux, Les Enfants du paradis<br />
aujourd’hui… <strong>et</strong> puis bientôt, tout un programme de restauration de <strong>films</strong><br />
de Maurice Tourneur. Ensuite, nous nous attaquerons aux <strong>films</strong> plus<br />
récents. Les Enfants du paradis a près de 70 ans d’âge, mais il y a <strong>des</strong> <strong>films</strong><br />
de vingt ou trente ans seulement qui ont aussi besoin d’être restaurés.<br />
A. : Certains disent : « il faut tout restaurer », d’autres sont plus sélectifs.<br />
Où vous situez-vous ?<br />
J.S. : Pathé n’a pas les moyens de tout restaurer. Les églises non plus ne<br />
sont pas toutes restaurées ! Et si vous prenez le patrimoine mondial,<br />
au moment du barrage d’Assouan, certains monuments égyptiens<br />
exceptionnels ont été reconstruits, je pense au temple d’Abou Simbel,<br />
mais beaucoup d’autres ne l’ont pas été <strong>et</strong> ne le seront peut-être jamais.<br />
Alors, dire « nous allons restaurer tous les <strong>films</strong> ! », c’est un peu n’importe<br />
quoi. Il y a <strong>des</strong> choix à faire <strong>et</strong> parfois, il vaut mieux restaurer une<br />
chapelle très importante plutôt que certains <strong>films</strong> dont on sait qu’ils<br />
sont médiocres <strong>et</strong> le resteront. Comme pour l’instant, nous démarrons<br />
notre « chantier de restauration », nous nous intéressons au <strong>des</strong>sus du<br />
panier, mais il est évident qu’il arrivera certainement un moment où les<br />
choses se compliqueront.<br />
A. : Êtes-vous personnellement un grand cinéphile… ou même un cinéphile<br />
tout court ?<br />
J.S. : J’adore le cinéma, mais j’ai fait plein d’autres choses dans ma vie.<br />
Le cinéphile est quelqu’un qui a vu beaucoup de <strong>films</strong> <strong>et</strong> qui a une bonne<br />
mémoire <strong>des</strong> images, ce n’est pas mon cas. Quand j’étais étudiant, oui<br />
j’allais facilement voir trois <strong>films</strong> par jour, mais cela n’avait rien d’étonnant,<br />
la plupart de mes copains faisaient la même chose. Sans compter que<br />
21<br />
nous étions une génération qui ne possédait pas la télévision. C’est tout<br />
à fait par hasard que je suis arrivé au cinéma. En 1970, je travaillais pour<br />
Schlumberger qui a rach<strong>et</strong>é une société qui s’appelait « La compagnie<br />
<strong>des</strong> compteurs », société qui était le principal actionnaire de Gaumont.<br />
Je suis par conséquent devenu l’administrateur de Gaumont… il y a un<br />
peu plus de 40 ans. Ensuite, je suis passé par la télévision <strong>et</strong> en 1987, je<br />
me suis associé avec Claude Berri avant de rach<strong>et</strong>er Pathé. Je considère<br />
véritablement passer une partie importante de ma vie dans le cinéma<br />
depuis 20 ans. Aujourd’hui, je ne fais plus que cela. Si on a la chance<br />
d’arriver à un certain âge, il faut se consacrer aux choses qui vous plaisent.<br />
A. : Comment surveillez-vous le vieillissement <strong>des</strong> <strong>films</strong> de la « maison » ?<br />
J.S. : Dans l’ensemble, pour tout ce qui est parlant, nous sommes assez<br />
contents de l’état dans lequel se trouvent nos <strong>films</strong>. Il faut rappeler que<br />
Pathé a eu <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> pendant lesquelles la société ne produisait plus<br />
rien du tout. Il n’y a ainsi quasiment rien eu durant les années 70 <strong>et</strong> 80.<br />
Ce qui m’a toujours frappé, c’est de constater combien les Américains<br />
ont mieux sauvegardé leur passé que nous, ils ont gardé énormément<br />
de matériel. Le fait d’avoir <strong>des</strong> studios – ce qui n’existe quasiment pas<br />
en Europe –leur a permis de garder physiquement les choses. En ce qui<br />
me concerne, j’ai créé avec Pathé une Fondation qui se trouve désormais<br />
en charge du patrimoine ancien « non commercial » de Pathé. Je ne<br />
parle pas seulement <strong>des</strong> <strong>films</strong>, je parle aussi de la vie de la société, <strong>des</strong><br />
comptes, <strong>des</strong> journaux qui ont été faits, <strong>des</strong> promotions, <strong>des</strong> affiches,<br />
du matériel publicitaire, <strong>des</strong> décors… Tout cela va maintenant être<br />
conservé <strong>et</strong> entr<strong>et</strong>enu par la Fondation. C’est très simple : lorsqu’une<br />
chose pourra prétendre à une exploitation commerciale, c’est Pathé qui en<br />
demeurera le maître d’œuvre, sinon ce sera la Fondation. La restauration<br />
du film Les Enfants du paradis qui est susceptible de générer <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes<br />
commerciales est entièrement payée par Pathé.<br />
Le Guépard de Luchino Visconti. Directeur de la photographie : Giuseppe Rotunno, ASC, AIC.<br />
© GB Pol<strong>et</strong>to - Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé<br />
La Dolce vita © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
A. : Où sera située c<strong>et</strong>te Fondation ?<br />
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
J.S. : Elle est en construction sous la direction de l’architecte Renzo Piano<br />
dans le quartier <strong>des</strong> Gobelins en lieu <strong>et</strong> place d’un ancien cinéma qui<br />
s’appelait le Rodin, tout simplement parce qu’il y avait deux sculptures<br />
de Rodin en façade. Les travaux devraient être terminés d’ici à fin 2012.<br />
C<strong>et</strong>te Fondation sera ouverte au public avec <strong>des</strong> expositions, mais elle<br />
est surtout <strong>des</strong>tinée aux chercheurs. C’est la première Fondation sur le<br />
cinéma en France.<br />
A. : Après la restauration, il y a son prolongement logique : la <strong>conservation</strong>.<br />
Comment cela se déroule-t-il ?<br />
J.S. : Nous essayons évidemment de conserver nos <strong>films</strong> du mieux<br />
possible <strong>et</strong> dans les meilleures conditions possibles. Lorsque nous<br />
avons la chance de posséder du matériel en double, on le stocke par<br />
exemple dans deux endroits différents au cas où, un jour, se produirait<br />
une catastrophe.<br />
A. : En même temps, on parle beaucoup de copies numériques depuis quelques<br />
années. Est-ce une solution envisageable pour vous ?<br />
J.S. : En la matière, notre politique est très claire : il faut numériser les<br />
œuvres pour pouvoir les exposer plus facilement <strong>et</strong> largement mais<br />
aussi les conserver sur pellicule <strong>et</strong> lorsqu’il s’agit de <strong>films</strong> qui ont bénéficié<br />
d’une restauration numérique, faire un r<strong>et</strong>our sur pellicule du film<br />
22<br />
restauré. Lorsque ce n’est pas nous qui avons en charge la <strong>conservation</strong><br />
du film, nous recommandons d’effectuer exactement la même démarche.<br />
Aujourd’hui, le numérique est très utile dans le cadre de la restauration<br />
<strong>et</strong> peut-être fera-t-on encore <strong>des</strong> progrès dans le domaine, mais dans<br />
l’état actuel <strong>des</strong> techniques, la seule garantie dont nous disposons quand<br />
on parle de la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong>, c’est la pellicule. C’est un suj<strong>et</strong><br />
sur lequel il y a unanimité. Demain, lorsque toute l’exploitation sera<br />
devenue numérique, il faudra continuer de sauvegarder les œuvres sur<br />
pellicule incluant les <strong>films</strong> neufs.<br />
A. : Faudrait-il en France une politique nationale visant à réglementer c<strong>et</strong>te<br />
chaîne de <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> ?<br />
J.S. : La France est déjà relativement bien équipée avec le CNC, les<br />
Archives du film en son sein <strong>et</strong> les Cinémathèques, nous n’avons pas<br />
à nous plaindre. Entre les interventions <strong>des</strong> organismes professionnels<br />
<strong>et</strong> le positionnement de l’Etat, il existe <strong>des</strong> schémas qui perm<strong>et</strong>tent<br />
d’envisager correctement la filière de <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong>.<br />
A. : Quel sera le prochain chantier de Pathé ?<br />
J.S. : La prochaine étape va consister à se pencher sur une période<br />
plus proche de nous, celle dont les <strong>films</strong> couleurs sont succeptibles de<br />
s’abîmer, je pense aux <strong>films</strong> <strong>des</strong> années 60-70 <strong>et</strong> par exemple à un film<br />
comme Le Samouraï que nous sommes en train de restaurer.<br />
Je pense aussi au film Tess de Roman Polanski.<br />
"Notre politique est très claire : il faut numériser les oeuvres<br />
pour pouvoir les exposer plus facilement <strong>et</strong> largement, mais<br />
aussi les conserver sur pellicule <strong>et</strong> lorsqu’il s’agit de <strong>films</strong> qui<br />
ont bénéficié d’un restauration numérique, faire un r<strong>et</strong>our<br />
sur pellicule du film restauré."<br />
Les Enfants du Paradis © Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé<br />
"Les Enfants du paradis va redevenir un film d’actualité."<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Gaumont<br />
"LE CINÉMA EST UNE DENRÉE PÉRISSABLE<br />
DONT IL FAUT SANS CESSE S’OCCUPER"<br />
NICOLAS SEYDOUX<br />
PRÉSIDENT DE GAUMONT<br />
23 | ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Actions : Quelle relation entr<strong>et</strong>enez-vous à titre personnel avec le patrimoine ?<br />
Nicolas Seydoux : Comme citoyen, je suis convaincu que regarder<br />
« devant » implique de savoir d’où l’on vient. Si j’avais été dans «le<br />
bâtiment», je me serais passionné pour la restauration <strong>des</strong> monuments.<br />
J’aime le patrimoine, peut-être parce que j’ai eu la chance d’avoir une<br />
mère qui m’a emmené très tôt au Louvre, bâtiment exceptionnel qui<br />
montre <strong>des</strong> trésors. Quand je lis qu’il faut cinq milliards d’euros pour<br />
restaurer les cathédrales, je me dis que si un pays de la taille <strong>et</strong> de<br />
la richesse de la France n’est pas capable de les trouver, c’est, <strong>et</strong> je<br />
n’aime pas l’expression, un crime contre la civilisation car on ne peut<br />
évidemment pas laisser s’effondrer une cathédrale sous prétexte qu’il<br />
y a moins de fidèles pour la fréquenter. Pour en revenir à Gaumont <strong>et</strong> à<br />
son patrimoine, lorsque la société a quitté le Gaumont-Palace de la place<br />
de Clichy, malheureusement seuls quelques très rares obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> affiches<br />
ont été « sauvés », le reste partant à la poubelle pour la plus grande joie<br />
<strong>des</strong> clients <strong>des</strong> Puces. En prime, dans l’incendie de Pontault-Combault<br />
qui abritait de nombreuses copies de <strong>films</strong> déposés à la Cinémathèque<br />
française 1 , une part significative du patrimoine cinématographique<br />
français a disparu, même si on ignore la liste <strong>des</strong> oeuvres parties en<br />
fumée puisque aucun inventaire n’existait à l’époque…<br />
A. : Quelle était la situation à votre arrivée chez Gaumont ?<br />
N.S. : Quelques années après ma prise de fonction, j’ai découvert que<br />
Gaumont ne disposait plus d’affiches de Cousin, cousine trois ans seulement<br />
après la sortie du film. Nous étions en 1978 <strong>et</strong> je me suis énervé….<br />
Ce qui m’a conduit à exiger que tout le matériel <strong>des</strong> <strong>films</strong> (affiches, photos,<br />
scenarii…) soit systématiquement conservé. Parallèlement nous avons<br />
commencé à tenter de récupérer ce qui avait été dispersé au cours <strong>des</strong><br />
décennies précédentes. Ce n’est pas anodin, car c’est parfois grâce à une<br />
affiche que Gaumont <strong>et</strong> certains de ses confrères ont appris l’existence<br />
de <strong>films</strong> qui avaient disparu. La question est souvent posée de savoir,<br />
pourquoi nombre de ces <strong>films</strong> ont-ils été détruits ? Dans le support<br />
pellicule de l’époque, il y a du nitrate d’argent, métal qui a de la valeur.<br />
Ce n’est pas une excuse, mais une explication. Tout le monde a tendance<br />
à oublier l’état d’absolue nécessité dans laquelle se trouvaient les pays<br />
européens, à commencer par la France, pendant <strong>et</strong> juste après la première<br />
guerre mondiale. A c<strong>et</strong>te époque, on estimait aussi, il faut bien le dire,<br />
que les <strong>films</strong> exploités n’avaient plus de valeur. Il nous a fallu du temps<br />
24<br />
pour découvrir à la cinémathèque de Hollande une copie de l’Atalante que<br />
les experts s’accordent à reconnaître comme étant «celle» de Jean Vigo.<br />
Gaumont continue donc aujourd’hui encore – <strong>et</strong> systématiquement - à<br />
feuill<strong>et</strong>er tous les catalogues de ventes aux enchères. Dernièrement,<br />
nous avons ainsi rach<strong>et</strong>é le costume de Gérard Philipe dans Belles de<br />
nuit. Toutes les cinémathèques, tous les collectionneurs savent que<br />
Gaumont s’intéresse à son patrimoine.<br />
A. : Quelles politiques ont-elles été menées dans le passé en faveur de la<br />
<strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> ?<br />
N.S. : Alors qu’Henri Langlois disait plutôt du mal de l’establishment cinématographique,<br />
<strong>et</strong> ce n’est pas lui faire injure que de dire cela, il entr<strong>et</strong>enait<br />
de bons rapports avec Gaumont. Mes prédécesseurs avaient signé <strong>des</strong><br />
accords avec la Cinémathèque Française (le premier datant d’avant la<br />
guerre, le second de l’immédiat après-guerre). Personnellement, j’avais<br />
d’excellents rapports avec lui, j’entr<strong>et</strong>enais également de bons rapports<br />
avec Raymond Borde, responsable de la Cinémathèque de Toulouse. Le<br />
point commun de Henri Langlois <strong>et</strong> Raymond Borde, j’ai le regr<strong>et</strong> de le<br />
dire, était qu’ils se détestaient. Leur approche cinématographique était<br />
très différente : pour l’un, les œuvres étaient faites « pour être vues » <strong>et</strong><br />
il ne se posait pas trop la question de savoir si elles résisteraient ou non<br />
au temps, pour l’autre, il fallait d’abord <strong>et</strong> en premier lieu « sauvegarder ».<br />
Je pense avoir été à peu près la seule personne s’occupant du suj<strong>et</strong> à<br />
avoir entr<strong>et</strong>enu <strong>des</strong> relations convenables avec chacun d’eux, ce qui<br />
avait le don de les énerver tous les deux. Raymond Borde «inventeur»<br />
de la Cinémathèque de Toulouse, n’a pas la notoriété de Henri Langlois,<br />
mais un de ses grands mérites est d’avoir rapporté de Moscou la plus<br />
belle copie de La Grande illusion.<br />
A. : À quel moment la réflexion sur la sauvegarde <strong>des</strong> <strong>films</strong> a-t-elle évoluée ?<br />
N.S. : Quand les premiers supports numériques sont apparus, nombre<br />
«d’experts» ont voulu « transférer les <strong>films</strong> » pour se séparer de produits<br />
dangereux à base de nitrate qui risquaient de prendre feu. À c<strong>et</strong>te<br />
époque, <strong>et</strong> ce n’est pas sans importance, un accident mortel avait eu<br />
lieu en Allemagne dans un bunker où les <strong>films</strong> étaient conservés 2 . Ce<br />
type d’accident ne s’est heureusement jamais produit en France car les<br />
<strong>films</strong> sont entreposés dans de p<strong>et</strong>ites cellules isolées les unes <strong>des</strong> autres<br />
pour justement éviter un incendie «majeur».<br />
"Les Maudits" de René Clément (tournage) (1947).<br />
Directeur de la photographie : Henri Alekan<br />
"Le Blé en herbe" de Claude Autant-Lara (tournage) (1954).<br />
Directeur de la photographie : Robert Lefebvre<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35<br />
© Cinémathèque de Lausanne (archives Claude Autant-Lara) © Fondation René Clément
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
A. : Si nous en venons maintenant à votre politique actuelle, quelles gran<strong>des</strong><br />
lignes dégagez-vous ?<br />
N.S. : Il n’y a pas besoin d’être un génie scientifique pour savoir que tout<br />
transfert d’un support à l’autre, quel qu’il soit, entraîne toujours une<br />
perte de qualité, même si c<strong>et</strong>te déperdition est, dans le meilleur <strong>des</strong> cas,<br />
minime. Ma première réflexion a donc été de dire : « essayons de sauver les<br />
originaux <strong>et</strong> une fois ceux-ci sauvés, essayons de ne plus y toucher en faisant<br />
procéder à la fabrication systématique d’un internégatif ! ». Ensuite : « c’est<br />
seulement lorsque c<strong>et</strong> internégatif sera « fatigué » que nous en tirerons un<br />
autre ». Pour celles <strong>et</strong> ceux qui ont eu la chance de regarder dans <strong>des</strong><br />
temps déjà anciens les ciné-clubs <strong>et</strong> autres « cinéma de minuit » à la<br />
télévision, on se souvient, sans forcément avoir les <strong>films</strong> en tête, de la<br />
qualité « physique » <strong>des</strong> <strong>films</strong> car la télévision française exigeait <strong>des</strong> copies<br />
d’excellente qualité. C’était formidable… si ce n’est que pour alimenter<br />
les chaînes, les producteurs faisaient tirer une copie neuve à partir du<br />
négatif original. C’est ainsi que procédait la production dans le monde<br />
entier. Un producteur comme Alain Poiré par exemple, très soucieux <strong>des</strong><br />
<strong>films</strong> qu’il produisait, ne se préoccupait pas de savoir d’où venaient les<br />
tirages <strong>des</strong> copies proposées aux télévisions. Au-delà de la détérioration<br />
du négatif imputable à <strong>des</strong> tirages excessifs de copies, la pellicule couleur<br />
s’affadit dans le temps. La maison <strong>Kodak</strong> connaît ce phénomène mieux<br />
que personne. Les premiers <strong>films</strong> couleurs comme Autant en emporte le<br />
vent sont tournés sur <strong>des</strong> supports qui tiennent bien dans le temps, alors<br />
que la période <strong>des</strong> années 1950 à 1970 est marquée par l’absence de<br />
tenue <strong>des</strong> couleurs dans le temps. Sans toucher au négatif ni effectuer<br />
de tirage de copies, le négatif s’affadit de lui-même. Les technologies<br />
numériques, nonobstant les eff<strong>et</strong>s dévastateurs du téléchargement<br />
illicite, perm<strong>et</strong>tent une restauration de qualité. La première restauration<br />
majeure a été, je crois, celle d’Alice au pays <strong>des</strong> merveilles chez Disney<br />
dont le coût avait avoisiné à l’époque les 40 millions de dollars. Quand<br />
j’avais demandé aux responsables s’ils avaient conservé les masters<br />
numériques, ils m’avaient répondu que le coût en était trop élevé…<br />
Nous étions pourtant chez Disney ! Aujourd’hui le coût de restauration a<br />
diminué, la qualité est meilleure <strong>et</strong> j’espère que les intéressés gardent les<br />
masters. Ainsi les spectateurs de Cannes, plus tard les téléspectateurs,<br />
vont voir un film qu’ils croient avoir vu <strong>et</strong> qu’ils n’ont jamais vu, Voyage<br />
dans la lune de Méliès dans sa version «couleurs au pochoir » restaurée<br />
à partir d’un « bloc » r<strong>et</strong>rouvé en Espagne qui menaçait à la fois d’être<br />
détruit par l’eff<strong>et</strong> vinaigre <strong>et</strong> de prendre feu.<br />
25<br />
A. : Dans le domaine de la sauvegarde <strong>des</strong> <strong>films</strong>, Gaumont apparaît donc<br />
comme une société assez exemplaire…<br />
N.S. : Le tapage fait autour <strong>des</strong> propos de Martin Scorsese, il y a quelques<br />
années, m’avait un peu énervé quand il déclarait haut <strong>et</strong> fort qu’il fallait<br />
commencer à s’occuper de la restauration <strong>des</strong> <strong>films</strong>. Ce n’est pas parce<br />
que nous ne m<strong>et</strong>tons pas de placards dans les journaux pour l’annoncer<br />
que Gaumont ne le fait pas depuis plusieurs décennies. La difficulté tient<br />
au fait que beaucoup de producteurs de cinéma ont peu de droits sur<br />
leurs <strong>films</strong>. Heureusement, nous sommes de moins en moins isolés dans<br />
notre démarche. Pathé fait par exemple construire pour sa fondation un<br />
musée dans le treizième arrondissement de Paris.<br />
A. : Quelle particularité m<strong>et</strong>triez-vous en avant dans le cadre de la politique<br />
que vous menez en faveur du patrimoine au sein de Gaumont ?<br />
N.S. : Un certain nombre de mes collègues se sont intéressés à leurs<br />
<strong>films</strong> quand ils se sont aperçus que les télévisions étaient susceptibles<br />
de les programmer ou que, grâce au DVD, ils pouvaient toucher un<br />
autre public. Je vais être très cru : je ne m’intéresse pas uniquement au<br />
patrimoine pour ce qu’il peut rapporter. J’adhère au propos de Henri<br />
Langlois : « il faut tout sauver, l’Histoire décidera ce qui devait l’être ! » Le<br />
cinéma est d’abord un art populaire <strong>et</strong> je ne crois pas aux chefs-d’œuvre<br />
méconnus, éventuellement aux chefs-d’œuvre « engloutis ». Dans un<br />
pays aussi ouvert à l’art que la France, quand il y a à la fois un refus <strong>des</strong><br />
critiques, de ceux qui pensent être à l’avant-garde, <strong>et</strong> le sont parfois, <strong>et</strong><br />
du grand public, je crains que le film ne soit également oublié par nos<br />
<strong>des</strong>cendants. Pour autant, sauvons tous les <strong>films</strong>. Le cinéma, dans sa<br />
volonté de conserver son patrimoine, est incontestablement meilleur<br />
aujourd’hui qu’il ne l’était hier, meilleur ne voulant pas dire parfait.<br />
J’attire l’attention sur le fait qu’un film tourné <strong>et</strong> diffusé en numérique<br />
en 2011 ne disposera plus d’aucun équipement pour le lire dans vingt<br />
ans. Je parle en connaissance de cause. Quand nous avons décidé de<br />
rééditer Don Giovanni de Joseph Losey, un <strong>des</strong> premiers <strong>films</strong> dont le<br />
son ait été enregistré sur support numérique, nous avons découvert que<br />
les appareils qui avaient servi à transférer le son en 1978 n’existaient<br />
plus. Il a fallu quasiment faire refaire un appareil pour pouvoir relire le<br />
son de l’époque. Il existe aujourd’hui un risque majeur, celui de ne pas<br />
conserver le film sur le seul support que l’on sache bien conserver (sous<br />
réserve que les conditions hydrométriques <strong>et</strong> de température soient<br />
"Le Blé en herbe" de Claude Autant-Lara (tournage)<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35<br />
© Cinémathèque de Lausanne (archives Claude Autant-Lara)
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
respectées) qui s’appelle la pellicule. La pellicule n’est sûrement plus le<br />
support du futur pour la projection dans les salles, elle ne va bientôt plus<br />
être le support principal de tournage <strong>des</strong> <strong>films</strong>, mais il ne faudrait pas<br />
que la chaîne du cinéma soit brisée quand, dans quelques décennies, on<br />
voudra regarder les chefs d’œuvre d’aujourd’hui pour découvrir que seul<br />
le Conservatoire <strong>des</strong> Arts <strong>et</strong> Métiers dispose d’une relique pour les lire.<br />
Gaumont peut se prévaloir d’une autre expérience très intéressante. Dès<br />
1908, son fondateur Léon Gaumont m<strong>et</strong> au point avec Georges Eastman<br />
la trichromie (ce procédé sera développé industriellement une trentaine<br />
d’années plus tard par Technicolor). Pour revoir ces images originales, il<br />
a fallu attendre les années 1980 pour pouvoir les transposer, avec <strong>des</strong><br />
ingénieurs hollandais, sur pellicule 35mm.<br />
A. : On dit du numérique qu’il faut le « recopier » régulièrement pour ne rien<br />
perdre de son contenu. Que cela vous inspire-t-il ?<br />
N.S. : Ma crainte est qu’à un moment donné, on oublie de le faire !<br />
Dans le cinéma peut-être plus qu’ailleurs, la préoccupation majeure<br />
est davantage le film à faire que la préservation <strong>des</strong> <strong>films</strong> déjà faits.<br />
La « recopie permanente», c’est paraît-il, <strong>et</strong> j’espère que c’est vrai, ce<br />
que fait l’INA qui dispose, grâce à son statut, du plus grand patrimoine<br />
audiovisuel mondial. Mais j’aimerais être convaincu que cela concerne<br />
bien l’ensemble du patrimoine <strong>et</strong> pas seulement la partie qui « tourne »,<br />
c’est-à-dire le matériel demandé par les chaînes de télévision françaises<br />
<strong>et</strong> étrangères. On nous avait dit que la pellicule avait une durée de vie<br />
de cent ans, on sait aujourd’hui que c<strong>et</strong>te durée peut être facilement<br />
prolongée de quelques autres centaines d’années. Le CNC devrait<br />
dégager les moyens pour assurer que tout film en salles dispose d’une<br />
copie acétate de bonne qualité. Mon conseil est : « aujourd’hui, il existe un<br />
support pérenne, surtout, gardez-le ! ». Et quand bien même vous n’auriez<br />
pas tourné sur ce support, faîtes faire une duplication sur ce support.<br />
Ce combat est le même que celui <strong>des</strong> responsables <strong>des</strong> monuments<br />
historiques à la recherche de crédits pour sauver nombre de bâtiments.<br />
Le cinéma est une denrée périssable <strong>et</strong> il faut sans cesse s’en occuper.<br />
Je me félicite que les pouvoirs publics, dans le cadre du grand emprunt,<br />
signent avec les principaux ayants-droit un accord cadre exemplaire sur<br />
la numérisation <strong>des</strong> œuvres. Les précurseurs avaient tout compris en<br />
faisant de c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong> technique <strong>et</strong> technologique, la caméra, un nouveau<br />
moyen d’expression de l’imaginaire. Si vous m<strong>et</strong>tez côte à côte les frères<br />
Lumière qui inventent le documentaire, Georges Méliès la science-fiction,<br />
26<br />
Emile Cohl le film d’animation, Feuillade le « sérial » <strong>et</strong> Jean Durand, le<br />
western, vous avez couvert l’ensemble <strong>des</strong> genres cinématographiques<br />
qui, 117 ans plus tard… font encore rêver. Sachons entr<strong>et</strong>enir ce rêve.<br />
QUELQUES-UNS DES FILMS RÉCEMMENT RESTAURÉS<br />
ET RÉÉDITÉS PAR GAUMONT :<br />
«La Traversée de Paris» de Claude Autant-Lara<br />
«Les Yeux sans visage» de Georges Franju<br />
«Un condamné à mort s’est échappé» de Robert Bresson<br />
«Razzia sur la chnouf» d’Henri Decoin<br />
«Le Silence de la mer» de Jean-Pierre Melville<br />
«Querelle» de R-W Fassbinder<br />
«La Cité <strong>des</strong> femmes» de Federico Fellini<br />
«French cancan» de Jean Renoir<br />
«Le Général della Rovere» de Roberto Rossellini<br />
«La Peau» de Liliana Cavani<br />
«La Beauté du diable» de René Clair<br />
«E la nave va» de Federico Fellini<br />
«Du rififi chez les hommes» de Jules Dassin<br />
«Le rouge est mis» de Gilles Grangier<br />
«Un amour de Swann» de Volker Schlöndorff<br />
«La Poison» de Sacha Guitry<br />
«Le Rouge <strong>et</strong> le Noir» de Claude Autant-Lara<br />
«La Main du diable» de Maurice Tourneur<br />
«Huit <strong>et</strong> demi» de Federico Fellini...<br />
(1) 3 août 1980<br />
(2) 20 avril 1961<br />
"Les Maudits" de René Clément (tournage)<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35<br />
© Fondation René Clément
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Les Archives du film<br />
"LES FILMS SONT LE PATRIMOINE DES<br />
PRODUCTEURS ET DES AYANTS DROIT AVANT<br />
D’ÊTRE LE NÔTRE"<br />
BÉATRICE DE PASTRE<br />
DIRECTRICE DES COLLECTIONS<br />
DES ARCHIVES DU FILM<br />
27 | ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Actions : Quelle est la mission <strong>des</strong> Archives du film ?<br />
Béatrice de Pastre : Nos actions s’articulent autour de quatre grands<br />
axes : collecter, conserver, restaurer <strong>et</strong> valoriser le patrimoine cinématographique.<br />
La collecte se fait principalement à partir de dépôts<br />
volontaires d’ayants droit ou de laboratoires. Nous assurons également<br />
le dépôt légal qui concerne tous les <strong>films</strong> sortis en salles disposant d’un<br />
numéro de visa, qu’ils soient français ou étrangers à c<strong>et</strong>te réserve près<br />
que les <strong>films</strong> étrangers doivent avoir été exploités avec un minimum de<br />
six copies salles. Un distributeur qui souhaiterait déposer un film étranger<br />
sorti sur un nombre inférieur de copies peut évidemment le faire, mais ce<br />
n’est pas une obligation. En ce qui concerne toujours les <strong>films</strong> étrangers,<br />
ce sont les distributeurs qui effectuent le dépôt alors que pour les <strong>films</strong><br />
français, il s’agit <strong>des</strong> producteurs. Pour le long-métrage, la collecte se<br />
situe autour de 90% mais pour le court-métrage qui a une économie<br />
plus fragile, on oscille entre 35 <strong>et</strong> 40%. Quand nous pourrons faire la<br />
collecte numérique, ce sera évidemment plus facile mais l’une de nos<br />
interrogations, c’est la manière dont nous allons pouvoir aujourd’hui<br />
collecter <strong>et</strong> conserver les <strong>films</strong> numériques tant que <strong>des</strong> fichiers pérennes<br />
ne seront pas capables de leur garantir une <strong>conservation</strong> ad vitam,<br />
espérons-le. Nous avons commandité à ce suj<strong>et</strong> une étude pour nous<br />
aider à définir les choix techniques indispensables à la pérennité <strong>des</strong><br />
œuvres. Les trois options sont pour le moment la sauvegarde argentique,<br />
la copie sur LTO <strong>et</strong> l’utilisation <strong>des</strong> serveurs numériques.<br />
A. : Avant les résultats de c<strong>et</strong>te étude, on sait déjà que la copie sur LTO <strong>et</strong><br />
les serveurs ne garantissent pas la pérennité <strong>des</strong> œuvres…<br />
B. de P. : C’est bien pour cela que nous pensons nous orienter vers le<br />
r<strong>et</strong>our sur pellicule, ce qui pourrait être une solution à moyen terme si<br />
l’on trouvait un jour un support qui autorise au numérique <strong>des</strong> garanties<br />
similaires. Cela fait déjà trois ou quatre ans que nous tenons ce discours,<br />
mais dans la mesure où la profession en est maintenant elle aussi<br />
convaincue, notre position devient un peu plus « confortable ». Disons<br />
que nous ne sommes plus les seuls, avec quelques autres « électrons »,<br />
à prêcher dans le désert.<br />
28<br />
28<br />
A. : Existe-t-il un dépôt légal numérique ?<br />
B. B. de P. : Très peu d’œuvres en format<br />
numérique « natif » ont été jusqu’à présent<br />
déposées dans la mesure où le texte de loi qui<br />
encadre le dépôt légal cinématographique<br />
n’a pas encore intégré la dimension numérique<br />
(les textes sont pour l’instant en cours<br />
de réécriture). Il n’empêche que certains<br />
distributeurs déposent déjà leurs <strong>films</strong>. Au<br />
titre du dépôt légal, nous venons tout juste<br />
de collecter ainsi notre premier film en 3D :<br />
« Jackass ».<br />
A. : J’ai été surpris d’apprendre que près de<br />
40% <strong>des</strong> bobines déposées aux Archives du<br />
film… n’avaient à ce jour jamais été ouvertes…<br />
///PARCOURS<br />
Béatrice de Pastre<br />
B. de P. : Au fur <strong>et</strong> à mesure <strong>des</strong> dépôts, nous<br />
avons fait un tri pour séparer les <strong>films</strong> nitrate<br />
<strong>et</strong> les <strong>films</strong> « saf<strong>et</strong>y », regardé quel était<br />
l’état de <strong>conservation</strong> de tous les <strong>films</strong> <strong>et</strong><br />
enregistré le titre figurant sur les boîtes, mais<br />
il n’y a pas encore eu d’inventaire pointu,<br />
c’est vrai. Ce premier tri était essentiel dans<br />
la mesure où les mo<strong>des</strong> de <strong>conservation</strong> ne<br />
sont pas les mêmes pour tous les <strong>films</strong>. Il demeure effectivement à ce<br />
jour <strong>des</strong> boîtes non encore enregistrées dont on ne sait pas très bien s’il<br />
s’agit de négatifs ou de positifs. Peut-être la boîte « ment-elle » aussi si<br />
l’élément qui se trouve à l’intérieur n’est pas celui qui est identifié sur<br />
l’étiqu<strong>et</strong>te ! Heureusement, le fait qu’un film soit inventorié ou pas n’obère<br />
en rien son monde de <strong>conservation</strong>. Toutes les boîtes sont stockées dans<br />
les mêmes conditions.<br />
A. : Quelle est la « politique de surveillance » <strong>des</strong> <strong>films</strong> stockés à Bois d’Arcy ?<br />
B. de P. : Nous faisons <strong>des</strong> tests réguliers sur la totalité de la collection.<br />
Il s’agit de tests chimiques pour savoir si, par exemple, les <strong>films</strong> sont<br />
atteints par le syndrome du vinaigre. Nous testons de c<strong>et</strong>te manière<br />
environ 200 boîtes par mois grâce à un système d’algorithmes qui, par<br />
Spécialiste du patrimoine cinématographique <strong>et</strong> photographique, Béatrice de Pastre, titulaire d’un Diplôme<br />
d’Étu<strong>des</strong> Approfondies en philosophie (Paris IV La Sorbonne, 1986), est depuis mars 2007 Directrice <strong>des</strong><br />
collections <strong>des</strong> Archives françaises du film du Centre national du cinéma <strong>et</strong> de l’image animée.<br />
Auprès du Directeur du patrimoine cinématographique du CNC, elle a en charge l’ensemble de l’activité liée<br />
aux collections <strong>des</strong> Archives françaises du film du CNC (collecte, <strong>conservation</strong>, catalogage, restauration,<br />
enrichissement, accès aux collections <strong>et</strong> valorisation), soit cent mille <strong>films</strong> collectés <strong>et</strong> conservés dans le<br />
cadre de dépôts volontaires <strong>et</strong> du dépôt légal, à Bois d’Arcy <strong>et</strong> Saint-Cyr (Yvelines).<br />
De 1991 à 2006, Responsable de la Cinémathèque Robert Lynen de la Ville de Paris, elle a réalisé l’inventaire,<br />
le catalogage <strong>et</strong> la <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> fonds (10 000 œuvres photographiques <strong>et</strong> 4 000 titres filmiques<br />
rassemblés depuis 1925) <strong>et</strong> entrepris la numérisation <strong>des</strong> collections photographiques de l’institution.<br />
Enseignante, programmatrice, elle est aussi auteur d’ouvrages consacrés au patrimoine cinématographique <strong>et</strong><br />
photographique, notamment avec Monique Dubost, Françoise Massit-Folléa <strong>et</strong> Michelle Aubert, de Cinéma<br />
pédagogique <strong>et</strong> scientifique. À la redécouverte <strong>des</strong> archives (ENS éditions, 2004).<br />
Présidente de la Fédération <strong>des</strong> cinémathèques <strong>et</strong> archives de <strong>films</strong> de France de mars 1998 à avril 2002,<br />
Béatrice de Pastre est depuis septembre 2005, membre du comité de rédaction de la Revue Documentaires.»<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
rapport au pourcentage de <strong>films</strong> négatifs, positifs <strong>et</strong> de son, nous aide à<br />
cibler le nombre de boîtes à tester dans chacun <strong>des</strong> bâtiments qui abritent<br />
les collections. Cela nous perm<strong>et</strong> au passage d’avoir une « image » de<br />
l’ensemble <strong>des</strong> salles de <strong>conservation</strong>. Certaines salles sont également<br />
équipées de « nez électroniques » qui sont <strong>des</strong> capteurs réglés très bas,<br />
lesquels nous alertent dès qu’il y a un dégagement de gaz nitré ou de gaz<br />
d’acide acétique. C<strong>et</strong>te installation concerne principalement toute une<br />
série de cellules nitrate dans lesquelles sont déposées un maximum de<br />
1500 boîtes. Ce suivi plus « fin » protège également notre personnel car<br />
le nitrate, à la différence du vinaigre, ne « sent » pas. En ce qui concerne<br />
les <strong>films</strong> « saf<strong>et</strong>y », le nombre de boîtes par bâtiment est supérieur car<br />
il n’y a pas de risque d’auto-enflammement ou de contamination. Les<br />
<strong>films</strong> sont stockés en fonction de leur état car il faut surtout éviter que<br />
<strong>des</strong> boîtes atteintes par le syndrome du vinaigre ne contaminent celles<br />
d’à côté. Nos salles ont donc <strong>des</strong> taux d’acidité différents. Dès qu’un<br />
problème nous est signalé, nous alertons le déposant ou l’ayant droit<br />
pour savoir s’il prend en charge la restauration ou la sauvegarde de<br />
l’élément ou si c’est nous qui le faisons <strong>et</strong> nous intervenons alors de la<br />
même manière, qu’il s’agisse de <strong>films</strong> « nitrate » ou de <strong>films</strong> « saf<strong>et</strong>y » si<br />
ce n’est que grâce au plan de sauvegarde <strong>des</strong> <strong>films</strong> anciens, la majeure<br />
partie du nitrate a d’ores <strong>et</strong> déjà été sauvegardée.<br />
A. : Sur le problème de la pérennité, quel discours tenez-vous à vos différents<br />
interlocuteurs ?<br />
B. de P. : Nous discutons avec les organisations professionnelles pour les<br />
sensibiliser au problème. Pourquoi ne pas faire rentrer par exemple dans<br />
le budg<strong>et</strong> de production un « r<strong>et</strong>our sur film » pour conserver l’œuvre ?<br />
Après tout, les <strong>films</strong> sont le patrimoine <strong>des</strong> producteurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> ayants<br />
droit avant d’être le nôtre. Si un film terminé « se limite » à devenir un<br />
disque sur une étagère dans un laboratoire, que se passera-t-il dans<br />
quelques années ? Les producteurs ne se posent pas suffisamment ce<br />
type de questions.<br />
A. : Qu’en est-il pour les œuvres dites « orphelines » ?<br />
B. de P. : Elles sont sauvegardées dans <strong>des</strong> conditions identiques si ce<br />
n’est que la loi ne nous perm<strong>et</strong> pas de les « exploiter », pas plus dans<br />
le cadre de dispositifs non commerciaux que de projections culturelles.<br />
Là encore, il faudrait une réflexion au niveau européen sur la nature <strong>des</strong><br />
29<br />
29<br />
œuvres orphelines car nous sommes en quelque sorte victimes d’une<br />
« double peine ». D’un côté, nous avons investi dans une restauration <strong>et</strong> de<br />
l’autre, il nous est interdit d’en faire profiter le public. Il nous tient à cœur<br />
de faire bouger le cadre réglementaire qui vise ces œuvres orphelines.<br />
A. : Quel est le pourcentage <strong>des</strong> œuvres « orphelines » inventoriées aux<br />
Archives du film ?<br />
B. de P. : Sur l’ensemble <strong>des</strong> collections, cela représente de 25 à 30%<br />
<strong>des</strong> <strong>films</strong> si l’on tient compte <strong>des</strong> corpus de <strong>films</strong> documentaires <strong>des</strong><br />
années 20 à 50 <strong>et</strong> <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites structures en déshérence. Pourquoi ne<br />
pas considérer qu’à partir du moment où au moins un auteur a été<br />
identifié, l’œuvre n’est plus qualifiée « d’orpheline » ? Pour l’instant, il<br />
nous faut avoir identifié, soit le producteur qui est l’ayant droit direct,<br />
soit l’ensemble <strong>des</strong> auteurs d’un film.<br />
A. : Un producteur « alerté » par vos services sur le vieillissement d’un film<br />
a-t-il la liberté d’entreprendre ses travaux de restauration là où il le souhaite ?<br />
B. de P. : Bien entendu, nous ne sommes « que » dépositaires du matériel.<br />
C’est le déposant qui conserve l’entière propriété <strong>des</strong> éléments qu’il nous<br />
a confiés, raison pour laquelle nous ne pouvons rien détruire sans son<br />
accord. Cela fait partie <strong>des</strong> droits <strong>et</strong> <strong>des</strong> devoirs qui nous lient tous les<br />
deux. Lorsque nous contribuons aux travaux de restauration, nous sommes<br />
vigilants sur les conditions dans lesquelles les opérations sont menées.<br />
A. : Comment sont financées les Archives du film ?<br />
B. de P. : Nous sommes à part entière un service du CNC. Le programme<br />
de restauration <strong>des</strong> <strong>films</strong> anciens a été financé par le Ministère de la<br />
Culture, mais depuis le 1 er janvier, c’est le CNC qui dirige les opérations.<br />
Lorsque nous entreprenons une restauration, une convention est signée<br />
avec l’ayant droit qui s’engage à nous rembourser sur ses RNPP.<br />
A. : L’obtention de son agrément de production pour le producteur pourraitelle<br />
être assuj<strong>et</strong>tie d’une obligation de r<strong>et</strong>our sur film pour la <strong>conservation</strong><br />
de l’œuvre ?<br />
B. de P. : Nous n’en sommes pas encore là, mais nous réfléchissons. Sur<br />
les gros budg<strong>et</strong>s de production , le r<strong>et</strong>our sur film pour <strong>conservation</strong><br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
ne représente qu’une part marginale <strong>et</strong> est en général déjà pratiqué.<br />
La question est plus difficile pour les <strong>films</strong> à p<strong>et</strong>its budg<strong>et</strong>s, mais il faut<br />
inciter les producteurs à le faire. Il faut aussi faire la promotion du dépôt<br />
légal. Lors de la rétrospective Riv<strong>et</strong>te au Centre Pompidou il y a quelques<br />
années, on s’est par exemple aperçu au moment de tirer la copie d’un<br />
film de commande tourné par Riv<strong>et</strong>te pour la ville de Paris, que l’élément<br />
existant au laboratoire était incompl<strong>et</strong>. C’est alors l’élément déposé au titre<br />
du dépôt légal qui a servi de référence pour refaire le bout d’internégatif<br />
manquant. Le dépôt légal peut dans les cas exceptionnels servir aussi à cela.<br />
A. : Que disent les textes de loi lorsqu’un réalisateur souhaite, bien <strong>des</strong> années<br />
plus tard, « remonter » son film ?<br />
B. de P. : Quand certains auteurs vivants s’opposent à la restauration du<br />
film tel qu’il est sorti en salles, les discussions deviennent vite difficiles<br />
<strong>et</strong> cela crée parfois <strong>des</strong> situations assez compliquées. Quelle que soit la<br />
restauration effectuée, nous sommes contraints en ce qui nous concerne,<br />
de conserver une trace de la version présentée au public au moment de<br />
sa sortie salles. Si ce n’était pas le cas, nous passerions notre temps à<br />
refaire <strong>et</strong> réécrire sans cesse l’histoire du cinéma.<br />
A. : Quelle tâche incombe au laboratoire photochimique <strong>des</strong> Archives du film ?<br />
B. de P. : Nous nous concentrons principalement sur <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s compliqués<br />
que les laboratoires extérieurs ne peuvent pas toujours prendre<br />
en charge. Nous avons ainsi développé <strong>des</strong> technologies spécifiques<br />
pour traiter les <strong>films</strong> très abîmés auxquels il manque <strong>des</strong> perforations<br />
ou bien <strong>des</strong> <strong>films</strong> qui ne passent plus sur les tireuses comme les formats<br />
substandards. De certains <strong>films</strong>, il n’existe parfois plus qu’une copie<br />
17,5mm ! Récemment, nos collègues de la Cinémathèque française ont<br />
restauré un film dont un fragment n’existait plus qu’en 9,5mm ! Avec nos<br />
outils, nous nous occupons de ce type de sauvegarde. Pour Le Voyage<br />
dans la lune de Méliès, nous avons utilisé un scanner spécial perm<strong>et</strong>tant<br />
de prendre en charge les <strong>films</strong> qui n’ont plus de perforations <strong>et</strong> qui<br />
sont très « secs ». Nos scans ont ensuite été envoyés chez Technicolor<br />
aux Etats-Unis pour la restauration finale. La seule chose que nous ne<br />
développons pas, c’est la couleur. Nous pouvons prendre en charge<br />
<strong>des</strong> restaurations en couleurs avec nos outils numériques, mais le<br />
développement <strong>et</strong> le tirage se font à l’extérieur car notre laboratoire ne<br />
possède pas de chimie couleurs.<br />
30<br />
30<br />
A. : Dans ses gran<strong>des</strong> lignes, en quoi consiste le « grand emprunt » ?<br />
B. de P. : Il s’agit d’aider les catalogues à numériser leur patrimoine.<br />
Le dispositif est porté par le Commissariat général à l’investissement<br />
via une enveloppe dite « grand emprunt » gérée par la Caisse <strong>des</strong><br />
dépôts <strong>et</strong> consignation. Les sommes engagées seront remboursées<br />
avec intérêts <strong>et</strong> cela concerne les catalogues ayant un réel potentiel<br />
économique. Les ayants droit sont donc appelés à proposer la<br />
numérisation de lots de <strong>films</strong> qui disposent d’un « business-plan »<br />
équilibré, c’est-à-dire <strong>des</strong> <strong>films</strong> susceptibles d’avoir une exploitation<br />
importante pour compenser les <strong>films</strong> à moindre rentabilité. Mais<br />
comme il y a <strong>des</strong> centaines de <strong>films</strong>, même téléchargeables en VAD,<br />
qui ne parviendront jamais à rembourser leurs frais de numérisation<br />
<strong>et</strong> de restauration, le CNC a formulé un appel spécifique pour ces<br />
<strong>films</strong>-là, appel qui doit maintenant être validé par Bruxelles. Ce programme<br />
comporte une aide, soit sous forme d’avance remboursable,<br />
soit sous forme de subventions pour aider les <strong>films</strong> fragiles car il ne<br />
faudrait pas que pour <strong>des</strong> raisons économiques, le public soit privé<br />
d’une partie du patrimoine. La première phase de c<strong>et</strong> appel concerne<br />
les <strong>films</strong> mu<strong>et</strong>s, le r<strong>et</strong>our sur pellicule <strong>des</strong> restaurations lour<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />
les courts-métrages de fiction.<br />
A. : Quelle place les Archives du film vont-elles occuper au cœur de ce<br />
dispositif ?<br />
B. de P. : Nous allons participer au financement <strong>des</strong> numérisations qui<br />
suivent la recommandation technique Ficam/CST exposée il y a quelques<br />
semaines <strong>et</strong> qui impose la numérisation au minimum en 2K.<br />
A. : Pourquoi en 2K <strong>et</strong> pas tout de suite en 4K ?<br />
B. de P. : Estimons-nous déjà heureux d’avoir pu imposer le 2K car il y<br />
en a encore beaucoup, <strong>et</strong> non <strong>des</strong> moindres, qui estiment toujours que<br />
la HD est largement suffisante ! Et puis, le 2K va nous perm<strong>et</strong>tre à la fois<br />
d’avoir <strong>des</strong> fichiers HD pour la télévision <strong>et</strong> de pouvoir tirer <strong>des</strong> copies<br />
<strong>films</strong> de bonne qualité. Ce qui est impératif, c’est que le traitement<br />
patrimonial ne soit pas d’une qualité inférieure à celle de la production<br />
dite « fraîche ».<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
A. : Avez-vous l’impression que les mentalités sont en train de changer ?<br />
B. de P. : Je travaille aux Archives du film depuis quatre ans <strong>et</strong> je dois<br />
dire qu’il y a encore peu, même au sein de la maison, nous passions pour<br />
<strong>des</strong> extra-terrestres en tenant ce discours. C’est aussi aux producteurs<br />
d’évoluer. Il y en a qui ne savent même pas où se trouve le master du film<br />
qu’ils ont produit deux ans auparavant, ce qui laisse rêveur. Souvenonsnous<br />
que dans les années 1910, <strong>des</strong> sociétés de production faisaient la<br />
publicité pour <strong>des</strong> autodafés au cours <strong>des</strong>quels on brûlait <strong>des</strong> copies <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> négatifs pour « faire place » à de la production « fraîche » ! Quand<br />
on parle de trous énormes dans l’histoire du cinéma, il faudrait aussi<br />
prendre en compte les « trous » voulus <strong>et</strong> organisés par les producteurs<br />
eux-mêmes. Aujourd’hui, les producteurs ne j<strong>et</strong>tent plus leurs <strong>films</strong>,<br />
mais ils ne pensent pas assez à m<strong>et</strong>tre en place une vraie politique<br />
patrimoniale (je ne parle évidemment pas <strong>des</strong> « grands catalogues »).<br />
Dès l’instant où les offres notamment sur intern<strong>et</strong> vont se développer,<br />
on s’apercevra qu’il existe un public pour tous les <strong>films</strong>. Le Canada a<br />
récemment mis à disposition une partie de son patrimoine francophone<br />
<strong>et</strong> malgré un nombre de <strong>films</strong> assez réduits, on a constaté… plus de<br />
100.000 connexions. Il y a d’évidence pour les détenteurs de catalogues<br />
un gros travail à faire avec les plates-formes <strong>et</strong> les diffuseurs sur intern<strong>et</strong><br />
pour signaler l’existence <strong>des</strong> <strong>films</strong> de patrimoine. Le public est là <strong>et</strong> on<br />
va de plus en plus découvrir ce potentiel.<br />
A. : Quel est le prochain « chantier » <strong>des</strong> Archives du film ?<br />
B. de P. : Après avoir travaillé sur <strong>des</strong> œuvres comme Orphée ou La<br />
bandera , nous restaurons l’œuvre de Jean Comandon qui est un pionnier<br />
du cinéma scientifique. Sa filmographie n’a aucun avenir commercial,<br />
mais c’est notre rôle de sauvegarder une œuvre qui traverse plus de 50<br />
ans de l’histoire du cinéma. Le cinéma de Comandon a inspiré le cinéma<br />
d’Abel Gance, de Marcel L’Herbier ou de Germaine Dulac. S’ils n’avaient<br />
pas un jour croisé La Cinématographie <strong>des</strong> microbes, ils n’auraient peut-être<br />
pas fait les <strong>films</strong> qu’ils ont faits !<br />
31<br />
31<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Conservation<br />
"ON ESTIME AUJOURD’HUI QU’UN FILM<br />
INTERMÉDIAIRE COULEUR DE LABORATOIRE A<br />
UNE DURÉE DE VIE DE PLUS DE CENT ANS"<br />
GWÉNOLÉ BRUNEAU<br />
INGÉNIEUR CONSEIL KODAK FRANCE,<br />
BENELUX ET AFRIQUE DU NORD<br />
32 | ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
« Jusqu’à présent, les gens n’avaient guère le choix, il fallait tourner en<br />
film. Du coup, on ne se posait pas la question de la <strong>conservation</strong> dans<br />
la mesure où le support argentique a déjà permis à <strong>des</strong> <strong>films</strong> du siècle<br />
dernier, voire à <strong>des</strong> <strong>films</strong> de plus de cent ans, de franchir le temps.<br />
Ne se posait pas non plus jusqu’à présent le problème du stockage<br />
normalisé car c’était un service <strong>des</strong> laboratoires. Dans la mesure où ce<br />
système fonctionnait « tout seul », personne ne se souciait donc de la<br />
<strong>conservation</strong> <strong>des</strong> œuvres.<br />
Avec les tournages <strong>et</strong> les exploitations en numérique, tout a changé<br />
<strong>et</strong> il faut aujourd’hui trouver <strong>des</strong> solutions pour archiver car il n’existe<br />
pas de support numérique pérenne. C’est d’ailleurs une interrogation<br />
qui interpelle les pouvoirs publics <strong>et</strong> le CNC en ce moment, lesquels<br />
mènent conjointement une réflexion pour adapter le dépôt légal <strong>des</strong><br />
œuvres à la technologie d’aujourd’hui. Quand on évoque ce suj<strong>et</strong>, on<br />
ne peut pas passer sous silence le rapport de l’académie <strong>des</strong> sciences<br />
(1) qui attire l’attention de tout le monde sur le fait que les CD <strong>et</strong> les<br />
DVD ne se conservent pas plus de cinq ou dix ans <strong>et</strong> que les disques<br />
durs deviennent rapidement obsolètes ! C<strong>et</strong>te enquête publiée au<br />
printemps 2010 touche autant le grand public que les entreprises. Il y a<br />
par conséquent aujourd’hui une prise de conscience indispensable du<br />
phénomène <strong>et</strong> le problème est de taille.<br />
Si l’on revient un peu en arrière, on sait qu’il y a différentes manières de<br />
conserver un film : on peut conserver le négatif lui-même ou bien dans<br />
une filière traditionnelle de laboratoire faire appel à <strong>des</strong> interpositifs<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> internégatifs qui sont <strong>des</strong> versions montées <strong>et</strong> étalonnées ou<br />
bien encore s’appuyer sur une copie positive sonore. Même si chaque<br />
élément a une durée de <strong>conservation</strong> différente, nous savons – <strong>et</strong> c’est<br />
le principal - que l’on peut tous les conserver.<br />
On estime aujourd’hui qu’un film intermédiaire couleurs de laboratoire a une<br />
durée de vie de plus de cent ans. Rien ne nous interdit de penser que d’ici<br />
à une vingtaine d’années, de nouvelles technologies de scans perm<strong>et</strong>tront<br />
d’exploiter toutes les informations enregistrées sur le négatif original ou<br />
sur un film intermédiaire sachant qu’à l’heure actuelle, on n’utilise qu’un<br />
quart de l’information enregistrée sur le film lorsque l’on post produit en<br />
2K. Ce qui est certain, c’est qu’il faut conserver un « master » <strong>et</strong> que le<br />
film est adaptable à toutes les normes futures de diffusion.<br />
33<br />
33<br />
Conservation<br />
+<br />
IP de<br />
<strong>conservation</strong><br />
ou<br />
Séparation<br />
R‐V‐B<br />
2238 2238<br />
R V<br />
2238<br />
B<br />
ou<br />
2238<br />
R‐V‐B<br />
Interpositif<br />
ou<br />
Internégatif<br />
de <strong>conservation</strong>*<br />
Négatif<br />
Original<br />
011001<br />
110010<br />
110100<br />
011001<br />
Tirage<br />
‐<br />
Scan<br />
Données<br />
( DI )<br />
Tournage<br />
Numérique<br />
Shoot<br />
Positif<br />
Ce que <strong>Kodak</strong> recommande vivement pour assurer la pérennité <strong>des</strong><br />
œuvres, c’est de tirer un interpositif sur support polyester à partir du<br />
négatif triacétate ou du master numérique car ce sont deux supports<br />
qui n’ont pas la même stabilité dans le temps. Au bout de plusieurs<br />
dizaines d’années plongé dans de mauvaises conditions de <strong>conservation</strong>,<br />
le triacétate est en eff<strong>et</strong> susceptible d’être atteint de ce que l’on appelle<br />
le « syndrome du vinaigre », c’est-à-dire qu’à ce moment-là, le plastique<br />
rej<strong>et</strong>te de l’acide <strong>et</strong> se durcit, il devient cassant. Heureusement, c’est<br />
une évolution très lente dont on peut facilement freiner le processus en<br />
capturant principalement l’humidité (c’est un phénomène qui est favorisé<br />
par un taux d’humidité <strong>et</strong> une température élevés). Cela implique juste de<br />
vérifier régulièrement les boîtes qui sont stockées. Pourquoi les négatifs<br />
ne sont-ils pas sur polyester ? Tout simplement parce que leur solidité<br />
pourrait, à l’occasion d’un bourrage, causer <strong>des</strong> dommages conséquents<br />
IP<br />
+<br />
TTirage<br />
direct<br />
‐ Export ‐ Export<br />
+ ‐ +<br />
ODN (nouvel original) ou IP ou IN<br />
IN<br />
Positif<br />
Flux de postproduction<br />
Légen<strong>des</strong> :<br />
IP : Interpositif<br />
IN : Internégatif<br />
DI : Digital intermediate ( intermédiaire numérique)<br />
Flux tradition nnel<br />
*Avantage du film Interpositif ou<br />
Internégatif de <strong>conservation</strong> par rapport au<br />
film intermédiaire de production conservé :<br />
Alors que l’Interpositif de production sur triacétate<br />
(1 ère génération) ou Internégatif (2 ème<br />
génération) a servi à faire <strong>des</strong> copies <strong>et</strong> peut être<br />
potentiellement rayé <strong>et</strong> présenter <strong>des</strong> rayures,<br />
l’Internégatif ou l’interpositif de <strong>conservation</strong> sur<br />
polyester (1 ere génération) n’a servit qu’une fois<br />
pour la vérification de la copie.<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
aux caméras alors qu’en cas de problème similaire, le triacétate se déchire.<br />
Il est indéniable qu’il vaut beaucoup mieux s’orienter vers le polyester<br />
dont la stabilité est extrêmement longue, une stabilité autant chimique<br />
que dimensionnelle. Le polyester ne se réduit pas, ne se gondole pas.<br />
Notre recommandation est donc d’utiliser un support polyester sur un<br />
tirage directement issu du négatif ou du master numérique.<br />
Une autre recommandation qui existe depuis longtemps <strong>et</strong> qui continue<br />
d’être une précaution essentielle, c’est de procéder à une séparation<br />
trichrome, c’est-à-dire séparer les informations en rouge, vert <strong>et</strong> bleu<br />
qui se trouvent sur le négatif original afin de les tirer sur <strong>des</strong> <strong>films</strong> noir <strong>et</strong><br />
blanc – toujours sur polyester – pour garantir une stabilité de plusieurs<br />
centaines d’années. C’est la solution royale adoptée par toutes les<br />
« majors » américaines. Pour aller encore plus loin, on recommande de<br />
m<strong>et</strong>tre ces images rouges, vertes <strong>et</strong> bleues les unes à la suite <strong>des</strong> autres<br />
sur le même film de manière à ce que, s’il se produisait un vieillissement<br />
ou si les bobines n’étaient pas conservées au même endroit, on ne<br />
se r<strong>et</strong>rouve pas avec un problème de colorimétrie supplémentaire.<br />
Si l’on « shoote » <strong>et</strong> que l’on passe aujourd’hui par un intermédiaire<br />
numérique – ce qui est la majorité <strong>des</strong> cas en post production – on peut<br />
sans problème <strong>et</strong> sur une même bobine physique « shooter » les images<br />
rouges, vertes <strong>et</strong> bleues à la suite. Le film <strong>Kodak</strong> 2238 est le film idéal de<br />
séparation noir <strong>et</strong> blanc, on peut aussi l’utiliser pour le «shoot» de film<br />
de patrimoine en noir <strong>et</strong> blanc. Pour l’interpositif couleur polyester, on<br />
parle dans l’industrie d’une durée de vie de 120 ans, mais pour les <strong>films</strong><br />
noir <strong>et</strong> blanc sur polyester, on annonce une durée de 500 ans.<br />
Quand on parle de patrimoine, c’est évidemment vers c<strong>et</strong>te filière qu’il<br />
faut s’orienter. C’est ce qu’ont très bien compris les majors américaines<br />
comme Disney qui ont systématiquement recours à c<strong>et</strong>te séparation noir<br />
<strong>et</strong> blanc. Ils s’assurent ainsi la possibilité de ressortir les <strong>films</strong> quand ils<br />
le voudront en possédant un original de qualité pour les exploitations<br />
futures.<br />
En numérique, il n’est pas certain que les informations se conservent, il<br />
faut donc m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>des</strong> solutions de <strong>conservation</strong> en recopiant,<br />
en contrôlant <strong>et</strong> en changeant de support régulièrement, ce qui va très<br />
vite coûter plus cher. À long terme, la <strong>conservation</strong> en numérique d’un<br />
master 4K coûte 11 fois plus cher (c’est une estimation) qu’un <strong>archivage</strong><br />
sur film (2). Sans compter qu’il y a toujours le risque que l’on saute une<br />
34<br />
34<br />
Support film <strong>et</strong> stabilité dans le temps : acétate versus polyester<br />
• Tri-acétate<br />
Utilisé depuis 1948 («Saf<strong>et</strong>y Film») pour tous les <strong>films</strong> cinéma :<br />
toutes les négatives de prise de vues, les <strong>films</strong> noir <strong>et</strong> blanc, les<br />
intermédiaires <strong>et</strong> certains film positif de projection.<br />
Points forts : caméra, montage, …<br />
• Polyester / ESTAR<br />
Utilisé pour les <strong>films</strong> noir <strong>et</strong> blanc de laboratoire, les <strong>films</strong><br />
positifs pour projection, <strong>et</strong> certains <strong>films</strong> intermédiaires.<br />
Points forts : résistance, stabilité dimensionnelle, ...<br />
=> Support idéal pour la <strong>conservation</strong><br />
•Conservation de l’élément original<br />
(négatif)<br />
•Conservation d’une copie de l’original<br />
(séparation trichrome)<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
étape ou que, pour une raison ou une autre, une cass<strong>et</strong>te magnétique se<br />
démagnétise brusquement. Le risque du numérique est celui de la perte<br />
<strong>des</strong> informations en falaise. Un disque dur ou une bande magnétique<br />
peut en eff<strong>et</strong> du jour au lendemain devenir illisible alors qu’un film, même<br />
mal conservé, peut restituer <strong>des</strong> informations proches de l’original après<br />
restauration (même le déchirement <strong>des</strong> perforations est réparable).<br />
Après un tournage numérique maintenant, on préconise donc là encore<br />
un shoot pour r<strong>et</strong>ourner sur l’argentique. Au choix, on peut shooter en<br />
noir <strong>et</strong> blanc ou sur un intermédiaire couleur. Il est certain que les p<strong>et</strong>ites<br />
productions ne pourront pas se payer la séparation noir <strong>et</strong> blanc, mais sur<br />
un intermédiaire couleur, on est déjà à plus de cent ans de sauvegarde, ce<br />
qui n’est pas rien. Pour le shoot d’un intermédiaire couleur de production<br />
<strong>et</strong> d’un intermédiaire couleur de <strong>conservation</strong>, nous recommandons<br />
d’utiliser le film <strong>Kodak</strong> Vision3 Color Digital Intermediate 2254/5254.<br />
Aujourd’hui, <strong>Kodak</strong> s’est lancé sur l’amélioration <strong>des</strong> processus existants<br />
en film pour l’<strong>archivage</strong> <strong>et</strong> la <strong>conservation</strong>. En particulier, nous souhaitons<br />
améliorer le film noir <strong>et</strong> blanc pour qu’il soit plus facile d’utilisation au<br />
moment <strong>des</strong> shoots. C’est un film que l’on peut optimiser en le rendant<br />
plus sensible aux imageurs ».<br />
35<br />
35<br />
BIBLIOGRAPHIE.<br />
« Longévité de l’information numérique ».<br />
Les données que nous voulons garder vont-elles s’effacer ?<br />
Rapport d’un groupe de travail commun Académie <strong>des</strong> sciences <strong>et</strong><br />
Académie <strong>des</strong> technologies.<br />
Éditions EDP Sciences – Mars 2010<br />
« The digital dilemna » (2007)<br />
publié par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.<br />
Rapport très compl<strong>et</strong> sur les stratégies de <strong>conservation</strong> pérennes à l’ère<br />
numérique. Téléchargeable à l’adresse suivante :<br />
« The Book of Film Care »<br />
Rochester : Eastman <strong>Kodak</strong> Co. 1992.<br />
Publié par <strong>Kodak</strong> USA<br />
« The Film Preservation Guide,<br />
The Basics for Archives, Libraries and Museums »<br />
Téléchargeable en PDF :<br />
Le site de <strong>Kodak</strong><br />
contient également de nombreux documents téléchargeables en PDF :<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Éclair Laboratoires<br />
"QU’UN FILM SOIT TOURNÉ EN 35MM<br />
OU EN NUMÉRIQUE, IL FAUT UN RETOUR<br />
SUR FILM POUR LE PÉRENNISER"<br />
PAR CHRISTIAN LURIN,<br />
DIRECTEUR DE LA FABRICATION<br />
CHEZ ÉCLAIR LABORATOIRES<br />
36<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35<br />
Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945). Directeur de la photographie : Roger Hubert<br />
© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Actions : Que préconise aujourd’hui « Eclair Laboratoires » en matière de<br />
<strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> ?<br />
Christian Lurin : Nous proposons la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> éléments négatifs à<br />
une température de 3°C avec un taux d’humidité allant de 20 à 30% dans<br />
<strong>des</strong> chambres froi<strong>des</strong> situées aux environs d’Auxerre dans une filiale du<br />
laboratoire. Nous recommandons aussi la <strong>conservation</strong> d’un interpositif<br />
de chaque film dans un autre lieu situé à une dizaine de kilomètres du<br />
premier pour éviter de perdre l’ensemble de l’image d’une œuvre en cas<br />
de catastrophe naturelle ou de sinistre majeur. Les interpositifs qui nous<br />
sont confiés sont conservés à 15°C avec toujours le même taux d’humidité<br />
allant de 20 à 30%. Nous appliquons <strong>des</strong> dispositions équivalentes à la<br />
<strong>conservation</strong> <strong>des</strong> éléments son.<br />
A : Depuis quand proposez-vous ce type d’offre ?<br />
C.L. : Cela fait maintenant une quinzaine d’années <strong>et</strong> nous sensibilisons<br />
nos clients à la nécessité de conserver leurs éléments dans ces conditions<br />
de température <strong>et</strong> d’humidité relative. La qualité de l’air, comme le<br />
montre <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> récentes, est également un facteur important car les<br />
polluants éventuels ont eux aussi une influence sur la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>films</strong>. C’est tout particulièrement le cas pour les vapeurs d’acide acétique<br />
relâchées par les <strong>films</strong> victimes du syndrome du vinaigre. Ce qu’il faut,<br />
c’est filtrer l’air pour éviter <strong>des</strong> teneurs trop élevées en acide acétique.<br />
A : Existe-t-il une analyse quasi-systématique <strong>des</strong> stocks à Epinay ?<br />
C.L. : Cela est fait à la demande <strong>des</strong> détenteurs de catalogues<br />
majeurs français tels Gaumont <strong>et</strong> Canal Plus qui sont déterminés à<br />
préserver leurs actifs. Tous les « éléments-maîtres » - à savoir les<br />
négatifs, les interpositifs <strong>et</strong> les négatifs son - sont alors expertisés<br />
avec un rapport de vérification détaillé pour chaque élément. Nous<br />
avons également <strong>des</strong> activités d’inventaire lorsque, pour certains<br />
catalogues d’importance, les <strong>films</strong> nous sont livrés sur pal<strong>et</strong>tes. Il<br />
faut savoir qu’une pal<strong>et</strong>te représente environ 150 bobines <strong>et</strong> qu’un<br />
long-métrage, si l’on tient compte <strong>des</strong> chutes, doubles, versions<br />
étrangères <strong>et</strong> autres, représente à lui seul deux à trois pal<strong>et</strong>tes. Pour<br />
les « éléments-maîtres » dont je parlais tout à l’heure, seule une<br />
vérification sur table perm<strong>et</strong> de savoir dans quel état ils se trouvent,<br />
ce qui est indispensable pour pouvoir proposer au détenteur <strong>des</strong><br />
37<br />
37<br />
droits une stratégie de <strong>conservation</strong>. Il est évident qu’un élément<br />
vinaigré ne se conserve pas de la même manière qu’un élément sain :<br />
plus l’élément est vinaigré, plus nous proposons une <strong>conservation</strong> au<br />
froid <strong>et</strong> dans le cas d’un danger de décomposition, on a recours à la<br />
duplication optique de l’élément, c’est-à-dire au tirage d’un nouvel<br />
interpositif ou d’un marron s’il s’agit de noir <strong>et</strong> blanc. En mesurant<br />
le degré d’avancement de la réaction à partir du degré d’acidité du<br />
film, nous sommes en mesure de prévoir à quel moment le film sera<br />
susceptible d’atteindre son point critique.<br />
A : Qu’en est-il de la surveillance <strong>des</strong> catalogues qui vous sont confiés ?<br />
C.L. : La surveillance <strong>des</strong> catalogues est aussi une prestation que nous<br />
proposons de plus en plus. Périodiquement, c’est-à-dire une fois par<br />
an, nous auscultons une bobine de chaque film, ce qui fait que pour un<br />
long-métrage, on peut considérer que toutes les bobines sont examinées<br />
chaque « six ans » si l’on tient compte d’une moyenne de six bobines par<br />
film. En ce qui concerne les <strong>films</strong> sur support tri-acétate, on est attentif<br />
à l’apparition éventuelle du syndrome du vinaigre. Si l’on constate qu’un<br />
film commence à réagir aux tests, il y a tout de suite préconisation de<br />
<strong>conservation</strong> ou alors préservation via une recopie du film sur un autre<br />
support.<br />
A : Dans le cadre d’une captation numérique, qu’êtes-vous en mesure de<br />
proposer pour garantir la pérennité <strong>des</strong> images ?<br />
C.L. : Nous allons très prochainement lancer un investissement de<br />
plusieurs centaines de milliers d’euros pour assurer la <strong>conservation</strong><br />
<strong>des</strong> données numériques en nous occupant de leur migration, de leur<br />
suivi <strong>et</strong> de leur entr<strong>et</strong>ien. Nous sommes sur ce suj<strong>et</strong> dans le même état<br />
d’esprit que pour la séparation du négatif <strong>et</strong> de l’interpositif en film. A<br />
partir de serveurs où seront stockées les images, nous proposons un<br />
« back-up » systématique sur LTO3 ou LTO5. A partir de la surveillance<br />
de toutes les données, il s’agira alors de déterminer tous les cinq ou dix<br />
ans à quel moment il faut migrer <strong>et</strong> à quel moment le « hardware ou le<br />
software » risque de devenir obsolète. Pour ne jamais se trouver face<br />
à une technologie qui ne soit plus lisible, on n’a d’autre choix que de<br />
suivre de près les évolutions technologiques, ce qui revient à migrer en<br />
permanence d’une plate-forme à l’autre.<br />
Les Enfants du Paradis © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
A : Cela garantit-il une vraie pérennité <strong>des</strong> œuvres ?<br />
C.L. : Sur un plan technique, pourquoi pas, mais cela implique <strong>des</strong><br />
efforts <strong>et</strong> <strong>des</strong> moyens permanents <strong>et</strong> je ne crois absolument pas au<br />
fait de garantir à quiconque que l’on va suivre pendant un siècle <strong>et</strong><br />
en permanence les évolutions technologiques. Au vingtième siècle,<br />
pendant les deux guerres mondiales, <strong>des</strong> tas de bobines de <strong>films</strong> sont<br />
demeurées sur <strong>des</strong> étagères sans aucune attention particulière <strong>et</strong> on<br />
constate, cinquante ou quatre-vingt ans plus tard, qu’elles sont toujours<br />
parfaitement « restaurables » <strong>et</strong> exploitables en très haute définition,<br />
qu’il s’agisse du 2K ou du 4K. Je ne crois pas que la même garantie<br />
existe pour les données numériques, puisque contrairement au film,<br />
elles ne se conservent pas d’elles-mêmes. Qu’un film soit tourné en<br />
35mm ou en numérique, il faut un r<strong>et</strong>our sur film pour le pérenniser<br />
sous forme d’un internégatif (ou mieux d’un interpositif) fabriqué sur<br />
un enregistreur, type Aaton K ou ArriLaser <strong>et</strong> c’est ce nouvel élément<br />
que l’on peut alors qualifier d’élément « de <strong>conservation</strong> ». C’est notre<br />
seule garantie aujourd’hui. Personnellement, j’y pose un léger bémol car<br />
dès lors que l’on a tourné en 4K ou en 35mm, l’élément 2K demeure un<br />
facteur limitatif. Le problème sera encore accru quand nous n’aurons<br />
plus que <strong>des</strong> sorties numériques sous forme de DCP <strong>et</strong> que le r<strong>et</strong>our sur<br />
film apparaîtra comme un coût supplémentaire, sans « utilité directe »<br />
au niveau de l’exploitation, si ce n’est de garantir une pérennité. Ce coût<br />
ne pourra certainement pas être absorbé par tous les producteurs, sans<br />
soutien par <strong>des</strong> financements complémentaires.<br />
A : On a souvent tendance à prendre exemple sur les Américains. Comment<br />
les choses se passent-elles outre-Atlantique ?<br />
C.L. : C’est différent parce que la conscience de la valeur <strong>des</strong> catalogues<br />
est profondément ancrée dans la mémoire <strong>et</strong> l’esprit américains alors<br />
qu’en France, elle est plus récente. En France, il y a toujours <strong>des</strong> personnes<br />
qui doutent de la valeur future de leur patrimoine… <strong>et</strong> même <strong>des</strong> <strong>films</strong><br />
en général alors que l’on ne peut jamais prévoir le futur d’un film. Un<br />
poisson nommé Wanda par exemple est un film qui avait fait une toute<br />
p<strong>et</strong>ite carrière à l’époque de sa sortie <strong>et</strong> qui en a fait une bien meilleure<br />
dès l’instant où il est ressorti en DVD <strong>et</strong> en Blu-Ray après restauration.<br />
Les Américains ont commencé avant nous à continuer d’exploiter leurs<br />
anciens titres, Disney en tête avec un catalogue majoritairement de <strong>films</strong><br />
d’animation exploitables à chaque nouvelle génération d’enfants, donc<br />
38<br />
38<br />
en gros tous les dix ou quinze ans. Evidemment, lorsque les Américains<br />
garantissent la pérennité de leurs œuvres en faisant appel à la séparation<br />
trichrome, nous sommes vite sur <strong>des</strong> niveaux de production budgétaire<br />
notablement plus élevés qu’en France.<br />
A : La séparation trichrome est-elle la solution « parfaite » ?<br />
C.L. : L’avantage de la séparation trichrome repose sur le fait qu’un film<br />
noir <strong>et</strong> blanc sur polyester développé correctement <strong>et</strong> proprement lavé,<br />
a une espérance de vie de plus de cinq siècles, même s’il est conservé à<br />
20°C dans <strong>des</strong> conditions d’humidité relative « juste » convenables. Ce<br />
n’est pas le cas <strong>des</strong> <strong>films</strong> couleurs car les colorants sont <strong>des</strong> produits<br />
chimiques assez sensibles qui subissent toujours un vieillissement. Si<br />
l’on veut véritablement pérenniser une œuvre sur plusieurs siècles sans<br />
que cela devienne un casse-tête - je parle notamment de température<br />
basse - le noir <strong>et</strong> blanc est la solution. Avec un film tourné en couleurs,<br />
on est obligé de procéder à une séparation trichrome pour conserver<br />
chacune <strong>des</strong> trois couleurs. Ceci dit, un bon internégatif couleurs sur<br />
polyester conservé à 3 ou 4°C dans de bonnes conditions peut également<br />
se conserver de l’ordre de trois ou quatre siècles. Disons que les conditions<br />
de température imposées par la couleur peuvent être légèrement<br />
« relâchées » sur le noir <strong>et</strong> blanc.<br />
A : La séparation trichrome pose néanmoins le problème de l’étalonnage…<br />
C.L. : Comme le r<strong>et</strong>our sur film va être utilisé dans l’avenir sur un scanner<br />
<strong>et</strong> non sur une tireuse, il est certain que l’étalonnage sera un problème<br />
si l’on ne conserve pas une copie de référence couleurs du film. Ceci dit,<br />
conservé à froid, ce type de copie supporte plutôt bien le temps, mais<br />
je n’ai pas de réponse franche sur le problème de l’étalonnage dans la<br />
mesure où lorsque les <strong>films</strong> ressortiront, ils seront aussi vus sur d’autres<br />
écrans que les écrans actuels. L’étalonnage est donc nécessaire <strong>et</strong> sera<br />
toujours nécessaire, d’autant plus que l’on étalonne différemment pour<br />
la HD ou la sortie salle. Comment faire pour ne pas trahir la volonté <strong>des</strong><br />
auteurs, c’est un vrai problème ?<br />
Quai <strong>des</strong> brumes de Marcel Carné. Directeur de la photographie : Eugène Schüfftan © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
A : Est-il possible de conserver sur un autre support les paramètres liés à<br />
l’étalonnage ?<br />
C.L. : Dans une certaine logique, il faudrait conserver les données sur<br />
la colorimétrie <strong>et</strong> la chromaticité, mais comment les exploiter dans dix,<br />
quinze ou vingt ans ? Ce que l’on peut faire de mieux, c’est enregistrer<br />
les données sensitométriques avec leurs valeurs, les relire dans vingt<br />
ans <strong>et</strong> les comparer à la valeur d’origine pour coller « au plus près » de<br />
l’original.<br />
A : Cela veut-il dire qu’en numérique, il va vite devenir problématique de<br />
conserver, comme on le fait en film, les chutes <strong>et</strong> les doubles ?<br />
C.L. : Absolument ! C’est vrai qu’en film, on conserve plus facilement<br />
les chutes <strong>et</strong> les doubles mais on les limite aussi à partir du moment où<br />
l’on dispose d’un négatif monté, sauf qu’aujourd’hui on monte de moins<br />
en moins le négatif. C’est un problème annexe (mais très important) du<br />
passage au numérique, c’est-à-dire que l’on a tendance à de plus en plus<br />
numériser le négatif sans l’avoir coupé. On travaille à partir de montages<br />
« gran<strong>des</strong> longueurs » ou de « sélections pour scan ». Mais un film non<br />
monté passe facilement de cinq ou six bobines de 600 mètres à… 25 ou<br />
30 boîtes qui contiennent non seulement les plans utilisés, mais aussi<br />
beaucoup d’autres. Sur certains <strong>films</strong>, cela peut même aller jusqu’à 150<br />
boîtes. Conserver le film dans de bonnes conditions voudrait donc dire<br />
conserver aussi ces 150 boîtes à une température de 4°C, ce qui est<br />
considérable , sans compter le risque de ne pas savoir r<strong>et</strong>rouver ses p<strong>et</strong>its,<br />
passé un certain nombre d’années. Dans ces conditions, il est évident<br />
que le coût de <strong>conservation</strong> devient très vite prohibitif. C’est la raison<br />
pour laquelle je suis personnellement favorable au montage du négatif<br />
même s’il y aura toujours <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s spéciaux traités en numérique qui<br />
n’y figureront pas. Il faut alors remplacer ces « bouts de film » par <strong>des</strong><br />
longueurs d’amorce <strong>et</strong> surtout, garder les plans qui ont servi à réaliser<br />
les trucages. Tout cela est un peu compliqué, mais c’est le seul moyen<br />
de limiter le nombre de boîtes à conserver.<br />
A : Demeure quand même le problème d’un remontage éventuel du réalisateur<br />
<strong>des</strong> années plus tard !<br />
C.L. : A ce moment-là, il faut que ce soit le réalisateur qui le décide si,<br />
au moment de la sortie de son film, il a été frustré pour une question<br />
39<br />
39<br />
de durée ou de censure ou de je ne sais quoi d’autre. Dès le départ par<br />
exemple, Coppola savait qu’il remonterait un jour, quinze ou vingt ans<br />
plus tard, Apocalypse now. C’était clair. En revanche, à partir du moment<br />
où le réalisateur est décédé, remonter un film devient une trahison.<br />
Quelque part, les chutes <strong>et</strong> les doubles ne devraient pas être conservés<br />
au-delà de la durée de vie du réalisateur.<br />
A : Cela revient à dire que face à toutes ces problématiques, le laboratoire<br />
a, bien plus qu’auparavant, un rôle majeur de conseiller à jouer auprès de<br />
ses clients…<br />
C.L. : C’est ce que « Eclair Laboratoires » essaie de développer à travers<br />
le pôle « patrimoine » que je co-dirige avec Jean-Pierre Neyrac. Qu’un<br />
film soit tourné en numérique ou en 35mm, le laboratoire doit pouvoir<br />
proposer en amont de la mise en œuvre du proj<strong>et</strong> une activité de conseil<br />
<strong>et</strong> de stratégie de <strong>conservation</strong>, laquelle doit idéalement être budgétée<br />
avant le tournage. Il faut éviter que ces questions-là ne figurent sur la<br />
dernière ligne du devis, celle qui est toujours la première à « sauter »<br />
quand il s’agit de boucler un film.<br />
A : La dernière grande restauration orchestrée par « Eclair Laboratoires »<br />
a été « Les Enfants du paradis » présenté c<strong>et</strong>te année à Cannes. Quelle est<br />
aujourd’hui sa garantie de pérennité?<br />
C.L. : Sur certains <strong>films</strong>, il nous est arrivé de shooter deux internégatifs<br />
2K, l’un pour les copies de série <strong>et</strong> l’autre pour la <strong>conservation</strong>, mais<br />
sur Les Enfants du paradis, c’est un vrai shoot de <strong>conservation</strong> 4K qui a<br />
sera fait à partir d’une restauration 4K. C’est une grande première, mais<br />
pour moi, le film de Carné va bien au-delà du cinéma classique, c’est un<br />
poème, une œuvre majeure. Notre engagement a été très important sur<br />
ce film, c’est une restauration qui a duré près de quatre mois <strong>et</strong> mobilisé<br />
de quinze à vingt personnes. Mais finir par un shoot de <strong>conservation</strong>,<br />
c’est un must !<br />
A : Quelles sont aujourd’hui les différents « chantiers » engagés ?<br />
C.L. : Nous travaillons en ce moment sur Quai <strong>des</strong> brumes pour le Studio<br />
Canal <strong>et</strong> sur Antoine <strong>et</strong> Antoin<strong>et</strong>te de Jacques Becker pour Gaumont.<br />
Antoine <strong>et</strong> Antoin<strong>et</strong>te de Jacques Becker.<br />
Directeur de la photographie : Pierre Montazel © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Laboratoire LTC<br />
"AU BOUT DE QUINZE ANS, IL Y A DE FORTES CHANCES<br />
QU’UN DISQUE DUR OU UNE CASSETTE LTO<br />
SOIT DEVENU TOTALEMENT ILLISIBLE"<br />
PAR JEAN-PIERRE BOIGET,<br />
DIRECTEUR DES "NOUVELLES TECHNOLOGIES"<br />
ET STÉPHANE MARTINIE,<br />
DIRECTEUR DU « PÔLE IMAGE »<br />
40 | ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Actions : Quelle est la politique de <strong>conservation</strong> du laboratoire ?<br />
Jean-Pierre Boig<strong>et</strong>, directeur <strong>des</strong> « nouvelles technologies » : Même<br />
dans le cas de <strong>films</strong> tournés en 35mm, nous avons à faire majoritairement<br />
aujourd’hui à de la postproduction numérique. Nous savons aussi que<br />
dans les deux ans à venir, de moins en moins de <strong>films</strong> seront exploités<br />
en 35mm, alors quel que soit le cas de figure – captation argentique ou<br />
numérique – nous recommandons de faire un shoot de <strong>conservation</strong>. On<br />
ne lui connaît pas d’équivalent numérique pour une <strong>conservation</strong> à long<br />
terme alors qu’un internégatif ou un interpositif, on sait déjà qu’on peut<br />
le garder plus de cent ans . Pour s’en convaincre, il suffit d’expertiser <strong>des</strong><br />
éléments datant <strong>des</strong> années 60 ou 70 : même s’il y a de la restauration à<br />
faire, la qualité d’image « source » est toujours présente <strong>et</strong> suffisamment<br />
bonne pour que les <strong>films</strong> soient encore exploités.<br />
A : Comment c<strong>et</strong>te « recommandation » est-elle perçue par les clients ?<br />
J.P. B. : Tout le monde a vécu l’expérience de perdre un jour un disque dur sur<br />
son PC ou un disque dur externe entreposé dans une armoire. Alors, quand<br />
on explique que la <strong>conservation</strong> numérique est quelque chose d’extrêmement<br />
sérieux, c’est compris, du moins pour l’instant <strong>et</strong> tant qu’il existe encore une<br />
exploitation 35mm. Dès lors que nous serons entrés dans la phase où il n’y<br />
en aura plus, là je ne sais pas comment la chose sera perçue.<br />
A : Ressentez-vous une perception différente selon qu’il s’agit d’une génération<br />
qui a « vécu » avec le film <strong>et</strong> une « nouvelle » génération tournée vers le<br />
numérique ?<br />
J.P. B. : Les gens de la nouvelle génération se rendent compte plus vite<br />
<strong>des</strong> problèmes parce qu’ils y ont été confrontés plus tôt alors que les<br />
gens qui ont toujours travaillé avec du 35mm n’ont pas eu à se poser ce<br />
genre de questions. Tout le monde sait que la <strong>conservation</strong> numérique<br />
n’est pas aussi simple que la <strong>conservation</strong> film. Quand on dispose d’un<br />
r<strong>et</strong>our sur film après une postproduction numérique, on peut passer<br />
quinze ans en Asie, l’élément sera toujours là au r<strong>et</strong>our. En numérique,<br />
c’est impossible. Je ne sais même pas si les interfaces qui existent sur<br />
mon élément perm<strong>et</strong>tront toujours de lire les fichiers. Au bout de quinze<br />
ans, il y a de fortes chances qu’un disque dur ou une cass<strong>et</strong>te LTO soit<br />
devenu totalement illisible même avec le bon matériel <strong>et</strong> le bon logiciel.<br />
Cela revient à dire qu’il faut entr<strong>et</strong>enir le stockage numérique.<br />
41<br />
41<br />
A : À savoir ?<br />
J.P. B. : Faire <strong>des</strong> copies, faire <strong>des</strong> migrations. Avec le LTO qui est de la<br />
bande magnétique, il faut compter deux ou trois ans de vie. Au-delà,<br />
vous prenez un risque <strong>et</strong> si vous êtes sur un serveur connecté en Red<br />
avec un système de surveillance, la problématique devient celle du<br />
changement de matériel. Il faut un contrat de maintenance sérieux sur<br />
le matériel – je parle de grosse machinerie – pour pouvoir changer les<br />
pièces en cas de besoin. Pour garantir une œuvre à long terme, le shoot<br />
35 est indispensable, il suffit de regarder <strong>des</strong> <strong>films</strong> qui ont déjà cent ans<br />
d’âge pour s’en convaincre. Dans ce débat, les directeurs de production<br />
<strong>et</strong> de post production sont <strong>des</strong> éléments clés car ce sont eux qui valident<br />
les dépensent dans les laboratoires, eux qui sont à la fois les garants de<br />
ce qui sort <strong>et</strong> de la dépense engagée.<br />
A : Comment s’opère chez LTC le suivi du numérique ?<br />
J.P. B. : Nous proposons au client une prestation payante de <strong>conservation</strong><br />
à base de serveurs sécurisés : n’importe quelle pièce du serveur peut<br />
tomber en panne, nous aurons accès aux données. De plus <strong>et</strong> quoiqu’il<br />
arrive, nous avons toujours en numérique deux copies, une sur serveur <strong>et</strong><br />
une autre qui peut être également sur serveur ou sur bande magnétique.<br />
Notre contrat de service nous engage vis-à-vis du client sur une période<br />
de six mois à trois ans, jamais au-delà. Au terme <strong>des</strong> trois ans <strong>et</strong> si le<br />
client veut prolonger la prestation, nous repassons un contrat avec lui<br />
après une nouvelle expertise du matériel.<br />
A : Comment accompagnez-vous l’évolution <strong>des</strong> matériels ?<br />
J.P. B. : L’exemple du LTO est symptomatique. Nous avons commencé<br />
avec du LTO simple devenu LTO1, puis 2, 3, 4 <strong>et</strong> bientôt LTO5. Avec ce<br />
serveur, nous devrions pouvoir relire ce qui se trouve sur le LTO1, mais<br />
on entend dire déjà qu’à force de progresser en technologie, il va y avoir<br />
un moment où ces lecteurs ne seront plus capables de lire les vieux LTO.<br />
Le LTO est une bande magnétique, on est loin de la durée de vie de la<br />
pellicule. D’un côté, il y a du « magnétisme », de l’autre quelque chose<br />
qui est « gravé dans le marbre ». Avec un LTO de plus de cinq ans, on<br />
va dire que l’on « tente le coup », mais rien n’est garanti. Au-delà de dix<br />
ans, on mise carrément sur la chance.<br />
Stéphane Martinie, directeur du « pôle image » : Avec les supports<br />
vidéo antérieurs comme le D1 <strong>et</strong> le D6 qui étaient les premiers stockages<br />
numériques, nous avons connu <strong>des</strong> problèmes similaires. Quand il a<br />
fallu pérenniser les contenus en faisant <strong>des</strong> « dubs » de D6 sur HDCam<br />
SR, on s’est aperçu qu’il y avait <strong>des</strong> problèmes de relecture <strong>et</strong> que<br />
malheureusement, il allait falloir entièrement « remasteriser » certains<br />
passages. Les ban<strong>des</strong> avaient été stockées au bon endroit, à bonne<br />
température <strong>et</strong> avec un taux d’humidité adéquat, mais cela ne suffisait<br />
pas. Le phénomène va se répéter avec le LTO aujourd’hui : on a beau avoir<br />
du stockage Data équipé d’un code binaire, la bande magnétique ne sera<br />
pas lisible partout <strong>et</strong> c’est comme ça. D’où l’intérêt de m<strong>et</strong>tre en avant<br />
la sauvegarde argentique en attendant un support numérique pérenne.<br />
A : Entre les recopies régulières <strong>des</strong> différents éléments à conserver <strong>et</strong> les<br />
contrats de maintenance à renouveler régulièrement, ne pas effectuer de<br />
r<strong>et</strong>our sur film va donc, en plus de m<strong>et</strong>tre la vie de l’œuvre en péril, coûter<br />
plus cher très vite…<br />
J.P. B. : C’est évident. Pour sauvegarder dans le temps <strong>des</strong> données<br />
numériques, il faut envisager une recopie tous les trois ans environ sachant<br />
que lorsque l’on décharge un LTO, il faut qu’un technicien en relise tout<br />
le contenu <strong>et</strong> en contrôle la bonne qualité. Entre la recopie, la fourniture<br />
du LTO5 <strong>et</strong> le temps passé, vous n’êtes pas loin tous les trois ans d’une<br />
facturation de près de trois mille euros. Faîtes le compte ! Par rapport à<br />
la valeur d’un film à long terme, un shoot revient finalement assez bon<br />
marché si l’on prend en compte ce que coûte sa <strong>conservation</strong> sur vingt<br />
ans <strong>et</strong> si on réalise ce que serait la perte de revenus si une partie du<br />
film venait à « s’évanouir » en cours de route. Il faut abolir c<strong>et</strong>te vision à<br />
courte durée. Le shoot de <strong>conservation</strong> est un élément de sécurité, mais<br />
il ne faut pas oublier de conserver les éléments d’exploitation <strong>des</strong> <strong>films</strong>,<br />
<strong>des</strong> éléments disponibles pour une exploitation immédiate. Au début,<br />
ce sera un master HD ou un DCP <strong>et</strong> peut-être un fichier de distribution<br />
vidéo dans deux ou trois ans. Ceci étant, il s’agira toujours d’éléments<br />
d’exploitation « compressés » qui n’auront pas la qualité ultime du<br />
film, ce qui sera moins grave si l’on dispose par ailleurs d’un shoot 35.<br />
Sur <strong>des</strong> éléments numériques seuls, aucun laboratoire ne s’engagera<br />
à garantir une pérennité quelconque aux images, c’est très clair. Vous<br />
imaginez le risque sur un film qui vaut plusieurs millions d’euros ! Nous,<br />
nous appliquons <strong>des</strong> technologies, mais ne saurions être tenus pour<br />
responsables du fait que l’on n’a pas trouvé en numérique un équivalent<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
du stockage <strong>et</strong> de l’<strong>archivage</strong> argentique. Autre intérêt du shoot, il perm<strong>et</strong><br />
de tirer une copie cinémathèque. Certes, tous les grands distributeurs<br />
seront équipés en projecteurs numériques serveurs fin 2012, mais d’ici<br />
là, les salles qui organisent <strong>des</strong> rétrospectives n’en disposeront pas, il<br />
y aura donc toujours besoin de tirer <strong>des</strong> copies. Quel dommage de se<br />
dire alors que l’on tire une copie seulement issue d’un vieil internégatif<br />
qui a cinquante ans !<br />
A : Proportionnellement, combien de clients sont-ils conscients de la valeur<br />
d’un catalogue ?<br />
S.M. : Nous rencontrons deux types de clients : les grands cataloguistes<br />
qui engagent <strong>des</strong> frais importants de remasterisation en 2K comme en<br />
HD, avec une exigence de défaut zéro <strong>et</strong> de plus p<strong>et</strong>its qui n’ont pas les<br />
mêmes moyens <strong>et</strong> du coup, nous demandent de serrer le plus possible<br />
le devis.<br />
J.P. B. : C’est en cela que le « grand emprunt » va représenter pour eux<br />
une aide non négligeable car les fonds vont perm<strong>et</strong>tre une numérisation<br />
en 2K.<br />
S.M. : A partir du moment où 30% du coût de la restauration 2K reste à<br />
la charge du client, quel sera le pourcentage de notre patrimoine restauré<br />
dans ces conditions ? Aujourd’hui, je ne sais pas, c’est encore un peu<br />
tôt pour le dire. Dans le catalogue de <strong>films</strong> <strong>des</strong> années 60 à 80, on peut<br />
vraiment se r<strong>et</strong>rouver avec un énorme travail à fournir parce qu’à l’époque,<br />
on tirait beaucoup de copies du négatif original <strong>et</strong> il y avait beaucoup de<br />
manipulations. A partir de 1987, les choses se sont un peu arrangées car<br />
les interpositifs étaient tirés par immersion, donc étaient devenus plus<br />
propres. Si, durant c<strong>et</strong>te période apparaissent d’énormes catastrophes<br />
sur le négatif, on aura au moins la possibilité d’avoir recours à de bons<br />
interpositifs sans zones <strong>et</strong> plutôt stables. Ce n’est pas le cas pour les <strong>films</strong><br />
d’avant 1960 mais quand on parle de patrimoine, on parle aussi de ces<br />
<strong>films</strong>-là. Tant que l’on peut restaurer avec <strong>des</strong> outils automatiques, c’est<br />
relativement simple mais dès qu’il y a <strong>des</strong> déchirures, de l’instabilité avec<br />
du dédoublement ou <strong>des</strong> perforations explosées, il n’est plus question<br />
de logiciels : ce sont <strong>des</strong> coûts considérables.<br />
42<br />
42<br />
A : Avant 1960, on est en noir <strong>et</strong> blanc. Cela change-t-il les choses ?<br />
S.M. : Vous me parlez « d’images fixées », moi je vous parle d’un état<br />
« physique » que le scan va reproduire. Il va ressortir l’état du négatif<br />
avec ses déchirures ou ses images manquantes, ses images noires. A<br />
l’époque, il arrivait fréquemment que lorsqu’un film casse, on remonte en<br />
longueur la partie manquante avec de l’amorce. Le temps de restauration<br />
à prévoir pour ces <strong>films</strong>-là est donc considérable. Quand nous nous<br />
étions penchés pour MK2 sur quelques Chaplin, on s’en était aperçu.<br />
C’était une restauration de prestige, mais quel travail !<br />
A : En matière d’<strong>archivage</strong>, quelle est votre politique ?<br />
S. M. : Nous pratiquons film par film à la demande de l’ayant droit. A<br />
partir du moment où celui-ci réalise une vente, il nous demande de nous<br />
pencher sur les éléments du film pour établir un devis, qu’il s’agisse<br />
d’une « masterisation » HD ou 2K. Tous nos <strong>films</strong> sont stockés sur<br />
pal<strong>et</strong>tes à température <strong>et</strong> hydrométrie contrôlées dans <strong>des</strong> hangars à<br />
côté de Reims, mais ce qui se trouve dans les boîtes n’est pas vérifié<br />
systématiquement, il faut que le client le demande.<br />
A : Qu’en est-il du fonds « nitrate » ?<br />
S.M. : Nous l’avons confié aux Archives du film. Ces bobines devaient<br />
être stockées dans <strong>des</strong> conditions particulières.<br />
A : Le laboratoire, par la force <strong>des</strong> choses, se r<strong>et</strong>rouve donc aujourd’hui investi<br />
d’une mission « pédagogique »…<br />
J.P. B. : Cela a toujours été le cas, mais avec la multiplication <strong>des</strong> formats,<br />
<strong>des</strong> process <strong>et</strong> <strong>des</strong> solutions, c<strong>et</strong>te « formation » est devenue permanente.<br />
Oui, nous passons notre temps à expliquer.<br />
S.M. : Pour un grand nombre de personnes, le mot « numérique » est<br />
souvent associé à l’idée qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir<br />
un élément dans la journée. Mais un fichier numérique se construit comme<br />
tout montage négatif à l’époque <strong>et</strong> ça se synchronise, qu’il s’agisse du<br />
son ou <strong>des</strong> sous-titres. Cela prend du temps. Si on nous demande de<br />
décliner un fichier 2K 10bits dans différents standards, il y a <strong>des</strong> process<br />
à respecter <strong>et</strong> il faut que les clients l’entendent.<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
S.M. : Notre but est de faire accepter les temps de process <strong>et</strong> le coût<br />
engendré. Soit nous gagnons la bataille, soit nous sommes amenés à<br />
disparaître, c’est du 50/50. Les gros distributeurs <strong>et</strong> les ayants droit qui<br />
ont <strong>des</strong> gens compétents dans leurs équipes l’entendent sans problème.<br />
Il y a encore beaucoup trop c<strong>et</strong>te idée : « c’est du numérique, ça ne<br />
coûte pas cher ».<br />
A : Aujourd’hui, on parle de restauration en 2K. Mais ne faudrait-il pas tout<br />
de suite envisager le 4K ?<br />
J .P. B. : Pour être précis, la recommandation CST dans le cadre du<br />
« grand emprunt » n’est pas le 2K, mais « un minimum 2K ». Elle dit<br />
autre chose : « le format de numérisation doit conserver la qualité de<br />
l’œuvre originale ». Si on suit le texte à la l<strong>et</strong>tre, il faudrait effectivement<br />
faire du 4K pour un négatif « fin <strong>des</strong> années 90 ».<br />
S.M. : En revanche, si on remonte un peu plus loin en arrière, les négatifs<br />
sont assez pauvres <strong>et</strong> le 4K ne se justifie pas. Le début <strong>des</strong> années 90<br />
est un peu charnière quant à la qualité <strong>des</strong> négatives car c’est l’époque<br />
où sont arrivées les nouvelles générations d’émulsions.<br />
J.P. B. : La recommandation du « 2K minimum » est assez équilibrée.<br />
Demander du « 4K minimum » aurait été ridicule <strong>et</strong> aurait tué le marché<br />
dans l’œuf. Là, nous sommes dans un équilibre qui va nous perm<strong>et</strong>tre de<br />
travailler dans <strong>des</strong> process de qualité tout en « sortant » quelque chose<br />
d’adapté au marché, du moins pour les gros intervenants.<br />
S.M. : Nous pouvons aussi envisager de faire <strong>des</strong> scans 4K « down-sizés »<br />
en fichiers 2K, c’est-à-dire obtenir un scan 2K possédant la finesse<br />
d’une captation 4K. Ce pourrait être d’ailleurs une solution au délicat<br />
problème du rapport qualité/coût de la numérisation de notre patrimoine<br />
en 4K, lequel ne sera pas une mince affaire. Bien que les coûts aient<br />
considérablement baissé, la numérisation 2K continue de faire peur,<br />
alors, en 4K ! Il vaut mieux un r<strong>et</strong>our sur film 2K plutôt qu’un fichier 4K<br />
stocké sur LTO qui, dans vingt ans, ne vaudra plus rien.<br />
A : Vous travaillez actuellement sur la restauration du « Samouraï » de<br />
Melville. Dans quel état se trouvait le négatif ?<br />
43<br />
43<br />
S.M. : Il était très fatigué pour<br />
avoir servi au tirage direct<br />
de beaucoup trop de copies.<br />
Nous avons eu droit à toute la<br />
gamme de problèmes : perforations<br />
explosées, instabilité,<br />
déchirures réparées au scotch<br />
américain, renforts de collures<br />
« colle » qui avaient laché dans<br />
le temps, images noires, défauts<br />
d’émulsion à certains endroits<br />
après un essuyage ou un tirage<br />
(du « perchloréthylène » avait<br />
dû être « oublié » en route, ce<br />
qui avait détérioré la gélatine par<br />
endroits), rayures, poussières<br />
incrustées… Quelques accidents<br />
s’étaient aussi produits<br />
sur le négatif car certains plans<br />
avaient été remplacés par de<br />
l’internégatif. Conclusion, on<br />
doit en être à près à de 200<br />
heures de travail <strong>et</strong> je ne vous<br />
parle pas <strong>des</strong> problèmes de<br />
raccords d’étalonnage dans<br />
la mesure où les internégatifs<br />
de l’époque avaient été tirés<br />
d’après <strong>des</strong> interpositifs de la génération 67, donc tirés à sec. Ceci étant,<br />
c’était encore pire dans les années 70/75 : là, on est carrément tombé<br />
dans l’économie de l’interpositif. Il restait un « 49 », mais comme vous le<br />
savez, c’est un produit qui ne dure pas dans le temps <strong>et</strong> qui vire au magenta.<br />
S.M. : On perd tous les détails dans les noirs, dans les basses lumières,<br />
c’est ignoble.<br />
A : Il a fallu recréer <strong>des</strong> images manquantes ?<br />
S.M. : Tout à fait : la restauration a été faite en totalité dans le groupe<br />
Quinta avec le savoir-faire de Scanlab <strong>et</strong> de Duboi BSFX.<br />
Le Samouraï de Jean-Pierre Melville (1967). Directeur de la photographie : Henri Decaë. © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
Playtime de Jacques Tati (1967). Directeur de la photographie : Jean Badal © DR<br />
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Arane-Gulliver<br />
"POUR L’INSTANT, L’IDÉAL, C’EST LE RETOUR<br />
SUR PELLICULE ET CELA, LES CLIENTS LE<br />
COMPRENNENT BIEN. LEUR DIRE QUE L’ON VA<br />
FAIRE DES COPIES ET METTRE SUR LTO, C’EST<br />
DÉJÀ PLUS DIFFICILE !"<br />
PAR JEAN-RENÉ FAILLIOT,<br />
DIRECTEUR GÉNÉRAL<br />
DU LABORATOIRE ARANE-GULLIVER<br />
44 | ACTIONS le mag’ #34-35
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Actions : Quelle est votre politique en matière de <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> ?<br />
Jean-René Failliot : Nous conservons les originaux <strong>et</strong> adressons un<br />
courrier à la production pour leur demander ce qu’elle a l’intention de<br />
faire <strong>des</strong> chutes <strong>et</strong> doubles. En ce qui me concerne, j’ai tendance à dire<br />
aux producteurs que pour conserver le montage original - celui qui a<br />
servi pour le scan du film ou bien le montage traditionnel - il faut aller<br />
aux Archives du film, excellente institution qui a fait ses preuves.<br />
A : Les producteurs sont-ils globalement « conservateurs » de leurs chutes<br />
<strong>et</strong> doubles ?<br />
J-R. F. : Non, la tendance est plutôt à leur <strong>des</strong>truction, la plupart du<br />
temps pour <strong>des</strong> questions financières. Ceux qui récupèrent leurs chutes<br />
<strong>et</strong> doubles sont finalement assez minoritaires.<br />
A : Que se passe-t-il dans le cas du numérique ?<br />
J-R. F. : Pour l’instant, nous n’avons pas vraiment de solutions, mis<br />
à part de faire <strong>des</strong> sécurités <strong>et</strong> de les rem<strong>et</strong>tre aux productions pour<br />
qu’elles les stockent. Il existe aujourd’hui un vide énorme dans le domaine<br />
en attendant, on l’espère, qu’une norme véritable soit instituée.<br />
Les pouvoirs publics devraient s’occuper de m<strong>et</strong>tre en place un équivalent<br />
à ce qui existe avec les Archives du film pour la pellicule. Mais tout<br />
est toujours une question d’argent. Alors, en attendant, on stocke les<br />
fichiers numériques <strong>et</strong> on avance « au jour le jour » en suivant attentivement<br />
les évolutions de la technologie.<br />
A : Quelle pérennité peut-on attribuer au numérique ?<br />
J-R. F. : Qu’un film soit tourné en argentique <strong>et</strong> finalisé en post-production<br />
numérique ou qu’il soit entièrement tourné en numérique, il<br />
se produit dans 98% <strong>des</strong> cas un « r<strong>et</strong>our sur film » <strong>et</strong> nous poussons à<br />
cela. La mise sur « support film » est pour l’instant ce qu’il y a de moins<br />
contraignant pour nous <strong>et</strong> ce qui est le plus sécurisant pour les producteurs<br />
<strong>et</strong> les réalisateurs désireux de conserver leurs œuvres. C’est ce<br />
que je vois de mieux. C<strong>et</strong> original peut aussi être déposé aux Archives<br />
du film comme cela se pratiquait jusqu’à présent : une fois un film sorti,<br />
son négatif partait aux « Archives » avec une copie de référence <strong>et</strong> le<br />
son optique.<br />
45<br />
45<br />
A : Les clients demandent-ils une <strong>conservation</strong> sur LTO ?<br />
J-R. F. : Ce qu’ils nous demandent, c’est de conserver les fichiers de<br />
disques durs <strong>et</strong> c’est nous qui les recopions systématiquement sur LTO<br />
pour les conserver. Cela reste néanmoins une pratique encore assez<br />
exceptionnelle pour nous.<br />
A : Avez-vous mis en place un système de recopies au laboratoire ?<br />
J-R. F. : Pas encore, car cela fait à peine un an que nous avons « mis<br />
en place » le numérique chez Arane. Jusqu’à présent, les productions<br />
« grands formats » - qui coûtent <strong>des</strong> fortunes - nous envoyaient <strong>des</strong><br />
disques durs pour qu’on les shoote <strong>et</strong> c’était nous qui faisions la recopie<br />
sur LTO <strong>et</strong> conservions disques durs <strong>et</strong> LTO.<br />
A : Comment parlez-vous « <strong>conservation</strong> » avec vos clients ?<br />
J-R. F. : Nous en parlons régulièrement car tout le monde est très<br />
conscient que la <strong>conservation</strong> est devenu un énorme problème. A notre<br />
p<strong>et</strong>it niveau, nous réfléchissons à ce que l’on pourrait proposer pour<br />
avancer dans c<strong>et</strong>te nébuleuse qu’est la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> fichiers numériques,<br />
mais nous ne savons pas nous-mêmes très bien où nous allons<br />
<strong>et</strong> comment va évoluer la <strong>conservation</strong>. Tant qu’on ne nous demande<br />
pas d’aller rechercher un plan, on imagine qu’en faisant <strong>des</strong> recopies de<br />
LTO tous les cinq ans, cela va marcher, mais on n’en est pas sûr du tout.<br />
Il peut y avoir mille problèmes, ne serait-ce qu’une démagnétisation !<br />
Pour l’instant, l’idéal, c’est le r<strong>et</strong>our sur pellicule <strong>et</strong> cela, les clients le<br />
comprennent bien. Leur dire que l’on va faire <strong>des</strong> copies <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre sur<br />
LTO, c’est déjà plus difficile. Surtout, l’on en revient toujours au même :<br />
combien cela va-t-il coûter ? Mon expérience principale en matière de<br />
<strong>conservation</strong>, c’est le film Playtime de Jacques Tati entièrement restauré<br />
par nos soins en 2000. C’est un film qui a été refait photochimiquement<br />
<strong>et</strong> numériquement dans son intégralité avec <strong>des</strong> séquences rallongées<br />
pour le conformer à son montage d’origine. C<strong>et</strong> original refait <strong>et</strong> l’interpositif<br />
de sécurité se trouvent toujours chez nous <strong>et</strong> pour l’instant,<br />
tout se passe bien. De temps en temps, un pays ou une cinémathèque<br />
nous demande une copie, nous la tirons <strong>et</strong> voilà ! Cela pour dire que<br />
seule la pellicule a fait ses preuves <strong>et</strong> que pour l’instant, c’est aussi ce<br />
qu’il y a de plus facile à chiffrer pour les producteurs. Il faut demeurer<br />
très pragmatique <strong>et</strong> en France, nous avons un peu de mal avec cela. En<br />
demeurant pragmatiques, nous trouverons certainement <strong>des</strong> solutions<br />
intéressantes pour résoudre le problème de <strong>conservation</strong> numérique.<br />
A : Quel était l’état de « Playtime » quand vous l’avez « repris en main » ?<br />
J-R. F. : Le négatif avait voyagé en Espagne <strong>et</strong> en France, il était déchiré<br />
à plusieurs endroits <strong>et</strong> réparé au scotch, mais il n’était pas décomposé,<br />
les perforations n’étaient pas « en r<strong>et</strong>rait » <strong>et</strong> les couleurs sont plutôt<br />
bien ressorties. Nous avons vécu la même chose avec la restauration<br />
anglaise de Mon oncle dont les éléments avaient été conservés aux Archives<br />
du film. Aucun problème ! Des histoires de collure, c’est tout !<br />
Le couple « Archives du film – pellicule » est pour l’instant ce qui se fait<br />
de mieux.<br />
Mon Oncle de Jacques Tati (1958). Directeur de la photographie : Jean Bourgoin © DR<br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
46<br />
CINÉ DIA<br />
"LES ARGUMENTS EN<br />
FAVEUR DE L’ARGENTIQUE<br />
SONT LÀ, IL SUFFIT DE LES<br />
METTRE EN AVANT"<br />
PAR DANIEL COLLAND,<br />
PRÉSIDENT<br />
DU LABORATOIRE CINÉ DIA<br />
46 46<br />
DOSSIER SPÉCIAL | ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES FILMS<br />
Dans le cadre du « Grand Paris », la Seine Saint-Denis qui est mon département a été<br />
choisie pour devenir le maître d’œuvre de l’audiovisuel, de l’argentique <strong>et</strong> du numérique.<br />
Le jour où j’ai assisté à l’une <strong>des</strong> premières réunions, tout le monde n’avait qu’un mot<br />
à la bouche : le numérique, le 2K, le 4K… Moi, j’ai posé une question : « conserver les<br />
<strong>films</strong>, c’est bien, mais sur quel support ? » La réponse a été : « …mais en argentique, bien sûr ! » Bien<br />
sûr… sauf que si nous, laboratoires, arrêtons demain la photochimie, que vont faire les fabricants de<br />
pellicule ? Eh bien, ils vont fermer à tour de rôle <strong>et</strong> à ce moment-là, on pourra toujours continuer de<br />
parler de « <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> », on ne saura plus sur « quoi » procéder. Aujourd’hui, tout le monde<br />
veut laisser tomber les copies argentiques dans les salles de cinéma, mais de quoi vivent les laboratoires<br />
si ce n’est précisément <strong>des</strong> copies ? Quelquefois, on parle beaucoup, mais on ne réfléchit pas assez.<br />
J’ai fait partie c<strong>et</strong>te année du jury de la Caméra d’or : sur les 25 <strong>films</strong> qui concourraient, beaucoup<br />
étaient en argentique. Cela m’a donné l’occasion de parler avec pas mal d’étrangers, le Président qui<br />
était coréen, <strong>des</strong> espagnols, <strong>des</strong> argentins… partout, il s’organise une « résistance argentique » ! En<br />
France, on est fou.<br />
On n’a jamais vu un cinéma être dans l’impossibilité de proj<strong>et</strong>er un film pour manque de copie. En<br />
numérique, il peut se produire un tas de choses depuis le fait de ne pas réussir à ouvrir les fichiers<br />
jusqu’au fait qu’après trois ou quatre passages, la copie numérique ne fonctionne parfois plus bien. En<br />
argentique, que je sache, les copies pouvaient circuler pendant plusieurs années dans toute la France<br />
sans le moindre problème ! Des rayures, oui… mais c’est tout ! Les arguments en faveur de l’argentique<br />
sont là, il suffit de les m<strong>et</strong>tre en avant.<br />
CINÉ DIA en Seine-Saint-Denis est voué à la <strong>conservation</strong> <strong>des</strong> <strong>films</strong> en argentique, noir <strong>et</strong> blanc <strong>et</strong><br />
couleurs. Il ne faut jamais s’avouer vaincu. Pour l’instant, j’ai la chance d’avoir <strong>des</strong> marchés avec le<br />
CNC, la Cinémathèque, l’ECPA ou le CNDP à Poitiers. Et pour l’INA, je travaille encore sur <strong>des</strong> « <strong>films</strong><br />
flamme »…<br />
Je suis un homme passionné par l’argentique, l’argent m’importe peu. Avant de mourir, je veux continuer<br />
de me battre. La mondialisation nous gu<strong>et</strong>te, pourquoi se laisser dévorer si l’on peut se défendre ? Quand<br />
je menace de licencier six ou huit personnes disposant d’un savoir-faire au cas où je ne décrocherais<br />
pas un marché, je ne fais pas de chantage, je m<strong>et</strong>s simplement les gens en face de leurs responsabilités.<br />
Bien entendu, je suis obligé de faire du numérique comme tout le monde, personne n’est en mesure de<br />
refuser un client, mais le calcul est très simple : chez CINE DIA, le numérique concerne cinq personnes<br />
<strong>et</strong> l’argentique… 65 !<br />
Les <strong>films</strong> ne se conservent qu’en argentique, pas en numérique. La question qui se pose aujourd’hui,<br />
c’est : « que va-t-on laisser à nos p<strong>et</strong>its-enfants ? » Cela fait dix ans que je me bats <strong>et</strong> que l’on ne<br />
m’écoute pas, mais je sais une chose : lorsqu’on me rappellera « là-haut », j’aurai fait mon boulot ».<br />
Bill<strong>et</strong><br />
| ACTIONS le mag’ #34-35
ARCHIVAGE<br />
“Si vous voulez créer <strong>des</strong> images dont<br />
la valeur sera précieusement conservée,<br />
la seule manière d’y parvenir est de les<br />
tourner sur film.”<br />
Bill Dill, ASC,<br />
directeur de la photographie/professeur<br />
"Durant ces deux dernières années,<br />
nous avons livré <strong>des</strong> données sous<br />
quatre formats différents, dont deux<br />
sont aujourd’hui complètement obsolètes...<br />
Le 35 mm est un standard reconnu<br />
depuis un siècle à présent, <strong>et</strong> ce n’est<br />
pas sans raison.“<br />
Laboratoire Framestore Ben Baker,<br />
directeur du département numérique<br />
Immortalisez vos <strong>films</strong><br />
Regardez notre film<br />
Version française ?<br />
Cliquez ici<br />
« Je suis très fière que tous les <strong>films</strong> de HBO<br />
bénéficient d’un <strong>archivage</strong> argentique, car<br />
cela nous garantit <strong>des</strong> conditions parfaites<br />
pour leur exploitation future. »<br />
Cynthia Kanner, vice-présidente responsable<br />
de la postproduction <strong>des</strong> <strong>films</strong> <strong>et</strong> mini-séries<br />
à HBO Films<br />
Les dossiers Film. No Compromise :<br />
Qualité d’image, coûts de production, Super 16mm,<br />
<strong>archivage</strong>, postproduction<br />
disponibles sur demande auprès de Régine Pérez :<br />
01 40 01 35 15, regine.perez@kodak.com<br />
www.kodak.fr/go/cinema