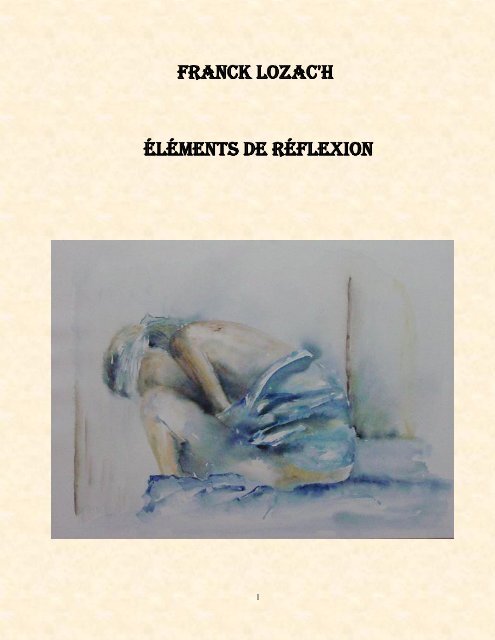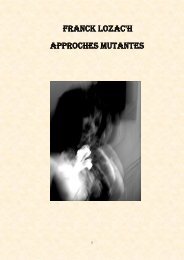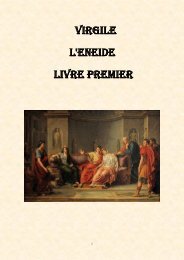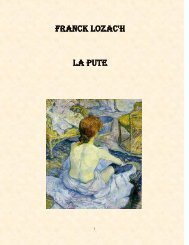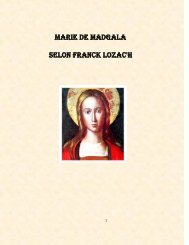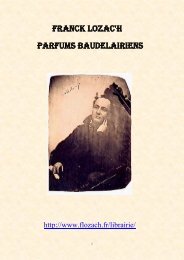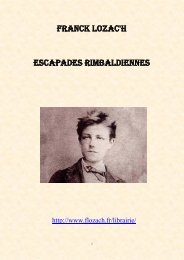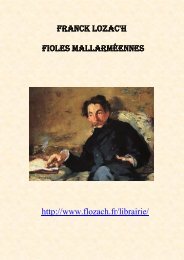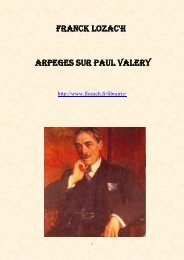You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FRANCK</strong> <strong>LOZAC'H</strong><br />
<strong>ÉLÉMENTS</strong> <strong>DE</strong> <strong>RÉFLEXION</strong><br />
1
CHAPITRE PREMIER<br />
2
De l’Intelligence<br />
Le parcours de l’esprit<br />
L’Esprit s’assoie sur son néant. Ainsi il perçoit sa première<br />
conscience. C’est toutefois une perception de la Nature qu’il<br />
reçoit dans cet état. Il ne peut en être autrement, puisqu’il est un<br />
élément de cet ensemble. L’Esprit se construit pour aller de la<br />
satisfaction des nécessités de survie jusqu’à la compréhension de<br />
l'après-vie. Il se cristallise pour accéder aux besoins immédiats.<br />
C’est donc une volonté d’effort à la nature qui est ainsi accompli.<br />
Il en est d’ailleurs de toute espèce, de toute diversité<br />
animale ou végétale. Une conscience de situations,<br />
d’apprentissage, d’expérience en quelque sorte se forme. La<br />
conscience s’adapte aux obligations de la Nature. L’on voit ainsi<br />
que c’est elle qui domine, et impose son diktat de vie et de survie.<br />
Le travail du vivant sera de s’adapter, de transformer, et de<br />
combattre cet ennemi. Le monde est en guerre. Ce monde<br />
d’actions mécaniques traduit la force, la déchéance, la<br />
3
transmission de l’héritage génétique. Ceci n’est pas ma logique.<br />
C’est bien la loi de la Nature qui nous soumet à cette vérité.<br />
Il est à supposer que l’Esprit, qui est déjà une forme<br />
élaborée de la conscience, est parvenu à combattre ou maîtriser<br />
certains éléments de la Nature. L’Esprit avance avec sa logique,<br />
mais il arrive rapidement au bord du gouffre, de son propre<br />
gouffre de la vie, - c’est l’échéance de la mort. Comment peut-il<br />
comprendre, ou supposer comprendre la possibilité de vie après la<br />
mort ? Il le fera en utilisant les propriétés sensitives mises à sa<br />
disposition par son organisme. Il le fera car vivant en<br />
communauté, il essayera de comprendre la suite de la destinée de<br />
ses proches. Peut-on prétendre que certains organismes, plus<br />
sensibles que d’autres, possèdent l’aptitude de percevoir un<br />
semblant de vie après la mort biologique ?<br />
Dans la logique de la pensée, le rationnel n’est pas toujours<br />
le plus sûr. C’est notre civilisation qui a établi le diktat de la<br />
science. Mais la compréhension du paranormal, c’est-à-dire de la<br />
suite après le gouffre s’opère par l’utilisation d’autres propriétés.<br />
Il n’y a pas que le rationnel qui soit réel. Le paranormal est du<br />
réel, mais perceptible en utilisant d’autres propriétés des sens. La<br />
capacité répétitive de la physique réduit au mépris et à<br />
4
l’insignifiant cette partie de la nature dont l’expérience ne peut<br />
être constamment reproduite.<br />
L’esprit poursuit donc son chemin logique pour accéder à<br />
une métaphysique. Cet élan vers un Principe absolu nécessite la<br />
séparation du corps d’avec l’esprit. Ainsi il faut voler, voler pour<br />
franchir le gouffre, et c’est déjà pénétrer dans l’histoire de la<br />
Religion.<br />
L’homme applique cette méthode. Certains pourtant<br />
prétendent qu’après le gouffre, il n’y a rien, et s’en retournent à<br />
leur propre néant. Faut-il parier ? Est-ce un pari d’ailleurs ? Ou<br />
est-ce une perception seulement accessible à une élite ?<br />
5
De la logique<br />
La pensée apparaît comme étant un petit accident de<br />
l’intelligence, une sorte de minuscule collision où s’associent et<br />
s’opposent des concepts, des images, des symboles et du langage.<br />
L’ensemble combiné engendre une pensée qui est le plus souvent<br />
une réflexion, ou du moins une action intérieure. Abstraite et<br />
volatile, rationnelle et concrète, sa définition épouse toutes les<br />
formes autorisées par la capacité créatrice de l’intelligence.<br />
Il semble difficile de prétendre savoir s’il est plus logique<br />
de faire apparaître des schémas simplifiés et ordonnés, ou des<br />
concepts impénétrables et délétères. La raison conseille d’aller du<br />
plus simple au plus compliqué, donc d’organiser sa création<br />
d’actions par des propositions élémentaires puis de les surcharger<br />
par des principes supérieurs à l’entendement. Qu’en est-il de la<br />
vérité ? Des doctrines et des thèses s’opposent. On dirait que<br />
chacune d’entre elles définit une méthode d’exploitation et<br />
d’expérimentation sans pour autant posséder toutes les définitions<br />
de l’autre. L’ensemble des méthodes offertes semble posséder la<br />
vérité, mais chaque partie séparée ne permet pas de tirer une<br />
analyse globale satisfaisante. L’arbitre conseillerait de prendre<br />
6
chaque ensemble sans pour autant décider d’un choix ou d’un<br />
prélèvement judicieux. Un principe risque d’exclure les autres<br />
principes, et si tous possèdent un peu de vrai, l’on ne peut choisir,<br />
et il faut tous les prendre.<br />
Le lecteur avisé prétendra que c’est aller dans beaucoup<br />
d’endroits à la fois, et que l’on se trouve ainsi entraîné dans une<br />
étonnante aventure de l’esprit. Que l’intelligence le veuille ou<br />
non, la raison s’arrête pour juger et décide d’un choix, car la<br />
capacité humaine d’absorption ne peut, faut de mémoire et de<br />
moyens, maîtriser l’ensemble des procédés mis à sa disposition.<br />
Les méthodes ou les principes employés pour ordonner cette<br />
aptitude de l’intelligence ne sont pas constamment opposés. Ils<br />
offrent parfois des similitudes d’actions quand bien même ils<br />
sembleraient pénétrer des voies différentes. Si la première<br />
perception semble abstraite ou éloignée de la logique, la finalité à<br />
atteindre est bien concrète et répond à une matérialisation<br />
quantifiable. Cette finalité semble bien éloignée de la première<br />
idée naïve qui apparaissait à la conscience. L’être trouvera la<br />
solution d’après sa perception interne ou en corrélation avec le<br />
monde extérieur.<br />
7
Tout d’abord, l’esprit s’entoure du néant, puis il avance et<br />
désire organiser un déplacement rationnel ou hasardeux. Il<br />
avance, regardant sur sa droite, sur sa gauche vers un avenir en<br />
utilisant un passé. Il tâtonne ou prétend aller fort vite, éclairé par<br />
une sorte de certitude. Ce matériel de l’intelligence s’élabore, se<br />
construit et se fortifie animé par les autres notions ou idées qui<br />
viennent le secourir. La logique alors construit avec la volonté<br />
d’aller de l’avant. La pensée ne fait-elle qu’avancer, ou parfois ne<br />
cherche-t-elle pas à tourner en cercle pour revenir à son point de<br />
départ, c’est-à-dire à son réflexe premier ?<br />
La logique de penseur accomplit tout d’abord son effort<br />
pour satisfaire à une matérialité, puis elle satisfait le désir de<br />
l’être, et quand elle a satisfait ce désir, elle échappe à l’être pour<br />
accéder à l’essence supérieure, c’est-à-dire à une volonté<br />
métaphysique. Elle agit par ordre de nécessité allant du plus<br />
simple au plus abstrait. Ce n’est pas une chute simplifiée, ni une<br />
trajectoire calculable. La construction s’opère d’une idée à l’autre<br />
par le principe de ressemblance. L’énergie utilisée pour fabriquer<br />
le mouvement permet à l’intelligence de se déplacer.<br />
8
Accéder à la pensée finale, c’est-à-dire à l’essence de la<br />
métaphysique est d’une importance capitale pour le devenir de<br />
l’homme. Élaborer, échafauder une construction de l’homme vers<br />
le haut permet de spéculer sur les idées éternelles.<br />
C’est donc en étudiant le mécanisme du fonctionnement de la<br />
logique, en déterminant le parcours qu’elle nous permettra<br />
d’accomplir, c’est-à-dire la suite de ces actions rationnelles et<br />
abstraites, que nous parviendrons à accéder à une philosophie de<br />
la nature. Il nous faudra avancer en décomposant de manière<br />
logique, donc avec un système de simplification pour comprendre<br />
la nature dans sa diversité.<br />
La pensée doit avancer, subirait-elle des heurts, des<br />
résistances ou des volontés de retournements sur soi-même. Elle<br />
doit avancer, accompagnée de sa propre négation, car lui faut<br />
comprendre.<br />
Ne faut-il pas essayer d’accéder au pur commencement, à la<br />
pensée première quand bien même il s’agirait encore d’un travail<br />
abstrait. Mais de toujours se déplacer selon un ordre, sans vouloir<br />
toutefois épuiser toutes les possibilités, ce qui serait un jeu<br />
éreintant pour l’esprit ? Difficile pourtant d’aborder ici le<br />
9
problème de la sélection ou du choix dans les actions à accomplir.<br />
L’ordre serait de découvrir le premier acte de logique, puis d’en<br />
expliquer le second. Ce premier acte ne pourrait trouver son<br />
origine dans la mémoire, c’est-à-dire dans le passé puisqu’avant<br />
ce premier acte de logique, il n’y avait rien.<br />
Il semble difficile d’avancer dans cette recherche de la<br />
logique sans y intégrer la valeur temporelle. L’avancée<br />
permanente de la raison qui progresse accompagnée de sa propre<br />
négation se développe sur l’étendue du temps. Mais je puis<br />
comprendre que pour des raisons évidentes de simplification,<br />
l’analyse s’effectue en dehors du paramètre temporel.<br />
Après avoir dégagé une première réflexion concernant la<br />
logique, nous nous promettons de spéculer quelque peu sur l’être<br />
et sur l’essence. Nous verrons à quelle hauteur ou quelle<br />
profondeur la difficulté nous entraîne, et comme il semble<br />
utopique de vouloir échafauder quelque construction en ne<br />
possédant pas tous les éléments d’analyse véritables.<br />
10
L’intelligence humaine<br />
L’intelligence humaine possède cette particularité de<br />
chercher constamment à défaire des questions qui reviennent sans<br />
cesse dans sa propre conscience. Sa volonté est de résoudre des<br />
problèmes posés par la nature, et d’y donner une réponse qui<br />
dépasse le plus souvent les limites de sa perception.<br />
Confrontée au difficile problème de l’adaptation à<br />
l’existence, par son savoir et son expérience, elle voudra dompter<br />
les éléments naturels pour tenter d’en devenir le maître. Intégrant<br />
de la pensée dans la matière, elle désire s’élever toujours plus<br />
haut jusqu’à la compréhension ultime des phénomènes<br />
métaphysiques. Et c’est en transmettant son héritage intellectuel,<br />
de génération en génération, que la raison parviendra à progresser.<br />
C’est élan qui pousse l’homme vers l’avenir défera les<br />
contradictions et l’obscurantisme dans lesquels son essence d’être<br />
vivant semblait l’avoir laissé.<br />
Il lui faudra aller au-delà des limites de sa capacité à<br />
percevoir. Il devra supposer au-delà du champ de l’expérience,<br />
11
n’ayant plus désormais par les moyens de sa perception la<br />
possibilité de vérifier ce qu’il avance.<br />
L’homme de science va croire sans voir, et s’en retournera<br />
ainsi à la conviction sensible de l’être spirituel qui a présupposé<br />
une possibilité de vie après la mort. Il est vrai que si l’outil<br />
qu’emploie l’homme de science apparaît plus subtil pour étayer ce<br />
qu’il avance, l’outil même virtuel est encore une fraction du réel,<br />
et cette simulation semble suffire.<br />
L’analyste doit donc attacher une immense importance à<br />
toutes ces sortes de recherche dont l’objet est d’élever la nature<br />
humaine. Celui qui exprime du mépris ou de l’indifférence à<br />
l’égard de ces choses cachées affiche un sentiment coupable de<br />
blocage et d’intelligence limitée.<br />
L’on peut apprécier chez l’homme de science sa volonté<br />
profonde remplie d’objectivité et de droiture rationnelle, et cette<br />
objectivité-là offrira la possibilité à la civilisation de progresser.<br />
Si le fondement est bien établi, si la discipline accède aux<br />
choses profondément enfouies, c’est encore toute la communauté<br />
12
qui bénéficie de cette excellence. Et cette réputation de solidité et<br />
de vigueur mérite tous les éloges.<br />
Il est d’autres disciplines nourries de sensibilité, dont la<br />
nature subtile et délétère ne favorise aucunement la vérification<br />
des principes, - ceux-ci étant du domaine du variable et du<br />
modifiable. Il en est ainsi des arts dont les règles établies<br />
constamment sont déplacées par le génie de leurs exécuteurs.<br />
Il y a enfin le monde spirituel constellé de points<br />
d’interrogation, légiféré par des structures de croyance qu’il<br />
semble le plus souvent difficile d’épouser. Celui-ci nécessite de<br />
l’entendement de coeur qui va au-delà de la raison ou de la vision<br />
de l’oeil. Il s’agit ici de percevoir par le soupçon, qui est encore<br />
une forme de sensibilité imperceptible et non renouvelable. C’est<br />
à chacun de lui accorder son propre examen d’après sa conviction<br />
intime.<br />
Il y aurait donc une critique à faire à l’égard de cette forme<br />
de connaissance qui peut se développer indépendamment de toute<br />
certitude quantifiable, quoique... les mystiques ne sont point<br />
hommes de confusion et leur intelligence est parfaite dans<br />
l’entendement du quotidien.<br />
13
Intégrer une métaphysique dans son monde spirituel, cela<br />
est certes une bonne chose, mais il faut encore que les principes<br />
sur lesquels l’on établit cette vérité-là soient bien déterminés.<br />
Il faut parfois s’en référer à la compétence d’autrui, car ceci<br />
est gain de temps et certitude de bonne méthode, mais l’opinion<br />
du grand nombre peut le plus souvent être détestable. Il est des<br />
perceptions encore inexpliquées qui inquiètent l’élite mais sont<br />
rejetées avec virulence par la masse d’humains.<br />
Il est des connaissances dont l’entendement est incertain,<br />
dont les contours sont difficilement délimités. Leur base ne peut<br />
être fermement déterminée. De certitude, il n’en est point. Leur<br />
recherche est encore insoupçonnée, leurs règles inconnues. Et<br />
c’est en exploitant l’intuition de l’homme que l’on parvient à<br />
extraire les premières parcelles de vérités.<br />
Pourtant l’opinion d’autrui fondée sur des entendements<br />
solides, transmise de générations en générations est d’une<br />
certitude autorisée. Faut-il tout reconsidérer, et vérifier par soimême<br />
ce que les pères ont intelligemment démontré ? La capacité<br />
temporelle mise à la disposition de l’homme lui impose d’aller<br />
outre, d’y gagner en vitesse et de refuser les tâtonnements.<br />
14
Pour ce qui est de l’hypothèse - j’accorde à dire qu’elle est<br />
l’une des “caractéristiques” de la personnalité humaine la plus<br />
audacieuse et la plus intéressante. Elle projette l’homme vers le<br />
devenir par la spéculation, par son risque et son résultat. Elle est<br />
l’aventure de l’esprit, elle se nourrit d’énergie pour explorer,<br />
chercher et parfois découvrir.<br />
15
L’idée<br />
L’idée est le pur concept, inadapté encore, ne possédant<br />
aucune mise en forme. Elle n’est qu’une perception délétère,<br />
inorganisée, elle est indice d’or, donc parcelles lumineuses dans<br />
un magma de boue. Elle ne possède pas toujours de certitude de<br />
vérité. L’or du pauvre est bien la pyrite, et beaucoup se sont<br />
laissés tromper.<br />
On doit davantage l’employer dans le sens de : “perception<br />
inconnue”, de rareté, d’unicité. L’idée n’appartient pas à un<br />
ensemble. Elle ne peut jaillir que d’un seul cerveau. L’idée n’est<br />
pas une opinion. On ne peut pas avoir une idée concernant un<br />
tableau ou une œuvre d’art. Il s’agit ici d’une réflexion critique<br />
que tout un chacun peut exprimer. Il n’y a pas nouveauté,<br />
détermination inconnue.<br />
Le but de l’idée est de devenir, devenir concept à forme<br />
rationnelle, palpable et quantifiable. On doit en faire un usage. Il<br />
y a donc l’idée et son but. Entre les deux s’expriment l’exécution,<br />
la mise en forme, l’exploitation, tout le travail de l’adaptation<br />
jusqu’à la finalité à obtenir. L’idée doit donc se construire dans le<br />
16
ationnel, et c’est seulement à cette condition qu’elle pénétrera<br />
l’espace de l’objectivité.<br />
Mais cette objectivité peut tout aussi bien revêtir une<br />
valeur personnelle. IL faut encore que la perception extérieure<br />
d’autrui s’accorde avec l’idée réalisée par le concepteur.<br />
L’habillage de l’idée, sa mise en forme en quelque sorte doit<br />
posséder bien du talent, c’est-à-dire des valeurs reconnues pour<br />
que l’idée nouvelle puisse être assimilée et comprise.<br />
L’idée se confond avec la pensée. Si la pensée a une<br />
connotation à tendance philosophique, c’est-à-dire intégrant des<br />
concepts de l’entendement, à forme représentative, l’idée doit<br />
déboucher sur un concept rationnel scientifique ou technique,<br />
épousant le signifiant aussi du service.<br />
L’Idée prétend donc posséder le Vrai en soi, et elle va<br />
tenter dans l’exécution de son travail de finaliser sa certitude.<br />
C’est pourquoi le devenir est un paramètre indispensable qui<br />
s’associe à la vérité de l’Idée. Il faut aller dans l’au-delà, dans le<br />
futur proche, et ainsi prouver que l’Idée possédait du Vrai. Il n’est<br />
17
pas toujours utile de concrétiser cette action pour détenir l’intime<br />
conviction que ce que l’on suppose pénètre le Vrai.<br />
La certitude subjective mais intime doit coïncider avec la<br />
certitude objective d’autrui, ainsi l’Idée devient-elle réelle.<br />
L’Idée qui germe pour pénétrer l’espace objectif doit<br />
constamment subir des modifications pour s’adapter, pour se<br />
construire et se conformer à la certitude d’autrui. Il est vrai que la<br />
finalité ne possède nul objet qui soit conforme à l’essence de<br />
l’Idée. Évidemment ! Puisque l’Idée subit des modifications pour<br />
pénétrer dans le Concret.<br />
La finalité de l’Idée jamais ne pourra prétendre répondre<br />
à son concept initial. La lente élaboration de sa forme première a<br />
modifié de manière significative son concept d’origine. L’idée ne<br />
s’oppose donc pas à sa réalisation, mais elle n’est plus ce qu’elle<br />
semblait supposer être. L’idée de la maquette ne peut être<br />
comparée au prototype, - grande est la distance qui la sépare de<br />
cette finalité-là. L’idée ne peut s’épanouir que dans le réel, et dans<br />
cet espace-là, elle doit s’analyser avec objectivité pour savoir si<br />
son essence est conforme à l’application de son concept.<br />
18
L’Intelligence accède à une forme de Vérité, quand<br />
l’Idée se finalise dans une réalisation. J’écris bien une forme de<br />
Vérité, car elle peut tout aussi bien revêtir une valeur personnelle<br />
et non pas universelle.<br />
Il y a donc intégration d’autres éléments permettant à<br />
l’idée de se finaliser. Cette obtention du résultat n’engendre pas<br />
toujours une détermination satisfaisante. Le concept dans sa pure<br />
spéculation permettait d’obtenir un objet ou d’envisager une<br />
finalité différente. L’Idée ne revêt qu’une détermination limitée,<br />
son contenu est imperceptible, - en vérité, il n’est qu’un réel<br />
virtuel, sans puissance d’existence. L’idée n’existe pas dans la<br />
réalité. Elle n’est que la conscience subjective et ne peut se<br />
réaliser que dans l’objectivité.<br />
Si l’idée se suffit d’elle-même, si elle conserve cet état<br />
initial de pureté, si elle ne peut vérifier avec exactitude ce qu’elle<br />
suppose, sa pensée reste abstraite. L’idée doit poursuivre à travers la<br />
vérification et le champ d’expériences la véracité de ce qu’elle<br />
prétend. Il s’agit encore d’accéder à une forme d’enrichissement, de<br />
développement après la germination initiale. Si le concept demeure,<br />
son apparence a subi des transformations. Cette succession<br />
d’expériences fortifie l’idée principale. Et c’est bien un processus<br />
19
d’élaboration et de progrès qui a permis cette évolution sur le<br />
concept initial. Il y a donc transformation considérable, et l’offre<br />
basée ne peut plus être connue dans le résultat obtenu. Mais est-ce le<br />
concept qui a subi une évolution, ou n’est-ce pas le travail de<br />
l’homme qui a conduit au changement ?<br />
20
Détester le doute<br />
La vérité est la pensée, par excellence, de l’esprit. Sans la<br />
vérité, les connaissances seraient bien hasardeuses, toute<br />
construction s’écroulerait. J’entends toutes les connaissances,<br />
celles qui se prévalent d’être les mieux pensées dans leur valeur<br />
fondamentale.<br />
Aller dans la certitude, sans erreur, sans l’imperceptible<br />
doute, c’est avancer à coup sûr, sans risque de revenir à son point<br />
de départ. C’est prétendre que l’on ne peut se tromper. Je sais,<br />
cela paraît difficile et pourtant...<br />
Car le doute est détestable. Il nous fait violence, il est<br />
l’alarme qui constamment fonctionne. Il nous enduit en faiblesse,<br />
il est une retenue de temps, il impose une vérification. Pourtant<br />
nous sommes dans l’obligation de douter, car la raison se plaît à<br />
examiner. C’est une sorte de réflexe qui constamment<br />
accompagne son action.<br />
21
On nous dit qu’il faut croire sans voir. Je prétends qu’il<br />
faut se faire voyant, comprendre l’au-delà quand bien même cela<br />
nécessiterait des perceptions paranormales.<br />
Il faut donc croire en ouvrant les yeux et tenter de<br />
percevoir la vérité. Et cette vérité-là est délétère, impalpable,<br />
difficilement quantifiable avec les instruments de la rigueur.<br />
Mais tout croire est folie. Nous voilà confrontés à une<br />
sorte de magma incompréhensible où semblent jaillir çà et là<br />
quelques taches de couleur un peu mieux discernables.<br />
Le privilège serait d’aller plus loin que la pensée, et son<br />
mécanisme. Il serait d’atteindre immédiatement la réponse juste,<br />
en ligne droite, pour accomplir le moins de chemin possible,<br />
c’est-à-dire agir avec l’effort minimum.<br />
C’est encore une question de croyance, car il s’agit de<br />
croire en soi, avec la certitude, sans opinion, sans balancement.<br />
C’est la foi en l’homme, en l’esprit qui s’y cache ou y vit. À<br />
savoir si cette foi-là sauve l’homme. Il est à craindre que<br />
beaucoup se soient perdus.<br />
22
Penser, c’est vérifier<br />
Penser, c’est vérifier. Ce qui signifierait qu’une<br />
organisation cérébrale déjà a été construite. L’action de<br />
l’intelligence consisterait à confirmer ce qui a été proposé à la<br />
conscience.<br />
Mais ce n’est peut-être qu’une apparence. Penser, ce n’est<br />
pas toujours dire non. Il peut y avoir volonté de remplissage, de<br />
recevoir des informations inconnues et de les stocker dans la<br />
mémoire.<br />
L’esprit n’est pas toujours à consentir, à prendre sans<br />
douter. Il est dans une perspective de compréhension,<br />
d’intégration de l’information offerte. Sa raison cherchera à n’être<br />
pas trompée. Il ne doute pas de sa capacité à recevoir, il doute de<br />
l’information que l’on met à sa disposition. Il devrait douter de sa<br />
propre capacité à comprendre. Mais il croit en lui, et prétend<br />
posséder suffisamment d’avertisseur pour être bon juge.<br />
Chacun règne en son esprit et aime sa royauté, l’ignorant<br />
comme le savant.<br />
23
Pourtant l’homme sait se dire non. Il dit non après<br />
analyse, après détermination du message perçu. Non à sa<br />
spéculation. Il ne peut pas toujours transformer le non en oui. Il y<br />
a blanc parfois.<br />
Quand la science s’abstient, il y a blanc. Elle sait que<br />
grande est son ignorance, et espère reculer son inaptitude à<br />
posséder la vérité.<br />
C’est le oui, c’est le non, c’est la vérification, c’est<br />
encore l’abstention. Avec ces comportements fondamentaux, la<br />
pensée prétend avancer.<br />
24
De juger<br />
Il y a une intelligence qui pense de l’intérieur. Fidèle à<br />
exploiter les informations reçues, elle trie, choisit, décide et agit<br />
d’après cette déduction, ou d’après cette synthèse de perceptions.<br />
Elle n’est pas faite pour enseigner ou conseiller autrui. Elle n’est<br />
pas conçue pour aider l’autre. Non, elle cherche à se gouverner et<br />
propose des actions à accomplir d’après l’état des choses qui lui<br />
est suggéré.<br />
Cette capacité de l’intelligence ne sert pas à prévoir ou<br />
supposer. Elle n’a pas pour but d’aller dans l’avenir proche pour<br />
en tirer des comportements à appliquer dans le présent.<br />
Est-ce une aptitude purement humaine ? Peut-on<br />
prétendre que l’animal est pourvu de cette qualité ? Difficile dans<br />
l’état actuel de nos connaissances de pouvoir l’assurer.<br />
Il s’agit du moins de juger - j’entends faire preuve de<br />
synthèse et tirer de cette synthèse un comportement satisfaisant. Il<br />
faut donc recevoir, accumuler des preuves et des certitudes, et en<br />
extraire une vérité.<br />
25
Puis un autre que moi-même qui est pourtant proche de<br />
ma conscience exploitera cette décision pour décider d’un<br />
comportement. C’est ainsi que cela doit s’accomplir.<br />
Il est pourtant utile même pur un homme libre d’écouter<br />
la raison d’autrui, d’avancer dans la pensée avec les soutiens<br />
d’une personne tierce. Là où le flux de propos et de paroles<br />
abonde, la décision s’enrichit d’informations nouvelles.<br />
Enfin la raison est de se bien gouverner, de manière<br />
autarcique, avec sa souveraineté. Oui, de la sorte, doit se<br />
comporter tout bon esprit, sans trop de concession mais avec une<br />
oreille ouverte pour le bon sens d’autrui...<br />
26
La quête de la vérité<br />
La quête de la vérité au moyen de l’intelligence est la<br />
condition première de toute investigation philosophique.<br />
L’homme possède un Esprit et sa volonté spirituelle lui impose à<br />
comprendre les choses de la nature. S’il doit douter, c’est<br />
toutefois de la qualité et de l’efficacité que son intelligence met à<br />
sa disposition. Possède-t-il suffisamment de grandeur et de<br />
puissance pour accéder aux réponses qui lui soumet sa curiosité ?<br />
La nature complexe, à la pénétration difficile, que représente la<br />
connaissance de cet objet tendrait à faire croire que la réponse est<br />
négative. Mais il peut avancer à petits pas, et s’assurer ainsi que le<br />
chemin parcouru était voie de certitude.<br />
L’homme veut comprendre. Cela lui est utile pour vivre.<br />
Il lui faut chercher et découvrir. La philosophie comme sa soeur<br />
la science a besoin de posséder une représentation exacte des<br />
objets qui l’environnent. De ces formes et de leur existence,<br />
l’esprit construira un mode de perception et de représentation<br />
indispensable à sa pensée.<br />
27
Il y a donc travail de l’intelligence avec recherches,<br />
doutes, suppositions, et démonstrations. L’esprit n’hésite pas à se<br />
contredire, à user de l’opposition avec soi-même pour tenter de<br />
pénétrer. L’esprit brasse et spécule, il aime à s’engager dans son<br />
contraire. Par le jeu des oppositions, il veut extraire une solution<br />
satisfaisante lui permettant d’avancer dans sa quête de<br />
connaissances.<br />
La pensée est immédiatement confrontée à une perception<br />
globale et simultanée des éléments qui l’environnent. Le travail<br />
de l’intelligence consistera à décomposer en sections simples ou<br />
complexes, en thèmes majeurs ces différents assemblages qui<br />
s’organisent dans une sorte d’ordre que l’on appelle Nature.<br />
La pensée accède-t-elle immédiatement à une perception<br />
de l’Absolu que l’on pourrait identifier à un Principe Divin ? Sa<br />
volonté de chercher ne lui impose-t-elle pas d’abolir cette<br />
conception-là pour s’en retourner à une décomposition des<br />
éléments de la Nature ?<br />
La pensée se développe en s’enrichissant de ses propres<br />
expériences et de ses déterminations. Encore faut-il qu’au-delà de<br />
sa propre vérité, qui parfois peut être trompeur, encore faut-il que<br />
28
ce qu’elle emmagasine pour construire son système soit matériel<br />
de certitude.<br />
Ainsi la vérification par la raison, par les sens ou<br />
l’expérience s’avère indispensable pour poursuivre son<br />
élaboration.<br />
29
L’intelligence doute<br />
L’intelligence constamment doute dans le choix de ses<br />
actions et dans le mécanisme de sa pensée. Et puisque c’est<br />
manquer de raison que de se précipiter avec toute sa foi dans le<br />
mouvement de l’existence, l’esprit sensé préfère s’abstenir ou du<br />
moins aller doucement pour ne point commettre d’erreurs. Mais le<br />
doute n’est pas toujours le plus sûr : il faut parfois quelques<br />
particules de folie, quelques volontés audacieuses pour faire<br />
avancer l’homme. L’intelligence a besoin de construire : il lui faut<br />
de l’énergie, de la prestance et encore du risque. Mais ces actions<br />
sont mesurées et c’est la certitude qui lui permet d’aller de<br />
l’avant.<br />
L’esprit insensé agit en premier et réfléchit par la suite<br />
sans se soucier des conséquences désastreuses qu’un tel<br />
comportement peut engendrer. Le doute est pourtant une<br />
résistance à l’action. Il remet constamment en cause le départ, et<br />
s’il avance quelque peu, c’est encore pour s’arrêter et regarder<br />
derrière soi. Est-ce jugement ? Est-ce raison ? L’esprit veut faire<br />
demi-tour, et recherche son point de départ.<br />
30
Il s’agit de se bien gouverner, ou d’imiter les bons<br />
modèles pour être certain de la manière dont il faut se comporter.<br />
L’esprit du créateur, riche d’audaces et de folie, de<br />
certitudes à peine perceptibles se voit dans l’obligation d’imiter<br />
en cela l’insensé, et de poursuivre un chemin qu’il ne connaît<br />
guère, qu’il n’a jamais emprunté ou qui ne mène nulle part.<br />
Combien d’artistes ou de soi-disant génies se sont fourvoyés en<br />
pénétrant des espaces inconnus de tous et d’eux-mêmes,<br />
prétendant ouvrir de nouvelles portes et n’allaient en vérité sur<br />
rien ! L’on pourrait rétorquer que ceci est encore du capital-risque<br />
artistique, et qui ne tente rien n’a rien.<br />
Je ne suis sûr que d’une certitude - celle de mon<br />
ignorance. J’ai beau tenter d’apprendre et de savoir, je me sens<br />
infiniment vide comme un alvéole d’abeille dépourvu de miel. Et<br />
qu’aurai-je réellement appris à la fin de mon existence ? Que la<br />
jeunesse ne se garde et que la mort nous appelle bien vite. Était-ce<br />
donc cela que de vivre ?<br />
31
Idées et réflexions<br />
Il est assez difficile d’avoir des idées ; l’idée renferme la<br />
notion d’inédit, d’inconnu. Il faut donc que ce qui est exprimé ou<br />
rendu à autrui possède la propriété rare de l’imprévu. L’on détient<br />
plus facilement des réflexions qui sont propres à chacun, mais<br />
communes à tous, un peu mieux exprimées par les spécialistes et<br />
grossièrement rendues par les esprits simples.<br />
L’intelligence, par son travail, se propose d’assembler le<br />
tout, d’extraire des endroits jugés utiles et de délaisser les moyens<br />
précaires ou caducs. Il ne s’agit pas ici de mêler à l’emportepièce,<br />
sans fil ni trame. Car l’esprit, pour bien se conduire, doit<br />
avancer avec raison, accumulant les uns derrière les autres les<br />
preuves ou les justificatifs.<br />
La difficulté est de savoir douter, d’oser remettre en<br />
cause le matériel à exploiter, qui se prête de bonne grâce et<br />
semble prêt à l’emploi par la capacité loquace du débit. Il faut<br />
donc se méfier, et apprendre à avancer lentement. Partout où<br />
l’intelligence construit un procédé pour prouver, la critique, sa<br />
fille aiguisée, se cache là à l’entrée de la bouche, prête à<br />
intervenir pour faire cesser le babillage.<br />
32
C’est pourquoi s’il surgit une grande idée, il la faut<br />
maîtriser avant que de la proposer à autrui. Il serait préférable de<br />
la malaxer, de la refaire, de la presser dans sa chambre ou dans<br />
son bureau, à l’écart de tous, sans cette détestable improvisation<br />
qui peut casser par son inexpérience les plus beaux élans.<br />
On ne peut guère être un inventeur d’idées. Le plus<br />
souvent nous exploitons des lectures, des références, des<br />
informations du quotidien pour extraire ou fusionner des concepts<br />
disparates. Les grandes créations sont rarement l’œuvre d’un seul<br />
homme. Elles découlent assez généralement d’un principe de<br />
synthèse, de condensation opérées par une intelligence qui<br />
ramasse les différentes mises. Nous ne faisons que perfectionner<br />
des systèmes déjà existants.<br />
Le vingtième a connu essentiellement deux grandes<br />
découvertes : l’ordinateur et la télévision. Le dix-neuvième, plus<br />
inventif peut-être, a vu ses découvertes fondamentales subir des<br />
progrès techniques et technologiques considérables.<br />
33
Des ressources humaines<br />
Peu d’hommes inventent et conçoivent. Peu d’hommes<br />
sont aptes à fixer leur intelligence sur un problème de sublimation<br />
artistique ou de création technique. Le génie solitaire a peu de<br />
chance de voir sa découverte reconnue. L’équipe de chercheurs<br />
bien menée peut voir son projet déboucher sur une application<br />
d’entreprise.<br />
Il semble évident qu’une réussite médicale sera<br />
hautement considérée par la communauté tandis qu’une œuvre<br />
poétique laissera dans une différence quasi-générale.<br />
Notre élite est de belle valeur. Pourquoi devrait-on s’en<br />
étonner ? Les structures scolaires, pédagogiques et<br />
professionnelles imposent une telle sélection, une telle aptitude à<br />
l’obéissance, que les cerveaux se musclent, se fortifient et<br />
deviennent de splendides petits soldats. Il n’y a ici de moquerie ;<br />
Il y a constatation que les structures d’accueil sont de qualité et<br />
permettent à l’intelligence supérieure de participer efficacement à<br />
l’évolution de la civilisation.<br />
34
Nous devons pourtant reconnaître qu’une obéissance<br />
zélée peut engendrer une corruption de l’intelligence, qui<br />
obséquieuse et soumise refusera d’aller au-delà de ce qu’elle peut<br />
obtenir. Un caractère élevé, vif et rempli d’espoirs, constamment<br />
arrêté par un système hiérarchique, usé et soumis, détruira sa<br />
propre capacité subliminale, obsédé par la crainte de l’argent. Il<br />
apprend à ruser, à truquer, trop soucieux de la rentabilité<br />
financière, c’est-à-dire du salaire. Il devient habile renard<br />
caressant à l’extrême, craignant de perdre sa place. Le salaire<br />
détruit la sublimation. Puis l’âge, l’usure du temps achève ce qu’il<br />
lui restait de capacité inventive. Voilà pourquoi la détection de la<br />
ressource humaine est un volet de l’exploitation de l’intelligence.<br />
Si elle ne s’accompagne de structures souples où la liberté<br />
créative évolue, si elle étouffe la capacité inventive dans un<br />
carcan de lois et de soumissions, jamais la potentialité humaine ne<br />
parviendra à s’épanouir pleinement, et cela serait grand dommage<br />
pour la civilisation.<br />
35
Les postulats<br />
La philosophie ne possède aucun postulat. Nulle vérité<br />
n’est fondée. Le travail de l’intelligence consiste aussi à vérifier<br />
que ce qui est avancé par les Anciens possède quelque fondement<br />
de certitude. Elle n’a aucun diktat préétabli. Elle n’existe pas dans<br />
un système de réflexions définies, même si le principe de<br />
l’échafaudage philosophique réduit les conceptions, les idées, les<br />
objections etc... dans un espace limité. L’élaboration du système<br />
engendre un domaine de définitions. Consciemment ou<br />
inconsciemment le philosophe construit donc un rempart<br />
protecteur où il limite son entendement. Ses concepts ne sauraient<br />
être multiréférentiels. Cette raison évidente découle du fait que<br />
l’homme est une unité en soi. Le contenu ne saurait être déjà<br />
pensé : il provient d’une accumulation d’expériences, de lectures<br />
et de productions de réflexions. Le contenu peut être une<br />
ramification d’un courant de pensées déjà existant.<br />
Le postulat mathématique, lui est déjà établi. On exige, on<br />
impose à l’intelligence de s’en référer immédiatement à<br />
l’obéissance des anciens, prétendant qu’il n’y a pas d’autres<br />
vérités que celles-là. L’exemple du repère est significatif. À l’état<br />
36
de nature, la droite n’existe pas : tout est courbe, tout est<br />
circulaire - voyez une pomme, un atome, un satellite.<br />
L’ensemble est bien rond. Je prétends qu’il est quasiment<br />
impossible de trouver des exemples naturels de droite. Une arête<br />
de poisson est un segment de cercle - c’est un arc. Un os n’est<br />
jamais tout à fait droit. Un arbre ne pousse jamais tel un bâton<br />
sans se pencher un peu. On enseigne la droite, le repère<br />
orthonormé, le système unitaire. Et pourtant cet outil ne permet<br />
pas même de calculer le volume d’une sphère avec exactitude ! Or<br />
la nature est essentiellement composée de sphères... Alors qui<br />
croire ?<br />
La philosophie n’a donc pas de point de départ. Elle se<br />
conçoit dans son propre absolu - et telle est sa liberté.<br />
37
L’intuition<br />
Quand l’homme commun s’en réfère à cette sorte de<br />
perception inexpliquée que l’on appelle intuition et prétend<br />
posséder une vérité à travers un système de valeurs délétères et<br />
floues, l’on peut en toute objectivité se demander s’il fait preuve<br />
d’aberration ou si, inconsciemment il n’a pas opéré un ensemble<br />
d’actions analytiques imperceptibles lui permettant toutefois de<br />
tirer une certitude ou sa certitude concernant le fait déterminé.<br />
Je prétends que celui qui juge d’après sa sensibilité<br />
épidermique agit en une fraction de secondes par esprit de<br />
synthèse, ayant mémorisé des situations, des renseignements, de<br />
l’expérience lui permettant de conclure à cela. Il y aurait donc<br />
conscience de l’individu, certitude immédiate fondée ou non sur<br />
un ensemble de déterminants à peine captables, mais en nombre<br />
suffisant pour tirer une information.<br />
S’il vient à partager avec autrui cette perception, la même<br />
référence d’analyse assez souvent tombe d’avis semblable. Cette<br />
vérité de l’immédiat sans fondement réel conscient peut paraître<br />
38
détestable, car dépourvue de raison et d’analyse. Cette vérité-là<br />
semble ne posséder aucune richesse constructible intellectuelle.<br />
39
La certitude de l’immédiat<br />
Le contenu de la certitude de l’immédiat laisse apparaître<br />
une connaissance quasi imparfaite, exploitant une détermination<br />
réalisée dans un temps très court. Il n’y a pas spéculation, doute<br />
ou retenue. L’intelligence prétend posséder la vérité, sa vérité<br />
d’après une analyse macro, grossière et incertaine. Comment un<br />
esprit raisonné, pourvu de sens critique aiguisé peut-il se<br />
précipiter dans un choix épidermique, réactif, sans enchaînement<br />
rationnel ou logique aucun ? Car il a la possibilité d’offrir à sa<br />
critique une richesse d’informations issue de l’expérience. Cette<br />
vérité-là semble loin d’être vraie, et pourtant elle est référentielle<br />
pour un grand nombre d’options, de choix ou d’opinion. Elle n’a<br />
pourtant accompli aucune analyse méthodique de l’objet mais le<br />
prend dans son entier. Sa certitude est approximative, floue et<br />
abstraite.<br />
40
Dialectique négative<br />
L’évolution scientifique s’opère essentiellement par la<br />
connaissance de la proposition négative. La détermination de cette<br />
certitude permet d’accéder à une vérité infaillible. Ce négatif-là<br />
dans sa pure essence possède une affirmation qui ne peut être<br />
contredite, celle de n’être pas.<br />
Quand l’intelligence détient une vérité, il faut que celle-ci<br />
soit suffisamment épurée, sans scories de doutes ou d’hypothèses<br />
sous-jacentes. Car s’il advenait qu’une seule partie de l’ensemble<br />
fût possiblement vraie, il faudrait l’extraire, la discuter et la<br />
vérifier encore.<br />
Le doute doit être de rigueur, car le négatif dans sa<br />
proposition principale pourrait servir d’éléments absorbant à<br />
l’image du zéro pour la multiplication, qui imprègne quelconque<br />
réel et quel que soit son rang pur le réduire à l’état de rien.<br />
que 10 = 100.<br />
Si 0 x 100 = 0 x 10, je dois bien me garder de prétendre<br />
41
La conscience et l’instinct<br />
La conscience est la morale de l’âme. Elle s’impose<br />
comme juge possédant sa propre sagesse pour déterminer son<br />
système de valeurs. Elle s’oppose donc à l’instinct qui lui produit<br />
des actions sans analyse aucune. L’instinct ne détient aucune<br />
objectivité - il agit par loi de nature, de manière animalière. À<br />
moins qu’il faille considérer qu’une accumulation de certitudes<br />
s’est imposée à l’esprit, et que celui-ci ne réagit pas de manière<br />
spontanée face à une situation précise et présupposée. Il y aurait<br />
donc accumulation d’expériences et violence dans le fait, tel un<br />
jaguar aux aguets prêt à bondir. L’instinct libérerait donc de la<br />
conscience qui était intégrée à son concept d’existence. Dans<br />
l’instinct, l’intelligence exprime une détermination qui se<br />
développe ou explose de manière instantanée. L’accumulation de<br />
la force intérieure peut découler d’un lent processus justifiant un<br />
laps de temps relativement long avant l’acte d’explosion.<br />
La morale peut être extrémiste et prétendre toutefois au<br />
bien fondé de sa valeur.<br />
42
Le royaume du doute<br />
La philosophie habite le royaume du doute, de l’à-peuprès<br />
et de l’incertain. Constamment elle se fonde sur du délétère<br />
et de l’impalpable pour tenter de construire ses fondations. Je ne<br />
l’accuse pas, je constate. Elle désire accéder à la vérité, à la<br />
connaissance exacte mais le matériel de mots, de dialectique, de<br />
sensations qu’elle exploite, - ses outils en quelque sorte -, sont<br />
loin de posséder la rigueur et la qualité des outils de la<br />
mathématique ou de la physique.<br />
Elle n’est pas plus propriétaire de l’idée que la science.<br />
L’esprit scientifique nécessite des perceptions, des suppositions,<br />
des sortes d’intuitions qui lui permettent d’envisager ou<br />
d’élaborer des théories.<br />
La volonté d’accéder au savoir n’est pas le propre de la<br />
philosophie, quand bien même son essence est de désirer<br />
comprendre. Elle est un immense brasseur de la connaissance,<br />
puis tente d’organiser par ressemblance, par énergie, par élan de<br />
vie l’ensemble du matériel dont elle dispose. Elle ignore le plus<br />
souvent qu’elle ne détient pas tous les éléments utiles à sa<br />
43
construction. Ce qui explique que son architecture ici et là repose<br />
sur des malfaçons ou s’affaisse quelque peu.<br />
Ce besoin vital qu’est la curiosité de l’homme doit<br />
répondre à un sentiment de dignité. Il est en effet estimable de<br />
vouloir atteindre les plus hautes vérités. La conscience du bien et<br />
du mal, du réel et du mensonge, du visible et de l’invisible, du<br />
Dieu et du Néant engendrant la détermination de son propre<br />
devenir ne saurait être trop grande pour la satisfaction de l’esprit.<br />
Est-ce l’amour de la vérité qu’au fond de soi-même<br />
cherche irrésistiblement l’homme ? N’est-ce pas plutôt une<br />
indispensable nécessité pour avancer avec les pieds affermis sur le<br />
parcours de l’existence ?<br />
S’il est un Dieu, créateur de toutes choses, l’essence<br />
même de l’univers restera pour longtemps cachée à l’intelligence<br />
de l’homme. Sa capacité spirituelle ne lui permettra pas de<br />
posséder les richesses et les profondeurs d’une si vaste nature.<br />
44
Méthode d’intégration<br />
Le temps est un paramètre indispensable à tout système<br />
de vie, au même titre que la longueur, la largeur ou la profondeur.<br />
L’une des caractéristiques qui spécifie tout ce qui est vivant ou<br />
inanimé, est sa soumission au vieillissement ou à l’érosion.<br />
Comment dans ces conditions de dimensions humaines<br />
parvenir à accéder à un savoir ou à une formation suffisante tandis<br />
que le temps est assassin, et n’est jamais à son côté, mais se<br />
positionne contre soi ?<br />
Il faut donc s’imposer des règles ou des lois, des sortes<br />
de principes d’existence, et les tenir fermement pour avancer sans<br />
commettre trop d’erreurs.<br />
La première est bien de recevoir les choses pour vraies et<br />
de tenter de les assimiler le plus rapidement possible. Il faut<br />
toutefois éviter la précipitation, et ceci est balancement et bonne<br />
mesure. “Intègre tout d’abord, tu comprendras par la suite”. Il faut<br />
donc s’en référer au savoir et à l’expérience du corps enseignant<br />
et de l’autorité parentale. La contrainte de cette obligation est le<br />
45
doute, que toute intelligence possède. Car si en quelque occasion<br />
l’esprit a raison de douter, tout le système peut être discuté et<br />
donc remis en cause.<br />
La seconde est de globaliser le problème dans son<br />
ensemble, de le comprendre outre le détail, et de chercher à<br />
atteindre la synthèse immédiatement. L’esprit qui tente de<br />
comprendre exploitera son énergie dans une analyse détaillée de<br />
chaque élément, et usera sa fonction intellectuelle à des fins<br />
puériles. Y a-t-il des objections ? Évidemment, mais j’exprime un<br />
système de pensées permettant d’y gagner en temps. L’on<br />
comprendra que l’intelligence doit accepter sans trop se soucier<br />
de la démonstration et d’aller outre l’analyse pour atteindre la<br />
finalité. Je songe à ces enfants qui désirent tout intégrer du cours<br />
de mathématique, et forcent leur attention sur la démonstration du<br />
professeur, et n’ont de réserve de compréhension pour assimiler le<br />
théorème ou l’axiome qui est l’instrument-clé de l’exercice à<br />
obtenir.<br />
La troisième sera de revenir sur l’ensemble des objets qui<br />
ont été intégrés, et de prétendre par le jeu de la décomposition<br />
d’en tirer l’explication sur chaque endroit. Il ne s’agit pas<br />
d’ordonner sa pensée pour aller du plus simple au plus complexe.<br />
46
Il s’agit d’assimiler l’endroit où il y a résistance, sans pour autant<br />
s’imposer à décortiquer l’ensemble des endroits.<br />
Les longues chaînes qui encastrent les raisonnements les<br />
uns dans les autres alourdissent les démonstrations, fatiguent<br />
l’intelligence qui les doit assimiler. Est-il possible que toutes ces<br />
choses parviennent à la connaissance de l’homme sans qu’il ait le<br />
souci de tout redécomposer ? Il est vrai que l’organisation et<br />
l’ordre balisent le cerveau, et lui permettent d’avancer à pas<br />
certains.<br />
47
Imaginer<br />
Imaginer, c’est parfois concevoir un objet ou l’ombre<br />
d’un objet, et prétendre possible son action sur nos sens ou sur<br />
une sélection de nos sens. L’imagination du présommeil, - celle<br />
qui fabrique assez rapidement des perceptions visuelles<br />
n’intervient que sur un seul de nos sens : ni le toucher, ni l’auditif,<br />
ni le tactile, ni le goût n’en exploitent la création. Nous voici donc<br />
confrontés à une sorte d’impression à deux dimensions mollement<br />
animée, aux contours nets ou parfois indéfinissables, rarement<br />
colorée, sans forme réelle. C’est une espèce de fantôme gazé venu<br />
de la fabrication de traits, qui apparaît en un lieu, celui du front,<br />
qui accomplit quelques mouvements et s’efface d’un coup.<br />
En réfléchissant quelques instants sur son origine, on<br />
peut prétendre qu’il naît de l’énergie électrique permettant<br />
l’activité de l’intelligence. Son explication trouve son essence<br />
dans le travail du rêve : il est symbolique, condensation,<br />
concentration, allusion.<br />
Je veux prétendre ici un exemple. Une nuit, j’interrogeais<br />
mon cerveau et je lui dis : montre-moi ce que tu aurais voulu être.<br />
48
Après un laps de temps très court, je reçois une image. C’était un<br />
cercle blanc coupé d’une croix ressemblant à un X. Et je compris<br />
immédiatement la signification du message.<br />
Le cercle blanc symbolise la pureté et le logo de Dieu,<br />
l’X est une croix chrétienne, il est aussi la représentation de<br />
l’école de Polytechnique.<br />
J’eusse donc aimé accomplir une Grande École et<br />
accéder à la purification divine. L’on peut évidemment tirer<br />
d’autres explications de cette image, mais j’en resterai là.<br />
Toute image visuelle renferme donc un relief et un sens.<br />
Il faut en comprendre son signifiant. Après quoi, l’on peut<br />
s’attarder sur un commentaire pour en dégager l’explication. Si<br />
l’image condensée semble en rendre ambigu le sens,<br />
l’investigation freudienne facilite son approche.<br />
Si j’avais ordonné à cette espèce de machine placée dans<br />
le cerveau, de faire resurgir une image précise, il est évident<br />
qu’elle en aurait été incapable. L’on tire de cette observation que<br />
l’on ne saurait inventer ce que nous désirons.<br />
49
La capacité d’exploiter la mémoire auditive semble<br />
encore plus délicate à maîtriser. Comment faire surgir la<br />
perception de voix bien précises, de mélodies longtemps<br />
entendues ?<br />
On semble être capable de retrouver, mais non pas<br />
d’enregistrer parfaitement un son comme cela se fait avec une<br />
récitation. Il ne s’agit peut-être pas du même mécanisme de<br />
perception intellectuelle.<br />
Nous avons pourtant un film enregistreur placé quelque<br />
part dans le cerveau. Dans les rêves, nous entendons bien des voix<br />
qui ne sont pas les nôtres. Non, il n’y a pas d’erreur, il s’agit ici<br />
d’une voix constituée par la mémoire, donc par une aptitude de<br />
mémorisation. Mais le mécanisme semble complexe. Les<br />
biologiques trouveront peut-être la clé de ce mystère.<br />
50
Dédoublement<br />
Rien ne change en moi, ou si peu ; j’ai la certitude de<br />
pouvoir maîtriser un grand nombre de perceptions, du moins je le<br />
prétends. Mais n’est-ce pas déraisonnable de faire preuve d’une<br />
telle assurance ? Non ! Voyons ! Cela était de l’humour... Je m’en<br />
retourne au sérieux.<br />
Quelle pensée me faut-il aborder ? De quoi voudrais-je<br />
parler ? Je souhaiterais m’intéresser au problème du Moi. Il est<br />
vrai que je ne puis échapper à sa vérité - le sujet de mes pensées<br />
est toujours et encore moi ! Ne pas être me semble donc<br />
impossible. Mais serait-il absurde de penser que je puisse être<br />
deux ?<br />
Je veux m’imaginer détenir un frère jumeau, de même<br />
essence, possédant mes caractéristiques génétiques, ayant reçu et<br />
perçu la même culture et les mêmes informations.<br />
Je suis donc un, et je puis être deux. Mon frère me<br />
ressemble pareillement. Je puis dire que je suis l’autre et que<br />
l’autre est moi. Je reste le même tout en me dédoublant. J’épargne<br />
51
le prix d’une glace, et me contemple à mon aise. Je dois m’aimer<br />
à la manière de Narcisse, ou mieux apprécier mes faiblesses et<br />
mes défauts.<br />
Je puis posséder le don d’iniquité, et être en deux endroits<br />
simultanément. Imaginons un instant que je puisse, étant en deux<br />
lieux différents, posséder deux variables temporelles, t1 et t2 qui<br />
se situent à deux moments distincts. Je parviendrai donc en<br />
fonction d’un présent connu à pouvoir me comporter autrement<br />
dans un avenir proche, ayant connaissance des conséquences<br />
d’évènements futurs... Mais il faudrait pour cela que je fusse doté<br />
de ces deux variables temporelles. Je ne possède que deux Moi, ce<br />
qui déjà est un privilège... Il est peut-être vain de spéculer sur la<br />
quatrième dimension.<br />
Il est vrai que les deux temps pourraient faire partie d’un<br />
même temps, et les deux espaces d’une même espace. Les deux<br />
Moi pourraient s’associer à nouveau, pourquoi pas ? Mais<br />
l’expérience prendrait fin, et plus rien ne serait plausible. Il n’est<br />
donc pas question ici de faire apparaître le Moi unique. Je reste<br />
avec ces deux Moi, et c’est pourquoi je prétends que nous<br />
pensons, distinctement est plausible?<br />
52
Les deux Moi sont puissants et concrets. Ils peuvent se<br />
contredire, ou s’instruire quelque peu l’un l’autre. L’unité de ces<br />
deux personnalités est toutefois incompatible, je reste pourtant<br />
bien séparé. Je suis en ce moi-même et je suis en cet autre. À moi<br />
de vivre avec cette apparente contradiction : être là et être ailleurs,<br />
uni et désuni. Je dois pour autant m’efforcer d’être en accord avec<br />
moi. Il me suffit de concevoir tout simplement cette notion<br />
concrète du nous pensons.<br />
Nous sommes, unis et séparés. Voilà une pensée de<br />
dédoublement qui semble fantaisiste par son contenu, mais qui<br />
par la Loi de Dieu et de Son Esprit pourrait s’avérer exacte.<br />
53
Volonté d’abolir la conscience<br />
Je veux fermer mes yeux, protéger mes oreilles pour ne<br />
plus rien entendre, rejeter consciemment par ordre logique toutes<br />
les perceptions que je puis avoir du monde extérieur. Ainsi fait,<br />
tout ce que je reçois d’autrui est aboli, n’existe plus par la<br />
suppression de l’activité de mes sens. Le concept matériel se<br />
détruit dans le silence de cette nuit profonde. Je suis un peu cet<br />
aveugle sourd et muet. Je suis bien en moi, et cette perception<br />
relève d’une étonnante intensité. Je reçois toutefois des<br />
informations venues de l’extérieur, d’une zone périphérique qui<br />
encercle mon corps. Le sensitif n’est pas inactif, mais pleinement<br />
efficace. Je possède aussi cette mémoire des souvenirs engendrés.<br />
Leur impression est forte et pleine. Ce degré de perception, sa<br />
hauteur d’intensité est fonction de l’abolition des autres sens.<br />
Comment parvenir à une perception qui s’approcherait du point<br />
zéro ? Comment obtenir une non-conscience parfaite du moi ?<br />
Car je ne puis gommer la trace de cette mémoire<br />
construite sur de l’acquis et de l’expérience. Je possède encore<br />
cette certitude d’activité qui anime mon cerveau, puisque je<br />
pense, et peux l’exprimer. Je vais toutefois tenter de réduire<br />
54
encore ces messages reçus du monde, c’est-à-dire de l’extérieur.<br />
Les voilà à présent réduits à une portion congrue, à de l’infinie<br />
insignifiance. Tout va-t-il disparaître ? Cela semble difficile,<br />
puisqu’un autre effet de conscience vient supputer ou se substituer<br />
à ce dernier pour analyser l’ultime perception. Je me vois donc<br />
dans l’obligation d’une constance de sensation, et pour l’abolir, il<br />
faudrait accéder à une destruction de la conscience, ou pour dire<br />
autrement à une mort biologique de ma cervelle. Je ressuscite à<br />
chaque instant par la conscience de ma perception ! Je tache de<br />
détruire, mais je reçois encore soit venus du dedans, soit imposés<br />
par l’extérieur, des messages de vie.<br />
55
CHAPITRE SECOND<br />
56
De la Mathématique<br />
La Mathématique<br />
Le doute, en tant que pensée parfaite, peut s’appliquer à<br />
toutes les formes et aspects du savoir. Il serait une sorte de<br />
témoignage de l’insuffisance et de la faiblesse de ce qui est<br />
avancé ou certifié. Mais il peut être un instrument qui ralentit, qui<br />
retient la pensée jusqu’à lui imposer une vérité infaillible. Il est<br />
pour la raison une perte de temps le plus souvent. Car faut-il<br />
réellement douter de ce que le bon sens offre à tout à chacun ? Le<br />
principe mathématique possède plusieurs moments. Il y a en un,<br />
le postulat à la question qui désire exprimer ce que l’on va tenter<br />
de démontrer ; il y en a deux, la démonstration elle-même,<br />
détenant une méthode d’investigation, et prétendant avancer avec<br />
certitude ; il y a en trois la finalité, c’est-à-dire la preuve qui a été<br />
tirée de ce mouvement logique. Le doute, trouve alors des formes<br />
satisfaisantes, certifiées par la démonstration, et son scepticisme<br />
se défait de son concept négatif.<br />
57
La science possède en elle-même une immense part de<br />
doute. Si elle admet une hypothèse, elle n’exploite sa preuve<br />
qu’avec la certitude de sa démonstration. La logique dialectique<br />
s’est débarrassée de tout parasitage, de tout élément variant ou<br />
d’exception. Elle n’évolue que dans un espace déterminé, fini,<br />
contingenté. Ainsi elle parvient à extraire des vérités et là est son<br />
immense force. De là prétendre qu’elle possède toutes les formes<br />
de savoir, de connaissances, de passé et d’avenir, qu’elle<br />
s’accompagne de sensibilité humaine... Je puis dire que la<br />
mathématique est vraie, car elle évolue dans une structure<br />
restrictive.<br />
58
Le vrai<br />
Selon moi, et cette appréciation peut être justifiée par la<br />
certitude de son impuissance, - l’homme ne sait rien, ou peu. Sa<br />
connaissance est fragmentaire, en mouvement. Son vrai est de<br />
faible valeur, à l’orée d’une civilisation. Pourtant il lui faut<br />
chercher, évoluer, comprendre, percevoir les mécanismes visibles<br />
et invisibles qui régissent les lois de la nature. Il doit aussi se<br />
projeter dans son passé pour y comprendre l’avenir, et spéculer<br />
sur l’éventualité d’une autre forme de vie en dehors du système<br />
terrestre. Il doit encore tenter d’accéder à la conception Divine, -<br />
seule substance qui a inquiété les hommes de toutes époques et de<br />
toutes civilisations.<br />
Peut-on prétendre que son fini est vrai ? Son fini n’est<br />
qu’une étape, qu’une borne, qu’une transition de savoir devant<br />
permettre d’obtenir une vérité pleine. Il cherche à casser du<br />
Néant, à souffler sur les brouillards pour tendre vers une vérité. Il<br />
doit se dépasser. Sa volonté est dans le dépassement.<br />
Le vrai et le faux sont par la simplicité de leur<br />
détermination deux notions opposées, intimement unies par la<br />
59
certitude du contraire, fixées, ne possédant que des éléments<br />
inverses pour les associer. Cela est fort pratique pour analyser,<br />
prétendre ou certifier dans le domaine rationnel de la science et de<br />
la science appliquée. Et cette vérité-là dans un espace de travail<br />
bien limité, dans une sorte de royaume autarcique, permet de<br />
détenir des plans, d’échafauder des constructions par les principes<br />
mêmes qui y sont exploités. Le vrai et le faux y sont facilement<br />
discernables. Nous sommes en plein dans l’esprit de géométrie de<br />
Blaise Pascal. Le faux apparaît donc comme étant l’aspect négatif<br />
de l’idée, ou de la substance. Cette partie de l’idée renferme une<br />
notion négative essentiellement parce que son concept est<br />
facilement déterminable, sa différenciation se conçoit avec<br />
lucidité, et peut se comparer à la main droite et la main gauche : il<br />
ne propose que deux cas possibles, - ce qui simplifie<br />
considérablement le choix.<br />
60
De la géométrie et de l’intuition<br />
L’esprit sans raison est un bateau sans cap.<br />
Constamment il divague, et ne sait où aller, empruntant tous les<br />
chemins sans savoir lequel suivre. Aussi faut-il s’imposer un bon<br />
principe d’investigation intellectuelle, basé sur une méthode<br />
efficace qui s’allie assez sensiblement au principe scientifique.<br />
L’esprit logique exploitera les procédés que l’expérience humaine<br />
répétitive met à sa disposition, et tentera parfois de pénétrer une<br />
issue jusqu’alors inconnue. L’avancée rationnelle s’avère<br />
indispensable et l’esprit parviendra à découvrir ce qu’il s’était<br />
promis de chercher. On observera que s’il ne parvient pas à<br />
atteindre son but, retournant sur ses propres pas avec son système<br />
bien indiqué, il ne pourra se perdre, mais reviendra à son point de<br />
départ sans dommage aucun.<br />
Pourtant il serait sot de prétendre que seul le mode<br />
d’emploi scientifique permet d’accéder à une vérité à découvrir.<br />
La science peut même, par son principe rigide, détruire toute une<br />
spéculation, toute une tentative audacieuse que savent à merveille<br />
investir les artistes. La preuve directe, constamment productible<br />
impose de l’expérience qu’elle soit renouvelable.<br />
61
Et chacun sait que certains phénomènes tirent la<br />
propriété ou leur spécificité de leur incapacité à être reproduits.<br />
Il est toutefois à supposer que le mathématicien ou que le<br />
physicien pénétrant dans des recherches de plus en plus<br />
profondes, faisant preuve de hardiesse et de capital-risque<br />
investissement en utilisant des procédés à la limite de la régularité<br />
scientifique.<br />
Ces moyens employés, je ne puis les condamner ayant<br />
constamment travaillé avec l’esprit de finesse et ayant été dans<br />
l’obligation de délaisser l’esprit de géométrie dont Pascal nous<br />
avait nourris sur notre adolescence.<br />
Il faut donc le plus souvent aller au-delà de ce que la<br />
doctrine enseigne, et pénétrer dans cette haute difficulté dont les<br />
parties ne sont ni évidentes ni clarifiées, en utilisant son propre<br />
système de perception.<br />
Quant à l’efficacité de cette méthode, il est difficilement<br />
possible de quantifier ses performances. Du moins sa portée<br />
62
semble être immédiate pour les hommes de science, comme grand<br />
nombre d’entre eux avouent l’utiliser régulièrement.<br />
Mais ce sont là de vieilles recettes, connues depuis des<br />
millénaires par les hommes de rigueur, qui percevaient une sorte<br />
de vérité dans l’air du temps sans pouvoir réellement prouver son<br />
origine. Ce que l’on a obtenu pour preuve a souvent été senti ou<br />
pressenti par la conscience, réfutant parfois ce qui lui paraissait<br />
évident, étant dans l’incapacité de le démontrer par la raison. Puis<br />
la certitude vint, et la chose fut entendue.<br />
63
Le 1 et le 0<br />
Le vrai et le faux, le 1 et le 0 sont des valeurs basées du<br />
langage mathématique, totalement épurés de quelconque contenu.<br />
Le concept de la vérité épouse un nuancier beaucoup plus subtil<br />
comparable aux différentes couleurs qui composent l’immense<br />
palette de la nature. Le vrai et le faux peuvent se mêler, et ce qui<br />
semble vérité dans tel espace, dans telle situation et dans un<br />
domaine de définition bien précis pourra s’avérer entièrement<br />
faux si l’on vient à faire varier un infime paramètre.<br />
La vérité mathématique tire son essence des propriétés et<br />
des lois qui la régissent. Sa nature justifie son existence par les<br />
lois mêmes qui la construisent, et c’est sur cette vérité-là qu’elle<br />
assoie sa certitude. C’est ainsi que le sens et la nature de la<br />
mathématique trouvent leur origine, leur développement et leur<br />
avenir par le résultat obtenu qui devient une preuve.<br />
Je vais ici donner un exemple : j’affirme être une banque<br />
qui accomplit des opérations financières et qui possède en dépôt<br />
500 millions de dollars. On me pose cette question : “ Qui êtesvous<br />
? ” Je réponds : je suis une banque qui accomplit des<br />
64
opérations financières. L’on insiste : quel est le montant de vos<br />
dépôts, - je réponds : je possède en dépôt 500 millions de dollars.<br />
L’on voit l’importance capitale du rapport entre le<br />
contenu et son sujet. L’affirmation est vraie, et tire son<br />
explication de son origine.<br />
La production du résultat découle d’une connaissance<br />
certifiée et prouvée. Et tel est le privilège de la logique<br />
dialectique.<br />
Le savoir philosophie veut spéculer sur le faux, sur le<br />
doute et le possible. Il refuse d’exclure l’indéterminé. La thèse et<br />
l’antithèse avancent ensemble pour accéder à la voie de la vérité.<br />
De ces deux conceptions naît un troisième concept : la synthèse.<br />
L’unification de ces deux mouvements contribue à agrandir le<br />
savoir philosophique.<br />
65
Insensible mathématique...<br />
La dialectique mathématique ignore la sensibilité, la<br />
transmission de l’amour, l’affectivité etc... Elle n’étudie que le<br />
rapport entre les grandeurs, et se plaît à accomplir des opérations<br />
sur de la matière inanimée. Son royaume est le calcul des masses<br />
déplacées. Son matériel est très grossier. Il ignore l’essence des<br />
phénomènes. Il ne se soucie que des rapports de divisions ou de<br />
multiplications. La mathématique refuse de considérer la réalité<br />
de l’esprit. Nous sommes confrontés à du matérialisme primaire.<br />
C’est pourquoi de petites machines sont aptes à résoudre des<br />
problèmes de calculs proportionnés de dix en dix. L’aptitude de la<br />
pensée qui produit d’autres pensées et conçoit le calcul, lui<br />
semble inexistant. La forme de la réalité qui est le plus souvent à<br />
saisir dans son schématisme ou son symbolisme, lui est inconnu.<br />
Elle ne vit que dans l’analyse du phénomène réel mais la<br />
puissance de l’âme qui produit ce phénomène n’a pas lieu d’être.<br />
Elle n’est donc qu’un outil au service d’un certain type de<br />
raisonnement, qu’un calcul de compas, qu’une distance à<br />
prétendre, qu’une balance à peser. Elle ne peut pas engendrer et sa<br />
créativité est nulle.<br />
66
Il ne sera pas aisé de vouloir déterminer le vrai dans son<br />
essence et dans son sujet ; car le vrai, s’il possède cette propriété<br />
et s’il en tire son principe d’existence et la transmet sur des objets,<br />
il ne peut en prétendre la valeur universelle. Le vrai est vrai car il<br />
évolue dans un espace limité avec un domaine de définition bien<br />
précis. En dehors de ce domaine, cette vérité devient aléatoire et<br />
ne peut être démontrée.<br />
67
CHAPITRE TROISIÈME<br />
68
De l’Art<br />
Trois distinctions dans l’art<br />
On peut déterminer trois distinctions fondamentales<br />
permettant aisément, mais de manière totalitaire toutefois, de<br />
sectionner le concept de l’Art. Nous pourrions y voir trois<br />
représentations de l’action de l’homme dans la matière.<br />
Il y a tout d’abord, la forme purifiée, simplifiée dont<br />
l’Idéal recherche la symbolique. On la trouve le plus souvent dans<br />
le signe exprimant par la limitation du sens une restriction à<br />
exprimer. Elle se veut parfois synthèse de plusieurs explications,<br />
et n’hésite pas à utiliser le travail de condensation. Apparue dans<br />
les sociétés primitives, la forme purifiée avec le symbolisme et<br />
autres Écoles d’Art a connu un immense succès à la fin du XIXe<br />
siècle. Cette forme exploite les vérités de la nature ou des<br />
comportements humains, mais se trouve confrontée à leur<br />
interprétation. Elle se dépouille de l’habillage, de l’abondance,<br />
pour ne saisir que l’essentiel. Son concept refuse l’identification<br />
exacte.<br />
69
Permet-elle par la purification de ses traits, de son Idée<br />
d’offrir au receveur la capacité d’intégrer totalement le message<br />
offert ? N’est-elle pas une sorte de raccourci, un principe codé,<br />
uniquement accessible à l’amateur possédant déjà une charge<br />
culturelle importante ?<br />
Elle est donc une représentation abstraite qui nécessite une<br />
interprétation. Sa forme n’est pas accomplie mais épurée.<br />
La seconde distinction fondamentale s’apparente à la<br />
forme classique. Elle se veut objectivité concrète, sans excès ni<br />
fioritures. La volonté de l’artiste sera de reproduire avec le<br />
maximum de ressemblance l’objet à réaliser. Et l’on peut songer<br />
aux commandes exécutées par les peintres officiels et à la qualité<br />
exacte des portraits obtenus. Certaines civilisations optent pour<br />
une représentation fidèle du produit à imiter. Mais la naïveté ou le<br />
manque de compétence de ses artistes réduisent à une<br />
configuration enfantine l’œuvre exécutée.<br />
L’Esprit qui pense se détermine et veut déterminer<br />
l’objet extérieur qu’il désire figurer. Il perçoit très nettement la<br />
forme externe, il tentera de s’unir parfaitement avec cette réalité<br />
objective. Il s’agit ici d’une imitation fidèle du travail à<br />
70
accomplir. Le contenu de l’œuvre sera donc limité à sa propre<br />
explication. Si la pensée est fidèle, si sa matière est parfaitement<br />
déterminée, son interprétation en est donc bornée. Cette forme<br />
d’Art applique fidèlement l’Idée perçue.<br />
Il en est tout autrement de la troisième distinction dont la<br />
caractéristique essentielle est d’interpréter le contenu à définir.<br />
L’Esprit décide alors d’intégrer sa propre définition, exploite le<br />
travail de son intelligence, et imprègne son action personnelle<br />
dans la représentation externe. La forme obtenue n’est plus<br />
qu’une extériorité, qu’une vision transformée par le travail de<br />
l’artiste. Le vrai a disparu, et laisse la place à une détermination<br />
totalement subjective. Il n’est nulle clé permettant de comprendre<br />
le sens de l’œuvre. Il faut donc épouser la particularité du<br />
créateur. On voit les immenses difficultés qu’engendre cette<br />
troisième section de l’art. Elle peut rejeter des artistes de qualité<br />
exceptionnelle mais inaptes à plaire ou à séduire. Mais elle peut<br />
tout aussi bien reconnaître des artistes qui n’auraient qu’une<br />
qualité douteuse et dont le temps se défera.<br />
71
Le vouloir créatif<br />
Il faut donc accéder à la connaissance qui permettra de<br />
concevoir de la création. Y a-t-il méthode, principe<br />
d’investigation intellectuelle, système d’assemblage, de<br />
condensation favorisant l’explosion d’un produit artistique ou<br />
scientifique nouveau ? Comment faut-il saisir l’instant autorisant<br />
quelque délire, menant l’idée jusqu’à sa finalité dans le réel ?<br />
Comment passer de l’imperceptible, de l’insignifiant et pouvoir le<br />
détecter pour l’épanouir dans le supérieur où règnent les pensées ?<br />
L’imagination ne permet pas de comprendre - elle n’est qu’un<br />
vaste réservoir où grouillent des centaines d’idées sans<br />
association aucune, le plus souvent. Elle n’est pas un moyen<br />
propre à l’entendement, - non. Mais elle est le lieu où l’audace<br />
dépasse la raison, où le risque se défait du rationnel. Ceux qui<br />
désirent utiliser la loi et le bâton pour avancer, s’interdirent tout<br />
volume de liberté.<br />
L’intelligence humaine créative se nourrit de constants<br />
changements dans l’appréciation. Ces évolutions ou ces variables<br />
de la perception favorisent une représentation autre de<br />
l’information reçue. Entre les informations reçues et le travail de<br />
72
l’esprit, il y a un temps durant lequel la conscience ou quelque<br />
chose d’équivalent dit : Comment interprètes-tu cela ?<br />
Il faut se comprendre, et parvenir à admettre que cette<br />
perception est bonne ou utile, et doit découler sur une forme<br />
nouvelle et inventive. Il faut posséder également une certitude<br />
dans son avancée et détenir cette puissance du vouloir, qui va audelà<br />
de la critique d’autrui, au-delà de sa propre résistance, qui est<br />
ténacité vers l’avenir.<br />
73
Arpèges sur le beau<br />
Le beau n’a pas besoin de s’associer à la vérité pour<br />
exister. Il n’est pas même un soupçon de cette vérité, il peut se<br />
situer en dehors. Le vrai est parfois beau. L’essence du vrai, c’est<br />
le Principe avant toute application, avant toute vérification de sa<br />
certitude. Le Principe peut donc concevoir dans le beau, il peut<br />
concevoir uniquement du beau, alors il est Art avec lois et<br />
techniques et maîtrise. Le Principe peut être vrai. S’il est faux, il<br />
ne peut résister à l’usure du temps. Car les générations le<br />
soumettront à rude exigence, à vérifications. La critique sait le<br />
ruiner et cherche à réduire son influence. S’il est vrai et fort, il<br />
résiste, - il est - sinon, il s’en retourne à l’état de Néant. La Pensée<br />
peut être pure, chercher le Beau dans son Essence, dans son<br />
application, mais parfois être décevante dans sa réalisation.<br />
Le beau doit charmer la conscience, la séduire. S’il<br />
étonne, c’est qu’il possède une charge autre, et ce sont peut-être<br />
ses techniques et ses méthodes que l’on cherche à découvrir. Si le<br />
Beau a communiqué son apparence externe, c’est qu’il est en<br />
osmose avec la conscience de l’autre.<br />
74
Le Beau habille l’Idée, il est l’épiderme superficiel de la<br />
pensée. Le beau s’associe à la forme, quand la forme vise le<br />
concept de l’art.<br />
La logique rationnelle appliquant son système de<br />
vérification n’est pas toujours l’instrument adopté à la<br />
détermination du Beau. Le Beau n’a pas à être soumis à l’analyse,<br />
il se reçoit dans son ensemble, et l’entendement s’opère de<br />
manière globale, d’un bloc. La décomposition du Beau peut<br />
engendrer le mépris ou l’indifférence. Un tableau, une œuvre de<br />
sculpture se reçoivent dans leur ensemble, et le Beau “ fouette la<br />
gueule ” comme une révélation. La perception doit être unifiée,<br />
car la décomposition de l’œuvre casse l’élan général.<br />
Si le beau n’est pas libre, s’il ne peut imposer ses propres<br />
exigences, s’il est limité par l’entendement et la commande<br />
d’autrui, sa réalité devient objective, et il y perd en sensibilité. Si<br />
l’exécution du Beau doit être libre, on comprendra que son<br />
essence elle-même qui trouve naissance à l’intérieur est plus libre<br />
encore. Le beau se nourrit de l’énergie du créateur, de sa<br />
technique et de son inspiration. Il prélève des éléments dans la<br />
nature et dans le savoir des hommes. Si le beau est objectif, son<br />
75
essence est asservie à une finitude. Il se met au service du<br />
pouvoir, et ne possède plus cette indépendance d’actions.<br />
76
De l’art<br />
L’esprit supérieur, détaché de toute contrainte matérielle,<br />
étant parvenu à créer des espaces temporels de liberté cherche une<br />
essence élevée où sa conscience pourra jouir d’un bien-être. Cet<br />
espace n’est pas un espace de vérité et de certitude où les<br />
oppositions et les contradictions cessent enfin de se confronter,<br />
non. La certitude y est relative, le savoir et son objet ne détiennent<br />
qu’une partie infime du vrai. Quelle que soit la forme qu’elle<br />
dégage ou le fond qu’elle renferme, elle ne peut prétendre valider<br />
sa vérité. Cette matière du génie humain est évidemment l’art.<br />
La conscience du vulgaire ne se soucie que fort peu de<br />
cette discipline. Elle éprouve d’étonnantes difficultés à intégrer sa<br />
valeur et lui préfère des considérations d’ordre primaire. Elle la<br />
rejette ou cherche un autre support pour satisfaire ses désirs<br />
immédiats. Elle résoudra des problèmes proches des besoins<br />
suscités par la survivance à la nature.<br />
L’esprit va donc pénétrer une forme qui sera chargée<br />
d’un signifiant à travers un objet. L’esprit portera à sa conscience<br />
77
la vérité de cet objet. Ayant considéré la valeur de son contenu, il<br />
en déterminera son utilité.<br />
Il veut saisir ou pénétrer avec profondeur une perception<br />
de forme à travers une sensibilité, il veut comprendre l’absolu qui<br />
se présente à sa conscience, et en exploitant son intuition<br />
accouplée à sa raison, il déterminera la jouissance et l’utilité qu’il<br />
peut en tirer.<br />
La réaction peut dans un premier temps être nourrie de<br />
sensibilité. C’est une sorte de perception immédiate qui engendre<br />
parfois l’acceptation ou le refus. Dans le second temps,<br />
l’intelligence décide d’associer une représentation de l’objet offert<br />
tirée de sa mémoire. La troisième phase de l’analyse de ce produit<br />
artistique consiste à construire une critique raisonnée qui provient<br />
de l’esprit.<br />
78
Esthétique<br />
L’esthétique recherche la grandeur, la beauté,<br />
l’admiration mêlées au plaisir. Il est évident que le beau de la<br />
nature répond parfaitement à cette définition. Il n’est qu’à<br />
considérer le spectacle d’un coucher de soleil, des teintes rousses<br />
de l’automne, ou du fracas des vagues ballottées par la tempête<br />
pour comprendre avec précision ce que l’entendement humain<br />
suppose derrière cette définition.<br />
Il serait stupide d’évincer de cette détermination le beau<br />
caché ou enfoui de la science pure. J’en veux pour exemple les<br />
magnifiques représentations microscopiques des systèmes<br />
cristallisés, les constructions infiniment petites des briques de la<br />
matière, ou les décompositions spectrales de la lumière.<br />
L’homme a inventé l’art. Il a prétendu proposer une<br />
représentation parfaite de la nature, avec sa sensibilité, ses<br />
dispositions, ses oppositions et ses différences. Y est-il parvenu ?<br />
Que fait-il aujourd’hui ?<br />
79
Qu’est-ce qui nous émeut, nous élève ou nous charme ?<br />
Dans quelles mesures peut-on attribuer aux éléments ou aux<br />
objets qui nous entourent la qualité du beau ? Les créations de<br />
l’homme ne sauraient rivaliser avec les aptitudes de la nature. Et<br />
si l’on admet la parfaite esthétique d’un corps féminin fixé dans la<br />
matière, l’on doit reconnaître que l’original fait de chair, de<br />
muscles et de vaisseaux sanguins est d’une finesse et d’une<br />
subtilité qu’aucun artiste ne pourrait prétendre obtenir.<br />
Une objection de taille peut affirmer que nulle part à<br />
l’état de nature l’on trouve une composition musicale de qualité<br />
acoustique supérieure en harmonie, en technique et en puissance<br />
de jeu à celles obtenues par le travail de nos prestigieux<br />
musiciens. Et le doux gazouillis d’une cascade, le chant<br />
mélodieux d’un rossignol ne sauraient par l’intensité de leur<br />
mouvement couvrir les riches percussions ou les cuivres sonores<br />
d’un orchestre.<br />
Peut-on prétendre que l’art est le propre de l’homme, que<br />
cette particularité de la conscience pensante est exclue du monde<br />
animal et végétal ? N’y a-t-il dans l’animal lors de sa parade<br />
nuptiale, recherche d’esthétique pour séduire et convaincre sa<br />
femelle ? Son pourtour ou celui de la fleur ne renferment-ils pas<br />
80
quelque essence de qualité qui ne découle pas de la loi du hasard ?<br />
L’inorganisé ne saurait être beau. Considérons l’emplacement<br />
chaotique sur la planète Mars, ou l’écrasement des météorites sur<br />
le satellite lunaire. On en tire que la non-conscience de la vie ne<br />
peut engendrer quelque particularité de Beau.<br />
L’évolution des choses de la nature a favorisé<br />
l’intégration d’une forme d’Art dans les éléments animés. L’oeil<br />
de l’homme est trompé et ne peut pas toujours user de<br />
perspicacité, mais deux oiseaux ne construisent pas leur nid avec<br />
le même résultat, deux mammifères n’éduquent pas leurs petits<br />
avec le même principe d’apprentissage, etc... Les exemples<br />
pourraient être multipliés par des milliers dans le monde animal et<br />
végétal.<br />
Lui, l’homme a atteint un stade de développement<br />
extrême si l’on compare ce qu’il peut faire et ce que peuvent<br />
accomplir les autres espèces vivantes sur la terre. S’il est<br />
totalement intégré à la nature, il peut aussi la modifier, la<br />
transformer, y ajouter sa force de travail. L’homme agit donc dans<br />
les choses externes, et ce besoin d’intégrer sa pensée dans la<br />
matière ira jusqu’à une sublimation de sa production que l’on<br />
appelle Art. Mais il est peut-être sot de prétendre que l’Art<br />
81
n’appartient qu’à l’homme, puisque d’autres perceptions et<br />
comportements dans la gent animale et végétale pénètrent ou<br />
possèdent des formes de Beau dont nous sommes sensibles.<br />
82
CHAPITRE QUATRIÈME<br />
83
De la Poésie<br />
De l’invisible et de la rigueur<br />
Je ne vis qu’avec des fantômes, des fantômes d’idées, des<br />
sortes de spectres de l’impalpable et de l’invisible. Leurs formes<br />
délétères se dérobent sous mes sens. Pourtant tel un apprenti<br />
médium, je tente de les capturer, de les saisir pour les offrir à la<br />
conscience de mon esprit. Je déteste ces brouillards vagues, ces<br />
fumées incomprises manquant de rigueur et de rationalité. La<br />
réflexion est détestable quand elle est constamment nourrie d’à<br />
peu près et de perceptions insolites. Il est vrai que cet immense<br />
mélange de la vie nous brasse une quantité considérable<br />
d’informations. Des évènements imprévus à la raison humaine se<br />
combinent les uns aux autres pour organiser ou troubler<br />
l’existence. Il ne s’agit pas ici de jeu pour l’esprit, non, - nous<br />
subissons régulièrement des contraintes dans notre quotidien.<br />
Ma volonté recherche la rigueur et déteste se laisser<br />
emporter à la dérive avec ce matériel d’imprécisions si volubile.<br />
Cela ne pourrait me satisfaire. Comment parviendrais-je à accéder<br />
à quelque chose de profond et de singulier si je me laisse bercer<br />
84
par l’enchantement du jeu, ou par le dérisoire et l’insignifiant ? Je<br />
dois les exclure de mon mode d’emploi ou de ma méthode<br />
personnelle. Certains riront de moi prétendant qu’il n’est pas de<br />
bon ton pour un poète de donner des leçons de rigueur quasimilitaires.<br />
Je connais trop bien ces moments d’ivresse et de<br />
nonchalance, quand la pensée flotte pour tenter d’accéder à<br />
quelque chose d’inconnu. L’âme s’y complaît, et s’y baigne avec<br />
aisance.<br />
Au seul nom de poésie, déjà je m’enivre et je crains de<br />
perdre ma capacité d’analyse et de synthèse. Je crains de<br />
vagabonder par monts et par vaux, cherchant je-ne-sais-quoi,<br />
allant vers l’insouciance et le hasard. Cela ne saurait me charmer,<br />
quand bien même j’avoue éprouver du plaisir à caresser cette<br />
femme volage et éphémère, qui s’enfuyant sans cesse,<br />
constamment désire me rejoindre pour un ballet nuptial.<br />
85
Le spectre d’autrefois<br />
Le spectre d’autrefois vint visiter l’apprenti poète, rempli<br />
d’élans et d’actions, aux yeux tournés vers l’avenir. Le spectre<br />
feuilletait un livre consacré à l’art grec, à ses colonnes et au<br />
temple du Panthéon. Au cours de cette cérémonie médiumnique,<br />
on sentait pleinement toute l’activité intellectuelle qui animait<br />
encore l’esprit échaudé et excité par cette rencontre. Cette petite<br />
boule verte de phosphore allait et venait, enfin elle se mit à parler<br />
: “ Nourris-toi de moi-même ! Apprends et instruis-toi. Je suis<br />
venu te dire ce que tu dois faire, ce qu’il te faut obtenir. Là sera ta<br />
suffisance. Il n’est pas ici question d’ambition, de prétention ou<br />
de toute sorte de termes péjoratifs. Non, là est ton but. Et ta raison<br />
est de l’atteindre. ”<br />
L’apprenti poète savait toutefois que les artistes et les<br />
écrivains étaient soumis à nombreuses critiques, qu’une poignée<br />
très réduite parvenait à crédibiliser sa capacité littéraire. Et s’ils<br />
avaient quelque avenir, c’était surtout la mort que leur offrait ce<br />
privilège.<br />
“ Il suffit, dit le jeune. Voilà, tu t’es déplacé pour rien.<br />
Tout ce que tu pouvais me dire, je le savais déjà en prescience de<br />
86
ons sens et de vérités. Tel est le privilège des âmes bien nées, -<br />
elles possèdent cet extraordinaire don de connaissance sans<br />
l’usage de l’expérience.<br />
C’est vrai, je suis de bonne race comme toi. Mais je<br />
doute de pouvoir atteindre cette place si hautement convoitée. Tu<br />
sais comme je puis apprécier ces challenges de l’esprit. Je m’y<br />
astreindrai par jeu de l’intelligence. ”<br />
87
Le don de plaire<br />
Un jeune poète qui se prévalait de posséder du génie,<br />
mais qui pour l’instant était le seul à le prétendre tenta vainement<br />
de rencontrer des hommes de lettres de qualité lui permettant de<br />
débuter ou du moins de faire ses premiers pas dans la République<br />
des Lettres. Le jeune auteur fit preuve d’un zèle remarquable,<br />
courant à droite, courant à gauche, d’une amabilité, d’une<br />
affabilité exceptionnelles. Avec ses petites plaquettes sous le bras,<br />
il résolut de faire la tournée des directeurs de revues et des<br />
Comités de lecture.<br />
Les directeurs de revues semblaient s’intéresser à sa<br />
production, du moins l’assuraient-ils, mais tous exigeaient que le<br />
jeune homme prît un abonnement d’un an à la revue pour espérer<br />
figurer dans la modeste parution.<br />
Ne se décourageant pas, il proposa ses manuscrits à<br />
différentes maisons d’édition. Les plus sérieuses lui retournèrent<br />
ses exercices accompagnés d’une lettre circulaire, le remerciant<br />
de son envoi mais prétendant que sa poésie n’entrait pas dans le<br />
cadre de leurs collections.<br />
88
Il voulut forcer la main du destin. “ Par Dieu, se dit-il, si<br />
tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ! ”<br />
Il envoya ses livres à des maisons spécialisées dans le<br />
compte d’auteur. Illico, celles-ci lui firent un contrat basé sur<br />
l’article 57 de la protection littéraire, ce qui voulait dire en<br />
d’autres termes que l’édition était à sa charge. On lui fit un tirage<br />
à mille exemplaires d’un recueil qui jamais ne fut distribué ou si<br />
mal qu’il ne put avoir un seul lecteur.<br />
Il en était tout dépité : “ Quelle injustice, que cette soidisant<br />
structure poétique d’accueil ! J’ai dépensé toute une petite<br />
fortune pour engraisser le compte bancaire d’un éditeur véreux !<br />
Me voilà retourné à mon point de départ. Mais que puis-je faire<br />
pour crédibiliser mon identité poétique auprès d’autrui ? ”<br />
Il osa se remettre en cause, décidant de repartir à zéro,<br />
achetant traité de versification sur traité de versification, y<br />
appliquant toute sa sève et toute sa force. Le travail ajouté sur le<br />
don de nature fit croître son aptitude poétique. Le jeune homme<br />
allait bon train, enfin je veux dire l’homme jeune, car de<br />
89
nombreuses années déjà s’étaient écoulées sans qu’il ne pût<br />
accéder à l’édition.<br />
Il poursuivit toutefois son œuvre entreprise. Il pouvait se<br />
flatter d’avoir obtenu une bonne vingtaine de plaquettes,<br />
quelques-unes éditées à compte d’auteur, d’autres fabriquées<br />
artisanalement par ses propres soins ou par des amis.<br />
Il frayait ici et là, se frottant à d’autres littéraires vus ou<br />
entrevus à des Journées du Livre ou à des Fêtes de l’édition. Cela<br />
ne permettait guère de percer dans le monde des lettres, mais du<br />
moins cela correspondait à du zèle actif, et qui sait...<br />
Le temps s’écoula, et toutes les tentatives entreprises<br />
échouèrent. “ Quel sale destin ! pensa-t-il. Pas un éditeur, pas de<br />
lecteur ! Quelques reconnaissances, quelques estimes, mais voilà<br />
qui est fort peu. Je ne puis donc parvenir ? ”<br />
Il se lamentait et poursuivait encore sa tâche animé par le<br />
besoin d’écrire, mais sans grand succès toutefois !<br />
Et voilà ce qui attend la quasi-totalité de ceux qui<br />
s’essaient à l’art d’écrire. Car il ne suffit pas d’avoir du génie<br />
90
pour exister dans cette discipline, non il faut quelque chose de<br />
bien plus important, et cela s’appelle le don de plaire. L’on peut<br />
parfois l’assimiler à du talent.<br />
Il permet de pénétrer, de se crédibiliser immédiatement. Il<br />
est l’énergie monnayable, achetable comme ces bons<br />
feuilletonistes qui ont couvert des pages et des pages de journaux<br />
au grand bonheur de leurs directeurs.<br />
Qu’est donc devenu cet homme jeune, âgé aujourd’hui et<br />
sur le point de passer à trépas ? Il a connu la destinée de dizaines<br />
de milliers de littéraires. Plein de fougue et d’entrain, animé par<br />
l’idée du génie, le voilà vieux, grommelant dans sa barbe blanche.<br />
Il finira poète de famille. Quelques écrits seront transmis de fils à<br />
petit-fils pour finir oublié sous le marbre du temps.<br />
91
De l’œuvre<br />
“ Jusqu’où Franck Lozac’h, irez-vous dans la recherche<br />
désespérée de cette production pléthorique ? ” Ainsi s’étonne la<br />
plupart des personnes qui ont pu accéder à mon Oeuvre. Ils n’y<br />
ont vu qu’une immense quantité et n’ont pu y déceler une aptitude<br />
quelconque d’écrivain. L’on prétend que je travaille grandement,<br />
j’écrirai plus volontiers, que chaque jour qui passe me voit noircir<br />
quelque vingt ou trente lignes. Et c’est l’accumulation de cette<br />
fréquence qui engendre la détermination d’une quantité<br />
importante.<br />
Je suis bien loin des œuvres immenses d’un Victor Hugo,<br />
d’un Voltaire ou d’un Balzac. Et c’est encore manquer de<br />
modestie que d’oser user de leurs noms pour se permettre une<br />
comparaison. Je crois toutefois que le lecteur comprendra ce que<br />
je souhaitais signifier.<br />
“ Mon cher Franck Lozac’h, vous ressemblez à Mickey<br />
Mouse dans l’apprenti sorcier, le dessin animé de Walt Disney sur<br />
une musique de Paul Ducat. Vous accumulez, accumulez de la<br />
92
quantité, et êtes débordé par votre propre abondance. Jusqu’où ira<br />
votre folie ? ”<br />
Tels sont à peu près les extraits des discours dont se<br />
glose la compagnie de gens qui me critiquent. Leur analyse est<br />
parfois judicieuse, mais elle semble ignorer que j’agis pour<br />
accomplir une Oeuvre - a Work - en quelque sorte. Je travaille<br />
pour ma propre personne conscient que nul lecteur n’aura la<br />
capacité de lire tout ce que j’ai pu produire ou concevoir sur ces<br />
quelques décennies.<br />
Je ne suis aucun plan général, ne sachant réellement où je<br />
vais, comparable à ce héron au long cou qui terminera son festin<br />
avec un ridicule vermisseau, il se peut. Si je<br />
prétends posséder un semblant d’organisation, c’est du moins<br />
pour produire et ranger mes ouvrages par ordre de composition.<br />
Cette petite société paraît toutefois se construire, et si je ne sais en<br />
concevoir la finalité, certains traits de l’esquisse semblent<br />
apparaître çà et là.<br />
Il me semble que cette société est en marche, qu’elle<br />
évolue, se développe par besoin, par prospérité, et commerce.<br />
93
N’est-ce pas à moi, en vérité, de la savoir bien gouvernée ? Je<br />
dois donc y mettre des lois et des décrets.<br />
Voilà très sommairement, sans poursuivre une analyse<br />
précise, ce que je puis penser de ce travail et de cette quantité.<br />
Parviendrai-je à obtenir un ensemble cohérent où chacun pourra<br />
s’y déplacer avec aisance, allant où bon lui semble, y découvrant<br />
ce qui l’intéresse ?<br />
Plaise à Dieu - ou du moins à ma raison - que cet espoir<br />
se réalise, et que j’obtienne ce que je m’étais promis - une<br />
représentation de qualité de ma propre personne, voilà tout.<br />
94
De l’association poétique<br />
Il y a ici une petite assemblée composée de littéraires de<br />
qualité, et de personnes fort savantes exerçant dans<br />
l’enseignement qui appartiennent à une communauté poétique,<br />
mais qui ne sont point du tout du même avis concernant la valeur<br />
à accorder aux uns et aux autres.<br />
Certains se prévalent de posséder un avenir littéraire<br />
quand la plupart ne croient ni en leur talent ni en leur génie.<br />
Je me souviens de quelques anecdotes et réflexions<br />
disposées çà et là dans le feu de la conversation pour tenter de<br />
limiter l’influence grandissante de l’un des adhérents. Cette<br />
société comparable à une mutuelle veut niveler les valeurs en<br />
haussant les plus défavorisés et en coupant les têtes de ceux qui<br />
sortent de l’alignement. Après tout, cette conception sociale est<br />
fort égalitaire et sa philosophie est défendable.<br />
Du moins tous sont d’accord pour reconnaître l’immense<br />
qualité du poète Arthur Rimbaud. Il est devenu un Dieu et chacun<br />
s’extasie devant sa précocité et son œuvre exceptionnelles.<br />
95
Cela semble toutefois aller très lentement dans cette<br />
assemblée. Certains poètes zélés dont l’œuvre tient dans deux<br />
boîtes de chaussures, n’ont édité qu’une mince plaquette de cinq<br />
cents vers. D’autres n’ont pas même de quoi construire un recueil.<br />
Mais, enfin, l’ensemble spécule, certifie et jure posséder la vérité.<br />
Car l’on parle ici de l’expérience accumulée depuis trente années<br />
de poésie. Cela serait une preuve irréfutable de sa compétence<br />
pour juger.<br />
Il faut user de politesse et de courtoisie, car la<br />
conversation ne doit employer de termes violents. L’on pourrait<br />
se fâcher et ces messieurs étant d’une sensibilité extrême, les pots<br />
de porcelaine ne sauraient résister.<br />
Vous voyez quelle ambiance circule dans cette<br />
compagnie. Tout y est courtoisie, amabilité et quantité<br />
insignifiante. La qualité des auteurs ne pourrait pourtant être<br />
remise en cause. Il n’y a pas de belles disputes ou de clans<br />
franchement séparés. Si ce n’est du mépris qui détermine la valeur<br />
que l’on accorde à autrui, c’est du moins de l’indifférence, qui est<br />
l’anti-sentiment par excellence.<br />
96
Cette assemblée est encore trop petite pour jouir de la<br />
renommée de certaines consœurs, mais elle l’obtiendra sans<br />
doute. Les adhérents y sont au nombre de deux cents, ce qui est<br />
loin d’être ridicule.<br />
L’on commence à lire dans cette revue les meilleures<br />
plumes du temps passé, et l’on se plaît à imaginer que<br />
l’immortalité de jadis côtoie déjà de superbes avenirs.<br />
Si Charles Baudelaire renaissait, l’on peut supposer qu’il<br />
parviendrait à se faire imprimer dans cette revue, à la condition<br />
toutefois qu’il n’oublie pas de payer sa cotisation comme tout un<br />
chacun, grand poète ou pas.<br />
97
De la critique poétique<br />
Je sais assez bien lire les poètes. Je connais les<br />
combinaisons, les analogies, les principes symboliques. Je puis<br />
décomposer un poème par un système de technique analytique. Je<br />
les ai compris en les lisant longtemps. J’avoue pourtant être assez<br />
déconcerté par un auteur inconnu. Je dois m’appliquer à le<br />
découvrir, à l’intégrer. Ne possédant que très peu de repères le<br />
concernant, je dois spéculer, envisager et douter. Il faut que je me<br />
fasse pardonner ma faible aptitude à savoir discerner. Je préfère le<br />
plus souvent m’abstenir que de prendre le risque de mépriser une<br />
personne douée, faute de visibilité intellectuelle. Certes, je puis<br />
m’enthousiasmer, acclamer certains auteurs, me désespérer<br />
devant la perfection de chefs-d’œuvre. Mais ce sont toujours des<br />
auteurs célèbres, dont la renommée a passé des décennies ou des<br />
siècles. Quel mérite peut-on avoir d’acclamer l’œuvre de<br />
Baudelaire ou de tomber des nues devant la pureté de Racine ?<br />
Ainsi il me faut tout découvrir. Ma sensibilité avec son<br />
éventail d’émotions ne s’adapte que très difficilement à de<br />
nouvelles propositions artistiques. Je dois recommencer et tenter<br />
de percevoir la fréquence poétique de l’autre.<br />
98
Ce que je veux détester c’est cette sorte de suffisance<br />
dont s’habillent les littéraires, prétendant avec un pseudo-esprit de<br />
synthèse être parvenus en quelques secondes à détruire ou<br />
mépriser le travail d’autrui. C’est le genre : “ Je sais que cela vaut<br />
peu. Allez voir ailleurs, Monsieur ! ” Il y a là un manque total<br />
d’honnêteté intellectuelle.<br />
Le poète se trouve donc dans l’obligation de caresser, de faire le<br />
joli coeur, d’aller chercher la considération élégante ou polie du<br />
critique. Il lui faut parfois des années d’insistance, de civilités<br />
pour parvenir à crédibiliser son aptitude littéraire. Quelle galère !<br />
Et combien de difficultés pour s’entendre dire deux ou trois mots<br />
flatteurs !<br />
99
Comprendre les poètes<br />
J’étudie souvent les recueils de poésie. Je les lis rarement<br />
avec l’oeil du lecteur ; non, je les lis avec l’oeil de l’analyste. Je<br />
décompose le vers, je compte les signes, je vérifie le rapport<br />
voyelles/consonnes, j’observe la technique de l’harmonie<br />
musicale, et je sais rapidement si je suis confronté à un écrivain<br />
au courant de la plume, ou à un technicien de l’écriture.<br />
Je puis toutefois aller outre, et me laisser emporter par<br />
l’ivresse de l’image, ou de l’ensemble produit. Je me dis que très<br />
rarement le texte, je préfère le murmurer, le prononcer à voix<br />
basse, et accomplir un effort de mastication. Car il y a plaisir<br />
buccal à prononcer un vers, et l’on peut en cela le comparer au<br />
plaisir de mâcher du vin.<br />
“ Le poème est fait pour être dit ”, répète-t-on. Je<br />
douterais aisément de cette vérité, sachant pertinemment qu’une<br />
avalanche de structures, d’images complexes, de retours sonores<br />
ne peut être assimilée par une bonne intelligence. Trop d’éléments<br />
s’opposent ou réagissent par interférence, et ne facilitent en rien la<br />
compréhension de l’endroit.<br />
100
Quel plaisir peut-on éprouver à écouter un orateur ? Que<br />
demande la conscience pour être bien charmée ?<br />
Elle désire bien entendre ce que la voix propose. Je<br />
prétends que l’on reçoit une grande satisfaction à écouter des<br />
textes ou des poèmes que l’on connaît déjà. L’intelligence s’arrête<br />
alors sur d’autres considérations que la seule compréhension du<br />
texte. L’esprit ne se limite pas à la transformation cérébrale pour<br />
intégrer des mots. Non, il possède déjà le contenu du message.<br />
Alors l’oreille se fait plus experte, elle apprécie le rythme,<br />
l’intonation, et la hauteur.<br />
Il faut dire que l’une des caractéristiques du produit<br />
poétique c’est d’être capable de répondre à grand nombre de<br />
considérations : un poème est multiréférentiel. Comment alors<br />
qu’il possède cette propriété, prétendre qu’un auditeur quelconque<br />
peut recevoir du plaisir lors de son écoute ? L’encombrement des<br />
raisons brouille sa lucidité intellectuelle.<br />
Mais que faire ? Dire le texte sur enregistrement avec<br />
musique et bruitage, dire le texte avec de grandes respirations et<br />
de nombreux silences, et proposer à l’éventuel auditeur la<br />
possibilité de suivre le poème avec un support écrit.<br />
101
Poésie, rigueur et liberté<br />
La poésie ne repose sur aucune connaissance<br />
systématique, elle ne peut donc être assimilée à une sorte de<br />
science quand bien même elle serait régie par des lois strictes de<br />
rythmiques, d’accents et de chiffres. La poésie libre, celle qui est<br />
au courant de la plume a décidé d’abolir les derniers diktats de<br />
l’harmonie musicale, du compte de signes et de syllabes. Nous<br />
voilà donc confrontés à un espace exceptionnel de liberté où tout<br />
peut être dit, où rien n’est interdit.<br />
La poésie épouse une forme qui pourrait s’apparenter à<br />
une conception individuelle d’interpréter un contenu. Les écrits<br />
poétiques n’embrassent que des secteurs isolés de son vaste<br />
éventail. De nombreuses sensibilités cohabitent, sont parfois<br />
contradictoires, ou en opposition farouche. Il y a donc sections,<br />
classes, écoles et s’il n’est pas possible d’embrasser l’ensemble<br />
des techniques offertes, les plus grands spécialistes ont une vaste<br />
palette d’émotions et de sentiments mis à leur disposition. Aucun<br />
poète ne pourra renfermer en lui-même l’ensemble des procédés<br />
ou des techniques qui découlent des différentes écoles. Il est<br />
ridicule d’exiger d’un sprinter de 100 mètres plat de concourir sur<br />
102
un Marathon ou sur une distance de demi-fond. Il est ridicule de<br />
prétendre qu’un sonnettiste parviendra à proposer des<br />
développements de plusieurs milliers d’alexandrins. Charles<br />
Baudelaire en ce sens s’oppose de manière significative à Victor<br />
Hugo. Quand l’un produit trois à quatre mille vers sur toute sa<br />
carrière, l’autre impose plus de deux cent mille alexandrins, et<br />
exploite à merveille des procédés de développement où son génie<br />
abonde.<br />
103
Le choix de la jeunesse<br />
Il est peu de temps où des circonstances semblent<br />
favorables au milieu desquelles la poésie peut espérer attirer la<br />
curiosité du public et se voir estimer de la même estime que celle<br />
d’autrefois. Là voilà encore retournée belle femme muette et<br />
silencieuse au mépris que l’on éprouve la concernant. Les intérêts<br />
de notre temps, le développement des sciences et des<br />
technologies, les obligations mesquines de notre réalité ont<br />
absorbé tous les instants de puissance que possédait l’esprit, toute<br />
l’énergie et les divertissements octroyés à chaque humain. Ainsi<br />
la vie intérieure se nourrit d’une autre forme de culture plus axée<br />
sur l’image à recevoir que sur l’image à fabriquer avec des signes.<br />
L’esprit se contente d’une certaine forme de réalité, et soutenue<br />
par le concours d’autrui l’intelligence n’a plus besoin de jouir par<br />
elle-même pour éprouver de la satisfaction. Elle se contente de<br />
gérer, de sélectionner le flot d’images que l’on met à sa<br />
disposition. On est loin de penser que le temps est enfin arrivé où<br />
le royaume de l’imaginaire instaurera à nouveau sa suprématie.<br />
Notre jeunesse a déjà manifesté son choix, et semble<br />
irrésistiblement attirée par l’image offerte. Mais son choix est<br />
peut-être plus judicieux qu’on ne le pense, car si elle exploite un<br />
104
support imagé déjà proposé, il lui faudra utiliser toute son<br />
intelligence et sa pensée pour remplir ces coquilles de<br />
programmes vides.<br />
Elle devra du moins faire preuve d’une forte vie<br />
spirituelle qui est l’élément fondamental de son existence. Il lui<br />
faudra aussi savoir lutter pour s’imposer une indépendance et une<br />
capacité libre de penser. Elle ne doit pas se soumettre, mais bien<br />
dominer l’effrayante puissance que peut représenter la machine.<br />
Tout dépendra encore de sa capacité autonome d’esprit, de son<br />
énergie intérieure mise au service de sa propre personnalité.<br />
Quelle place accordera cette génération au produit<br />
poétique ? Ne le méprisera-t-elle pas comme une vulgaire<br />
discipline d’hier, dépassée, à oublier ? Le poète ne sera-t-il pas<br />
rangé au patrimoine artistique comme le maréchal-ferrant et le<br />
sabotier, le sont au musée de l’artisanat ?<br />
C’est pourtant dans ces immenses entreprises de l’esprit<br />
que la pensée s’élève pour accéder à une dignité, qui l’éloigne du<br />
vulgaire et de l’insignifiant pour s’emporter dans des espaces où<br />
s’épanouit la grandeur de l’homme.<br />
105
I<br />
L’inspiration apparaît aussi comme un immense<br />
réservoir de mots qui s’associent, se combinent et se multiplient.<br />
Il y a donc interférence, - indispensable nécessité d’union, de<br />
frottements, de refus, d’accouplements. Voilà ! Il y a acte<br />
physique entre les mots qui doivent former un bel accord, comme<br />
deux êtres forment un beau couple.<br />
L’impulsion, l’élan vital de l’inspiré est passé par là. Il<br />
fallait bien qu’il eût ce que l’on peut appeler “ Énergie ” pour<br />
favoriser cet accouplement. C’est vrai, de nombreux obstacles,<br />
des retards, des blocages ont constamment tenté de condamner ce<br />
droit à l’orgasme littéraire. Le plus virulent est certainement<br />
l’interdit du critique, qui est un gendarme redoutable, doutant de<br />
tout, et réglant la circulation du flux sans réellement connaître les<br />
règles du déplacement. La conscience du poète le pousse le plus<br />
souvent vers une impasse : pourquoi produire cela ? Quel intérêt y<br />
a-t-il à caramboler de cette sorte ? Le raisonnement de la critique<br />
virulente provoque en lui une volonté de refus, je dirai - de<br />
stérilité.<br />
106
II<br />
La poésie nous introduit dans le monde de l’imaginaire.<br />
Elle nous montre la relation de non-vie entre un mot, masse inerte<br />
ou objet instrumental et un autre mot, qui associés formeront un<br />
bel accord, ou une combinaison criarde. Tout dépendra de<br />
l’analyse auditive du poète ou de sa volonté à obtenir l’effet<br />
recherché. Il suffit d’écouter sa conscience, et de décider d’après<br />
le choix arrêté. Parfois c’est une liberté absolue qui dicte la<br />
marche à suivre. Le poète devient joueur de jazz, à l’inspiration<br />
vagabonde au plan indéterminé. C’est juste une question de<br />
feeling. L’exercice de poésie dite libre s’apparente assez<br />
sensiblement à ce type de travail. L’auteur subit, ou voltige<br />
papillon hoqueteux, de fleur en fleur, ou pour reprendre l’exemple<br />
du pianiste, d’accords en accords, de combinaisons en<br />
combinaisons. Mais la comparaison cesse là. Car le poète, à sa<br />
table, possède ce que l’on appelle des blancs. Ce sont des laps de<br />
temps d’une certaine durée qui vont de quelques secondes à deux<br />
ou trois heures...<br />
107
Les moments de blancs sont remplis de façon diverse :<br />
lecture, doute, refus, activités autres, dessin, que sais-je encore !<br />
Je veux dire par là que le poète travaille sans continuité à l’instar<br />
du musicien de bar ou du jazzman qui par le son engendre le son.<br />
III<br />
La poésie doit le plus souvent abandonner cette<br />
conscience de critique si elle veut poursuivre le chemin de<br />
l’écriture. Un écrivain foudroyant tue tous les mots qui passent<br />
devant son regard. Il devient le destructeur du soi-même, et sa<br />
tendance le poussera à la stérilité.<br />
Il y a en tout poète un étrange mélangeur d’intelligence,<br />
d’intuition et de critique. Pourtant ne peut-on pas considérer qu’il<br />
y a une sorte d’incompatibilité dans la gestion de ces différents<br />
paramètres ? Un poète bien fait semble pouvoir maîtriser ces<br />
divers états de l’activité consciente, et en exploiter pleinement<br />
leur synergie. Il y a d’ailleurs des variables de densité entre ces<br />
différents ingrédients qui réclament des dosages entre l’instinct et<br />
l’intelligence. Là est une part du travail de sublimation dans la<br />
108
structure mentale du poète. Une gymnastique de l’entraînement<br />
peut produire un développement de telle fonction au détriment de<br />
telle autre. Il est difficile de prétendre savoir quelle partie de soimême<br />
est la plus apte à exploiter ou à maîtriser. Il semble acquis<br />
que la seule conscience du poète peut lui permettre de savoir. Estce<br />
une lumière intérieure plus ou moins intense, faible ou<br />
éblouissante qui éclaire la conscience de son manque de lucidité ?<br />
La critique a besoin de beaucoup d’intelligence.<br />
109
La poésie<br />
La poésie, qui a enrichi les âmes supérieures a contribué<br />
à les instruire, et cette instruction a fortifié leur intelligence ; de<br />
là, vient une vérité que ceux qui nous dominent et nous dirigent<br />
ont intégré des valeurs élevées en science et en lettres.<br />
C’est la poésie qui est le support incontournable de<br />
l’imaginaire, et qui fait des poètes des hommes en décalage avec<br />
leurs confrères. Ils ont le plus souvent une poétique possédant un<br />
siècle d’avance sur les autres disciplines. La postérité s’est trop<br />
bien rendre des comptes à ses illustres esprits et leur offre des<br />
hommages et des carrières le plus souvent posthumes.<br />
Comment se fait-il que des poètes obscurs et méprisés<br />
incompris de tous, à l’allure pataude, au gueuloir exorbitant<br />
deviennent par leur puissance d’évocation, par la maîtrise de leur<br />
langue et de leur technique, des références incontournables et<br />
immortelles dont on s’inspire encore trois siècles après leur décès ?<br />
Quand des écrivains lecteurs de Grandes Maisons<br />
d’Éditions Prix Nobel de littérature, ou futurs académiciens<br />
110
festonnaient en tête et se prévalaient de mépriser des Stéphane<br />
Mallarmé ou des Paul Verlaine, quand des directeurs de revues ou<br />
de collections rejetaient avec dédain des œuvres de Paul Claudel<br />
ou de Paul Valéry, ces derniers eurent recours à leurs propres<br />
confrères qui comprirent aisément le degré de leur valeur.<br />
Certains auraient pu dire : “ Maîtres, n’ayez crainte. Nous avons<br />
considéré la valeur de vos œuvres. Nous saurons faire fructifier<br />
vos images immortelles, votre postérité déjà est assurée. ”<br />
Tout cela peut rendre ridicule les structures littéraires<br />
actuelles si l’on ose comparer le bouquet des écrivains de la<br />
postérité avec les lamentables collections dont se prévalent et dont<br />
s’enorgueillissent des présidents de groupes.<br />
C’est pourquoi de très grands poètes ne dédaignent pas<br />
de travailler dans des revues que l’on ose parfois rejeter,<br />
considérant avec dédain le faible tirage qu’elles engendrent.<br />
Tandis que des André Gide et des Paul Valéry se<br />
formaient pour accéder à la carrière que nous leur connaissons, ils<br />
n’hésitaient pas à proposer leurs œuvres dans une revue<br />
aujourd’hui oubliée de tous, - La jeune conque.<br />
111
Et cette coutume est loin de passer, si l’on en juge par les<br />
centaines de feuillets imprimés qui fleurissent ici et là dans nos<br />
régions et départements. Pourtant à Paris, tout semble impossible,<br />
- la plus infime édition nécessite mille ans d’amitiés auprès des<br />
uns et des autres. Et encore, cela paraît faveur de vous donner le<br />
droit d’imprimer quelques endroits de votre personne...<br />
Dans cette Capitale, rien qui n’engendre l’argent ne<br />
saurait être utile. Il faut se hâter de proposer une biographie sous<br />
un chanteur ou un ouvrage de politique, si l’on veut voir son nom<br />
figurer sur un livre. Le littéraire entend parler de soi avec mépris,<br />
il est assez sot pour cacher sa production poétique de crainte de<br />
subir des lazzis.<br />
J’ignore pourtant lequel est le plus utile à la postérité. Ou<br />
un torche-cul qui fera quelque dix mille francs de droits d’auteur,<br />
ou un poète immortel qui saura instruire des générations de têtes<br />
blondes et contribuera ainsi à l’éducation de notre pays.<br />
112
Stylistique en prose et stylistique poétique<br />
La stylistique en prose permet de recevoir l’objet à<br />
transformer de manière réelle, sans nécessité aucune<br />
d’adaptabilité de la capacité intellectuelle à la proposition offerte.<br />
L’entendement est direct, et la cause suit l’effet. Il y a pourtant<br />
une substitution d’éléments écrits en images à produire. Le roman<br />
en est une parfaite illustration. D’ailleurs, s’il y avait une étude<br />
réelle du psychisme qui transforme les caractères écrits, l’on<br />
observerait des différences et des écarts considérables dans la<br />
mutation de l’expression écrite. Pourtant les types d’individus qui<br />
lisent le roman parviennent à se mettre d’accord sur l’extériorité<br />
du produit et sa finitude interne. L’intelligence est collective, et<br />
reçoit grosso modo le même message. La capacité particulière ne<br />
se différencie que très peu de la conscience collective, le contenu<br />
étant unique quoique possédant des ramifications et des détails<br />
spécifiques. Il y aura selon les individus plus ou moins d’aptitude<br />
à tout recevoir ou à recevoir une grande partie de la proposition<br />
écrite. L’ensemble des lecteurs peut donc se prévaloir de s’être<br />
mis d’accord sur le message reçu.<br />
113
Il faut bien que cette conscience soit ordinaire,<br />
satisfaisante à l’ensemble, sinon elle ne pourrait pas être assimilée<br />
par la grande majorité. Ce qui lui arrive a peu de chances d’être<br />
singulier ou de s’habiller de solutions rares. Il n’y a pas résistance<br />
à l’entendement.<br />
Qu’en est-il réellement de la stylistique poétique ? La<br />
pensée poétique construit son système de valeur sans exploiter la<br />
rationalité du langage et en faisant varier la signification des<br />
choses. Elle devient alors inutilisable pour l’immense majorité des<br />
lecteurs qui exigent de leur conscience une application de la<br />
réalité, du moins d’une certaine réalité. Aussi la compréhension<br />
d’un univers construit sur du délétère, aux lois variables, aux<br />
signifiants dénaturés de leur réel contenu engendre un refus<br />
catégorique de la plupart des lecteurs. Cette juxtaposition<br />
d’éléments indépendants fabrique, il est vrai, une vitalité créative<br />
et inventive, mais peut sembler totalement inadaptée à un esprit<br />
authentique. Pour l’esprit à la pensée profonde, la vie extérieure<br />
revêt une apparence d’intérêt moindre. L’épanouissement de<br />
l’âme peut s’accomplir en employant l’imagerie poétique.<br />
114
Cet espace de variantes, d’associations délétères est le<br />
royaume de l’aptitude spéculative qui combine, additionne de<br />
l’invraisemblable pour obtenir du possible. Ce ne sont pas des<br />
défauts de l’entendement qui engendrent cette aptitude à varier, à<br />
déplacer le sens commun, - cela découle de la vitalité de<br />
l’intelligence à concevoir autrement ce que l’ensemble ne voit que<br />
d’une seule manière. Ceci est donc un privilège,... inutile hélas, et<br />
le plus souvent rejeté de l’ensemble. Il s’agit encore de capter la<br />
forme de la réalité pour la transformer en principe idéalisé et<br />
supérieur. La stylistique poétique veut donc élever l’entendement,<br />
mais elle ne peut prétendre épouser la perception exacte de la<br />
vérité. Elle ne saurait être une conciliation du vrai et de<br />
l’imaginaire, quoi que parfois son assise se manifeste dans la<br />
réalité du quotidien.<br />
115
De la critique de soi<br />
Qui peut se prévaloir d’avoir obtenu un résultat digne de<br />
sa compétence, qui peut ? On est rarement soi-même, on travaille<br />
en dessous. Il y a une constance de déception, une vérité critique à<br />
l’intérieur de soi qui murmure : “ Tu étais capable d’accéder à<br />
quelque chose de bien meilleur. Regarde, observe où tu en es à<br />
présent ! Le temps, ton ennemi, aura bien su te ronger et te<br />
détruire lentement. ” Pourtant l’analyse se veut impartiale. Elle ne<br />
recherche pas à distribuer des éloges, ou à rosser à coups de<br />
trique.<br />
Quand on a la certitude d’avoir accompli correctement sa<br />
tâche, l’on peut encore se dire : “ Oui, j’aurais pu toutefois ajouter<br />
ceci, j’avais la potentialité pour trouver cela, hélas, le temps m’a<br />
détruit. ” Il est pénible de se déplaire, mais il est détestable de<br />
faire preuve d’une avidité maladive.<br />
Certains hommes toutefois recherchent des caresses et<br />
des flatteries. Les littéraires sont des gens de politesse et de<br />
courtoisie, toujours enclins à obtenir quelque faveur. Mais tout est<br />
gratuité, et cela ne coûte rien de s’entendre dire : “ Monsieur,<br />
116
vous êtes un grand poète ”, ou encore “ Ce jeune artiste a un bel<br />
avenir. ” Certains rétorqueront que la belle critique est agréable à<br />
l’oreille, et peut engendrer un vif élan d’actions. Il est pourtant<br />
plus puissant de se nourrir de soi-même et d’extirper de sa propre<br />
négation de l’énergie et de la volonté de gains.<br />
D’ailleurs l’outil de mesure qu’emploie autrui est<br />
rarement le vôtre. Il détermine votre suffisance en fonction de sa<br />
propre aptitude à agir. Ainsi des poètes peu féconds condamnent<br />
votre opulence et votre générosité. Et ceci vous porte encore<br />
préjudice. L’on appelle excès ce qui fait votre force, et votre<br />
abondance se transforme en obésité.<br />
Il faut parfois penser en égoïste car ce n’est pas toujours<br />
mal pensé. Faut-il être aux yeux d’autrui ? Faut-il que l’autre se<br />
pose en tant que juge ? Je ne saurais condamner l’acuité critique,<br />
cette sorte de lucidité qui fait souvent défaut à l’homme qui ne<br />
peut être et se voir sous toutes ses dimensions. Je conseillerai<br />
toutefois de se fier à son propre sérieux, qui est le plus souvent un<br />
superbe ange gardien. Certains appellent cette sorte d’allégorie, la<br />
conscience, tout simplement.<br />
117
Fragment sur la poésie<br />
Rester en soi, au plus profond de son aptitude, et ne<br />
jamais faire sortir l’activité de son génie, même dans une société<br />
limitée à quelques initiés, voilà l’une des caractéristiques de ce<br />
genre particulier qu’est la poésie. Cette création libre, hors de<br />
toute contrainte sociale ou de règles établies ne peut s’épanouir<br />
dans une situation extérieure.<br />
L’homme et le poète, deux personnes en une seule,<br />
capable de se dédoubler, d’échapper à la préoccupation pratique<br />
peuvent donc penser ou concevoir par l’observation du monde<br />
extérieur ou par l’activité créatrice interne. Son aptitude directrice<br />
qui le pousse à écrire lui offre un immense sentiment de liberté<br />
mêlée à une vérité autarcique et personnelle. Il n’est donc pas<br />
affranchi de toute nécessité matérielle, mais il lui faut trouver des<br />
espaces temporels de liberté durant lesquels il pourra développer<br />
son aptitude inventive.<br />
Difficile de prétendre connaître la courbe évolutive de<br />
l’intelligence poétique, et certifier que telle période de l’existence<br />
est plus favorable que telle autre pour obtenir une production de<br />
118
qualité. La raison voudrait que la période de jeunesse associée à la<br />
maîtrise de la bouillonnante activité offrît les meilleures<br />
conditions pour l’écriture. Mais cette vérité peut être objectée par<br />
grand nombre d’autres considérations. Si la vieillesse est<br />
dépourvue d’intuition et d’énergie, elle possède du moins la<br />
maturité et l’expérience lui permettant d’avancer à pas assurés<br />
dans l’élaboration de son œuvre. Et l’on peut songer à l’admirable<br />
poème conçu par le vieil Homère, ou relire des œuvres de Goethe<br />
obtenues à l’apogée de sa vie.<br />
119
Blocage de la transmission poétique<br />
La poésie a perdu son caractère initial qui est de<br />
fabriquer des images. Elle ne peut plus rivaliser avec les nouvelles<br />
formes des techniques modernes, qui elles sans difficulté aucune<br />
offrent à l’intelligence la certitude d’une évasion à moindre effort.<br />
L’association audacieuse, au-delà du réel, du possible ou de<br />
l’imaginable pénalise et interdit à la capacité poétique de<br />
l’amateur de pénétrer le plus souvent le monde créé par l’auteur.<br />
Il y a une sorte de barrage, de blocage, et le texte donné reste<br />
hermétique, en quelque sorte inaccessible. Il ne peut donc y avoir<br />
plaisir immédiat ni plaisir retardé, car la dialectique proposée<br />
interdit toute communication entre le poète et l’amateur. Elle n’a<br />
plus aucune vérité, pas même onirique. Son essence abstraite ne<br />
saurait être transmise et comprise. Elle a une apparence de<br />
fausseté, de mensonge et d’invraisemblance. Le public lui préfère<br />
d’autres modes d’expression. Ce n’est pas seulement au niveau de<br />
la lecture que s’opère le blocage. Il serait identique dans le parlé,<br />
dans le transmis à l’oreille : l’intelligence ne saurait convertir des<br />
solutions d’images en images émotives pour l’esprit.<br />
120
Morceau<br />
Difficile de prétendre savoir quel est le but de la poésie.<br />
Certains assurent que la poésie n’a pour but qu’elle-même, et ceci<br />
est pensée de parnassien. D’autres qu’elle doit charmer, élever ou<br />
instruire. Qui a raison ? Qui peut se prévaloir d’en tirer son<br />
essence réelle ?<br />
Il est plus délicat de lui conférer une existence pratique,<br />
utile à l’ensemble. Elle nourrit l’élite, instruit l’esprit supérieur.<br />
L’homme, au for de lui-même, cherche à purifier sa pensée, et<br />
l’expression poétique lui offre un instrument parfait de<br />
sanctification. L’association de vocables employée veut atteindre<br />
une hauteur et son mode d’expression se distingue de tout autre.<br />
121
CHAPITRE CINQUIÈME<br />
122
De Dieu<br />
De Dieu, de l’intelligence de coeur<br />
Je ne sais plus quel homme stupide a osé dire que Dieu<br />
n’existait pas, comme si c’était une raison d’être aveugle aux pays<br />
des voyants ; comme s’il fallait se crever les pupilles pour se<br />
prétendre libre de penser ! Cette liberté-là ne permet pas de<br />
marcher, mais d’avancer en tâtonnant pour tomber dans le<br />
précipice. S’il faut croire en Dieu, ce n’est certes pas avec<br />
prudence, mais avec toute la puissance de conviction qui est en<br />
soi. Il n’y a pas deux juges, il n’y en a qu’un, et c’est Dieu. Quant<br />
à l’homme, s’il se prévaut de pouvoir choisir, il ignore qu’une<br />
immense programmation a déjà balisé son chemin. Tout ce que<br />
nous accomplissons a été pensé, pré-imaginé - nous ne sommes<br />
que la confirmation d’une phénoménale loi planifiée dans les<br />
moindres détails.<br />
Quand un homme construit un pont, érige un mur, il<br />
accomplit un nombre considérable d’études et de vérifications. Il<br />
connaît avec exactitude le coût du chantier, le but à atteindre, la<br />
finalité escomptée, - et l’on voudrait que la sagesse divine<br />
123
n’atteigne pas le bout du nez de la compétence humaine ! Comme<br />
cela paraît ridicule, et semble mépriser la capacité d’un être doué<br />
d’une gigantesque compétence !<br />
Qui donc peut juger et considérer Dieu ? Peut-on juger<br />
Dieu et prétendre savoir ce qu’il fallait faire ? Le pot dit-il au<br />
potier, - je vaux plus que toi ? La prudence est de craindre les<br />
grands. C’est sagesse d’homme et d’animal. Craindre, c’est se<br />
protéger de toutes les embûches et de toutes les erreurs. La<br />
témérité mène tout droit au tombeau. L’acte de bravoure est<br />
orgueil de soldat. Mais le soldat perd sa vie pour trois fois rien, le<br />
plus souvent.<br />
Mais Dieu est-il peut-être l’objet de sentiments opposés,<br />
de conceptions critiquables car encore incomprises ? Je sais Dieu,<br />
et je vois tant d’hommes souffrir, tant de femmes et d’enfants<br />
vivre dans des conditions détestables, que j’en suis à condamner<br />
ces existences de misère, sans parler de ces immenses guerres et<br />
du génocide du peuple élu. Il n’est guère d’homme dont la<br />
conscience ne se révolte contre ces abominations.<br />
L’homme de religion, à cet égard, doit faire preuve d’une<br />
formidable acceptation : glorifier une puissance sans en<br />
124
comprendre les desseins fondamentaux. Il faut donc parvenir à<br />
servir sans connaître réellement le sens de son travail. À travers la<br />
lecture des livres sacrés, la pensée prétend se consolider, savoir et<br />
déduire. Mais le plus souvent elle emprunte une voie qui la mène<br />
vers une interprétation douteuse ou erronée. Parfois des fantaisies<br />
enfantines suffisent à engendrer des comportements dans le culte<br />
divin. La théologie prétend posséder la vérité avec ces exégèses,<br />
ces savants qui ne sont que des hommes s’essayant encore au jeu<br />
de l’interprétation. Mon Dieu, que ces hommes prennent des<br />
risques ! Même doté de la lumière du Saint-Esprit, je prétends<br />
qu’il est toutefois difficile de ne pas commettre d’énormes<br />
bévues.<br />
Ce monde dans lequel nous vivons, n’a jamais été<br />
véritablement compris. Les plus grands physiciens, tous les deux<br />
siècles nous apportent une loi fondamentale nouvelle. Nous<br />
sommes fascinés par le travail de la nature et n’en connaissons<br />
que fort mal les mécanismes. Ce spectacle nous émerveille, mais<br />
nous sommes incapables d’en découvrir l’essence. Pourtant nous<br />
nous targuons en exploitant des livres difficiles non seulement de<br />
spéculer sur l’au-delà, mais d’en connaître les structures.<br />
125
Voilà qui est audacieux ! Certains, fanatiques, exploitent<br />
des pseudo-vérités pour torturer ou soumettre leurs congénères !<br />
Jusqu’où n’ira pas la folie de l’homme ! Mais cela a déjà été écrit<br />
par d’autres que moi-même, avec une qualité de style plus<br />
brillante, à n’en pas douter.<br />
Pourtant il faut croire aux miracles. Cela confère à notre<br />
esprit un espoir d’avenir après la mort. Et cette sécurité pour l’audelà<br />
augmente le plaisir de nos sens par la jouissance qu’il<br />
procure. Ainsi la nature nous semble favorable et pleinement<br />
satisfaisante. Les bienfaits de l’homme n’ont pas d’avenir. C’est<br />
peut-être de l’intelligence d’anticipation que de se projeter vers le<br />
futur en méprisant le quotidien.<br />
Et l’on voit peu l’intérêt de la femme dans ce cas de<br />
spéculation. S’il est vrai que l’amitié disparaît, que les êtres chers<br />
s’éloignent les uns des autres, que les enfants s’en vont ailleurs,<br />
plus loin, - le système de valeurs et l’amour qui en découle paraît<br />
bien incertain. On s’en retourne encore à une situation égoïste où<br />
la seule Force à glorifier est celle de Dieu.<br />
Les épouses du Christ l’ont compris, elles qui délaissent<br />
leur mission de femme, pour s’unir à un Dieu, éternellement.<br />
126
Elles ont certainement pressenti cette nécessaire union entre les<br />
éléments de la nature et leur créateur. Il s’agirait en quelque sorte<br />
de l’unification de l’esprit de Dieu à travers l’univers. Un<br />
immense message de communication et de fraternité entre les<br />
êtres et les choses visibles et invisibles de l’espace.<br />
Il est toutefois difficile de déterminer le degré de parenté<br />
entre toutes les formes de vie et d’esprit dans la nature. La<br />
communion pourtant pourrait être parfaite à l’image d’une société<br />
où chaque élément est une partie intégrante et indispensable à<br />
autrui.<br />
Ainsi renaît l’espérance d’une immense osmose entre tous<br />
les êtres vivants visibles ou non, du présent et de l’avenir. Il faut,<br />
je le reconnais, faire toutefois preuve d’une grande foi et<br />
interpréter d’une certaine manière les choses de la nature pour<br />
raisonner de la sorte.<br />
La finalité de cette douteuse démonstration est encore de<br />
convaincre l’homme d’aimer l’homme, - je dis aimer avec<br />
sincérité et non pas avec la crainte du châtiment divin, malgré les<br />
excès et les désordres, les passions dont toute société se sait ivre.<br />
127
Ceux qui parviennent à aimer leurs ennemis vont au-delà de ce<br />
qui provoque la répulsion et le dégoût. Ils sont pleinement dans le<br />
coeur de Jésus-Christ. Cela dépasse la charité. La pensée<br />
théologique a rarement imposé à ses adeptes d’atteindre ce degré<br />
de perfection. C’est pourquoi cette conception de l’amour semble<br />
la plus belle. Elle est plus grande que la charité, elle est<br />
l’intelligence du coeur, et peu se prévalent d’en être pourvu.<br />
Pourtant toutes ces spéculations audacieuses sur Dieu,<br />
sur la foi, l’espérance et la charité ne sont-elles pas de fausses<br />
lumières qui tentent d’éclairer ici et là mais ne dirigent que vers<br />
l’ombre, en vérité ?<br />
128
De la grandeur du Saint-Esprit<br />
Les spécialistes de la religion chrétienne n’ont guère pu<br />
traiter de la vérité de l’Esprit de Dieu, n’ayant à leur disposition<br />
qu’une quantité infiniment ridicule d’informations concernant ce<br />
sujet. Le Talmud des Juifs associe le Saint-Esprit à la Chekina,<br />
qui serait la présence de Dieu à côté de Dieu. Lorsque Dieu au<br />
commencement de la Bible écrit : “ Faisons un homme à notre<br />
image. ” Il semble s’adresser à la communauté d’Anges qui forme<br />
sa cour, mais en y réfléchissant de plus près, on peut y déceler<br />
dans ce Faisons deux personnalités distinctes et pourtant<br />
identiques, une sorte de dédoublement de soi-même, qui pourrait<br />
indiquer la représentation du Saint Esprit à côté du Père. Cette<br />
grandeur d’âme, cette sorte de supra conscience à côté du Père<br />
étant juge de tout, semble au-dessus de tout. Il aurait la capacité<br />
de mesurer avec exactitude la valeur des choses, sans indulgence<br />
mais sans sévérité, avec la raison parfaite de la pure intelligence.<br />
Cette supra conscience de Dieu semble moins active que le Père -<br />
car s’il n’est pas le créateur de toutes choses, il en est la critique,<br />
l’observation et la parfaite analyse.<br />
129
J’y vois aussi une immense humilité, une volonté de<br />
retrait et de discrétion que l’on ne trouve ni chez le Père ni chez le<br />
Fils. Sur les tables de la Loi remises à Moïse, le Père indique<br />
clairement qu’il interdit toute représentation de sa propre<br />
personne. Le Fils suivant l’exemple du Père aurait dû interdire<br />
l’imitation de son image. Or, il n’est pas un village reculé, une<br />
infime place d’un hameau, où l’on ne voit l’image crucifiée du<br />
Fils. Le Père lui-même s’étale dans de nombreux musées, tandis<br />
que personne ne semble l’avoir vu, et donc n’en peut prétendre la<br />
reproduction. Il en va tout autrement du Saint-Esprit. On ne peut<br />
l’identifier qu’à une colombe et là est son unique gloire ! Il est à<br />
supposer qu’un Dieu vaut plus qu’un volatile.<br />
On ne peut non plus prétendre connaître le timbre de sa<br />
voix. Il est aisé d’imaginer le langage employé par le Christ -<br />
c’était l’Araméen. Il est plus audacieux de soupçonner connaître<br />
la voix du Père. On l’associe à la colère, à la violence, au feu, au<br />
volcan, au chant délicat de la source. On peut supposer que le<br />
Père exploite un autre mode d’expression non pas imitant le<br />
langage des hommes, mais adapté à sa spécificité divine.<br />
Que savons-nous réellement de l’Esprit de Dieu ? Il<br />
appartient à la Trinité. Jésus-Christ en venant sur terre a dit : “ Il<br />
130
n’est pas UN, mais nous sommes TROIS. ” Il est donc élément<br />
intégrant la famille divine. Dieu de lumière, Dieu de gloire,<br />
constitué des mêmes éléments que le Père, c’est une Force qui a<br />
participé à la construction de l’espace. On peut donc dire qu’il est<br />
le Frère de Dieu, le frère spirituel, ou le grand frère. Le paradoxe<br />
de sa grandeur est d’obéir à la pensée du Fils. On peut lire (Jean<br />
16,7) :<br />
“ Pourtant je vous dis la vérité :<br />
il vaut mieux pour vous que je parte ;<br />
car si je ne pars pas,<br />
Le Paraclet ne viendra pas à vous ;<br />
mais si je pars,<br />
je vous l’enverrai. ”<br />
131
Le Parfait<br />
Dieu est donc la représentation du parfait. Il s’agit de le<br />
considérer petit de taille, et immense dans sa réalisation. Il faut<br />
aussi l’imaginer en un lieu qui pourrait s’apparenter au Saint<br />
Sanctuaire, et tenter de supposer son rapport avec les choses<br />
visibles et invisibles qu’Il prétend dominer. Il faudrait aussi tenter<br />
de comprendre quel est son rapport mécanique ou actif avec les<br />
objets qui l’entourent. Encore est-il nécessaire de prétendre qu’il<br />
habite le même espace-temps que les objets qu’il a produits. Et<br />
voilà la grande difficulté à laquelle est soumis tout spéculateur. Il<br />
suppose d’après des éléments aléatoires mis à sa disposition. S’il<br />
construit sur une théorie de l’erreur, il ne s’en doute pas et ne veut<br />
en démentir. S’il travaille avec l’outil biblique, il jugera en la<br />
vérité des Saintes Écritures. Alors que faire ?<br />
Dieu est lumière, et tous s’accordent sur ce point. La<br />
lumière serait donc un principe d’intelligence, de vie et<br />
d’immortalité. Cette énergie-là conférerait des propriétés qui<br />
engendreraient du pouvoir.<br />
132
Dieu n’est pas toujours dans l’âme ou dans le coeur, car<br />
il existe autant d’hommes à ne rien croire que d’hommes à croire<br />
en quelque chose. Si tous considèrent qu’il y a une organisation à<br />
l’échelle de la nature, quand certains y voient la preuve de Dieu,<br />
d’autres n’y décèlent qu’un élan vital biologique.<br />
133
Le mystique<br />
Le mystique est un homme de raison, qui a pu juger par<br />
ses sens et accéder à une expérience paranormale unique,<br />
rarissime dans son fait et difficilement renouvelable. Et c’est la<br />
rareté de son expérience qui engendre chez autrui le doute<br />
concernant la véracité de ce fait.<br />
Imaginons un papou indigène, ignorant tout de la<br />
civilisation occidentale, - s’il aperçoit un objet volant tel un avion<br />
de transport, s’il observe attentivement le déplacement de cet<br />
objet, il ne pourra prétendre avoir été berné par la qualité de ses<br />
sens. De retour dans son village, s’il raconte son histoire, il peut<br />
ne pas être cru par le reste de la communauté, qui ne verra en lui<br />
qu’un sinistre fabulateur en proie à l’ivresse de quelques<br />
champignons hallucinogènes.<br />
Le mystique est donc un homme qui a une expérience<br />
exceptionnelle avec l’inconnu, avec l’inexplicable. Il entend des<br />
voix, assiste à des manifestations quasi-divines et choisit le plus<br />
souvent de conserver le silence plutôt que de se savoir la risée de<br />
ses contemporains. Il en arrive même à taire à ses supérieurs le<br />
134
phénomène fantastique qu’il a éprouvé. Le silence, la certitude de<br />
Dieu en son for intérieur lui semblent plus raisonnables : il craint<br />
parfois que l’interprétation de son expérience ne soit jugée<br />
comme étant une volonté délibérée de surestimer sa “ valeur<br />
humaine réelle. ” Car c’est bien se grandir que de prétendre<br />
communier avec la Vierge, avec un Dieu ou avec le Christ. Le<br />
voilà dans son immense solitude, enrichi d’une expérience<br />
phénoménale, qui grandit sa foi, mais le marginalise dans la<br />
communauté.<br />
Je ne suis pas loin de penser que nombre de sœurs qui<br />
ont épousé Jésus-Christ, de prêtres qui ont fait vœu d’abstinence,<br />
ont quelque part eu un rendez-vous pour un immense témoignage<br />
avec un principe de l’Au-delà. Mais l’humilité de leur coeur a<br />
préféré ne rien dévoiler, ne rien divulguer, n’imitant pas en cela<br />
un simple racontar de secrets.<br />
Car il s’agit d’un secret qui veut certifier la vérité d’une<br />
vie après la mort, d’une existence hors de l’enveloppe charnelle,<br />
là où règne l’Esprit. Nous descendons à présent dans le commun<br />
des mortels. Grand nombre de personnes, fort raisonnables,<br />
pourvues de bon sens populaire, ont éprouvé lors d’un décès la<br />
certitude perceptible de phénomènes paranormaux tels la présence<br />
135
à leurs côtés du proche disparu. L’analyse médicale prétend que<br />
tout cela découle du travail du décès, qui ne s’appuie sur aucune<br />
explication rationnelle.<br />
Je prétends que c’est par cet endroit que l’on pénétrera le<br />
mystère d’une possible survie après la mort. La religion a suscité<br />
autant de vocations qu’elle a fabriquées d’incrédules.<br />
Le mystique dit : “ Je crois parce que j’ai vu, parce que<br />
je sais. ” Le prêtre dit : “ Croyez car cela est écrit dans la Bible. ”<br />
Pascal dit : “ Pariez pour Dieu, vous n’avez rien à perdre. ”<br />
L’homme de science demain dira peut-être : “ Vous pouvez croire<br />
en Dieu, car il y a une forme de vie après la mort. ”<br />
136
Révélations sur l’au-delà<br />
Il faut ici considérer la détermination divine avec un oeil<br />
rationnel, sans aucune concession pour la religion. Il la faut donc<br />
voir avec la certitude et la logique des moyens dont nous<br />
disposons.<br />
Jetons tout d’abord à la poubelle de la facilité la<br />
croyance sans la preuve, la croyance du coeur ou de l’enfant. Je<br />
ne dispute point sur sa beauté ni sur son fondement réel, mais je<br />
l’exclus car s’il est preuve en soi, il ne saurait être vérité<br />
universelle.<br />
Les hommes de religion m’accorderont le droit pour le<br />
développement de ce raisonnement, quand bien même il nierait<br />
dans un premier temps l’existence du Fils et du Père, d’exploiter<br />
cette manœuvre fort utile dans les démonstrations mathématiques.<br />
J’ai détenu entre mes mains, voilà déjà presque vingt<br />
ans, un livre fort lumineux, traduit de l’américain et qui<br />
maintenant est accessible pur les petites bourses en collection bon<br />
marché. Le titre de l’ouvrage : “ La vie après la vie. ”<br />
137
Je dois reconnaître que durant ma période d’adolescence,<br />
j’étais curieux des choses inconnues et paranormales. Je<br />
m’intéressais à la parapsychologie, au déplacement d’objet à<br />
distance, à la transmission télépathique et autres étonnements.<br />
J’avais lu des endroits extraits d’une revue, et la publicité ayant<br />
fait preuve d’efficacité, je décidai de commander le livre.<br />
Dans les années soixante-dix, soixante-quinze, aux<br />
États-Unis, d’énormes progrès avaient été réalisés dans la<br />
réanimation des patients. Il était déjà possible à cette époque de<br />
ramener à la conscience des individus en situation de comas<br />
dépassés. Un médecin plus attentif que les autres avait remarqué<br />
que d’étranges témoignages qui se recoupaient, offraient des<br />
similitudes de détails et d’explications concernant des histoires<br />
abracadabrantes.<br />
La plupart de ces patients prétendaient être sortis hors de<br />
leur corps physique, avoir entendu des voix les appelant, des voix<br />
de l’au-delà ou de proches disparus, s’être engouffrés dans une<br />
sorte de tunnel, et pour certains même avoir pu accéder à une<br />
source de lumière qu’ils identifiaient à Dieu ou au Christ.<br />
138
Il est évident que cela peut surprendre, et l’on prétend le<br />
plus souvent que ces états hypnotiques engendrent par le travail<br />
du cerveau des hallucinations bien connues. Mais les témoignages<br />
étaient concordants et l’hallucination si elle se nourrit de la<br />
mémoire de l’esprit, donc possède une valeur individuelle précise,<br />
ne peut revêtir un habillage collectif.<br />
Ce docteur a donc entrepris une enquête et n’a pas hésité<br />
à questionner certaines personnes qui n’osaient, de crainte de<br />
passer pour ridicules, de dévoiler leur témoignage. La recherche<br />
ne faisait que confirmer ce qui déjà avait été dit.<br />
Je n’ose croire que ce montage ne soit que pure fantaisie<br />
et qu’il ait été inventé pour vendre du papier. Je pense<br />
sincèrement qu’un grand secteur d’investigation s’offre à<br />
l’intelligence humaine, et lui permettra certainement de mieux<br />
pénétrer dans le mystère de la vie après la vie, et de la<br />
métaphysique divine.<br />
Nous voilà donc dépourvus de toute croyance sans<br />
preuve quantifiable. Nous rejetons la certitude du coeur et<br />
pénétrons par la démonstration scientifique, dans l’un de nos plus<br />
éminents problèmes : l’existence de Dieu.<br />
139
Rappel<br />
Je me suis évertué dans mes recherches personnelles à<br />
tenter d’accéder au mystère et au paranormal, non pas que la<br />
curiosité me poussa vers cette forme irrationnelle et inconnue,<br />
mais je pourrais dire que le phénomène inexpliqué est venu à moi.<br />
Emprunter cette voie est hautement difficile. Elle n’est<br />
composée que d’indices, que de perceptions non renouvelables, et<br />
si elle possède quelque intérêt pour un esprit, elle est toutefois<br />
rejetée par l’immense majorité des rationalistes. La raison ne doit<br />
pas se laisser emporter par de vaines apparences, non. Elle doit<br />
constamment faire preuve de rigueur et de volonté pour ne pas<br />
s’embarquer vers des destinations sans but. Une intelligence<br />
responsable s’aperçoit que seule cette méthode peut le conduire à<br />
la vérité et à la connaissance.<br />
Il faut donc employer l’esprit de science, le seul<br />
réellement capable d’offrir une sécurité de certitude.<br />
L’expérience doit se concilier avec l’évidence absolue, et<br />
constamment s’entretenir avec la raison.<br />
140
Mysticisme et paranormal<br />
La forme nouvelle dans laquelle la vérité doit exister, ne<br />
peut être que le paranormal et le mysticisme.<br />
Il est vrai que cela contredit la pensée fondamentale de<br />
la certitude dite scientifique, qui dans ce siècle rationnel à la<br />
technique appliquée n’a fait que d’affirmer le contraire. Il y a là<br />
tout un gisement d’une richesse inouïe qui nécessite évidemment<br />
un nettoyage ou une purification, - mais qui par son contenu et les<br />
questions qu’il pose - veut offrir à l’intelligence rationnelle tout<br />
un espace d’apprentissage et de compréhension. Ne peut-on pas<br />
aborder le problème de la voyance à travers une étude scientifique<br />
circonspecte ? Vérifier aux moyens de fréquences, de statistiques,<br />
de probabilité afin d’abolir la loi du hasard, vérifier l’exactitude<br />
des faits avancés ? Dans le domaine du mysticisme, serait-il<br />
stupide d’analyser avec rationalité des témoignages d’hommes de<br />
bon sens, qui cent fois pourraient répondre parfaitement aux<br />
questions ordinaires ou spécifiques, et qui affirment toutefois la<br />
vérité d’une communication paranormale ? Ces cobayes<br />
141
accepteraient-ils de bonne grâce de se soumettre aux tests de<br />
détecteurs de mensonges ou de “ pain ” total<br />
142
La vérité biblique<br />
Il ne faut pas confondre interprétation humaine d’un<br />
Livre transmis par un Dieu, et vérité définitive et immuable. Il<br />
s’agit ici d’intégrer le développement progressif de la vérité, et de<br />
comprendre que la nature conserve un nombre considérable de<br />
secrets, que l’intelligence humaine n’en est qu’à ses<br />
balbutiements dans la connaissance, et que ce qui peut apparaître<br />
comme une contradiction n’est qu’un passage de l’ombre à la<br />
lumière, du boisseau tamisé à la réelle clarté.<br />
La certitude qui s’en dégage n’est qu’une affirmation du<br />
moment. En ce sens, le vrai et le faux ne s’opposent pas dans la<br />
détermination commune, mais avancent tous deux dans la<br />
direction du progrès. Il n’est donc pas question de rejeter en bloc<br />
l’ensemble de l’ouvrage sous prétexte qu’une explication semble<br />
contredire l’usage donné à la vérité.<br />
Ce n’est pas ainsi que l’on comprend la contraction dans<br />
le système mathématique basé sur des 1 et des 0, des affirmations<br />
et des négations. Il n’est admis que l’une ou l’autre de ces<br />
143
attitudes, - ce qui refuse le progrès dans le savoir et exclut toute<br />
évolution sensible.<br />
144
CHAPITRE SIXIÈME<br />
145
Divers<br />
Continuité d’un monde occidental<br />
Il est facile de voir que notre monde est un monde<br />
capitaliste qui ne subit aucune modification dans son principe, et<br />
qui certainement se poursuivra de la sorte dans les prochaines<br />
décennies. La pensée capitaliste s’impose et se positionne dans les<br />
pays de l’Est. C’est là un immense succès pour le leader ship<br />
américain.<br />
Certes, il y a des modifications, des transformations<br />
étonnantes liées en grande partie à l’émergence de certains<br />
marchés à croissance rapide, mais la pensée occidentale semble<br />
s’imposer et régner dans un monde de libre-échange où la<br />
puissance des banques et des multinationales se fortifient et se<br />
renforcent. Les progrès accomplis dans les domaines des<br />
techniques engendrent des évolutions et non pas des révolutions<br />
de comportements.<br />
Le grand perdant de cette crise économique qui a vu le<br />
jour en 1973 avec la guerre du Kippour et dont les effets de<br />
146
estructurations semblent en grande partie être accomplis, - le<br />
grand perdant, disais-je, me paraît être le parti ouvrier occidental.<br />
Des millions d’hommes et de femmes quémandent le droit au<br />
travail, d’autres vendent leur force pour des mi-temps avec des<br />
salaires dérisoires, d’autres encore sont sans logis et errent des<br />
journées entières marchant avec enfants pour quelques-uns dans<br />
les rues de la ville. Tout cela est pitoyable, et peu digne d’une<br />
société se prévalant d’être l’une des plus riches au monde.<br />
Le nombre d’adhésions aux syndicats ne cesse de<br />
baisser, l’ouvrier frileux et replié sur soi-même craint pour son<br />
emploi, et préfère se taire plutôt que d’intervenir et voir son poste<br />
supprimé.<br />
Il faut donc se satisfaire d’un revenu dérisoire, en peau<br />
de chagrin et l’on prétend encore que pour résoudre le problème<br />
du chômage, le partage du temps de travail s’avère nécessaire. On<br />
propose une diminution du temps de travail accompagnée<br />
évidemment d’une diminution de salaire, donc du pouvoir<br />
d’achat.<br />
Dans le même temps, les profits réalisés par les<br />
entreprises sont en hausse constante. La balance commerciale de<br />
147
la France tire des excédents jamais atteints. Si les grandes<br />
reconstructions ont déjà été accomplies dans d’importants<br />
secteurs, si le dégraissage a été effectué, la bonne santé de ces<br />
entreprises qui progressent en profit n’a pas encore entraîné la<br />
moindre création d’emplois d’ouvriers ou de techniciens qualifiés.<br />
Le profit va au profit, et nulle relance pour l’économie.<br />
Les ménages ne peuvent consommer, faute de moyens financiers.<br />
Les capitaux dans une certaine mesure, se placent à taux élevé sur<br />
les bourses étrangères. La France s’essouffle. Le gouvernement<br />
tant bien que mal, plutôt mal que bien d’ailleurs, propose aux<br />
bénéficiaires de PEP d’utiliser les sommes bloquées dans les<br />
contrats, et cherchent à convaincre les Français de tirer dans leurs<br />
bas de laine leurs faibles économies pour relancer la demande par<br />
la consommation. Tout cela prête à rire.<br />
L’Allemagne, notre colossal partenaire, prévoit une<br />
croissance de son PIB de 0,5 à 1 % pour l’année 96. Le Japon ne<br />
resplendit guère mieux, et de grands centres de statistiques<br />
assurent une augmentation du produit intérieur de 0,5 % pour<br />
l’année fiscale qui va débuter.<br />
148
Que faire dans une conjoncture occidentale si difficile ?<br />
Et quel peut être l’espoir et l’avenir du monde ouvrier dans de<br />
telles circonstances internationales ?<br />
Je l’écris - c’est bien la continuité du monde occidental,<br />
l’on y terrasse l’ouvrier, l’on y soumet les techniciens et le<br />
personnel d’encadrement à des rendements excessifs. L’homme<br />
au chapeau clap et au gros cigare semble réellement avoir gagné<br />
son tour de bras de force avec l’ouvrier. Ce dernier est miné,<br />
soumis à quémander quelque obole pour survivre. Et je ne vois<br />
guère de possibles évolutions de changements. Cela risque de<br />
durer longtemps ainsi encore.<br />
149
Second degré<br />
N’est-ce pas une chose difficile que d’avoir constamment<br />
des étrangers autour de soi et d’être dans l’obligation de subir leur<br />
présence ? Toutes les différences de peau, de faciès, de couleur et<br />
de culture ajoutent encore à cette contradiction. On ne peut pas<br />
même s’échanger les plus infimes propos. Aux temps bénis des<br />
colonies, comme l’a chanté Michel Sardou, le relationnel était<br />
tout autre : c’était un rapport dominant/dominé. Le noir obéissait<br />
à l’ordre du blanc - un point, c’est tout. L’ensemble était compris,<br />
admis, appliqué. La suprématie de la race blanche s’imposait et<br />
semblait faire bénéficier de sa compétence la race noire, c’est-àdire<br />
la race inférieure. Remarquez qu’il n’y avait pas de haine. De<br />
vraies amitiés pouvaient même se nouer. De splendides dou dous<br />
aimaient leurs bons maît’es, pleines de reconnaissance pour les<br />
gages qu’ils leur octroyaient. Il n’y avait là ni haine ni violence,<br />
ni explosif ni dynamite.<br />
On s’étonne parfois que pas un chef politique, pas un<br />
leader d’opposition à l’exception peut-être de Jean-Marie Le Pen<br />
n’ait agité l’étendard de la colonisation, du big back to the blacks.<br />
Chacun y trouverait profit : les malheureux et les pauvres, les<br />
150
crève-la-faim à qui l’on apprendrait à semer, les sidaïques à qui<br />
l’on apprendrait à bien mourir. Car pour tout vous dire, ils sont<br />
des millions et des millions en Ouganda et pays limitrophes à être<br />
contaminés par l’HIV.<br />
Il s’agit ici de solidarité à l’échelle planétaire. Mais les<br />
états, les tribus se replient sur eux-mêmes et refusent de participer<br />
à cet immense élan de générosité. Certains prétendent que l’on a<br />
assez donné, d’autres que l’on n’a pas assez pris. Prendre,<br />
donner... c’est échanger.<br />
L’on voit toute l’utilité du commerce pour une<br />
civilisation. Le commerce rend prospère et cette prospérité est<br />
mère de nombreuses vertus.<br />
Nous-mêmes, ne devons-nous pas subir la domination de<br />
la race jaune qui nous surpasse dans tous les domaines de la<br />
technique appliquée, qui est en avance sur nos précédés et sur<br />
notre connaissance ?<br />
bouclée.<br />
Cela serait un bon retour des choses, et la boucle serait<br />
151
De la femme<br />
Est-il bon de se répandre dans la chair des femmes,<br />
d’épuiser sa semence vitale pour accéder à quelques instants de<br />
plaisir ? On prétendra qu’il est dans la nature de l’homme d’aller<br />
et venir dans le corps de sa compagne afin d’y générer un soimême<br />
qui lui ressemblera.<br />
Ne serait-il pas plus raisonnable de se défaire par un acte<br />
masturbatoire du trop plein qu’engendrent notre hypophyse ou<br />
nos glandes sexuelles, de se débarrasser de cet amas visqueux et<br />
gluant que le pénis secoue et expulse dans des contorsions<br />
étranges ?<br />
Quelqu’un s’est-il essayé de comptabiliser toutes les<br />
heures perdues à courir, supplier, quémander ou implorer aux<br />
pieds de sa femme ou de sa maîtresse ? Est-il possible de<br />
déterminer le nombre de conflits, d’embarras, de violence ou<br />
d’excès que peut entraîner la présence de la femme à ses côtés ?<br />
Je suppose que grand nombre de philosophes par raison<br />
ou par expérience ont dû apprécier à leur manière cette<br />
152
interrogation, et sachant y répondre ont préféré la solitude à la vie<br />
en commun avec une compagne.<br />
153
De la critique littéraire<br />
Est-ce vraiment raisonnable de s’essayer au jeu<br />
divertissant de l’écriture ? De s’amuser à construire des<br />
structures, associant des substantifs à des adjectifs pour obtenir de<br />
beaux accords ? Sont-ils beaux d’ailleurs, ces accords ? Qui<br />
pourrait juger de la qualité stylistique ainsi obtenue ? Quel artiste,<br />
grand amateur de beau, quel critique à la plume virulente, pourra<br />
se prévaloir de posséder la vérité dans l’exercice de l’art ?<br />
Pourtant chacun se prétend pourvu d’une quantité<br />
appréciable de vérité dans l’analyse d’autrui. “ Cette certitude est<br />
le fruit de l’expérience, disent certains. Voilà, déjà trente ans que<br />
je lis de la poésie, de la prose ou du roman. Je sais donc ce qui est<br />
bon et ce qui est mauvais. Je puis aisément séparer le grain de<br />
l’ivraie, et je vous certifie, mon cher ami etc... ” Combien de gens<br />
de bonne foi ai-je pu entendre s’exprimer de la sorte, et tous<br />
avaient la conviction comme une croix autour du cou.<br />
J’ai appris qu’il était impossible de savoir qu’untel était<br />
doué et que tel autre était un triple nigaud. Que l’œuvre de celui-<br />
154
ci passera à la postérité tandis que l’œuvre de celui-là sera jetée<br />
au plus profond des oubliettes.<br />
L’histoire de la littérature est composée d’incapables, de<br />
rejetés, d’ignorés de leur temps présent, qui aujourd’hui<br />
instruisent et nourrissent les enfants de l’éducation nationale.<br />
155
Sur la mort<br />
En vérité, il y a pour l’espèce humaine deux espaces -<br />
temps bien définis. Le premier, qui se conçoit de lui-même, c’est<br />
celui dans lequel nous vivons où le temps est mesuré de façon<br />
précise. Cet espace est palpable, il est quadridimensionnel, et<br />
l’homme y est fait de chair. L’une des caractéristiques de cet<br />
espace, c’est la difficulté que rencontre l’homme à s’y mouvoir -<br />
difficultés de substances matérielles, difficultés corporelles et<br />
difficultés spirituelles. On peut dire de façon amusante que<br />
l’homme est une tortue avec sa carapace, ses contraintes et son<br />
poids. Mais que la tortue vienne à atteindre l’eau, et elle se<br />
déplacera à la vitesse de trente-deux kilomètres/heure. Et nous<br />
voilà dans le deuxième espace-temps, plus intéressant à pénétrer<br />
et à comprendre. C’est encore l’image de la tortue mais sans sa<br />
carapace, ou l’image de l’homme sans son enveloppe charnelle.<br />
Pour ce faire, pour atteindre ce nouvel espace, il faut donc quitter<br />
son enveloppe charnelle, il faut mourir dans la plupart des cas, car<br />
grand nombre de personnes sont déjà parvenues à sortir hors de<br />
leur corps et à le réintégrer. Il doit y avoir des techniques<br />
relativement simples de yoga permettant d’accomplir cette sortie<br />
hors de soi.<br />
156
Ce nouvel espace-temps peut être assimilé à l’idée<br />
simple que se font les croyants de la vie après la vie, ou tout<br />
bêtement “ le ciel.”<br />
157
De la rigueur mathématique<br />
Quoi de plus incongru, de plus étonnant que de faire<br />
appel à des poètes pour tirer quelques vérités. Ce sont des esprits<br />
remplis de chimères, qui se nourrissent d’images et se languissent<br />
constamment pour des insignifiances et du ridicule.<br />
Ils se prélassent des heures durant sur des divans, ou se<br />
reposent au cabaret et se prévalent de détenir quelques certitudes.<br />
N’est-ce pas insensé que d’utiliser de telles raisons qui parlent<br />
dans de telles bouches pour annoncer le Droit et la Loi ?<br />
Comment est-il possible de comprendre une Force Supérieure<br />
qui a construit avec sa magnifique intelligence ce splendide univers ?<br />
Le voilà qui parle par la bouche de ses prophètes avec des images<br />
poétiques ! Le voilà encore qui sacre le roi des rois - Salomon - et lui<br />
fait rédiger des recueils de sentences !<br />
N’aurait-il pas été plus raisonnable d’utiliser un homme<br />
charpenté de vérités mathématiques sachant pertinemment que 2<br />
et 2 font quatre ?<br />
158
Il est vrai me répond ma malice que dans le principe de<br />
La Trinité un plus un plus un font un.<br />
159
L’état prophétique<br />
Il est assez humain de vouloir comparer la pensée<br />
philosophique à l’image poétique et le lyrisme poétique à l’état<br />
prophétique. Le tout se ressemble et paraît se mêler dans une<br />
mixture intellectuelle sublime ou cocasse. L’accumulation de la<br />
raison s’associe au déversement de l’image, et le tout relié par des<br />
éléments de coordination donne au chant, au chapitre ou au<br />
poème un mouvement qui semble pouvoir s’entendre, - quoique<br />
des résistances de sens s’opèrent ici et là. Mais ne faut-il pas,<br />
pense le lecteur, qu’il y ait en quelques endroits du moins de la<br />
difficulté ? Où serait le plaisir de la compréhension ?<br />
Je prétends et je veux affirmer avec beaucoup de<br />
véhémence que l’état prophétique n’est pas une chimère donnée à<br />
quelque inspiration poétique débrayée, mais qu’il est un choix<br />
puissant et responsable de l’Esprit de Dieu qui confère à l’homme<br />
prédestiné la capacité de servir d’intermédiaire entre Dieu et le<br />
peuple. Entend qui voudra.<br />
160
Du plaisir dans l’apprentissage<br />
Ce qui semble étonnant c’est de voir certains hommes<br />
capables de répéter inlassablement les mêmes actions, les mêmes<br />
comportements, les mêmes déplacements et de s’en bien porter<br />
pour autant. Y aurait-il donc plaisir dans l’obligation de<br />
reproduire un même geste, de concevoir une même pensée ou<br />
d’agir de façon semblable ? Serait-ce de la paresse ou de la<br />
jouissance nonchalante que de balayer son regard sur un paysage<br />
que l’on a déjà vu des milliers de fois, de caresser le corps d’une<br />
femme que l’on possède depuis de longues années ou d’accomplir<br />
la même tâche à son bureau ou dans son atelier ?<br />
Il est peut-être dans la nature de l’homme de se suffire du<br />
fameux steak frites 6 fois par semaine, de regarder la même<br />
émission de télévision présentée par Michel Drucker ou de subir<br />
les fameux embouteillages de fin de semaine.<br />
Car ne faut-il pas condamner cet éternel étudiant qui<br />
toujours à s’instruire, toujours à s’ouvrir sur des mondes<br />
nouveaux, avide de savoir et de connaissance veut encore<br />
apprendre et ne sait jamais rien ?<br />
161
Domaine du défini<br />
On parvient toutefois en mathématique à utiliser un<br />
langage commun qui va au-delà de sa propre langue (l’écriture<br />
mathématique russe est la même que l’écriture mathématique<br />
anglaise), on peut exprimer des concepts, des notions, des<br />
certitudes, des propositions ou des vérités uniquement parce que<br />
l’on travaille dans un espace bien défini, bien régi.<br />
Que l’on vienne à se poser un problème en se déplaçant<br />
d’espace ou de lieu de définition, et la certitude devient doute, et<br />
la vérité est à reconsidérer, à vérifier à nouveau.<br />
C’est le grand privilège du langage mathématique : une<br />
affirmation est vraie parce que l’on raisonne dans un espace<br />
déterminé. Que l’on vienne à changer d’espace etc.<br />
162
Lire ou compter<br />
Je ne me souviens pas avoir éprouvé le moindre intérêt à<br />
lire quelques ouvrages dans mon enfance. La connaissance que je<br />
pouvais en tirer me paraissait le plus souvent ennuyeuse et<br />
astreignante. Je pensais que je parviendrais à acquérir un savoir<br />
précis et utile à ma formation en côtoyant le quotidien, en me<br />
frottant à des adultes, en vérité, en me nourrissant avec les yeux.<br />
J’estimais fort peu la poésie, prétendant que cet art était<br />
plutôt le jeu d’esprits insouciants, dépourvus de rigueur et enclins<br />
aux excès les plus détestables.<br />
Ceux qui s’essayaient à ce genre de discipline me<br />
paraissaient manquer de pensées claires et lucides, n’ayant que<br />
peu de moyens pour persuader et se complaisant dans des<br />
pleurnicheries et des jérémiades sans fin.<br />
Je ne méprisais pas leur habileté à savoir maîtriser la<br />
tournure, et savais apprécier leur manière et leur douceur, mais je<br />
ne pensais pas que cette discipline pût apporter à ma raison<br />
l’équilibre certain qu’elle s’efforçait de trouver.<br />
163
Je croyais en toute évidence, à la sacro-sainte<br />
mathématique - la reine des sciences - à cause de sa certitude et de<br />
l’évidence de ses raisonnements. Je pensais qu’elle n’avait pour<br />
but qu’elle-même, c’est-à-dire sa propre pureté. Je ne voyais<br />
guère l’utilité de ses applications...<br />
164
Quelle méthode ?<br />
Ce que je recherche avec cette méthode - la mienne -<br />
c’est de parvenir en utilisant toute la raison qui est mise à ma<br />
disposition, ou pour le mieux en mon pouvoir, à exploiter les<br />
ressources intellectuelles connues et inconnues. Je commence à<br />
sentir - terme qui ne me convient guère par son manque de<br />
précision - que l’esprit s’essaie peu à peu à tirer de soi de<br />
nouvelles possibilités et de nouveaux moyens.<br />
Suis-je homme qui marche seul, dans la rue sans<br />
lumières ? Me faut-il aller lentement en usant de beaucoup de<br />
circonspection, craignant de trébucher ou de chuter sur un<br />
obstacle ?<br />
Mais je cherche à avancer vite, pressé par le temps peutêtre.<br />
J’ai la certitude d’avoir mes Dieux à mes côtés. Quel risque<br />
puis-je encourir ?<br />
Ce que je méprise le plus en moi, le plus en l’homme,<br />
c’est sa petitesse intellectuelle, sa médiocrité d’être né si tôt tandis<br />
que la civilisation en est à ses balbutiements de développements<br />
165
et de savoir. Alors je subis le ridicule de ma capacité à<br />
comprendre, à percevoir, à assimiler.<br />
Je vis par le sexe et le bien-être matériel, incapable que je<br />
suis à vivre auprès de Dieu, à le palper avec de grands bras<br />
invisibles.<br />
166
La folie<br />
La folie. Il faudrait tout d’abord s’entendre sur la<br />
signification de ce mot. À quoi est-on fou ? Quel péché a-t-on pu<br />
commettre pour arriver à cet état de souffrance ? Est-ce d’ailleurs<br />
la résultante d’une faute présente ou antérieure ? Répondre à cette<br />
question, c’est prétendre posséder ce mystère de valeurs, de<br />
rachats, de fautes, de justice en quelque sorte que pourrait détenir<br />
le Seigneur. Je reviens à ma première question, après cette légère<br />
parenthèse : À quoi est-on fou ? Il serait préférable d’interroger<br />
des spécialistes, des psychiatres plus aptes à intervenir<br />
efficacement car en contact permanent avec ces malades.<br />
plus intéressante.<br />
À quoi n’est-on pas fou ? Voilà une question peut-être<br />
167
Bilan<br />
En ce jour détestable, où tout est souffrance et violence et<br />
douleur, où certaines figues viennent à maturation, où d’autres<br />
sont encore jeunes pour être cueillies, un soleil de conscience<br />
vient d’éclairer ma raison : j’observe ce que j’ai fait, je conçois ce<br />
que j’aurais dû produire, jamais je n’ai obtenu les œuvres que<br />
mon cerveau m’aurait permis d’extraire. Voilà bien un triste bilan.<br />
J’analyse mes résultats aujourd’hui dans ma trente-sixième année.<br />
Je n’ai pu travailler qu’à 50 % de ma capacité intellectuelle et j’ai<br />
perdu 90 % de ma technique d’écriture. Quelle misère ! Voilà<br />
pourquoi, je puis gémir, sans que personne ne puisse me consoler,<br />
hélas !<br />
168
De bien mourir<br />
Il faudrait trouver une méthode d’investigation humaine<br />
permettant de se préparer à bien mourir, c’est-à-dire de se<br />
présenter devant Dieu dans les meilleures conditions possibles de<br />
purification, de formation, d’apprentissage et d’expériences<br />
terrestres positives.<br />
Mais pour cela, il serait nécessaire tout d’abord de croire<br />
en la certitude d’une vie après la mort. Car à quoi peut bien servir<br />
un système d’apprentissage, de formation ou d’expérience si<br />
l’individu intéressé prétend qu’il n’existe aucune forme de vie<br />
dite supérieure après la mort ? Ceci prouve que ce principe de vie<br />
n’est concevable qu’accompagné d’une certitude de morale à<br />
appliquer.<br />
Il s’agirait toutefois pour l’homme rempli d’athéisme ou<br />
de certitude du rien et du néant de se construire un système<br />
d’existence à travers une multitude d’expériences - expériences<br />
169
susceptibles d’enrichir son esprit et de favoriser ainsi son principe<br />
de vie et de pensées.<br />
170
L’existence de Dieu<br />
Pour démontrer l’existence de Dieu, il suffirait que Dieu<br />
se laissât rendre accessible à nos sens, que l’on pût le voir, le<br />
toucher, discuter avec lui - ceci serait une preuve, un état de<br />
certitude, et le grand problème de la métaphysique serait ainsi<br />
révolu avec un peu de moyens, avec une grande économie de<br />
tergiversations et de discussions. Mais hélas pour l’intelligence<br />
humaine, ce Dieu est bien discret, et ne se veut montrer qu’à<br />
quelques-uns - on les appelle mystiques, voyants ou sanctifiés.<br />
C’est encore une démonstration par le Cercle. Or il faut être en<br />
dehors du Cercle pour admettre ce type de vérités. Et celui qui<br />
croit dans le périmètre... Il faudrait une certitude collective telle<br />
une vérité mathématique, tandis que l’acte de foi consiste à se<br />
crédibiliser auprès de chaque individu, de façon indépendante, -<br />
de façon unitaire. On fabrique des prosélytes en vérité, touchés de<br />
manière indépendante.<br />
La croyance n’est pas basée sur des faits concrets. C’est<br />
un acte de foi,... dommage.<br />
171
Savoir, ignorer<br />
Il y a<br />
Ce que je sais - ce dont je ne puis douter ; ce que je crois par<br />
raison impalpable ; ce que je sais et ne puis révéler ;<br />
Il y a<br />
Ce que je ne sais pas, et qui est vérité ; ce que je crois savoir mais qui<br />
est fausseté ; ce que je prétends connaître et qui est confusion ;<br />
Il y a<br />
Ce que je n’ai jamais su et que je ne saurai jamais ;<br />
172
Philosophie<br />
Comment construire un homme ?<br />
Utiliser le langage humain pour raisonner, c’est employer<br />
l’appréciation de l’oeil pour déterminer les distances. Quoi de<br />
plus impur que le langage des mots ! Et l’on voudrait utiliser un<br />
instrument si imparfait pour défendre des raisons, pour annoncer<br />
des vérités philosophiques, pour convaincre et prétendre détenir la<br />
certitude !<br />
Le bon sens est encore de s’abstenir et de faire preuve de<br />
modestie dans l’emploi du langage, puisque ce dernier est<br />
composé de mots qui sont des variables de valeur dont les<br />
définitions diffèrent selon chaque individu.<br />
Il faut donc se mettre d’accord sur le sens, sur la valeur<br />
des mots que l’on emploie. Et cela n’est pas chose aisée.<br />
173
Méthode d’adolescent<br />
Je doutais de la morale et des vérités et de la foi. Pourtant<br />
elles avaient été les toutes premières à nourrir mon esprit, et à lui<br />
servir de créance. Je prétendais qu’en toutes mes opinions, je<br />
pouvais librement juger au-delà d’une certaine norme et d’une<br />
certaine raison.<br />
Je compris l’utilité de converser avec les hommes plutôt<br />
que de rester enfermé longtemps en soi-même. Je ne fis autre<br />
chose que de me nourrir de spectacle de la vie et de travailler avec<br />
mes yeux, tachant d’y être un habile observateur plutôt qu’un<br />
déplorable comédien.<br />
Je pouvais de cette sorte remettre en cause grand nombre<br />
d’informations reçues qui donnent toujours l’occasion de<br />
commettre des erreurs, et je parvenais à me corriger.<br />
Il va s’en dire, que je ne tachais pas d’imiter les<br />
sceptiques qui toujours en sont à douter. Non. J’essayais de<br />
construire lentement selon un procédé de certitudes indéniables et<br />
174
de m’y fixer comme structures de base, ou d’architectures<br />
métalliques.<br />
Et je prétendais obtenir des gains de vérité assez certains.<br />
Ces constructions ou ces avancées raisonnées et claires me<br />
permettaient de substituer à des premières “certitudes” douteuses,<br />
d’autres informations plus fondées et plus réalistes.<br />
J’ose employer cette image : je défaisais certains pans de<br />
mon habitation, et reconstruisais avec plus de ciment et de<br />
meilleures briques.<br />
175
Question<br />
Recevoir des informations fausses pour véritables, et ne<br />
pouvoir dans des principes si mal assurés discerner l’erreur de la<br />
certitude ; comment parvenir à se défaire de tous ces mauvais<br />
fondements et comment reconstruire un principe de certitude<br />
tandis que la méthode afin d’évaluer, de peser ou de prétendre<br />
savoir peut s’avérer être inexacte ?<br />
176
Le génie<br />
Le génie est rarement cette impulsion inexplicable qui<br />
surgirait d’un inconnu créatif dont on serait l’instrument et en<br />
même temps la victime passive. Le génie n’est pas seulement le<br />
médium entre un inconscient qui dicte et une feuille de papier qui<br />
reçoit des informations. Je dis feuille de papier, mais j’entends<br />
aussi bien le maillet du sculpteur, le pinceau du peintre ou le<br />
piano du compositeur.<br />
Je pense que l’artiste se nourrit de toutes sortes<br />
d’informations qu’il ingurgite, avale, assimile, consciemment ou<br />
inconsciemment, je prétends que son cerveau travaille et peut lui<br />
enseigner une manière, un tour, des refus, des choix de<br />
combinaisons qu’il aura vite fait d’utiliser pour appliquer son<br />
principe de création.<br />
Alain dans ses Eléments de philosophie tente dans son<br />
chapitre X du quatrième livre de mieux cerner la spécificité du<br />
génie. Il lui accorde une facilité dans l’exécution, une vitesse et<br />
une précision rares. Il y voit la marque de la spontanéité dans<br />
177
l’improvisation. D’après cela, la raison et la mesure, la maîtrise de<br />
soi seraient assez éloignées de la définition qu’il pourrait revêtir.<br />
Ne faut-il pas au-delà de cette difficulté certaine à<br />
comprendre le mécanisme fondamental de la création humaine, y<br />
voir une association entre une impulsion cérébrale et<br />
mémorisation d’expériences qui combinées l’une à l’autre permet<br />
d’engendrer un acte inventif de qualité supérieure ?<br />
Comprendre comment fonctionne le cerveau sublimé,<br />
est-ce réellement nécessaire ? Qu’est-ce qui sépare Picasso d’un<br />
enfant de six ans ? C’est un rapport de 1 à 1 milliard pour ce qui<br />
est de l’aptitude à peindre. C’est la bille et la planète. Comprendre<br />
la bille n’est pas un échantillonnage suffisant pour comprendre la<br />
planète ?<br />
Pourquoi s’intéresser à la sublimation de l’artiste ?<br />
N’est-ce pas plus raisonnable de tenter de savoir comment<br />
fonctionne ce cerveau humain ? C’est peut-être la machine la plus<br />
extraordinaire mise à la disposition de l’homme. C’est un<br />
instrument bien plus complexe encore que la meilleure de nos<br />
navettes spatiales, car son tableau de bord nous est à 90 %<br />
inconnu.<br />
178
Entre deux âges<br />
Assis sur le toit des deux âges, je regarde jeunesse qui<br />
s’enfuit et vieillesse qui arrive à pas de loup. Je ne me crois ni<br />
jeune ni vieux, et si je balance de l’un à l’autre, la force vive<br />
semble toutefois puissamment ancrée dans ma personne. Je ne<br />
possède plus cette formidable impulsion de jeunesse qui offre à<br />
l’esprit la capacité d’aller outre la construction logique, et par<br />
aptitude de synthèse de comprendre sans avoir démontré.<br />
J’avance plus doucement et j’aime échafauder ; oui, j’apprécie<br />
cette élaboration lente et précise qui accompagne les faits. Le<br />
jugement appelle le repos, et prétend que la raison doit aller bon<br />
train, sans trop se hâter accompagnée de la preuve et de la<br />
certitude.<br />
Il serait peut-être judicieux que l’une et l’autre imitent<br />
les qualités et tentent de rejeter leurs défauts. Cela n’est pas une<br />
belle chose que de froncer les sourcils et de prendre des airs<br />
ténébreux pour s’imaginer posséder quelque importance. Cela<br />
peut sembler ridicule que d’être partant pour la danse quand des<br />
premiers rhumatismes ou sciatiques attaquent nerfs et os.<br />
179
Comment faut-il se comporter ? De quelle manière faut-il<br />
exploiter cette expérience ?<br />
Pour aller vite, jeunesse doit savoir sans avoir eu à<br />
démontrer. Pour aller bien, vieillesse doit tenter d’être utile en<br />
prétendant à l’innovation.<br />
“ Moi qui balance entre deux âges ”... Tout à coup me<br />
revient à la mémoire la chanson de Georges Brassens... Nous<br />
devons posséder de l’intelligence et exister, et nous assumer sur<br />
les trois âges, - celui de la jeunesse, celui de l’âge de force, et<br />
celui de la vieillesse. Je reconnais la formidable capacité créatrice<br />
de Pablo Picasso qui dans sa dernière façon peignait de manière<br />
buissonneuse mais encore splendide.<br />
Une remarque semble assez paradoxale. Quand on essaie<br />
de récupérer le filon de la jeunesse, en y ajoutant sa compétence,<br />
l’ensemble réunit n’offre pas un produit de qualité. La maîtrise de<br />
l’inspiration détruirait donc cette sorte d’impulsivité qui est<br />
parfois la marque du génie ?<br />
180
La discipline de la musique moderne bruyante et<br />
agressive semblerait donner raison à la jeunesse. Passer un certain<br />
âge, comme l’on dit souvent, le Rock And Roll n’est plus qu’une<br />
visite au Musée où l’on voit gesticuler des quinquagénaires qui se<br />
contorsionnent. Mais la substance des produits musicaux a été<br />
conçue en d’autres époques, passées, dépassées... oubliées.<br />
Alors que faire ? De quelle manière faut-il se comporter ?<br />
Puis-je réellement répondre à cette question ? Il est plus sage<br />
d’attendre que le temps me donne l’expérience pour m’exprimer à<br />
nouveau.<br />
181
TABLE <strong>DE</strong>S MATIÈRES<br />
CHAPITRE PREMIER - De l’Intelligence<br />
Le parcours de l’esprit<br />
De la logique<br />
L’intelligence humaine<br />
L’idée<br />
Détester le doute<br />
Penser, c’est vérifier<br />
De juger<br />
La quête de la vérité<br />
L’intelligence doute<br />
Idées et réflexions<br />
Des ressources humaines<br />
Les postulats<br />
L’intuition<br />
La certitude de l’immédiat<br />
Dialectique négative<br />
La conscience et l’instinct<br />
Le royaume du doute<br />
182
Méthode d’intégration<br />
Imaginer<br />
Dédoublement<br />
Volonté d’abolir la conscience<br />
CHAPITRE SECOND - De la Mathématique<br />
La Mathématique<br />
Le vrai<br />
De la géométrie et de l’intuition<br />
Le 1 et le 0<br />
Insensible mathématique<br />
CHAPITRE TROISIÈME - De l’Art<br />
Trois distinctions dans l’art<br />
Le vouloir créatif<br />
Arpèges sur le beau<br />
De l’art<br />
Esthétique<br />
183
CHAPITRE QUATRIÈME - De la Poésie<br />
De l’invisible et de la rigueur<br />
Le spectre d’autrefois<br />
Le don de plaire<br />
De l’œuvre<br />
De l’association poétique<br />
De la critique poétique<br />
Comprendre les poètes<br />
Poésie, rigueur et liberté<br />
Le choix de la jeunesse<br />
I<br />
II<br />
III<br />
La poésie<br />
Stylistique en prose et stylistique poétique<br />
De la critique de soi<br />
Fragment sur la poésie<br />
184
Blocage de la transmission poétique<br />
Morceau<br />
CHAPITRE CINQUIÈME - De Dieu<br />
De Dieu, de l’intelligence de coeur<br />
De la grandeur du Saint-Esprit<br />
Le parfait<br />
Le mystique<br />
Révélations sur l’au-delà<br />
Rappel<br />
Mysticisme et paranormal<br />
La vérité biblique<br />
CHAPITRE SIXIÈME - Divers<br />
Continuité d’un monde occidental<br />
Second degré<br />
De la femme<br />
De la critique littéraire<br />
Sur la mort<br />
185
De la rigueur mathématique<br />
L’état prophétique<br />
Du plaisir dans l’apprentissage<br />
Domaine du défini<br />
Lire ou compter<br />
Quelle méthode ?<br />
La folie<br />
Bilan<br />
De bien mourir<br />
L’existence de Dieu<br />
Savoir, ignorer<br />
Philosophie<br />
Méthode d’adolescent<br />
Question<br />
Le génie<br />
Entre deux âges<br />
186