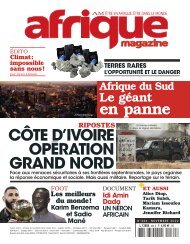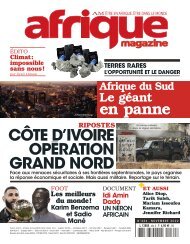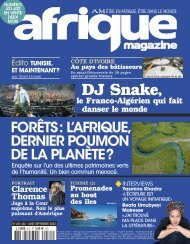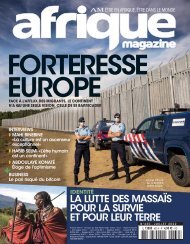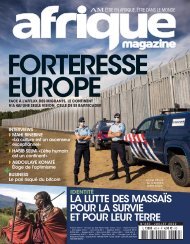You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NUMÉRO<br />
<strong>431</strong>-<strong>432</strong><br />
EN VENTE<br />
DEUX<br />
MOIS<br />
Édito TUNISIE,<br />
ET MAINTENANT ?<br />
par Zyad Limam<br />
CÔTE D’IVOIRE<br />
Au pays des bâtisseurs<br />
Un maxi-Découverte de 28 pages<br />
spécial grands travaux<br />
L’usine d’eau potable de la Mé.<br />
DJ Snake,<br />
le Franco-Algérien qui fait<br />
danser le monde<br />
FORÊTS : L’AFRIQUE,<br />
DERNIER POUMON<br />
DE LA PLANÈTE ?<br />
Enquête sur l’un des ultimes patrimoines verts<br />
de l’humanité. Un bien commun menacé.<br />
PORTRAIT<br />
Clarence<br />
Thomas<br />
Juge à la Cour<br />
suprême, Noir le plus<br />
puissant d’Amérique<br />
N° <strong>431</strong>-<strong>432</strong> - AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />
L 13888 - <strong>431</strong> - F: 5,90 € - RD<br />
TUNISIE (2)<br />
Promenades<br />
au bout<br />
des îles<br />
Zembra.<br />
+<br />
INTERVIEWS<br />
Yasmina Khadra<br />
« L’ÉCRITURE EST<br />
UN VOYAGE INITIATIQUE »<br />
Beata Umubyeyi<br />
Mairesse<br />
« J’AI TROUVÉ<br />
MA PLACE DANS<br />
LA LITTÉRATURE »<br />
France 5,90 € – Afrique du Sud 49,95 rands (taxes incl.) – Algérie 320 DA – Allemagne 6,90 €<br />
Autriche 6,90 € – Belgique 6,90 € – Canada 9,99 $C – DOM 6,90 € – Espagne 6,90 € – États-Unis 8,99 $<br />
Grèce 6,90 € – Italie 6,90 € – Luxembourg 6,90 € – Maroc 39 DH – Pays-Bas 6,90 € – Portugal cont. 6,90 €<br />
Royaume-Uni 5,50 £ – Suisse 8,90 FS – TOM 990 F CFP – Tunisie 7,50 DT – Zone CFA 3500 FCFA ISSN 0998-9307X0 07X0
Je conjugue<br />
efficacité et<br />
durabilité.<br />
NICOLAS KOUASSI<br />
CONDUCTEUR D’ENGIN, FORMATEUR<br />
SC BTL-06/22- Crédits photos : © Révolution plus.<br />
MOBILISER plus POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX<br />
Grâce à des pratiques vertueuses et par l’innovation, Bolloré Transport & Logistics se<br />
mobilise pour préserver l’environnement. Des solutions sont mises en place pour réduire<br />
l’impact de nos activités. Nous sommes engagés dans des démarches de certifications<br />
pointues, à l’image du Green Terminal déployé sur tous nos terminaux portuaires.<br />
NOUS FAISONS BIEN plus QUE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
édito<br />
PAR ZYAD LIM<strong>AM</strong><br />
LA TUNISIE, SUITE ET SUITE…<br />
Voilà, les jeux sont (provisoirement) faits. Kaïs<br />
Saïed a fait adopter sa nouvelle constitution. La<br />
participation aura été faible, le débat largement<br />
tronqué. Mais il aura eu gain de cause. La Tunisie<br />
entre dans un nouveau régime, marqué par un<br />
pouvoir présidentiel fort, des contre-pouvoirs limités.<br />
On peut reconnaître au président de l’obstination,<br />
et suffisamment de sens politique pour s’imposer.<br />
Il a fait tomber la deuxième République sans coup<br />
férir, il est soutenu visiblement par l’appareil d’État.<br />
Que la deuxième République ait été un échec, personne<br />
véritablement ne le remet en cause, sauf ceux<br />
qui ont profité de ce modèle hybride pour prospérer.<br />
Et gouverner. Et s’enrichir. Difficile aussi de passer de<br />
plus d’un demi-siècle d’autoritarisme (Bourguiba,<br />
1957-1987, et Ben Ali, 1987-2011) à une démocratie<br />
opérationnelle en un clin d’œil historique. Et puis, la<br />
révolution était multiple dans sa nature. Elle mobilisait<br />
des élites avant tout soucieuses de modernisation<br />
politique. Mais aussi des couches plus populaires,<br />
moins « politiques », qui aspiraient surtout à la dignité,<br />
à l’égalité, à la promotion économique.<br />
Pourtant, le renouveau ne pourra pas venir en<br />
« relativisant » les acquis de la révolution. La Tunisie<br />
a besoin de centralité, d’autorité, d’une forme de discipline,<br />
mais pas aux dépens des idées démocratiques,<br />
du principe de justice équitable, de la liberté d’expression<br />
et du pluralisme. La Tunisie a besoin d’autorité,<br />
mais pas de l’autorité d’un seul homme, une sorte<br />
de raïs prodigieux et infaillible. Ce modèle-là a été<br />
expérimenté, et on connaît ses limites. Et la Tunisie a<br />
changé. Elle s’est complexifiée, politisée justement.<br />
On peut aussi essayer de « limiter » la Tunisie à<br />
sa nature musulmane et arabe. Évidemment oui,<br />
mais pas seulement. Ce qui fait la richesse de la Tunisie,<br />
sa différence, son apport au monde, y compris<br />
au monde arabo-musulman, c’est sa diversité. Ses<br />
identités multiples. La Tunisie est arabo-musulmane,<br />
elle est méditerranéenne, africaine, elle est berbère,<br />
elle a une histoire juive et même chrétienne, elle fut<br />
Carthage, un empire, elle fut Rome aussi… Si l’on<br />
rejette cette fusion, on étrique la nation, on l’affaiblit.<br />
En l’assumant, on s’ouvre des portes sur le grand large.<br />
On se positionne comme une nation multiple, ouverte<br />
au dialogue, nécessaire et séduisante.<br />
On peut souligner la souveraineté. Le nationalisme.<br />
C’est important. Chaque pays a droit au<br />
respect. Mais chaque pays doit mesurer sa marge<br />
de manœuvre. La Tunisie est fragile, épuisée par une<br />
décennie de désordre. Elle est endettée, elle est divisée.<br />
Le réalisme compte. Rompre avec les uns ou les<br />
autres, avec les États-Unis ou avec l’Europe (principaux<br />
marchés, principales sources de financement),<br />
relève de l’illusion dangereuse. La Tunisie est bordée<br />
de puissants voisins, l’Algérie, la Libye (avec le chaos<br />
permanent) et, au-delà de la Libye, par l’Égypte et<br />
les pays du Golfe. De puissants voisins qui cherchent<br />
à la rendre « compatible » avec leurs propres intérêts.<br />
La souveraineté, dans ce contexte, c’est l’agilité,<br />
la souplesse, en étant capable de dialoguer avec<br />
tous, de conforter cette place de nation ouverte, de<br />
nation carrefour.<br />
Et puis, il y a un enjeu central, celui qui relie<br />
la révolution, les élites et le peuple. La Tunisie<br />
s’appauvrit. Son modèle social (santé, éducation,<br />
formation) se dégrade. Le pays s’endette, sans créer<br />
de valeur ajoutée. Le système est ancien, verrouillé<br />
par les monopoles de fait, le poids du secteur public,<br />
de l’État, des syndicats. La réforme économique est<br />
urgente pour sortir de cette spirale descendante.<br />
Et pour créer des emplois et de la richesse pour le<br />
peuple. La constitution, dans ce domaine, n’offre<br />
pas de solutions magiques. La lutte contre les corrupteurs<br />
ne définit pas un modèle nouveau, efficace,<br />
innovateur. Cette remise en cause, cette remise à<br />
niveau est la plus complexe, la plus exigeante. Parce<br />
que, disons-le, la Tunisie, idéalement placée, pourrait<br />
être riche.<br />
L’histoire n’est pas écrite d’avance. La révolution<br />
continue son chemin. Dans ce chapitre,<br />
Kaïs Saïed cherche à parler au nom de ce peuple. Il<br />
est lui-même « peuple ». Il se sent légitime pour gouverner<br />
quasi seul. En étant ainsi au centre du jeu, le<br />
président assume une immense responsabilité. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 3
Zembra.<br />
France 5,90 € – Afrique du Sud 49,95 rands (taxes incl.) – Algérie 320 DA – Allemagne 6,90 €<br />
Autriche 6,90 € – Belgique 6,90 € – Canada 9,99 $C – DOM 6,90 € – Espagne 6,90 € – États-Unis 8,99 $<br />
Grèce 6,90 € – Italie 6,90 € – Luxembourg 6,90 € – Maroc 39 DH – Pays-Bas 6,90 € – Portugal cont. 6,90 €<br />
Royaume-Uni 5,50 £ – Suisse 8,90 FS – TOM 990 F CFP – Tunisie 7,50 DT – Zone CFA 3500 FCFA ISSN 0998-9307X0 07X0<br />
L’usine d’eau potable de la Mé.<br />
Le chantier de la route côtière.<br />
Demain, la tour F dans la perspective du pont de Cocody.<br />
Le parc des expositions et le Convention Center.<br />
Ci-dessus, le stade d’Ébimpé.<br />
Ci-contre, l’université de San Pedro.<br />
<strong>AM</strong> <strong>431</strong> De couverte couve.indd 47 02/08/2022 12:51<br />
N° <strong>431</strong>-<strong>432</strong> - AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />
3 ÉDITO<br />
La Tunisie, suite et suite…<br />
par Zyad Limam<br />
6 ON EN PARLE<br />
C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE,<br />
DE LA MODE ET DU DESIGN<br />
De l’Afrique au Finistère,<br />
une ferveur sacrée<br />
22 CE QUE J’AI APPRIS<br />
Nadia Hathroubi-Safsaf<br />
par Astrid Krivian<br />
25 C’EST COMMENT ?<br />
Chapeau mossi<br />
et baguette de mil<br />
par Emmanuelle Pontié<br />
94 PORTFOLIO<br />
La force de l’objectif<br />
par Catherine Faye<br />
122 VINGT QUESTIONS À…<br />
Rébecca M’Boungou<br />
par Astrid Krivian<br />
NUMÉRO<br />
<strong>431</strong>-<strong>432</strong><br />
EN VENTE<br />
DEUX<br />
MOIS<br />
TEMPS FORTS<br />
26 Forêts : l’Afrique, dernier<br />
poumon de la planète ?<br />
par Thibaut Cabrera<br />
40 « Justice Thomas »,<br />
l’homme qui veut figer<br />
l’Amérique<br />
par Cédric Gouverneur<br />
76 DJ Snake, ce Franco-Algérien<br />
qui fait danser le monde<br />
par Luisa Nannipieri<br />
82 Malek Lakhal :<br />
« Il est essentiel<br />
de politiser l’intime »<br />
par Catherine Faye<br />
86 Yasmina Khadra :<br />
« L’écriture, ce voyage<br />
initiatique »<br />
par Astrid Krivian<br />
90 Beata Umubyeyi Mairesse :<br />
« J’ai trouvé ma place<br />
dans la littérature »<br />
par Sophie Rosemont<br />
100 La Tunisie au gré des îles<br />
par Frida Dahmani<br />
DÉCOUVERTE<br />
47 CÔTE D’IVOIRE<br />
Le futur est en travaux !<br />
par Zyad Limam et Francine Yao<br />
<br />
DÉCOUVERTE<br />
Comprendre un pays, une ville, une région, une organisation<br />
Côte d’Ivoire<br />
Le futur est en travaux !<br />
Infrastructures, urbanisme, routes, eau, énergie<br />
et aussi les stades de la CAN… Le pays investit<br />
pierre par pierre, mètre par mètre.<br />
DOSSIER RÉALISÉ PAR ZYAD LIM<strong>AM</strong> AVEC FRANCINE YAO<br />
Un dossier de 28 pages<br />
P.6<br />
Édito TUNISIE,<br />
ET MAINTENANT ?<br />
par Zyad Limam<br />
DJ Snake,<br />
le Franco-Algérien qui fait<br />
danser le monde<br />
FORÊTS : L’AFRIQUE,<br />
DERNIER POUMON<br />
DE LA PLANÈTE ?<br />
PORTRAIT<br />
Clarence<br />
Thomas<br />
Juge à la Cour<br />
suprême, Noir le plus<br />
puissant d’Amérique<br />
N° <strong>431</strong>-<strong>432</strong> - AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />
L 13888 - <strong>431</strong> - F: 5,90 € - RD<br />
CÔTE D’IVOIRE<br />
Au pays des bâtisseurs<br />
Un maxi-Découverte de 28 pages<br />
spécial grands travaux<br />
Enquête sur l’un des ultimes patrimoines verts<br />
de l’humanité. Un bien commun menacé.<br />
TUNISIE (2)<br />
Promenades<br />
au bout<br />
des îles<br />
+<br />
INTERVIEWS<br />
Yasmina Khadra<br />
« L’ÉCRITURE EST<br />
UN VOYAGE INITIATIQUE »<br />
Beata Umubyeyi<br />
Mairesse<br />
« J’AI TROUVÉ<br />
MA PLACE DANS<br />
LA LITTÉRATURE »<br />
<strong>AM</strong> <strong>431</strong> COUV.indd 1 02/08/2022 20:05<br />
PHOTOS DE COUVERTURE : NABIL ZORKOT - AL<strong>AM</strong>Y<br />
PHOTO - SHUTTERSTOCK - TASOS KATOPODIS/GETTY<br />
IMAGES - N. FAUQUÉ/IMAGES DE TUNISIE.COM - DR<br />
Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande<br />
nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps.<br />
Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement<br />
de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com<br />
CHRISTIAN LUTZ<br />
4 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
FONDÉ EN 1983 (38 e ANNÉE)<br />
31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE<br />
Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93<br />
redaction@afriquemagazine.com<br />
Zyad Limam<br />
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION<br />
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION<br />
zlimam@afriquemagazine.com<br />
Assisté de Laurence Limousin<br />
llimousin@afriquemagazine.com<br />
RÉDACTION<br />
Emmanuelle Pontié<br />
DIRECTRICE ADJOINTE<br />
DE LA RÉDACTION<br />
epontie@afriquemagazine.com<br />
Isabella Meomartini<br />
DIRECTRICE ARTISTIQUE<br />
imeomartini@afriquemagazine.com<br />
Jessica Binois<br />
PREMIÈRE SECRÉTAIRE<br />
DE RÉDACTION<br />
sr@afriquemagazine.com<br />
Amanda Rougier PHOTO<br />
arougier@afriquemagazine.com<br />
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO<br />
Thibaut Cabrera, Jean-Marie Chazeau,<br />
Frida Dahmani, Catherine Faye, Virginie<br />
Gazon, Cédric Gouverneur, Dominique<br />
Jouenne, Astrid Krivian, Luisa Nannipieri,<br />
Sophie Rosemont.<br />
VIVRE MIEUX<br />
Danielle Ben Yahmed<br />
RÉDACTRICE EN CHEF<br />
avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.<br />
VENTES<br />
EXPORT Laurent Boin<br />
TÉL. : (33) 6 87 31 88 65<br />
FRANCE Destination Media<br />
66, rue des Cévennes - 75015 Paris<br />
TÉL. : (33) 1 56 82 12 00<br />
ABONNEMENTS<br />
TBS GROUP/Afrique Magazine<br />
235 avenue Le Jour Se Lève<br />
92100 Boulogne-Billancourt<br />
Tél. : (33) 1 40 94 22 22<br />
Fax : (33) 1 40 94 22 32<br />
afriquemagazine@cometcom.fr<br />
P.76<br />
P.86<br />
AL<strong>AM</strong>Y PHOTO - MYRI<strong>AM</strong> <strong>AM</strong>RI - JEAN-PIHLIPPE BALTEL/SIPA - PAOLO WOODS<br />
BUSINESS<br />
108 Alimentation :<br />
le grand désordre<br />
mondial<br />
112 Nicolas Bricas :<br />
« L’interdépendance<br />
est devenue<br />
une dépendance »<br />
114 Le streaming s’impose<br />
en Afrique<br />
115 La Gambie<br />
s’engage contre<br />
la déforestation<br />
116 Monaco s’intéresse<br />
de plus en plus à son sud<br />
117 OCP ouvre<br />
des perspectives<br />
au Niger<br />
par Cédric Gouverneur<br />
VIVRE MIEUX<br />
118 Forme : de nouvelles<br />
gyms pour la rentrée<br />
119 N’abusez pas du sel<br />
120 Vitiligo, une maladie<br />
mal connue<br />
121 L’arthrose du pouce :<br />
douloureux, mais<br />
cela se soigne !<br />
par Annick Beaucousin<br />
et Julie Gilles<br />
P.94<br />
P.82<br />
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ<br />
regie@afriquemagazine.com<br />
<strong>AM</strong> International<br />
31, rue Poussin - 75016 Paris<br />
Tél. : (33) 1 53 84 41 81<br />
Fax : (33) 1 53 84 41 93<br />
AFRIQUE MAGAZINE<br />
EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR<br />
31, rue Poussin - 75016 Paris.<br />
SAS au capital de 768 200 euros.<br />
PRÉSIDENT : Zyad Limam.<br />
Compogravure : Open Graphic<br />
Média, Bagnolet.<br />
Imprimeur : Léonce Deprez, ZI,<br />
Secteur du Moulin, 62620 Ruitz.<br />
Commission paritaire : 0224 D 85602.<br />
Dépôt légal : août 2022.<br />
La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos<br />
reçus. Les indications de marque et les adresses figurant<br />
dans les pages rédactionnelles sont données à titre<br />
d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction,<br />
même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique<br />
Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction.<br />
© Afrique Magazine 2022.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 5
ON EN PARLE<br />
C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode, du design et du voyage<br />
« AFRIQUE :<br />
LES RELIGIONS<br />
DE L’EXTASE »,<br />
Abbaye<br />
de Daoulas,<br />
(France),<br />
jusqu’au<br />
4 décembre.<br />
cdp29.fr<br />
Holy 1, série « Vues<br />
de l’esprit », Fabrice<br />
Monteiro, 2014.<br />
6 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
L’abbaye de Daoulas, en Bretagne, plonge les visiteurs<br />
dans une ATMOSPHÈRE MYSTIQUE très particulière.<br />
Série « Kimbanguiste », Christian Lutz, 2018.<br />
SPIRITUALITÉ<br />
DE L’AFRIQUE AU FINISTÈRE,<br />
UNE FERVEUR SACRÉE<br />
ORGANISÉE PAR LE MUSÉE d’ethnographie de Genève,<br />
cette exposition invite à découvrir les cultures religieuses<br />
du continent et la ferveur des croyants dans leur recherche<br />
d’une communion avec le divin. De nombreux objets de culte<br />
et d’œuvres d’art (plus de 300 pièces) révèlent la richesse<br />
et la pluralité des pratiques en Afrique et dans la diaspora.<br />
Les rituels et la notion du sacré sont mis en avant à travers<br />
les témoignages des adeptes eux-mêmes : des guérisseurs,<br />
des devins, des danseurs de masques, des chrétiens ainsi<br />
que des pratiquants du vaudou. Cinq installations vidéo<br />
et de fascinantes images de neuf photographes poussent<br />
à réfléchir aux pratiques contemporaines et à l’expression<br />
de l’émotion religieuse, comme la série « Train Church »,<br />
de Santu Mofokeng, datant de 1986, qui immortalise<br />
des trains de banlieue sud-africains transformés en églises<br />
sur la ligne Soweto-Johannesbourg. Pour prolonger<br />
l’expérience, direction les jardins remarquables<br />
de l’abbaye et les ruelles de la commune, investis par trois<br />
artistes afro-descendants : Maïmouna Guerresi, Ayana<br />
V. Jackson et Omar Victor Diop. ■ Luisa Nannipieri<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 7
ON EN PARLE<br />
FESTIVAL<br />
MONTPELLIER<br />
CÉLÈBRE LES ARTS<br />
DU MONDE ARABE<br />
Depuis 2006, Arabesques s’est<br />
imposé comme un RENDEZ-VOUS<br />
MULTIDISCIPLINAIRE<br />
incontournable.<br />
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, cinéma, humour,<br />
arts visuels… La programmation multidisciplinaire<br />
et éclectique du festival Arabesques met en lumière<br />
tant la jeune garde des scènes contemporaines que les<br />
artistes consacrés, les esthétiques alternatives comme<br />
les traditionnelles. Défricheur de talents et soutien aux<br />
artistes émergents, cet événement, qui jette un pont entre<br />
Orient et Occident, investit différents lieux de Montpellier.<br />
Au sein de la pinède du domaine d’O, une médina<br />
plante son décor à l’ombre des arbres et devient un cœur<br />
palpitant où se croisent ateliers de découverte culinaire<br />
ou de calligraphie, tables rondes, rencontres littéraires…<br />
Parmi les nombreux musiciens qui enchanteront cette<br />
17 e édition, on trouvera Dhafer Youssef accompagné<br />
de Ballaké Sissoko et Eivind Aarset pour leur projet<br />
Digital Africa, le duo folk Ÿuma, la transe hypnotique de<br />
Bedouin Burger, le groupe féminin originaire de la Saoura<br />
algérienne Lemma, l’illustre oudiste Marcel Khalifé et son<br />
fils Bachar, Anouar Brahem ou encore Kabareh Cheikhats<br />
– des artistes masculins explorant le répertoire séculaire<br />
des cheikhates (chanteuses et danseuses marocaines).<br />
Côté humour, le jeune AZ régalera le public avec son<br />
regard décalé et ses punchlines hilarantes. ■ Astrid Krivian<br />
FESTIVAL ARABESQUES, Montpellier (France),<br />
du 6 au 18 septembre. festivalarabesques.fr<br />
❶<br />
SOUNDS<br />
À écouter maintenant !<br />
Ferkat Al Ard<br />
Oghneya, Habibi Funk<br />
Merci au label Habibi Funk<br />
qui, après avoir réédité le<br />
superbe album du Libanais<br />
Issam Hajali, déterre<br />
les compositions de son groupe, Ferkat<br />
Al Ard, qu’il formait avec Toufic Farroukh<br />
et Elia Saba. Se nourrissant de la poésie<br />
palestinienne, notamment celle de Mahmoud<br />
Darwich, Oghneya bénéficie des arrangements<br />
du fils de Fairouz, Ziad Rahbani. Il explore<br />
le folk psyché, les musiques traditionnelles<br />
orientales et brésiliennes, l’exotica… Sublime.<br />
❷ Moonchild<br />
Sanelly<br />
Phases, Transgressive<br />
Records/Pias<br />
« Undumpable », chante<br />
Sanelisiwe Twisha (de son vrai nom) dès<br />
l’ouverture de son deuxième album. On n’en<br />
doute pas une seconde, au vu de l’énergie<br />
de la figure de proue du gqom sud-africain.<br />
Ayant collaboré avec des pointures de la<br />
pop music, telles que Beyoncé ou Gorillaz,<br />
elle prend ici la parole au nom de toutes<br />
les femmes que l’on oublie : les travailleuses<br />
du sexe, les strip-teaseuses ou encore les<br />
twerkeuses, mais aussi les mères, les filles et<br />
les sœurs… Le tout avec un groove effarant !<br />
❸<br />
Ysee<br />
Tony Allen Makes<br />
Me High, Ysee<br />
Le nom de cet EP n’est pas<br />
volé : le regretté batteur<br />
nigérian était en effet l’un des complices<br />
de cette chanteuse et actrice française<br />
d’origine béninoise, qui tourne actuellement<br />
aux côtés de Noel Gallagher. C’est sur<br />
scène qu’Ysee s’est liée d’amitié avec<br />
le roi de l’afrobeat, qui s’écoute ici via<br />
plusieurs titres d’une belle élégance<br />
sonique. Une superbe voix à découvrir<br />
de toute urgence ! ■ Sophie Rosemont<br />
DR (4)<br />
8 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
LÉGENDE<br />
CALYPSO ROSE FOREVER !<br />
Dans son nouvel album, la chanteuse de Trinité-et-Tobago clame<br />
la JOIE D’ÊTRE SOI, libre et ouverte sur le monde.<br />
FIFOU - DR<br />
POUR LES RARES qui ne la connaîtraient pas encore,<br />
rappelons que Calypso Rose, née McArtha Lewis sur l’île<br />
caribéenne de Tobago, au sein d’une famille de 13 enfants,<br />
a vécu un premier déchirement à l’âge de 9 ans. Sans le sou,<br />
ses parents doivent la confier à un couple de l’île<br />
de Trinité. Celle qui devient, dès l’adolescence,<br />
Calypso Rose, s’y épanouit néanmoins. Forte<br />
d’un mental en acier et d’une voix mémorable,<br />
elle fait ses armes dans les calypso tents, où l’on<br />
doit, face à une sacrée concurrence, imposer<br />
son bagout. En 1978, elle est la première femme<br />
à remporter la couronne de « Calypso Queen »<br />
– alors que personne n’y croyait dans le circuit<br />
très machiste du carnaval. Féministe ? Et pas<br />
qu’un peu ! 800 chansons plus tard, désormais<br />
basée à New York, celle qui a fêté ses 82 ans ne compte<br />
pas lâcher le micro. Pour ce nouveau disque, engagé et à<br />
l’énergie contagieuse, elle reste fidèle à ses compagnons de<br />
musique. L’objectif étant de rester authentique sans se priver<br />
CALYPSO ROSE,<br />
Forever, Because Music.<br />
des sonorités électroniques. En premier lieu, le producteur<br />
bélizien Ivan Duran, qui la suit depuis plus de quinze ans et fait<br />
intervenir son groupe The Garifuna Collective. Également de<br />
la partie, Manu Chao, qui a réalisé en 2016 son Far From Home,<br />
devenu disque de platine, des musiciens trinidadiens<br />
(Machel Montano, Kobo Town), jamaïcains<br />
(Mr Vegas), mais aussi Oli, du duo français Bigflo<br />
& Oli – car Calypso Rose est toujours attentive<br />
aux propositions de la nouvelle génération… Sans<br />
oublier des pointures du même calibre qu’elle.<br />
Ainsi, le guitariste Santana transcende de ses riffs<br />
l’ouverture de l’album, « Watina »., une reprise d’Andy<br />
Palacio en 2007, qui rappelle la mise en esclavage et<br />
la déportation du peuple des Garifunas. Un discours<br />
qui s’inscrit dans les convictions défendues par<br />
l’artiste depuis ses débuts, dont l’égalité de toutes et tous, quels<br />
que soient la couleur de peau, le sexe et les origines sociales. En<br />
2019, elle est d’ailleurs rentrée à l’Icons of Tobago Museum, qui<br />
n’a pas oublié, comme elle, d’où McArtha-Calypso venait. ■ S.R.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 9
ON EN PARLE<br />
Kad Merad<br />
et Fatsah<br />
Bouyahmed.<br />
FILM<br />
LA VIE (AU BLED) EST UN ROMAN<br />
Un écrivain franco-algérien tout juste nobélisé est accueilli en héros dans<br />
le village natal qu’il avait fui… Une COMÉDIE POLITIQUE douce-amère.<br />
S<strong>AM</strong>IR <strong>AM</strong>IN, écrivain français né en Algérie, reçoit le prix<br />
Nobel de littérature. Le summum de la reconnaissance,<br />
mais qui ne guérit pas son état dépressif : il refuse toutes<br />
les sollicitations… sauf celle du village où il a grandi, qui<br />
veut lui décerner le titre de « citoyen d’honneur ». Il finit<br />
par sauter dans un avion d’Air Algérie pour rejoindre les<br />
contreforts de l’Atlas et ce pays dont il a fui la guerre civile<br />
trente ans plus tôt. Le romancier va alors se confronter aux<br />
personnages réels qui lui ont inspiré la plupart de ses livres…<br />
Kad Merad est parfait dans la peau de cet auteur<br />
neurasthénique de retour au bled. À ses côtés, Fatsah<br />
Bouyahmed, l’un des clowns les plus attachants de la<br />
comédie francophone, donne son tempo doucement comique<br />
au film en l’accompagnant à tous ses rendez-vous. Un très<br />
beau village marocain fait illusion, le tournage n’ayant<br />
pu avoir lieu en Algérie, mais le réalisateur Mohamed<br />
Hamidi (La Vache, Né quelque part) – qui est aussi directeur<br />
artistique du Marrakech du rire – a su trouver l’endroit<br />
idéal. Ses producteurs lui avaient proposé d’adapter un<br />
film argentin où un écrivain nobélisé quittait Barcelone<br />
pour retrouver son village dans la pampa. Il en a fait<br />
un film sur l’Algérie d’aujourd’hui, avec le personnage<br />
de la jeune étudiante impliquée dans les manifestations<br />
du Hirak (Oulaya Amamra, la révélation de Divines).<br />
Le rythme n’est pas toujours au rendez-vous, malgré la<br />
belle musique d’Ibrahim Maalouf et quelques surprises (dont<br />
une apparition de Jamel Debbouze). Et l’on peut s’étonner<br />
de voir la langue française triompher dans un pays où elle<br />
reste une question politique sensible. Mais cette nouvelle<br />
déclinaison d’un retour au pays natal se laisse voir avec plaisir,<br />
et parvient même à nous toucher. ■ Jean-Marie Chazeau<br />
CITOYEN D’HONNEUR (France), de Mohamed<br />
Hamidi. Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,<br />
Oulaya Amamra. En salles.<br />
STRE<strong>AM</strong>ING<br />
LES CINÉMAS ORIENTAUX À LA MAISON<br />
Yema est la première plate-forme française VOD de films d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.<br />
BURNING CASABLANCA ou Une histoire d’amour et de désir à l’affiche chez soi, quand on n’a pas<br />
pu les voir en salles : c’est ce que propose la plate-forme Yema, lancée en juin, qui sélectionne les meilleures productions actuelles<br />
ou de patrimoine, et dont le catalogue s’enrichit d’une dizaine de titres par mois. Les films sont accessibles à un prix raisonnable<br />
(entre 2,99 et 4,99 euros selon la qualité HD ou la date de sortie), mais une formule d’abonnement est à l’étude. Pour les visionner,<br />
il faut habiter en France, les droits d’auteur devant encore être négociés pour un accès depuis le Maghreb. Fictions, documentaires,<br />
courts-métrages (qui eux sont gratuits) couvrent le monde oriental au sens (très) large, de l’Algérie à la Turquie, en passant par<br />
Israël, la Palestine et l’Iran. Chaque mois, un invité présente une sélection autour d’une thématique : pour septembre, c’est Leïla<br />
Slimani qui a choisi cinq œuvres sur la place des femmes dans les sociétés orientales. Avec en bonus, une interview affûtée<br />
de l’écrivaine franco-marocaine, qui explique comment le regard féminin est d’abord universel. ■ J.-M.C. yema-vod.com<br />
LAID LIAZID/AXEL FILMS PRODUCTION/APOLLO FILMS/JANINE - DR (2)<br />
10 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
INSTITUTION<br />
ALBUM<br />
DE VOYAGE<br />
Plus de quarante ans<br />
de créations de Lecoanet<br />
Hemant, alliant l’ART DE<br />
LA HAUTE COUTURE<br />
française à l’esprit de l’Orient.<br />
ROBES DES MILLE ET UNE NUITS,<br />
drapés somptueux, manteaux opulents<br />
ou tailleurs structurés… L’univers<br />
exubérant du duo de couturiers<br />
globe-trotters illumine les galeries<br />
du musée de référence de la dentelle<br />
tissée, à Calais. Il faut dire que Didier<br />
Lecoanet et Hemant Sagar, créateurs<br />
de leur griffe éponyme en 1981,<br />
l’une des plus inventives de l’époque,<br />
sont des prestidigitateurs de la mode.<br />
Leurs modèles chatoyants et raffinés<br />
explorent le métissage subtil des textiles<br />
et des cultures. Présente dès leurs<br />
débuts, la déclinaison autour du sari<br />
indien marque l’ensemble de l’œuvre<br />
de la maison. Tout comme le thème de la<br />
nature, à travers des vêtements réalisés<br />
à partir de matières végétales, minérales<br />
ou animales : raphia, bois, coquillages,<br />
papier de riz… Cette pâte inventive a<br />
valu aux deux créateurs d’être considérés<br />
comme les orientalistes de la haute<br />
couture. Et la rétrospective calaisienne,<br />
de plus de 80 pièces, retrace la magie<br />
de l’alliance des matières et des styles de<br />
l’Occident et de l’Orient. ■ Catherine Faye<br />
DHRUV KAKOTI<br />
« LECOANET HEMANT :<br />
LES ORIENTALISTES<br />
DE LA HAUTE COUTURE »,<br />
Cité de la dentelle et de la mode,<br />
Calais (France), jusqu’au 31 décembre.<br />
cite-dentelle.fr<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 11
ON EN PARLE<br />
TEASER<br />
Chadwick Boseman (en costume noir) incarnait T’Challa, la Panthère noire,<br />
dans le premier opus. Après son décès en 2020, le scénario du second volet<br />
a dû être réécrit, et le rôle de Churi, sa sœur, s’annonce désormais central.<br />
L’AFRIQUE AU SOMMET D’HOLLYWOOD !<br />
Les combattantes du futuriste Wakanda dans la suite de Black Panther,<br />
mais aussi des guerrières du Dahomey au xix e siècle : les FEMMES SONT AU<br />
CŒUR de deux grosses productions américaines très attendues à la rentrée.<br />
SI L’ON EN CROIT une coiffeuse du staff de Black Panther:<br />
Wakanda Forever, le tournage de la suite du premier<br />
blockbuster afro-américain (1,3 milliard de dollars de recettes<br />
dans le monde en 2018) aura duré presque 30 jours de plus<br />
que prévu : 117 au lieu de 88. Après avoir tardé à démarrer<br />
pour cause de réécriture du scénario à la suite du décès<br />
en 2020 de Chadwick Boseman (qui incarnait T’Challa, la<br />
Panthère noire), la production a ensuite dû faire face à des<br />
interruptions pour cause de Covid-19 (jusqu’à Lupita Nyong’o,<br />
positive en janvier dernier). Une cascade qui a mal tourné<br />
(et une fracture de l’épaule) a également immobilisé plusieurs<br />
semaines Letitia Wright. Or, son rôle de Churi, la sœur<br />
de T’Challa, s’annonce central dans ce nouvel épisode.<br />
Ira-t-elle jusqu’à prendre la succession de son frère ? En tout<br />
cas, Disney s’est refusé à remplacer son héros par un autre<br />
acteur, voire à recourir à des images de synthèse. Et mise<br />
tout sur le Wakanda et ses combattantes dans ce nouvel opus.<br />
Ce puissant pays africain imaginaire, caché entre l’Éthiopie<br />
et le Kenya, allie toujours haute technologie et sens aigu de<br />
l’esthétique. Deux nouveaux personnages de la galaxie Marvel<br />
devraient faire leur apparition : le méchant Namor, prince des<br />
mers, oreilles pointues et slip vert, joué par l’acteur mexicain<br />
Tenoch Huerta, et l’étudiante Riri Williams et son armure<br />
Ironheart, qui aura les traits de l’Américaine Dominique<br />
Thorne. Pour le reste, toujours devant la caméra de Ryan<br />
Coogler, on retrouvera la même distribution, très black power,<br />
les femmes en tête, dont Danai Gurira, qui incarne Okoye,<br />
la générale du Wakanda, appelée à être au cœur d’une série<br />
dérivée pour Disney+. Sortie prévue pour novembre.<br />
D’autres guerrières noires vont débarquer dès septembre<br />
devant la caméra d’un autre cinéaste afro-américain,<br />
en l’occurrence une réalisatrice : Gina Prince-Bythewood.<br />
The Woman King plonge au cœur du royaume, réel<br />
celui-là, du Dahomey au XIX e siècle. Inspiré des amazones<br />
du futur Bénin, le film (tourné en Afrique du Sud) met<br />
en scène les faits d’armes de la générale Nanisca, incarnée<br />
par Viola Davis, qui entraîne une nouvelle génération de<br />
recrues au sein de l’Agoledjié, le corps des femmes de guerre<br />
du roi. Elle va les préparer à la bataille contre un ennemi<br />
déterminé à détruire leur mode de vie. « Il y a des valeurs<br />
qui méritent d’être défendues », souligne le synopsis de<br />
Sony Pictures. Entre les guerrières historiques du royaume<br />
du Dahomey et les superhéroïnes du Wakanda, le système<br />
hollywoodien a décidé cette année de mettre en avant<br />
celles qu’il ne montre que trop rarement… ■ J.-M.C.<br />
Dans The Woman<br />
King, Viola Davis<br />
forme les Amazones<br />
de Dahomey.<br />
KWAKU ALSTON/2017 MVLFFLLC.TM/2017 MARVEL - ILZE KITSHOFF/2022 CTMG.INC<br />
12 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
8 E ART<br />
EN ARLES,<br />
ROYAUME<br />
DE L’IMAGE<br />
C’est un retour en grand<br />
format, de véritables<br />
retrouvailles, pour la 53 e édition<br />
des RENCONTRES<br />
DE LA PHOTOGRAPHIE.<br />
C’EST UN PEU comme si nous avions enfin<br />
tourné, d’une manière ou d’une autre, la page de<br />
l’épreuve, celle de la pandémie de Covid-19. Arles<br />
accueille à nouveau, à bras ouverts, le monde de<br />
la photo. On peut, enfin, se concentrer sur les<br />
œuvres, les images, en flânant d’une ruelle à une<br />
autre, sous les voûtes d’une église, dans une friche,<br />
dans une maison faite d’histoire. Cette année,<br />
les rencontres accordent une place importante<br />
au féminin, à la féminité et au féminisme. Avec<br />
des expositions qui naviguent entre le radical,<br />
le subversif, le mouvement. Les rencontres ouvrent<br />
également un large espace aux artistes émergents,<br />
dont le Marocain Seif Kousmate. Et à l’histoire.<br />
Avec, en particulier, une exposition émouvante<br />
sur la vie et l’œuvre de l’Américaine Lee Miller,<br />
mannequin devenue photographe au cœur de<br />
la Seconde Guerre mondiale. ■ Zyad Limam<br />
Lee Miller, Chapeaux<br />
Pidoux (avec marque<br />
de recadrage originale<br />
de Vogue Studio),<br />
Londres, Angleterre, 1939.<br />
LEE MILLER ARCHIVES, ENGLAND 2013 - DR<br />
LES RENCONTRES<br />
DE LA PHOTOGRAPHIE,<br />
Arles (France),<br />
jusqu’au 25 septembre.<br />
rencontres-arles.com<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 13
ON EN PARLE<br />
MUSIQUE<br />
AFRODELIC<br />
LA GLOIRE<br />
DU PÈRE<br />
Avec son majestueux premier<br />
album, c’est un VIBRANT<br />
HOMMAGE que nous livre<br />
le musicien et producteur<br />
lituano-malien Victor Diawara.<br />
DUSUNKUN HAKILI signifie « la mémoire<br />
du cœur »… Et c’est bien de cela<br />
qu’il s’agit tout au long de ce disque<br />
imaginé, conçu et enregistré entre<br />
Bamako et Vilnius par Victor Diawara<br />
pour honorer le corpus de son père,<br />
le poète malien Gaoussou Diawara,<br />
disparu en 2018. Plusieurs invités au<br />
programme, parmi lesquels la chanteuse<br />
Hawa Kassé Mady Diabaté… Le folk<br />
traditionnel est organique, entrelacé<br />
des cordes maîtrisées par Diawara<br />
fils, qui n’hésite guère à faire appel à<br />
l’électrique, à des sonorités rap ou des<br />
technologies plus récentes pour apporter<br />
de l’air frais à ces mélopées entêtantes,<br />
comme sur « Je n’aime pas les fêtes »<br />
ou « Le temps est venu », à la superbe<br />
ouverture gospel. Ici se mêlent poésie,<br />
engagement et désir sincère de<br />
rassembler grâce à la musique. ■ S.R.<br />
AFRODELIC,<br />
Dusunkun Hakili, Ankata.<br />
DONATAS PETKEVICIUS<br />
14 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
DR (3)<br />
LIVE<br />
La chanteuse<br />
malienne<br />
Oumou<br />
Sangaré.<br />
L’ART<br />
DE LA JOIE<br />
L’AFRIQUE FESTIVAL fait<br />
son grand retour à Strasbourg<br />
avec une programmation<br />
en grande partie féminine.<br />
IL ÉTAIT TEMPS. Après deux saisons troublées par<br />
la crise sanitaire, la 4 e édition de l’événement s’annonce<br />
volcanique. Créé en 2003 à Newcastle, au Royaume-Uni,<br />
par Manouté Seri, un promoteur culturel d’origine<br />
ivoirienne désormais installé en Alsace, le festival a vu<br />
passer outre-Manche des stars telles que Manu Dibango,<br />
Alpha Blondy et Tony Allen. Importé d’Angleterre, le<br />
concept strasbourgeois est le même. Ainsi, au bord du<br />
Rhin se côtoieront cette année de grands noms de la scène<br />
internationale féminine. Sur la Grande Scène, dédiée à la<br />
programmation musicale africaine, se succéderont la diva<br />
malienne Oumou Sangaré, artiste engagée et femme de<br />
défis, la chanteuse, danseuse et percussionniste ivoirienne<br />
Dobet Gnahoré, mais aussi la Gambienne Sona Jobarteh,<br />
première femme joueuse professionnelle de kora, ainsi<br />
que la chanteuse, musicienne et auteure-compositrice<br />
camerounaise Charlotte Dipanda. Leurs voix et leurs<br />
musiques se mêleront pendant trois jours à celles d’artistes<br />
locaux comme Boni Gnahoré, Redlights Dream, Lisa,<br />
The One Armed Man, et bien d’autres. Une renaissance<br />
attendue pour ce festival, dont la vocation est de mettre<br />
en valeur les cultures africaines et de redynamiser<br />
les vertus de la convivialité et de la tolérance. ■ C.F.<br />
L’AFRIQUE FESTIVAL, Ostwald (France),<br />
du 16 au 18 septembre. lafriquefestival.com<br />
QUÊTE<br />
CARTE AU TRÉSOR<br />
Récit d’une trajectoire : des motivations<br />
de l’exil à la construction de soi.<br />
QUI EST-ON et d’où vient-on ?<br />
C’est ce double questionnement, à la<br />
fois banal et fondamental, qu’explore<br />
la primo-romancière, partie sur<br />
la terre natale de ses ascendants. Un<br />
voyage tout en subtilité, qui emmène le lecteur dans les<br />
labyrinthes de l’émigration, des choix et des contraintes,<br />
de la transmission et de l’identité. Car que signifie l’exil<br />
volontaire ou involontaire, à l’aune d’une vie, d’une lignée,<br />
ou plus simplement au regard de l’histoire de l’humanité ?<br />
« Je ne comprends pas comment tu as pu commencer ta vie<br />
à Ajar, décider un jour de tout quitter, traverser la Mauritanie<br />
puis la Méditerranée, arriver en France et enfin rejoindre<br />
Paris alors que, moi, je ne vais même pas dans le 77 »,<br />
s’enquiert celle qui, au moment de la mort de sa grand-mère,<br />
choisit l’écriture pour explorer le canevas des origines et<br />
de l’ineffaçable héritage de son histoire. Une quête sensible<br />
et universelle, inspirée du parcours de son père. ■ C.F.<br />
FANTA DR<strong>AM</strong>É, Ajar-Paris, Plon, 208 pages, 19 €.<br />
ROMAN<br />
FUITE DU TEMPS<br />
Trois personnages, trois histoires,<br />
un village. Une grande fresque<br />
de l’Algérie, sur près d’un siècle.<br />
CE N’EST PAS UN HASARD, si le titre<br />
de son nouveau roman fait référence<br />
au poème Chanson d’automne, de Paul<br />
Verlaine : « Et je m’en vais / Au vent<br />
mauvais / Qui m’emporte / Deçà, delà / Pareil à la feuille<br />
morte. » Conçu à la villa Médicis, à Rome, où Kaouther Adimi<br />
a été pensionnaire (promotion 2021-2022), ce texte nous<br />
emporte dans les tourments et les tournants de l’histoire, de la<br />
colonisation à la lutte pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992,<br />
au moment où l’Algérie bascule dans la guerre civile. Au cœur<br />
de ces remous, trois personnages : Tarek, Leïla et Saïd. Au fil<br />
du temps qui passe et des aléas – de la guerre, des espoirs,<br />
des déceptions –, chacun déroule son propre chemin, se<br />
transforme. Et tandis que l’histoire s’écrit, entre eux, les liens<br />
se font, se défont. Encore une fois, la sémillante auteure de<br />
Nos richesses, prix Renaudot des lycéens 2017, nous entraîne<br />
dans les récits oubliés et les destins croisés, les blessures<br />
et les embellies, la réalité et l’imaginaire. Captivant. ■ C.F.<br />
KAOUTHER ADIMI, Au vent mauvais,<br />
Seuil, 272 pages, 19 €.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 15
ON EN PARLE<br />
JAZZ<br />
KOKOROKO, FIÈVRE COLLECTIVE<br />
Ils sont huit et DYN<strong>AM</strong>ISENT LA SCÈNE LONDONIENNE<br />
depuis quelques saisons.<br />
C’EST AUTOUR de la trompettiste Sheila<br />
Maurice-Grey que s’active ce groupe aux larges<br />
latitudes, devenu l’un des nouveaux grands espoirs<br />
de la scène londonienne grâce au single « Abusey<br />
Junction », paru en 2018. Ce premier album<br />
résume tout ce que l’on attendait de Kokoroko :<br />
un mélange à fois subtil et foisonnant de jazz, de<br />
highlife et de soul tendance seventies. Rajoutons-y<br />
une touche d’afrobeat, et le tour est joué : Could<br />
We Be More n’a pas besoin de grands discours pour<br />
raconter une multitude d’histoires, des Caraïbes<br />
à l’Angleterre, sans oublier le terreau artistique et<br />
fondateur de l’Afrique de l’Ouest. Aux percussions,<br />
Onome Edgeworth garde la cadence et varie les<br />
rythmes, tout comme le batteur Ayo Salawu ou la<br />
saxophoniste Cassie Kinoshi. Quant à la pochette,<br />
elle mérite d’être encadrée, pendant que le vinyle<br />
tourne en boucle sur nos platines… ■ S.R.<br />
KOKOROKO,<br />
Could We Be More,<br />
Brownswood<br />
Recordings/Bigwax.<br />
VICKY GROUT - DR<br />
16 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
LITTÉRATURE<br />
CONVERGENCE<br />
DES LUTTES<br />
Dans une narration originale, JENNIFER<br />
RICHARD revient avec une odyssée<br />
historique, doublée d’un roman politique.<br />
DR (2)<br />
LE LIVRE S’OUVRE avec un carton d’invitation. Ota Benga<br />
convie ses invités à la réunion de l’Amicale des insurgés, une<br />
sorte de conférence-débat, dans une dimension parallèle. Mais<br />
qui est cet hôte mystérieux ? Et que font tous ses convives réunis<br />
autour d’une convocation pour le moins surprenante : « Mort<br />
suspecte ? Mort précoce ou violente ? Vous pensez avoir été<br />
assassiné ? Le cas échéant, vous estimez l’avoir été pour vos<br />
idées ? Sortez de l’ombre ! » Ota Benga n’est pas un personnage<br />
fictif. La romancière franco-américaine, d’origine<br />
guadeloupéenne, et documentaliste pour la télévision,<br />
en a entendu parler dans un guide de New York. Un<br />
encart sur le zoo du Bronx y indiquait qu’il y avait été<br />
enfermé dans la cage des singes, en 1906… À la fin<br />
du XIX e siècle, ce Pygmée voit sa famille et sa tribu<br />
décimées lors d’atrocités perpétrées par le système<br />
colonial établi par le roi des Belges, Léopold II, dans l’État<br />
indépendant du Congo. Récupéré par un pasteur, qui<br />
l’amène aux États-Unis pour devenir une attraction majeure<br />
de l’exposition universelle de Saint-Louis, il se donnera la mort<br />
en 1916. Cette destinée poignante est au cœur de ce<br />
nouveau texte sans concessions, aux allures de farce<br />
macabre, politique et polémique. Après le très remarqué<br />
Il est à toi ce beau pays (2018) sur la colonisation en<br />
Afrique, puis Le Diable parle toutes les langues (2021)<br />
et les mémoires fictives de Basil Zaharoff,<br />
un marchand d’armes qui fit fortune lors de la<br />
Première Guerre mondiale, ce troisième volet<br />
poursuit le contre-récit de l’histoire officielle.<br />
Construit en deux temps, on y découvre Ota<br />
Benga qui raconte son histoire, et ce monde<br />
parallèle, bizarrement fréquenté, auquel il<br />
nous convie et où l’on retrouve Jean Jaurès,<br />
Che Guevara, Thomas Sankara, Martin<br />
Luther King, Rosa Luxemburg, ou encore<br />
Patrice Lumumba… Tous assassinés pour<br />
leurs idées et tous liés à son destin. Des<br />
révolutionnaires, des idéalistes, engagés<br />
pour leur cause, en sachant très bien qu’ils<br />
mourraient, que leur « royaume n’est pas<br />
de ce monde » et que leur récompense…<br />
ils l’auraient plus tard. Puissant. ■ C.F.<br />
JENNIFER RICHARD,<br />
Notre royaume n’est pas de ce monde,<br />
Albin Michel, 736 pages, 24,90 €.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 17
ON EN PARLE<br />
DESIGN<br />
PASSION<br />
ZELLIGE<br />
L’Atelier Maloukti revisite<br />
les CÉR<strong>AM</strong>IQUES<br />
MAROCAINES<br />
pour créer des objets entre<br />
tradition et contemporain.<br />
L’ART DU ZELLIGE, ces morceaux de terre cuite<br />
émaillés, découpés un à un et assemblés pour<br />
créer des motifs géométriques, a donné vie à des<br />
œuvres d’art millénaires. Avec l’Atelier Maloukti,<br />
l’architecte d’intérieur Nicolas Pascolini rend hommage<br />
à cette tradition marocaine revisitant des objets de tous<br />
les jours. Il fait arriver dans son atelier de Marrakech<br />
les carreaux bruts de Fès, ville renommée pour la qualité<br />
de sa terre argileuse, avant de procéder à la découpe en<br />
bâtonnets, losanges ou étoiles pour créer des tesselles qui<br />
recouvriront des tables, des plateaux en bois ou fabriqués à partir<br />
d’anciens tamis à couscous, ou encore des miroirs. Chaque pièce<br />
apporte une touche créative dans un appartement contemporain mais<br />
a aussi sa place dans une maison traditionnelle marocaine, comme les<br />
magnifiques riads et villas que l’Atelier a redessinés depuis son ouverture,<br />
en 2020. Pour souligner l’esprit moderne de ses créations, Nicolas Pascolini a<br />
travaillé avec les couleurs, introduisant des nouvelles teintes et des nuances<br />
pastel, comme le rose et le vert, mais aussi avec les lignes. Les structures<br />
des tables, en métal, ont été conçues pour obtenir des profils plus fins,<br />
qui valorisent les motifs en céramique. ■ L.N. ateliermaloukti.com<br />
DR (2)<br />
18 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Les motifs des vêtements<br />
sont cousus et sérigraphiés<br />
à la main, faisant de<br />
chaque pièce une œuvre<br />
d’art à part entière.<br />
MODE<br />
KATUSH, ÉTHIQUE<br />
ET MODERNE<br />
Le style unisexe de ce<br />
label kényan restitue des<br />
IDENTITÉS CULTURELLES<br />
UNIQUES dans des tenues<br />
pour le quotidien.<br />
La designeuse<br />
Katungulu Mwendwa.<br />
ELIE ULYSSE - AWCA CREATIVES - MARTHE SOBCZAK - EMMANUEL J<strong>AM</strong>BO<br />
LA DESIGNEUSE Katungulu Mwendwa a lancé sa propre<br />
griffe, Katush, en 2014 et en a fait l’une de ces jeunes<br />
marques qui conjuguent durabilité, culture africaine<br />
et qualité artisanale. Katush est un surnom assez commun<br />
chez les enfants dont le nom commence par « Kat », dans<br />
la communauté de Nairobi où la styliste a grandi. Des jeunes<br />
qui, comme elle, aiment un style décontracté et évocateur<br />
en même temps, pensé pour vivre au quotidien dans un<br />
monde globalisé, sans oublier leur identité ni leur héritage.<br />
Les huit collections qu’elle a créées jusqu’ici s’inspirent<br />
aussi bien des corsets perlés du Sud-Soudan que des robes<br />
recherchées portées par les Wodaabe, un sous-groupe du<br />
peuple peul, pour ensuite les décliner en tenues confortables.<br />
Avec « One Manjano », sa dernière collection en date, qui a été<br />
influencée par une carte postale représentant une femme au<br />
début des années 1900 à Zanzibar, la styliste célèbre les savoirfaire<br />
des artisans du continent. Son nom (« un jaune ») est une<br />
expression swahilie pour dire que chaque pièce est unique.<br />
En observant les robes traditionnelles swahilies<br />
et la versatilité du caftan, porté à travers les siècles<br />
par les hommes et les femmes, Katungulu Mwendwa a<br />
dessiné des silhouettes fonctionnelles, adaptées à la vie<br />
frénétique d’une ville en plein essor comme la capitale<br />
kenyane. Tel un clin d’œil graphique à la carte postale,<br />
les motifs organiques en noir, blanc ou ocre qui décorent<br />
les pièces rappellent les travaux de l’artiste italien Giuseppe<br />
Capogrossi, l’un des précurseurs de la peinture abstraite.<br />
Ils ont tous été cousus et sérigraphiés à la main, faisant<br />
de chaque vêtement une œuvre d’art à part entière.<br />
Dans le but de soutenir une mode locale, responsable<br />
et éthique, Katush travaille avec plusieurs partenaires<br />
qui lui permettent, par exemple, d’importer le coton filé<br />
à la main du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ou le jersey<br />
de la Tanzanie. Le cuir est sourcé et traité au Kenya, et<br />
les boutons et les boucles sont réalisés à partir de corne<br />
de vache ou de cuivre recyclé. ■ L.N. katushnairobi.com<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 19
ON EN PARLE<br />
La terrasse<br />
de l’établissement<br />
accueille cinq<br />
restaurants durant<br />
l’événement.<br />
SPOTS<br />
Chez Afro Jojo, le chef relève<br />
les plats avec des marinades<br />
spéciales et des sauces originales.<br />
GROUND<br />
CONTROL MET<br />
À L’HONNEUR<br />
LA FOOD AFRO<br />
Jusqu’à fin octobre, le continent investit les extérieurs<br />
de l’ICONIQUE LIEU DE VIE CULTUREL PARISIEN.<br />
CINQ RESTAURANTS AFRO en un seul lieu : la terrasse<br />
du Ground Control, près de la gare de Lyon. L’ancienne<br />
halle de la SNCF, transformée depuis 2017 en lieu de vie<br />
et de culture, donne carte blanche à une nouvelle génération<br />
de chefs afro-descendants avec le projet Ground Africa.<br />
Parmi les équipes installées dans les vieux bus aménagés<br />
en cuisines, on retrouve celle du BMK Paris-Bamako, qui<br />
n’a plus besoin d’être présentée, ou du New Soul Food,<br />
avec sa street-food afropéenne et ses grillades au charbon<br />
de bois. Mais aussi de nouveaux visages afro-parisiens :<br />
Boukan est le pari réussi de trois Guadeloupéens, qui<br />
ont créé leur première carte pour ce projet. Ils proposent<br />
une cuisine du terroir caribéen avec des plats de viande,<br />
des crustacés ou des poissons boucanés (marinés et fumés<br />
à l’étouffée), accompagnés de fluffy rice au lait du coco<br />
ou de houmous de banane plantain. Chez Afro Jojo,<br />
le chef, adepte d’une cuisine déstructurée, relève plats<br />
et sandwichs avec des marinades spéciales et des sauces<br />
originales à base de poivre vert de Penja ou d’épices du<br />
Nigeria : le Jojolof Rice Bowl, avec poulet frit maison,<br />
ragoût de haricots rouges et sauce maison à base de<br />
piment antillais, étonnera vos papilles. Et si chaque resto<br />
a des options végé, L’Embuscade propose une cuisine<br />
totalement afro-végane : les fêtards parisiens connaissent<br />
déjà le club (à Pigalle) et sa cantine inaugurée en 2019, les<br />
autres apprécieront les portions généreuses et gourmandes<br />
d’une cuisine métissée, déclinée en bowls et buns<br />
pour l’occasion. ■ L.N. groundcontrolparis.com<br />
FRED H - ELISE AUGUSTYNEN<br />
20 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SENESTUDIO<br />
ARCHI<br />
L’ALLIANCE ENTRE<br />
INDUSTRIE ET CULTURE<br />
Senestudio a créé un écrin aux volumes fluides pour accueillir<br />
LA MAISON EIFFAGE, près du port autonome de Dakar.<br />
TERMINÉE À TEMPS pour accueillir les premières expositions<br />
à l’occasion de la biennale, la Maison Eiffage est un nouvel<br />
espace culturel implanté dans la zone industrielle du port de<br />
Dakar. Le projet a été conçu par l’agence Senestudio, basée au<br />
Sénégal depuis 2007, comme une série de volumes imbriqués<br />
et superposés qui créent des espaces polyfonctionnels ouverts<br />
et transparents. Les pièces, distribuées sur trois étages, sont<br />
éclairées par la lumière indirecte qui rentre par les grandes<br />
verrières, orientées de façon à garantir le confort thermique<br />
intérieur et à offrir une connexion visuelle constante avec<br />
l’extérieur. Les trois grands arbres déjà présents sur le terrain<br />
ont été conservés et intégrés dans l’architecture, ce qui<br />
contribue à créer un microclimat et participe d’un effet<br />
de dépaysement dans le contexte industriel du site. Tout<br />
le projet se caractérise par cette volonté d’associer à une<br />
esthétique soignée des dispositifs techniques qui assurent<br />
le confort des visiteurs et l’écoresponsabilité du bâtiment,<br />
équipé de panneaux solaires. Les plafonds en double<br />
hauteur permettent notamment d’accrocher de très grandes<br />
œuvres d’art de la collection du constructeur français, tout<br />
en favorisant la ventilation naturelle et contrôlée. Le béton<br />
brut de décoffrage, rouge et gris, donne une allure moderne<br />
et épurée à la structure, en améliorant en même temps<br />
l’isolation acoustique et thermique. ■ L.N. senestudio.net<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 21
CE QUE J’AI APPRIS<br />
Nadia<br />
Hathroubi-Safsaf<br />
LA JOURNALISTE D’ORIGINE TUNISIENNE,<br />
rédactrice en chef du mensuel Le Courrier de l’Atlas, signe une<br />
enquête bouleversante sur les enfants des rues à Paris et alerte<br />
sur l’urgence de les prendre en charge. propos recueillis par Astrid Krivian<br />
Mes parents m’ont donné une belle éducation, en m’inculquant la générosité.<br />
Ma mère était femme de ménage, mon père commis de cuisine, ils travaillaient dur mais ont toujours partagé. Ils<br />
envoyaient de l’argent en Tunisie pour aider un voisin, accueillaient des personnes sans toit… Ça m’a structurée.<br />
Un jour, alors que j’étais enfant, ma mère faisait part de sa préoccupation concernant mon avenir<br />
professionnel à celle d’un camarade. Elle lui a répondu : « Ne vous inquiétez pas, on aura toujours besoin<br />
de femmes de ménage ! » Cette phrase violente, pleine de mépris social, m’a marquée au fer rouge. En mon<br />
for intérieur, je me suis dit que jamais je ne ferai ce métier.<br />
Au lycée, une professeure nous a parlé du déterminisme social : environ 6 % des enfants<br />
d’ouvriers obtenaient le bac. Je devais absolument en faire partie. Comme j’étais l’aînée, ma mère m’avait attribué<br />
le rôle de locomotive : si je réussissais à l’école, mes frères et sœurs suivraient. J’avais<br />
cette pression sur les épaules, mais ça a marché (et aussi pour ma fratrie). De pigiste<br />
à rédactrice en chef, j’ai gravi les échelons, sans carnet d’adresses. C’est une fierté.<br />
Je n’ai pas connu mes grands-pères. Je suis amputée d’une partie de mes<br />
racines. D’où mon besoin de trouver un ancrage à travers mes romans, c’est une façon<br />
de m’approprier mon histoire. Mon grand-père paternel est mort enseveli en effectuant<br />
des travaux de terrassement, commandés par l’administration coloniale. Qu’il ait été<br />
considéré comme indigène de sa naissance à sa mort est une douleur pour moi. Je vis<br />
dans le pays qui a colonisé le sien. Même si j’aime la France et me sens pleinement<br />
citoyenne, une bipolarité demeure. J’ai créé ma maison d’édition, Bande organisée,<br />
pour transmettre nos histoires. Et que mes aïeux ne tombent pas dans l’oubli.<br />
Mon livre Frères de l’ombre raconte le sacrifice des tirailleurs sénégalais<br />
durant les deux guerres mondiales. Ils ont versé un lourd tribut à la France, « l’amère<br />
patrie », mais ont sombré dans l’oubli : peu de gens connaissent le naufrage du paquebot Afrique, en 1920,<br />
ou le massacre de Chasseley, en 1940, et leurs droits ont été minorés. La citoyenneté, c’est redonner à chacun<br />
sa place dans le roman national, combler ces vides mémoriels. Et dire à ces descendants de soldats : vos aïeux<br />
ont participé à cette histoire, vous lui appartenez.<br />
Enfances abandonnées,<br />
JC Lattès, 192 pages, 18 €.<br />
Enfances abandonnées est née de la rencontre avec Fatiha de Gouraya, présidente de l’association<br />
SOS Migrants mineurs. Face à la défaillance des institutions, elle se bat pour la prise en charge des enfants non<br />
accompagnés qui vivent dans les rues du quartier Barbès, à Paris. Issus de situations familiales complexes ou<br />
s’estimant sans avenir dans leur pays, ils viennent essentiellement du Maroc et d’Algérie. Alors que l’État pourrait<br />
réquisitionner des places, comme il l’a fait pour les réfugiés ukrainiens. Il faut absolument les protéger de la<br />
violence de la rue. En France, septième puissance mondiale, des gosses dorment dehors, et on trouve ça normal ? ■<br />
DR<br />
22 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
PATRICE NORMAND<br />
« Même si j’aime<br />
la France et me sens<br />
pleinement citoyenne,<br />
une bipolarité<br />
demeure. »
274 rue Saint-Honoré 75001 Paris • 26 rue des Mathurins 75009 Paris<br />
191 Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris • 107 rue de Rennes 75006 Paris<br />
Créateur de chemises originales depuis 1993
C’EST COMMENT ?<br />
PAR EMMANUELLE PONTIÉ<br />
CHAPEAU MOSSI<br />
ET BAGUETTE DE MIL<br />
DOM<br />
Juillet, août. Chacun, d’une manière ou d’une autre, va prendre un peu de<br />
repos, faire une pause, les pieds en éventail quelque part. Sur sa terrasse ou dans son<br />
jardin, à l’étranger, au village. Justement, au village… L’occasion de fréquenter un peu<br />
les anciens, de se remémorer leurs habitudes alimentaires, par exemple. Et pourquoi<br />
pas, de rêver un peu. En ces temps très alarmistes concernant l’approvisionnement<br />
en pain du continent, et sa dépendance assez surréaliste au blé<br />
ukrainien (ou russe), dont l’exportation pâtit de la guerre, on peut se<br />
demander comment on est passés de la galette de mil au petit déj<br />
ou de l’igname bouillie en accompagnement d’un repas, que nos<br />
grands-mères continuent à privilégier aujourd’hui, au pain blanc<br />
fabriqué à base de blé. Bien entendu, la réponse est dans la bouche<br />
de n’importe quel Béotien : le Nord a imposé sa céréale reine au Sud,<br />
et la mondialisation aidant, la baguette « parisienne » est devenue<br />
incontournable au pays du mil et du sorgho. C’est ballot…<br />
Alors, en ces temps de villégiature, on peut se mettre à<br />
rêver qu’une série de boulangers africains, amateurs de sensations<br />
gustatives novatrices et branchées, lancent la mode de la baguette<br />
de mil, des croissants d’igname ou des petits pains de fonio. Après<br />
tout, la vague healthy food qui s’est abattue en Occident a bien mis<br />
la galette de maïs, la miche d’épeautre et les croûtes sésame dans<br />
les corbeilles. Le comble du chic chez les « bobo-bread » qui boudent<br />
leur pain blanc, accusé de tous les maux contre la santé. On<br />
trouve même des baguettes aux neuf céréales, que vous conseillent<br />
des vendeurs bien incapables de vous donner leurs noms… Bref,<br />
si l’Afrique a décidé que le pain était incontournable sur sa table,<br />
autant en fabriquer du local, doper les cultures, créer de l’emploi et lancer la mode.<br />
Après les Français « béret basque et baguette de pain », on pourra dire d’un Burkinabé :<br />
« chapeau Mossi et baguette de mil » ! On peut rêver plus loin et imaginer déjeuner à<br />
Paris avec un pain au sorgho importé du continent…<br />
En tous les cas, depuis le Covid-19, on a dit et redit qu’il fallait privilégier les<br />
circuits courts. Une règle confirmée en partie par la guerre en Ukraine et ses retombées.<br />
Et si l’on ajoute le réchauffement climatique, il n’est pas exclu que l’Occident se mette à<br />
cultiver du mil à la place du blé dans quelques temps. Il est plus résistant à la chaleur.<br />
Et tout aussi goûteux. Si, si… On a le droit de rêver que la baguette de mil devienne la<br />
baguette magique de demain ! ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 25
perspectives<br />
FORÊTS<br />
L’AFRIQUE,<br />
DERNIER POUMON<br />
DE LA PLANÈTE ?<br />
26 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Du nord au sud, c’est<br />
l’un des plus grands<br />
territoires verts du monde,<br />
avec en particulier<br />
le bassin du Congo,<br />
deuxième forêt humide<br />
après l’Amazonie.<br />
Une richesse naturelle<br />
essentielle pour l’humanité,<br />
un potentiel immense<br />
pour le continent, menacé<br />
chaque jour un peu plus par<br />
l’exploitation et les trafics.<br />
par Thibaut Cabrera<br />
NANNA HEITMANN/NYT/REDUX-REA<br />
Dans les environs<br />
de Mbandaka,<br />
en République<br />
démocratique<br />
du Congo.<br />
De la Californie à la Gironde (en<br />
France), en passant par le Maroc,<br />
les incendies viennent de ravager<br />
des milliers d’hectares de forêts en<br />
l’espace de quelques semaines. Les<br />
conséquences désastreuses de ces<br />
« mégafeux » nourrissent fatalement<br />
les réflexions autour de l’avenir des<br />
forêts, en bute au dérèglement climatique.<br />
Mais aussi à l’action directe de l’homme. En 2021, l’Amazonie<br />
a perdu 18 arbres par seconde en moyenne, en grande<br />
partie à cause de la déforestation. Le principal « poumon » du<br />
monde pourrait prochainement être amputé. Pour survivre,<br />
la planète devra alors miser sur son second poumon, la forêt<br />
d’Afrique centrale. Elle semble pourtant être vouée au même<br />
sort. Les forêts du continent sont des écosystèmes uniques et<br />
fascinants : la forêt d’arganiers du Maroc, les forêts sèches de<br />
Miombo, au Mozambique, sont tous des symboles de sa biodiversité<br />
foisonnante. Pourtant, elles sont grandement menacées<br />
par une tendance au développement de la déforestation. Malgré<br />
les discours des dirigeants africains et de leurs confrères<br />
occidentaux contre ce phénomène, leur destruction continue<br />
de progresser de jour en jour. Le contexte de dérèglement climatique<br />
et de croissance démographique du continent ne joue<br />
pas non plus en faveur de la préservation des forêts. Les effets<br />
de la guerre en Ukraine sur les prix alimentaires devraient faire<br />
augmenter les surfaces agricoles, ce qui induit, dans la plupart<br />
des cas, de nouveaux déboisements. Finalement, la préservation<br />
des forêts africaines est tributaire d’une volonté commune<br />
et de la transparence de ses parties prenantes : gouvernements,<br />
exploitants, société civile et organismes de financement. Un<br />
consensus difficile à trouver tant les paradoxes autour de la<br />
lutte contre la déforestation sont grands.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 27
PERSPECTIVES<br />
État des lieux<br />
en 6 questions<br />
1. Où se trouvent<br />
les forêts d’Afrique ?<br />
LE CONTINENT EST RECOUVERT DE FORÊTS dont la biodiversité<br />
est riche. Elles représentaient plus d’un cinquième de<br />
sa superficie en 2020, selon l’Organisation des Nations unies<br />
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), soit 636 millions<br />
d’hectares. Dans neuf pays d’Afrique subsaharienne, les forêts<br />
couvrent plus de la moitié du territoire. À l’ouest, c’est le cas<br />
de la Guinée-Bissau et du Liberia. C’est également le cas du<br />
Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo<br />
(RDC), de l’Angola, de la Zambie et de la Tanzanie. Quant<br />
au Gabon et à la Guinée équatoriale, leur surface forestière<br />
atteint près de 90 %. L’Afrique centrale abrite la deuxième plus<br />
grande forêt tropicale du monde, après l’Amazonie et devant la<br />
Papouasie-Nouvelle- Guinée : la forêt du bassin du Congo. Cette<br />
dernière s’étend sur six pays, du Cameroun à la RDC, et sur plus<br />
de 3,5 millions de km 2 . Les trésors dont elle regorge ne doivent<br />
pas faire oublier les autres espaces forestiers du continent. À<br />
l’est, les 273 300 hectares de la forêt Mau, au Kenya, abritent<br />
la source de nombreuses rivières qui alimentent le plus grand<br />
lac africain, le lac Victoria. Dans le sud du Nigeria, les forêts de<br />
l’État de Cross River couvrent plus de 4 000 km 2 et disposent<br />
d’une riche biodiversité. Au cœur du pays le plus densément<br />
peuplé du continent, elles sont fortement menacées. Malgré une<br />
surface forestière forcément moins importante qu’en Afrique<br />
subsaharienne, le Maghreb compte également son lot de forêts.<br />
Le Maroc en est l’illustration, avec 9 millions d’hectares, qui<br />
constituent l’un des atouts de la richesse écologique du pays.<br />
2. Quelles sont<br />
leurs caractéristiques ?<br />
L’AFRIQUE EST COMPOSÉE de territoires aux climats divers,<br />
qui accueillent de vastes communautés d’organismes vivants,<br />
les biomes terrestres. On en dénombre trois grands qui correspondant<br />
aux forêts africaines. Les pays d’Afrique centrale,<br />
d’Afrique de l’Ouest, au niveau de l’équateur, et la partie est de<br />
Madagascar sont composés de forêts tropicales humides, similaires<br />
à l’Amazonie et aux forêts d’Asie du Sud-Est. Ces régions<br />
à la température chaude et constante bénéficient de précipitations<br />
abondantes qui favorisent le développement de la biodiversité.<br />
Les forêts tropicales sont entourées de savanes, dont le<br />
climat est marqué par une saison des pluies et une période de<br />
sécheresse. On y trouve des prairies et terres arbustives au sein<br />
desquelles se trouvent des espaces forestiers moins denses. Au<br />
nord du Maghreb et au niveau de la pointe sud du continent, le<br />
climat méditerranéen, caractérisé par une courte saison sèche,<br />
des précipitations irrégulières et des vents importants, requiert<br />
des forêts une constante adaptation. Dans certains pays, elles<br />
sont surtout une source de richesse non négligeable. Malgré<br />
la faible part des exportations de produits forestiers, principalement<br />
du bois brut (moins de 2 % pour l’Afrique subsaharienne),<br />
le continent tire plus de bénéfices de ses forêts que les<br />
autres continents. En 2020, ces bénéfices atteignaient 2,4 %<br />
du PIB en Afrique subsaharienne, montant jusqu’à 9,4 % pour<br />
la République démocratique du Congo. Dans les pays dont la<br />
couverture forestière est importante, le secteur peut devenir<br />
un pilier de l’économie. Au Gabon, il représente 60 % du PIB<br />
(hors hydrocarbures). Face à l’importance et au dynamisme de<br />
ce secteur, le pays a pris un tournant il y a une dizaine d’années<br />
visant à industrialiser la filière forêt-bois. Cela s’est par exemple<br />
traduit par l’interdiction de l’exportation de grumes non transformées<br />
ou la promotion d’une gestion durable des ressources<br />
naturelles de ces forêts.<br />
3. Peut-on parler<br />
de « poumon du monde » ?<br />
GRÂCE À LEURS FEUILLES, les arbres captent le dioxyde de<br />
carbone (CO 2<br />
) présent dans l’atmosphère et utilisent l’énergie<br />
du soleil pour le réduire et produire des glucides leur permettant<br />
de vivre. Par le biais de ce processus de photosynthèse,<br />
ils produisent et rejettent du dioxygène, communément<br />
appelé oxygène. C’est en référence à ce fonctionnement que la<br />
forêt amazonienne, couvrant environ 5,3 millions de km 2 , est<br />
considérée comme le poumon du monde. La forêt du bassin<br />
du Congo, s’étendant sur plus de 3,5 millions de km 2 , est par<br />
déduction considérée comme le second poumon du monde.<br />
Cependant, les scientifiques s’accordent pour relativiser ce<br />
rôle que l’on prête à ces immenses espaces. Le cliché véhiculé<br />
par certaines ONG affirmant que l’Amazonie produit 20 % de<br />
notre oxygène est faux. Sans s’arrêter sur un chiffre précis,<br />
une grande partie communauté scientifique ne lui en accorde<br />
pas plus de 6 %. Au-delà des estimations, il faut retenir que la<br />
forêt consomme, à elle seule, une grande partie de l’oxygène<br />
qu’elle produit. L’excédent d’oxygène rejetée nous permettant<br />
de respirer représente donc une part minime. La préservation<br />
des forêts contribue surtout à la lutte contre le réchauffement<br />
planétaire et la disparition de leur biodiversité. Elles constituent<br />
l’un des plus larges réservoirs de dioxyde de carbone.<br />
C’est ce fameux gaz à effet de serre, qui contribue à dérégler<br />
le climat de la planète, que les arbres et de nombreuses autres<br />
plantes absorbent. La disparition de ces forêts augmenterait<br />
drastiquement la teneur en CO 2<br />
dans l’air, ce qui serait désastreux<br />
pour l’effet de serre. En matière de biodiversité, la forêt<br />
du bassin du Congo est un réel cas d’école : on y trouve environ<br />
10 000 espèces de plantes tropicales, dont 30 % sont uniques,<br />
selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).<br />
28 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
ASHLEY GILBERTSON/NYT/REDUX-RÉA<br />
Près de Kinshasa, en RDC. L’écosystème du bassin<br />
du Congo est exploité tant par les populations locales<br />
que par de grandes entreprises, qui transportent<br />
leur production sur le fleuve,<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 29
PERSPECTIVES<br />
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, lors de la COP 26, à Glasgow, en novembre 2021.<br />
4. En quoi sont-elles menacées ?<br />
L’AFRIQUE PRÉSENTE le taux annuel de recul de la forêt le<br />
plus élevé sur la période 2010-2020, selon la FAO. La disparition<br />
de 3,9 millions d’hectares témoigne d’abord d’une entreprise<br />
organisée. Celle-ci s’explique notamment par l’accroissement<br />
de la population : l’ONU anticipe le doublement de la population<br />
continentale entre 2022 et 2050. Dès lors, il n’est pas<br />
surprenant d’entendre le président de la République démocratique<br />
du Congo, Félix Tshisekedi, annoncer en 2019 qu’au<br />
« rythme actuel d’accroissement de la population et de nos<br />
besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition<br />
à l’horizon 2100 ». Une grande partie des pertes en Afrique<br />
centrale se situent dans des zones d’agriculture de subsistance<br />
pratiquée par les populations locales. De plus, en RDC, plus<br />
de 90 % de l’énergie consommée provient du bois. En Côte<br />
d’Ivoire, les chiffres sont marquants : le pays ne compte plus<br />
que 3 millions d’hectares de forêts, contre 16 millions dans<br />
les années 1960. La culture du cacao est la cause principale de<br />
ce recul massif. Mécaniquement, la croissance démographique<br />
fulgurante, combinée à la nécessité d’assurer les moyens de<br />
subsistance des populations locales, favorise la déforestation.<br />
D’autres causes, moins honorables, doivent être évoquées. Le<br />
double discours de certains dirigeants d’Afrique centrale en est<br />
une. Si la plupart défendent publiquement la préservation des<br />
forêts, ils n’hésitent pas non plus à céder ces dernières à des<br />
entreprises étrangères avides d’en faire d’immenses exploitations<br />
commerciales. La protection des écosystèmes forestiers<br />
se heurte de manière frontale aux intérêts privés des États. En<br />
RDC, concéder des terrains aux multinationales dans le cadre<br />
de l’exploitation minière et pétrolière a eu des effets catastrophiques<br />
sur la forêt. Récemment, le gouvernement a autorisé<br />
de nouveaux forages pétroliers dans des zones écologiquement<br />
sensibles, comme le parc national du Virunga, situé à l’extrême<br />
est du pays. Sanctuaire de gorilles le plus important du monde,<br />
ce parc protégé se voit désormais menacé, alors que le président<br />
Tshisekedi avait approuvé, lors du sommet mondial sur le climat<br />
à Glasgow, en novembre 2021, un accord de dix ans visant à<br />
protéger la forêt tropicale du bassin du Congo. Il ne s’agit pas de<br />
la première contradiction relevée. En mars 2020, Greenpeace<br />
dénonçait l’attribution de plusieurs contrats de concession<br />
d’exploitation forestière par le gouvernement congolais à deux<br />
sociétés chinoises. Cela intervenait quelque temps après que la<br />
RDC eut reçu une aide internationale de plus de 10 millions de<br />
dollars dans le cadre d’un programme de gestion durable des<br />
forêts. Depuis février 2021, en Centrafrique, c’est la Russie qui<br />
tire bénéfice des forêts. L’influence du groupe Wagner sur les<br />
autorités centrafricaines lui a permis de mettre la main sur une<br />
YVES HERMAN/REUTERS<br />
30 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
À Madagascar, des habitants prélèvent de la matière première pour leurs constructions sur un baobab à terre.<br />
PASCAL MAÎTRE/MYOP<br />
immense parcelle forestière dans la province de Lobaye, dans<br />
le sud-ouest du pays. Liée au groupe russe, l’entreprise chargée<br />
de ces forêts les exploite de manière intensive, au mépris de<br />
la loi, sans même payer de taxes. Les intérêts privés des États<br />
centre-africains les poussent donc à autoriser des concessions<br />
étrangères, souvent chinoises et vietnamiennes, à surexploiter<br />
leurs forêts. Dans cette conjoncture, les incendies s’ajoutent à<br />
la longue liste des dangers qui menacent ces zones. Ils sont dus<br />
à la conjonction de vagues de chaleur et de sécheresse, résultats<br />
du réchauffement climatique. C’était récemment le cas en<br />
Tunisie, en Algérie et au Maroc, où ils ont provoqué le déplacement<br />
de plusieurs milliers de familles. Selon la FAO, 78 % des<br />
superficies brûlées dans les zones arborées entre 2001 et 2019<br />
étaient situées sur le continent. Mais ce chiffre doit être relativisé<br />
: d’abord, le feu a une fonction écologique sur certaines<br />
surfaces de savanes, qui brûlent de façon cyclique. De plus, les<br />
incendies qui se sont déclarés en Afrique centrale, là où sont<br />
comptabilisés la majorité d’entre eux, touchent principalement<br />
des écosystèmes agricoles, et résultent de la culture sur brûlis,<br />
une pratique simple et peu coûteuse qui vise à refertiliser les<br />
sols par le brûlage des terres. Cependant, ce type de culture,<br />
parfois risqué, peut entraîner des incendies non maîtrisés. Face<br />
à cela, la préservation des forêts doit aussi inclure la protection<br />
des populations qui y vivent.<br />
5. Qui pour les protéger ?<br />
LE 18 JUILLET DERNIER, à Kigali, au Rwanda, s’ouvrait le<br />
premier Congrès des aires protégées d’Afrique. L’événement,<br />
qui rassemblait les acteurs politiques et la société civile, était<br />
destiné à échanger sur le rôle de ces zones dans le développement<br />
de l’Afrique. Au cœur des stratégies de conservation de la<br />
biodiversité, celles-ci représentent actuellement plus d’un quart<br />
des forêts du continent. Cette proportion n’est pas négligeable,<br />
et devrait s’accroître, selon l’objectif mondial déterminé en<br />
octobre 2021 lors de la COP15, visant à protéger, d’ici à 2030,<br />
30 % des mers et des terres du globe. Les six catégories d’aire<br />
protégée vont de la simple « conservation », qui admet l’activité<br />
économique et les interactions avec les humains, à la « conservation<br />
stricte », comme c’est le cas dans les réserves naturelles<br />
intégrales. Plusieurs rapports ont montré que la dernière permettait<br />
une meilleure préservation des ressources. Mais les<br />
aires protégées sont parfois remises en cause. D’abord, parce<br />
que la majorité d’entre elles sont sous-financées, victimes de<br />
gestion défaillante et des contradictions des gouvernements<br />
nationaux. Dans la plupart des pays d’Afrique, les premières<br />
aires protégées ont été créées au cours de la période coloniale.<br />
D’anciens cadres d’administrations coloniales ont ensuite été à<br />
l’initiative de la création de nombreuses ONG internationales<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 31
PERSPECTIVES<br />
qui visent à protéger ces territoires et sont engagées dans leur<br />
institution. Leur discours est influencé par le mythe, hérité de<br />
cette période, d’une Afrique aux forêts vierges et sauvages. Par<br />
conséquent, certaines aires protégées concilient difficilement<br />
préservation de la biodiversité et prise en compte des droits<br />
humains et fonciers. Les exclusions de populations locales et<br />
les violences à leur encontre sont monnaie courante dans les<br />
aires protégées à conservation stricte. Les gestionnaires visent<br />
avant tout à séduire une clientèle de touristes occidentaux en<br />
tentant de leur vendre une nature vierge et encore inexplorée.<br />
Au-delà du strict périmètre des aires protégées, la lutte pour<br />
la préservation des forêts mobilise des organisations comme la<br />
Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC). L’organisation,<br />
créée en 2005, regroupe les six pays abritant le bassin<br />
du Congo (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale,<br />
Centrafrique, RDC) ainsi que le Burundi, le Rwanda, le Tchad<br />
et São Tomé-et-Principe. Via une approche durable et économiquement<br />
inclusive, la commission plaide pour une gestion<br />
raisonnée de la forêt tropicale. Le rôle des acteurs occidentaux,<br />
ONG et gouvernements, dans le combat contre la déforestation<br />
sur le continent est également notable. Cependant, il est<br />
de plus en plus critiqué par la société civile et les dirigeants<br />
politiques africains. Les appels publics des pays occidentaux<br />
aux États du continent à contribuer à la lutte contre le réchauffement<br />
climatique en renonçant à la déforestation et à leurs<br />
réserves de combustibles fossiles passent mal. La raison en est<br />
simple : la prospérité occidentale s’est construite sur la base<br />
de ces mêmes combustibles. De plus, le rôle de ces pays dans<br />
l’exportation de minéraux rares joue un rôle direct sur la déforestation<br />
en Afrique.<br />
6. La finance verte<br />
est-elle la solution ?<br />
QUELLE SOLUTION pour sauver la forêt africaine ? L’insuffisance<br />
des actions entreprises ne rend pas honneur au large<br />
consensus selon lequel il est crucial de préserver les espaces<br />
forestiers. La mise en défens de certains d’entre eux – consistant<br />
à en interdire l’exploitation – pourrait aider à leur restauration.<br />
En Côte d’Ivoire par exemple, cette solution permettrait<br />
d’assurer leur régénération en un temps relativement court<br />
– une vingtaine d’années. Cette technique implique de laisser<br />
32 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Dans le port de Douala, au Cameroun, un chargement destiné au marché européen,<br />
ALFREDO D’<strong>AM</strong>ATO/PANOS-RÉA<br />
une terre entièrement vacante pour favoriser sa restauration<br />
naturelle. Cependant, quand bien même cette technique serait<br />
choisie, elle risquerait de se heurter à une limite foncière identifiée<br />
sur le continent : une terre non utilisée est considérée<br />
comme pouvant être occupée. De plus, de nombreuses populations<br />
qui habitent et gravitent autour des forêts vivent de<br />
leur exploitation. Elles verraient une grande partie de leurs<br />
revenus disparaître avec l’interdiction d’y accéder. Dans une<br />
étude parue en mai 2022, la Banque africaine de développement<br />
(BAD) présente les pionniers africains de la finance verte.<br />
Parmi eux, on retrouve notamment le Gabon et le Mozambique,<br />
considérés comme des modèles à suivre dans la lutte contre la<br />
déforestation. En plus de l’interdiction d’exporter du bois non<br />
transformé et de l’exploiter de manière abusive, le pays a introduit<br />
des systèmes d’incitation financière. Les taxes payées par<br />
les concessions forestières sont désormais modulées, variant<br />
en fonction des certifications qu’elles obtiennent. Le Gabon<br />
obligera prochainement les sociétés opérant sur son territoire<br />
à se conformer au label environnemental Forest Stewardship<br />
Council (FSC), qui promeut une gestion durable et responsable<br />
des forêts. En parallèle, le marché du carbone gagne<br />
progressivement du terrain. Jusqu’à présent, le faible prix des<br />
crédits carbone en Afrique l’empêchait de décoller. Le continent<br />
ne représentait pas plus de 2 % du marché mondial du carbone<br />
en 2021. Mais pour atteindre les objectifs de lutte contre le<br />
changement climatique, de plus en plus d’États s’y intéressent.<br />
Il y a fort à parier que la demande augmentera et que les initiatives<br />
commerciales en la matière se multiplieront. En RDC,<br />
certaines concessions forestières sont actuellement à l’arrêt, ne<br />
pouvant plus assumer leurs coûts logistiques. L’idée de placer<br />
les immenses espaces qu’elles possèdent en conservation pour<br />
convertir des sites d’exploitation forestière en programmes de<br />
crédits carbone a déjà séduit certaines d’entre elles… Des initiatives<br />
dont l’éthique est largement discutable. Les contradictions<br />
relevées dans la lutte contre la déforestation en Afrique soulèvent<br />
la question du point d’équilibre entre le développement<br />
du continent et la protection de ses forêts. Elles soulèvent également<br />
la question de la redistribution des richesses qui émanent<br />
du commerce du bois. Les intérêts engendrés, en particulier<br />
en Chine, sont colossaux (75 % de la production de bois en<br />
Afrique part pour la Chine). Pourtant, les retombées locales<br />
sont dérisoires. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 33
PERSPECTIVES<br />
«Olivier Mushiete<br />
« Nous bâtissons un édifice<br />
arbre par arbre »<br />
Il a été nommé en août 2021 responsable de l’Institut congolais pour la conservation<br />
de la nature (ICCN), un organisme qui gère les aires protégées. Celles-ci couvrent<br />
13,8 % de la surface de la République démocratique du Congo (RDC), soit un total<br />
de 345 000 km2. Entretien franc et direct sur les enjeux, les défis de la conservation<br />
et de la protection de la nature. propos recueillis par Zyad Limam<br />
<strong>AM</strong> : Vous dirigez l’Institut congolais pour<br />
la conservation de la nature (ICCN) depuis août 2021.<br />
Quels sont les objectifs de cet organisme ?<br />
Olivier Mushiete : L’ICCN est une entreprise publique qui a été<br />
créée en 1975, presque un demi-siècle, et qui a comme mission<br />
principale de mettre en application la loi 14/003 sur la conservation<br />
de la nature. Cette loi et le cadre juridique sont assez précis.<br />
L’une de nos principales missions consiste justement à mettre au<br />
point certaines des règles de mise en application.<br />
Qu’est-ce que l’ICCN représente sur le terrain ?<br />
Il gère 80 aires protégées, dont les plus connues sont le parc<br />
national des Virunga et le parc national de Kahuzi-Biega (qui<br />
abritent les fameux gorilles de montagne), le parc national de la<br />
Garamba (où nous allons réintroduire les rhinocéros blancs, et<br />
qui abrite des girafes), le parc marin des Mangroves, le long du<br />
littoral, et le parc national de l’Upemba, à l’extrême sud du pays.<br />
Ces aires protégées couvrent 13,8 % de l’étendue du territoire<br />
national. Une vingtaine est active et connue, mais la plupart de<br />
ces zones sont aujourd’hui inexploitées ou inactives, endormies<br />
en quelque sorte. Nous avons pour mission de les réveiller, de<br />
les rendre dynamiques. Mais l’autorité et les missions de l’ICCN<br />
s’étendent au-delà des aires protégées. Nos « rangers », nos écogardes,<br />
ont le droit de poursuivre les braconniers jusqu’à 50 kilomètres<br />
en dehors de ce périmètre. De plus, nous travaillons avec<br />
les communautés locales, ce qui nous oblige à définir des zones<br />
tampons autour des aires protégées. La superficie totale de notre<br />
juridiction représente ainsi 550 000 km², soit près de 22 % du<br />
territoire national. L’ICCN a donc un impact direct sur un tiers de<br />
la population congolaise, c’est-à-dire 30 millions de personnes.<br />
C’est immense. Est-ce réellement faisable ?<br />
Les espaces gérés représentent en gros la superficie de la<br />
France métropolitaine. C’est immense. Mais le contexte actuel,<br />
marqué par les fortes préoccupations globales sur les changements<br />
climatiques, les pertes irrémédiables de biodiversité, est<br />
favorable pour repenser et reconstruire la relation entre l’humain<br />
et la nature. En RDC, nous avons cette chance d’avoir<br />
encore de très grands espaces naturels, parfois totalement<br />
vierges et qui ouvrent des possibilités d’investir justement<br />
dans cette relation. La promotion de l’économie verte à grande<br />
échelle est un acte naturel pour nous, les Congolais. L’agroforesterie<br />
permet de créer des itinéraires agricoles plus respectueux<br />
de l’environnement. Quelques dizaines d’exemples existent. On<br />
peut aussi investir dans la production et la distribution de l’énergie<br />
qui, dans un pays aussi grand que le nôtre et compte tenu<br />
de la diversité des écosystèmes, peut provenir de l’eau (froide<br />
ou chaude), du soleil, du vent, ou encore de la biomasse. En<br />
connectant intelligemment la production d’énergie durable avec<br />
la production et la transformation des produits agricoles, on<br />
peut développer à très grande échelle des activités bénéfiques<br />
à la fois pour les hommes et pour l’environnement Nous voilà<br />
en plein cœur de l’économie verte !<br />
Vous avez entrepris un travail de fond pour redonner à<br />
l’organisation sa raison d’être et son efficacité. Avez-vous<br />
la sensation d’être soutenu par les autorités publiques ?<br />
Mon équipe et moi avons commencé à travailler à la direction<br />
générale de l’ICCN en août 2021, nous venons d’arriver en<br />
quelque sorte [sourire]. Nous avons commencé par faire un état<br />
des lieux qui, vu l’immensité du patrimoine de l’institution et<br />
son long historique, n’est pas encore tout à fait terminé. L’ICCN<br />
est sous la tutelle du ministère de l’Environnement et du Développement<br />
durable, dirigé par Eve Bazaiba, qui a rang de vice-<br />
Premier ministre, le ministère du Tourisme, dirigé par Modero<br />
Nsimba Matondo, et le ministère de la Défense nationale et des<br />
Anciens combattants, dirigé par Gilbert Kabanda Rukemba,<br />
34 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Le directeur de l’ICCN, lors d’une promotion des agents du site, dans la réserve de Bombo-Lumene.<br />
DR<br />
qui supervise l’ensemble de nos rangers, le Corps chargé de la<br />
sécurisation des parcs nationaux et réserves apparentées (Cor-<br />
PPN). Dans la ligne de conduite confirmée à plusieurs reprises<br />
par le chef de l’État lui-même, nous bénéficions du soutien des<br />
autorités. Il m’incombe désormais de concevoir et de mettre en<br />
œuvre un programme clair ainsi que des actions concrètes sur le<br />
terrain. J’ai bon espoir de réussir ce défi à court terme, notamment<br />
grâce au soutien de nos autorités publiques nationales.<br />
Comment s’organise la relation avec les bailleurs<br />
de fonds internationaux ? Avez-vous l’impression<br />
d’être aidé et financé à la hauteur des enjeux ?<br />
L’ICCN dépend de bailleurs de fonds internationaux pour<br />
plus de 90 % de ses dépenses de fonctionnement et d’investissement.<br />
Nous fonctionnons sur la base de partenariats public-privé<br />
avec de grandes ONG internationales ou nationales, qui cogèrent<br />
une dizaine de nos aires protégées. Les supports financiers internationaux<br />
se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros<br />
par an. Les ressources financières dont a besoin l’ICCN pour<br />
atteindre ses objectifs ne peuvent pas dépendre uniquement de<br />
ce schéma de fonctionnement. L’État prend en charge une partie<br />
de nos dépenses d’investissement et de fonctionnement ainsi<br />
qu’une très petite partie de la rémunération du personnel. Les<br />
financements que nous recevons actuellement donnent un premier<br />
élan. Cependant, ils restent insuffisants pour permettre de<br />
déployer l’immense potentiel de l’institution. Il est fondamental<br />
pour nous de développer des activités indépendantes productrices<br />
de revenus. L’économie verte sera le poumon de l’ICCN !<br />
Comment peut-il générer ses propres ressources ?<br />
Dès notre arrivée dans la cabine de pilotage de l’ICCN, nous<br />
avons défini quatre grands piliers d’action. En premier lieu, il<br />
faut assurer la souveraineté du territoire et restaurer l’autorité de<br />
l’État jusqu’au plus profond du pays. Le deuxième pilier consiste<br />
à mettre l’homme au cœur de la mission de conservation de la<br />
nature, en améliorant drastiquement l’effectif et les conditions<br />
de travail du personnel de l’ICCN et en organisant une bien<br />
meilleure coopération avec les communautés locales. Pour le<br />
troisième, il s’agit d’assumer notre propre responsabilité par<br />
une montée en puissance drastique de notre capacité d’autofinancement<br />
par la promotion d’une économie verte et vertueuse<br />
à grande échelle. Pour cela, nous nous engageons sur quatre<br />
pistes prometteuses. Piste 1 : le développement de l’agroforesterie<br />
communautaire climatique durable. Il existe déjà plusieurs<br />
modèles de ce type d’agriculture dans notre pays. Les projets<br />
pilotes ont été réalisés depuis près de vingt ans à petite échelle.<br />
Aujourd’hui, avec sa capacité de mobilisation et sa grande<br />
diversité d’écosystèmes, l’ICCN est en mesure de reproduire<br />
ces modèles à grande échelle dans de nombreuses localités.<br />
Piste 2 : la production et la distribution d’énergie durable. Depuis<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 35
PERSPECTIVES<br />
le début de l’année, nous nous sommes engagés dans un partenariat<br />
avec l’Agence nationale de l’électrification et des services<br />
énergétiques en milieux rural et périurbain, et avons déjà<br />
une petite dizaine de projets prévus. Ils prévoient des productions<br />
d’énergie durable par le recours à diverses sources : l’eau<br />
(froide ou chaude), le soleil, le vent, la biomasse, etc. Piste 3 :<br />
l’écotourisme. Les possibilités touristiques sont innombrables<br />
en RDC. Malheureusement, le pays est encore fermé, il est<br />
difficile de venir, d’obtenir un visa – lequel coûte cher. C’est<br />
compliqué aussi pour les Congolais de se déplacer à l’intérieur<br />
de leur pays, de découvrir les trésors de leur nature. Il faut<br />
des connexions aériennes accessibles, régulières et sécurisées<br />
pour qu’un habitant de Goma, par exemple, puisse aller voir les<br />
lamantins du parc marin des Mangroves 2 500 kilomètres plus<br />
loin. Nous travaillons sur un très beau projet qui s’appelle Congo<br />
Air Nature, afin de développer un service<br />
de connexion aérienne interne pour<br />
l’ICCN et des services et infrastructures<br />
en rapport avec le tourisme. Nous avons<br />
potentiellement une vingtaine de destinations,<br />
dont une petite douzaine est<br />
accessible et opérationnelle. Les plus<br />
courageux peuvent déjà venir et voir<br />
des choses assez extraordinaires. Enfin,<br />
piste 4 : la finance climat et carbone. J’ai<br />
déjà eu l’occasion de développer un puits<br />
de carbone agroforestier sur le plateau<br />
des Batéké il y a quelques années. Nous<br />
pouvons répliquer ce genre de modèle<br />
sur l’ensemble du patrimoine foncier<br />
de l’ICCN. Nous avons la possibilité de<br />
rémunérer le travail de protection de la<br />
nature mené par l’institut et ses partenaires.<br />
Le quatrième et dernier pilier stratégique du programme<br />
propose d’améliorer nos connaissances du monde vivant et de<br />
repenser la relation de l’homme avec la nature par l’éducation<br />
de base, la formation professionnelle, la recherche scientifique<br />
et la promotion de la culture traditionnelle.<br />
« Le taux<br />
de déforestation<br />
est de moins de<br />
1 % et reste très<br />
faible, même s’il<br />
paraît alarmant<br />
en valeur<br />
absolue, la forêt<br />
étant immense. »<br />
La finance verte reste pour le grand public un concept<br />
assez mystérieux. Est-ce que cela représente<br />
une véritable opportunité ? Et à quelles conditions ?<br />
C’est l’un des outils essentiels pour transformer ce lien entre<br />
l’homme et la nature. La finance verte représente une véritable<br />
opportunité, et c’est l’une des grandes missions de l’ICCN. Investir<br />
dans la conservation de la nature doit devenir une opération<br />
rentable. Sur le plan économique, mais aussi écologique et<br />
humain. Nous avons notre propre travail à faire pour que cela<br />
fonctionne. Nous devons définir des axes d’intervention clairs<br />
et un processus d’appropriation par les communautés locales,<br />
délimiter précisément les zones concernées, les protéger, développer<br />
en priorité les investissements dans les productions de<br />
base, alimentaires et énergétiques, et établir un dispositif de<br />
surveillance pour évaluer avec précision les résultats en matière<br />
de conservation de la nature. Cette finance a un impact global<br />
positif en permettant de partager équitablement les bénéfices,<br />
de consommer moins d’énergie fossile et d’intrants, d’augmenter<br />
les espaces de forêt grâce à des programmes agroforestiers,<br />
de replantation ou de régénération naturelle au sein de nos<br />
aires protégées. Avec des retombées globalement positives sur<br />
le changement climatique. Voici quelques années, sur le plateau<br />
des Batéké, nous avons augmenté le stock de carbone<br />
en plantant une forêt sur un sol de savane herbeuse. De là,<br />
nous avons tiré un revenu en vendant des crédits carbone à la<br />
Banque mondiale. Une autre performance consiste à réduire le<br />
taux de déforestation. En RDC, la grande majorité est due à la<br />
pratique de l’agriculture sur abattis-brûlis – le paysan lambda<br />
brûle la forêt pour accéder à des terrains fertiles. Ainsi, il va<br />
brûler 50 hectares alors qu’il n’a besoin<br />
que d’un demi-hectare. Il est possible de<br />
le réorienter vers une activité vertueuse<br />
en utilisant des techniques appropriées<br />
d’agroforesterie. La RDC dispose d’un<br />
potentiel immense dans ce domaine. La<br />
mise en place d’un système d’évaluation<br />
de notre performance écologique autour<br />
de nos aires protégées nous permettra<br />
de négocier une rémunération équitable<br />
pour ce service environnemental global.<br />
Sous notre impulsion, l’ICCN a déjà commencé<br />
à travailler sur plusieurs projets<br />
avec quelques partenaires. J’ai bon espoir<br />
que le marché carbone nous apportera<br />
ses premières ressources durant l’année.<br />
Nous sommes ainsi au cœur des schémas<br />
de l’économie verte. Nous avons tous les<br />
éléments en main, et allons nous y employer avec une très<br />
forte détermination.<br />
Le milliardaire américain Jeff Bezos a alloué plus<br />
de 35 millions de dollars pour la préservation des forêts<br />
au Gabon. Peut-on espérer un jour voir venir en RDC<br />
de richissimes bienfaiteurs ?<br />
C’est bien sûr une perspective réjouissante. La famille<br />
Buffett a déjà investi à plusieurs reprises en RDC. Leur soutien<br />
engendre une forte visibilité, mais nous en aurons encore plus<br />
si nous sommes crédibles. C’est à nous de créer les conditions et<br />
opportunités pour attirer les grandes fortunes internationales.<br />
Cela passe par la confiance institutionnelle. Nous devons faire<br />
de l’ICCN un organisme solide et transparent, avec une stratégie,<br />
une vision et une mission claires et pertinentes, proposer<br />
des programmes bénéfiques en priorité aux communautés<br />
locales. Nous sommes en train de mettre en place ces conditions<br />
pour que cela devienne réalité. Chaque euro doit être pertinent<br />
dans son utilisation, qu’il soit d’origine publique, privée, charitable…<br />
C’est notre responsabilité.<br />
36 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Le Kahuzi-Biega est l’une des plus belles aires protégées du pays, mais il attire les convoitises en raison de son sous-sol très riche.<br />
AL<strong>AM</strong>Y PHOTO<br />
Peut-on dissocier la question des aires protégées et celle,<br />
plus large, de la préservation des forêts primaires ?<br />
Les aires protégées sont des territoires de l’État. Il est<br />
évident que leur préservation est étroitement liée à celle des<br />
forêts primaires. Ce travail de préservation va se faire à partir<br />
de « noyaux initiateurs ». L’ICCN joue un rôle clé en faisant ce<br />
premier travail, qui aura un effet tache d’huile, un impact positif<br />
sur les zones environnantes, servira de catalyseur pour la préservation<br />
de l’environnement global. Cela étant dit, la gestion<br />
des forêts primaires ne relève pas de notre compétence. C’est<br />
clairement les attributions du ministère de l’Environnement.<br />
Peut-on envisager une exploitation rationnelle<br />
des forêts ? Ou sommes-nous condamnés à subir<br />
le même sort que l’Amazonie ?<br />
Oui, nous pouvons l’envisager. Et non, il y a peu de chance<br />
que l’on subisse le même sort que la forêt amazonienne, ou que<br />
la boréale ou l’indonésienne, car les contextes sont très différents.<br />
La forêt congolaise couvre 150 à 160 millions d’hectares.<br />
C’est énorme, il est difficile de s’imaginer ce que représente<br />
physiquement une telle surface. Aujourd’hui, son taux de déforestation<br />
est de moins de 1 % et reste très faible, même s’il paraît<br />
alarmant en valeur absolue. La forêt étant immense, les volumes<br />
de ce petit pourcent sont effrayants. Mais il en reste plus de<br />
99 % à préserver et à développer dans un même mouvement<br />
vertueux. La situation me rappelle cette citation de Mobutu,<br />
en 1972, lors de la création du parc de la Garamba : « Lorsque<br />
les savants auront transformé le monde des vivants en un milieu<br />
artificiel, il existera encore au Zaïre, dernier refuge de l’humain,<br />
une nature à l’état pur. » Je voudrais souligner qu’il y a, en RDC,<br />
de nombreuses communautés qui vivent en symbiose avec la<br />
nature, telles que les Batwas ou les Bantous. Le rôle de l’ICCN est<br />
justement d’accompagner ces populations et de leur permettre<br />
de continuer à vivre de la chasse et de la cueillette, tant que<br />
cela se fait dans un périmètre délimité. Le rapprochement entre<br />
l’homme et la nature est un élément essentiel dans la conduite<br />
de nos activités. À notre échelle, celle de l’ICCN, nous pouvons<br />
agir sur les aires protégées dans le but de préserver et d’exploiter<br />
rationnellement des espaces de forêt, mais aussi de savane,<br />
d’autres écosystèmes. C’est à nous d’être une fois encore inventifs<br />
et crédibles, en développant des coopérations intelligentes et<br />
mutuellement bénéfiques avec les communautés locales.<br />
Plusieurs organisations internationales accusent<br />
la RDC de chercher à expulser les populations<br />
de la communauté batwa du parc de Kahuzi-Biega,<br />
à l’est. Et affirment que les rangers de l’ICCN<br />
eux-mêmes ont commis des exactions.<br />
Le Kahuzi-Biega est l’une de nos plus belles aires protégées.<br />
Elle se trouve juste un peu au nord de la ville de Bukavu, le<br />
long du lac Kivu, et a cette particularité d’avoir deux ensembles<br />
distincts : une zone de haute altitude, avec le mont Kahuzi,<br />
qui culmine à 3308 mètres, et une zone de basse altitude, à<br />
1000-1 500 mètres, vers l’ouest. C’est un écosystème très diversifié.<br />
Le revers de la médaille de cette beauté souvent envoûtante<br />
est un sous-sol très riche (or, diamant, coltan, etc.), qui<br />
attire les convoitises et les appétits, souvent peu honorables.<br />
Dans l’est du pays, nous sommes dans des régions à très haute<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 37
PERSPECTIVES<br />
densité de population, ce qui crée des situations extrêmement<br />
complexes à gérer. Fin 2021, l’ONG britannique Minority Rights<br />
Group International (MRG) a publié un rapport faisant état de<br />
violations des droits de l’homme à l’encontre des populations<br />
pygmées et batwas, lesquelles auraient eu lieu dans le nord du<br />
parc national, en zone de basse altitude, entre 2019 et 2021. On<br />
reprochait à nos écogardes de comploter avec les forces armées<br />
pour aller délibérément détruire des villages, violer des femmes<br />
et égorger des enfants ! En ce début d’année, nous avons mené<br />
une enquête avec des experts de l’ICCN, un expert international<br />
en droits de l’homme et l’un des membres de l’ONG en question.<br />
Nous avons reconstitué les faits, et je peux vous affirmer<br />
que ceux-ci se sont déroulés d’une manière très différente de ce<br />
qui a été décrit. Les résultats de l’enquête ont montré que tout<br />
dysfonctionnement a été lourdement sanctionné. Certains de<br />
nos écogardes ont outrepassé leurs droits et commis des actes<br />
violents. Ils ont été identifiés et sanctionnés sur le plan administratif<br />
au sein de l’ICCN. Des actions en justice sont toujours<br />
en cours, aussi bien du côté de la justice civile que de l’auditorat<br />
militaire. Mais encore une fois, l’enquête conjointe a révélé que<br />
ce qu’il s’est passé en réalité était nettement moins violent que<br />
les faits décrits dans le rapport de l’ONG, notamment au sujet du<br />
traumatisme des populations. Pour preuve, nos équipes ont été<br />
très chaleureusement accueillies, ce qui n’aurait pas du tout été<br />
le cas si des membres de l’ICCN avaient commis des actes aussi<br />
graves que ceux décrits par MRG. Je tiens aussi à réagir contre<br />
l’une des accusations du rapport, qui prétend que nous menons<br />
des actions ciblées contre certaines ethnies. De telles accusations<br />
sont inacceptables et inexactes. J’ai commencé ma carrière<br />
en 1987 au Kahuzi-Biega, et j’y suis resté pendant une dizaine<br />
d’années. C’est un territoire que je connais bien. La situation<br />
sur le terrain est très complexe. Le terme générique « batwa »<br />
englobe plusieurs sous-communautés, qui parfois ne s’entendent<br />
pas très bien les unes avec les autres. L’ICCN a justement ce rôle<br />
de réconciliateur et de pacificateur. Nous avons une vingtaine<br />
d’ONG qui travaillent sur l’intégration des groupes minorisés et<br />
marginalisés dans le travail de conservation, et plus largement<br />
dans l’économie globale. Notre nouvelle vision de la conservation<br />
de la nature promeut la mise en place d’actions de coopération<br />
entre ces communautés locales, y compris les Batwas, et<br />
les agents de l’ICNN, les écogardes comme les scientifiques et<br />
le personnel administratif. De nombreux Batwas font partie de<br />
nos équipes, en tant que rangers, chercheurs ou managers du<br />
parc. La majorité des individus qui constituent les écogardes,<br />
notre police de l’environnement, sont issus des communautés<br />
locales. On est vraiment loin d’une situation de cloisonnement<br />
ou d’expulsion, telle que décrite dans les rapports. Je voudrais<br />
ajouter que nous cherchons à nous assurer que la question fondamentale<br />
des droits de l’homme est prise en considération<br />
dans tous les axes de nos travaux. Cela passe par l’attitude des<br />
rangers vis-à-vis des communautés, mais aussi par un travail<br />
en interne avec les 3 500 employés de l’ICCN pour permettre<br />
à chacun de nos agents de s’exprimer librement. Ces rapports<br />
alarmistes ont pour conséquence de bloquer le financement de<br />
nos opérations et nous empêchent de travailler correctement<br />
sur le terrain. C’est d’autant plus inquiétant que ceux qui en profitent<br />
sont les trafiquants, les groupes armés non identifiés qui<br />
pullulent dans la région, et les braconniers. Je tiens à rappeler<br />
que nos rangers sont eux aussi soumis à des violences extrêmement<br />
brutales. Ces dix dernières années, nous avons perdu<br />
200 agents dans l’exercice de leurs fonctions, abattus par des<br />
groupes armés à caractère militaire ou par des bandits braconniers.<br />
Le pire cas que nous ayons connu a été une embuscade<br />
en 2020, dans laquelle 14 agents ont été tués au cours d’une<br />
fusillade d’une violence inouïe. La situation est tendue, et nos<br />
écogardes au Nord-Kivu, confrontés au quotidien au M23 ainsi<br />
qu’à plusieurs autres groupes armés, en sont aussi les victimes.<br />
Il faut le souligner fermement.<br />
Un certain nombre de chercheurs évoquent<br />
un néocolonialisme vert, dénonçant la multiplication<br />
des aires protégées et la militarisation qui les entoure,<br />
produit d’une vision mythifiée de l’Afrique. Et de celle<br />
d’une nature qui doit être « vidée » de ces habitants…<br />
Ce concept doit, selon moi, s’entendre et se comprendre avec<br />
une vision de l’avenir. Aujourd’hui, franchement, les risques<br />
pour l’humanité en matière de perte de biodiversité, de changement<br />
climatique ne sont plus à prouver. C’est une nécessité absolue<br />
d’organiser des zones de conservation et de mise en valeur<br />
de la nature. Je fais partie de ceux qui militent contre l’idée que<br />
la nature doit être vidée de ses habitants. Nous devons nous y<br />
opposer pour repenser le paradigme de la relation homme-nature<br />
et y laisser l’humain. Il en fait partie ! Surtout quand on<br />
pense aux communautés locales… Il y a plus de 450 ethnies en<br />
RDC. Il est essentiel de concevoir des dispositifs pour qu’elles<br />
continuent à vivre en harmonie avec la nature, harmonie menacée<br />
par « des externalités négatives ». Comme les trafiquants de<br />
tous genres qui viennent chercher à bon marché des matières<br />
premières et les exportent via des circuits illégaux. On ne peut<br />
pas laisser faire. Les pratiques illégales menacent les communautés<br />
locales. Et cette manière de vivre en harmonie avec la<br />
nature. Les dégâts pourraient être irrémédiables.<br />
Pensez-vous que les populations sont suffisamment<br />
mobilisées sur la question de la préservation des aires<br />
protégées et des forêts ?<br />
Il est clair qu’elles ne le sont pas suffisamment. Le pays est<br />
immense et diversifié dans ses paysages et ses écosystèmes. Il est<br />
clair que la perception environnementale varie selon que vous<br />
posez la question de la conservation à un citadin de Kinshasa,<br />
de Kisangani ou de Lubumbashi, à un villageois forestier ou à<br />
un Pygmée ou un Batwa justement. D’ici peu, nous allons lancer,<br />
pour la première fois, une enquête à l’échelle nationale pour<br />
mieux comprendre comment les Congolais perçoivent leur environnement<br />
et leurs interactions avec la nature. C’est inédit. Nous<br />
avons la capacité de la mener, étant présents à tous les étages<br />
38 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
de l’immeuble gigantesque de la nature congolaise, depuis le<br />
niveau de la mer, à Muanda, à l’ouest, jusqu’aux 4 500 mètres<br />
du sommet du Ruwenzori, à l’est. Cette compréhension de l’environnement<br />
fait partie de notre vocation. Comme celle qui<br />
consiste à mieux connaître et comprendre le vivant animal ou<br />
végétal. Je prends l’exemple du comportement animal, que nous<br />
maîtrisons mal. Nous avons des plaintes de villageois qui nous<br />
parlent d’éléphants sortant des périmètres protégés qui viennent<br />
saccager les cultures. Cela arrive aussi avec les hippopotames.<br />
C’est beaucoup plus rare avec les lions ou les léopards, mais nous<br />
avons quand même eu des témoignages. L’ICCN a un réseau de<br />
compétences qui se déploie à l’échelle nationale. Certains de nos<br />
experts peuvent se rendre auprès des populations pour essayer<br />
d’atténuer les conséquences de ces comportements. Comme nous<br />
ne maîtrisons pas les risques de cohabitation avec les animaux<br />
sauvages, nous proposons plusieurs solutions, tels une modification<br />
des comportements agricoles ou un<br />
système d’assurance pour dédommager<br />
les personnes qui ont été affectées par<br />
leurs attaques.<br />
Le pays a annoncé le 19 juillet<br />
dernier la mise aux enchères de près<br />
de 30 blocs pétroliers (exploration),<br />
dont un certain nombre empiète<br />
sur les aires protégées, risquant de<br />
dégrader plus encore la situation<br />
écologique de ces dernières…<br />
Effectivement, mais tout cela répond<br />
à une logique évidente. La RDC a besoin<br />
de générer des ressources, qui vont lui<br />
permettre de financer son développement<br />
et sa mission de protection et de<br />
conservation de la nature. Elle s’appuie<br />
pour cela sur la valorisation de ses ressources<br />
naturelles, y compris les hydrocarbures.<br />
La question est posée. En tant que directeur général<br />
de l’ICCN, mon rôle est d’assurer la protection de nos parcs et<br />
domaines naturels. Aujourd’hui, nous n’avons pas atteint l’objectif<br />
de 15 % du territoire national dédié aux aires protégées. Et<br />
la loi est claire : tant que l’on n’a pas atteint ce seuil, on ne peut<br />
pas réaffecter de terres ou démembrer des aires protégées. Nous<br />
allons nous réunir avec nos collègues des hydrocarbures, comme<br />
nous l’avons fait récemment avec ceux du cadastre minier. Nous<br />
asseoir autour de la table pour tracer des frontières communes.<br />
Je suis pleinement engagé dans cette discussion. L’exploitation<br />
de ces terres doit se faire en concertation parfaite, entre la nécessité<br />
de générer des revenus par l’exploitation des ressources<br />
pétrolières ou du sous-sol et celle d’engendrer des ressources<br />
pour le travail de conservation de la nature.<br />
Vous n’étiez pas présent au Rwanda lors du premier<br />
Congrès des aires protégées d’Afrique, qui s’est<br />
déroulé à Kigali en juillet dernier, alors que la RDC<br />
est concernée au premier chef. Peut-on isoler la question<br />
de la préservation de celle des enjeux politiques ?<br />
Nous n’y avons pas participé, et c’est regrettable. La RDC<br />
est fortement concernée par ce congrès, car c’est le pays qui<br />
détient la plus grande superficie d’aires protégées en Afrique.<br />
Mais il aurait été inconvenant, incompréhensible d’être présent<br />
à Kigali alors que se déroule un conflit extrêmement violent à<br />
notre frontière de l’est avec le Rwanda. Nous savons de manière<br />
précise que ce dernier interfère dans les groupes armés opérationnels<br />
dans le parc national des Virunga ou celui de Kahuzi-Biega.<br />
Les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri sont en état<br />
de siège depuis plus d’un an. La communauté internationale ne<br />
reconnaît pas que nous sommes une fois de plus victimes d’une<br />
guerre d’agression. Il n’est ainsi pas possible d’isoler la question<br />
de la préservation de la nature de celle des enjeux politiques,<br />
qui y sont étroitement imbriqués. Il faut qu’il y ait une volonté<br />
politique très forte ainsi que la<br />
paix et la sécurité sur le terrain<br />
« Je travaille<br />
depuis plus<br />
de trente ans<br />
sur les questions<br />
environnementales.<br />
Nous avons fait<br />
de belles choses<br />
sur le terrain avec<br />
les communautés. »<br />
pour que les communautés s’approprient<br />
pleinement la mission de<br />
conservation de la nature. Toutes<br />
ces interventions de déstabilisation<br />
qui entretiennent la violence<br />
dans nos villages ont pour conséquence<br />
de laisser la voie libre aux<br />
trafiquants et commerces illégaux<br />
de toutes sortes, au détriment de la<br />
conservation de la nature, qui est<br />
un facteur clé du succès du développement<br />
des populations qui y<br />
vivent.<br />
Avez-vous parfois l’impression<br />
de mener un combat solitaire,<br />
d’être un peu seul au monde,<br />
dans cette lutte ?<br />
Oui, parfois, c’est le lot du chef [sourire]… Je travaille depuis<br />
plus de trente ans sur les questions environnementales. Nous<br />
avons fait de belles choses sur le terrain avec les communautés<br />
locales et mes collègues chefs coutumiers. Ma nomination à la<br />
tête de l’ICCN est un aboutissement. J’ai la chance de travailler<br />
avec des ministres, des personnalités publiques qui ont une véritable<br />
vision. L’ICCN est une équipe de 3 500 agents avec lesquels<br />
les interactions sont multiples, permanentes. Nous avons également<br />
des interactions régulières avec les communautés locales.<br />
Je voyage, je rencontre des experts, j’échange avec mes équipes<br />
sur le meilleur moyen de redresser l’institut, d’accomplir notre<br />
mission. Franchement, je ne suis pas seul ! Les choses se mettent<br />
en place progressivement, les briques se positionnent les unes<br />
à côté des autres, et l’édifice de la conservation de la nature est<br />
en train de monter en puissance. C’est un mouvement encore<br />
en démarrage, mais je crois être en mesure de vous prédire un<br />
avenir intéressant. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 39
40 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
destin<br />
« JUSTICE<br />
THOMAS »<br />
L’HOMME<br />
Il est noir, et il est<br />
au cœur du pouvoir.<br />
Il est pour le port<br />
d’armes, contre<br />
l’avortement, contre<br />
le mariage homosexuel,<br />
contre les contraintes<br />
environnementales…<br />
Portrait du juge<br />
le plus réactionnaire<br />
de la Cour suprême.<br />
par Cédric Gouverneur<br />
QUI VEUT FIGER<br />
L’<strong>AM</strong>ÉRIQUE<br />
TASOS KATOPODIS/GETTY IMAGES/AFP<br />
Tous les quatre ans, le monde vit au<br />
rythme du suspense infernal de l’élection<br />
présidentielle américaine : dans ce<br />
pays clivé à l’extrême entre républicains<br />
et démocrates, son résultat n’a – du<br />
fait du scrutin indirect et du système<br />
des grands électeurs – qu’un vague<br />
rapport avec le total des voix réunies par le vainqueur…<br />
Une fois élu, le président des États-Unis – sur le papier,<br />
l’homme le plus puissant de la planète – sait que son pouvoir<br />
est aussi bref que fragile : au Sénat et à la Chambre<br />
des représentants, les majorités parlementaires tiennent<br />
souvent à une faible marge, et les élections de mi-mandat<br />
se traduisent parfois par la paralysie, au bout de deux ans,<br />
de la Maison-Blanche. Et déjà, une nouvelle course à la<br />
présidentielle débute… Alors, chaque chef d’État s’efforce<br />
de peser sur l’institution la plus immuable et la plus solide<br />
des États-Unis : la Cour suprême. Les neuf garants de la<br />
Constitution étant nommés à vie, la démission ou le décès<br />
de l’un d’entre eux peut constituer, pour le président, une<br />
formidable occasion d’ancrer le pays – pour des décennies<br />
– dans son « camp ». Car il faut bien parler de camp idéologique,<br />
tant les opinions sont polarisées, entre républicains<br />
et démocrates, entre pro-life (« anti-avortement ») et prochoice<br />
(« favorables à l’avortement »), entre partisans des<br />
armes à feu et partisans de leur contrôle, entre nostalgiques<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 41
DESTIN<br />
des Confédérés et « gauchistes » radicaux woke, entre négateurs<br />
du réchauffement climatique et écologistes, et ainsi de suite.<br />
Lorsqu’en 1991, George Bush Senior nomme à la Cour<br />
suprême un juge afro-américain, issu d’une famille pauvre du<br />
Sud profond, les observateurs étrangers s’étonnent : ce Clarence<br />
Thomas est-il si à droite ? Après tout, cet ancien séminariste, né<br />
en 1948, est également un ancien partisan des Black Panthers,<br />
ces révolutionnaires qui, dans les années 1960, avaient leur<br />
QG à Alger ! Rosa Parks, considérée comme la mère spirituelle<br />
du mouvement des droits civiques pour avoir, le 1 er décembre<br />
1955, refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus de Montgomery<br />
(Alabama), a cependant immédiatement dissipé toute<br />
illusion sur le nouveau juge : cette nomination « ne représente<br />
pas un pas en avant sur la route du progrès<br />
racial, mais un demi-tour ». Clarence<br />
Thomas, mettait-elle en garde,<br />
« veut remonter la pendule » !<br />
Trois décennies plus tard, l’histoire<br />
aura, encore une fois, donné raison à<br />
Rosa Parks : le jeudi 23 juin dernier,<br />
la Cour suprême – dotée d’une majorité<br />
conservatrice depuis que Donald<br />
Trump y a nommé pas moins de trois<br />
magistrats sur neuf ! – a inscrit dans<br />
le marbre le droit fédéral de porter<br />
une arme en public. Une décision qui<br />
intervient un mois à peine après l’une<br />
des plus horribles fusillades de masse<br />
jamais perpétrées : dans une école primaire<br />
du Texas, 19 enfants et deux institutrices<br />
ont été massacrés fin mai par un<br />
adolescent, avec un fusil d’assaut acheté<br />
le jour de ses 18 ans. Les progressistes<br />
s’étranglent, et ils n’ont encore rien vu…<br />
Dès le lendemain, le 24 juin, la Cour<br />
suprême revient sur l’arrêt Roe v. Wade,<br />
qu’elle avait rendue en 1973 : l’avortement n’est plus un droit<br />
fédéral, et l’institution renvoie aux États le soin de légiférer sur<br />
la question. Aussitôt, une douzaine d’entre eux, dans le Sud et<br />
le Midwest, l’interdisent. Les conséquences sont immédiates :<br />
dans l’Ohio, une fillette de 10 ans, enceinte après un viol, doit<br />
se rendre dans un autre État pour avorter… Imperturbable, la<br />
Cour suprême, à majorité conservatrice, poursuit sa croisade :<br />
le 30 juin, elle interdit à Washington de contraindre les États à<br />
agir contre le réchauffement climatique (que nient, mordicus,<br />
la plupart des républicains…). En l’espace d’une semaine, la<br />
juridiction a donc imposé au pays, gouverné par la gauche, trois<br />
décisions à la droite de la droite. Et ce n’est pas fini : Clarence<br />
Thomas veut détricoter tous les droits acquis depuis le New<br />
Deal des années 1930… Contraception. Mariage homosexuel. Il<br />
en a la volonté. Il en a le pouvoir. Il est inamovible. Surpuissant.<br />
Déterminé. Et en pleine forme !<br />
Son épouse Virginia, en 2017,<br />
impliquée dans l’enquête sur les événements<br />
du 6 janvier 2021.<br />
Ce 24 juin, le juge a obtenu « ce dont il avait toujours rêvé :<br />
la reconnaissance », estime son biographe, Corey Robin, dans<br />
les colonnes du New Yorker du 9 juillet. « Le Noir le plus puissant<br />
d’Amérique » ne s’arrêtera pas là, prévient le journaliste :<br />
« Clarence Thomas règle le pas de la Cour, posant des jalons<br />
qui initialement paraissent extrêmes, avant d’être finalement<br />
adoptés. » Les progressistes – qui ne parviennent pas à comprendre<br />
qu’un homme noir issu d’un quartier pauvre ne soit pas<br />
de leur bord – le voient comme un imbécile, comme un vendu.<br />
En fait, « c’est le plus symptomatique de nos intellectuels », doté<br />
d’« une vision terrifiante de la race, des droits et de la violence<br />
qui est en passe de devenir la description de la vie quotidienne<br />
aux États-Unis », analyse Corey Robin, pour qui nul ne saurait<br />
cerner Clarence Thomas sans appréhender<br />
son parcours atypique.<br />
LE MODÈLE DU GRAND-PÈRE<br />
L’homme est né le 23 juin 1948<br />
à Savannah, en Géorgie, dans une<br />
famille pauvre parlant le gullah (un<br />
patois créole). Son père abandonne sa<br />
famille un an plus tard. Peu après, un<br />
incendie accidentel se déclare dans la<br />
maison : la mère, célibataire et femme<br />
de ménage, est reléguée dans un petit<br />
appartement avec ses deux garçons.<br />
En 1955, débordée, elle confie ses<br />
enfants aux grands-parents, qui vivent<br />
à deux pâtés de maisons de chez eux.<br />
« Toutes mes affaires tenaient dans un<br />
sac en papier », expliquait le juge dans<br />
une longue interview donnée au Daily<br />
Signal, le 22 juin dernier.<br />
Le grand-père est une force de la<br />
nature, « ouest-africain assurément »,<br />
estime Thomas. Né de père inconnu,<br />
il avait été élevé par sa grand-mère, une esclave affranchie.<br />
Dès l’arrivée de Clarence et de son frère, Myers, il apporte à<br />
ces garçons privés de père l’autorité qui leur manquait : « Les<br />
enfants, les damnées vacances sont finies », leur annonce-t-il.<br />
Entrepreneur, travailleur infatigable, économe, il sera pour<br />
Clarence un exemple permanent : « Je ne vous dirai jamais de<br />
faire ce que je dis, mais de faire ce que je fais », leur répètet-il.<br />
Le juge l’appelle « papa » et le considère comme tel, intitulant<br />
même ses mémoires My Grandfather’s Son (« le fils de<br />
mon grand-père ») : « Il est la personne la plus forte que j’ai<br />
connue… Mes grands-parents étaient des Noirs pauvres du Sud<br />
profond, mais ils ont obtenu ce qu’ils voulaient dans la vie. Ce<br />
fut leur victoire. »<br />
Le jeune garçon, motivé par cet homme bosseur et intègre,<br />
est un élève brillant. Il fait toute sa scolarité dans l’enseignement<br />
catholique, et y expérimente le racisme comme le mépris<br />
CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES<br />
42 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
WILL OLIVER/EPA-EFE<br />
Une manifestation contre l’abandon du droit à l’avortement devant la Cour suprême, à Washington, le 25 juin 2022.<br />
social : ses camarades afro-américains se moquent de sa sombre<br />
complexion, le surnommant ABC (America Blackest Child), et<br />
raillent son parler créole. Mais lorsque Clarence abandonne<br />
le séminaire, l’inflexible grand-père le chasse de la maison<br />
le jour même…<br />
Nous sommes dans les années 1960. Le jeune homme s’intéresse<br />
aux Black Panthers et manifeste contre la guerre du<br />
Vietnam. En 1971, il intègre la faculté de droit de Yale grâce<br />
à la discrimination positive. Plus tard, il se prononcera contre,<br />
préférant la méritocratie : il estime en effet que ce dispositif<br />
stigmatise celui qui en profite, lui faisant encourir le soupçon de<br />
se hisser socialement non pas du fait de ses compétences, mais<br />
grâce à sa couleur de peau. Dès lors, il s’engage résolument à<br />
droite toute. Avocat, il ne défend pas la veuve et l’orphelin, mais<br />
représente le groupe phytosanitaire Monsanto, bête noire des<br />
défenseurs de l’environnement. Puis, il devient assistant juridique<br />
du sénateur républicain du Missouri, John C. Danforth.<br />
En 1986, il épouse une militante républicaine blanche, Virginia<br />
Lamp. Dans les années 1980, l’homme grimpe les échelons de<br />
l’administration de Ronald Reagan (1981-1988), puis de George<br />
H. W. Bush (1988-1992). Jusqu’à ce que ce dernier le nomme à<br />
la Cour suprême en 1991. L’ancien gamin de Savannah décore<br />
son bureau avec le buste de son grand-père. Et va tout faire pour<br />
Dans les années 1960,<br />
le jeune homme<br />
s’intéresse aux Black<br />
Panthers et manifeste<br />
contre la guerre<br />
du Vietnam.<br />
imposer ses vues, ultraconservatrices et ultralibérales, à la plus<br />
puissante juridiction des États-Unis…<br />
De son grand-père, Clarence Thomas a appris que « l’État<br />
providence vous arrache votre virilité ». De l’absence de son<br />
père, que « la liberté sexuelle fait fuir aux hommes leurs responsabilités<br />
familiales ». De son enfance dans un quartier<br />
pauvre, que « trop de clémence envers la délinquance » nuit<br />
aux honnêtes travailleurs. « La révolution des droits progressistes<br />
a sapé l’autorité traditionnelle et généré une culture de<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 43
DESTIN<br />
la permissivité et de la passivité », déclarait-il en 1992 dans<br />
un débat au Federalist Institute. Il entend donc « restaurer le<br />
patriarcat noir », détruit selon lui à cause de la révolution des<br />
droits civiques et dont il estime que les femmes et les enfants ont<br />
besoin pour leur sécurité et leur instruction. C’est sa mission sur<br />
Terre, et il est absolument convaincu d’agir pour le bien de tous.<br />
En croisade contre l’ensemble des idées progressistes<br />
promues par le New Deal de Franklin Delano Roosevelt<br />
(1933-1945), puis par les mouvements sociétaux depuis les<br />
années 1960, « Justice » Clarence Thomas use d’une arme de<br />
destruction massive à la Cour suprême : une interprétation<br />
stricte de la « privileges or immunities clause » du 14 e amendement.<br />
Son argument est aussi<br />
simple que radical : si un droit n’est<br />
pas dans la Constitution de 1791, il<br />
n’a pas à être garanti… Et comme,<br />
à la fin du XVIII e siècle, il n’y avait<br />
évidemment pas de droits à l’avortement,<br />
au mariage homosexuel,<br />
de droit de l’environnement, ni<br />
même à la contraception, l’État<br />
fédéral n’a aucune raison de protéger<br />
ces notions… Juridiquement,<br />
l’argument est difficile à parer.<br />
En 1994, Clarence Thomas assumait<br />
la révulsion qu’il inspire aux<br />
progressistes, se déclarant « fièrement<br />
et sans vergogne hors sujet<br />
et anachronique ».<br />
« ARMÉ ET RESPONSABLE »<br />
À l’inverse, comme les colons<br />
des XVIII e et XIX e siècles étaient<br />
armés jusqu’aux dents, l’État fédéral<br />
se doit de garantir ce droit. Car<br />
dans la désarmante logique de Thomas et des partisans des<br />
armes à feu, la réponse aux tragédies humaines provoquées<br />
par les armes est… davantage d’armes : un « homme armé responsable<br />
» est, de leur point de vue, la meilleure riposte à la<br />
présence d’un « méchant » avec un fusil. Après chaque tuerie<br />
de masse, dans cette atroce litanie qui ponctue l’actualité du<br />
pays, les républicains se contentent de prier pour les victimes<br />
et de dénoncer le mal. Peu leur chaut que plus un seul de ces<br />
épisodes n’ait eu lieu en Australie depuis qu’une loi y a restreint<br />
l’accès aux armes, en 1996… Pour le journaliste Robin Corey, la<br />
Cour suprême « assume une société américaine extraordinairement<br />
violente et aux libertés minimales, sans espoir que l’État<br />
puisse protéger ses citoyens ». Impitoyable, Clarence Thomas<br />
s’était prononcé contre le financement des frais d’avocat des<br />
prisonniers trop pauvres pour s’en offrir les services. Et il a bien<br />
entendu défendu l’embastillement à Guantanamo des détenus<br />
suspectés de terrorisme.<br />
Il s’était<br />
prononcé contre<br />
le financement<br />
des frais<br />
d’avocat des<br />
détenus trop<br />
pauvres pour<br />
s’en offrir<br />
les services.<br />
LES SMS QANON DE « GINNI »<br />
Le seul obstacle sur lequel pourrait trébucher le juge dans<br />
sa croisade s’appelle… Virginia « Ginni » Thomas. Sa propre<br />
épouse, mère de leur fils unique. La militante républicaine<br />
blanche est une trumpiste fanatique. Deux jours après le<br />
scrutin du Super Tuesday du 3 novembre 2020, où Joe Biden<br />
l’a emporté contre Donald Trump, elle a envoyé des SMS au<br />
patron de la Maison-Blanche, Mark Meadows. Ginni Thomas<br />
tentait par là de convaincre le chef de l’administration Trump<br />
d’agir pour bloquer l’élection de Biden. Et reprenait sans vergogne<br />
les théories de la mouvance complotiste d’extrême droite<br />
Qanon : « la famille criminelle Biden » et « les conspirateurs<br />
de la fraude électorale » ont été arrêtés,<br />
assurait-elle à Meadows. Ils sont<br />
« détenus sur des barges » au large<br />
de Guantanamo, dans l’attente de<br />
paraître « devant un tribunal militaire<br />
pour sédition » !<br />
Dans quelle mesure le juge était-il<br />
au courant des SMS délirants de son<br />
épouse, c’est toute la question. D’autant<br />
que Clarence Thomas est le seul<br />
des neuf « sages » à s’être opposé à<br />
ce que les enregistrements de la Maison-Blanche<br />
soient remis à la commission<br />
d’enquête sur la tentative de<br />
putsch du 6 janvier 2021… Pourtant,<br />
selon les experts juridiques interrogés<br />
par la National Public Radio<br />
(NPR), il n’existe aucun moyen de<br />
forcer Thomas à se récuser. Selon le<br />
professeur de droit Charles Geyh, de<br />
l’université d’Indiana, interviewé en<br />
mars par la NPR, « le fait est que sur<br />
les 25 000 juges environ aux États-<br />
Unis, seulement neuf ne sont pas soumis à un code de conduite,<br />
et ces neuf sont les plus puissants du pays, sinon de la planète ».<br />
En septembre prochain, la Cour suprême va examiner l’arrêt<br />
Moore v. Harper, qui a trait au découpage des circonscriptions<br />
électorales en Caroline du Nord. L’institution pourrait<br />
alors décider de laisser aux États le soin de trancher en cas<br />
de litige : 30 législatures sur 50 étant aux mains des républicains,<br />
cette majorité pourrait donc faire basculer le vote<br />
en sa faveur et désigner de grands électeurs sans prendre en<br />
compte le résultat des urnes ! La parlementaire démocrate<br />
élue au Congrès Alexandria Ocasio-Cortez (« AOC ») met en<br />
garde contre un coup d’État judiciaire. Hillary Clinton parle<br />
également de « la plus grave menace pour la démocratie<br />
depuis le 6 janvier 2021 », date de l’assaut raté des trumpistes<br />
contre le Capitole. Sauf que les hommes qui menacent les institutions<br />
ne sont plus des émeutiers désorganisés, mais des<br />
juges surpuissants… ■<br />
44 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
LIU JIE/XIN HUA/RÉA<br />
Ketanji Brown Jackson,<br />
l’antithèse de Thomas<br />
Elle est la première Afro-Américaine à intégrer la plus haute juridiction du pays.<br />
Et elle incarne des valeurs diamétralement opposées.<br />
À<br />
sa naissance, en 1970, ses parents ont demandé<br />
à une tante, travailleuse humanitaire en Afrique<br />
de l’Ouest, de leur transmettre une liste de prénoms<br />
locaux chatoyants. Ils ont opté pour Ketanji<br />
Onyika, signifiant « la charmante », a-t-elle raconté durant<br />
son audition au Sénat le 21 mars dernier. De la part de<br />
Johnny et Ellory Brown, enseignants en lycée à Miami, ce<br />
choix était aussi militant que courageux. Militant, car les<br />
Afro-Américains portent les noms imposés à leurs ancêtres<br />
esclaves par les esclavagistes ; et courageux, car les enquêtes<br />
démontrent que les CV des Américains aux prénoms africains<br />
sont 50 % plus souvent refusés que les autres. Et pourtant,<br />
Ketanji Brown Jackson a gravi tous les échelons : « Dans<br />
ma famille, il a fallu une seule génération pour passer de la<br />
ségrégation raciale à la Cour suprême », se félicite la première<br />
femme noire à accéder à une telle fonction. En plus de<br />
deux cent trente années d’existence, la Cour a ainsi vu passer<br />
120 juges, dont 117 blancs et 115 hommes…<br />
Le président Joe Biden avait promis de nommer une<br />
Afro-Américaine en remplacement du juge progressiste<br />
Stephen Breyer, 83 ans, démissionnaire. Son choix s’est<br />
donc porté sur cette juge de la cour d’appel fédérale de<br />
Washington DC. Lors de son audition au Sénat, les républicains<br />
(tout en prenant bien soin d’écorcher son prénom…)<br />
lui ont reproché d’avoir défendu des criminels et des terroristes,<br />
le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley s’interrogeant<br />
par exemple sur « la façon dont [elle] traiterait des affaires<br />
Le 8 avril 2022, sa nomination<br />
est confirmée en présence<br />
du président Joe Biden<br />
et de la vice-présidente<br />
Kamala Harris.<br />
de terrorisme », et son collègue du Nebraska Ben Sasse l’accusant<br />
d’avoir « contribué à remettre des criminels violents<br />
dans la rue »… Ketanji Brown Jackson leur a calmement<br />
rappelé cette évidence : tout prévenu a droit à une défense<br />
digne de ce nom.<br />
Mariée à un chirurgien, elle est mère de deux enfants.<br />
Son frère et deux de ses oncles sont (ou ont été) policiers,<br />
notamment à Baltimore, l’une des villes les plus violentes du<br />
pays. Et un autre de ses oncles purge une longue peine de<br />
prison pour une affaire de stupéfiants. Lorsqu’elle était fraîchement<br />
diplômée de l’université de Yale, elle a « compris<br />
qu’elle manquait d’expérience » et a donc « décidé de servir<br />
“dans les tranchées” » : elle s’est donc portée volontaire pour<br />
défendre des délinquants sans le sou, et même des « combattants<br />
ennemis » embastillés sans jugement sur la base<br />
américaine de Guantanamo après le 11 septembre 2001.<br />
Or, au pays du Far West, un tel dévouement plombe une<br />
carrière : « Typiquement, écrit le New York Times, les avocats<br />
qui ambitionnent de devenir juges servent comme procureurs<br />
et envoient les criminels en prison » au lieu de les<br />
défendre. « En tant qu’avocate, j’ai réalisé que les attentats<br />
du 11 septembre ne menaçaient pas seulement notre sécurité,<br />
explique Ketanji Brown Jackson en faisant référence<br />
à Guantanamo, mais menaçaient également nos principes<br />
constitutionnels. » Ses débats avec Clarence Thomas et les<br />
autres juges de la majorité réactionnaire, qui domine la<br />
Cour suprême, promettent donc d’être tendus… ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 45
DÉCOUVERTE<br />
Comprendre un pays, une ville, une région, une organisation<br />
Côte d’Ivoire<br />
Le futur est en travaux !<br />
Infrastructures, urbanisme, routes, eau, énergie<br />
et aussi les stades de la CAN… Le pays investit<br />
pierre par pierre, mètre par mètre.<br />
Demain, la tour F dans la perspective du pont de Cocody.<br />
Le chantier de la route côtière.<br />
Le parc des expositions et le Convention Center.<br />
DR - NABIL ZORKOT (4)<br />
Ci-dessus, le stade d’Ébimpé.<br />
Ci-contre, l’université de San Pedro.<br />
DOSSIER RÉALISÉ PAR ZYAD LIM<strong>AM</strong> AVEC FRANCINE YAO
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Au pays<br />
des bâtisseurs<br />
Depuis l’indépendance, on construit<br />
et on élève avec enthousiasme.<br />
La stratégie actuelle vise à répondre<br />
aux besoins en infrastructures,<br />
tout en dopant la compétitivité<br />
et la modernisation de l’économie.<br />
48 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SEIBOU TRAORÉ<br />
Le président Alassane Ouattara<br />
lors de l’inauguration du stade<br />
olympique d’Ébimpé,<br />
à Abidjan, le 3 octobre 2020.<br />
C’est véritablement devenu une tradition<br />
ivoirienne. Construire, bâtir, dessiner<br />
et redessiner la physionomie du<br />
pays, lancer des ponts et des routes,<br />
et monter des immeubles vers le ciel… Ici, en<br />
Côte d’Ivoire, l’ambition, c’est aussi de « transformer<br />
le terrain ». À l’indépendance, le pays est marqué<br />
par l’empreinte de l’économie coloniale, avec comme<br />
seules véritables infrastructures les comptoirs sur<br />
la côte, dont la ville de Grand-Bassam, et le fameux<br />
train Abidjan-Bobo-Dioulasso. Abidjan d’ailleurs<br />
existe à peine. On est loin de la future métropole<br />
de 5 millions d’habitants, qui deviendra l’une des<br />
portes de l’Afrique. L’ère du premier président,<br />
Félix Houphouët-Boigny, sera celle d’une véritable<br />
« construction » du pays, avec l’émergence du<br />
Plateau, ce quartier d’affaires emblématique,<br />
des premiers immeubles iconiques, comme l’hôtel<br />
Ivoire, ou des tours de la cité administrative.<br />
Avec le développement de la culture du cacao,<br />
le pays s’enrichit, le « Vieux » se lance dans la<br />
« création » de Yamoussoukro comme capitale,<br />
avec la fameuse basilique, œuvre de l’architecte<br />
Pierre Fakhoury, né à Dabou, dont le travail<br />
tout au long des décennies à venir marquera lui<br />
aussi le territoire. Les années Houphouët sont<br />
celles de la naissance de la fameuse DCGTx<br />
(Direction et contrôle des grands travaux), dirigée<br />
par Antoine Cesareo, presque un personnage de<br />
roman. Les années Bédié seront celle du Bureau<br />
national d’études techniques et de développement<br />
(BNETD), dirigé un temps par Tidjane Thiam. Celles<br />
également de la naissance du concept de l’Éléphant,<br />
avec les 12 grands travaux, largement inachevés,<br />
mais dont un certain nombre seront repris par<br />
ses successeurs. Les années Gbagbo sont celles de<br />
la confusion et d’une quasi-guerre civile. L’arrivée du<br />
président Alassane Ouattara, en mai 2011, entraîne<br />
une vigoureuse relance de l’investissement dans les<br />
infrastructures. Il s’agit tout d’abord de réhabiliter<br />
un système à genoux, au lendemain de la grave<br />
crise électorale de novembre 2010, de remettre<br />
littéralement en marche l’eau et électricité. Puis<br />
de retrouver le niveau après vingt ans de stagnation,<br />
de doper la croissance par l’investissement public.<br />
Sur un plan stratégique, l’objectif d’ADO et de<br />
son équipe va être d’accentuer la compétitivité du<br />
pays, en le dotant d’un backbone, de « l’armature »<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 49
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
L’échangeur<br />
de l’Indénié,<br />
dans la capitale<br />
économique.<br />
Pour favoriser<br />
le développement du<br />
secteur privé,<br />
il faut aussi mettre en<br />
place l’armature<br />
nécessaire,<br />
les structures pour<br />
favoriser l’activité.<br />
nécessaire pour soutenir et induire l’activité.<br />
Les infrastructures et les grands travaux sont<br />
alors des éléments centraux de l’émergence.<br />
Et, dans un cercle vertueux, ils entraînent<br />
la création d’emplois. Réhabilitation du<br />
patrimoine immobilier de l’État, relance de<br />
la production d’énergie, relance d’un grand<br />
programme autoroutier vers le nord et vers l’est,<br />
construction du barrage de Soubré, construction<br />
du troisième pont d’Abidjan, lancement de<br />
nouveaux projets… À l’orée du second mandat,<br />
les travaux s’enchaînent et l’on doit saluer<br />
ici la mémoire d’Amadou Gon Coulibaly,<br />
secrétaire général de la présidence, puis Premier<br />
ministre, qui fut le principal coordinateur<br />
de ce programme présidentiel très ambitieux.<br />
Locomotive de l’Union économique et<br />
monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec un<br />
produit intérieur brut (PIB) de 69,76 milliards de<br />
dollars en 2021, la Côte d’Ivoire aspire à devenir<br />
une économie à revenu intermédiaire d’ici à 2030.<br />
Pour atteindre l’objectif, les pouvoirs publics<br />
structurent l’effort via des plans stratégiques<br />
qui orientent l’investissement, en particulier<br />
dans le domaine des grands travaux et des<br />
infrastructures. Le premier Plan national de<br />
développement (PND) 2012-2015 avait prévu<br />
un montant d’investissements publics et privés<br />
de 11 000 milliards de francs CFA, et le PND<br />
2016-2020 une enveloppe de 30 000 milliards<br />
de FCFA. Les deux premiers plans ont permis<br />
au pays de réaliser une croissance moyenne<br />
de plus de 8 % sur la période de 2012 à 2019.<br />
L’impact de la pandémie de Covid-19 aura<br />
fortement ralenti le processus en 2020 (2 %),<br />
mais le pays aura aussi su prouver sa résilience<br />
aux chocs. Le PND 2021-2025 renoue avec<br />
une voie haute en matière d’ambition, avec un<br />
montant estimé de 59 000 milliards de FCFA.<br />
L’objectif de l’équipe du Premier ministre,<br />
Patrick Achi, est de poser de véritables jalons<br />
dans la perspective de 2030. La population<br />
du pays avoisinera alors 34 millions d’habitants<br />
(au lieu de 28 millions aujourd’hui), avec une<br />
grande majorité de jeunes de moins de 30 ans.<br />
Abidjan comptera aux alentours de 8 millions<br />
de résidents, s’imposant plus encore comme<br />
l’une des cités majeures du continent. En 2030,<br />
si tout se passe comme prévu, la richesse<br />
du pays aura de nouveau doublé (par rapport<br />
à la décennie 2011-2020), pour atteindre<br />
un PIB au-dessus de 90 milliards de dollars.<br />
NABIL ZORKOT<br />
50 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
DR<br />
Des chiffres nécessaires pour diviser par<br />
deux la pauvreté et pour créer des emplois.<br />
Outre son potentiel intérieur, cette<br />
« plate-forme » Côte d’Ivoire s’adresse et<br />
s’adressera à un double marché : l’UEMOA,<br />
qui compte plus de 130 millions d’habitants avec<br />
une monnaie unique et stable, et la Communauté<br />
économique des États de l’Afrique de l’Ouest<br />
(CEDEAO), avec plus de 400 millions d’habitants.<br />
Pour atteindre ces objectifs, favoriser<br />
le développement du secteur privé national<br />
et les investissements privés internationaux,<br />
les infrastructures restent un paramètre clé.<br />
Aujourd’hui comme hier, la Côte d’Ivoire<br />
est en chantier. La capitale économique vit au<br />
rythme des pelleteuses et des grues (et des<br />
embouteillages). Les accès à l’eau potable,<br />
à l’électricité, à l’énergie, à Internet restent<br />
des priorités. Les 4 e et 5 e ponts, au-dessus des<br />
lagunes, avancent à grands pas. Deux grands<br />
projets emblématiques sont en cours. Celui de<br />
la tour F, la dernière de la cité administrative,<br />
qui sera la plus haute d’Afrique, au cœur<br />
du Plateau. Et celui du métro d’Abidjan, dont<br />
les travaux ont commencé et qui sera, malgré<br />
les obstacles et les retards, une formidable<br />
aventure humaine et urbaine. L’agrandissement<br />
du Port autonome d’Abidjan (PAA) est en marche.<br />
Poumon économique de la Côte d’Ivoire, il<br />
assure 90 % des échanges extérieurs. Il s’est<br />
doté d’un second terminal à conteneurs. Et des<br />
travaux d’extension sont en cours. Concernant<br />
le transport aérien, Air Côte d’Ivoire, qui<br />
génère 72 % du trafic global sur la plate-forme<br />
aéroportuaire ivoirienne, a ouvert récemment<br />
deux nouvelles dessertes (Johannesbourg et<br />
Bissau). Le programme autoroutier avance vers<br />
le nord, au-delà de Bouaké, et vers l’est, au-delà<br />
de Grand-Bassam. La rénovation, urgente,<br />
de la fameuse « côtière », la nationale qui relie<br />
Abidjan à San Pedro, a démarré de chaque côté.<br />
La formation et les ressources humaines sont<br />
au cœur de la compétitivité. D’où la création<br />
d’universités, en particulier à l’intérieur du pays.<br />
Daloa, Man, San Pedro et Korhogo comptent<br />
désormais des établissements supérieurs.<br />
D’autres sont en cours de construction,<br />
notamment à Bondoukou et Odienné.<br />
Enfin, le pays se prépare aussi à accueillir<br />
de grands événements. Cela après avoir reçu la<br />
conférence des parties de la Convention des Nations<br />
unies sur la lutte contre la désertification (COP 15),<br />
du 9 au 20 mai. Un événement qui a réuni plus<br />
de 7 000 participants venus de plus de 150 pays.<br />
Au cours de cet événement, la Côte d’Ivoire a<br />
présenté l’Initiative d’Abidjan, ou Abidjan Legacy<br />
Program, qui vise à restaurer les écosystèmes<br />
forestiers dégradés et à promouvoir une agriculture<br />
nouvelle, une gestion durable des sols.<br />
Dans ce contexte, un parc d’exposition pouvant<br />
recevoir plus de 5 000 personnes est en cours de<br />
réalisation près de l’aéroport d’Abidjan. Et enfin,<br />
le pays travaille d’arrache-pied pour accueillir<br />
la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN)<br />
de football, en janvier 2024, avec la réalisation<br />
de six stades flambant neufs dans cinq villes.<br />
Le chemin parcouru depuis 2011 est assez<br />
impressionnant. Mais les défis demeurent.<br />
La dernière saison des pluies aura montré le<br />
besoin de repenser le système d’assainissement<br />
et d’évacuation des eaux, en soulignant l’urgence<br />
d’une gestion de l’urbanisme. Plus structurellement,<br />
les bases de la croissance doivent se diversifier<br />
et le secteur privé doit monter en gamme pour<br />
participer à sa mesure à l’investissement, y compris<br />
dans les infrastructures. La croissance doit aussi<br />
se « délocaliser », sortir du périmètre du grand<br />
Abidjan pour entraîner les hinterlands, les villes<br />
secondaires et les campagnes.<br />
En attendant, que la visite commence<br />
[voir pages suivantes] ! ■<br />
Inauguration de<br />
la phase IV de la<br />
centrale thermique<br />
d’Azito, le 27 juin<br />
2022, par le Premier<br />
ministre Patrick Achi<br />
(au centre), en présence<br />
du ministre des Mines,<br />
du Pétrole et de l’Énergie<br />
Mamadou Sangafowa<br />
Coulibaly (au premier<br />
plan, à gauche).<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 51
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
52 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
La tour F,<br />
sur le<br />
toit de<br />
l’Afrique<br />
La sixième tour de la cité<br />
administrative du Plateau<br />
s’élèvera à plus de<br />
400 mètres. Et symbolisera<br />
l’émergence ivoirienne.<br />
La maquette du projet, avec vue du futur pont de Cocody (ci-contre).<br />
Et le chantier fin juillet à Abidjan (ci-dessus).<br />
DR - NABIL ZORKOT<br />
Elle sera le symbole<br />
de l’émergence ivoirienne.<br />
Celui d’une ville ouverte,<br />
cosmopolite, industrieuse,<br />
tournée vers le monde. Elle s’élève<br />
progressivement au cœur du<br />
Plateau, dans l’axe du futur pont de<br />
Cocody. Et viendra compléter la cité<br />
administrative d’Abidjan, les tours A,<br />
B, C, D et E construites à partir du<br />
milieu des années 1970, qui font aussi<br />
l’objet d’un important programme<br />
de rénovation. Dessinée et conçue<br />
par l’architecte Pierre Fakhoury, elle<br />
culminera à près de 400 mètres pour<br />
76 étages et 140 000 m 2 de surface,<br />
desservie par 23 ascenseurs, devenant<br />
la plus haute tour du continent (à date).<br />
Les travaux sont menés par PFO<br />
Africa et mobilisent de nombreux<br />
sous-traitants majeurs, comme le<br />
géant belge Besix. La tour est destinée<br />
à accueillir de nombreux services<br />
de l’État, aujourd’hui disséminés dans<br />
toute la ville, avec les conséquences<br />
budgétaires que cela implique.<br />
Elle sera aussi ouverte au public,<br />
avec des espaces commerciaux,<br />
des zones privatives et des zones de<br />
bureaux. C’est un projet immobilier<br />
particulièrement novateur. Une<br />
structure monolithique de verre où la<br />
forme et la matière ne font qu’un, qui se<br />
veut œuvre d’art. Tout en proposant un<br />
formidable outil de travail, à la hauteur<br />
des ambitions ivoiriennes. Les travaux<br />
ont démarré en juillet 2021. Et<br />
devraient s’achever fin 2025. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 53
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
La révolution<br />
métro<br />
Une traversée du nord au sud, 37,9 kilomètres de voie,<br />
et plus de 500 000 passagers par jour.<br />
Innovant, exigeant, hors norme…<br />
C’est véritablement un projet<br />
emblématique, celui d’une<br />
transformation radicale de<br />
la mobilité dans une ville de près<br />
de 5 millions d’habitants. Le métro<br />
changera la vie des Abidjanais,<br />
contraints aujourd’hui de subir<br />
de longues heures de transport et<br />
d’embouteillages quotidiens. Selon le<br />
ministre des Transports Amadou Koné,<br />
le projet d’Abidjan est le plus ambitieux<br />
de toute l’Afrique subsaharienne.<br />
Lancées en 2017, les négociations entre<br />
l’exécutif et le groupe Bouygues, tête<br />
de pont du consortium d’entreprises<br />
françaises chargées des travaux,<br />
ont finalement abouti à la signature<br />
d’un protocole d’accord entre les<br />
deux parties le 8 octobre 2019.<br />
L’investissement, estimé à environ<br />
918 milliards de FCFA (soit 1,4 milliard<br />
d’euros), sera financé par la France.<br />
« C’est l’effort le plus important que la<br />
France ait jamais réuni au démarrage<br />
d’un projet de transport urbain à<br />
l’étranger », avait affirmé en 2017 le<br />
président Emmanuel Macron. Depuis<br />
août 2021, le projet est entré dans sa<br />
phase active avec la création de la base<br />
vie à Abobo, la très délicate libération<br />
des emprises et le dédommagement des<br />
personnes concernées, en particulier<br />
les plus vulnérables. Le métro<br />
sera construit sur une plate-forme<br />
ferroviaire à part entière, avec deux<br />
voies d’un écartement de 1,435 mètre<br />
La ligne 1 comptera 20 stations.<br />
chacune. Des passerelles piétonnes<br />
jalonneront le trajet, ainsi qu’un pont<br />
ferroviaire pour la traversée de la<br />
lagune. Le tracé de la ligne 1 du<br />
métro sera ponctué de 20 stations<br />
multimodales, avec parking, galeries<br />
et commerces. Le système transportera<br />
1 demi-million de passagers par jour,<br />
sur une distance de 37,9 kilomètres<br />
allant d’Anyama (Abidjan-nord)<br />
à Port-Bouët (Abidjan-sud). Et<br />
surtout, il devrait faire la fierté des<br />
Ivoiriens. En attendant la réalisation<br />
de la deuxième ligne, qui devrait<br />
relier Yopougon à Bingerville<br />
dans les années à venir. ■<br />
DR (2)<br />
54 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Les travaux ont commencé<br />
dans le secteur d’Abobo.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 55
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Un 4 e pont<br />
sur les lagunes<br />
Le chantier avance à grands pas :<br />
la livraison est annoncée pour fin 2022.<br />
Reliant au-dessus des eaux les communes de Yopougon, Attécoubé et Adjamé,<br />
il devrait permettre de fluidifier la circulation dans la capitale économique.<br />
Historiquement,<br />
il y a eu le pont Félix<br />
Houphouët-Boigny (1958),<br />
puis le pont Charles de<br />
Gaulle (1967), tous deux récemment<br />
rénovés. Puis, en 2017, le pont Henri<br />
Konan Bédié, qui s’élance entre<br />
Cocody et la commune de Marcory.<br />
Voilà donc le quatrième pont de la<br />
ville. Le chantier avance à grands<br />
pas. Livraison annoncée : fin 2022.<br />
D’un coût de 142 milliards de<br />
francs CFA, ce projet financé par la<br />
Banque africaine de développement<br />
(BAD) et l’État de Côte d’Ivoire vise<br />
à accroître la mobilité dans une ville<br />
notoirement congestionnée. Selon<br />
la Banque mondiale, on y compte<br />
plus de 10 millions de déplacements<br />
par jour. Aux manettes : l’entreprise<br />
China State Construction Engineering<br />
Corporation (CSCEC). Ce pont<br />
reliera les communes de Yopougon,<br />
Attécoubé et Adjamé sur une longueur<br />
de 7,2 kilomètres. L’ouvrage sera<br />
composé d’une chaussée de 2 x 3 voies<br />
séparées par un terre-plein central<br />
de 20 mètres, qui constituera la<br />
zone de passage du deuxième train<br />
urbain d’Abidjan. Seront aussi érigés<br />
trois échangeurs à Yopougon, une<br />
plate-forme de péage à Attécoubé,<br />
d’une longueur de 850 mètres, un<br />
viaduc sur la baie du Banco, et trois<br />
échangeurs au niveau de la traversée<br />
du boulevard de la Paix. ■<br />
DR<br />
56 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Le nouveau cœur<br />
battant d’Abidjan<br />
Le 5 e pont, symbole du renouveau<br />
de la baie de Cocody. Et de la lagune Ébrié.<br />
DR<br />
Clairement, le stade<br />
de l’esquisse et de la<br />
maquette est dépassé.<br />
La silhouette du 5 e pont<br />
s’élance déjà entre le quartier des<br />
affaires du Plateau et la commune<br />
huppée de Cocody. Un ouvrage épuré<br />
d’une longueur de 1,5 kilomètre<br />
qui sera surmonté d’un hauban de<br />
200 mètres de haut. La livraison,<br />
initialement prévue pour la fin 2021,<br />
a été retardée par la pandémie de<br />
Covid-19. Mais la construction devrait<br />
être finie pour le tout début de 2023.<br />
L’ouvrage est composé d’un viaduc<br />
d’accès, côté est de la baie (Cocody),<br />
long de 258 mètres et composé de<br />
2 x 2 voies de circulation ainsi que de<br />
deux passages de 1,5 mètre de large<br />
chacun pour les cycles et les piétons.<br />
Un second viaduc d’accès, côté ouest<br />
de la baie (Plateau), long de 147 mètres,<br />
comporte une voie de circulation et<br />
également un passage pour les cyclistes<br />
et les piétons. Les travaux de cette<br />
infrastructure, dessinée par l’architecte<br />
Pierre Fakhoury, sont financés par la<br />
Banque islamique de développement<br />
(BID) et réalisés par la China Road and<br />
Bridge Corporation (CRBC). Ambitieux,<br />
l’ouvrage s’inscrit dans le projet de<br />
réhabilitation de la lagune, dont les<br />
méandres façonnent la géographie de la<br />
ville. C’est le vaste Projet de sauvegarde<br />
et de valorisation de la baie de Cocody<br />
et de la lagune Ébrié (PABC), porté par<br />
le Maroc et la Côte d’Ivoire. La baie de<br />
Cocody doit devenir l’un des nouveaux<br />
cœurs battants d’Abidjan, avec un parc<br />
urbain et des berges destinées à la<br />
promenade. Également à l’agenda,<br />
un port de plaisance, un programme<br />
résidentiel, des espaces de loisirs et<br />
des installations commerciales. Les<br />
bruits de machine et les incessants<br />
déplacements des engins de chantier,<br />
la réalisation de ronds-points à<br />
proximité soulignent l’avancement des<br />
travaux, malgré les retards inévitables.<br />
Second volet, la réhabilitation<br />
écologique de la baie répond à la<br />
nécessité de dépolluer la lagune<br />
Ébrié, de favoriser le renouvellement<br />
de ses eaux et la reconstitution de<br />
ses ressources halieutiques. Une<br />
ambition au long cours qui devrait<br />
transformer le visage d’Abidjan. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 57
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Le bâtiment permettra<br />
d’accueillir des salons<br />
d’envergure dédiés<br />
aux professionnels<br />
ou au grand public.<br />
58 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Le parc<br />
des<br />
expositions,<br />
étape de la<br />
nouvelle ville<br />
La structure futuriste du nouveau<br />
Convention Center préfigure ce que devrait<br />
être Aérocité dans les années à venir.<br />
NABIL ZORKOT<br />
La structure s’élève et prend<br />
forme. Le parc des expositions<br />
et le Convention Center<br />
d’Abidjan, avec un périmètre de<br />
100 hectares, s’inscrivent dans le cadre<br />
de l’aménagement d’Aérocité, future<br />
ville nouvelle autour de l’aéroport<br />
Félix Houphouët-Boigny (en phase<br />
d’extension). Le parc permettra<br />
d’accueillir des salons d’envergure<br />
dédiés aux professionnels ou au grand<br />
public, mais également des congrès<br />
et conventions politiques, des grands<br />
événements culturels et sportifs.<br />
Selon le ministre du Commerce,<br />
de l’Industrie et de la Promotion<br />
des PME Souleymane Diarrassouba,<br />
cette infrastructure totalement<br />
couverte, avec une capacité d’accueil<br />
de plus de 5 000 personnes, verra le<br />
jour à la fin de cette année. La troisième<br />
édition de la Foire commerciale<br />
intra-africaine (IATF) devrait en<br />
particulier s’y tenir en novembre 2023.<br />
La première composante des travaux<br />
porte sur le Hall 1, et la seconde<br />
sur le Convention Center. Celui-ci se<br />
présente comme une nef audacieuse,<br />
développant environ 9 000 m 2 sous<br />
35 mètres de haut. L’ensemble est<br />
entièrement modulable. À long<br />
terme, Aérocité devrait accueillir,<br />
sur une surface de 27 hectares, des<br />
structures hôtelières, des restaurants,<br />
des entreprises, des centres de<br />
divertissement, des parkings, etc. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 59
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Le port<br />
autonome<br />
d’Abidjan<br />
en marche<br />
avant !<br />
Un second terminal à conteneurs<br />
et de nouveaux portiques<br />
renforceront la croissance moyenne<br />
actuelle de 12 % par an du PAA.<br />
60 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Le port autonome d’Abidjan<br />
(PAA), poumon économique<br />
de la Côte d’Ivoire, qui<br />
assure 90 % de ses échanges<br />
extérieurs, se transforme. Le PAA<br />
traite quelque 800000 conteneurs<br />
chaque année et connaît depuis<br />
2012 une croissance moyenne de<br />
12 % par an. Cette infrastructure<br />
d’envergure se dote d’un second<br />
terminal à conteneurs (TC2), destiné<br />
à doubler sa capacité. Sa construction<br />
a été confiée à l’entrepreneur China<br />
Harbour Engineering Company (CHEC)<br />
à la suite du contrat de concession de<br />
vingt ans remporté par le consortium<br />
constitué par Bolloré et APM Terminals<br />
(Maersk). Ce nouveau terminal, d’une<br />
superficie de 37,5 hectares, comporte<br />
six portiques de quai (réceptionnés<br />
en avril dernier), et 13 portiques de<br />
parc ainsi que 36 tracteurs électriques<br />
pour la manutention des conteneurs<br />
sont attendus. L’objectif étant de<br />
répondre à la qualification ISO 14001<br />
(environnement). L’infrastructure,<br />
dont le coût est évalué à 311 milliards<br />
de francs CFA (400 millions d’euros),<br />
est dimensionnée pour accueillir des<br />
navires de 16 mètres de tirant d’eau<br />
transportant 12 000 EVP. Avec un quai<br />
de 1100 mètres et un tirant d’eau de<br />
18 mètres, le second terminal permettra<br />
alors de décharger des navires<br />
de grande capacité et de dernière<br />
génération. Sa mise en service, prévue<br />
pour novembre 2022, entraînera la<br />
création de plus de 450 emplois directs<br />
locaux et de milliers d’emplois indirects.<br />
La structure pourra ainsi répondre non<br />
seulement aux besoins du pays, mais<br />
aussi à ceux de toute la sous-région. ■<br />
DR<br />
Avec un quai de 1 100 mètres et un tirant<br />
d’eau de 18 mètres, l’extension<br />
(au fond, à gauche) permettra<br />
de décharger des navires de grande<br />
capacité et de dernière génération.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 61
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
L’usine que construit Fluence Corporation puisera dans la lagune Aghien.<br />
De l’eau<br />
pour tous !<br />
Deux projets majeurs vont permettre d’assurer<br />
à terme l’autosuffisance pour le grand Abidjan.<br />
La population de la capitale<br />
économique approche les<br />
5 millions d’habitants (soit<br />
20 % du pays). La desserte de la<br />
mégalopole en eau est donc un enjeu<br />
pour aujourd’hui et les années à venir.<br />
Le déficit est déjà avéré. La production<br />
actuelle à Abidjan est de 640000 m 3<br />
par jour, contre une demande évaluée<br />
à 840000 m 3 par jour. Les nappes<br />
souterraines sont importantes, mais<br />
il faut aussi diversifier les ressources.<br />
Deux projets majeurs sont en cours.<br />
Fluence Corporation construit une<br />
usine d’eau potable qui exploitera la<br />
lagune Aghien, la plus grande réserve<br />
d’eau douce de Côte d’Ivoire, située<br />
à l’est de la ville. L’installation achevée<br />
affichera une capacité de 150 000 m 3<br />
par jour. Ce projet distribuera de<br />
l’eau à 1,5 million d’habitants.<br />
Par ailleurs, l’usine d’eau potable de<br />
la Mé, sur la route du Grand Alépé,<br />
au nord d’Abidjan, est quasi finalisée,<br />
et fournira 240 000 m 3 d’eau par jour.<br />
L’eau traitée dans cette station sera<br />
pompée à partir de la rivière la Mé<br />
grâce à une prise d’eau réalisée sur un<br />
terrain de 1 hectare. L’eau potable sera<br />
transportée sur 28 km, jusqu’à deux<br />
châteaux d’eau, de 5 000 m³ chacun,<br />
où elle sera stockée. Les travaux de<br />
cette usine sont réalisés par PFO<br />
Africa, en association avec Veolia. ■<br />
NABIL ZORKOT (2)<br />
62 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
L’usine de traitement de la Mé<br />
est presque finalisée et fournira<br />
240 000 m 3 d’eau par jour.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 63
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
L’urgence<br />
énergétique<br />
64 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
DR<br />
L’augmentation des capacités de production<br />
électrique est une priorité pour soutenir la croissance<br />
et alimenter les marchés régionaux.<br />
Azito aura une capacité<br />
de plus de 710 MW, soit près<br />
de 27 % de la puissance<br />
totale installée dans le pays.<br />
La Côte d’Ivoire a vécu une crise<br />
énergétique durant une partie de<br />
l’année 2021, provoquée par une<br />
demande en hausse (particuliers<br />
et entreprises), une série de pannes sur<br />
la turbine à gaz de la centrale d’Azito<br />
et l’assèchement de certains barrages<br />
hydrauliques. Le gouvernement a<br />
donc décidé de changer la donne. Avec<br />
en priorité un renforcement du parc<br />
existant. L’électricité étant dépendante<br />
à plus de 80 % des centrales thermiques<br />
réparties entre celles d’Azito, Aggreko<br />
et Vridi, l’État incite ces unités à<br />
augmenter leurs capacités de production<br />
thermique. En juin 2022, la phase 4 de<br />
la centrale d’Azito a été inaugurée. Elle<br />
permet un accroissement de production<br />
de 253 MW (grâce à une turbine à gaz<br />
de 180 MW et une turbine à vapeur<br />
de 73 MW). Cela porte la capacité de<br />
la centrale à plus de 710 MW, soit près<br />
de 27 % de la puissance totale installée<br />
dans le pays. Le montant des travaux<br />
s’élève à environ 217 milliards de FCFA.<br />
En sus, la construction de la centrale<br />
Atinkou à cycle combiné de 390 MW,<br />
d’un montant de 260 milliards de<br />
FCFA, est en cours depuis mars 2021,<br />
à Jacqueville. C’est l’entreprise Tractebel<br />
(Belgique) qui est en charge du chantier.<br />
Livraison prévue dans vingt-huit mois.<br />
Le pays, qui se positionne également<br />
comme un fournisseur sous-régional, a<br />
pour ambition d’atteindre une puissance<br />
installée de 4000 MW à l’horizon 2030,<br />
contre 2369 MW actuellement. Dans<br />
ce contexte ambitieux, le PND 2021-<br />
2025 prévoit la mise en place d’une<br />
nouvelle centrale thermique d’une<br />
capacité de 200 MW, dont les modalités<br />
d’exploitation sont à définir (acquisition,<br />
leasing…). La découverte de pétrole<br />
et de gaz au large des côtes devrait<br />
permettre, à partir de 2023, d’assurer<br />
un équilibre énergétique. Tout comme<br />
les investissements dans les énergies<br />
durables, tels le solaire ou la tourbe. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 65
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
L’autoroute du Nord devrait bientôt être<br />
entièrement ouverte à la circulation.<br />
Des autoroutes<br />
pour connecter centres<br />
et périphéries<br />
Au nord et à l’est, les « quatre voies » progressent, ouvrant la voie aux échanges, créant<br />
un lien du nord au sud, de l’est à l’ouest, et tout le long du littoral du golfe de Guinée.<br />
Les structures autoroutières<br />
sont chères, complexes à<br />
financer (avec la question<br />
toujours délicate du péage),<br />
mais elles contribuent fortement au<br />
désenclavement des villes secondaires,<br />
à la promotion du commerce, aux<br />
échanges urbains et interurbains dans<br />
un contexte économique favorable. Elles<br />
sont également un facteur de sécurité<br />
routière améliorée. Le 11 décembre<br />
2013, le président Alassane Ouattara<br />
inaugurait le tronçon rénové de<br />
l’autoroute du Nord entre Singrobo<br />
et Yamoussoukro. Le 29 mars 2017,<br />
feu le Premier ministre Amadou Gon<br />
Coulibaly donnait le premier coup de<br />
pioche marquant le démarrage des<br />
travaux de la section Yamoussoukro-<br />
Tiébissou, longue de 37 kilomètres.<br />
Quant à la section Tiébissou-Bouaké,<br />
de 95 kilomètres, les travaux ont<br />
officiellement démarré le 29 novembre<br />
2018 et sont réalisés à près de 80 %,<br />
selon l’Agence de gestion des routes<br />
(Ageroute), entreprise assurant la<br />
maîtrise d’ouvrage pour le compte<br />
du ministère de l’Équipement et de<br />
l’Entretien routier. L’autoroute du Nord<br />
(section Yamoussoukro-Tiébissou-<br />
Bouaké) devrait donc bientôt être<br />
entièrement ouverte à la circulation,<br />
permettant de mieux connecter le nord<br />
et le sud du pays, et la Côte d’Ivoire<br />
à son hinterland (Burkina Faso et<br />
Mali notamment). C’est un chantier<br />
réellement stratégique dont l’objectif est<br />
de toucher la frontière et de participer<br />
activement au développement des zones<br />
sahéliennes. À l’est, le projet autoroutier<br />
avance également. La section Abidjan-<br />
Grand-Bassam a été achevée en<br />
septembre 2015. En décembre 2021,<br />
les travaux du tronçon Abidjan-Assinie,<br />
d’un montant estimé à 68 milliards de<br />
FCFA, ont démarré. Ils sont prévus pour<br />
durer vingt-quatre mois. Initialement,<br />
cette première section devait relier<br />
Grand-Bassam au village de Samo, en<br />
passant par Bonoua, mais le projet a<br />
connu des modifications en raison des<br />
NABIL ZORKOT<br />
66 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Son renforcement présente de sérieuses opportunités économiques et touristiques pour le pays.<br />
NABIL ZORKOT<br />
coûts élevés qu’il aurait engendrés :<br />
« Entre Bassam et Bonoua, il existe<br />
beaucoup de zones marécageuses. Les<br />
premières études effectuées portaient<br />
le projet à 4 milliards de FCFA le<br />
kilomètre. Ça coûtait excessivement<br />
cher. Il a fallu effectuer un autre<br />
tracé, afin de baisser le coût à un<br />
peu moins de 2 milliards de FCFA le<br />
kilomètre, y compris les échangeurs,<br />
les passerelles piétons », explique<br />
Amédé Koffi Kouakou, ministre de<br />
l’Équipement et de l’Entretien routier.<br />
Le bitumage en 2x2 voies de cette<br />
route de 30 kilomètres, construite le<br />
long du canal d’Assinie, ouvre le trafic<br />
vers l’est du pays et vers le Ghana.<br />
Le tracé participe surtout, même si<br />
cela reste encore au stade du symbole,<br />
au grand projet global de l’autoroute<br />
Abidjan-Lagos (1 081 kilomètres).<br />
Cette autoroute du futur relierait<br />
les deux principales métropoles de<br />
l’Afrique de l’Ouest, en passant par<br />
Accra, Lomé, Cotonou… Un défi à la<br />
hauteur de l’ambition de la nouvelle<br />
zone de libre-échange continentale<br />
africaine (Zlecaf), forte de son<br />
1,3 milliard de consommateurs. ■<br />
Enfin la Côtière<br />
Les travaux de rénovation de cette route<br />
mythique du littoral sont enfin lancés. Une urgence<br />
et un challenge de 350 kilomètres !<br />
Lancés par le Premier ministre<br />
Patrick Achi, le 18 septembre<br />
2021, à San Pedro, les<br />
travaux de rénovation et<br />
de réhabilitation de la fameuse<br />
nationale « côtière » sont en cours.<br />
Et particulièrement attendus par<br />
les entreprises et les particuliers,<br />
pour qui cet axe qui relie Abidjan<br />
à San Pedro est essentiel. L’objectif<br />
est de dynamiser le commerce et les<br />
échanges et de désenclaver les villes<br />
du littoral comme Fresco et Sassandra.<br />
De générer aussi des flux touristiques<br />
sur un littoral particulièrement<br />
séduisant. Près de onze mois après<br />
le démarrage des travaux, beaucoup<br />
reste à faire. En raison notamment<br />
des fortes précipitations intervenues<br />
lors de la dernière saison des pluies.<br />
Le chantier long de 353,5 kilomètres<br />
a été réparti en trois lots et<br />
attribués à trois entreprises :<br />
le tronçon Songon-Dabou-Grand-<br />
Lahou (93 kilomètres) à Sogea<br />
Satom, l’axe Grand-Lahou-Fresco<br />
(80 kilomètres) à Razel, et le tronçon<br />
Fresco-Sassandra-San Pedro-<br />
Grand-Béréby (180,5 kilomètres)<br />
à PFO Auteuil. Ce projet coûtera<br />
308 milliards de FCFA. Selon le<br />
Premier ministre, le renforcement<br />
de la Côtière présente non seulement<br />
de sérieuses opportunités économiques<br />
et touristiques pour le pays, mais il<br />
servira également d’outil d’intégration<br />
sous-régionale. En effet, cet axe<br />
constitue un maillon du réseau<br />
routier communautaire appelé<br />
« la Transcôtière », qui tant bien que<br />
mal chemine de Dakar, au Sénégal,<br />
jusqu’à la frontière du Nigeria. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 67
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
68 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Akouédo,<br />
révolution verte<br />
La décharge de sinistre mémoire a fermé en 2019. Sur cet<br />
espace est en train de naître un complexe rare en Afrique.<br />
DR (2)<br />
Éloigné de 12 kilomètres<br />
d’Abidjan à son<br />
ouverture, le site fait<br />
aujourd’hui partie<br />
de son agglomération.<br />
Ouverte en 1966, la décharge<br />
d’Akouédo a enfin été<br />
fermée le 4 juillet 2019.<br />
Un événement accueilli<br />
avec soulagement par des milliers de<br />
riverains, forcés de vivre à proximité<br />
de montagnes de déchets jetés à<br />
la sauvage au mépris des normes<br />
environnementales. Tout le monde se<br />
souvient aussi de la tragédie du navire<br />
Probo Koala et de ses résidus toxiques<br />
jetés ici et dans d’autres endroits<br />
d’Abidjan, en août 2006. Lors de sa<br />
création, la décharge était éloignée<br />
de la ville de 12 kilomètres. Au fil du<br />
temps, la cité s’est étendue au point<br />
d’absorber Akouédo. Décision a été prise<br />
de déplacer la décharge sur un espace<br />
sécurisé à Kossihouen, sur l’autoroute<br />
du Nord. Et Akouédo s’apprête à vivre<br />
une nouvelle vie. Les travaux ont<br />
officiellement été lancés en 2019 par<br />
feu le Premier ministre Amadou Gon<br />
Coulibaly. PFO Africa est chargé, en<br />
association avec Veolia, de ce projet<br />
d’un coût estimé à 121 milliards<br />
de francs CFA, véritable refondation<br />
d’un site de près de 100 hectares.<br />
Ce dernier a été entièrement nettoyé,<br />
réaménagé, les déchets enfouis sous<br />
des dômes de 30 mètres de haut.<br />
Le paysagiste français Philippe Niez<br />
dirige la mise en place de pépinières<br />
et d’un parc botanique qui illustrera<br />
les différents écosystèmes naturels<br />
du pays. Une plate-forme de traitement<br />
et de valorisation du biogaz (émis par<br />
les déchets organiques enfouis) devrait<br />
atteindre une puissance d’environ<br />
2 MW. Également prévu, un centre<br />
de formation et de documentation<br />
sur l’économie circulaire, la valorisation<br />
des déchets et leur recyclage.<br />
Une véritable révolution verte. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 69
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Coup d’envoi pour la CAN !<br />
Les chantiers avancent à vive allure, avec six stades prévus pour la 34 e édition<br />
de la compétition.<br />
La 34 e Coupe d’Afrique des<br />
nations (CAN) se déroulera en<br />
janvier et février 2024 en Côte<br />
d’Ivoire. Le pays s’est engagé à<br />
organiser une compétition mémorable.<br />
Faisant le point des travaux à l’issue<br />
d’une rencontre avec une délégation de<br />
la Confédération africaine de football<br />
(CAF) en juin dernier, le ministre<br />
des Sports Paulin Danho déclarait :<br />
« La Côte d’Ivoire sera prête pour<br />
organiser une CAN exceptionnelle. »<br />
Même son de cloche chez Albert<br />
François Amichia, président du comité<br />
d’organisation de la CAN (COCAN),<br />
qui s’exprimait le 3 juillet sur le report<br />
de la compétition à janvier 2024<br />
(pour éviter l’intense saison des pluies<br />
de juin-juillet). Pour cet événement<br />
continental (et international), cinq<br />
grandes villes ont été sélectionnées<br />
pour abriter les matchs dans six<br />
stades : le stade Félix Houphouët-<br />
Boigny, à Abidjan (40 000 places), le<br />
stade Alassane Ouattara, à Ébimpé<br />
(Abidjan, 60 000 places), et les<br />
stades de Bouaké (40 000 places),<br />
Korhogo (20 000 places), San Pedro<br />
(20 000 places) et Yamoussoukro<br />
(20 000 places). Ceux d’Ébimpé,<br />
San Pedro, Yamoussoukro et Korhogo<br />
sont nouveaux. Les autres font l’objet<br />
d’une rénovation importante.<br />
Les travaux sont pratiquement achevés,<br />
avec comme dernière étape certaines<br />
mises aux normes demandées par<br />
la CAF. Ces infrastructures devraient<br />
favoriser l’économie locale avant,<br />
pendant et après la CAN 2023.<br />
Et, dans le même temps, offrir au<br />
football des structures dignes de ce<br />
nom. Vivement le coup d’envoi ! ■<br />
À Bouaké, l’extension devrait être terminée pour la fin du mois de décembre 2022.<br />
NABIL ZORKOT<br />
70 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Ci-dessus, le stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, dont la réhabilitation permettra de recevoir 40 000 personnes.<br />
Ci-dessous, la structure d’Ébimpé, à la périphérie nord de la capitale économique, inaugurée le 4 octobre 2020.<br />
NABIL ZORKOT (2)<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 71
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Le haut débit<br />
pour rassembler<br />
La future autoroute de l’information<br />
devrait réduire la fracture numérique<br />
entre zones rurales et urbaines.<br />
L’accès à un Internet de qualité est essentiel pour accélérer le développement<br />
économique, aux quatre points cardinaux du territoire.<br />
La fracture numérique entre<br />
les zones urbaines et zones<br />
rurales en matière d’accès aux<br />
ressources technologiques reste<br />
une question cruciale dans une Côte<br />
d’Ivoire qui aspire à un développement<br />
économique et social plus inclusif.<br />
Depuis 2011, le pays a connu un<br />
important bond qualitatif et quantitatif<br />
dans le secteur des technologies de<br />
l’information et de la communication<br />
(TIC), avec notamment l’adoption<br />
de la 4G par les opérateurs et un<br />
nombre toujours croissant d’abonnés et<br />
d’utilisateurs des services liés à Internet.<br />
Mais beaucoup reste à faire, notamment<br />
en matière de couverture. Certaines<br />
zones sont connectées, mais vivent<br />
malheureusement les aléas d’un réseau<br />
de qualité insuffisante. D’autres sont<br />
en attente de raccordement. La priorité<br />
est donc de doter le pays d’un réseau<br />
haut débit performant, pour un accès<br />
plus facile et moins onéreux à Internet.<br />
La Côte d’Ivoire, dès 2013, a lancé<br />
un projet visant à déployer un réseau<br />
très haut débit en fibre optique. Le<br />
pays a notamment souhaité construire<br />
une autoroute de l’information, ou<br />
« backbone », de 7 000 km, réalisée<br />
en trois phases. La phase III est en<br />
cours d’achèvement. Le réseau national<br />
haut débit (RNHD) devra permettre<br />
de réduire de manière considérable<br />
la fracture numérique entre zones<br />
rurales et urbaines. De connecter les<br />
administrations du pays. Et de servir<br />
de plate-forme pour les principaux<br />
fournisseurs de services de téléphonie et<br />
data. Selon l’Agence nationale du service<br />
universel des télécommunications-TIC<br />
(ANSUT), chargée du projet, le RNHD<br />
permettra également de vulgariser<br />
l’accès aux réseaux à long terme et<br />
de créer de nouveaux emplois. ■<br />
NABIL ZORKOT<br />
72 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Les premiers étudiants ont été<br />
accueillis à la rentrée 2021.<br />
Une université à San Pedro<br />
Un établissement flambant neuf, témoignage de la volonté de décentraliser<br />
l’éducation supérieure.<br />
NABIL ZORKOT<br />
La première pierre de<br />
l’Université de San Pedro,<br />
dont la construction a coûté<br />
95 milliards de francs CFA,<br />
a été posée le 30 novembre 2018<br />
par feu le Premier ministre Amadou<br />
Gon Coulibaly. Elle a ouvert ses<br />
portes le 19 octobre 2021, avec plus<br />
de 400 étudiants inscrits. Et est<br />
emblématique du vaste programme<br />
de décentralisation des universités<br />
(PDU) entamé en 2014. Il s’agit<br />
pour le pays d’investir massivement<br />
dans les ressources et la formation<br />
des jeunes, clés de l’émergence,<br />
et de faire face au nombre, à l’effet<br />
de choc démographique. De créer<br />
également des pôles de vie et d’activité<br />
autour de sites décentralisés. Enfin,<br />
chaque pôle doit s’orienter vers une<br />
spécialisation liée à l’écosystème local.<br />
Chaque nouvelle université, comme<br />
celles de San Pedro ou de Bondoukou,<br />
ouvre phase par phase pour garantir<br />
un enseignement de qualité à un<br />
corps d’étudiants progressivement<br />
plus nombreux. Le pôle de<br />
San Pedro propose des formations<br />
innovantes dans quatre unités de<br />
formation et de recherche (UFR) :<br />
agriculture, ressources halieutiques<br />
et agro-industrie ; sciences de la<br />
mer ; logistique, tourisme, hôtellerierestauration<br />
; sciences de la santé et<br />
formation de médecins généralistes.<br />
L’établissement compte également<br />
une classe préparatoire aux grandes<br />
écoles (CPGE) – mathématiques,<br />
physiques et sciences de l’ingénieur<br />
(MPSI) – et deux écoles d’ingénieurs<br />
– bâtiment et travaux publics,<br />
construction navale. Bâti sur une<br />
superficie totale de 302 hectares,<br />
le campus attend dorénavant<br />
l’ouverture de sa cité universitaire. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 73
DÉCOUVERTE/Côte d’Ivoire<br />
Râleurs et fiers à la fois !<br />
par Emmanuelle Pontié<br />
Arrivée à l’aéroport Félix<br />
Houphouët-Boigny. Direction<br />
le Plateau. C’est le soir, tard.<br />
La circulation est fluide. Je<br />
le souligne en m’adressant au chauffeur,<br />
qui me rétorque, renfrogné : « À cette heure<br />
peut-être, mais vous allez voir demain. Ils ont<br />
fermé l’échangeur, encore pour des travaux<br />
de je ne sais quoi. On n’en peut plus. Il y<br />
a des embouteillages partout ! Cette ville<br />
n’est plus possible. Il faut arrêter là-haut<br />
[le pouvoir, ndlr] avec toute cette agitation.<br />
Ça ne sert à rien. On roule de plus en plus<br />
mal à Abidjan ! » Le lendemain soir, dîner<br />
chez des amis, dont l’appartement surplombe<br />
la lagune. Un peu exprès, je lance l’éternel<br />
débat : « Alors, cette baie de Cocody, elle<br />
en est où ? » La réponse fuse : « Nulle part !<br />
Les travaux sont arrêtés. Encore un truc<br />
qu’on ne verra jamais ! » Bon, ça, c’est fait…<br />
Les exemples de la mauvaise foi abidjanaise<br />
sur la multitude des travaux d’embellissement<br />
de leur ville annoncés, lancés, en cours, et<br />
parfois même réceptionnés, sont légion.<br />
Jusqu’au sempiternel « Est-ce qu’on mange<br />
la route ?», manière de dire que les<br />
chantiers, c’est bien joli, mais ça ne remplit<br />
pas l’assiette. Eh oui, Abidjan, à l’image<br />
de l’ensemble de la Côte d’Ivoire, est en<br />
chantier. Des routes, une autoroute, des<br />
ponts, des échangeurs, des stades, les bords<br />
de la lagune, etc. De nouveaux immeubles<br />
ultramodernes aussi, et prochainement un<br />
métro. En région, des écoles, des universités<br />
et des hôpitaux sortent de terre, des voies<br />
se bitument, des spots touristiques se<br />
viabilisent. Et quelle que soit l’incrédulité<br />
ambiante dans les quartiers ou les moues<br />
des éternels ronchons, le pays avance.<br />
Sérieusement. Le jour et la nuit avec hier.<br />
Au sens propre déjà, puisque la capitale<br />
économique s’est tout à coup éclairée<br />
il y a une dizaine d’années, rompant avec<br />
une longue période de zones coupe-gorge<br />
plongées dans le noir. Et depuis, elle a<br />
repris sa place de leader, avec sa kyrielle<br />
d’enseignes d’hôtels ou de restaurants<br />
pour le tourisme d’affaires. Les chargés de<br />
mission africains se débrouillent pour mettre<br />
Abidjan comme escale sur leur feuille de<br />
route. « On essaye de passer une nuit ici.<br />
C’est trop bien, on se détend un peu. » Et<br />
l’Ivoirien de la rue, jonglant allègrement<br />
avec ses contradictions, le sait parfaitement.<br />
Le soir, au maquis, il compare et ironise sur<br />
les voisins : « Tu as vu, en Guinée, ils n’ont<br />
rien fait. Conakry, c’est toujours un gros<br />
campement ! » « Ouais, mais gars, tu peux<br />
pas comparer. Ici, on est en Côte d’Ivoire ! »<br />
Proud of Ivory Coast, les Babi Boys ! Une fierté<br />
qui passe par… les travaux d’embellissement<br />
et les chantiers du développement. Préalable<br />
incontournable à la redistribution des<br />
richesses. Quoi qu’en disent les râleurs. Et<br />
d’ailleurs, on ne sait pas trop si les volées<br />
de bois vert que reçoivent les pouvoirs<br />
publics sur les réseaux sociaux lorsque tel<br />
ou tel projet prend du retard ne sont pas la<br />
preuve, au final, de l’impatience trépignante<br />
d’avoir enfin son autoroute flambant neuve<br />
ou son métro ultramoderne. Car sur la route<br />
du retour, un autre chauffeur reconnaît :<br />
« Depuis qu’on a le 3 e pont, tout a changé. Et<br />
quand on aura le 4 e et le 5 e , alors là, Abidjan,<br />
Madame, ça sera quelque chose ! » Ah bon ?<br />
Parce que franchement, lorsque l’on voyage,<br />
que l’on compare avant et après, ici ou<br />
là, « Babi », c’est déjà quelque chose ! ■<br />
74 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
PROFITEZ D'<br />
100 % NUMÉRIQUE<br />
Être en Afrique et être dans le monde.<br />
S'informer, découvrir, comprendre, s'amuser, décrypter, innover…<br />
À tout moment et où que vous soyez,<br />
+<br />
POURQUOI S'ABONNER ?<br />
Tout le contenu du magazine en version digitale disponible sur vos écrans.<br />
Des articles en avant-première, avant leur publication dans le magazine.<br />
Des contenus exclusifs afriquemagazine.com pour rester connecté au rythme de l’Afrique et du monde.<br />
Des analyses et des points de vue inédits.<br />
L’accès aux archives.<br />
accédez en illimité à afriquemagazine.com !<br />
www.afriquemagazine.com
portrait<br />
DJ SNAKE<br />
CE FRANCO-ALGÉRIEN QUI<br />
AL<strong>AM</strong>Y PHOTO<br />
76 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
FAIT DANSER LE MONDE<br />
Dans son dernier tube,<br />
« Disco Maghreb », le génie<br />
de l’électro renoue avec ses origines<br />
et met le raï à l’honneur.<br />
Parcours, de son enfance<br />
dans une cité du Val-d’Oise<br />
à son succès planétaire.<br />
par Luisa Nannipieri<br />
À l’Ultra Music<br />
Festival, à Miami,<br />
en 2018.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 77
PORTRAIT<br />
Dans le film<br />
culte La Haine, de Mathieu Kassovitz,<br />
sorti en 1995, une séquence devenue<br />
mythique montre le célèbre DJ<br />
franco-marocain Cut Killer en train de<br />
mixer « Sound of da Police », de KRS-One,<br />
depuis la fenêtre d’une HLM, en banlieue<br />
parisienne. Si elle a contribué à sortir le<br />
rap français de l’ombre, cette scène a<br />
aussi poussé un grand nombre de jeunes<br />
vers les platines. William Grigahcine,<br />
alias DJ Snake, est l’un d’entre eux. Celui<br />
qui connaîtra le succès international aux<br />
côtés d’artistes comme Lil Jon (« Turn<br />
Down for What »), Justin Bieber (« Let Me<br />
Love You »), ou encore Selena Gomez et<br />
Cardi B (« Taki Taki ») est à peine adolescent<br />
quand il voit pour la première fois<br />
Cut Killer. Enfant timide, pendant les<br />
booms, il préférait déjà passer son temps<br />
avec les CD deux titres, à côté des chaînes<br />
hi-fi, pour envoyer du Ace of Base ou du<br />
Tupac, plutôt que se démener sur la piste<br />
de danse. Mais dans son quartier, il n’y a<br />
pas de DJ, et la performance de Cut Killer<br />
à l’écran est une révélation.<br />
Nous sommes au début des<br />
années 2000. William, né à Paris le<br />
13 juin 1986, vit avec sa mère, algérienne<br />
originaire de Sétif, et son petit<br />
frère dans une cité d’Ermont, dans le<br />
Val-d’Oise. Toujours très discret et soucieux<br />
de sauvegarder la vie privée de ses<br />
proches, il n’a jamais dévoilé beaucoup<br />
de détails sur sa famille, mais on sait que<br />
son père, un forain français, a quitté le<br />
foyer quand il n’avait que 2 ans, et que sa<br />
mère, qui travaillait notamment comme<br />
femme de ménage, les élève lui et son<br />
frère seule. Dans ce quartier populaire<br />
et multiethnique, où le raï algérien, le<br />
kompa haïtien ou le zouk antillais se<br />
mélangent aux sonorités du rap et du<br />
hip-hop, il se forge des goûts musicaux<br />
éclectiques. Le futur DJ décroche son<br />
premier job rémunéré, à 15 ans. Un cliché<br />
le montre en train de mixer sur deux<br />
bacs à disques dans un gymnase d’Argenteuil<br />
: « Il n’y avait pas grand monde,<br />
mais c’était énorme », se souvient-il. C’est<br />
à peu près à cette période qu’il choisit<br />
son nom de scène, même si aujourd’hui<br />
il avoue qu’il ne lui plaît plus vraiment :<br />
« C’est une idée “pourrie” que j’ai eue<br />
quand j’étais gamin. » En effet, Snake,<br />
c’est le surnom que sa bande de potes<br />
lui donne quand il commence à faire des<br />
graffitis, vers 12 ans, et se découvre un<br />
talent pour glisser, tel un serpent, entre<br />
les mains de la police. C’est aussi son<br />
tag, qui, à l’époque, apparaît un peu partout<br />
sur les murs du nord de Paris et de<br />
l’Île-de-France.<br />
À L’ÉCOLE DES GRANDS<br />
Il y a quelque chose d’attendrissant<br />
dans la façon dont DJ Snake raconte cette<br />
période de sa vie et ce qui a suivi. Au-delà<br />
de l’image du mec cool et grande gueule<br />
derrière ses lunettes de soleil, qu’il a<br />
d’ailleurs adoptées à ses débuts pour ne<br />
pas se laisser intimider par le public, on<br />
découvre plutôt quelqu’un de modeste,<br />
bosseur, qui n’a jamais pris la grosse<br />
tête. Quand il explique avoir arrêté<br />
l’école à 17 ans pour suivre sa passion,<br />
car il s’ennuyait en cours et avait du mal<br />
avec les règles, il ajoute que ce n’est pas<br />
forcément l’exemple à suivre. Et qu’il a<br />
eu la chance d’être soutenu par sa mère,<br />
qui lui a acheté une platine, même si elle<br />
ne roulait pas sur l’or, et lui a donné un<br />
an pour trouver sa voie. Il devient alors<br />
vendeur chez Samad Records, un magasin<br />
de disques parisien, à Châtelet, tenu<br />
par le cousin de DJ Mehdi, à qui il donnait<br />
déjà un coup de main aux puces de<br />
Clignancourt en échange de quelques<br />
Au-delà<br />
de l’image<br />
du mec cool,<br />
on découvre<br />
quelqu’un<br />
de modeste,<br />
qui n’a<br />
jamais pris<br />
la grosse tête.<br />
CAPTURES D’ÉCRAN DU CLIP « DISCO MAGHREB » (2) - DR<br />
78 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Dans la vidéo de « Disco<br />
Maghreb », l’artiste se<br />
met en scène au cœur<br />
de la cité Carrière<br />
Jaubert, dans l’un<br />
des quartiers les plus<br />
pauvres d’Alger.<br />
Un clip symbole<br />
Le clip du single<br />
« Disco Maghreb »,<br />
dont la pochette<br />
évoque les<br />
cassettes de raï<br />
des années 1980<br />
et 1990, a été réalisé par Elias<br />
Belkeddar, avec l’aide de Romain<br />
Gavras. En moins de 4 minutes,<br />
la vidéo met à l’honneur un pays<br />
qui navigue entre modernité et<br />
tradition : les personnages portent<br />
des robes berbères comme des<br />
maillots du PSG – le club de cœur<br />
de DJ Snake –, se déplacent à<br />
motocross ou à dos de chameau…<br />
Loin des démons du passé, tout<br />
le monde danse, insouciant, que<br />
ce soit dans une salle des fêtes,<br />
pour une cérémonie traditionnelle,<br />
ou dans la cité Carrière Jaubert,<br />
à Alger. Construit en 1957 pour<br />
pacifier la population en pleine<br />
guerre d’Algérie, ce ghetto délabré<br />
se transforme en décor de fête aux<br />
couleurs nationales, et en symbole<br />
de l’histoire qui lie l’enfant de<br />
la banlieue parisienne au pays<br />
de ses ancêtres. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 79
PORTRAIT<br />
ambiances au fil des morceaux, dans ses<br />
albums, comme il le faisait avec ses mixtapes.<br />
Au seuil des années 2010, alors qu’il<br />
a l’impression d’avoir atteint un palier<br />
professionnellement parlant, son travail<br />
attire l’attention de Clin Sparks, un DJ<br />
américain, qui lui propose d’aller travailler<br />
aux États-Unis. William ne parle pas<br />
un mot d’anglais, mais a confiance dans<br />
son talent et se donne à fond pour proposer<br />
des morceaux aux producteurs. Le<br />
succès est au rendez-vous, et il décroche<br />
des collaborations importantes, notamment<br />
avec Lady Gaga, pour « Government<br />
Hooker », en 2011.<br />
Il découvre aussi l’envers du décor<br />
de l’industrie du disque américaine…<br />
Il dépense presque tout son budget<br />
en hôtels et billets d’avion, est à peine<br />
crédité dans les albums, et personne<br />
ne prend son avis en compte : « Tu n’es<br />
personne ou presque. Tu es en studio<br />
avec des gens, mais tu ne peux pas<br />
vraiment “driver” la session. On te dit :<br />
“Fais ça.” C’est dur de faire de l’art à la<br />
commande », reconnaîtra-t-il dans une<br />
interview donnée à Konbini en 2019.<br />
L’expérience l’endurcit, et il décide que<br />
ce qu’il veut, c’est avoir du succès avec<br />
ses sons à lui, sa vision, ou il arrêtera<br />
tout s’il échoue.<br />
vinyles. Ce travail lui permet de s’acheter<br />
sa deuxième platine et de côtoyer les<br />
plus grands : Cut Killer, Laurent Garnier<br />
et, bien sûr, DJ Mehdi. Fasciné par le<br />
scratch, les techniques et les gestuelles<br />
derrière la console, il bombarde de questions<br />
ces derniers, qui le prennent sous<br />
leur aile. Cut Killer, qui était son idole,<br />
devient son mentor et son ami. Ils sont<br />
encore très proches aujourd’hui.<br />
Ses contacts lui ouvrent les portes<br />
Ses lunettes de soleil ?<br />
Un souvenir de ses débuts,<br />
quand il était encore<br />
intimidé par le public.<br />
du club Gibus, à Paris, où il devient DJ<br />
résident 100 % hip-hop. En même temps,<br />
il compose des mixtapes aux influences<br />
multiples, qui lui permettent d’explorer<br />
d’autres univers musicaux et d’animer<br />
des soirées dans la capitale. Aujourd’hui<br />
comme à l’époque, il ne supporte pas<br />
l’idée de se cantonner au même style.<br />
Pour offrir une expérience toujours<br />
plus originale au public et se faire plaisir,<br />
il n’hésite pas à varier les sons et les<br />
PARIS-MI<strong>AM</strong>I<br />
De retour en France à l’été 2012, il<br />
loue avec ses dernières économies un<br />
studio à Boulogne-Billancourt, où il<br />
s’enferme pendant deux mois pour laisser<br />
libre cours à son imagination. Il est<br />
tellement pris par le processus créatif<br />
qu’il en sort seulement une fois par jour<br />
pour aller prendre une douche… à la piscine<br />
municipale, qui se trouve à côté. La<br />
demi-mesure n’est pas son style, et son<br />
talent s’avère à la hauteur de sa détermination.<br />
Fasciné et inspiré par la musique<br />
trap électro de Baauer, phénomène de<br />
l’année avec « Harlem Shake », ou le<br />
projet TNGHT, de Hudson Mohawke<br />
et Lunice, il publie chaque semaine un<br />
nouveau morceau sur la plate-forme<br />
gratuite SoundCloud et, décidé à risquer<br />
le tout pour le tout, spamme des<br />
MICHAEL DE ALMEIDA GONCALVES<br />
80 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
inStargram<br />
Son compte Instagram, @djsnake,<br />
affiche plus de 9,6 millions d’abonnés.<br />
Habitué des collaborations artistiques,<br />
il a notamment travaillé avec Selena<br />
Gomez et Cardi B (« Taki Taki »).<br />
CAPTURES D’ÉCRAN INSTAGR<strong>AM</strong> DE DJ SNAKE<br />
producteurs avec sa meilleure création.<br />
Diplo, qui collabore entre autres avec<br />
Snoop Dogg, Madonna ou Beyoncé, est<br />
le seul à lui répondre. Ensemble, ils vont<br />
signer en 2013 « Turn Down for What »,<br />
qui se serait vendu à plus de 10 millions<br />
d’exemplaires ! Le titre est même repris<br />
par Michelle Obama sur le compte de la<br />
Maison-Blanche.<br />
Une telle réussite aurait satisfait n’importe<br />
quel artiste, mais ce n’est qu’après<br />
l’enregistrement de « Lean On », autre<br />
tube planétaire aux sonorités électropop,<br />
house et reggae, que William s’accorde<br />
le droit de souffler : le nom DJ Snake est<br />
désormais une valeur sûre. Son installation<br />
à Miami, en 2013, se fait dans de<br />
meilleures conditions que son premier<br />
séjour outre-Atlantique. Il s’affiche en<br />
ambassadeur de la musique électronique<br />
française aux États-Unis (et dans<br />
le monde, avec le collectif Pardon My<br />
French) et devient le premier DJ à mixer<br />
sur le toit de l’Arc de triomphe, à Paris,<br />
ou à mettre le son à la garden-party de<br />
l’Élysée, lors de la victoire des Bleus à la<br />
Coupe du monde de 2018. Il sort également<br />
deux albums, Encore et Carte<br />
blanche, numéros 1 des charts de dance.<br />
DJ Snake, le Français le plus écouté<br />
dans le monde, est aussi… algérien. Et<br />
fier de l’être. Son lien très fort avec sa<br />
mère et sa grand-mère, décédée l’an dernier,<br />
a marqué toute sa vie. Il a grandi<br />
en écoutant les classiques du raï, qu’il a<br />
intégrés, à côté de sonorités allaoui, dans<br />
un nouveau tube qui signe son retour<br />
aux sources. Dévoilé fin mai, « Disco<br />
Maghreb » a dépassé les 50 millions de<br />
vues sur YouTube en moins d’un mois.<br />
PROMENADE À ORAN<br />
Ce morceau qui mélange musique<br />
algérienne et électro est une véritable<br />
lettre d’amour aux villes d’Oran et d’Alger,<br />
où a été tournée la vidéo. Mais c’est aussi<br />
un hommage au label homonyme, qui<br />
a dominé la scène musicale algérienne<br />
jusqu’à la fin des années 1990 sous la<br />
direction de Boualem Benhaoua, qui<br />
apparaît dans le clip. Effet imprévu de ce<br />
succès, ou exemple concret de soft power,<br />
le vieux magasin de disques du producteur<br />
est devenu en quelques mois une<br />
attraction touristique incontournable.<br />
Imaginé comme un pont entre les<br />
différentes générations et origines, le<br />
morceau a fait le bonheur des 60 000 spectateurs<br />
venus écouter DJ Snake au Parc<br />
des Princes le 11 juin dernier, et lui a valu<br />
l’adoration de jeunes Algériens, qui l’ont<br />
accueilli comme un héros lors de sa visite<br />
à Oran pour les Jeux méditerranéens.<br />
L’occasion de filmer un nouveau clip<br />
sur les coulisses de son séjour, « Algeria<br />
2022 », où on le voit se promener dans<br />
les lieux mythiques de la ville, rencontrer<br />
les habitants et déguster un couscous<br />
préparé par la diva Cheba Zahouania. Le<br />
tout sur la musique des chanteurs de raï<br />
Cheb Khaled et Cheb Hasni.<br />
Quelques heures après sa mise<br />
en ligne, les vues du clip ont explosé,<br />
garantissant la promotion, à l’échelle<br />
planétaire, d’un pays multiple et accueillant.<br />
Et comme l’a promis DJ Snake à<br />
ses fans, ses projets en Algérie ne font<br />
que commencer… ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 81
82 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />
MYRI<strong>AM</strong> <strong>AM</strong>RI
À<br />
la fois énigmatique et tout en retenue,<br />
Malek Lakhal, formée aux théories politiques,<br />
donc à la philosophie, propose un<br />
récit piqué de non-dits, dans lequel les<br />
méandres d’une famille bourgeoise tunisienne<br />
se dessinent à travers les regards<br />
croisés de chacun des protagonistes. Et<br />
le lecteur, tiraillé entre les ressentis des<br />
six voix de cette expérience littéraire, circule dans ce puzzle<br />
social comme avec une caméra invisible. Difficile de ne pas<br />
penser au prodigieux Juste la fin du monde, de Xavier Dolan.<br />
Un va-et-vient cinématographique furieux autour des silences<br />
d’un fils et de l’impossible annonce de sa mort prochaine. C’est<br />
cette intimité familiale, nourrie de ses secrets et de ses codes,<br />
que l’auteure et cofondatrice d’Asameena, magazine littéraire<br />
en ligne, explore. Au cœur de son premier roman, Ahmed,<br />
malade du sida, sait qu’il doit repartir en France pour se soigner.<br />
Mais le poids de la société, des non-dits, des sentiments<br />
comprimés, irrépressibles, l’assigne à un mutisme, fragile, prêt<br />
à éclater. Tout comme cette « valse des silences », titre du livre,<br />
dans laquelle, autour de lui, la mère, le père, le frère, la tante<br />
et l’amie oscillent, se cachent ou se dévoilent, se figent ou se<br />
transforment. Sans un mot. Un roman cubiste, où chacun tisse<br />
ou détricote l’écheveau des liens familiaux. En naviguant à vue.<br />
entrevue<br />
Dans un premier roman choral,<br />
la jeune autrice tunisienne,<br />
formée à la philosophie,<br />
explore les liens familiaux.<br />
<strong>AM</strong> : Pour quelle raison avez-vous construit<br />
votre roman autour d’Ahmed, malade du sida ?<br />
Malek Lakhal : Ce désir est venu parce qu’à la fois je n’avais<br />
pas lu d’histoire qui parlait du sida dans un contexte tunisien et<br />
parce que ce récit est comme une sorte d’expérience en philosophie.<br />
C’est-à-dire que j’ai pris une expérience extrême et que<br />
j’ai imaginé les dilemmes moraux qui en découlent. À savoir<br />
ici, à partir du postulat de la mort prochaine d’Ahmed, tester<br />
ce qui résiste et ce qui ne résiste pas, et observer comment on<br />
se meut dans une telle situation. Mais je ne saurais dire d’où<br />
Malek Lakhal<br />
« Il est essentiel<br />
de politiser l’intime »<br />
propos recueillis par Catherine Faye
ENTREVUE<br />
vient Ahmed, un personnage imaginaire, situé dans son temps<br />
et dans son orientation sexuelle. J’avais juste envie d’écrire sur<br />
ce tout, un homme gay, issu d’une famille bourgeoise tunisienne,<br />
qui vit dans les années 1990, entre Paris et Tunis. Il y a<br />
bien sûr eu beaucoup d’emprunts autour de moi, le fait d’avoir<br />
moi-même vécu à Paris et d’être revenue en Tunisie… Et je me<br />
suis inspirée de trajectoires connues ou entrevues, auxquelles<br />
j’ai voulu réfléchir, et dans lesquelles j’ai fait évoluer mon personnage.<br />
Par ailleurs, je n’ai pas voulu d’indication temporelle<br />
nette. Les indices sont éparpillés. Comme le fait qu’il n’y ait pas<br />
de trithérapie ni de traitement. Ce qui signifie que l’histoire a<br />
lieu avant 1996. C’est donc un récit du passé. Qui serait probablement<br />
très différent aujourd’hui.<br />
Vous avez choisi d’aborder<br />
cette histoire à travers différents<br />
prismes, différents personnages,<br />
pour quelle raison ?<br />
Il m’était important de montrer<br />
qu’il y a une plus grande complexité<br />
que la simple perspective d’Ahmed,<br />
qui voit ses proches d’une manière<br />
un peu inerte. Il connaît leurs réactions,<br />
n’en attend rien de nouveau.<br />
Pour lui, ils sont un peu inamovibles.<br />
Je voulais parler de la famille dans<br />
sa globalité, introduire des formes de<br />
complexité, montrer que cela bouge<br />
chez tout le monde, qu’il n’y a rien<br />
de figé, chez personne, et que, finalement,<br />
tout le monde paie le prix<br />
d’une silenciation générale. Il n’y a<br />
pas forcément une victime et des<br />
coupables, mais plutôt une espèce de<br />
pacte mutuel, où tout le monde serait<br />
un peu victime de tout le monde et le<br />
geôlier de tout le monde.<br />
La question de l’expatriation,<br />
de l’exil, de ce qui nous manque ou nous complète,<br />
« On n’est<br />
jamais tout<br />
à fait chez soi,<br />
que ce soit sur<br />
sa terre natale<br />
ou sur celle<br />
d’accueil. Mais<br />
on n’est jamais<br />
tout à fait<br />
en dehors. »<br />
est au cœur du roman…<br />
En effet, et c’est comme cela que j’ai grandi et vécu. Mais<br />
le sens profond de ce que j’ai voulu dire est politique. Il y a<br />
beaucoup d’illustrations et de sous-entendus dans le récit. Par<br />
exemple, contrairement à ce que pensent les consulats français,<br />
lorsqu’ils ne délivrent pas de visa craignant que « l’étranger » ne<br />
veuille plus rentrer chez lui : en réalité, un Maghrébin n’a pas<br />
forcément envie de rester, de vivre en France. L’important pour<br />
moi était donc de montrer l’ambivalence des relations à une<br />
terre. Ahmed arrive en France avec une ambition, ce rêve d’en<br />
être, et repart convaincu qu’en fait, non, il n’a pas envie de vivre<br />
comme cela. Son amie, Amal, au contraire, est convaincue, au<br />
début, qu’elle ne va pas repartir. Pourtant, c’est elle qui reste,<br />
même si c’est un peu à contrecœur. Ce chassé-croisé, qui se<br />
joue en matière d’ambivalences, m’intéresse. On n’est jamais<br />
vraiment maître avec l’endroit où l’on est. On n’est jamais tout à<br />
fait chez soi, que ce soit sur sa terre natale ou sur celle d’accueil.<br />
En même temps, on n’est jamais tout à fait en dehors. C’est ce<br />
que mes personnages apprennent, une forme de négociation<br />
entre les deux espaces, où chacun fait un choix différent et<br />
apprend à accepter le choix de l’autre.<br />
De tous vos personnages, Amal semble<br />
être la seule à comprendre Ahmed…<br />
Amal, qui est également homosexuelle, est celle qui l’a le<br />
plus aidé, notamment à Paris, où il s’est installé à 17 ans, pour<br />
suivre ses études et pouvoir vivre plus librement son homosexualité.<br />
Avec elle, il s’est construit, s’est mis à exister, même<br />
secrètement. Et réciproquement. Dans<br />
ce livre, je voulais parler d’une amitié<br />
de l’ordre de la construction de soi. Une<br />
amitié radicale, où les enjeux pèsent plus<br />
lourd et où l’on exige plus de l’autre. Une<br />
amitié totale, dans laquelle il faut évoluer<br />
et accepter les limites de l’autre. Mais cela<br />
implique également de faire de la place<br />
aux choix de l’autre et de ne pas imposer<br />
ses décisions de force.<br />
Ces deux protagonistes<br />
finissent-ils par n’en former qu’un seul,<br />
qui se complète et qui s’oppose,<br />
comme le yin et le yang ?<br />
Pas forcément. Ahmed et Amal sont<br />
assez distants et à même de rentrer<br />
en conflit. C’est autre chose. Ils ne se<br />
complètent pas. Ils se tiennent séparément,<br />
mais debout et ensemble. Sur la<br />
même ligne.<br />
Vous écrivez : « Jamais on ne devient<br />
adulte aux yeux des mères.<br />
Elles sont trop seules pour ça.<br />
On n’est jamais qu’un fils, à jamais<br />
endetté par les sacrifices. » La relation entre Ahmed<br />
et sa mère a quelque chose de très radical…<br />
Ce que j’ai observé dans les relations parentales, ce sont des<br />
mères très sacrificielles, qui font peser cette abnégation comme<br />
une forme de dette et de culpabilité. Dernièrement, je lisais How<br />
to Mend: Motherhood and Its Ghosts, un livre de la poétesse<br />
égyptienne Iman Mersal, qui écrit sur la maternité et le sentiment<br />
de culpabilité des mères dès qu’elles mettent leur enfant<br />
au monde. Son point de vue est intéressant. Et je me demande<br />
si, finalement, cette culpabilité ne s’alimente pas mutuellement,<br />
comme une espèce de rapport de sacrifice et de dette. Dans un<br />
cycle qui ne s’arrête pas.<br />
Pourquoi le père est-il si absent ?<br />
J’ai eu beaucoup de mal à écrire ses passages, car il m’est<br />
difficile de cerner le rapport d’un père à ses enfants. Je n’ai<br />
84 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
DR<br />
d’ailleurs pas beaucoup lu de livres qui traitaient de cela. Je<br />
pense que cette absence est propre au patriarcat : le père,<br />
construit comme une figure d’autorité éloignée, ne s’implique<br />
pas dans la famille. Il m’a donc été difficile de rentrer dans<br />
sa subjectivité.<br />
Au fil des pages, on comprend que vous situez cette<br />
histoire il y a une trentaine d’années. Une telle famille<br />
pourrait-elle encore exister aujourd’hui ?<br />
L’immuabilité dans les rapports familiaux est très difficile<br />
à faire bouger. Il me semble d’ailleurs essentiel de politiser<br />
ces espaces : le lien, l’intime et, spécifiquement, la famille, car<br />
elle est toujours considérée comme une sphère autre, de sentiments<br />
et d’intersubjectivité, alors qu’il y a des comportements,<br />
des systèmes auxquels on peut réfléchir en termes théorique,<br />
politique, subjectif et collectif. C’est ce qu’explorent<br />
d’ailleurs la sociologue de la littérature<br />
française Kaoutar Harchi ou l’auteure<br />
franco-camerounaise Leonora Miano dans<br />
Crépuscule du tourment, un récit initiatique<br />
né de questionnements liés à son histoire, à<br />
sa construction, aux figures féminines qui<br />
l’ont entourée, à la sexualité et surtout aux<br />
non-dits familiaux d’une famille bourgeoise<br />
africaine. Je voulais continuer sur cette voie,<br />
car je considère la famille comme un espace<br />
politique. On peut faire sa psychanalyse tant<br />
que l’on veut, mais seules une réflexion et une<br />
remise en question intrafamiliales collectives<br />
peuvent réparer.<br />
Vous nous livrez une histoire de<br />
solitudes, de mots et de maux tus.<br />
Pourquoi un tel silence ?<br />
L’idée qu’un être humain, apprenant qu’il<br />
a le sida, ne sache pas ce qu’il va faire de cette<br />
information et ne puisse en parler à ses proches m’a totalement<br />
percutée. Il fallait absolument que j’essaie d’explorer chaque<br />
protagoniste d’une telle intrigue. Et que j’en profite pour me<br />
poser toutes les questions possibles sur ce silence pesant qui<br />
plane à l’intérieur des familles.<br />
Pourquoi les non-dits sont-ils surtout présents<br />
dans les familles bourgeoises ?<br />
Les statistiques montrent qu’il est beaucoup plus compliqué<br />
pour les femmes victimes de violences dans un milieu bourgeois<br />
d’en parler autour d’elles et de se plaindre que dans un milieu<br />
populaire. Les familles bourgeoises ont une espèce d’honneur à<br />
tenir : « On ne va pas se rabaisser à la parole » ou « On ne va pas<br />
se laisser aller à des excès de sentiments ». Dans ce lieu de socialisation,<br />
il y a énormément de retenue : ne pas parler trop fort,<br />
ne pas exhiber un problème, ne pas se faire remarquer, surtout<br />
quand on est une fille. Cela me fascine, et je le vois autour de<br />
moi de manière assez extraordinaire. Une retenue, quoi qu’il en<br />
coûte, quoi qu’il arrive. C’est tout un système, un peu victorien,<br />
Valse des silences, JC Lattès,<br />
280 pages, 20 €.<br />
et il y a quelque chose à explorer. Surtout lorsqu’il s’agit de la<br />
famille bourgeoise en Afrique. Je voulais gratter de ce côté-là.<br />
Observe-t-on une grande similitude entre<br />
ce type de familles en Afrique et en Europe ?<br />
Beaucoup plus qu’on ne le croit, même si la bourgeoisie<br />
post-coloniale est beaucoup plus cosmopolite que les occidentales.<br />
La première parle plusieurs langues, scolarise ses enfants<br />
dans des écoles étrangères, les envoie étudier à l’étranger, avec<br />
un désir d’extravertir sa descendance. C’est d’ailleurs souvent<br />
pour cette raison que cela crée des rapports un peu plus complexes<br />
dans les lieux où leurs enfants se trouvent. Par exemple,<br />
lorsqu’ils sont racisés, quand ils sont ramenés à leurs origines<br />
ou leur couleur de peau, alors que dans leur société, ils sont<br />
habitués à être dominants. Ce sont des situations particulières,<br />
dont très peu de gens parlent.<br />
On dit souvent que la littérature et le<br />
travail artistique, intellectuel, sont des<br />
sports de bourgeois. Qu’en pensez-vous ?<br />
En termes matérialistes et marxistes, il y a<br />
selon moi une forme de mécanisme assez perverse<br />
qui veut que, comme c’est de l’art, avec<br />
un grand A, et beaucoup de majuscules, il y a<br />
comme un effacement des réalités pratiques et<br />
une espèce d’idéologie qui consisterait à dire<br />
que c’est quelque chose d’inutile. Et donc que<br />
la littérature est un luxe de bourgeois. C’est<br />
faux et, en même temps, cela devrait être un<br />
métier auquel plus de personnes que celles<br />
qui ont le temps et les moyens devraient pouvoir<br />
aspirer. Car, oui, devenir écrivain, cela<br />
demande du temps et des moyens. Ce n’est pas<br />
neutre, et c’est quelque chose que l’on devrait<br />
dégager des majuscules, pour le mettre au<br />
niveau des professions, en clarifiant donc les<br />
rapports matériels d’un auteur avec une maison d’édition et<br />
toutes les relations économiques qui s’y rapportent.<br />
Quant au combat féministe, que l’on devine entre<br />
les lignes de votre roman, quel regard portez-vous<br />
sur son avancement ?<br />
En tant qu’autrice, je suis féministe. En tant que chercheuse,<br />
j’écris beaucoup sur le féminisme. Mais la réalité de<br />
ce mouvement social est complexe, et j’ai du mal à donner des<br />
réponses englobantes. À mon avis, la situation est double : il y<br />
a continuellement des avancées et des contrecoups. Comme<br />
dans une guerre. Nous avons eu une percée féministe avec<br />
#MeToo, en France, et #EnaZeda, l’équivalent tunisien. Mais<br />
en ce moment, il y a un effet de recul, notamment aux États-<br />
Unis avec la révocation du droit à l’avortement. L’important est<br />
de garder les lignes et de s’organiser collectivement, avec des<br />
objectifs politiques clairs, sans rien attendre des hommes politiques.<br />
Parfois, on perd du terrain, comme depuis le Covid-19.<br />
Puis, on en regagne. La lutte ne s’arrête jamais. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 85
interview<br />
Yasmina Khadra<br />
« L’écriture, ce<br />
voyage initiatique »<br />
Son dernier roman, Les Vertueux, raconte le destin d’un berger<br />
jeté dans les fracas de la Grande Guerre et de l’adversité. Pour<br />
l’auteur, cette fresque historique palpitante, pétrie de philosophie,<br />
signe son œuvre la plus accomplie. propos recueillis par Astrid Krivian<br />
Algérie, dans l’arrière-pays, à l’aube du<br />
xx e siècle. Un jeune berger, Yacine<br />
Chéraga, voit son destin bouleversé<br />
par l’autorité d’un caïd, qui l’enrôle de<br />
force dans un régiment colonial. Arraché<br />
aux siens, il est jeté sous le feu de<br />
la Première Guerre mondiale. Une fois<br />
revenu dans son pays, il traverse les<br />
revers, les injustices, en butte à l’animosité<br />
d’adversaires redoutables. Avec Les Vertueux, Yasmina<br />
Khadra porte son art romanesque à son paroxysme, entre virtuosité<br />
narrative, profondeur philosophique, puissance d’évocation.<br />
Il offre une réflexion sur la faculté d’un être à garder sa vertu<br />
malgré les coups du sort et les assauts de la cruauté humaine.<br />
Et dessine une fresque historique de l’Algérie, de ses paysages<br />
désertiques infinis à l’effervescente comédie sociale des villes.<br />
<strong>AM</strong> : Vous présentez ainsi votre nouveau roman : « J’ai écrit<br />
tous mes livres pour mériter d’écrire celui-là. » Pourquoi<br />
tient-il cette place particulière dans votre œuvre ?<br />
Yasmina Khadra : Il dépasse tout ce que j’ai écrit jusque-là.<br />
Jamais je n’ai été aussi satisfait au sortir d’un texte comme cette<br />
fois-ci. Mais laissons au lecteur le soin d’en juger. Pour ma part,<br />
je suis confiant, persuadé d’avoir franchi un cap avec ce roman.<br />
Je l’ai travaillé sans relâche, trois ans durant, sachant qu’aucune<br />
œuvre n’est parfaite, mais qu’il est possible de se surpasser. Pour<br />
moi, la littérature est un art qui ne se livre qu’aux artisans du<br />
verbe. Je l’ai su depuis mes premiers balbutiements de faiseur<br />
de prose et, toute ma vie, j’ai rêvé d’accéder à cette catégorie<br />
d’auteurs. Pas une seconde je n’ai lâché prise. Les Vertueux est<br />
l’aboutissement de plus d’un demi-siècle d’écriture passionnée,<br />
d’investissement personnel, de courage et de sacrifices.<br />
Vous le dédiez par ailleurs à votre mère…<br />
Je n’ai pas arrêté de penser à elle en écrivant ce roman. Ses<br />
évocations, son amour pour les grands espaces, sa nostalgie<br />
tribale ont jalonné mon écriture. J’ai regardé l’histoire de cette<br />
époque à travers ses yeux à elle. Ma mère était une émotion<br />
incarnée. Il me suffisait de m’asseoir en face d’elle pour que,<br />
d’un coup, mille oasis se mettent à miroiter au fond de ses prunelles.<br />
Conteuse hors pair et poétesse « nature », « pur jus », elle<br />
ne savait ni lire ni écrire, mais lorsqu’elle parlait, j’avais envie de<br />
n’entendre qu’elle sur Terre. Elle savait dire les choses avec une<br />
telle justesse et une telle tendresse que j’en avais les larmes<br />
jusque dans les veines. C’est elle qui m’a appris comment<br />
insuffler une âme aux natures mortes, comment déceler<br />
la beauté en toute chose car, me révélait-elle, il n’est<br />
de laideur que dans les esprits retors. J’ai convoqué,<br />
dans Les Vertueux, les héros qui l’avaient bouleversée,<br />
et j’ai articulé autour d’eux les espaces<br />
infinis de la steppe algérienne, les paysages<br />
époustouflants de l’arrière-pays surchargé<br />
d’histoires épiques, de chevauchées légendaires<br />
et d’affrontements. C’est-à-dire un<br />
monde tel qu’elle l’imaginait lorsque,<br />
enfant, son père lui racontait les<br />
combats que la mythique tribu des<br />
N’Soumeur avait menés pour ne pas<br />
JEAN-PHILIPPE BALTEL/SIPA<br />
86 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 87
INTERVIEW<br />
disparaître de la surface de la Terre. Je suis certain que de là où<br />
elle s’est exilée pour l’éternité, elle a un sourire attendri pour<br />
moi et beaucoup de fierté. Car ce roman est un peu le sien, aussi.<br />
Votre héros est enrôlé en 1914 dans le régiment des<br />
tirailleurs algériens pour combattre l’Allemagne aux côtés<br />
des Français, sur le front nord-est de l’Hexagone. Pourquoi<br />
cela vous intéressait de le plonger dans le feu du conflit ?<br />
Tout ce qui m’interpelle m’inspire. Écrire, pour moi, c’est<br />
m’instruire. Chaque histoire que j’invente me fait découvrir des<br />
réalités autres, parfois insoupçonnables, sur moi d’abord et sur ce<br />
qui m’entoure. Ici, j’ai voulu voir de plus près une période mouvementée<br />
de mon pays, accéder à ses non-dits, écarter les tentures<br />
poussiéreuses sur ses différents visages, remonter aux sources de<br />
ce qui fait de nous un peuple d’écorchés vifs. On ne peut expliquer<br />
le présent qu’en se référant au passé. Pour comprendre l’Algérie<br />
d’aujourd’hui, il faut interroger les fantômes de ceux qui ne<br />
sont plus. Les Vertueux s’est proposé de m’aider dans ce sens. J’ai<br />
suivi le parcours d’un berger qui n’avait jamais quitté son douar<br />
et que l’on envoie brutalement découvrir un monde aux antipodes<br />
du sien. Il connaîtra la Grande Guerre en tant que tirailleur,<br />
Oran en naufragé de l’histoire, la déroute, la traque, l’amour,<br />
les vacheries de la fatalité, les chamboulements qui ont secoué<br />
l’Algérie de la première moitié du XX e siècle. Toute une vie pleine<br />
d’enseignement, avec des rebondissements sidérants comme<br />
l’existence sait si bien échafauder en toute impunité. Ce roman,<br />
je ne l’ai pas seulement écrit, je l’ai subi. Je n’en<br />
étais pas simplement l’auteur, j’étais un acteur,<br />
un personnage parmi les autres dont je sentais<br />
la sueur, percevais le pouls et redoutais les<br />
colères. J’étais en immersion, en apnée, et il<br />
m’est arrivé plusieurs fois de refuser de remonter<br />
à l’air libre tellement je m’y sentais bien.<br />
Estimez-vous que ce lourd tribut payé<br />
comme s’ils avaient été les figurants de leur propre histoire.<br />
C’est cette injustice que Les Vertueux tente de réparer.<br />
Une partie du livre se déroule dans l’Oran des<br />
années 1920. En quoi cette ville vous inspire-t-elle ?<br />
Elle a quelque chose de magique. J’ignore quoi au juste, mais<br />
elle me troublera toujours autant qu’elle m’afflige par moments.<br />
J’y vis depuis soixante-cinq ans. Mon père y est né. Ma mère<br />
est venue au monde non loin d’Oran, du côté de Rio Salado (El<br />
Maleh aujourd’hui). C’est une cité où les paradoxes se rejoignent<br />
sans jamais se remettre en question. Ils sont là, se boudent, s’affrontent,<br />
se jettent la pierre sans pour autant alarmer la ville, qui<br />
paraît ne pas les « calculer » du tout. Oran n’a d’attention que pour<br />
elle-même. Elle est persuadée d’être le seul repère digne d’intérêt.<br />
Je l’ai chantée aux quatre coins de la planète sans qu’elle me<br />
gratifie d’un clin d’œil reconnaissant. Elle trouve évident qu’on la<br />
magnifie, que c’est la moindre des choses qu’on la célèbre. Camus<br />
l’avait appris à ses dépens. Jamais, au grand jamais, cette ville ne<br />
m’a regardé en face, ou regardé comme je la regarde.<br />
Quel est votre lien avec ses habitants ?<br />
Par endroits, en particulier dans le milieu « intello », je suscite<br />
plus d’hostilité que d’admiration. Cependant, paradoxalement,<br />
lorsque je me tourne vers le peuple, je ne vois que bienveillance,<br />
générosité, ambiance bon enfant, et une très belle camaraderie.<br />
Les Oranais font d’un éclat de rire une fête et d’un casse-croûte<br />
un festin. Rien ne semble en mesure de venir à bout de leur<br />
joie de vivre, en dépit des désillusions et du<br />
naufrage de la nation. C’est sans doute pour<br />
cela que je pardonne à la ville sa discourtoisie<br />
à mon encontre. Mais bon, souvent ceux qu’on<br />
aime ne nous le rendent pas. L’essentiel est<br />
d’aimer, qu’importe si la réciprocité ne suit pas.<br />
Un autre volet de votre intrigue<br />
s’implante à Kenadsa, où vous êtes né,<br />
par ces soldats n’est pas assez connu ?<br />
L’histoire ne retient que les héros qui l’arrangent.<br />
J’ai voulu parler de ces braves que<br />
l’on oublie, raconter leur destin, leur vaillance,<br />
leur ériger une stèle à travers mon texte. Ils<br />
se sont battus et ont triomphé. Pourtant, sur<br />
le vaste écran de la mémoire, ils font l’effet<br />
d’une illusion d’optique, pareils à des ombres<br />
chinoises vite absorbées par les angles morts<br />
du souvenir. Ils ont été sur tous les fronts, de<br />
la Crimée au Mexique, de la Grande Guerre à<br />
Les Vertueux, Mialet-Barrault,<br />
544 pages, 21 €.<br />
dans le Sahara. Que représente-t-elle<br />
pour vous ?<br />
Je suis le fils du désert. Chez nous, la<br />
force de toute chose réside dans sa simplicité.<br />
Nous ne savons pas tourner autour du pot, ni<br />
apostropher les autres sans nous assurer que<br />
nous ne sommes pas pires qu’eux. Dans la<br />
rigueur de notre droiture, quelqu’un qui perd<br />
la face perd le reste avec. Car il n’y a aucune<br />
raison, pour les mortels que nous sommes, de<br />
renoncer à la dignité pour glaner quelques<br />
celle contre les nazis. Leur nom est une légende : on les appelait<br />
les Turcos, les tirailleurs algériens. Leur sang a irrigué des terres<br />
inconnues, écrit des épopées aussitôt archivées et mises sous<br />
scellés ; leurs corps ont pavé les chemins de toutes les gloires<br />
sans que l’hommage leur soit rendu en entier. La paix d’hier<br />
leur doit beaucoup, mais qui l’admet ouvertement ? De temps à<br />
autre, on leur consacre deux ou trois mots, on les raconte sommairement<br />
comme s’ils avaient évolué dans un monde parallèle,<br />
misérables privilèges ou ne pas assumer nos faits et méfaits. Le<br />
salut, le vrai, est de se regarder dans une glace sans se détourner,<br />
de regarder derrière soi sans trop de regret, de marcher<br />
dans les pas du temps avec sérénité. J’ai hérité de mes ancêtres<br />
cette sagesse qui me permet de rester debout au cœur des turpitudes,<br />
en gardant le cap contre vents et marées. Si vous tenez à<br />
accéder à vous-même, allez dans le Sahara, cohabitez quelques<br />
jours avec les gens du désert, regardez-les vivre de peu et s’en-<br />
DR<br />
88 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
ichir de chaque instant, écoutez-les dire la vie, la douleur, les<br />
beautés de la nudité, la fausseté des vanités, et surtout ne dites<br />
rien. Contentez-vous d’écouter, d’engranger les émotions jusqu’à<br />
votre retour parmi le stress et le bruit, la carrière et les promotions,<br />
la compétitivité vampirisante et la quête névrotique du<br />
profit – vous mettrez alors un peu plus d’eau dans le vin des<br />
ivresses insidieuses, et vous aurez, peut-être, une chance de ne<br />
plus céder aux tentations. Tout d’un coup, le clinquant illusoire,<br />
le bling-bling, le balek-balek – la frime des pauvres zélés –, les<br />
lauriers, les tapis rouges, toute cette profusion d’attentions dérisoires<br />
vous livrera l’étendue de son obscénité. Kenadsa, plus que<br />
ma ville natale, est ma première école de la vie. Après vingt ans<br />
d’absence, j’y suis retourné avant la pandémie, et j’ai constaté<br />
qu’elle n’avait pas changé d’un iota. J’ai compris alors pourquoi<br />
l’authenticité est immuable. Je suis fier d’être venu au monde<br />
dans ce village séculaire qui a engendré de grands humanistes (à<br />
l’instar de Pierre Rabhi), mais aussi des poètes et des musiciens.<br />
C’est également la terre des Doui-Menia, une tribu<br />
comptant de grands guerriers qui ont combattu contre<br />
les colons. Vous êtes-vous inspiré de vos oncles, qui ont<br />
rejoint le chef Abdelkrim el-Khattabi durant l’insurrection<br />
contre les armées françaises et espagnoles dans le Rif ?<br />
Absolument. Après la défaite contre l’armée française à Asla,<br />
en 1903, au cours de laquelle 70 % de la population mâle des<br />
Doui-Menia et des Ouled Djerir furent décimés, les rescapés<br />
n’avaient pas déposé les armes. Certains devinrent brigands de<br />
grand chemin, d’autres furent déportés en Nouvelle- Calédonie,<br />
et d’autres encore guettaient la moindre protestation pour l’alimenter<br />
et relancer de nouvelles insurrections. Lorsque Abdelkrim<br />
el-Khattabi a soulevé le Rif contre la France et l’Espagne,<br />
beaucoup de guerriers de ma tribu l’ont rejoint avec armes et<br />
bagages. D’ailleurs, beaucoup y sont restés. Mon oncle, Abderrahmane<br />
Moulessehoul (de son nom de guerre Mohand Amokrane),<br />
a été très proche de lui et a longtemps combattu à ses côtés.<br />
Afin d’étendre la révolte jusque sur les terres algériennes, il a<br />
promis au chef el-Khattabi de soulever les spahis contre l’armée<br />
française, mais il a échoué et n’a plus relevé la tête ensuite. Il est<br />
mort en 1993, misérable, pauvre, aveugle et nu.<br />
C’était important de représenter une figure de guerrière ?<br />
Car ce combat était aussi mené par les femmes.<br />
Il n’y a pas que les guerrières. Les femmes, en Algérie, ont<br />
combattu sur tous les fronts et depuis toujours. Elles portent<br />
TOUT sur leurs épaules, mais les hommes regardent trop leur<br />
nombril pour le remarquer – et pour l’admettre. Je crois que l’un<br />
des torts que nous nous faisons stupidement est l’ingratitude faite<br />
à nos femmes. Et nous le payons très cher. Sans leur accorder la<br />
place qui leur revient au sein de notre société, nous ne pouvons<br />
prétendre à la nôtre dans le concert des nations. La fatuité des<br />
hommes est une camisole. Beaucoup de choses restent à faire<br />
pour dépolluer les mentalités et écarter les œillères. Lorsque je<br />
vois la science à deux doigts d’envoyer une sonde de l’autre côté<br />
du Système solaire tandis qu’ici, on continue de diaboliser les<br />
« L’histoire ne<br />
retient que les héros<br />
qui l’arrangent.<br />
J’ai voulu ériger une<br />
stèle à ces braves<br />
que l’on oublie, à<br />
travers mon texte. »<br />
femmes et de ramener la foi à une vulgaire question vestimentaire,<br />
j’ai envie de m’acheter une corde et de me pendre avec.<br />
Cependant, je suis convaincu que la dictature masculine n’est<br />
qu’une diversion qu’elles finiront par déjouer. Déjà, par endroits,<br />
le rapport de force traditionnel est en train de prendre l’eau.<br />
Les femmes ne supportent plus que le « p’tit gars » gras et ingrat<br />
qu’elles toilettent, nourrissent et soignent se prenne pour un seigneur,<br />
alors qu’il n’est qu’un fieffé assisté qui s’ignore. Une révolution<br />
est en marche, et rien ne semble en mesure de la dérouter.<br />
« Il en est des poètes comme des cierges. […] Ils brûlent<br />
et fondent en larmes pour que la lumière soit », dit<br />
le personnage du poète. Partagez-vous cette idée ?<br />
Et comment ! Ils ont une sensibilité urticante, une humanité<br />
à fleur de peau, parfois un amour sacrificiel. Le poète est l’âme,<br />
le pouls, la sève des survivances. Son verbe est une prophétie,<br />
son altruisme est un martyre. C’est lui qui sait mieux dire les<br />
choses, cerner l’indicible et aviver les esprits. Quand j’étais adolescent,<br />
je voulais être poète. Comme je n’avais pas suffisamment<br />
de magie, je me suis contenté de n’être qu’un romancier.<br />
Comment avez-vous cohabité avec les personnages<br />
des Vertueux ? Vous ont-ils appris quelque chose sur vous ?<br />
Dans mes romans, je suis avec les meilleurs compagnons du<br />
monde. Je m’enrichis de chaque rencontre, de chaque intrigue.<br />
J’aime tous mes personnages, les bons et les mauvais, je partage<br />
équitablement leurs joies et leurs peines, et il m’arrive d’applaudir<br />
certaines fulgurances de leur sagacité. J’ai vécu l’écriture<br />
des Vertueux comme un voyage initiatique, un retour éclairé<br />
dans le passé de mon pays, avec des escales qui reposent l’âme.<br />
Il y a dedans des réponses à beaucoup de préoccupations existentielles.<br />
Cette œuvre m’a guéri de beaucoup de malentendus.<br />
Jamais je ne m’étais autant senti en phase avec moi-même avant.<br />
Mon héros m’a éveillé à ce qui doit compter dans la vie, c’est-àdire<br />
la force de supplanter ce qui tente de nous détourner de ce<br />
qui est censé nous émerveiller, et la présence d’esprit qui nous<br />
aide à aimer la vie malgré tout. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 89
encontre<br />
Beata Umubyeyi Mairesse<br />
« J’ai trouvé<br />
ma place<br />
dans la littérature »<br />
Rescapée du génocide des Tutsis, la romancière franco-rwandaise<br />
manipule avec grâce la langue de Molière dans son nouveau<br />
très beau livre, et continue d’explorer la mémoire et l’histoire<br />
de son pays natal. propos recueillis par Sophie Rosemont<br />
Elle le précise dès l’ouverture : si les personnages<br />
de Consolée sont fictifs, l’institut<br />
pour enfants mulâtres de Save, au<br />
Rwanda, lui, a bien existé. Il s’agissait<br />
d’un pensionnat dirigé par les Sœurs<br />
blanches d’Afrique, qui vit passer<br />
des centaines d’enfants brutalement<br />
retirés à leur famille sur instruction<br />
de l’État colonial. Lors des indépendances,<br />
ils seront envoyés en Belgique pour être adoptés… ou<br />
pas. Cette sombre histoire est aussi celle de Consolée, l’héroïne<br />
de ce superbe roman de Beata Umubyeyi Mairesse, dont l’on a<br />
bien du mal à se séparer à la dernière page.<br />
<strong>AM</strong> : Comment est né ce roman, à la fois<br />
transcontinental et transgénérationnel ?<br />
Beata Umubyeyi Mairesse : J’ai eu connaissance, très récemment,<br />
de l’institut pour enfants mulâtres, à Save. Les anciens<br />
pensionnaires s’étaient constitués en association et allaient<br />
porter leur histoire devant le parlement belge. Les médias ont<br />
commencé à en parler, et j’ai compris que cet endroit était situé<br />
à seulement quelques kilomètres de Butare, la ville où je suis<br />
née. Je suis moi-même métisse, donc cette histoire oubliée m’a<br />
particulièrement touchée. Étant jusqu’à présent dans le champ<br />
de la fiction, j’ai eu envie de raconter un bout de cet événement<br />
historique – comme je le fais depuis mes débuts, en passant par<br />
un destin individuel, l’intime d’un destin.<br />
90 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
CÉLINE NIESZAWER/FL<strong>AM</strong>MARION<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 91
RENCONTRE<br />
Deux personnalités se croisent ici : l’aïeule Astrida,<br />
née Consolée, et la quinquagénaire Ramata,<br />
dont c’est la première mission en établissement<br />
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes<br />
(EHPAD). Où avez-vous puisé votre inspiration ?<br />
Dans mon dernier travail. Pendant trois ans, j’ai coordonné<br />
un projet de prévention au suicide, notamment celui des personnes<br />
âgées qui est très important en France. Parallèlement<br />
à la découverte de cette histoire de l’institut de Save, un ami<br />
travaillant en EHPAD m’a raconté que beaucoup de personnes<br />
d’origine espagnole ne s’exprimaient plus en français et qu’on<br />
devait s’adresser à eux dans la langue de leur enfance. J’ai alors<br />
pris conscience de cette réalité : ceux qui ont dû apprendre la<br />
langue de leur pays d’adoption, une fois atteints de maladies<br />
neurodégénératives, oublient la langue avec laquelle ils ont<br />
pu vivre pendant des décennies. C’est à<br />
la fois incroyable et effrayant. Ainsi, j’ai<br />
entrelacé ces deux informations pour en<br />
faire un roman.<br />
Un livre qui n’en omet pas moins<br />
un certain engagement sociétal…<br />
Cette réalité est générationnelle, sociétale<br />
et interroge au-delà de l’individu. À<br />
quoi ressemble la fin de vie des migrants,<br />
du point de vue des familles mais aussi<br />
des professionnels ? Car on pense qu’ils<br />
arrivent dans leur nouveau pays lorsqu’ils<br />
sont petits ou encore très jeunes, pour<br />
travailler. C’est comme si l’on ne pouvait<br />
pas les imaginer âgés. Ceux que l’on voit<br />
prendre de l’âge sont issus des migrations<br />
européennes, que l’on ne considère plus<br />
comme des immigrés, contrairement à<br />
ceux venus d’Afrique du Nord ou subsaharienne.<br />
Eux, en raison de leur couleur de<br />
peau, on ne les voit ni vieillir, ni mourir.<br />
Consolée, Autrement, 376 pages, 21 €.<br />
Et très peu retournent au pays.<br />
Vous avez choisi d’alterner les récits<br />
d’enfance et de maturité pour donner plus de corps à<br />
cette réflexion, au-delà même du prisme romanesque ?<br />
On juge une société à l’aune dont elle traite les deux âges<br />
de la vie. Le Rwanda des années 1940-1950 gardait ses anciens<br />
au cœur de la famille, alors qu’Astrida-Consolée, au XXI e siècle,<br />
devient complètement effacée en EHPAD. Effacée comme on<br />
fait disparaître des enfants sous la colonisation.<br />
Dans votre corpus, il y a un intérêt tout particulier<br />
porté aux prénoms et aux noms…<br />
Comment se libérer ou apprivoiser l’identité assignée – ou<br />
en choisir une nouvelle – pour pouvoir trouver une certaine<br />
paix ? L’ancien nom de Butare est Astrida, et j’ai grandi en<br />
voyant sur le mur de la cathédrale une plaque indiquant qu’elle<br />
était dédiée à la mémoire de la reine Astrid de Belgique – un<br />
stigmate de l’emprise coloniale. C’est en filigrane, derrière la<br />
famille adoptive. Consolée est un prénom rwandais, comme<br />
beaucoup d’autres, très parlant. Et à cet institut de Save, on a<br />
rebaptisé certains enfants… C’est ce qui se passe souvent dans<br />
le processus de l’adoption. Or, dans la culture rwandaise, le<br />
nom que l’on donne possède une vraie signification, il porte<br />
une histoire. Il y a une scène à ce propos dans Tous tes enfants<br />
dispersés : il est ce que l’on attend de nous, ce que l’on souhaite<br />
pour nous, dans quelles conditions on est né…<br />
Que signifie Umubyeyi ?<br />
Littéralement, il veut dire « parent », mais on ne le donne<br />
qu’aux filles et signifie « celle qui est une bonne mère » ou « qui<br />
a une bonne mère ». C’est plutôt positif !<br />
Revenons à Butare, centre névralgique<br />
de vos livres. Quel est votre rapport<br />
à votre ville natale, que vous avez été<br />
contrainte de fuir lors du génocide<br />
perpétré contre les Tutsis ?<br />
J’y suis allée en mars dernier, il n’y<br />
avait plus grand monde que je connaissais,<br />
mais cela a été le cas dès le lendemain du<br />
génocide. Elle ne fait plus figure de grand<br />
centre intellectuel. J’y suis viscéralement<br />
attachée et j’ai, comme tous les exilés<br />
sans doute, la nostalgie d’une époque qui<br />
n’existe plus. C’est Butare qui m’a initiée à<br />
la lecture. Elle avait un accès à la culture<br />
important par rapport au reste du pays :<br />
une bibliothèque, une librairie, un centre<br />
culturel français… Je ne serais pas devenue<br />
écrivaine sans avoir eu cet accès aux livres.<br />
Astrida-Consolée est métisse,<br />
comme vous. « Blanche en Afrique,<br />
noire en Europe », écrivez-vous<br />
dans la préface d’Ejo. Comment<br />
avez-vous vécu cette dualité ?<br />
Quand on est plus jeune, ce sont des questions identitaires<br />
qui peuvent être douloureuses… mais que j’ai apprivoisées.<br />
J’ai finalement trouvé ma place dans la littérature. Cependant,<br />
c’est aussi cette expérience qui a fait de moi une écrivaine, cet<br />
état constant entre deux mondes dont j’ouvre les portes pour le<br />
raconter aux uns et aux autres. Je peux passer entre mes deux<br />
langues, même si le français est celle avec laquelle j’ai appris à<br />
lire et à écrire, et que je la maîtrise plus que le kinyarwanda. Je<br />
suis une transfuge de classe, et de race également, du monde<br />
noir au monde blanc, apprenant les codes ici et là, à habiter le<br />
plus harmonieusement possible la frontière…<br />
D’après vous, la littérature est-elle un pays ?<br />
Oui, c’est un endroit que j’habite. Ce sont des racines<br />
aériennes, on peut l’emmener où que l’on aille.<br />
DR<br />
92 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
La musicalité de votre écriture résonne<br />
plus encore dans Consolée…<br />
Quand j’ai terminé Tous tes enfants dispersés, j’avais l’impression<br />
d’avoir traité des sentiments, mais pas des sensations,<br />
alors que je pense que c’est cela qui reste le plus : le toucher,<br />
l’odorat, la vue… Lorsqu’on fait métier de la langue, on l’interroge.<br />
J’écris en français, mais à la rwandaise : il n’y a pas<br />
besoin de tout dire !<br />
Vous variez les formats : roman, nouvelle, poésie…<br />
D’où vient cette quête d’hybridité ?<br />
Je n’avais pas prévu de devenir autrice… J’ai commencé à<br />
écrire à 30 ans passés ! Depuis toujours, la forme s’adapte au<br />
fond en fonction de ce que je souhaite raconter. Mes premiers<br />
textes parlaient beaucoup plus du génocide, et je voulais me<br />
rapprocher de près du conte traditionnel rwandais. Il fallait<br />
que ce soit court, sans se concentrer sur une seule et unique<br />
intrigue, mais une mosaïque. D’où le choix des nouvelles, réunies<br />
dans le recueil Ejo. L’amplitude de l’intrigue et des personnages,<br />
elle, exige le cadre romanesque. Et en poésie, je peux<br />
parler de l’intime…<br />
Vous êtes l’une des rares écrivaines à traiter de ce<br />
génocide à travers le roman. Quel est votre regard sur<br />
les récits couvrant ce sujet, qui sont loin d’être légion ?<br />
Je ne suis pas la première à avoir parlé du génocide rwandais<br />
à travers le prisme fictionnel : avant moi, il y a eu La Chanson<br />
de l’aube, de Vénuste Kayimahe. Et j’espère que l’on sera<br />
de plus en plus nombreux à écrire sur le sujet… Scholastique<br />
Mukasonga – que j’admire – est la première Rwandaise lue et<br />
connue, mais elle a quitté le pays en 1973. Petit pays, de Gaël<br />
Faye, évoque surtout le Burundi. Dominique Celis, qui est une<br />
amie, parle du Rwanda après le génocide dans Ainsi pleurent nos<br />
hommes (qui paraît ces jours-ci). Du côté de la non- fiction, il y a<br />
eu beaucoup de témoignages, le travail crucial effectué par les<br />
historiens Jean-Pierre Chrétien et Hélène Dumas. Dans Le Génocide<br />
au village, celle-ci raconte la topographie de ces crimes.<br />
Les tueurs non seulement assassinaient, mais détruisaient les<br />
maisons brique par brique, pour ne laisser que les buissons et<br />
les arbres. Pour son dernier ouvrage, Sans ciel ni terre, elle a<br />
retrouvé des cahiers d’enfants orphelins du génocide…<br />
Les arbres sont souvent convoqués dans<br />
votre œuvre… Souvenirs de votre enfance ?<br />
Les arbres sont témoins des époques, du pire comme du<br />
meilleur. Et en effet, je puise dans les images du Rwanda où j’ai<br />
vécu jusqu’à mes 15 ans. Ce paysage est inoubliable ! Étonnamment,<br />
il ne change pas. Les collines et la verdure sont toujours<br />
là. En revanche, les jacarandas de Butare, dont j’imaginais dans<br />
Tous tes enfants dispersés qu’ils allaient être coupés à la suite<br />
d’une maladie, l’ont effectivement été quelques mois après sa<br />
parution. Ils ont été remplacés par des palmiers…<br />
Qu’est-ce qui a initié votre désir d’écrire ?<br />
J’ai écrit mes premières nouvelles car, comme l’a dit Toni<br />
Morrison, je ne trouvais pas ce que je voulais lire dans la<br />
« Je suis<br />
une transfuge<br />
de classe, et<br />
de race également,<br />
du monde noir<br />
au monde blanc,<br />
apprenant les codes<br />
ici et là, à habiter<br />
le plus possible<br />
la frontière… »<br />
littérature : le récit du quotidien en tant que survivant. Il a fallu<br />
me sentir légitime : d’après l’inconscient collectif patriarcal, les<br />
hommes sont des écrivains, et les femmes écrivent ! Ainsi, il m’a<br />
toujours semblé évident de m’engager dans le combat féministe,<br />
car nous sommes souvent broyées par la domination politique<br />
et la société viriliste.<br />
D’où l’importance que vous donnez,<br />
dans tous vos livres, aux figures féminines ?<br />
Absolument, je tiens à leur apporter toute la lumière qu’elles<br />
méritent. Et les personnages masculins sont en seconde ligne ! Il<br />
s’agit de ce qu’elles font ou ne parviennent pas à faire, et ce au<br />
sein de toutes les générations. Dans Consolée, la fille de Ramata,<br />
Inès, fait partie de ces très jeunes femmes d’aujourd’hui qui<br />
ignorent les combats d’antan et qui regardent du côté des afroféministes<br />
américaines. En oubliant parfois que leurs mères,<br />
leurs grands-mères se sont également battues, même si elles<br />
n’ont pas toujours pu percer le plafond de verre.<br />
Si vous deviez choisir quelques-unes<br />
des nombreuses femmes de lettres qui ont compté<br />
pour vous, de qui s’agirait-il ?<br />
L’histoire du Rwanda a été créée par une femme, Nyirarumaga,<br />
qui a mis en place et codifié le groupe des poètes, surtout<br />
des hommes, qui (se) transmettaient l’histoire des souverains<br />
du pays. Elle fait partie de mes grandes figures tutélaires littéraires,<br />
aux côtés d’Audre Lorde ou de Nadine Gordimer, la<br />
seule Sud-Africaine à avoir eu le prix Nobel de littérature, et<br />
une femme blanche activiste contre l’apartheid. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 93
PORTFOLIO<br />
VISA POUR L’IMAGE 2022<br />
La force de l’objectif<br />
présenté par Catherine Faye<br />
L’Ukraine, aujourd’hui,<br />
est évidemment dans l’esprit de tous.<br />
Mais la profession réunie à Perpignan<br />
pour ce 34 e festival international du<br />
photojournalisme révèle d’autres clichés<br />
de notre monde tout aussi éloquents :<br />
de l’interminable guerre afghane<br />
à la situation alarmante des femmes<br />
dans les prisons d’Amérique latine,<br />
en passant par l’impact de la pêche<br />
industrielle ou encore la souffrance<br />
psychique en Afrique… 25 expositions<br />
sont au programme. Elles mettent à<br />
l’honneur celles et ceux qui s’engagent,<br />
souvent au péril de leur vie, pour les<br />
droits humains et la liberté d’informer.<br />
Visa pour l’image n’est pas uniquement<br />
consacré au reportage de guerre.<br />
L’intention est de montrer ce que nous<br />
vivons, la brutalité et le désordre de<br />
notre époque. Et de rappeler combien<br />
le photojournalisme est essentiel pour<br />
le droit à une information exigeante<br />
et pour le débat démocratique. ■<br />
VISA POUR L’IMAGE, Perpignan (France),<br />
du 27 août au 11 septembre. visapourlimage.com<br />
94 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Mstyslav Chernov<br />
(Associated Press)<br />
Marioupol, Ukraine<br />
Pendant les bombardements,<br />
les habitants s’abritent<br />
dans la cave, le 12 mars 2022.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 95
PORTFOLIO<br />
96 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
George Steinmetz<br />
Pêches mondiales<br />
Inhambane, Mozambique.<br />
À marée basse, les hommes unissent<br />
leurs efforts pour pêcher dans les eaux<br />
peu profondes entre les îles de Benguerra<br />
et Bazaruto. Cette surexploitation<br />
dure depuis des décennies.<br />
Valerio Bispuri<br />
Dans les chambres de l’esprit<br />
Une femme venant d’avoir une crise. Centre d’accueil<br />
psychiatrique de Tokan, Bénin, 2021.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 97
PORTFOLIO<br />
Ana María<br />
Arévalo Gosen<br />
(Lauréate du prix<br />
Camille Lepage 2021)<br />
Días Eternos :<br />
Venezuela,<br />
Salvador,<br />
Guatemala<br />
(2017-2022)<br />
Au centre<br />
de détention<br />
de La Yaguara,<br />
les femmes passent<br />
leurs journées<br />
dans l’inactivité<br />
la plus totale.<br />
Caracas, Venezuela,<br />
mars 2018.<br />
Andrew Quilty (Agence VU’) La Fin d’une guerre interminable<br />
Depuis que les talibans ont repris le pouvoir, il n’y a plus d’aide financière internationale,<br />
et les résidents de la capitale afghane se retrouvent confrontés à la misère. Le long de la route,<br />
ils sont nombreux à vendre des objets de chez eux. Kaboul, octobre 2021.<br />
98 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Paolo<br />
Woods<br />
et Arnaud<br />
Robert<br />
Happy Pills<br />
Pendant cinq<br />
ans, les deux<br />
photographes<br />
ont parcouru<br />
le monde à<br />
la recherche<br />
de ces « pilules<br />
du bonheur »,<br />
qui nous<br />
permettent<br />
de « tenir ». Ici,<br />
les marchands<br />
ambulants dans<br />
les rues d’Haïti,<br />
qui vendent<br />
à la pièce<br />
un mélange<br />
de pilules<br />
fabriquées<br />
en Chine, de<br />
contrefaçons<br />
conçues en<br />
République<br />
dominicaine et<br />
de médicaments<br />
périmés<br />
abandonnés<br />
par les ONG.<br />
Haïti, 2016.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 99
évasion<br />
LA TUNISIE AU<br />
Renommée pour ses plages, la Tunisie a centré,<br />
pendant des décennies, son tourisme sur<br />
l’offre balnéaire, en tentant d’y adjoindre<br />
quelques circuits culturels axés sur les sites<br />
archéologiques et l’artisanat local. Mais<br />
depuis la révolution de 2011, la tendance est<br />
d’aller à la rencontre d’une Tunisie profonde,<br />
qui constitue un véritable creuset méditerranéen. Encore méconnues,<br />
les îles qui ponctuent les 1200 kilomètres de côtes du pays<br />
demeurent un territoire où la nature est généreuse et sauvage, et<br />
où la singularité des communautés est préservée. Éclaboussées<br />
de lumière, vêtues de maquis qui plongent dans des camaïeux<br />
de bleus hypnotiques, les îles tunisiennes sont des lieux encore<br />
confidentiels et pour la plupart protégés, que ce soit en tant que<br />
zones naturelles ou par les coutumes et l’identité insulaires.<br />
Elles contraignent le visiteur à laisser ses habitudes citadines<br />
derrière lui et à s’immerger dans un moment hors du temps.<br />
Cette incursion dans l’un de ces ultimes paradis terrestres,<br />
où les conditions de vie sont souvent rudes et les équilibres<br />
écologiques fragiles, provoque parfois une certaine nostalgie<br />
pour un passé pas si lointain où la Méditerranée était un havre<br />
préservé du développement des métropoles.<br />
Zembra<br />
LA PÊCHE<br />
ET LES FAUCONS<br />
■<br />
ROCHER IMPOSANT où le maquis embaume, souvent<br />
caché du continent par de mystérieuses volutes d’embruns,<br />
Zembra, avec son satellite Zembretta, veille sur le golfe<br />
de Tunis. Reconnu réserve de biosphère par l’Unesco, ce parc<br />
national est classé aire spécialement protégée d’importance<br />
méditerranéenne. Les falaises qui plongent à pic dans la mer ont<br />
été témoins de la matanza, pêche au thon traditionnelle qui réunissait<br />
sous la conduite d’un raïs des équipages venus de Sicile et<br />
des marins du cap Bon. Une corrida marine qui a épuisé les ressources<br />
en thon rouge, poisson si apprécié des Japonais. Jamour,<br />
comme l’appellent les locaux, est un refuge de faucons pèlerins.<br />
Les randonnées (d’une journée) sont donc soumises à autorisation.<br />
L’île est également le paradis des plongeurs, pour ses abysses<br />
limpides entre les rochers de l’Antorcho et de la Cathédrale,<br />
ceux de la grotte aux Pigeons ou au large de la Maison du poète.<br />
100 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
GRÉ DES ÎLES<br />
Elles sont là, à quelques encablures du continent,<br />
souvent méconnues, réserves naturelles menacées<br />
et témoignages de l’histoire. par Frida Dahmani<br />
NICOLAS FAUQUÉ/WWW.IMAGESDETUNISIE.COM<br />
À l’entrée du golfe de Tunis,<br />
une réserve de biosphère<br />
accueille plongeurs et<br />
randonneurs… à la journée<br />
et sur autorisation.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 101
ÉVASION<br />
Djerba<br />
AU TEMPS SUSPENDU<br />
■<br />
LE PÈLERINAGE DE LA GHRIBA attire chaque année<br />
en mai des milliers de visiteurs juifs à Djerba, mais l’île,<br />
connue pour son tourisme de masse, est aussi un phalanstère<br />
aux multiples visages. Paradisiaque par certains aspects et au<br />
croisement des influences en Méditerranée, elle est imprégnée<br />
d’une apaisante spiritualité. L’église orthodoxe, le quartier juif<br />
de la Hara, l’église catholique de Houmt Souk ainsi que les<br />
humbles mosquées ibadites magnifient l’ombre et la lumière.<br />
Le charme de l’île opère dès l’arrimage du bac qui la relie au<br />
continent. Sur le quai, l’activité livre un aperçu de ses échanges<br />
commerciaux : huile, éponge, produits de la pêche sont des fondamentaux<br />
historiques, auxquels s’ajoutent les flux de touristes.<br />
L’île a du succès et sa population est entreprenante, mais une<br />
absence de volonté politique l’empêche de se déployer et d’avoir<br />
une autonomie au moins administrative. Tout se joue à Médenine,<br />
chef-lieu du gouvernorat à environ 75 kilomètres de là sur<br />
le continent. Un handicap au développement de l’île, qui n’est<br />
reliée à la terre que par une antique chaussée romaine. Alors<br />
que le projet de construction d’un pont semble une chimère<br />
bien compliquée, Djerba compte sur elle-même et sur la solidarité<br />
des siens. De nombreux chefs d’entreprise, originaires de<br />
l’île, ont contribué à sa préservation et à l’essor du tourisme de<br />
sa côte est. Au nord, le littoral sauvage témoigne de l’époque<br />
tourmentée des barbaresques, qui se livraient à la course au<br />
XVI e siècle. Ils avaient trouvé à Djerba un refuge et une halte<br />
fiable ; le fortin de Houmt Souk, mitoyen du théâtre où se déroulera<br />
le sommet de la Francophonie en novembre 2022, se souvient<br />
de cette époque mouvementée. La Tour des crânes, amas<br />
de têtes prélevées sur l’ennemi, installée devant la place forte,<br />
a aujourd’hui disparu mais continue à faire vibrer les imaginaires.<br />
L’île est plutôt le lieu des légendes extraordinaires, et<br />
une étape du fabuleux voyage d’Ulysse : sous les frondaisons des<br />
palmiers, les émissaires de son équipage ont succombé au lotos,<br />
fruit mythique que les insulaires identifient comme le nbeg,<br />
une baie sphérique semblable à l’olive, largement répandu sur<br />
l’île. Dignes de la mythologie, les saveurs djerbiennes sont bien<br />
réelles et constituent un récit gastronomique de la sociologie de<br />
l’île. Notons par exemple les bricks servies, dès le coucher du<br />
soleil, dans les petites échoppes de l’entrée du quartier juif de<br />
Hara El Kbira, véritable rituel gourmand, le fameux couscous au<br />
poisson, lequel est acheté à la criée au marché de Houmt Souk,<br />
ou encore la chakchouka, savoureuse ratatouille de citrouille et<br />
de fèves qui se déguste avec l’incontournable pain local, la kesra.<br />
Un plat du pauvre aux saveurs royales. Des goûts qui remontent<br />
102 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
NICOLAS FAUQUÉ/WWW.IMAGESDETUNISIE.COM<br />
La mosquée de Sidi Jmour,<br />
sur la côte ouest de l’île.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 103
ÉVASION<br />
loin, parfois aux lointaines origines berbères des habitants ; en<br />
témoignent les consonances des noms de villages perdus entre<br />
les chemins de sable, comme Tlet ou Tianest. Au cœur de cet<br />
espace authentique, on croise des femmes, drapées d’un voile<br />
clair à l’antique, qui s’abritent du soleil et des regards derrière<br />
des chapeaux de paille pointus, tandis que les hommes, actifs<br />
dans tous types de commerces, portent le traditionnel vêtement<br />
gris. Djerba n’est pas hors du temps, elle sauvegarde son<br />
authenticité. La société civile a d’ailleurs fait de la préservation<br />
des communautés et des droits des minorités, dont la communauté<br />
noire, un objectif pour lutter contre la marginalisation.<br />
À l’ombre d’oliveraies millénaires, les poteries de Guellala sont<br />
identiques à celles qui étaient produites du temps d’Homère,<br />
avec les mêmes gestes et selon les mêmes procédés. L’artisanat<br />
ici est utilitaire et axé sur une production écoresponsable. Il<br />
en va ainsi de l’huile produite à l’ancienne dans des huileries<br />
enfouies dans la terre sableuse, à l’abri des regards et de la chaleur.<br />
L’île, où le temps semble suspendu, est source d’inspiration<br />
et d’expressions les plus inattendues. Depuis 2015, les artistes de<br />
rue s’approprient des pans de murs pour déployer des fresques<br />
qui font du village d’Erriadh une incroyable galerie d’art à ciel<br />
ouvert. La mer, divertissement des touristes, vivier à poissons<br />
de l’île, est aussi un lieu de magie quand les oiseaux, selon la<br />
migration, organisent un ballet autour de l’île des Flamants<br />
roses, une langue de sable qui flotte sur des eaux turquoise<br />
où certains jurent avoir vu des mirages. Les changements climatiques,<br />
qui affectent l’île et rognent le littoral, poussent à<br />
préserver les ressources en eau mais lui permettent également<br />
d’exporter des crocodiles, qui sont nés et ont grandi dans le parc<br />
de Djerba Explore. Le pouvoir magique de l’île semble avoir mis<br />
les tropiques au cœur de la Méditerranée, mais cela n’ôte rien<br />
au charme ni au mystère de cette terre riante et discrète, à la<br />
fois laborieuse, pugnace et douce. À la synagogue<br />
de la Ghriba,<br />
en mai 2022, lors<br />
du pèlerinage annuel.<br />
La Galite<br />
PRESQUE AU BOUT<br />
DU MONDE<br />
■<br />
ACCESSIBLE DEPUIS TABARKA, cette île se mérite : y<br />
séjourner ne laisse pas de place à l’improvisation puisque<br />
l’archipel de la Galite, composé de l’île principale, du Galiton,<br />
de la Fauchelle et des îlots des Chiens, est coupé du continent.<br />
Y passer une nuit ou plus relève de l’expérience initiatique<br />
durant laquelle, au contact d’une nature préservée, renaissent<br />
des réflexes anciens. Cette île, où Bourguiba a été exilé<br />
entre 1952 et 1954, a été un territoire convoité par différents<br />
ONS ABID - SHUTTERSTOCK<br />
104 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
envahisseurs de la Tunisie, mais aussi occupé par les Phéniciens<br />
et les Romains, qui cinglaient vers le bassin occidental de la<br />
Méditerranée. Aborder à la Galite suspend le temps : l’archipel,<br />
figé dans une sorte d’éternité, semble avoir été créé par<br />
un dieu antique qui, en façonnant la Sardaigne, aurait laissé<br />
échapper des bouts de terre qui seraient cette poignée d’îles,<br />
les plus septentrionales de l’Afrique. Occupé par des pêcheurs<br />
italiens et des représentants de l’autorité coloniale jusqu’à l’indépendance,<br />
puis déserté, l’archipel est devenu le territoire des<br />
dauphins et des phoques moines. Entre coraux et mérous, ses<br />
eaux ont souvent été généreuses, mais les pêches miraculeuses<br />
se font rares aujourd’hui, et le corail, objet de convoitise, est<br />
strictement contrôlé. Véritable herbier odorant sous une voûte<br />
étoilée d’une pureté devenue rare, la Galite, où règne le silence,<br />
est simplement envoûtante et intemporelle.<br />
Comme ce timbre le représente, Bourguiba<br />
y a été interné, dans un isolement complet,<br />
du 21 mai 1952 au 22 mai 1954.<br />
CAPTURE D’ÉCRAN<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 105
ÉVASION<br />
Le port d’El Ataya, sur Chergui.<br />
Ici, on n’abuse pas de la pêche<br />
et on respecte la reproduction<br />
des espèces.<br />
Kerkennah UN EDEN EN DANGER<br />
■<br />
À UNE HEURE DU CONTINENT, l’archipel des Kerkennah,<br />
que les flots grignotent au fil des marées au risque de<br />
le faire disparaître, dessine une ligne à fleur d’eau au large de<br />
Sfax (centre-est) : les habitants, descendants de bagnards, corsaires<br />
et renégats, semblent avoir inspiré le fameux « Homme<br />
libre, toujours tu chériras la mer », de Charles Baudelaire. Ici, les<br />
palmiers résistent au vent qui les décoiffe, les oliviers s’agrippent<br />
à un sol de plus en plus salin, et les hommes s’accrochent aussi.<br />
Confrontés à un milieu naturel souvent difficile, voire hostile,<br />
ils ont édifié sur fond d’autarcie une société solidaire, sans distinction<br />
entre hommes et femmes. La parité, acquise, permet<br />
à ces dernières d’être marins-pêcheuses, tandis que la mer est<br />
considérée comme une terre et un bien. On peut ainsi être propriétaire<br />
d’un lopin de mer pour pêcher à la charfia, un procédé<br />
aussi ingénieux que durable inscrit au patrimoine de l’Unesco<br />
depuis 2021 : le poisson est conduit via un dédale de palmes<br />
fichées dans le fond marin jusqu’à une nasse, où il suffira au<br />
pêcheur de le prélever, vivant, au gré de ses besoins. Ici, on ne<br />
pêche pas, on cueille les fruits de la mer, on n’en abuse pas et<br />
on respecte la reproduction des espèces. Ces particularités sont<br />
des règles de survie ; à l’écart du continent et des décisions, les<br />
Kerkennah souffrent d’une absence d’infrastructures et de développement<br />
ainsi que d’un stress hydrique dû à la sécheresse.<br />
L’archipel attire près de 40000 visiteurs, surtout tunisiens, en<br />
haute saison, mais aucun projet de tourisme écologique n’y a vu<br />
le jour. Les aléas de la pêche ont fait que les ateliers ont fermé,<br />
faute de rentabilité. Comment les pêcheurs en felouque pourraient-ils<br />
rivaliser avec les chalutiers du continent qui détruisent<br />
les fonds marins ? Les insulaires peinent à préserver leur écosystème<br />
: depuis quelques années, des vases en plastique font<br />
concurrence aux poteries utilisées depuis l’Antiquité pour une<br />
pêche au poulpe respectueuse de l’environnement. Difficile de<br />
résister pourtant aux Kerkennah, berceau du mouvement syndicaliste<br />
tunisien : fortes têtes au caractère rugueux, tous y sont<br />
des militants nés, à la fois patriotes, engagés et vigies politiques.<br />
Ce récit est retracé au musée d’El Abassia, entièrement réalisé<br />
par une enfant du pays, que l’on peut découvrir à bicyclette,<br />
comme tant d’autres coins et recoins de l’île où la mer n’est<br />
jamais loin. Une occasion pour rencontrer des artisanes dont les<br />
broderies sont imprégnées de l’ancestrale influence berbère ou<br />
pour assister à la traditionnelle cueillette des olives, en saison.<br />
Après la découverte de la côte sauvage, le long des salins, les<br />
parties de pêche et de plongée au large de Kraten ou des vestiges<br />
sous-marins aux pieds du Borj Elhsar, assister au départ<br />
des pêcheurs qui vont poser leurs filets, au crépuscule, depuis<br />
la terrasse de l’hôtel Cercina, est un rituel incontournable. Il<br />
rappelle que malgré toutes les promesses, les autorités n’ont<br />
pas investi sur l’archipel dans le tourisme durable et que la<br />
recherche d’emploi pousse les jeunes vers le grand large et une<br />
migration irrégulière au sort incertain.<br />
NICOLAS FAUQUÉ/WWW.IMAGESDETUNISIE.COM<br />
106 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
Kuriat<br />
POUR QUELQUES<br />
HEURES<br />
■<br />
EAUX TURQUOISE et bancs de sable blanc : on dirait<br />
les tropiques. Mais les deux îlots de l’archipel des Kuriat<br />
affleurent au large de Monastir (centre-est). Ces minuscules<br />
langues de terre sont l’ultime refuge d’une faune préservée<br />
des nuisances produites par l’homme. Ce point d’étape dans la<br />
migration saisonnière des oiseaux est le royaume incontesté des<br />
tortues caouannes, qui se reproduisent dans ses sables immaculés.<br />
Ce petit territoire où l’on retrouve des traces d’occupation<br />
humaine remontant au Néolithique est aujourd’hui un espace<br />
qui protège la biodiversité et maintient les équilibres que le<br />
changement climatique et la pollution bouleversent, notamment<br />
celle des déchets de plastique. On ne peut séjourner sur<br />
les îles, mais on peut être autorisé à y passer quelques heures, de<br />
mai à octobre. Les Robinsons modernes vivront une expérience<br />
unique ; les bénévoles de l’ONG Notre Grand Bleu, en collaboration<br />
avec l’Agence de protection du littoral, les sensibiliseront à<br />
cet écosystème et aux moyens de le préserver. ■<br />
NICOLAS FAUQUÉ/WWW.IMAGESDETUNISIE.COM<br />
Pour préserver la faune<br />
qui se réfugie sur ces<br />
minuscules langues de terre,<br />
la présence humaine<br />
y est rigoureusement régulée.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 107
BUSINESS<br />
Interview<br />
Nicolas<br />
Bricas<br />
Le streaming<br />
s’impose<br />
en Afrique<br />
Monaco<br />
s’intéresse de plus<br />
en plus à son sud<br />
Alimentation :<br />
le grand désordre<br />
mondial<br />
Le Covid-19, puis la guerre en Ukraine ont exacerbé les déséquilibres<br />
structurels d’un secteur agricole incapable de nourrir correctement<br />
la planète, alors même que la production est encore supérieure aux besoins.<br />
La faim et l’obésité progressent, tandis que la biodiversité s’effondre !<br />
Des solutions existent et il est urgent d’agir. Explications.<br />
par Cédric Gouverneur<br />
C’était dans le « monde d’hier », celui<br />
d’avant la pandémie et la guerre en<br />
Ukraine : en 2015, la communauté<br />
internationale s’engageait à « éradiquer<br />
la faim dans le monde en 2030 », soit en quinze ans.<br />
Or, non seulement la faim n’a pas reculé, mais elle<br />
a progressé ! Selon le rapport sur l’état de la sécurité<br />
alimentaire et de la nutrition, publié en juillet par<br />
cinq agences onusiennes, 9,8 % des êtres humains<br />
(environ 800 millions) sont sous-alimentés, contre<br />
8 % en 2019. C’est 150 millions de personnes de plus<br />
en deux ans ! À noter que le continent africain est<br />
le plus affecté : 20 % de la population est concernée<br />
(deux fois plus qu’en Asie et en Amérique latine).<br />
Les coupables ont vite été désignés : la pandémie<br />
de Covid-19 qui, à partir de mars 2020, a empêché<br />
pendant des mois producteurs et consommateurs<br />
de se rencontrer, du fait des confinements,<br />
et perturbé les chaînes logistiques, notamment<br />
entre l’Afrique et l’Asie. Puis, alors que le monde<br />
émergeait à peine de ce choc sanitaire, la Russie<br />
qui a envahi l’Ukraine : la guerre entre les deux<br />
principaux greniers à blé de la planète paralyse<br />
leurs exportations de blé et d’huile de tournesol,<br />
bases de l’alimentation dans de nombreux pays.<br />
Sauf que ces deux chocs ne sont pas les seuls<br />
responsables de la situation. Ces événements ont<br />
en fait amplifié une crise préexistante, due aux<br />
dysfonctionnements du système agricole industriel.<br />
Un chiffre le démontre : selon l’Organisation des<br />
Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation<br />
(FAO), la production agricole mondiale excède<br />
108 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SHUTTERSTOCK<br />
Selon l’ONU, même sur une planète<br />
désormais peuplée de 8 milliards d’individus,<br />
tous devraient pouvoir se nourrir…<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 109
BUSINESS<br />
de 30 % les besoins calorifiques<br />
de l’humanité ! Même sur une planète<br />
désormais peuplée de 8 milliards<br />
d’individus, il y a à manger pour<br />
tous… Chercheur et socio-économiste<br />
de l’alimentation, Nicolas Bricas<br />
[voir son interview pages suivantes]<br />
dénonce un système injuste. Ainsi<br />
en est-il des subventions publiques<br />
à l’agriculture qui inondent l’Afrique<br />
de produits européens ou chinois à<br />
bas coût, aux dépens des agriculteurs<br />
du continent – les Kenyans ont ainsi<br />
découvert avec consternation que<br />
les frites des KFC installés dans leur<br />
pays étaient importées de Chine…<br />
En outre, ces aides favorisent les<br />
grandes exploitations mécanisées<br />
et la monoculture, dont les ravages<br />
sur la biodiversité ne sont plus à<br />
démontrer : « Il faudrait lier davantage<br />
ces subventions aux performances<br />
environnementales, suggère le<br />
chercheur. L’agriculture peut absorber<br />
du carbone, entretenir la biodiversité<br />
et les paysages, rafraîchir le climat.<br />
Utilisons ces subventions pour<br />
financer la transition écologique ! »<br />
Autre aberration : si un être humain<br />
sur dix souffre de la faim, la même<br />
proportion est désormais obèse (et ce<br />
chiffre a triplé depuis les années 1970) !<br />
L’Organisation mondiale de la santé<br />
(OMS) soulignait en mars que<br />
« le surpoids et l’obésité sont désormais<br />
en augmentation dans les pays<br />
à revenus faibles et intermédiaires ».<br />
Faim et obésité<br />
progressent de concert :<br />
comment expliquer ce<br />
paradoxe ? « Jusqu’aux<br />
années 1980, le monde<br />
manquait de nourriture,<br />
nous précise Nicolas<br />
Bricas. L’industrie a donc<br />
produit un maximum de<br />
calories à moindre coût.<br />
Les gens se remplissent le<br />
ventre de calories “vides”,<br />
d’huile, de sucre, sans<br />
fibres. La diversification<br />
alimentaire a été négligée. En Afrique,<br />
en Asie et en Amérique latine, des gens<br />
pâtissent de ce que l’on appelle une<br />
“double-charge” : ils sont en surpoids,<br />
mais carencés en micronutriments<br />
Si un être humain sur dix souffre de la faim, la même proportion est désormais obèse.<br />
Choisir une<br />
culture au<br />
détriment d’une<br />
autre répond<br />
à des logiques<br />
industrielles,<br />
pas forcément<br />
en phase avec<br />
les intérêts des<br />
consommateurs.<br />
(vitamine A, fer, zinc, etc.), contenus<br />
notamment dans les fruits et les<br />
légumes. Le système agricole provoque<br />
trop de dégâts sur l’environnement et<br />
la santé. Mais de puissants acteurs n’ont<br />
pas intérêt à le changer, car ils veulent<br />
conserver le pouvoir et la richesse. »<br />
Un exemple ? Le Mexique, où 70 %<br />
de la population est en surpoids,<br />
a imposé en 2019 un<br />
étiquetage afin d’alerter<br />
les consommateurs.<br />
Mais l’ONG suisse<br />
Public Eye a révélé<br />
en juillet que le géant de<br />
l’agroalimentaire Nestlé<br />
et les autorités helvétiques<br />
avaient cherché à<br />
dissuader Mexico<br />
de prendre ces mesures<br />
de santé publique…<br />
Face aux aberrations<br />
du système agricole actuel,<br />
un retour aux sources s’impose. Depuis<br />
que l’homme a inventé l’agriculture<br />
il y a environ douze millénaires,<br />
« 6 000 à 7 000 espèces végétales<br />
ont été cultivées pour se nourrir,<br />
sur un total d’environ 30 000 plantes<br />
comestibles », rappelait la FAO dans<br />
un rapport de 2018. Or, aujourd’hui,<br />
nous n’en cultivons qu’« environ 170.<br />
Et trois seulement fournissent 40 %<br />
de nos calories : le blé, le riz et le maïs ».<br />
Le paradoxe est que de nombreux<br />
pays africains consomment un pain<br />
qu’ils ne produisent pas : « Le pain est<br />
omniprésent, on oublierait presque que<br />
la culture du blé est peu répandue en<br />
Afrique », souligne Téguia Bogni, auteur<br />
et spécialiste culinaire camerounais,<br />
dans une tribune publiée sur le site du<br />
Monde le 25 mars. La FAO remarque<br />
aussi que l’abandon de milliers de fruits<br />
et légumes est « non seulement une<br />
honte pour tous les goûts que nous<br />
perdons, mais aussi pour les nutriments<br />
qu’ils fournissent ». Or, choisir une<br />
SHUTTERSTOCK<br />
110 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SHUTTERSTOCK (2)<br />
culture au détriment d’une autre<br />
répond à des logiques industrielles, pas<br />
forcément en phase avec les intérêts<br />
des consommateurs, des agriculteurs<br />
ou des pays émergents… Parce qu’elle<br />
résiste mieux au transport, la banane<br />
Cavendish s’est ainsi imposée parmi<br />
le millier de variétés que la nature nous<br />
offre, allant jusqu’à représenter 50 %<br />
de la production mondiale ! Les cultures<br />
négligées sont « généralement des<br />
cultures indigènes ou traditionnelles »,<br />
souligne la FAO. « Soutenus par<br />
les politiques et les fonds nécessaires,<br />
ces espèces négligées peuvent revenir<br />
sur le marché. » En témoigne le retour<br />
en grâce, depuis les années 1990,<br />
du quinoa : cette plante riche en<br />
acides aminés et originaire des pays<br />
andins a vu sa production tripler. Elle<br />
est désormais cultivée dans 70 pays,<br />
dont l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda.<br />
Idem avec la patate douce, dont<br />
l’Autorité intergouvernementale pour<br />
le développement (IGAD) en Afrique<br />
de l’Est souligne le potentiel en tant<br />
qu’aliment très nutritif et résistant<br />
à la sécheresse, dans une Corne de<br />
l’Afrique où près de 20 millions de<br />
personnes se trouvent en insécurité<br />
alimentaire aiguë du fait de la<br />
sécheresse, des conflits régionaux et<br />
du blocage des ports ukrainiens.<br />
Face à la dépendance au blé, Téguia<br />
Bogni suggère que « les pays africains<br />
explorent la piste du pain enrichi aux<br />
farines locales à base de millet, de<br />
sorgho, de teff [céréale éthiopienne, ndlr],<br />
de fonio, de maïs, de patate, de manioc<br />
ou encore de plantain ». Une approche<br />
à même de « réduire les importations<br />
de blé » et de « valoriser les produits<br />
locaux ». D’autant que la monoculture en<br />
Afrique est une importation coloniale :<br />
jusque dans les années 1880 et l’arrivée<br />
des « plantations », l’agriculteur y<br />
pratiquait naturellement l’agroforesterie<br />
et la diversité des cultures… ■<br />
LES CHIFFRES<br />
3 pays africains<br />
figurent dans<br />
le top 10 des<br />
détenteurs de<br />
cryptomonnaies :<br />
le Nigeria, le Kenya<br />
et l’Afrique du Sud.<br />
9,18 %, SOIT LA BAISSE<br />
DU FRANC CFA FACE AU DOLLAR<br />
EN 2022 (SON COURS LE PLUS<br />
BAS DEPUIS CINQ ANS).<br />
ARRIMÉ À L’EURO, LE FCFA PÂTIT<br />
DE LA CHUTE DE CE DERNIER.<br />
314<br />
milliards<br />
de francs CFA<br />
C’est la somme que<br />
le Gabon va engranger<br />
en plus en 2022 du fait<br />
de la hausse des cours<br />
du pétrole.<br />
600 milliards<br />
d’euros,<br />
soit le montant<br />
du programme<br />
d’infrastructures<br />
promis par le G7<br />
à l’Afrique et à l’Asie,<br />
pour notamment<br />
contrer l’influence<br />
chinoise.<br />
100 millions de dollars, c’est le budget<br />
de la Super League africaine de football,<br />
qui sera lancée en 2023 par la Confédération<br />
africaine de football (CAF).<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 111
BUSINESS<br />
Nicolas Bricas<br />
SOCIOÉCONOMISTE DE L’ALIMENTATION AU CIRAD<br />
« L’interdépendance<br />
est devenue une dépendance »<br />
Membre du panel international d’experts sur les systèmes alimentaires<br />
durables, le chercheur au Centre de coopération internationale<br />
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) souligne<br />
l’importance des facteurs structurels dans l’actuelle crise alimentaire.<br />
propos recueillis par Cédric Gouverneur<br />
<strong>AM</strong> : Vous expliquez que cette crise a des raisons<br />
plus profondes que le conflit en Ukraine.<br />
Nicolas Bricas : Les prix du blé, du maïs et du riz grimpent<br />
depuis plus d’un an du fait de la hausse du tarif de l’énergie<br />
liée à la reprise post-Covid-19. L’industrialisation du système<br />
alimentaire est tributaire de ce dernier, de la culture<br />
mécanisée ou irriguée au transport, en passant par la chaîne<br />
du froid. Le prix des engrais chimiques est par exemple<br />
lié à celui du gaz. Même si demain le conflit en Ukraine<br />
prend fin et que le blé bloqué à Odessa est exporté, les prix<br />
alimentaires resteront élevés à cause de la crise énergétique.<br />
Les leçons des précédentes crises alimentaires,<br />
en 2008 et 2011, ont-elles été tirées ?<br />
À l’époque, en Afrique comme en Asie, la plupart des<br />
pays qui s’approvisionnaient sur le marché international ont<br />
pris conscience des risques. Ces crises furent des premières<br />
sonnettes d’alarme. Mais le système pâtit de beaucoup<br />
d’inertie : on ne relance pas du jour au lendemain la<br />
production agricole. Cela exige des capacités de recherche,<br />
des filières organisées, du crédit, etc. Le choc de la guerre<br />
en Ukraine va entraîner un mouvement pour réduire cette<br />
dépendance aux importations. Agriculteurs et pays sont<br />
trop dépendants de systèmes techniques et d’acteurs sur<br />
lesquels ils n’ont aucune prise : marchés internationaux,<br />
producteurs d’engrais et de produits phytosanitaires,<br />
semenciers, organismes de crédit et d’assurance, etc.<br />
L’asymétrie du pouvoir aux dépens des agriculteurs<br />
et des États, qui se font « balader ». L’interdépendance est<br />
devenue une dépendance. Il faut retrouver une capacité<br />
d’agir. C’est pourquoi on parle tant de souveraineté.<br />
Le paradoxe de l’actuelle crise est que la production<br />
mondiale excède les besoins.<br />
La production alimentaire par habitant continue<br />
d’augmenter : un adulte a besoin d’environ 2000 kilocalories<br />
par jour, mais on considère qu’avec une disponibilité<br />
alimentaire moyenne de 2500 kilocalories par personne et par<br />
jour, un pays est à l’abri d’un risque de pénurie. Jusque dans<br />
les années 1980, on ne produisait pas assez. Mais la production<br />
a grimpé plus vite que la population, et selon l’Organisation<br />
des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO),<br />
on frise aujourd’hui les 3000 kilocalories par personne et par<br />
jour ! Énormément de nourriture est gaspillée. La différence<br />
entre ce qui est produit et ce qui est consommé est de 30 %!<br />
Comment dès lors expliquer la hausse<br />
de l’insécurité alimentaire ?<br />
Environ 800 millions de personnes dans le monde,<br />
y compris en Europe, n’ont pas assez de pouvoir d’achat.<br />
Des paysans ne possèdent pas suffisamment de terres<br />
pour subvenir à leurs besoins. L’insécurité alimentaire<br />
est aussi liée aux migrations provoquées par la sécheresse<br />
et les conflits. Une partie de la production est utilisée<br />
pour les agrocarburants : c’était un nouveau débouché<br />
pour les agriculteurs. Cela peut être intéressant car il s’agit<br />
d’une ressource énergétique renouvelable, mais le calcul doit<br />
112 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
DR<br />
être précis, car si l’on déforeste et que l’on utilise un maximum<br />
de mécanisation et de chimie, le bilan environnemental<br />
devient nul, voire négatif. Afin de faire diminuer la pression<br />
sur le marché des céréales, il serait possible de réduire la<br />
part de l’éthanol et des huiles végétales dans les carburants.<br />
En outre, 42 % de la production mondiale de blé et de maïs<br />
est employée pour la nutrition animale, les Européens et les<br />
Américains mangeant trop de produits animaux, comparé<br />
à leurs besoins. L’élevage industriel contribue largement<br />
aux émissions de gaz à effet de serre. Changer de mode de<br />
production implique de revoir nos habitudes, en mangeant<br />
moins souvent de produits animaux et en acceptant qu’ils<br />
soient plus onéreux. La consommation<br />
de viande s’est banalisée dans les<br />
pays riches, on ne peut plus continuer<br />
ainsi, ni généraliser ce mode de<br />
vie, intenable pour la planète.<br />
Vous évoquez également<br />
le rôle de la spéculation.<br />
Les contrats à terme peuvent constituer pour<br />
l’agriculteur une certaine sécurité, afin de lui garantir<br />
un prix entre le moment où il met en culture et la récolte.<br />
Cependant, si le courtier qui a signé le contrat pressent<br />
un risque de surproduction, il peut le revendre avant<br />
qu’il ne perde de sa valeur. La spéculation devient abusive<br />
quand trop d’acteurs qui pensent que la tendance est à<br />
la hausse des prix achètent des contrats et font grimper<br />
artificiellement les cours : une partie de la hausse<br />
actuelle du blé résulte de cette spéculation excessive.<br />
Que peut apporter la diversification des cultures ?<br />
Il existe en Afrique une vraie prise de conscience sur<br />
le fait qu’il faut jouer la diversification. Comme dit l’adage,<br />
« il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier »:<br />
en Égypte, la dépendance aux importations de blé – principale<br />
céréale consommée – est devenue catastrophique avec<br />
la guerre en Ukraine. Et la monoculture rend les récoltes<br />
plus vulnérables aux attaques de maladies et de parasites.<br />
À l’inverse, le Nigeria a par exemple su diversifier ses<br />
cultures : igname, maïs, manioc, riz, mil et sorgho, patate<br />
douce, banane plantain, etc. Grâce à cette diversification,<br />
le pays est devenu relativement peu vulnérable. L’apport<br />
de la diversification est également nutritionnel : il faut<br />
manger un peu de tout pour assurer ses besoins.<br />
En octobre aura lieu le Comité de la sécurité alimentaire<br />
mondiale (CSA), qui réunira des représentants de la<br />
plupart des pays, de la société civile, des organisations<br />
internationales et du secteur privé. Qu’en attendez-vous ?<br />
Le CSA est un lieu de confrontation de points de vue.<br />
L’Afrique a conscience de la nécessité de relancer sa production<br />
agricole. Mais comment ? Une production industrielle qui peut<br />
permettre un accroissement rapide des rendements mais qui<br />
provoque des dégâts environnementaux, ou une agro-écologie<br />
qui garantit une production plus durable et équitable ?<br />
L’Ouganda est par exemple très impliqué dans l’agro-écologie<br />
et l’agroforesterie. Les systèmes paysans africains traditionnels<br />
tirent ainsi parti des arbres pour aller piocher des fertilisants<br />
naturels en profondeur dans le sol, tel le phosphore, qui<br />
va ensuite remonter à la surface via les feuilles des arbres.<br />
La recherche occidentale a privilégié des solutions techniques<br />
industrielles, mais il est possible de faire autrement. Le souci<br />
est que les acteurs industriels<br />
Nous essayons<br />
de trouver des solutions<br />
à l’échelle de chaque territoire.<br />
pratiquent le lobbying pour<br />
imposer leurs mesures. C’est<br />
hélas le cas de la fondation<br />
Bill et Melinda Gates :<br />
l’informaticien américain<br />
a révolutionné les usages avec Windows et estime donc que<br />
la technologie peut tout résoudre… C’est à mon sens une fuite<br />
en avant. L’enjeu n’est pas de remplacer une solution unique<br />
par une autre, mais de reconnaître la multiplicité des solutions<br />
expérimentées par les agriculteurs en fonction des climats<br />
et des sols. Au CIRAD, nous essayons de faire de la recherche<br />
autrement, avec les agriculteurs, pour trouver des solutions<br />
à l’échelle de chaque territoire. La démarche agro-écologique<br />
est nouvelle, difficile, et peu d’agronomes sont encore formés<br />
à cette nouvelle façon de travailler. Les habitudes vont mettre<br />
un certain temps pour changer, mais il faut les soutenir. ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 113
BUSINESS<br />
Le service sud-africain<br />
Showmax surclasse<br />
Netflix, avec 2 millions<br />
d’abonnés en 2021.<br />
Le groupe Canal+ a acquis Zacu<br />
Entertainment, leader de la production et<br />
de la distribution audiovisuelle au Rwanda.<br />
Le streaming<br />
s’impose<br />
en Afrique<br />
En jouant « local » et « international »,<br />
les plates-formes et la télévision payante<br />
conquièrent de plus en plus d’abonnés<br />
sur le continent.<br />
La plate-forme américaine<br />
coproduit avec le studio<br />
nigérian EbonyLife la série<br />
Blood Sisters.<br />
La progression est<br />
vertigineuse : selon le<br />
cabinet français Dataxis,<br />
les plates-formes de vidéo<br />
à la demande par abonnement (SVOD)<br />
ont doublé leur nombre d’abonnés<br />
en Afrique subsaharienne entre 2018<br />
et 2021, pour atteindre environ<br />
5 millions de foyers. Elles devraient<br />
voir leur croissance progresser encore<br />
plus fortement ces prochaines années<br />
et en toucher 15 millions en 2026.<br />
Alors qu’en Europe dominent les<br />
sociétés américaines Netflix, Disney+<br />
et Amazon Prime Video, le marché<br />
africain se caractérise par l’excellente<br />
performance des entreprises du<br />
continent : Showmax, plate-forme<br />
de streaming du groupe sud-africain<br />
MultiChoice, y surclasse même<br />
Netflix, avec 2 millions d’abonnés<br />
en 2021 et 5 millions prévus en 2026,<br />
contre 1,5 million en 2021 et 4,7<br />
en 2026 pour le service américain.<br />
« Le succès de Showmax repose<br />
en partie dans sa capacité à offrir à<br />
la fois des productions internationales<br />
et locales », écrit Léa Zouein,<br />
analyste de Dataxis. L’an dernier,<br />
« quatre des cinq plus gros succès de<br />
Showmax en Afrique subsaharienne »<br />
étaient des programmes africains.<br />
Face à l’appétence du public du<br />
continent pour les films et séries made<br />
in Africa, Netflix s’adapte et « cherche<br />
à devenir un acteur majeur du cinéma<br />
DR (5)<br />
114 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SHUTTERSTOCK<br />
nigérian », le foisonnant et inventif<br />
Nollywood. Depuis le 5 mai, la<br />
plate-forme américaine diffuse une<br />
série coproduite avec le studio nigérian<br />
EbonyLife : Blood Sisters, de Biyi<br />
Bandele et Kenneth Gyang (un thriller<br />
sur fond de dénonciation du fléau des<br />
violences conjugales). Le studio vient<br />
par ailleurs de lancer à Lagos une<br />
école de cinéma, Ebony Life Creative,<br />
dans le but de former les talents<br />
locaux et de poursuivre l’exportation<br />
de Nollywood. « Bien que l’écart<br />
entre Showmax et Netflix se réduise,<br />
le faible taux de pénétration » des<br />
plates-formes de streaming en Afrique<br />
subsaharienne, combiné au lancement<br />
de nouveaux acteurs en 2022 tels<br />
que Disney+, Baze (Safaricom,<br />
Kenya) et KIWI (Côte Ouest<br />
audiovisuel, Côte d’Ivoire), suggère<br />
que la concurrence va s’intensifier<br />
entre plates-formes africaines et<br />
internationales », note Dataxis.<br />
Face au streaming, la télévision<br />
payante n’est pas en reste : le cabinet<br />
britannique Digital TV Research<br />
estime que la clientèle des chaînes<br />
payantes en Afrique subsaharienne<br />
va progresser de 50 % ces prochaines<br />
années, pour atteindre environ<br />
50 millions d’abonnés en 2026.<br />
Ici aussi, le sud-africain MultiChoice<br />
se place dans le trio de tête, derrière<br />
le chinois StarTimes, mais devant<br />
le français Canal+. Le 5 juillet,<br />
le groupe de Vincent Bolloré a par<br />
ailleurs annoncé l’acquisition de Zacu<br />
Entertainment, leader de la production<br />
et de la distribution audiovisuelle<br />
au Rwanda, disposant « de plus de<br />
500 heures de nouveaux films et séries<br />
produits par an et d’un catalogue de<br />
700 heures », précise Canal+. Présente<br />
depuis dix ans déjà au pays des mille<br />
collines, la chaîne entend aussi « lancer<br />
une chaîne de fiction 100 % en<br />
kinyarwanda », la langue nationale. ■<br />
Le port de Banjul est devenu ces dernières années une plaque tournante du trafic illégal.<br />
La Gambie s’engage<br />
contre la déforestation<br />
Les autorités adoptent une série de mesures<br />
radicales, sur fond de coupes illégales sur son sol<br />
et en Casamance sénégalaise.<br />
La Gambie a annoncé<br />
début juillet la suspension<br />
d’absolument toutes<br />
les exportations de bois,<br />
et ce jusqu’à nouvel ordre. Les<br />
autorités appellent aussi les citoyens<br />
à signaler « les cas présumés de<br />
destruction de l’environnement,<br />
de coupes d’arbres protégés, de<br />
feux de brousse, d’empiètement de<br />
forêt ». Plus aucune grume (tronc<br />
coupé et élagué) ne doit quitter le<br />
port de Banjul, devenu ces dernières<br />
années une plaque tournante du<br />
trafic illégal, principalement à<br />
destination de la Chine, du bois de<br />
rose et du bois de vène (pterocarpus<br />
erinaceus, également connu sous le<br />
nom de palissandre). Il y a deux ans,<br />
le transporteur maritime français<br />
CMA CGM, alerté par des défenseurs<br />
de l’environnement, avait cessé<br />
d’embarquer sur ses navires des grumes<br />
depuis le port gambien. Les forêts de<br />
ce petit pays (11 300 km 2 ) ne suffisant<br />
plus, les trafiquants ont pris l’habitude<br />
de traverser la frontière pour s’en<br />
prendre aux troncs de la Casamance<br />
sénégalaise. Depuis plusieurs années,<br />
militants écologistes et élus sénégalais<br />
y dénoncent le trafic de bois précieux,<br />
au profit notamment de mouvements<br />
séparatistes locaux. Exilé en Guinée<br />
équatoriale, l’ancien président<br />
gambien Yahya Jammeh (1996-2017)<br />
est soupçonné d’avoir été impliqué<br />
dans le trafic de bois avec un<br />
négociant suisso-roumain, Nicolae<br />
Bogdan Buzaianu : fin juin, le<br />
ministère de la Justice helvétique<br />
a ainsi formulé à la Gambie une<br />
« demande d’entraide judiciaire »<br />
dans le cadre d’une procédure pour<br />
« crimes contre l’environnement ». ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 115
BUSINESS<br />
Monaco s’intéresse<br />
de plus en plus à son sud<br />
Derrière son image<br />
glamour, la principauté<br />
est aussi un vivier<br />
d’entrepreneurs.<br />
Qui regardent<br />
vers le continent.<br />
La cité-État indépendante dispose d’un prestige international.<br />
Le 29 juin dernier, le Club des<br />
entrepreneurs monégasques<br />
en Afrique (CEMA), en<br />
partenariat avec Afrique<br />
Magazine, le Monaco Economic Board<br />
(MEB) et la Fédération des entreprises<br />
monégasques (FEDEM), a organisé<br />
au Yacht Club de Monaco la première<br />
édition d’Africa Day. Une journée<br />
de rencontres et de débats, « afin<br />
de mieux faire connaître l’Afrique<br />
à Monaco », résume Frédéric Geerts.<br />
Président du CEMA, senior advisor<br />
chez Rothschild & Co Monaco, et<br />
administrateur de la Chambre de<br />
commerce, d’industrie et d’agriculture<br />
Le panel d’ouverture d’Africa Day, avec, de gauche à droite, Lionel Zinsou, Étienne Giros,<br />
Zyad Limam, Khaled Igué, Johanna Houdrouge et Frédéric Geerts.<br />
Belgique-Luxembourg-Afrique-<br />
Caraïbes-Pacifique (CBL-ACP),<br />
il explique ce que la principauté peut<br />
apporter au continent. La cité-État<br />
indépendante dispose d’un prestige<br />
international inversement proportionnel<br />
à sa minuscule superficie (seulement<br />
2 km 2 et moins de 40 000 habitants). La<br />
principauté de Monaco a une réputation<br />
très glamour, de luxe ostentatoire et<br />
de qualité de vie méditerranéenne.<br />
Une image en partie tronquée, nous<br />
explique Frédéric Geerts : « Monaco<br />
est un État-PME, avec un solide esprit<br />
entrepreneurship qui encourage<br />
l’initiative ! Beaucoup d’entrepreneurs<br />
s’y installent. Certes, la qualité de vie<br />
est un plus : le climat et la végétation<br />
– qui peut rappeler l’Afrique – attirent<br />
davantage que l’Europe du Nord. »<br />
« L’Afrique est le deuxième<br />
partenaire commercial de la<br />
WIKIPEDIA - HELENA AHONEN<br />
116 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SHUTTERSTOCK<br />
principauté, juste après l’Europe »,<br />
souligne le président du CEMA.<br />
« Monaco accueille quasiment<br />
le monde entier, environ<br />
130 nationalités ! Une quinzaine<br />
de pays africains y sont présents<br />
via des consuls honoraires, rattachés<br />
à l’ambassade de France. Aussi,<br />
la principauté a toujours été très<br />
active sur le plan caritatif : au niveau<br />
du gouvernement monégasque, il<br />
existe une direction de la coopération<br />
qui intervient dans différents<br />
projets au bénéfice des populations<br />
à Madagascar, au Niger, au<br />
Burkina Faso, au Burundi… »<br />
Fondé en 2014, le CEMA compte<br />
environ « une vingtaine de membres,<br />
qui réalisent plus de 2 milliards<br />
d’euros de chiffre d’affaires sur<br />
le continent. Nous sommes le levier<br />
opérationnel sur le continent du<br />
MEB », la chambre de commerce<br />
de la principauté. Avant la parenthèse<br />
du Covid-19, « le CEMA avait organisé,<br />
avec le MEB, plusieurs voyages<br />
d’affaires entre 2015 et 2019 sur le<br />
continent, à Kinshasa, Dakar, Abidjan<br />
et Maurice ». Les entreprises du CEMA<br />
– parmi lesquelles figurent Mercure<br />
International, Monaco Resources<br />
Group (MRG), Ascoma, Sonema<br />
et ES-KO – sont présentes dans la<br />
majeure partie des pays du continent.<br />
Surtout, la principauté n’a « aucun<br />
objectif politique » sur le continent,<br />
relève Frédéric Geerts. « Monaco<br />
n’est pas un mastodonte étatique :<br />
la principauté sait établir des<br />
relations commerciales, de PME à<br />
PME, avec ses partenaires africains. Il<br />
n’y a pas de passé, ni de passif colonial,<br />
pas de soupçons d’interventionnisme<br />
politique » dans les affaires intérieures<br />
des pays partenaires, comme cela peut<br />
être le cas avec les grandes puissances<br />
étatiques, en ces temps troubles<br />
de recomposition géopolitique. ■<br />
Une délégation d’OCP Africa,<br />
filiale du Groupe OCP,<br />
conduite par Mohamed<br />
Hettiti (vice-président<br />
Afrique de l’Ouest) et Mohammed<br />
Benzekri (directeur Afrique de<br />
l’Ouest), a été reçue le 17 juin à<br />
Niamey par le Premier ministre<br />
nigérien Ouhoumoudou Mahamadou.<br />
Objectif : soutenir la production<br />
agricole du pays en le dotant d’une<br />
usine de production d’engrais. Une<br />
question essentielle, stratégique,<br />
pour le Niger, confronté à un déficit<br />
alimentaire chronique. La production<br />
agricole brute par habitant est la plus<br />
faible depuis deux décennies, dans<br />
un contexte aggravé par l’insécurité<br />
djihadiste, la sécheresse amplifiée à<br />
cause du réchauffement climatique,<br />
ainsi que le conflit, depuis mars,<br />
Niamey,<br />
sur le fleuve Niger.<br />
OCP ouvre<br />
des perspectives au Niger<br />
Cet immense pays sahélien, avec une forte<br />
croissance démographique, est confronté<br />
à une crise alimentaire majeure, aggravée<br />
par l’insécurité et le conflit en Ukraine.<br />
entre l’Ukraine et la Russie, importants<br />
exportateurs de blé. Le nombre de<br />
Nigériens en insécurité alimentaire<br />
a doublé en un an, atteignant<br />
2,5 millions. Et ce chiffre pourrait<br />
grimper à 3,6 millions en août. Le pays<br />
sahélien de 24 millions d’habitants<br />
connaît la plus forte croissance<br />
démographique au monde et voit<br />
donc ses besoins sans cesse augmenter.<br />
Les difficultés d’approvisionnement<br />
en engrais pourraient être durablement<br />
palliées par le projet d’usine du leader<br />
mondial des engrais phosphatés,<br />
présent également dans le domaine<br />
de la réorganisation et de la<br />
dynamisation des filières agricoles.<br />
Le groupe marocain, à travers OCP<br />
Africa, opère aussi dans 16 pays<br />
du continent : Sénégal, Côte d’Ivoire,<br />
Bénin, Nigeria, Ghana… ■<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 117
VIVRE MIEUX<br />
Pages dirigées par Danielle Ben Yahmed, avec Annick Beaucousin et Julie Gilles<br />
FORME DE NOUVELLES<br />
GYMS POUR LA RENTRÉE<br />
BASÉES SUR LA NOTION DE BIEN-ÊTRE DU CORPS ET DE L’ESPRIT, ELLES SOIGNENT LE MENTAL<br />
AUSSI BIEN QUE LES MUSCLES EN DOUCEUR.<br />
L’ESCALADE ET LA BOXE ont toujours les faveurs<br />
de nombreux pratiquants, mais aujourd’hui, on fait<br />
du sport différemment. Et il est de moins en moins<br />
question de brusquer son corps, on le fait bouger le plus<br />
possible sans souffrance, et l’on entretient son mental<br />
qui ne peut être séparé du corps. De plus, le confinement<br />
étant passé par là, le sport s’invite à la maison.<br />
LE SPORT CHEZ SOI, UN BON DÉBUT<br />
Le digital a explosé dans l’univers sportif. Il existe de<br />
nombreux cours en ligne et des applications (Blackroll,<br />
Neoness Live…) pour faire des exercices d’échauffement,<br />
de mobilité, de renforcement, ou suivre des séances de<br />
sport et de danse en live ou replay. Le sport vient à nous,<br />
pratiqué via un écran, il incite en plus à faire attention et<br />
éviter les blessures, puisqu’on ne suit plus le rythme forcé du<br />
groupe. Par ailleurs, on ne craint plus le regard des autres.<br />
Inconvénients en revanche, l’énergie d’un groupe peut<br />
manquer, et la motivation aussi.<br />
LE YOGA, LA DISCIPLINE STAR<br />
La tendance amorcée au cours de la pandémie se poursuit.<br />
On a même vu arriver le pool yoga, consistant à prendre<br />
des postures sur une planche sur l’eau ! Au début, mieux vaut<br />
privilégier les formes lentes, comme le hatha yoga. Ce sport<br />
fait du bien sur le plan physique (souplesse, renforcement<br />
musculaire) et au niveau de l’équilibre mental, de l’écoute<br />
de soi. Pour des cours en ligne, on attend en revanche d’avoir<br />
SHUTTERSTOCK<br />
118 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SHUTTERSTOCK<br />
acquis les bases. À savoir : une technique particulière,<br />
le « stomach vacuum », est plébiscitée pour prendre soin<br />
de son ventre et avoir une bonne musculature de la sangle<br />
abdominale. Elle consiste à gonfler le ventre au maximum<br />
en inspirant, puis à le rentrer le plus possible en expirant.<br />
On contracte ensuite le périnée, et on crée comme un<br />
mouvement de vagues qui sollicite le transverse. Cela masse<br />
les organes internes, les décongestionne et stimule le transit.<br />
LES COURS DE DANSE, UNE TENDANCE QUI TIENT<br />
La Biodanza est une danse qui vise aussi au bien-être du corps<br />
et de l’esprit. On redécouvre le plaisir de bouger, de ressentir<br />
et d’exprimer des émotions. Séance après séance, on se sent<br />
plus vivant. Cette activité stimule les émotions et provoque<br />
une certaine joie de vivre. Des études scientifiques montrent<br />
qu’elle a des effets positifs sur le stress et les affections<br />
psychosomatiques, et par conséquent sur la santé globalement.<br />
Pas besoin de savoir danser : on se met en mouvement en<br />
suivant son rythme.<br />
Autres disciplines tendance, le Ballet Sculpt et le Barre Sculpt,<br />
qui allient grâce de la danse classique et énergie du fitness.<br />
Le premier est un cours de fitness intense, dansé sur une<br />
playlist dynamique, avec renforcement musculaire, cardio<br />
et travail au sol. Mais il n’est pas facile à suivre si l’on n’a<br />
jamais fait de danse… Le second est un cours de renforcement<br />
musculaire (toujours sur musique dynamique) pratiqué<br />
à la barre et au sol. Plus facile d’accès pour les novices,<br />
et ultra-efficace pour tonifier la silhouette.<br />
LE ELLE PILATES, POUR UNE ÉNERGIE NOUVELLE<br />
Cette méthode pour le corps et l’esprit s’adressant aux<br />
femmes a pour objectif de diminuer la charge mentale<br />
et de développer une image de soi plus positive. Une partie<br />
du cours est consacrée au ventre pour muscler le périnée,<br />
travailler les muscles abdominaux profonds, affiner la taille.<br />
Une autre est consacrée au yoga du visage pour prévenir<br />
ou atténuer les rides d’expression, redessiner l’ovale du visage<br />
et booster l’éclat. Enfin, le cours met le curseur sur l’estime<br />
de soi et le bonheur grâce à des techniques de développement<br />
personnel (exercices de visualisation, de méditation…).<br />
L’EMS, QUI PROCURE DES RÉSULTATS RAPIDES<br />
L’électro-myo-stimulation (EMS) est une nouvelle manière<br />
de faire des entraînements quand on a peu de temps.<br />
Iron Bodyfit, leader sur le marché, propose des séances<br />
d’électrostimulation de 25 minutes, correspondant à 4 heures<br />
de sport en matière de contraction musculaire ! Huit groupes<br />
sont sollicités : cuisses, fessiers, abdominaux, haut du dos,<br />
dorsaux, lombaires, pectoraux et bras. Cette activité diminue<br />
la masse graisseuse, améliore le métabolisme de base,<br />
remodèle et tonifie la silhouette. ■ Annick Beaucousin<br />
N’ABUSEZ PAS DU SEL<br />
EN EXCÈS, IL PEUT ÊTRE NÉFASTE.<br />
LA PLUPART D’ENTRE NOUS consomment<br />
bien plus de sel qu’il ne le faudrait. Celui-ci est<br />
certes nécessaire – il aide à réguler le volume<br />
sanguin et sert au fonctionnement des muscles,<br />
à l’influx nerveux et au cœur –, mais en excès sur<br />
des années, il devient néfaste pour la santé, en<br />
augmentant notamment le risque d’hypertension<br />
artérielle et de maladies cardiovasculaires.<br />
Ce n’est pas celui que l’on ajoute (gros sel, sel<br />
de table) qui pose vraiment problème, puisqu’il ne<br />
représente que 10 à 20 % de notre consommation ;<br />
on peut cependant essayer d’oublier le réflexe<br />
« salière », trop systématique, et miser sur des<br />
herbes et des épices pour donner du goût…<br />
Mais il faut surtout se méfier du sel caché,<br />
qui englobe 80 % de nos apports ! On réduit<br />
les produits qui en sont riches : charcuterie,<br />
fromage, viennoiseries, plats cuisinés, chips,<br />
biscuits apéritifs, soupes du commerce ou encore<br />
poissons fumés. Ceux qui affichent un taux<br />
réduit (jambon blanc, soupes…) sont néanmoins<br />
intéressants. Attention également au pain blanc,<br />
plus salé qu’on ne le croit : il est préférable de se<br />
tourner vers les pains aux céréales. ■ Julie Gilles<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 119
VIVRE MIEUX<br />
En bref<br />
Stop au mal de dos<br />
◗ Dans ce guide, on<br />
découvre des conseils<br />
ciblés selon nos besoins.<br />
Et des solutions concrètes<br />
pour agir : choisir sa<br />
literie, améliorer ses<br />
postures, faire les bons<br />
exercices de renforcement<br />
musculaire, connaître<br />
les chirurgies du dos en<br />
cas de troubles sévères.<br />
Prévenir et soulager le mal<br />
de dos, par Rachel Frély<br />
et Alix Lefief-Delcourt,<br />
Larousse, 13,95 euros.<br />
VITILIGO, UNE MALADIE MAL CONNUE<br />
DE NOUVEAUX TRAITEMENTS POUR REPIGMENTER LA PEAU.<br />
VICTIMES DE NOMBREUSES idées<br />
fausses, ses plaques blanches sur la<br />
peau inquiètent, pourtant cette maladie<br />
n’est pas contagieuse, et de nouveaux<br />
traitements permettent de repigmenter et<br />
d’atténuer les plaques. En effet, le vitiligo<br />
se manifeste par des plaques blanches sur<br />
la peau, qui correspondent à des zones<br />
où les cellules mélanocytes – fabriquant<br />
la mélanine, le principal pigment de<br />
la peau – ont disparu. En général, ces<br />
plaques ne grattent pas et ne font pas<br />
mal. Cette maladie est encore l’objet de<br />
nombreuses idées fausses. À l’occasion<br />
de la journée mondiale du vitiligo<br />
le 25 juin dernier, Thierry Passeron,<br />
dermatologue au CHU de Nice, chef<br />
d’équipe à l’Institut national de la santé<br />
et de la recherche médicale (INSERM)<br />
et membre de la Société française de<br />
dermatologie, a précisé certains points :<br />
ni héréditaire ni contagieux, il est souvent<br />
considéré comme un problème esthétique<br />
bénin, or il a été démontré qu’il a des<br />
retentissements importants sur la vie<br />
des personnes qui en souffrent, parfois<br />
comparables à ceux d’une dépression.<br />
D’autre part, on entend encore dire qu’il<br />
s’agit d’une maladie psychologique,<br />
qu’il n’y a rien à faire, mais il s’agit<br />
en fait d’une maladie auto-immune, et<br />
des solutions existent désormais pour<br />
repigmenter la peau, notamment sur<br />
le visage – la zone qui répond le mieux.<br />
Les UV du soleil, les lampes ou les cabines<br />
UVB (pas celles de bronzage) sont ainsi<br />
conseillés pour agir sur la repigmentation<br />
et atténuer les plaques. Mais grâce à des<br />
traitements, dans 60 à 80 % des cas,<br />
il est possible d’avoir une repigmentation<br />
complète, ou quasi complète, des zones du<br />
visage. À savoir : quand un vitiligo est en<br />
train de s’étendre, il doit être rapidement<br />
traité car il est alors plus facile à<br />
repigmenter. Un nouveau traitement<br />
sous forme de crème, le ruxolitinib,<br />
très efficace pour le visage, et dans une<br />
moindre mesure le corps, est sur le point<br />
d’arriver aux États-Unis et devrait être<br />
disponible en fin d’année en Europe. Et<br />
la recherche est active. Pour les zones<br />
difficiles, une nouvelle classe prometteuse<br />
de médicaments est en développement<br />
au CHU de Nice. D’autres traitements<br />
(par voie orale ou cutanée) sont en essais<br />
cliniques pour évaluation aux CHU<br />
de Bordeaux, Créteil et Nice. ■ A.B.<br />
Plus d’informations sur cure-vitiligo.com.<br />
On pense<br />
à nos reins<br />
◗ Ils jouent un grand rôle<br />
côté santé : ils éliminent<br />
les toxines et déchets<br />
en filtrant le sang,<br />
régulent la quantité d’eau,<br />
de sels minéraux dans<br />
le corps, et interviennent<br />
dans le contrôle de la<br />
pression artérielle. Voilà<br />
un livre pour adopter<br />
de bons réflexes et une<br />
alimentation saine pour<br />
y faire attention.<br />
Prendre soin de ses reins,<br />
par le Dr Jean-Louis<br />
Poignet, Alpen,<br />
16,50 euros.<br />
SHUTTERSTOCK - DR (2)<br />
120 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SHUTTERSTOCK (2)<br />
L’ARTHROSE<br />
DU POUCE<br />
DOULOUREUX,<br />
MAIS CELA SE SOIGNE !<br />
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES Y SONT POUR<br />
QUELQUE CHOSE DANS CETTE AFFECTION FRÉQUENTE,<br />
MAIS IL NE FAUT PAS SE RÉSIGNER.<br />
L’USURE DU CARTILAGE du pouce va entraîner des douleurs et l’empêcher<br />
de fonctionner normalement, de faire la pince : des gestes quotidiens<br />
comme ouvrir une bouteille, une boîte, cuisiner ou encore taper sur un<br />
clavier deviennent difficiles, voire impossibles. C’est un handicap. Les<br />
causes sont multiples : il y a les prédispositions anatomiques, l’hérédité<br />
et le travail manuel répétitif, l’utilisation accrue de nos pouces avec les<br />
nouvelles technologies… Cette affection va toucher des personnes de plus<br />
en plus jeunes. Il ne faut pas se résigner. Les professionnels de santé sont<br />
souvent mal informés. Pour réduire la douleur et la perte de mobilité,<br />
plusieurs solutions peuvent être proposées : le port d’une attelle, la prise<br />
d’antidouleurs, des infiltrations de cortisone, ou encore des injections<br />
d’acide hyaluronique – pour lubrifier l’articulation –, avec des résultats<br />
variables. Mais enfin, et c’est encore trop peu connu, on peut recourir<br />
à la chirurgie lorsque le traitement ne suffit pas. Aujourd’hui, la pose<br />
d’une petite prothèse pour remplacer l’articulation de la base du pouce<br />
donne de très bons résultats : elle permet de retrouver un fonctionnement<br />
normal de la main et supprime les douleurs. Réalisée par un chirurgien<br />
de la main, l’opération se déroule sous anesthésie locorégionale, sans<br />
hospitalisation, et les résultats peuvent durer de dix à quinze ans. ■ A.B.<br />
Plus d’informations sur ce site nouvellement créé : arthrose-pouce.com.<br />
MANGER AU MIEUX<br />
PAR TEMPS DE CANICULE<br />
IL N’Y A PAS QUE L’EAU QUI HYDRATE<br />
NOTRE ORGANISME !<br />
EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS<br />
notamment, notre corps a besoin d’être<br />
correctement hydraté. En premier lieu,<br />
on pense bien sûr à boire de l’eau : si en<br />
temps normal, 1,5 litre est recommandé,<br />
cela monte à 2 litres par temps caniculaire.<br />
Et il ne faut pas attendre d’avoir soif car<br />
c’est déjà signe que l’on est déshydraté.<br />
Parallèlement, l’alimentation<br />
permet d’assurer une bonne hydratation.<br />
Les fruits et légumes sont à mettre aux<br />
menus, puisque composés à 90 % d’eau<br />
en moyenne : concombre, salade verte,<br />
courgette, tomate figurent parmi les<br />
légumes qui en sont les plus riches. Quand<br />
il fait chaud, on mise sur les crudités,<br />
les salades composées, mais les légumes<br />
cuits sont bons aussi. Les soupes froides et<br />
gaspachos sont également excellents pour<br />
s’hydrater en faisant le plein de vitamines.<br />
Côté dessert, on choisit des fruits ou une<br />
salade de fruits : melon, pastèque, fruits rouges<br />
et pêche notamment sont très riches en eau. En<br />
cas d’envie de glace, on opte pour des sorbets<br />
à base d’eau et de fruits frais. Et les laitages<br />
type fromages blancs ou yaourts sont souvent<br />
oubliés, alors qu’ils représentent une source<br />
d’hydratation aussi importante que les fruits.<br />
À l’inverse, il y a des denrées à éviter, ou<br />
fortement limiter, s’il fait très<br />
chaud, comme les aliments<br />
gras, qui demandent des<br />
efforts pour les digérer,<br />
et augmentant donc<br />
la température du<br />
corps. Attention<br />
également aux<br />
mets très salés :<br />
de forts apports<br />
en sel favorisent<br />
la déshydratation.<br />
Cela vaut aussi pour<br />
les sucreries et pâtisseries<br />
ainsi que les boissons<br />
diurétiques, type thé,<br />
café, bière ou alcool. ■ J.G.<br />
AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 121
LES 20 QUESTIONS<br />
Rébecca<br />
M’Boungou<br />
La chanteuse du SEXTET KOLINGA<br />
rend hommage à ses racines congolaises<br />
sur leur nouvel album. Une soul<br />
envoûtante étoffée de jazz et de rumba<br />
pour explorer son héritage spirituel.<br />
propos recueillis par Astrid Krivian<br />
1 Votre objet fétiche ?<br />
Deux peluches, auxquelles j’attribue<br />
plein de qualités et d’espièglerie !<br />
2 Votre voyage favori ?<br />
Le Congo-Brazzaville, pays de mon père. Vedettes<br />
de la musique congolaise, mes parents s’y sont<br />
rencontrés. Ce voyage a transformé ma vie.<br />
3 Le dernier voyage que vous avez fait ?<br />
À Toulouse, pour le festival Rio Loco. Une superbe<br />
expérience ! Et le Rwanda : j’ai été<br />
éblouie par sa beauté, et horrifiée<br />
par l’histoire du génocide.<br />
4 Ce que vous emportez<br />
toujours avec vous ?<br />
Un carnet et un stylo. Mes souvenirs<br />
de voyage sont en majorité des textes.<br />
5 Un morceau de musique ?<br />
« Melody noir », de Patrick Watson :<br />
réconfortant comme une étreinte ou un plaid.<br />
6 Un livre sur une île déserte ?<br />
Le Cercle des guérisseuses, de Jean-Philippe<br />
de Tonnac. Il m’a aidé à me sentir moins seule.<br />
7 Un film inoubliable ?<br />
Legacy, Kolinga,<br />
Underdog<br />
Records.<br />
Into the Wild, de Sean Penn. Son héros fait ce choix<br />
extrême d’une vie authentique pure, hors de la société.<br />
C’est parlant pour moi, qui me sens aussi en décalage.<br />
8 Votre mot favori ?<br />
« Chatoyance » : présenter des reflets changeants<br />
selon le jeu de la lumière. Profond !<br />
9 Prodigue ou économe ?<br />
En matière d’argent ou d’énergie, je tends à être<br />
prodigue. Mais avec l’âge, j’essaie de m’économiser.<br />
10 De jour ou de nuit ?<br />
Du soir ! Dans la journée, je me débarrasse des<br />
tâches contraignantes. Puis je fais ce que j’aime.<br />
11 Twitter, Facebook, e-mail,<br />
coup de fil ou lettre ?<br />
E-mails et lettres. Je m’attelle aux réseaux sociaux<br />
pour mon métier, mais ce n’est pas mon truc.<br />
12 Votre truc pour penser à autre chose,<br />
tout oublier ?<br />
Écouter de la musique. Ça me réconforte,<br />
me donne une perspective sur des<br />
situations, me décolle d’un problème.<br />
13 Votre extravagance favorite ?<br />
Faire ou dire des choses qui ne correspondent<br />
pas à ce que l’on attend de moi. Ça fait<br />
du bien de bousculer les lignes.<br />
14 Ce que vous rêviez d’être<br />
quand vous étiez enfant ?<br />
Être à l’aise avec moi-même et les autres,<br />
avoir une vie harmonieuse.<br />
15 La dernière rencontre qui vous<br />
a marquée ?<br />
Chaque personne rencontrée m’apprend<br />
quelque chose, m’inspire, me nourrit.<br />
16 Ce à quoi vous êtes incapable<br />
de résister ?<br />
La nourriture ! Je suis épicurienne.<br />
17 Votre plus beau souvenir ?<br />
Des moments avec mes proches,<br />
au cœur de la nature, sans confort<br />
matériel. On revient à l’essentiel.<br />
18 L’endroit où vous aimeriez vivre ?<br />
Je le cherche ! Au calme, entourée<br />
d’arbres et de ma petite tribu.<br />
19 Votre plus belle déclaration d’amour ?<br />
Que ce soit en amour ou en amitié, être vraie et<br />
authentique. Avoir le courage de parler des moments<br />
inconfortables, quand l’on se sent blessée.<br />
20 Ce que vous aimeriez que l’on retienne<br />
de vous au siècle prochain ?<br />
Que j’ai fait de mon mieux, intègre et entière.<br />
Que ma musique continue à toucher les autres. ■<br />
DR (2)<br />
122 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022
CONTRIBUER À LA CROISSANCE DURABLE<br />
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES AFRICAINS<br />
Située au Maroc, avec 12 filiales et 212 employés représentant 17 nationalités africaines, OCP Africa<br />
est une entreprise africaine multiculturelle qui contribue à la transformation agricole du continent.<br />
Depuis sa création, OCP Africa a soutenu les stratégies de développement agricole et a développé des<br />
programmes de grande envergure pour aider à promouvoir une agriculture productive et structurée.<br />
OCP Africa s’appuie sur ses atouts agronomiques et technologiques pour mettre en œuvre<br />
d'importants programmes à fort impact sur les petits exploitants agricoles et sur l'ensemble<br />
de la chaîne de valeur agricole.<br />
Plusieurs millions d’agriculteurs ont bénéficié de ces programmes phares depuis 2016.