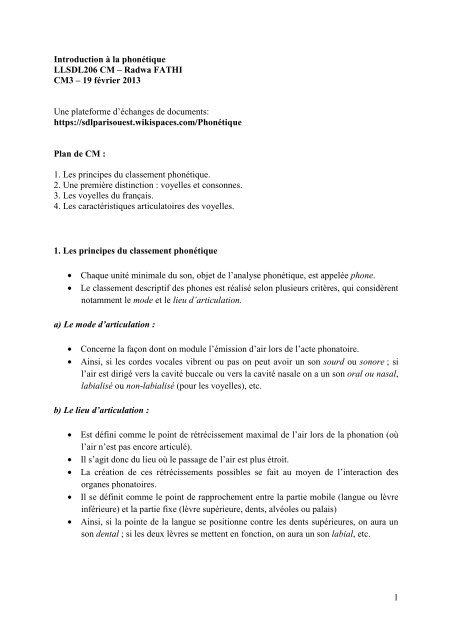1 Introduction à la phonétique LLSDL206 CM – Radwa FATHI CM3 ...
1 Introduction à la phonétique LLSDL206 CM – Radwa FATHI CM3 ...
1 Introduction à la phonétique LLSDL206 CM – Radwa FATHI CM3 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Introduction</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>phonétique</strong><br />
<strong>LLSDL206</strong> <strong>CM</strong> <strong>–</strong> <strong>Radwa</strong> <strong>FATHI</strong><br />
<strong>CM</strong>3 <strong>–</strong> 19 février 2013<br />
Une p<strong>la</strong>teforme d’échanges de documents:<br />
https://sdlparisouest.wikispaces.com/Phonétique<br />
P<strong>la</strong>n de <strong>CM</strong> :<br />
1. Les principes du c<strong>la</strong>ssement <strong>phonétique</strong>.<br />
2. Une première distinction : voyelles et consonnes.<br />
3. Les voyelles du français.<br />
4. Les caractéristiques articu<strong>la</strong>toires des voyelles.<br />
1. Les principes du c<strong>la</strong>ssement <strong>phonétique</strong><br />
• Chaque unité minimale du son, objet de l’analyse <strong>phonétique</strong>, est appelée phone.<br />
• Le c<strong>la</strong>ssement descriptif des phones est réalisé selon plusieurs critères, qui considèrent<br />
notamment le mode et le lieu d’articu<strong>la</strong>tion.<br />
a) Le mode d’articu<strong>la</strong>tion :<br />
• Concerne <strong>la</strong> façon dont on module l’émission d’air lors de l’acte phonatoire.<br />
• Ainsi, si les cordes vocales vibrent ou pas on peut avoir un son sourd ou sonore ; si<br />
l’air est dirigé vers <strong>la</strong> cavité buccale ou vers <strong>la</strong> cavité nasale on a un son oral ou nasal,<br />
<strong>la</strong>bialisé ou non-<strong>la</strong>bialisé (pour les voyelles), etc.<br />
b) Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion :<br />
• Est défini comme le point de rétrécissement maximal de l’air lors de <strong>la</strong> phonation (où<br />
l’air n’est pas encore articulé).<br />
• Il s’agit donc du lieu où le passage de l’air est plus étroit.<br />
• La création de ces rétrécissements possibles se fait au moyen de l’interaction des<br />
organes phonatoires.<br />
• Il se définit comme le point de rapprochement entre <strong>la</strong> partie mobile (<strong>la</strong>ngue ou lèvre<br />
inférieure) et <strong>la</strong> partie fixe (lèvre supérieure, dents, alvéoles ou pa<strong>la</strong>is)<br />
• Ainsi, si <strong>la</strong> pointe de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue se positionne contre les dents supérieures, on aura un<br />
son dental ; si les deux lèvres se mettent en fonction, on aura un son <strong>la</strong>bial, etc.<br />
1
2. Une première distinction : voyelles et consonnes<br />
1) Les voyelles :<br />
• Le passage de l'air se fait librement, il n'y a pas d'obstacle au passage de l'air.<br />
• Elles sont toujours sonores. Autrement dit, l'émission d'une voyelle est toujours<br />
accompagnée de <strong>la</strong> vibration des cordes vocales.<br />
• Elles peuvent constituer une syl<strong>la</strong>be <strong>à</strong> elles seules, par exemple , prononcé [a] est<br />
une syl<strong>la</strong>be <strong>à</strong> part entière (c.<strong>à</strong>.d. <strong>la</strong> voyelle est si cruciale comme un noyau de<br />
construction de <strong>la</strong> syl<strong>la</strong>be).<br />
2) Les consonnes :<br />
• Le passage d’air est obstrué.<br />
• L'air expiré rencontre un obstacle ou une occlusion totale (comme dans [p]) ou un<br />
obstacle partiel (comme dans [s]).<br />
• Les consonnes peuvent être sourdes ou sonores.<br />
• Elles ne peuvent pas constituer une syl<strong>la</strong>be <strong>à</strong> elles seules. Pour constituer une syl<strong>la</strong>be,<br />
elles doivent être accompagnées d'au moins une voyelle. Par exemple le son [t] ne<br />
peut pas constituer une syl<strong>la</strong>be, en revanche, les suites de sons [ta] ou [at] constituent<br />
des syl<strong>la</strong>bes.<br />
Avant d'aller plus loin, on signalera que le passage des consonnes aux voyelles ne se fait pas<br />
de manière abrupte, mais sur un continuum. On distinguera ainsi des articu<strong>la</strong>tions<br />
intermédiaires comme par exemple les semi-voyelles.<br />
3) Les semi-voyelles « les glides » :<br />
• Elles partagent des caractères des voyelles, où elles sont toujours voisés (sonores).<br />
• et des caractères des consonnes où en principe :<br />
1- elles ne peuvent pas construire une syl<strong>la</strong>be <strong>à</strong> elles-seuls.<br />
2- elles ont besoin des voyelles <strong>à</strong> côté.<br />
3- leur production est accompagnée d’une occlusion partielle de l’air (un passage<br />
partiellement obstrué de l’air expiré).<br />
Nota : La syl<strong>la</strong>be :<br />
• Les sons se regroupent en syl<strong>la</strong>bes pour construire des mots.<br />
• La syl<strong>la</strong>be est formée obligatoirement d’au moins une voyelle [a-mi], ou plusieurs<br />
consonnes [stʁikt]….etc.<br />
2
• En français, on dit qu’il y a autant des syl<strong>la</strong>bes que de sons vocaliques.<br />
• On distingue deux types de syl<strong>la</strong>bes :<br />
1- syl<strong>la</strong>be ouverte : une syl<strong>la</strong>be se terminant par une voyelle, ex. <strong>la</strong> deuxième syl<strong>la</strong>be<br />
dans [feʁ-me]<br />
2- syl<strong>la</strong>be fermée : une syl<strong>la</strong>be se terminant par une consonne ou un glide, ex. <strong>la</strong><br />
première syl<strong>la</strong>be dans [feʁ-me] ou dans [nuj].<br />
3. Les voyelles du français :<br />
• Les voyelles sont caractérisées selon <strong>la</strong> théorie des traits 1 par le trait [+/ - syl<strong>la</strong>bique]<br />
• Se qui différencie les voyelles les unes des autres, c'est <strong>la</strong> façon dont les résonateurs<br />
(principalement cavités buccale, <strong>la</strong>biale et nasale) entrent en jeu dans l'articu<strong>la</strong>tion du<br />
son.<br />
• Pour faire varier les sons vocaliques, on fait varier :<br />
a) le nombre des résonateurs : <strong>la</strong> cavité nasale par exemple (ou <strong>la</strong> cavité <strong>la</strong>biale) est<br />
impliquée ou pas.<br />
b) <strong>la</strong> forme du résonateur buccal en dép<strong>la</strong>çant <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
c) le volume du résonateur buccal en dép<strong>la</strong>çant <strong>la</strong> mâchoire et <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
• Les voyelles donc se distinguent selon quatre caractères ou sur quatre dimensions:<br />
1) Aperture :<br />
• Le volume du résonateur buccal se modifie en fonction du degré de l’ouverture de <strong>la</strong><br />
bouche (c.<strong>à</strong>.d. les mouvements de <strong>la</strong> mâchoire).<br />
2) Lieu d’articu<strong>la</strong>tion (le lieu de <strong>la</strong> masse de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue) :<br />
• La forme du résonateur buccal change en fonction de l’emp<strong>la</strong>cement de <strong>la</strong> masse de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue.<br />
3) Labialisation :<br />
• Qui se définit par <strong>la</strong> mise en fonction du résonateur <strong>la</strong>bial dont <strong>la</strong> forme se modifie en<br />
fonction de <strong>la</strong> position des lèvres.<br />
1 Le système de traits distinctifs est un système dans lequel chaque trait articu<strong>la</strong>toire/ acoustique est donné une<br />
valeur binaire (+/-). C’est un des bases de l’analyse phonologique. Cf. Jakobson, Fant et Halle (1951), Jakobson<br />
et Halle (1952) et Chomsky et Halle (1968).<br />
3
4) Nasalité :<br />
• La nasalité se définit par <strong>la</strong> mise en fonction du résonateur nasal et en fonction des<br />
cavités employées : orale ou nasale.<br />
Les quatre critères majeurs pour distinguer les voyelles :<br />
1. Aperture.<br />
2. Lieu de <strong>la</strong> masse de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
3. Labialisation.<br />
4. Nasalité.<br />
4. Les caractéristiques articu<strong>la</strong>toires des voyelles<br />
Chacune de ces variations possibles renvoie <strong>à</strong> des propriétés qui permettent de définir les<br />
voyelles :<br />
1) Le degré d’aperture de <strong>la</strong> mâchoire : Qui faire varier le degré d’aperture du canal buccal.<br />
• La position de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (et de <strong>la</strong> mâchoire) sur un axe verticale détermine le volume<br />
de <strong>la</strong> cavité orale et donc le degré de l’aperture de <strong>la</strong> voyelle.<br />
• Selon de degré d’aperture, les voyelles du français peuvent être c<strong>la</strong>ssées en voyelles<br />
fermées et voyelles ouvertes.<br />
• Il y a deux c<strong>la</strong>sses intermédiaires : voyelles mi-fermées et voyelles mi-ouvertes.<br />
• Se définissent selon le system de traits binaires par les traits suivants : [+/ - Haut], [+/-<br />
Bas]<br />
4
• Donc, en français, on distingue quatre degrés d’aperture :<br />
a- Voyelles fermées (hautes) : i, y, u [+ Haut, - Bas] « <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et le pa<strong>la</strong>is sont<br />
proches »<br />
b- Voyelles mi-fermées : e, ø, o [- Haut, - Bas]<br />
c- Voyelles mi-ouvertes : ε, œ, ᴐ [- Haut, + Bas] « <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et le pa<strong>la</strong>is sont éloignés »<br />
d- Voyelles ouvertes (basses) : a [- Haut, + Bas]<br />
Notamment, les voyelles mi-ouvertes et les voyelles basses se distinguent entre elles par les<br />
autres traits articu<strong>la</strong>toires, +/- Arrière, +/- Arrondie.<br />
Exercice :<br />
Prononcez les séries suivantes, en faisant attention <strong>à</strong> <strong>la</strong> distance entre votre <strong>la</strong>ngue et votre<br />
pa<strong>la</strong>is :<br />
i. [i e a]<br />
ii. [u o ɔ]<br />
iii. [y ø œ]<br />
a) Voyelle fermée (Haute)<br />
b) Voyelle ouverte (basse)<br />
Dans <strong>la</strong> série (i), <strong>la</strong> distance entre <strong>la</strong>ngue et pa<strong>la</strong>is est faible pour le [i], elle s'agrandit<br />
pour le [e] et devient très importante pour le [a].<br />
De même pour les séries (ii) et (iii), <strong>la</strong> cavité buccale s'ouvre de plus en plus au fur et <strong>à</strong><br />
mesure de <strong>la</strong> série.<br />
2) Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion (le lieu de <strong>la</strong> masse de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue):<br />
• les voyelles se définissent par un lieu d'articu<strong>la</strong>tion, c'est-<strong>à</strong> dire le lieu de<br />
rétrécissement maximal de <strong>la</strong> cavité buccale.<br />
5
• A <strong>la</strong> différence des consonnes, le lieu d'articu<strong>la</strong>tion des voyelles est moins « précis » et<br />
n'engage que 3 articu<strong>la</strong>teurs :<br />
1. articu<strong>la</strong>teurs supérieurs:<br />
<strong>–</strong> <strong>la</strong> partie postérieure du pa<strong>la</strong>is<br />
<strong>–</strong> <strong>la</strong> partie antérieure du pa<strong>la</strong>is<br />
2. articu<strong>la</strong>teur inférieur :<br />
<strong>–</strong> le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
• Les voyelles peuvent être c<strong>la</strong>ssées selon ce critère en voyelles antérieures, voyelles<br />
centrales et voyelles postérieures.<br />
• Elles se définissent selon le trait [+/ - Arrière]<br />
• Donc, en français, on distingue des :<br />
a- Voyelles antérieures : pour lesquelles <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue s’oriente vers l’avant.<br />
Ex. i, e, ɛ, y : [- Arrière]<br />
b- Voyelles postérieures : pour lesquelles <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue se masse <strong>à</strong> l’arrière de <strong>la</strong> cavité<br />
buccale. Ex. u, o, ᴐ : [+ Arrière]<br />
Exercice :<br />
a) Voyelle antérieur (pa<strong>la</strong>tale)<br />
b) Voyelle postérieur (vé<strong>la</strong>ire)<br />
Prononcez les séries suivantes en faisant attention <strong>à</strong> <strong>la</strong> position de votre <strong>la</strong>ngue, plus<br />
précisément en essayant de sentir si votre <strong>la</strong>ngue se masse plutôt vers l'avant ou l'arrière du<br />
pa<strong>la</strong>is :<br />
i. [y] [u] ([y] comme dans rue et [u] comme dans roux).<br />
ii. [ɛ] [ɔ]<br />
6
Dans <strong>la</strong> série (i), lorsque l'on prononce <strong>la</strong> voyelle [y], <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue s'oriente vers l'avant du<br />
pa<strong>la</strong>is, alors que pour <strong>la</strong> production de [u], <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est massée au fond de <strong>la</strong> bouche,<br />
vers l'arrière du pa<strong>la</strong>is.<br />
Dans <strong>la</strong> série (ii), <strong>la</strong> différence est un peu plus subtile, mais vous devez sentir que<br />
votre <strong>la</strong>ngue est plutôt dirigée vers l'avant du pa<strong>la</strong>is lors de <strong>la</strong> production de [ɛ]. Pour<br />
<strong>la</strong> voyelle [ɔ], votre <strong>la</strong>ngue se creuse un peu <strong>à</strong> l'avant et se masse en arrière. Les<br />
voyelles pour lesquelles <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est orientée vers l'avant du pa<strong>la</strong>is sont des voyelles<br />
antérieures (ou pa<strong>la</strong>tales), celles pour lesquelles <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue se masse <strong>à</strong> l'arrière sont<br />
des postérieures (ou vé<strong>la</strong>ires).<br />
Croisement des c<strong>la</strong>ssements selon le degré d'aperture et le lieu d'articu<strong>la</strong>tion :<br />
3) L’arrondissement des lèvres :<br />
• L'arrondissement est une propriété qui prend en compte <strong>la</strong> forme des lèvres.<br />
• Lorsque les lèvres sont arrondies <strong>la</strong> cavité <strong>la</strong>biale entre en jeu et l'air expiré y résonne.<br />
• Sur cette dimension, les voyelles sont c<strong>la</strong>ssées en voyelles arrondies ou voyelle nonarrondies<br />
(étirées).<br />
• Les voyelles se distinguent entre elles par le trait [+/ - Arrondie]<br />
• Donc, en français :<br />
a- Lorsque les lèvres sont arrondies : on parle des voyelles arrondies. Ex. u, o, ᴐ, y, ø,<br />
œ : [+ Arrondie]<br />
7
- Lorsque les lèvres ne sont pas arrondies (étirés) : on parle des voyelles non-arrondies<br />
(étirées). Ex. i, e, ɛ où les lèvres sont écartées : [- Arrondie]<br />
Exercice :<br />
Prononcez les séries suivantes en faisant attention <strong>à</strong> <strong>la</strong> position de vos lèvres :<br />
i. [i u]<br />
ii. [e œ]<br />
iii. [ɛ y]<br />
Dans chacune des séries, pour <strong>la</strong> production de <strong>la</strong> première voyelle, les lèvres sont<br />
re<strong>la</strong>tivement relâchées ou étirées (notamment pour [i]). La deuxième voyelle implique<br />
au contraire chaque fois un arrondissement des lèvres.<br />
4) La nasalité :<br />
• Le phénomène de <strong>la</strong> nasalité est identique pour les consonnes et pour les voyelles.<br />
• La position du vélum (et donc l’ouverture ou non du passage vélo-pharyngé)<br />
détermine <strong>la</strong> nasalité de <strong>la</strong> voyelle.<br />
• Les voyelles peuvent être c<strong>la</strong>ssées selon <strong>la</strong> nasalité en voyelles orales ou voyelles<br />
nasales.<br />
• Les voyelles se définissent selon le trait [+/ - Nasale]<br />
• Au carrefour du pharynx, le passage de l'air peut s'effectuer dans une ou deux<br />
directions, selon <strong>la</strong> position du voile du pa<strong>la</strong>is :<br />
8
a- Si le voile du pa<strong>la</strong>is est relevé, l'accès aux fosses nasales est bloqué, et l'air ne peut<br />
traverser que <strong>la</strong> cavité buccale et on obtient une voyelle orale. [- Nasal]<br />
b- Si le voile du pa<strong>la</strong>is est abaissé, une partie de l'air traversera les fosses nasales<br />
(l'autre partie poursuivant son chemin <strong>à</strong> travers <strong>la</strong> cavité buccale) et on obtient une<br />
voyelle nasale. [+ Nasal]<br />
• Il existe quatre voyelles nasales en français [ɛ̃, ɑ̃, ɔ̃, ]. On peut remarquer que chaque<br />
voyelle nasale correspond sensiblement <strong>à</strong> une voyelle orale. Ce<strong>la</strong> signifie qu'elles<br />
partagent les mêmes caractéristiques articu<strong>la</strong>toires (lieu d'articu<strong>la</strong>tion, degré<br />
d'aperture et arrondissement des lèvres), sauf celle de <strong>la</strong> nasalité.<br />
a- [ɛ] et [ɛ̃]<br />
b- [ɑ] et [ɑ̃]<br />
c- [ɔ] et [ɔ̃]<br />
d- [œ] et []<br />
Tableau récapitu<strong>la</strong>tif<br />
antérieures postérieures<br />
non-arrondies arrondies arrondies<br />
fermées i y u<br />
mi-fermées e ø o<br />
mi-ouvertes ε ε̃ œ œ̃ ᴐ ᴐ̃<br />
ouvertes a ɑ ɑ̃<br />
9
Schémas articu<strong>la</strong>toires des voyelles, d’après Bothorel et al. (1986)<br />
11
Le quadri<strong>la</strong>tère (trapèze) vocalique du français :<br />
13
Liens utiles :<br />
• The international phonetic association :<br />
http://www.<strong>la</strong>ngsci.ucl.ac.uk/ipa/ipa_redirects.php<br />
• Symbole sons et vidéos : http://ipa.group.shef.ac.uk/symbols.php<br />
• Illustrations sonore du « Handbook of the IPA » (nombreuses <strong>la</strong>ngues):<br />
http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/handbook.htm<br />
• Université Lausanne « Cours de <strong>phonétique</strong> » :<br />
http://www.unil.ch/ling/page12580.html<br />
• on peut écouter les sons :<br />
http://ipa.group.shef.ac.uk/dialog_main.php?num=48b&type=vowels<br />
• Daniel Currie Hall « Interactive Sagittal Section » :<br />
http://www.chass.utoronto.ca/~danhall/phonetics/sammy.html<br />
(site interactif où on peut faire bouger les organes du conduit vocal pour voir <strong>à</strong> quel<br />
son ça correspond)<br />
Bibliographie<br />
• Vaissière, J. (2006). La <strong>phonétique</strong>, Que sais-je ? No. 637, P.U.F.<br />
• Léon, P. (2007). Phonétisme et prononciation du français. Paris, Armand Colin.<br />
• Ladefoged, P. (2005). A course in phonetics, 5 th Ed. Thomson, Wadsworth publishers.<br />
• Landercy, A. et Renard, R. (1977). Eléments de <strong>phonétique</strong>, Bruxelle, Ed. Didier.<br />
14