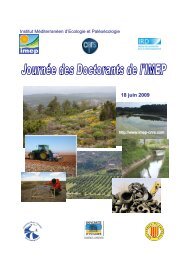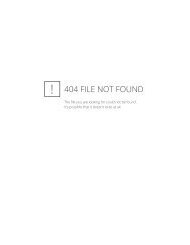TITRES ET TRAVAUX - IMEP
TITRES ET TRAVAUX - IMEP
TITRES ET TRAVAUX - IMEP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
conjointe du retrait glaciaire, de la vitesse de colonisation végétale et des changements de végétation<br />
seront entreprises à moyenne et à haute altitude.<br />
L'enregistrement le plus complet des changements climatiques qui sont intervenus entre 25 ka et<br />
10 ka BP, apparaît dans la séquence de Barbazan (Andrieu, 1991; Andrieu et al., 1993). La courbe du δ<br />
18 O de cette séquence témoigne de fluctuations climatiques parfaitement concordantes avec celles<br />
déduites de la séquence isotopique de Vostok (Jouzel, 1999): enregistrement synchrone de trois<br />
maximums de froid à 21, 18 et 15 ka cal. BP. Le maximum de 21 ka cal. BP est unanimement corrélé au<br />
"Last Glacial Maximum: LGM) par les paléoclimatologues. Certaines données continentales comme<br />
celles livrées par les Pyrénées (Andrieu et al., 1988) et les Alpes du nord (glacier du Rhône: Nicoud et al,<br />
1988 et travaux en cours) montrent qu'à cette date, les glaciers würmiens étaient déja bien en retrait de<br />
leurs moraines frontales. De nouvelles recherches ont démarré (F. Guiter, thésard <strong>IMEP</strong>) sur le complexe<br />
morainique et glaciolacustre qui borde la rive sud du lac Léman, en partenariat avec les géologues<br />
quaternaristes de l'Université de Chambéry afin de caractériser plus finement les dynamiques conjointes<br />
de retrait de la langue glaciaire du Rhône, et de colonisation végétale des terres libérées des glaces.<br />
Dans les Pyrénées méditerranéennes, des études conjuguées du contenu en pollen, macrorestes<br />
végétaux et d'insectes de sites étagés entre 1500 m et 2000 m d'altitude sont menées à bien dans le but de<br />
retracer les variations altitudinales de la limite supérieure de la forêt à partir de 15 ka BP. Les<br />
séquences étudiées proviennent de deux vallées glaciaires: 1) la vallée de la Têt (site de La Borde, Ponel<br />
et al., 1999, et du Racou, Guiter et al., 2000 et soumis à J.Q.S.); 2) la vallée de la Bruyante (sites de<br />
Soucarade et de La Restanque, Reille et Andrieu, 1993). De nouvelles recherches associant une approche<br />
palynologique et entomologiques (P. Ponel) ont été entreprises sur un profil prélevés à La Restanque. La<br />
publication du résultat de ces travaux est prévue courant 2003.<br />
Le pourtour méditerranéen: la Provence et l'Afrique du nord<br />
Le principal objectif des travaux que nous avons entrepris en Méditerranée occidentale est<br />
d'estimer la part de responsabilité de l'Homme et celle du climat dans la structuration des végétations<br />
méditerranéennes actuelles. L'étude croisée du contenu pollinique et en sclérites d'insectes a été<br />
entreprise sur plusieurs profils choisis dans l’axe rhodanien (La Calade, Andrieu-Ponel et al, 2000,<br />
Marais des Baux, Andrieu-Ponel et al, 2000, Courthézon, Andrieu et al., 1997, La Camargue) et dans le<br />
Centre-Var (Tourves, Andrieu-Ponel et Ponel, 1999). Ces données biologiques montrent que la précocité<br />
et l'intensité de la pression humaine sur les écosystèmes forestiers méditerranéens sont à l'origine de la<br />
physionomie du paysage actuel et de l'explosion de la diversité taxonomique des communautés<br />
végétales et d'insectes. La séquence de la Calade, dont la base est contemporaine de l'arrivée des<br />
premières communautés gréco-romaine en terres provençales, montre qu'il y a 2000 ans, le paysage était<br />
aussi déforesté que de nos jours. Dans la séquence des Baux, le fait le plus remarquable concerne<br />
l'enregistrement d'un épisode forestier contemporain de l'Atlantique au sein duquel la sapinière ainsi que<br />
la hêtraie jouaient un rôle de premier plan à basse altitude. La sapinière à Buxus étaient également<br />
une des composantes principales du paysage provençal comme l'indiquent les assemblages polliniques de<br />
la séquence littorale de Berre (Andrieu, non publié) dont la base est d'un âge antérieur à 36 ka BP.<br />
En Afrique du nord, l'histoire de la végétation n'est connue que dans ses grands traits. Une des<br />
séquences polliniques les plus remarquables est celle de Garrat El Ouez (marais d'El Kala, N.E. algérien),<br />
datée de 16 ka à la base, qui témoigne de l'existence de forêts de cèdres pendant le Tardiglaciaire, dans<br />
une région qui, de nos jours, en est totalement dépourvue. Les occurrences de hêtre enregistrées à la<br />
même époque pourraient être le signe de l'extension passée de la hêtraie, actuellement absente<br />
d'Afrique du nord. Ces nouvelles études ont été entreprises en collaboration avec M. Reille et M.<br />
Benslama, l'initiateur de ces travaux (Benslama et al., 1999; Benslama et al., en cours). D'autres<br />
recherches paléoécologiques seront menées à bien dans l'ensemble de l'Afrique du nord, au Maroc en<br />
particulier.<br />
Le Massif Central<br />
Le Velay constitue l'un des ateliers les plus remarquables pour l'étude des anciens<br />
environnements. L'histoire de la végétation et des changements climatiques des 450 000 dernières<br />
5