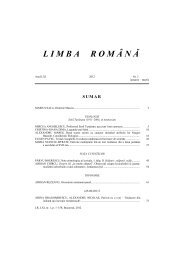cependant, toutefois, pourtant
cependant, toutefois, pourtant
cependant, toutefois, pourtant
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
18<br />
Christiane Marchello-Nizia 12<br />
polarité négative : ‘ce n’est pas pour cela que…’, ‘malgré cela’, en phrase négative.<br />
Non<strong>pourtant</strong> est bien un connecteur, car contrairement à <strong>pourtant</strong> il ne fait pas<br />
partie du prédicat verbal, il exprime une relation entre les deux énoncés, il pourrait<br />
se traduire par ‘Cela n’a servi à rien’ :<br />
24. …si les accuilly une maladie, de laquelle morurent la plus grant partie de<br />
eaux. Non <strong>pourtant</strong> li sires de Caraintaine ne les laissoit pas sejourner ne perdre<br />
temps, ains les prenoit et aloit sovent courre et gaaignier sur sez anemis. (Chronique<br />
de Morée 1320-24 : p.194 : ‘Une maladie les frappa, dont la plus grande partie<br />
moururent. Cette cause n’a pas été efficace/Malgré cela le seigneur de Carantaine ne<br />
les laissait pas se reposer…’)<br />
Puis, dans une seconde phase, non<strong>pourtant</strong> apparaît également en phrase non<br />
négative, et alors il exprime, non plus la cause inefficace, mais la concession, dès<br />
début 15 e s. :<br />
25. Et la tresbelle Katherine estoit de mal tant oppressée, voyant et oyant la<br />
desloyauté de celuy qu' elle amoit plus que tout le monde, qu' elle se souhaitoit<br />
morte. Non <strong>pourtant</strong> elle adossa la teneur feminine, et s' adouba de virile vertu. Car<br />
elle eut bien la constance de longuement et largement lendemain deviser avecques<br />
celle qui luy faisoit tort..(Cent nouvelles nouvelles, 1460, p. 178 : ‘Et la belle<br />
Catherine était si malheureuse en constatant la déloyauté de celui qu’elle aimait plus<br />
que tout au monde, qu’elle souhaitait la mort. Cependant/Malgré cela elle tourna le<br />
dos à cette attitude féminine et adopta un courage viril…’)<br />
7.4. Pourtant concessif : dernier quart du 16 e s.<br />
Mais cette nouveauté, ce morphème négatif, ne subsiste pas. En revanche,<br />
<strong>pourtant</strong> commence à développer lui aussi le même emploi de connecteur et la<br />
même valeur concessive que non<strong>pourtant</strong>, mais sans préfixe négatif :<br />
26. Vous faschez vous des mots de camps / Il faudra <strong>pourtant</strong> esprouver /<br />
Tous les moyens pour pais trouver. (Jodelle, Eugène: daté par FEW 1538, mais<br />
Jodelle né en 1532 : date Frantext : 1573)<br />
Selon Gaudin, Salvan et Mellet (2008 : 104), Montaigne est l’un des premiers<br />
à employer à peu près aussi souvent <strong>pourtant</strong> causal et <strong>pourtant</strong> concessif, c’est à<br />
dire introduisant une conséquence inattendue (ou plutôt l’inverse de la conséquence<br />
attendue) et non plus spécifiant qu’une certaine cause est inopérante :<br />
29. Nostre poëte represente un mariage plein d'accord et de bonne<br />
convenance, auquel <strong>pourtant</strong> il n'y a pas beaucoup de loyauté. (Montaigne, Essais, I,<br />
1592 : ‘Notre poète met en scène un mariage harmonieux et convenable, d’où<br />
<strong>cependant</strong> la loyauté est absente’ )<br />
Dès le second tiers du 17 e s., l’évolution est presque achevée, et <strong>pourtant</strong><br />
concessif domine (Montchestien, Sorel, Guez de Balzac, Mersenne, Corneille…).