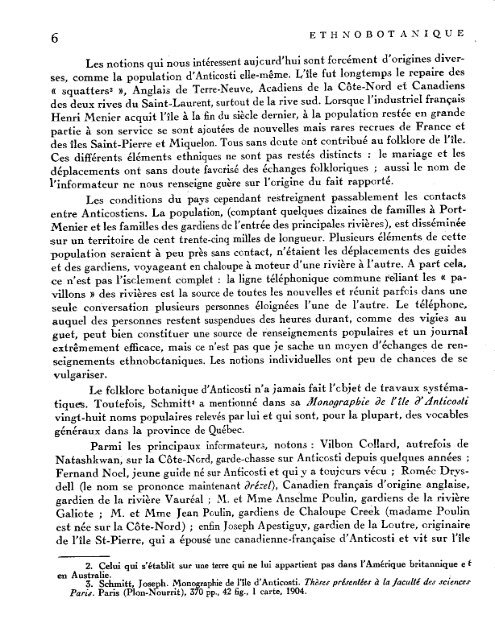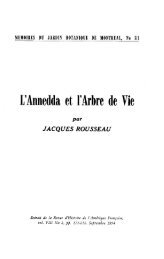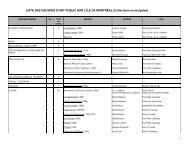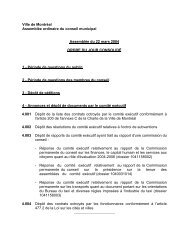NOTES SUR L'ETHNOBOTANIQUE D'ANTICOSÃT - Ville de Montréal
NOTES SUR L'ETHNOBOTANIQUE D'ANTICOSÃT - Ville de Montréal
NOTES SUR L'ETHNOBOTANIQUE D'ANTICOSÃT - Ville de Montréal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6 ETHXOBOTANIQUELes notions qui nous intéressent aujourd'hui sont forcément d'origines diverses,comme la population d'Anticosti elle-même. L'île fut longtemps le repaire <strong>de</strong>s« squatters3 », Anglais <strong>de</strong> Terre-Neuve, Acadiens <strong>de</strong> la Côte-Nord et Canadiens<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux rives du Saint-Laurent, surtout <strong>de</strong> la rive sud. Lorsque l'industriel françaisHenri Menier acquit l'île à la fin du siècle <strong>de</strong>rnier, à la population restée en gran<strong>de</strong>partie à son service se sont ajoutées <strong>de</strong> nouvelles mais rares recrues <strong>de</strong> France et<strong>de</strong>s îles Saint-Pierre et Miquelon. Tous sans doute ont contribué au folklore <strong>de</strong> l'île.Ces différents éléments ethniques ne sont pas restés distincts : le mariage et lesdéplacements ont sans doute favorisé <strong>de</strong>s échanges folkloriques ; aussi le nom <strong>de</strong>l'informateur ne nous renseigne guère sur l'origine du fait rapporté.Les conditions du pays cependant restreignent passablement les contactsentre Anticostiens. La population, (comptant quelques dizaines <strong>de</strong> familles à PortjMenieret les familles <strong>de</strong>s gardiens <strong>de</strong> l'entrée <strong>de</strong>s principales rivières), est disséminéesur un territoire <strong>de</strong> cent trente-cinq milles <strong>de</strong> longueur. Plusieurs éléments <strong>de</strong> cettepopulation seraient à peu près sans contact, n'étaient les déplacements <strong>de</strong>s gui<strong>de</strong>set <strong>de</strong>s gardiens, voyageant en chaloupe à moteur d'une rivière à l'autre. A part cela,ce n'est pas l'isolement complet : la ligne téléphonique commune reliant les « pavillons» <strong>de</strong>s rivières est la source <strong>de</strong> toutes les nouvelles et réunit parfcis dans uneseule conversation plusieurs personnes éloignées l'une <strong>de</strong> l'autre. Le téléphone,auquel <strong>de</strong>s personnes restent suspendues <strong>de</strong>s heures durant, comme <strong>de</strong>s vigies auguet, peut bien constituer une source <strong>de</strong> renseignements populaires et un journalextrêmement efficace, mais ce n'est pas que je sache un moyen d'échanges <strong>de</strong> renseignementsethnobotaniques. Les notions individuelles ont peu <strong>de</strong> chances <strong>de</strong> sevulgariser.Le folklore botanique d'Anticosti n'a jamais fait l'cbjet <strong>de</strong> travaux systématiques.Toutefois, Schmitt3 a mentionné dans sa Monographie d e l'île d'Anticoôtivingt-huit noms populaires relevés par lui et qui sont, pour la plupart, <strong>de</strong>s vocablesgénéraux dans la province <strong>de</strong> Québec.Parmi les principaux informateurs, notons : Vilbon CoIIard, autrefois <strong>de</strong>Natashkwan, sur la Côte-Nord, gar<strong>de</strong>-chasse sur Anticosti <strong>de</strong>puis quelques années ;Fernand Noël, jeune gui<strong>de</strong> né sur Anticosti et qui y a toujours vécu ; Roméc Orvs<strong>de</strong>llQe nom se prononce maintenant drézel), Canadien français d'origine anglaise,gardien <strong>de</strong> la rivière Vauréal ; M. et Mme Anselme Poulin, gardiens <strong>de</strong> la rivièreGaliote ; M. et Mme Jean Poulin, gardiens <strong>de</strong> Chaloupe Creek (madame Poulinest née sur la Côte-Nord) ; enfin Joseph Apestiguy, gardien <strong>de</strong> la Loutre, originaire<strong>de</strong> l'île St-Pierre, qui a épousé une canadienne-française d'Anticosti et vit sur l'île2. Celui qui s'établit sur une terre qui ne luî appartient pas dans l'Amérique britannique e ten Australie.3. Schmitt, Joseph. Monographie <strong>de</strong> l'île d'Anticosti. Thèses présentées à tajaculté <strong>de</strong>s sciencesParis. Paris (Plon-Nourrît), 370 pp., 42 fig-, 1 carte, 1904.