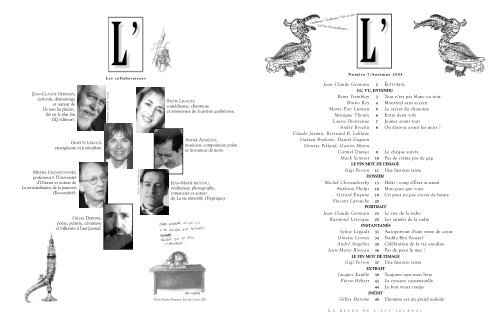Jean-Claude Germain Rémy Tremblay Bruno Roy ... - L'Aut'Journal
Jean-Claude Germain Rémy Tremblay Bruno Roy ... - L'Aut'Journal
Jean-Claude Germain Rémy Tremblay Bruno Roy ... - L'Aut'Journal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JEAN-CLAUDE GERMAIN,<br />
écrivain, dramaturge<br />
et auteur de<br />
De tous les plaisirs,<br />
lire est le plus fou<br />
(IQ éditeur).<br />
MICHEL CHOSSUDOVSKY,<br />
professeur à l’Université<br />
d’Ottawa et auteur de<br />
La mondialisation de la pauvreté<br />
(Écosociété).<br />
GINETTE LEROUX,<br />
enseignante et journaliste.<br />
GILLES DEROME,<br />
poète, peintre, céramiste<br />
et billetiste à l’aut’journal.<br />
Les collaborateurs<br />
PHOTO : JEAN-GUY THIBODEAU<br />
PHOTO : SIMON FERLAND<br />
SYLVIE LEGAULT,<br />
comédienne, chanteuse<br />
et amoureuse de la poésie québécoise.<br />
ANDRÉ ANGÉLINI,<br />
musicien, compositeur, poète<br />
et inventeur de mots.<br />
JEAN-MARIE BIOTEAU,<br />
réalisateur, photographe,<br />
romancier et auteur<br />
de La vie immobile (Tryptique).<br />
Tiré de Bande d’humains, L’oie de Cravan 2003<br />
Guillemet ! Guillemet ! Est-ce que<br />
j’ai l’air d’un guillemet ?<br />
<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong><br />
<strong>Rémy</strong> <strong>Tremblay</strong><br />
<strong>Bruno</strong> <strong>Roy</strong><br />
Marie-Pier Luneau<br />
Monique Thouin<br />
Louise Bienvenue<br />
André Brochu<br />
<strong>Claude</strong> Jasmin, Bertrand B. Leblanc<br />
Gaëtan Brulotte, Daniel Gagnon<br />
Ginette Pelland, Gaston Miron<br />
Carmel Dumas<br />
Mack Sennett<br />
Numéro 7/Automne 2004<br />
Jacques Keable<br />
Pierre Hébert<br />
ÉDITORIAL<br />
Tout n’est pas blanc ou noir<br />
Montreal sans accent<br />
Le secret du chanoine<br />
Entre deux vols<br />
Jeunes avant tout<br />
Où étais-je avant les mots ?<br />
9 Le chèque suivra<br />
10 Pas de crème pas de gag<br />
LE FIN MOT DE L’IMAGE<br />
Gigi Perron 11 Une histoire triste<br />
DOSSIER<br />
Michel Chossudovsky 13 Haïti : coup d’État as usual<br />
Anthony Phelps 18 Mon pays que voici<br />
Gérard Étienne 19 Cri pour ne pas crever de honte<br />
Vincent Larouche 20<br />
PORTRAIT<br />
<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong> 23 Le rire de la radio<br />
Raymond Lévesque 25 Les années de la radio<br />
INSTANTANÉS<br />
Sylvie Legault 33 Autoportrait d’une reine de coeur<br />
Ginette Leroux 34 Nadila Ben Youssef<br />
André Angélini 35 Célébration de la vie anodine<br />
<strong>Jean</strong>-Marie Bioteau 36 Pas de peau le mec !<br />
LE FIN MOT DE L’IMAGE<br />
Gigi Perron 37 Une histoire triste<br />
Toujours sans mon livre<br />
La censure consensuelle<br />
Le bon vieux temps<br />
INÉDIT<br />
Gilles Derome 45 L’homme est un grand malade<br />
L A R E V U E D E L ’ A U T’ J O U R N A L<br />
2<br />
LU, VU, ENTENDU<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
EXTRAIT<br />
39<br />
43<br />
44
LES COLLABORATEURS<br />
Renaud <strong>Germain</strong> • Michel Chossudovsky<br />
<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong> • Raymond Lévesque<br />
Sylvie Legault • André Angélini<br />
Vincent Larouche • Ginette Leroux<br />
<strong>Jean</strong>-Marie Bioteau • Gilles Derome<br />
L’Apostrophe, 3575 boul. Saint-Laurent,<br />
bureau 117, Montréal, Québec, H2X 2T7<br />
Tél. : (514) 843-5236<br />
Télécopieur : (514) 849-0637<br />
Courriel : info@lautjournal.info<br />
ÉDITEUR<br />
Éditions du renouveau québécois<br />
DIRECTEUR<br />
Pierre Dubuc<br />
RÉDACTEUR EN CHEF<br />
<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong><br />
SECRÉTAIRE À LA RÉDACTION<br />
Ginette Leroux<br />
DIRECTION ARTISTIQUE<br />
ET ILLUSTRATION DE LA PAGE COUVERTURE<br />
Olivier Lasser<br />
INFOGRAPHIE<br />
Réjean Mc Kinnon<br />
RÉVISION ET CORRECTION<br />
Jacques Serge<br />
COMITÉ DE RÉDACTION<br />
André Bouthillier, Gaëtan Breton,<br />
Ginette Guindon, Jacques Pelletier,<br />
Paul Rose<br />
IMPRESSION<br />
Alliance des professeures<br />
et professeurs de Montréal<br />
DISTRIBUTION<br />
Messageries de presse Benjamin<br />
9600 <strong>Jean</strong>-Milot, La Salle<br />
(514) 364-1780<br />
Dépôt légal: Bibliothèque du Québec<br />
Périodicité: 4 numéros par année<br />
(automne, hiver, printemps, été)<br />
ISSN: 1496-7537<br />
N o de convention postale: 1923722<br />
Numéro 7/Automne 2004<br />
LA REVUE DE L’AUT’JOURNAL<br />
2 • L’ A P O S T R O P H E<br />
La revanche des faire-valoir<br />
À la radio et à la télé, les intervieweurs sont de plus en plus saisis d’une grande<br />
torpeur intellectuelle. Depuis toujours, les interviewés ont été réquisitionnés pour<br />
fournir le matériau brut. En somme, ils sont la ressource naturelle. C’est la loi de la<br />
mise en marché du génie, du talent ou de la simple notoriété.<br />
Pour produire de la bonne copie ou être réinvités sur les ondes et au petit écran,<br />
les interviewés se doivent de renouveler périodiquement leur stock d’anecdotes et<br />
être prêts à lancer un regard amusé ou décapant sur tout et sur rien, bref à en mettre<br />
plein la vue comme un feu d’artifice. Mais encore faut-il que l’intervieweur ou l’intervieweuse<br />
soient à tout le moins des bons faire-valoir.<br />
Imaginez un straight postmoderne qui après chaque gag d’un Olivier Guimond ou<br />
d’un Gilles Latulippe demanderait au comique d’apprécier la qualité du rire qu’il vient<br />
d’obtenir et ensuite de le comparer à ceux qu’il a obtenus la veille avec le même gag.<br />
Est-ce que le public du mardi est plus réceptif que celui du vendredi ? Qu’est-ce qui<br />
se passe lorsque le public ne rit pas ? Est-ce que ça vous affecte ? On voit déjà la pluie<br />
de tartes à la crème qui s’abat sur le pauvre straight postmoderne, sans compter deux<br />
ou trois coups de pied au cul à l’ancienne.<br />
Malheureusement les interviewés ne jouissent pas de l’impunité des comiques et<br />
doivent se prêter à cette nouvelle mode de l’autocritique qui s’est emparée de la radio<br />
et de la télé. À une nouvelle vedette minute de Star Académie, on demande illico :<br />
Croyez-vous que la gloire va vous changer ? Il faudrait lui laisser le temps ! À l’ancienne<br />
gloire qui connaît un regain de popularité : Comment avez-vous vécu vos longues<br />
années d’insuccès ? Encore plus mal que vous ne pourriez l’imaginer ! Ou la classique :<br />
Comment expliquez-vous le succès imprévu de votre dernier disque ? Il était imprévu !<br />
Sans oublier : Qu’est-ce que vous avez pensé deux secondes avant d’entrer en scène ?<br />
Oh, mon dieu ! j’ai laissé mes phares de voiture allumés ! et la pièce dure deux heures<br />
sans entracte. Croyez-vous que vous allez être la même personne après avoir interprété<br />
ce rôle éprouvant ? Le plus éprouvant est d’être identifié au personnage ! Ou tout<br />
bêtement : Pourquoi avez-vous accepté ce rôle à ce moment précis de votre carrière ? Et la<br />
seule réponse que l’acteur pourrait honnêtement donner est qu’on le lui a offert précisément<br />
au moment où il s’était résigné à accepter que le téléphone ne sonnerait plus<br />
jamais.<br />
Peu leur importe qu’ils soient le cinquième ou le huitième choix, les acteurs<br />
comme les actrices ne jouent que les rôles qu’on leur offre aussi bien à la scène qu’à<br />
la télé ou au cinéma. C’est la loi de leur métier. Mais ils seront beaux joueurs, c’est la<br />
deuxième loi de leur profession : savoir mentir vrai. L’acteur racontera qu’il a beaucoup<br />
hésité avant d’accepter un rôle aussi exigeant sur le plan émotif. Il avait peur de<br />
ne pas être à la hauteur mais le réalisateur a apaisé ses doutes lorsqu’il lui a dit : Je ne<br />
vois personne d’autre dans le rôle ! C’est toi ou Alain Delon ! Et Delon coûtait trop cher !<br />
Ça fait rire et ça fait une bonne entrevue.<br />
La troisième loi est un précepte : le jeu est la seule vérité des comédiens. Pour<br />
interpréter un jeune Juif hanté par le souvenir de l’Holocauste dans Marathon Man,<br />
Dustin Hoffman s’était préparé, documenté, entraîné à la manière de l’Actors’Studio,<br />
mais il n’arrivait pas à comprendre comment Laurence Olivier pouvait littéralement<br />
se transformer sous ses yeux en l’incarnation du mal absolu qu’était son personnage<br />
inspiré de l’infâme docteur Mengele. Qu’est-ce que vous faites que je ne fais pas ? lui<br />
demande Hoffman. Et ce bon vieux Larry de lui répondre<br />
avec un brin d’ironie : Have you tried acting ?<br />
Toute vérité n’est pas psychologique : pour<br />
les comédiens, le jeu est la réponse ultime,<br />
l’acte, pas le commentaire.<br />
JEAN-CLAUDE GERMAIN<br />
BENJAMIN RABIER<br />
appliquer un onguent. Et la nuit est faite pour dormir. Il y a<br />
une façon de placer sa tête sur l’oreiller qui vous permet de<br />
ne pas entendre battre votre cœur. Toutes les horloges sont<br />
macabres.<br />
Une éraflure faite en jouant est automatiquement désinfectée<br />
avec du peroxyde, badigeonnée de mercurochrome<br />
rouge et couverte d’une bande aide, on dit aussi d’un diachylon<br />
résolutif. L’enfant d’un médecin n’a pas à lire le dictionnaire<br />
médical. La pharmacie familiale se renouvelle constamment.<br />
Une égratignure est traitée à l’iode, c’est brun et ça<br />
chauffe plus. Pendant une épidémie, lorsque les microbes<br />
courent le monde dans notre direction, toujours dans notre<br />
direction, les microbes du rhume, du rhume de cerveau, de<br />
l’influenza ou de la fièvre des foins – nommez-les ! – une petite<br />
lampe brûle sous une petite assiette de métal contenant un<br />
liquide noir. Son odeur bénéfique se répand et la maison sent<br />
l’iode et le camphre. Mais c’est dangereux pour les incendies<br />
: Faites attention au feu !<br />
Il est mal vu d’éternuer. Mettez vos mains devant votre<br />
bouche ! Nous portons en plus, attachées à notre camisole,<br />
nos médailles bénites. Saint Christophe n’a pas encore été<br />
destitué du martyrologe et il fait bien son travail. L’hiver, une<br />
fois par semaine, lorsque la grippe est mauvaise, les quatre<br />
enfants en caleçons s’étendent sur un grand lit avec des<br />
lunettes noires opaques pour s’exposer aux radiations mauves<br />
des rayons ultraviolets. Un privilège qui nous fait l’affreuse<br />
tête du Yves Montand de L’Aveu.<br />
Lorsque leur père est à la maison, les enfants ne vont pas<br />
à la toilette parce qu’il pose toujours un diagnostic et le plus<br />
souvent défavorable. Qui est allé à la selle ? C’est trop jaune,<br />
noir, vert. C’est trop. C’est trop dur, clair, mou. Ça sent acide<br />
ou amer. Ça a même un âge : c’est jeune, c’est vieux. Ça sent<br />
trop, pas assez. Notre père est un expert implacable. Il y a des<br />
parfums tenaces qui s’accrochent et il y en a des fuyants qui<br />
disparaissent aussitôt. Il faut savoir distinguer entre un parfum,<br />
une odeur et une fadeur. La fragrance est un piège dans<br />
tous les cas.<br />
CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN<br />
POUR UNE DOSE PLUS FORTE<br />
Il faut connaître ses couleurs. Vivre sans laisser de trace<br />
ni pour l’œil, le nez ou l’oreille. Tu manges trop vite ! Tu ne<br />
mâches pas assez ! Tu bois de l’eau en mangeant ! C’est interdit.<br />
Tu te couches trop tard ! Tu as le teint cendreux ! Ta langue est<br />
blanche ! Tes dents sont jaunes ! Une rousseur rose Winsor et<br />
Newton n’est pas garance rose d’Alizarine et tout dépend de la<br />
grandeur de la tache et du membre sur lequel elle apparaît.<br />
Tes cheveux ne sont pas souples ! La lunule de ton index droit<br />
est mince, il faut boire plus de lait ! Tu cours trop ! Tu te promènes<br />
sous la pluie sans imperméable !Tu marches dans l’eau ! Tu as<br />
trop chaud en jouant ! Tu te tiens mal : ta colonne ! Tu forces<br />
trop : ton hernie ! Tiens ta tête droite ! Ne gratte pas ! Si tu as un<br />
orgelet, c’est parce que tu touches à ton œil avec tes mains sales !<br />
Ne crie pas : ta voix ! Attention aux<br />
bruits : tes oreilles ! Attention à la poussière<br />
: tes bronches ! Qu’est ce qui<br />
reste ?<br />
Je me souviens d’avoir eu sur<br />
la fesse droite un clou que j’ai eu le<br />
malheur de déclarer. J’en porte<br />
encore les marques. Mon grand-père<br />
m’a enroulé dans une grande serviette de<br />
bain mouillée. Le lendemain, ils étaient douze. Il les a crevés,<br />
un à un, pendant les dix jours que j’ai passé au lit. Parce qu’il<br />
est méthodiquement consciencieux, il se lave les mains avant<br />
de presser mes furoncles, inexorablement.<br />
Celui qui tousse une fois doit se mettre un thermomètre<br />
sous la langue et faire attention de ne pas le croquer, comme<br />
une hostie, à cause du mercure qu’il contient, qui est mortel.<br />
Le seul métal que je connais est un poison. La Suractiflore est<br />
une déesse pilule qui se transforme en suppositoire au besoin.<br />
Elle varie ses couleurs et ses formes et ses textures à l’infini.<br />
Je n’ai jamais su si la belle fille du tableau de Renoir est nourrie,<br />
elle aussi, aux suppositoires. Elle est pétante de santé. Je<br />
ne sais pas qui prend sa pression ? Qui lui regarde la pupille<br />
de l’œil ou le creux de l’oreille avec sa lampe ? Qui lui tape<br />
le genou avec un petit marteau ? Qui lui cherche les ganglions<br />
? Qui lui met un stéthoscope froid dans le dos ?<br />
Celui qui tousse encore une fois a droit à la piqûre. Un<br />
enfant fort ne se plaint pas. Il a de la veine. Un liquide froid<br />
aseptise la peau et aujourd’hui ce sera le bras gauche ou le<br />
droit ou la fesse droite et la gauche. L’espace à trous ne<br />
manque pas. Il vaut mieux ne pas faire de fièvre.<br />
Si vous toussez une troisième fois, c’est la radiographie.<br />
Dans son bureau, mon père utilise un équipement, une boîte<br />
à inquisition qui date du Moyen Âge par le style. Tout cependant<br />
fonctionne. Je compte les os d’un enfant de trois ans.<br />
J’apprend à les nommer. C’est ma première photo bébé. Pour<br />
reproduire l’image d’un os, l’élève partira d’une construction préliminaire<br />
simplifiée. Ce travail le conduira, presque à son insu, à<br />
dessiner l’os sous sa forme exacte et dans sa structure anatomique.<br />
(Chez l’éditeur Masson, le 25 janvier 1927, 10 F.) Mon père<br />
développe ses grands négatifs dans des cuves aménagées dans<br />
un vieux bain. La lumière, dans l’antre du sorcier, est jaune<br />
et un vieux réveil fait résonner son tic-tac de ferraille durant<br />
toute l’opération. Je ne vois pas mes sœurs et mon frère nus<br />
; je vois à travers. Comment aimer un os ?<br />
Nous ne sommes pas beaux comme les Courbet de la<br />
plaquette illustrée de la Galerie Rosenberg qui vend des pilules<br />
pour calmer vos nerfs et des œuvres d’art pour les exciter.<br />
Nous sommes maigres comme les Saints<br />
Suaires mexicains du grand livre de<br />
la tuberculose purulente. La vie<br />
n’est que prêtée. Si l’effet de la<br />
Suractiflore n’est pas immédiat,<br />
consultez votre médecin à nouveau.<br />
Il saura vous recommander<br />
une dose plus forte.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 7
dage sur le côté gauche de la tête. On<br />
m’explique que je suis tombé sur un<br />
des coins de mon carré de sable. Il<br />
me semble que je vois encore mon<br />
petit habit blanc et jaune taché de<br />
sang. Les personnes qui m’entourent<br />
ont l’air heureux de me voir<br />
sain et sauf. Je me sens comme un<br />
visiteur qui revient de loin.<br />
Vous allez dire : Le grand-père chirurgien et les deux oncles<br />
médecins au chevet d’un enfant qui n’a perdu conscience que<br />
quelques instants, c’est un peu trop ! Eh bien non, vous vous<br />
méprenez. J’ai été élevé par un père médecin, fils de chirurgien,<br />
et par une mère, fille de médecin, et par deux oncles<br />
médecins dont l’un était marié à une garde-malade et par un<br />
grand-oncle chirurgien dont le fils aîné était orthopédiste, un<br />
autre grand-oncle dentiste et un troisième vétérinaire.<br />
Mon éditeur me dit : Enlevez ces deux ou trois médecins !<br />
même un roman y perdrait toute vraisemblance. Je n’en ferai<br />
rien. La consultation dans la famille n’était pas seulement fréquente<br />
mais régulière et obligatoire. On ne faisait que ça. On<br />
ne disait pas bonjour. On disait : Tu as bon teint ! tu as le nez<br />
embarrassé ! tu as la main moite ! Comment vas-tu ?<br />
Mon enfance se déroule dans une atmosphère antituberculeuse.<br />
À Sainte-Agathe où je passe mes vacances, il y a<br />
plusieurs sanatoriums. La fin de semaine, pour me désennuyer,<br />
il m’arrive souvent d’accompagner mon père qui sert<br />
de chauffeur à mon grand-père pour visiter un malade au<br />
mont Sinaï, le sanatorium juif. Les tuberculeux Canadiens<br />
français pour leur part sont soignés dans un sanatorium de<br />
langue anglaise. Sans doute parce qu’il est souvent trop tard<br />
pour les guérir et que pour faire comprendre qu’on ne veut<br />
pas mourir, il n’est pas nécessaire de le faire dans sa langue.<br />
Les prières récitées devant les mourants sont toutes en latin.<br />
Rendu là ça sert à quoi une langue ? Au ciel, toutes les langues<br />
sont comprises même si on les massacre parce qu’on en<br />
EN PLUS DE MON GRAND-PÈRE,<br />
MON PÈRE ET DEUX DE MES ONCLES<br />
SONT TOUS MÉDECINS<br />
ignore les règles. Dieu est le seul être qui ne donne jamais de<br />
dictées. Incapable de faire des fautes d’inattention, il ne fait<br />
que des fautes voulues et ne se sent pas tenu de parler exclusivement<br />
la langue de la majorité.<br />
Dans la voiture, au retour de la visite aux sanatoriums,<br />
je me souviens que, tout le long du trajet, il est beaucoup<br />
question d’hygiène, de microbes et de secours direct.<br />
Aujourd’hui, le secours est indirect et moins humiliant. La<br />
Suractiflore calme toutes les frayeurs. Elle vous aide à l’occasion<br />
à vous transformer. Elle rejoint l’intention de celui qui<br />
dessine : métamorphoser une passion en une seule ligne. Se<br />
vouloir une esquisse. Se garder léger comme un trait,<br />
4 6 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Suractiflore<br />
QUI PRENDRA LA PRESSION DE LA BELLE<br />
FILLE DU TABLEAU DE RENOIR ?<br />
inachevé, presque inexistant. Chercher un bonheur fugitif et<br />
linéaire. Se dissocier de son plaisir. S’amuser dans son carré<br />
de sable comme le petit saint jésuite exemplaire qui joue<br />
maintenant à la balle. Vivre de son âme, généreusement, sans<br />
épaisseur. Ne pas mépriser son corps qui en se déformant trop<br />
cesse de vous informer. Qui fait l’ange ! L’endormir à petites<br />
doses répétées, l’éteindre. Devenir une épure de soi.<br />
S’amortir. L’accoutumance n’est pas automatique et la<br />
Suractiflore est légèrement mortifiante.<br />
Le midi et le soir, avant les repas, les quatre enfants que<br />
nous étions se plaçaient sur une seule ligne afin de prendre<br />
leur capsule de foie de morue et leur abécédaire de vitamines<br />
qui contenaient les sulfates, sulfures, sels et autres minéraux<br />
de A à Z, nécessaires à notre croissance et à notre excroissance.<br />
Et la cuillerée de sirop qu’il fallait avaler sans la goûter.<br />
C’est le rituel de l’indifférence. L’idée de discuter ne nous<br />
vient même pas à l’esprit. Ce que notre mère met dans notre<br />
assiette non plus. Notre mère sait ce qui est bon pour nous :<br />
la sorte de légumes qu’il faut manger ce jour-là, plutôt trois<br />
que deux, et la quantité. Le protestataire est condamné à l’avance.<br />
Nous avons toujours faim et autant que notre mère le<br />
dit.<br />
Nous n’avons pas mal au ventre ou à la tête. Il ne faut<br />
pas roter, il ne faut pas péter. Les bruits que vous faites sont<br />
les symptômes de vos malaises stomacaux et intestinaux et<br />
ceux de votre impolitesse. On ne met jamais son doigt dans<br />
son nez ou dans une oreille. Quand on touche, c’est pour<br />
Lu<br />
(GUERRE OUBLIÉE)<br />
Tout n’est pas<br />
blanc ou noir<br />
RÉMI TREMBLAY demeure l’un des rares<br />
Québécois à s’être engagé comme combattant<br />
dans la guerre de Sécession américaine<br />
(1861-1865). Remarquablement présenté et<br />
abondamment annoté par <strong>Jean</strong> Levasseur,<br />
le roman en partie autobiographique que<br />
<strong>Tremblay</strong> a tiré de son expérience,<br />
Un revenant (Éditions de la Huit, 2003),<br />
illustre la confusion dans les idées<br />
et les allégeances engendrée par<br />
cette guerre civile également célèbre<br />
pour ses camps d’extermination.<br />
Dans le convoi de chemin de fer,<br />
Eugène avait abordé le sergent de<br />
garde, et lui avait dit que, n’ayant<br />
pas été pris les armes à la main, il désirait<br />
ne pas être confondu avec les prisonniers<br />
de guerre. Je suis déserteur de l’armée fédérale,<br />
ajouta-t-il, et comme tel j’ai été envoyé<br />
à la frontière du Kentucky par le gouvernement<br />
confédéré. Plus tard, j’ai été ramassé<br />
par des soldats de l’armée nordiste de<br />
Burbridge qui m’ont amené avec eux à<br />
Saltville en qualité de domestique d’un de<br />
leurs officiers, mais je n’ai pas repris les<br />
armes contre la confédération et je désirerais<br />
qu’on prît de nouvelles mesures pour me<br />
rapatrier.<br />
Naturellement, Eugène avait eu<br />
grand soin de ne pas ajouter que, rendu<br />
à Gladesville, il s’était engagé dans l’armée<br />
confédérée, qu’il avait quittée<br />
quelques jours après sans autorisation. Il<br />
ne m’appartient pas de décider cette<br />
question, avait répondu le sous-officier,<br />
mais lorsque nous serons arrivés à<br />
Richmond, je verrai à ce que les autorités<br />
soient saisies de l’affaire.<br />
Une fois débarqués dans la capitale<br />
de la confédération, les prisonniers<br />
furent conduits en face de la fameuse<br />
prison Libby, où le sergent fit l’appel et,<br />
ayant constaté que tous étaient présents,<br />
il dit : S’il y a parmi vous des déserteurs,<br />
qu’ils sortent des rangs. Eugène ne se le fit<br />
pas dire deux fois. Un Américain suivit<br />
son exemple. Donner une idée du<br />
concert d’imprécations et de malédictions<br />
qui s’éleva du groupe de prisonniers<br />
serait chose difficile, et répéter les<br />
paroles un peu vives qui furent prononcées<br />
en cette circonstance ne serait<br />
guère poli. On huait les déserteurs, on<br />
les menaçait, on les insultait, on les<br />
maudissait, on les vouait au diable et on<br />
leur promettait bien de les pendre haut<br />
et court, si jamais on les rencontrait.[…]<br />
La prison Libby, de même que le<br />
Castle Lightning et la prison Pemberton,<br />
avait été autrefois une manufacture de<br />
tabac. C’était un grand bâtiment en<br />
brique à deux étages sur rez-de-chaussée,<br />
dont l’intérieur se composait de trois<br />
vastes salles superposées, communicant<br />
entre elles au moyen d’escaliers ouverts<br />
surmontés de trappes pratiquées à travers<br />
le plancher. Ces salles recevaient la<br />
lumière et le froid à travers des fenêtres,<br />
grillées mais dépourvues de vitres, qui<br />
donnaient d’un côté sur la rue principale<br />
et de l’autre sur la rivière James.<br />
Vu<br />
Les prisons de Richmond servaient<br />
surtout de dépôt et d’école de jeûne pour<br />
les prisonniers. Pendant les mois d’été, le<br />
personnel des détenus se renouvelait<br />
sans cesse, on les envoyait mourir de<br />
faim à Andersonville et à Salisbury; mais<br />
pendant l’hiver comme les armées ne<br />
livraient guère que des combats partiels,<br />
les prisons Libby et Pemberton offraient<br />
assez d’espace pour loger à peu près tous<br />
les prisonniers que l’on pouvait prendre<br />
dans les environs.<br />
Les prisonniers n’y perdaient rien :<br />
on mourait de faim tout aussi bien à<br />
Richmond qu’ailleurs et l’on avait au<br />
moins l’avantage de s’y trouver à l’abri<br />
d’un toit, tandis que les prisonniers<br />
d’Andersonville ou de Salisbury étaient<br />
exposés à toutes les intempéries de la saison.<br />
Aussi la moyenne de mortalité<br />
parmi les prisonniers de guerre y étaitelle<br />
beaucoup plus élevée qu’à<br />
Richmond. [Des 45 000 prisonniers qui passèrent<br />
par Andersonville, il est permis d’affirmer<br />
que 13 000 y ont péri.]<br />
En arrivant à la prison Libby, Eugène<br />
fut d’abord logé au rez-de-chaussée, où<br />
se trouvaient une centaine de nègres et<br />
une vingtaine de Blancs. Ce n’était certainement<br />
pas par esprit d’humanité que<br />
les rebelles avaient jugé à propos de laisser<br />
la vie sauve à ces prisonniers de<br />
l’espèce noire, genre esclave, de la<br />
famille des soldats fédéraux. On les avait<br />
d’abord employés à travailler aux fortifications<br />
sous le feu de l’ennemi, mais le<br />
général Butler, ayant aperçu ces travailleurs<br />
en uniforme fédéral et ayant<br />
constaté, en collant le plus grand de ses<br />
deux yeux au verre d’une lunette, que<br />
ces nouveaux terrassiers avaient été<br />
bronzés plus que de raison par le soleil de<br />
Virginie, s’était empressé de recueillir<br />
tous les officiers confédérés nouvellement<br />
tombés entre les mains des fédéraux<br />
et de les faire travailler aux fortifications<br />
sous le feu des rebelles.<br />
Conséquence : les rebelles avaient fini<br />
par ramener les nègres à la prison Libby,<br />
où ils espéraient que ces moricauds se<br />
rendraient très utiles en faisant damner<br />
les quelques Blancs qu’il plairait au geôlier<br />
de leur jeter en pâture.<br />
Tant que les nègres avaient travaillé,<br />
on leur avait donné en dehors un dîner<br />
assez copieux pour permettre à<br />
quelques-uns d’entre eux d’apporter le<br />
soir à la prison Libby, où ils passaient la<br />
nuit, un morceau de pain ou une tranche<br />
de lard fumé. Parmi les Blancs qui se<br />
trouvaient là, il y en avait qui traitaient<br />
les nègres avec un suprême dédain, ce<br />
qui ne les empêchait pas, lorsqu’ils<br />
croyaient ne pas être observés, de ramasser<br />
et de porter à leur bouche soit un os,<br />
soit une couenne qu’un nègre avait jetée<br />
après l’avoir mâchée pendant une heure<br />
sans réussir à l’avaler. […]<br />
Il y avait parmi les Blancs un soldat<br />
de cavalerie qui était un boxeur émérite.<br />
Entendu<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3
Un rescapé du camp d’Andersonville<br />
Il commença avec un jeune nègre une<br />
partie amicale dans laquelle chaque<br />
boxeur cherchait à décoiffer son adversaire.<br />
Le Blanc eut le dessus. Il essaya un<br />
autre nègre, puis un autre, puis un autre,<br />
jusqu’à ce qu’il eût vaincu cinq ou six des<br />
plus adroits. Enfin, il se présenta un<br />
moricaud qui fit sauter le chapeau du<br />
cavalier, aux grands applaudissements<br />
des sombres Africains. Le Blanc se remit<br />
en garde, mais après quelques passes, son<br />
couvre-chef partit de nouveau; bref,<br />
après s’être fait découvrir sept ou huit<br />
fois, il écumait de rage et se mit à taper<br />
comme un sourd, les poings fermés en<br />
injuriant tous les nègres en général et<br />
son adversaire en particulier. Ce dernier<br />
para presque tous ses coups et lui servit<br />
une raclée des mieux conditionnées.<br />
Quelques Blancs voulurent intervenir;<br />
ils en furent quittes pour une bordée de<br />
horions qui donnèrent à leurs yeux une<br />
couleur tout africaine.<br />
À partir de ce moment, les vingt<br />
Blancs devinrent en quelque sorte les<br />
esclaves des cent nègres. C’était le<br />
monde renversé. À cette époque, à part<br />
la minuscule portion de pain, les prisonniers<br />
recevaient en outre, chacun, envi-<br />
4 • L’ A P O S T R O P H E<br />
ron une cuillerée d’une soupe faite avec<br />
des petites fèves noires. On apportait<br />
cela dans une espèce de cuveau fait avec<br />
un baril scié en deux. Les nègres<br />
manœuvraient de façon à empêcher les<br />
Blancs d’avoir accès au cuveau. La position<br />
était devenue intolérable.<br />
Les Blancs se plaignirent au geôlier<br />
confédéré qui leur dit : Ces nègres sont<br />
vos protégés, vos favoris, vos égaux ; vous<br />
vous êtes battus pour obtenir le privilège<br />
d’en faire vos maîtres, de quoi vous plaignezvous<br />
? Vous devriez bénir les mains noires<br />
qui vous frappent.<br />
Heureusement, au bout de quelques<br />
jours, les nègres furent tirés de la prison<br />
Libby pour être envoyés, on n’a jamais<br />
pu savoir où. D’autres prisonniers blancs<br />
arrivèrent en grand nombre. On les<br />
logea au rez-de-chaussée et l’on fit monter<br />
les anciens compagnons des nègres<br />
au premier, où se trouvaient déjà deux<br />
ou trois cents hommes, parmi lesquels<br />
Eugène reconnut avec terreur quelquesuns<br />
de ceux qui faisaient partie de l’escouade<br />
de prisonniers fédéraux en compagnie<br />
de laquelle il était arrivé à<br />
Richmond.<br />
(DÉFRANCISATION)<br />
Montreal<br />
sans accent<br />
BRUNO ROY s’insurge contre la dérive<br />
multilinguisante de l’administration du<br />
maire Gérald <strong>Tremblay</strong>. Dans un mémoire<br />
présenté à l’Office de consultation publique<br />
de Montréal en avril 2004, le président de<br />
l’UNEQ rappelle non sans raison que la distinction<br />
première de la métropole montréalaise<br />
n’est pas d’être multiculturelle – ce qui<br />
est à la portée de toutes les grandes villes –<br />
mais bien d’être française.<br />
Quel sens donner à une Charte montréalaise<br />
des droits et responsabilités si<br />
cette charte ne fait aucune mention<br />
liée à la préservation de la langue de<br />
la majorité à Montréal : la langue française<br />
? Le projet d’une charte montréalaise,<br />
lit-on, veut mobiliser les citoyens et les<br />
citoyennes de Montréal, mais jamais dans<br />
l’un ou l’autre des articles de cette char-<br />
te, il est question de préserver l’environnement<br />
linguistique de la majorité francophone<br />
à Montréal.<br />
Dès lors la question se pose : la langue<br />
est-elle une valeur en soi pour la<br />
ville de Montréal ? Peut-elle constituer<br />
une valeur de solidarité et d’inclusion ?<br />
Si le projet de charte montréalaise veut<br />
également protéger et enrichir l’habitat<br />
collectif dans un environnement économique,<br />
culturel et social, force est de<br />
constater que, dans ce projet de charte,<br />
l’environnement linguistique demeure<br />
une entière abstraction. À l’article 9, par<br />
exemple, on lit ceci : La sauvegarde du<br />
patrimoine architectural, historique et naturel<br />
de la ville participe aux droits culturels<br />
des citoyens et des citoyennes. Et les droits<br />
linguistiques ? La ville n’y participe pas ?<br />
Si Montréal a une fierté, c’est bien<br />
d’être français ! C’est ce caractère qui en<br />
fait l’intérêt et l’originalité comme<br />
métropole du Québec : un grand centre<br />
urbain à majorité française, le seul sur ce<br />
continent et la deuxième plus grande<br />
ville francophone après Paris. Dans les<br />
circonstances, on ne fait pas la promotion<br />
de Montréal en vantant son cosmopolitisme<br />
-toutes les grandes villes du<br />
monde sont cosmopolites. Non ! on doit<br />
centrer la promotion sur sa spécificité :<br />
une métropole française en Amérique<br />
du Nord.<br />
Montréal est une ville internationale<br />
de langue française, mais à trop vouloir<br />
la présenter comme une ville multiculturelle,<br />
on risque fort d’occulter ce<br />
qui la distingue de Toronto ou de<br />
Vancouver. L’un des effets pervers du<br />
bilinguisme institutionnel est d’amenuiser<br />
le rayonnement d’une grande capitale<br />
culturelle comme Montréal tout en<br />
L’homme<br />
est un grand malade<br />
qui s’ignore<br />
Inédit de GILLES DEROME<br />
Mon père recevait beaucoup d’échantillons<br />
des multinationales pharmaceutiques.<br />
Ces compagnies publiaient<br />
en même temps sur beau papier d’assez belles<br />
plaquettes d’art exclusivement réservées à<br />
messieurs les médecins.<br />
Calme et sommeil, dessins de peintres<br />
et de sculpteurs. De jeunes gardes-malades<br />
dessinées par Gauguin dorment sous les<br />
arbres. Elles ont pris le petit-déjeuner sur<br />
l’herbe avec les internes bleus de Matisse.<br />
Des résidents qui se reposent au lit empruntent<br />
à Manet ses noirs et à Dunoyer de<br />
Segonzac ses plus jolies parturientes.<br />
Dans les états anxieux, surmenage,<br />
angoisse, hyperémotivité, insomnie, la<br />
Suractiflore ramène le calme et procure le<br />
sommeil. Posologie : deux comprimés tous les<br />
soirs avant de se coucher. Cette dose fait<br />
disparaître toutes les frayeurs. Si l’effet n’est<br />
pas immédiat, consultez à nouveau votre<br />
médecin. La Suractiflore n’est pas mortifiante.<br />
Identifiée par Ovide à la nymphe<br />
grecque Chloris, épouse du Zéphyr et mère<br />
du Printemps, cette divinité devint dans<br />
mon esprit la déesse de seize ans du tableau<br />
de Renoir qui – vous pouvez m’en croire – peut causer du surmenage<br />
à celui qui veut l’acheter, de l’angoisse à celui qui en<br />
a la garde et de l’insomnie à l’hyperémotif qui en rêve. Je sens<br />
que pour être médecin et posséder toutes ces peintures, il<br />
faut être riche et ne pas tomber malade.<br />
À cinq ans, quand je tombe du deuxième étage – si c’est<br />
bien moi qui suis tombé – ce n’est pas trop grave. Je n’ai pas<br />
un corps à moi depuis quelque temps déjà. La santé c’est<br />
quand le corps n’est plus là. Une machine parfaite rêvée par<br />
Saint-Exupéry : l’avion qui se laisse oublier. Surtout quand<br />
vous exigez de lui ce qu’il ne peut pas donner. Comme le<br />
nageur qui entreprend seul la traversée d’un lac trop grand<br />
pour les forces qui lui restent. Ah ! si la machine peut tenir !<br />
La perfection de l’invention qui confine à l’absence<br />
d’invention.<br />
Le ronron dodu du chat-moteur sur la<br />
route de Saint-Jérôme en revenant des<br />
Laurentides. Mon père qui conduit tard la<br />
nuit n’est pas très fatigué et ma mère qui vit<br />
habitée par l’imminence d’une catastrophe<br />
et n’a aucune confiance en la vie nous fait<br />
réciter un chapelet complet. La récitation,<br />
à peine plus monotone que le paysage, se<br />
termine toujours avant que nous nous<br />
engagions sur le pont Plessis-Bélair qui est<br />
en bois et ça me rassure. Ne pas avoir un<br />
corps à soi est une habitude que l’on prend<br />
jeune en monde chrétien. Il appartient à<br />
Dieu de le détruire en échange de notre<br />
âme et ce n’est pas négociable comme dans<br />
Faust.<br />
Je m’éveille et je vois, penché sur moi,<br />
le visage de mon grand-père paternel :<br />
William James le chirurgien. Il porte au<br />
menton la barbe grise de Freud. Celle que<br />
ce dernier arbore en 1909 lorsqu’il atteint<br />
ses cinquante-trois ans. L’année où il publie<br />
L’analyse d’une phobie d’un petit garçon de<br />
cinq ans. Ça n’a rien à voir avec la mienne<br />
mais c’est mon âge à peu près. Je tombe et<br />
on fait venir mon grand-père chirurgien. C’est ma version<br />
des faits. Peut-être qu’il est à la maison pour une fête de<br />
famille ou à l’occasion de la naissance d’une de mes sœurs. Je<br />
ne le saurai jamais.<br />
Je suis étendu dans le lit de mes parents, dans la chambre<br />
à l’arrière de l’appartement où il entre beaucoup de soleil.<br />
Cette chambre ouvre sur un balcon du côté sud et donne sur<br />
le jardin des pères Dominicains. Un campanile adjacent à la<br />
chapelle Saint-Victor a été ajouté à la vieille église et j’entends<br />
sonner l’heure des cérémonies. La mort du Christ le<br />
matin et le trépas des paroissiens les après-midi.<br />
Dans la pièce, en plus de mon grand-père, il y a mon père<br />
et deux de mes oncles, tous trois médecins. J’ai un épais ban-<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 5
Le bon vieux<br />
temps<br />
Fulgence Charpentier,<br />
j’aimerais que vous nous rappeliez<br />
dans quel contexte la<br />
censure s’est imposée à partir<br />
de 1939, compte tenu que<br />
vous en étiez responsable du<br />
côté francophone.<br />
– La censure était d’abord<br />
une affaire d’informations militaires, mais elle touchait aussi<br />
l’opinion publique et les communications. Les journalistes, vous<br />
savez, ils ont leur caractère ! Ils n’accepteront pas aveuglément<br />
des ordres. Il faut s’entendre avec les journalistes pour qu’ils<br />
puissent suivre des directives.<br />
Mais si les directives n’étaient pas suivies ?<br />
– Qu’est-ce qu’on pouvait faire ? C’est une bonne question.<br />
La censure était préventive et aussi laissée à la discrétion<br />
des journalistes, à cause justement des directives en question<br />
qui étaient consignées dans un volume qui existe toujours. On<br />
n’avait pas vraiment de difficultés parce que les journalistes ont<br />
très bien compris ce qui se passait.<br />
Pourtant, avec Le Devoir en particulier, ça n’a pas été<br />
facile ?<br />
– Le Devoir n’essayait pas de renseigner l’ennemi, mais il<br />
cherchait plutôt à reproduire ce qui était contre la guerre, très<br />
souvent des articles provenant de journaux suisses. J’avais<br />
insulté un jour son directeur, Georges Pelletier, en lui disant :<br />
Est-ce que c’est sciemment que vous mettez ça dans la<br />
cinquième colonne ?<br />
Vous étiez censeur de toutes les publications, du livre<br />
et de la radio dont tous les textes d’ailleurs devaient être<br />
lus au préalable.<br />
– Pas tout à fait. On communiquait plutôt avec la station<br />
qui dépendait de nous pour obtenir la permission de diffuser et<br />
qui était consciente que violer les règlements l’exposait à se faire<br />
couper. C’est pourquoi, dans chaque poste, il y avait quelqu’un<br />
qui lisait les textes et disait : Cela peut passer, cela ne peut<br />
pas passer !<br />
L’image que vous donnez de la censure finalement est<br />
celle d’une censure douce ?<br />
– Il y a des choses qui nous étonnaient nous-mêmes.<br />
Chaque année on tenait nos assemblées avec le public, c’est-àdire<br />
avec les propriétaires de journaux. Si vous vous voulez<br />
vous plaindre, dites-le nous. Chaque fois, ils nous ont répondu<br />
la même chose : On est heureux de ne pas renseigner l’ennemi<br />
et de suivre des règlements qui ne nous nuisent pas.<br />
Si vous en voulez d’autres, dites-le nous, on en discutera.<br />
C’était inutile à ce moment-là de faire des recommandations.<br />
Propos recuillis par PIERRE HÉBERT,<br />
La censure 1920-1960, Voix et images, Hiver 1998.<br />
4 4 • L’ A P O S T R O P H E<br />
ditoire, qui de son succès de vente, qui d’un<br />
quelconque sujet qui mette en vedette non<br />
pas l’écrivain mais sa personne et son<br />
extraordinaire bagout.<br />
Il peut arriver qu’on les invite dans les<br />
émissions du genre intimiste. Les pires !<br />
Comme si nous, dans nos chaumières, on ne<br />
s’en foutait pas royalement de savoir si tel<br />
auteur connu écrit le matin plutôt que le<br />
soir et quel est son état d’âme en hiver, si<br />
telle écrivaine vedette écrit à l’ordinateur<br />
ou à la plume d’oie, si telle ou tel vit des<br />
angoisses personnelles, si son enfance a été heureuse, si elle<br />
dort nue, s’il est bain ou douche, thé ou café !<br />
Le plus extraordinaire de tout cela, quand on y pense,<br />
c’est précisément notre silence collectif, notre incroyable<br />
tolérance face à cette situation. Nous, l’auditoire propriétaire<br />
de cette télévision dite publique, nous acceptons pareil<br />
comportement sans mot dire, ou presque ! À commencer, au<br />
cœur de cet auditoire, par les premiers intéressés, les écrivains,<br />
auteures, critiques et les organisations qui les rassemblent.<br />
Comme s’ils acceptaient de bonne grâce ce bâillon<br />
qu’on leur impose ! Faut dire que l’ayant toujours porté, ils<br />
ont peut-être fini par croire que c’était normal. Une sorte de<br />
syndrome de Stockholm qu’on pourrait ici appeler syndrome<br />
de Radio-Canada.<br />
Cela dit, avant de lancer la pierre, reconnaissons que,<br />
pour briser le mur d’indifférence dressé par les médias face<br />
aux revendications populaires ou citoyennes, il faut consentir<br />
à y mettre beaucoup de temps, de concertation et d’effort. À<br />
cet égard, les choses ont commencé à changer quand, à la fin<br />
novembre 2003, devant l’édifice de Radio-Canada, l’UNEQ<br />
a rassemblé une centaine de ses membres pour venir y crier<br />
leur colère contre le silence de la télévision. […]<br />
LA TÉLÉVISION PUBLIQUE<br />
ASPHYXIE LA PENSÉE<br />
QUÉBÉCOISE<br />
Après plus de 50 ans d’existence, il serait peut-être temps<br />
que la télévision publique, la nôtre, celle qui vit de nos<br />
impôts et de nos taxes, cesse d’asphyxier littéralement, sans<br />
nécessairement toujours s’en rendre vraiment compte, la<br />
pensée. La pensée québécoise, ouverte sur le monde mais que<br />
le monde entend bien peu, puisqu’on lui refuse la tribune la<br />
plus populaire, la télévision. Si notre propre télévision ne<br />
donne pas la parole à celles et ceux d’entre nous qui nous<br />
expriment, nous et le monde, quelle télévision d’ailleurs au<br />
monde le fera ?<br />
l’empêchant d’occuper sa place comme<br />
l’une des grandes villes françaises du<br />
monde. Montréal se doit d’être la porte<br />
d’entrée en Amérique de la culture française<br />
mondiale et sa tête de pont.<br />
Plus la culture montréalaise favorisera<br />
l’accès des communautés ethniques<br />
à la culture majoritaire de langue française<br />
et permettra réciproquement aux<br />
cultures minoritaires de nourrir la culture<br />
de la majorité, plus elle sera près de<br />
son expression réelle en territoire montréalais.<br />
La dynamique de l’échange<br />
interculturel fait appel à une ouverture<br />
simple et généreuse aux différences.<br />
L’art d’habiter une ville comme<br />
Montréal, de la représenter, de la jouer,<br />
de la chanter et de l’écrire est un savoirvivre<br />
qui se traduit par un accueil<br />
respectueux de toutes les cultures dans<br />
une langue commune, le français en l’occurrence.<br />
C’est la raison pour laquelle<br />
dans sa nouvelle Charte des droits et<br />
responsabilités, la ville de Montréal doit<br />
s’engager formellement à protéger le<br />
français, la langue de la majorité sur son<br />
territoire. Il en va non seulement de la<br />
responsabilité d’une métropole mais du<br />
patrimoine de tout un peuple.<br />
(MARKETING)<br />
Le secret<br />
du chanoine<br />
MARIE-PIER LUNEAU poursuit des<br />
recherches sur les stratégies d’écrivains. Son<br />
essai Lionel Groulx Le mythe du berger<br />
(Leméac, 2003) est le fruit d’une confrontation<br />
entre la correspondance de l’écrivain et le<br />
discours mythique sur sa figure d’auteur.<br />
Derrière la pose d’un modeste écrivain<br />
d’histoire qu’il aimait se donner, le chanoine<br />
se révèle un carriériste de première, doublé<br />
d’un redoutable publiciste.<br />
Lionel Groulx est probablement un<br />
des premiers auteurs de best-sellers<br />
au Québec. Les Rapaillages, contes<br />
publiés pour la première fois en recueil<br />
en 1916, ont été imprimés à quelque<br />
65 000 exemplaires au XX e siècle. La<br />
deuxième édition de 1919 était déjà tirée<br />
à 25 000 exemplaires, alors que quelque<br />
8 000 exemplaires avaient été écoulés<br />
entre 1916 et 1919. Les ventes étaient<br />
donc massives et rapides. Le seul talent –<br />
notion ô combien vague ! – d’un écrivain<br />
peut-il à lui seul expliquer un tel<br />
succès ?<br />
On pourrait donner des chiffres<br />
semblables pour les deux romans de<br />
Groulx et pour plusieurs de ses essais historiques.<br />
On en arriverait aux mêmes<br />
questions. Comment un tel phénomène<br />
se produit-il dans le marché du livre ? De<br />
quels facteurs externes au texte dépendil<br />
? Est-ce que, par exemple, le fait que<br />
Groulx ait encensé lui-même, sous<br />
pseudonyme, son roman L’Appel de la<br />
race pendant plusieurs mois dans sa<br />
revue L’Action française, a pu contribuer,<br />
un tant soit peu, à écouler rapidement<br />
les trois mille premiers exemplaires ?<br />
Lionel Groulx est un des premiers<br />
auteurs de best-sellers au Québec parce<br />
qu’il s’est hissé lui-même au haut du palmarès<br />
à force de stratégie littéraire. […]<br />
Groulx est partout à L’Action française,<br />
non seulement sous son nom propre,<br />
mais encore sous de multiples noms de<br />
plume, la plupart empruntés aux compagnons<br />
de Dollard des Ormeaux. Une<br />
étude exhaustive des textes publiés par<br />
Groulx sous pseudonyme dans la revue<br />
m’a vite portée à constater que ces<br />
masques sont les plus fidèles admirateurs<br />
de son œuvre. Groulx parle effectivement<br />
de lui-même ou de ses livres dans<br />
63 % de ses textes publiés sous un nom<br />
d’emprunt dans L’Action française. Entre<br />
1920 et 1925, années au cours desquelles<br />
il consacre le plus clair de son temps<br />
à l’œuvre de L’Action française, il est<br />
question de lui dans 56 des 60 textes<br />
qu’il publie sous pseudonymes. Voilà<br />
bien une tactique qui a pu permettre à<br />
l’écrivain de créer un effet d’omniprésence<br />
sur la scène intellectuelle, si bien<br />
qu’on ne s’étonnera pas de voir ses correspondants<br />
lui répéter inlassablement<br />
qu’il est l’âme de L’Action française et que<br />
tous les succès récoltés par la revue lui<br />
reviennent de droit. […]<br />
Dans ses Mémoires, Lionel Groulx<br />
avance innocemment à propos de son<br />
roman Au cap Blomidon : Dans le monde<br />
de mes amis, il fallait s’y attendre, ce fut le<br />
concert d’éloges coutumiers. Il fallait s’y<br />
attendre, certes, puisque Groulx luimême<br />
orchestre une campagne de publicité<br />
digne d’un grand stratège. Omer<br />
Héroux se dit prêt à publier toute critique<br />
du roman dans Le Devoir : Groulx<br />
commence la chasse aux louanges.<br />
Le 28 novembre 1932, il écrit à<br />
Georges Courchesne une lettre dans<br />
laquelle, en demandant une critique, il<br />
rejette subtilement la responsabilité<br />
d’une campagne publicitaire favorable<br />
au Cap Blooming sur Omer Héroux. Il<br />
faut remarquer encore une fois comment<br />
l’écrivain, feignant l’indifférence devant<br />
la critique, fournit pourtant un canevas<br />
au rédacteur.<br />
Non seulement il s’intéresse au discours<br />
critique sur ses livres tout en prétendant<br />
y être froid, mais il tente en plus<br />
de l’orienter. Le procédé devient courant<br />
dans le discours de Groulx : M. Héroux<br />
m’a téléphoné hier pour me dire le bien qu’il<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 5<br />
NORMAND HUDON
vous a plu de dire, l’autre soir, au Cercle, de<br />
Au cap Blomidon. Et il a ajouté : Son<br />
Excellence avait d’autant plus de mérite<br />
qu’elle disait ce bien hors la présence de<br />
l’auteur.<br />
Et il a encore ajouté : Pourquoi ne<br />
demanderiez-vous pas à son Excellence<br />
quelques mots d’appréciation qui<br />
seraient insérés sous notre rubrique : Le<br />
sentiment du lecteur ? Vous aurez peutêtre<br />
observé, en effet, que depuis quelques<br />
jours, Le Devoir publie, en 3 e page, au bas<br />
de la première colonne, Le sentiment du<br />
lecteur sur Au cap Blomidon.<br />
Je ne vous demande pas, mon cher<br />
Seigneur, une appréciation littéraire, bien<br />
que vous soyez compétent en la matière.<br />
Mais peut-être pourriez-vous ramasser, en<br />
quelques lignes, 7 à 8, votre sentiment sur le<br />
dynamisme moral du petit livre s’il en a un,<br />
et, par exemple, ce qu’y pourrait trouver<br />
notre jeunesse pour qui je l’ai écrit.<br />
Monseigneur Courchesne rédige<br />
l’article et recommande particulièrement<br />
le roman à la jeunesse, comme le<br />
souhaitait Groulx. (…) On ne peut<br />
manquer de remarquer que la rubrique<br />
Le sentiment du lecteur sur Au cap<br />
Blomidon, publiée dans Le Devoir, appartient<br />
à ce qu’on appelle parfois à l’époque<br />
la critique-réclame. D’emblée, le<br />
titre est factice, puisque le lecteur qui<br />
donne son sentiment n’est pas choisi au<br />
hasard, mais est invariablement un<br />
inconditionnel de Groulx. (…)<br />
Quatorze textes laudatifs sur Au cap<br />
Blomidon sont parus dans Le Devoir entre<br />
novembre 1932 et mars 1933, donc en<br />
l’espace de cinq mois. Pas étonnant que<br />
le mémorialiste souligne si souvent la<br />
contribution exceptionnelle d’Omer<br />
Héroux à sa carrière d’écrivain ! En<br />
décembre 1932, Groulx écrit à Robert<br />
Rumilly : Je suis un peu surpris, je vous l’avoue,<br />
du généreux accueil que l’on fait à ce<br />
qui fut véritablement pour moi un véritable<br />
divertissement de vacances.<br />
Peut-il vraiment être surpris de l’accueil<br />
favorable réservé à son roman,<br />
alors qu’il sollicite lui-même moult critiques<br />
? Non, feindre l’étonnement fait<br />
partie de sa construction d’une image<br />
d’écrivain mythique détaché du sort<br />
matériel de ses livres.<br />
6 • L’ A P O S T R O P H E<br />
(RÉCIT DE VOYAGE)<br />
Entre<br />
deux vols<br />
MONIQUE THOUIN a tiré Empreintes de<br />
séjour (Éditions Trois-Pistoles, 2004) de ses<br />
premières impressions du Chili et de<br />
l’Argentine. Complété par une riche iconographie<br />
populaire et une suite d’encadrés<br />
pertinents sur l’état politique des lieux, le<br />
livre nous entraîne dans la foulée d’une<br />
voyageuse qui, entre le dépaysement et l’étonnement,<br />
découvre que quitte à s’y prendre<br />
à deux fois pour le prouver, tous les<br />
hasards ne sont pas heureux.<br />
Arrivée à destination, quelle compagnie<br />
d’autobus choisir pour gagner<br />
Buenos Aires ? Chauffeurs de taxi<br />
comme des maringouins après moi. Je les<br />
fuis et tombe dehors sur la file bruyante<br />
des voyageurs attendant le minibus<br />
Tienda Leone, tente d’acheter 17 $ US le<br />
billet nécessaire, mais le préposé m’expédie<br />
cavalièrement et me fait signe de me<br />
fondre dans la foule, ce que je fais,<br />
contrariée de ne pas saisir son système.<br />
À ma droite, un homme s’agite, crie<br />
que non, il ne va pas attendre une demiheure<br />
de plus. Je lui demande en espagnol<br />
de m’expliquer lentement ce qui se<br />
passe et il me répond en anglais qu’il est<br />
argentin, avocat et vit à Washington<br />
depuis 30 ans, que ses compatriotes sont<br />
tous des incompétents, qu’il a un rendezvous<br />
d’affaires et qu’on ne va pas nous<br />
prendre lui et moi dans le prochain minibus<br />
car toutes les places en sont vendues.<br />
Ce sur quoi il se remet à hurler<br />
après le préposé, qui finit par le calmer<br />
en lui affirmant qu’on va nous transporter<br />
en voiture jusqu’au centre.<br />
Le bus parti, un chauffeur en livrée<br />
nous ouvre les portes de sa quasi-limousine,<br />
avocat autoritaire devant et moi<br />
derrière. Service express, on me dépose à<br />
l’hôtel choisi dans mon Routard mais,<br />
même si j’avais téléphoné, pas de chambre<br />
disponible. Je marcherai jusqu’à mon<br />
deuxième choix.<br />
•<br />
Irai-je à Iguazu, ce parc national de<br />
65 000 hectares, antre de 275 chutes aux<br />
gorges tapissées d’orchidées ? Une heure<br />
d’avion à peine, me dit la blonde épouse<br />
du patron de l’hôtel en berçant son nouveau-né<br />
sur sa petite poitrine et elle ressemble<br />
à ma sœur. Ils vont garder mon<br />
gros sac à La Recoleta le temps de mon<br />
excursion vers le Nord-Est.<br />
•<br />
Montevideo, capital nacional de la<br />
orchidea. Il est 10 h 40. Millions de tronc<br />
d’arbres empilés et sapins ressemés, on se<br />
croirait dans le film de Desjardins, couleurs<br />
et espèces mises à part. À l’écran de<br />
télé du boui-boui, on souligne l’anniversaire<br />
de l’assassinat de John Lennon.<br />
Dans le bus, à tue-tête, Céline Dion,<br />
Talk about love…je capote.<br />
•<br />
Orage, averses, on ne m’a pas prévenue,<br />
fin de la saison des pluies. Genou<br />
blessé sur rue pavée de pierres mal assorties<br />
et on m’a presque vidé mon portefeuille<br />
alors que j’étais tombée endormie.<br />
La seule banque du lieu est fermée, car<br />
entrée en fonction du nouveau président<br />
du pays. Ulysette est contrariée, voyeur à<br />
la fenêtre de sa chambrette de la<br />
Residencial Liliane qui s’en fout mais<br />
éperdument, goutte sur le point de faire<br />
déborder un verre saturé d’insatisfaction<br />
! Argent pour un repas, le seul pendant<br />
les deux jours que je suis forcée de<br />
passer dans ce bled car billet d’avion<br />
inchangeable et je dois garder quatre<br />
pesos pour le collectivo vers l’aéroport.<br />
•<br />
Vendredi, je suis affamée. Il pleut<br />
des fleuves, le Parana va-t-il déborder ?<br />
Eau rouge à hauteur des chevilles.<br />
L’Italienne croisée dans la jungle hier<br />
tarde à arriver au terminus d’autobus,<br />
seul être gentil rencontré dans les parages<br />
de Porto Iguazu et pendant deux<br />
heures, transie et écœurée, je l’espère.<br />
Alessandra, qui vit à Rome et travaille<br />
dans le pétrole, arrive et je renais, serrant<br />
mes quatre misérables pesos dans ma<br />
main et qu’on en finisse. L’assistant du<br />
conducteur nous vend nos précieux<br />
LE LIVRE N’A JAMAIS EU LA PARTIE BELLE<br />
À AUCUN MOMENT DE L’HISTOIRE<br />
DE RADIO-CANADA<br />
primes d’assurance-chômage et l’opposition à la mondialisation<br />
soutenue par nos gouvernements.<br />
Ces débats n’auront pas lieu alors même que, sur tous ces<br />
sujets, on trouve chez nous une grande variété de chercheuses,<br />
d’écrivains, d’essayistes et de poètes qui ont des choses à<br />
dire. Et pourquoi toutes ces personnes ne seraient-elles pas<br />
conviées à mener publiquement ces débats ? Parce que les<br />
réunir, leur donner la parole, leur proposer de débattre entre<br />
eux, en public, sur des sujets chauds dont on parle peu, équivaut<br />
forcément à reconnaître que la critique du pouvoir<br />
dominant est une pratique démocratique acceptable ! Ce qui<br />
est inimaginable ! La té1évision, plus que les autres médias,<br />
a peur des visages nouveaux qui ne voient pas nécessairement<br />
le monde par le prisme du pouvoir dominant. C’est<br />
trop risqué ! Elle s’abstient. Au fond pour être plus exact,<br />
disons qu’elle ne refuse pas le droit de parole : elle se contente<br />
de ne pas l’offrir.<br />
En lieu et place, pour meubler les ondes d’une manière<br />
distrayante, la télévision présentera des quiz, des variétés, des<br />
téléromans, du cinéma, quelques bulletins de nouvelles. Tout<br />
cela, comme le suggère Pierre Bourdieu, prend du temps, du<br />
temps qui pourrait être employé à dire autre chose. Or, le temps est<br />
une denrée extrêmement rare à la télévision. Et si l’on emploie des<br />
minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c’est que ces<br />
choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où<br />
elles cachent des choses précieuses.<br />
Censure par cachotterie, censure par omission, censure<br />
invisible, gants de velours et rideau de fer, d’où la difficulté de<br />
l’appréhender et de la dénoncer de manière crédible. […]<br />
À la télévision, déplore l’écrivain et journaliste Hervé<br />
Fischer, les intellectuels n’ont droit qu’au murmure. Ils n’ont<br />
pas leur place. Ne la veulent-ils pas ? Ou n’y sont-ils guère admis<br />
parce qu’ils y paraîtraient mauvais acteurs, trop dramatiques ou<br />
trop élitistes ? On semble le croire, mais cela reste à prouver : il s’agit<br />
plutôt d’un préjugé répandu, ce que démentent bien des exemples<br />
d’intellectuels qui savent aussi percer l’écran.<br />
La règle veut que pour passer à la tévé, un écrivain doive<br />
remporter un prix prestigieux comme Yann Martel, avoir<br />
signé une œuvre qui obtient un succès populaire exceptionnel<br />
comme Marie Laberge ou alors être un verbomoteur sympathique<br />
et d’un naturel très accrocheur comme Dany<br />
Laferrière. Toutes qualités qui font les vedettes.<br />
Plus gênant encore : de ces auteurs<br />
conviés sous les projecteurs, on attend<br />
rarement qu’ils émettent leurs idées sur<br />
les grands sujets de l’heure, qu’ils commentent<br />
l’actualité ou présentent une<br />
quelconque réflexion. Tout ce qu’on leur<br />
demande, c’est de nous parler du prix<br />
obtenu et d’en mettre plein la vue à l’au-<br />
NORMAND HUDON<br />
La censure consensuelle<br />
La censure au niveau profond désigne une entreprise<br />
de balisage, de programmation. Dans un premier temps,<br />
elle vise à instituer le dicible et, ainsi, son effet est de<br />
cacher toute parole divergente. Dans un second temps, la<br />
censure profonde préventive vise à faire cacher un propos<br />
discordant, par des interventions préalables de nature privée.<br />
Sur le plan de la manifestation, c’est-à-dire lorsque le<br />
discours profond a été si inefficace que se produit un discours<br />
hétérodoxe, l’activité censoriale doit se résoudre à<br />
montrer (le Saint Office avec l’Index par exemple) pour<br />
cacher, contradiction difficile à contourner. La grande<br />
transformation de la censure cléricale, du XIX e siècle au<br />
début du XX e , aura été de passer du niveau de la manifestation<br />
au niveau profond.<br />
Ce modèle (rhétorique) de la censure parle en<br />
quelque sorte de lui-même. J’attire cependant l’attention<br />
sur le coefficient d’efficacité de la censure, qui va diminuant<br />
avec le niveau de la manifestation. Cela revient à<br />
dire que plus la censure se manifeste publiquement, plus<br />
la coercition montre sa faiblesse. On ne peut pas en faire<br />
une vérité générale, mais il est bien certain qu’à l’inverse,<br />
l’absence de censure au niveau de la manifestation n’est<br />
pas l’indice d’une absence de censure tout court, mais<br />
peut-être davantage d’un consensus inconscient. […]<br />
En dernière analyse, l’Église a compris au tournant du<br />
siècle ce que John Saul a exprimé dans son essai Les<br />
Bâtards de Voltaire (Payot, 1993). C’est le langage et non l’argent<br />
qui est facteur de légitimité. Tant que les systèmes militaire,<br />
politique, religieux ou financier ne contrôlent pas le langage,<br />
l’imagination du public peut évoluer librement, au gré des idées<br />
qui lui sont propres. L’autorité établie a toujours eu davantage<br />
à redouter des propos incontrôlés que des forces armées.<br />
C’est dans cette entreprise du contrôle du langage<br />
que se lance le pouvoir religieux au début du XX e siècle.<br />
Au XIX e siècle, par exemple, la Semaine religieuse du<br />
Québec s’objectait à ce que le mot miracle fût employé<br />
dans les réclames publicitaires, injure à Dieu ! Mais au XX e ,<br />
c’est le discours entier que l’on tentera de baliser.<br />
PIERRE HÉBERT<br />
CENSURE ET LITTÉRATURE AU QUÉBEC<br />
Le livre crucifié 1625-1919, PIERRE HÉBERT, Fides, 1997.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 3
au printemps 2002. Puis plus rien.<br />
[…]<br />
Si c’est la concurrence de la<br />
télévision privée qui justifie l’absence<br />
actuelle d’émissions sur le livre, il<br />
faut logiquement en déduire, à l’inverse,<br />
qu’en l’absence de ladite<br />
concurrence ou face à une concurrence<br />
de peu de poids, de telles<br />
émissions auraient trouvé une place<br />
importante dans la programmation<br />
régulière de la télévision publique. Or l’histoire nous montre<br />
que tel n’est pas le cas.<br />
Née en 1952, Radio-Canada a été en situation de parfait<br />
monopole jusqu’à la naissance du canal 10, à Montréal, en<br />
1961. Donc pendant 10 ans. Ce n’est qu’en 1971, dix années<br />
plus tard, qu’un premier réseau privé apparaîtra, TVA,<br />
regroupant au départ les stations de Montréal, Québec et<br />
Chicoutimi. Radio-Canada existait alors depuis 20 ans.<br />
Quant à la diffusion par câble, elle ne connaîtra un véritable<br />
essor qu’à partir des années 1980. TQS pour sa part ne naîtra<br />
qu’en 1986, soit 34 ans après Radio-Canada.<br />
La forte concurrence actuelle constitue sans doute un<br />
argument ponctuel et opportun de plus dans le carquois de<br />
Radio-Canada pour justifier son absence totale d’intérêt pour<br />
le livre et la pensée, mais ce n’est guère plus qu’un fauxfuyant<br />
qui ne tient pas la route. La moitié ou presque de ses<br />
cinquante ans d’existence a bel et bien été vécue à l’abri de<br />
toute véritable concurrence. […]<br />
Quant à la présente modestie des budgets alloués à la<br />
télévision publique, elle ne saurait, de toute manière, être en<br />
elle-même une excuse justifiant l’absence d’émissions construites<br />
à partir des livres. Un studio habité par des essayistes,<br />
des romancières, des poètes et des auteurs qui sont là pour<br />
débattre entre eux exige un minimum de décors et d’accessoires,<br />
et tout au plus, à l’occasion, de légers frais de déplacement<br />
pour les invités, le cachet d’un animateur ou animatrice<br />
et le coût d’une petite équipe de production.<br />
Même une télévision pauvrette pourrait produire ce type<br />
d’émission. On est ici à mille lieues des frais encourus pour<br />
produire La Fureur ! Par exemple, Cent titres, à Télé-Québec,<br />
coûtait 900 000 $ , en tout et pour tout, pour 26 émissions<br />
diffusées d’abord à Télé-Québec, puis à ARTV, dans un<br />
montage différent. Un coût moyen, par émission, de<br />
34 615 $. Pour fins de comparaison, une série dramatique du<br />
type Omertà, ou Jack Carter, ou Simonne et Chartrand, coûte<br />
plus ou moins un million de dollars par émission. […]<br />
Tant les artisans que les cadres des grands médias sont de<br />
plus en plus interchangeables. On les voit régulièrement passer<br />
du secteur public au secteur privé et inversement. Du<br />
Journal de Montréal à Radio-Canada à Télé-Québec.<br />
SI L’OCCASION FAIT LE LARRON,<br />
IL SUFFIT DE SUPPRIMER L’OCCASION<br />
4 2 • L’ A P O S T R O P H E<br />
De TVA à Radio-Canada. Du Soleil à CBVT. De Télé-<br />
Québec au Journal de Montréal. De Radio-Canada à TQS.<br />
Tout cela ne fait que confirmer, s’il le fallait, les propos<br />
d’Anne-Marie Gingras, professeure de science politique à<br />
l’Université Laval et spécialiste des communications, à savoir<br />
que ces grandes institutions participent d’une idéologie commune.<br />
Et donc exclusive. Ces institutions participent ainsi à<br />
la formation et à l’enracinement d’une forme molle de pensée<br />
unique, ce qui est évidemment inimaginable sans l’apport<br />
d’un mélange de censure et de propagande, revers d’une<br />
même médaille.<br />
De nos jours, hors des situations de guerre, rares sont les<br />
cas flagrants de censure dans les grands médias, encore qu’ils<br />
existent à l’occasion. C’est que la censure est rendue de<br />
moins en moins nécessaire au quotidien : les journalistes, et<br />
à plus forte raison leurs cadres, sont maintenant triés sur le<br />
volet, comme le note Anne-Marie Gingras dans son ouvrage<br />
incontournable Médias et démocratie (Presses de l’Université<br />
du Québec, 1999). Donc, à peu près inutilité de la censure<br />
formelle.<br />
LA PENSÉE PUBLIQUE<br />
SE RÉSUME<br />
À QUELQUES<br />
JOURNALISTES<br />
ET UNE POIGNÉE<br />
D’INTELLECTUELS<br />
PATENTÉS<br />
Dans ces conditions, les médias font, comme naturellement,<br />
l’impasse sur quantité de sujets majeurs. Tabous. La<br />
pauvreté est un sujet tabou, sauf au temps de la Guignolée où<br />
le pleur – mais non la révolte, attention ! – est permis : compassion<br />
minimale pour les plus démunis vue sous l’angle de la charité,<br />
écrit Anne-Marie Gingras.<br />
Sauf quand ils prennent la couleur des faits divers, un<br />
grand nombre de sujets traités dans bon nombre d’ouvrages<br />
sont néanmoins tabous à la télé comme l’écart des revenus<br />
qui s’élargit entre les riches et les pauvres, ici même au<br />
Québec où, à Montréal par exemple, 50 % de la population<br />
vit avec à peine 18 % des revenus disponibles, l’autre moitié<br />
en accaparant 82 % ; la prostitution ; la gestion actuelle et<br />
prévisible de l’eau ; l’usage de drogues vu par l’histoire, les<br />
sciences et les arts ; l’état même de la presse super concentrée<br />
et ses effets sur la liberté d’expression ; les liens intimes<br />
qui unissent milieux politiques et d’affaires ; le rapport immigration,<br />
intégration et sécurité nationale ; le libéralisme nouvelle<br />
mouture et ses impacts sociaux ; le détournement des<br />
billets et un militaire vérifie ma destination,<br />
la compagnie de bus choisie, et<br />
note tout ça. N’y a-t-il donc que les<br />
oiseaux qui n’aient pas de chaîne aux<br />
pattes dans ce pays ? Encore doivent-ils<br />
parvenir à naître car, explique le Routard,<br />
les vibrations des hélicoptères brésiliens<br />
au-dessus des cataractes d’Iguazu brisent<br />
la coquille des œufs.<br />
•<br />
Avion jusqu’à l’aéroport national de<br />
Buenos Aires. Heureusement on ne m’a<br />
volé ni mon passeport ni ma Visa. Grâce<br />
à cette dernière donc, parcours jusqu’à<br />
mon petit hôtel de La Recoleta dans une<br />
voiture de la compagnie Tienda Leone,<br />
quoiqu’un article de journal découpé par<br />
la mère d’Andrés m’ait appris par la suite<br />
que le matin de mon arrivée au pays, je<br />
l’ai échappé belle. Le minibus où l’avocat<br />
colérique et moi n’avions pas pu prendre<br />
place avait été braqué par un passager<br />
dont la mallette contenait un revolver et<br />
par ses complices qui l’avaient suivi en<br />
voiture. Cellulaires, bijoux, poches ventrales,<br />
bagages et tutti frutti, y compris<br />
cartes de crédit, passeports et enfin les<br />
clés du chauffeur d’autobus ont été<br />
réquisitionnées. Et le journaliste de préciser<br />
que c’était la première fois qu’on<br />
s’attaquait à cette compagnie. Robin des<br />
Bois, le héros national, venait de réussir<br />
un gros coup sans que j’écope. Il était<br />
écrit que ma quote-part allait être versée<br />
quand même, mais plus tard et plus au<br />
nord.<br />
O’KIF<br />
(MONDIALISME)<br />
Jeunes<br />
avant tout<br />
LOUISE BIENVENUE rappelle dans<br />
Quand la jeunesse entre en scène (Boréal,<br />
2003) une évidence occultée. Le fait qu’au<br />
Québec, avant la Révolution tranquille,<br />
c’est l’Action catholique – à l’instar du fascisme<br />
et du communisme en Europe – qui a<br />
pris en main la jeunesse et l’a organisée<br />
comme groupe social. Dès la fin de la<br />
guerre, au nom de cette jeunesse même,<br />
les leaders du mouvement contestent l’unanimité<br />
immobile en adoptant le parti de<br />
l’ouverture au monde et aux autres.<br />
La jeunesse, version 1945 – du moins<br />
la vraie jeunesse, celle que prétend<br />
représenter l’Action catholique –<br />
n’est plus la victime se relevant héroïquement<br />
de ses épreuves. Elle est plutôt<br />
citoyenne du monde, sans œillères, résolument<br />
inscrite dans la modernité et<br />
ouverte au progrès. […]<br />
À la JEC (Jeunesse étudiante catholique)<br />
et surtout à la JIC (Jeunesse indépendante<br />
catholique), de même qu’au<br />
CNAC (Comité national d’Action<br />
catholique), s’amorce une lutte contre<br />
l’anticommunisme primaire qui, au-delà de<br />
la sympathie réelle pour certains aspects<br />
de l’idéologie, a pour fonction de distinguer<br />
l’Action catholique du discours<br />
dominant qu’on estime tissé de préjugés<br />
et alimenté par la peur de l’Autre. Un<br />
article du journal jéciste de février 1945<br />
donne parfaitement le ton. Gérard<br />
Pelletier y relate une rencontre effectuée<br />
avec de jeunes communistes. Malgré<br />
quelque précaution de vocabulaire,<br />
Pelletier se doute bien que son analyse,<br />
suggérant d’approfondir la source de<br />
notre psychose anticommuniste ne fera<br />
pas l’unanimité.(…)<br />
Pelletier néanmoins dans une comparaison<br />
téméraire, fait état des similitudes<br />
entre jeunes militants catholiques et<br />
communistes : Les lecteurs me croiront-ils<br />
quand je raconterai des contacts avec des<br />
militants communistes ardents, aimables,<br />
jeunes, polis et de bonne volonté ? Les problèmes<br />
des jeunes sont, en réalité, un<br />
peu partout les mêmes, dit en substance<br />
le jéciste. Il insiste donc sur les solidarités<br />
propres à la classe d’âge, plutôt que<br />
d’invoquer les habituelles divergences<br />
idéologiques : De quoi ils m’ont parlé ?<br />
Certains de leur misère, certains de leurs<br />
idées, d’autres de leur rancœur. Leur misère,<br />
c’était la nôtre : le manque d’argent, la<br />
difficulté de poursuivre des études, la gêne<br />
dans leurs familles. Et dans leurs cellules,<br />
ces jeunes ont trouvé une partie de leur<br />
soulagement : un enthousiasme pour une<br />
cause, une grande ardeur vers un but.<br />
Pelletier en rajoute en faisant l’éloge<br />
de certaines qualités rencontrées chez<br />
les jeunes communistes. L’ardeur envers<br />
la cause, la ferveur, le caractère révolutionnaire,<br />
autant d’attributs que<br />
devraient cultiver davantage les jeunes<br />
catholiques. Aux côtés des communistes,<br />
poursuit-il, ces derniers paraissent<br />
d’ailleurs tièdes, conventionnels, déjà<br />
vieux…Comment en vouloir, alors, à des<br />
jeunes gens qui, faute d’avoir pu assouvir<br />
leur soif d’engagement social, tombent<br />
dans le communisme. Ils seront repêchés<br />
quand on leur aura montré le christianisme<br />
comme une force révolutionnaire,<br />
affirme Pelletier. Quand les chrétiens<br />
trancheront violemment sur le milieu<br />
par leur façon de se conduire, par leur<br />
vie profonde et leur intransigeance chrétienne,<br />
nous verrons revenir ces frères<br />
éloignés.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 7
Le futur citélibriste se montre outré<br />
par un catholicisme embourgeoisé,<br />
conformiste et borné qui juge sans<br />
connaître. Apprenons à connaître le<br />
communisme dans sa réalité concrète,<br />
poursuit-il, plutôt que de donner libre<br />
cours à des fantasmes et projections délirantes<br />
: On m’avait parlé des formidables<br />
techniques communistes. Je ne les ai pas<br />
vues. Je n’ai vu que des jeunes intelligents<br />
qui disposent de moyens simples et les exploitent<br />
à fond. […]<br />
On ne combattra efficacement le<br />
communisme, ajoute le secrétaire du<br />
Comité national d’Action catholique,<br />
<strong>Claude</strong> Ryan, dans Jeunesse canadienne,<br />
que lorsqu’on aura fait l’effort intellectuel<br />
nécessaire pour comprendre profondément<br />
cette idéologie. Les condamnations<br />
répétées de l’Église à l’endroit du<br />
communisme ont été, pour trop de<br />
catholiques, une raison facile de ne pas<br />
l’étudier. Encore une fois, c’est à la jeunesse<br />
qu’il revient de réparer ces<br />
erreurs : Nous les jeunes, nous devons, de<br />
ce côté, être extrêmement ouverts et optimistes.<br />
Les jeunes qui ont adopté la philosophie<br />
communiste, ils ne sont pas toujours, en tant<br />
qu’individus, éloignés de nous-mêmes. (…)<br />
On ne devient pas communiste, en règle<br />
générale, par haine de Dieu ou des saints,<br />
mais par révolte contre des abus trop précis.<br />
(ACTE DE NAISSANCE)<br />
Où étais-je<br />
avant les<br />
mots ?<br />
RENAUD GERMAIN sonde à nouveau<br />
les arcanes de l’écriture en parcourant les<br />
derniers titres de la protéiforme collection<br />
Écrire (Éditions Trois-Pistoles) auxquels<br />
s’adjoignent quelques compagnons de route<br />
plus anciens.<br />
Rois et magistrats, empereurs ou édiles,<br />
consuls ou ethnarques, toutes<br />
ces personnes n’écrivent pas, elles<br />
édictent, c’est-à-dire qu’elles ordonnent,<br />
proclament et dominent. Avec des mots.<br />
Je vous aime écrit Adalbert à Yvonne... Je<br />
8 • L’ A P O S T R O P H E<br />
vous aime écrit Tristan à Iseult... Je vous<br />
aime écrit Romain à Aurore... Je vous<br />
aime écrit Justine à Denis... Je vous<br />
aime écrit Estelle à Eudes... Je vous aime<br />
écrit Marie-Soleil à <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong>... Je<br />
vous aime écrit Hubert à Hortense. Ils<br />
les ont griffonnés sur... Ils ont laissé leurs<br />
notes sur... Qui ne sait lire n’écrit pas !...<br />
Qui est aveugle n’écrit pas !... Qui est<br />
sourd n’écrit pas !... Qui ne voyage pas<br />
n’écrit pas !... Qui ne pille pas n’écrit<br />
pas !... Qui parle trop n’écrit pas !... Qui<br />
craint de se faire voler ses idées n’en a<br />
pas assez pour écrire !... Qui se censure<br />
n’écrit pas !... Qui ne connaît rien au<br />
lieu, à l’époque et au sujet n’écrit pas !...<br />
Qui ne sait comment commencer ou<br />
comment finir n’écrit pas !<br />
MOSE<br />
ANDRÉ BROCHU<br />
La visée critique<br />
Boréal<br />
Il y a un rythme dans l’écriture et, en<br />
écrivant manuellement, je peux le maintenir,<br />
c’est-à-dire que la main peut généralement<br />
suivre la pensée. Quand les<br />
idées affluent trop vite, je griffonne une<br />
note dans la marge de façon à pouvoir y<br />
revenir. J’écris également à toutes les<br />
deux lignes de la page. Ainsi, je peux, la<br />
plupart du temps, corriger mon texte<br />
sans avoir à le réécrire. Toujours la paresse...<br />
Et au diable le papier gaspillé. Je ne<br />
fais pas de plan non plus. Pour la simple<br />
et bonne raison que ce sont les personnages<br />
qui mènent le jeu. Vouloir les corseter<br />
dans un mouvement préétabli ne<br />
marche pas. En tout cas, pas pour moi.<br />
J’ai déjà essayé mais j’ai vite abandonné.<br />
La pensée est volage, l’imagination est la<br />
folle du logis, et je n’ai jamais eu l’intention<br />
de leur passer la camisole de force.<br />
Par ailleurs, le dictionnaire est toujours à<br />
portée de main. Pour vérifier l’orthographe<br />
d’un mot et surtout m’assurer qu’il<br />
veut bien dire ce que je veux exprimer.<br />
CLAUDE JASMIN<br />
Pour l’argent et la gloire<br />
Au fond quelle est l’entreprise créatrice<br />
qui ne comporte aucun risque ? Le<br />
risque fait partie intégrante du métier<br />
d’écrire, comme de bien d’autres situa-<br />
tions, à commencer par le risque de tout<br />
être vivant que la mort guette dès sa<br />
mise au monde. Écrire, c’est risqué, on<br />
ne le dira jamais assez. Dans sa recherche,<br />
l’écrivain s’expose dans toute sa fragilité.<br />
Ce n’est pas facile. Cela demande<br />
tout de même un peu de courage. Il s’expose<br />
tout le temps et tout entier sans<br />
défense, il se montre vulnérable, il<br />
réveille son inconscient, il traverse<br />
quelque exil intérieur, il frise volontairement<br />
ou non l’hérésie morale, sociale,<br />
politique, il rompt avec un état de la<br />
société, il s’offre en nature aux censures<br />
sous toutes leurs formes, il dérange l’ordre<br />
établi, il est à la merci des autres, non<br />
seulement des lecteurs mais aussi de la<br />
critique, des fanatiques, des intolérants.<br />
BERTRAND B. LEBLANC<br />
Les chemins de l’écriture<br />
Écrivains à vos mains, tenons la<br />
plume ardente et fraîche, farouchement<br />
écrivons, bâtissons l’œuvre, il faut y croire,<br />
couchons sur la feuille blanche dans<br />
la lumière crue les plus beaux mots,<br />
allons ! Camouflant mes tendances suicidaires<br />
et mes tares, je cherche désespérément<br />
l’appui de l’autre, l’accord tacite<br />
de ce lecteur hypothétique en moi, j’ai<br />
besoin de me confier à cet être imaginaire.<br />
Je n’ai pas d’ami plus proche. Je ne<br />
sais rien dire d’intéressant, sinon à ce<br />
confident secret et je ne peux pas être<br />
cet autre intime devant une salle pleine<br />
d’invités. Que me sert en effet de parler<br />
dans ce centre commercial? On me pose<br />
des questions. J’ai du mal à parler de moi,<br />
je me tire d’affaire avec ce que je sais de<br />
mon roman, comme si je parlais d’un<br />
HOGARTH<br />
même type que la sienne, répondait tout bonnement : Parce<br />
que vous ne le voulez pas ! Parce que les dirigeants de votre télévision<br />
ne trouvent pas utile d’avoir une émission sur les livres.<br />
Pour des raisons propres à chaque télévision nationale<br />
mais aussi pour une raison sans doute commune à toutes :<br />
une forme de peur. Une crainte inavouable qui pousse à la<br />
censure. Et plus souvent à l’autocensure, laquelle a le puissant<br />
avantage d’être une censure invisible, comme le dit<br />
Pierre Bourdieu (Sur la télévision, Raisons d’agir, 1996). À cet<br />
égard, comme le souligne Pierre Hébert (Censure et littérature<br />
au Québec, Fides,1997), l’absence de censure au niveau de la<br />
manifestation n’est pas l’indice d’une absence de censure tout<br />
court, mais peut-être davantage d’un consensus inconscient.<br />
Cette censure s’attaque au livre en raison de la potentielle<br />
et souvent imprévisible charge de subversion dont il est<br />
porteur. On le sait, au moment où on s’y attend le moins, un<br />
livre surgit, lourd d’une idée, d’une pensée critique au plan<br />
moral ou politique ou social, idéologique, religieux, économique.<br />
Si la télévision avait inscrit à son horaire une véritable<br />
émission qui traite des livres tout en tenant compte de<br />
l’actualité et des grands débats de société, ce livre imprévu,<br />
inattendu et subversif aurait de fortes chances de s’avérer<br />
incontournable.<br />
À L’ORIGINE,<br />
POUR ÊTRE PRISE<br />
AU SÉRIEUX,<br />
LA TÉLÉVISION<br />
SOLLICITAIT<br />
LA CAUTION D’UNE<br />
BIBLIOTHÈQUE<br />
À cet égard ce que nous révèle un simple coup d’œil sur<br />
l’actualité du jour est fort instructif : qui prétendra que seul<br />
un faible auditoire serait intéressé à un débat opposant, par<br />
livres interposés, le général Roméo Dallaire (J’ai serré la main<br />
du diable), Robin Philpot (Ça ne s’est pas passé comme ça à<br />
Kigali) et Gil Courtemanche (Un dimanche à la piscine de<br />
Kigali) ?<br />
Comment la télévision réussit-elle à faire l’impasse sur<br />
ces ouvrages dangereux sans perdre la face, sans avoir l’air de<br />
restreindre la liberté de parole et sans pratiquer de visibles et<br />
gênantes censures ? La réponse qu’elle a trouvée est simple et<br />
radicale : elle ne créera tout simplement pas l’occasion qui fait<br />
le larron ! Ainsi elle se place en situation de ne pas se retrouver<br />
devant la nécessité de censurer, ce qui est fort désagréable<br />
et généralement mal vu. Elle n’aura pas à refuser ou restreindre<br />
le droit de parole puisqu’elle se contentera de ne pas<br />
POURQUOI, LORSQU’ELLE PARLE DU LIVRE,<br />
LA TÉLÉVISION SE LIMITE-T-ELLE<br />
ÀL’ENTREVUE CABOTINE OU INTIMISTE ?<br />
offrir la possibilité de l’exercer, sous prétexte qu’elle a d’autres<br />
obligations plus pressantes. La télévision n’interdit pas la<br />
prise de parole : elle n’ouvre pas le micro, tout simplement !<br />
Une censure par omission, ce qui est une façon, sans crise,<br />
d’installer le silence.<br />
La pensée publique transmise par la télé québécoise<br />
demeure, pour l’essentiel, celle de quelques journalistes et<br />
d’une poignée d’intellectuels patentés, encore là toujours les<br />
mêmes, à qui la télé a recours surtout dans les temps de crise<br />
et qui forment un carrousel dont les visages et propos sans<br />
surprises reviennent périodiquement.<br />
Ça n’est pas faire insulte à ces personnes d’affirmer que<br />
limitant l’expression de la pensée publique à la leur, la télé se<br />
prive et nous prive d’un riche réservoir de connaissances :<br />
celles de nos plus grandes chercheuses, de nos plus éminents<br />
intellectuels, des meilleurs de nos écrivains et des plus intéressantes<br />
de nos auteures qui en sont réduits à demeurer à la<br />
maison au coin du feu et à regarder la télé des autres. À syntoniser<br />
TV5 ou PBS. […]<br />
Le livre n’a jamais eu la partie belle à Radio-Canada, à<br />
aucun moment de son histoire. En 1959, sept ans après sa<br />
naissance, la Société fait le bilan de ses émissions en Arts et<br />
Lettres. En théâtre et en musique, elle se dit fière avec raison<br />
de sa jeune tradition des Téléthéâtres et des Heures du<br />
Concert. Mais sur le thème de la littérature à la télévision,<br />
c’est le silence : elle n’a rien à dire, rien à signaler.<br />
Pourtant, au fil des ans, les arts en général se succéderont<br />
à l’écran. Le plus souvent présentés à des heures invraisemblables,<br />
genre 23h30, après le sport, les nouvelles et le commentaire.<br />
On y parlera théâtre, peinture, danse et, occasionnellement,<br />
livres. Cela s’appellera Arts et Lettres (fin des<br />
années 1950, début des années 1960), Présence de l’art (début<br />
des années 1960). À livre ouvert (été 1964). Miroirs de l’art et<br />
Prisme (fin des années 1960). Ce sera aussi l’increvable série<br />
Rencontres (1971 à 1985) offrant des entrevues sur des thèmes<br />
philosophiques, religieux, artistiques. Certaines années,<br />
au cours de cette période 1960-1980, Radio-Canada affichera<br />
une production intégralement importée de France :<br />
Lecture pour tous, par exemple, avec des animateurs français.<br />
La décennie 1980 nous amènera<br />
Noir sur blanc et Entre les lignes, émissions<br />
consacrées au livre. Puis Coup<br />
d’œil. De 1989 à 1993, La bande des<br />
six, émission culturelle diversifiée,<br />
prendra l’affiche à son tour pour<br />
céder la place à Sous la couverture jusqu’en<br />
1997. Puis, le silence jusqu’en<br />
1999, alors qu’apparaîtra Jamais sans<br />
mon livre, qui décédera sans héritier,<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 1
ILLUSTRATIONS : GRANDVILLE<br />
Disperser la littérature<br />
dans des émissions, mêmes<br />
culturelles, ne rend pas la littérature<br />
visible. Il ne faut pas confondre promotion de la<br />
littérature, lorsqu’il y en a, et émissions littéraires.<br />
Couvrir la littérature à l’intérieur d’autres émissions<br />
est une formule inadéquate et insuffisante. Ce<br />
qu’il faut, ce sont des émissions dédiées à la littérature,<br />
comme certaines sont dédiées à la science, à<br />
l’économie, au sport ou à la religion. La littérature<br />
peut passionner et cela n’a rien à voir avec la formule<br />
tant décriée du show de chaises, décriée<br />
d’ailleurs pour le livre seulement, mais pas pour les<br />
autres domaines, rappelle <strong>Bruno</strong> <strong>Roy</strong> dans la préface<br />
de LA GRANDE PEUR DE LA TÉLÉVISION : LE<br />
LIVRE, un ouvrage qui relève à la fois du plaidoyer<br />
et du pamphlet où JACQUES KEABLE tente de<br />
répondre à une question : l’indifférence de Radio-<br />
Canada pour la littérature québécoise est-elle un<br />
geste politique ou un effet de la bêtise ?<br />
4 0 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Pourquoi la télévision publique n’offre-t-elle pas à son<br />
auditoire, de manière habituelle, à de bonnes heures d’écoute,<br />
des émissions bâties à même l’univers du livre, d’ici et<br />
d’ailleurs, étant donné que non seulement elle peut le faire<br />
mais qu’en plus la culture est au cœur de son mandat principal<br />
?<br />
La télévision de Radio-Canada existe depuis plus de<br />
50 ans, et Télé-Québec depuis plus de 35 ans ! Plus d’un<br />
demi-siècle pendant lequel des équipes de professionnelles et<br />
d’artisans ont été formées, ont animé et animent encore ces<br />
plateaux de télévision. Une aussi longue histoire a forcément<br />
enfanté un bon nombre de pros, comme on dit, parfaitement<br />
capable d’inventer et de concrétiser les bonnes formules,<br />
pourvu qu’on veuille bien leur en offrir le défi et l’occasion.<br />
À tous égards, la compétence télévisuelle existe.<br />
Dès lors pourquoi les rares fois où l’on parle du livre à la<br />
télévision se limite-t-on à l’entrevue cabotine, type émission<br />
de variétés, ou à l’entrevue intimiste, très cu-culturelle, très<br />
bcbg, gentille, complaisante pour ne pas dire servile, comme<br />
si le monde du livre relevait nécessairement d’un univers précieux,<br />
propret, gentillet et bien élevé ?<br />
Pourquoi, pour traiter des grands enjeux sociaux, des<br />
interrogations ou des inquiétudes collectives, des maux de<br />
nos sociétés ou alors de nos aspirations communes, plonge-ton<br />
toujours la ligne à pêche – pour<br />
peu qu’on le fasse – dans le même<br />
petit bassin contenant quelques politiciens<br />
et quelques analystes patentés,<br />
toujours les mêmes, dont<br />
quelques journalistes au savoir évidemment<br />
universel ?<br />
Pourquoi cette exclusive mise en<br />
valeur de la pensée courte et en surface<br />
? Et pourquoi ne s’aventure-t-on<br />
pas plutôt sur des cours d’eau plus<br />
vivaces, plus tourmentés, plus imprévisibles aussi, en y donnant<br />
la parole à celles et ceux de nos écrivains, écrivaines et<br />
intellectuels qui consacrent leur vie à réfléchir à telle ou telle<br />
de ces vastes questions, chacun à sa manière et de son poste<br />
d’observation particulier ?<br />
Bref pourquoi les auteurs, hommes ou femmes, poètes ou<br />
essayistes, tous genres confondus, sauf les quelques visages<br />
habituels qui réapparaissent avec la régularité des saisons,<br />
sont-ils systématiquement absents du petit écran ?<br />
À toutes ces questions, les réponses généralement mises<br />
de l’avant apparaissent comme autant de prétextes opportuns<br />
destinés à déculpabiliser les responsables de la télévision<br />
et justifier leur désintérêt. Aucune des explications fournies à<br />
ce jour n’arrive à faire comprendre la pérennité du phénomène.<br />
: le livre est absent des ondes québécoises depuis la<br />
naissance de la télévision, en 1952. L’exception d’une présence<br />
ponctuelle ne fait que confirmer la règle.<br />
Bernard Pivot, à qui des Anglais, Suédois et autres<br />
Européens demandaient systématiquement pourquoi diable<br />
ils ne bénéficiaient pas, chez eux, d’émissions littéraires du<br />
autre, je pourrais donner des conseils,<br />
mais beaucoup sont impossibles à suivre.<br />
Où étais-je avant les mots ? Enfant,<br />
ils m’ont servi à énumérer, à mettre en<br />
forme, à paginer mes jours. J’ai eu des<br />
mots favoris, des mots qui m’ont impressionné,<br />
je me suis habillé de mots, ils<br />
m’ont marqué, puis un jour, j’ai su lire<br />
des phrases, écrire des phrases au tableau<br />
noir de la classe et dans mon cahier de<br />
composition, j’ai appris les verbes pronominaux,<br />
les noms composés et leur pluriel,<br />
les participes passés variables et surtout<br />
j’ai respiré le parfum des livres à la<br />
bibliothèque et j’ai été saisi par l’esprit<br />
des légendes, c’est là que j’ai voulu devenir<br />
écrivain. Maintenant le silence tout<br />
autour de moi m’envahit, l’écriture n’est<br />
pas un job. Au clair de la lune, j’ai perdu<br />
ma plume, les griffes de l’ombre se resserrent<br />
sur moi. La mort viendra et je<br />
n’aurai rien écrit (...)<br />
GAËTAN BRULOTTE<br />
La chambre des lucidités<br />
C’est un fait que les livres restent<br />
dans leur ghetto culturel ou ils étouffent<br />
dans des entrepôts en attendant leur<br />
pilonnage. Quel gaspillage d’argent des<br />
contribuables ! Des efforts concrets doivent<br />
être déployés pour la promotion et<br />
la diffusion des livres écrits directement<br />
en français au Québec, pour leur traduction<br />
et leur exportation, ailleurs au<br />
Canada et dans le monde, et autrement<br />
qu’au compte-gouttes actuel.<br />
DANIEL GAGNON<br />
A contrario<br />
Hélas, le colonisé n’a pas de passé.<br />
Même si sa devise est Je me souviens, il<br />
oublie tout, faisant persister dans le futur<br />
son passé de colonisé qui continue de se<br />
projeter dans son absence d’avenir culturel<br />
autonome. La culture a besoin que<br />
son peuple la porte, pour la faire rayonner,<br />
ici et ailleurs. Ce n’est que comme<br />
cela qu’elle existe : parce que le monde<br />
en parle et est fier de bénéficier d’un<br />
contact étroit avec elle, parce que le<br />
peuple s’identifie à la force de créativité<br />
qui en émane et qu’il s’enorgueillit des<br />
talents des siens dont il sait que les siens<br />
et les autres font la critique et l’éloge.<br />
Ainsi que l’a parfaitement compris<br />
Gaston Miron, c’est de cette façon que<br />
l’on arrive à édifier quelque chose<br />
comme une conscience nationale, une<br />
fierté nationale.<br />
GINETTE PELLAND<br />
Dans un pays colonisé<br />
(Lors d’un séjour en France.) Nous,<br />
c’est pas pareil. On a de l’argent, eh bien<br />
soit, ça vaut bien certaines valeurs. On<br />
achète. La civilisation appartient à ceux<br />
qui ont de l’argent; on est en train de<br />
vider vos musées, vos châteaux, j’ai vu<br />
des Américains l’autre jour leur voiture<br />
pleine à craquer de tableaux, de mobilier,<br />
et ils vont transporter ça en Amérique.<br />
Oui, on achète, et la civilisation s’achète,<br />
et la culture vient ensuite. Pour le<br />
moment, money talks et le reste viendra<br />
par surcroît, comme c’est arrivé pour les<br />
Grecs et les Romains.<br />
GASTON MIRON<br />
À bout portant,<br />
correspondance<br />
avec <strong>Claude</strong> Hæffely<br />
(1954-1965) Leméac<br />
(COUP DE GRIFFE)<br />
Le chèque<br />
suivra<br />
CARMEL DUMAS a l’habitude de porter<br />
plusieurs chapeaux : journaliste, recherchiste,<br />
scénariste et réalisatrice. Dans son<br />
deuxième roman, Le retour à l’école d’une<br />
waitress de la télévision (VLB éditeur,<br />
2003), elle fait un portrait charge<br />
des producteurs qui n’est pas dénué<br />
de vraisemblance.<br />
Dans l’antichambre du producteur,<br />
les petites gens sont dans leurs<br />
petits souliers. Ne vous laissez pas<br />
intimider. Que le budget en devenir soit<br />
considéré gros, petit, honnête, ridicule,<br />
peu importe. Une tranche importante de<br />
ce budget sera engloutie dans le roulement<br />
du bureau où vous venez de mettre<br />
les pieds. […]<br />
S’il y a une préposée à la réception,<br />
l’auteur d’un projet en devenir peut se<br />
féliciter de contribuer à son salaire. Le<br />
télécopieur, le système informatisé, le<br />
papier, les cartouches, la machine à<br />
café : tout l’équipement de ce bureau<br />
fera partie des coûts de production de<br />
votre projet à vous.<br />
J’ai tout vu. Des penthouse luxueux,<br />
avec des pièces de collection : téléviseurs<br />
d’époque, sculptures, tableaux, juke-box.<br />
Une pièce unique dans un chic immeuble<br />
du Vieux, pas un objet personnalisé,<br />
avec un bureau de métal de location,<br />
trois chaises chromées, des étagères en<br />
mélamine avec quelques cassettes, un<br />
téléphone pour reconduire les appels sur<br />
le portable. Il ne s’agissait pas d’un<br />
récent déménagement ; le producteur s’y<br />
sentait très bien, il répétait à toutes les<br />
deux phrases qu’il n’aimait pas la bullshit.<br />
Des anciennes usines, des maisons patriciennes.<br />
Le quartier huppé<br />
d’Outremont, le quartier avoisinant<br />
Radio-Canada, TVA et Télé-Québec, le<br />
quartier industriel longeant le canal<br />
Lachine, le sympathique Quartier latin.<br />
Lorsque les producteurs choisissent leur<br />
adresse, ils cherchent à se positionner<br />
dans l’opinion des autres. […]<br />
Pour retarder la signature et l’application<br />
des contrats après la poignée de<br />
main, les producteurs ont mille trucs. Le<br />
directeur de production, l’administrateur<br />
ou l’avocat a tous les détails, il va<br />
vous appeler dès qu’il aura une minute.<br />
L’avocat a préparé le contrat, mais il attend<br />
la signature d’un des associés actuellement<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 9<br />
SONIA LÉONTIEFF
en voyage, lequel associé<br />
ne manquera pas de se<br />
libérer pour monter sur<br />
le podium au gala des<br />
Gémeaux le jour où<br />
l’œuvre en devenir se<br />
montrera méritoire de ladite signature.<br />
Le contrat est signé, on vous en fait parvenir<br />
copie. Le courrier est lent, n’est-ce pas ?<br />
– Oui, cher producteur, cher maître,<br />
cher bras droit des dieux, j’ai bien reçu<br />
copie du contrat signé, il y a un mois,<br />
cependant je ne trouve pas dans l’enveloppe<br />
le chèque correspondant à cette<br />
petite clause : payable à la signature de la<br />
présente. – Ça, il faut demander à la<br />
comptabilité. Ou : La pratique chez nous,<br />
c’est d’émettre les chèques des pigistes une<br />
fois par mois : ça va aller au mois prochain,<br />
la comptabilité vient juste de recevoir sa<br />
copie du contrat.<br />
Dans les bureaux, où ils ne sont<br />
qu’un, ou un et une douce moitié, après<br />
l’entente verbale, on est trop débordé<br />
pour retourner les appels, et après la<br />
signature du contrat, on entraîne l’auteur<br />
dans un beau grand voyage de<br />
transparence, en copain-copain : Le c…<br />
de diffuseur n’a pas encore émis mon (sic)<br />
chèque…Mon gérant de banque refuse de<br />
me faire une avance… La SODEC m’a<br />
encore envoyé un formulaire à remplir…<br />
J’attends des crédits d’impôts… N’importe<br />
quoi ! […]<br />
La culture mercantile mène l’univers<br />
culturel de la production télévisuelle.<br />
On ne parle que de ça. Les producteurs<br />
et leurs bras droits, qui ne viennent<br />
jamais sur les lieux de tournage, qui ne<br />
rencontrent jamais face à face l’équipe et<br />
les forces vives des émissions, s’imaginent<br />
qu’ils font de la télévision. Rien<br />
n’est plus trompeur. C’est pathétique, à<br />
la longue. On est fier d’avoir fait sa part<br />
quand a réussi à négocier un artiste à la<br />
baisse, quand on a réussi à obtenir gratuitement<br />
un bateau ou une salle de bal,<br />
alors que nous avions convenu, sur le<br />
terrain, d’y aller d’un petit cent dollars.<br />
Croyez-moi, c’est sans fin.<br />
Lorsque, excédée, je demandais à un<br />
administrateur : Dis-moi combien on peut<br />
mettre là-dessus, je vais m’organiser, la<br />
réponse toute prête enfonçait le clou : Si<br />
je dis que je peux mettre tant, tu vas me dire<br />
1 0 • L’ A P O S T R O P H E<br />
ça coûte tant. Essaie de voir ce que tu peux<br />
négocier de moins cher et on en discutera.<br />
J’ai trop entendu d’administrateurs ou de<br />
prétendus coordonnateurs de production<br />
qui ne sont en fait que des serreurs<br />
de cordons de la bourse parler du budget<br />
d’une production comme s’ils avaient<br />
ouvert leur propre compte de banque<br />
pour la rendre possible : J’ai tant… J’ai<br />
pas ça… Je vais lui payer ça… Jamais de<br />
nous. Jamais de Comment va le tournage ?<br />
Ce chapitre me déprime : je m’appauvris<br />
à chaque paragraphe ! Le plus triste,<br />
c’est qu’il dilue l’amour du métier.<br />
Ben Turpin<br />
(ENTARTOLOGIE)<br />
Pas de crème<br />
pas de gag<br />
MACK SENNETT est natif des Cantons de<br />
l’Est, réalisateur comique à la Biograph avec<br />
D. W. Griffith, puis patron de la Keystone,<br />
il a été l’inventeur des Keystone Kops et<br />
l’accoucheur de presque tous les grands<br />
comiques du cinéma muet dont Charlie<br />
Chaplin. Dans son autobiographie, Le roi du<br />
comique (Points, Seuil,1994), il raconte la<br />
naissance d’un art, l’entartage.<br />
Les historiens du cinéma me tiennent<br />
pour le créateur de ce qui fut jadis un<br />
aspect noble de l’art cinéplastique :<br />
le lancer de tartes à la crème. La tarte à<br />
la crème était tout un symbole : c’était<br />
l’assouvissement d’un désir que tout le<br />
monde avait, surtout lorsque cette tarte<br />
visait un digne représentant de l’auto-<br />
rité, un policier ou une belle-mère. Je<br />
serais donc flatté de revendiquer cette<br />
trouvaille, mais le mérite en revient à<br />
Mabel Normand. […]<br />
Un après-midi, aux studios de la<br />
Keystone, le tournage d’une scène qui<br />
paraissait ultra-simple posa des problèmes.<br />
Ben Turpin devait passer la tête<br />
dans l’embrasure d’une porte, et, comme<br />
ses yeux roulaient dans toutes les directions,<br />
on pensait que la scène serait amusante.<br />
Il n’en fut rien.<br />
Mabel Normand, qui n’avait rien à<br />
voir avec cette séquence, observait la<br />
scène. Elle était assise bien sagement et<br />
pour une fois s’occupait de ses affaires<br />
lorsqu’elle se retrouva avec une tarte<br />
dans la main. C’était une tarte à la<br />
crème. Le dessert de deux charpentiers.<br />
Mabel renifla la tarte et eut une idée.<br />
Elle soupesa la pâtisserie, la fit sauter<br />
dans sa main droite, la considéra avec<br />
bienveillance, prit appui sur la plante des<br />
pieds, prépara son lancer comme un<br />
joueur de base-ball professionnel et tira.<br />
L’histoire du cinéma, des millions de dollars<br />
et des rires à foison allaient dépendre<br />
de la justesse de son tir : la tarte décrivit<br />
une belle trajectoire et s’écrasa sur le<br />
visage de Turpin avec un bruit sourd.<br />
Personne ne s’attendait à ce tir<br />
mémorable et Turpin encore moins que<br />
les autres. La caméra, qui tournait à seize<br />
images secondes, était cadrée sur lui.<br />
Quand la tarte l’atteignit, le visage de<br />
Turpin exprima une stupéfaction absolue.<br />
Sa belle assurance disparut sous la<br />
coulée de crème qui dégoulinait sur le<br />
devant de sa chemise. La caméra était<br />
toujours braquée sur lui lorsque ses yeux<br />
refirent surface : ils papillotaient dans<br />
tous les sens sans comprendre ce qui leur<br />
était arrivé.<br />
La tarte à la crème devint par la<br />
suite un numéro classique, au même<br />
titre que la chute sur le derrière, la réaction<br />
tardive, la montée progressive de la<br />
colère et le saut kamikaze<br />
qui constituaient les effets<br />
de base de tout bon<br />
acteur comique. Comble<br />
de malchance pour les<br />
érudits, j’ai oublié le nom<br />
du film dans lequel la première<br />
tarte fut lancée.<br />
Toujours sans<br />
mon livre<br />
Le syndrome<br />
de Radio-Canada<br />
de JACQUES KEABLE<br />
EXTRAIT<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3 9<br />
ARCIMBOLDO
Une histoire triste<br />
3 8 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Une histoire triste<br />
Gigi Perron<br />
Faut-il ajouter qu’elle a tenu sept expositions individuelles et neuf collectives ?<br />
Pourquoi je la trouve importante ? Parce que c’est un peintre qui ouvre la porte de<br />
votre salon à ces êtres sombres et lumineux dont Baudelaire a le secret.<br />
Mon enfant a des yeux obscurs, profonds et vastes<br />
Comme toi, Nuit immense, éclairés comme toi !<br />
GILLES DEROME<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 1 1
Une histoire triste<br />
1 2 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Une histoire triste<br />
Gigi Perron<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3 7
Pas de peau le mec !<br />
Un polar ïde<br />
Les flics étaient sur les dents. Faut dire que le mec était<br />
carrément barjo. Genre pas franc du collier ! Ils avaient<br />
beau le filer depuis deux mois, impossible de dénicher le<br />
corps. Pour eux y’avait pas photo. Il avait zigouillé sa bourgeoise,<br />
mais pas de macchabée, pas de preuve.<br />
Même un cheveu aurait suffi pour le choper, mais que<br />
dalle ! Les condés avaient d’autant plus les boules que le mec,<br />
libéré après une mise en examen, roulait carrosse, sous leur<br />
nez, avec un sourire narquois en travers de sa petite gueule<br />
de marlou. Eux, ça commençait à les gonfler cette histoire. Ils<br />
avaient autre chose à foutre.<br />
Des affaires de mœurs avec des maquereaux basanés, des<br />
stups planqués dans de la lingerie féminine à l’intérieur d’une<br />
valise diplomatique, des branleurs qui chouravaient dans les<br />
caisses du Ministère des Finances, un<br />
rastaquouère pris en flagrant délit de<br />
prostitution dans les chiottes de l’archevêché,<br />
une hystérique complètement<br />
givrée qui avait planté un surin dans la<br />
fesse gauche d’un chanteur de charme<br />
en plein adultère, des mioches qui n’avaient<br />
rien d’autre à branler qu’à prendre<br />
des vieux en otage, des rois de la<br />
pédale qui se tapaient des topettes revigorantes<br />
entre deux étapes de montagne<br />
et un ministre fringué en danseuse<br />
brésilienne qui faisait des heures sup<br />
dans le petit-bois derrière chez lui. Ils en<br />
avaient par-dessus la tête les poulets.<br />
Pour dire les choses plus simplement : ils<br />
en avaient plein le cul !<br />
C’est là que le divisionnaire décida d’arrêter les frais et<br />
refila le dossier en désespoir de cause à Roger-Marcel, encore<br />
appelé Roma, le seul flic qui pouvait se tenir en planque<br />
toute une journée dans un dépotoir sans broncher. Lui, y s’en<br />
foutait, du moment qu’il ne glandait pas au burlingue avec les<br />
autres, ça lui allait. Et puis, les affaires à la mord-moi-lenœud,<br />
c’était plutôt son truc.<br />
D’abord il ne partait pas de rien. Il y avait le dossier sur<br />
le mec en question et assez d’infos. Il pigea tout de suite que<br />
c’était une affaire de pognon. Si le mec avait trucidé sa grosse<br />
c’était pour palper un max de blé. Et depuis le gonze se la<br />
coulait façon nabab dans une baraque de rupin sur la côte.<br />
Roma, plutôt du genre fouineur, décida de lui rendre une<br />
3 6 • L’ A P O S T R O P H E<br />
�<br />
JEAN-MARIE BIOTEAU<br />
petite visite, histoire de renifler la taule. Il préféra sa meule à<br />
la caisse de fonction et la joua genre employé du gaz.<br />
Il se présenta l’air de rien. Le mec ne moufta pas quand<br />
il voulu aller reluquer le compteur. Faut dire que le zigue faisait<br />
du gras au bord de sa pistoche avec une travailleuse<br />
sociale plutôt accorte. Roma prit tout son temps et visita la<br />
maison dans ses moindres recoins, en vain! Pas un bout d’ongle,<br />
pas un cil. La bicoque était nickel avec les meubles et<br />
décorations craignos, type nouveau riche. Des tableaux pourris,<br />
des bibelots de supermarché et des sculptures à gerber<br />
comme cette tronche de vierge en peau de zébu. Circulez, y’a<br />
rien à voir. Il s’arracha à contrecœur.<br />
De retour dans son gourbi, il fila du mou à son cabot et<br />
se prépara à bouffer en pensant au mec et à sa bicoque.<br />
Y’avait quelque chose qui le turlupinait<br />
mais il ne savait pas quoi. Tout en se faisant<br />
cuire un boudin blanc, il se disait<br />
que le mariolle avait effectivement l’air<br />
un peu branque. Il réchauffa une vieille<br />
purée, y ajouta le boudin et s’installa à<br />
table avec un litron de rouquin. Sans<br />
savoir pourquoi il n’arrêtait pas de penser<br />
à la piaule du zigoto et à quelque<br />
chose qui clochait dans la décoration,<br />
mais il ne savait pas quoi. Il prit son couteau<br />
et tailla dans le boudin pour enlever<br />
la peau qu’il ne bouffait jamais. Il la<br />
trouvait dégueulasse. Et c’est là qu’il<br />
suspendit son geste et eut aussitôt un<br />
frisson d’illumination du genre vierge<br />
dans une grotte le soir au bord d’un gave. La piaule, bordel<br />
! Mais c’est sûr. Il est encore plus givré que j’pensais !<br />
Dans la nuit, il fit sortir toute une armada de flics qui<br />
pionçaient tranquillos avec leur bobonne et débarqua chez le<br />
taré qui s’envoyait en l’air avec une autre travailleuse sociale,<br />
dans sa piaule, sous la tronche de vierge en peau de zébu.<br />
Le mec fut menotté dans le temps de le dire et embarqué surle-champ<br />
à la maison Poulaga.<br />
En fait de peau de zébu, l’analyse révéla que c’était celle<br />
de sa bourgeoise qu’il avait ainsi immortalisée après empoisonnement<br />
en bonne et due forme. Puis il avait fait disparaître<br />
le reste selon la technique du docteur Petiot. Ni vu ni<br />
connu. Une histoire de cinglé. Mais c’était sans compter sur<br />
la perspicacité de Roger-Marcel. Pas de peau le mec !<br />
Haïti :<br />
UN DOSSIER DE MICHEL CHOSSUDOVSKY<br />
Ce n’est pas une coïncidence<br />
si Washington a choisi de remettre<br />
officiellement en question la légitimité<br />
de la présidence de <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide<br />
la veille même de son nouvel exil forcé en<br />
République Dominicaine.<br />
Son échec à adhérer aux principes démocratiques a provoqué<br />
une profonde polarisation de la population et contribué aux violentes<br />
émeutes auxquelles nous assistons aujourd’hui à Haïti,<br />
décrétait alors le communiqué de la Maison-Blanche en invitant<br />
le président haïtien désavoué à bien évaluer sa situation,<br />
à en tirer la conclusion qui s’impose et à agir dans l’intérêt de son<br />
peuple. Bref, la justification anticipée de son kidnapping.<br />
En fait rien n’avait été laissé au hasard pour l’effacer du<br />
portrait. L’insurrection armée qui a permis de renverser le<br />
président Aristide le 29 février 2004 était le fruit d’une opération<br />
de type militaire combinée à diverses opérations de<br />
renseignements. L’armée des insurgés a traversé la frontière<br />
de la République Dominicaine au début du mois de février.<br />
On parle ici d’une unité paramilitaire bien armée, équipée et<br />
entraînée à laquelle se sont intégrés d’anciens membres du<br />
Front pour l’avancement et le progrès en Haïti (FRAPH)<br />
qui regroupait ces sinistres escadrons de la mort en tenue de<br />
ville, impliqués dans des assassinats politiques et des massacres<br />
d’innocents perpétrés lors du coup d’État militaire de<br />
1991. On se souviendra que ce dernier était commandité par<br />
la Central Intelligence Agency (CIA) pour renverser le premier<br />
gouvernement démocratiquement élu du président<br />
<strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide.<br />
Le Front autoproclamé pour la libération et la reconstruction<br />
nationale (FLRN) est dirigé par Guy Philippe, un<br />
ancien membre des Forces armées haïtiennes et par ailleurs<br />
chef de la police. Lors du coup d’État de 1991 et en compagnie<br />
d’une douzaine d’autres officiers de l’armée haïtienne,<br />
Philippe a suivi un entraînement avec les Forces spéciales<br />
américaines en Équateur. Les deux autres commandants qui<br />
ont dirigé les attaques des insurgés contre Gonaïves et Cap-<br />
Haïtien sont des associés de Guy Philippe, tous deux anciens<br />
Tontons Macoutes et ex-dirigeants du FRAH : Emmanuel<br />
Constant, surnommé Toto, et Jodel Chamblain.<br />
coup d’État<br />
as usual<br />
En 1994, Emmanuel Constant dirigeait les opérations<br />
d’un escadron de la mort du FRAPH dans un bidonville<br />
côtier à quelque 150 km au nord de la capitale Port-au-<br />
Prince. Le village de Raboteau qui compte environ 6 000 habitants,<br />
dont la plupart sont pêcheurs ou sauniers, avait la réputation<br />
d’être un bastion de l’opposition où des dissidents politiques<br />
venaient souvent se cacher, rappelle le St Petersburg Time<br />
(Floride, 1er septembre 2002).<br />
Le 18 avril 1994, une centaine de soldats et une trentaine de<br />
paramilitaires y débarquent pour ce que les enquêteurs allaient<br />
décrire plus tard comme une répétition générale du Massacre<br />
de Raboteau. Ils expulsent les gens de leurs maisons pour découvrir<br />
où se cache Amiot Cubain Métayer, un partisan bien connu<br />
d’Aristide, tabassent de nombreuses personnes, dont une femme<br />
enceinte qui en fait une fausse-couche, forcent d’autres personnes<br />
à boire à même les égouts à ciel ouvert et torturent un vieil aveugle<br />
de 65 ans jusqu’à ce qu’il vomisse du sang. L’homme meurt le<br />
lendemain.<br />
Le 22 avril avant l’aube, les soldats réapparaissent. Cette fois,<br />
ils mettent les maisons à sac et abattent des gens dans les rues.<br />
Lorsque les habitants s’enfuient vers leurs barques, d’autres soldats<br />
leur tirent dessus depuis des embarcations qu’ils ont réquisitionnées.<br />
Pendant plusieurs jours, la mer rejettera les corps. Le<br />
nombre des victimes a été estimé entre deux douzaines et une trentaine.<br />
Craignant de nouvelles représailles, des centaines d’autres<br />
ont fui Raboteau.<br />
ILLUSTRATIONS : GUADALUPE POSADA<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 1 3
Sous la dictature militaire<br />
(1991-1994), le FRAPH était<br />
passé officieusement sous la<br />
juridiction des Forces armées<br />
et prenait ses ordres du commandant<br />
en chef, le général<br />
Raoul Cedras. Selon un rapport<br />
de la Commission des<br />
droits de l’Homme des<br />
Nations unies, daté de 1996,<br />
le FRAPH bénéficiait également<br />
des largesses de la CIA. Il<br />
n’était pas le seul puisque les<br />
dirigeants de la junte militaire<br />
qui protégeait le trafic de la<br />
drogue figuraient sur les feuilles de paie depuis le coup d’État.<br />
Toto Constant l’a confirmé en 1995 dans une entrevue à<br />
l’émission 60 Minutes (CBS) : la CIA lui versait environ 700<br />
dollars par mois et le FRAPH a été constitué avec les encouragements<br />
et le soutien financier de la CIA et de la Defense<br />
Intelligence Agency (DIA). (Miami New Times, 26 février<br />
2004)<br />
La Plate-forme démocratique des Organisations de la<br />
Société civile et des Partis politiques de l’Opposition est<br />
formée de la Convergence démocratique (CD) de l’ancien<br />
maire de Port-au-Prince, Evans Paul, et du Groupe des 184<br />
Organisations de la Société civile (G-184) dirigé par André<br />
(Andy) Apaid, chaud partisan du coup d’État militaire de<br />
1991. Né aux États-Unis de parents haïtiens, Apaid est<br />
citoyen américain. Il est propriétaire d’Alpha Industries, l’une<br />
des plus importantes lignes d’assemblage destiné à l’exportation.<br />
Ces bagnes à main-d’œuvre bon marché qui ont vu le<br />
jour sous Duvalier manufacturent des produits textiles et des<br />
produits électroniques pour un certain nombre de firmes<br />
américaines, parmi lesquelles Sperry/Unisys, IBM, Remington<br />
et Honeywell.<br />
Avec une main-d’œuvre de quelque 4 000 travailleurs,<br />
Andy Apaid est le plus gros employeur industriel d’Haïti. Et<br />
le pire des exploiteurs. Alors que le salaire minimal haïtien<br />
est aux environs de 1,50 $ dollars par jour, les salaires payés<br />
dans les usines d’Apaid ne dépassent pas 68 cents (Miami Times,<br />
26 février 2004). Déjà en 1996, le Comité national de<br />
l’Emploi, un organisme basé aux États-Unis, dénonçait les<br />
mauvaises conditions de travail des employées d’Apaid obligées<br />
de travailler 78 heures par semaine.<br />
Le G-184 d’Apaid et la CD d’Evans Paul entretiennent<br />
des liens étroits avec le FLRN de Guy Philippe, lequel FLRN<br />
reçoit des fonds de la communauté haïtienne des affaires. En<br />
d’autres termes, il n’y a pas de division bien tranchée entre<br />
l’opposition civile qui s’affiche non violente et les paramilitaires<br />
mortifères du FLRN puisqu’ils font tous partie de cette<br />
plate-forme prétendument démocratique. Il faut savoir qu’en<br />
février dernier, durant toute la période qui a précédé le<br />
départ du président Aristide pour la République<br />
Dominicaine, l’organisation parapluie des cercles d’affaires<br />
1 4 • L’ A P O S T R O P H E<br />
de l’élite et des ONG religieuses était en relation avec le<br />
secrétaire d’État des États-Unis, Colin Powell, par le biais<br />
d’Andy Apaid, dont le G-184 reçoit également des sommes<br />
d’argent considérables de l’Union européenne.<br />
À Haïti, cette opposition civile est commanditée par le<br />
National Endowment for Democracy (NED) qui travaille<br />
main dans la main avec la CIA. La Plate-forme démocratique<br />
et le G-184 sont financés de leur côté par l’une des<br />
composantes actives du NED, l’International Republican<br />
Institute (IRI) dont le sénateur républicain John McCain est<br />
président du conseil de direction. Le NED (que supervise<br />
l’IRI) ne fait pas officiellement partie de la CIA, mais il remplit<br />
d’importantes fonctions sur le plan des renseignements<br />
dans l’arène des partis politiques civils et des ONG.<br />
Rappelons que le National Endowment for Democracy a été<br />
créé en 1983 à l’époque où la CIA était précisément accusée<br />
de corrompre en sous-main les hommes politiques et de<br />
monter de fausses organisations de protection de la société<br />
WASHINGTON N’A RIEN NÉGLIGÉ POUR<br />
EFFACER ARISTIDE DU PORTRAIT<br />
civile. Selon Allen Weinstein, l’homme qui a mis le NED sur<br />
pied à l’époque de l’administration Reagan, une bonne partie<br />
de ce qu’on fait aujourd’hui était déjà fait en secret par la CIA, il<br />
y a 25 ans (Washington Post, 21 septembre 1991).<br />
Le NED draine des fonds du Congrès américain vers<br />
quatre institutions : l’International Republican Institute déjà<br />
cité, le National Democratic Institute for International<br />
Affairs (NDI), le Center for International Private<br />
Enterprise (CIPE), et l’American Center for International<br />
Labor Solidarity (ACILS). Ces organisations,<br />
veut-on nous faire croire, ne sont qualifiées que<br />
pour fournir de l’assistance technique aux démocrates<br />
en herbe du monde entier. Autrement dit, il existe<br />
une nette répartition des tâches entre la CIA et le<br />
NED. Pendant que la CIA finance en secret des<br />
groupes rebelles de paramilitaires armés et autres<br />
Célébration<br />
intime de la vie anodine<br />
Un lexique poétique d’ANDRÉ ANGÉLINI<br />
ADOUCET n.m. Phrase joyeuse servant<br />
à entreprendre une conversation avec<br />
une personne qui semble de mauvaise<br />
humeur.<br />
AFFRIOLET n.m. Partie la plus intense<br />
d’une déclaration d’amour.<br />
AMANTEAU n.m. Amant de petite<br />
taille.<br />
BARTAISE n.f. Tante éloignée et corpulente<br />
qui porte une robe très décolletée<br />
au réveillon de Noël.<br />
BÉCOLLE n.f. Petite école où l’on n’apprend<br />
pas grand-chose.<br />
CAMILITUDE n.f. État de grande paix<br />
atteint après un long voyage dans le<br />
désert à dos de chameau.<br />
CORRIDON n.m. Partie intime du corridor<br />
qui mène directement de l’ascenseur<br />
à la porte de votre appartement.<br />
DASMADOLE n.m. Médicament clinique<br />
servant à contrôler l’éjaculation<br />
précoce. La femme moderne transporte<br />
avec elle, dans son sac à main, des condoms<br />
et du dasmadole.<br />
DERMILLE n.f. Bout d’étoffe ou de peau<br />
qui se coince dans la fermeture éclair<br />
d’un pantalon. Se prendre la dermille.<br />
DRAMITON n.m. Querelle d’amoureux<br />
dont la raison exacte n’est pas tout à fait<br />
évidente.<br />
ÉCOUTIRETTE n.f. Conversation téléphonique<br />
qui n’en finit plus.<br />
ÉPIDONETTE n.f. Instrument de<br />
musique accordé en do. Pour les autres<br />
tonalités, il faut utiliser l’épirénette, l’épiminette.<br />
l’épifanette, l’épisolnette, l’épilanette<br />
et enfin, l’épissinette.<br />
FABRAC n.f. Petite usine où sont fabriqués<br />
des objets de qualité douteuse.<br />
FRIPOLINE n.f. Visage d’un homme de<br />
40 ans, le lendemain d’une beuverie.<br />
GAUBE n.f. Voiture écologique de fabrication<br />
belge qui fonctionne à l’eau<br />
Perrier.<br />
GOSPÈRE Petite localité d’Abitibi difficile<br />
d’accès.<br />
HADAIRE n.m. Type de cuir dont sont<br />
recouvertes certaines chaises anciennes<br />
et qui a la propriété de retenir le pantalon<br />
ou la robe de quiconque s’y assied<br />
plus de cinq minutes.<br />
HENTREAU n.m. Pièce d’ameublement<br />
qui ne semble plus cadrer dans votre<br />
nouvel appartement.<br />
INCOMPLÉTAIN n.m. Se dit d’une<br />
personne qui a de la difficulté à terminer<br />
ses travaux ou ses phrases ou ses…<br />
INSTAMINETTE n.f. Jeune fille qui se<br />
donne rapidement.<br />
INVISSE n.m. Le tracé imaginaire qu’on<br />
se fait du chemin parcouru dans la dernière<br />
demi-heure lorsqu’on s’aperçoit<br />
qu’on a perdu son portefeuille.<br />
JANDOURET n.m. Partie de l’épaule<br />
masculine sur laquelle la femme aime<br />
reposer sa tête après les politesses d’usage.<br />
JINET n.m. Le tiroir du milieu d’une<br />
commode qui, sans raison valable, est<br />
généralement impossible à ouvrir alors<br />
que les autres s’ouvrent comme s’ils<br />
étaient montés sur des roulettes.<br />
KANDON n.m. Le condom qui demeure<br />
dans la pochette de côté d’un portefeuille<br />
depuis maintenant plusieurs mois.<br />
KATAFE n.f. Claque sur la gueule qui<br />
fait beaucoup de bruit.<br />
LALEAU n.f. Enseigne routière indiquant<br />
la proximité d’une rivière.<br />
Chercher le laleau.<br />
LASQUIPE n.m. Disque laser qui saute.<br />
MAMILETTE n.f. Partie mobile d’une<br />
sonnette d’entrée.<br />
MÉNACHINON n.m. Diachylon utilisé<br />
pour la seconde fois.<br />
NICRONÉBAF n.f. Facture outrageusement<br />
élevée qui n’était pas prévue.<br />
NIPLUSE n.f. Morceau de trottoir qui,<br />
inexplicablement, demeure sec pendant<br />
une grosse pluie.<br />
ODOUCET n.m. La partie directement<br />
palpable d’un postérieur féminin.<br />
ORÉLÉFANT n.m. Petit oreiller en<br />
forme de pachyderme.<br />
PARCONQUINELLE n.f. Espace de stationnement<br />
réservé à une toute petite<br />
voiture.<br />
PLANTÈRE n.f. Morceau de glace noire<br />
déguisée en asphalte dont la fonction est<br />
d’attendre le piéton inattentif.<br />
QURISSE Ville portuaire du bas du fleuve<br />
souvent évoquée au cours des conversations<br />
entre travailleurs au Québec.<br />
RHODOTENDREAU n.m. Mot exact à<br />
utiliser pour décrire le roulis roulant<br />
d’une rame de métro entre deux stations.<br />
RIDENCE n.f. Le dernier d’une série de<br />
48 paiements à terme.<br />
SERMONTEILLE n.f. Type de fatigue<br />
qu’on ne ressent qu’à l’église.<br />
TERMALINE n.f. Phrase sèche et détachée<br />
d’émotion dont on se sert pour couper<br />
court à une conversation qu’on ne<br />
désirait pas avoir.<br />
TRINQUELET n.m. Goutte d’eau chaude<br />
qui coule en permanence dans un<br />
logement modeste et froid, empêchant<br />
ainsi les tuyaux de geler.<br />
USANCÈNE n.m. Comédien qui aurait<br />
dû choisir un autre métier.<br />
VIRCOMANT n.m. Tournevis dont la<br />
tige ne correspond à aucune des vis en<br />
usage sur le marché.<br />
XIRELLE n.f. Soirée Tupperware avec<br />
parade de sous-vêtements érotiques.<br />
YOUBETTE n.f. Yaourt glacé à saveur de<br />
betterave.<br />
ZOMBILILOU n.m. Gros clou joyeux<br />
qui s’enfonce dans le bois en chantant.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3 5<br />
GRANDVILLE
3 4 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Nabila Ben Youssef<br />
Une entrevue de GINETTE LEROUX<br />
J’m’aime ici !<br />
Arrivée en décembre par un<br />
froid de canard, j’ai compris<br />
pourquoi on l’avait<br />
choisi comme symbole sur le<br />
dollar, raconte l’humoriste<br />
d’origine tunisienne Nabila<br />
Ben Youssef dans un des<br />
monologues de son premier<br />
spectacle solo. J’m’aime ici,<br />
lance-t-elle lorsqu’on l’interroge<br />
sur la raison qui l’a retenue au Québec il y a huit ans.<br />
Dès le départ, il lui a fallu beaucoup de patience. À cause<br />
de mon accent, on ne me proposait que des rôles d’arabe. Il fallait<br />
donc qu’elle se démarque. Elle s’est d’abord inscrite à divers<br />
ateliers de théâtre. Puis question d’apprivoiser les rouages de<br />
la machine théâtrale québécoise, on lui a conseillé une formation<br />
en gestion de carrière artistique. Comme il fallait<br />
monter un spectacle dans son domaine, elle a choisi d’écrire<br />
un monologue humoristique, ce qui l’a menée, naturellement,<br />
à l’École nationale de l’humour.<br />
Côtoyer des jeunes de 20 ans quand on en a 40, même si<br />
on n’en paraît que 25, n’était rien comparé à la difficulté d’écrire<br />
en français pour répondre à l’exigence ultime de signer<br />
un monologue par semaine tout au long d’une formation<br />
intense échelonnée sur une année.<br />
Pari gagné ! Après une tournée de vingt représentations<br />
en région organisée par l’ÉNH, elle donne son premier spectacle<br />
au Théâtre de l’Esquisse, soutenue dans l’écriture de ses<br />
textes par Pierre Sévigny, auteur notamment des monologues<br />
de <strong>Jean</strong>-Marc Parent. Depuis, invitée par les Zapartistes, elle<br />
s’est produite au suivi d’une prestation au Lion d’or, dans le<br />
cadre de la semaine contre le racisme en mars 2004.<br />
Très différent du théâtre, l’humour permet de vivre et raconter<br />
en même temps, précise-t-elle. La relation est directe avec le<br />
public, les applaudissements spontanés, une énergie incroyable s’en<br />
dégage. J’ai découvert que c’est ici que je peux créer, constate l’humoriste,<br />
profondément émue par la réponse chaleureuse du<br />
public.<br />
J’arrive ! le spectacle d’une heure de Nabila Ben Youssef<br />
compte cinq monologues liés entre eux par le regard naïf que<br />
porte une immigrante sur sa société d’accueil. En ouverture,<br />
la mariée qui n’est jamais sortie de son petit village tunisien<br />
se présente à l’aéroport en robe de noces. Pleine de bonnes<br />
intentions, elle est attendue par un congénère immigré<br />
depuis vingt ans qui s’est commandé une épouse.<br />
Dans le monologue<br />
Bonjour maman, une femme<br />
parle au téléphone avec sa<br />
mère. Tout le long de la conversation,<br />
je ne raconte que des<br />
mensonges, nous apprend<br />
celle qui n’a qu’une longueur<br />
d’avance sur son personnage.<br />
Ma mère est analphabète complète.<br />
Mon père, lui, sait à peine<br />
lire et écrire. Tous les deux sont très croyants. Par amour pour ma<br />
mère, je lui invente des histoires, car ce que je vis ici la dépasse<br />
complètement.<br />
Mes parents ne voulaient pas que je fasse du théâtre. Que<br />
vont penser les voisins ? me disait sans cesse ma mère. Alors<br />
Nabila l’a fait en cachette. Toute jeune, j’aimais rire et faire<br />
rire. Le petit clown que j’étais apprenait toutes les blagues, même<br />
les plus vulgaires. Puis, elle fait partie d’une troupe amateur de<br />
théâtre engagé. Dénoncer l’ordre établi n’étant pas toléré<br />
dans un pays aussi répressif que la Tunisie, les membres de la<br />
troupe sont arrêtés.<br />
Sfax, sa ville natale, offre peu de débouchés. À 20 ans,<br />
elle part pour Tunis, la capitale, où elle touche au théâtre<br />
professionnel et fait un peu de télé. J’habitais seule, se souvient-elle,<br />
et une femme seule est toujours considérée comme une<br />
femme facile. Partie trois mois en tournée avec Les Troyennes<br />
montées par la Compagnie de Saint-Étienne, elle constate<br />
qu’en France, le statut de l’artiste est respecté. Pour la première<br />
fois, j’ai goûté à cette liberté qui m’était si chère.<br />
Louise Carré, réalisatrice québécoise d’un documentaire,<br />
Les dévoilées de l’Islam, une coproduction avec la Tunisie, lui<br />
offre de remplacer l’assistant monteur et de venir au Québec<br />
compléter la postproduction. J’ai tout de suite aimé la place<br />
qu’on accordait aux femmes ici, dit la Maghrébine enchantée.<br />
Pour assurer sa survie, la jeune immigrante s’est tournée<br />
vers un talent naturel. Danser le baladi dans les restaurants,<br />
puis l’enseigner, ce qui la rapproche du but qu’elle s’est fixée :<br />
la scène.<br />
La liberté d’expression n’existe pas dans les pays arabes et le<br />
théâtre représente pour moi la voie artistique ultime de la parole<br />
retrouvée. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, me sermonnait ma<br />
mère, n’élève pas la voix, ne ris pas si fort, baisse les yeux quand<br />
tu parles à un homme. Il me fallait bousculer ces contraintes,<br />
conclut l’humoriste québécoise et J’arrive ! est un beau pied<br />
de nez aux interdits !<br />
Photo : ALAIN GRAVEL<br />
escadrons de la mort, le NED et ses quatre organisations<br />
constituantes commanditent des ONG<br />
et des partis politiques civils en vue d’installer la<br />
démocratie à l’américaine aux quatre coins du<br />
monde. Le NED constitue donc en quelque<br />
sorte le bras civil de la CIA.<br />
Les interventions combinées de ces deux<br />
organisations dans diverses parties du monde sont caractérisées<br />
par un modèle constant utilisé dans de nombreux pays.<br />
Ainsi le NED a fourni récemment des fonds aux organisations<br />
de la société civile au Venezuela pour mettre sur pied une<br />
tentative de coup d’État contre le président Hugo Chavez.<br />
C’est la Coordination démocratique vénézuélienne qui a<br />
joué le rôle de la Convergence démocratique haïtienne et du<br />
G-184. De la même manière, depuis 1995, dans l’ancienne<br />
Yougoslavie, la CIA a apporté son soutien à l’Armée de<br />
Libération du Kosovo (UCK), un groupe paramilitaire<br />
impliqué dans des attentats terroristes contre la police et l’ar-<br />
LES ESCADRONS DE LA MORT REPRENNENT<br />
DU SERVICE POUR SAUVER LA DÉMOCRATIE<br />
mée yougoslaves. En même temps, en Serbie et au<br />
Monténégro, via le CIPE, le NED apportait son aide financière<br />
à une coalition dite Opposition démocratique de<br />
Serbie (ODS). Plus spécifiquement, le NED commanditait<br />
le G-17, un groupe d’opposition constitué d’économistes<br />
responsables de la formulation néolibérale de la plate-forme<br />
de réformes d’ouverture du marché de l’ODS. Une intervention<br />
qui a conduit à la chute de Slobodan Milosevic lors des<br />
élections présidentielles de 2000.<br />
Dans le processus de déstabilisation économique et politique,<br />
le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque<br />
mondiale (BM) s’avèrent des acteurs de tout premier plan.<br />
Les réformes du FMI sont généralement appliquées sous les<br />
auspices d’un corps intergouvernemental, mais tendent invariablement<br />
à s’aligner sur les objectifs de la stratégie et de la<br />
politique étrangère des États-Unis. Les mesures d’austérité et<br />
de restructuration du FMI, qui reposent sur un prétendu<br />
consensus de Washington, contribuent plus souvent qu’autrement<br />
à déclencher des contestations sociales et ethniques.<br />
Les effets terriblement dévastateurs de ces mesures ont souvent<br />
précipité la chute de gouvernements élus et, dans certains<br />
cas extrêmes, l’imposition des réformes du FMI a mené<br />
à la déstabilisation de pays tout entiers, comme ce fut le cas<br />
en Somalie, au Rwanda et en Yougoslavie.<br />
Il faut bien dire que le programme du FMI est un instrument<br />
permanent de désorganisation économique. Dans le<br />
dessein de remodeler et de minimiser les institutions étatiques<br />
des pays qui font appel à son aide, le FMI exige l’application<br />
de mesures draconiennes d’austérité. Ces dernières<br />
ne viennent pas seules puisqu’elles ouvrent la porte à d’autres<br />
formes d’intervention et d’ingérence politique, dont le financement<br />
par la CIA des partis politiques d’opposition et des<br />
groupes paramilitaires rebelles. Sans oublier que, dans le sillage<br />
d’une guerre civile, d’un changement de régime ou dans le<br />
cadre d’une urgence au niveau national, on en profite souvent<br />
pour introduire sous la direction désintéressée du FMI des<br />
réformes qualifiées de relance d’urgence ou de postconflictuelles.<br />
À Haïti, le coup d’État militaire de 1991 a eu lieu huit<br />
mois seulement après l’accession de <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide à<br />
la présidence. Il visait en partie à supprimer les réformes progressistes<br />
du gouvernement d’Aristide et à remettre le programme<br />
politique néo-libéral de l’ère Duvalier à l’ordre du<br />
jour. En juin 1992, c’est un ancien fonctionnaire de la<br />
Banque mondiale qui fut désigné au poste de Premier ministre<br />
par la junte militaire. En fait, c’était le Département d’État<br />
américain qui avait poussé la nomination de Marc Bazin<br />
dont la réputation était faite pour avoir toujours travaillé<br />
dans le sens du consensus de Washington.<br />
Déjà en 1983, sous le régime de <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> Duvalier,<br />
Bazin avait été nommé ministre des Finances avec une forte<br />
recommandation du FMI. Plus tard, en 1990, le poulain du<br />
FMI est toujours le favori de Washington lorsqu’il se présente<br />
contre <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide aux élections présidentielles<br />
de 1990. Et quoi de plus naturel qu’en 1992, le même Bazin<br />
soit choisi par la junte militaire pour former un gouvernement<br />
de consensus comme l’entend Washington. Et quoi de plus<br />
prévisible que ce soit durant la période où il occupe le poste<br />
de Premier ministre que soient produits les massacres politiques<br />
et les tueries extrajudiciaires perpétrés par les escadrons<br />
de la mort du FRAPH, avec<br />
l’encouragement de la CIA.<br />
Rappelons-nous qu’au même<br />
moment où la CIA lance une campagne<br />
de calomnies qui présente Aristide<br />
comme un personnage mentalement<br />
instable (Boston Globe, 21 septembre<br />
1994), plus de 4 000 civils haïtiens<br />
sont tués, quelque 300 000 se muent<br />
en réfugiés internes, des milliers d’autres<br />
se sont enfuis de l’autre côté de la<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 1 5
frontière, en République Dominicaine,<br />
et plus de 60 000 ont quitté<br />
le pays par la mer. (Déclaration<br />
de Dina Paul Parks, directrice<br />
exécutive de la Coalition<br />
nationale des Droits des<br />
Haïtiens, Commission sénatoriale<br />
de la Justice, Sénat des<br />
États-Unis d’Amérique,<br />
Washington, D.C., 1 er octobre<br />
2002).<br />
En 1994, les États-Unis<br />
interviennent sur le terrain<br />
après trois années de régime<br />
militaire. La mission des 20 000<br />
hommes, troupes d’occupation et gardiens de la paix, qui<br />
débarquent à Haïti n’est pas de restaurer la démocratie mais<br />
plutôt d’empêcher une insurrection populaire contre la junte<br />
militaire et ses partisans néo-libéraux. En d’autres termes,<br />
l’intervention des États-Unis visait d’abord à assurer la continuité<br />
politique et, pour la garantir, ses troupes resteront sur<br />
place jusqu’en 1999. Les membres de la défunte junte militaire<br />
sont donc exilés pour la galerie, mais le retour du gouvernement<br />
constitutionnel n’est pas inconditionnel. Il doit se<br />
plier aux diktats du FMI, ce qui exclut toute possibilité d’une<br />
alternative progressiste au planning néo-libéral.<br />
Les Forces armées haïtiennes sont dissoutes et le<br />
Département d’État américain loue les services d’une société<br />
de mercenariat pour fournir une aide technique à la restructuration<br />
de la Police nationale haïtienne (PNH). La première<br />
intervention de la DynCorp sera de recommander que la<br />
nouvelle PNH admette dans ses rangs les anciens Tontons<br />
Macoutes et les officiers de l’armée haïtienne impliqués dans le<br />
coup d’État de 1991 (The Nation, Privatizing War, Ken<br />
Silverstein, 28 juillet 1997). Ce qui tombe sous le sens<br />
puisque la DynCorp a toujours fonctionné en sous-traitance dans<br />
les opérations sous le manteau du Pentagone et de la CIA<br />
(Counterpunch, Jeffrey St.Clair et Alexander Cockburn,<br />
25 février 2002).<br />
En octobre 1994, Aristide revient d’exil et réintègre la<br />
présidence jusqu’à la fin de son mandat en 1996. Non sans<br />
conditions toutefois. Des réformateurs du libre marché sont<br />
imposés à son cabinet et une nouvelle fournée de mesures<br />
politiques macroéconomiques néfastes sont adoptées sous<br />
l’étiquette d’un prétendu Plan d’urgence de relance économique<br />
(PURE) qui s’appliquera à réaliser une stabilisation<br />
macroéconomique rapide, à restaurer l’administration publique et<br />
à parer aux besoins les plus pressés (IMF Approves Three-Year<br />
ESAF Loan for Haiti, Washington, 1996).<br />
La restauration du gouvernement constitutionnel avait<br />
été négociée à huis clos avec des créanciers à l’extérieur<br />
d’Haïti et le nouveau gouvernement s’est retrouvé dans l’obligation<br />
d’apurer les arriérés de sa dette extérieure préalablement<br />
au retour de <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide à la présidence.<br />
En fait, les nouveaux prêts consentis par la Banque mondia-<br />
1 6 • L’ A P O S T R O P H E<br />
le, la Banque interaméricaine de Développement (IDB) et<br />
le FMI l’ont été d’abord et avant tout pour honorer les obligations<br />
d’Haïti vis-à-vis de ses créanciers internationaux. Il<br />
allait de soi qu’utiliser l’argent frais pour rembourser d’anciennes<br />
dettes ne pouvait que provoquer une spirale de la<br />
dette extérieure.<br />
Entre 1992 et 1994, durant la période coïncidant en gros<br />
avec celle du gouvernement militaire, le Produit intérieur<br />
brut (PIB) a décliné de 30 %. Avec un revenu par tête de<br />
250 dollars par an, Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère<br />
occidental et l’un des plus pauvres de la planète<br />
(Haïti : les défis de la réduction de la pauvreté, Banque mondiale,<br />
Washington, août 1998). La Banque mondiale estimait le<br />
chômage de l’ordre de 60 %. Un rapport du Congrès américain<br />
qui date de 2000 l’estime désormais à 80 %.<br />
Dans le sillage de ces trois années de junte militaire et de<br />
déclin économique, la relance économique urgente envisagée<br />
dans l’accord de prêt du FMI était irréaliste. En fait, c’est tout<br />
le contraire qui s’est produit. Tout d’abord, la stabilisation<br />
imposée par la relance exigeait de nouvelles restrictions budgétaires<br />
dans des programmes sociaux quasiment non existants.<br />
Malgré cette évidence, un programme de réforme des<br />
IL YA25 ANS, LA CIA<br />
FAISAIT SECRÈTEMENT<br />
CE QUE LE NED<br />
FAIT AUJOURD’HUI<br />
services civils a été mis sur pied pour réduire la taille desdits<br />
services inexistants et licencier un introuvable surplus d’employés<br />
de l’État. La conséquence des mesures du FMI et de la<br />
Banque mondiale est à l’origine d’une paralysie des services<br />
publics haïtiens qui a débouché sur la désintégration finale de<br />
la totalité du système étatique.<br />
Dans un pays où l’on compte à peine 1,2 médecin pour<br />
10 000 habitants et où la grande majorité de la population est<br />
illettrée, le FMI s’est obstiné, pour atteindre ses objectifs budgétaires,<br />
à exiger le licenciement des surplus dans les services<br />
de santé et d’éducation. L’application de cette thérapie économique<br />
de choc, en parfait synchronisme avec la politique<br />
étrangère de Washington, a littéralement poussé Haïti au<br />
bord d’un gouffre économique et social.<br />
Au moment du coup d’État militaire, plus de 75 pourcent<br />
de la population haïtienne était engagée dans l’agriculture<br />
et produisait à la fois des plantes vivrières pour le marché<br />
intérieur ainsi qu’un certain nombre de plantes de rapport<br />
destinées à l’exportation. Mais déjà à l’époque de <strong>Jean</strong>-<br />
<strong>Claude</strong> Duvalier, l’économie paysanne avait été torpillée.<br />
Avec l’adoption par la suite des réformes économiques favorisées<br />
par le FMI et la Banque mondiale, le système agricole,<br />
qui produisait jusque-là des denrées alimentaires pour le marché<br />
local, s’est retrouvé déstabilisé. La levée des barrières<br />
o Autop rtrait<br />
d’une reine de cœur<br />
par SYLVIE LEGAULT<br />
Quand ma mère me laisse enfin voir le jour, je sais ce que<br />
je veux faire de ma vie : comédienne. Cinq ans : je décide<br />
que je m’arrange seule voyant mon père fortement<br />
préoccupé par la séparation d’avec ma mère et la garde des<br />
dix enfants dont il aura l’exclusivité. Seize ans : je voyage<br />
seule jusqu’à Vancouver.<br />
Sur l’île de Gabriola, près du Pacifique, face à l’immensité,<br />
je conçois un plan de match pour ma prochaine année. Je<br />
reviens vivre dans la maison paternelle, je prépare mes auditions<br />
pour l’École Nationale de Théâtre dans le cadre du<br />
cours de théâtre du Cégep et déménage dans la métropole<br />
l’année suivante. Je suis seule à savoir que je vis mes derniers<br />
mois au sein de ma famille. Au Cégep, je ne suis pas le programme<br />
établi. Précurseure de programme hors Dec, je choisis<br />
mes cours par intérêt et non par devoir et ce malgré les<br />
conseils de l’orienteur.<br />
Trois années à l’ENT au cours desquelles je travaille avec<br />
les figures importantes du paysage culturel du Québec. La<br />
première année inaugure ma vie en appartement, avec deux<br />
camarades. La seconde, ma sœur de trois ans mon aînée se<br />
pend dans un parc pour enfants ; la troisième année, alors<br />
que j’interprète Christine de Suède dans L’Abdication, mon<br />
frère <strong>Jean</strong> se donne la mort. Cette reine est le rôle le plus<br />
marquant que j’aie jamais interprété : elle abandonne le pouvoir<br />
pour trouver la paix de l’âme.<br />
Neuvième d’une famille de dix, le gros de mon héritage<br />
me vient de mon père. À ses côtés j’apprends tolérance,<br />
patience et respect. En prime, j’hérite de son charme redoutable.<br />
Il me donne deux conseils : assure ton autonomie financière<br />
et ne crois jamais un homme qui te dit qu’il contrôle son éjaculation.<br />
Vingt-et-un ans : j’accouche à la maison de mon fils<br />
Alexandre. (J’avais un stérilet quand même !)<br />
Élevée par un homme, mon père encourage mes aspirations<br />
et respecte mes choix. C’est dans un climat de confiance<br />
absolue que j’envisage la vie. Vivre et laisser vivre ! Maxime<br />
que je transpose sur la patinoire de la LNI. À mes débuts, je<br />
n’attendais pas que l’entraîneur de l’équipe me désigne : je<br />
sautais. Je n’ai peur de rien sauf de moi-même. Passent les<br />
prix, les étoiles et les titres, on me surnomme La reine de l’impro.<br />
Cette reine n’abdiquera jamais.<br />
Je crois en la vérité, c’est le chemin le plus court. Je n’hé-<br />
site pas à dire le fond de ma pensée et monte aux barricades<br />
quand les droits de mes pairs sont lésés. Je défends la cause<br />
des femmes, remarquant très tôt qu’on a minimisé l’importance<br />
de ces dernières dans notre société. Quand j’apprends<br />
qu’Einstein reçoit le prix Nobel en duo avec sa femme, qui<br />
est également mathématicienne, je constate qu’il y a une<br />
couille dans le pâté. Ne dit-on pas : Derrière chaque grand<br />
homme, il y a une femme…qui le pousse et derrière chaque grande<br />
femme, il y a un homme…qui tente de la retenir. Ma mission :<br />
révéler la femme. Dénoncer la répression de la sexualité<br />
féminine et, avec le sourire d’une belle assouvie, exiger notre<br />
droit de jouissance, d’autonomie financière et du libre-arbitre<br />
de notre corps.<br />
Europe, Afrique, Amérique du Sud et du Nord; je saute<br />
en bas d’un pont de 180 pieds dans le canyon du Mont Sainte-<br />
Anne ou entreprends le Rallye des Gazelles, raid de 10 jours<br />
dans le désert de la Mauritanie; pour médiatiser l’évènement<br />
au Québec, devient porte-parole pour les enfants du Tiers-<br />
Monde, anime en direct la Saint-<strong>Jean</strong>-Baptiste à la télé d’État,<br />
propose ma candidature pour le parti Rhinocéros, en plus de<br />
mon métier d’artiste…je suis profondément souverainiste.<br />
À travers bientôt vingt-cinq ans de tournées, je me<br />
découvre chanteuse, metteure en scène, animatrice, conférencière,<br />
professeure, rénovatrice... horticultrice. On pourrait<br />
dire que rien ne m’arrête vraiment. À l’image de mon<br />
âme, mon jardin est une variété infinie de vert. Le tendre de<br />
l’olivier de Bohême, la vigne qui gagne toujours plus de terrain,<br />
les rosiers de Rolande, les hémérocalles, les iris, les<br />
cèdres, les framboisiers. Et sur le balcon, l’hibiscus, le cactus<br />
chinois, les papyrus…et j’en passe.<br />
Autant d’espèces végétales que de gens et de sphères<br />
d’activités variées. Autant j’aime le monde, dans le sens<br />
large, autant j’adore être seule et ma nature ermite s’épanouit<br />
dans mon havre de paix sacré et essentiel. Mon nid est heureux,<br />
chaleureux et généreusement éclairé.<br />
La peur tenaille toujours mon âme. / Bien des rêves à réaliser./<br />
Je rêve d’un lac tranquille / pour nager mes matins. / D’une<br />
plume volubile / pour allonger mes nuits./ Je ne sais plus / si je rêve<br />
de l’âme sœur / ou de l’homme frère. / Au destin le soin de me<br />
donner ce cœur / pour cette reine qui n’abdiquera jamais / dans sa<br />
quête du bonheur./ En attendant je m’acharne à chanter.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3 3
Tex Lecor<br />
Un mode d’emploi polonais<br />
PHARMACIEN– (Au téléphone) Allô oui !<br />
TEX LECOR– (Avec un fort accent polonais)<br />
Pharmacie ?<br />
PHARMACIEN– Oui.<br />
TEX– J’ai acheté chez vous suppositoires.<br />
PHARMACIEN– Oui.<br />
TEX– Instructions marqué introduire dans anousse.<br />
PHARMACIEN– Oui.<br />
TEX– Trouve pas anousse dans boîte.<br />
PHARMACIEN– Ah ! vous trouvez pas l’anus dans la<br />
boîte. Savez-vous ce que c’est qu’un anus ?<br />
TEX– J’trouve pas dans boîte.<br />
PHARMACIEN– C’est pas dans la boîte que vous allez le<br />
trouver non plus.<br />
TEX– J’en ai pris un dans un verre d’eau.<br />
PHARMACIEN– Vous avez pris un suppositoire dans un<br />
verre d’eau. Pis ? Ça tu faite effet ?<br />
TEX– Je sais pas !<br />
PHARMACIEN– Ben faudrait attendre. Parce que vous<br />
allez voir que ça va faire effet.<br />
TEX LECOR, Les insolences d’un téléphone (CKAC-l975-l992)<br />
La sanction papale<br />
PIERRE BRASSARD– (Quittant la voix de <strong>Jean</strong><br />
Chrétien pour la sienne) Je tenais à démontrer Saint Père<br />
que la religion catholique demeure une religion ouverte et<br />
très tolérante et la meilleure façon de faire cette démonstration,<br />
c’est en vous demandant humblement et publiquement<br />
votre pardon pour cette supercherie.<br />
JEAN-PAUL II– Oui ! Que Dieu vous bénisse<br />
! Que Dieu bénisse Canada !<br />
LES BLEU POUDRE (CKOI–1994-1997),<br />
transcription de l’Insolence papale,<br />
diffusée le ll avril l995.<br />
3 2 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Ils sont mûrs pour frapper un grand coup.<br />
Le 11 avril, Brassard empruntant la voix et<br />
la personnalité de <strong>Jean</strong> Chrétien s’entretient<br />
au téléphone pendant une dizaine de<br />
minutes avec Sa Sainteté <strong>Jean</strong> Paul II qui ne se doute de rien.<br />
Le Saint Père n’a entendu que ce qu’il voulait entendre<br />
lorsque celui qu’il croit être le Premier ministre du Canada lui<br />
annonce son intention d’aller dans le sens de sa dernière<br />
Encyclique et d’assurer à tous les Canadiens et Canadiennes un<br />
droit total à la vie à partir du moment de la conception jusqu’à<br />
l’arrêt complet des fonctions vitales. <strong>Jean</strong> Paul II s’en réjouit et<br />
ne sursaute pas lorsque Brassard-Chrétien lui demande où en<br />
sont les travaux de réfection de la tiare papale. Quand est-ce<br />
que vous allez mettre une hélice sur votre casse, Saint Père ?<br />
Sa Sainteté, un peu comme le prétendait naguère Mark<br />
Twain avec humour, parle le français mais n’y entend goutte<br />
lorsque Brassard-Chrétien, après avoir fait l’éloge de son<br />
conseiller religieux l’abbé Daine Raymond Beaudoin, confesse<br />
que le but de son imposture a été de démontrer l’ouverture et<br />
la tolérance de l’Église catholique. <strong>Jean</strong> Paul II se contente alors<br />
de faire ce qu’un pape fait lorsqu’il ne sait pas quoi faire, il<br />
marmonne urbi et orbi des vœux pieux et raccroche rapidement<br />
le combiné.<br />
Pour le rire québécois, c’est la gloire. Dans les heures qui<br />
suivent la diffusion du canular des Bleu Poudre sur les ondes<br />
de CKOI, la télévision américaine et la presse internationale<br />
se manifestent, le magazine L’Express dépêche un journaliste<br />
à Montréal et les demandes d’entrevues pleuvent de Paris,<br />
Londres, Washington. Lorsqu’on demande à Pierre Brassard<br />
quelle sera sa prochaine victime après le Pape ? il lève les<br />
yeux vers le ciel. Peut-être son patron, mais ça risque de coûter<br />
cher d’interurbain.<br />
AU JEU DES INSOLENCES D’UN TÉLÉPHONE,<br />
MÊME LE PAPE N’EST PAS À L’ABRI<br />
Le canular téléphonique est devenu l’événement et le<br />
pape <strong>Jean</strong>-Paul II son faire-valoir. Quarante-deux ans après<br />
la mise au ban de Carte Blanche pour avoir prêté la voix de<br />
Monseigneur Léger à un tartufe de comédie qui manifestait<br />
son indulgence pour les confesseurs qui étaient les amants de<br />
leurs pénitentes, l’entartrage radiophonique du Pape est le<br />
triomphe de l’irrévérence et la revanche du rire québécois.<br />
La radio est faite pour l’irrévérence. De tous les médias,<br />
c’est celui qui s’y prête le mieux. L’insolence lui va comme un<br />
gant. Lorsque ses auditeurs sont immobilisés dans leurs voitures,<br />
c’est elle qui bouge, lorsqu’ils sont en mouvement dans<br />
leurs maisons, elle les accompagne et dans les moments de<br />
crise comme celle du verglas, c’est sa voix qui informe, qui<br />
réconforte et qui fait rire. Chaleureux, intime, planté au<br />
creux de l’oreille, le rire de la radio demeure ce qui se rapproche<br />
le plus d’une conscience collective.<br />
Les témoignages de Guy Banville, Louis-Paul Allard, Alaim Dumas,<br />
Robert Blondin, Tex Lecor et Yvan Ducharme sont tirés d’entrevues<br />
réalisées dans le cadre de la série DEBOUT LES COMIQUES,<br />
une production télévisuelle d’Orbi XXI.<br />
commerciales a entraîné la destruction de toute l’économie<br />
paysanne en ouvrant le marché local à l’affluence des surplus<br />
agricoles américains, y compris le riz, le sucre et le maïs.<br />
Gonaïves avec ses vastes rizières était la région par excellence<br />
de la production du riz à Haïti. Elle s’est retrouvée plongée<br />
dans une faillite générale. À la fin des années 1990, Haïti,<br />
un petit pays très pauvre des Antilles, était devenu le quatrième<br />
importateur mondial de riz américain, après le Japon,<br />
le Mexique et le Canada.<br />
Depuis le début de son intervention dans les affaires haïtiennes,<br />
le FMI ne tolère aucune déviation en rapport à son<br />
programme néo-libéral. À peine deux semaines avant les<br />
élections présidentielles, fixées au 23 novembre 2000, l’administration<br />
sortante signait une déclaration d’intention<br />
pour le FMI et le ministre des Finances transmettait l’amendement<br />
budgétaire au Parlement le 14 décembre. Toutes les<br />
décisions majeures concernant le budget de l’État, le management<br />
du secteur public, les investissements publics, la privatisation,<br />
le commerce et la politique monétaire avaient<br />
déjà été prises. Elles faisaient partie de l’accord conclu le<br />
6 novembre 2000 et le soutien financier du FMI dépendait<br />
de son entérinement par la législature. Le nouveau président<br />
LES PROGRAMMES<br />
ÉCONOMIQUES DU FMI<br />
SONT UN INSTRUMENT<br />
PERMANENT<br />
DE DÉSTABILISATION<br />
<strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide avait promis d’augmenter le salaire<br />
minimum, de se lancer dans la construction d’écoles et la<br />
mise sur pied de programmes d’alphabétisation mais les<br />
mains de son nouveau gouvernement étaient liées.<br />
En 2003, le FMI impose l’application du système flexible<br />
dans les prix des carburants, un système dont la dite flexibilité<br />
déclenche aussitôt une spirale inflationniste. La monnaie<br />
haïtienne est dévaluée et en janvier et février 2003, les prix<br />
du pétrole augmentent d’environ 130 p. 100. Ce qui ne<br />
contribue pas pour peu à alimenter le mécontentement<br />
populaire à l’égard du gouvernement Aristide qui soutient les<br />
réformes économiques. La montée en flèche des prix des carburants<br />
a contribué à une hausse de 40 p. 100 des prix à la<br />
consommation en 2002-2003.<br />
En dépit de cette hausse dramatique du coût de la vie, le<br />
FMI réclame néanmoins, pour contrôler les pressions inflationnistes,<br />
un gel des salaires et l’établissement d’un salaire statutaire<br />
minimum d’environ 25 cents de l’heure. Le FMI prétend<br />
que la flexibilité du marché de l’emploi va attirer les investisseurs<br />
étrangers. Autrement dit la flexibilité veut dire que les<br />
salaires flexibles sont généralement versés en dessous du salaire<br />
statutaire minimum. En 1994, le salaire quotidien minimum<br />
était de 3 dollars, en 2004, il varie entre 1,50 $ et 1,75 $<br />
selon le taux d’échange entre la gourde, qui est la monnaie<br />
haïtienne, et le dollar.<br />
En suivant la logique particulièrement tordue de la politique<br />
de la main-d’œuvre bon marché du FMI et de la Banque<br />
mondiale, les salaires effroyablement bas pratiqués à Haïti<br />
seraient un moyen d’améliorer le niveau de vie de sa population<br />
! En d’autres termes, les conditions inhumaines des<br />
industries d’assemblage dans un environnement totalement<br />
dérégulé tout comme les conditions de travaux forcés dans<br />
les plantations agricoles haïtiennes doivent être considérées<br />
comme une force d’attraction pour les investisseurs étrangers, lesquels<br />
pour le FMI sont la clé de toute prospérité économique.<br />
Après la dégringolade du pouvoir d’achat qui affecte toutes<br />
les classes de la société et les taux d’intérêt qui atteignent<br />
des proportions astronomiques, les hausses brutales des prix<br />
du carburant ont engendré une paralysie des transports et des<br />
services publics, y compris l’eau et l’électricité, dans les parties<br />
nord et est du pays. La perspective d’une catastrophe<br />
humanitaire et de l’effondrement de l’économie a permis à la<br />
Plate-forme démocratique d’accroître considérablement sa<br />
popularité en accusant le président <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide<br />
d’être le grand responsable de la mauvaise gestion économique.<br />
Ironiquement, les dirigeants de la dite Plate-forme démocratique,<br />
dont le pire des exploiteurs haïtiens, Andy Apaid, sont<br />
les principaux protagonistes de l’économie des bas salaires<br />
encouragée par le FMI.<br />
En février 2003, au moment où le FMI intensifiait sa<br />
pression sur le gouvernement du président Aristide,<br />
Washington nomme James Foley au poste d’ambassadeur à<br />
Haïti. De toute évidence, Foley a été choisi en prévision<br />
d’une opération commanditée par la CIA. Il quitte le poste<br />
de chef de mission adjoint au bureau européen des Nations<br />
unies qu’il occupait à Genève et arrive à Port-au-Prince en<br />
septembre 2003.<br />
Il est sûrement important de rappeler l’implication de<br />
l’ambassadeur Foley dans le soutien à l’Armée de Libération<br />
du Kosovo (UCK) en 1999. À l’époque de la guerre du<br />
Kosovo, James Foley était le porte-parole du Département<br />
d’État et travaillait en étroite collaboration avec son homologue<br />
de l’Otan à Bruxelles, Jamie Shea. À peine deux mois<br />
avant le déclenchement de la guerre menée par l’Otan, le 24<br />
mars 1999, Foley proposait que l’on transforme l’UCK en une<br />
organisation politique respectable. Nous voulons développer de<br />
bonnes relations avec eux (…) et nous avons des conseils à leur<br />
fournir et de l’aide s’ils deviennent le genre d’acteurs politiques que<br />
nous aimerions les voir devenir. (...) Si<br />
nous pouvons les aider et s’ils veulent que<br />
nous les aidions dans cet effort de transformation<br />
de leur organisation, je pense<br />
que personne ne pourra y trouver à redire<br />
(New York Times, 2 février 1999).<br />
Ce n’est un secret pour personne<br />
que l’UCK se finançait avec l’argent<br />
de la drogue et de la CIA. Elle a été<br />
impliquée aussi bien dans des assassinats<br />
politiques ciblés que dans des<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 1 7
massacres de civils; et ce, tout<br />
autant au cours des mois qui<br />
ont précédé l’invasion de<br />
l’Otan en 1999 que par la suite.<br />
Après l’invasion et pendant<br />
l’occupation du Kosovo<br />
menées par l’Otan, l’UCK s’est<br />
métamorphosée en Force de<br />
Protection du Kosovo (FPK)<br />
sous les auspices de l’Onu. Au<br />
lieu d’être désarmée pour mettre<br />
fin au massacre des civils, la<br />
FPK, qui est liée au crime organisé<br />
et au trafic de drogue dans<br />
les Balkans, s’est vue conférer<br />
un statut politique légal.<br />
La position du Département d’État américain telle qu’elle<br />
est alors présentée dans la déclaration de Foley était que<br />
l’UCK ne serait pas autorisée à poursuivre ses activités en tant<br />
que force militaire, mais qu’elle aurait l’occasion d’aller de l’avant<br />
dans sa quête d’un gouvernement autonome placé dans un contexte<br />
différent (La guerre d’agression de l’Otan contre la Yougoslavie,<br />
Michel Chossudovsky, 1999). Ce qui revenait à inaugurer<br />
une narco-démocratie de fait sous la protection de l’Otan.<br />
Est-ce le modèle d’état qu’on a privilégié pour Haïti ? La<br />
présence de James Foley comme ambassadeur n’est sûrement<br />
pas une coïncidence. Tout d’abord le trafic de la drogue occupe<br />
une place à Haïti qui n’est pas différente du rôle qu’il joue<br />
au Kosovo où c’est un lien crucial dans le transit des drogues<br />
depuis le Croissant d’Or, via l’Iran et la Turquie, vers l’Europe<br />
occidentale. Pour la CIA et le Département d’État, le FLRN<br />
et Guy Philippe sont à Haïti ce que l’UCK et son chef<br />
Hashim Thaci sont au Kosovo où les liens de l’UCK avec la<br />
mafia albanaise et les syndicats du crime impliqués dans le<br />
trafic des narcotiques ne l’empêchent en rien d’être à la fois<br />
financée par la CIA et soutenue par l’Otan.<br />
En renversant l’administration Lavalas, le but de<br />
Washington était de remplacer le parti d’Aristide par un<br />
régime fantoche obéissant encore plus servilement aux États-<br />
Unis. Un gouvernement d’unité nationale susceptible d’intégrer<br />
la Convergence démocratique d’Evans Paul, le G-184<br />
d’Andy Apaid et le FLRN de Guy Philippe qui, fort de son<br />
expérience à la tête des escadrons de la mort du FRAPH,<br />
pourrait sans doute reconstruire les Forces armées haïtiennes<br />
dissoutes en 1995. Ce n’est pas impensable. Quel est l’enjeu<br />
d’un éventuel partage de pouvoir entre ces divers groupes<br />
d’opposition et des insurgés qui sont liés au commerce de<br />
transit de la cocaïne de la Colombie à la Floride ? Rien de<br />
moins que la formation d’un nouveau narco-gouvernement<br />
qui servira les intérêts américains en assurant la protection<br />
de ce commerce.<br />
Sous le choc des réformes du FMI, l’économie réelle<br />
d’Haïti a été poussée à la banqueroute, mais le commerce des<br />
narcotiques continue à être florissant. Haïti demeure le premier<br />
pays de transbordement de la drogue pour toute la région des<br />
1 8 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Mon pays<br />
que voici<br />
[…] Ô mon pays si triste est la<br />
saison<br />
Qu’il est venu le temps de parler<br />
par signes<br />
Je continue ma lente marche de<br />
Poète<br />
à travers les forêts de ta nuit<br />
province d’ombre peuplée<br />
d’aphones<br />
Qui ose rire dans le noir ?…<br />
Nous n’avons plus de bouche<br />
pour parler<br />
quel chœur obscène chante<br />
dans l’ombre<br />
cette chanson dans mon sommeil<br />
cette chanson des grands marrons<br />
marquant le rythme au ras des<br />
lèvres<br />
Qui ose rire dans le noir<br />
Nous n’avons plus de bouches pour parler<br />
les mots usuels sont arrondis<br />
collants du miel de la résignation<br />
et la parole feutrée de peur<br />
s’enroule dans nos cerveaux capitonnés<br />
Qui ose rire dans le noir<br />
Nous n’avons plus de bouche pour parler<br />
nous portons les malheurs du monde<br />
et les oiseaux ont fui notre odeur de cadavre<br />
Le jour n’a plus sa transparence et ressemble à la nuit<br />
Tous les fruits ont coulé nous les avons montrés du doigt<br />
Qui ose rire dans le noir<br />
Nous n’avons plus de bouche pour parler<br />
car le clavier des maîtres mots des Pères de la Patrie<br />
au grenier du passé se désaccorde abandonné<br />
Ô mon pays si triste est la saison<br />
qu’il est venu le temps de parler par signes […]<br />
ANTHONY PHELPS,<br />
Anthologie de la littérature haïtienne<br />
Un siècle de poésie 1901-2001,<br />
Mémoire d’encrier, 2003.<br />
ALBÉRIK<br />
Le retour aux études<br />
BÉATRIX– La semaine prochaine, je<br />
commence à suivre des cours de culture<br />
générale à l’Institut du Savoir Incorporé...<br />
ALAIN– Bravo, m’man, j’t’encourage...<br />
FÉLIX– Tu s’rais mieux de prendre des cours de couture...<br />
BÉATRIX– Tes insultes ne me touchent pas... Je vais<br />
prendre des cours de littérature, d’histoire ancienne, d’économie<br />
politique, d’histoire de la musique, de philosophie...<br />
ALAIN– Bravo, m’man... enfin je vas avoir quelqu’un<br />
pour discuter de Marcuse.<br />
FÉLIX– Pis tant qu’à y être, échange le réfrigérateur contre<br />
un piano à queue... T’es malade ?<br />
BÉATRIX– Quand j’pense que depuis que je suis bachelière,<br />
j’ai pas ouvert un livre par ta faute...<br />
FÉLIX– Je t’en ai jamais empêchée !<br />
BÉATRIX– Le seul livre qu’on a ici c’est le Do-it-yourself...<br />
FÉLIX– Veux-tu dire que si t’es ignorante, c’est de ma<br />
faute...? C’est pas moi qui allume la télévision pour Cré<br />
Basile, Madame s’amuse, pis Les Trois Cloches...<br />
BÉATRIX– A partir de maintenant, y a pus de télévision<br />
pour moi...<br />
ALAIN– Si tu fais ça, m’man, p’pa pourra jamais suivre...<br />
BÉATRIX– Certainement pas ! L’an prochain, j’vas aller<br />
me parfaire à Paris... avec une bourse du gouvernement...<br />
FÉLIX– Sûrement pas du Conseil des Arts ?<br />
BÉATRIX– Non ! Avec l’allocation aux mères nécessiteuses.<br />
ALBERT BRIE, Chez Miville (CBF–1956-1970)<br />
Le comique et l’humour à la radio québécoise (1930-1970), volume II, PIERRE<br />
PAGÉ, avec la collaboration de RENÉE LEGRIS, Éditions La Presse, 1979<br />
Pour frapper, a frappait<br />
Ça c’est comme la mère à Rolland, mon Dieu qu’a frappait.<br />
Ah ! Elle était habillée, moi j’connais pas les toilettes<br />
féminines, mais a l’avait une robe, m’as vous dire à peu<br />
près parce que...une robe fourreau, en satin rouge vif avec<br />
des pois chuschias jaune-orange et bleu pâle et, dans le<br />
cou, elle avait un pendentif en fonte avec un portrait en<br />
relief de Taschereau avant la chute du R-100 et sur les<br />
épaules, ici, elle avait les épaules nues, elle avait des pierres<br />
au Rhin, a l’avait un chapeau mauve avec une plume<br />
d’autruche jaune pis une finale noire pis une p’tite clochette<br />
au boutte qui lui donnait un air canaille.<br />
GILLES PELLERIN, Le fantôme au clavier (CKVL–l948)<br />
Monologues québécois (l890-l980), LAURENT MAILHOT<br />
et DORIS-MICHEL MONTPETIT, Leméac, 1980.<br />
LE RIRE MATINAL VOIT LE JOUR<br />
AVEC L’INVENTION DE LA RADIO<br />
Dans l’histoire du rire au Québec, l’influence<br />
de la radio a été déterminante. Elle n’a pas seulement<br />
inventé le rire du matin mais créé de toutes<br />
pièces un nouveau rire qui n’existerait pas sans<br />
elle, celui des Insolences d’un téléphone. Yvan<br />
Ducharme qui a donné ses lettres de créances à ce nouveau<br />
genre comique en attribue la paternité à Graham Bell. Parce<br />
que je présume qu’il a été le premier à jouer un tour au téléphone<br />
puisque tout le monde l’a fait au moins une fois dans sa vie. Mon<br />
seul crédit aura été d’avoir fait de cette tentation vieille comme<br />
l’appareil lui-même une émission radiophonique. Dont le succès<br />
a été foudroyant.<br />
Les Insolences d’un téléphone à la Ducharme (CJMS–l963l972)(<br />
CKAC–l975) sont nées dans le cadre du rire matinal<br />
pour s’étendre progressivement à presque toutes les plages<br />
horaires de la journée. Sous le règne débonnaire de Tex Lecor<br />
(CKAC–l975-l992) le canular radiophonique du téléphone,<br />
dont certains sont d’une truculence mémorable, s’inscrit<br />
désormais dans la vie quotidienne au même titre que les bulletins<br />
de circulation ou de météo.<br />
Même après plus de vingt ans, il y a une insolence qui<br />
n’est pas prête d’être oubliée. C’est celle du Polonais qui appelle<br />
à la pharmacie et qui dit avec son accent gros comme le bras :<br />
Acheté suppositoire. R’garde dans boîte. C’est marqué introduire<br />
dans anousse. R’garde boîte. Trouve pas anousse.<br />
Et Tex en rit toujours d’aussi bon cœur. Je dois avoir appelé<br />
quinze pharmacies pour avoir des réponses différentes. Les réactions<br />
des pharmaciens avaient pas de bon sens hostine. Quand y<br />
essayaient pas de m’donner le mode d’emploi en essayant de garder<br />
leur sérieux, la plupart riaient : Eille viens icite, c’t’un Polonais,<br />
ch’sais pas diousqu’y d’sort mais y trouve pas l’anus dans une boîte<br />
de suppositoires. S’il en est des insolences comme des œuvres<br />
d’art, l’anus polonais est le classique des classiques.<br />
Quand il assiste à une comédie, le public a plutôt tendance<br />
à s’identifier à ceux qui reçoivent les coups qu’à ceux<br />
qui les donnent. Dans le cas des Insolences d’un téléphone,<br />
c’est tout le contraire. Les auditeurs sont toujours du côté de<br />
celui qui tend le piège et jamais du côté des victimes parce<br />
que tous et chacun sont absolument convaincus qu’eux, ils<br />
ne tomberaient pas dans un piège aussi évident ; qu’eux, ils<br />
ne seraient pas aussi facilement dupés ; et qu’eux, ils sauraient<br />
flairer le canular. Plus on se sent à l’abri du risible en<br />
somme, plus on se réjouit du ridicule qui frappe les autres et<br />
le plaisir est encore plus grand lorsque la cible est généralement<br />
hors de portée pour la majorité.<br />
Les Bleu Poudre (CKOI–1994-1997) vont prouver qu’au<br />
jeu des insolences d’un téléphone, tout le monde a un canular<br />
qui lui pend au bout du fil. En 1995, Pierre Brassard et son<br />
équipe ont déjà piégé Jacques Parizeau,<br />
<strong>Jean</strong> Chrétien et Brigitte Bardot, cette<br />
dernière deux fois dans la même semaine.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3 1
Tribunal de protection du peuple, il s’était<br />
passé une chose affreuse... Et Séguin le<br />
coupe en confirmant qu’elle va mettre fin à<br />
leurs carrières !<br />
Les auditeurs abasourdis entendent alors des roulements<br />
de tambour et le commandement d’une voix anonyme, celle<br />
de la censure cléricale qui a ourdi la manœuvre. Portez<br />
armes ! ...En joue ! Laissez-nous au moins le temps de faire nos<br />
adieux implore Fernand Séguin sans effet. La même voix laisse<br />
tomber l’ordre : Feu ! Et la satire disparaît des ondes pour<br />
quelques décennies.<br />
Prendre un matériau qui n’est pas drôle à l’origine comme<br />
celui des discours politiques ou des conférences de presse et qui le<br />
devient par la vertu des montages et des mixages sonores rappelle<br />
Robert Blondin, ça nous vient de Carte Blanche qui a pratiqué<br />
le canular radiophonique du temps où ça se faisait à la lame de<br />
rasoir et au ruban quart-de-pouce.<br />
Un art et un savoir-faire comique qui s’est perpétué de<br />
nos jours dans les fausses pubs et les capsules tribales et historiques<br />
de Philippe Lagüe à Macadam Tribus (CBF-l997- )<br />
où l’équipe qui gravite autour de Jacques Bertrand manifeste<br />
la même irrévérence que Fernand Séguin et André Roche<br />
devant tout ce qui pontifie et la même passion que Roger<br />
Rolland pour les farces sonores et les parodies.<br />
Pendant longtemps, le samedi matin, le rire à la radio fait<br />
la grasse matinée comme les auditeurs. D’abord avec Zézette<br />
(CKVL–l951-1963) qui débutait invariablement par un cri<br />
d’exaspération de Désiré, le père de l’héroïne, et la réponse<br />
impénitente de cette dernière : Allô v’là le fun qui commence !<br />
Au départ, Ovila Légaré avait conçu ses textes pour les<br />
enfants. Il les a progressivement adaptés au rire des adultes<br />
qui écoutaient l’émission d’une autre oreille. Les enfants,<br />
pour leur part, étaient fascinés par une héroïne de leur âge<br />
qui faisait fi de tous les interdits. Quant aux parents qui<br />
voyaient leurs pires appréhensions se réaliser dans les tours<br />
pendables de Zézette et de ses amis, ils profitaient de la comparaison<br />
pour se consoler des frasques de leurs propres petits<br />
monstres.<br />
Tous les samedis matin, la guerre était donc déclarée aux<br />
parents par les enfants. Mais la lutte est inégale pour les adultes.<br />
Dans une émission type de Zézette, on entend le père descendre<br />
les premières marches d’un escalier en chantonnant<br />
puis écrasement ! Babine ! mon patin à roulettes lui a coupé sa<br />
chanson en deux, laisse tomber Zézette. Elle est en compagnie<br />
de Ti Beu, son cousin, qui, lui non plus, ne donne pas sa place<br />
pour semer le désordre. Comment tu fais-toi pour faire tomber<br />
ton père en bas de l’escalier ? lui demande sa cousine.<br />
Vous avez rien qu’un étage chez vous. Ti-Beu la<br />
regarde avec commisération. Puis ? L’escalier de la<br />
cave, qu’est-ce que t’en fait ?<br />
Mais l’échange est interrompu par le retour<br />
du paternel qui s’est remis de sa chute. Attends un<br />
peu ma petite bonjour ! annonce-t-il sur un ton<br />
menaçant à Zézette qui s’esquive en vitesse, la<br />
strappe va te rouler sur le corps, toi. Il semble qu’à l’é-<br />
3 0 • L’ A P O S T R O P H E<br />
poque, ni les enfants, ni les parents n’étaient politiquement<br />
corrects puisque tout le monde se plaisait alors à imaginer<br />
que Zézette allait en manger toute une après la fin de l’émission.<br />
Dans la prochaine décennie, c’est le Festival de l’humour<br />
(CKAC–l977-l993) qui va prendre la relève pour être diffusé<br />
à terme par plus de l40 stations et rejoindre un demi-million<br />
d’auditeurs de l0 heures à 11 heures tous les samedis matin –<br />
ce qui demeure un record inégalé pour la grasse matinée.<br />
Une de mes sœurs avait travaillé Chez Miville, raconte<br />
Louis-Paul Allard, et j’avais gardé dans l’idée qu’on pouvait faire<br />
de la radio comme dans le bon vieux temps. La formule élaborée<br />
avec Paul-Émile Beaulne pour le Festival sera mivilienne : un<br />
musicien polyvalent, deux ou trois humoristes, dont au<br />
moins un qui est imitateur, et une batterie de scripteurs à<br />
l’humour politique, culturel et social décapant dont les plus<br />
endurants et les plus musclés au lancer de fleurs avec pot<br />
auront été <strong>Jean</strong> Robitaille, Pierre Légaré et Louise Bureau.<br />
UN RECORD POUR LE SAMEDI MATIN<br />
500 000 AUDITEURS<br />
AU FESTIVAL DE L’HUMOUR<br />
Dans l’émission, Louis-Paul Allard assurait les imitations<br />
des hommes politiques, des personnalités publiques et de certains<br />
personnages comme le p’tit Bébert qui se prêtait à toutes<br />
les sauces. Roger Joubert assumait la direction musicale et<br />
en plus c’était évidemment le maudit Français, détestable,<br />
qui ne comprenait rien mais qui connaissait tout sur tout. Et<br />
Tex Lecor était indissociable de sa madame Legault, sa bonne<br />
femme qui essayait de bien perler et qui ne pouvait ouvrir la<br />
bouche sans faire des dîtes-me-le-pas à tout propos.<br />
Quatrième mousquetaire du Festival de l’humour, Pierre<br />
Labelle était le plus sauté de tous par ses mimiques, ses hésitations,<br />
son phrasé disjoncté et son étrange capacité à se mettre<br />
dans la peau d’un objet domestique comme un répondeur<br />
aussi bien que dans l’écorce d’un arbre qui s’inquiète de son<br />
avenir. Moé une affaire que j’aimerais pas, ça s’rait finir mes jours<br />
comme baguette d’in restaurant chinois...ou comme chaise de cuisine<br />
chez Ginette Reno. T’sais tu y penses à ça...c’pas donné à toéz-arbres<br />
de finir leurs jours comme sculpture ou beau meuble, ça<br />
prend des allumettes pis des cure-dents pour faire un monde.<br />
Cri pour ne pas<br />
crever de honte<br />
[…] mais je hurle mais je<br />
souffre<br />
et la misère et le crime<br />
car ça vous fait péter la cervelle<br />
l’amour aussi<br />
l’illusion de croire<br />
qu’on sert à quelque chose<br />
de ce côté du monde<br />
car ça vous fait marcher dans<br />
la honte<br />
tous ces mots<br />
pour des jardins de rose de<br />
fille du roi<br />
tous ces morts<br />
pour les esprits vaudou du président<br />
Donc il neige dehors<br />
ils sont dans ma chambre<br />
des monstres que les hommes ont créés<br />
et des monstres<br />
ont dévoré ma race mon portrait<br />
ils ont déchiré mon âme<br />
qui marchait à côté d’une pauvresse<br />
Ils ont englouti les matins<br />
non une histoire à rebours<br />
et ils ont frappé à la porte de ma chambre<br />
jusqu’à ce que tombe le rideau<br />
sur la comédie des monstres […]<br />
Il neige dehors<br />
Une nouvelle crampe à l’estomac<br />
me fait serrer les dents<br />
ma cage ma révolte<br />
cette nièce qui vient de débarquer à Moncton<br />
la peau sur les os<br />
rien pour rattraper la réalité<br />
diluée dans les contradictions de l’esprit<br />
et dans ces puits de morts<br />
où viennent renaître les Saints du général<br />
Il neige dehors<br />
Ma cage se referme<br />
lourde et sans remords<br />
Moncton-Montréal, août 2003.<br />
GÉRARD ÉTIENNE,<br />
Anthologie de la littérature haïtienne<br />
Un siècle de poésie 1901-2001,<br />
Mémoire d’encrier, 2003<br />
ALBÉRIK<br />
Antilles, au dire même de la Drug Enforcement<br />
Administration (DEA), il achemine d’importants chargements<br />
de cocaïne depuis la Colombie jusqu’aux États-Unis (Chambre<br />
américaine des Représentants, Justice criminelle, Sous-commission<br />
sur la politique en matière de drogues et sur les ressources<br />
humaines, Transcriptions FDHC, 12 avril 2000). On estime<br />
actuellement que 14 % de toutes les entrées de cocaïne aux<br />
États-Unis transitent par Haïti, ce qui représente des<br />
milliards de dollars de revenus pour le crime organisé et les<br />
institutions financières américaines qui blanchissent des<br />
quantités colossales d’argent sale. Miami, à cet égard, est un<br />
centre de recyclage en investissements légitimes, en propriétés<br />
immobilières, par exemple. Les preuves abondent que la CIA<br />
a protégé ce commerce tout au long de la dictature militaire,<br />
de 1991 à 1994.<br />
En 1987, le sénateur John Kerry, en sa qualité de président<br />
de la sous-commission sénatoriale des Affaires étrangères<br />
sur les narcotiques, le terrorisme et les opérations internationales,<br />
se voyait confier une enquête importante qui s’est<br />
intéressée de près aux liens entre la CIA et le trafic de drogue,<br />
y compris le blanchiment de l’argent de la drogue aux<br />
fins du financement des insurrections armées. Publié en<br />
1989, le Rapport Kerry, concentrait son attention sur les<br />
contras nicaraguayens, mais il comprenait également une<br />
section sur les liens étroits qui existaient déjà entre les autorités<br />
militaires haïtiennes de l’époque et les trafiquants<br />
colombiens.<br />
DE 60 % EN 1998,<br />
LE CHÔMAGE À HAÏTI<br />
ÉTAIT PASSÉ<br />
À 80 % EN 2000<br />
Jack Blum a été le conseiller particulier du sénateur John<br />
Kerry. En 1996, dans un témoignage devant la Commission<br />
restreinte de renseignements sur le trafic de drogue et la<br />
guerre des contras, une commission qui relève du Sénat américain,<br />
il insistait pour sa part sur la complicité de certains<br />
hauts fonctionnaires américains : Au lieu de mettre la pression<br />
sur la direction pourrie de l’armée haïtienne, nous l’avons défendue.<br />
Nous nous sommes bouché le nez et nous avons fait comme<br />
si de rien n’était chaque fois qu’eux et leurs<br />
amis criminels aux États-Unis ont distribué<br />
de la cocaïne à Miami, Philadelphie et<br />
New York.<br />
Principale source des rentrées d’échange<br />
d’Haïti, l’afflux de narcodollars<br />
sert les intérêts des créanciers étrangers.<br />
Même si les plus hautes autorités<br />
se sont engagées pour la forme à lutter<br />
contre le trafic de la drogue, la libéralisation<br />
imposée du marché des<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 1 9
L’invasion des sauvages<br />
Selon les scénarios les plus optimistes,<br />
les Haïtiens devront attendre au<br />
moins jusqu’en 2005 avant de pouvoir<br />
remplacer le nouveau régime putschiste<br />
par un gouvernement élu. L’intervention<br />
de la force étrangère de stabilisation<br />
(Canada, États-Unis, France), maintenant<br />
remplacée par des casques bleus de l’ONU, a reconfiguré<br />
le paysage politique. Mais il reste encore beaucoup de<br />
stabilisation à faire pour que Washington et ses partenaires<br />
locaux permettent la tenue d’élections.<br />
À l’heure actuelle, même au sein des opposants à<br />
Aristide, il est généralement admis que le parti Lavalas sortirait<br />
vainqueur d’une éventuelle élection. Les racines du<br />
mouvement créé par l’ancien prêtre sont profondes, et les<br />
couches défavorisées qui forment l’immense majorité de la<br />
population continuent de s’y identifier. Interrogée par<br />
L’Apostrophe, une coopérante américaine de<br />
l’Institute for Justice and Democracy in Haiti affirmait<br />
récemment que nous ne sommes d’aucune façon reliés<br />
à Lavalas. Notre travail se fait auprès des pauvres et des<br />
organisations de la base; et ces gens-là sont tous lavalassiens.<br />
À quoi bon organiser un coup-d’État pour<br />
ensuite assister impuissants à la réélection du gouvernement<br />
constitutionnel ! Les putschistes s’activent<br />
donc actuellement à réprimer de façon systématique<br />
les partisans du gouvernement renversé.<br />
Les arrestations politiques sont encore monnaie<br />
courante en Haïti. L’ex-premier ministre Yvon<br />
Neptune, tout comme la chanteuse Sò Anne et<br />
l’ancien ministre de l’Intérieur Jocelerme Privert<br />
sont toujours détenus sous des prétextes douteux.<br />
Un de leurs avocats, Me Mario Joseph, dénonce<br />
d’ailleurs fortement le rôle des troupes canadiennes,<br />
françaises et américaines dans la répression qui a<br />
suivi le départ d’Aristide. Il les décrit comme des<br />
sauvages, des hors-la-loi qui multipliaient les arrestations<br />
illégales et les actes de brutalité.<br />
Alors que les lavalassiens croupissent toujours en prison,<br />
les autorités ont acquitté le 16 août dernier l’ancien chef des<br />
escadrons de la mort du FRAPH, Louis Jodel Chamblin.<br />
Avant de se livrer à la justice, ce dernier avait conclu un<br />
accord avec le nouveau ministre de la Justice. La répression<br />
est encore pire à la campagne, où les groupes armés formés<br />
de militaires démobilisés, d’anciens membres du FRAPH et<br />
d’ex-tonton-macoutes, ne prennent même pas la peine de<br />
passer par le système judiciaire, préférant régler le cas des<br />
sympathisants Lavalas de façon plus expéditive. Lorsque le<br />
gouvernement de facto, soucieux de conserver un vernis de<br />
2 0 • L’ A P O S T R O P H E<br />
JASMIN JOSEPH<br />
légitimité, tente de les calmer, ils n’hésitent pas à le défier<br />
ouvertement, comme le 15 août dernier alors qu’ils ont défilé<br />
en uniforme dans les rues de Port-au-Prince, avec fanfare<br />
et armes de gros calibre.<br />
En plus de travailler à détruire le parti d’Aristide, les<br />
États-Unis et leurs alliés s’assurent que le pays revienne sur<br />
le droit chemin des réformes néolibérales avant les élections.<br />
C’est le rôle du fameux Cadre de coopération intérimaire<br />
(CCI), qui fixe les grandes orientations du pays pour les<br />
années à venir. Concocté le 23 mars lors d’une rencontre<br />
tenue à Washington, adopté officiellement lors d’une rencontre<br />
entre le gouvernement de facto et la communauté<br />
internationale dans cette même ville le 23 avril, le document<br />
devra être respecté par le prochain gouvernement à être élu,<br />
quel qu’il soit. Même au sein des plus hautes instances gouvernementales,<br />
rares sont les Haïtiens qui ont eu accès à la<br />
version finale. Mais l’essentiel est connu de tous : réduction<br />
des dépenses de l’État, augmentation du rôle du<br />
secteur privé, privatisation de ce qui ne l’a pas<br />
encore été. Rappelons que la population haïtienne<br />
n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur ce<br />
document qui est presque entièrement l’œuvre d’étrangers.<br />
Aujourd’hui, alors que les grandes lignes de la<br />
reconstruction d’Haïti se précisent, il devient clair<br />
que l’opération ne bénéficiera qu’à une mince couche<br />
de privilégiés. Pendant que les petits paysans<br />
s’enfoncent dans la misère à la campagne, on<br />
importe toujours plus de riz américain grassement<br />
subventionné, qui tue la production locale. Les<br />
autorités font la vie dure aux milliers de petits commerçants<br />
du secteur informel tout en accordant des<br />
exemptions de taxes aux grandes entreprises. Rien<br />
n’est annoncé pour l’éducation et les services<br />
sociaux, et certains évoquent déjà l’idée de recréer<br />
l’armée dissoute par Aristide.<br />
Finalement, ce qu’on propose de mieux à bien<br />
des Haïtiens pour le futur, c’est un emploi dans l’un<br />
des ateliers de misère d’Apaid et de ses associés. Comme l’explique<br />
Yannick Étienne, militante syndicaliste de Batay<br />
Ouvrye, ils contrôlaient déjà l’économie, maintenant ils ont fait<br />
leur entrée en politique. Apaid et sa clique continueront donc<br />
de jouir pleinement des faramineux contrats de sous-traitance<br />
signés avec des entreprises nord-américaines comme<br />
le fabricant de t-shirts montréalais Gildan Activewear. En<br />
fait, l’homme d’affaires est tellement efficace pour combattre<br />
le syndicalisme et payer ses employés en deçà du salaire<br />
minimum que Gildan a annoncé cet été qu’elle transférerait<br />
une part croissante de sa production en Haïti.<br />
VINCENT LAROUCHE<br />
Fernand Séguin<br />
Le mot du<br />
commanditaire<br />
ANNONCEUR– Passons maintenant<br />
au Supplice de la question,<br />
notre invité cette semaine<br />
est monsieur James Fumist,<br />
directeur de la compagnie de<br />
tabac Joker, qui commandite le<br />
programme Carte blanche ! messieurs<br />
Roche et Séguin allez-y !<br />
ROCHE ET SÉGUIN– Bonjour,<br />
monsieur Fumiste!<br />
FUMIST– Bonsoir, mes jeunes amis.<br />
SÉGUIN– Alors, c’est vous qui fabriquez les cigarettes<br />
Joker?<br />
FUMIST– En effet, c’est moi.<br />
ROCHE– Et vous n’avez pas honte d’empoisonner les<br />
gens ?<br />
FUMIST– Pas du tout. Mes cigarettes sont les plus douces<br />
sur le marché. Vous en savez quelque chose, d’ailleurs,<br />
puisque votre contrat vous oblige à ne fumer que des<br />
Jokers.<br />
SÉGUIN– Parlez-en ! Ça fait trois mois que je me fais traiter<br />
pour une bronchite chronique ! Avouez que vos cigarettes<br />
sont tout ce qu’il y a de<br />
plus irritant.<br />
ROCHE– Et qu’elles sont infumables<br />
!<br />
FUMIST– Heu..<br />
SÉGUIN– Vous refusez de<br />
répondre ?<br />
ROCHE– Faites au moins<br />
une déclaration que diable !<br />
FUMIST– Heu...<br />
SÉGUIN– Dites quèque chose !<br />
FUMIST– O.K. Laissez-moi<br />
vous poser une question. C’est<br />
vous les fantaisistes que mon service<br />
de publicité a engagés pour annoncer<br />
notre produit ?<br />
ROCHE– C’est nous.<br />
FUMIST– Glad to meet you both. You<br />
are fired !<br />
André Roche<br />
ANDRÉ ROCHE, FERNAND SÉGUIN,<br />
Carte blanche (CBF–1951-1953)<br />
Le comique et l’humour à la radio québécoise (l930l970),<br />
volume I, PIERRE PAGÉ, avec la collaboration<br />
de RENÉE LEGRIS, Éditions La Presse, l976.<br />
20 ANS DE QUELLES NOUVELLES<br />
SEMBLENT UNE PASSADE FACE AUX<br />
36 ANS DES JOYEUX TROUBADOURS<br />
accompagnés par Billy Monroe et son orchestre. Quand il ne<br />
tire pas sur tout ce qui vole – entendez les politiciens,<br />
Normand s’applique à étriver son souffre-douleur de prédilection,<br />
Gilles Pellerin, dont il s’inquiète parfois de l’état de<br />
santé.<br />
Je reviens de l’hôpital, lui confie Pellerin toujours prêt à<br />
raconter sa vie par le détail. Qu’est-ce qu’y vous ont fait ? poursuit<br />
Normand. Une radiophonie des poumons lui annonce un<br />
Pellerin intarissable. Ça c’est comme un kodak, c’est comme un<br />
appareil de télévision, pis on se place l’estomac devant ça...pis faut<br />
pas bouger hein parce que moi j’ai bougé pis ça c’est allumé :<br />
N’ajustez pas vos poumons !<br />
Faussement transi d’admiration pour la mère de son ami<br />
Rolland, une maîtresse femme en possession tranquille de la<br />
vérité comme la société qu’elle incarne, Gilles Pellerin apporte<br />
dans ses monologues une touche d’émotion et une qualité<br />
d’empathie pour la quétainerie du petit monde qui tout en<br />
s’inscrivant dans la foulée des tableaux de mœurs de Gratien<br />
Gélinas préfigure celle du gars qui a un bon boss d’Yvon<br />
Deschamps.<br />
Puis vint Carte Blanche (CBF–l951-l953) pour ajouter le<br />
satirique à la riche palette des rires de soirée. Trois tueurs à<br />
gags, Fernand Séguin, André Roche et Roger Rolland, vont<br />
d’abord parodier sans pitié le ton lénifiant des émissions dites<br />
sérieuses de Radio-Canada, la redondance des romans<br />
savons, l’enflure verbale des politiciens, puis dénoncer la suffisance<br />
des élites, l’hypocrisie du clergé et la médiocrité généralisée<br />
d’une société dont l’ignorance, pour citer Antoine<br />
Rivard, est un héritage du passé qu’elle se doit de transmettre aux<br />
générations futures.<br />
Aucun coup de pied au cul de Carte Blanche ne s’était<br />
perdu jusqu’au jour où les auditeurs de<br />
l’émission eurent la surprise de s’entendre<br />
annoncer par la voix d’André Roche<br />
que, suite à un réquisitoire devant le<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 2 9
auteur comique majeur qui passe les<br />
mœurs de son temps à travers le crible et<br />
le microcosme absurde et insensé de<br />
Casimirville, un village québécois atteint de haute loufoquerie.<br />
Longtemps avant que les auteurs de téléromans adoptent<br />
la pratique d’affubler chacun de leurs personnages d’un<br />
patois qui remplit la même fonction que le sacre dans la langue<br />
parlée, Légaré, qui avec son compère Georges Bouvier<br />
interprétait les voix de tous les personnages de son village<br />
d’originaux et détraqués, avait déjà fait de l’attribution du<br />
patois un art raffiné des plus inventif.<br />
Hé torbrûle ! s’exclamait Nazaire. Et Barnabé abondait<br />
dans le même sens Téquière ! Bougrine d’affaire commentait<br />
Fulgence. Voyez-vous Flybean tentait d’expliquer Damase.<br />
Écoute-moi donc cataplasme ! insistait Oscar. Gâzette lâchait<br />
Polycarpe. M’as dire comme c’t’homme, acquiesçait Casimir.<br />
Cocombre c’est parce que ! rajoutait Ti-Clin. Bateau d’un nom !<br />
tonnait Simon. Mais Kellil était d’accord avec tout ce qui s’était<br />
dit comme d’habitude Ça la dit ! Ça la dit !<br />
Avec Radio-Carabin (CBF–l944-l953), le rire change de<br />
palette. On quitte la roublardise paysanne de la campagne<br />
pour la gouaille insolente de la grande ville. Entre un numéro<br />
de claquettes et une prestation pianistique de Walter<br />
Gieseking , les scripteurs Émilien Labelle et Laurent Jodoin<br />
qui ne font pas dans la dentelle empruntent le coup de<br />
crayon expressionniste de l’humour noir pour dénoncer les<br />
problèmes qui affectent les classes populaires dont la crise<br />
montréalaise du logement qui sévit depuis l’après-guerre.<br />
Jacques Normand et Gilles Pellerin<br />
Pourquoi restez-vous dans un fond de cour demande le<br />
speaker de l’émission à un personnage qui n’éprouve aucune<br />
gêne à mettre les points sur les i. Parce que je ne peux pas me<br />
trouver de logement. D’ailleurs, je suis habitué au fond de cour,<br />
c’est moins dur pour moi. Et c’est encore une joie aujourd’hui<br />
d’imaginer Roger Garand bombant fièrement le torse pour<br />
lancer triomphalement à son interlocuteur interloqué : Je suis<br />
avocat !<br />
Au Fantôme au clavier (CKVL–l948), toujours en soirée,<br />
Jacques Normand brille de tous ses feux pour présenter les<br />
numéros d’une émission moins éclectique que Radio-<br />
Carabin, principalement des chanteurs et des chanteuses,<br />
2 8 • L’ A P O S T R O P H E<br />
Tout un party de fête<br />
TIBEU– Allô<br />
Zézette !<br />
Bonne fête !<br />
ZÉZETTE–<br />
Merci ! Mais de<br />
quoi c’est que tu fais<br />
amanché de même ?<br />
TIBEU– C’est pour ta fête<br />
que j’ai mis mon costume de sauvage...puis<br />
papa m’a acheté une histoire<br />
du Canada...<br />
ZÉZETTE– Puis t’as emporté tes flèches<br />
aussi ?<br />
TIBEU– Ouais... pour tirer...On va<br />
faire l’histoire du Canada...<br />
(Course précipitée... bruit de vitre<br />
brisée.)<br />
ZÉZETTE– Aie ! Tibeu t’as cassé le<br />
beau miroir là !<br />
TIBEU– Ça fait rien, un sauvage ça<br />
connaît pas ça un miroir...<br />
ZÉZETTE– Laisse faire, moi je suis la<br />
police, je vas te le poigner le sauvage.<br />
TIBEU– T’es pas capable ! Je vas<br />
monter sur la table de la salle à dîner,<br />
puis essaye pour voir !<br />
(Son : Crash.)<br />
ZÉZETTE– Babine il a tout cassé la verrerie<br />
! Tu vas te faire chicaner toi !<br />
<strong>Jean</strong>ne Couet<br />
Zézette<br />
TIBEU– (Pleurant) C’est pas moi bon...tu m’as fait tomber<br />
!<br />
(Son de porte.)<br />
MATHILDA– (Approchant) J’espère qu’ils n’ont pas fait<br />
trop de gâchis ! Mon Dieu !<br />
DÉSIRÉ– Barrière regarde-moi donc ça ! Non mais...le<br />
cabinet de verrerie à terre !<br />
MATHILDA– Toute la verrerie cassée !<br />
DÉSIRÉ– Mon capot de chat tout coupaillé.<br />
MATHILDA– Le miroir du salon brisé !<br />
Mais qu’est-ce qui s’est passé?<br />
ZÉZETTE– (Piteuse) Maman c’est les<br />
sauvages qui sont passés pour ma fête de<br />
naissance.<br />
OVILA LÉGARÉ, Zézette (CKVL–1951-1963)<br />
Le comique et l’humour à la radio québécoise (l930-l970),<br />
volume I, PIERRE PAGÉ, avec la collaboration<br />
de RENÉE LEGRIS, Éditions La Presse, l976.<br />
échanges avec l’étranger a<br />
ouvert la voie au blanchiment<br />
des narcodollars au sein du système<br />
bancaire domestique.<br />
Ajoutés aux envois légitimes de<br />
la diaspora, les narcodollars<br />
sont alors recyclés vers le trésor<br />
haïtien où ils sont utilisés pour<br />
honorer les obligations de remboursement<br />
de la dette nationale.<br />
Haïti toutefois ne récolte<br />
qu’un infime pourcentage du<br />
produit de cette lucrative<br />
contrebande. La plupart des<br />
revenus du transit de la coke reviennent d’abord aux intermédiaires<br />
criminels qui s’occupent du commerce de gros et<br />
de détail, ensuite aux services de renseignements qui protègent<br />
ledit trafic et enfin aux institutions financières et bancaires<br />
qui blanchissent les dits revenus. Sans oublier que ces<br />
narcodollars sont également versés sur des comptes privés<br />
dans une pléiade de paradis fiscaux offshore dont la plupart<br />
sont contrôlés par les plus importantes banques et institutions<br />
financières occidentales.<br />
Les principales banques de Wall Street et d’Europe<br />
comme les firmes de courtage boursier blanchissent par<br />
milliards l’argent de la drogue qui est investi, par exemple,<br />
dans des transactions boursières ou des valeurs refuges.<br />
D’autre part, l’expansion des livraisons d’argent en coupures<br />
par le système de la Réserve fédérale et l’impression de<br />
milliards de dollars papier qui servent à finaliser les narcotransactions<br />
représentent un bénéfice pour la Réserve fédérale<br />
et toutes les institutions bancaires privées qui la constituent<br />
dont la plus importante est la New York Federal<br />
Reserve Bank. (Executive Intelligence Review, Jeffrey<br />
Steinberg, Les revenus de la came atteignent 600 milliards de dollars<br />
et ne cessent de croître, 14 déc. 2001) Bref, l’establishment<br />
financier de Wall Street joue un rôle non négligeable dans la<br />
formulation de la politique étrangère américaine et il a tout<br />
intérêt à la remise en place d’une narco-démocratie fiable à<br />
Port-au-Prince pour assurer la bonne suite du commerce de<br />
transit haïtien.<br />
Au cours des semaines qui ont précédé directement le<br />
coup d’État de 2004, les médias ont largement concentré leur<br />
attention sur les gangs armés et les hommes de main partisans<br />
du président <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide sans se soucier de fournir<br />
la moindre explication sur le rôle de leurs vis-à-vis, les<br />
insurgés du FLRN. Pas un seul mot dans les déclarations officielles<br />
ou les résolutions de l’Onu sur la nature du FLRN.<br />
Comment s’en étonner quand on sait que l’ambassadeur<br />
américain aux Nations unies et l’homme qui siège alors au<br />
Conseil de sécurité est John D. Negroponte, le même qui,<br />
lorsqu’il était ambassadeur au Honduras dans les années 80,<br />
a joué un rôle de tout premier plan dans la mise sur pied des<br />
escadrons de la mort honduriens soutenus par la CIA. (San<br />
Francisco Examiner, 20 octobre 2001).<br />
En avril 2004, Negroponte a quitté son siège à l’Onu<br />
pour occuper celui d’ambassadeur en Irak. Il a remplacé l’administrateur<br />
proconsulaire Paul Bremer et pourrait fort bien<br />
renverser la décision de ce dernier de dissoudre l’entièreté de<br />
l’armée irakienne et suivre la recommandation des généraux<br />
américains de permettre aux anciens membres du parti Baas de<br />
Saddam Hussein d’occuper des postes au gouvernement. Comme<br />
en Allemagne et au Japon après la guerre, les anciens membres du<br />
parti ne sont-ils pas habituellement ceux qui ont le plus d’expérience<br />
dans la direction d’une administration gouvernementale ?<br />
(Los Angeles Times, 22 avril 2004).<br />
Le peuple haïtien n’ignore pas ce que les médias occidentaux<br />
ont choisi de taire en rejetant tout le blâme des violences<br />
sur le président Aristide : les insurgés du FLRN sont<br />
d’anciens Tontons Macoutes de l’époque Duvalier et des<br />
assassins de l’ancien FRAPH. Qu’arrive-t-il lorsque les<br />
mêmes médias apprennent que l’armée des insurgés est constituée<br />
d’anciens des escadrons de la mort ? ils se refusent aussitôt<br />
à remettre en question leur interprétation des faits et<br />
s’abstiennent surtout de souligner le rôle que la CIA et la<br />
DIA ont joué dans leur création.<br />
SELON LA BANQUE MONDIALE,<br />
LES BAS SALAIRES ATTIRENT<br />
LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS<br />
Le New York Times n’a pas caché que la société civile<br />
d’opposition non violente collaborait avec des escadrons de la<br />
mort, mais considère cet événement comme un accident de<br />
parcours. Aucune mise en contexte historique n’est fournie. Il<br />
faut comprendre que des insurgés plutôt violents ont scellé<br />
une alliance avec des braves types non violents qui composent<br />
l’opposition politique.<br />
Au fur et à mesure que la crise haïtienne dégénérait vers la<br />
guerre civile, une toile d’alliances, dont certaines fortuites, s’est tissée.<br />
Elle liait les intérêts d’un mouvement d’opposition politique qui<br />
professe la non-violence à ceux d’un groupe d’insurgés qui comprend<br />
un ancien chef des escadrons de la mort accusé d’avoir tué<br />
des milliers de personnes, un ancien chef de la police accusé d’avoir<br />
ourdi un coup d’État et un gang armé sans pitié jadis partisan<br />
de Monsieur Aristide et qui maintenant<br />
s’est retourné contre lui. Compte tenu de<br />
leurs origines diverses, les opposants à<br />
Monsieur Aristide ne sont unis somme<br />
toute que par l’ardent désir qu’ils partagent<br />
tous de le voir chassé du pouvoir<br />
(New York Times, 26 février 2004).<br />
Il n’y avait rien de spontané ou<br />
d’accidentel dans les attaques rebelles.<br />
Les forces armées de la République<br />
Dominicaine avaient détecté des<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 2 1
camps d’entraînement de guérilla à<br />
l’intérieur de leur propre territoire, à la<br />
frontière nord-est entre les deux pays.<br />
(El Caribe, 27 février 2004) Le remplacement<br />
de <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide par<br />
un président asservi a toujours été à<br />
l’ordre du jour de l’administration<br />
Bush.<br />
Neuf jours avant le départ programmé<br />
du président Aristide, soit le<br />
20 février, l’ambassadeur James Foley<br />
réunissait une équipe de quatre experts militaires émanant de<br />
l’U.S. Southern Command basé à Miami. Officiellement,<br />
leur mandat se résume à évaluer les risques qui menacent l’ambassade<br />
et son personnel (Seattle Times, 20 février 2004). Les<br />
Forces spéciales américaines sont déjà dans l’île et<br />
Washington a annoncé que par mesure de précaution, trois<br />
vaisseaux de guerre sont parés pour se rendre à Haïti. Le Saipan<br />
est équipé d’hélicoptères d’attaque et d’avions de combat<br />
Harrier à décollage vertical. Les deux autres vaisseaux sont<br />
l’Oak Hill et le Trenton. Côté intervention sur le terrain,<br />
quelque 2 200 Marines du 24e Corps expéditionnaire des<br />
Marines du Camp Lejeune (N.C.) peuvent être déployés dans<br />
les plus brefs délais.<br />
Même après avoir atteint son but qui était le départ du<br />
chef de l’État haïtien, la Maison-Blanche n’entendait pas<br />
pour autant désarmer les forces paramilitaires. Bien au<br />
contraire, Washington leur<br />
réservait un rôle par procuration<br />
dans la transition. Organisé sur<br />
le modèle des précédentes opérations<br />
dirigées par la CIA, on<br />
pense au Guatemala, à<br />
l’Indonésie, au Salvador; le<br />
coup d’État haïtien leur donne<br />
carte blanche. L’objectif de l’administration<br />
Bush n’a jamais été d’empêcher ce qui était plus<br />
que prévisible, même inévitable, dans la foulée de la déportation<br />
de <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide : les massacres de civils et<br />
les assassinats politiques ciblés des partisans de Lavalas, l’ancien<br />
parti présidentiel.<br />
Pour la suite, on pourra envisager, sous supervision internationale,<br />
un désarmement simulé des insurgés, plus symbolique<br />
que réel, comme cela s’est produit avec l’UCK au<br />
Kosovo en 2000. Et avec la sanction des États-Unis, les<br />
anciens terroristes pourront alors être intégrés tant au sein de<br />
la police civile que dans la reconstitution des forces armées<br />
haïtiennes. En bout de piste, les structures terroristes de l’époque<br />
Duvalier auront été restaurées et, pour Washington,<br />
tout sera bien qui finit bien.<br />
Inutile d’ajouter que les médias occidentaux ont complètement<br />
occulté tout le contexte historique de la crise haïtienne.<br />
Même le rôle joué par la CIA n’a jamais été mentionné.<br />
La communauté internationale qui se prétend tellement<br />
soucieuse de la démocratie et de la légitimité des gou-<br />
2 2 • L’ A P O S T R O P H E<br />
vernements a fermé obligeamment les yeux sur des massacres<br />
de civils perpétrés par une armée paramilitaire commanditée<br />
par les États-Unis. Quant aux médias états-uniens, ils<br />
feront encore pire en reconnaissant ex officio d’anciens dirigeants<br />
d’escadrons de la mort comme porte-parole d’une<br />
opposition démocratique dont la légitimité ne peut être mise<br />
en doute.<br />
Le bât blesse encore plus lorsque dans le même souffle les<br />
mêmes médias remettent en question la légitimité d’un président<br />
démocratiquement élu et l’accusent d’être l’unique<br />
responsable d’une situation économique et sociale qui ne cesse<br />
d’empirer. Une détérioration imputable en majeure partie aux<br />
réformes économiques dévastatrices imposées par le FMI<br />
depuis les années 80. En 1994, la restauration du gouvernement<br />
constitutionnel était conditionnelle à son acceptation<br />
de s’imposer le traitement de choc du FMI et, en raison<br />
même de cette thérapie économique, ledit gouvernement<br />
s’est vu à son tour dans l’impossibilité d’instaurer une démocratie<br />
digne de ce nom. Aussi bien sous la gouverne d’André<br />
Préval que de <strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide, les hauts fonctionnaires<br />
des gouvernements haïtiens ont respecté les diktats du<br />
FMI mais il semble que ce n’était jamais assez. À preuve et en<br />
dépit même de sa complaisance, le président Aristide a été<br />
mis au pilori médiatique et chimérisé par l’administration<br />
américaine.<br />
Les États-Unis ambitionnent de redonner à Haïti un statut<br />
de colonie tout en y maintenant une démocratie d’opérette<br />
soutenue par une occupation<br />
militaire permanente. Au<br />
bout du compte, l’administration<br />
américaine ne poursuit qu’un<br />
objectif : militariser la totalité du<br />
bassin antillais qui est bordé au<br />
PAR HAÏTI<br />
nord-ouest par Cuba et au sud<br />
par le Venezuela. L’île<br />
d’Hispaniola, constituée d’Haïti<br />
et de la République Dominicaine, est la porte d’entrée du<br />
bassin antillais et l’installation de bases militaires américaines<br />
à Haïti visent d’abord à intensifier la pression politique sur<br />
Cuba et le Venezuela; et en sous-main à assurer la fluidité du<br />
transit des stupéfiants en provenance de la Colombie, du<br />
Pérou et de la Bolivie.<br />
À cet égard, la militarisation du bassin antillais complètera<br />
celle que Washington a déjà imposée à la région andine<br />
de l’Amérique du Sud avec son Plan Colombie, rebaptisé<br />
Initiative andine. Dans ce cas, la mise en tutelle militaire des<br />
puits de pétrole et de gaz naturel a pour but de garantir l’acheminement<br />
de la ressource en protégeant le parcours des<br />
pipelines et les couloirs de transport. Et en<br />
prime de rendre le même service au trafic<br />
des stupéfiants. Dieu bénisse l’Amérique ! et<br />
merde aux autres !<br />
Une première version de ce texte a été<br />
rédigée en février 2004 et complétée le jour<br />
du départ pour l’exil du président<br />
<strong>Jean</strong>-Bertrand Aristide.<br />
14 % DE TOUTES<br />
LES ENTRÉES DE COCAÏNE<br />
AUX ÉTATS-UNIS PASSENT<br />
<strong>Jean</strong>-Maurice Bailly<br />
et Estelle Caron<br />
Le frère de Minou<br />
Drouet<br />
GÉRARD PARADIS– Il y a un<br />
petit gars - le fils de mon voisin -<br />
qui a écrit un roman en se levant<br />
ce matin.<br />
JEAN-MAURICE BAILLY– En<br />
se levant ?<br />
GÉRARD– Ça lui a pris 10 minutes. Pas plus.<br />
JEAN-MAURICE– Impossible !<br />
GÉRARD– Sa maîtresse, à l’école, lui avait dit que, pour<br />
faire un bon roman – un roman vendable – il fallait parler<br />
de quatre choses : la religion, la monarchie, le sexe et le<br />
mystère. C’est-à-dire mêler ces quatre éléments. Alors le<br />
petit garçon a fait un roman de quatre phrases qui parle de<br />
religion, de monarchie, de sexe et de mystère. Il se lit<br />
comme suit : Jésus Marie ! cria la princesse. Tout de suite<br />
t’as ta religion et ta monarchie. Encore enceinte ? C’est qui<br />
cette fois-là ? Là, t’as ton sexe et puis ton mystère.<br />
ANDRÉ RUFIANGE, Les Joyeux Troubadours (CBF–l94l-l977)<br />
30 ans d’humour avec les Joyeux troubadours, ANDRÉ RUFIANGE,<br />
Éditions libres, Montréal, 1971.<br />
Un soir d’été sur la rue Débraillée<br />
LÉRINTÉE– C’est-y effrayant, m’ame Esquintée, des chaleurs<br />
de même.<br />
ESQUINTÉE– Si ça continue, je pense que je vas fondre.<br />
LÉRINTÉE– Avec vos deux cents six livres, ça va faire<br />
une méchante tache de graisse.<br />
TI-NEST– (Essoufflé) Hé m’man, Harpège vient de se<br />
faire écraser.<br />
ESQUINTÉE– (Calmement) Cré petit fou. Est-ce qu’il<br />
est mort?<br />
TI-NEST– J’sais pas, mais le chauffeur a été obligé de<br />
prendre un couteau pour le décoller d’après la roue.<br />
ESQUINTÉE– Ah bien il doit être mort, lui qui était déjà<br />
malade.<br />
TI-NEST– On peut-tu continuer notre partie de moineau<br />
pareil ?<br />
ESQUINTÉE– Non, on est en deuil. Sors ta musique à<br />
bouche et dis à tes p’tits frères de pleurer en masse.<br />
LÉRINTÉE– Pauvre ma’me Esquintée...un chèque d’allocution<br />
familiale de moins.<br />
ESQUINTÉE– Ce qui est de plus de valeur, c’est que je<br />
vais être obligée de le retourner, je l’ai reçu hier.<br />
ÉMILIEN LABELLE, Radio-Carabin (CBF–l944-l953)<br />
Le comique et l’humour à la radio québécoise (l930-l970), volume I, PIERRE PAGÉ,<br />
avec la collaboration de RENÉE LEGRIS, Éditions La Presse, l976.<br />
LA GOUAILLE URBAINE DE RADIO-<br />
CARABIN COMPLÈTE LA ROUBLARDISE<br />
RURALE DE NAZAIRE ET BARNABÉ<br />
enfants pour l’école, les nouvelles, la vaisselle et L’heure du<br />
dessert (CBF) avec Philippe Robert.<br />
La maîtresse de maison peut s’accorder un répit bien<br />
mérité à une heure de l’après-midi et apprécier qu’une émission<br />
qui regarde la vie avec les yeux d’une femme lui permette<br />
de croire qu’elle n’est pas la seule à avoir des problèmes<br />
avec les hommes.<br />
Ah si seulement le sien pouvait trouver le courage de<br />
demander une augmentation à son boss. Et de s’entendre<br />
interpeller par un sketch à la radio. Pis j’y ai dit : Patron, ma<br />
femme m’a dit de vous demander une augmentation de salaire. Ça<br />
c’est lui tout craché. Pis ? Il m’a dit : Correct Benoît, je vais<br />
demander à ma femme si je peux faire ça pour vous. Mieux vaut<br />
en rire. Bon ! Par où je commence ? Par les boutons qui manquent<br />
ou les trous dans les bas ?<br />
Au retour du boulot, depuis plus de trente ans, les auditeurs<br />
sont toujours immobilisés dans des bouchons de circulation<br />
quotidiens qui s’éternisent et toujours aussi captifs<br />
dans leurs voitures que le matin. Mais avec leur journée de travail<br />
dans le corps, ils ne s’attendent pas à retrouver la même<br />
ambiance. L’heure est plutôt à la blague qu’aux questions de fond,<br />
explique Guy Banville qui en tant que directeur de programmation<br />
s’est penché sur la question. C’est un moment de la<br />
journée où les duos comiques font merveille. Je pense entre autres<br />
à celui de Patrice L’Écuyer et de Mario Lirette qui a fait date. Rien<br />
de trop élaboré, des échanges spontanés, de l’impromptu. Comme<br />
dirait le Confucius de L’Écuyer : Après journée so so, happy<br />
hour ping-pong.<br />
Après le souper, à l’époque où la soirée n’était pas encore<br />
la chasse gardée de la télé, la table desservie, on s’assoyait<br />
devant le radio pour écouter la radio dont le rire devenait<br />
mordant et critique plus le soir avançait avec une liberté dans<br />
le ton et une audace dans les styles qui ne correspond pas à<br />
l’image qu’on a gardée de l’époque.<br />
Ovila Légaré a laissé d’une part le souvenir d’un acteur<br />
qui en imposait par sa prestance et son poids dramatique et<br />
d’autre part celui d’un conteur et d’un folkloriste à la mode<br />
de chez nous. Mais on a oublié que dans<br />
Nazaire et Barnabé (CKAC–l939-l958)<br />
dont il a écrit les textes, c’est aussi un<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 2 7
parodies de tounes à succès commandent<br />
l’engagement de chanteurs professionnels<br />
et des arrangements aussi sophistiqués que<br />
ceux des chansons originales. La qualité<br />
de l’habillage sonore du Zoo a amorcé la transformation du<br />
sketch en capsule humoristique que François Pérusse va<br />
consacrer dans les années quatre-vingt-dix avec ses magistrales<br />
2 minutes du peuple et son JourNul.<br />
Les univers qu’on est parvenu à créer pouvaient facilement<br />
projeter un vidéo-clip dans la tête de ceux qui les entendaient, se<br />
souvient Alain Dumas avec la fierté d’un précurseur. Cela<br />
dit, il est le premier à en convenir aujourd’hui. Le succès du<br />
Zoo reposait d’abord et avant tout sur une connivence de génération<br />
entre ceux qui la faisaient et ceux qui l’écoutaient.<br />
La radio, c’est un peu comme une horloge qui poufferait<br />
de rire à certaines heures plutôt que de se contenter de les<br />
sonner comme le carillon de Westminster. Pendant 36 ans, à<br />
tous les jours de la semaine, à 11 heures et demie tapant, le<br />
rire au Québec a eu une odeur de soupe. Quand on arrivait de<br />
l’école et qu’on entendait... Toc! ...Toc! ...Toc! ...Qui est là ? ça<br />
voulait dire que le dîner était en train de chauffer sur le poêle, se<br />
remémore le réalisateur Robert Blondin.<br />
Les Joyeux Troubadours (CBF–1941-1977) pour Tex<br />
Lecor, c’est son premier contact avec les choses de l’humour.<br />
Jeune, j’étais pas un gars de maison, j’aimais mieux être dehors<br />
dans la nature, mais Les Joyeux Troubadours, on les écoutait,<br />
c’était régulier, régulier. Plus tard, quand j’étais aux Beaux-Arts et<br />
que j’ai commencé à gratter la guitare, un midi, j’ai passé à l’émission<br />
comme chanteur. Pour moi, c’était le summum.<br />
Pour plusieurs générations d’auditrices, les trois piliers<br />
des Troubadours, <strong>Jean</strong>-Maurice Bailly, Estelle Caron et<br />
Gérard Paradis faisaient partie de la famille. J’ai laissé mon dernier<br />
emploi à cause de quelque chose que le patron m’a dit, lançait<br />
Gérard. Qu’est-ce qui t’as donc dit ? lui rétorquait Bailly. Il<br />
m’a dit que j’étais dehors, de conclure Gérard en s’esclaffant.<br />
M’man quecé qu’on mange aujourd’hui ? Du chiard, on est<br />
jeudi.<br />
2 6 • L’ A P O S T R O P H E<br />
PENDANT 15 ANS, CHEZ<br />
MIVILLE SERT L’HUMOUR<br />
AVEC LES TOASTS ET LE CAFÉ<br />
En amour, lorsque les rendez-vous deviennent quotidiens,<br />
on se met en ménage. Les auditrices et les auditeurs<br />
adoptent la même attitude face aux émissions qui leur plaisent<br />
et, en radio, les mariages sont d’une longévité exemplaire.<br />
Après Les Joyeux Troubadours, qui, eux, ont pris la précaution<br />
après les dix premières années d’acheter leur temps<br />
d’antenne de Radio-Canada pour les prochains 25 ans,<br />
Quelles nouvelles ? (CBF–1939-1959) peut avec ses 20 ans<br />
sembler une passade. Mais le rire gentiment moqueur de<br />
Jovette Bernier tombe à point nommé après le départ des<br />
Un cas de force majeure<br />
LE JUGE– Madame Basile, lorsque<br />
votre mari vous a demandé en mariage...<br />
Jovette Bernier ELLE– Pardon, c’est moi Votre<br />
Honneur. Il était trop engourdi pour<br />
me demander.<br />
LE JUGE– Mais alors c’est encore pire : vous venez de<br />
déclarer devant la Cour que c’est vous qui avez demandé<br />
votre mari en mariage. Donc vous l’aimiez ?<br />
ELLE– (Se dérhume).<br />
LE JUGE– Il faut aimer un homme pour le demander en<br />
mariage.<br />
ELLE– J’avais trente-huit ans Votre Honneur.<br />
JOVETTE BERNIER, Quelles nouvelles ? (CBF–l939-l959)<br />
Le comique et l’humour à la radio québécoise (l930-l970), volume I, PIERRE PAGÉ,<br />
avec la collaboration de RENÉE LEGRIS, Éditions La Presse, l976.<br />
La petite vie<br />
d’une dinde<br />
OSCAR– Écoute-moi donc là... la<br />
v’la ta dinde !<br />
DAMASE– Mets-la sur la table,<br />
voyez-vous...<br />
(Gloussement de dinde).<br />
Ovila Légaré<br />
NAZAIRE– Torbrûle, elle est en vie...<br />
on en mangera pas à soir...<br />
DAMASE– Flybean son... qu’est-ce que t’as fait ?<br />
OSCAR– Je suis venu à bout d’en emprunter une, écoute-moi<br />
donc...mais va falloir que je la remette demain,<br />
écoute-moi donc...ils reçoivent aux Rois...<br />
CASIMIR– Ouais ben approchez tout le monde...on va<br />
mettre la dinde sur le milieu de la table...M’as dire comme<br />
c’t’homme faut faire contre importune bon coeur....<br />
(Re-gloussement de la dinde).<br />
BARNABÉ – Ben oui. Mais qu’est-ce que tu veux qu’on<br />
fasse avec cette dinde-là ? Téquière elle est en vie...on<br />
n’est pas des Esquimaux...<br />
NAZAIRE– Ouais, si au moins elle était<br />
morte...<br />
(Bruit de coup de carabine au loin. Une balle<br />
qui siffle passe à travers la vitre et vient tuer la<br />
dinde au milieu de la table).<br />
OVILA LÉGARÉ, Nazaire et Barnabé<br />
(CKAC–l939-l958)<br />
Le comique et l’humour à la radio québécoise (l930-l970), volume I,<br />
PIERRE PAGÉ, avec la collaboration de RENÉE LEGRIS,<br />
Éditions La Presse, l976.<br />
Le rire<br />
de la radio<br />
Ce n’est pas sous la plume des<br />
poètes grecs ou latins qui s’émerveillaient<br />
plutôt des doigts roses de<br />
l’aurore ou de l’état des rayons des<br />
roues du char d’Apollon qu’on trouve<br />
l’explosion lyrique d’un Ah le premier<br />
rire du matin qui nous fait tant de<br />
bien !<br />
L’être humain a le pouvoir de<br />
s’esclaffer tout seul à tout moment<br />
depuis la nuit des temps. Mais pour<br />
participer à un éclat de rire collectif,<br />
il a eu besoin d’un incitatif. Les<br />
Anciens n’étaient pas des rigolos. Ils<br />
n’y seraient pas arrivés sans l’aide<br />
des dieux du vin, Dionysos et<br />
Bacchus, les deux joyeux drilles<br />
auxquels l’Antiquité avait confié la<br />
tutelle du rire collectif – un peu comme si aujourd’hui on<br />
donnait la direction artistique du comique à la SAQ.<br />
À Athènes du temps de Périclès, les Grecs devaient<br />
attendre la fin de l’après-midi pour se paqueter la figue et se<br />
dilater collectivement la rate. Encore là pas tous les jours<br />
mais une fois l’an à l’occasion des Grandes Dionysies, l’ancêtre<br />
lointain de nos Rozonysies contemporaines, le Festival<br />
juste pour rire.<br />
Au Moyen Âge, le rire est demeuré une activité qui se<br />
pratique collectivement entre l’angélus du midi et l’angélus<br />
du soir. Le clergé médiéval ne prise guère le comique et ne<br />
saurait tolérer qu’une batterie de jongleurs, de bateleurs et de<br />
farceurs officient sur le parvis des églises au même moment<br />
PORTRAIT<br />
D’UNE JOURNÉE D’ÉCOUTE<br />
PAR<br />
JEAN-CLAUDE GERMAIN<br />
Inspiré d’une scénarisation élaborée en collaboration avec Marc Grégoire<br />
La musique hindoue nous a appris<br />
qu’il existe une musique spécifique pour chaque<br />
saison de l’année et pour chaque moment du jour : les ragas du<br />
matin, de l’après-midi et du soir. La radio nous a permis de découvrir qu’il en était de<br />
même pour le rire : chaque segment de la journée possède un rire qui lui est particulier. Ce qui n’a pas toujours<br />
été le cas.<br />
MAGRITTE<br />
où les ministres du culte célèbrent<br />
leurs offices à l’intérieur.<br />
À la cour de Versailles, la matinée<br />
n’est plus régie par la liturgie<br />
mais par le protocole. Dorénavant<br />
au lever du roi, c’est l’humeur de Sa<br />
Majesté qui donne la couleur de la<br />
journée et il faut bien le dire, au saut<br />
du lit, règle générale, les souverains<br />
ne sont pas d’humeur à rire.<br />
Bref, avant que la radio ne l’invente,<br />
le rire matinal n’existait pas.<br />
On se levait du bon ou du mauvais<br />
pied, mais on ne se réveillait pas<br />
dans l’attente du premier rire<br />
comme c’est le cas depuis près d’un<br />
demi-siècle. Dans ma vie, le rire de<br />
Normand Brathwaite est devenu un<br />
point de repère, reconnaît Guy Banville. Lorsque je l’entends<br />
fuser à son émission du matin, ça me dit que la terre tourne, qu’on<br />
est encore en vie, que ça fonctionne et que tout va !<br />
Le rire du réveil, c’est désormais le pain, le beurre et les<br />
confitures de la radio. Tous les directeurs de programme vont<br />
le confirmer. Le matin on met la totale. C’est le caviar, le foie gras<br />
et le sirop d’érable, surenchérit Banville. Tout saisir n’est pas<br />
aussi important pour des auditeurs qui vaquent à leurs occupations<br />
matinales. Ce qui importe, c’est de créer une ambiance.<br />
Jusqu’à l’avènement de la radio, la présence réelle d’un<br />
public dans le même amphithéâtre, la même salle, sous la<br />
même tente ou devant les mêmes tréteaux était incontournable<br />
pour s’adonner au plaisir de rire ensemble.<br />
L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 2 3
La radio va libérer le rire de cette<br />
contrainte, en offrant à ses auditeurs la<br />
possibilité d’écouter les mêmes propos<br />
comiques en même temps dans des<br />
endroits différents et d’en rire tous<br />
ensemble au même moment, de concert<br />
avec un auditoire à l’ancienne qui assiste<br />
à leur diffusion en direct dans un studio.<br />
Si la représentation théâtrale demeure à ce jour une rencontre<br />
dans un espace précis, l’émission de radio s’est tout de<br />
suite imposée comme un rendez-vous ouvert dont chaque<br />
auditeur, au jour et à l’heure dite, se réserve le choix du lieu.<br />
C’était une révolution sans précédent qui, en élargissant<br />
ainsi la notion de public à toute la société québécoise autant<br />
urbaine que rurale, a permis à cette dernière de s’inventer des<br />
héros, des héroïnes, des boucs émissaires, des têtes de turc et<br />
toute la galerie des personnages hilarants, cocasses, ridicules<br />
et inénarrables sans lesquels une société ne saurait pas qu’elle<br />
est unique et à nulle autre pareille. Le rire québécois est né<br />
à la radio dans les années trente.<br />
On a tendance à l’oublier, mais la société québécoise n’a<br />
pas toujours été une société du spectacle comme elle l’est<br />
devenue depuis son entrée dans l’âge de la télévision. Jusqu’à<br />
la fin des années quarante, comme toutes ses émules occidentales,<br />
elle était une société de la radio qui n’avait rien à<br />
envier à celle de la télévision.<br />
Au Québec, la radio favorise l’éclosion du premier vedettariat<br />
artistique et son immense popularité confère le statut<br />
de vedettes nationales non seulement à des comédiens, à des<br />
comédiennes ou à des chefs d’orchestre, mais à toute une<br />
nouvelle faune radiophonique composée d’auteurs, de scripteurs,<br />
de réalisateurs, d’annonceurs et d’animateurs bouteen-train,<br />
voire d’un rieur émérite dont le rire est reconnu<br />
irrésistible pour dégeler les auditoires, celui de Marcel<br />
Gamache.<br />
La radio ne se contente pas de consacrer les gloires existantes<br />
de la scène et du cabaret, elle s’évertue à créer les siennes.<br />
L’exemple de Gratien Gélinas est probant. En 1937, il<br />
crée son personnage de Fridolin sur les ondes de CKAC, dans<br />
le cadre de l’émission Le Carrousel de la gaieté. Le succès qu’il<br />
remporte auprès des auditeurs est tel que l’année suivante,<br />
Fridolin se matérialise sur la scène du Monument national<br />
dans Fridolinons, la première d’une série de huit revues<br />
annuelles qui vont donner à la satire sociale et politique la<br />
place prédominante qu’elle occupe toujours dans le rire québécois.<br />
La radio, c’était notre télé de l’époque, puis on était branché<br />
là-dessus pas à peu près. Mon père écoutait sûrement les nouvelles<br />
vingt fois par jour, se souvient Louis-Paul Allard. Toute la vie<br />
familiale tournait autour de l’appareil radio et j’ai grandi avec<br />
Chez Miville. Il n’est pas le seul. Tous les matins, sur les ondes<br />
de CBF, du lundi au vendredi, de 1955 à 1970, Miville<br />
Couture et ses deux acolytes, <strong>Jean</strong> Mathieu et <strong>Jean</strong> Morin,<br />
ont invité leurs auditeurs à déjeuner en leur compagnie, au<br />
sens propre avec toasts et café, pour ceux qui assistaient à<br />
Chez Miville en studio, et au sens figuré pour ceux qui l’écoutaient<br />
au foyer.<br />
En rimettes, en chansons, jeux de mots et railleries / On s’amuse<br />
aux dépens des échos quotidiens. C’est la chanson thème<br />
de l’émission qui traduit le mieux sa formule. Dès ses dernières<br />
notes, Miville Couture et ses deux comparses s’attaquent<br />
au menu composé par le réalisateur et ses scripteurs qui,<br />
depuis leur première réunion à trois heures du matin ont<br />
identifié tous les sujets d’actualité susceptibles d’être l’objet<br />
d’une boutade, d’un sketch ou d’une chanson.<br />
Le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton sur le<br />
bilinguisme et le biculturalisme a-t-il été publié la veille par<br />
exemple, <strong>Jean</strong> Morin est le premier à tendre le micro à l’homme<br />
de la rue qu’interprète <strong>Jean</strong> Mathieu pour obtenir ses<br />
commentaires Mais faut dire que dans ma famille, nous autres,<br />
ça fait au-d’là de trois siècles qu’on était au courant de la question.<br />
Et le ton est donné pour lancer le rire de la journée. Tout<br />
est dans la manière. Et vive l’esprit français ! Yes sir !<br />
FRIDOLIN NAÎT SUR<br />
LES ONDES DE<br />
CKAC AVANT DE<br />
FRIDOLINER SUR<br />
SCÈNE<br />
Quand la télévision est arrivée dans le paysage au tout<br />
début des années cinquante, la radio se serait sans doute progressivement<br />
perdue dans le décor si elle n’avait connu un<br />
revirement inespéré de fortune, amené par la mise au point<br />
d’une petite radio transistorisée qu’on pouvait installer dans<br />
le tableau de bord des automobiles et par l’exode massif des<br />
citadins vers la banlieue. Une nouvelle réalité sociologique<br />
qui va assurer l’avenir de la radio. Les banlieusards captifs<br />
dans leurs voitures à l’aller et au retour du travail forment un<br />
public idéal pour le rire radiophonique.<br />
Au milieu des années quatre-vingts, c’est ce public<br />
immobilisé quotidiennement dans des bouchons de circulation<br />
qui fait ses délices du Zoo de Québec (CJFM 93–1985-<br />
1990), une émission du matin qui rejoint un demi-million<br />
d’auditeurs dans la seule région de Québec, et tout le Québec<br />
lorsqu’elle devient La Jungle (CHIK-Radio Mutuel) pendant<br />
quelques années supplémentaires. Avec André Parent, Alain<br />
Dumas et Michel Morin à la barre du Zoo, le rire matinal a<br />
quitté la scène de théâtre pour l’écran de cinéma. On n’imagine<br />
plus ce qu’on entend, on le voit.<br />
Au Zoo, les sketches littéraires à la<br />
façon de Chez Miville sont devenus des<br />
mini-productions qui ont la qualité<br />
d’une trame sonore de film et les<br />
Les années de la radio<br />
Si la télévision vous fatigue les yeux,<br />
dans les années quarante vous en<br />
auriez pris un coup dans les oreilles.<br />
C’était alors la belle époque de la radio.<br />
Aux heures de pointe et dans la soirée,<br />
votre appareil aurait surchauffé et vous<br />
auriez dû, par prudence, garder quelques<br />
lampes de rechange à portée de la main.<br />
À partir de midi, vous aviez toutes les<br />
quinze minutes, un radioroman tel que<br />
Jeunesse dorée ou Rue principale ou Vie de<br />
famille ou La métairie Rancourt. Comme<br />
vous auriez eu à suivre quatre histoires en<br />
même temps, cela aurait été excellent<br />
pour votre mémoire. Car, il ne fallait surtout<br />
pas confondre les intrigues.<br />
À cette époque-là, ce qui faisait le<br />
succès d’une vedette, c’était sa voix. Avoir une belle voix était<br />
de première importance. Vous auriez pu avoir une tête d’abruti,<br />
mais si la voix y était cela ne causait aucun problème.<br />
Simplement par le timbre de la voix des personnages, on<br />
pouvait imaginer une physionomie de son choix, c’était l’avantage<br />
de la radio. Mais avec les photos des artistes dans les<br />
journaux à potins, la comparaison pouvait s’avérer décevante.<br />
Si la télévision consacre aujourd’hui les vedettes, elles ne<br />
pourront jamais atteindre le degré d’amour et de passion que<br />
pouvaient susciter les vedettes de la radio. C’était de la folie<br />
pure. Les admirateurs se tenaient à la porte des stations<br />
radiophoniques pour les voir sortir. Les stars de cette époque<br />
se nommaient Alfred Brunet, François Lavigne, Paul de<br />
Vassal, René Verne, <strong>Jean</strong>-René Coutlé, Henri Poitras, Albert<br />
Duquesne, Fred Barry, Albert Cloutier, Roger Garceau,<br />
André Treck, Clément Latour, Olivette Thibeault, <strong>Jean</strong>ne<br />
Maubourg, Denise Saint-Pierre, Mimi D’Estée, Jacques<br />
Auger, Julien Lippé, Armand Leguet, Gaston Doriac, Léon<br />
Noël de Tilly, Ovila Légaré, Georges Bouvier, Lucille Laporte,<br />
Amanda Alarie, Juliette Béliveau, Estelle Maufette et combien<br />
d’autres. Qui se souvient aujourd’hui de tous ces noms ?<br />
Autant en emporte le vent ! Tout est éphémère a dit le<br />
Bouddha. D’ailleurs, s’il n’avait pas été un sage, qui se<br />
souviendrait de lui lorsqu’il chantait à la radio ?<br />
Si les émissions du midi étaient d’abord dédiées aux<br />
bonnes mères de famille, à l’heure du souper, il y en avait<br />
d’autres qui s’adressaient aux écoliers qui se dépêchaient<br />
de faire leurs devoirs pour écouter leurs émissions préférées,<br />
Madeleine et Pierre et La marmaille de Radio-Canada,<br />
et en soirée aux travailleurs écrasés dans le gros fauteuil<br />
du repos bien mérité. On retrouvait là Les secrets du docteur<br />
Morhanges d’Henry Deyglun, Faubourg à m’lasse de<br />
Dans les années quarante vous en<br />
auriez pris un coup dans les oreilles<br />
Pierre Dagenais, La fiancée du commando<br />
de Paul Gury et, sommet de tous les sommets,<br />
Un homme et son péché de <strong>Claude</strong>-<br />
Henri Grignon. Ma mère nous obligeait à<br />
écouter cette émission pour notre formation.<br />
J’aurais dû y prêter plus d’attention,<br />
j’aurais appris ainsi à faire des économies.<br />
L’arrivée de CKVL en 1946 fit l’effet<br />
d’une étoile filante qui traverse le ciel et<br />
balaya les cotes d’écoutes de toutes les<br />
autres stations. CKVL attirait les auditeurs<br />
avec sa Parade de la chanson française<br />
qui occupait une grande partie de l’horaire.<br />
Ce qui tournait en ce temps-là n’était<br />
pas du tout du genre de ce qui allait<br />
suivre quelques années plus tard avec<br />
Félix Leclerc, Georges Brassens, Jacques<br />
Brel, <strong>Jean</strong> Ferrat et Barbara.<br />
C’était l’époque des petites chansons faciles, presque<br />
insipides, telles que Bébert le monte en l’air, Le danseur de tango,<br />
La plume au chapeau, Pigalle, interprétées par Lily Fayol,<br />
Andrex, Lucienne Delisle, Tohama et Jacques Hélian. Tous<br />
ces succès étaient dûment repris par Lucille Dumont,<br />
Murielle Millard, Michel Noël, Jacques Normand et…j’ai la<br />
mémoire qui flanche. Il y avait aussi des traductions de chansons<br />
américaines reprises par Fernand Robidoux, <strong>Jean</strong><br />
Lalonde et André Rancourt. Le succès de ces artistes et les<br />
choix du public ne juraient que par ce style de chansons.<br />
CKVL avait aussi créé ses propres vedettes. Léon<br />
Lachance, ou autres compères, animaient des émissions<br />
publiques diffusées du Café Saint-Jacques ou de la Salle<br />
Poissant, tandis que Gaby Laplante y allait de refrains enlevés<br />
et que Roland Legault était le chanteur populaire. Mais la<br />
vraie vedette de la station était d’abord Jacques Normand.<br />
Tout un phénomène. De l’humour…de l’esprit…de la classe;<br />
le seul qui avait un peu de culture et de raffinement dans<br />
toute la baraque…avec Roger Baulu.<br />
Tous les soirs, vers l’heure du souper, Normand présentait,<br />
directement du Théâtre Bijou rue Papineau, son Fantôme<br />
au clavier avec Billy Monroe au piano et Gilles Pellerin pour<br />
les réparties. C’était au boutte. Tout le monde écoutait<br />
ça. Avec le chapelet, c’était la plus grosse cote d’écoute.<br />
Et pas compliqué. Un jeu…des invités…des chansons et<br />
des blagues. Mais l’esprit fusait…le gag à toutes les 15<br />
secondes. Après l’émission, il n’y avait plus un malheur<br />
qui tenait debout. Tout le monde était heureux. Même<br />
les morts ressuscitaient. J’entends par là les auditeurs des<br />
émissions culturelles de Radio-Canada. Ah oui…Jacques<br />
Normand…à lui tout seul…ce fut toute une époque.<br />
RAYMOND LÉVESQUE<br />
2 4 • L’ A P O S T R O P H E L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 2 5