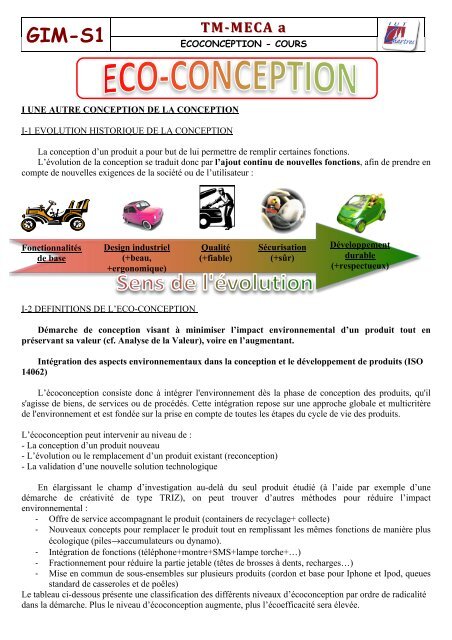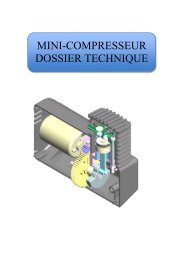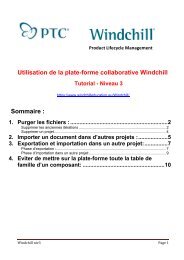Ecoconception_files/Cours d'ECOCONCEPTION.pdf
Ecoconception_files/Cours d'ECOCONCEPTION.pdf
Ecoconception_files/Cours d'ECOCONCEPTION.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
I UNE AUTRE CONCEPTION DE LA CONCEPTION<br />
I-1 EVOLUTION HISTORIQUE DE LA CONCEPTION<br />
La conception d’un produit a pour but de lui permettre de remplir certaines fonctions.<br />
L’évolution de la conception se traduit donc par l’ajout continu de nouvelles fonctions, afin de prendre en<br />
compte de nouvelles exigences de la société ou de l’utilisateur :<br />
Fonctionnalités<br />
de base<br />
Design industriel<br />
(+beau,<br />
+ergonomique)<br />
I-2 DEFINITIONS DE L’ECO-CONCEPTION<br />
Qualité<br />
(+fiable)<br />
Démarche de conception visant à minimiser l’impact environnemental d’un produit tout en<br />
préservant sa valeur (cf. Analyse de la Valeur), voire en l’augmentant.<br />
Intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits (ISO<br />
14062)<br />
L’écoconception consiste donc à intégrer l'environnement dès la phase de conception des produits, qu'il<br />
s'agisse de biens, de services ou de procédés. Cette intégration repose sur une approche globale et multicritère<br />
de l'environnement et est fondée sur la prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie des produits.<br />
L’écoconception peut intervenir au niveau de :<br />
- La conception d’un produit nouveau<br />
- L’évolution ou le remplacement d’un produit existant (reconception)<br />
- La validation d’une nouvelle solution technologique<br />
Sécurisation<br />
(+sûr)<br />
Développement<br />
durable<br />
(+respectueux)<br />
En élargissant le champ d’investigation au-delà du seul produit étudié (à l’aide par exemple d’une<br />
démarche de créativité de type TRIZ), on peut trouver d’autres méthodes pour réduire l’impact<br />
environnemental :<br />
-‐ Offre de service accompagnant le produit (containers de recyclage+ collecte)<br />
-‐ Nouveaux concepts pour remplacer le produit tout en remplissant les mêmes fonctions de manière plus<br />
écologique (piles→accumulateurs ou dynamo).<br />
-‐ Intégration de fonctions (téléphone+montre+SMS+lampe torche+…)<br />
-‐ Fractionnement pour réduire la partie jetable (têtes de brosses à dents, recharges…)<br />
-‐ Mise en commun de sous-ensembles sur plusieurs produits (cordon et base pour Iphone et Ipod, queues<br />
standard de casseroles et de poêles)<br />
Le tableau ci-dessous présente une classification des différents niveaux d’écoconception par ordre de radicalité<br />
dans la démarche. Plus le niveau d’écoconception augmente, plus l’écoefficacité sera élevée.
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
I-3 PLACE DE L’ECO-CONCEPTION DANS LE CYCLE DE CONCEPTION<br />
Dans le cas d’un produit éco-conçu dès l’origine, la démarche d’écoconception doit être manée en parallèle<br />
avec celle de conception, sans l’alourdir exagérément.<br />
En cas de conflit dans les choix (exemple : solution plus écologique mais plus coûteuse), un ordre de<br />
priorité devra être défini avec le commanditaire.<br />
Dans le cas d’une reconception, l’analyse du produit existant sera prépondérante :
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
II IMPACTS DE L’ECOCEPTION POUR L’ENTREPRISE<br />
II-1 INTERETS<br />
Le respect des Directives européennes<br />
Elles sont de plus en plus nombreuses et couvrent d’ores et déjà tous les champs de pollution existants :<br />
- Directives de fin de vie :<br />
- VHU (véhicules hors d’usage)<br />
- DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et électroniques) ou WEEE : 70 à 80% de recyclabilité<br />
- LSD (Limitation des substances dangereuse) ou RoHS : Pb, Mercure, Cadmium, Cr hexavalent,<br />
retardateurs de flammes…<br />
- Directive EuP (Energy Using Product) : pour les équipements consommant de l’énergie.<br />
- Règlement Reach (Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals) : pour les substances<br />
chimiques.<br />
- Directive « Emballages »<br />
- Système ETS (Emission Trading Scheme) sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre<br />
Par ailleurs, cette tendance étant irréversible, la démarche d’écoconception a également pour devoir<br />
d’anticiper les futures normes qui viendront compléter ou renforcer celles-ci.<br />
Autres intérêts<br />
Il est possible de transformer la « contrainte écologique » en opportunité pour l’entreprise.<br />
L’écoconception d’un produit peut en effet être l’occasion d’en réduire le coût global (réduction des flux,<br />
des emballages, de la maintenance, des transports, des frais de recyclage)<br />
En outre, elle représente un bénéfice de plus en plus recherché en terme d’image de marque ; il est à noter<br />
que ce principe peut conduire à un effet purement publicitaire pervers : l’Ecoblanchiment (green washing)<br />
Concrètement, après avoir procédé à une ACV sur un produit ou une gamme de produits, l’entreprise le<br />
valorisera en effectuant une déclaration environnementale de Type III (ISO 14025).<br />
Ces déclarations sont destinées à une communication interentreprises, mais leur utilisation pour la<br />
communication entre une entreprise et des particuliers dans certaines conditions n'est pas exclue.<br />
II-2 INCONVENIENTS<br />
Le premier frein qui vienne à l’esprit est financier. En effet, les impératifs environnementaux ne<br />
manqueront pas d’alourdir un cahier des charges parfois déjà conséquent (même si comme on l’a vu, il arrive<br />
que l’écoconception amène une réduction des coûts).<br />
Par ailleurs, un investissement est nécessaire pour changer la démarche de conception, et ce au plan :<br />
-‐ Financier (achat de logiciel, formation du personnel…)<br />
-‐ Personnel (investissement en temps, implication…)<br />
Enfin, l’entreprise n’a tout simplement pas toujours accès à l’expertise nécessaire pour effectuer cette<br />
conversion.
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
III CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT<br />
III-1 LES ETAPES DU CYCLE DE VIE<br />
Les étapes du cycle de vie d’un produit sont résumées dans le schéma suivant :<br />
Matières premières<br />
(Energie de combustion)<br />
Déchet final<br />
Les flèches rouges illustrent le circuit traditionnel du cycle de vie du produit.<br />
Les flèches vertes illustrent les circuits de valorisation du produit.<br />
A chacune de ces étapes, ainsi qu’au cours des transports, la pollution s’effectue par :<br />
- Des Flux entrants (matière première, énergies nécessaires)<br />
- Des Flux sortants (Rejets, Déchets)<br />
III-2 OBJECTIFS GLOBAUX DE L’ECOCONCEPTION<br />
Sachant cela, on peut mieux ébaucher une définition des objectifs de l’Eco-conception :<br />
- Préserver les ressources naturelles<br />
- Minimaliser de la consommation d’énergie<br />
- Minimaliser des émissions<br />
- Minimaliser des déchets<br />
- Minimaliser des substances dangereuses<br />
Fabrication<br />
Utilisation/Consommation<br />
et Maintenance<br />
} Actions sur les flux entrants<br />
} Actions sur les flux sortants<br />
III-3 LE RISQUE DE TRANSFERT DE POLLUTION (OU TRANSFERT D’IMPACT)<br />
Packaging et Distribution<br />
Le transfert de pollution constitue le principal piège d’une étude qui ne tiendrait pas compte de toutes les<br />
étapes du cycle de vie d’un produit, et à chacune de ces étapes de tous les critères environnementaux (voir<br />
chapitre suivant).<br />
Exemple : pour réduire l’énergie à la production d’une pièce, on remplace le matériau actuel (ferraille) par<br />
un plastique non recyclable. Au final, l’impact environnemental sera plus important.
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
IV LES OUTILS D’ECO-CONCEPTION<br />
IV-1 LES OUTILS EXISTANTS<br />
Bases de données de matériaux :<br />
Ecoinvent, ETH-ESU 96, Buwal, IdeMat,<br />
CES Selector<br />
Outils d’évaluation des impacts :<br />
Eco-indicator 99…<br />
Logiciels réalisant l’ACV :<br />
EIME, SimaPro, TEAM<br />
ACCV : analyse carbone sur le cycle de vie<br />
Tous les outils de l’éco-conception sont des outils préventifs. On peut les classer suivant deux critères :<br />
l’objectivité de l’évaluation environnementale qu’ils permettent d’obtenir (de qualitatif à quantitatif) et les<br />
pistes d’amélioration qu’ils donnent à l’éco-concepteur.<br />
Nous traiterons principalement des outils d’évaluation, car ils sont les plus faciles à mettre en œuvre.<br />
En ce qui concerne l’amélioration, quelques pistes seront fournies au chapitre V-1.<br />
IV-2 OUTILS D’EVALUATION<br />
L’évaluation des impacts environnementaux d’un produit est capitale pour :<br />
- Valider une solution écoconçue<br />
- Evaluer l’impact d’une solution non écoconçue, en vue d’une reconception<br />
Comme on l’a vu au chapitre III-3, l’étude doit être aussi exhaustive que possible pour éviter tout risque de<br />
transfert de pollution ; il faut cependant garder en mémoire que le coût de l’évaluation dépendra de cette<br />
exhaustivité.<br />
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV)<br />
L’Analyse du cycle de Vie est une évaluation des impacts d’un produit, aussi exhaustive que possible.<br />
Généralement réalisée par un organisme spécialisé, son coût avoisine 30000€. Elle tient compte :<br />
-‐ De toutes les étapes du cycle de vie du produit (Multi-étape)<br />
-‐ Du maximum de critères environnementaux à chaque étape (Multi-critères)<br />
-‐ Des composants périphériques au produit lui-même : emballage, consommables… (Multi-produit)<br />
L'analyse du cycle de vie est régie par les normes de la série ISO 14040 à ISO 14044<br />
Au croisement de chaque<br />
critère et de chaque étape, est<br />
menée une étude en quatre<br />
phases :<br />
▪ la définition des objectifs et<br />
du champ de l'étude<br />
▪ l'analyse de l'inventaire<br />
▪ l'évaluation de l'impact<br />
▪ l'interprétation des résultats<br />
obtenus en fonction<br />
des objectifs initiaux.
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
L’ ESQCV<br />
L'évaluation simplifiée et qualitative du cycle de vie ou ESQCV est une méthode basée sur une évaluation<br />
qualitative des impacts, évaluation également réduite à certaines étapes du cycle de vie.<br />
C’est une démarche sélective consistant à rechercher des options de conception permettant de réduire le<br />
poids d'un ou de plusieurs critères environnementaux (ex : émission de Gaz à effet de serre) préalablement<br />
identifiés et vérifier que les pistes d'amélioration retenues ne risquent pas d'aggraver d'autres impacts.<br />
Concrètement, l'entreprise renseigne un questionnaire balayant différents critères préalablement<br />
sélectionnés. Les réponses apportées positionnent le produit à un niveau " bon ", " moyen " ou " faible ". Cette<br />
démarche présente l'avantage d'être facilement appropriable par les PME-PMI<br />
L’Ecobilan et autres outils synthétiques<br />
Ils identifient les flux en vue de réduire les coûts et les impacts environnementaux<br />
Pour faciliter l'évaluation des différentes options de conception ou d'amélioration des produits,<br />
L'intérêt de ces outils réside dans leur commodité d'emploi : pour disposer d'une évaluation, il suffit à<br />
l'utilisateur de répondre à un certain nombre de questions prédéterminées.<br />
Parmi ces outils, on distingue :<br />
▪ les check-lists qui sont toujours spécifiques à une catégorie de produits donnée et prennent en compte les<br />
aspects quantitatifs et qualitatifs (ex : critères destinés à favoriser la réutilisation),<br />
▪ les logiciels (EIME pour les produits électroniques, EDIT pour l'automobile...)
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
V UNE DEMARCHE D’ECO CONCEPTION<br />
V-1 Exemple d’améliorations à apporter à chaque étape de la vie du produit<br />
Matériaux (critères<br />
tenant compte de toutes<br />
les étapes) :<br />
Obtention des matières<br />
premières :<br />
Production :<br />
Packaging et<br />
Distribution :<br />
Utilisation/Consommation<br />
et Maintenance :<br />
Fin de vie :<br />
-‐ Réduction de la masse et du volume des pièces, du nombre de pièces<br />
-‐ Privilégier les matériaux peu ou pas toxiques<br />
-‐ Privilégier les matériaux consommant peu d’énergie<br />
-‐ Privilégier les matières premières recyclables, recyclées, ou provenant de<br />
ressources renouvelables.<br />
-‐ Réduire le nombre d’étapes de production et le transport entre elles.<br />
-‐ Réduction des rejets (éviter les traitements de surface, etc…)<br />
-‐ Réduction de la consommation énergétique lors de la production<br />
-‐ Réduction des déchets (chutes, copeaux), réutiliser les rebuts, carottes…<br />
-‐ Réduction de la masse et du volume des emballages, de leur nombre.<br />
-‐ Privilégier les emballages les plus propres et consommant moins d’énergie<br />
lors de leur production.<br />
-‐ Privilégier les emballages recyclables ou recyclés.<br />
-‐ Réduire la consommation énergétique du produit (fonctionnement/veille)<br />
-‐ Minimiser les rejets (ex : Fréon) et pollutions (encres, peintures, etc…)<br />
-‐ Prolonger la vie du produit<br />
-‐ Favoriser l’assemblage par vis ou clips<br />
-‐ Faciliter la maintenance (fiabilité, modularité, standardisation…)<br />
-‐ Modulariser le produit, principalement les parties à renouveler.<br />
-‐ Choisir soigneusement les plastiques et colles utilisés.<br />
-‐ Privilégier les monomatériaux (sinon, faciliter la séparation des matériaux)<br />
-‐ Faciliter le désassemblage (parties valorisables ou parties toxiques…)<br />
-‐ Rédiger une notice de fin de vie.<br />
Comme on le voit, la principale difficulté est de connaître et maîtriser chacun de ces paramètres (ex : quels<br />
sont les moyens de production les moins polluants, quels matériaux sont recyclables ou non, etc…).<br />
Certaines étapes n’étant pas maîtrisées par le concepteur (conditions d’utilisation, de transport, de<br />
recyclage du produit …), celui-ci en est réduit à émettre des hypothèses à leur propos.<br />
C’est la raison pour laquelle l’écoconception n’est réellement efficace que si elle s’inscrit dans une<br />
démarche de PLM, qui inclut des bases de données et des outils de choix au service du concepteur.
TM- TM MECA a<br />
GIM-S1 ECOCONCEPTION - COURS<br />
V-2 Démarche générale<br />
Les étapes d’une démarche d’écoconception sont les suivantes :<br />
I Identification des enjeux pour l’entreprise → Choix du produit à cibler.<br />
II Évaluation environnementale d’une situation de référence<br />
III Recherche de pistes d’éco-conception (Créativité, implication partenaires et fournisseurs...)<br />
III Aide à la décision (Attentes des clients, Faisabilité et coûts, Environnement)<br />
III Communication/information (clients et utilisateurs, autres acteurs)<br />
Dans le cadre ce cours, on se concentrera sur les étapes II et III, qui se décomposent comme suit :<br />
1/ Trouver une ligne directrice pour améliorer le produit (en utilisant par exemple via la norme NF E 01-<br />
005 ou le logiciel en ligne Ecodesign Pilot)<br />
2/ Analyser les axes d’amélioration en s’inspirant du tableau fourni au chapitre V-1 ou d’une liste fournie<br />
par la méthode choisie.<br />
3/ Evaluer et classer ces axes par ordre de pertinence.<br />
4/ Effectuer une évaluation simplifiée et qualitative des évolutions d’impacts environnementaux suite à la<br />
modification (grâce par exemple au logiciel Bilan Produit 2008)<br />
Application : Etude du mini-compresseur (voir TD)<br />
Ce TD se limite aux étapes 1 à 3. La démarche choisie, inspirée de l’ATEP, s’appuie sur la norme NF E 01-<br />
005 et consiste à produire une évaluation des impacts environnementaux. Cette évaluation sera :<br />
-‐ Qualitative, donc les améliorations apportées ne seront pas chiffrables.<br />
-‐ Interne au produit : il s’agit de comparer entre eux les différents impacts du produit. Cette méthode ne<br />
permet donc pas d’évaluer la qualité environnementale d’un produit dans l’absolu, ni même par rapport<br />
à un autre produit similaire.<br />
Le support est un mini-compresseur domestique, dont la durée de vie est estimée entre 2 et 4 ans pour une<br />
utilisation occasionnelle.