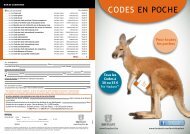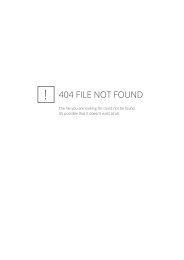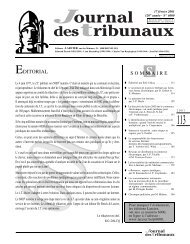Michel Coipel - Editions Larcier
Michel Coipel - Editions Larcier
Michel Coipel - Editions Larcier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LARCIER<br />
PRÉFACE<br />
Pour sa thèse, réalisée sous la direction du professeur André<br />
Prüm, et soutenue le 18 février 2011, Isabelle Corbisier a obtenu le<br />
titre de docteur en droit de l’Université de Luxembourg avec la<br />
meilleure mention (excellent). Ayant eu le privilège de faire partie<br />
du jury 1 , je me réjouis que ce remarquable travail fasse déjà l’objet<br />
d’une publication sous un titre simplifié et interpellant : «La société :<br />
contrat ou institution?» 2 .<br />
Présenter ce livre est un honneur et surtout un bonheur.<br />
Le lecteur doit d’emblée être averti : il ne trouvera pas à la fin de<br />
l’ouvrage une réponse catégorique à la question posée par le titre<br />
mais il ne sera pas étonné car la profondeur et l’originalité des<br />
développements qu’il aura lus l’auront préparé à cette inévitable<br />
issue.<br />
Pour tenter de rendre compte de toute la richesse de l’œuvre foisonnante<br />
d’Isabelle Corbisier je vais recourir à des métaphores<br />
musicales et distinguer : des thèmes, des instruments, de la polytonalité,<br />
des bémols, de la cadence et, enfin, une clef.<br />
Des thèmes<br />
Le thème central, qui donne son titre à l’œuvre, c’est la question<br />
classique de savoir si la société participe du contrat ou de l’institution.<br />
Mais, dès l’ouverture 3 , ce thème est associé à celui de la finalité<br />
d’une société : s’agit-il de maximiser la richesse des actionnaires<br />
(shareholders) ou de prendre aussi en compte d’autres parties prenantes<br />
ou partenaires de l’entreprise comme les travailleurs ou des<br />
tiers affectés en bien ou en mal par l’activité sociale (stakeholders)?<br />
Chacune de ces deux finalités caractérise un modèle de corporate<br />
governance. Le premier, shareholder-oriented, est de type financier<br />
ou patrimonial et qualifié d’outsider : les intérêts autres que ceux<br />
qui servent le patrimoine des associés restent à l’extérieur (outside)<br />
et peuvent éventuellement être pris en charge par l’État mais en<br />
tout cas pas par la société. Le second, stakeholder-oriented, est de<br />
type managérial et qualifié d’insider : les autres intérêts sont pris en<br />
compte en interne (inside) par le management et l’organisation de<br />
la société.<br />
1 Présidé par le professeur Jean-Jacques Daigre et composé, outre André Prüm et moi-même,<br />
des professeurs Isabelle Riassetto et <strong>Michel</strong> Tison.<br />
2 Le titre original de thèse était : «L’autonomie et l’organisation. Essai aux fondements du<br />
droit privé comparé des sociétés».<br />
3 Pp. 14-18.<br />
VII
VIII<br />
LA SOCIÉTÉ : CONTRAT OU INSTITUTION?<br />
Comme dans un opéra de Wagner, ces deux thèmes reviendront<br />
constamment dans tout l’ouvrage et seront développés dans de<br />
nombreuses variations.<br />
Des instruments<br />
Pour jouer ces thèmes, Isabelle Corbisier mobilise quantité d’instruments<br />
qui, pour l’oreille des juristes, vont apporter des sonorités<br />
différentes du ton grave des querelles doctrinales traditionnelles.<br />
L’analyse économique du droit, la sociologie, l’histoire économique<br />
et politique, la philosophie générale et la philosophie du droit occupent<br />
une place importante dans la partition : ce ne sont pas des<br />
visions fugitives mais des études poussées qui élargissent considérablement<br />
la perspective et nourrissent les thèmes.<br />
Par exemple, la conception de la société comme un nœud de<br />
contrats (nexus of contracts) provient d’une analyse économique du<br />
droit des sociétés dite contractarienne que l’auteure ne se contente<br />
pas de résumer pour l’essentiel mais explique en profondeur. Elle<br />
remonte d’abord à ses origines dans l’utilitarisme des 17ème et<br />
18ème siècles 4 puis dans le libéralisme d’économistes comme<br />
Friedrich Hayek et Milton Friedman 5 ; elle met en évidence ses présupposés<br />
que sont la rationalité instrumentale de l’«homo<br />
oeconomicus» 6 et l’hypothèse d’efficience des marchés 7 ; elle<br />
entame ensuite l’exposé des différentes théories qui relèvent de<br />
l’analyse contractarienne, principalement la théorie des droits de<br />
propriété 8 et celle de l’agence 9 , pour en arriver, enfin, à la théorie<br />
du nœud de contrats proprement dite 10 qui exerce, en droit étasunien,<br />
une forte pression en matière de sociétés publiques dotées<br />
d’un actionnariat dispersé 11 .<br />
Autre instrument : l’histoire. La dialectique contrat-institution est<br />
longuement étudiée dans six systèmes juridiques : l’étasunien, le<br />
français, le belge, le luxembourgeois, le néerlandais et l’allemand<br />
mais cette étude s’accompagne d’élucidations historiques qui permettent<br />
de mieux comprendre les différences entre ces systèmes et<br />
4 Pp. 257-258.<br />
5 Pp. 258-268.<br />
6 Pp. 268-270.<br />
7 Pp. 270-273.<br />
8 Pp. 273-278.<br />
9 Pp. 278-283.<br />
10 Pp. 284-286.<br />
11 Pp. 381-382.<br />
LARCIER
LARCIER<br />
PRÉFACE<br />
contribuent à dissiper les illusions de ceux qui rêvent à leur totale<br />
disparition à l’ère de la globalisation. Voici deux exemples parmi<br />
bien d’autres. Un : la vision allemande de la société comme un<br />
«contrat organisationnel» se rattache à une volonté de liberté organisationnelle<br />
en réaction à l’hostilité du nazisme envers pareille<br />
liberté 12 et la Soziale Marktwirtschaft (économie sociale de marché),<br />
modèle de type insider, s’est surtout développée après la seconde<br />
guerre mondiale et a joué un rôle important dans la phase de<br />
reconstruction du pays 13 . Deux : la convergence américano-britannique<br />
vers un modèle outsider de corporate governance s’enracine<br />
dans une histoire commune au 17 ème siècle, époque de la colonisation<br />
britannique sur le territoire américain 14 .<br />
De la polytonalité<br />
Les notions de contrat et d’institution se développent selon différentes<br />
tonalités en raison de leur fondamentale polysémie qui se<br />
manifeste dans de nombreux passages de l’ouvrage et contribue<br />
pour une importante part à sa richesse mais aussi à sa complexité.<br />
Voici quelques exemples.<br />
Les mots «institution» ou «institutionnel» servent à caractériser<br />
les modèles insider de gouvernance mais si on s’occupe de la<br />
nature de la société, l’institution s’oppose au contrat sans que la<br />
question des finalités entre nécessairement en jeu.<br />
La conception institutionnelle qui est de principe en droit néerlandais<br />
se différencie nettement, par sa flexibilité, de la conception<br />
française où l’optique est plus dirigiste 15 . Quant à la conception institutionnelle<br />
belge, elle charrie de nombreuses divergences notamment<br />
quant aux types de sociétés visées par la théorie 16 ou au<br />
mécanisme qui donne naissance à l’institution (contrat ou faisceau<br />
de déclarations unilatérales de volonté) 17 .<br />
Ajoutez à cela que le terme «institution» a des sens variables en<br />
droit, en économie et en sociologie 18 .<br />
12 Pp. 553-555.<br />
13 Pp. 547 et suiv.<br />
14 Pp. 599-600.<br />
15 Pp. 513-516.<br />
16 Pp. 402-420.<br />
17 Pp. 420-422.<br />
18 Numéro 6.2.<br />
IX
X<br />
LA SOCIÉTÉ : CONTRAT OU INSTITUTION?<br />
La vision contractuelle, quant à elle, se différencie souvent de la<br />
théorie contractarienne et sert à désigner les progrès de la liberté<br />
contractuelle 19 ou à expliquer la naissance de la société. De plus,<br />
elle n’implique pas nécessairement l’adhésion à un modèle de gouvernance<br />
outsider.<br />
Mais la manifestation la plus importante de la polytonalité réside<br />
dans la constatation qu’aucun des six systèmes juridiques étudiés<br />
n’apparaît comme totalement institutionnel ou totalement contractuel<br />
ou contractarien. «Chaque système comporte des dosages institutionnel<br />
et contractuel permettant la prise en compte de la complexité<br />
de la relation sociétaire et/ou la construction d’une théorie<br />
de la personnalité morale» 20 .<br />
Des bémols<br />
Isabelle Corbisier possède un sens critique aiguisé qui la conduit<br />
à relever les incohérences ou la face cachée de certaines positions<br />
dont la solidité apparente est ainsi tempérée. On pourrait dire<br />
qu’elle pratique une «impertinence méthodologique» : elle ne s’en<br />
laisse pas conter et ne prend rien pour argent comptant.<br />
Ainsi, malgré son admiration perceptible – et justifiée comme<br />
pourra le constater le lecteur – pour le sociologue David Sciulli, elle<br />
montre que, en dépit des réserves exprimées à de nombreuses<br />
reprises par cet auteur envers l’approche contractarienne, son<br />
«modèle constitutionnaliste sociétal (…) peut être perçu comme<br />
légitimant de manière fonctionnelle une approche shareholderoriented<br />
pour autant que celle-ci s’entoure de garanties procédurales»<br />
21 .<br />
Autre exemple : Maurice Hauriou qui est un des pères de la<br />
notion d’institution en France – et auquel se réfère explicitement<br />
Jean Van Ryn dans la théorie institutionnelle qu’il a exposée en<br />
1954 22 – s’affirme positiviste tout en ajoutant, vu son fervent catholicisme,<br />
que c’est un «positivisme chrétien». Mais Isabelle Corbisier<br />
tient à souligner que l’idée d’œuvre (qui est l’âme de l’institution) et<br />
les manifestations de communion (orientation spiritualiste) qui sont<br />
deux des trois éléments principaux de la définition de l’institution<br />
19 Par exemple : pp. 428-431 et 519-521.<br />
20 P. 595.<br />
21 P. 115.<br />
22 J. VAN RYN, Principes de droit commercial, t. I, 1ére édit., Bruylant, 1954, pp. 206-207.<br />
LARCIER
LARCIER<br />
PRÉFACE<br />
par Hauriou, ajoutés au rôle secondaire que cet auteur confère à la<br />
règle de droit, donnent à sa pensée une «orientation nettement<br />
jusnaturaliste» 23 .<br />
Dans la même veine, Isabelle Corbisier dénonce l’angélisme qui<br />
s’attache à la notion d’intérêt social dans ses versions extrêmes :<br />
soit la plus étroite puisque seuls les intérêts financiers à court terme<br />
des actionnaires sont pris en compte, soit la plus élargie qui<br />
«aboutit à une impasse en raison du caractère non nécessairement<br />
convergent des divers intérêts impliqués» 24 .<br />
De la cadence<br />
Le mouvement pendulaire et l’approche dialectique sont omniprésents<br />
dans l’ouvrage et lui donnent sa cadence. Que ce soit dans<br />
l’exposé des théories, notamment économiques, ou dans l’étude<br />
des systèmes juridiques, le va-et-vient, au fil du temps, entre les<br />
positions institutionnelles et contractuelles, les tentatives de conciliation<br />
des contraires font entrer le lecteur dans la danse et le<br />
convainquent de plus en plus de l’absurdité de l’idée d’une «fin de<br />
l’histoire du droit des sociétés» avancée en 2001 par deux auteurs<br />
américains appartenant pourtant à de prestigieuses law schools<br />
(Yale et Harvard) 25 .<br />
Une clef<br />
Comment expliquer l’éclatante réussite d’Isabelle Corbisier dans<br />
l’étude d’une question que certains trouvent dépassée et peu pratique.<br />
Un débat «académique» dit-on parfois, ce qui est évidemment<br />
péjoratif et, au surplus, particulièrement étonnant lorsque<br />
pareil propos émane de professeurs d’université.<br />
La clef de la réussite c’est l’ouverture d’esprit d’Isabelle Corbisier,<br />
sa curiosité insatiable et sa foi dans la rationalité limitée qui invite au<br />
débat argumenté et non aux affirmations péremptoires.<br />
Sur le plan formel, cette curiosité et cette horreur des sentiers<br />
battus induisent une manière très personnelle d’écrire et d’agencer<br />
les développements. Continuons l’analogie avec la musique : de<br />
même qu’un mélomane averti reconnait, après quelques mesures,<br />
du Mozart ou du Wagner, le spécialiste belge ou luxembourgeois<br />
23 Pp. 157-158.<br />
24 P. 645.<br />
25 Pp. 14-18 et 352-354.<br />
XI
XII<br />
LA SOCIÉTÉ : CONTRAT OU INSTITUTION?<br />
du droit des sociétés peut dire sur base de quelques pages que<br />
l’auteure est Isabelle : «Ah c’est bien elle!». Certains peuvent préférer<br />
une autre façon de rédiger mais la manière d’Isabelle Corbisier<br />
force le respect et l’admiration car elle travaille cartes sur table en<br />
fournissant au lecteur tout le matériau sur lequel elle appuie ses raisonnements,<br />
ce qui atteste sa rigueur et son honnêteté intellectuelles.<br />
Comme je l’ai écrit au début, cette recherche ne pouvait déboucher<br />
sur une conclusion qui aurait désigné le vainqueur de la joute<br />
entre contrat et institution.<br />
Le débat n’est pas clos mais il y a des pistes. Il restait donc à Isabelle<br />
Corbisier une seule façon de conclure : former le vœu que le<br />
droit des sociétés ne ferme pas les portes, ne dérive pas vers un<br />
modèle pur, quel qu’il soit, et, de la sorte, qu’il laisse le débat<br />
ouvert. C’est essentiel dans une société démocratique!<br />
LARCIER