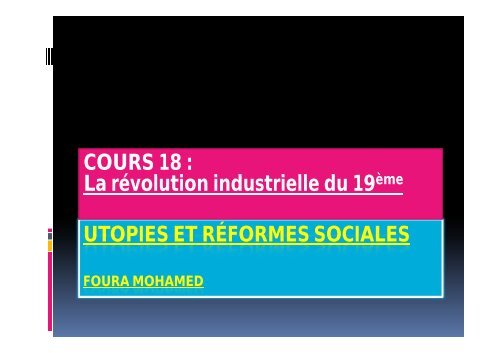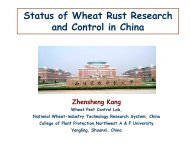La révolution industrielle du 19 ème . Utopies et réformes sociales
La révolution industrielle du 19 ème . Utopies et réformes sociales
La révolution industrielle du 19 ème . Utopies et réformes sociales
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
COURS 18 :<br />
<strong>La</strong> <strong>révolution</strong> <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> <strong>du</strong> <strong>19</strong><strong>ème</strong> <strong>La</strong> <strong>révolution</strong> <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> <strong>du</strong> <strong>19</strong><strong>ème</strong> UTOPIES ET RÉFORMES SOCIALES<br />
FOURA MOHAMED
LES SOURCES DE L’UTOPIE
Origines de l’utopie<br />
Thomas More (1477-1535), humaniste anglais<br />
publia en 1516 la première édition de son Utopie.<br />
Le mot « utopie » est forgé par Thomas More à<br />
partir <strong>du</strong> grec ou-topos, « non lieu », « nulle<br />
part » <strong>et</strong> « eu-topos »,« lien de bohneur ».<br />
Dans « Utopia », qui est présentée sous forme de<br />
dialogue, Thomas More s’inspire de la<br />
« République » de Platon pour en fait<br />
démontrer la situation économique <strong>et</strong> sociale<br />
difficile en Angl<strong>et</strong>erre où il décrit un mode de<br />
vie contraire à la situation qui dominait à<br />
l’époque.<br />
« Utopia » était un pays où régnaient<br />
l’harmonie <strong>et</strong> le bonheur <strong>et</strong> où la<br />
raison gouvernait, un monde libéré <strong>du</strong><br />
fanatisme religieux.<br />
Les cinquante quatre cités de l’île d’utopie<br />
sont planifiées d’une manière rigoureuse,<br />
possède la même organisation spatiale <strong>et</strong><br />
comporte des édifices identiques : Cinquante<br />
quatre cités, « toutes de plan identique <strong>et</strong><br />
d'aspect semblable, pour autant que leur<br />
assi<strong>et</strong>te naturelle le leur perm<strong>et</strong> ». L'auteur<br />
ajoute : « Qui connaît une seule cité les<br />
connaît toutes, tant elles sont semblables<br />
entre elles.<br />
Thomas More (BNF)<br />
Plan de l'ile d'Utopia dessinée par<br />
Thomas More.
Origines de l’utopie<br />
<strong>La</strong> fin <strong>du</strong> 18<strong>ème</strong> siècle verra ainsi<br />
l’avènement de l’architecture<br />
symbolique <strong>et</strong> visionnaire de<br />
Ledoux <strong>et</strong> Boullée.<br />
Inspiré certainement par Thomas<br />
More, Ledoux va dessiner des<br />
villes pavillonnaires dont les<br />
constructions sont alignées <strong>et</strong> qui<br />
ne s’intègre d’aucune façon au<br />
site.<br />
C’est le cas de la cité idéale de<br />
Chaux, ville en forme de cercle, qui<br />
ne verra jamais le jour mais<br />
deviendra « l’archétype<br />
de la ville utopique » .<br />
Olivier Jonas<br />
Vue perspective de la cité idéale de Chaux imaginée par<br />
C.N. Ledoux.<br />
.<br />
C<strong>et</strong>te vision qui ne sera jamais réalisée deviendra l'archétype<br />
de la ville utopique.
Origines de l’utopie<br />
Le proj<strong>et</strong> qui se rapproche de la cité idéale de chaux <strong>et</strong><br />
qui sera réalisé sera <strong>La</strong> Saline Royale d’Arc-<strong>et</strong>-Senans,<br />
formant un demi-cercle, où Ledoux n’observe aucune<br />
hiérarchie <strong>et</strong> dira à ce suj<strong>et</strong> : «Pour la première fois on<br />
verra sur la même échelle la magnificence de la<br />
guingu<strong>et</strong>te <strong>et</strong> <strong>du</strong> palais ».<br />
C’est sans doute le premier site in<strong>du</strong>striel intégré qui a<br />
anticipé les phalanstères, les familistères <strong>et</strong> les cités<br />
ouvrières qui apparaîtront au siècle suivant, celui de la<br />
<strong>révolution</strong> <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>.<br />
Dans la Saline, l’ensemble est pensé de manière à<br />
maximiser la pro<strong>du</strong>ctivité <strong>et</strong> à rationaliser le travail<br />
tout en ré<strong>du</strong>isant le traj<strong>et</strong> vers le lieu de travail.<br />
L’organisation spatiale devient un instrument de<br />
contrôle en perm<strong>et</strong>tant une surveillance continue des<br />
ouvriers.<br />
Ainsi, la « maison <strong>du</strong> directeur » est placée en plein<br />
milieu de la cité, de part <strong>et</strong> d’autres les locaux de<br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> sel <strong>et</strong>, refermant le demi-cercle, les<br />
maisons collectives <strong>et</strong> différents magasins sont<br />
entourés de jardins potagers <strong>et</strong> d’une enceinte.<br />
<strong>La</strong> Saline apparaît évidemment comme un centre<br />
concentrationnaire. Ainsi, Ledoux, s’appuyant sur les<br />
idées progressistes <strong>du</strong> siècle des Lumières, vise à<br />
modeler le comportement social par une nouvelle<br />
organisation <strong>du</strong> travail.
Manufacture royale <strong>du</strong> XVIIIe siècle, la Saline d’Arc <strong>et</strong> Senans fut<br />
conçue par le célèbre architecte visionnaire, Claude-Nicolas Ledoux.<br />
Aujourd’hui classée patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est un<br />
témoignage unique dans l’histoire de l’architecture <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>.
NAISSANCE DE LA CITÉ<br />
OUVRIÈRE
Naissance de la cité ouvrières<br />
Pendant que les cités ouvrières tentent de<br />
résoudre des probl<strong>ème</strong>s circonscrits <strong>et</strong><br />
localisés, les utopistes vont proposer de<br />
nouvelles formes de vie collective, lançant<br />
ainsi un appel à la rénovation d'une société<br />
qui a montré ses limites face au chaos <strong>et</strong> au<br />
délabrement des villes.
Naissance de la cité ouvrières<br />
En fait, on avait besoin d’un nouveau type de<br />
concepteur, un urbaniste était nécessaire,<br />
quelqu'un qui pourrait superviser le<br />
fonctionnement d'une ville dans son<br />
intégralité pour qu'elle soit un lieu de vie sain<br />
<strong>et</strong> décent. Son rôle allait se développer au<br />
cours <strong>du</strong> siècle suivant.
Naissance de la cité ouvrières<br />
L’aménagement urbain était laissé à la charge<br />
des utopistes (philanthropes, critiques <strong>et</strong><br />
romanciers, médecins ayant une conscience<br />
sociale) de réclamer des actions en faveur de<br />
ceux qui étaient condamnés à vivre dans la<br />
misère noire.<br />
Les idées utopiques paraissent importantes<br />
car elles incitent à la réflexion <strong>et</strong> provoquent<br />
l'émergence de solutions originales.
Naissance de la cité ouvrières<br />
L’utopie au <strong>19</strong> <strong>ème</strong> siècle est la réaction d’une<br />
classe par rapport à l’ordre établit. C’est la<br />
vision d’une société idéale dans une cité<br />
idéale.<br />
Au cours su <strong>19</strong> <strong>ème</strong> siècle, les utopistes étaient<br />
représentés par deux courants principaux, les<br />
progressistes <strong>et</strong> les culturalistes, les deux<br />
fondées sur l’idéologie sociétaire <strong>et</strong><br />
hygiéniste.
L’utopie progressiste <strong>et</strong> culturaliste<br />
L’utopie se reflètera dans l’urbanisme culturaliste <strong>et</strong> progressiste selon Françoise<br />
Choay.<br />
L’utopie culturaliste se fonde sur une référence aux villes <strong>du</strong> passé, sur la<br />
diversité <strong>et</strong> sur la dimension esthétique.<br />
L’utopie progressiste a une conception de l’être humain comme type universel,<br />
« un homme-type qui a des besoins-types ».<br />
L’urbanisme, issu de l’utopie progressiste, sera une discipline qui m<strong>et</strong>tra l’accent<br />
sur l’habitat, qui dominera à travers les valeurs de progrès social, technique,<br />
scientifique <strong>et</strong> de l’hygiène, pour élaborer un modèle d’espace standardisé <strong>et</strong><br />
éclaté.<br />
L’urbanisme tendra à pro<strong>du</strong>ire des espaces habités normalisés, dont sont exclus<br />
les dimensions culturelles <strong>et</strong> la diversité des comportements sociaux, con<strong>du</strong>isant<br />
à la négation des permanences <strong>et</strong> des pratiques <strong>sociales</strong>, considérant les<br />
habitants comme une masse indifférenciée, comme T. More l’avait recommandé.<br />
L’urbanisme progressiste contribuera à l’uniformisation <strong>et</strong> l’universalisation des<br />
formes urbaines comme on le verra dans la deuxi<strong>ème</strong> partie.
L’UTOPIE PROGRESSISTE.
L’utopie progressiste.<br />
Nicolas Ledoux est le premier à avoir imaginé<br />
Nicolas Ledoux est le premier à avoir imaginé<br />
une ville ouvrière modèle pour les Salines<br />
d'Arc <strong>et</strong> Senans, à la fin <strong>du</strong> 18éme siècle.
L’utopie progressiste.<br />
L’utopie progressiste est animée par Robert<br />
Owen, Charles Fourier, Jean Pierre Godin,<br />
Eugène Cab<strong>et</strong> <strong>et</strong> d’autres qui fondent leurs<br />
théories sur le progrès scientifique <strong>et</strong><br />
technique. Ils ont une même conception de<br />
l’indivi<strong>du</strong> comme type universel, identique en<br />
tous temps <strong>et</strong> en tous lieux.
L’utopie progressiste.<br />
Dans les années 1820, l’in<strong>du</strong>striel Robert<br />
Owen veut m<strong>et</strong>tre fin aux conséquences<br />
désastreuses de la ville <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong><br />
proposant des proj<strong>et</strong>s de villages modèles,<br />
précurseurs des cités-jardins d’Ebenezer<br />
Howard, où vivront ensemble agriculteurs<br />
<strong>et</strong> manufacturiers.
L’Utopie progressiste: village modèle de R.Owen
Le « Phalanstère de Fourrier<br />
A la même époque, Charles Fourier, en<br />
France, prône des établissements réunissant<br />
les familles dans une sorte d’autogestion.<br />
L’organisation sociale de l’avenir sera réalisé<br />
dans des communautés idéales appelées<br />
« phalanstères » dont le rôle sera de sauver<br />
l’humanité grâce à des coopératives<br />
agricoles <strong>et</strong> manufacturières.
Le « Phalanstère » de Fourrier<br />
Charles Fourier est l’inventeur <strong>du</strong> « Phalanstère », un « Versailles <strong>du</strong> peuple » .<br />
<strong>La</strong> pensée de Charles Fourier se situe entre celle de Saint-Simon <strong>et</strong> de celle <strong>du</strong><br />
socialiste britannique Robert Owen.<br />
<strong>La</strong> grandeur de sa vision radicale est explicitée en détail dans son utopie:<br />
« Nouveau monde in<strong>du</strong>striel », ouvrage publié en 1829. Fourier recommande<br />
une société « non-répréssive » qui devrait dépendre de l’établissement de<br />
communautés idéales qu’il appellera « Phalanxes », ou « Palais social ». Dans<br />
ces communautés idéales, les rapports entre les indivi<strong>du</strong>s devraient être basés<br />
sur le principe psychologique de « l’attraction passionnée » .<br />
« L'idée de s'éloigner de la ville <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> s'accompagne <strong>du</strong> souhait d'isolement<br />
« L'idée de s'éloigner de la ville <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> s'accompagne <strong>du</strong> souhait d'isolement<br />
volontaire de l'expérience : pour préserver la communauté des attaques de<br />
l'environnement, il faut l'isoler dans sa pur<strong>et</strong>é. <strong>La</strong> solution idéale n'est-elle pas<br />
alors de s'installer en zone vierge, pour éviter d'avoir, comme le préconise Fourier,<br />
à construire quatre enceintes autour de la colonie ? C'est que l'innovation, en fait,<br />
touche l'ensemble de la configuration sociale, <strong>et</strong> pas seulement le niveau matériel<br />
<strong>du</strong> travail <strong>et</strong> de son organisation. <strong>La</strong> Phalange n'est autre que la Communauté<br />
idéale constituée selon la libre-attraction mutuelle, <strong>et</strong> selon c<strong>et</strong> idéal<br />
communautaire, qui dépasse certains clivages entre par exemple Fourier <strong>et</strong> Saint-<br />
Simon. Le salut réside dans la fuite hors de la Société <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>, pour préserver<br />
la pur<strong>et</strong>é de la Communauté, en grande partie contre l'Etat moderne en voie de<br />
consolidation ».
Le « Phalanstère de Fourrier<br />
Le Phalanstère: ce majestueux palais social imaginaire, à<br />
mi-chemin entre le Palais-Royal de Paris <strong>et</strong> le château de<br />
Versailles, contrairement à ceux-ci, loge "l'homme", <strong>et</strong> pas<br />
seulement "quelques hommes". En fait, il réunit<br />
idéalement mille six cent vingt sociétaires.
L’architecture <strong>du</strong> Phalanstère<br />
Fourier ne se contente pas de décrire l’implantation géographique <strong>et</strong><br />
la composition sociologique de la Phalange, il la dote d’un bâtiment, à<br />
la fois lieu de vie <strong>et</strong> de travail. De tous les néologismes inventés par<br />
Fourier, celui par lequel il désigne ce lieu est sans doute un des rares<br />
qui a laissé une trace <strong>du</strong>rable dans le langage commun : il s’agit en<br />
eff<strong>et</strong> <strong>du</strong> « Phalanstère », mot créé par Fourier à partir <strong>du</strong> radical<br />
phalan(ge), <strong>et</strong> <strong>du</strong> suffixe emprunté à (mona)stère. L’ensemble des<br />
prescriptions architecturales contenues dans les descriptions<br />
fouriéristes <strong>du</strong> Phalanstère ne vise qu’un seul <strong>et</strong> même but, faciliter<br />
les relations interindivi<strong>du</strong>elles afin de perm<strong>et</strong>tre le déploiement<br />
intégral des eff<strong>et</strong>s de l’attraction passionnée : de c<strong>et</strong>te ambition<br />
témoignent la volonté de rapprocher les différents bâtiments les uns<br />
des autres, la multiplication des « rues-galeries », passages abrités <strong>et</strong><br />
chauffés destinés à faciliter la circulation, ou encore la multiplication<br />
des salles de réunions - ou « séristères » - de toutes tailles. En 1822,<br />
Fourier n’a pas eu la possibilité d’insérer dans son traité les plans <strong>du</strong><br />
Phalanstère qu’il imaginait, plans qu’il jugeait pourtant «<br />
indispensables quand il s’agit de dispositions inusitées en architecture<br />
». Ce n’est donc qu’en 1829, dans Le nouveau monde in<strong>du</strong>striel, que<br />
ces plans furent repro<strong>du</strong>its.
Pland’unPhalanstère<br />
Lenouveaumondein<strong>du</strong>striel,1829,pp.122-123<br />
Chaque phalange est logée dans une maison-cité que Fourier appelle le<br />
"phalanstère". Il décrit très précisément son phalanstère idéal : un château de trois à<br />
cinq étages. Au premier niveau, des rues rafraîchies en été par des j<strong>et</strong>s d’eau,<br />
chauffées en hiver par de grandes cheminées. Au centre se trouve une Tour d’ordre<br />
où sont installés l’observatoire, le carillon, le télégraphe Chappe, le veilleur de nuit.
Vue générale <strong>du</strong> « Phalanstère » de Fourrier
Le « Familistère deGodin<br />
L’application la plus rapprochée <strong>du</strong><br />
phalanstère entreprise par J.B. Godin à Guise<br />
(1871), concrétisée dans le « familistère » où<br />
est expérimentée pour la première fois l’idée<br />
de logement social.<br />
Séparé de l'usine par un cours d'eau, le<br />
familistère (château des ouvriers) comporte<br />
aussi une crèche, une bibliothèque <strong>et</strong> un<br />
théâtre.
Le « Familistère » deGodin<br />
Le Familistère, créé par l’assemblage de ces trois quadrilatères,<br />
comporte une série d’équipements collectifs. Les verrières qui<br />
recouvrent les cours intérieures <strong>et</strong> les coursives d’accès aux logements<br />
abritent la vie quotidienne <strong>et</strong> donnent un cadre pour les fêtes<br />
principales telles que fête de la jeunesse, fête <strong>du</strong> travail <strong>et</strong>c. Le<br />
familistère offre aussi de nombreux équipements extérieurs, un<br />
théâtre, deux écoles, une coopérative, des bains publics, une buanderie<br />
<strong>et</strong>c. Le plus remarquable de tous est sans doute la crèche-jardin<br />
d’enfants où ces derniers sont élevés selon les dernières règles de<br />
l’hygiène <strong>et</strong> disposant de mobilier fait à leurs dimensions.<br />
Dans son livre « Solutions <strong>sociales</strong> », Godin définit ce qu’il appelle « une<br />
approche scientifique » <strong>du</strong> probl<strong>ème</strong> de l’habitat en justifiant son choix<br />
de groupement: « …Chaque logement a des fenêtres, donnant sur le<br />
parc, aussi bien devant que derrière <strong>et</strong> sur les côtés... aucune construction<br />
ne faisant face au familistère, il n’y a pas de curieux pour regarder par des<br />
fenêtres ouvertes ou fermées. Par une belle soirée d’été, chaque habitant<br />
n’a qu’à fermer la porte ouvrant sur le grand hall pour fumer sa pipe ou lire<br />
en paix devant la fenêtre ouverte <strong>et</strong> à l’abri de toute indiscrétion, comme<br />
s’il était le propriétaire d’une villa isolée dans son jardin ».
Le « Familistère » deGodin
Le « Familistère » deGodin<br />
Le Familistère de Guise, qui est toujours conservé, présente un type d’habitat<br />
ayant des caractéristiques très particulières. C’est un ensemble collectif que<br />
Godin appelle « le Palais social », comme Fourier pour la reprise de l’idée <strong>du</strong><br />
château de Versailles pour son phalanstère.<br />
Godin prévoit des bâtiments en forme de quadrilatère, mais tous les deux,<br />
Fourier avec sa « rue galerie » <strong>et</strong> Godin avec ses cours intérieures couvertes avec<br />
des verrières <strong>et</strong> les coursives de dessertes des logements, prévoient des espaces<br />
sociaux qui lui paraissent primordiales.<br />
Chaque familistère s’organise autour d’une cour centrale couverte autour de<br />
laquelle s’articulent les logements desservis par un couloir donnant sur c<strong>et</strong><br />
espace central.<br />
Les « fontaines » ou points d’eau, sanitaires <strong>et</strong> salles d’eau sont disposés aux<br />
angles de chacun des quatre étages, à proximité des circulations.<br />
Godin rationalise tout, le fonctionnement des robin<strong>et</strong>s, aux points d’eau qui<br />
existent à chaque étage, sur lesquels il suffit d’accrocher son sceau pour que<br />
l’eau coule.
Le « familistère de Godin (Coupe <strong>et</strong> Plan)
L’Utopie progressiste: le familistère de<br />
Guise
L’Utopie progressiste: le familistère de<br />
Guise
Façade d’un familistère
Façade d’un familistère
Dans le Familistère deGuise, l’organisation de la vie matérielle <strong>et</strong> sociale<br />
était construite <strong>et</strong> réelle, tout en laissant à l’esprit la plus grande liberté<br />
que la peur <strong>du</strong> lendemain ne venait pas ternir.
Intérieur <strong>du</strong> Familistère en 2005
<strong>La</strong> cité-jardin<br />
Vers fin <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>ème</strong> siècle toute l’Europe était concernée par<br />
la question <strong>du</strong> logement. Par conséquent, le probl<strong>ème</strong> de<br />
la qualité de vie des ouvriers, mais aussi la notion de ville<br />
moderne saine faisaient partie des priorités.<br />
<strong>La</strong> solution la plus radicale de l'époque fut la création de<br />
<strong>La</strong> solution la plus radicale de l'époque fut la création de<br />
nouvelles villes où le logement pour les grand nombre<br />
domine. Certains proposent des cités-jardins, d’autres<br />
des cités <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>s
<strong>La</strong>Cité-jardin<br />
L’idée de la cité-jardin n’aurait pas pu se concrétiser sans le développement <strong>du</strong><br />
chemin de fer à la fin <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>ème</strong> siècle. En eff<strong>et</strong>, le chemin de fer va être l’élément<br />
déterminant des deux modèles de cités-jardins.<br />
Il faut comprendre aussi que ces deux modèles ont une différence fondamentale<br />
qui provient de l’attitude à l’égard <strong>du</strong> transport ferroviaire.<br />
Ebenezer Howard voulait éliminer le traj<strong>et</strong> « domicile/travail/domicile », le chemin<br />
Ebenezer Howard voulait éliminer le traj<strong>et</strong> « domicile/travail/domicile », le chemin<br />
de fer étant réservé aux marchandises plutôt qu’aux indivi<strong>du</strong>s, alors que la cité<br />
linéaire de Soria Y Mata était expressément conçue pour faciliter les<br />
communications.
<strong>La</strong>citéjardindeSoriaYMata<br />
En 1880, l’espagnol Soria Y Mata<br />
propose son modèle de cité-jardin<br />
linéaire. Adoptant une structure axiale<br />
linéaire, Soria y Mata voyait sa ville<br />
dynamique, indépendante, structurée<br />
sur une seule voie de communication<br />
(dans ce cas le chemin de fer ) d’environ<br />
500 mètres de largeur <strong>et</strong> dont la<br />
longueur pouvait atteindre Bruxelles,<br />
Saint-P<strong>et</strong>ersbourg ou Pékin. <strong>La</strong> citéjardin<br />
espagnole serait de type régional,<br />
non limitée <strong>et</strong> même « continentale »,<br />
comme l’appelle Soria y Mata, « une<br />
colonne vertébrale de locomotion »<br />
constituée, en plus des transports, par<br />
les services essentiels de la ville moderne<br />
(eau courante, gaz, électricité)<br />
compatible avec les besoins de la<br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>. <strong>La</strong> cité-jardin<br />
linéaire est l’antithèse de celle à plan<br />
radial. Elle est aussi un moyen de<br />
développement dans un réseau<br />
triangulaire de voies préexistantes,<br />
reliant un ensemble de centres<br />
régionaux traditionnels.
Urbanisme progressiste: Le premier véritable modèle<br />
d'urbanisme progressiste est proposé en 1882 sous le nom<br />
de « Ciudad lineal » (Cité linéaire) par un Espagnol,Arturo<br />
Soria y Mata.
L’Utopie Progressiste:<br />
la cité linéaire de Soria Y Mata
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
Au début <strong>du</strong> 20 <strong>ème</strong> siècle, en France, la remise en ordre de<br />
certaines villes <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>s qui s’étaient développées<br />
pendant le <strong>19</strong>è siècle, donneront à Tony Garnier des<br />
exemples concr<strong>et</strong>s pour la conception de son proj<strong>et</strong><br />
utopique de la « Cité In<strong>du</strong>strielle ».<br />
Une Cité In<strong>du</strong>strielle a pour principes directeurs l'analyse <strong>et</strong><br />
la séparation des fonctions urbaines (habiter, travailler, se<br />
récréer, circuler), l'exaltation des espaces verts qui jouent le<br />
rôle d'éléments isolants, l'utilisation systématique de<br />
matériaux nouveaux, en particulier le béton armé. Dans la<br />
description de la ville imaginée par Tony Garnier, le zonage<br />
occupe une place centrale.
L’UTOPIE PROGRESSISTE:<br />
LA CITÉ INDUSTRIELLE DE TONY<br />
GARNIER
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
Tony Garnier (fin <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>ème</strong> <strong>et</strong> début <strong>du</strong> 20 <strong>ème</strong> s.) publie « Une<br />
cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>; Étude pour la construction des villes », série<br />
d'études, de planches <strong>et</strong> de réflexions, ouvrage publié pour la<br />
première fois en <strong>19</strong>01.<br />
Tony Garnier veut édifier une ville pour ses contemporains,<br />
une ville pour une vie quotidienne moderne, une ville où les<br />
techniques participent pleinement au mieux-être général.<br />
Dans sa Cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>, les diverses activités (travail,<br />
administration, é<strong>du</strong>cation, sports <strong>et</strong> loisirs, <strong>et</strong>c.) sont répartie<br />
sur le territoire - un zonage avant l'usage <strong>du</strong> mot -, les<br />
transports mécaniques facilitent les déplacements, les<br />
matériaux nouveaux (le béton, le verre, <strong>et</strong>c.) perm<strong>et</strong>tent t des<br />
architectures plus variées (les maisons indivi<strong>du</strong>elles ont des<br />
toits terrasses, par exemple). Le Corbusier avare de<br />
complaignent pour ses condisciples, fera l'éloge de Tony<br />
Garnier <strong>et</strong> lui empruntera quelques thématiques.
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
L’organisation urbaine méticuleuse de la cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> était<br />
aussi en avance sur l’époque de Garnier : une zone<br />
résidentielle sans espaces clos m<strong>et</strong>tant en valeur des espacés<br />
verts continus ainsi que des rues piétonnes, des écoles en<br />
plein air , des hôpitaux conçus en blocs séparés , un grand<br />
nombre de terrains de sport , un centre civique qui servira de<br />
modèles aux futurs centres socioculturels , la séparation de la<br />
circulation piétonnière de celle des véhicules, une n<strong>et</strong>te<br />
distinction entre les fonctions de la ville moderne en secteur<br />
d’habitat, de travail, de loisirs, d’é<strong>du</strong>cation <strong>et</strong> de circulation.<br />
Toutes ces idées hygiénistes contribueront aux fondements<br />
de l’urbanisme moderne. Elles seront à la base de la théorie<br />
des C.I.A.M (congrès internationaux de l’architecture<br />
moderne) synthétisée dans la Charte d’Athènes (<strong>19</strong>33).
L’utopie progressiste:<br />
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
« <strong>La</strong> Cité In<strong>du</strong>strielle » est le premier manifeste<br />
de l'urbanisme moderne au 20 <strong>ème</strong> siècle dont les<br />
valeurs sont le progrès social <strong>et</strong> technique,<br />
l'efficacité <strong>et</strong> l’hygiène, reposant sur un modèle<br />
d’espace uniforme, standardisé <strong>et</strong> éclaté.<br />
Les idées de T. Garnier vont jouer un rôle clé dans<br />
les modèles que propose Le Corbusier tels que «<br />
<strong>La</strong> ville radieuse » <strong>et</strong> la « charte d’Athènes » qui<br />
aboutiront à la réalisation sans précédent de<br />
grands ensembles urbains d’habitation<br />
consistant en tours <strong>et</strong> barres.
L’Utopie progressiste: <strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong><br />
de Tony Garnier
L’Utopie progressiste:<br />
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
Disposition Générale<br />
Tony Garnier décrit la cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> en la décomposant en<br />
trois zones principales :<br />
1. <strong>La</strong> ville proprement dite : quartiers d'habitation <strong>et</strong> leurs<br />
différents services.<br />
2. Le complexe in<strong>du</strong>striel.<br />
3. Les établissements sanitaires; équipements hospitaliers <strong>et</strong><br />
para-hospitaliers.<br />
Le principe d'organisation consiste à assurer l'isolement des<br />
zones les unes par rapport aux autres. D'une part chaque<br />
secteur se définit par des besoins fonctionnels <strong>et</strong> hygiénistes<br />
différents. D'autre part c<strong>et</strong>te organisation perm<strong>et</strong><br />
l'extension de chacune sans rem<strong>et</strong>tre en cause la structure<br />
des secteurs limitrophes. En outre, c<strong>et</strong>te décomposition<br />
perm<strong>et</strong> au proj<strong>et</strong> de conserver son aspect théorique.
L’Utopie progressiste:<br />
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> de Tony Garnier
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
Le béton armé utilisé comme matériau de<br />
construction, engendre les formes simples <strong>et</strong><br />
fonctionnelles dont Tony Garnier fût l'un des<br />
précurseur <strong>et</strong> qu'il défendit en tant que<br />
vocabulaire architectural de base afin de<br />
rationaliser la construction, en ré<strong>du</strong>ire les<br />
coûts <strong>et</strong> normaliser les modèles.
Quartier d’habitations de<br />
la cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTony<br />
Garnier<br />
Modèles d'habitations<br />
indivi<strong>du</strong>elles.
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
L'espace non bâti entre les habitations est<br />
important <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> de circuler librement, les<br />
voies sont larges, aérées, plantées,<br />
hiérarchisées en fonction des moyens de<br />
locomotion envisagés.<br />
Les immeubles comportent trois étages<br />
seulement, des toits en terrasse, des baies<br />
vitrées, des passages...
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTony<br />
Garnier<br />
"Habitation en communs" vue<br />
d'ensemble.
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
L’Ecole verte. <strong>La</strong> cité jardin.
<strong>La</strong> cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong> deTonyGarnier<br />
L’Hôpital.<br />
<strong>La</strong> zone <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>
<strong>La</strong> gare de la cité <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>
L’UTOPIE CULTURALISTE:<br />
LA CITÉ JARDIN
L’utopie culturaliste: la cité jardin<br />
L’utopie culturaliste est animée<br />
principalement en Angl<strong>et</strong>erre par<br />
W. Pugin, J. Ruskin, W. Morris <strong>et</strong><br />
Ebenezer Howard.<br />
Le modèle culturaliste est fondé<br />
sur le concept de culture.<br />
L'espace culturaliste doit<br />
répondre à un certain nombre de<br />
critères.<br />
<strong>La</strong> cité modèle est circonscrite à<br />
l'intérieur de limites précises;<br />
elle forme un contraste avec la<br />
nature environnante; ses<br />
dimensions sont modestes,<br />
inspirées par celles des cités<br />
médiévales.<br />
Elle ne présente aucune trace de<br />
géométrisation irrégularité <strong>et</strong><br />
asymétrie sont la marque de son<br />
ordre organique.<br />
Elle fait régner la différence <strong>et</strong><br />
exclut toute standardisation.
L’utopie culturaliste: la cité jardin<br />
L’utopie culturaliste a été<br />
dominé par le<br />
mouvement des citésjardins,<br />
né en Angl<strong>et</strong>erre<br />
à la fin <strong>du</strong> <strong>19</strong><strong>ème</strong> à la fin <strong>du</strong> <strong>19</strong> siècle,<br />
<strong>ème</strong> siècle,<br />
fera largement écho de<br />
ses idées à travers le<br />
monde, surtout au début<br />
<strong>du</strong> 20è siècle.<br />
<strong>La</strong> théorie de Ebenezer<br />
Howard a été publiée<br />
dans un livre en 1898,<br />
dont le titre, tra<strong>du</strong>it<br />
littéralement est<br />
« Demain : une voie<br />
pacifique vers une<br />
réforme sociale » (« Les<br />
cités-jardins de demain »,<br />
tra<strong>du</strong>ction <strong>et</strong> édition<br />
française, <strong>19</strong>69).
<strong>La</strong> cité jardin de Ebenezer Howard<br />
<strong>La</strong> théorie de E. Howard a été publiée dans un livre en<br />
1898, dont le titre, tra<strong>du</strong>it littéralement est « Demain :<br />
une voie pacifique vers une réforme sociale » ( « Les<br />
cités-jardins de demain », édition française, <strong>19</strong>69 ). C<strong>et</strong><br />
ouvrage développe la théorie des cités-jardins <strong>et</strong> des<br />
villes satellites, en s’appuyant sur des diagrammes <strong>et</strong><br />
leurs descriptions (voir ci-contre), dont le nombre<br />
d’habitants serait strictement limité.<br />
Proposant une ville à la campagne, la cité jardin est la<br />
solution à tous les probl<strong>ème</strong>s de l’habitat, l’idée était la<br />
création d’une commune qui serait maîtresse de la<br />
propriété foncière tout en profitant à elle seule de<br />
l’augmentation de la valeur des terrains à bâtir dont les<br />
revenus reviendront exclusivement à la collectivité <strong>et</strong><br />
par conséquent éliminant toute spéculation
« Demain : une voie pacifiquevers une<br />
<strong>réformes</strong>ociale » ( « Les cités-jardins<br />
de demain », édition française, <strong>19</strong>69 ).
<strong>La</strong> cité jardin de Ebenezer Howard<br />
Ainsi, Les probl<strong>ème</strong>s que pose le développement urbain à la fin <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>ème</strong> siècle,<br />
qui sont loin d'être résolus, vont alimenter des discours anti urbains <strong>et</strong><br />
donneront naissance au modèle de la cité-jardin qui opposait à la confusion<br />
des grandes villes <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>s l'ordre vertueux de la campagne.<br />
<strong>La</strong> cité idéale imaginée par Ebenezer Howard est un modèle de<br />
développement urbain qui veut apporter une réponse au probl<strong>ème</strong> de l'habitat<br />
à l'ère <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>. C’est une forme urbaine radicale.<br />
<strong>La</strong> cité-jardin est de taille limitée (la population ne doit pas dépasser trente<br />
mille personnes), elle regroupe toutes les fonctions administratives <strong>et</strong> les<br />
activités tertiaires au centre, lui même entouré de jardins <strong>et</strong> d'avenues<br />
arborées bordées d'habitations <strong>et</strong> de commerces.<br />
Le modèle prôné est celui de «ville à la campagne» alliant les avantages des<br />
deux environnements: l'animation sociale d'une cité qui reste cependant à<br />
dimension humaine <strong>et</strong> la qualité de vie d'un espace calme, non pollué, où la vie<br />
est bon marché <strong>et</strong> qui s'inscrit en harmonie avec les zones rurales.
L’utopie de Ebenezer<br />
Howard:<br />
Les cité jardins de<br />
demain
L’utopie de Ebenezer Howard:<br />
les cités jardins de demain
L’utopie de Ebenezer<br />
Howard:<br />
les cités jardins de demain
L’utopie de Ebenezer Howard<br />
E. Howard conçoit la ville-jardin sur le principe<br />
de la réunion de la ville <strong>et</strong> de la campagne qui<br />
devait réunir 35000 personnes.<br />
L'organisation interne de la ville est marquée<br />
L'organisation interne de la ville est marquée<br />
par la rigoureuse séparation des fonctions:<br />
culture, loisirs <strong>et</strong> administrations au centre,<br />
habitat à quelques distances, in<strong>du</strong>stries en<br />
périphérie, l’agriculture formant une ceinture<br />
verte.
Le diagramme de la cité-jardin de Ebenezer<br />
Howard
Le centre de la cité-jardin de Ebenezer Howard
<strong>La</strong> cité jardin de L<strong>et</strong>chworth<br />
L’application des diagrammes de Howard<br />
sera expérimentée naïvement à la l<strong>et</strong>tre dans<br />
un premier prototype, « L<strong>et</strong>chworth » (<strong>19</strong>03),<br />
suivant un tracé néo-médiéval par l’architecte-<br />
urbaniste Raymond Unwin, très influencé par<br />
les théories néo-médiévales de Camillo Sitte<br />
<strong>et</strong> la philosophie de Ruskin.
Plan général de la cité<br />
jardin de L<strong>et</strong>chworth
Vue par satellite de L<strong>et</strong>chworth
Plan général de la cité jardin de L<strong>et</strong>chworth
Plan <strong>du</strong> centre de<br />
L<strong>et</strong>chworth
Détail de l’organisations spatiale montrant le « close
Organisationspatiale: groupement<strong>et</strong> close
Organisationspatiale: groupement<strong>et</strong> close
Un close de L<strong>et</strong>chworth
Espace vert <strong>et</strong> habitations
Rue de la cité jardin de L<strong>et</strong>chworth
Rue de la cité jardin de L<strong>et</strong>chworth
Rue de la cité jardin de L<strong>et</strong>chworth
Le centre de la cité jardin de L<strong>et</strong>chworth
Habitations de la cité jardin de L<strong>et</strong>chworth
CAMILLO SITTE: L’ART DE BÂTIR<br />
LES VILLES
Influences sur la conceptionde cités-jardins<br />
Pour l’élaboration des deux proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> leur réalisation, E.<br />
Howard fait appel à deux architectes, Raymond Unwin, Barry<br />
Parker.<br />
L’application des diagrammes de Howard sera expérimentée<br />
naïvement à la l<strong>et</strong>tre dans un premier prototype,<br />
« L<strong>et</strong>chworth » (<strong>19</strong>03), suivant un tracé néo-médiéval par<br />
l’architecte-urbaniste Raymond Unwin très influencé par les<br />
théories néo-médiévales de Camillo Sitte <strong>et</strong> la philosophie de<br />
Ruskin.<br />
Unwin reprendra beaucoup de préceptes de Sitte pour<br />
l’élaboration de son livre <strong>et</strong> que l’on peut considérer comme une<br />
anticipation de « l’ Urban design « .<br />
Le grand intérêt de Unwin <strong>et</strong> de son premier collaborateur,<br />
Barry Parker , pour les villes irrégulières <strong>du</strong> moyen âge venait<br />
de l’étude comparative de certaines villes médiévales<br />
allemandes . Ces modèles seront à la base <strong>du</strong> tracé pittoresque<br />
de Hampstead Garden Suburb , commencé près de Londres en<br />
<strong>19</strong>07 .
RaymondUnwin: «Town planning in practice »<br />
Raymond Unwin reprendra beaucoup de<br />
préceptes de Camillo Sitte pour<br />
l’élaboration de son livre « Town planning in<br />
practice « (version française: « L'Etude<br />
pratique des Plans de Villes »), publié en <strong>19</strong>09<br />
<strong>et</strong> que l’on peut considérer comme une<br />
anticipation de « l’Urban design ».
Camillo Sitte :L’art de bâtir les villes<br />
C’est un livre qui critique les<br />
transformations de la capitale<br />
autrichienne, Vienne, par François<br />
Joseph.<br />
C'est aussi un livre de théorie faisant<br />
écho aux recherches qui, dans la<br />
Vienne des années 1880-1890,<br />
donnaient naissance à la<br />
psychanalyse, à la psychologie de la<br />
forme - EHRENFELS -, à l'ébauche<br />
d'une science de l'art - de FIDLER à<br />
RIEGL -.<br />
Le succès de ce livre <strong>et</strong> l'application de<br />
ses principes furent immédiats dans<br />
les pays germaniques.<br />
En Grande-Br<strong>et</strong>agne ce p<strong>et</strong>it ouvrage<br />
a marqué la conception <strong>et</strong> la<br />
réalisation des cité-jardin <strong>et</strong> des villes<br />
nouvelles.
Camillo Sitte: L’art de bâtir les villes<br />
Camillo Sitte est l’auteur <strong>du</strong> livre «L'art de bâtir<br />
les villes - l'urbanisme selon ses fondements<br />
artistiques – (Stadtebau nach seinen<br />
Künstlerischen Grundsiitzen) » (1889).<br />
Ce livre traite que de la seule dimension<br />
esthétique de la ville, qui veut remplacer la<br />
pauvr<strong>et</strong>é formelle des espaces urbains <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>ème</strong><br />
siècle, symétriques, standardisés, réguliers<br />
illustrés dans la modernisation de Paris <strong>et</strong> de<br />
Vienne, oppose la richesse des espaces urbains<br />
antiques, médiévaux, classiques <strong>et</strong> baroques.
RaymondUnwin: «Town planning in practice »
Raymond Unwin: « Town planning in practice »<br />
version française: « Plan des villes »<br />
Raymond Unwin construisit avec Barry Parker la citéjardin<br />
de L<strong>et</strong>chworth <strong>et</strong> fut l'un des premiers<br />
professeurs d'urbanisme en Grande-Br<strong>et</strong>agne.<br />
Son livre "Town planning in Practice" fut publié en<br />
français en <strong>19</strong>22 sous le titre "Plan des Villes".<br />
Unwin ne repousse pas l'architecture <strong>du</strong> passé,<br />
considérant que l'on peut en tirer parti sans la copier.<br />
Il préconise les écrans de ver<strong>du</strong>re, l'aménagement de<br />
parcs, de terrains de jeux <strong>et</strong> même de champs cultivés<br />
dans les grandes villes.<br />
Contrairement aux urbanistes progressistes, il<br />
considérait en eff<strong>et</strong> que l'entassement n'était pas<br />
rentable.
Town planning in practice
Illustration tirée <strong>du</strong> livre town planning in practice
Illustration tirée <strong>du</strong> livre town planning in practice
Illustration tirée <strong>du</strong> livre « town<br />
planning in practice ».
Illustration tirée <strong>du</strong> livre « town planning in practice ».
Illustration tirée <strong>du</strong> livre town planning in practice
Illustration tirée <strong>du</strong> livre town planning in practice
Les cité-jardin sur le terrain<br />
Le grand intérêt R. Unwin <strong>et</strong> de son premier<br />
collaborateur, Barry Parker, pour les villes<br />
irrégulières <strong>du</strong> moyen âge venait de l’étude<br />
comparative de certaines villes médiévales<br />
allemandes.<br />
Ces modèles seront à la base <strong>du</strong> tracé<br />
pittoresque de Hampstead Garden Suburb,<br />
commencé près de Londres en <strong>19</strong>07 <strong>et</strong><br />
Welwyn commencé en <strong>19</strong><strong>19</strong> <strong>et</strong> jamais<br />
terminée.
Plan général de HampsteadGardenSuburb
Plan général de la cité jardin par satellite
Plan <strong>du</strong> centre de Hampstead garden city
Hampstead Garden Suburb; peinture de William Ratcliffe,<br />
<strong>19</strong>14
Hampstead garden suburb: Groupement de<br />
maisons en « close »
Habitations de Hampstead garden city
Welwyn Garden City<br />
Après la 1 ère guerre mondiale, Raymond Unwin avec la collaboration<br />
d’un architecte de formation classique (beaux-arts de Paris), le<br />
français Louis de Soissons, vont faire le plan de Welwin Garden City,<br />
commencée en <strong>19</strong><strong>19</strong> mais jamais terminée en vérité (voir ci-contre).<br />
<strong>La</strong> stratégie urbaine des deux architectes se fait en deux étapes. <strong>La</strong><br />
première est d’utiliser le terrain comme un support de la nouvelle<br />
croissance, respectant les anciens chemins, certains arbres<br />
centenaires, la topographie générale, afin de déterminer<br />
l’emplacement des quartiers résidentiels <strong>et</strong> la zone <strong>in<strong>du</strong>strielle</strong>.
Welwyn Garden City<br />
Dans la deuxi<strong>ème</strong> étape, ils superposent deux<br />
conceptions de la ville tout à fait différentes comme<br />
structure générale : celle de la ville classique, une<br />
influence de Louis de Soissons, avec sa symétrie <strong>et</strong> sa<br />
rigueur pour le centre civique <strong>et</strong> administratif, <strong>et</strong> celle<br />
de la ville médiévale avec ses variétés irrégulières pour<br />
les quartiers résidentiels voir ci-contre.<br />
Dans c<strong>et</strong>te conception, les deux architectes voulaient<br />
arriver à une forme urbaine m<strong>et</strong>tant en valeur le<br />
traitement pittoresque <strong>et</strong> la notion <strong>du</strong> « Close », un<br />
espace privé formé par le groupement de maisons<br />
autour d’un cul-de-sac (sorte d’impasse).
<strong>La</strong> cité jardin de<br />
Welwyn<br />
Plan de Raymond<br />
Unwin
Plan de Raymond<br />
Unwin de la cité<br />
jardin deWelwyn
Habitation type de la cité jardin deWelwyn
Organisation spatiale de la cité jardin deWelwyn
Organisation spatiale de la cité jardin deWelwyn
Le « close »<br />
Le close est un ensemble de logements ou<br />
pavillons groupés autour d'un espace<br />
centrale, privé ou semi-privé.<br />
On y accède par un porche ou portique le plus<br />
souvent inclus dans un front bâti sur rue ou<br />
par une voie de desserte se terminant en<br />
impasse sur l’espace centrale.<br />
Ce type d'habitat a été développé <strong>et</strong> employé<br />
par R. Unwin dans sa conception des cités<br />
jardins.
Le « Close »
Le « close »
Le « close »
Le « close »
Welwyn garden city
Vue satellitaireWelwyn garden city
Vue satellitaireWelwyn garden city
Conclusion<br />
<strong>La</strong> cité-jardin est la source de l'urbanisme<br />
culturaliste au 20 <strong>ème</strong> siècle, dont les valeurs<br />
sont, la richesse des relations humaines <strong>et</strong><br />
la permanence des traditions culturelles<br />
proposant un modèle spatial circonscrit,<br />
clos <strong>et</strong> différencié.
Conclusion<br />
Bien que son importance diminuera avec<br />
l’application des théories urbaines progressistes <strong>du</strong><br />
mouvement moderne, la théorie d’Ebenezer Howard<br />
persistera dans la planification urbaine de beaucoup<br />
de pays, particulièrement dans l’établissement de<br />
« villes nouvelles » jusqu’aux années <strong>19</strong>70.<br />
En eff<strong>et</strong>, ce mouvement créera une nouvelle école<br />
en urbanisme dont les théories s’opposent au<br />
machinisme, préconisant le « désurbanisme » des<br />
grandes agglomérations <strong>et</strong> le respect de leur<br />
contexte urbain existant.