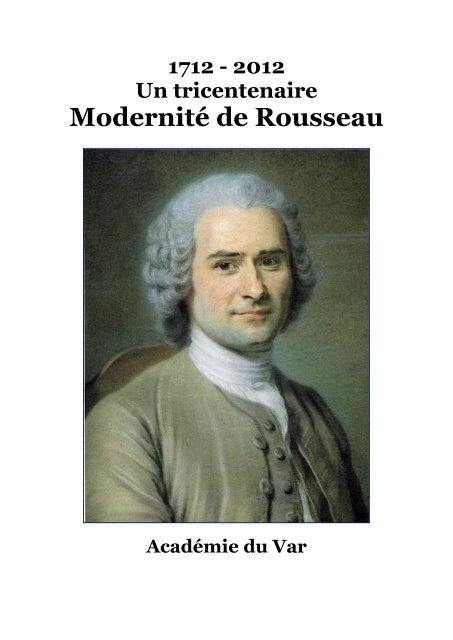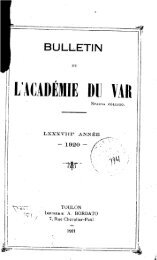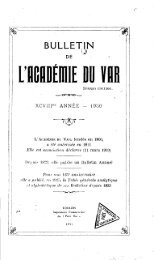(Textes des communications (Clic) - Académie du Var
(Textes des communications (Clic) - Académie du Var
(Textes des communications (Clic) - Académie du Var
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1712 - 2012<br />
Un tricentenaire<br />
Modernité de Rousseau<br />
<strong>Académie</strong> <strong>du</strong> <strong>Var</strong>
Portrait de Jean-Jacques Rousseau, 1764<br />
Maurice Quentin de La Tour (1704-1788)<br />
Pastel. Montmorency, Musée Jean-Jacques Rousseau
1712 - 2012<br />
Un tricentenaire<br />
Modernité de Rousseau<br />
Actes <strong>du</strong> colloque<br />
Toulon, salle Mozart<br />
le vendredi 23 novembre 2012<br />
publiés sous la direction<br />
d’Yves Stalloni et André Bérutti<br />
Dominique Amann<br />
André Bérutti<br />
Roland Billault<br />
Monique Bourguet-Vic<br />
Monique Broussais<br />
Intervenants :<br />
Yves Stalloni<br />
<strong>Académie</strong> <strong>du</strong> <strong>Var</strong><br />
Novembre 2012<br />
1<br />
Monique Dautemer<br />
Philippe Granarolo<br />
É. Marot de Lassauzaie<br />
Pierre Navarranne<br />
Anne Sohier-Meyrueis
Les opinions émises dans cette publication n’engagent que la responsabilité <strong>des</strong> auteurs.<br />
Droits de tra<strong>du</strong>ction et d’adaptation réservés pour tous pays.<br />
La loi n° 57-298 <strong>du</strong> 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, article 41, alinéas 2 et 3,<br />
n’autorise « que les copies ou repro<strong>du</strong>ctions strictement réservées à l’usage privé <strong>du</strong> copiste et non<br />
<strong>des</strong>tinées à une utilisation collective » ainsi que « les analyses et courtes citations ». L’article 40 alinéa<br />
1 er de la même loi prévoit que « toute représentation ou repro<strong>du</strong>ction intégrale ou partielle faite sans le<br />
consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. »<br />
© <strong>Académie</strong> <strong>du</strong> <strong>Var</strong>, 2012<br />
ISBN 978-2-9527274-5-7<br />
2
SOMMAIRE<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
Jacques Keriguy p. 5<br />
Le temps de Rousseau, le monde de Jean-Jacques (1712-1778)<br />
Gilbert BUTI p. 7<br />
Malade de quoi, Jean-Jacques ?<br />
Pierre NAVARRANNE p. 15<br />
Les chemins de Jean-Jacques, <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> randonnées aux promena<strong>des</strong> solitaires<br />
André BÉRUTTI p. 19<br />
L’Émile : une pédagogie novatrice<br />
Monique BROUSSAIS p. 23<br />
Le Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau<br />
Dominique AMANN p. 29<br />
Rousseau musicien de la nature et <strong>du</strong> naturel<br />
Monique DAUTEMER p. 37<br />
Portraits de femmes dans Les Confessions<br />
Jocelyne-Eléonore MAROT DE LASSAUZAIE p. 43<br />
Rousseau et la botanique<br />
Anne SOHIER-MEYRUEIS p. 47<br />
De marbre ou de bronze : les malheurs de Jean-Jacques … en sculpture<br />
Monique BOURGUET-VIC p. 51<br />
Relire La Nouvelle Héloïse ?<br />
Yves STALLONI p. 55<br />
Rousseau inventeur de la République<br />
Philippe GRANAROLO p. 61<br />
Conclusion<br />
Roland BILLAULT p. 67<br />
Jean-Jacques Rousseau. Chronologie p. 69<br />
Quelques titres pour découvrir Rousseau p. 71<br />
3
On a fêté le 28 juin de cette année le trois<br />
centième anniversaire de la naissance de<br />
Jean-Jacques Rousseau. Comment<br />
l’académie <strong>du</strong> <strong>Var</strong> pouvait-elle s’associer<br />
aux multiples manifestations <strong>des</strong>tinées à<br />
célébrer l’événement ? Devait-elle le faire,<br />
d’ailleurs ? Le nombre <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>,<br />
anciennes et récentes,<br />
consacrées à l’illustre<br />
écrivain avait de quoi<br />
décourager les<br />
meilleures volontés tant<br />
il est difficile d’apporter<br />
<strong>des</strong> éléments nouveaux<br />
dans un paysage critique<br />
aussi savamment<br />
encombré.<br />
Et pourtant, plusieurs<br />
membres de notre<br />
académie ont relevé le<br />
défi. Il leur a semblé que,<br />
par ignorance ou<br />
perfidie, les exégètes de<br />
Rousseau ont souvent<br />
maltraité sa pensée<br />
souvent incertaine, il est<br />
vrai, parfois même<br />
obscure. Comment en<br />
serait-il autrement ?<br />
Rousseau s’est maintes fois contredit luimême<br />
; il s’est trompé, aussi, avec<br />
obstination, mais ses vagabondages, qui,<br />
parfois, relèvent de la mauvaise foi, ne<br />
doivent faire oublier ni la profonde<br />
sincérité de l’homme ni la pureté de ses<br />
intentions, encore moins la force de ses<br />
convictions laborieusement acquises au fil<br />
<strong>des</strong> années.<br />
À travers <strong>des</strong> expériences douloureuses, sa<br />
volonté a toujours été de perfectionner son<br />
être moral ; il a cultivé l’obsession de<br />
construire une pensée cohérente, d’établir<br />
un socle à partir <strong>du</strong>quel il se proposait<br />
INTRODUCTION<br />
Jacques KERIGUY<br />
Président de l’académie <strong>du</strong> <strong>Var</strong><br />
5<br />
d’harmoniser son action d’écrivain autant<br />
que sa con<strong>du</strong>ite d’homme et de citoyen.<br />
Une telle démarche ne pouvait que susciter<br />
la passion de ses lecteurs : de fait, la<br />
réprobation indignée le dispute à la béate<br />
admiration. Cette passion ne s’est jamais<br />
éteinte. Elle rend malaisés les<br />
commentaires de son<br />
œuvre et l’interprétation<br />
de sa vie.<br />
Les intervenants qui<br />
vont se succéder tout au<br />
long de la journée se<br />
proposent, hors de toute<br />
prévention et de toute<br />
partialité, de revenir à la<br />
source, c’est-à-dire au<br />
texte, et d’interroger la<br />
vie de Rousseau afin de<br />
mettre en lumière la<br />
vraie nature <strong>du</strong><br />
théoricien de la société<br />
et les différentes facettes<br />
de l’homme de lettres, si<br />
aisément reconnaissable<br />
au mouvement de ses<br />
phrases et à l’élégance<br />
de son style.<br />
En un mot, si, par nécessité, ils font le<br />
point sur les approches de la critique<br />
contemporaine, ils procèdent à une lecture<br />
singulière.<br />
Agissant ainsi, ils s’attribuent, pour<br />
employer une expression très<br />
contemporaine, un droit d’inventaire sur<br />
une œuvre complexe, multiforme, qui,<br />
certes, provient d’un autre temps, mais a<br />
laissé une <strong>des</strong>cendance aujourd’hui encore<br />
vivace. Car, ne nous y trompons pas, que<br />
nous l’aimions ou le détestions, le miel de<br />
sa pensée irrigue nos esprits.
LE TEMPS DE ROUSSEAU, LE MONDE DE JEAN-JACQUES<br />
(1712-1778)<br />
1712-1778. La vie de Jean-Jacques Rousseau se situe<br />
au cœur <strong>du</strong> XVIII e siècle, au cœur <strong>du</strong> fameux Siècle<br />
<strong>des</strong> Lumières, de ces Lumières auxquelles le nom de<br />
Rousseau est si étroitement associé. Il serait<br />
pourtant ré<strong>du</strong>cteur de limiter le XVIII e siècle<br />
français, et plus largement européen, à ce<br />
mouvement, si riche eût-il été. Fils <strong>des</strong> Lumières, ce<br />
siècle est porteur de changements, de mutations qui<br />
affectent la société et l’économie, le cadre de vie et la<br />
culture matérielle, les courants de<br />
pensée et les relations<br />
internationales et annoncent <strong>des</strong><br />
temps nouveaux – même s’il est<br />
toujours plus facile de l’affirmer<br />
quand on connaît la suite !<br />
1712-1778. Rousseau naît et meurt<br />
dans une Europe en guerre.<br />
Pourtant, à y regarder de plus près,<br />
les conflits qui posent les bornes de<br />
cette existence illustrent les<br />
mutations qui sont en marche au fil<br />
de ces décennies.<br />
En 1712, c’est la guerre de<br />
Succession d’Espagne (1701-<br />
1713/14). Elle a pour cadre<br />
essentiellement l’Europe avec ses<br />
prolongements méditerranéens ;<br />
l’absolutisme, la crainte d’une<br />
domination européenne par une nation - en<br />
l’occurrence la France -, les jeux dynastiques sont au<br />
cœur de ce conflit emblématique de l’Ancien<br />
Régime.<br />
En 1778, c’est la guerre d’Amérique (1776-1781/83).<br />
Elle affecte certes l’Europe mais se déroule sur <strong>des</strong><br />
théâtres plus lointains. On la dit mondiale car on<br />
croise le fer en Amérique et dans l’océan Indien. Par<br />
ailleurs, il s’agit d’une guerre d’un nouveau type. La<br />
nouveauté ne réside ni dans la tactique, ni dans la<br />
stratégie mais dans l’objectif proclamé : il s’agit<br />
d’une guerre d’Indépendance, d’une guerre de<br />
« libération nationale » qui vise à se débarrasser de<br />
la tutelle d’une lointaine et oppressante métropole<br />
coloniale. Les Insurgés désirent bâtir un autre<br />
monde, construire ce Nouveau monde appelé de<br />
leurs vœux par les premiers pionniers, les Pères<br />
pèlerins <strong>du</strong> XVII e siècle. Pour ce faire, les<br />
représentants <strong>des</strong> Treize colonies d’Amérique<br />
veulent mettre en application les principes énoncés<br />
par les hommes <strong>des</strong> Lumières, les principes de John<br />
Locke, cette Déclaration <strong>des</strong> droits de la fin <strong>du</strong><br />
XVII e siècle reçue en héritage, et ceux proposés par<br />
Montesquieu qui prône la séparation <strong>des</strong> pouvoirs<br />
pour mettre à bas l’Ancien Régime absolutiste, sans<br />
Gilbert BUTI<br />
7<br />
remettre en cause la monarchie (De l’esprit <strong>des</strong> lois).<br />
Cependant, il ne s’agit pas d’appliquer un<br />
quelconque Contrat social : les Insurgés américains,<br />
à commencer par leurs porte-parole - Jefferson,<br />
Madison, Washington ou Franklin - n’ont pas lu<br />
Rousseau. Qui plus est, il n’y a pas de place dans cet<br />
ouvrage pour la « représentation politique ».<br />
Un nouvel ordre politique et social est en marche en<br />
Europe et, dans ce prolongement de<br />
l’Europe, outre-mer que l’on dira<br />
bientôt États-Unis d’Amérique.<br />
D’aucuns le rêvent, certains le<br />
combattent, d’autres l’ignorent ou<br />
s’y résignent. La vie de Jean-Jacques<br />
Rousseau s’inscrit assurément dans<br />
ce basculement, dans ces décennies<br />
de transition sinon de mutation.<br />
Est-ce « la faute à Voltaire, ou est-ce<br />
« la faute à Rousseau » ? La réponse<br />
à la question <strong>des</strong> liens entre la<br />
Révolution et les Lumières dépasse<br />
notre ambition qui se limite à<br />
définir le temps de Rousseau. Riche<br />
et complexe, le « siècle de Jean-<br />
Jacques », que l’on qualifie de<br />
« Beau », voire de « Glorieux »,<br />
présente <strong>des</strong> hésitations et <strong>des</strong><br />
lézar<strong>des</strong> qui sont autant de fauxsemblants<br />
qu’il convient de pointer<br />
pour tenter de replacer Rousseau en son temps.<br />
Toutefois, est-il bien raisonnable de vouloir<br />
présenter en une poignée de minutes l’épaisseur de<br />
ce siècle, même en nous limitant à l’Europe à<br />
laquelle est étroitement associée la référence aux<br />
Lumières ? Assurément, il a fallu faire <strong>des</strong> choix,<br />
effectuer <strong>des</strong> coupes et passer inévitablement sous<br />
silence nombre de facettes, sombres ou<br />
éblouissantes.<br />
Le Siècle <strong>des</strong> Lumières<br />
C’est avant tout celui d’une extraordinaire aventure<br />
scientifique et intellectuelle, celui d’une diffusion de<br />
connaissances <strong>des</strong>tinées à éclairer le monde, à<br />
commencer par les élites qui le dirigent.<br />
Le siècle <strong>des</strong> Lumières est d’abord celui d’un<br />
engouement pour les sciences. Depuis le milieu <strong>du</strong><br />
XVII e siècle, les travaux se sont multipliés qui<br />
encouragent à penser que l’esprit humain peut<br />
vaincre l’ignorance et fonder le progrès. Aux côtés<br />
de l’Anglais Newton, <strong>du</strong> Néerlandais Huyghens, de<br />
l’Allemand Leibnitz, <strong>des</strong> Suédois Linné et Celsius,<br />
<strong>du</strong> Suisse Euler les Français ne sont pas en reste<br />
depuis Descartes et Pascal : ainsi, Lagrange et
Monge contribuent aux progrès <strong>des</strong> mathématiques,<br />
Buffon est l’auteur d’une monumentale Histoire<br />
naturelle (un <strong>des</strong> plus gros succès de librairie <strong>du</strong><br />
temps), Jussieu crée le Jardin <strong>du</strong> roi, futur Jardin<br />
<strong>des</strong> Plantes et Lavoisier fonde la chimie moderne.<br />
Ces savants sont <strong>des</strong> personnages souvent<br />
recherchés par les chefs d’État qui les comblent<br />
d’honneurs et favorisent leurs travaux en les<br />
subventionnant. Songeons au soutien un temps<br />
accordé par Frédéric II aux savants reçus à sa table.<br />
Que l’on soit grand seigneur, banquier ou magistrat,<br />
il est de bon ton de posséder un « cabinet de<br />
physique » où l’on effectue de petites expériences et<br />
collectionne <strong>des</strong> plantes, <strong>des</strong> pierres ou <strong>des</strong><br />
instruments. Des académies scientifiques se fondent<br />
un peu partout en Europe, sur le modèle de<br />
l’<strong>Académie</strong> <strong>des</strong> sciences de Paris ou de la Société<br />
royale de Londres ; elles distribuent <strong>des</strong> prix et <strong>des</strong><br />
pensions et financent parfois <strong>des</strong> missions<br />
scientifiques, comme celles à <strong>des</strong>tination de la<br />
Laponie avec Maupertuis (1735) et <strong>du</strong> Pérou avec La<br />
Condamine.<br />
C’est aussi en grande partie l’esprit de recherche<br />
scientifique qui est à l’origine de la seconde vague de<br />
grands voyages de découvertes, en direction de<br />
l’océan Indien et plus encore <strong>du</strong> Pacifique et de<br />
l’Océanie. Faute de trouver le « continent austral »,<br />
Cook, Bougainville ou La Pérouse explorent <strong>des</strong><br />
mers inconnues, cherchent <strong>des</strong> paradis terrestres<br />
peuplés de bons sauvages non corrompus par la<br />
civilisation.<br />
Ces voyages sont associés à <strong>des</strong> avancées techniques,<br />
à l’éveil de la mentalité scientifique : songeons<br />
simplement à la détermination de la longitude en<br />
mer associée à la mise au point, par l’Anglais<br />
Harrisson, puis le Français Le Roy, de chronomètres<br />
et par l’invention de l’horloge marine <strong>du</strong> Suisse<br />
Ferdinand Berthoud. Des navires plus rapi<strong>des</strong>, plus<br />
légers, aux coques doublées de cuivre pour les mers<br />
chau<strong>des</strong>, peuvent suivre <strong>des</strong> routes maritimes plus<br />
régulières en ré<strong>du</strong>isant les temps de parcours. Ces<br />
connaissances résultent d’observations empiriques,<br />
de travaux sur le tas et de calculs scientifiques.<br />
De Portsmouth à Carthagène, de Rochefort à Venise,<br />
les arsenaux sont de véritables laboratoires de<br />
recherche que visitent techniciens et savants,<br />
comme le fait Duhamel <strong>du</strong> Monceau à Toulon. Les<br />
bois, les métaux, les textiles (cordages, voiles)<br />
retiennent l’attention de ces nouveaux<br />
« ingénieurs » qui s’interrogent également sur les<br />
maladies <strong>des</strong> gens de mer (Antoine Poissonnier-<br />
Desperrières).<br />
Les expéditions maritimes sont également l’occasion<br />
d’avancées médicales ; ainsi en est-il <strong>des</strong><br />
observations de James Lind pour lutter contre la<br />
« peste de mer » ou scorbut, ou encore celles<br />
d’Amédée Lefèvre pour essayer de comprendre<br />
l’origine <strong>des</strong> coliques sèches qui affectent les marins<br />
lors <strong>des</strong> voyages au long cours, premiers pas dans<br />
l’explication <strong>du</strong> saturnisme. Les collections de<br />
coquillages garnissent les vitrines et les tiroirs de<br />
cabinets de curiosité, qui préfigurent les musées, et<br />
le Marseillais Peysonnel démontre l’origine animale<br />
<strong>du</strong> corail.<br />
8<br />
Les airs retiennent également l’attention de savants.<br />
L’astronomie d’observation poursuit et amplifie les<br />
travaux de Galilée <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XVII e siècle ; les<br />
grands astronomes comme l’Anglais Halley<br />
s’attachent à confirmer le système newtonien ; les<br />
Français Bouguer, Maupertuis et Clairaut<br />
démontrent l’aplatissement de la terre aux pôles ; en<br />
fin de siècle, Laplace regroupe toutes les<br />
connaissances acquises dans son Explication <strong>du</strong><br />
système <strong>du</strong> monde (1796).<br />
Les connaissances nouvelles sur les propriétés <strong>des</strong><br />
gaz permettent aux hommes de réaliser les<br />
premières ascensions dans les airs en ballon. Les<br />
années 1780 connaissent la vogue <strong>des</strong> aérostats et<br />
montgolfières ; en 1783, Pilâtre de Rozier et le<br />
marquis d’Arlande réalisent la première ascension<br />
aérienne sur l’engin mis au point par <strong>des</strong> papetiers,<br />
les frères Montgolfier ; la même année le physicien<br />
Charles monte à 4000 mètres avec un ballon gonflé<br />
à l’hydrogène et deux ans plus tard Blanchard<br />
traverse la Manche sur un « vaisseau volant ».<br />
Le XVIII e siècle marque les débuts d’une révolution<br />
technique, inaugure l’ère <strong>du</strong> machinisme,<br />
particulièrement en Grande-Bretagne. Les progrès<br />
les plus spectaculaires concernent d’abord les<br />
« mécaniques », c’est-à-dire les machines <strong>des</strong>tinées<br />
à accroître le rendement humain dans les ateliers,<br />
grands ou petits. L’in<strong>du</strong>strie textile et la métallurgie<br />
enregistrent d’importantes innovations (le rouet<br />
manuel cède le pas à <strong>des</strong> machines à filer comme la<br />
jenny ou le waterframe), mais l’une <strong>des</strong> conquêtes<br />
majeures <strong>du</strong> siècle est la mise au point de la<br />
machine à vapeur, déjà connue au XVII e siècle ; les<br />
Britanniques Newcomen puis Watt mettent au point<br />
une « machine à double effet » et, en cherchant à lui<br />
donner une application immédiate dans le domaine<br />
<strong>des</strong> transports, le Français Cugnot expérimente sans<br />
grand succès un véhicule à vapeur (1769-1770) et le<br />
marquis Jouffroy d’Abbans fait remonter la Saône à<br />
un navire doté d’une roue à aubes actionnée par la<br />
vapeur.<br />
Les progrès de la médecine et de la chirurgie sont<br />
moins spectaculaires mais ne sont pas négligeables.<br />
Les chirurgiens qui, à la fin <strong>du</strong> XVII e siècle exercent<br />
encore leur art dans la boutique <strong>du</strong> barbier,<br />
obtiennent la création d’un enseignement spécialisé<br />
et la fondation en France d’une <strong>Académie</strong> de<br />
chirurgie (1731). Ce sont eux, rompus aux pratiques<br />
de l’observation, qui font accomplir à la médecine<br />
les avancées les plus remarquables, tel l’Anglais<br />
Jenner, inventeur de la vaccine antivariolique à la<br />
fin <strong>du</strong> siècle.<br />
L’enthousiasme avec lequel ces découvertes sont<br />
suivies - et nous n’en avons retenu ici qu’un mince<br />
échantillon ayant omis par exemple de signaler les<br />
recherches portant sur l’électricité - témoigne non<br />
seulement de l’engouement pour les sciences mais<br />
aussi de la volonté de remettre en cause les<br />
croyances traditionnelles. Il souligne la foi dans le<br />
progrès, qui est un <strong>des</strong> aspects majeurs de la<br />
philosophie <strong>du</strong> XVIII e siècle, moment décisif dans<br />
l’histoire <strong>des</strong> idées.<br />
Mais qu’est-ce que les Lumières ?
Une réponse a été avancée par la marquise de<br />
Lambert dès 1715 :<br />
« C’est rendre à la raison toute sa dignité (…) c’est<br />
secouer le joug de l’opinion et de l’autorité. »<br />
À l’extrémité <strong>du</strong> siècle, la réponse apportée par Kant<br />
à cette question est sensiblement la même :<br />
« Les Lumières se définissent comme la sortie de<br />
l’homme hors de l’état de minorité où il se maintient<br />
par sa propre faute. La minorité c’est l’impuissance<br />
de servir de sa raison sans être guidé par autrui. (…)<br />
Aie le courage de te servir de ta propre raison ! Tel<br />
est le mot d’ordre <strong>des</strong> Lumières. Or, pour répandre<br />
les Lumières, il n’est rien requis d’autre que la<br />
liberté ! » (E. Kant, « Qu’est-ce les Lumières »,<br />
Berlinishe Monatsschrift, décembre 1784)<br />
Ces définitions sont amplement partagées par les<br />
grands philosophes <strong>du</strong> XVIII e siècle qui se livrent,<br />
comme Montesquieu, Voltaire, d’Alembert, l’abbé<br />
Raynal, Condorcet…, à une critique de la société et<br />
<strong>des</strong> institutions de leur temps. Tout le combat <strong>des</strong><br />
Lumières est là : libérer, par la connaissance et la<br />
raison, les hommes victimes « <strong>des</strong> opinions fausses,<br />
<strong>du</strong> fanatisme et <strong>des</strong> préjugés qui ont longtemps<br />
régné sur terre » (Isnard, Traité sur les richesses,<br />
1781). Pour ces philosophes – ces « amis de la<br />
sagesse » - le désir d’instruire et de vulgariser<br />
remplace celui de plaire ou de servir le Prince. Ils<br />
s’engagent dans la vie publique pour « éclairer le<br />
peuple » et assurer « le bonheur <strong>du</strong> plus grand<br />
nombre <strong>des</strong> hommes ».<br />
Sur le plan politique, ils sont favorables à la<br />
monarchie et observent de près, comme le fait<br />
Rousseau, le modèle mis en place en Angleterre<br />
depuis la Glorieuse révolution (1688-1689). Ils se<br />
prononcent pour une monarchie respectueuse <strong>des</strong><br />
libertés fondamentales : libertés indivi<strong>du</strong>elle, de<br />
pensée et d’expression. Ils se dressent contre l’usage<br />
<strong>des</strong> lettres de cachet et le fonctionnement arbitraire<br />
de la justice. Ils combattent le pouvoir absolu de<br />
droit divin et plaident, à la suite de Montesquieu,<br />
pour la séparation <strong>des</strong> pouvoirs. Ils ne récusent pas<br />
l’autorité et appellent même une réelle fermeté :<br />
comme l’écrit Voltaire : « Au peuple sot et barbare,<br />
il faut un joug, un aiguillon et <strong>du</strong> foin ». Il revient<br />
cependant aux philosophes de combattre cette<br />
sottise et cette barbarie qui con<strong>du</strong>isent au<br />
<strong>des</strong>potisme.<br />
Sur le plan social, Rousseau, qui défend l’égalité et<br />
souhaite limiter le droit de propriété, est<br />
relativement isolé ; la plupart <strong>des</strong> philosophes<br />
justifient et défendent la propriété, vantent les<br />
mérites de la liberté d’entreprendre et critiquent,<br />
notamment en France, l’intervention de l’État<br />
héritée de Colbert. Pour la majorité d’entre eux,<br />
l’inégalité <strong>des</strong> fortunes est naturelle dans la mesure<br />
où les talents sont inégaux.<br />
Sur le plan religieux enfin, ils admettent presque<br />
tous – car certains comme Diderot se disent athées -<br />
l’existence d’un Dieu « grand architecte de<br />
l’univers » (Voltaire), mais contestent les dogmes,<br />
dénoncent les ordres religieux et se font, à la suite<br />
de Voltaire, les champions de la tolérance.<br />
Toutefois, dans la seconde moitié <strong>du</strong> siècle, se fait<br />
jour une réaction contre un rationalisme jugé<br />
<strong>des</strong>séchant. Le plus important représentant de ce<br />
9<br />
courant est précisément Rousseau dans sa<br />
Profession de foi <strong>du</strong> vicaire savoyard et ses<br />
Rêveries <strong>du</strong> promeneur solitaire.<br />
Le succès <strong>des</strong> Lumières tient en partie à la<br />
multiplication <strong>des</strong> voies par lesquelles elles furent<br />
diffusées.<br />
La plupart <strong>des</strong> philosophes ont écrit dans ce<br />
monument de l’édition qu’est l’Encyclopédie,<br />
publiée à partir de 1751. Dirigée par Diderot et<br />
d’Alembert elle se veut, comme le dit son<br />
prospectus, un « Tableau général <strong>des</strong> efforts de<br />
l’esprit humain dans tous les genres et dans tous les<br />
siècles » ; elle se présente également comme une<br />
critique habile <strong>des</strong> institutions politiques et <strong>des</strong><br />
idées religieuses <strong>du</strong> siècle. Rédigée par 150 auteurs,<br />
son but « … est de rassembler les connaissances<br />
éparses (…) d’en exposer le système général aux<br />
hommes avec qui nous vivons et de le transmettre<br />
aux hommes qui viendront après nous. Il nous faut<br />
fouler aux pieds toutes les vieilles puérilités,<br />
renverser les barrières que la raison n’aura point<br />
posées ; rendre aux sciences et aux arts une liberté<br />
qui lui est si précieuse (…) il n’appartenait qu’à un<br />
siècle philosophe de tenter une Encyclopédie »<br />
(Diderot).<br />
De Londres à Naples, de Lisbonne à Saint-<br />
Pétersbourg se forme une véritable « république <strong>des</strong><br />
Lettres et <strong>des</strong> idées ». Certes, il n’y a pas<br />
d’unanimité <strong>des</strong> philosophes sur tous les sujets.<br />
Quelle que soit la diversité <strong>des</strong> tempéraments et <strong>des</strong><br />
options, ce qui les unit est leur volonté commune de<br />
tout examiner librement à la lumière de la raison,<br />
d’affranchir l’humanité <strong>des</strong> ténèbres de l’ignorance<br />
et <strong>du</strong> fanatisme. Les lieux de rencontre où l’on débat<br />
avec ardeur se multiplient en Europe et touchent<br />
essentiellement les milieux bourgeois et<br />
aristocratiques <strong>des</strong> villes.<br />
Les salons mondains – de la marquise de Lambert,<br />
de Mmes <strong>du</strong> Deffand, de Tencin ou de Geoffrin placé<br />
sous l’autorité de Voltaire, en présence de Rousseau<br />
– réunissent savants et penseurs ; mais ces<br />
« nouvelles muses » restent confinées aux domaines<br />
artistique et littéraire.<br />
D’autres lieux et espaces de sociabilité favorisent la<br />
circulation <strong>des</strong> idées comme les clubs (club de<br />
l’Entresol à Paris) et les cafés, qui se sont multipliés<br />
en Europe depuis le Procope ouvert à Paris en 1684<br />
ou l’<strong>Académie</strong> <strong>du</strong> café fréquentée à Marseille au<br />
début <strong>du</strong> siècle suivant.<br />
Les loges maçonniques, comme celle de l’Espérance<br />
Nouvellement Couronnée à laquelle appartenait<br />
Mozart, ou Saint Jean d’Écosse, concurrente <strong>du</strong><br />
Grand Orient de France à Marseille, disposent d’un<br />
vaste réseau dans l’ensemble de l’Europe, favorisant<br />
la transmission <strong>des</strong> idées nouvelles (50 loges avant<br />
1750, plus de 400 à la fin <strong>du</strong> siècle).<br />
Enfin, les sociétés de pensée et les académies de<br />
province jouent un rôle capital dans cette diffusion ;<br />
celles d’Aix, de Marseille, de Montpellier et bientôt<br />
<strong>du</strong> <strong>Var</strong>. Elles vulgarisent le discours <strong>des</strong> savants et<br />
<strong>des</strong> philosophes, en proposant une vision laïque,
scientiste, utilitaire et politisée <strong>du</strong> monde. Les<br />
concours variés qu’elles organisent distinguent<br />
également de nouveaux talents. Ainsi, en 1750,<br />
Rousseau est couronné par l’académie de Dijon pour<br />
son Discours sur les sciences et les arts.<br />
Ces contacts sont souvent amorcés et prolongés par<br />
une bonne correspondance, cette « académie de<br />
papier » comme on a pu la qualifier, qui participe<br />
également à la propagation <strong>des</strong> Lumières. Faut-il<br />
rappeler les voyages et la correspondance de<br />
Voltaire avec Frédéric II de Prusse, et les<br />
déplacements, volontaires ou non, de Rousseau<br />
dans une Europe où la langue française a remplacé<br />
le latin comme « langue internationale » ?<br />
Mais, plus amplement, ce siècle est le « beau XVIII e<br />
siècle.<br />
Le « beau XVIII e siècle »<br />
À l’échelle européenne – de manière plus marquée<br />
ici ou là – le « beau XVIII e siècle » est d’abord celui<br />
<strong>du</strong> recul de la mort, et par là, celui de la croissance<br />
démographique. Les trois fléaux qui ont longtemps<br />
hanté les populations et occasionné de fortes<br />
mortalités – à savoir la peste, la guerre et la famine<br />
– perdent de leur intensité ou s’éloignent <strong>du</strong><br />
continent européen. La peste frappe pour la<br />
dernière fois de façon massive la Provence (1720-<br />
1722) puis la Sicile (Messine, 1743), tandis que les<br />
conflits qui provoquent la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> récoltes et<br />
la propagation <strong>des</strong> maladies tendent à se dérouler<br />
hors <strong>du</strong> continent.<br />
Alors que la natalité reste élevée, malgré <strong>des</strong> signes<br />
de limitation volontaire <strong>des</strong> naissances, les taux de<br />
mortalité baissent à partir <strong>des</strong> années 1730 : ces<br />
évolutions contraires con<strong>du</strong>isent à l’accroissement<br />
de la population. Ainsi la population de la France<br />
qui s’élevait à 20 millions d’habitants au début <strong>du</strong><br />
XVIII e siècle, dépasse les 26 millions à la veille de la<br />
Révolution ; dans le même temps la population<br />
anglaise passe de 5 à 10 millions. Au total la<br />
population de l’Europe augmente de plus de 50% en<br />
trois quarts de siècle. C’est surtout la mortalité<br />
infantile qui recule de manière sensible ; celle <strong>des</strong><br />
femmes en couches également, mais plus<br />
légèrement, à la suite d’une meilleure hygiène et de<br />
progrès en obstétrique.<br />
Dans ce contexte, s’affirme un nouveau regard porté<br />
sur l’enfant qui n’est plus considéré comme un<br />
homme en modèle ré<strong>du</strong>it ou comme un être<br />
inachevé. De nombreux indicateurs soulignent cette<br />
perception dont les premiers signes sont attestés au<br />
siècle précédent. L’intérêt accordé à la question de<br />
l’é<strong>du</strong>cation en est un. De nouveaux modèles sont<br />
proposés dans le prolongement <strong>des</strong> réflexions et<br />
métho<strong>des</strong> <strong>des</strong> frères <strong>des</strong> écoles chrétiennes et <strong>des</strong><br />
jésuites. Des brochures, <strong>des</strong> ouvrages, <strong>des</strong><br />
mémoires, <strong>des</strong> conférences démontrent cet intérêt<br />
croissant. L’article « É<strong>du</strong>cation » de l’Encyclopédie<br />
– dû au chevalier Louis de Jaucourt – rappelle que<br />
les philosophes n’ont pas été indifférents au sujet.<br />
D’aucuns indiquent parfois <strong>des</strong> voies plus<br />
originales : on songe bien enten<strong>du</strong> à celle suivie par<br />
l’Émile de Rousseau.<br />
10<br />
La disparition <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> famines, et non <strong>des</strong><br />
disettes, résulte d’un ensemble de facteurs qui ont<br />
contribué à la croissance de la pro<strong>du</strong>ction agricole,<br />
sans faire oublier la question <strong>des</strong> subsistances qui<br />
reste souvent préoccupante, notamment dans les<br />
villes. Si l’on ne parle plus aujourd’hui de<br />
« révolution agricole », on s’accorde sur l’existence<br />
d’une accumulation de petits progrès intervenant<br />
dans une conjoncture climatique favorable. Les<br />
années 1730-1740 marquent en effet la fin <strong>du</strong> miniâge<br />
glaciaire caractérisé, depuis la fin <strong>du</strong> XVI e siècle,<br />
par <strong>des</strong> hivers rigoureux et <strong>des</strong> étés pourris, à<br />
l’origine <strong>des</strong> crises de subsistances. Au XVIII e siècle,<br />
le recul de la jachère, les défrichements de terres<br />
incultes, l’amélioration de l’outillage (charrue à<br />
versoir, semoir), l’intro<strong>du</strong>ction de plantes nouvelles,<br />
comme le maïs, la pomme de terre, les plantes<br />
fourragères (trèfle, sainfoin, luzerne) et à racines<br />
pivotantes (betteraves, navets, turneps) qui<br />
enrichissent le sol au lieu de l’épuiser, ont un rôle<br />
décisif dans l’amélioration de l’agriculture<br />
permettant de mieux nourrir la population et de<br />
développer l’élevage. C’est en Angleterre, où les<br />
grands domaines s’étendent aux dépens de la petite<br />
propriété et adoptent les techniques les plus<br />
modernes, que les transformations sont les plus<br />
rapi<strong>des</strong> ; les Provinces-Unies et la France suivent<br />
plus lentement le mouvement.<br />
Les réflexions et débats sur l’agriculture n’ont pas<br />
échappé aux philosophes <strong>des</strong> Lumières ; il suffit de<br />
parcourir l’Encyclopédie et notamment d’observer<br />
les planches qui y sont associées pour s’en rendre<br />
compte ! Les physiocrates comme Quesnay, pour<br />
lesquels la terre est la source essentielle de la<br />
richesse, diffusent ces savoirs nouveaux,<br />
encouragent leur mise en pratique en mobilisant de<br />
semblables canaux que ceux mis en œuvre pour la<br />
diffusion <strong>des</strong> Lumières : les brochures, les sociétés<br />
savantes, la correspondance, les nombreux articles<br />
donnés à l’Encyclopédie (« fermiers », « grains »)<br />
contribuent à favoriser cet intérêt pour l’agronomie<br />
qui devient quelquefois « agromanie ». Une<br />
noblesse éclairée se pique de curiosité et n’hésite pas<br />
à donner l’exemple ; ainsi le rappellent ces<br />
estampes, médailles et peintures qui montrent<br />
l’empereur Joseph II labourant (1769), comme le<br />
fait au même moment le Dauphin, futur Louis XVI,<br />
et comme le fera plus tard, au Trianon, la<br />
« bergère » Marie-Antoinette, sœur de Joseph II, en<br />
élevant <strong>des</strong> moutons. La mode est aux champs, à la<br />
nature et à ses mystères. Voltaire surveille<br />
personnellement ses terres à Ferney et se livre à <strong>des</strong><br />
expériences agricoles, comme Lavoisier applique ses<br />
découvertes en chimie sur les terres de ses domaines<br />
agricoles.<br />
La liberté, que défendent les philosophes dans tous<br />
les domaines, est aussi liberté d’agir sur le plan<br />
économique. Ils derniers défendent le principe de la<br />
libre circulation <strong>des</strong> marchandises, demandent la<br />
suppression <strong>des</strong> péages et octrois qui entravent la<br />
liberté de circuler, qui renchérissent les prix <strong>des</strong><br />
marchandises et contribuent aux difficultés<br />
alimentaires. Le principe <strong>du</strong> « laissez faire, laissez<br />
passer », énoncé par Vincent de Gournay,<br />
inspecteur <strong>des</strong> manufactures Dupont de Nemours et
ancien négociant, est au cœur de La richesse <strong>des</strong><br />
nations d’Adam Smith, livre publié en 1776 ; cette<br />
même année, en France, Turgot, intendant puis<br />
ministre de Louis XVI, libère la circulation <strong>des</strong><br />
grains, mais cette liberté n’est que de courte <strong>du</strong>rée et<br />
ne résiste pas à la « Guerre <strong>des</strong> farines ».<br />
Les réseaux routiers doivent pouvoir répondre à ces<br />
exigences. Plusieurs États européens engagent <strong>des</strong><br />
travaux pour améliorer les infrastructures de<br />
transports intérieurs (routes, chemins et canaux).<br />
Les résultats sont, il est vrai, très inégaux, mais réels<br />
comme le rappelle cette toile de Joseph Vernet qui a<br />
toutefois consacré une large partie de son œuvre aux<br />
choses de la mer.<br />
Car le Siècle <strong>des</strong> Lumières voit se renforcer la<br />
mondialisation <strong>des</strong> échanges amorcée au XVI e siècle<br />
à la suite <strong>des</strong> premiers grands voyages de<br />
découvertes et dans l’esprit <strong>du</strong> « cosmopolitisme »<br />
que développent les penseurs. Les grands ports<br />
européens, comme Londres, Amsterdam ou Cadix<br />
connaissent une dilatation de leurs espaces<br />
marchands jusqu’aux limites <strong>du</strong> monde commercial<br />
connu. Marseille se hisse alors au rang de port<br />
mondial. Les navires européens sillonnent les<br />
espaces océaniques : de l’Atlantique, de l’océan<br />
Indien, <strong>du</strong> Pacifique et de la mer de Chine. La<br />
Méditerranée n’est pas pour autant marginalisée ;<br />
elle est même source de convoitises pour les<br />
puissances européennes. Les pavillons anglais,<br />
hollandais mais également nordiques – Danois et<br />
Suédois – y sont de plus en plus nombreux, de plus<br />
en plus actifs.<br />
Les cargaisons <strong>des</strong> navires européens qui vont vers<br />
ces <strong>des</strong>tinations lointaines témoignent de l’essor <strong>des</strong><br />
pro<strong>du</strong>ctions artisanale, manufacturière, voire déjà<br />
in<strong>du</strong>strielle. Ce sont les textiles <strong>des</strong> petits ateliers et<br />
gran<strong>des</strong> manufactures (toiles et draps de laine <strong>du</strong><br />
Languedoc), <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its métallurgiques <strong>des</strong> petites<br />
forges ou gran<strong>des</strong> fabriques. Figurent également <strong>des</strong><br />
pro<strong>du</strong>its tropicaux redistribués après<br />
transformation ou non : sucre, café, indigo qui<br />
rappellent le contrôle d’espaces coloniaux par les<br />
puissances européennes. Le « commerce<br />
triangulaire », dont la marchandise est l’homme,<br />
acheté ou troqué le long <strong>des</strong> côtes africaines, fait la<br />
fortune de négociants-armateurs de Liverpool,<br />
Londres, Bristol, Nantes, La Rochelle ou Bordeaux.<br />
Au milieu <strong>du</strong> XVIII e siècle, certains philosophes<br />
condamnent verbalement la traite et l’esclavage,<br />
mais investissent discrètement dans ce « trafic<br />
honteux » ; on songera certes à Voltaire, mais il ne<br />
fut pas seul dans ce cas. Les hôtels particuliers <strong>des</strong><br />
grands négociants négriers affichent clairement<br />
cette activité sur leurs faça<strong>des</strong>, comme à Nantes, le<br />
long <strong>du</strong> quai de la Fosse, ou dans d’autres villes<br />
portuaires.<br />
Si les Européens vivent en grande majorité à la<br />
campagne, le nombre <strong>des</strong> citadins progresse au<br />
XVIII e siècle. Les villes rassemblent près d’un quart<br />
de la population en Europe de l’Ouest, avec<br />
quelques gran<strong>des</strong> cités comme Londres, Paris ou<br />
Naples. Ces villes, décriées et présentées comme <strong>des</strong><br />
lieux de perdition par nombre d’auteurs – Rousseau<br />
parle « d’espaces funestes et de lieux corrompus » –,<br />
11<br />
connaissent cependant <strong>des</strong> aménagements : places,<br />
cours, allées, rues éclairées, théâtres, opéras,<br />
fontaines sont autant de lieux de sociabilité. Même<br />
les cités plus mo<strong>des</strong>tes enregistrent quelques<br />
changements.<br />
Ainsi, à Toulon, pourtant si malmenée par Michelet<br />
qui retient crasse et misère et en fait un <strong>des</strong> pires<br />
bastions de l’obscurantisme, un nouvel urbanisme<br />
tente de modifier la structure de la cité. En l’absence<br />
de plan et de conception générale, les opérations se<br />
font de gré à gré. En 1769, les rues sont marquées et<br />
les maisons numérotées ; la ville est éclairée neuf<br />
mois l’an, de la fin <strong>du</strong> jour à une heure <strong>du</strong> matin ; le<br />
nombre de fontaines passe de 30 à la fin <strong>du</strong> XVII e<br />
siècle, à 70 à la fin <strong>du</strong> siècle suivant ; on dispose,<br />
depuis 1771, d’un service de lutte contre les<br />
incendies et le vieil abattoir insalubre est réparé en<br />
1780. De nouvelles places sont aménagées à la suite<br />
de la démolition d’îlots vétustes : la place aux Grains<br />
en 1757, la place Puget (ex-place <strong>des</strong> voitures de<br />
poste) en 1780, décorée d’une fontaine par le<br />
sculpteur aixois Chastel. On démolit pour aérer,<br />
mais on construit ou reconstruit : ici le Palais de<br />
Justice (1769), là une rectification <strong>du</strong> quai <strong>du</strong> port à<br />
la suite d’un agrandissement de l’arsenal (1769), là<br />
encore l’embellissement de l’Hôtel de ville par la<br />
décoration d’une porte (1772) en attendant la<br />
construction de l’Hôtel de la Marine en 1786, au<br />
moment où la ville se soucie de régulariser les rues<br />
et commence à se préoccuper d’un plan général<br />
d’agrandissement. Toutefois, il reste beaucoup à<br />
faire, et « les consuls reconnaissent qu’il y a<br />
beaucoup d’immondices dans les rues, atten<strong>du</strong> qu’il<br />
n’y a qu’un seul chariot pour les enlever. » Et cette<br />
même année 1782 est rétabli l’office de chassemendiants.<br />
Cette réflexion sur l’aménagement <strong>des</strong> villes con<strong>du</strong>it<br />
à certaines créations comme ce village utopique de<br />
Maupertuis - aujourd’hui Coulommiers - conçu par<br />
Claude-Nicolas Ledoux de 1763 à 1767, et encouragé<br />
par le marquis de Montesquiou. Là se mêlent<br />
préoccupations architecturales, agronomiques et<br />
sociales. Cet ensemble comprend un château, une<br />
chapelle, un temple de la religion naturelle, un parc,<br />
<strong>des</strong> jardins, vergers, potagers, dépendances<br />
agricoles et logements. Ledoux, qui doit à Rousseau<br />
l’essentiel de ses conceptions morales, considère ce<br />
village comme une « communauté de travail<br />
heureuse » et non comme une « communauté de<br />
propriété ». On ignore si ce village, dont le plan fut<br />
présenté à l’<strong>Académie</strong> royale d’Architecture, fut<br />
réellement construit, comme le sera, par ce même<br />
architecte, la cité de Chaux, autour de la saline<br />
d’Arc-et-Senans en 1775-1779.<br />
Nombre de réalités et quelques « rêveries »<br />
contribuent à éclairer ce « beau » siècle qui reste<br />
néanmoins un siècle en demi-teinte.<br />
Un XVIII e siècle en demi-teinte<br />
Il ne s’agit pas de dresser un inventaire ou de<br />
confectionner un catalogue <strong>des</strong> éléments qui<br />
assombrissent l’éclatant tableau <strong>du</strong> XVIII e siècle,<br />
mais d’en pointer simplement quelques-uns.
Ainsi, ce serait naïveté de croire qu’une belle<br />
unanimité règne parmi les hommes <strong>des</strong> Lumières.<br />
Les différends sont nombreux, les rivalités<br />
fréquentes et les propos parfois féroces autant<br />
qu’injustes. Ainsi Duhamel <strong>du</strong> Monceau, inspecteur<br />
général de la Marine – mais aussi agronome,<br />
sylviculteur, botaniste, chimiste – a subi les attaques<br />
<strong>des</strong> Encyclopédistes qui tendent à mépriser la<br />
Marine en proclamant que la supériorité de la<br />
France vient <strong>des</strong> Arts et <strong>des</strong> Lettres. Ainsi, pour<br />
Denis Diderot : « Ce Duhamel a inventé une infinité<br />
de machines qui ne servent à rien ; écrit et tra<strong>du</strong>it<br />
une infinité de livres sur l'agriculture, qu'on ne<br />
connaît plus ; fait toute sa vie <strong>des</strong> expériences dont<br />
on attend encore quelque résultat utile.» Diderot<br />
passe allègrement sous silence les emprunts faits à<br />
Duhamel <strong>du</strong> Monceau dans la rédaction <strong>des</strong> articles<br />
« Agriculture », « Corderie » et « Sucre » de<br />
l’Encyclopédie…<br />
Si l’information circule en empruntant plusieurs<br />
canaux – gazettes, cabinets de lecture – les journaux<br />
et les livres sont souvent strictement contrôlés. La<br />
presse connaît un rapide développement à partir <strong>du</strong><br />
milieu <strong>du</strong> siècle, en particulier en Angleterre et dans<br />
les Provinces-Unies ; en France il faut attendre 1777<br />
pour voir paraître le premier journal quotidien (le<br />
Journal de Paris) et une autorisation officielle reste<br />
obligatoire pour obtenir le droit de parution. Les<br />
livres, qui connaissent un réel succès malgré <strong>des</strong><br />
prix élevés, sont la plupart <strong>du</strong> temps rédigés en<br />
Français mais doivent souvent être imprimés à<br />
l’étranger. Les feuilles clan<strong>des</strong>tines qui fleurissent<br />
ici et là sont pourchassées et les plus grands auteurs<br />
n’échappent pas à la vigilance de la censure. Au<br />
contrôle exercé par le directeur de la Librairie<br />
viennent s’ajouter ceux de la Sorbonne, <strong>du</strong><br />
Parlement et de l’Archevêché de Paris. Publiées en<br />
1721, les Lettres persanes de Montesquieu (publiées<br />
hors de France et sans nom d’auteur) inquiètent<br />
l’État monarchique car l’auteur critique l’autorité<br />
centrale et conteste l’origine surnaturelle <strong>du</strong> pouvoir<br />
royal – à savoir celui de guérir les écrouelles le jour<br />
<strong>du</strong> sacre à Reims. En 1734, les Lettres<br />
philosophiques de Voltaire, écrites en Angleterre –<br />
un <strong>des</strong> refuges de la pensée libre, comme la<br />
Hollande – sont condamnées, faute de pouvoir en<br />
brûler l’auteur ; Diderot, à l’origine, avec son roman<br />
La Religieuse, d’une violente attaque contre les<br />
couvents, est incarcéré à Vincennes, et Rousseau,<br />
dont certains textes sont condamnés à Genève et à<br />
Paris, est chassé de plusieurs refuges.<br />
L’Encyclopédie, la plus grande aventure éditoriale<br />
<strong>des</strong> Lumières, n’a pas échappé aux oppositions,<br />
malgré la bienveillance de certains responsables<br />
proches <strong>du</strong> pouvoir, comme la marquise de<br />
Pompadour ou Malesherbes, responsable de la<br />
censure. Les jésuites condamnent ce qu’ils pensent<br />
être une machine de guerre contre l’Église, et le<br />
Conseil d’État interdit sa vente en 1759. Malgré ces<br />
poursuites, l’impression se poursuit, y compris hors<br />
de France, et le 35 e et dernier volume paraît en 1772.<br />
Le combat contre le fanatisme et l’arbitraire de la<br />
justice ne parviennent pas à faire fléchir les<br />
décisions de justice. L’affaire Calas montre les<br />
limites de l’action <strong>des</strong> philosophes, et de Voltaire en<br />
particulier ; Marc Antoine Calas, négociant<br />
12<br />
calviniste de Toulouse accusé d’avoir tué son fils<br />
pour l’empêcher de se convertir au catholicisme est<br />
roué vif en 1762. Peu de temps après, Jean François<br />
Lefebvre, chevalier de La Barre, âgé de 19 ans, est<br />
condamné à avoir le poing coupé et la langue<br />
arrachée avant d’être brûlé vif pour ne pas s’être<br />
découvert devant une procession et avoir mutilé un<br />
crucifix. Voltaire n’obtiendra jamais la réhabilitation<br />
<strong>du</strong> chevalier ; le Parlement de Paris accorde<br />
simplement en appel que le jeune noble soit<br />
décapité avant de subir sa peine (1766).<br />
Par ailleurs, l’ouverture au monde, qu’illustrent les<br />
grands voyages de découvertes, ne répond pas à une<br />
simple curiosité intellectuelle. Elle a <strong>des</strong> objectifs<br />
plus prosaïques. Il suffit de lire attentivement les<br />
directives transmises à La Pérouse pour prendre la<br />
mesure <strong>des</strong> objectifs recherchés. Sur chaque île, les<br />
« découvreurs » hissent les couleurs de leurs<br />
souverains respectifs, car les rivalités <strong>des</strong> États<br />
européens s’étendent au reste <strong>du</strong> monde. Dans les<br />
années 1720-1730, Français et Anglais se disputent<br />
l’Inde <strong>des</strong> Grands Moghols ; Robert Clive combat les<br />
troupes de Dupleix, avant que celui-ci soit rappelé<br />
en France et que son successeur renonce à toute<br />
domination politique. Durant la guerre de Sept ans<br />
(1755-1763) la rivalité coloniale franco-britannique<br />
se poursuit en Amérique <strong>du</strong> Nord ; les colons de la<br />
Nouvelle-France luttent, à armes inégales, contre<br />
ceux <strong>des</strong> Treize colonies. Dans Candide, Voltaire se<br />
moque de ces affrontements pour « quelques<br />
arpents de glace » au Canada (1757).<br />
En Méditerranée, les tensions entre puissances<br />
européennes sont vives et si la menace barbaresque<br />
a fléchi, force est de reconnaître qu’elle n’a pas<br />
totalement disparu. Le risque d’être pris et con<strong>du</strong>it<br />
en « esclavitude » dans un bagne d’Alger ou de<br />
Tunis est toujours d’actualité. Rousseau, bien<br />
renseigné par diverses lectures de qualité, ne<br />
l’ignore pas, qui nous montre Émile captif <strong>des</strong><br />
Barbaresques après s’être confié à un capitaine<br />
renégat tardivement démasqué. L’économie de la<br />
rançon anime toujours les deux rives de la<br />
Méditerranée avec quelques points de rencontre<br />
pour négocier les rachats ou les échanges. Rousseau<br />
le sait qui fait état dans la suite de l’Émile – Émile et<br />
Sophie ou les Solitaires - d’une île partagée entre les<br />
deux cultures, une île où se réfugie Émile et où<br />
disparaît Sophie. Cette île – le thème de l’île est<br />
récurrent chez Rousseau comme chez d’autres<br />
auteurs, tels Diderot dans Le Supplément au voyage<br />
de Bougainville – n’est pas nommée par Rousseau,<br />
mais tout porte à croire qu’il s’agit de Lampe<strong>du</strong>sa.<br />
Au reste, Rousseau se livre dans ce texte inachevé à<br />
d’intéressantes comparaisons entre les captifs et les<br />
esclaves qui nourrissent alors les trafics atlantiques,<br />
sans pour autant prendre position dans cette<br />
question qui agite certains cercles d’érudits.<br />
Dans les pays de l’Europe centrale, orientale et<br />
méditerranéenne, où l’empreinte de la féodalité<br />
reste forte, plusieurs souverains entreprennent,<br />
dans la seconde moitié <strong>du</strong> XVIII e siècle, de<br />
moderniser leurs États en imposant <strong>des</strong> réformes,<br />
théoriquement inspirées <strong>du</strong> programme <strong>des</strong><br />
philosophes <strong>des</strong> Lumières. Les objectifs de ces<br />
« <strong>des</strong>potes éclairés » sont partout les mêmes. En
principe, il s’agit de renforcer la puissance de l’État<br />
en lui donnant une meilleure organisation, non pour<br />
répondre à un goût personnel de pouvoir absolu<br />
mais pour assurer le bonheur de leurs sujets ; ces<br />
chefs d’État affichent leurs bonnes relations avec les<br />
philosophes. Imprégné dans sa jeunesse de l’esprit<br />
<strong>des</strong> Lumières, Frédéric II, roi de Prusse à partir de<br />
1740, correspond avec Voltaire et l’invite en 1745.<br />
Catherine II de Russie entretient <strong>des</strong> relations<br />
épistolaires avec d’Alembert, Voltaire et surtout<br />
Diderot (1773-1774). En réalité, les idées nouvelles –<br />
tolérance, suppression <strong>des</strong> privilèges, abolition <strong>du</strong><br />
servage - sont surtout utilisées par ces souverains<br />
pour faire triompher les forces traditionnelles et<br />
conservatrices (clergé, aristocratie <strong>des</strong> Junkers ou<br />
grands propriétaires fonciers en Prusse). Les soucis<br />
de grandeur et de prestige l’emportent très<br />
rapidement sur les considérations philosophiques.<br />
Seul Joseph II, dans l’empire <strong>des</strong> Habsbourg,<br />
amorce, après 1780, de véritables réformes en<br />
s’attaquant aux privilèges de la noblesse (abolition<br />
<strong>du</strong> servage, de la corvée et <strong>des</strong> corporations) et en<br />
soumettant étroitement l’Église à l’État, au risque<br />
d’un conflit avec le pape.<br />
Ce siècle qui participe à façonner un nouveau regard<br />
porté sur l’enfant, à la vie désormais moins fragile,<br />
se singularise par un paradoxe maintes fois<br />
mentionné. En effet, les naissances illégitimes ne<br />
cessent de croître dès le début <strong>du</strong> XVIII e siècle, alors<br />
que se multiplient les abandons de nouveau-nés. Les<br />
fameuses trajectoires de deux philosophes <strong>des</strong><br />
Lumières illustrent ces comportements. Ainsi,<br />
Rousseau, si attentif à l’é<strong>du</strong>cation <strong>des</strong> enfants, a<br />
abandonné, pour <strong>des</strong> « raisons économiques », ses<br />
cinq enfants dont un dans le tour d’une institution<br />
charitable ; on sait tout aussi bien que Jean le Rond,<br />
dit D’Alembert est un enfant abandonné en 1717 par<br />
sa mère, Mme de Tencin, et trouvé, par la femme<br />
d’un vitrier, sur les marches de la chapelle Saint-<br />
Jean-le-Rond (d’où son nom).<br />
Les richesses et la prospérité <strong>du</strong> siècle sont<br />
inégalement partagées. Les principaux bénéficiaires<br />
<strong>du</strong> « beau XVIII e siècle » sont <strong>des</strong> membres de la<br />
haute noblesse qui se sont lancés dans les affaires,<br />
une petite fraction <strong>du</strong> clergé mais surtout la<br />
bourgeoisie urbaine qui domine la pro<strong>du</strong>ction et les<br />
échanges, le négoce et la finance ; imprégnée <strong>des</strong><br />
idées nouvelles, celle-ci aspire à occuper une autre<br />
place dans la direction <strong>des</strong> affaires publiques. À<br />
l’exception de Montesquieu, authentique aristocrate,<br />
la majorité <strong>des</strong> philosophes <strong>des</strong> Lumières<br />
appartiennent à cette bourgeoisie dont la puissance<br />
économique et l’influence politique ne cessent de<br />
croître et qui aspire à l’exercice <strong>du</strong> pouvoir.<br />
Face à ce monde <strong>des</strong> gagnants celui <strong>des</strong> perdants,<br />
plus nombreux, est davantage composite. Les<br />
paysans, devenus libres – le servage sévit<br />
néanmoins encore en Europe orientale – et<br />
propriétaires de petites exploitations, pratiquent<br />
une agriculture souvent routinière et doivent<br />
acquitter un ensemble de redevances. En cas de<br />
crise et devant l’impossibilité de faire face à ces<br />
exigences, ils vont grossir le monde <strong>des</strong> errants. Les<br />
travailleurs <strong>des</strong> métiers urbains et les domestiques<br />
suivent alors cette même trajectoire.<br />
13<br />
Depuis la Régence (1715-1723) qui a vu une vive<br />
réaction contre l’absolutisme royal et les mœurs<br />
austères de la fin <strong>du</strong> règne de Louis XIV, les<br />
tentatives de réformes se sont multipliées et<br />
heurtées à de nombreux blocages. Après le ministère<br />
<strong>du</strong> prudent cardinal Fleury (1726-1743), le roi Louis<br />
XV laisse ses ministres faire face aux nombreuses<br />
difficultés et aux résistances <strong>des</strong> parlements. Louis<br />
XVI renonce aux réformes hardies amorcées par<br />
Maupeou puis proposées par Turgot, Necker,<br />
Calonne ou Loménie de Brienne.<br />
Les tensions sont vives, les inégalités croissantes, les<br />
menaces réelles. Rousseau s’en fait l’écho :<br />
« Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans<br />
songer que cet ordre est sujet à <strong>des</strong> révolutions<br />
inévitables (…) Nous approchons de l’état de crise et<br />
<strong>du</strong> siècle <strong>des</strong> révolutions.<br />
Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez<br />
alors ? Tout ce qu’ont fait les hommes, les hommes<br />
peuvent le détruire. Il n’y a de caractères<br />
ineffaçables que ceux qu’imprime la nature et la<br />
nature n’a fait ni princes, ni riches, ni grands<br />
seigneurs (…)<br />
Celui qui mange dans l’oisiveté ce qu’il n’a pas gagné<br />
lui-même le vole. Il doit en travail le prix de son<br />
entretien : cela est sans exceptions. Travailler est<br />
donc un devoir indispensable à l’homme social.<br />
Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen<br />
oisif est un fripon ! » (Rousseau, Émile, livre III).<br />
« Révolution, nature, citoyen, fripon… ». Ce sont là<br />
<strong>des</strong> termes qui auront certaines résonances après la<br />
disparition de Rousseau. On comprend combien les<br />
révolutionnaires français de 89, et plus encore ceux<br />
de 93, aient pu être davantage sensibles à Rousseau<br />
qu’aux Encyclopédistes qui, dans leur ensemble, ne<br />
prônaient pas la démocratie et ne souhaitaient<br />
nullement une rupture révolutionnaire ! Au vrai, les<br />
peuples oscillent entre le besoin de marquer une<br />
filiation avec ce qui précède et le désir de rompre<br />
avec le passé.<br />
Le XVIII e siècle a longtemps cru à la Raison, mais<br />
l’homme <strong>du</strong> XVIII e siècle n’a pas été entièrement<br />
soumis à son empire. Avec Rousseau il s’est<br />
enthousiasmé pour les sentiments et la nature. Un<br />
puissant courant sentimental se développe et se<br />
manifeste dans de nombreux domaines artistiques.<br />
L’Europe se met à l’école <strong>des</strong> artistes français - <strong>des</strong><br />
peintres Watteau, Chardin et Fragonard, <strong>des</strong><br />
sculpteurs Bouchardon et Houdon – mais<br />
l’Angleterre, l’Espagne ou Venise ont aussi leurs<br />
artistes de génie qui répondent aux mêmes<br />
aspirations (Gainsborough, Goya ou Guardi).<br />
Ainsi, alors que disparaît Jean-Jacques, on soupire<br />
auprès d’un lac ou d’une ruine. Sa tombe, dans l’île<br />
artificielle <strong>des</strong> Peupliers, à Ermenonville, dans le<br />
domaine familial <strong>du</strong> marquis de Girardin, reflète<br />
cette nouvelle sensibilité. Rousseau n’a-t-il pas<br />
suggéré la fin envisagée à son roman resté inachevé,<br />
Émile et Sophie, à son jeune ami Bernardin de<br />
Saint-Pierre, le père de Paul et Virginie ?
La raison triomphante a cédé le pas à l’instinct et à<br />
l’émotion. Le temple de la Philosophie est à<br />
l’arrière-plan, et en réalité inachevé. La nature, la<br />
solitude et le rêve brisé : les grands thèmes <strong>du</strong><br />
romantisme se sont invités à Ermenonville.<br />
14<br />
La tombe de Rousseau devient un lieu de pèlerinage<br />
où Marie-Antoinette, Mirabeau, Robespierre,<br />
Bonaparte et <strong>des</strong> milliers d’autres sont venus verser<br />
<strong>des</strong> « torrents de larmes ». Et ce bien après 1794,<br />
année où les cendres de Rousseau ont été déposées<br />
au Panthéon.
Ce titre exprime une affirmation préliminaire : nul<br />
ne peut nier que Jean-Jacques Rousseau ait été<br />
souvent malade et surtout qu'il fut vraiment un<br />
malade. Qui oserait en douter, alors que toute son<br />
œuvre autobiographique (Confessions, Dialogues,<br />
Rêveries <strong>du</strong> Promeneur solitaire, Correspondance)<br />
est émaillée de <strong>des</strong>criptions pathologiques le<br />
concernant. Lui-même s'y présente ouvertement<br />
comme un malade chronique, un malade congénital<br />
dirais-je. Deux citations seulement, parmi tant<br />
d'autres :<br />
Dès les premières pages <strong>des</strong> Confessions (1. pp. 7-8) :<br />
« J'étais né presque mourant, on espérait peu me<br />
conserver. J'apportai le germe d'une incommodité<br />
que les ans ont renforcée et qui, maintenant, ne me<br />
donne quelquefois de relâches que pour me laisser<br />
souffrir plus cruellement d'une autre façon ». Et,<br />
dans une lettre <strong>du</strong> 26 Mars 1757 à Madame<br />
d'Epinay : « En qualité de malade, j'ai droit aux<br />
ménagements que l'humanité doit à la faiblesse et à<br />
l'humeur d'un homme qui souffre ; quel est l'ami,<br />
quel est l'honnête homme qui ne doit pas craindre<br />
d'affliger un malheureux tourmenté d'une maladie<br />
incurable et douloureuse ? » (2)<br />
Mon rôle ne sera donc pas de vous démontrer<br />
l'existence de cette pathologie, mais d'essayer d'en<br />
préciser la nature. Malade de quel mal, ou de quels<br />
maux, Jean-Jacques ? Là commencent, en effet,<br />
discussions, divergences, oppositions, conflits<br />
même, dans la surabondante littérature relative à ce<br />
sujet (thèses, ouvrages, <strong>communications</strong>). Gardonsnous<br />
de nous égarer, dans ce maquis... Résumons<br />
plutôt faits et hypothèses.<br />
Les faits<br />
Ou, si vous préférez, la séméiologie qu'expose<br />
Rousseau lui-même dans son autobiographie, ses<br />
« écrits pathobiographiques », comme les dénomme<br />
Philippe Brenot dans son très bon ouvrage Le Génie<br />
et la folie (3) . Cette pathologie, on peut la<br />
schématiser en deux syndromes (qui ne furent pas<br />
forcément synchrones au long de sa vie) : un<br />
syndrome somatique et un syndrome mental.<br />
Le syndrome somatique semble être apparu vers<br />
la vingtième année, encore que Rousseau ait signalé<br />
dans ses Confessions (1. p. 361) : « Un vice de<br />
conformation dans la vessie me fit éprouver dans<br />
mes premières années une rétention d'urines<br />
presque continuelle ». Sa tante Suzon, qui l'éleva,<br />
eut beaucoup de mal à en venir à bout, mais elle y<br />
parvint... et ce n'est qu'à son jeune âge a<strong>du</strong>lte que<br />
l'on reparlera, - ô combien !, - de crises de rétention,<br />
parfois prolongées, très rebelles, nécessitant de<br />
MALADE DE QUOI, JEAN-JACQUES ?<br />
Professeur Pierre NAVARRANNE<br />
15<br />
fréquents recours aux sondages, aux « bougies »,<br />
aux cathéters. Alternent avec cette rétention,<br />
mictions impérieuses et mal contrôlées, voire<br />
incontinence... Tout cela, décrit si fréquemment par<br />
Jean-Jacques tout au long de sa vie qu'un brillant<br />
neurobiologiste actuel, Jean-Didier Vincent (4) ,<br />
retrouvant son vocabulaire de carabin, surnomme<br />
Rousseau « le pisseux disgracieux » ; il cite même le<br />
Dr. Théodore Tronchin, médecin et ami de Voltaire<br />
il est vrai ; celui-ci prétendait que « Rousseau avait<br />
sa vessie à la place <strong>du</strong> cœur et l'urine à la place <strong>du</strong><br />
sang ». Horresco referens...<br />
Outre ce si fréquent inconvénient urinaire,<br />
surviennent de temps en temps, très espacées, <strong>des</strong><br />
manifestations abdominales aiguës : crises<br />
douloureuses intenses irradiant parfois en région<br />
lombaire (on a pu les prendre pour <strong>des</strong> coliques<br />
néphrétiques, mais il n'y eut jamais émission de<br />
calcul). Elles peuvent s'accompagner d'un important<br />
météorisme abdominal, être fébriles, <strong>du</strong>rer de<br />
quelques heures à plusieurs jours.<br />
En 1752, Rousseau parle de « quelques<br />
semaines de lit » ;<br />
En 1762, il crut en mourir et il rédigea son<br />
testament, demandant à être autopsié par<br />
« d'habiles gens » (sic) pour éclairer enfin<br />
« l'étrange maladie qui me consume depuis<br />
tant d'années » (1 p. 1224) .<br />
Entre ces crises, qui peuvent réveiller ou pas les<br />
troubles urinaires, l'état physique redevient normal.<br />
Le syndrome mental est essentiellement<br />
constitué d'idées délirantes de persécution. On a pu,<br />
certes, retenir chez lui d'autres traits<br />
psychopathologiques, mais que vous me permettrez<br />
sans doute, de juger mineurs aux yeux <strong>du</strong><br />
neuropsychiatre.<br />
Dès l'adolescence, une « dromomanie »,<br />
cette tendance à la fugue impulsive, bien<br />
étudiée chez lui par le Pr. Régis (5) ,<br />
retrouvée tout au long de sa vie, accentuée<br />
encore par ses idées de persécution.<br />
Des tendances mytho-maniaques :<br />
fabulation, usurpation d'identité.<br />
Une immaturité sexuelle, avec masochisme<br />
dans l'enfance, exhibitionnisme à<br />
l'adolescence, autoérotisme prolongé à<br />
l'âge a<strong>du</strong>lte.<br />
Une extrême sensibilité émotionnelle et<br />
affective, génératrice d'angoisses, voire de<br />
dépression.
Sur ce fond de fragilité psycho affective, assortie<br />
d'un caractère paranoïaque (surestimation de soi,<br />
difficultés d'adaptation sociale), s'allument à la fin<br />
<strong>des</strong> années 1750, <strong>des</strong> « orages précurseurs » (6) :<br />
brouille avec ses amis, philosophes ou mondains,<br />
bombardés de lettres multiples, parfois violentes,<br />
injustes, injurieuses, où il parle « d'opprobres »,<br />
« outrages », « déshonneur ».<br />
Après 1762, - tandis qu'il a fui Paris (non sans<br />
raisons légitimes!) et qu'il erre à travers la Suisse,<br />
indésirable et banni, là aussi, - apparaissent dans sa<br />
correspondance de multiples interprétations<br />
délirantes : « regards curieux », « sottes<br />
chuchoteries », « langues empoisonnées qui<br />
distillent plus de venin que tous les serpents<br />
d'Afrique », « espions qui violent sa<br />
correspondance », « oppresseurs », etc. On assiste à<br />
l'organisation véritable d'un délire de persécution<br />
qui éclatera superbement en Angleterre, où son ami<br />
David Hume lui donne asile en Janvier 1766.<br />
La conviction délirante est alors absolue, définitive.<br />
C'est « la grande tourmente » (6) : une « ligue » s'est<br />
constituée contre lui et s'ingénie à le détruire avec<br />
<strong>des</strong> complicités diverses : publiques et privées,<br />
politiques, littéraires, religieuses, populaires même.<br />
C'est un ténébreux complot universel, cosmique<br />
presque ! En même temps, migrant ça et là en<br />
Angleterre, il écrit les premiers livres <strong>des</strong><br />
Confessions, comme un dérivatif et une catharsis<br />
apaisants. On comprend que Jean d'Ormesson, dans<br />
son Autre Histoire de la Littérature Française (7) ait<br />
intitulé le chapitre Rousseau : « un Candide<br />
enragé ».<br />
Enragé, oui, avec même <strong>des</strong> raptus délirants<br />
suraigus : en Angleterre, lorsqu'il mobilise la presse<br />
britannique pour quelle publie une « déclaration » à<br />
« ses amis et ennemis pourvu qu'ils aiment la<br />
justice » (fin 1766), ou lorsqu'il harangue la foule<br />
sur les quais de Douvres (Mai 1767), s'agite comme<br />
un forcené, se barricade dans une cabine de<br />
paquebot. Autre exemple : après son retour en<br />
France, lorsqu'il envoie un tonitruant Mémoire à M.<br />
de Saint-Germain (Février 1770) : Le ministre<br />
Choiseul « a concerté dans le secret l'œuvre de ma<br />
diffamation, m'a fait enlacer de toutes parts par ses<br />
satellites, m'a fait traîner par eux dans la fange, m'a<br />
ren<strong>du</strong> la fable <strong>du</strong> peuple et le jouet de la canaille. Il a<br />
pris soin de faire sortir la haine publique par les<br />
moqueuses caresses <strong>des</strong> fourbes dont il me faisait<br />
entourer et, dernier raffinement, il fait en sorte que<br />
partout les égards et les attentions parussent me<br />
suivre afin que, si j'exhale quelque plainte, j'eusse<br />
l'air d'un homme inquiet » [...]. Suivent <strong>des</strong> pages et<br />
<strong>des</strong> pages de la même encre... Ou bien en Février<br />
1776, lorsqu'il distribue dans la rue, aux promeneurs<br />
parisiens ébahis, une autre déclaration À tous les<br />
Français aimant encore la Justice et la Vérité.<br />
Tels furent les symptômes de la maladie de<br />
Rousseau, ses « maux de vessie et de l'âme », a-t-on<br />
pu dire. Essayons de voir maintenant à quelle<br />
pathologie ils ressortissent, quelle étiquette<br />
nosographique on pourrait leur attribuer.<br />
16<br />
Les hypothèses<br />
Elles sont multiples et proposent <strong>des</strong> diagnostics<br />
très divers. Pour le syndrome urinaire, on a parlé de<br />
malformations congénitales <strong>des</strong> voies excrétoires<br />
(urètre, col de la vessie, phimosis, hypospadias),<br />
d'une maladie prostatique, d'une lithiase rénale<br />
(coliques néphrétiques et complications<br />
mictionnelles). Mais il n'y a jamais eu d'émission de<br />
calcul et l'autopsie pratiquée au lendemain de sa<br />
mort, comme le demandait son testament, a éliminé<br />
tous ces diagnostics, puisqu'elle a montré l'intégrité<br />
absolue de son appareil génito-urinaire, prostate<br />
comprise. L'intégrité anatomique de son appareil<br />
digestif aussi.<br />
Très fiable pourtant, cette autopsie, nous affirme le<br />
professeur Lacassagne (8) , - l'autorité majeure <strong>du</strong><br />
XX e siècle en matière de médecine légale. On n'en a,<br />
en somme, retenu qu'un certain degré<br />
d'hydrocéphalie, c'est-à-dire une augmentation <strong>du</strong><br />
volume <strong>du</strong> liquide céphalo-rachidien dans le crâne<br />
(méninges et ventricules cérébraux). « Apoplexie<br />
séreuse » a-t-on dit (ce qui ne signifie<br />
scientifiquement rien...), conséquence d'une<br />
éventuelle urémie, jamais prouvée. J'attacherais<br />
personnellement plus d'importance au traumatisme<br />
crânien, - bénin dit-on, mais qui avait tout de même<br />
entraîné plusieurs heures d'état confusionnel, - dont<br />
Jean-Jacques avait été victime deux ans avant sa<br />
mort (24 Octobre 1776). Des troubles de résorption<br />
<strong>du</strong> liquide céphalorachidien peuvent survenir ainsi<br />
chez <strong>des</strong> sujets d'un certain âge (Rousseau avait<br />
alors 64 ans), installant silencieusement une<br />
hydrocéphalie à pression normale.<br />
De toute façon, rien à voir avec la pathologie<br />
somatique et mentale de Jean-Jacques, ni avec sa<br />
mort. Curieuse, cette mort, survenue de façon quasisubite,<br />
le 2 Juillet 1778 à Ermenonville. Au retour<br />
d'une promenade matinale, violente crise<br />
douloureuse abdominale, fatigue intense,<br />
dysesthésies corporelles, chute fatale lorsqu'il veut<br />
se lever. Vous imaginez aisément les hypothèses<br />
que, depuis 250 ans, cette mort subite a soulevées :<br />
assassinat, empoisonnement (il venait de prendre<br />
son petit déjeuner), suicide ?, « attaque<br />
cérébrale » ?..., toutes écartées grâce à cette<br />
opportune autopsie. Celle-ci, hélas ! nous dit bien ce<br />
que Rousseau n'avait pas, mais rien de ce dont il a<br />
souffert de son vivant, rien de ce qui l'emporta dans<br />
la tombe.<br />
Mais voilà que, dans les années 1969-70, un<br />
médecin érudit, le Dr David Bensoussan, lit par<br />
hasard un article de deux auteurs britanniques, Ida<br />
Mac Alpine et Richard Hunter, attribuant à une<br />
maladie génétique assez récemment identifiée<br />
(Waldenström, 1937), la Porphyrie Aiguë<br />
Intermittente (P.A.I.), les troubles dont avait jadis<br />
souffert le roi George III d'Angleterre. Frappé par<br />
un certain nombre de concordances entre les<br />
troubles somatiques et psychiques <strong>du</strong> souverain et<br />
ceux constatés chez Jean-Jacques Rousseau, David<br />
Bensoussan se prit à penser qu'ils pouvaient être<br />
atteints <strong>du</strong> même mal.
Parti de cette idée préconçue, il étudie<br />
minutieusement les publications scientifiques<br />
relatives à cette P.A.I., d'une part, les écrits<br />
autobiographiques de Jean-Jacques d'autre part,<br />
souligne certaines coïncidences symptomatiques et<br />
affirme, dans un ouvrage de 140 pages (9) , que ce<br />
diagnostic lève enfin les doutes et apporte une<br />
explication unique tant aux manifestations<br />
somatiques qu'aux troubles psychiques dont<br />
l'écrivain a été atteint. Opinion maintenant adoptée<br />
par beaucoup d'auteurs.<br />
La porphyrie aiguë intermittente, maladie génétique<br />
rare, <strong>du</strong>e à une erreur congénitale <strong>du</strong> métabolisme<br />
<strong>des</strong> porphyrines, - pigments retrouvés dans toutes<br />
les cellules vivantes et qui jouent un rôle<br />
fondamental dans les phénomènes de respiration<br />
cellulaire, - se manifeste cliniquement par de graves<br />
crises aiguës à triple symptomatologie digestive,<br />
neurologique et psychique.<br />
Le syndrome digestif, essentiel, est fait de<br />
violentes douleurs abdominales, assez voisines, -<br />
c'est vrai, - <strong>des</strong> crises présentées par Jean-Jacques,<br />
... sans que ni les unes, ni les autres ne comportent<br />
cependant d'éléments caractéristiques.<br />
Le syndrome neurologique réalise une<br />
neuropathie périphérique, c'est-à-dire une atteinte<br />
<strong>des</strong> racines et <strong>des</strong> nerfs rachidiens entraînant une<br />
paralysie temporaire au niveau <strong>des</strong> membres (<strong>des</strong><br />
membres inférieurs surtout) et, souvent, <strong>des</strong><br />
troubles sphinctériens (rétention d'urine ou<br />
incontinence). Voilà donc qui expliquerait les ennuis<br />
urinaires qui empoisonnèrent la vie de Jean-<br />
Jacques.<br />
Des urologues aussi célèbres que le Pr Alain<br />
Jardin (10) n'en sont pas convaincus. Notre collègue le<br />
Pr André Bérutti ne l'est pas davantage... et je ne<br />
trouve personnellement dans la « pathobiographie »<br />
de Jean-Jacques aucun épisode paralytique franc<br />
susceptible d'affirmer une neuropathie<br />
périphérique. Seulement, quelquefois, un<br />
enraidissement pseudo paralytique <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs, nullement caractéristique, mais qui a été<br />
signalé dans la P.A.I.<br />
Ajoutons que les porphyriques émettent<br />
généralement pendant les crises <strong>des</strong> urines<br />
rougeâtres, virant au noir à la lumière <strong>du</strong> jour.<br />
Jamais Jean-Jacques Rousseau, pourtant si prolixe<br />
lorsqu'il décrit ses troubles urinaires, n'a signalé une<br />
telle coloration. Elle n'a donc certainement jamais<br />
marqué ses urines.<br />
Quant au syndrome mental, en principe<br />
concomitant <strong>des</strong> précédents, il est fait d'anxiété,<br />
d'agitation, d'insomnie et, dans 30 % <strong>des</strong> cas<br />
environ, de manifestations plus graves, mais très<br />
polymorphes : « toute la pathologie psychiatrique<br />
peut être réalisée », écrit Cyril Koupernik (11) . Ça<br />
peut aller de simples troubles névrotiques<br />
(hystériques, hypocondriaques) à <strong>des</strong> états<br />
confusionnels et hallucinatoires, de troubles de<br />
l'humeur à <strong>des</strong> manifestations de type délirant. Oui,<br />
mais Koupernik insiste surtout sur l'évolution par<br />
poussées <strong>des</strong> troubles psychiques de la P.A.I.<br />
17<br />
Ils accompagnent ou suivent les troubles<br />
abdominaux, disparaissent avec les poussées et ne<br />
passent jamais à la chronicité.<br />
On est loin de la pathologie mentale que nous<br />
venons de voir évoluer chez Jean-Jacques :<br />
installation progressive d'interprétations délirantes<br />
qui se systématisent, s'organisent, s'enkystent<br />
définitivement, réalisant une psychose délirante<br />
interprétative chronique, un « syndrome de<br />
Sérieux et Capgras », comme disent les vieux<br />
psychiatres, absolument typique. D'ailleurs, dans<br />
l'ouvrage princeps qu'ils ont consacré à la<br />
<strong>des</strong>cription de cette maladie (1909), ces deux<br />
auteurs détaillaient, sur une quarantaine de pages,<br />
la maladie de Rousseau !<br />
Si la psychopathologie de Jean-Jacques avait été <strong>du</strong>e<br />
à <strong>des</strong> atteintes de P.A.I., - ce qui ne pourra jamais<br />
être prouvé, faute d'arguments chimiques (présence<br />
de dérivés porphyriques dans les urines) et<br />
d'arguments génétiques (enquête familiale)<br />
réalisables, - on eût observé <strong>des</strong> « expériences<br />
délirantes aiguës », soit conscientes, soit<br />
confusionnelles, mais sans séquelles et sans<br />
lendemain, celles que réalisent toujours les<br />
intoxications <strong>du</strong> système nerveux, telle la P.A.I.<br />
Le délire que nous avons vu s'installer chez lui n'a<br />
pas été passif et accidentel, comme dans les<br />
expériences délirantes <strong>des</strong> psychoses toxiques. Il<br />
s'est incorporé à sa personnalité, - une personnalité<br />
bien adaptée par ailleurs à la réalité, comme il est<br />
classique dans le syndrome de Sérieux et Capgras.<br />
Vous l'avez vu, pendant la « grande tourmente »<br />
anglaise, se détendre avec Les Confessions. Pendant<br />
l'apaisement de ses dernières années parisiennes, il<br />
écrira les fameux Dialogues, où « Rousseau juge<br />
Jean-Jacques », puis en 1776-77 les si jolies Rêveries<br />
<strong>du</strong> Promeneur Solitaire.<br />
Notez pourtant que son délire reste très présent<br />
dans les Dialogues (Jacques Borel trouve même que<br />
ce délire est l'objet exclusif de cette œuvre!) ; il reste<br />
présent aussi dans sa correspondance et n'est pas<br />
tout à fait absent <strong>des</strong> Rêveries : Marcel Raymond,<br />
qui les présente dans La Pléiade, y sent « la présence<br />
multitudinaire d'un adversaire invisible qui assiège<br />
son Moi et viendra l'anéantir » (1. p. LXXX V III) .<br />
Mes conclusions<br />
Alors, malade de quoi, Jean-Jacques ?<br />
Certainement d'une psychose délirante chronique<br />
interprétative, un délire de persécution qui évolua<br />
progressivement depuis la fin <strong>des</strong> années cinquante,<br />
sur un fond de fragilité affective et de caractère<br />
paranoïaque. « Un paranoïaque de génie », disait de<br />
lui Jacques Lacan qui l'a si bien campé aux prises<br />
avec « l'AUTRE ». De génie ?... De grand,<br />
d'immense talent, en tout cas, - avec quelle diversité<br />
dans ses intérêts, quel polymorphisme dans ses<br />
mo<strong>des</strong> d'expression verbaux et non verbaux ! Ces<br />
talents multiples ont certainement contribué à la<br />
relative stabilisation de cet écrivain, malgré la<br />
psychopathie sous-jacente.
En même temps, ont évolué chez lui <strong>des</strong> troubles<br />
d'ordre urinaire et d'ordre abdominal, souvent très<br />
invalidants, dont il reste difficile d'affirmer la cause,<br />
malgré les nombreuses étu<strong>des</strong> dont ils ont fait<br />
l'objet. L'éventualité d'une maladie génétique<br />
(méconnue jusqu'au XX e siècle), la porphyrie aiguë<br />
intermittente, est volontiers mise en avant<br />
aujourd'hui, sans qu'aucune démonstration<br />
vraiment convaincante n’ait été apportée. Ce n'est<br />
cependant pas impossible et ça pourrait expliquer sa<br />
mort, au cours d'une crise aiguë de porphyrie. Mais<br />
à mon sens, elle ne serait en tout cas intervenue<br />
dans la psychopathie de Jean-Jacques que pour en<br />
mo<strong>du</strong>ler parfois l'expression clinique, comme l'ont<br />
mo<strong>du</strong>lée aussi les péripéties de sa vie, publique et<br />
privée, assurément riche en avanies réelles !<br />
Voila mon opinion nullement iconoclaste, croyez-le<br />
bien. Que ceux d'entre vous qui admirent en Jean-<br />
Jacques « l'inventeur de la République », - comme<br />
dit Philippe Granarolo, - se rassurent d'ailleurs :<br />
L'Émile et le Contrat Social étaient déjà écrits avant<br />
qu'éclate sa psychose !<br />
18<br />
Ouvrages cités<br />
1-ROUSSEAU J.-J. « Les Confessions », in J.-J.<br />
ROUSSEAU ŒUVRES COMPLÈTES, Gallimard (La<br />
Pléiade), 1959<br />
2-ROUSSEAU J.-J. Correspondance Générale<br />
éditée par Pierre-Paul PLAN, T. XIX p. 47-48 :<br />
Lettre à Madame d'Épinay (1737)<br />
3-BRENOT Ph. Le Génie et la folie en peinture,<br />
musique et littérature. Plon (Paris) 1997, 1 vol. 245<br />
p.<br />
4-VINCENT J.-D. Désir et mélancolie. Les<br />
mémoires apocryphes de Thérèse Rousseau. Odile<br />
Jacob (Paris), 2006, 1 vol. 270 p.<br />
5-RÉGIS E. La Dromomanie de Jean-Jacques<br />
Rousseau. Société Française de Librairie, Paris<br />
(1910)<br />
6-BOREL J. Génie et folie de Jean-Jacques<br />
Rousseau. José Corti (Paris), 1966, 1 vol. 320 p.<br />
7-ORMESSON (J. d'). Une autre histoire de<br />
la littérature française, NIL Éditions (Paris), 1998,<br />
T.2. pp. 75-90<br />
8-LACASSAGNE A. La Mort de Jean-Jacques<br />
Rousseau. REY (Lyon), 1913, 1 vol. 58 p.<br />
9-BENSOUSSAN D. La Maladie de Rousseau, C.<br />
Klinckgieck (Paris) 1974, 1 vol. 140 p.<br />
10-ANDROUTSOS D. et GEROULAN S. « La<br />
Porphyrie aiguë intermittente, une nouvelle<br />
hypothèse pour expliquer les troubles urinaires de<br />
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) » in Progrès en<br />
urologie (2000, 10, pp. 1282-1289). Article suivi <strong>des</strong><br />
commentaires d'Alain Jardin<br />
11-KOUPERNIK C., TOMKIEWICZ S. et BASQUIN<br />
M. « Les Troubles psychiques au cours <strong>des</strong><br />
affections neurologiques et musculaires. » E.M.C.<br />
Psychiatrie (1963), 37670.A.40. Porphyries.
LES CHEMINS DE JEAN-JACQUES<br />
Des « gran<strong>des</strong> randonnées » aux promena<strong>des</strong> solitaires<br />
« Marcher ou écrire, il faut choisir ! ».<br />
Trois siècles après la naissance de Rousseau, dans<br />
une ville <strong>des</strong> États-Unis, écrire (<strong>des</strong> « textos » ou<br />
SMS) en marchant dans la rue est considéré, en<br />
raison <strong>du</strong> risque d’accident encouru par les piétons,<br />
comme une infraction passible d’une amende de 85<br />
dollars. Voici ce qui aurait pu menacer Montaigne<br />
qui écrivait dans son Journal de voyage « Il faut<br />
que j’aille de la plume comme de mes pieds »<br />
Jean-Jacques, lui, n’écrivait pas en marchant. Il<br />
rêvait lors de ses promena<strong>des</strong> solitaires, même s’il<br />
lui arrivait de jeter quelques notes sur le recto ou le<br />
verso de cartes à jouer (27 au<br />
total), brouillon ou aidemémoire<br />
lors de l’écriture <strong>des</strong><br />
Rêveries.<br />
Il fut cependant le 24 octobre<br />
1776 victime d’un accident de<br />
la circulation provoqué par<br />
« un gros chien danois qui<br />
s’élançant à toutes jambes<br />
devant un carrosse, écrit-il<br />
dans la Deuxième promenade<br />
<strong>des</strong> Rêveries (2) , n’eut même<br />
pas le temps de retenir sa<br />
course ou de se détourner<br />
quand il m’aperçut. »<br />
Rêveur en marche, errant<br />
infirme, persécuté<br />
migrateur ! Jean-Jacques a-til<br />
été tout cela ?<br />
Je préfère le « grand<br />
déambulateur pé<strong>des</strong>tre »<br />
dont il est question dans la<br />
première édition <strong>du</strong> Grand<br />
Larousse parue en 1875 (12).<br />
À cette première approche s’ajoutent les lignes<br />
suivantes : «Malgré le manque de moyens de<br />
<strong>communications</strong> faciles, le XVIII e siècle, a vu Jean-<br />
Jacques Rousseau donner le premier exemple aux<br />
touristes par ses longs voyages pé<strong>des</strong>tres en Suisse<br />
et en Italie, qu’il accomplissait le sac sur le dos et le<br />
bâton à la main, se nourrissant de pain bis, de<br />
laitage et de cerises, en véritable enfant de la<br />
nature. »<br />
Au XIX e siècle l’écrivain et alpiniste anglais Leslie<br />
Stephen qui faisait <strong>des</strong> Alpes « le terrain de jeux de<br />
l’Europe » n’hésitait pas à appeler Rousseau « le<br />
Christophe Colomb <strong>des</strong> Alpes », ou encore « le<br />
Luther <strong>du</strong> nouveau credo de la montagne » (12) .<br />
André BÉRUTTI<br />
19<br />
M’éloignant de ces formules grandiloquentes et<br />
injustifiées, je retiendrai plutôt la sobriété plus<br />
évocatrice de trois titres : La Marche à la gloire<br />
selon Raymond Trousson (7) , Le Chemin de Jean-<br />
Jacques Rousseau selon Pierre Corajoud (3) , ou<br />
encore Rousseau, une pensée en marche, titre d’une<br />
lecture-spectacle programmée à l’occasion <strong>du</strong><br />
tricentenaire.<br />
Les premiers pas de Jean-Jacques ne sont pas ceux<br />
qu’il fit comme tous les jeunes enfants un an après<br />
sa naissance, dont il dira que ce fut le premier de ses<br />
malheurs, mais ceux qu’il fit le 14 mars 1728.<br />
Ce jour là, à l’issue de sa<br />
promenade dominicale dans<br />
la campagne genevoise le<br />
jeune homme qui n’avait pas<br />
encore seize ans, accompagné<br />
de deux camara<strong>des</strong>, voit les<br />
portes de la ville se fermer.<br />
Cette mésaventure est la<br />
troisième, les deux premières<br />
ayant été sanctionnées par<br />
une correction administrée<br />
par Abel Ducommun, son<br />
maître graveur chez qui il<br />
était en apprentissage depuis<br />
trois ans. Jean-Jacques<br />
redoute le père tape <strong>du</strong>r et,<br />
après une nuit passée à la<br />
belle étoile décide de ne pas<br />
retourner à Genève. Son<br />
cousin Abraham, prévenu de<br />
cette décision lui offre de<br />
menus présents dont une<br />
épée. Sait-on jamais !<br />
Après avoir erré deux ou trois jours autour de la<br />
ville, Jean-Jacques se décide à aller jusqu’à<br />
Confignon, à deux lieues de Genève, où il connaît le<br />
curé Benoît de Pontverre, spécialisé dans la<br />
conversion <strong>des</strong> protestants, ayant une véritable<br />
« aversion pour l’idolâtrie papiste ». Muni d’un<br />
billet de recommandation, le jeune fugueur arrive à<br />
Annecy le 21 mars, jour <strong>des</strong> Rameaux, les Pâques<br />
fleuries, pour rencontrer celle qu’il appellera<br />
« Maman », et pour laquelle il sera « Petit »,<br />
Françoise Louise de Warens : « un visage pétri de<br />
grâces, de beaux yeux pleins de douceur, un teint<br />
éblouissant, le contour d’une gorge enchanteresse ».<br />
Après trois jours passés auprès d’elle, Jean-Jacques<br />
quitte à regret Madame de Warens qui l’envoie à<br />
Turin rejoindre le couvent <strong>des</strong> catéchumènes où il<br />
sera baptisé. Il est accompagné de M. et Mme<br />
Sabran : « Si jeune, aller en Italie, avoir déjà vu tant
de pays, suivre Annibal au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong> monts, me<br />
paraissait une gloire au <strong>des</strong>sus de mon âge. » écrit-il<br />
dans le Livre second <strong>des</strong> Confessions, et plus loin :<br />
« Je ne me souviens pas d’avoir eu dans tout le cours<br />
de ma vie, d’intervalle plus parfaitement exempt de<br />
soucis et de peine que celui de ces sept ou huit jours<br />
que nous mîmes à ce voyage… Je n’ai voyagé à pied<br />
que dans mes beaux jours et toujours avec délices. »<br />
Remarquons que ce premier voyage, d’Annecy à<br />
Turin, ne se fit pas en solitaire, et que le pas de<br />
Madame Sabran sur lequel son mari et Jean-<br />
Jacques <strong>du</strong>rent régler le leur, « n’en fit qu’une<br />
longue promenade ».<br />
La relation succincte de ce voyage initiatique (Jean-<br />
Jacques est converti à la religion catholique et<br />
baptisé, il rencontre celle qui sera l’amour de sa vie,<br />
et je passe sur les initiations qu’une grande ville<br />
comme Turin peut offrir), cette relation donc<br />
appelle trois remarques :<br />
- Jean-Jacques Rousseau annonce son goût pour les<br />
voyages pé<strong>des</strong>tres, ce que nous appellerions<br />
aujourd’hui les gran<strong>des</strong> randonnées, surtout ceux<br />
qui à trois reprises vont le ramener auprès de<br />
« Maman ». Il se contredit d’ailleurs dans Les<br />
Confessions (Livre second) lorsqu’il écrit qu’étant<br />
obligé plus tard de prendre <strong>des</strong> voitures : « dès lors,<br />
au lieu qu’auparavant dans mes voyages (à pied), je<br />
ne sentais que le plaisir d’aller, je n’ai plus senti que<br />
le besoin d’arriver. »<br />
« Ce souvenir m’a laissé le goût le plus vif pour tout<br />
ce qui s’y rapporte, surtout pour les montagnes et<br />
pour les voyages pé<strong>des</strong>tres. » (Les Confessions.<br />
Livre second).<br />
- S’il apprécie les voyages pé<strong>des</strong>tres, avait-il alors les<br />
moyens financiers de voyager en chaise ou en<br />
voiture? Ces moyens, il ne les avait pas, mais plus<br />
tard il écrira : « Quand on m’offrait quelque place<br />
vide dans une voiture, ou que quelqu’un m’accostait<br />
en route, je rechignais de voir renverser la fortune<br />
dont je bâtissais l’édifice en marchant ».<br />
- Il ne voyage pas seul, ce qui l’éloigne <strong>du</strong> futur<br />
promeneur solitaire. Le pécule offert par Mme de<br />
Warens est confié aux époux Sabran dont il est<br />
dépendant, et la sémillante Mme Sabran, « assez<br />
bonne femme plus tranquille le jour que la nuit » ne<br />
le laisse pas indifférent.<br />
Après un séjour de trois mois à Turin, Jean-Jacques<br />
prendra le chemin <strong>du</strong> retour accompagné de Pierre<br />
Bâcle, un camarade d’apprentissage genevois qui a<br />
suivi le même parcours que lui, et dont il se<br />
débarrasse en arrivant à Annecy : Madame de<br />
Warens l’attend!<br />
Plus tard, se souvenant de ce voyage, il écrira dans<br />
le Livre II <strong>des</strong> Confessions : « J’ai cherché<br />
longtemps, à Paris, deux camara<strong>des</strong> de même goût<br />
que moi, qui voulussent consacrer chacun cinquante<br />
louis de sa bourse et un an de son temps à faire<br />
ensemble, à pied, le tour de l’Italie… ». Et il<br />
ajoutera: « L’idée d’un grand voyage flattait ma<br />
manie ambulante qui déjà commençait à se<br />
déclarer. »<br />
20<br />
De plus, ce long voyage sur les routes de Savoie et<br />
d’Italie peut être considéré, avec ceux qui suivront,<br />
comme le début <strong>des</strong> « universités » d’un Jean-<br />
Jacques débutant sa vie consciente en contact direct<br />
avec le peuple.<br />
D’autres voyages pé<strong>des</strong>tres suivront en effet. Tout<br />
d’abord de Lyon à Annecy, après qu’il eut<br />
abandonné à une crise d’épilepsie le pauvre M.<br />
Lemaître, maître <strong>du</strong> chapitre de la cathédrale<br />
d’Annecy à qui Mme de Warens l’a confié. Personne<br />
à son arrivée chez « Maman » ! Il fréquente sa<br />
femme de chambre, Anne-Marie Merceret qui ne<br />
voyant pas revenir sa maîtresse veut rejoindre sa<br />
famille à Fribourg. La voici partie à petites étapes<br />
accompagnée de Jean-Jacques, dont elle assure la<br />
subsistance. Le couple passe à Genève, puis Jean-<br />
Jacques rend visite à son « bon père » à Nyon.<br />
Après avoir remis Anne-Marie entre les mains de<br />
son père à Fribourg, notre futur promeneur,<br />
jusqu’ici pas si solitaire que cela, se lance, écrira-t-il,<br />
« dans les plus gran<strong>des</strong> extravagances de sa vie », un<br />
périple sans but, vivant comme il peut en<br />
« enseignant à <strong>des</strong> écolières la musique qu’il ne sait<br />
pas ».<br />
En novembre 1730, il part à Lausanne, puis vers<br />
Neuchâtel dans un long vagabondage en pays<br />
protestant qui aurait bien déplu à Mme de Warens à<br />
laquelle il pense en allant visiter Vevey, sa ville<br />
natale.<br />
Début avril 1731 Jean-Jacques rencontre dans une<br />
taverne de Boudry, près de Neuchâtel, Athanasius<br />
Paulus, faux archimandrite <strong>des</strong> saints Pierre-et-<br />
Paul-de-Jérusalem, mais véritable escroc avec qui<br />
notre jeune homme s’acoquine pour obtenir <strong>des</strong><br />
subsi<strong>des</strong> <strong>des</strong>tinés à racheter <strong>des</strong> esclaves chrétiens<br />
ou à restaurer le Saint-Sépulcre. Dérogeant à ses<br />
habitu<strong>des</strong>, et disposant d’un moyen de locomotion<br />
fourni par son protecteur, Jean-Jacques, engagé<br />
comme interprète, part à cheval. La pitance étant<br />
assurée par les dons, les deux complices<br />
commencent leur tournée en allant à Fribourg, puis<br />
Berne jusqu’à ce que le saint homme soit démasqué<br />
à Soleure. Prenant goût à la solitude, Jean-Jacques<br />
reprend seul sa marche pour retourner à Neuchâtel,<br />
puis revenir à Soleure.<br />
De là, ayant obtenu la promesse d’une place à Paris,<br />
notre fougueux jeune homme reprend la route à<br />
pied, fidèle à ce qu’il écrira dans L’Émile : « Je ne<br />
conçois qu’une manière plus agréable que d’aller à<br />
cheval, c’est d’aller à pied ! On part à son temps, on<br />
s’arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d’exercice<br />
qu’on veut. »<br />
Ce voyage de Soleure à Paris a laissé à Jean-Jacques<br />
un souvenir inoubliable : « Je mis à ce voyage une<br />
quinzaine de jours, que je peux compter parmi les<br />
plus heureux de ma vie. J’étais jeune, je me portais<br />
bien, j’avais assez d’argent, beaucoup d’espérance, je<br />
voyageais, je voyageais à pied et je voyageais seul…<br />
Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant<br />
été moi, si j’ose ainsi dire, que dans les voyages que<br />
j’ai fait seul et à pied. »
La capitale dont il attendait tant lui paraît sinistre,<br />
la place qui aurait fait de lui un général (il en rêvait)<br />
n’est qu’une place de laquais. Il prend le chemin <strong>du</strong><br />
retour vers Maman qui est à Chambéry.<br />
Pas si pressé que cela de la revoir, et n’étant pas sûr<br />
de la trouver, voici qu’il envisage de faire un détour<br />
par le Forez pour voir sur les bords <strong>du</strong> Lignon les<br />
lieux où se déroule L’Astrée, le roman fleuve<br />
d’Honoré d’Urfé, une <strong>des</strong> lectures faites par son<br />
père, qui ont enchanté son enfance. Il y renonce en<br />
apprenant « que c’était un bon pays de ressource<br />
pour les ouvriers, qu’il y avait beaucoup de forges et<br />
qu’on y travaillait fort bien en fer ».<br />
Poursuivant sa route il s’arrête à Lyon sept à huit<br />
jours, écrit-il « pour attendre les commissions dont<br />
Maman avait chargé Mlle <strong>du</strong> Châtelet ».<br />
Cette dernière propose à Jean-Jacques de<br />
poursuivre son chemin à cheval : « je n’y pus<br />
consentir, et j’eus raison : j’aurais per<strong>du</strong> le plaisir <strong>du</strong><br />
dernier voyage pé<strong>des</strong>tre que j’ai fait en ma vie ; car<br />
je ne peux donner ce nom aux excursions que je<br />
faisais souvent à mon voisinage quand je demeurais<br />
à Moutiers.»<br />
Cet ultime voyage qui se situe à l’automne 1731 a fait<br />
aussi découvrir à Jean-Jacques les charmes de la<br />
marche solitaire, il goûtera plus tard avec Mme de<br />
Warens à la solitude à deux, ce que les romantiques<br />
allemands appelleront die Zweisammkeit : « Nous<br />
partîmes ensemble et seuls de bon matin, après la<br />
messe… J’avais proposé d’aller parcourir la côte<br />
opposée à celle où nous étions, et que nous n’avions<br />
pas visitée encore… La course devait <strong>du</strong>rer tout le<br />
jour. Maman, quoiqu’un peu ronde et grasse, ne<br />
marchait pas mal : nous allions de colline en colline<br />
et de bois en bois, quelquefois au soleil et souvent à<br />
l’ombre. » (Les Confessions. Livre sixième).<br />
Ainsi, aux voyages succède le vagabondage,<br />
con<strong>du</strong>isant à la promenade, les trois mo<strong>des</strong> de<br />
déplacement classiques selon Normand Doiron (13) .<br />
Les Confessions contiennent la <strong>des</strong>cription de<br />
quelques promena<strong>des</strong>, et dans le Livre huitième, le<br />
récit d’une marche bien particulière qui à la fin de<br />
l’été 1749 con<strong>du</strong>isait régulièrement Jean-Jacques de<br />
son domicile parisien jusqu’au château de<br />
Vincennes où Diderot, qui était encore son ami, était<br />
emprisonné pour avoir remis en question la bonté<br />
divine dans sa Lettre sur les aveugles. Là c’est par<br />
nécessité avouée que le trajet de 10 kilomètres<br />
environ est fait à pied : il n’a pas les moyens de<br />
payer un fiacre. Ce n’est pas une promenade, mais<br />
une sorte de marche forcée : « Les arbres de la<br />
route, toujours élagués, à la mode <strong>du</strong> pays, ne<br />
donnaient presque aucune ombre, et souvent ren<strong>du</strong><br />
de chaleur et de fatigue, je m’étendais par terre n’en<br />
pouvant plus. Je m’avisai, pour modérer mon pas,<br />
de prendre quelque livre. Je pris un jour le Mercure<br />
de France, et tout en marchant et le parcourant, je<br />
tombai sur cette question proposée par l’académie<br />
de Dijon pour le prix de l’année suivante : Si le<br />
progrès <strong>des</strong> sciences et <strong>des</strong> arts a contribué à<br />
corrompre ou épurer les mœurs. À l’instant de cette<br />
lecture je vis un autre univers, et je devins un autre<br />
homme.» Illumination ou insolation, ou les deux ?<br />
21<br />
Cette marche permit à Jean-Jacques de rédiger et<br />
publier le discours qui en 1750 lui vaudra le premier<br />
prix de l’académie de Dijon et marquera le début de<br />
sa gloire et sa véritable entrée en littérature, à près<br />
de 40 ans.<br />
Dans Rêveries <strong>du</strong> promeneur solitaire (2) , dont la<br />
marche est le prétexte plus que le sujet, divisé en dix<br />
chapitres portant le titre de Promena<strong>des</strong>, Jean-<br />
Jacques relate (Deuxième promenade) la plus<br />
emblématique :« Le jeudi 24 octobre 1776 je suivis<br />
après dîner (déjeuner) les boulevards jusqu’à la rue<br />
<strong>du</strong> chemin vert par laquelle je gagnai les hauteurs<br />
de Ménilmontant, et de là prenant les sentiers à<br />
travers les vignes et les prairies, je traversai jusqu’à<br />
Charonne le riant paysage qui sépare ces deux<br />
villages, puis je fis un détour pour revenir par les<br />
mêmes prairies en prenant un autre chemin. Je<br />
m’amusais à les parcourir avec ce plaisir et cet<br />
intérêt que m’ont toujours donné les sites agréables,<br />
et m’arrêtant quelquefois à fixer <strong>des</strong> plantes dans la<br />
ver<strong>du</strong>re… »<br />
La promenade rousseauiste est tout entière dans ces<br />
quelques lignes :<br />
- Rousseau ne conçoit la promenade que solitaire et<br />
annonce sa profonde solitude dans l’incipit <strong>des</strong><br />
Rêveries : « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant<br />
plus de frère, de prochain, d’ami de société que moimême…<br />
»<br />
- Il fait route à pied, ne dépendant ainsi de<br />
personne.<br />
- Il suit un chemin ou un sentier, mais il n’hésite pas<br />
à faire <strong>des</strong> détours pour aller où son plaisir le mène.<br />
- Sa promenade se fait en campagne où il peut<br />
herboriser.<br />
-Elle est source inépuisable de rêverie et de<br />
réflexion, parfois d’extase : « La marche a quelque<br />
chose qui anime et avive mes idées ; je ne puis<br />
presque penser quand je suis en place ; il faut que<br />
mon corps soit en branle pour y mettre mon<br />
esprit. »<br />
C’est per<strong>du</strong> dans ses rêveries au retour de cette<br />
promenade d’octobre 1776 que Rousseau est victime<br />
de l’accident évoqué au début. Lorsqu’il reprend ses<br />
esprits, bien que blessé, il préfère continuer son<br />
chemin à pied, <strong>du</strong> Temple à la rue Plâtrière, devenue<br />
rue Jean-Jacques Rousseau, respectant ce qu’il dit<br />
être l’unique « règle de con<strong>du</strong>ite de ses dernières<br />
années : suivre en tout son penchant sans<br />
contrainte. »<br />
C’est sur son dernier chemin, que deux années plus<br />
tard, à Ermenonville, le 2 juillet 1778, Jean-Jacques<br />
rentre prématurément d’une promenade entre le<br />
pavillon que le marquis de Girardin a mis à sa<br />
disposition et le château. Il s’écroule, mort, à 10<br />
heures <strong>du</strong> matin.<br />
Ainsi Jean-Jacques Rousseau a parcouru lors de ses<br />
voyages pé<strong>des</strong>tres de 1728 à 1731 <strong>des</strong> milliers de
kilomètres, pour terminer par sa plus belle<br />
randonnée, de Paris à Annecy.<br />
Par la suite il a fait en Savoie et Haute-Savoie<br />
d’innombrables excursions et promena<strong>des</strong>,<br />
devenant un <strong>des</strong> « écrivains marcheurs » les plus<br />
célèbres, la plume dans la main droite, le bâton dans<br />
la gauche.<br />
À l’issue de cette communication, posons-nous deux<br />
questions.<br />
La « manie ambulante » dont parlait Rousseau,<br />
correspond-t-elle à cette « dromomanie », affection<br />
psychiatrique caractérisée par une impulsion<br />
irrésistible à marcher ou à courir, véritable<br />
automatisme ambulatoire ? Alors mon goût de la<br />
marche ferait-il de moi un dromomaniaque ? Le<br />
professeur Navarranne a abordé ce sujet dans les<br />
pas (encore la marche!) de son maître le professeur<br />
Régis !<br />
Jean-Jacques, « philosophe marcheur », était-il un<br />
péripatéticien, <strong>des</strong>cendant <strong>des</strong> élèves d’Aristote qui<br />
déambulaient en conversant et en philosophant ?<br />
En accolant l’adjectif solitaire au mot promeneur,<br />
Rousseau s’écarte de la tradition antique qui faisait<br />
de la promenade une activité liée à la conversation.<br />
Rousseau se promène avec son âme : « Livrons nous<br />
tout entier à la douceur de converser avec mon<br />
âme» écrit-il dans la Première promenade.<br />
Il se promène aussi avec son lecteur à qui il ouvre<br />
son cœur : « Je veux que tout le monde lise dans<br />
mon cœur », entretenant avec lui une amitié, une<br />
confiance, une complicité qui ressemblent à celles<br />
qui naissent entre les marcheurs, qui, au bout de<br />
quelques heures n’hésitent pas à tisser avec <strong>des</strong><br />
inconnus <strong>des</strong> liens très serrés et <strong>du</strong>rables. Tous les<br />
marcheurs au long cours et tous les pèlerins ont<br />
éprouvé cette belle sensation sur tous les chemins.<br />
En route vers Turin avec le couple Sabran<br />
22<br />
Jean-Jacques va bien au-delà de l’exercice de la<br />
marche. À la boutade de Michel Audiard dans Un<br />
taxi pour Tobrouk, « Un intellectuel assis va moins<br />
loin qu’une brute qui marche », il pourrait répliquer<br />
qu’un intellectuel qui marche ira toujours plus loin<br />
que la même brute, la brute qu’est devenu pour<br />
Rousseau, selon Frédéric Gros (16) , « l’homme<br />
civilisé, saturé de politesses et d’hypocrisies, rempli<br />
de méchancetés et d’envies ».<br />
En définitive ce n’est pas déboulonner Jean-Jacques<br />
de son pié<strong>des</strong>tal comme cela fut fait en 1913 pour<br />
<strong>des</strong> raisons idéologiques, ni minimiser son talent<br />
que de dire qu’il était un marcheur « ordinaire »,<br />
pour qui marcher était le symbole de la liberté et de<br />
l’indépendance, l’emblème de la vie simple et un<br />
moyen de rester au contact de la nature et<br />
d’échapper à la société. La marche était pour lui,<br />
comme, pour beaucoup d’autres, un exercice de<br />
simplicité, un mode de réflexion et de<br />
contemplation de la nature dont il a fourni <strong>des</strong><br />
<strong>des</strong>criptions inoubliables.<br />
Ré<strong>du</strong>ire la marche selon Rousseau aux proportions<br />
d’une moderne randonnée, ses sentiments et ses<br />
rêveries à ceux éprouvés par un randonneur <strong>du</strong> XXI e<br />
siècle peut certes paraître à la fois présomptueux et<br />
simpliste. Mais c’est là aussi que siège la modernité<br />
de Rousseau, bien que le recours à la lenteur de la<br />
marche soit aux antipo<strong>des</strong> de la modernité dans un<br />
monde voué à la vitesse. Et quand bien-même Jean-<br />
Jacques perdrait quelques plumes dans ce<br />
rapprochement, l’essentiel n’est-il pas qu’il<br />
conserve dans la main celle qui lui a permis de nous<br />
offrir une sorte de profession de foi à l’usage <strong>des</strong><br />
marcheurs ?<br />
«J’aime à marcher à mon aise, et m’arrêter quand il<br />
me plaît. La vie ambulante est celle qu’il me<br />
faut. Faire route à pied par un beau temps, dans un<br />
beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de<br />
ma course un objet agréable : voila de toutes les<br />
manières de vivre celle qui est la plus de mon goût. »<br />
(Les Confessions)
Œuvres de Jean-Jacques Rousseau<br />
1-Les Confessions, Folio classique. 2776. 2012<br />
2-Rêveries <strong>du</strong> promeneur solitaire, Le Livre de<br />
poche classique. 16099. 2001<br />
Sur Jean-Jacques Rousseau<br />
3-CORAJOUD Pierre, Le Chemin de Jean-Jacques.<br />
Lausanne. 2012<br />
4-HILDEBRAND Rémy, Il était une fois Jean-<br />
Jacques Rousseau. L’Archipel. 2012<br />
5-LAGARDE et MICHARD. XVIII e siècle, Bordas.<br />
1961<br />
6-TROUSSON Raymond, Jean-Jacques Rousseau.<br />
Hachette. 1993<br />
7-TROUSSON Raymond,. Jean-Jacques Rousseau.<br />
I. La marche à la gloire, Paris, Tallandier, 1988.<br />
8-Une vie, une œuvre, Jean-Jacques Rousseau le<br />
subversif. Hors série Le Monde. 2012<br />
9-Voltaire contre Rousseau, Le Point références.<br />
Mai juin 2012<br />
10-Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Actes<br />
sud/Fondation Facim. 2012<br />
Ouvrages consultés<br />
23<br />
Sur la marche<br />
11-BAROZZI Jacques, Le goût de la marche.<br />
Mercure de France. 2008<br />
12-BOYER Marc, Histoire de l’invention <strong>du</strong><br />
tourisme. XVI e -XIX e siècles. L’aube. 2000<br />
13-DOIRON Normand, L’Art de voyager. Pour une<br />
définition <strong>du</strong> récit de voyage à l’époque classique.<br />
Presses de l’Université Laval. 1995<br />
14-FISSET Émeric, L’ivresse de la marche.<br />
Transboréa<br />
15-GROS Frédéric, Petite bibliothèque <strong>du</strong> marcheur.<br />
Flammarion. 2011<br />
16-GROS Frédéric, Marcher, une philosophie.<br />
Flammarion. 2011<br />
17-JOURDAN Michel et VIGNE Jacques, Marcher,<br />
méditer. Albin Michel. 1998<br />
18-LACARRIÈRE Jacques, Chemin Faisant. Fayard.<br />
1997<br />
19-LEBRETON David, Éloge de la marche.<br />
Métailié. 2000<br />
20-MICHEL Franck, Voyage au bout de la route.<br />
L’Aube. 2004<br />
21-PACCALET Yves, Le Bonheur en marchant. J. C.<br />
Lattès. 2000<br />
22-SOLNIT Rebecca, L’Art de marcher. Actes sud.<br />
2004<br />
23-TESSON Sylvain, Petit traité sur l’immensité <strong>du</strong><br />
monde. Équateurs. 2005
Profession de foi <strong>du</strong> vicaire savoyard<br />
24
« Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux Enfants-<br />
Trouvés ! J'ai chargé de leur entretien<br />
l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes<br />
maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher,<br />
c'est un malheur dont il faut me plaindre, et non un<br />
crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance, je<br />
la leur ai procurée meilleure ou<br />
plus sûre au moins que je<br />
n'aurais pu la leur donner moimême.<br />
Depuis plusieurs années le<br />
remords de cette négligence<br />
trouble mon repos et je meurs<br />
sans pouvoir la réparer au<br />
grand regret de la mère et au<br />
mien. »<br />
Rousseau écrit cette lettre le 20<br />
avril 1751 à son amie Mme<br />
Dupin de Francueil, la future<br />
grand-mère de George Sand. Il<br />
y évoque les enfants qu’il a eus<br />
avec Thérèse Levasseur.<br />
Jean-Jacques avait trente-trois<br />
ans, soit neuf ans de plus que<br />
Thérèse, lorsqu’il la rencontra à<br />
Paris, en 1745. Elle était<br />
lingère, dans un petit hôtel<br />
garni, que Rousseau<br />
fréquentait. Dans les<br />
Confessions, il brosse un<br />
tableau sans concession de<br />
celle qui fut pendant trente-trois ans sa compagne<br />
« II est vrai que cette personne si bornée, si stupide<br />
en apparence, était d’excellent conseil, sensée et<br />
affectueuse…Elle avait un caractère pur, excellent,<br />
sans malice, digne de toute mon estime. »<br />
Rousseau a donc eu de Thérèse, cinq enfants, nés<br />
entre 1747 et 1755. Il précise que ce fut lui et la mère<br />
de Thérèse, une femme dominatrice, qui décidèrent<br />
leur placement aux Enfants-Trouvés. Certains de ses<br />
amis prétendirent que Rousseau n’était pas le père<br />
<strong>des</strong> enfants de Thérèse, d’autant qu’on peut lire dans<br />
l’Émile : « Celui qui ne peut remplir les devoirs de<br />
père n’a point droit de le devenir. Il n’y a ni pauvreté<br />
ni travaux ni respect humain qui le dispensent de<br />
nourrir ses enfants, et de les élever lui-même.<br />
Lecteurs, vous pouvez m’en croire. Je prédis à<br />
quiconque a <strong>des</strong> entrailles et néglige de si saints<br />
devoirs qu’il versera longtemps sur sa faute <strong>des</strong><br />
larmes amères, et n’en sera jamais consolé » Faut-il<br />
voir là un aveu douloureux ? Si c’est le cas il s’agirait<br />
d’une étonnante contradiction de la part de l’auteur.<br />
L’ÉMILE : UNE PÉDAGOGIE NOVATRICE<br />
Monique BROUSSAIS<br />
25<br />
Rousseau et son projet<br />
Connaissant cet épisode de la vie de Rousseau, il est<br />
en effet difficile de comprendre voire d’admettre<br />
comment cet homme ayant abandonné cinq enfants<br />
a pu se pencher sur le thème<br />
de l’é<strong>du</strong>cation. C’est à l’âge<br />
de 50 ans, que Rousseau<br />
publie Émile ou De<br />
l’É<strong>du</strong>cation. Ce traité ne peut<br />
qu’inviter à se poser <strong>des</strong><br />
questions : est-il une façon<br />
de se racheter, un repentir<br />
sincère ? Rousseau répond :<br />
« Je n’écris pas pour excuser<br />
mes fautes mais pour<br />
empêcher mes lecteurs de les<br />
imiter ».<br />
À cette époque, les<br />
ouvrages sur l’é<strong>du</strong>cation ne<br />
sont pas rares. Depuis<br />
l’Antiquité, de nombreux<br />
écrits concernent ce thème et<br />
Rousseau, grand lecteur <strong>des</strong><br />
anciens, s'est nourri, par<br />
exemple, de La République,<br />
de Platon, dont il dira que<br />
« c’est le plus beau traité<br />
d’é<strong>du</strong>cation qu’on ait jamais<br />
fait ». Il n’en oublie pas<br />
moins Aristote, Plutarque<br />
mais aussi les moralistes,<br />
Cicéron, Sénèque et Epictète.<br />
Au XVIII e siècle, les écoles ne manquaient pas, mais<br />
l’instruction faisait défaut dans beaucoup de<br />
familles. La moitié <strong>des</strong> hommes savaient écrire et<br />
signer de leur nom, les femmes étaient moins<br />
nombreuses. Alors que, depuis le Moyen-âge, les<br />
é<strong>du</strong>cateurs s’efforcent d’inculquer une hygiène<br />
mentale abstraite dont la croyance religieuse fait<br />
partie intégrante, Rousseau, dans son ouvrage,<br />
ouvre toutes gran<strong>des</strong> les portes à la nature, au<br />
monde extérieur, aux choses de la science.<br />
Rabelais et Montaigne avaient déjà pensé aux<br />
valeurs d’une telle méthode. Rousseau la précise en<br />
laissant son Émile à l’école de l’initiative et, nous<br />
oserons dire, de la débrouillardise. Il développe ses<br />
théories qui découlent étroitement de ses opinions<br />
sur la société et sur l’homme exposées dans Le<br />
Contrat Social et Les Confessions. Rousseau définit<br />
le thème de son traité par une phrase audacieuse et<br />
lapidaire : « L’art de former les hommes ». Il va<br />
donc mettre dans ce long texte toutes ses
compétences, sa passion, sa foi, son savoir, le<br />
résultat de ses observations, afin d’unifier la<br />
démarche philosophique, la recherche<br />
anthropologique et le parcours spirituel que lui<br />
inspire son Émile. Il sait fort bien que vouloir parler<br />
d’é<strong>du</strong>cation est indissociable de l’étude de la<br />
conception de l’être humain. Il veut « laisser mûrir<br />
les enfants dans les enfants » à l’abri <strong>du</strong> monde<br />
corrompu <strong>des</strong> a<strong>du</strong>ltes.<br />
Le choix <strong>du</strong> prénom Émile n’est peut être pas<br />
anodin, quand on sait que c’est le nom d'une grande<br />
famille romaine, la gens Aemiliana, qui s’est<br />
illustrée en nous laissant de nombreux hommes<br />
politiques sur plusieurs siècles. On attribue aux<br />
Émile ambition, rivalité et désir de gloire.<br />
Le contenu de l’ouvrage<br />
Émile ou De l'E<strong>du</strong>cation est un traité qui, pour le<br />
lecteur <strong>du</strong> XXI e siècle, peut paraître ingrat et<br />
fastidieux. Dans la forme, Rousseau veut persuader<br />
de la justesse de son écrit. Pour mieux convaincre<br />
ses lecteurs, il s'appuie sur le « Je » : « je dis que »,<br />
« je demande », et aussi sur le « vous » pour<br />
impliquer le <strong>des</strong>tinataire. Alors qu’il aurait pu se<br />
contenter d’écrire un long monologue, il intro<strong>du</strong>it<br />
avec subtilité quelques dialogues afin de rompre la<br />
monotonie. L’ouvrage est composé de cinq livres<br />
retraçant les étapes chronologiques d’un<br />
programme é<strong>du</strong>catif dont Rousseau considère que<br />
l’homme a véritablement besoin, comme le<br />
suggèrent ces phrases :<br />
« Nous naissons faibles, nous avons besoin de<br />
forces; nous naissons dépourvus de tout, nous avons<br />
besoin d’assistance ; nous naissons stupi<strong>des</strong>, nous<br />
avons besoin de jugement. Tout ce que nous n’avons<br />
pas à notre naissance et dont nous avons besoin<br />
étant grand nous est donné par l’é<strong>du</strong>cation. »<br />
Pour son essai, Rousseau part <strong>du</strong> principe que :<br />
« Tout est bien, sortant <strong>des</strong> mains de l’Auteur <strong>des</strong><br />
choses ; tout dégénère entre les mains de l’homme».<br />
Il faut donc protéger l'enfant contre l'influence<br />
néfaste de la civilisation. « Vivre est le métier que je<br />
veux lui apprendre. En sortant de mes mains, il ne<br />
sera, j’en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre :<br />
il sera premièrement homme. »<br />
Le livre I est consacré à la première enfance. Émile<br />
ne parle pas encore. Les gestes les plus simples de la<br />
mère nourricière contribuent au développement<br />
physique de cet enfant et à la découverte <strong>des</strong> toutes<br />
premières impressions et sensations. « C’est à toi<br />
que je m’adresse tendre et prévoyante mère qui sut<br />
garantir l’arbrisseau naissant <strong>du</strong> choc <strong>des</strong> opinions<br />
humaines ! Cultive, arrose la jeune plante avant<br />
qu’elle meure ; ses fruits feront un jour tes délices.<br />
Forme de bonne heure une enceinte autour de l’âme<br />
de ton enfant : un autre peut en marquer le circuit ;<br />
mais toi seule y dois poser la barrière. » Il faut donc<br />
laisser à Émile le droit naturel de se développer<br />
librement, comme y invite le texte : « Ne<br />
l'enveloppez donc pas dans un maillot, allaitez-le<br />
avec le lait de sa mère, ne le dorlotez pas, laissez le<br />
26<br />
suivre son instinct de conservation et faire lui-même<br />
ses expériences, ne l'instruisez pas de ce qu'il peut<br />
apprendre lui-même, ne lui faites pas de sermons,<br />
n'excitez pas en lui <strong>des</strong> désirs et <strong>des</strong> besoins avant<br />
qu'ils ne puissent être satisfaits. »<br />
Afin de donner libre cours à ses réflexions<br />
pédagogiques et à ses applications, l’auteur décide<br />
de rendre son Émile orphelin mais riche : « Le<br />
pauvre n’a pas besoin d’é<strong>du</strong>cation ; celle de son état<br />
est forcée… Choisissons donc un riche ; nous serons<br />
sûrs au moins d’avoir fait un homme de plus, au lieu<br />
qu’un pauvre peut devenir homme de lui-même. »<br />
Le livre II suit Émile de deux à douze ans. Son<br />
précepteur, auquel s’identifie Rousseau par l’emploi<br />
<strong>du</strong> « je », guide sa sensibilité, son raisonnement<br />
moral et intellectuel, é<strong>du</strong>que son corps et développe<br />
ses qualités sensorielles. Rousseau considère que<br />
l’Homme est prisonnier de deux dépendances : « Il<br />
y a deux sortes de dépendances : celles <strong>des</strong> choses,<br />
qui est de la nature ; celle <strong>des</strong> hommes, qui est de la<br />
société. La dépendance <strong>des</strong> choses, n'ayant aucune<br />
moralité, ne nuit point à la liberté, et n'engendre<br />
point de vices ; la dépendance <strong>des</strong> hommes étant<br />
désordonnée les engendre tous, et c'est par elle que<br />
le maître et l'esclave se dépravent mutuellement. »<br />
Se trouve donc défen<strong>du</strong>e une pédagogie faite<br />
d’expériences pratiques, de découvertes par soimême<br />
qui accorde en même temps un grand rôle à<br />
l'é<strong>du</strong>cation physique :<br />
« Nos premiers maîtres de philosophie sont nos<br />
pieds, nos mains, nos yeux. Substituer <strong>des</strong> livres à<br />
tout cela, ce n'est pas nous apprendre à raisonner,<br />
c'est nous apprendre à nous servir de la raison<br />
d'autrui. » Et on peut lire ailleurs : « Émile n’aura ni<br />
bourrelets, ni paniers roulants, ni chariots, ni<br />
lisières ; ou <strong>du</strong> moins, dès qu’il commencera de<br />
savoir mettre un pied devant l’autre, on ne le<br />
soutiendra que sur les lieux pavés, et l’on ne fera<br />
qu’y passer en hâte. Au lieu de le laisser croupir<br />
dans l’air usé d’une chambre, qu’on le mène<br />
journellement au milieu d’un pré. Là, qu’il coure,<br />
qu’il s’ébatte, qu’il tombe cent fois le jour, tant<br />
mieux : il en apprendra plus tôt à se relever. Le bienêtre<br />
de la liberté rachète beaucoup de blessures.<br />
Mon élève aura souvent <strong>des</strong> contusions ; en<br />
revanche, il sera toujours gai.
Si les vôtres en ont moins, ils sont toujours<br />
contrariés, toujours enchaînés, toujours tristes. Je<br />
doute que le profit soit de leur côté. » Au total : « Il<br />
faut distinguer avec soin le vrai besoin, le besoin<br />
naturel, <strong>du</strong> besoin de fantaisie qui commence à<br />
naître, ou de celui qui ne vient que de la<br />
surabondance de vie.»<br />
Ce livre II se conclut par l’exemple d’un garçon pour<br />
qui cette phase de l’é<strong>du</strong>cation a réussi. Le père<br />
emmène l’enfant faire <strong>du</strong> cerf-volant, et lui demande<br />
de trouver la position <strong>du</strong> cerf-volant à partir de son<br />
ombre. Bien qu’on ne lui ait pas appris à le faire,<br />
l’enfant, ayant développé sa capacité de<br />
compréhension <strong>du</strong> monde physique, et sa capacité à<br />
procéder à <strong>des</strong> inférences, y parvient sans peine.<br />
Le livre III, saisit Émile entre sa douzième et sa<br />
quinzième année. Le précepteur se charge de<br />
l’é<strong>du</strong>cation de son intelligence par l'observation de<br />
la nature qui lui fournira matière à <strong>des</strong> leçons<br />
d'astronomie, de physique, etc. Émile est formé<br />
aussi à un métier manuel, nécessaire pour gagner sa<br />
vie : il sera donc menuisier. C’est aussi un moyen de<br />
développer sa socialisation : « Émile a peu de<br />
connaissances, mais celles qu’il a sont véritablement<br />
siennes … La raison, le jugement, viennent<br />
lentement, les préjugés accourent en foule ».<br />
Pour Rousseau, cet âge ne doit pas être celui <strong>des</strong><br />
livres mais doit plutôt développer les sens. Il faut<br />
habituer l’enfant à procéder lui-même à <strong>des</strong><br />
dé<strong>du</strong>ctions en multipliant ses relations avec le<br />
monde. Il faut lui laisser la possibilité de commettre<br />
<strong>des</strong> fautes et essayer qu’il les corrige tout seul. Pour<br />
ce faire, Jean-Jacques remplace les punitions par<br />
<strong>des</strong> sanctions qu’il pense logiques. Par exemple,<br />
Émile casse un carreau de la fenêtre de sa chambre ;<br />
on ne le gronde pas : il aura froid. Si la lecture n’est<br />
pas toujours nécessaire, Rousseau nomme malgré<br />
tout un seul livre qui peut être utile à Émile :<br />
Robinson Crusoé, roman qu’il considère comme un<br />
véritable traité d’é<strong>du</strong>cation naturelle et qualifie de «<br />
livre merveilleux » : « Robinson Crusoé dans son<br />
île, écrit-il, seul, dépourvu de l'assistance de ses<br />
semblables et <strong>des</strong> instruments de tous les arts,<br />
pourvoyant cependant à sa subsistance, à sa<br />
conservation, et se procurant même une sorte de<br />
bien-être, voilà un objet intéressant pour tout âge, et<br />
qu'on a mille moyens de rendre agréable aux<br />
enfants. » En s’identifiant à ce héros, l’enfant<br />
s’imaginera être un homme isolé qui jugera par luimême<br />
l’utilité <strong>des</strong> choses nécessaires à sa vie.<br />
Dans le livre IV, Émile est âgé de 16 à 20 ans :<br />
« C’est l’âge de raison et <strong>des</strong> passions ». Il est temps<br />
d'aborder les questions de sexualité, de morale et de<br />
religion. Parallèlement aux théories proprement<br />
pédagogiques, ce livre IV comprend la célèbre et<br />
controversée Profession de foi <strong>du</strong> Vicaire savoyard,<br />
qui aborde précisément les problèmes religieux et<br />
dont il faut dire quelques mots. Dans une société où<br />
l'État et l'Église dépendent l’un de l’autre, il est très<br />
difficile de soulever <strong>des</strong> questions touchant à la foi<br />
sans créer <strong>des</strong> polémiques, subir <strong>des</strong> poursuites ou<br />
27<br />
<strong>des</strong> menaces pour « blasphème ». Aussi Rousseau<br />
prend-il <strong>des</strong> précautions pour aborder ce sujet, en<br />
parlant par la bouche d'un intermédiaire. Il confie<br />
Émile à un brave vicaire de campagne qui se décrit<br />
et se dévoile. Ce vicaire ne parle pas n'importe<br />
quand, ni n'importe où. Il le fait selon une soigneuse<br />
mise en scène poétique voulue par l’auteur.<br />
À la pointe <strong>du</strong> jour , le Vicaire emmène Émile « hors<br />
de la ville, sur une haute colline, au <strong>des</strong>sous de<br />
laquelle passait le Pô, dont on voyait le cours à<br />
travers les fertiles rives qu'il baigne ; dans<br />
l'éloignement, l'immense chaîne <strong>des</strong> Alpes<br />
couronnait le paysage ; les rayons <strong>du</strong> soleil levant<br />
rasaient déjà les plaines, et projetant sur les champs<br />
par longues ombres les arbres, les coteaux, les<br />
maisons, enrichissaient de mille accidents de<br />
lumière le plus beau tableau dont l'œil humain<br />
puisse être frappé. » C'est dans ce cadre à la fois<br />
grandiose et serein, en pleine nature, loin de<br />
l'agitation humaine, que Rousseau décrit le<br />
questionnement d’un homme en crise qui a vu<br />
s’écrouler toutes les certitu<strong>des</strong> auxquelles il croyait.<br />
Voici le début : « Je suis né pauvre et paysan,<br />
<strong>des</strong>tiné par mon état à cultiver la terre ; mais on crut<br />
plus beau que j’apprisse à gagner mon pain dans le<br />
métier de prêtre, et l’on trouva le moyen de me faire<br />
étudier… J’appris ce qu’on voulait que j’apprisse, je<br />
dis ce qu’on voulait que je disse, je m’engageai<br />
comme on voulut, et je fus fait prêtre. » Mais très<br />
vite le jeune homme a compris que son état de<br />
prêtre exigeait de lui ce qu'il se sentait incapable de<br />
tenir. La chasteté, à laquelle ses vœux l'engageaient,<br />
était contraire aux lois les plus simples de la nature,<br />
et il ne put s'y conformer. Cédant à la voix de la<br />
nature, mais se refusant à l'hypocrisie, il fut très vite<br />
objet de scandale : « Arrêté, interdit, chassé, je fus<br />
bien plus la victime de mes scrupules que de mon<br />
incontinence » Condamné sans avoir tenté de se<br />
dissimuler, le Vicaire vit basculer toutes les idées<br />
qu'il avait « <strong>du</strong> juste, de l'honnête et de tous les<br />
devoirs de l'homme ». Il sombre alors dans un<br />
pénible état de trouble où il « erre de doute en<br />
doute » et dont il ne ressort « qu'incertitude,<br />
obscurité, contradiction ». Cette crise, le vicaire la<br />
retrouve comme en écho dans celle de son jeune<br />
disciple. Recueilli dans un hospice, instruit dans une<br />
nouvelle religion, il fait l'expérience <strong>du</strong> doute. Il fait<br />
surtout l'expérience <strong>du</strong> mal : victime <strong>des</strong> mœurs<br />
dissolues de ses protecteurs il « voulut fuir, on<br />
l'enferma ; il se plaignit, on le punit de ses plaintes :<br />
à la merci de ses tyrans, il se vit traiter en criminel<br />
pour ne pas avoir voulu céder au crime. » C'est<br />
pourquoi, prenant le jeune garçon sous sa<br />
protection, le Vicaire tente de lui exposer la voie<br />
qu'il a suivie pour retrouver la paix de l'âme et<br />
l'estime de soi. Dans une première partie, il définit<br />
la religion naturelle fondée sur le sentiment et le<br />
raisonnement. Dans une seconde, il montre que la<br />
religion naturelle est l'essentiel de toutes les<br />
religions, qu'elles n'ont rien ajouté d'important à ce<br />
que l'indivi<strong>du</strong> trouve par l'exercice de sa pensée ;<br />
que leurs dogmes et leurs rites n'ont causé que<br />
misère et persécution, fanatisme et crime; qu'il est<br />
impossible de choisir entre le judaïsme, le<br />
christianisme et le mahométisme, entre le<br />
catholicisme, le calvinisme et le luthéranisme ; que<br />
nul signe visible ne guide l'homme dans ce choix,
que les miracles ne prouvent rien puisqu’ils ne<br />
peuvent être expliqués.<br />
Rousseau, dans cette longue et importante<br />
digression, fait dire au vicaire ce que lui-même ne<br />
veut et ne peut pas dire directement ; mais le propos<br />
aura, nous le verrons, de terribles conséquences.<br />
Dans le livre V ayant pour titre « Sophie ou la<br />
femme », Émile doit se marier. Il rencontre, il aime<br />
et épouse Sophie, une jeune fille au prénom symbole<br />
de sagesse, que l'on a élevée dans les mêmes<br />
principes que lui. Rencontrer Sophie va permettre à<br />
Émile d’entrer pleinement dans la vie de famille et<br />
dans la vie sociale. Il deviendra ainsi véritablement<br />
un homme accompli. Le début de l’idylle prend <strong>des</strong><br />
accents romanesques : « À ce nom de Sophie,<br />
eussiez vu tressaillir Émile. Frappé d'un nom si cher,<br />
il se réveille en sursaut, et jette un regard avide sur<br />
celle qui l'ose porter. Sophie, ô Sophie ! Est-ce vous<br />
que mon cœur cherche ? Est-ce vous que mon cœur<br />
aime ? » L’élue représente pour Rousseau l'épouse<br />
idéale. Il lui donne tous les traits de caractère et les<br />
attitu<strong>des</strong> que chaque femme doit avoir d'après lui.<br />
Dans ce cinquième et dernier livre, est abordé aussi<br />
le problème de l'é<strong>du</strong>cation <strong>des</strong> filles. Cette é<strong>du</strong>cation<br />
dont, à l’époque, on ne voyait pas l’intérêt, d’autant<br />
plus que celle <strong>des</strong> hommes n’était pas non plus une<br />
priorité. Rousseau, ici, prend une position assez<br />
datée: il ne conçoit l’é<strong>du</strong>cation <strong>des</strong> femmes que par<br />
rapport à l’homme : « Ainsi, toute l’é<strong>du</strong>cation <strong>des</strong><br />
femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire,<br />
leur être utile, se faire aimer et honorer d’eux, les<br />
élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les<br />
consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà<br />
les devoirs <strong>des</strong> femmes en tout temps, et ce qu’on<br />
doit leur apprendre dès l’enfance… Elles doivent<br />
apprendre beaucoup de choses, mais seulement<br />
celles qu'il leur convient de savoir. » Après quoi<br />
Émile va devoir quitter momentanément Sophie. Il<br />
va voyager afin de comprendre les mœurs et usages<br />
d'autres peuples et de pouvoir choisir les plus<br />
convenables. Il faut, par ses choix, qu’il assimile les<br />
28<br />
fondements et les raisons de la société civile et<br />
devienne un bon citoyen. Malheureusement, Émile<br />
découvre que tout semble corrompu par l'intérêt<br />
particulier et l'abus de pouvoir. Pour échapper à<br />
cette perversion, il retourne là où il est né, là où les<br />
mœurs et les usages sont les plus stables, c'est-àdire<br />
à la campagne. Il sera conscient de sa mission :<br />
être proche de la nature, être juste et fonder une<br />
famille avec Sophie. La paternité d'Émile marque la<br />
fin de son é<strong>du</strong>cation et son aboutissement.<br />
La portée de l’Émile<br />
Rousseau savait fort bien que ce livre hardi qu’il<br />
achève en 1760 allait faire l’objet de nombreuses<br />
critiques. Il craignit que les censeurs exigent <strong>des</strong><br />
modifications, <strong>des</strong> coupures et pensa le faire éditer<br />
en Hollande. Mais le libraire Malherbe accepta de<br />
l’imprimer à Paris. Par prudence, il inscrivit sur la<br />
première page : Jean Jacques Rousseau Citoyen de<br />
Genève. Et ajouta le lieu d’édition et le nom de<br />
l’éditeur : À Amsterdam. Chez Jean Néaulme,<br />
libraire. De cette manière, le texte échappa à la<br />
censure, mais d’autres épreuves allaient bientôt<br />
surgir. L’ouvrage paraît en mai 1762, obtenant tout<br />
de suite un grand succès. Mais très vite il est l’objet<br />
de critiques et de réfutations de la part <strong>des</strong><br />
catholiques autant que <strong>des</strong> protestants, surtout à<br />
cause de la fameuse Profession de foi d’un Vicaire<br />
Savoyard. Les thèses défen<strong>du</strong>es par Rousseau<br />
étaient, selon un arrêt <strong>du</strong> Petit Conseil de Genève<br />
«téméraires, scandaleuses, impies, tendant à<br />
détruire la religion chrétienne et tous les<br />
gouvernements. » À cela s’ajoute le jugement <strong>du</strong><br />
meilleur ennemi, Voltaire, qui dit d’Émile : « C’est<br />
l’enfant le plus mal élevé <strong>du</strong> monde ».<br />
Le 8 juin 1762, alors que Rousseau est dans son<br />
ermitage de Montmorency, il apprend sa<br />
condamnation pour cette publication qui est<br />
interdite. Il souhaiterait ne pas fuir, être jugé et<br />
pouvoir répondre à ses accusateurs, mais ses amis<br />
lui conseillent de partir.<br />
Ses meubles seront ven<strong>du</strong>s par Thérèse afin de<br />
financer l’exil. Rousseau se réfugie à Yverdon en<br />
Suisse, puis près de Neuchâtel, à Môtiers. Trois ans<br />
plus tard, en septembre 1765, il est chassé par les<br />
habitants de la région, il sera accueilli par un ami, le<br />
philosophe Hume en Angleterre, avant de rentrer en<br />
France.<br />
L'Émile, brûlé par ordre <strong>du</strong> Parlement, et condamné<br />
par un mandement de l'archevêque de Paris, eut<br />
malgré tout un retentissement considérable dans<br />
notre pays. Il rendit aux mères le sentiment <strong>du</strong><br />
devoir maternel. Les femmes <strong>du</strong> monde devinrent<br />
les nourrices de leurs enfants. Il révolutionna<br />
l'hygiène de la première enfance et remit en<br />
l'honneur l'é<strong>du</strong>cation physique, les jeux d'adresse et<br />
de force. L'instruction devint pratique et positive.<br />
Enfin, comme Émile apprend l'art <strong>du</strong> menuisier,<br />
beaucoup de jeunes gentilshommes et de fils de<br />
famille apprirent un métier manuel.
Les grands pédagogues <strong>des</strong> époques qui suivirent<br />
doivent beaucoup à l’ouvrage et s’en inspirèrent<br />
chacun à leur manière. Son principal élève fut le<br />
suisse Henri Pestolazzi, admirateur convaincu de<br />
l’Émile fort prisé par ses étudiants zurichois. Dans<br />
son livre Léonard et Gertrude, écrit en 1781,<br />
Pestolazzi traite d’une é<strong>du</strong>cation morale et naturelle<br />
visant à stimuler et exploiter les facultés de l’enfant.<br />
Un autre disciple fut Jean Itard. Ce médecin, qui<br />
participa au siège de Toulon en 1793, fut l’un <strong>des</strong><br />
premiers é<strong>du</strong>cateurs d’enfants inadaptés. Pour eux,<br />
il a créé un matériel pédagogique fondant les bases<br />
de l’é<strong>du</strong>cation sensorielle. Un autre continuateur,<br />
Fröbel, pédagogue allemand <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XIX e<br />
siècle, créateur <strong>des</strong> jardins d’enfants, s’attache à<br />
développer l’imagination, la patience et l’habileté<br />
manuelle par jeux et comptines. Plus célèbre, Maria<br />
Montessori, à la fin <strong>du</strong> XIX e siècle et au début <strong>du</strong><br />
XX e , rejette les métho<strong>des</strong> traditionnelles et<br />
contraignantes et crée un milieu propice à<br />
l’épanouissement et au besoin d’expérimentation<br />
<strong>des</strong> enfants. Elle propose les trois formes<br />
d’é<strong>du</strong>cation inspirées de Rousseau : motrice,<br />
sensorielle et intellectuelle.<br />
Il faut encore mentionner Piaget, au début <strong>du</strong> XX e<br />
siècle, qui travailla à l’Institut Jean-Jacques<br />
Rousseau de Genève et qui préconise un<br />
enseignement adapté aux besoins de chaque enfant,<br />
militant pour une é<strong>du</strong>cation indivi<strong>du</strong>elle<br />
difficilement réalisable.<br />
29<br />
Citons enfin Célestin Freinet qui, dès 1924, est un<br />
autre acteur important de l'évolution <strong>des</strong> pratiques<br />
pédagogiques. Sa méthode nouvelle d'é<strong>du</strong>cation<br />
populaire met en évidence les découvertes<br />
bénéfiques possibles grâce aux promena<strong>des</strong><br />
scolaires, et elle est surtout fondée sur l'expression<br />
libre. Freinet définit ainsi ses métho<strong>des</strong> : « La voie<br />
normale de l’acquisition est le tâtonnement<br />
expérimental, démarche naturelle et universelle…<br />
Elle ne se fait pas comme l’on croit parfois, par<br />
l’étude <strong>des</strong> règles et <strong>des</strong> lois, mais par l’expérience.<br />
Étudier d’abord ces règles et ces lois, en français, en<br />
art, en mathématiques, en sciences, c’est placer la<br />
charrue devant les bœufs. »<br />
Nous pouvons conclure en suggérant que<br />
l’Émile inventa indiscutablement une pédagogie<br />
novatrice qui a exercé une influence <strong>du</strong>rable et en<br />
profondeur. Bien que cette é<strong>du</strong>cation soit de style<br />
aristocratique, puisqu’un précepteur particulier est<br />
attaché à un seul élève, les principes peuvent être<br />
jugés valables pour une é<strong>du</strong>cation collective comme<br />
celle de notre école. Parmi ces principes, nous en<br />
retiendrons un seul, qui nous paraît essentiel : faire<br />
de l’enfant l’objet principal <strong>des</strong> préoccupations<br />
pédagogiques ce qui entraîne, évidemment, un<br />
changement d’attitude de l’a<strong>du</strong>lte qui doit - ou<br />
devrait - s’adapter à la nature de chaque enfant.
LE DICTIONNAIRE DE MUSIQUE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU<br />
Jean-Jacques Rousseau est connu principalement<br />
comme un philosophe <strong>des</strong> Lumières, panthéonisé<br />
par la Convention thermidorienne le 11 octobre<br />
1794. Les amateurs d’opéra ont enten<strong>du</strong> parler de<br />
son intermède musical Le Devin <strong>du</strong> village, mais<br />
seuls les musicologues savent qu’il écrivit un<br />
Dictionnaire de musique.<br />
Je voudrais donc rappeler que Rousseau, bien avant<br />
d’entrer en littérature et en philosophie, fut d’abord<br />
un musicien.<br />
Le musicien<br />
Les quelques étu<strong>des</strong> un peu<br />
approfondies que le jeune Jean-<br />
Jacques ait faites concernent l’art<br />
musical, étant enten<strong>du</strong> que, en<br />
raison d’une existence d’une<br />
incroyable instabilité, il n’a fait<br />
aucun apprentissage bien<br />
systématique et a seulement<br />
complété ses acquis d’autodidacte<br />
par la fréquentation épisodique<br />
<strong>des</strong> maîtres que le hasard mit sur<br />
son chemin.<br />
Dans ses Confessions, il indique<br />
que son attrait pour la musique lui<br />
est venu de sa « tante Suson » :<br />
« Je suis persuadé que je lui dois<br />
le goût ou plutôt la passion pour la<br />
musique qui ne s’est bien<br />
développée en moi que longtemps<br />
après. Elle savait une quantité<br />
prodigieuse d’airs et de chansons<br />
qu’elle chantait avec un filet de<br />
voix fort douce 1 . »<br />
Après une enfance chaotique et <strong>des</strong> essais<br />
d’apprentissages sans suite 2 , il fut envoyé à Turin en<br />
vue de sa conversion au catholicisme romain ; il y<br />
séjourna environ une année de 1728 à juin 1729 – il<br />
avait alors entre seize et dix-sept ans – et partit à la<br />
découverte de la ville : « J’étais surtout fort exact à<br />
faire ma cour et j’assistais régulièrement tous les<br />
matins à la messe <strong>du</strong> Roi. Je trouvais beau de me<br />
voir dans la même chapelle avec ce Prince et sa<br />
suite : mais ma passion pour la musique, qui<br />
commençait à se déclarer, avait plus de part à mon<br />
assi<strong>du</strong>ité que la pompe de la cour qui bientôt vue et<br />
1 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Confessions, tome I, livre<br />
I, page 18. Dans cet article, je réfère à l’édition de Genève,<br />
1782, en deux volumes de 471+279 pages pour les livres I-<br />
VI ; et Genève, 1789, en deux volumes de 594+542 pages<br />
pour les livres VII-XII.<br />
2 Notamment un apprentissage, à Genève chez M.<br />
Masseron, <strong>du</strong> métier de greffier, que Jean-Jacques appelle<br />
« les grapignans » (Confessions, tome I, livre I, page 73) !<br />
Dominique AMANN<br />
31<br />
toujours la même ne frappe pas longtemps. Le Roi<br />
de Sardaigne avait alors la meilleure symphonie de<br />
l’Europe. Somis, Desjardins, les Bezuzzi y brillaient<br />
alternativement. Il n’en fallait pas tant pour attirer<br />
un jeune homme que le jeu <strong>du</strong> moindre instrument,<br />
pourvu qu’il fût juste, transportait d’aise 3 . »<br />
Revenu à Annecy chez sa protectrice, M me de<br />
Warens, qui « avait de la voix, chantait<br />
passablement et jouait un peu <strong>du</strong> clavecin 4 », il se<br />
mit à l’étude de la musique. Admis à la maîtrise de la<br />
cathédrale, il y passa six mois parmi les musiciens et<br />
les enfants de chœur, sous la direction d’un<br />
professeur fort qualifié.<br />
En l’absence de sa bienfaitrice partie<br />
à Paris, il se rendit ensuite à<br />
Lausanne, puis à Neuchâtel où ses<br />
premières leçons de musique ne<br />
rencontrèrent pas un bien grand<br />
succès.<br />
En septembre 1731, il retrouve à<br />
Chambéry, où elle s’est installée, M me<br />
de Warens chez qui il va passer une<br />
dizaine d’années. Dans la quiétude de<br />
ce séjour, il approfondit sa<br />
connaissance de la musique, par ses<br />
lectures, par l’étude <strong>du</strong> Traité de<br />
l’harmonie de Rameau et grâce aux<br />
conseils de quelques maîtres, qu’il<br />
cite dans ses Confessions, tels le<br />
jeune abbé Palais ou le moine<br />
cordelier Caton. Fort de ses progrès,<br />
Jean-Jacques abandonne un mo<strong>des</strong>te<br />
emploi de secrétaire au cadastre et s’établit<br />
professeur de musique : « Je passai là pour un bon<br />
maître parce qu’il n’y en avait que de mauvais. Ne<br />
manquant pas, au reste, d’un certain goût de chant,<br />
favorisé d’ailleurs par mon âge et par ma figure,<br />
j’eus bientôt plus d’écolières qu’il ne m’en fallait<br />
pour remplacer ma paye de secrétaire 5 . » Jusqu’en<br />
1735-1736, il consacre une grande partie son temps à<br />
sa formation : « La musique était pour moi une<br />
autre passion moins fougueuse mais non moins<br />
consumante par l’ardeur avec laquelle je m’y livrais,<br />
par l’étude opiniâtre <strong>des</strong> obscurs livres de Rameau,<br />
par mon invincible obstination à vouloir en charger<br />
ma mémoire qui s’y refusait toujours, par mes<br />
courses continuelles, par les compilations immenses<br />
3 ROUSSEAU, Confessions, tome I, livre II, pages 186-<br />
187. 4 ROUSSEAU, Confessions, tome I, livre III, page 312.<br />
5 ROUSSEAU, Confessions, tome II, livre I, page 35.
que j’entassais, passant très souvent à copier les<br />
nuits entières 6 . »<br />
À l’été 1736, M me de Warens et Jean-Jacques<br />
quittèrent Chambéry pour s’installer dans une<br />
proche campagne, aux Charmettes. Dans cette<br />
retraite, il commença à s’intéresser à la philosophie,<br />
à la géométrie et à l’algèbre. Pour autant, il<br />
poursuivit ses étu<strong>des</strong> musicales, notamment avec<br />
l’Historia musica de Bontempi 7 et le traité <strong>du</strong> chant<br />
Cartella de Banchieri 8 , ouvrages qui lui furent<br />
apportés, <strong>du</strong>rant l’hiver 1736, par un ami de retour<br />
d’Italie.<br />
En 1741, Rousseau, pour simplifier la notation<br />
musicale et en faciliter l’apprentissage, imagina de<br />
remplacer les portées et les notes par <strong>des</strong> chiffres. Ce<br />
nouveau système 9 mis au point, il s’en fut le<br />
présenter à Paris où il arriva à l’automne 1741. L’une<br />
de ses relations lui fit rencontrer Réaumur 10 , qui<br />
accepta de soumettre l’invention à l’<strong>Académie</strong> <strong>des</strong><br />
sciences : « Le même jour 22 août 1742, j’eus<br />
l’honneur de lire à l’<strong>Académie</strong> le mémoire que j’avais<br />
préparé pour cela 11 . » Cette assemblée nomma une<br />
commission de trois membres – MM. de Mairan,<br />
Hellot et de Fouchy 12 – pour en faire une évaluation<br />
approfondie, « Tous trois gens de mérite<br />
assurément ; mais dont pas un ne savait la musique,<br />
assez <strong>du</strong> moins pour être en état de juger mon<br />
projet 13 . » Ces censeurs déclarèrent que la notation<br />
musicale par chiffres avait déjà été imaginée par le<br />
père Souhaitty 14 et que l’idée proposée par Rousseau<br />
n’était donc pas originale : « L’<strong>Académie</strong> m’accorda<br />
un certificat plein de très beaux compliments, à<br />
travers lesquels on démêlait pour le fonds, qu’elle ne<br />
jugeait mon système ni neuf ni utile 15 . » Persuadé<br />
que les savants n’avaient pas apprécié son travail à<br />
6 ROUSSEAU, Confessions, tome II, livre V, page 127.<br />
7 BONTEMPI (Giovanni Andrea), Historia musica,<br />
Perugia, Costantini, 1695.<br />
8 BANCHIERI (Adriano), Cartella, 1/ Venise, 1601. Cet<br />
ouvrage connut cinq éditions <strong>du</strong> vivant de son auteur.<br />
9 Le système proposé par Rameau n’est « nouveau »<br />
qu’en ce qu’il connaît <strong>des</strong> développements importants.<br />
Dans la réalité, l’idée de remplacer les notes <strong>des</strong>sinées sur<br />
une portée par une suite de chiffres est plus ancienne. On<br />
la trouve, par exemple, chez Pierre Davantès l’aîné, dans<br />
son psautier publié à Genève en 1560.<br />
10 René-Antoine FERCHAULT DE REAUMUR (1683-1757),<br />
admis à l’<strong>Académie</strong> <strong>des</strong> sciences en 1708. Ce savant aux<br />
goûts très éclectiques s’est intéressé à la géométrie, la<br />
géologie, la météorologie, les sciences naturelles, mais<br />
aussi aux métaux et à la métallurgie ; on lui doit l’invention<br />
<strong>du</strong> thermomètre à alcool.<br />
11 ROUSSEAU, Confessions, tome III, livre VII, pages 25-<br />
26. — Le mémoire présenté avait pour titre Projet<br />
concernant de nouveaux signes pour la musique.<br />
12 Jean-Jacques DORTOUS DE MAIRAN (1678-1771),<br />
mathématicien, astronome et géophysicien, admis le 24<br />
décembre 1778. — Jean HELLOT (1685-1766), chimiste,<br />
admis en 1735. — Jean-Paul GRANDJEAN DE FOUCHY (1707-<br />
1788), astronome, élu secrétaire perpétuel de l’académie le<br />
31 août 1743.<br />
13 ROUSSEAU, Confessions, tome III, livre VII, page 26.<br />
14 SOUHAITTY (Jean-Jacques), Nouveaux éléments de<br />
chant ou l’Essai d’une nouvelle découverte qu’on a faite<br />
dans l’art de chanter, Paris, Pierre Le Petit, 1677, in-4°, 56<br />
pages. —Essai <strong>du</strong> chant de l’Église par la nouvelle<br />
méthode <strong>des</strong> nombres, Paris T. Jolly et A. Pralard, 1679, in-<br />
8°, 40 pages.<br />
15 ROUSSEAU, Confessions, tome III, livre VII, pages 29-<br />
30.<br />
32<br />
sa juste valeur, Jean-Jacques refondit son texte et le<br />
fit imprime 16 . Toutefois, malgré tout l’enthousiasme<br />
de l’auteur pour les mérites et avantages de sa<br />
trouvaille, la rupture avec les habitu<strong>des</strong> séculaires<br />
était bien trop radicale ; la méthode aussi bien que<br />
la publication ne rencontrèrent aucun succès !<br />
Parmi toutes les œuvrettes musicales alors<br />
composées par Rousseau 17 , deux seulement<br />
obtinrent quelque succès. Tout d’abord son opéra<br />
Les Muses galantes 18 , commencé avant le départ à<br />
Venise et achevé au retour, représenté deux fois en<br />
1745, mais torpillé par Jean-Philippe Rameau et son<br />
élève M me de La Pouplinière. Et surtout son<br />
intermède musical en un acte, Le Devin <strong>du</strong> village 19 ,<br />
interprété à Fontainebleau devant le roi et la Cour<br />
les 18 et 24 octobre 1752 : « La pièce fut très mal<br />
jouée quant aux acteurs, mais bien chantée et bien<br />
exécutée quant à la musique 20 ». Cette œuvre<br />
novatrice poursuivit une honnête carrière pendant<br />
plus de cinquante années 21 .<br />
Jusqu’en 1752, – c’est-à-dire jusqu’à l’âge de<br />
quarante ans, – Rousseau n’a guère fait que de la<br />
musique. S’il a commencé à ouvrir son esprit à<br />
d’autres branches <strong>du</strong> savoir, <strong>du</strong> moins n’a-t-il rien<br />
publié en ces matières. Passé 1752, Jean-Jacques<br />
délaissa peu à peu la musique pour le roman et la<br />
philosophie. Hormis sa participation à la Querelle<br />
<strong>des</strong> Bouffons, il acheva toutefois son Dictionnaire de<br />
musique et revint à la scène avec Daphnis et Chloé 22<br />
16 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Dissertation sur la<br />
musique moderne, Paris, G.-F. Quillau père, 1743, in-8°,<br />
XVI-104 pages.<br />
17 Œuvres lyriques : Iphis et Anaxarète, 1740, dont seul<br />
le livret subsiste, publication posthume dans les Œuvres<br />
complètes. — La Découverte <strong>du</strong> nouveau monde, 1741,<br />
dont seul le livret subsiste, publication posthume dans les<br />
Œuvres complètes. — Les Fêtes de Ramire, ballet donné à<br />
Versailles le 22 décembre 1745, livret de Voltaire, musique<br />
de Rousseau ; Paris, Jean-Baptiste-Christophe Ballard,<br />
1745, in-4°, 14 pages.<br />
18 Les Muses galantes, opéra-ballet, paroles et musique<br />
de Jean-Jacques Rousseau, fragments manuscrits au<br />
musée de Chaalis, collection Girardon, carton 12, quatorze<br />
parties instrumentales et vocales, 108 pages in-folio.<br />
19 Le Devin <strong>du</strong> village, intermède musical en un acte,<br />
livret et musique de Jean-Jacques Rousseau. 1/ Paris, M me<br />
Boivin, sd, grand in-4°, 95 pages, 1 re version ; 2/ avec<br />
l’ariette ajoutée par M. Philidor en 1763, Paris, Le Clerc, 95<br />
pages (1 re version) + pages 96-101 (ariette rajoutée). La<br />
bibliothèque de l’Opéra de Paris possède plusieurs<br />
manuscrits : manuscrit autographe in-4° (A 185 a),<br />
aujourd’hui déposé à la bibliothèque de la Chambre <strong>des</strong><br />
députés ; manuscrit in-4°, 124 pages, 1 re version,<br />
exemplaire <strong>des</strong> représentations de 1753 (A 185 b) ;<br />
manuscrit in-4°, 143 pages, 2 e version donnée par<br />
l’<strong>Académie</strong> royale de musique le 20 avril 1779 (A 185 e) ;<br />
manuscrit grand in-4°, 314 pages, 3 e version, 1780<br />
(A.185.g).<br />
20 ROUSSEAU, Confessions, tome III, livre VIII, page 311.<br />
— Les personnages furent créés par les plus gran<strong>des</strong> voix<br />
françaises de l’époque : la soprano Marie Fel (Colette), le<br />
ténor Pierre Jélyotte (Colin), le baryton Louis-Antoine<br />
Cuvillier (le Devin).<br />
21 Le Devin <strong>du</strong> village fut joué, par exemple, au théâtre<br />
de Toulon en 1814 (deux représentations) et de nouveau<br />
<strong>du</strong>rant la saison 1818-1819 (deux représentations).<br />
22 Daphnis et Chloé, pastorale, livret de Corancez,<br />
musique inachevée (1774-1776). Publication partielle<br />
(premier acte, esquisse <strong>du</strong> prologue, morceaux préparés<br />
pour le second acte et le divertissement) : Paris, Esprit,<br />
1779, in-folio, 1+XII+167 pages, partition d’orchestre. —
et avec Pygmalion 23 , prototype <strong>du</strong> mélodrame 24 . Et,<br />
sur un plan plus matériel, il reprit son travail –<br />
certes fort mo<strong>des</strong>te ! – de copiste de musique<br />
chaque fois que sa situation pécuniaire le contraignit<br />
à cette <strong>du</strong>re nécessité.<br />
La rédaction <strong>du</strong> Dictionnaire<br />
L’histoire de la lexicographie musicale de langue<br />
française commence avec le Dictionnaire de<br />
musique de Sébastien de Brossard 25 publié en 1703.<br />
Son très long titre indique un ouvrage composite : le<br />
volume réunit en effet 1° un dictionnaire de termes<br />
grecs, latins, italiens… et accessoirement français ;<br />
Fragments et matériel manuscrits à Paris, bibliothèque de<br />
l’Opéra, A 185 f.<br />
23 Pygmalion, un acte en prose. L’histoire de la pièce<br />
est fort embrouillée. Écrite en 1770 à Lyon, elle y fit l’objet<br />
d’une création en mai ; une édition publiée sans<br />
l’assentiment de l’auteur vit le jour : Genève, 1771, in-8°,<br />
6+14 pages. — Elle fut reprise à Vienne, en 1772, avec une<br />
musique d’Aspelmeyer, inédite et per<strong>du</strong>e ; publication :<br />
Vienne, Kurzböck, 1772, avec notes liminaires par G.<br />
Becker. Facsimilé : Genève, Georg, 1878, petit in-4°, 15<br />
pages (intro<strong>du</strong>ction) +15 pages (texte seul). — Elle arriva<br />
enfin à la Comédie-Française qui la représenta le 30<br />
octobre 1775 avec une musique d’Horace Coignet ;<br />
publication : Paris, veuve Duchesne, 1775, deux parties,<br />
18+8 pages, texte seul ; facsimilé : Paris, J. Lemonnyer,<br />
1883, deux parties en un volume in-4° ; et manuscrit à la<br />
bibliothèque de la Comédie-Française.<br />
Les fichiers de la Bibliothèque nationale de France<br />
signalent encore les éditions de : Milan, Bianchi, 1775,<br />
scène lyrique représentée en français au théâtre <strong>du</strong>cal de<br />
Milan par Thomas et Antoinette Grandi, comédiens<br />
italiens ; Mannheim, F. Schwan, 1778, in-8°, 19 pages.<br />
La bibliothèque de l’Opéra détient, sous la cote C 7280,<br />
un recueil factice réunissant plusieurs documents de tailles<br />
différentes ; notamment, dans la sous-cote C 7280 (1), une<br />
intéressante intro<strong>du</strong>ction en quinze pages expliquant qu’il<br />
y eut plusieurs musiques : celle d’Aspelmeyer jouée à<br />
Vienne en 1772, restée manuscrite et per<strong>du</strong>e ; celle de<br />
Coignet, donnée à Paris en 1775 (deux éditions : à Lyon<br />
chez Castan, et à Paris chez Lobry) ; celle de Baudron, chef<br />
d’orchestre de la Comédie-Française, jamais jouée ; celles<br />
de George Benda, Pierre Gavaux et Chrétien Kalkbrenner.<br />
Cette intro<strong>du</strong>ction est suivie d’une tra<strong>du</strong>ction italienne<br />
(Venezia, 1787), d’une édition allemande (Leipzig,<br />
Breitkopf und Härtel, collection « Publikationen der<br />
Internationalen Music-Gesellschaft », 1901, 90 pages,<br />
exemples musicaux) et d’une repro<strong>du</strong>ction par Edgard Istel<br />
de la partition originale (tome I <strong>des</strong> Annales de la Société<br />
Jean Jacques Rousseau, 32 pages de texte + 5 pages de<br />
musique).<br />
24 Rousseau invente là un genre lyrique nouveau :<br />
« J’ai imaginé un genre de drame dans lequel les paroles et<br />
la musique, au lieu de marcher ensemble, se font entendre<br />
successivement, où la phrase parlée est en quelque sorte<br />
annoncée et préparée par la phrase musicale » (Fragments<br />
d’observations sur l’Alceste italien de M. Gluck,<br />
publication posthume).<br />
25 BROSSARD (Sébastien de), Dictionnaire de musique,<br />
contenant une explication <strong>des</strong> termes grecs, latins, italiens<br />
et françois les plus usitez dans la musique... ensemble une<br />
table alphabétique <strong>des</strong> termes françois qui sont dans le<br />
corps de l’ouvrage, sous les titres grecs, latins et italiens,<br />
pour servir de supplément, un Traité de la manière de<br />
bien prononcer, surtout en chantant, les termes italiens,<br />
latins et françois, et un catalogue de plus de 900 auteurs<br />
qui ont écrit sur la musique en toutes sortes de temps, de<br />
pays et de langues… 1/ Paris, Christophe Ballard, 1703, infolio.<br />
2/ Paris, Christophe Ballard, 1705, in-8°, XII-380<br />
pages et tableaux.<br />
33<br />
2° une table alphabétique <strong>des</strong> termes français avec<br />
renvois aux mots équivalents <strong>du</strong> dictionnaire ; 3° un<br />
traité de la manière de bien prononcer les mots<br />
italiens dans le chant ; 4° une table récapitulant les<br />
principales difficultés de la prononciation italienne ;<br />
5° un catalogue <strong>des</strong> auteurs qui ont écrit sur la<br />
musique. Cet essai est fort méritoire, mais ses<br />
entrées n’offrent que de courtes notices simplement<br />
limitées à <strong>des</strong> définitions.<br />
Rousseau conçut un projet plus ambitieux,<br />
dépassant de beaucoup le cadre d’une simple<br />
lexicographie. Il travailla à cet ouvrage, de manière<br />
discontinue certes, pendant une quinzaine d’années,<br />
et cette période peut être divisée en quatre parties.<br />
1748-1749 : les articles pour l’Encyclopédie<br />
À l’origine se trouvent les articles rédigés à la<br />
demande de Diderot et d’Alembert : « Ces deux<br />
auteurs venaient d’entreprendre le Dictionnaire<br />
Encyclopédique, qui ne devait d’abord être qu’une<br />
espèce de tra<strong>du</strong>ction de Chambers, semblable à peu<br />
près à celle <strong>du</strong> Dictionnaire de médecine de James,<br />
que Diderot venait d’achever. Celui-ci voulut me<br />
faire entrer pour quelque chose dans cette seconde<br />
entreprise, et me proposa la partie de la musique<br />
que j’acceptai, et que j’exécutai très à la hâte et très<br />
mal, dans les trois mois qu’il m’avait donnés comme<br />
à tous les auteurs qui devaient concourir à cette<br />
entreprise 26 . »<br />
En 1748, le grand maître de la musique en France<br />
était incontestablement Jean-Philippe Rameau,<br />
compositeur fécond, pédagogue écouté et théoricien<br />
inspiré de l’harmonie. Mais, à soixante-cinq ans, il<br />
n’aurait pu con<strong>du</strong>ire à bien une telle entreprise ; par<br />
ailleurs, il était enfermé dans <strong>des</strong> spéculations certes<br />
brillantes, mais d’un abord difficile pour le profane,<br />
et dans la tragédie lyrique dont le genre était déjà<br />
suranné. À l’opposé, Rousseau paraissait plus<br />
proche de la sensibilité populaire et <strong>du</strong><br />
bouillonnement <strong>des</strong> idées nouvelles. Ce jeune talent<br />
original fut donc choisi, à la fin de l’année 1748, de<br />
préférence à l’illustre Rameau trop inféodé à une<br />
esthétique que les esprits éclairés jugeaient<br />
finissante.<br />
Rousseau ne disposa que de trois mois – il lui aurait<br />
fallu trois ans ! – pour effectuer un travail<br />
considérable supposant une immense compilation<br />
de toute la littérature de l’époque ; il fournit, en<br />
effet, trois cent quatre-vingt-neuf articles : « Je fis<br />
vite et mal, ne pouvant bien faire en si peu de temps<br />
[…] je me repens d’avoir été téméraire, et d’avoir<br />
plus promis que je ne pouvais exécuter 27 ».<br />
26 ROUSSEAU, Confessions, tome III, livre VII, pages<br />
218-219. — CHAMBERS (Éphraïm), Cyclopaedia or an<br />
Universal Dictionary of Arts and Sciences, Londres, 1728,<br />
deux volumes.<br />
27 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Dictionnaire de musique,<br />
Paris, veuve Duchesne, 1768, in-4°, XII-550 pages et 14<br />
planches. Le texte cité est pris aux pages III-IV de<br />
l’intro<strong>du</strong>ction moderne <strong>du</strong> facsimilé publié par les éditions<br />
Minkoff (Genève, 1998), réalisé d’après l’édition in-quarto<br />
à laquelle je réfèrerai ici. L’exemplaire d’auteur possédé<br />
par Rousseau appartenait, en effet, à ce premier tirage<br />
(Abbaye de Chaalis, musée Jacquemart-André).
1753-1756 : ébauche d’un dictionnaire<br />
Bien que la publication de l’Encyclopédie eût pris un<br />
retard considérable, Rousseau ne put récupérer son<br />
manuscrit et améliorer ses contributions : « Blessé<br />
de l’imperfection de mes articles à mesure que les<br />
volumes de l’Encyclopédie paraissaient, je résolus de<br />
refondre le tout sur mon brouillon, et d’en faire à<br />
loisir un ouvrage à part traité avec plus de soin 28 . »<br />
C’est donc un souci perfectionniste qui lui donna<br />
l’idée de son dictionnaire<br />
Mais Rousseau voulait également répondre aux<br />
attaques de Rameau.<br />
Au début <strong>du</strong> mois d’août 1752, une troupe<br />
ambulante de comédiens italiens représenta à<br />
l’<strong>Académie</strong> royale de musique la Serva padrona de<br />
Pergolèse 29 : l’intrusion de l’opera buffa dans le<br />
temple de la tragédie lyrique déclencha une véritable<br />
guerre pamphlétaire,connue sous le nom de<br />
Querelle <strong>des</strong> Bouffons, sorte de réédition de la<br />
Querelle <strong>des</strong> Anciens et Modernes qui avait agité les<br />
dernières années <strong>du</strong> XVII e siècle. L’affrontement<br />
opposa fondamentalement deux cultures : la<br />
française, défen<strong>du</strong>e par l’abbé Raynal et Rameau, et<br />
l’italienne, prônée par Grimm et Rousseau. Il prit<br />
naissance au théâtre : la tragédie lyrique,<br />
emblématique <strong>du</strong> classicisme français, écrite sur <strong>des</strong><br />
thèmes mythologiques exploitant le merveilleux,<br />
nécessitait une mise en scène somptueuse, mais<br />
d’une pompe fastidieuse, pour célébrer le monarque<br />
absolu ; à l’opposé, l’opéra bouffe italien, populaire<br />
et truculent, cultivant la simplicité, le naturel et la<br />
spontanéité, apportait une fraîcheur appréciée <strong>des</strong><br />
partisans d’un goût nouveau.<br />
La Querelle investit également le champ musical 30 :<br />
partant <strong>des</strong> connaissances acoustiques de son<br />
temps, Rameau avait codifié une écriture établie sur<br />
les concepts de « basse fondamentale », d’ « accord<br />
parfait » et de « mo<strong>du</strong>lation », fondant ainsi<br />
l’harmonie tonale, raffinée et savante, réservée à une<br />
élite. Les compositeurs italiens, quant à eux,<br />
donnaient le primat à la mélodie et à son<br />
expressivité, à la simplicité et à la spontanéité,<br />
ré<strong>du</strong>isant l’harmonie à quelques règles plus<br />
élémentaires ; ce nouveau style connaissait une<br />
grande faveur dans toute l’Europe, apparaissant par<br />
là plus « universel ».<br />
Rousseau entra dans ce débat avec sa Lettre sur la<br />
musique française 31 , publiée à la fin de l’année 1753,<br />
qui établissait la plus grande musicalité de la langue<br />
italienne reconnue plus « chantable », la primauté<br />
de la musique italienne sur la musique française, et<br />
de la mélodie sur l’harmonie. Par ailleurs, ses<br />
28 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page IV de<br />
l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> facsimilé <strong>des</strong> éditions Minkoff.<br />
29 PERGOLESI (Giovanni-Battista), La Serva padrona,<br />
intermède créé en 1733. — Édition française : Paris, aux<br />
adresses ordinaires, sd [1752], 68 pages. La bibliothèque<br />
de l’Opéra de Paris possède un cahier manuscrit in-4°<br />
oblong de 41 folios portant la date « 1 er aoust 1752 » (A 175<br />
b), qui paraît être l’exemplaire de ces représentations.<br />
30 Rousseau parle, d’ailleurs, de « la querelle <strong>des</strong> deux<br />
Musiques » (Dictionnaire, préface, page IX).<br />
31 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Lettre sur la musique<br />
française, slnd [novembre 1753], in-8°, II-92 pages.<br />
34<br />
articles musicaux de l’Encyclopédie, dont les<br />
volumes avaient commencé de paraître, véhiculaient<br />
les mêmes idées. Aussi Rameau et sa coterie<br />
attaquèrent-ils de tous côtés le pauvre Jean-<br />
Jacques, qui choisit de ne pas leur répondre au sein<br />
d’une polémique de bas étage aux arguments<br />
consternants, mais dans un ouvrage sérieux et<br />
digne.<br />
On sait par sa correspondance qu’il travaillait<br />
assi<strong>du</strong>ment à son dictionnaire en 1753, envisageant<br />
la fin de son travail en 1756 ; il se livrait alors à de<br />
gran<strong>des</strong> lectures et compilations, notamment à la<br />
bibliothèque <strong>du</strong> roi. Dans les années 1753 à 1756, il<br />
put ainsi donner un grand avancement à son projet.<br />
Parallèlement, le Discours sur l’origine et les<br />
fondements de l’inégalité parmi les hommes 32<br />
témoigne que les spéculations philosophiques<br />
suscitaient également son intérêt.<br />
1756-1762 : compléments<br />
Retiré à Montmorency d’août 1756 à 1762, éloigné<br />
de la vie intellectuelle de la Capitale et <strong>des</strong><br />
bibliothèques, Rousseau n’avait plus les mêmes<br />
moyens pour continuer ses travaux<br />
lexicographiques. Par ailleurs, il nourrissait d’autres<br />
préoccupations et mit en chantier simultanément la<br />
Nouvelle Héloïse, l’Émile et le Contrat social 33 . La<br />
rédaction <strong>du</strong> dictionnaire en pâtit nécessairement<br />
mais l’ouvrage fit toutefois quelques progrès :<br />
« J’avais cependant eu la précaution de me pourvoir<br />
aussi d’un travail de cabinet pour les jours de pluie.<br />
C’était mon dictionnaire de musique, dont les<br />
matériaux épars, mutilés, informes, rendaient<br />
l’ouvrage nécessaire à reprendre presque à neuf.<br />
J’apportais quelques livres dont j’avais besoin pour<br />
cela ; j’avais passé deux mois à faire l’extrait de<br />
beaucoup d’autres qu’on me prêtait à la bibliothèque<br />
<strong>du</strong> roi, et dont on me permit même d’emporter<br />
quelques-uns à l’Ermitage. Voilà mes provisions<br />
pour compiler au logis, quand le temps ne me<br />
permettait pas de sortir, et que je m’ennuyais de ma<br />
copie 34 . »<br />
1762-1764 : achèvement<br />
Exilé à Môtiers – sous la protection de Frédéric II de<br />
Prusse – en raison <strong>des</strong> condamnations encourues<br />
par l’Émile et le Contrat social, Jean-Jacques<br />
retrouva quelques loisirs. Mais ses ressources<br />
s’épuisaient et, à l’été 1762, il revint à la<br />
lexicographie : « Je repris mon Dictionnaire de<br />
musique, que dix ans de travail avaient déjà fort<br />
avancé, et auquel il ne manquait que la dernière<br />
main et d’être mis au net. Mes livres qui m’avaient<br />
été envoyés depuis peu, me fournirent le moyen<br />
32 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Discours sur l’origine et<br />
les fondements de l’inégalité parmi les hommes,<br />
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1755, LXX-2-262 pages.<br />
33 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Julie ou la Nouvelle<br />
Héloïse, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1761. Émile ou De<br />
l’é<strong>du</strong>cation, La Haye, J. Néaulme, 1762, quatre volumes in-<br />
8°. Du Contrat social ou Principes <strong>du</strong> droit politique,<br />
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762.<br />
34 ROUSSEAU, Confessions, tome III, livre IX, pages<br />
405-406.
d’achever cet ouvrage 35 . » La préface est datée « À<br />
Motiers-Travers le 20 Décembre 1764 ». Le<br />
manuscrit fut remis à la veuve Duchesne,<br />
l’approbation donnée par Alexis-Claude Clairault le<br />
15 avril 1765 et le privilège royal accordé à<br />
Compiègne le 17 juillet suivant. La première<br />
livraison <strong>du</strong> Dictionnaire parut en librairie en<br />
novembre 1767, millésimée 1768.<br />
Compte tenu de l’histoire un peu chaotique de sa<br />
rédaction, le Dictionnaire ne pouvait être une<br />
entreprise parfaite et son auteur reconnut bien<br />
volontiers avoir pro<strong>du</strong>it une « très mauvaise<br />
rapsodie que j’ai compilée, il y a plusieurs années,<br />
sous le nom de Dictionnaire de musique, et que je<br />
suis forcé de donner aujourd’hui pour avoir <strong>du</strong><br />
pain 36 . » Malgré cela, l’ouvrage rencontra un vif<br />
succès : second tirage à Paris en 1775 ; publication à<br />
Amsterdam en 1772, à Genève en 1781, et dans les<br />
différentes éditions <strong>des</strong> Œuvres complètes de<br />
l’écrivain. Il fut, par ailleurs, intégré au Supplément<br />
à l’Encyclopédie 37 , puis refon<strong>du</strong> dans l’Encyclopédie<br />
méthodique 38 . Ainsi largement diffusé, il a été lu,<br />
étudié et cité par tous les praticiens et théoriciens de<br />
la musique pendant au moins un demi-siècle.<br />
Le contenu <strong>du</strong> Dictionnaire<br />
Avec cinq cent quarante-huit pages de texte dans<br />
l’édition in-quarto et neuf cent trois entrées, le<br />
Dictionnaire de Rousseau se présente comme un<br />
monument d’une importance que la musique<br />
française n’avait encore jamais connue. L’auteur y a<br />
inclus de larges extraits de ses textes musicologiques<br />
inédits 39 .<br />
La lexicographie est l’objet principal <strong>du</strong> livre 40 . Les<br />
articles, généralement courts 41 , concernent la<br />
35 ROUSSEAU, Confessions, tome IV, livre XII, pages<br />
392-393.<br />
36 Lettre à M. Clairault, 1765.<br />
37 Supplément à l’Encyclopédie ou Dictionnaire<br />
raisonné <strong>des</strong> sciences, <strong>des</strong> arts et <strong>des</strong> métiers, par une<br />
société de gens de lettres, Amsterdam, Marc-Michel Rey, et<br />
Paris, Charles-Joseph Panckoucke, 1776-1777, tomes I-IV,<br />
sous la direction de Jean-Baptiste-René Robinet.<br />
38 Encyclopédie méthodique, Paris, Charles-Joseph<br />
Panckoucke et successeurs ; et Liège, Clément Plomteux,<br />
1782-1832 ; 206 volumes.<br />
39 <strong>Textes</strong> qui firent l’objet d’une publication posthume :<br />
Traités sur la musique, Genève, 1781, in-12, 2+395 pages.<br />
Ce volume contient : « Projet concernant de nouveaux<br />
signes pour la musique » (page 1) ; « Dissertation sur la<br />
musique moderne » (page 21) ; « Essai sur l’origine <strong>des</strong><br />
langues » (page 187) ; « Lettre à M. l’abbé Raynal » (page<br />
292) ; « Examen de deux principes avancés par M. Rameau<br />
dans sa brochure intitulée “Erreurs sur la musique dans<br />
l’Encyclopédie” » (page 299) ; « Lettre à M. Burney sur la<br />
musique » (page 337) ; « Extrait d’une réponse <strong>du</strong> petit<br />
faiseur à son prête-nom » (page 386).<br />
40 « La Musique est, de tous les beaux Arts, celui dont<br />
le Vocabulaire est le plus éten<strong>du</strong>, et pour lequel un<br />
Dictionnaire est, par conséquent, le plus utile. »<br />
(Rousseau, Dictionnaire de musique, préface, page III).<br />
41 Outre 55 entrées traitées en une seule ligne ne<br />
marquant généralement qu’un renvoi à un terme<br />
synonyme, 543 entrées (60 %) sont rédigées en 1 à 9 lignes<br />
et 149 (16,5 %) en 10 à 20 lignes Mais il y a aussi 76 articles<br />
(8,4 %) d’une longueur de 50 lignes et plus, les trois plus<br />
longs étant de 381, 468 et 758 lignes. [Décomptes réalisés<br />
dans l’édition in-quarto de 1768].<br />
35<br />
notation, la théorie musicale, l’harmonie ; la<br />
pratique musicale ; les genres et formes ; mais aussi<br />
la physique <strong>des</strong> sons et l’acoustique musicale, avec<br />
leurs explications mathématiques ; le tempérament ;<br />
l’histoire. Dans tous ces exposés, qu’ils soient<br />
techniques, esthétiques, scientifiques ou<br />
mathématiques, Rousseau manifeste une aisance et<br />
une précision qui témoignent d’une formation<br />
multidisciplinaire très développée. Il faut, toutefois,<br />
signaler une lacune importante : l’organologie ou<br />
étude <strong>des</strong> instruments de musique y est ré<strong>du</strong>ite à<br />
presque rien. Il est vrai que cette partie eût nécessité<br />
toute une iconographie… déjà magnifiquement<br />
traitée par les planches de l’Encyclopédie 42 .<br />
Mais, s’il traite généralement les sujets d’une<br />
manière très précise, pédagogique et objective,<br />
l’auteur n’hésite pas à sortir de la réserve imposée<br />
par l’esprit de l’ouvrage pour exposer <strong>des</strong> querelles,<br />
prendre parti dans certaines disputes, encenser les<br />
uns et blâmer les autres ; et il verse dans le<br />
manifeste en prônant une esthétique et un goût qui<br />
allaient, effectivement, succéder aux conceptions et<br />
pratiques déjà désuètes de son temps.<br />
La musique grecque tient une place considérable<br />
dans ce dictionnaire, avec pas moins de cent<br />
soixante-six entrées ! Deux raisons me paraissent<br />
avoir présidé à ce choix : d’une part, la nécessité<br />
d’exposer dans le détail <strong>des</strong> échelles ayant servi de<br />
modèles à celles de la musique occidentale ; d’autre<br />
part, le souci de démontrer la richesse d’une<br />
musique essentiellement vocale, purement<br />
monodique et dont chaque mode est chargé d’un<br />
éthos, c’est-à-dire d’un contexte affectif et<br />
émotionnel particulier. L’Antiquité inspire donc ce<br />
nouveau classicisme musical privilégiant la mélodie<br />
expressive.<br />
C’est ensuite l’harmonie qui connaît de grands<br />
développements, en raison de son caractère fort<br />
technique, <strong>des</strong> nombreuses règles qui président à la<br />
formation et à l’ordonnancement <strong>des</strong> accords.<br />
Rousseau expose tout d’abord le système de<br />
Rameau 43 , qui régissait alors toute la musique<br />
42 « Quant aux parties qui tiennent à l’Art sans lui être<br />
essentielles […]. Telle est celle <strong>des</strong> Instruments de<br />
Musique, partie vaste et qui remplirait seule un<br />
Dictionnaire, surtout par rapport aux Instruments <strong>des</strong><br />
Anciens. M. Diderot s’était chargé de cette partie dans<br />
l’Encyclopédie, et comme elle n’entrait pas dans mon<br />
premier plan, je n’ai eu garde de l’y ajouter dans la suite »<br />
(Rousseau, Dictionnaire de musique, préface, pages VII-<br />
VIII).<br />
43 L’œuvre théorique de Jean-Philippe Rameau<br />
consiste en quatorze ouvrages dont les monuments sont :<br />
Traité de l’harmonie ré<strong>du</strong>ite à ses principes naturels,<br />
Paris, Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 1722 ; Nouveau<br />
système de musique théorique, Paris, Jean-Baptiste-<br />
Christophe Ballard, 1726 ; Dissertation sur les différentes<br />
métho<strong>des</strong> d’accompagnement pour le clavecin ou pour<br />
l’orgue, Paris, Bailleux, 1732 ; Génération harmonique,<br />
Paris, Prault fils, 1737 ; Démonstration <strong>du</strong> principe de<br />
l’harmonie servant de base à tout l’art musical théorique<br />
et pratique, Paris, Durand et Pissot, 1750 ; Code de<br />
musique pratique, Paris, Imprimerie royale, 1760. — Ce<br />
corpus aboutissant à une science harmonique d’une grande<br />
complexité, d’Alembert en donna un exposé simplifié dans<br />
ses Éléments de musique théorique et pratique suivant les<br />
principes de M. Rameau, Paris, David l’aîné, 1752.
française, mais lui oppose celui de Tartini 44 , encore<br />
peu connu : « J’ai traité la partie Harmonique dans<br />
le système de la Basse-fondamentale, quoique ce<br />
système, imparfait et défectueux à tant d’égards, ne<br />
soit point, selon moi, celui de la Nature et de la<br />
vérité, et qu’il en résulte un remplissage sourd et<br />
confus, plutôt qu’une bonne Harmonie. Mais c’est<br />
un système, enfin ; c’est le premier, et c’était le seul<br />
jusqu’à celui de M. Tartini, où l’on ait lié, par <strong>des</strong><br />
principes, ces multitu<strong>des</strong> de règles isolées qui<br />
semblaient toutes arbitraires, et qui faisaient, de<br />
l’Art Harmonique, une étude de mémoire plutôt que<br />
de raisonnement 45 . » Les deux démarches étaient<br />
effectivement opposées : « M. Rameau fait<br />
engendrer les Dessus par la Basse ; M. Tartini fait<br />
engendrer la Basse par les Dessus : celui-ci tire<br />
l’Harmonie de la Mélodie, et le premier fait tout le<br />
contraire 46 . »<br />
Et surtout, Rousseau conteste le principe même de<br />
la primauté de l’harmonie dans la composition. Il<br />
déclare tout d’abord que l’harmonie n’est pas<br />
donnée par la Nature, même si elle paraît dériver<br />
<strong>des</strong> propriétés <strong>du</strong> son : « Le principe physique de la<br />
résonance nous offre les Accords isolés et solitaires ;<br />
il n’en établit pas la succession 47 . » De plus, pour<br />
lui, tout système harmonique « n’est établi que sur<br />
<strong>des</strong> analogies et <strong>des</strong> convenances qu’un homme<br />
inventif peut renverser demain par d’autres plus<br />
naturelles 48 ». Enfin, il recourt à une observation<br />
ethnologique : « Quand on songe que, de tous les<br />
peuples de la terre, qui tous ont une Musique et un<br />
Chant, les Européens sont les seuls qui aient une<br />
Harmonie, <strong>des</strong> Accords, et qui trouvent ce mélange<br />
agréable ; quand on songe que le monde a <strong>du</strong>ré tant<br />
de siècles, sans que, de toutes les Nations qui ont<br />
cultivé les beaux Arts, aucune ait connu cette<br />
Harmonie ; qu’aucun animal, qu’aucun oiseau,<br />
qu’aucun être dans Nature ne pro<strong>du</strong>it d’autre<br />
Accord que l’Unisson, ni d’autre Musique que la<br />
Mélodie ; que les langues orientales, si sonores, si<br />
musicales ; que les oreilles Grecques, si délicates, si<br />
sensibles, exercées avec tant d’Art, n’ont jamais<br />
guidé ces peuples voluptueux et passionnés vers<br />
notre Harmonie ; que, sans elle, leur Musique avait<br />
<strong>des</strong> effets si prodigieux ; qu’avec elle la nôtre en a de<br />
si faibles ; qu’enfin il était réservé à <strong>des</strong> Peuples <strong>du</strong><br />
Nord, dont les organes <strong>du</strong>rs et grossiers sont plus<br />
44 Le Dictionnaire de Rousseau contient trois entrées<br />
SYSTEME, correspondant aux trois acceptions <strong>du</strong> terme. La<br />
première (pages 470-474, 172 lignes) définit l’intervalle<br />
sonore exploité par la musique et sa division en degrés<br />
successifs. La deuxième (pages 474-482, 232 lignes) réfère<br />
à la mesure <strong>des</strong> intervalles entre les degrés constitués,<br />
aboutissant à distinguer plusieurs échelles. Dans un<br />
dernier sens (pages 480-496, 758 lignes, le plus long<br />
article de l’ouvrage), il considère <strong>des</strong> constructions<br />
harmoniques et développe longuement celle de Giuseppe<br />
Tartini, exposée dans son fameux Trattato di musica<br />
secondo la vera scienza dell’armonia (Padova, G. Manfré,<br />
1754, in-4°, 176 pages).<br />
45 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, préface, page<br />
VIII.<br />
46 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 240,<br />
HARMONIE.<br />
47 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 240,<br />
HARMONIE.<br />
48 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 240,<br />
HARMONIE.<br />
36<br />
touchés de l’éclat et <strong>du</strong> bruit <strong>des</strong> Voix, que de la<br />
douceur <strong>des</strong> accents et de la Mélodie <strong>des</strong> inflexions,<br />
de faire cette grande découverte et de la donner pour<br />
principe à toutes les règles de l’Art ; quand, dis-je,<br />
on fait attention à tout cela, il est bien difficile de ne<br />
pas soupçonner que toute notre Harmonie n’est<br />
qu’une invention Gothique et barbare, dont nous ne<br />
nous fussions jamais avisés, si nous eussions été<br />
plus sensibles aux véritables beautés de l’Art, et à la<br />
musique vraiment naturelle 49 . »<br />
Dans toute cette argumentation, Rousseau démolit<br />
systématiquement tous les principes invoqués par<br />
Rameau, démontre la fausseté <strong>des</strong> expériences qui<br />
les fondent, et relègue son harmonie à un exercice<br />
factice de spécialistes, à une construction humaine<br />
dont le caractère artificiel est patent.<br />
Pour Rousseau, seule la mélodie procède<br />
véritablement de la Nature, puisque les degrés qui<br />
composent la gamme sont générés par un principe<br />
unique, la consonance de quinte. L’article MELODIE<br />
n’est pas très développé par lui-même (cinquantequatre<br />
lignes), mais il est précisé par les entrées<br />
ACCENT, RYTHME, UNITE DE MELODIE, MODE,<br />
RECITATIF, MODULATION, IMITATION, EXPRESSION, etc.<br />
Au départ est la parole, avec ses accents : l’accent<br />
grammatical qui accorde aux syllabes prononcées<br />
une hauteur grave ou aiguë, et une quantité brève ou<br />
longue ; l’accent logique ou rationnel qui ordonne<br />
les propositions en vue de leur intelligibilité ; et<br />
l’accent pathétique ou oratoire qui, par les inflexions<br />
de la voix, un ton plus ou moins élevé, un débit vif<br />
ou lent, exprime les sentiments de celui qui parle et<br />
les communique à ses auditeurs. À cet égard, il<br />
reconnaît que les différentes langues humaines ne<br />
sont pas égales : « Le plus ou moins d’Accent est la<br />
vraie cause qui rend les langues plus ou moins<br />
musicales 50 ».<br />
À l’accent se superpose le rythme, ou mouvement,<br />
<strong>du</strong> discours, la prosodie de la langue ; mais aussi le<br />
rythme inhérent à la Nature : la tristesse marche à<br />
temps égaux et lents, plaintifs et graves, tandis que<br />
la joie est marquée par <strong>des</strong> tons sautillants et<br />
rapi<strong>des</strong>, gais et animés.<br />
La réunion <strong>des</strong> accents et <strong>du</strong> rythme constitue la<br />
mélodie ; mo<strong>des</strong> et mo<strong>du</strong>lations sont <strong>des</strong> moyens<br />
musicaux qui les renforcent et permettent à la<br />
mélodie de chanter et de parler au cœur. La règle de<br />
l’unité de la mélodie invite à donner la primeur à un<br />
chant monodique, soutenu, animé et renforcé par<br />
une harmonie adaptée.<br />
Entre la voix parlée et le chant, Rousseau conçoit un<br />
récitatif ou « discours récité d’un ton musical et<br />
harmonieux », « manière de chant qui approche de<br />
beaucoup la parole 51 ».<br />
D’une façon générale, Rousseau en appelle à un<br />
chant expressif, totalement calqué sur les accents et<br />
le rythme de la langue, imitant autant que faire se<br />
49 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 245,<br />
HARMONIE.<br />
50 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 22,<br />
ACCENT.<br />
51 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 406,<br />
RECITATIF.
peut les objets à peindre ou les passions à exprimer,<br />
afin de « mettre l’œil dans l’oreille 52 ».<br />
C’est au nom de toutes ces considérations<br />
techniques et esthétiques qu’il en vient à dénier à la<br />
langue française toute expressivité vraiment<br />
musicale et à préférer la musique <strong>des</strong> Italiens : « Les<br />
premières habitu<strong>des</strong> m’ont longtemps attaché à la<br />
Musique Française, et j’en étais enthousiaste<br />
ouvertement. Des comparaisons attentives et<br />
impartiales m’ont entraîné vers la Musique<br />
Italienne, et je m’y suis livré avec la même bonne<br />
foi 53 . » Dans sa recherche d’une esthétique nouvelle<br />
antimonarchique et antiramiste, cultivant le naturel<br />
plutôt que la sophistication, recherchant les accents<br />
tendres de la voix plutôt que la physique <strong>des</strong> sons, il<br />
marque sa préférence pour la musique italienne,<br />
parfaite réalisation de l’imitation de la Nature et de<br />
l’unité de mélodie.<br />
Enfin, dans son très long article OPERA – quatre cent<br />
soixante-huit lignes, le deuxième par la taille, –<br />
Rousseau étend les théories précédemment<br />
développées en les appliquant à tout « spectacle<br />
dramatique et lyrique où l’on s’efforce de réunir tous<br />
les charmes <strong>des</strong> beaux Arts, dans la représentation<br />
d’une action passionnée, pour exciter, à l’aide de<br />
sensations agréables, l’intérêt et l’illusion 54 . » Arrivé<br />
à un moment où les idées connaissaient une<br />
évolution majeure, il prend fait et cause pour le goût<br />
naissant : « C’est alors que, commençant à se<br />
dégoûter de tout le clinquant de la féerie, <strong>du</strong> puéril<br />
fracas <strong>des</strong> machines, et de la fantasque image <strong>des</strong><br />
choses qu’on n’a jamais vues, on chercha dans<br />
l’imitation de la Nature <strong>des</strong> tableaux plus<br />
intéressants et plus vrais. […] Le Théâtre fut purgé<br />
<strong>du</strong> jargon de la Mythologie, l’intérêt fut substitué au<br />
merveilleux, les machines <strong>des</strong> Poètes et <strong>des</strong><br />
Charpentiers furent détruites, et le Drame lyrique<br />
prit une forme plus noble et moins gigantesque.<br />
Tout ce qui pouvait émouvoir le cœur y fut employé<br />
avec succès, on n’eut plus besoin d’en imposer par<br />
<strong>des</strong> êtres de raison, ou plutôt de folie, et les Dieux<br />
furent chassés de la Scène quand on y fut<br />
représenter les hommes 55 . » Son opéra exclut les<br />
fêtes et divertissements, qui suspendent l’action et<br />
détruisent la vraisemblance.<br />
Avec autant d’idées aussi nouvelles et aussi<br />
longuement développées, Rousseau se fait le chantre<br />
<strong>du</strong> goût nouveau qui commence à supplanter<br />
l’esthétique baroque finissante.Mais, là ne se<br />
limitent pas les ouvertures esquissées par son<br />
Dictionnaire.<br />
Rousseau manifeste par exemple de l’intérêt pour la<br />
chanson populaire (CHANSON), ses acteurs (BARDES)<br />
ou son répertoire (RANZ DES VACHES). Dans l’article<br />
MUSIQUE il transcrit un air chinois, un air persan et<br />
deux chansons « <strong>des</strong> Sauvages de l’Amérique » ;<br />
ailleurs, il insiste sur les différentes formes et<br />
52 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 253,<br />
IMITATION.<br />
53 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, préface, page<br />
IX.<br />
54 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 344,<br />
OPERA.<br />
55 ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, page 349,<br />
OPERA.<br />
37<br />
conceptions de l’art musical aux différents âges ou<br />
dans différentes cultures ; en ramenant ainsi la<br />
musique à sa dimension simplement mélodique, il<br />
valorise les pratiques populaires vocales et<br />
instrumentales, invitant à développer une approche<br />
ethnomusicologique.<br />
Enfin, il n’oublie pas les « petits métiers » de la<br />
musique – le copiste (bel article de deux cent<br />
quatre-vingts lignes), l’accordeur, le facteur, le<br />
luthier – comme pour rappeler que le grand art ne<br />
saurait se passer de petites mains.<br />
Au total, même si le Dictionnaire de Rousseau n’est<br />
pas exempt d’erreurs et de contradictions, il était, à<br />
sa sortie en 1768, l’ouvrage le plus complet sur la<br />
question. Aujourd’hui encore, c’est le meilleur<br />
témoin de l’état <strong>des</strong> connaissances concernant la<br />
théorie musicale au XVIII e siècle.<br />
Conclusion<br />
Dans le domaine musical, Rousseau est resté un<br />
compositeur mineur, aujourd’hui quasiment oublié<br />
56 . Ses adversaires l’ont, bien évidemment, traité de<br />
« mauvais musicien » et Jean-Jacques lui-même<br />
paraît leur avoir donné raison en soulignant<br />
constamment ses insuffisances, comme il le fait par<br />
exemple dans les Confessions. Et pourtant, son<br />
œuvre est de qualité, notamment dans sa partie<br />
lyrique : « Un mélodiste bien inspiré qui structure<br />
élégamment ses airs, contraste fortement ses<br />
récitatifs et compense son fragile métier<br />
harmonique par une recherche de transparence<br />
dans le tissu orchestral 57 . »<br />
Son Dictionnaire de musique, quoique<br />
régulièrement réédité, n’intéresse plus guère que les<br />
historiens de la musique.<br />
56 Le catalogue <strong>des</strong> œuvres musicales de Jean-Jacques<br />
Rousseau contient essentiellement <strong>des</strong> pièces vocales ; de<br />
nombreuses compositions sont restées à l’état de<br />
manuscrits. La musique instrumentale publiée paraît se<br />
ré<strong>du</strong>ire à : Le Printemps de Vivaldi, arrangé pour une<br />
flûte sans accompagnement, Paris, Bignon, sd [1775], infolio,<br />
5 pages. — Après sa mort, les manuscrits autographes<br />
de musique retrouvés parmi ses papiers furent déposés à la<br />
bibliothèque <strong>du</strong> roi le 10 avril 1781 ; ils appartiennent<br />
aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France,<br />
département de la musique, reliés en un recueil factice<br />
(Rés Vm 7 667) de 19+601 pages, (pagination continue<br />
ajoutée aux paginations originales) contenant : « Recueil<br />
de nouveaux airs sur d’anciennes chansons » (pages 1-157),<br />
ariettes et <strong>du</strong>os (pages 158-357), musique latine religieuse<br />
(pages 357-462), ainsi qu’une partition abrégée et divers<br />
fragments de Daphnis et Cloé. — Enfin, ses derniers amis<br />
ont publié une centaine d’airs et d’ariettes accompagnés de<br />
harpe, clavecin ou orchestre, sous le titre Les Consolations<br />
<strong>des</strong> misères de ma vie ou Recueil d’airs, romances et <strong>du</strong>os,<br />
Paris, De Roullède de la Chevardière, 1781, 11-199-II pages,<br />
partition.<br />
57 DAUPHIN (Claude), intro<strong>du</strong>ction (page XVI) au<br />
facsimilé Dictionnaire de musique, Arles, Actes Sud,<br />
collection « Thesaurus », 2007, in-16, LXVIII-XVI-550 pages<br />
et 14 planches + planches de lutherie tirées de<br />
l’Encyclopédie. Ce facsimilé repro<strong>du</strong>it un exemplaire <strong>du</strong><br />
second tirage in-octavo.
Par contre, les idées que Rousseau a émises, les<br />
impulsions qu’il a données et les voies qu’il a<br />
ouvertes ont profondément marqué les évolutions<br />
esthétiques ultérieures, dans cette période-clé qui,<br />
de la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750 à la<br />
naissance de Ludwig van Beethoven en 1770, vit<br />
l’éclosion <strong>du</strong> classicisme sur les cendres de la<br />
38<br />
musique baroque, l’émergence <strong>des</strong> Lumières et de la<br />
démocratie républicaine. Par sa volonté de<br />
populariser les pratiques musicales, de les libérer <strong>du</strong><br />
carcan de la tradition et <strong>des</strong> célébrations<br />
monarchiques, il a puissamment contribué à<br />
l’apparition d’une nouvelle esthétique et au<br />
renouveau de la société et de ses institutions.
ROUSSEAU MUSICIEN DE LA NATURE ET DU NATUREL<br />
Tout lecteur attentif <strong>des</strong> Confessions sait que Jean-<br />
Jacques Rousseau a aimé la musique avec passion, au<br />
point de vouloir en faire sa profession. À Paris il sort<br />
de l’anonymat grâce à la musique et se présente<br />
comme musicien. Il a eu en face de lui deux<br />
compositeurs d’envergure, le Français Rameau puis<br />
l’Allemand Gluck. Si ses rapports avec Gluck, un<br />
musicien de sa génération, arrivé en France en 1774,<br />
furent assez pacifiques, il n’en fut pas de même pour<br />
Rameau dont il stigmatisa dans ses écrits la<br />
complexité.<br />
Rousseau musicien c’est tout d’abord le copiste : toute<br />
sa vie il a recopié <strong>des</strong> parties séparées pour l’exécution<br />
de nombreuses partitions de ses contemporains.<br />
Monique DAUTEMER<br />
Les œuvres musicales de Rousseau<br />
39<br />
C’est ce qui lui a permis de vivre. Rousseau musicien<br />
c’est aussi le jeune maître de musique d’enfants de<br />
bonne famille. Il avoue « Me voilà maître à chanter<br />
sans savoir déchiffrer un air ». À Chambéry, à 20 ans,<br />
il décide d’apprendre sérieusement la musique grâce<br />
au Traité d’harmonie de Rameau. Rousseau musicien<br />
c’est encore le compositeur. Ses premiers essais ne<br />
sont qu’une suite d’échecs cuisants (symphonie jouée<br />
à Lausanne en 1730).<br />
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Rousseau<br />
n’a jamais renoncé à la musique. En consultant la liste<br />
de ses compositions on peut constater qu’il s’y est<br />
consacré dès sa jeunesse et jusqu’à ses derniers jours.<br />
1. Symphonie composée et exécutée à Lausanne en 1730<br />
2. Cantates, chansons, composées et exécutées à Chambéry de 1733 à 1737.<br />
3. Un papillon badin caressait une rose. Chanson mise en musique par M Rousseau à Chambéry. Mercure de France,<br />
juin 1737<br />
4. Iphis et Anaxarète. Opéra composé à Chambéry vers 1740<br />
5. La Découverte <strong>du</strong> nouveau monde. Opéra composé à Lyon en 1741<br />
6. Les Muses galantes. Opéra-ballet en trois actes composé en 1743-1745. (Il ne reste de cette œuvre que le livret et la<br />
musique de la 1 ère entrée, Hésiode)<br />
7. Les Fêtes de Ramire. Remaniement de La Princesse de Navarre de Voltaire et Rameau, représenté à Versailles le<br />
22 décembre 1745.<br />
8. Canzoni di Batello. Chansons italiennes, composées en 1743 ou 1744 et gravées à Paris en 1753<br />
9. Symphonie à cors de chasse. Exécutée au Concert spirituel le 23 mai 1751<br />
10. Salve regina. Motet pour voix seule et orchestre composé pour Mlle Fel et chanté par elle au Concert spirituel le 17<br />
et le 19 avril 1752<br />
11. Le Devin <strong>du</strong> Village. Intermède en un acte représenté pour la première fois à Fontainebleau le 18 octobre 1752 et à<br />
l'Opéra de Paris le 1 er mars 1753<br />
12. Ecce se<strong>des</strong> hic tonantis. Motet pour voix seule et orchestre composé pour la dédicace de la chapelle <strong>du</strong> château de<br />
la Chevrette et exécuté le 15 septembre 1757<br />
13. Quam dilecta tabernacula. Motet pour deux voix et basse composé à Trye-le-Château en 1767-1768<br />
14. Quomodo sedet sola civitas, avec un répons, pour chant et basse continue, 1772<br />
15. Principes persecuti sunt. Motet en rondeau pour voix seule (date inconnue)<br />
16. Pygmalion. Scène lyrique représentée pour la première fois à Lyon le 19 avril 1770, puis à Paris à la Comédie<br />
Française, le 30 octobre 1775, avec ouverture et musique de scène d’Horace Coignet et deux morceaux de la<br />
composition de Rousseau<br />
17. Six nouveaux airs <strong>du</strong> Devin <strong>du</strong> village composés vers novembre 1774 et chantés à l'Opéra le 20 avril 1779<br />
18. Daphnis et Chloé. Opéra inachevé<br />
19. Les Consolations <strong>des</strong> misères de ma vie, ou Recueil d'airs, romances et <strong>du</strong>os.
L’œuvre musicale la plus célèbre de Rousseau est sans<br />
nul doute Le Devin <strong>du</strong> village (1752). Créé à<br />
Fontainebleau devant Louis XV, ce petit ouvrage en un<br />
acte a connu 540 représentations sur la scène de<br />
l’opéra de Paris jusqu’à la Révolution de Juillet (1830)<br />
et a été l’un <strong>des</strong> fleurons de l’art français à travers<br />
l’Europe. On ne mesure pas<br />
toujours l’importance de cette<br />
œuvrette qui a transformé la<br />
sensibilité de l’époque,<br />
con<strong>du</strong>isant à la recherche <strong>du</strong><br />
naturel et de la vérité <strong>des</strong><br />
sentiments par la mise en scène<br />
de personnages contemporains<br />
(<strong>des</strong> gens de tous les jours) avec<br />
un texte, une musique et une<br />
scénographie soignés. C’est cette<br />
œuvre qui a con<strong>du</strong>it au<br />
rayonnement de l’opéracomique<br />
français et à ses<br />
incidences sur l’art lyrique<br />
européen. Beaumarchais a su<br />
s’en inspirer dans sa trilogie et<br />
Mozart aussi…<br />
Berlioz, appartenant à cette<br />
génération de Français qui a été<br />
é<strong>du</strong>quée en suivant les principes<br />
de l’Émile, témoignera sur<br />
Rousseau dans ses Mémoires. Il<br />
a assisté à Paris à la dernière<br />
représentation <strong>du</strong> Devin <strong>du</strong><br />
Village en 1829, l’année <strong>du</strong><br />
Guillaume Tell de Rossini,<br />
œuvre qui marque la naissance<br />
de l’opéra romantique :<br />
« Pauvre Rousseau, qui<br />
attachait autant d’importance à sa partition <strong>du</strong> Devin<br />
<strong>du</strong> village, qu’aux chefs-d’œuvre d’éloquence qui ont<br />
immortalisé son nom, lui qui croyait fermement avoir<br />
écrasé Rameau tout entier avec les petites chansons,<br />
les petits flonflons, les petits rondeaux, les petits solos,<br />
les petites bergeries, les petites drôleries de toute<br />
espèce dont se compose son petit intermède ; lui qu’on<br />
a tant tourmenté, lui qu’on a accusé de n’en être pas<br />
l’auteur, lui qui a été chanté par toute la France,<br />
depuis Jéliotte et Mlle Fel jusqu’au roi Louis XV, qui<br />
ne pouvait se lasser de répéter : « J’ai per<strong>du</strong> mon<br />
serviteur » avec la voix la plus fausse de son royaume ;<br />
lui enfin dont l’œuvre favorite obtint à son apparition<br />
tous les genres de succès ; pauvre Rousseau ! qu’eût-il<br />
dit de nos blasphèmes, s’il eût pu les entendre ? Et<br />
pouvait-il prévoir que son cher opéra, qui excita tant<br />
d’applaudissements, tomberait un jour pour ne plus se<br />
relever, sous le coup d’une énorme perruque poudrée,<br />
jetée aux pieds de Colette par un insolent railleur ?<br />
J’assistais à cette dernière représentation <strong>du</strong> Devin ;<br />
beaucoup de gens, en conséquence, m’ont attribué la<br />
mise en scène de la perruque ; mais je proteste de mon<br />
innocence. Je crois même avoir été au moins autant<br />
indigné que diverti par cette grotesque irrévérence, de<br />
sorte que je ne puis savoir au juste si j’en eusse été<br />
capable. Mais s’imaginerait-on que Gluck, oui, Gluck<br />
lui-même, à propos de ce triste Devin, il y a quelque<br />
40<br />
cinquante ans, a poussé l’ironie plus loin encore, et<br />
qu’il a osé écrire et imprimer dans une épître la plus<br />
sérieuse <strong>du</strong> monde, adressée à la reine Marie-<br />
Antoinette, que la France, peu favorisée sous le<br />
rapport musical, comptait pourtant quelques ouvrages<br />
remarquables, parmi lesquels il fallait citer Le Devin<br />
<strong>du</strong> village de M. Rousseau ?<br />
Qui jamais se fût avisé de<br />
penser que Gluck pût être aussi<br />
plaisant ? Ce trait seul d’un<br />
Allemand suffit pour enlever<br />
aux Italiens la palme de la<br />
perfidie facétieuse. » (Berlioz,<br />
Mémoires)<br />
Au milieu <strong>du</strong> XVIII e siècle le<br />
grand art en Europe était<br />
l’opéra, dont le grand prêtre en<br />
France était Rameau, regardé<br />
aussi comme le grand<br />
théoricien musical français. Le<br />
22 août 1742, Rousseau,<br />
parrainé par Réaumur grâce à<br />
<strong>des</strong> connaissances lyonnaises,<br />
présente à Paris, devant une<br />
commission de l'<strong>Académie</strong> <strong>des</strong><br />
Sciences, son Projet de<br />
nouveaux signes pour la<br />
musique. Il s’agit de simplifier<br />
la lecture <strong>des</strong> notes grâce à une<br />
notation chiffrée. Dans sa<br />
communication, il déclare<br />
notamment : « Cette quantité<br />
de lignes, de clefs, de dièses, de<br />
bémols, de bécarres, de<br />
mesures simples et composées,<br />
de ron<strong>des</strong>, de blanches , de<br />
noires, de croches, de doubles, de triples croches, de<br />
pauses, de demi-pauses, de soupirs, de demi- soupirs,<br />
de quarts de soupirs, etc., donne une foule de signes et<br />
de combinaisons d`où résultent deux inconvénients<br />
principaux , l’un d’occuper un trop grand volume, et<br />
l’autre de surcharger la mémoire <strong>des</strong> écoliers… ». Le<br />
grand Rameau fait partie de la commission et oppose<br />
<strong>des</strong> arguments que Rousseau accepte, notamment que<br />
ce système n’est pas nouveau et qu’il n’est pas au<br />
point. Jusque-là, Rousseau admire en secret le grand<br />
homme dont il se considère le disciple, mais Rameau,<br />
âgé de 59 ans, quant à lui, ignore totalement son<br />
cadet. Plus d’une génération les sépare.<br />
Après cette communication Rousseau est<br />
immédiatement reconnu à Paris comme musicien et<br />
c’est en cette qualité qu’il fréquente le monde<br />
intellectuel et artistique de son époque. L’année<br />
suivante il remanie son Projet qu’il rebaptise<br />
Dissertation sur la musique moderne 1743. C’est sa<br />
deuxième publication officielle. «La musique a eu le<br />
sort <strong>des</strong> arts qui ne se perfectionnent que<br />
successivement : les inventeurs de ses caractères n’ont<br />
songé qu’à l’état où elle se trouvait en leur temps sans<br />
prévoir celui où elle pourrait parvenir par la suite. »<br />
Puis plus loin Jean-Jacques se lamente sur la<br />
difficulté <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> musicales «tout le monde,<br />
excepté les artistes, ne cesse de se plaindre de
l’extrême longueur qu’exige l’étude de la musique<br />
avant que de la posséder passablement». Par cette<br />
remarque, par ailleurs plutôt juste, il confirme<br />
l’extrême faiblesse de sa connaissance <strong>du</strong> langage<br />
musical !<br />
En septembre 1743 Rousseau part pour Venise comme<br />
secrétaire personnel de M. de Montaigu<br />
l’Ambassadeur de France ; ce séjour de 18 mois<br />
seulement va avoir une grande importance pour lui :<br />
celle de lui faire connaître la meilleure <strong>des</strong> musiques<br />
italiennes, celle que l’on pratique à Venise. Il donne<br />
notamment, dans Les Confessions un témoignage très<br />
intéressant sur le concert <strong>des</strong> jeunes filles à l’Ospedale<br />
dei Mendicanti et ceci juste l’année où Vivaldi a quitté<br />
définitivement la lagune. Ayant réussi à se rendre<br />
indésirable, il quitte Venise le 6 août 1744.<br />
Rentré à Paris en octobre de la même année, il<br />
commence à travailler pour gagner sa vie : quelques<br />
travaux de copie pour <strong>des</strong> musiciens et secrétariat chez<br />
Mme Dupin et son beau-fils M. de Francueil. Il<br />
commence la composition d’un opéra-ballet, Les<br />
Muses galantes dont il écrit aussi le livret. Rousseau, à<br />
cette période, fréquente assi<strong>du</strong>ment le salon<br />
d’Alexandre Le Riche de la Pouplinière, fermier<br />
général fortuné et protecteur <strong>des</strong> artistes et <strong>des</strong><br />
philosophes, notamment de Voltaire, <strong>du</strong> célèbre<br />
pastelliste Quentin de La Tour, et de Rameau, qui est<br />
son directeur musical et le chef de son orchestre privé.<br />
Madame de la Pouplinière, Thérèse Des Hayes est<br />
l’élève de Rameau.<br />
En juillet 1745 Rousseau achève son opéra-ballet Les<br />
Muses galantes qui est représenté partiellement chez<br />
La Pouplinière en septembre, devant Rameau qui<br />
apostrophe brutalement Rousseau, ce qui marquera le<br />
début d’une haine réciproque. Rameau évoque les faits<br />
dix ans plus tard dans sa publication de 1755 Erreur<br />
sur la musique dans l'Encyclopédie à la suite de la<br />
parution <strong>du</strong> 6 e volume de l’Encyclopédie dans lequel<br />
Rousseau était le rédacteur <strong>des</strong> articles sur la musique.<br />
Voici ce qu’écrit Rameau : «Il y a dix ou douze ans<br />
qu’un particulier fit exécuter chez M. *** un ballet de<br />
sa composition, qui depuis fut présenté à l’Opéra, et<br />
refusé : je fus frappé d’y trouver de très beaux airs de<br />
violon dans un goût absolument italien, et en même<br />
temps tout ce qu’il y a de plus mauvais en musique<br />
française tant vocale qu’instrumentale, jusqu’à <strong>des</strong><br />
ariettes de la plus plate vocale secondée <strong>des</strong> plus jolis<br />
accompagnements italiens. Ce contraste me surprit, et<br />
je fis à l’auteur quelques questions, auxquelles il<br />
répondit si mal, que je vis bien, comme je l’avais déjà<br />
conçu, qu’il n’avait fait que la musique française, et<br />
avait pillé l’italienne. » (pp.41-42) Quelques semaines<br />
plus tard l’opéra-ballet était exécuté intégralement<br />
chez M. de Bonneval devant le <strong>du</strong>c de Richelieu qui<br />
déclara enthousiaste : «M. Rousseau, voilà de<br />
l'harmonie qui transporte. Je n'ai jamais enten<strong>du</strong> rien<br />
de plus beau : je veux faire donner cet ouvrage à<br />
Versailles » et il lui conseilla de procéder à quelques<br />
modifications. Le remaniement, achevé en trois<br />
semaines, ne fut pas donné à la cour. Rameau était<br />
intervenu auprès de Mme de La Pouplinière, son élève,<br />
41<br />
qui était aussi la maîtresse <strong>du</strong> <strong>du</strong>c de Richelieu, un<br />
grand débauché comme il y en avait tant à cette<br />
époque.<br />
À la fin de l'année 1745, Richelieu demande à<br />
Rousseau, pour les fêtes de Versailles, de retoucher<br />
Les Fêtes de Ramire, une ré<strong>du</strong>ction de La Princesse de<br />
Navarre de Voltaire/Rameau. Il est bien rémunéré<br />
pour son travail mais son nom ne se trouve pas sur le<br />
livret distribué ce jour-là. Il juge immédiatement qu'il<br />
s'agit d'une intrigue de Rameau et Mme de La<br />
Pouplinière ; il tombe malade, renonce pour le<br />
moment à la carrière de musicien et reprend son<br />
secrétariat chez la bonne Madame Dupin.<br />
En 1749 Rousseau commence sa collaboration à<br />
l’Encyclopédie, qui va paraître au rythme d’un volume<br />
par an pendant onze ans. Il semble aujourd’hui<br />
étonnant que Diderot et D’Alembert aient confié à<br />
Rousseau, plutôt qu’à Rameau, la rédaction <strong>des</strong><br />
articles sur la musique. Il rédigera trois cent soixantedeux<br />
articles dont quarante-quatre mentionnent<br />
Rameau, ce qu’il ne peut éviter, s’agissant <strong>des</strong> articles<br />
sur la théorie musicale. Au fil <strong>des</strong> publications<br />
D'Alembert adoucira, voire supprimera les critiques<br />
sur Rameau, ce fleuron de la musique française, mais<br />
certaines échapperont à sa surveillance et, chaque fois<br />
qu'un nouveau tome de l'Encyclopédie paraîtra la<br />
colère de Rameau s’amplifiera.<br />
En février 1752, Rousseau publie, anonymement, la<br />
Lettre à M. Grimm sur la musique de Rameau où il<br />
écrit notamment « Le célèbre Monsieur Rameau, dont<br />
les écrits ont ceci de singulier qu’ils ont fait grande<br />
fortune sans avoir été lus de personne ». Plus loin il<br />
reconnait : « L’orchestre de l’Opéra ressemblait, avant<br />
lui, à une troupe de quinze-vingt attaquée de<br />
paralysie ; il les a un peu dégourdis » mais il ajoute<br />
aussitôt « M. Rameau a abusé de cet orchestre. Il a<br />
ren<strong>du</strong> ses accompagnements si confus que la tête a<br />
peine à tenir au tintamarre continuel <strong>des</strong> divers<br />
instruments… »<br />
Après ces échanges sympathiques publiés de réponse<br />
en réponse, un intermède bouffe italien va mettre le<br />
feu aux poudres, et ce sera la fameuse « Querelle <strong>des</strong><br />
bouffons ». Rappelons-en les gran<strong>des</strong> lignes. En août<br />
1752, les Bouffons italiens sont en effet autorisés à<br />
jouer à l’<strong>Académie</strong> Royale. Ils font leurs débuts avec<br />
La Serva Padrona de Pergolèse, excellent intermède<br />
bouffe en un acte. Enorme succès qui partage la<br />
capitale entre partisans <strong>des</strong> Italiens et partisans de la<br />
musique française et va donner naissance à de<br />
nombreux articles vindicatifs dans la presse. Or<br />
Rousseau avait déjà composé son Devin <strong>du</strong> Village au<br />
printemps, s’inspirant <strong>des</strong> intermezzi italiens : un acte<br />
et pas d’ouverture, ni de final. Le 18 octobre 1752 son<br />
opéra-comique est représenté à Fontainebleau devant<br />
la cour. Il est alors âgé de quarante ans et a publié<br />
dans le domaine littéraire seulement l’essai<br />
philosophique Discours sur les sciences et les arts<br />
avec succès d’ailleurs.<br />
Le Devin <strong>du</strong> Village, est représentatif de la sensibilité<br />
française qui s’attache alors à présenter l’homme dans
toute la vérité de la nature. Rousseau y ajoute la<br />
recherche de la justice sociale. C’est cette pensée qui<br />
va contribuer au développement de l’art <strong>des</strong> musiciens<br />
romantiques, à commencer par Beethoven. Dans cette<br />
œuvre il cherche à démontrer que la simplicité et le<br />
naturel peuvent émouvoir, toucher l’auditeur et cette<br />
recherche de vérité va impulser un profond<br />
changement dans l’art lyrique.<br />
Voici la genèse de son Devin évoquée ultérieurement<br />
dans les Confessions. Au printemps 1751, Jean-<br />
Jacques faisait une cure à Passy, non loin <strong>du</strong> château<br />
de Boulainvilliers, demeure de M. de la Pouplinière. Il<br />
résidait chez son ami Mussard, ancien Genevois,<br />
comme lui. Alors qu’ils discutaient de l’opera-buffa<br />
qu’ils avaient tous deux connu en Italie, l’idée lui vint<br />
de « barbouiller » <strong>des</strong> vers et <strong>des</strong> chants. Ce fut le<br />
point de départ de son intermède qu’il étoffa bien vite.<br />
Un de ses amis de l’<strong>Académie</strong> royale de musique se<br />
chargea de faire essayer l’ouvrage à l’Opéra sans<br />
donner le nom de l’auteur. Selon Rousseau « une<br />
exclamation générale salua l’ouvrage » et il fut décidé<br />
que l’œuvre serait d’abord jouée à la cour, à<br />
Fontainebleau, devant le Roi Louis XV et Mme de<br />
Pompadour, le 18 octobre. Le haute-contre Jélyotte, la<br />
soprano Marie Fel et la basse Cuvillier, tous de<br />
l’Opéra, interprétèrent les trois rôles, respectivement :<br />
Colin, Colette et Le Devin. Jélyotte remania les<br />
récitatifs, avec le consentement de Rousseau.<br />
L’argument en est d’une simplicité enfantine, les<br />
dialogues et la musique aussi : Colette se plaint « Colin<br />
me délaisse… ». Elle va consulter le Devin <strong>du</strong> village.<br />
Le Devin lui apprend que la Dame <strong>du</strong> lieu a su<br />
charmer son Colin et lui conseille de feindre<br />
l’indifférence, afin de ramener à elle l’infidèle. Colin<br />
rend visite à son tour au Devin qui lui apprend que sa<br />
bergère l’a quitté pour un Monsieur de la ville. Le<br />
berger est désespéré tandis que le Devin fait un tour<br />
de magie sur son grimoire. Après une brève et<br />
touchante explication les deux jeunes gens tombent<br />
dans les bras l’un de l’autre. Tout est bien qui finit<br />
bien, par un divertissement ajouté par la suite<br />
« Allons danser sous les ormeaux… ».<br />
Rousseau, installé dans la loge royale était venu « sans<br />
changer ses habitu<strong>des</strong>, grande barbe et perruque mal<br />
peignée ». Le public et le roi lui-même furent ravis.<br />
Louis XV proposa d’octroyer une pension à<br />
Rousseau… qui avait déjà quitté les lieux ! L’ouvrage<br />
fut repris à Fontainebleau puis porté à la scène de<br />
l’Opéra à Paris le 1 er mars 1753. Rousseau <strong>du</strong>t<br />
compléter sa pièce par une Ouverture au début et un<br />
Divertissement final dans le style français. L’ouvrage<br />
fut bien reçu. Le Mercure de France, gazette de<br />
l’époque, déclarait « Les gens d’esprit ont remarqué<br />
dans la musique une finesse, une vérité, une naïveté<br />
d’expression fort rare ».<br />
Le Devin fut rejoué les 4 et 6 mars 1753 au château de<br />
Bellevue à Meudon chez Mme de Pompadour qui,<br />
travestie, tenait le rôle de Colin. Plusieurs spectacles<br />
furent donnés dans la soirée qui se termina par un feu<br />
d'artifice tiré depuis le théâtre en plein air. Enchantée,<br />
la marquise de Pompadour envoya à l’auteur<br />
42<br />
cinquante louis en témoignage de satisfaction. Le 2<br />
octobre 1759, on intercala le Devin <strong>du</strong> village dans les<br />
Fêtes Vénitiennes, avec Sophie Arnould dans le rôle de<br />
Colette. Le Mercure de France rapporte : « On peut<br />
regarder l'acte <strong>du</strong> Devin de Village comme le modèle<br />
d'un genre de pastorale française, plus vrai que tout ce<br />
qu'on a vu sur ce même théâtre, et plus noble que tout<br />
ce qu'on a donné sur le Théâtre italien et sur celui de<br />
l'Opéra comique. C'est ce choix de la belle nature dans<br />
les mœurs et dans le langage <strong>des</strong> bergers qui rend<br />
l'acte <strong>du</strong> Devin de Village original et nouveau dans un<br />
genre qui semblait épuisé. » L’œuvre a connu une<br />
grande postérité et elle a surtout changé l’histoire de<br />
l’opéra. Avant 1752 le genre léger de l’opera buffa et<br />
l’opéra-comique était assez stéréotypé, avec <strong>des</strong><br />
personnages rustiques et populaires. Les protagonistes<br />
étaient placés dans <strong>des</strong> situations proches de la farce.<br />
En France l’opéra-comique s’appelait aussi Vaudeville.<br />
On y parodiait, sur <strong>des</strong> airs connus, les gran<strong>des</strong><br />
tragédies lyriques, comme par exemple le Dardanus<br />
de Rameau qui dès sa sortie en 1739 avait été parodié<br />
sur le théâtre de la Foire. Après le Devin, le genre léger<br />
deviendra l’opéra-comique à la française, c’est-à-dire<br />
plutôt exemplaire et moralisateur, qui tout en mettant<br />
en scène <strong>des</strong> personnages contemporains, comporte<br />
une réflexion philosophique, même si elle est donnée<br />
avec le sourire. Un sourire parfois amer comme dans<br />
le Cosi fan tutte de Mozart/Da Ponte.<br />
Mais revenons à Rousseau après son succès. En<br />
novembre 1753, la publication de la Lettre sur la<br />
musique française de Rousseau parue vers la fin de la<br />
Querelle <strong>des</strong> Bouffons porte la fureur de Rameau à son<br />
comble et suscite un tollé général. Rousseau<br />
commence ainsi son Avertissement : « La querelle<br />
excitée l'année dernière à l'Opéra n'ayant abouti qu'à<br />
<strong>des</strong> injures, dites, d'un côté, avec beaucoup d'esprit, et<br />
de l'autre avec beaucoup d'animosité, je n'y voulus<br />
prendre aucune part; car cette espèce de guerre ne me<br />
convenait en aucun sens… » Il y déclare notamment<br />
« À l’égard <strong>des</strong> contrefugues, doubles fugues, fugues<br />
renversées, basses contraintes, et autres sottises<br />
difficiles que l’oreille ne peut souffrir et que la raison<br />
ne peut justifier, ce sont évidemment <strong>des</strong> restes de<br />
barbarie et de mauvais goût, qui ne subsistent, comme<br />
les portails de nos églises gothiques, que pour la honte<br />
de ceux qui ont eu la patience de les faire. » Et plus<br />
loin : « Pour ôter l'insipidité, ils augmenteraient la<br />
confusion; ils croiraient faire de la musique, et ils ne<br />
feraient que <strong>du</strong> bruit ». Il argumente : « J'ai donné à<br />
chanter à <strong>des</strong> Italiens les plus beaux airs de Lulli, et à<br />
<strong>des</strong> musiciens français <strong>des</strong> airs de Pergolèse; et j'ai<br />
remarqué que, quoique ceux-ci fussent fort éloignés de<br />
saisir le vrai goût de ces morceaux, ils en sentaient<br />
pourtant la mélodie, et en tiraient à leur manière <strong>des</strong><br />
phrases de musique chantantes, agréables et bien<br />
cadencées. Mais les Italiens solfiant très-exactement<br />
nos airs les plus pathétiques, n'ont jamais pu y<br />
reconnaître ni phrases ni chant; ce n'était pas pour eux<br />
de la musique qui eût <strong>du</strong> sens, mais seulement <strong>des</strong><br />
suites de notes placées sans choix, et comme au<br />
hasard; ils les chantaient précisément comme vous<br />
liriez <strong>des</strong> mots arabes écrits en caractères français. »<br />
La conclusion est célèbre « Je crois avoir fait voir qu’il
n’y a ni mesure ni mélodie dans la musique française,<br />
parce que la langue n’en est pas susceptible ; que le<br />
chant français n’est qu’un aboiement continuel, que<br />
l’harmonie en est sans expression, sentant<br />
uniquement son remplissage d'écolier; que les airs<br />
français ne sont point <strong>des</strong> airs; que le récitatif français<br />
n’est point <strong>du</strong> récitatif. D’où je conclus que les<br />
Français n’ont point de musique ... »<br />
En guise de réponse Rameau publie en 1754<br />
Observations sur notre instinct pour la musique et<br />
sur son principe, puis après la sortie <strong>du</strong> volume de<br />
l’encyclopédie de 1754 Rameau riposte en 1755 avec<br />
Erreurs sur la musique de l'Encyclopédie et en 1756 à<br />
la suite <strong>du</strong> nouveau volume il récidive avec Suite <strong>des</strong><br />
Erreurs sur la musique de l'Encyclopédie. Rousseau<br />
commence sa réponse dès 1755 dans un texte appelé<br />
Principe de la Mélodie ou réponse aux erreurs sur la<br />
Musique, pour en fin de compte remanier son texte, le<br />
scindant en trois articles qui ne seront pas publiés de<br />
son vivant : Essai sur l'origine <strong>des</strong> langues - De<br />
l'origine de la mélodie - Examen de deux principes<br />
avancés par M. Rameau. Finalement Jean-Jacques<br />
déclarera qu'il publiera le Dictionnaire de musique au<br />
lieu de répondre directement à Rameau. Furieux<br />
contre D'Alembert, le directeur de l’Encyclopédie,<br />
Rameau va, à force d’ergoter, se discréditer comme<br />
théoricien et D’Alembert ironisera dans ses Réflexions<br />
sur la théorie de la musique Rameau où il écrira que<br />
«… [Rameau] finit par vouloir trouver dans les<br />
proportions musicales toute la géométrie, dans les<br />
mo<strong>des</strong> majeur et mineur les deux sexes <strong>des</strong> animaux,<br />
enfin la Trinité dans la triple résonance <strong>du</strong> corps<br />
sonore ».<br />
Venons-en à une curiosité qui a dépassé son cadre<br />
originel grâce à Rousseau : il s’agit <strong>du</strong> Ranz <strong>des</strong> vaches<br />
qui appartient à une tradition <strong>des</strong> alpages suisses. Dès<br />
sa Dissertation sur la musique moderne de 1743,<br />
Rousseau montre son intérêt, chose assez nouvelle,<br />
pour la musique <strong>des</strong> folklores, si simple et naturelle. Il<br />
y relève par exemple un Carillon milanais. Dans<br />
43<br />
l’Encyclopédie il organisera une planche à ce sujet<br />
avec : un air chinois, une chanson <strong>des</strong> sauvages <strong>du</strong><br />
canada, un air canadien, un air suisse (ranz <strong>des</strong><br />
vaches) et une chanson persane avec tra<strong>du</strong>ction <strong>des</strong><br />
paroles ! L’air suisse dit « Ranz <strong>des</strong> vaches » semble<br />
l’intéresser tout particulièrement et partant de là, il va<br />
marquer la génération <strong>des</strong> musiciens romantiques<br />
comme élément pittoresque. En 1808, le thème <strong>du</strong><br />
final de la Symphonie Pastorale de Beethoven (soustitrée<br />
Souvenir de la vie à la campagne) en est issu,<br />
tout comme quelques années auparavant (1793) l’Air<br />
pour la Suisse <strong>du</strong> Triomphe de la République de<br />
Gossec (livret de Marie-Joseph Chénier). Les plus<br />
célèbres sont ensuite Le Ranz <strong>des</strong> vaches de<br />
l'ouverture <strong>du</strong> Guillaume Tell de Rossini en 1829 et<br />
celui de la Symphonie Fantastique de Berlioz (1830).<br />
Meyerbeer, le maître <strong>du</strong> grand opéra français ne l’a<br />
pas dédaigné, composant une mélodie pour chant et<br />
piano sur un poème de Scribe : Le Ranz <strong>des</strong> vaches<br />
d'Appenzell. Moins connues sont le belles<br />
Paraphrases sur le Ranz <strong>des</strong> vaches de Franz Liszt<br />
(vers 1835-40).<br />
Jean-Jacques Rousseau l'évoque ainsi à la page 443 de<br />
son Dictionnaire de la musique : « J’ai ajouté dans la<br />
même Planche le célèbre Rans-<strong>des</strong>-Vaches, cet Air si<br />
chéri <strong>des</strong> Suisses qu’il fut défen<strong>du</strong> sous peine de mort<br />
de le jouer dans leurs Troupes, parce qu’il faisoit<br />
fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui<br />
l’entendoient, tant il excitoit en eux l’ardent désir de<br />
revoir leur pays… Ces effets, qui n’ont aucun lieu sur<br />
les étrangers, ne viennent que de l’habitude, <strong>des</strong><br />
souvenirs, de mille circonstances qui, retracées par cet<br />
Air à ceux qui l’entendent, & leur rappelant leur pays,<br />
leurs anciens plaisirs, leur jeunesse & toutes leurs<br />
façons de vivre, excitent en eux une douce amertume<br />
d’avoir per<strong>du</strong> tout cela. La Musique alors<br />
n’agit point précisément comme<br />
Musique, mais comme signe<br />
mémoratif…». Le Ranz <strong>des</strong> vaches ou<br />
Lyoba ou Kühreihen, chant de<br />
transhumance, est le chant traditionnel a<br />
cappella <strong>des</strong> armaillis, bergers <strong>des</strong> Alpes<br />
Suisses. On le chante surtout dans le<br />
canton de Fribourg et la Gruyère depuis<br />
<strong>des</strong> siècles. L’appellation lyoba vient <strong>du</strong><br />
patois gruérien alyôbâ (appeler le<br />
bétail). Si le Ranz <strong>des</strong> vaches est chanté<br />
<strong>du</strong>rant la montée (poya) vers l'alpage, il<br />
prend toute sa dimension lors de la<br />
re<strong>des</strong>cente <strong>des</strong> vaches dans la vallée à la<br />
fin de l'été.<br />
Ce chant comporte trois parties : tout<br />
d’abord l'appel <strong>des</strong> vaches (le mot lyoba<br />
répété), ensuite l'énumération <strong>des</strong> noms<br />
<strong>des</strong> vaches, et enfin un chant improvisé<br />
en vers évoquant l’Alpage et le bonheur<br />
<strong>du</strong> retour. Le Ranz <strong>des</strong> vaches est<br />
souvent joué sur le cor <strong>des</strong> Alpes, instrument <strong>des</strong><br />
bergers suisses.<br />
Après cette étude, non exhaustive, on peut ajouter que<br />
bien que Jean-Jacques Rousseau soit avant tout passé
à la postérité pour ses écrits philosophiques, dont on<br />
reconnaît qu’ils ont contribué au changement de la<br />
société non seulement française, mais européenne,<br />
son rôle dans le domaine musical n’est aucunement<br />
négligeable.<br />
Il a influencé la musique française au tournant <strong>du</strong><br />
siècle en soulignant le rôle de la musique et <strong>du</strong> chant<br />
dans l’é<strong>du</strong>cation, en prônant une musique simple et<br />
chantable, loin <strong>des</strong> savants contrepoints.<br />
Son émule le plus important est le français Gossec<br />
(1734-1829) qui était d’ailleurs aussi son ami depuis le<br />
Le refrain d’un menuet <strong>du</strong> Dardanus de Rameau.<br />
Publié par Rousseau en 1743 dans sa Lettre sur la musique moderne<br />
44<br />
temps de La Pouplinière ; contemporain à la fois de<br />
Haydn, Mozart et Beethoven, Gossec a assuré le<br />
passage <strong>du</strong> baroque au classicisme ; il est le père de la<br />
symphonie en France et <strong>des</strong> grands hymnes de la<br />
Révolution donnant les modèles au grand Beethoven<br />
qui admirait sa musique.<br />
Le malheur de Rousseau musicien c’est qu’il avait <strong>des</strong><br />
idées géniales mais qu’il n’avait pas appris<br />
véritablement la musique. On pourrait résumer ainsi :<br />
Rousseau l’a rêvé, Gossec l’a réalisé.
PORTRAITS DE FEMMES DANS LES CONFESSIONS<br />
Après l’accusation anonyme - bien sûr de Voltaire -<br />
parue sous le titre Le Sentiment <strong>des</strong> Citoyens,<br />
révélant l’abandon de ses enfants, Rousseau, qui<br />
venait de publier Émile ou de l’É<strong>du</strong>cation (1762),<br />
entreprit la rédaction d’une justification intitulée<br />
Confessions et dont l’Avertissement au lecteur<br />
précisait « Voici le seul portrait d’homme, peint<br />
exactement d’après nature et dans toute sa vérité ».<br />
On n’a eu de cesse de s’interroger sur le titre choisi,<br />
synonyme nuancé de Mémoires,<br />
d’Autobiographie, sans oublier un rapprochement<br />
avec Montaigne regrettant, dès 1580, de ne pouvoir<br />
se peindre « tout entier et tout nu ». Mais ce qui<br />
n’est pas non plus sans surprendre, c’est le terme<br />
« portrait » impliquant autant<br />
un genre littéraire que la<br />
représentation picturale d’une<br />
personne.<br />
Ces deux aspects vont être<br />
évoqués dans une étude<br />
ambivalente : d’une part, pour<br />
mieux situer le projet de<br />
Rousseau, retrouver les raisons<br />
<strong>du</strong> titre choisi qui intrigua ses<br />
contemporains et les inquiéta;<br />
d’autre part, pour le choix <strong>du</strong><br />
terme « portrait », qui<br />
s’applique aussi bien à <strong>des</strong><br />
rencontres féminines fortuites<br />
<strong>du</strong>rant sa vie, qu’à <strong>des</strong><br />
accompagnements prolongés,<br />
affectionnés ou protecteurs.<br />
Le livre<br />
Il est peut-être nécessaire de<br />
rappeler que Les Confessions demeurent une œuvre<br />
posthume, publiée en 1782, pour la Première Partie,<br />
et la Seconde en 1789. Rousseau s’attela à la tâche<br />
dès 1765 (il avait 53 ans) et termina les six premiers<br />
livres en 1767. La suite fut rédigée pendant les<br />
années 1769/70 (8 ans avant sa disparition). On<br />
pourrait penser qu’il chercha à se justifier, post<br />
mortem. En réalité, dès la fin de l’année 1770 il<br />
entreprit de faire lecture de son texte, dans plusieurs<br />
salons. Mais ces séances furent interdites en mai<br />
1771 car on craignait <strong>des</strong> révélations importunes.<br />
C’est ce « complot », pour rester dans la perspective<br />
pathologique de Rousseau, qui retarda la<br />
publication de l’ouvrage.<br />
Jocelyne-Eléonore MAROT DE LASSAUZAIE<br />
Portrait de Mme de Warens<br />
45<br />
Le choix <strong>du</strong> titre surprit dans un siècle ou le terme<br />
« confession » relevait <strong>du</strong> domaine spirituel même si<br />
l’élite intellectuelle n’ignorait pas l’ouvrage de saint<br />
Augustin auquel il renvoyait implicitement.<br />
Cependant, en lisant le livre VI de ses Confessions,<br />
on apprend que le jeune Jean-Jacques avait eu accès<br />
à la bibliothèque de Mme de Warens, que les écrits<br />
jansénistes l’avaient troublé et qu’il avait reçu une<br />
excellente formation religieuse en étudiant avec son<br />
père Histoire de l’Église et de l’Empire <strong>du</strong> pasteur<br />
Le Sueur. D’ailleurs, dans son second livre, à la<br />
veille de sa conversion au catholicisme, il raconte<br />
comment il avait été mis à l’épreuve par un prêtre<br />
« beau parleur… content de lui si<br />
jamais Docteur le fut… Il croyait<br />
m’assommer avec saint<br />
Augustin, saint Grégoire et les<br />
autres Pères et il trouvait … que<br />
je maniais tous ces Pères-là<br />
presque aussi légèrement que<br />
lui ». (L. II) Ajoutons, à ces<br />
preuves d’un choix de titre qui<br />
devait beaucoup à sa culture<br />
personnelle, que saint Augustin<br />
faisait acte de contrition envers<br />
Dieu, lequel, par essence,<br />
connaissant le présent et l’avenir<br />
ne pouvait rien ignorer <strong>du</strong> passé;<br />
donc, pourquoi lui confesser sa<br />
vie si ce n’était afin de solliciter<br />
une prise de conscience chez le<br />
lecteur, ce que cherchait<br />
Rousseau.<br />
Quant à Montaigne, Rousseau<br />
ironise : « Montaigne se peint<br />
ressemblant mais de profil ». Il faudra la deuxième<br />
promenade <strong>des</strong> Rêveries pour qu’il se souvienne,<br />
après un évanouissement, de l’épisode connu <strong>des</strong><br />
Essais titré « de l’Exercitation » (T. II).<br />
Enfin, si les Mémoires <strong>du</strong> Grand Siècle faisaient<br />
usage <strong>des</strong> portraits intercalés dans le récit pour<br />
diversifier le déroulement <strong>des</strong> événements, on<br />
comprend bien que Rousseau n’a pas non plus<br />
cherché à s’inspirer <strong>du</strong> cardinal de Retz ou de Saint-<br />
Simon. Il revendique « Une entreprise qui n’eut<br />
jamais d’exemple ». Sa façon de révéler <strong>des</strong><br />
rencontres fortuites ou <strong>des</strong> expériences<br />
sentimentales en est une illustration.
Portraits de femmes<br />
Des rencontres fortuites<br />
Nous lisons en effet certaines confidences qui<br />
stylisent une galerie de portraits enrichie par la<br />
diversité de ses rencontres ou d’accompagnements<br />
pendant sa vie : amours vénales ou sentimentales et<br />
dames protectrices de l’aristocratie. Ainsi, en 1728, à<br />
Turin, à seize ans, il rencontre à l'hospice <strong>des</strong><br />
catéchumènes <strong>des</strong> jeunes filles, appelées sœurs « ...<br />
qui s'allaient régénérer, non par le baptême, mais<br />
par une solennelle abjuration. C'étaient bien les plus<br />
gran<strong>des</strong> salopes et les plus vilaines coureuses qui<br />
jamais aient empuanti le bercail <strong>du</strong> Seigneur ».<br />
Dans cette présentation de groupe, assez floue - non<br />
dans l'effet moral pro<strong>du</strong>it, mais par le manque de<br />
précisions physiques – « une seule (lui) parut jolie<br />
et assez intéressante. Elle était à peu près de (son)<br />
âge... avait <strong>des</strong> yeux fripons ... » (L.II)<br />
Quinze ans plus tard, il visite un trio de filles<br />
publiques à Venise qui ne dépare pas la précédente<br />
galerie coquine « La Padoana... était d'une assez<br />
jolie figure, belle même, mais non pas d'une beauté<br />
qui me plût ». Une autre « … jeune personne<br />
éblouissante… aussi charmante que vive, une<br />
brunette de vingt ans au plus » dont il prend plaisir<br />
à rappeler « la fraîcheur (<strong>des</strong>) chairs ... la blancheur<br />
(<strong>des</strong>) dents, la douceur de son haleine ». La dernière<br />
évoquée se nomme : Anzoletta « ... une petite fille<br />
d'onze à douze ans, que son indigne mère cherchait<br />
à vendre ... Elle était blonde et douce comme un<br />
agneau ». Nous voici renseignés sur <strong>des</strong> rencontres<br />
sans lendemain, sauf la jeune proie Anzoletta que<br />
Jean-Jacques et son ami Carrio, secrétaire de<br />
l’ambassade d’Espagne à Venise, vont aider en<br />
donnant régulièrement de l’argent pour la faire<br />
é<strong>du</strong>quer en dehors de la prostitution décidée par sa<br />
mère. (L.VII)<br />
S’ajoute une fréquentation de nécessité à Turin,<br />
puisque Rousseau cherche un emploi pour vivre et<br />
se met au service de Mme Basile « une jeune<br />
marchande » qui lui confie <strong>des</strong> tâches, en l’absence<br />
de son mari. Jean-Jacques se découvre alors une<br />
attirance amoureuse pour son honnête patronne<br />
« une brune extrêmement piquante, mais dont le<br />
bon naturel peint sur son joli visage rendait la<br />
vivacité touchante ... ». Un portrait cristallise dans<br />
ses moindres détails l’attente érotisée : »Sa chambre<br />
était entr'ouverte; j'y entrai sans être aperçu. Elle<br />
brodait près d'une fenêtre… Son attitude était<br />
gracieuse, sa tête un peu baissée laissait voir la<br />
blancheur de son cou; ses cheveux relevés avec<br />
élégance étaient ornés de fleurs… Je me jetai à<br />
genoux à l’entrée de la chambre, en tendant les bras<br />
vers elle d’un mouvement passionné… et ne pensant<br />
pas qu’elle pût me voir : mais il y avait à la cheminée<br />
une glace qui me trahit… d’un simple mouvement de<br />
doigt, elle me montra la natte à ses pieds. » (L.II)<br />
Même si le doute existe d’une émotion ou d’un<br />
calcul de coquetterie chez la jolie patronne,<br />
l’agencement <strong>des</strong> détails illustre le plus intime et<br />
réussi <strong>des</strong> tableaux d’intérieur à l’atmosphère<br />
trouble. Doit-on conclure en précisant que le retour<br />
<strong>du</strong> mari parti en voyage, et préparé à la jalousie par<br />
les calomnies <strong>du</strong> commis principal, se solda d’un<br />
renvoi ?<br />
46<br />
Avec quelques années de plus, Rousseau entreprend<br />
un voyage vers Montpellier « ayant pris une chaise à<br />
Grenoble » pour assurer son confort. Une<br />
voyageuse, Mme Larnage, participe activement à ce<br />
désir de confort se chargeant d’occuper le jeune<br />
homme solitaire. Il se souvient « ... l'amour la<br />
rendait charmante; il lui rendait tout l'éclat de la<br />
première jeunesse... n'étant... ni laide ni vieille, elle<br />
n'avait rien dans sa figure qui empêchât son esprit et<br />
ses grâces de faire tout leur effet. Tout au contraire<br />
<strong>des</strong> autres femmes, ce qu'elle avait de moins frais<br />
était son visage » (L. VI) Le croquis n’est pas si<br />
sévère que nous pourrions le penser, car la<br />
voyageuse avait quarante-cinq ans et Jean-Jacques<br />
vingt-cinq. Elle vivait séparée de son mari après lui<br />
avoir donné dix enfants. Ceci vaut une absolution<br />
digne de saint Augustin.<br />
Quant aux demoiselles qui furent ses élèves à<br />
Chambéry, elles constituent une suite de tableaux<br />
commandés par un sérieux souci pécuniaire : Marie-<br />
Anne de Mellarède, fille <strong>du</strong> ministre de l'Intérieur<br />
<strong>du</strong> roi de Sardaigne « était une brune très vive, mais<br />
d'une vivacité caressante, pleine de grâces, et sans<br />
étourderie. Elle était un peu maigre [...] <strong>des</strong> yeux<br />
brillants, une taille fine... ». Françoise-Sophie, fille<br />
<strong>du</strong> comte Bernard de Menthon « Ses cheveux étaient<br />
d'un blond cendré: elle était très mignonne, très<br />
timide et très blanche; une voix nette, juste et flûtée,<br />
mais qui n'osait se développer. Elle avait au sein la<br />
cicatrice d'une brûlure d'eau bouillante, qu'un fichu<br />
de chenille bleue ne cachait pas extrêmement ».<br />
Gasparde-Balthazarde, fille <strong>du</strong> marquis de Challes<br />
[…] « grande, belle carrure, de l'embonpoint; elle<br />
avait été très bien »(L.V) La chute s’explique par la<br />
trentaine d’années de cette élève ; âge fatal, au sens<br />
étymologique <strong>du</strong> terme… si on n’a pas le charme<br />
convaincant d’une Mme Larnage ! D’un milieu<br />
mo<strong>des</strong>te car fille d’un épicier, Mlle Lard est<br />
mémorisée tel un « vrai modèle d'une statue grecque<br />
[…] son indépendance, sa froideur, son insensibilité,<br />
allaient à un point incroyable ». Cette esquisse est<br />
compensée par le portrait détaillé de sa mère « un<br />
petit minois éveillé, chiffonné, marqué de petite<br />
vérole. Elle avait de petits yeux très ardents, et un<br />
peu rouges, parce qu'elle y avait presque toujours<br />
mal » (L. V)<br />
Du trait précis aux sensations ressenties, Rousseau<br />
se met toujours en scène quand il dépeint un visage,<br />
un caractère dévoilé à ses yeux par <strong>des</strong> indices<br />
subjectifs ou <strong>des</strong> détails physiques. Il est sensible à<br />
la ligne générale – embonpoint ou maigreur – à la<br />
couleur <strong>des</strong> cheveux, au regard ou aux yeux. La<br />
<strong>des</strong>cription de Pauline, fille <strong>du</strong> marquis et de la<br />
marquise de Breil - qui l’ignorait jusqu’à la fameuse<br />
explication de « tel fiert qui ne tue pas » - renseigne<br />
sur son attirance pour les blon<strong>des</strong> dans une<br />
périphrase subtile. « C’était une jeune personne à<br />
peu près de mon âge, bien faite, assez belle, très<br />
blanche, avec <strong>des</strong> cheveux très noirs, et, quoique<br />
brune, portant sur son visage cet air de douceur <strong>des</strong><br />
blon<strong>des</strong> auquel mon cœur n'a jamais résisté »(L .III)
N’est-ce pas ainsi, associant douceur et blondeur,<br />
qu’il a fait le portrait de Mme de Warens dont<br />
l’accompagnement constituera l’essentiel <strong>du</strong> second<br />
livre, <strong>du</strong> moins dans la révélation d’une prise en<br />
charge maternelle et amoureuse ?<br />
Des accompagnements<br />
« Je vois un visage, pétri de grâces, de beaux yeux<br />
bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le<br />
contour d'une gorge enchanteresse ... Elle avait alors<br />
vingt-huit ans ... Elle avait de ces beautés qui se<br />
conservent parce qu'elles sont plus dans la<br />
physionomie que dans les traits ... Elle avait un air<br />
caressant et tendre, un regard très doux, un sourire<br />
angélique, une bouche à la mesure de la mienne, <strong>des</strong><br />
cheveux cendrés d'une beauté peu commune, et<br />
auxquels elle donnait un tour négligé qui la rendait<br />
très piquante. Elle était petite de stature, courte<br />
même et ramassée un peu dans sa taille, quoique<br />
sans difformité; mais il était impossible de voir une<br />
plus belle tête, un plus beau sein, de plus belles<br />
mains et de plus beaux bras ». (L.II) « Elle avait de<br />
la voix, chantait passablement, et jouait un peu <strong>du</strong><br />
clavecin » (L. III)<br />
Ce qui est à rappeler, c’est la double présentation<br />
faite par Rousseau quand il confesse cette étape de<br />
sa vie : d’abord son propre portrait à seize ans ; puis<br />
sa rencontre, à Annecy, avec celle qu’il s’était<br />
imaginée « une vieille dévote bien rechignée ». Le<br />
coup de pinceau délicat précisant « elle avait de ces<br />
beautés qui se conservent parce qu’elles sont plus<br />
dans la physionomie que dans les traits » fait<br />
référence à la nature profonde, à « l’âme » pour<br />
citer saint Augustin.<br />
Le portrait peint par Largillière ne fait pas mentir<br />
Rousseau : Françoise-Louise de La Tour, mariée à 14<br />
ans (l’âge légal est alors 12 à Lausanne) quitte le<br />
foyer conjugal à 27 ans, passe en Savoie et abjure le<br />
protestantisme, munie d’une pension <strong>du</strong> roi de<br />
Sardaigne Victor-Amédée, en caution de son<br />
dévouement à l’Église. Rousseau commença la<br />
rédaction <strong>des</strong> Confessions trois ans après sa mort.<br />
Ce qui peut expliquer ce portrait nimbé d’une<br />
vénération mêlée de sensualité.<br />
Il en est tout autrement avec celle qui partagea sa<br />
vie <strong>du</strong>rant 33 ans (1745-1778), Thérèse Levasseur,<br />
épousée civilement en 1768, ce qui n’avait alors<br />
aucune valeur juridique. Il la présente « Une fille…<br />
d’environ vingt-deux à vingt-trois ans […] Cette fille,<br />
appelée Thérèse Le Vasseur, était de bonne famille ;<br />
son père était officier de la Monnaie d’Orléans ; sa<br />
mère était marchande […] Je fus frappé de son<br />
maintien mo<strong>des</strong>te, et plus encore de son regard vif<br />
et doux […] Elle était très timide » L’aveu <strong>du</strong><br />
dépucelage n’affecte en rien Rousseau. Ce qui a<br />
marqué davantage sa mémoire et pèse toujours sur<br />
leur foyer à l’heure où il rédige son second livre est<br />
une sorte de découragement « Je voulus former son<br />
esprit. J’y perdis ma peine ». Elle ne saura ni lire<br />
l’heure, ni reconnaître les dates calen<strong>du</strong>laires, ni<br />
compter .Mais il ajoute, au livre suivant : « Le cœur<br />
de ma Thérèse était celui d’un ange » ; pour<br />
conclure dans son dernier livre : « Depuis<br />
longtemps je m’apercevais de (son) attiédissement<br />
[…] elle avait pour moi le même attachement par<br />
47<br />
devoir, mais elle n’en avait plus par amour ». On<br />
peut s’interroger sur cette femme, assez bien<br />
accueillie par les dames protectrices de Rousseau.<br />
Un <strong>des</strong>sin de Thérèse, gravé par Nadet, postérieur à<br />
la mort de Rousseau, n’apporte que peu de détails<br />
sur sa carnation, ses cheveux, ses yeux, sa<br />
morphologie.<br />
Thérèse formait avec Rousseau un couple reconnu<br />
par ses protectrices. Il en fut ainsi <strong>du</strong> trio : Mmes<br />
Dupin, de la Touche et d'Arty qui « [ …] étaient trois<br />
sœurs qu'on pouvait appeler les trois Grâces ».<br />
Il prend plaisir à préciser « Mme d’Arty était une<br />
femme adorable autant par la douceur, par la bonté<br />
de son charmant caractère, que par l'agrément de<br />
son esprit et par l'inaltérable gaieté de son humeur<br />
[...] Mme Dupin, la plus belle <strong>des</strong> trois ... était une<br />
<strong>des</strong> plus belles femmes de Paris. Elle me reçut à sa<br />
toilette. Elle avait les bras nus, les cheveux épars,<br />
son peignoir mal arrangé ... » (L.VII) Mais il regrette<br />
« Mme Dupin, tout aimable qu'elle était, était<br />
sérieuse et froide » (L. IX) Son époux, fermier<br />
général, ayant acheté et restauré Chenonceaux,<br />
Rousseau sera invité au château à plusieurs<br />
reprises. Malgré sa froideur, qui n’était qu’une<br />
honnêteté conjugale, fait rare dans cette aristocratie<br />
<strong>du</strong> XVIII e , Louise-Marie-Madeleine Dupin s’occupa<br />
toujours généreusement de Rousseau et même de<br />
Thérèse.<br />
Ses rapports avec Louise-Florence-Pétronille<br />
d’Epinay furent beaucoup plus ambigus. La<br />
<strong>du</strong>chesse invita Rousseau à l’Ermitage de<br />
Montmorency (1756-1757) et, après une amitié<br />
débordante d’affection, elle se brouilla avec lui. Elle<br />
serait la responsable de l’arrêt, par le préfet de<br />
police Sartine, <strong>des</strong> séances de lecture <strong>des</strong><br />
Confessions. Ses craintes se comprennent car, sans<br />
doute influencée par Grimm, elle avait tenu un rôle<br />
trouble et <strong>du</strong>t craindre <strong>des</strong> révélations à son sujet.<br />
Mais Rousseau se contente d’appréciations banales<br />
aux livres VII et VIII « Elle était aimable, avait de<br />
l’esprit, <strong>des</strong> talents ». Son portrait physique n’est<br />
brossé qu’au Livre IX et le moins que l’on puisse<br />
dire est qu’il surprend « Elle était fort maigre, fort<br />
blanche, de la gorge comme sur ma main (sic). Ce<br />
défaut seul eût suffi pour me glacer : jamais mon<br />
cœur ni mes sens n’ont su voir une femme dans<br />
quelqu’un qui n’eût pas <strong>des</strong> tétons, et d’autres<br />
causes inutiles à dire m’ont toujours fait oublier son<br />
sexe auprès d’elle ». Il serait étonnant que cette<br />
aversion n’ait pas été, progressivement, décelée par<br />
Mme d’Épinay qui a pu en prendre ombrage.<br />
En revanche, Jean-Jacques est subjugué par la<br />
maréchale de Luxembourg, épouse <strong>du</strong> <strong>du</strong>c de<br />
Montmorency « Je l’avais vue… lorsqu’elle était<br />
<strong>du</strong>chesse de Bouffers et qu’elle brillait encore de sa<br />
première beauté. Mais elle passait pour méchante »<br />
Quelques pages plus loin <strong>du</strong> livre X, son opinion se<br />
nuance et même il reconnaît « Je la trouvais<br />
charmante, de ce charme à l’épreuve <strong>du</strong> temps, le<br />
plus fait pour agir sur mon cœur ». Elle ne fut pas<br />
moins aimable que son mari avec Rousseau et<br />
voulut le voir à l’<strong>Académie</strong> française. Elle s’offrit<br />
même à retrouver et élever ses enfants. La<br />
condamnation de l’Émile provoqua le départ de son
obligé de Montmorency, la prise de corps ayant été<br />
décidée.<br />
Ainsi, au fil de sa <strong>des</strong>tinée qui s’encombre de<br />
désordres physiologiques et psychiques, Rousseau<br />
amasse <strong>des</strong> souvenirs entremêlés de rancœurs et<br />
d’émotions attendrissantes. Le plus extraordinaire<br />
exemple de ses attachements se cristallise dans les<br />
sentiments qu’il éprouve pour la belle-sœur de Mme<br />
d’Épinay : Élisabeth-Sophie-Françoise Lalive de<br />
Bellegarde, comtesse d’Houdetot.<br />
« Mme la comtesse d’Houdetot approchait de la<br />
trentaine, et n’était point belle ; son visage était<br />
marqué de la petite vérole ; son teint manquait de<br />
finesse, elle avait la vue basse et les yeux un peu<br />
ronds : mais elle avait l’air jeune avec tout cela, et sa<br />
physionomie, à la fois vive et douce, était caressante.<br />
Portrait de Mme d’Houdetot<br />
48<br />
Elle avait une forêt de grands cheveux noirs,<br />
naturellement bouclés, qui lui tombaient au jarret ;<br />
sa taille était mignonne, et elle mettait dans tous ses<br />
mouvements de la gaucherie et de la grâce tout à la<br />
fois… »<br />
Sa conclusion est déstabilisante, si nous nous<br />
référons aux attentes sentimentales habituelles :<br />
« Nous étions ivres d’amour l’un et l’autre, elle pour<br />
son amant, moi pour elle… » La comtesse, fidèle<br />
dans sa passion jusqu’à la mort au marquis de Saint-<br />
Lambert, restera le modèle par excellence, d’une<br />
fusion entre le vécu et le romanesque, car Rousseau<br />
conclut « Je vis ma Julie en Mme d’Houdetot ».<br />
Il ne reste plus qu’à relire La Nouvelle Héloïse !<br />
Conclusion<br />
Dans cette étude limitée par <strong>des</strong> impératifs<br />
circonstanciés, bien <strong>des</strong> croquis et <strong>des</strong> esquisses de<br />
femmes, de jeunes filles ayant traversé ou partagé la<br />
vie de Rousseau, n’ont pu être évoqués ; de même<br />
sont restés dans l’ombre ses aptitu<strong>des</strong> précoces en<br />
<strong>des</strong>sin et son apprentissage chez le graveur<br />
Ducommun que rappelle son art de la <strong>des</strong>cription<br />
<strong>des</strong> paysages. Et <strong>des</strong> visages !<br />
Il ne peut être exclu de reconnaître l’influence de<br />
Rousseau sur son époque dans la recherche<br />
picturale qui s’infléchit progressivement vers le<br />
naturel et l’authenticité et s’orienta vers les portraits<br />
de « genre » mis à la mode par Chardin ou Greuze.<br />
Quant au succès de son roman épistolaire La<br />
Nouvelle Héloïse (1761), il fit naître un courant<br />
sentimental empreint de douceur et de féminité,<br />
qu’illustre dans sa composition l’Autoportrait de<br />
Mme Vigée-Lebrun avec sa fille (1786).<br />
Le pastelliste Quentin de La Tour, qui exécuta le<br />
portrait <strong>du</strong> philosophe en 1753, disait de ses<br />
modèles – et peut-être de Rousseau - « Ils croient<br />
que je ne saisis que leur visage mais je <strong>des</strong>cends au<br />
fond d’eux-mêmes ». En cela il anticipait sur le<br />
projet de Jean-Jacques avec Les Confessions : être<br />
l’interprète de sa propre vérité et s’attribuer celle<br />
<strong>des</strong> autres.
Rousseau aimait la nature, la couleur <strong>des</strong> prés et<br />
celle <strong>des</strong> fleurs, la lumière <strong>des</strong> soleils couchants et<br />
l’ombre fraîche <strong>des</strong> grands arbres. Et les sons : la<br />
musique <strong>des</strong> torrents, le chant <strong>des</strong> oiseaux et le<br />
silence … Il ne découvrit les plantes que vers la fin<br />
de sa vie. Il aurait pu s’initier lors de ses séjours aux<br />
Charmettes chez Madame de Warens, mais il<br />
affichait alors un profond mépris pour la botanique,<br />
qu'il considérait comme une vulgaire étude<br />
d’apothicaire. « L’herboriste ne voit que <strong>des</strong> herbes<br />
pour les lavements », quand lui, rêve de «<br />
guirlan<strong>des</strong> pour les bergères ». (RP 7 e promenade) 1<br />
« Le malheur de la botanique est d’avoir été<br />
regardée […] comme une partie de la<br />
médecine »(DB) écrit-il. Au XVIII e siècle, toutes les<br />
écoles de médecine disposaient de jardins <strong>des</strong>tinés à<br />
l’enseignement.<br />
À Toulon, la marine entretenait pour ses médecins<br />
un petit jardin au quartier Saint-Roch. Le jardin <strong>des</strong><br />
plantes de Paris n'est autre que l'ancien jardin<br />
d'apothicaire créé en 1635 par Louis XIII puis<br />
amélioré par Buffon.<br />
Suivant la mode de l’époque, Madame de Warens<br />
aimait les plantes. Un jour, elle cueillit pour Jean-<br />
Jacques une pervenche; cette plante restera<br />
longtemps sa fleur préférée et sa seule référence<br />
botanique.<br />
Claude Anet, le jeune jardinier <strong>des</strong> Charmettes<br />
entretenait un joli jardin de simples qui existe<br />
toujours. Il avait de soli<strong>des</strong> connaissances en<br />
botanique. Rousseau l'admirait mais il ne s'intéressa<br />
jamais à ses travaux. Ce fut une occasion manquée.<br />
Une passion tardive<br />
1762. Rousseau, qui a 50 ans, fuit Paris après la<br />
condamnation de l’Émile et se réfugie en Suisse à<br />
Môtiers près de Neufchâtel. Il s’ennuie. Il fait la<br />
connaissance <strong>du</strong> docteur d’Ivernois, un passionné de<br />
botanique qui l’entraine dans ses herborisations. La<br />
flore alpine est exceptionnelle et la Suisse le<br />
royaume <strong>des</strong> botanistes.<br />
Lors de ces promena<strong>des</strong>, Jean-Jacques est heureux,<br />
la nature est belle et il a trouvé une occupation. Pour<br />
lui, la botanique est « une étude oiseuse propre à<br />
remplir le vide de (s)es loisirs ». (CO) Mais il y<br />
prend goût et ce goût va se transformer en une<br />
passion dévorante qui occupera les quinze dernières<br />
années de sa vie.<br />
ROUSSEAU ET LA BOTANIQUE<br />
Anne SOHIER-MEYRUEIS<br />
49<br />
« Je raffole de la botanique, cela ne fait qu’empirer<br />
tous les jours, je n’ai plus que <strong>du</strong> foin dans la tête, je<br />
vais devenir plante un de ces matins et je prends<br />
déjà racine à Môtier». (CC 4555, août 1765)<br />
La relation de Rousseau avec la botanique ne fut<br />
cependant pas un long fleuve tranquille ; de<br />
profon<strong>des</strong> dépressions alternaient avec les pério<strong>des</strong><br />
d’euphorie. À plusieurs reprises, il renonce à cette<br />
discipline qui « fatigue la mémoire et l’esprit ». (CC<br />
6614, 7 novembre 1769) En 1768, il prend une<br />
décision : « Ne parlons plus de botanique » (CC<br />
6634, 15 novembre 1768). Avant de partir pour Paris<br />
en 1770, il offre à son ami Claret de La Tourette<br />
toutes « ces misérables herbailles » (CC 6693, 16<br />
mars 1770), cet herbier auquel il avait tant travaillé.<br />
Mais à peine installé dans la capitale, il est «repris<br />
de cette folie " et il s’y «livre avec un engouement<br />
qui tient de l’extravagance » (RP 7 e promenade).<br />
En 1777, hébergé à Ermenonville chez le marquis de<br />
Girardin, il herborise toujours avec ardeur. Le 26<br />
juin 1778, six jours avant sa mort, il commandait<br />
encore <strong>des</strong> livres et <strong>du</strong> matériel pour un nouvel<br />
herbier.<br />
Rousseau herborisant à Ermenonville.<br />
Aquarelle de Mayer (1779). BNF
"L'attirail <strong>du</strong> botaniste"<br />
À Môtier, tout à l’exaltation de la découverte, le<br />
néophyte commence ses achats : « trois ou quatre<br />
microscopes […] <strong>des</strong> petites pinces délicates et<br />
minces pour tenir les fleurs, <strong>des</strong> ciseaux très fins,<br />
canifs et lancettes pour les découper » (CC 4536, 20<br />
juillet 1765). Précis et méticuleux, il veille à la<br />
fabrication <strong>des</strong> lancettes et discute la qualité de<br />
l’optique.<br />
Il utilisera les compétences en aquarelle acquises<br />
chez Madame de Warens pour « enluminer plantes<br />
et fleurs dans leurs couleurs naturelles » (CC 3755,<br />
20 décembre 1764). Il choisit ses pigments avec<br />
précision « carmin, outremer, vert de vessie, vert de<br />
gris, encre de chine… » (Ibid.) Il prépare ses<br />
couleurs lui-même, ne laissant rien au hasard « il<br />
faut bien broyer le bleu de Prusse et le délayer peu à<br />
peu avec de l’eau dans lequel vous aurez fait fondre<br />
un peu de gomme arabique ; il faut moins de<br />
gomme dans le vert que dans le bleu ». (CC 6113, 4<br />
novembre 1767)<br />
Il commande <strong>des</strong> cahiers de papier doré et <strong>des</strong><br />
feuilles blanches, rouges ou bleues qui feront<br />
ressortir la couleur <strong>des</strong> fleurs et aussi « <strong>des</strong><br />
portefeuilles pour l’immense collection que nous<br />
allons faire ». (CC 6375, 6 juillet 1768)<br />
Les livres<br />
Au début, Jean-Jacques voyait dans la botanique<br />
"une étude charmante". (CC 6655, 26 novembre<br />
1770) Il déchanta vite car cette science se révéla<br />
complexe; il lui faudra apprendre. Or, à cette<br />
époque, les livres de botanique étaient rares et fort<br />
chers ; au fil <strong>des</strong> années il y engloutira une petite<br />
fortune. Il les commande à Paris, à Amsterdam, en<br />
Angleterre… Dans sa bibliothèque, les philosophies<br />
botaniques cohabitent avec les ouvrages de<br />
détermination, les flores de Lorraine avec celles de<br />
Montpellier ou de Prusse. On trouve <strong>des</strong> dizaines de<br />
titres, dont de savants traités sur les arbres et<br />
arbustes ou les ombellifères.<br />
Cette accumulation disparate révèle un<br />
comportement d’autodidacte auquel il a manqué un<br />
guide qui eut orienté ses choix. Car cet<br />
amoncellement d’ouvrages qui ne répond pas à ses<br />
attentes ne fait que lui poser <strong>des</strong> problèmes. Tout<br />
d’abord, ils sont écrits en latin, langue qu'il déteste :<br />
« J’étais <strong>des</strong>tiné à apprendre souvent le latin et à ne<br />
le jamais savoir ». (CO III) Puis il bute sur un<br />
vocabulaire spécialisé qu’il ne comprend pas car il<br />
n’existe aucun ouvrage pour débutants. « Les livres<br />
<strong>des</strong> botanistes modernes n’instruisent que les<br />
botanistes» (CC 5725, 12 février 1767). Enfin les<br />
planches colorées sont absentes. « Je voudrais<br />
pouvoir me figurer une plante, savoir si elle est<br />
grande ou petite, si sa fleur est bleue ou rouge, me<br />
représenter son port. Rien ! ». (CC 6725, 12 février<br />
1767)<br />
_______________________________<br />
1 Abréviations en fin de texte (Bibliographie)<br />
50<br />
Mais surtout, il se perd dans « le chaos de la<br />
synonymie ». (CC 6933, 17 avril 1772) Au XVIII e<br />
siècle, les problèmes de taxonomie n’étant pas<br />
réglés, chaque auteur donnait un nom (souvent le<br />
sien) aux plantes qu’il découvrait. Une même plante<br />
pouvait donc avoir plusieurs noms et, inversement,<br />
un même nom était parfois attribué à deux plantes<br />
différentes. Pour être sûrs de ne rien oublier, les<br />
spécialistes énuméraient les divers patronymes ou,<br />
pire, les désignaient par de longues phrases en latin.<br />
Ce qui fit écrire à Jean-Jacques : « Rien n’est plus<br />
ridicule lorsqu’une femme vous demande le nom<br />
d’une fleur que de cracher en réponse une longue<br />
enfilade de noms latins, inconvénient suffisant pour<br />
rebuter ces personnes frivoles avec un appareil aussi<br />
pédantesque». (DB)<br />
Il était donc urgent de classer et nommer.<br />
Heureusement, ses amis de Môtier, lui conseillèrent<br />
d’acheter les ouvrages de Linné, le grand naturaliste<br />
suédois.<br />
Linné répartit les plantes en 24 classes en se basant<br />
sur la structure de la fleur et, plus précisément, sur<br />
le nombre d’étamines, organes sexuels mâles et leur<br />
relation avec le pistil, organe femelle. Pour rendre<br />
son système compréhensible, Linné eut l’étrange<br />
idée de faire de l’anthropomorphisme poussé : les<br />
étamines devinrent les maris et les pistils les<br />
épouses. La fleur était la chambre nuptiale. On<br />
débouchait alors sur <strong>des</strong> situations délicates, lorsque<br />
<strong>des</strong> dizaines de maris occupaient la chambre d’une<br />
seule épouse… La classification linnéenne n’a pas<br />
résisté à l’épreuve <strong>du</strong> temps.<br />
En revanche, sa nomenclature binominale est<br />
toujours le langage international <strong>des</strong> botanistes. Elle<br />
est basée sur deux mots, un substantif désignant le<br />
genre et une épithète l'espèce. « Ces mots sont tous<br />
grecs ou latins expressifs courts et sonores ». (DB)<br />
Admirateur inconditionnel de Linné, Rousseau<br />
milita pour la nomenclature binominale et il<br />
condamnait sans nuance ses nombreux<br />
contemporains qui contestaient son maître: « Il est<br />
étonnant à quel point de crasse et de barbarie on<br />
reste en France sur cette belle et ravissante étude<br />
que l'illustre Linneus a mise à la mode" ». (CC 6100,<br />
17 octobre 1767)<br />
Les herborisations<br />
Annotant les pages <strong>des</strong> livres, colorant les <strong>des</strong>sins,<br />
rédigeant <strong>des</strong> fiches, Jean-Jacques acquiert de<br />
bonnes connaissances qu'il complète sur le terrain.<br />
A ses débuts, il accompagne <strong>des</strong> botanistes<br />
chevronnés aux alentours de Môtiers. Il est un peu<br />
dépassé : « Je me perds comme un insecte parmi les<br />
plantes <strong>des</strong> prés, j’ose à peine espérer herboriser<br />
aussi bien que les moutons qui paissent sous ma<br />
fenêtre et de savoir comme eux trier mon foin » (CC<br />
5482, 8 octobre 1766) dira-t-il plus tard avec<br />
humour.<br />
Les herborisations qui <strong>du</strong>raient souvent plusieurs<br />
jours étaient soigneusement préparées. Lors d'une<br />
expédition au mont Chasseron dans le Jura, une<br />
mule est chargée de porter le matériel soit « quatre<br />
flacons de vin, un ample pâté, un gigot, une longe de
veau, une daube et une langue » (CC 4549, 22 juillet<br />
1765) … « le Linnaeus … quelques livres et quelques<br />
jeux amusants ». (CC 4477, 11 juin 1765). On<br />
noteraque le seul ouvrage de botanique cité vient<br />
nettement après les nourritures terrestres.<br />
En 1765, Jean-Jacques, qui fuit Môtiers dont la<br />
population excitée par le pasteur avait lapidé la<br />
maison, se réfugie dans l’ile Saint-Pierre sur le " lac<br />
de Bienne. C'est l’enthousiasme : « J’ai entrepris de<br />
décrire toutes les plantes de l’Isle sans en omettre …<br />
je ne voulais pas laisser un poil d’herbe, pas un<br />
atome de végétal qui ne fut amplement<br />
décrit ». « J’allais une loupe à la main et mon<br />
Systema Naturae sous le bras ». « Au bout de 2 à 3<br />
heures, je m’en revenais chargé d’une ample<br />
moisson, provision d’amusement pour l’après diner<br />
au logis ». (RP 5 e promenade) Des plantes séchaient<br />
sur tous les meubles de sa chambre.<br />
Séjournant à Grenoble en 1768, il herborise le long<br />
de l’Isère avec <strong>des</strong> compagnons qu'il juge plus<br />
ignorants que lui.<br />
1769. Rousseau, qui fait de la botanique depuis<br />
bientôt sept ans, organise une sortie pé<strong>des</strong>tre au<br />
mont Pilat en bor<strong>du</strong>re <strong>du</strong> Massif Central, avec trois<br />
messieurs « qui font semblant d’aimer la<br />
botanique » (CC 6613, 8 septembre 1769). Une fois<br />
de plus, il est déçu car il n'y découvre que <strong>des</strong><br />
plantes courantes : « Une seule plante m’a fait grand<br />
plaisir Sonchus alpinus […] plante de 5 à 6 pieds de<br />
haut dont le feuillage et le port sont admirables et à<br />
qui ses gran<strong>des</strong> et belle fleurs bleues donnent un<br />
éclat qui la rendrait digne d’entrer dans votre<br />
jardin » (CC 6641, 17 décembre 1769). La laitue <strong>des</strong><br />
Alpes qui couvre de vastes espaces au-<strong>des</strong>sus de<br />
1500 mètres est en fait une plante très commune.<br />
L’ignorance de ses compagnons le navre et il en<br />
profite pour étaler ses connaissances avec une<br />
suffisance certaine: « Meynier m’appela pour me<br />
montrer une soi-disant belle ancolie ; comment, une<br />
ancolie monsieur, dis-je, c’est le napel ». Puis, se<br />
moquant : « Je lui racontai la fable que le peuple<br />
débite en Suisse sur le napel ». (CC 6622, 18 octobre<br />
1769) Pour un non spécialiste, il est parfaitement<br />
excusable de confondre les grappes bleues de<br />
l'ancolie et celles <strong>du</strong> napel (aconit) d'autant que ces<br />
deux fleurs très voisines appartiennent à la même<br />
famille <strong>des</strong> Renonculacées.<br />
Et nos amis helvètes se méfiaient avec raison de<br />
l'aconit qui est la plante la plus toxique de la flore de<br />
France. Vénéneuse par toutes ses parties, elle<br />
contient de l'aconitine, un alcaloïde qui a <strong>des</strong> effets<br />
paralysants sur toutes les fonctions vitales, ce que<br />
notre spécialiste semblait ignorer à l'époque.<br />
Lorsqu’en 1770 Jean-Jacques s’installe à Paris, il<br />
rencontre enfin <strong>des</strong> botanistes dignes de ce nom. Il<br />
participe aux sorties organisées par Antoine de<br />
Jussieu, démonstrateur <strong>du</strong> Jardin et héritier d’une<br />
longue lignée de naturalistes. Mais là encore, il fait<br />
la fine bouche : « J’ai suivi monsieur de Jussieu<br />
dans sa dernière herborisation… je la trouvai si<br />
tumultueuse et si peu utile ». Certes, ajoute-t-il, il<br />
« connaissait toutes les plantes <strong>du</strong> Jardin <strong>du</strong> roi,<br />
51<br />
mais pas une de la campagne » (CC 6933, 17 avril<br />
1772).<br />
Déçu par les herborisations collectives, il choisit<br />
d'herboriser tout seul dans les rues et les prairies<br />
entre les villages de Charonne et de Ménilmontant.<br />
Bernardin de Saint-Pierre décrira la tenue<br />
d’herborisation urbaine avec laquelle il ne devait pas<br />
passer inaperçu. « Il accrochait son chapeau à sa<br />
poche. Sa femme l’avait cousu car il perdait tout.<br />
Une loupe avec un microscope à lentille excellente,<br />
une boite de fer blanc pour mettre les plantes, un<br />
louchet de fer blanc ajusté avec une serpette qu’il<br />
ajustait au bout de sa canne pour attraper les<br />
plantes qu’il ne pouvait pas atteindre à travers les<br />
palissa<strong>des</strong> <strong>du</strong> bois de Boulogne ».<br />
Les herbiers<br />
Rousseau consacra beaucoup de temps et de soin à<br />
la confection d'herbiers. Les collections de plantes<br />
sèches étaient pour lui <strong>des</strong> aide-mémoires au<br />
pouvoir évocateur : « Je ne reverrai plus ces beaux<br />
paysages […] dont l'aspect a toujours touché mon<br />
cœur, mais maintenant que je ne peux plus courir<br />
ces heureuses contrées, je n'ai qu'à ouvrir mon<br />
herbier et bientôt il m'y transporte ». (RP 7 e<br />
promenade)<br />
Impécunieux, il envisagea un temps de constituer<br />
<strong>des</strong> petites collections d’environ 600 plantes<br />
courantes et de les vendre aux naturalistes<br />
amateurs. Mais il se rendit rapidement compte de<br />
l’aspect « chimérique»(CC 6989, 18 avril 1773) de ce<br />
projet et l'abandonna.<br />
Au XVIII e siècle, on échangeait volontiers <strong>des</strong><br />
plantes sèches. On offrait <strong>des</strong> espèces rares et<br />
parfois <strong>des</strong> collections entières. C’est ainsi qu’en<br />
1768, un jeune botaniste fit à Rousseau un cadeau<br />
« somptueux » : « 10 grands cartons de plus de 1<br />
500 plantes ». « Ce sera mon unique bibliothèque »<br />
et « Je défie les hommes de me rendre malheureux<br />
maintenant ». (CC 6365, 19 juin 1768) Mais le<br />
bonheur <strong>du</strong>re peu et une fois de plus son esprit<br />
chagrin se réveille: « Monsieur Dombey déterminait<br />
fort légèrement et souvent se trompait». (CC 6320,<br />
6 octobre 1769)<br />
Le consultant<br />
Au fil <strong>des</strong> années, Rousseau avait acquis une<br />
certaine notoriété en matière de botanique et il<br />
arrivait qu’on le consultât. Il entretint une longue<br />
relation épistolaire avec la <strong>du</strong>chesse de Portland<br />
qu'il avait connue lors de son séjour en Angleterre. Il<br />
déterminait les fleurs sèches qu'elle lui envoyait : "<br />
Je ne crois pas que ce soit Viola lutea comme vous le<br />
marquez […] celle en question me parait être de la<br />
famille <strong>des</strong> liliacées, elle a six pétales, six étamines<br />
[…], je la prendrais pour un ornithogale ». (CC 6185,<br />
4 janvier 1768) La <strong>du</strong>chesse qui identifiait les fleurs<br />
à la couleur avait beaucoup à apprendre…<br />
Il nous a laissé une abondante correspondance mais<br />
ces échanges se terminaient le plus souvent par <strong>des</strong><br />
brouilles. C'est ainsi qu'après dix années d’amitié, il<br />
se fâcha avec la <strong>du</strong>chesse qui avait cru lui être<br />
agréable en lui offrant <strong>des</strong> livres. Il réexpédia le colis
« sans l’ouvrir » car lire, dit-t-il « est devenu trop<br />
fatigant pour mon âge ». (CC 7093, 11 juillet 1776) Il<br />
rompit également avec Malesherbes qui, pensant<br />
bien faire, avait osé retourner les échantillons qu’il<br />
possédait en double.<br />
En 1770, on lui confia pour expertise les premiers<br />
numéros de La Botanique mise à la porté de tous,<br />
de Regnault . C’était un énorme travail sans<br />
prétention scientifique comme l’admet l’auteur luimême:<br />
« Notre objectif a été de figurer les plantes<br />
dont les hommes cherchent le secours dans les<br />
maladies qui les affligent». Les fascicules, qui<br />
paraîtront par souscription pendant douze ans,<br />
comportent 360 superbes planches <strong>des</strong>sinées par<br />
Geneviève Regnault, alors que les notices étaient<br />
rédigées par son mari qui précise : « Nous nous<br />
sommes servi <strong>des</strong> écrits <strong>des</strong> médecins anciens et <strong>des</strong><br />
connaissances <strong>des</strong> modernes pour indiquer les<br />
propriétés de chaque plante». La présentation en<br />
feuillets libres permettait de classer suivant les<br />
nomenclatures de Tournefort ou de Linné ou même<br />
par ordre alphabétique<br />
.<br />
Les Regnault étaient <strong>des</strong> <strong>des</strong>sinateurs-graveurs. À<br />
une époque où aucun livre de botanique illustré<br />
n’existait, leur travail novateur aurait pu plaire à<br />
Rousseau. Ce ne fut pas le cas. Il recherche la<br />
moindre faute et annote sévèrement le texte. Alors<br />
que le travail <strong>des</strong> Regnault était vraiment digne de<br />
respect, il traque avec jubilation les imprécisions<br />
dans les <strong>des</strong>criptions, les erreurs de détermination<br />
et même les éventuelles fautes d’orthographe. Ces<br />
critiques sarcastiques témoignent de connaissances<br />
réelles, mais révèlent aussi un caractère ombrageux.<br />
Rousseau botaniste ?<br />
« Si Rousseau se fût livré plus tôt à la botanique, il<br />
fût devenu un autre Linnaeus » écrivit son ami<br />
François-Louis d'Eschery. Mais fut-il vraiment<br />
botaniste? Il s'avouait lui-même « mince<br />
botaniste » (CC 6883, 22 aout 1771) et ses pairs ne<br />
le reconnurent point. En 1770, lors d’un bref séjour<br />
chez Buffon à Montbard il rencontra le naturaliste<br />
Daubenton qui, après l’avoir encouragé, constata<br />
son ignorance et «rétracta ses éloges». (CC 6742, 4<br />
juillet 1770) Jean-Jacques en fut très affecté.<br />
Il fut avant tout un collectionneur insatiable : « Je<br />
me dis avec satisfaction encore une plante pour mon<br />
herbier !» (RP 7 e promenade). Dans une optique<br />
encyclopédique de détermination, il souhaitait<br />
mettre un nom sur toutes les plantes. À 65 ans<br />
passés il écrit : «Me voila sérieusement occupé <strong>du</strong><br />
sage projet […] de connaître toutes les plantes<br />
connues sur la terre ». (RP 7 e promenade)<br />
Quinze années d'un travail intense, mais brouillon,<br />
n'ont rien apporté à la science et se résument à peu<br />
de choses.<br />
Les Huit lettres élémentaires sur la botanique<br />
adressées à son amie, Madame Delessert et<br />
<strong>des</strong>tinées à sa fillette de quatre ans, « l’aimable<br />
Madelon », témoignent avant tout de son talent de<br />
pédagogue. Avec un vocabulaire simple et précis,<br />
l'auteur de l'Émile commence par <strong>des</strong> données<br />
générales d’anatomie avant d’étudier, sur un<br />
52<br />
exemple, six familles importantes <strong>du</strong> monde végétal.<br />
Excellente approche de la Systématique, cette<br />
démarche correspondant à ce qu’on l’enseignait à<br />
une époque pas si lointaine quand la biologie<br />
s'appelait Sciences Naturelles.<br />
Madelon aura son petit herbier fait de plantes<br />
cueillies pour elle dans les bois de Meudon et elle<br />
devra observer : « apprendre à voir ce qu’elle voit »<br />
(CC 6883, 22 aout 1777) quand les autres «ne voient<br />
même pas ce qu’il faut regarder» (CO XII). Il<br />
recommande l'observation qui est l'un <strong>des</strong> piliers de<br />
toute démarche scientifique mais il n’y aura<br />
malheureusement pas de neuvième lettre.<br />
Velléitaire ou utopique? Il se lançait dans <strong>des</strong><br />
entreprises démesurées pour un vieil homme<br />
solitaire.<br />
Lors de son bref séjour sur le lac de Bienne, il avait<br />
manifesté l’intention de rédiger une flore de l'ile<br />
Saint-Pierre ; il ne donnera pas suite au projet. Il<br />
n’achèvera pas non plus le Dictionnaire de<br />
botanique dans lequel il se proposait de définir les<br />
principaux termes techniques.<br />
Mais son œuvre la plus étrange demeure sa<br />
Pasigraphie botanique un système de signes qu’il<br />
mit au point pour remplacer les mots. Considérant<br />
qu’avec ses 1 684 pages, le Linné en deux volumes<br />
était trop encombrant sur le terrain, il décida de<br />
l’alléger. Pour cela, il inventa 178 signes différents<br />
avec lesquels il commença de tra<strong>du</strong>ire le premier<br />
tome. L’entreprise, qui lui prit beaucoup de temps,<br />
demeura évidemment inachevée.<br />
Rousseau travaillait au gré de ses errances<br />
géographiques et de ses humeurs changeantes et son<br />
travail révèle sa fragilité psychologique, son<br />
« tempérament versatile qu’un vent impétueux<br />
agite » (RP 7 e promenade). La botanique qui lui<br />
occupait le corps et l’esprit, fut pour lui une drogue,<br />
un «moyen de ne laisser germer dans [s]on cœur<br />
aucun levain de vengeance ou de haine ». (RP 7 e<br />
promenade) Lorsque, perdant peu à peu le contact<br />
avec la réalité, il se croyait victime d’une<br />
conjuration, la botanique l'aida à conjurer ses<br />
cauchemars, et même, pensait-il, à se venger de ses<br />
persécuteurs : « Je ne saurais les punir plus<br />
cruellement que d’être heureux malgré eux. » (RP 7 e<br />
promenade)<br />
Bibliographie<br />
DUCOURTHIAL (G.), La botanique selon Jean-<br />
Jacques Rousseau, Belin, 2009<br />
ROUSSEAU (J.J.), Les Rêveries <strong>du</strong> promeneur<br />
solitaire, Classiques Garnier, Dunod Paris 1997<br />
(RP)<br />
ROUSSEAU (J.J.), Fragments pour un Dictionnaire<br />
<strong>des</strong> termes en usage en Botanique, Gallimard La<br />
Pléiade. Tome IV Paris 1969 (DB)<br />
ROUSSEAU (J.J.), Correspondance complète,<br />
Édition critique étable et annotée par R.A. de Leigh,<br />
The Voltaire Foundation at the Taylor Institution,<br />
Oxford, 1965-1998 (CC)<br />
ROUSSEAU (J. J.), Les Confessions. Gallimard.<br />
La Pléiade. Tome I, 1959
C’est par le biais de la sculpture que se répand<br />
l’image de Rousseau. Le sculpteur Jean-Baptiste II<br />
Lemoyne est l’auteur <strong>du</strong> seul buste en marbre de<br />
Rousseau, exécuté de son vivant et dont on a per<strong>du</strong><br />
la trace. Pourtant, sous Louis XVI, avait été repris<br />
l’usage antique de commémorer les hommes<br />
illustres en les sculptant, ce qui ne concerna pas<br />
Rousseau en raison de ses idées combattues par<br />
l’Église.<br />
À partir de 1790, se manifeste la reconnaissance<br />
envers les grands précurseurs de la Révolution dont<br />
Rousseau fait partie. Ce n’est pas la France<br />
révolutionnaire qui réalisera une statue en marbre<br />
ou en bronze <strong>du</strong> philosophe mais c’est sa ville natale<br />
de Genève dans la première moitié <strong>du</strong> XIX e siècle. Il<br />
faut attendre la troisième République française pour<br />
que soit enfin érigées <strong>des</strong> statues <strong>du</strong> philosophe<br />
dans une France devenue à nouveau républicaine.<br />
À l’époque de néoclassicisme de la fin <strong>du</strong> XVIII e<br />
siècle, il convenait d’observer une unité de thème<br />
dans la composition d’une œuvre sculptée, ce qui<br />
rendait difficile un travail sur un personnage aussi<br />
complexe que Rousseau, à l’exception <strong>des</strong> bustes, de<br />
facture peu variée. Comment représenter<br />
simultanément le philosophe et le législateur,<br />
l’auteur de l’Émile et celui <strong>du</strong> Contrat Social ?<br />
De plus, que représente l’œuvre d’art ? L’effigie de<br />
l’homme Rousseau, ou bien la tra<strong>du</strong>ction de ce que<br />
l’artiste retient de la pensée de l’écrivain ? À cette<br />
difficulté d’inspiration, il faut ajouter celle de la<br />
réalisation d’une œuvre dont les projets sont<br />
modelés d’abord en plâtre ou en terre cuite, avant de<br />
trouver éventuellement le commanditaire finançant<br />
la transformation en pierre, en marbre ou en<br />
bronze.<br />
À la mort de Rousseau à Ermenonville le 2 juillet<br />
1778, son hôte, le marquis de Girardin, fait appel,<br />
pour confectionner son masque mortuaire, au<br />
sculpteur Houdon qui venait de pro<strong>du</strong>ire un buste<br />
de Voltaire réalisé avant sa mort. À partir de ce<br />
masque mortuaire et la même année, Houdon<br />
exécuta trois types de bustes repro<strong>du</strong>its en plusieurs<br />
exemplaires et qui serviront de modèles à la plupart<br />
<strong>des</strong> futurs sculpteurs de l’effigie <strong>du</strong> philosophe.<br />
Le Rousseau à la française en terre cuite, <strong>du</strong> musée<br />
<strong>du</strong> Louvre ou <strong>du</strong> musée <strong>des</strong> Beaux-Arts d’Orléans,<br />
donne l’image d’un personnage <strong>du</strong> XVIII e siècle,<br />
vêtu d’un habit avec cravate, coiffé d’une perruque.<br />
Ses traits sont expressifs, avec un regard particulier<br />
donné par les yeux aux pupilles sculptées. L’image<br />
est celle de l’écrivain de l’époque.<br />
Le Rousseau tête nue sans vêtement, en plâtre<br />
DE MARBRE OU DE BRONZE :<br />
les malheurs de Jean-Jacques … en sculpture<br />
Monique BOURGUET-VIC<br />
53<br />
patiné, détenu par le musée <strong>des</strong> Arts décoratifs à<br />
Paris, présente un personnage aux traits aussi<br />
véridiques mais plus idéalisés, buste coupé, cheveux<br />
courts, au sourire esquissé : il devient intemporel.<br />
Houdon avait inauguré ce type avec le buste de<br />
Diderot en 1771 et, avec celui de Voltaire réalisé en<br />
marbre.<br />
Le bronze à l’antique <strong>du</strong> Louvre, situe le<br />
personnage dans la lignée historique <strong>des</strong> grands<br />
philosophes. Doté <strong>des</strong> mêmes traits, enrobé de<br />
lour<strong>des</strong> draperies, le personnage porte le bandeau<br />
de l’immortalité dit « <strong>des</strong> philosophes ».<br />
Ces portraits, maintes fois revendiqués par Houdon<br />
comme étant les seuls véridiques, contribuèrent à<br />
immortaliser l’image de l’écrivain qui se substitue à<br />
celle omniprésente créée par le pastel de Maurice<br />
Quentin de La Tour en 1763. Les estampes qui<br />
repro<strong>du</strong>isirent ces bustes y contribuèrent aussi<br />
beaucoup.<br />
Toutefois, ces bustes n’ont pas inspiré la facture <strong>du</strong><br />
tombeau qui a remplacé, le 4 janvier 1780, la simple<br />
urne en plâtre, déposée provisoirement en guise de<br />
sépulture dans l’île <strong>des</strong> Peupliers, située au milieu<br />
<strong>du</strong> lac, en face <strong>du</strong> château d’Ermenonville, et que<br />
représente la gravure de Jean-Michel Moreau le<br />
jeune. Ce tombeau a été sculpté par Jacques-<br />
Philippe Le Sueur, d’après Hubert Robert. François<br />
Godefroy en fait la même année une estampe qui<br />
contribua à faire connaître cette sépulture devenue<br />
un lieu de pèlerinage. La maquette, détenue par le<br />
musée Jacquemart-André à Chaalis, représente,<br />
dans un bas-relief historié, la Maternité, la Nature et<br />
Émile, évocations <strong>des</strong> thèmes préférés de l’écrivain<br />
qui, lui, n’est pas représenté.<br />
Le portrait sculpté <strong>du</strong> vivant de Rousseau se<br />
retrouve seulement sur le premier monument privé<br />
non funéraire à la gloire de Rousseau, érigé à<br />
Genève. Conçue au début 1778 par un grand<br />
admirateur de Rousseau, l’orfèvre suisse Jacques<br />
Argand, cette œuvre est réalisée par le sculpteur<br />
Jean-François Hess. Achevée en 1779, elle est<br />
repro<strong>du</strong>ite par la gravure de Carl Guttenberg,<br />
d’après le <strong>des</strong>sin de Jacques Barbier, peintre <strong>du</strong> Roi.<br />
Jacques Argand, souhaitait laisser dans la pierre les<br />
principes énoncés dans l’Émile, devenus un modèle<br />
é<strong>du</strong>catif pour son fils. Rousseau souriant, debout,<br />
cheveux courts au naturel, drapé à l’antique, tient<br />
une guirlande de fleurs d’où partent <strong>des</strong><br />
chaînes mollement ten<strong>du</strong>es qui lient le maître à son<br />
« Élève à la manière <strong>des</strong> esclaves en signe<br />
d’assujettissement qu’il doit consacrer à l’enfant »,<br />
selon les termes <strong>du</strong> texte de cette gravure ; il est
précisé que l’enfant est aussi enchaîné à la Nature,<br />
ce qui ne se voit pas sur ce modèle. Le maître<br />
s’appuie sur un bouclier volontairement brisé, en<br />
signe d’opposition à la scène de punition qui est<br />
représentée et qui symbolise les abus de l’é<strong>du</strong>cation<br />
scolastique.<br />
À la demande de Hess qui était aussi céramiste,<br />
Argand fait réaliser le modèle en terre <strong>du</strong>re. À la<br />
mort d’Argand en 1782, le monument est acheté par<br />
Samuel de Constant, l’oncle de Benjamin.<br />
Ré<strong>du</strong>ctions en terre cuite, repro<strong>du</strong>ctions en biscuit<br />
par la manufacture de Niderviller et gravures<br />
permirent de faire connaître cette œuvre restée<br />
privée et disparue à la fin <strong>du</strong> XVIII e siècle.<br />
La révolution de 1789 ouvre une période de<br />
glorification pour Rousseau qui fait alors l’objet de<br />
nombreux projets de représentation sculptée,<br />
souvent restés à l’état d’ébauche, en raison de<br />
l’accélération <strong>des</strong> événements historiques qui<br />
privilégient d’autres priorités.<br />
Dès janvier 1790, la souscription lancée pour élever<br />
une statue de Rousseau à Paris connaît un grand<br />
succès, et auprès d’une large éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> corps<br />
social, mais elle est ren<strong>du</strong>e obsolète par la décision<br />
de l’Assemblée Nationale, en décembre 1790,<br />
d’élever un monument aux frais de l’État. Au Salon<br />
de septembre 1791, plusieurs projets de statues en<br />
terre cuite voient le jour, en prévision d’un concours<br />
qui tarde à être organisé:<br />
Antoine-Denis Chaudet présente un projet dont on<br />
possède seulement la <strong>des</strong>cription dans les livrets <strong>du</strong><br />
Salon. Une terre cuite, ven<strong>du</strong>e à Drouot en 1978<br />
intitulée Rousseau assis foulant au pied l’idole <strong>du</strong><br />
préjugé, correspond à ce projet. Elle présente le<br />
personnage, assis, en perruque et habit à la<br />
française, identifié par les livres les plus cités<br />
pendant la révolution, aux titres bien visibles,<br />
CONTRAT SOCIAL ÉMILE ; il est assis à côté d’un<br />
chêne et son pied est posé sur la statue<br />
emblématique <strong>des</strong> préjugés.<br />
Le plâtre patiné de Jean-Robert-Nicolas Lucas de<br />
Montigny le représente avec un enfant tenant une<br />
tige feuillue, deux symboles liant é<strong>du</strong>cation et<br />
nature, une idée chère à l’écrivain. La critique a mis<br />
en cause l’absence de lien affectif dans la<br />
représentation entre le personnage de Rousseau et<br />
l’enfant. C’est pourtant un magnifique modèle, dont<br />
on peut regretter qu’il n’ait pas abouti à une<br />
réalisation définitive.<br />
Le troisième projet, celui de Jean-Baptiste Stouf,<br />
offre une composition pyramidale très élaborée : au<br />
sommet, le buste de Rousseau, couronné par un<br />
génie tenant la trompette de la renommée ; à la<br />
base, d’un côté, une mère et ses deux enfants<br />
déposant une couronne civique et, de l’autre, un<br />
enfant tenant une lyre et posant son pied - qui a<br />
disparu depuis - sur l’envie entourée d’un serpent et<br />
symbolisée par le personnage couché à gauche.<br />
Si pour les deux premiers projets, la sobriété se<br />
dégage <strong>du</strong> personnage, identifié par un attribut<br />
particulier et dont le visage est empreint de<br />
réflexion, pour le troisième projet, la composition<br />
complexe de ce groupe emphatique n’est pas<br />
54<br />
convaincante. Mais tous ces hommages restent à<br />
l’état de projet, dans l’attente de la fixation <strong>des</strong><br />
modalités d’un concours qui ne se fait pas.<br />
De 1791 à 1794, <strong>des</strong> nouveaux projets, présentés aux<br />
Salons, sont élaborés dans la perspective d’élever<br />
une statue de Rousseau sur les Champs-Élysées,<br />
comme le préconisaient les décrets <strong>du</strong> 21 septembre<br />
1791 et de novembre 1793. Mais il y avait d’autres<br />
priorités face aux dangers intérieurs et extérieurs et<br />
dans un contexte de luttes sanglantes au sein de la<br />
Convention entre Girondins et Montagnards.<br />
Les révolutionnaires se contentent <strong>du</strong> buste de<br />
l’écrivain, objet d’extraordinaires mises en scène<br />
révolutionnaires qui prennent le pas sur le sacré :<br />
pour l’anniversaire <strong>du</strong> serment <strong>du</strong> Jeu de Paume en<br />
1790 où il est associé à ceux de Voltaire et de<br />
Benjamin Franklin ; le 4 avril 1791 lors <strong>du</strong> transfert<br />
<strong>des</strong> cendres de Mirabeau au Panthéon, ancienne<br />
église Sainte-Geneviève transformée en temple<br />
dédié aux Grands Hommes ; en juillet 1791 pour la<br />
« panthéonisation » de Voltaire ; enfin lors de la<br />
grande fête champêtre en l’honneur de Rousseau,<br />
célébrée à Montmorency le 25 septembre 1791.<br />
Malgré la chute de Robespierre, ardent partisan de<br />
l’écrivain, la gloire de Rousseau per<strong>du</strong>re et il est<br />
transféré au Panthéon le 11 octobre 1794, par les<br />
soins <strong>du</strong> sculpteur Le Sueur, déjà cité, qui a été<br />
chargé d’exhumer les cendres de son tombeau à<br />
Ermenonville et de les transporter à Paris.<br />
De 1794 à 1798, la question d’une statue de<br />
Rousseau revient de façon récurrente. À cet effet, le<br />
Comité de Salut Public établit enfin en mai 1794 le<br />
concours placé sous l’autorité d’un Jury <strong>des</strong> Arts qui<br />
décerne en février 1795 le premier prix à Jean-<br />
Guillaume Moitte, vainqueur <strong>des</strong> 24 concurrents.<br />
Pour son Jean-Jacques Rousseau méditant sur les<br />
premiers pas de l’enfance (terre cuite, musée<br />
Carnavalet, Paris), Moitte choisit le thème de<br />
l’é<strong>du</strong>cation et de l’Émile. Le philosophe est<br />
représenté « héroïsé à la romaine », assimilé à<br />
Hercule représentant le peuple en tant que force de<br />
la Nation, alors qu’à ses côtés Émile représente le<br />
citoyen régénéré par l’é<strong>du</strong>cation. Le sculpteur se<br />
conforme tout à fait au discours jacobin concernant<br />
l’é<strong>du</strong>cation, envisagée selon la conception<br />
rousseauiste. Le torse est sculpté à la façon de<br />
l’Apollon <strong>du</strong> Belvédère, modèle néoclassique de<br />
beauté et de puissance. La scène met l’accent sur les<br />
rapports affectueux entre les deux personnages,<br />
l’auteur de l’Émile regardant les premiers pas de<br />
l’enfant qui s’appuie sur lui. Cette œuvre, <strong>des</strong>tinée à<br />
être placée sur les Champs-Élysées, fut appréciée à<br />
un moment où le pays commençait à éprouver un<br />
désir de pacification intérieure après les journées<br />
sanglantes <strong>des</strong> années précédentes. Moitte obtient<br />
l’autorisation de l’exécuter en marbre plutôt qu’en<br />
bronze, dans un délai de trois ans. Envoyé en<br />
mission en Italie immédiatement après, sa<br />
composition fut oubliée à son retour en 1798, ayant<br />
peut-être cessé de plaire, et son plâtre ne fut jamais<br />
transcrit dans le marbre.<br />
Toutefois, une statue de Rousseau, dont on a per<strong>du</strong><br />
la trace, fut exposée au public dans le jardin <strong>des</strong>
Tuileries et sa détérioration motiva un décret de<br />
remplacement pris par le Conseil <strong>des</strong> Anciens sous<br />
le Directoire, le 20 octobre 1798. Pour éviter la<br />
lenteur d’un concours, la commande fut attribuée<br />
directement à François Masson, sculpteur officiel<br />
<strong>des</strong> Tuileries. Sur la maquette <strong>du</strong> modèle présenté<br />
provenant <strong>du</strong> Louvre, quatre figures à l’Antique sont<br />
juchées sur un pié<strong>des</strong>tal historié : Émile adolescent,<br />
recevant une leçon de Rousseau, à leur côté une<br />
femme qui offre un sein dénudé à son nourrisson.<br />
L’unité de l’œuvre est respectée et c’est sur le<br />
pié<strong>des</strong>tal que sont représentés quatre bas-reliefs<br />
titrés ainsi :<br />
1. Le Contrat social, contrat d’union juré par <strong>des</strong><br />
hommes libres (sous le groupe)<br />
2. Les figures allégoriques <strong>du</strong> Devin <strong>du</strong> village, de<br />
la musique, <strong>du</strong> Pygmalion, et <strong>du</strong> goût de Rousseau<br />
pour la botanique et la nature (à gauche)<br />
3. Héloïse reprenant ses sens et couvrant de baisers<br />
son enfant retiré <strong>des</strong> flots (à l’arrière)<br />
4. Les figures allégoriques <strong>des</strong> principes de<br />
Rousseau en législation générale, de son triomphe à<br />
l’<strong>Académie</strong> de Dijon, et de son combat polémique<br />
avec d’Alembert (à droite).<br />
Mais, si le modèle en plâtre fut élaboré en grand et<br />
installé au Palais <strong>du</strong> Sénat (Palais <strong>du</strong> Luxembourg),<br />
il disparut en 1836, sans être réalisé en marbre. Il<br />
fut toutefois largement connu grâce à l’estampe.<br />
« Où est le marbre, où est le bronze, où sont les<br />
statues et les temples élevés à la gloire de nos<br />
héros ? » s’exclamait-on au conseil <strong>des</strong> Cinq Cents à<br />
la fin <strong>du</strong> Directoire.<br />
Malgré les déclamations et les projets, la Révolution<br />
ne réussit pas à ériger en marbre ou en fonte un<br />
monument à son grand homme, ce qu’était<br />
Rousseau. Sa ville natale le fera une trentaine<br />
d’années après.<br />
À Genève en effet, dès 1793, on avait bien eu l’idée<br />
d’ériger une statue à Rousseau, mais seul un buste<br />
avait été réalisé. Il s’agissait d’un buste « colossal »<br />
par le sculpteur suisse Jean Jaquet, dont Pradier fut<br />
l’élève. Placé en 1794 au sommet d’une colonne de<br />
briques sur la promenade <strong>des</strong> Bastions, il fut<br />
supprimé en février 1817 lors de la création <strong>du</strong><br />
jardin botanique. Le projet fut repris en 1818 et,<br />
après le désistement de Canova à qui on avait fait<br />
appel, les membres de la Société <strong>des</strong> Arts de Genève<br />
s’adressèrent au sculpteur James Pradier, pour la<br />
commande <strong>des</strong> bustes de Rousseau et <strong>du</strong> botaniste<br />
Charles Bonnet, <strong>des</strong>tinés à orner, avec quatre autres<br />
bustes commandés à d’autres sculpteurs, la façade<br />
de l’orangerie <strong>du</strong> jardin botanique tout juste créé.<br />
Pradier, genevois d’origine, Prix de Rome en 1813,<br />
s’était installé à Paris, après son séjour à la villa<br />
Médicis.<br />
Inauguré le 30 avril 1821, ce buste de Rousseau en<br />
hermès montre le sujet, torse nu sans épaule,<br />
cheveux courts à la romaine. Il se situe dans la<br />
lignée <strong>des</strong> bustes de Houdon, mais il reste<br />
caractéristique de l’époque romantique par sa<br />
représentation frontale, et également caractéristique<br />
55<br />
de l’art de Pradier par son expressivité.<br />
En février 1830, Pradier, reçut une nouvelle<br />
commande, après une correspondance avec Marc-<br />
Antoine Fazy-Pasteur, président <strong>du</strong> comité de la<br />
commission chargée de la souscription pour<br />
l’élévation d’une statue à Rousseau. Le musée de<br />
Nantes en possède une maquette acquise en 1866, se<br />
rapprochant de l’original en bronze de huit pieds de<br />
haut. Non seulement la première fonte à la cire<br />
per<strong>du</strong>e fut défectueuse et irrécupérable, mais le<br />
fondeur Honoré Gonon lui-même disparut. Un<br />
nouveau fondeur, Crozatier, exécuta avec succès une<br />
nouvelle fonte au sable. Ainsi, la réalisation de ce<br />
Rousseau fut pénible, lente et coûteuse, au grand<br />
désespoir de Pradier, comme le montre sa<br />
correspondance.<br />
Monument à Rousseau. J. Pradier. Genève<br />
C’est un Rousseau théiste et moralisateur qui a été<br />
choisi comme thème. Revêtu d’une longue chemise à<br />
col ouvert et amplement drapée, coiffé à la romaine,<br />
pieds nus, l’écrivain pensif est assis sur un lourd<br />
fauteuil aux pieds en balustre. Il tient un stylet,<br />
légèrement penché en avant sur un livre, ouvert sur<br />
ces mots tirés de La Profession de foi d’un vicaire<br />
savoyard : « (oui si)… la vie et la mort de Socrate<br />
sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un<br />
dieu … ». Sous le fauteuil, d’autres livres sans titre.<br />
Si la statue s’inscrit à la suite <strong>des</strong> projets de la<br />
période révolutionnaire, elle n’en retient que<br />
l’essentiel, la personnalité <strong>du</strong> penseur. Fin 1834, la<br />
statue de Pradier est exposée à Paris dans la cour de<br />
l’Institut où elle reçoit <strong>des</strong> appréciations mitigées.<br />
Transportée à Genève, elle est placée sur l’île<br />
devenue depuis Île Rousseau, face à la ville, et<br />
inaugurée avec faste. Sa position a varié au cours<br />
<strong>des</strong> temps : dans les années 1860, on la déplace pour<br />
la mettre face au lac, alors que récemment elle vient<br />
de retrouver son orientation d’origine vers le centre<br />
de l’île. Pur hasard ou errements symboliques de la<br />
difficulté de compréhension de la part <strong>du</strong> public<br />
pour cet écrivain à la personnalité complexe ?<br />
C’est certainement une <strong>des</strong> plus belles<br />
représentations de Rousseau <strong>du</strong>e à l’art de Pradier.<br />
Parmi les thèmes choisis par les sculpteurs français,<br />
en proie à un cruel dilemme dû aux exigences <strong>du</strong>
néoclassicisme, arrivent en tête les thèmes de<br />
l’É<strong>du</strong>cation, de la Maternité, et <strong>du</strong> Contrat social.<br />
Toutefois, sur l’éventuel pié<strong>des</strong>tal, la sculpture<br />
pouvait s’enrichir de thèmes complémentaires.<br />
La récupération politique a joué à plein au temps<br />
<strong>des</strong> révolutionnaires français, adeptes d’un<br />
Rousseau idéalisé, figé dans son image de législateur<br />
ou <strong>des</strong>tructeur de préjugés é<strong>du</strong>catifs ou familiaux,<br />
sans tenir compte <strong>des</strong> facettes moins connues de ce<br />
personnage, davantage mises à l’honneur seulement<br />
à la fin <strong>du</strong> XIX e siècle.<br />
L’Empire, la Restauration, la Monarchie de juillet<br />
ont été peu sensibles à Rousseau. David d’Angers le<br />
fit apparaître sur le fronton <strong>du</strong> Panthéon, mais on le<br />
distingue mal. La II e République n’eut pas le temps<br />
de l’honorer ; le Second Empire commanda au<br />
sculpteur Jean-Baptiste Farochon une statue en<br />
pied placée en 1856 dans la salle Courtauld au<br />
Louvre. Le musée de Chambéry en possède une<br />
ré<strong>du</strong>ction en bronze.<br />
C’est la III e République qui, non sans mal, allait<br />
mettre un terme à ces projets continuellement repris<br />
depuis un siècle. Les difficultés de réalisation se<br />
poursuivirent. En 1876, ce n’est pas le centenaire de<br />
la mort de Rousseau qui fut célébré, mais celui de<br />
Voltaire, pourtant doté de cinq statues à Paris. En<br />
1885, le Conseil municipal de la Ville, malgré<br />
certaines oppositions violentes en son sein, lança<br />
un concours pour l’érection d’une statue de<br />
Rousseau. Paul Berthet, dijonnais d’origine, en fut le<br />
lauréat.<br />
Une photographie, document exceptionnel, trouvé à<br />
la documentation <strong>du</strong> musée d’Orsay, signée de la<br />
main <strong>du</strong> sculpteur, représente le modèle en plâtre<br />
exposé au salon de 1887. L’écrivain en costume<br />
d’époque est représenté la jambe en avant posée<br />
devant une touffe d’herbes symbolisant la Nature,<br />
tricorne et canne sous le bras gauche, la main tenant<br />
un livre dont le doigt marque la page, le bras gauche<br />
ten<strong>du</strong> en avant. Après de longues querelles sur le<br />
choix de son emplacement, le bronze d’une hauteur<br />
de 2,50 m. fut installé place <strong>du</strong> Panthéon où<br />
l’architecte J. C. Formigé lui fit un pié<strong>des</strong>tal de<br />
marbre rose, portant <strong>des</strong> inscriptions rappelant les<br />
décrets révolutionnaires auxquels se référait la ville<br />
de Paris.<br />
Inaugurée le 3 février 1889, année propice aux<br />
commémorations, la magnifique effigie de l’écrivain<br />
n’eut qu’une courte vie de cinquante ans. Ses 1520<br />
kilogrammes de bronze furent fon<strong>du</strong>s sous le régime<br />
de Vichy, et on lui substitua, en 1952, une statue en<br />
pierre de qualité moindre, œuvre d’André Bizette-<br />
Lindet.<br />
Au début <strong>du</strong> XX e siècle, les villes de province<br />
suivirent cet exemple, mettant en place <strong>des</strong> statues<br />
pro<strong>du</strong>ites par Carrier-Belleuse, Greber et Mars-<br />
Vallet.<br />
Albert-Ernest Carrier-Belleuse a représenté, dans<br />
une petite terre cuite de 76 cm, un Rousseau<br />
herborisant, concentré sur l’observation d’une<br />
plante et en habit d’un promeneur de l’époque,<br />
chapeau sous le bras et bâton à la main. Elle se<br />
56<br />
trouve au Musée <strong>du</strong> château de Nemours. À partir<br />
de cette maquette, son fils, Louis-Robert, exécutera<br />
une statue de Rousseau, Promeneur solitaire,<br />
inaugurée le 27 octobre 1907 à Montmorency, dans<br />
le val d’Oise, et qui se trouve dans le musée consacré<br />
à l’écrivain.<br />
Placé à l’entrée <strong>du</strong> village d’Ermenonville, le<br />
monument à Rousseau, œuvre d’Henri Greber, est<br />
l’étape obligée de tout « pèlerin de Jean-Jacques »<br />
dans ce lieu célèbre. L’écrivain est assis sur un<br />
rocher, à l’ombre d’un chêne, accompagné de la<br />
figure allégorique de la Vérité placée derrière lui.<br />
Inauguré le 18 octobre 1908, en présence <strong>du</strong><br />
ministre <strong>du</strong> travail et de nombreuses personnalités<br />
politiques, ce monument domine la rue principale à<br />
l’entrée <strong>du</strong> village, mais placé sur un îlot étroit, au<br />
centre d’un petit carrefour, il subit les aléas d’une<br />
circulation devenue dense dans ce lieu où le<br />
promeneur solitaire était venu chercher la<br />
tranquillité.<br />
À Chambéry, le bronze de Rousseau eut aussi <strong>des</strong><br />
malheurs. Dans les années 1910, moment de<br />
tensions politiques à Chambéry entre les<br />
républicains arrivés au pouvoir et les conservateurs<br />
monarchistes, l’annonce d’un monument à<br />
Rousseau, déclencha une violente polémique. Non<br />
seulement le choix de l’écrivain libéral choquait,<br />
mais son monument devait dominer la ville, au<br />
grand dam <strong>des</strong> conservateurs qui avaient fait édifier<br />
auparavant la statue de Joseph de Maistre, placée<br />
dans la ville. Ainsi se déclencha « la guerre <strong>des</strong><br />
statues » dont la violence apparaît dans l’affiche sur<br />
laquelle on lit « Citoyen détestable, voleur,<br />
mauvais époux, père indigne, corrupteur,<br />
polisson… misérable … ».<br />
Œuvre en bronze de Mars-Valett, Rousseau apparaît<br />
au retour d’une herborisation, <strong>des</strong>cendant, la canne<br />
à la main, de la colline <strong>des</strong> Charmettes dont la<br />
maison, entourée d’un bois de châtaigniers, est<br />
représentée en bas-relief sur le socle. Elle fut<br />
inaugurée avec une certaine provocation, à<br />
l’occasion <strong>du</strong> cinquantenaire <strong>du</strong> rattachement de la<br />
Savoie à la France en 1910, le 4 septembre, jour de<br />
l’anniversaire de la proclamation de la III e<br />
République, et en présence <strong>du</strong> président Fallières<br />
en personne. Trois ans plus tard, en 1913, la statue<br />
eut les pieds sciés, elle fut renversée, le visage lacéré.<br />
Cet acte de vandalisme, qualifié de « sauvage » par<br />
la presse locale, clôtura cette guerre politique dont<br />
l’écrivain fut l’enjeu doublement malheureux<br />
puisque la statue, restaurée l’année suivante, fut<br />
fon<strong>du</strong>e en Allemagne en 1943. Tout ne fut pas<br />
négatif toutefois : le moulage de 1916, opéré à<br />
l’occasion de sa restauration, permit de la fondre à<br />
nouveau en 1962 pour le 250 e anniversaire de sa<br />
naissance, sauvant un <strong>des</strong> portraits sculptés les plus<br />
réussis en France.<br />
Terminons en citant le monument construit enfin au<br />
Panthéon par Albert Bartholomé, inauguré avec<br />
faste en présence <strong>du</strong> président Fallières le 30 juin<br />
1912, pour le bicentenaire de sa naissance, mais sur<br />
lequel il ne figure qu’en médaillon.<br />
Rappelons encore que les représentations picturales,<br />
volontairement laissées de côté dans cet exposé,
n’étaient pas appréciées de Rousseau, rarement<br />
content de son effigie peinte, excepté pour le pastel<br />
de la Tour.<br />
En ce qui concerne les gravures, elles sont très<br />
nombreuses, estimés à plus de 10.000 en 1764,<br />
selon Rousseau lui-même qui essayait de les<br />
contrôler, en particulier celles <strong>des</strong>tinées à illustrer<br />
les éditions de ses ouvrages.<br />
Au total, les représentations sculptées ont joué un<br />
rôle capital dans le façonnement de l’image <strong>du</strong><br />
personnage dans la mesure où, d’une part, elles<br />
étaient repro<strong>du</strong>ites en plusieurs exemplaires et,<br />
Figures allégoriques <strong>des</strong> principes de Rousseau<br />
François Masson. Socle <strong>du</strong> modèle <strong>du</strong> monument à Rousseau<br />
57<br />
d’autre part, elles étaient offertes dans un espace<br />
public accessible à tous, contribuant ainsi à la<br />
vulgarisation. De plus, les estampes, faciles d’accès,<br />
repro<strong>du</strong>isaient ces effigies sculptées et leur<br />
permettaient de ne pas tomber dans l’oubli en cas<br />
de disparition.<br />
De marbre ou de bronze, Jean-Jacques a été<br />
représenté avec bien <strong>des</strong> malheurs. Pur hasard de<br />
l’histoire ou difficultés symboliques logiques pour<br />
cet écrivain complexe et controversé ? Je vous laisse<br />
juges.
RELIRE LA NOUVELLE HELOÏSE ?<br />
Yves STALLONI<br />
Julie et Saint-Preux sur le lac Léman. Charles-Édouard Crespy Le Prince (1784-1850)<br />
La question mérite d’être posée au seuil de cette<br />
communication : est-il utile de consacrer <strong>du</strong> temps à<br />
parler d’un livre que plus personne ne lit ? Un livre<br />
que très peu de lecteurs ont lu, y compris parmi le<br />
public cultivé qui compose cette salle. Un livre que<br />
l’auteur lui-même tenait pour confidentiel quand il<br />
écrivait dans sa Préface : « Ce livre n’est point fait<br />
pour circuler dans le monde et convient à très peu<br />
de lecteurs. » Précaution que confirmait la suite :<br />
« À qui plaira-t-il donc ? Peut-être à moi seul : mais<br />
à coup sûr il ne plaira que médiocrement à<br />
personne. »<br />
Rousseau se trompait, ou faisait le coquet : dès sa<br />
sortie, le succès de ces « lettres de deux amants » est<br />
prodigieux. « On passe <strong>des</strong> nuits blanches à les lire ;<br />
les loueurs ne les cèdent qu’à prix d’or » explique<br />
Daniel Mornet, professeur à la Sorbonne 58 . De 1761,<br />
date de publication, à 1800, en moins de quarante<br />
ans, paraissent environ soixante-dix éditions.<br />
58 Daniel Mornet, La Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau,<br />
collection Mellottée, 1957, p. 310.<br />
59<br />
Seul le Candide de Voltaire, sorti deux ans plus tôt,<br />
peut rivaliser.<br />
Ce serait déjà une bonne raison de s’intéresser à ce<br />
roman : il fut un événement littéraire et son<br />
influence s’est fait sentir <strong>du</strong>rablement.<br />
Mais là n’est pas l’essentiel. Le plus important est<br />
que dès la préface, ou plus exactement les préfaces,<br />
puisqu’il en existe deux, ce roman, autant que les<br />
autres ouvrages de Jean-Jacques, peut nous aider à<br />
comprendre sa personnalité et son génie – ce qui est<br />
un <strong>des</strong> enjeux de cette journée. Les préventions qu’il<br />
formule sur son livre, la revendication, assez<br />
paradoxale, mais fréquente sous sa plume, de<br />
n’écrire que « pour lui seul », s’accordent à son goût<br />
de l’isolement et à sa misanthropie. D’autres<br />
tricheries illustrent les contradictions de l’écrivain :<br />
le refus de paternité littéraire, Rousseau, suivant un<br />
subterfuge répan<strong>du</strong>, se présentant comme le simple<br />
éditeur de cette correspondance ; le refus de la<br />
fiction aussi, puisqu’il assure que ces lettres sont<br />
authentiques et leurs auteurs <strong>des</strong> personnages réels.
Ces puériles mystifications lui évitent de se déjuger,<br />
permettant à celui qui fit profession de farouche<br />
opposant au genre romanesque d’y sacrifier luimême.<br />
Vient enfin l’argument décisif : la préten<strong>du</strong>e portée<br />
morale <strong>du</strong> livre affirmée dès le début de la première<br />
préface : « J’ai vu les mœurs de mon temps, et j’ai<br />
publié ces lettres », longuement développé dans la<br />
deuxième. L’excuse suprême de ce roman est que le<br />
message est édifiant, à la différence de ces livres<br />
dont parle Saint-Preux « qui sont peut-être la<br />
dernière instruction qu’il reste à donner à un peuple<br />
[…] corrompu » (II, 21). Les vertus conjugales y<br />
sont célébrées, la religion sort victorieuse, le<br />
bonheur répand sa contagion, les bons sentiments<br />
métamorphosent les êtres – et le roman atteint,<br />
comme l’assurent les Confessions, cet « objet de<br />
concorde et de paix publique ». Une telle ambition<br />
rendra, dit Rousseau, le livre déplaisant à la<br />
catégorie « <strong>des</strong> beaux-esprits, <strong>des</strong> académiciens, <strong>des</strong><br />
philosophes ». Les membres de notre compagnie<br />
répondant à l’une au moins de ces étiquettes –<br />
parfois, dans le meilleur <strong>des</strong> cas, aux trois – j’ai<br />
souhaité leur offrir <strong>des</strong> raisons de prendre à revers<br />
la fausse mo<strong>des</strong>tie de l’auteur en réhabilitant ce<br />
roman oublié et en déclinant quelques raisons de<br />
l’aimer et de le défendre.<br />
Le roman de Sophie<br />
Première interrogation : comment Rousseau,<br />
intraitable contempteur de ce genre méprisable<br />
qu’est le roman, en est-il venu, à près de cinquante<br />
ans, à en écrire un ? Si nous laissons de côté les<br />
questions de vanité – montrer qu’il est capable de<br />
briller sur ce terrain – ; son goût naturel pour la<br />
rêverie, refuge de la solitude et de la maladie ; son<br />
reniement – provisoire, mais sincère – de la<br />
philosophie ; sa préoccupation morale, que nous<br />
avons déjà mentionnée ; sa volonté de célébrer une<br />
région suggestive, le lac Léman et ses environs, qui<br />
ressuscite pour lui tout un passé, il nous faut bien<br />
reconnaître que la vraie raison est sentimentale.<br />
Julie, c’est un peu le roman de Sophie.<br />
Rappelons les circonstances. Au printemps 1756,<br />
Rousseau vient s’installer au Mont-Louis, dans la<br />
maison qu’a fait réparer pour lui Mme d’Épinay,<br />
près de son château de l’Ermitage à l’orée de<br />
Montmorency. Divers projets l’animent, dont un<br />
livre sur les institutions politiques (ce sera le<br />
Contrat social), un essai sur l’é<strong>du</strong>cation (ce sera<br />
l’Émile) ; un Dictionnaire de musique, qui ne<br />
paraîtra qu’en 1767 ; enfin un roman, dont la<br />
simplicité et la fraîcheur éclipseraient les<br />
pro<strong>du</strong>ctions frivoles d’alors. Délaissant les ouvrages<br />
austères qu’il a en chantier, il commence à rédiger<br />
pour lui, pour son plaisir, cette œuvre de fiction qui,<br />
pour l’instant, est sans intrigue, qu’il situe dans un<br />
cadre idyllique et dont l’objet est simplement de<br />
fixer un rêve. « L’impossibilité d’atteindre aux êtres<br />
réels me jeta dans le pays <strong>des</strong> chimères » écrit-il au<br />
livre IX <strong>des</strong> Confessions.<br />
Il en est là, quand, aux premiers jours de l’automne,<br />
une personne de condition, élégante, spirituelle, se<br />
présente au château : elle s’est égarée, alors que son<br />
60<br />
carrosse a versé dans la boue. Elle n’est autre que la<br />
belle-sœur de Mme d’Épinay, la comtesse Sophie<br />
d’Houdetot, que Rousseau a déjà rencontrée, et qui,<br />
après cette spectaculaire apparition, revient au<br />
château quelques temps plus tard, pour une<br />
nouvelle visite, à cheval cette fois, vêtue en<br />
amazone. « Quoique je n’aime guère ces sortes de<br />
mascara<strong>des</strong>, dira Rousseau dans les Confessions, je<br />
fus pris à l’air romanesque de celle-là, et pour cette<br />
fois, ce fut de l’amour. » Le fantôme qu’aimait<br />
jusqu’alors Jean-Jacques, orphelin depuis vingt ans<br />
de Mme de Warens, prend soudain un visage, celui<br />
d’une jeune femme gaie et charmante. Il décide de<br />
transformer l’ébauche en cours en une œuvre<br />
véritable et non plus <strong>des</strong>tinée à lui-même, mais au<br />
public. Le sauvage s’est civilisé. La rêverie se<br />
métamorphose en roman. La transcription <strong>des</strong><br />
chimères devient peinture de la passion.<br />
Il faudra un peu plus de deux ans à Rousseau pour<br />
terminer la rédaction de son livre, et à peu près le<br />
même temps pour épuiser sa liaison orageuse et<br />
inaccomplie avec Sophie d’Houdetot. La piquante<br />
comtesse de trente ans a déjà un amant en titre, le<br />
falot Saint-Lambert, et trouve son vieux soupirant<br />
ennuyeux et encombrant – malgré sa relative<br />
célébrité. Nous négligerons de narrer en détail la<br />
suite de l’aventure, mais nous retiendrons<br />
l’interférence de la vie dans l’œuvre, comme le<br />
reconnaissent Les Confessions : « Je vis ma Julie en<br />
Mme d’Houdetot, et bientôt, je ne vis plus que Mme<br />
d’Houdetot. » Sophie sera Julie, Jean-Jacques,<br />
Saint-Preux, avec quelques années en plus, Wolmar,<br />
le tiers importun, Saint-Lambert. L’hypothèse <strong>du</strong><br />
ménage à trois – deux hommes pour une femme –<br />
est même suggérée dans le roman. Et faute de<br />
célébrer la victoire de la passion, le romancier louera<br />
les mérites de la fidélité conjugale.<br />
Le roman de l’amour<br />
Nous avons ainsi commencé à pénétrer dans<br />
l’œuvre. Voyons ce qu’elle nous raconte<br />
précisément. Elle est centrée autour <strong>du</strong> personnage<br />
de Julie, comme l’indique le titre complet <strong>du</strong> roman,<br />
Julie ou La Nouvelle Héloïse. Julie donc, fille <strong>du</strong><br />
baron d’Étange, vit sur les bords <strong>du</strong> lac Léman, à<br />
Vevey, près de Lausanne. Un jeune précepteur,<br />
Saint-Preux, doit faire son é<strong>du</strong>cation, mais très vite<br />
un sentiment d’amour mutuel rapproche les deux<br />
jeunes gens. Cette situation justifie la seconde partie<br />
<strong>du</strong> titre qui renvoie à l’histoire d’Héloïse et<br />
d’Abélard. Bien que Julie ne devienne pas abbesse et<br />
que Saint-Preux n’ait pas à subir le célèbre et<br />
néanmoins cruel supplice. Comme il se doit, les<br />
conventions sociales interdisent le mariage d’une<br />
jeune aristocrate avec un roturier. Saint-Preux,<br />
après s’être une première fois éloigné pour un séjour<br />
dans le Valais, quitte la Suisse pour Paris, ce qui<br />
nous vaut de longues lettres sur les mœurs<br />
parisiennes. Après bien <strong>des</strong> tourments, Julie, de son<br />
côté, se résigne à épouser, sans amour, le sage M. de<br />
Wolmar, un ami de son père. Le temps passe, deux<br />
enfants naissent chez les Wolmar, tandis que la<br />
dissipation parisienne ne parvient pas à distraire<br />
Saint-Preux. Les anciens amants n’ont rien oublié<br />
<strong>du</strong> passé. Pour conjurer cet amour persistant et
complaire à sa femme, Wolmar invite Saint-Preux<br />
dans la maison familiale de Clarens.<br />
Les retrouvailles entre les deux amants s’avèrent<br />
décevantes : le temps a modifié les consciences, la<br />
vie à Clarens offre l’image <strong>du</strong> bonheur et Julie<br />
semble une épouse et une mère comblée. Saint-<br />
Preux repart pour l’Italie et refuse de se marier. Peu<br />
après, Julie, alitée suite à une bronchite contractée<br />
alors qu’elle a voulu sauver son fils de la noyade,<br />
finit par expirer en faisant promettre à Saint-Preux,<br />
par l’intermédiaire de son mari, de veiller sur ses<br />
enfants.<br />
Pour compléter ce trop rapide résumé, je<br />
souhaiterais m’arrêter à trois caractéristiques.<br />
La première, c’est qu’il s’agit d’un roman long, plus<br />
de huit cents pages dans l’édition de la Pléiade. Il est<br />
soigneusement composé et découpé en six parties.<br />
L’intrigue en est simple, un amour contrarié, et les<br />
tentatives, de la part <strong>des</strong> deux amants, pour trouver<br />
un équilibre à travers les crises. Diverses péripéties,<br />
liées à <strong>des</strong> personnages secondaires comme Claire,<br />
l’amie intime et confidente de Julie, ou Milord<br />
Edouard, le mentor anglais de Saint-Preux,<br />
agrémentent le récit.<br />
Deuxième caractéristique, liée à la précédente, ce<br />
roman s’inscrit dans la <strong>du</strong>rée, courant sur une<br />
période de près de neuf ans. Avec <strong>des</strong> contrastes<br />
dans l’écoulement <strong>du</strong> temps, puisque les trois<br />
premières parties couvrent sept ans, les trois<br />
dernières à peine un an et demi, pour quasiment le<br />
même nombre de pages. Rousseau a soigneusement<br />
travaillé cette question de la <strong>du</strong>rée, qui tantôt se<br />
contracte, tantôt se dilate, tantôt se fond dans le<br />
silence. Le temps qui, au début, est un allié <strong>des</strong><br />
amants placés en situation d’attente, devient un<br />
dangereux protagoniste, creusant la séparation,<br />
accusant les différences, menaçant les cœurs. Le<br />
roman est nourri de l’attente et avance par crises<br />
successives. Avec, au bout de l’attente la perception<br />
<strong>du</strong> changement. Le temps a accompli son travail<br />
<strong>des</strong>tructeur : effacer les souvenirs, modifier les<br />
sentiments, favoriser le reniement.<br />
Troisième caractéristique, la plus importante, il<br />
s’agit d’un roman par lettres. Depuis Montesquieu et<br />
ses Lettres persanes, le genre est à la mode – et le<br />
restera jusqu’à Laclos qui, avec Les Liaisons<br />
dangereuses en 1782, en sera le liquidateur.<br />
Rousseau se reconnaît deux modèles, l’un déjà<br />
ancien, Les Lettres d’une religieuse portugaise,<br />
publiées en 1669 et dont on ne sait pas encore que<br />
l’auteur s’appelle Guilleragues, l’autre, plus récent,<br />
qu’il commente dans sa Lettre à d’Alembert, le<br />
roman de l’anglais Richardson qui porte pour titre<br />
Les Lettres anglaises ou histoire de Miss Clarisse<br />
Harlowe – que l’on abrège souvent en Clarisse<br />
Harlowe.<br />
Notre roman compte 167 lettres qui, pour certaines,<br />
peuvent être très longues, 37 pages par exemple<br />
pour celle qui raconte la mort de Julie (VI, 11). Le<br />
choix de la forme épistolaire permet à l’auteur,<br />
comme il a déjà été dit, de se présenter comme le<br />
simple éditeur de la correspondance, de récuser la<br />
61<br />
fiction en entretenant le mythe de l’authenticité, et<br />
de donner au récit et aux personnages une<br />
impression de plus grande de vraisemblance.<br />
Rousseau a parfaitement su exploiter les ressources<br />
de l’esthétique épistolaire. La lettre, dans l’usage<br />
qu’il en fait, doit répondre à un besoin, à une<br />
urgence. Sa spontanéité exclut le calcul. Le<br />
sentiment s’y offre sans fard. Mais la lettre répond<br />
aussi à une inquiétude, elle doit conjurer l’angoisse<br />
née de l’absence : que fait le correspondant ? Où estil<br />
? Avec qui ? De quoi sont faites ses pensées ?<br />
Quand tout le monde est réuni, comme au cours de<br />
l’hiver 1744, c’est le bonheur et l’on n’éprouve pas le<br />
besoin d’écrire. En revanche la séparation, parce<br />
qu’elle exacerbe le sentiment, appelle la<br />
correspondance. Enfin, d’un point de vue littéraire,<br />
la lettre permet d’expérimenter la polyphonie<br />
stylistique, le romancier devant adopter le ton de ses<br />
divers personnages ; elle autorise aussi toutes les<br />
digressions – comme ce développement assez<br />
gratuit sur l’opéra, que Saint-Preux adresse à Claire<br />
qui souhaite recevoir un éclairage sur le genre<br />
lyrique.<br />
Le premier roman moderne<br />
« La Nouvelle Héloïse est peut-être, suggère Jean-<br />
Louis Lecercle, le premier grand roman moderne,<br />
<strong>du</strong> moins en France 59 ». Moderne, l’ouvrage l’est<br />
d’abord par la simplicité de son sujet, qui rompt<br />
avec les artifices <strong>des</strong> romans traditionnels ; puis par<br />
l’unité <strong>du</strong> ton et de l’intrigue, par la finesse de<br />
l’analyse psychologique, par la sincérité de la leçon<br />
morale et pour quelques autres aspects comme ces<br />
quatre thèmes, parmi les principaux, que je voudrais<br />
développer : la peinture de la nature, l’exaltation de<br />
l’amour, le temps, la sensibilité.<br />
La peinture lyrique de la nature<br />
Le roman n’existerait pas sans son décor, celui <strong>du</strong><br />
lac Léman et <strong>des</strong> montagnes <strong>du</strong> Valais où se déroule<br />
l’essentiel de l’action. Dans sa Préface dialoguée,<br />
Rousseau rappelle son intention d’opposer la vie <strong>des</strong><br />
villes – insupportable, factice, bruyante – à<br />
l’existence rurale, celle que mènent « les habitants<br />
d’une petite ville aux pieds <strong>des</strong> Alpes ». Jean-<br />
Jacques connaît parfaitement les lieux qu’il décrit,<br />
ces charmants villages que sont Vevey, Montreux,<br />
Clarens, Chillon. Le lac de Genève, à ses yeux, est le<br />
plus beau <strong>du</strong> monde. Le personnage qui figure le<br />
double de l’auteur, Saint-Preux, développe sur plus<br />
de dix pages les charmes de la montagne vaudoise<br />
où il est resté trop peu de temps : « A peine ai-je<br />
employé huit jours à parcourir un pays qui<br />
demanderait <strong>des</strong> années d’observation. » (I, 23) Les<br />
paysages, la perspective lui apportent l’équilibre<br />
qu’il recherche, même s’ils favorisent aussi la<br />
mélancolie. Là, les gens sont accueillants, les vaches<br />
sont grasses, le vin généreux. Paris, à l’opposé, sera<br />
une punition : « J’entre avec une secrète horreur,<br />
écrit-il, dans ce vaste désert <strong>du</strong> monde. » (II, 14) La<br />
capitale lui semble être le lieu de la tromperie :<br />
« Jusqu’ici j’ai vu beaucoup de masques ; quand<br />
verrais-je <strong>des</strong> visages d’hommes ? » (Ibid.) Les<br />
59 Lean-Louis Lecercle, Jean-Jacques Rousseau, modernité<br />
d’un classique, Larousse Université, 1973, p. 199.
Parisiennes n’ont rien de la grâce <strong>des</strong> paysannes<br />
helvètes, car elles ont « le maintien soldatesque et le<br />
ton grenadier » (II, 21). Ce qui ne les empêche pas<br />
de cultiver le mensonge et de pratiquer l’a<strong>du</strong>ltère :<br />
« L’amour même, l’amour a per<strong>du</strong> ses droits, et n’est<br />
pas moins dénaturé que le mariage. » (Ibid.)<br />
« Dénaturé », le mot n’est pas choisi au hasard.<br />
Cette longue – et assez conventionnelle – satire de<br />
Paris, de ses mœurs, de ses spectacles, veut signifier<br />
le rejet de la vie mondaine au profit d’une vie<br />
naturelle plus authentique. Julie, après son mariage,<br />
se réfugie dans la nouvelle Arcadie que constitue<br />
Clarens où elle réinvente une société fondée sur le<br />
bonheur, l’entente, la fusion avec la nature. Le lieu<br />
privilégié de ce refuge est le jardin, nommé<br />
symboliquement l’Élysée. On y a délaissé la<br />
régularité <strong>des</strong> jardins français pour préférer un<br />
joyeux désordre « à l’anglaise » où la nature<br />
s’exprime librement, dans une semi sauvagerie<br />
calculée : « Julie, le bout <strong>du</strong> monde est à votre<br />
porte » s’écrit Saint-Preux », et la jeune femme<br />
répond : « Il est vrai […] que la nature a tout fait<br />
mais sous ma direction, et il n’y a rien que je n’aie<br />
ordonné. » (IV, 11) Rousseau nous rappelle, comme<br />
il le fait ailleurs, que l’homme civilisé est condamné<br />
à repro<strong>du</strong>ire la nature, puisqu’il ne peut la<br />
ressusciter dans son état primitif. Même la mort de<br />
Julie sera provoquée par un élan naturel, « le<br />
premier mouvement de la Nature », l’instinct<br />
maternel, qui la pousse à sauver son fils de la<br />
noyade. Au-delà de la peinture bucolique que<br />
propose le roman, se devine le souci d’une relation<br />
harmonieuse et respectueuse de l’environnement<br />
dont notre époque redécouvre les vertus.<br />
L’exaltation de l’amour<br />
L’autre dimension essentielle <strong>du</strong> livre,<br />
complémentaire de la précédente, est l’exaltation <strong>du</strong><br />
sentiment amoureux. L’amour donne à l’homme<br />
courage, ferveur, force, le rapproche de la<br />
perfection. Rousseau, qui dénigre les romans mais<br />
en a beaucoup lus, défend une conception<br />
pétrarquisante de l’amour. Il s’agit d’une passion<br />
saine, car elle est l’expression intense de la vie.<br />
Grâce à l’amour, déclare Saint-Preux, « je trouve la<br />
campagne plus riante, la ver<strong>du</strong>re plus fraîche et plus<br />
vive, l’air plus pur, le ciel plus serein. » (I, 38).<br />
L’amour est parfois créateur de désordre, l’histoire<br />
<strong>des</strong> deux amants le prouve, mais il est aussi porteur<br />
de valeurs, il élève l’homme, le rapproche de la<br />
vertu.<br />
Au fil <strong>des</strong> pages, les multiples variations <strong>du</strong><br />
sentiment amoureux nous sont offertes : sa<br />
naissance sous la forme <strong>du</strong> coup de foudre « Mon<br />
cœur fut tout à vous dès la première vue. » (III. 18)<br />
L’accord <strong>des</strong> âmes : « Le véritable amour ne peut se<br />
passer <strong>du</strong> cœur et <strong>du</strong>re autant que les rapports qui<br />
l’ont fait naître » (Ibid.). Et puis la jalousie, les<br />
menues querelles, les douleurs de la séparation,<br />
de l’absence, comme l’illustre une grande partie <strong>du</strong><br />
roman. Mais l’amour véritable survit aux épreuves ;<br />
il ne s’épuise pas non plus dans la sensualité ; il est<br />
même sublimé par la distance ainsi que le vérifient<br />
douloureusement les amants. C’est en étant séparés<br />
qu’ils atteignent l’idéal <strong>du</strong> sentiment. Le mariage<br />
n’eût abouti qu’à sa dégradation, comme l’eût fait<br />
62<br />
l’a<strong>du</strong>ltère, frôlé au moment <strong>des</strong> retrouvailles que<br />
Wolmar provoque pour guérir les amants. La<br />
conclusion est qu’il n’est d’amour vrai que<br />
malheureux car il est le seul qui résiste au temps<br />
<strong>des</strong>tructeur.<br />
Le temps<br />
Ce rapport au temps est une <strong>des</strong> marques de cette<br />
modernité déjà signalée. La vie est changeante,<br />
fuyante, le bonheur auquel rêve l’homme ne peut<br />
être fixé, il se limite à une succession d’instants<br />
privilégiés. Les êtres se transforment, le moi est<br />
fluctuant « Je suis si loin de ce que j’étais » se<br />
lamente Julie (IV, 1). Constat que partagera son<br />
amant : « Je connus qu’elle ou moi-même n’étions<br />
plus les mêmes » (IV, 6). L’idylle rustique voulue<br />
par Rousseau débouche sur un échec et sur la mort,<br />
ultime victoire <strong>du</strong> temps. La mort qui à la fois<br />
détruit toute chose et intro<strong>du</strong>it à l’éternité, et dont il<br />
est longuement question dans le roman. « Ô<br />
mourons ma douce amie » propose Saint-Preux au<br />
lendemain de la nuit d’amour. Et l’« horrible<br />
tentation », celle <strong>du</strong> suicide, réapparaît au moment<br />
de la promenade sur le lac. Exilé à Paris, le jeune<br />
précepteur a déjà pensé à se supprimer, avant de<br />
proposer plus prudemment une dissertation sur la<br />
question. L’épilogue est donc écrit d’avance : Julie<br />
sera arrachée à la vie. Même Clarens est voué à la<br />
<strong>des</strong>truction, comme l’explique M. de Wolmar dans<br />
la très longue lettre 11 de la sixième partie. La seule<br />
chose qui marque la permanence est le souvenir, tel<br />
qu’il se manifeste dans les nombreuses évocations<br />
nostalgiques <strong>du</strong> passé, le pèlerinage aux<br />
« monuments <strong>des</strong> anciennes amours », le jeu <strong>des</strong><br />
réminiscences qui prépare Proust.<br />
Une autre caractéristique <strong>du</strong> roman en même temps<br />
qu’un autre trait de modernité est la place faite à la<br />
sensibilité, c’est-à-dire à tout ce qui est l’occasion de<br />
douleur ou de plaisir, moral ou physique. Tous les<br />
personnages sont <strong>des</strong> âmes sensibles, jusqu’au froid<br />
Wolmar. La sensibilité ne se confond pas avec le<br />
sentiment, ni avec l’amour, ni avec la passion, ni<br />
avec le bonheur – même si ces divers éléments la<br />
nourrissent. Pour Rousseau, la sensibilité est perçue<br />
comme un principe fondamental de la vie. « Il n’y a<br />
que <strong>des</strong> âmes de feu qui savent combattre et<br />
vaincre » (IV, 12) Une vie d’où le plaisir n’est pas<br />
absent, à condition qu’il soit sans excès et conforme<br />
aux désirs. Julie est sensuelle, gourmande, frivole<br />
parfois ; elle aime la danse, les promena<strong>des</strong> en<br />
bateau. Mais elle ne s’abandonne pas à un<br />
hédonisme passif, car la vertu encadre ses élans ;<br />
l’amour-propre, au sens classique <strong>du</strong> terme, c’est-àdire<br />
l’amour de soi, (nous dirions « maîtrise de soi »<br />
ou encore « dignité »), doit contrôler les dérapages<br />
de la vie affective. Il est important, dit le texte de<br />
« se plaire avec soi-même » (IV, 3). Certes, les<br />
dangers de la sensibilité sont réels – et Rousseau<br />
lui-même a pu les expérimenter – : la versatilité,<br />
l’inconstance, la tentation, la violence <strong>des</strong> réactions,<br />
l’agitation, les larmes, l’effusion verbale... Mais la<br />
sensibilité reste malgré tout indispensable à la vie<br />
car elle donne une coloration neuve au monde et elle<br />
procure le sentiment d’exister. Au moment de son<br />
agonie, Julie mesure la force de l’émotion qui<br />
l’entoure : « On m’a fait boire jusqu’au bout la coupe<br />
amère et douce de la sensibilité. » (VI, 11) Notre
société contemporaine, volontiers indivi<strong>du</strong>aliste,<br />
voire narcissique, centrée sur la recherche <strong>des</strong><br />
plaisirs personnels et sur le culte <strong>du</strong> moi (qui<br />
envahit jusqu’à la littérature) semble avoir retenu le<br />
message.<br />
Il n’est pas bien sûr que cette présentation<br />
sommaire, qui laisse de côté bien <strong>des</strong> aspects <strong>du</strong><br />
livre, suffise à redonner au public l’envie de le lire ou<br />
de le relire, de le trouver au goût <strong>du</strong> jour, même si<br />
elle signale certains traits de modernité. Réhabiliter<br />
La Nouvelle Héloïse relève un peu, j’en ai<br />
conscience, de la défense <strong>des</strong> causes per<strong>du</strong>es. Il faut,<br />
pour apprécier le roman, accepter les conventions<br />
<strong>du</strong> romanesque, être sensible au lyrisme de l’amour,<br />
cette parole alanguie qui fait que la lettre « d’un<br />
amant vraiment passionné sera, comme l’écrit<br />
Rousseau dans sa Préface dialoguée, lâche, diffuse,<br />
toute en longueurs, en désordre, en répétitions »<br />
pleine « d’un sentiment qui déborde, redit toujours<br />
la même chose, et n’a jamais achevé de dire. »<br />
Épanchement et prolixité difficilement compatibles<br />
avec le laconisme <strong>des</strong> textos d’aujourd’hui.<br />
63<br />
Peut-être un argument, assez inatten<strong>du</strong>, pourrait-il<br />
placer à nouveau la Julie parmi les best-sellers<br />
littéraires.<br />
C’est encore Jean-Jacques qui nous le suggère<br />
quand, dans la même Préface, il exprime ce souhait :<br />
« J’aime à me figurer deux époux lisant ce recueil<br />
ensemble, y puisant un nouveau courage pour<br />
supporter leurs travaux communs. »<br />
Lire La Nouvelle Héloïse pourrait donc avoir pour<br />
vertu secrète, en rendant plus soli<strong>des</strong> et plus<br />
<strong>du</strong>rables les liens <strong>du</strong> mariage, d’enrayer la vague<br />
actuelle de divorce. Mais outre que les effets de cette<br />
thérapeutique ne sont pas garantis, il serait injuste<br />
de terminer ce parcours sur un raisonnement qui<br />
néglige les vraies raisons de lire ce livre, celles que<br />
formule un spécialiste reconnu, Jean-Louis<br />
Lecercle à qui je laisse le dernier mot : « C’est bien le<br />
plus grand roman <strong>du</strong> siècle, et l’un de nos maîtres<br />
livres 60 . »<br />
60 Jean-Louis Lecercle, Rousseau et l’art <strong>du</strong> roman, Slatkine<br />
Reprints, Genève 1979, p. 308.
Commençons par élucider le caractère paradoxal <strong>du</strong><br />
titre que j’ai choisi de donner à mon exposé. Quel<br />
sens y a-t-il à parler d’ « invention » à propos d’un<br />
régime politique né à Rome plus de deux millénaires<br />
avant le siècle <strong>des</strong> Lumières ? L’étrangeté de la<br />
notion d’invention se creuse encore davantage si l’on<br />
a en mémoire le véritable dithyrambe que l’auteur<br />
<strong>du</strong> Discours sur l’origine et les fondements de<br />
l’inégalité parmi les hommes dresse à la République<br />
helvétique, dans le préambule de l’écrit de 1755 qui a<br />
précisément pour titre « À la République de<br />
Genève » 1 . Quant au Contrat Social, publié sept ans<br />
plus tard en 1762, il inscrit sur la couverture même<br />
de l’ouvrage une référence à la République de<br />
Genève, le nom de l’auteur étant suivi dans l’édition<br />
originale de la mention « citoyen de Genève ». Les<br />
deux grands textes politiques de Rousseau renvoient<br />
donc, l’un comme l’autre, à la République helvétique<br />
dont Rousseau se vante d’être le citoyen : parler<br />
d’ « invention » serait donc aberrant.<br />
Mais faut-il négliger le fait que l’auteur <strong>du</strong> second<br />
Discours décide, dès les premières pages de sa<br />
recherche, de faire table rase de tous les éléments<br />
empiriques qui auraient pu le guider dans son<br />
investigation : « Commençons donc par écarter tous<br />
les faits, car ils ne touchent point à la question » 2 ,<br />
phrase que l’auteur aurait pu reprendre telle quelle<br />
dans le Contrat Social, où elle aurait été plus<br />
légitime encore. Une autre formule se substitue à<br />
elle, la première <strong>du</strong> chapitre 1 de l’ouvrage, qui<br />
semble remplir une fonction équivalente :<br />
« L’homme est né libre, et partout il est dans les<br />
fers » 3 . Avec l’adverbe « partout », l’auteur s’interdit<br />
d’emblée de se référer à tout système politique<br />
existant ou ayant existé. Je suis conscient de ne pas<br />
vous faciliter la tâche en citant dès l’intro<strong>du</strong>ction de<br />
mon exposé deux <strong>des</strong> phrases de Rousseau qui ont<br />
suscité les commentaires les plus nombreux et les<br />
plus contradictoires. Mais sans m’engager dans les<br />
polémiques qu’elles ont entraînées, je ne veux<br />
retenir ici que l’idée suivante : qu’il s’agisse d’une<br />
société égalitaire idéale, telle que le second Discours<br />
l’envisage en partant en quête <strong>des</strong> raisons qui nous<br />
en fait nous en éloigner, ou de cette liberté per<strong>du</strong>e<br />
qu’aucun régime n’a jamais su nous procurer dans<br />
toute l’histoire <strong>des</strong> hommes d’après le Contrat<br />
Social, les deux grands textes politiques<br />
rousseauistes l’affirment avec une particulière<br />
vigueur : la République n’existe pas, la République<br />
n’a jamais existé, la République n’existera<br />
probablement jamais.<br />
Voir en Rousseau l’ « inventeur de la République »,<br />
ce n’est donc nullement jouer avec les paradoxes,<br />
c’est se donner les moyens de cerner dans sa grande<br />
ROUSSEAU INVENTEUR DE originalité LA RÉPUBLIQUE<br />
la philosophie politique de Jean-Jacques.<br />
Philippe GRANAROLO<br />
65<br />
La République : un trésor enfoui dans<br />
l’esprit <strong>des</strong> hommes<br />
Avant Rousseau, c’est le Maître qui n’a cessé sé<strong>du</strong>ire<br />
les philosophes, de les fasciner au point que bon<br />
nombre d’entre eux n’ont pas hésité à devenir leurs<br />
« bouffons ». Platon et Denys de Syracuse, Aristote<br />
et Alexandre, Sénèque et Néron, Machiavel et<br />
Laurent de Médicis, Descartes et Christine de Suède,<br />
Voltaire et Catherine II : interminable est la liste de<br />
ces relations ambiguës que nos grands philosophes<br />
ont entretenu avec les hommes et les femmes de<br />
pouvoir. Une seule exception à la règle : Etienne de<br />
la Boétie qui, dans son génial Discours de la<br />
servitude volontaire (1549) 4 , inverse la perspective<br />
en interrogeant le dominé, ouvrant la voie à<br />
Rousseau qui ne cessera d’éprouver pour La Boétie<br />
une véritable vénération.<br />
De même que La Boétie recherchait le secret <strong>du</strong><br />
pouvoir <strong>du</strong> côté <strong>du</strong> faible, et non plus <strong>du</strong> fort,<br />
Rousseau, dès le troisième chapitre <strong>du</strong> livre I <strong>du</strong><br />
Contrat Social intitulé « Du droit <strong>du</strong> plus fort » (l’un<br />
<strong>des</strong> chapitres les plus décisifs de l’ouvrage), se livre à<br />
une sorte de psychanalyse <strong>du</strong> dominé. « Le plus fort<br />
n’est jamais assez fort pour être toujours le maître<br />
s’il ne transforme la force en droit et l’obéissance en<br />
devoir » 5 . Il n’y a que chez les bêtes que les rapports<br />
de force gèrent les relations entre les êtres. Chez les<br />
hommes, animaux dotés de conscience, les relations<br />
avec autrui sont toujours de l’ordre de la<br />
représentation, et il ne saurait exister entre eux de<br />
rapports de force au sens strict <strong>du</strong> terme. Les forts le<br />
savent, qui ne se contentent jamais de démontrer<br />
leur puissance. Si la manifestation de celle-ci<br />
suffisait, les forts se dispenseraient d’orner l’étalage<br />
de leur force d’un discours de légitimation. Aucun<br />
dominant n’a jamais tenu <strong>des</strong> propos qui soient le<br />
simple écho de sa puissance, <strong>du</strong> type : « Obéissezmoi,<br />
parce que je suis le plus fort ». La force <strong>des</strong><br />
forts tient à ce qu’ils connaissent, comme tous leurs<br />
semblables, la force <strong>du</strong> droit, elle tient à ce qu’ils<br />
savent, ainsi que l’a magistralement résumé Paul<br />
Valéry, que « la faiblesse de la force est de ne croire<br />
qu’à la force ». La force est ponctuelle, elle est<br />
relative, un fort tombant un jour ou l’autre sur un<br />
plus fort que lui. Rien de <strong>du</strong>rable ne peut s’établir<br />
sur la force. Or le propre de tous les systèmes<br />
politiques est d’organiser <strong>des</strong> relations stables entre<br />
les indivi<strong>du</strong>s, de hiérarchiser <strong>du</strong>rablement les<br />
hommes au sein <strong>du</strong> groupe, ce que la force seule est<br />
incapable de faire. Aucun chemin ne mène donc de<br />
la force au droit, une dichotomie radicale et<br />
définitive les sépare.
Reste la question délicate de savoir pourquoi le<br />
discours frau<strong>du</strong>leux <strong>du</strong> fort, qui réussit à faire<br />
passer la force pour le droit, parvient à tromper si<br />
aisément le faible. Il n’est guère que deux réponses<br />
possibles à cette énigme. La première supposerait<br />
que les forts ne sont pas seulement ceux qui<br />
disposent de la puissance, mais bien ceux qui ont la<br />
meilleure représentation de la justice : en<br />
travestissant habilement la force en droit, ils<br />
utilisent la connaissance supérieure qu’ils ont de la<br />
justice et peuvent ainsi berner les faibles dont les<br />
représentations floues ne leur permettent pas de<br />
déjouer la supercherie. Mais s’il en était ainsi, ne<br />
serions-nous pas tout près d’admettre la légitimité<br />
de la domination <strong>des</strong> forts ? Non seulement plus<br />
puissants, mais plus habiles, plus intelligents, plus<br />
proches <strong>du</strong> monde intelligible de Platon et de l’idée<br />
<strong>du</strong> Juste qui y règne, les forts, toute morale mise à<br />
part, ne mériteraient-ils pas de dominer les faibles ?<br />
Une seconde réponse peut seule nous permettre de<br />
sortir de cette impasse. Le droit, la justice, l’idée de<br />
la légitimité, sont <strong>des</strong> forces plus puissantes que la<br />
puissance physique. De ce fait la hiérarchie entre le<br />
fort et le faible s’inverse. C’est parce qu’il a une idée<br />
plus adéquate de la justice que le faible est trompé.<br />
Plus sensible que le fort à la force <strong>du</strong> droit, plus<br />
proche de l’idée platonicienne <strong>du</strong> Juste que le fort, le<br />
faible a au plus profond de lui-même un sens <strong>du</strong><br />
devoir très supérieur à celui <strong>du</strong> fort. Tandis que le<br />
fort n’a recours à l’idée de légitimité que par<br />
stratégie, que parce qu’il a compris que seul ce<br />
travestissement pouvait lui assurer une domination<br />
<strong>du</strong>rable, le faible, lui, croit profondément au droit.<br />
C’est la puissance de sa croyance qui explique la<br />
facilité qu’il y a à le berner.<br />
Du même coup, le constat tragique <strong>du</strong> début <strong>du</strong> livre<br />
se mue en message d’espoir. Si l’homme est<br />
« partout dans les fers », ce n’est pas parce que<br />
d’éternelles hiérarchies distinguent les forts et les<br />
faibles au sein de notre espèce. Rousseau croit à<br />
l’inverse à une grande proximité entre tous les<br />
humains. S’il n’avait voulu s’opposer<br />
systématiquement aux thèses de Thomas Hobbes, il<br />
aurait pu emprunter au grand philosophe anglais la<br />
superbe démonstration de l’égalité que celui-ci avait<br />
forgée. Pour l’auteur <strong>du</strong> De Cive et <strong>du</strong> Léviathan, les<br />
hommes sont égaux parce que le plus faible peut<br />
tuer le plus fort 6 . En s’opposant à Hobbes, Rousseau<br />
s’est compliqué la tâche, et ses propos sur l’égalité<br />
sont infiniment plus tortueux que ceux de son<br />
devancier anglais. Mais il demeure proche de son<br />
adversaire en admettant comme lui que les rapports<br />
de force n’ont jamais pu régler les relations entre les<br />
humains. Empruntant le chemin ouvert pat La<br />
Boétie, Rousseau montre que la servitude ne<br />
s’explique que parce qu’il existe dans la conscience<br />
<strong>des</strong> hommes une idée <strong>du</strong> droit qui résiste à toutes les<br />
avanies de l’histoire. La servitude n’existe que parce<br />
que la force <strong>du</strong> droit est un <strong>des</strong> moteurs les plus<br />
puissants et les plus constants de l’action humaine.<br />
Rousseau invente donc une première fois la<br />
République en extirpant l’idée <strong>du</strong> juste de la tête <strong>des</strong><br />
hommes. Proche de Platon, il s’en éloigne cependant<br />
par la méthode suivie. Le philosophe grec supposait<br />
un accès de l’âme au monde intelligible et aux idées<br />
qui y séjournent. Les Modernes sont devenus plus<br />
sceptiques, et entre Platon et Rousseau, Descartes a<br />
66<br />
découvert la subjectivité qui nous constitue. C’est en<br />
Moderne que Rousseau part en quête de l’idée de<br />
République. C’est en psychologue, voire en<br />
psychanalyste, qu’il explore le subconscient<br />
politique de ses congénères. Qu’elle soit ou non<br />
inscrite dans une éternité platonicienne (les<br />
spécialistes n’en finiront sans doute jamais de<br />
s’affronter à propos <strong>du</strong> platonisme de Jean-<br />
Jacques), l’idée de République, que nous allons<br />
maintenant décrypter dans notre seconde partie, est<br />
inscrite dans notre psychè. Avec une grande<br />
subtilité, Rousseau parvient à repérer dans les<br />
systèmes de servitude qui jalonnent notre histoire<br />
l’indice même de sa présence.<br />
La République : un rêve rousseauiste<br />
Contemporaine<br />
ou presque de la République<br />
romaine, la démocratie est inventée par les Grecs au<br />
quatrième siècle avant notre ère. Nous attendrons la<br />
troisième et dernière partie de notre propos pour<br />
éclairer ce qui distingue république et démocratie.<br />
Mais nous devons dès à présent mettre l’accent sur<br />
le point commun qui les réunit. Avec la démocratie<br />
athénienne comme avec la République romaine sont<br />
apparus sur la planète <strong>des</strong> régimes en rupture avec<br />
tout ce que les hommes avaient mis en place depuis<br />
<strong>des</strong> temps immémoriaux. Toutes les sociétés<br />
reposaient sur <strong>des</strong> hiérarchies incontestées, qui<br />
supposaient une naturalité de la domination de<br />
certains sur d’autres, naturalité inscrite dans un<br />
paradigme religieux. Une caste voulue par les dieux<br />
était chargée par eux de gérer les affaires <strong>des</strong><br />
hommes, et nul n’aurait jamais songé à s’opposer à<br />
la volonté divine.<br />
À Rome, et plus nettement encore à Athènes, pour la<br />
première fois dans l’histoire, les hommes rompent<br />
avec cette idéologie naturaliste. Le cœur de la<br />
démocratie athénienne est l’ « isonomie »,<br />
autrement dit l’égalité <strong>des</strong> citoyens devant la loi,<br />
sans aucune distinction de rang ou de naissance.<br />
Avec l’abolition <strong>des</strong> hiérarchies « naturelles » vient<br />
la fin <strong>des</strong> certitu<strong>des</strong>, et l’humanité entre alors dans<br />
une période de turbulence dont nous ne sommes<br />
toujours pas sortis. Nul ne l’a mieux formulé que le<br />
grand politologue récemment disparu Claude<br />
Lefort : « La démocratie s'institue et se maintient<br />
dans la dissolution <strong>des</strong> repères de la certitude. Elle<br />
inaugure une histoire dans laquelle les hommes font<br />
l'épreuve d'une indétermination dernière, quant au<br />
fondement <strong>du</strong> Pouvoir, de la Loi et <strong>du</strong> Savoir ... ». 7<br />
Mais qu’il s’agisse de la démocratie athénienne ou<br />
de la République romaine, dans tous les systèmes<br />
politiques antiques une sorte de compromis atténue<br />
l’indétermination dont parle Claude Lefort, et<br />
retarde cette « dissolution » dont il appartient à la<br />
modernité de faire l’épreuve. En effet, il peut<br />
sembler d’une extrême banalité de le rappeler, mais<br />
l’oublier serait catastrophique, la démocratie<br />
athénienne ou la République romaine demeuraient<br />
<strong>des</strong> régimes aristocratiques, dans lesquelles une très<br />
petite minorité de citoyens égaux en droit<br />
dominaient une masse de non-citoyens, parmi<br />
lesquels une majorité d’esclaves. Quand Rousseau<br />
déplore que seul un petit groupe d’hommes peut<br />
vivre selon les principes <strong>du</strong> contrat social, ne tient-il<br />
pas, peut-être inconsciemment, un double
discours ? Selon le premier, il est infiniment plus<br />
aisé à une société quantitativement limitée, telle la<br />
République de Genève, de fonctionner suivant un<br />
schéma proche de la République idéale, tandis que<br />
les groupes plus nombreux rencontrent <strong>des</strong><br />
difficultés insurmontables en ce domaine. Mais<br />
selon le second, n’est-on pas fondé à éprouver une<br />
nostalgie (nostalgie bien enten<strong>du</strong> refoulée par<br />
l’auteur <strong>du</strong> Contrat Social) à l’égard de ces sociétés<br />
antiques dont les citoyens, ultra-minoritaires,<br />
pouvaient se lier les uns aux autres suivant les<br />
normes républicaines parce que la masse, asservie<br />
aux tâches nécessaires à la survie <strong>du</strong> groupe, vivait<br />
hors société ?<br />
Autrement dit, le Contrat Social n’est-il pas miné,<br />
dans la logique de son développement, par le refus<br />
rousseauiste d’interroger philosophiquement la<br />
notion d’égalité ? On nous objectera qu’il n’avait pas<br />
à développer cette interrogation, puisqu’il lui avait<br />
consacré l’intégralité <strong>du</strong> Discours sur l’origine et les<br />
fondements de l’inégalité parmi les hommes. Mais<br />
cette objection peut-elle nous convaincre ? J’ai la<br />
certitude, même s’il m’est impossible de l’étayer<br />
dans le cadre de ce bref exposé, que le second<br />
Discours n’interroge pas davantage les défis de<br />
l’égalité que ne le fait le Contrat Social. Si Rousseau,<br />
prétendant écarter tous les faits, multiplie les<br />
références à l’Antiquité gréco-romaine, aussi bien<br />
dans le premier ouvrage que dans le second, n’est-ce<br />
pas pour dérober à notre regard l’abîme qui sépare<br />
l’Antiquité <strong>des</strong> Temps Modernes ? N’est-ce pas pour<br />
s’épargner le supplice de se lancer dans une<br />
recherche dont dépend pour une part l’avenir de nos<br />
sociétés, recherche répondant à cette interrogation :<br />
les merveilleux principes de la démocratie<br />
athénienne, les règles admirables de la République<br />
romaine, sont-ils transposables à <strong>des</strong> sociétés qui<br />
ont éten<strong>du</strong> à tous les prérogatives que le monde<br />
antique réservait au petit nombre ?<br />
Rousseau a sans doute magnifiquement formulé le<br />
principe <strong>du</strong> contrat social : « Trouver une forme<br />
d'association qui défende et protège de toute la force<br />
commune la personne et les biens de chaque<br />
associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous<br />
n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre<br />
qu'auparavant » 8 . Mais il a oublié de se demander<br />
pourquoi les Républiques antiques avaient pu<br />
mettre en place <strong>des</strong> régimes approchant cet idéal,<br />
tandis que la Modernité en semble incapable. La<br />
République rousseauiste n’a pas besoin seulement<br />
d’une égalité de droit, elle a besoin d’une égalité <strong>des</strong><br />
capacités intellectuelles et <strong>des</strong> compétences<br />
politiques de ses citoyens. Pour être autre chose<br />
qu’un simple idéal, le contrat social doit laisser<br />
s’exprimer la volonté générale, qui « est toujours<br />
droite et tend toujours à l'utilité publique » 9 . Certes<br />
Rousseau multiplie les conditions nécessaires,<br />
extrêmement complexes à réunir, pour que cette<br />
expression puisse émerger (existence d’un vrai<br />
débat, absence de communication entre les citoyens<br />
qui doivent s’exprimer en tant qu’indivi<strong>du</strong>scitoyens,<br />
et non en tant que parties <strong>du</strong> tout, absence<br />
d’ « associations partielles » entre citoyens, etc. 10 ).<br />
Mais il pose comme un dogme intangible et qui ne<br />
mérite pas d’être soumis à l’analyse le fait que les<br />
citoyens sont égaux, encore une fois égaux non pas<br />
67<br />
seulement en droit, égalité qui relève seulement<br />
d’un choix arbitraire, d’un postulat politique, mais<br />
égaux en fait. Et s’il existe, nul ne saurait le nier, <strong>des</strong><br />
inégalités constatables dans les sociétés historiques,<br />
elles sont d’une part bien moindres que ce que l’on<br />
croit, et d’autre part elles ne sont rien d’autre que les<br />
pro<strong>du</strong>its de hiérarchies sociales créées de toute pièce<br />
et donc aisément éliminables.<br />
Rousseau invente donc une seconde fois la<br />
République en imaginant possible l’extension à la<br />
totalité <strong>des</strong> membres <strong>du</strong> groupe <strong>des</strong> principes que<br />
les sociétés antiques avaient réservés au petit<br />
nombre <strong>des</strong> citoyens Cette extension est légitimée<br />
par le fait que les hommes sont égaux en intelligence<br />
et en capacité politiques, leurs différences<br />
apparentes n’étant que l’effet superficiel et<br />
éliminable <strong>des</strong> scandaleuses hiérarchies mises en<br />
place par les sociétés historiques.<br />
La République : un délire rousseauiste ?<br />
L’impossibilité de la République se lit dans le<br />
mouvement même <strong>du</strong> Contrat Social. Sitôt qu'il<br />
abandonne les définitions théoriques pour revenir à<br />
la question qui était celle <strong>du</strong> Discours, à savoir<br />
quand et comment un authentique contrat doit être<br />
effectivement établi entre les hommes, Rousseau ne<br />
peut qu'accumuler les paradoxes, les apories, voire<br />
les antinomies. Un véritable abîme sépare les<br />
admirables constructions théoriques <strong>des</strong> deux<br />
premiers livres <strong>du</strong> Contrat <strong>des</strong> réflexions beaucoup<br />
plus concrètes <strong>des</strong> deux livres suivants. Plus<br />
précisément, le livre II sert de transition entre la<br />
théorisation de l’idée républicaine <strong>du</strong> livre I, et les<br />
considérations nettement plus pratiques <strong>des</strong> livres<br />
III et IV. Pour établir effectivement la Constitution<br />
qui permettra à l'idée de contrat de s'incarner dans<br />
la réalité politique, un législateur surhumain, et<br />
pour ainsi dire divin, paraît nécessaire, affirme<br />
l’auteur au livre II <strong>du</strong> Contrat : « II faudrait <strong>des</strong><br />
dieux pour donner <strong>des</strong> lois aux hommes » 11 .<br />
Quant au Livre III, qui procède à l'analyse <strong>des</strong><br />
différents systèmes politiques, il constate<br />
amèrement que le régime démocratique, le seul qui<br />
serait en parfaite adéquation avec les définitions<br />
théoriques données précédemment, ne convient<br />
qu'à de minuscules États, et qu'en définitive il est<br />
bien trop parfait pour convenir à <strong>des</strong> hommes. La<br />
vraie République est la démocratie, or la démocratie<br />
est impossible. « À prendre le terme dans la rigueur<br />
de l'acception, il n'a jamais existé de véritable<br />
démocratie, et il n'en existera jamais […] S'il y avait<br />
un peuple de Dieux, il se gouvernerait<br />
démocratiquement. Un Gouvernement si parfait ne<br />
convient pas à <strong>des</strong> hommes. » 12 .<br />
Peut-on alors, comme nombre de politologues l’ont<br />
proposé, distinguer la République et la démocratie,<br />
renonçant à une partie <strong>du</strong> dogme égalitaire en<br />
acceptant la règle d’un « élitisme républicain » qui<br />
rétablirait une justice minimale faute de pouvoir<br />
mettre en place l’impossible démocratie ? D’un<br />
élitisme républicain qui créerait de nouvelles<br />
hiérarchies, en substituant aux privilèges liés à la<br />
naissance <strong>des</strong> sociétés aristocratiques les hiérarchies<br />
naturelles repérées par un régime politique<br />
équitable. Mais contrairement aux révolutionnaires
de 1789, Rousseau a le mérite de prendre en compte<br />
les réalités qui résultent de l’histoire inégalitaire <strong>des</strong><br />
hommes. Construire la République avec les hommes<br />
qu’a engendrés une histoire inégalitaire est tout à<br />
fait impossible. Le simple énoncé <strong>des</strong> conditions<br />
nécessaires à l’instauration de la République suffit à<br />
en démontrer le caractère utopique : exigence d’un<br />
« État très petit où le peuple soit facile à<br />
rassembler », nécessité d’une population vivant<br />
dans « une grande simplicité de mœurs », existence<br />
de « beaucoup d'égalité dans les rangs et dans les<br />
fortunes », ascétisme généralisé au sein d’une<br />
société ne connaissant que « peu ou point de<br />
luxe » 13 , etc.<br />
Mais le rêve est si beau que Rousseau, tout en<br />
multipliant les remarques négatives, va rendre ce<br />
rêve éminemment attractif à tous ceux qui se<br />
réclameront de lui. Puisque les hommes engendrés<br />
par l’histoire réelle sont trop différenciés pour entrer<br />
dans le moule <strong>du</strong> contrat républicain, il ne reste<br />
guère qu’une voie pour établir un régime juste : faire<br />
table rase de tout ce qu’a pro<strong>du</strong>it l’histoire. Il s’agit<br />
donc de se donner tous les moyens nécessaires pour<br />
annihiler le vieil homme et pro<strong>du</strong>ire un homme<br />
nouveau. Construire un homme nouveau, ce sera le<br />
fantasme de tous les régimes fascistes <strong>du</strong> XX e<br />
siècle 14 . Rousseau, qui continue à passer aux yeux<br />
<strong>des</strong> ignorants comme un préromantique exalté et<br />
confus, comme le chantre <strong>des</strong> passions et le<br />
dénonciateur de la raison, a incontestablement<br />
construit avec le Contrat Social l'une <strong>des</strong> théories<br />
politiques les plus rigoureuses de tous les temps. Et<br />
c'est précisément cette rigueur qui, à deux siècles de<br />
distance, nous inquiète et nous fait même un peu «<br />
froid dans le dos ». Car c'est bien au nom de la<br />
Raison que la Terreur a imposé, trente ans à peine<br />
après la parution <strong>du</strong> Contrat Social, sa barbarie<br />
sanguinaire, c'est au nom de la Raison que<br />
Robespierre écrira: « La Terreur n'est autre chose<br />
que la justice prompte, sévère, inflexible; elle est<br />
donc une émanation de la vertu ». Monstrueuse<br />
idéologie dont n'auront plus qu'à s'inspirer les<br />
<strong>des</strong>potes <strong>du</strong> XIX e et <strong>du</strong> XX e siècle : c’est au nom <strong>du</strong><br />
peuple et de son infaillibilité que seront érigées les<br />
plus terribles dictatures de l'histoire, au nom de<br />
l’infaillibilité de la volonté générale que seront mis<br />
en place les camps et les goulags.<br />
Rousseau invente ainsi une troisième fois la<br />
République en bâtissant l’utopie d’un système<br />
draconien égalisant par la force les citoyens<br />
hiérarchisés par le mouvement de l’histoire en leur<br />
68<br />
imposant l’inflexibilité d’une loi ne laissant face à<br />
elle que <strong>des</strong> indivi<strong>du</strong>s tragiquement démunis.<br />
Conclusion<br />
Faut-il rendre Rousseau responsable <strong>des</strong> abus<br />
idéologiques auxquels il a ouvert la voie,<br />
responsable de nos modernes sophistes qui se sont<br />
emparés de ses créations, ou tout au moins de son<br />
vocabulaire, pour camoufler sous une géniale «<br />
langue de bois » leurs entreprises <strong>des</strong>potiques?<br />
Faut-il ranger Rousseau parmi les « Maitres<br />
Penseurs » que le philosophe André Glucksmann<br />
(dans un ouvrage portant ce titre) 5 accusait d'être à<br />
l'origine de nos dérives barbares? Question délicate,<br />
et en partie insoluble. Car une lecture attentive,<br />
prenant en compte à la fois le Discours et le<br />
Contrat Social, est amenée à reconnaitre que<br />
Rousseau, sitôt qu'il abandonne l'analyse<br />
purement théorique et les définitions<br />
conceptuelles, se montre toujours d'une extrême<br />
prudence, et peut-être même, d'un scepticisme<br />
quasiment pascalien (nous avons rappelé ce qu'il dit<br />
<strong>du</strong> législateur et de la démocratie). C'est donc<br />
uniquement au niveau théorique que l'on pourrait le<br />
soupçonner : le seul reproche qu'il pourrait mériter<br />
serait d'avoir mis à jour les fondements de l'idée<br />
républicaine. Mais un tel reproche devrait alors<br />
dénoncer l’idée républicaine elle-même comme une<br />
idée pernicieuse qui serait à l'origine <strong>des</strong><br />
déchaînements barbares <strong>des</strong> deux derniers siècles.<br />
Les critiques démocrates de l'auteur <strong>du</strong> Contrat<br />
Social sont-ils prêts à franchir ce pas ?<br />
Impossible au début de l'histoire, parce que<br />
l'homme y est encore prisonnier de son animalité,<br />
impossible au milieu de l'histoire, parce que les<br />
inégalités déjà établies le transforment<br />
inévitablement en pseudo-contrat (ainsi que le<br />
démontre le second Discours), possible à la fin de<br />
l’histoire à condition qu'un « sage législateur »<br />
veuille bien nous prendre en pitié, le contrat social<br />
ne saurait être qu'une « idée régulatrice » au sens<br />
kantien de l’expression. Reste à déterminer quel<br />
chemin régule une telle idée : le chemin difficile<br />
mais à terme merveilleux qui nous con<strong>du</strong>it à <strong>des</strong> «<br />
lendemains qui chantent », ou les impasses <strong>du</strong> XX e<br />
siècle, le chemin nietzschéen <strong>du</strong> nihilisme, l'abime<br />
que nous côtoyons toujours au début <strong>du</strong> troisième<br />
millénaire, et dont Heidegger pensait que<br />
«Seul un Dieu pourrait nous sauver» ?
[1] Discours sur l’origine et les fondements de<br />
l’inégalité parmi les hommes, Paris, Éditions<br />
Sociales, 1954, p. 47-58.<br />
[2] Ibidem, p. 68-69.<br />
[3] Du contrat social, Paris, Éditions Garnier-<br />
Flammarion, 2001, p. 46.<br />
[4] Discours de la servitude volontaire, Paris,<br />
Éditions Garnier-Flammarion, 1994.<br />
[5] Du contrat social, op. cit., p. 49.<br />
[6] Thomas Hobbes, Le Citoyen (De Cive), Paris,<br />
Éditions Garnier-Flammarion, 1988, et Léviathan,<br />
Paris, Éditions Sirey, 1971. Les formules les plus<br />
nettes de Hobbes à ce sujet sont les suivantes :<br />
- « Ceux-là sont égaux qui peuvent choses égales. Or<br />
ceux qui peuvent ce qu’il y a de plus grand et de pire,<br />
à savoir ôter la vie, peuvent choses égales. Tous les<br />
hommes sont donc naturellement égaux » (Le<br />
Citoyen, chapitre 1, op. cit., p. 95).<br />
- « Pour ce qui est de la force corporelle, l’homme le<br />
plus faible en a assez pour tuer le plus fort, soit par<br />
une machination secrète, soit en s’alliant à d’autres<br />
qui courent le même danger que lui » (Léviathan,<br />
op. cit., chapitre XIII, p. 121).<br />
Notes<br />
69<br />
[7] Claude Lefort, Essais sur la politique, Paris, Le<br />
Seuil, 1986.<br />
[8] Du contrat social, Livre I, chapitre VI, « Du<br />
pacte social », op. cit., p. 56.<br />
[9] Ibidem, Livre II, Chapitre III, « Si la volonté<br />
générale peut errer », p. 68.<br />
[10] Ibidem, p. 68-69.<br />
[11] Ibidem, Livre II, Chapitre VII, « Du<br />
législateur », p. 79.<br />
[12] Ibidem, Livre III, Chapitre IV, « De la<br />
démocratie », p. 107.<br />
[13] Ibidem, p. 106.<br />
[14] Cf. L’Homme Nouveau dans l’Europe fasciste<br />
(1922-1945), sous la direction de Marie-Anne<br />
Matard-Bonucci et Pierre Milza, Paris, Fayard,<br />
2004.<br />
[15] André Glucksmann, Les Maîtres penseurs,<br />
Paris, Grasset, 1977.
Rousseau à Montmorency chez le Maréchal de Luxembourg<br />
Esquisse de Houel, B. N. E.<br />
70
Nous voilà bien avancés, serais-je tenté de dire, au<br />
terme de cette journée, au risque de froisser les<br />
intervenants de ce colloque ! Je crois qu’on peut<br />
dire, en effet, que Rousseau reste, décidément,<br />
l’énigmatique personnage qui a fait réfléchir ,<br />
discuter, et si souvent se quereller, tant de lecteurs<br />
et de commentateurs, et c’était bien prévisible. Et<br />
pourtant les a-t-on explorés, scrutés, avec une<br />
talentueuse perspicacité, tout au long de ce colloque,<br />
les différents visages de cet insaisissable Protée !<br />
À vrai dire, nos collègues savaient bien qu’il<br />
s’agissait surtout d’illustrer, dans ses emportements,<br />
les sautes d’humeur, les mouvances de l’âme d’un<br />
écrivain, déjà si controversé parce que souvent mal<br />
compris en son temps. Mais s’ils ont si brillamment<br />
mené leurs investigations chacun dans sa spécialité,<br />
n’était-ce pas, au fond, tout de même, avec l’espoir<br />
de faire tomber le masque ? Hélas qui l’aurait pu ?<br />
Ah s’ils avaient eu affaire à quelqu’un <strong>des</strong><br />
contemporains de Rousseau, à un Montesquieu avec<br />
sa rigoureuse clarté, à un Voltaire avec sa fielleuse<br />
agressivité, à un Diderot avec son débraillé de génie,<br />
à un Beaumarchais avec ses impudences tapageuses,<br />
bref à quelqu’un avec qui « on sait où on va »,<br />
l’enquête eût été autrement aisée ! Rousseau, quant<br />
à lui, a jeté le trouble dans son époque, pourtant<br />
déjà si progressiste et tumultueuse, comme un<br />
caillou jeté dans l’eau de ces beaux lacs qu’il aimait<br />
tant, y faisant irradier les plus étincelantes lueurs<br />
jusqu’aux rives les plus lointaines, hors de portée de<br />
nos prospections les plus aventureuses. Henri<br />
Guillemin eut bien raison de dire qu’il faut chercher<br />
chez Rousseau « un homme qui a deux ombres » et,<br />
assurément, on peut évoquer, à travers les<br />
<strong>communications</strong> que nous venons d’écouter avec<br />
tant d’intérêt, deux personnages : l’égocentrique et<br />
le paradoxal.<br />
J’herborise, donc je suis. Je marche, donc je suis. Je<br />
légifère, donc je suis. J’é<strong>du</strong>que, donc je suis. J’aime,<br />
donc je suis. Oserai-je ajouter : je pisse, donc je<br />
suis ?! Tout dans son œuvre et dans ses actes<br />
proclame l’affirmation de soi et l’autosuffisance, aux<br />
deux sens <strong>du</strong> terme : la conviction d’être,<br />
exceptionnellement, dans le Vrai, et l’affirmation de<br />
l’aptitude, si souvent affichée, à pouvoir et à savoir<br />
se passer <strong>des</strong> autres. Et, bien sûr, se profile derrière<br />
ces deux postures, la hantise d’être mal jugé, donc le<br />
souci maladif de se justifier et, de plus en plus, la<br />
certitude insensée d’être le meilleur <strong>des</strong> hommes.<br />
Nous le voyons, ce premier constat dépeint un être<br />
complexe et obsessionnel mais, somme toute,<br />
presque cohérent. Mais que dire <strong>du</strong> deuxième<br />
personnage, celui <strong>des</strong> contradictions qui émaillent<br />
pratiquement toutes ses attitu<strong>des</strong>, tous ses choix et<br />
que seuls ses admirateurs inconditionnels nomment<br />
CONCLUSION<br />
Roland BILLAULT<br />
71<br />
<strong>des</strong> « nuances », pour les plus timorés, <strong>des</strong> traits de<br />
génie pour les plus ardents ? Car, enfin, voilà un<br />
homme qui a conçu <strong>des</strong> systèmes politiques dont il<br />
sait- et dit - l’inanité ou l’utopie, ne fût-ce qu’en les<br />
rattachant au désenchantement de son Romain<br />
idéal, Fabricius, un homme qui magnifie les élans<br />
d’amour, la ferveur sentimentale et jusqu’à la<br />
fidélité, mais qui a envisagé les situations les plus<br />
scabreuses comme le ménage à trois et a poursuivi<br />
tous les jupons de rencontre en leur attribuant, avec<br />
une tranquille assurance, une cote de notation<br />
impitoyable, préfigurant presque les palmarès<br />
coquins de Victor Hugo, un homme qui propose un<br />
système é<strong>du</strong>catif d’ailleurs tout droit venu, en partie,<br />
de Montaigne, une sorte de « méthode globale »<br />
tous azimuts, mais qui a abandonné ses enfants au<br />
motif qu’il ne se sentait pas capable de les élever, un<br />
homme qui ne connait pas la musique mais<br />
l’enseigne avec un aplomb déconcertant et<br />
s’applique à la révolutionner.<br />
Un homme qui déteste la botanique puis qui la<br />
révère comme son seul soutien, allant jusqu’à<br />
proposer de remplacer les noms grecs et romains<br />
<strong>des</strong> plantes et <strong>des</strong> fleurs par <strong>des</strong> signes ! (Voilà qui a<br />
de quoi plaire à notre ancien Président !) Un homme<br />
qui crée lui-même les situations qui le con<strong>du</strong>isent à<br />
l’exil, qui se brouille avec ses hôtes et change<br />
d’adresses, de boites aux lettres et de noms même<br />
dans ses retraites à l’étranger. Un homme enfin qui<br />
veut être Encyclopédiste mais élabore son propre<br />
dictionnaire et réussit à « se mettre à dos » même<br />
les ministres favorables aux Lumières ! On serait<br />
même tenté de reprocher à ses statues leurs<br />
invraisemblables errances ou leurs humiliantes<br />
disgrâces, jusque dans l’Allemagne hitlérienne : le<br />
comble ! Qu’allait-il faire dans cette galère ?!<br />
Mais « l’archi-tout qui aurait pu être quelque<br />
chose » comme le dit cruellement Voltaire, aime<br />
mieux, il l’a dit lui-même, « être homme à paradoxes<br />
qu’homme à préjugés ». Le moins qu’on puisse dire<br />
c’est qu’il a bien réussi son coup ! Et puis, il faut<br />
bien le reconnaître, le pauvre diable a bu le calice<br />
jusqu’à la lie ( qu’on me pardonne cette mauvaise<br />
plaisanterie !), confronté qu’il fut aux situations les<br />
plus ridicules : renversé par un chien, remplacé ou<br />
supplanté par <strong>des</strong> soupirants plus habiles,<br />
« caillassé » là où il se croit désiré, caricaturé<br />
impitoyablement, moqué quand il distribue <strong>des</strong><br />
tracts d’alibis vertueux, sommé d’aller brouter<br />
l’herbe <strong>des</strong> prés où il trouvait refuge… Nos<br />
adolescents diraient qu’ « il a tout faux »..!<br />
La tempête su
Comme il est malaisé de conclure une conclusion !<br />
Que dire pour finir ? Eh bien que cet homme qui a<br />
voulu aller au Paradis sans passer par la<br />
case « départ », avec une certitude qui nous incline à<br />
la méfiance, nous avons très souvent l’impression<br />
qu’il nous prend pour <strong>des</strong> benêts, et nous éprouvons<br />
le besoin d’une pierre de Rosette pour le lire et le<br />
comprendre au lieu d’en être ré<strong>du</strong>it aux<br />
supputations… Scruter ses nombreux portraits, se<br />
pencher sur les maux de cet éternel moribond,<br />
autopsier son pauvre corps, tout cela n’a rien donné.<br />
72<br />
Alors je crois qu’il faut se tourner vers ce qui chez<br />
Rousseau ne trompe pas : une sensibilité aux<br />
épanchements sublimes servie par une prose d’une<br />
exaltante poésie qui reste l’une <strong>des</strong> plus belles de<br />
notre littérature, <strong>des</strong> « tressaillements », pour<br />
reprendre le mot de Jean-Pierre Amette, qui nous<br />
bouleversent, <strong>des</strong> épanchements <strong>des</strong>criptifs qu’on ne<br />
trouve que chez Chateaubriand, <strong>des</strong> enchantements<br />
qui nous transportent. Comme pour Stendhal qui<br />
l’aimera tant, et avec lequel il présente tant de<br />
points communs, ce fut là sa façon de poursuivre le<br />
bonheur et, peut-être, de l’atteindre, en trempant sa<br />
plume à la rosée <strong>des</strong> fossés. Où s’est-il donc<br />
retrouvé le 2 juillet 1778 ? Encore une question…
JEAN-JACQUES ROUSSEAU<br />
Chronologie<br />
1712 28 juin. Naissance à Genève de Jean-Jacques Rousseau, d’un père horloger et d’une<br />
mère fille de pasteur. Celle-ci meurt peu de temps après l’accouchement. Jean-Jacques vit à<br />
Genève auprès de son père et d’une tante.<br />
1722. Il est placé en pension à Bossey, chez le pasteur Lemercier. Années heureuses.<br />
1724. Retour à Genève chez son oncle Gabriel Bernard. Petits métiers : apprenti greffier,<br />
graveur.<br />
1728. À Annecy, par l’intermédiaire de M. de Pontverre, il rencontre Mme de Warens qui<br />
l’envoie à Turin. Conversion au catholicisme. Il entre au service de la comtesse de Vercellis.<br />
Puis devient « laquais » chez le comte de Gouvon et secrétaire de son fils.<br />
1729-30. Il quitte Turin avec un ami de rencontre : vie errante. Retour à Annecy auprès de<br />
Mme de Warens ; court séjour au séminaire, puis pensionnaire à la maîtrise de la<br />
cathédrale.<br />
1730-31. De retour d’un voyage à Lyon, il a la surprise de ne pas retrouver Mme de<br />
Warens, partie pour Paris. Divers déplacements en Suisse en tant que maître de musique.<br />
1731. Interprète d’un faux archimandrite ; départ à pied pour Paris.<br />
Octobre 1731-1735. Retour à Chambéry près de Mme de Warens. Il vit en donnant <strong>des</strong><br />
leçons de musique. Devient l’intendant de la maison après la mort de Claude Anet.<br />
1735-1737. Mme de Warens s’installe aux Charmettes (Chambéry). Rousseau y connaît <strong>des</strong><br />
années de bonheur.<br />
1737. Voyage à Montpellier pour raisons de santé.<br />
1738. Retour aux Charmettes ; il découvre qu’il est supplanté dans le cœur de Mme de<br />
Warens par Vintzenried.<br />
1740. A Lyon, précepteur chez M. de Mably. Invention de son système de notation<br />
musicale.<br />
1742. Arrivée à Paris ; amitié avec Diderot ; Jean-Jacques fréquente le salon de Mme Dupin<br />
où il se lie avec le monde. Il renonce à son système de notation musicale.<br />
1743-1744. Secrétaire de l’ambassadeur de France à Venise.<br />
1744-1745. De retour à Paris, il compose un opéra, Les Muses galantes. Rencontre Thérèse<br />
Levasseur, une lingère qui lui donnera plusieurs enfants.<br />
1746-1748. Secrétaire de Mme Dupin ; séjour à Chenonceaux. Il rencontre Mme d’Épinay,<br />
puis Mme d’Houdetot.<br />
1749. Pour l’Encyclopédie, Rousseau rédige <strong>des</strong> articles sur la musique. Se lie avec Grimm.<br />
Visite à Vincennes (« l’illumination ») où Diderot est emprisonné.<br />
1750. L’<strong>Académie</strong> de Dijon couronne son Discours sur les sciences et les arts. Succès.<br />
1752-1753. Il choisit de mener une vie retirée ; nouvel opéra, Le Devin de village,<br />
représenté à Paris devant le roi. Une comédie, Narcisse, est jouée sans succès.<br />
1754. Retour à Genève : il reprend la religion protestante.<br />
1755. Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, dédié à la république de<br />
Genève. Lettre de Voltaire qui ironise sur ce texte.<br />
1756. Il s’installe à l’Ermitage, près de Montmorency, chez Mme d’Epinay, puis à<br />
Montlouis, chez le maréchal de Luxembourg.<br />
1757. Brouille avec les « philosophes », puis avec Mme d’Épinay. Il se prend de passion<br />
pour Mme d’Houdetot qui lui inspire La Nouvelle Héloïse.<br />
1758. Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Rupture avec Diderot.<br />
1761. Parution de La Nouvelle Héloïse ; la santé de Rousseau s’altère – son humeur aussi –<br />
au point qu’il songe au suicide. Il achève la rédaction de l’Émile et <strong>du</strong> Contrat social.<br />
1762. Ces deux livres paraissent et sont immédiatement condamnés au Parlement.<br />
Rousseau s’enfuit de Paris pour se réfugier en Suisse, près de Neuchâtel, à Môtiers-Travers.<br />
Publication <strong>des</strong> quatre Lettres à Malesherbes. Mort de Mme de Warens.<br />
1764. Lettres écrites de la montagne, pour tenter de se justifier. S’initie à la botanique.<br />
Libelle de Voltaire à son encontre.<br />
1765. Inquiété à Môtiers, il se réfugie à l’île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne. Début de la<br />
rédaction <strong>des</strong> Confessions.<br />
1766-1769. Court exil en Angleterre. Retour en France, vie errante, puis Rousseau est<br />
hébergé chez <strong>des</strong> amis provinciaux dans le Dauphiné.<br />
73
1770. Il s’installe à nouveau à Paris, rue Plâtrière (actuelle rue Jean-Jacques Rousseau). Il<br />
gagne sa vie en copiant de la musique, achève les Confessions et en fait quelques lectures<br />
privées.<br />
1772-1777. Vie difficile et tourmentée ; Rousseau rédige les Dialogues qu’il souhaite<br />
déposer, sans succès, à Notre-Dame de Paris (24 février 1776) et écrit Les Rêveries <strong>du</strong><br />
promeneur solitaire.<br />
1778. Il se réfugie à Ermenonville, chez le marquis de Girardin ; c’est là qu’il meurt le<br />
2 juillet.<br />
1782. Publication <strong>des</strong> six premiers livres <strong>des</strong> Confessions.<br />
1789. Publication <strong>des</strong> livres VII à XII <strong>des</strong> Confessions.<br />
1794. Ses cendres sont transférées au Panthéon.<br />
L’île Rousseau à Genève. James Pradier<br />
74
QUELQUES TITRES POUR DÉCOUVRIR ROUSSEAU<br />
Robert DERATHÉ, Le Rationalisme de Rousseau, PUF, 1950.<br />
Michel LAUNAY, Rousseau, PUF, 1968.<br />
Jean STAROBINSKI, La Transparence et l’obstacle, Gallimard « Tel »,<br />
1971.<br />
Victor GOLDSCHMIDT, Anthropologie et politique.<br />
Les Principes <strong>du</strong>système de Rousseau, Vrin, 1974.<br />
Paul BÉNICHOU, La Pensée de Rousseau, Seuil, 1984.<br />
Raymond TROUSSON, Jean-Jacques Rousseau,<br />
2 vol. Tallandier, 1988-1989 (biographie).<br />
Raymond TROUSSON, Jean-Jacques Rousseau, Hachette, 1993.<br />
Dictionnaire de J. J. Rousseau,<br />
(sous la direction de R. Trousson et F. Egeldinger), Champion, 2001.<br />
Magazine littéraire, N° 357 (septembre 1997) et N° 514, (décembre 2011).<br />
Le Nouvel Observateur « Hors-série »,<br />
Rousseau, le génie de la modernité » (juillet-août 2010).<br />
75
ISBN 978-2-9527274-5-7
Maquette, composition typographique<br />
et mise en page<br />
André BÉRUTTI<br />
*<br />
Achevé d’imprimer par<br />
TOULON REPRO SERVICES<br />
83 avenue Jean Moulin<br />
83000 Toulon<br />
Pour le compte de<br />
ACADÉMIE DU VAR<br />
Passage de la Corderie<br />
83000 Toulon – France<br />
Tél. 04 94 92 62 67<br />
Mèl. : acadvar@free.fr<br />
Site Internet : http://www.academie<strong>du</strong>var.org<br />
en novembre 2012<br />
*<br />
ISBN 978-2-9527274-5-7<br />
Dépôt légal 4 e trimestre 2012<br />
76