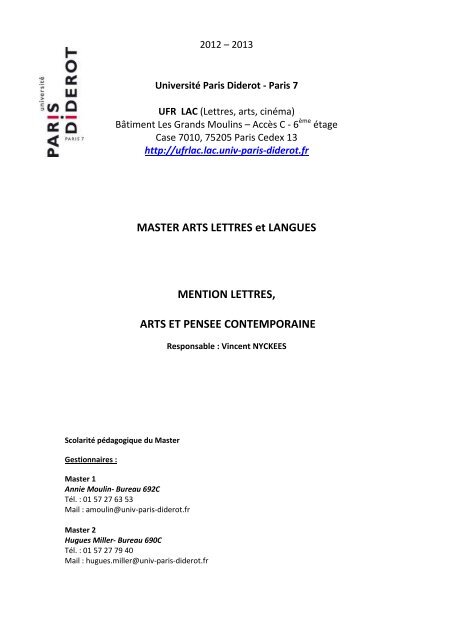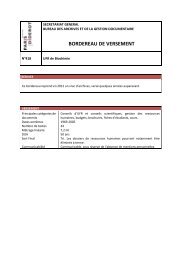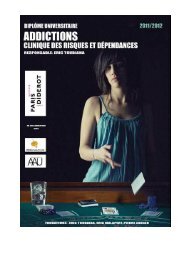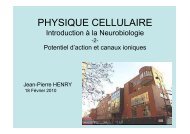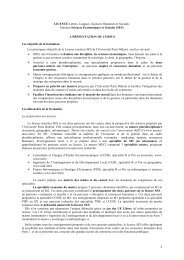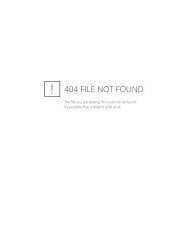Brochure à télécharger - Université Paris Diderot-Paris 7
Brochure à télécharger - Université Paris Diderot-Paris 7
Brochure à télécharger - Université Paris Diderot-Paris 7
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2012 – 2013<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> - <strong>Paris</strong> 7<br />
UFR LAC (Lettres, arts, cinéma)<br />
Bâtiment Les Grands Moulins – Accès C - 6 ème étage<br />
Case 7010, 75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr<br />
Scolarité pédagogique du Master<br />
Gestionnaires :<br />
Master 1<br />
Annie Moulin- Bureau 692C<br />
Tél. : 01 57 27 63 53<br />
Mail : amoulin@univ-paris-diderot.fr<br />
Master 2<br />
Hugues Miller- Bureau 690C<br />
Tél. : 01 57 27 79 40<br />
Mail : hugues.miller@univ-paris-diderot.fr<br />
MASTER ARTS LETTRES et LANGUES<br />
MENTION LETTRES,<br />
ARTS ET PENSEE CONTEMPORAINE<br />
Responsable : Vincent NYCKEES
Sommaire<br />
1 - Présentation du Master mention Lettres, Arts et Pensée contemporaine …………… p. 3<br />
2 - Organisation des enseignements ………………………………………………………………………………………………………… p. 5<br />
3 - Liste des cours et séminaires prévus en 2012-2013 ………………………………………………….…………… p. 6<br />
4 - Descriptifs des cours et des séminaires de spécialité<br />
Littérature, histoire, société ……………………………………………………………………………………………………………… p. 11<br />
Littératures, théories, modernités ……………………………………………………………………………………….……… p. 21<br />
Arts, esthétique, littératures comparées ………………………………………………………………………………… p. 31<br />
Séminaires hors UFR LAC …………………………………………………………………………………………………………….……… p. 41<br />
5 - Mémoires : Calendrier, rédaction, soutenance …………………………………………………….…………………… p. 48<br />
7 - Stages ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… p. 49<br />
8 - Liste des enseignants : susceptibles de diriger des mémoires ………………………..……………… p. 51<br />
9 - Formulaire : accord pour la direction de mémoire …………………………………………………………….…… p. 55<br />
2
MASTER ARTS LETTRES ET LANGUES<br />
MENTION<br />
LETTRES, ARTS ET PENSEE CONTEMPORAINE<br />
1. Présentation<br />
Le Master mention « Lettres, arts et pensée contemporaine » prend la suite de la Licence mention Lettres (parcours<br />
Lettres modernes, Lettres et arts, Métiers du livre) et propose trois spécialités détaillées ci-après : « Littérature,<br />
histoire, société », « Littératures, théories, modernités », « Arts, esthétique, littératures comparées ».<br />
2. Spécificités<br />
On doit noter la triple caractéristique de cette mention de Master :<br />
1. Elle couvre l’ensemble des littératures françaises, anciennes et étrangères, et offre des enseignements de<br />
littératures comparées.<br />
2. Elle prend partout en compte les arts (théâtre, cinéma, arts plastiques, musique) et plus précisément dans la<br />
spécialité « Arts, esthétique, littératures comparées».<br />
3. Elle donne une place <strong>à</strong> la réflexion théorique contemporaine (philosophie, psychanalyse, sémiologie) mais sans<br />
sacrifier la nécessaire connaissance de l’histoire des littératures et des arts.<br />
Assurée par des enseignants chercheurs qui exercent au sein de l’UFR LAC (Lettres, arts, cinéma) de <strong>Paris</strong> 7, et en<br />
synergie avec d’autres centres de recherche (<strong>Paris</strong> I, ENS Ulm, ENS Lyon, etc.), cette mention profite de la diversité<br />
des enseignements et des recherches d’une communauté de plus de cinquante enseignants chercheurs. L’esprit<br />
général de cet enseignement consiste <strong>à</strong> associer étroitement littérature et sciences humaines (philosophie, histoire,<br />
psychanalyse…) <strong>à</strong> l’enseignement proprement littéraire. Dans le cadre de chacune des trois spécialités, l’étudiant<br />
pourra être guidé par une véritable équipe d’enseignants, attachant une grande importance <strong>à</strong> une pédagogie active<br />
et vivante.<br />
3. Durée et validation<br />
La formation s’étend sur quatre semestres, et implique, outre la validation de cours et de séminaires, la réalisation<br />
de deux mémoires, réalisés l’un en 1 ère année (M1), l’autre en seconde année (M2). La scolarité du premier<br />
semestre de la 1 ère année (S1) est en tronc commun. Le choix du directeur de mémoire et celui du sujet de<br />
recherche se fait au début de ce 1 er semestre de M1, et oriente le choix d’une spécialité. Mais il est fortement<br />
conseillé <strong>à</strong> l’étudiant de rencontrer un enseignant dès le mois de juin afin de mettre en place le début d’une<br />
recherche pendant les vacances (délimitation du corpus, lectures critiques).<br />
À la fin du premier semestre de M1, l’étudiant doit pouvoir proposer un projet de 5 <strong>à</strong> 7 pages, avec problématique<br />
et bibliographie succincte. Le premier mémoire (40 pages) sera soutenu <strong>à</strong> la fin de la première année. C’est <strong>à</strong> la fin<br />
du second semestre de M2 qu’a lieu la soutenance du second mémoire, qui pourra éventuellement être articulé au<br />
premier, ou proposer un autre objet de recherche.<br />
Rappel :<br />
Les travaux universitaires (devoirs, exposés, mémoires, thèses…) doivent revêtir un caractère personnel, ce qui<br />
exclut tout plagiat y compris <strong>à</strong> partir de documents issus de sites internet. Le délit de contrefaçon (plagiat) peut<br />
donner lieu <strong>à</strong> une sanction disciplinaire indépendante de la mise en oeuvre de poursuites pénales.<br />
(Règlement intérieur <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> - <strong>Paris</strong> 7, articles 6.2 et 25.1)<br />
La présence en cours est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées aux étudiants salariés. Les étudiants<br />
titulaires du CAPES de Lettres sont dispensés du cours commun (Questions de théorie littéraire en S1 et S2) ; les<br />
étudiants admissibles <strong>à</strong> ou titulaires de l’agrégation de Lettres sont dispensés d’un séminaire (au choix en S3 ou S4).<br />
Une UE (Unité d’Enseignement) est définitivement acquise lorsque sa note est égale ou supérieur <strong>à</strong> 10/20.<br />
Pour les enseignements dont les résultats sont inférieurs <strong>à</strong> 10 et qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation<br />
(dans le cadre de la moyenne d’UE ou de semestre) <strong>à</strong> l’issue du jury de 1 ère session, les épreuves doivent être<br />
repassées lors de la seconde session.<br />
En Master 1 et 2, la non validation des séminaires ne donne pas lieu <strong>à</strong> un rattrapage <strong>à</strong> la différence des cours.<br />
En aucun cas une note de 1 ère session, inférieure <strong>à</strong> 10 et non compensée, ne peut-être utilisée dans le cadre d’une<br />
session ultérieure.<br />
Un étudiant peut renoncer au bénéfice d’une compensation entre ECUE d’une UE ou UE d’un semestre. Cette<br />
renonciation entraîne automatiquement, et <strong>à</strong> titre définitif, la renonciation <strong>à</strong> la note précédente.<br />
Le diplôme de maîtrise continue <strong>à</strong> être délivré pour les étudiants qui en font la demande <strong>à</strong> la fin de M1.<br />
4. Stages (voir pages 5 et 49)<br />
3
5. Débouchés<br />
Le débouché naturel des trois spécialités est le doctorat de Lettres. Elles peuvent aussi offrir des débouchés<br />
professionnels vers les métiers du livre, de la communication et de la culture.<br />
NB : la scolarité du Master Lettres et arts, pensée contemporaine a été conçue pour s’articuler au mieux avec les<br />
préparations aux concours du CAPES et de l’Agrégation de Lettres modernes, qui font l’objet d’une préparation<br />
complète dans le cadre de l’UFR LAC (voir brochures spécifiques et information sur la mastérisation des concours).<br />
6. Accès et inscription<br />
En M1 : l’entrée en M1 est de plein droit pour tout étudiant ayant obtenu la Licence mention Lettres <strong>à</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong><br />
- <strong>Paris</strong> 7.<br />
Tous les étudiants extérieurs <strong>à</strong> <strong>Paris</strong> 7 ou ayant obtenu une Licence autre que littéraire doivent déposer une<br />
demande d’autorisation d’inscription sur le site de l’<strong>Université</strong> <strong>à</strong> l’aide du logiciel Sesame <strong>à</strong> l’adresse suivante :<br />
http://sesame.univ-paris-diderot.fr/Candidat/accueil<br />
Le dossier d'inscription fait alors l’objet d’un examen pour orientation par une commission d’admission.<br />
L’étudiant souhaitant s’inscrire en M1 doit prendre contact avec un enseignant susceptible de diriger son mémoire<br />
pour obtenir son accord de principe. Le formulaire <strong>à</strong> retirer au secrétariat pédagogique de l’UFR (voir également<br />
page 53), visé par l’enseignant, sera exigé lors de l’inscription administrative et lors de l’inscription pédagogique.<br />
Les étudiants de pays non francophones, pour l’accès en M1, doivent obligatoirement passer un test de langue et<br />
consulter le site http://www.univ-paris-diderot.fr pour prendre connaissance des dispositions spéciales relatives <strong>à</strong><br />
l’inscription des étudiants étrangers.<br />
En M2 : l’inscription en M2 suppose la validation des deux semestres de M1, qui est notamment soumise <strong>à</strong> la<br />
soutenance d’un mémoire manifestant des qualités exigées par la recherche. L’inscription en M2 n’est pas<br />
automatiquement accordée. Elle est soumise <strong>à</strong> une commission d’admission constituée par les enseignants<br />
responsables du Master qui se réunit deux fois par an (<strong>à</strong> la fin du mois de juin et <strong>à</strong> la mi-septembre). L’étudiant doit<br />
constituer pour l’une ou l’autre de ces commissions un dossier d’admission (projet de recherche en 4-5 pages, lettre<br />
de motivation, relevé des notes obtenues en M1, CV, attestation d’un enseignant acceptant de diriger cette<br />
recherche). L’inscription en M2 n’est effective qu’après l’accord d’un directeur de recherche. Tous les étudiants (y<br />
compris ceux qui ont obtenu leur M1 <strong>à</strong> <strong>Paris</strong> 7 en 2011-2012) devront déposer une demande d’autorisation<br />
d’inscription sur le site de l’<strong>Université</strong> <strong>à</strong> l’aide du logiciel Sesame <strong>à</strong> l’adresse suivante :<br />
http://sesame.univ-paris-diderot.fr/Candidat/accueil<br />
Les étudiants postulant une inscription en M2 doivent donc être acceptés sur des critères scientifiques et<br />
pédagogiques avant toute inscription administrative.<br />
7. Langues vivantes<br />
Les cours de langues sont proposés par l’UFR EILA responsable du programme LANSAD de <strong>Paris</strong> 7 (Langue pour<br />
Spécialistes d’Autres Disciplines). Ils ont lieu aux deux semestres de M1 et au 1 er semestre de M2. Les étudiants<br />
doivent obligatoirement s’inscrire en ligne <strong>à</strong> l’adresse suivante :<br />
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad<br />
Les étudiants pourront également choisir pour valider la langue vivante des séminaires ou cours de LEA ou de l’UFR<br />
d’Etudes Anglophones dispensés en langue étrangère (s'inscrire dans les UFR concernées).<br />
8. Calendrier :<br />
REUNION D’INFORMATION : JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 A 15H00<br />
RENTREE : LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012<br />
Veuillez consulter le calendrier affiché dans votre composante<br />
Les secrétariats sont ouverts <strong>à</strong> partir du 04 septembre 2012. Les cours et séminaires débuteront le 24 septembre<br />
2012.<br />
9. Contact :<br />
- Responsable de M1 Florence Dumora (reçoit sur rendez-vous – mail : fdumora@free.f)<br />
- Responsable de M2 Vincent Nyckees (reçoit sur rendez-vous - mail : nyckees@wanadoo.fr)<br />
4
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS<br />
Volume horaire ECTS Coeff.<br />
Semestre 1 – Tronc commun<br />
Cours commun :<br />
Questions de théorie littéraire et esthétique 1<br />
24 6 2<br />
Cours de Méthodologie de la recherche<br />
12 2 1<br />
Langue vivante (1)<br />
24 3 1<br />
Cours 1 (dans la spécialité) 24 4 2<br />
Séminaire 1 (dans la spécialité) 24 4 2<br />
Clefs de contact : conférences professionnelles 12 4 2<br />
Mémoire (projet avec problématique et bibliographie)<br />
Semestre 2<br />
Cours commun :<br />
7 2<br />
Questions de théorie littéraire et esthétique 2<br />
24 4 2<br />
Cours 2 (au choix dans la spécialité, la mention) 24 4 2<br />
Séminaire 2 (au choix dans la spécialité, la mention ou le domaine) (2)<br />
24 4 2<br />
Langue vivante 24 3 1<br />
Rédaction (40 pages) et soutenance du mémoire 1<br />
Semestre 3<br />
15 4<br />
Séminaire3 (de spécialité) ou Cours de spécialité (3)<br />
24 4 2<br />
Séminaire 4 (au choix dans la spécialité, la mention ou le domaine) (4)<br />
24 4 2<br />
Langue vivante 24 3 1<br />
Mémoire 2 (rédaction 30-40 pages)<br />
Semestre 4<br />
19 5<br />
Séminaire 5 (de spécialité) 24 4 2<br />
Séminaire 6 (au choix dans la spécialité, la mention ou le domaine) (4)<br />
24 4 2<br />
Mémoire 2 : rédaction (80-100 pages) et soutenance 22 6<br />
(1) Pour l’obtention du master, tous les étudiants doivent attester leur maîtrise d’une langue étrangère. Une<br />
validation peut être délivrée par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de <strong>Paris</strong> 7 (Langue pour<br />
Spécialistes d’Autres disciplines), ou par un des partenaires conventionnés habilités <strong>à</strong> délivrer cette validation. Ne<br />
suivront obligatoirement les cours de langue vivante que les étudiants n’ayant pas obtenu cette validation <strong>à</strong> l’entrée<br />
de M1.<br />
(2) Possibilité de validation de séminaires dans des UFR de <strong>Paris</strong> 7 (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences<br />
Humaines et Sociales) ou extérieurs <strong>à</strong> <strong>Paris</strong> VII (EPHE, EHESS et <strong>Paris</strong> 13).<br />
(3) Les étudiants arrivant en M2 <strong>à</strong> <strong>Paris</strong> 7 peuvent suivre un cours de spécialité au premier semestre en lieu et place<br />
d’un séminaire.<br />
(4) L’un des séminaires obligatoires de M2 (au choix pour l’étudiant en S3 ou S4) sera validé par une attestation<br />
d’assiduité.<br />
(5) Les cours de latin du M2 MEF sont ouverts aux étudiants du Master recherche, désireux de suivre<br />
ultérieurement la préparation <strong>à</strong> l'agrégation.<br />
DISPENSES<br />
Les étudiants titulaires du CAPES de Lettres sont dispensés du cours commun (Questions de théorie<br />
littéraire et esthétique en S1 et S2 et de conférences professionnelles : clef de contact S1).<br />
Les étudiants admissibles <strong>à</strong> ou titulaires de l’agrégation de Lettres sont dispensés d’un séminaire (au<br />
choix en S3 ou S4)<br />
STAGES<br />
Les étudiants pourront suivre un stage d’un minimum de 40 heures en lieu et place d’un séminaire<br />
soit en M1 soit en M2. Ils seront évalués sur un rapport écrit (50%) et une soutenance orale (50%) par<br />
leur directeur de mémoire auquel se joindra dans la mesure du possible un représentant de<br />
l’entreprise.<br />
5
- Questions de théorie littéraire et esthétique 1 et 2 (S1,S2) ……………………………………………………………………..……… p. 7<br />
- Clefs de contact : conférences professionnelles (S1)………………………………………………………………………………………….…… p. 9<br />
- Cours de Méthodologie de la recherche…………………………………………………………………………………….……………………………. p. 10<br />
COURS et SEMINAIRES DE SPECIALITES 2012-2013<br />
Spécialité : Littérature, histoire et société (responsable J. Vignes)<br />
2 cours :<br />
- La fonction auteur. Approche historique (S1): J. Vignes, P. Debailly, J-L. Diaz, A. Paupert …………..……… p. 12<br />
- Littérature et histoire (S2): E. Valette, F. Lotterie, H. Baty ………………………….……………….………………..……… p. 13<br />
- 7 séminaires :<br />
- - Ecrire sous la menace, écrire la menace : C. Trévisan, A. Dahan,-Roseman (S1, S3) ………………….………….<br />
- - Révolution de la littérature (1830-1891) : J-L. Diaz (S1, S3) ………………………………………………………...……….<br />
- - Figures du poète dans le texte poétique : J. Vignes (S1, S3) ………..…………………………………………..……………<br />
- - Le merveilleux au XIXème siècle : P. Petitier (S1,S3) ……………………….………………………………………………..….<br />
- - Eros et Catharsis comique : M. Debailly (S2, S4) ……………………………………………………………………….….………<br />
- - Modernité de Christine de Pizan : A. Paupert (S2, S4) ………………………………………………………………….………<br />
- - Corps des lumières : <strong>Diderot</strong> et la médecine : F. Lotterie (S2, S4) ………………………………….………………….….<br />
Spécialité : Littératures, théories, modernités (responsable E. Marty)<br />
6<br />
P. 14<br />
p. 15<br />
p. 16<br />
p. 17<br />
p. 18<br />
p. 19<br />
p. 20<br />
2 cours :<br />
- Penser le roman et la poésie (S1): N. Piegay-Gros, L. Zimmermann ……………………………………………………… p. 22<br />
- Théories critiques (S2): P. Zaoui et L. Zimmermann………………………………………………………………….…………… p. 23<br />
7 séminaires :<br />
- L’imaginaire des archives: N. Piegay-Gros (S1, S3) ………………………………………………………………………………..<br />
- Philosophie et littérature : P. Zaoui, J-O. Bégot (S1, S3) ………………………………………………………………………..<br />
- Le document du théâtre : I. Barberis, S. Lucet (S1, S3) ……………………………………..…………………………………..<br />
- La voix chantée, une approche anthropologique : M. Manca (S2, S4)……………………….……………………….…<br />
p. 24<br />
p. 25<br />
p. 26<br />
p. 27<br />
- Politiques de Rimbaud (II) : « une saison en enfer » : E. Marty (S2, S4) ………………….……………………………. p. 28<br />
- Arts et histoires du mensonge : F. Dumora (S2, S4) ……………………………………………………………………………... p. 29<br />
- Vivable, invivable, vivant: E. Grossman (S2, S4) ……………………………………………….….……….……………………… p. 30<br />
Spécialité : Arts, Esthétique, littératures comparées (responsable C. Murcia)<br />
2 cours :<br />
- Littérature et cinéma (S1): C. Murcia ……………………………………………………………………………………………….…………………… p. 32<br />
- Esthétique générale (S2): J-O. Bégot, C. Flécheux …………………………………………………………………………………..……………… p. 33<br />
7 séminaires :<br />
- Littérature, esthétique, écologie (II) : J.P. Courtois (S1, S3) ……………………………………………………………..…… p. 34<br />
- Lecture de Shakespeare : mesure pour mesure : J. Delabroy (S1, S3) ……………………..…………………………… p. 35<br />
- Apocalypse et apocalyptismes : C. Coquio (S1, S3) ……………………………………………………………………….……... p. 36<br />
- Surface et profondeur : C. Nau, D. Arnaud (S2, S4) ………………………………………………………………………………. p. 37<br />
- La mémoire du monde : B. Bricout (S2, S4) …………………………………………………………………………………….……. p. 38<br />
- L’intranquilité <strong>à</strong> l’œuvre : R. Salado (S2, S4) …………………………………………………………………………………………. p. 39<br />
- Atelier de recherches et de création (ACR) : C. Flécheux (S2, S4) …………………………………………………………. p. 40
Questions de théorie littéraire et esthétique<br />
Cours commun aux trois spécialités<br />
Responsable : José-Luis Diaz Mercredi 18h - 20h <strong>à</strong> chaque semestre<br />
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants un panorama des théories critiques existantes. Une<br />
bibliographie essentielle sera distribuée au début du semestre. L’évaluation consiste en un travail en<br />
temps limité, en trois heures, portant sur deux des questions traitées en cours.<br />
Début du cours : le 26 septembre 2012<br />
Semestre 1 : L’objet 1) F. Dumora / 2) J-L. Diaz / 3) S. Lucet / 4) P. Vilar, N. Piegay-Gros, E. Marty<br />
/ 5) J. Nacache<br />
I. « Abolis bibelots de l’âge classique » (2 cours) :<br />
Florence DUMORA<br />
Si les choses ne sont plus ce qu’elles étaient… elles n’étaient pas non plus ce qu’elles sont. Longtemps même elles<br />
n’existèrent pas sous ce nom. « Chose », mot supplétif large, reste jusqu’<strong>à</strong> Littré étranger <strong>à</strong> notre définition<br />
matérielle, tandis qu’« objet », introduit dans le vocabulaire philosophique au Moyen Âge, est défini <strong>à</strong> l’âge<br />
classique dans sa relation avec les sens, l’imagination, l’entendement ou les passions, et non comme artefact –<br />
lequel peine <strong>à</strong> se faire place dans le domaine de la pensée. Le XVII e siècle n’énonce explicitement aucun « parti pris<br />
des choses », mais son goût pour les collections de curiosités et le splendide avènement en peinture de la nature<br />
morte, ainsi que la truculence descriptive de certains romans invitent <strong>à</strong> réfléchir <strong>à</strong> cette acception manquante, et <strong>à</strong><br />
l’intuition selon laquelle les choses entreraient en littérature avec le roman réaliste – quand le Grand Cyrus, dès<br />
1651, était connu comme « le livre du monde le mieux meublé ». On explorera d’abord le statut, circonscrit mais<br />
intéressant, des objets et de leur description dans la fiction et la philosophie, puis au théâtre et en peinture, en<br />
mesurant la part des discours symbolique, pratique et artistique attachés <strong>à</strong> la magie de la chevillette et du<br />
microscope, aux passions scéniques de l’épée ou de la cassette, et <strong>à</strong> la vie tranquille (still life) de la gaufrette et du<br />
corbillon.<br />
Eléments de bibliographie :<br />
- S. ALPERS, L’Art de dépeindre, Gallimard, 1990.<br />
- Michel FOUCAULT, Les Mots et les choses, Gallimard, 1966.<br />
- Kristopher POMIAN, Collectionneurs, amateurs, curieux : <strong>Paris</strong>-Venise, XVI e - XVIII e siècles, Gallimard, 1987.<br />
II. L’objet au XIX e siècle (4 cours) :<br />
À mesure que le siècle avance, l’industrialisation, la fabrication en série, la consommation de masse placent les<br />
objets sur le devant de la scène : le bibelot s’affiche, la vitrine met en spectacle la marchandise, la publicité<br />
naissante l’institue en objet de désir, le musée s’institue et se nationalise, le bazar exhibe son bric-<strong>à</strong>-brac. Le statut<br />
esthétique de l’objet est nécessairement pris dans cette révolution. L’être-l<strong>à</strong> des choses advient en particulier au<br />
roman, où il provoque une inflation du descriptif. Ces trois séances se proposent d’observer les effets principaux<br />
d’une telle mutation.<br />
- José-Luis DIAZ : - Le nouveau statut de l’objet : marchandises, expositions, collections, bazars…<br />
- Des choses-signes au bric-<strong>à</strong>-brac balzacien<br />
- L’objet en régime réaliste (Stendhal, Flaubert, Goncourt, Zola)<br />
- Sophie LUCET : - L’objet fin-de-siècle<br />
Eléments de bibliographie :<br />
- Roland BARTHES, « L’effet de réel » (1968), Littérature et réalité, Seuil, coll. « Points », p. 81-90.<br />
- ID., « Sémantique de l’objet », L’Aventure sémiologique, <strong>Paris</strong>, Seuil, « Points », 1985, p. 249-260.<br />
- Jean BAUDRILLARD, Le Système des objets, Gallimard, 1968.<br />
- Claude DUCHET, « Roman et objets. L’exemple de Madame Bovary », Europe, sept.-nov. 1969, p. 11-43.<br />
Repris dans Travail de Flaubert, Seuil, coll. « Points », 1983.<br />
- Juliette FRÖLICH, Des hommes, des femmes et des choses : langages de l’objet dans le roman de Balzac <strong>à</strong><br />
Proust, PU de Vincennes, 1997.<br />
- Dominique PETY, Poétique de la collection au XIX e siècle. Du document de l’historien au bibelot de l’esthète,<br />
PU de <strong>Paris</strong>-Ouest, 2010.<br />
- Clément ROSSET, Le Réel. Traité de l’idiotie, Minuit, 1977.<br />
7
- ID., L’Objet singulier, Minuit, 1979.<br />
- De l’objet <strong>à</strong> l’œuvre, textes réunis par Gisèle Séginger, PU de Strasbourg, 1997.<br />
- Dossier sur « Les choses », Le Magasin du XIX e siècle, 2012.<br />
III. L’objet au XX e siècle (3 cours) :<br />
- Pierre VILAR : Équations de l'objet dans le surréalisme<br />
- Eric MARTY : Le Parti pris des choses (Francis Ponge)<br />
- Nathalie PIEGAY-GROS : Les choses selon Georges Perec et le Nouveau Roman<br />
Eléments de bibliographie :<br />
- Emmanuel GUIGON, L’Objet surréaliste, Jean-Michel Place, 2005.<br />
- François DAGOGNET, Les dieux sont dans la cuisine, Philosophie de l’objet et objets de la philosophie, Les<br />
empêcheurs de penser en rond, 1996<br />
- Gérard WACJMAN, L’objet du siècle, Verdier, coll. Philia, 1998.<br />
Catalogues :<br />
- La révolution surréaliste, Centre Georges Pompidou, 2002.<br />
- Choses du surréalisme, Musée Guggenheim, Bilbao, et Victoria and Albert Museum, London, 2008.<br />
- Surreale Dinge, Skulpturen und Objekte von Dalí bis Man Ray - « Objets surréalistes. Œuvres en trois<br />
dimensions de Dalí <strong>à</strong> Man Ray”, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 2011.<br />
IV. L’objet cinématographique (3 cours) :<br />
Jacqueline NACACHE<br />
Le corps humain, venu du théâtre, n’avait rien de neuf au cinématographe ; l’objet en revanche en fut la grande<br />
découverte. « Il n’est de théâtre que de l’homme », écrit Bazin, « mais le drame cinématographique peut se passer<br />
d’acteurs. Une porte qui bat, une feuille dans le vent, les vagues qui lèchent une plage peuvent accéder <strong>à</strong> la<br />
puissance dramatique. » L’écran, dans la filiation de la peinture, donne <strong>à</strong> l’objet une nouvelle dignité. Le muet<br />
invente d’abord l’objet-qui-parle, le surcharge de sens, l’enferme dans l’insert. Le parlant ne le libère que pour le<br />
rendre plus éloquent : les corps se réifient, les objets s’humanisent, comme ce « Rosebud » dans lequel se dépose<br />
tout le mystère de Citizen Kane. Les genres produisent une collection de fétiches, et les cinéastes élaborent leurs<br />
musées d’objets : Chaplin, Lubitsch, Hitchcock dont le cinéma est une leçon de choses ; Bresson, Becker, Resnais,<br />
Tarkovski, chez lesquels l’objet se tait enfin, devenant pure présence, muette et sensible. Lié <strong>à</strong> la forme, au sens, au<br />
récit, <strong>à</strong> la plasticité visuelle et sonore, l’objet est le point où se rencontrent idéalement histoire et théorie du<br />
cinéma.<br />
Eléments de bibliographie :<br />
- AUMONT Jacques, « L'objet cinématographique et la chose filmique », Cinémas : revue d'études<br />
cinématographiques, vol. 14, numéro 1, 2003, pp.179-203.<br />
- AUMONT Jacques, L’Œil interminable. Cinéma et peinture, <strong>Paris</strong>, Séguier, 1989, rééd. La Différence,<br />
2007.<br />
- BAZIN André, Qu'est-ce que le cinéma ?, <strong>Paris</strong>, Le Cerf, 2005, coll. 7 e art.<br />
- COSTA DE BEAUREGARD Raphaëlle, MENEGALDO Gilles, SALEH Zenat (dir.), Le Cinéma et ses objets,<br />
Poitiers, La Licorne, 1997.<br />
- EPSTEIN Jean, « L’intelligence d’une machine », Ecrits sur le cinéma, tome 1, 255-334, <strong>Paris</strong>, Seghers,<br />
1974.<br />
Semestre 2 : Le personnage (4 cycles de trois séances) G. Hautcoeur / J-L. Diaz / R. Salado / S.<br />
Lucet<br />
Bibliographie :<br />
- Émergences du personnage moderne XVI e -XVIII e siècles (Guiomar Hautcoeur)<br />
- Le personnage de roman, entre Balzac et Proust (José-Luis Diaz)<br />
- Dissolution et résistance du personnage dans le contexte des modernités (Régis Salado)<br />
- Le personnage de théâtre (Sophie Lucet)<br />
Émergences du personnage moderne XVI e -XVIII e siècles :<br />
- Anthony Cascardi, Subjectivité et modernité, <strong>Paris</strong>, PUF, 1992.<br />
- C Esmein., Poétiques du roman. Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques du XVII e siècle<br />
sur le genre romanesque, <strong>Paris</strong>, Champion, 2004.<br />
- D.-H. Pageaux., Naissances du roman, <strong>Paris</strong>, Klincksieck, 1995.<br />
- Charles Taylor, Les Sources du Moi. La formation de l’identité moderne, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1998 [1989].<br />
8
Le personnage de roman, entre Balzac et Proust :<br />
- Francis Berthelot, Le Corps du héros. Pour une sémiologie de l’incarnation romanesque, Nathan, « Le texte <strong>à</strong><br />
l’œuvre », 1997.<br />
- Pierre Glaudes et Yves Reuter, Le Personnage, PUF, « Que sais-je ? », 1998.<br />
- Philippe Hamon, « Pour un statut sémiologique du personnage », in R. Barthes et alii, Poétique du récit, Seuil,<br />
coll. « Points », 1977.<br />
- Vincent Jouve, L’Effet-personnage dans le roman, PUF, « Écriture », 1992.<br />
- Jean-Philippe Miraux, Le Personnage de roman, Nathan, coll. « 128 », 1997.<br />
- Jean-Yves Tadié, Proust et le roman, Gallimard, « Tel », 1971.<br />
Dissolution et résistance du personnage dans le contexte des modernités<br />
- Jacques Bouveresse, La Connaissance de l’écrivain (Sur la littérature, la vérité et la vie), Agone, 2008.<br />
- Dorrit Cohn, La Transparence intérieure, Seuil, « Poétique », 1981 [Transparent Minds, 1978].<br />
- Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Seuil, 1965 [Opera aperta, 1962]<br />
- Laurent Jenny, La Fin de l’intériorité, <strong>Paris</strong>, PUF, « Perspectives littéraires », 2002.<br />
- Milan Kundera, L’Art du roman, Gallimard, « Folio-essais », 1975.<br />
- Modernism – A Guide to European Literature 1890-1930, ed. by Malcom Bradbury and James McFarlane,<br />
Penguin Books, 1991 [1976 pour la première edition].<br />
- Jean Molino et Raphaël Lafhail-Molino, Homo Fabulator – Théorie et analyse du récit, Leméac/Actes Sud,<br />
2003, [en particulier, ch. V « les Personnages », alinéa « Crise et mort du personnage : un être de papier ? »,<br />
p. 166-172].<br />
Le personnage de théâtre<br />
- Constantin Stanislavski, La Construction du personnage [1929-1930] (Building a character, 1949), traduction<br />
de Charles Antonetti, préface de Bernard Dort, Pygmalion, 2006.<br />
- Annie Ubersfeld, Lire le théâtre, Éditions sociales, <strong>Paris</strong>, 1977.<br />
- Robert Abirached, La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Grasset, 1978, Tel Gallimard, 1994.<br />
- -Id., article « Personnage », in Dictionnaire encyclopédique du théâtre de Michel Corvin, Larousse-Bordas,<br />
1998.<br />
- Patrice Pavis, article « Personnage », in Dictionnaire du théâtre, Messidor, 1986.<br />
- Christian Biet et Christophe Triau, « Le corps, le jeu du comédien, l’illusion », in Qu’est-ce que le théâtre,<br />
Folio essais, 2006, pp. 441-535.<br />
- Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon, Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition,<br />
éditions théâtrales, 2006.<br />
- Georges Zaragoza, Le Personnage de théâtre, « Lettres sup », Armand Colin, 2006.<br />
Modalités d'évaluation : Examen 100%. 2 sujets au choix (sur trois proposés) <strong>à</strong> traiter en trois heures.<br />
Conférences Clefs de contact<br />
Responsables : Laurent ZIMMERMANN (3 séances), Isabelle BARBERIS (3 séances)<br />
Mercredi 12h – 15h (semestre 1)<br />
Ce cycle de six conférences de deux heures est destiné <strong>à</strong> mettre en contact les étudiants en master 1 de Lettres, arts<br />
et pensée contemporaine avec des personnalités du monde professionnel qui viendront présenter leur métier ou<br />
leur fonction. Toutes exercent dans des domaines susceptibles d'offrir des perspectives de débouchés<br />
professionnels <strong>à</strong> des étudiants de masters littéraires, ayant tiré bénéfice de leur formation de manière directe ou<br />
indirecte. Chacune évoquera son expérience dans ce domaine. Qu'il s'agisse de critiques (journalistes ou non),<br />
d'éditeurs, de libraires, de hauts fonctionnaires (dans l'administration ou par exemple le compte rendu des débats<br />
parlementaires), d’acteurs de la vie culturelle, de comédiens ou de chercheurs, conservateurs de musée ou<br />
animateurs de galeries, ils pourront <strong>à</strong> l'issue de leur présentation s'entretenir avec les étudiants.<br />
L’assiduité au cycle complet est obligatoire.<br />
Un calendrier des conférences sera fourni <strong>à</strong> la rentrée.<br />
Modalités d'évaluation : l’évaluation portera, pour ce cycle de conférences, sur la rédaction d’un rapport de séance<br />
détaillé et documenté, selon des critères définis avec l’enseignant responsable.<br />
9
Cours de Méthodologie de la recherche (<strong>à</strong> l'usage des candidats au Master 1)<br />
Responsable : X Lundi 18h - 20h (6 séances de 2h)<br />
Dans ce bref cours, nous allons aborder les différentes phases de la rédaction d'un mémoire de Master 1<br />
depuis l'examen du sujet en cause, jusqu'aux problèmes de réalisation (présentation du mémoire et normes), en<br />
passant par les méthodes de recherche d'information et les méthodes de travail qui devraient conduire les<br />
étudiants <strong>à</strong> avoir un produit achevé au début du mois de juin.<br />
Modalités d'évaluation : Remise d’un échéancier du mémoire.<br />
10
Spécialité<br />
« LITTÉRATURE, HISTOIRE, SOCIÉTÉ »<br />
Responsable : Jean VIGNES<br />
Notre spécialité propose d’envisager la littérature française depuis ses origines, dans son<br />
rapport <strong>à</strong> l’Histoire et aux évolutions majeures de la société. Pour étudier conjointement l’inscription<br />
historique des formes littéraires et l’écriture de l’Histoire dans sa dimension littéraire, elle articule deux<br />
types d’enseignements.<br />
Les uns proposent une approche historique et critique de la littérature. On y étudie sous tous<br />
ses angles le phénomène littéraire : formes, genres, théories rhétoriques et poétiques, mouvements et<br />
milieux littéraires. On s’intéresse <strong>à</strong> la condition sociale des auteurs et des publics : stratégies de carrière,<br />
institutions littéraires, usages éditoriaux et modes de diffusion, espaces de sociabilité. Pour<br />
appréhender ces évolutions, on fait appel aux travaux des historiens et des philosophes, de manière <strong>à</strong><br />
mettre en évidence les enjeux éthiques et idéologiques (politiques ou religieux) du travail esthétique.<br />
Nous n’oublions pas l’histoire du livre, sa naissance, ses conditions de diffusion, sa matérialité. Ces<br />
approches, dans l’esprit de <strong>Paris</strong> 7, s’appuient sans exclusive sur les travaux critiques modernes, avec le<br />
souci de penser une histoire de la critique littéraire. Elles n’hésitent pas non plus <strong>à</strong> se nourrir de l’apport<br />
des autres sciences humaines : anthropologie, sociologie, psychanalyse, linguistique.<br />
L’autre domaine de nos enseignements explore la façon dont l’Histoire s’écrit, se construit, se<br />
pense, s’imagine <strong>à</strong> travers les témoignages et l’historiographie : textes des historiens, mémoires,<br />
correspondances, journaux, biographies et autobiographies, etc. Mais il s’agit aussi de comprendre<br />
comment l’Histoire travaille et irrigue les œuvres littéraires ou cinématographiques, et tous types de<br />
documents susceptibles d’une analyse attentive aux faits de langue.<br />
Notre spécialité invite donc <strong>à</strong> croiser un regard historique sur la littérature et un regard littéraire<br />
sur l’Histoire, de manière <strong>à</strong> saisir leurs évolutions. Cette ambition est favorisée par la présence dans<br />
notre équipe de spécialistes de l’Antiquité, du Moyen âge, de la Renaissance, de l’Age classique, des<br />
Lumières, du XIX e siècle et de l’époque contemporaine. Il nous importe de poser les bases d’une histoire<br />
de la littérature française dans sa continuité, mais en la soumettant constamment <strong>à</strong> des méthodes<br />
innovantes.<br />
11
Programme :<br />
COURS de M1-M2 / S1-S3<br />
Jeudi 10h - 12h<br />
La fonction auteur<br />
Approche historique<br />
12<br />
Anne Paupert,<br />
Pascal Debailly,<br />
José-Luis Diaz,<br />
Jean Vignes<br />
Au fil des siècles émerge et s’affirme de plus en plus nettement une entité qui assume et revendique face<br />
au public des lecteurs la responsabilité du texte, sa paternité symbolique : depuis le XV e siècle, nous l’appelons<br />
l’auteur. Dans quelles circonstances historiques, économiques, sociales et juridiques s’affirme cette « figure<br />
auctoriale » ? Comment s’impose-t-elle en tant qu’autorité intellectuelle, mais aussi en tant que puissance<br />
créatrice, porteuse d’innovation ? Quelles stratégies littéraires et sociales mettent en œuvre les écrivains pour<br />
s’affirmer en tant qu’auteurs ? Dans quels domaines la notion d’auteur tend-elle <strong>à</strong> organiser le champ littéraire<br />
(relations avec les mécènes et protecteurs, avec les imprimeurs, les éditeurs, les libraires, ou avec le « lecteur »<br />
anonyme, devenu interlocuteur et destinataire idéal). On s’intéressera enfin aux instances juridiques, aux espaces<br />
de sociabilité et aux institutions littéraires qui consacrent l’auteur : académies, salons, sociétés d’auteurs,<br />
anthologies, revues, concours et prix littéraires, programmes scolaires et universitaires, etc.<br />
12 (4 x 3) séances de deux heures assurées par quatre spécialistes des périodes envisagées.<br />
- Séances 1 <strong>à</strong> 3 : Le Moyen Âge (Anne Paupert)<br />
- Séances 4 <strong>à</strong> 6 : La Renaissance (Jean Vignes)<br />
- Séances 7 <strong>à</strong> 9 : L’Âge classique (Pascal Debailly)<br />
- Séances 10 <strong>à</strong> 12 : Le XIX e siècle (José-Luis Diaz)<br />
Bibliographie :<br />
- Roland Barthes, « La mort de l’auteur » (1968), article repris dans Le Bruissement de la langue, <strong>Paris</strong>, Seuil,<br />
1984.<br />
- Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur », Bulletin de la Société française de Philosophie, juilletseptembre<br />
1969, n° LXIV, p. 73-140, repris dans le revue Littoral, 1983, n° 9, p. 3-32, et dans M. Foucault,<br />
Dits et Écrits, Gallimard, coll. « Quarto », t. I, 1969.<br />
- Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1970 – rééd. coll. Points, 2000 (en particulier,<br />
introduction et chapitres 1 et 2, « La nuit des temps » et « Le poète et le texte »).<br />
- Paul Bénichou, Le Sacre de l’écrivain (1750-1830), José Corti, 1973.<br />
- Marie-Claude Dock, « Genèse et évolution de la propriété littéraire », Revue internationale du droit<br />
d’auteur, LXXIX, janvier 1974, p. 127-205.<br />
- Alain Viala, Naissance de l’écrivain, <strong>Paris</strong>, Minuit, 1985.<br />
- Images de l’écrivain, Textuel n° 22, <strong>Paris</strong> 7, 1989.<br />
- Maurice Couturier, La Figure de l’auteur, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1995.<br />
- Alain Goulet éd., L’Auteur, colloque de Cerisy-la-Salle, PU Caen, 1996.<br />
- Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1998. Voir chap. II.<br />
- José-Luis Diaz, « La notion d’auteur (1750-1850) », Histoires littéraires, oct.-déc. 2000, 4, p. 77-93.<br />
- Alain Brunn, L’Auteur, <strong>Paris</strong>, Flammarion, coll. « GF-Corpus lettres », 2001,<br />
- François Rigolot, Poésie et Renaissance, <strong>Paris</strong>, Seuil, coll. « Points », 2002. 2 e partie : « La naissance du<br />
poète-auteur », p. 65-113.<br />
- José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales <strong>à</strong> l’époque romantique (1770-1850),<br />
Champion, 2007.<br />
Modalités d’évaluation : Une seule note. Examen terminal écrit.
Le souverain monstrueux :<br />
COURS de M1-M2 / S2<br />
Mardi 17h - 19h<br />
Littérature et histoire<br />
13<br />
Emmanuel Valette,<br />
Florence Lotterie,<br />
Hélène Baty<br />
L’histoire, écrit Victor Hugo, est une « galerie de monstres ». On explorera cette galerie pour, de<br />
l’Antiquité aux mondes contemporains, en retenir quelques images, certaines légendaires, d’autres historiques,<br />
afin d’interroger les traits de monstruosité, anormalité, déviance, pathologie associées <strong>à</strong> la figure du tyran et la<br />
représentation, ou construction, du souverain monstrueux dans la mise en récit de l’Histoire.<br />
Le descriptif précis, accompagné de la brochure des textes et images correspondant <strong>à</strong> chaque cycle de quatre<br />
séances, sera fourni <strong>à</strong> la rentrée par chacune des trois enseignantes en début de cours.<br />
Modalités d’évaluation : Un examen sur table en fin de semestre.
Séminaire M1-M2 / S1-S3<br />
Mercredi 15h - 17h<br />
Ecrire sous menace, écrire la menace<br />
14<br />
Carine Trevisan,<br />
Anny Dayan-Roseman<br />
Ce séminaire étudiera des textes de nature et d’époques différentes, mais qui témoignent tous d’une<br />
expérience similaire : celle d’un contact intime de l’auteur ou du personnage avec la menace de son propre<br />
anéantissement, physique ou psychique. Le mot lui-même, « menace », renvoie <strong>à</strong> des contextes qu’il importe de<br />
préciser. Dans les textes présentés ici, la puissance qui enveloppe et saisit l’individu est toujours liée, directement<br />
ou indirectement, <strong>à</strong> l’exercice du pouvoir : la guerre, les persécutions raciales ou politiques, l’emprisonnement et<br />
l’enfermement arbitraires, les déportations et les exécutions sont des situations extrêmes où la mort (possible ou<br />
certaine) n’est jamais une mort « naturelle », mais une mort violente légitimée par l’Etat, qui ne relève donc pas de<br />
la violence « privée ».<br />
L’époque ouverte par la Première Guerre mondiale, avec la « brutalisation » des sociétés européennes qui l’a<br />
suivie, s’est rapidement révélée « une machine <strong>à</strong> liquider permanente », selon l’expression d’Imre Kertesz. La<br />
menace touche <strong>à</strong> la peur, que nous examinerons également, notamment dans les projets totalitaires.<br />
Nous étudierons la façon dont les textes évoquant la menace ou la peur s’arrachent souvent <strong>à</strong> la tentation<br />
du silence et de l’anesthésie de la pensée ou de la créativité.<br />
Comme nous l’avons vu l’an dernier, l’expérience de la menace peut aussi induire chez celui qui y a<br />
survécu un silence mortifère qui tient lieu d’héritage et les textes de descendants évoquant ces situations<br />
extrêmes se présentent souvent comme des confrontations, par l’écriture <strong>à</strong> un secret de famille ou <strong>à</strong> un noyau de<br />
silence<br />
Bibliographie :<br />
- Hélène Berr, Journal<br />
- Vercors, Le silence de la mer et autres nouvelles<br />
- Victor Klemperer, Mes soldats de papier<br />
- J.M. Coetzee, Mickael K. sa vie, son œuvre<br />
- Kafka, le Terrier<br />
- Kertesz, Etre dans destin<br />
- C. Mouchard, Qui si je criais…<br />
- N. Mandelstam, Contre tout espoir<br />
- Philippe Grimbert, Un secret<br />
- Kressman Taylor, Inconnu <strong>à</strong> cette adresse .<br />
Modalités d'évaluation :<br />
Un dossier <strong>à</strong> remettre impérativement en fin de séminaire et/ou un exposé oral (dans ce cas : 50% pour le dossier ;<br />
50 % pour l'exposé).
Descriptif :<br />
Séminaire M1-M2 / S1-S3<br />
Mercredi 15h - 18h<br />
José-Luis Diaz (en Bibliothèque J. Seebacher, GM, Bât. A, 2 e étage),<br />
Avec la collaboration de Jean-Didier Wagneur (BnF)<br />
Révolutions de la littérature (1830-1891)<br />
Le séminaire se propose d’étudier les mutations qui affectent la littérature en cette époque d’accélération<br />
de l’histoire littéraire.<br />
On prêtera d’abord attention aux transformations de la temporalité littéraire, dont les contemporains<br />
essaient de rendre de compte en ayant recours <strong>à</strong> des notions politiques (révolution, réforme, crise, réaction, etc.)<br />
La réflexion portera ensuite sur les grands changements structurels qui affectent le « champ littéraire » :<br />
sacre de l’écrivain, théâtralisation de la vie littéraire, subjectivation de la littérature, révolutions de la<br />
communication littéraire, nouvelles formes de sociabilités littéraires, « biographisation » de la littérature<br />
redéfinitions de la notion même de littérature, statut changeant de la critique, batailles littéraires, industrialisation<br />
de la littérature, importance prise par les diverses formes de la presse (journal, petit-Journal, revue), mythologies<br />
littéraires (le poète, l’artiste, le dandy littéraire, la vie de bohème), etc.<br />
Les séances tiendront compte de la chronologie de mutations <strong>à</strong> l’œuvre, en guettant l'émergence du<br />
« nouveau » : nouvelles « écoles », nouveaux genres, nouvelles « scénographies auctoriales », nouveaux « ethos »,<br />
nouveaux écrivains-phares, etc.<br />
Dans la continuité du séminaire de l’an dernier, une place de choix sera faite aux analyses contemporaines<br />
du champ littéraire que proposent écrivains et journalistes, se faisant les ethnologues de leur propre tribu.<br />
Quelques textes d’étude :<br />
- Code du littérateur et du journaliste, par un entrepreneur littéraire (1829).<br />
- BALZAC, « De la mode en littérature » (1830), Illusions perdues (1837-1843), Monographie de la presse<br />
parisienne (1842)<br />
- GAUTIER, Les Jeunes-France, romans goguenards (1833) ; Mademoiselle de Maupin (1835-1836), Les<br />
Grotesques (1844).<br />
- BAUDELAIRE, La Fanfarlo (1849).<br />
- GONCOURT, Journal de la vie littéraire (1851-1896), Charles Demailly (1860).<br />
- VALLES, Les Réfractaires (1865).<br />
- VERLAINE, Les Poètes maudits (1884).<br />
- H. BEAUCLAIR et G. VICAIRE, Les Déliquescences d’Adoré Floupette (1888).<br />
- Jules HURET, Enquête sur l’évolution littéraire (1891).<br />
Modalités d'évaluation : Un dossier sur un sujet en rapport avec le séminaire, en accord avec les enseignants.<br />
15
Descriptif :<br />
Séminaire M1-M2 / S1-S3<br />
Mardi 9h - 11h<br />
Figures du poète dans le texte poétique<br />
16<br />
Jean Vignes<br />
Qu’est-ce que la Poésie ? Qu’est ce qu’un Poète ? D’Homère <strong>à</strong> Léo Ferré, en passant par Du Bellay,<br />
Ronsard, La Fontaine, Chénier, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Breton (pour s’en tenir <strong>à</strong><br />
quelques figures emblématiques), les représentations du poète, la nature propre du verbe poétique et les<br />
fonctions qu’on lui prête font l’objet de débats passionnés, mis en scène avec éclat dans les textes poétiques euxmêmes.<br />
Pour éclairer ces lignes de fracture et en mesurer les enjeux, on fera notamment comparaître quelques<br />
couples notionnels féconds, parce qu’objets de controverses : poète et orateur, poète et prosateur, poète et<br />
versificateur, poète et prophète, poète et historien, poète et musicien, poète et prince, poète et courtisan, poète<br />
et joueur de quilles…<br />
Dans le cadre d’exposés oraux ou de dossiers rédigés les étudiants seront invités <strong>à</strong> repérer et <strong>à</strong> comparer les<br />
figures du poète et les représentations de la poésie dans des textes poétiques et/ou théoriques d’époques variées.<br />
Modalités d’évaluation : exposé oral ou dossier de recherche en rapport avec le sujet du séminaire.
Descriptif :<br />
Séminaire M1-M2 / S1-S3<br />
Mercredi 16h - 18h<br />
Le Merveilleux au XIXè siècle<br />
17<br />
Paule Petitier<br />
Le siècle du rationalisme, du réalisme, du positivisme, du naturalisme, du scepticisme, ce siècle<br />
« désenchanté », s’est pourtant intéressé au merveilleux. La littérature du XIXe siècle redécouvre le merveilleux<br />
populaire, qui devient partie prenante de sa bibliothèque imaginaire, mais elle invente aussi de nouvelles formes,<br />
de nouvelles écritures du merveilleux, que ce soit dans la poésie (Les Chimères de Nerval), dans le récit (les Contes<br />
d’Andersen, Alice au pays des merveilles) ou au théâtre (le genre de la féerie). Laïcisé, le merveilleux se glisse dans<br />
l’histoire, lançant un défi aux capacités herméneutiques de cette discipline (La Sorcière de Michelet). Il ressurgit<br />
dans la littérature dérivée de la science (romans de Jules Verne, vulgarisation scientifique), qui prétend<br />
réenchanter le monde en le faisant découvrir tel que l’on ne l’a jamais vu. Le merveilleux hante même le roman<br />
réaliste et naturaliste, comme son envers et son complice. Les formes prises par le merveilleux dans l’illustration<br />
(Grandville, Gustave Doré), la peinture et la musique (Berlioz) seront également abordées.<br />
Bibliographie indicative :<br />
- Charles Nodier, La Fée aux miettes.<br />
- George Sand, Contes d’une grand-mère, La Petite Fadette, Voyage dans le cristal.<br />
- Balzac, La Dernière Fée.<br />
- Nerval, Les Chimères.<br />
- Zola, Le Rêve, La Faute de l’abbé Mouret.<br />
- Michelet, La Sorcière, La Mer.<br />
- Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers.<br />
- Andersen, Contes.<br />
- Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles.<br />
- Victor Hugo, Théâtre en liberté.<br />
Modalités d’évaluation :<br />
Pour valider le séminaire, les étudiants rendront un dossier de 10 pages portant sur le sujet du séminaire et défini<br />
en accord avec le responsable de celui-ci.
Descriptif :<br />
Séminaire M1-M2 / S2-S4<br />
Mercredi 15h - 17h<br />
Éros et catharsis comique (Suite) :<br />
hystérie et histrionisme chez Molière et George Feydeau<br />
18<br />
Pascal Debailly<br />
Nous avons en 2012 travaillé sur la question du mariage chez Feydeau, <strong>à</strong> la lumière de nos précédents<br />
séminaires sur Molière. Nous nous sommes principalement appuyés sur Le Dindon, Le Fil <strong>à</strong> la patte et Feu la mère<br />
de Madame. La question du mariage, centrale chez les deux auteurs n’est pas un thème ; elle est consubstantielle<br />
<strong>à</strong> leur conception du comique.<br />
Nous continuerons en 2013 <strong>à</strong> comparer les deux univers comiques en les approfondissant sous l’angle de<br />
l’hystérie. Les grands maniaco-dépressifs du théâtre de Molière comme les pantins survoltés de Feydeau sont <strong>à</strong><br />
leur manière des hystériques. Tous ces personnages font preuve d’un excès émotionnel parfois incontrôlable et<br />
d’un goût prononcé pour la simulation, la représentation, la théâtralisation… Tous sont atteints d’une raideur<br />
mécanique et parfois convulsive. Tous sont prisonniers de leurs obsessions et de leurs manies. On sait que<br />
Feydeau est passionné par l’hystérie, qui est très <strong>à</strong> la mode <strong>à</strong> la fin du XIXe siècle. Mais il sera intéressant de<br />
mettre cette problématique <strong>à</strong> l’épreuve du théâtre moliéresque par le biais notamment de l’histrionisme. Nous<br />
nous efforcerons de préciser ainsi la nature du lien qui unit éros et comique. Comme les années précédentes,<br />
notre méthode d’approche vise <strong>à</strong> forger des instruments critiques pour aborder la question du comique et du rire.<br />
Nous poursuivrons en particulier nos investigations sur certaines formes du rire : le rire collectif, le rire sacrificiel,<br />
le fou rire, le rire du bébé…<br />
Bibliographie de base :<br />
- FEYDEAU, George, Théâtre, <strong>Paris</strong>, Presses de la Cité, Omnibus, 1995.<br />
- GIDEL, Henry, Le Théâtre de Feydeau, <strong>Paris</strong>, Klincksieck, 1970.<br />
- HEYRAUT, Violaine, Répétition et mécanismes chez Feydeau (1880-1916). Comédie, psyché, langage (Thèse,<br />
<strong>Paris</strong> X, 2009).<br />
- MAURON Charles, Des Métaphores obsédantes au mythe personnel, Introduction <strong>à</strong> la psychocritique, <strong>Paris</strong>,<br />
José Corti, 1988.<br />
- MAURON Charles, Psychocritique du genre comique, <strong>Paris</strong>, José Corti, 1982.<br />
- MOLIÈRE, Théâtre complet.<br />
Modalités d’évaluation :<br />
L’évaluation du séminaire consiste en la rédaction d’un travail personnel de réflexion d’une dizaine de pages <strong>à</strong><br />
partir des œuvres étudiées et de l’une des notions analysées pendant le semestre.
Séminaire M1-M2 / S2-S4<br />
Mardi 17h - 19h<br />
Modernité de Christine de Pizan<br />
19<br />
Anne Paupert<br />
Modernité de Christine de Pizan (1364 -1431): lectures plurielles d’une « femme de lettres » du Moyen Âge.<br />
On s’interrogera sur l’étonnante popularité récente d’une écrivaine totalement ignorée ou jugée avec<br />
mépris par la plupart des critiques du XIX e et du début du XX e siècle. Citée par Simone de Beauvoir dès le premier<br />
chapitre de son Deuxième Sexe, encore peu connue du grand public mais célébrée (ou parfois contestée) par les<br />
féministes, notamment aux Etats-Unis, désormais bien connue des spécialistes grâce <strong>à</strong> des éditions récentes, son<br />
œuvre a donné lieu dans les dernières décennies <strong>à</strong> une bibliographie critique considérable qui ne cesse de<br />
s’accroître. L’auteure a sa place <strong>à</strong> la table imaginaire et monumentale des femmes remarquables créée en 1979<br />
par l’artiste Judy Chicago sous le titre « The Dinner Party ». Elle mérite de retrouver aussi la place qui lui est due<br />
dans les études littéraires, en France comme ailleurs. Et son œuvre représente un objet intéressant pour une<br />
étude de la réception <strong>à</strong> travers les époques, du XVe au XXIe siècle.<br />
Après une lecture attentive de quelques-unes de ses œuvres (les plus connues, la poésie lyrique, le Débat<br />
sur le Roman de la Rose et la Cité des Dames), on s’intéressera <strong>à</strong> leur réception, en s’attardant plus<br />
particulièrement sur le XVIe siècle (avec la participation de Chantal Liaroutzos) et sur les XXe et XXIe siècles.<br />
Outre les œuvres étudiées et les approches critiques présentées dans les séances du séminaire, d’autres<br />
aspects de l’œuvre de Christine de Pizan et des perspectives critiques très variées pourront être abordées <strong>à</strong><br />
l’occasion des travaux présentés par les participants. On n’exclura pas les représentations artistiques, miniatures,<br />
films ou arts plastiques.<br />
Œuvres étudiées<br />
- Christine de Pizan, Le livre de la Cité des Dames ; édition avec une traduction en français moderne par A.<br />
Paupert (<strong>à</strong> paraître aux éditions Champion, <strong>Paris</strong>, fin 2012-début 2013).<br />
- Traduction en français moderne par E. Hicks et T. Moreau (<strong>Paris</strong>, Stock / Moyen Âge, 1986).<br />
- Christine de Pisan, Oeuvres poétiques, éd. Maurice Roy, <strong>Paris</strong>, Firmin Didot, 1890 (photocopies).<br />
- Le Débat sur le Roman de la Rose, éd. Eric Hicks, 1977 - Slatkine reprints, Genève, 1996. D’autres textes<br />
seront distribués au cours du séminaire.<br />
Bibliographie : Une bibliographie détaillée sera donnée au début du séminaire.<br />
Lectures conseillées en introduction<br />
- Une biographie historique : Françoise Autrand, Christine de Pizan, <strong>Paris</strong>, Fayard, 2009.<br />
- Parmi les récents recueils d’articles consacrés <strong>à</strong> l’oeuvre de Christine de Pizan, vous pouvez regarder :<br />
- Une femme de Lettres au Moyen Age. Études autour de Christine de Pizan, éd. L. Dulac et B. Ribémont,<br />
Orléans, Paradigme, 1995.<br />
- Christine de Pizan, a casebook, ed. B. K. Altmann and D. L. McGrady, Routledge, New York and London,<br />
2003.<br />
- Desireuse de plus avant enquerre. Actes du 6 e colloque International Christine de Pizan, éd. L. Dulac, A.<br />
Paupert, C. Reno et B. Ribémont, <strong>Paris</strong>, Champion, collection « Etudes christiniennes », 2009.<br />
Modalités d’évaluation :<br />
Un exposé ou un travail écrit (environ 8 pages) portant sur un sujet au choix, <strong>à</strong> déterminer avec l’enseignante, en<br />
rapport avec le thème du séminaire.<br />
Nombre de crédits : 4 – Coefficient : 2
Argumentaire:<br />
Séminaire M1-M2 / S2-S4<br />
Mardi 14h – 16h<br />
Corps des Lumières : <strong>Diderot</strong> et la médecine<br />
20<br />
Florence Lotterie<br />
« Je veux qu’on se porte bien je le veux absolument, entendez-vous ? » C’est avec cette apostrophe que le<br />
Bordeu du Rêve de d’Alembert, figuration fictive du médecin réel, contributeur <strong>à</strong> l’Encyclopédie, se justifie auprès<br />
de la non moins fictive Mademoiselle de Lespinasse de ses audaces en matière de pratiques sexuelles. Ainsi se<br />
croiseront, chez <strong>Diderot</strong>, imaginaire libertin saisi par le « prétexte anatomique » (M. Delon), philosophèmes<br />
matérialistes, intuitions transformistes, moralisme réformateur soucieux de la santé comme (bio)politique (M.<br />
Foucault) : cette volonté de savoir polymorphe, entée sur une passion principielle pour la médecine qui peut aller<br />
jusqu’<strong>à</strong> défendre les vertus de la vivisection, engage le corps comme lieu d’expérimentation indissociablement<br />
esthétique, philosophique et politique, ouvrant notamment sur une reconfiguration possible des rapports de sexe<br />
et de genre. Les Lumières visionnaires, mélancoliques et (parfois) cruelles : c’est aussi cela que donne <strong>à</strong> saisir<br />
<strong>Diderot</strong>, et dont on explorera le mouvement obsédant en suivant le fil de la construction d’un savoir (la médecine)<br />
et de ses affects (la maladie et ses histoires) dans une traversée de l’œuvre, de la correspondance avec Sophie<br />
Volland en passant par les dialogues matérialistes, les romans, les textes médicaux, les Salons. De quel présent le<br />
matérialisme diderotien ainsi investi est-il alors, pour nous, le nom ? Que révèle-t-il, notamment, du rapport entre<br />
littérature et médecine ?<br />
Bibliographie :<br />
Corpus.<br />
Un dossier de textes (y compris quelques pages essentielles de Georges Canguilhem, Michel Foucault et alii) et<br />
d’illustrations sera mis <strong>à</strong> disposition afin de servir de base de travail et de discussion. Il serait toutefois souhaitable<br />
de lire en œuvre intégrale les titres suivants :<br />
- Les Bijoux indiscrets, Le Neveu de Rameau, Le Rêve de D’Alembert, La Religieuse, Mystification et le<br />
Supplément au voyage de Bougainville.<br />
Secondaire.<br />
- Gilles Barroux, Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle, <strong>Paris</strong>, Champion, 2008.<br />
- Michel Foucault, La Volonté de savoir, <strong>Paris</strong>, Gallimard, 1976.<br />
Id., « La politique de la santé au XVIIIe siècle », in Dits et écrits, II, Gallimard-Quarto, 2001, p. 725-742.<br />
- Gérard Danou (éd.), Littérature et médecine, ou les pouvoirs du récit, actes du colloque de juillet 2001, <strong>Paris</strong>,<br />
BPI, « en actes », 2001.<br />
- Jean Starobinski, Histoire de la médecine, Lausanne, Rencontre, 1964.<br />
- Aurélie Suratteau, « <strong>Diderot</strong> et la médecine, un matérialisme vitaliste ? », Recherches sur <strong>Diderot</strong> et<br />
l’Encyclopédie, 26, 1991, p. 173-195.<br />
- Alexandre Wenger, Le médecin et le philosophe. Théophile de Bordeu selon <strong>Diderot</strong>, <strong>Paris</strong>, Hermann, «<br />
Fictions pensantes », 2012.<br />
Modalités d’évaluation :<br />
Un dossier d’une vingtaine de pages inscrivant les problématiques du séminaire dans le traitement d’une œuvre ou<br />
d’un corpus choisi en accord avec l’enseignant.
Spécialité<br />
« LITTERATURES, THEORIES, MODERNITES »<br />
Responsable : Eric Marty<br />
Cette spécialité entend proposer aux étudiants un ensemble d’instruments conceptuels,<br />
méthodologiques et critiques leur permettant d’acquérir une autonomie dans la recherche et la<br />
rédaction de leurs travaux.<br />
Les étudiants seront confrontés aux exigences de la pensée contemporaine au travers de la<br />
question des théories des formes, de la littérature contemporaine, de l’anthropologie des systèmes<br />
symboliques.<br />
Il s’agit donc d’une spécialité pluridisciplinaire (littérature, théorie, psychanalyse, arts, critique,<br />
philosophie,…), qui promeut une réelle transversalité historique, sans découpage conventionnel par<br />
« siècles ». Par « modernités », il faut entendre le souci d’interpréter « les littératures » (modernes,<br />
antiques, classiques…) dans une perspective résolument innovante.<br />
Cette spécialité entend ainsi accueillir des étudiants pour qui la recherche dans le champ<br />
littéraire suppose tout <strong>à</strong> la fois une formation rigoureuse aux méthodes d’analyse contemporaines mais<br />
également un esprit critique, de la curiosité, et le désir de la découverte.<br />
21
Descriptif :<br />
COURS de M1-M2 / S1-S3<br />
Lundi 14h - 16h<br />
Penser le roman et la poésie<br />
22<br />
Nathalie Piégay-Gros,<br />
Laurent Zimmermann<br />
Il s'agira, dans ce cours, d'étudier successivement les grandes conceptions et théories du roman et de la poésie.<br />
Pour le roman, premier volet du cours, la réflexion s'articulera autour de trois grands axes : roman et<br />
réalité (le roman comme prise sur le réel ; questions de la représentation et du réalisme) ; roman et subjectivité<br />
(expériences de pensées propres au roman ; rapport <strong>à</strong> la temporalité ; romanesque) ; roman et vérité (quel<br />
rapport <strong>à</strong> la vérité instaure le roman ? quel savoir peut-il délivrer ?)<br />
Pour le deuxième volet, on donnera <strong>à</strong> entendre une réflexion sur la poésie en trois moments qui<br />
recoupent trois questions : poésie et formes (forme du poème, forme du vers, poème en prose), poésie et vie<br />
(sujet lyrique, possibilité autobiographique, rapport <strong>à</strong> la circonstance) et poésie, expérience et pensée. La méthode<br />
sera celle des allers et retours entre théorie et pratique.<br />
Bibliographie :<br />
I.<br />
II.<br />
- Pierre Chartier, Introduction aux grandes théories du roman, Bordas, 1990<br />
- Vincent Descombes, Proust, Minuit, 1987<br />
- Nathalie Piégay-Gros, Le Roman, GF corpus, 2005<br />
- Dominique Rabaté, Le Roman et le sens de la vie, Corti, Les essais, 2010.<br />
Un ensemble de textes critiques d'écrivains (Balzac, Zola, Aragon, Gracq, Simon, etc ...) sera constitué et mis<br />
<strong>à</strong> la disposition des étudiants.<br />
- La Poésie – Textes critiques XIVè-XXème siècles, par J.M. Gleize, Larousse, Textes Essentiels, 1995.<br />
- Hugo Friedrich, Structure de la poésie moderne, Poche Références, 1999.<br />
- Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, Seuil, 1974.<br />
- Michel Collot, La Matière émotion, PUF, 1997.<br />
- Henri Meschonnic, Pour la poétique I, II et III, Gallimard, 1970-1973.<br />
- Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, « Perspectives littéraires » PUF, 1996<br />
- Jacques Roubaud, La Vieillesse d’Alexandre, Maspéro, 1978<br />
- Guillaume Peureux, La Fabrique du vers, Seuil, coll. Poétique, 2009.<br />
Modalités d’évaluation : Un devoir en temps limité
Descriptif :<br />
COURS de M1-M2 / S2<br />
Mercredi 10h - 12h<br />
Théories critiques<br />
23<br />
Pierre Zaoui,<br />
Laurent Zimmermann<br />
Repartant d’Aristote, mais pour arriver au plus vite aux enjeux contemporains, ce cours vise <strong>à</strong> enrichir la<br />
formation critique et théorique des étudiants de master. Traversant les points de vue philosophiques,<br />
sociologiques, psychanalytiques, stylistiques et sémiotiques, nous tenterons de réfléchir ensemble aux multiples<br />
manières de faire parler ou fonctionner les textes littéraires.<br />
Parcours :<br />
- Pérennité de la mimésis (d'Aristote <strong>à</strong> Auerbach & H.R. Jauss)<br />
- Critique romantique, critique hégélienne (ironie et dialectique)<br />
- Bavardage et écoute (Heidegger)<br />
- Théorie critique (Adorno & Benjamin)<br />
- Qu'est-ce que la déconstruction? (Derrida)<br />
- Première critique des écrivains (Proust & Joyce)<br />
- Lectures psychanalytiques (Freud, Lacan, Bellemin-Noël, Bayard)<br />
- Sociologie de la littérature (Lukacs, Bakhtine)<br />
- Poétique (Jakobson, Todorov, Genette)<br />
- La théorie du texte (Barthes, Kristeva)<br />
- Seconde critique des écrivains (Bataille, Blanchot, Bonnefoy, Deguy)<br />
- La littérature parmi les autres arts (Didi-Huberman, Badiou, Rancière)<br />
Modalités d’évaluation : Examen en temps limité en fin de semestre
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2 / S1- S3<br />
Mardi 16h - 18h<br />
L’imaginaire des archives<br />
24<br />
Nathalie Piégay-Gros<br />
Le roman s'approprie les documents pour étayer la force de la représentation sur une vérité historique.<br />
Mais il peut demander tout autre chose <strong>à</strong> l'archive, qu'elle soit politique, familiale ou personnelle : une incitation <strong>à</strong><br />
l'imagination et au romanesque, une réserve d'images et de scènes. Nous étudierons donc la manière dont le<br />
roman s'approprie l'archive pour en faire un objet imaginaire mais aussi la façon dont le discours de l'archive est<br />
modifié par son implantation dans la fiction. Ce sont alors les limites entre le roman et ce qu'il n'est pas qu'il<br />
faudra interroger : comment lire l'archive apocryphe ? quel statut ont les personnages nés de l'archive ? Comment<br />
les dispositifs du discours historique peuvent-ils migrer dans la fiction ? En quoi l’accumulation d’archives<br />
modifient-elles le statut du récit fictionnel ? Quelle est sa part de négativité ? L’inflation de l’archive partout<br />
observable traduit une inquiétude de la mémoire et de la transmission que nous chercherons <strong>à</strong> mieux cerner et<br />
comprendre.<br />
Bibliographie :<br />
- Boltanski, C. Grenier, La vie possible de Christian Boltanski, Seuil, 2007, Fiction et Cie.<br />
- Alain Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, Sur les traces d’un inconnu (1798-1876),<br />
Flammarion, Champs, 2011.<br />
- Derrida, Mal d’archive, Galilée, 1995.<br />
- Michel Foucault et alii. Moi Pierre Rivière… Gallimard, « Folio histoire ».<br />
- Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, La librairie du XXIe siècle, Seuil, 2012.<br />
- Pierre Michon, Les Onze, Verdier, 2009<br />
- G. Perec, Ellis Island, POL, 1195.<br />
- Robert Pinget, L'Apocryphe, Minuit, 1980.<br />
- Claude Simon, Histoire, Minuit, 1967 , Les Géorgiques, Minuit, 1981<br />
D'autres textes seront distribués pendant le séminaire (Michelet, Pascal Quignard, Sebald, M. Ollender, H. M.<br />
Enzenberger, pourront être étudiés, etc...)<br />
Modalités d’évaluation : un exposé ou un dossier.
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2 / S1-S3<br />
Lundi 11h - 13h<br />
Philosophie et littérature<br />
25<br />
Pierre Zaoui,<br />
Jacques-Olivier Bégot<br />
Ce nouveau séminaire prétend interroger les rapports multiples et souvent contradictoires entre<br />
philosophie et littérature. Pour la première année, nous tenterons de répertorier et d’évaluer les principaux types<br />
d’interrogation allant en ce sens. En particulier, nous essaierons de dégager, tantôt diachroniquement, tantôt<br />
synchroniquement, six grands types de rapports traditionnels entre philosophie et littérature (ou poésie).<br />
- Un rapport de confusion ou d’indiscernabilité relative <strong>à</strong> certains moments historiques : les poètes et physiciens<br />
pré-socratiques ; la mystique médiévale ; la Renaissance ; les Lumières ; Goethe, Hegel et le romantisme<br />
allemand ; les années 1950-1960 en France… ;<br />
- Un rapport d’assujettissement du littéraire au philosophique courant d’un certain Platon et d’Aristote <strong>à</strong> un<br />
certain Sartre ;<br />
- Un rapport au contraire d’écoute, voire de soumission, du philosophique au littéraire, courant d’un autre Platon<br />
<strong>à</strong> un autre Sartre, en passant par Schopenhauer, Nietzsche ou Heidegger ;<br />
- Un rapport de « différance » ou de distribution des possibilités et des rôles respectifs du littéraire et du<br />
philosophique (les frères James, Derrida, Deleuze, Lyotard,…) ;<br />
- Un rapport d’exclusion réciproque qui n’interdit pourtant pas des formes de braconnage inédites (la scolastique<br />
médiévale, Spinoza, Wittgenstein,…) ;<br />
- Un rapport plus contemporain encore <strong>à</strong> définir. En ce sens, ce séminaire est ouvert <strong>à</strong> toutes celles et ceux<br />
croisant dans leurs recherches, d’une manière ou d’une autre, la question poétique et la question philosophique.<br />
Modalités d’évaluation : Un mini-dossier <strong>à</strong> rendre en fin de semestre
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2/ S1-S3<br />
Vendredi 15h – 17h<br />
Le document du théâtre<br />
26<br />
Isabelle Barberis,<br />
Sophie Lucet<br />
Partant de l’observation de la dimension éphémère constitutive de l’œuvre scénique, nous émettons<br />
l’hypothèse que cette dernière se voit « compensée » par un appareil complexe de traces qui environnent le<br />
processus théâtral.<br />
La diversité de ces traces sert de révélateur <strong>à</strong> la complexité même de l’œuvre théâtrale (interdisciplinarité,<br />
multiplicité des mediums, multi-temporalité). Elles doivent être envisagées de manière aussi bien diachronique<br />
que synchronique. Des prémices de la conception (documentation du processus créatif, dramaturgie, notes,<br />
croquis de mise en scène, scripts) jusqu’aux empreintes de la représentation fixant sa mémoire (photos, tableaux,<br />
articles de presse, témoignages), la ventilation chronologique « naturelle » des traces de « l’œuvre <strong>à</strong> deux temps »<br />
n’empêche pas de les trouver inscrites dans une synchronie où le document de théâtre coexiste avec l’œuvre ellemême<br />
(comme en atteste par exemple, la feuille de salle) et interagit avec elle.<br />
L’objectif de ce séminaire est tout autant de procéder <strong>à</strong> un catalogue raisonné de ces différents dispositifs qui<br />
inscrivent la réalité de l’œuvre scénique, que d’en proposer des méthodes d’analyse au vu de la spécificité de la<br />
représentation théâtrale.<br />
- De la peinture <strong>à</strong> la photographie : capturer la théâtralité (Isabelle Barbéris)<br />
- La revue de théâtre (Sophie Lucet)<br />
Bibliographie fournie en début d’année.<br />
Modalités d’évaluation : Un mini-dossier de 10 pages
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2 / S2-S4<br />
Vendredi 10h - 12h<br />
La voix chantée. Une approche anthropologique<br />
27<br />
Maria Manca<br />
Pourquoi et comment chante-t-on <strong>à</strong> travers le monde? et en particulier, avec quelle voix?<br />
Le chant fait entendre une infinie variété d’expressions qui utilisent autant de techniques vocales: voix hyper-grave<br />
des moines tibétains ou suraiguë de l’opéra de Pékin; voix "noire" du flamenco et mélismatique des pays arabes;<br />
voix “projetée” ou “masquée”; a cappella ou accompagnée, en polyphonie, etc…<br />
À partir des données articulatoires et acoustiques de la voix (tessiture, timbre, souffle), sera établie une<br />
description typologique de la voix chantée, et plus largement, sera étudié le “geste vocal” impliquant tout le corps<br />
et révélant la personnalité du chanteur.<br />
On se demandera ensuite ce qu'est une belle voix dans une culture donnée. À travers quelques exemples<br />
monographiques et documents de terrain, comme ceux sur le flamenco, la voix arabe et le théâtre Nô, on<br />
dégagera la notion de “voix culturelle” procédant d'une esthétique qui met en jeu des valeurs sociales et<br />
symboliques.<br />
Mais chanter n’est pas parler, et on ne chante pas dans n’importe quelle situation. Ainsi on dit en chantant ce<br />
qu’on ne dirait pas en parlant. Une étude des textes et des contextes de chant permettra d’interroger – <strong>à</strong> travers la<br />
voix – les rapports qu’entretiennent parole et musique, (métrique, forme, répétition, symétrie etc.).<br />
In fine, il sera montré que la voix chantée dit et se dit. Elle est une clé d'accès <strong>à</strong> la culture qui la porte et qu’elle<br />
porte.<br />
Bibliographie indicative :<br />
- CORNUT Guy, La Voix, Que sais-je?, PUF, <strong>Paris</strong>, 2009.<br />
- FONAGY Ivan, La Vive voix, Payot, <strong>Paris</strong>, 1983.<br />
- LAMBERT Jean, La Médecine de l’âme , Société d’ethnologie, <strong>Paris</strong>, 1997.<br />
- LEROI JONES, Le Peuple du blues, Gallimard, <strong>Paris</strong>, 1968.<br />
- LÉOTHAUD Gilles, LORTAT-JACOB Bernard et Hugo ZEMP, Les Voix du monde. Une anthologie des<br />
expressions vocales, Le Chant du monde, CNRS/Musée de l’Homme, <strong>Paris</strong>, 1996.<br />
- LÉOTHAUD Gilles, “Classification universelle des types de techniques vocales”, in Musiques, une<br />
encyclopédie pour le XXIe siècle, Actes Sud/Cité de la musique, vol. 5, <strong>Paris</strong>, 2007.<br />
- LORTAT-JACOB Bernard, Chants de Passion, au cœur d’une confrérie de Sardaigne, Le Cerf, <strong>Paris</strong>, 1998.<br />
- PASQUALINO Caterina, Flamenco gitan, CNRS Ed., <strong>Paris</strong>, 2008.<br />
- TAMBA Akira,“La technique vocale du Nô et son esthétique”, in Cahiers de musiques traditionnelles<br />
n°4,1991.<br />
- ZUMTHOR Paul, La Lettre et la voix. De la “littérature” médiévale, Seuil, <strong>Paris</strong>, 1987.<br />
Modalités d’évaluation : Contrôle continu: fiche de lecture, dossier ou exposé oral.
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2 / S2-S4<br />
Mardi 16h - 18h<br />
Politiques de Rimbaud II « Une Saison en enfer »<br />
28<br />
Eric Marty<br />
Après avoir l’an dernier analysé les politiques de Rimbaud autour de la séquence 1869-1871 (la Commune<br />
de <strong>Paris</strong> et l’engagement révolutionnaire), notre propos sera cette année d’explorer l’œuvre majeure de Rimbaud,<br />
Une Saison en enfer (1873), en faisant l’hypothèse que cet enfer est aussi un enfer politique et historique.<br />
Dans ce récit biographique, Rimbaud engage une confrontation d’une violence extrême avec l’époque et avec sa<br />
propre image, sa propre existence. « L’enfer », alors, élargit considérablement le champ du politique en y incluant<br />
une lecture critique du sujet occidental qui sera l’un des axes majeurs de notre recherche<br />
Bibliographie :<br />
- Arthur Rimbaud, Œuvres Complètes, GF Flammarion.<br />
Les textes critiques seront présentés lors de la première séance.<br />
Modalités d’évaluation : Un exposé pendant le semestre ou un dossier en fin de semestre sur un sujet discuté<br />
avec l’étudiant(e).
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2/ S2-S4<br />
Vendredi 11h – 13h<br />
Arts et histoires du mensonge<br />
29<br />
Florence Dumora<br />
Le séminaire se propose de remonter de thèses convergentes sur le caractère spécifique d’un mensonge<br />
moderne (Koyré, Arendt, Derrida), vers des théorisations anciennes du mensonge, de saint Augustin <strong>à</strong> La<br />
Rochefoucauld. On s’appuiera aussi bien sur la réflexion propre <strong>à</strong> la mise en œuvre littéraire que sur les tentatives<br />
de traiter du mensonge d’un point de vue philosophique, moral, « extramoral », linguistique, psychanalytique. Les<br />
étudiants seront invités <strong>à</strong> participer <strong>à</strong> une réflexion commune sur les liens du mensonge <strong>à</strong> la fiction, <strong>à</strong> l’individu, <strong>à</strong><br />
la politique, <strong>à</strong> l’image, sur les avatars du paradoxe du menteur ou du mensonge <strong>à</strong> soi, et <strong>à</strong> apporter au débat sur<br />
les conditions de possibilité d’une histoire du mensonge des matériaux issus de leur propre recherche (corpus<br />
cinématographique et iconographique bienvenus).<br />
Bibliographie :<br />
Quelques références :<br />
- Saint Augustin, Du mensonge et Contre le mensonge<br />
- Molière, Tartuffe<br />
- Corneille, Le Menteur<br />
- La Rochefoucauld, Maximes<br />
- Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire<br />
- Kant, Théorie pratique. Sur un prétendu droit de mentir par humanité (Vrin, 2000).<br />
- Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral (Folio)<br />
- Koyré, Réflexions sur le mensonge (Allia, 1998)<br />
- Arendt, Du Mensonge en politique, dans Du mensonge <strong>à</strong> la violence (Pocket, 2002)<br />
- Derrida, Histoire du mensonge (Galilée, 2012).<br />
Modalités d’évaluation : Travail écrit <strong>à</strong> rendre en fin de semestre.
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2/ S2-S4<br />
Lundi 16h - 18h<br />
Vivable, invivable, vivant<br />
(Écritures littéraires, écritures philosophiques)<br />
30<br />
Evelyne Grossman<br />
A la suite du séminaire de l’année dernière, on repartira de ce constat de la clinique contemporaine, celui de la<br />
fréquence de sujets chez qui domine un clivage douloureux entre corps, émotion et pensée – sujets apparemment<br />
hypernormaux, hypernormés (voire normopathes) et cependant crispés sur une forteresse intérieure déshabitée, réduits<br />
<strong>à</strong> faire « comme si » … comme s’ils étaient vivants.<br />
Paradoxalement, la douleur non éprouvée de ce clivage, la répression ou l’oubli du corps propre, a donné lieu<br />
au vingtième siècle <strong>à</strong> de fondamentales expériences d’écriture (littéraire, philosophique) visant <strong>à</strong> réinventer un lien<br />
vivant entre corps et psyché. Chez Barthes ou Blanchot, Beckett ou Artaud, Levinas ou Derrida, Lacan, bien d’autres<br />
encore, ce corps absent ou devenu insensible, ce corps manquant des traumas et désastres collectifs du XXème siècle, il<br />
s’agit de le réinventer (modernes et laïques résurrections), de l’éprouver <strong>à</strong> nouveau dans l’expérience de l’art, de<br />
l’écriture, de la pensée. Resurgit ainsi la vieille question du romantisme allemand, celle d’un devenir-sensible de la<br />
pensée, d’un devenir-pensée de la matérialité sensible et le texte, ce mot magique des années structuralistes, est sans<br />
doute l’une des hypostases de ce corps réinventé. Car non seulement le texte « pense » mais il jouit et souffre… Il nous<br />
fait ressentir <strong>à</strong> distance.<br />
Que veut dire alors : « corps vivant » ? Non plus le « corps vécu » de la phénoménologie ni le « corps vivable »<br />
de la reconfiguration des formes de vie et de sensibilités dans la construction d’un monde commun (H. Arendt, J.<br />
Rancière, J. Butler, les éthiques modernes du politique), mais l’exploration de ce que Deleuze appelait l’invivable. Le<br />
corps-affect des écritures modernes tente peut-être d’incarner non plus le commun anthropologique (la vie commune,<br />
le sens commun) mais l’ici-ailleurs, le moi-non moi des modernes désidentités, le transfert des prothèses et greffes, des<br />
« expropriations télé-sensibles », comme disait Derrida : d’autres réalités du vivant.<br />
Textes étudiés (extraits) : Louis-Ferdinand Céline, Marguerite Duras, Samuel Beckett, Antonin Artaud, Henri<br />
Michaux ; textes philosophiques et psychanalytiques …<br />
Bibliographie indicative :<br />
- Louis Althusser, Psychanalyse et Sciences humaines (1963-1964), Biblio-essais, Le livre de poche<br />
- Michel de Certeau, La fable mystique [1982], Tel-Gallimard<br />
- Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, 1966 (repris dans la collection « Tel »)<br />
- Evelyne Grossman, La Défiguration, Minuit, 2004<br />
- Joyce McDougall, Théâtres du corps, Gallimard, 1989<br />
- Deleuze et Deleuze-Guattari (passim)<br />
Modalités d’évaluation : Un bref dossier (10-15 000 signes, espaces compris) <strong>à</strong> rendre en fin de semestre ou un<br />
exposé sur un sujet au choix en rapport avec le sujet du séminaire.
Spécialité<br />
« ARTS, ESTHETIQUE, LITTERATURES COMPAREES »<br />
Responsable : Claude Murcia<br />
La spécialité « Arts, esthétique, littératures comparées » est propre <strong>à</strong> notre UFR. Elle prolonge <strong>à</strong><br />
la fois les enseignements de littératures comparées en L et le parcours Lettres et arts de L. Elle permet <strong>à</strong><br />
l’étudiant de conjuguer une solide formation littéraire, alliée <strong>à</strong> un complément philosophique fondé sur<br />
l’esthétique, avec l’étude de plusieurs domaines artistiques (cinéma, théâtre, musique, sémiologie de<br />
l’image et de l’écriture, arts plastiques). Elle fournit des instruments de lecture pluridisciplinaires<br />
adaptés <strong>à</strong> la compréhension de la culture contemporaine. La présence d’enseignements comparatistes<br />
favorise l’ouverture aux domaines étrangers. Les aires géographiques, historiques, linguistiques et<br />
culturelles abordées sont très diversifiées (outre les cultures occidentales, sont prises en compte, entre<br />
autres, le théâtre indien, ainsi que les littératures et arts d’Extrême-Orient grâce <strong>à</strong> un partenariat avec<br />
l’UFR Langues et Civilisations d’Asie Orientale). Un cursus partiellement bilingue est proposé, en<br />
collaboration avec l’UFR d’anglais de Charles-V. Des cours en espagnol seront assurés, selon les<br />
demandes, dans le cadre de notre UFR.<br />
Cette spécialité s’adresse en priorité :<br />
- aux étudiants du parcours Lettres et Arts<br />
- aux étudiants du parcours Lettres modernes ayant suivi les enseignements Texte et image et<br />
Pratique théâtrale, ou désireux de s’initier <strong>à</strong> la recherche en littératures comparées<br />
- aux étudiants de langues anciennes désireux d’aborder une recherche de type comparatiste<br />
- aux étudiants des Beaux-Arts, aux comédiens en formation qui trouvent la possibilité de joindre <strong>à</strong><br />
leur apprentissage une réflexion et une recherche dans un cadre universitaire.<br />
31
Descriptif :<br />
COURS de M1-M2 / S1-S3<br />
Mardi 16h - 18h<br />
Littérature et cinéma<br />
32<br />
Claude Murcia<br />
Depuis sa naissance, le cinéma entretient avec la littérature un dialogue constant, complexe et<br />
protéiforme. Il s’agit bien l<strong>à</strong> d’un échange, le cinéma se nourrissant de littérature depuis ses origines, et la<br />
littérature s’abreuvant aux sources du 7 ème art au fil des 20 ème et 21 ème siècles.<br />
Ce cours proposera, dans un premier temps, une confrontation d’ordre théorique entre le langage<br />
littéraire et le langage cinématographique, qui permettra un éclairage réciproque des deux modes d’expression.<br />
Dans un second temps, on explorera différentes modalités de relations, telles que l’adaptation<br />
(appropriation, réécriture…), la novellisation ou le roman de montage, et diverses formes de porosité entre le<br />
cinéma et la littérature, en prenant appui <strong>à</strong> la fois sur des outils théoriques et des études de cas.<br />
Bibliographie succincte :<br />
- Vanoye, Francis, Récit écrit/récit filmique, Nathan, 1979.<br />
- Gaudreault, André, Du littéraire au filmique, Méridiens Klincksieck, 1988.<br />
- Clerc, Jeanne-Marie, Ecrivains et cinéma : des mots aux images, des images aux mots, Presses Univ. de<br />
Metz, 1985.<br />
- Clerc, Jeanne-Marie, Littérature et cinéma, Nathan, 1993.<br />
- Ropars-Wuilleumier, Marie-Claire, Ecraniques, le film du texte, Presses univ. de Lille, 1990.<br />
- Murcia, Claude, Nouveau Roman, Nouveau cinéma, Nathan, 1998.<br />
Modalités d’évaluation : Travail en temps limité.
Descriptif :<br />
COURS de M1-M2 / S2<br />
Lundi 11h - 13h<br />
Esthétique générale<br />
33<br />
Jacques-Olivier Bégot<br />
Céline Flécheux<br />
Ce cours a pour objet de présenter quelques grands concepts fondamentaux de la tradition esthétique en<br />
les confrontant <strong>à</strong> un ensemble d’œuvres majeures. Organisé chaque année autour d’une question directrice, le<br />
cours associera une perspective théorique et critique <strong>à</strong> une approche historique et fera appel <strong>à</strong> une variété de<br />
pratiques artistiques.<br />
En 2012-2013, le cours portera sur la question de l’informe. À partir du travail réalisé par Yve-Alain Bois et<br />
Rosalind Krauss pour l’exposition « L’informe : mode d’emploi » présentée au Centre Pompidou en 1996 ainsi que<br />
de la relecture de Bataille proposée presque simultanément par Georges Didi-Huberman, il s’agira de dégager les<br />
enjeux historiques, théoriques et critiques que ce terme concentre, proposant sur l’aventure de l’art moderne et<br />
contemporain une perspective fort différente du grand récit construit par le modernisme. L’informe permettra<br />
également de revisiter toute une série de termes tels que le laid, l’exagération, le sublime, l’anamorphose, le<br />
grotesque, la tache, les objets sans limite (ciel, eau, nuit), le difforme et l’amorphe, etc. – autant d’indices qui<br />
montrent assez que l’esthétique est loin de se réduire <strong>à</strong> une philosophie du beau.<br />
Bibliographie sélective :<br />
- Y.- A. Bois et R. Krauss, L’Informe : mode d’emploi, Centre Pompidou, 1996<br />
- G. Didi-Huberman, La Ressemblance informe, Macula, 1995<br />
- F. Jullien, La Grande image n’a pas de forme, Points Essais, 2009<br />
- J.- C. Lebensztejn, L’Art de la tache, Editions du limon, 1990<br />
Modalités d’évaluation : Examen écrit en temps limité
Descriptif :<br />
Séminaire de M1-M2 / S1-S3<br />
Mercredi 15h - 17h<br />
Littérature, esthétique, écologie (II)<br />
34<br />
Jean-Patrice Courtois<br />
Si l’écologie est d’abord une science (Haeckel, 1866), force est de constater que sa juridiction est devenue<br />
philosophique, éthique, politique, esthétique. C’est la crise qui donne depuis 40 ans environ <strong>à</strong> l’écologie une<br />
importance croissante et une capacité <strong>à</strong> aller investir des domaines situés hors de son champ scientifique<br />
d’origine. Mais la relation <strong>à</strong> l’espace et <strong>à</strong> la nature s’est thématisée bien avant cette science qui, de son côté,<br />
redéfinit la « nature ». Il s’agira donc de comprendre comment <strong>à</strong> partir des catégories majeures mise en avant par<br />
la crise écologique (nature, vulnérabilité, soin, interdépendances, pilotage, laboratoire des détails), on peut<br />
réinterroger la littérature, l’esthétique et les arts, de la Bible <strong>à</strong> Hésiode, de la littérature américaine du XIX e et XX e<br />
siècles (Emerson, Thoreau, Whitman, Leopold), de Montesquieu et Rousseau <strong>à</strong> Valéry, Ponge ou Seebald, du Land<br />
Art <strong>à</strong> Pistoletto ou Salvatore Sciarrino. Ce séminaire croise les littératures et les disciplines du point de vue d’une<br />
tâche actuelle pour construire des catégories, certes issues des questions posées par l’écologie, mais parallèlement<br />
appelées <strong>à</strong> se transformer sous l’effet de la littérature et des arts comme matériau sensible et spéculatif.<br />
Bibliographie :<br />
(Une bibliographie supplémentaire sera donnée en début de cours)<br />
1) Henry D. Thoreau, Walden, Le Mot et le Reste, 2010.<br />
- Cap Cod, Imprimerie Nationale, 2000.<br />
- Essais, le Mot et le Reste, 2007.<br />
- Les Forêts du Maine, Corti, 2002.<br />
- Un Yankee au Canada, La Part Commune, 2006.<br />
- De la marche, Mille et Une Nuits, 2003.<br />
- Journal - 1837-1861, Denoël, 2001.<br />
- Journal – 1837-1842, Finitude, 2012.<br />
- Walt Whitman, Feuilles d’herbe, Corti, 2008 (1 e édition 1855).<br />
- Sarah Orne Jewett, La Pays des sapins pointus, Editions ENS Ulm, 2004.<br />
- Ralph Waldo Emerson, La Nature, Allia, 2004.<br />
- Essais politiques et sociaux, trad. Marie Dugard, Armand Colin, 1912.<br />
- Leopold, A., Almanach d’un comté des sables, GF, 2000 (1948).<br />
2) Linné C., L’Equilibre de la nature, Vrin, 1972.<br />
- Montesquieu, De l’esprit des lois, Garnier, éd. R. Derathé, 1973.<br />
- Essai sur le goût, Rivages/Poche, 1993.<br />
- Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Gallimard/Pléiade, Œuvres complètes, tome II, 1964.<br />
3) Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, GF, 1979 (1816).<br />
- Maeterlinck M., la Vie de la nature, in Œuvres complètes, 4 tomes, éd. Paul Gorceix, André Versaille, 2010.<br />
- Alexis de Tocqueville, Quinze jours au désert, Le Passager clandestin, 2011.<br />
- Valéry P., « Dialogue de l’arbre », Œuvres, tome 2, Gallimard/Pléiade, 1960, 177-196. Et Francis Ponge et<br />
d’autres.<br />
4) Michelangelo Pistoletto, Le Troisième Paradis, Actes Sud, 2012.<br />
- Salvatore Sciarrino, L’Origine des idées subtiles, L’Itinéraire, 2012.<br />
Modalités d’évaluation : Un dossier en fin de semestre.
Séminaire de M1-M2 / S1-S3<br />
Lundi 13h - 15h<br />
Lecture de Shakespeare : Mesure pour mesure<br />
35<br />
J. Delabroy<br />
Pour sa dix-neuvième année, le séminaire Shakespeare a choisi de se consacrer <strong>à</strong> l'une des plus singulières<br />
"problem plays" de l'œuvre, récemment redécouverte et revisitée par de nouvelles et prestigieuses productions.<br />
Le travail, partagé, consistera, selon l'esprit et la méthode qui ont présidé depuis l'origine <strong>à</strong> ce séminaire, <strong>à</strong> suivre<br />
ligne <strong>à</strong> ligne et scène <strong>à</strong> scène le texte de Shakespeare, <strong>à</strong> se mettre <strong>à</strong> l'écoute et <strong>à</strong> la veille de ses sollicitations, pour<br />
dégager, de peu en peu, quelques hypothèses susceptibles de rendre pensable sa cohérence comme drame, et<br />
donc son intention comme fable, et ainsi son effet comme signification. Sans craindre ni d'hésiter, ni de se<br />
tromper, ni de ne pas finir, ni de ne pas tout comprendre, on essayera <strong>à</strong> la fois de tisser au fil des séances un vrai<br />
séminaire (un espace-temps de recherches en liberté d'invention et de tentative), et de faire servir, une fois de<br />
plus, cet exercice de lecture <strong>à</strong> un exercice d'admiration pour une œuvre qui incarne la littérature même, ou le<br />
théâtre, et ce qui fait son exigence mystérieuse et proprement existentielle.<br />
Edition de travail : Shakespeare, Œuvres complètes, édition bilingue,"Bouquins", Robert Laffont, Tragicomédies I,<br />
présenté et traduit par Sylvère Monod.<br />
Modalités d’évaluation : Les participants au séminaire, <strong>à</strong> quelque titre qu'ils soient inscrits, seront conviés <strong>à</strong><br />
intervenir, par oral ou par écrit, soit sur un moment de la pièce dans le cours du séminaire, et sous forme<br />
d'intervention, soit sur une question qui aura été préalablement validée, et sous forme de dossier <strong>à</strong> rendre en fin<br />
de séminaire.
Séminaire de M1-M2 / S1-S3<br />
Mardi 13h - 15h<br />
Apocalypse et apocalyptisme : devenir et actualités d’un imaginaire<br />
36<br />
Catherine Coquio<br />
On observera les formes qu'ont prises la pensée apocalyptique et l’imaginaire de l'Apocalypse, des<br />
premiers textes religieux (juifs et chrétiens) aux formes profanes de l'apocalypti sme en littérature et au<br />
cinéma, parallèlement <strong>à</strong> son rôle politique du côté de la subversion anarchisante ou des intégrismes. On tentera de<br />
comprendre ce qui joint et ce qui sépare le propos idéologique et l’écriture poétique ou l’œuvre d’art. On<br />
observera les mutations du messianisme dans le domaine profane, de la modernité au XXIe siècle, et ce qu’il en est<br />
aujourd’hui d’une certaine culture de l’apocalyptisme et du post-apocalyptisme. On tentera de comprendre <strong>à</strong> la<br />
fois la structure de pensée propre au temps apocalyptique et la manière dont elle interfère dans notre expérience<br />
du temps historique.<br />
On donnera d’abord des instruments de lecture pour saisir le contenu politique des textes fondateurs,<br />
dont on observera la fortune iconographique, liée <strong>à</strong> la puissance figurative du thème (cf Dürer, « Apocalipsis cum<br />
figuris »). On montrera que le motif de l’apocalypse est indissolublement lié <strong>à</strong> l’espoir messianique (G. Scholem), et<br />
on réfléchira sur sa « sécularisation » en revisitant les concepts de « profane » et « sacré » (G. Agamben). Puis on<br />
étudiera ce phénomène au plan esthétique et poétique, dans des oeuvres choisies avec les étudiants, en<br />
interprétant les formes qu’a pu prendre ce messianisme selon les moments et situations historiques. On pourra<br />
observer comment cet imaginaire traverse et nourrit différents genres, dont la contre-utopie et la science-fiction,<br />
mais aussi la philosophie de l’histoire et la théorie critique, et le rôle qu’il joue dans les témoignages de<br />
catastrophes politiques ou écologiques ; ou encore comment ce messianisme, gagné <strong>à</strong> la déconstruction ou <strong>à</strong> de<br />
nouveaux nihilismes, investit de nouveaux thèmes comme celui de l’animal (Derrida, Coetzee). On tentera de<br />
comprendre pourquoi le scénario apocalyptique fait ainsi retour dans une civilisation qui n’est plus soudée par la<br />
croyance religieuse ni l’espoir révolutionnaire, y compris dans le cinéma, où, au-del<strong>à</strong> du film de guerre ou des<br />
scénarios-catastrophe, on voit poser la question du destin ou du bonheur <strong>à</strong> travers la reprise, plus moins<br />
parodique, de cet héritage religieux (Magnolia, Babel, A Serious man…)<br />
Bibliographie : Une bibliographie sera distribuée <strong>à</strong> la rentrée.<br />
Modalité d’évaluation : Les étudiants auront <strong>à</strong> présenter un exposé ou un dossier sur une question choisie en<br />
concertation avec l’enseignante
Séminaire de M1-M2 / S2-S4<br />
Jeudi 15h – 17h<br />
Surface et profondeur<br />
37<br />
Diane Arnaud,<br />
Clélia Nau<br />
Pour l’art pictural, il s’agira de réinterroger la tension entre surface et profondeur depuis les origines de la<br />
perspective, où la surface n’est donnée pour le support d’une construction qui ne la produit comme telle que sous<br />
la condition de la nier, de la creuser, jusqu’au dogme moderniste de la flatness, de la planéité, en mettant l’accent,<br />
du côté de l’art ancien, sur les effets de pan ou d’affleurement qui ont dès la Renaissance traversé des œuvres<br />
encore pourtant attachées <strong>à</strong> simuler une profondeur (Piero della Francesca, Botticelli), et du côté de l’art<br />
moderne, sur les stratégies de stratification de l’épaisseur du plan, de voilement, de tissure, de texture, de saillie,<br />
de saillance, de surimpression (Mondrian, Ryman, Rothko) qui n’ont cessé de trouer (d’une profondeur strictement<br />
« optique » celle-l<strong>à</strong>, si l’on en croit Greenberg) la « platitude » de la modernité, sans oublier les corps - d’entrailles<br />
et de peau, ou épidermisés - qui ont trouvé place en cet espace pictural constamment remodelé. Pour l’art<br />
cinématographique, la tension entre surface et profondeur implique l’enchaînement et le mouvement des plans. Il<br />
s’agira donc de partir des propositions théoriques qui ont rapproché l’écran de la toile, d’Hubert Damisch <strong>à</strong><br />
Jacques Aumont, avant de proposer des études poïétiques <strong>à</strong> travers les œuvres d’Alexandre Sokourov, de David<br />
Lynch et de Kiyoshi Kurosawa. Trois modalités, <strong>à</strong> même de convoquer le fantasme d’une matière filmique, seront<br />
approfondies : « l’entoilement » du plan par une composition picturale, l’émergence de la figuration par le fond, et<br />
la trouée de la représentation, spatiale ou corporelle, par une ouverture figurale.<br />
Bibliographie :<br />
- Leon Battista Alberti, De Pictura, trad. D. Sonnier, 2007.<br />
- John White, Naissance et renaissance de l’art pictural, <strong>Paris</strong>, Adam Biro, 2003.<br />
- Philostrate, Les images ou tableaux de platte-peinture; traduction et commentaire de Blaise de Vigenère<br />
(1578); présenté et annoté par Françoise Graziani, <strong>Paris</strong>, Honoré Champion, 1995.<br />
- Clement Greenberg, Art et culture, <strong>Paris</strong>, Macula, 1988.<br />
- Eric de Chassey, Platitudes. Une histoire de la photographie plate, <strong>Paris</strong>, Gallimard, 2006<br />
Modalités d’évaluation: Un dossier de 10 <strong>à</strong> 15 pages.
Séminaire de M1-M2 / S2-S4<br />
Mercredi 15h-17h<br />
La mémoire du monde<br />
38<br />
Bernadette Bricout<br />
La fréquentation des mythes et des contes comme celle des petits genres de la littérature orale (devinettes,<br />
proverbes, formulettes) nous conduit <strong>à</strong> porter sur notre environnement familier un regard différent. L’objet le plus<br />
humble qui soit s’y trouve investi d’une densité singulière, d’une dimension poétique qui souvent nous échappe<br />
dans la vie quotidienne. Le séminaire s’attachera <strong>à</strong> explorer cette année, dans une perspective interdisciplinaire, le<br />
langage obscur qui dans les contes merveilleux est celui de la création mais aussi les liens particuliers que les êtres<br />
humains tissent avec leur propre corps et avec l’univers, avec le temps et les grandes étapes de leur vie. Façons de<br />
dire, façons de faire que nous nous attacherons <strong>à</strong> décrypter en interrogeant des textes oraux mais aussi la trame<br />
invisible des coutumes et des croyances issues de savoirs séculaires qui tissent notre quotidien.<br />
Bibliographie :<br />
- Amades, Joan, Des étoiles aux plantes, Toulouse, GARAE/Hésiode, coll. «Classiques de la littérature orale»,<br />
1994.<br />
- -, L'origine des bêtes. Petite cosmologie catalane, Toulouse, GARAE/Hésiode, coll. «Classiques de la<br />
littérature orale», 1988<br />
- Nicole Belmont, Les Signes de la naissance, Plon, 1971 ; Mythes et croyances dans l’ancienne France,<br />
Flammarion, 1973 ; Poétique du conte, Gallimard, 1999.<br />
- Bettelheim, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, <strong>Paris</strong>, Robert Laffont, coll. «Réponses», 1976.<br />
- Bernadette Bricout, La Clé des contes, Editions du Seuil, 2005.Le savoir et la saveur. Henri Pourrat et le<br />
Trésor des contes, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées, 1992.<br />
- Les Evangiles des Quenouilles (éd. M. Jeay, Vrin ; traduction par Anne Paupert, <strong>à</strong> paraître dans Le Moyen<br />
Age et la femme : voix poétiques, utopiques et amoureuses, Robert Laffont, coll. Bouquins).<br />
- François Flahault, La Pensée des contes, Anthropos, coll. « Psychanalyse », 2001.<br />
- Marie-Louise von Franz, La Femme dans les contes de fées, La Fontaine de Pierre, 1979.<br />
- Françoise Héritier, Masculin/Féminin : la pensée de la différence, Odile Jacob, 1997.<br />
- Helias, Per Jakez Hélias, Les autres et les miens, <strong>Paris</strong>, Plon, 1977.<br />
- Jean-Claude Kaufmann, La trame conjugale, L’analyse du couple par son linge, Pocket, coll.<br />
- « Agora », 1997 ; Le cœur <strong>à</strong> l’ouvrage, Théorie de l’action ménagère, Nathan, coll. « Essais et Recherches »,<br />
1997 ; Corps de femmes, Regards d’hommes, Pocket, coll. « Agora», 2001 ; La femme seuleet le Prince<br />
charmant : Enquête sur la vie en solo, Pocket, coll. « Agora », 2003.<br />
- Robert Muchembled, Passions de femmes au temps de la Reine Margot (1553-1615), Seuil, 2003.<br />
- Anne Muxel, Individu et mémoire familiale, Nathan, coll. « Essais et Recherches », 1996.<br />
- Le pouvoir de la femme, Cahiers de littérature orale, n°34, 1993.<br />
- Martine Segalen, Amours et mariages de l’ancienne France, Berger-Levrault, 1981 ; Mari et femme dans la<br />
société paysanne, Flammarion, coll. « Champs Flammarion »,1984 ; Rites et rituels contemporains, Nathan,<br />
coll. « Nathan <strong>Université</strong> »,1998.<br />
- Van Gennep, Arnold, Manuel de Folklore français contemporain, <strong>Paris</strong>, Picard, 7 vol. (1943-1958).<br />
- Les Rites de passage. <strong>Paris</strong>, Picard, 1981.<br />
- Coutumes et croyances populaires en France, <strong>Paris</strong>, Le chemin vert, 1980.<br />
- Yvonne Verdier, Façons de dire, Façons de faire, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines »,<br />
1979 ; Coutumes et destin, Thomas Hardy et autres essais, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences<br />
humaines », 1995.<br />
Modalités d’évaluation : dossier <strong>à</strong> caractère thématique sur un objet ou une pratique (dans le cadre de notre<br />
étude du quotidien merveilleux).
Séminaire de M1-M2 / S2-S4<br />
Vendredi 16h00-18h00<br />
L’intranquillité <strong>à</strong> l’œuvre<br />
39<br />
Régis Salado<br />
« L’intranquillité <strong>à</strong> l’œuvre : inachèvement et réflexivité (<strong>à</strong> partir du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa et<br />
autres textes de la modernité) »<br />
Attribué par Fernando Pessoa (1888-1935) <strong>à</strong> son semi-hétéronyme Bernardo Soares, le Livre de l’intranquillité,<br />
dont les fragments ont été écrits sur une période de plus de vingt ans jusqu’<strong>à</strong> la mort de l’écrivain, est le lieu où<br />
s’expérimente une écriture paradoxalement placée sous le signe de l’effacement. La tentative de faire œuvre –que<br />
dit le mot « livre »– y est contrariée par l’incessant retour sur soi d’un sujet qui ne coïncide jamais avec lui-même.<br />
Inchoative et ressassante, l’écriture inquiète du Livre entre en résonance avec d’autres grandes œuvres de la<br />
modernité, elles aussi marquées par une réflexivité radicale et par l’inachèvement. C’est cette constellation des<br />
« intranquilles » que l’on se propose d’explorer <strong>à</strong> partir du texte de Pessoa, qu’on mettra en relation avec des<br />
ouvrages relevant du genre du journal intime (Amiel, Kafka), mais aussi avec des essais (Michaux, Valéry) et des<br />
œuvres où la fiction est partie prenante (Lettre de Lord Chandos de Hofmannsthal, écrits de Beckett, récits de<br />
Blanchot, Ostinato de Louis-René des Forêts).<br />
Texte de référence :<br />
- Fernando PESSOA : Le Livre de l’intranquillité, Christian Bourgois éditeur, 2011 (édition revue et augmentée,<br />
établie par Richard Zenith, traduction de Françoise Laye).<br />
- L’édition originale portugaise, O Livro do desassossego, a paru en 2 volumes <strong>à</strong> Lisbonne chez l’éditeur Ática<br />
en 1982. L’édition établie par Richard Zenith a paru en 1 volume <strong>à</strong> Lisbonne chez l’éditeur Assirio e Alvim en<br />
2006.<br />
- La bibliographie critique et le corpus des œuvres littéraires auxquelles il sera fait appel dans le séminaire<br />
seront communiqués <strong>à</strong> la rentrée.<br />
Modalités d’évaluation : Un dossier <strong>à</strong> remettre en fin de semestre.
Ce séminaire sera confirmé <strong>à</strong> la rentrée<br />
Séminaire de M1-M2 / S2<br />
Mercredi 11h - 13h<br />
Atelier de Recherche et de Création (ACR)<br />
Lieu : Bétonsalon, esplanade Vidal-Naquet sur le campus des Grands Moulins<br />
40<br />
Céline Flécheux<br />
Ce projet naît d’une collaboration entre l’<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-<strong>Diderot</strong> et le centre d’art et de recherche Bétonsalon. A<br />
partir de la rentrée 2012, nous nous associerons au centre d’art et de recherche Bétonsalon pour inviter une<br />
personnalité du monde artistique <strong>à</strong> présenter un projet sur des questions contemporaines. Nous organiserons<br />
conjointement un séminaire en lien direct avec le projet retenu.<br />
Pour des raisons de calendrier, nous donnerons les détails (thème, invités, dates) <strong>à</strong> partir de la rentrée 2012.<br />
Modalités d’évaluation : L’évaluation des étudiants se fait par l’assiduité au séminaire, par le rendu d’un minimémoire<br />
et par la participation, pour ceux qui le souhaiteront, <strong>à</strong> un projet avec le centre d’art et de recherche<br />
Bétonsalon.
SEMINAIRES<br />
HORS<br />
UFR LAC<br />
41
UFR SCIENCES SOCIALES<br />
« Politiques culturelles »<br />
MASTER<br />
« Sociologie et anthropologie :<br />
politique, culture, migrations »<br />
Responsable du Master : M. Laurent FLEURY<br />
laurent.fleury@univ-paris-diderot.fr<br />
Responsable du M 2 : Mme Anne KUPIEC<br />
anne.kupiec@univ-paris-diderot.fr<br />
Responsable du M 1 : MME NATHALIE MONTOYA<br />
nathalie.montoya@gmail.com<br />
Année universitaire 2012-2013<br />
Adresse administrative<br />
UFR de Sciences Sociales – Boîte courrier 7101 – 75205 <strong>Paris</strong> cedex 13<br />
ufr-sciences.sociales@univ-paris-diderot.fr<br />
42
Master 1 Spécialité : Politiques culturelles<br />
L’objectif de la spécialité « Politiques culturelles » est de former des responsables d’institutions culturelles, des<br />
concepteurs de manifestations culturelles et des cadres pouvant œuvrer <strong>à</strong> la définition et <strong>à</strong> la mise en œuvre de<br />
politiques culturelles, locales, régionales, nationales, voire internationales. Le but est de former des<br />
professionnels détenteurs de compétences spécifiques au secteur culturel ainsi que d’une solide culture<br />
générale permettant de mieux fonder un dialogue avec une grande diversité de partenaires (hauts<br />
fonctionnaires, hommes politiques, artistes et professionnels de la culture). Aussi une place importante est-elle<br />
accordée tant aux enseignements fondamentaux qu’aux enseignements professionnels. Toutefois, les étudiants<br />
sont également tenus de suivre les enseignements de tronc commun : anthropologie, épistémologie (UE1),<br />
sociologie (UE2) et langues (UE4).<br />
Semestre 1 (M1) - 30 ECTS<br />
UE 1 - Enseignements fondamentaux – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Anthropologie culturelle – Laurent Fleury<br />
Ce cours poursuit l’objectif de comprendre comment la découverte de cultures différentes a participé <strong>à</strong> la<br />
formation d’un regard anthropologique. Il s’agira de saisir comment un regard sur l'autre a ainsi pu se façonner<br />
au fil des siècles ainsi que de s’intéresser aux modalités de la compréhension de modes de penser différents par<br />
l’évocation de types de sociétés différenciées par leur principe spécifique d’organisation sociale. Ainsi seront<br />
étudiées les sociétés hiérarchiques, les sociétés individualistes et les sociétés segmentaires.<br />
Sociologie générale – Patrick Cingolani (cours de tronc commun)<br />
UE 2 – Disciplines – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Politiques culturelles – Nathalie Montoya<br />
L’objectif de ce cours est de fournir quelques repères permettant de comprendre et d’interroger le<br />
développement récent des politiques culturelles en France. Si celles-ci se caractérisent par l’ancienneté de<br />
l’intervention de l’Etat, leurs formes actuelles se redéfinissent autour des engagements multiples des<br />
collectivités territoriales dans le champ culturel. Dans une perspective socio-historique, le cours explorera plus<br />
particulièrement quelques grands axes permettant de saisir les reconfigurations des politiques culturelles :<br />
gouvernance territoriale, rôle et engagement de l’Etat ; fonction des équipements culturels, statut des<br />
institutions; économie culturelle et financement de la création artistique ; enjeux esthétiques contemporains et<br />
renouvellement des formes ; publics, démocratisation et activités de médiation culturelle.<br />
Anthropologie – Françoise Lestage (cours de tronc commun)<br />
UE 3 – Thèmes – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Culture et politique – Anne Kupiec<br />
Les relations entre culture et politique sont anciennes et complexes. En France, dans les années trente, elles<br />
prennent un tour particulier. Les effets des nouveaux modes de reproduction des images et des sons,<br />
l’avènement des loisirs, les modalités nouvelles de l’intervention étatique constituent autant d’éléments<br />
significatifs qui éclairent le présent et permettent de comprendre les politiques publiques menées, aujourd’hui,<br />
dans le domaine de la culture.<br />
UE 4 – Outils – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Langue<br />
UE 5 – Projet – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Méthodes spécifiques <strong>à</strong> la spécialité – Laurence Gillot<br />
L'approche se centrera sur la nécessité et les modalités d'une référence disciplinaire ou interdisciplinaire venant<br />
étayer la construction d'une problématique dans un mémoire. On envisagera la diversité des disciplines pouvant<br />
servir de points d'appui (sociologie, anthropologie mais aussi histoire, histoire de l'art...) et la manière dont<br />
cette référence peut intervenir pour fournir le cadre conceptuel qui permet d'organiser le matériel empirique<br />
et de le rendre intelligible (notions de base d'épistémologie). On s'appuiera pour ce faire sur des textes<br />
épistémologiques et sur l'expérience de direction de mémoires déj<strong>à</strong> effectués dans le cursus<br />
43
Semestre 2 (M1) - 30 ECTS<br />
UE 1 – Enseignements fondamentaux – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Mouvements artistiques et littéraires – Federico Tarragoni<br />
Quels sont les mouvements artistiques et littéraires les plus importants du XX e siècle. Le Cubisme, le Surréalisme,<br />
le Nouveau Roman, seront quelques uns des mouvements que nous étudierons, sans oublier les plus récents<br />
comme l’Oulipo, l’Arte Povera, l’Action Painting, les Installations, le Video Art etc. Nous essaierons <strong>à</strong> partir de<br />
manifestations récentes de comprendre comment les arts dit vivants prédominent progressivement et<br />
socialement sur des arts plus solitaires comme la littérature.<br />
Epistémologie – Dominique Vidal (cours de tronc commun)<br />
UE 2 – Disciplines – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Art et société – Etienne Tassin<br />
Le cours de cette année sera consacré au thème : « Théâtre et politique » dans l’idée de dégager la spécificité de<br />
la notion d’acteur : acteur théâtral et acteur politique. L’élucidation de ce qu’est un acteur (théâtral) ne permetelle<br />
pas une nouvelle compréhension de l’acteur politique ? Non pas au sens convenu qu’un homme ou une<br />
femme politique est toujours « en situation » et joue un rôle. Mais au sens où le domaine politique peut être<br />
pensé comme une scène d’action où se joue, face <strong>à</strong>, mais aussi avec, un public le destin d’une communauté. Le<br />
théâtre est né <strong>à</strong> Athènes où il occupait une place politique aussi importante que l’agora dans la vie des citoyens<br />
et dans l’idée qu’ils se faisaient de leurs responsabilités civiques. Il y a dans la tragédie grecque une élaboration<br />
raffinée de cette responsabilité, liée <strong>à</strong> une interrogation sur l’agent et le rapport qu’il entretient <strong>à</strong> ses actes. On<br />
suivra cette ligne inaugurée par les tragédiens pour envisager <strong>à</strong> l’époque moderne les enjeux philosophiques<br />
d’une théâtralité du politique.<br />
Sociologie – Gérald Bronner (cours de tronc commun)<br />
UE 3 – Thèmes – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Sociologie de la culture – Laurent Fleury<br />
Développer un sens critique dans l’approche des définitions de la « culture » et maîtriser les outils d’analyse<br />
sociologique susceptibles d’expliquer la distribution sociale des pratiques culturelles : tels sont les objectifs de<br />
ce cours qui s’attachera aussi <strong>à</strong> présenter les orientations contemporaines qui visent <strong>à</strong> mieux cerner les modes<br />
de construction de la relation entre institutions culturelles et comportements individuels.<br />
UE 4 – Outils – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Méthode spécifique – Federico Tarragoni<br />
UE 5 - Projet – Coef. 2 - 6 ECTS<br />
Elaboration du projet<br />
L'étudiant réalisera un projet de mémoire, durant les premier et deuxième semestres, sous la responsabilité<br />
d'un directeur de mémoire.<br />
Semestre 3 (Semestre 1 du Master 2) – 30 ECTS<br />
UE 1 – Sciences sociales et politiques culturelles – Coef. 3 – 9 ECTS<br />
Cette UE est composée de trois modules. Le cours « Sociologie des politiques culturelles » propose des outils<br />
d’analyse pour comprendre tant les modalités de la décision publique en matière culturelle que celles de la mise<br />
en œuvre des politiques publiques de la culture. Le cours « Enjeux économiques de la culture » étudie des<br />
aspects qui sont désormais placés au cœur de l’évaluation des politiques culturelles. Le cours « Les approches<br />
anthropologiques et historiques de la création artistique » se propose d’examiner la profondeur généalogique et<br />
les processus de constitution de la création.<br />
Sociologie des politiques culturelles – Laurent Fleury<br />
Parce que la démocratisation de la culture a fondé politiquement l’intervention publique en matière culturelle,<br />
au moins depuis 1959, les politiques culturelles qui se sont ensuite déployées ont été régulièrement jugées <strong>à</strong><br />
44
l’aune de ce corps de doctrine. Sur fond d’instrumentalisation d’une administration culturelle, de<br />
professionnalisation du champ artistique et d’élaboration de référentiels successifs d’action publique (action<br />
culturelle, développement culturel, médiation culturelle), une conception technocratique des politiques de la<br />
culture s’est substituée <strong>à</strong> une conception plus symbolique du politique. L’interdépendance entre culture et<br />
politique cède alors la place <strong>à</strong> la l’articulation entre sociologie de la culture et politiques publiques. Ce cours<br />
s’attachera <strong>à</strong> présenter les catégories centrales de l’analyse sociologique pour appréhender tant les politiques<br />
publiques de la culture que les outils indispensables pour penser la question politique de la démocratisation<br />
de la culture et de l’évaluation de sa réalisation, étroitement liée <strong>à</strong> celle du pouvoir des institutions culturelles.<br />
Eléments d’économie culturelle – Yann Nicolas<br />
Ce cours est une introduction <strong>à</strong> l’analyse économique du domaine culturel. Son intention est d’apporter <strong>à</strong> de<br />
futurs professionnels de ce domaine des éléments de compréhension des comportements de divers acteurs<br />
culturels en tant qu’agents économiques. Sont étudiés en particulier la demande et l’offre de spectacles vivants,<br />
la « maladie des coûts » de l’industrie du spectacle vivant, le phénomène de star-system dans les industries<br />
culturelles et médiatiques, les droits d’auteur en tant que réglementation de marché, l’analyse d’impact<br />
économique de dépenses d’un événement ou d’un équipement culturel pour son territoire environnant, et<br />
l’économie des musées.<br />
Approches anthropologiques et historiques de la création artistique – Alain Lévy<br />
Ce cours se propose d’explorer la profondeur généalogique des processus de création artistique : depuis quand<br />
la notion de création s’applique-t-elle <strong>à</strong> l’activité artistique, quelle en est la légitimité et la pertinence. On<br />
s’interrogera, notamment, sur le(s) statut(s) attribué(s) <strong>à</strong> l’artistique ainsi qu sur la réception et la fonction des<br />
œuvres selon les lieux et les périodes historiques.<br />
UE 2 – Droit de la culture – Coef. 2 – 6 ECTS<br />
Cette UE est centrée sur les questions spécifiques aux relations de travail dans le secteur de la création en<br />
mettant l’accent sur les singularités de la réglementation du travail dans ce secteur et de la législation sociale<br />
des intermittents, ainsi que sur la manière dont le droit d’auteur régit les rapports entre les différents acteurs<br />
du secteur de la création (créateurs, exploitants, public, etc.). Le module « droit des contrats » s’intéressera <strong>à</strong> la<br />
notion de contrat et aux fondements de sa valeur juridique.<br />
Droit de la création – David Forest<br />
Droit des contrats – David Forest<br />
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants au droit d’auteur, qui protège notamment les créations<br />
artistiques – œuvres littéraires, musicales, théâtrales, chorégraphiques, audiovisuelles, etc. –, ainsi qu’aux<br />
autres grandes catégories de propriété intellectuelle que sont les marques, dessins et modèles, le savoir-faire,<br />
les secrets commerciaux. L’approche de ce cours sera plus pratique que théorique et permettra aux étudiants<br />
de se familiariser avec différentes notions juridiques et pratiques contractuelles (contrat d’édition, de cession<br />
des droits d’adaptation audiovisuelle, de production). Des éléments de comparaison avec le droit nordaméricain<br />
de la propriété intellectuelle (notamment le copyright) seront proposés.<br />
UE 3 – Enjeux contemporains de la culture – Coef. 2 – 6 ECTS<br />
Valeurs esthétiques et valorisation monétaire – Alain Lévy<br />
Une œuvre d’art a un prix que lui attribuent les différents acteurs qui animent ce que l’on appelle le marché de<br />
l’art. Elle a aussi un coût qui, selon le cas, peut être en relation avec le dit marché. Mais qu’en est-il de sa valeur,<br />
notion plus complexe <strong>à</strong> laquelle ce cours se propose de réfléchir.<br />
Livre, lecture, écriture – Anne Kupiec<br />
Au-del<strong>à</strong> des données quantitatives qui révèlent nombre de paradoxes relatifs au livre, <strong>à</strong> la lecture et <strong>à</strong> l’écriture<br />
dans les sociétés contemporaines, et singulièrement en France, il va s’agir de repérer des indices qui font<br />
apparaître un statut spécifique du livre et de l’écrit et de mettre au jour les remaniements continus qui<br />
l’affectent.<br />
Politiques du spectacle vivant – Nathalie Montoya<br />
Le spectacle vivant constitue l'un des enjeux actuels des politiques culturelles et ses spécificités font l'objet d'un<br />
examen approfondi dans le cadre de ce cours.<br />
UE 4 – Outils – Coef. 1 – 3 ECTS<br />
Langue<br />
Pour les étudiants de M2, l’anglais de spécialité leur est ouvert <strong>à</strong> la suite du passage d’un test qui<br />
déterminera leur niveau.<br />
Atelier de méthode – Nathalie Montoya<br />
Cet atelier vise <strong>à</strong> une sensibilisation aux pratiques de recherche.<br />
UE 5 – Création, conservation, conduite de projets – Coef. 2 – 6 ECTS<br />
Parmi quatre modules proposés : « Conduite de projet », « Cinéma documentaire », « Patrimoine »,<br />
« Photographie », deux au choix doivent être retenus par l’étudiant pour la validation de cette UE.<br />
45
Conduite de projet – Danielle Bellini<br />
Cette option a pour objectif de proposer aux étudiants d’organiser concrètement une action culturelle en<br />
partenariat avec une structure culturelle <strong>à</strong> <strong>Paris</strong> et en Région parisienne. Le contenu de l’action sera défini avec<br />
la structure accueillante. Le groupe d’étudiants sera réparti en deux sous-groupes : un sous-groupe conduira<br />
une action culturelle, l’autre sous-groupe conduira une série de conférences-débats sur des questions et des<br />
enjeux liés aux politiques culturelles. Ces conférences publiques seront organisées sous l’égide de l’UFR de<br />
Sciences Sociales de <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>, se tiendront au Musée du Montparnasse.<br />
Cinéma documentaire – Isabelle Rèbre<br />
Il s’agit d’une approche du cinéma documentaire par le sensible, où nous formulerons progressivement une<br />
définition du genre en nous appuyant sur des œuvres que nous regarderons ensemble. Nous suivrons pour cela<br />
un parcours thématique qui pourrait aller de « filmer la parole » <strong>à</strong> « filmer le passé ». Nous nous intéresserons <strong>à</strong><br />
leur fabrication et verrons en quoi ce qu’on appelle « le documentaire de création » se différencie du reportage<br />
ou du magazine, en quoi il est écriture et invention de formes.<br />
Patrimoine – Alain Lévy<br />
Le patrimoine est affaire de mémoires : mémoire individuelle et mémoire collective sont appelées <strong>à</strong> s’y<br />
confronter. Pour se rendre crédible, la mémoire collective se réclame de l’exactitude historique fondée sur<br />
l’exhibition de sources constituées d’un certain nombre d’objets matériels, et aujourd’hui immatériels, tenus<br />
pour autant de traces de l’activité des antécesseurs témoignant d’intentions supposées congruentes avec ce qui<br />
donne ses raisons d’être <strong>à</strong> la société présente. Ce sont ces objets, revêtus d’un discours qui les rend vénérables,<br />
qui constituent le patrimoine. C’est ce discours que l’on se propose d’étudier au travers, notamment, des<br />
législations qui se sont succédées et accumulées jusqu’<strong>à</strong> aujourd’hui, ainsi qu’au travers des politiques actuelles<br />
du patrimoine, en France aussi bien qu’<strong>à</strong> l’échelle internationale.<br />
Semestre 4 (Semestre 2 du Master 2) – 30 ECTS<br />
UE 1 – Création artistique et projets culturels – Coef. 1 – 4 ECTS<br />
Gestion budgétaire et projets artistiques – Vincent Tenenbaum<br />
La notion de projets sera abordée en se référant au monde concret des institutions culturelles. Ce cours est un<br />
lieu d’apprentissage <strong>à</strong> l’élaboration et au pilotage de projets culturels en intégrant leur dimension budgétaire.<br />
Sociologie de l’art et de la création artistique – Federico Tarragoni<br />
Ce cours cherche <strong>à</strong> comprendre les mécanismes sociaux essentiels de la création et particulièrement de la<br />
création artistique : comment l’humain crée en contribuant indéfiniment <strong>à</strong> la création de la société, et comment<br />
approfondir le sens de la création artistique. Qu’est-ce qui donne sens aux œuvres artistiques, et comment<br />
analyser le sens et les sens d’une œuvre d’art <strong>à</strong> travers le temps ?<br />
UE 2 – Politiques culturelles et territoires – Coef. 1 – 4 ECTS<br />
Cette UE, composée de deux modules, articulent les différents échelons territoriaux. Les politiques publiques<br />
nationales de l’art et de la culture « commandent » en grande partie les politiques locales/territoriales, et les<br />
politiques internationales (cultures et artistes étrangers en France, cultures et artistes français <strong>à</strong> l’étranger). Et<br />
si la tradition spécifiquement française d’organisation et de financement public de la culture demeure, même<br />
après vingt-cinq ans de lois de décentralisation, le processus de construction européenne, en favorisant les<br />
coopérations entre régions – les euro-régions - a néanmoins permis <strong>à</strong> la région face <strong>à</strong> l’Etat central et aux villes,<br />
de combler quelque peu son déficit identitaire, l<strong>à</strong> encore, spécifique <strong>à</strong> la France<br />
Politiques culturelles locales – Sophie Delvainquière<br />
Le cours porte sur l'activité des collectivités locales dans le domaine culturel ainsi que sur l'action terrotoriale<br />
des services de l'Etat concernés par ce domaine (aux niveaux central et déconcentré). Sont successivement<br />
examinés le cadre légal de l'intervention des collectivités locales en matière culturelle, la décentralisation, les<br />
moyens mobilisés ainsi que les modes d'action et de coopération développés dans le cadre de partenariats<br />
entre les différents niveaux de gouvernement, des fonds, conventions et contrats jusqu'aux instances partagées<br />
de concertation.<br />
Echanges artistiques internationaux – Laurence Gillot<br />
Afin d’élargir la conception traditionnelle des mondes de l’art (musées, grandes collections publiques et privées,<br />
etc.) et de dépasser les cadres national et européen traditionnellement étudiés, le cours envisagera les<br />
échanges d’objets issus de découvertes archéologiques et les relations qui se tissent, dans ce cadre, entre pays<br />
découvreurs et pays sources <strong>à</strong> l’échelle internationale. L’attention portera principalement sur les impacts des<br />
découvertes et les relations sociales et politiques qui se tissent entre les acteurs de ces échanges. Dans une<br />
perspective historique, le cours traitera précisément du mouvement antiquaire des XVIII e et XIX e siècles, de<br />
l’appropriation par les grandes puissances coloniales d’objets d’art issus de pays étrangers (colonies ou sphères<br />
46
d’influence) et de la question de la propriété culturelle (dont les polémiques sur le retour des antiquités vers les<br />
pays sources), ainsi que du développement contemporain du commerce d’antiquités et du marché de l’art.<br />
UE 3 – Thèmes : Pluralité des secteurs culturels – Coef. 2 – 4 ECTS<br />
Spécificités professionnelles – Danielle Bellini<br />
A partir d’expériences de terrain, ce cours engage une réflexion la façon dont les projets sont pensés et réalisés<br />
sur un territoire. Les méthodologies adoptées par les professionnels de la culture sont liées aux orientations<br />
des structures mais aussi aux parcours personnels et aux dynamiques mises en œuvre de façon globale avec les<br />
habitants (les publics). Ce cours a pour objectif la constitution d’outils d’identification et d’analyse des<br />
environnements culturels et des postures professionnelles<br />
Métiers de la culture – Nathalie Montoya<br />
Ce module insiste sur la relation directe au monde professionnel.<br />
UE 4 – Outils / Stage – Coef. 1 – 3 ECTS<br />
Stage<br />
UE 5 – Mémoire – Coef. 5 – 15 ECTS<br />
47
Mémoires : calendrier, rédaction, soutenance<br />
Juillet, septembre : choix d’un sujet et d’un directeur de mémoire (voir la liste ci-jointe). Accord écrit<br />
(indispensable pour l’inscription administrative et l'inscription pédagogique).<br />
Fin du premier semestre de M1 : validation d’un projet de 5 <strong>à</strong> 7 pages avec problématique et<br />
bibliographie.<br />
Fin du second semestre de M1 : soutenance du premier mémoire (40 pages) avec le directeur du<br />
mémoire, lequel peut éventuellement être accompagné d'un second enseignant.<br />
Fin du premier semestre de M2 : présentation et validation de la première étape du second mémoire<br />
(30-40 pages).<br />
Fin du second semestre de M2 : soutenance du second mémoire (80 <strong>à</strong> 100 pages). La soutenance a lieu<br />
devant un jury composé du directeur du mémoire et d'un second enseignant.<br />
Les mémoires sont des travaux personnels de recherche. Ils doivent comporter l’étude proprement dite,<br />
des notes et des références, une bibliographie, une table des matières, éventuellement une annexe et<br />
des illustrations.<br />
Ils doivent être soigneusement rédigés par traitement de texte (interligne 1,5, corps de 12, marge d’au<br />
moins 3 cm, pagination).<br />
On pourra se reporter <strong>à</strong> la Fiche d’information sur la rédaction et la soutenance des mémoires disponible<br />
dans le secrétariat de Master, ou <strong>à</strong> l’un des nombreux ouvrages consacrés <strong>à</strong> cette question.<br />
48
Stages en milieu professionnel pour les étudiants de LAC<br />
L’UFR LAC a mis en place un dispositif d’aide aux étudiants désireux d’effectuer un stage en entreprise dans le<br />
courant de l’année universitaire. Ce dispositif vise <strong>à</strong> développer le dialogue avec les entreprises, <strong>à</strong> améliorer la<br />
circulation de l’information sur les stages et les entreprises, et <strong>à</strong> harmoniser l’intégration progressive des stages<br />
dans la validation des enseignements.<br />
Ce dispositif est animé par le secrétariat de direction (son adresse électronique et son numéro de téléphone seront<br />
disponibles <strong>à</strong> le rentrée), et Marc Vernet, professeur, responsable des stages pour l’UFR (marc.vernet@univ-parisdiderot.fr<br />
).<br />
Les formulaires de convention de stages doivent être téléchargés. On trouvera également les textes généraux<br />
d’encadrement des stages et de nombreuses informations (notamment sur les stages proposés par des<br />
entreprises) sur le site de l’<strong>Université</strong> <strong>à</strong> la rubrique Stages. Pour toutes les années, la procédure d’enregistrement<br />
de la convention de stage est la même (voir ci-dessous).<br />
1. La convention de stage :<br />
La convention de stage n’est pas un formulaire administratif. C’est un contrat quadripartite entre l’entreprise,<br />
l’étudiant, l’UFR et l’université, engageant conjointement les uns et les autres dans un cadre précis,<br />
pédagogiquement, juridiquement et socialement fixé. Elle a pour but de permettre :<br />
- <strong>à</strong> l’étudiant de bénéficier pendant son stage d’une couverture sociale,<br />
- <strong>à</strong> l’entreprise de faire l’économie de celle-ci,<br />
- <strong>à</strong> l’étudiant de définir précisément, avec l’entreprise, l’objet et l’objectif du stage, ainsi que les<br />
conditions de déroulement et de rémunération de ce dernier,<br />
- <strong>à</strong> l’étudiant de définir précisément, avec un enseignant responsable pédagogique, la forme et le fond<br />
de la validation de ce stage dans le cursus suivi.<br />
L’<strong>Université</strong> exerce donc plusieurs fonctions :<br />
Au niveau de l’UFR :<br />
- elle met en place un dispositif de suivi technique, avec la secrétaire en charge des stages et un<br />
enseignant responsable de la bonne forme des conventions, de leur intégration dans les cursus et de<br />
la bonne circulation de l’information (Marc Vernet).<br />
- elle permet la prise en compte pédagogique du stage par une validation, par l’enseignant qui a<br />
accepté la responsabilité pédagogique, dans le cadre du cursus.<br />
Au niveau du Secrétariat général :<br />
- elle enregistre la convention dont elle assure la mise en œuvre administrative (par exemple en cas de<br />
problème de santé de l’étudiant).<br />
2. Conditions :<br />
Depuis novembre 2009, tous les stages sont de statut « obligatoire », ce qui signifie qu’ils doivent recevoir une<br />
validation pédagogique dans le cadre du cursus de l’étudiant. En l’état actuel de la maquette, les étudiants ne<br />
sont pas tous obligés de faire un stage, mais s’ils en effectuent un, celui-ci doit être validé dans le cadre du<br />
cursus.<br />
Les possibilités de stages sont communiquées soit par l’<strong>Université</strong> (voir tableau d’affichage près du secrétariat),<br />
soit sont décelées par l’étudiant lui-même qui en a pris l’initiative.<br />
Il convient de prévoir, dès l’élaboration de la convention de stage, les modalités de validation, par un enseignant<br />
responsable pédagogique, dans le cursus suivi par l’étudiant, de l’expérience du stage.<br />
Le cadre juridique permet <strong>à</strong> chaque étudiant d’effectuer sur une année universitaire au maximum deux stages<br />
pour une durée globale maximale de six mois <strong>à</strong> temps plein.<br />
C’est pourquoi l’UFR recommande pour chaque stage une durée moyenne de trois mois, ce qui permet de<br />
véritables acquis du côté professionnel et du côté universitaire.<br />
49
3. Recommandations :<br />
Il convient, pour l’étudiant, de faire établir la convention de stage dans les meilleures conditions de clarté et de<br />
coordination possible. La marche <strong>à</strong> suivre est la suivante :<br />
- retirer ou <strong>télécharger</strong> le formulaire de convention de stage, en s’informant de l’offre déj<strong>à</strong> existante<br />
(stages proposés par des entreprises, par le biais de l’UFR).<br />
- le remplir d’une part avec l’employeur (données administratives, objet précis du stage, temps consacré,<br />
rémunération…), et d’autre part avec l’enseignant responsable (qui assurera dès lors la validation<br />
pédagogique du stage),<br />
- soumettre le formulaire au secrétariat de LAC qui le visera dans sa forme, avant de le soumettre <strong>à</strong> la<br />
signature finale du secrétariat général de l’<strong>Université</strong>.<br />
LAC se réserve le droit de demander la révision d’un formulaire d’une convention si la rédaction de celle-ci ou<br />
certaines informations ne lui paraissent pas conformes aux dispositions générales afin de tendre vers les meilleurs<br />
résultats possibles pour les parties prenantes. Il appartient alors <strong>à</strong> l’étudiant de renégocier les termes avec<br />
l’entreprise et/ou avec l’enseignant responsable de la validation pédagogique.<br />
50
ENSEIGNANTS SUSCEPTIBLES DE DIRIGER<br />
DES MEMOIRES DE MASTER<br />
S U J E T S E T D O M A I N E S C O N C E R N E S<br />
ISABELLE BARBERIS<br />
Théâtre contemporain<br />
Performance, jeu de l'acteur, esthétique scénique<br />
CECILE DE BARY<br />
Roman du XXe s. au contemporain<br />
Littératures <strong>à</strong> contraintes, Oulipo.<br />
Relations texte-image. Edition électronique.<br />
HELENE BATY-DELALANDE<br />
Littérature française du XXe, notamment le roman (1900-1950); les écritures de l'Histoire; littérature et<br />
politique.<br />
JACQUES-OLIVIER BEGOT<br />
Esthétique et philosophie de l’art<br />
Littérature et philosophie, théorie littéraire<br />
BERNADETTE BRICOUT<br />
Contes<br />
Mythes littéraires<br />
Littératures orales<br />
Littérature pour la jeunesse<br />
JEAN-FRANCOIS COTTIER<br />
Littérature latine. Réception des auteurs antiques<br />
Moyen Âge et Renaissance<br />
Littérature de la Nouvelle-France<br />
JEAN-PATRICE COURTOIS<br />
Esthétique<br />
Arts (danse, littérature et danse)<br />
Ecologie, écocritique, théories de l'environnement (XVIII-XXe)<br />
Liens littérature, arts, esthétique, écologie<br />
Littérature du XXè<br />
Poésie<br />
CATHERINE COQUIO<br />
Littératures européennes et littératures du monde. XIXe-XX-XXIe siècles.<br />
Domaines francophone, anglophone, germanophone.<br />
Littérature, Histoire, Politique. Témoignages littéraires et violence historique.<br />
Littérature, sciences humaines et philosophie.<br />
Postcolonialité, littératures africaines.<br />
Littérature et arts, littérature et cinéma, esthétique.<br />
PASCAL DEBAILLY<br />
JEAN DELABROY<br />
JOSE-LUIS DIAZ<br />
Littérature du XVI e et du XVII e siècle<br />
Les écritures comiques, satiriques et militantes <strong>à</strong> la Renaissance et <strong>à</strong> l’Age classique<br />
Littérature du XIX e siècle<br />
La représentation de l'écrivain (XVII e - XX e siècle)<br />
Balzac, Stendhal, Sand, Musset, les romantiques en général<br />
Autobiographies et correspondances<br />
Sociabilités littéraires<br />
51
FLORENCE DUMORA<br />
Poétique et imaginaire<br />
Littérature et philosophie<br />
Littérature des XVI e et XVII e siècles<br />
CELINE FLECHEUX<br />
LAURENT FLIEDER<br />
Esthétique<br />
Perspective, art moderne et contemporain, littérature<br />
Roman français d’aujourd’hui<br />
Poésie française du XX e siècle<br />
Jeu verbal et expérimentations formelles<br />
EVELYNE GROSSMAN<br />
Littérature des XX e- XXI e siècles<br />
Théorie littéraire - Approches psychanalytiques<br />
Littérature et philosophie<br />
GUIOMAR HAUTCOEUR<br />
Littérature comparée (XVII e -XVIII e )<br />
Roman, nouvelle<br />
Siècle d’Or espagnol (roman, théâtre)<br />
GENEVIEVE JOLY<br />
Edition critique des textes du Moyen Âge<br />
Traductions de textes du Moyen Âge<br />
Etudes de morpho-syntaxe, de syntaxe et de lexicologie <strong>à</strong> partir de textes en ancien français<br />
(chansons de geste, romans arthuriens, romans de Chrétien de Troyes)<br />
MARTIN KALTENECKER<br />
Musicologie, Musique du XXe siècle<br />
Esthétique – Théories de l'écoute<br />
CHANTAL LIAROUTZOS<br />
Récits de voyage, représentation de l’espace, histoire, littérature de vulgarisation au début des temps<br />
modernes<br />
Littérature de la Renaissance et baroque<br />
FLORENCE LOTTERIE<br />
Littérature du XVIIIe siècle<br />
Histoire des idées et de la culture<br />
Questions de genre.<br />
Marivaux, Prévost, <strong>Diderot</strong>, Rousseau, Mercier, Sade, Staël, Constant.<br />
SOPHIE LUCET<br />
MARIA MANCA<br />
ERIC MARTY<br />
CLAUDE MILLET<br />
XIXème siècle : littérature fin-de-siècle, symbolisme<br />
Histoire du théâtre en France et en Europe entre 1870 et 1914, théâtre et politique<br />
Critique théâtrale<br />
Éthnopoétique<br />
Poésie et musique<br />
Anthropologie des cultures méditerranéennes<br />
Poésie fin XIX e et XX e siècles<br />
Littérature contemporaine<br />
Autobiographie au XX e siècle<br />
Théorie de la littérature (Barthes)<br />
Littérature du XIX e siècle<br />
52
CLAUDE MURCIA<br />
CLÉLIA NAU<br />
Littérature et cinéma<br />
Littérature comparée (en particulier domaine français, hispanique, hispano-américain, moderne et<br />
contemporain)<br />
Traductologie<br />
Cinéma de la modernité<br />
Histoire de l’art<br />
VINCENT NYCKEES<br />
Lexique, polysémie, changement de sens<br />
Métaphores et figures discursives<br />
Théorie sémantique<br />
Enonciation<br />
Grammaire<br />
SYLVIE PATRON<br />
ANNE PAUPERT<br />
PAULE PETITIER<br />
Critique et théorie littéraires au XXe siècle<br />
Les revues au XXe siècle<br />
Théorie du récit<br />
Histoire et épistémologie de la théorie littéraire<br />
Auteurs français du XXe siècle (notamment Gide, Pierre Herbart, Proust, Céline, Segalen, Beckett, Robert<br />
Pinget, Claude Simon).<br />
Littérature médiévale (en particulier, genres narratifs et poésie, écriture du moi)<br />
Paroles de femmes dans la littérature française du Moyen Age<br />
Œuvre de Christine de Pizan<br />
Culture populaire et culture savante/oral et écrit dans la littérature médiévale<br />
Littérature du XIX e siècle (roman, histoire, essais, littérature de vulgarisation scientifique)<br />
Écriture de l’histoire, représentations de l’espace<br />
Histoire culturelle du XIX e siècle<br />
NATHALIE PIEGAY-GROS<br />
Littérature du XX e siècle et notamment Nouveau Roman, Claude Simon, Robert Pinget, Pierre Michon,<br />
œuvre d’Aragon …<br />
Surréalisme<br />
Théorie du récit, Questions de poétique ; Théories de la lecture<br />
DOMINIQUE RABATÉ<br />
Roman et récit au XX° siècle,<br />
Lyrisme et énonciation poétique,<br />
Formes en prose de l'extrême contemporain,<br />
Théorie littéraire.<br />
REGIS SALADO<br />
DIDIER SAMAIN<br />
YANNICK SÉITE<br />
Littérature comparée du XX e siècle<br />
Oeuvres narratives (Domaines anglo-saxon, espagnol, portugais)<br />
Etudes de réception des textes - travaux concernant James Joyce<br />
Histoire et épistémologie des sciences du langage<br />
Philosophie du langage<br />
Histoire de la langue française<br />
18e siècle (Rousseau; mouvement des Lumières; histoire du livre; roman; presse ancienne)<br />
Époque contemporaine (études musico-littéraires en part. le jazz; Perec)<br />
STEPHANIE SMADJA<br />
Prose littéraire aux XIX e -XX e siècles (romans, nouvelles)<br />
53
LAURENCE TIBI<br />
CARINE TREVISAN<br />
Poésie de 1850 <strong>à</strong> 1950<br />
Stylistique, histoire de la langue littéraire, rhétorique. Syntaxe, énonciation<br />
Synonymie aux XVIII e -XX e siècles<br />
Littérature et musique<br />
Littérature française du XIX e siècle<br />
Littérature et Histoire au XX e siècle<br />
Autobiographie et fiction au XX e siècle<br />
Proust, Aragon<br />
Ecritures de guerre<br />
Littérature carcérale.<br />
EMMANUELLE VALETTE<br />
Anthropologie culturelle<br />
Anthropologie des sociétés anciennes grecque et romaine<br />
Histoire de la lecture<br />
JEAN VIGNES<br />
PIERRE VILAR<br />
PIERRE ZAOUI<br />
Littérature française du XVI e siècle<br />
Poésie<br />
Poésie et musique<br />
Chanson française<br />
Poésie contemporaine.<br />
Histoire du livre et des revues, XX e siècle.<br />
Littérature et peinture XX e siècle.<br />
Philosophie générale<br />
Art contemporain<br />
Psychanalyse<br />
LAURENT ZIMMERMANN<br />
Poésie fin 19e, 20e siècle<br />
Théorie littéraire<br />
Esthétique<br />
54
UFR LAC (Lettres, arts, cinéma)<br />
Bâtiment Les Grands Moulins – Case 7010 – 75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
ACCORD POUR LA DIRECTION DE MEMOIRE<br />
Mme, M. ___________________________________<br />
Accepte de diriger le mémoire de M1 – M2 *<br />
De Mme, Mlle, M. _____________________________________<br />
Ayant pour titre ________________________________________<br />
Durant l’année universitaire 2012-2013.<br />
Date et signature du directeur du mémoire<br />
* rayer la mention inutile<br />
55