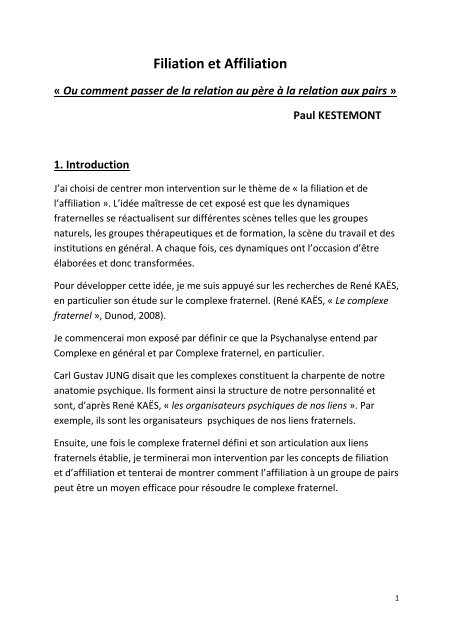Filiation et Affiliation - SBSA
Filiation et Affiliation - SBSA
Filiation et Affiliation - SBSA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Filiation</strong> <strong>et</strong> <strong>Affiliation</strong><br />
« Ou comment passer de la relation au père à la relation aux pairs »<br />
1. Introduction<br />
Paul KESTEMONT<br />
J’ai choisi de centrer mon intervention sur le thème de « la filiation <strong>et</strong> de<br />
l’affiliation ». L’idée maîtresse de c<strong>et</strong> exposé est que les dynamiques<br />
fraternelles se réactualisent sur différentes scènes telles que les groupes<br />
naturels, les groupes thérapeutiques <strong>et</strong> de formation, la scène du travail <strong>et</strong> des<br />
institutions en général. A chaque fois, ces dynamiques ont l’occasion d’être<br />
élaborées <strong>et</strong> donc transformées.<br />
Pour développer c<strong>et</strong>te idée, je me suis appuyé sur les recherches de René KAËS,<br />
en particulier son étude sur le complexe fraternel. (René KAËS, « Le complexe<br />
fraternel », Dunod, 2008).<br />
Je commencerai mon exposé par définir ce que la Psychanalyse entend par<br />
Complexe en général <strong>et</strong> par Complexe fraternel, en particulier.<br />
Carl Gustav JUNG disait que les complexes constituent la charpente de notre<br />
anatomie psychique. Ils forment ainsi la structure de notre personnalité <strong>et</strong><br />
sont, d’après René KAËS, « les organisateurs psychiques de nos liens ». Par<br />
exemple, ils sont les organisateurs psychiques de nos liens fraternels.<br />
Ensuite, une fois le complexe fraternel défini <strong>et</strong> son articulation aux liens<br />
fraternels établie, je terminerai mon intervention par les concepts de filiation<br />
<strong>et</strong> d’affiliation <strong>et</strong> tenterai de montrer comment l’affiliation à un groupe de pairs<br />
peut être un moyen efficace pour résoudre le complexe fraternel.<br />
1
2. Qu’est-ce qu’un complexe ?<br />
a. Définition :<br />
Du latin « complexus », le complexe désigne un ensemble de plusieurs<br />
éléments distincts imbriqués ou pliés ensemble. (Littré)<br />
Pour la psychanalyse, le complexe est un ensemble organisé de représentations<br />
<strong>et</strong> d’investissements inconscients.<br />
Nos complexes sont constitués à partir de nos fantasmes <strong>et</strong> de nos relations<br />
intersubjectives, principalement les relations que nous avons connues durant<br />
notre enfance. Essentiellement, nos relations avec nos parents <strong>et</strong> avec nos<br />
frères <strong>et</strong> sœurs.<br />
Nous sommes des êtres complexes, nos complexes en sont les témoins <strong>et</strong> les<br />
relations que nous entr<strong>et</strong>enons avec les autres sont également complexes.<br />
Qu’est-ce qui caractérise le complexe ?<br />
Principalement, c’est le conflit interne ou conflit intrapsychique.<br />
Qu’est-ce qu’un conflit interne ?<br />
Le conflit interne est le résultat d’exigences psychiques contradictoires. Par<br />
exemple, le conflit entre des pulsions contradictoires ou des affects<br />
antagonistes comme l’amour <strong>et</strong> la haine. Cela peut être aussi le conflit entre un<br />
désir <strong>et</strong> un interdit <strong>et</strong>c.<br />
La résolution de nos conflits internes peut se faire de différentes manières :<br />
- Sur le mode du compromis<br />
- Par le rêve, les lapsus <strong>et</strong> les actes manqués<br />
- Par les symptômes.<br />
- Par la synthèse créative des opposés.<br />
3. Le complexe fraternel<br />
Au regard de la définition qui précède, le complexe fraternel est bien un<br />
complexe à part entière, du moins au sens psychanalytique du terme.<br />
2
Or, force est de constater que jusqu’à présent, la psychanalyse n’a pas donné<br />
une réelle place à ce complexe.<br />
Pourquoi ce manque d’intérêt ?<br />
René Kaës propose l’idée que plusieurs obstacles se sont érigés à l’encontre de<br />
l’élaboration de la question du fraternel <strong>et</strong> donc du complexe fraternel depuis<br />
le début de la psychanalyse. Je vais développer deux obstacles qui me semblent<br />
importants.<br />
1. Le complexe fraternel <strong>et</strong> les liens fraternels qu’il conviendra de distinguer<br />
l’un de l’autre ont jusqu’à présent été examinés en lien avec les parents. Ainsi,<br />
le complexe fraternel est généralement considéré comme un simple<br />
déplacement, un substitut ou ersatz du complexe d’Œdipe. Derrière le frère, il y<br />
a le père <strong>et</strong> derrière la sœur se cache la mère. Les rivalités fraternelles <strong>et</strong><br />
sororales, les désirs entre frères <strong>et</strong> sœurs sont généralement analysés comme<br />
des déflections des rivalités <strong>et</strong> désirs œdipiens. Or, selon René Kaës, le groupe<br />
fraternel s’organise au croisement de deux axes. Mireille Delporte nous en a<br />
parlé hier. L’axe vertical, constitué par le rapport au couple parental <strong>et</strong> l’axe<br />
horizontal formé par la génération paritaire. Le premier axe s’organise dans les<br />
modalités du complexe d’Œdipe alors que selon lui, le second s’organise dans<br />
les modalités du complexe fraternel.<br />
Un exemple : Un patient, aîné d’une fratrie de quatre garçons me dit qu’il s’est<br />
toujours vécu comme très soumis à l’autorité de ses parents. Il se souvient qu’il<br />
se sentait fréquemment mal pris dans les relations à ses frères lorsque ceux-ci<br />
transgressaient les règles imposées par les parents. Lui avait la charge de faire<br />
respecter les limites en l’absence des parents, il était désigné comme<br />
responsable de la fratrie <strong>et</strong> il se sentait investi de ce rôle. Mais il se souvient<br />
aussi qu’il enviait la capacité transgressive de ses frères. Aujourd’hui, c<strong>et</strong>te<br />
complexité interne <strong>et</strong> intersubjective, il l’a r<strong>et</strong>rouve sur son lieu de travail.<br />
Ingénieur, il occupe une fonction de chef d’équipe <strong>et</strong> est chargé de faire<br />
respecter aux employés les directives de son employeur, même si parfois il les<br />
ressent comme arbitraires <strong>et</strong> injustes. Il vit à nouveau un manque de confiance<br />
en lui-même <strong>et</strong> se trouve partagé entre la difficulté de faire respecter les<br />
consignes <strong>et</strong> correspondre à ce que son patron (père symbolique) attend de lui<br />
<strong>et</strong> son envie vis-à-vis de la solidarité entre ses collègues (frères symboliques)<br />
3
dont il se sent parfois exclu. Pour moi, il se trouve « coincé » au carrefour des<br />
deux axes, les deux axes organisateurs de ses liens avec la direction d’une part<br />
<strong>et</strong> les collègues, d’autre part.<br />
Le complexe d’Œdipe pose clairement – grâce à l’interdit de l’inceste – la<br />
différence des générations.<br />
La sexualité (au sens large) entre frères <strong>et</strong> sœurs, entre frères <strong>et</strong> entre sœurs,<br />
ne m<strong>et</strong> pas en jeu à proprement parler la différence des générations. Encore<br />
que dans certains cas, notamment dans les familles nombreuses ou dans<br />
certaines familles recomposées, la différence d’âge est telle que la différence<br />
des générations peut exister.<br />
Mais, ce qui est plus spécifique en ce qui concerne les fratries, concerne l’eff<strong>et</strong><br />
de rang. Il représente d’une certaine manière, par déplacement, l’eff<strong>et</strong> que<br />
produit la différence des générations. Il est, en eff<strong>et</strong>, bien connu que « le p<strong>et</strong>it<br />
dernier » le reste toute sa vie aux yeux des aînés. Tantôt, il en souffre, tantôt, il<br />
en tire quelques avantages. Mais, en tout cas, la place assignée à chaque<br />
enfant dans la fratrie va avoir incontestablement une influence sur le<br />
développement de sa personnalité ; notamment sur son complexe fraternel. Il<br />
n’est pas rare, par exemple, qu’un deuxième enfant se structure dans une<br />
identité négative par rapport à l’aîné. Si l’aîné est devenu un enfant turbulent<br />
suite à l’imbrication de différents facteurs préœdipiens <strong>et</strong> œdipiens, le second<br />
développera une personnalité davantage consensuelle <strong>et</strong> se comportera<br />
éventuellement en « enfant sage », refoulant en grande partie ses pulsions<br />
agressives. Nous pouvons, bien-sûr, analyser ce comportement en fonction du<br />
désir des parents sur c<strong>et</strong> enfant, comprendre qu’il ou elle a trouvé par là une<br />
façon d’occuper une place qui lui assurait la bienveillance de ses parents. Mais,<br />
il n’en n’est pas moins vrai pour autant que la la personnalité <strong>et</strong> le<br />
comportement de l’aîné ainsi que leurs relations fraternelles ont eu une<br />
incidence sur la construction de la personnalité de l’un <strong>et</strong> de l’autre de ces deux<br />
enfants.<br />
2. Un deuxième obstacle à penser le complexe fraternel en psychanalyse vient<br />
de la méthodologie de la cure analytique elle-même. Le « colloque singulier »<br />
se prête difficilement à l’analyse des transferts latéraux ou transversaux. Il a<br />
fallu attendre la création des thérapies de groupe <strong>et</strong> des thérapies familiales<br />
4
psychanalytiques pour comprendre que les transferts latéraux ne sont pas<br />
seulement des résistances au transfert sur l’analyste, mais qu’ils peuvent être<br />
aussi des résistances de transfert. Or, nous dit Kaës, l’analyse de ces transferts<br />
révèle souvent qu’il s’agit de complexes fraternels qui cherchent à se<br />
concrétiser dans des liens réels chaque fois que l’analyse du complexe fraternel<br />
est négligée.<br />
4. Complexe fraternel <strong>et</strong> liens fraternels<br />
Le complexe fraternel désigne une organisation interne des désirs amoureux,<br />
de la haine <strong>et</strong> de l’agressivité vis-à-vis de c<strong>et</strong> « autre » qu’un suj<strong>et</strong> se reconnaît<br />
comme frère ou sœur.<br />
Le lien fraternel désigne une organisation intersubjective. Il m<strong>et</strong> en jeu les<br />
rapports entre les différents complexes des frères <strong>et</strong> sœurs lorsqu’ils sont en<br />
relation.<br />
Le complexe fraternel est donc un organisateur psychique du lien fraternel <strong>et</strong><br />
par extension, de tout lien : de famille, de couple <strong>et</strong> de groupe.<br />
5. Un complexe crucial<br />
Le complexe fraternel est important pour la constitution du moi.<br />
Par exemple, dans le film « Ma saison préférée » d’A. Téchiné, Antoine<br />
présente ce qu’on pourrait appeler une personnalité borderline. Il est englué<br />
dans une relation incestuelle dont il n’arrive pas à décoller avec sa mère <strong>et</strong> avec<br />
sa sœur. Son moi est relativement peu constitué <strong>et</strong> il passe facilement à l’acte<br />
car il n’arrive pas à contenir toutes ses contradictions internes. Les images des<br />
frères ou sœurs siamois(es) du générique sont des métaphores significatives<br />
de la difficulté d’individuation chez les protagonistes du film en général.<br />
Hypothèse : « L’avenir du complexe d’Œdipe est le complexe fraternel <strong>et</strong><br />
…réciproquement, le complexe fraternel aboutit à une impasse s’il ne se<br />
restructure pas avec l’Œdipe ». (R.Kaës)<br />
6. <strong>Filiation</strong> <strong>et</strong> <strong>Affiliation</strong><br />
5
C<strong>et</strong>te citation m’amène à la dernière partie de mon exposé, celle des rapports<br />
entre « filiation » <strong>et</strong> « affiliation » ou comment passer de la relation au père à<br />
la relation aux pairs.<br />
a. Définitions :<br />
<strong>Filiation</strong> : Le terme « filiation » désigne la descendance de père en fils en ligne<br />
directe. La filiation légitime se prouve par l’acte de naissance. Par extension, on<br />
parle d’union par filiation. Par exemple, la dépendance d’un monastère à<br />
l’égard d’un autre, parce qu’il en tire son origine. Une abbaye de la filiation de<br />
Clairvaux.<br />
C’est également la liaison entre des choses qui naissent les unes des autres. La<br />
filiation des mots. En Histoire <strong>et</strong> en Philosophie, c’est l’enchevêtrement des<br />
évènements qui fait que du précédent naît le suivant ; d’où se forme la trame<br />
de l’Histoire.<br />
Mais, il ne faut pas confondre la filiation avec l’affiliation : la filiation est la<br />
descendance par fils, <strong>et</strong>, figurément, la série, l’enchaînement ; l’affiliation, est –<br />
quant à elle – l’adjonction comme fils au sens premier du terme, c’est-à-dire<br />
l’association.<br />
Ainsi, selon Hach<strong>et</strong>te (1996), l’affiliation renvoie au verbe « affilier », donc à<br />
une action. Et ce terme a deux emplois. Le premier est en rapport avec le terme<br />
d’organisation <strong>et</strong> avec le fait de se regrouper sous une forme plus vaste. Le<br />
second renvoie à l’action d’adhérer à une organisation.<br />
Le verbe « affilier » dérive cependant d’un terme de latin juridique – affiliare –<br />
employé au XIV qui avait comme sens « Prendre pour fils, pour adepte,<br />
adopter » (Goelzer H., 1996). Donc, à l’origine de ce terme, nous trouvons<br />
l’idée de filiation, c’est-à-dire de transmission transgénérationnelle de biens,<br />
probablement matériels, puisque dérivant d’une terminologie juridique.<br />
En ce qui nous concerne, en tant que psychothérapeute, nous pouvons<br />
r<strong>et</strong>rouver dans l’affiliation, le fait de nous reconnaître comme appartenant à un<br />
courant qui partage un même paradigme. Par exemple, l’affiliation comme<br />
membre à la <strong>SBSA</strong>, elle-même affiliée à la Fédération des Psychothérapies<br />
Humanistes. Ce paradigme <strong>et</strong> les concepts qu’il contient, nous aide à<br />
structurer, décoder, organiser ce que nous entendons dans les récits de nos<br />
6
patients. Il nous offre un cadre de travail dans lequel nous nous reconnaissons<br />
<strong>et</strong> auquel nous adhérons.<br />
Pour René Kaës, le groupe non familial – le groupe d’affiliation – peut jouer un<br />
rôle capital dans la résolution du complexe fraternel <strong>et</strong> par là, nous pouvons<br />
ajouter, dans la résolution des problématiques de liens « fraternels ».<br />
« Le groupe est ce que l’enfant découvre lorsqu’il franchit les limites de la<br />
famille. A l’école, notamment, il fait l’expérience d’être confronté à des pairs,<br />
semblables <strong>et</strong> différents, <strong>et</strong> à des situations qui mobilisent les structures <strong>et</strong> les<br />
harmoniques du complexe fraternel, sans pour autant en reproduire tous les<br />
caractères <strong>et</strong> tous les enjeux. Ce déplacement se traduit par le passage des liens<br />
de filiation aux liens d’affiliation. Ce passage est pour l’essentiel, celui de la<br />
famille au groupe. » (René Kaës, « Le complexe fraternel », p196).<br />
De c<strong>et</strong>te manière, l’affiliation à un groupe entre en conflit avec la filiation. On<br />
pourrait dire que c<strong>et</strong>te appartenance questionne notre organisation psychique.<br />
Le fait de participer à un groupe <strong>et</strong> à fortiori d’adhérer à la manière de penser,<br />
aux croyances <strong>et</strong> aux normes d’un groupe extrafamilial, nous confronte<br />
souvent de manière inconsciente avec l’héritage parental. « C’est par le groupe<br />
que l’adolescent peut se constituer comme suj<strong>et</strong> singulier, en rej<strong>et</strong>ant, en<br />
suspendant, puis en acceptant la filiation. L’articulation de ces deux processus<br />
est importante car elle nous perm<strong>et</strong> de comprendre qu’un groupe ou une<br />
institution n’est pas une famille, mais que s’y rejouent, des mouvements<br />
psychiques de filiation <strong>et</strong> de liens fraternels ». (R.Kaës, p196).<br />
L’affiliation est donc bien ce passage de la relation au père à la relation aux<br />
pairs. Le mot « affiliation » contient – en eff<strong>et</strong> - suffisamment l’idée de<br />
l’articulation entre les deux axes dont nous avons parlés, à savoir l’axe vertical<br />
qui nous situe dans la chaîne successive des générations avec l’héritage, la<br />
transmission des savoirs <strong>et</strong> des connaissances, le point d’appui narcissique –<br />
dans le meilleur des cas – que perm<strong>et</strong> le fait de se reconnaître « fils ou fille de »<br />
<strong>et</strong>, l’axe horizontal qui est celui de la parité organisée essentiellement par le<br />
complexe fraternel <strong>et</strong> qui essentiellement nous aide à nous structurer <strong>et</strong> nous<br />
restructurer dans notre rapport à c<strong>et</strong> autre semblable que peut représenter un<br />
frère ou une sœur symbolique. Ces deux axes sont complémentaires, ils sont<br />
constamment placés dans un rapport dialectique, l’un ne doit pas supplanter<br />
7
l’autre comme la clinique, mais aussi nos relations au sein d’un groupe ou<br />
d’une association nous le rappellent régulièrement. A ce suj<strong>et</strong>, René Kaës nous<br />
m<strong>et</strong> en garde <strong>et</strong> c’est par là que je terminerai mon exposé : « Ce rêve qui<br />
nourrit l’utopie des rapports strictement horizontaux est soutenu par un<br />
évitement des enjeux conflictuels <strong>et</strong> des renoncements qu’impose la double<br />
reconnaissance du triangle rivalitaire fraternel <strong>et</strong> du triangle œdipien. L’utopie<br />
fraternelle, lorsqu’elle se réalise comme c<strong>et</strong> évitement contient toujours un<br />
surcroît d’aliénation, <strong>et</strong> l’on voit apparaître régulièrement, dans ces utopies, la<br />
substitution d’un Big Brother en lieu <strong>et</strong> place du Urvater cruel <strong>et</strong> persécuteur ».<br />
.<br />
8