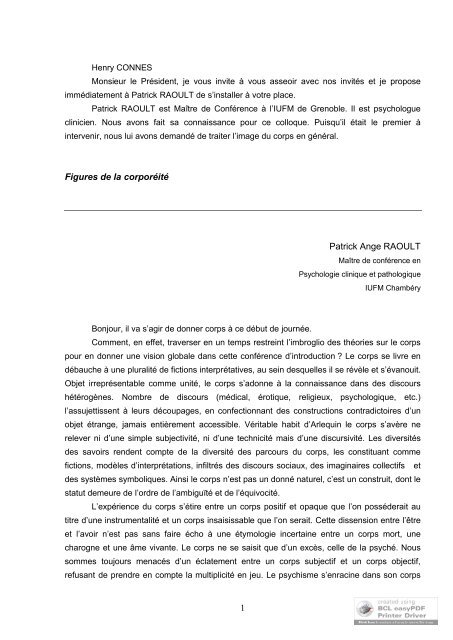1 Figures de la corporéité Patrick Ange RAOULT
1 Figures de la corporéité Patrick Ange RAOULT
1 Figures de la corporéité Patrick Ange RAOULT
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Henry CONNES<br />
Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt, je vous invite à vous asseoir avec nos invités et je propose<br />
immédiatement à <strong>Patrick</strong> <strong>RAOULT</strong> <strong>de</strong> s’installer à votre p<strong>la</strong>ce.<br />
<strong>Patrick</strong> <strong>RAOULT</strong> est Maître <strong>de</strong> Conférence à l’IUFM <strong>de</strong> Grenoble. Il est psychologue<br />
clinicien. Nous avons fait sa connaissance pour ce colloque. Puisqu’il était le premier à<br />
intervenir, nous lui avons <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong> traiter l’image du corps en général.<br />
<strong>Figures</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>corporéité</strong><br />
Bonjour, il va s’agir <strong>de</strong> donner corps à ce début <strong>de</strong> journée.<br />
1<br />
<strong>Patrick</strong> <strong>Ange</strong> <strong>RAOULT</strong><br />
Maître <strong>de</strong> conférence en<br />
Psychologie clinique et pathologique<br />
IUFM Chambéry<br />
Comment, en effet, traverser en un temps restreint l’imbroglio <strong>de</strong>s théories sur le corps<br />
pour en donner une vision globale dans cette conférence d’introduction ? Le corps se livre en<br />
débauche à une pluralité <strong>de</strong> fictions interprétatives, au sein <strong>de</strong>squelles il se révèle et s’évanouit.<br />
Objet irreprésentable comme unité, le corps s’adonne à <strong>la</strong> connaissance dans <strong>de</strong>s discours<br />
hétérogènes. Nombre <strong>de</strong> discours (médical, érotique, religieux, psychologique, etc.)<br />
l’assujettissent à leurs découpages, en confectionnant <strong>de</strong>s constructions contradictoires d’un<br />
objet étrange, jamais entièrement accessible. Véritable habit d’Arlequin le corps s’avère ne<br />
relever ni d’une simple subjectivité, ni d’une technicité mais d’une discursivité. Les diversités<br />
<strong>de</strong>s savoirs ren<strong>de</strong>nt compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s parcours du corps, les constituant comme<br />
fictions, modèles d’interprétations, infiltrés <strong>de</strong>s discours sociaux, <strong>de</strong>s imaginaires collectifs et<br />
<strong>de</strong>s systèmes symboliques. Ainsi le corps n’est pas un donné naturel, c’est un construit, dont le<br />
statut <strong>de</strong>meure <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> l’ambiguïté et <strong>de</strong> l’équivocité.<br />
L’expérience du corps s’étire entre un corps positif et opaque que l’on possé<strong>de</strong>rait au<br />
titre d’une instrumentalité et un corps insaisissable que l’on serait. Cette dissension entre l’être<br />
et l’avoir n’est pas sans faire écho à une étymologie incertaine entre un corps mort, une<br />
charogne et une âme vivante. Le corps ne se saisit que d’un excès, celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> psyché. Nous<br />
sommes toujours menacés d’un éc<strong>la</strong>tement entre un corps subjectif et un corps objectif,<br />
refusant <strong>de</strong> prendre en compte <strong>la</strong> multiplicité en jeu. Le psychisme s’enracine dans son corps
qu’il façonne et renouvelle en même temps que ce <strong>de</strong>rnier l’appelle, le rend possible et le<br />
secourt. Il n’y a pas <strong>de</strong> pensée sans corps, il n’y a qu’une pensée incarnée dans un corps.<br />
Cette conception du vivre consiste à ne pas réduire le corps à un dispositif objectif ainsi que le<br />
prétend <strong>la</strong> méthodologie dite scientifique. On concevra le corps comme faisant partie <strong>de</strong><br />
l’institution symbolique <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture, au sens anthropologique du terme.<br />
Sans en saisir toute <strong>la</strong> complexité, nous nous donnerons quelques balises. Le corps<br />
p<strong>la</strong>tonicien est celui <strong>de</strong> l’usage, quoiqu’il soit un corps habité, vivant. Le « Phédon » montre que<br />
le sensoriel empêche l’accès au vrai. Philosopher ou penser consiste alors à mourir, au sens<br />
<strong>de</strong> se séparer <strong>de</strong> l’enveloppe corporelle. La maîtrise du corps, <strong>la</strong> mortification évite le danger<br />
d’un corps d’illusions, <strong>de</strong> souillures, <strong>de</strong> déceptions. Le « Banquet », s’il rappelle que le sensible<br />
déforme et cache l’intelligible, montre qu’un certain <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> proximité <strong>de</strong>s corps s’affirme dans<br />
<strong>la</strong> progression du savoir. Le corps est gage <strong>de</strong> sécurité et d’enrichissement. Le « Georgias »<br />
dénonce les séductions du corps (toilette, cuisine) qui s’adjoignent aux autres f<strong>la</strong>tteries<br />
(rhétorique, sophistique). Avec le « Politique » s’affirme l’intégration du corps en tant qu’il prône<br />
<strong>la</strong> sagesse du corps et <strong>la</strong> loi <strong>de</strong>s mariages afin <strong>de</strong> permettre <strong>de</strong>s individus ouverts à <strong>la</strong><br />
tempérance. Mais c’est avec le « Philèbe » qu’il y a une réhabilitation du p<strong>la</strong>isir. Le jeu <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>isirs sensoriels favorise celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée et assure <strong>la</strong> sagesse. Dans le « Timée » le corps<br />
<strong>de</strong>vient paradigmatique selon une tripartition biomorphique. Le corps est ainsi finalisé et l’excès<br />
ou le défaut entraînent <strong>de</strong>s défauts. Les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> l’âme traduisent l’état du corps. Le corps<br />
aristotélicien ramène à une union substantielle du corps et <strong>de</strong> l’âme, en regard d’une<br />
dialectique <strong>de</strong> l’enveloppement et <strong>de</strong> l’exhaussement.<br />
Mais une gran<strong>de</strong> rupture intervient avec <strong>la</strong> pensée chrétienne du corps promulguant<br />
l’évacuation progressive du corps. On décèle un pôle positif, celui <strong>de</strong> l’incarnation, et un pôle<br />
négatif, celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière impure. Le corps <strong>de</strong>vient l’objet <strong>de</strong> haine, en attente d’une<br />
transmutation du corruptible à l’incorruptible. Les trois dogmes (l’Incarnation, <strong>la</strong> Trinité,<br />
l’Eucharistie) sont re<strong>la</strong>tifs au corps dans sa double dimension dualiste et unitaire. Le dualisme<br />
est celui d’une chair, où gît le faible, le corruptible, <strong>la</strong> mort, le négatif, et l’âme à libérer.<br />
L’unitaire renvoie à l’unification <strong>de</strong>s différents membres, au sens d’un corps chrétien incorporé<br />
au Christ. Le corps du chrétien, incorporée à <strong>la</strong> chair stigmatisée du Christ, n’est plus ce corps<br />
troué d’une chair. Le Christ, par son sacrifice, restaure ce corps qui n’est plus le lieu du<br />
manque, mais épanouissement. Il est question <strong>de</strong> se débarrasser du corps <strong>de</strong> <strong>la</strong> chair par une<br />
sévère mortification et un refus <strong>de</strong> <strong>la</strong> jouissance.<br />
La Renaissance institue le corps isolément comme propriété. Il bascule ainsi dans le<br />
registre <strong>de</strong> l’Avoir. Et c’est dans cette continuité avec l’école <strong>de</strong>s anatomistes italiens et<br />
hol<strong>la</strong>ndais, qu’émergera le corps cartésien, corps machine, perçu comme instrument <strong>de</strong> l’âme<br />
qui nécessite qu’on le maîtrise. Avec Spinoza, il y a hétéronomie en corps et pensée, mais à<br />
partir d’une substance infinie pouvant s’exprimer en une infinité d’attributs. Le corps <strong>de</strong>vient<br />
2
contingent, en particulier d’autres corps. Il s’inscrit dès lors dans un rapport d’inter<strong>corporéité</strong>.<br />
Malebranche, lui, concevra un corps enveloppe fédérant les divers éléments. De Liebniz à<br />
Nietzsche, <strong>la</strong> philosophie travaillera au corps ces notions, avant l’émergence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
phénoménologie.<br />
Merleau-Ponty entend le corps comme véhicule <strong>de</strong> « l’être-au-mon<strong>de</strong> » impliquant qu’il<br />
n’y ait pas <strong>de</strong> césure entre <strong>la</strong> physiologie et le psychique. Le corps est expérience, tout autant<br />
espace expressif que nœud <strong>de</strong> significations vivantes. J.P. Sartre, <strong>de</strong> son côté, distingue le<br />
corps en tant qu’ « être-pour-soi » et en tant qu’ « être-pour autrui ». Dans sa conception il n’y a<br />
rien <strong>de</strong>rrière le corps, le corps est tout entier psychique. Le corps comme « être-pour-soi » se<br />
confond avec l’affectivité originelle : « …ce corps psychique, étant <strong>la</strong> projection, sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
l’en-soi, <strong>de</strong> l’intracontexture <strong>de</strong> <strong>la</strong> conscience, fait <strong>la</strong> matière implicite <strong>de</strong> tous les phénomènes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> psyché »(1).Le corps définit un espace psychique alors comme le corps d’autrui apparaît<br />
comme instrument et s’avère signifiant. Le corps est surtout le seul objet psychique, qui en<br />
vient à être connu dans <strong>la</strong> rencontre avec autrui.<br />
Cette perspective phénoménologique constitue <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> <strong>corporéité</strong>, dont se poursuit<br />
l’é<strong>la</strong>boration dans le travail <strong>de</strong> G. Deleuze sur <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> surface du corps chez le<br />
schizophrène (2).<br />
Les cinquante <strong>de</strong>rnières années ont vu l’émergence <strong>de</strong> plusieurs mises en scènes du<br />
corps après <strong>de</strong>s décennies d’enfouissement :<br />
o Le corps façonné et sophistiqué par l’organisation sociale à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong><br />
production et <strong>de</strong> reproduction<br />
o Le corps fétichisé, marchandise et produit <strong>de</strong> consommation<br />
o Le corps fantasmé, acteur plein d’une dramatique personnelle.<br />
Les prémisses sont peut-être à entendre dans le théâtre <strong>de</strong>s années cinquante qui<br />
invente un personnage sans nom, sans passé, source d’angoisse. Le personnage, désorienté<br />
dans le temps, ne parvient jamais à saisir son i<strong>de</strong>ntité. Et son corps morcelé et souffrant ne lui<br />
permet pas d’accé<strong>de</strong>r à une représentation <strong>de</strong> son moi. C’est un corps brisé qui trouve<br />
représentation. Ce corps, aucunement moyen <strong>de</strong> jouissance, <strong>de</strong>vient lieu <strong>de</strong> l’aliénation et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
persécution (Beckett, Adamov), image <strong>de</strong> mort (Ionesco), objet d’une horrible répulsion<br />
(Beckett). Une véritable <strong>de</strong>structuration du corps, telle que certaines parties du corps <strong>de</strong>venues<br />
autonomes par un processus métonymique, sont <strong>de</strong>s objets persécuteurs. C’est une vision<br />
archaïque du corps, pré-spécu<strong>la</strong>ire, qui travail<strong>la</strong>nt au cœur du processus i<strong>de</strong>ntitaire est mise en<br />
exergue.<br />
Les années soixante marque une rupture autour du thème <strong>de</strong> <strong>la</strong> libération corporelle. Le<br />
corps, au titre d’une libération politique et d’un éc<strong>la</strong>tement <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>vient le lieu d’explosion<br />
du désir et d’une possible transgression socioculturelle. Le lien communautaire se marque dans<br />
3
les circu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s flux libidinaux et dans l’intensité <strong>de</strong>s vécus. Ceci est conjoint à une<br />
fétichisation du corps ouverte par <strong>la</strong> psychologie humaniste, nouveau module <strong>de</strong> l’économie<br />
spécialisée dans <strong>la</strong> production et <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s services affectifs, thérapeutiques et<br />
re<strong>la</strong>tionnels. La psychologie du Moi se trouve transposée au niveau biologique : le corps se dit<br />
représentatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité <strong>de</strong> son propriétaire. L’abâtardissement théorique, physicalisant<br />
l’inconscient, ouvre <strong>de</strong> nouvelles formes d’aliénation sociale fondée sur une gestion<br />
manipu<strong>la</strong>toire passant par une instrumentalisation psychologique. Derrière l’autonomisation<br />
apparente du corps libidinal se tient le retour du corps productif et du corps fétichisé.<br />
Les années soixante-dix prolonge ce mouvement mais avec une inflexion qui fait du<br />
corps le lieu d’une libération personnelle. Surtout ce mouvement est celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarcation du<br />
corps pour l’organiser en un matériel structural d’échange <strong>de</strong> signes, à l’égal <strong>de</strong> <strong>la</strong> sphère <strong>de</strong>s<br />
objets(3). Il y a une fétichisation du phallus comme équivalent général. Le corps fétichisé est le<br />
lieu d’un déni <strong>de</strong> <strong>la</strong> castration. La différence érogène s’efface en une substance diaphane,<br />
lisse, épilée d’un corps glorieux et asexué. Toute aspérité est annulée, <strong>la</strong> division irréductible du<br />
sujet se trouve niée. Le corps <strong>de</strong>vient un système <strong>de</strong> signes ordonné par <strong>de</strong>s modèles. Se<br />
trame par-<strong>de</strong>là une rhétorique <strong>de</strong> l’emprise corporelle dans les institutions. J.M. Brohm insistera<br />
dans ses travaux sur le fait que tout ordre social produit un ordre corporel spécifique, que le<br />
pouvoir repose sur une incorporation invisible. L’emprise culturelle et l’hégémonie idéologique<br />
dominante s’exercent prioritairement par le truchement d’une politique du corps légitime qui<br />
assigne à tous les agents sociaux un statut, une fonction et un rôle corporel. Il y a <strong>de</strong>s<br />
mécanismes <strong>de</strong> domination dans, par et à travers le corps. Tout pouvoir se maintient par <strong>la</strong><br />
violence réelle ou symbolique sur les corps. C’est à <strong>la</strong> fois une machinerie disciplinaire, une<br />
manière d’intérioriser les signifiants corporels et une inscription <strong>de</strong>s règlements sociaux à<br />
même le corps. C’est encore un discours juridique qui délimite un corps légitime : « <strong>la</strong> loi<br />
s’empare du corps en le découpant en paragraphes articulés sur un système <strong>de</strong> valeurs et <strong>de</strong><br />
normes (propriété, intégrité, décence, outrage, etc.) »(4). Il y a un appareil<strong>la</strong>ge juridique du<br />
corps concernant <strong>la</strong> division <strong>de</strong>s sexes, l’antagonisme <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse et les variations culturelles.<br />
L’image du corps est <strong>la</strong> construction du corps comme rapport social.<br />
Avec les années quatre-vingt, on assiste à un repli sur le corps comme <strong>de</strong>rnier lieu<br />
d’une i<strong>de</strong>ntité. L’individualisme a pris <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> socialité communautaire. Non seulement se<br />
voit affirmer que l’entremise <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>corporéité</strong> est insécable <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion au mon<strong>de</strong> (activités<br />
perceptives, expression <strong>de</strong>s sentiments, étiquettes <strong>de</strong>s rites d’interaction, gestuelles et<br />
mimiques, mise en scène <strong>de</strong> l’apparence, entretien physique, re<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> douleur, etc.), mais<br />
est confirmé que l’expérience corporelle se fon<strong>de</strong> au sein d’un processus <strong>de</strong> socialisation. Il n’y<br />
a pas <strong>de</strong> naturalité du geste ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> sensation, le corps se révèle une structure symbolique.<br />
Sont rappelés tout un ensemble <strong>de</strong> travaux. Les techniques du corps (M. Mauss) ou techniques<br />
corporelles (C. Levi Strauss, B. Koechlin), les activités sportives (G. Bruant, A. Rauch, G.<br />
Vigarello, etc.), les techniques artisanales (F. Loux), etc. nécessitent <strong>de</strong>s apprentissages très<br />
4
formalisés et désignent les outils du corps comme palimpseste du corps. Elles constituent une<br />
structuration du schéma corporel dans un contexte socio-symbolique qui en livre conjointement<br />
les normes. Les soins du corps, l’hygiène, subissent <strong>de</strong>s variations historiques et sociales, tout<br />
autant que les thérapeutiques du corps (G. Vigarello). La gestualité interactive renvoie à <strong>de</strong>s<br />
co<strong>de</strong>s corporels fonctionnant comme moyens <strong>de</strong> communication dans le cadre d’institutions<br />
précises. C’est aussi le produit d’i<strong>de</strong>ntification au groupe d’appartenance, assurant les signes<br />
<strong>de</strong> reconnaissance et d’adhésion. Cette communication intercorporelle est échange : il y a<br />
intériorisation en creux <strong>de</strong>s gestes d’autrui auxquels nous réagissons par <strong>de</strong>s réponses<br />
appropriées (l’amphimixie <strong>de</strong> Ferenczi). Il est question d’i<strong>de</strong>ntification et <strong>de</strong> symbolisation dans<br />
<strong>la</strong> rencontre. Les sentiments, qui s’inscrivent sur le visage, le corps, sont enracinés dans les<br />
normes collectives implicites et ne sont pas conçus comme <strong>de</strong>s réalités en soi. L’expression <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> douleur n’échappe à ce tamisage social et psychologique. Et le visage est le lieu d’une<br />
véritable théâtralisation sociale. Plus finement encore, le décodage sensoriel du mon<strong>de</strong> est<br />
marqué par <strong>la</strong> dimension socioculturelle (G. Simmel). Chaque communauté en vient à é<strong>la</strong>borer<br />
son propre univers sensoriel comme univers <strong>de</strong> sens. Le façonnement symbolique du corps<br />
(soustraction rituelle d’un fragment du corps, marquages dans l’épaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chair,<br />
inscriptions tégumentaires sous formes <strong>de</strong> tatouages, modifications <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme du corps, etc.)<br />
désigne le corps comme support inévitable du rituel (Maertens, Doug<strong>la</strong>s, De Heutsch, etc.).<br />
Cependant <strong>la</strong> fonction rituelle (affronter l’inconnu et l’altérité, canaliser les émotions<br />
fondamentales, régler <strong>la</strong> sexualité) se trouve dérégulée dans nos sociétés. Elle <strong>la</strong>isse p<strong>la</strong>ce à<br />
l’emballement <strong>de</strong>s imaginaires sociaux du corps dont les corps fantasmatiques du racisme et<br />
<strong>de</strong> l’handicap font témoins. En ces cas, il y a réification du corps au regard <strong>de</strong> traits sail<strong>la</strong>nts,<br />
l’autre est réduit à sa visibilité et <strong>la</strong> différence se creuse en stigmate. L’altération, <strong>la</strong> différence<br />
est socialement transformée en stigmate, assimilé à un désordre dans <strong>la</strong> sécurité ontologique<br />
(E. Goffman). Cette stigmatisation est d’autant plus prégnante dans le mouvement <strong>de</strong><br />
personnalisation du corps, dans ce néo-narcissisme dans lequel le corps <strong>de</strong>vient le tenant-lieu<br />
<strong>de</strong> l’individu.<br />
Les années quatre-vingt dix s’inscrivent en partie en rupture en raison même <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
figuration dramatique d’une jouissance mortifiée, au travers du corps cachexique du sujet<br />
atteint du S.I.D.A. La mort extradée jusqu’alors trouvera à s’exacerber au lieu impensable d’une<br />
jeunesse se vivant immortelle. C’est le temps <strong>de</strong> l’effondrement <strong>de</strong> l’insouciance <strong>de</strong> l’Eros et le<br />
retour d’une figure décharnée <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort, dans une confusion entre jouissance et mort. On<br />
découvre le sexe mortifère dont par<strong>la</strong>it Baudril<strong>la</strong>rd avec un renversement terrifiant dans lequel<br />
<strong>la</strong> sexualité se fait l’agent <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort. Le corps <strong>de</strong> son côté perd <strong>de</strong> son triomphalisme, les<br />
techniques corporelles s’enferrent dans une récupération psychiatrique, les étu<strong>de</strong>s savantes<br />
s’amenuisent, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du corps s’anthropologise dans un discours conformiste (D. Le Breton).<br />
En même temps, <strong>la</strong> violence envahit l’espace imaginaire <strong>de</strong> nos sociétés et s’affiche sur le<br />
mo<strong>de</strong> banal <strong>de</strong> <strong>la</strong> violence télévisuelle surréalitaire.<br />
5
Les années <strong>de</strong>ux mille voient <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> ce mouvement d’extradition qui tente <strong>de</strong> se<br />
théâtraliser dans <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> guerre propre, technologique avant qu’elle ne soit elle-même<br />
rattrapée par l’archaïsme <strong>de</strong>s corps déchiquetés et par l’imagerie barbare <strong>de</strong> <strong>la</strong> torture. La<br />
généralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur d’usage dans sa glorification verra son renversement ou sa logique<br />
propre se déployer dans les processus d’exclusion, par lesquels <strong>la</strong> mort s’installe désormais<br />
dans son quotidien. Le discours savant est désormais envahi par un scientisme étroit et<br />
discriminatif, ramenant le corps à un biologisme, à un comportementalisme ou à un<br />
cognitivisme. C’est un discours normatif, naturalisant les manifestations du corps, le réduisant à<br />
un ensemble <strong>de</strong> signes, niant les fonctions premières <strong>de</strong>s facteurs socioculturels et<br />
psychologiques. On retrouve un discours hégémonique restaurant <strong>de</strong>s machineries<br />
disciplinaires, discours <strong>de</strong> nature paranoïaque s’affirmant détenteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérité. Mais il se<br />
refuse à prendre en compte que le corps se voit livré à <strong>la</strong> pure violence : violences urbaines ou<br />
guerrières, actes autovulnérants ou suicidaires, généralisation <strong>de</strong>s actes déritualisés à<br />
connotation masochique, prégnance d’un discours victimologique.<br />
S. Freud mettra rapi<strong>de</strong>ment l’anatomie à l’écart dans l’étiologie névrotique, non sans<br />
avoir tenté d’é<strong>la</strong>borer le rapport conceptuel psychique/physiologique (1891, 1892, 1895). La<br />
psychanalyse va instaurer un écart d’avec <strong>la</strong> position médicale aussi bien au registre clinique<br />
qu’au registre <strong>de</strong> <strong>la</strong> science <strong>de</strong>s corps. L’opération freudienne est une opération <strong>de</strong> sens qui<br />
déjoue <strong>la</strong> logique linéaire d’une matérialité visible. Au regard médical ou psychiatrique, Freud<br />
substitue l’écoute <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte du ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. A <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’objectivité positiviste qui réalise le<br />
corps du ma<strong>la</strong><strong>de</strong> comme corps <strong>de</strong> savoir, il convoque l’approche <strong>de</strong> <strong>la</strong> souffrance si bien<br />
amorcée dans l’équivalence entre douleur imaginaire et douleur somatique. Là où le ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
somatique déploie une <strong>de</strong>scription avec tranquillité et certitu<strong>de</strong>, localisant l’origine <strong>de</strong> ses<br />
douleurs et leur diffusion, l’hypochondriaque donne l’impression d’accomplir un travail mental<br />
au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> ses forces, alors que l’hystérique montre une singulière expression <strong>de</strong><br />
satisfaction au lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> douleur lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> stimu<strong>la</strong>tion du point sensible. L’hystérique se<br />
comporte comme si l’anatomie n’existait pas, l’altération est celle <strong>de</strong> l’idée du membre. Très<br />
vite référée au <strong>la</strong>ngage, cette symbolisation corporelle, cette conversion <strong>de</strong>ssine, dans ses<br />
effets <strong>de</strong> sens, une anatomie fantasmatique. Freud fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte <strong>la</strong> vérité du trouble<br />
pathologique et y introduit le corps imaginaire du désir, voire <strong>de</strong> <strong>la</strong> passion. Le réalisme du<br />
corps est dép<strong>la</strong>cé par rapport à sa fantasmatique et à sa signifiance. Son attention porte sur <strong>la</strong><br />
position subjective <strong>de</strong> l’énonciataire. Il y a une rupture d’avec le corps objet du neurologue.<br />
Freud dép<strong>la</strong>ce le signe médical vers le symptôme comme formation <strong>de</strong> compromis et<br />
surdétermination. La position médicale se soutient d’une mise à l’écart <strong>de</strong> <strong>la</strong> subjectivité face à<br />
un organisme qui ne ment pas. Ce sont <strong>de</strong>s rapports référentiels, universalisables. Le<br />
symptôme médical renvoie à quelque chose, sans sujet aucun. Alors que le symptôme<br />
6
psychanalytique est, comme le formule J. Lacan, un retour <strong>de</strong> vérité, interprétable dans l’ordre<br />
du signifiant. Freud accor<strong>de</strong> au <strong>la</strong>ngage une fonction <strong>de</strong> symbolisation corporelle et un rôle <strong>de</strong><br />
soutien aux phénomènes <strong>de</strong> conversion. Cette symbolisation corporelle se développe dans une<br />
re<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> sens entre une série associative et une disposition organique. Le corps se trouve<br />
ainsi pris dans l’articu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> signifiants qui le découpe ; il est pris dans le corps du<br />
symbolique.<br />
Freud constitue le corps dans son rapport au désir inconscient. La sexualité, à ce titre,<br />
réalise une véritable transgression anatomique. La pulsion sexuelle s’étend au corps tout<br />
entier, <strong>de</strong> même que se joue <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion du corps au fantasme. Le corps s’avère <strong>la</strong> scène<br />
d’accomplissement d’un appareil psychique et d’une réalité psychique ; le moi se révèle dérivé<br />
<strong>de</strong> sensations corporelles, il est <strong>la</strong> projection mentale <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface du corps.<br />
L’approche neurologique, non sans proximité avec l’approche psychiatrique, n’a pas été<br />
sans décrire <strong>de</strong> nombreux tableaux d’atteinte <strong>de</strong>s fonctions corporelles ; parmi les plus<br />
singulières s’illustrent les problèmes <strong>de</strong> reconnaissance et d’appréhension. Les agnosies<br />
neurologiques et les troubles <strong>de</strong> somatognosie sont envisagés comme <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
reconnaissance et <strong>de</strong> <strong>la</strong> nomination touchant l’image du corps. De J. Lhermitte à Ajuriaguerra<br />
et Hécaen, voire <strong>Ange</strong>lergues, <strong>la</strong> notion d’image du corps est interrogée alors qu’elle n’est plus<br />
présente dans <strong>la</strong> neurologie actuelle qui y a substitué les dysconnexions entre les divers<br />
systèmes <strong>de</strong> perception et <strong>de</strong> conscience. L’agnosie affecte <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> l’objet qui est<br />
vu, senti mais pas reconnu. Appréhendé par le regard, il ne peut être nommé. Il y a <strong>de</strong>s<br />
agnosies pour les choses, pour les couleurs, <strong>de</strong>s agnosies spatiales, <strong>de</strong>s agnosies <strong>de</strong>s<br />
physionomies (prosopagnosie). Il s’agit d’une perte <strong>de</strong> significations. Dans une même<br />
perspective, les dyspraxies affectent l’hémisphère droit, les alexies l’hémisphère gauche.<br />
L’asomatognosie est une forme d’agnosie qui porte sur ce qui est reconnu et désigné au titre<br />
<strong>de</strong> son corps (schéma <strong>de</strong> notre corps <strong>de</strong> Bonnier, l’image spatiale du corps <strong>de</strong> Pick, le schéma<br />
postural <strong>de</strong> Head, le schéma corporel <strong>de</strong> Schil<strong>de</strong>r, l’image <strong>de</strong> soi <strong>de</strong> Von Bogaert, l’image <strong>de</strong><br />
notre <strong>de</strong> corps <strong>de</strong> Lhermitte). C’est le sens <strong>de</strong> notre corps qui est perdu, se traduisant en une<br />
mauvaise connaissance du corps. La notion <strong>de</strong> membre fantôme est <strong>la</strong> persistance d’un<br />
membre illusionnel senti en lieu et p<strong>la</strong>ce d’un membre amputé. Il réalise <strong>la</strong> distinction entre<br />
corps physique et l’image du corps. Il y a prégnance <strong>de</strong> l’image du corps et sa prépondérance<br />
par rapport à <strong>la</strong> perception du corps réel. Le syndrome <strong>de</strong> Gerstmann (agnosie digitale,<br />
indistinction droite/gauche, acalculie et agraphie dite pure) décrit l’incapacité à distinguer,<br />
nommer les différents doigts <strong>de</strong> sa propre main ou <strong>de</strong> l’observateur. C’est une atteinte d’une<br />
fonction primordiale <strong>de</strong> symbolisation <strong>de</strong> l’espace à partir d’une orientation du corps. Ce<br />
7
phénomène est plus massif dans l’autotopoagnosie qui est <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation <strong>de</strong>s<br />
différents éléments du corps. Il y a incapacité <strong>de</strong> nommer et <strong>de</strong> décrire les diverses parties du<br />
corps (exemple c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> l’oreille gauche perdue et recherchée sur <strong>la</strong> table). On constate un<br />
phénomène <strong>de</strong> négation avec l’idée que les organes ont été soustraits par l’autre.<br />
L’asomatognosie est <strong>la</strong> méconnaissance d’un hémicorps ; l’hémiasomatognosie est l’illusion ou<br />
le délire d’absence <strong>de</strong> l’hémicorps lésé ; l’anosognosie est l’ignorance apparente du trouble<br />
survenu. L’asomatognosie totale est insensibilité générale au lieu du corps, d’où un sentiment<br />
<strong>de</strong> déréalisation et <strong>de</strong> dépersonnalisation. Nous avons là une atteinte du champ entier <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
reconnaissance. On relève encore <strong>de</strong>s perturbations somatognosiques paroxystiques sources<br />
<strong>de</strong> sentiment d’absence, d’illusions <strong>de</strong> transformation corporelle, d’illusions <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement<br />
corporel entraînant <strong>de</strong>s manifestations psychoaffectives.<br />
Ainsi tout trouble neurologique (agnosique, aphasique, apraxique, paralytique) a une<br />
inci<strong>de</strong>nce sur les modalités d’assomption <strong>de</strong> l’image du corps, jusqu’à <strong>de</strong>s réactions<br />
catastrophiques (Goldstein) suscitant une pathologie <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité.<br />
S. Thibierge rappelle utilement les pathologies <strong>de</strong> l’image du corps au p<strong>la</strong>n<br />
psychiatrique en partant du syndrome d’illusion <strong>de</strong>s sosies <strong>de</strong> Capgras et Reboul-Lachaux en<br />
1923. C’est dans le cadre d’un délire systématisé chronique qu’est relevé un symptôme<br />
singulier. Il s’agit là d’une méconnaissance systématique procédant d’une interprétation d’ordre<br />
affectif consistant à substituer <strong>de</strong>s sosies aux visages familiers. Ce syndrome précè<strong>de</strong> <strong>la</strong> mise<br />
en avant du syndrome d’illusion <strong>de</strong> Frégoli, exposé en 1927 par Courbon et Fail. C’est là une<br />
même personnalité que diversifie une multitu<strong>de</strong> d’apparences. Disjonction entre<br />
reconnaissance et nomination : il y a bien disjonction entre le nom d’un côté, comme support <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> quelque chose, et <strong>de</strong> l’autre côté l’image comme ensemble <strong>de</strong> traits<br />
normalement articulés à <strong>la</strong> reconnaissance, mais en l’espèce détachés <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconnaissance.<br />
Un troisième syndrome psychiatrique est relevé, celui d’intermétamorphose <strong>de</strong> Courbon<br />
et Tusques qui affecte aussi les registres <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconnaissance, <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nomination. Ces pathologies psychiatriques <strong>de</strong> l’image du corps seront interprétées comme une<br />
i<strong>de</strong>ntification délirante sous <strong>de</strong>ux actualisations différentes :<br />
Les syndromes <strong>de</strong> méconnaissance (illusion <strong>de</strong>s sosies <strong>de</strong> Capgras) : image<br />
sans nom<br />
Les syndromes <strong>de</strong> fausse reconnaissance (illusion <strong>de</strong> Frégoli, illusion<br />
d’intermétamorphose) : nom sans image.<br />
C’est bien entendu autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> psychose que cette fonction corporelle<br />
est singulièrement cernée dans une inspiration psychanalytique. Parmi les nombreux auteurs,<br />
G. Pankow fait référence. La psychose, selon elle, renvoie à une dissociation ou à une<br />
<strong>de</strong>struction <strong>de</strong> l’image du corps <strong>de</strong> telle manière que ses parties per<strong>de</strong>nt leur lien avec le tout<br />
8
pour réapparaître dans le mon<strong>de</strong> extérieur. Elle définit une double fonction <strong>de</strong> l’image du corps,<br />
fonction <strong>de</strong> structure (réseau <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tions interhumaines, constituées <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> lois) et<br />
fonction <strong>de</strong> contenu ou <strong>de</strong> communication. La première fonction concerne sa structure spatiale<br />
en tant que forme, soit l’expression d’un lien dynamique entre les parties et <strong>la</strong> totalité. La<br />
secon<strong>de</strong> fonction abor<strong>de</strong> le contenu et le sens. Privilégiant les notions <strong>de</strong> limite et <strong>de</strong> surface,<br />
elles sont symbolisantes, à savoir qu’elles réalisent un ensemble <strong>de</strong> systèmes symboliques<br />
visant une règle d’échange. La psychose exprime divers mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dissociation (perte du lien<br />
entre les parties et le tout) alors que <strong>la</strong> névrose signale <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> muti<strong>la</strong>tions. Elle construit<br />
ainsi une forme <strong>de</strong> sémiologie <strong>de</strong> l’atteinte <strong>de</strong>s fonctions du corps en regard du registre<br />
psychopathologique. Elle précise <strong>la</strong> précocité <strong>de</strong>s atteintes <strong>de</strong> ces fonctions, spécifiant une<br />
construction primaire <strong>de</strong> l’image du corps. Pareillement, dans un autre espace psychanalytique,<br />
G. Haag insiste sur ces échecs <strong>de</strong> <strong>la</strong> « corporéation » dans les psychoses précoces. La<br />
corporéation désigne en quoi les diverses parties du corps sont <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s<br />
interre<strong>la</strong>tions entre les ébauches du sentiment <strong>de</strong> soi et les ébauches du sentiment <strong>de</strong><br />
l’existence <strong>de</strong> l’objet d’amour, connu initialement par l’expérience corporelle <strong>de</strong> jonctions dans<br />
les phénomènes <strong>de</strong> portage et <strong>de</strong> nourrissage. L’échec <strong>de</strong> cette opération entraîne <strong>la</strong><br />
régression du moi psychique naissant sous <strong>la</strong> forme d’une désorganisation, soit le<br />
« démantèlement » <strong>de</strong> l’appareil perceptuel en ses composants sensuels et sensoriels. Dans<br />
un autre registre, F. Dolto développe <strong>la</strong> notion d’une image inconsciente du corps, lieu d’une<br />
re<strong>la</strong>tion interhumaine. Cette image est <strong>la</strong> mémoire inconsciente <strong>de</strong> tout vécu re<strong>la</strong>tionnel<br />
précoce dans <strong>la</strong> dya<strong>de</strong> mère-enfant. Elle est l’articu<strong>la</strong>tion dynamique d’une image <strong>de</strong> base,<br />
d’une image fonctionnelle et d’une image <strong>de</strong>s zones érogènes. L’image <strong>de</strong> base, constitutive du<br />
sentiment d’existence, est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> <strong>la</strong> continuité narcissique, et va se modifier par d’autres<br />
images <strong>de</strong> base (respiratoire-olfactive-auditive, orale, anale). L’image fonctionnelle vise à<br />
l’accomplissement du désir, elle s’objective dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion au mon<strong>de</strong>, et prépare à l’utilisation<br />
du schéma corporel, qui lui réfère, à un autre niveau, au corps actuel dans l’espace <strong>de</strong><br />
l’expérience immédiate. L’image érogène est associée au lieu où se focalisent p<strong>la</strong>isir et<br />
dép<strong>la</strong>isir érotiques dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion à l’autre. Ces trois composantes se synthétisent dans<br />
l’image dynamique. Cette construction opère dans le rapport <strong>la</strong>ngagier à autrui, à défaut<br />
s’inscrit une faille interrompant le processus <strong>de</strong> symbolisation. Cette image inconsciente du<br />
corps se verra refouler tout d’abord par l’image scopique, puis par <strong>la</strong> castration oedipienne.<br />
J. Lacan précisera <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> l’image spécu<strong>la</strong>ire dans l’économie subjective à partir<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> sta<strong>de</strong> du miroir, reprise <strong>de</strong>s psychologues généticiens. Située entre 6 et 18<br />
mois, cette opération est celle, au décours d’une pério<strong>de</strong> d’impuissance et <strong>de</strong> dépendance, <strong>de</strong><br />
l’unité formelle anticipée <strong>de</strong> sa propre image au miroir. Ce sta<strong>de</strong> du miroir peut se caractériser<br />
par trois traits principaux :<br />
La reconnaissance <strong>de</strong> l’image par une captation narcissique où le sujet<br />
méconnaît l’inversion spécu<strong>la</strong>ire ;<br />
9
L’i<strong>de</strong>ntification du sujet (imaginaire) à cette image suppose le regard d’un<br />
autre, et un élément symbolique est requis comme trait par lequel le sujet<br />
peut d’abord être représenté dans l’élément <strong>de</strong> <strong>la</strong> parole (i<strong>de</strong>ntification<br />
symbolique) ;<br />
La consistance <strong>de</strong> cette image dans sa valeur narcissique <strong>de</strong> forme idéale est<br />
subordonnée à une neutralisation <strong>de</strong> l’investissement libidinal attaché à l’objet<br />
phallique.<br />
La faillite <strong>de</strong> cette opération, qui est celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation entre corps et psychisme, qui<br />
est matrice du moi et <strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntifications, entraîne <strong>de</strong>s troubles psychopathologiques.<br />
On voit s’opérer <strong>de</strong> ce rapi<strong>de</strong> rappel <strong>de</strong>s auteurs une différenciation entre l’image pré-<br />
spécu<strong>la</strong>ire et l’image spécu<strong>la</strong>ire, caractérisant chacune <strong>de</strong>s modalités d’expression<br />
pathologique. La fondation corporelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> psyché se retrouve chez <strong>de</strong> nombreux autres<br />
auteurs parmi lesquels D. Anzieu occupe un site <strong>de</strong> choix avec sa notion <strong>de</strong> Moi-peau. On peut<br />
se référer à l’excellente synthèse <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> Ciccone et Lhopital en 1991.<br />
La psychosomatique, processus au cours duquel le soma seul sert <strong>de</strong> théâtre sans le<br />
concours <strong>de</strong> l’instance psychique, permet d’interroger cette image du corps. Elle traduit <strong>la</strong><br />
mobilisation du corps pour évacuer <strong>de</strong>s conflits ou <strong>de</strong>s fantasmes psychiques, en l’absence <strong>de</strong><br />
représentations. J. Mac Dougall décrit un fonctionnement psychique <strong>de</strong> type alexithymique<br />
(pensée opératoire, rejet hors-psyché <strong>de</strong>s idées pénibles, <strong>de</strong>s représentations) qui est une<br />
défense massive contre <strong>de</strong>s angoisses narcissiques et psychotiques donnant lieu à un récit<br />
désaffecté. Elle lie ce fonctionnement à un contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère <strong>de</strong> certaines parties du corps <strong>de</strong><br />
l’enfant, ainsi envahi et qui ne peut s’approprier psychiquement <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> son corps. Les<br />
parties du corps sont vécues comme propriété <strong>de</strong> l’Autre et cet excès est ressenti comme une<br />
substance toxique. Ceci entraînera <strong>de</strong>s expériences <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> limite en tant qu’existe un<br />
corps pour <strong>de</strong>ux. C’est un couple constitué d’une mère abyssale et d’un enfant bouchon. De fait<br />
les conflits psychiques sont immédiatement éjectés hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> psyché. Le même<br />
fonctionnement peut résulter <strong>de</strong> l’exposition à un vécu traumatique précoce. Les somatisations<br />
réalisent alors une défense archaïque contre le désir <strong>de</strong> se perdre en se confondant avec<br />
l’Autre ; le soma réagit contre un affect débordant traité comme une ma<strong>la</strong>die physiologique.<br />
C’est l’inexistence <strong>de</strong>s affects qui implique une vulnérabilité aux désorganisations<br />
psychosomatiques. Le corps est séparé du sujet qui habite ce corps.<br />
Ces conclusions resteront ouvertes. La traversée rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces figures <strong>de</strong> l’image du<br />
corps insiste sur les fonctions singulières du corps, objet innommable en proie à <strong>de</strong>s opérations<br />
conjointes, hétérogènes et à <strong>de</strong>s discours multiples. Il reste, mais ce n’était pas l’objet du<br />
propos, à travailler ce qu’il en est du <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> ces images du corps quand le handicap vient<br />
10
marquer le corps. Là encore <strong>de</strong>s différenciations s’imposent entre le handicap <strong>de</strong> naissance et<br />
le handicap acquis, entre un mo<strong>de</strong> d’acquisition traumatique ou consécutif à une évolution<br />
progressive, entre le lieu spécifique du corps neutre ou fortement signifiant, entre un handicap<br />
lié à <strong>de</strong>s atteintes neurologiques ou celui lié à une traumatologie, etc. Ces handicaps viennent<br />
s’inscrire dans une historicité psychique et les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> construction <strong>de</strong>s images du corps, ils<br />
les sollicitent, dép<strong>la</strong>cent les équilibres antérieurs, réactualisent <strong>de</strong>s failles. Ils obligent, au-<strong>de</strong>là<br />
d’une appropriation et d’une récupération fonctionnelle, à un nouveau travail d’appropriation<br />
psychique. Ils interrogent le corps social, le corps sexualisé et le corps sensorialisé, entraînent<br />
un travail <strong>de</strong> <strong>de</strong>uil ou d’acceptation <strong>de</strong> limitation, conduisent à lutter contre un renoncement.<br />
Ces situations soulignent d’un point <strong>de</strong> vue psychologique qu’on ne peut aucunement se limiter<br />
à une approche neuropsychologique, nécessaire aux p<strong>la</strong>ns évaluatif et rééducatif, mais<br />
insuffisante au p<strong>la</strong>n psychique. L’exposition présentée d’ailleurs lors du congrès rappe<strong>la</strong>it cette<br />
nécessité existentielle pour ne pas se vivre comme un corps aliéné par l’instrumentalité<br />
médicale. Celle-ci d’ailleurs se présente pour le sujet comme une paradoxalité aliénante car elle<br />
s’impose pour son bien, voire pour sa survie, se centre sur l’objectivité du corps en déniant <strong>la</strong><br />
part subjective. Il est donc d’importance <strong>de</strong> restaurer à chaque étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> médicalisation<br />
nécessaire un travail <strong>de</strong> subjectivation, un travail <strong>de</strong> psychologie clinique, qui ne se réduise pas<br />
à un comportementalisme réadaptatif. Le sujet ne peut se réduire à <strong>la</strong> visibilité <strong>de</strong> son<br />
handicap, <strong>de</strong> ses limitations fonctionnelles, <strong>de</strong> ses difficultés adaptatives, aux pertes <strong>de</strong> sa<br />
qualité <strong>de</strong> vie (familiale, sexuelle, sociale). Il lui faut se réapproprier sa qualité <strong>de</strong> sujet avec les<br />
limitations spécifiques qui le marquent, enjeu particulièrement prégnant chez les jeunes<br />
acci<strong>de</strong>ntés mais tout autant chez les personnes d’un âge plus avancé.<br />
Je vous remercie.<br />
11