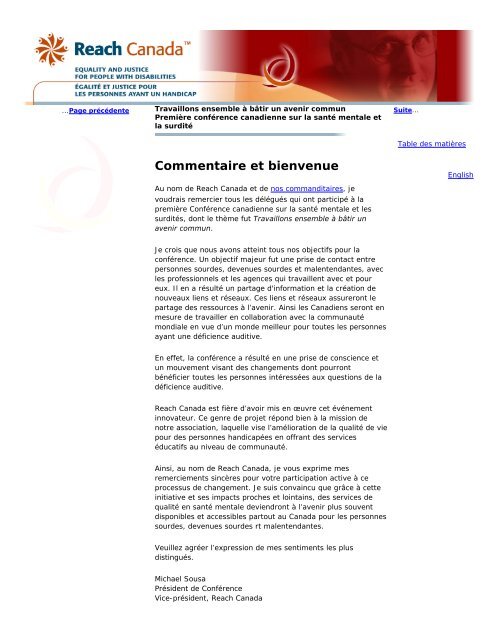Commentaire et bienvenue - Reach Canada
Commentaire et bienvenue - Reach Canada
Commentaire et bienvenue - Reach Canada
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
<strong>Commentaire</strong> <strong>et</strong> <strong>bienvenue</strong><br />
Au nom de <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong> <strong>et</strong> de nos commanditaires, je<br />
voudrais remercier tous les délégués qui ont participé à la<br />
première Conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong> les<br />
surdités, dont le thème fut Travaillons ensemble à bâtir un<br />
avenir commun.<br />
Je crois que nous avons atteint tous nos objectifs pour la<br />
conférence. Un objectif majeur fut une prise de contact entre<br />
personnes sourdes, devenues sourdes <strong>et</strong> malentendantes, avec<br />
les professionnels <strong>et</strong> les agences qui travaillent avec <strong>et</strong> pour<br />
eux. Il en a résulté un partage d'information <strong>et</strong> la création de<br />
nouveaux liens <strong>et</strong> réseaux. Ces liens <strong>et</strong> réseaux assureront le<br />
partage des ressources à l’avenir. Ainsi les Canadiens seront en<br />
mesure de travailler en collaboration avec la communauté<br />
mondiale en vue d’un monde meilleur pour toutes les personnes<br />
ayant une déficience auditive.<br />
En eff<strong>et</strong>, la conférence a résulté en une prise de conscience <strong>et</strong><br />
un mouvement visant des changements dont pourront<br />
bénéficier toutes les personnes intéressées aux questions de la<br />
déficience auditive.<br />
<strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong> est fière d’avoir mis en œuvre c<strong>et</strong> événement<br />
innovateur. Ce genre de proj<strong>et</strong> répond bien à la mission de<br />
notre association, laquelle vise l’amélioration de la qualité de vie<br />
pour des personnes handicapées en offrant des services<br />
éducatifs au niveau de communauté.<br />
Ainsi, au nom de <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>, je vous exprime mes<br />
remerciements sincères pour votre participation active à ce<br />
processus de changement. Je suis convaincu que grâce à c<strong>et</strong>te<br />
initiative <strong>et</strong> ses impacts proches <strong>et</strong> lointains, des services de<br />
qualité en santé mentale deviendront à l’avenir plus souvent<br />
disponibles <strong>et</strong> accessibles partout au <strong>Canada</strong> pour les personnes<br />
sourdes, devenues sourdes rt malentendantes.<br />
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus<br />
distingués.<br />
Michael Sousa<br />
Président de Conférence<br />
Vice-président, <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong><br />
VERSION TEXTE<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
English
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Table des matières<br />
<strong>Commentaire</strong> <strong>et</strong> <strong>bienvenue</strong><br />
Michael Sousa, LL.B.<br />
Keynote address<br />
Services en santé mentale pour personnes sourdes <strong>et</strong><br />
malentendantes en Europe.<br />
Dr Alexis Karacostas<br />
Première Conférence Canadienne sur la Santé Mentale <strong>et</strong> la<br />
Surdité<br />
Pirjo Leino<br />
Les systèmes de contrôle – L'héritage mondial de la<br />
maltraitance institutionnelle des enfants<br />
Roch Longueépée<br />
L’évolution du programme Well-Being (bien-être) pour les<br />
Sourds, les malentendants <strong>et</strong> les sourds-aveugles<br />
Susan Chernoff<br />
Surdicécité <strong>et</strong> santé mentale : Mieux comprendre pour<br />
mieux intervenir<br />
Daniel Bolduc, Lyne Bris<strong>et</strong>te, Gilles Lefebvre<br />
L'impact De La Perte Auditive Sur La Communication Verbale<br />
René Rivard<br />
L’accès à la justice pour les Canadiens malentendants ou<br />
sourds<br />
Carole Willans-Théberge, Thibault Cadro<br />
Proj<strong>et</strong> de services VCT* pour les Sourds de Nairobi -<br />
Rapport d'activités du premier trimestre 2004.<br />
Joël Omondi Owino<br />
Pont des Signes<br />
Dr. Anne Toth<br />
Différence entre le Deaf Youth R<strong>et</strong>reat program <strong>et</strong> le Social<br />
Youth Club Program!<br />
Brad Saunders, Brenda Dean<br />
Suite...<br />
Anglais
La communication affective entre l’enfant sourd, sa famille<br />
<strong>et</strong> l’équipe de réadaptation<br />
Louise Roberge<br />
Le pouvoir des parents<br />
Vicki Robinson<br />
Expérience d'intervention auprès des enfants <strong>et</strong> adolescents<br />
ayant un problème de santé mentale.<br />
Louise Ménard<br />
Services <strong>et</strong> programmes Sourd-Aveugles en Finlande<br />
Ulla Kungas<br />
Les troubles psychotiques <strong>et</strong> la surdité<br />
Dr. Cathy Chovas McKinnon<br />
La Perte Auditive Comme Question De Santé Publique :<br />
Défis Et Stratégies<br />
Robert Alexander<br />
Réconcilier les divers groupes <strong>et</strong> leurs besoins particuliers.<br />
Roger Saint-Louis<br />
Les implants cochléaires pour les adultes<br />
Dr. David Schramm, Shelly Armstrong, Josée Chénier<br />
L’équipe d’approche mobile de consultation pour les<br />
diagnostics doubles face aux handicaps auditifs<br />
Stéphanie Symank Boileau<br />
Les problèmes de la famille sourde : les CODA <strong>et</strong> l'identité<br />
Thomas Bull<br />
L'abus éducationnel dans les écoles résidentielles pour les<br />
Sourds<br />
David Lucas<br />
L'intégration scolaire des élèves ayant une surdité <strong>et</strong> la<br />
question de santé mentale<br />
Aurèle Bertrand, Johanne Venne-Brisebois<br />
Qu’est-ce qu’un sourd ?<br />
Andréa Benvenuto<br />
Réduire le risque de problèmes psychosociaux chez les<br />
enfants Sourds <strong>et</strong> leurs parents<br />
Dr. Anne Toth<br />
Surdité <strong>et</strong> résilience<br />
Christiane Grimard, Col<strong>et</strong>te Dubuisson<br />
Le syndrome des grands pavots chez les Sourds<br />
Claire Raisin, Richard Townshend<br />
Qualité de Vie <strong>et</strong> surdité: Validation de l’Inventaire<br />
Systémique de Qualité de Vie© en Langue des Signes<br />
Québécoise<br />
Isabelle Lemay
Le Développement de Services de Santé Mentale Pour les<br />
Personnes Sourdes, Devenues Sourdes <strong>et</strong> Malentendantes<br />
Lynn Cochrane, Paul Boileau<br />
Sourds-aveugles : ça vaut l'effort<br />
Otto Fritschy<br />
Le "ASL Parent-Child Mother Goose Program<br />
Kristin Snoddon<br />
Que dit RÉELLEMENT la recherche sur la maladie<br />
psychiatrique <strong>et</strong> la surdité ?<br />
Deena M. Martin<br />
Services de santé mentale destinés aux Sourds,<br />
malentendants, & sourds-aveugles>/A><br />
Marjorie Cameron<br />
L'autre façon de s'y prendre<br />
Myrtle Barr<strong>et</strong>t<br />
Am<strong>et</strong>hyst : Un programme pour les femmes sourdes<br />
Josephine Fitzgerald<br />
L’accès à la justice pour les Canadiens malentendants ou<br />
sourds<br />
Carole Willans-Théberge, Michael Sousa<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Services en santé mentale pour<br />
personnes sourdes <strong>et</strong> malentendantes<br />
en Europe<br />
Conférencier principal par Dr Alexis Karacostas<br />
Madame le Ministre de la Culture chargée des<br />
Affaires Francophones, Monsieur le Président<br />
de <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>, Monsieur le Président du<br />
Comité de préparation du congrès, Mesdames,<br />
Messieurs, Chers Collègues <strong>et</strong> Amis,<br />
C’est un très grand honneur pour moi de me trouver aujourd’hui<br />
parmi vous à l’invitation du comité d’organisation du congrès <strong>et</strong><br />
de M. René Rivard que je remercie vivement. Cela fait de fort<br />
nombreuses années que René Rivard <strong>et</strong> moi nous connaissons.<br />
Nous avons tissé une solide amitié à travers nos activités<br />
communes dans le domaine de la santé mentale <strong>et</strong> de la<br />
surdité. Les contributions de René ont toujours été<br />
extrêmement variées <strong>et</strong> utiles. Au niveau international, il<br />
participe depuis longtemps aux travaux de la Société<br />
européenne de santé mentale <strong>et</strong> surdité, il a constitué <strong>et</strong> mis à<br />
disposition des chercheurs du monde entier une précieuse<br />
banque de données bibliographiques, il écrit des articles<br />
appréciés dans des revues parmi lesquelles la revue<br />
francophone « Surdités », il fait de nombreuses interventions<br />
dans des colloques <strong>et</strong> symposia. Je connais moins dans le détail<br />
son action au niveau canadien mais je sais le rôle majeur qu’il a<br />
joué dans la préparation de ce premier congrès canadien de<br />
santé mentale <strong>et</strong> surdité. C’est dire qu’il est un travailleur<br />
infatigable qui a toujours œuvré pour j<strong>et</strong>er des ponts entre les<br />
cultures. Du fond du cœur, je t’adresse, René, ce témoignage<br />
renouvelé de ma reconnaissance.<br />
Et si j’ai accepté c<strong>et</strong>te invitation, c’est précisément dans ce<br />
même objectif, pour contribuer à mon tour, comme lui, comme<br />
vous tous, à des échanges qui façonnent incessamment un<br />
monde nouveau. Je me sens ému <strong>et</strong> aussi un peu intimidé<br />
d’ouvrir ce congrès au programme si riche <strong>et</strong> prom<strong>et</strong>teur. À un<br />
niveau très personnel, comme praticien français de la santé<br />
mentale, je suis venu avec l’intention d’en savoir plus sur vos<br />
pratiques, d’élargir mon horizon mental <strong>et</strong> je compte bien aussi<br />
connaître enfin un tant soit peu ce beau pays qu’est le <strong>Canada</strong><br />
<strong>et</strong> dont mes pieds viennent de fouler le sol pour la première<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
fois. Mais mon égoïsme foncier ne saurait me faire oublier que<br />
je suis venu à votre rencontre avant tout <strong>et</strong> surtout au titre de<br />
la Société européenne de santé mentale <strong>et</strong> surdité (ESMHD) que<br />
je représente ici. J’ai ainsi le très grand honneur de transm<strong>et</strong>tre<br />
au comité d’organisation de ce congrès <strong>et</strong> aux congressistes ici<br />
présents les chaleureuses salutations du Conseil <strong>et</strong> du Comité<br />
Exécutif de l’ESMHD, ainsi que leurs vœux de soutien envers<br />
tous ceux qui œuvrent à promouvoir le développement, sous<br />
toutes ses formes, de soins de santé <strong>et</strong> de santé mentale<br />
adaptés aux besoins de la population sourde. L’ESMHD a<br />
toujours été <strong>et</strong> sera toujours présente aux côtés de ceux qui<br />
luttent contre toutes les discriminations, pour la reconnaissance<br />
des droits fondamentaux des citoyens sourds, en matière de<br />
santé comme dans les autres domaines.<br />
Depuis une vingtaine d’années, un immense chantier s’est<br />
ouvert dans de nombreux pays. Les membres de nombreuses<br />
communautés sourdes <strong>et</strong> des professionnels de santé se sont<br />
unis entre eux <strong>et</strong> à bien d’autres acteurs de la société civile<br />
pour instaurer de nouvelles pratiques institutionnelles.<br />
Inévitablement, <strong>et</strong> ajouterai-je, heureusement, ce mouvement<br />
a entraîné le développement d’un débat éthique, <strong>et</strong> c’est<br />
aujourd’hui sur ces deux terrains, celui des nouvelles pratiques<br />
professionnelles <strong>et</strong> celui de l’éthique de ces actions que, dans le<br />
cadre de ce congrès, nous aurons à réfléchir. L’éthique doit<br />
guider chacun de nos pas mais elle se forge aussi en marchant,<br />
elle ne préexiste pas tout entière au chemin que l’on parcourt.<br />
Je vais donc essayer de présenter tout à la fois des pratiques <strong>et</strong><br />
les grandes lignes du débat éthique au carrefour de la surdité,<br />
de la santé <strong>et</strong> de la santé mentale.<br />
Globalement, il est possible de dire que les pratiques<br />
institutionnelles <strong>et</strong> les idéologies s’articulent autour de deux<br />
tendances. La première tendance se focalise sur la notion de<br />
déficit sensoriel (auditif <strong>et</strong>/ou visuel) <strong>et</strong> m<strong>et</strong> donc en exergue le<br />
manque, le défaut qui serait à combler. La seconde m<strong>et</strong> au<br />
contraire l’accent sur la relativité du ou des déficits sensoriels<br />
par rapport aux autres sens existants <strong>et</strong> mise sur les stratégies<br />
globales originales, individuelles <strong>et</strong> sociales, que les sourds,<br />
malentendants ou sourds-aveugles sont capables de m<strong>et</strong>tre en<br />
œuvre pourvu qu’ils rencontrent un environnement favorable.<br />
Les tenants de la première tendance voient dans la surdité un<br />
mal absolu qu’il faut combattre résolument, soit par la<br />
prévention, soit par la réparation. La prévention de la surdité<br />
intervient sur plusieurs terrains comme celui de la surveillance<br />
de la grossesse, le dépistage néonatal <strong>et</strong> le bilan génétique. Les<br />
techniques réparatrices sont d’ordre médical, chirurgical,<br />
audiologique <strong>et</strong> orthophonique. Centrée sur l’organe déficient, la<br />
réparation a pour enjeu fondamental la récupération auditive <strong>et</strong>,<br />
par voie de conséquence, le recours aussi naturel que possible à<br />
la langue écrite <strong>et</strong> à l’expression orale du pays où ont lieu les<br />
échanges interhumains. L’objectif, dans c<strong>et</strong>te perspective, est<br />
(sur le plan audiologique comme sur le plan identitaire <strong>et</strong> social)<br />
que le sourd devienne autant que possible entendant. Face à la<br />
surdité, on érige un front du refus. La visée réparatrice mobilise<br />
sourds, professionnels, enseignants <strong>et</strong> parents vers<br />
l’entendance.<br />
Dans la seconde perspective, la surdité est perçue comme une
donnée irréversible, constitutive d’une situation. La surdité<br />
étant là, il s’agit de l’accepter <strong>et</strong> de compter avec elle. L’intérêt<br />
de ceux qui se réclament de c<strong>et</strong> objectif se portera sur les<br />
potentialités offertes par l’écosystème, c’est-à-dire sur<br />
l’interaction entre un ou plusieurs sourds, malentendants ou<br />
sourd-aveugles <strong>et</strong> leur environnement. La surdité ou la<br />
surdicécité est ici abordée comme la relation qui se tisse entre<br />
le sourd ou le sourd-aveugle <strong>et</strong> autrui, individus, institutions ou<br />
société. Il me paraît ici utile de rappeler une idée élémentaire.<br />
Comme tout handicap, le handicap sensoriel peut être défini<br />
comme l’ensemble des lieux <strong>et</strong> des fonctions sociales dont une<br />
personne est exclue en raison de l’infirmité. De ce fait, la<br />
solution passe non par la disparition de la surdité <strong>et</strong> de la<br />
surdicécité, <strong>et</strong> donc des sourds ou des sourds-aveugles, mais<br />
par le fait que le droit à l’existence, à part entière, des sourds <strong>et</strong><br />
sourds-aveugles soit reconnu. La lutte contre l’exclusion signifie<br />
que c’est le cadre relationnel, ou ce que j’ai appelé<br />
l’écosystème, qui doit être changé <strong>et</strong> la priorité de l’effort<br />
consistera alors à rendre accessible un lieu ou une fonction.<br />
Depuis une vingtaine d’années, <strong>et</strong> grâce à une mobilisation<br />
massive des communautés de sourds <strong>et</strong> d’acteurs des sociétés<br />
civiles, de nombreux lieux privés, publics ou institutionnels leur<br />
ont été rendus accessibles, des lois ont été votées qui leur ont<br />
permis d’accéder à l’exercice réel de la citoyenn<strong>et</strong>é dont ils<br />
avaient été longtemps écartés par les écosystèmes antérieurs.<br />
Des pays de plus en plus nombreux ont reconnu l’existence des<br />
langues des signes nationales <strong>et</strong> le droit des sourds d’y avoir<br />
recours si tel est leur choix. Il faut se réjouir de c<strong>et</strong>te évolution,<br />
parce qu’émerge enfin la conscience que de nombreux sourds<br />
ne peuvent faire l'économie d'une communication visuellegestuelle<br />
<strong>et</strong> que la Langue des Signes, qu'ils doivent être libres<br />
de ne pas apprendre s'ils le souhaitent, n'en constitue pas<br />
moins une langue susceptible de leur rendre d'innombrables<br />
services <strong>et</strong> un mieux-être général dans leurs rapports sociaux.<br />
Je considère pour ma part que ces langues des signes<br />
constituent un patrimoine inaliénable de l’humanité, ce sont des<br />
langues que les entendants ont tout intérêt à apprendre, non<br />
pour étancher leur soif de philanthropie, mais pour enrichir leur<br />
culture <strong>et</strong> pour leur plaisir. La Société européenne de santé<br />
mentale <strong>et</strong> surdité a toujours défendu, ce qui est clairement<br />
exposé dans ses textes constitutifs, que les sourds,<br />
malentendants <strong>et</strong> sourds-aveugles, comme tous les êtres<br />
humains, doivent pouvoir être soignés dans la langue de leur<br />
choix <strong>et</strong> être ainsi respectés dans leurs droits fondamentaux.<br />
Je voudrais ici attirer votre attention sur un point capital, source<br />
de confusion. La détermination de principes d’action est ici plus<br />
que jamais la condition d’une résolution correcte des<br />
contradictions. J’affirme qu’il est essentiel de bien différencier<br />
les techniques, par exemple les techniques réparatrices dont j’ai<br />
parlé plus haut, des contextes idéologiques dans lesquels elles<br />
s’inscrivent. Un exemple. L’éducation orale des enfants sourds<br />
est une technique : elle vise à promouvoir la meilleure élocution<br />
possible de ces enfants. Elle m<strong>et</strong> en œuvre des moyens<br />
spécifiques qui ont fait l’obj<strong>et</strong> de nombreuses évaluations, au<br />
cours de son histoire certains de ces moyens ont été jugés<br />
inutiles <strong>et</strong> abandonnés, d’autres se sont vus développer. Elle a<br />
ainsi fait l’obj<strong>et</strong> d’une accumulation progressive de<br />
connaissances. Autre exemple : les prothèses auditives. Elles<br />
existent depuis des siècles <strong>et</strong> n’ont cessé de se perfectionner au<br />
fil du temps. Nul ne m<strong>et</strong> aujourd’hui en doute leur valeur <strong>et</strong> leur
utilité en tant qu’outil technologique, du moment que les<br />
indications en sont soigneusement portées. Un troisième<br />
exemple : les implants cochléaires. Il s’agit là d’une technologie<br />
plus récente, certes beaucoup plus sophistiquée <strong>et</strong> audacieuse<br />
que les prothèses, qui comporte des risques, qui est suivie de<br />
succès ou d’échecs, mais leur évolution rapide témoigne aussi<br />
de l’amélioration de leurs performances.<br />
D’une tout autre portée est le contexte idéologique dans<br />
lesquels s’inscrit le recours à ces techniques. Faire parler un<br />
enfant sourd ne peut jamais être considéré comme un objectif<br />
indépendant des choix éducatifs généraux des parents, de leurs<br />
orientations idéologiques, de leur conception du monde : c<strong>et</strong><br />
objectif sera prioritaire ou non selon que les parents se<br />
mobilisent pour effacer la surdité de leur vie ou pour tirer toutes<br />
les conséquences concrètes de son existence considérée comme<br />
définitive, en luttant pour l’accessibilité. Lutter pour<br />
l’accessibilité peut d’ailleurs ne pas avoir le même sens pour<br />
tout le monde. Certains sourds peuvent militer en faveur du<br />
bilinguisme (langue des signes/langue écrite), d’autres (comme<br />
c’est fréquent avec les personnes que l’on caractérise<br />
audiologiquement comme des devenus sourds ou comme des<br />
malentendants) feront le choix d’un monolinguisme strict (vers<br />
la langue orale <strong>et</strong> écrite de leur pays) <strong>et</strong> recourront plutôt à des<br />
aides techniques (sous-titrage, lecture labiale, <strong>et</strong>c.). Mais peu<br />
importe : dans tous les cas, la lutte pour l’accessibilité nécessite<br />
ipso facto que la surdité soit rendue présente, existante, qu’elle<br />
constitue une donnée du réel à partir de laquelle des mesures<br />
concrètes seront prises.<br />
Il y a eu, dans l’histoire de la surdité, de longues périodes<br />
d’obscurantisme où l’idéologie de l’éducation orale a pu<br />
recouvrir de tout autres objectifs que celui de perm<strong>et</strong>tre aux<br />
enfants sourds de s’exprimer oralement. Lorsqu’en 1880, au<br />
congrès de Milan, les pédagogues entendants <strong>et</strong> les ministères<br />
ont uni leurs voix pour imposer la parole articulée, dans le<br />
même mouvement ils ont totalement banni la langue des signes<br />
de l'enseignement <strong>et</strong> ils ont expulsés les enseignants sourds du<br />
champ de l’enseignement. Ce faisant, ils ont plongé les sourds<br />
dans le malheur (en France, par exemple, pendant près d'un<br />
siècle puisque la mesure n'a été levée qu'en 1976). De même,<br />
lorsqu’en 1883 aux Etats-Unis, Graham Bell proposait à<br />
l'Académie Nationale des Sciences, dans une optique eugéniste,<br />
d'interdire la langue des signes, de supprimer les écoles<br />
spécialisées, d’interdire la presse sourde <strong>et</strong> de fermer les<br />
associations de sourds afin d’empêcher la constitution d'une<br />
variété sourde de la race humaine, il j<strong>et</strong>ait les bases<br />
idéologiques d'une politique eugéniste qui n'a trouvé son<br />
aboutissement qu'avec l'avènement d'Hitler <strong>et</strong> les<br />
exterminations de sourds dans les camps. Il convient donc de<br />
bien distinguer l’éducation orale, technique pédagogique, de<br />
l’oralisme, tendance idéologique niant à la langue des signes<br />
toute valeur <strong>et</strong> toute existence - de fait, tout droit d’exister<br />
comme sourd. Or la mise en pratique de l’éducation orale ne va<br />
pas automatiquement de pair avec l’idéologie oraliste, tant s’en<br />
faut. De même, le port d’appareils auditifs n’implique pas<br />
automatiquement que le sourd délaisse ou méconnaisse la<br />
langue des signes. Enfin, le recours à l’implant cochléaire<br />
n’exige pas qu’on nie le droit de sourds à la communication<br />
visuelle-gestuelle. En France <strong>et</strong> dans de trop nombreux pays,
malheureusement, <strong>et</strong> contrairement à ce qu’il en est par<br />
exemple en Suède, la pose d’implants cochléaires est effectuée<br />
dans une ambiance d’hostilité franche envers la langue des<br />
signes : loin d’être seulement une technique, elle est le fer de<br />
lance de la nouvelle croisade oraliste de nos médecins<br />
chevaliers des temps modernes. Et c’est cela qui est, à nos<br />
yeux, condamnable : non l’éducation orale, non la prothèse,<br />
non l’implant, mais le refus de reconnaître aux sourds <strong>et</strong> à leur<br />
entourage le droit de choisir entre différentes options de vie,<br />
d’éducation, de culture <strong>et</strong> d’exercice de leur citoyenn<strong>et</strong>é, c’est-àdire<br />
le refus de m<strong>et</strong>tre en œuvre les moyens matériels, humains<br />
<strong>et</strong> institutionnels perm<strong>et</strong>tant l’exercice de ce droit (par exemple,<br />
le droit d’accéder au bilinguisme langue des signes/langue<br />
écrite). Le danger est de remplacer l’universalité des droits par<br />
l’uniformité de la pensée <strong>et</strong> des comportements. Ainsi,<br />
concevoir l’implant cochléaire comme la réponse à toutes les<br />
questions <strong>et</strong> prétendre qu’ils rendent inutiles les efforts de<br />
promotion des langues des signes <strong>et</strong> de l’accessibilité est une<br />
politique dangereuse <strong>et</strong> néfaste. Cela sous-entend qu’une seule<br />
manière de concevoir la vie, aussi justifiée soit-elle, supplante<br />
toutes les autres <strong>et</strong> peut nier à des communautés entières<br />
d’humains le droit d’édifier leur vie sur d’autres bases, selon<br />
d’autres normes.<br />
Pour dire les choses autrement, le critère fondamental qui doit<br />
r<strong>et</strong>enir notre attention est en dernière instance celui d’un<br />
développement social tel qu’il offre aux sourds le droit de choisir<br />
leurs appartenances culturelles <strong>et</strong> le droit de se doter d’un<br />
statut identitaire <strong>et</strong> social - celui qu’ils souhaitent s’attribuer<br />
tout autant que celui que les entendants leur reconnaissent. Le<br />
critère fondamental n’est nullement le statut audiophonologique<br />
du sourd. Non que ce critère n’ait aucune importance : il n’est<br />
pas indifférent pour un suj<strong>et</strong> sourd d’être sourd sévère ou sourd<br />
profond, sourd congénital ou devenu sourd, sourd voyant ou<br />
sourd aveugle ! Mais c’est toujours au suj<strong>et</strong> sourd d’évaluer ses<br />
compétences individuelles <strong>et</strong> d’exprimer ses propres désirs<br />
quant à leur utilisation, par exemple s’il veut <strong>et</strong> peut porter un<br />
appareil auditif ou non, s’il veut <strong>et</strong> peut s’exprimer oralement ou<br />
non, s’il suivra les choix pédagogiques initiaux <strong>et</strong> les<br />
orientations culturelles de ses parents - oralistes ou en faveur<br />
du bilinguisme - ou non, s’il nouera des relations sociales<br />
incluant des relations avec les sourds, <strong>et</strong> éventuellement le<br />
mariage, ou les excluant, s’il participera ou non, <strong>et</strong> de quelle<br />
manière, aux activités sociales des sourds <strong>et</strong> à leur lutte pour la<br />
reconnaissance de leurs droits, <strong>et</strong>c. Ce qui importe sera sa<br />
manière d’intégrer ces données dans une culture <strong>et</strong> non son<br />
degré d’audition. En dernière analyse, ce sont les moyens<br />
offerts <strong>et</strong> mis à sa disposition par l’écosystème, qui<br />
détermineront le niveau de bien-être optimal. Et en refusant<br />
l’idéologie (je dis bien : l’idéologie, pas la technique) qui réduit<br />
les sourds à des oreilles déficientes, en luttant pour<br />
l’établissement de relations citoyennes, le corps social tout<br />
entier assume sa responsabilité face à la question du droit à<br />
l’existence des sourds. Chacun de nous peut alors jouer un rôle<br />
dans la réduction du handicap - vous m’avez compris, je dis<br />
bien du handicap, qui est une relation, <strong>et</strong> non de l’infirmité, qui<br />
concerne un organe.<br />
L’histoire des sourds n’est autre que celle de leur visibilité, un<br />
caractère éminemment variable suivant les pays <strong>et</strong> les époques.
C<strong>et</strong>te visibilité a connu depuis le 18ème siècle des phases<br />
successives d’expansion <strong>et</strong> de régression avec un n<strong>et</strong> regain<br />
d’intensité dans la seconde moitié du 20ème siècle. Depuis<br />
quelques décennies, les sourds se donnent à voir. Leur présence<br />
individuelle <strong>et</strong> collective se banalise <strong>et</strong> simultanément le niveau<br />
d’information de la population entendante sur la surdité<br />
augmente sensiblement. Les sourds ne sont plus perçus comme<br />
des êtres étranges <strong>et</strong> fascinants parce que rares, dont on se<br />
demande encore s’ils font partie de l’humanité. L’ignorance <strong>et</strong><br />
l’incompréhension cèdent devant les manifestations d’une<br />
présence quotidienne. Les sourds, les sourds-aveugles font<br />
maintenant partie de notre environnement social <strong>et</strong> de notre<br />
paysage mental, au point que leur présence en devient banale.<br />
Je rêve du jour où personne ne sera plus sidéré d’effroi ou saisi<br />
d’impuissance lors d’une rencontre avec un sourd. Je rêve d’une<br />
disparition de la surdophobie, telle que l’a nommée une<br />
professionnelle de santé néerlandaise au congrès de l’ESMHD de<br />
Manchester en 1997 : la surdophobie, c’est-à-dire la peur <strong>et</strong> le<br />
rej<strong>et</strong> de la surdité <strong>et</strong> du sourd, c’est-à-dire l’intolérance. Il<br />
faudra voir dans c<strong>et</strong>te accoutumance une situation où la norme<br />
sociale ne sera plus seulement entendante. Mais c<strong>et</strong>te<br />
accoutumance a une condition, celle du maintien permanent de<br />
la visibilité. Et la visibilité a un prix : c’est la lutte quotidienne<br />
pour l’accessibilité. Notre devoir de citoyen <strong>et</strong> de professionnel<br />
est de rendre accessibles aux sourds tous les lieux dont ils sont<br />
exclus. Il est de tout m<strong>et</strong>tre en œuvre pour qu’entre sourds <strong>et</strong><br />
entendants se créent des passerelles <strong>et</strong> des échanges. Cela<br />
passe par la modification des lois, des fonctionnements<br />
institutionnels <strong>et</strong> des mentalités. Il faudra, par exemple,<br />
reconnaître l'immense avantage que présente pour tous, sourds<br />
<strong>et</strong> entendants, la mise à disposition d’interprètes langue orale/<br />
langue des signes afin de faciliter l’accessibilité de tous les lieux<br />
publics, les institutions d’enseignement, l’audiovisuel, les lieux<br />
de soins, <strong>et</strong>c. Il faudra ne plus craindre les contacts de sourds<br />
entre eux, en classe, dans les loisirs ou au travail ; ne plus voir<br />
un danger dans les mariages entre sourds ou dans la<br />
scolarisation collective des sourds dans des classes annexées. Il<br />
faudra reconnaître enfin que c<strong>et</strong>te dimension collective de la vie<br />
sociale des sourds est un élément capital de leur intégration<br />
sociale dans la société entendante <strong>et</strong> non un facteur en soi de “<br />
gh<strong>et</strong>toïsation » ou de “ communautarisme ».<br />
Ne nous berçons pas de douces illusions : la visibilité des sourds<br />
n’est pas <strong>et</strong> ne sera jamais un acquis irréversible, elle est<br />
quotidiennement confrontée à l’oubli, au refus, à<br />
l’uniformisation, au prêt-à-porter de la pensée <strong>et</strong> il y a là une<br />
lutte incessante entre ces deux tendances. Il n’y a donc pas à<br />
attendre que les sourds entendent pour rendre accessibles les<br />
soins médicaux <strong>et</strong> chirurgicaux, la psychothérapie, la justice,<br />
l’école, les informations télévisées, les musées, les théâtres, le<br />
permis de conduire, les voyages en avion, <strong>et</strong>c. Il s’agit plutôt<br />
d’œuvrer inlassablement en faveur d’une société ouverte à<br />
plusieurs normes de vie, où chacun trouve sa place quel que<br />
soit son statut audiologique. Les professionnels de tous terrains<br />
ont un grand rôle à jouer. Et nous en arrivons tout<br />
naturellement à c<strong>et</strong>te question des nouvelles pratiques de santé<br />
que je vais maintenant décrire, un peu schématiquement il est<br />
vrai mais en souhaitant que ces réflexions donnent matière à<br />
débat dans ce congrès.
Depuis deux décennies, parfois un peu plus longtemps selon les<br />
pays, les praticiens de la santé physique <strong>et</strong> ceux de la santé<br />
mentale ont engagé, à travers le monde, une lutte pour la<br />
création de services de santé adaptés aux besoins des sourds.<br />
Pourquoi ? Parce que ces praticiens ont été nombreux, <strong>et</strong> ils<br />
sont de plus en plus nombreux là où ces services se font encore<br />
attendre, à constater la mauvaise qualité des soins dispensés à<br />
la population sourde : erreurs de diagnostics, malentendus<br />
linguistiques <strong>et</strong> culturels entraînant des erreurs de traitement,<br />
absence de tout traitement psychothérapeutique aboutissant à<br />
un allongement indu des durées d’hospitalisation <strong>et</strong> parfois à<br />
l’oubli du patient sourd au sein d’un service pendant vingt ou<br />
trente ans, méconnaissance des droits du patient hospitalisé,<br />
défaut d’information <strong>et</strong> de consentement du patient recevant<br />
des soins, non-respect de la confidentialité, isolement du<br />
patient générateur de souffrance, d’anxiété, de dépression <strong>et</strong><br />
d’image dévalorisée de soi, absence de politique de prévention<br />
aboutissant à des catastrophes sanitaires (le sida a pu faire des<br />
ravages parmi la population sourde <strong>et</strong> les personnes en contact<br />
avec elle avant que s’instaurent les premières campagnes<br />
authentiques d’information <strong>et</strong> les premiers traitements). Ces<br />
praticiens en sont arrivés aux mêmes conclusions : il faut<br />
m<strong>et</strong>tre en œuvre des services où l’accueil des sourds puisse<br />
s’effectuer non selon des normes imposées arbitrairement mais<br />
conformément au mode de vie choisi par les patients. Et cela<br />
implique d’aller vers la population sourde, d’étudier ses besoins<br />
<strong>et</strong> de partager des pratiques <strong>et</strong> des valeurs qui lui sont chères.<br />
Il n’y a rien de plus destructeur que d’indifférencier les besoins<br />
d’une population, par exemple en confondant les revendications<br />
des sourds bilingues <strong>et</strong> celles des sourds ou malentendants<br />
luttant pour l’amélioration de leurs moyens d’audition.<br />
Concrètement, cela a signifié que, pour améliorer l’accueil des<br />
sourds bilingues, il a fallu tourner des services de soins <strong>et</strong> des<br />
services sociaux entiers vers la pratique de la langue des<br />
signes : soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants,<br />
psychiatres <strong>et</strong> assistants sociaux entendants ont dû apprendre<br />
c<strong>et</strong>te langue <strong>et</strong> les équipes se sont dotées d’interprètes langue<br />
des signes/langue orale. Des sessions de formations des<br />
soignants ont dû être mises en place. Cela ne signifie nullement<br />
que les sourds soient obligés d’être reçus en langue des signes<br />
s’ils ne le souhaitent pas. De nombreux malentendants (sur le<br />
plan audiologique) optent pour un monolinguisme strict <strong>et</strong> se<br />
sentent plus proches de la culture entendante. C’est leur droit,<br />
<strong>et</strong>, personnellement je m’abstiens de tout signe lorsque je<br />
reçois un patient qui les ignore ou les refuse. C’est la moindre<br />
des choses que l’on puisse faire pour exercer son métier dans le<br />
respect du patient <strong>et</strong> sans comm<strong>et</strong>tre de funestes erreurs. La<br />
possibilité est donc maintenant offerte aux patients d’être<br />
soignés dans la langue de leur choix. Des centaines d’unités de<br />
soins ont ainsi vu le jour à travers le monde. Je vous<br />
recommande vivement de lire l’impressionnant document mis<br />
au point par nos collègues britanniques “ Signs of the Time »<br />
qui, s’il est adopté par les autorités sanitaires de Grande-<br />
Br<strong>et</strong>agne, constituera une sorte de charte des bonnes pratiques<br />
<strong>et</strong> un guide pour les développements à venir, au niveau<br />
national, des services de santé mentale pour sourds. Ce<br />
document a incontestablement une valeur pour les<br />
professionnels de santé d’autres pays, même exerçant dans des<br />
conditions différentes. Aux Pays-Bas, cinq centres de soins se<br />
sont ouverts, géographiquement bien répartis, offrant
hospitalisations, consultations <strong>et</strong> visites à domicile. Mon<br />
collègue Otto Fritschy pourra ainsi vous décrire le formidable<br />
travail de son équipe <strong>et</strong> de lui-même en direction des sourds du<br />
troisième âge, à Ede, au centre des Pays-Bas, non loin de<br />
l’endroit où a été construite une non moins formidable maison<br />
de r<strong>et</strong>raite pour sourds comme il n’en existe nulle part ailleurs<br />
dans le monde <strong>et</strong> qui soit autant source de bien-être pour les<br />
vieux sourds (du moins à ma connaissance). En France, ce sont<br />
douze centres régionaux hospitaliers qui ont été créés depuis<br />
1996, subventionnés par le gouvernement. Ces centres<br />
fonctionnent encore de manière inégale mais ils tissent un<br />
réseau de soins de mieux en mieux coordonné sur tout le<br />
territoire. Je pourrais multiplier les exemples mais je ne<br />
voudrais pas laisser croire que ces développements soient aussi<br />
avancés dans tous les pays. Tout est loin d’être rose : on<br />
constate par exemple de grandes différences entre les pays du<br />
Nord <strong>et</strong> ceux du Sud de l’Europe, ces derniers étant n<strong>et</strong>tement<br />
moins dotés en services de soins pour les sourds.<br />
Un autre élément essentiel du développement de soins adaptés<br />
a été l’embauche de professionnels sourds dans les équipes. Le<br />
vocable “ professionnel » couvre toutes sortes de compétences.<br />
Il est surtout utilisé lorsque des sourds participent, bien souvent<br />
sans diplômes, au travail quotidien des équipes, en tant<br />
qu’experts de la condition sourde à qui il manque encore la<br />
formation académique suivie par leurs collègues entendants.<br />
Partout où c<strong>et</strong>te collaboration sourds-entendants s’instaure, les<br />
équipes entrent de plain-pied dans la culture des sourds <strong>et</strong> dans<br />
leur mode de vie, une plus grande réciprocité se manifeste<br />
entre soignants entendants <strong>et</strong> soignants sourds <strong>et</strong> la<br />
reconnaissance sociale <strong>et</strong> professionnelle entre équipes, au sein<br />
d’un hôpital <strong>et</strong> à l’extérieur, en est infiniment facilitée. Il s’agit<br />
d’un excellent moyen de dépasser les attitudes philanthropiques<br />
qui assignent aux sourds une place d’individus démunis <strong>et</strong><br />
assistés par des entendants bien-pensants. Professionnels<br />
sourds <strong>et</strong> entendants travaillent au coude à coude, échangent<br />
leur expérience <strong>et</strong> se découvrent mutuellement en j<strong>et</strong>ant<br />
quotidiennement des ponts entre leurs cultures. Ils réfléchissent<br />
ensemble aux améliorations à apporter à leur pratique,<br />
organisent des réunions avec les usagers sourds pour recueillir<br />
des avis extérieurs, produisent des cass<strong>et</strong>tes vidéo pour des<br />
campagnes d’information en langue des signes sur des thèmes<br />
de santé, bref ils déploient leurs activités dans tous les<br />
domaines. Et je pense ici au travail de pionnier mené par des<br />
professionnels sourds comme Barbara Brauer aux Etats-Unis, à<br />
qui je veux rendre hommage. Barbara dirigeait le Centre de<br />
Santé Mentale de l’Université Gallaud<strong>et</strong>. Comme vous le savez<br />
déjà, elle est décédée il y a deux mois. Je pense aussi à Sharon<br />
Ridgeway, psychologue à Manchester en Angl<strong>et</strong>erre qui soigne<br />
les victimes sourdes d’abus sexuels, à Birgitta Martinell en<br />
Suède, à Michel Girod à Paris, responsable du programme “ Dire<br />
la santé en langue des signes française »… <strong>et</strong> à tant d’autres<br />
que je ne citerai pas. Il existe pourtant des services qui ne<br />
comptent aucun professionnel sourd. Il n’est pas indifférent,<br />
dans le travail quotidien, d’avoir à s’exprimer du matin au soir<br />
en langue des signes avec des collègues, en réunion, ou lors<br />
des pauses où l’on se raconte des histoires drôles pour se<br />
détendre. Les entendants apprennent ainsi à mieux diriger leur<br />
regard, à respecter les sourds dans les prises de parole, à<br />
mieux observer les entrées en contact, les manières de toucher,
les différentes qualités de gestuelles… La présence de<br />
professionnels sourds donne incontestablement un caractère<br />
très différent à la marche d’un service. D’une manière générale,<br />
je pense que le partage d’une langue pendant le seul temps<br />
d’une consultation ne représente qu’une infime entrée dans la<br />
culture sourde. Les ponts entre sourds <strong>et</strong> entendants<br />
nécessitent des contacts beaucoup plus variés, dans <strong>et</strong> hors du<br />
champ professionnel.<br />
L’organisation de soins adaptés à la population sourde <strong>et</strong> la<br />
collaboration sourds-entendants posent les conditions de<br />
création d’un nouveau référentiel de travail. Ce nouveau cadre<br />
autorise des découvertes cliniques qui, sans lui, n’auraient<br />
jamais pu se faire. Les professionnels entendants de la santé<br />
mentale sont généralement formés selon certains modèles<br />
théoriques <strong>et</strong> pratiques qu’ils ont acquis à l’université. Lors de<br />
leur rencontre avec un patient sourd, il leur sera tout naturel<br />
d’user de ce savoir de la même manière qu’ils le feraient dans<br />
un entr<strong>et</strong>ien avec un patient entendant, sans chercher à y<br />
introduire des modifications. À court terme, cela paraît<br />
concevable. Mais l’inadaptation de c<strong>et</strong>te méthode apparaît<br />
n<strong>et</strong>tement lorsqu’on évalue soigneusement à plus long terme le<br />
déroulement <strong>et</strong> les résultats des soins. Par exemple, il ne suffira<br />
pas d’introduire un interprète dans une séance de<br />
psychothérapie pour bien soigner un patient sourd. Une<br />
pratique digne de ce nom nécessite non seulement d’évaluer les<br />
eff<strong>et</strong>s de la présence de l’interprète dans les entr<strong>et</strong>iens mais<br />
aussi de comparer les résultats d’un entr<strong>et</strong>ien à ceux d’une<br />
séance où seuls sont en contact le thérapeute entendant <strong>et</strong> le<br />
patient sourd, tous deux s’exprimant en langue des signes, ainsi<br />
qu’à ceux d’une séance qui m<strong>et</strong> en présence un thérapeute <strong>et</strong><br />
un patient sourds.<br />
La barrière de la langue est tout à la fois un obstacle, source de<br />
malentendus, <strong>et</strong> une occasion <strong>bienvenue</strong> d’expliciter sa pensée<br />
<strong>et</strong> de sonder le bien-fondé de ses idées. Il n’y a rien de plus<br />
enrichissant que de se soum<strong>et</strong>tre à la nécessité de faire passer<br />
un sens, lorsque le maniement de la langue est incertain <strong>et</strong><br />
maladroit. La peur de l’incompréhension mutuelle - mais c’est<br />
une peur vivifiante - jalonne tous les entr<strong>et</strong>iens entre sourds <strong>et</strong><br />
entendants. C<strong>et</strong>te vigilance accrue exigée par la situation est la<br />
condition du renouveau du regard clinique. Les professionnels<br />
de la santé mentale ont tous fait l’expérience de moments où ils<br />
perçoivent les troubles des patients sourds simultanément<br />
comme des troubles analogues à ceux des patients entendants<br />
<strong>et</strong> comme des éléments spécifiques d’une situation originale.<br />
Ces spécificités doivent être prises attentivement en<br />
considération. Les besoins de la population sourde ont été trop<br />
longtemps négligés par l’environnement entendant pour les<br />
laisser de nouveau sombrer dans le fossé de l’indifférence. Un<br />
travail clinique authentique ne fait pas bon ménage avec la<br />
paresse mentale des cliniciens.<br />
Les évolutions dont je vous ai parlé nous convient à repenser<br />
l’ensemble du dispositif théorique <strong>et</strong> pratique de soins. Sur un<br />
plan théorique, les professionnels de la surdité sont<br />
généralement convaincus, <strong>et</strong> c’est heureux, qu’il n’y a pas de<br />
psychologie du sourd. Ils adm<strong>et</strong>tent qu’une typologie des sourds<br />
n’a aucune raison d’être (les sourds sont comme ceci, ou<br />
comme cela…). Mais il ne faut pas s’étonner de les voir revenir à
l’idéologie de la surdité comme déficience quand ils se<br />
contentent d’importer les modèles traditionnels de pensée dans<br />
ce cadre nouvellement créé. Au lieu de penser la rencontre<br />
sourd-entendant comme un pont à construire entre deux<br />
singularités, ils auront tendance à s’extraire de la rencontre <strong>et</strong> à<br />
attribuer les spécificités de l’entr<strong>et</strong>ien au seul patient sourd. Il<br />
m’est ainsi arrivé d’entendre des professionnels de la surdité<br />
dire que les entr<strong>et</strong>iens avec les patients sourds durent deux fois<br />
plus longtemps que ceux avec de patients entendants, comme<br />
si c<strong>et</strong>te caractéristique était un attribut en soi des sourds. Ces<br />
professionnels étaient, bien sûr, entendants. Ils ne leur venaient<br />
pas à l’idée de m<strong>et</strong>tre ce doublement du temps sur le compte<br />
d’un choc des façons d’être respectives du patient comme du<br />
soignant, pas plus que de se demander ce qu’il en serait si un<br />
professionnel sourd rencontrait un patient sourd. Ils en<br />
arrivaient ainsi à r<strong>et</strong>omber dans les pièges de l’objectivation de<br />
l’autre.<br />
La collaboration entre professionnels sourds <strong>et</strong> entendants au<br />
sein d’équipes soignantes n’a rien d’évident. Sa mise en œuvre<br />
est toujours traversée par des conflits générateurs d’angoisse <strong>et</strong><br />
de culpabilité. S’il en est ainsi, c’est que la difficulté à trouver<br />
une langue commune va bien au-delà de l’apprentissage de la<br />
langue orale <strong>et</strong> de la langue des signes. S’entendre, au sens le<br />
plus accompli du terme, suppose une adhésion commune à des<br />
objectifs <strong>et</strong> donc à des valeurs. Elle suppose aussi un accord<br />
dans la communication non-verbale que les seules<br />
performances linguistiques ne perm<strong>et</strong>tent pas d’atteindre. C’est<br />
un reproche fréquent que les sourds adressent aux entendants<br />
qui se lancent dans l’apprentissage de la langue des signes : les<br />
entendants meuvent gauchement leurs bras <strong>et</strong> leurs mains,<br />
sans amplitude, sans souplesse, trahissant une inhibition<br />
gestuelle. Par manque d’habitude ou de tradition culturelle ou<br />
par honte, ils restreignent leur gestualité. De même, les traits<br />
de leur visage demeurent souvent immobiles <strong>et</strong> inexpressifs. Or,<br />
en langue des signes, la mimique faciale est une composante<br />
linguistique essentielle sans laquelle aucun message ne peut<br />
être correctement compris par un interlocuteur sourd. Les<br />
sourds incitent donc fréquemment les entendants à mobiliser<br />
leurs muscles faciaux, à donner du volume <strong>et</strong> de l’assurance à<br />
leurs gestes, en somme à lever l’inhibition qui bride leur<br />
capacité d’expression. Autrement dit, c’est à un engagement<br />
corporel différent, c’est à un changement de notre rapport au<br />
monde que nous convient les sourds. Pour un<br />
psychothérapeute, pour qui les voies de la guérison du patient<br />
passent par l’instauration avec lui d’une symbiose<br />
thérapeutique, c<strong>et</strong>te invitation à libérer sa propre expression<br />
gestuelle est le meilleur atout pour opérer le rapprochement<br />
nécessaire au développement d’une bonne intimité<br />
psychologique.<br />
Nous professionnels, sourds <strong>et</strong> entendants, avons donc à<br />
apprendre à adm<strong>et</strong>tre les incertitudes de notre identité, à<br />
laisser l’angoisse nous étreindre non pour qu’elle nous paralyse<br />
mais parce qu’elle nous signale des terres inconnues à<br />
découvrir. D’obstacle gênant, la “ surdophobie » ou, plus<br />
généralement, la peur de l’étranger peut se changer en un<br />
puissant moyen d’éviter le naufrage de la communication. La<br />
collaboration sourds-entendants est donc, de ce point de vue,<br />
une chance. Il nous est ainsi donné l’occasion d’aller à la
encontre d’autrui, c<strong>et</strong> autre étranger qui n’en est pas moins un<br />
être humain <strong>et</strong> que nous finissons parfois, dans le meilleur des<br />
cas, par découvrir en nous-mêmes.<br />
Mais les chocs de cultures ne sont pas le privilège des échanges<br />
entre sourds <strong>et</strong> entendants. On en trouve aussi dans les<br />
rencontres internationales. Il n’est pas toujours facile de se<br />
comprendre d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une<br />
culture à l’autre <strong>et</strong> le travail d’explicitation des malentendus<br />
nous oblige à toujours rester sur le qui-vive lors de ces<br />
échanges internationaux. Ces derniers se multiplient<br />
prodigieusement <strong>et</strong> le mouvement ne semble pas fléchir. Depuis<br />
sa création en 1986, l’ESMHD organise tous les trois ans des<br />
congrès dans une ville à chaque fois différente du monde.<br />
Depuis 1998 sont apparus les congrès mondiaux, à Washington,<br />
puis à Copenhague en 2000. Le prochain congrès mondial aura<br />
ainsi lieu en Afrique du Sud, en octobre 2005. Plusieurs congrès<br />
ont déjà été organisés à Buenos Aires, qui programment de<br />
j<strong>et</strong>er les bases d’une société latino-américaine de santé mentale<br />
<strong>et</strong> surdité. À ces congrès internationaux, il faut ajouter les<br />
rencontres de dimensions plus modestes mais plus fréquentes,<br />
des Groupes d’Intérêt Spécifique (SIG) de la Société<br />
européenne de santé mentale <strong>et</strong> surdité, où les praticiens<br />
s’informent de leurs pratiques respectives. Et je ne compte plus<br />
les sociétés nationales, comme la Société britannique ou la<br />
Société espagnole de santé mentale <strong>et</strong> surdité, qui tiennent<br />
leurs assemblées générales annuelles <strong>et</strong> proposent<br />
régulièrement des colloques. Enfin, il faut citer l’excellent travail<br />
impulsé par notre collègue italien Ettore Guaia qui a mis en<br />
route un forum d’échanges entre professionnels de la surdité <strong>et</strong><br />
de la santé mentale sur Intern<strong>et</strong>, le répertoire international des<br />
adresses de professionnels mis au point par nos collègues de<br />
l’Université Gallaud<strong>et</strong>, les liens qui se sont tissés avec la<br />
Fédération Mondiale des Sourd. Je vous prie de ne pas m’en<br />
vouloir si je ne cite pas tout le monde. Ce serait impossible. Je<br />
tenais simplement à souligner l’accélération <strong>et</strong> l’intensité<br />
récentes des échanges qui se produisent à travers le monde<br />
dans ce domaine si particulier de la santé mentale <strong>et</strong> de la<br />
surdité.<br />
Comme vous le voyez, la tâche est immense. Nous sommes<br />
convaincus que l’intégration sociale <strong>et</strong> le bien-être des sourds<br />
nous concernent tous. Il est impossible de réduire ces objectifs<br />
aux seuls paramètres professionnels. Lorsqu’il est question de<br />
santé mentale, c’est la vie toute entière qui est mise sur la<br />
sell<strong>et</strong>te. C’est pourquoi le bien-être de tous, sourds <strong>et</strong><br />
entendants, passe par une reconnaissance mutuelle d’existence,<br />
sous toutes ses formes. Je crois avoir été assez clair sur<br />
l’importance des ponts entre les cultures, <strong>et</strong> il en reste<br />
beaucoup à construire. Mesdames <strong>et</strong> messieurs, au seuil de<br />
c<strong>et</strong>te première conférence canadienne à laquelle j’adresse tous<br />
mes vœux de succès, je vous renouvelle le soutien de l’ESMHD<br />
tout entière <strong>et</strong> je suis heureux que les professionnels européens<br />
de la santé mentale joignent leurs forces à celles des<br />
Canadiens, sourds <strong>et</strong> entendants, pour bâtir un avenir meilleur.<br />
Je vous remercie.
au bébut
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Par : Pirjo Leino, Finlande<br />
Première Conférence Canadienne<br />
sur la Santé Mentale <strong>et</strong> la Surdité<br />
Ottawa, du 9 au 11 septembre 2004<br />
Il me fait plaisir d'être avec vous pour la seconde fois dans une<br />
brève période de temps. L'été dernier, en eff<strong>et</strong>, j'étais au<br />
Congrès mondial de la Fédération mondiale des Sourds, à<br />
Montréal, <strong>et</strong> me voici maintenant de r<strong>et</strong>our, c<strong>et</strong>te fois-ci à<br />
Ottawa, pour vous apporter des salutations de Finlande.<br />
J'aimerais vous remercier de m'avoir invitée à c<strong>et</strong>te conférence.<br />
En préparant c<strong>et</strong>te présentation, je me suis demandé quelle<br />
était la question essentielle que je devrais traiter dans le cadre<br />
de la présente conférence. Devrais-je vous dire comment nous,<br />
en Finlande, nous avons organisé les services pour les Sourds <strong>et</strong><br />
donner au suj<strong>et</strong> un point de vue un peu plus large, ou devraisje<br />
essayer de susciter chez vous tous des pensées <strong>et</strong> des<br />
émotions <strong>et</strong> vous demander d'y réfléchir <strong>et</strong> de les absorber en<br />
vous.<br />
Ordinairement, nous parlons de services de réadaptation, de<br />
réadaptation. Généralement, nous associons au mot<br />
'réadaptation' une déficience fonctionnelle, déficience pour<br />
laquelle nous préparons un plan de réadaptation à l'intention du<br />
patient qui doit être réadapté <strong>et</strong> pour perm<strong>et</strong>tre à ce patient de<br />
pouvoir fonctionner de façon indépendante après cela.<br />
Habituellement on guérit d'une maladie avec l'aide de soins <strong>et</strong>,<br />
peut-être, de médicaments. Un patient de santé mentale qui<br />
traverse une réadaptation a souvent besoin de services de<br />
thérapie dont le but est de servir de soutien aux services<br />
médicaux qui le réadapteront en son état de membre<br />
fonctionnel de la société <strong>et</strong> lui feront gagner son indépendance<br />
au chapitre des aptitudes sociales. Mais comment tout ça a-t-il<br />
une connexion avec la surdité, avec la personne sourde, lorsque<br />
nous utilisons les mots 'réadaptation' ou 'formation en<br />
adaptation' ? C'est de ce problème que j'aimerais discuter avec<br />
vous dans c<strong>et</strong>te présentation, tout en vous parlant du travail qui<br />
se fait chez les Sourds, en Finlande.<br />
De par mes origines familiales, je suis moi-même utilisatrice de<br />
la langue des signes. J'ai grandi <strong>et</strong> j'ai reçu mon éducation<br />
primaire dans une famille où j'ai été élevée par trois personnes<br />
sourdes-aveugles. Plus tard, j'ai eu un beau-père sourd <strong>et</strong> une<br />
soeur, Ulla, qui est également sourde-aveugle. Depuis 1978, je<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
travaille dans l'Organisation finlandaise des sourds-aveugles<br />
comme travailleuse sur le terrain pour les personnes sourdesaveugles.<br />
En 1988, j'ai changé d'emploi pour aller travailler<br />
comme conseillère en réadaptation pour les sourds au service<br />
social <strong>et</strong> service de réadaptation de l'Association finlandaise des<br />
Sourds. Depuis 1995 je travaille comme psychothérapeute au<br />
niveau de la famille, du couple <strong>et</strong> de l'individu <strong>et</strong>, en 2001, je<br />
suis devenue thérapeute à plein temps pour le proj<strong>et</strong> HANDLE<br />
(un proj<strong>et</strong> de thérapie familiale en langue des signes). J'ai eu la<br />
bonne fortune d'avoir un travail intéressant <strong>et</strong> d'avoir été en<br />
mesure de participer à plusieurs tâches stimulantes lorsque<br />
nous avons planifié la façon de développer des services pour les<br />
utilisateurs sourds de la langue des signes en Finlande.<br />
J'ai participé à la planification de différentes sortes d'activités<br />
d'ajustement pour les personnes sourdes, à la formation<br />
d'interprètes en langue des signes <strong>et</strong>, à l'heure actuelle, je<br />
m'intéresse à la façon de soutenir la fonction parentale chez les<br />
parents sourds <strong>et</strong> à développer des services de santé mentale<br />
disposant des moyens de la thérapie.<br />
Lorsque nous planifions des services pour différents groupes de<br />
populations dans la société, il est très important de savoir quelle<br />
langue nous utilisons, <strong>et</strong> ce que nous voulons dire par là, <strong>et</strong><br />
quels genres d'impression nous créons dans la majorité de la<br />
population ainsi que chez les utilisateurs des services en<br />
question. Je ne parle pas comme un chercheur qui s'adresse à<br />
des chercheurs ou comme un professeur parle aux<br />
planificateurs de services, mais j'essaie de vous toucher tous<br />
d'une façon ou d'une autre à partir du niveau de la base d'une<br />
travailleuse qui pratique sur le terrain. J'ai compris que nous qui<br />
sommes réunis ici aujourd'hui provenons de milieux très<br />
différents ; parmi les participants, il y a des sourds, des sourdsaveugles,<br />
les membres de leurs familles, des travailleurs sur le<br />
terrain <strong>et</strong> des spécialistes. Lorsque nous planifions <strong>et</strong> bâtissons<br />
des services, nous devrions garder à l’esprit l'entité finale. Nous<br />
devrions nous rappeler que chacun d'entre nous est un être<br />
physique, mental <strong>et</strong> social, un être humain. Dans le travail<br />
effectué auprès des personnes ayant des déficiences<br />
sensorielles nous ne pouvons pas découper les personnes en<br />
oreilles, yeux ou esprits, sur lesquels nous pourrions faire des<br />
recherches séparées. Nous devrions d'abord examiner notre<br />
propre perception d'être humain, <strong>et</strong> combien nous tolérons que<br />
quelqu'un soit différent ou bien si nous sommes au départ dans<br />
une frénésie de "guérissage" <strong>et</strong> de correction de tout. Si c'est le<br />
cas, nous sommes privés de la possibilité de voir avec des yeux<br />
humains.<br />
(Rétroprojecteur – PowerPoint)<br />
Dans le travail effectué avec les personnes sourdes-aveugles en<br />
Finlande, la prestation de service a changé, lorsqu'on en est<br />
venu à la question de savoir qui paierait pour les services de<br />
réadaptation interne, à même les fonds de l'État versés au<br />
secteur de la santé. Je me rappelle de la première réunion où<br />
j'ai invité le chef ophtalmologiste principal, le chef otologiste<br />
principal <strong>et</strong> le médecin responsable de la réadaptation. L'objectif<br />
était que nous puissions commencer à travailler avec un être<br />
humain compl<strong>et</strong>. C'est ainsi que tout devrait fonctionner ;<br />
travailler avec un être humain compl<strong>et</strong>, en ayant pour objectif
toute la famille avec le bien-être <strong>et</strong> l'égalité perm<strong>et</strong>tant à<br />
chacun d'être membre de la société.<br />
Même en Finlande, nous avons discuté pendant des années sur<br />
la formation en réadaptation <strong>et</strong> en adaptation. Les termes<br />
restent en usage <strong>et</strong> sont trompeurs. Toutefois, nous avons été<br />
de l'avant un peu <strong>et</strong>, au lieu d'adaptation, nous parlons de cours<br />
de "ressources pour les familles". Ces cours sont payés par la<br />
l'État. Le cours prend 8+4 jours, <strong>et</strong> nous organisons trois cours<br />
de c<strong>et</strong>te sorte chaque année. L'idée de base est que nous avons<br />
une structure <strong>et</strong> un échéancier pour le programme de la<br />
journée. Mais le cours est construit sur les ressources des<br />
familles participantes <strong>et</strong> sur une base individuelle. Nous<br />
demandons à nos participants comment il vont <strong>et</strong> où ils ont<br />
besoin d'aide pour se tirer d'affaire dans leur vie de tous les<br />
jours. Ces cours sont organisés pour les parents entendants qui<br />
ont des enfants sourds ou malentendants <strong>et</strong>, séparément, pour<br />
les parents sourds <strong>et</strong> leurs enfants. Plus que tout, les familles<br />
ont besoin, de la part des travailleurs, de "grandes oreilles"<br />
pour entendre, des yeux pour voir <strong>et</strong> des sentiments pour<br />
sentir. Simplement dit : les travailleurs doivent être présents<br />
pour les participants. Si nous, comme travailleurs, pouvons<br />
montrer que la famille est l'expert dans la situation <strong>et</strong><br />
transm<strong>et</strong>tre le respect en leur donnant l'espace dont elles ont<br />
besoin, les barrières sont ouvertes pour nous faire bénéficier<br />
ensemble d'une bonne coopération positive. Je ne vais pas<br />
prendre plus de temps pour passer plus en détail à travers le<br />
contenu du cours parce que vous pouvez le lire dans ce rapport<br />
de proj<strong>et</strong>. Ce programme va vivre <strong>et</strong> continuer à se développer<br />
lorsque nous sommes créatifs ensemble, déjà à l'étape de la<br />
planification.<br />
Par mon travail, j'ai conçu une façon de travailler que j'ai<br />
décrite comme suit (PowerPoint). Quelle est ici la question<br />
essentielle <strong>et</strong> quelle est la source en profondeur du problème ?<br />
C'est le LANGAGE, n'est-ce pas ? Il nous manque une langue<br />
commune. La langue des signes est une langue, mais c'est la<br />
langue maternelle d'une si p<strong>et</strong>ite minorité, celle des Sourds,<br />
qu'elle est toujours aux prises avec une barrière linguistique qui<br />
leur reste infranchissable à cause de leur impossibilité<br />
d'entendre. Nous, de la majorité de la population, connaissons<br />
si peu <strong>et</strong> si mal la langue des signes, qu'il est plus facile pour<br />
nous d'essayer de transformer les Sourds en entendants. Ceci<br />
n'est pas une prise de position dans la discussion sur l'implant<br />
cochléaire. Je navigue en profondeur parce que, à partir de là,<br />
je peux trouver des motifs pour développer des services pour<br />
les sourds sur différents niveaux <strong>et</strong> sur le niveau individuel<br />
parce que je suis psychothérapeute de profession. Comme<br />
psychothérapeute, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de<br />
compréhension. Je comprends (je connais) la langue des signes,<br />
mais est-ce que je comprends ce que mon client essaie de me<br />
dire/signer. Comprendre une langue <strong>et</strong> comprendre la question<br />
sont deux choses séparées à mon avis. Comme puis-je mesurer<br />
combien je comprends <strong>et</strong> si mon client comprend mon 'écriture',<br />
de sorte qu'il/elle puisse m'aider dans le processus de thérapie.<br />
Le travail de psychothérapie <strong>et</strong> le développement de méthodes<br />
pour ce travail au moyen de l'analyse constituent un nouveau<br />
défi de taille dans mon travail. Je fais de la thérapie en langue<br />
des signes tous les jours. Je réserve 90 minutes pour les
familles <strong>et</strong> les couples, 60 minutes pour des séances de thérapie<br />
individuelle, <strong>et</strong> 45 minutes pour thérapie à distance via<br />
vidéophone. Les thérapies peuvent prendre de 10 fois la<br />
thérapie de crise jusqu'à 3-5 ans de thérapie intensive. Je ne<br />
répéterai pas ici ce que j'ai écrit dans le rapport, mais j'aimerais<br />
soulever la discussion éthique <strong>et</strong> morale à côté de ces<br />
questions, discussion qui pourrait conduire à un développement<br />
au niveau professionnel. Mes clients possèdent différents<br />
niveaux de compétence linguistique selon leur éducation, leurs<br />
aptitudes sociales <strong>et</strong> leurs compétences en interaction. J'ai<br />
quelques (2-3) clients entendants qui sont en thérapie de<br />
longue durée. J'enregistre sur vidéo mes séances de thérapie <strong>et</strong><br />
compare mes propres façons de travailler, pour voir si elles<br />
diffèrent selon le fait que le client est entendant ou sourd ou<br />
non. J'ai également une formation comme superviseur en<br />
thérapie. Comment est-ce que je fais de la recherche <strong>et</strong> sur<br />
quoi porte ma recherche pour superviser d'autres thérapeutes<br />
dans le travail de thérapie avec des patients sourds ?<br />
(Power Point)<br />
Nous sommes très isolés dans notre travail. Avec mes<br />
nombreuses années d'expérience je pense à ce que je vais dire,<br />
comment articuler mes opinions <strong>et</strong> comment faire du<br />
réseautage au niveau des professionnels. C'est également un<br />
domaine qui soulève souvent des émotions parce que nous,<br />
experts entendants, ne voyons pas toujours à quel moment<br />
nous utilisons notre pouvoir sur une personne individuelle <strong>et</strong> sur<br />
une famille. Y a-t-il de la place pour respirer <strong>et</strong> pour s'asseoir <strong>et</strong><br />
réfléchir aux services lorsque ceux-ci sont développés à partir<br />
de différents points de vue ? Je reviendrai sur la question que<br />
j'ai déjà mentionnée. Comment les gens se tirent-ils d'affaire<br />
dans leur vie de tous les jours, ce sur quoi nos connaissances<br />
restent insuffisantes, mais nous devons accompagner nos<br />
clients afin d'assurer une prestation de service pour les Sourds<br />
qui soit professionnelle ?<br />
À la fin, j'aimerais nous lancer à tous une question qui<br />
mériterait réflexion : servons-nous les Sourds ou la bonne<br />
conscience des entendants vis-à-vis des Sourds ? Ce qui nous<br />
fait nous sentir bien n'est pas toujours nécessairement bon ou<br />
juste pour le client sourd ou sa famille. Cela je l'ai appris dans<br />
mon travail <strong>et</strong> j'en ai encore beaucoup à apprendre, <strong>et</strong> nous<br />
avons beaucoup à apprendre les uns des autres. J'espère que<br />
c<strong>et</strong>te conférence sera capable de construire c<strong>et</strong> espoir un peu<br />
plus loin pour développer de meilleurs services qu'auparavant <strong>et</strong><br />
pour créer une interaction fructueuse les uns avec les autres.<br />
au début
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
présentateurs de conférence<br />
Michael Sousa, LL.B.,<br />
Master of Ceremonies / Maître de cérémonies<br />
Comments and Welcome / Mot d’ouverture <strong>et</strong> <strong>bienvenue</strong><br />
Dr Alexis Karacostas -<br />
Keynote address / Conférencier<br />
principal<br />
Services en santé mentale pour personnes<br />
sourdes <strong>et</strong> malentendantes en Europe/<br />
Mental Health Services for People Who<br />
are Deaf and Hard of Hearing in Europe<br />
D r Alexis Karacostas est psychiatre <strong>et</strong><br />
psychothérapeute à Paris. Il exerce à mi-temps à l’hôpital la<br />
Salpêtrière dans l’Unité d’Information <strong>et</strong> de Soins des Sourds <strong>et</strong><br />
à mi-temps à son cabin<strong>et</strong> privé. Il est président de l’association<br />
GESTES <strong>et</strong> de l’ESMHD (European Soci<strong>et</strong>y for Mental Health and<br />
Deafness). Il dirige la revue Surdités, revue internationale<br />
francophone sur la santé mentale <strong>et</strong> la surdité.<br />
D r Karacostas a présenté quelques thèmes courants relatifs au<br />
développement des services en santé mentale pour les<br />
personnes sourdes <strong>et</strong> malentendantes en Europe. Il a expliqué<br />
aussi le développement des sociétés pour la santé mentale <strong>et</strong> la<br />
surdité en Europe. C<strong>et</strong>te présentation a été offerte en français.<br />
Il y a eu interprétation simultanée vers l’anglais.<br />
Dr. Alexis Karacostas is a psychiatrist and psychotherapist in<br />
Paris. He practices half-time at l’hôpital la Salpêtrière in the<br />
Unité d’Information <strong>et</strong> de Soins des Sourds and half-time in<br />
private practice. He is president of G.E.S.T.E.S. and of the<br />
European Soci<strong>et</strong>y for Mental Health and Deafness. He is director<br />
of Surdités, an international French language publication on<br />
mental health and deafness.<br />
Dr. Karacostas presented current developments in mental<br />
health services for persons who are deaf and hard of hearing in<br />
Europe. He also discussed the development of mental health<br />
and deafness soci<strong>et</strong>ies in Europe. This presentation was offered<br />
in French with English interpr<strong>et</strong>ation.<br />
Table des matières
Pirjo Leino, Family Therapist in<br />
Private Practice/Thérapeute<br />
familiale en pratique privée<br />
A Family Therapy Program in Finland/Un<br />
programme de thérapie familiale en<br />
Finlande<br />
Ms. Leino has spent over 25 years working as a therapist with<br />
deaf and deaf-blind persons. For the last 8 years, Ms. Leino has<br />
been the only therapist working with the Ripa Project which<br />
offers family therapy. She provides intense family therapy in<br />
sign language throughout Finland, both face-to-face and to<br />
remote communities using video conferencing.<br />
Ms. Leino described the RIPA Project, its development and its<br />
application in Finland. This presentation was in Finnish Sign<br />
Language with interpr<strong>et</strong>ation.<br />
M me Leino a œuvré pendant plus de 25 ans à titre de thérapiste<br />
pour personnes sourdes <strong>et</strong> sourdes-aveugles. Depuis 8 ans,<br />
Mme Leino est l’unique thérapiste au sein du proj<strong>et</strong> RIPA qui<br />
offre des services de thérapie pour les familles.<br />
Elle offre des services de counselling intense en Langue des<br />
signes finlandaise à des familles à travers la Finlande, soit en<br />
personne, soit par l’entremise de communications à distance<br />
utilisant les techniques de vidéo-conférences.<br />
M me Leino a donné une description du proj<strong>et</strong> RIPA, de son<br />
développement <strong>et</strong> de son application en Finlande. C<strong>et</strong>te<br />
présentation a été offerte en Langue des signes finlandaise avec<br />
interprétation.<br />
Roch Longueépée -<br />
Systems of Control - The Global Legacy of Institutional<br />
Child Abuse<br />
Mr. Longueépée is Founder and President of the Internations’<br />
Justice Federation based in Halifax, Nova Scotia. He has<br />
launched a civil action suit against the Governments of Nova<br />
Scotia and Prince Edward Island for institutional child abuse.<br />
Mr. Longueépée shared his experiences and challenges in trying<br />
to incite governments to accept responsibility for the abuse that<br />
occurred and to offer compensation to the victims. This<br />
presentation was in English.<br />
Susan Chernoff -<br />
The Evolution of the Well-Being Program<br />
Ms. Chernoff has been a registered therapist with the Well Being<br />
Program for the past three years. She graduated with a Masters<br />
in Social Work from Gallaud<strong>et</strong> University in 1998. She works for<br />
the Mental Health Services for Deaf, Hard of Hearing and Deafblind<br />
in British Columbia.
Since its inception in 1991, the Well Being Program has<br />
successfully provided a wide range of mental health services to<br />
deaf, deaf-blind and hard of hearing individuals in the province<br />
of British Columbia. This presentation reviewed the growth of<br />
the program and its services, identifying the main challenges<br />
and critical aspects and developments over the last 13 years<br />
and articulated a vision for the future. This presentation was be<br />
in ASL.<br />
Daniel Bolduc, Lyne Bris<strong>et</strong>te, Gilles Lefebvre -<br />
Surdicécité <strong>et</strong> santé mentale : mieux comprendre pour<br />
mieux intervenir<br />
M. Bolduc est psychologue <strong>et</strong> travaille depuis 13 ans au<br />
Programme Surdicécité de l’Institut Raymond-Dewar.<br />
M me Bris<strong>et</strong>te est travailleuse sociale depuis 1984 <strong>et</strong> travaille au<br />
Programme Surdicécité de l’Institut Raymond-Dewar depuis<br />
2002.<br />
M. Lefebvre possède une formation en pédagogie, a enseigné à<br />
des enfants sourds de 1967 à 1977 <strong>et</strong> agit depuis comme<br />
conseiller en surdicécité à l’Institut Raymond-Dewar.<br />
La perte de l’audition <strong>et</strong> de la vision engendrent de nombreuses<br />
conséquences en limitant l’accès à l’information <strong>et</strong> le contrôle<br />
exercé sur son environnement. Leurs expérience clinique ainsi<br />
que leurs réflexions suggèrent certaines pistes d’intervention<br />
que ils souhait explorer d’avantage. C<strong>et</strong>te présentation a été<br />
offerte en français.<br />
René Rivard -<br />
The Impact of Hearing Loss on Verbal Communication<br />
Mr. Rivard has been involved in mental health services for many<br />
years.<br />
He has also been involved in the deaf community and the<br />
Canadian Hard of Hearing Association. His research on<br />
communication b<strong>et</strong>ween hearing and deaf individuals in<br />
counselling situations was presented at the First World<br />
Conference on Mental Health and Deafness at Gallaud<strong>et</strong><br />
University in 1998 and was published in Surdités by G.E.S.T.E.S<br />
in France. René has been building a reference data base on<br />
mental health and deafness.<br />
Hearing loss has a significant impact on communication which<br />
can result in dramatic changes in personal relationships. These<br />
can be devastating to one’s self-esteem and result in isolation<br />
and depression. A b<strong>et</strong>ter understanding of the changes in the<br />
communication process can significantly improve the situation<br />
both for the person with a hearing loss and their friends and<br />
colleagues. It can help avoid many of the effects on a person’s<br />
mental and physical health. This presentation was in English.
Carole Willans-Théberge, Thibault Cadro -<br />
Accès à la justice pour canadiens malentendants ou<br />
sourds<br />
M e Willans-Théberge est avocate malentendante, depuis<br />
longtemps défendeur des droits des personnes malentendantes<br />
<strong>et</strong> devenues sourdes. Elle est présidente de l’Association des<br />
malentendants canadiens <strong>et</strong> membre du conseil d’administration<br />
de <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>. Elle est membre fondateur du Comité<br />
national des employés handicapés de la Fonction publique<br />
fédérale. Alors qu’elle était conseillère juridique dans la section<br />
de la politique en matière de droit pénal du ministère de la<br />
Justice du <strong>Canada</strong>, elle a accepté la responsabilité du Comité<br />
consultatif des personnes handicapées pour le Sous-ministre.<br />
Aujourd’hui, elle est conseillère juridique pour l’initiative Liaison<br />
<strong>et</strong> partenariats au même ministère.<br />
M. Cadro a complété sa dernière année en droit à l’Université<br />
d’Ottawa. D’origine franco-polonaise, les quatorze années<br />
passées au <strong>Canada</strong> lui ont permis d’avoir une vision différente;<br />
tirer le meilleur de chaque mentalité. Après un baccalauréat en<br />
Sciences Économiques <strong>et</strong> Sociales, le choix de faire du droit<br />
n’était qu’une continuité, apprendre le fondement de nos<br />
sociétés, les règles qui les régissent, pour mieux comprendre <strong>et</strong><br />
défendre ce qui nous est cher.<br />
C<strong>et</strong>te présentation a examiné le système judiciaire canadien <strong>et</strong><br />
les moyens qu’il prend pour répondre aux besoins des<br />
personnes malentendantes, devenues sourdes <strong>et</strong> sourdes. Une<br />
attention particulière a été offerte aux aspects qui traitent des<br />
problèmes de santé mentale. Il est impératif d’assurer la pleine<br />
participation des personnes ayant une déficience auditive afin<br />
d’assurer équité <strong>et</strong> transparence de ce processus judiciaire. La<br />
communication inclusive est essentielle afin d’assurer la<br />
protection des droits de ces individus. C<strong>et</strong>te présentation a été<br />
offerte en français.<br />
Joël Omondi Owino -<br />
Deafness and Mental Health in Deaf VCT<br />
Mr. Owindo has worked with the Deaf community as a Deaf<br />
AIDS Consultant for over four years. He is currently consulting<br />
with the Kenya National Deaf HIV/AIDS Education Program<br />
(KNDAEP). He was one of the key resource persons in the<br />
development, establishment and current management of the<br />
Nairobi Deaf VCT Project.<br />
The Nairobi Deaf VCT is the first health facility in Africa, run<br />
exclusively by the deaf themselves as a project of the Nairobi<br />
Association of the Deaf, a branch of the KNDAEP funded by the<br />
Centre for Disease Control (CDC) and supervised by the<br />
Liverpool VCT and Care Kenya, using sign language, in a soci<strong>et</strong>y<br />
where persons who are deaf are referred to as mentally<br />
unhealthy. This presentation was in English.<br />
Dr. Anne Toth -
Bridge of Signs<br />
Dr. Toth has over 25 years of experience in providing<br />
consultation, assessment and counselling to persons affected by<br />
trauma, abuse, bereavement, adoption, interpersonal and work<br />
related issues. She holds a Masters degree in social work and Ph.<br />
D. in education. Dr. Toth has published papers relative to<br />
bridging communication b<strong>et</strong>ween the Deaf and Hearing.<br />
This presentation described a project of the Canadian<br />
Association of the Deaf which will attempted to d<strong>et</strong>ermine<br />
wh<strong>et</strong>her the use of sign language can help hearing children<br />
triumph over communication disabilities. This presentation was<br />
in English.<br />
Brad Saunders, Brenda Dean -<br />
A Deaf Children’s Mental Health Program - At Last - PAH!<br />
Brad Saunders is the Executive Director of the Bob Rumball<br />
Association for the Deaf.<br />
Brenda Dean is a social worker and team leader for the PAH!<br />
Program.<br />
She worked as a social worker for 12 years with the E.C. Drury<br />
School for the Deaf before coming to PAH!<br />
PAH! is a unique government funded (Ministry of Community<br />
and Social Services) Program, which provides specialized<br />
mental health services to Deaf and Hard of Hearing children,<br />
youth and their families. The focus of the PAH! Program is to<br />
provide mental health treatment and supports, from trained<br />
professionals, who can communicate with these children and<br />
understand their situation. This presentation was in English.<br />
Louise Roberge -<br />
La communication affective entre l’enfant sourd, sa<br />
famille, le psychothérapeute <strong>et</strong> l’équipe de réadaptation<br />
M me Roberge est psychologue à l’Institut Raymond Dewar,<br />
Programme Enfants depuis 1982. Elle est psychothérapeute<br />
pour enfants, psychothérapeute conjugale <strong>et</strong> familiale, <strong>et</strong><br />
superviseur en formation.<br />
La surdité ayant des impacts individuels <strong>et</strong> interactionnels, c<strong>et</strong><br />
atelier a présenté des concepts intra-psychiques <strong>et</strong><br />
interactionnels, <strong>et</strong> des illustrations cliniques, reliés à la<br />
communication affective. Un aspect essentiel de la relation<br />
psycho-thérapeutique consiste à décoder les messages non<br />
verbaux émis par les enfants sourds <strong>et</strong> leurs familles. C<strong>et</strong>te<br />
présentation a été offerte en français.<br />
Vicki Robinson -<br />
The Power of Parents
Ms. Robinson is the mother of a 24 year old severely deaf son<br />
who has a diploma in broadcasting. She has been a Director of<br />
VOICE for hearing impaired children since 1993, was on the<br />
Education Committee for a number of years and Chairman of<br />
the Board from 1994 to 1997. She is a firm believer in the<br />
benefits of auditory verbal therapy for most hearing impaired<br />
children.<br />
VOICE has a central mission to “ensure that all hearing impaired<br />
children have the right to listen and speak and have access to<br />
services which will enable them to listen and speak”. This<br />
presentation explored strategies and tactics which were<br />
successfully used in affecting these accomplishments.<br />
Templates for applying these strategies were shared. This<br />
presentation was in English.<br />
Louise Ménard -<br />
Expérience d’intervention auprès des enfants <strong>et</strong><br />
adolescents ayant un problème de santé mentale<br />
Louise Ménard détient un B.A. en travail social <strong>et</strong> un B.A. en<br />
psychologie.<br />
Elle est travailleuse sociale à l’école provinciale du Centre Jules-<br />
Léger pour enfants, adolescents <strong>et</strong> jeunes adultes sourds <strong>et</strong><br />
sourds-aveugles où elle<br />
intervient auprès des élèves de niveau élémentaire <strong>et</strong><br />
secondaire.<br />
C<strong>et</strong>te présentation vise à partager avec les participants<br />
l’expérience vécue auprès des enfants <strong>et</strong> adolescents sourds<br />
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mme Ménard<br />
a discuté de l’intervention auprès du personnel scolaire, de<br />
l’appui accordé aux élèves <strong>et</strong> à leurs familles; elle a fait ressortir<br />
quels sont les obstacles à la réussite d’un plan d’intervention<br />
ainsi que les lacunes des services existants dans la<br />
communauté <strong>et</strong> elle a suggéré les solutions possibles.<br />
Ulla Kungas -<br />
Deaf-Blind Services and Programs in<br />
Finland/Les services <strong>et</strong> programmes pour<br />
sourds-aveugles en Finlande<br />
Ms. Kungas is deaf-blind as a result of Usher’s<br />
Syndrome. She has been president of the<br />
Finnish Deaf-blind Association since 2002. She<br />
is an ADL teacher of the deaf-blind at the Vocational School for<br />
the Deaf. She is also a member of the 2005 Hellen Keller<br />
Conference Planning Committee.<br />
Ms. Kungas’ presentation focused on services for deaf-blind<br />
individuals and Programs to fund such services. This<br />
presentation was in Finnish Sign Language with interpr<strong>et</strong>ation in<br />
English.
M me Kungas est devenue sourde-aveugle des suites du<br />
syndrome de Usher. Elle est présidente de l’Association<br />
finlandaise des sourds-aveugles depuis 2002. Elle enseigne<br />
l’ADL des sourds-aveugles à l’école professionnelle des sourds.<br />
Elle est également membre du comité de planification de la<br />
conférence Hellen Keller en 2005.<br />
La présentation de Mme Kungas a porté sur les services<br />
destinés aux sourds-aveugles <strong>et</strong> aux programmes qui financent<br />
ces services. C<strong>et</strong>te présentation était en langue des signes<br />
finlandais avec interprétation en anglais <strong>et</strong> français.<br />
Dr. Cathy Chovas McKinnon -<br />
Psychotic Disorders and Deafness<br />
Dr. Chovas McKinnon holds a Ph.D. in Clinical Psychology from<br />
the University of Western Ontario where she is currently an<br />
instructor in Mental Health and Deafness. She is a psychologist<br />
at the Robarts School for the Deaf in London, Ontario.<br />
The early d<strong>et</strong>ection of the first ons<strong>et</strong> of psychosis has become<br />
the benchmark for successful treatment in hearing people. This<br />
early d<strong>et</strong>ection is more difficult with deaf patients due to<br />
linguistic differences, cultural difference and the response of<br />
mainstream mental health care professionals. This presentation<br />
was in English.<br />
Robert Alexander -<br />
Hearing Loss as a Public Health Issue: Challenges and<br />
Strategies<br />
Mr. Alexander is a Community Health Officer with the Public<br />
Health Division of the City of Toronto. He is also President of the<br />
Ontario Chapter of the Canadian Hard of Hearing Association.<br />
In his presentation, Mr. Alexander focused on the community,<br />
or public, health aspect of hearing loss by discussing a health<br />
promotion approach. This has two main dimensions: community<br />
development and healthy public policy. This presentation was in<br />
English.<br />
Roger Saint-Louis -<br />
Réconcilier les divers groupes <strong>et</strong> leurs besoins particuliers<br />
M. St.-Louis est président de l’Association ontarienne des sourds<br />
(es) francophones.<br />
Dans une société où les fonds disponibles pour les personnes<br />
ayant un handicap sont très limités, il y a souvent des conflits<br />
entre les groupes qui sollicitent de ces fonds afin de subvenir<br />
aux besoins de leur communauté. Ceci est d’autant plus<br />
important pour les Sourds <strong>et</strong> malentendants, surtout quand il y<br />
a des problèmes de santé mentale. Pourquoi? Parce que les<br />
personnes ayant ces handicaps invisibles sont les derniers à<br />
bénéficier des Programmes d’équité. C<strong>et</strong>te présentation était en
Langue des signes du Québec.<br />
Dr. David Schramm, Shelly Armstrong,<br />
Josée Chénier -<br />
Adult Recipients of the Cochlear Implant<br />
Dr. Schramm graduated in medicine from the University of<br />
Toronto in 1983 and compl<strong>et</strong>ed his ENT residency in Ottawa in<br />
1988. Dr. Schramm did his fellowship in otology and neuroontology<br />
in Illinois. He has been involved in the Cochlear<br />
Implant Program at the Children’s Hospital of Eastern Ontario<br />
and at the Ottawa Hospital - Civic Campus since 1993.<br />
Shelly Armstrong graduated in audiology from Western<br />
University in London, Ontario. She joined the Adult Cochlear<br />
Implant Team in 1995 and has been involved in several clinical<br />
trials. Ms. Armstrong is responsible for the Bone Anchored<br />
Hearing Aids at the Ottawa Hospital.<br />
Josée Chénier graduated in audiology from the Université de<br />
Montréal in 1993. She worked with both adults and children in<br />
New Brunswick from 1993 to 2001. She joined the Adult<br />
Cochlear Implant Team at the Ottawa Hospital in 2002. She has<br />
been involved in several clinical trials.<br />
The increasing popularity and availability of cochlear implants,<br />
and the developments in technology have led to new candidacy<br />
and management issues. Adults with severe to profound hearing<br />
losses can now have access to high technology that could have<br />
an impact on their quality of life. Various aspects of the cochlear<br />
implantation process were discussed, including a description of<br />
the cochlear implant devices, selection criteria, surgery,<br />
rehabilitation and outcomes. This presentation was in English.<br />
Stéphanie Symank Boileau -<br />
L’équipe d’approche mobile de consultation pour les<br />
diagnostics doubles face aux handicaps auditifs<br />
Stéphanie Symank Boileau a fait des études en linguistique ainsi<br />
qu’en psychologie avant d’entamer son baccalauréat en<br />
ergothérapie. Elle est diplômée du Programme d’ergothérapie<br />
de l’Université d’Ottawa en mai 1999. Par la suite, elle a<br />
travaillé comme ergothérapeute pour les services intégrés.<br />
C<strong>et</strong>te présentation a été offerte en français.<br />
C<strong>et</strong>te présentation a eu pour but premier de décrire les services<br />
de l’Equipe d’approche mobile de consultation pour les<br />
diagnostics doubles (ÉAMCDD) de l’Hôpital Royal Ottawa. Suite<br />
à la description des services de l’ ÉAMCDD, Mme Symank<br />
Boileau a partagé les défis liés à la prestation de soins à la<br />
clientèle ayant un diagnostic double. Pour illustrer ces deux<br />
aspects, elle a présenté une histoire de cas qui était<br />
accompagné d’un extrait de vidéo. Ensuite, elle nous fait part de<br />
l’impact de la surdité dans la vie des personnes ayant un<br />
diagnostic double. Pour terminer, M me Symank Boileau a<br />
partagé certaines considérations <strong>et</strong> stratégies d’intervention<br />
propre à sa profession en ergothérapie.
Thomas Bull -<br />
Deaf Family Issues: Codas and Identity<br />
Mr. Bull is a hearing adult, son of deaf parents whose first<br />
language is ASL. He is certified by the Registry of Interpr<strong>et</strong>ers<br />
and holds an M.A. in education from Gallaud<strong>et</strong> University. He is<br />
the author of On the Edge of Deaf Culture: Hearing Children/<br />
Deaf Parents.<br />
A person’s cultural identity is clearly an important<br />
developmental milestone. Codas (hearing children of deaf<br />
parents) often feel conflicted, marginalized or alone growing up<br />
hearing in the Deaf World, raised in a bilingual and bicultural<br />
family with deaf parents. What does that conflict look like and<br />
how can it be resolved? This multimedia presentation explored<br />
the power of the “shared story” and group identity toward a<br />
triumphant resolution of the often asked question “Am I hearing<br />
or am I deaf?” This presentation was in English.<br />
David Lucas -<br />
Educational Abuse in Residential Schools for the Deaf<br />
Mr. Lucas is a deaf victim of educational abuse at the hands of<br />
the Ontario Ministry of Education. He has courageously and<br />
persistently challenged the government in order that it should<br />
acknowledge its responsibility for the abuse. He is requesting<br />
compensation in the form of a public fund to be used to develop<br />
literacy and training Programs for the adult victims. Mr. Lucas is<br />
the Executive Director of the Ontario Deaf Education Victims’<br />
N<strong>et</strong>work.<br />
Deaf individuals did not receive an adequate education in a<br />
system that imposed oralism, aural/visual and speech reading<br />
while it denied the value of sign language as a true language<br />
and as a fundamental element of deaf culture. Mr. Lucas<br />
discussed the challenges and barriers he has encountered in<br />
trying to defend the cause of the victims of educational abuse.<br />
This presentation was in ASL.<br />
Aurèle Bertrand, Johanne Venne-Brisebois -<br />
L’intégration scolaire des élèves ayant une surdité <strong>et</strong> la<br />
question de santé mentale<br />
M. Bertrand est enseignant à l’école provinciale du Centre Jules-<br />
Léger pour enfants, adolescents <strong>et</strong> jeunes adultes sourds <strong>et</strong><br />
sourds-aveugles.<br />
M me Venne-Brisebois est enseignante à l’école provinciale du<br />
Centre Jules-Léger pour enfants, adolescents <strong>et</strong> jeunes adultes<br />
sourds <strong>et</strong> sourds-aveugles.<br />
Deux enseignants, l’une sourde <strong>et</strong> l’autre entendant, ont<br />
partagé leurs connaissances relatives à la santé mentale des<br />
élèves sourds <strong>et</strong> malentendants intégrés en milieu scolaire
franco-ontarien. Les problèmes de santé mentale chez l’enfant<br />
sourd <strong>et</strong> malentendant à domicile <strong>et</strong> en milieu scolaire a été<br />
décrit. La présentatrice <strong>et</strong> le présentateur ont offert leurs<br />
témoignages personnels - l’une à partir de son expérience de<br />
vie avec une surdité, <strong>et</strong> l’autre, à partir de son travail auprès<br />
des élèves sourds <strong>et</strong> malentendants. Une analyse du contexte<br />
socio-politique a servi de conclusion à la présentation. C<strong>et</strong>te<br />
présentation a été offerte en LSQ <strong>et</strong> en français.<br />
Andréa Benvenuto -<br />
Qu’est-ce qu’un sourd ?<br />
M me Benvenuto est professeur en philosophie. Née en Uruguay,<br />
elle a enseigné la philosophie aux élèves sourds d’un lycée<br />
bilingue à Montevideo. Elle vit <strong>et</strong> travaille actuellement à Paris<br />
où elle prépare une thèse de doctorat de philosophie sur le<br />
thème « Qu’est-ce qu’un sourd? » (Université Paris 8<br />
Vincennes- Saint Denis).<br />
Tout au long de l’histoire, le sourd a été perçu tantôt l’élu des<br />
dieux ou au contraire, comme un être abominable <strong>et</strong>, à ce titre,<br />
à éliminer, tantôt comme déficient ou handicapé. Exclus de la<br />
communauté humaine, est-ce que les sourds ont accès au<br />
langage <strong>et</strong> à la pensée? Malgré le fait que l’Abbé de l’Épée ait<br />
reconnu la langue des signes <strong>et</strong> de son usage en éducation, un<br />
point décisif dans le développement de la communauté sourde,<br />
le désir social de compenser (médical) <strong>et</strong> d’intégrer (éducatif),<br />
ont d’autant plus nié leur existence, leur culture <strong>et</strong> leur<br />
présence linguistique. C<strong>et</strong>te présentation a été offerte en<br />
français.<br />
Dr. Anne Toth -<br />
Reducing the Risk of Psychosocial Problems for Children<br />
who are Deaf and their Parents<br />
Dr. Toth has over 25 years of experience in providing<br />
consultation, assessment and counselling to persons affected by<br />
trauma, abuse, bereavement, and adoption, interpersonal and<br />
work related issues. She holds a Masters degree in social work<br />
and Ph.D. in education. Dr. Toth has published papers relative<br />
to bridging communication b<strong>et</strong>ween the Deaf and Hearing.<br />
This applied research project was designed to address the<br />
psychological problems experienced by deaf students and their<br />
parents as evidenced by behaviours of low self-esteem in the<br />
students and high stress levels in the parents. The research<br />
concluded that, to the extent change was evidenced in the<br />
reduction of reports of child abuse, expressed feelings of<br />
depression or anger, and self-harm in the children studied,<br />
when tested for levels of self-esteem and stress, both children<br />
and parents showed improvement.<br />
This presentation was in English.<br />
Christiane Grimard, Col<strong>et</strong>te Dubuisson -
Surdité <strong>et</strong> résilience<br />
Christiane Grimard est psychologue. Elle travaille depuis 1994<br />
au Programme 12-21 ans de l’Institut Raymond-Dewar, centre<br />
de réadaptation, spécialisé en surdité <strong>et</strong> en communication.<br />
Col<strong>et</strong>te Dubuisson est linguiste. Elle a mis sur pied, à partir de<br />
1988, le Groupe de recherche sur la langue des signes<br />
québécoise (LSQ) <strong>et</strong> le bilinguisme sourd, à l’Université du<br />
Québec à Montréal. R<strong>et</strong>raitée depuis trois ans, elle poursuit ses<br />
recherches en tant que professeur associé.<br />
La surdité a nécessairement des impacts sur les plans de la<br />
communication <strong>et</strong> du développement d’une personne <strong>et</strong> de son<br />
entourage. L’objectif de c<strong>et</strong>te présentation a été de proposer<br />
une analyse de récits de vie de personnes sourdes privées sur le<br />
plan de la communication. Elles ont montré que, malgré les<br />
privations en matière de communications, les suj<strong>et</strong>s ont réussi à<br />
développer des capacités pour faire face à des expériences<br />
traumatiques. De plus, elles ont tenté de faire ressortir les<br />
principaux facteurs de résilience en lien avec la surdité. C<strong>et</strong>te<br />
présentation a été offerte en français.<br />
Claire Raisin,<br />
Richard Townshend -<br />
The Tall Poppy Syndrome/Le syndrome<br />
du « pavot trop grand »<br />
Claire Raisin is from Aotearoa, the land of the<br />
long white cloud (New Zealand). She is<br />
currently working for the Deaf Association as a<br />
social worker and has worked in the mental<br />
health area for the last 7 years. Through this,<br />
Ms. Raisin studied and gained a degree in<br />
Human Services. She is also involved with the<br />
Deaf Youth Club and activities within the Deaf<br />
community.<br />
Richard Townshend is from New Zealand. He is<br />
a Deaf counselor working part time for the last year and a half.<br />
He has always been interested in becoming a counselor because<br />
of the poor quality of life Deaf people lead. He is involved with<br />
the mainstream elderly group through the church.<br />
This presentation was an insight into New Zealand’s Deaf<br />
Community and how Tall Poppy Syndrome (TPS) has an impact<br />
on people’s lifestyle. Tall Poppy Syndrome is a term that is used<br />
to describe people who have the potential to be successful but<br />
can be put down by a small community. This is also known as<br />
‘professional jealousy’. Within the deaf community there are<br />
people who lack confidence and have low self-esteem and this<br />
can lead to mental health problems. This dilemma is affecting<br />
people across the border and sabotaging ambitions and dreams<br />
through lack of role modeling in the Deaf community. The<br />
presentation was in New Zealand Sign Language.<br />
Claire Raisin est de Aotearoa, terre du long nuage blanc<br />
(Nouvelle-Zélande). Elle travaille présentement pour
l'Association des sourds comme travailleuse sociale <strong>et</strong> elle<br />
travaille depuis 7 ans dans le domaine de la santé mentale.<br />
Pendant ce temps, M me Raisin a étudié en services sociaux <strong>et</strong><br />
obtenu un diplôme en services humanitaires. Elle s'occupe<br />
également du club des jeunes sourds <strong>et</strong> d'activités au sein de la<br />
collectivé sourde.<br />
Richard Townshend vient de la Nouvelle-Zélande. Il est<br />
conseiller sourd <strong>et</strong> travaille à temps partiel depuis plus d’un an.<br />
Il a toujours désiré devenir conseiller à cause de la piètre<br />
qualité de vie que vivent les sourds. Il participe au groupe<br />
paroissial mixte d'aînés.<br />
C<strong>et</strong>te présentation a donné un aperçu de la collectivité sourde<br />
de la Nouvelle-Zélande <strong>et</strong> de la façon dont le syndrome du « tall<br />
poppy » influence le style de vie des gens. Le syndrome du<br />
« pavot trop grand » est un terme néo-zélandais utilisé pour<br />
décrire des gens qui ont le potentiel nécessaire pour réussir<br />
mais qui peuvent être étouffés par une p<strong>et</strong>ite collectivité. On le<br />
connaît aussi sous l'appellation de « jalousie professionnelle ».<br />
Au sein de la collectivité sourde il y a des gens qui manquent de<br />
confiance <strong>et</strong> qui ont peu d'estime d'eux-mêmes, ce qui peut<br />
mener à des problèmes de santé mentale. Ce dilemme affecte<br />
les gens sans distinction <strong>et</strong> sabote les ambitions <strong>et</strong> les rêves à<br />
cause du manque de modèles à suivre dans la collectivité<br />
sourde. La présentation a été en langue des signes de la<br />
Nouvelle-Zélande.<br />
Isabelle Lemay -<br />
Qualité de vie <strong>et</strong> surdité : validation de l’inventaire<br />
systémique de qualité de vie en Langue des signes<br />
québécoise<br />
Mme Lemay est psychologue au Centre métropolitain de<br />
réadaptation spécialisé en surdité <strong>et</strong> en communication. Elle<br />
rédige actuellement sa thèse de doctorat.<br />
Peu d’études ont évalué la qualité de vie des sourds.<br />
L’Inventaire Systémique de Qualité de Vie a été validé pour les<br />
entendants. Le but de c<strong>et</strong>te étude a été de le traduire en<br />
Langue des signes québécoise afin d’évaluer la qualité de vie<br />
des sourds québécois. C<strong>et</strong>te présentation a été offerte en<br />
français.<br />
Lynn Cochrane, Paul Boileau -<br />
Developing Deaf Services in a Hearing/Mainstream<br />
Agency<br />
Lynn Cochrane is an experienced psychiatric nurse with over 25<br />
years in the mental health field. Her most recent work has been<br />
in developing deaf services as part of case management<br />
program in a community mental health agency. She is currently<br />
a task force member of the Provincial Mental Health and<br />
Addictions Expansion Program.<br />
Paul Boileau is a seasoned mental health worker with over 13<br />
years of experience. His strong interest in advocacy issues
stems from his current work as a case manager to deaf,<br />
deafened and hard of hearing individuals. He uses three<br />
languages in his current work (English, French, and ASL) and<br />
will be learning LSQ in the coming year.<br />
The workshop took a practical approach and demonstrated the<br />
3-year pilot project that Salus was involved in to develop<br />
specialized services targ<strong>et</strong>ed to deaf, deafened and hard of<br />
hearing individuals. The purpose of the workshop was to share<br />
clinical experiences in providing a number of support services:<br />
supportive housing, rehabilitation services including case<br />
management and concurrent disorder counselling (addictions<br />
and mental health) to deaf individuals. This presentation was in<br />
English.<br />
Otto Fritschy -<br />
Deaf and Blind in a Home for Special Care<br />
Mr. Fritschy is a geriatrician with the Mental Health Services of<br />
“De Ri<strong>et</strong>horst”, a home for seniors who are deaf, hard of<br />
hearing or deaf-blind.<br />
Deaf-blindness is mostly a problem of older people, although<br />
there is a small group of younger individuals who are deaf-blind.<br />
Older people are more likely to become institutionalized. A<br />
possible reason for this may be that it provides a safer<br />
environment where they can socialize more easily. These<br />
expectations are not necessarily realized. The challenge for<br />
professionals and helpers is to find out how one can help deafblind<br />
people me<strong>et</strong> their needs. This presentation was in English.<br />
Kristin Snoddon -<br />
ASL and Early Literacy Services: Introducing the ASL<br />
Mother Goose Program<br />
Kristin Snoddon (BA, MA) is the training coordinator for the<br />
Ontario Cultural Soci<strong>et</strong>y of the Deaf (OCSD)’s American Sign<br />
Language (ASL) and Early Literacy Services.<br />
Shannon Pollock is an instructor at York University. She holds a<br />
BA in ASL from Gallaud<strong>et</strong> University and has extensive<br />
experience as an ASL and Literacy Consultant.<br />
Since May 2001, the Ontario Cultural Soci<strong>et</strong>y of the Deaf<br />
(OCSD) has made great strides in establishing ASL and Early<br />
Literacy Services for young deaf children and their families<br />
across the province of Ontario. Their presentation explained the<br />
origins of this Program and outlined the OCSD’s affiliations with<br />
the Ontario Ministry of Health and Long Term Care’s Infant<br />
Hearing Program and Ontario Early Years Centres. This<br />
presentation was in American Sign Language.<br />
René Rivard -<br />
L’impact de la perte auditive sur la communication<br />
verbale
M. Rivard œuvre depuis plusieurs années dans le domaine de la<br />
santé mentale à titre de conseiller en réadaptation. Il est aussi<br />
très actif dans la communauté des sourds <strong>et</strong> malentendants. Il<br />
a présenté ses recherches sur la communication entre<br />
thérapeute entendant <strong>et</strong> client sourd à la première conférence<br />
mondiale sur la santé mentale <strong>et</strong> la surdité à l’Université<br />
Gallaud<strong>et</strong> en 1998. La recherche a été publiée dans la revue<br />
Surdités l’année suivante. M. Rivard est membre fondateur du<br />
Conseil de l’Est ontarien sur la santé mentale <strong>et</strong> la surdité.<br />
La perte d’ouïe a sur la communication un impact important qui<br />
produit d’immenses changements dans les relations<br />
personnelles, autant au travail qu’à domicile <strong>et</strong> dans les<br />
relations amicales. Il en découle une perte d’estime de soi <strong>et</strong><br />
donc l’isolation <strong>et</strong> la dépression. Une compréhension des<br />
changements dans le processus de communication peut aider à<br />
améliorer la situation autant pour la personne malentendante<br />
que pour sa famille, ses amis <strong>et</strong> ses collègues de travail. De<br />
plus, c<strong>et</strong>te compréhension peut diminuer considérablement les<br />
eff<strong>et</strong>s de la perte d’ouïe sur la santé physique <strong>et</strong> mentale de<br />
l’individu. C<strong>et</strong>te présentation a été offerte en français.<br />
Deena M. Martin -<br />
What Does Research REALLY say about Psychiatric<br />
Illness and Deafness?<br />
Ms. Martin is a Fellow with the David Peikoff Chair of Deafness<br />
Studies. She has also compl<strong>et</strong>ed courses in nursing, medicine<br />
and dentistry. She believes that understanding hearing loss<br />
from a vari<strong>et</strong>y of perspectives contributes to supporting and<br />
advocating for individuals with a hearing loss.<br />
This presentation summarized findings from a m<strong>et</strong>hodological<br />
analysis of research addressing deafness and psychiatric illness.<br />
Specifically, the presentation addressed the m<strong>et</strong>hodological<br />
complications currently restricting the contribution of research<br />
findings on deafness and psychiatric illness. This presentation<br />
was in English.<br />
Marjorie Cameron -<br />
Providing Mental Health Services to Marginalized Groups<br />
within the Deaf Community<br />
Marjorie Cameron has worked as a support worker for the Well<br />
Being Program for the last 10 years. She has a diploma in<br />
Community Social Services from Douglas College. She is a<br />
volunteer for numerous organizations in the deaf community.<br />
She is a recipient of the Hughes Award for Access to Justice as a<br />
result of her work in developing and producing an ASL video on<br />
British Columbia’s legal system.<br />
The Well Being Program serves a very diverse population within<br />
the larger deaf, deaf-blind and hard of hearing communities.<br />
This presentation focused specifically on providing mental health<br />
services to two unique and marginalized groups within the<br />
larger communities: individuals with cognitive challenges (deaf-
plus) and new immigrants and refugees. This presentation was<br />
in ASL.<br />
Myrtle Barr<strong>et</strong>t -<br />
The Other Way Around: Can a Deaf Social Worker Work<br />
with Hearing Clients?<br />
Ms. Barr<strong>et</strong>t became hard of hearing at an early age and her loss<br />
was progressive. She has been deaf for the past 20 years. She<br />
is a social worker employed by Health and Community Services,<br />
St. John’s Newfoundland. She has worked in the helping<br />
profession for 25 years and has worked with hearing, hard of<br />
hearing and deaf clients. Presently, she works in a hearing<br />
environment and relies on lip-reading and interpr<strong>et</strong>ers as a<br />
means of communication. She provides counselling and a<br />
vari<strong>et</strong>y of other services to clients with developmental delays.<br />
Ms. Barr<strong>et</strong>t presented her experience and challenges as a deaf<br />
social worker offering services to hearing clients. This<br />
presentation was in English.<br />
Josephine Fitzgerald -<br />
Am<strong>et</strong>hyst Women’s Addiction Centre - A Program for Deaf<br />
Women<br />
Ms. Fitzgerald is a counsellor working with women dealing with<br />
substance abuse at Am<strong>et</strong>hyst Women’s Addiction Centre. She<br />
graduated from Carl<strong>et</strong>on University with her MSW in 1999. She<br />
has five children, two of whom have a severe to profound<br />
hearing loss. She is involved with VOICE for hearing impaired<br />
children in Ottawa and was president for several years. She now<br />
represents Voice at the Special Education Advisory Committee<br />
for the Ottawa-Carl<strong>et</strong>on District School Board.<br />
Ms. Fitzgerald described the history, the work and challenges of<br />
the Am<strong>et</strong>hyst Women’s Addiction Centre. She discussed the<br />
philosophy of the Centre and described the programs offered.<br />
Am<strong>et</strong>hyst has recently conducted a pilot project which included<br />
deaf women in their 10-day residential program. Ms. Fitzgerald<br />
reviewed this project and discussed the process. This<br />
presentation was be in English.<br />
Carole Willans-Théberge, Michael Sousa, LL.B.<br />
-<br />
Access to Justice for Hard of Hearing and Deaf Canadians<br />
Ms. Willans-Théberge is a hard of hearing lawyer and long-time<br />
advocate for persons who are hard of hearing or deafened. She<br />
is the President of the Canadian Hard of Hearing Association<br />
and also sits on the Board of <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>. She is one of the<br />
founding members of the National Committee of Federal Public<br />
Servants with Disabilities. While still Counsel in the Criminal<br />
Law Policy Section of Justice <strong>Canada</strong>, she took responsibility for<br />
the Deputy Minister’s Advisory Committee for Persons with<br />
Disabilities. She is now Advisory Counsel with Outreach and<br />
Partnerships of Justice <strong>Canada</strong>.
Mr. Michael Sousa was educated at Queen’s University in<br />
Kingston (B.A. Honours) and the University of Windsor (LL.B.).<br />
He is currently practicing law as legal counsel at the federal<br />
Department of Justice <strong>Canada</strong> in the legal services unit for the<br />
<strong>Canada</strong> Border Services Agency under the federal minister of<br />
Public Saf<strong>et</strong>y and Emergency Preparedness. Mr. Sousa chairs<br />
the Department of Justice’s Advisory Committee for Persons<br />
with Disabilities and the <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong> Education Committee.<br />
He sits on the Board of Directors of <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>.<br />
This presentation examined the Canadian system of justice and<br />
the means taken to respond to the needs of hard of hearing,<br />
deafened and deaf persons. Special attention was paid to<br />
aspects dealing with mental health issues. It is essential that we<br />
ensure the full participation of persons with a hearing disability<br />
in order to make the judiciary process equitable and<br />
transparent. Inclusive communication is essential if we wish to<br />
protect the rights of these individuals. This presentation was in<br />
English.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Les systèmes de contrôle –<br />
L'héritage mondial de la<br />
maltraitance institutionnelle des<br />
enfants<br />
Par : Roch Longueépée, fondateur & président,<br />
Internations’ Justice Federation<br />
Conférence publique sur la maltraitance des<br />
enfants dans les institutions<br />
Ottawa Marriott, Ottawa, Ontario, <strong>Canada</strong><br />
Le vendredi 10 septembre 2004<br />
Distingués invités, membres de <strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>, mesdames <strong>et</strong><br />
messieurs. Je veux remercier tous <strong>et</strong> chacun d'entre vous d'être<br />
ici aujourd'hui. Je m'appelle Roch Longueépée <strong>et</strong> je suis le<br />
fondateur <strong>et</strong> président de Internations' Justice Federation. C<strong>et</strong><br />
organisme, présentement en voie de développement, intercède<br />
en faveur d'un changement dans les standards de restitution<br />
concernant la maltraitance des enfants en institutions. La<br />
fédération intercède également pour le changement dans les<br />
standards de protection des enfants touchant la génération<br />
actuelle <strong>et</strong> les générations futures d'enfants.<br />
Ma passion pour ce travail est profondément enracinée dans ma<br />
propre expérience personnelle. Si je suis un avocat du<br />
changement, je n'en suis pas moins un survivant.<br />
Je ne suis pas seul. Je suis un parmi les nombreux survivants<br />
du monde entier. Nous sommes les victimes de l'exploitation <strong>et</strong><br />
de la maltraitance des enfants. Nous sommes les anciens<br />
enfants des rues. Nous sommes les anciens enfants de la<br />
guerre. Nous sommes les enfants <strong>et</strong> les victimes de la<br />
maltraitance institutionnelle. Notre enfance nous a été enlevée<br />
par ceux à qui on avait confié la mission de nous protéger <strong>et</strong> de<br />
prendre soin de nous. Dans le sillage de c<strong>et</strong>te maltraitance sont<br />
apparus la pauvr<strong>et</strong>é, l'itinérante, la corruption, les mutilations,<br />
l'éradication culturelle, le génocide <strong>et</strong> la mort. Ces institutions<br />
ont bâti leur avenir sur nos malheurs.<br />
Même si la santé mentale <strong>et</strong> la surdité constituent<br />
nécessairement <strong>et</strong> à proprement parler le suj<strong>et</strong> principal ici,<br />
c<strong>et</strong>te semaine, je veux souligner d'entrée de jeu que je crois<br />
que nous avons des enjeux bien plus critiques à affronter pour<br />
le moment. En tant que défenseur de la maltraitance<br />
institutionnelle des enfants, je travaille avec un ensemble<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
étendu de groupes <strong>et</strong> de cultures. Parmi ces dernières, il y a la<br />
culture des Sourds. La question de la maltraitance<br />
institutionnelle des enfants touche, à tous égards, les groupes<br />
<strong>et</strong> les individus marginalisés. Je veux d'abord vous dire<br />
aujourd'hui que je ne suis pas sourd. Je ne suis pas expert dans<br />
les questions de culture sourde. Je suis ici, tout comme vous,<br />
dans une certaine mesure pour me renseigner davantage sur<br />
les questions de surdité. Je ne prétend pas savoir ce que c'est<br />
que d'être sourd. Mais j'espère bien que je vais aider chacun<br />
d'entre vous à comprendre comment la cause que je représente<br />
affecte la collectivité dont vous faites partie <strong>et</strong> dans laquelle<br />
vous travaillez.<br />
C'est dans ce contexte que j'espère m'adresser à vous<br />
aujourd'hui. Je vous parle non pas comme une victime de la<br />
maltraitance institutionnelle des enfants. Je vous parle comme<br />
un survivant qui essaie de dépasser ce vécu.<br />
Il sied parfaitement au contexte d'aujourd'hui que je commence<br />
par l'histoire d'un des cas les plus notoires m<strong>et</strong>tant en cause la<br />
collectivité sourde. C'était en 1991, lorsque le scandale de la<br />
maltraitance des enfants à l'école Jericho Hill pour les Sourds <strong>et</strong><br />
les aveugles, en Colombie-Britannique, fit les manch<strong>et</strong>tes à<br />
travers le <strong>Canada</strong>. L'école Jericho Hill, un pensionnat, devenait<br />
ainsi le premier cas de maltraitance institutionnelle d'enfants<br />
m<strong>et</strong>tant en cause des enfants sourds, <strong>et</strong> l'un des cas les plus<br />
infamants du <strong>Canada</strong>.<br />
Pendant les quelques premières années de fonctionnement, la<br />
rumeur voulait que l'école Jericho Hill était l'un des meilleurs<br />
pensionnats au monde pour les enfants sourds.<br />
L'école Jericho Hill avait pour mission de dispenser la meilleure<br />
éducation aux enfants sourds <strong>et</strong> aveugles partout. Pendant les<br />
décennies où elle a fonctionné elle a vu passer en ses murs des<br />
enfants de toute l'Amérique du Nord. Ce qui est triste, c'est que<br />
ceux qui ont construit la structure physique n'ont pas vu<br />
l'isolement qu'auraient à affronter les enfants de Jericho,<br />
l'isolement de la surdité. Pour beaucoup d'enfants sourds qui<br />
quittaient leurs familles <strong>et</strong> leur entourage familier, leur nouveau<br />
lieu de résidence ne ferait qu'ajouter à c<strong>et</strong> isolement.<br />
Derrière les murs de Jericho repose le sombre secr<strong>et</strong> de<br />
l'histoire de maltraitance physique <strong>et</strong> d'abus sexuel. L'abus<br />
sexuel des jeunes enfants resta ignoré des ministères<br />
gouvernementaux jusqu'à ce que les victimes deviennent à leur<br />
tour abuseurs <strong>et</strong> que la maltraitance infecte les étudiants de<br />
Jericho pendant des décennies. Les victimes poursuivaient le<br />
cycle en abusant d'autres enfants, jusqu'à ce que l'abus<br />
devienne un rite de passage, une situation normale. L'inaction<br />
des gouvernements responsables de l'école verraient à nouveau<br />
de nouvelles horreurs remonter à la surface dans de nouvelles<br />
réalités. À l'extérieur des murs de Jericho, les étudiants<br />
continueraient à comm<strong>et</strong>tre des crimes comme adultes. Les<br />
cycles de maltraitance finiraient par pénétrer les foyers<br />
familiaux des victimes <strong>et</strong> les collectivités. Un ancien résident tua<br />
à coups de poignards un autre ancien résident alors qu'ils<br />
vivaient dans une résidence de groupe ; le motif de<br />
l'altercation : le sexe. Et les vagues de douleur s'ensuivraient<br />
pour les nouveaux étudiants de Jericho, leurs familles <strong>et</strong> leurs
collectivités. À l'époque où les cycles de maltraitance avaient<br />
atteint les collectivités dans leur ensemble, des accusations de<br />
viol contre d'anciens étudiants de Jericho Hill ramèneraient les<br />
enquêtes policières à l'école. Les enquêteurs de la police<br />
relèveront des incidents d'abus, à Jericho, aussi loin dans le<br />
passé que 1945.<br />
Fintan O'Toole, reporter irlandais au Irish Times l'a exprimé le<br />
mieux lorsqu'il écrivit :<br />
"L'État, pour dire les chose de façon crue, a fonctionné<br />
remarquablement bien pour prendre des enfants vulnérables,<br />
négligés <strong>et</strong> victimes d'abus <strong>et</strong> en faire des toxicomanes, des<br />
prostitués <strong>et</strong> des criminels."<br />
La société a malheureusement tendance à marquer les victimes<br />
qui sont devenues abuseurs de l'étiqu<strong>et</strong>te 'méchants'. Je ne<br />
crois pas au mal. S'il y a du mal ici, c'est dans les omissions <strong>et</strong><br />
les commissions des gouvernements <strong>et</strong> des organismes<br />
responsables de ces horreurs. Dans une cause récente qui a fait<br />
date, dans laquelle se trouvait impliqué le scandale d'abus<br />
sexuel perpétré par des membres du clergé de l'Église<br />
catholique romaine, le juge John Kerr de la Cour suprême de<br />
l'Ontario a résumé c<strong>et</strong>te question dans les meilleurs termes.<br />
Dans ce cas particulier, le diocèse avait essayé d'intenter une<br />
contre poursuite à une victime qui avait abusé de ses jeunes<br />
frères. Le diocèse prétendait que la victime devenue abuseur<br />
était en partie responsable de la souffrance de ses frères<br />
lorsqu'il en a abusé sexuellement, mais le juge Kerr a dit qu'il<br />
ne trouvait aucun mérite à c<strong>et</strong> argument. Il a dit : "reprocher à<br />
John ses agressions serait semblable à reprocher au monstre de<br />
Frankenstein ses actions, plutôt que d'attribuer son<br />
comportement au savant qui l'avait créé."<br />
La collectivité sourde n'est pas le seul groupe identifié dans ces<br />
scandales en matière d'abus. Les questions de maltraitance<br />
institutionnelle des enfants affectent également d'autres<br />
groupes, dans notre pays <strong>et</strong> ailleurs dans le monde. En<br />
pourtant, lorsque nous pensons en ces termes, nous pensons<br />
souvent à des écoles comme Jericho Hill pour les Sourds <strong>et</strong> les<br />
aveugles. Mais le sens de la maltraitance institutionnelle des<br />
enfant de renvoie pas simplement aux 'pensionnats'.<br />
La maltraitance infligée aux enfants n'est en elle-même rien de<br />
nouveau dans la société. En fait, la recherche montre des cas de<br />
maltraitance des enfants à des époques aussi reculées que<br />
2 000 avant notre ère.<br />
L'abus peut être vu comme n'importe quoi d'excessif <strong>et</strong>/ou de<br />
ce qui cause du mal comme résultat de c<strong>et</strong> excès. Même des<br />
poètes bien connus ont parlé la valeur sociétale honteuse placée<br />
sur les enfants. William Blake a jadis écrit un morceau intitulé<br />
"Jérusalem"<br />
"Et la divine Tolérance<br />
A-t-elle brillé sur nos monts ennuagés ?<br />
Et Jérusalem fut-elle bâtie ici<br />
Parmi ces noirs moulins sataniques ?"
Ce à quoi Blake fait référence ici, c'est le travail des enfants<br />
dans les moulins à pâtes <strong>et</strong> papiers industrialisés de son temps.<br />
Les dictionnaires définissent le mot 'institution' comme "Ce qui<br />
institue ou instruit ; un manuel ; un système d'éléments ou de<br />
règles ; un institut. Société ou corporation établie ou<br />
organisée ; établissement, particulièrement à caractère public,<br />
ou affectant une collectivité ; une fondation ; comme, une<br />
institution littéraire ; une institution de bienfaisance ;<br />
également, bâtiment ou bâtiments occupés ou utilisés par une<br />
telle organisation." Alors, lorsque nous faisons référence à une<br />
institution, nous devrions également penser à tout corps<br />
gouvernemental, religieux, séculier ou de bienfaisance qui est<br />
chargé du soin des enfants. La signification du terme a été mal<br />
interprétée pendant des années. Le terme prend un sens plus<br />
littéral à mesure que la société commence à s'en prendre aux<br />
impacts de la maltraitance institutionnelle des enfants.<br />
En mars 2000, la Commission du droit du <strong>Canada</strong> a produit un<br />
rapport au Parlement intitulé "La dignité r<strong>et</strong>rouvée - La<br />
réparation des sévices infligés aux enfants dans des<br />
établissements canadiens". Le rapport présente des<br />
recommandations visant à redresser la situation de la<br />
maltraitance des enfants dans les institutions canadiennes.<br />
Malgré ses qualités, le rapport n'est pas compl<strong>et</strong>. On a fait peu<br />
de recherche sur la maltraitance institutionnelle des enfants, en<br />
partie à cause du manque d'une définition précise.<br />
D'un contexte de définition approprié vient une histoire qui<br />
s'étend sur quatre siècles. Les débuts de c<strong>et</strong>te histoire ont<br />
marqué un moment de l'Empire britannique, époque où les<br />
groupes marginalisés, comme les enfants, étaient définis<br />
comme les "ordres sociaux inférieurs". Vers la fin des années<br />
1600, les oeuvres de bienfaisance chrétiennes, les<br />
gouvernements <strong>et</strong> les groupes recherchaient un moyen de<br />
"débarrasser l'empire" des 'indésirables'. Parmi les plans<br />
introduits se trouvaient des proj<strong>et</strong>s de migration impliquant les<br />
pays sous dominion des lois de l'Empire britannique. Allan Gill,<br />
auteur de "Les orphelins de l'Empire", écrit :<br />
"La migration des enfants fut articulée comme offrant aux<br />
enfants déshérités un 'nouveau départ' dans un pays tout neuf.<br />
C'était également une façon pour la Grande-Br<strong>et</strong>agne de<br />
solutionner ses problèmes sociaux. C'était un moyen de 'semer<br />
l'empire', <strong>et</strong> il était poursuivi avec un zèle de missionnaire. Les<br />
enfant n'étaient pas mis en adoption ni, dans le sens habituel<br />
du mot, placés en foyers nourriciers. Quoique commanditées<br />
par le gouvernement, les agences d'envoi <strong>et</strong> de réception était<br />
pour la plupart des oeuvres de bienfaisance Chrétiens qui<br />
partageaient c<strong>et</strong> objectif <strong>et</strong> qui voyaient en leur travail une<br />
mission intrinsèquement noble. "Les pays récepteurs<br />
partageaient l'enthousiasme de la Grande-Br<strong>et</strong>agne. Le désir<br />
des Dominions – en particulier l'Australie, le <strong>Canada</strong> <strong>et</strong> la<br />
Rhodésie (maintenant le Zimbabwe) d'accroître leurs<br />
populations blanches, préférablement anglo-saxonnes,<br />
coïncidait avec le désir de la mère patrie de se débarrasser de<br />
son excédent d'enfants nés des couches sociales de bas étage."<br />
D'évidence, le <strong>Canada</strong> est à prédominance anglo-saxonne. Les<br />
valeurs qui ont découlé de c<strong>et</strong>te période font intrinsèquement<br />
partie de la société canadienne. L'eff<strong>et</strong> de vagues de ces valeurs
eprésente nos systèmes politiques en poste de gouvernement.<br />
La plupart des gens sont si désespérément dépendants de ce<br />
système qu'ils vont se battre pour le protéger.<br />
À mesure que la civilisation occidentale évoluait, les systèmes<br />
de valeur de c<strong>et</strong>te époque j<strong>et</strong>aient les bases des abus contre les<br />
droits de la personne dans le monde. Les siècles qui ont suivi<br />
verraient ces systèmes de valeurs infliger des abus aux groupes<br />
minoritaires, aux enfants <strong>et</strong> aux groupes marginalisés.<br />
Comme le dit le rapport au Parlement de la Commission du droit<br />
du <strong>Canada</strong> intitulé" La dignité r<strong>et</strong>rouvée - La réparation des<br />
sévices infligés aux enfants dans des établissements<br />
canadiens", au <strong>Canada</strong>, pendant la décennie qui a précédé mars<br />
2000, plus de 5 210 victimes ont déposé des plantes de sévices<br />
physiques <strong>et</strong> sexuels, d'éradication culturelle, de stérilisation <strong>et</strong><br />
de génocide impliquant plus de 72 institutions résidentielles.<br />
Beaucoup d'enfants sont morts suite à des négligence graves <strong>et</strong><br />
à des sévices physiques qu'ils ont reçus des mains de leurs<br />
intervenants.<br />
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le monde a vu certains<br />
des crimes les plus horribles contre l'humanité commis par<br />
Adolph Hitler <strong>et</strong> les membres de son parti nazi allemand. Parmi<br />
ces pratiques inhumaines, les membres du parti nazi ont<br />
poursuivi des expériences eugéniques <strong>et</strong> humaines. Il est<br />
particulièrement intéressant de noter que le <strong>Canada</strong> n'a pas<br />
critiqué le parti nazi pour ces crimes.<br />
Les écoles industrielles d'Europe ; les orphelinats où les enfants<br />
étaient envoyés à pleins bateaux en Australie, au <strong>Canada</strong>, en<br />
Afrique, en Irlande <strong>et</strong> dans bien d'autres pays.<br />
Dans le monde entier il y a des cim<strong>et</strong>ières collectifs d'enfants<br />
enterrés dans des tombes sans marques, leurs identités<br />
inconnues. En Irlande, les écoles industrielles sont accaparées<br />
par des scandales d'abus physique <strong>et</strong> sexuel <strong>et</strong> de morts<br />
mystérieuses d'enfants. Sur les terrains de la Artane Industrial<br />
School se trouve un cim<strong>et</strong>ière collectif d'enfants enterrés les uns<br />
par-dessus les autres dans des tombes non-marquées.<br />
On estime qu'environ 120 enfants sont morts dans ces<br />
institutions entre les années 1930 <strong>et</strong> 1970.<br />
Les enfants deviendraient aussi des pions pour les<br />
gouvernements, les organismes <strong>et</strong> la police collaboreraient avec<br />
des groupes, comme célèbre parti Nazi de l'Allemagne, qui les<br />
utiliserait comme suj<strong>et</strong>s d'étude pour la recherche scientifique.<br />
Comme exemple canadien, nous avons celui des orphelins de<br />
Duplessis. Le cas des Orphelins de Duplessis est largement<br />
reconnue comme le cas le plus étendu d'abus institutionnel des<br />
jeunes de l'histoire du <strong>Canada</strong>. (http://members.tripod.com/<br />
~rootsunknown/intro1.htm ) Il y a environ 6 000 survivants qui,<br />
enfants, furent mis dans des orphelinats <strong>et</strong> des institutions<br />
psychiatriques.<br />
"Le premier ministre de la province en ce temps-là était Maurice<br />
Duplessis ; c'est de là que vient le nom Les survivants<br />
prétendent que, pendant qu'ils étaient dans des institutions
dirigées par des congrégations religieuses catholiques, ils ont<br />
souffert de mauvais traitements <strong>et</strong> d'abus sexuel. On croit que<br />
la plupart des "orphelins" étaient de fait des enfants nés hors du<br />
mariage. Comme cela se passait dans les années 1930, 40 <strong>et</strong><br />
50, ils étaient laissés aux soins de congrégations religieuses qui<br />
tenaient les orphelinats. Dans certains cas, ces établissement<br />
étaient transformés en institutions de soins de santé <strong>et</strong> dans<br />
d'autres, les enfants étaient envoyés des orphelinats à des<br />
hôpitaux déjà existants. Dans ces hôpitaux, également tenus<br />
par les congrégations religieuses, les Orphelins de Duplessis<br />
prétendent que les médecins ont faussement étiqu<strong>et</strong>é beaucoup<br />
d'enfants comme déficients mentaux. La raison de tout cela est<br />
que le Québec pouvait obtenir plus de fonds du fédéral pour les<br />
institutions de soins que pour les écoles <strong>et</strong> les orphelinats. Plus<br />
d'argent pour le Québec voulait dire plus d'argent pour les<br />
congrégations religieuses." Une fois étiqu<strong>et</strong>és comme déficients<br />
mentaux, les enfants étaient soumis à des traitements comme<br />
la camisole de force, la thérapie à l'électrochoc, la médication<br />
excessive, la détention en cellule <strong>et</strong> même les lobotomies. Leurs<br />
histoires d'abus physique <strong>et</strong> sexuel sont terrifiantes. ( http://<br />
members.tripod.com/~rootsunknown/intro1.htm )<br />
Les victimes disent aussi avoir été témoins du meurtre d'autres<br />
résidents. Dans certains cas les enfants qui en étaient victimes<br />
sont morts d'avoir été gravement négligés. Pour les témoins<br />
enfants, ils vivent jusqu'à nos jours avec l'horreur de ces<br />
dernières images. Nombre de ces enfants n'ont jamais été<br />
r<strong>et</strong>rouvés.<br />
Pour ces orphelins qui survécurent, lorsqu'il n'était plus possible<br />
de faire d'autres gains financiers en les gardant, ils sont libérés<br />
de leur épouvantable existence derrière les murs de ces<br />
institutions. Sans éducation <strong>et</strong> avec de faux dossiers médicaux,<br />
ils n'étaient pas préparés à leur vie d'adultes. Les moindres<br />
traces de leurs familles leur avaient été volées. (http://<br />
members.tripod.com/~rootsunknown/intro1.htm )<br />
Si des cas comme celui des orphelins de Duplessis étaient<br />
contenus à une seule province, d'autres groupes d'offenseurs<br />
étaient mondialisés. Le mouvement des Frères des écoles<br />
chrétiennes, sous la gouverne de l'Église catholique, tenaient<br />
des orphelinats dans le monde entier. C<strong>et</strong>te communauté est<br />
l'un des pires groupes de délinquants impliqués dans les<br />
questions d'abus institutionnels de l'histoire. Leur histoire<br />
criminelle s'est étendue sur plus de quatre siècles <strong>et</strong> a affligé<br />
des victimes par milliers. La communauté a maintenant été<br />
dissoute.<br />
Dans le sillage de cas comme ceux-là, il y a eu des découvertes<br />
de sites de charniers d'enfants, dont l'identité est inconnue. Au<br />
<strong>Canada</strong> <strong>et</strong> dans le monde entier, beaucoup de cas restent non<br />
imputés <strong>et</strong> les responsables ne sont pas poursuivis pour leurs<br />
crimes.<br />
Au <strong>Canada</strong>, d'autres formes de violations des droits de la<br />
personne ont été perpétrées contre les enfants <strong>et</strong> les<br />
marginalisés, comme les opérations d'eugénisme qui se sont<br />
déroulées aussi récemment que dans les années 1970 <strong>et</strong> 1980.<br />
L'eugénisme est défini comme "l'étude de l'amélioration
héréditaire de la race humaine au moyen d'une reproduction<br />
sélective contrôlée". Parmi les candidats qualifiés qui furent<br />
identifiés se trouvaient les Sourds. L'histoire de la culture<br />
sourde elle-même est une lutte longue <strong>et</strong> ardue étendue sur<br />
plusieurs générations.<br />
Dans à peu près quatre semaines un étudiant en droit <strong>et</strong> moi<br />
allons tenir une conférence de presse pour annoncer la sortie<br />
d'un rapport sur l'eugénisme en Nouvelle-Écosse. Jusqu'à ce<br />
jour, le public a tout ignoré de ce scandale. Le rapport est<br />
cinglant <strong>et</strong> solidement appuyé sur une preuve bien fondée. Le<br />
seul fait qu'une telle pratique ou valeur existe aussi tard qu'à la<br />
fin des années 1980 devrait nous dire quelque chose, à nous<br />
tous qui sommes ici. Cela nous dit que les problèmes du passé<br />
ne sont pas finis. Les gouvernements <strong>et</strong> la société font souvent<br />
des commentaires comme "c'était il y a longtemps, ces choses<br />
ne se produisent plus", ou comment l'abus institutionnel contre<br />
les enfants a-t-il rapport au présent ? Beaucoup d'entre vous<br />
qui êtes ici aujourd'hui connaissent, j'en suis sûr, l'apartheid de<br />
l'Afrique du Sud. Vous êtes tous bien au courant du stratagème<br />
des réserves indiennes du <strong>Canada</strong>. Ce que vous ne savez peutêtre<br />
pas, c'est que l'apartheid de l'Afrique du Sud fut inspiré du<br />
modèle des réserves indiennes du <strong>Canada</strong>.<br />
On cite aussi souvent la société en disant que la violence<br />
poussée à c<strong>et</strong> extrême ou à c<strong>et</strong>te échelle n'existe pas. En<br />
termes actuels <strong>et</strong> futurs, la violence ne finit pas ; elle ne fait<br />
que prendre de nouvelles formes. C'est la violence de l'inaction,<br />
de l'indifférence <strong>et</strong> de la détérioration lente.<br />
Lorsque vous enseignez à d'autres à haïr <strong>et</strong> à craindre autrui,<br />
lorsque vous enseignez qu'un individu ou un groupe est<br />
inférieur à cause de sa race, de ses croyances ou des politiques<br />
qu'ils poursuivent, lorsque vous enseignez que ceux qui ne sont<br />
pas d'accord avec vous menacent votre liberté <strong>et</strong> votre survie<br />
ou votre famille, alors vous leur apprenez aussi à voir les autres<br />
non pas comme des citoyens égaux, mais comme des ennemis<br />
qui ne méritent que d'être rendus conformes <strong>et</strong> maîtrisés. C'est<br />
la réalité de la connexion canadienne à l'apartheid de l'Afrique<br />
du Sud.<br />
Ce qu'on vient de dire ici est également vrai des mesures<br />
réparatoires ou de la réponse donnée aux victimes de la<br />
violence institutionnelle faite aux enfants par le gouvernement.<br />
Lorsque ceux d'entre nous autour du monde avons clamé ce<br />
que nous avions perdu, nos adversaires ont répondu en<br />
réduisant notre douleur <strong>et</strong> notre souffrance à des tendances<br />
statistiques <strong>et</strong> des chiffres.<br />
Ils ont érigé des monuments optimistes pour dissimuler la vraie<br />
mesure de leurs crimes contre les enfants vulnérables, négligés<br />
<strong>et</strong> abusés. Ils ont refusé à leurs victimes une inhumation digne.<br />
Ils ont rédigé des apologies qui ne pouvaient servir à diminuer<br />
leur responsabilité.<br />
Il nous ont stigmatisés avec des étiqu<strong>et</strong>tes. Ces étiqu<strong>et</strong>tes sont<br />
une façade pour protéger les institutions sans honneur. Pendant<br />
des décennies, le gouvernement <strong>et</strong> les institutions religieuses <strong>et</strong><br />
séculières du monde entier ont possédé la capacité – mais pas
la volonté – de traiter des omissions <strong>et</strong> des commissions qu'ils<br />
ont perpétrées contre les groupes marginalisés de la société.<br />
Les eff<strong>et</strong>s de l'abus sont fortement réfléchis dans nos<br />
programmes correctionnels <strong>et</strong> de nos taux de criminalité. De ce<br />
point de vue, c'est une question d'économie <strong>et</strong> de maux de<br />
société.<br />
La Commission du droit du <strong>Canada</strong> cite dans son rapport que le<br />
processus de remédiation ou de guérison doit être à la fois<br />
qualitatif <strong>et</strong> quantitatif. Beaucoup de victimes qui intentent des<br />
poursuites au civil ou au criminel se plaignent souvent que<br />
l'expérience a souvent été comme celle d'une répétition<br />
intégrale de l'abus <strong>et</strong> de l'exploitation.<br />
Il y a de nombreuses raisons qui peuvent aider à expliquer<br />
pourquoi c'est ce qu'ils ont ressenti. Dans plusieurs des cas<br />
d'abus institutionnel, les institutions en cause ont fréquemment<br />
mené des "enquêtes internes". Les résultats de ces enquêtes,<br />
dans presque tous les cas ont abouti à l'acquittement des<br />
accusés de tous méfaits. Dans les cas où les gouvernement sont<br />
accusés, une enquête criminelle est lancée par les organismes<br />
policiers, ordinairement après des pressions considérables de la<br />
part des victimes. Le résultat est habituellement le même, c'està-dire<br />
qu'aucun des auteurs n'est accusé ou poursuivi.<br />
Dans le premier cas de l'institution délinquante enquêtant sur<br />
elle-même, la chose va sans dire. Si n'importe qui d'entre nous<br />
faisait enquête sur lui-même, je suis plutôt sûr que nous serions<br />
tous disculpés nous aussi. Dans le cas de la police menant des<br />
enquêtes criminelles, nous devons nous rappeler qui est leur<br />
employeur ; le présumé auteur des crimes, c'est-à-dire le<br />
gouvernement. En plus, dans bien des cas, la police <strong>et</strong> autres<br />
professionnels n'avaient pas la formation ou l'expérience qu'il<br />
fallait pour faire enquête sur les questions d'abus institutionnel<br />
des enfants. Le cas de l'école Jericho Hill a été un exemple<br />
parfait de cela. Les enquêteurs de police ne comprenaient pas la<br />
culture de la langue des Sourds. Les enquêteurs ne<br />
comprenaient pas non plus l'impact de l'abus, qui avait infecté<br />
tous les enfant de l'école Jericho Hill. Les enquêteurs de police,<br />
dans un grand nombre d'entrevues se trouvaient devant des<br />
étudiants comme victimes une journée <strong>et</strong> devant les mêmes<br />
étudiants comme délinquants le lendemain. Toujours, les<br />
enquêteurs approchaient le cas d'un point de vue accusatoire.<br />
C'est ce qu'ils appellent la démocratie.<br />
Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait d'études sur les résultats de<br />
ces programmes de rémédiation, qu'il s'agisse de règlements au<br />
niveau du droit civil ou de programmes du mode alternatif de<br />
résolution des conflits du gouvernement. Il n'y a aussi aucun<br />
registre exact du nombre de victimes dans ce pays. C'est en<br />
partie dû au fait que nous en sommes à peine aux étapes<br />
préliminaires du processus. En tant qu'intercesseur <strong>et</strong> survivant<br />
dans la question de la violence institutionnelle faite aux enfants,<br />
je peux vous offrir quelques aperçus de ma propre expérience.<br />
Les avocats avec qui je m'entr<strong>et</strong>iens à travers le <strong>Canada</strong>, qui<br />
ont représenté des victimes, disent que jusqu'à maintenant, le<br />
processus de rémédiation est un fiasco. Les victimes que je<br />
rencontre sont d'accord. Je le suis aussi. Les programmes<br />
d'indemnisation ne touchent pas adéquatement les problèmes<br />
qui affligent les survivants. Au bout du compte, les
gouvernements dépensent des montants d'argent<br />
considérablement plus élevés à se défendre, alors dans que<br />
99,99 % de ces cas il a été trouvé coupable.<br />
Il est difficile d'attendre de la justice, lorsque la partie<br />
contrevenante fait toutes les règles, qu'elle contrôle toute la<br />
preuve <strong>et</strong> dispose de beaucoup plus de ressources. Ce dont il<br />
est aussi question ici, c'est que nous appliquons la "common<br />
law" à un problème qui ne s'apparente pas de façon juste à ces<br />
lois. Les actions en recours collectif, au <strong>Canada</strong>, n'ont<br />
commencé qu'en 1978. Alors, le manque d'expérience dans ce<br />
domaine ralentit, là encore, le processus juridique.<br />
Dans le cas de l'école Jericho Hill, nous perdons deux percent de<br />
la population par année alors que nous intentons des poursuites<br />
en justice pour les victimes. Le cas de Jericho Hill est en activité<br />
depuis plus de quinze ans. C'est là, une fois encore, une<br />
tactique du gouvernement, de r<strong>et</strong>arder les choses jusqu'à ce<br />
que les victimes laissent tomber, meurent ou optent pour un<br />
règlement qui comprom<strong>et</strong> leur processus de rémédiation.<br />
Les gouvernements qui ne règlent pas ces cas avec une<br />
rémédiation adéquate nous font injustice à tous. Qu'en arriverat-il<br />
de bon si, après quelques années, ces plaignants se<br />
r<strong>et</strong>rouvent dans le système par le biais de la sécurité sociale, de<br />
la santé mentale, ou de la justice criminelle ? Si les<br />
gouvernements doivent dépenser de l'argent des impôts sur ces<br />
cas, ils doivent en être redevables auprès du Canadien moyen.<br />
Ce n'est que bon sens économique logique.<br />
Trop souvent dans ces cas, les gouvernements refusent de<br />
s'attaquer au problème <strong>et</strong> ils fabriquent des lois de prescription,<br />
qui empêchent les victimes de faire valoir un jour leur droit<br />
devant un tribunal, ils refusent de faire cas du rapport<br />
obligatoire, ils ne créent pas de registre national pour ceux qui,<br />
dans les professions d'aide, s'occupent de groupes vulnérables,<br />
ils inventent des politiques publiques sans épine dorsale <strong>et</strong><br />
privent les bons organismes de ressources <strong>et</strong> d'argent.<br />
Ils prônent les dissimulations <strong>et</strong> des procédures internes<br />
propres à décourager des réclamations futures pour<br />
maltraitance. C<strong>et</strong>te affirmation vise les avocats qui terrorisent<br />
les victimes d'abus qui se déclarent <strong>et</strong> les personnages propres<br />
à rien de la bureaucratie <strong>et</strong> du secteur de la santé, qui n'ont pas<br />
fait leur boulot.<br />
En toute bonne conscience, les gouvernements doivent<br />
reconnaître que les lois <strong>et</strong> les valeurs des systèmes de<br />
gouvernement actuels ont contribué aux détriments des<br />
groupes vulnérables des enfants négligés <strong>et</strong> des groupes<br />
marginalisés. La chose appropriée <strong>et</strong> juste que devrait faire les<br />
gouvernements, c'est de commencer à rédiger, avec les<br />
victimes, une législation qui traitera de l'abus institutionnel tant<br />
pour le principe de la prévention que de la rémédiation des torts<br />
causés dans le passé.<br />
Le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dans son<br />
allocution d'ouverture de l'Assemblée générale, s'est adressé<br />
aux enfants du monde en disant :
" Nous, les adultes, vous avons déplorablement fait défaut," ditil,<br />
en faisant remarquer que 33 pour cent des jeunes souffrent<br />
de malnutrition avant l'âge de cinq ans, que 25 pour cent ne<br />
sont pas immunisés, que près de 20 pour cent ne fréquentent<br />
pas l'école, <strong>et</strong> que beaucoup trop d'entre eux" ont été témoins<br />
d'une violence qu'aucun enfant ne devrait jamais voir.''<br />
Les gouvernements <strong>et</strong> la société doivent pareillement<br />
reconnaître que les systèmes actuels de la politique <strong>et</strong> de la<br />
justice n'ont servi qu'à perpétuer les problèmes du passé. Trop<br />
souvent les professions d'aide de ces groupes <strong>et</strong> les experts<br />
chargés du soin des groupes <strong>et</strong> des individus vulnérables<br />
étiqu<strong>et</strong>tent ou cherchent des mesures punitives pour traiter les<br />
comportements que leurs systèmes ont créés.<br />
Lorsque vous dégradez un être humain aux premiers stages de<br />
son développement, pour les renvoyer ensuite dans la société<br />
privés des moyens de s'y intégrer, comment pouvez-vous leur<br />
j<strong>et</strong>er le blâme ?<br />
Les victimes que je rencontre dans ce pays <strong>et</strong> partout dans le<br />
monde vivent toutes dans une pauvr<strong>et</strong>é abjecte. Nombre<br />
d'entre elles ont des troubles de santé mentale. Beaucoup<br />
d'entre elles qui sont encore fonctionnelles souffrent encore<br />
d'un long parcours de relation en relation parce que leur<br />
comportement aliène souvent les gens. Un grand nombre n'ont<br />
pas de bases de soutien familiales. Beaucoup sons itinérants.<br />
En 1969, le Dr Ironside, professeur à la Psychological Medicine<br />
de la Monash university d'Australie, a déclaré lors d'un<br />
séminaire sur la maltraitance des enfants :<br />
"Les historiens sociaux de l'avenir reverront c<strong>et</strong>te époque<br />
comme une de celles où, dans les sociétés affluentes au moins,<br />
les enfants étaient paradoxalement privés de leur droit de<br />
naissance malgré l'amélioration croissante des connaissance des<br />
besoins relatifs au développement d'une saine croissance<br />
émotive, mentale <strong>et</strong> de la personnalité. L'historien social de<br />
l'avenir notera également que les législation portant sur<br />
l'amélioration des services destinés aux jeunes enfants dans le<br />
besoin non seulement a raté c<strong>et</strong> objectif louable, mais,<br />
paradoxalement, il a contribué à une dépossession plus poussée<br />
pour les enfants vulnérables."<br />
Tandis que nous cherchons à instaurer des mesures de<br />
restitution justes, comment évaluerons-nous le prix de l'enfance<br />
d'une personne ? La réalité est que nous ne le pouvons pas.<br />
Toutefois, si nous sommes pour aller dans le sens de<br />
redressement des torts, nous ne pouvons commencer qu'en<br />
engendrant une conscience sociale.<br />
Il y a une rédemption, qu'on peut encore trouver. Si les<br />
gouvernements devaient adm<strong>et</strong>tre leurs méfaits <strong>et</strong> en rendre<br />
compte dans la maltraitance institutionnelle des enfants, alors<br />
nous pourrions regarder du côté d'autres pays où il y a la<br />
guerre, des ralentissements économiques, de la famine <strong>et</strong> le<br />
sida. Sans aucun doute, ces pays m<strong>et</strong>tront en place des<br />
institutions pour prendre soin des endants négligés, orphelins <strong>et</strong>
vulnérables. Le <strong>Canada</strong> pourrait se tourner vers ces pays <strong>et</strong> dire<br />
"voici les erreurs que nous avons commises, puissiez-vous en<br />
tirer des leçons".<br />
Le message que je vous apporte aujourd’hui est celui-ci. Nous<br />
ne traitons pas seulement des problèmes du passé, mais aussi<br />
de ceux du présent <strong>et</strong> du futur. Ces problèmes n'affectent pas<br />
seulement les victimes, ils nous affectent tous. Maintenant, plus<br />
que jamais ces victimes ont besoin de toute l'aide que nous<br />
pouvons leur donner. Et c'est la responsabilité de tous en<br />
chacun d'entre nous qui traitons avec elles, <strong>et</strong> d'autres qui sont<br />
dans des circonstances analogues, de faire tout ce qui est en<br />
notre pouvoir pour soutenir leur croissance personnelle.<br />
On leur a fait grand tort. Nous avons tous souffert de grandes<br />
pertes. Et, dans notre chagrin <strong>et</strong> notre colère, nous avons<br />
trouvé notre cause <strong>et</strong> notre désir pour les générations futures.<br />
Cela ne doit jamais plus se produire. Nous sommes en guerre.<br />
Comme dans toute autre guerre, il y a des vrais morts. Et à<br />
toutes les époques on dit que le changement ne rencontre que<br />
de la résistance.<br />
Il y a deux types de personnes dans ce monde – ceux qui font<br />
l'histoire <strong>et</strong> ceux qui la lisent. Je vous dis ceci avec toute<br />
certitude – ces victimes ont déjà commencé à faire l'histoire.<br />
Dans le monde entier, ces survivants sont rapidement en train<br />
de devenir les auteurs du changement en c<strong>et</strong>te matière. Ils<br />
n'ont pas droit à moins que notre profond respect <strong>et</strong> notre<br />
gratitude. Je vous demanderais maintenant de vous lever <strong>et</strong> de<br />
vous joindre à moi en reconnaissance de leurs contributions.<br />
D'abord <strong>et</strong> avant tout, cherchons à exercer notre liberté. La<br />
liberté de parole, le droit d'exprimer <strong>et</strong> de communiquer nos<br />
idées, le droit de rappeler les gouvernements à leur devoir <strong>et</strong> à<br />
leurs obligations <strong>et</strong>, par dessus tout, le droit d'affirmer notre<br />
appartenance <strong>et</strong> notre allégeance au corps politique, à la<br />
société. Le pouvoir de nous faire entendre, d'avoir notre part<br />
dans les décisions du gouvernement qui informent nos vies.<br />
Tout ce qui rend nos vies valables, famille, travail, éducation,<br />
un lieu pour élever nos enfants <strong>et</strong> un endroit où poser notre tête.<br />
Donnons notre aval à la Convention des Nations Unies sur les<br />
Droits de l'enfant, maintenant ratifiée par plus de 190 pays. Un<br />
plus grand nombre de pays ont ratifié la convention que tout<br />
autre traité sur les droits de la personne dans l'histoire.<br />
Prenons la résolution de ne jamais céder aux cruautés <strong>et</strong> aux<br />
obstacles des dogmes obsolètes <strong>et</strong> des slogans usés, ni de nous<br />
accrocher à des illusions de sécurité. Amis <strong>et</strong> ennemis, nous<br />
avons tous en partage l'investissement du progrès pacifique.<br />
Avec une bonne conscience comme notre guide, puissent toutes<br />
nos entreprises faire place à un monde où les forts sont justes<br />
<strong>et</strong> les faibles en sécurité.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Cadre 1<br />
L’évolution du programme Well-<br />
Being (bien-être) pour les<br />
Sourds, les malentendants <strong>et</strong> les<br />
sourds-aveugles<br />
Cadre 2<br />
Par : SUSAN CHERNOFF, MSW RSW<br />
Well-Being Program (WBP)<br />
● Programme de santé mentale au service des Sourds, des<br />
malentendants, des sourds aveugles <strong>et</strong>/ou de leurs familles<br />
dans toute la province de la Colombie-Britannique.<br />
● Financement : Services provinciaux pour les Sourds <strong>et</strong> les<br />
malentendants<br />
● Fondé en 1991<br />
Cadre 3<br />
La Province de la Colombie-Britannique<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Cadre 4<br />
L’ENGAGEMENT DU WBP<br />
Le programme WBP s’engage à offrir des services<br />
thérapeutiques sûrs <strong>et</strong> confidentiels pour aider ses clients à<br />
améliorer leur vie <strong>et</strong> à la m<strong>et</strong>tre en valeur. Le programme vise à<br />
faire en sorte que tous les clients soient conscients de leurs<br />
droits <strong>et</strong> qu’ils reçoivent des services satisfaisants.<br />
Cadre 5<br />
Cadre 6<br />
Composition du programme<br />
Composition du programme - (continué)
● Psychothérapie<br />
Individuelle, de groupe, familiale <strong>et</strong> évaluation<br />
● Soutien communautaire<br />
Soutien en santé mentale, intercession & promotion de la<br />
qualité de vie <strong>et</strong> des aptitudes sociales<br />
● Éducation communautaire<br />
Psycho-éducation & ateliers<br />
● c.-à-d. Aptitudes à l’affirmation <strong>et</strong> limites, VIH/SIDA,<br />
Syndrome de la table du dîner, aptitudes au<br />
parentage, <strong>et</strong>c.<br />
● Interprétation en santé mentale<br />
Cadre 7<br />
● Influences historiques<br />
Défis<br />
Stigmates de la maladie mentale & services de santé<br />
mentale<br />
Expériences au sein de la collectivité des Sourds<br />
● ex. barrières linguistiques <strong>et</strong> culturelles, lacunes de<br />
l’emploi, abus physique <strong>et</strong> sexuel dans les<br />
pensionnats<br />
Indemnisations<br />
● (JHS-CA/ Jericho Hill School for the Deaf Class<br />
Action, JIC/Jericho Individual Compensation)<br />
● Développement de programme / défis du<br />
financement<br />
Cadre 8<br />
Défis (continué)<br />
● Relations Thérapeute-interprète-client en santé<br />
mentale<br />
Rôles <strong>et</strong> limites complexes à l’intérieur <strong>et</strong> à l’extérieur de<br />
l’environnement thérapeutique<br />
● Développement professionnel<br />
Lacunes dans la formation en santé mentale spécialisée
dans les questions de perte auditive<br />
● Diversité<br />
Vaste gamme de toiles de fond derrière la perte auditive<br />
(par ex., Sourds culturels, gériatrie), sexes, <strong>et</strong>hnies,<br />
sexualité, <strong>et</strong>c.<br />
● Géographie<br />
Cadre 9<br />
● Expansion du WBP<br />
RÉALISATIONS<br />
Commencé avec une personne, maintenant neuf<br />
personnes en même temps<br />
Le développement d’un spectre de ressources <strong>et</strong> de<br />
services (ex., interprètes/interprètes sourds; services de<br />
soutien pour sourds aveugles, réfugiés/immigrants;<br />
services à l’enfance <strong>et</strong> à la famille <strong>et</strong> éducation<br />
communautaire)<br />
● Plus grande accessibilité aux services<br />
ex., partenariats communautaires, services de<br />
vidéoconférences <strong>et</strong> bureaux satellites dans le Lower<br />
Mainland de Vancouver<br />
Cadre 10<br />
Réalisations (continué)<br />
● Maintenu la qualité des services & resté au courant<br />
des préoccupations <strong>et</strong> des intérêts<br />
ex., Enquêtes sur la satisfaction des clients (trois<br />
enquêtes séparées), rapport d’enquête sur l’alcool <strong>et</strong> les<br />
drogues, MHCEU -Mental Health.<br />
● Amélioré la sensibilisation vis-à-vis la variété des<br />
services de santé mentale<br />
ex. : service/programme de traitement des toxicomanies,<br />
counselling religieux, programme de jour de traitement<br />
des jeunes, groupes de soutien, <strong>et</strong>c.<br />
Cadre 11<br />
Réalisations (continué)<br />
● Identification précoce innovatrice<br />
Ex., programmes préscolaires <strong>et</strong> scolaires, programmes
de réadaptation/d’insertion professionnelle<br />
● Développement professionnel & formations pour les<br />
professionnels <strong>et</strong> les interprètes en santé mentale<br />
ex. études : "Psychotherapy with Deaf Clients: The<br />
Evolving Process of a Therapist/ Interpr<strong>et</strong>er Team", vidéoproductions<br />
● Reconnaissance internationale<br />
ex. Fédération mondiale des sourds, Université Gallaud<strong>et</strong><br />
Cadre 12<br />
Vancouver Coastal Health Authority<br />
Deaf, Hard of Hearing, Deaf-Blind Well-Being<br />
Program<br />
200-1070 West Broadway<br />
Vancouver, BC, <strong>Canada</strong>, V6H-1E7<br />
Tel: 604-732-7656 Voice<br />
Tel: 604-732-7549 TTY<br />
Tel: 1-800-949-1155 TTY<br />
Fax: 604-732-5042<br />
www.vch.ca/wbp<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Surdicécité <strong>et</strong> santé mentale :<br />
Mieux comprendre pour mieux<br />
intervenir<br />
Bolduc, Daniel (psychologue) dbolduc@raymond-dewar.<br />
gouv.qc.ca ;<br />
Briss<strong>et</strong>te, Lyne (travailleuse sociale) lbriss<strong>et</strong>te@raymonddewar.gouv.qc.ca<br />
; <strong>et</strong><br />
Lefebvre, Gilles (conseiller en surdicécité)<br />
glefebvre@raymond-dewar.gouv.qc.ca de<br />
l’Institut Raymond-Dewar(1), Montréal.<br />
Introduction<br />
Une personne ayant une bonne santé mentale est une personne<br />
ayant une connaissance de soi <strong>et</strong> une opinion positive d’ellemême,<br />
ayant la capacité de conserver son équilibre en situation<br />
de stress, ayant des relations satisfaisantes avec les autres,<br />
capable d’exercer son autonomie, capable de nuance <strong>et</strong> de<br />
recul, ayant accès à ses émotions <strong>et</strong> pouvant les exprimer.(2)<br />
Conserver sa santé mentale représente toutefois un défi<br />
considérable pour la personne vivant une double perte<br />
sensorielle.<br />
La surdicécité peut engendrer de nombreuses conséquences<br />
dans plusieurs sphères de la vie d’une personne. Toutefois<br />
parmi les sphères touchées, la santé mentale est sans contredit<br />
l’une des plus importantes. D’une part, la surdicécité amène des<br />
conséquences psychologiques. Mais alors que certaines<br />
personnes arrivent à r<strong>et</strong>rouver un nouvel équilibre, d’autres<br />
n’arrivent plus à fonctionner normalement. On peut alors parler<br />
de problème de santé mentale <strong>et</strong> dans certains cas de<br />
psychopathologie.<br />
En tant qu’intervenants dans un programme de réadaptation,<br />
nous sommes témoins de la détresse de notre clientèle <strong>et</strong> nous<br />
sommes amenés à nous questionner sur nos pratiques<br />
perm<strong>et</strong>tant à ces personnes de r<strong>et</strong>rouver un certain sentiment<br />
de contrôle sur leur vie. Nous nous attarderons ici<br />
principalement à la clientèle adulte ayant une surdicécité<br />
acquise.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Conséquences psychosociales de la<br />
surdicécité<br />
L’appauvrissement de l’accès à l’information sonore <strong>et</strong> visuelle<br />
entraîne des conséquences graves <strong>et</strong> cela a tout d’abord un<br />
impact sur la capacité à communiquer <strong>et</strong> à maintenir des<br />
contacts sociaux. Le réseau social s’effrite graduellement,<br />
certains amis s’éloignent. Ces impacts varient selon l’influence<br />
de multiples facteurs: l’âge, le mode de communication,<br />
l’appartenance ou non à la culture Sourde, la nature de la perte<br />
sensorielle, le niveau d’éducation, le revenu, le réseau social,<br />
l’emploi, la personnalité, <strong>et</strong>c.<br />
Les pertes sont nombreuses : ne plus pouvoir profiter de<br />
certaines activités (lire le journal, écouter de la musique),<br />
perdre son autonomie (ne plus pouvoir conduire sa voiture), ne<br />
plus être capable d’occuper son emploi, <strong>et</strong>c. Les personnes<br />
sourdes-aveugles nous disent se sentir alors déphasées par<br />
rapport à ce qui se passe dans leur entourage immédiat <strong>et</strong> dans<br />
la société en général. La personne peut alors ressentir de la<br />
frustration, de l’injustice, de la peine, une baisse d’estime de<br />
soi, de l’anxiété, <strong>et</strong>c. Elle doit composer avec ces émotions, les<br />
gérer <strong>et</strong> trouver des moyens pour s’adapter constamment à<br />
c<strong>et</strong>te nouvelle condition sensorielle.<br />
Certaines personnes sourdes-aveugles ne se sentiront à l’aise ni<br />
dans la communauté Sourde, ni avec les entendants. Cela<br />
nourrira un questionnement sur l’identité <strong>et</strong> entraînera des<br />
remises en question.<br />
L’adaptation peut varier selon l’ampleur de la perte, les<br />
expériences de vie ainsi que la qualité des ressources dont la<br />
personne dispose. Dans le meilleur des cas, elles réussiront à<br />
s’adapter aux pertes <strong>et</strong> à surmonter les diverses difficultés<br />
auxquelles elles seront confrontées. D’autres seront à risque de<br />
développer des problèmes de santé mentale.<br />
Relations avec la famille <strong>et</strong> l’entourage<br />
La progression des déficiences sensorielles affectera<br />
grandement la dynamique de la famille <strong>et</strong> de l’entourage de la<br />
personne sourde-aveugle. Ceux-ci devront composer avec la<br />
perte de qualité des échanges, leurs peurs, leurs frustrations, le<br />
stress <strong>et</strong> l’incertitude face à l’avenir. Ils peuvent parfois vivre le<br />
deuil de la vie sociale ou d’une communication satisfaisante,<br />
avec tout ce que cela représente comme impact émotif. Par<br />
exemple, le conjoint ou la famille peut voir ses contacts sociaux<br />
diminuer car la personne sourde-aveugle peut difficilement<br />
participer aux conversations de groupe, elle n’en éprouve plus<br />
de plaisir ou elle peut craindre d’apparaître diminuée ou<br />
inadéquate.<br />
On ne peut donc aider la personne sourde-aveugle sans tenir<br />
compte de sa place, de son rôle <strong>et</strong> de la fonction qu’elle occupe<br />
dans sa famille. Par exemple, certains parents sourds-aveugles<br />
peuvent être portés à avoir de grandes attentes face aux<br />
responsabilités que leurs enfants doivent assumer. Le parent<br />
devra en arriver à r<strong>et</strong>rouver un sentiment de compétence à
exercer son rôle ou utiliser les ressources du milieu pour pallier<br />
à certaines incapacités. L’entourage doit être soutenu pour<br />
arriver à comprendre <strong>et</strong> à s’adapter au fait que le rythme <strong>et</strong> les<br />
besoins de la personne sourde-aveugle ne sont plus les mêmes<br />
mais qu’elle peut <strong>et</strong> qu’elle doit continuer ses activités dans la<br />
mesure de ses capacités. Entre autres, le système familial doit<br />
arriver à renégocier des règles de fonctionnement satisfaisantes<br />
<strong>et</strong> équitables. L’information doit circuler à nouveau entres les<br />
personnes par l’utilisation de nouveaux moyens.<br />
Pour combattre son anxiété, un système familial qui n’aura pas<br />
réussi à s’adapter pourrait adopter plusieurs attitudes<br />
nuisibles : la surprotection, le déni des pertes, la dévalorisation<br />
de la personne sourde-aveugle, l’épuisement psychologique des<br />
aidants naturels, <strong>et</strong>c. Le stress pourra également exacerber les<br />
difficultés préexistantes dans la dynamique familiale ou<br />
conjugale : des situations de rej<strong>et</strong>, un divorce, des conflits vont<br />
alors contribuer à l’isolement de la personne <strong>et</strong> ainsi fragiliser<br />
davantage sa santé mentale.<br />
Problème de santé mentale <strong>et</strong><br />
surdicécité<br />
Aspects cognitifs<br />
Il peut être long <strong>et</strong> difficile d’arriver à bien cerner le problème<br />
de santé mentale, à poser les bonnes hypothèses <strong>et</strong> d’en arriver<br />
au diagnostic. Ce qui peut sembler être une hallucination est<br />
possiblement le résultat d’une perception morcelée de<br />
l’information sonore <strong>et</strong> visuelle. Entre autres, certaines<br />
personnes vivant de l’anxiété ont de la difficulté à interpréter<br />
les changements de perception qu’ils expérimentent lorsqu’il y a<br />
baisse de vision. Certains nous rapportent qu’ils voient des<br />
lumières, de la couleur, des obj<strong>et</strong>s qui bougent, <strong>et</strong>c.(3) Ces<br />
illusions peuvent être interprétées ou non comme une menace.<br />
Les croyances ou idées fausses peuvent se cristalliser <strong>et</strong><br />
augmenteront encore l’anxiété. Confrontée à un monde qu’elle<br />
perçoit de moins en moins, à un avenir incertain <strong>et</strong> à la perte<br />
d’autonomie, la personne peut développer une intolérance<br />
grandissante à l’incertitude (trouble d’anxiété généralisée). La<br />
capacité de voir <strong>et</strong> d’entendre, qui perm<strong>et</strong>tait à la personne<br />
d’exercer son jugement, ne perm<strong>et</strong> plus le même contact avec<br />
la réalité; la personne ne parvient plus à distinguer ce qui<br />
relève de son imagination (stimulus intérieur) ou de la réalité<br />
(stimulus extérieur). La réalité étant perçue de façon morcelée<br />
<strong>et</strong> sélective, la personne peut établir de faux liens de cause à<br />
eff<strong>et</strong> avec toutes les conséquences comportementales que cela<br />
entraîne.<br />
N’ayant que peu d’échanges avec les autres <strong>et</strong> devenant<br />
imperméable aux feedbacks à cause des difficultés de<br />
communication <strong>et</strong> de perception, la personne perd la<br />
perspective sur sa vie relationnelle. Les émotions prennent le<br />
dessus, la pensée peut difficilement se structurer <strong>et</strong> le<br />
« monologue intérieur » prend toute la place.<br />
Aspects reliés à l’humeur
La perte de l’audition <strong>et</strong> de la vision engendre inévitablement<br />
des réactions émotives plus ou moins intenses. Les personnes<br />
ont parfois été fragilisées par une première déficience puis<br />
l’apparition de la deuxième les atteints à nouveau. Ce processus<br />
peut se reproduire tout au long de la vie puisque, pour plusieurs<br />
personnes, ces pertes se font sentir de façon progressive ou<br />
encore par pallier.<br />
Etant moins stimulées ou moins sollicitées par ce qui se passe<br />
dans leur environnement, certaines personnes sourdes-aveugles<br />
peuvent sombrer dans le désintéressement ou un état de<br />
léthargie. Il y a aussi risque de présenter un trouble de<br />
dépression majeure. On peut r<strong>et</strong>rouver ici des personnes aux<br />
prises avec un deuil non résolu de leurs pertes sensorielles, qui<br />
peut perdurer ou qui se répète selon l’évolution de leur<br />
syndrome. Le tableau clinique de la dépression majeure peut<br />
être plus ou moins sévère <strong>et</strong> s’accompagner de problèmes<br />
d’alcoolisme, de toxicomanie, d’idées suicidaires, <strong>et</strong> dans<br />
certains cas, de tentatives de suicide.<br />
Chez certains individus, des obsessions <strong>et</strong> compulsions sur le<br />
thème du doute <strong>et</strong> de la vérification (trouble d’obsessioncompulsion)<br />
peuvent aussi apparaître, de même que des<br />
pointes d’anxiété extrême provocant des troubles de panique<br />
avec agoraphobie <strong>et</strong> pouvant culminer en attaque de panique.<br />
Symptômes de nature psychotiques<br />
Dans des cas plus rares, il y a apparition de symptômes de la<br />
lignée psychotique. Ainsi, des personnes n’ayant presque plus<br />
d’audition <strong>et</strong> de vision présentent des hallucinations visuelles <strong>et</strong>/<br />
ou auditives. D’autres entr<strong>et</strong>iennent des idées délirantes de<br />
persécution, se désorganisent ou adoptent des comportements<br />
agressifs <strong>et</strong> socialement inacceptables. Éventuellement, elles<br />
peuvent en venir à se construire une compréhension menaçante<br />
de la réalité. On est alors en présence d’un trouble délirant.<br />
Il n’est pas clairement établi pourquoi une personne sourdeaveugle<br />
en vient à présenter des symptômes aussi graves. Il<br />
semble toutefois que cela puisse être, en partie, le résultat de la<br />
double déficience sensorielle puisque les symptômes semblent<br />
s’atténuer lorsqu’on stimule la personne <strong>et</strong> qu’on réduit<br />
l’isolement.<br />
Expériences de privation sensorielles<br />
Des études indiquent clairement que la privation sensorielle<br />
peut favoriser l’apparition d’hallucinations(4). Ce phénomène a<br />
été observé lors d’expériences de privation sensorielle chez des<br />
suj<strong>et</strong>s normaux, de même que chez des personnes ayant une<br />
surdité importante, ayant perdu la vision ou un membre. Une<br />
personne atteinte d’une double déficience sensorielle peut alors<br />
trouver difficile de départager ce qui est de l’ordre de la réalité<br />
<strong>et</strong> de ses hallucinations. Combiné à de l’isolement social, cela<br />
peut donner lieu à des comportements aberrants <strong>et</strong> à de la<br />
désorganisation.<br />
Le rôle d’un programme de
éadaptation en surdicécité en regard<br />
de la santé mentale<br />
Le traitement des maladies mentales en phase aiguë relève du<br />
milieu de la psychiatrie. Nous sommes toutefois amenés à<br />
dispenser des services relatifs à la santé mentale: la prévention,<br />
le soutien au traitement en psychiatrie <strong>et</strong> la réadaptation.<br />
Prévention: notre rôle en centre de réadaptation est de réduire<br />
les eff<strong>et</strong>s découlant de la double déficience sensorielle afin<br />
d’assurer l’utilisation maximale des capacités de l’individu, dont<br />
les capacités mentales (cognitives, affectives <strong>et</strong> relationnelles).<br />
Un des moyens privilégié est le développement de nouvelles<br />
compétences afin que la personne puisse maintenir sa<br />
participation sociale (L.S.Q., braille, stratégies de<br />
communication, stratégies en orientation <strong>et</strong> mobilité,<br />
réaménagements des responsabilités au sein du couple <strong>et</strong> de la<br />
famille, <strong>et</strong>c.) Nous offrons également un soutien à la personne<br />
dans son processus de deuil afin d’éviter l’émergence de<br />
problématiques plus graves.<br />
Le soutien au traitement en psychiatrie: nous sommes<br />
également appelés à soutenir les intervenants en psychiatrie en<br />
raison des grandes difficultés de communication des personnes<br />
sourdes-aveugles, de leur besoin d’un mode de communication<br />
adapté, du lien de confiance déjà établi <strong>et</strong> de notre<br />
connaissance des ressources adaptées. Les intervenants de<br />
milieux hospitaliers se disent souvent démunis auprès des<br />
personnes sourdes-aveugles <strong>et</strong> des personnes de culture<br />
Sourde. De plus, le besoin <strong>et</strong> le droit à des services<br />
d’interprétation gestuelle ne sont pas toujours reconnus <strong>et</strong> nous<br />
avons parfois à soutenir notre client pour l’exercice de ce droit.<br />
La réadaptation: les services en psychiatrie (qui ne sont pas<br />
spécialisés en surdité ou surdicécité) se résument<br />
habituellement, pour les personnes Sourdes communicant en L.<br />
S.Q., à une médication <strong>et</strong> un suivi plus ou moins régulier<br />
perm<strong>et</strong>tant une diminution de certains symptômes. Il importe<br />
toutefois de demeurer impliqués dans le milieu de vie afin de<br />
désamorcer les situations anxiogènes puisque la personne<br />
sourde-aveugle a encore besoin d’un soutien sécurisant.<br />
Ultimement, la personne doit aussi réaliser que malgré l’impact<br />
de ses déficiences, elle possède toujours la capacité de<br />
comprendre, d’influencer <strong>et</strong> de se fixer ses propres buts.<br />
Vign<strong>et</strong>te clinique : Rémi<br />
Historique: Rémi est un homme sourd-aveugle de 40 ans qui<br />
communique en L.S.Q. Il a accumulé des r<strong>et</strong>ards scolaires<br />
malgré un bon potentiel intellectuel. Rémi présentait des<br />
problèmes de comportement à l’adolescence <strong>et</strong> était peu intégré<br />
à la communauté Sourde. Sa déficience visuelle, causée par le<br />
syndrome d’Usher, n’a été diagnostiquée qu’à l’age de 18 ans.<br />
À l’age adulte, il a été autonome en appartement <strong>et</strong> il a travaillé<br />
une dizaine d’année en industrie. Le travail était une valeur<br />
importante pour lui. Des accidents de travail <strong>et</strong> sa baisse<br />
visuelle ont entraîné la perte de son emploi. Il a exprimé des
sentiments de détresse <strong>et</strong> des idées suicidaires reliées à ces<br />
pertes. Il vit pendant quelques années une période de forte<br />
consommation d’alcool <strong>et</strong> de drogues. L’attribution d’un chienguide<br />
s’avéra un facteur positif tant au plan affectif que pour sa<br />
sécurité. Rémi r<strong>et</strong>rouve une certaine adaptation, fonctionne bien<br />
dans son appartement régulier. Ses idées suicidaires ne sont<br />
plus présentes. Il a cependant peu d’amis suite à la rupture d’un<br />
lien significatif.<br />
Développement des symptômes: Graduellement Rémi<br />
éprouve de l’insécurité, a peur d’être seul, imagine des intrus<br />
dans son logement, sent de la fumée, <strong>et</strong>c. Il demande à<br />
déménager dans un nouveau logement. Il veut obtenir une<br />
caméra de surveillance. Il se plaint de la présence d’un p<strong>et</strong>it<br />
singe qui le touche <strong>et</strong> se cache. Il tente de l’effrayer par ses cris<br />
<strong>et</strong> cela est dérangeant pour les voisins.<br />
Hypothèses de facteurs précipitants: nouvelle perte<br />
visuelle, perte d’un lien avec un ami important, augmentation<br />
de l’isolement, manque d’activité, mauvaise communication<br />
avec le concierge créant de la tension.<br />
Des moyens d’intervention diversifiés sont nécessaires :<br />
● lui perm<strong>et</strong>tre d’exprimer sa souffrance, même s’il est<br />
réticent à le faire de façon directe en entrevue.<br />
Questionnement des intervenants sur les moyens à<br />
privilégier pour perm<strong>et</strong>tre une expression <strong>et</strong> un accès aux<br />
émotions à c<strong>et</strong>te personne de culture Sourde (comment<br />
exploiter son intérêt pour l’art <strong>et</strong> les animaux dans un but<br />
thérapeutique?).<br />
● communication <strong>et</strong> information: Rémi n’a qu’une perception<br />
partielle de l’information <strong>et</strong> il interprète les choses de façon<br />
biaisée. Il faut donc tenter d’y remédier en lui donnant des<br />
explications additionnelles afin de diminuer l’anxiété. Par<br />
exemple, ses éblouissements <strong>et</strong> ses îlots de vision doivent<br />
être réinterprétés comme des éléments non menaçants.<br />
● briser l’isolement psychologique, lui perm<strong>et</strong>tre de<br />
rencontrer des personnes avec des expériences similaires<br />
<strong>et</strong> des personnes sourdes-aveugles qui sont des modèles<br />
positifs.<br />
● identification des intérêts <strong>et</strong> stimulation: apprentissage du<br />
braille, du français <strong>et</strong> de l’informatique. Les symptômes<br />
sont moindres lorsqu’il a des loisirs <strong>et</strong> des activités<br />
manuelles.<br />
● suivi en psychiatrie, médication, information <strong>et</strong> discussions<br />
sur les eff<strong>et</strong>s secondaires des médicaments. Il rem<strong>et</strong> en<br />
question la pertinence de la médication périodiquement.<br />
● soutien à la famille.<br />
● a cessé de vivre seul (possiblement de façon temporaire).<br />
Recherche d’appartement supervisé afin de vivre de façon<br />
autonome mais sans pour autant être isolé.<br />
Situation actuelle: Rémi continue de prendre une médication<br />
anti-psychotique à faible dose. Plus actif, il s’investit dans des<br />
activités gratifiantes. Il fonctionne mieux de façon générale <strong>et</strong><br />
réalise parfois que sa vision le « trompe ». Il demeure<br />
cependant fragile <strong>et</strong> on observe une recrudescence des
symptômes en situation d’incompréhension ou s’il vit un<br />
événement stressant.<br />
Vign<strong>et</strong>te clinique : Manon<br />
Dame de 50 ans ayant le syndrome d'Usher de type 1 (surdité<br />
congénitale profonde <strong>et</strong> rétinite pigmentaire), fonctionnellement<br />
voyante avec vision périphérique de 7 degrés. Communique en<br />
Langue des signes québécoise « LSQ ».<br />
Situation de vie :<br />
Mère de deux enfants d'âge adulte. Vit seule depuis 6 ans<br />
éloignée de sa famille dans une habitation à loyer modique pour<br />
personnes non voyantes où elle est la seule personne<br />
communiquant en LSQ. Isolement social.<br />
Événements:<br />
Des voisins se sont plaints que madame crie la nuit en frappant<br />
sur les murs <strong>et</strong> le plancher de son appartement <strong>et</strong> croient<br />
qu'elle est en danger.<br />
Nous rencontrons madame pour lui exprimer les plaintes de ses<br />
voisins. Madame nous explique qu'elle entend des bruits dans<br />
son oreille droite au moment du coucher <strong>et</strong> qu'elle croit que<br />
quelqu'un veut entrer chez elle ou bien que ce sont les voisins<br />
qui font la fête. Elle nous indique le plancher <strong>et</strong> les murs d'où<br />
proviendraient les bruits. Madame dit avoir peur. Elle frappe sur<br />
le plancher <strong>et</strong> les murs pour avertir ses voisins de se calmer.<br />
Elle a perçu ces bruits à plusieurs reprises ces deux dernières<br />
semaines.<br />
Après investigation auprès des voisins, il s'avère que les nuits<br />
sont relativement calmes dans l'immeuble sauf celles où<br />
madame crie <strong>et</strong> produit elle-même des bruits.<br />
Hypothèses :<br />
● présence réelle de bruits dans l'environnement?<br />
● acouphènes?<br />
● hallucinations auditives?<br />
● besoin d’attention ou de contacts sociaux avec les<br />
intervenants? Isolement social ?<br />
● expression d’un malaise?<br />
● autre cause?<br />
Intervention :<br />
● Nous faisons part à madame des résultats de nos<br />
investigations en lui suggérant qu'il existe des bruits autres<br />
que ceux pouvant être produits par des voisins. En<br />
identifiant leur provenance, il est possible de contrôler<br />
deux sources sonores de son environnement.<br />
● Une rencontre en audiologie lui perm<strong>et</strong> de comprendre<br />
qu'un acouphène n’est pas provoqué par un stimulus
sonore de son environnement. Il s’agit d’un concept difficile<br />
à comprendre pour une personne qui n’a pas de concept de<br />
personne entendante.<br />
● Madame expérimente le phénomène auditif dont elle se<br />
plaint dans un autre environnement que le sien ce qui<br />
l'inquiète <strong>et</strong> la rassure en même temps.<br />
● Discussions <strong>et</strong> coopération avec la personne responsable<br />
des plaintes dans l’immeuble afin d’éviter des procédures<br />
d’éviction.<br />
● Une visite est faite dans un centre communautaire pour<br />
personnes Sourdes afin de diminuer l’isolement.<br />
● Des rencontres sont proposées afin qu’elle puisse exprimer<br />
ce qui la préoccupe, puisqu’il y a répétition de ses appels à<br />
l’aide.<br />
Dénouement :<br />
Madame peut maintenant contrôler deux sources sonores de<br />
son environnement. Les épisodes de bruits <strong>et</strong> cris produits par<br />
madame ont beaucoup diminué mais sont encore présents de<br />
temps à autre. Elle aura besoin de soutien additionnel pour<br />
intégrer l’organisme communautaire pour personne Sourdes.<br />
Pour l’instant madame fait appel à nous dans certains moments<br />
de détresse mais d’autres aspects de ses difficultés liés au deuil,<br />
à l’estime de soi <strong>et</strong> à des besoins fonctionnels n’ont été que peu<br />
travaillés à cause de ses grandes résistances <strong>et</strong> sa peur d’être<br />
infantilisée.<br />
Peu d’études cliniques<br />
Une étude(5) descriptive de la clientèle desservie au<br />
programme Surdicécité réalisée en 1993 indique qu’entre 20%<br />
<strong>et</strong> 27% des gens présentent des problèmes de santé mentale.<br />
Ces résultats sont basés sur des données recueillies auprès de<br />
117 clients. Il faut cependant interpréter ces résultats avec<br />
prudence car la méthodologie utilisée pour déterminer la<br />
présence d’un problème de santé mentale n’est pas clairement<br />
décrite. D’autre part, c<strong>et</strong>te même étude rapporte que 12% de la<br />
clientèle consommait des psychotropes (10.3% des<br />
anxiolytiques <strong>et</strong> 1.7% des antipsychotiques). Qu’en est-il<br />
aujourd’hui?<br />
Conclusion<br />
La perte de l’audition <strong>et</strong> de la vision, qu’elle se produise<br />
progressivement ou abruptement, qu’elle soit totale ou partielle,<br />
a un impact certain au plan psychologique. C<strong>et</strong> impact peut être<br />
modulé par l’ampleur des pertes, les ressources personnelles de<br />
l’individu, le soutien qu’il reçoit de son réseau social de même<br />
que par les services communautaires ou professionnels qu’il<br />
peut obtenir. Ce dernier facteur peut être d’autant plus crucial<br />
pour ces personnes disposant de peu de ressources ou pour<br />
ceux qui présentent des problèmes de santé mentale.<br />
Il demeure que même si une intervention appropriée <strong>et</strong><br />
beaucoup d’efforts <strong>et</strong> de détermination perm<strong>et</strong>tent à la
personne sourde-aveugle de mieux vivre sa situation, sa<br />
démarche personnelle devra l’amener à rem<strong>et</strong>tre en question<br />
ses valeurs <strong>et</strong> trouver pour elle-même un sens à ce qu’elle vit.<br />
Recommandations<br />
Une analyse globale des besoins de la personne sourde-aveugle<br />
<strong>et</strong> des moyens adaptés <strong>et</strong> diversifiés sont nécessaires afin de<br />
combler le manque d’information, de rétablir la communication,<br />
de briser l’isolement <strong>et</strong> de perm<strong>et</strong>tre l’accès aux émotions. Une<br />
approche autant individuelle, qu’auprès des familles <strong>et</strong> un<br />
groupe perm<strong>et</strong> de répondre aux nombreux besoins :<br />
interventions individuelles pour réduire la détresse<br />
psychologique <strong>et</strong> l’isolement, information, ateliers de gestion du<br />
stress, groupes de soutien pour prévenir ou atténuer les<br />
réactions psychologiques associées aux pertes, ateliers de<br />
sensibilisation à la double perte sensorielle destinés à<br />
l’entourage, groupe de parents d’adultes sourds-aveugles, <strong>et</strong>c.<br />
Préconiser une approche basée sur l’autodétermination de la<br />
personne; la personne doit identifier ses capacités <strong>et</strong> intérêts,<br />
parfois en développer d’autres plus réalistes, développer de<br />
nouvelles compétences <strong>et</strong> ultimement vivre des expériences<br />
positives.<br />
Développement de ressources adaptées aux capacités des<br />
personnes sourdes-aveugle ; travail, éducation, loisirs,<br />
hébergement de type appartements supervisés ou dépannage,<br />
<strong>et</strong>c.<br />
Complémentarité entre les milieux de réadaptation <strong>et</strong> les<br />
établissements hospitalier: suivi en psychiatrie, consultations<br />
par les intervenants auprès d’un psychiatre, accompagnement<br />
de la personne pour consultation ou urgence, <strong>et</strong>c.<br />
Formation des intervenants pour mieux intervenir auprès des<br />
personnes présentant des symptômes psychotiques ou des<br />
idées suicidaires.<br />
Recherches à poursuivre sur la prévalence des problèmes de<br />
santé mentale chez les personnes sourdes-aveugles <strong>et</strong> sur<br />
l’intervention à préconiser.<br />
Notes<br />
1. Centre de réadaptation spécialisé en surdité <strong>et</strong> en<br />
communication, l'IRD fait partie du réseau public de la<br />
Santé <strong>et</strong> des Services sociaux du Québec. Elle comporte<br />
une équipe multidisciplinaire en surdicécité composée<br />
d’audiologistes, d’un conseiller en surdicécité,<br />
d’éducateurs, d’une orthophoniste, d’un psychologue <strong>et</strong><br />
d’une travailleuse sociale.<br />
2. Fortin, Bruno. Intervenir en santé mentale. Fidès, 1997.<br />
3. Syndrome de Charles Bonn<strong>et</strong> Teunisse RJ, Cruysberg JR,<br />
Hoefnagels WH, Verbeek AL, Zitman FG: Visual<br />
hallucinations in psychologically normal people: Charles
Bonn<strong>et</strong>’s syndrome. Lanc<strong>et</strong> 1996; 347:794–797<br />
4. Sauerburger, Dona. Independance without sight or sound.<br />
A.F.B.<br />
5. Grimard, C., Dupuis, J.-L <strong>et</strong> Lord, L. (1993). Le programme<br />
Surdicécité de l’Institut Raymond-Dewar : étude<br />
descriptive des caractéristiques <strong>et</strong> besoins de la clientèle<br />
adulte. Institut Raymond-Dewar, Montréal, juin 1993.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
L'impact De La Perte Auditive Sur<br />
La Communication Verbale<br />
Par : René Rivard<br />
On dit que la première étape vers la solution d'un problème<br />
consiste à bien comprendre le problème. J'espère que la plus<br />
grande partie de ce que nous ferons ici aujourd'hui sera<br />
d'apprendre à comprendre le problème. J'espère aussi qu'une<br />
fois que nous aurons exploré le problème, nous serons en<br />
mesure de partager nos points de vue à ce suj<strong>et</strong>. Je suis sûr<br />
qu'il nous restera encore des questions à la fin, mais j'espère<br />
qu'elles seront dans un contexte qui nous offrira quelques<br />
directions vers des solutions concrètes. Aussi, nous allons<br />
acquérir c<strong>et</strong>te compréhension ensemble, ce qui fait qu'il est<br />
important de partager vos expérience avec les autres personnes<br />
présentes. Dans ce sens, je me sens plutôt comme un<br />
animateur qui a fait un peu de recherche qui peut aider à j<strong>et</strong>er<br />
un éclairage sur vos expérience partagées, mais vous allez<br />
apprendre plus les uns des autres que de moi. Je serai satisfait<br />
si je peux créer un contexte qui peut vous aider à faire cela.<br />
Le "problème" qui nous intéresse est le suivant : "Qu'arrive-t-il<br />
à la communication entre deux ou plusieurs personnes<br />
lorsqu'une de celles-ci connaît une perte auditive ?" Ces<br />
personnes peuvent entr<strong>et</strong>enir des relations personnelles comme<br />
amis <strong>et</strong> époux ou des relations professionnelles comme<br />
collègues de travail de pourvoyeurs de services. Pour la<br />
personne qui a une perte auditive, cela pourrait vouloir dire que<br />
sa relation avec la société en général affectant des activités<br />
comme regarder la télévision, écouter les nouvelles, aller au<br />
théâtre ou à un concert. Toutes ces circonstances sont des<br />
opportunités de communication, l'essence même de notre<br />
participation à notre société. Tous souffrent suite des<br />
conséquences d’une perte auditive.<br />
Je pense que je devrais commencer en disant que mon premier<br />
but dans la vie est de bien communiquer avec les autres. Il faut<br />
comprendre que chaque personne a des façons différentes de<br />
communiquer <strong>et</strong> qu' on doit respecter le style de communication<br />
de l'autre, qui peut être basée sur la personnalité, mais<br />
également sur d'autres aptitudes physiques plus fondamentales,<br />
comme la capacité d'entendre les mots. La communication m<strong>et</strong><br />
en présence au moins deux personnes qui sont à tour de rôle<br />
transm<strong>et</strong>teur <strong>et</strong> récepteur. Et, si une de ces personnes est<br />
incapable d'entendre certains mots, comment peut-on<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
s'attendre à ce qu'elle comprenne immédiatement des phrases<br />
complètes <strong>et</strong> des conversations, <strong>et</strong> que, par conséquent, elle<br />
participe pleinement au processus de la communication ?<br />
Toutefois, lorsqu'il y a perte auditive, la responsabilité' du<br />
manque de communication qui s'ensuit est ordinairement<br />
attribuée seulement a la personne ayant une perte auditive.<br />
Mais, quelle que soit la capacité' auditive ou au défi de<br />
communication analogue que l'autre peut vivre, il est important<br />
que le communicateur, s'il tient a se faire comprendre, s'assure<br />
que l'autre personne a un accès à l'information qui est<br />
pertinente a la communication, <strong>et</strong> encore plus Si on s'attend a<br />
ce que l'autre participe en tant qu'égale au processus de<br />
communication. Les personnes ayant une perte auditive<br />
peuvent avoir le sentiment que leurs interlocuteurs entendait<br />
ont des lacunes de ce côté, <strong>et</strong> ils peuvent souvent avoir raison.<br />
Nous devons comprendre pourquoi.<br />
On a beaucoup parlé, ces dernières années, des merveilleuses<br />
innovations <strong>et</strong> des développements qui se sont produits dans le<br />
monde de la technologie. Beaucoup de ces développements<br />
technologiques ont eu un énorme impact sur les personnes<br />
ayant une perte auditive <strong>et</strong> ont ouvert un nouveau monde<br />
d'interaction entre les personnes sur l'Intern<strong>et</strong>. Des outils<br />
comme le système "ICQ" (je te cherche) a ouvert les autoroutes<br />
de la communication dans le monde entier. Les personnes<br />
sourdes, devenues sourdes <strong>et</strong> malentendantes ont été capables<br />
d'utiliser ces outils pour avoir finalement accès a d'innombrables<br />
services <strong>et</strong> à des sources inépuisables d'information. Toutefois,<br />
ce fait peut avoir assombri nos tentatives de comprendre <strong>et</strong><br />
d'améliorer notre compréhension de la communication<br />
personnelle, face-à-face entre deux personnes. Que se passe-til<br />
lorsqu'une des deux personnes ne peut entendre qu'une partie<br />
des mots prononcés par l'autre ? N'est-ce pas la composante la<br />
plus importante de la communication les interactions face-àface,<br />
avec l'expression du visage <strong>et</strong> le langage corporel ?<br />
Je suis entendant, <strong>et</strong> je n'ai absolument aucune perte auditive<br />
dont je suis conscient... heu...peut-être une légère perte<br />
d'audition sélective due à la situation. Pourquoi alors ai-je osé<br />
m'intéresser à un tel groupe avec la prétention que je pourrais<br />
peut-être donner une certaine explication aux problèmes de<br />
communication qui les touchent ? Je travaille depuis de<br />
nombreuses années dans le domaine de la santé mentale <strong>et</strong> je<br />
crois avoir essayé de développer une compréhension du lien qui<br />
existe entre la communication <strong>et</strong> les problèmes reliés à la santé<br />
mentale. S'il vous plaît, ne vous offensez pas de l'usage que je<br />
fais des termes "problèmes de santé mentale". Nous avons tous<br />
des problèmes de santé mentale, qui émanent tous des pertes<br />
que nous subissons dans nos vies. La perte auditive est une de<br />
ces pertes. Cependant, <strong>et</strong> c'est là un point très important, il<br />
s'agit d'une perte plus importante <strong>et</strong> plus nocive que beaucoup<br />
d'autres, en ce qu'elle affecte le processus de communication.<br />
Elle touche à toutes nos relations humaines, que ce soit avec<br />
nos familles, nos amis ou nos collègues de travail. On ne souffre<br />
pas seulement d'une perte importante, on est également affecté<br />
par l'incapacité de communiquer avec d'autres concernant c<strong>et</strong>te<br />
perte.<br />
Je dois ajouter ici que, depuis que j'ai offert de faire une<br />
présentation sur ce suj<strong>et</strong> à c<strong>et</strong>te conférence, j'ai eu la bonne
fortune de rencontrer quelques personnes qui avaient<br />
récemment connu une perte auditive <strong>et</strong> avec lesquelles j'ai<br />
partagé quelques-unes de mes idées. Elles m'ont littéralement<br />
passé à tabac, bien amicalement quand même, <strong>et</strong> je crois que<br />
le résultat est que ma présentation n'en sera que plus utile pour<br />
vous. Merci, Linda <strong>et</strong> Cession.<br />
Alors, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à faire un<br />
p<strong>et</strong>it jeu avec moi. Nous allons laisser voguer librement notre<br />
imagination. Je vais vous présenter un certain nombre d'idées<br />
<strong>et</strong> de situations que je vais vous demander d'imaginer, chacun<br />
pour soi. Vous pouvez rester brefs ou élaborer à loisir, mais la<br />
spontanéité est importante. Si vous changez d'idée à propos de<br />
quelque chose, bien, mais vous voudrez bien vous en souvenir<br />
plus tard.<br />
Réchauffement : Un sentier (ne pas oublier de demander aux<br />
auditeurs de regarder le sentier qui s'étend devant <strong>et</strong> derrière<br />
eux), les bois, une tasse, une clôture, un ours, un téléphone, un<br />
lac, une maison.<br />
J'ai toujours trouvé que ce test était amusant <strong>et</strong> révélateur, <strong>et</strong><br />
j'espère que vous avez été capables d'en rire un peu. Mais,<br />
j'aimerais maintenant vous poser une question : "Vos réponse<br />
auraient elles été différentes avant votre perte auditive ou celle<br />
de votre partenaire ? Dans l'affirmative, de quelle façon ? C'est<br />
pourquoi je vous ai demandé de visualiser le sentier qui se<br />
trouvait devant vous <strong>et</strong> aussi derrière vous. Je ne vous<br />
demanderai pas de répondre à ces questions maintenant, en<br />
public, mais je vous demande d'y répondre pour vous-mêmes <strong>et</strong><br />
de réfléchir à la façon dont elles reflètent les changements qui<br />
se sont produits dans votre vie suite à la perte auditive. Ce que<br />
j'espère, c'est que c<strong>et</strong>te compréhension des changements qui se<br />
sont produits dans la perception que vous avez de votre<br />
environnement immédiat, combinée à une compréhension des<br />
changements survenus dans le processus de communication<br />
vous aideront, ainsi que votre famille, vos amis, vos pairs <strong>et</strong> vos<br />
employeurs, à découvrir des stratégies de communication qui<br />
aident à une meilleure compréhension des manques de<br />
communication <strong>et</strong> qui offrent des solutions qui allègent les<br />
frustrations vécues par les deux parties. Je ne vous propose pas<br />
d'offrir ces solutions, étant donné leur caractère hautement<br />
individuel, mais, comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez les<br />
trouver plus facilement si vous avez une meilleure<br />
compréhension du problème.<br />
Je suis sûr que nous pouvons tous partager des expériences,<br />
parfois drôles <strong>et</strong> parfois moins drôles, que nous avons vécues,<br />
où il y avait une panne dans le processus de communications,<br />
<strong>et</strong> les frustrations, la colère <strong>et</strong> l'isolement qui s'en sont suivis,<br />
résultat des mauvaises communications. Mais mon intention<br />
première n'est pas de vous parler ici de l'impact émotif de la<br />
perte auditive. Je n'ai pas prévu traiter des changements dans<br />
les relations entre la personne qui devient sourde ou qui l'est<br />
devenue <strong>et</strong> les autres, soit au travail, soit avec la famille <strong>et</strong> les<br />
amis. Je crois que ces suj<strong>et</strong>s ont déjà fait abondamment l'obj<strong>et</strong><br />
de discussions par d'autres. Je vous suggérerais de lire "Life<br />
after Deafness", de Bena Shuster. J'avais plutôt l'intention de<br />
discuter des mécanismes de la communication verbale <strong>et</strong> des<br />
changements qui se passent lors de la perte de l'ouïe. Il se peut
que je touche, de fait, aux deux domaines, mais mon objectif<br />
premier est de discuter de communication. Le résultat que je<br />
vise est double :<br />
1. Quand les entendants <strong>et</strong> les malentendants<br />
réaliseront qu'il y a un processus mécanique qui<br />
est en train de changer <strong>et</strong> quand ils comprendront<br />
de quelle façon se fait ce changement, nous<br />
aurons tendance à devenir beaucoup moins<br />
frustrés les uns par rapport aux autres.<br />
2. Si nous, entendants <strong>et</strong> malentendants,<br />
comprenons ce qui est réellement en train de se<br />
passer avec l'usage que nous faisons des mots<br />
suite à la perte de l'ouïe, nous serons dans une<br />
meilleure position pour faire un usage plus efficace<br />
de ces mots.<br />
La substance de ces idées est issue de mon expérience<br />
personnelle en tant que conseiller entendant en santé mentale<br />
qui essayait de comprendre pourquoi ce que je croyais être mes<br />
compétences cliniques "éprouvées" semblaient devenir<br />
inefficaces lorsque je conseillais une personne ayant une perte<br />
auditive. J'étais incapable de comprendre pourquoi les<br />
compétences cliniques qui s’étaient avérées bien marcher dans<br />
le passé me faisaient présentement défaut, <strong>et</strong> faisaient donc<br />
défaut au client ou à la cliente. Finalement, il m'apparut que le<br />
problème ne se situait peut-être pas du côté des techniques de<br />
counselling, mais plutôt du côté du processus de communication<br />
entre moi-même <strong>et</strong> le client ou la cliente. Même si le client <strong>et</strong><br />
moi nous nous entendions bien évidemment, même si nous<br />
sentions que la relation client/thérapeute <strong>et</strong> la confiance étaient<br />
établies, même si nous voulions poursuivre le processus, à un<br />
certain moment, les communications étaient coupées. Je ne<br />
savais plus quel était le point focal des préoccupations du client/<br />
de la cliente. Ma seule option était d'explorer le processus de<br />
communication. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces<br />
situations particulières, mais je dirai que la recherche dans ce<br />
domaine m'a mené à certaines observations pertinentes<br />
concernant la communication avec les personnes<br />
malentendantes. C'est de cela que j'aimerais vous entr<strong>et</strong>enir<br />
aujourd'hui. Je devrais ajouter que, aux toutes premières<br />
étapes de c<strong>et</strong>te entreprise, j'ai présenté ces idées a un groupe<br />
de couples où l'un des partenaires était en train de subir une<br />
perte de l'ouïe <strong>et</strong> que, bien qu'à ce moment-là peu de recherche<br />
ait été complétée, ils ont tous confirmé mes observations quant<br />
aux raisons pour lesquelles la rupture des communications<br />
faisait écho à leur expérience. Cela m'a convaincu d'étendre<br />
mes observations à la perte auditive progressive <strong>et</strong> tardive,<br />
ainsi qu'à l'apparition précoce de la surdité.<br />
Une partie de ce que je vais présenter à ce point-ci peut<br />
sembler technique <strong>et</strong> scientifique, mais ne laissez pas c<strong>et</strong>te<br />
impression vous déranger. L'intention est de montrer qu'il y a<br />
une recherche scientifique qui soutient ce que je dis <strong>et</strong> je vais<br />
tenter de présenter c<strong>et</strong>te information d'une façon telle qu'elle<br />
s'accumule pour former le contenu le plus important, la<br />
compréhension pratique qui facilitera la communication de tous<br />
les jours.
La perte auditive a un impact dramatique sur la communication<br />
verbale quotidienne entre les individus, que ce soit dans le<br />
contexte de la vie familiale, du milieu de travail ou des relations<br />
sociales. Il est important de comprendre comment la<br />
communication est affectée par la perte auditive si nous voulons<br />
trouver des façons de réduire les frustrations de toutes les<br />
parties en cause. Lorsque nous comprenons pourquoi la<br />
communication est coupée, nous pouvons compenser c<strong>et</strong>te<br />
perte <strong>et</strong> réduire la frustration que tous éprouvent de ce fait.<br />
Ceci dit, examinons des exemples concr<strong>et</strong>s de ce processus de<br />
communication. J'ai essayé de développer des exemples visuels<br />
des changements qui surviennent dans le processus de<br />
communication suite à la perte de l'ouïe <strong>et</strong> l'impact de ce<br />
changement sur le processus de la pensée. Examinons une<br />
phrase qui serait tout à fait normale <strong>et</strong> acceptable dans la<br />
plupart des conversations entre deux entendants.<br />
Hier, j’ai rencontré ma soeur qui m’a dit qu’elle<br />
rentrait de la Toscane où elle avait fait un voyage<br />
fantastique.<br />
Qu'arrive t il à c<strong>et</strong>te phrase lorsque l'auditeur connaît une perte<br />
auditive ? Si la perte auditive est minime, 1'auditeur peut<br />
manquer quelques mots <strong>et</strong> entendre quelque chose comme<br />
ceci :<br />
elle a mon frère lui il<br />
Hongrie il<br />
Hier, j’ ai rencontré ma soeur qui m’<br />
a dit qu’ elle rentrait de la Toscane où elle<br />
avait fait un voyage fantastique.<br />
C'est-à-dire, que pour un certain nombre de mots exprimés, la<br />
personne qui a une perte auditive devra décider entre un<br />
certain nombre de possibilités avant d'en arriver à une<br />
conclusion concernant le sens réel de ce qui a été exprimé.<br />
Au fur <strong>et</strong> à mesure que la perte auditive progresse, le nombre<br />
de mots qui peuvent être mal compris augmente, pour créer un<br />
eff<strong>et</strong> semblable à ceci :<br />
elle a mon frère lui il<br />
Hongrie il<br />
Alors, tu as mère t’<br />
as ils Norvège ils vu<br />
film affreux<br />
Hier, j’ ai rencontré ma<br />
soeur qui m’ a dit qu’ elle rentrait de la<br />
Toscane où elle avait fait un voyage<br />
fantastique.<br />
Lundi, ils ont mes<br />
cousins leur ont ils<br />
rentraient du Maroc ils vécu
drame épeurant.<br />
nous avons mon<br />
copain nous il Br<strong>et</strong>agne<br />
Une première observation s'impose devant ces exemples. Les<br />
entendants communiquent d'une façon linéaire. La personne qui<br />
subit une perte de l'ouïe vit un changement dans le processus<br />
de communication qui laisse des trous ou des blancs dans le<br />
contenu exprimé par le processus linéaire. À mesure que la<br />
perte auditive progresse, la communication devient moins<br />
linéaire. Là où, dans la “phrase d'entendant", tous les éléments<br />
sont présentés d'une façon linéaire, dans une telle mesure<br />
qu'on peut ordinairement prédire la fin de la phrase avant de<br />
l'avoir entendue, lorsqu'il y a perte auditive, certains des<br />
éléments sont perdus, <strong>et</strong> l'auditeur doit composer avec une<br />
information partielle. L'aspect linéaire est perdu <strong>et</strong> la personne<br />
qui a une perte auditive doit commencer à improviser, à<br />
composer avec un nombre de variables qui pourraient convenir<br />
au contexte <strong>et</strong> y avoir un sens grammatical. Toutefois, ces<br />
variables peuvent être très différentes de ce qui s'est réellement<br />
dit <strong>et</strong> mener à des contresens importants.<br />
Les diapositives qui suivent vont démontrer quelques-unes des<br />
diverses options que la personne ayant une perte auditive peut<br />
être amenée à considérer avant de faire une "supposition<br />
informée" concernant ce qui s'est réellement dit <strong>et</strong> de<br />
commencer à formuler une réponse. Si la compréhension d'un<br />
seul des éléments primaires est erronée, la personne ayant une<br />
perte auditive risque de se trouver dans un grand embarras.<br />
Une seconde observation est de mise ici. Il est important, tant<br />
pour l'entendant que pour le malentendant, de comprendre que<br />
ce phénomène ralentit le processus de communication. Alors<br />
qu'une personne entendante peut ordinairement être<br />
raisonnablement certaine de la conclusion de la phrase bien<br />
avant que celle-ci ne soit entièrement exprimée, le<br />
malentendant doit attendre que son interlocuteur ait fini de<br />
parler avant d'essayer de rassembler les pièces tout en<br />
espérant avoir fait les bonnes suppositions. Il peut ne s'agir que<br />
de quelques secondes, mais c'est quand même<br />
considérablement plus de temps que ce dont une personne<br />
entendante a besoin pour traiter la même information. Ce n'est<br />
qu'à ce moment là que la personne malentendante est en<br />
mesure de commencer à formuler une réponse. Rendu là, il est<br />
probable que la personne entendante est devenue frustrée du<br />
manque de réponse ou qu'elle soit passée à la formulation d'une<br />
nouvelle idée. Il se peut fort bien que la personne entendante<br />
ait le sentiment que l'autre n'est tout simplement pas intéressée<br />
<strong>et</strong> abandonne la partie par frustration. Par ailleurs, la personne<br />
malentendante se sentira frustrée <strong>et</strong> stupide. Le résultat est une<br />
rupture des communications <strong>et</strong> un isolement mutuel des deux<br />
parties, même si l'une <strong>et</strong> l'autre savent très bien qu'elles<br />
partagent une compréhension <strong>et</strong> une relation positive.<br />
Il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui<br />
suggèrent l'idée que ce changement dans le mode de<br />
communication n'est pas seulement dû aux changements dans<br />
la quantité d'information perçue, mais également dans la façon<br />
dont le cerveau traite en réalité c<strong>et</strong>te information. Ces études
suggèrent que, à mesure que la perte auditive progresse <strong>et</strong> que<br />
la perception <strong>et</strong> l'expression du langage est affectée, il se<br />
produit des changements dans la partie du cerveau qui traite<br />
l'information. Il faudra poursuivre les recherches, mais certaines<br />
études neurologiques indiquent que, lorsque la perception du<br />
langage change, la partie du cerveau qui traite c<strong>et</strong>te information<br />
change aussi. II semblerait que le traitement de l'information<br />
linguistique passe de la partie du cerveau qui traite l'information<br />
auditive à celle qui traite l'information visuelle.<br />
Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que, dans la<br />
communication, on se sert plus des yeux pour la lecture labiale<br />
<strong>et</strong> la langue des signes, par exemple, que des oreilles. L'aspect<br />
important de c<strong>et</strong>te information est que les problèmes de<br />
communication qui se produisent ne sont pas le résultat d'une<br />
mauvaise volonté de la part de l'orateur ou de l'auditeur. Ils<br />
sont dus en grande partie aux changement dans la façon dont le<br />
corps <strong>et</strong> le cerveau traitent c<strong>et</strong>te information. Ce n'est pas une<br />
question de choix ou de caprice, c'est une question de<br />
changements physiologiques qui se produisent dans le corps,<br />
principalement à l'intérieur du cerveau, suite à la perte auditive.<br />
Si je dis principalement à l'intérieur du cerveau, c'est parce qu'il<br />
se produit également d'importants changements dans le<br />
langage corporel. Nous, en tant qu'entendants qui ne sommes<br />
pas nécessairement des travailleurs sociaux, sous-estimons<br />
l'importance de ce qui est communiqué par le langage corporel.<br />
Nous pouvons donc être moins enclins à percevoir le langage<br />
corporel des autres <strong>et</strong> aussi moins enclins a faire le meilleur<br />
usage de notre propre langage corporel.<br />
J'espère que ces illustrations vous aident à comprendre ce qui<br />
arrive à la communication entre une personne entendante <strong>et</strong><br />
une personne qui subit une perte auditive. Le facteur le plus<br />
important à se rappeler est qu'aucune de ces personnes n'est<br />
fautive. Ce fait est important à noter parce que les deux,<br />
l'entendant <strong>et</strong> le malentendant, faute de comprendre la<br />
situation, peuvent facilement accumuler des sentiments de<br />
frustration <strong>et</strong> de ressentiment envers l'autre. C'est la principale<br />
raison pour laquelle la perte de l'ouïe peut détruire des relations<br />
qui ont été sincères, attentives <strong>et</strong> de longue durée.<br />
À part les aspects linéaire <strong>et</strong> non linéaire de la communication,<br />
nous devons également explorer le concept du contexte de la<br />
communication. C'est-à-dire que la communication peut se<br />
passer dans un contexte riche <strong>et</strong> dans un contexte pauvre.<br />
Qu'est-ce que cela veut dire? Je me réfère à E.T. Hall <strong>et</strong> à ce<br />
qu'il écrit dans « Beyond Culture ». Il étudie la communication à<br />
contexte riche <strong>et</strong> à contexte pauvre entre les personnes.<br />
Perm<strong>et</strong>tez-moi d'essayer d'expliquer la différence. Dans la<br />
communication à contexte riche, toute ou presque toute<br />
l'information pertinente à l'énoncé est exprimée avec les mots<br />
qui sont dits. La combinaison des mots exprimés <strong>et</strong> entendus<br />
contient toute l'information nécessaire au succès de la<br />
communication. Dans la communication à contexte pauvre, une<br />
grande part de l'information est implicite <strong>et</strong> pas nécessairement<br />
exprimée sous la forme de mots énoncés. C'est ce qui se passe<br />
dans la phrase montrée plus haut. Bien que le locuteur ait inclus<br />
tout le contexte requis pour la communication, l'auditeur, étant<br />
malentendant, n'a capté qu'une partie de c<strong>et</strong>te information. Le<br />
contexte devient alors implicite <strong>et</strong> 1'auditeur doit imaginer,
supposer, deviner une importante partie de l'information afin de<br />
comprendre la communication dans son détail.<br />
À ce point-ci, j'aimerais utiliser des exemples tirés de l'art<br />
pictural pour démontrer visuellement ce que je veux dire. Je<br />
dois adm<strong>et</strong>tre que j'ai choisi des oeuvre qui illustrent clairement<br />
mon argument <strong>et</strong> que d'autres oeuvres peuvent ne pas<br />
démontrer aussi clairement mon point. Dans la peinture de De<br />
Chirico, un artiste dans la tradition occidentale, nous pouvons<br />
facilement voir que la peinture est une narration <strong>et</strong> que tous les<br />
aspects pertinents de l'image sont présents dans le cadre de la<br />
peinture. Dans l'oeuvre de l'artiste oriental You Wan-shan,<br />
l'aspect narratif est beaucoup moins évident <strong>et</strong> même, en ce qui<br />
a trait au contexte physique, nous notons que la plus grande<br />
partie des détails n'ont pas été peints à l'intérieur des limites de<br />
l'image. On nous donne quelques détails saillants <strong>et</strong> on nous<br />
laisse imaginer le reste. Et l'image n'en est pas moins<br />
complète!!! Seulement, elle n'est pas dite mot à mot. Nous,<br />
même comme occidentaux, pouvons nous identifier à l'image <strong>et</strong><br />
comprendre ce que l'artiste a voulu exprimer.<br />
Un autre aspect qui demande qu'on s'y arrête, c'est celui selon<br />
lequel, en tant qu'entendants, nous soyons habitués à recevoir<br />
toute l'information en contexte. Il en résulte que nous avons<br />
perdu notre aptitude à utiliser l'intuition <strong>et</strong> le langage corporel<br />
comme un moyen de communication. Je crois que les personnes<br />
qui ont connu une perte auditive doivent automatiquement<br />
apprendre à re-développer ces aptitudes <strong>et</strong> à s'y fier. Il se peut<br />
que ces tentatives ne soient pas infaillibles, mais elles<br />
contiennent certainement une composante importante du<br />
processus de communication.<br />
Lorsqu'une personne souffre d'une perte auditive, une grande<br />
partie de l'information transmise par la parole est perdue <strong>et</strong> la<br />
personne doit se fier sur une information implicite ou déduite.<br />
C'est le besoin de choisir entre les différentes possibilités des<br />
mots telles que montrées plus haut avec les phrases utilisées<br />
comme exemples.<br />
Comme vous pouvez le voir, le non linéaire <strong>et</strong> le contexte riche/<br />
pauvre sont très étroitement reliés. Lorsque quelqu'un perd<br />
l'ouïe, il doit composer avec un nombre plus restreint<br />
d'éléments de la conversation. Cela force la personne à<br />
abandonner le processus de communication linéaire <strong>et</strong> à<br />
s'adapter à une façon non linéaire de communiquer.<br />
Simultanément, l'individu qui a une perte auditive doit aussi<br />
ajuster la façon selon laquelle l'information est entreposée <strong>et</strong><br />
traitée. Il doit toujours y avoir une opportunité de substituer un<br />
détail d'information à un autre qui peut être une variante très<br />
subtile sur le thème de base, mais qui peut avoir un impact<br />
majeur sur la communication fondamentale.<br />
En toute justice, nous devrions aussi essayer de comprendre<br />
c<strong>et</strong>te situation du point de vue de l'entendant: 1'époux/épouse,<br />
1'enfant, 1'ami/e ou le/la collègue. La personne entendante vit<br />
aussi une frustration face à la rupture de communication avec<br />
une personne qui est un parent cher, un ami ou un collègue.<br />
C<strong>et</strong>te frustration est tout aussi réelle que celle que connaît la<br />
personne qui subit la perte de 1'ouïe. Il est difficile d'imaginer<br />
que l'autre, la personne entendante, rumine les pensées
suivantes : "Je suis frustré d'essayer de communiquer avec toi.<br />
Je n'ai rien fait de mal. J'entends. Je peux communiquer.<br />
J'essaie. C'est toi qui a un problème Pourquoi devais-je me<br />
sentir mal parce que je suis normal ? Comment pourrais-je<br />
savoir quoi faire d'une façon différente ? C'est toi qui a changé."<br />
C'est un point de vue valide.<br />
Toutefois, nous devons tous nous rappeler que l'époux/épouse<br />
ou le/la collègue entendant/e doit faire face à un problème de<br />
communication avec une seule personne, tandis que la<br />
personne qui subit une perte auditive a ce problème avec tous<br />
les gens qu'elle connaît. La personne qui subit une perte<br />
auditive est également aux prises avec tous les problèmes de la<br />
perte <strong>et</strong> du deuil. Tant que quelqu'un n'a pas connu la perte, il a<br />
probablement cru tous les concepts généralement acceptés<br />
voulant qu'un handicap soit une déficience. Comment alors<br />
concilier ces concepts bien ancrés <strong>et</strong> le fait qu'ils s'appliquent<br />
maintenant à moi ? Je suis devenu déficient. Je suis devenu une<br />
personne diminuée. C'est donc ma responsabilité, ma faute.<br />
Logiquement, <strong>et</strong> dans un environnement politiquement correct,<br />
nous savons tous que ces énoncés sont terriblement faux, que<br />
les deux points de vue présentés ci-dessous sont terriblement<br />
erronés. Mais encore, en introspection sérieuse, nous savons<br />
tous que ce sont ces concepts qui ont préséance en dedans de<br />
nous, quelle que soit la force avec laquelle nous essayons de<br />
prendre nos distances vis-à-vis ces sentiments.<br />
Je crois qu' il ne sera jamais possible de se débarrasser de ces<br />
sentiments. ils sont réels <strong>et</strong> ils sont légitimes. Ils deviennent<br />
seulement frustrants <strong>et</strong> troublants lorsqu'on ne les comprend<br />
pas. Et les comprendre ne veut pas dire les supprimer ou les<br />
éliminer. Les comprendre veut dire, d'abord <strong>et</strong> avant tout, en<br />
être conscients. Ça veut dire aussi les accepter comme<br />
légitimes <strong>et</strong> acceptables. Personne n'est à blâmer. Personne<br />
n'est le truand. Ce sont là des sentiments légitimes qui<br />
surgissent d'une situation inattendue <strong>et</strong> incomprise.<br />
Malheureusement, il se produit habituellement un nombre<br />
considérable de douleurs <strong>et</strong> de frustration avant que les parties<br />
ne commencent à comprendre qu'il y a une explication physique<br />
derrière tout ça.<br />
Comment faire pour créer une sensibilisation qui aiderait à<br />
comprendre la situation avant que de tels sentiments ne se<br />
développent ? Et, une fois que nous comprenons la nature du<br />
problème, comment y remédier, renverser l'eff<strong>et</strong> de la douleur<br />
<strong>et</strong> de l'incompréhension qui se sont déjà produites ? On doit<br />
réfléchir à rebours sur la situation qui a créé le stress <strong>et</strong> essayer<br />
de comprendre ce qui s'est passé, mais dans le contexte de la<br />
nouvelle compréhension. Il devrait alors être relativement facile<br />
de pardonner <strong>et</strong> d'oublier, d'ouvrir la porte à une nouvelle<br />
communication complémentaire <strong>et</strong> à l'acceptation de soi.<br />
Je réalise que je n'ai pas offert de solution aux défis de<br />
communication auxquels les gens doivent faire face suite à une<br />
perte de l'ouïe. J'espère que j'ai pu vous aider à mieux<br />
comprendre ce qui se produit dans le processus <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te<br />
compréhension aidera à réduire une partie de la frustration <strong>et</strong><br />
des autres sentiments négatifs qui résultent du défi proposé par<br />
une perte auditive.
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
L’accès à la justice pour les<br />
Canadiens malentendants ou<br />
sourds (1)<br />
Par : Carole Willans-Théberge (2)<br />
Le Contexte<br />
Partie 1 – Le Système Juridique Canadien<br />
Partie 2 – Au Palais De Justice Et Dans La Salle D’audience :<br />
Les Aménagements Pour Les Personnes Malentendantes,<br />
Devenues Sourdes Ou Sourdes<br />
Dispositifs facilitant l’écoute<br />
Interprétation écrite<br />
Interprétation gestuelle<br />
Interprétation orale<br />
Éclairage<br />
Acoustique<br />
Disposition des sièges<br />
Système d’information publique visuelle<br />
Systèmes d’alarme<br />
Signalisation<br />
Téléphones <strong>et</strong> téléscripteurs<br />
Les obstacles comportementaux<br />
Un coordonnateur des aménagements pour personnes<br />
handicapées<br />
Les environnements connexes<br />
Accès À La Justice Pour Tous Les Canadiens Et<br />
Canadiennes<br />
Annexe – Bibliographie<br />
Notes<br />
Le Contexte<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Dans c<strong>et</strong> exposé en deux parties, j’examine le système<br />
juridique canadien <strong>et</strong> les questions d’accès à la justice<br />
des personnes malentendantes, devenues sourdes ou<br />
sourdes. La première partie contient une description<br />
concise du système juridique, notamment un aperçu de<br />
quelques textes législatifs pertinents. Dans la deuxième<br />
partie, je donne les grandes lignes des aménagements<br />
pratiques qui peuvent être mis en œuvre dans les palais<br />
de justice en général, <strong>et</strong> aussi plus précisément dans les<br />
salles d’audience.<br />
Partie 1 – Le Système Juridique<br />
Canadien<br />
Le droit est un ensemble de règles destinées à protéger à<br />
la fois la société <strong>et</strong> les droits des particuliers, d’une<br />
manière juste <strong>et</strong> équitable. On peut diviser ces règles en<br />
deux grandes catégories : le droit privé <strong>et</strong> le droit public.<br />
Le droit privé m<strong>et</strong> l’accent sur le règlement des<br />
différends entre particuliers, ou groupes de particuliers<br />
(par ex., une personne en poursuit une autre <strong>et</strong> demande<br />
des dommages intérêts, ou un conjoint s’adresse au<br />
tribunal pour demander le divorce). Le droit public a trait<br />
aux questions qui touchent la société dans son ensemble<br />
– comme le droit pénal, le droit constitutionnel ou le droit<br />
administratif.<br />
J<strong>et</strong>ons d’abord un coup d’œil rapide sur le système de<br />
droit privé au <strong>Canada</strong>. En vertu de la Loi constitutionnelle<br />
de 1982 (3) , chaque province canadienne adopte ses<br />
propres règles de droit privé, tant de fond que de<br />
procédure. Dans ce domaine, le système juridique varie<br />
donc d’une province à l’autre, tout comme les modalités<br />
d’accès aux palais de justice. De plus, le caractère privé<br />
des différends (entre particuliers ou groupes de<br />
particuliers) signifie que l’État n’est pas directement<br />
concerné par les questions d’aménagement des salles<br />
d’audience dans les causes de droit privé, <strong>et</strong> qu’il n’a ni le<br />
devoir ni le droit d’intervenir à c<strong>et</strong> égard. Comme tous les<br />
autres Canadiens, les personnes handicapées peuvent<br />
avoir droit à l’aide juridique provinciale, mais seulement<br />
si leurs revenus le justifient. Sinon, si une personne a<br />
besoin de mesures spéciales pour être en mesure de<br />
participer à l’audition d’une cause civile, il s’agit de frais<br />
supplémentaires qu’elle doit assumer. En droit privé, la<br />
loi des provinces ne contient, en général, pas de<br />
disposition ayant trait aux frais d’accès à la justice. Le<br />
principe fondamental est que la partie à une poursuite<br />
civile est responsable de ses propres frais. Cependant, la<br />
partie qui a gain de cause peut demander le<br />
remboursement par la partie adverse des frais d’accès<br />
(au même moment qu’elle demande le remboursement<br />
de ses frais judiciaires généraux). C’est au tribunal ou au<br />
greffier qu’il revient, le cas échéant, d’ordonner ce<br />
remboursement.<br />
Dans le domaine du droit public, penchons-nous surtout<br />
sur le droit pénal. Dans les causes pénales s’affrontent un<br />
défendeur (c’est-à-dire un accusé), dont on prétend qu’il<br />
a commis une infraction, <strong>et</strong> la Reine (c’est-à-dire l’État).
La Loi constitutionnelle de 1982 (4) confère au législateur<br />
fédéral la compétence de fond en matière de droit<br />
criminel. Les infractions pénales sont donc les mêmes<br />
dans tout le <strong>Canada</strong>. Le Code criminel (5) <strong>et</strong> la Loi sur la<br />
preuve au <strong>Canada</strong> (6) constituent deux exemples<br />
importants de lois criminelles qui sont applicables dans<br />
tout le pays. La Constitution canadienne confère aux<br />
provinces la compétence en matière d’administration de<br />
la justice. En d’autres termes, par exemple, l’organisation<br />
des procès, les palais de justice <strong>et</strong> la répression des<br />
infractions par les forces de l’ordre relèvent<br />
généralement de la responsabilité du gouvernement des<br />
provinces.<br />
En 1982, la Charte canadienne des droits <strong>et</strong> libertés (7) est<br />
entrée en vigueur; entre autres choses, elle a confirmé<br />
que, en droit pénal, l’accusé a droit à un procès équitable<br />
<strong>et</strong> à une défense pleine <strong>et</strong> entière. (8) La personne<br />
accusée d’une infraction pénale prévue par la loi fédérale<br />
a donc un droit d’accès à la justice garanti par la<br />
Constitution. C’est la responsabilité de l’État d’assurer au<br />
justiciable c<strong>et</strong> accès. En pratique, c’est le procureur de la<br />
Couronne qui exerce c<strong>et</strong>te responsabilité. Ce droit<br />
d’accès à la justice garanti par la Charte dans la salle<br />
d’audience n’est applicable qu’à l’accusé. Il ne s’étend,<br />
par exemple, ni aux témoins, ni aux jurés, ni aux juges,<br />
ni aux avocats plaidants, ni à personne d’autre. L’article<br />
14 de la Charte prévoit une exception : le témoin qui est<br />
sourd a droit à l’assistance d’un interprète. Ceci signifie<br />
que tout témoin qui est sourd (qu’il s’agisse de l’accusé<br />
ou non) a le droit d’avoir un interprète gestuel. Il serait<br />
possible de soutenir que ce droit, de nature<br />
constitutionnelle, englobe l’accès à d’autres formes<br />
d’interprétation, comme le sous-titrage en temps réel de<br />
l'audience, mais c<strong>et</strong>te thèse semble n’avoir jamais été<br />
plaidée.<br />
En fin de compte, le ministère fédéral de la Justice a<br />
conclu que l’on pouvait améliorer les règles juridiques de<br />
fond afin de rendre la justice pénale plus accessible aux<br />
personnes handicapées, ce qui a mené à une proposition<br />
de réforme du droit pénal qui a pris la forme du proj<strong>et</strong> de<br />
loi S-5. Il a été adopté par le législateur fédéral en 1998.<br />
(9)<br />
À bien des égards, ces modifications à la justice pénale<br />
ont amélioré la situation des personnes qui sont<br />
malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.<br />
L’article 6 de la Loi sur la preuve au <strong>Canada</strong> a été<br />
modifié : le témoin dans une cause pénale (y compris la<br />
victime) a dorénavant le droit de déposer de telle<br />
manière que son témoignage puisse être intelligible. Ceci<br />
signifie que si le témoin est malentendant, il doit avoir<br />
notamment accès, lorsqu’il dépose, à des dispositifs<br />
facilitant l’écoute ou à des services d’interprétation orale,<br />
de sous-titrage en temps réel ou d’interprétation<br />
gestuelle. C<strong>et</strong> accès doit être assuré aux frais de la
Couronne (c’est-à-dire de l’État).<br />
La Loi sur la preuve au <strong>Canada</strong> est une loi fédérale. Elle<br />
n’est applicable que lorsque le tribunal applique les lois<br />
fédérales. Par exemple, elle n’est pas applicable<br />
lorsqu’une personne conteste une contravention de<br />
stationnement en cour municipale.<br />
Le proj<strong>et</strong> de loi S-5 a aussi modifié plusieurs dispositions<br />
du Code criminel (10) pour que les personnes handicapées<br />
puissent servir plus facilement en qualité de jurés. Le<br />
Code criminel prévoit maintenant qu’une déficience<br />
physique (comme la déficience auditive) ne constitue<br />
pas, en général, un motif de récusation, si l’intéressé est<br />
capable de servir sur le jury en recevant une assistance.<br />
(11)<br />
Des modifications connexes ont trait à la présence,<br />
dans la salle de délibérations du jury, d’une personne<br />
assistant un juré (par ex., d’un interprète gestuel ou d’un<br />
opérateur d’un système de sous-titrage en temps réel);<br />
bien entendu, l’interprète, ou tout autre intervenant, a<br />
l’obligation de ne pas divulguer les délibérations du jury<br />
<strong>et</strong> de ne pas s’y immiscer, ou d’influencer les jurés.<br />
Le texte du proj<strong>et</strong> de loi S-5 contenait de nombreuses<br />
autres modifications législatives profitant aux Canadiens<br />
<strong>et</strong> Canadiennes handicapés. On a donné ici les grandes<br />
lignes des dispositions qui touchent directement les<br />
personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes<br />
ou sourdes.<br />
Contrairement à ce qui se passe en droit privé (où les<br />
parties assument le risque des frais découlant des<br />
aménagements spéciaux, sauf si elles sont éligibles à<br />
l’aide juridique), en droit pénal, la Couronne (c’est-à-dire<br />
l’État) est tenue de couvrir les frais découlant de l’accès<br />
au tribunal du défendeur (c’est-à-dire de l’accusé), des<br />
témoins (notamment de la victime), ou des jurés.<br />
Cependant, même en ce qui concerne la justice pénale,<br />
l’obligation de l’État de faire des aménagements spéciaux<br />
se limite à la salle d’audience. Par exemple, les<br />
conférences avec les avocats en dehors de la salle<br />
d’audience ne relèvent pas de la responsabilité de la<br />
Couronne. Ceci dit, les personnes admissibles à un<br />
programme d’aide juridique provincial peuvent à<br />
l’occasion obtenir une couverture de leurs besoins en<br />
matière d’accessibilité à l’extérieur de la salle<br />
d’audience; tout dépend de ce qui est prévu au<br />
programme applicable.<br />
La Cour d’appel du Manitoba (12) a refusé d’élargir<br />
l’application de l’article 14 de la Charte (c’est-à-dire celui<br />
qui garantit, dans toute procédure, le droit à l’assistance<br />
d’un interprète gestuel aux parties ou aux témoins qui<br />
sont sourds) à l’assistance d’un interprète gestuel afin de<br />
perm<strong>et</strong>tre à l’accusé de communiquer avec son avocat.<br />
Cependant, le même tribunal a laissé entendre que, dans<br />
certains cas, le droit à un interprète gestuel pour<br />
communiquer avec un avocat à l’extérieur de la salle<br />
d’audience pouvait éventuellement constituer un aspect
du droit à l’assistance d’un avocat, du droit à un procès<br />
équitable ou du droit à une défense pleine <strong>et</strong> entière.<br />
Notre analyse du droit canadien ayant trait aux<br />
personnes handicapées, <strong>et</strong> de son incidence sur les<br />
personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes<br />
ou sourdes ne serait pas complète si nous ne<br />
mentionnons pas la décision de la Cour suprême du<br />
<strong>Canada</strong>, Eldridge c. Procureur général de la Colombie-<br />
Britannique. (13) Il s’agit d’un arrêt de principe touchant<br />
les droits de la personne au <strong>Canada</strong>, <strong>et</strong> notamment les<br />
droits des personnes ayant une déficience auditive. Le<br />
plus haut tribunal du pays a ouvert une porte aux<br />
personnes ayant une déficience auditive dans le domaine<br />
de la santé en reconnaissant le droit des patients qui sont<br />
sourds à l’assistance d’interprètes gestuels dont les<br />
services sont financés publiquement, en milieu<br />
hospitalier. La Cour a avalisé la thèse suivante : ne pas<br />
fournir aux personnes qui sont sourdes l’assistance<br />
d’interprètes gestuels lorsqu’ils reçoivent des soins<br />
médicaux constitue une atteinte au droit à l’égalité<br />
protégé par l’article 15 de la Charte. (14) C<strong>et</strong> arrêt pourrait<br />
éventuellement avoir une incidence sur les domaines de<br />
l’éducation, de l’emploi, <strong>et</strong> sur d’autres éléments de la vie<br />
quotidienne.<br />
Partie 2 – Au Palais De Justice Et<br />
Dans La Salle D’audience : Les<br />
Aménagements Pour Les Personnes<br />
Malentendantes, Devenues Sourdes Ou<br />
Sourdes (15)<br />
La deuxième partie de c<strong>et</strong>te présentation traite des<br />
aménagements nécessaires devant les tribunaux pour les<br />
personnes malentendantes, devenues sourdes ou<br />
sourdes. Plusieurs des éléments mentionnés s’appliquent<br />
également dans des contextes parallèles au système<br />
judiciaire canadien, incluant la mise en œuvre de la loi,<br />
l’aide aux victimes <strong>et</strong> aux témoins <strong>et</strong> les cabin<strong>et</strong>s<br />
d’avocat. Cependant il n’est pas possible de traiter tous<br />
ces contextes au cours de c<strong>et</strong>te présentation.<br />
Plus de trois millions de Canadiens ont une déficience<br />
auditive. Cela signifie que dans chaque salle d’audience,<br />
il existe une possibilité réelle qu’au moins une personne<br />
(p. ex. juge, greffier, huissier, demandeur, défendeur,<br />
avocat, juré, témoin) ait une déficience auditive.<br />
C<strong>et</strong>te présentation présente une grande diversité<br />
d’aménagements. Cependant il faut tenir compte que<br />
répondre à des besoins en c<strong>et</strong>te matière exige une<br />
grande flexibilité, car il n’existe pas de solution « à taille<br />
unique ». Par exemple, les personnes possédant une<br />
audition résiduelle suffisante peuvent préférer les<br />
dispositifs facilitant l’écoute, alors que les personnes<br />
devenues sourdes, les personnes ayant un implant<br />
cochléaire <strong>et</strong> les personnes sourdes oralistes peuvent<br />
préférer un aménagement lié à l’interprétation écrite (p.
ex. le sous-titrage instantané). Les personnes sourdes<br />
vont rechercher de l’interprétation gestuelle. De plus, les<br />
personnes ayant de l’acouphène (bruit perçu dans la tête<br />
qui peut être accompagné d’une déficience auditive ou<br />
non) ont aussi des besoins particuliers. Dans tous les cas,<br />
la personne qui est malentendante, devenue sourde ou<br />
sourde est la personne qui connaît le mieux ses propres<br />
besoins.<br />
Les palais de justice présentent souvent des obstacles<br />
physiques qui créent inutilement des problèmes pour les<br />
personnes malentendantes, devenues sourdes ou<br />
sourdes. Voici quelques exemples :<br />
1. mauvais éclairage qui nuit à la lecture labiale<br />
correcte (p. ex. obscurité, éblouissement ou<br />
éclairage inégal)<br />
2. téléphones publics dépourvus d’amplificateur de<br />
volume <strong>et</strong> de télécapteur <strong>et</strong> non installés dans une<br />
cabine fermée<br />
3. absence de tout ATS (appareil téléscripteur) [un<br />
dispositif qui perm<strong>et</strong> aux personnes avec une<br />
déficience auditive profonde d’utiliser le téléphone<br />
au moyen de texte tapé qui est transmis par ligne<br />
téléphonique]<br />
4. banc des jurés placé dans un angle qui ne perm<strong>et</strong><br />
pas au juré malentendant de voir le juge, le témoin<br />
<strong>et</strong> les avocats<br />
5. acoustique de mauvaise qualité qui crée de l’écho,<br />
qui empêche le son de se propager suffisamment<br />
dans la salle d’audience ou qui génère des bruits de<br />
fond<br />
6. manque de moyens de remplacement pour obtenir<br />
l’information transmise sur un système d’annonces<br />
publiques verbales<br />
7. manque de dispositifs facilitant l’écoute (p. ex.<br />
système MF ou système à infrarouge)<br />
8. absence de service de sous-titrage instantané<br />
9. panneaux indicateurs inexistants ou inappropriés<br />
On doit faire remarquer que le coût d’intégration des<br />
caractéristiques d’accès répondant aux besoins des<br />
personnes ayant n’importe quel type de déficience (p. ex.<br />
auditive, visuelle, motrice) dans la conception d’un<br />
nouveau palais de justice ou dans l’ajout d’un bâtiment<br />
est insignifiant par rapport au budg<strong>et</strong> global affecté aux<br />
coûts de construction. Toutefois, les dépenses pour<br />
assurer l’accès visant de multiples déficiences peuvent<br />
constituer un fardeau financier beaucoup plus sérieux<br />
lorsque des changements à la structure d’un palais de<br />
justice existant doivent être effectués.<br />
Dans le cas de la déficience auditive, les mesures<br />
d’accessibilité ne demandent généralement pas de<br />
changement de la structure <strong>et</strong> elles sont relativement<br />
peu coûteuses. Autre avantage, un grand nombre des<br />
caractéristiques conceptuelles requises pour satisfaire<br />
les besoins relatifs aux tribunaux des personnes ayant
une déficience auditive profitent à la plupart des<br />
personnes présentes au tribunal. Par exemple, des<br />
panneaux indicateurs clairs avec un l<strong>et</strong>trage en gros<br />
caractères <strong>et</strong> une acoustique appropriée dans la salle<br />
d’audience sont deux caractéristiques conceptuelles qui<br />
profitent à la plupart des personnes, qu’elles aient ou non<br />
une déficience auditive.<br />
Les aménagements<br />
Dispositifs facilitant l’écoute<br />
Il existe de nombreux types de dispositifs facilitant<br />
l’écoute. Un circuit fermé à induction, un système MF ou<br />
un système à infrarouge sont tous des dispositifs qui<br />
peuvent aider la personne malentendante à entendre plus<br />
clairement ce qui se dit pendant les procédures. Ces<br />
dispositifs font appel à des impulsions<br />
électromagnétiques, à des ondes radio ou à la lumière<br />
infrarouge pour transm<strong>et</strong>tre le son directement à<br />
l’appareil auditif, par le biais de son télécapteur. Le choix<br />
du matériel le plus approprié à une situation particulière<br />
dépend des spécifications <strong>et</strong> de l’acoustique de la salle,<br />
de l’utilisation visée <strong>et</strong> de la préférence de la personne<br />
malentendante. Les systèmes à infrarouge fonctionnent<br />
mieux, par exemple dans les situations où il y a peu de<br />
lumière solaire ou de mouvement de personnes. La<br />
plupart des dispositifs facilitant l’écoute nécessitent<br />
l’utilisation d’un récepteur. Dans ce cas, plusieurs<br />
récepteurs doivent être ach<strong>et</strong>és pour perm<strong>et</strong>tre à<br />
plusieurs personnes d’utiliser le système simultanément.<br />
De plus, on doit pouvoir choisir parmi plusieurs<br />
configurations (boucle de cou, silhou<strong>et</strong>te simple, double<br />
silhou<strong>et</strong>te <strong>et</strong> écouteurs) pour répondre aux besoins<br />
individuels <strong>et</strong> aux préférences. Certaines personnes<br />
malentendantes ne portent pas d’appareil auditif ou en<br />
portent un qui n’est pas équipé d’un télécapteur. Dans<br />
ces cas, un ensemble d’écouteurs est le seul dispositif<br />
utile <strong>et</strong> il conviendra seulement dans certains cas,<br />
notamment pour les personnes ayant une déficience<br />
auditive légère ou modérée.<br />
Tous les palais de justice devraient avoir au moins une<br />
salle d’audience équipée en permanence d’un dispositif<br />
facilitant l’écoute. L’accès à c<strong>et</strong>te salle serait accordé en<br />
priorité aux affaires auxquelles participe une personne<br />
malentendante.<br />
Interprétation écrite<br />
Il existe fondamentalement deux types<br />
d’interprétation écrite. La première est le sous-titrage<br />
instantané produit par un sténotypiste (habituellement<br />
un sténographe judiciaire) à l’aide d’un ordinateur<br />
portatif muni d’un logiciel spécialisé. (16) Le logiciel est<br />
conçu pour traduire les mots de leur forme phonétique<br />
tels que consignés par le sténotypiste dans leur forme<br />
écrite habituelle. La transcription textuelle des mots<br />
prononcés dans la salle d’audience est produite au
ythme de la parole (c’est-à-dire plus de 200 mots par<br />
minute). La personne malentendante lit simplement le<br />
texte à mesure qu’il est produit. Le sous-titrage<br />
instantané s’ajoute aux dispositifs facilitant l’écoute<br />
comme un des moyens les plus efficaces pour les<br />
personnes malentendantes ou devenues sourdes grâce à<br />
sa rapidité <strong>et</strong> à sa précision. Le sous-titrage instantané<br />
devient le moyen préféré de la plupart des personnes qui<br />
portent un implant cochléaire ou sont devenues sourdes.<br />
Il est relativement facile pour les sténographes<br />
judiciaires d’offrir ce service en même temps que les<br />
autres services qu’ils offrent déjà (une formation pour<br />
l’utilisation du logiciel spécialisé est nécessaire).<br />
L’Association des malentendants canadiens perfectionne<br />
un système de sous-titrage instantané à distance qui<br />
perm<strong>et</strong> aux sténotypistes d’offrir leurs services à<br />
distance.<br />
Le deuxième type d’interprétation écrite est la prise de<br />
notes informatisée. Un dactylographe utilise un clavier<br />
ordinaire <strong>et</strong> résume ce qui se dit au moyen d’abréviations<br />
<strong>et</strong> de paraphrases, à une cadence d’environ 60 à 100<br />
mots par minute (selon son habil<strong>et</strong>é). La prise de notes<br />
ne produit pas un texte compl<strong>et</strong> mais seulement un<br />
résumé des procédures telles qu’interprétées par le<br />
dactylographe; ainsi son utilisation ne convient pas à une<br />
salle d’audience. Toutefois, il peut s’avérer utile dans les<br />
situations où le débit de la parole peut être contrôlé plus<br />
facilement, par exemple au cours de consultations<br />
privées entre un avocat <strong>et</strong> un client.<br />
Pour le sous-titrage instantané <strong>et</strong> la prise de notes<br />
informatisée, un ordinateur portatif suffit lorsqu’il y a<br />
une seule personne voulant profiter de ce service.<br />
Lorsque le service doit être offert à plusieurs personnes,<br />
le texte doit être proj<strong>et</strong>é sur un grand écran que toutes<br />
les personnes présentes dans la salle d’audience peuvent<br />
voir.<br />
Un inconvénient de l’un ou l’autre type de service<br />
d’interprétation écrite est qu’il est souvent difficile de<br />
noter les expressions faciales <strong>et</strong> le langage corporel de<br />
l’intervenant en même temps qu’on regarde le texte sur<br />
l’écran. Pour de nombreuses personnes malentendantes,<br />
le meilleur moyen peut être une combinaison de soustitrage<br />
instantané <strong>et</strong> de dispositif facilitant l’écoute.<br />
Un aspect particulièrement épineux est de savoir qui doit<br />
assumer le coût des services d’interprétation écrite. La<br />
plupart des autres types d’aménagements nécessitent<br />
l’achat d’équipement ou un changement à<br />
l’environnement physique du palais de justice <strong>et</strong> n’ont<br />
aucun lien direct avec une affaire particulière; ces<br />
dépenses relèvent n<strong>et</strong>tement de l’autorité fédérale,<br />
provinciale ou municipale responsable du tribunal.<br />
Toutefois, en ce qui concerne l’interprétation, les services<br />
du sténotypiste, du dactylographe ou de l’interprète sont<br />
r<strong>et</strong>enus pour une seule affaire ou une seule audience<br />
clairement déterminée.
Dans les affaires civiles, le juge peut décider si les coûts<br />
d’aménagement font partie des frais de justice <strong>et</strong> peut<br />
ordonner que la partie perdante paye ces frais.<br />
Autrement, la personne qui a demandé les services devra<br />
les payer. De nombreuses personnes malentendantes ne<br />
peuvent pas se perm<strong>et</strong>tre de payer ces services. Pour<br />
c<strong>et</strong>te raison, elles peuvent choisir de ne pas entamer une<br />
poursuite judiciaire même si elles ont un droit légitime de<br />
le faire ou elles peuvent choisir d’accepter un règlement<br />
inadéquat.<br />
Dans les affaires criminelles où l’accusé, un témoin ou un<br />
juré a une déficience auditive <strong>et</strong> a besoin d’une<br />
interprétation écrite, gestuelle ou orale, ces services sont<br />
n<strong>et</strong>tement à la charge de l’État.<br />
Dans le cas des bénéficiaires de l’aide juridique, les<br />
services <strong>et</strong> les aménagements utilisés dans un contexte<br />
pertinent (p. ex. pour les communications au palais de<br />
justice ou entre le procureur <strong>et</strong> le client) devraient être<br />
couverts par le programme d’aide juridique provincial ou<br />
territorial. De même, les programmes d’assistance aux<br />
victimes <strong>et</strong> aux témoins devraient également couvrir ces<br />
services dans le contexte de leurs activités. Les<br />
programmes d’aide juridique <strong>et</strong> d’assistance aux victimes<br />
<strong>et</strong> aux témoins devraient obtenir un financement<br />
gouvernemental leur perm<strong>et</strong>tant de rendre ces services<br />
accessibles.<br />
Les tribunaux ainsi que les barreaux provinciaux <strong>et</strong><br />
territoriaux devraient envisager d’établir un fonds pour<br />
aider les personnes ayant une déficience auditive à<br />
accéder pleinement aux services nécessaires lorsque leur<br />
coût n’est pas couvert par un autre programme.<br />
La Cour canadienne de l’impôt a promulgué en septembre<br />
2000 une politique selon laquelle lorsqu’une personne,<br />
une partie, un témoin, un avocat ou un stagiaire<br />
malentendant, devenu sourd ou sourd comparaît devant<br />
le tribunal ou dans les cabin<strong>et</strong>s des juges, le registraire<br />
du palais de justice prendra des dispositions <strong>et</strong> payera<br />
les frais du sous-titrage instantané, d’un interprète<br />
gestuel ou d’un autre moyen reconnu pour répondre aux<br />
besoins des personnes malentendantes, devenues<br />
sourdes ou sourdes. (17) L’Association des malentendants<br />
canadiens recommande la promulgation d’une politique<br />
de c<strong>et</strong>te nature dans tout le système judiciaire canadien.<br />
Interprétation gestuelle<br />
L’article 14 de la Charte canadienne des droits <strong>et</strong><br />
libertés précise que toute partie <strong>et</strong> tout témoin qui ne<br />
peut suivre les procédures parce qu’ils « sont atteints de<br />
surdité » ont droit à l’assistance d’un interprète. Il en<br />
résulte que tout témoin sourd (qu’il soit l’accusé ou non)<br />
a droit à l’interprétation gestuelle. Ce droit enchâssé<br />
dans la Charte s’applique en matière de droit pénal, ainsi<br />
que dans les autres cas relevant du droit public (p. ex. les<br />
tribunaux administratifs), en autant qu’une loi fédérale
est concernée. Dans les causes civiles, cependant, les<br />
mêmes commentaires que formulés pour l’interprétation<br />
écrite s’appliquent (c’est-à-dire la personne sourde peut<br />
obtenir la subvention des frais d’interprète si elle est<br />
éligible à l’aide juridique, autrement elle doit en assumer<br />
le coût <strong>et</strong> être ou non remboursée dans l’attribution des<br />
frais de cour).<br />
Interprétation orale<br />
Un interprète oraliste est un professionnel qualifié<br />
qui reproduit silencieusement les paroles d’un<br />
intervenant <strong>et</strong> fait appel à diverses stratégies pour<br />
rendre la lecture plus facile (par exemple, remplacer un<br />
mot par un synonyme plus facile à lire sur les lèvres,<br />
ajouter un geste naturel comme indice <strong>et</strong> prendre une<br />
expression faciale qui aide à transm<strong>et</strong>tre le ton de<br />
l’intervenant). On doit mentionner que les interprètes<br />
oralistes sont plus souvent utiles aux personnes ayant<br />
perdu l’ouïe tôt dans la vie <strong>et</strong> ayant l’avantage de<br />
nombreuses années de pratique de la lecture labiale.<br />
Certains adultes devenus sourds font appel à un<br />
interprète oraliste. Toutefois, avec l’évolution de la<br />
technologie, la plupart des personnes malentendantes ou<br />
devenues sourdes préfèrent le sous-titrage instantané.<br />
Éclairage<br />
Les personnes ayant une déficience auditive<br />
comptent beaucoup sur l’information visuelle, ce qui<br />
explique l’importance d’un éclairage approprié. La<br />
principale préoccupation touchant à l’éclairage est de<br />
garantir que les meilleures conditions sont en place pour<br />
favoriser la visibilité de l’interprétation gestuelle ou de la<br />
lecture labiale. [La lecture labiale comprend non<br />
seulement de « lire » les mots sur les lèvres mais aussi<br />
d’interpréter les expressions faciales <strong>et</strong> le langage<br />
corporel.]<br />
Dans la salle d’audience, l’éclairage devrait rendre<br />
clairement visible la physionomie des intervenants <strong>et</strong> des<br />
autres participants importants (p. ex. l’accusé dans une<br />
affaire criminelle), avec le moins d’ombre possible.<br />
Lorsqu’on fait appel à un interprète, il est<br />
particulièrement important que son visage soit toujours<br />
visible. L’éclairage placé de façon appropriée est<br />
également nécessaire pour s’assurer que le sous-titrage<br />
instantané est facile à lire. On doit également mentionner<br />
que chaque fois qu’un dispositif facilitant l’écoute à<br />
l’infrarouge est utilisé, il faut bloquer la lumière solaire<br />
excessive.<br />
Les fenêtres ou les puits de lumière peuvent offrir un<br />
éclairage naturel <strong>et</strong> diffus approprié, mais ils peuvent<br />
également être une source d’éblouissement. On devrait<br />
installer des vol<strong>et</strong>s pouvant bloquer complètement la<br />
lumière du soleil. Les intervenants ne devraient jamais<br />
être placés le dos à une fenêtre ou à une autre source<br />
d’éclairage parce que cela rend difficile la lecture labiale<br />
ou le suivi de l’interprétation gestuelle.
Il est important d’assurer un éclairage approprié non<br />
seulement dans la salle d’audience mais aussi dans<br />
toutes les aires publiques du palais de justice, par<br />
exemple les corridors, la salle d’attente <strong>et</strong> le greffe. Les<br />
conditions d’éclairage peuvent être également<br />
essentielles dans certaines zones restreintes, par<br />
exemple les salles réservées aux délibérations du jury <strong>et</strong><br />
les cabin<strong>et</strong>s des juges.<br />
Acoustique<br />
Une bonne acoustique est indispensable dans la<br />
salle d’audience. De toute évidence, il s’agit de lieux où<br />
les personnes ayant une audition normale bénéficient<br />
également de la mise en œuvre de mesures efficaces<br />
d’accès auditif.<br />
En ce qui concerne l’acoustique, l’objectif est à deux<br />
vol<strong>et</strong>s. Premièrement, il est important d’éliminer ou de<br />
réduire les sources de bruit parasite. Par exemple, l’écho<br />
<strong>et</strong> le bruit de fond (comme le moteur du système de<br />
climatisation ou le ventilateur au plafond, le<br />
bourdonnement des fluorescents) sont une source de<br />
distraction <strong>et</strong> déforment souvent la perception des<br />
paroles. Pour les personnes ayant un acouphène, l’eff<strong>et</strong><br />
est particulièrement dérangeant.<br />
Les participants qui portent des bijoux bruyants ou qui<br />
tapent avec leurs mains ou leurs pieds produisent des<br />
bruits qui interfèrent avec la réception sonore pour une<br />
personne malentendante qui essaie d’entendre les<br />
procédures avec ou sans dispositif facilitant l’écoute. Si<br />
possible, la source d’un bruit parasite doit être<br />
déterminée <strong>et</strong> éliminée ou du moins réduite. Les juges <strong>et</strong><br />
les procureurs devraient être conscients des problèmes<br />
associés au bruit parasite <strong>et</strong> prendre des mesures<br />
appropriées pour le supprimer ou le réduire (par<br />
exemple, demander à un témoin de s’abstenir de faire<br />
cliqu<strong>et</strong>er ses bijoux, de taper avec un crayon ou avec ses<br />
doigts près du microphone). De même, certains obj<strong>et</strong>s<br />
sont gênants visuellement (comme les gros bijoux) <strong>et</strong><br />
peuvent distraire la personne qui lit sur les lèvres <strong>et</strong><br />
l’empêcher de se concentrer sur ce qui se dit.<br />
Le deuxième objectif concernant l’acoustique est de créer<br />
<strong>et</strong> de d’encourager des situations d’écoute favorables<br />
(par exemple, les avocats devraient demeurer devant les<br />
microphones fixes en tout temps en présentant leurs<br />
arguments). Les juges <strong>et</strong> les procureurs devraient être<br />
conscients de l’environnement d’écoute <strong>et</strong> prendre les<br />
mesures correctives appropriées au besoin. De plus, en<br />
concevant le palais de justice, les salles d’audience<br />
devraient être situées loin des zones bruyantes ou à<br />
grande circulation (par exemple, la cafétéria, les toil<strong>et</strong>tes<br />
<strong>et</strong> le quai de chargement extérieur). Les matériaux<br />
absorbant le son dans le palais de justice <strong>et</strong><br />
particulièrement dans les salles d’audience peuvent aider<br />
à réduire le niveau de bruit. La moqu<strong>et</strong>te, les rideaux, les<br />
tapisseries murales <strong>et</strong> les sièges rembourrés sont des
exemples d’éléments qui peuvent aider à absorber le son.<br />
Disposition des sièges<br />
Toutes les salles d’audience devraient être conçues<br />
en pensant qu’un participant peut avoir une déficience<br />
auditive. Les sièges devraient être disposés de manière à<br />
laisser le champ visuel libre entre les positions<br />
stratégiques dans la salle d’audience. Par exemple, un<br />
témoin devrait pouvoir voir l’écran de sous-titrage<br />
instantané, le juge, les jurés <strong>et</strong> les avocats. Certains<br />
tribunaux provinciaux de la famille appliquent déjà des<br />
dispositions souples perm<strong>et</strong>tant au juge, aux parties <strong>et</strong> à<br />
leurs représentants de s’asseoir plus près ou au même<br />
niveau.<br />
Système d’information publique visuelle<br />
Des systèmes de sonorisation pour les annonces<br />
publiques sont souvent utilisés dans les palais de justice,<br />
par exemple pour appeler un témoin qui attend à<br />
l’extérieur de la salle d’audience. Comme ces systèmes<br />
reposent exclusivement sur la perception auditive, de<br />
nombreuses personnes ayant une déficience auditive ne<br />
peuvent pas entendre ou comprendre les messages<br />
transmis (dans certains cas, la qualité de la transmission<br />
est si mauvaise que même les personnes à l’audition<br />
normale manquent parfois un message important). De<br />
plus, pour les personnes malentendantes, la crainte de ne<br />
pas pouvoir entendre ces messages est une importante<br />
source de stress. Quant aux personnes sourdes ou<br />
devenues sourdes, elles ne peuvent saisir ces messages<br />
de façon autonome.<br />
Chaque salle d’audience devrait être équipée d’un<br />
système d’affichage visuel (comme ceux des aéroports)<br />
pour rendre le message visuellement. La salle d’audience<br />
équipée d’un dispositif facilitant l’écoute devrait au<br />
moins avoir un tel système d’affichage visuel près de la<br />
porte. Le greffier, présent dans la salle d’audience, doit<br />
s’assurer que chaque message vocal est également<br />
présenté visuellement. Une autre méthode serait<br />
d’utiliser un seul système d’affichage visuel pour toutes<br />
les salles d’audience, l’information étant présentée selon<br />
le numéro de chaque salle.<br />
Lorsqu’il n’y a pas d’affichage visuel <strong>et</strong> que le greffier a<br />
été averti de la présence d’une personne malentendante,<br />
devenue sourde ou sourde, le greffier doit s’engager à<br />
sortir de la salle d’audience <strong>et</strong> à avertir la personne - <strong>et</strong><br />
ne pas oublier de le faire. Si l’affaire est ajournée ou<br />
reportée, le greffier doit en aviser la personne<br />
personnellement.<br />
Systèmes d’alarme<br />
Des avertisseurs clignotants (en cas d’incendie ou<br />
d’autre urgence nécessitant l’évacuation immédiate de<br />
lieux) sont nécessaires dans des endroits stratégiques de
tout le palais de justice, particulièrement dans les<br />
toil<strong>et</strong>tes ou les zones semblables où une personne<br />
malentendante, devenue sourde ou sourde peut être<br />
isolée. Le cabin<strong>et</strong> du juge pourrait être équipé d’un<br />
avertisseur clignotant si le juge ou son adjoint a une<br />
déficience auditive, mais un système plus mobile serait<br />
préférable. On pourrait fournir au juge qui a une<br />
déficience auditive une téléavertisseur (« pag<strong>et</strong>te »)<br />
branché sur l’avertisseur. Le téléavertisseur vibre en cas<br />
d’alarme incendie ou d’autre urgence. L’avantage du<br />
téléavertisseur est qu’on peut le porter partout dans<br />
l’édifice; par exemple, un juge malentendant est ainsi<br />
averti du déclenchement de l’alarme incendie non<br />
seulement lorsqu’il est dans son bureau mais aussi s’il se<br />
trouve dans un coin isolé de la bibliothèque.<br />
Signalisation<br />
Des affiches claires <strong>et</strong> uniformes aux l<strong>et</strong>tres bien<br />
espacées <strong>et</strong> aux couleurs contrastantes sont utiles pour<br />
toutes les personnes voyantes qui entrent dans le palais<br />
de justice. Des affiches utilisant des symboles (au lieu<br />
des mots) devraient être installées chaque fois que c’est<br />
possible (par exemple, les symboles internationaux<br />
familiers indiquant l’emplacement des toil<strong>et</strong>tes, de la<br />
cafétéria ou des téléphones). Des affiches claires évitent<br />
aux personnes malentendantes, devenues sourdes ou<br />
sourdes de demander leur chemin <strong>et</strong> de tenir des<br />
conversations difficiles avec des inconnus dans un<br />
mauvais environnement acoustique.<br />
Il est important d’indiquer par des affiches où se<br />
trouvent les services aux personnes ayant une déficience<br />
auditive. Le symbole international (l’oreille bleue avec<br />
une barre brisée) peut être utilisé pour indiquer, par<br />
exemple, la salle d’audience où se trouve un dispositif<br />
technique pour malentendant, l’emplacement d’un<br />
téléphone équipé d’un amplificateur ou d’un<br />
téléscripteur. Il est également utile d’ajouter un symbole<br />
secondaire indiquant le type de service offert. Par<br />
exemple, pour indiquer l’emplacement d’un téléscripteur,<br />
le symbole international de l’oreille peut apparaître audessus<br />
d’un second symbole représentant un<br />
téléscripteur Dans certains cas, le symbole secondaire<br />
est si bien connu qu’il peut apparaître seul.<br />
Téléphones <strong>et</strong> téléscripteurs<br />
Bien qu’il soit préférable que chaque téléphone<br />
public du palais de justice soit équipé d’une boucle à<br />
induction dans le récepteur <strong>et</strong> d’un contrôle<br />
d’amplification affiché clairement, au moins un téléphone<br />
dans chaque groupe de téléphones publics devrait être<br />
équipé ainsi. On doit mentionner qu’aujourd’hui, dans la<br />
plupart des régions du <strong>Canada</strong>, les centres téléphoniques<br />
sont entièrement composés de téléphones équipés d’une<br />
boucle à induction. On recommande en outre qu’au moins<br />
un téléphone ainsi équipé soit situé dans un endroit isolé<br />
ou dans une cabine. L’écoute au téléphone sera facilitée<br />
en réduisant la présence ou l’intensité du bruit ambiant.
L’endroit où se trouve ce téléphone particulier devrait<br />
être indiqué clairement par une signalisation appropriée.<br />
Parmi les téléphones mis à la disposition des avocats<br />
dans le palais de justice (par exemple, dans la salle de<br />
repos des avocats, près de la bibliothèque <strong>et</strong> au greffe),<br />
au moins un téléphone devrait être équipé correctement<br />
pour les avocats malentendants.<br />
Il devrait y avoir au moins un téléscripteur accessible au<br />
public dans le palais de justice, <strong>et</strong> sa disponibilité <strong>et</strong> son<br />
emplacement devraient être indiqués clairement par<br />
plusieurs affiches. Un téléscripteur est un dispositif qui<br />
perm<strong>et</strong> à une personne qui a une déficience auditive<br />
grave ou profonde de communiquer par téléphone en<br />
tapant des messages plutôt que de les énoncer<br />
oralement. Un téléscripteur ressemble à un p<strong>et</strong>it<br />
ordinateur portatif avec un p<strong>et</strong>it écran où les messages<br />
apparaissent. Il est très facile à utiliser.<br />
Les obstacles comportementaux<br />
Le personnel travaillant au palais de justice, y<br />
compris la magistrature, qui ne connaît pas bien les<br />
problèmes associés à la déficience auditive, ne sera pas<br />
en mesure d’offrir une aide appropriée à une personne<br />
malentendante, devenue sourde ou sourde. Pire, le<br />
personnel peut aggraver la situation en étant impatient<br />
ou insensible.<br />
Le personnel judiciaire peut supposer (à tort !) qu’une<br />
déficience auditive réduit la capacité d’une personne de<br />
participer au processus judiciaire <strong>et</strong> que ce défi est<br />
impossible à surmonter. En outre, ils peuvent ne pas<br />
comprendre les obstacles à la communication d’une<br />
personne ayant une déficience auditive, considérant que<br />
la personne est irrespectueuse, lente ou sénile.<br />
Il est important que le personnel travaillant au palais de<br />
justice suit une formation suffisante de façon à<br />
comprendre qu’avec les bons aménagements, les<br />
personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes<br />
peuvent participer au processus judiciaire de la même<br />
manière que les personnes dont l’audition est normale. Il<br />
est également crucial de reconnaître que les besoins<br />
d’une personne qui a une déficience auditive ne sont pas<br />
les mêmes que ceux d’une autre personne ayant la même<br />
déficience <strong>et</strong> que les besoins d’une personne peuvent<br />
changer en raison des fluctuations associées à certains<br />
types de déficience auditive ou d’un changement dans les<br />
conditions d’écoute.<br />
Un autre obstacle systémique possible est que les<br />
personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes<br />
tout comme leurs contreparties entendantes, ne<br />
connaissent probablement pas bien la terminologie<br />
légale, mais qu’en plus il leur est pratiquement<br />
impossible de lire sur les lèvres des mots inconnus. La<br />
patience, la répétition fréquente <strong>et</strong> l’emploi d’un langage
simple sont des moyens logiques qui peuvent aider à<br />
surmonter c<strong>et</strong> obstacle particulier.<br />
Une déficience auditive est un handicap qui entrave la<br />
capacité de communiquer <strong>et</strong> qui tend à causer des<br />
sentiments d’isolement <strong>et</strong> de stress, même dans des<br />
circonstances normales. Dans une salle d’audience, le<br />
stress accru, l’ambiance étouffante, la terminologie<br />
légale inconnue <strong>et</strong> les procédures obscures, ainsi que le<br />
désir de comprendre tout ce qui se passe, se combinent<br />
pour accroître le stress <strong>et</strong> nuire à la capacité de se<br />
concentrer sur ce qui est essentiel à l’écoute attentive <strong>et</strong><br />
à la lecture labiale efficace. Dans le cas des personnes<br />
qui ont un acouphène (tintement ou autres bruits dans<br />
les oreilles), le stress accru peut augmenter l’intensité<br />
des symptômes, affaiblissant la capacité d’entendre <strong>et</strong> de<br />
se concentrer. Le traitement des personnes ayant une<br />
déficience auditive d’une manière juste, équitable <strong>et</strong><br />
humaine aidera à soulager une bonne partie de ce stress.<br />
La règle d’or est la consistance. Les personnes<br />
entendantes sont souvent enclines à suivre ces conseils<br />
au début mais lorsque tout semble bien fonctionner, elles<br />
oublient <strong>et</strong> reprennent la façon « régulière » de faire les<br />
choses, ce qui complique la communication pour la<br />
personne qui est malentendante, devenue sourde ou<br />
sourde.<br />
Un coordonnateur des aménagements<br />
pour personnes handicapées<br />
La technologie d’aide <strong>et</strong> les services spécialisés pour<br />
offrir l’accès aux personnes handicapées sont variés <strong>et</strong><br />
parfois complexes <strong>et</strong> ils changent <strong>et</strong> s’améliorent<br />
constamment. Pour faire un usage efficace des moyens<br />
disponibles <strong>et</strong> pour se tenir au courant des nouveautés,<br />
les palais de justice ont besoin des conseils de divers<br />
experts dans différents domaines. De plus, certaines<br />
personnes handicapées savent ce qui fonctionne pour<br />
elles <strong>et</strong> demanderont un équipement ou des services<br />
spécifiques alors que d’autres ignorent ce qui existe.<br />
Savoir où trouver la technologie <strong>et</strong> les services <strong>et</strong> savoir<br />
comment les installer <strong>et</strong> les utiliser efficacement peut<br />
nécessiter de l’expérience <strong>et</strong> du temps.<br />
Afin de prévenir les cas de discrimination <strong>et</strong> d’assurer la<br />
participation efficace des personnes handicapées dans<br />
les tribunaux, y compris les personnes ayant une<br />
déficience auditive, un coordonnateur des aménagements<br />
pour personnes handicapées devrait être nommé dans<br />
chaque palais de justice par le fonctionnaire judiciaire ou<br />
administratif compétent. Le rôle de ce coordonnateur<br />
serait le suivant :<br />
«…établir des procédures pour recevoir les<br />
demandes d’aménagements des personnes<br />
handicapées <strong>et</strong> répondre par des aménagements<br />
raisonnables qui satisfont aux besoins de la<br />
personne, y compris, s’il y a lieu, la suppression des<br />
obstacles architecturaux, la modification des règles
<strong>et</strong> des pratiques <strong>et</strong> la prestations d’aides <strong>et</strong> de<br />
services auxiliaires.» (18)<br />
Les environnements connexes<br />
Les agents de paix (c’est-à-dire les autorités<br />
policières) sont souvent les intervenants de première<br />
ligne entre la personne malentendante, devenue sourde<br />
ou sourde <strong>et</strong> le système judiciaire canadien. Les<br />
organismes policiers ont la responsabilité de fournir un<br />
aménagement aux personnes ayant une déficience<br />
auditive lorsque ces personnes sont suspectes, victimes<br />
ou témoins. De plus, dans les situations d’urgence, les<br />
agents de paix sont généralement les premiers arrivés<br />
sur la scène <strong>et</strong> doivent être bien formés au plan des<br />
habil<strong>et</strong>és à communiquer. Dans certaines régions <strong>et</strong><br />
municipalités, les services d’urgence liés au système<br />
d’appel téléphonique 911 ont établit un inventaire<br />
confidentiel électronique des personnes ayant une<br />
déficience auditive dans la localité, améliorant ainsi la<br />
réponse des agents de paix en les avertissant qu’il est<br />
possible qu’une personne ayant une déficience auditive<br />
soit sur les lieux <strong>et</strong> ait besoin d’une aide particulière.<br />
Les programmes d’aide aux victimes <strong>et</strong> aux témoins ont<br />
aussi des liens importants avec le système de justice<br />
pénal. Tout comme les autres membres du public, de<br />
nombreuses personnes malentendantes, devenues<br />
sourdes ou sourdes craignent le processus judiciaire. Le<br />
fait d’avoir une déficience auditive intensifie souvent<br />
leurs peurs. Elles peuvent craindre de ne pas pouvoir<br />
suivre les procédures, d’être exploitées, de paraître<br />
stupides, bref, que dès le départ leur déficience auditive<br />
les désavantagera gravement.<br />
C<strong>et</strong>te crainte ne se limite pas à la salle d’audience mais<br />
s’étend également au contexte d’une enquête policière,<br />
au bureau de l’avocat, au centre d’aide aux victimes<br />
d’agression sexuelle <strong>et</strong> dans d’autres situations<br />
semblables. Les victimes d’un crime qui ont une<br />
déficience auditive peuvent décider de ne pas déclarer le<br />
crime, craignant que le système judiciaire ne soit pas<br />
accessible. Les personnes plus âgées qui sont<br />
malentendantes, devenues sourdes ou sourdes <strong>et</strong> qui<br />
n’ont jamais été exposées au système judiciaire<br />
éprouvent souvent ce genre d’inquiétude.<br />
Un moyen utile de rassurer les victimes ou les autres<br />
témoins de crimes est d’offrir des programmes d’aide<br />
adéquatement financés dans tous les districts judiciaires.<br />
Ces programmes doivent être accessibles <strong>et</strong> répondre aux<br />
besoins des personnes malentendantes, devenues<br />
sourdes <strong>et</strong> sourdes.<br />
Accès À La Justice Pour Tous Les<br />
Canadiens Et Canadiennes<br />
« Accès à la justice » n’est pas seulement un slogan<br />
accrocheur – c’est un besoin important <strong>et</strong> le droit de tous
les Canadiens <strong>et</strong> Canadiennes. Il existe une panoplie<br />
d’aménagements susceptibles d’aider les personnes<br />
malentendantes, devenues sourdes ou sourdes, <strong>et</strong> de<br />
nouvelles technologies <strong>et</strong> stratégies sont en voie de<br />
développement. L’utilisation cohérente d’aménagements<br />
dans les tribunaux du pays servira à rehausser la<br />
reconnaissance de leur importance. Le plus important est<br />
que les personnes malentendantes, devenues sourdes <strong>et</strong><br />
sourdes commenceront à effectuer de plus en plus une<br />
bonne utilisation du système judiciaire.<br />
Le système de justice canadien doit servir tous les<br />
Canadiens <strong>et</strong> Canadiennes.<br />
Annexe – Bibliographie<br />
Action On-Line, Entering the 21 st Century with Real<br />
Time Captioning, printemps 1998, www.pfcec.org/pf8044.<br />
htm<br />
American Bar Association, IRR News Report (Individual<br />
Rights and Responsibilities), Hon. Richard S. Brown,<br />
www.aban<strong>et</strong>.org/irr<br />
American Bar Association, National Judicial College,<br />
Court-Related Needs of the Elderly and Persons with<br />
Disabilities, A Blueprint for the Future, 1991<br />
American Bar Association, Section of Individual Rights<br />
and Responsibilities, Commission on Mental and Physical<br />
Disability Law, National Conference of Administrative<br />
Law Judges, Report, Zona F. Host<strong>et</strong>ler and Hon. Richard<br />
Teitelman, février 2002<br />
Americans with Disabilities Act (ADA), 42 U.S.C. Sections<br />
12131-12134; 28 C.F.R. Section 35.130<br />
Association des malentendants canadiens (AMEC), P<strong>et</strong>it<br />
guide pour mieux entendre, décembre 1991 [Version<br />
révisée]<br />
Association des malentendants canadiens (AMEC).<br />
Access-2000, Accessibility for Deaf and Hard of Hearing<br />
People by the Year 2000. North American Program to<br />
Make Hospitals Accessible, 1991<br />
Association des malentendants canadiens (AMEC), Accès<br />
égal au système judiciaire canadien pour les personnes<br />
malentendantes ou devenues sourdes, 2002<br />
Association des malentendants canadiens (AMEC), Guide<br />
pour les aînés malentendants, 1993<br />
Association du Barreau canadien, Magazine National,<br />
Access & Justice, "Professional Conduct: Treating your<br />
colleagues with disabilities in a respectful, thoughtful<br />
and professional manner", Jean Cumming, janvier/février<br />
2001
Association du Barreau canadien, Magazine National,<br />
Access & Justice, "Lawyers with disabilities face<br />
numerous barriers in the legal profession – physical,<br />
institutional, attitudinal. And they’re doing som<strong>et</strong>hing<br />
about it", Jean Cumming, janvier/février 2001<br />
Association du Barreau canadien, Touchstone/Infoégalité<br />
(newsl<strong>et</strong>ter of the CBA’s Standing Committee on<br />
Equality), "Racial Equality Resolution", P.A. Neena Gupta,<br />
février 2000.<br />
Association du Barreau canadien, Touchstone/Infoégalité<br />
(newsl<strong>et</strong>ter of the CBA’s Standing Committee on<br />
Equality), "Message from the Chair", Priti Shah, février<br />
2000.<br />
Bibliothèque du Parlement, Direction générale de la<br />
recherche parlementaire, Proj<strong>et</strong> de loi S-5 : Loi modifiant<br />
la Loi sur la preuve au <strong>Canada</strong>, le Code criminel <strong>et</strong> la Loi<br />
canadienne sur les droits de la personne – Historique<br />
législatif du Proj<strong>et</strong> de loi S-5, préparé par Nancy Holmes,<br />
LS-298E, révisé le 12 novembre 1998.<br />
Boone, Steven, Watson, Steven <strong>et</strong> Miller, Roy, Changing<br />
Lives in Changing Times – Addressing the Needs of Late-<br />
Deafened Adults, Selected Proceedings of ALDAcon ’95,<br />
Université d’Arkansas, Services de réadaptation<br />
d’Arkansas, 1997<br />
<strong>Canada</strong>, Loi constitutionnelle de 1982, partie 1, Charte<br />
canadienne des droit <strong>et</strong> libertés, promulgué par la Loi du<br />
<strong>Canada</strong> 1982 (U.K.), c. 11, en vigueur le 17 avril 1982.<br />
<strong>Canada</strong>, Lois du <strong>Canada</strong>, 1997, c.C-9 (proj<strong>et</strong> de loi S-5)<br />
Commission canadienne des droits de la personne,<br />
Communiqué de presse, (Catherine Baratt, Relations<br />
extérieures <strong>et</strong> avec les médias), La déficience en t•te des<br />
motifs de plaintes renvoyées au tribunal, 3 janvier 2002,<br />
www.chrc-ccdp.ca/news-comm/2002/<br />
NewsComm030102<br />
Cour canadienne de l’impôt, Avis aux avocats (septembre<br />
2000)<br />
Féderation internationale des personnes malentendantes,<br />
The 4 th International Congress of Hard of Hearing People<br />
(IFHOH), Jerusalem, Israel, Congress Report, 1992<br />
Groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées<br />
(<strong>Canada</strong>), Donner un sens à notre citoyenn<strong>et</strong>é<br />
canadienne: La volonté d’intégrer les personnes<br />
handicapées, publié sous droits d’auteur du ministère des<br />
Travaux publics <strong>et</strong> des Services gouvernementaux du<br />
<strong>Canada</strong>, 1996<br />
Groupe d’étude interministériel sur l’utilisation des
technologies de l’information <strong>et</strong> des communications<br />
pour l’intégration des employés handicapés,<br />
L’aménagement d’un environnement informatique<br />
accessible <strong>et</strong> inclusive, Rapport final, (présidence : J.<br />
Lyr<strong>et</strong>te), mars 2000.<br />
Ministère de la Justice du Manitoba, Public Prosecutions<br />
Policy Directive, Investigation/Prosecution of Cases<br />
Involving Persons with Special Communication Needs,<br />
Guideline No. 2:INV:1, 26 août 1991<br />
Nouvelle-Écosse, Department of the Attorney General and<br />
Department of the Solicitor General, Protocol for<br />
Investigation and Prosecution of Cases involving Persons<br />
with Special Communication Needs, 12 avril1991<br />
<strong>Reach</strong> <strong>Canada</strong>, Advancing Professional Opportunities and<br />
Employment Accommodation for Lawyers and Other Law<br />
Graduates who have Disabilities, (Allan McChesney,<br />
Richard Nolan and Martin Schmieg), Ottawa, mars 2001<br />
Réseau d'action des femmes handicapées du <strong>Canada</strong><br />
(DAWN <strong>Canada</strong>), Me<strong>et</strong>ing our Needs, An Access Manual<br />
for Transition Houses, Shirley Masuda <strong>et</strong> Jillian<br />
Riddington, juin 1990<br />
Roeher Institute, The Americans with Disabilities Act,<br />
Research Project, présenté au ministère des Affaires<br />
civiques, de la<br />
Culture <strong>et</strong> des Loisirs de l’Ontario, 3 juin 1997<br />
Shuster, Bena, Life After Deafness, A Resource-Book for<br />
Late-Deafened Adults, Association des malentendants<br />
canadiens, 1995<br />
Secrétariat d’État du <strong>Canada</strong>, Step By Step, An Overview<br />
of the 1992 Omnibus Bill and Previous Legislative<br />
Changes Aimed at the Full Participation of People with<br />
Disabilities, 1992<br />
United States of America, Americans with Disabilities Act,<br />
1990, S.933<br />
United States Department of Justice, Civil Rights Division,<br />
Disability Rights Section, Enforcing the ADA: A Status<br />
Report from the Department of Justice, January-March<br />
2001, April-June 2001 and July-September 2001.<br />
United States Department of Justice, Civil Rights Division,<br />
Disability Rights Section, Enforcing the ADA: Looking<br />
Back on a Decade of Progress, July 26, 2000<br />
United States of America (Department of Justice) vs.<br />
North Kingstown Police Department, Department of<br />
Justice complaint number 204-66-34, S<strong>et</strong>tlement<br />
Agreement, www.usdoj.gov/crt/ada/kings<strong>et</strong>t.htm
Vlug, Henry, ASL/LSQ Laws and Deaf Laws, rédigé pour<br />
l’Association des Sourds du <strong>Canada</strong>, janvier 1995<br />
Vlug, Henry, Resource Book for ASL/LSQ Laws and Deaf<br />
Laws, rédigé pour l’Association des Sourds du <strong>Canada</strong>,<br />
janvier 1995<br />
Notes :<br />
1. L’auteure a cherché à s’exprimer en langage<br />
courant. Elle a simplifié les concepts juridiques <strong>et</strong><br />
elle s’est livrée à quelques généralisations. Elle m<strong>et</strong><br />
en garde le lecteur qui a un problème concr<strong>et</strong> : il ne<br />
doit pas s’en tenir au présent article, mais consulter<br />
un avocat.<br />
2. L’auteure, Carole Willans-Théberge, est conseillère<br />
juridique, Liaisons <strong>et</strong> Partenariats, au ministère de la<br />
Justice du <strong>Canada</strong>. Cependant, les opinions<br />
exprimées ici sont ses opinions personnelles, elles ne<br />
reflètent pas nécessairement celles du ministère de<br />
la Justice du <strong>Canada</strong>. L’exposé oral a été fait en<br />
anglais par Michael Sousa <strong>et</strong> Carole Willans-<br />
Théberge, <strong>et</strong> en français par Thibault Cadro <strong>et</strong> Carole<br />
Willans-Théberge.<br />
3. Loi constitutionnelle de 1982, promulguée par la Loi<br />
de 1982 sur le <strong>Canada</strong>, 1982, ch. 11 (R.-U.) ;<br />
proclamée en vigueur le 17 avril 1982<br />
4. Ibid<br />
5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46<br />
6. Loi sur la preuve au <strong>Canada</strong>, L.R.C. 1985, ch. C-5<br />
7. Charte canadienne des droits <strong>et</strong> libertés, Partie I de<br />
la Loi constitutionnelle de 1982, promulguée par la<br />
Loi de 1982 sur le <strong>Canada</strong>, 1982, ch. 11 (R.-U.),<br />
proclamée en vigueur le 17 avril 1982<br />
8. Article 7 <strong>et</strong> suivants de la Charte canadienne des<br />
droits <strong>et</strong> libertés<br />
9. Loi modifiant la Loi sur la preuve au <strong>Canada</strong>, le Code<br />
criminel <strong>et</strong> la Loi canadienne sur les droits de la<br />
personne relativement aux personnes handicapées,<br />
Lois du <strong>Canada</strong>, 1998, ch. 9, proclamée en vigueur le<br />
30 juin 1998<br />
10. Articles 627, 638 <strong>et</strong> 649 du Code criminel.<br />
11. Al. 638(1)e) du Code criminel. Au Royaume-Uni, une<br />
modification semblable a été adoptée avec la<br />
Disability Discrimination Act, 1995 (Loi sur la<br />
discrimination à l’endroit des personnes<br />
handicapées). Les modifications connexes apportées<br />
au Code criminel concernent l’art. 627, le par. 631(4)<br />
<strong>et</strong> l’art. 649.<br />
12. R. c.. R. (A.L.) (1999), 141 C.C.C. (3d) 151, 29 C.R.<br />
(5th ) 320 (C.A. du Man.)<br />
13. (1997) 3 RCS 624<br />
14. La Cour suprême du <strong>Canada</strong> a ajouté que ne pas<br />
fournir aux patients l’assistance d’interprètes<br />
gestuels constituait une atteinte à l’article 15 de la<br />
Charte, qui ne pouvait être justifiée au titre de<br />
l’article 1er .
15. La deuxième partie de c<strong>et</strong>te présentation est en<br />
grande partie tirée d’une publication de l’Association<br />
des malentendants canadiens, Accès égal au système<br />
judiciaire canadien pour les personnes<br />
malentendantes ou devenues sourdes (mai 2002) <strong>et</strong><br />
l’auteure remercie c<strong>et</strong>te association de perm<strong>et</strong>tre la<br />
reproduction de plusieurs extraits de c<strong>et</strong> excellent<br />
document. Des ajustements ont été apportés pour<br />
inclure les aménagements appropriés aux personnes<br />
sourdes dont la langue maternelle est une langue de<br />
signes gestuels.<br />
16. Action On-Line, Entering the 21st Century with Real<br />
Time Captioning, 1998<br />
17. Cour canadienne de l’impôt, Avis aux avocats<br />
(septembre 2000). C<strong>et</strong>te politique a été promulguée<br />
en réponse à une plainte à la Commission<br />
canadienne des droits de la personne, déposée par<br />
Scott Simser, un avocat malentendant alors employé<br />
du ministère de Justice <strong>Canada</strong>.<br />
18. American Bar Association, Section of Individual<br />
Rights and Responsibilities, Commission on Mental<br />
and Physical Disability Law, National Conference of<br />
Administrative Law Judges, Report, Zona F. Host<strong>et</strong>ler<br />
<strong>et</strong> Richard Teitelman, février 2002.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong> la<br />
surdité<br />
Proj<strong>et</strong> de services VCT* pour les<br />
Sourds de Nairobi<br />
Rapport d'activités du premier trimestre<br />
2004.<br />
[* Le sigle VCT désigne des services bénévoles de<br />
conseillers <strong>et</strong> de tests du Kenya]<br />
Préparé par Joel Omondi.<br />
Table des matières.<br />
1.0 Fichier des données du proj<strong>et</strong>.<br />
1.1 Contacts.<br />
1.2 Gestion.<br />
1.3 Personnel.<br />
1.4 Formateurs/Superviseurs.<br />
1.5 Donateurs Actuels.<br />
2.0 Objectifs.<br />
2.1 Objectifs à court terme.<br />
2.2 Objectifs à long terme.<br />
2.3 Banque.<br />
2.4 Comité actuel.<br />
3.0 Activités.<br />
3.1 Préparations.<br />
3.2 Lancement de commercial télé.<br />
3.3 Questions touchant la mobilisation communautaire.<br />
3.4 Ouverture officielle.<br />
3.5 Questions touchant le VCT mobile.<br />
4.0. Activités VCT mobiles.<br />
a) Karen.<br />
b) Githunguri.<br />
c) Ikinu.<br />
5.0 Défis de gestion.<br />
5.1 Expansion des services VCT sourds à la grandeur du<br />
pays.<br />
5.2 Intégration à la politique nationale du SIDA chez les<br />
Sourds.<br />
5.3 Questions touchant le personnel.<br />
5.4 Mobilisation communautaire.<br />
6.0 Recommandations.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
1.0 Fichier des données du proj<strong>et</strong><br />
1.1 Contacts relatifs au proj<strong>et</strong><br />
Mumias South Road, Buru Buru, opp. Buru Buru Police Station.<br />
Epren Centre (with HFCK on ground floor). 3 rd floor suite 17 & 20.<br />
Portable : 0721 544434<br />
Courriel : nairobideaf_aidsproject@yahoo.com<br />
1.2 Gestion<br />
a) Boniface U Inyanya, directeur de proj<strong>et</strong>s<br />
b) Aggrey Akaranga, interprète de proj<strong>et</strong>s/directeur<br />
administratif<br />
c) Joel Omondi, directeur de programmes<br />
1.3 Personnel<br />
a) Henry Maina, conseiller sourd masculin<br />
b) Moses Nteere, conseiller sourd masculin<br />
c) Susan Mwikali, mobilisatrice sourde<br />
d) Josephine Shisia Were, mobilisatrice sourde<br />
e) Leah Muruka, conseillère/interprète féminine<br />
1.4 Formateurs<br />
Liverpool VCT <strong>et</strong> Care Kenya.<br />
1.5 Donateurs actuels<br />
CDC.<br />
2.0 Objectifs<br />
2.1 À court terme<br />
a. Étendre les services de VCT sourds à la grandeur du<br />
pays par l'expansion du service VCT mobile <strong>et</strong><br />
l'ouverture d'autres sites VCT autonomes.<br />
b. Sensibilisation continue des sourds à l'importance de<br />
connaître son état VIH par l'usage de la langue des<br />
signes dans la communication directe.<br />
c. Développer une documentation efficace sur<br />
l'information, l'éducation <strong>et</strong> la communication (IEC)<br />
pour servir dans la mobilisation <strong>et</strong> la formation<br />
communautaires.<br />
d. Augmenter le nombre de personnes sourdes qui
connaissent la mobilisation communautaire <strong>et</strong> le<br />
counselling VCT par des sourds.<br />
e. Dispenser des services de consultation <strong>et</strong> de tests<br />
de qualité aux clients sourds <strong>et</strong> entendants qui<br />
viennent pour des services de VCT.<br />
f. Organiser des séances de VCT mobile dans chaque<br />
région avec une cible de participants sourds dans<br />
l'ensemble du pays.<br />
g. Offrir des occasions de mobilisation communautaire<br />
pour les services de VCT pour les Sourds de travailler<br />
efficacement au sein de partenariats avec le Liverpool<br />
VCT <strong>et</strong> Care Kenya.<br />
h. Établir la capacité de gérer le site dans le cadre des<br />
normes établies par le donateur, la supervision <strong>et</strong> les<br />
régulateurs, afin de bien servir la collectivité des<br />
Sourds.<br />
i. Intégrer de façon efficace le proj<strong>et</strong> de services de VCT<br />
au sein du programme VIH/SIDA visant à la<br />
l'atténuation <strong>et</strong> à la prévention de la pandémie.<br />
j. Gérer le proj<strong>et</strong> avec perspicacité pour perm<strong>et</strong>tre à<br />
celui-ci de se poursuivre après la fin de la phase<br />
contractuelle actuelle.<br />
2.2 Objectifs à long terme<br />
a. M<strong>et</strong>tre un terme à l'incidence <strong>et</strong> à la prévalence<br />
croissantes du VIH/SIDA <strong>et</strong> des MTS au sein de la<br />
collectivité des Sourds en faisant connaître aux<br />
Sourds le changement de comportements à<br />
risque de la culture sourde <strong>et</strong> les façons d'enrayer<br />
la pandémie.<br />
b. Unifier <strong>et</strong> mobiliser les efforts <strong>et</strong> les ressources locaux<br />
<strong>et</strong> nationaux dans leur lutter contre le HIV/SIDA par<br />
l'entremise de médias appropriés aux Sourds <strong>et</strong><br />
accessibles en langue des signes.<br />
c. Prendre en main la gestion complète du proj<strong>et</strong> de<br />
services de VCT après un an <strong>et</strong> ouvrir d'autres sites<br />
VCT sensibles aux Sourds dans le pays avec la<br />
supervision de Liverpool <strong>et</strong> NASCOP.<br />
d. Offrir un traitement anti-rétroviral des Sourds vivant<br />
avec le VIH à l'intérieur de régimes de traitements de<br />
qualité <strong>et</strong> répondant aux normes nationales, au sein<br />
d'une programmation HIV/SIDA intégrée au service<br />
de VCT.<br />
2.3 Banque du proj<strong>et</strong> :<br />
Kenya Commercial Bank<br />
2.4 Membres Actuels du Comité :<br />
a. Dominic O. Majiwa<br />
b. Judith Mahindu<br />
c. Isabel Mugure<br />
d. Dr. Michael Ndurumo – K.I.E<br />
e. Boniface Inyanya - Coordonnateur du proj<strong>et</strong><br />
f. Aggrey Akaranga - Interpète du proj<strong>et</strong>
g. Joel Omondi – Conseiller du proj<strong>et</strong><br />
h. Représentant du ministère de la Santé<br />
i. Représentant du donnateur<br />
3.0 Activités<br />
3.1 Préparation annuelle<br />
L'année a commencé pour de bon avec une circulation de clients<br />
bien au-dessus de la moyenne hebdomadaire. Principalement des<br />
résidents locaux <strong>et</strong> des Sourds résidant dans les domaines<br />
entourant le Site, qui n'étaient pas encore r<strong>et</strong>ournés au collège<br />
ou à l'école technique.<br />
Le site a aussi commencé la première nouvelle année avec des<br />
plans sur la façon d'améliorer les diverses régions prévues<br />
comme posant un défi. L'objectif principal était d'augmenter la<br />
circulation des clients grâce au VCT mobile <strong>et</strong> à une mobilisation<br />
communautaire autour de la ville de Nairobi.<br />
3.2 Lancement du commercial télé sur le VCT<br />
Le commercial télé sur le VCT dans lequel paraît la Première<br />
Dame, Mme Lucy Kibaki, <strong>et</strong> une de nos employées, Susan Mwikali<br />
Mugambi, tuée à l'hôtel Mombassa Serena Beach en décembre<br />
2003, fut lancé le 16 janvier 2004 au Panafric Hotel.<br />
3.3 Mobilisation communautaire<br />
La mobilisation communautaire a dû affronter quelques défis qui<br />
ont causé une réduction du nombre total de clients, entendants<br />
<strong>et</strong> sourds. Les principales difficultés furent reliées au transport <strong>et</strong><br />
à l'introduction de nouveaux frais pour l'utilisateur.<br />
3.4 Ouverture officielle<br />
Le VCT pour les Sourds de Nairobi a ouvert officiellement le 14<br />
février 2004, le jour de la Saint-Valentin. L'occasion a attiré<br />
divers visiteurs de la communauté des donateurs, des formateurs<br />
<strong>et</strong> superviseurs du VCT, des partenaires, des régulateurs <strong>et</strong> des<br />
représentants du ministère de la Santé.<br />
L'invitée d'honneur était l'ambassadeur adjoint de l'Ambassade<br />
américaine, Mme Leslie Rowe, qui représentait l'ambassadeur des<br />
États-Unis, M. Bellamy.<br />
Le D r Elizab<strong>et</strong>h Murum représentait le principal donateur du CDC ;<br />
le conseil national de contrôle du SIDA (NACC – National AIDS<br />
Control Council) était représenté par le directeur adjoint des<br />
finances <strong>et</strong> de l'administration M. Mathew Chepkwony.<br />
3.5 Le service de VCT mobile pour les Sourds<br />
Le service de VCT mobile continue à être le point de croissance<br />
des clients pour le site. Le nombre de clients reçus pendant les<br />
séances du VCT mobile a été plus élevé que ceux qui ont été<br />
capables de se rendre d'eux-mêmes au site. Le nombre des<br />
séances du VCT mobile a cependant été inférieur aux attentes à
cause des questions de transition annuelle <strong>et</strong> de la planification<br />
du travail. Les deux activités ont pris plus de temps que<br />
nécessaire <strong>et</strong> les activités mobiles initiales ont été r<strong>et</strong>ardées. Au<br />
cours du mois de janvier, nous avons eu une séance mobile à<br />
Karen, <strong>et</strong> à Githunguri <strong>et</strong> Ikinu dans les quatre premiers mois de<br />
l'année. Les séances ont vu le nombre des clients reçus s'élever,<br />
soit de 11 à 20 par séance mobile. Le plus gros défi fut l'accès<br />
des Sourds aux services sanitaires de base causé par la<br />
compréhension générale que le service de VCT est une institution<br />
de santé.<br />
L'utilisation des institutions de santé pour les séances du VCT<br />
mobile <strong>et</strong> le besoin de soutien <strong>et</strong> de soins après une séance a fait<br />
en sorte qu'il fut nécessaire de répéter les visites des collectivités<br />
sourdes de façon périodique. Cela les a également aidés à avoir<br />
accès à l'institution de santé locale grâce à l'interprète.<br />
L'équipe d'avant-poste a été importante pour faire les<br />
arrangements nécessaires <strong>et</strong> pour perm<strong>et</strong>tre la préparation des<br />
régions pour la séance de l'unité mobile.<br />
4.0 Activités du VCT mobile.<br />
a. VCT mobile de Karen<br />
Le site de Karen était prévu pour novembre 2003,<br />
alors que les mobilisateurs allèrent à Karen pour<br />
donner des cours sur le SIDA <strong>et</strong> proj<strong>et</strong>er le vidéo. Il<br />
ne fut pas possible de visiter Karen en décembre à<br />
cause du fait que l'école technique pour les Sourds<br />
de Karen est une institution de savoir <strong>et</strong> qu'on a<br />
pensé qu'il n'était pas sage de tenir une session<br />
juste avant les examens <strong>et</strong> au moment où les<br />
étudiants partent pour le congé scolaire. Ils peuvent<br />
ne pas pouvoir gérer leur état lorsqu'ils sont chez<br />
eux, de nombreux sourds n'ayant pas de meilleures<br />
structures de soutien que celles qu'ils ont dans les<br />
écoles <strong>et</strong> telles institutions.<br />
Ce fut l'une des meilleures sessions, car le nombre<br />
de personnes testées fut d'environ 22 clients qui ont<br />
été vus, dans une école de plus de 70 étudiants.<br />
Des documents divers sont utilisés, mais on a<br />
particulièrement utilisé la vidéo. Les jeunes sourds<br />
sont spécifiques concernant la sorte de<br />
documentation utilisée pendant la sensibilisation. Ils<br />
adorent les documents qui se rapportent à la sorte<br />
de comportement commune entre eux. La questions<br />
du SIDA, de la toxicomanie, des relations <strong>et</strong> du sexe.<br />
On a vu le besoin de plus de sensibilisation <strong>et</strong> de<br />
soutien <strong>et</strong> de structures de soins basés sur les<br />
écoles. Il a été important que des professeurs<br />
choisis reçoivent une formation sur l'appui <strong>et</strong> les<br />
soins, qui leur perm<strong>et</strong>tent de soutenir les étudiants<br />
dans n'importe quel état. Les étudiants furent<br />
également positifs concernant les plans de mise sur<br />
pied de clubs du SIDA, qui non seulement<br />
développeraient du théâtre <strong>et</strong> chanterait des<br />
chansons à utiliser dans l'école <strong>et</strong> d'autre
sensibilisation de sourds, mais ils vont également<br />
fait beaucoup pour développer la capacité de l'école<br />
de soutenir les étudiants <strong>et</strong> les enseignants qui sont<br />
VIH positifs. Il y a un plan de visiter Karen à tous les<br />
semestre ou trois fois par année.<br />
b. Service de VCT mobile de Githunguri<br />
Les clients de Githunguri étaient plus constitués de<br />
jeune familles <strong>et</strong> de couples sourds <strong>et</strong> de leur<br />
premier ou leur second enfant. Ils étaient plus<br />
préoccupés de ce qu'est le SIDA au sein de la<br />
famille. La question des aventures extra maritales<br />
est assez fréquente chez les sourds, comme chez les<br />
entendants.<br />
La question de l'usage d'un condom dans la famille<br />
<strong>et</strong> l'importance de le faire. Le site mobile a utilisé le<br />
centre de santé local. Les services VCT furent<br />
dispensés au centre de santé de Githunguri <strong>et</strong> à<br />
environ 14 Sourds. La mobilisation fut faite à l'église<br />
des Sourds de la région de Githunguri.<br />
c. VCT mobile d'Ikinu<br />
L'équipe de reconnaissance composée d'un<br />
conseiller <strong>et</strong> de mobilisateurs s'est rendue à Ikinu le<br />
Vendredi 16 avril <strong>et</strong> a conclu les arrangements<br />
nécessaires pour l'événement du dimanche.<br />
Environ 14 Sourds furent testés le dimanche 18<br />
avril, à Ikinu. Les organisateurs se sont servis du<br />
bureau de chef local pour le service de VCT. Les<br />
mobilisateurs utilisèrent divers matériaux, comme<br />
les affiches normales, des dessins <strong>et</strong> des sessions<br />
orales de questions <strong>et</strong> réponses. Les t-shirts du<br />
KNDAEP ont aussi attiré la foule pendant le service<br />
mobile de VCT.<br />
5.0 Les défis de gestion<br />
Plusieurs problèmes de gestion se sont soulevés <strong>et</strong> ils méritent<br />
qu'on en traite. La direction, à cause du manque de formation<br />
individuelle de la part de la supervision a tenu les comptes selon<br />
les normes d'autres donateurs. Mais on a découvert que c<strong>et</strong>te<br />
pratique n'était pas satisfaisante, <strong>et</strong> plusieurs défis de<br />
comptabilité en découlèrent.<br />
Le nouveau protocole d'entente a augmenté les montants alloués<br />
à la mobilisation communautaire <strong>et</strong> aux sessions de VCT mobiles<br />
à 30 000, à rembourser par le compte de proj<strong>et</strong>. Après trois<br />
mois, ce protocole fut aussi r<strong>et</strong>iré, également à cause de ces<br />
problèmes de rapports. Il y a eu des tentatives par la direction<br />
vis-à-vis les superviseurs d'aider à bâtir une capacité de<br />
comptabilité répondant à leurs exigences, lesquelles reçurent une<br />
réponse positive, ce qui n'empêcha pas qu'on mît fin au protocole.<br />
La supervision avait également l'intérêt de reprendre la gestion<br />
du service de VCT des mains de la Narobi Association of the Deaf.
Toutefois, il fut convenu que le contrôle actuel de l'octroi des<br />
fonds <strong>et</strong> du paiement des salaires soit maintenu directement,<br />
mais que l'administration soit laissée au NAD, puisque c'était un<br />
proj<strong>et</strong> communautaire des Sourds. C<strong>et</strong>te décision a été synonyme<br />
de changements dans la façon dont la mobilisation <strong>et</strong> le VCT<br />
mobile furent organisés. Le NAD n'avait alors plus de pouvoirs<br />
pour organiser ces activités de première importance avec le<br />
financement qu'elle recevait du LVCT.<br />
5.1 L'expansion des services de VCT à la<br />
grandeur du pays<br />
Des questions se sont soulevées, à savoir si le VCT mobile venant<br />
du VCT pour les Sourd de Nairobi dispenserait des services à<br />
l'ensemble du pays ou s'il était possible qu'un donateur finance la<br />
formation <strong>et</strong> l'établissement d'autres DVCT dans les provinces<br />
sous la forme d'une stratégie d'expansion.<br />
Une fois encore CDC a financé le programme d'expansion <strong>et</strong> il fut<br />
décidé que d'autres Sourds seraient formés <strong>et</strong> d'autres sites de<br />
DVCT établis dans les régions. Bien que c<strong>et</strong>te phase ait été<br />
obscurcie par un manque de transparence, à la fin les organismes<br />
de Sourds purent participer à la phase activités.<br />
Il y eut le problème de la permanence des sites VCT autonomes,<br />
dans les régions rurales, sans questions d'intégration avec les<br />
institutions de santé. Le développement de structures de soutien<br />
qui sont indépendantes du système de la santé. Les DVCT<br />
intégrés aux hôpitaux <strong>et</strong> la qualité de l'accueil fait aux sourds<br />
dans la plupart des hôpitaux est un problème dont il a fallu tenir<br />
compte. Le développement de l'accessibilité de ces hôpitaux à la<br />
collectivité des Sourds en tant que stratégie de gestion du SIDA a<br />
été un problème qu'il a fallu étudier. L'accès à des soins de santé<br />
de base, sans parler des traitements ARV (anti-rétro-viraux)<br />
gratuits par le gouvernement, est un problème qui exige une<br />
planification dès les premières étapes.<br />
Venant à un moment où il y avait des plans pour une expansion<br />
au niveau de l'ensemble du pays <strong>et</strong> dans laquelle un programme<br />
solide, le Kenya National Deaf HIV/AIDS Education Programme<br />
(KNDAEP) de l'organisation nationale des Sourds venait juste de<br />
recevoir des fonds du NACC pour le proj<strong>et</strong> de sensibilisation des<br />
Sourds au SIDA. Gardant à l'esprit l'importance des services VCT<br />
Sourds au sein du Programme national de gestion du SIDA, il y<br />
avait un grand besoin de partenariat entre le LVCT <strong>et</strong> le KNDAEP,<br />
qui contrôlaient également la gestion de la NAD.<br />
Le KNDAEP a vu que, puisque ils étaient impliqués dans le<br />
développement du VCT <strong>et</strong> sa gestion à travers le NAD, il y avait<br />
un besoin pour a) que les organismes de Sourds aient une<br />
administration directe des proj<strong>et</strong>s de services de VCT en<br />
partenariat avec le LVCT, b) qu'il y avait un besoin de bâtir la<br />
capacité des groupes de gérer le service de VCT, c) qu'il y avait<br />
un besoin d'une participation conjointe dans des activités de<br />
proj<strong>et</strong> avec le LVCT prenant les questions de gestion du suivi, de<br />
la supervision <strong>et</strong> du counseling, <strong>et</strong> les organisation de Sourds<br />
prenant la mobilisation communautaire. Les sessions du service<br />
de VCT mobile sont données conjointement.<br />
5.2 Expansion des DVCT <strong>et</strong> intégration aux
proj<strong>et</strong>s nationaux<br />
La base de gestion pour l'expansion des services de VCT pour les<br />
Sourds à la grandeur du pays. C<strong>et</strong>te mesure fut rendue<br />
nécessaire par le fait que le succès du proj<strong>et</strong> dépend de<br />
l'appropriation du proj<strong>et</strong> par la collectivité sourde, quels qu'en<br />
soient les déficiences. Ces déficiences devraient toutefois être<br />
prises en compte à l'intérieur des paramètres de soutenabilité du<br />
proj<strong>et</strong>. L'expansion à la grandeur du pays, qui a commencé avec<br />
la formation de personnes sourdes des provinces Nyanza,<br />
Western <strong>et</strong> Coast, sera également fait à l'intérieur de ces<br />
paramètres. Le LVCT paiera le loyer <strong>et</strong> le personnel salarié<br />
directement, mais les organismes de Sourds locaux seront<br />
chargés de l'administration des sites.<br />
C<strong>et</strong>te expansion s'intégrera bien au programme de gestion<br />
national du SIDA pour les Sourds. Elle perm<strong>et</strong>tra également aux<br />
Sourds d'avoir accès à d'autres institutions de santé dans un<br />
environnement dans lequel les organisations de Sourds se<br />
donnent une croissance dont l'objectif ultime est de gérer les<br />
sites eux-mêmes.<br />
Les questions de soutenabilité devraient être étudiées en vue<br />
d'une croissance mutuelle. Des partenariats de programmes des<br />
services de DVCT qui sont mutuellement bénéfiques <strong>et</strong><br />
participatoires devraient être développés partout. Chaque<br />
partenaire devrait être bâti au sein de son domaine d'expertise.<br />
Ceux-ci devraient être constitués de façon à favoriser la<br />
soutenabilité <strong>et</strong> la croissance.<br />
5.3 Questions touchant le personnel<br />
À mesure que le travail a augmenté, il s'est développé une<br />
pénurie aiguë de personnel pour diverses activité. Les activités de<br />
mobilisation de la collectivité organisées par le LVCT <strong>et</strong> celles qui<br />
ont été organisées par le NAD ou le KNDAEP. D'abord elles ne<br />
peuvent être complètement séparées, en plus de ne pouvoir être<br />
comblées sans personnel <strong>et</strong> ressources supplémentaires.<br />
On espère qu'avec une formation supplémentaire <strong>et</strong> un meilleur<br />
usage du personnel déjà formé, il sera possible de diminuer la<br />
charge de travail. Une meilleure planification <strong>et</strong> gestion des<br />
recours amélioreront aussi le déroulement du travail. On avait<br />
besoin de faire une meilleure utilisation du personnel formé lors<br />
de la première formation, mais qui n'avaient pas obtenu d'emploi,<br />
William Nyakinya <strong>et</strong> Lydia Wagatwe comme conseillers, <strong>et</strong><br />
Elizab<strong>et</strong>h Khamalla <strong>et</strong> Caroline Atieno comme mobilisatrices<br />
communautaires. Ils seraient r<strong>et</strong>enus pour améliorer leur<br />
expérience pratique <strong>et</strong> seraient payés à des taux de temps partiel.<br />
La nouvelle formation pour les trois provinces a été également<br />
perçue comme importante <strong>et</strong> déjà, lors de l'ouverture officielle du<br />
Nairobi Deaf VCT, le Dr Murum du CDC s'est engagé à appuyer le<br />
financement visant l'expansion des services de VCT vers les<br />
régions rurales, dont la formation constitue un composante.<br />
Les réunions tenues entre le LVCT <strong>et</strong> le KNDAEP en ce sens ont<br />
également indiqué le besoin de former des représentants sourds<br />
des diverses provinces. À c<strong>et</strong>te fin des sélections furent faites<br />
dans les régions Nyanza, Westenr <strong>et</strong> Coast. Le KNDAEP fut
directement impliqué dans les sélections de la province Coastal,<br />
qui fut faite avec un représentant du LVCT, le Prince Bahati. Le<br />
KNDAEP n'a pas été directement impliqué dans les régions de<br />
Nyanza <strong>et</strong> Western. Six Sourds furent sélectionnés dans chacune<br />
de ces provinces, <strong>et</strong> deux mobilisateurs communautaires de<br />
Central <strong>et</strong> Rift Valley. On n'a pas eu suffisamment de temps<br />
pendant la planification pour perm<strong>et</strong>tre des mobilisateurs effectifs<br />
des régions Central <strong>et</strong> Rift Valley.<br />
Mwamburi (interprète), Ruth, Rose, Abdalla, Kagunya, Tsuma, <strong>et</strong><br />
Truphosa furent choisis pour une formation à Nairobi à la fin<br />
d'avril, avec d'autres qui viendront des autres provinces.<br />
On espère que l'expansion perm<strong>et</strong>tra de soulager les pénuries de<br />
personnel de soins aiguë. C<strong>et</strong>te expansion donnera lieu à une<br />
mobilisation nationale effective <strong>et</strong> à une éducation de la<br />
collectivité des Sourds à la grandeur du pays.<br />
Publicité du VCT des Sourds<br />
La NAD <strong>et</strong> le KNDAEP ont fait plusieurs tentatives pour<br />
augmenter la publicité du VCT des Sourds. Cela fut nécessaire à<br />
cause de la mauvaise accessibilité <strong>et</strong> sensibilisation chez les<br />
décideurs/auteurs de politiques du statut de près d'un million de<br />
Kenyans qui sont sourds <strong>et</strong> qui n'ont pas accès aux institutions de<br />
santé à cause des barrières de communication. C<strong>et</strong>te campagne<br />
médiatique a toutefois eu des eff<strong>et</strong>s secondaires qui donnaient<br />
une mauvaise impression des choses, <strong>et</strong> qui, en même temps,<br />
faisaient surgir des images qui n'étaient pas propices à la<br />
croissance des services VCT. Il s'est trouvé des gens qui ont cru<br />
que la grande publicité médiatique jouera le jeu de ceux qui sont<br />
opposés aux sites de services de VCT qui n'ont pas d'assistants<br />
de laboratoires.<br />
Mais c'était une campagne médiatique qui ne pouvait pas être<br />
relâchée, parce que le DVCT fut la première institution de santé<br />
où la prestation des services s'est faite en langue des signes. Il<br />
n'est pas possible de trop insister sur le besoin d'un plus grand<br />
nombre d'employés de la santé qui savent la langue des signes.<br />
Le proj<strong>et</strong> a reçu de la publicité de la part des médias locaux <strong>et</strong><br />
internationaux, dont la BBC radio, le New York Times, les sites<br />
Intern<strong>et</strong>, California News, <strong>et</strong> diverses revues internationales sur<br />
la santé. Au niveau local, le proj<strong>et</strong> DVCT a reçu une bonne presse<br />
de la part du Nation Newspaper, du Standard Newspaper, du<br />
People Newspaper, de Nation TV, KBC du KTN.<br />
Le KNDAEP proj<strong>et</strong>te de continuer avec une campagne médiatique<br />
pour perm<strong>et</strong>tre à la communauté des Sourds d'avoir accès à des<br />
opportunités de vie égales à celles des entendants,<br />
particulièrement avec la mise en oeuvre de la Loi sur les<br />
handicaps.<br />
5.4 La Mobilisation Communautaire<br />
C<strong>et</strong>te activité a connu divers défis. La principale fut celle de la<br />
crise du transport. Le principal problème fut la crise des<br />
transports, qui a rendu difficile pour les mobilisateurs d'organiser<br />
des activités d'animation au centre même de la ville. La questions<br />
de la documentation en KSL continue à r<strong>et</strong>enir la mobilisation
communautaire. Le KNDAEP est en processus d'élaborer de<br />
nouvelles documentation en KSL devant servir non seulement au<br />
sein de la mobilisation communautaire des services VCT, mais<br />
également dans les programmes d'éducation au sein des<br />
institutions <strong>et</strong> des organismes sensibilisés aux Sourds. La<br />
mobilisation communautaire s'est faite dans les régions<br />
suivantes :<br />
i. Différents lieux d'affaires pour les Sourds, dans<br />
des parties de la ville, périodiquement, où les Sourds<br />
font des affaires, <strong>et</strong> les mobilisateurs peuvent<br />
toujours y rencontrer 5 personnes sourdes venant de<br />
diverses parties du pays.<br />
ii. Églises pour les Sourds, où, chaque dimanche,<br />
lorsque les mobilisateurs vont à l'église <strong>et</strong> sont<br />
capable de trouver des points de discussion surgissant<br />
des diverses questions ou des divers cas soulevés<br />
dans l'église des Sourds.<br />
iii. Dandora, où il y a toute une quantité de Sourds, plus<br />
de 250, mais qui ne sont pas faciles à réunir en un<br />
seul forum, mais où les mobilisateurs se servent<br />
toujours des maisons de de leaders sourds ou des<br />
réunions de sports pour les Sourds, ou bien les<br />
funérailles <strong>et</strong> les réunions communautaires. C'est la<br />
même chose à Kariobangi North.<br />
iv. Huruma visant 91 Sourds au groupe sourd des<br />
régions Huruma mathare.<br />
v. Kayole à l'atelier tushuriane pour Mr. Ogama où on<br />
vise environ 77 Sourds.<br />
vi. Ikinu, où on vise environ 199 Sourds.<br />
vii. La collectivité sourde de Kiambu, où on vise74<br />
Sourds dans le premier groupe.<br />
viii. L'église pour les Sourds de Githurai, où on vise 62<br />
Sourds.<br />
ix. À Athi Rive, où on vise 47 Sourds.<br />
x. À l'église pour les Sourds de Ruiru. où on vise<br />
environ 8 Sourds.<br />
xi. Le séminaire de sensibilisation de la NAD pour<br />
les Sourds de Westlands aux bureaux du KNDAEP<br />
pour 30 Sourds par jour pendant 3 jours.<br />
xii. À Korogocho, où on vise 60 Sourds à l'école<br />
informelle High Ridge<br />
Le Volume De Clients<br />
Le volume de clients chez les entendants <strong>et</strong> les Sourds a diminué<br />
de façon dramatique en février, avec 64 clients, comparativement<br />
à 195 en janvier. C<strong>et</strong>te diminution est aux difficultés de transport<br />
provoquées par les nouveaux règlements de la circulation.<br />
L'industrie Matatu a été stagnante pendant un mois compl<strong>et</strong> <strong>et</strong> la<br />
plus grande partie du travail en est venue à un arrêt. Les<br />
changements chez les clients entendants furent toutefois dus à<br />
l'introduction de frais à l'usager. C<strong>et</strong>te mesure a dramatiquement<br />
diminué le nombre des clients entendants. Nombreux sont ceux<br />
qui, alors qu'ils avaient entendu dire que les services de VCT<br />
étaient gratuits, sont r<strong>et</strong>ournés sur leurs pas lorsqu'on les a<br />
informés que le site demandait maintenant 50 Ksh. Les clients<br />
sourds, pour leur part, furent surtout soumis à une tension par le
système de transport chaotique.<br />
Toutefois, après le mois de mars, les choses ont commencé à<br />
revenir à la normale, avec 177 clients. Les mobilisateurs<br />
communautaires étaient également capables de se déplacer<br />
comme d'habitue.<br />
Mais pendant plus de trois mois, le site a traité une moyenne de<br />
150 clients par mois, le mois de février étant le plus sec, <strong>et</strong> les<br />
mois de mars <strong>et</strong> avril étant les meilleurs.<br />
Le site a reçu plus d'hommes que de femmes en janvier, avec<br />
54 %, mais par la suite la tendance ordinaire d'un plus grand<br />
nombre de femmes s'est rétablie à 54 % <strong>et</strong> 51 %,<br />
respectivement, en février <strong>et</strong> mars. Seulement 52 % des clients<br />
furent référés en janvier, comparativement à 42 % en février <strong>et</strong><br />
en 78 % en mars, la plupart pour MTS <strong>et</strong> VIH.<br />
6.0 Recommandations.<br />
● Il est nécessaire que le KNDAEP <strong>et</strong> le NAD travaillent plus<br />
fort pour atteindre l'objectif d'auto-suffisance.<br />
● Les constants problèmes de contrôle de la gestion ne<br />
serviront pas bien la collectivité sourde. Mais six mois<br />
constituent un temps bien court pour mesurer le succès d'un<br />
proj<strong>et</strong> ; c'est pourquoi on a espéré que le protocole<br />
d'entente avec LVCT serait prolongé d'un autre six mois,<br />
après quoi le KNDAEP <strong>et</strong> le NAD auraient été capables<br />
d'obtenir qu'un autre donateur continue à soutenir le proj<strong>et</strong>.<br />
● Les partenaires devraient également bâtir plus de confiance<br />
<strong>et</strong> de coopération en vue d'améliorer la qualité du service<br />
dispensé à la collectivité sourde.<br />
● Les proj<strong>et</strong>s pourraient être plus participatifs avec plus<br />
d'implication dans la planification de base ; des<br />
changements de plans devraient être discutés. Le proj<strong>et</strong><br />
Mobile VCT devraient faire appel à un partenaire qui avait<br />
initialement participé au développement de l'idée.<br />
Sommaire du budg<strong>et</strong><br />
1 USD =75 Kenya shillings.<br />
Item Unit<br />
cost<br />
in<br />
KSH<br />
A Staff salaries.<br />
Counselors 6 X<br />
267<br />
USD/75KSH Sub-total in<br />
KSH.<br />
1,600 120,000.00
Community<br />
Mobilizers<br />
Total<br />
B Administration<br />
4 X<br />
267<br />
Management 3 X<br />
534<br />
1,600 120,000.00<br />
1,600 120,000.00<br />
Office Rent 400 400 30,000.00<br />
Office<br />
Stationery &<br />
bills<br />
Total<br />
C Community<br />
Mobilization<br />
Constituency<br />
Mobilization<br />
D Mobile VCT<br />
Sessions<br />
Constituency<br />
Mobile VCT<br />
Total Cost<br />
Per year cost<br />
Five year cost<br />
200.00 200 15,000.00<br />
8 X<br />
267<br />
8 X<br />
534<br />
2136. 160,000.00<br />
4270 320,000.00<br />
10,005 885,000.00<br />
120,060<br />
600,300 45,022,500.00<br />
Les principaux défis dans la mobilisation communautaire<br />
comprennent le manque de matériaux de sensibilisation IEC en<br />
langue des signes, affiches, vidéos, t-shirts, dépliants <strong>et</strong> bill<strong>et</strong>s.<br />
C<strong>et</strong>te pénurie a nécessité le développement de matériaux à<br />
l'interne, ce qui augmente les coûts des fournitures de bureau. Là<br />
encore, ces matériaux fabriqués à l'interne ne peuvent pas être<br />
suffisants pour couvrir les régions rurales où ils sont plus
efficaces, <strong>et</strong> également où vit une majorité de la communauté<br />
sourde. Le manque de caméra vidéo fait qu'il est vraiment difficile<br />
de faciliter la présentation des modèles à suivre. Les prises vidéo<br />
d'activités qui se déroulent dans une région ont beaucoup<br />
d'impact sur l'enseignement dans une autre région ou pendant<br />
une formation de suivi. Le proj<strong>et</strong> a besoin d'une caméra <strong>et</strong> d'une<br />
vidéo caméra parce que la langue des signes est visuelle <strong>et</strong> les<br />
aides visuelles vont très loin dans l'amélioration de<br />
l'apprentissage.<br />
L'autre problème principal est le transport. Le coût de location du<br />
transport pendant les activités est très élevé comparativement à<br />
ce qu'il en coûterait pour conduire notre propre véhicule. Cela<br />
veut dire qu'il est moins cher d'ach<strong>et</strong>er <strong>et</strong> de conduire un véhicule<br />
4x4 pendant la mobilisation communautaire de la région <strong>et</strong> les<br />
sessions de VCT mobile.<br />
L'autre problème est celui de la durabilité. Il serait plus pratique<br />
de chercher un financement à long terme qui peut aider à donner<br />
des fonds de continuité, plutôt que des fonds qui nous arrivent<br />
goutte à goutte sur six mois ou un an. L'intégration de Deaf AIDS<br />
au système de santé national dépend du succès de ce proj<strong>et</strong>.<br />
Celui-ci demande que les Sourds puissent effectivement trouver<br />
des ARV aux hôpitaux locaux dans le cadre des programmes du<br />
gouvernement. Cela veut dire que les structures de soutien <strong>et</strong> de<br />
soins pour les sourds qui sont testés devraient être construites<br />
autour des centres de santé locaux. Mais très peu de centres de<br />
santé sont accueillants pour les Sourds.<br />
Une personne doit aller à l'hôpital avec un interprète. Mais, dans<br />
ce proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> dans le processus d'intégration, les matériaux IEC <strong>et</strong><br />
les sessions de VCT mobile sont faits dans les hôpitaux locaux. Ce<br />
proj<strong>et</strong> s'est intégré au programme du KNDAEP pour enseigner la<br />
langue des signes à au moins à cinq employés d'hôpitaux, ce qui<br />
les intègre complètement.<br />
Statistiques nationales sur les Sourds <strong>et</strong> rapport sur le<br />
développement humain (HDR).<br />
La population nationale compte plus de 30 millions de personnes<br />
(selon le recensement de 1999) dont environ 10 % sont estimées<br />
être handicapées.<br />
Il existe divers handicaps <strong>et</strong> nombre d'entre eux sont causés par<br />
divers facteurs.<br />
Les principaux facteurs causant les handicaps sont les maladies<br />
infantiles, principalement celles qui sont reliées à la nutrition.<br />
Définitions<br />
3 millions de Kenyans sont handicapés d'une façon ou d'une<br />
autre. Parmi ceux-ci, 51 % sont handicapés physiquement,<br />
environ 31 % ont un handicap auditif, <strong>et</strong> 9 %, 7 % <strong>et</strong> 3 % sont<br />
mentalement handicapés, aveugles ou sourds-aveugles,<br />
respectivement.<br />
31 % de la population, cela signifie que le Kenya compte de<br />
930 000 à 1 million de personnes sont sourdes.
Les Sourds se divisent encore en sourds <strong>et</strong> malentendants dans<br />
une proportion de trois à sept. Les Sourds ont une incapacité<br />
totale d'entendre <strong>et</strong>, dans la plupart des cas, ils sont également<br />
mu<strong>et</strong>s. Les malentendants peuvent entendre certains sons/mots<br />
<strong>et</strong> peuvent aussi vocaliser avec un certain degré de clarté. Mais,<br />
suivant la pratique internationale, le mot sourd signifie ici à la fois<br />
ceux qui sont entièrement sourds <strong>et</strong> ceux qui sont malentendants.<br />
Une personne est dite avoir un handicap auditif ou être (Sourde)<br />
si "il/elle est incapable d'entendre un son ou ne peut<br />
entendre que des sons de forte intensité, ou ne peut<br />
entendre que des mots qu'on lui crie, ou pourrait entendre<br />
un interlocuteur que s'il était assis devant elle, ou<br />
demanderait habituellement qu'on répète les mots<br />
énoncés, ou aimerait voir le visage de l'interlocuteur."<br />
La distribution régionale des sourds au Kenya est fortement reliée<br />
aux distributions de la pauvr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> à l'inscriptions dans les écoles,<br />
comparativement aux regroupements de Sourds. Mais les Sourds<br />
urbains sont plus faciles à définir que les Sourds ruraux ou ceux<br />
des taudis.<br />
Répartition des distributions par province :<br />
Province Pourcentage Population<br />
Moins<br />
de 20<br />
20 à<br />
40<br />
Plus<br />
de 40<br />
1 Nairobi 41 38 21 91,000<br />
2 Coast 29 44 27 116,000<br />
3 Eastern 44 40 16 128,000<br />
4 Rift Valley 43 46 11 212,000<br />
5 Central. 47 31 22 151,000<br />
6 North Eastern 36 35 29 44,000<br />
7 Western 44 42 14 143,000<br />
8 Nyanza 46 33 21 120,000
Totaux<br />
nationaux<br />
La surdité <strong>et</strong> le développement mental<br />
980,000<br />
La distribution des handicaps dans la population montre que les<br />
handicapés physiques sont les plus nombreux, suivis par les<br />
sourds, les aveugles, les personnes ayant une déficience<br />
intellectuelle <strong>et</strong> les sourds-aveugles.<br />
L'état de développement des handicapés au Kenya, selon l'index<br />
de développement humain. (KNHDR 1999; page xi).<br />
On estime à plus de 900 000 le nombre de personnes sourdes au<br />
Kenya.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Pont des Signes<br />
Développé à partir du programme de PowerPoint s'est préparé à<br />
la présentation par Dr. Anne Toth.<br />
Pont des Signes Bridge of Signs<br />
par<br />
Dr. Anne Toth R.S.W.<br />
Directrice du proj<strong>et</strong><br />
Association des Sourds du <strong>Canada</strong><br />
Pont des Signes<br />
● Est-ce que la langue des signes peut perm<strong>et</strong>tre aux enfants<br />
non sourds de triompher à travers leurs handicaps en<br />
communication?<br />
● Financé par le Programme de partenariat en<br />
développement social<br />
● Début: 5 janvier 2004<br />
● Fin: 31 mars 2006<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Besoins du proj<strong>et</strong><br />
● Les enfants qui présentent divers types<br />
d’handicaps font face à des barrières qui ne leur<br />
perm<strong>et</strong>tent pas d’utiliser la langue pour<br />
communiquer efficacement.<br />
● Il n’y a aucun modèle actuel qui explore ou<br />
démontre l’efficacité de la langue des signes<br />
comme outil pour faciliter la communication.<br />
● De plus en plus, la surdité chez les enfants, ne se<br />
présente pas comme seul handicap. C’est-à-dire<br />
qu’un enfant sourd a une forte probabilité d’avoir<br />
un autre handicap.<br />
● Aucune recherche n’a été faite pour explorer les<br />
bénéfices d’enseigner la langue des signes aux<br />
enfants qui ont un handicap au niveau<br />
développeméntal <strong>et</strong> cognitif.<br />
Objectifs du proj<strong>et</strong><br />
Étudier le potentiel de la Langue des signes en tant<br />
qu’outil de communication chez les enfants sourds <strong>et</strong><br />
non sourds de 0 à 6 ans présentant divers handicaps,<br />
tel que :<br />
● le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF)<br />
● des r<strong>et</strong>ards de développement<br />
● le trisomie<br />
● autisme<br />
● d’autres handicaps.<br />
Collaborer avec des professionnels oeuvrant avec les<br />
enfants ayant divers handicaps afin d’élaborer des<br />
programmes modèles souples ou universels pour<br />
former ces enfants (<strong>et</strong> ceux travaillant avec eux) à la<br />
langue des signes.<br />
Créer des trousses professionnelles, incluant manuel <strong>et</strong><br />
vidéo, pour distribution aux personnes soignantes, aux<br />
professionnels, aux organisations <strong>et</strong> aux parents dans<br />
l’ensemble du pays afin de les inciter <strong>et</strong> de les aider à<br />
se servir des leçons apprises au cours de ce proj<strong>et</strong>.
Résultats attendus<br />
Création d’un corps de recherche <strong>et</strong> de connaissances<br />
relatifs à la langue des signes en tant qu’outil de<br />
communication qui aidera à:<br />
1. Surmonter les obstacles de communication qui<br />
sont imposés par les handicaps cognitifs.<br />
2. Éliminez les obstacles qui rendent difficile<br />
l’intégration dans la société aux enfants <strong>et</strong> aux<br />
jeunes atteints de troubles de la communication.<br />
Groupe cible<br />
● Les enfants entre 0 à 6 ans qui présentent des<br />
handicaps cognitifs.<br />
● Parents, personnes soignantes, éducateurs <strong>et</strong><br />
autre professionnels qui travaillent auprès des<br />
enfants.<br />
● Les organisations <strong>et</strong> associations qui sont<br />
associées avec ces handicaps.<br />
Activités du proj<strong>et</strong><br />
Première rencontre avec les personnes impliquées - les<br />
2 <strong>et</strong> 3 avril 2004 :<br />
● Revue de littérature - mai 2004<br />
● Travail de recherche général (visiter des<br />
programmes) -mai à juin 2004<br />
● Deux conférences nationales -automne 2004 <strong>et</strong><br />
été 2005<br />
● Développement <strong>et</strong> mis en place du programmes<br />
modèles<br />
● Évaluations - Au cours du proj<strong>et</strong>
Jim Roots<br />
Directeur général de l’ASC<br />
Anne Toth<br />
Directrice du Proj<strong>et</strong><br />
Stephanie Duguay<br />
Assistante administrative<br />
L'équipe du proj<strong>et</strong>
Michel Lelièvre<br />
Coordonnateur du proj<strong>et</strong><br />
Tamara Witcher<br />
Assistante de recherche<br />
Evelyne Goun<strong>et</strong>enzi<br />
Assistante exécutive<br />
Pont des Signes
Utilisation de la littérature<br />
Pont des Signes<br />
Pourquoi utilise-t-on ASL <strong>et</strong> LSQ?<br />
Pont des Signes<br />
Engagement de nos partenaires impliqués<br />
Présentations réalisé<br />
Pont des Signes<br />
● École Gadbois, Montreal, Mai 25, 2004<br />
● Learned Soci<strong>et</strong>ies conference, Quebec City, Mai<br />
23-26, 2004<br />
● Centre Jules-Léger, Ottawa, Mai 27, 2004<br />
● Council for Exceptional Children, New Orleans,<br />
Avril 14-19, 2004<br />
● Canadian Association of Social Workers,<br />
Saskatoon, Juin 3-8, 2004<br />
● Board of Education, Saskatoon, Juin 8, 2004<br />
Pont des Signes<br />
Méthodologie du modèle pédagogique<br />
Pont des Signes
Pont des Signes<br />
La l<strong>et</strong>tre des parents pour<br />
l’autorisation de participation de leur<br />
enfant au «proj<strong>et</strong> Pont des signes»<br />
Pont des Signes<br />
Procédure d'évaluation<br />
Pont des Signes<br />
Journal de bord<br />
Évaluation
● Pré-évaluation<br />
● Post-évaluation<br />
Diffusion de recherche<br />
Les trousses<br />
d'apprentissage<br />
● CD<br />
● un manuel<br />
Présentations à venir<br />
● Deaf <strong>Canada</strong> Conference of CAD, Winnipeg, juill<strong>et</strong><br />
19-25, 2004<br />
● First Canadian Conference on Mental Health,<br />
Ottawa, Séptembre 9-12, 2004<br />
● Me<strong>et</strong>ing of a provincial group of parents of<br />
hearing, hard of hearing and Deaf children,<br />
l'autome 2004<br />
Pont des Signes<br />
Promotion <strong>et</strong> évaluation planifiées<br />
● Collection <strong>et</strong> analyse des données.<br />
● Discussion avec les partenaires <strong>et</strong> membres de<br />
l’équipe en ce qui concerne l’interprétation des<br />
données.<br />
● Consultation avec les partenaires pour identifier<br />
les conclusions, les démarches requises pour<br />
recherche future <strong>et</strong> le développement du proj<strong>et</strong>.
● Programme Modèle<br />
Réalisations Attendues<br />
● Trousses d’informations<br />
❍ manuel<br />
❍ vidéo cas<strong>et</strong>te, CD, DVD<br />
● Rapport final<br />
● Publication des résultats de recherche<br />
● ASC en Bref, site Web de l’ASC<br />
● Promotion publique aux conférences <strong>et</strong><br />
présentations<br />
● Conférence bi-annuelle Canadienne des Sourds<br />
(qui aura lieu à Winnipeg en 2004) <strong>et</strong> au gala des<br />
65ième anniversaire d’Association des Sourds du<br />
<strong>Canada</strong> (qui sera célébrée en 2005).<br />
Pont des Signes<br />
Questions? <strong>Commentaire</strong>s?<br />
Pont des Signes<br />
Merci pour votre intérêt <strong>et</strong> support envers le Pont des<br />
signes!<br />
Dr Anne Toth T.S.I.<br />
Directrice du Proj<strong>et</strong><br />
Association des Sourds du <strong>Canada</strong><br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Par : Saunders & Dean<br />
Différence entre le Deaf Youth<br />
R<strong>et</strong>reat program <strong>et</strong> le Social<br />
Youth Club Program<br />
Deaf Youth R<strong>et</strong>reat Program : Long terme :<br />
● Un week-end par mois<br />
I<br />
● Quelques fois en congé spécial de 3 jours (Noël <strong>et</strong> Congé<br />
scolaire de mars)<br />
● Limite de 10 enfants<br />
● Les enfants passe la nuit au chal<strong>et</strong> (Ontario Camp for the<br />
Deaf)<br />
● Répit pour les parents<br />
● Supervision exercés sur 24 heures<br />
● Les conseillers à la jeunesse se réunissent pour examiner<br />
les profils du client<br />
Parfois les enfants parviennent à un point de niveaux élevés de<br />
frustration, <strong>et</strong> nous serons là pour les soutenir de toutes les<br />
façons qui sont en notre pouvoir. Ensemble, notre équipe<br />
supervisera leurs interactions sociales, identifiera les aptitudes<br />
sociales positives, les aidera à apprendre à identifier leurs<br />
émotions <strong>et</strong> à pratiquer quelques connaissances pratiques. Nous<br />
allons également faire des activités intérieures <strong>et</strong> extérieures,<br />
dont les arts & artisanat, la natation, la randonnée, le théâtre <strong>et</strong><br />
plus encore. Un de nos objectifs de programme est de donner<br />
aux enfants une occasion de rencontrer de nouveaux amis, de<br />
pratiquer des interactions positives <strong>et</strong> de s'amuser. Nous<br />
encourageons aussi les enfants à participer à des activités qui<br />
améliorent l'estime de soi <strong>et</strong> les comportements positifs.<br />
Social Club Youth Program : Court terme .<br />
● 7 à 10 sessions - sessions de 2 heures.<br />
● Une fois par semaine par groupe.<br />
● Stable quant au langage <strong>et</strong> capable de communiquer.<br />
● Un groupe peut être constitué pour les buts particuliers.<br />
● Le programme peut comprendre un apprentissage<br />
concernant l'intimidation ("bully") <strong>et</strong> les "aptitudes sociales"<br />
● Le club social peut modifier le besoin de l'enfant <strong>et</strong> ce qu'ils<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
viennent chercher dans le programme.<br />
Ce programme donnera aux enfants l'occasion de donner une<br />
poussée à leur estime de soi, pour les enfants sourds, <strong>et</strong> leur<br />
donnera l'occasion d'exprimer leurs émotions <strong>et</strong> de pratiquer la<br />
résolution de conflits, d'apprendre la sociabilité <strong>et</strong> de<br />
développement une compréhension de l'amitié.<br />
BUTS du Deaf Youth R<strong>et</strong>reat program <strong>et</strong> du Social Club program:<br />
1. Augmenter l'estime de soi<br />
2. Améliorer les communications<br />
3. Soutenir la prise de décisions positive indépendante<br />
4. Enseigner la résolution de conflits<br />
5. Enseigner les sentiments d'appartenance <strong>et</strong> de connexion<br />
Les conseillers à la jeunesse sont formés pour l'ICR <strong>et</strong> le RCR <strong>et</strong><br />
en premiers soins <strong>et</strong> en ASL – l'American Sign Language est la<br />
langue première de tous nos programmes.<br />
1) L'estime de soi : Carrie<br />
Comment un groupe social améliore-t-il l'estime de soi ?<br />
● Les enfants ont quelque chose à quoi ils appartiennent, le<br />
PAH! Le personnel a été surpris de ce que les clients euxmêmes<br />
pensent que la participation à notre club social<br />
était considérée "cool", positive. Les clients qui viennent<br />
pour des rendez-vous individuels ou des réunions familiales<br />
se sentaient parfois stigmatisés comme client "mentaux".<br />
Nos clients se sentent déjà "différents" à cause d'un r<strong>et</strong>ard,<br />
ou d'une histoire qui contribue à leurs sentiments<br />
d'isolement.<br />
● L'estime de soi en groupe serait promue en affirmant leur<br />
identité individuelle de façons positives, selon plusieurs<br />
approches différentes, y compris l'invention de votre nom<br />
signé. Une des clientes les plus jeunes <strong>et</strong> les plus r<strong>et</strong>ardées<br />
dans le groupe des filles a trouvé énormément de<br />
satisfaction à se donner le nom de "juge" <strong>et</strong> à utiliser ce<br />
nom dans d'autres groupes. Également, des activités,<br />
comme celles consistant à faire des choses puis à les<br />
décrire devant les autres membres du groupe, ont affirmé<br />
l'identité personnelle. Dans le groupe des garçons, nous<br />
avons travaillé à fabriquer leurs propres boîtes pendant<br />
plusieurs semaines, une boîte avec un dehors <strong>et</strong> un dedans.<br />
● Certaines activités ressemblaient à de la thérapie par l'art<br />
ou à des activités de thérapie expressive. La différence<br />
tient au contexte. Le club social a de nombreux résultats<br />
positifs <strong>et</strong> des buts similaire comme thérapie de groupe,<br />
mais il n'est pas conçu avec les mêmes délimitations. Par<br />
exemple, tenir un groupe de thérapie exige de la<br />
confidentialité – difficile à réaliser dans un environnement<br />
de pensionnat. L'ouverture à des problématiques plus<br />
profondes avec des camarades qu'on voit tous les jours<br />
n'est pas nécessairement utile pour tous les clients. Un<br />
club social résout certaines de ces problématiques.<br />
2) La communication : Carrie
Comment le groupe aide-t-il à améliorer la communication ?<br />
● Beaucoup de nos clients marquent des r<strong>et</strong>ards du langage<br />
ou du développement, à cause de facteurs cognitifs, de<br />
privation de langage, de traumatismes pendant la p<strong>et</strong>ite<br />
enfance, <strong>et</strong>c. Aider les clients à s'exprimer simplement<br />
avec le langage, le jeu de rôles <strong>et</strong>... la communication non<br />
verbale dans une arène différente ... soutenir/ les buts de<br />
la thérapie comme la divulgation à des adultes/personnel/<br />
parents lorsqu'on se sent menacé dans sa sécurité.<br />
Exemple : une cliente, une p<strong>et</strong>ite fille de 9 ans appelés<br />
"Jennifer", m'informa qu'une des autres clients avait mis<br />
du beurre d'arachides sur son muffin anglais sans d'abord<br />
"demander la permission" au personnel. Plutôt que de lui<br />
dire qu'elle fait du "commérage" <strong>et</strong> lui demander d'arrêter<br />
ce comportement, nous avons discuté des raisons pour<br />
lesquelles elle m'avait donné c<strong>et</strong>te information. Plus tard,<br />
en thérapie individuelle, nous avons pu traiter de la façon<br />
dont elle informe le personnel de "p<strong>et</strong>ites" choses, mais<br />
dont elle a de la difficulté à informer des adultes<br />
concernant des choses "plus grosses", comme l'abus<br />
sexuel <strong>et</strong> le passage à l'acte. Le fait qu'elle puisse voir la<br />
différence était important dans sa propre prise de<br />
conscience d'elle-même.<br />
Carrie - Avantages : positifs, acceptation d'un<br />
environnement qui m<strong>et</strong> l'accent sur l'appui d'un point focal<br />
positif sur l'individu <strong>et</strong> ses émotions. Les enfants ont utilisé<br />
les modèles de comportement, <strong>et</strong> peut-être viennent de<br />
familles qui ne signent pas. Les programmes pour les<br />
jeunes donnent aux client une autre occasion de pratiquer<br />
des compétences avec un appui spécifique visant à<br />
"décortiquer" les étapes de la communication positive.<br />
3) Le soutien d'une prise de décisions positive indépendante :<br />
Juan<br />
● Le personnel servira de modèle pour les compétences de<br />
leadership voulues <strong>et</strong> soutiendra une bonne prise de<br />
décisions à travers la discussion, les activités <strong>et</strong> leur<br />
réflexion positive.<br />
● Les conseillers à la jeunesse soutiendront les enfant<br />
pendant qu'ils apprennent à éviter les situations négatives<br />
en utilisant une approche positive. Le conseiller à la<br />
jeunesse passe du temps à prévoir <strong>et</strong> anticiper les<br />
situations de conflit. Les enfants seront également<br />
encouragés à développer leurs propres solutions positives<br />
personnelles au conflit avant que le problème se présente<br />
par le truchement de jeux <strong>et</strong> d'autres activités. Une des<br />
meilleures méthodes est celle du jeu de rôles.<br />
● Les conseillers à la jeunesse encourageront la réflexion par<br />
le jeu de rôles, les journaux, les discussions en tête-à-tête<br />
ou en groupe.<br />
4) La résolution de conflit : Juan<br />
● Que se passe-t-il lorsqu'un conflit se produit entre<br />
camarades ? Les sentiments de dérangement peuvent
mener à un comportement agressif <strong>et</strong> il y en a qui ne<br />
savent tout simplement pas comment résoudre ce<br />
problème. Les conseillers à la jeunesse rencontrent les<br />
enfants <strong>et</strong> examinent les problèmes auxquels ils sont<br />
confrontés dans l'immédiat, de façon à trouver une<br />
solution positive avant que l'agression fasse irruption. Leur<br />
principal conseiller à la jeunesse fera un suivi avant la fin<br />
de la journée.<br />
● Apprendre à connaître les sentiments peut aider les<br />
enfants à mieux identifier les causes de leur agression.<br />
● Une des techniques que nous utilisons pour aider les<br />
enfants à résoudre les problèmes, c'est la "roue des<br />
sentiments".<br />
5) L'appartenance <strong>et</strong> la connexion : Juan<br />
● Les pairs partagent la même culture sourde <strong>et</strong> le même<br />
vécu<br />
● Le conseiller à la jeunesse comme modèle positif à imiter<br />
● Endroit où on se sent en sécurité / environnement où on<br />
est en sécurité<br />
Juan Jaramillo<br />
Child & Youth Worker Coordinator<br />
PAH! Milton,Ont.<br />
Mental Health Services for the Deaf & Hard of Hearing Children<br />
& Youth<br />
TTY: 905-878-0164<br />
Fax: 905-875-3007<br />
E-Pager: juanfj@mobile.rogers.com<br />
Web Site: http://www.bobrumball.org/pah.html<br />
II<br />
On estime à plus de 600 le nombre des enfants Sourds <strong>et</strong><br />
malentendants en Ontario, qui ont des problèmes graves de<br />
santé mentale.<br />
PAH fut créé pour offrir des services <strong>et</strong> de la consultation à<br />
quelques-uns d'entre eux.<br />
Nos clients nous sont référés pour cause de :<br />
● dépression <strong>et</strong> autres maladies psychiatriques <strong>et</strong><br />
conflits familiaux<br />
● troubles de l'attachement<br />
● sociabilité médiocre<br />
● questions d'orientation sexuelle<br />
● agression <strong>et</strong> aptitudes médiocres en gestion de la<br />
colère<br />
● victimes <strong>et</strong> auteurs d'abus sexuel <strong>et</strong> physique<br />
● abus d'alcool <strong>et</strong> toxicomanie<br />
L'équipe de PAH se compose d'un(e) thérapeute de l'enfance <strong>et</strong><br />
de la famille à temps plein <strong>et</strong> un(e) à temps partiel , 1<br />
coordonnateur à l'enfance <strong>et</strong> à la jeunesse, 1 travailleur social.
Lorsque nous avons été établis, il y a 5 ans, un de nos premiers<br />
proj<strong>et</strong>s fut d'établir des principes de santé mentale.<br />
Nous avons une liste de six principes en vertu desquels nous<br />
faisons notre travail.<br />
Ce sont :<br />
Être linguistiquement accessibles <strong>et</strong> culturellement sensibles.<br />
Cela comprend l'usage de l'ASL <strong>et</strong> le respect de la culture des<br />
Sourds, mais nous respectons aussi la diversité de nos<br />
populations <strong>et</strong> faisons appel à des interprètes d'autres langues<br />
(comme l'Urdu) lorsque le besoin de fait sentir.<br />
Nous avons travaillé à augmenter notre capacité de servir la<br />
collectivité des Sourds <strong>et</strong>, en même temps, nous avons travaillé<br />
à augmenter la capacité de la collectivité des Sourds à soutenir<br />
les enfants sourds qui ont des besoins en santé mentale.<br />
Nous avons amélioré l'accès à des services <strong>et</strong> des soutiens<br />
spécialisés.<br />
Une autre composante importante de notre travail est notre<br />
processus informé d'enveloppement.<br />
Ce processus vient du processus d'enveloppement qui<br />
enveloppe de services un client <strong>et</strong>/ou une famille.<br />
C'est le client <strong>et</strong> la famille qui déterminent quels sont les<br />
services qui leur seront le plus utile.<br />
C<strong>et</strong>te modalité a le plus souvent pris la forme de mentors<br />
sourds en accompagnement direct de l'enfant. Ce mentor<br />
conduira l'enfant dans la collectivité en m<strong>et</strong>tant l'accent sur le<br />
développement <strong>et</strong> l'amélioration des aptitudes sociales <strong>et</strong><br />
individuelles de celui-ci.<br />
Nous utilisons également ces fonds pour soutenir notre club<br />
social <strong>et</strong> notre r<strong>et</strong>raite des jeunes Sourds. Juan <strong>et</strong> Carrie<br />
parleront de ces programmes dans quelques minutes.<br />
Nous ne pourrions pas faire cela sans la souplesse financière<br />
inscrite dans notre budg<strong>et</strong>.<br />
Je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un de nos<br />
clients qui a bénéficié de notre programme.<br />
Darlene est une jeune Sourde de 17 ans qui représente un<br />
grand nombre de nos clients. Elle est née dans une famille<br />
d'entendants qui n'ont jamais appris à signer plus que quelques<br />
phrases de base.<br />
Elle avait eu des problèmes comportementaux <strong>et</strong> sociaux<br />
pendant bien des années avant la mise sur pied de PAH ! Après<br />
un an comme notre cliente il fut déterminé qu'elle avait besoin<br />
de traitement en résidence, mais il n'y avait pas de programme<br />
pour les Sourds en Ontario.
PAH! fut donc confronté au défi d'accéder à ce service pour elle<br />
dans la collectivité entendante <strong>et</strong> d'élaborer les soutiens qui<br />
perm<strong>et</strong>traient à ce programme de réussir.<br />
Bien sûr, nos inquiétudes initiales concernaient la façon dont<br />
elle communiquerait avec le personnel <strong>et</strong> les autres clients, <strong>et</strong> la<br />
façon dont le traitement serait dispensé.<br />
Éventuellement, nous avons trouvé un programme qui<br />
consentait à se lancer avec nous dans c<strong>et</strong>te expérience.<br />
PAH offrit une formation <strong>et</strong> du soutien au personnel autour de la<br />
formation en sensibilisation à la surdité.<br />
Une équipe d'interprètes en santé mentale fut constituée <strong>et</strong><br />
c<strong>et</strong>te équipe se réunit régulièrement avec le thérapeute<br />
primaire.<br />
Le contact avec la collectivité des Sourds fut maintenu par la<br />
participation, deux fois par semaine, d'un mentor sourd.<br />
Darlene continua à fréquenter une école pour les Sourds, ayant<br />
ainsi un contact quotidien avec ses camarades sourds.<br />
Comment les choses ont-elles changé ?<br />
Au cours des 2 dernières années, il y a eu une réduction du<br />
nombre des épisodes de dépression, <strong>et</strong> une réduction du<br />
comportement d'automutilation.<br />
Il y a eu une réduction de l'agression <strong>et</strong> des menaces verbales.<br />
Darlene n'a plus besoin d'un employés à son service exclusif<br />
dans la résidence de groupe ou à l'école. En fait, elle est<br />
présentement dans les 6 derniers mois d'un programme qui<br />
s'occupe surtout de préparer les jeunes à la vie indépendante<br />
une fois qu'ils ont leurs 18 ans.<br />
Darlene a développé une bonne sociabilité <strong>et</strong> s'est fait des amis<br />
dans le monde des Sourds <strong>et</strong> des malentendants.<br />
Elle peut faire des visites chez elle sur une base régulière, <strong>et</strong>,<br />
même si c<strong>et</strong>te situation n'a pas beaucoup changé, sa réaction à ;<br />
a situation a changé. Elle accepte que sa famille sera toujours<br />
comme elle est, <strong>et</strong> qu'elle ne peut pas les changer, mais qu'elle<br />
ne peut qu'être responsable pour elle-même.<br />
Elle a détenu un travail à temps partiel pendant presque un an.<br />
Je ne peux clore c<strong>et</strong>te histoire sans dire à quel point nous<br />
sommes reconnaissants au Ministère des Services à l'enfance<br />
pour l'appui financier qu'il a mis à la disposition de Darlene.<br />
J'ai parlé d'un aspect du programme. Carrie Cardwell <strong>et</strong> Juan<br />
Jaramillo vous parleront maintenant des programmes Social<br />
Club <strong>et</strong> Deaf Youth R<strong>et</strong>reat dirigés par PAH!
III<br />
Les buts du DYR <strong>et</strong> du Social Club:<br />
1. Accroître l'estime de soi<br />
2. Améliorer les communications<br />
3. Résolution de conflits<br />
4. Soutien de la prise de décisions positive indépendante<br />
Carrie : Comment les groupes sociaux<br />
accroissent-ils l'estime de soi ?<br />
● Les clients qui viennent à des rendez-vous individuels ou<br />
des réunions familiales peuvent se sentir stigmatisés<br />
comme client "mentaux". Les clients se sentent déjà<br />
"différents" à cause de leur statut cognitif, ou d'une<br />
histoire traumatique, qui contribue intrinsèquement au<br />
sentiment d'isolement.<br />
● Lorsqu'ils se joignent à un groupe social, les clients ont<br />
quelque chose de positif à quoi ils appartiennent. Le<br />
personnel de PAH! a été surpris d'entendre dire que les<br />
clients avaient dit à d'autres clients que c'était "cool" de<br />
participer au club social.<br />
● Pour les dispensateurs de soins, y compris le personnel de<br />
la résidence, un groupe social peut être "facile à vendre"<br />
aux services de santé mentale. Un parent qui n'est pas<br />
encore prêt à rencontrer un thérapeute <strong>et</strong> son enfant peut<br />
être ouvert à envoyer son enfant à un club d'après l'école.<br />
Après l'expérience, un dispensateur de soins peut se sentir<br />
plus à l'aise avec le programme. Entendre parler du club<br />
social peut démystifier ce que le personnel de santé<br />
mentale fait en réalité.<br />
● L'estime de soi en groupe est promue par l'affirmation de<br />
leur identité individuelle de façons positives, à partir d'une<br />
variété d'approches structurées.<br />
Exemple : dans le premier groupe, présentez-vous en<br />
inventant votre nom signé. Une des plus jeunes clients, <strong>et</strong><br />
des plus r<strong>et</strong>ardés, dans le groupe des filles a trouvé<br />
beaucoup de satisfaction à se donner le nom de "juge" <strong>et</strong> a<br />
utilisé ce nom dans d'autres groupes.<br />
● des activités comme celle de faire des choses, puis les<br />
décrire devant les autres membres du groupe, ont affirmé<br />
l'auto-identité. Dans le groupe des garçons, ils ont travaillé<br />
à faire leurs propres boîtes pendant plusieurs semaines,<br />
une boîte avec un dehors <strong>et</strong> un dedans.<br />
● Au club social, certaines activités sont semblables à la<br />
thérapie d'art en groupe ou aux activités de thérapie<br />
expressive, mais le contexte du "club" est conçu avec<br />
différentes limites que celles d'une thérapie de groupe plus<br />
orientée clinique. L'accent dans le club social <strong>et</strong> sur bâtir<br />
des compétences en communication directement dans un<br />
contexte social. Les limites sont moins rigides dans le club<br />
social que pour une thérapie de groupe orientée en<br />
profondeur, où la confidentialité est critique pour la<br />
sécurité émotive des clients. La confidentialité est<br />
virtuellement impossible à réaliser dans un environnement<br />
de non traitement en résidence. Après écouté secrètement
les filles à la cafétéria, une client courut à sa conseillère <strong>et</strong><br />
discuta avec excitation du thème <strong>et</strong> des activités du groupe<br />
autour de ce qu'est un "bon" secr<strong>et</strong> <strong>et</strong> ce qu'est un secr<strong>et</strong><br />
"négatif".<br />
● Les clients qui assistent à une thérapie de groupe dans un<br />
environnement confidentiel n'ont pas tendance à se<br />
connaître <strong>et</strong> les amitiés en dehors du groupe ne sont pas le<br />
but de la thérapie <strong>et</strong> peuvent même être découragées.<br />
Dans un environnement de grand pensionnat, les clients<br />
ont établi depuis longtemps l'histoire qui les relie. Ouvrir<br />
les clients à u processus plus profond en groupe serait<br />
contre thérapeutique. Lorsque des questions plus<br />
profondes se soulèvent, par exemple, des sentiments non<br />
résolus reliés à l'abus, je peux reconnaître le problème, le<br />
nommer, <strong>et</strong> rediriger les clients vers leur thérapie<br />
individuelle pour traiter plus loin une mémoire.<br />
● Le club social n'est pas un groupe de thérapie qui traite<br />
d'enjeux plus profonds. Le Social Club est un groupe avec<br />
des approches structurées, planifiées, thérapeutiques qui<br />
encouragent directement le changement sans s'en<br />
rem<strong>et</strong>tre à l'introspection du client. Comme nombre de nos<br />
clients ont est problèmes d'attachement, <strong>et</strong> ont des r<strong>et</strong>ards<br />
de langage dus à une variété de facteurs cognitifs <strong>et</strong><br />
environnementaux, nous trouvons que la thérapie<br />
individuelle est la meilleure approche de traitement pour<br />
travailler à travers des problèmes de base.<br />
Comment le groupe améliore-t-il la<br />
communication ?<br />
● Beaucoup de nos clients sont r<strong>et</strong>ardés pour le langage <strong>et</strong> le<br />
développement, à cause de facteurs cognitifs, de privation<br />
de langage de traumatismes de la p<strong>et</strong>ite enfance, <strong>et</strong>c. Le<br />
club social soutient l'expression par le langage, le jeu de<br />
rôle, la communication non verbale, l'art, les jeux de<br />
constitution d'équipes. Les but thérapeutiques, comme de<br />
dire aux adultes/personnel/parents lorsqu'on ne se sens<br />
pas en sécurité, sont soutenus dans un contexte plus<br />
informel qu'une session de thérapie.<br />
● Vign<strong>et</strong>te de "beurre d'arachides". Une client de 9 ans<br />
nommée "Jennifer" m'informa qu'une des autres clientes<br />
avait utilisé du beurre d'arachides sur son muffin anglais<br />
sans d'abord "demander la permission" du personnel.<br />
Plutôt que de lui dire qu'elle faisait du "commérage" <strong>et</strong> de<br />
lui demander de cesser ce comportement, ce à quoi elle<br />
était habituée dans l'école <strong>et</strong> la résidence, nous avons fait<br />
le point sur ce qu'elle ressentait, <strong>et</strong> comment l'autre client<br />
se sentait. Le groupe participa activement à la discussion<br />
en témoignant de ses réactions. Ici, l'accent portait sur<br />
l'action du moment, <strong>et</strong> non sur la raison sous-jacente du<br />
comportement.<br />
● Plus tard en thérapie individuelle, nous avons été capables<br />
de traiter de la façon dont elle est sur la bonne voie, en<br />
communiquant au personnel lorsqu'elle ne se sent pas à<br />
l'aise. Elle raconte au personnel des choses sur des<br />
questions qui ont l'air insignifiant, mais elle a de la<br />
difficulté à informer les adultes concernant les<br />
préoccupations significatives qui se rattachent à la sécurité<br />
<strong>et</strong> au passage à l'acte sexuel. Le but de l'augmentation de<br />
sa sensibilisation à sa réaction à la peur, à la perte de
contrôle, <strong>et</strong>c. est un but thérapeutique. Le but d'amorcer<br />
une discussion positive, c'est l'un des buts d'un groupe du<br />
club social.<br />
● Les groupes sociaux donnent aux clients une autre<br />
occasion de pratiquer des compétences. Le personnel aide<br />
à identifier, à chaque étape, la communication positive. La<br />
communication positive ne veut bien sûr pas dire<br />
l'expression seulement de sentiments joyeux, mais plutôt,<br />
l'usage des communications pour montrer quels sont vos<br />
sentiments sans passer à l'acte.<br />
Différences entre le club social <strong>et</strong> le DYR :<br />
● le club social est mieux pour ceux qui touchent le<br />
développement du langage, parce qu'un cadre temporel<br />
plus court exige plus de langage ; modèle convenant aux<br />
filles qui sont en général plus verbales.<br />
● DYR, avec un cadre temporel plus large, place à la<br />
répétition, <strong>et</strong> à une approche orientée vers l'action<br />
fonctionne mieux pour les garçons.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
La communication affective entre<br />
l’enfant sourd, sa famille <strong>et</strong><br />
l’équipe de réadaptation<br />
Par : Louise Roberge, psychologue<br />
Thérapeute conjugale <strong>et</strong> familiale<br />
Institut Raymond Dewar<br />
En réadaptation, l’objectif poursuivi est de favoriser le<br />
développement de la communication chez l’enfant sourd. Ce<br />
dernier <strong>et</strong> ses parents tentent de communiquer aux<br />
intervenants de réadaptation l’expérience affective reliée à la<br />
surdité. C<strong>et</strong>te tentative de communication se fait souvent à leur<br />
insu, <strong>et</strong> de manière implicite <strong>et</strong> non-verbale. Des phénomènes<br />
tels que les symptômes de l’enfant, le transfert <strong>et</strong> le contr<strong>et</strong>ransfert,<br />
ainsi que la résonance sont impliqués. Il importe que<br />
les intervenants reçoivent, <strong>et</strong> tentent de décoder ces messages<br />
afin de mieux intervenir.<br />
C<strong>et</strong>te communication vise à sensibiliser les intervenants à<br />
l’importance de la communication affective avec les enfants<br />
sourds <strong>et</strong> leurs familles, <strong>et</strong> à l’utilisation de leur subjectivité<br />
comme source d’information. La surdité ayant des impacts<br />
individuels <strong>et</strong> interactionnels, il s’agit de présenter certains<br />
concepts intra-psychiques <strong>et</strong> systémiques pertinents à la<br />
communication affective, <strong>et</strong> d’appliquer ces idées au travail en<br />
équipe interdisciplinaire.<br />
Symptôme <strong>et</strong> communication affective<br />
Nous aborderons d’abord le symptôme comme étant un<br />
phénomène de communication affective. Plus précisément, il<br />
sera question dans un premier temps du sens intra-psychique<br />
du symptôme chez l’enfant.<br />
Selon Maud Mannoni (1967), les symptômes d’un enfant<br />
constituent en fait une parole voilée, c’est-à-dire un moyen<br />
d’exprimer indirectement les difficultés vécues. Par son<br />
symptôme, l’enfant tente donc de communiquer, même si cela<br />
se fait à son insu. Le symptôme peut exprimer la difficulté de<br />
l’enfant de s’adapter à la réalité de sa surdité, comme il peut<br />
être relié à la difficulté de composer avec la séparation de ses<br />
parents, ou avec l’arrivée d’un autre enfant dans la famille.<br />
Le symptôme est aussi une tentative inconsciente de solution<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
d’un enjeu développeméntal que l’enfant n’arrive pas à<br />
résoudre. Il exprime l’impasse développeméntal dans lequel<br />
l’enfant se trouve.<br />
L’exemple clinique suivant peut être présenté les crises de<br />
colère d’une enfant sourde de sept ans, qui sont apparues vers<br />
l’âge de deux ans, suite au diagnostic de la surdité.• Par ses<br />
crises de colère, l’enfant exprime sa frustration, sa rage, <strong>et</strong><br />
aussi son impuissance, face à la surdité <strong>et</strong> aux difficultés de<br />
communication qui en découlent. En s’opposant fortement à sa<br />
mère, l’enfant tente aussi de se séparer, de se différencier<br />
psychologiquement. Elle éprouve des difficultés à y arriver<br />
parce qu’elle n’a pas pu comme une autre enfant s’appuyer sur<br />
le langage. Donc les crises d’agressivité indiquent une difficulté<br />
de séparation psychologique reliée à la surdité.<br />
Après avoir présenté le sens intra-psychique que peut avoir un<br />
symptôme, il est pertinent d’en aborder le sens systémique. Le<br />
sens systémique du symptôme est relié au message, que<br />
l’enfant exprime à son insu, concernant l’expérience affective de<br />
la famille. Par son symptôme, l’enfant est à son insu le hautparleur,<br />
le porte-parole de l’expérience affective de tous <strong>et</strong><br />
chacun des membres de la famille.<br />
Par ses crises, l’enfant est le haut-parleur de l’expérience<br />
affective vécue par tous <strong>et</strong> chacun des membres de la famille<br />
face à la surdité: leur colère, leur peine, <strong>et</strong> aussi leur<br />
impuissance à communiquer par le langage la complexité des<br />
émotions présentes.<br />
Transfert, contre-transfert <strong>et</strong><br />
communication affective<br />
Un autre phénomène de communication affective est relié au<br />
transfert <strong>et</strong> au contre-transfert.•• Avant d’apporter des<br />
exemples cliniques, il importe d’expliquer ces mécanismes dans<br />
un premier temps.<br />
Au suj<strong>et</strong> du transfert, Freud a écrit que tout individu possède<br />
une manière d’être personnelle de vivre ses relations affectives.<br />
C<strong>et</strong>te manière d’être caractéristique peut se comparer à un<br />
cliché qui se reproduit <strong>et</strong> se répète plusieurs fois dans la vie de<br />
l’individu dans ses relations affectives. Freud écrit :<br />
«Ce que le client recrée dans le transfert est …ce<br />
qui ne peut être pensé (traduit) ou dit. Le transfert<br />
est fondamentalement adressé à un autre…<strong>et</strong> c’est<br />
dans c<strong>et</strong>te adresse qu’une vérité peut se faire<br />
jour».(Freud, 1952/1992, p.50-51)<br />
Le concept de transfert qui a été élaboré dans le cadre de la<br />
psychothérapie individuelle psychanalytique peut être utile pour<br />
comprendre certains phénomènes qui surviennent dans la<br />
relation entre un enfant sourd <strong>et</strong> les intervenants.<br />
L’exemple suivant illustre c<strong>et</strong>te idée. Un enfant sourd, disposant<br />
encore de peu de langage, entre spontanément en contact dans<br />
la salle d’attente avec son orthophoniste, en lui heurtant le
ventre avec une p<strong>et</strong>ite auto (jou<strong>et</strong>). Ajoutons que le jeu,<br />
symbolique spontané préféré de c<strong>et</strong> enfant est le suivant: des<br />
autos qui entrent en collision.•<br />
Plus tard, dans le processus de l’intervention, les intervenants<br />
apprennent un secr<strong>et</strong> concernant le contexte ayant entouré la<br />
conception de c<strong>et</strong> enfant. Ces derniers sont informés que<br />
l’enfant était un accident, selon l’image employé en langage<br />
populaire. De plus, les intervevants apprennent que depuis le<br />
diagnostic de la surdité, les conjoints se heurtent <strong>et</strong><br />
s’affrontent, ce dont l’enfant est témoin. Par ses comportements<br />
<strong>et</strong> ses jeux symboliques, l’enfant tente donc d’exprimer, à son<br />
insu, une expérience affective reliée à des enjeux fondamentaux<br />
dans la famille.<br />
Abordons maintenant le concept de contre-transfert <strong>et</strong> son<br />
évolution. En 1910, Freud mentionne pour la première fois le<br />
terme de contre-transfert qui réfère à l’expérience affective du<br />
thérapeute face à une personne aidée. Jusqu’à 1950, les<br />
réactions émotives vécues face à une personne aidée sont<br />
d’abord vues comme reliées aux conflits personnels du<br />
thérapeute <strong>et</strong> comme pouvant nuire à la relation thérapeutique.<br />
En 1950, Paula Heimann enrichit la notion de contre-transfert<br />
en y voyant une source d ’information sur le patient. Saint-<br />
Pierre <strong>et</strong> al., rapportant la pensée de Heimann, écrivent :•« le<br />
contre-transfert renseigne ... sur le monde interne du patient tel<br />
qu ’il est communiqué à travers les échanges <strong>et</strong> les transactions<br />
au sein du champ dynamique qu’est la situation thérapeutique. »<br />
L’expérience subjective vécue par un intervenant dans sa<br />
relation avec l’enfant sourd <strong>et</strong> sa famille peut donc constituer<br />
donc une source d’information perm<strong>et</strong>tant de mieux<br />
comprendre les clients. Dans la présentation, des exemples<br />
cliniques sont apportés.<br />
Concepts systémiques<br />
Quand une équipe d’intervenants intervient auprès d’un enfant<br />
sourd <strong>et</strong> de ses parents, les concepts systémiques sont très<br />
pertinents pour comprendre les phénomènes de communication<br />
affective qui surviennent.<br />
En approche systémique, la première cybernétique, qui est<br />
apparue vers 1950, accordait une grande importance à<br />
l’objectivité de l’intervenant. Ce dernier était considéré comme<br />
un spécialiste neutre à l ’extérieur du système thérapeutique.<br />
Rappelons d’ailleurs que l’approche systémique est née en<br />
réaction à la psychanalyse qui accordait une grande importance<br />
aux phénomènes transférentiels <strong>et</strong> contre-transférentiels.<br />
La seconde cybernétique, qui est apparue aux débuts des<br />
années 1980, considère qu’un nouveau système se construit<br />
dans la relation entre l’intervenant (ou groupe d’intervenants)<br />
<strong>et</strong> la famille desservie. Ce nouveau système qui émerge<br />
constitue le système thérapeutique. La seconde cybernétique<br />
accorde de plus une place importante à la subjectivité de<br />
l’intervenant. Des nouveaux concepts, tels que l’auto-référence<br />
<strong>et</strong> la résonance notamment, en témoignent.
Concernant le concept d’auto-référence, Maurizio Andolfi, écrit :<br />
« Les motivations <strong>et</strong> attentes du thérapeute ne<br />
peuvent… être ni neutres ni d’ordre générique,<br />
mais se caractérisent au contraire par<br />
l’autoréférentialité <strong>et</strong> sont guidées par ses<br />
convictions personnelles <strong>et</strong> par son propre système<br />
de valeurs » (Andolfi, 1995, p.130).<br />
Quant au concept de résonance, Mony Elkaïm écrit:<br />
«J’appelle résonances ces assemblages<br />
particuliers, constitués par l’intersection d’<br />
éléments communs à différents individus ou<br />
systèmes humains, que constituent les<br />
constructions mutuelles du réel du système<br />
thérapeutique; ces éléments semblent résonner<br />
sous l’eff<strong>et</strong> d’un facteur commun, un peu comme<br />
des corps se m<strong>et</strong>tent à vibrer sous l’eff<strong>et</strong> d’une<br />
fréquence déterminée». Il poursuit en ajoutant:<br />
«les sentiments qui naissent chez tel ou tel<br />
membre du système thérapeutique ont …un sens<br />
<strong>et</strong> une fonction par rapport au système même où<br />
ils émergent» (Elkaïm, 1995, p.602).<br />
En appliquant ces idées à l’intervention auprès de l’enfant sourd<br />
<strong>et</strong> des membres de sa famille, il est permis de penser que ces<br />
derniers éveillent <strong>et</strong> amplifient des éléments particuliers, donc<br />
des résonnaces, chez les intervenants de l’équipe. L’expérience<br />
subjective vécue par les intervenants est donc une source<br />
d’information importante.<br />
Elkaïm écrit :<br />
«nous ne pouvons éprouver un sentiment<br />
particulier, dans une situation spécifique, que si,<br />
quelque part, une corde sensible vibre en nous. A<br />
mes yeux, toutefois, le sens <strong>et</strong> la fonction de la<br />
vibration de c<strong>et</strong>te corde ne doivent pas être<br />
recherchés uniquement dans l’économie de<br />
l’individu: ils sont liés, en même temps, au<br />
système au sein duquel l’individu se découvre en<br />
train de vivre ce sentiment». Il ajoute : «… je ne<br />
crois pas que ce que nous ressentons … soit un<br />
handicap: ces prétendus handicaps me semblent<br />
au contraire pouvoir être transformés en des outils<br />
de travail qui constituent de précieux<br />
atouts» (Elkaïm, 1995, p.602)<br />
D’autres éléments d’information reliés à l’exemple clinique<br />
apporté précédemment peuvent illustrer le concept de<br />
résonance. Ce jeune enfant sourd mentionné précédemment,<br />
collaborait peu à l’orthophonie, en s’opposant beaucoup<br />
notamment quand les deux parents étaient présents.<br />
L’orthophoniste <strong>et</strong> l’audiologiste n’osaient pas dire aux parents<br />
que l’intervention stagnait, que l’enfant ne progressait pas selon<br />
le pronostic établi en fonction de critères objectifs, tels que le<br />
degré d’audition corrigée <strong>et</strong> de perte auditive, <strong>et</strong> l’age lors de
l’appareillage auditif. Un secr<strong>et</strong> s’était donc graduellement<br />
installé entre les intervenants <strong>et</strong> les parents. Plus tard, les<br />
intervenants apprenaient qu’il y avait aussi un secr<strong>et</strong> dans la<br />
famille.<br />
D’autres phénomènes de résonance qui se sont produits en<br />
relation avec c<strong>et</strong>te famille peuvent être mentionnés.<br />
L’orthophoniste s’efforçait d’obtenir rapidement des résultats<br />
avec l’enfant, en résonance avec la demande implicite de la<br />
mère qui s’inquiétait beaucoup pour le développement de la<br />
parole de l’enfant. L’audiologiste, en résonance avec le père,<br />
avait bon espoir qu’avec le temps, l’enfant progresserait.<br />
Conclusion<br />
En conclusion, l’intervention vise à symboliser le non-dit, ce qui<br />
est vécu de manière implicite, d’abord entre les intervenants,<br />
lors des discussions cliniques entre eux, <strong>et</strong> par la suite avec la<br />
famille. Il s’agit donc de nommer ce qui était jusque là<br />
innommable. L’intervention tente ainsi de rétablir un processus<br />
essentiel dans le développement de la communication qui a été<br />
ébranlé par la surdité.<br />
Benoit Virole, dans un texte encore inédit, formule clairement<br />
c<strong>et</strong>te idée en écrivant :<br />
«Un des apports les plus importants de l’étude de<br />
la surdité est le constat que le langage ne se<br />
développe pas sur des bases «protophonologiques»<br />
mais comme une extension des<br />
compétences interactionnelles du nourrisson en<br />
relation avec son environnement parental. Le<br />
premier instant critique dans la vie d’un enfant<br />
sourd est celui de l’établissement des relations<br />
affectives précoces. On sait que l’établissement<br />
des relations affectives précoces se construit sur<br />
une modalité biologique, celui de l’attachement,<br />
mais qu’il ne s’y réduit pas. …Ces relations<br />
s’établissent au travers d’un processus<br />
inconscient ... De façon schématique, ce que le<br />
p<strong>et</strong>it enfant ressent comme dangereux <strong>et</strong> toxique<br />
dans son moi primitif doit être expulsé à l’extérieur<br />
au travers du comportement. … le contenu de ces<br />
expulsions doit être compris par la mère,<br />
symbolisé par elle <strong>et</strong> r<strong>et</strong>ranscris sous un autre<br />
mode chez son propre enfant pour que celui-ci<br />
puisse l’introjecter dans sa constitution psychique.<br />
Ce processus … est mis à mal par l’existence de la<br />
surdité. … En eff<strong>et</strong>, du fait de la dépression post<br />
diagnostique chez la mère, qu’elle soit manifeste<br />
ou masquée, ces échanges inconscients sont<br />
généralement grandement altérés. L’enfant <strong>et</strong> sa<br />
mère ne peuvent avancer ensemble dans une<br />
synergie des échanges inconscients.» (Virole, B.,<br />
<strong>et</strong> al., 2003, p.7)<br />
Bibliographie<br />
Andolfi,M. (1995).Famille/Individu: un modèle trigénérationnel,
in Mony Elkaïm (sous la direction de), Panorama des thérapies<br />
familiales, Paris, Seuil.<br />
Bouchard,M.A .& al. (1994). De l’écoute à l’interprétation: une<br />
approche des phénomènes de contre-transfert. Revue<br />
québecoise de psychologie, Vol.15, no.1<br />
Elkaïm, M.<strong>et</strong> Stengers,I. (1997). Assemblages <strong>et</strong> production de<br />
subjectivité en thérapie familiale» in Cahiers critiques de<br />
thérapie familiale <strong>et</strong> de pratiques de réseaux, No.18, 1997/1,<br />
p.111-133<br />
Elkaïm, M. (sous la direction de) (1995). Panorama des<br />
thérapies familiales. Paris, Seuil.<br />
Freud, S. (1953|1992) La technique psychanalytique, Paris, P.U.<br />
F..<br />
Mannoni,M. (1967). L’enfant, sa «maladie» <strong>et</strong> les autres: le<br />
symptôme <strong>et</strong> la parole. Paris, Seuil.<br />
Saint-Pierre, F., Pauzé,R., Normandin,L.<strong>et</strong> Bouchard, M.-A..<br />
Auto-référence <strong>et</strong> contre-transfert: deux territoires aux<br />
frontières communes, in Générations, 6, p.45-43<br />
Virole,B. <strong>et</strong> Ibad-Ramos,M.. Psychiatrie de l,enfant <strong>et</strong> de<br />
l’adolescent sourd, 20 ans de clinique, document inédit<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Le pouvoir des parents<br />
Le vendredi 10 septembre 2004<br />
11:15-12:00<br />
Bonjour. Je m'appelle Vicki Robinson <strong>et</strong> je fais c<strong>et</strong>te<br />
présentation en tant que représentante de l'organisation VOICE<br />
For Hearing Impaired Children. Je suis la mère d'un garçon de<br />
24 ans qui a subi une perte auditive sensori-neurale bilatérale<br />
de modérée à sévère depuis sa naissance.<br />
Même si les membres de VOICE sont des professionnels,<br />
audiologistes, enseignants de malentendants, orthophonistes <strong>et</strong><br />
thérapeutes selon la méthode d'enseignement orale - <strong>et</strong> même<br />
si VOICE For Hearing Impaired Children a un personnel<br />
professionnel à Toronto – directeur général, directeur de<br />
services thérapeutiques, conseiller en éducation <strong>et</strong> en santé, <strong>et</strong><br />
adjoint(e) à la direction – VOICE est une organisation de<br />
parents <strong>et</strong> de familles . Il sied donc que je vous adresse la<br />
parole aujourd'hui, en tant que parente <strong>et</strong> sur le suj<strong>et</strong> du<br />
pouvoir des parents.<br />
VOICE célèbre c<strong>et</strong>te année son 40e anniversaire. Nous avons<br />
commencé comme organisation de soutien de parents à la base<br />
<strong>et</strong>, aujourd'hui, VOICE offre de l'aide émotive <strong>et</strong> technique aux<br />
familles d'enfants malentendants en soutenant le choix des<br />
parents quant à la façon dont leurs enfants communiquent.<br />
VOICE comprend environ 1000 membres répartis en 17<br />
chapitres à travers le <strong>Canada</strong>.<br />
Parmi les caractéristiques de ceux qui font arriver les choses se<br />
trouvent un objectif clair <strong>et</strong> une mission définie, du dévouement<br />
<strong>et</strong> de la persévérance. Les parents qui furent <strong>et</strong> sont encore la<br />
force motrice derrière VOICE For Hearing Impaired Children<br />
sont des personnes de c<strong>et</strong>te trempe. VOICE s'est donné comme<br />
mission centrale "de faire en sorte que tous les enfants<br />
ayant une déficience auditive aient le droit d'entendre <strong>et</strong><br />
de parler."<br />
Au cours des 40 dernières années, les parents <strong>et</strong> les<br />
professionnels ont travaillé de façon diligente <strong>et</strong> collaborative à<br />
atteindre ces objectifs. Grâce à leurs efforts visionnaires, ils ont<br />
éduqué les représentants des gouvernements des services de la<br />
santé <strong>et</strong> de l'éducation <strong>et</strong> ils ont intercédé pour les services dont<br />
ils ont besoin. Ils sont restés concentrés sur leur but <strong>et</strong> ont<br />
continué leurs efforts face à la résistance au changement <strong>et</strong> ils<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
ont été capables d'influencer le développement de programmes<br />
d'intervention précoce, de services itinérants dans les<br />
commissions scolaires locales <strong>et</strong> ils ont été en mesure d'assurer<br />
le financement nécessaire pour soutenir les services d'implant<br />
cochléaire.<br />
En plus, VOICE offre maintenant des services d'intervention<br />
thérapeutique selon la méthode orale dans toute la province<br />
d'Ontario, forme des professionnels pour travailler avec les<br />
enfants ayant une perte auditive qui sont en train d'apprendre à<br />
entendre <strong>et</strong> à parler, <strong>et</strong> offre des programmes de soutien pour<br />
les familles d'enfants sourds <strong>et</strong> malentendants. Le <strong>Canada</strong><br />
s'enorgueillit d'avoir une grande concentration de thérapeute<br />
selon la méthode orale <strong>et</strong> VOICE attribue c<strong>et</strong>te situation aux<br />
efforts unifiés des parents.<br />
En 2000, VOICE a élaboré un plan stratégique qui solidifiait/<br />
consolidait les buts de l'organisme :<br />
Faire en sorte que tous les parents d'enfants qui viennent de<br />
recevoir un diagnostic de surdité en Ontario soient sensibilisés à<br />
l'option de l'approche orale<br />
Étendre l'accès à la thérapie selon la méthode orale en Ontario<br />
Améliorer l'intégration des enfants sourds au système<br />
d'éducation de l'Ontario.<br />
J'ai déjà fait référence plusieurs fois à la thérapie selon la<br />
méthode orale -- TAV. Et vous vous demandez probablement<br />
ce que c'est ? Parce que la TAV est une des pierres d'assise de<br />
VOICE ; parce que c'est ce que nous proposons pour tous les<br />
enfants sourds <strong>et</strong> malentendants ; parce que nous savons que<br />
ça fonctionne ; <strong>et</strong> parce que c'est ce que nous faisons le mieux.<br />
Je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous<br />
l'expliquer !<br />
Qu'est-ce donc que la méthode d'enseignement orale ?<br />
C<strong>et</strong>te méthode souscrit sur la croyance que les enfants sourds<br />
<strong>et</strong> malentendant peuvent apprendre à entendre <strong>et</strong> à parler.<br />
Même un minimum d'audition résiduelle, lorsqu'elle est<br />
amplifiée <strong>et</strong> formée, suffit pour que les enfants développent le<br />
langage oral.<br />
Voici un certain nombre de principes qui sous-tendent la<br />
méthode d'enseignement orale :<br />
DÉTECTION PRÉCOCE – les bébés peuvent être testés à la<br />
naissance pour détecter la présence d'une perte auditive.<br />
Souvent les parents soupçonnent une perte des mois avant<br />
qu'elle soit confirmée en réalité.<br />
AJUSTEMENT PRÉCOCE DE PROTHÈSES AUDITIVES OU<br />
D'IMPLANTS COCHLÉAIRES – avec les progrès réalisés dans la<br />
technologie des prothèses auditives <strong>et</strong> de l'implant cochléaire,<br />
les bébés peuvent recevoir des prothèses auditives aussi tôt que<br />
nécessaire. Les implants cochléaires sont maintenant
disponibles pour les bébés ayant des pertes profondes qui ont<br />
aussi peu que 1 an.<br />
MAXIMISATION DES APTITUDES D'ÉCOUTE – avec<br />
l'amplification voulue, les enfants qui sont sourds ou<br />
malentendants apprennent le langage par la voie normale, c'està-dire<br />
l'OUÏE.<br />
INTERVENTION ORTHOPHONIQUE IMMÉDIATE – Il est important<br />
de maximiser la période critique de l'acquisition du langage<br />
pendant les premières années. Aucun bébé n'est trop jeune<br />
pour commencer la MEO.<br />
MÉTHODE CENTRÉE SUR LE PARENT DISPENSATEUR DE SOINS<br />
–Les jeunes enfants apprennent le langage toute la journée,<br />
dans toutes les situations. Les parents <strong>et</strong> les dispensateurs de<br />
soins sont les enseignants naturel du langage. La méthode<br />
d'enseignement oral harnache <strong>et</strong> améliore les capacités que<br />
possèdent déjà les parents pour leur perm<strong>et</strong>tre de développent<br />
les aptitudes dont ils ont besoin pour aider l'enfant à apprendre<br />
à entendre <strong>et</strong> à parler.<br />
MÉTHODE DIAGNOSTIQUE – Le progrès de l'enfant dans<br />
l'apprentissage de l'écoute!!! est évalué avec soin <strong>et</strong> enregistré<br />
pour garantir que c'est la méthode appropriée pour que chaque<br />
enfant développe sa communication parlée. La MEO ne<br />
s'applique pas à tous les enfants, mais la majorité ont appris<br />
avec succès à utiliser leur ouïe <strong>et</strong> leurs aptitudes orales pour<br />
communiquer avec leur famille, leurs amis <strong>et</strong> l'ensemble de la<br />
collectivité.<br />
APPUIE LE CONCEPT DE MAINSTREAMING ET D'INTÉGRATION<br />
d'enfants ayant un handicap auditif à leurs écoles de quartier.<br />
Nous nous attendons à ce que nos enfants grandissent en<br />
faisant les mêmes activités que leurs pairs entendants, pour<br />
prendre ensuite leur place légitime dans l'ensemble de la<br />
société. Mais j'en parlerai davantage à la fin de la présentation.<br />
MÉTHODE D'ÉQUIPE – C<strong>et</strong>te méthode assure la meilleure<br />
prestation de services en faisant participer les médecins dans la<br />
détection précoce, les audiologistes dans la gestion audiologique<br />
permanente, les thérapeutes dans la méthode d'enseignement<br />
orale <strong>et</strong> toujours avec la participation entière de la famille.<br />
La méthode d'enseignement orale fonctionne-t-elle ? La<br />
recherche récente montre que c'est une méthode qui réussit. En<br />
1993, un sondage de résultats a interviewé les "diplômés" d'un<br />
programme de thérapie en méthode d'enseignement orale pour<br />
déterminer si l'objectif était atteint – c<strong>et</strong> objectif étant : que ces<br />
enfants grandissent dans des environnements d'apprentissage<br />
<strong>et</strong> de vie réguliers qui leur perm<strong>et</strong>taient de devenir des citoyens<br />
indépendants, participants <strong>et</strong> contribuant au "mainstream" de la<br />
société. L'échantillon de répondants, composé de 157 adultes<br />
affectés d'une perte de sévère à profonde, fut d'avis que<br />
l'objectif avait été atteint.<br />
En 1999, VOICE a participé à une étude financée par le Conseil<br />
de recherches en sciences humaines du <strong>Canada</strong> <strong>et</strong> l'Institut de<br />
recherche de l'Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario sur La
facilitation de l'intégration des enfants <strong>et</strong> des jeunes<br />
ayant une perte auditive.<br />
L'étude démontre que la méthode d'enseignement orale<br />
développe les aptitudes d'écoute <strong>et</strong> de langage parlé qui aident<br />
à la réussite de l'intégration des enfants ayant une perte<br />
auditive dans les classes régulières.<br />
L'étude a montré qu'un programme intensif de thérapie orale<br />
dans les années préscolaires était un des facteurs identifiés<br />
comme contribuant au succès de l'intégration à l'école <strong>et</strong> à la<br />
communauté.<br />
La recherche a également conclu que l'identification précoce de<br />
la perte auditive, avec une évaluation <strong>et</strong> une gestion<br />
audiologiques promptes, est essentielle à la réussite de<br />
l'intégration.<br />
Et, pour finir sur le suj<strong>et</strong> de la Méthode d'enseignement orale, je<br />
dois souligner que c<strong>et</strong>te méthode est pratiquée <strong>et</strong> reconnue au<br />
niveau international. À la conférence de VOICE tenue ici, à<br />
Ottawa, en 1987, est né le groupe Auditory Verbal<br />
International, qui découlait d'un groupe de parents <strong>et</strong> de<br />
professionnels AG Bell. AVI est l'organe de régulation<br />
professionnelle des thérapeutes de la méthode d'enseignement<br />
orale, dont le nombre de membres certifiés s'élève maintenant<br />
à 253. Nous sommes très fiers de ces 253, dont 60 se trouvent<br />
au <strong>Canada</strong> <strong>et</strong> 38 en Ontario.<br />
Les examens de certification ont lieu chaque année – la<br />
prochaine se tiendra à Toronto à l'été 2005.<br />
Revenons donc maintenant à VOICE <strong>et</strong> à ses parents. Ces 40<br />
dernières années, les parents <strong>et</strong> les professionnels de l'Ontario<br />
ont travaillé de façon persistante à faire passer un message à<br />
l'ensemble de la collectivité :<br />
… Les enfants qui ont n'importe quel degré de perte<br />
auditive peuvent apprendre à entendre <strong>et</strong> à parler.<br />
Le résultat de ces efforts persistants est que plusieurs<br />
programmes majeurs ont été mis au point en Ontario pour<br />
dispenser une intervention orale aux familles <strong>et</strong> à leurs enfants<br />
qui sont sourds ou malentendants. Les familles de VOICE ont<br />
été à l'avant-plan du développement de beaucoup de ces<br />
programmes.<br />
En 1962, l'Hospital for Sick Children (Toronto) a lancé un<br />
programme d'intervention précoce en formation orale pour les<br />
enfants ayant une perte auditive.<br />
Grâce à ce programme, des centaines d'enfants ont appris à<br />
entendre <strong>et</strong> à parler sous la tutelle de Louise Crawford, formée<br />
à l'école de Doreen Pollack, une des pionnières de la méthode<br />
d'enseignement orale.<br />
Concurremment, un groupe de parents, qui croyaient avec<br />
passion que leurs enfants sourds profonds pouvaient apprendre
à entendre <strong>et</strong> à parler <strong>et</strong> fréquenter leurs écoles locales avec les<br />
enfants de leurs quartiers, commencèrent à mobiliser leurs<br />
efforts pour intercéder pour une augmentation des services<br />
pour leurs enfants.<br />
Au milieu des années 60, ces parents se sont détachés du<br />
groupe de parents qui existait alors – le M<strong>et</strong>ro Toronto<br />
Association for the Hearing Handicapped Children, qui posa la<br />
fondation de l'organisation VOICE, incorporée en 1975.<br />
En 1979, VOICE établit un programme de thérapie selon la<br />
méthode d'enseignement orale au North York General Hospital.<br />
Le programme se continua sous les auspices de VOICE jusqu'à<br />
ce que la Learning to Listen Foundation prit charge de la<br />
responsabilité du programme en 1994. Ce programme, dirigé<br />
par Warren Estabrooks, offre présentement des services de<br />
MEO à plus de 50 familles.<br />
Au milieu des années 70, l'Hôpital des enfants de l'est de<br />
l'Ontario ouvrait ses portes <strong>et</strong> abritait un programme<br />
d'enseignement oral dans le cadre de son service d'audiologie.<br />
Judy Simser, thérapeute de MEO <strong>et</strong> parente d'un enfant ayant<br />
une perte profonde, était membre du personnel initial<br />
embauché pour offrir une intervention MEO aux enfants d'âge<br />
préscolaire ayant des pertes auditives. Ce programme est<br />
financé par le budg<strong>et</strong> global de l'hôpital <strong>et</strong> continue à offrir une<br />
thérapie MEO aux bébés <strong>et</strong> aux enfants d'âge préscolaire, ainsi<br />
qu'aux récipiendaires d'implants cochléaires.<br />
En 1985, un autre programme de thérapie MEO fut mis sur pied<br />
au Credit Valley Hospital, où Hope Turcotte a dispensé des<br />
interventions en MEO pour les familles de Mississauga <strong>et</strong><br />
d'autres collectivités de l'ouest de Toronto. Malgré l'excellence<br />
du programme <strong>et</strong> malgré la preuve de sa nécessité, les<br />
compressions budgétaires de l'hôpital ont amené son annulation<br />
en 1995, seulement 10 ans après sa mis sur pied. les parents<br />
de VOICE ont protesté avec vigueur – mais en vain.<br />
En fermant le programme de Credit Valley, Toronto <strong>et</strong> Ottawa<br />
étaient les seuls centres en Ontario à offrir des services de<br />
thérapie MEO. Les familles de toute la province se sont rendues<br />
vers eux pour les programmes pour leurs enfants, mais ce<br />
n'était pas là un arrangement satisfaisant. VOICE avait une<br />
vision que ces services soient disponibles proche de la maison<br />
familiale, dans l'ensemble des villes de l'Ontario.<br />
En 1999, le programme itinérant de VOICE fut mis sur pied <strong>et</strong> un<br />
(e) thérapeute de VOICE a visité chaque mois les chapitres de<br />
VOICE en Ontario en dispensant des services de thérapie MEO.<br />
Depuis ces débuts, le programme de thérapie MEO de VOICE<br />
s'est agrandi à sa capacité actuelle, qui dispense des<br />
interventions par 12 thérapeutes MEO, 73 familles dans 7<br />
collectivités de l'Ontario.<br />
L'un des facteurs majeurs qui assurent d'excellents services<br />
MEO, c'est la disponibilité de thérapeutes formés certifiés en<br />
MEO. Après la ferm<strong>et</strong>ure du programme de diplôme de McGill,<br />
qui avait formé de nombreux professionnels en MEO en Ontario,
aucune autre université n'a comblé ce manque. À sa place, des<br />
occasions créatives de formation se sont développées pour<br />
combler c<strong>et</strong>te lacune.<br />
En Ontario, VOICE a établi son programme de formation MEO<br />
pour les internes en 1994, qui s'est assuré que chaque chapitre<br />
dispose de thérapeutes certifiés pour offrir des services locaux.<br />
Présentement 9 thérapeutes ont terminé leur formation....<br />
…<strong>et</strong> 6 ont obtenu leur certification.<br />
VOICE a également travaillé étroitement avec York University<br />
pour veiller à ce que les cours de MEO soient enchâssés dans le<br />
programme d'études du programme ... Enseignants pour les<br />
Sourds.<br />
Pareillement, VOICE a offert des cours d'éducation permanente<br />
à l'intention des enseignants des Sourds <strong>et</strong> des malentendants<br />
qui étaient intéressés à développer leurs aptitudes à la MEO.<br />
Plus de 60 professionnels ont assisté à ces cours de qualification<br />
supplémentaires <strong>et</strong> au moins 15 d'entre eux sont maintenant<br />
des thérapeutes MEO certifiés qui enseignent dans les<br />
commissions scolaires de l'Ontario.<br />
Plus récemment, le Ministère de la Santé, suite à son<br />
programme nouvellement développé de dépistage précoce<br />
l'Ouïe de nourrisson, a fourni des fonds pour former 16<br />
orthophonistes dans le développement de techniques MEO.<br />
En Ontario, les famille <strong>et</strong> les professionnels ont développé une<br />
forte coalition au cours des années, qui a posé la fondation pour<br />
le développement de programmes d'intervention <strong>et</strong> de<br />
formation MEO de grande réputation.<br />
L'Ontario est la province où se trouvent ces programmes si<br />
riches <strong>et</strong> nous servons de modèle pour les autres provinces <strong>et</strong><br />
les autres pays.<br />
Avec le lancement, l'an dernier, du programme universel l'Ouïe<br />
du nourrisson en Ontario, VOICE s'est assurée que tous les<br />
parents des enfants nouvellement diagnostiqués sourds en<br />
Ontario soient sensibilisés à l'option de la méthode<br />
d'enseignement orale. Et que tous les parents auront accès à<br />
une thérapie fondée sur c<strong>et</strong>te méthode.<br />
L'Ontario est le chef de file au <strong>Canada</strong>...<br />
dans sa reconnaissance de l'importance d'une<br />
identification précoce de la perte auditive<br />
<strong>et</strong> dans l'accès à des soutiens audiologiques<br />
efficaces, <strong>et</strong><br />
pour la première fois en Ontario, à une thérapie<br />
fondée sur le méthode d'enseignement orale<br />
financée par la province
Les parents de tous les enfants de l'Ontario qui sont identifiés<br />
comme ayant une perte auditive seront maintenant informés de<br />
l'option de thérapie fondée sur la méthode d'enseignement<br />
orale, <strong>et</strong> leurs enfants auront accès à la thérapie au sein de leur<br />
collectivité pendant les deux ans qui suivent le diagnostic.<br />
Les résultats statistiques, à la fin de la première année du<br />
programme l'Ouïe du nourrisson, ont montré que la majorité<br />
des familles ayant des bébés identifiés comme ayant une perte<br />
auditive choisissent l'approche orale pour enseigner à leurs<br />
enfants à communiquer.<br />
Parmi les 120 enfants dont les familles sont dans le<br />
programmes d'intervention précoce :<br />
80 ont choisi la méthode d'enseignement orale<br />
7 ont choisi l'ASL<br />
9 ont choisi une approche double<br />
22 approche de communication non identifiée<br />
Tournons-nous maintenant vers l'éducation, où l'intégration<br />
n'est pas toujours la pratique.<br />
Au début des années 60, un groupe de parents de l'Ontario<br />
avaient une vision que leurs enfants qui étaient sourds profonds<br />
pouvaient apprendre à entendre <strong>et</strong> à parler, <strong>et</strong> pouvaient aller à<br />
l'école dans leurs collectivités locales.<br />
Le gouvernement provincial croyait que les enfants qui étaient<br />
étiqu<strong>et</strong>és éducativement sourds seraient mieux servis en<br />
fréquentant un pensionnat pour les Sourds à Milton.<br />
Il est clair que les parents avaient un travail à faire pour<br />
éduquer les représentants du gouvernement sur les besoins de<br />
leurs enfants sourds qui apprenaient à entendre <strong>et</strong> à parler.<br />
Dans une époque où les enfants sourds avaient historiquement<br />
été victimes de ségrégation, ces familles visionnaires tinrent<br />
fermement à leur détermination d'avoir leurs enfants sourds ou<br />
malentendants éduqués avec leurs pairs entendants.<br />
Ils contribuèrent à aider à l'établissement d'enseignants<br />
itinérants de services pour les sourds dans les écoles de<br />
Toronto, qui s'est aujourd'hui étendu à l'ensemble de la<br />
province.<br />
Dans les années 70, à mesure de l'évolution du soutien<br />
technologique, VOICE a fait du lobby pour un accès aux<br />
systèmes FM dans les écoles. Aujourd'hui les systèmes FM pour<br />
les sourds <strong>et</strong> les malentendants sont assurés en vertu de la<br />
formule de financement courant.<br />
VOICE continue à s'adresser aux commissions scolaires avec<br />
une représentation d'une quarantaine de bénévoles,<br />
représentants <strong>et</strong> substituts, au comité consultatif de<br />
l'enseignement spécial (Special Education Advisory Committee -<br />
SEAC)
Pendant des années, les parents ont maintenu un oeil sur les<br />
budg<strong>et</strong>s des commissions scolaires <strong>et</strong> sur les changements de<br />
programmes, <strong>et</strong> ils n'ont pas hésité à faire des présentations à<br />
leurs commissaires locaux. Je devrais ajouter que, lorsque les<br />
choses allaient bien, nous présentions les bonnes nouvelles<br />
aussi à la commission scolaire !<br />
Tant <strong>et</strong> plus, les parents ont répondu aux énoncés de politiques<br />
distribués dans la collectivité par le Ministère de l'Éducation<br />
pour faire l'essai des vents de changements – changement à la<br />
fois dans les politiques de l'école régulière <strong>et</strong> dans les politiques<br />
d'éducation des Sourds. Presque toujours, les changements ne<br />
tenaient pas compte des besoins de nos enfants. Nous avons dû<br />
nous assurer que leur voix soit entendue.<br />
VOICE a souvent été représentés sur des groupes de travail<br />
traitant de l'éducation des Sourds. Aujourd'hui, c'est une force<br />
active dans le traitement de l'éducation des Sourds.<br />
Aujourd'hui, c'est un participant actif sur le Conseil consultatif<br />
du Ministre sur l'éducation spéciale, <strong>et</strong> le Conseil consultatif de<br />
l'association provinciale au Conseil consultatif sur l'éducation<br />
spéciale.<br />
Dès le début, il a été important pour les parents de VOICE de<br />
faire du lobby auprès des élus pour des services pour nos<br />
enfants – <strong>et</strong> pour éduquer les députés de la législature <strong>et</strong> les<br />
commissaires d'écoles – pour les informer que les enfants<br />
sourds peuvent apprendre à entendre <strong>et</strong> à parler. Il a été<br />
important d'être en contact avec les députés provinciaux locaux,<br />
de leur écrire, de leur présenter nos enfants, de les inviter à des<br />
réunions de VOICE.<br />
Mais toujours, notre point focal revient à nos familles <strong>et</strong> à nos<br />
enfants. VOICE offre un soutien d'un à un aux parents <strong>et</strong> aux<br />
familles. Dans de nombreux chapitres, nous jumelons des<br />
parents "d'expérience" avec des nouveaux, de sorte que ceux<br />
dont l'enfant vient d'être diagnostiqué récemment d'une perte<br />
auditive aient quelqu'un vers qui se tourner pour obtenir des<br />
conseils.<br />
VOICE offre l'occasion aux familles de se réunir socialement <strong>et</strong><br />
pour les enfants sourds ou malentendants de rencontrer<br />
d'autres enfants comme eux.<br />
Les chapitres de VOICE préparent <strong>et</strong> donnent régulièrement des<br />
ateliers sur une gamme étendue de suj<strong>et</strong>s tels que le<br />
parentage, l'éducation <strong>et</strong> les appareils techniques.<br />
VOICE distribue à ses membres des bull<strong>et</strong>ins de nouvelles<br />
locaux <strong>et</strong> national – pour tenir les parents en rapport les uns<br />
avec les autres <strong>et</strong> les tenir informés.<br />
Que veut dire tout cela dans le contexte de la présent<br />
conférence ?<br />
Lorsque nous parlons de santé mentale <strong>et</strong>, ce qui est plus<br />
important, de bien-être mental – la meilleure façon dont je puis<br />
démontrer ce qu'ont signifié les efforts des parents de VOICE,<br />
c'est de vous parler de nos enfants. Des enfants qui ne sont
plus des enfants, mais qui sont maintenant des membres<br />
participants de la société dans son ensemble.<br />
Une jeune femme vient de terminer le programme « Educational<br />
Assistant Special Needs Support » du Niagara College. Une<br />
autre possède un diplôme en sciences informatiques <strong>et</strong> travaille<br />
depuis 10 ans dans l'industrie de la haute technologie – elle est<br />
maintenant propriétaire de sa propre maison. Une troisième est<br />
diplômés comme technicienne en chirurgie. Une de nos enfants<br />
VOICE d'Ottawa a obtenu un baccalauréat en sciences, en<br />
communications professionnels <strong>et</strong> techniques, puis un MBA. Elle<br />
travaille comme spécialiste de marché des produits chez MCI's<br />
« Information Systems and Solutions ». Une de ses amies a<br />
reçu un baccalauréat en sciences en travail social <strong>et</strong> travaille<br />
comme conseillère résidentielle dans une résidence de groupe.<br />
Un jeune homme qui a grandi comme enfant VOICE à Toronto<br />
est maintenant avocat d'entreprise chez une grande firmes<br />
torontoise. Un autre a obtenu un MBA <strong>et</strong> un diplôme en droit <strong>et</strong><br />
travaille pour le gouvernement provincial. Mon fils a reçu son<br />
diplôme du Centennial College en diffusion radio <strong>et</strong> télévision. Il<br />
travaille comme cameraman pour CityTV à Toronto.<br />
Il n'a pas été facile pour aucun de ces jeunes – ou pour leurs<br />
parents. Et il y a encore d'innombrables défis devant eux – à la<br />
fois pour tous <strong>et</strong> chacun des enfants ayant une perte auditive,<br />
pour leurs parents, <strong>et</strong> pour des organisations telles que VOICE.<br />
Mais j'ai confiance que ces défis seront vaincus.<br />
Les programmes que nous avons aujourd'hui existent parce les<br />
parents ont refusé de s'avouer défaits par le manque de<br />
ressources, le manque de connaissances <strong>et</strong> le manque de<br />
programmes.<br />
C'est exclusivement l'étoffe <strong>et</strong> la détermination de parents se<br />
battant pour une autre option, une option d'entendre <strong>et</strong> de<br />
parler, pour leurs enfants qui a fait naître VOICE <strong>et</strong> nous avons<br />
tous été capables d'accomplir au nom d'enfant ayant des<br />
handicaps auditifs partout.<br />
Sans faute, lorsque les besoins se font sentir, nos parents <strong>et</strong><br />
thérapeutes sont là pour montrer la voie, leur énergie <strong>et</strong> leur<br />
dévouement alimentant notre dynamisme pour nous assurer<br />
que tous les enfants ayant des pertes auditives sévère puissent<br />
obtenir l'aide nécessaire pour leur perm<strong>et</strong>tre de prendre la place<br />
qui leur revient dans la société.<br />
Je serais très heureuse d'essayer de répondre à vos question<br />
pendant le temps qui reste. Merci.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Sommaire<br />
(Aucun texte n'ayant été soumis, nous reproduisons ici le<br />
sommaire paru dans le programme de la Conférence.)<br />
Expérience d'intervention auprès<br />
des enfants <strong>et</strong> adolescents ayant<br />
un problème de santé mentale.<br />
Par : Louise Ménard<br />
C<strong>et</strong>te présentation vise à partager avec les participants<br />
l'expérience vécue auprès des enfants <strong>et</strong> adolescents sourds<br />
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mme Ménard<br />
discutera de l'intervention auprès du personnel scolaire, de<br />
l'appui accordé aux élèves <strong>et</strong> à leurs familles ; elle fera ressortir<br />
quels sont les obstacles à la réussite d'un plan d'intervention<br />
ainsi que les lacunes des services existants dans la<br />
communauté <strong>et</strong> suggérera les solutions possibles.<br />
au début<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Services <strong>et</strong> programmes Sourd-<br />
Aveugles en Finlande<br />
Par Ulla Kungas<br />
L'Association des sourds-aveugles de Finlande est l'organisme<br />
d'intercession, d'expertise <strong>et</strong> de récréation des sourds-aveugles<br />
<strong>et</strong> des personnes affectées de handicaps graves de la vue <strong>et</strong> de<br />
l'ouïe. L'organisme fut fondé en 1971 par une quinzaine de<br />
sourds-aveugles. Les activités <strong>et</strong> les différentes sortes de<br />
services sont basés sur les besoins individuels des personnes<br />
sourdes-aveugles. Ce sont les sourds-aveugles qui ont le plus<br />
grand pouvoir de décision aux assemblées annuelles.<br />
Pour le moment, en Finlande, il y a environ 900 sourdsaveugles<br />
ou personnes ayant un handicap visuel <strong>et</strong> auditif, <strong>et</strong><br />
l'organisme compte environ 350 membres. L'organisme a deux<br />
centres de services, 10 districts de conseillers régionaux, <strong>et</strong> le<br />
bureau central comme centre de l'administration.<br />
Parmi les activités des conseillers régionaux, la partie la plus<br />
importante du travail est constituée de visites à domicile, de<br />
rencontres avec les clients, de travail d'intercession <strong>et</strong> de<br />
réseautage régional, ainsi que de formation en adaptation.<br />
Les clients reçoivent soutien <strong>et</strong> conseils dans leur vie<br />
quotidienne, ainsi que dans l'intercession en faveur de leurs<br />
droits comme, par exemple, en dressant par écrit une liste de<br />
leurs besoins de services en vue de l'établissement de leurs<br />
plans de services <strong>et</strong> de réadaptation. Ces plans supposent, au<br />
préalable, un travail d'intercession. Également la réalisation de<br />
l'accessibilité aux services fait l'obj<strong>et</strong> d'un suivi. La famille <strong>et</strong> la<br />
collectivité environnante sont soutenues, par exemple, en<br />
apprenant la communication <strong>et</strong> l'interaction fonctionnelles. En<br />
plus, l'éducation <strong>et</strong> l'orientation professionnelle pour les jeunes<br />
bénéficient également d'un soutien.<br />
Le travail d'intercession au niveau régional, l'influence <strong>et</strong> le<br />
réseautage forment la principale partie du travail des conseillers<br />
régionaux. Les contacts avec les décideurs locaux sont<br />
importants, comme le fait de les informer des besoins <strong>et</strong> des<br />
désirs des clients dans l'obtention des services. Pendant l'année<br />
d'activité, des contacts seront également établis avec les<br />
décideurs politiques locaux, qui sont aussi fonctionnels au<br />
niveau national.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Les centres sont situés à Tampere <strong>et</strong> à Jyväskylä. Dans le<br />
Centre de ressources pour les sourds-aveugles de Tampere, il y<br />
a des services de logement <strong>et</strong> des activités de cours. Le service<br />
de logement assure la personne sourde-aveugle la possibilité de<br />
vivre une vie bonne <strong>et</strong> indépendante dans un environnement de<br />
langue des signes. Il y a 18 appartements en rangée de<br />
grandeurs différentes pour les sourds-aveugles, où il est tenu<br />
compte des besoins spéciaux causés par la surdicécité. Le<br />
service domiciliaire <strong>et</strong> infirmier, les besoins individuels d'accès à<br />
l'information, les services de repas, les services de l'homme<br />
d'entr<strong>et</strong>ien, la prise en charge des questions reliées au bien-être<br />
social, le soutien pour les activités professionnelles, les activités<br />
reliées au travail, <strong>et</strong> les activités récréatives forment les<br />
services résidentiels. - Dans les activités de cours, diverses<br />
sortes de cours sont offertes pour les groupes, par exemple, des<br />
cours en facilité d'interaction, pour avancer dans votre vie de<br />
tous les jours, <strong>et</strong> la joie de faire de l'exercice sont organisées<br />
avec des fonds de l'association nationale provenant des<br />
machines à sous, comme des exercices d'amincissement le<br />
printemps venu, des ressources dans les handicaps en<br />
progression, un cours pour les aînés <strong>et</strong> un cours pour les<br />
membres des familles. En plus de ces cours pour des groupes,<br />
des cours de formation en adaptation individuelle sont organisés.<br />
Le centre de réadaptation pour les sourds-aveugles de<br />
Jyväskylä est un centre de ressources national dans le domaine<br />
de la surdicécité pour les personnes sourdes-aveugles <strong>et</strong> les<br />
enfants entendants <strong>et</strong> handicapés visuels <strong>et</strong> les jeunes gens <strong>et</strong><br />
leurs familles, les adultes congénitalement sourds-aveugles <strong>et</strong><br />
les clients qui ont des handicaps auditifs <strong>et</strong> visuels. 13 cours<br />
sont organisés pour les groupes mentionnés ci-dessus, par<br />
exemple, le cours de formation en adaptation pour les familles<br />
inclut également, en plus de séances de planification <strong>et</strong> de<br />
r<strong>et</strong>our d'information, deux visites vers la municipalité d'origine<br />
de la personne qui reçoit c<strong>et</strong>te formation. L'intention de ces<br />
visites est d'activer le processus de réadaptation. Des réunions<br />
de famille à titre de formation en adaptation sont organisées<br />
dans différentes partie de la Finlande, à chaque fois que c'est<br />
possible. Dans ces réunions, les familles reçoivent un soutien de<br />
leur pairs <strong>et</strong> une information à jour sur les handicaps auditifs <strong>et</strong><br />
visuels. Les familles qui viennent récemment de se joindre à ces<br />
services sont invitées à ces réunions. Entre les cours de<br />
réadaptation, le travail dans la municipalité d'origine est<br />
également activé. L'intervention en réadaptation est continuée<br />
dans les municipalités d'origine suivant les ententes conclues<br />
avec les hôpitaux centraux. En rapport avec les cours de<br />
réadaptation dans différentes sortes d'activités de formation <strong>et</strong><br />
dans les municipalités d'origine des clients une formation est<br />
offerte pour les travailleurs de réadaptation <strong>et</strong> les réseaux<br />
voisins.<br />
En 2004 les domaines les plus importants sur lesquels<br />
l'organisation a mis l'accent sont le travail d'intercession,<br />
l'administration financière, l'information <strong>et</strong> les activités<br />
culturelles, ainsi que la formation du personnel. Les proj<strong>et</strong>s vont<br />
améliorer les possibilités des activités de recherche <strong>et</strong><br />
développement. Les bonnes pratiques <strong>et</strong> les résultats obtenus<br />
dans les proj<strong>et</strong>s devraient produire des bénéfices pour qu'il leur<br />
soit permis de demeurer comme partie de nos activités de base.<br />
La technologie de l'information <strong>et</strong> la technologie de
communication sont utilisées dans les communications <strong>et</strong> l'accès<br />
à l'information des personnes sourdes-aveugles.<br />
Les activités de base de l'organisation<br />
Travail d'intercessions, de suivi <strong>et</strong> de surveillance des droits :<br />
En 2004, le travail d'intercessions sera renforcé dans tous les<br />
domaines d'activité. Les questions les plus pressantes sont le<br />
système d'aide-guide personnel où la langue des signes est<br />
utilisée, le développement des services de communication <strong>et</strong><br />
d'interprétation pour les sourds-aveugles, <strong>et</strong> l'acceptation de la<br />
surdicécité comme un handicap à part entière. On porte une<br />
attention particulière à l'accès légal, juste <strong>et</strong> égal aux services<br />
de base. L'expertise propre des personnes sourdes-aveugles<br />
sera utilisée dans le travail d'intercession. On pourra bénéficier<br />
des résultats des proj<strong>et</strong>s qui sont pratiquement terminés.<br />
Pour commencer, j'aimerais mentionner quelles sortes de<br />
proj<strong>et</strong>s seront en cours, en Finlande, pendant la période de<br />
2004 à 2009. Dans mes présentations, j'approfondirai<br />
probablement les proj<strong>et</strong>s les plus importants suivant le thème<br />
de votre conférence.<br />
Proj<strong>et</strong>s ayant rapport avec les capacités d'interaction des<br />
personnes sourdes-aveugles :<br />
1. Différentes possibilités de communications pour le proj<strong>et</strong><br />
des personnes sourdes-aveugles pour la période 2001-<br />
2005.<br />
2. Comment utiliser un proj<strong>et</strong> d'interprètes pour la période<br />
2003-2007.<br />
Proj<strong>et</strong>s connectés avec les activités <strong>et</strong> le développement de<br />
possibilités récréatives pour les personnes sourdes-aveugles :<br />
1. Mesures d'incitation pour les activités de jour à Helsinki <strong>et</strong><br />
Kuopio pour la période 2002-2005.<br />
2. Proj<strong>et</strong> de sondage <strong>et</strong> développement d'équipement<br />
technique pour les personnes sourdes-aveugles dans leur<br />
vie de tous les jours pour la période de 2004-2007.<br />
Centre de ressources <strong>et</strong> services de logement à Tampere :<br />
1. Proj<strong>et</strong> de développement pour activités de réadaptation<br />
pour la période 2003-2007.<br />
2. Proj<strong>et</strong> de journée d'activités pour la période 2002-2006.<br />
3. Nouveau proj<strong>et</strong> de médias <strong>et</strong> d'apprentissage tout au long<br />
de la vie pour la période de 2001-2005.<br />
4. Proj<strong>et</strong> de développement pour les services d'interprétation<br />
dans le district de Pirkanmaa pour la période de 2004-2007.<br />
Centre de réadaptation pour les enfants <strong>et</strong> les jeunes sourdsaveugles<br />
à Jyväskylä :<br />
1. Proj<strong>et</strong> d'égalité des occasions d'apprentissage au niveau<br />
étudiants entendants <strong>et</strong> handicapés visuels pour la période
2001-2004; un financement additionnel a été demandé<br />
pour prolonger de proj<strong>et</strong> jusque en 2007.<br />
2. Proj<strong>et</strong> de qualité de vie <strong>et</strong> de développement de services<br />
pour les personnes congénitalement entendantes <strong>et</strong><br />
visuellement handicapées pour la période 2004-2009.<br />
Proj<strong>et</strong>s de coopération extérieure :<br />
L'organisation coopère en partageant son savoir-faire <strong>et</strong> des<br />
compétences dans ces proj<strong>et</strong>s réalisés par d'autres partenaires<br />
comme, par exemple, avec la fondation de services pour les<br />
Sourds <strong>et</strong> la fondation Honkalampi dans le proj<strong>et</strong> de soutien<br />
psychosocial. Nous travaillons également en étroite<br />
collaboration avec l'association finlandaise des Sourds dans son<br />
proj<strong>et</strong> où sont formés des bénévoles utilisant la langue des<br />
signes <strong>et</strong> le proj<strong>et</strong> d'interprétation à distance au moyen de<br />
vidéophones.<br />
Fin<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Sommaire<br />
(Aucun texte n'ayant été soumis, nous reproduisons ici le<br />
sommaire paru dans le programme de la Conférence.)<br />
Les troubles psychotiques <strong>et</strong> la<br />
surdité<br />
Par : Dr. Cathy Chovas McKinnon<br />
La détection précoce de la première apparition de la psychose<br />
est devenue le point de référence de la réussite du traitement<br />
chez les entendants. C<strong>et</strong>te détection précoce est plus difficile<br />
avec les patients sourds à cause des différences linguistiques,<br />
des différences culturelles <strong>et</strong> de la réaction des professionnels<br />
des soins de santé mentale tenants du courant de pensée<br />
dominant.<br />
au début<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
La Perte Auditive Comme<br />
Question De Santé Publique :<br />
Défis Et Stratégies<br />
Par : Robert Alexander<br />
Président, Chapitre de l'Ontario de l'Association<br />
canadienne des malentendants <strong>et</strong> Agent communautaire<br />
de la santé, Services de santé publique de Toronto<br />
Sommaire d'introduction<br />
Je vais commencer ma présentation en décrivant les éléments<br />
d'une approche santé publique : un politique publique saine <strong>et</strong><br />
une promotion de la santé (développement communautaire). Je<br />
discuterai ensuite de l'intersection de ces deux éléments, puis<br />
ensuite relier le tout à l'accès <strong>et</strong> à l'équité pour les personnes<br />
handicapées en m<strong>et</strong>tant un accent particulier sur la population<br />
malentendante.<br />
Ce sera suivi par une considération de quelques questions de<br />
santé mentale, là encore en m<strong>et</strong>tant l'accent sur la population<br />
malentendante.<br />
Note : c<strong>et</strong>te présentation sera faite à partir du point de vue de<br />
l'expérience personnelle du présentateur, <strong>et</strong> dans le contexte de<br />
c<strong>et</strong>te expérience, en tant que travailleur professionnel du<br />
développement communautaire dans le domaine de la santé<br />
publique <strong>et</strong> qui porte des prothèses auditives depuis 6 ans.<br />
Présentation du présentateur<br />
Perm<strong>et</strong>tez-moi de décrire plus en détail mon histoire<br />
personnelle comme le contexte <strong>et</strong> l'expérience de ce qui suit :<br />
1. Je travaille dans le développement communautaire depuis<br />
plus de 35 ans.<br />
2. Je suis employé du Service de santé publique de la Ville de<br />
Toronto depuis 1985 comme agent de santé<br />
communautaire avec responsabilité de développement<br />
communautaire dans une variété de suj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> de<br />
collectivités géographiques.<br />
3. Présentement engagé dans des initiatives d'accès <strong>et</strong><br />
d'équité pour les personnes handicapées à la fois au niveau<br />
de la Division (santé publique) <strong>et</strong> de l'ensemble (Ville de<br />
Toronto).<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
4. D'abord diagnostiqué d'une perte auditive bilatérale<br />
progressive en 1988 ; première prothèse auditive prescrite<br />
<strong>et</strong> reçue en 1998.<br />
5. Membre du conseil du Chapitre de l'Ontario de l'Association<br />
canadienne des malentendants(président depuis 2002.)<br />
6. Engagé, en 2002-03, dans un processus de consultation à<br />
la grandeur de l'Ontario concernant les préoccupations des<br />
malentendants, <strong>et</strong> sur le rôle du Chapitre ; sur la base des<br />
réponses reçues ai ébauché un premier plan stratégique<br />
pour le Chapitre, qui sera présenté aux membres à leur<br />
réunion d'octobre.<br />
7. J'ai également examiné le document de travail préparé par<br />
le Mexique sur "Une convention internationale globale <strong>et</strong><br />
intégrale pour promouvoir les droits <strong>et</strong> la dignité des<br />
personnes qui ont des handicaps" présentée au Comité ad<br />
hoc des Nations Unies en 2002 <strong>et</strong> présenté une réaction<br />
informelle.<br />
J'offre ces éléments non seulement comme une base de ma<br />
prétention à un certain degré d'expertise dans ce domaine ;<br />
mais, ce qui est plus important, pour souligner le cadre dans<br />
lequel j'ai acquis une certaine expérience, <strong>et</strong>, donc, la source<br />
des commentaires qui suivent.<br />
Veuillez noter que, si j'ai jadis été impliqué dans le<br />
développement communautaire dans le domaine de la santé<br />
mentale, je ne me considère pas comme un spécialiste dans le<br />
domaine.<br />
La santé publique<br />
Aujourd'hui, une grande part de l'accent mis, en santé publique<br />
(SP), sur la santé de la population, c'est-à-dire le concept<br />
voulant que la promotion, la protection <strong>et</strong> le maintien de la<br />
santé de n'importe quel groupe d'individus, est réalisé par le<br />
truchement d'une approche qui m<strong>et</strong> l'accent sur la santé du<br />
groupe tout entier. Un second principe est celui des<br />
déterminants de la santé : c'est-à-dire que, sans les nécessités<br />
de base de l'existence, de la sécurité <strong>et</strong> de la dignité, la santé<br />
d'une collectivité ou n'importe quel groupe qu'elle contient est<br />
compromise.<br />
Un troisième principe de la SP (<strong>et</strong> l'un de ceux sur lequel je<br />
veux me concentrer ici), c'est celui de la promotion de la santé :<br />
il ne suffit pas de donner aux gens de l'information sur ce qui<br />
constitue une vie saine, bien que ce soit crucial de le faire. Mais<br />
en plus, on doit également aider une collectivité, <strong>et</strong> ainsi les<br />
individus qui la composent à avoir les moyens, les ressources<br />
pour être capable de suivre les lignes directrices de vie saine.<br />
Par exemple, lorsque on donne de l'information sur les lignes<br />
directrices d'une nutrition saine, si ces lignes directrices sont<br />
inaccessibles à quiconque dans la collectivité, cela ne fait pas la<br />
promotion de leur santé. Ainsi, si une personne malentendante<br />
assiste à une présentation orale <strong>et</strong> qu'aucune accommodation<br />
n'est fournie, alors la santé de c<strong>et</strong>te personne n'est pas affecté<br />
par c<strong>et</strong>te promotion. C<strong>et</strong>te inaccessibilité peut également être<br />
causée par des barrières dues à la langue ou à la culture, aux<br />
limites de mobilité physique, au manque de ressources<br />
financières, au manque de ressources dans un quartier, <strong>et</strong>c.
La santé publique, qui est une des bases fondamentales pour la<br />
façon d'aborder mon travail dans <strong>et</strong> avec la collectivité des<br />
malentendants, comporte deux aspects primaires :<br />
● une saine politique publique, <strong>et</strong><br />
● une promotion de la santé ou un développement<br />
communautaire.<br />
C'est sur ces deux piliers de la santé publique que je désire faire<br />
porter ma présentation.<br />
Mais, d'abord, quelques commentaires généraux :<br />
1. Les conséquences sur la santé de tout cadre de politiques<br />
sont des facteurs non seulement du contenu des politiques,<br />
mais également du processus d'établissement, de mise en<br />
oeuvre, d'évaluation <strong>et</strong> de modification de ces politiques.<br />
2. Mon expérience, en ce qui a trait au thème de c<strong>et</strong>te<br />
conférence, est limitée d'abord à mon travail avec les<br />
malentendants, tel que distincts des Sourds<br />
(particulièrement les Sourds culturels), non seulement<br />
parce que c'est mon expérience personnelle, mais<br />
également parce que la population des malentendants a<br />
beaucoup à apprendre de la collectivité des Sourds (avec<br />
un S majuscule), <strong>et</strong> un grand r<strong>et</strong>ard à rattraper,<br />
concernant le besoin de faire inscrire nos problématiques<br />
(celles qui sont distinctes de celles de la collectivité des<br />
Sourds) à l'agenda public. Ce n'est pas que les Sourds ont<br />
tout ce qu'il leur faut <strong>et</strong> que nous n'avons rien, non plus<br />
que je leur reproche tous les avantages pour lesquels ils<br />
ont travaillé dur. Seulement que les deux collectivités ont<br />
des besoins, des préoccupations <strong>et</strong> des problèmes très<br />
différents, même si elles sont reliées <strong>et</strong> comportent un part<br />
de chevauchement.<br />
3. Veuillez noter que mon propos ici (ou du moins le contexte<br />
de mes remarques) porte sur les politiques publiques telles<br />
qu'imposées par un gouvernement municipal. Ma<br />
discussion sera applicable, avec quelques modifications,<br />
aux divers niveaux de gouvernement, ou même aux<br />
structures internationales, ainsi qu'au sein de la sphère<br />
privée également.<br />
Une saine politique publique<br />
Les éléments d'une politique publique saine comprennent :<br />
1. Un audit des impacts, positifs ou négatifs, sur la santé des<br />
individus, de la collectivité <strong>et</strong>, le cas échéant, sur<br />
l'ensemble de la société. C<strong>et</strong> examen doit comprendre des<br />
considérations basées sur la preuve telle que distincte de la<br />
preuve scientifique stricte ; le critère de base ici doit être<br />
celui du principe de précaution (qui exige que le fardeau de<br />
la preuve consiste à prouver qu'il n'y a pas de coûts reliés<br />
à la santé avant d'accorder une permission, plutôt que<br />
d'avoir à prouver le tort avant d'interdire l'activité).
Il est important que la politique soit défendable. Elle sera<br />
mise aux tests, particulièrement si elle est, ou perçue<br />
comme étant intrusive par les gardiens des droits<br />
individuels ou les intérêts commerciaux. Alors, tandis que<br />
le besoin de "preuve" scientifique est souvent une limite<br />
trop haute pour déterminer une action raisonnable, la<br />
politique doit s'appuyer sur une science de bonne qualité<br />
(c.-à-d., la preuve doit être réelle <strong>et</strong> démontrable) <strong>et</strong> non<br />
pas se baser exclusivement sur des soupçons, des<br />
intuitions ou des croyances irrationnelles, ce qui<br />
risquerait de discréditer le processus tout entier.<br />
2. Le véritable apport du public à divers points du processus,<br />
qui doit inclure une explication <strong>et</strong> un débat compl<strong>et</strong>s<br />
concernant les implications pour la santé. Cela peut être<br />
désordonné <strong>et</strong> lourd (comme toute démocratie),<br />
particulièrement dans le cas d'un problème urgent. Mais<br />
les résultats de la consultation publique sont pluriels : les<br />
gens affectés ventilent leurs préoccupations <strong>et</strong> leurs idées ;<br />
les "experts" ont une chance de faire entendre leurs<br />
préoccupations <strong>et</strong> d'en discuter, de sorte qu'ils soient<br />
mieux compris par la collectivité ; enfin, si les gens sont<br />
consultés <strong>et</strong> sentent qu'ils sont entendus <strong>et</strong> pris au sérieux,<br />
ils sont beaucoup plus susceptibles d'être capables<br />
d'accepter le résultat, même si celui-ci ne correspond pas<br />
entièrement à leurs propres positions.<br />
La participation doit être ouverte, démocratique,<br />
accessible <strong>et</strong> équitable.<br />
3. Être réactif <strong>et</strong> proactif - il est important que les<br />
représentants de la Ville (comme dans les autres niveaux<br />
de gouvernement) fassent preuve de leadership tout en<br />
étant préparés à répondre aux préoccupations <strong>et</strong> aux idées<br />
des citoyens.<br />
4. Être soumis à des périodes d'essai, <strong>et</strong> être ouverts à<br />
l'évaluation <strong>et</strong> à la reconsidération. Les politiques devraient<br />
de fait être réexaminées sur une base périodique.<br />
5. Rôles de :<br />
La collectivité <strong>et</strong> les ONG : soulèvent des<br />
questions, des problèmes ; donne de l'information,<br />
des données ; travaille de façon stratégique à<br />
résoudre les enjeux, les préoccupations ou les<br />
problèmes ;<br />
La fonction publique : prend les préoccupations<br />
de la collectivité <strong>et</strong> les traduit en enjeux de<br />
politique ; entreprend <strong>et</strong>/ou collectionne la<br />
recherche, fournit l'information, les données<br />
(impacts sur la santé, quantifiables ou<br />
anecdotiques) ; prépare des scénarios de<br />
conséquences d'agir/de ne pas agir ; prépare une<br />
liste complète d'actions de substitution - explique<br />
les possibilités <strong>et</strong> les limites des politiques (par<br />
ex., les limites des juridictions) au public <strong>et</strong> aux<br />
politiciens ; amène dans le dialogue des groupes
pertinents - publics <strong>et</strong> privés ;l<br />
Les politiciens : élaborent, publicisent <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tent<br />
en oeuvre des structures <strong>et</strong> des processus de<br />
dialogue d'information avec le public ; considèrent<br />
les conséquences sanitaires aussi bien que<br />
politiques de l'agir ou du non-agir ; identifient,<br />
travaillent stratégiquement avec des alliés <strong>et</strong> des<br />
opposants/adversaires ; écoutent tous les côtés,<br />
mais pas aux dépens de l'agir ; assument le<br />
leadership <strong>et</strong> agissent dans l'intérêt public.<br />
NOTE : Perm<strong>et</strong>tez-moi de souligner que les politiques publiques<br />
saines sont une question de processus autant de contenu.<br />
Le développement communautaire<br />
Le développement communautaire (DC) est maintenant souvent<br />
appelé "construction de capacité communautaire" ; je suis de la<br />
vieille école <strong>et</strong> je tiens c<strong>et</strong>te dernière version comme n'étant<br />
qu'un aspect du développement communautaire, même si c'est<br />
un aspect très important.<br />
Ma définition : Le DC est le processus par lequel une collectivité<br />
de personnes reconnaissent <strong>et</strong> établissent leurs points communs<br />
comme collectivité <strong>et</strong> travaillent collectivement à développer<br />
certains processus <strong>et</strong>, si possible, certaines structures qui leur<br />
perm<strong>et</strong>tront de a) comprendre leurs besoins <strong>et</strong> leurs points<br />
forts ; b) d'identifier quelles lacunes il faudra combler <strong>et</strong>c. de<br />
développer des stratégies pour établir, surveiller <strong>et</strong> évaluer des<br />
services propres à combler ces lacunes.<br />
Note : selon mon expérience, le DC -<br />
● porte surtout sur les lacunes (c'est habituellement ce qui<br />
mobilise une collectivité, non les points forts ou les<br />
bénéfices actuels)<br />
● nécessite souvent une aide directe <strong>et</strong> la direction de<br />
quelqu'un qui a de l'expérience ou des compétences en DC<br />
(adm<strong>et</strong>tre que c'est là un parti pris de travailleur<br />
"professionnel" du développement communautaire)<br />
<strong>Commentaire</strong>s sur la promotion de la santé (PS) :<br />
● Définition de l'OMS de la promotion de la santé (mon<br />
interprétation) : perm<strong>et</strong>tre à une collectivité d'identifier ses<br />
besoins <strong>et</strong> d'être capable de prendre contrôle des<br />
stratégies nécessaires pour répondre à ces besoins.<br />
● une collectivité qui est organisée <strong>et</strong> capable d'agir est, par<br />
définition, une collectivité plus saine ;<br />
● même si elle est organisée autour d'un enjeu unique, une<br />
collectivité organisée, en vertu de c<strong>et</strong>te organisation, reçoit<br />
des bénéfices bien au-delà de la résolution de c<strong>et</strong> enjeu ;<br />
● alors, l'action d'une collectivité qui s'organise elle-même<br />
est en fait une entreprise d'amélioration de la santé.<br />
J'utilise les deux termes DC <strong>et</strong> PS pratiquement comme<br />
interchangeables. Alors perm<strong>et</strong>tez-moi de clarifier encore mon
usage du terme de DC :<br />
Collectivité : tout groupe de personnes qui partagent une<br />
caractéristique commune, <strong>et</strong> qui ont par là des besoins, des<br />
préoccupations, des enjeux communs reliés à ces facteurs<br />
communs -- géographie, âge, langue/culture, état ou condition<br />
de santé, capacité/incapacité, statut d'emploi, compétences/<br />
certification professionnelles, <strong>et</strong>c.<br />
● elle peut être très homogène ou diversifiée.<br />
Développement : processus d'un groupe qui devient une<br />
entité cohésive, reconnaissance de l'état de membre, de valeurs<br />
communes, de leadership, de limites autour du domaine de<br />
préoccupation des groupes. Le développement suppose :<br />
● un déplacement vers des niveaux plus complexes, plus<br />
sophistiqués d'organisation : sélection de leaders, prise de<br />
décisions, résolution de conflits ;<br />
● établissement de structures <strong>et</strong> processus qui sont<br />
institutionnels plutôt que basés sur la personne -<br />
planification de succession, recrutement/formation de<br />
leaders, responsabilité, obligations juridiques <strong>et</strong><br />
considérations éthiques, planification <strong>et</strong> évaluation,<br />
développement des ressources <strong>et</strong> soutenabilité ;<br />
● souvent, un personnel professionnel, expérimenté est<br />
nécessaire ;<br />
● le DC est un processus par lequel une collectivité,<br />
commençant à n'importe quel niveau d'organisation, va de<br />
l'avant <strong>et</strong> (au moins théoriquement) devient de plus en<br />
plus efficace à refléter <strong>et</strong> à agir de façon appropriée sur les<br />
besoins de c<strong>et</strong>te collectivité.<br />
NOTE : Nous appartenons tous à plusieurs collectivités ; aucune<br />
collectivité est seule, mais toutes sont, à un degré plus ou<br />
moins élevé, interconnectées (bien que distinctes) à travers<br />
leurs membres ; les frontière entre les diverses collectivités<br />
peuvent être bien définies ou peuvent être floues.<br />
L'intersection entre politique <strong>et</strong> développement<br />
communautaire<br />
1. Une approche communautaire saine suppose une politique<br />
publique saine <strong>et</strong> un public sûr de soi, affirmatif <strong>et</strong> informé.<br />
2. Les politiques doivent être en place pour assurer l'équité<br />
d'accès à une gamme complète de possibilités, de services,<br />
de privilèges <strong>et</strong> de responsabilités. (Note : nous devons<br />
distinguer entre égalité - tous sont traités de la même<br />
façon, les intrants sont égaux - <strong>et</strong> l'équité - ceux qui ont le<br />
plus de besoins reçoivent davantage que les autres, de<br />
sorte que les extrants sont égaux.)<br />
3. Ceux qui ont besoin des bénéfices d'un traitement ou<br />
d'accommodations équitables ont besoin de s'identifier<br />
comme tels, de connaître leurs droits <strong>et</strong> les bénéfices qui<br />
leur sont dus, <strong>et</strong> d'être informés des actions <strong>et</strong> des<br />
ressources auxquelles ils ont besoin d'avoir accès.
4. Le processus de développement communautaire offre<br />
l'occasion :<br />
a. d'informer tous les membres de la collectivité de<br />
leurs droits, de leurs responsabilités <strong>et</strong> des<br />
stratégies qu'ils ont besoin d'exiger pour réaliser une<br />
égalité d'accès ; <strong>et</strong><br />
b. d'avoir une participation structurée de participation<br />
à l'identification, au développement, à la promotion<br />
<strong>et</strong> à la mise en oeuvre des politiques.<br />
5. Ceux qui ont des responsabilités de développement de<br />
politiques ont accès à la collectivité la plus affectée par<br />
l'enjeu en cause.<br />
6. C'est un système synergétique, c'est-à-dire, l'interaction<br />
de deux composantes développe un r<strong>et</strong>our d'information<br />
mutuel <strong>et</strong> chacun bâtit sur l'autre, de sorte que le produit<br />
final est plus grand que la somme des parties.)<br />
Pertinence pour la collectivité des malentendants<br />
1. Une hypothèse que je fais concernant la discrimination ou<br />
le manque d'accommodation <strong>et</strong> d'accès équitable, <strong>et</strong> je<br />
crois que cela est particulièrement vrai de la discrimination<br />
sur la base de la perte auditive, c'est que la plupart de<br />
c<strong>et</strong>te discrimination est le résultat de l'ignorance :<br />
ignorance d'abord du fait de la perte auditive dans<br />
l'individu, <strong>et</strong>, en second lieu, concernant ce qu'il faut faire<br />
pour l'accommoder.<br />
2. Une des mésententes les plus communes, c'est que toutes<br />
les pertes auditives sont les mêmes, <strong>et</strong> qu'elles nécessitent<br />
les mêmes stratégies d'accommodation. À c<strong>et</strong> égard, au<br />
moins dans le système gouvernemental que je connais le<br />
mieux, les Sourds culturels ont créé une sensibilisation très<br />
publique, à la fois de la présence des Sourds <strong>et</strong> de ce qui<br />
est nécessaire pour abattre les barrières de communication<br />
qui s'ensuivent ; ainsi, par exemple, dans la Ville de<br />
Toronto, il ne se tiendrait pas une réunion publique à<br />
laquelle on n'offrirait pas d'interprétation en langue des<br />
signes. C<strong>et</strong> état de fait a créé un problème pour ceux<br />
d'entre nous qui sont malentendants parce qu'on assume<br />
qu'une interprétation en langue des signes répondra à nos<br />
besoins. (Jusqu'à ce printemps, lorsque je me faisais un<br />
point d'honneur d'informer le bureau du maire <strong>et</strong> celui du<br />
protocole des besoins particuliers des malentendants,<br />
particulièrement dans les réunions publiques, ils n'avaient<br />
jamais entendu parler de sous-titrage en temps réel<br />
(STTR). Je comprends que le STTR sera disponible pour les<br />
réunions publiques tenues par la Ville, mais seulement si la<br />
demande en est faite à l'avance.)<br />
3. Il y a le problème connexe du manque de ressources<br />
qualifiées pour le sous-titrage en nombre suffisant. Cela<br />
exige un partenariat avec les fournisseurs de sous-titrage<br />
pour élaborer une stratégie de correction. (Un problème<br />
analogue est également apparu concernant la disponibilité<br />
d'interprètes ASL certifiés.)
4. Un autre problème, c'est celui de l'absence de volonté de<br />
nombreuses personnes malentendantes de s'identifier<br />
comme telles <strong>et</strong> leurs besoins. Ce problème est une<br />
combinaison des éléments suivants :<br />
● l'invisibilité particulière de notre condition ;<br />
● la timidité personnelle <strong>et</strong> le refus d'être vu comme<br />
différent, ou comme exigeant un traitement spécial<br />
ou une attention particulière ;<br />
● une peur d'être mal compris, de mal comprendre, de<br />
ne pas entendre même les questions qu'on nous<br />
pose pour nous aider à identifier le problème ou la<br />
solution ;<br />
● un manque de connaissances concernant au juste<br />
les stratégies, les actions, les ressources qui<br />
répondront le plus à nos besoins (plusieurs, <strong>et</strong><br />
probablement la plupart des malentendant n'ont<br />
jamais entendu parler de sous-titrage en temps réel<br />
dans les endroits publics même s'ils l'ont vu à la<br />
télévision.)<br />
5. Ce qui est peut-être le problème le plus critique, c'est celui<br />
de s'assurer que les accommodations très spécifiques <strong>et</strong> les<br />
besoins d'équité des malentendants, c'est de distinguer ces<br />
zones comme étant distinctes de celles des autres sourds<br />
culturels tout en présentant nos problématiques à l'agenda<br />
des politiques publiques (sans créer un sens de<br />
compétition ou de rivalité avec d'autres groupes).<br />
Alors, il est d'une importance vitale que la collectivité des<br />
malentendants devienne mieux organisée afin :<br />
● de modéliser <strong>et</strong> d'encourager l'acceptation tant dans<br />
l'individu que dans le public de l'identification de la<br />
condition <strong>et</strong> de surmonter la stigmatisation que<br />
plusieurs ressentent devant "l'étiqu<strong>et</strong>te" ;<br />
● de promouvoir la sensibilisation chez les<br />
malentendants à l'égard de nos droits ;<br />
● de servir de collectivité à consulter pour les<br />
fabricants de politiques ;<br />
● de servir de groupe cohésif pour identifier nos<br />
besoins <strong>et</strong> nos préoccupations <strong>et</strong> lutter pour eux.<br />
La santé mentale <strong>et</strong> la perte auditive : quelques<br />
commentaires connexes<br />
Je ne suis pas très bien placé ici parce que je ne suis pas un<br />
professionnel de la santé mentale ; en particulier, bien que j'aie<br />
eu quelque expérience par le passé dans l'organisation de<br />
services de santé mentale pour des personnes connaissant des<br />
barrières linguistiques <strong>et</strong> culturelles, j'ai eu peu d'implication<br />
dans la prestation directe de services aux personnes ayant des<br />
problèmes de santé mentale (à l'exception, il y a longtemps,<br />
lorsque je travaillais dans le domaine des toxicomanies <strong>et</strong> que<br />
je faisais un peu de counseling auprès de ceux qui avaient un<br />
problème d'alcoolisme.)
Étant donné c<strong>et</strong>te restriction, perm<strong>et</strong>tez-moi de faire quelques<br />
observations dérivées personnellement concernant la question<br />
d'une approche santé publique aux problèmes auxquels doivent<br />
faire face les personnes malentendantes ayant des problèmes<br />
de santé mentale :<br />
1. La perte auditive peut par elle-même amener des<br />
questions de santé mentale, <strong>et</strong> peut certainement<br />
exacerber tout problème de santé mentale existant ou<br />
latent chez un individu ;<br />
2. D'après mon expérience qu'il est très difficile d'organiser<br />
directement la population de la santé mentale ; sauf qu'il y<br />
a eu quelques exemples brillants d'organisation par ceux<br />
qui faisaient partie de la collectivité. Il est certain qu'il y a<br />
de nombreux exemples d'organisation réussie en réseaux,<br />
de coalitions <strong>et</strong> l'équivalent au sein du personnel<br />
d'organismes ou organisations qui travaillent avec c<strong>et</strong>te<br />
population.<br />
3. Il me semble que l'enjeu majeur dans ce domaine, c'est<br />
celui de l'accessibilité, qu'il s'agisse de centres de jour, de<br />
logement, de counseling, de suivi de médication ou<br />
d'autres services ou programmes spécifiquement destinés<br />
à la santé mentale ; ou dans des services médicaux,<br />
sociaux ou humains plus "mainstream".<br />
4. Concernant le counseling : puisque le problème est<br />
principalement basé sur la communication verbale, la<br />
question de l'accommodation est absolument cruciale : il<br />
est évident qu'elle ne peut absolument pas fonctionner à<br />
moins que les participants puissent se comprendre les uns<br />
les autres en conversation.<br />
5. Je maintiendrais - bien que je sois prêt à accepter d'être<br />
corrigé par ceux qui ont une expérience plus directe ici -<br />
que, mise à part la question de la fiabilité de l'information<br />
concernant les besoins <strong>et</strong> les préoccupations à savoir qui<br />
parle réellement pour ce groupe, les principaux points que<br />
j'ai fait valoir sur l'approche de santé publique s'appliquent<br />
à c<strong>et</strong>te collectivité aussi bien qu'à n'importe quelle autre.<br />
Sommaire<br />
En analyse finale, les enjeux méritent réellement d'être traités<br />
avec respect <strong>et</strong> d'avoir la même possibilité de profiter de la<br />
gamme complète de services, de programmes <strong>et</strong> d'activités, <strong>et</strong><br />
d'avoir les mêmes occasions de contribuer aux sphères privée<br />
<strong>et</strong> publique de la société. Ces possibilités auront leur limites,<br />
mais nous ne devons jamais simplement r<strong>et</strong>omber sur c<strong>et</strong>te<br />
supposition : nous trouvons tout le temps des façons de briser<br />
les barrières <strong>et</strong> d'éliminer les limitations. Cela peut vouloir dire<br />
équité : c.-à-d., un traitement différentiel de sorte que les<br />
résultats soient les mêmes, à la différence de l'égalité, dans<br />
laquelle tout le monde est traité de la même façon.<br />
Comprenant aussi que les attitudes - celles du public en<br />
général, ainsi que celles des membres des collectivités<br />
particulières - ne peuvent pas changer <strong>et</strong> ne changeront pas à
travers la législation. Mais le comportement peut <strong>et</strong> doit<br />
changer, <strong>et</strong> le comportement peut être légiféré. Nous savons<br />
aussi que dans de nombreuses circonstances, le changement<br />
d'attitudes suit le changement de comportement.<br />
Les membres de la collectivité, dans ce cas-ci celle des<br />
malentendants <strong>et</strong> des sourds, sont experts sur nos besoins, nos<br />
problèmes, nos préoccupations ; ainsi que sur nos espoirs <strong>et</strong><br />
nos aspirations, nos forces <strong>et</strong> nos dons. Il y a les professionnels,<br />
les techniciens, <strong>et</strong>c. qui peuvent, de concert avec la collectivité,<br />
être les experts sur les stratégies d'accommodation les plus<br />
efficaces. Les deux groupes peuvent <strong>et</strong> doivent travailler<br />
ensemble à résoudre les problèmes <strong>et</strong> surmonter les obstacles.<br />
Et, bien sûr, les politiques ont besoin d'être en place pour<br />
assurer que les solutions soient disponibles à tous ceux qui en<br />
ont besoin, à mesure que nous en avons besoin.<br />
Voilà les principes qu'une politique publique bonne <strong>et</strong> saine doit<br />
garder à l'esprit ; ils sont, en fait, les éléments d'une approche<br />
publique efficace à la perte auditive.<br />
Je veux faire un commentaire final. Une grande part de<br />
l'attention au <strong>Canada</strong> a été mise sur l'approche des droits de la<br />
personne. Cela est absolument crucial pour assurer que les<br />
politiques soient suivies, <strong>et</strong> particulièrement pour surmonter<br />
l'inattention, l'inertie, la résistance <strong>et</strong> le refus n<strong>et</strong> du<br />
changement dans les structures <strong>et</strong> les individus. C<strong>et</strong>te approche<br />
exige des politiques (<strong>et</strong> une législation <strong>et</strong> des réglementations,<br />
<strong>et</strong>c.), <strong>et</strong> va main dans la main avec ces politiques, <strong>et</strong> elle est<br />
donc inextricablement liée à l'approche de santé publique.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Réconcilier les divers groupes <strong>et</strong><br />
leurs besoins particuliers.<br />
Présentation en Langue des signes du Québec (LSQ).<br />
Je me présente : Roger St-Louis; président de l’Association<br />
ontarienne des sourds(es) francophones, le bureau chef se<br />
trouve à Sudbury Ontario.<br />
Je suis devenu sourd profond à l’âge de sept ans par suite de<br />
méningite.<br />
Je suis marié avec Murielle Richer qui est sourde profonde. Nous<br />
avons eu sept enfants.<br />
Mes parents ont grandi avec un cousin sourd qui ne pouvait pas<br />
articuler <strong>et</strong> ont vite appris à marcher dans les souliers d’une<br />
personne sourde, ils ont compris mon besoin en me donnant<br />
des outils pour que je puisse me débrouiller au lieu d’essayer de<br />
guérir ma surdité.<br />
Dès ma plus tendre enfance je me souviens bien d’avoir été<br />
gardé par des adultes sourd lorsque mes parents étaient<br />
demandés pour aller les dépanner <strong>et</strong> agir comme interprète ou<br />
facilitateur pour la communication, alors j’ai vécu ma plus<br />
tendre enfance entouré de gens sourds-malentendants, ce qui<br />
m’a permis de comprendre mieux comment devenir défenseur<br />
des droits des personnes sourdes <strong>et</strong> obtenir des programmes<br />
divers pour aider la population sourde franco ontarienne à<br />
combler leur besoins. Nous avons le droit d'avoir une langue, ce<br />
n'est pas un prérogatif, mais bien un droit fondamental qui<br />
devrait être accordé pour la survie de notre culture francoontarienne.<br />
Les personnes sourdes d’origine francophones étaient envoyés<br />
aux écoles provinciales anglophones, furent assimilés <strong>et</strong> la<br />
majorité ont perdu leur culture franco ontarienne.<br />
Puis, devenu adultes, ces personnes furent frustrés de ne pas<br />
pouvoir bénéficier <strong>et</strong> de ne pas pouvoir comprendre les<br />
conversations en français avec leurs parents <strong>et</strong> leurs proches<br />
qui étaient francophones <strong>et</strong> ne pouvaient pas participer<br />
pleinement aux activités familiales le temps des fêtes, alors la<br />
plupart des personnes sourdes se sont éloigné de leur familles<br />
pour se regrouper à la communauté Sourde <strong>et</strong> créer leur<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
patrimoines.<br />
L`éducation aux personnes sourdes de langue française en<br />
Ontario est un dossier qui a été mis à l`écart depuis trop<br />
longtemps. Dans le passé, les parents francophones d`enfants<br />
sourds devaient dépendre de la sagesse des enseignants du<br />
clergé, des fonctionnaires ou des médecins quant à la sélection<br />
d`un programme éducationnel pour leur enfants.<br />
Avant 1970, on cite trois options populaires, soit un programme<br />
résidentiel de langue française au Québec ou un programme<br />
résidentiel de langue anglaise à Belleville ou à Milton ou bien<br />
soit garder les enfants à la maison. Puisque les écoles<br />
provinciales résidentielles pour étudiants sourds sont de langue<br />
anglaise, plusieurs sourds d`origine française sont devenus des<br />
étrangers dans leur propre famille.<br />
Les services pour les enfant sourds d’origine franco ontarienne<br />
ont vu le jour au début des années 1990 avec l’ouverture de<br />
l’école provinciale en français, le Centre Jules Léger à Ottawa,<br />
qui était auparavant rattaché à l’école Sir James Whitney de<br />
Belleville anglophone <strong>et</strong> sous le parapluie de l’Université<br />
d’Ottawa comme établissement d’éducation pour enfants en<br />
difficultés d’apprentissage <strong>et</strong> par la suite devint une école<br />
provinciale ayant quatre programmes, donc Surdité, Surdicécité,<br />
cécité <strong>et</strong> difficulté d’apprentissage. Ce fut le début de<br />
programmes en LSQ, alors les enfants provenant de familles<br />
francophones peuvent maintenant bénéficier d’avoir enfin leur<br />
propre langue en LSQ-français.<br />
Il n’existait pas de services d’interprètes LSQ en Ontario <strong>et</strong> ce<br />
n’est qu’au début des années 1990 que les services<br />
d’interprètes virent le jour au Collège Boréal sous le<br />
gouvernement du Nouveau Parti Démocratique <strong>et</strong> hélas ce<br />
programme fut AXÉ par le gouvernement conservateur, ainsi<br />
que les programmes francophones qui furent aussi mis sous la<br />
hache. Nous espérons que le présent gouvernement libéral<br />
rem<strong>et</strong>tra la pendule à l’heure avec la réouverture de<br />
programmes que nous avons tant besoins afin de nous<br />
perm<strong>et</strong>tre d’avoir un meilleur futur.<br />
Pour obtenir ces changements éducationnels, ce fut l’Ontario<br />
Association of the Deaf (OAD) avec le thème Deaf Ontario Now,<br />
(DON) à la fin des années 1980 qui fit de la pression pour<br />
obtenir la Loi 4 qui permis l’introduction des programmes<br />
éducationnels en LSQ/ASL <strong>et</strong> par la suite l’Association<br />
Ontarienne des Sourd(e)s francophones fut mise sur pied pour<br />
les programmes français/LSQ.<br />
Les services d’interprètes chevronnés en LSQ se font de plus en<br />
plus rares depuis la ferm<strong>et</strong>ure du seul <strong>et</strong> unique programme de<br />
formation d’interprète au Collège Boréal il y a quelques années.<br />
Nous sommes donc très vulnérable <strong>et</strong> des gros perdants face<br />
aux agences professionnelles qui sont bien reconnue <strong>et</strong> les<br />
fonds sont dirigé vers c<strong>et</strong>te agence pour nous offrir des<br />
services, qui sont hélas, plus orientés sur le coté des<br />
anglophones, on nous dit d’aller voir c<strong>et</strong>te agence pour obtenir<br />
des services ou faire appel a des fonds, alors encore une fois<br />
nous sommes les perdants si nous ne pouvons pas nous
débrouiller en anglais.<br />
La plupart du temps, on nous assigne des interprètes ASL, ou<br />
bien ils demandent si nous pouvons avoir des interprètes<br />
bénévoles, car ne voulant pas défrayer le coût pour les services<br />
d’interprètes qui résident dans une autre ville ou au Québec, car<br />
il leur faut défrayer les coûts de déplacements, hébergement <strong>et</strong><br />
pour leurs services, nous sommes donc très frustrés de voir que<br />
les services d’interprètes chevronnés en LSQ ne nous sont pas<br />
accessibles du au manque de fonds. Les agences ne veulent pas<br />
défrayer les coûts pour les interprètes qui ne sont pas de la<br />
région.<br />
En ce moment, nous souffrons de manque d’interprètes <strong>et</strong> les<br />
seules interprètes que nous avons sont surchargées de travail<br />
<strong>et</strong> risquent leur santé. Ceci est une injustice qui ne devrait pas<br />
avoir lieu <strong>et</strong> nous avons lutté pendant des années pour obtenir<br />
ce dont nous avons tant besoin pour devenir des citoyens à part<br />
entière <strong>et</strong> fiers de pouvoir participer comme des gens ordinaires<br />
<strong>et</strong> pouvoir dire le soleil brille sur nous, car nous étions dans<br />
l’ombre auparavant sans le soutiens d’interprètes. Ne pouvant<br />
pas se débrouiller, plusieurs personnes sourdes d’origine<br />
francophone ont été internées dans les asiles psychiatriques<br />
parce qu’elles ne pouvaient pas se faire comprendre. (la même<br />
chose s’est produit du coté anglophone) Sans interprètes on<br />
risque de voir le nombre de Sourds internés s’augmenter.<br />
Dans une société où les fonds sont disponibles pour les<br />
personnes ayant un handicap visible, les fonds pour les<br />
handicapés Sourds qui ont un handicap invisible le sont très<br />
limités, les fonds ne sont pas toujours disponibles pour les<br />
associations Sourdes <strong>et</strong> surtout pour obtenir les services<br />
d’interprètes chevronnés en LSQ, nous pouvons les compter sur<br />
les doigts d’une main <strong>et</strong> trop souvent, l’on fait appel a des<br />
interprètes non qualifiés ou utilisant l’ASL pour agir comme<br />
interprètes, ou bien pouvoir établir une communication à moins<br />
que des interprètes chevronnés bénévoles se dévouent, il faut<br />
faire appel au secrétariat d’État du <strong>Canada</strong> pour revendiquer<br />
nos besoins, leur présenter le document de la Cour Suprème au<br />
BC qui stipule Eldridge Case. Les agences du gouvernement<br />
n’acceptent pas de défrayer les coûts reliés à moins<br />
d’intervention au secrétariat d’État ou a l’Eldridge Case.<br />
Quand un nouveau directeur dans un ministère ou agence est<br />
nommé, il faut recommencer à le sensibiliser, l’informer <strong>et</strong><br />
l’éduquer, c’est un processus perpétuel. Alors si on ne peut pas<br />
parler à voix, <strong>et</strong> les services d’interprètes ne sont pas<br />
disponibles, ce sont nous les perdants, car ayant un handicap<br />
invisible, il est difficile de se faire comprendre <strong>et</strong> trop souvent le<br />
Ministère n’accepte pas de verser les frais de services<br />
d’interprètes à moins d’être bien sensibilisé à nos besoins, nous<br />
aurons donc de l’aide, mais rare sont les personnes haut<br />
placées qui comprennent nos besoins. Il arrive aussi que les<br />
employés des agences ne sont pas au courant sur l’utilisation<br />
d’un ATS ou le SRB, ils placent des appels par voix en direct<br />
sans pouvoir nous parler, alors quand nous sommes équipés<br />
d’Identifieur d’appel, nous r<strong>et</strong>ournons l’appel avec l’aide du SRB<br />
pour établir une communication, <strong>et</strong> encore une fois les<br />
sensibiliser, les informer <strong>et</strong> les éduquer sur l’utilisation de<br />
communication avec un ATS ou au travers du SRB, toujours un
processus perpétuel.<br />
Pour obtenir des fonds, les agences du gouvernement nous<br />
envoient voir une agence qui est bien connue, <strong>et</strong> il est difficile<br />
d’avoir des fonds si l’on est pas reconnu, il y a souvent des<br />
conflits entre les groupes qui sollicitent de ces fonds afin de<br />
subvenir aux besoins de leur communauté. Alors, l’on nous dit<br />
d’aller voir une agence qui gère les programmes de services<br />
d’interprètes, <strong>et</strong> les services pour personnes sourdesmalentendantes<br />
<strong>et</strong> l’agence qui offre les services d’interprète<br />
dans une ville, refuse de défrayer les déplacements de<br />
l’interprète si la distance est plus de 50 kilomètres à parcourir.<br />
Nous sommes toujours les derniers à bénéficier des<br />
programmes d’équité si les fonds ne sont pas disponibles pour<br />
les services d’interprètes dans telle ville. Ce sont les personnes<br />
entendantes qui obtiennent les prestigieux postes pour<br />
desservir les services d’interprètes <strong>et</strong> ils prennent avantage de<br />
notre surdité, car nous ne pouvons pas entendre les dialogues<br />
<strong>et</strong> nous recevons simplement un court abrégé de ce qui se<br />
passe.<br />
La plupart des gens haut placés dans les agences<br />
gouvernementales indiquent qu’ils sont confortables avec les<br />
personnes qui sont atteint d’un handicap pourvu que la<br />
communication n’est pas affectée, alors les personnes ayant un<br />
handicap visible <strong>et</strong> qui peuvent articuler a voix ne sont pas<br />
affectées, une personne qui est aveugle <strong>et</strong> entendante peut bien<br />
communiquer par voix tandis que la communication avec une<br />
personne sourde ou malentendante est gênante <strong>et</strong> moins<br />
confortable, les personnes qui n’ont aucune idée de la<br />
communication en signes ou bien l’utilisation des services<br />
d’interprètes chevronnés ont besoins d’être informés, éduqués<br />
<strong>et</strong> sensibilisés.<br />
Trop souvent les personnes ayant aucune connaissance de la<br />
surdité parlent trop fort en espérant que nous entendrons sa<br />
voix, nous tournent le dos <strong>et</strong> continuent à parler fort sans<br />
réaliser que la lecture des lèvres <strong>et</strong> l’expression faciale peut être<br />
utile pour aider la communication.<br />
Ceci est d’autant plus important pour les Sourds <strong>et</strong><br />
malentendants, surtout quand il y a des problèmes de santé<br />
mentale. Pourquoi? Parce que les personnes Sourdes ou<br />
malentendantes sont les derniers à bénéficier des programmes<br />
d’équité. Il n’y a pas de services de Psychologues, pas de<br />
services de Psychiatres, pas de services de professionnel de la<br />
santé mentale qui peuvent communiquer en langue des signes<br />
LSQ, les services sont là pour les personnes entendantes.<br />
Le sous-titrage n’est pas assez compl<strong>et</strong> en comparaison aux<br />
programmes de sous titrage offert pour les anglais, les services<br />
doivent être plus accessibles aux francophones sourds ainsi que<br />
les services d'interprètes en LSQ qui parlent l'anglais, le français<br />
<strong>et</strong> la LSQ afin que les sourds reçoivent de bons services en<br />
Ontario, sans être obligés d'engager un interprète de l'anglais<br />
au français en ce qui a trait aux besoins au niveau<br />
communautaire (médecin, dentiste, hôpital, <strong>et</strong>c. Trop souvent<br />
on nous offre un interprète ASL au lieu de LSQ, il n’y a pas
assez d’interprètes en LSQ <strong>et</strong> les agences ne veulent pas<br />
défrayer les coûts de déplacements, citant c’est trop<br />
dispendieux <strong>et</strong> c’est bien nous les gros perdants, il faut porter<br />
plainte au Droit de la personne pour obtenir les services en LSQ.<br />
Un Sourd fut envoyé à l'hôpital mental lorsque ses parents ont<br />
décédés, car les autres membre de sa famille ont voulu<br />
s’accaparer de ses biens <strong>et</strong> l’ont fait interner, il avait demeuré<br />
avec ses parents <strong>et</strong> avait investis son argent dans diverses<br />
choses, Moto Neige, appareil divers, TV & enregistreuse VHS,<br />
Caméra, caméra vidéo, appareils ménager <strong>et</strong> avait payé les<br />
frais d’entr<strong>et</strong>ient toute sa vie, alors pour saisir ses biens, ses<br />
propres membres de famille l’ont fait interner, car le pauvre ne<br />
pouvais pas parler <strong>et</strong> se défendre à voix, ne pouvait pas bien<br />
lire <strong>et</strong> écrire, alors sans interprètes pour le dépanner, il fut<br />
enfermé <strong>et</strong> les membre de sa famille se sont accaparé de tous<br />
ses biens <strong>et</strong> l’ont laissé sans le sous. Avec l’aide d’une personne<br />
Sourde <strong>et</strong> de l’aumônier de la province, c<strong>et</strong> homme fut libéré du<br />
Sanatorium <strong>et</strong> se r<strong>et</strong>rouva sur la rue sans le sous <strong>et</strong> ne put rien<br />
faire pour ravoir ses biens. Si il y avait eu un endroit désigné<br />
pour aider aux personnes sourdes, c<strong>et</strong> homme aurait pu obtenir<br />
l’aide nécessaire pour obtenir ce qui lui était dû.<br />
En ce moment, la loi pour les personnes handicapées <strong>et</strong> le<br />
Ministère des Affaires civiques <strong>et</strong> de l'Immigration en Ontario a<br />
fait du chemin <strong>et</strong> il en reste encore à faire. Il faut rem<strong>et</strong>tre sur<br />
pied la formation d’interprètes en LSQ en Ontario, car les<br />
interprètes en Ontario peuvent comprendre les deux langues le<br />
français <strong>et</strong> l’anglais <strong>et</strong> traduire simultanément en LSQ. Ceci va<br />
perm<strong>et</strong>tre d’obtenir que les droits des personnes Sourdes soit<br />
bien desservie avec services de Psychologues, Psychiatres <strong>et</strong><br />
avoir services professionnels de la santé mentale tous niveaux<br />
ainsi que les services juridiques.<br />
Pour ce qui est de population vieillissante chez les sourds <strong>et</strong> les<br />
personnes qui deviennent malentendantes en vieillissant. Est-ce<br />
que ce sont des populations où la fraude <strong>et</strong> le vol est plus facile<br />
auprès d'eux? Ils ont des besoins, mais ils ne sont pas toujours<br />
compris. Qu'est-ce qui doit être mis en place pour assurer<br />
davantage la sécurité <strong>et</strong> le bien-être de ces gens qui ont<br />
travaillé toute leur vie, <strong>et</strong> ne reçoivent qu’une maigre pension<br />
insuffisante pour bien vivre ou qui sont limités quant à des<br />
services qu'ils devraient pouvoir recevoir.<br />
Ou sont donc les services d’interprètes pour leur aider ?<br />
Le service le plus pressant pour les sourds d`origine<br />
francophone qui demeurent en Ontario est celui des interprètes<br />
LSQ. Il n`existe pas encore au <strong>Canada</strong> un programme adéquat<br />
pour former les interprètes LSQ; pourtant c`est le service qui<br />
allège le milieu de la surdité. Il faut encore dépendre sur les<br />
familles parents pour ce service qui est fondamental à notre<br />
pleine intégration. Pouvez-vous imaginer ne pas être capable<br />
communiquer avec les enseignants-enseignantes de vos<br />
enfants, les serveurs dans les restaurants, les vendeursvendeuses<br />
dans les magasins ou même votre médecin de<br />
famille ?. Pourtant c`est ce qui nous arrive chaque jour. Le plus<br />
grand geste à entreprendre sera d`établir des services<br />
d`interprétariat pour les sourds de l`Ontario qui sont d`origine<br />
francophone.
Le manque de service d’interprètes, le manque de sous titrage<br />
<strong>et</strong> preneur de notes, le manque d’aide pour service de la santé<br />
mentale <strong>et</strong> physique sont une des priorité que nous devons<br />
avoir immédiatement.<br />
Les Sourds <strong>et</strong> les malentendants n’ont pas les mêmes besoins,<br />
car les Sourds optent pour la langue des signes, le sous titrage ,<br />
preneur de notes <strong>et</strong> interprètes en LSQ, les malentendants ont<br />
un différent besoin, soit interprètes orale, sous titrage, preneur<br />
de notes <strong>et</strong> prothèse pour mieux entendre les sons.<br />
L`ANALPHABÈTE - THE ILLITERATE<br />
L`analphabète du passé était celui qui n`avait pas appris à lire<br />
ou à écrire; l`analphabète d`aujourd`hui est celui qui n`a pas<br />
appris à apprendre; mais l`analphabète de demain sera la<br />
personne qui n`aura pas appris à créer par lui-même.<br />
La revue des échanges afides, avril, 1986.<br />
L`enfant apprend à lire avant ses premières années à l`école,<br />
mais il lit pour apprendre le reste de sa vie.<br />
Robert Orr.<br />
Le problème de surdité semble avoir créé un obstacle pour<br />
l`enfant sourd; faute d`oppression de sa langue, il n`a pu<br />
surmonter les obstacles de l`analphabétisme; n`ayant aucun<br />
soutien pédagogique, il n`a pu s`enrichir <strong>et</strong> devenir autonome.<br />
Roger St-Louis<br />
Oeuvres Littéraires<br />
Les enfants ont un droit; ils ont droit aux oeuvres littéraires; ils<br />
ont le droit d`être assistés <strong>et</strong> guidés dans l`apprentissage des<br />
l<strong>et</strong>tres; l`habil<strong>et</strong>é pour apprendre la langue parlée ou écrite<br />
dépend de nous, car les enfants seront les éducateurs de<br />
demain; alors que les conditions soient établies afin que la<br />
langue des signes s`épanouisse <strong>et</strong> devienne florissante. La<br />
responsabilité est nôtre, le futur est à eux, faisons que la langue<br />
des signes pour les personnes sourdes devienne une oeuvre<br />
littéraire.<br />
Roger St-Louis<br />
idée tirée de l`article anglais FAMILY LITERACY<br />
Reading Begins at Birth de DAVID DOAKE
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Les implants cochléaires pour les<br />
adultes<br />
Par : Shelly Armstrong M.Cl.Sc. <strong>et</strong><br />
Josée Chénier M.O.A. <strong>et</strong><br />
David Schramm MD FRCSC FACS<br />
L'Hôpital d'Ottawa, Campus Civic<br />
A l'Hôpital d'Ottawa, nous avons un programme d'implant<br />
cochléaire depuis 1993. À l'heure actuelle, un total de 190<br />
adultes ont reçu des implants à notre centre ; ces personnes<br />
venaient de l'Ontario, du Québec, des Maritimes <strong>et</strong> du Manitoba.<br />
Un implant cochléaire est un appareil implanté par intervention<br />
chirurgicale pour les personnes qui bénéficient de façon limitée<br />
des prothèses auditives. Avant de pouvoir comprendre comment<br />
fonctionne l'implant cochléaire, il est important de comprendre<br />
comment l'oreille normale fonctionne.<br />
Le son entre par le canal auditif <strong>et</strong> frappe le tympan. Le son est<br />
communiqué par trois ossel<strong>et</strong>s. Le dernier, l'étrier, est connecté<br />
à la cochlée (le limaçon), qui, en se mouvant, fait vibrer le<br />
fluide contenu à l'intérieur de la cochlée. La cochlée est un sac<br />
rempli de fluide qui contient des dizaines de milliers de cellules<br />
nerveuses de la grosseur d'un cheveu, qui peuvent percevoir le<br />
mouvement du fluide. Lorsque ces cellules sont stimulées, elles<br />
génèrent des impulsions électriques qui voyagent le long des<br />
nerfs auditifs vers le cerveau. Ce dernier fait une séparation des<br />
sons les uns des autres <strong>et</strong>, éventuellement, associe les mots<br />
aux idées.<br />
La plupart des pertes auditives sont causées lorsque les cellules<br />
capillaires ne fonctionnent pas. Parce que ces cellules sont<br />
endommagées, l'oreille est incapable de convertir la vibration<br />
sonore en impulsions électriques qu'elle enverrait au cerveau.<br />
L'implant cochléaire est un appareil qui est implanté par voie<br />
chirurgicale chez les personnes ayant une perte auditive de<br />
sévère à profonde. On distingue des composantes internes <strong>et</strong><br />
des composantes externes. Les composantes internes se<br />
composent de la chaîne d'électrodes <strong>et</strong> du stimulateur<br />
récepteur. Les composantes externes sont composées du<br />
processeur de parole, d'un casque <strong>et</strong> d'un câble de transmission.<br />
Le microphone capte les sons <strong>et</strong> les transforme en signaux<br />
électriques. Le signal est envoyé au processeur de parole par le<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
câble de transmission.<br />
Le processeur de parole transforme le signal en impulsions<br />
numériques. Ces impulsions sont r<strong>et</strong>ournées au casque d'écoute<br />
<strong>et</strong> aux électrodes implantées dans la cochlée.<br />
Les électrodes stimulent le nerf auditif qui envoie les impulsions<br />
électriques au cerveau.<br />
Il faut faire beaucoup de tests avant la chirurgie pour s'assurer<br />
que vous êtes un(e) candidat(e) pour un implant cochléaire <strong>et</strong><br />
que vous pourriez bénéficier d'un tel implant.<br />
Les tests auditifs, pratiqués avant <strong>et</strong> après l'opération,<br />
mesurent vos progrès dans le traitement des mots <strong>et</strong> des sons.<br />
Typiquement, le candidat à l'implant cochléaire :<br />
● a une perte auditive de sévère à profonde dans les deux<br />
oreilles<br />
● reçoit peu de bénéfices des prothèses auditives<br />
● trouve l'usage du téléphone difficile, limité ou impossible<br />
● se fie lourdement à la lecture labiale ou à l'échange de<br />
notes<br />
● n'a pas de contre-indications médicales<br />
Les difficultés mentionnés ci-dessus sont d'abord dues à une<br />
perte auditive qui a pour résultat un manque de clarté de<br />
l'élocution.<br />
D'importants groupes d'utilisateurs de l'implant sont en mesure<br />
de tirer une large gamme de bénéfices de l'implant cochléaire.<br />
Essentiellement, tous les utilisateurs de l'implant cochléaire ont<br />
une meilleure sensibilisation aux sons <strong>et</strong> peuvent pratiquer plus<br />
facilement la lecture labiale. Beaucoup de gens qui utilisent les<br />
implants cochléaires sont capables de comprendre un peu de<br />
langage parlé par la seule écoute. La quantité de<br />
compréhension du langage dans un environnement silencieux<br />
peut varier de 0 à 100 p. cent.<br />
Il y a de nombreux facteurs qui affectent le degré de clarté<br />
qu'un individu recevra avec un implant. Ces facteurs sont l'âge,<br />
la durée de la surdité, la langue, d'autres handicaps, la<br />
motivation <strong>et</strong> l'usage de la langue parlée comme moyen<br />
primaire de communication.<br />
L'âge n'est pas un facteur limitatif pour recevoir un implant<br />
cochléaire. Il faut qu'une personne soit en assez bonne santé<br />
pour subir une chirurgie. Ce critère serait déterminé par le Dr<br />
Schramm <strong>et</strong> le personnel de pré-admission de l'hôpital, qui se<br />
compose de médecins <strong>et</strong> de professionnels de la médecine. La<br />
plus vieille personne à recevoir l'implant à notre centre avait 85<br />
ans. Une personne âgée peut prendre plus de temps pour se<br />
rétablir après la chirurgie <strong>et</strong> peut prendre plus de temps à<br />
s'adapter au nouveau son produit par l'implant. Toutefois la<br />
personne peut encore bénéficier d'un implant <strong>et</strong> celui-ci pourrait<br />
avoir un impact majeur sur sa qualité de vie.
En général, les personnes qui ont connu une surdité de sévère à<br />
profonde pendant plusieurs années peuvent prendre plus de<br />
temps pour r<strong>et</strong>irer le bénéfice compl<strong>et</strong> de leur implant<br />
cochléaire. Également, c<strong>et</strong>te personne peut ne pas être capable<br />
d'obtenir autant de compréhension du langage par l'écoute<br />
seule, comparativement à quelqu'un qui a perdu l'ouïe plus<br />
récemment.<br />
Le langage peut affecter le résultat de l'implant cochléaire de<br />
deux façons. D'abord, si une personne a une perte auditive<br />
depuis la naissance <strong>et</strong> possède un vocabulaire limité ou une<br />
connaissance limitée du langage, un implant cochléaire seul<br />
n'améliorera pas la compétence linguistique de la personne,<br />
sans réadaptation.<br />
En second lieu, si la personne ne parle ni l'anglais, ni le français,<br />
elle peut quand même être considérée pour recevoir un implant.<br />
La plus grande part d'amélioration dans la capacité de<br />
communiquer se produira dans sa langue maternelle. Les<br />
services d'interprètes seraient nécessaires pendant l'évaluation<br />
<strong>et</strong> les visites de suivi.<br />
Si on est en présence d'autres handicaps, il est encore possible<br />
de considérer un implant cochléaire. Selon l'étendue des autres<br />
handicaps, les attentes vis-à-vis l'implant cochléaire peuvent<br />
devoir être modifiées.<br />
Les résultats découlant de l'implant cochléaire ne sont pas<br />
immédiats. Il y a un processus d'apprentissage. Il faut du temps<br />
pour que la personne s'adapte au nouveau son <strong>et</strong> pour associer<br />
le son au sens. Pour réussir avec un implant, la motivation<br />
compte pour beaucoup. La personne qui songe à un implant<br />
devra consentir à m<strong>et</strong>tre du temps <strong>et</strong> des efforts pour s'adapter<br />
à la nouvelle façon d'entendre. Il faudra de la persévérance.<br />
Il est important que la personne considérant un implant<br />
possède un certain degré de langue parlée <strong>et</strong> un certain rapport<br />
avec le monde des entendants. Un implant cochléaire donne le<br />
meilleur résultat lorsqu'une personne a déjà eu accès à l'usage<br />
de l'ouïe <strong>et</strong> qu'elle a connu une perte auditive progressive ou<br />
qu'elle s'est servie de prothèses auditives. Si une personne n'a<br />
pas entendu de sons depuis plusieurs années <strong>et</strong> ne communique<br />
pas par la parole, elle bénéficiera beaucoup moins d'un implant.<br />
L'évaluation médicale comporte un dossier médical, l'examen de<br />
l'oreille, un tomodensitogramme des oreilles <strong>et</strong> un EOG (ou test<br />
d'équilibre). Il peut être nécessaire d'avoir un IRM des oreilles<br />
ou une stimulation promontoire. Il peut arriver qu'une référence<br />
à d'autres spécialistes soit nécessaire.<br />
Une évaluation complète de l'ouïe sera complétée, y compris<br />
des tests qui évaluent la compréhension de la parole avec des<br />
prothèses auditives. Il faudra du counseling pour discuter des<br />
différents types de systèmes d'implants <strong>et</strong> des attentes face à<br />
l'implant.<br />
La chirurgie exige que le patient soit admis à l'hôpital pour la<br />
nuit. Une anesthésie générale est nécessaire. L'opération pren<br />
de 3 à 4 heures.
Selon notre expérience de plus de 360 implantations chez les<br />
adultes <strong>et</strong> les enfants, les risques de la chirurgie d'implant<br />
cochléaire sont minimes.<br />
Ce sont :<br />
● atteinte au nerf facial (
genre de phrases, le rendement décroît, mais, en général, il<br />
tend à être mieux qu'avec des prothèses auditives.<br />
L'implant cochléaire produit une gamme de bénéfices possibles,<br />
dont :<br />
1. une meilleure compréhension de la parole,<br />
comparativement à la prothèse auditive,<br />
2. la capacité de parler au téléphone<br />
3. une meilleure appréciation de la musique<br />
4. une sensibilisation <strong>et</strong> une réaction à l'environnement<br />
5. une moindre dépendance sur les membres de la famille<br />
pour la vie quotidienne<br />
6. une connexion renouvelée avec le monde du son<br />
7. une facilitation des communications avec la famille <strong>et</strong> les<br />
proches.<br />
Les personnes qui ont un implant cochléaire rapportent souvent<br />
une diminution de la solitude, de la dépression <strong>et</strong> de l'isolement<br />
social. Elles ont souvent plus d'indépendance, d'estime de soi,<br />
d'interaction sociale <strong>et</strong> d'occasions d'emploi.<br />
Bien qu'il y ait de nombreux aspects positifs à la réception d'un<br />
implant cochléaire, il doit y avoir aussi quelques inconvénients.<br />
Les implants cochléaires sont des appareils électroniques.<br />
Semblables aux prothèses auditives, à certains moments, les<br />
pièces externes font défaut <strong>et</strong> demandent à être remplacées.<br />
Les récipiendaires d'implants cochléaires <strong>et</strong>/ou leurs familles<br />
peuvent avoir des expectatives déraisonnables à vouloir<br />
comprendre le langage parlé en l'écoutant de façon isolée <strong>et</strong><br />
sans se servir de signaux de lecture labiale.<br />
Les gens qui ont des implants cochléaires n'ont pas une ouïe<br />
normale. Ils doivent encore lutter pour entendre dans des<br />
situations d'écoute difficiles, comme lorsqu'ils sont en présence<br />
de sons à distance <strong>et</strong> de bruits de fond.<br />
C'est un mythe que les implants cochléaires restaurent l'ouïe<br />
normale, mais la réalité est qu'ils peuvent offrir une perception<br />
améliorée de la parole <strong>et</strong> de la qualité du son. Après une<br />
implantation cochléaire, il y a un processus d'apprentissage<br />
pour obtenir le maximum de bénéfices de l'appareil. Lorsque le<br />
processeur de parole est débranché, il n'y a aucun son.<br />
Choisir de se faire m<strong>et</strong>tre un implant cochléaire est une décision<br />
très personnelle <strong>et</strong> c'est un processus qui doit être examiné<br />
avec l'équipe d'implant cochléaire. Si vous avez des questions,<br />
n'hésitez pas à communiquer avec l'Hôpital d'Ottawa, campus<br />
Civic :<br />
Téléphone : (613) 798-5555, poste 18003<br />
ATM : (613) 761-4948<br />
Télécopieur : (613) 761-4312<br />
Courriel : cseguin@ottawahospital.on.ca
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
L’équipe d’approche mobile de<br />
consultation pour les diagnostics<br />
doubles face aux handicaps<br />
auditifs<br />
(présenté par Stéphanie Symank Boileau,<br />
ergothérapeute)<br />
C<strong>et</strong>te présentation a pour but premier de décrire les services de<br />
l’Équipe d’approche mobile de consultation pour les diagnostics<br />
doubles (ÉAMCDD) de l’Hôpital Royal Ottawa. Suite à la<br />
description des services de l’ÉAMCDD, je vous partagerai les<br />
défis liés à la prestation de soin à la clientèle ayant un<br />
diagnostic double. Pour illustrer ces deux aspects, je vous<br />
présenterai une histoire de cas qui sera accompagnée d’un<br />
extrait d’un vidéo. Ensuite, je vous ferai part des impacts de la<br />
surdité dans la vie des personnes ayant un diagnostic double.<br />
Pour terminer, je partagerai certaines considérations <strong>et</strong><br />
stratégies d’intervention propre à ma profession en<br />
ergothérapie.<br />
L’ÉAMCDD est un programme de l’Hôpital Royal Ottawa qui a vu<br />
le jour en novembre 2001, suite à une prise de conscience des<br />
besoins d’offrir des soins psychiatriques aux personnes ayant<br />
une déficience intellectuelle. En eff<strong>et</strong>, environ 1 % de la<br />
population ontarienne (soit 80 000 personnes) a une déficience<br />
intellectuelle de moyenne à sévère. Des estimations prudentes<br />
démontrent que 30 % des personnes qui ont une déficience<br />
intellectuelle (soit 24 000 personnes) éprouvent également des<br />
troubles de santé mentale. D’autres études indiquent plutôt que<br />
50 à 60% de ces individus souffrent de troubles psychiatriques.<br />
Le mandat de l’ÉAMCDD consiste à offrir des services<br />
d’évaluation, de consultation <strong>et</strong> d’aide en matière de<br />
planification du traitement des personnes ayant un diagnostic<br />
double. De plus, l’ÉAMCDD a un mandat d’offrir de l’éducation<br />
<strong>et</strong> de la formation aux personnes qui travaillent auprès de c<strong>et</strong>te<br />
clientèle. L’ÉAMCDD se compose d’une psychiatre à demi temps,<br />
d’une psychologue, de deux travailleuses sociales, de trois<br />
infirmières (dont une est la gestionnaire d’équipe), d’une<br />
adjointe administrative, d’une ergothérapeute <strong>et</strong> d’un ou d’une<br />
orthophoniste, poste qui n’est pas encore comblé. L’ÉAMCDD<br />
dessert les personnes âgées de 16 ans <strong>et</strong> plus ayant une<br />
déficience intellectuelle ainsi qu’un trouble de santé mentale <strong>et</strong><br />
résidant dans le district de Champlain. Ce territoire s’étend à<br />
l’est jusqu'à Hawkesbury <strong>et</strong> à l’ouest quelque peu passé<br />
Pembroke. Les critères d’aiguillage vers nos services<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
correspondent à un diagnostic de déficience intellectuelle<br />
(légère à profonde) ainsi qu’un trouble de santé mentale. Il est<br />
à noter qu’il n’est pas nécessaire que le trouble de santé<br />
mentale soit préalablement diagnostiqué. L’identification d’un<br />
trouble psychiatrique fait partie du rôle de la psychiatre de<br />
l’équipe. Les critères diagnostics de la déficience intellectuelle<br />
que l’équipe a adoptés correspondent aux critères établis par le<br />
DSM-IV (manuel regroupant les critères diagnostics de<br />
l’ensemble des troubles psychiatriques). Les critères diagnostics<br />
sont les suivants : un fonctionnement intellectuel général sous<br />
la moyenne, ce qui signifie un score inférieur à 70 <strong>et</strong><br />
accompagné de déficits fonctionnels dans les domaines de la<br />
communication, de la vie sociale, des activités de la vie<br />
quotidienne <strong>et</strong>/ou d’autosuffisance. Les scores d’un test de<br />
quotient intellectuel aident à déterminer le niveau de la<br />
déficience intellectuelle. L’échelle de Q.I. est la suivante : la<br />
déficience légère se situe entre 55 <strong>et</strong> 70 ; moyenne entre 35 <strong>et</strong><br />
55 ; sévère entre 20 <strong>et</strong> 35 <strong>et</strong> profonde correspond à un score<br />
inférieur à 20. Il est à noter que l’on peut présumer la présence<br />
d’une déficience intellectuelle lorsque l’on ne peut évaluer au<br />
moyen de ces méthodes standardisées. Toute personne peut<br />
référer un individu à nos services y compris un membre de la<br />
famille, un gestionnaire de cas <strong>et</strong> un prestataire de soin. Il est à<br />
noter qu’une l<strong>et</strong>tre de référence d’un médecin (médecin de<br />
famille, neurologue, psychiatre ou autre) est requise afin que ce<br />
dernier puisse assurer le suivi des recommandations émises par<br />
notre équipe. De plus, l’ÉAMCDD offre un service de<br />
consultation à court terme. Ce processus de consultation de<br />
l’ÉAMCDD s’effectue tout d’abord par un contact initial avec la<br />
personne effectuant la demande de service. De l’information est<br />
alors recueillie afin d’en déterminer la priorité. Le nom de la<br />
personne référée est ensuite placée sur une liste d’attente, qui,<br />
malheureusement, correspond présentement à environ un an<br />
d’attente. Au temps opportun, la personne est assignée à un<br />
membre de l’équipe qui entreprend le processus d’évaluation.<br />
Quelques rencontres sont effectuées à domicile (ou autres<br />
milieux de vie selon les besoins) avec les personnes<br />
significatives dans la vie de la personne. Lorsque suffisamment<br />
d’information est obtenue, les données sont présentées aux<br />
membres de l’ÉAMCDD. Par la suite, la psychiatre rencontre la<br />
personne pour y réaliser une évaluation psychiatrique. Au<br />
besoin, d’autres membres de l’équipe sont invités à participer<br />
au processus d’évaluation. Enfin, un rapport final de<br />
consultation est élaboré <strong>et</strong> des recommandations sont émises<br />
au médecin traitant, aux membres de la famille <strong>et</strong> aux<br />
prestataires de soin. Les recommandations peuvent inclure des<br />
stratégies perm<strong>et</strong>tant de mieux soutenir l’individu ; de<br />
l’éducation au suj<strong>et</strong> des besoins de la personne (par exemple,<br />
trouble de santé mentale <strong>et</strong>/ou niveau de la déficience<br />
intellectuelle de la personne) ainsi que l’aiguillage vers d’autres<br />
services communautaires appropriés.<br />
En deuxième lieu, explorons les défis liés à la prestation de<br />
service à la clientèle ayant un diagnostic double. Tout d’abord, il<br />
y a présence de barrières systémiques qui rendent difficiles<br />
l’accès aux soins des personnes ayant une déficience<br />
intellectuelle <strong>et</strong> un trouble de santé mentale. Effectivement,<br />
c<strong>et</strong>te clientèle est desservie par deux systèmes distincts, soit le<br />
ministère de la Santé <strong>et</strong> des soins de longue durée qui se<br />
charge entre autres des soins des personnes souffrant de<br />
troubles de santé mentale <strong>et</strong> le ministère des Services sociaux
<strong>et</strong> communautaires qui subventionne un éventail de services<br />
pour personnes ayant une déficience intellectuelle. Étant donné<br />
que ces bailleurs de fonds ont un budg<strong>et</strong>, une mission <strong>et</strong> une<br />
philosophie qui diffèrent, il est parfois difficile de bien répondre<br />
aux besoins des personnes ayant à la fois un trouble de santé<br />
mentale <strong>et</strong> une déficience intellectuelle. De plus, il y a une<br />
lacune sérieuse de ressources <strong>et</strong> de services appropriés pour<br />
personnes ayant un diagnostic double, <strong>et</strong> tout particulièrement<br />
pour les adultes. En plus, nous constatons qu’il existe encore<br />
des croyances erronées ainsi que des mythes à l’égard des<br />
personnes ayant une déficience intellectuelle. Par exemple, il<br />
nous arrive d’entendre que les personnes ayant une déficience<br />
intellectuelle ne peuvent souffrir de troubles de santé mentale<br />
ou que celles-ci sont toujours joviales. Il y a parfois une<br />
tendance à croire que leurs besoins sont identiques, ce qui<br />
empêche de considérer chaque individu comme personne<br />
unique. Un autre défi lié à la prestation de service à c<strong>et</strong>te<br />
clientèle correspond au fait qu’aux yeux de nombreux<br />
professionnels de la santé, la déficience intellectuelle est<br />
prédominante. Les prestataires de soin peuvent ainsi attribuer<br />
tous les symptômes <strong>et</strong> problèmes au fait que la personne a une<br />
déficience intellectuelle. C’est comme si la déficience<br />
intellectuelle ‘éclipsait’ les autres conditions ou problèmes<br />
présents. Étant donné leurs limites (cognitives, verbales <strong>et</strong><br />
autres), ces personnes peuvent démontrer des comportements<br />
‘inhabituels’ voire même ‘étranges’. Nous croyons qu’une<br />
meilleure compréhension des besoins de ces personnes<br />
améliore la qualité des soins offerts. En plus d’un quotient<br />
intellectuel inférieur à la moyenne, la déficience intellectuelle<br />
peut être associée à un délai de développement dans les<br />
sphères suivantes : communication, motricité globale<br />
(mouvements des gros muscles du corps), motricité fine<br />
(mouvements des p<strong>et</strong>its muscles), activités de la vie<br />
quotidienne ainsi que de la vie sociale. Ces défis additionnels se<br />
présentent lorsqu’il y a présence de troubles comportementaux,<br />
médicaux, génétiques <strong>et</strong>/ou neurologiques. Ces personnes<br />
peuvent aussi présenter des handicaps physiques, des limites<br />
visuelles <strong>et</strong>/ou auditives. Compte tenu de l’ensemble de ces<br />
particularités propres à chaque individu <strong>et</strong> à chaque milieu,<br />
nous devons adapter <strong>et</strong> modifier nos méthodes d’évaluation. Les<br />
méthodes d’évaluation privilégiées employées avec c<strong>et</strong>te<br />
clientèle correspondent à des entrevues avec les personnes qui<br />
connaissent le mieux la personne, des observations de la<br />
personne au sein de ses divers milieux de vie <strong>et</strong> l’essai de<br />
stratégies.<br />
Afin d’illustrer la prestation de service de l’ÉAMCDD ainsi que<br />
d’entamer la discussion au suj<strong>et</strong> des impacts de la surdité, je<br />
vous présente l’histoire de Hilda. Hilda est une femme âgée de<br />
37 ans atteinte de la rubéole congénitale. Elle est sourdeaveugle.<br />
Il est estimé qu’elle a une déficience intellectuelle de<br />
sévère à profonde. En plus, Hilda souffre de nombreux troubles<br />
médicaux <strong>et</strong> orthopédiques (par exemple, maladie congénitale<br />
du cœur, cyphoscoliose, condition douloureuse de la cornée de<br />
l’œil). Elle habite dans un foyer pour personnes âgées dans une<br />
communauté rurale. Elle a été référée à l’ÉAMCDD suite à une<br />
augmentation de la fréquence <strong>et</strong> de l’intensité d’agitation <strong>et</strong> de<br />
comportements auto-mutilatoires; elle se frappait l’œil <strong>et</strong> se<br />
mordait la main. Hilda a été assignée à une travailleuse sociale<br />
de l’équipe qui a entamé le processus d’évaluation. Pour ce
faire, elle a rencontré les membres de la famille ainsi que les<br />
intervenantes des agences communautaires impliquées (Agence<br />
d’intégration communautaire <strong>et</strong> Programme pour personnes<br />
sourdes-aveugles de INCA). L’information historique ainsi que<br />
les rapports pertinents (médicaux <strong>et</strong> autres) ont été obtenus.<br />
Des observations dans son milieu de vie <strong>et</strong> en communauté ont<br />
été effectuées. La psychiatre de l’équipe a rencontré Hilda ainsi<br />
que les personnes significatives dans sa vie dans le but d’offrir<br />
une évaluation psychiatrique. La psychiatre a posé le diagnostic<br />
de dépression <strong>et</strong> a recommandé des médicaments<br />
psychotropes. En plus, on a soigné Hilda pour sa condition de<br />
l’œil <strong>et</strong> pour ses menstruations douloureuses. La combinaison<br />
de ces soins a eu pour résultat de réduire de façon significative<br />
la fréquence <strong>et</strong> l’intensité de ses comportements automutilatoires.<br />
Hilda est apparue plus calme <strong>et</strong> a r<strong>et</strong>rouvé le<br />
sourire. Par la suite, une évaluation en ergothérapie a été<br />
entamée afin d’identifier les forces <strong>et</strong> les besoins de Hilda. Les<br />
forces identifiées sont les suivantes : Hilda possède une<br />
mémoire spatiale <strong>et</strong> tactile très développée. En eff<strong>et</strong>, elle réussit<br />
à se r<strong>et</strong>rouver aisément <strong>et</strong> se souvient où les choses sont<br />
placées dans un endroit familier. De plus, elle parvient à<br />
identifier une personne par une caractéristique particulière, par<br />
exemple la forme des ongles ou des bagues. Aussi, Hilda utilise<br />
le toucher <strong>et</strong> l’odorat pour apprendre, pour communiquer <strong>et</strong><br />
pour entrer en relation avec son environnement. Quoique ses<br />
habil<strong>et</strong>és de communication soient limitées, elle parvient à<br />
communiquer à l’aide de comportements <strong>et</strong> de sons. Par contre,<br />
ceux-ci doivent être interprétés par les gens qui l’entourent.<br />
Hilda s’intéresse à quelques activités, telles que se baigner, se<br />
faire masser, manipuler certains obj<strong>et</strong>s de couleurs vives <strong>et</strong><br />
écouter de la musique. Les membres de sa famille ainsi que ses<br />
intervenantes sont présents <strong>et</strong> dévoués. Les limites <strong>et</strong> les défis<br />
de Hilda sont les suivants : ses limites cognitives sont<br />
importantes (sa déficience intellectuelle se situerait entre sévère<br />
<strong>et</strong> profonde). Elle a des limites sensorielles significatives<br />
(considérée aveugle <strong>et</strong> sourde, quoiqu’elle répond à des<br />
instructions simples composées d’un signe fait avec les mains <strong>et</strong><br />
de mots dits d’une voix forte). Hilda a peu d’activités<br />
significatives. Tout changement d’activités, de lieux <strong>et</strong> de<br />
personnes demeurent difficiles pour elle. Enfin, les ressources<br />
communautaires pour personne ayant un diagnostic double en<br />
plus d’être aveugle-sourde sont limitées. La résidence pour<br />
personnes âgées <strong>et</strong> plus particulièrement l’unité pour personnes<br />
atteintes d’Alzheimer où elle demeure est peu adaptée aux<br />
besoins spéciaux de Hilda.<br />
A la lumière de l’histoire de Hilda <strong>et</strong> d’autres clients de<br />
l’ÉAMCDD étant malentendants ou sourds, j’aimerais aborder les<br />
impacts de la surdité chez les personnes ayant un diagnostic<br />
double. Tout d’abord, il est très difficile d’isoler les impacts<br />
associés uniquement à la surdité étant donné la présence de<br />
nombreux autres déficits. Les limites doivent être considérées<br />
dans leur ensemble. La surdité <strong>et</strong> la cécité limitent <strong>et</strong> même<br />
distordent la compréhension du monde. Conséquemment, il<br />
n’est pas étonnant que le monde puisse sembler imprévisible <strong>et</strong><br />
menaçant. Aussi, les difficultés de communication <strong>et</strong> de<br />
compréhension peuvent occasionner des troubles<br />
comportementaux, émotifs <strong>et</strong> psychiatriques. Étant donné ces<br />
limites, les apprentissages se font par les sens fonctionnels <strong>et</strong> à<br />
l’aide de nombreuses répétitions. L’ensemble de ces déficits ne<br />
peut faire autrement que d’entraîner une dépendance sur les
autres afin de comprendre <strong>et</strong> d’interpréter le monde, d’être<br />
rassuré, de se déplacer d’un endroit à un autre <strong>et</strong> d’effectuer les<br />
activités de la vie quotidienne. Il y a aussi généralement<br />
présence de difficultés lorsqu’il y a des changements dans la<br />
routine quotidienne. Ceci est commun chez les personnes ne<br />
pouvant s’exprimer verbalement ou qui démontrent de pauvres<br />
habil<strong>et</strong>és de communication <strong>et</strong> de compréhension. En eff<strong>et</strong>, les<br />
changements amènent l’imprévisibilité <strong>et</strong> l’inconnu <strong>et</strong> par<br />
conséquent ceux-ci peuvent sembler menaçants.<br />
Finalement, voici quelques considérations <strong>et</strong> stratégies<br />
d’intervention en ergothérapie auprès de personnes ayant une<br />
déficience intellectuelle <strong>et</strong> des limites sensorielles y compris la<br />
surdité. Tout d’abord, il est très important de s’assurer que<br />
toutes conditions médicales soient traitées étant donné que de<br />
nombreux comportements <strong>et</strong>/ou symptômes peuvent être reliés<br />
à des troubles médicaux non identifiés <strong>et</strong> non soignés (par<br />
exemple, la dépression ou la présence de douleur). De plus, afin<br />
de bien comprendre les limites auditives <strong>et</strong> visuelles des<br />
personnes, il peut être nécessaire de référer celles-ci à des<br />
professionnels, tels qu’à un audiologiste <strong>et</strong>/ou à un<br />
ophtalmologiste. Ces informations facilitent les évaluations <strong>et</strong><br />
les interventions des ergothérapeutes. Suite à une évaluation<br />
en ergothérapie, voici quelques stratégies d’intervention propres<br />
à c<strong>et</strong>te clientèle. Entre autres, il importe de créer un<br />
environnement positif qui réponde aux besoins de la personne.<br />
Par exemple, faciliter l’accès à un endroit calme <strong>et</strong> reposant <strong>et</strong><br />
offrir une routine prévisible. Étant donné les limites cognitives<br />
importantes, il est plus réaliste <strong>et</strong> efficace de modifier<br />
l’environnement plutôt que de viser des changements chez<br />
l’individu. Une autre stratégie d’intervention en ergothérapie<br />
consiste en faciliter l’accès à des activités significatives, c’est-àdire<br />
à des activités intéressantes <strong>et</strong> valorisantes pour la<br />
personne. Par exemple, la baignade, la massothérapie <strong>et</strong> la<br />
musique. Étant donné que ces personnes présentent des limites<br />
sur le plan sensoriel, il est important d’incorporer des stratégies<br />
durant la journée afin d’enrichir l’environnement sensoriel de<br />
celles-ci. Par exemple, en offrant l’accès à la musique, à divers<br />
obj<strong>et</strong>s de textures <strong>et</strong> de couleurs différentes, à une chaise<br />
berçante <strong>et</strong> à des odeurs de choix. Tel que décrit ci haut,<br />
plusieurs manifestent des difficultés lors de changements dans<br />
la routine quotidienne. Il s’agit donc de faciliter la<br />
compréhension de ces événements à l’aide de mots simples, de<br />
signes ou d’obj<strong>et</strong>s que la personne peut toucher (dans le cas de<br />
personnes aveugles). Afin de faciliter ces temps de changement<br />
<strong>et</strong> toutes activités qui soient perçues comme stressantes, il est<br />
souvent bénéfique d’incorporer des stratégies calmantes avant<br />
<strong>et</strong> durant ces changements, telles que le massage, la vibration<br />
<strong>et</strong> la musique calme. Il incombe aussi d’éduquer les prestataires<br />
de soin au suj<strong>et</strong> des besoins spéciaux de la personne <strong>et</strong> des<br />
stratégies d’intervention afin de faciliter les soins.<br />
Enfin, concluons en rappelant que pour procéder à des<br />
stratégies d’intervention efficaces auprès des personnes ayant<br />
un double diagnostic ainsi que des limites sensorielles, il faut<br />
créer des liens de confiance. Il importe aussi que ces personnes<br />
sentent dans toute leur fragilité le désir profond des<br />
intervenants <strong>et</strong> intervenantes de les guider <strong>et</strong> de les<br />
accompagner. En somme, elles doivent se sentir aimées <strong>et</strong><br />
valorisées.
Pour nous joindre, veuillez contacter l’adjointe administrative au<br />
(613) 722-6521 poste 7141. Il nous fera plaisir de répondre à<br />
vos questions. Vous pouvez aussi obtenir de plus amples détails<br />
concernant nos services à l’adresse Intern<strong>et</strong> suivante : www.<br />
rohcg.on.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Les problèmes de la famille<br />
sourde : les CODA* <strong>et</strong> l'identité<br />
Par : Thomas H. Bull, M.Div., M.A., CSC, CI, CT<br />
Gallaud<strong>et</strong> University<br />
*CODA (États-Unis) - c'est le nom de l'association Children of<br />
Deaf Adults (CODA) - enfants de Sourds adultes ; les membres<br />
de c<strong>et</strong>te association se désignent eux-mêmes par ce nom,<br />
également écrit coda ou même koda ; nous l'emploieront tel<br />
quel dans la traduction qui suit. (Note du traducteur)<br />
Sommaire<br />
La question "Suis-je entendant ou sourd ?" crée souvent un<br />
conflit d'identité pour les enfants entendants élevés dans une<br />
famille bilingue <strong>et</strong> biculturelle où l'un des parents ou les deux<br />
sont S/sourds. L'identité personnelle <strong>et</strong> culturelle d'une<br />
personne est un jalon important du développement, <strong>et</strong> les<br />
expériences de vie de ces enfants entendants ont un eff<strong>et</strong> sur la<br />
dynamique familiale. Les Codas (enfants entendants de Sourds<br />
adultes) peuvent se sentir en conflit, marginalisés, seuls ou<br />
différents, à grandir entendants dans le monde des Sourds.<br />
Malheureusement, comprendre <strong>et</strong> embrasser c<strong>et</strong>te différence ne<br />
se produit pas avant l'âge adulte, lorsqu'on trouve une<br />
communauté avec d'autres "comme moi". C<strong>et</strong>te présentation<br />
illustre le conflit <strong>et</strong> explore la puissance de l'histoire partagée <strong>et</strong><br />
de l'identité de groupe pour apporter une résolution positive <strong>et</strong><br />
triomphale. Les parents qui sont sourds bénéficient également<br />
des ressources professionnelles <strong>et</strong> communautaires <strong>et</strong> de l'appui<br />
des pairs dans l'effort qu'ils ont faits pour aider leurs enfants<br />
entendants à se tirer d'affaires avec la différence "monde des<br />
entendants/monde des Sourds" plus tôt dans la vie. Un certain<br />
nombre de ressources organisationnelles, éducatives <strong>et</strong><br />
imprimées sont suggérées.<br />
Quelques acronymes<br />
Je suis entendant <strong>et</strong> mes parents étaient sourds. On avait<br />
coutume d'appeler des gens comme moi des HCDP (enfants<br />
entendants de parents sourds), jusqu'à ce que l'organisme<br />
CODA (Children of Deaf Adults, Inc.) soit fondé en 1983. Avec la<br />
croissance de CODA, devenue un organisme international, <strong>et</strong><br />
avec la simplicité lyrique de l'acronyme, aujourd'hui un plus<br />
grand nombre d'entre nous s'identifient comme codas, que nous<br />
ayons un ou deux parents sourds. Tout comme cela dépend<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
d'une décision individuelle de s'appeler sourd ou malentendant,<br />
c'est pareillement une décision individuelle que de s'appeler<br />
coda. Il n'y a ici aucune supposition ou implication que l'un ou<br />
l'autre des parents est nécessairement culturellement ou<br />
profondément sourd, ou fait usage de l'American Sign<br />
Language. Il existe un certain nombre de chapitres de CODA<br />
aux États-Unis, <strong>et</strong> des groupes semblables se sont formés en<br />
Australie, en Angl<strong>et</strong>erre, au <strong>Canada</strong>, au Danemark, en Finlande,<br />
en Allemagne, en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas <strong>et</strong> ailleurs.<br />
Les parents sourds ont tendance à se réunir pour satisfaire leurs<br />
besoins d'appui mutuels <strong>et</strong> offrir des activités sociales pour leurs<br />
jeunes enfants entendants, aussi connus sous le nom de kodas<br />
(kids of Deaf Adults). Ces groupes de parents KODA se sont<br />
formés à Montgomery County (Maryland), Seattle<br />
(Washington), Long Island (New York) <strong>et</strong> ailleurs. Quelques<br />
agences reconnaissent les besoins de ces parents <strong>et</strong> de leurs<br />
enfants entendants <strong>et</strong> elles commencent à offrir des services<br />
très nécessaires. L'acronyme "koda" est de plus en plus utilisé<br />
pour décrire les jeunes enfants entendants dont l'un ou les deux<br />
parents sont sourds.<br />
Je vais partager quelques histoires avec vous. En fait, plus de la<br />
moitié de c<strong>et</strong>te présentation est sur ruban vidéo. Je partagerai<br />
une partie de ma propre histoire <strong>et</strong> les clips vidéo illustreront<br />
des expériences communes de codas <strong>et</strong> de parents sourds.<br />
Comme on dit : "Un image vaut mille mots." Les histoires de vie<br />
personnelle des autres peuvent avoir un impact profond sur<br />
nous personnellement, <strong>et</strong> être source d'inspiration <strong>et</strong> de pouvoir.<br />
Mon entrée dans la culture des Sourds<br />
Une des différences significatives entre la culture des<br />
entendants <strong>et</strong> celle des Sourds se trouve dans le rituel de<br />
"salutation" ou de "présentation". Lorsque des Sourds se<br />
rencontrent, ils se présentent d'une façon différente des<br />
entendants. La présentation, dans la culture des Sourds,<br />
comprend l'échange des noms <strong>et</strong> quelques-uns des éléments<br />
suivants : a) quelle école vous avez fréquentée (pensionnat ou<br />
programme d'éducation mainstream) ; b) si vous êtes marié,<br />
qui est votre époux ou épouse, comment vous vous êtes<br />
rencontrés <strong>et</strong> si vous avez des enfants entendants ou sourds ;<br />
c) à quels organismes communautaires pour les Sourds vous<br />
appartenez; <strong>et</strong> d) les personnes de la collectivité que vous<br />
connaissez. Parce que le monde des Sourds est tellement p<strong>et</strong>it,<br />
vous essayez de découvrir des amis <strong>et</strong> des connaissances<br />
mutuels, que vous pouvez avoir connus pendant de nombreuses<br />
années. Dans le monde des Sourds, on veut savoir quelles sont<br />
vos affiliations au sein de la collectivité.(Lane, Hoffmeister &<br />
Bahan, p. 5)<br />
Si vous êtes un entendant, dans ce rituel, la personne sourde<br />
voudra savoir comment votre rapport au monde des Sourds<br />
s'est établi. Les Sourds veulent savoir si vous avez des parents<br />
ou des connaissances sourds, comment vous vous êtes<br />
intéressés au monde des Sourds, comment vous avez appris la<br />
langue des signes <strong>et</strong> qui ont été vos professeurs d'ASL, <strong>et</strong>c. Les<br />
Sourds veulent connaître votre histoire dans ses rapports avec<br />
leur monde <strong>et</strong> ils veulent en savoir tous les détails, de A à Z,<br />
comme on dit. Ces renseignements aident à développer la
confiance <strong>et</strong> l'acceptation au sein de la collectivité.<br />
Dans un effort que je fais pour développer un rapport avec le<br />
lecteur, perm<strong>et</strong>tez-moi de vous donner ma présentation dans la<br />
culture des Sourds. Je suis né entendant de parents sourds.<br />
Mon père est né au Nebraska en 1903, <strong>et</strong> ma mère, au Missouri,<br />
en 1904. Si vous connaissez bien le roman de Joanne<br />
Geenberg, In This Sign (1970), il parle d'un couple sourd,<br />
Janice <strong>et</strong> Abel Ryder, qui sont nés en 1900 <strong>et</strong> qui ont élevé deux<br />
enfants entendants pendant la dépression <strong>et</strong> la Seconde Guerre<br />
mondiale. Si vous avez vu le film 1985 (Hallmark Hall of Fame),<br />
Love is Never Silent, basé sur le roman de Greenberg, vous<br />
avez une bonne idée de la vie <strong>et</strong> de l'époque de mes parents <strong>et</strong><br />
du vécu des Sourds de ce temps-là.<br />
Mon père est né sourd d'une cause inconnue <strong>et</strong> il a fréquenté la<br />
Kansas School for the Deaf, à Olathe, parce que c'était plus près<br />
de chez lui que l'école du Nebraska. Lorsqu'il eut 10 ans, mes<br />
grands-parents déménagèrent dans la vallée de San Joaquin, en<br />
Californie, <strong>et</strong> il fréquenta la California School for the Deaf à<br />
Berkeley. Mon père a appris le métier de cordonnier, il excellait<br />
dans les sports, <strong>et</strong>, en 1922, il devint le deuxième Sourd aux<br />
États-Unis à réussir le grade Eagle Scout. À c<strong>et</strong>te époque-là<br />
l'école de donnait qu'un enseignement limité à la huitième<br />
année, <strong>et</strong> il r<strong>et</strong>ourna donc en situation de "mainstream" au highschool<br />
public de sa ville rurale où il jouait au football <strong>et</strong><br />
compléta deux autres années d'éducation. Il poursuivit en<br />
gérant sa propre cordonnerie pendant 18 ans dans sa ville de<br />
résidence. Après son mariage naquirent ma soeur <strong>et</strong> moi, <strong>et</strong> la<br />
famille déménagea dans la région de la Bay avant la Deuxième<br />
Guerre mondiale, où les emplois en usine étaient abondants, <strong>et</strong><br />
mon père devint membre du syndicat des United Auto Workers.<br />
Ma mère est née entendante <strong>et</strong> est devenue sourde à cause<br />
d'une série de maladies contractées entre les âges de 24 <strong>et</strong> de<br />
36 mois. Son élocution ne fut jamais très intelligible, ni<br />
complètement grammaticale, mais parce qu'elle avait une<br />
certaine capacité à parler, sa famille la mit dans des<br />
programmes d'éducation orale. Entre-temps, sa famille<br />
déménagea aussi en Californie, où elle finit par entrer à la<br />
California School for the Deaf, à l'âge de 15 ans, visiblement un<br />
"fiasco oral". Je suppose que son potentiel éducationnel fut<br />
perdu pendant ces années de fréquentation d'une école orale,<br />
parce qu'elle était fonctionnellement ill<strong>et</strong>trée. Elle avait de la<br />
difficulté à comprendre le sens d'un article de journal, elle tenait<br />
la plume de façon gauche, <strong>et</strong> elle ne conduisit jamais d'auto. En<br />
autant que je sache, la surdité n'est pas héréditaire dans ma<br />
famille.<br />
C'est étrange de voir combien d'aspects de la vie de famille de<br />
Janice <strong>et</strong> Abel Ryder ressemblent à l'histoire de ma propre<br />
famille. Ils vivaient à New-York <strong>et</strong> avaient deux enfants<br />
entendants, Margar<strong>et</strong> <strong>et</strong> Bradley, qui étaient séparés de six ans,<br />
<strong>et</strong> la famille communiquait en American Sign Language. Mes<br />
parents communiquaient aussi en ASL à la maison. Ma soeur<br />
avait 6 ans quand je suis né, <strong>et</strong> pendant ses premières années,<br />
la famille vivait avec ma grand-mère entendante dans une<br />
région fermière de la Californie. Bradley Ryder avait quatre ans<br />
lorsqu'il escalada une échelle d'évacuation en cas d'incendie de<br />
leur édifice d'appartements <strong>et</strong> se tua en tombant. Margar<strong>et</strong>
avait dix ans <strong>et</strong> joua l'interprète pour ses parents lorsqu'ils<br />
choisirent un cercueil <strong>et</strong> traitèrent avec le directeur des pompes<br />
funèbres. Ma grand-mère paternelle fut frappée <strong>et</strong> tuée par le<br />
conducteur d'un pick-up alors qu'elle traversait une route rurale<br />
à la tombée de la nuit. J'avais 12 ans <strong>et</strong> j'aidai mes parents à<br />
choisir le cercueil <strong>et</strong> à communiquer avec le personnel de la<br />
maison mortuaire. Abel Ryder <strong>et</strong> mon père étaient tous deux<br />
cols bleus, ils prirent tous les deux leur r<strong>et</strong>raite après 25 ans de<br />
service, <strong>et</strong> tous deux reçurent une montre en or jaune à leur<br />
r<strong>et</strong>raite. Comme Janice, qui travailla de nombreuses années<br />
comme couturière dans une usine, ma mère travailla aussi<br />
comme couturière à la pièce pour les Goodwill Industries.<br />
Pour poursuivre les comparaisons, Margar<strong>et</strong> Ryder se maria <strong>et</strong><br />
eut un fils qui, comme jeune adulte, s'enrôla dans les<br />
mouvements de droits civils <strong>et</strong> alla à Selma (Alabama). Pendant<br />
des années, il avait vu assez d'oppression <strong>et</strong> de discrimination<br />
dans le cas de ses grands-parents sourds. Moi, j'étais étudiant à<br />
la Pacific School of Religion, à Berkeley (Californie), où je me<br />
préparais au ministère à l'Église United M<strong>et</strong>hodist lorsque le Dr<br />
Marin Luther King, Jr. lança un appel pour avoir des bénévoles.<br />
En réponse à c<strong>et</strong> appel, je montai dans un autobus avec 41<br />
autres étudiants du séminaire de la Bay Area <strong>et</strong> partis pour le<br />
sud. Je fis la marche de Selma à Montgomery sur la foi de mes<br />
préoccupations <strong>et</strong> de mon engagement en matière de justice<br />
sociale. Le fait d'avoir des parents sourds était sûrement aussi<br />
un facteur. (Il faut se rappeler que, lorsque je grandissais, il n'y<br />
avait pas de loi comme l'American Disabilities Act, il n'y avait<br />
pas d'interprètes certifiés en langue des signes, par d'ATM, <strong>et</strong><br />
pas de sous-titrage des émissions de télévision <strong>et</strong> des films.) Je<br />
suis émerveillé de ce que Greenberg ait pu écrire une telle<br />
peinture de parents sourds <strong>et</strong> de la vie de famille, étant donné<br />
ses expériences limitées, parce que son mari était conseiller en<br />
rééducation professionnelle auprès des Sourds.<br />
Lorsque CODA fut fondée, en novembre 1983, je m'abonnai au<br />
bull<strong>et</strong>in de nouvelles internationales, pour ensuite assister à la<br />
première conférence nationale, en Californie, en 1986. J'ai été<br />
rédacteur des actes des cinq premières conférences <strong>et</strong>, depuis<br />
ce temps-là, j'ai assisté à toutes les conférences<br />
internationales. J'ai contribué à établir un de nos premiers<br />
chapitres dans la région métropolitaine de Washington (D.C.) <strong>et</strong><br />
j'ai compilé <strong>et</strong> publié On the Edge of Deaf Culture: Hearing<br />
Children/Deaf Parents Annotated Bibliography en 1998. Suite à<br />
ces expériences, je suis maintenant bien ancré dans mon<br />
patrimoine CODA. Même mes plaque minéralogiques<br />
personnalisées déclarent que je suis un CODA. Toutefois,<br />
pendant toute mon enfance <strong>et</strong> plusieurs de mes années<br />
d'adulte, c'était une identité qui m'était étrangère. J'ai passé<br />
beaucoup de mes années d'adulte à essayer de rattraper mon<br />
identité biculturelle.<br />
Un<br />
Tant que les montagnes seront plantées sur terre,<br />
Tant que les rivières couleront dans la mer, ces histoires seront<br />
dites <strong>et</strong> redites.<br />
La Ramavana
Perm<strong>et</strong>tez-moi maintenant de vous peindre un tableau du<br />
dilemme interculturel que connaissent les enfants sourds élevés<br />
dans une famille entendante. La façon dont nous nous<br />
percevons peut se résumer dans le mot identité. La question de<br />
base de l'identité est "Qui suis-je ?" Il s'agit là d'un suj<strong>et</strong><br />
extrêmement complexe. La formation <strong>et</strong> le changement<br />
d'identité sont des processus permanents, aussi bien pour les<br />
entendants que pour les Sourds. Même si notre perception du<br />
monde soit constamment en train de changer, certains aspects<br />
de l'identité sont formés très tôt dans la vie <strong>et</strong> envahissent tout.<br />
Au fur <strong>et</strong> à mesure que nous mûrissons <strong>et</strong> que nous faisons face<br />
aux vicissitudes de la vie (l'éducation, le monde du travail, le<br />
mariage <strong>et</strong> la vie de famille, le parentage, le "grand-parentage",<br />
le vieillissement, <strong>et</strong>c.), nos identités évoluent également. Même<br />
là, il se peut que d'aucuns restent confus ou incertains pendant<br />
des années concernant leur identité, même jusque dans leur<br />
trentaine <strong>et</strong> leur quarantaine.<br />
Un certain nombre d'écrivains ont examiné la question de<br />
l'identité au sein de la collectivité sourde à partir de plusieurs<br />
points de vue différents. L'incertitude, la confusion, le doute <strong>et</strong><br />
l'ambiguïté vis-à-vis sa propre identité semblent être les thèmes<br />
communs. Les statistiques indiquent qu'environ 90 % des<br />
enfants sourds, aux États-Unis, sont nés dans des foyers où les<br />
parents sont entendants. La tension <strong>et</strong> la différence culturelle<br />
dans ces familles sont bien connues de nombreuses personnes<br />
du monde des Sourds. Une personne malentendante peut<br />
ressentir des conflits, à savoir si elle est sourde ou<br />
malentendante. Par exemple, dans un article de la revue Deaf<br />
Life, Heather Whitestone, Miss America 1955, on rapporte<br />
qu'elle a dit :"Je me sens prise en plein milieu." Une autre<br />
personne malentendante se sentait ainsi : "Je suis un individu<br />
carré dans une collectivité ronde." Une personne devenue<br />
sourde tardivement a comparé sa situation à celle d'un<br />
immigrant coincé entre deux cultures. Les membres des<br />
groupes <strong>et</strong>hniques peuvent également reconnaître la diversité<br />
de leur identité, où le défi consiste à se mélanger ou à s'intégrer.<br />
Dans le monde des Sourds, les histoires de "sourds perdus"<br />
sont légion. Un scénario commun, c'est celui de l'étudiant sourd<br />
passé par l'école mainstream, qui s'ennuie, qui n'a aucun pair<br />
sourd, qui ne connaît pas l'ASL, qui n'est pas exposé à la<br />
richesse du patrimoine des Sourds, <strong>et</strong> qui n'a pas de modèle<br />
Sourd à suivre à l'école. Lorsque le jeune arrive enfin à l'école<br />
des Sourds, assiste à sa première réunion de Club sourd, ou<br />
poursuit des études de diplôme dans un milieu éducationnel où<br />
il y a un important programme pour les Sourds (California State<br />
University, Northridge, the National Technical Institute for the<br />
Deaf, ou Gallaud<strong>et</strong> University), c'est tout un monde nouveau qui<br />
s'ouvre à lui. Lorsqu'il apprend l'American Sign Language,<br />
s'implique dans des organisations de la collectivité sourde <strong>et</strong><br />
développe le sens de ce que ces gens "font partie de mon<br />
monde", il se sent chez lui. Les ambiguïtés d'identité subissent<br />
des changements qui sont parfois dramatiques.<br />
Un vidéo intitulé ASL Pah: Deaf Student’s Perspectives on their<br />
Language illustre c<strong>et</strong>te expérience. Ici nous voyons quelle<br />
gravité avait la question d'identité pour une femme appelée<br />
Cheryl. Même si on peut faire valoir que ce ne sont pas tous les<br />
jeunes Sourds qui se sentent dans une telle insécurité, dans
mon expérience, c'est assez commun. Ce n'est pas avant le<br />
high school que Cheryl commença à développer un sens de la<br />
collectivité, d'une estime de soi positive, là où elle devint une<br />
personne sourde culturellement identifiée. Elle devint forte <strong>et</strong><br />
sûre du fait de se connaître elle-même comme membre d'une<br />
collectivité de personnes qui sont toutes comme elle : sourdes.<br />
Deux<br />
Relate à quelqu'un un fait <strong>et</strong> tu atteins son esprit, raconte-lui<br />
une histoire <strong>et</strong> tu touches son âme.<br />
Proverbe hassidique<br />
Une disparité culturelle <strong>et</strong> une perte analogues peuvent<br />
confronter un enfant entendant né dans un foyer aux parents<br />
sourds <strong>et</strong> élevé dans le monde des Sourds. Les statistiques<br />
indiquent que 88-92 % des enfants nés de parents sourds aux<br />
États-Unis sont entendants. Ils se demandent souvent : "Suis-je<br />
entendant ou suis-je sourd ?" Dans mon expérience étendue,<br />
les questions d'identité illustrent le mieux le conflit culturel que<br />
connaissent les codas, mais ce ne sont pas tous les codas qui le<br />
vivent au même degré. Les parallèles entre le vécu des codas <strong>et</strong><br />
celui d'enfants sourds nés dans une famille entendante sont<br />
extrêmement intéressants. L'identité culturelle est clairement<br />
un jalon de croissance important pour les personnes sourdes,<br />
tout autant que pour les codas. Les codas peuvent se sentir en<br />
conflits, marginalisés <strong>et</strong> seuls, à grandir entendants dans un<br />
monde de Sourds. C'est tout comme un enfant sourd qui grandit<br />
dans le monde d'une famille sourde.<br />
Dans son livre, Life with Two Languages: An Introduction to<br />
Bilingualism (1982), Francois Grosjean décrit quelques-uns des<br />
traits de la langue parlée d'individus bilingues <strong>et</strong> biculturels.<br />
Une des caractéristiques majeures, c'est l'expérience de la<br />
marginalité. Il utilise les adjectifs suivants pour décrire leur<br />
expérience d'identité : sans amis, confus, solitaires, seuls,<br />
ambivalents, isolés, marqués, différents, pas affiliés, perdus,<br />
bizarres <strong>et</strong> déconnectés. Les codas ont aussi tendance à sentir<br />
qu'ils ne sont ni chair ni poisson. Voici quelques propositions qui<br />
décrivent leurs expériences analogues : coincés entre, le seul,<br />
sur le bord, un pont, <strong>et</strong> pas sûr de qui je suis. Un coda a dit "Je<br />
me sens comme si j'avais visité deux maisons mais que je<br />
n'avais pas de place pour moi-même." Une autre coda a réalisé<br />
sa différence lorsque, à l'âge de six ans, ses cousins sourds<br />
furent envoyés à l'école de l'État pour les Sourds pour y rester,<br />
en l'abandonnant derrière eux. Évidemment, vous savez que<br />
vous êtes différent lorsqu'on vous demande : "Comment as-tu<br />
appris à parler ?"<br />
La même question fut posée il y a bien longtemps, en 1904.<br />
Dans une l<strong>et</strong>tre à la rédaction du journal The Silent Worker, E.<br />
Florence Long, la femme de J. Schuyler Long, de Council Bluffs<br />
(Iowa), <strong>et</strong> mère de plusieurs enfants entendants, louange le<br />
journal pour sa série de photos "d'enfants typiques de parents<br />
sourds." Elle poursuit en disant :<br />
Maintenant, si plus de parents sourds envoyaient à votre journal<br />
des photos de leurs p<strong>et</strong>its qui sont d'âge scolaire, il y en aurait
assez pour les m<strong>et</strong>tre ensemble en forme de livre qu'ils<br />
pourraient ach<strong>et</strong>er <strong>et</strong> distribuer à des connaissances<br />
entendantes comme celles-là en posant la question : "Votre<br />
bébé parle-t-il ?" "Comment peut-il jamais entendre ou parler,<br />
alors que vous ne le pouvez pas ?" <strong>et</strong>c. Un si p<strong>et</strong>it livre pourrait<br />
être une bonne chose dans les bibliothèques publiques, où les<br />
entendants pourraient le lire <strong>et</strong> débarrasser leurs esprits de<br />
l'erreur populaire à l'eff<strong>et</strong> que les mariages mixtes avec des<br />
Sourds avaient pour résultat des rej<strong>et</strong>ons sourds ou idiots.<br />
(Long, 1905, p. 76)<br />
Le stigmate dont la société affuble les Sourds déteint<br />
inévitablement sur leurs enfants entendants. En 1996, Charlotte<br />
Abrams a publié son autobiographie sous le titre, The Silents.<br />
Imaginez à quel point c'est source de confusion pour un enfant<br />
entendant dans une famille de Sourds que de se faire identifier<br />
comme "un des silencieux." Dans son autobiographie, Doris<br />
Isabell Crowe (1993) a décrit de quelle façon elle avait grandi<br />
avec ses parents sourds à Cave Springs (Géorgie). Son père<br />
était connu en ville comme "le Nul" <strong>et</strong> elle était simplement<br />
identifiée comme "la p<strong>et</strong>ite du Nul". Des grands-parents<br />
entendants sans réfléchir j<strong>et</strong>tent occasionnellement le fardeau<br />
sur les épaules de leurs p<strong>et</strong>its-enfants entendants de "raconter"<br />
<strong>et</strong> "expliquer", <strong>et</strong>, autrement, de "prendre soin de" leurs parents<br />
sourds. Il s'ensuit que les codas savent très tôt dans la vie qu'ils<br />
sont différents.<br />
Bien sûr, ma soeur <strong>et</strong> moi savions que nous étions différents.<br />
Lorsque le téléphone fut installé chez nous, j'avais 9 ans <strong>et</strong> elle,<br />
15. Nous passions la journée entière à appeler tous nos amis<br />
entendants. J'ai su que j'étais différent au high school lorsque,<br />
dans mes conversations avec des amis, je leur portais une<br />
attention visuelle intense <strong>et</strong> je maintenais un contact visuel, ce<br />
que ne faisaient pas mes amis entendants. La pensée qui me<br />
traversait l'esprit était : "Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? "<br />
Ils ne me regardaient pas de la même façon que moi, je les<br />
regardais. Nathie Marbury décrit le besoin de sa fille entendante<br />
d'avoir un contact visuel, dans ce clip vidéo humoristique<br />
intitulé Deaf Culture Lecture: Cultural Differences (1996).<br />
C'est une expérience pénible que celle du conflit culturel alors<br />
qu'on ignore ce qui se passe. Je pensais que j'étais le seul à<br />
avoir besoin de contact visuel. J'aurais souhaité que quelqu'un<br />
m'explique c<strong>et</strong>te partie de la culture sourde internalisée lorsque<br />
j'étais jeune. Ce n'est pas avant 1987, alors que j'assistais au<br />
congrès du Registry of Interpr<strong>et</strong>ers for the Deaf, à St. Paul<br />
(Minnesota), pendant une présentation en plénière par feue<br />
Marie Jean Philip, que j'ai finalement compris ce qui se passait.<br />
Philip expliqua qu'un des aspects de la culture sourde, c'est le<br />
besoin de maintenir un contact visuel. Les entendants ont<br />
coutume d'éviter le contact visuel soutenu. Il est considéré<br />
grossier de "fixer". J'ai eu une épiphanie. C<strong>et</strong>te toute p<strong>et</strong>it<br />
particule d'information m'a aidé à commencer à comprendre ce<br />
message négatif qui remontait au temps du high school :<br />
"Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?" <strong>et</strong> de boucler la boucle làdessus.<br />
J'avais également bénéficié d'idées recueillies dans les écrits<br />
d'autres codas. Par exemple, lorsque le livre de Lou Ann Walker,<br />
A Loss for Words (1986), fut publié, quelques-unes de mes
expériences comme coda commencèrent à prendre un sens. À<br />
ma connaissance, c'est la toute première histoire<br />
autobiographique de coda largement distribuée. Dans l'émission<br />
de télévision, Deaf Mosaic: A Bridge B<strong>et</strong>ween, Walker les<br />
raisons qu'elle avait pour écrire ce livre.<br />
Walker se sentait très protectrice de ses parents <strong>et</strong> voulait<br />
s'assurer qu'ils ne seraient pas troublés par les divulgations<br />
personnelles contenues dans le livre. Un des préoccupations<br />
communes des codas, c'est : "Qu'est-ce que les gens vont<br />
penser de mes parents sourds si j'ai des propos négatifs à leur<br />
égard ? " Depuis 1986, 14 autres récits autobiographiques ont<br />
été publiés, <strong>et</strong> l'excellente recherche du coda Paul Prestons,<br />
Mother Father Deaf: Living b<strong>et</strong>ween Sound and Silence (1994) a<br />
été bien reçue. Le vécu partagé dans ces livres <strong>et</strong> d'autres<br />
devrait être également utiles aux codas <strong>et</strong> à leurs parents<br />
sourds.<br />
À l'âge de huit ans, Walker pensait que ses parents pouvaient<br />
entendre <strong>et</strong> qu'ils étaient des espions. J'ai aussi eu mes doutes<br />
à l'eff<strong>et</strong> que mes parents pouvaient réellement entendre, mais<br />
j'ai gardé c<strong>et</strong>te pensée secrète. Comme enfant, j'ai mis mes<br />
parents au test. Il y avait des moments où, lorsque je frappais<br />
des mains ou que je faisais beaucoup de bruit, ma mère se<br />
r<strong>et</strong>ournait. D'autres fois elle ne réagissait pas. Bien sûr, je<br />
faisais ce qu'apparemment beaucoup d'autres jeunes codas ont<br />
fait : je fonctionnais avec une fantaisie idéalisée à savoir que<br />
mes parents pouvaient entendre <strong>et</strong> que, par conséquent, ils<br />
étaient comme les parents de mes amis. Je suppose que mes<br />
espoirs étaient qu'ils ne soient pas sourds. Mais je pensais que<br />
j'étais seul à avoir ces sentiments. Je pensais que j'étais seul à<br />
faire ce que j'avais fait. L'histoire de Walker m'a aidé à<br />
normaliser mon expérience <strong>et</strong>, par la suite, j'ai cessé de me<br />
sentir seul <strong>et</strong> taré à c<strong>et</strong> égard.<br />
Un documentaire exceptionnel m<strong>et</strong>tant en lumière le vécu de<br />
sept codas adultes australiens fut produit en 1992. Aux États-<br />
Unis, dans la collectivité des codas, on s'entend pour dire que<br />
Passport without a Country est une peinture éloquente de<br />
l'expérience des codas. Le segment "A Search for Identity" est<br />
particulièrement émouvant. Là encore, reconnaissant que, peutêtre,<br />
ce ne sont pas tous les codas qui vivent la polarité sourd/<br />
entendant de façon aussi vive que ce qui est dépeint ici, le sens<br />
qu'on se sent aliéné de sa terre natale, même si vous avez le<br />
passeport en main, est une métaphore vive pour décrire les<br />
conflits culturels <strong>et</strong> identitaires internes contre lesquels codas<br />
peuvent avoir à lutter.<br />
La dernière illustration vient d'une époque où je songeais à<br />
changer de carrière <strong>et</strong> je pris part à un programme de<br />
conseillers en orientation professionnelle d'une durée de deux<br />
jours. Un des instruments de tests que je complétai fut le<br />
Stanford-Bin<strong>et</strong> Intelligence Test. Le psychologue connaissait<br />
bien la collectivité des Sourds, savait que mes parents étaient<br />
sourds <strong>et</strong> réalisa que l'anglais était ma langue seconde. Il<br />
expliqua qu'il y avait des normes bilingues (ESL) pour le<br />
Stanford-Bin<strong>et</strong> <strong>et</strong> procéda à interpréter les résultats du test à<br />
partir des normes ESL. C'était la première fois de ma vie qu'un<br />
professionnel ou n'importe qui me considérait comme une<br />
personne bilingue. J'avais 48 ans.
Trois<br />
Raconter notre histoire est peut-être la chose la plus humaine à<br />
faire. En racontant des histoires, nous nous souvenons de notre<br />
passé, nous inventons notre présent, <strong>et</strong> nous imaginons notre<br />
avenir. Puis, en partageant ces histoires avec d'autres, nous<br />
vainquons la solitude, nous découvrons la compassion <strong>et</strong> nous<br />
créons une collectivité avec des âmes soeurs.<br />
Sam Keen, philosophe, théologien <strong>et</strong> poète<br />
Perm<strong>et</strong>tez-moi maintenant de décrire une façon, pour les codas,<br />
de résoudre la question d'identité. Mon parcours vers<br />
l'intégralité a inclus une compréhension de ce que je suis<br />
bilingue <strong>et</strong> biculturel, <strong>et</strong> un coda. C'est là mon identité, mais ce<br />
ne fut pas toujours le cas. J'ai travaillé à l'University Gallaud<strong>et</strong><br />
comme professeur à la Kendall Demonstration Elementary<br />
School for the Deaf pendant 17 ans avant d'assister à mon<br />
premier congrès de CODA. Lorsque je suis r<strong>et</strong>ourné au travail <strong>et</strong><br />
que je suis rentré sur le campus, je savait qu'il y avait quelque<br />
chose de différent. Kendall Green était le même, mais j'étais<br />
différent. Au cours des années, j'avais consciemment cherché<br />
d'autres HCDP, mais je n'avais pas de collectivité. Au CODA, je<br />
trouvais enfin c<strong>et</strong>te collectivité. Au CODA, je commençais un<br />
parcours vers la compréhension de moi-même comme coda,<br />
quelque chose entre sourd <strong>et</strong> entendant, une troisième<br />
possibilité. J'ai découvert le moment des codas.<br />
L'identité de groupe, le sens de ne pas être seul, le sens qu'il y<br />
en a d'autres comme moi, est une expérience très personnelle,<br />
mais libératrice <strong>et</strong> positive. En mars 1988, un des orateurs au<br />
rallye Deaf President Now, à Washington D.C., m'a dit que,<br />
lorsqu'il regardait Maryland Avenue du haut de la tribune <strong>et</strong><br />
plusieurs milliers d'étudiants <strong>et</strong> de membres <strong>et</strong> de supporters de<br />
la collectivité sourde en marche de l'université vers le Capitole,<br />
il avait le sentiment de "Voilà mon peuple". Jusqu'à la formation<br />
de CODA, en 1983, il n'y avait aucun croch<strong>et</strong> où je pouvait<br />
accrocher mon sens d'identité de groupe. Jusqu'à mon premier<br />
congrès CODA, en 1986, je n'avais jamais rencontré d'autre<br />
coda auto-identifié. Il n'y avait aucune occasion de se<br />
rassembler sous c<strong>et</strong>te bannière ou c<strong>et</strong>te identité culturelle.<br />
L'identité culturelle sans collectivité est impossible.<br />
Aujourd'hui, il est impensable que les gens qui sont sourds<br />
embrassent une identité sourde dans l'isolement, sans occasion<br />
de se rassembler entre eux. Là encore, aux premiers jours de<br />
CODA, il y avait des craintes <strong>et</strong> des angoisses parmi nous qui<br />
m<strong>et</strong>taient un nuage sur notre rencontre. Beaucoup d'entre nous<br />
avaient grandi avec le sentiment d'être si protecteurs de nos<br />
parents qu'il y avait un sens de trahison dans le fait de nous<br />
rencontrer <strong>et</strong> de partager des "secr<strong>et</strong>s de famille". Comme le<br />
disait Sheila Jacobs, une des premières pionnières fortes <strong>et</strong><br />
indéfectibles partisanes au sein de CODA, à notre premier<br />
congrès, en 1986 :<br />
Les codas sont sortis de nulle part. Nous commençons à nous<br />
parler entre nous, à réfléchir sur notre vécu personnel <strong>et</strong><br />
collectif. Je peux me souvenir de ma propre réaction négative
lorsque j'ai découvert qu'une telle organisation existait. Ma<br />
première réaction fut : "Quel culot ! Pour quoi faire ? " (Bull,<br />
Rutherford & Jacobs, pp. 1-2)<br />
Dieu merci, après tant d'années à nous réunir, nous nous en<br />
sommes sortis. La deuxième source de résistance qui s'opposait<br />
au développement d'une collectivité CODA provenait de notre<br />
parenté sourde <strong>et</strong> de la collectivité sourde. Nous étions<br />
suspects. Un des mythes que les codas ont eu à surmonter,<br />
c'est la notion que nous nous étions réunis dans le but de<br />
"poignarder nos parents dans le dos" ou pour dire du mal de<br />
notre famille. Bonnie Kraft, autre supporter dynamique <strong>et</strong><br />
ardente de CODA, raconte une anecdote sur la fois où sa mère<br />
lui a demandé : "Pourquoi en fais-tu tant pour CODA ? Est-ce<br />
que j'ai été une mauvaise mère ? "<br />
L'explication que Bonnie donne dans le vidéo Tomorrow Dad will<br />
Still be Deaf and Other Stories (1996) est que le "CODA est<br />
mon club sourd". C'est vrai. Nous nous réunissons parce que<br />
nous sommes pareils <strong>et</strong> que nous avons beaucoup en commun,<br />
tout comme les personnes sourdes se r<strong>et</strong>rouvent au club sourd<br />
ou assistent à d'autres activités communautaires pour partager<br />
leurs vies parce qu'elles sont pareilles. En tant que codas, nous<br />
nous rassemblons pour partager une collectivité avec ceux qui<br />
sont comme nous. Le parallèle le plus clair est celui d'un<br />
étudiant sourd qui trouve enfin une collectivité d'amis sourds <strong>et</strong><br />
qui se sent, pour la première fois, chez lui. Rappelez-vous du<br />
premier clip vidéo sur l'expérience de Cheryl. Une des façons,<br />
pour un coda, de résoudre son débat intérieur : "Suis-je<br />
entendant ou sourd ? ", c'est de devenir membre d'une<br />
collectivité <strong>et</strong> d'entr<strong>et</strong>enir c<strong>et</strong>te identité culturelle.<br />
Avec le soutien d'amis codas, Sherry Hicks a écrit une pièce<br />
autobiographique pour femme seule dans laquelle elle décrit<br />
avec vivacité la lutte entre ses entités internes sourde <strong>et</strong><br />
entendante. Elle a trouvé une résolution de son conflit en se<br />
comprenant comme une coda. Phoenix The (1993) est un<br />
témoignage à la clarté <strong>et</strong> à la force qu'elle a trouvées à CODA.<br />
Ses proj<strong>et</strong>s de création sont un testament au pouvoir de la<br />
collectivité (Sherry: The Music Sign Language Video – 1994).<br />
Nous sommes tous sur un voyage à la recherche de la guérison<br />
<strong>et</strong> de la totalité. Pour les codas, le conflit culturel <strong>et</strong> les luttes<br />
d'identifié peuvent être résolus. Je peux montrer du doigt tant<br />
<strong>et</strong> plus d'histoires personnelles de codas qui, quel que soit leur<br />
âge, leur sexe ou leur nationalité, ont vécu une percée<br />
personnelle très significative lorsqu'ils "se sont trouvés" à<br />
nouveaux eux-mêmes, au CODA. L'expérience "d'arriver chez<br />
soi" <strong>et</strong> de "mon peuple" est un écho des expériences que les<br />
gens ont lorsqu'ils trouvent enfin la collectivité dans le monde<br />
des Sourds. Pour les enfants entendants de parents sourds qui<br />
ne se sentent pas entièrement connectés au monde des<br />
entendants, qui ne se sentent pas comme faisant totalement<br />
partie du monde des Sourds, il existe une troisième place où ils<br />
peuvent être à 100 % connectés, intégrés <strong>et</strong> chez eux : au<br />
CODA, <strong>et</strong> avec d'autres codas.<br />
Quatre
Les histoires sont nos protecteurs, comme notre système<br />
immunitaire ; elles nous défendent contre les attaques d'une<br />
aliénation débilitante, elles sont le tissu connecteur entre la<br />
culture <strong>et</strong> la nature, le soi <strong>et</strong> les autres, la vie <strong>et</strong> la mort, qui<br />
cousent les mondes les uns aux autres, <strong>et</strong> dans le récit, l'âme<br />
s'émeut <strong>et</strong> naît à la vie.<br />
Joan Halifax (1993), The Fruitful Darkness<br />
Les parents qui sont sourds, qui profitent de ressources<br />
professionnelles <strong>et</strong> communautaires, ainsi que de soutien de<br />
leurs pairs, sont mieux placés pour aider leurs enfants<br />
entendants à vivre leurs expériences biculturelles. Mon identité<br />
de coda s'est concrétisée pour moi à mon âge mûr, mais il n'est<br />
pas nécessaire qu'il continue à en être ainsi pour les autres.<br />
Mon but ici est de faire en sorte que la collectivité des Sourds <strong>et</strong><br />
les parents d'enfants entendants deviennent plus engagés vis-àvis<br />
les besoins de leurs enfants entendants envers une identité<br />
communautaire <strong>et</strong> culturelle. Les parents sourds peuvent aider<br />
leurs jeunes enfants entendants à trouver leur identité à un âge<br />
précoce. C'est merveilleux de voir de jeunes codas obtenir du<br />
soutien parental <strong>et</strong> communautaire pour leur identité<br />
biculturelle. Les parents sourds peuvent améliorer l'estime de<br />
soi de leurs enfants en transm<strong>et</strong>tant leur connaissance de l'ASL,<br />
des normes culturelles, des valeurs, des règles de<br />
comportement, des traditions, <strong>et</strong> le patrimoine de la collectivité<br />
des Sourds. Les parents sourds peuvent dire à leurs enfants<br />
qu'ils sont spéciaux parce qu'ils sont bilingues <strong>et</strong> biculturels. Les<br />
parents sourds peuvent s'assurer que leurs enfants ont une<br />
collectivité coda <strong>et</strong> qu'ils rencontrent des codas adultes, juste<br />
comme on dit que les enfants sourds de parents entendants ont<br />
besoin de Sourds adultes comme modèles de comportement.<br />
Les parents sourds sont dans la meilleur position pour montrer<br />
à leurs enfants entendants qu'ils font partie d'une collectivité<br />
mondiale de codas qui sont fiers de contribuer positivement à la<br />
collectivité, ainsi qu'au monde des Sourds.<br />
Ce cours est un ensemble de deux vidéos de 90 minutes<br />
accompagnés d'un guide du facilitateur de huit leçons. Le vidéo<br />
est une compilation des expériences de 19 parents sourds qui<br />
ont des enfants entendants. Huit sessions de groupe couvrent<br />
ces questions : les attentes des parents, la communication,<br />
l'interprétation, la discipline, les valeurs, l'estime de soi, <strong>et</strong> les<br />
années d'adolescence. La conception est, pour un facilitateur<br />
parent sourd de recevoir la formation qui lui perm<strong>et</strong>tra de<br />
mener des discussions <strong>et</strong> de couvrir les suj<strong>et</strong>s. Les parents sont<br />
encouragés à se soutenir les uns les autres <strong>et</strong> à réaliser le<br />
caractère unique de leurs enfants bilingues <strong>et</strong> biculturels.<br />
Lorsque les parents se sentent assez bien pour exprimer leurs<br />
pensées <strong>et</strong> leurs sentiments, ils sont dans une meilleure<br />
position pour apprendre les uns des autres <strong>et</strong> pour comprendre<br />
leurs enfants entendants <strong>et</strong> pour intercéder convenablement en<br />
leur faveur.<br />
Une autre façon qui perm<strong>et</strong> aux parents sourds de partager<br />
leurs joies <strong>et</strong> leurs frustrations, d'apprendre les uns des autres<br />
<strong>et</strong> de se soutenir les uns les autres, c'est de former un groupe<br />
KODA. En 1992, des parents sourds du Maryland ont perçu le<br />
besoin pour leurs enfants codas <strong>et</strong> forger des amitiés avec<br />
d'autres codas. Ils se sont organisés, on préparé des activités
amusantes pour les enfants <strong>et</strong> ont eu le temps de discuter de<br />
leurs préoccupations comme parents. Leurs pique-niques<br />
annuels grossirent jusqu'à réunir plus de 150 participants<br />
pendant plusieurs années. Une équipe de film de Deaf Mosaic a<br />
assisté à l'un de leur pique-niques <strong>et</strong> produit l'émission : Deaf<br />
Mosaic: KODA, a National Organization for Kids of Deaf Adults<br />
(1993).<br />
La collectivité des Sourds, par l'entremise de la National<br />
Association of the Deaf, a offert des programmes de camps<br />
d'été en leadership pour les jeunes Sourds (YLC) depuis 1969.<br />
Les expériences de camps réservés aux codas ont commencé en<br />
Australie en 1993. C'était un effort conjoint de Australian CODA<br />
<strong>et</strong> des collectivités sourdes. Leur session la plus récente s'est<br />
tenue à Victoria en janvier 2004. Aux États-Unis, le Camp Mark<br />
7, au nord de l'État de New York, offre depuis 1997 des sessions<br />
pour les enfants codas <strong>et</strong> les jeunes de 9 à 16 ans. Les nombres<br />
ont grandi, de 16 à 100 codas sur deux sessions. Un des plus<br />
importants aspects du camp, c'est la qualité <strong>et</strong> la diversité des<br />
conseillers : ce sont des codas adultes exceptionnels, certains<br />
viennent même de l'étranger. Certains sont des conseillers en<br />
formation qui assistent au camp depuis des années. Les codas<br />
adultes <strong>et</strong> les membres de la collectivité sourde partagent les<br />
même préoccupations pour la génération future : la nôtre<br />
s'exprime dans notre appui au Koda Camp, la leur l'est par leur<br />
appui du YLC.<br />
J'ai beaucoup appris des écrits d'autres codas <strong>et</strong> je crois que les<br />
parents sourds ont soif d'information. Il y a un grand besoin<br />
pour les parents sourds de partager leurs histoires de parentage<br />
d'enfants entendants. Je peux compter sur les doigts d'une<br />
seule main le nombre d'articles écrits par des parents sourds<br />
américains sur la vie de famille. J'encourage les parents sourds<br />
à partager leurs expériences dans l'éducation d'enfants<br />
entendants. Il y a également un besoin de livres d'histoires pour<br />
les enfants, qui tracent un portrait de la vie de famille où les<br />
parents sont sourds avec des enfants entendants. À ma<br />
connaissance, il n'en existe pas.<br />
Il est difficile d'être parent, mais cela a aussi ses moments<br />
d'hilarité <strong>et</strong> de plaisir. L'humour est une façon exceptionnelle<br />
pour les familles d'aider leurs enfants à résoudre le conflit entre<br />
Sourds <strong>et</strong> entendants. J'ai deux histoires racontées par des<br />
mères sourdes à partager avec vous. Nathie Marbury raconte<br />
son shopping avec ses deux filles dans Deaf Culture Lecture:<br />
Tools for a Cross-Cultural Adventure (1996). Elinor Kraft, dans<br />
Live at SMI: Elinor Kraft (1994) partage l'histoire délicieuse<br />
d'une mère canadienne de six enfants, dont deux sont<br />
entendants. Partager ces anecdotes peuvent rassembler les<br />
parents sourds d'un façon unique. Les contes, l'humour <strong>et</strong> le<br />
rire sont des fils indispensables qui forment le tissu de nos<br />
congrès internationaux du CODA. Nous sommes les enfants d'un<br />
peuple de conteurs unis par une tradition orale.<br />
Tout au long de c<strong>et</strong>te présentation j'ai essayé de montrer que la<br />
confusion <strong>et</strong> le conflit d'identité pour les codas peuvent être<br />
améliorés de cinq façons comme suit : 1) en acquérant de<br />
l'information par la lecture d'autobiographies <strong>et</strong> autres<br />
ressources ; 2) en développant intentionnellement des identités<br />
individuelles <strong>et</strong> de groupe ; 3) en formant des groupes de
soutien pour les parents <strong>et</strong> en offrant une variété d'activités de<br />
camping <strong>et</strong> autres pour les enfants entendants ; 4) en utilisant<br />
l'humour pour renforcer le lien des parents ; <strong>et</strong> 5) en<br />
augmentant les occasions d'éducation des parents <strong>et</strong> de<br />
développement de ressources d'information. Tous ces efforts<br />
peuvent aider les enfants entendants nés dans des familles où<br />
un parent ou les deux sont sourds va vers le développement<br />
d'une identité culturelle ferme <strong>et</strong> positive.<br />
En concluant, perm<strong>et</strong>tez-moi de partager un courriel reçu d'une<br />
mère sourde. Elle parle ici de sa fille (coda) entendante : "Il y a<br />
quelques semaines, ma fille <strong>et</strong> moi avions une conversation. Je<br />
venais de découvrir qu'elle était enceinte <strong>et</strong> ma fille me<br />
demandait pourquoi c'est arrivé <strong>et</strong> toutes sortes de question<br />
d'un enfant de 5 ans. Je ne suis pas une personne religieuse,<br />
mais j'ai pensé parler de Dieu qui l'aiderait à m<strong>et</strong>tre les choses<br />
en perspective. J'ai dit : 'Tu sais, je suis sourde <strong>et</strong> Dieu m'a<br />
choisie pour être sourde, même chose pour ton père.' Puis j'ai<br />
dit : 'Dieu t'a choisie pour être entendante <strong>et</strong> ton p<strong>et</strong>it frère [de<br />
trois ans] aussi.' Elle me dit : 'Non ! Je suis entendante <strong>et</strong><br />
sourde.' Abasourdie, je lui demandai : 'Qui t'a dit ça ? ’ Elle<br />
répondit : 'Dieu.' Elle dit ça avec un p<strong>et</strong>it sourire."<br />
Et c<strong>et</strong>te mère continue en disant : "C'est la plus belle chose qui<br />
s'est produite. Cela disait vraiment quelque chose de son<br />
identité, qu'elle l'a explorée elle-même, <strong>et</strong> c'est évident que<br />
c'est ce qu'elle ressent. Je pense que c'est formidable." Hé bien,<br />
je pense aussi que c'est formidable. J'ajouterai seulement que<br />
j'espère que c<strong>et</strong>te mère <strong>et</strong> tous les parents diront à sa fille <strong>et</strong> à<br />
leurs enfants dès leur plus jeune âge : "Oui, vous êtes<br />
entendants <strong>et</strong> sourds <strong>et</strong> vous êtes aussi un coda."<br />
RÉFÉRENCES : AUTOBIOGRAPHIES<br />
D'EAS (* paperback)<br />
* Abrams, C. (1996). The silents. Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong><br />
University Press.<br />
* Allan, J. (2002). Because I love you: The silent shadow of<br />
child sexual abuse. Charlottesville, VA: Virginia Foundation for<br />
the Humanities Press. (http://www.tim<strong>et</strong>ospeak.com)<br />
* Barash, H. L., and Barash-Dicker, E. (1991). Our father<br />
Abe: The story of a deaf shoe repairman. Madison, WI: Abar<br />
Press.<br />
Chism, S. C. (2002). A search for identity: The unfolding of an<br />
unknown past. Philadelphia, PA: Xlibris Corporation. (available<br />
from http://www.xlibris.com)<br />
* Clark, G. (2000). Sounds from silence: Graeme Clark and<br />
the Bionic Ear story. St. Leonards, NSW, Australia: Allen &<br />
Unwin.<br />
* Corfmat, P. (1990). "Please Sign Here": The world of the<br />
deaf. Worthing, West Sussex, England: Churchman Publishing<br />
Limited.
Crowe, D. I. (1993). Dummy's little girl. New York: Carlton<br />
Press, Inc. (Out of print)<br />
Davis, L. J. (2000). My sense of silence: Memoirs of a<br />
childhood with deafness. Urbana & Chicago: University of Illinois<br />
Press.<br />
* Enos-Perez, J. (1985). A sign of love. Glenn, CA: Jan<strong>et</strong><br />
Enos Perez.<br />
Hicks, S. L. (1993). Phoenix The: A one act play, an<br />
autobiographic life work in progress. Unpublished B.A. Thesis,<br />
Performance Art and Humanities, New College, San Francisco,<br />
California.<br />
Miller-Hall, M (1994). Deaf, dumb and BLACK: An account of<br />
an actual life of a family. New York: Carlton Press Corp. (Out of<br />
print)<br />
* Sidransky, R. (1990). In silence: Growing up hearing in a<br />
deaf world. New York: St. Martin's Press. (Out of print)<br />
* Slocombe, A. (1996). My parents’ voice. Surrey, England:<br />
A. Slocombe.<br />
* Vivo, P. (1991/1996). Turn right at the next corner.<br />
Granville, OH: Trudy Knox Publisher.<br />
* Walker, L. A. (1986). A loss for words: The story of<br />
deafness in a family. New York: Harper and Row.<br />
* Worzel-Miller, L. (2000). The best of both worlds (a-not-sosilent<br />
life). San Jose, CA: Writers Club Press.<br />
AUTRES LIVRES (+ fiction * paperback)<br />
* Arana, M. (2001). American Chica: Two worlds, one<br />
childhood. New York: Random House, Inc.<br />
* Bull, T. H. (1998). On the edge of deaf culture: Hearing<br />
children/deaf parents annotated bibliography. Alexandria, VA:<br />
Deaf Family Research Press. Write DFR Press, P.O. Box 8417,<br />
Alexandria, VA 22306-8417.<br />
Davis, L. J. (Ed.). (1999). Shall I say a kiss?: The courtship<br />
l<strong>et</strong>ters of a deaf couple 1936-1938. Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong><br />
University Press.<br />
+Ferris, J. (2001). Of sound mind. NY: Farrar Straus Giroux.<br />
(children’s story: 8 th grade reading level)<br />
+ Glickfeld, C. L. (1989). Useful gifts: Stories by Carole L.<br />
Glickfeld. Athens, GA: The University of Georgia Press.<br />
* Goff Paris, D. & Kay Wood, S. (Eds.). (2002). Step into<br />
the circle: The heartbeat of American Indian, Alaska Native, and
First Nations Deaf communities. Salem, OR: AGO Publications.<br />
+ * Greenberg, J. (1970). In this sign. New York: Holt,<br />
Rinehart and Winston.<br />
* Grosjean, F. (1982). Life with two languages: An<br />
introduction to bilingualism. Cambridge, MA: Harvard University<br />
Press.<br />
+ * Jeffers, A. (1995/1998). Safe as houses. London: Gay<br />
Men's Press.<br />
Lane, H., Hoffmeister, R., & Bahan, B. (1996). A Journey<br />
into the DEAF-WORLD. San Diego: DawnSignPress.<br />
* Pollock, D. C. & VanReken, R. E. (1999/2001). Third<br />
culture kids: The experience of growing up among worlds.<br />
Yarmouth, ME: Intercultural Press.<br />
* Preston, P. M. (1994). Mother father deaf: Living b<strong>et</strong>ween<br />
sound and silence. Cambridge, MA: Harvard University Press.<br />
Uhlberg, M. (2003). The printer. Atlanta, GA: Peachtree<br />
Publishers. (Children’s book for 4-8 year olds, by a coda,<br />
beautifully illustrated)<br />
AUTRES ARTICLES PRIS EN RÉFÉRENCE ET<br />
CONNEXES<br />
Andrews, G. (1995, July). Heather Whitestone: An exclusive<br />
interview. Deaf Life, 8(1), 19-21.<br />
Bull, T. H., Rutherford, S. D., & Jacobs, S. (Eds.). (1994).<br />
Celebration and exploration of our heritage. Proceedings of the<br />
first National CODA Conference, Fremont, California. August 8-<br />
10, 1986. (Rev. ed.). Santa Barbara, CA: Children of Deaf<br />
Adults, Inc.<br />
Carroll, C. (1989, January). Born hearing and trying not to<br />
hate it: Sheila Palmer didn't know it for the first 7 years of her<br />
life, but she was born hearing. The World Around You, 11 (4), 8-<br />
9, 15. Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong> University, Pre-College<br />
Programs.<br />
Filer, R. D. & Filer, P. A. (2000, Winter). Practical<br />
Considerations for Counselors Working with Hearing Children of<br />
Deaf Parents. Journal of Counseling and Development, 78 (1),<br />
38-43.<br />
Gannon, J. R. & Gannon, R. L. (1990, Fall). B<strong>et</strong>ween two<br />
worlds: Deaf children of hearing parents grow up in a bicultural<br />
environment. Gallaud<strong>et</strong> Today, 21 (1), 12-16.<br />
Halifax, J. (1993). The fruitful darkness: Reconnecting with<br />
the body of the Earth. New York: Harper Collins.<br />
Harvey, M. A. (1985, July/August). B<strong>et</strong>ween two worlds:<br />
One psychologist’s view of the hard of hearing person’s
experience. Self Help for Hard of Hearing People, 6 (4), 4-5.<br />
Heather Whitestone: An exclusive interview. (1995,<br />
July). Deaf Life, 8 (1), pp. 19-21. (Cover title is "Miss America:<br />
'I feel caught in the middle.'")<br />
Jacobs, S. (1990, February). I-N-T-R-O-D-U-C-I-N-G Coda<br />
Talk column. CODA Connection, 9 (2), 9.<br />
Long, E. F. (1905, February). L<strong>et</strong>ter to the Editor. The Silent<br />
Worker, 17(5), 76.<br />
Markowicz, H. (2002, Winter). A kindred response to a new<br />
annotated bibliography about CODAs (book review essay: On<br />
the Edge of Deaf Culture: Hearing Children/Deaf Parents by<br />
Thomas Bull). Sign Language Studies, 2 (2), 212-216.<br />
Moyers, B. (1991). The World of Ideas: Interview with Sam<br />
Keen. Public Broadcasting System.<br />
Prick<strong>et</strong>t, D. (2000, Fall). The CODA connection: Do your<br />
parents know Braille? Gallaud<strong>et</strong> Today, 31 (1), 26-35.<br />
Shultz-Myers, S., Myers, R. R. & Marcus, A. L. (1999).<br />
Hearing children of deaf parents: Issues and interventions<br />
within a bicultural context. In I. W. Leigh (Ed.), Psychotherapy<br />
with deaf clients from diverse groups (pp. 121-148).<br />
Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong> University Press.<br />
Singl<strong>et</strong>on, J. (2002, Summer). Hearing children of deaf<br />
parents bridging two languages and two cultures. CSD<br />
Spectrum, 2 (2), 26-28.<br />
Singl<strong>et</strong>on, J. L., & Tittle, M. D. (Summer, 2000). Deaf<br />
parents and their hearing children. Journal of Deaf Studies and<br />
Deaf Education, 5 (3), 221-236.<br />
Walter, V. (1990, Fall). The ties that bind: Hearing children<br />
and deaf parents talk about being a family. Gallaud<strong>et</strong> Today, 21<br />
(1), 2-16.<br />
Younkin, L. (1990, January/February). B<strong>et</strong>ween two<br />
worlds: Welcomed by neither Black nor deaf people, deaf Blacks<br />
can find themselves in a virtual no-man's land. The Disability<br />
Rag, 11 (1), pp. 30-33.<br />
VIDÉOS<br />
ASL pah! Deaf student's perspectives on their language.<br />
(1992). 65 minutes. Color. VHS. Producers, Clayton Valli, Ceil<br />
Lucas, Esme Farb and Paul Kulick; director Dennis Cokely. (With<br />
an accompanying bookl<strong>et</strong>) Burtonsville, MD: Sign Media Inc.<br />
Deaf Culture lecture: Cultural differences. (1994). 35<br />
minutes. Color. VHS. Sound. CC. (Tape No. 8i) In American<br />
Sign Language with voice-over by Bonnie Sherwood. Salem,<br />
OR: Sign Enhancers, Inc.
Deaf Culture lecture: Shared wisdom for families. (1996).<br />
45 minutes. Color. VHS. Sound. CC. (Tape No. 8L) In American<br />
Sign Language with voice-over by Jan<strong>et</strong> Maxwell. Salem, OR:<br />
Sign Enhancers, Inc.<br />
Deaf Culture lecture: Tools for a cross-cultural adventure.<br />
(1996). 45 minutes. Color. VHS. CC. (Tape No. 8k) In<br />
American Sign Language with voice-over by Jan<strong>et</strong> Maxwell.<br />
Salem, OR: Sign Enhancers, Inc.<br />
Deaf Mosaic: A bridge b<strong>et</strong>ween. Program No. 212. (1987,<br />
February). 28 minutes. Color. Signed, sound and open<br />
captioned. Produced by Tony Hornick and Annjoy Marcus.<br />
Hornick interviews Lou Ann Walker, author of A loss for words.<br />
Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong> University, Department of<br />
Television, Film and Photography.<br />
Deaf Mosaic: KODA, a national organization for Kids of<br />
Deaf Adults. Program No. 908. (1993, December). 28<br />
minutes. Color. VHS. Signed, sound and open captioned.<br />
Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong> University, Department of<br />
Television, Film and Photography.<br />
Live at SMI (video No. 256): Elinor Kraft. (1994). 90<br />
minutes. Color. VHS. Burtonsville, MD: Sign Media Inc.<br />
Love is never silent. (1985, December 1). 90 Minutes.<br />
Color. (Based on the 1970 novel In this sign by Joanne<br />
Greenberg, this Emmy Award winning Hallmark Hall of Fame<br />
production aired on NBC Television, December 9, 1985)<br />
Passport without a country. (1992/1993). Color. 47<br />
minutes. VHS. Sound. Open captions. Produced by Cameron<br />
Davie at Griffith University and Queensland University of<br />
Technology, Queensland, Australia. Princ<strong>et</strong>on, NJ: Films for the<br />
Humanities.<br />
Sherry: The music sign language video. (1994). 29<br />
minutes. Color. VHS. Sound. CC. Berkeley, CA: UNI-QUE<br />
Productions.<br />
Tomorrow Dad will still be deaf and other stories. (1997).<br />
90 minutes. Color. Sound. CC. VHS. In American Sign Language<br />
with voice-over by Bonnie Kraft. San Diego, CA: DawnSignPress.<br />
ARTICLES ÉCRITS PAR DES PARENTS SOURDS<br />
Bergmann, R. (1994, April). Parent guidance of Deaf parents<br />
with deaf children: We need deaf parent counselors. WFD News,<br />
No. 1, 28-29. (World Federation of the Deaf publication)<br />
Burd<strong>et</strong>t, J. (1997, October 17). The joys and challenges of<br />
living in two different words: Deaf parents’ first experience with<br />
a hearing child. Cal News, 112 (3), 6-7. {Publication of the<br />
California School for the Deaf, Fremont}<br />
Finton, L. (1996). Living in a bilingual-bicultural family. In I.<br />
Parasnis (Ed.), Cultural and language diversity and the Deaf
experience (pp. 258-271). New York: Cambridge University<br />
Press.<br />
Galloway, G. (1990, Fall). Raising hearing kids: A deaf<br />
mother remembers the joys and trials of parenthood. Gallaud<strong>et</strong><br />
Today, 21 (1), 6-7.<br />
Jaech, T. A. (1981). The Jaech family: From dad with love...<br />
deaf kids. The Deaf American, 34 (3), 5-7.<br />
Johnson, R. L. (1968). Unique problems encountered in<br />
raising deaf and hearing children: Views of deaf parents of<br />
hearing children. (2 pages - source unidentified).<br />
Kahlil, L. (1988, Winter). Phobia. The Deaf American, 38 (1),<br />
19-20.<br />
Paris, V. (2001, Spring). Wall of sound: Silence, music, and<br />
raising an abled child. Brain, Child: The Magazine for Thinking<br />
Mothers, 2 (2), 12-13.<br />
Pelarski, J., Poorbaugh, J., & Hines, J. (1973). Tell it like it<br />
is. In National Conference on Program Development for and<br />
with Deaf People (Ed.), Proceedings of National Conference on<br />
Program Development for and with Deaf People, Washington, D.<br />
C., October 9-12, 1973 (pp. 19-21). Washington, DC: Gallaud<strong>et</strong><br />
College, Public Service Programs.<br />
Sheridan, M. (1995). A mother’s gift. In M. D. Garr<strong>et</strong>son<br />
(Ed.), Deafness, life and culture II: A Deaf American<br />
monograph, 45 (pp. 107-109). Silver Spring, MD: National<br />
Association of the Deaf.<br />
Stone-Harris, R. (1983). Deaf parents’ perceptions of family<br />
life with deaf and/or hearing children. In G. D. Tyler (ed.),<br />
Rehabilitation and human services: Critical issues for the<br />
eighties, proceedings of the 1980 conference of the American<br />
Deafness and Rehabilitation Association, Cincinnati, 1980,<br />
Readings in deafness: Monograph No. 6 (pp. 5-9). Silver Spring,<br />
MD: American Deafness and Rehabilitation Association.<br />
Watson, T. (1991). A deaf parent’s view. In National Council<br />
for Social Workers with Deaf People Training Committee (Ed.),<br />
Special needs or special breed? Hearing children of deaf adults<br />
(pp. 10-11). London, England: NCSWDP.<br />
Williams, J. S. (1976, Spring). Bilingual experiences of a deaf<br />
child. Sign Language Studies, 10, 37-41.<br />
RESSOURCES/MATÉRIAUX ÉDUCATIFS POUR LES<br />
PARENTS SOURDS<br />
Neubacher, M. (1987). Pathways for parenting, parents<br />
guide: (1) Our baby is hearing (24 pages); (2) Our child - two<br />
worlds (40 pages); (3) Adolescence to grown-up (28 pages).<br />
Illustrated by Steve Schudlich. D<strong>et</strong>roit, MI: Lutheran Social<br />
Services of Michigan.
Parenting: Bringing two worlds tog<strong>et</strong>her [Videotapes].<br />
(1992). 180 minutes. Color. VHS. ASL. Fairfax, VA: Parenting<br />
Advisory Council, Inc. {Kit includes videotapes and manual}<br />
http://www.pacfamily.org/<br />
Parenting skills: Bringing tog<strong>et</strong>her two worlds, one home,<br />
two cultures [Manual]. (1992). 206 pagesl. Fairfax, VA:<br />
Parenting Advisory Council, Inc {Kit includes videotapes and<br />
manual} http://www.pacfamily.org/<br />
Pathways for parenting video: A video program for deaf<br />
parents with hearing children. (1987). 66 minutes. Three<br />
videocass<strong>et</strong>tes. Part 1: Our baby is hearing,18 minutes; Part 2:<br />
Our child goes to school, 20 minutes; Part 3: From teenager to<br />
adult, 30 minutes. Color. Signed. Open captioned. Produced by<br />
Linda Tebelman. D<strong>et</strong>roit, MI: Lutheran Social Services of<br />
Michigan.<br />
Tebelman, L. (1989a). Pathways for parenting video:<br />
facilitator’s guide. D<strong>et</strong>roit, MI: Lutheran Social Services of<br />
Michigan. (146 pages)<br />
Tebelman, L. (1989b). Pathways for parenting video: parent’s<br />
guide. D<strong>et</strong>roit, MI: Lutheran Social Services of Michigan. (102<br />
pages)<br />
RESSOURCES INTERNET<br />
Camp Mark 7: KODA Camp information: http://www.<br />
campmark7.org<br />
CODA International. P.O. Box 30715, Santa Barbara,<br />
California 93130-0715 Adult hearing children of deaf parents<br />
organization. http://www.coda-international.org<br />
Deaf Parents and their Hearing Children Information<br />
Pack<strong>et</strong> (26 pages) at http://www.coda-international.org/ (Click<br />
on "All About" then "Info Pack<strong>et</strong>." This is designed for parents to<br />
give to school personnel and other professionals who deal with<br />
their hearing children.)<br />
Gallaud<strong>et</strong> University Library "Pathfinders" for further<br />
research are available at http://library.gallaud<strong>et</strong>.edu/dr/guiddpohc.html<br />
or<br />
http://library.gallaud<strong>et</strong>.edu/dr/guid-hcodp.html<br />
KODA: Kids of Deaf Adults. Montgomery County, Maryland:<br />
http://fawfamily.com/index2.htm<br />
National CODA Outreach Contact: thomas.bull@gallaud<strong>et</strong>.edu<br />
Parenting Advisory Council, Inc, P.O. Box 2624, Fairfax, VA<br />
22031 http://www.pacfamily.org/ or send an email to<br />
info@pacfamily.org<br />
Notice biographique :
Thomas Bull s'implique depuis longtemps auprès des enfants<br />
d'adultes sourds (amér.: CODA), organisation éducative<br />
internationale qui s'adresse aux enfants entendants de parents<br />
sourds. Il a été certifié au niveau national par le Registry of<br />
Interpr<strong>et</strong>ers for the Deaf depuis 1972 <strong>et</strong> possède un M.A. en<br />
éducation des Sourds de Gallaud<strong>et</strong> University, où il est<br />
présentement membre du personnel des services<br />
d'interprétation de Gallaud<strong>et</strong>. Il est l'auteur du travail de<br />
référence hautement louangé, On the Edge of Deaf Culture:<br />
Hearing Children/Deaf Parents Annotated Bibliography. Il a fait<br />
des présentations sur des questions intéressant les codas à des<br />
congrès régionaux, nationaux <strong>et</strong> internationaux <strong>et</strong> il est<br />
présentement rédacteur d'une anthologie de nouvelles, de<br />
poésie <strong>et</strong> autres écrits de codas, de parents sourds <strong>et</strong> leur<br />
enfants codas. Il a été désigné contact du National CODA<br />
Outreach <strong>et</strong> est consultant auprès de la Fédération mondiale<br />
des Sourds sur les questions de codas. On peut le rejoindre à<br />
l'adresse suivante : thomas.bull@gallaud<strong>et</strong>.edu<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
L'abus éducationnel dans les<br />
écoles résidentielles pour les<br />
Sourds*<br />
[*Note concernant la stylistique : l'original de c<strong>et</strong>te traduction<br />
est lui-même une transcription d'une pensée articulée en ASL<br />
par l'auteur ; nous avons essayé de nous en tenir de près à la<br />
forme donné <strong>et</strong> de ne pas "corriger" l'élocution. – Le traducteur]<br />
Expérience personnelle <strong>et</strong> génocide<br />
d'arrière-plan<br />
Nous avons des abus physiques, sexuels, mentaux, émotifs,<br />
éducationnels <strong>et</strong> communicationnels, sous toutes les formes,<br />
mais j'aimerais plutôt expliquer quatre choses au lieu de dresser<br />
de longues listes d'événements qui se sont produites au<br />
pensionnat.<br />
Premier exemple : À 16 ans, le jour de mon diplôme j'obtins le<br />
prix du meilleur discours <strong>et</strong> j'ai été obligé parler sur scène<br />
devant un auditoire <strong>et</strong> des représentants du gouvernement.<br />
J'avais pratiqué en classe pendant deux semaines. Je fis mon<br />
discours, mais je remarquai que de nombreuses personnes<br />
entendantes ne faisaient pas attention à moi. Ils regardaient de<br />
côté vers les murs pendant que je parlais. Je savais que ma<br />
voix sonnait mal <strong>et</strong> faux. "L'oralisme est un abus de<br />
communication"<br />
(2) Lorsque j'étais dans la résidence de juniors, tous les jeunes<br />
enfants devaient aller au lit avant 18 heures 30 pour que les<br />
mères aubergistes aient beaucoup de temps à elles-mêmes,<br />
payées, ce qui était égoïste ! Où sont passées nos occasions de<br />
lire des histoires de chev<strong>et</strong> ? Nos mères ne pouvaient pas venir<br />
à l'école parce que c'était trop loin. J'étais à 1 300 milles de<br />
chez moi <strong>et</strong> nous restions là 10 mois de l'année pendant<br />
plusieurs années. Il n'y avait aucun encouragement pour<br />
apprendre à lire <strong>et</strong> cela n'avait pas de sens pour moi. "Modèle<br />
de déficit"<br />
(3) Dans la résidence des intermédiaires, je n'oublierai jamais<br />
l'abus que nous avons subi. Il y avait beaucoup d'exemples<br />
d'abus physique <strong>et</strong> sexuel dans l'école. Je n'oublierai jamais<br />
cinq mère aubergistes célibataires qui avaient plus de 55 ans.<br />
Elles étaient très méchantes. Je sais maintenant qu'elles<br />
n'avaient pas d'enfants à elles. Pas surprenant ! Pouvez-vous<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
imaginer, lorsque nous allions prendre un bain. Tous les garçons<br />
devaient s'aligner près du mur, alors les mère aubergistes<br />
faisaient couler l'eau chaude jusqu'à ce que les baignoires<br />
soient remplies. Vous pouviez voir la vapeur chaude se dégager<br />
de la surface des baignoires. Chaque fois je devais courir avec<br />
mon ami jusqu'au coin <strong>et</strong> faire couler l'eau froide avec mes<br />
mains pour que les mères aubergistes ne nous entendent pas<br />
pendant que les autres garçons couraient dans tous les sens<br />
pour trouver ces baignoires. Et puis c<strong>et</strong> ami à moi <strong>et</strong> moi nous<br />
précipitions pour nous asseoir en sécurité. J'étais un des élèves<br />
qui criaient de douleur parce qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir.<br />
Les mères aubergistes nous poussaient dans l'eau. Une fois je<br />
me suis fait brûler. Après cela, il a fallu que je fasse quelque<br />
chose. Plus tard elles nous ordonnaient de nous lever <strong>et</strong> nous<br />
lavaient le corps avec du savon en nous regardant tout nus – Si<br />
vous ne vous laviez pas bien, une des mère aubergistes vous<br />
lavait. Je n'oublierai jamais que nous étions trop jeunes pour<br />
comprendre ce mode d'activité sexuelle. En réalité, elles<br />
détruisaient nos sentiments. J'en ai beaucoup plus à dire, mais<br />
je ne peux pas parce que ça vous ferait lever le coeur. "Abus<br />
continus"<br />
(4) Dans la résidence des seniors, quelques-uns de mes amis <strong>et</strong><br />
moi étions impliqués dans des batailles avec certains des<br />
étudiants entendants qui nous taquinaient <strong>et</strong> nous traitaient de<br />
stupides. Il nous arrivait de les battre dans le sous-sol. Avant le<br />
diplôme, un des garçons entendants admit qu'il était un<br />
délinquant juvénile <strong>et</strong> que le juge lui a avait dit de choisir entre<br />
un centre de détention pour jeunes délinquants <strong>et</strong> l'école des<br />
Sourds de l'Ontario. Il avait choisit l'école des Sourds. Cela nous<br />
avait remplis de colère. Cela nous avait été caché. Cela nous a<br />
fait nous sentir que nous aussi nous étions des prisonniers !<br />
Imaginez, se servir de notre école pour les Sourds comme d'une<br />
forme de punition. Si vous quittiez le campus, vous vous faisiez<br />
punir. C'était vraiment comme une prison. Certains étudiants<br />
sourds se sentaient mal à ce propos <strong>et</strong> vous pouvez imaginer<br />
comment cela affectait notre estime de soi. Un garçon<br />
entendant a mentionné qu'il avait appris sa bonne discipline de<br />
nous, pas de l'école. Où est notre discipline ? Cela a aussi créé<br />
un grand conflit entre les étudiants entendants <strong>et</strong> sourds. Le<br />
juge pensait-il que nous ne découvririons pas cela ? Nous<br />
sommes sourds, pas stupides. Je me sens encore aigri <strong>et</strong> blessé<br />
quand j'essaie de gérer mon passé. Je ne peux pas m'empêcher<br />
de blâmer le gouvernement pour la plus grande partie des<br />
dommages que cela a causé à la confiance des victimes d'abus<br />
comme moi, qui ont souffert à cause de la mauvaise éducation<br />
<strong>et</strong> des soins inférieurs aux normes. Il y a beaucoup d'adultes<br />
sourds qui sont passés par les mêmes difficultés que moi. Tout<br />
cela est dû aux mauvais traitements infligés par le<br />
gouvernement aux citoyens sourds. "Génocide culturel"<br />
Crises de suicides, de drogues <strong>et</strong><br />
d'alcool<br />
Depuis lors nous nous sommes plaints de ce que les secr<strong>et</strong>s de<br />
la bureaucratie nous avaient gardés à l'écart du public. À<br />
l'époque, j'avais appris la nouvelle qu'un adolescent sourd<br />
victime qui avait commis un suicide une semaine après<br />
l'enquête du gouvernement, en avril 1998.
Dans ma l<strong>et</strong>tre précédente, de juin 1999, le directeur général<br />
de l'association des Sourds <strong>et</strong> moi-même avions eu une réunion<br />
confidentielle avec le coordonnateur de proj<strong>et</strong> de la Méthode de<br />
règlement des réclamations du gouvernement pour discuter de<br />
la femme enquêteur. J'ai découvert qu'elle avait été réaffectée<br />
par le gouvernement au Ministère des Services sociaux <strong>et</strong><br />
communautaires. Elle devint subitement embarrassée <strong>et</strong> dit<br />
qu'elle ne savait pas qui était c<strong>et</strong>te femme enquêteur. Quelques<br />
minutes plus tard, elle adm<strong>et</strong>tait que l'enquêteur était au<br />
Ministère de la Santé.<br />
Je ne peux pas croire que la femme enquêteur n'ait pas été<br />
accusée par la police, à cause de la bureaucratie<br />
gouvernementale. Après que la victime se fût tuée le<br />
représentant du gouvernement a rapidement changé de poste<br />
vers un autre ministère <strong>et</strong> fut transféré à nouveau dans un<br />
autre ministère ! Avec ça, j'avais le sentiment que (le système)<br />
était corrompu par le secr<strong>et</strong> <strong>et</strong> l'injustice.<br />
Plus tard, j'ai appris que le gouvernement avait embauché deux<br />
enquêteurs qui étaient très soigneux d'enquêter sur les victimes<br />
sourdes d'abus physique <strong>et</strong> sexuel, mais il était trop tard pour<br />
c<strong>et</strong>te victime sourde. Je pense que la femme enquêteur <strong>et</strong> les<br />
représentants du gouvernement devraient être accusés de<br />
mauvaise conduite <strong>et</strong> d'incompétence, mais j'ai appris que le<br />
gouvernement a plus d'autorisation de pouvoir que la police<br />
pour résoudre c<strong>et</strong>te question. Pouvez-vous imaginer c<strong>et</strong>te<br />
situation ? J'espère que vous ne serez pas surpris.<br />
Pendant l'atelier du réseau des victimes de l'éducation des<br />
Sourds de l'Ontario (Ontario Deaf Education Victims N<strong>et</strong>work -<br />
ODEVN) auquel on avait été donné le mandat en Ontario pour<br />
un an en 2001, j'ai aussi trouvé qu'il y avait un plus grand<br />
nombre d'événements isolés de suicides, avec des problèmes de<br />
drogue, d'alcool, qui n'avaient aucuns moyens de se débrouiller<br />
dans la vie. Ils ne savaient pas la différence entre chercher de<br />
l'aide <strong>et</strong> garder le silence. Certaines personnes entendantes les<br />
possédaient comme leur propriété sexuelle comme des<br />
prisonniers, de sorte qu'ils ne puissent pas faire rapport à la<br />
police. Je leur ai suggéré d'aller demander de l'aide aux bureaux<br />
de la Société canadienne de l'ouïe <strong>et</strong> ils répondirent qu'ils ne<br />
comprennent pas <strong>et</strong> qu'ils ne font donc pas de rapports à eux.<br />
Et j'ai appris que certaines victimes n'obtenaient parfois pas<br />
d'aide professionnelle de plusieurs bureaux de la SCO. Jusqu'à<br />
maintenant je suis au courant d'environ cinq victimes<br />
adolescentes qui ont déjà commis le suicide. Mais je crois<br />
fortement qu'il y en a plus de trente qui ont commis un suicide<br />
en Ontario, plusieurs d'entre eux étaient des victimes isolées<br />
(sans connaissances de base), qui vivent dans le nord. J'avais<br />
rencontré mon vieil ami que je n'avais pas vu depuis cinq ans,<br />
qui était malade <strong>et</strong> sans abri. Et avec lui, je me suis porté<br />
volontaire pour prétendre que j'étais sans abri pour être témoin<br />
de plusieurs abris pour les sans-abri. J'ai rencontré environ<br />
trente Sourds sans abri avec de mauvais toxicomanes contrôlés<br />
par des pairs entendants avec des peurs. Ils ne pouvaient<br />
même pas me répondre à cause de leurs problèmes d'abus<br />
mental, mais deux d'entre eux n'étaient pas si mal. Plusieurs<br />
milliers de quêteux sourds furent forcés de gagner leur vie en<br />
vendant des cartes illégales <strong>et</strong> souvent la police les prenait, <strong>et</strong><br />
les relâchait, même des milliers de fois.
Il y a un besoin évident d'aide professionnelle, particulièrement<br />
ceux avec de l'expérience en surdité, en culture des Sourds, en<br />
droit des Sourds <strong>et</strong>, le plus important, avec quelqu'un qui peut<br />
communiquer dans leur langue, l'American Sign Language –<br />
l'ASL ! La langue qui n'est pas reconnue <strong>et</strong> embrassée comme<br />
notre langue maternelle par le gouvernement <strong>et</strong> par tous les<br />
niveaux du gouvernement canadien !<br />
Ce que je crois est nécessaire, c'est une enquête publique<br />
complète sur la situation présente des Sourds chômeurs <strong>et</strong> des<br />
Sourds sans abris au <strong>Canada</strong>.<br />
Négligence criminelle<br />
En 2001, un collègue <strong>et</strong> moi-même avons visité vingt<br />
collectivités, tenu des ateliers, <strong>et</strong> parlé avec de nombreux<br />
adultes sourds concernant les traumatismes qu'ils avaient subis<br />
dans les pensionnats. J'ai beaucoup de documentation<br />
concernant diverses formes d'abus <strong>et</strong> même de meurtres.<br />
Depuis 1995 j'ai approché le gouvernement pour avoir de l'aide<br />
en de nombreuses occasions ; mais j'ai toujours été référé aux<br />
surintendants des écoles pour les Sourds. Il semble qu'ils<br />
peuvent être partie du problème puisqu'ils ne prennent pas ces<br />
allégations au sérieux, parce qu'il n'y a eu aucun rapport à la<br />
police. Dans le passé, il semble que certain d'entre eux peuvent<br />
avoir eu de faux rapports, qui n'étaient pas des accidents, mais<br />
réellement des meurtres. Me demander de traiter avec des<br />
surintendants semble être un conflit d'intérêt comme ces<br />
problèmes touchent leurs anciens collègues. Je comprends que<br />
deux témoins sourds ont envoyé des rapports au gouvernement<br />
concernant deux meurtres, mais le gouvernement ne fit rien <strong>et</strong><br />
il n'y eut aucune réponse. Je crois fermement que plus de cinq<br />
personnes ont été victimes de meurtres (pas de mort<br />
accidentelle) à l'école pour les Sourds de Belleville entre 1950<br />
<strong>et</strong> 1965. Cela ne surprend pas concernant l'intégrité <strong>et</strong><br />
l'efficacité du gouvernement lorsqu'il semble y avoir si peu ou<br />
pas d'intérêt lorsqu'il s'agit de s'attaquer à ces questions<br />
criminelles. Depuis 1907, le gouvernement a expérimenté de<br />
nombreuses formes de langue des signes à enseigner dans les<br />
écoles (de l'anglais exact signé, à l'oral, à la communication<br />
totale, au bilinguisme/biculturel, <strong>et</strong> certains à l'American Sign<br />
Language). Il n'est pas surprenant que beaucoup d'étudiants<br />
sourds aient décroché ou qu'ils aient terminé le high school avec<br />
des compétences limitées en littératie <strong>et</strong> en communication<br />
parce qu'il n'y a eu aucune méthode d'enseignement<br />
conséquente ! Cela a également affecté la santé mentale de<br />
citoyens sourds, au point où beaucoup sont marginalisés <strong>et</strong> sur<br />
l'assistance sociale. Sûrement, c'est là une forme d'abus<br />
éducationnel. C<strong>et</strong>te situation, par certains côtés, est comparable<br />
aux Autochtones canadiens qui ont vécu la suppression de leur<br />
culture, de leur langue <strong>et</strong> de leur mode de vie.<br />
Je suis sourd profond <strong>et</strong> j'ai affronté bien des défis dans ma vie.<br />
À l'âge de 40 ans, j'ai réalisé que mon éducation était bien loin<br />
au-dessous des standards des étudiants entendants <strong>et</strong> j'ai<br />
décidé de r<strong>et</strong>ourner à l'école pour un recyclage académique.<br />
L'expérience m'a aussi donné la confiance de m'instruire de<br />
questions juridiques, ainsi que de faire de l'intercession au sein
de la collectivité sourde. Si on m'avait donné des occasions<br />
"normales" qui sont à la disposition des étudiants entendants, je<br />
pourrais avoir eu beaucoup plus de possibilités. Comme vous le<br />
savez, je suis encore bénévole comme directeur général du<br />
Réseau des victimes de l'éducation des Sourds en Ontario<br />
(ODEVN). Certains parents sourds <strong>et</strong> entendants <strong>et</strong> d'enfants<br />
sourds <strong>et</strong> des administrateurs m'ont approché <strong>et</strong> se sont plaints<br />
des écoles pour les Sourds <strong>et</strong> de conseils scolaires pour les<br />
Sourds. Il m'a été difficile d'accepter c<strong>et</strong>te situation ennuyeuse.<br />
Exemple (1) : Un des parents était très perturbé du fait que les<br />
psychologue des enfants entendants de l'évaluation éducative<br />
ne sache même pas signer. Comment pouvait-il comprendre ses<br />
aptitudes <strong>et</strong> son comportement sans l'aide d'un interprète ? Et,<br />
si avec un interprète, comment pouvait-il comprendre un enfant<br />
sourd comme tierce partie, dans quoi il ne peut dire une<br />
différence. (2) Un autre parent était en colère parce que son<br />
adolescente avait un niveau d'éducation de deuxième année <strong>et</strong><br />
que cela m<strong>et</strong>trait un fardeau sur eux après son diplôme. (3) Le<br />
gouvernement avait une mésentente avec le bureau<br />
d'administration, parce que le gouvernement prétendait que<br />
tout enfant/étudiant sourd n'avait pas la capacité d'être éduqué<br />
au niveau d'éducation des entendants <strong>et</strong> il y avait d'autres<br />
incidents supplémentaires en relation avec des problèmes<br />
d'éducation. Ces questions ne furent jamais résolues, même<br />
maintenant, en 2004. J'ai eu des rencontres avec divers<br />
représentants du gouvernement au cours des cinq dernières<br />
années, <strong>et</strong> la plupart ont choisi d'ignorer nos besoins. Nous<br />
demandons simplement au gouvernement de nous accorder un<br />
"comité consultatif communautaire" pour le nouvel organisme<br />
de la Commission des Services pour les Sourds de l'Ontario aux<br />
écoles pour les Sourds de l'Ontario <strong>et</strong> concernant des<br />
changements systémiques généraux fondamentaux au lieu de<br />
prendre une autre action en justice contre le gouvernement.<br />
Allégation de crise en éducation<br />
D'abord, au téléphone avec imprimante de messages, du 17<br />
juin 1999, le gouvernement, un conseiller senior dit au<br />
coordonnateur de l'ADR de nous informer que c'est l'opinion du<br />
conseiller senior que l'abus en éducation est une question de<br />
politique, <strong>et</strong> qu'elle devrait être traitée par le gouvernement. Il<br />
pensait que, si nous avions des opinions bien arrêtées, ce qui<br />
est évident de par nos l<strong>et</strong>tres récentes, qui nous devrions porter<br />
ces questions à la police, ou à l'avocat de la couronne local pour<br />
décision en matière criminelle.<br />
Deuxièmement, dans la l<strong>et</strong>tre du surintendant datée du 24<br />
novembre 1999, il nous mentionne que nous ne discuterions<br />
pas des allégation d'abus éducationnels ou de toute autre<br />
question qui étaient présentement traitées par des organismes<br />
du gouvernement. En premier lieu, nous avons été d'accord <strong>et</strong><br />
nous aurions offert d'avoir une rencontre avec nos pour discuter<br />
de la Commission de l'Ontario pour les Services offerts aux<br />
Sourds <strong>et</strong> de l'établissement du nouveau comité consultatif au<br />
lieu de contacter la police pendant la rencontre à son bureau de<br />
Belleville (Ontario), le 25 octobre 1999. Mais pendant les<br />
réunions du comité consultatif, la présidente entendante, avait<br />
souvent orienté la discussion surtout sur les améliorations sur<br />
les écoles pour les Sourds de l'Ontario plutôt que sur nos<br />
problèmes. Nous nous attendions également qu'un des
intervenants sourds serait président(e), pas un entendant.<br />
Paradigme ?<br />
Après ça, tout a échoué lorsque le surintendant/ représentant<br />
du gouvernement furent conscients de ce qu'il avait déplu aux<br />
intervenants sourds que le gouvernement se joue de nous <strong>et</strong> du<br />
comité consultatif en organisant seulement deux réunions en<br />
deux ans. Au moment où le nouveau directeur de la direction<br />
des écoles provinciales furent embauché par le gouvernement<br />
<strong>et</strong> nous ne pouvions pas imaginer pourquoi, comme il n'avait<br />
aucune expérience préalable du système d'éducation des<br />
sourds, de la culture des Sourds avant, <strong>et</strong> ne savait pas signer.<br />
Audisme ?<br />
D'abord nous ne comprenions pas pourquoi le surintendant<br />
mentionnait qu'il appellerait son gouvernement pour nous<br />
accorder le nouveau comité consultatif automatiquement<br />
pendant la réunion d'urgence concernant la Commission de<br />
l'Ontario sur les Services pour les Sourds <strong>et</strong> créer le nouveau<br />
comité consultatif. Le surintendant était au courant des<br />
méthodes d'enseignement inférieures de l'éducation pour les<br />
Sourds en Ontario puis qu'il avait travaillé comme enseignant,<br />
principal <strong>et</strong> surintendant pendant trente ans ; il est maintenant<br />
à la r<strong>et</strong>raite. Patronage ?<br />
Troisièmement, nous avons reçu une l<strong>et</strong>tre du cinquième<br />
surintendant /représentant du gouvernement qui mentionnait<br />
qu'il était très désolé d'avoir fait ce que lui <strong>et</strong> le gouvernement<br />
croyaient faire de mieux à l'époque. Nous avons aussi reçu<br />
récemment la pétition signée, entre autres, par plusieurs<br />
enfants sourds de l'une des écoles pour les Sourds de l'Ontario<br />
qui ne sont pas heureux du système d'éducation maintenant, <strong>et</strong><br />
indique que nous avons une crise de l'éducation !<br />
Quatrièmement, nous devons conclure que le gouvernement luimême<br />
ne parle pas avec beaucoup d'intégrité. Le système<br />
éducatif abusif déjà laisse les vies des Sourds marquées des<br />
cicatrices des problèmes sociaux émotifs <strong>et</strong> de confiance en soi<br />
endommagée. Le problème d'abus mental éducationnel avait<br />
existé longtemps avant l'été de 1993, jusqu'à ce que l'American<br />
Sign Language soit finalement reconnue comme la langue des<br />
Sourds dans les écoles de l'Ontario. Mais qu'est-ce qui en<br />
advient onze ans plus tard ? Plusieurs adolescents sourds ont<br />
aussi perdu leurs propres vies avec une éducation limitée <strong>et</strong><br />
quatre-vingt-cinq pour cent sont sans emploi <strong>et</strong> sous-employés.<br />
Les victimes culturellement sourdes n'ont jamais eu l'occasion<br />
d'être des étudiants modèles.<br />
Finalement, nous devons insister que la collectivité des Sourdes<br />
croit fermement en ce que nous faisons si nous voulons<br />
maintenir un contrôle <strong>et</strong> nous devons nous tenir debout pour<br />
nos droits <strong>et</strong> exiger d'être entendus. La seule façon dont les<br />
survivants innocents peuvent atteindre quelque chose, c'est de<br />
sortir <strong>et</strong> d'aller le cherche. Tous les faits sur les cas criminels<br />
non résolus sont disponibles sur demande. Prise en charge ?
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Sommaire<br />
(Aucun texte n'ayant été soumis, nous reproduisons ici le<br />
sommaire paru dans le programme de la Conférence.)<br />
L'intégration scolaire des élèves<br />
ayant une surdité <strong>et</strong> la question<br />
de santé mentale<br />
Par : Aurèle Bertrand <strong>et</strong><br />
Johanne Venne-Brisebois<br />
Deux enseignants, l'une sourde <strong>et</strong> l'autre entendant,<br />
partageront leurs connaissances relatives à la santé mentale<br />
des élèves sourds <strong>et</strong> malentendants intégrés en milieu scolaire<br />
franco-ontarien. Les problèmes de santé mentale chez l'enfant<br />
sourd <strong>et</strong> malentendant à domicile <strong>et</strong> en milieu scolaire seront<br />
décrits. La présentatrice <strong>et</strong> le présentateur offriront leurs<br />
témoignages personnels - l'une à partir de son expérience de<br />
vie avec une surdité, <strong>et</strong> l'autre, à partir de son travail auprès<br />
des élèves sourds <strong>et</strong> malentendants. Une analyse du contexte<br />
socio-politique servira de conclusion à la présentation.<br />
au début<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Qu’est-ce qu’un sourd ?<br />
(ou : de quoi parlons-nous quand nous<br />
parlons de "sourds" ?)<br />
Par Andrea Benvenuto<br />
Si nous demandons aux gens dans la rue : qu’est-ce qu’un<br />
sourd ? peut-être nous r<strong>et</strong>rouverons-nous avec des réponses<br />
variables parmi lesquelles : " c’est quelqu’un qui n’entend pas ",<br />
" quelqu’un qui ne parle ni n’entend ", " un handicapé ", " une<br />
personne qui parle avec ses mains <strong>et</strong> son corps ", <strong>et</strong>c. On dira<br />
qu’a priori tout le monde a raison parce qu’il s’agit de<br />
représentations de la question posée. Notre intention n’est pas<br />
de contester ces réponses, il ne s’agira pas non plus d’en<br />
trouver une de plus mais plutôt de les interroger sur ce qu’elles<br />
nous disent à voix basse. Nous pouvons alors reposer la<br />
question sous la forme suivante : de quoi parlons-nous quand<br />
nous parlons de "sourds" ?<br />
De prime abord, c<strong>et</strong>te question peut paraître tout à fait banale,<br />
mais quand nous nous réunissons entre professionnels de la<br />
santé mentale, enseignants, travailleurs sociaux, parents,<br />
sourds ou entendants, pour parler de nos pratiques respectives,<br />
nous ne pouvons négliger le fait, comme le souligne Michel<br />
Foucault, que « les discours (qui rendent compte de telles<br />
pratiques) forment systématiquement les obj<strong>et</strong>s dont ils<br />
parlent »(1). Il est hors de mon propos d’affirmer que les<br />
sourds sont une invention discursive, je voudrais simplement<br />
vous inviter à réfléchir avec moi aux catégories dans lesquelles<br />
nous rangeons les suj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> figeons les idées, sclérosant par làmême<br />
nos pratiques.<br />
Entre déficience <strong>et</strong> différence : les<br />
sourds<br />
Nous pouvons parler de la surdité comme d’un obj<strong>et</strong>, c’est-àdire<br />
prendre la déficience auditive comme un manque physique<br />
qui concerne le corps de celui qui est atteint d’infirmité. Mais<br />
nous pouvons aussi parler des rapports que les suj<strong>et</strong>s sourds<br />
entr<strong>et</strong>iennent avec leurs prochains (sourds ou entendants) <strong>et</strong><br />
des implications de la surdité dans ces rapports. De ce point de<br />
vue, la déficience physique est déplacée du corps infirme aux<br />
rapports <strong>et</strong> la dimension sociale du problème apparaît. L’article<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
du sociologue français Bernard Mottez « À s’obstiner contre les<br />
déficiences, on augmente souvent le handicap : l’exemple des<br />
sourds »(2), est incontournable. Les distinctions que l’auteur<br />
opère entre déficience <strong>et</strong> handicap <strong>et</strong> les eff<strong>et</strong>s qui en découlent<br />
me paraissent indispensables à toute approche conceptuelle qui<br />
prétend épouser les nuances de la vie. Examinons-les<br />
brièvement.<br />
La surdité : déficience ou handicap ?<br />
Si la déficience <strong>et</strong> le handicap font partie d’un même ensemble,<br />
la déficience renvoie à l’aspect physique, le handicap à la<br />
dimension sociale. La déficience est mesurable <strong>et</strong> nécessaire<br />
pour situer l’individu dans une catégorie <strong>et</strong> cela perm<strong>et</strong> à<br />
l’organisation sociale de planifier ses politiques. La mesure de la<br />
déficience revêt un caractère technique <strong>et</strong> donc indiscutable <strong>et</strong><br />
situe le suj<strong>et</strong> dans des catégories purement médicales en<br />
l’ordonnant par rapport à une norme. Plus un individu s’écarte<br />
de ce qui représente la norme, plus il devient « anormal » <strong>et</strong><br />
plus c<strong>et</strong> écart apparaît comme un échec ou un vice de forme.<br />
Nous reviendrons un peu plus loin sur ce point.<br />
Par opposition, le handicap doit être entendu, toujours selon<br />
Bernard Mottez, comme «l’ensemble des lieux <strong>et</strong> rôles sociaux<br />
desquels un individu ou une catégorie d’individus se trouve<br />
exclu en raison d’une déficience physique»(3). C<strong>et</strong>te définition<br />
sociale du handicap m<strong>et</strong> l’accent sur le caractère relatif de la<br />
déficience. Une même déficience n’entraîne pas le même<br />
handicap, c’est pourquoi les modes d’organisation sociale <strong>et</strong><br />
politique feront de la déficience tantôt un handicap léger dans<br />
certaines sociétés, tantôt une marginalisation, une exclusion<br />
voire même un enfermement dans d’autres. En ce sens, le<br />
handicap est, au contraire de l’infirmité, un produit de<br />
l’organisation sociale. Mais quel est l’intérêt de c<strong>et</strong>te distinction ?<br />
Quand les sociétés se proposent de réduire le handicap, deux<br />
grandes orientations s’offrent à elles. Soit les efforts se tournent<br />
vers des changements d’organisation sociale qui perm<strong>et</strong>tent<br />
d’éliminer tout ce qui fait obstacle à l’accessibilité, <strong>et</strong> dans ce<br />
cas on tente d’agir sur le handicap ; soit ils se focalisent sur la<br />
réduction de l’infirmité, espérant par là-même diminuer le<br />
handicap. La première voie mobilise la collectivité ; dans la<br />
seconde perspective, l’effort porte essentiellement sur<br />
l’individu : de ses performances dépendront ses chances<br />
d’intégration sociale.<br />
Quand on parle de sourds comme de déficients, que fait-on<br />
d’autre sinon donner à l’adjectif une valeur d’attribut qui revêt<br />
de ce fait un caractère accidentel ? En plaçant l’infirmité au<br />
centre de politiques <strong>et</strong> de pratiques sociales, éducatives <strong>et</strong><br />
médicales, on laisse ipso facto de côté le handicapé comme<br />
suj<strong>et</strong>, membre d’une communauté <strong>et</strong> acteur d’une organisation<br />
sociale qui participe de concert avec lui à son intégration<br />
sociale. Lorsqu’on privilégie la voie de la réductioncompensation<br />
de la déficience dans l’espoir de réduire le<br />
handicap, la singularité n’en sort-elle pas irrémédiablement<br />
niée ? Et la négation de la singularité comme forme de vie n’estelle<br />
pas tout simplement la négation de la vie ?
La surdité : handicap ou différence ?<br />
Posons-nous maintenant la question : la surdité est-elle un<br />
handicap ou une différence ? Les réponses que c<strong>et</strong>te question<br />
suscite font l’obj<strong>et</strong> (surtout parmi les entendants) de débats<br />
sans fin. Les lignes de feu sont parfois tracées de manière<br />
radicale, comme si penser dialectiquement chacune des options<br />
était chose impossible. Nous en sommes de nos jours à un tel<br />
point de polarisation que nous ne savons plus aborder un aspect<br />
du problème sans laisser de côté tous les autres.<br />
Si on parle en termes de handicap, reconnaître l’existence d’une<br />
minorité linguistique <strong>et</strong> culturelle devient inimaginable. Au<br />
mieux, la langue des signes peut être considérée comme un<br />
outil pour atteindre la langue officielle <strong>et</strong> la culture sourde n’est<br />
plus qu’une affaire de sourds. Si l’on parle de langue<br />
minoritaire, de différence culturelle <strong>et</strong> de communauté, alors le<br />
handicap se dissout.<br />
Je me demande ce qui a bien pu pousser les sourds à créer une<br />
langue visuo-gestuelle pour communiquer si ce n’est la surdité<br />
de l’oreille. C’est justement c<strong>et</strong>te singularité qui a permis de<br />
transformer en un acte de vie, ce que certains (généralement<br />
entendants) considèrent comme un manque. «…On peut<br />
interpréter la singularité individuelle comme un échec ou<br />
comme un essai, écrit G. Canguilhem, comme une faute ou<br />
comme une aventure… »(4). Si nous choisissons d’interpréter la<br />
singularité de l’être sourd comme une aventure, cela favorisera<br />
la reconnaissance, au-delà d’une infirmité physique que<br />
personne ne peut contester, d’une expérience de vie, d’une<br />
façon d’être dans le monde différente de celle des entendants.<br />
Et justement, dans la mesure où la valeur n’est autre que la vie<br />
- je paraphrase Canguilhem -, aucun autre jugement de valeur<br />
ne sera porté sur l’existence des sourds <strong>et</strong> leur façon d’être-aumonde.<br />
Concernant la santé <strong>et</strong> d’autres domaines encore, ces<br />
considérations revêtent une importance capitale.<br />
En revanche, l’idéologie qui a interprété la singularité<br />
individuelle comme un échec, comme une faute, <strong>et</strong> qui a inscrit<br />
le sourd dans le discours de la déficience par le biais de<br />
dispositifs politiques <strong>et</strong> sociaux déterminés, oriente <strong>et</strong> limite le<br />
regard que les professionnels, les enseignants <strong>et</strong>, au-delà, la<br />
société tout entière, j<strong>et</strong>tent sur c<strong>et</strong> individu concr<strong>et</strong> qu’est le<br />
sourd. On peut alors légitimement se demander : les suj<strong>et</strong>s<br />
sont-ils limités, ou ne sont-ce pas plutôt les limites qui<br />
assuj<strong>et</strong>tissent ? Ce n’est pas la surdité en elle-même qui produit<br />
des suj<strong>et</strong>s limités dans leur capacité d’acquérir une langue <strong>et</strong><br />
une identité, de développer des fonctions cognitives <strong>et</strong><br />
d’accéder à la pensée abstraite, de créer des liens<br />
communautaires <strong>et</strong> d’élaborer une culture. Ce sont les pratiques<br />
qui se fondent sur la déficience <strong>et</strong> s’y épuisent, qui produisent<br />
des suj<strong>et</strong>s limités. En revanche, si l’on considère la surdité non<br />
comme un accident à normaliser mais comme une différence qui<br />
produit l’existence propre de l’individu, les limites se dissolvent<br />
dans c<strong>et</strong>te existence même.<br />
On peut dire que le discours qui considère les sourds comme<br />
des êtres porteurs d’une différence <strong>et</strong> non comme des<br />
déficients, a émergé lorsqu’il s’est détourné de l’obsession du<br />
manque pour m<strong>et</strong>tre en valeur une façon de vivre <strong>et</strong> d’être au
monde. Au fur <strong>et</strong> à mesure que les sourds ont occupé de<br />
nouvelles places dans la société <strong>et</strong> dans l’espace public, qu’ils<br />
sont devenus des êtres de droit (à l’éducation ou à la santé par<br />
exemple) <strong>et</strong> que les recherches sur la langue des signes ont<br />
démontré qu’il s’agit bien d’une langue comme les autres, le<br />
mouvement de reconnaissance de l’existence des sourds a<br />
permis de j<strong>et</strong>er un regard différent sur leur singularité. Bernard<br />
Mottez écrit : « On ne fait (aux sourds) par avance crédit sur<br />
rien. […] Ils doivent tout prouver, même leur existence »(5). On<br />
peut ajouter : si les entendants ont nié l’existence des sourds<br />
pour mieux affirmer la leur propre, pour éprouver les limites de<br />
leur propre normalité, c’est que la place des uns est en rapport<br />
étroit avec celle des autres. La reconnaissance des sourds par<br />
les entendants implique que ces derniers acceptent un<br />
décentrement de leur rapport à la langue, à la culture, <strong>et</strong><br />
finalement à eux-mêmes. La question peut alors se formuler<br />
ainsi : comment concevoir un monde où il n’est plus nécessaire<br />
de nier l’autre pour trouver sa place ? Je voudrais ici m’arrêter<br />
sur le processus de la nomination, partie intégrante de c<strong>et</strong>te<br />
lutte entre négation de l’autre <strong>et</strong> reconnaissance de son<br />
existence.<br />
S’agit-il simplement de nommer ?<br />
Si nous adm<strong>et</strong>tons l’idée que la nomination d’un fait, <strong>et</strong> dans ce<br />
cas précis d’un suj<strong>et</strong>, engendre par elle-même un champ<br />
d’actions <strong>et</strong> de réflexions différentes de celles qu’impliquerait un<br />
autre type de nomination, alors la désignation devient par ellemême<br />
un fait politique qui implique comme telle la société tout<br />
entière. Et si nous reprenons l’idée de Michel Foucault selon<br />
laquelle les discours forment les suj<strong>et</strong>s dont ils parlent, que fautil<br />
alors penser de la multiplicité des dénominations que les<br />
entendants attribuent aux sourds : sourds de naissance, sourds<br />
post-linguaux, malentendants, devenus sourds, Sourds ou vrais<br />
sourds, sourds oralistes ou sourds gestuels, sourds-mu<strong>et</strong>s,<br />
déficients auditifs, handicapés, défavorisés, pour ne citer que<br />
quelques-uns des termes du XX e siècle ; ou encore, idiot, être<br />
inférieur, monstre, essentiellement dépourvu d’intelligence,<br />
sourd <strong>et</strong> mu<strong>et</strong>, comme on pouvait l’entendre <strong>et</strong> le lire jusqu’au<br />
XIX e siècle ? Si chaque période historique a usé de<br />
dénominations propres, il n’en reste pas moins que certaines<br />
ont parfois fait r<strong>et</strong>our, en un mouvement de balancier qui<br />
mériterait une analyse. Quelles politiques sociales, sanitaires,<br />
éducatives, juridiques se déploient pour répondre aux besoins<br />
ainsi repérés ? De leur côté, les suj<strong>et</strong>s répondent-il aux noms<br />
qui leur ont été donnés ? Quels changements sociaux sont<br />
requis pour qu’une nomination chasse l’autre <strong>et</strong> assigne les<br />
sourds à une nouvelle place ?<br />
Des conceptions de l’ancien temps, qui assimilaient le sourd à<br />
un " idiot du village " aux définitions contemporaines qui le<br />
considèrent comme un être " souffrant de difficultés du<br />
raisonnement <strong>et</strong> de la pensée abstraite ", il n’y a pas grande<br />
différence. Il me faut un instant remonter à l’étymologie <strong>et</strong> à la<br />
sémantique du mot sourd. L’intérêt de ce détour n’est pas de<br />
nous ancrer dans la tradition mais bien d’ouvrir des voies<br />
d’exploration de nouveaux possibles. Là est l’enjeu.
Étymologie <strong>et</strong> sémantique du mot sourd<br />
En grec ancien, le champ sémantique de κοφ•ς (cophos) était<br />
large. Le mot signifiait " être privé de quelque chose ", " être<br />
coupé de ", <strong>et</strong> ce pouvait être de la vue, de l’odorat, <strong>et</strong>c. Une<br />
personne sourde était celle qui avait subi une mutilation, dont<br />
un sens était " émoussé " ou " entaillé ". Le mot pouvait donc<br />
aussi signifier " aveugle ", " infirme " <strong>et</strong> sur le plan intellectuel,<br />
" hébété " ou " stupide "(6). Les racines indo-européennes du<br />
mot surdus en latin, se réfèrent à la notion de " bruit ".<br />
Les Grecs ne différenciaient pas la surdité de la mutité. Le<br />
défaut de parole orale était perçu comme la conséquence,<br />
comme une infirmité dérivée du défaut d’audition. C<strong>et</strong>te<br />
conception reste toujours en vigueur. Les dénominations<br />
" sourd-mu<strong>et</strong> " ou " sourd <strong>et</strong> mu<strong>et</strong> " parlent d’elles-mêmes. Le<br />
fait qu’un sourd prononce imparfaitement la langue orale n’est<br />
dû à aucune déficience de l’appareil phonatoire, mais à la<br />
déficience de l’audition qui l’empêche d’apprendre les sons<br />
d’une langue de manière naturelle.<br />
Dans un sens figuré, cophos désignait le faible d’esprit, sans<br />
intelligence. Ici, le manque n’est pas localisable matériellement<br />
mais métaphoriquement <strong>et</strong> c’est l’image de la surdité qui est<br />
convoquée pour le désigner. C<strong>et</strong> usage figuré du mot sourd par<br />
les Grecs est toujours d’actualité.<br />
Du champ sémantique plus étroit – celui qui se réfère à<br />
l’audition – du mot sourd, à celui des métaphores qui peuplent<br />
les fantasmes de ceux qui voient dans la surdité la source de<br />
tous les maux (l’incompréhension, l’incommunication, le défaut<br />
d’intelligence), la trace de la nomination d’antan marque<br />
toujours le présent de son empreinte.<br />
Comment nommait-on aux XIX e <strong>et</strong> XX e<br />
siècles ?<br />
Au XIXe siècle, le mot "sourd" servait à désigner ceux que nous<br />
appelons aujourd’hui les "devenus sourds" <strong>et</strong> les<br />
"malentendants". Le terme était utilisé dans le sens de " dur<br />
d’oreille ", tandis que le mot " cophose " désignait la surdité<br />
totale. Cependant les termes " sourd-mu<strong>et</strong> " ou simplement<br />
" mu<strong>et</strong> " étaient réservés aux sourds de naissance <strong>et</strong> aux sourds<br />
prélinguaux.(7) En langue des signes, les sourds désignaient les<br />
entendants par un geste qui signifiait "parlant " (l’index tendu<br />
horizontalement face aux lèvres tourne comme un moulin<strong>et</strong>),<br />
tandis que pour se désigner eux-mêmes ils employaient le signe<br />
" sourd-mu<strong>et</strong> ", en déplaçant l’index de l’oreille à la bouche.<br />
C<strong>et</strong>te désignation a une longue histoire <strong>et</strong> elle est généralement<br />
acceptée par tous les sourds.<br />
Au XXe siècle, les revues spécialisées <strong>et</strong> nombre d’institutions<br />
d’éducation de sourds commencent à changer de nom. Les<br />
enseignants oralistes qui prétendaient que la majorité des<br />
élèves parlaient, commencent à remplacer progressivement le<br />
terme " sourd-mu<strong>et</strong> " par " déficient auditif ", " malentendant ",<br />
" hypoacousique ", ce qui signe, selon B. Mottez, le passage à la<br />
médicalisation de la surdité(8). La terminologie qui entre dès<br />
lors en vigueur revient au champ sémantique du mot " sourd "
en grec ancien, " être privé de quelque chose ". Quelque chose<br />
est manquant même si le manque n’est pas absolu. C<strong>et</strong>te<br />
conception justifiera le développement de techniques médicales<br />
qui viendront combler ce manque. Quelques années plus tard,<br />
les sourds revendiqueront la langue des signes comme<br />
alternative à l’oralité <strong>et</strong> le mot " mu<strong>et</strong> " sera abandonné <strong>et</strong><br />
remplacé par le mot " silencieux ": associations silencieuses,<br />
presse silencieuse, sport silencieux. Dans les années 1970 une<br />
nouvelle désignation apparaît, " Sourd " avec majuscule,<br />
rappelant que celui-ci est membre d’une réalité sociologique <strong>et</strong><br />
linguistique déterminée.(9)<br />
Depuis quelques années, une autre expression fait son<br />
apparition pour désigner les sourds : " personne sourde ". Il<br />
s’agit de ne pas identifier la personne à son handicap mais de<br />
ne voir dans ce dernier qu’un des attributs de la personne. C’est<br />
pourquoi, dans ce registre, on ne parle pas d’un handicapé mais<br />
de "quelqu’un qui a un handicap", " en situation de handicap ",<br />
" personne handicapée ", <strong>et</strong>c. Il y a des nominations qui<br />
renforcent les identités <strong>et</strong> d’autres qui les invalident. La<br />
nomination peut alors devenir un élément d’une stratégie de<br />
négation de l’existence d’autrui. La terminologie employée pour<br />
nommer les sourds – mais aussi d’autres catégories de<br />
handicapés – apparaît comme une manière de rapprocher celui<br />
qu’on nomme des critères de la normalité. « Ôtez<br />
l’empêchement <strong>et</strong> vous obtenez la norme », disait Canguilhem<br />
(10). Tout se passe comme si les suj<strong>et</strong>s qui nous font face<br />
n’existaient pas en leur singularité. En refusant de les nommer,<br />
on nie leur place <strong>et</strong> même leur existence. Mottez remarque :<br />
« … à propos des sourds-mu<strong>et</strong>s, on est passé en l’espace d’un<br />
siècle d’un nom à un adjectif <strong>et</strong> d’une catégorie anthropologique<br />
ou sociologique désignant des personnes à une catégorie<br />
purement médicale ».(11)<br />
À propos de normal <strong>et</strong> de pathologique<br />
C<strong>et</strong>te catégorisation médicale des sourds nous ramène au suj<strong>et</strong><br />
de la norme que j’ai abordé plus haut. Les concepts de<br />
« normal » <strong>et</strong> de « pathologique » sont incontournables en<br />
médecine. Cependant leur signification est loin d’être toujours<br />
évidente. Le pathologique est-il opposé au normal ? Quelle<br />
relation ces concepts entr<strong>et</strong>iennent-ils entre eux ? Et en quoi le<br />
recours à ces concepts contribue-t-il à éclairer nos pratiques ?<br />
Le normal renvoie communément soit à un idéal, à un prototype<br />
ou à une forme parfaite, soit à un fait susceptible d’être décrit<br />
de manière statistique. Selon G. Canguilhem, l’enjeu<br />
fondamental est de savoir si nous devons considérer le vivant<br />
comme un système de lois de la nature ou comme une<br />
organisation de propriétés. Faut-il parler des lois de la vie ou de<br />
l’ordre de la vie ?<br />
Quand on parle de lois de la nature, les phénomènes singuliers<br />
sont perçus comme des aberrations. Tout ce qui s’écarte de la<br />
loi, c’est-à-dire tout ce qui se singularise, est considéré comme<br />
un échec. Le singulier est irrégulier <strong>et</strong> c’est en cela qu’il est hors<br />
norme. Dans c<strong>et</strong>te perspective, les cas individuels atypiques<br />
apparaissent comme des « cas pathologiques ».
Quand on parle de l’ordre de la vie ou de la vie comme une<br />
organisation de propriétés, on conçoit des fonctions<br />
hiérarchisées dont la stabilité est nécessairement précaire. C<strong>et</strong><br />
équilibre instable résulte d’ajustements <strong>et</strong> de compromis entre<br />
pouvoirs différents <strong>et</strong> en concurrence. De ce point de vue,<br />
« l’irrégularité ou l’anomalie n’est pas conçue comme un<br />
accident affectant l’individu mais comme son existence même ».<br />
L’individu a la capacité de produire du nouveau, c’est la<br />
condition même de son existence. Si la singularité est<br />
considérée comme un échec, le jugement porté sur elle sera<br />
nécessairement négatif. Mais si nous la considérons comme une<br />
aventure, sa valeur positive aura pour condition sa capacité à<br />
s’adapter à la vie. En ce sens, <strong>et</strong> en tenant compte des mille <strong>et</strong><br />
une manières de vivre, nous ne pourrons pas parler de<br />
différence entre un « mode de vie manqué » <strong>et</strong> un « mode de<br />
vie réussi ». Il n’y a a priori aucune différence.<br />
Mais revenons aux sourds. La surdité peut être considérée<br />
comme un écart par rapport à la norme <strong>et</strong> dans ce sens le sourd<br />
est celui qui vit hors norme. Il est coupé de l’audition <strong>et</strong> la<br />
fonction de l’ordre médical sera de la lui rendre. Tout est<br />
organisé autour du soin.<br />
Mais si la surdité est conçue comme une organisation singulière<br />
de l’ordre du vivant, alors nous sommes dans l’au-delà de la<br />
pathologie, dans la production d’un mode de vie particulier.<br />
Dans ce cas, les termes de normal <strong>et</strong> de pathologique n’auront<br />
pas de valeur absolue. La surdité, pas plus que l’entendance, ne<br />
peuvent être les sources en elles- mêmes des malheurs des<br />
individus. On ne peut parler ni d’un suj<strong>et</strong> normal ou<br />
pathologique en soi, ni d’un milieu normal ou pathologique en<br />
soi. On ne peut le faire qu’en m<strong>et</strong>tant suj<strong>et</strong> <strong>et</strong> milieu en relation.<br />
Alors, dans c<strong>et</strong>te optique, la tâche devient immense. Elle revêt<br />
un caractère politique, social, éthique <strong>et</strong> comme telle, elle ne<br />
pourra jamais être mise en place dans la solitude de la pensée<br />
<strong>et</strong> de l’action. C’est une question publique, au sens de res<br />
publica, une question qui appartient à la collectivité sociale <strong>et</strong><br />
qui en émane. Collectivité dont nous faisons tous partie.<br />
Notes<br />
1. Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard,<br />
1969, p. 49.<br />
2. Bernard Mottez, « A s’obstiner contre les déficiences, on<br />
augmente souvent le handicap : l’exemple des sourds », in<br />
Coup d’œil, Éd. B.Mottez, H.Markowicz, Centre d’Étude des<br />
Mouvements Sociaux, EHESS, n°39, 1984. Premier<br />
publication in Sociologie <strong>et</strong> Société, Montréal, 1977.<br />
3. Bernard Mottez, op.cit., p.3.<br />
4. Georges Canguilhem, « Le Normal <strong>et</strong> le<br />
Pathologique » (1951), in La connaissance de la vie, Paris,<br />
J. Vrin, 1998, p.159.<br />
5. Bernard Mottez, « Les sourds existent-ils ? », in<br />
Psychanalystes, revue du Collège des Psychanalystes,<br />
Paris, n° 46-47, 1993, p.57.<br />
6. Ienke Keijzer, La surdité dans la société gréco-romaine,
Mémoire de maîtrise L<strong>et</strong>tres Classiques, Université Paul<br />
Valéry, Montpellier, 1995-1996, p. 17.<br />
7. Bernard Mottez, Une entreprise de dénomination : Les<br />
avatars du vocabulaire pour désigner les sourds aux XIXe <strong>et</strong> XXe siècles, H. J. Stiker, M. Vial, C. Barral (dir.),<br />
Fragments pour une histoire : notions <strong>et</strong> acteurs, Paris,<br />
Alter, diffusion CTNERHI, 1996, p. 101.<br />
8. Ibid., p. 108.<br />
9. Ibid., p. 110.<br />
10. G. Canguilhem, « La monstruosité <strong>et</strong> le monstrueux », La<br />
connaissance de la vie, Paris, J. Vrin, 1998, p. 180.<br />
11. Mottez, Bernard, op.cit., p. 109.<br />
Andrea Benvenuto<br />
Université Paris 8<br />
Ottawa, Septembre 2004<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Réduire le risque de problèmes<br />
psychosociaux chez les enfants<br />
Sourds <strong>et</strong> leurs parents<br />
Par : Anne Toth<br />
Résumé<br />
La présente recherche a été conçue pour traiter des problèmes<br />
psychosociaux que les étudiants d'une école pour les Sourds <strong>et</strong><br />
leurs parents ont connus <strong>et</strong> qui ont été mis en évidence par les<br />
comportements de faible estime de soi observés chez les<br />
enfants <strong>et</strong> par les niveaux élevés de stress chez les parents. On<br />
a étudié des enfants Sourds <strong>et</strong> leurs parents selon une approche<br />
faisant appel à un pré-test <strong>et</strong> à un post-test. Le plan<br />
d'application, établi d'après les besoins évalués grâce à une<br />
enquête pré-application, faisait appel aux ressources de l'école,<br />
aux parents <strong>et</strong> à la communauté. Les données de l'enquête<br />
réalisée suite à l'application du programme montrent une<br />
hausse de 10 % relative aux quatre objectifs poursuivis, soit :<br />
sensibiliser des enfants Sourds <strong>et</strong> leurs parents à un<br />
programme de développement des aptitudes en<br />
communications sociales, favoriser leur assiduité, faire en sorte<br />
qu'ils utilisent le programme <strong>et</strong> assurer leur participation active.<br />
Après l'administration de tests visant à mesurer le niveau<br />
d'estime de soi <strong>et</strong> de stress chez les suj<strong>et</strong>s, la recherche a<br />
permis de conclure – à la lumière des changements qui ont été<br />
mis en évidence par la réduction du nombre de cas signalés de<br />
violence envers les enfants, de sentiments de dépression <strong>et</strong> de<br />
colère <strong>et</strong> d'actes autodestructeurs commis par les enfants –<br />
qu'à la fois les enfants <strong>et</strong> les parents ont affiché un<br />
accroissement des scores compris dans la gamme normale.<br />
Étant donné l'appui reçu des parents, de l'école, des<br />
programmes résidentiels <strong>et</strong> dans le cadre du programme<br />
d'amélioration des aptitudes en communications sociales, la<br />
façon dont les problèmes ont été résolus augure bien pour la<br />
santé psychosociale des enfants Sourds <strong>et</strong> de leurs parents.<br />
Obj<strong>et</strong><br />
La présente recherche a été mise en oeuvre pour répondre aux<br />
problèmes psychosociaux que les étudiants d'une école pour les<br />
Sourds <strong>et</strong> leurs parents éprouvaient en termes d'estime de soi,<br />
dans le cas des enfants, <strong>et</strong> de stress, dans le cas des parents.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
L'admission des enfants à l'école est basée sur leur déficience<br />
auditive. Cependant, l'école sait que l'utilisation de l'American<br />
Sign Language (ASL) <strong>et</strong> la participation aux activités de<br />
l'ensemble de la communauté des personnes sourdes<br />
contribuent de façon importante à la différenciation des<br />
personnes atteintes d'une déficience auditive (sourdes) de celles<br />
qui se considèrent non pas comme des déficients auditifs, mais<br />
plutôt comme des membres d'une minorité linguistique <strong>et</strong><br />
culturelle (celle des Sourdes) (Hindley <strong>et</strong> coll., 1994; Padden <strong>et</strong><br />
Humphries, 1988). Même si les critères d'admission à l'école<br />
exigent que l'enfant soit atteint d'une déficience auditive, le<br />
contexte familial <strong>et</strong> le fait que l'enfant se perçoit<br />
individuellement comme une personne Sourde sont également<br />
considérés.<br />
Bien que c<strong>et</strong>te différenciation soit subtile, l'identification des<br />
enfants comme étant « sourds » ou « Sourds » exerce un eff<strong>et</strong><br />
important sur la façon dont ils pourront répondre à leurs<br />
besoins, sur leur niveau d'estime de soi <strong>et</strong> sur le stress que les<br />
parents ressentiront relativement à leur capacité d'aider leurs<br />
enfants à franchir les étapes développementales <strong>et</strong> sociales de<br />
la vie. Les communications étant cruciales à c<strong>et</strong>te fin, il est<br />
important de savoir comment ces communications seront<br />
réalisées.<br />
Si l'enfant est capable d'utiliser un appareil fonctionnel ou de<br />
lire sur les lèvres, les parents peuvent choisir de l'envoyer dans<br />
une école ordinaire, <strong>et</strong> il se peut que l'enfant en arrive ainsi à<br />
s'identifier aux malentendants <strong>et</strong> aux déficients auditifs. Par<br />
contre, si l'enfant est exposé à d'autres adultes Sourds ainsi<br />
qu'à des enfants qui utilisent un langage gestuel <strong>et</strong> qu'il ou elle<br />
trouve que ce moyen visuel <strong>et</strong> gestuel de communication lui<br />
procure signification <strong>et</strong> facilité, les parents peuvent choisir de<br />
l'envoyer à l'école pour les Sourds, <strong>et</strong> l'enfant peut en venir à<br />
s'identifier culturellement <strong>et</strong> linguistiquement à d'autres<br />
personnes Sourdes. Pour les enfants <strong>et</strong> les parents, l'effort<br />
requis pour en arriver à l'une ou l'autre identification peut<br />
nécessiter un grand nombre d'essais <strong>et</strong> d'années. Afin de bien<br />
faire comprendre la pertinence de c<strong>et</strong>te question pour le présent<br />
rapport, nous avons fait une distinction entre « sourd » <strong>et</strong> «<br />
Sourd » dans le but de fournir un moyen de cerner les<br />
problèmes psychosociaux complexes qui touchent les enfants<br />
Sourds <strong>et</strong> leurs parents.<br />
À titre de contexte au présent proj<strong>et</strong> de recherche, il faut noter<br />
qu'au cours d'une période de trois ans, dans l'école pour les<br />
Sourds où l'auteure travaille, il a été observé que les enfants<br />
éprouvaient de la difficulté à résoudre les problèmes qui se<br />
posaient avec leurs pairs, leurs professeurs, les conseillers des<br />
résidences <strong>et</strong> leurs parents. Lorsque les enfants rapportaient<br />
faire l'obj<strong>et</strong> d'actes de violence, exprimaient des sentiments de<br />
dépression <strong>et</strong> de colère ou tentaient de se suicider, on les<br />
aiguillait vers des services de counseling <strong>et</strong> de protection. Même<br />
si les demandes de services identifiaient habituellement l'enfant<br />
comme étant celui qui avait le problème, les services sociaux<br />
adoptaient une autre approche fondée sur la théorie des<br />
systèmes. C'est-à-dire que l'étudiant en tant qu'individu, la<br />
famille, l'école <strong>et</strong> la résidence étaient considérés comme des<br />
éléments qui exerçaient un eff<strong>et</strong> intrinsèque les uns sur les<br />
autres (Hern, 1979; Pincus <strong>et</strong> Minahan, 1973).
Exprimant leur propre frustration, les parents des étudiants<br />
avaient décrit les besoins spéciaux de leurs enfants ainsi que<br />
leur désir d'améliorer les communications à la maison, de<br />
résoudre les problèmes <strong>et</strong> de s'occuper des questions<br />
d'isolement liées au fait d'être Sourd dans un monde<br />
d'entendants. Des barèmes ont été appliqués aux étudiants<br />
(mesure de l'estime de soi) <strong>et</strong> aux parents (mesure du niveau<br />
de stress) qui avaient demandé des services d'intervention, de<br />
protection <strong>et</strong> de counseling. Les résultats ont fourni la preuve<br />
que les enfants avaient un faible niveau d'estime de soi <strong>et</strong> que<br />
les parents subissaient un niveau de stress élevé.<br />
Les résultats ont<br />
fourni la preuve<br />
que les enfants<br />
avaient un faible<br />
niveau d'estime de<br />
soi <strong>et</strong> que les<br />
parents subissaient<br />
un niveau de stress<br />
élevé.<br />
On a recueilli de la<br />
documentation sur le problème<br />
à partir de l'information fournie<br />
par les enfants <strong>et</strong> les parents<br />
ainsi qu'à partir des<br />
observations faites par le<br />
personnel de l'école. On a<br />
également examiné les<br />
dossiers tenus par l'école,<br />
lesquels ont montré que les<br />
enfants <strong>et</strong> les parents avaient<br />
eu recours à de l'aide pour s'occuper des problèmes de<br />
communication parent-enfant <strong>et</strong> pour exprimer des<br />
préoccupations concernant la santé mentale des enfants, c.-à-d.<br />
à propos de leurs sentiments de dépression <strong>et</strong> de colère <strong>et</strong> de<br />
leurs actes destructeurs réels ou planifiés à l'endroit d'euxmêmes<br />
ou d'autres personnes. En particulier, sur une période<br />
de 3 ans, les statistiques indiquent que parmi les 96 étudiants<br />
admissibles à recevoir des services <strong>et</strong> leurs parents, une<br />
moyenne mensuelle de 31 étudiants <strong>et</strong> parents ont reçu des<br />
services de counseling, de soutien <strong>et</strong> d'aiguillage. Les dossiers<br />
scolaires indiquent également 13 incidents pour lesquels des<br />
craintes concernant la santé de l'enfant ont motivé un aiguillage<br />
vers les autorités de la protection de l'enfance (société d'aide à<br />
l'enfance <strong>et</strong> police). D'après des enquêtes réalisées par la suite,<br />
9 familles ont reçu des services visant à réduire les problèmes<br />
entre l'enfant <strong>et</strong> les parents. Parmi les 12 étudiants qui ont été<br />
confiés aux services parce qu'ils avaient déclaré vouloir<br />
comm<strong>et</strong>tre un acte autodestructeur ou parce qu'ils avaient<br />
commis des actes destructeurs à l'égard d'eux-mêmes ou<br />
d'autres personnes, un enfant s'est suicidé à la maison.<br />
Analyse Documentaire<br />
La cause des problèmes psychosociaux a été difficile à isoler.<br />
Mis en évidence par les comportements de faible estime de soi<br />
chez les enfants <strong>et</strong> le niveau de stress élevé chez les parents, le<br />
problème a été examiné dans le cadre d'une comparaison entre<br />
ce qui avait été identifié à l'école <strong>et</strong> l'analyse que fait la<br />
documentation existante des problèmes psychosociaux courants<br />
chez les enfants Sourds <strong>et</strong> leurs parents. Si l'on se fonde sur les<br />
connaissances actuelles au suj<strong>et</strong> de l'importance des<br />
communications dans le fonctionnement des familles, les écrits<br />
montrent un lien entre les sentiments de refus <strong>et</strong> de honte<br />
comme facteurs contributifs à la difficulté d'accepter la<br />
déficience <strong>et</strong> de s'y adapter (Desselle, 1994; Jones, 1995;<br />
Koester <strong>et</strong> Meadow-Orlans, 1990; Watson, Henggeler <strong>et</strong>
Whelan, 1990). La négation de la perte d'audition <strong>et</strong> sa<br />
désignation en tant que handicap peuvent mener à des<br />
problèmes d'insuffisance ou d'excès de participation de la part<br />
des parents <strong>et</strong> des pairs qui peuvent avoir des conséquences<br />
sur le fonctionnement émotionnel <strong>et</strong> social de l'enfant<br />
(Backenroth, 1993; Hadadian <strong>et</strong> Rose, 1991; Krauss, 1993).<br />
Toth (2000) s'est penchée sur les obstacles perçus par les<br />
parents dans leurs communications <strong>et</strong> résolutions de problèmes<br />
avec leurs enfants Sourds, <strong>et</strong> sur la façon dont les services de<br />
soutien scolaires sont appréciés. Les données obtenues dans le<br />
cadre d'une évaluation ultérieure des besoins, laquelle incluait<br />
un examen des dossiers scolaires, des entrevues directes <strong>et</strong> la<br />
complétion, par les enfants Sourds, leurs parents <strong>et</strong> les<br />
enseignants, du questionnaire de Gresham <strong>et</strong> Elliott (1990) sur<br />
les aptitudes sociales, appuyaient les rapports non scientifiques<br />
formulés par le même groupe de participants lors de ses<br />
réunions annuelles de planification de l'enseignement individuel<br />
(Toth, 2000). La recherche conclut que les problèmes de<br />
frustration <strong>et</strong> de honte qui se posent lorsqu'on constate qu'un<br />
enfant ne peut ni comprendre ni reproduire le langage de ses<br />
parents ou de la majorité de la population <strong>et</strong> qu'il doit<br />
communiquer au moyen d'un langage faisant appel aux gestes<br />
<strong>et</strong> à la vision, comme le langage gestuel, étaient perçus comme<br />
des obstacles à la bonne communication entre les parents <strong>et</strong> les<br />
enfants (Jacobs,1989; Ormerod <strong>et</strong> Huebner, 1988).<br />
Étant donné que l'on peut s'attendre à ce que seulement 10 %<br />
de la population soit atteinte de surdité congénitale (Sacks,<br />
1990) <strong>et</strong> vu qu'au moins 90 % des enfants sourds ont des<br />
parents entendants (Carver, 1989; Desselle, 1994; Drasgow,<br />
1998; Padden <strong>et</strong> Humphries, 1988; Ritter-Brinton <strong>et</strong> Stewart,<br />
1992), il se peut que les parents se sentent isolés relativement<br />
à leur capacité d'établir des relations avec les autres parents de<br />
leur communauté <strong>et</strong> mal à l'aise lorsqu'ils suivent des cours de<br />
langage gestuel avec des inconnus provenant d'une autre<br />
communauté. Puisqu'il est possible que le langage gestuel ne<br />
soit pas le premier langage des parents ou de l'enfant (Cerney,<br />
1995; Drasgow, 1998), la majorité des parents devront<br />
l'apprendre en même temps que leurs enfants. L'intensité ainsi<br />
accrue de la perception que leurs enfants ne sont pas normaux<br />
<strong>et</strong> que l'acquisition d'un autre langage constitue une tâche<br />
ardue peut poser d'autres obstacles à un système de<br />
communication déjà compromis.<br />
Même si l'on<br />
pourrait alléguer<br />
que la surdité est<br />
un handicap<br />
invisible (Hadadian<br />
<strong>et</strong> Rose, 1991), le<br />
langage gestuel, de<br />
par sa visibilité,<br />
marque son<br />
utilisateur.<br />
À mesure que l'on continue<br />
d'éprouver des difficultés de<br />
communication sans les<br />
résoudre, la perception<br />
négative de la surdité (SKI-HI<br />
Institute, 1996) <strong>et</strong> les<br />
comportements inappropriés<br />
peuvent accroître les niveaux<br />
de stress <strong>et</strong> diminuer encore<br />
davantage la capacité des<br />
familles à nourrir un sentiment<br />
positif d'estime de soi <strong>et</strong> à<br />
réduire le niveau de stress par la résolution des problèmes<br />
(Desselle, 1994; Jones, 1995; Pisterman <strong>et</strong> al ., 1992). Même si<br />
l'on pourrait alléguer que la surdité est un handicap invisible
(Hadadian <strong>et</strong> Rose, 1991), le langage gestuel, de par sa<br />
visibilité, marque son utilisateur. Dans leur tentative pour faire<br />
face au stigma associé au handicap, les parents peuvent rej<strong>et</strong>er<br />
l'apprentissage du langage gestuel <strong>et</strong> limiter la formation de<br />
leur enfant à l'apprentissage de la parole seulement ou à<br />
l'utilisation d'appareils fonctionnels de communication (Grimes<br />
<strong>et</strong> Prick<strong>et</strong>t, 1988).<br />
Comme on le note dans la documentation existante, le stress<br />
associé à l'éducation d'un enfant atteint d'un handicap, laquelle<br />
exige, pour communiquer avec lui <strong>et</strong> résoudre les problèmes qui<br />
se posent, d'adapter non seulement l'environnement de<br />
l'enfant, mais aussi les capacités de ses fournisseurs de soins,<br />
nuit énormément au développement de relations saines <strong>et</strong><br />
normales entre parents <strong>et</strong> enfants (Lederberg, 1993; McBride,<br />
1989; Meadows-Orlans, 1994; Preston, 1995; Sexton <strong>et</strong> al.,<br />
1992). Non seulement l'estime de soi de l'enfant mais aussi le<br />
fonctionnement familial peuvent être touchés par la perception<br />
d'incapacité de communiquer de façon significative qu'ont les<br />
membres de la famille (Lane, 1988; Vaccari <strong>et</strong> Marschark,<br />
1997; Watson, Henggeler <strong>et</strong> Whelan, 1990). Pour aplanir c<strong>et</strong>te<br />
difficulté, les stratégies de communication entre les parents <strong>et</strong><br />
leurs enfants Sourds peuvent donc inclure l'utilisation d'un<br />
langage gestuel <strong>et</strong> le recours à un adulte modèle Sourd, mais<br />
aussi l'utilisation, par les familles, d'appareils techniques, d'une<br />
langue parlée <strong>et</strong> écrite, de la lecture sur les lèvres <strong>et</strong> de<br />
l'interprétation (Calderon <strong>et</strong> Greenberg, 1993; Meadow-Orlans,<br />
Mertens <strong>et</strong> coll., 1997; Schloss <strong>et</strong> Smith, 1990).<br />
Outre les préoccupations concernant les stratégies de<br />
communication entre parents <strong>et</strong> enfants, on a comparé le degré<br />
d'inadaptation des enfants sourds par rapport aux enfants<br />
entendants de la même famille en utilisant la norme observée<br />
dans l'ensemble de la population <strong>et</strong> on a trouvé que ce degré<br />
était élevé (Hindley <strong>et</strong> coll., 1994; McEntee, 1991; Vostanis <strong>et</strong><br />
coll., 1997). De même, les problèmes d'adaptation<br />
psychosociale observés chez les enfants sourds sont des indices<br />
de faible niveau d'estime de soi, de dépression <strong>et</strong> d'actes<br />
autodestructeurs (Backenroth, 1993; Hindley <strong>et</strong> coll., 1994;<br />
Knutson <strong>et</strong> Lansing, 1990; Sam <strong>et</strong> Wright, 1988; Watt <strong>et</strong> Davis,<br />
1991).<br />
Les travaux de Manfredi (1993) <strong>et</strong> de Lederberg <strong>et</strong> Mobley<br />
(1990) concernant les répercussions psychologiques du fait<br />
d'avoir un enfant handicapé, particulièrement un enfant atteint<br />
de surdité, nous donnent une idée du soutien <strong>et</strong> du counseling<br />
nécessaires. Bien que les communications <strong>et</strong> le rapprochement<br />
interpersonnel soient des ingrédients essentiels au maintien de<br />
la santé mentale des enfants (Grimes <strong>et</strong> Prick<strong>et</strong>t, 1988; Hojat,<br />
1989; Lederberg, 1993), on ne peut pas négliger l'eff<strong>et</strong><br />
psychologique exercé sur les parents <strong>et</strong> lié au fait que leur<br />
enfant est handicapé par une perte d'audition ou par la surdité<br />
(McKellin, 1995; Vaccari <strong>et</strong> Marschark, 1997). Même si<br />
l'apprentissage d'un langage gestuel <strong>et</strong> le counseling offert par<br />
les services sociaux ne peuvent pas à eux seuls éliminer ce<br />
problème, il peut y avoir un lien entre le fait d'encourager le<br />
recours aux mesures de soutien <strong>et</strong> les conclusions soulignées<br />
par Bodner-Johnson (1991) <strong>et</strong> Desselle (1994) au suj<strong>et</strong> des<br />
parents qui font montre de sincérité dans la recherche d'une<br />
méthode perm<strong>et</strong>tant d'avoir des communications significatives
avec leur enfant.<br />
Il est normal de s'attendre à ce que les communications entre<br />
les parents <strong>et</strong> les enfants soient difficiles de temps en temps.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a un obstacle supplémentaire à la<br />
communication, dû notamment à la surdité, la capacité de<br />
résoudre les problèmes peut également être déficiente (Knutson<br />
<strong>et</strong> Lansing, 1990; Yachnik, 1986) <strong>et</strong> se traduire par un mauvais<br />
fonctionnement des relations parentales <strong>et</strong> sociales (Pearce,<br />
1993; Wallander, Pitt <strong>et</strong> Mellins, 1990).<br />
Méthodologie<br />
Le proj<strong>et</strong> de recherche avait pour obj<strong>et</strong> d'étudier les problèmes<br />
psychosociaux mis en évidence par les comportements de faible<br />
estime de soi observés chez les enfants <strong>et</strong> les hauts niveaux de<br />
stress observés chez les parents <strong>et</strong> d'appliquer une stratégie de<br />
saine résolution des problèmes <strong>et</strong> d'amélioration des<br />
communications.<br />
Étant donné que l'on tentait d'obtenir un changement, c'est-àdire<br />
la réduction du nombre de cas de violence envers les<br />
enfants <strong>et</strong> de l'intensité des sentiments de dépression ou de<br />
colère <strong>et</strong> d'actes autodestructeurs chez les enfants étudiés, on<br />
s'attendait, lorsqu'on a évalué les niveaux d'estime de soi, à ce<br />
que les enfants obtiennent un plus grand nombre de scores<br />
compris dans la gamme normale <strong>et</strong> à ce que les parents<br />
rapportent des niveaux de stress faisant également partie de la<br />
gamme normale, celles-ci étant établies selon des échelles<br />
normalisées.<br />
Vu que le groupe comprenait 96 étudiants (de la maternelle au<br />
deuxième cycle du secondaire) <strong>et</strong> leurs parents — qui étaient<br />
admissibles à des programmes d'acquisition de compétences<br />
sociales dispensés par l'école <strong>et</strong> qui avaient fait l'obj<strong>et</strong> d'une<br />
enquête visant à évaluer leurs besoins — le nombre de<br />
participants possible aurait pu être de 237. Conformément aux<br />
résultats d'autres chercheurs, selon lesquels le taux de réponse<br />
aux documents de collecte de données a tendance à être<br />
inférieur à 100 % (Gall, Borg <strong>et</strong> Gall, 1996), parmi les 40<br />
parents qui ont exprimé la volonté que leur enfant participe à<br />
un programme, seulement 28 ont accepté l'invitation à remplir<br />
les questionnaires, malgré les l<strong>et</strong>tres de relance, les appels<br />
téléphoniques <strong>et</strong> les offres d'appel téléphonique individuel ou<br />
d'entrevue à la maison. Même si ce groupe plus restreint a pu<br />
être davantage motivé à recourir au programme pour ses<br />
enfants, il reste que 14 parents <strong>et</strong> 14 enfants ont accepté de<br />
participer aux programmes proposés.<br />
Grâce à l'évaluation des besoins, qui incluait du travail<br />
exploratoire effectué en groupe auprès des enfants ainsi que<br />
des consultations tenues avec une équipe chargée du proj<strong>et</strong> de<br />
recherche <strong>et</strong> composée d'administrateurs de l'école,<br />
d'enseignants, de conseillers des résidences <strong>et</strong> de personnel<br />
chargé des ressources, on a obtenu un appui relatif à la<br />
réalisation d'un programme visant à tenir compte des<br />
préoccupations identifiées <strong>et</strong> à établir un lien avec ce que les<br />
parents eux-mêmes ont déclaré souhaiter pouvoir enseigner à<br />
leur enfant. On s'est rendu compte qu'il y avait possibilité, grâce
…parmi les 40<br />
parents qui ont<br />
exprimé la volonté<br />
que leur enfant<br />
participe à un<br />
programme,<br />
seulement 28 ont<br />
accepté l'invitation<br />
à remplir les<br />
questionnaires…<br />
aux liens positifs existants, de<br />
faire participer les enfants à<br />
l'application significative, dans<br />
tous les vol<strong>et</strong>s de leur vie, des<br />
aptitudes sociales qu'ils<br />
devaient apprendre.<br />
Afin de connaître à fond l'eff<strong>et</strong><br />
de l'intervention, on a eu<br />
recours à une approche faisant<br />
appel à un pré-test <strong>et</strong> à un<br />
post-test. On a administré les pré-tests <strong>et</strong> les post-tests en<br />
utilisant des échelles normalisées perm<strong>et</strong>tant de déterminer les<br />
niveaux d'estime de soi des étudiants <strong>et</strong> de stress des parents.<br />
Les enfants ont été testés à l'aide de l'indice d'estime de soi<br />
(Brown <strong>et</strong> Alexander, 1991), <strong>et</strong> les parents, à l'aide de l'indice<br />
du stress parental (Abidin, 1995). Comme le document de<br />
consentement distribué à chaque parent avant la mise en<br />
oeuvre du proj<strong>et</strong> de recherche le garantissait, la confidentialité<br />
a été maintenue au moment de la détermination <strong>et</strong> de la<br />
mesure des résultats du proj<strong>et</strong> de recherche.<br />
Un programme d'acquisition de compétences en<br />
communications sociales a été conçu d'après la documentation<br />
existante (Henderson <strong>et</strong> Hendershott, 1991; Toth, 2000).<br />
Servant de pont entre l'école <strong>et</strong> le foyer, entre les Sourds <strong>et</strong> les<br />
entendants ainsi qu'entre les enfants <strong>et</strong> les parents, le<br />
programme a été créé pour fournir une formation <strong>et</strong> un soutien<br />
systémiques favorisant les saines relations. Les discussions<br />
tenues dans le cadre de travaux individuels <strong>et</strong> en groupe<br />
réalisés auprès des étudiants, des parents, des enseignants <strong>et</strong><br />
des conseillers des résidences ont porté principalement sur<br />
l'acquisition de compétences liées à la saine résolution des<br />
problèmes <strong>et</strong> aux communications sociales. Des documents<br />
basés sur les travaux de Gajewski <strong>et</strong> Mayo (1989) ont été<br />
utilisés en tant que feuilles de travail <strong>et</strong> comme devoirs <strong>et</strong><br />
distribués aux étudiants entre les ateliers, lesquels étaient<br />
divisés en trois blocs de huit semaines répartis sur une période<br />
de huit mois. Après avoir distribué des copies de ces mêmes<br />
documents aux parents, aux enseignants <strong>et</strong> aux conseillers des<br />
résidences, on a demandé à ces personnes de les utiliser à titre<br />
de référence dans leur travail avec les étudiants, pour fournir à<br />
l'auteure des observations pouvant servir dans le cadre d'autres<br />
enseignements destinés aux étudiants <strong>et</strong> pour appuyer<br />
davantage les parents <strong>et</strong> les conseillers des résidences. Étant<br />
donné que son but était d'en arriver à un changement qui ferait<br />
que, dans le cadre des tests sur les niveaux d'estime de soi <strong>et</strong><br />
de stress, les enfants <strong>et</strong> les parents obtiendraient un nombre<br />
accru de scores faisant partie de la gamme normale, c<strong>et</strong>te<br />
approche systémique a bien rempli sa fonction au chapitre de<br />
l'information <strong>et</strong> de l'orientation du plan d'application.<br />
Reconnaissant que chaque enfant <strong>et</strong> chaque parent avaient des<br />
capacités <strong>et</strong> des besoins différents, l'auteure a adapté les<br />
stratégies de façon à ce qu'elles aplanissent les difficultés<br />
particulières de communication <strong>et</strong> de résolution de problèmes<br />
qui avaient été déterminées relativement aux parents <strong>et</strong> aux<br />
enfants (Desselle, 1994). Les séances tenues avec l'auteure ont<br />
été utilisées comme base pour l'évaluation, l'enseignement des<br />
compétences en communications sociales <strong>et</strong> la prise en compte
des problèmes psychosociaux à mesure qu'ils se posaient chez<br />
les enfants <strong>et</strong> leurs fournisseurs de soins. Ainsi, suivant les<br />
recommandations des autorités compétentes du domaine de la<br />
surdité, pour concevoir le programme, on a mis à profit les<br />
points forts des outils de communication existants, notamment<br />
les appareils techniques, les services d'interprétation <strong>et</strong><br />
l'utilisation de langages gestuels, écrits <strong>et</strong> verbalisés (Calderon<br />
<strong>et</strong> Greenberg, 1993).<br />
On a jugé que l'inclusion de personnel travaillant dans des<br />
programmes spécialisés de soutien du comportement — un<br />
camp d'été en informatique <strong>et</strong> un programme de tutorat pour<br />
les Sourds — constituait une façon efficace d'atteindre le but du<br />
programme en dehors des périodes de cours régulières. Après<br />
des discussions tenues avec les parents <strong>et</strong> les étudiants, on en<br />
est venu à une entente au suj<strong>et</strong> d'un programme à la maison<br />
(c'est-à-dire l'envoi hebdomadaire à la maison de documents<br />
destinés aux enfants <strong>et</strong> aux parents) qu'ils pourraient suivre à<br />
leur propre rythme durant la période estivale. Sanctionnés par<br />
le directeur des programmes <strong>et</strong> le directeur de l'école, ces<br />
documents ont été diffusés au personnel chargé de ces<br />
programmes auxiliaires, <strong>et</strong> la stratégie de résolution des<br />
problèmes qu'ils décrivaient a été appliquée.<br />
Afin de m<strong>et</strong>tre le programme en application, les parents <strong>et</strong> le<br />
personnel ont accepté de renforcer ce que les enfants<br />
apprenaient en groupe ou dans le cadre du travail individuel<br />
effectué en présence de la travailleuse sociale. Après avoir reçu<br />
les copies des leçons utilisées <strong>et</strong> des devoirs distribués, les<br />
parents <strong>et</strong> le personnel qui avaient des contacts avec les<br />
enfants ont reçu une formation sur l'utilisation de ces<br />
documents <strong>et</strong> ont appliqué les idées qu'on y exposait aux<br />
interactions avec les enfants. En conformité avec ce que les<br />
enfants apprenaient dans le cadre du programme d'acquisition<br />
de compétences en communications sociales, c<strong>et</strong> ajout au plan<br />
d'application a servi non seulement à renforcer leur<br />
apprentissage, mais aussi à élargir le cercle de soutien qui<br />
favorisait les saines relations avec les adultes qui jouent un rôle<br />
important dans la vie des enfants.<br />
Un soutien aux enfants Sourds a également été fourni grâce à<br />
des services de counseling offerts aux individus, aux groupes de<br />
pairs, aux parents <strong>et</strong> à la famille dans le contexte de l'école <strong>et</strong><br />
du foyer familial. En accord avec Vaccari <strong>et</strong> Marschark (1997),<br />
selon lesquels la question des communications est cruciale pour<br />
tout travail impliquant des enfants Sourds <strong>et</strong> leurs parents, on a<br />
encouragé le recours à des programmes prouvés efficaces,<br />
comme les programmes d'apprentissage d'un langage gestuel <strong>et</strong><br />
d'encadrement des personnes sourdes offerts par l'école.<br />
En s'inspirant des travaux de Calderon <strong>et</strong> Greenberg (1993), on<br />
a porté notre attention sur les difficultés personnelles ou<br />
familiales des parents afin d'étudier le problème de la présence<br />
aux réunions d'information, aux ateliers ou aux séances de<br />
counseling. Bien que l'intention de participer ait pu être sincère,<br />
on a trouvé que les préoccupations connexes telles que les<br />
relations matrimoniales, le soin d'autres enfants à la maison <strong>et</strong><br />
les pressions financières ou dues à l'emploi constituaient des<br />
facteurs contributifs à ce problème.
Outre les services fournis directement par le personnel de<br />
l'école <strong>et</strong> les responsables des programmes, l'auteure a travaillé<br />
étroitement avec le directeur des programmes de l'école ainsi<br />
qu'avec le personnel chargé des ressources, celui de l'école <strong>et</strong><br />
celui des résidences de telle sorte que les services sociaux ont<br />
pu contribuer à aider les parents à accéder aux services<br />
communautaires. Bien qu'il soit devenu évident que les lacunes<br />
dans les services communautaires offerts aux enfants Sourds <strong>et</strong><br />
à leurs parents étaient une réalité qui ne pouvait pas être<br />
résolue simplement par l'application d'un programme<br />
d'acquisition de compétences en communications sociales, le<br />
fait d'établir des liens avec les personnes chargées des<br />
ressources, de l'éducation <strong>et</strong> du lobbying a néanmoins constitué<br />
un exercice utile.<br />
Résultats<br />
Dans un effort pour réduire les risques d'incidence de problèmes<br />
psychosociaux chez les enfants Sourds, une stratégie de saine<br />
résolution des problèmes a été mise en application. Les données<br />
recueillies au début <strong>et</strong> à la fin de la période d'application ont<br />
servi à enregistrer les cas d'actes de violence, les cas signalés<br />
par l'école aux autorités de la protection de l'enfance en raison<br />
de craintes que des actes de violence soient commis envers les<br />
enfants, les sentiments de dépression <strong>et</strong> de colère exprimés <strong>et</strong><br />
les comportements destructeurs à l'endroit de soi-même ou<br />
d'autres personnes ; elles ont également servi à identifier la<br />
participation des parents <strong>et</strong> des enfants aux séances de groupe.<br />
En ce qui concerne les rapports <strong>et</strong> les aiguillages effectués dans<br />
le cas des étudiants aux prises avec des problèmes<br />
psychosociaux, tels qu'un faible niveau d'estime de soi ou la<br />
dépression, on a noté une réduction du nombre moyen<br />
d'aiguillages, qui est passé de 31 par mois durant les trois<br />
dernières années à 23 par mois pour les 8 derniers mois.<br />
Comparativement aux 12 étudiants qui ont été aiguillés vers<br />
des services en raison de menaces d'autodestruction ou d'actes<br />
destructeurs commis à l'égard d'eux-mêmes ou d'autres<br />
personnes au cours des 3 dernières années, seulement 2<br />
étudiants ont fait l'obj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te mesure au cours des 8<br />
derniers mois suite à des menaces d'autodestruction. Aucun<br />
étudiant n'a tenté de comm<strong>et</strong>tre ou n'a commis de suicide<br />
durant c<strong>et</strong>te dernière période. En outre, bien qu'on ait dû faire<br />
13 rapports aux autorités de la protection de l'enfance durant<br />
les 3 dernières années, seulement 2 situations ont justifié c<strong>et</strong>te<br />
mesure durant les 8 derniers mois, période de mise en<br />
application du programme.<br />
Les résultats tirés des réponses fournies par les 14 parents<br />
ayant subi le pré-test sur l'ISP (Abidin, 1995) <strong>et</strong> par les 14<br />
enfants qui ont subi le pré-test sur l'IES (Brown <strong>et</strong> Alexander,<br />
1991) ont été comparés avec les résultats des post-tests. Dans<br />
le cas des parents participant au proj<strong>et</strong> de recherche, les scores<br />
pré-application ont indiqué la présence de stress, car 9 parents<br />
ont obtenu des scores supérieurs au niveau normal, <strong>et</strong> 5<br />
parents des scores normaux. Aucun des parents n'a obtenu de<br />
scores inférieurs au niveau normal. Ces résultats ont été<br />
comparés aux réponses obtenues après l'application du<br />
programme, où l'on a constaté que 7 parents ont obtenu des<br />
scores faisant partie du niveau normal susmentionné <strong>et</strong> 7
parents ont obtenu des scores indiquant un niveau normal de<br />
stress selon les mêmes échelles.<br />
En ce qui concerne les scores obtenus pour l'estime de soi, l'IES<br />
(Brown <strong>et</strong> Alexander, 1991) a fourni une évaluation du niveau<br />
d'estime de soi signalé par les 14 étudiants, dont l'âge variait<br />
entre 10 <strong>et</strong> 18 ans. D'après les échelles d'estimation du niveau<br />
global d'estime de soi, 7 étudiants ont obtenu des scores faisant<br />
partie de la gamme normale tandis que les 7 autres ont obtenu<br />
des scores inférieurs à la normale. Ces résultats ont été<br />
comparés avec les réponses obtenues après l'application du<br />
programme, où l'on a constaté que 3 étudiants ont obtenu des<br />
scores au-dessus de la gamme normale, que 9 étudiants ont<br />
obtenu des scores normaux <strong>et</strong> que 2 étudiants ont obtenu des<br />
scores inférieurs à la normale.<br />
Dans un dernier<br />
effort pour obtenir<br />
des observations,<br />
on a demandé aux<br />
participants de<br />
répondre à un<br />
questionnaire postapplication.<br />
Dans un dernier effort pour<br />
obtenir des observations, on a<br />
demandé aux participants de<br />
répondre à un questionnaire<br />
post-application. Bien que<br />
c<strong>et</strong>te activité n'ait pas été prise<br />
en compte en tant que résultat<br />
spécifique, on a considéré que<br />
les réponses reçues étaient<br />
représentatives du succès ou<br />
de l'échec globaux du proj<strong>et</strong> de recherche aux yeux des<br />
participants. Nous avons constaté que les participants avaient le<br />
sentiment que l'entente mutuelle conclue entre l'auteure, les<br />
parents, les enfants <strong>et</strong> l'école avait été respectée. Nous avions<br />
établi une relation fonctionnelle qui a été facilitée par des<br />
communications téléphoniques ou par téléscripteur, par des<br />
observations écrites formulées dans des l<strong>et</strong>tres ou des articles<br />
de bull<strong>et</strong>ins <strong>et</strong> par des rencontres directes tenues sur demande<br />
ou planifiées. Non seulement les parents <strong>et</strong> les étudiants ont-ils<br />
porté attention à la réalisation des objectifs de l'expérience,<br />
mais ils ont aussi exprimé le désir de résoudre leurs problèmes<br />
pour bien se sentir <strong>et</strong> être en mesure de gérer leur stress sans<br />
se blesser ou blesser les autres.<br />
D'après les réponses au questionnaire, 10 des 14 parents sont<br />
d'avis que la participation au programme d'acquisition de<br />
compétences en communications sociales a exercé un eff<strong>et</strong><br />
positif sur eux-mêmes <strong>et</strong> sur leurs enfants; 2 parents estiment<br />
que le programme a eu un eff<strong>et</strong> positif sur leur enfant <strong>et</strong> que<br />
eux sont demeurés à peu près les mêmes. Seulement un des<br />
parents a estimé que sa participation n'a influé ni positivement<br />
ni négativement sur lui ou sur son enfant. À partir des réponses<br />
des enfants, un comptage a déterminé que tous les étudiants<br />
pensent que leur participation au programme les a aidés (dans<br />
une plus ou moins grande mesure) à résoudre les problèmes<br />
qu'ils connaissent avec leurs parents, leurs enseignants <strong>et</strong> leurs<br />
pairs.<br />
Les données précédentes offrent un aperçu des difficultés dont<br />
on a tenu compte, des innovations appliquées <strong>et</strong> des méthodes<br />
de résolution de problèmes mises en oeuvre en vue de réduire<br />
les risques de problèmes psychosociaux chez les enfants<br />
Sourds. Les résultats indiquent que le but du proj<strong>et</strong> de<br />
recherche a été atteint. En eff<strong>et</strong>, étant donné les changements
constatés, soit la réduction du nombre de rapports d'actes de<br />
violence à l'égard des enfants, <strong>et</strong> la baisse des sentiments de<br />
dépression ou de colère <strong>et</strong> des actes autodestructeurs signalés<br />
chez les enfants étudiés, tant les enfants que les parents,<br />
lorsqu'on les a soumis respectivement à des tests d'évaluation<br />
de l'estime de soi <strong>et</strong> du stress, ont présenté une augmentation<br />
de leurs scores faisant partie de la gamme normale.<br />
Discussion<br />
Même si la création de tous les services de soutien<br />
recommandés par les intervenants ne faisait pas partie des<br />
objectifs du proj<strong>et</strong> de recherche, étant donné que celui-ci visait<br />
à obtenir des données, appuyer les éléments fonctionnels <strong>et</strong><br />
attirer l'attention sur les éléments qui doivent encore être<br />
améliorés, il a été considéré comme ayant atteint son but <strong>et</strong><br />
comme une amorce à la collecte d'information <strong>et</strong> à l'orientation<br />
des activités futures de résolution de problèmes. Grâce à<br />
l'application de ce proj<strong>et</strong>, les parents ont été informés du<br />
soutien <strong>et</strong> du counseling dont eux-mêmes ou leurs enfants<br />
pourraient (ou devraient) disposer pour faire face aux<br />
problèmes de stress <strong>et</strong> d'estime de soi, en langage gestuel ou<br />
verbal, par l'entremise de l'école ou dans la communauté. Outre<br />
qu'elle a recueilli des données à partir de l'évaluation des<br />
besoins effectuée avant l'application du programme <strong>et</strong> auprès<br />
des représentants des intervenants – enfants, parents <strong>et</strong><br />
personnel – l'auteure a tenté de faciliter l'établissement d'un<br />
consensus à propos des moyens grâce auxquels les priorités<br />
choisies pouvaient être réalisées.<br />
Bien que les problèmes de stress chez les parents <strong>et</strong> d'estime<br />
de soi chez les enfants Sourds puissent ne pas être résolus par<br />
la mise en oeuvre des stratégies de résolution de problèmes<br />
susmentionnées, on considère que le risque de problèmes<br />
psychosociaux a été réduit étant donné qu'on a prouvé<br />
l'existence d'un changement, mis en évidence par la réduction,<br />
chez les étudiants étudiés, du nombre de rapports d'actes de<br />
violence commis à leur égard, des sentiments de dépression ou<br />
de colère <strong>et</strong> d'actes destructeurs à l'endroit d'eux-mêmes ou<br />
d'autres personnes. Il demeure toutefois nécessaire d'effectuer<br />
d'autres évaluations <strong>et</strong> d'autres traitements psychosociaux pour<br />
les enfants Sourds <strong>et</strong> leurs parents dans le cadre d'autres<br />
proj<strong>et</strong>s de recherche.<br />
Conclusion<br />
Après avoir examiné les observations fournies par les<br />
participants au proj<strong>et</strong>, il est devenu évident qu'il n'existe pas de<br />
solution unique à la réduction des risques de problèmes<br />
psychosociaux chez les enfants Sourds. Bien qu'on ait trouvé<br />
utile de rendre disponibles des programmes d'apprentissage de<br />
langages, de résolution de problèmes <strong>et</strong> de sensibilisation aux<br />
défis que suscite la surdité, la simple participation à ces<br />
programmes n'est pas suffisante. En traitant ce problème dans<br />
une perspective systémique, il est devenu clair que les efforts<br />
concertés de la part des parents <strong>et</strong> des enfants, que le soutien<br />
fourni par d'autres familles, les enseignants, les pairs <strong>et</strong> les<br />
services communautaires <strong>et</strong> que le recours au counseling visant<br />
à résoudre les questions de santé mentale sous-jacentes sont<br />
également importantes si l'on veut obtenir des changements.
Grâce aux changements notés relativement à la réduction du<br />
nombre de cas de violence à l'égard des enfants, de sentiments<br />
de dépression ou de colère <strong>et</strong> d'actes destructeurs à l'égard de<br />
soi-même ou d'autres personnes, il a été établi, tant chez les<br />
parents que chez les enfants, que ceux-ci présentaient une<br />
augmentation des scores faisant partie de la gamme normale<br />
lorsqu'ils ont subi des tests d'évaluation des niveaux de stress<br />
<strong>et</strong> d'estime de soi. Même si les circonstances qui appuient<br />
chaque relation parent-enfant ou qui nuisent à c<strong>et</strong>te relation<br />
peuvent être très différentes, c'est dans une attitude de respect<br />
envers tous les parents <strong>et</strong> les enfants qui trouvent le moyen de<br />
communiquer avec succès que la responsable du présent proj<strong>et</strong><br />
de recherche formule sa conclusion.<br />
Après que l'on a reconnu la difficulté de garantir des services<br />
communautaires aux enfants Sourds <strong>et</strong> à leurs parents,<br />
l'importance de la relation parent-enfant a été mise en<br />
évidence. Les services communautaires, peu importe leur degré<br />
de développement, ne peuvent jamais – <strong>et</strong> ne devraient jamais<br />
– remplacer la relation fondamentale entre le parent <strong>et</strong> l'enfant.<br />
Ce que nous avons appris dans le cadre du proj<strong>et</strong> de recherche<br />
expose davantage que les mots l'importance d'aider les enfants,<br />
les parents <strong>et</strong> les autres fournisseurs de soins à trouver des<br />
façons de communiquer, de résoudre les problèmes <strong>et</strong> d'être<br />
bien dans sa peau. Ce n'est que dans ces conditions que les<br />
risques de problèmes psychosociaux chez les enfants Sourds<br />
pourront être réduits.<br />
Références<br />
Abidin, R. (1995). Parenting stress index (3 e éd.), Odessa, FL,<br />
Psychological Assessment Resources.<br />
Backenroth, G. (1993). « Loneliness in the deaf community: A<br />
personal or an enforced choice? », dans International Journal of<br />
Rehabilitation Research, 16, 331-336.<br />
Bodner-Johnson, B. (1991). « Family conversation style: Its<br />
effect on the deaf child's participation », dans Exceptional Child,<br />
57 (6), 502-509.<br />
Brown, L. <strong>et</strong> J. Alexander (1991). Self-esteem index, Austin, TX,<br />
Pro-Ed.<br />
Calderon, R. <strong>et</strong> M. Greenberg (1993). « Considerations in the<br />
adaptation of families with school-aged deaf children », dans M.<br />
Marschark and M. Clark (Eds.), Psychological perspectives on<br />
deafness, (pp. 27-47). Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum<br />
Associates.<br />
Carver, R. (1989). Deaf illiteracy: A genuine educational puzzle<br />
or an instrument of oppression? A critical review, Edmonton,<br />
University of Alberta.<br />
Cerney, B. (1995, July). Language acquisition, language<br />
teaching, and the interpr<strong>et</strong>er as a model for language input.<br />
Document présenté à la convention nationale du Registry of
Interpr<strong>et</strong>ers for the Deaf, New Orleans, LA.<br />
Desselle, D. (1994). «Self-esteem, family climate, and<br />
communication patterns in relation to deafness », dans<br />
American Annals of the Deaf, 139, 322-328<br />
Drasgow, E. (1998). «American sign language as a pathway to<br />
linguistic comp<strong>et</strong>ence », dans Exceptional Children, 64 (3), 329-<br />
342.<br />
Gall, M., W. Borg <strong>et</strong> J. Gall (1996). Educational research: An<br />
introduction (6 e éd.), White Plains, NY, Longman.<br />
Gajewski, N. <strong>et</strong> P. Mayo (1989). SSS: Social skill strategies, Eau<br />
Claire, WI, Thinking Publications.<br />
Gresham, F. <strong>et</strong> S. Elliot (1990). Social skills rating system,<br />
Circle Pines, MN, American Guidance Service, Inc.<br />
Grimes, V. <strong>et</strong> H. Prick<strong>et</strong>t (1988). «Developing and enhancing a<br />
positive self-concept in deaf children », dans American Annals of<br />
the Deaf, 133, 255-257.<br />
Hadadian, A. <strong>et</strong> S. Rose (1991). « An investigation of parents<br />
attitude and the communication skills of their deaf children »,<br />
American Annals of the Deaf, 136, 273-277.<br />
Henderson, D. <strong>et</strong> A. Hendershott (1991). « ASL and the family<br />
system », American Annals of the Deaf, 136, 325-329.<br />
Hern, G. (1979). « General systems theory and social work »,<br />
dans F.J. Turner (Ed.), Social work treatment: Interlocking<br />
theor<strong>et</strong>ical perspectives (2 e éd., pp. 333-359), New York, The<br />
Free Press.<br />
Hindley, P., <strong>et</strong> coll. (1994). «Psychiatric disorder in deaf and<br />
hearing impaired children and young people: A prevalence study<br />
», dans Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35 (5), 917-<br />
934<br />
Hojat, M. (1989). « A psychodynamic view of loneliness and<br />
mother-child relationships », dans M. Hojat and R. Crandall<br />
(Eds.), Loneliness: Theory, research, and applications (pp. 89-<br />
104), Newbury Park, CA, Sage Publications, Inc.<br />
Jacobs, L. (1989). A deaf adult speaks out, Washington,<br />
Gallaud<strong>et</strong> University Press.<br />
Jones, E. (1995). « Deaf and hearing parents' perceptions of<br />
family functioning », dans Nursing Research, 44 (2), 102-105.<br />
Knutson, J. <strong>et</strong> C. Lansing (1990). «The relationship b<strong>et</strong>ween<br />
communication problems and psychological difficulties in<br />
persons with profound acquired hearing loss », dans Journal of<br />
Speech and Hearing Disorders, 55, 656-664.<br />
Koester, L. <strong>et</strong> K. Meadow-Orlans (1990). « Parenting a deaf
child: Stress, strength, and support », dans D. Moores and K.<br />
Meadow-Orlans (Eds.), Educational and developmental aspects<br />
of deafness (pp. 299-320), Washington, DC, Gallaud<strong>et</strong><br />
University Press.<br />
Krauss, M. (1993). «Child-related and parenting stress:<br />
Similarities and differences b<strong>et</strong>ween mothers and fathers of<br />
children with disabilities », dans American Journal of Mental<br />
R<strong>et</strong>ardation, 97, 393-404.<br />
Lane, H. (1988). «Is there a psychology of the deaf'? », dans<br />
Exceptional Children, 55 (1), 7-19.<br />
Lederberg, A. (1993). « The impact of deafness on mother-child<br />
and peer relationships », dans M. Marschark and M. Clark<br />
(Eds.), Psychological perspectives on deafness (pp. 93-122).<br />
Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.<br />
Lederberg, A. <strong>et</strong> C. Mobley (1990). « The effect of hearing<br />
impairment on the quality of attachment and mother-toddler<br />
interaction », dans Child Development, 61, 1596-1604.<br />
Manfredi, M.M. (1993). « The emotional development of deaf<br />
children », dans M. Marschark and M. Clark (Eds.),<br />
Psychological perspectives on deafness, pp. 93-122, Hillsdale,<br />
NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.<br />
McBride, B. (1989). «Stress and fathers' parental comp<strong>et</strong>ence:<br />
Implications for family life and parent educators », dans Family<br />
Relations, 38, 385-389.<br />
McEntee, M. (1991). «Accessibility of mental health services and<br />
crisis intervention to the deaf », dans American Annals of the<br />
Deaf , 138, 26-30.<br />
McKellin, W. (1995). « Hearing impaired families: The social<br />
ecology of hearing loss », dans Social Science Medicine, 40<br />
(11), 1469-1480.<br />
Meadows-Orlans, K. (1994). «Stress, support, and deafness:<br />
Perceptions of infants' mothers and fathers », dans Journal of<br />
Early Intervention, 18, 91-102.<br />
Meadows-Orlans, K., <strong>et</strong> coll. (1997). « Support services for<br />
parents and their children who are deaf or hard of hearing: A<br />
national survey », dans American Annals of the Deaf, 142, 278-<br />
293.<br />
Ormerod, J. <strong>et</strong> E. Huebner (1988). « Crisis intervention:<br />
Facilitating parental acceptance of a child's handicap », dans<br />
Psychology in the Schools, 25, 422-428<br />
Padden, C. <strong>et</strong> T. Humphries (1988). Deaf in America: Voices<br />
from a culture, Cambridge, MA, Harvard University Press.<br />
Pearce, J. (1993). « Child health surveillance for psychiatric<br />
disorder: practical guidelines », dans Archives of Disease in<br />
Childhood, 69, 394-398.
Pincus, A. <strong>et</strong> A. Minahan (1973). Social work practice: Model<br />
and m<strong>et</strong>hod, Itasca, IL, F.E. Peacock.<br />
Pisterman, S., <strong>et</strong> coll. (1992). « The effects of parent training<br />
on parenting stress and sense of comp<strong>et</strong>ence », dans Canadian<br />
Journal of Behavioural Science, 24, 41-58.<br />
Preston, P. (1995). « Mother father deaf: The heritage of<br />
difference », dans Social Science Medicine, 40 (11), 1461-1467.<br />
Ritter-Brinton, K. <strong>et</strong> D. Stewart (1992). « Hearing parents and<br />
deaf children: Some perspectives on sign communication and<br />
service delivery », dans American Annals of the Deaf, 137, 85-<br />
91.<br />
Sacks, O. (1990). Seeing voices. New York: HarperCollins.<br />
Sam, A. <strong>et</strong> I. Wright (1988). « The structure of moral reasoning<br />
in hearing-impaired students », dans American Annals of the<br />
Deaf, October, 264-269.<br />
Schloss, P. <strong>et</strong> M. Smith (1990). Teaching social skills to hearingimpaired<br />
students, Washington, Alexander Graham Bell<br />
Association for the Deaf.<br />
Sexton, D., <strong>et</strong> coll. (1992). « Measuring stress in families of<br />
children with disabilities », dans Early Education and<br />
Development, 3, 60-66.<br />
SKI-HI Institute (1996). Bilingual-bicultural enhancement for<br />
infants, toddlers, and preschoolers who are deaf through deaf<br />
mentors in family-centered early home-based programming:<br />
The deaf mentor project (Proj<strong>et</strong>s expérimentaux CFDA<br />
84.024H), Logan, UT, Utah State University, Department of<br />
Communicative Disorders.<br />
Toth, A. (2000). Improving the delivery of the sign language<br />
instruction program for parents of children who are deaf and<br />
receiving services from a school for the deaf, Fort Lauderdale,<br />
FL, Nova Southeastern University (ERIC Document Reproduction<br />
Service No. ED437755).<br />
Vaccari, C. <strong>et</strong> M. Marschark (1997). « Communication b<strong>et</strong>ween<br />
parents and deaf children: Implications for social-emotional<br />
development », dans Journal of Child Psychology and<br />
Psychiatry, 38, 7, 793-801.<br />
Vostanis, P., <strong>et</strong> coll. (1997). « D<strong>et</strong>ection of behavioral and<br />
emotional problems in deaf children and adolescents:<br />
Comparison of two rating scales », dans Child Care, Health and<br />
Development, 23 (3), 233-246.<br />
Wallander, J., L. Pitt <strong>et</strong> C. Mellins (1990). « Child functional<br />
independence and maternal psychosocial stress as risk factors<br />
threatening adaptation in mothers of physically or sensorially<br />
handicapped children », dans Journal of Consulting and Clinical<br />
Psychology, 58(6), 818-824.
Watson, S., S. Henggeler <strong>et</strong> J. Whelan (1990). « Family<br />
functioning and the social adaptation of hearing-impaired<br />
youths », dans Journal of Abnormal Psychology, 18 (2), 143-<br />
163.<br />
Watt, J. <strong>et</strong> F. Davis (1991). «The prevalence of boredom<br />
proneness and depression among profoundly deaf residential<br />
school adolescents », dans American Annals of the Deaf, 136,<br />
409-413.<br />
Yachnik, M. (1986). «Self-esteem in deaf adolescents », dans<br />
American Annals of the Deaf, 131, 305-310.<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Surdité <strong>et</strong> résilience<br />
Par : Christiane Grimard (IRD, CRIR) <strong>et</strong><br />
Col<strong>et</strong>te Dubuisson (UQAM, CRIR)<br />
● Introduction<br />
● Cadre théorique<br />
❍ La résilience<br />
❍ Le traumatisme<br />
❍ Mécanismes <strong>et</strong> tuteurs de résilience<br />
❍ Méthodologie<br />
● L’isolement social <strong>et</strong> ses conséquences<br />
❍ Les mécanismes de défense utilisés<br />
❍ Mécanismes internes<br />
❍ Tuteurs de résilience<br />
● Conclusion<br />
● Références<br />
Introduction<br />
En nous basant sur les récits obtenus de personnes sourdes<br />
dans le cadre d’une recherche qualitative nous avons constaté<br />
que quelques-uns des suj<strong>et</strong>s, malgré des expériences sociales<br />
traumatisantes (rej<strong>et</strong> <strong>et</strong> isolement réel pendant de longues<br />
périodes), réussissent non seulement à dépasser ces<br />
expériences mais aussi à poursuivre leur développement.<br />
Le concept de résilience largement diffusé par Cyrulnik (2003,<br />
2002, 2001) apparaît un cadre théorique intéressant pour<br />
analyser <strong>et</strong> comprendre les données que nous avons recueillies.<br />
C’est en utilisant ce cadre que nous avons tenté de saisir<br />
comment des personnes qui vivent de fréquentes expériences<br />
de rej<strong>et</strong> <strong>et</strong> d’isolement social, pendant la période critique de<br />
l’enfance <strong>et</strong> de l’adolescence réussissent à poursuivre leur<br />
développement sans manifester de problèmes graves de santé<br />
mentale ou d’adaptation. Selon nous, ce cadre est adéquat pour<br />
décrire le récit <strong>et</strong> le développement des suj<strong>et</strong>s. Contrairement<br />
aux principes du déterminisme, il perm<strong>et</strong> de garder espoir <strong>et</strong> de<br />
donner des pistes pour solutionner des problèmes <strong>et</strong> des<br />
carences qui dépassent les capacités d’adaptation de l’individu à<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
certains moments de la vie. En eff<strong>et</strong>, il diffère du discours de la<br />
psychologie plus traditionnelle qui conçoit généralement les<br />
carences du passé comme des marques qui influencent le<br />
développement de l’individu. Les eff<strong>et</strong>s du traumatisme peuvent<br />
selon Cyrulnik (2002 : 89) laisser des traces, mais si l’enfant ou<br />
l’adolescent rencontre sur son chemin des tuteurs de résilience,<br />
le développement peut se poursuivre malgré les carences <strong>et</strong> les<br />
manques provoqués par le traumatisme. Cyrulnik (2003) utilise<br />
la métaphore du tricot pour décrire le processus de construction<br />
de la résilience: «un enfant seul n’a aucune chance de<br />
résilience. C’est pas une qualité inhérente à l’enfant, c’est une<br />
interaction, c’est une relation. Donc il faut qu’on puisse se<br />
tricoter ensemble, donc il faut être deux pour faire la résilience.<br />
Et si volontairement j’emploie un mot du quotidien, c’est que<br />
c’est très souvent dans les actes quotidiens que se tricote la<br />
résilience.»<br />
Nous croyons que des caractéristiques appartenant à la<br />
personne, mais surtout à l’environnement humain agissent<br />
comme facteurs de protection <strong>et</strong> tuteurs de résilience.<br />
Dans c<strong>et</strong>te présentation, nous décrirons tout d’abord<br />
brièvement les deux suj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> leurs expériences en lien avec les<br />
manques de communication sur le plan social. Nous<br />
présenterons ensuite le cadre théorique que nous avons choisi<br />
<strong>et</strong> les définitions en lien avec la résilience. Finalement, nous<br />
tenterons, en nous appuyant sur les récits de vie des suj<strong>et</strong>s, de<br />
faire ressortir les mécanismes internes <strong>et</strong> externes qui ont pu<br />
favoriser chez eux le développement de la résilience <strong>et</strong><br />
d’expliquer comment ils ont réussi à poursuivre leur<br />
développement.<br />
Cadre théorique<br />
Pour établir notre cadre théorique, nous avons utilisé les<br />
concepts de résilience, de traumatisme <strong>et</strong> de tuteurs de<br />
résilience.<br />
La résilience:<br />
Le terme résilience est emprunté au domaine de la physique.<br />
Dans son sens premier, il exprime la propriété de certains<br />
matériaux à résister aux chocs, par exemple l’or qui peut<br />
fondre, s’étirer, être transformé, mais qui ne casse pas. Donc<br />
résilience ne signifie pas résistance. La résilience, «est une<br />
aptitude à s’adapter <strong>et</strong> à se reformer ensuite» (Cyrulnik, 2003)<br />
alors que la résistance est ce qui peut s’appliquer jusqu’au<br />
moment ou quelque chose se brise. Il ne s’agit pas du tout de la<br />
même stratégie face au coup, «la résilience est une stratégie<br />
plus adaptative <strong>et</strong> plus évolutive» (ibid.).<br />
Résilience n’est pas non plus à confondre avec capacité d’être<br />
heureux. Selon Cyrulnik (2002 : p 50), le concept de résilience<br />
« désigne ce qui fait rebondir face aux coups <strong>et</strong> non pas une<br />
aptitude au bonheur ». Autrement dit, une personne peut être<br />
résiliente <strong>et</strong> triste.<br />
Finalement, la résilience c’est «La capacité à réussir, à vivre <strong>et</strong><br />
à se développer positivement, de manière socialement
acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité qui<br />
comportent normalement le risque grave d’une issue négative<br />
» (Vanistendael, 1998, cité par Cyrulnik, 2001)<br />
Le traumatisme<br />
Selon Cyrulnik (2003), pour qu’il y ait résilience, il doit y avoir<br />
un traumatisme. Dans le cadre de ce travail, nous considèrerons<br />
le traumatisme comme un événement qui a une forte portée<br />
émotionnelle <strong>et</strong> un impact significatif dans le fonctionnement de<br />
l’individu. Comme le précise Cyrulnik (2003), même un<br />
événement qui peut sembler bénin, comme un déménagement,<br />
peut être traumatique pour certains enfants. Cependant, «il faut<br />
deux coups pour faire un traumatisme. Le premier il est dans le<br />
réel, le deuxième il est dans la représentation du réel. […] Le<br />
premier coup dans le réel c’est la blessure, c’est l’enfant<br />
maltraité, il a mal, il est cassé, […] c’est à dire que ça fait mal<br />
<strong>et</strong> on cicatrise ou des fois on ne cicatrise pas, mais on fait sa vie<br />
avec la blessure, ça reste dans la mémoire de l’enfant.» (Freud<br />
cité par Cyrulnik, 2003),<br />
Ce qui fait traumatisme, c’est le deuxième coup. Cela peut être<br />
le récit ou l’interprétation que l’enfant se fait de ce qu’il a vécu<br />
ou encore le récit qu’il en fait à autrui. C’est alors «l’idée que<br />
l’enfant se fait de sa blessure sous votre regard. […] C’est vous,<br />
être normal, adulte normal qui transformez la blessure en<br />
traumatisme.» (Cyrulnik, 2003)<br />
Pour se protéger des traumatismes <strong>et</strong> des émotions parfois très<br />
intenses qui leur sont associées, on utilise des mécanismes<br />
internes <strong>et</strong> externes.<br />
Comme le précise Cyrulnik (2003), même un événement qui<br />
peut sembler bénin, comme un déménagement, peut être<br />
traumatique pour certains enfants. Les évènements ont une<br />
portée différente pour chaque individu en fonction du sens qu’il<br />
prend pour la personne en lien avec son histoire de vie.<br />
Mécanismes <strong>et</strong> tuteurs de résilience<br />
Cyrulnik (2003) précise que les personnes résilientes utilisent<br />
des mécanismes internes <strong>et</strong> externes qui leur perm<strong>et</strong>tent<br />
temporairement de tolérer ou d’isoler la souffrance <strong>et</strong>, à un<br />
moment donné, de l’intégrer <strong>et</strong> de poursuivre leur<br />
développement. Ces mécanismes ne correspondent pas à une<br />
faculté de l’enfant mais à « un ensemble qui se m<strong>et</strong> en place,<br />
qui a été imprégné dans l’enfant, […]. Donc, c’est pour ça que<br />
c’est plus un système qu’une faculté de l’enfant » (Cyrulnik,<br />
2003)<br />
Les mécanismes internes sont, par exemple, le langage interne<br />
(interprétation <strong>et</strong> cognitions), la capacité d’exprimer ce qui est<br />
vécu (récit) <strong>et</strong> les stratégies de défense psychologiques<br />
(négation, clivage, suppression, haine, <strong>et</strong>c.).<br />
Les mécanismes externes sont ce que Cyrulinik (2003) appelle<br />
des tuteurs de développement ou de résilience. Selon lui, ils<br />
sont bien plus simples que ce qu’on croit, ce sont « des<br />
relations affectives, […] des relations sociales, (des valeurs)
culturelles qui, lorsqu’elles sont disposées autour de l’enfant lui<br />
perm<strong>et</strong>tent de reprendre son développement ». À ceux qui<br />
disent : troubles précoces eff<strong>et</strong>s durables, Cyrulinik (2003 : 89)<br />
répond « que les troubles précoces provoquent des eff<strong>et</strong>s<br />
précoces qui peuvent durer si l’alentour familial <strong>et</strong> social en fait<br />
des récits permanents.»<br />
Quatre tuteurs de résilience nous sont apparus importants pour<br />
expliquer le comportement de nos suj<strong>et</strong>s : l’écologie familiale, la<br />
capacité de récits, le regard des autres <strong>et</strong> le discours social.<br />
L’écologie familiale<br />
Le fait de se développer, par exemple, dans un milieu familial<br />
stable, chaleureux qui favorise l’attachement <strong>et</strong> le tissage de<br />
liens, constitue un tuteur de résilience. « Il y a tout d’abord,<br />
imprégnation des ressources internes : au cours de la p<strong>et</strong>ite<br />
enfance, l’enfant sécurisé par son entourage, imprègne dans sa<br />
mémoire le fait qu’il est capable de surmonter les p<strong>et</strong>ites<br />
épreuves. C<strong>et</strong>te structure solide combinée à d’autres tuteurs de<br />
développement pourra aider à maintenir un tout cohérent face à<br />
l’événement traumatique.» Cyrulnik (2002 :)<br />
La capacité de récits<br />
Cyrulnik réfère, entre autres, au langage comme tuteur de<br />
résilience : m<strong>et</strong>tre des mots sur un évènement perm<strong>et</strong> de s’en<br />
distancer «Ce qui revient à dire que le monde change dès qu’on<br />
parle <strong>et</strong> qu’on peut changer le monde en parlant » (2001 :<br />
152). Le langage interne a le pouvoir de blesser à nouveau ou<br />
de réparer la blessure. Pour que la blessure se répare, il faut<br />
«Faire de son épreuve une confidence qui prend valeur de<br />
relation » (Cyrulnik, 2002 : 106)<br />
Cyrulnik (2002 : 90) souligne qu’il est important de « distinguer<br />
les eff<strong>et</strong>s réels du traumatisme <strong>et</strong> la représentation du<br />
traumatisme ».Autrement dit, ce qu’un individu se fait dire, se<br />
dit, ce qu’il croit ou comprend du traumatisme a le pouvoir de le<br />
blesser à nouveau ou, au contraire, de réparer les eff<strong>et</strong>s du<br />
traumatisme réel <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te représentation est fortement associée<br />
au discours social. Le récit qu’un individu se fait de son<br />
traumatisme à partir du discours ou de ses expériences sociales<br />
peut donc être un facteur de résilience.<br />
Le regard des autres<br />
Le traumatisme, comme nous l’avons vu, peut en quelque sorte<br />
se concrétiser sous le regard d’autrui. Cependant, ce regard<br />
peut aussi être un tuteur de résilience. « Le regard des autres a<br />
un pouvoir façonnant » (Cyrulnik, 2002 : 101)<br />
Il faut pouvoir dire son malheur à quelqu’un <strong>et</strong> que c<strong>et</strong> autre<br />
puisse avoir une attitude ou un regard empathique, fort,<br />
soutenant : « Il ne suffit pas de dire son malheur pour que tout<br />
soit réglé. La réaction de celui qui entend le secr<strong>et</strong> imprègne un<br />
sentiment dans le psychisme de celui qui se confie. C’est<br />
pourquoi le secr<strong>et</strong> révélé peut aussi bien provoquer un<br />
soulagement qu’une torture. » (Cyrulnik, 2002 : 169).
Le discours social<br />
Les préjugés <strong>et</strong> les stéréotypes peuvent enrayer la résilience. En<br />
fait, selon Cyrulnik (2003), c’est l’organisation sociale ellemême<br />
qui cause souvent le plus de problèmes à l’enfant<br />
traumatisé : Par contre, la prise en charge de l’enfant<br />
traumatisé peut lui perm<strong>et</strong>tre d’intégrer le traumatisme pour<br />
continuer à se développer, ou tout au moins lui offrir des<br />
explications acceptables d’évènements traumatisants. La notion<br />
de discours social fait donc appel autant à l’organisation de<br />
services qu’aux valeurs sociales qu’elle véhicule.<br />
Cyrulnik (2003) explique : « la stéréotypie sociale, le préjugé, le<br />
discours social dit : ces enfants sont blessés dans les p<strong>et</strong>ites<br />
années, donc ils sont foutus. Et pensant que ces enfants sont<br />
foutus, on leur fabrique des institutions mortes, [...] alors que si<br />
on sait que la reprise évolutive est possible, si on sait qu’après<br />
un traumatisme la vie est encore possible on va organiser, les<br />
états, les décideurs <strong>et</strong> nous, on va organiser autour de ces<br />
enfants des dispositifs bien plus simples que ce que l’on croit<br />
qui perm<strong>et</strong>tront à un bon nombre d’enfants de reprendre leur<br />
développement. »<br />
Selon Cyrulnik (2002 : 13) «La résilience constitue un processus<br />
naturel où ce que nous sommes à un moment donné doit<br />
obligatoirement se tricoter avec ses milieux écologiques,<br />
affectifs <strong>et</strong> verbaux. »<br />
Méthodologie<br />
Recueil de données<br />
Les données que nous utilisons pour c<strong>et</strong>te présentation sont un<br />
sous-ensemble du corpus recueilli dans le cadre du proj<strong>et</strong> «<br />
L’approche bilingue : vers une adaptation/réadaptation sociale<br />
optimale des Sourds du Québec », financé par le Conseil<br />
québécois de la recherche sociale. L’objectif de ce vol<strong>et</strong> du<br />
proj<strong>et</strong> était de recueillir des informations approfondies sur le<br />
vécu de la surdité, particulièrement en ce qui concerne la<br />
communication en LSQ <strong>et</strong> en français.<br />
Les données ont été recueillies sous forme d’entrevues semidirigées,<br />
touchant différents thèmes tels la vie familiale/<br />
jeunesse, le vécu scolaire, la vie familiale/adulte, le vécu social<br />
<strong>et</strong> le travail. Tous ces aspects sont abordés sous l’angle de la<br />
communication. Les entrevues que nous utilisons ici ont été<br />
menées par l’interviewer entendant, qui. a rencontré tous les<br />
suj<strong>et</strong>s entendants <strong>et</strong> les sourds oralistes qui ont choisi de faire<br />
l’entrevue en français oral.<br />
L’analyse des entrevues a été faite avec la méthode d’analyse<br />
phénoménologique utilisée en psychologie (Giorgi, 1985;<br />
Bachelor <strong>et</strong> Joshi, 1986). En eff<strong>et</strong>, nous n’avions prédéterminé<br />
aucune catégorie d’analyse <strong>et</strong> les attentes exprimées aux suj<strong>et</strong>s<br />
par l’interviewer, tout en étant stimulantes, se voulaient<br />
suffisamment larges pour leur perm<strong>et</strong>tre d’aborder leur histoire<br />
de vie comme ils le voulaient. À partir de l’analyse<br />
phénoménologique, nous avons reconstitué l’histoire de vie.
Dans c<strong>et</strong>te présentation, nous allons nous concentrer sur deux<br />
de nos suj<strong>et</strong>s : Benoît <strong>et</strong> Laurence.<br />
Benoît : Au moment de l’entrevue, Benoît est un jeune homme<br />
de 26 ans ayant une surdité profonde, de type neuro-sensoriel.<br />
Il porte des prothèses auditives, il fait une bonne lecture labiale<br />
<strong>et</strong> parle de façon claire. Il a utilisé le mode de communication<br />
oral jusqu’à ce qu’il ait 21 ans. Par la suite il a choisi le mode<br />
gestuel, ayant constaté comment ce type de communication<br />
était efficace <strong>et</strong> satisfaisant pour lui. Il est content de pouvoir<br />
s’exprimer oralement mais considère que, sur le plan social, il<br />
était désavantagé quand il n’utilisait pas le mode gestuel. Il<br />
travaille à temps partiel car il a repris ses études le soir. Il a<br />
deux frères mais il est le seul sourd de sa famille. Il vient d’un<br />
milieu aisé <strong>et</strong> a grandi en région. Son père est un homme<br />
d’affaire <strong>et</strong> sa mère a consacré toute sa vie à l’éducation de ses<br />
enfants.<br />
Laurence : Au moment de l’entrevue, Laurence est une jeune<br />
femme de 24 ans. Elle poursuit des études universitaires. Elle<br />
porte des prothèses auditives. Son reste auditif lui perm<strong>et</strong> de<br />
profiter des gains d’amplification. Au cours de son<br />
développement, elle a changé de mode de communication. Elle<br />
a commencé l’école dans une classe spécialisée en surdité. Dans<br />
c<strong>et</strong>te classe, elle apprenait la LSQ grâce aux contacts avec les<br />
autres élèves sourds. À la fin de la maternelle, elle a été<br />
intégrée dans l’école de son quartier <strong>et</strong> a grandi en mode<br />
oraliste. À la fin du secondaire, elle a recommencé à apprendre<br />
la LSQ. Laurence n’a pas de difficulté à s’exprimer oralement.<br />
Cependant sa compréhension de l’oral est difficile <strong>et</strong> lui<br />
demande beaucoup d’efforts. Elle préfère la communication<br />
signée parce qu’elle est plus efficace <strong>et</strong> qu’elle lui perm<strong>et</strong> de<br />
mieux comprendre en classe <strong>et</strong> de se faire des amis.<br />
L’isolement social <strong>et</strong> ses conséquences :<br />
Pouvons-nous parler de traumatisme dans le cas où il n’y aurait<br />
ni abus physique, ni abus sexuel, ni agression ? Comment se<br />
définit le traumatisme en lien avec la surdité? Selon nous, il<br />
n’est pas nécessaire que la vie de la personne soit en danger<br />
pour qu’il y ait traumatisme. Cyrulnik (2002, 2001) parle de<br />
l’inégalité des traumatismes dans le sens qu’une même blessure<br />
frappe différemment différentes personnes. La surdité, <strong>et</strong><br />
surtout les limites qu’elle impose sur le plan de la<br />
communication, est vécue différemment par chaque personne<br />
sourde <strong>et</strong> n’a rien à voir avec le degré de perte auditive réelle<br />
mesuré en décibels. Les personnes sourdes font l’expérience<br />
quotidienne de l’impuissance. Elles ont peur du regard des<br />
autres, de leur attitude <strong>et</strong> elles en sont dépendantes pour<br />
développer une communication satisfaisante <strong>et</strong> se faire des<br />
amis. Elles doivent gérer <strong>et</strong> tolérer des situations ou leur estime<br />
d’elles-mêmes est mise à rude épreuve, fréquemment<br />
accompagnées d’émotions comme la frustration, le<br />
ressentiment, l’amertume <strong>et</strong> l’impuissance. La prise de<br />
conscience de la surdité, des limites de communication qui lui<br />
sont associées, <strong>et</strong> surtout de la différence entre soi <strong>et</strong><br />
l’environnement social <strong>et</strong> familial qu’elle impose, peut avoir<br />
l’eff<strong>et</strong> d’un choc pour l’enfant à un moment donné dans sa vie.<br />
Nous croyons qu’être soumis à de telles situations de façon
épétée, sans avoir le pouvoir d’agir sur l’environnement, peut<br />
créer les eff<strong>et</strong>s d’un traumatisme. Pour se protéger des<br />
émotions parfois très intenses que ces situations font vivre, des<br />
mécanismes internes <strong>et</strong> externes sont utilisés.<br />
Les mécanismes de défense utilisés<br />
Les mécanismes psychologiques utilisées par les personnes<br />
sourdes sont les mêmes que ceux qu’utilisent les personnes qui<br />
ont vécu un traumatisme <strong>et</strong> dont la vie ou celle d’un proche à<br />
été en danger réel (négation, clivage suppression,<br />
rationalisation, évitement, <strong>et</strong>c.).<br />
Nos suj<strong>et</strong>s racontent que, dans l’enfance, ils se comportaient<br />
comme si la souffrance associée à l’isolement était minime<br />
(négation, suppression). Avant de rencontrer un tuteur de<br />
résilience, ils n’ont pas fait l’expérience d’une communication<br />
vraiment satisfaisante, par conséquent, ils toléraient la piètre<br />
communication qu’ils vivaient, n’ayant pas d’autres moyens de<br />
comprendre <strong>et</strong> de vivre leur réalité. Par contre lorsqu’ils ont fait<br />
la rencontre d’un tuteur de résilience comme l’utilisation de la<br />
LSQ, qui ouvre la possibilité d’échanges riches <strong>et</strong> satisfaisants,<br />
ils ont pu se perm<strong>et</strong>tre d’être en contact avec le manque <strong>et</strong> dire<br />
à quel point ils souffraient de manques dans les relations <strong>et</strong> la<br />
communication avec leur entourage, en oralisme. Parfois,<br />
temporairement, ils disent souffrir davantage après avoir<br />
découvert leur tuteur de résilience parce que leurs croyances <strong>et</strong><br />
leur identité sont remis en question. Ils doivent à nouveau faire<br />
des choix <strong>et</strong> se redéfinir. La révolte <strong>et</strong> parfois la rage d’avoir<br />
souffert alors qu’ils auraient pu espérer mieux, explose.<br />
Certains réussissent à résoudre la crise <strong>et</strong> à intégrer les<br />
éléments de leur histoire personnelle dans un tout cohérent,<br />
sachant qu’il y a au moins un lieu où ils ne vivront plus les<br />
mêmes difficultés <strong>et</strong> émotions.<br />
Ces mécanismes ont une fonction adaptative <strong>et</strong> seront<br />
abandonnés si la personne voit un avantage à ne plus les<br />
utiliser. Pendant que la situation traumatique est vécue, la<br />
personne peut ne pas être consciente de l’ampleur de son<br />
désarroi ou encore se cliver pour agir sur la souffrance.<br />
Mécanismes internes<br />
Suppression<br />
En dépit du fait que Benoît ait réussi ses études <strong>et</strong> que le mode<br />
oral lui ait permis de développer la parole, dont il en est fier, il<br />
est aussi très seul. À l’adolescence, n’ayant pas pu maintenir les<br />
relations avec ses amis d’enfance, il fait l’expérience que les<br />
liens sont difficiles à maintenir <strong>et</strong> le sentiment d’abandon ou de<br />
rej<strong>et</strong> vécu est une expérience face à laquelle il ne peut pas<br />
grand chose. Il évite les situations sociales susceptibles de le<br />
blesser à nouveau ou de le confronter à ses difficultés, ce qui<br />
reviendrait à le blesser au niveau de son estime de lui. Il<br />
investit dans ses études <strong>et</strong> un sport qui le passionne.<br />
« C'est plutôt mes relations avec mes amis qui ont changé.<br />
Comment je me suis débrouillé? Patiemment. L'été, j'avais un<br />
[…] travail. L'hiver, j'étais à l'école. »
« j'aimais beaucoup jouer [à un sport]. Je jouais […] depuis<br />
l'âge de douze ans […]J'étais un maniaque, maniaque du X. Je<br />
jouais […] tout le temps, tout le temps.»<br />
Minimisation <strong>et</strong> négation<br />
Benoît préfère penser que s’il avait appris les signes plus tôt, il<br />
ne parlerait pas aussi bien. Il nie ainsi que l’isolement dû au fait<br />
qu’il ne connaissait pas la LSQ ait été vain. Il minimise la<br />
souffrance associée à c<strong>et</strong> isolement.<br />
« […]Je suis content aussi d'avoir appris les signes un peu tard,<br />
à l'âge de vingt <strong>et</strong> un ans, parce que je pense que si j'avais<br />
appris les signes tôt, peut-être que je parlerais pas aussi bien<br />
aujourd'hui Mais d'un autre côté, ma vie sociale a souffert un<br />
p<strong>et</strong>it peu. »<br />
Laurence, comme Benoît, minimise les difficultés que lui a<br />
posées l’apprentissage de la parole <strong>et</strong> se dit que c’est c<strong>et</strong><br />
apprentissage qui lui a permis de communiquer avec les<br />
entendants comme elle est capable de le faire.<br />
« J'étais tannée, c'était plate pour moi; <strong>et</strong> toujours, toujours<br />
pratiquer. Je voyais dehors les enfants qui jouaient, j'avais le<br />
goût moi aussi d'aller jouer; mais non, il fallait tout le temps<br />
que j'aille faire des pratiques d'orthophonie pendant une heure,<br />
c'était plate.[…] Mais je suis contente que ma mère m'ait<br />
enseigné parce que présentement je suis capable de parler<br />
comme les entendants; je peux communiquer, parce que je suis<br />
oraliste. Mais aussi parce que les personnes comprennent ce<br />
que je dis. Ils disent que c’est clair, que ma voix est claire. Alors<br />
je suis contente pour ça, mais en même temps, c'est trop, parce<br />
que j'étais jeune, j'aurais voulu jouer, c'est normal. »<br />
Tuteurs de résilience<br />
Attachement <strong>et</strong> milieu aimant<br />
Le fait d’avoir eu un milieu familial stable, chaleureux <strong>et</strong> une<br />
mère qui a investi, entre autres, beaucoup de temps pour que<br />
son fils développe la parole, fournit à Benoît une base solide<br />
pour vivre les difficultés d’isolement de la fin de l’adolescence à<br />
l’âge adulte.<br />
« Il y avait peut-être cinq enfants sourds cinq enfants<br />
entendants. Et puis, en même temps, je suivais des cours<br />
d'orthophoniste. Dans mon cas, ça a bien fonctionné, pas juste<br />
à cause de l'école, mais aussi de ma mère qui s'est occupé de<br />
moi à temps plein. Ça fonctionnait bien. […]Mes relations avec<br />
mes professeurs, avec mes parents, avec ma famille ont<br />
toujours été excellentes, excellentes. »<br />
Benoît est reconnaissant du fait que ses parents l’aient toujours<br />
soutenu, même lorsqu’il a décidé de se rendre à Montréal pour<br />
avoir plus de contacts avec la communauté sourde.<br />
« Mes parents m'ont beaucoup encouragé d'aller à Montréal. Je<br />
suis content, je suis content d'avoir de bons parents.»
Le milieu familial de Laurence aussi était stable <strong>et</strong> aimant <strong>et</strong> sa<br />
mère a aussi consacré beaucoup de temps à lui apprendre à<br />
parler (voir extrait ci-dessus). Chez nos deux suj<strong>et</strong>s, le milieu<br />
familial a été un tuteur de résilience important.<br />
La capacité de récits<br />
Benoît <strong>et</strong> Laurence disposent tous deux d’une langue qui leur<br />
perm<strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre des mots sur ce qu’ils vivent, ce qui ne<br />
signifie pas qu’ils sont capables d’en parler à d’autres. Durant la<br />
fin de son adolescence <strong>et</strong> le début de l’âge adulte, Benoît est<br />
très isolé, il ne pouvait parler de sa réalité à personne. Ce n’est<br />
qu’une fois sorti de c<strong>et</strong>te période qu’il peut se perm<strong>et</strong>tre de<br />
raconter son expérience. C’est aussi parce qu’il a la certitude<br />
que son expérience n’est pas unique. Il a vécu sa rencontre<br />
avec la communauté sourde comme un sauv<strong>et</strong>age. Le mot<br />
sauv<strong>et</strong>age renvoie à des expériences qui décrivent la survie<br />
dans des situations telles que la noyade. Nous pouvons penser<br />
qu’il étouffait dans sa solitude même si rien dans son discours<br />
<strong>et</strong> son comportement ne traduit cela.<br />
De son coté, Laurence peut parler de son expérience de rej<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />
de gêne à partir du moment où sa situation change. Pendant<br />
qu’elle vit du rej<strong>et</strong> elle ne peut pas parler de son vécu parce<br />
qu’elle est isolée <strong>et</strong> aussi parce que personne ne comprendrait<br />
sa situation.<br />
« Puis ça tombait bien, parce qu'en même temps, ça allait<br />
régler mon problème de rej<strong>et</strong>, que je vivais. Donc, je voulais<br />
changer d'école. Quand je suis arrivée là, je connaissais<br />
personne. Les gens étaient ouverts, pas gênés de communiquer<br />
<strong>et</strong> je me suis ouverte. […] Auparavant, secondaire deux, quand<br />
j'étais p<strong>et</strong>ite, j’étais très gênée. J'avais de la misère à avoir plus<br />
d’amis. J'étais contente, parce que (à ma nouvelle école) les<br />
personnes ne me connaissaient pas, puis ils apprenaient c'était<br />
quoi la surdité. C’était la première fois que j’expliquais moimême<br />
c’est quoi être sourd. »<br />
Accès à l’information <strong>et</strong> aux échanges relationnels<br />
Benoît <strong>et</strong> Laurence ont développé une bonne prononciation <strong>et</strong><br />
une bonne lecture labiale qui leur ont permis d’accéder à<br />
l’information <strong>et</strong> de réussir dans leurs études. Benoît s’est senti<br />
bien intégré socialement jusqu’en secondaire 4.<br />
« A partir de la cinquième année, la sixième année, je suis allé<br />
à l’école régulière de mon quartier, ça très bien fonctionné.<br />
Ensuite à l’école secondaire, la même chose, je suis allé à<br />
l’école secondaire de mon quartier, ça a très bien fonctionné<br />
aussi. À partir du secondaire quatre, du secondaire cinq j’ai<br />
commencé à me sentir isolé. […] Mes amis [d’enfance] ont<br />
vieilli, ont changé, c'était très différent. »<br />
Laurence est satisfaite de sa communication orale.<br />
« Mais je suis contente que ma mère m'ait enseignée parce que<br />
présentement je suis capable de parler comme les entendants;
je peux communiquer, parce que je suis oraliste. Mais aussi<br />
parce que les personnes comprennent ce que je dis. Ils disent<br />
que c’est clair, que ma voix est claire. »<br />
Le fait d’être compétente en français oral, ajouté à l’ouverture<br />
qu’elle perçoit chez les élèves <strong>et</strong> les enseignants de sa nouvelle<br />
école envers la surdité lui ont permis d’expliquer la surdité aux<br />
entendants <strong>et</strong> de revendiquer certaines besoins de<br />
communication sans craindre le jugement des autres..<br />
« C’est là (à la nouvelle école) que j’ai commencé à être<br />
capable moi-même d'expliquer, d'être responsable, j'étais pas<br />
gênée. Plus tard en secondaire III j'allais les voir, puis je<br />
disais : "C'est clair, je suis sourde, j'ai pas compris." S'ils<br />
pensaient que j'étais ignorante, c'était de leur faute à eux<br />
autres! C'était pas de ma faute à moi. »<br />
Découverte <strong>et</strong> utilisation de la LSQ <strong>et</strong> accès à une vie sociale<br />
plus satisfaisante<br />
Le regard des autres, quand les autres n’étaient que des<br />
entendants, renvoyait à Benoît l’image de sa différence. Après<br />
sa rencontre avec la LSQ <strong>et</strong> la grande communauté sourdebilingue,<br />
qui donne accès à une vie sociale, à des relations<br />
satisfaisantes, à une vie normale, le regard des autres, les<br />
Sourds, lui renvoie une image : « Tu es comme nous, il n’y a<br />
rien là d’être sourd». Alors seulement, Benoît peut vivre ce qu’il<br />
est vraiment, «un gars impliqué socialement » qui prend<br />
conscience de son désir de voir des gens, qui a d’excellentes<br />
habil<strong>et</strong>és sociales <strong>et</strong> une certaine facilité à se lier d’amitiés.<br />
La rencontre avec la communauté sourde perm<strong>et</strong> à Benoît de<br />
développer un sentiment d’appartenance <strong>et</strong> facilite ses<br />
échanges avec les autres.<br />
« Je me sentais très différent des autres. Surtout quand j'allais<br />
à l'école, j'écoutais mes amis parler de ce qu'ils ont fait la fin de<br />
semaine. Ils rencontraient des filles. Moi j'étais... j'étais très<br />
très gêné avec les filles. Je savais... je savais même pas<br />
comment aborder la communication avec les filles. Et puis je<br />
voyais mes amis comment qu'ils se débrouillaient, comment ils<br />
étaient capables, tandis que moi, j'étais pas capable. Je me<br />
sentais isolé. »<br />
« Puis heureusement, quelques mois après, j'ai rencontré des<br />
gens sourds. J'ai fait la connaissance du langage gestuel... ça<br />
m'a sauvé. […] Ça m'a sauvé , parce que je suis très heureux<br />
aujourd’hui. […] J’en reviens pas, à cause de ça, à cause du<br />
milieu de la surdité. Aujourd'hui, à Montréal, tous mes amis,<br />
c'est tous des gens qui sont dans le milieu de la surdité : des<br />
sourds, des entendants, des intervenants qui travaillent avec<br />
des sourds, comme les interprètes, des travailleurs sociaux,<br />
tous, du monde entendant dans le milieu de la surdité. Je n'ai<br />
pas d'amis entendants en dehors du milieu de la surdité, j'en ai<br />
pas. Ça ne me rend pas malheureux, parce que, il y a du monde<br />
dans le milieu de la surdité. Je m'entends bien, je suis à l'aise<br />
avec... parce que toutes ces personnes-là ont un vécu. Puis,<br />
heu... les entendants impliqués dans le milieu, comprennent ce<br />
que les Sourds vivent ».
Laurence a, elle aussi, vécu beaucoup d’isolement, mais<br />
beaucoup plus jeune que Benoît. Quand elle a été intégrée dans<br />
une école pour enfants entendants, après avoir passé la<br />
prématernelle avec des enfants sourds, elle ne se sentait plus<br />
de sentiment d’appartenance..<br />
« Quand je suis arrivée à l’école, vraiment là, je savais pas<br />
vraiment quoi faire. Je voyais que c'étaient tous des<br />
entendants, j'étais la seule sourde; je me demandais comment<br />
j'allais faire pour communiquer. Je regr<strong>et</strong>tais, je voulais mes<br />
amis sourds car on a la même culture <strong>et</strong> on se comprenait.<br />
J'avais l'impression que j'avais perdu mes amis sourds. J'étais<br />
seule parmi des entendants. J’ai essayé, j'ai vécu l'intégration.<br />
Mai, juin, ça allait bien, mais deux mois c'est pas très long, c'est<br />
comme léger. »<br />
Par la suite, sa scolarité, intégrée avec les entendants s’est bien<br />
déroulée. Pendant son secondaire, Laurence a cependant repris<br />
l’apprentissage de la LSQ, qu’elle avait abandonné à la<br />
maternelle <strong>et</strong> elle a progressivement modifié son choix de mode<br />
de communication. Ce changement constitue un tuteur de<br />
résilience car, comme elle le dit, il lui donne accès à l’éducation<br />
<strong>et</strong> aux relations satisfaisantes avec les utilisateurs de la LSQ<br />
« Au secondaire, avant le cégep j'ai commencé à apprendre des<br />
signes, avec des amis que je rencontrais, j’observais comment<br />
ils faisaient les signes; j'étais intéressée. […] Avec les signes,<br />
on comprend tout de suite, on a pas besoin de faire répéter <strong>et</strong><br />
de se concentrer sur les lèvres. Depuis que j'étais toute p<strong>et</strong>ite,<br />
je lisais toujours sur les lèvres; c'était fatigant. Avec les signes,<br />
on fournit moins d'efforts: j'arrivais à comprendre plus vite; les<br />
signe. C'était clair, je comprenais tout de suite. Ça me faisait du<br />
bien. Ça me reposait les yeux. »<br />
Discours social<br />
L’organisation sociale se traduit, entre autres, par la<br />
disponibilité <strong>et</strong> la qualité des services offerts aux personnes<br />
sourdes. Les services peuvent devenir des tuteurs de résilience<br />
en soutenant les personnes.<br />
Beaucoup d’acteurs dans le système d’éducation pensent qu’il<br />
est normal pour les enfants sourds de ne pas réussir aussi bien<br />
que les entendants. Les élèves sourds qui réussissent en dépit<br />
de ce discours social <strong>et</strong> du surinvestissement dans les études<br />
sont donc extrêmement fiers. Une personne sourde, qui obtient<br />
un diplôme de secondaire cinq ou qui réussit une formation qui<br />
peut lui donner accès à un travail intéressant, est considérée<br />
comme ayant accompli une sorte d’exploit.<br />
L’intégration scolaire est vue comme une promotion sociale <strong>et</strong><br />
les critères qui perm<strong>et</strong>tent c<strong>et</strong>te intégration, surtout la réussite<br />
scolaire, font en sorte que ce sont les enfants les plus<br />
performants qui sont intégrés. Pourtant l’intégration scolaire<br />
m<strong>et</strong> quotidiennement l’emphase sur les différences. Laurence<br />
exprime le sentiment d’isolement que l’intégration a suscité<br />
chez elle, pas tellement lorsqu’elle en a fait l’essai que<br />
lorsqu’elle l’a vécue vraiment.
«. Je regr<strong>et</strong>tais, je voulais mes amis sourds parce qu’on avait la<br />
même culture <strong>et</strong> on se comprenait. J'avais l'impression que<br />
j'avais perdu mes amis sourds. J'étais seule parmi des<br />
entendants. J’ai essayé, j'ai vécu l'intégration. Mai, juin, ça allait<br />
bien, mais deux mois c'est pas très long, c'est comme léger. […]<br />
En septembre, quand j'ai commencé la vraie école en première<br />
année, je me sentais isolée. […]Par exemple, si le professeur<br />
disait: "Ok, maintenant, il faut faire des équipes de deux", je<br />
voyais le monde autour qui se plaçait en équipe tout de suite,<br />
puis moi, je restais la dernière, puis il y a personne qui voulait<br />
être avec moi, vraiment personne! Je me sentais rej<strong>et</strong>ée,<br />
abandonnée. Je me sentais seule. J'avais beaucoup de peine,<br />
puis je pleurais toujours »<br />
Conclusion<br />
Aujourd’hui, Benoît a une famille <strong>et</strong> un bon emploi. Il poursuit<br />
encore des études. Il m<strong>et</strong> régulièrement ses compétences à la<br />
disposition des autres Sourds <strong>et</strong> consacre du temps à la<br />
reconnaissance des droits des Sourds. Il entr<strong>et</strong>ient des liens<br />
avec la communauté sourde bilingue. Il a été capable de<br />
construire sa vie en intégrant à sa construction identitaire le<br />
traumatisme de l’isolement vécu à l’adolescence.<br />
Depuis l’entrevue, Laurence a terminé ses études universitaires<br />
avec succès <strong>et</strong> travaille dans son domaine d’études. La<br />
souffrance liée à l’isolement <strong>et</strong> au rej<strong>et</strong>, qu’elle a vécue pendant<br />
une partie de sa scolarité semblent avoir eu un impact sur le<br />
développement de son identité ainsi que sur celui de son image<br />
<strong>et</strong> de son estime d’elle-même. Laurence a su utiliser ses<br />
ressources personnelles pour faire face <strong>et</strong> tolérer les blessures<br />
vécues. Elle a su se prendre en charge sa différence. Les<br />
remarques blessantes concernant ses capacités intellectuelles à<br />
poursuivre des études l’ont stimulée à prouver ses capacités.<br />
Elle s’est vue changer graduellement positivement. Laurence est<br />
une jeune femme dynamique, courageuse <strong>et</strong> persévérante. Elle<br />
a su trouver sa place <strong>et</strong> donner un sens à sa vie.<br />
Références<br />
Bachelor, A. <strong>et</strong> P. Joshi (1986). La méthode phénoménologique<br />
de recherche en psychologie, guide pratique. Québec, Les<br />
presses de l’Université Laval.<br />
Cyrulnik, B. (2003) Entrevue de Chasseur d’idées, Télé-Québec.<br />
Cyrulnik, B. (2002) Un merveilleux malheur, Odile Jacob<br />
poches, Paris.<br />
Cyrulnik, B. (2001) Les vilains p<strong>et</strong>its canards, Odile Jacob, Paris<br />
Giorgi, A. (1985). «Sk<strong>et</strong>ch of psychological Phenomenological<br />
M<strong>et</strong>hod», In A. Giorgi (ed.) Phenomenology and Psychological<br />
Research. Pittsburgh : Duquesne University Press.
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Le syndrome des grands pavots<br />
chez les Sourds<br />
C<strong>et</strong>te présentation donne une idée de la collectivité des<br />
Sourds de la Nouvelle-Zélande <strong>et</strong> montre comment le<br />
syndrome du grand pavot (SGP) peut avoir un impact sur les<br />
styles de vie. Le syndrome du grand pavot est un terme utilisé<br />
pour décrire des personnes qui ont le potentiel de réussir, mais<br />
qui peuvent être rabaissés par une p<strong>et</strong>ite collectivité. On peut<br />
aussi l'appeler la "jalousie professionnelle". Au sein de la<br />
collectivité des Sourds, il y a des personnes qui manquent de<br />
confiance <strong>et</strong> qui ont peu d'estime d'eux-mêmes, ce qui peut les<br />
mener à des problèmes de santé mentale. Ce dilemme affecte<br />
tous les milieux <strong>et</strong> sabote les ambitions <strong>et</strong> les rêves en<br />
empêchant l'apparition de modèles à suivre dans la collectivité<br />
des Sourds. Grâce à l'éducation, à l'intervention <strong>et</strong> à la<br />
sensibilisation, les problèmes de santé mentale pourraient être<br />
réduits avec l'aide de professionnels <strong>et</strong> de modèles à suivre qui<br />
perm<strong>et</strong>traient de trouver des façons de diminuer le problème. Si<br />
un changement est créé dans l'avenir, un plus grand nombre de<br />
personnes réussiront, il y aura plus de leaders, de modèles <strong>et</strong><br />
de gens qui réaliseront leurs ambitions <strong>et</strong> leurs rêves. Cela ne<br />
changera pas la perception du SGP dans tous les esprits, mais<br />
nous devons penser à notre jeune génération future <strong>et</strong> espérer<br />
voir une diminution graduelle du SGP au sein de notre<br />
collectivité sourde.<br />
La Nouvelle-Zélande<br />
La Nouvelle-Zélande se situe tout à fait au bas de l'atlas. Elle<br />
comporte deux îles principales – celle du Nord <strong>et</strong> celle du Sud –<br />
ainsi qu'un certain nombre d'îles plus p<strong>et</strong>ites. On y compte<br />
approximativement 4 061 300 (juin 2004) habitant. Le pays se<br />
compose :<br />
❍ d'Européens néo-zélandais 75,7 %<br />
❍ de Maori néo-zélandais 13,9 %<br />
❍ de Polynésiens des îles du Pacifique 6,1 %<br />
❍ d'Asiatiques 6,3 %<br />
❍ d'autres 0,7 %<br />
La Nouvelle-Zélande est aussi connue sous le vocable<br />
"Aotearoa", ce qui veut dire "Terre du long nuage blanc", pour<br />
les Maori, la peuplade indigène – premiers colons de la Nouvelle-<br />
Zélande <strong>et</strong> les tangata whenua (peuple de la terre).<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
La collectivité sourde<br />
Selon les statistiques du recensement de la Nouvelle-Zélande de<br />
2001, on estimait à 223 500 le nombre d'adultes qui étaient<br />
sourds, ou qui avaient des déficiences auditives qui ne<br />
pouvaient être éliminées par une prothèse, en 2001. Ce nombre<br />
comprend des gens qui ont un certain niveau de déficit auditif à<br />
cause duquel il leur est difficile de suivre une conversation avec<br />
une autre personne ou avec un groupe, ainsi qu'avec ceux qui<br />
sont complètement sourds.<br />
Aperçu général des dénombrements de Sourds :<br />
● Il existe 2 écoles pour les Sourds en Nouvelle-Zélande – la<br />
van Asch Deaf Education Centre, à Christchurch, <strong>et</strong> le<br />
Kelston Deaf Education Centre, à Auckland.<br />
❍ L'enseignement se fait en NZSL, en classes<br />
bilingues, en anglais oral ou signé.<br />
❍ Il existe, sur le campus du van Asch Deaf Education<br />
Centre une Unité de l'implant cochléaire (IC) pour<br />
aider à programmer/maintenir le progrès des<br />
étudiants ayant un IC.<br />
❍ À l'heure actuelle, en mai 2004, il y a 34 étudiants<br />
sourds au van Asch Deaf Education Centre.<br />
❍ En mai 2004, à Canterbury, on comptait 62 enfants<br />
sourds soumis aux programmes en "mainstream",<br />
qui voient un professeur itinérant.<br />
● Il y a, en Nouvelle-Zélande, environ 20 à 30 Sourds<br />
culturels qui sont qualifiés <strong>et</strong> possèdent un diplôme.<br />
● Il y a environ 500 Sourds dans la région de Christchurch.<br />
● En avril 2004, il y avait un total de 129 membres de club<br />
Sourds à Christchurch.<br />
● À Christchurch, à l'heure actuelle, il y a seulement 2<br />
interprètes qualifiés <strong>et</strong> 1 communicateur (sans<br />
qualifications officielles) qui travaillent avec la collectivité<br />
sourde.<br />
Qu'est-ce que le syndrome du grand<br />
pavot ?<br />
Sens donné par le dictionnaire au syndrome du grand pavot :<br />
L'habitude néo-zélandaise qui consiste à dénigrer ou à "couper<br />
les pieds" de ceux qui ont du succès ou qui sont<br />
superperformants. <strong>et</strong>c. (traduit du The New Zealand Oxford<br />
Paperback Dictionary, 1998).<br />
Dans d'autres pays, le mot de patois est connu comme :<br />
en Amérique – "la théorie du crabe" – le mot performatif pour<br />
ce sens est "jalousie"<br />
Australie <strong>et</strong> Nouvelle-Zélande – "le syndrome du grand pavot"<br />
Japon - "le poteau qui dépasse sera remis à sa place à force de<br />
coups"
Qu'est-ce que le "grand pavot en général" en<br />
Nouvelle-Zélande <strong>et</strong> quoi affecte-t-il les gens ?<br />
Dès l'âge le plus tendre, celui qui s'efforce de faire mieux que<br />
ses pairs s'expose à faire l'obj<strong>et</strong> de la désapprobation du milieu,<br />
<strong>et</strong> les "grands pavots" sont impitoyablement ramenés à leur<br />
juste taille.<br />
D'un point de vue étranger sur le syndrome du grand pavot,<br />
lorsqu'on fait du commérage sur des Sourds qui ont réussi,<br />
toute notre collectivité en souffre. "La théorie du crabe", selon<br />
le rédacteur de Deaf Life, Matthew S. Moore, renvoie à la<br />
pratique destructive de Sourds qui rabaissent <strong>et</strong> écrasent leurs<br />
semblables qui ont réussi. Ce dénigrement se fait par le<br />
truchement de commérages vicieux (le poignard dans le dos),<br />
de la diffusion de fausses rumeurs (la diffamation), de l'envoi de<br />
courriels haineux, <strong>et</strong>c., <strong>et</strong> est basé sur un phénomène de la vie<br />
réelle : celui des crabes sont capturés <strong>et</strong> j<strong>et</strong>és dans un seau. Si<br />
un crabe essaie de s'échapper en rampant sur les parois du<br />
seau, les autres le tirent à eux pour l'en empêcher. C'est<br />
probablement instinctif, une réponse panique de leur part. C'est<br />
ce qui fait qu'aucun crabe s'échappe jamais. Ce comportement<br />
chez les crabes a largement la réputation d'être un mythe, mais<br />
il a été observé (Lala, 2004).<br />
Les professionnels sourds qui travaillent au coeur de la<br />
collectivité des Sourds sont soumis à d'énormes pressions.<br />
Prenons pour exemple les cours de Berlings, un instructeur<br />
extrêmement populaire auprès des étudiants. Il était tout à fait<br />
piètre professeur, même si la matière enseignée était tout à fait<br />
simple <strong>et</strong> s'il était incapable d'appliquer ce qu'il enseignait dans<br />
une situation de la vie réelle, les étudiants l'aimaient en réalité<br />
tellement qu'il n'était que "l'un d'entre eux". Il gardait des<br />
contacts sociaux compl<strong>et</strong>s avec plusieurs des anciens de l'école<br />
des dernières années, <strong>et</strong>, malheureusement, les rumeurs de<br />
partouses <strong>et</strong> d'utilisation de marijuana <strong>et</strong> d'alcool finirent par<br />
filtrer jusqu'au niveau de l'école secondaire. C'est un de ceux<br />
qui comptent parmi les leaders des Sourds. Les étudiants le<br />
regardaient comme "esprit ouvert". Ce comportement faisait<br />
subtilement la promotion de l'usage de drogues, d'un<br />
comportement contraire à l'éthique, rabaissait les attentes, <strong>et</strong><br />
établissait pour les étudiants sourds la "normalité" de ce type de<br />
comportement.<br />
Comme il vivent <strong>et</strong> travaillent au coeur de la collectivité des<br />
Sourds, les professionnels sourds doivent décider de leurs choix<br />
d'amis <strong>et</strong> du moment où il convient de socialiser à cause de la<br />
taille de la collectivité <strong>et</strong> des autres qui observent le<br />
comportement des professionnels. C<strong>et</strong>te situation mène souvent<br />
d'autres à parler <strong>et</strong>, éventuellement, les choses finissent par<br />
être tordues <strong>et</strong> amères. Le professionnel doit alors travailler<br />
beaucoup plus dur pour réparer les dommages <strong>et</strong> redresser les<br />
choses.<br />
Une histoire concernant le point de vue d'une Sourde néozélandaise<br />
qui est dans une situation où le syndrome du<br />
grand pavot n'est plus un problème<br />
"Après avoir travaillé dans un environnement
entendant, j'ai commencé à travailler pour la<br />
collectivité des Sourds. Presque immédiatement,<br />
mes contacts avec les Sourds ont changé parce<br />
que j'en savais trop sur leurs problèmes<br />
personnels, <strong>et</strong> je portais mon chapeau de "travail"<br />
24/7.<br />
Il y a des moments où je ne pouvais pas socialiser<br />
à aucune fonction sourde ou à un club de Sourds,<br />
parce que les adultes sourds ou les entendants<br />
parleraient "travail" ou demanderaient des<br />
renseignements ayant rapport à mon travail. Ils<br />
peuvent s'écarter de vous par timidité parce qu'ils<br />
pensent que je les surveille ou se sentir mal à<br />
l'aise de me parler à cause de mon travail <strong>et</strong> ne<br />
veulent pas être vus alors qu'ils me parlent au cas<br />
où d'autres "penseraient qu'ils ont un problème" ?<br />
Le travail lui-même a détruit de nombreux mariages parce que<br />
le travail lui-même est si stressant <strong>et</strong> que vous êtes "marié" au<br />
boulot. Il a détruit une de mes relations que j'avais avec une<br />
personne sourde <strong>et</strong> maintenant je suis dans une relation à long<br />
terme avec mon partenaire entendant, qui n'a rien à voir avec<br />
mon monde de Sourds. Je trouve qu'il est plus facile de garder<br />
ces mondes séparés <strong>et</strong> de vivre dans un monde entendant, mais<br />
il est des fois où j'ai un fort désir d'amis sourds pour donner à<br />
ma vie un sens d'équilibre dans un monde de Sourds ET<br />
d'entendants dans lequel je vis <strong>et</strong> je travaille 24/7." (Deaf<br />
Woman in New-Zealand, 2004)<br />
Les sentiments des Sourds dans la collectivité<br />
J'ai pris quelques textes de différents Sourds <strong>et</strong> les<br />
commentaires qu'ils ont faits.<br />
"Mon sentiment envers la collectivité est que je<br />
suis Sourd <strong>et</strong> que vous êtes Sourd. Nous sommes<br />
pareils. Je suis sourd, c'est ce que je suis. C'est un<br />
sentiment. Nous avons une affinité." (Townshend<br />
2000)."<br />
"Ma famille, ce sont les Sourds. J'ai soixante,<br />
soixante-dix, quatre-vingt frères <strong>et</strong> soeurs. Rien<br />
n'importe concernant les différents niveaux de<br />
communication ou les gémissements ou les<br />
querelles ou les discussions. Cinq minutes après,<br />
ça va. Même les couteaux dans le dos, le<br />
lendemain, "ça va !" nous sommes Sourds,<br />
ensemble. Nous n'abandonnons jamais la partie<br />
devant l'autre, nous sommes toujours amis <strong>et</strong><br />
nous restons collés, nous ne nous lâchons pas.<br />
Nous sommes bien. Je suis fier des<br />
Sourds." (Townshend 2000).<br />
"J'ai essayé de me mélanger avec la collectivité<br />
des Sourds mais, à cause de la façon dont je me<br />
comporte, je ne vais pas descendre à leur niveau,<br />
donc, je ne me mélangerai pas à eux."
"J'ai remarqué que les personnes sourdes qui ont<br />
réussi sont toujours rabaissées par d'autres<br />
Sourds, par manque d'appui <strong>et</strong> par des<br />
commérages – coups de couteau dans le dos <strong>et</strong><br />
dénigrements, rumeurs méchantes. Est-ce que les<br />
Sourds ne peuvent pas apprécier des performants<br />
qui ont réussi <strong>et</strong> qui bénéficient à leur<br />
collectivité ?" (Moore.1993)<br />
Un commentaire à l'eff<strong>et</strong> que certains Sourds ont une réaction<br />
craintive, stigmatisant <strong>et</strong> ignorante devant la maladie mentale :<br />
"………lorsque les gens ont des problèmes, je ne<br />
m'en mêle pas, je ne les aide pas. Je veux<br />
seulement être à l'aise avec moi-même. Je suis sûr<br />
qu'il y a des gens là-bas, mais je ne les aide pas,<br />
la personne qui a créé le problème devrait s'en<br />
occuper, mais pas moi, parce que si je m'en mêle<br />
il va empirer <strong>et</strong> je vais assumer leur inquiétude, <strong>et</strong><br />
je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de m'occuper de<br />
moi <strong>et</strong> de ma famille."<br />
L'oppression est la plus manifeste dans le domaine des relations<br />
qui se sont envenimées. Voici des exemples d'aigreur <strong>et</strong><br />
d'absence de confiance menant (réclamé par certains<br />
participants sourds) à la maladie mentale :<br />
"Je pense que les Sourds commèrent trop, je ne<br />
suis pas réellement sûr, mais je trouve difficile de<br />
faire face à d'autres personnes, alors il y a<br />
beaucoup de choses qui se passent derrière votre<br />
dos, vous ne pouvez pas attraper qui a dit quoi,<br />
vous ne savez pas si c'est vrai ou faux - il n'y a<br />
pas de preuve de ça – si c'est le problème de<br />
quelqu'un d'autre ou mon propre problème."<br />
"Certains Sourds ont deux faces, ils vous<br />
enfoncent des poignards dans le dos."<br />
"Le stress peut être causé par des sources<br />
extérieures, à travers un mal interne, peut-être<br />
par des commérages ou un poignard dans le dos."<br />
"La plupart parlent de leur m.... ego – deux faces."<br />
Ces commentaires reflètent la réalité de la vie dans de p<strong>et</strong>ites<br />
collectivités, où vos affaires peuvent facilement devenir les<br />
affaires de tout le monde, <strong>et</strong> le grand besoin de trouver d'autres<br />
solutions aux impacts de l'oppression des entendants,<br />
autrement que d'éclater en invectives à l'endroit d'amis <strong>et</strong> de<br />
congénères de sa collectivité. L'oppression internalisée est une<br />
attente dupe d'elle-même de la part de la personne sourde de<br />
"sortir de dessous la haine de soi internalisée assez pour se<br />
sentir bien vis-à-vis elle-même". (Kaiser, 1990).<br />
Attitudes<br />
Réalité qui n'est pas très répandue dans le monde extérieur,
parce que la collectivité sourde lui cache délibérément certains<br />
renseignements, la malheureuse prévalence du commérage, du<br />
couteau dans le dos <strong>et</strong> de l'entr<strong>et</strong>ien de rumeurs, serait un réel<br />
révélateur pour ceux qui sont nouveaux pour la collectivité<br />
sourde. Un écrivain sourd qualifie le commérage comme l'un<br />
des soutiens principaux de la collectivité des Sourds. Il dit<br />
également que nombre de personnes sourdes culturelles<br />
manquent de rêves <strong>et</strong> d'ambition. Les attentes réduites ont<br />
beaucoup à voir avec c<strong>et</strong>te attitude. La jalousie semble être une<br />
autre raison pour laquelle ces conditions existent.<br />
Les Sourds qui reçoivent des prestations restent écrasés sur<br />
leur derrière <strong>et</strong> socialisent avec d'autres Sourds. Voici des<br />
commentaires de ceux qui sont sur les prestations demandant à<br />
des Sourds :<br />
"Pourquoi vous ne travaillez pas ?<br />
"Travailler, pourquoi ? Perdre temps - mieux prestation !"<br />
Les drogues <strong>et</strong> l'alcool jouent un grand rôle dans la vie des<br />
Sourds.<br />
Vous entendez souvent les Sourds dire qu'ils souhaiteraient être<br />
entendants pour diverses raisons : certaines raisons étant, de<br />
leur point de vue, que la culture des entendants est meilleure<br />
que la culture des Sourds. Être Sourd, si vous êtes incapables<br />
de suivre une "conversation d'entendants", les Sourds<br />
perçoivent souvent que les c<strong>et</strong>te attitude provient du fait que<br />
les entendants n'ont pas le même problème à subir le syndrome<br />
du grand pavot au sein de leur collectivité, la collectivité des<br />
"entendants" étant une collectivité de étendue. Comme nous le<br />
savons tous, la collectivité des Sourds est très p<strong>et</strong>ite ; les<br />
entendants peuvent choisir de quitter le groupe <strong>et</strong> de se joindre<br />
à un autre. C'est très difficile pour des Sourds de quitter le<br />
groupe. Si une personne sourde quitte la collectivité <strong>et</strong> se joint<br />
à la collectivité entendante, elle devient souvent isolée dans le<br />
monde entendant. Ce passage pourrait mener à des problèmes<br />
de santé mentale pour ceux qui choisissent de le faire.<br />
La collectivité a été décrite par différentes personnes comme<br />
étant une "solidarité" <strong>et</strong> les loyautés de groupe ont fait de la<br />
collectivité sourde une société conformiste rigide. Tristement,<br />
dans la collectivité des Sourds, une des choses discutées est de<br />
savoir comment une personne est capable d'obtenir plus de<br />
services <strong>et</strong> de "prestations", plutôt que sur le moyen devenir<br />
autosuffisant <strong>et</strong> sur la façon de devenir une personne qui<br />
contribue à la société.<br />
Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi certains<br />
Sourds se sentent opprimés ou rej<strong>et</strong>és par la grande collectivité.<br />
En voici des exemples :<br />
❍ barrières de communication au sein des familles <strong>et</strong><br />
entre partenaires<br />
❍ éducation déficiente<br />
❍ attitudes négatives de la société en général vis-à-vis
les Sourds<br />
❍ manque d'aptitudes sociales enseignées pendant<br />
que l'enfant grandissait<br />
Ces situations mènent à des sentiments d'impuissance <strong>et</strong> de<br />
désespoir pour la plus grande partie de la vie d'une personne<br />
sourde. Cela peut conduire à une "oppression<br />
internalisée" (Kaiser, 1990). Kaiser explique que l'oppression<br />
internalisée naît d'un handicap psychologique <strong>et</strong>/ou physique <strong>et</strong><br />
que ce sont les "stéréotypes <strong>et</strong> les mensonges répétés" utilisés<br />
par les membres du groupe d'handicapés pour justifier<br />
l'oppression subie par le groupe.<br />
Il y a beaucoup de leaders de la collectivité sourde qui sont<br />
souvent des personnes culturellement sourdes qui essaient de<br />
créer des changements au sein de la collectivité des Sourds. Ce<br />
sont également des membres estimés de la collectivité sourde<br />
sans position officielle. Souvent des personnes sourdes<br />
vulnérables suivent l'exemple de certains de ces leaders <strong>et</strong><br />
suivent quoi que ce soit qu'ils offrent afin de pouvoir continuer à<br />
avoir leur/une place dans leur cercle. Des cours Bertlings, voici<br />
de nombreux leaders qui sont bons, mais ils prennent souvent<br />
la position de refléter les attitudes de la collectivité des Sourds<br />
qui les ont placés au pouvoir. Leurs actions <strong>et</strong> leurs points de<br />
vue pourraient ne pas être nécessairement les leurs propres.<br />
Tandis que les attributs positifs d'une collectivité sourde sont<br />
attrayants pour de nombreux Sourds (pour la plupart,<br />
l'atmosphère sociale tricotée serré, familiale), il y a un côté<br />
négatif, un envers du décor qui peut être destructif pour la<br />
personne sourde). On verra ci-dessous le cycle négatif <strong>et</strong> le<br />
cycle positif qui jouent un rôle important dans la collectivité.<br />
Le cycle négatif est un processus d'échec <strong>et</strong> de frustration –<br />
peut-être d'une mauvais éducation menant à une mauvaise<br />
communication, à un manque de compréhension, à de<br />
mauvaises attitudes, à du ressentiment, à un manque de<br />
confiance <strong>et</strong> à l'isolement.<br />
Le cycle positif est un processus de transformation de<br />
l'individu au moyen d'une communication satisfaisante menant<br />
à la compréhension, à de meilleures attitudes, à l'inclusion dans<br />
la collectivité <strong>et</strong> au bonheur (Dugdale, 2001).<br />
Problèmes<br />
● Pas assez d'encouragement.<br />
● Le "renversement des rôles" n'a pas été suffisamment<br />
renforcé chez la collectivité sourde. Il n'y a pas de respect<br />
pour les autres – un exemple donné ci-dessous :<br />
Personne sourde 1 "Claire Raisin pas assez bonne"<br />
Personne sourde 2 "Comment tu le sais ?"<br />
Personne sourde 1 "Sourd m'a dit"<br />
Personne sourde 2 "Toi "déjà" travaillé avec
Claire ?"<br />
Personne sourde 1 "Non, pas besoin, ami m'a parlé<br />
d'elle"<br />
Personne sourde 2 "Comment te sentirais-tu si<br />
quelqu'un disait la même chose de toi ? Suppose<br />
que les autres parlent de toi, penses-tu que les<br />
gens ont raison ?"<br />
La personne sourde 1 s'arrête alors <strong>et</strong> pense à ce<br />
qu'elle ressentirait si elle était traitée de la sorte.<br />
● Les tendances naturelles que les entendants ont apprises<br />
en grandissant, en prenant d'autres personnes pour<br />
modèles, à savoir quels étaient les comportements sociaux<br />
acceptables <strong>et</strong> non acceptables, échappent aux adultes<br />
sourds.<br />
Plans futurs<br />
Il faudra plus de discussions entre les Sourds <strong>et</strong> les entendants<br />
travaillant en partenariat dans le monde pour faire disparaître<br />
les barrières <strong>et</strong> pouvoir travailler d'une façon efficace à produire<br />
des résultats pour les Sourds.<br />
Plus de sensibilisation envers les Sourds a besoin d'être<br />
enseignés aux professionnels sourds <strong>et</strong> entendants <strong>et</strong> à la<br />
collectivité.<br />
Les professionnels sourds ont besoin d'éduquer les leaders<br />
sourds à enseigner aux autres.<br />
Il existe un besoin d'un groupe de soutien pour les parents des<br />
nouveaux nés diagnostiqués comme sourds.<br />
Tout le monde doit encourager l'affirmation "LES SOURDS<br />
PEUVENT TOUT FAIRE, SAUF ENTENDRE"<br />
Pour terminer c<strong>et</strong>te présentation, prenez un moment pour<br />
réfléchir à nos générations futures de tous les enfants sourds à<br />
venir, à partir de la chanson que chante Whitney Houston –<br />
"The Greatest Love of All’ (Le plus grand amour de tous)<br />
Je crois que les enfants sont notre avenir<br />
Enseignez-leur bien <strong>et</strong> laissez-les prendre le devant<br />
Montrez-leur toute la beauté qu'ils possèdent en eux<br />
Donnez-leur un sens de fierté pour faciliter ça<br />
Laissez le rire enfantin nous rappeler comment nous<br />
étions<br />
Tout le monde se cherche un héros<br />
On a besoin de quelqu'un qui donne l'exemple<br />
Je n'ai jamais trouvé personne pour combler mes besoins<br />
Un endroit pour être solitaire<br />
J'ai donc appris à me fier à moi-même<br />
J'ai décidé il y a longtemps de ne jamais marcher dans<br />
l'ombre de quelqu'un
Si j'échoue, si je réussis<br />
Au moins je vis comme je crois<br />
Peu importe ce qu'ils me prennent<br />
Ils ne peuvent m'ôter ma dignité<br />
Parce que le plus grand amour de tous<br />
Est en train de m'arriver<br />
J'ai trouvé le plus grand amour de tous<br />
À l'intérieur de moi<br />
Le plus grand amour de tous<br />
Est facile à réaliser<br />
Apprendre à vous aimer vous-même<br />
C'est le plus grand amour de tous<br />
Bibliographie<br />
Bertling, Tom. (1994). A child sacrificed to the Deaf culture.<br />
Oregon: Kodiak Media Group<br />
Central Intelligence Agency. The World Fact Book. R<strong>et</strong>rieved<br />
April 19, 2004, from http://www.cia.gov/cia/publications/<br />
factbook/geos/nz.html#Issues<br />
Deverson, Tony. (1998). The New Zealand Oxford Paperback<br />
Dictionary; The New Zealand Standard Encyclopedic content.<br />
Auckland; Oxford University Press<br />
Dugdale, Pat. (2001). Talking Hands, Listening Eyes.<br />
Wellington: Astra Print<br />
Houston, Whitney. (1995). The Greatest Love of All. Song<br />
r<strong>et</strong>rieved June 2004 from http://www.80smusiclyrics.com/<br />
artists/whitneyhouston.htm<br />
Lala, (2003). Malicious Lies: Slander and Gossip in the Deaf<br />
Community r<strong>et</strong>rieved June 2004 from http://www.deaftoday.<br />
com/news/archives/002581.html<br />
Moore, Matthew S. & Levitan, Linda. (1993). For Hearing people<br />
only: Answers to some of the most commonly asked questions<br />
about the Deaf community, its culture, and the "Deaf Reality".<br />
(2 nd Ed). New York: Deaf Life Press<br />
New Zealand Immigration Services TeRatonga Manene. (2003).<br />
The Facts. New Zealand,<br />
Statistics New Zealand. (2004). National Population Estimates<br />
(June 2004 quarter) - Media Release r<strong>et</strong>rieved July 2004 from<br />
http://www.stats.govt.nz/<br />
Townshend, Suzan. (1993). The hands just have to move: Deaf<br />
education in New Zealand = a perspective from the Deaf<br />
Community. Massey University. Exam paper (unpubl.)<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Présentatrice principale : Isabelle Lemay, M. Ps.,<br />
psychologue, candidate au Ph.D. affiliée à Dr. Gilles<br />
Dupuis, Ph.D., Université du Québec à Montréal<br />
Biographie: Isabelle Lemay est psychologue au Centre<br />
métropolitain de réadaptation spécialisé en surdité <strong>et</strong> en<br />
communication <strong>et</strong> rédige actuellement sa thèse de doctorat.<br />
Qualité de Vie <strong>et</strong> surdité:<br />
Validation de l’Inventaire<br />
Systémique de Qualité de Vie©<br />
en Langue des Signes Québécoise<br />
Mots-clés: qualité de vie, surdité, évaluation<br />
Position du problème: Peu d’études évaluent la qualité de vie<br />
(QV) des personnes sourdes <strong>et</strong> il semble qu’aucune étude n’ait<br />
été réalisée à ce suj<strong>et</strong> au Québec. L’Inventaire Systémique de<br />
Qualité de Vie (ISQV) est validé dans le but d’évaluer la QV<br />
chez des entendants. Objectif: Le but de c<strong>et</strong>te étude est de<br />
traduire l’ISQV en Langue des Signes Québécoise (LSQ) afin<br />
d’évaluer la QV des sourds gestuels au Québec. Méthode:<br />
L’ISQV est traduit par deux sourds nés de parents sourds <strong>et</strong><br />
signeurs natifs en LSQ. Les énoncés finaux sont signés par un<br />
des deux traducteurs sourds <strong>et</strong> enregistrés sur cd-rom afin d'en<br />
faire un montage multimédia sur ordinateur, pour uniformiser <strong>et</strong><br />
faciliter l'utilisation du questionnaire. Des échelles mesurant la<br />
détresse psychologique, la présence d’événements stressants <strong>et</strong><br />
le soutien social sont aussi traduites en LSQ. Échantillon: 23<br />
sourds gestuels sont recrutés par le biais d’associations en<br />
surdité. Analyses statistiques: La cohérence interne, la fidélité<br />
test-r<strong>et</strong>est <strong>et</strong> la validité de contenu (par rapport à la détresse<br />
psychologique, à la présence d’événements stressants <strong>et</strong> au<br />
soutien social) sont mesurées. Résultats: La moyenne des<br />
cohérences internes pour les 9 sous-échelles de l’ISQV est ,68<br />
<strong>et</strong> la fidélité test-r<strong>et</strong>est est ,79. La validité de contenu est<br />
démontrée.<br />
Note: C<strong>et</strong>te étude s’inscrit dans un proj<strong>et</strong> plus vaste qui porte<br />
sur l’évaluation de la qualité de vie des personnes sourdes en<br />
fonction de l’âge au début de l’apprentissage de la langue des<br />
signes québécoise. La validation de l’ISQV <strong>et</strong> les données<br />
obtenues sur la qualité de vie des personnes sourdes gestuelles<br />
feront l’obj<strong>et</strong> de deux articles de thèse qui seront soumis à des<br />
revues scientifiques dans les mois à venir.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Le Développement de Services de<br />
Santé Mentale Pour les<br />
Personnes Sourdes, Devenues<br />
Sourdes <strong>et</strong> Malentendantes<br />
PLAN DE L'ATELIER<br />
1. Introduction<br />
2. Description de l'organisme<br />
3. Historique du proj<strong>et</strong> pilote<br />
4. Développement des services<br />
5. Problèmes de mise en oeuvre<br />
INTRODUCTION :<br />
La société Ottawa Salus Corporation est un organisme<br />
communautaire de santé mentale financé par le Ministère<br />
provincial de la Santé. C'est un organisme à but non lucratif qui<br />
travaille avec les personnes qui se rétablissent de problèmes de<br />
santé mentale graves <strong>et</strong> persistants.<br />
Les éléments qui suivent, vision, énoncé de mission <strong>et</strong> valeurs<br />
de l'organisme, furent élaborés en coopération avec les clients,<br />
le personnel <strong>et</strong> les membres du conseil d'administration.<br />
VISION<br />
La croissance de la personne <strong>et</strong> de la collectivité.<br />
ÉNONCÉ DE MISSION<br />
Promouvoir la croissance <strong>et</strong> le bien-être individuels en milieu<br />
communautaire pour les personnes qui ont des problèmes de<br />
santé mentale en offrant du logement <strong>et</strong> des services de soutien<br />
de qualité dans les deux langues officielles.<br />
VALEURS DE L'ORGANISME<br />
Ottawa Salus croit qu'il est important que notre travail reflète<br />
les valeurs suivantes :<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
La confiance, l'intégrité <strong>et</strong> l'apprentissage de toute la vie.<br />
Confiance – que toutes les relations doivent être construites/<br />
établies sur la confiance, la compassion <strong>et</strong> le respect des<br />
différences individuelles.<br />
Intégrité - que les personnes seront traitées avec honnêt<strong>et</strong>é <strong>et</strong><br />
équité en respectant la riche diversité du vécu de chaque<br />
personne.<br />
Apprentissage de toute la vie - que l'apprentissage <strong>et</strong> le<br />
développement personnel est un processus qui dure toute la vie<br />
<strong>et</strong> qui doit être alimenté <strong>et</strong> cultivé.<br />
DESCRIPTION D'OTTAWA SALUS<br />
Salus veut dire "bien-être" en latin ; l'organisme a obtenu ses<br />
l<strong>et</strong>tres patentes en 1977.<br />
Tous les services de Salus sont basés sur un modèle de<br />
croissance <strong>et</strong> de rétablissement centré sur le client <strong>et</strong> basé sur<br />
les forces, avec, comme point focal, les intérêts <strong>et</strong> les buts de la<br />
personne.<br />
Ottawa Salus a commencé comme une p<strong>et</strong>it organisation de<br />
logement <strong>et</strong> a pris de l'expansion au cours des années, pour<br />
également offrir du soutien. Comme nous le savons tous, le<br />
logement sûr <strong>et</strong> abordable est le fondement d'une bonne santé<br />
<strong>et</strong> est une partie essentielle du processus de rétablissement de<br />
la personne.<br />
L'organisme a 2 fonctions principales :<br />
1. offrir du logement avec services de soutien<br />
2. offrir des services de soutien à long terme.<br />
Le portefeuille de logements avec services de soutien comporte<br />
un certain nombre d'options de logement :<br />
3 maisons de groupe, <strong>et</strong> 186 appartements individuels <strong>et</strong><br />
partagés en fonction du revenu.<br />
Salus est aussi en partenariat avec la Société de logement<br />
d'Ottawa pour offrir un soutien sur place dans 3 grands édifices<br />
à appartements.<br />
Les services de soutien sont les suivants :<br />
Accompagnement communautaire (gestion de cas), récréologie,<br />
ergothérapie <strong>et</strong> développement communautaire. Ce sont tous<br />
des services à long terme qui aident les clients à vivre avec<br />
succès dans la collectivité. Au cours des années, les services de<br />
soutien sont devenus plus spécialisés afin de mieux répondre<br />
aux besoins de notre clientèle.<br />
Nouveaux services ajoutés :
1. Services de troubles concurrents – ces services sont<br />
destinés à des individus qui ont une maladie mentale ainsi<br />
qu'un problème de toxicomanie.<br />
2. Services d'accompagnement communautaire pour les<br />
Sourds, les devenus sourds <strong>et</strong> les malentendants (mis sur<br />
pied en 2000).<br />
3. Services en français – il y a 4 accompagnateurs<br />
communautaires qui travaillent avec les clients de langue<br />
française <strong>et</strong> qui offrent tous leurs services en français.<br />
HISTOIRE DU PROJET PILOTE<br />
Notre intérêt à travailler avec des personnes sourdes est apparu<br />
tout à fait par accident. Un Sourd fut référé à l'une de nos<br />
maisons de groupe <strong>et</strong> fut refusé à cause de l'incapacité du<br />
personnel de communiquer avec lui. Le travailleur social<br />
référant a contesté c<strong>et</strong>te décision en disant que c'était<br />
l'incapacité du personnel d'offrir le service <strong>et</strong> non pas<br />
l'admissibilité du client qui faisait problème. Ce défi a vraiment<br />
changé la façon dont l'organisme percevait son accessibilité <strong>et</strong> a<br />
amené un certain nombre d'employés de première ligne à<br />
prendre des cours d'ASL. L'homme emménagea, les choses se<br />
passèrent bien, <strong>et</strong> le personnel commença à avoir confiance en<br />
sa capacité d'offrir ses services de soutien à des personnes<br />
sourdes. Évidemment, il ne fallut pas attendre bien longtemps<br />
avant que le mot se répande, à savoir qu'Ottawa Salus devenait<br />
"accessible aux Sourds" <strong>et</strong> nous avons tôt reçu de nombreuses<br />
références de logement pour des individus sourds.<br />
Les organismes qui offrent des services à la collectivité des<br />
Sourds (SOC, ODC, pour n'en nommer que 2) ont déterminé le<br />
besoin de services spécialisés de santé mentale <strong>et</strong> ils se<br />
préoccupaient beaucoup de ce que leurs clients ne puissent<br />
avoir accès à ces services essentiels qui étaient offerts à la<br />
population entendante. Les préoccupations étaient les<br />
suivantes :<br />
a. il n'y avait aucun psychiatre pouvant s'exprimer<br />
couramment en ASL dans la région d'Ottawa<br />
b. il n'y avait pas de programme de traitement des<br />
toxicomanies <strong>et</strong> de l'alcoolisme<br />
c. on n'offrait aucun service spécialisé en santé mentale.<br />
En s'appuyant sur le manque de services, un certain nombre<br />
d'intervenants intéressés firent du lobby auprès du<br />
gouvernement provincial pour que celui-ci débloque des fonds<br />
pour des services s'adressant aux personnes sourdes affligées<br />
d'une maladie mentale grave <strong>et</strong> persistante. (organismes : SCO,<br />
ACSM, Ottawa Salus).<br />
En mars 2000, le Ministère de la Santé accordait les fonds<br />
nécessaires pour offrir des services d'accompagnement<br />
communautaire à des personnes sourdes. Il accordait<br />
également des fonds pour l'interprétation en langue des signes<br />
pour soutenir ces services. Nous disposions ainsi de fonds pour<br />
2 travailleurs en santé mentale à plein temps (accompagnateurs<br />
communautaires) à Ottawa Salus, pour dispenser des services à<br />
environ 20 clients <strong>et</strong> un(e) interprète à plein temps à la SCO.
Le modèle de prestation de service voulait que 2 travailleurs<br />
dispensent des services dans la culture du client (sourd, à base<br />
orale en fonction du client) <strong>et</strong> aient le soutien d'une interprète<br />
en langue des signes à plein temps pour prêter assistance,<br />
d'une part aux travailleurs pour leur perm<strong>et</strong>tre de travail plus<br />
globalement avec le système <strong>et</strong> d'autre part, aux clients pour<br />
leur perm<strong>et</strong>tre d'avoir accès aux services offerts dans la<br />
collectivité. C'était là un groupe de gens qui avaient rarement<br />
été desservis auparavant <strong>et</strong> qui avaient été grandement<br />
marginalisés <strong>et</strong> négligés. Dans le cadre de la préparation du<br />
lobby pour obtenir ces fonds, il avait été déterminé que le<br />
nombre de clients possibles pourrait s'élever à 520 (10 % de la<br />
population sont sourds, devenus sourds <strong>et</strong> malentendants, <strong>et</strong><br />
2 % de la population sont affligés de maladie mentale sévère <strong>et</strong><br />
persistante).<br />
LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES<br />
Tous les intéressés furent ravis de l'annonce de financement <strong>et</strong><br />
Salus mit rapidement au point un plan de mise en oeuvre.<br />
Comme on pouvait s'y attendre, la mise en oeuvre du plan prit<br />
beaucoup plus de temps qu'on s'y attendait, pour un certain<br />
nombre de raisons.<br />
Le premier obstacle fut le recrutement de 2 employés très<br />
expérimentés en santé mentale qui s'exprimaient couramment<br />
en ASL. C<strong>et</strong>te tâche s'avéra très difficile. Il y avait beaucoup de<br />
personnes compétentes, mais peu d'entre elles possédaient les<br />
deux spécialités. Après consultation avec nos collègues de la<br />
collectivité des Sourds, il devint évident que Salus devait<br />
développer des compétences en ASL. Nous avions un certain<br />
nombre d'employés qui possédaient l'ASL à un certain degré <strong>et</strong><br />
deux d'entre eux se proposèrent d'accepter ce nouveau défi. Ils<br />
consentaient à assumer le défi, exigeant du temps <strong>et</strong> imposant<br />
du stress, de perfectionner leurs compétences linguistiques<br />
dans un bref laps de temps. Il s'avéra difficile d'avoir accès à<br />
des cours de langue dans la collectivité, particulièrement à un<br />
niveau plus avancé de formation. Souvent les cours étaient<br />
offerts, mais n'avaient pas lieu à cause du faible niveau<br />
d'inscriptions. À cause des contraintes de temps, nous avons<br />
décidé d'offrir du tutorat 1:1, ce qui s'avéra être un excellent<br />
choix. Nous avons eu recours à 2 tuteurs différents <strong>et</strong> le niveau<br />
d'enseignement <strong>et</strong> la rapidité du développement des<br />
compétences fut un excellent investissement en temps <strong>et</strong> en<br />
argent. L'autre avantage du tutorat individuel, c'est qu'il y a un<br />
certain nombre de termes fréquemment utilisés dans le système<br />
de santé mentale <strong>et</strong> que nous avons pu adapter nos besoins<br />
d'apprentissage avec les tuteurs.<br />
En même temps que le personnel était formé, nous faisions une<br />
part de formation de l'organisme pour améliorer notre capacité<br />
d'accessibilité à c<strong>et</strong>te population. Nous avons collaboré avec nos<br />
collègues de la collectivité des Sourds pour donner des ateliers<br />
de l'organisme qui étaient instructifs <strong>et</strong> amusants (voir<br />
distribution). Typiquement les personnes sourdes ont reçu leurs<br />
services à la SCO, dont la culture d'organisation est très<br />
accessible à l'usager. Le nouveau partenariat que Salus avait<br />
avec la SCO élargit la mission des deux organismes pour qu'ils<br />
s'habituent mieux à c<strong>et</strong>te nouvelle clientèle. Salus offrait du
soutien <strong>et</strong> de l'éducation pour la SCO sur la façon de soutenir<br />
les clients qui avaient de graves problèmes psychiatriques <strong>et</strong> les<br />
aidait à se familiariser avec les divers signes <strong>et</strong> symptômes avec<br />
lesquels les clients luttent souvent.<br />
LE DÉVELOPPEMENT D'UN PROFIL AU SEIN DE LA<br />
COLLECTIVITÉ SOURDE<br />
Le défi de recruter des clients était l'étape suivante dans le<br />
processus d'ensemble. Typiquement les clients qui avaient<br />
besoin de services d'accompagnement communautaire ou qui<br />
en voulaient remplissent un formulaire de référence <strong>et</strong> sont<br />
inscrits sur une liste d'attente centrale à l'ACSM. L'ACSM n'a pas<br />
été un organisme ou une ressource typique identifiée par la<br />
collectivité des Sourds, ni perçue comme leader des services<br />
dispensés à ce secteur.<br />
La collectivité sourde avait quelque appréhension à l'égard de ce<br />
type de service qui s'ouvrait pour les personnes sourdes, à<br />
l'extérieur de la culture traditionnelle des Sourds. On hésitait<br />
également à prendre contact avec un organisme clairement<br />
identifié comme un organisme de santé mentale, avec le<br />
stigmate associé qui peut être associé à leurs services.<br />
Étant donné tous les obstacles, il est devenu clair que les<br />
nouveaux travailleurs se devaient de commencer à établir un<br />
profil de confiance avec le collectivité sourde. Le plan était de<br />
devenir plus visibles en faisant un certain nombre d'heures de<br />
bénévolat à un organisme communautaire qui offrait une variété<br />
de services visant la collectivité sourde. C<strong>et</strong>te idée s'avéra<br />
excellente <strong>et</strong> plut beaucoup au personnel.<br />
Le temps passé au centre a servi à un certain nombre de buts :<br />
1. Les diverses activités <strong>et</strong> relations ont fourni au personnel<br />
de multiples occasions de pratiquer ses compétences en<br />
ASL fraîchement acquises<br />
2. Le personnel a lentement bâti une visibilité dans la<br />
collectivité des Sourds<br />
3. Les gens se sont intéressés au travail des employés <strong>et</strong> ont<br />
commencé à poser des questions sur les services qu'ils<br />
offraient. Ils sont souvent devenus des sources de<br />
référence pour des amis ou des collègues qui pouvaient<br />
faire appel aux services.<br />
4. Le travail de bénévole, ainsi que l'extension vers les clients<br />
en puissance ont aidé à diminuer l'appréhension <strong>et</strong> le<br />
stigmate perçu des "services de santé mentale".<br />
CRÉATION DE LIENS ET EXTENSION<br />
Le travail de bénévolat fut perçu comme une activité<br />
d'extension, étant donné que le personnel de Salus approchait<br />
des clients en puissance <strong>et</strong> leur donnait des renseignements sur<br />
les services possibles. Initialement, les clients voulaient<br />
beaucoup avoir accès à des services comme l'aide financière ou<br />
le logement, <strong>et</strong> une grand part du travail du début consista à<br />
relier les gens au service dont ils avaient besoin.
On fit appel aux dispensateurs de services aux Sourds tant dans<br />
les programmes de counseling que dans les programmes de<br />
jour, ainsi qu'aux dispensateurs de services plus traditionnels<br />
des hôpitaux <strong>et</strong> de la collectivité pour les informer des<br />
nouveaux services <strong>et</strong> susciter des références.<br />
En une brève période de temps nous avons reçu un certain<br />
nombre de références, formellement de l'intérieur de la<br />
collectivité des professionnels entendants <strong>et</strong> directement de la<br />
collectivité des Sourds. Il est très intéressant de noter que,<br />
malgré toutes nos inquiétudes vis-à-vis la stigmatisation des<br />
clients en puissance avec l'étiqu<strong>et</strong>te de "maladie mentale", très<br />
peu de clients ont eu des inquiétudes concernant le fait d'être<br />
identifiés comme malades mentaux. Le modèle<br />
d'accompagnement communautaire que Salus utilise est un<br />
service portable, souple où les clients sont vus là où ils<br />
préfèrent, souvent chez eux. Pareillement, un certain nombre<br />
de clients préfèrent avoir leurs rendez-vous à nos bureaux<br />
d'administration, qui arbore une p<strong>et</strong>ite enseigne sur laquelle<br />
apparaît l'inscription "Ottawa Salus", sans rien qui identifie le<br />
bâtiment comme organisme de santé mentale.<br />
Ce fut là un proj<strong>et</strong> emballant <strong>et</strong> enrichissant à entreprendre. Il y<br />
a eu une énorme courbe d'apprentissage de l'organisme avant<br />
de s'habituer au fait que l'organisme est accessible <strong>et</strong> de bien le<br />
connaître. Dans tout nouveau proj<strong>et</strong>, il y a toujours 2 processus<br />
qui fonctionnent en même temps, le proj<strong>et</strong> (contenu, le "quoi")<br />
<strong>et</strong> le processus (le "comment").<br />
Les détails du proj<strong>et</strong> lui-même étaient toutes les techniques<br />
mentionnées plus tôt.<br />
Étude du plan d'implantation :<br />
1. Recrutement <strong>et</strong> formation du personnel.<br />
2. Amélioration de la capacité de l'organisme de desservir la<br />
population visée.<br />
3. Développement d'un profil au sein de la collectivité sourde<br />
4. Liaison, extension<br />
5. Services directs<br />
Examen du processus :<br />
Comme nous le savons d'expérience, le processus est aussi<br />
important, sinon plus, que le proj<strong>et</strong> lui-même. Les relations<br />
personnelles <strong>et</strong> le réseautage que nous prenons parfois pour<br />
acquis sont ce qui 'fait ou défait' un partenariat. Les choses<br />
peuvent paraître parfaites sur papier, mais c'est à des<br />
personnes qu'il tient d'opérationnaliser le proj<strong>et</strong>. Toutes les<br />
relations sont grouillantes de politique <strong>et</strong> de possibilités de<br />
conflit. Cela peut sembler évident, mais il est très important<br />
d'entr<strong>et</strong>enir les relations de partenariat <strong>et</strong> d'être prêts de<br />
consacrer le temps <strong>et</strong> l'effort nécessaire pour avoir un<br />
partenariat réussi.<br />
Étapes du développement <strong>et</strong> du maintien de partenariats<br />
communautaires
1. Choisir avec qui vous allez avoir une relation. Souvent en<br />
tant qu'organismes, nous nous trouvons à travailler avec<br />
des collègues qui ont des mandats différents, des missions<br />
différentes <strong>et</strong> des cultures organisationnelles très<br />
différentes. Dans notre partenariat avec la SCO nous avons<br />
eu la grande chance d'avoir un but commun, celui de<br />
développer des services qui n'avaient pas existé<br />
auparavant.<br />
2. Apprendre à connaître votre partenaire. Il est critique de<br />
connaître : les forces <strong>et</strong> les faiblesses de l'un <strong>et</strong> de l'autre.<br />
Il est important de développer des façons d'atteindre les<br />
buts mutuels <strong>et</strong> de développer des services<br />
complémentaires.<br />
3. Maintenir de bonnes relations. Il est évident qu'il y aura<br />
des hauts <strong>et</strong> des bas <strong>et</strong> des occasions où il y aura des<br />
domaines de conflit. Il sera utile de discuter d'un format de<br />
résolution de crise avant de commencer le partenariat<br />
plutôt qu'une fois que le processus de mise en oeuvre est<br />
lancé <strong>et</strong> que les conflits apparaissent.<br />
4. Il est intéressant de noter que le Ministère de la Santé fait<br />
beaucoup de promotion des ententes de services entre les<br />
organismes. Ces ententes consistent simplement à prendre<br />
des façons informelles de travailler pour les rendre<br />
explicites dans des ententes écrites. Dans le passé, nous<br />
avons souvent travaillé des partenaires communautaires<br />
sans ententes formelles écrites, mais, dans un climat où la<br />
responsabilité prend le dessus, les ententes de services<br />
sont devenues la norme.<br />
5. Un processus d'évaluation continu comportant un<br />
mécanisme intégré de révision des services en fonction des<br />
besoins est un autre ingrédient essentiel de bon<br />
fonctionnement.<br />
Consultez le document distribué no. 2<br />
Ce document est une référence rapide qu'un organisme aurait<br />
probablement avantage à utiliser s'il songe à réaliser une<br />
expansion de ses services.<br />
LA PHASE DE MISE EN OEUVRE<br />
Nous venons de voir le processus de développement de services<br />
spécialisés <strong>et</strong> maintenant nous verrons la prestation de services<br />
elle-même.<br />
Paul Boileau est un des accompagnateurs communautaires de<br />
Salus qui est spécialisé dans le travail avec les Sourds, les<br />
devenus sourds <strong>et</strong> les malentendants. Il possède une riche<br />
expérience <strong>et</strong> il parlera de certaines des choses que nous avons<br />
apprises, à Salus.<br />
DOCUMENT À DISTRIBUER no. 1<br />
LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'ORGANISME<br />
1. Membres de la collectivité des Sourds<br />
- sourds, devenus sourds <strong>et</strong> malentendants
- sourds oralistes, par opposition aux Sourds culturels<br />
2. Qu'est-ce que l'ASL ?<br />
- histoire<br />
- MSL, LSQ <strong>et</strong>c.<br />
- dactylologie<br />
- structures du discours – anglais vs ASL<br />
3. Technologie<br />
- sous-titrage<br />
- ATM (TTY)<br />
- prothèses auditives, implants cochléaires, <strong>et</strong>c.<br />
- réveils-matin<br />
- détecteurs de fumée<br />
- Relai Bell<br />
4. La culture des Sourds<br />
- règles de comportement social<br />
- présentations<br />
- attention<br />
- rituel du départ<br />
- noms en signes<br />
5. Normes de groupe<br />
6. Comment utiliser un(e) interprète<br />
DOCUMENT À DISTRIBUER no. 2<br />
C<strong>et</strong> outil pourrait servir lorsqu'un organisme songe à<br />
étendre ses services
Niveau de l'organisme<br />
1) démontre un<br />
engagement à offrir des<br />
services aux client .. de<br />
"pratique exemplaire"<br />
2) démontre un<br />
engagement à développer<br />
<strong>et</strong> étendre ses services pour<br />
répondre aux besoins du<br />
client<br />
Niveau de la direction<br />
1)démontre un leadership<br />
dans le développement de<br />
nouveaux services<br />
2) démontre une volonté de<br />
faire partenariat avec<br />
d'autres organismes dans la<br />
prestation de services<br />
3) démontre une ouverture<br />
au r<strong>et</strong>our d'information de<br />
la part des partenaires<br />
communautaires concernant<br />
la prestation de services<br />
4) démontre l'importance<br />
du recrutement <strong>et</strong> de la<br />
rétention du personnel pour<br />
assurer la bonne qualité du<br />
personnel<br />
5) démontre l'importance<br />
de l'investissement dans la<br />
formation du personnel<br />
Niveau du travailleur de<br />
première ligne<br />
1) démontre la foi en un<br />
apprentissage permanent<br />
2) démontre un intérêt à<br />
accepter de nouveaux défis<br />
Intérêt<br />
élevé<br />
Intérêt<br />
moyen<br />
Peu<br />
d'intérêt<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Sourds-aveugles : ça vaut l'effort<br />
Par : Otto Fritschy<br />
Les sourds-aveugles sont aussi normaux que les gens spéciaux<br />
<strong>et</strong> aussi spéciaux que les gens normaux. Le problème est que la<br />
communication fait défaut dans la plupart des circonstances. Et<br />
lorsque la communication s'arrête, il y a place à toutes sortes<br />
de sentiments inadéquats <strong>et</strong> de mauvaises interprétations. Cela<br />
est cause d'un manque d'information des deux côtés. Et la fin<br />
de l'histoire est que les sourds-aveugles paient la note. Même<br />
les bureaux de contrôle de la santé sont ignorants de ce qui se<br />
passe. Alors qui sera le juge de la négligence ? Et les sourdsaveugles<br />
sont négligés de toutes sortes de façons, parfois<br />
même lorsque les intentions sont irréprochables.<br />
Il y a quelques années, nous avons fait une recherche dans une<br />
maison de soin pour les sourds dans les Pays-Bas. Le nombre<br />
de personnes soumises à l'enquête n'était pas bien important,<br />
mais nous avons essayé d'examiner le plus grand nombre de<br />
caractéristiques possibles. Nous avons soumis à l'enquête dix<br />
personnes qui étaient nées sourdes (ou qui étaient au moins<br />
devenues sourdes très jeunes) <strong>et</strong> qui ont développé plus tard<br />
une déficience visuelle. Nous avons étudié l'état physique, en<br />
portant une attention particulière aux oreilles <strong>et</strong> aux yeux, à<br />
l'état mental, aux circonstances sociales <strong>et</strong> à la communication.<br />
En nous avons essayé de faire une biographie. Tous ces articles<br />
furent reportés d'un grand nombre de façons. Par exemple :<br />
nous n'avons fait pas seulement fait un examen physique, mais<br />
nous avons également essayé de consigner combien de fois une<br />
personne avait consulté un médecin au cours des dix années<br />
précédentes. Il s'est avéré que plus la vision empirait, moins les<br />
gens consultaient un médecin. Et dans les groupes entendants<br />
d'aînés, c'est l'inverse ; plus on vieillit, plus on visite le<br />
médecin. C'est triste de penser que de perdre la vue voulait dire<br />
moins voir le médecin dans tous les sens du mot.<br />
Anne Sullivan est morte en 1936 à l'âge de 70 ans. Elle était<br />
aveugle d'une cause inconnue, <strong>et</strong> elle recouvrit une partie de la<br />
vue avec un certain nombre d'opérations chirurgicales. En 1880<br />
elle fut admise au Perkins Institute and Massachuss<strong>et</strong>ts School<br />
for the Blind, à Boston. Et dure-à-cuir qu'elle était, son nom<br />
était "spitfire", un rappel de son tempérament inflammable <strong>et</strong><br />
de sa langue acérée. Elle avait la tâche de guider les enfants<br />
aveugles. La première favorite d'Anne fut Laura Bridgman, la<br />
première enfant sourde <strong>et</strong> aveugle qui alla à l'école aux É.-U.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Laura apprit l'alphab<strong>et</strong> manuel, tout comme Ann. En 1886 elle<br />
termina ses études comme la meilleure étudiante <strong>et</strong> elle eut<br />
l'honneur de prononcer le discours.<br />
Helen Keller mourut en 1968 à l'âge de 88 ans. Ses histoires<br />
étaient si immenses <strong>et</strong> si intenses que tout le monde devrait<br />
savoir maintenant tout ce qu'il en est des sourds <strong>et</strong> des<br />
aveugles. Et, de fait, il y a juste deux besoins de base : la<br />
communication <strong>et</strong> l'information.<br />
Elle est née le 17 juin 1880 à Tuscumbia (Alabama). Selon sa<br />
mère, elle pouvait parler un peu à l'âge de six mois, mais à 19<br />
mois elle eut une "fièvre du cerveau" comme on appelait la<br />
chose en ce temps-là, ce qui était très probablement une<br />
méningite. Les conséquences furent désastreuses ; elle devint<br />
sourde <strong>et</strong> aveugle. Et, en ce temps-là, la fièvre du cerveau était<br />
synonyme de déficience mentale. On ne savait pas alors que les<br />
enfants sourds <strong>et</strong> aveugles soient incapables de se développer,<br />
simplement parce qu'ils ne pouvaient comprendre leur<br />
entourage.<br />
Dans la population totale des sourds <strong>et</strong> des aveugles, seulement<br />
une fraction, de l'ordre de 10 – 15 %, étaient déjà sourds <strong>et</strong><br />
aveugles dès l'enfance. La plupart d'entre eux ont des maladies<br />
congénitales ou héréditaires. La plupart des sourds <strong>et</strong> des<br />
aveugles deviennent ce qu'ils sont dans leur troisième étape de<br />
vie. Entre temps il y a le groupe d'aveugles précoces-sourds<br />
tardifs <strong>et</strong> le groupe de sourds précoces-aveugles tardifs. En<br />
vieillissant, une personne présente plus de risques <strong>et</strong> de fils<br />
pour une perte de sens, <strong>et</strong> la perte combinée de deux sens<br />
comme l'ouïe <strong>et</strong> la vue n'est pas si rare qu'on le croit.<br />
Alors Helen Keller fut seulement très malchanceuse d'avoir eu<br />
une maladie qui lui a détruit les yeux <strong>et</strong> les oreilles. Elle fut<br />
toutefois chanceuse d'avoir pu conserver le reste de ses<br />
capacités du cerveau, parce que la perte de deux sens signifie<br />
souvent davantage de destruction. Mais, bien qu'il n'y ait eu<br />
aucun résultat de tests connu pour son QI, il n'y a aucun doute<br />
qu'il était extrêmement élevé. Il a fait d'elle le modèle de rôle<br />
parfait, une légende <strong>et</strong> un leader des sourds <strong>et</strong> aveugles, en son<br />
temps <strong>et</strong> même après sa mort.<br />
Avec ses aptitudes extraordinaires, elle avait un besoin de<br />
communication, d'information, d'apprentissage, de<br />
connaissances <strong>et</strong> de stimulation qu'elle obtiendrait d'une façon<br />
ou d'une autre. Comme une personne mourant de faim qui vole<br />
même de la nourriture pour l'obtenir. Mais ce que nous avons<br />
appris, c'est que tous les sourds-aveugles ont ce besoin, <strong>et</strong> que,<br />
s'ils l'ont, ils sont en bien meilleur posture.<br />
S'il y a communication, des maladies cachées peuvent être<br />
r<strong>et</strong>racées. Dans notre recherche nous avons trouvé que, sur 10<br />
cas, 9 troubles mentaux classifiables n'avaient pas été<br />
diagnostiqués auparavant. Au moins ce n'était pas connu des<br />
antécédents médicaux. Trois personnes souffraient de démence.<br />
Une avait la maladie d'Alzheimer, une un type de démence, <strong>et</strong><br />
une avait la maladie de Parkinson. Les trois troubles devraient<br />
être abordés de façon différente, <strong>et</strong> devraient, en fait, se<br />
trouver dans une population entendante. Mais dans ces cas il y
n'y avait pratiquement pas d'approche.<br />
5 personnes avaient un type de dépression, l'une d'elle une<br />
dépression majeure, qui est très accessible pour traitement<br />
médical. Mais ce ne fut pas fait ainsi. Personne ne le savait. La<br />
personne fut traitée <strong>et</strong> surmonta sa dépression dans environ 6<br />
semaines.<br />
Ai-je mentionné que les ophtalmologistes visités par les<br />
personnes sourdes-aveugles ? Voyez ce que nous pouvons<br />
apprendre de la biographie d'Helen Keller. Et ce fut une visite<br />
qui comportait un impact surprenant.<br />
Plus la p<strong>et</strong>ite Helen grandissait, plus ses frustrations <strong>et</strong> sa<br />
colère empiraient. Elle devint sauvage <strong>et</strong> vraiment impossible à<br />
contrôler. Elle devint violente, volait <strong>et</strong> faisait des choses<br />
réellement dangereuses. Une fois, elle poussa le lit de bébé de<br />
sa p<strong>et</strong>ite soeur à l'envers, une fois elle enferma à clé sa mère<br />
dans un garde-manger. Il fallait juste faire quelque chose.<br />
Ses parents la menèrent chez un oculiste de Baltimore, un<br />
spécialiste de la cécité, <strong>et</strong> il les conduisit à nul autre<br />
qu'Alexander Graham Bell. Celui-ci n'était pas seulement<br />
l'inventeur du téléphone, vous savez, l'ancêtre de l'ATM avec<br />
des fonctions Braille, mais il était également un expert en<br />
éducation des sourds. Graham Bell reconnut instantanément<br />
son intelligence. Comme vous savez c'est ce que font les gens<br />
aux aptitudes élevées, comme des frères <strong>et</strong> des soeurs dans<br />
l'âme. Car il ne se trouvait pas exactement au bout de la ligne,<br />
non plus, lorsque les cerveaux furent distribués. Alors il l'envoya<br />
au Perkins Institute. Le principal sut immédiatement qu'Anne<br />
Sullivan lui correspondrait parfaitement.<br />
Et voyez ce que Anne décrit sur le premier moment où elle a<br />
rencontré Helen. Je cite son journal : "Son visage était difficile à<br />
décrire. Il est intelligent, mais il manque de sensibilité, ou peutêtre<br />
d'âme." Et plus loin : "Elle sourit rarement".<br />
Mais, même si Anne avait 20 ans, elle comprenait Helen, ayant<br />
été aveugle <strong>et</strong> ayant montré le même comportement, tout à fait<br />
comme elle.<br />
Je me rappelle de ce que nous avons trouvé dans notre<br />
recherche :6 sur 10 personnes étaient déprimées, 3 des autres<br />
souffraient de démence, de sorte que la dépression pouvait<br />
rester cachée. Alors Helen n'était probablement que déprimée<br />
<strong>et</strong> personne ne reconnaissait c<strong>et</strong> état. Elle en montrait toutes<br />
les caractéristiques dans son comportement.<br />
Rien n'a changé en un siècle.<br />
Lorsque des non experts regardent des personnes sourdesaveugles,<br />
ils voient ce qu'ils croient être acceptable : un visage<br />
sans âme qui ne sourit jamais. Les personnes qui savent<br />
communiquer avec eux savent que ce visage peut changer ou,<br />
mieux, peut être changé.<br />
Mais le jumelage entre Anne <strong>et</strong> Helen nous enseigne quelque<br />
chose d'autre. Quelle que soit l'intelligence, l'habil<strong>et</strong>é ou la
capacité de la personne sourde-aveugle, il y a, <strong>et</strong> il y aura<br />
toujours un besoin de guidage. Meilleur est le guide, meilleures<br />
seront les qualités qui ressortiront. Et les meilleurs guides sont<br />
ceux qui possèdent des caractères personnels qui font bien le<br />
jumelage. Dans le cas d'Anne, c'était sa propre cécité, plus tard<br />
guérie, <strong>et</strong> ses problèmes de comportement (probablement aussi<br />
basés sur un QI plutôt élevé, si on regarde le reste de l'histoire<br />
de sa vie).<br />
Dans notre recherche nous avons examiné en profondeur les<br />
aptitudes à la communication des sourds-aveugles. Seulement<br />
quelques personnes avaient un niveau adéquat de<br />
communication en langue des signes. Quelques-uns étaient<br />
capables de comprendre l'épellation digitale tactile, d'autres<br />
dépendaient de l'écriture dans la main. Nous savons tous que<br />
les sourds sont les meilleurs guides pour les sourds-aveugles<br />
sachant la langue des signes. Mais nous avons trouvé que les<br />
sourds venus de l'étranger, comme les réfugiés, faisaient<br />
étonnamment bien avec ceux des niveaux plus bas. C'était<br />
comme s'ils devaient se rencontrer à mi-chemin du pont,<br />
sachant qu'il y en avait un à vaincre pour commencer.<br />
Helen Keller était assez habile pour rendre son propre langage<br />
compréhensible à ses parents ; <strong>et</strong> Anne Sullivan était assez<br />
vaillante pour apprendre le signe tactile. Mais Helen avait une<br />
histoire, ce qui faisait qu'elle devait être déprogrammée.<br />
Lorsque Anne essayait de laisser Helen faire quelque chose<br />
qu'elle ne voulait pas faire, Helen commençait à crier <strong>et</strong> à<br />
mordre. L'outil de défense d'Helen était la colère. Et la famille<br />
d'Helen était très protectrice <strong>et</strong> faisait constamment<br />
interférence avec la façon dont Anne traitait avec Helen. Alors<br />
Anne décida de vivre avec Helen dans une p<strong>et</strong>ite maison,<br />
seules. Anne n'était plus obligée d'abandonner la partie, <strong>et</strong> le<br />
comportement d'Helen changea. Cela ouvrit des occasions<br />
perm<strong>et</strong>tant à Helen d'apprendre. Anne ne savait que l'écriture<br />
de l<strong>et</strong>tre dans la main <strong>et</strong> Helen avait un vocabulaire d'environ<br />
60 signes. Après deux mois il y avait entre elles une certaine<br />
compréhension de langage : bien sûr dans la méthode d'écriture<br />
dans la main d'Anne. Pas à la façon d'Helen, de signes tactiles.<br />
Que serait-il arrivé si Anne avait été sourde??? Mais le besoin<br />
de base d'Helen était l'information, quelle que soit la façon dont<br />
elle l'obtenait. Alors elle s'en fichait pas mal.<br />
Dans notre recherche il y avait des bénévoles qui avaient des<br />
aptitudes à la communication très faibles, mais une attitude<br />
formidable. Et un esprit très ouvert aussi. Toutefois, il y avait<br />
aussi un cas où une femme sourde semblait avoir pris<br />
possession de "son" amie sourde-aveugle. Nous ne pouvions<br />
pas approcher la femme sourde-aveugle pour une investigation<br />
proprement dite, <strong>et</strong> lorsque nous utilisions son guide comme<br />
interprète, nous voyions que c<strong>et</strong>te dernière donnait de fausses<br />
informations sur nous <strong>et</strong> sur nos objectifs de recherche. C'était<br />
une situation terrible : essayer de nous rapprocher l'effrayait, la<br />
laisser dans c<strong>et</strong>te situations sociale pauvre <strong>et</strong> malade nous<br />
faisaient également nous sentir mal. La réalité, l'image du<br />
monde d'une sourde-aveugle dépendait d'une femme qui était<br />
très bonne dans le sign tactile, mais mauvaise guide. Pour nous<br />
c'était, comme on dit en Hollande, un choix entre dégobiller <strong>et</strong><br />
vomir (excusez-moi, je suis hollandais). Nous avons essayé de<br />
nous faire amis avec le guide, nous avons essayé de la
convaincre.<br />
Je me demande encore exactement comment Anne s'y est prise<br />
pour séparer Helen de sa famille sachant quelle force une<br />
symbiose peut avoir.<br />
Chemin faisant, Anne apprit la bonne langue des signes.<br />
Comme personne entendante je sais que nous sommes toujours<br />
un peu lents à comprendre que c'est beaucoup plus facile <strong>et</strong><br />
rapide à exprimer <strong>et</strong> expliquer tout. Alors elle alla à l'école des<br />
sourds, à New-York, <strong>et</strong> Anne était son interprète. Les deux<br />
femmes développèrent plusieurs capacités langagières parce<br />
qu'Helen était tellement brillante pour toutes les apprendre. Elle<br />
pouvait parler, signer, écrire dans la main, lire le Braille, sentir<br />
la parole avec un doigt sur la gorge de quelqu'un. Elle était<br />
tellement en contact avec le monde. Mais.... elle manqua les<br />
funérailles de son père en 1896. On avait oublié de le lui dire.<br />
Les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs sont là pour<br />
que nous puissions en tirer des leçons.<br />
Nous avons trouvé que les sourds-aveugles de la résidence<br />
avaient très peu de contacts avec leurs familles. Et ils étaient<br />
très souvent coupés de l'information les concernant, par oubli<br />
ou délibérément. "Ne lui disons pas, il ne peut pas le prendre, il<br />
ne comprend pas, il a oublié son père, de toutes façons." Ce<br />
que nous faisons, c'est de filtrer l'information. Nous décidons ce<br />
qui est utile, ce qui est bon ou mauvais, ce qui est important.<br />
Quelle que soit votre intelligence, si vous n'avez pas la bonne<br />
information,<br />
vous ne savez pas,<br />
vous ne pouvez pas prendre de décision personnelle,<br />
vous ne pouvez pas pleurer ou rire ,<br />
vous ne semblez pas avoir d'âme, vous ne pouvez sourire.<br />
Helen fur la première personne sourde-aveugle à obtenir un<br />
baccalauréat ès arts, <strong>et</strong> avec distinction. Elle avait une<br />
excellente concentration, une mémoire fantastique, combinés<br />
avec de l'audace <strong>et</strong> de la vaillance. Alors, j'en suis sûr, elle s'est<br />
réellement mérité le titre. Mais nous devons être prudents : les<br />
sourds-aveugles méritent une estime honnête. Pas basée sur<br />
des motifs faux, mais sur un jugement <strong>et</strong> des connaissances<br />
réalistes. Pas sur des préjudices, positifs ou négatifs : les deux<br />
sont mauvais. Par des gens qui se pourvoient de bons<br />
communicateurs, ou interprètes. Avec un esprit totalement<br />
ouvert.<br />
Un guidage par une seule personne est très vulnérable, à la fois<br />
pour le guide <strong>et</strong> pour la personne guidée.<br />
Anne épousa John Albert Macy en 1905. Il était l'éditeur du livre<br />
d'Helen. "The Story of her Life", qui la rendit indépendante de<br />
fortune. Quel symbole. Le mariage ne réussit pas <strong>et</strong> on<br />
considéra y m<strong>et</strong>tre fin en 1914. Il n'y eut jamais de divorce<br />
officiel. Un guide de ce type a deux mariages : la personne<br />
sourde-aveugle <strong>et</strong> son mari. Le mari perdit la partie.<br />
En 1916 Anne tomba gravement malade pendant une courte
période. P<strong>et</strong>er Fagan devint le secrétaire d'Helen ; il avait 29<br />
ans <strong>et</strong> possédait un journal. Ils tombèrent amoureux <strong>et</strong> il y eut<br />
de sérieux proj<strong>et</strong>s de mariage. Ils vécurent comme couple non<br />
marié dans la même maison. Mais un reporter d'un autre<br />
journal flaira un bon article <strong>et</strong> écrivit un article vicieux<br />
concernant c<strong>et</strong>te liaison. Il suggérait une situation très<br />
indécente. Helen ordonna à P<strong>et</strong>er de quitter la maison. Elle était<br />
également une enfant de son époque <strong>et</strong> très religieuse. La<br />
courte aventure devint un doux souvenir, <strong>et</strong> sa solitude qui<br />
suivit, sa plus grande déception.<br />
Si je pouvais voir, je me marierais certainement, disait-elle. Les<br />
sourds-aveugles ne sont que des gens normaux, avec des<br />
besoins normaux <strong>et</strong> des exigences normales. Mais ils sont jugés<br />
<strong>et</strong> traités différemment par les entendants.<br />
Considérant tout cela, nous avons décidé d'organiser les choses<br />
différemment. Les sourds-aveugles devraient avoir plus d'un<br />
guide, afin de vérifier l'information, d'obtenir plus d'information,<br />
d'éliminer les concentrations personnelles, d'être capables<br />
d'aimer <strong>et</strong> de détester un guide sans beaucoup dépendre de<br />
c<strong>et</strong>te personne. Les guides devraient avoir plus de personnes<br />
sourdes-aveugles, de façon à apprendre qu'il y a plus d'une<br />
personne sourde-aveugle, d'acquérir plus de compétences,<br />
d'éviter les caractéristiques inadéquates dans une relation.<br />
Nous savons aussi qu'il est très important d'amener les sourdsaveugles<br />
ensemble pour communiquer sur eux-mêmes. Pour<br />
développer un langage servant à exprimer leurs plaintes à un<br />
médecin qui n'est pas au courant du manque de ce que nous<br />
appelons un proto-professionnalisme. C'est la connaissance que<br />
les entendants recueillent des contacts sociaux, de la famille,<br />
des voisins, de la radio. Nous pouvons ne pas réaliser cela, mais<br />
c'est le bagage que nous commençons avec une consultation<br />
médicale, <strong>et</strong> ils attendent également cela de nous. Ils<br />
s'attendent inconsciemment la même chose d'un sourd-aveugle<br />
<strong>et</strong> c'est là qu'est le danger. Personne n'est à blâmer. Les deux<br />
côté ne savent simplement pas.<br />
Dans notre service pour les aînés sourds nous avons également<br />
parfois des personnes sourdes-aveugles. C'est triste à dire que<br />
les personnes sourdes-aveugles avaient des maladies physiques<br />
graves dans presque tous les cas. En, incidemment : environ<br />
80 % des sourds également. Les deux groupes disaient<br />
fréquemment qu'il ne servait à rien de visiter un médecin parce<br />
qu'il ne les comprendrait pas de toute façon, <strong>et</strong> certains disaient<br />
qu'ils ne feraient pas en sorte que le guide y participe <strong>et</strong> aussi<br />
qu'il ne voulaient pas les offenser en y allant sans eux. Un<br />
désastre. Pas surprenant que beaucoup de choses indiquent que<br />
les sourds <strong>et</strong> les sourds-aveugles ont une espérance de vie<br />
moins longue que les entendants.<br />
Incidemment. Nous avons réalisé une enquête dans un groupe<br />
de 67 aînés sourds, qui ne visitaient pas d'oculiste sur une base<br />
régulière. La vision moyenne était de 40 %. De ce groupe,<br />
80 % s'avéraient avoir une maladie de l'oeil grave, dont 20 %<br />
avaient besoin d'une chirurgie immédiate. Il semble que nous<br />
créons des sourds-aveugles par notre seul manque<br />
d'organisation. Il est moins cher de prévenir avec toutes sortes<br />
de moyens.
Helen Keller n'était pas dans la moyenne. Et elle avait<br />
l'information. Elle écrivit 12 livres importants sur en large<br />
éventail de questions, <strong>et</strong> non seulement sur la surdité <strong>et</strong> la<br />
cécité. Elle était habile à faire de la levée de fonds, elle donna<br />
des conférences dans le monde entier, elle était très proche de<br />
plusieurs présidents des É.-U. <strong>et</strong> a visité des monarques<br />
étrangers. Elle a lutté contre la peine de mort, pour les droits de<br />
la femme, contre le travail des enfants.<br />
Cependant, elle resta en contact avec son groupe de pairs. Elle<br />
savait qu'ils avaient besoin d'elle pour partager l'information. Et<br />
peut-être à cause de toutes ces compétences pour obtenir de<br />
l'information, elle resta en santé <strong>et</strong> elle fit bien ses 88 ans. Bien<br />
sûr ; au-dessus de la moyenne. Comme elle l'était.<br />
Dans notre enquête nous avons parcouru 10 biographies. Et<br />
nous avons appris beaucoup de choses. Dix personnes<br />
ordinaires dans une maison de soins spéciaux pour aînés<br />
sourds. Ces gens se trouvaient être également aveugles ou<br />
étaient en train de le devenir. La biographie d'Helen Keller est<br />
un grand miroir pour ceux qui traitent avec des sourdsaveugles.<br />
Elle était très spéciale.<br />
Mais comme je l'ai dit : Les sourds-aveugles sont aussi<br />
ordinaires que les gens spéciaux <strong>et</strong> aussi spéciaux que les gens<br />
ordinaires. Le travail vaut vraiment l'effort. Mais rappelez-vous :<br />
un sourire n'est qu'un début encourageant, pas un but final.<br />
Donnez seulement un peu d'âme <strong>et</strong> laissez sortir l'âme.<br />
Ottawa, septembre 2004.<br />
Conférence de <strong>Reach</strong><br />
Otto B.M. Fritschy, gériatricien social<br />
Centre de santé mentale "De Ri<strong>et</strong>horst"<br />
Service des sourds <strong>et</strong> malentendants<br />
Willy Brandtlaan 20<br />
6716RR Ede<br />
The N<strong>et</strong>herlands<br />
Tel: 00 31 318 433610<br />
Fax: 00 31 318 433689<br />
o.fritschy@degelderseroos.nl<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Le "ASL Parent-Child Mother<br />
Goose Program"<br />
Par : Kristin Snoddon, ASL and Literacy Training Coordinator<br />
Shannon Pollock, ASL and Literacy Consultant<br />
Ontario Cultural Soci<strong>et</strong>y of the Deaf<br />
Introduction<br />
En 1974, l'Ontario Cultural Soci<strong>et</strong>y of the Deaf (OCSD) fut<br />
affiliée à la Canadian Cultural Soci<strong>et</strong>y of the Deaf afin de<br />
promouvoir la culture <strong>et</strong> le patrimoine des Sourds en Ontario <strong>et</strong><br />
d'encourager les contributions des Sourds dans les domaines<br />
des arts, du théâtre <strong>et</strong> de la littérature. L'OCSD fut<br />
formellement établie en 1980 <strong>et</strong> constituée en société en 1987.<br />
Ces dernières années, nous avons fait de grands progrès dans<br />
notre travail pour renforcer les liens familiaux entre les parents<br />
<strong>et</strong> leurs enfants sourds <strong>et</strong> pour augmenter les possibilité d'étude<br />
formelle de l'American Sign Language (ASL) <strong>et</strong> de la culture des<br />
Sourds.<br />
La mission de l'OCSD est de fournir un leadership, des<br />
ressources, de la formation <strong>et</strong> des activités qui font la<br />
promotion de la langue des Sourds, de leur culture <strong>et</strong> de leur<br />
patrimoine. Notre travail actuel comporte les activités<br />
suivantes :<br />
ASL <strong>et</strong> litératie précoce : Avec une subvention de la<br />
Fondation Trillium de l'Ontario, nous avons formé des<br />
conseillers en ASL <strong>et</strong> en littératie pour donner un enseignement<br />
en ASL portant sur les besoins linguistiques des parents de<br />
jeunes enfants sourds. Les conseillers en ASL <strong>et</strong> en littératie<br />
renseignent aussi les parents sur les étapes du développement<br />
de l'ASL <strong>et</strong> encouragent le développement du langage <strong>et</strong> de la<br />
littératie chez leur enfant par le jeu. Le gouvernement de<br />
l'Ontario a accordé une subvention pour soutenir l'emploi d'un<br />
coordonnateur provincial <strong>et</strong> d'un conseiller provincial bilingue<br />
pour le programme de conseillers en ASL <strong>et</strong> littératie. De plus,<br />
les centres régionaux de l'Ouïe du nourrisson (ODN) peuvent<br />
passer des contrats avec les conseillers en ASL <strong>et</strong> en littératie<br />
pour dispenser des services aux nourrissons. Si votre enfant a<br />
été identifié comme sourd par l'ODN, votre famille est<br />
admissible, pour une durée maximale de deux ans, aux services<br />
ASL d'un conseiller en ASL <strong>et</strong> en littératie.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Services de conseillers sourds de la P<strong>et</strong>ite enfance :<br />
Conçu comme une ressource pour les centres de la P<strong>et</strong>ite<br />
enfance de l'Ontario, ces services aident les spécialistes à<br />
répondre aux premiers besoins des enfants sourds de l'Ontario<br />
en matière de langage <strong>et</strong> de littératie. Les services de<br />
conseillers sourds de la P<strong>et</strong>ite enfance tiennent également des<br />
ateliers sur le langage, la littératie <strong>et</strong> la narration d'histoires à<br />
l'intention des parents <strong>et</strong> des familles, y compris notre nouveau<br />
"Parent-Child Mother Goose Program" en ASL pour les parents<br />
<strong>et</strong> les enfants. Le soutien, pour ces services, vient du Fonds Défi<br />
de la P<strong>et</strong>ite enfance.<br />
Ressources : Au printemps 2004, l'OCSD a publié A Parent<br />
Guidebook: ASL and Early Literacy <strong>et</strong> le ASL Parent-Child<br />
Mother Goose Program (DVD <strong>et</strong> VHS). C<strong>et</strong> automne, nous<br />
publierons American Sign Language and Early Literacy: a<br />
Natural Approach for Communicating with your Deaf Child (DVD<br />
<strong>et</strong> VHS). Nous offrons aussi d'autres ressources en ASL <strong>et</strong><br />
littératie précoce à l'intention des professionnels, dont le livr<strong>et</strong><br />
d'information You and Your Deaf Child rédigé à l'intention des<br />
parents d'enfants sourds.<br />
Le "Parent-Child Mother Goose<br />
Program" à l'intention des parents <strong>et</strong><br />
des enfants<br />
Le Parent-Child Mother Goose Program original fut fondé en<br />
1984 par Joan Bodger (thérapiste <strong>et</strong> conteuse) <strong>et</strong> Barry Dickson<br />
(travailleur social <strong>et</strong> conteur) (1) . Ces personnes ont mis sur pied<br />
un programme, à Toronto, pour les familles à risque élevé, avec<br />
la conviction que l'usage de comptines interactives pourrait<br />
favoriser le processus de liaison <strong>et</strong> offrir aux parents de<br />
nouvelles ressources pour s'occuper de leurs enfants (2) .<br />
L'efficacité du Parent-Child Mother Goose Program’s à<br />
promouvoir la littératie familiale, le bien-être de la famille <strong>et</strong> le<br />
développement cognitif <strong>et</strong> langagier de l'enfant est bien<br />
documenté.<br />
Le Parent-Child Mother Goose Program a été utilisé avec<br />
différentes langues partout dans le monde. L'idée de lancer un<br />
programme en ASL pour les parents Sourds <strong>et</strong> entendants <strong>et</strong> les<br />
jeunes enfants vient d'abord de Johanne Cripps (directrice du<br />
Canadian Deaf Heritage Project pour la Canadian Cultural<br />
Soci<strong>et</strong>y of the Deaf <strong>et</strong> coordonnatrice provinciale du programme<br />
ASL and Literacy de l'OCSD), qui rencontra Celia Lottridge,<br />
conteuse/éducatrice qui a beaucoup contribué à la mise sur pied<br />
du Parent-Child Mother Goose Program originel sous la forme<br />
d'un organisme de bienfaisance doté d'un conseil<br />
d'administration actif (3) . La première session de formation du<br />
Parent-Child Mother Goose Program pour les conseillers en<br />
ASL <strong>et</strong> en littératie fut tenue en janvier 2003. Deux autres<br />
sessions de formation furent par la suite tenues pour les<br />
conseillers en ASL <strong>et</strong> en littératie pour élaborer de nouvelles<br />
comptines, de nouveaux rhythmes <strong>et</strong> de nouveaux contes. (Le<br />
Parent-Child Mother Goose Program en ASL ne se sert pas de<br />
comptines <strong>et</strong> de rhythmes traduis de l'anglais. Nous avons<br />
élargi, <strong>et</strong> continuons à élargir notre répertoire de comptines, de<br />
rhythmes <strong>et</strong> de contes en ASL. Ce développement est important<br />
à cause de la quantité extrêmement limitée de littérature pour<br />
les jeunes enfants en ASL.)
Le pilote du proj<strong>et</strong> Parent-Child Mother Goose Programs en<br />
ASL fut lancé au printemps 2004 à plusieurs endroits (Toronto,<br />
Hamilton, Belleville, London, Oshawa, Milton, Newmark<strong>et</strong>). De<br />
nouveaux programmes devraient commencer c<strong>et</strong> automne à<br />
Barrie, Owen Sound <strong>et</strong> Sudbury. L'OCSD a fait une proposition<br />
de subvention à la Fondation Trillium de l'Ontario pour tenir une<br />
version élargie du Parent-Child Mother Goose Programs en<br />
ASL partout dans la province, <strong>et</strong> un plus grande nombre de<br />
sessions de formation pour les dispensateurs du programme.<br />
Pour en savoir davantage sur le Parent-Child Mother Goose<br />
Program en ASL <strong>et</strong> pour commander des ressources, veuillez<br />
communiquer avec Kristin Snoddon à kristin.<br />
snoddon@sympatico.ca ou 905-897-6881 (TTY).<br />
1. http://www.nald.ca/mothergooseprogram/history.htm<br />
2. http://www.nald.ca/mothergooseprogram/history.htm<br />
3. http://www.nald.ca/mothergooseprogram/history.htm<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Sommaire<br />
(Aucun texte n'ayant été soumis, nous reproduisons ici le<br />
sommaire paru dans le programme de la Conférence.)<br />
Que dit RÉELLEMENT la recherche<br />
sur la maladie psychiatrique <strong>et</strong> la<br />
surdité ?<br />
Par : Deena M. Martin<br />
C<strong>et</strong>te présentation donnera un sommaire des constatations<br />
découlant d'une analyse méthodique de la recherche sur la<br />
surdité <strong>et</strong> la maladie mentale. Particulièrement, la présentation<br />
traitera des complications méthodologiques qui restreignent<br />
présentement la contribution des conclusions de recherche à la<br />
surdité <strong>et</strong> à la maladie mentale.<br />
au début<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Services de santé mentale<br />
destinés aux Sourds,<br />
malentendants, & sourdsaveugles<br />
C<strong>et</strong>te page a été développée à partir du programme de<br />
PowerPoint préparé pour la présentation par Marjorie Cameron<br />
Elle <strong>et</strong> travailleuse de soutien en santé mentale<br />
Cadre 1<br />
Programme Bien-être<br />
Services de santé mentale destinés aux<br />
Sourds, malentendants, & sourds-aveugles<br />
Cadre 2<br />
Services de santé mentale dispensés<br />
aux groupes marginalisés au sein de la<br />
collectivité des Sourds<br />
Cadre 3<br />
Marjorie Cameron, Mental Health Support Worker<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
Cadre 4<br />
La province de Colombie-<br />
Britannique<br />
Données sur le programme WBP<br />
● débuta en 1991<br />
● plus de 1 000 client depuis le début<br />
● environ 350-400 dossiers ouverts simultanément<br />
● 70 % font de la thérapie<br />
Cadre 5<br />
Organisation <strong>et</strong> financement
Cadre 6<br />
Cadre 7<br />
Cadre 8<br />
Budg<strong>et</strong> annuel : 1 227 000,00 $<br />
Well-Being Program<br />
Budg<strong>et</strong> 2003-2004<br />
Well-Being Program
Cadre 9<br />
● Therapy - 35<br />
Well-Being Program<br />
● Mental Health Interpr<strong>et</strong>ing - 19<br />
● Support Work & Groups<br />
● Community Education<br />
To whom do we provide service<br />
Cadre 10<br />
● Deaf<br />
● Deaf-Blind<br />
● Hard of Hearing<br />
● Late deafened<br />
● CODA’s<br />
● Senior Citizens<br />
● Refugees<br />
● New Immigrants and their families<br />
Mental Health Support Workers<br />
● Life skills development<br />
● Advocacy<br />
● Case management<br />
● Supportive counselling<br />
● Deaf interpr<strong>et</strong>ing/Relay interpr<strong>et</strong>ing<br />
● Referrals<br />
● Co-ordinate/Facilitate Groups<br />
● Community Education<br />
In service training for consumers and professionals<br />
Cadre 11<br />
Community liaison<br />
● Liaison with other agencies & Deaf organization & agencies:<br />
Hospitals<br />
Psychiatrists<br />
Mental Health Team
Cadre 12<br />
Court<br />
Corrections<br />
Ministry of Human Resources<br />
BC Employment & Assistance<br />
Community Support<br />
● 3 trained Deaf Community Support Workers:<br />
2 Lower Mainland<br />
1 Vancouver Island<br />
Cadre 13<br />
Cadre 14<br />
Cadre 15<br />
Cadre 16<br />
Case Management<br />
● Community liaison support<br />
● Informal counselling<br />
● Life skills and coping<br />
● Referrals<br />
Deaf Issues<br />
● Access to mainstream services<br />
● Substance abuse<br />
● Mental illness<br />
● Multiple disabilities (Deaf-Plus)<br />
● Abuse<br />
Personal Development<br />
● Learn how to access<br />
● Improve their communication skills<br />
● Empowerment<br />
● Self-esteem<br />
● Social interaction:<br />
How to me<strong>et</strong> new people.
Cadre 17<br />
Cadre 18<br />
Well-Being Program<br />
Coffee Group<br />
● Multi-Cultural Coffee Group 1998 – 2001<br />
● Summer Activities Group 2001 – 2003<br />
● Deaf-Plus Coffee Group 2000 – 2001<br />
● WBP Coffee Group 2001 – 2004<br />
● Deaf Community Kitchen Coffee Group 2004<br />
Benefits of Groups<br />
● New Friends<br />
● Developing Communication<br />
● Playing Games<br />
● Healthy Foods<br />
● Volunteer Education Program:<br />
communication skills<br />
team building & work skills<br />
More information<br />
If you want more information on WBP publications and<br />
resources, contact us!<br />
Well-Being Program:<br />
Telephone: 604.732.7656<br />
TTY: 604.732.7549<br />
Fax: 604.732.5042<br />
For more information, check at website:<br />
http://www.vch.ca/wbp/<br />
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
L'autre façon de s'y prendre<br />
par Myrtle Barr<strong>et</strong>t<br />
Le jour où j'ai perdu l'ouïe, j'ai cru que ma vie était fichue <strong>et</strong>,<br />
jusqu'à un certain point, elle l'était, ou, du moins, la vie que je<br />
connaissais. Ce fut une expérience très traumatisante, mais<br />
comme j'étais travailleuse sociale dans un milieu de santé<br />
mentale, j'ai supposé que j'avais toutes les réponses <strong>et</strong> qu'il ne<br />
faudrait qu'un peu de temps avant que la vie ne reprenne son<br />
cours. Comme je me trompais. Travailler dans un milieu de<br />
santé mentale <strong>et</strong> avoir une bonne santé mentale, c'était deux<br />
choses différentes ! Ce qui représentait un défi encore plus<br />
grand, c'était de convaincre mon employeur <strong>et</strong> mes collègues de<br />
travail que je pouvais relever le défi. Un des commentaires les<br />
plus fréquents étaient : TU NE PEUX PAS FAIRE ÇA.<br />
Je ne vais pas parler de ma perte auditive. La plupart d'entre<br />
nous avons les mêmes histoires <strong>et</strong> des expériences qui se<br />
ressemblent. Ce qui nous différencie, c'est la façon dont nous<br />
nous en tirons <strong>et</strong> les habil<strong>et</strong>és de débrouillardise sont très<br />
individuelles mais très importantes pour la survie. Nous ne<br />
sommes pas que des personnes qui ont une perte auditive,<br />
nous sommes des personnes, <strong>et</strong> les personnes ont des<br />
personnalités différentes <strong>et</strong> différentes façons de s'adapter. Ce<br />
sont les habil<strong>et</strong>és de survie positives qui révèlent nos habil<strong>et</strong>és<br />
<strong>et</strong> contribuent à notre bonne santé mentale <strong>et</strong> qui, à leur tour,<br />
nous perm<strong>et</strong>tent de nous brancher au monde qui nous entoure.<br />
Je me suis toujours considérée comme bien équilibrée <strong>et</strong><br />
capable de relever les défis de la vie, mais répondre aux défis<br />
d'une vie de sourde ? Ce fut une période difficile d'ajustements<br />
<strong>et</strong> ce n'est pas encore facile, mais, à ce moment-là, la grande<br />
question était QU'EST-CE QUI M'ARRIVE MAINTENANT ? J'avais<br />
coutume de rester à attendre quelqu'un qui surviendrait <strong>et</strong> qui<br />
dirait : "Hé, j'ai toutes les réponses", mais pas de chance !| Puis<br />
un beau jour, j'en suis venue à réaliser que tout ça revenait à<br />
moi <strong>et</strong> à mon ATTITUDE ! Comment pourrais-je convaincre les<br />
autres si je ne l'étais pas moi-même ?<br />
Ma perte d'ouïe ne fut pas seulement une perte physique. J'ai<br />
rencontré des problèmes émotifs, sociaux <strong>et</strong> psychologiques<br />
également. Malheureusement, beaucoup de mes problèmes<br />
furent aggravés davantage par l'attitude de mon employeur visà-vis<br />
la surdité, les idées fausses concernant mon handicap <strong>et</strong><br />
l'ignorance de mes capacités.<br />
Suite...<br />
Table des matières<br />
Anglais
La réponse de l'employeur à mon problème était : TU NE PEUX<br />
PAS FAIRE ÇA <strong>et</strong> l'alternative était un placement à l'École des<br />
Sourds. Les Sourds devraient travailler avec les Sourds, non ?<br />
Hé bien, me voilà partie pour mon nouveau job comme<br />
travailleuse sociale à l'École des Sourds. Le fait que ne je<br />
pouvais pas parler la même langue, que j'avais une<br />
compréhension limitée de la surdité <strong>et</strong> que je ne voulais pas y<br />
aller, tout cela ne créait que de p<strong>et</strong>its obstacles que je saurais<br />
surmonter. On dit que l'estime de soi est la valeur que vous<br />
vous attribuez à vous-même, hé bien, croyez-moi, j'étais à ma<br />
cote la plus basse jamais atteinte.<br />
Lorsque j'ai franchi la porte de l'École des Sourds, j'ai vraiment<br />
pensé que c'était ma punition finale pour être devenue sourde,<br />
pour commencer. J'avais tellement tort ! Ce fut le<br />
commencement d'un voyage qui me mènerait à de nouveaux<br />
endroits passionnants dans mon coeur, mon esprit <strong>et</strong> mon âme.<br />
Je visité des lieux dont j'ignorais tout à fait l'existence <strong>et</strong> j'ai<br />
rencontré une Myrtle qui était forte <strong>et</strong> survivante. J'ai rencontré<br />
Myrtle, qui avait de la valeur <strong>et</strong> qui continuait à avoir la faculté<br />
de faire une différence dans la vie des gens, pas seulement des<br />
gens sourds, mais des gens. Ainsi commença mon voyage...<br />
La première chose que j'ai dû faire, ce fut d'accepter que j'avais<br />
un HANDICAP. Comment pouvais-je aider les gens à<br />
comprendre ce dont j'avais besoin pour survivre si je ne le<br />
savais pas moi-même ? Je devais apprendre à connaître mes<br />
DROITS en vertu du Code des droits de la personne, les<br />
ACCOMMODEMENTS dont j'aurais besoin pour faire tomber les<br />
BARRIÈRES. J'ai dû m'éduquer moi-même avant de pouvoir<br />
éduquer mon employeur, ma famille, mes amis <strong>et</strong> le monde qui<br />
m'entourait. J'ai dû connaître mes HABILETÉS. J'ai dû savoir ce<br />
qu'il faudrait pour m'amener là.<br />
Il m'a fallu cinq ans pour convaincre mon employeur que je<br />
pouvais relever les défis d'une charge de travail d'entendant. Ce<br />
n'est pas encore facile. Bien que les accommodements soient là<br />
pour moi, il me faut encore franchir les barrières des attitudes.<br />
Je suis forte <strong>et</strong> j'ai une bonne santé mentale, <strong>et</strong> je crois en moi.<br />
Les gens penseront toujours <strong>et</strong> cela ne changera jamais. Je<br />
pense positivement <strong>et</strong> je pense OUI, JE LE PEUX.<br />
Ma suggestion à quiconque se bat pour relever les défis de la<br />
vie est NE RESTE PAS LÀ ASSIS À ATTENDRE QUE LES CHOSES<br />
ARRIVENT, FAIT-LES ARRIVER ! Sors de toi, éduques-toi <strong>et</strong><br />
éduques les autres, trouve un bon groupe de soutien, garde ton<br />
sens de l'humour, crois en toi <strong>et</strong>, dernier conseil <strong>et</strong> pas le<br />
moindre, OUVRE TOUTES LES PORTES QUE TU PEUX.<br />
Je suis Sourde <strong>et</strong> je suis heureuse. Lorsque je dis ça certains de<br />
mes amis <strong>et</strong> de mes collègues disent "Mon Dieu, Myrtle<br />
comment peux-tu être heureuse, tu es Sourde. Tu dois être en<br />
état de déni ! Une porte s'est fermée, mais je suis passée par<br />
tellement de nouvelles autres, <strong>et</strong> mon monde est bien !<br />
Vous pouvez le faire !!!<br />
Myrtle
au début
...Page précédente<br />
Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun<br />
Première conférence canadienne sur la santé mentale <strong>et</strong><br />
la surdité<br />
Am<strong>et</strong>hyst : Un programme pour<br />
les femmes sourdes<br />
Par : Josephine FitzGerald, Am<strong>et</strong>hyst Women's Addiction<br />
Centre, 488 Wilbrod, Ottawa, Ontario, 613-563-0363<br />
Am<strong>et</strong>hyst : qui nous sommes <strong>et</strong><br />
comment nous avons commencé<br />
Am<strong>et</strong>hyst a ouvert ses portes en février 1979. Le travail qui a<br />
mené à c<strong>et</strong> aboutissement avait commencé en 1975. Un comité<br />
d'Ottawa avait demandé à un groupe de femmes qui<br />
travaillaient surtout dans les toxicomanies <strong>et</strong> les soins de santé<br />
se réunissent pour étudier les besoins des femmes ayant des<br />
addictions. À c<strong>et</strong>te époque-là, le seul service pour les femmes<br />
aux prises avec des addictions était un groupe de discussion des<br />
Alcooliques anonymes. Dans les années 1970, il devenait de<br />
plus en plus évident que les femmes vivent les problèmes de<br />
toxicomanie d'une façon très différente des hommes. Pendant<br />
ce temps, la recherche commença aussi à indiquer que<br />
beaucoup de femmes avaient été victimes d'abus sexuel dans<br />
leur enfance. La recherche d'alors <strong>et</strong> d'aujourd'hui appuie l'idée<br />
que la très grande majorité des femmes aux prises avec des<br />
toxicomanies ont également subi des abus sexuels, physiques <strong>et</strong><br />
émotifs graves comme enfants. Ces sévices mènent souvent à<br />
des problèmes de santé mentale profonds.<br />
Am<strong>et</strong>hyst a exploré des façons d'offrir du soutien aux femmes.<br />
Les programmes conventionnels étaient faits surtout pour les<br />
hommes, mais les femmes, dans le temps comme aujourd'hui,<br />
vivent dans des rôles très différents de ceux des hommes. Pour<br />
les femmes qui vivent avec des addictions, la honte est une<br />
question profonde <strong>et</strong>, pour traiter de c<strong>et</strong>te question, il faut un<br />
endroit sûr où les femmes sentent qu'elles peuvent exposer les<br />
messages internalisés qu'elles ont reçus enfants <strong>et</strong> aussi pour<br />
établir des connexions avec d'autres femmes pour briser le<br />
sentiment d'isolement. Comme une des façons de s'attacher à<br />
diminuer l'isolement que les femmes toxicomanes connaissent<br />
souvent, les groupes ont toujours été une composante très<br />
importante du travail que nous faisons, à Am<strong>et</strong>hyst.<br />
En plus des services de toxicomanies, Am<strong>et</strong>hyst offre aussi des<br />
services pour les femmes qui identifient le jeu comme<br />
problème. Ce service est assez nouveau à Am<strong>et</strong>hyst, bien que<br />
nous puissions voir une augmentation constante du nombre des<br />
femmes qui y ont accès. Notre programme de promotion de la<br />
Table des matières<br />
Anglais
santé est un autre programme important d'Am<strong>et</strong>hyst. Le but de<br />
ce programme est d'encourager les femmes à créer des<br />
changements de style de vie sains en les aidant à prendre le<br />
contrôle de leurs vies. Un certain nombre d'ateliers est mis à la<br />
disposition des femmes dans l'ensemble de la collectivité. Des<br />
services <strong>et</strong> du soutien sont également offerts aux enfants qui<br />
sont affectés par le problème de toxicomanie de leurs mères.<br />
Nous reconnaissons également que tout le monde a des besoins<br />
<strong>et</strong> un vécu différents <strong>et</strong> que, par conséquent, il est prioritaire<br />
d'honorer, de respecter <strong>et</strong> de participer à la diversité. Les<br />
services sont disponibles en anglais <strong>et</strong> en français. Mais nous<br />
reconnaissons également que le vécu de la toxicomanie par la<br />
femme est affecté par sa race, sa classe, sa santé mentale, la<br />
capacité ou l'incapacité, l'orientation sexuelle, <strong>et</strong>c. Au centre de<br />
nos services on trouve la certitude que l'expérience de<br />
toxicomanie d'une femme ne peut pas être séparée du contexte<br />
social dans lequel son usage devient problématique.<br />
Ce que nous faisons<br />
Pour avoir accès aux services d'Am<strong>et</strong>hyst, une femme doit<br />
d'abord nous appeler. À ce moment-ci, la préposée à l'accueil<br />
ramasse des renseignements préliminaires auprès de la femme,<br />
<strong>et</strong> fixe un premier rendez-vous. Présentement, la période<br />
d'attente entre le moment où une femme appelle Am<strong>et</strong>hyst<br />
pour la première fois <strong>et</strong> le premier rendez-vous va de trois à six<br />
semaines dans le programme de prévention de la toxicomanie<br />
<strong>et</strong> de deux à quatre semaines dans le programme du jeu<br />
compulsif.<br />
Lorsque la femme vient à Am<strong>et</strong>hyst pour le rendez-vous<br />
d'évaluation initiale, c'est l'occasion pour elle de partager de<br />
l'information sur sa vie, son usage <strong>et</strong> sa compréhension de ce<br />
qui a conduit à l'usage problématique. La conseillère donne<br />
aussi à la femme une information plus détaillée sur Am<strong>et</strong>hyst<br />
<strong>et</strong>, à ce moment-là, la femme <strong>et</strong> la conseillère décident<br />
ensemble si Am<strong>et</strong>hyst est un service approprié pour ce dont la<br />
femme a besoin.<br />
Notre programme comporte trois vol<strong>et</strong>s : counselling individuel,<br />
counselling de groupe <strong>et</strong> programme de traitement intensif.<br />
Pendant la phase de pré-traitement, une femme peut avoir<br />
accès au counseling individuel <strong>et</strong> de groupe, <strong>et</strong> une fois qu'elle a<br />
complété le programme de traitement intensif, elle est<br />
encouragée à se prévaloir du counseling individuel <strong>et</strong> en groupe<br />
pendant une période maximale de deux ans de soutien de suivi.<br />
Les conseillères sont capables de voir les femmes sur une base<br />
individuelle environ une fois par trois semaines, <strong>et</strong> donc,<br />
d'encourager les femmes à chercher d'autre appui dans les<br />
groupes qui se produisent trois fois par semaine dans le<br />
programme de prévention des toxicomanies. Ces groupes ont<br />
pour obj<strong>et</strong> de créer un endroit sûr où les femmes peuvent<br />
laisser libre cours à leurs histoires <strong>et</strong> à leurs émotions<br />
douloureuses qu'elles ont vécues, de sorte qu'elles puissent<br />
aller de l'avant à partir de ce point. Un aspect important de la<br />
participation de groupe consiste à briser le sens d'isolement que<br />
ressentent la plupart des femmes qui vivent une addiction, <strong>et</strong> à<br />
aider les femmes à reconnaître que leurs réactions aux<br />
traumatismes <strong>et</strong> à la douleur est une réaction normale. Nous
encourageons les femmes à avoir rapport à ce que d'autres<br />
femmes partagent, mais nous leur demandons de ne pas<br />
donner de conseils ou porter de jugements sur ce qui a été<br />
partagé.<br />
L'autre vol<strong>et</strong> de nos services, c'est le programme intensif de 10<br />
jours, qui est offert sept fois par année. Il s'agit de groupes<br />
fermés qui ne comptent pas plus de 12 femmes. Ce programme<br />
se compose de groupes de partage, d'exercices de détente <strong>et</strong><br />
d'ateliers de psycho-éducation chaque jour. Le but de ce<br />
programme est de perm<strong>et</strong>tre aux femmes d'explorer leurs<br />
toxicomanies plus en profondeur, en compagnie d'autres<br />
femmes, <strong>et</strong> de découvrir de nouvelles façons de survivre <strong>et</strong> de<br />
vivre sans s'appuyer sur l'alcool ou les drogues. Nous traitons<br />
d'une gamme de suj<strong>et</strong>s, y compris (mais sans s'y limiter) la<br />
prévention des rechutes, les femmes <strong>et</strong> la dépression, la colère,<br />
les femmes <strong>et</strong> la violence, <strong>et</strong> la honte <strong>et</strong> la toxicomanie.<br />
Dans le programme de contrôle du jeu compulsif, il y a<br />
également trois composantes : counseling individuel, counseling<br />
de groupe <strong>et</strong> programme de traitement intensif. Toutefois, pour<br />
le moment, les groupes ne sont disponibles qu'une fois toutes<br />
les deux semaines <strong>et</strong> le programme de traitement intensif<br />
s'échelonne sur un certain nombre de semaines. Les femmes se<br />
rencontrent une fois par semaine pendant deux heures, pour un<br />
total de dix semaines. Une différence majeure entre le<br />
programme de contrôle du jeu compulsif <strong>et</strong> celui de toxicomanie<br />
est que le second est à base d'abstinence, alors que le premier<br />
est à base de réduction des préjudices. Par conséquent, dans le<br />
programme de contrôle du jeu compulsif, un soutien est fourni<br />
aux femmes soit pour les aider à maintenir leur abstinence du<br />
jeu, soit réduire les préjudices associés au jeu.<br />
Soutien pour les femmes toxicomanes<br />
sourdes ou malentendantes :<br />
Voici ma propre expérience dans ce domaine. Je suis r<strong>et</strong>ournée<br />
aux études lorsque le plus jeune de mes enfants commença sa<br />
première année <strong>et</strong>, trois ans plus tard, je recevais une maîtrise<br />
en travail social. Ma dernière étape avant ça fut mon placement<br />
à Am<strong>et</strong>hyst. Après l'obtention de mon diplôme, je suis allée à la<br />
société d'aide à l'enfance <strong>et</strong>, un an plus tard, j'eus l'occasion de<br />
faire une demande d'emploi à Am<strong>et</strong>hyst, où il y avait un poste<br />
disponible – <strong>et</strong> je l'ai eu. Dès les deux premiers mois je<br />
rencontrai une cliente sourde qui utilisait la langue des signes,<br />
ce qui fait que nous nous rencontrions avec une interprète.<br />
C'était nouveau pour moi, mais beaucoup de choses résonnaient<br />
en moi à cause de mes enfants. J'en avais 5, alors âgés de 14 à<br />
22 ans, mais le troisième <strong>et</strong> le quatrième sont sourds. Ils furent<br />
diagnostiqués bébés <strong>et</strong> reçurent de la thérapie, qui fait qu'ils<br />
sont oralistes, mais qu'ils continuent à éprouver de nombreuses<br />
difficultés du fait de leur surdité.<br />
Je vis qu'il y avait une raison pour laquelle j'avais dû rencontrer<br />
c<strong>et</strong>te femme. Depuis lors, j'ai rencontré plusieurs autres<br />
femmes sourdes, dont trois utilisent la langue des signes. À<br />
Am<strong>et</strong>hyst le counseling individuel est la forme privilégiée<br />
d'intervention pour ces femmes, bien qu'elles aient eu un accès<br />
quelconque aux sessions de groupe lorsque des interprètes
étaient disponibles. Cependant, pour des femmes qui luttent<br />
contre un problème de toxicomanie, le rétablissement <strong>et</strong> la<br />
sobriété nécessitent souvent un programme plus intensif,<br />
comme notre programme de dix jours, ou un programme en<br />
résidence à court terme. Mais pour les gens qui, au <strong>Canada</strong>,<br />
utilisent la langue des signes <strong>et</strong> ont une toxicomanie, il n'existe<br />
aucun service. Aux États-Unis, il existe quelques programmes,<br />
<strong>et</strong> j'ai référé des clients à l'un d'eux, à Rochester (New-York).<br />
Ce programme reçoit des clients entendants, sourds <strong>et</strong><br />
malentendants, mais il s'adresse aux deux sexes.<br />
C'était un endroit difficile pour plusieurs des femmes avec<br />
lesquelles j'avais travaillé. Am<strong>et</strong>hyst est née parce que, pour<br />
beaucoup de femmes, il n'est d'aucune aide lorsqu'elles sont<br />
entourées d'hommes pendant qu'elles luttent pour leur<br />
rétablissement. C<strong>et</strong>te situation faisait partie du problème pour<br />
mes clientes qui ont fréquenté le programme de Rochester, tout<br />
comme le fait que, pour avoir accès aux services, elles devaient<br />
se rendre aux États-Unis.<br />
C'est ce qui nous a motivées à faire une demande de<br />
financement pour des interprètes en American Sign Language,<br />
ce qui nous perm<strong>et</strong>trait de faire un proj<strong>et</strong> pilote de notre<br />
programme intensif de 10 jours ouvert aux femmes sourdes <strong>et</strong><br />
donné en langue des signes.<br />
Le proj<strong>et</strong> pilote<br />
Lorsqu'il fut confirmé que nous obtiendrions quelque<br />
financement pour des interprètes, nous avons formé un comité<br />
directeur qui réunissait plusieurs organismes locaux de<br />
toxicomanie <strong>et</strong> des organismes de soutien pour les clients<br />
sourds ou malentendants. L'autre organisme avec lequel nous<br />
avons travaillé en étroite collaboration était la Société<br />
canadienne de l'ouïe, où nous obtenions nos interprètes.<br />
Pendant plusieurs mois, le comité directeur tint des réunions <strong>et</strong><br />
fit circuler de l'information concernant le proj<strong>et</strong> pilote dans tout<br />
l'Ontario. C<strong>et</strong>te information fut distribuée aux organismes de<br />
toxicomanie <strong>et</strong> aux organismes de santé <strong>et</strong> autres. Il fut<br />
confirmé que nous aurions deux femmes sourdes dans le proj<strong>et</strong><br />
pilote. Une venait de la ville <strong>et</strong> l'autre d'en-dehors. Nous avons<br />
examiné notre programme de 10 jours <strong>et</strong> nous avons reçu un<br />
r<strong>et</strong>our d'information <strong>et</strong> des suggestions concernant la façon de<br />
travailler efficacement avec des interprètes, ainsi que sur les<br />
besoins particuliers des Sourds. Le proj<strong>et</strong> commença le 1er<br />
mars 2004. Les femmes sourdes participèrent bien <strong>et</strong><br />
partagèrent leurs histoires. Elle échangèrent toutes les deux sur<br />
l'expérience difficile qu'elles avaient traversée à Rochester <strong>et</strong> se<br />
dirent heureuses de participer à un programme en Ontario <strong>et</strong>, le<br />
plus important, à un programme qui s'adressait exclusivement<br />
aux femmes.<br />
R<strong>et</strong>our d'information des clientes : ce que nous avons<br />
appris sur les besoins des femmes sourdes<br />
Dans l'ensemble, le r<strong>et</strong>our d'information que nous avons reçu<br />
fut très positif<br />
● Les femmes ont dit qu'il était très important que le<br />
programme se déroule dans un environnement
exclusivement de femmes, ce qui leur a permis de discuter<br />
de leur vécu de violence. Elles avaient le sentiment qu'un<br />
tel environnement augmentait leurs sentiments de sécurité.<br />
● Les femmes ont aimé la gamme des suj<strong>et</strong>s couverts, <strong>et</strong> ont<br />
apprécié le fait que nous traitions du contexte social dans<br />
lequel leur usage de substances était devenu<br />
problématique.<br />
● De façon générale, les femmes ont aimé le fait qu'il<br />
s'agisse d'un environnement intégré réunissant des<br />
femmes sourdes <strong>et</strong> des entendantes, <strong>et</strong> s'y sont senti à<br />
l'aise. Une sourde a toutefois dit qu'elle aimerait quand<br />
même avoir le choix de fréquenter un traitement offert<br />
dans un environnement exclusivement réservé aux<br />
femmes sourdes.<br />
● La taille d'un p<strong>et</strong>it groupe fut très importante : elle a aidé à<br />
égaliser la dynamique de pouvoir entre les entendantes <strong>et</strong><br />
les sourdes, <strong>et</strong> a aussi contribué à ralentir le rythme du<br />
programme.<br />
Comment pouvons-nous faire des améliorations ? :<br />
● Pour les sourdes, la journée était trop longue. Même les<br />
sessions étaient trop longues.<br />
● Trop d'information concentrée dans un laps de temps si<br />
court.<br />
● Pour celle qui venait d'en-dehors de la ville, les nuits <strong>et</strong> les<br />
fins de semaine étaient vraiment difficiles pour elle. Les<br />
services d'un programme de jour ne conviennent pas aux<br />
femmes qui viennent de l'extérieur de la ville.<br />
● Le personnel aurait pu faire plus pour modéliser une<br />
communication avec les sourdes qui aurait pu se passer<br />
d'interprètes.<br />
De quelle façon peut-on répondre aux besoins des<br />
femmes sourdes <strong>et</strong> qui ont des problèmes de<br />
toxicomanie ?<br />
Sur la base de ma recherche, je ne crois pas qu'il y ait, nulle<br />
part dans le monde, des services qui s'adressent spécifiquement<br />
aux femmes sourdes qui ont des problèmes de toxicomanie. À<br />
partir de ce que j'ai dit auparavant, il est clair que nombreuses<br />
sont les femmes qui ont besoin de traiter de leurs problèmes<br />
seulement avec d'autres femmes.<br />
Réactions ? Suggestions ? <strong>Commentaire</strong>s ?<br />
au début