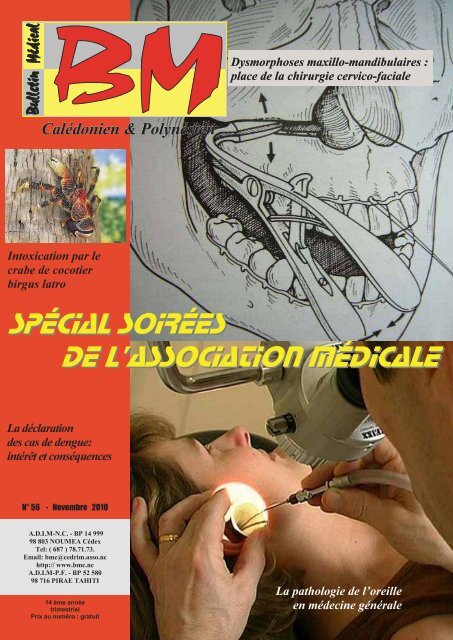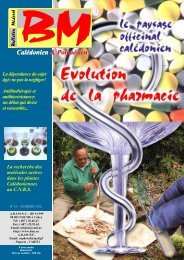SPÉCIAL SOIRÉES DE L'ASSOCIATION MÉDICALE
SPÉCIAL SOIRÉES DE L'ASSOCIATION MÉDICALE
SPÉCIAL SOIRÉES DE L'ASSOCIATION MÉDICALE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Calédonien & Polynésien<br />
Intoxication par le<br />
crabe de cocotier<br />
birgus latro<br />
<strong>SPÉCIAL</strong> <strong>SOIRÉES</strong><br />
<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> L’ASSOCIATION <strong>MÉDICALE</strong><br />
La déclaration<br />
des cas de dengue:<br />
intérêt et conséquences<br />
N° 56 - Novembre 2010<br />
A.D.I.M-N.C. - BP 14 999<br />
98 803 NOUMEA Cédex<br />
Tel: ( 687 ) 78.71.73.<br />
Email: bmc@cedrim.asso.nc<br />
http:// www.bmc.nc<br />
A.D.I.M-P.F. - BP 52 580<br />
98 716 PIRAE TAHITI<br />
14 ème année<br />
trimestriel<br />
Prix au numéro : gratuit<br />
Dysmorphoses maxillo maxillo-mandibulaires maxillo mandibulaires :<br />
place de la chirurgie cervico cervico-faciale<br />
cervico faciale<br />
La pathologie de l’oreille<br />
en médecine générale
e voudrais tout d’abord vous souhaiter à toutes<br />
J et tous une bonne fin d’année 2010.<br />
C’est une date 2010, et voila déjà écoulée la première<br />
décennie du 21 e siècle…<br />
Votre bulletin médical tient toujours la route, lui qui<br />
vous accompagnait déjà avant les années 2000, quel<br />
chemin !<br />
Vous trouverez dans ce numéro un dossier ORL<br />
assez complet puisque la place du chirurgien dans<br />
cette pathologie « in » qu’est la dysmorphose maxillomandibulaire,<br />
y est largement abordée. Gageons que<br />
vous saurez alors le solliciter pour vos cas les plus<br />
difficiles…<br />
En ces temps qui devraient être chauds, le rappel<br />
des pathologies de l’oreille en médecine générale<br />
vous rafraîchira les sinus, pour mieux rentrer dans<br />
la saison des otites externes chères à nos nageurs<br />
et autres aquatiques.<br />
Avec l’été, n’oubliez pas non plus notre chouchou<br />
local, la dengue, mais qu’il ne faut toujours pas<br />
mésestimer. Vos déclarations permettent réellement<br />
de lutter contre ce fléau.<br />
Enfin, en cette période de fêtes, un petit rappel sur<br />
les méfaits de l’alcool et la façon d’aborder ces<br />
patients particuliers, seront d’une actualité<br />
brûlante, mais malheureusement peut-être un peu<br />
« hors sujet »… D’ailleurs vous pourrez peaufiner<br />
vos connaissances des ITT ; elles seront sûrement<br />
encore fraîches pour servir largement à nos confrères<br />
de garde en fin d’année…<br />
Sinon il ne restera plus qu’à vous rabattre sur la<br />
très « lôcale » intoxication au crabe de cocotier,<br />
maladie nouvelle, dans sa description et sa connaissance<br />
au moins. Très beau travail réalisé là par Le<br />
Dr Maillaud, à qui nous conseillerons plutôt crevettes<br />
ou langoustes pour le réveillon, puisque la pêche au<br />
crabe de mangrove vient de fermer, et ne rouvrira<br />
que fin janvier !<br />
Bonnes fêtes à toutes et tous, et bonnes vacances.<br />
Directeur de la publication : E Lancrenon<br />
Secrétaire de Rédaction : P. Nicot.<br />
Conception, Maquette, Mise en page : J. Nicot<br />
***<br />
Comité de Rédaction de Nouméa pour le<br />
B.M. n° 56<br />
B. Rouchon, J M Tivollier, F. Vangheluwe.<br />
***<br />
Les articles signés sont publiés<br />
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.<br />
***<br />
Tiré à 2 000 exemplaires par ARTYPO.<br />
Distribué à 1400 ex. en Nouvelle Calédonie, Wallis et<br />
Futuna. et à 450 exemplaires en Polynésie Française<br />
02<br />
Dr Eric lancrenon<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
ACTUALITES<br />
NC 2011 - Professionnels de santé : c’est le moment de nous rejoindre!<br />
CONSEIL <strong>DE</strong> L’ORDRE<br />
Évaluation d’une ITT.<br />
ASSOCIATION MEDICALE <strong>DE</strong> NOUVELLE CALEDONIE<br />
CALEDONIE<br />
L’organisation des soirées de l’AMNC en brousse et dans les Iles.<br />
La pathologie de l’oreille en médecine générale.<br />
Place du chirurgien cervico-facial<br />
dans la prise en charge des dysmorphoses maxillo-mandibulaires.<br />
Diagnostic de la dengue à l’IPNC de Nouvelle-Calédonie.<br />
La déclaration de cas de dengue: intérêt et conséquences.<br />
AGENCE SANITAIRE ET SOCIALE <strong>DE</strong> NOUVELLE<br />
NOUVELLE-CALEDONIE<br />
NOUVELLE CALEDONIE<br />
Quelques trucs et astuces pouvant être utiles pour aborder l’alcool.<br />
EXERCER AUJOURD’HUI<br />
Intoxication par le crabe de cocotier birgus latro en Nouvelle-Calédonie.<br />
Le dépistage et les signes de l’autisme.<br />
LA VIE <strong>DE</strong>S ASSOCIATIONS<br />
ASSOCIATIONS<br />
L’EMDR, une nouvelle thérapie, effet de mode ou réel traitement?<br />
PACIFIQUE<br />
Les agents Fidjiens de la santé en lutte contre la dengue et la filariose.<br />
Rompre la loi du silence - Lutter contre les IST dans le Pacifique.<br />
Les territoires français se joignent au programme 2-1-22<br />
3<br />
5<br />
7<br />
10<br />
13<br />
19<br />
21<br />
16<br />
23<br />
26<br />
28<br />
30<br />
30<br />
31
ACTUALITES<br />
ACTUALITES<br />
François Lallemand, président de la commission médicale de NC2011,<br />
Comité organisateur des XIV e Jeux du Pacifique<br />
Quel est le dispositif<br />
médical prévu pendant<br />
les Jeux du Pacifique ?<br />
Comme l’exige la charte des<br />
Jeux, notre commission doit<br />
répondre à 3 objectifs : assurer<br />
le fonctionnement d’un centre<br />
médical dans le Village des<br />
Jeux, organiser une permanence<br />
sur les sites de compétition<br />
et effectuer les contrôles<br />
antidopage. Sur chaque site,<br />
nous serons aidés dans notre<br />
tâche par une équipe de<br />
secouristes composée de<br />
quatre secouristes.<br />
Comment constituez-vous<br />
l’équipe médicale qui<br />
interviendra pour<br />
les Jeux du Pacifique ?<br />
Sur la base du volontariat.<br />
NC2011 a fondé toute l’organisation<br />
des XIV e Jeux du<br />
Pacifique sur un modèle<br />
impliquant la collaboration de<br />
bénévoles. C’est d’ailleurs<br />
une tradition dans l’histoire<br />
des Jeux du Pacifique. Nous<br />
recrutons ainsi des médecins,<br />
dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,<br />
ostéopathes…<br />
Professionnels de santé :<br />
c’est le moment de nous rejoindre!<br />
À neuf mois des Jeux du pacifique, le plus grand rassemblement<br />
des îles du Pacifique, François Lallemand, président de la commission<br />
médicale de NC2011, nous parle du dispositif prévu pour l’événement.<br />
Il invite ses collègues professionnels de santé à s’engager dans<br />
cette grande aventure.<br />
Les XIV e Jeux du Pacifique en résumé<br />
Une manifestation sportive organisée tous les 4 ans<br />
Première édition en 1963<br />
Du 27 août au 10 septembre 2011<br />
en Nouvelle-Calédonie<br />
Participation de 22 pays d’Océanie (tout le continent<br />
Océanien hormis l’Australie et la Nouvelle-Zélande)<br />
Le plus grand rassemblement des îles du Pacifique :<br />
5000 sportifs et officiels techniques<br />
27 disciplines sportives<br />
37 sites de compétition<br />
Compétitions organisées dans 10 communes<br />
de la Nouvelle-Calédonie<br />
Un village unique pour l’accueil des athlètes<br />
300 000 repas servis en 15 jours de compétitions<br />
3 500 volontaires mobilisés pendants les Jeux<br />
Votre équipe est-elle déjà<br />
au complet ?<br />
Non, pas tout fait, il est encore<br />
temps de nous rejoindre !<br />
Nous recherchons du personnel<br />
médical et paramédical pour<br />
intervenir sur le village ou les<br />
sites de compétition.<br />
Quelles sont les disponibilités<br />
requises pour les volontaires<br />
qui seront mobilisés ?<br />
Les volontaires interviendront<br />
sur des tranches horaires d’une<br />
durée de 5h. Bien sûr, l’idéal<br />
serait d’être disponible sur<br />
plusieurs tranches horaires.<br />
François Lallemand, bio express<br />
Généraliste et médecin du sport,<br />
François Lallemand a posé ses<br />
valises en Nouvelle-Calédonie, il<br />
y a plus de 20 ans. Il accompagne<br />
l’équipe de Nouvelle-Calédonie<br />
pour la première fois aux Jeux<br />
de Papouasie Nouvelle-Guinée, en<br />
1991. Depuis, il n’a manqué aucune<br />
édition de cet événement. Il est<br />
secrétaire de la Société de<br />
Médecine du Sport du Pacifique<br />
Sud (SMSPS) créée par le Dr<br />
Dominique CHAZAL. Il est président<br />
de la commission médicale de<br />
NC2011 depuis sa création, en<br />
2008.<br />
Vous avez accompagné<br />
l’équipe de Nouvelle-<br />
Calédonie à tous les Jeux<br />
depuis 1991, qu’est-ce qui<br />
motive encore ?<br />
C’est toujours enthousiasmant!<br />
D’abord parce que je suis un<br />
passionné de sport, mais pas<br />
seulement. C’est une véritable<br />
aventure humaine. Nous avons<br />
affaire à des sportifs, ce sont<br />
des patients « atypiques », ils<br />
sont jeunes et en bonne santé !<br />
Nous les traitons principalement<br />
pour des pathologies sportives<br />
et médicales classiques (type<br />
ORL). Souvent, nous les<br />
revoyons dans nos cabinets<br />
après les Jeux. Je connais<br />
certains d’entre eux depuis<br />
plusieurs années.<br />
Le personnel médical assuré pendant les Jeux<br />
Par application des usages sportifs en général et de la Charte des Jeux en particulier, le Comité organisateur a souscrit une garantie<br />
d'assurance de responsabilité civile professionnelle au profit du personnel médical ou paramédical engagé dans l'événement.<br />
Seront donc assurés les médecins affectés au service des athlètes et officiels sportifs, les actes de kinésithérapie, soins dentaires<br />
d'urgence, pharmacie, dispensés au village notamment. La convention d'assurance s'appliquera également à la couverture<br />
médicale dédiée aux spectateurs des cérémonies et des épreuves sportives.<br />
Novembre 2010 - N° 56 03
04<br />
Novembre 2010 - N° 56
CC OO NN SS EE II L L DD E E L L ’ ’ OO RR DD RR E E<br />
Evaluation d’une ITT (Incapacité Totale de Travail)<br />
au sens pénal en cas de coups et blessures volontaires<br />
INFORMATION INFORMATION<br />
INFORMATION<br />
INFORMATION<br />
Depuis 1994, une nouvelle dénomination des incapacités totales de travail a été établie (ITT) à la place de l’ancienne ITTP (Incapacité totale de travail<br />
personnel).<br />
Au sens pénal, il peut y avoir une ITT si une plainte a été portée contre un auteur supposé (connu ou inconnu, alors plainte contre « X).<br />
L’ITT s’applique à tous : enfants, retraités, femmes au foyer, personnes au chômage ou sans emploi. Elle est donc à distinguer de l’incapacité temporaire<br />
professionnelle ou économique.<br />
La durée de l’ITT est un facteur d’appréciation fondamental de la gravité pénale des violences (articles 222-11, 12, 13, 19 et 20 du Code pénal).<br />
L’ITT implique une action qui a pour but d’infliger une sanction à l’auteur des coups et blessures volontaires et qui est à distinguer de l’action civile, qui<br />
a pour but la réparation du dommage subi par la victime.<br />
Définition<br />
Aucune définition ne précise ce qu’est cette ITT. Il est admis qu’il s’agit<br />
de la durée pendant laquelle la victime de violence ne peut remplir la totalité<br />
des fonctions basiques normales de la vie courante du fait de sont état :<br />
habillement, déplacements, toilette, … Il s’agit donc de la gêne réelle et<br />
globale éprouvée par la victime pour effectuer les gestes de la vie courante,<br />
à la suite des coups et blessures dont elle a fait l’objet.<br />
Elle s’applique donc à tous les âges de la vie et doit être donc adaptée.<br />
Elle concerne toutes les catégories socioprofessionnelles.<br />
Attention : cette durée n’est pas synonyme, pour les personnes ayant un<br />
emploi ou une activité rémunérée, d’un arrêt de travail qui peut être souvent<br />
supérieur mais jamais inférieur à l’ITT pénale. En effet, l’arrêt de travail<br />
tient compte de la profession exercée.<br />
Exemples :<br />
Lorsqu’une victime est hospitalisée, la durée de séjour constitue la durée<br />
minimum de l’ITT.<br />
En cas d’immobilisation complète d’un membre majeur (bras droit si le<br />
blessé est droitier), du bassin ou d’un membre inférieur imposant un<br />
décubitus prolongé, l’ITT prend fin au moment de la levée de l’immobilisation<br />
(une fracture de jambe avec 45 jours de plâtre et 45 jours de rééducation<br />
sans appui = 90 jours d’ITT, les soins de suite relèvent de l’arrêt de travail).<br />
En dehors des lésions objectives, il faut tenir compte des signes<br />
fonctionnels et du retentissement psychique, ce qui peut expliquer des<br />
grandes divergences qui peuvent exister.<br />
Facteurs d’évaluation<br />
L’examen clinique doit être complet et minutieux :<br />
Il recueille les doléances du patient : plaintes, douleurs, vécu du patient<br />
peuvent être notés : il ne s’agit pas d’une observation médicale au sens<br />
strict mais des doléances de la victime, sauf si un syndrome anxieux ou<br />
dépressif est cliniquement diagnostiqué.<br />
Examen clinique : les lésions attestées seront les signes fonctionnels et<br />
des éléments de l’observation, retrouvés soit lors de l’examen clinique<br />
direct ou par des examens complémentaires (radiographies, échographies,<br />
audiogrammes, ...). Elles seront objectives : mesurées, situées, décrites<br />
avec précision, avec un vocabulaire précis, en différenciant bien les lésions<br />
avec et sans solution de continuité.<br />
Ex : ecchymose de 4x3 cm au tiers antérieur et externe du bras droit,<br />
récente, rougeâtre bleuâtre ; limitation à 45° de la rotation horizontale<br />
du bras gauche vers l’extérieur …)<br />
Il existe des tableaux qui sont présentés page suivante. Ils sont indicatifs et<br />
peuvent servir de base de réflexion pour aider les médecins. Des références<br />
seraient indispensables et une méthode d’estimation plus objective qui<br />
tiendrait compte du type de lésion, du nombre de lésions, de leur taille,<br />
de la gêne fonctionnelle, de la durée d’immobilisation et d’hospitalisation<br />
est en cours de développement (G. Lorin de la Grandmaison).<br />
A noter qu’il vaut mieux éviter l’ITT de 8 jours qui peut être difficile<br />
à interpréter par rapport à la définition pénale de l’acte selon les<br />
circonstances (infraction, délit, crime).<br />
Destinataires de l’ITT<br />
- aux autorités judiciaires. La rédaction se fait sur papier à en-tête à la<br />
demande du patient ou sur réquisition de l’autorité judiciaire.<br />
- ne doit pas être transmis à l’employeur, qui n’est destinataire que du<br />
certificat d’arrêt de travail sur formulaire spécifique.<br />
Rédaction de l’ITT<br />
La responsabilité du médecin est engagée dans tous les cas.<br />
Le médecin atteste ce qu’il a constaté, certifie la réalité de son observation<br />
et s’engage personnellement en fixant une ITT.<br />
Certificat à visée pénale : orienter vers une UMJ<br />
Certificat à la demande de la victime : établi avec prudence et objectivité,<br />
avec les mentions « remis en mains propres » et « pour faire valoir ce que<br />
de droit ». Double conservé par le médecin.<br />
Certificat établi sur réquisition d’une autorité judiciaire (art. L637 du CSP) :<br />
établi avec objectivité et remis à l’autorité judiciaire qui le demande,<br />
double et réquisition conservés.<br />
Caractéristique de la sanction pénale<br />
IIT de moins de 8 jours : contravention<br />
IIT de plus de 8 jours : délit (tribunal correctionnel)<br />
Facteurs aggravants :<br />
- mineur de moins de 15 ans<br />
- personne vulnérable (âge, infirmité, maladie, déficience psychique,<br />
grossesse, ..)<br />
- ascendant ou parent adoptif<br />
- conjoint ou concubin<br />
- avec une arme<br />
ITT aggravée de moins de 8 jours : délits<br />
ITT aggravée de plus de 8 jours : délits, avec peine plus lourde<br />
Attention ne jamais indiquer une ITT = 8 jours !!<br />
Cas particulier : accident de travail<br />
Un arrêt de travail suite à un accident de travail, est un arrêt pour lequel<br />
une IJ est versée pendant le temps où l’incapacité temporaire de travail<br />
(professionnelle) est totale (dite aussi ITT) ou partielle (ITP) d’où la<br />
confusion. L’accident du travail n’implique pas nécessairement un tiers.<br />
Novembre 2010 - N° 56 05
INFORMATION INFORMATION<br />
INFORMATION<br />
INFORMATION<br />
06<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
CC OO NN SS EE II L L DD E E L L ’ ’ OO RR DD RR E E<br />
Evaluation d’une ITT (Incapacité Totale de Travail)<br />
au sens pénal en cas de coups et blessures volontaires<br />
1 — TETE<br />
TC sans PC, persistance vertiges et céphalées à J 5<br />
TC avec PC (2 j d'hospitalisation), persistance vertiges et céphalées à J 5<br />
Hématome périorbitaire simple, retour à état initial en 10 j 3<br />
I T T<br />
(jours)<br />
Hématome périorbitaire avec lésions cornéennes traitées par collyres (retour état initial à J 10) 10<br />
Fracture du plancher de l'orbite, ambulatoire à J 5 sans autre signe 5<br />
Conjonctivite par gaz lacrymogènes (TT collyres durant 10j) gène disparue au 2' jour 4<br />
Hématome périorbitaire avec occlusion de l'oeil pendant 5 j, retour à l'état normal à J 10 9<br />
Fracture OPN non déplacée 6<br />
Fracture OPN déplacée non chirurgicale 7<br />
FR OPN non déplacée chez sujet n'y voyant rien sans ses lunettes et ne pouvant les porter durant 9 j 9<br />
5 au<br />
moins<br />
5 au<br />
moins<br />
Fracture OPN opérée (2 j d'hospitalisation et plâtre 8 j) 10<br />
Dent « mobile » et douloureuse durant 5 j, sans gêne alimentaire réelle 5<br />
Avulsion d'une molaire, douleur et gêne à l'alimentation 3 j 3<br />
Douleur mâchoire ou bouche gênant l'alimentation durant 5 j 5<br />
2 - RACHIS- COTES<br />
Cervicalgies durant 5 jours 5<br />
Cervicalgies nécessitant port collier durant 10j, ambulatoire à J 3 10<br />
Lombalgies gênant la marche durant 5 j 5<br />
Trauma costal sans fracture avec douleur à la mobilisation, gênant le sommeil durant 8 j 8<br />
Fracture 1 côte, même tableau clinique, consolidation en 21 j 14<br />
3 - MEMBRES INFERIEURS<br />
Entorse genou traitée par attelle-velcro (genou bloqué, marche possible, s'enlève à volonté) pdt 21 j 21<br />
Entorse genou traitée par genouillère plâtrée : pas d'appui durant 21 j 21<br />
Plâtre cruro-pédieux (genou et cheville bloqués) sans appui, durant 6 semaines 42<br />
Entorse sans arrachement osseux traitée par Elastoplast 6 j, marche possible 6<br />
Entorse sans arrachement osseux traité par Elastoplast, décharge par cannes anglaises 8 j 10<br />
Entorse avec arrachement osseux, plâtre de marche durant 21j 21<br />
Fracture 1/3 moyen péroné avec plâtre de marche durant 21 j 21<br />
Fracture cheville avec plâtre sans appui durant 6 semaines 42<br />
Fracture phalange petit orteil, marche possible, syndactylie 15 j 7<br />
Fracture gros orteil, marche pénible durant 5 jours, consolidation 21 j 15<br />
Fracture métatarsien, traitée par Elastoplast, marche possible avec attelle, consolidation 21 j 15<br />
Fracture calcanéum : pas de contention mais aucun appui durant 5 semaines 35<br />
Fracture Tibia traitée par enclouage 60<br />
Fracture du col du Fémur 90<br />
Fracture du pilon tibial ouvert 120<br />
Tableaux 1 à 4 : les ITT en fonction de leur localisation<br />
Atteintes du membre supérieur directeur / pince<br />
Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 8<br />
Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 9<br />
FR phalange traitée par attelle « grenouille » immobilisant 1 doigt durant 15 j 15<br />
Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 15<br />
FR métacarpien traitée par syndactylie 15 j 15<br />
FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 25<br />
FR scaphoïde : plâtre brachio-antébrachial 6 sem. puis manchette 6 sem. (total 12 sem) 90<br />
Atteintes du membre supérieur directeur / autres doigts<br />
Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 3<br />
Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 5<br />
FR phalange TT par attelle «grenouille» immobilisant 1 doigt durant 15 j 11<br />
Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 12<br />
FR métacarpien TT par syndactylie 15 j 13<br />
FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 15<br />
FR poignet traitée par manchette (poignet fixe, coude libre) 21 j 24<br />
FR poignet/av. bras : brachio-antébrachial 21 j (poignet et coude bloqués) 24<br />
Luxation ou fracture épaule traitée par « Mayo clinic » 21 j 21<br />
Atteintes du membre supérieur non directeur / pince<br />
Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 3<br />
Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 7<br />
Fr phalange traitée par attelle « grenouille » immobilisant 1 doigt durant 15 j 15<br />
Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 15<br />
FR métacarpien traitée par syndactylie 15 j 15<br />
FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 20j 20<br />
FR scaphoïde : plâtre brachio-antébrachial 6 sem. puis manchette 6 sem. (total 12 sem.)<br />
Atteintes du membre supérieur non directeur / autres doigts<br />
90<br />
Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 2<br />
Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 6<br />
FR phalange TT par attelle « grenouille » immobilisant 1 doigt durant 15 j 10<br />
Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 10<br />
FR métacarpien TT par syndactylie 15 j 10<br />
FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 14<br />
FR poignet traitée par manchette (poignet fixé, coude libre) 21 j 20<br />
FR poignet/av-bras : brachio-antébrachial 21 j (poignet et coude bloqués) 21<br />
Luxation ou fracture épaule traitée par « Mayo clinic » 21 j 20<br />
TC : traumatisme crânien<br />
J 5 : 5e jour<br />
TT : traité ou traitement<br />
PC : perte de connaissance<br />
OPN : os propres du nez<br />
j : jour FR : fracture<br />
4 - MEMBRES SUPERIEURS<br />
Abréviations<br />
Le Conseil de l’Ordre<br />
ORDRE NATIONAL <strong>DE</strong>S ME<strong>DE</strong>CINS ORGANE <strong>DE</strong> l’ORDRE de NOUVELLE CALEDONIE — B.P. 3864 - 98846 NOUMEA CE<strong>DE</strong>X - : (687) 28.29.26 - FAX : (687) 28.58.70 E.Mail : cnom@ordmed.nc
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
L’organisation de soirées de l’AMNC en brousse et aux Îles<br />
F. Vangheluwe<br />
L’association médicale essaie, autant que possible, de délocaliser ses soirées d’information.<br />
L’organisation de celles-ci n’est jamais facile car il faut tenir compte de très nombreux facteurs,<br />
le principal étant les possibilités pour les professionnels visités de pouvoir se libérer pour<br />
assister à ces formations.<br />
Plusieurs déplacements ont été réalisés<br />
sur la grande terre dans les années passées<br />
à l’occasion du passage en Nouvelle<br />
Calédonie de professeurs de faculté,<br />
notamment ceux de Bordeaux qui viennent<br />
de façon régulière donner des cours aux<br />
internes en stage au CHT.<br />
Plus récemment, deux déplacements<br />
ont été réalisés en 2009 : un sur Lifou et<br />
un sur Koné. Le thème de ces soirées<br />
était « la responsabilité des professionnels<br />
de santé dans le cadre de leurs activités ».<br />
Ce thème a été traité par Monsieur le<br />
professeur LECA qui est Professeur agrégé<br />
de droit, spécialisé en Droit de la Santé<br />
et, depuis novembre 2000, Directeur du<br />
Centre de Droit de la Santé de l’université<br />
de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-<br />
Marseille III.<br />
La soirée sur Lifou avait permis de<br />
regrouper une trentaine de professionnels,<br />
celle sur Koné avait réuni 3 personnes.<br />
En 2010 nous avons organisé également<br />
deux déplacements. Un sur Maré sur le<br />
« bilan du dépistage du cancer du sein »<br />
animé par M Loïc Broquart de l’Agence<br />
Sanitaire et Sociale et un sur Lifou sur<br />
« le cancer du poumon en Nouvelle Calédonie<br />
» avec Mme le Dr Benichou.<br />
La soirée sur Maré n’a malheureusement<br />
pas réuni beaucoup de professionnels,<br />
celle sur Lifou a encore été un succès.<br />
La formation sur le cancer du Poumon<br />
à Wé s’est tenue le samedi matin et a<br />
réuni une vingtaine de professionnels.<br />
Cette matinée faisait suite à une formation<br />
qui avait été organisée la veille, le vendredi<br />
soir, par « l’association calédonienne<br />
des pathologies du sommeil » et Mme<br />
Mylène Alméras qui représentait un<br />
prestataire de service dans le domaine<br />
de l’insuffisance respiratoire. Cette soirée<br />
qui traitait de la ventilation non invasive<br />
a également particulièrement intéressé<br />
les confrères de l’île, qui étaient pratiquement<br />
tous présents et ont pu avec<br />
les pneumologues présents aborder les<br />
problèmes pratiques auxquels sont<br />
confrontés les professionnels (médecins<br />
et infirmiers) qui suivent les patients<br />
sous ventilation non invasive.<br />
Le bureau de l’association médicale<br />
souhaite pouvoir poursuivre les formations<br />
en dehors de Nouméa, mais voudrait être<br />
sûr que ces déplacements auront un<br />
intérêt pour les professionnels visités.<br />
Aussi nous vous demandons de bien vouloir<br />
nous aider en nous donnant toutes les<br />
informations qui pourraient nous être<br />
utiles (nous vous rappelons que l’association<br />
médicale regroupe TOUTES les<br />
professions de santé) :<br />
- Lieu de résidence ?<br />
- Vaut-il mieux venir en journée ? Quel<br />
jour ? En soirées ? Fin de semaine ?<br />
Milieu de semaine ? Pensez-vous qu’il vous<br />
soit possible de participer à plusieurs<br />
formations qui se suivraient (deux soirs<br />
consécutifs ou un WE) ?<br />
- Y a-t-il des thèmes qui vous semblent<br />
plus d’actualité ?<br />
Merci de nous transmettre vos avis et<br />
suggestions soit par courrier à l’adresse<br />
suivante : AMNC BP 2 343 - 98846 Nouméa<br />
Cedex…Soit par mail : amnc@canl.nc<br />
Soirée « La ventilation non invasive » à Lifou<br />
Novembre 2010 - N° 56 07
La pathologie de l’oreille en médecine générale<br />
Dr Johan Nouwen<br />
L'essentiel de la pathologie de l'oreille<br />
peut être abordé en médecine générale, au<br />
moyen d'un otoscope et d'un diapason.<br />
Sans avoir l'ambition de dresser un tableau<br />
complet de la pathologie de l'oreille, cette<br />
présentation, non exhaustive, a pour<br />
but de rappeler les "bonnes pratiques"<br />
otologiques en médecine générale.<br />
Pathologie du pavillon<br />
Othématome: hématome du pavillon,<br />
qui fait suite à un traumatisme. A drainer<br />
rapidement sous peine de voir le cartilage<br />
du pavillon se nécroser et se déformer en<br />
cicatrisant (cf. oreilles des rugbyman).<br />
Chondrite du pavillon : infection du<br />
pavillon, consécutive à une otite externe,<br />
une plaie, blessure,... Un traitement antibiotique<br />
(IV) est requis pour éviter une<br />
lyse du cartilage.<br />
Cancer du pavillon : carcinome basocellulaire<br />
plus fréquent que spinocellulaire.<br />
Une chirurgie d’exérèse est indiquée.<br />
Oreilles décollées : l'otoplastie se<br />
pratique idéalement vers l'âge de 8-9 ans,<br />
dès que l'enfant se plaint de moqueries<br />
à l'école. À cet âge, les oreilles ont presque<br />
atteint leur taille définitive et l'enfant<br />
n'a pas eu le temps de développer de<br />
complexe. L'intervention qui se fait sous<br />
anesthésie locale ou générale, est complètement<br />
prise en charge par la CAFAT<br />
08<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
LES MARDIS <strong>DE</strong> L’ ASSOCIATION<br />
Soirée du 05 octobre 2010<br />
(jusqu'à 18 ans) et les suites opératoires<br />
sont simples et peu douloureuses.<br />
Pathologie du conduit<br />
auditif externe<br />
Bouchon de cérumen : l'oreille est<br />
auto-nettoyante chez tous les mammifères<br />
et le cérumen est une sécrétion naturelle<br />
et nécessaire au nettoyage du conduit et<br />
à la bonne hydratation de son épiderme.<br />
L'usage du coton tige enfonce le cérumen<br />
(favorisant la formation de bouchons),<br />
blesse le conduit qui n'est pas rectiligne<br />
(favorisant les otites externes) et enlève<br />
le film gras (cérumen) qui hydrate<br />
l'épiderme, rendant la peau du conduit<br />
sèche, squameuse et prurigineuse,<br />
mimant à tort un eczéma de l'oreille. Il faut<br />
conseiller aux patients de laisser leurs<br />
oreilles en paix. En cas de bouchon,<br />
après la minute pédagogique, curette,<br />
aspiration, cérulyse ou ORL...<br />
Otorrhée résulte d'une otite externe<br />
ou d'une otite moyenne aigue perforée.<br />
La distinction entre les deux étiologies<br />
n'est pas toujours aisée. L'otite externe<br />
est associée à un rétrécissement du<br />
conduit et la palpation du tragus est<br />
douloureuse, ce qui n'est pas le cas<br />
dans l'otite moyenne perforée.<br />
Otite externe: fait souvent suite à un<br />
traumatisme de l'oreille externe (coton<br />
tige) et/ou à une baignade. Son traitement<br />
est exclusivement local, sauf si une<br />
chondrite du pavillon y est associée.<br />
Otite mycotique est rebelle aux<br />
gouttes classiques et son otoscopie est<br />
en général assez typique.<br />
Le nettoyage de l'oreille est un pré<br />
requis à l'efficacité du traitement local<br />
(aspiration, ORL).<br />
Furoncle du conduit nécessite une<br />
antibiothérapie per os (photo ci-contre).<br />
Corps étranger : s’il s’agit d’un insecte<br />
vivant, le tuer en injectant de l’éther ou<br />
un gel (dentifrice, sylo gel,…) puis l’extraire<br />
et s’assurer de l’intégrité du tympan. Le<br />
corps étranger est à ôter avec un petit
Ostéome du conduit : tumeur bénigne<br />
fréquente chez les nageurs qui ne nécessite<br />
un traitement qu’exceptionnellement,<br />
un cas d’obstruction du conduit.<br />
Pathologies<br />
de l’oreille moyenne<br />
Otite moyenne aiguë: traitement AB.<br />
Si inefficace après 48 heures et si mal<br />
toléré, une paracentèse associée à une<br />
culture est indiquée.<br />
enfant < 2ans, Augmentin, Ciflox<br />
enfant > 5ans : amocycilline, céphalosporine<br />
1ère génération, + mouche bébé.<br />
Otite phlycténulaire : traitement symptomatique<br />
(photo ci-contre à droite).<br />
Otite séreuse : pas de traitement<br />
efficace. Surveiller et si persistance,<br />
rétraction tympanique, otites moyennes<br />
aiguës récidivantes, indication de pose<br />
de drains transtympaniques.<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
Mastoïdite: constante en cas d'otite<br />
moyenne aiguë du fait de la communication<br />
entre la mastoïde et l’oreille moyenne.<br />
En cas de mastoïdite +++ avérée<br />
(décollement du pavillon, collection rétro<br />
auriculaire), un traitement antibiotique<br />
intraveineux, voire exceptionnellement<br />
chirurgical est requis.<br />
Otite moyenne chronique : nécessite<br />
un suivi spécialisé :<br />
- perforation tympanique persistante<br />
qui indique une fermeture chirurgicale,<br />
pour améliorer l'audition, fermer<br />
l'oreille moyenne aux bactéries du conduit<br />
et limiter le risque de cholestéatome.<br />
- Poche de rétraction : conséquence<br />
d'un processus pathologique de l'oreille<br />
moyenne et de la trompe d'Eustache,<br />
entraînant une dépression dans l'oreille<br />
moyenne et une destruction progressive<br />
de l'armature fibreuse du tympan. Le<br />
tympan se rétracte progressivement et<br />
va peu à peu venir se coller au fond de<br />
l'oreille moyenne ( on parle alors d'atélectasie<br />
), et se coller aux osselets, qu'il va<br />
progressivement détruire. Cette rétraction<br />
est responsable d’une hypoacousie évolutive<br />
et est généralement à l’origine du cholestéatome.<br />
Un traitement chirurgical est<br />
généralement nécessaire.<br />
- cholestéatome : développement<br />
dans l'oreille moyenne d'un kyste épidermoïde<br />
appelé cholestéatome. Le plus<br />
souvent ces cellules épidermiques pénètrent<br />
dans l'oreille moyenne par migration de<br />
la peau qui recouvre le tympan, soit par<br />
l'invagination d'une poche de rétraction<br />
tympanique dans l'oreille moyenne, soit<br />
par migration au travers d'une perforation<br />
marginale du tympan. Plus rarement des<br />
cellules épidermiques sont situées de<br />
façon congénitale dans l'oreille<br />
moyenne, et donnent naissance à un<br />
cholestéatome dit congénital. Le cholestéatome<br />
est colonisé par de nombreuses<br />
bactéries et provoque une otorrhée<br />
purulente chronique. Il a une action<br />
ostéolytique, sur les osselets d’abord<br />
(entraîne une surdité) périphérique<br />
ensuite (oreille interne, nerf facial, base<br />
du crâne). Son traitement est exclusivement<br />
chirurgical.<br />
Novembre 2010 - N° 56 09
Surdité de transmission : l'oreille<br />
externe ou l'oreille moyenne est touchée,<br />
et l'oreille interne est intacte. Le diapason<br />
est perçu dans l’oreille sourde. La surdité<br />
de transmission est presque toujours<br />
accessible à un traitement.<br />
Pathologies<br />
de l’oreille interne<br />
Surdité de perception, qui atteint la<br />
cochlée ou les voies nerveuses postcochléaires.<br />
Le diapason est perçu dans<br />
l’oreille saine. Cette surdité est appareillable<br />
plus que curable.<br />
Surdité brusque : urgence nécessitant<br />
une prise en charge rapide (corticoïdes,<br />
vasodilatateurs). Le pronostic fonctionnel<br />
est péjoratif si la surdité est sévère et si<br />
le traitement est retardé ou nul.<br />
Surdité par traumatisme sonore :<br />
destruction des cellules ciliées de l'oreille<br />
interne suite à un son de très forte intensité,<br />
ou à l’exposition prolongée à des<br />
bruits intenses, d’où l’intérêt de protéger<br />
ses oreilles!<br />
Acouphènes : les acouphènes peuvent<br />
être générés par un dysfonctionnement<br />
n’importe où dans l’oreille, oreille<br />
externe, moyenne, interne, nerf auditif,<br />
cerveau. Un bilan auditif complet est<br />
indiqué, ainsi que la réalisation de potentiels<br />
évoqués auditifs si les acouphènes sont<br />
unilatéraux. Si l’acouphène est pulsatile,<br />
synchrone aux pulsations cardiaques, il<br />
faut rechercher une anomalie des axes<br />
vasculaires du cou. Si les acouphènes<br />
ne sont pas associés à une pathologie de<br />
l’oreille, on parle d’acouphènes idiopathiques.<br />
Il n’existe pas de traitement<br />
miraculeux pour traiter les acouphènes<br />
idiopathiques.<br />
10<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
Vertiges périphériques: ils représentent<br />
75% des vertiges, par atteinte du vestibule<br />
ou du nerf vestibulaire. Le vertige<br />
périphérique est dit harmonieux, il associe<br />
vertige rotatoire franc, signes neurovégétatifs,<br />
latérodéviation, nystagmus, est<br />
aggravé à la fermeture des yeux et<br />
l’examen neurologique est normal.<br />
4 étiologies, par ordre de fréquence,<br />
VPPB, Neuronite, Ménière, neurinome.<br />
- Le VPPB est une pathologie mécanique<br />
qui nécessite un diagnostic précis<br />
pour localiser le vestibule dysfonctionnel<br />
et le canal semi circulaire responsable.<br />
Le traitement est mécanique et vise à<br />
purger le canal semi-circulaire atteint de<br />
ses impuretés. Il existe six canaux semicirculaires,<br />
chacun pouvant être le siège<br />
d’un VPPB et nécessitant un traitement<br />
spécifique. Il existe donc six manipulations<br />
spécifiques et il n’y a pas d’indication de<br />
traitement médical.<br />
- La neuronite provoque un vertige<br />
périphérique continu durant plusieurs<br />
jours, qui impose une hospitalisation en<br />
cas de vomissements associés. La récupération<br />
est spontanée en quelques<br />
jours et est accélérée par un traitement<br />
kiné spécifique.<br />
- La maladie de Ménière associe<br />
des crises vertigineuses durant plusieurs<br />
heures, associées à des acouphènes unilatéraux<br />
et à une hypoacousie unilatérale.<br />
C’est une maladie qui impose un<br />
traitement médical continu pour limiter<br />
le risque de récidive, entraînant une<br />
dégradation progressive de l’audition.<br />
Paralysie faciale<br />
La paralysie faciale périphérique peut<br />
être liée à une tumeur comprimant le<br />
nerf, une fracture du rocher, une neuropathie<br />
diabétique, un zona,…<br />
Dans la majorité des cas on n’en<br />
trouve pas la cause. On parle alors<br />
de paralysie faciale « a frigore » probablement<br />
d'origine virale. Le traitement<br />
repose sur une corticothérapie rapide.<br />
Plus le traitement est précoce, meilleurs<br />
sont les chances de récupération.<br />
Neurinome<br />
Le neurinome est une tumeur bénigne<br />
de l’angle ponto-cérébelleux. Elle peut<br />
se manifester de différentes façons, en<br />
comprimant le paquet nerveux VII-VIII et<br />
provoquer une surdité, des acouphènes,<br />
une paralysie faciale unilatérale ou encore<br />
des vertiges. Le diagnostic se pose en<br />
réalisant des potentiels évoqués auditifs<br />
à la recherche d’un ralentissement de la<br />
transmission de l’information nerveuse<br />
auditive ou en réalisant une IRM de<br />
l’angle ponto-cérébelleux. Le traitement<br />
repose sur le suivi, l’exérèse et/ou<br />
l’irradiation spécifique.
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
LES MARDIS <strong>DE</strong> L’ ASSOCIATION<br />
Soirée du 01 juin 2010<br />
Place du chirurgien cervico-facial dans la prise en charge<br />
thérapeutique des dysmorphoses maxillo-mandibulaires<br />
Dr Ph. Baillot<br />
Introduction<br />
La gestion des troubles morphologiques<br />
et fonctionnels des étages moyen<br />
et inférieur faciaux intéresse le chirurgien<br />
cervico-facial à deux titres :<br />
- à un stade précoce, c'est l'identification<br />
et la prise en charge médicale et / ou<br />
chirurgicale d'une pathologie ORL causale,<br />
qui permettra d'optimiser le résultat orthodontique<br />
du patient et parfois d'éviter le<br />
passage à l'étape suivante.<br />
- celle-ci intéresse le chirurgien cervicomaxillo-facial,<br />
dans le cadre de la<br />
conduite des interventions de chirurgie<br />
orthognathique.<br />
Au-delà, il faut insister sur le caractère<br />
pluridisciplinaire de la prise en charge<br />
thérapeutique et le rôle incontournable<br />
du traitement orthodontique.<br />
Un préambule anatomique, ainsi<br />
qu'une description des modèles de<br />
croissance faciale, apparaissent nécessaires<br />
car ils permettront d'éclairer les<br />
«pourquoi» des modalités et principes<br />
chirurgicaux retenus.<br />
Rappel anatomique<br />
Le complexe maxillo-mandibulaire<br />
occupe les étages moyen et inférieur de<br />
la face, cette dernière s'inscrivant entre<br />
la ligne pré-capillaire frontale en haut et<br />
le plan mentonnier en bas.<br />
La ligne bi-pupillaire, axe transverse<br />
médian, sépare l'étage crânien de l'étage<br />
facial et l'étage facial, lui-même, est séparé<br />
par le plan occlusal en deux étages,<br />
maxillaire et mandibulaire. Ceci correspond<br />
à la classique règle des 1/3.<br />
Les éléments constitutifs sont donc le<br />
maxillaire supérieur et la mandibule,<br />
avec par ailleurs, deux plans de référence<br />
à cet étage facial ; un à la base du<br />
crâne avec une relation crânio-maxillaire<br />
fixe en avant et une relation crâniomandibulaire<br />
mobile latéralement ; l'autre<br />
en bas est le plan de référence déterminé<br />
par les arcades dentaires.<br />
1°) Le maxillaire supérieur (photo 1)<br />
Photo 1<br />
Il est suspendu à l'étage antérieur de<br />
la base du crâne, s'adossant en arrière<br />
aux apophyses ptérygoïdes du sphénoïde<br />
et encadré latéralement par les zygoma.<br />
Il projette en avant la pyramide nasale,<br />
constituant avec elle le 1/3 médian facial.<br />
Son infrastructure est le support de l'arcade<br />
dentaire, d'accès simple par voie buccale,<br />
dans le cadre des gestes de chirurgie<br />
orthognathique. La vascularisation par les<br />
artères palatines descendantes sera à<br />
respecter lors de l'abord chirurgical.<br />
2°) Le mandibule (photo 2)<br />
Photo 2<br />
C'est le seul os mobile de l'étage facial,<br />
d'une grande complexité anatomophysiologique,<br />
dominée par son implication<br />
au niveau de la fonction manducatrice.<br />
On lui distingue 2 portions :<br />
Le ramus : ou branche montante,<br />
portion profonde en relation basi-crânienne<br />
par le condyle, portion mandibulaire de<br />
l'articulation temporo-mandibulaire, dont<br />
les autres éléments sont représentés par<br />
la glène temporale et le menisque intraarticulaire.<br />
Cette situation rend compte<br />
des problèmes de stabilité lors de la<br />
pratique des ostéotomies mandibulaires.<br />
Le ramus est par ailleurs le siège d'insertions<br />
musculaires pour les effecteurs puissants<br />
que réalisent les muscles pterygoïdiens<br />
interne, externe et masseter sur les faces<br />
latérales du ramus et du muscle temporal<br />
sur le coroné.<br />
Le corpus : c'est la portion dentée<br />
de la mandibule, qui en outre, assure la<br />
tenue du plancher buccal et de la masse<br />
musculaire linguale, étant par ailleurs en<br />
rapport avec l'os hyoïde.<br />
3°) Le plan occlusal<br />
ou interface maxillo-mandibulaire<br />
Le développement anatomique maxillomandibulaire<br />
a pour but et référent l'intercuspidation<br />
physiologique des arcades<br />
dentaires.<br />
L'interface adaptative alvéolodentaire<br />
en permet l'ajustement précis,<br />
le corollaire étant la labilité de cet équilibre<br />
sous l'effet des effecteurs labio-linguaux<br />
en particulier.<br />
Le traitement orthodontique profitera<br />
de cette plasticité ; l'occlusion<br />
ainsi s'intègre dans un concept<br />
d'équilibre facial en tant que :<br />
1°) Critère de normalité anatomophysiologique.<br />
2°) Plan de référence thérapeutique au<br />
cours des mobilisations squelettiques.<br />
3°) Facteur d'équilibre et de stabilité<br />
dans la relation maxillo-mandibulaire.<br />
La croissance faciale<br />
Il existe une interdépendance septosinusienne<br />
et maxillo-mandibulaire.<br />
Avant la naissance : il existe une<br />
disproportion crânio-faciale et une rétromandibulie<br />
physiologique.<br />
Novembre 2010 - N° 56 11
Après la naissance : le développement<br />
va concerner avant tout la portion nasobuccale<br />
de la face, qui subit l'influence<br />
des différentes matrices fonctionnelles :<br />
- sinus et fosses nasales par le flux<br />
aérien,<br />
- cavité buccale et structures maxillopalatines<br />
par l'appui lingual,<br />
- architectonique faciale par le biais<br />
des piliers manducateurs et de l'occlusion<br />
dentaire ; la croissance mandibulaire, en<br />
particulier, dépendra de l'action de l'appareil<br />
manducateur et de la maturation du cartilage<br />
de croissance condylien (photo 3).<br />
Photo 3<br />
Les deux fonctions phares seront<br />
donc la ventilation et la manducation, qui<br />
doivent intervenir au maximum dès la<br />
naissance.<br />
En cas d'insuffisance, la précocité du<br />
trouble et son importance conditionneront<br />
la gravité de la dysmorphose.<br />
D'autres facteurs interviennent, en<br />
particulier génétiques, s'exprimant dès le<br />
stade embryogénique et concernant l'évolution<br />
des bourgeons faciaux. Signalons<br />
également le rôle très important des appositions<br />
périostées liées à l'émergence<br />
des bourgeons dentaires.<br />
Quant au développement des sinus,<br />
phénomène post-natal et multifactoriel, il<br />
concourt à la pneumatisation du massif<br />
facial avec descente de l'arcade dentaire,<br />
recul du prognathisme et maintien de<br />
l'occlusion fonctionnelle.<br />
L'allaitement au sein imposant un<br />
contact bi-labial et un mouvement de<br />
propulsion, fait intervenir l'appareil manducateur<br />
et favorise la croissance mandibulaire<br />
à l'opposé du biberon qui, par son<br />
rôle favorisant sur la succion, pérennise<br />
la rétro-mandibulie. De plus, la stimulation<br />
jugale à la prise du biberon altère la<br />
croissance transversale des maxillaires.<br />
Au final, la prise du biberon, l'alimentation<br />
molle, l'insuffisance respiratoire<br />
nasale majorée par la pollution croissante,<br />
12<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
constituent autant de facteurs expliquant<br />
la fréquence actuelle de la rétro-mandibulie<br />
et des encombrements dentaires relatifs.<br />
Les dysharmonies<br />
maxillo-mandibulaires<br />
Les unes sont en rapport avec des<br />
anomalies des bases osseuses maxillomandibulaires<br />
et des arcades dentaires<br />
dans un contexte céphalique, par ailleurs<br />
normal. Elles constituent le cadre habituel<br />
de la chirurgie orthognathique.<br />
L'autre cadre concerne les malocclusions<br />
qui s'intègrent dans des syndromes<br />
polymorphes, car combinant le problème<br />
maxillo-mandibulaire à des anomalies<br />
orbito-basi-crâniennes parfois complexes<br />
(comme le syndrome d'Apert-Crouzon,<br />
le syndrome de Binder, les hypertelorismes....)<br />
; elles sortent du champ de<br />
cette présentation..<br />
Les dysmorphoses qui nous occupent<br />
ont un retentissement fonctionnel sur<br />
l'articulation temporo-mandibulaire et<br />
esthétique sur l'harmonie faciale.<br />
Elles relèvent d'une prise en charge<br />
reposant avant tout sur une étroite<br />
collaboration entre l'orthodontiste et le<br />
chirurgien orthognathique.<br />
Quelles dysmorphoses sont à opérer ?<br />
Théoriquement, celles liées à des<br />
anomalies majeures des bases osseuses<br />
avec un décalage tel que l'orthodontie<br />
serait seule insuffisante.<br />
Il existe cependant d'autres indications :<br />
1° - chez l'adulte, afin d'obtenir un<br />
résultat concret de façon plus rapide,<br />
2° - chez les édentés,<br />
3° - dans la situation où il existe des<br />
anomalies alvéolaires verticales, exposant<br />
à un risque de récidive après traitement<br />
orthodontique.<br />
On peut séparer, en matière de<br />
dysmorphose :<br />
Les anomalies des bases osseuses :<br />
- avec un décalage antéro-postérieur :<br />
c'est le problème des pro et rétrognathies<br />
mandibulaires et maxillaires.<br />
- les décalages transversaux : c'est le<br />
problème des latérognathies et asymétries<br />
faciales.<br />
- les anomalies dans le sens vertical :<br />
c'est le problème des excès verticaux<br />
antérieurs, type «face longue» avec béance<br />
et des insuffisances verticales antérieures<br />
avec supraclusie type «face courte».<br />
Les anomalies alvéolaires :<br />
Elles concernent le maxillaire ou la<br />
mandibule, le plus souvent dans la région<br />
des incisives avec :<br />
- des pro ou rétro-alvéolies à retentissement<br />
labial,<br />
- des hyper ou infra alvéolies pouvant<br />
conduire respectivement, soit à un<br />
«sourire des gencives», soit à une<br />
béance d'incisive.<br />
- dans la région molaire, elles sont<br />
responsables de béances antérieures ou<br />
postérieures.<br />
L'analyse céphalométrique doit permettre<br />
d'identifier de façon précise les anomalies<br />
anatomiques présentes, d'établir un planning<br />
qualitatif et quantitatif des gestes correcteurs<br />
à apporter et d'évaluer en fonction de<br />
ceux-ci, le retentissement à attendre sur<br />
la morphologie faciale à l'aide de projets<br />
traditionnels ou numérisés.<br />
Rappelons ici que, dans le cadre<br />
classique de l'analyse céphalométrique,<br />
l'évaluation de la position réciproque des<br />
bases osseuses se détermine en fonction<br />
du rapport des premières molaires, selon<br />
la classification d'ANGLE :<br />
- la classe I correspond à un articulé<br />
dentaire normal où la cuspide mésiovestibulaire<br />
de la première molaire supérieure<br />
est en rapport avec le sillon intercuspidien<br />
de la première molaire inférieure.<br />
- dans la classe II, il existe une dystocclusion<br />
de la molaire inférieure correspondant<br />
à l'existence d'une promaxillie<br />
et/ou d'une rétro-mandibulie.<br />
- dans la classe III, il existe une mésioocclusion<br />
de la molaire inférieure correpondant<br />
à une prognathie mandibulaire<br />
et/ou une rétrognathie maxillaire.<br />
Enfin, la recherche de facteurs étiologiques<br />
associés est impérative, autant<br />
pour faire la part des anomalies héréditaires<br />
souvent présentes, que pour évaluer<br />
le retentissement des troubles de la<br />
croissance secondaires à des problèmes<br />
divers. Infectieux ou traumatiques dans<br />
certains cas, ailleurs en relation avec des<br />
troubles fonctionnels ayant un impact<br />
sur la croissance osseuse à travers une<br />
gêne respiratoire nasale et/ou pharyngée,<br />
une hypertonicité labiale, une interposition<br />
linguale, l'ensemble de ces problèmes
pouvant relever de gestes associés spécifiques.<br />
Le défaut de leur prise en compte<br />
est souvent facteur de récidive postchirurgicale.<br />
Modalités d’intervention<br />
et de traitement<br />
1°) Au stade précoce : Il convient<br />
d'agir sur les facteurs défavorables,<br />
impactant la croissance maxillo-mandibulaire<br />
et avant tout, de dépister chez l'enfant une<br />
insuffisance ventilatoire naso-pharyngée.<br />
On interviendra ici sur le paquet adénoamygdalien<br />
si nécessaire, on gèrera une<br />
hypertrophie des cornets, de façon médicale<br />
ou chirurgicale, par le biais d'une<br />
turbinoplastie ou d'une turbinectomie<br />
partielle. De la même façon, on évaluera<br />
la situation nasale à la recherche d'une<br />
déviation septale et/ou septo-pyramidale,<br />
l'une et l'autre relevant d'une approche<br />
chirurgicale spécifique la plus conservatrice<br />
possible, en particulier chez l'enfant.<br />
2°) Au stade tardif : (c'est-à-dire des<br />
lésions constituées chez l'adulte), la prise<br />
en compte des anomalies au niveau de<br />
la filière respiratoire supérieure n'est pas<br />
inutile, car les anomalies présentes retentissent<br />
sur l'état général et sur la fonction<br />
d'équilibration de l'articulation temporomandibulaire.<br />
Mais c'est surtout, ici, le stade de<br />
l'indication de la correction des dysmorphoses<br />
par chirurgie orthopédique maxillomandibulaire,<br />
dite chirurgie orthognathique.<br />
Les techniques d'ostéotomie maxillomandibulaires<br />
ont pour but de réaliser une<br />
modification spatiale des bases osseuses,<br />
afin de rétablir un équilibre occlusal et facial.<br />
L'orthodontie péri-opératoire conditionne<br />
la garantie du résultat final. Il en est de<br />
même pour la précision du diagnostic<br />
des dysmorphoses présentes quant au<br />
choix thérapeutique, simple ou combiné.<br />
Enfin, les progrès techniques apportés<br />
par les ostéo-synthèses focales par miniplaque,<br />
résorbable ou non, l'utilisation<br />
de piezotome, bistouri à ultrason pour la<br />
section osseuse et la chirurgie assistée<br />
par ordinateur, simplifient et sécurisent<br />
les interventions et leurs suites. Insistons<br />
encore une fois sur la préparation orthodontique,<br />
son caractère incontournable<br />
dès lors qu'elle permet d'organiser la<br />
mise en congruence des arcades pour le<br />
post-opératoire à venir, en extériorisant<br />
tous les défauts et en supprimant les<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
compensations alvéolo-dentaires spontanément<br />
installées.<br />
Codification du traitement<br />
chirurgical<br />
Il repose sur trois axes : clinique,<br />
orthodontique et céphalométrique.<br />
a) Clinique : il conviendra d'évaluer les<br />
proportions des étages faciaux, la situation<br />
de l'articulé dentaire et les rapports labiodentaires,<br />
en particulier au niveau de la<br />
lèvre supérieure.<br />
b) Occlusal ou orthodontique : il repose<br />
sur la pratique de moulages permettant<br />
l'évaluation des anomalies, la simulation<br />
des déplacements avec reconstitution de<br />
l'articulé et la préparation d'une congruence<br />
de qualité à la fin du traitement orthodontique.<br />
La simulation des ostéotomies<br />
par une découpe sur moulage, commencera<br />
comme pour l'étape chirurgicale,<br />
par l'étage maxillaire supérieur, complétée<br />
secondairement par les découpes au<br />
niveau des étages mandibulaires.<br />
c) L'étape céphalométrique : elle repose<br />
sur les analyses des incidences téléradiographiques<br />
(Face-Profil-Hirtz), permettant,<br />
selon l'analyse architecturale de Delaire,<br />
le diagnostic de la dysmorphose. La<br />
quantification des déplacements avec<br />
simulation des coupes sur radiographies,<br />
photographies ou par le biais d'une approche<br />
numérique, permettra de déterminer le<br />
mouvement à apporter aux bases maxillaires<br />
et/ou mandibulaires.<br />
Les ostéotomies<br />
Les ostéotomies concernent le maxillaire<br />
supérieur, la mandibule ; elles peuvent<br />
être totales ou partielles. Parfois, elles sont<br />
associées à la pratique de distractions<br />
osseuses chirurgicales, qui seront évoquées<br />
également ici.<br />
Ostéotomie totale du maxillaire<br />
supérieur (photos 4 & 5):<br />
Photo 4<br />
Photo 5<br />
Leur conception repose sur l'analyse des<br />
tracés des lignes de fracture, observées<br />
en traumatologie, selon la classification<br />
de Lefort. Elles permettent la mobilisation<br />
en monobloc de l'arcade dentaire supérieure<br />
avec et par disjonction ptérygo-maxillaire.<br />
Les variantes existent, quant au niveau<br />
de réalisation des tracés d'ostéotomie.<br />
Les interventions de Lefort I - II ou III sont<br />
indiquées dans les dysmorphoses à<br />
décalage sagittal antéropostérieur simple ;<br />
les ostéotomies type II ou III ajoutent, en<br />
matière de complexité, la gestion des<br />
anomalies orbito-nasales associées, mais<br />
le problème de l'articulé reste comparable<br />
à celui de l'intervention princeps.<br />
La section osseuse permet la mobilisation<br />
des infrastructures du maxillaire<br />
permettant leur avancée ou leur recul,<br />
une fois la disjonction ptérygo-maxillaire<br />
réalisée en arrière.<br />
Un contrôle de l'articulé dentaire est<br />
réalisé avec mise en place d'un blocage<br />
bi-maxillaire transitoire.<br />
L'intervention peut être couplée à l'interposition<br />
ou l'apposition de greffon osseux.<br />
Les ostéosynthèses sont enfin mises en<br />
place, utilisant des microplaques vissées,<br />
résorbables ou non, ceci après contrôle<br />
définitif de la bonne mise en place des<br />
structures osseuses.<br />
Ostéotomie segmentaire du maxillaire<br />
supérieur :<br />
Elles sont d'indication rare du fait des<br />
progrès de la préparation orthodontique,<br />
ainsi qu'on l'a déjà souligné.<br />
Le recul du bloc incisivo-canin dans<br />
les proalvéolies, selon la technique de<br />
Wassmund, constitue sans doute celle<br />
dont l'indication demeure la plus fréquente ;<br />
à part la disjonction intermaxillaire<br />
d'extension transversale indiquée sur les<br />
formes sévères d'endognathie et utilisant<br />
le principe de la distraction sur lequel on<br />
reviendra.<br />
Novembre 2010 - N° 56 13
Au niveau mandibulaire :<br />
Les problèmes chirurgicaux sont<br />
différents car la structure osseuse<br />
concernée peut être assimilée à une<br />
structure bivalve, présentant des rapports<br />
anatomiques particuliers :<br />
- rapport étroit avec le nerf dentaire,<br />
- siège d'insertion d'un bloc musculaire<br />
puissant, constituant l'appareil manducateur,<br />
- d'une extrême mobilité par rapport à<br />
l'axe condylien rendant sa gestion en<br />
per-opératoire complexe.<br />
Deux territoires chirurgicaux sont<br />
ici fondamentaux :<br />
Le premier est antérieur, en avant du<br />
trou mentonnier permettant la pratique<br />
d'ostéotomie segmentaire, dont on précisera<br />
l'indication.<br />
Le second est postérieur, siégeant au<br />
niveau du ramus, ou branche montante.<br />
a) Le territoire antérieur : les ostéotomies<br />
segmentaires vont intéresser le<br />
relief mentonnier et/ou la portion des<br />
blocs dentés, incisivo-canins. Il s'agit ici<br />
surtout des génioplasties associées ou non,<br />
par ailleurs, à des ostéotomies maxillomandibulaires,<br />
dont le but est de permettre<br />
la reposition spatiale exacte du point<br />
mentonnier. Elles peuvent être réalisées<br />
à titre isolé ou combinées souvent à une<br />
rhinoplastie dans le cadre d'une profiloplastie<br />
standard, en-dehors de toute<br />
anomalie ou correction de l'articulé<br />
dentaire d'un patient. Quant aux ostéotomies<br />
segmentaires du bloc incisivocanin,<br />
elles sont exceptionnelles, correspondant<br />
à la technique de Koele et<br />
permettant une mise en congruence des<br />
étages antérieurs dentaires.<br />
b) le territoire postérieur : le ramus<br />
est le site chirurgical par excellence.<br />
Différents types d'intervention y<br />
sont réalisés avec, pour constante, la<br />
pratique d'un clivage sagittal séparant<br />
la branche montante en deux aires :<br />
- Externe, solidaire de l'articulation<br />
temporo-mandibulaire et siège du coroné.<br />
- Interne, solidaire du pédicule vasculonerveux<br />
et de l'arcade dentaire.<br />
L'intervention la plus classique est<br />
l'intervention d'Obweseger Dalpont, qui<br />
constitue une ostéotomie sagittale de la<br />
branche montante (Photo 6).<br />
L'abord chirurgical endo-buccal extrapériosté<br />
expose la zone rétromolaire et<br />
le bord antérieur du ramus.<br />
14<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
Photo 6<br />
Le pédicule, au niveau de l'épine du<br />
spix, est préservé ; le tracé de l'ostéotomie<br />
sera sus-jacent à la pénétration du nerf<br />
dentaire. Les insertions musculaires sont<br />
ruginées largement afin d'éviter toute<br />
incidence indésirable sur les éléments<br />
osseux mobilisés. La section osseuse,<br />
réalisant un clivage sagittal des deux<br />
corticales, va permettre un déplacement<br />
de la portion dentée par rapport au ramus<br />
selon un axe antéro-postérieur (Photo 7).<br />
Photo 7<br />
L'intervention nécessite une vérification<br />
per-opératoire de la situation condylienne.<br />
La mise en congruence de l'articulé en<br />
per-opératoire est assurée par la pratique<br />
d'un blocage bi-maxillaire transitoire.<br />
Une fois les ultimes vérifications de la<br />
qualité de la correction de l'articulé et du<br />
centrage du condyle réalisées, l'ostéosynthèse<br />
sera assurée par un vissage bicortical,<br />
conduit par voie transjugale.<br />
La vérification de l'occlusion peropératoire<br />
après levée du blocage bimaxillaire<br />
est obligatoire.<br />
Des drains et une antibio-corticothérapie<br />
seront indiqués ainsi que la mise en<br />
place d'une sonde au niveau pharyngé<br />
pendant 48 heures.<br />
Une contention orthodontique par<br />
élastiques est mise en place avec une<br />
alimentation liquide pendant 10 jours,<br />
mixée pendant 6 semaines et retour à<br />
un régime normal au bout de 2 mois.<br />
La contention élastique sera<br />
assurée en quasi-continuité pendant les 3<br />
premiers mois et de façon nocturne<br />
pendant les 3 mois suivants.<br />
Le contrôle clinique sera réalisé à 15<br />
jours - 1 mois - 3 mois - 6 mois et 1 an.<br />
Un bilan radiographique sera réalisé<br />
avec orthopantomogramme et téléradiographie<br />
à 8 jours - 6 mois et 1 an.<br />
Les distractions osseuses<br />
(Photo 8)<br />
Imaginées et utilisées initialement en<br />
chirurgie orthopédique (Illizarov) : elles ont<br />
pour but l'obtention d'une néo-formation<br />
osseuse. Elles peuvent ainsi permettre<br />
de résoudre le problème orthognathique<br />
sans avoir recours à des greffes, comme<br />
c'était le cas classiquement.<br />
Un foyer d'ostéogénèse est induit par<br />
la réalisation d'une ostéotomie corticale<br />
au niveau de laquelle le cal va se<br />
constituer, sous l'effet de la stimulation<br />
des facteurs plaquettaires et de la fibrine.<br />
L'ostéogénèse est aussi favorisée par la<br />
présence de facteurs de croissance locaux.<br />
Après une période d'attente d'une<br />
semaine, la stimulation par distraction du<br />
matériel installé sera amorcée à raison de 1<br />
mm par jour, l'ostéogénèse pouvant ainsi<br />
permettre de gagner jusqu'à 15 mm.<br />
La consolidation à l'obtention du déplacement<br />
est obtenue en 6 à 8 semaines.<br />
L'utilisation de produits d'activation<br />
des foyers d'ostéogénèse, tels les PRF,<br />
est proposée par de nombreux auteurs.<br />
Conclusion<br />
Photo 8<br />
Il semble utile d'insister sur trois notions :<br />
- la nécessité d'une approche multidisciplinaire<br />
de la prise en charge des<br />
dysmorphoses maxillo-faciales et le rôle<br />
majeur du traitement orthodontique.<br />
- l'importance du dépistage précoce<br />
des facteurs aggravants sinon déclenchants,<br />
en particulier chez l'enfant.<br />
- l'intérêt des nouvelles technologies<br />
en matière de simplicité et de sécurité<br />
des suites opératoires.
16<br />
AA GG EE NN CC E E SS AA NN II TT AA II RR E E EE T T SS OO CC II AA LL E E -- NN C C<br />
Quelques trucs et astuces pouvant être utiles<br />
pour aborder l’alcool :<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
L’OMS a défini des normes de consommations<br />
à moindre risque.<br />
Comment les retenir?<br />
Il y a cinq chiffres que le professionnel de<br />
santé doit connaître et doit faire connaître à<br />
la population dans le cadre de ses activités<br />
de soins primaire et d’éducation pour la santé:<br />
Ces chiffres sont : 0, 1, 2, 3, 4<br />
0 verre d’alcool chez la femme enceinte<br />
du début à la fin de la grossesse<br />
1 jour par semaine sans alcool chez le<br />
buveur régulier<br />
Pas plus de 2 verres d’alcool par jour<br />
chez la femme buveuse régulière<br />
Pas plus de 3 verres d’alcool par jour<br />
chez l’homme buveur régulier<br />
Pas plus de 3 verres d’alcool par occasion<br />
chez la femme buveuse occasionnelle<br />
Pas plus de 4 verres d’alcool par occasion<br />
chez l’homme buveur occasionnel<br />
Qu’entend-on par verre d’alcool : il s’agit de verres standards, c’est-à-dire les verres que l’on boit dans un lieu public.<br />
Un demi pression équivaut à un verre de vin, à un verre de whisky ou de cognac.<br />
Mais les consommations ne se font pas<br />
toujours dans des lieux publics...<br />
...et à la maison nos verres de whisky sont<br />
souvent plus généreux qu’au bar.<br />
Certains modes de consommation<br />
se font parfois directement à la bouteille<br />
dans laquelle chacun prend une gorgée.<br />
Il est alors intéressant de calculer<br />
les équivalences.
= 23 VERRES<br />
AA GG EE NN CC E E SS AA NN II TT AA II RR E E EE T T SS OO CC II AA LL E E -- NN C C<br />
STANDARDS<br />
= 19 BOITES <strong>DE</strong> BIERE<br />
= 10 VERRES STANDARDS 7<br />
À partir de 0,80g d’alcool/litre de sang il ne s’agit plus d’une contravention mais d’un délit.<br />
Quel est le taux correspondant à l’ivresse?<br />
=<br />
<strong>DE</strong> 33 cl<br />
BOITES <strong>DE</strong> BIERE<br />
<strong>DE</strong> 33 cl<br />
Quel est le taux normal d’alcool dans le<br />
sang?<br />
Ce taux est zéro<br />
Quel est le taux légal pour la conduite d’un<br />
véhicule?<br />
En Nouvelle-Calédonie ce taux est 0,50g<br />
d’alcool/litre de sang (soit 0,25mg d’alcool/<br />
litre d’air expiré)<br />
Ce taux là ne correspond pas à l’ivresse<br />
mais au taux au-delà duquel on est en<br />
contravention (15 000 cfp).<br />
Il est variable d’un individu à l’autre (un alcoolo dépendant a toujours de l’alcool dans le sang mais présente rarement<br />
des signes d’ivresse.<br />
Il en est de même pour le coma éthylique : un adolescent peut être en coma avec un taux d’alcool inférieur à 2g/l alors qu’un<br />
alcoolo dépendant ne le sera parfois pas avec une alcoolémie au delà de 3g/litre de sang<br />
Lorsque nous prenons le volant nous confondons souvent taux légal et signe d’ivresse. C’est dangereux. Un adulte de 70kg<br />
qui a bu trois canettes de bière pourra avoir une alcoolémie de 0,50 g/litre mais ne sera pas ivre et dira facilement qu’il<br />
est capable de gérer et de conduire son véhicule<br />
Alcool et grossesse<br />
Le risque dépend :<br />
De la dose ingérée,<br />
De la date de l’exposition à l’alcool,<br />
De la durée de l’exposition,<br />
De la vulnérabilité individuelle de la mère,<br />
Le risque existe à partir de 30 grammes<br />
d’alcool/ jour (3 verres de vin ou 2 canettes<br />
de bière) et il est permanent du début à la<br />
fin de la grossesse.<br />
Première cause non génétique de handicap<br />
mental chez l'enfant<br />
Plus fréquent que la trisomie,<br />
Evitable à 100%,<br />
Irréversible à 100%<br />
Novembre 2010 - N° 56 17
Diagnostic biologique de la dengue à l’Institut Pasteur de<br />
Nouvelle-Calédonie (IPNC)<br />
Ann-Claire Gourinat, Eric D’Ortenzio<br />
IPNC Nouméa<br />
Il existe quatre sérotypes distincts du<br />
virus de la dengue qui entrainent les<br />
mêmes signes cliniques sans immunité<br />
croisée entre ces 4 sérotypes. Autrement<br />
dit, un même individu peut en théorie<br />
avoir la dengue 4 fois dans sa vie.<br />
Deux épidémies de dengue incriminant<br />
d’abord le sérotype <strong>DE</strong>N-1 en<br />
2008 puis des sérotypes <strong>DE</strong>N-4 (majoritaire)<br />
et <strong>DE</strong>N-1 en 2009 se sont succédées<br />
en Nouvelle-Calédonie. La persistance<br />
du sérotype <strong>DE</strong>N-1 pendant plus de 2<br />
ans, avec des cas sporadiques diagnostiqués<br />
en inter-épidémie et en saison<br />
fraîche, suggère fortement l’installation<br />
d’une situation endémo-épidémique sur le<br />
territoire.<br />
Rappels cliniques<br />
et biologiques<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
LES MARDIS <strong>DE</strong> L’ ASSOCIATION<br />
Soirée du 05 octobre 2010<br />
La dengue est une arbovirose due à un virus de la famille des flaviviridae transmise à<br />
l'homme par la piqûre d'un moustique diurne du genre Aedes. Elle sévit dans les régions<br />
tropicales et subtropicales, avec une prédilection pour les zones urbaines et semi-urbaines. La<br />
dengue serait l’affection virale la plus répandue au monde, avec 55% de la population<br />
mondiale exposée au virus (2,5 milliards) dans plus de 120 pays. Chaque année, on estime à<br />
36 millions le nombre de cas symptomatiques dont 2,1 millions de formes sévères (formes<br />
hémorragiques et formes avec syndrome de choc) et à 21 000 le nombre de décès [1, 2].<br />
Après une période d’incubation moyenne<br />
de 5 à 6 jours (extrême : 3 à 15 jours)<br />
apparaissent les premiers signes cliniques<br />
de la maladie. Le virus de la dengue<br />
peut provoquer alors un large éventail<br />
de formes cliniques, allant de la forme<br />
totalement asymptomatique à la forme<br />
hémorragique parfois mortelle. Les signes<br />
cliniques de la dengue sont généralement<br />
une fièvre élevée d’apparition brutale, des<br />
céphalées, des myalgies, des arthralgies,<br />
des douleurs rétro-orbitaires, une asthénie,<br />
des nausées, parfois un érythème facial<br />
ou diffus et une injection conjonctivale.<br />
Sur le plan biologique, on peut observer<br />
une thrombopénie associée à une<br />
leuconeutropénie, une lymphopénie et<br />
la présence de lymphocytes hyperbasophiles<br />
signalés à la formule sanguine. La<br />
cytolyse (ASAT) est modérée et la CRP<br />
reste subnormale.<br />
Le pourcentage des formes asymptomatiques<br />
est non négligeable et pourrait<br />
atteindre 30 à 80% de la population selon<br />
certaines études [2, 3, 4].<br />
Les examens biologiques<br />
Plusieurs examens de laboratoire<br />
sont disponibles pour diagnostiquer la<br />
dengue : la mise en évidence de l’ARN<br />
du virus par RT-PCR et de l’antigène<br />
NS1 (marqueurs précoces) et la recherche<br />
des anticorps de type IgM et IgG dirigés<br />
contre le virus (marqueurs tardifs).<br />
ARN viral<br />
AgNS1<br />
IgM<br />
J-1 J+5/6<br />
Figure 1 : cinétique des outils diagnostiques<br />
Figure 1 : cinétique des outils diagnostiques<br />
J+1 J+9<br />
L’antigène NS1<br />
L’antigène NS1 (Non stuctural protein)<br />
est une protéine du virus produite en<br />
excès lors de la réplication virale. Il peut<br />
persister dans le sérum des patients<br />
jusqu’au 9 ème jour suivant l’apparition des<br />
premiers symptômes (fig.1). L’antigène<br />
NS1 est détectable soit par technique<br />
ELISA (technique automatisée réalisée<br />
tous les jours à l’IPNC), soit par technique<br />
immunochromatographique (test rapide<br />
avec un résultat donné en 30’). La spécificité<br />
du test ELISA est proche de 100%<br />
et sa sensibilité avoisine les 90%.<br />
Cependant une sensibilité moindre a<br />
été observée avec le kit Biorad durant<br />
l’épidémie de 2008-2009 sans doute liée<br />
à la production d’IgG anti-NS1 lors d’une<br />
infection antérieure [5]. Les tests rapides<br />
J(3)-J5 M2M3<br />
Novembre 2010 - N° 56 19
présentent une sensibilité moins élevée<br />
que le test ELISA et sont réservés uniquement<br />
aux demandes urgentes et<br />
ponctuelles pour des patients hospitalisés.<br />
20<br />
La PCR dengue<br />
La détection de l’ARN viral est réalisée<br />
par la méthode RT-PCR, plus complexe,<br />
longue (8h) et coûteuse [6]. Ce test est<br />
réalisé une à deux fois par mois à<br />
l’IPNC, sauf situation exceptionnelle. En<br />
Nouvelle-Calédonie, la PCR est utilisée<br />
pour la surveillance épidémiologique car<br />
elle seule permet d’identifier les sérotypes<br />
circulants et permet chaque année de<br />
détecter l’intrusion de nouveaux sérotypes<br />
chez des voyageurs (retour d’Asie du<br />
Sud Est principalement).<br />
La sérologie<br />
Les IgM spécifiques dirigés contre le<br />
virus sont détectables par méthode ELISA,<br />
quelques jours après l’apparition des<br />
symptômes (fig.1). La sensibilité de ce<br />
test est de 95% mais sa spécificité peut<br />
varier selon les coffrets utilisés. Un résultat<br />
positif isolé doit être interprété avec<br />
précaution, car des réactions croisées<br />
ont été observées dans des syndromes<br />
infectieux comme l’hépatite A, la leptospirose,<br />
le paludisme, le virus West Nile,<br />
etc…, ou encore lors d’activations polyclonales<br />
ou de pathologies auto-immunes.<br />
Une deuxième sérologie, après un intervalle<br />
de 15 jours, peut permettre de<br />
confirmer le diagnostic de dengue<br />
(séroconversion ou séro-ascension<br />
significative du taux d’IgM).<br />
La recherche des IgG a peu d’intérêt<br />
sur un prélèvement isolé, car d’une part<br />
l’apparition des IgG est plus tardive que<br />
celle des IgM et d’autre part une majorité<br />
de la population calédonienne a probablement<br />
déjà été exposée à un des 4<br />
sérotypes et présente donc des IgG. Si<br />
un deuxième prélèvement est réalisé à<br />
distance, la recherche des IgG sur ces 2<br />
sérums peut permettre, en cas d’augmentation<br />
significative du titre d’anticorps,<br />
d’établir un diagnostic de certitude de<br />
dengue, et de différencier une dengue<br />
primaire d’une dengue secondaire<br />
(fig 2). La sérologie IgG n’est actuellement<br />
pas réalisée à l’IPNC car la<br />
deuxième sérologie reste rarement<br />
prescrite, mais elle pourrait être mise en<br />
œuvre prochainement.<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
Le réseau sentinelle dengue<br />
L’IPNC est le laboratoire de référence<br />
pour la surveillance de la dengue en<br />
Nouvelle-Calédonie. La recherche de<br />
l’antigène NS1 est réalisée tous les jours<br />
quelle que soit l’activité épidémique. La<br />
sérologie IgM est faite deux fois par<br />
semaine (hors épidémie) et tous les<br />
jours pendant les périodes épidémiques.<br />
Les coordonnées des patients positifs à<br />
l’un des deux tests sont aussitôt transmises<br />
à la DASS-NC qui fait suivre le même<br />
jour ces renseignements aux services<br />
municipaux. Ces derniers mettent alors<br />
Cas confirmé confirm<br />
Ag NS1<br />
+ -<br />
- Hors épidémie : RT-PCR dengue<br />
sérotypage<br />
- Epidémie : RT-PCR<br />
voyageurs<br />
nouveaux foyers<br />
Figure 3 : stratégie diagnostic diagnostique pour pour le le réseau réseau sentinelle<br />
Figure 2 : réponse<br />
immunitaire lors d’une<br />
primo-infection et lors<br />
d’une réinfection du<br />
virus de la dengue<br />
en place la lutte anti-vectorielle périfocale<br />
autour des habitations concernées.<br />
L’IPNC perçoit une subvention du<br />
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie<br />
pour réaliser les activités de surveillance.<br />
Le réseau sentinelle dengue est défini par<br />
la DASS-NC et il est actuellement ouvert à<br />
tous les médecins. Lorsqu’un prélèvement<br />
parvient à l’IPNC, accompagné d’une<br />
fiche de renseignement du réseau sentinelle,<br />
les examens les plus adaptés sont<br />
réalisés (fig.3), le patient bénéficie de la<br />
gratuité des examens et les données<br />
cliniques alimentent les données de la<br />
DASS.<br />
1 ère sérologie<br />
SC
La déclaration de cas de dengue : intérêt et conséquences<br />
Anne Pfannstiel<br />
DASS-NC<br />
Situation épidémiologique<br />
de la dengue en<br />
Nouvelle Calédonie<br />
Avec un peu plus d’une centaine de<br />
cas depuis le début de l’année, et environ<br />
1 cas par semaine actuellement, ainsi<br />
que du fait que la circulation du virus est<br />
permanente sur le territoire depuis<br />
plusieurs années, la Nouvelle Calédonie<br />
connaît une situation endémo épidémique.<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
Bien que seul le virus de type 1 circule<br />
sur le territoire, d’autres sérotypes circulent<br />
dans la région (<strong>DE</strong>N 4 en Polynésie<br />
française, <strong>DE</strong>N 3 à la Réunion, les 4<br />
sérotypes en Indonésie et en Asie du<br />
Sud-est).<br />
Rappelons que le moustique vecteur<br />
de la dengue, Aedes aegypti est également<br />
vecteur d’autres maladies<br />
comme le chikungunya et la fièvre jaune.<br />
Il est donc important d’interroger les<br />
patients présentant une hyperthermie ou<br />
Circuit de déclaration de la dengue<br />
* : Service d’Inspection et de Prévention des Risques Environnementaux et Sanitaires<br />
*<br />
des signes cliniques suspects sur un<br />
éventuel retour de voyage afin de limiter<br />
les risques d’introduction d’un autre<br />
sérotype de dengue ou d’une nouvelle<br />
pathologie sur le territoire.<br />
La dengue est une maladie à<br />
déclaration obligatoire en Nouvelle<br />
Calédonie.<br />
Novembre 2010 - N° 56 21
Conseils aux patients<br />
Ne pas oublier de donner une ordonnance<br />
jaune à chaque patient suspect de dengue,<br />
avec quelques explications sur l’importance<br />
de réaliser une protection individuelle contre les<br />
piqûres de moustique en période de virémie,<br />
ceci afin d’éviter la contamination d’autres<br />
moustiques qui diffuseront à leur tour la maladie.<br />
En conclusion, il est impératif que chaque<br />
patient porteur d’une dengue confirmée biologiquement<br />
ou suspect de dengue sans confirmation<br />
biologique soit déclaré afin qu’une lutte<br />
périfocale puisse débuter dans les meilleurs<br />
délais afin de limiter l’extension de la maladie.<br />
Qu’avec l’approche de la période chaude et<br />
pluvieuse et l’entrée de la Nouvelle Calédonie<br />
en phase El Niña qui devrait entraîner des<br />
températures (+++) et précipitations supérieures<br />
aux normales saisonnières pour les prochains<br />
mois, la Nouvelle Calédonie n’est pas à l’abri<br />
d’une nouvelle épidémie de dengue.<br />
22<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />
Renseignements indispensables :<br />
1 Nom, prénom, adresses réelles<br />
et n° de téléphone<br />
=> réalisation d’une lutte périfocale dans un périmètre<br />
de 150 m autour de l’habitation du patient<br />
2 Voyage récent hors NC,<br />
lieu et date de retour<br />
=> éviter l’introduction de nouveaux sérotypes en<br />
NC<br />
3 Date d’apparition des signes<br />
et signes cliniques<br />
=> aide au diagnostic en cas de résultats douteux<br />
et calcul du J de la maladie<br />
4 Date de prélèvement,<br />
J de la maladie<br />
=> oriente pour choisir le test biologique à utiliser
EE XX EE RR CC EE R R AA UU JJ OO UU RR D D ’ ’ HH UU I I<br />
Intoxication par le crabe de cocotier Birgus latro<br />
en Nouvelle-Calédonie<br />
Dr Claude MAILLAUD, SAMU 988<br />
Il s’agit d’une intoxication alimentaire potentiellement<br />
létale par le crabe de cocotier, dont<br />
la forme clinique observée en Nouvelle-<br />
Calédonie a été récemment décrite (Maillaud<br />
et al., 2010). Cette entité a été à l’origine de<br />
quatre décès en 2008 et 2009, et de treize<br />
cas d’évolution favorable entre 2008 et 2010.<br />
Elle semble limitée aux îles Loyauté, et concerner<br />
les quatre îles de cet archipel.<br />
Toxinologie<br />
Le crabe de cocotier Birgus latro peut<br />
être porteur de toxines de la famille des<br />
cardénolides, à laquelle appartiennent<br />
également les digitaliques, suite à la<br />
consommation par le crustacé du noyau<br />
du fruit du faux manguier Cerbera<br />
manghas, un arbre de la famille des<br />
Apocynaceae. Les toxines apparaissent<br />
concentrées dans l’hépatopancréas et le<br />
tube digestif du crustacé, correspondant<br />
à partie noire du céphalothorax de<br />
l’animal, normalement non consommée<br />
dans les îles Loyauté. Toutefois, la préparation<br />
selon la méthode traditionnelle<br />
visant à éliminer cette partie de l’animal<br />
ne prévient pas toujours l’intoxication,<br />
comme en témoignent quatre cas dont un<br />
mortel faisant suite à la consommation<br />
du céphalothorax de crabes de cocotier<br />
préparés conformément à ces recommandations.<br />
Une confirmation de l’hypothèse toxinologique<br />
par dosage des cardénolides<br />
dans le sérum des patients décédés, le<br />
noyau du faux manguier et les viscères<br />
du crabe de cocotier a été obtenue,<br />
mettant en cause la neriifoline, toxine<br />
produite par certains Apocynaceae<br />
(deux autres cardénolides, la cerberine et<br />
cerberigenine, ont également été identifiés<br />
en faible quantité dans les tissus du<br />
crustacé). La nériifoline a également été<br />
retrouvée dans le sérum de patients ayant<br />
présenté des intoxications non létales.<br />
La recherche de neriifoline dans la<br />
chair du crabe de cocotier a amené des<br />
résultats positifs pour la chair du céphalothorax<br />
et celle du haut des pattes<br />
(à des taux plus faibles que dans les<br />
viscères), elle n’a pas été réalisée pour<br />
les pinces.<br />
La période de fructification du faux<br />
manguier dans les îles Loyauté est<br />
considérée comme s’étendant de janvier<br />
à avril, et les quatre cas mortels observés<br />
l’ont été en avril 2008 et avril 2009. Toutefois,<br />
si la majorité des cas observés l’a été<br />
entre les mois de janvier et avril, deux<br />
cas non mortels relevés aux mois de mai<br />
et d’octobre viennent relativiser cette<br />
donnée. Ce d’autant que des observations<br />
récentes tendent à montrer que la<br />
période de fructification de Cerbera<br />
manghas s’étend en fait de mars à<br />
novembre et que des fruits de l’arbre<br />
sont présents au sol toute l’année.<br />
Cerbera manghas (fleurs et fruits)<br />
Structure chimique de la nériifoline<br />
Crabe de cocotier Birgus latro<br />
Photo : P Bacchet<br />
Les cas d’intoxication mortels ont été<br />
décrits suite à la consommation de crabes<br />
de cocotiers provenant de Maré (districts<br />
de Menakou, Ro, Padawa, Tenane), les<br />
cas non mortels ont été imputés à des<br />
crustacés en provenance de Maré (7 cas,<br />
districts de Menaku, Tenane, Eni), Lifou<br />
(2 cas), Ouvéa (2 cas) et Tiga (2 cas).<br />
Clinique et<br />
investigations paracliniques<br />
Assez proche de l’intoxication digitalique,<br />
cette intoxication associe des<br />
signes dans un premier temps digestifs<br />
(vomissements, diarrhée), motivant habituellement<br />
le recours aux soins, à des<br />
signes cardiovasculaires apparaissant<br />
secondairement (dans un délai mal précisé,<br />
pouvant atteindre plusieurs heures) et qui<br />
Photo : C Pivert<br />
Novembre 2010 - N° 56 23
font le pronostic de l’intoxication : bradycardie,<br />
hypotension, troubles de la<br />
conduction (BAV complet) évoluant vers<br />
l’asystolie. Il n’est pas noté de signes<br />
neurosensoriels.<br />
Une hyperkaliémie est constante,<br />
associée à une insuffisance rénale plus<br />
ou moins sévère. La correction de l’hyperkaliémie<br />
ne permet pas la régression des<br />
troubles de la conduction. S’y associe<br />
une acidose métabolique. La présence<br />
de l’hyperkaliémie semble constituer un<br />
facteur de mauvais pronostic.<br />
Des formes digestives pures ont également<br />
été observées, se limitant à un<br />
épisode de vomissements et diarrhée<br />
pouvant durer jusqu’à 24 heures.<br />
Un cas avec bradycardie sinusale<br />
transitoire et majoration d’un BAV1 préexistant,<br />
accessibles à l’atropine, sans<br />
hyperkaliémie, a été récemment observé.<br />
Le passage d’une forme digestive<br />
pure à une forme cardio-vasculaire<br />
engageant le pronostic vital en l’absence de<br />
traitement spécifique n’est pas prévisible.<br />
Les formes cardio-vasculaires mortelles<br />
représenteraient à ce jour moins d’un<br />
quart des cas.<br />
Diagnostic différentiel<br />
L’intoxication peut être confondue<br />
avec : une hyperkaliémie d’autre origine<br />
(insuffisance rénale), une intoxication<br />
digitalique, un SCA.<br />
Pronostic<br />
La létalité de l’intoxication a été<br />
constante dans quatre cas relevés en<br />
Nouvelle-Calédonie avec signes cardiovasculaires<br />
(troubles de la conduction<br />
réfractaires à toute thérapeutique évoluant<br />
vers l’asystolie). Le décès est survenu<br />
dans les premières vingt-quatre heures<br />
suivant le repas toxique dans trois cas,<br />
au quatrième jour dans un cas<br />
(corrélation avec une kaliémie initiale<br />
moins élevée ?).<br />
La constatation d’une hyperkaliémie<br />
(parfois très marquée : jusqu’à 9,4<br />
mmol/L) a été associée à la totalité des<br />
cas mortels ; à l’inverse, une kaliémie<br />
normale a été constatée chez plusieurs<br />
patients ayant présenté des formes<br />
uniquement digestives. Cette hyperkaliémie<br />
est considérée comme le reflet de<br />
l’action toxique des cardénolides en<br />
particulier sur les cellules myocardiques,<br />
ce qui peut expliquer l’inefficacité en<br />
termes de mortalité de la correction de<br />
24<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
EE XX EE RR CC EE R R AA UU JJ OO UU RR D D ’ ’ HH UU I I<br />
cette anomalie biologique en l’absence<br />
de traitement visant à neutraliser la<br />
toxine en cause.<br />
L’âge et la présence de comorbidités<br />
(diabète, insuffisance rénale, cardiopathie)<br />
semblent apparaître comme des facteurs<br />
de mauvais pronostic, présents chez la<br />
totalité des patients décédés.<br />
La consommation du céphalothorax a<br />
été associée aux quatre cas mortels, que<br />
l’animal ait été préparé conformément à<br />
la tradition orale des île Loyauté (qui<br />
recommande d’en extraire hépatopancréas<br />
et tube digestif, à savoir la « partie<br />
noire », ou de ne pas consommer le<br />
crabe si le céphalothorax a un aspect<br />
« noirâtre ») ou non (conformément à<br />
ces recommandations dans 1 cas, sans<br />
préparation particulière dans 3 cas).<br />
La consommation d’autres parties du<br />
crustacé (pattes, pinces) n’a pas été<br />
associée jusqu’ici à des cas mortels,<br />
mais à des formes uniquement digestives<br />
observées dans l’entourage des victimes<br />
ainsi qu’à l’occasion d’intoxications<br />
distinctes des cas mortels. Toutefois,<br />
compte tenu de la présence de nériifoline<br />
dans différents tissus de l’animal et du<br />
manque de données permettant de tirer<br />
des généralités quant à la toxicité des<br />
différentes parties de celui-ci (nécessité<br />
de dosages toxinologiques sur de vastes<br />
échantillons de crustacés), il semble<br />
actuellement hasardeux de conclure que<br />
seule la consommation du céphalothorax<br />
puisse exposer au risque d’intoxication<br />
mortelle.<br />
Traitement<br />
Ont été tentés, sans succès en termes<br />
de mortalité : MCE, IOT + ventilation<br />
mécanique, adrénaline, atropine, isoprénaline,<br />
sonde d’EES, gluconate de calcium,<br />
bicarbonate de sodium 4,2%, G5% +<br />
insuline rapide, salbutamol au PSE, lavage<br />
gastrique, épuration extra-rénale.<br />
Les anticorps Fab anti-digitaliques<br />
(DIGIBIND ® ) semblent indiqués en cas<br />
de manifestations cardio-vasculaires de<br />
l’intoxication, compte tenu de la proche<br />
parenté des toxines en cause avec les<br />
digitaliques ainsi qu’avec différents<br />
cardénolides en cause dans d’autres<br />
intoxications par les Apocynaceae et dans<br />
lesquelles l’efficacité de ce traitement<br />
est établie.<br />
Il semble raisonnable de réserver leur<br />
utilisation aux patients présentant au<br />
moins l’un des signes suivants: BAV<br />
complet, bradycardie résistante à l’atropine,<br />
hypotension artérielle, hyperkaliémie.<br />
L’indication des anticorps Fab antidigitaliques<br />
chez les patients présentant<br />
une bradycardie accessible à l’atropine<br />
et/ou des troubles mineurs de la conduction<br />
(BAV1) doit être pesée au cas par cas,<br />
en tenant compte des facteurs de mauvais<br />
pronostic que représentent l’âge et<br />
l’existence de comorbidités.<br />
Prévention<br />
Dans l’état actuel des connaissances<br />
sur la question, il paraît raisonnable de<br />
déconseiller formellement toute consommation<br />
de crabe de cocotier en provenance<br />
des îles Loyauté. Un complément<br />
d’enquête, visant en particulier à mieux<br />
cerner la toxicité des différentes parties<br />
du crustacé à différentes périodes de<br />
l’année, voire d’évaluer l’effet du jeûne<br />
ou de l’alimentation contrôlée en captivité<br />
du crustacé en préalable à sa<br />
consommation, mériterait de se voir diligenter<br />
afin de mieux cerner le risque en<br />
termes de santé publique. Faute que de<br />
telles investigations soient entreprises,<br />
le principe de précaution semble devoir<br />
s’appliquer, lequel recommande l’abstention<br />
complète de toute consommation de<br />
crabe de cocotier en provenance des îles<br />
Loyauté jusqu’à plus ample informée.<br />
Proposition de prise en charge<br />
Transport médicalisé et admission<br />
en Réanimation (au Centre Hospitalier<br />
Territorial Gaston Bourret) de tout patient<br />
présentant des signes digestifs et a fortiori<br />
cardiovasculaires au décours de la<br />
consommation de crabes de cocotier ;<br />
alternative : admission en Soins Intensifs<br />
voire à défaut à l’UHCD (lit scopé) si signes<br />
digestifs seuls, transfert en Réanimation<br />
si apparition secondairement de signes<br />
cardiovasculaires.<br />
ECG, monitorage continu des paramètres<br />
vitaux, kaliémie en urgence (i-STAT).<br />
Bilan sanguin : NFS, ionogramme,<br />
créatininémie, urée plasmatique, calcémie,<br />
gaz du sang artériel, lactates ; dosages<br />
répétés de la kaliémie.<br />
Traitement des troubles de la<br />
conduction et de l’hyperkaliémie tel<br />
que décrit plus haut, en l’attente ou en<br />
complément d’un traitement spécifique.<br />
Envisager l’utilisation d’anticorps<br />
Fab anti-digitaliques dès lors que des<br />
signes cardiovasculaires (bradycardie,<br />
troubles de la conduction, hypotension)
et/ou une hyperkaliémie sont présents,<br />
compte tenu d’arguments théoriques<br />
forts allant dans le sens de leur efficacité<br />
et du pronostic constamment fatal de<br />
l’intoxication avec présence de ces signes<br />
cardiovasculaires associés à cette anomalie<br />
biologique.<br />
Prélèvements en vue d’analyses toxicologiques,<br />
à adresser au Laboratoire de Biochimie<br />
du CHT à l’attention du Dr Yann BARGUIL :<br />
- un tube sec pour recherche de toxiques<br />
sanguins + un prélèvement d’urines,<br />
- les crustacés toxiques et/ou ceux<br />
provenant du même lot si disponibles<br />
(à congeler),<br />
- 20 g de myocarde en cas d’autopsie<br />
d’un patient décédé.<br />
Signalement à la DASS.<br />
Intoxication par Apocynaceae<br />
Outre Cerbera manghas, la famille<br />
des Apocynaceae comprend plusieurs<br />
espèces toxiques, dont :<br />
- Cascabela thevetia (anciennement<br />
Thevetia peruviana, laurier jaune),<br />
- Nerium oleander (laurier rose).<br />
Différentes parties de ces plantes<br />
contiennent des hétérosides cardiotoxiques :<br />
thevetines A et B et neriifoline pour la<br />
première, oléandrine pour la seconde.<br />
La prise en charge des intoxications<br />
par ces végétaux fait également appel<br />
aux anticorps Fab anti-digitaliques.<br />
EE XX EE RR CC EE R R AA UU JJ OO UU RR D D ’ ’ HH UU I I<br />
Anticorps Fab Anti-Digitaliques (Digibind ® )<br />
Présentation<br />
DIGIBIND ® : flacons de 38 mg de fragments Fab d’immunoglobuline antidigoxine (Laboratoires SERB).<br />
Un stock de 30 flacons est entretenu à la Pharmacie du CHT.<br />
Ce stock peut être mis à la disposition du SAMU sur appel du pharmacien de garde, en vue d’une<br />
administration du produit avant ou pendant le transport du patient vers le CHT.<br />
La mise à disposition d’une dose curative de fragments Fab d’immunoglobuline antidigoxine à l’un<br />
des dispensaires de Maré est une option qui n’a pas été retenue, en raison des problèmes de coût, de<br />
conservation (au froid et à l’abri de la lumière) et de péremption rapide du produit.<br />
Propriétés :<br />
DIGIBIND ® : 1 flacon neutralise 0,5 mg de digitalique (digoxine ou digitoxine).<br />
Posologie<br />
En raison des inconnues quant aux propriétés pharmacologiques de la neriifoline et de l’absence de<br />
données quant à l’intoxication par cette toxine seule, les posologies suivantes peuvent être proposées :<br />
- 760 mg soit 20 flacons de DIGIBIND ® , posologie recommandée en cas d’ingestion aiguë d’une<br />
quantité inconnue de glycoside (voir caractéristiques du produit, in : SERB - Laboratoires)<br />
- 1 140 mg soit 30 flacons de DIGIBIND ® , à renouveler au besoin une voire deux fois en cas de<br />
réponse insuffisante, posologie recommandée quels que soient l’âge et le poids du patient en cas<br />
d’intoxication par le laurier jaune Cascabela thevetia - anciennement Thevetia peruviana (Rajapakse,<br />
2009). Il est en effet établi que des doses supérieures à celles efficaces pour le traitement de l’intoxication<br />
digitalique sont nécessaires en cas d’intoxication par les cardénolides (thevetines A et B et neriifoline)<br />
contenus dans cette plante.<br />
Indications<br />
Il paraît logique de réserver l’administration des anticorps Fab anti-digitaliques aux seuls patients présentant<br />
des symptômes cardio-vasculaires, compte tenu de l’inconstance de la survenue de ceux-ci parmi les<br />
patients présentant des signes digestifs. Cette stratégie impose le transport médicalisé et la mise en<br />
observation de tout patient suspect d’intoxication par le crabe de cocotier dans un service équipé des<br />
moyens techniques et humains permettant un monitorage continu des fonctions vitales et l’intervention<br />
immédiate d’une équipe soignante formée à l’utilisation des anticorps Fab anti-digitaliques lorsque<br />
nécessaire. Le très faible délai d’action de ce produit lors des intoxications par digitaliques semble<br />
autoriser cette attitude. L’administration prophylactique du produit soulève un problème de coût.<br />
Effets indésirables<br />
Il est noté la possibilité de réactions allergiques.<br />
Coût<br />
Environ 70000CFP le flacon de DIGIBIND ® .<br />
Références bibliographiques<br />
MAILLAUD C, LEFEVRE S, SEBAT C, BARGUIL Y, CABALION P, CHEZE M, HNAWIA E, NOUR M, DURAND F. Double lethal Coconut<br />
Crab (Birgus latro L.) poisoning. Toxicon 2010 ; 55 : 81-6. - LAPOSTOLLE F. Intoxication digitalique aigue. In: BISMUTH C, BAUD F,<br />
CONSO F, DALLY S, FREJAVILLE JP, GARNIER R, JAEGER A. Toxicologie Clinique. 5ème édition. Paris: Flammarion, 2000 : 254-65.<br />
RAJAPAKSE S. Management of yellow oleander poisoning. Clin Toxicol 2009 ; 47 : 206-12. - SERB – Laboratoires. caractéristiques du<br />
produit, in : Lettre d’information destinée aux professionnels de santé. Paris, 15 février 2008.- PIVERT C. Intoxication aux cardénolides par<br />
Apocynacée (Cerbera manghas) via la consommation de crabe de cocotier (Birgus latro) en Nouvelle-Calédonie. Thèse. Rennes, 2010.<br />
Novembre 2010 - N° 56 25
Définition donnée<br />
par la Haute Autorité<br />
de la Santé<br />
En Nouvelle-Calédonie:<br />
quelques chiffres<br />
En 2008, 82 mineurs étaient<br />
recensés « TED » en province Sud, et<br />
1 en Province Nord, au nombre<br />
desquels se trouvent les autistes<br />
(données croisées CEJH, établissements<br />
spécialisés, centre de pédo<br />
psychiatrie, Direction enseignement).<br />
Ce recensement est à minima<br />
puisque le dépistage précoce<br />
n’est pas mis en place et que les<br />
26<br />
Novembre 2010- N° 56<br />
EE XX EE RR CC EE R R AA UU JJ OO UU RR D D ’ ’ HH UU I I<br />
Le dépistage et les signes de l’autisme<br />
Roselyne Tordjman - Sous directrice du secteur médico social - DPASS Sud<br />
La définition de l’autisme a<br />
beaucoup changé depuis sa<br />
description par en 1943 par Kanner.<br />
L’autisme est actuellement classé<br />
parmi les Troubles Envahissants du<br />
Développement (TED). Dans la CIM-<br />
10, les TED sont classés dans les<br />
troubles du développement psychologique.<br />
C’est un groupe caractérisé<br />
par des altérations qualitatives<br />
des interactions sociales réciproques<br />
et des modalités de communication,<br />
ainsi que par un répertoire d’intérêts<br />
et d’activités restreint, stéréotypé<br />
et répétitif. Ces anomalies qualitatives<br />
constituent une caractéristique<br />
envahissante du fonctionnement<br />
du sujet, en toute situation.<br />
Parmi les huit catégories de<br />
TED Identifiés dans la CIM-10<br />
l’autisme représente une catégorie<br />
particulière caractérisée par un<br />
développement anormal ou altéré,<br />
manifeste avant l’âge de 3 ans<br />
associé avec 3 types de perturbations<br />
:<br />
- des troubles des interactions<br />
sociales,<br />
- des troubles de la communication<br />
verbale et non verbale,<br />
- des comportements stéréotypés<br />
et répétitifs.<br />
Par ailleurs le trouble s’accompagne<br />
souvent d’autres manifestations<br />
non spécifiques telles que<br />
phobies, des perturbations du<br />
sommeil et de l’alimentation, des<br />
crises de colères et des gestes<br />
auto-agressifs.<br />
Les données de l’INSERM<br />
(étude de 2002) donnent une prévalence<br />
en population générale de<br />
9/10 000 habitants avec un ratio de<br />
4 garçon pour 1 filles.<br />
troubles ne sont souvent pris en<br />
compte qu’après 6 ans, âge de<br />
la scolarité obligatoire et de<br />
l’entrée dans les apprentissages<br />
scolaires.<br />
L’importance du<br />
diagnostic précoce<br />
Le repérage et le diagnostic<br />
précoces de l’autisme constitue<br />
une condition déterminante pour<br />
un pronostic de développement<br />
optimum en raison d’une<br />
possible mise en œuvre, dès<br />
le plus jeune âge, d’une prise<br />
en charge appropriée.<br />
Les professionnels de santé<br />
ont donc un rôle prépondérant<br />
dans ce repérage des premiers<br />
troubles du développement de<br />
l’enfant.<br />
A ce jour on constate qu’avant<br />
la prise en compte sérieuse des<br />
signes d’alerte nécessitant un suivi<br />
rapproché, les familles doivent<br />
souvent faire face à un parcours<br />
d’errance long et douloureux.<br />
L’incompréhension de l’entourage<br />
et des différents professionnels<br />
face au comportement d’un enfant<br />
développant des troubles à caractère<br />
autistique, et parfois leur<br />
méconnaissance de cette pathologie<br />
spécifique, imposent à la<br />
famille et à l’enfant d’être<br />
confrontés à des situations et<br />
des pratiques professionnelles<br />
non adaptées et qui bien souvent<br />
perturbent voire aggravent leur<br />
mal être respectif.<br />
Recherche des<br />
signaux d’alerte<br />
Le praticien doit rechercher<br />
ces signes sur la base de l’interrogatoire<br />
des parents et d’un<br />
examen de l’enfant permettant<br />
de l’observer et de le solliciter sur un<br />
temps suffisant dans l’interaction<br />
avec son environnement.<br />
Voir tableau page suivante<br />
« signaux d’alerte pouvant faire<br />
penser à l’autisme ».<br />
Écoutez les parents<br />
Les parents sont souvent les<br />
premiers à se rendre compte que<br />
leur enfant présente des comportements<br />
inhabituels.<br />
Lors d’une consultation, certains<br />
enfants atteints d’autisme ne<br />
manifestent aucun symptôme<br />
décelable immédiatement. Pourtant,<br />
les parents peuvent rapporter<br />
des éléments troublants dans le<br />
développement et le comportement<br />
de leur enfant et faire part de<br />
leurs inquiétudes.<br />
Il est indispensable de prendre<br />
en compte les observations ou<br />
les questionnements des parents<br />
qui peuvent être des signes spécifiques<br />
et prédictifs de l’autisme.<br />
Vous repérez des signaux<br />
d’alerte pouvant faire<br />
penser à l’autisme<br />
Il est recommandé de ne pas<br />
annoncer un diagnostic avant les<br />
résultats de l’évaluation pluridisciplinaire<br />
de spécialistes.<br />
Il est conseillé en cas de doute<br />
de revoir l’enfant après un test<br />
d’audition et de vision afin de<br />
vérifier si les troubles de la communication<br />
ne proviennent pas de<br />
déficience auditive ou visuelle.<br />
Si le doute est persistant<br />
après cet examen, l’enfant devra<br />
être orienté vers une équipe<br />
spécialisée dans le diagnostic<br />
des troubles du développement.<br />
Vers qui l’orienter?<br />
Vers le Centre médico psychologique<br />
du CHS (situé 48 bis rue<br />
Roger Gervolino à Magenta -<br />
Tel : 25 24 55) compétent en<br />
matière de prise en charge pédopsychiatrique<br />
et disposant d’une<br />
équipe spécialisée permettant<br />
l’accueil et l’information des<br />
familles ainsi que le diagnostic des<br />
troubles du comportement et du<br />
développement de l’enfant.
SIGNES D’ALERTE POUVANT FAIRE PENSER A L’AUTISME<br />
Avertissement : pris individuellement, chacun de ces signes n’est pas caractéristiques de l’autisme. C’est la concordance et la persistance de plusieurs symptômes dans<br />
chacune des 4 catégories suivantes qui doit vous alerter.<br />
Autres manifestations<br />
Comportements stéréotypés<br />
et répétitifs<br />
Troubles de la communication<br />
verbale et non verbale<br />
Troubles des<br />
interactions sociales<br />
- anomalies ou retards moteurs, troubles<br />
de la motricité, anomalie du tonus,<br />
défaut d’ajustement : bébé raide, bébé<br />
mou<br />
- hypo ou hypertonie<br />
- troubles du sommeil,<br />
sommeil très insuffisant<br />
- pleurs très fréquents<br />
sans raison apparente<br />
- apathie<br />
- impression d’anomalie<br />
(bébé trop calme ou trop excité)<br />
- absence de babillage<br />
- peu de vocalisation<br />
- absence ou rareté du sourire social<br />
(3 mois)<br />
- impression d’indifférence<br />
- anomalies du regard (fugacité, regard<br />
vague…)<br />
- pas de suivi visuel<br />
- absence de geste d’anticipation<br />
(ne tend pas les bras quand on vient le<br />
chercher vers 6 mois)<br />
De 0 à 6 mois<br />
EE XX EE RR CC EE R R AA UU JJ OO UU RR D D ’ ’ HH UU I I<br />
- troubles de l’alimentation (difficultés<br />
à passer à l’alimentation solide…)<br />
- troubles digestifs possibles<br />
- retard moteur<br />
- sensibilité exacerbée aux modifications<br />
de l’environnement<br />
- réaction paradoxale au bruit<br />
- absence de geste d’anticipation<br />
- pas d’imitation dans la<br />
communication gestuelle (faire<br />
« coucou », « bravo »….)<br />
- désintérêt pour les personnes<br />
- ne répond pas à son prénom<br />
- intolérance au contact physique<br />
- impression d’indifférence au contact<br />
extérieur<br />
- peu de réaction à la séparation<br />
- absence de réactions joyeuses<br />
- absence ou faible attention conjointe<br />
- attention difficile à fixer, regard difficile<br />
à capter<br />
- pas de présentation d’objet<br />
De 6 à 12 mois<br />
- manipulation étrange des objets<br />
(faire tournoyer, les aligner, les flairer)<br />
- mouvements inhabituels du corps<br />
(balancements, battement rapides<br />
des mains en ailes de paillons)<br />
- absence ou retard de langage<br />
- difficultés de communication réceptive<br />
comme expressive<br />
- impassibilité face aux tentatives de<br />
communication<br />
- absence d’imitation<br />
- langage limité, sans tentative de<br />
communiquer par la mimique<br />
ou le geste<br />
- ne pointe pas du doigt<br />
- semble ignorer les autres<br />
- semble préférer l’isolement, la solitude<br />
- anomalie du jeu : absence du faire<br />
semblant ou d’imitation sociale<br />
(dinette, petite voiture…)<br />
De 12 à 24 mois<br />
- troubles des apprentissages<br />
- déficience intellectuelle<br />
- hétéro ou auto agressivité<br />
(automutilation)<br />
- instabilité émotionnelle : éclats de rires,<br />
crises de larmes…<br />
- absence du sens du danger<br />
- insensibilité ou hypersensibilité à la douleur<br />
- préoccupations persistantes pour<br />
certaines parties d’objet<br />
- attachements inhabituels à des objets<br />
- insistance à poursuivre<br />
les actes routiniers<br />
- inconsolable face au changement<br />
- l’enfant utilise la main de l’autre<br />
pour saisir un objet<br />
- langage dont l’objet n’est pas de<br />
communiquer ou d’échanger<br />
- tendance à répéter (écholalie)<br />
- façon inhabituelle de parler<br />
(arythmie, cris…)<br />
- inversion pronominale<br />
(« tu à la place de « je)<br />
- absence d’intérêt pour les autres enfants<br />
- absence ou pauvreté des jeux<br />
Après 24 mois<br />
Novembre 2010- N° 56 27
L’EMDR, une nouvelle thérapie, effet de mode ou réelle<br />
révolution pour le traitement des traumatismes ?<br />
Ghylaine Manet<br />
Origine du sigle : EMDR<br />
L’intuition de Francine Shapiro<br />
28<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
LLL AAA VV V II I EE<br />
E DD D EE E SS<br />
S AA A SS S SS S OO O CC C II I AA A TT T II I OO O NN N SS<br />
S<br />
« L’EMDR a changé mon comportement, ma capacité à résoudre mes problèmes. Cette<br />
thérapie m’a donné confiance en moi. Aujourd’hui, j’ai digéré des événements qui<br />
m’empêchaient de vivre ». « Incroyable, impensable » disent les incrédules et pourtant<br />
les études scientifiques nombreuses attestent que l’EMDR réussit avec des sujets traumatisés<br />
là où la psychanalyse et les thérapies cognitives ont mal fonctionné.<br />
Plus de 60 000 thérapeutes formés dans le monde, principalement dans le monde anglosaxon,<br />
et deux millions de personnes ont été traités par l’EMDR avec succès.<br />
« Eye Movement Desensitization and<br />
Reprocessing », ce qui se traduit par Désensibilisation<br />
et retraitement (de l’information) par<br />
les mouvements oculaires.<br />
L’EMDR est reconnue depuis 2004 par<br />
l'INSERM et l’APA (Association Psychological<br />
American).<br />
Actuellement, la littérature scientifique<br />
concernant cette nouvelle approche thérapeutique<br />
est l’une des plus riches de tout le<br />
paysage des psychothérapies. Dès 1989, la<br />
méthode se répand dans tous les pays du<br />
monde et particulièrement grâce à l’œuvre<br />
humanitaire bénévole de l’HAP qui vient en<br />
aide aux populations victimes des catastrophes<br />
naturelles.<br />
L’EMDR a été mis au point depuis 1987<br />
par Francine Shapiro, Docteur en psychologie<br />
clinique et chercheur associé au Mental<br />
Research INSTITUTE de PALO ALTO<br />
(Californie). En 2002, elle reçut le prix Sigmund<br />
Freud. Elle nous restitue le cheminement de<br />
sa découverte dans son livre “ Des yeux pour<br />
guérir “. En 1979, on lui annonce qu’elle a un<br />
cancer. Et à partir de ce moment-là, elle subit la<br />
chirurgie et les rayons mais voulut en savoir<br />
plus sur les causes de sa maladie. Elle s'intéressa<br />
aux manifestations du stress et étudia<br />
le rapport du stress et de la psychopathologie,<br />
la relation intime du corps et de l’esprit qui<br />
sera le socle sur lequel sera bâtie la thérapie<br />
EMDR.<br />
Puis ce fut l’intuition de Francine Shapiro.<br />
“ L’idée de l’EMDR a germé un après-midi<br />
ensoleillé de 1987. J’avais pris un moment<br />
pour faire le tour d’un petit lac. C’était le<br />
printemps….pendant que je marchais, une<br />
chose bizarre s’est produite. J’avais pensé à<br />
quelque chose de perturbant…simplement<br />
une de ces petites pensées négatives obsédantes<br />
qu’on remâche (sans arriver à les<br />
digérer) jusqu’à ce qu’on les chasse exprès.<br />
La chose bizarre, c’est que mon idée obsédante<br />
avait disparu. Toute seule. Quand je l’ai<br />
Le docteur Francine Chapiro au 1er congrès<br />
d’Asie - Bali du 9 au 11 juillet 2010<br />
ramenée à ma conscience, je me suis rendu<br />
compte que sa charge émotionnelle négative<br />
n’était plus là.” Elle développa son intuition,<br />
modifia par essais et erreurs ses protocoles<br />
en multipliant les expériences sur une centaine<br />
de sujets. Et elle ajoute : “ j'étais mon propre<br />
laboratoire pour mes recherches sur les liens et<br />
ce changement émotionnel suscita chez moi un<br />
intérêt considérable “.<br />
Elle termina son doctorat en psychologie<br />
clinique en 1988. Sa thèse porte le titre :<br />
“ Désensibilisation du traumatisme par les<br />
mouvements oculaires ”. On peut dire que<br />
l’EMDR est à la jonction de plusieurs thérapies.<br />
Certes, on trouve l’utilisation des mouvements<br />
oculaires dans d’autres civilisations anciennes,<br />
ce n'est pas Francine Shapiro qui les a<br />
découvert, tout le monde s'accorde là-dessus ;<br />
c’est l’utilisation des protocoles qui en fait<br />
une thérapie de grande efficacité. Il y a<br />
longtemps que le concept de globalité de<br />
l'être a affleuré dans beaucoup de thérapies :<br />
l’hypnose ericksonienne, la PNL, la technique<br />
Le docteur Francine Chapiro avec G Manet, lors de<br />
la cérémonie de clôture du congrès<br />
de C. Simonton de Los Angeles, dans son<br />
centre de cancérologie, toutes les relaxations.<br />
Nous avons assisté au 1 er congrès d’Asie<br />
qui eut lieu du 9 au 11 juillet à Bali et qui a<br />
rassemblé 300 personnes. Ils sont venus de<br />
Thaïlande, d’Indonésie, de l’Inde, de l’Australie,<br />
de la Chine, des Philippines, de la Nouvelle<br />
Zélande, médecins, psychothérapeutes, psychologues<br />
cliniciens, tous formés ou en formation.<br />
Et Francine Shapiro a subjugué les<br />
congressistes d’Asie. Elle impose par sa<br />
prestance. On sent en elle une grande force<br />
de caractère, une puissante détermination,<br />
une chaleur humaine étonnante. C’est une<br />
passionnée de la recherche. Pendant une<br />
heure et demie, sans discontinuer, d’une<br />
voix ferme, debout et droite derrière son<br />
pupitre, elle a livré un message percutant et<br />
dense, plein d’espoir pour les nouvelles<br />
générations.<br />
” Si nous voulons diminuer la souffrance<br />
humaine, commençons par soigner les enfants<br />
de tous les traumatismes qu’ils ont subis afin
qu’ils retrouvent la joie de vivre et la capacité<br />
de construire leur vie dans la joie et en bonne<br />
santé ”. Les parents ne sont pas oubliés naturellement<br />
mais l’accent est donné à la jeunesse<br />
pour changer le monde. C’est un message<br />
d’une portée humaniste qui traduit bien les<br />
enjeux du XXI ème siècle.<br />
Le développement en FRANCE :<br />
EMDR-FRANCE<br />
En 20 ans, cette thérapie a bien évolué.<br />
Régulièrement, les protocoles sont remaniés.<br />
On insiste beaucoup aujourd’hui sur la nécessité<br />
d’associer les approches thérapeutiques<br />
connues du thérapeute au protocole de<br />
l’EMDR : par exemple le lieu sûr où le<br />
consultant se sent en sécurité et en<br />
confiance peut être travaillé en sophrologie,<br />
en hypnose ericksonienne et en EMDR ;<br />
l’expérience du thérapeute et sa capacité à établir<br />
une relation thérapeutique, stable, “ secure ” favorisera<br />
le retraitement de l’information du sujet<br />
qui a subi un traumatisme ; il en est de<br />
même pour la “ fenêtre de tolérance ” que<br />
chaque thérapeute doit être capable d’évaluer<br />
avant de commencer un traitement. C’est<br />
pourquoi l’EMDR ne doit pas être galvaudé<br />
et utilisé par des personnes non formées et<br />
non fiables.<br />
En France, c’est David Servan-Schreiber qui<br />
a fait découvrir cette méthode au grand public<br />
grâce à son livre “ Guérir sans psychanalyse et<br />
sans médicaments ”. Depuis plus de 15 ans<br />
une équipe forme les professionnels de la<br />
santé qui étendent les applications dans tous<br />
les domaines. De nombreux psychologues<br />
cliniciens, médecins se sont formés, se<br />
forment à l’EMDR et supervisent les futurs<br />
praticiens. Le docteur Patrick ZILLHARDT<br />
(psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute<br />
Gestalt-thérapie, praticien consultant au CHU<br />
de Bichat-Claude Bernard, et depuis 1986,<br />
spécialiste des centres de lutte contre le<br />
cancer, membre de la commission de<br />
déontologie de l’EMDR-France, médecin<br />
légiste et chargé de cours à l’Université de<br />
Paris V et de Metz) fait à Paris des formations<br />
spéciales pour la pratique de l’EMDR dans<br />
les troubles du comportement alimentaire<br />
et des troubles psychosomatiques.<br />
Le président de l’EMDR-France Michel<br />
Sylvestre (psychologue clinicien, thérapeute<br />
systémique, responsable de la commission<br />
EMDR-enfants de l'association France et<br />
Président de l’association EMDR-France)<br />
publie régulièrement des articles concernant<br />
les traitements des enfants, des adolescents,<br />
et des familles. Martine Iracane-Blanco<br />
(psychologue clinicienne, spécialisée en criminovictimologie)<br />
est très impliquée bénévolement<br />
dans les formations pour les pays en voie de<br />
développement à l’HAP ” Humanitarian<br />
Assistance Program ” dont elle est secrétaire.<br />
Elle est devenue formatrice avec Ludwig Cornil,<br />
psychologue clinicien qui assure depuis plus<br />
de 10 ans les formations à Paris avec David<br />
Servan-Schreiber.<br />
LLL AAA VV V II I EE<br />
E DD D EE E SS<br />
S AA A SS S SS S OO O CC C II I AA A TT T II I OO O NN N SS<br />
S<br />
L'EMDR et ses indications<br />
La première indication : l’ESPT<br />
L’ESPT, appelé traumatisme grand T : Etat<br />
de stress post-traumatique, servit de base à<br />
l'étude comparative des effets des thérapies<br />
utilisées généralement.<br />
Les praticiens de l’EMDR ont commencé par<br />
le traitement des ESPT des vétérans du<br />
Vietnam. Puis, ils sont intervenus pour les<br />
victimes des attentats, aux USA et ailleurs,<br />
dans les catastrophes et tous les traumatismes<br />
de la vie : les deuils, les ruptures, le harcèlement<br />
moral, les violences conjugales, les<br />
agressions sexuelles, les troubles psychosomatiques,<br />
les troubles du comportement alimentaire,<br />
voire même les troubles de la<br />
personnalité, tous les traumatismes complexes<br />
et la douleur chronique.<br />
Le mécanisme en jeu<br />
Nous sommes spectateurs du phénomène<br />
que la nature nous enseigne depuis notre<br />
naissance c'est-à-dire le phénomène d’autoréparation<br />
de notre corps et de notre cerveau.<br />
Nous sommes capables de digérer des<br />
situations qui paraissent difficiles voire impossibles<br />
: un décès, l'incendie de notre maison,<br />
un accident de voiture, une rupture…<br />
Les traumatismes importants sont stockés<br />
dans la mémoire émotionnelle, implicite non<br />
déclarative, qui garde les émotions et les<br />
sensations physiques liées à l’événement.<br />
Rien à voir avec le degré d’intelligence, de<br />
raisonnement et de culture du sujet. Nous<br />
avons des facilités différentes de retraiter<br />
l’information. Nous sommes plus ou moins<br />
résilients. Grâce à l’EMDR, on peut avoir<br />
accès à ces souvenirs bloqués.<br />
Conduite d’une séance<br />
Les mouvements oculaires apaisent les<br />
émotions et favorisent de nouvelles connexions<br />
neuronales dans l’hémisphère droit et l’hémisphère<br />
gauche, et apportent des informations<br />
nouvelles au sujet et c’est ce qui lui permet de<br />
se détacher de l’événement, de prendre un<br />
recul et d’archiver l’événement tout en se<br />
débarrassant des émotions perturbatrices et<br />
des croyances négatives car l’approche EMDR<br />
se base sur ce concept : la croyance est le symptôme<br />
et non la cause du symptôme.<br />
Le sujet face à soi-même développe un<br />
dialogue intérieur et une prise de<br />
conscience assez rapidement. L’esprit comme<br />
le corps est auto-réparateur. Cerveau et corps<br />
vont ensemble et sont donc gouvernés par<br />
les mêmes lois. L’EMDR n'est pas une<br />
panacée. Il y a comme dans toutes psychothérapies<br />
un résultat complet à 70%. De quoi<br />
souffrent nos patients ? D’angoisse, de reviviscence<br />
d'histoires vécues, du ressassement,<br />
de l’impossibilité d'agir et de passer à autre<br />
chose, de fermer la porte au passé.<br />
Cette approche thérapeutique affirme la<br />
globalité de la personne, l’importance du<br />
cerveau émotionnel et du rôle de l'amygdale,<br />
attestées par l’imagerie cérébrale. Un article<br />
ultérieur présentera l’apport de la neurobiologie<br />
et des neurosciences dans l’action<br />
neurophysiologique de l’EMDR.<br />
Le certificat donné par l’EMDR nécessite<br />
une formation permanente. L’accréditation<br />
est liée à cette obligation qui est présente<br />
dans le code de déontologie de l’association<br />
EMDR–Europe.<br />
Bibliographie : l’EMDR de Jacques Roques,<br />
psychanalyste, psychothérapeute (3 ouvrages)<br />
Ghylaine Manet, psychanalyste, hypnothérapeute,<br />
sophrologue-analyste®, certifiée EMDR -Europe<br />
Après l’anamnèse, la demande reformulée, le contrat, l’établissement du lieu sûr, nous<br />
nous assurons des ressources du sujet. Nous connaissons alors la fenêtre de tolérance<br />
pour éviter une abréaction trop brutale, une décharge émotionnelle trop forte qui arrêterait le<br />
processus de retraitement de l’information. Nous pouvons alors commencer la séance<br />
proprement dite des mouvements oculaires, des stimulations bilatérales alternées. Le patient est<br />
assis confortablement, le thérapeute s’assoit face à lui, un peu décalé, pour éviter le regard sur<br />
le visage du thérapeute qui déplace deux doigts (en général l’index et le majeur) de gauche à<br />
droite et de droite à gauche devant les yeux du patient. Le patient doit suivre du regard,<br />
sans bouger la tête, les doigts du thérapeute (ou une baguette ou un crayon) qui font ainsi<br />
des mouvements latéraux pendant environ 20 secondes. Les séances se déroulent selon un<br />
protocole précis qui permet de prendre en compte l’état émotionnel du sujet, ses cognitions<br />
ou ses convictions ou pensées négatives sur lui-même et ses cognitions positives, ses<br />
ressources personnelles. Entre les stimulations bilatérales alternées, le patient donne ses<br />
réactions, il rapporte des émotions, des images, des affirmations. Au fur et à mesure du<br />
travail, des associations se font, l’état émotionnel du sujet change et s’abaisse au point de<br />
terminer la séance dans un grand soulagement, une légèreté du corps, un bien-être qui<br />
continue après la séance. Lorsqu’on atteint le souvenir source qui semble être à l’origine<br />
des traumatismes complexes, la libération mentale, émotionnelle du patient s’accélère.<br />
C’est souvent dans les traumatismes complexes des scènes vécues douloureusement dans<br />
l’enfance qui reviennent : la violence verbale, les coups, les humiliations en classe…<br />
Le thérapeute n’interprète pas le matériel donné par le sujet, il le recueille. Et surtout, il<br />
travaille avec le “ noyau sain ” du sujet. Le nombre de séances varie en fonction du patient<br />
et du traumatisme à retraiter. C’est une thérapie brève.<br />
Novembre 2010 - N° 56 29
Secrétariat Général de la<br />
Communauté du Pacifique<br />
Les agents du Ministère fidjien de la santé renforcent leur<br />
capacité de surveillance des moustiques pour lutter contre<br />
la dengue et la filariose<br />
30<br />
ACTUALITÉS<br />
ACTUALITÉS<br />
Vingt-cinq agents du Ministère fidjien<br />
de la santé, venus des quatre coins du<br />
pays, ont participé à un cours de formation<br />
de cinq jours afin de mieux maîtriser les<br />
techniques permettant de déceler et de<br />
surveiller l’activité et la densité des<br />
moustiques vecteurs et ce, en vue de<br />
lutter contre les grandes maladies à<br />
transmission vectorielle aux Îles Fidji, à<br />
savoir la dengue et la filariose.<br />
D'après des études récentes sur les<br />
infections sexuellement transmissibles<br />
(IST) dans la région, parmi les jeunes<br />
ayant une activité sexuelle, en moyenne<br />
un sur quatre souffre d'une IST, la prévalence<br />
des infections à Chlamydia chez<br />
les jeunes atteignant jusqu'à 40%, l'un<br />
des taux les plus élevés du monde*.<br />
Face à ces inquiétants résultats, un<br />
groupe de travail régional océanien sur<br />
les IST a été créé pour étudier la situation<br />
et s'appuyer sur des faits pour formuler<br />
des recommandations aux pays et les<br />
aider ainsi à réduire la prévalence des IST,<br />
notamment les infections à Chlamydia,<br />
les gonorrhées et la syphilis.<br />
Novembre 2010 - N° 56<br />
DU DU COTE COTE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong> LA LA CPS CPS<br />
Les Îles Fidji abritent plusieurs espèces<br />
de moustiques vecteurs de la dengue et<br />
de la filariose, notamment Aedes aegypti,<br />
Aedes albopictus, Aedes polynesiensis et<br />
Culex quinquefasciatus. Le renforcement<br />
de la surveillance des moustiques et une<br />
meilleure compréhension de leur dynamique<br />
dans l’environnement aideront le pays à<br />
prévenir de nouvelles flambées de dengue<br />
et à réduire l’incidence de la filariose.<br />
La dengue est une maladie inquiétante<br />
aux Îles Fidji. En 1997-1998 et en<br />
2008, le pays a été touché par des épidémies<br />
importantes qui ont fait des<br />
victimes, exercé une forte pression sur le<br />
système sanitaire national et occasionné<br />
des pertes considérables sur le plan<br />
économique. La flambée de 1998 avait<br />
touché 24 000 personnes (dont 1 600<br />
avaient dû être hospitalisées) et celle de<br />
2008 près de deux mille personnes.<br />
PACIFIQUE<br />
La filariose est également une maladie<br />
prioritaire, sa prévalence étant estimée à<br />
environ 6,3 pour cent de la population<br />
touchée par la microfilariose.<br />
La formation a été dispensée avec le<br />
soutien du Secrétariat général de la<br />
Communauté du Pacifique (CPS) et<br />
l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie<br />
et le concours financier de l’Agence<br />
française de développement (AFD).<br />
Pour de plus amples informations,<br />
veuillez contacter Christelle Lepers,<br />
Division Santé publique de la CPS<br />
- Tél. : 687 26 01 81<br />
- Courriel : christellel@spc.int).<br />
Rompre la loi du silence - lutter contre les infections<br />
sexuellement transmissibles dans le Pacifique<br />
Le groupe de travail se compose<br />
d'experts techniques de la CPS, de l'Organisation<br />
mondiale de la Santé (OMS), du<br />
Fonds des Nations Unies pour l'enfance<br />
(UNICEF), du Fonds des Nations Unies<br />
pour la population (UNFPA) et de la Société<br />
océanienne pour la santé sexuelle et la<br />
médecine du VIH (OSSHHM).<br />
Bien que les IST soient souvent<br />
asymptomatiques, si elles ne sont pas<br />
traitées, elles peuvent provoquer des<br />
fausses couches et une infertilité chez la<br />
femme, ainsi que des infections oculaires<br />
et pulmonaires chez le nouveau-né. Par<br />
ailleurs, il a été démontré que la présence<br />
d'IST favorise la transmission du VIH<br />
*Enquêtes CPS/OMS de surveillance de deuxième génération, disponibles à l'adresse suivante : http://www.spc.int/hiv/index.php?<br />
option=com_docman&task=cat_view&gid=76&Itemid=148<br />
tant chez l'homme que chez la femme.<br />
Les méthodes de dépistage et de<br />
traitement des IST actuellement employées<br />
dans la plupart des pays insulaires<br />
océaniens ne permettent pas de réduire<br />
efficacement leur prévalence, notamment<br />
celle des infections à Chlamydia. Par<br />
conséquent, le groupe de travail sur les<br />
IST a publié une directive à l'intention<br />
des responsables de santé intitulée<br />
Breaking the silence: Responding to the<br />
STI epidemic in the Pacific (rompre la loi du<br />
silence pour faire face à l'épidémie d'IST<br />
dans le Pacifique). Cette directive décrit<br />
un ensemble exhaustif d'interventions<br />
visant à renforcer la lutte contre les IST.<br />
Pour tout complément d'information sur cette trousse complète d'interventions pour lutter contre les IST, veuillez consulter le site web de la CPS (http://<br />
www.spc.int/hiv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=148&Itemid=148) ou vous adresser à Nicole Gooch (courriel : nicoleg@spc.int)
ACTUALITÉS<br />
ACTUALITÉS<br />
DU DU COTE COTE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong> LA LA CPS CPS<br />
PACIFIQUE PACIFIQUE<br />
Les territoires français se joignent au programme 2-1-22<br />
Secrétariat Général de la<br />
Communauté du Pacifique<br />
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française se sont joints aux autres pays et<br />
territoires sur le front de la bataille contre les maladies non transmissibles (MNT) dans<br />
le Pacifique. Les deux territoires français ont signé l’accord de coopération en 2010<br />
attribuant une subvention de pays dans le cadre du Programme 2-1-22 géré par le<br />
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) et l'Organisation mondiale de<br />
la Santé (OMS).<br />
Dr Bernard Rouchon, à droite, de l'Agence Sanitaire et Sociale de<br />
la Nouvelle-Calédonie (ASSNC), a signé l’accord pour la<br />
Nouvelle-Calédonie avec le Directeur général de la CPS, Dr Jimmie<br />
Rodgers, à gauche, au siège de la CPS. Également sur la photo,<br />
Dr Viliami Puloka, à gauche, chef de la section des modes de vies<br />
sains dans le Pacifique, et Karen Fukofuka, conseillère en<br />
nutrition qui a négocié la subvention.<br />
La Nouvelle-Calédonie utilisera la<br />
subvention de 150.000 AUD $ par année<br />
pendant trois ans afin d'évaluer l'ampleur<br />
et la nature des problèmes des MNT dans<br />
le territoire, de négocier avec l'industrie<br />
alimentaire une charte de bonne conduite<br />
des industries et importateurs, et d’évaluer<br />
le programme territorial sur le diabète .<br />
En remerciant la CPS, le Dr Rouchon<br />
a affirmé que ce financement était très<br />
apprécié. « Chaque dollar est le début<br />
d’une nouvelle action contre les maladies<br />
non transmissibles », dit-il.<br />
Dr Patricia Maire Tuheiava a négocié l'accord avec la CPS pour la<br />
Polynésie française.<br />
La Polynésie française investit ses<br />
fonds dans la lutte contre l'obésité et ses<br />
complications. Depuis 1999, le programme<br />
« Vie saine et poids santé » fait la promotion<br />
d'une alimentation équilibrée, d’une activité<br />
physique régulière et d’environnements<br />
plus propices à la santé. Ceci est accompli<br />
grâce à des actions de sensibilisation,<br />
des campagnes médiatiques annuelles,<br />
la création d'outils pédagogiques et d’information<br />
du public, ainsi que la formation<br />
des professionnels de la santé.<br />
De nombreuses interventions ont ciblé<br />
les enfants scolarisés et l'amélioration<br />
de la qualité nutritionnelle des aliments<br />
dans les écoles. Le programme est géré<br />
par le Bureau des maladies liées au mode<br />
de vie qui est rattaché au Département<br />
programmes de prévention de la Direction<br />
de la Santé de la Polynésie française. Il<br />
sera mis à jour en 2011 à partir des<br />
recommandations d'une évaluation de<br />
base en 2008 et essentiellement des<br />
résultats de l'enquête STEPS en cours.<br />
La subvention 2-1-22 a également pris<br />
en charge la participation de la Polynésie<br />
française au Forum des îles du Pacifique<br />
sur les maladies non transmissibles à<br />
Nadi en Juin, et de petites subventions<br />
ont financé trois initiatives axées sur la<br />
promotion d’habitudes alimentaires saines<br />
dans les écoles. Les résultats de l'enquête<br />
STEPS aideront à améliorer les stratégies<br />
d'intervention pour divers segments de<br />
la population. Toutefois, le partenariat<br />
avec le Ministère de l'Agriculture sera<br />
renforcé afin de soutenir des projets visant<br />
à promouvoir les produits locaux dans<br />
les écoles.<br />
Mme Malia Lape, à gauche, et Mme Marie Isabelle Lisiahi de<br />
l’Agence de Santé, Wallis et Futuna.<br />
Mme Katia Cateine, coordinatrice du RESIR (Réseau sur l'Insuffisance<br />
rénale) en Nouvelle-Calédonie.<br />
Wallis et Futuna utiliseront la subvention<br />
pour des actions destinées aux personnes<br />
identifiées dans une étude en 2009<br />
comme étant à risque de maladies non<br />
transmissibles. Avec l'assistance technique<br />
de la CPS et du RESIR (Réseau sur<br />
l'Insuffisance rénale en Nouvelle-<br />
Calédonie), les agents du programme<br />
MNT mettent en œuvre des plans visant<br />
à encourager la consommation d'aliments<br />
nutritifs, les jardins potagers et l'activité<br />
physique dans les écoles, les communautés<br />
et les lieux de travail. Un suivi<br />
des personnes à risque aura lieu tous<br />
les six mois.<br />
Pour de plus amples informations,<br />
contacter Richard Thomson, Division<br />
Santé Publique de la CPS (Tél. : 26 20 00<br />
– Courriel : richardt@spc.int)<br />
Secrétariat Général de la<br />
Communauté du Pacifique<br />
Novembre 2010 - N° 56 31