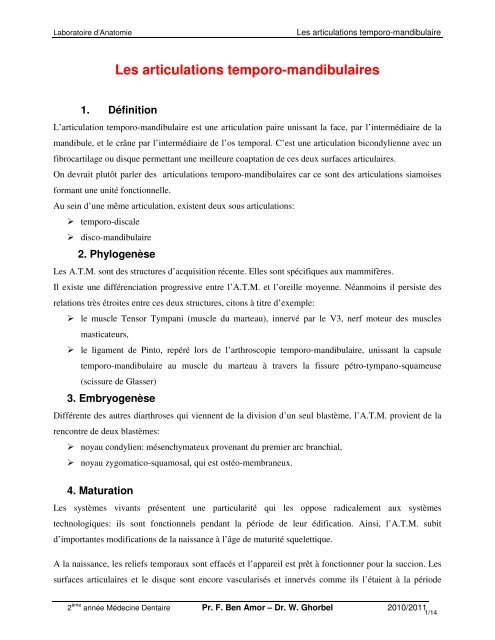Les articulations temporo-mandibulaires
Les articulations temporo-mandibulaires
Les articulations temporo-mandibulaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
<strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-<strong>mandibulaires</strong><br />
1. Définition<br />
L’articulation <strong>temporo</strong>-mandibulaire est une articulation paire unissant la face, par l’intermédiaire de la<br />
mandibule, et le crâne par l’intermédiaire de l’os temporal. C’est une articulation bicondylienne avec un<br />
fibrocartilage ou disque permettant une meilleure coaptation de ces deux surfaces articulaires.<br />
On devrait plutôt parler des <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-<strong>mandibulaires</strong> car ce sont des <strong>articulations</strong> siamoises<br />
formant une unité fonctionnelle.<br />
Au sein d’une même articulation, existent deux sous <strong>articulations</strong>:<br />
<strong>temporo</strong>-discale<br />
disco-mandibulaire<br />
2. Phylogenèse<br />
<strong>Les</strong> A.T.M. sont des structures d’acquisition récente. Elles sont spécifiques aux mammifères.<br />
Il existe une différenciation progressive entre l’A.T.M. et l’oreille moyenne. Néanmoins il persiste des<br />
relations très étroites entre ces deux structures, citons à titre d’exemple:<br />
le muscle Tensor Tympani (muscle du marteau), innervé par le V3, nerf moteur des muscles<br />
masticateurs,<br />
le ligament de Pinto, repéré lors de l’arthroscopie <strong>temporo</strong>-mandibulaire, unissant la capsule<br />
<strong>temporo</strong>-mandibulaire au muscle du marteau à travers la fissure pétro-tympano-squameuse<br />
(scissure de Glasser)<br />
3. Embryogenèse<br />
Différente des autres diarthroses qui viennent de la division d’un seul blastème, l’A.T.M. provient de la<br />
rencontre de deux blastèmes:<br />
noyau condylien: mésenchymateux provenant du premier arc branchial,<br />
noyau zygomatico-squamosal, qui est ostéo-membraneux.<br />
4. Maturation<br />
<strong>Les</strong> systèmes vivants présentent une particularité qui les oppose radicalement aux systèmes<br />
technologiques: ils sont fonctionnels pendant la période de leur édification. Ainsi, l’A.T.M. subit<br />
d’importantes modifications de la naissance à l’âge de maturité squelettique.<br />
A la naissance, les reliefs temporaux sont effacés et l’appareil est prêt à fonctionner pour la succion. <strong>Les</strong><br />
surfaces articulaires et le disque sont encore vascularisés et innervés comme ils l’étaient à la période<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
1/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
fœtale. Ces caractéristiques disparaissent lorsque les fonctions de mastication et phonation provoquent la<br />
compression du disque entre condyle et os temporal. L’organisation progressive des arcades dentaires et<br />
l’établissement de l’occlusion permettent aux A.T.M. d’assurer leur fonction.<br />
Cliniquement, les considérations sur les structures des A.T.M. doivent toujours tenir compte de l’état de<br />
développement de la denture au moment de l’examen.<br />
L’éminence articulaire est habituellement bien formée vers l’âge de 6, 7 ans, âge correspondant à<br />
l’éruption des premières molaires permanentes. <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> se trouvent alors dans des conditions<br />
proches de celles imposées par les contraintes occlusales de l’adulte.<br />
En effet, il a été mis en évidence, le rôle de l’ajustement occlusal sur la croissance condylienne.<br />
L’apparition des dents temporaires se traduit par une modification du geste mandibulaire qui passe d’un<br />
mouvement simple de translation, permettant la succion, à un mouvement hélicoïdal, assurant la<br />
mastication.<br />
Il faut noter que même après l’âge de maturation squelettique et la cessation du développement, les<br />
procédés de remodelage adaptatif, des surfaces articulaires, continuent. Ce remodelage ne serait qu’un<br />
prolongement de la croissance.<br />
La question est de savoir où s’arrête le processus adaptatif et où commence la pathologie?<br />
5. Description anatomique<br />
<strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-<strong>mandibulaires</strong> sont des <strong>articulations</strong> synoviales de type ellipsoïde. Ce sont des<br />
diarthroses à disque intermédiaire.<br />
5.1. <strong>Les</strong> surfaces articulaires<br />
Au niveau de la mandibule: le condyle mandibulaire.<br />
Au niveau du temporal: la fosse mandibulaire (cavité glénoïde) et le tubercule articulaire.<br />
Entre ces deux surfaces, existe le disque (ménisque)<br />
5.1.1. Du côté du temporal<br />
La fosse mandibulaire et le tubercule articulaire (fig. 10):Le tubercule articulaire et la racine transverse<br />
du processus zygomatique. Convexe dans le sens sagittal, il se continue en avant par le plan infra-<br />
temporal de l’écaille du temporal. C’est sur ce plan, que l’on trouve l’une des insertions de la capsule<br />
articulaire. En arrière, se trouve la fosse mandibulaire. De forme elliptique, la fosse est une cavité plus ou<br />
Figure 10: En bleu, surfaces articulaires de l’os temporal<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
2/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
moins profonde divisée en deux parties par la fissure pétro-tympano-squameuse: une antérieure articulaire<br />
squameuse, formée par l’écaille du temporal, l’autre postérieure non articulaire tympanique, se<br />
confondant avec la paroi antérieure du méat acoustique externe (C.A.E.)<br />
5.1.2. Du côté mandibulaire<br />
Le condyle mandibulaire: C’est une saillie ellipsoïde configurée en dos d’âne, avec un versant antérieur convexe et<br />
un versant postérieur vertical, tous deux séparés par une crête intermédiaire. Le versant antérieur et la crête sont<br />
tapissés de cartilage articulaire (fig. 11)<br />
Figure 11: Processus condylien de la mandibule<br />
5.1.3. Le disque :<br />
C’est une structure fibrocartilagineuse, on dit qu’elle a la forme d’une lentille biconcave. En fait, il est<br />
concavo-convexe (fig. 12) Structure avasculaire, à grand axe transversal, sépare l’articulation en deux<br />
cavités virtuelles: une <strong>temporo</strong>-discale et une disco-mandibulaire. Sa face supérieure épouse le relief du<br />
temporal et sa face inférieure se moule sur la tête condylienne (fig. 12)<br />
Figure 12: disque articulaire en forme de lentille biconcave<br />
D: Disque D<br />
C: condyle mandibulaire<br />
PL: ptérygoïdien latéral C<br />
PL<br />
Figure 12: coupe sagittale du disque<br />
divisant l’articulation en deux sous<br />
<strong>articulations</strong><br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
3/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
Le disque présente à décrire plusieurs zones (fig.13):<br />
un bourrelet postérieur très épais coiffant la tête condylienne comblant le fond de la fosse<br />
mandibulaire (fig. 11-12)<br />
une zone bilaminaire: elle prolonge en arrière le bourrelet postérieur. Elle est richement<br />
vascularisée et innervée. Ses fibres supérieures, <strong>temporo</strong>-discales, contiennent de l’élastine. Lorsque le<br />
complexe condylo-discal occupe une position haute dans la fosse mandibulaire, ces fibres présentent des<br />
replis. Ses fibres inférieures, disco-<strong>mandibulaires</strong>, contenant exclusivement du collagène, ferment<br />
postérieurement la cavité inférieure en s’insérant sur la partie basse du col.<br />
un bourrelet antérieur plus mince se prolongeant avec les fibres supérieures du muscle<br />
ptérygoïdien latéral.<br />
une zone intermédiaire amincie, entre les deux bourrelets.<br />
une lame tendineuse prédiscale: elle est formée par les attaches antérieures du disque. C’est une<br />
zone d’insertion pour le muscle ptérygoïdien latéral au niveau de la moitié médiale de son bord<br />
antérieur.<br />
a: zone bilaminaire<br />
b: bourrelet postérieur<br />
c: zone intermédiaire<br />
d: bourrelet antérieur<br />
e: lame tendineuse<br />
Figure 13: Différentes parties du disque<br />
Le disque est plus épais du côté interne que du côté externe. Latéralement, il est attaché par de puissants<br />
ligaments aux pôles du condyle mandibulaire, ce qui le rend totalement dépendant de ce condyle lors du<br />
mouvement de translation qui se produit dans le compartiment supérieur, d'où la notion du complexe<br />
condylo-discal.<br />
<strong>Les</strong> rapports du disque avec les fibres musculaires du ptérygoïdien latéral ont donné lieu à de nombreuses<br />
controverses. Il est maintenant bien établi que la majorité des fibres du chef supérieur de ce muscle ont<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
4/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
une insertion osseuse. <strong>Les</strong> plus latérales se réfléchissent sur le talon du bourrelet antérieur et les plus<br />
médiales gagnent le pôle interne du condyle.<br />
<strong>Les</strong> fibres qui pénètrent dans le disque sont peu nombreuses et situées principalement du côté médial.<br />
Cette disposition ne traduit pas le rôle traditionnel attribué au chef supérieur, qui est la traction du disque<br />
vers l’avant lors du mouvement d’ouverture mandibulaire (fig. 14)<br />
Le versant antérieur du complexe condylo-discal se différencie en deux zones:<br />
une partie externe dépourvue d’insertion musculaire. Elle supporte la majorité des contraintes,<br />
ce qui explique la fréquence des lésions discales et osseuses à ce niveau.<br />
une partie interne, soumise à l’action du ptérygoïdien latéral. Elle est plutôt destinée à<br />
contrôler le déplacement du complexe condylo-discal pendant la fonction (fig.15)<br />
Figure 14: attache du muscle ptérygoïdien<br />
latéral sur le disque<br />
5.2. <strong>Les</strong> moyens d’union<br />
<strong>Les</strong> surfaces articulaires sont réunies par un manchon capsulaire, renforcé par deux ligaments, un latéral<br />
et un médial.<br />
5.2.1. La capsule:<br />
Elle est mince, lâche, en forme de tronc de cône à petite base inférieure.<br />
Elle s’insère sur le pourtour du tubercule temporal, de la fosse mandibulaire et du condyle.<br />
En haut elle s’attache:<br />
en avant, sur le rebord articulaire du tubercule articulaire,<br />
en dedans, sur le versant latéral de l’épine du sphénoïde,<br />
en arrière sur la lèvre antérieure de la fissure pétro-tympano-squameuse<br />
en dehors, sur le bord inférieur de la racine longitudinale du processus zygomatique.<br />
En bas, elle s’attache su le col du condyle.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
5/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
Par sa face profonde, la capsule adhère au pourtour du disque articulaire, divisant le volume intra-<br />
capsulaire en deux cavités: une supérieure <strong>temporo</strong>-discale et une inférieure disco-mandibulaire.<br />
<strong>Les</strong> fibres profondes courtes se trouvent renforcées en arrière, formant les freins discaux antérieur et<br />
postérieur.<br />
5.2.2. <strong>Les</strong> ligaments:<br />
5.2.2.1. <strong>Les</strong> ligaments vrais:<br />
Ce sont des ligaments intrinsèques à l’articulation (fig. 16):<br />
le ligament latéral: puissant, épais et rectangulaire. Il descend obliquement de la racine<br />
longitudinale du zygomatique sur la partie postéro-latérale du col du condyle.<br />
le ligament médial: moins résistant que le latéral, il descend de la base de l’épine du sphénoïde<br />
pour se terminer sur la face médiale du col du condyle.<br />
Figure 16: Ligaments vrais de l’ATM.<br />
LL: ligament latéral, LM: ligament médial<br />
5.2.2.2. <strong>Les</strong> ligaments extrinsèques (fig. 17):<br />
Ce sont des ligaments à distance et sont au nombre de trois:<br />
le ligament sphéno-mandibulaire: correspond à la partie postérieure, très épaisse, du fascia<br />
interptérygoïdien. Il s’attache en haut à l’épine du sphénoïde et descend en s’élargissant pour<br />
s’insérer en bas sur le pourtour du foramen mandibulaire et en particulier sur la base de la lingula<br />
(épine de Spix)<br />
le ligament stylo-mandibulaire: Il s’étend du processus styloïde jusqu’aux bord postérieur de la<br />
branche mandibulaire (branche montante)<br />
le ligament ptérygo-mandibulaire: tendu entre le hamulus de la lame médiale du processus<br />
ptérygoïde et la crête buccinatrice, en arrière de la dernière molaire. Ce ligament mérite le nom de<br />
ligament buccinato-pharyngien car il donne insertion en arrière au constricteur supérieur du<br />
pharynx et en avant au muscle buccinateur.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
6/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
5.2.3. La synoviale<br />
Elle tapisse l’intérieur de la capsule, venant s’insérer sur le pourtour des cartilages articulaires. Elle se<br />
divise en deux parties, répondant aux deux étages de l’articulation : une partie supérieure <strong>temporo</strong>-discale<br />
et une inférieure disco-mandibulaire.<br />
5.3. Vascularisation-innervation<br />
5.3.1. Vascularisation<br />
La vascularisation artérielle des <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-<strong>mandibulaires</strong> est assurée par l’artère temporale<br />
superficielle et l’artère tympanique branche de l’artère maxillaire (fig. 17)<br />
Le sang veineux se déverse dans le confluent veineux intraparotidien résultant de la veine maxillaire, la<br />
veine temporale superficielle, la veine auriculaire postérieure, la veine occipitale et la veine rétro-<br />
mandibulaire.<br />
Le drainage lymphatique se fait par les nœuds parotidiens.<br />
5.3.2. Innervation<br />
L’innervation sensitive des A.T.M. est assurée par le nerf <strong>temporo</strong>-massétérin et le nerf auriculo-<br />
temporal. (fig. 17) Ces fibres nerveuses sont attachées à des structures réceptrices de quatre types,<br />
particulièrement présents au niveau des attaches du disque et au niveau de la zone bilaminaire.<br />
des terminaisons libres: détectent les stimulations nociceptives,<br />
récepteurs de Golgi: mécanorécepteur sensible à l’étirement des ligaments,<br />
récepteurs de Ruffini: Présentent une sensibilité angulaire. Ils renseignent sur la posture, mandibulaire<br />
récepteurs de Pacini: récepteurs phasiques, dynamiques, ils codent les vitesses et les accélérations des<br />
mouvements <strong>mandibulaires</strong>.<br />
Ces trois derniers récepteurs sont des propriocepteurs articulaires.<br />
Figure 17:Vascularisation et innervation<br />
des <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibumlaires<br />
Nerf auriculo-temporal<br />
Artère temporale superficielle<br />
Veine temporale superficielle<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
7/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
<br />
<strong>Les</strong> mouvements <strong>mandibulaires</strong> sont effectués par un système musculaire comprenant les élévateurs<br />
puissants, à insertion crânienne (temporal, masseter, et ptérygoïdien médial) et les abaisseur faibles à<br />
insertion hyoïdienne (digastrique, génio-hyoïdiens, mylo-hyoïdien, stylo-hyoïdien, sterno-thyroïdien,<br />
tyhyro-hyoïdiens, sterno-cleïdo-hyoïdiens et omo-hyoïdien) Le ptérygoïdien latéral quant à lui, participe à<br />
la fois aux mouvements de propulsion, d’abaissement et de diduction (fig. 1)<br />
Ptéryg. latéral<br />
Masséter<br />
Temporal<br />
Ptéryg.<br />
médial<br />
Abaisseurs Ptéryg. Latéral<br />
inférieur<br />
Figure 1: système musculaire manducateur<br />
1- <strong>Les</strong> muscles élévateurs (masticateurs)<br />
1.1 Temporal<br />
C'est un muscle large, aplati, rayonnant en éventail. Il s’étend de la fosse temporale, sur la face latérale du<br />
crâne au processus coronoïde de la mandibule (Fig. 2).<br />
Origine: Il naît par des fibres charnues sur toute l'étendue de la fosse temporale exceptée la gouttière<br />
rétromolaire, au-dessous de la ligne temporale inférieure et sur les deux tiers supérieurs de la face<br />
profonde de l’aponévrose temporale.<br />
Terminaison: se fait sur le processus coronoïde par un tendon terminal très puissant qui va engainer ce<br />
processus.<br />
<strong>Les</strong> insertions seront plus étendues sur la face médiale et le bord postérieur du processus coronoïde.<br />
Trajet: de leurs origines les fibres vont converger vers le processus coronoïde par trois faisceaux:<br />
<strong>Les</strong> faisceaux antérieurs: dont les fibres sont presque verticales<br />
<strong>Les</strong> faisceaux postérieurs: les libres sont presque horizontales.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
8/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
Action: Il est élévateur de la mandibule par ses fibres antérieures, rétropulseur par ses fibres postérieures.<br />
Il entraîne le mouvement de fermeture<br />
1.2. Masséter<br />
Figure 2: Muscle Temporal<br />
1: ligne temporale 7: nerf massétérique<br />
2: faisceau postérieur du temporal 8: nerf temporal profond<br />
3: faisceau moyen 9: nerf temporal antérieur<br />
4: faisceau antérieur 10: nerf ptérygoïdien latéral<br />
5: Nerf mandibulaire 11: nerf buccal<br />
6: nerf temporal profond postérieur 12: tendon du temporal<br />
C'est un muscle puissant, volumineux, rectangulaire, tendu entre: l'arcade zygomatique et la face latérale<br />
de la mandibule. Il comprend deux faisceaux (Fig. 3):<br />
Un faisceau superficiel: le plus épais, oblique. il s'insère en haut. Sur les deux tiers antérieurs du<br />
bord inférieur de l'arcade zygomatique. Ces fibres se dirigent obliquement en bas et en arrière et se<br />
terminent sur la partie inférieure de la face latérale de la branche mandibulaire et sur les tubérosités<br />
massétériques situées sur l’angle mandibulaire. A ce niveau, le masséter échange quelques fibres avec le<br />
muscle ptérygoïdien médial pour former une puissante sangle musculaire.<br />
Un faisceau profond: plus mince que le précédent qui le recouvre. Il s'insère de la face médiale de<br />
l'arcade zygomatique et de la face profonde de l'aponévrose temporale voisine. De là, les fibres vont<br />
converger vers le processus coronoïde et se terminent immédiatement au-dessous du temporal.<br />
Action: C'est un muscle élévateur de la mandibule.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
9/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
1.3. Ptérygoïdien latéral<br />
Figure 3: Masséter en vue latérale.<br />
FS: faisceau superficiel,<br />
FP: Faisceau profond<br />
C'est un muscle épais, court, en forme de cône tronqué. Il s'étend (horizontalement, du processus<br />
ptérygoïde et de la grande aile du sphénoïde au col du condyle mandibulaire. Sa direction est oblique en<br />
dehors et en arrière.<br />
Il est formé de deux faisceaux (fig. 4):<br />
Un faisceau supérieur: sphénoïdal.<br />
Un faisceau inférieur: ptérygoïdien<br />
1.3.1. Le faisceau sphénoïdal ou chef supérieur<br />
Origine: Il naît du tiers supérieur de la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde et du<br />
tubercule sphénoïdal et de la crête infra -temporale au niveau de la grande aile du sphénoïde.<br />
Trajet et terminaison: Le corps charnu se dirige horizontalement en arrière et en dehors pour se fixer sur<br />
le tiers médial du bord antérieur du disque et sur le tiers supérieur de la fossette ptérygoïdienne.<br />
1.3.2. Le faisceau ptérygoïdien ou chef inférieur:<br />
Origine: Il naît au niveau des deux tiers inférieurs de la face latérale de la lame latérale du processus<br />
ptérygoïde, sur la face externe du processus pyramidal du palatin et sur la partie adjacente de la tubérosité<br />
du maxillaire.<br />
Trajet et terminaison: <strong>Les</strong> fibres supérieures suivent un trajet analogue au faisceau précédent. '<strong>Les</strong> fibres<br />
inférieures suivent un trajet oblique. Ces fibres se terminent par de fortes fibres aponévrotiques sur les<br />
deux tiers inférieurs de la fossette ptérygoïdienne.<br />
<strong>Les</strong> faisceaux sphénoïdal et ptérygoïdien sont séparés à leurs origines par un étroit espace triangulaire à<br />
base antéro-interne. Entre ces deux faisceaux s’engage l’artère maxillaire dans sa variété profonde.<br />
Action:<br />
Faisceau supérieur:<br />
- Elévateur de la mandibule: Il se produit une contraction à la fin de la fermeture buccale constituant un<br />
frein protecteur pour le mouvement de rétropulsion;<br />
- Propulseur de la mandibulaire;<br />
- Diducteur si la contraction se fait d'un seul côté.<br />
Faisceau inférieur :<br />
- Abaisseur de la mandibule;<br />
- Propulseur de la mandibule;<br />
- Diducteur si la contraction se fait d’un seul côté.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
10/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
1.1.4. Ptérygoïdien médial<br />
C'est un muscle épais, quadrilatère, tendu de la fosse ptérygoïdienne à la face interne de l'angle<br />
mandibulaire.<br />
Il se dirige en bas, en arrière et en dehors (Fig. 4)<br />
Origine: Il naît de la face latérale de la lame médiale du processus ptérygoïde, de la face médiale de l'aile<br />
latérale de ce processus, de toute l'étendue de la fosse ptérygoïde exceptée la fosse scaphoïde ou s'insère<br />
le muscle péristaphylen externe; de la face postérieure du processus pyramidal du palatin et de la partie<br />
adjacente de la tubérosité maxillaire.<br />
Terminaison: Le muscle va se terminer sur la face interne de la mandibule. La surface d'insertion répond<br />
à l'angle mandibulaire. Ces insertions se font par des fibres charnues et aponévrotiques.<br />
Au niveau de son insertion angulaire; le ptérygoïdien médial échange des fibres avec le masséter formant<br />
une véritable sangle musculaire qui va enchâsser la mandibule.<br />
Action: Sa contraction bilatérale provoque l'élévation de la mandibule; sa contraction unilatérale<br />
provoque des mouvements de diduction.<br />
2. Muscles abaisseurs<br />
Figure 4:Ptérygoïdien latéral et ptérygoïdien médial en vue latérale<br />
FS-FP: Faisceaux sphénoïdal et ptérygoïdien du ptérygoïdien latéral<br />
FA-FP: Faisceaux antérieur et postérieur du ptérygoïdien médial<br />
2.1. Supra hyoïdiens : abaisseurs directs<br />
2.1.1 Digastrique<br />
Il est situé à la partie supérieure et latérale du cou. Il est formé de deux ventres antérieur et postérieur,<br />
réunis par un tendon intermédiaire. Il s'étend depuis le processus mastoïde jusqu'à la région mentonnière<br />
Figure 5: Muscle digastrique: ventres antérieur et postérieur<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
11/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
Origine: Le ventre postérieur va se fixer en haut et en arrière au niveau de l'incisure digastrique<br />
située à la face interne du processus mastoïde sur le versant antéro-latéral de l'éminence mastoïdienne.<br />
Trajet: L'insertion du muscle digastrique se fait par des fibres charnues et tendineuses. Le corps<br />
musculaire du ventre postérieur se dirige en bas, en avant et en dedans pour se terminer au niveau du<br />
tendon intermédiaire. Ce dernier passe au-dessus de la petite corne de l'os hyoïde entre le ligament et le<br />
muscle stylo-hyoïdien, puis se continue par un deuxième corps charnu aplati: le ventre antérieur du<br />
muscle. Ce dernier se dirige en avant et en dedans sous le mylo-hyoïdien.<br />
Terminaison: La fossette digastrique de la mandibule.<br />
Action: Il est élévateur de l'os hyoïde. Son ventre postérieur tire en arrière l'os hyoïde, et son ventre<br />
antérieur baisse la mandibule.<br />
2.1.2. Mylo-hyoïdien<br />
Pair, aplati, large, tendu transversalement de la face médiale du corps mandibulaire à l'os hyoïde et au<br />
raphé médian (<strong>Les</strong> deux muscles sont unis sur la ligne médiane par un raphé pour former le plancher oral)<br />
(Fig.6)<br />
a:muscle mylohyoïdien<br />
b: ventre antérieur du digastrique b<br />
c: ventre postérieur du digastrique a<br />
d: muscle stylo-hyoïdien<br />
e: ligament stylo-hyoïdien<br />
f: muscle hyoglosse g<br />
g: raphé h<br />
h:tendo intermédiaire<br />
du digastrique<br />
c<br />
Figure 6: muscles supra-hyoïdiens<br />
Origine: En haut, le muscle s’insère sur toute la longueur de la ligne mylo-hyoïdienne. <strong>Les</strong> fibres vont se<br />
diriger obliquement en bas et en dedans.<br />
Terminaison: <strong>Les</strong> fibres antérieures se terminent sur le raphé médian. <strong>Les</strong> fibres postérieures se terminent sur la<br />
face antérieure de l’os hyoïde tout près de son bord inférieur. Au niveau du raphé médian, les deux mylo-hyoïdiens<br />
vont échanger des fibres.<br />
Action: Abaisse la mandibule quand le point fixe est hyoïdien et élève l’os hyoïde quand le point fixe est<br />
mandibulaire.<br />
2.1.3. Génio-hyoïdien<br />
C'est un muscle court, épais, conique situé immédiatement au-dessus du mylo-hyoïdien.<br />
Il naît de l'épine mentonnière inférieure; s'élargit progressivement d'avant en arrière et un peu de haut en<br />
bas. Il se termine sur la face antérieure de l'os hyoïde.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
12/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
<strong>Les</strong> deux muscles droit et gauche sont unis sur la ligne médiane par un mince septum conjonctif.<br />
Action: Abaisse la mandibule quand l'os hyoïde est fixe et élève l'os hyoïde quand le point fixe est<br />
mandibulaire.<br />
2.2. Muscles infra-hyoidiens: abaisseurs indirects<br />
2.2.1. Sterno-hyoïdien ou Sterno-cleïdo-hyoïdien (S.C.H.)<br />
C'est un muscle long, aplati et rubané. Il prend son origine sur le bord postérieur de l'extrémité médiale de<br />
la clavicule et de la face postérieure du manubrium sternal. Son corps musculaire est légèrement oblique<br />
en haut et en dedans et se termine sur le bord inférieur de l'os hyoïde (Fig. 7)<br />
Il est abaisseur direct de l’os hyoïde et secondairement de la mandibule.<br />
1: cartilage thyroïde<br />
2: muscle sterno-hyoïdien<br />
3: muscle sterno thyoïdien<br />
4:muscle thyro-hyoïdien<br />
5:ventre supérieur de l’omo-hyoïdien<br />
6:tendon intermédiaire de l’omo-hyoïdien<br />
7: trachée<br />
8: clavicule<br />
9: Première côte<br />
2.2.2. Omo-hyoïdien<br />
Figure 7: Muscles infra-hyoïdiens<br />
Il est formé de deux ventres: supérieur et inférieur (fig.8), réunis par un tendon intermédiaire.<br />
Le ventre postérieur s'insère sur le bord supérieur de la scapula et en dedans sur l'incisure<br />
scapulaire.<br />
Il se dirige obliquement en haut, en avant et en dedans.<br />
Le tendon intermédiaire va se situer en dehors de la veine jugulaire interne<br />
Le ventre antérieur se porte en haut et en dedans le long du bord externe du sterno-cleïdo-hyoïdien<br />
pour se terminer sur le bord inférieur du corps de l'os hyoïde.<br />
2.2.3. Sterno-thyroïdien<br />
C'est un muscle mince et allongé. Il est sous-jacent au sterno-hyoïdien.(fig.9) Il se trouve dans un<br />
dédoublement de la lame prétrachiale de l'aponévrose cervicale moyenne.<br />
Il naît de la face postérieure du manubrium sternal et du premier cartilage costal. Le corps musculaire<br />
aplati se dirige légèrement oblique en haut et en dehors.<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
13/14
Laboratoire d’Anatomie <strong>Les</strong> <strong>articulations</strong> <strong>temporo</strong>-mandibulaire<br />
Le bord interne de ce muscle et le bord interne du sterno-hyoïdien limitent un losange: losange de la<br />
trachéotomie.<br />
Il se termine sur la ligne oblique qui se trouve sur le cartilage thyroïde du larynx.<br />
Action: Il abaisse le larynx et fixe l'insertion du thyrohyoïdien en stabilisant l'os hyoïde, ce dernier<br />
permet l'action des muscles supra-hyoïdiens et contribue ainsi l'abaissement de la mandibule.<br />
2.2.4. Thyro-hyoïdien<br />
C'est un muscle mince, aplati, fait suite au précèdent (fig. 9) Il prend son origine sur la ligne oblique du<br />
cartilage thyroïde. Le corps musculaire se dirige en haut et en avant de la membrane thyroïdienne, et se<br />
termine sur le tiers latéral du bord inférieur du corps de l'os hyoïde et à la moitié médiale de la grande<br />
corne.<br />
Action:<br />
-Abaisse l'os hyoïde, et secondairement la mandibule.<br />
-Il est respirateur accessoire et élévateur du larynx quand os hyoïde et mandibule sont fixés.<br />
1: muscle sterno-thyroïdien<br />
2: Muscle thyro-hyoïdien<br />
3: Glande thyroïde<br />
Figue 9: Muscles infra-hyoïdiens profonds<br />
2 ème année Médecine Dentaire Pr. F. Ben Amor – Dr. W. Ghorbel 2010/2011<br />
14/14