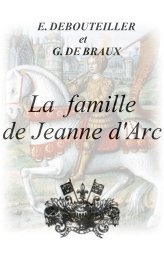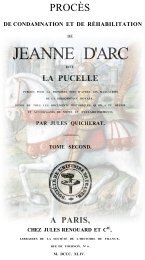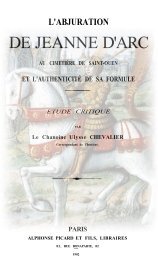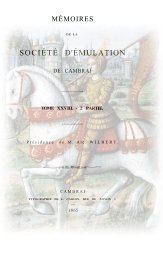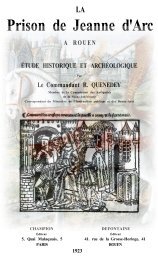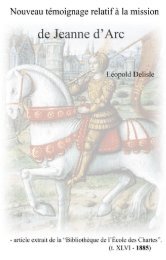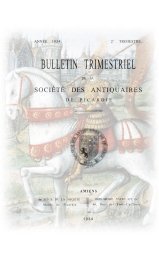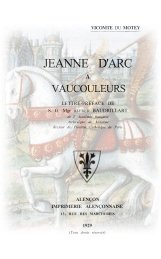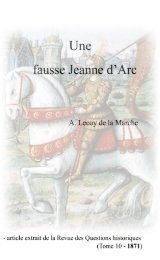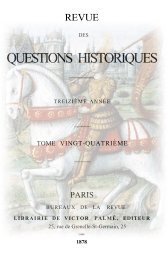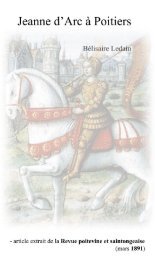Jeanne d'Arc devant Paris - Sainte Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc devant Paris - Sainte Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc devant Paris - Sainte Jeanne d'Arc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
HENRI COUGET<br />
Chanoine honoraire<br />
Curé de Saint-Roch<br />
<strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong><br />
<strong>devant</strong> <strong>Paris</strong><br />
17, RUE SOUFFLOT, PARIS (V e )
<strong>Paris</strong>, le 1 er juillet 1925.<br />
Cher Monsieur le Curé,<br />
Vous avez, comme tous les bons Français, le<br />
culte de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>. Mais, <strong>Paris</strong>ien, tout ce<br />
qui rappelle à <strong>Paris</strong> le souvenir de la <strong>Sainte</strong> vous<br />
est à cœur. Vous y cherchez ses traces, vous<br />
évoquez sa mémoire aux lieux même où elle a<br />
prié, combattu, souffert.<br />
Je vous en félicite et puisque tout cela<br />
contribue à la gloire de la sainte Pucelle, je vous<br />
en remercie.<br />
Le petit livre que vous publiez aujourd'hui<br />
rassemble vos études sur « <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> <strong>devant</strong><br />
<strong>Paris</strong> » ; il éclaire une question historique<br />
particulièrement intéressante.<br />
Mais il sera mieux qu'une contribution à<br />
l'histoire de la Pucelle ; il aidera à la construction<br />
de la basilique qui doit s'élever en l'honneur de<br />
<strong>Jeanne</strong> à Saint-Denys-de-la-Chapelle, qui garde<br />
le parfum de sa prière et la mémoire de sa<br />
vaillance.<br />
Veuillez agréer, cher Monsieur le Curé,<br />
l'assurance de mes sentiments affectueux et<br />
dévoués en N. S.<br />
† LOUIS, Card. DUBOIS,<br />
Arch. de <strong>Paris</strong>.
AU LECTEUR<br />
Les chapitres de cette brochure ne forment pas un<br />
ensemble homogène ; c'est une suite de fragments, qui<br />
n'ont entre eux d'autre lien logique que de se rapporter,<br />
plus ou moins directement, à l'entreprise de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong><br />
sur <strong>Paris</strong> et à ses suites.<br />
L'échec de la Pucelle <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> et les causes qui<br />
l'ont provoqué sont le sujet principalement étudié ;<br />
on y verra groupées diverses circonstances, interventions,<br />
considérations, plus ou moins éparses en d'autres ouvrages,<br />
mais dont l'assemblage éclaire, nous semble-t-il, l'obscurité<br />
de cet épisode militaire.<br />
Au cours de ses lectures, l'auteur a été conduit à noter<br />
certains faits assez significatifs, à relever tel ou tel détail<br />
de l'opération militaire, telle ou telle manifestation de l'état<br />
d'esptit de la population parisienne, dont le développement<br />
lui a fourni matière à plusieurs pages ; il en est résulté<br />
parfois quelques répétitions que, pour la clarté et la<br />
précision de l'exposition, on n'a pas cru devoir supprimer.<br />
Puissent les dévots de notre héroïne nationale et les<br />
amis de <strong>Paris</strong> trouver dans cette brochure le même<br />
intérêt qu'a pris l'auteur à en rassembler les éléments !<br />
H. C.
ATTAQUE DE LA PORTE SAINT-HONORÉ<br />
LE 8 SEPTEMBRE 1429,<br />
d'après une reconstitution de J. Hoffbauër
L'ECHEC DE JEANNE D'ARC<br />
DEVANT PARIS<br />
Les Sources.<br />
Rappeler les circonstances de l'attaque de <strong>Paris</strong><br />
par <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; rechercher les causes de son échec ;<br />
tel est l'objet de cette étude.<br />
Sur ces deux points les chroniques de l'époque<br />
fournissent de précieux renseignements, qui ne sont<br />
pas toujourd concordants. Les divergences, à propos<br />
de tel ou tel détail, s'expliquent parfois par le parti<br />
auquel appartient le chroniqueur ; son récit se ressent<br />
du milieu où il vit et écrit ; il en partage, plus ou<br />
moins vivement, les sentiments, les préjugés et les<br />
passions. Il importe d'en tenir compte, si l'on veut<br />
essayer de ramener à une juste valeur — ce qui est<br />
loin d'être facile — des relations qui ne pouvaient<br />
être absolument impartiales.<br />
Les documents provenant du parti français sont,<br />
en général, assez explicites sur les événements survenus<br />
depuis l'arrivée de la Pucelle à Chinon jusqu'à<br />
la levée du siège de <strong>Paris</strong> ; ils se montrent plus sobres<br />
sur les suivants (1).<br />
(1) Parmi ceux qui mentionnent le siège de <strong>Paris</strong>, il convient<br />
de citer : la Chronique dite de la Pucelle (écrite entre 1439 et<br />
1450) ; le Journal du siège d'Orléans (entre 1456 et 1466); la
4 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Au contraire ceux qui viennent du parti anglobourguignon<br />
sont ordinairement assez brefs sur la<br />
première partie de la vie guerrière de <strong>Jeanne</strong> et plus<br />
étendus sur la seconde ; les uns sont peu ou point<br />
défavorables à la Pucelle (1); d'autres se montrent<br />
ouvertement hostiles ou manifestement haineux (2).<br />
Enfin certains écrits proviennent de l'étranger et<br />
sont utiles à consulter, au moins pour connaître<br />
Chronique de Jean Chartier, historiographe officiel de Charles VII<br />
(avant 1443) ; la Chronique de Perceval de Cagny, écuyer du duc<br />
d'Alençon (entre 1436 et 1438); le Greffier de la Rochelle, la<br />
Chronique de Tournay (chroniques officielles de ces deux villes) ;<br />
l'Histoire de Charles VII par Thomas Basin, évêque de Lisieux<br />
(écrite sous Louis XI) ; la Chronique de Gilles le Bouvier, dit le<br />
Héraut Berry, premier héraut du roi de France et roi d'armes du<br />
Berry. (Elle s'étend de 1402 à 1455) ; le fragment d'une Chronique<br />
de Normandie d'un auteur inconnu (manuscrit du XV e siècle ;<br />
British Museum, n. 1542) ; le poème sur la Pucelle de Christine<br />
de Pisan (terminé écrit l'auteur, le 31 juillet 1429) ; les Vigiles de<br />
Charles VII, chronique rimée de Martial d'Auvergne, procureur<br />
au Châtelet et greffier au Parlement (écrit avant 1484).<br />
(1) La Chronique d'Enguerrand de Monstrelet, prévôt de Cambrai<br />
(elle s'étend de 1400 à 1444) ; la Chronique dite des Cordeliers du<br />
couvent de <strong>Paris</strong> jusqu'en 1433) ; la Chronique de Gilles de Roye,<br />
moine bernardin (elle s'étend de 1415 à 1431); la Chronique<br />
normande de Pierre Cochon, notaire apostolique de Rouen (elle<br />
s'arrête en 1430) ; les Notes insérées entre les actes judiciaires<br />
par Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de <strong>Paris</strong><br />
(jusqu'en 1435).<br />
(2) La Chronique de Jean Le Fèvre de Saint-Rémy, officier du<br />
duc de Bourgogne (écrite en 1464) ; le Journal d'un Bourgeois de<br />
<strong>Paris</strong>, attribué à Jean Chuffart, chanoine de Notre-Dame de<br />
<strong>Paris</strong>, chancelier du Chapitre, chancelier de l'Université de <strong>Paris</strong>,<br />
chancelier et exécuteur testamentaire de la reine Isabeau de<br />
Bavière, curé de Saint-Laurent et de <strong>Sainte</strong>-Opportune (il s'étend<br />
de 1408 à 1449); les Registres du Chapitre de Notre-Dame-de-<br />
<strong>Paris</strong>.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 5<br />
l'impression produite hors de France par l'héroïque<br />
Française (1).<br />
(1) La Chronique Morosini (lettres italiennes écrites au fur et à<br />
mesure que s'accomplissent les événements jusqu'en 1433);<br />
les Récits des événements mémorables du pape Pie II (1459-1464);<br />
la Chronique de Metz, du Doyen de Saint-Thibaud (elle s'arrête<br />
en 1445); la Chronique d'Ecosse, du moine Walter Bower (elle<br />
s'arrête en 1436).
L'opération militaire.<br />
Après le sacre à Reims, « La Pucelle avait l'intention<br />
de remettre le roi en sa seigneurie et le royaume en son<br />
obéissance — écrit dans sa Chronique Perceval de<br />
Cagny, écuyer et maître de l'hôtel du duc d'Alençon ;<br />
— pour cela, après la délivrance du comté de<br />
Champagne, elle le fit mettre en voyage afin de<br />
venir vers <strong>Paris</strong> » (1).<br />
Successivement Charles VII soumet Soissons,<br />
Château-Thierry; puis soudain se replie sur Provins,<br />
où il séjourne du 2 au 5 août ; ce n'était plus la marche<br />
sur sa capitale.<br />
Que s'était-il passé? « Quelques-uns de la compagnie<br />
du roi, — est-il écrit dans la Chronique de<br />
la Pucelle — avaient grande envie qu'il retournât<br />
vert la rivière de Loire, et le lui conseillaient fort,<br />
conseil auquel il adhéra très volontiers lui-même.<br />
Étant de leur sentiment, il conclut qu'il s'en retournerait.<br />
« le Journal du Siège d'Orléans n'est<br />
(1) La plupart des textes, que nom empruntons aux vieux<br />
documents, sont cités d'après La vraie <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, du<br />
R. P. AYROLES : cet auteur avertit qu'il les a rajeunis, pour faciliter<br />
leur lecture en modifiant leur orthographe, en substituant<br />
aux vieux mots peu compréhensibles les termes aujourd'hui<br />
usités, sans cependant, affirme-t-il, altérer le sens : « C'est avec<br />
un vrai scrupule qu'il a été procédé aux changements indiqués.<br />
Ne faire dire à l'écrivain que ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, a été<br />
l'objet d'une préoccupation constante ». (Tome III, au lecteur,<br />
P. XI).
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 7<br />
pas moins affirmatif : le roi « avait aucunes gens<br />
en sa compagnie qui tant désiraient retourner de là<br />
la rivière de la Loire que pour leur complaire il avait<br />
conclu le faire ». Quel motif grave avait fait changer<br />
la décision? Nous le verrons, quand nous constaterons<br />
les tractations qui s'opposaient aux desseins de<br />
<strong>Jeanne</strong>.<br />
« Le roi méditait de passer la Seine à Bray, — écrit<br />
le moine Gilles de Roy — lorsqu'un certain nombre<br />
d'Anglais y rentrèrent ; il revint alors sur ses pas ».<br />
Le chroniqueur bourguignon s'exprime comme la<br />
Chronique de la Pucelle qui, après avoir rapporté ce<br />
même fait, continue : « Et par là le passage fut rompu<br />
et empêché ; ce dont les ducs d'Alençon, de Bourbon<br />
et de Bar, les comtes de Vendôme et de Laval, tous<br />
les capitaines furent bien joyeux et contents ; car la<br />
résolution de se retirer allait contre leur gré et volonté ».<br />
Ainsi il y avait désaccord entre les militaires et les<br />
conseillers du roi. L'annonce de la retraite vers la<br />
Loire jeta les Rémois dans l'inquiétude. Le 3 août,<br />
le conseil de la ville de Reims décide « de rescrire<br />
à Monseigneur de Reims (1) qu'on a entendu que le<br />
roi veut délaisser son chemin sur <strong>Paris</strong> » ; le 4 août,<br />
« de rescrire à Laon et à Châlons qu'on a entendu que<br />
le roi veut prendre son chemin vers Orléans et<br />
Bourges ». Le 5 août, <strong>Jeanne</strong> adresse à ses amis de<br />
Reims une lettre, sur laquelle il nous faudra revenir,<br />
et dans laquelle elle manifeste son intention de se<br />
mettre en route vers <strong>Paris</strong> : « écrit ce vendredi,<br />
cinquième jour d'août, près d'un logis aux champs<br />
au chemin de <strong>Paris</strong> ».<br />
(1) Regnault de Chartres, archevêque de Reims, chancelier<br />
de France, l'un des plus écoutés parmi les conseillers du roi.
8 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Cependant, tandis que l'armée royale gagnait<br />
Coulommiers, les Anglais prenaient leurs dispositions<br />
pour dégager les abords de la capitale. Par lettre datée<br />
du 7 août, le duc de Bedford, régent de France pour<br />
le roi d'Angleterre, offrait la bataille à Charles VII.<br />
Passant par Château-Thierry, La Ferté-Milon, Crépyen-Valois,<br />
Lagny-le-Sec, le roi atteignait Dammartin.<br />
Bedford vint au <strong>devant</strong> de lui jusqu'à Mithry.<br />
Quelques engagements, sans combat, eurent lieu à<br />
Thieux, le 13 août. Le lendemain les deux armées se<br />
retrouvaient en présence à Montépilloy, près de<br />
Senlis ; là encore, la rencontre se borna, dans la<br />
journée du 15, à quelques escarmouches ; le 16, les<br />
Anglais rebroussaient chemin vers <strong>Paris</strong> et Charles VII,<br />
vers Crépy. Le 18, le roi faisait son entrée à Compiègne;<br />
il y séjourna « douze jours environ » au dire de Monstrelet.<br />
Tandis que le comte de Vendôme allait soumettre<br />
Senlis, que faisait à Compiègne la cour royale?<br />
La suite nous l'apprendra ; toujours est-il que <strong>Jeanne</strong>»<br />
« très marrie » de ce qui se tramait, déclara au duc<br />
d'Alençon : « Mon beau duc, faites apprêter vos gens<br />
et ceux des autres capitaines » ; et elle ajouta, continue<br />
Perceval de Cagny : « Par mon martin, je veux aller<br />
voir <strong>Paris</strong> de plus près que je ne l'ai vu ».<br />
Partie de Compiègne avec le duc d'Alençon, le<br />
mardi 23 août, la Pucelle recueillait sur son passage<br />
une partie de ceux qui avaient occupé Senlis et,<br />
trois jours après, (le 26 août, d'après Cagny ; le 25,<br />
d'après le Bourgeois de <strong>Paris</strong>) elle logeait son armée à<br />
Saint-Denis. « Le lendemain, ils couraient jusqu'aux<br />
portes de <strong>Paris</strong>. »<br />
*<br />
* *<br />
L'alarme fut grande dans la capitale. Déjà, au témoignage<br />
de Jean Chufïart, la marche triomphante du roi
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 9<br />
à travers la Champagne et vers Reims avait fortement<br />
jeté la panique. « Quand ceux des villages d'alentour<br />
<strong>Paris</strong>, — écrit-il dans son Journal, — surent que les<br />
Armagnacs conquéraient ainsi le pays, ils emportèrent<br />
leurs biens et leurs meubles, scièrent leurs blés avant<br />
qu'ils fussent mûrs et les apportèrent dans la ville<br />
de <strong>Paris</strong>. Quelque temps après, les Armagnacs<br />
entrèrent à Compiègne et gagnèrent les châtellenies<br />
d'alentour privées de toute défense. Les habitants<br />
de <strong>Paris</strong> avaient grand'peur... Sans cesser ni jour ni<br />
nuit (cela se passe à la fin de juin) ceux de <strong>Paris</strong><br />
renforcèrent le guet et firent fortifier les murs. Ils y<br />
mirent grand nombre de canons et d'autre artillerie ;<br />
ils changèrent le prévôt des marchands et les échevins —<br />
(pourquoi? Le chroniqueur ne le dit pas ; peut-être<br />
parce qu'ils étaient peu sûrs)—... Le 25 e jour d'août, —<br />
continue le Journal, — ils (les Armagnacs) prirent la<br />
cité de Saint-Denis, et le lendemain, ils couraient<br />
jusqu'aux portes de <strong>Paris</strong>. Pas un homme n'osait<br />
sortir pour cueillir un fruit à sa vigne, ou du verjus,<br />
ni aller aux marais rien ramasser. Par suite tout<br />
renchérit... La vigile de saint Laurent la porte Saint-<br />
Martin fut fermée. Il fut crié que nul ne fut<br />
si osé que d'aller à Saint-Laurent par dévotion ni<br />
pour nulle marchandise, sous peine de la corde. Aussi<br />
personne n'y vint-il... La première semaine de<br />
septembre de l'an 1429, les quarteniers, chacun en son<br />
quartier, commencèrent à fortifier <strong>Paris</strong>, aux portes<br />
par des boulevards ; aux maisons qui étaient sur les<br />
murs en y faisant disposer des canons et, sur les murs,<br />
des tonneaux pleins de pierre ; en faisant redresser<br />
des barrières au dehors et au dedans. »<br />
Le greffier du Parlement, Clément de Fauquembergue,<br />
fournit d'autres renseignements non moins
10 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
inintéressants. Le vendredi 26 août, Louis de Luxembourg,<br />
évêque de Thérouanne et chancelier de<br />
France (pour les Anglais), convoque, en la Chambre<br />
du Parlement, les présidents et conseillers des trois<br />
chambres du Parlement, les maîtres des requêtes<br />
de l'hôtel, l'évêque de <strong>Paris</strong>, le prévôt de <strong>Paris</strong>, les<br />
maîtres et clercs des comptes, les avocats et procureurs,<br />
et nombreuses autres personnalités, abbés, prieurs,<br />
chanoines, curés, etc. ; et leur fait renouveler le<br />
serment de fidélité et d'obéissance au roi d'Angleterre<br />
et de France, déjà prêté au régent, duc de Bedford,<br />
et au duc de Bourgogne, le 15 juillet précédent. Il<br />
donne pouvoir à deux délégués pour recevoir le même<br />
serment des gens d'église, séculiers et réguliers, dans<br />
les chapitres, couvents et églises de la ville. Le Parlement<br />
suspend ses séances et n'expédie plus que les<br />
affaires urgentes. De par le roi d'Angleterre et de<br />
France, on fait prendre et lever tous les dépôts ; on<br />
impose des emprunts aux églises et personnes ecclésiastiques,<br />
aux bourgeois et habitants de <strong>Paris</strong>, pour<br />
payer et entretenir les gens d'armes chargés de garder<br />
la ville et sa population.<br />
Les Registres du Chapitre de Notre-Dame-de-<strong>Paris</strong><br />
témoignent, eux aussi, de l'émoi causé par l'approche<br />
de la Pucelle et de son armée ; cela se conçoit d'autant<br />
mieux que la plupart des chanoines étaient des<br />
Français « reniés », c'est-à-dire anglo-bourguignons.<br />
Le conseil royal a demandé au Chapitre une contribution<br />
pour faire face aux dépenses de la guerre ;<br />
les trois délégués désignés, parmi lesquels le chancelier<br />
Jean Chuffart, pourront offrir 80 m. (?) et, si<br />
le Conseil n'est pas satisfait, ils pourront aller jusqu'à<br />
cent. Le 31 août, il est décrété que, vu les périls du<br />
temps, une messe sera célébrée tous les jours <strong>devant</strong>
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 11<br />
la Vierge, en dehors du chœur. Le 5 septembre,<br />
trois chanoines, dont Jean Chuffart, sont autorisés à<br />
modifier, comme ils jugeront le plus convenable,<br />
les mesures, déjà prises pour la garde du cloître et de<br />
l'église ; ils verront s'il est expédient de disposer des<br />
provisions de vivres dans les tours, pour l'entretien<br />
des chanoines qui désireront s'y retirer. Les fabriciens<br />
prendront les mesures nécessaires pour mettre les<br />
reliques et le trésor à l'abri de la malice des ennemis.<br />
On vend le buste de la statue de saint Denis, mais l'on<br />
garde le pied, qui est d'argent, la tête et le diadème..<br />
Chuffart est autorisé à mettre deux moulins en location.<br />
Le mercredi 7 septembre une procession solennelle<br />
est faite à <strong>Sainte</strong>-Geneviève, sur la montagne,<br />
pour obtenir la cessation des maux présents et de<br />
l'attaque de l'ennemi ; les chanoines de la <strong>Sainte</strong>-<br />
Chapelle y assistent et portent la relique de la vraie<br />
croix.<br />
Des bruits troublants circulaient dans la ville ;<br />
les Armagnacs, disait-on, avaient fait le serment, et<br />
s'en vantaient, de mettre à mort les personnes de l'un<br />
et l'autre sexe qui leur tomberaient sous la main.<br />
(Registres du Chapitre ; de même, Pierre Cochon).<br />
On avait dit et on disait publiquement que Charles VII<br />
avait abandonné à ses gens <strong>Paris</strong> et ses habitants,<br />
grands et petits, de tous états, hommes et femmes ;<br />
et que son intention était de faire passer la charrue<br />
sur <strong>Paris</strong> ; « ce qui n'est guère croyable, quod non<br />
erat facile credendum », — ajoute Fauquembergue,<br />
qui rapporte ces on-dit.<br />
A la fin d'août, dans la crainte que les troupes<br />
françaises ne vinssent attaquer la Normandie, le<br />
duc de Bedford partit avec son armée défendre cette
12 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
province. « Il laissa <strong>Paris</strong>, — écrit Cagny — au<br />
gouvernement des bourgeois, du sire de l'Isle-Adam,<br />
et des Bourguignons de sa compagnie, et n'y laissa<br />
guère d'Anglais. Il s'en alla a Rouen très marri et en<br />
grande crainte que la Pucelle ne remît le roi en sa<br />
seigneurie ». Trois éléments devaient ainsi concourir<br />
à la garde et à la défense de la ville : les bourgeois, les<br />
Bourguignons et les Anglais. Les autres chroniques<br />
complètent ainsi ces renseignements : « Messire Louis<br />
de Luxembourg, évêque de Thérouanne, soi-disant<br />
chancelier de France pour les Anglais ; un chevalier<br />
anglais nommé messire Jean Radlay (ou Rathelet) et<br />
un chevalier français nommé messire Simon Morhier,<br />
qui se disait alors prévôt de <strong>Paris</strong>, avaient à leur disposition<br />
environ deux mille Anglais » (Chronique de la<br />
Pucelle et Chronique de Jean Chartier). Jean Chuffart<br />
— mais nous aurons lieu de remarquer que, soit<br />
parti-pris, soit faute d'information, ses évaluations<br />
sont parfois fantaisistes — prétend que, lors de<br />
l'assaut par <strong>Jeanne</strong>, « il n'y avait presque nul homme<br />
d'armes, si ce n'est quarante ou cinquante Anglais,<br />
qui y firent bien leur devoir ». Le parti bourguignon<br />
était également représenté par des hommes d'armes ;<br />
le duc de Bourgogne avait envoyé « plusieurs notables<br />
chevaliers — écrit Monstrelet — tels que le seigneur<br />
de Créquy, le seigneur de l'Isle-Adam (maréchal de<br />
France), messire Simon de Lalaing, messire Waleran<br />
de Beauval, et d'autres notables hommes qui avaient<br />
amené quatre cents combattants ». De son côté, la<br />
Chronique des Cordeliers nous dit : « La ville de <strong>Paris</strong><br />
était gardée et défendue par le seigneur de Saveuse,<br />
messire Hue de Lannoy, les bâtards de Saint-Pol<br />
et de Thyans, et d'autres », tous bourguignons.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 13<br />
* *<br />
Quand Charles VII sut que <strong>Jeanne</strong> et le<br />
duc d'Alençon s'étaient établis à Saint-Denis, « il<br />
vint à son grand regret — remarque Cagny —<br />
en la ville de Senlis ; il semblait qu'il fût conseillé<br />
dans le sens contraire au vouloir de la Pucelle, du<br />
duc d'Alençon et de ceux de leur compagnie » ; ce qui<br />
semble une apparence au brave écuyer était bien une<br />
réalité. Le roi dut arriver à Senlis vers le 30 août,<br />
puis qu'au dire de Monstrelet, il séjourna douze jours<br />
environ à Compiègne.où il était entré le 18. Cependant,<br />
comme l'en informait un message envoyé par <strong>Jeanne</strong><br />
et le duc d'Alençon, on l'attendait à Saint-Denis<br />
pour commencer l'attaque de <strong>Paris</strong>. Ne le voyant pas<br />
venir, le duc d'Alençon alla le trouver le 1 er septembre ;<br />
il lui fut dit que le roi se mettrait en route le 2. Le<br />
duc revînt auprès de ses troupes ; l'attente se prolongeant,<br />
il retourna le 5 vers le roi et fit tant qu'il le<br />
décida à se diriger vers sa capitale. Le 7 septembre,<br />
Charles VII arrivait enfin à Saint-Denis, au milieu<br />
de la journée, à l'heure du repas. Que de tergiversations<br />
! Et comme est significatif le propos rapporté<br />
par Cagny ; de ce moment « il n'y eut personne,<br />
de quelque état qu'elle fût, qui ne dit : elle (la Pucelle)<br />
mettra le roi dans <strong>Paris</strong>, si à lui ne tient » (s'il ne<br />
l'empêche pas).<br />
<strong>Jeanne</strong> ni le duc n'avaient cependant attendu<br />
Charles VII pour prendre leurs dispositions en vue<br />
de l'assaut, et même faire quelques opérations. Les<br />
troupes avaient été réparties « en plusieurs places aux<br />
environs de <strong>Paris</strong> » (Fauquembergue) ; à Saint-<br />
Denis, dont « les plus grands bourgeois et plus<br />
notables habitants s'en étaient enfuis à <strong>Paris</strong> »
14 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
(Monstrelet) ; « à Aubervilliers, à Montmartre et<br />
autres villages près de <strong>Paris</strong> » (Monstrelet, Pierre<br />
Cochon) ; à Monceau (Martial d'Auvergne). Le<br />
duc d'Alençon avait fait jeter un pont sur la Seine,<br />
près de Saint-Denis, ce qui permettait de s'étendre<br />
à l'ouest ; on s'était emparé, entre Poissy et Saint-<br />
Germain-en-Laye, de deux châteaux ou forteresses<br />
que l'on occupait, ceux de Béthemont et de Montjoie-<br />
Saint-Denis. <strong>Paris</strong> fut mis « en telle sujétion qu'il n'y<br />
venait vivres de nul côté, et les vivres étaient si chers<br />
en la ville que c'était grand merveille « (Pierre Cochon) ;<br />
non qu'ils manquassent ; la ville « en était pourvue<br />
pour longtemps », assure Fauquembergue, et pouvait<br />
soutenir le siège.<br />
Les escarmouches avaient commencé dès le 26<br />
ou 27 août ; nous avons déjà lu dans Chuffart que<br />
« le lendemain (du jour où ils parvenaient à Saint-<br />
Denis) ils couraient jusqu'aux portes de <strong>Paris</strong> ».<br />
Cagny est plus explicite : « Depuis que la Pucelle<br />
fut arrivée à Saint-Denis, deux ou trois fois par jour,<br />
nos gens étaient à l'escarmouche aux portes de <strong>Paris</strong>,<br />
tantôt en un lieu, tantôt en un autre, parfois au moulin<br />
à vent devers (entre) la porte Saint-Denis et La<br />
Chapelle. Il ne se passait pas de jour que la Pucelle<br />
ne vint faire les escarmouches ; elle se plaisait beaucoup<br />
à considérer la situation de la ville, et par quel<br />
endroit il lui semblerait convenable de donner un<br />
assaut. Le duc d'Alençon était le plus souvent avec<br />
elle ». La Chronique de Tournay dit de même : « Elle<br />
(la Pucelle) fit avec ses gens plusieurs courses <strong>devant</strong>,<br />
les remparts et autour de la place ». Ce que confirme<br />
le moine Gilles de Roye : « Il y eut alors divers engagements<br />
entre les Anglais qui étaient à <strong>Paris</strong> et les<br />
Français campés à Saint-Denis » ; de sorte que,
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 15<br />
d'après le Journal du Siège d'Orléans, « il y eut de part<br />
et d'autres plusieurs beaux faits d'armes ».<br />
En même temps qu'on engageait ces préludes<br />
de l'attaque, on s'efforçait de semer la division parmi<br />
les assiégés et de ranimer les sentiments des partisans<br />
de Charles VII, qui, ne manquaient pas dans la ville.<br />
« Les Français, écrit l'évêque de Lisieux, Thomas<br />
Basin, avaient quelque espérance que les citadins,<br />
bien supérieurs en nombre et en force aux Anglais<br />
et aux Bourguignons, seconderaient leur tentative<br />
et leur dessein ». En effet, si nous en croyons le<br />
Journal du Siège d'Orléans, « il y avait alors dans <strong>Paris</strong><br />
plusieurs personnages qui reconnaissaient que le<br />
roi Charles, septième du nom, était leur souverain<br />
seigneur et le vrai héritier du royaume de France,<br />
que c'était à grand tort et par vengeance qu'on les<br />
avait séparés de sa seigneurie et enlevés à son obéissance,<br />
pour les mettre en la main du roi Henri d'Angleterre<br />
» ; il ajoute qu'ils étaient prêts à se mettre en<br />
son obédience et à lui faire « plénière ouverture de<br />
sa principale ville de <strong>Paris</strong>, comme ils le firent six ans<br />
après (1) ». Des promesses d'amnistie, telles qu'en<br />
faisait <strong>Jeanne</strong> aux cités qu'elle allait soumettre,<br />
furent sans doute envoyées ; c'est vraisemblablement<br />
à elles que fait allusion Chuffart : « En ce temps les<br />
Armagnacs firent écrire des lettres scellées du sceau<br />
(1) Chronique des Cordeliers, Chuffart et Fauquembergue<br />
confirment l'existence, à <strong>Paris</strong>, d'un parti dévoué au roi. Ils rappellent<br />
la conjuration ourdie six mois après, en mars 1430, pour<br />
introduire Charles VII dans sa capitale, par des notables du<br />
Parlement, du Châtelet, de la Cour des comptes, des marchands,<br />
des gens de métier, des religieux. La conspiration fut découverte ;<br />
on arrêta 150 conjurés et plusieurs furent exécutés. (Voir plus.<br />
loin » le chapitre : Un carme conspirateur).
16 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
du comte d'Alençon. Les lettres portaient : « A vous,<br />
prévôt de <strong>Paris</strong>, prévôt des marchands et échevins ».<br />
— (On remarquera que, de l'aveu de Chuffart, elles<br />
sont adressées, non aux combattants, Anglais ou<br />
Bourguignons, mais à la population parisienne.) —<br />
Ils étaient nommés par leurs noms. On leur mandait<br />
des salutations par beau langage, longuement, dans<br />
la pensée de diviser le peuple et de l'exciter contre<br />
eux ; mais on aperçut bien leur malice et on leur<br />
demanda de ne plus jeter de papier pour cela, et l'on<br />
n'en tint nul compte ». On n'y répondit, d'après<br />
Thomas Basin, que par le mépris et la dérision. Ces<br />
missives ne furent pas toutefois sans produire quelque<br />
impression, puisqu'entre les arrêts judiciaires qu'il<br />
transcrit, le greffier Fauquembergue note que<br />
« les gens d'armes de messire Charles de Valois...<br />
espéraient grever et endommager la ville et les habitants<br />
de <strong>Paris</strong> par commotion (soulèvement) du<br />
peuple plus que par puissance ou force d'armes ».<br />
Il nous dira plus loin que le jour de l'assaut, s'il n'y<br />
eut pas « commotion », il y eut du moins grande<br />
épouvante.<br />
Le mercredi 7 septembre, le roi étant à Saint-Denis,<br />
les capitaines vinrent établir leur quartier général et<br />
« se loger en un village qui est comme à mi-chemin<br />
entre <strong>Paris</strong> et Saint-Denis et qu'on nomme La Chapelle<br />
». (Chronique de la Pucelle ; de même, le Journal<br />
du siège d'Orléans et la Chronique de Jean Chartier (1).<br />
(1) Sur le séjour de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> à La Chapelle voir Revue des<br />
Deux Mondes, 15 avril 1923 ; article de CH. GAILLY DE TAURINES.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 17<br />
Auprès de <strong>Jeanne</strong> se trouvaient le duc d'Alençon, que<br />
Charles VII avait nommé, après la délivrance d'Orléans,<br />
lieutenant-général du roi avec ordre d'obéir à la<br />
Pucellc ; René, duc de Bar ; Charles de Bourbon,<br />
comte de Clermont (1) ; Louis de Bourbon, comte de<br />
Vendôme ; le comte Guy de Laval ; le maréchal<br />
Jean (le la Brosse, seigneur de <strong>Sainte</strong>-Sévère et de<br />
Boussac ; le maréchal Gilles de Rais (2) ; Etienne de<br />
Vignolles, dit La Hire ; Poton, seigneur de Xamtrailles ;<br />
Charles, sire d'Albret, frère utérin de La Trémoille ;<br />
Raoul de Gaucourt, bailli d'Orléans et grand maître<br />
de la maison du roi ; et « plusieurs autres vaillants<br />
chevaliers, capitaines et écuyers ». (Mêmes Chroniques<br />
que ci-dessus.) L'armée dont ils disposaient<br />
aurait compté « trente à quarante mille hommes, tant<br />
Français, Hennuyers (3), Liégeois comme Barrois » ;<br />
ce chiffre, fourni par un anglo-bourguignon, le notaire<br />
apostolique de Rouen, Pierre Cochon, paraît excessif.<br />
Jean Chuffart, qui avait cependant motif, pour mieux<br />
faire ressortir l'importance de leur échec, à grossir<br />
le nombre des assiégeants, dira que le jour de l'assaut,<br />
ils étaient « douze mille ou plus » ; « dix mille » écrira<br />
le moine écossais, Walter Bower (4).<br />
(1) Perceval de Cagny dit que le duc de Bar, le comte de Clermont<br />
et autres de la compagnie du roi ne vinrent à La Chapelle<br />
que le lendemain 8 septembre.<br />
(2) Doyen des Barons de Bretagne, Gilles de Rais, fut fait<br />
maréchal par Charles VII le jour de son sacre à Reims ; il avait<br />
alors vingt-cinq ans ; ses instincts de luxure, de cruauté, d'ivrognerie<br />
en firent un criminel ; il fut condamné au dernier supplice<br />
et exécuté le 26 octobre 1440, près de Nantes. La légende populaire<br />
s'empara de lui et l'identifia, à tort, paraît-il, avec le personnage<br />
de Barbe-Bleue.<br />
(3) Habitants du Hainaut : Hainuiers, Hannuyers u Hennuyers.<br />
(4) Les Ecossais étaient nombreux dans l'armée de Charles VII ;
18 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Ce même mercredi 7 septembre eut lieu une<br />
attaque assez vive. Il semble qu'il faille l'identifier<br />
avec celle entreprise près d'un moulin à vent, qui, si<br />
l'on s'en rapporte à Martial d'Auvergne, se produisit<br />
en ce jour. Déjà nous avons lu, dans l'écrit de l'écuyer<br />
du duc d'Alençon, qu'il y avait eu précédemment<br />
quelques escarmouches près de ce moulin à vent,<br />
situé « entre la porte Saint-Denis et La Chapelle » ;<br />
« touchant aux faubourgs de la ville (urbis suburbia<br />
tangens) » précise la Chronique latine de Jean Chartier.<br />
Les anciens plans dits d'Arnoulet, de Braun, de<br />
Truschet et Hoyau ou de Bâle, montrent aux faubourgs<br />
de la ville, non loin des remparts, trois moulins sur<br />
une butte, entre les portes Saint-Denis et Montmartre.<br />
Le moulin, le plus voisin de la porte Saint-Denis,<br />
paraît occuper l'emplacement de la hauteur actuelle<br />
entre le boulevard Bonne-Nouvelle et la rue de Cléry,<br />
dans les environs de l'église de Notre-Dame-de-<br />
Bonne-Nouvelle ; peut être est-ce là le moulin près<br />
duquel se fit l'attaque du 7 septembre ; c'est aux<br />
érudits à nous le dire (1).<br />
c'est par quelques-uns d'entre eux, sans doute, que Walter Bower<br />
aura été renseigné.<br />
(1) Voir plus loin le chapitre : Sur les traces de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>.<br />
Dans le cas où cette hypothèse se trouverait confirmée,<br />
nous y trouverions une indication très précieuse sur la tactique<br />
militaire de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>. L'attaque du rempart se présenterait<br />
alors exactement dans les mêmes conditions à la porte Saint-Denis<br />
qu'à la porte Saint-Honoré. Les portes de la ville étant imprenables<br />
directement, <strong>Jeanne</strong> choisirait celles qui ont une butte<br />
dans leur voisinage ; derrière la butte elle embusque un corps de<br />
réserve ; sur la butte elle place son artillerie, pour contrebattre<br />
l'artillerie ennemie et balayer le rempart, afin de faciliter l'assaut,<br />
d'escalader le mur d'enceinte aussi près que possible de la porte<br />
et, une fois dans la ville, de s'emparer de la porte et l'ouvrir à ses<br />
troupes ; cette tactique expliquerait pourquoi, ayant trouvé la
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 19<br />
Donc, écrit le Bourgeois de <strong>Paris</strong>, « la vigile de la<br />
Nativité Notre-Dame, en septembre, les Armagnacs<br />
vinrent assaillir les murs de <strong>Paris</strong>, qu'ils croyaient<br />
emporter d'assaut, mais ils y gagnèrent peu, si ce<br />
n'est de la douleur, de la honte et du malheur ; car<br />
plusieurs d'entre eux en emportèrent blessures pour<br />
toute leur vie, qui auparavant étaient entièrement<br />
sains ». Et Chuffart continue son récit, en invectivant<br />
La Pucelle : « créature en forme de femme, ce que<br />
c'était, Dieu le sait ». De leur côté, les Registres du<br />
Chapitre de Notre-Dame laissent soupçonner l'inquiétude<br />
suscitée par cette violente agression : « Le mercredi<br />
7 septembre », disent-ils, les « ennemis ont fait<br />
une attaque contre la ville » ; on a ordonné « une procession<br />
solennelle à <strong>Sainte</strong>-Geneviève sur la montagne<br />
; les chanoines du Palais y ont assisté, portant<br />
la vraie croix ; la procession s'est faite pour obtenir<br />
la cessation des maux présents et de l'attaque des<br />
ennemis ». Qu'ajoutent-ils ? Que leurs adversaires<br />
ont été repoussés? Non point; ils notent qu'ils se<br />
ont retirés d'eux-mêmes : « le soir ils ont cessé leur<br />
attaque et se sont retirés ». Il n'y a pas là l'apparence<br />
d'une défaite, mais plutôt celle d'une insuffisance de<br />
préparation dans une attaque improvisée ; d'ailleurs<br />
Chuffart est contraint d'avouer « qu'ils y gagnèrent<br />
peu » ; s'ils y gagnèrent peu, c'est donc qu'ils ne<br />
perdirent pas. La Chronique des Cordeliers, œuvre<br />
d'un anglo-bourguignon, prétend, il est vrai, que<br />
« le duc d'Alençon et la Pucelle furent repoussés et<br />
porte Saint-Denis bien gardée, <strong>Jeanne</strong> aurait alors cherché un<br />
autre endroit semblable et l'aurait rencontré près la porte Saint-<br />
Honoré, alors qu'elle venait «considérer la ville et par quel endroit<br />
il lui semblerait convenable de donner l'assaut » (Cagny).
20 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
battus, jusqu'à avoir de six à sept cents morts » ;<br />
elle est seule à le dire. Chuffart, — on vient de le lire —<br />
qui relate à sa façon l'insuccès partiel de cette affaire,<br />
ne parle que de blessés « pour toute leur vie » ; il<br />
n'eût pas manqué, sinon d'amplifier le nombre des<br />
morts, comme il le fera pour l'assaut du jour suivant,<br />
du moins de relever un chiffre de tués aussi important ;<br />
il n'en mentionne même pas un. Il y eut échec, en<br />
ce sens que la ville ne fut pas prise ; c'est manifeste ;<br />
mais, dans cette escarmouche, se proposait-on de<br />
s'emparer de la ville? Il ne le semble pas, non plus —<br />
comme on va le voir, — que ne se le proposeront les<br />
capitaines, quand <strong>Jeanne</strong> attaquera les approches de<br />
la porte Saint-Honoré. Des renseignements fournis<br />
par les chroniqueurs anglo-bourguignons, il convient<br />
de rapprocher ceux donnés par Martial d'Auvergne,<br />
qui dit de cette affaire qu'il y « eust escarmouche<br />
belle » ; à l'entendre, les Anglais, pour éviter la<br />
défaite, durent se replier dans <strong>Paris</strong> et s'y fortifier (1).<br />
C'aurait donc été partie nulle ; la nuit serait venue<br />
interrompre le combat ; et il ne faudrait peut-être<br />
voir dans cette entreprise qu'un de ces « beaux faits<br />
d'armes », signalés par le Journal du Siège d'Orléans,<br />
comme ayant été fait « de part et d'autre » <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>.<br />
L'affaire fut reprise, le lendemain, avec plus<br />
d'ampleur ; mais, —nous aurons occasion d'y insister<br />
— pas plus que celui du 7 septembre, l'assaut du 8<br />
ne fut suffisamment ni préparé, ni soutenu ; il fut<br />
(1) Le texte de Martial d'Auvergne sur le repli des Anglais<br />
est si général qu'il ne semble pas s'appliquer spécialement à<br />
l'escarmouche du moulin à vent. Toutefois, comme il suit immédiatement<br />
ce fait d'armes et précède immédiatement l'assaut de<br />
la porte Saint-Honoré, du lendemain, il subsiste un doute sur<br />
l'interprétation de ce texte.
LA PORTE SAINT-HONORÉ<br />
D'APRÈS UN PETIT MÉDAILLON TIRÉ DE SAINT-VICTOR<br />
(Bibliothèque Nationale — Cabinet des Estampes).<br />
C'est la représentation la plus nette que nous possédions. On remarquera<br />
qu'elle est très étroitement apparentée à celle du plan dit de « Tapisserie ».<br />
Comme dans ce dernier, chaque tourelle d'angle est percée de deux meurtrières.<br />
Le premier étage, servant de logement, est éclairé par quatre fenêtres ; au milieu<br />
se détache une tourelle plaie et en saillie, garnie d'un oculus.<br />
Ce qui distingue cette représentation de celle du plan de « Tapisserie »,<br />
c'eut que, d'une part, la baie d'entrée, haute et large, est précédée de quelques<br />
marches ; d'autre part, le pont-levis, dont un distingue les bras et les chaînes,<br />
est abaissé et s'ajuste au pont dormant, qui relie la porte et l'avant-porte.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 21<br />
improvisé par <strong>Jeanne</strong>, lasse des atermoiements<br />
qu'on lui imposait, et entrepris plus ou moins contre<br />
le gré des capitaines, par qui elle était « peu secondée »<br />
(Chronique de Tournay).<br />
* *<br />
<strong>Paris</strong> était ville fortifiée. L'enceinte Caroline, commencée<br />
par Etienne Marcel et achevée par Charles V,<br />
suivait, sur la rive droite, à peu près le tracé suivant :<br />
elle commençait au fleuve vers l'endroit où est<br />
aujourd'hui le pont du Carrousel, traversait les lieux<br />
occupés actuellement par la place du même nom, les<br />
rues de Rivoli et de Saint-Honoré ; s'infléchissait vers<br />
le nord-est pour couper en biais ce qui de nos jours<br />
est désigné sous les noms de place du Théâtre-Français,<br />
rue de Richelieu, jardin du Palais-Royal, rues de<br />
Valois et des Bons-Enfants, Banque de France et place<br />
des Victoires ; par la rue actuelle d'Aboukir, elle<br />
rejoignait la porte Saint-Denis ; suivait ensuite les<br />
rues modernes <strong>Sainte</strong>-Apolline et de Meslay, les boulevards<br />
du Temple, des Filles-du-Calvaire et Beaumarchais<br />
; franchissait la place de la Bastille et, s'orieninnt<br />
dans la direction du canal Saint-Martin, rejoignait<br />
la Seine.<br />
Sur une butte de terre se dressait le mur d'enceinte<br />
d'une hauteur d'environ huit mètres. Du côté de la<br />
ville il était garni d'une terrasse, d'environ 25 mètres<br />
à la base, moins large au sommet, s'abaissant en<br />
pente douce jusqu'au niveau du sol gazonné ; cette<br />
pente permettait de monter les pièces d'artillerie jusqu'au<br />
sommet de la terrasse. De distance en distance<br />
(environ de 110 à 120 mètres) s'élevaient des tours<br />
et bastides, bâtiments généralement rectangulaires et
22 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
dont le côté le plus long était parallèle au fossé ; certains<br />
d'entre eux, moins importants, prenaient l'aspect<br />
de ces maisons où, comme nous l'avons lu dans<br />
Chuffart (1), on pouvait disposer des canons ; ils<br />
étaient surmontés d'une plate-forme terrassée et crénelée<br />
; un chemin de ronde, crénelé lui aussi, les<br />
reliait entre eux. Les parapets s'appuyaient sur des<br />
consoles dentelées, dont les intervalles formaient des<br />
vides, dits machicoulis. Les échauguettes, les guérites<br />
de pierre, les tourelles en encorbellement, les moucharabis,<br />
ou balcons surplombants, permettant de<br />
faire tomber les projectiles sur les assaillants, hérissaient<br />
la muraille de leurs saillies.<br />
Les anciens plans, notamment ceux dits de Tapisserie,<br />
de Braun, de Ducerceau, donnent une image de<br />
cette enceinte et permettent de s'en faire une idée ;<br />
elle était protégée, à l'extérieur, par un large fossé,<br />
plus ou moins rempli d'eau et large de 32 mètres ; le<br />
versant du fossé, faisant face au mur, se terminait par<br />
un talus, en dos d'âne formant boulevard ; au delà<br />
se trouvait un second fossé à sec, ou arrière-fossé,<br />
ayant par endroits près de trois mètres de profondeur,<br />
et dominé, sur la campagne, par un chemin de contrescarpe.<br />
Sur la rive droite six portes s'ouvraient dans la muraille<br />
: celles de Saint-Antoine, du Temple, de Saint-<br />
Martin, de Saint-Denis, de Montmartre et de Saint-<br />
Honoré ; véritables bastilles en quelque sorte inexpugnables<br />
.<br />
La porte Saint-Honoré, à l'ouest de la ville, non<br />
loin du carrefour formé par le « grand chemin d'Argenteuil<br />
» et la « chaussée du Roule » — à l'endroit<br />
(1) Ci-dessus, p. 9.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 23<br />
actuellement occupé, sur la place du Théâtre-Français,<br />
en partie par l'immeuble portant le n° 163 de la<br />
rue Saint-Honoré, en partie par le trottoir et la chaussée<br />
bordant cet immeuble (1) — était une massive<br />
bâtisse rectangulaire de 18 m. 50 sur 8 m. 34, flanquée<br />
aux quatre angles de tourelles en encorbellement,<br />
rondes, à toit conique et munies de meurtrières.<br />
Surmontée d'un toit aigu, au milieu duquel se détachait<br />
une tourelle plate, en saillie et garnie d'un oculus<br />
(ou œil de bœuf), la porte était percée, en son milieu,<br />
d'une large baie en arc surbaissé, donnant accès sur la<br />
campagne. Au-dessus de cette ouverture, le premier<br />
étage servait de logement et était éclairé par quatre<br />
fenêtres carrées à croisillons en pierre. Pour livrer<br />
passage, un pont-levis s'abattait, au-dessus du fossé<br />
rempli d'eau, et venait s'ajuster à un pont dormant en<br />
. pierre ; ce pont était lui-même protégé par une avantporte<br />
et une herse à bascule dont, à dessein, l'axe<br />
ne correspondait pas à celui de la grande baie du<br />
bâtiment.<br />
Tel était l'aspect des lieux où <strong>Jeanne</strong> se disposait à<br />
porter son attaque.<br />
* *<br />
Quand, le 8 septembre au matin, l'armée s'ébranla<br />
vers <strong>Paris</strong>, quel but se proposait-on? Il importe de<br />
s'en rendre compte pour comprendre comment l'attaque<br />
tourna en échec. <strong>Jeanne</strong> a donné elle-même la<br />
réponse. Interrogée à Rouen, au cours de son procès,<br />
le 13 mars 1431, elle répondit : « les gentilshommes voulaient<br />
faire une escarmouche ou une vaillance d'armes ;<br />
(1) Berty et Vacquer en ont reconnu les substructions en 1866.
24 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
j'avais bien l'intention d'aller outre et de passer les<br />
fossés. »<br />
C'est clair ; les capitaines ne jugent pas opportun<br />
de donner l'assaut et d'emporter la place ; pourquoi ?<br />
Nous essaierons de le dire. Ils en restent aux préliminaires,<br />
comme les jours précédents, comme la veille ;<br />
ils vont faire une « escarmouche », quelque attaque<br />
locale, un engagement quelconque ; une « vaillance<br />
d'armes », une démonstration militaire, pour harceler<br />
l'assiégé, ne pas lui laisser de répit, le lasser, l'affaiblir<br />
et préparer ainsi l'assaut final ; si tant est que<br />
celui-ci doive avoir lieu, ce dont ils ne sont sans doute<br />
pas très persuadés, tellement le roi paraît y peu tenir.<br />
<strong>Jeanne</strong>, excédée de tous ces retards, a hâte d'y<br />
mettre un terme ; elle a « bien l'intention », si l'occasion<br />
est propice, « d'aller outre », c'est-à-dire de transformer<br />
l'escarmouche en attaque violente et décisive ;<br />
« de passer les fossés », c'est-à-dire de franchir les remparts<br />
et de pénétrer de vive force dans la ville.<br />
Les essais des jours précédents vers la porte Saint-<br />
Denis avaient démontré que, de ce côté, l'assiégé se<br />
gardait bien ; c'était bien là d'ailleurs que devait se<br />
porter l'attaque d'une armée, débouchant par « la<br />
chaussée pavée de Monseigneur Saint Denys » ;<br />
aussi était-ce sur ce point qu'était surtout établie la<br />
forte artillerie, dont les « grands canons largement<br />
atteignaient de la porte Saint-Denis jusqu'au delà<br />
de Saint-Lazare » (Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>),<br />
<strong>Jeanne</strong> qui, à plusieurs reprises, s'était plu « à considérer<br />
la situation de la ville, et par quel endroit il lui<br />
semblerait plus convenable de donner un assaut »<br />
(Cagny), entraîna les troupes vers la porte Saint-<br />
Honoré, dans le voisinage de laquelle se trouvait une<br />
butte qui servirait ses projets.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 25<br />
Le jeudi, 8 septembre, en la fête de la Nativité<br />
de Notre-Dame, sur les « huit heures du matin », dit<br />
Cagny, l'armée quitta La Chapelle « en belle<br />
ordonnance ». Elle descendît la « route pavée de Monseigneur<br />
Saint Denys », jusqu'à Saint-Lazare ; là elle<br />
fit une conversion vers l'ouest, par le « chemin tendant<br />
à Saint-Lazare », longea le flanc de la colline<br />
Montmartre jusqu'au « grand chemin d'Argenteuil »<br />
qu'elle emprunta, pour franchir sur un pont le « ruisseau<br />
de Ménilmontant » et aboutir près d'une butte,<br />
au « Marché aux pourceaux ». Sur son passage l'avaient<br />
rejointe les contingents descendus d'Aubervilliers,<br />
Montmartre, Monceau et autres lieux où ils étaient<br />
cantonnés. A toutes fins, les assiégeants traînaient<br />
avec eux leur artillerie : canons, coulevrines, etc., et<br />
un important matériel de siège : « un très grand nombre<br />
de fascines, avec lesquelles ils voulaient combler<br />
les fossés, — notent les Registres du Chapitre de<br />
Notre-Dame — six cent cinquante échelles, et bien<br />
quatre milliers de claies. Ils avaient bien trois cents<br />
chars pour porter ce bagage ; ils s'y étaient attelés et<br />
les traînaient chargés de matières inflammables, de<br />
bourrées, d'échelles et de claies ». Chuffart dit également,<br />
quoique moins explicitement, qu'ils « menaient<br />
très grand nombre de chariots, de charrettes, de<br />
chevaux tous chargés de grandes bourrées à trois liens,<br />
pour combler les fossés de <strong>Paris</strong> »,<br />
Vers la fin de la matinée, l'armée était rendue dans<br />
le voisinage du « Marché aux pourceaux ». Une butte<br />
qui prit plus tard le nom de Butte des moulins,<br />
puiscelui de Butte de Saint-Roch) dominait, ce foirail ;<br />
elle s'élevait sur un territoire que, dans l'état actuel<br />
de <strong>Paris</strong>, on peut se représenter ainsi : limitée au nord<br />
par la rue des Petits-Champs, elle s'étendait à l'est
26 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
au-delà de la rue <strong>Sainte</strong>-Anne jusqu'à la rue Villedo ;<br />
à l'ouest jusqu'au côté impair de l'avenue de l'Opéra,<br />
dans l'espace compris entre la rue Saint-Roch et la<br />
rue des Pyramides. A l'est de la butte, se tenait le<br />
« Marché aux pourceaux », sur le prolongement de la<br />
rue Thérèse, entre la rue Villedo et la rue Molière.<br />
Ayant établi leur place d'armes sur ce champ de<br />
foire, les assiégeants se trouvaient faire face au mur<br />
d'enceinte, non loin de la porte Saint-Honoré, dont la<br />
lourde bâtisse se montrait sur leur droite.<br />
On partagea l'armée en deux fractions, un corps<br />
d'attaque et un corps de réserve : « les uns pour livrer<br />
la bataille, les autres pour garder de surprise ceux qui<br />
donneraient l'assaut » (Cagny). Et, en effet, « les<br />
Français s'attendaient à ce que les Anglais vinssent par<br />
la porte Saint-Denis fondre sur eux ; c'est pourquoi<br />
les ducs d'Alençon et de Bourbon, entourés de leurs<br />
gens, s'étaient mis en embuscade derrière la butte, qui<br />
se trouvait auprès et contre le Marché aux pourceaux ;<br />
ils s'y tenaient constamment avec de grandes forces<br />
et prêts à combattre ; mais ils perdirent leur peine,<br />
car ceux de <strong>Paris</strong> n'osèrent saillir hors de la ville. »<br />
(D'après les Chroniques de la Pucelle, de Jean Chartier<br />
et le Journal du siège d'Orléans.)<br />
Sur la butte on fit « ajuster plusieurs canons et<br />
coulevrines pour tirer dans la ville. » (Chronique de la<br />
Pucelle). On en dirigea « les décharges en plusieurs<br />
lieux et souvent dans <strong>Paris</strong> ». (Journal du siège d'Orléans.)<br />
Dans la cité assiégée « on avait assigné à chacun, par<br />
capitainerie, la garde des lieux propices et convenables »<br />
(Monstrelet). « Les gens de guerre de la garnison<br />
et aussi le peuple y étaient en armes ; ils faisaient<br />
porter plusieurs étendards de diverses couleurs qu'ils
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 27<br />
faisaient tournoyer, aller et venir autour des remparts,<br />
entre autres une bannière blanche, traversée par une<br />
croix rouge (1), portée assez haut pour qu'elle fut<br />
très visible des Français tenant la campagne.» (D'après<br />
les mêmes Chroniques que ci-dessus.)<br />
De suite, l'escarmouche s'engagea. Des combattants,<br />
du côté des assiégés, gardaient, hors la ville, les<br />
approches de la porte Saint-Honoré, c'est-à-dire,<br />
les barrières et le boulevard en avant du grand fossé.<br />
Quelques seigneurs français, parmi lesquels un chevalier<br />
dauphinois, le sire de Saint-Vallier « qui, avec<br />
ses gens, fit grandement son devoir », se portèrent<br />
contre eux, franchirent l'arrière-fossé, parvinrent<br />
jusqu'au boulevard et mirent le feu aux barrières.<br />
Les Anglais furent contraints de se replier et de<br />
rentrer par la porte dans la ville. Le dos d'âne pris<br />
d'assaut, les Français restèrent maîtres de la barrière et<br />
du boulevard ; il n'y avait plus qu'un fossé qui les<br />
séparât du mur d'enceinte. (D'après les mêmes Chroniques<br />
que ci-dessus.)<br />
Alors « <strong>Jeanne</strong> la Pucelle dit qu'elle voulait donner<br />
l'assaut à <strong>Paris</strong> » (Chronique de Jean Chartier ; de même,<br />
Chronique de la Pucelle et Journal du siège d'Orléans).<br />
Ainsi trois chroniqueurs sont d'accord pour dire que<br />
<strong>Jeanne</strong> prit l'initiative de l'assaut ; elle manifestait par là<br />
qu'elle n'entendait pas s'en tenir à une simple « escarmouche<br />
», se contenter d'une « vaillance d'armes » ;<br />
mais qu'elle « avait bien l'intention d'aller outre et de<br />
passer les fossés ». — « Elle s'avança avec grande force<br />
et nombreux hommes d'armes, parmi lesquels le sire<br />
(1) La croix rouge était l'insigne des Anglais ; la croix de<br />
Saint-André, celui de la maison de Bourgogne ; la croix blanche<br />
et droite, celui des Armagnacs.
28 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
de Rais, maréchal de France, le sire de Gaucourt et,<br />
par l'ordonnance de la Pucelle, ceux que bon lui<br />
sembla », c'est-à-dire ceux qu'elle se choisit et à qui<br />
elle donna l'ordre de la suivre. (Chroniques de la<br />
Pucelle, de Jean Chartier, de Perceval de Cagny.)<br />
De l'aveu des chroniqueurs, quel que soit leur<br />
parti, mais surtout de l'aveu des anglo-bourguignons,<br />
l'assaut fut âpre, long, très dur, très cruel, très violent »<br />
« si merveilleux que ceux de dedans (<strong>Paris</strong>) furent tous<br />
tout ébahis ». (Pierre Cochon) (1). Il dura toute l'aprèsmidi<br />
et se prolongea dans la soirée, avec les péripéties<br />
qu'on va rapporter. Vers quelle heure commença-t-il<br />
et quand finit-il? C'est assez difficile à préciser,<br />
les documents n'étant pas absolument concordants ;<br />
cela tient, nous semble-t-il, à ce que certains écrivains<br />
envisagent l'ensemble de l'opération ; d'autres, seulement<br />
la pleine action de l'assaut ; à peu près tous sont<br />
d'accord, cependant, pour dire que la nuit interrompit<br />
l'attaque. Monstrelet est seul de son avis, en faisant<br />
commencer l'assaut « à dix heures environ ». Jean<br />
Chuffart, qui était sur place, est mieux informé ;<br />
mais sa partialité est évidente et ses renseignements<br />
suspects, quand ils ne sont pas confirmés par d'autres ;<br />
il écrit : « ils vinrent sur l'heure de la grand'messe,<br />
entre onze et douze heures ; » on remarquera qu'il ne<br />
parle ni de l'assaut, ni de l'escarmouche qui le précéda,<br />
mais de l'arrivée de l'armée sur le terrain ; il semble<br />
(1) « Le lendemain, les escarmouches recommencèrent plus<br />
âpres que <strong>devant</strong> » (Chronique de la Pucelle) ; — « L'assaut fut dur<br />
et long » (Cagny) ; — « très dur, âpre et cruel » (Monstrelet) ; —<br />
« si âpre et si merveilleux que ceux de dedans furent tous tout<br />
ébahis » (Pierre Cochon) ; — « très cruel », répète à deux reprises<br />
Jean Chuffart ; — « attaque très violente » (Registres du Chapitre<br />
de Notre-Dame).
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 29<br />
donc s'accorder avec Perceval de Cagny, l'écuyer du<br />
duc d'Alençon, qui note : « l'assaut dura depuis l'heure<br />
de midi jusqu'à environ l'heure du jour faillant ». Le<br />
secrétaire du chapitre de Notre-Dame ne fait commencer<br />
l'attaque que « vers une heure après midi » ;<br />
Fauquembergue dit « environ deux heures après<br />
midi » ; mais nous croyons, d après les détails que nous<br />
allons lui emprunter, qu'il a été surtout impressionné<br />
par le commencement de « commotion » qui se produisit<br />
dans <strong>Paris</strong>. On ne serait sans doute pas très loin<br />
de la vérité en plaçant entre midi et une heure le début<br />
de l'intervention personnelle de <strong>Jeanne</strong>.<br />
Son étendard en main, suivie des seigneurs et<br />
hommes d'armes mentionnés plus haut, « tous en belle<br />
ordonnance », la Pucelle se dirigea vers le mur d'enceinte.<br />
En quittant « la place aux pourceaux et les<br />
environs » (Fauquembergue), tous « se mirent à<br />
pied et descendirent au premier fossé, où ils se<br />
postèrent » (dans l'arrière-fossé, où il n'y avait point<br />
d'eau), « en face du Marché aux pourceaux » (Chronique<br />
de la Pucelle, Journal du siège d'Orléans, Chroniques<br />
de Jean Chartier, de Perceval de Cagny) ;<br />
c'est-à-dire tournant le dos à ce marché, et laissant<br />
à une soixantaine de mètres sur leur droite, la porte<br />
Saint-Honoré. « <strong>Jeanne</strong> les y laissa (dans l'arrièrefossé)<br />
et monta sur le dos d'âne (le talus formant<br />
boulevard), d'où elle descendit au second fossé<br />
(celui dont l'eau baignait le pied de la muraille) ;<br />
elle plongea sa lance en divers lieux, tâtant et sondant la<br />
profondeur de l'eau et de la vase; elle y passa un grand<br />
espace de temps » (Journal du siège d'Orléans) ; car<br />
l'eau « était bien profonde », s'accordent à dire plusieurs<br />
des chroniqueurs, français ou bourguignons.<br />
Vainement elle chercha un endroit guéable.
30 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Autour d'elle, la bataille faisait rage. « C'était merveille<br />
— observe Cagny — d'ouïr le bruit et le<br />
fracas des canons et des coulevrines que ceux du<br />
dedans jetaient à ceux du dehors, et le sifflement de<br />
toute espèce d'armes de trait, en si grande quantité<br />
qu'elles étaient comme innombrables. Et quoique la<br />
Pucelle et grand nombre de chevaliers, d'écuyers et<br />
d'autres gens de guerre fussent descendus dans les<br />
fossés, que d'autres se tinssent sur le bord et aux<br />
environs, très peu furent atteints et portés à terre<br />
de coups de pierres de canon. » Le Greffier de La<br />
Rochelle dit de même : « C'était très merveilleuse<br />
chose que le nombre de canons et de coulevrines que<br />
ceux de <strong>Paris</strong> tiraient contre nos gens » ; mais il exagère<br />
en affirmant que « jamais homme n'en fut ni<br />
blessé ni tué, du moins qu'on ait pu le savoir, si ce<br />
n'est Jean de Villeneuve, bourgeois de La Rochelle, qui<br />
fut tué d'un coup de canon » (pour celui-là, son concitoyen,<br />
il ne pouvait le nier). Le trait qu'il ajoute ne<br />
manque pas de piquant : « il advint que nos gens<br />
furent frappés desdits canons, mais sans en recevoir<br />
aucun mal ; ils ramassaient les pierres qui les avaient<br />
atteints, et les montraient à ceux qui étaient sur les<br />
murailles. » Le fragment d'une Chronique de Normandie<br />
(d'un auteur inconnu) relate également : « ceux de<br />
la place firent grande résistance, en tirant fort de<br />
canons et de grosses arbalètes qui firent peu de mal ».<br />
L'attaque des assiégeants n'était pas moins vigoureuse<br />
que la défense des assiégés. « Il n'y avait homme<br />
— écrit Pierre Cochon — qui osât s'aventurer dessus<br />
le mur à cause des traits de ceux qui assaillaient.<br />
Les dits assaillants avaient une manière d'instruments<br />
nommés couleuvres, qui jetaient des pierres et des<br />
plombées, mais ne faisaient point de noise, sinon un
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 31<br />
peu siffler ; elles jetaient aussi droit qu'une arbalète ».<br />
Cependant que l'artillerie balayait ainsi le rempart,<br />
les hommes d'armes de <strong>Jeanne</strong> se hâtaient de jeter<br />
leurs fagots, bourrées et fascines dans le fossé rempli<br />
d'eau, afin de le combler (Fauquembergue) (1).<br />
La Pucelle — c'est un anglo-bourguignon qui<br />
l'écrit dans la Chronique des Cordeliers — faisait<br />
« merveille par ses paroles, par ses pressantes invitalions,<br />
donnant cœur et hardiesse à ses gens d'aller à<br />
l'assaut. » Debout, « avec son étendard, sur le dos<br />
d'âne des fossés, la Pucelle disait à ceux de <strong>Paris</strong>,<br />
— raconte Chuffart — : Rendez-vous à nous promptement<br />
de par Jésus, car si vous ne vous rendez pas avant<br />
la nuit, nous entrerons par force, que vous le veuillez ou<br />
non. » A ce moment l'assaut était au plus fort de sa<br />
violence, « si fort que ceux de dedans avaient comme<br />
abandonné la défense du mur ; et les assaillants étaient<br />
si près du rempart qu'il ne fallait que lever les échelles<br />
dont ils étaient bien pourvus, pour qu'ils eussent été<br />
dedans » (Pierre Cochon). Il était alors environ quatre<br />
heures. Les assiégés mollissaient ; ils perdaient confiance<br />
et étaient sur le point de désespérer du salut de<br />
leur ville : c'est Jean Chuffart lui-même qui, à travers<br />
ses réticences, le laisse entendre d'une manière<br />
assez significative, quand il dit que les assiégés ne<br />
reprirent « cœur en eux-mêmes — (c'est donc qu'ils<br />
étaient découragés) — qu'un peu après quatre heures ».<br />
Et une phrase de Fauquembergue insinue, par ses<br />
(1) « Et hâtivement plusieurs d'entre eux qui étaient sur la<br />
place aux pourceaux et aux environs, non loin de la susdite porte,<br />
portant de longues bourrées et des fagots descendirent et se<br />
boutèrent ès-premiers fossés, où il n'y avait point d'eau ; et ils<br />
jetèrent lesdites bourrées et les fagots dans l'autre fossé voisin<br />
des murs, esquels il y avait grande eau » (Fauquembergue).
32 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
sous-entendus, que les combattants volontaires avaient<br />
disparu et que seuls étaient restés ceux dont c'était le<br />
devoir et le métier de garder leur poste.<br />
La panique se répandit parmi les <strong>Paris</strong>iens : « ils<br />
s'enfuyaient dans les églises pensant que la ville<br />
était prise — raconte le Greffier de La Rochelle ; —<br />
c'est ce que plusieurs religieux, et d'autres qui se<br />
trouvaient alors, à <strong>Paris</strong>, rapportèrent au roi. » Les<br />
partisans de Charles VII, voyant la tournure que<br />
prenaient les événements, crurent venu le moment<br />
d'agir. « A cette heure, relate Fauquembergue, —<br />
(est-ce celle qu'il vient de noter quelques lignes plus<br />
haut, environ deux heures après midi?) — il y eut dans<br />
<strong>Paris</strong> gens affectés ou corrompus, qui poussèrent<br />
un cri en toutes les parties de la ville, de çà et de là<br />
les ponts, criant que tout était perdu, que les ennemis<br />
étaient entrés dans <strong>Paris</strong>, et que chacun se retirât et<br />
fit diligence de se sauver. » Cette fausse nouvelle,<br />
mise sans doute en circulation dans le but d'affaiblir<br />
la résistance et de précipiter la reddition, jeta l'épouvante.<br />
Du coup, les fidèles qui assistaient au sermon —<br />
(la Nativité de la Vierge était fête chômée) — vidèrent<br />
les églises et les prédicateurs durent s'empresser<br />
eux-même de descendre de chaire ; c'est du moins ce<br />
que dit Fauquembergue : « A cette voix, à une<br />
même heure de l'approche des ennemis, tous les<br />
gens étant lors ès sermons sortirent des églises de<br />
<strong>Paris</strong>, furent très épouvantés, se retirèrent en leurs<br />
maisons et fermèrent leurs portes. » Les faux bruits,<br />
qu'on leur avait rapportés sur les intentions des assiégeants<br />
qui devaient tout massacrer, les remplissaient<br />
de terreur. Les « Armagnacs » de <strong>Paris</strong> n'allaient-ils<br />
pas relever la tête et la ville être mise à sac et au pillage?<br />
Le brave Fauquembergue ne paraît pas
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 33<br />
avoir été, lui même, très rassuré à ce moment ; c'est<br />
avec une satisfaction visible qu'il constate que ses<br />
craintes ont été vaines : « mais pour cela, il n'y eut<br />
pas d'autre commotion de fait parmi les habitants. »<br />
Après l'insuccès de <strong>Jeanne</strong>, il éprouvera même le<br />
besoin, comme tous les peureux une fois le péril<br />
passé, de manifester quelque bravade pour se rassurer<br />
encore : « Ils s'attendaient à grever <strong>Paris</strong> plus par ladite<br />
commotion que par assaut ou force d'armes ; car<br />
si pour chaque homme qu'ils avaient alors, ils en<br />
eussent eu quatre ou même plus, aussi bien armés qu'ils<br />
étaient (les assiégés), ils (les assiégeants) n'auraient<br />
jamais pris <strong>Paris</strong> ni par assaut ni siège, tant qu'il y<br />
aurait eu des vivres dans la ville, et elle en était pourvue<br />
pour longtemps. Les habitants étaient fort unis avec<br />
les hommes d'armes pour résister à l'assaut ».<br />
* *<br />
« L'assaut fut très cruel de part et d'autre, — avoue<br />
Chuffart ; — il dura bien jusques à quatre heures<br />
après dîner, sans que l'on sût qui avait l'avantage. »<br />
Bien que l'artillerie continuât à faire son œuvre,<br />
l'attaque s'était à ce moment ralentie, les fagots, dont<br />
on avait besoin pour combler le fossé, faisaient défaut ;<br />
en vain <strong>Jeanne</strong> réclamait qu'on en fît porter ; imposnible<br />
cependant, tant qu'on ne pouvait pénétrer à<br />
plain pied dans le fossé, de dresser les échelles et de<br />
« passer avec les gens de guerre jusqu'aux remparts ».<br />
Il eut fallu un plus grand nombre d'hommes pour<br />
apporter les bourrées, les jeter, et pour assurer les<br />
claies ; la Pucelle « n'avait pas assez de gens pour ce<br />
faire » (Journal du siège d'Orléans) ; et, malgré ses<br />
réclamations, on ne lui en fournissait pas. Ce n'est
34 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
pas que les fascines manquassent ; les nombreuses<br />
charrettes, laissées au Marché aux pourceaux, en<br />
étaient pleines et on n'en avait encore jeté que « quelques-unes,<br />
mais peu » (Registres du Chapitre de Notre-<br />
Dame). Les quatre mille claies, dont on était pourvu,<br />
n'étaient pas amenées à pied d'œuvre. Il eût été<br />
cependant facile de les fournir, de combler par<br />
endroits, sinon partout, le fossé, de dresser plusieurs<br />
des 650 échelles dont on s'était muni. Rien ne<br />
fut fait. Non sans raison, <strong>Jeanne</strong> « était courroucée<br />
de ce qu'elle était peu secondée » (Chronique de Tournay).<br />
Peut-être faisait-on circuler le bruit que les fossés<br />
étaient trop profonds, qu'il n'y avait rien à faire<br />
qu'à se retirer ; peut-être, dès ce moment, quelquesuns<br />
conseillaient-ils déjà à <strong>Jeanne</strong> de renoncer à son<br />
entreprise, comme ils le lui conseilleront avec plus d'insistance<br />
dans la soirée ; mais elle ne les écoutait pas.<br />
Ce temps d'arrêt permit aux assiégés de se ressaisir.<br />
« Un peu après quatre heures, — rapporte<br />
Chuffart, — ceux de <strong>Paris</strong> prirent cœur en eux-mêmes »,<br />
c'est-à-dire reprirent confiance et courage. Les combattants<br />
reçurent du renfort ; les citadins, apprenant<br />
que les assaillants étaient arrêtés par le fossé, qu'ils ne<br />
parvenaient pas à franchir, sentirent l'espoir renaître<br />
et se mêlèrent aux guerriers : « Ceux qui étaient<br />
députés à la garde et à la défense des portes et des<br />
murs demeurèrent à leur poste (1), — note Fauquembergue<br />
; — et à leur aide survinrent plusieurs<br />
des habitants qui firent très bonne et forte résistance<br />
aux gens dudit messire Charles de Valois. » <strong>Jeanne</strong><br />
(1) D'où il semble que l'on puisse conclure que les combattants<br />
volontaires s'étaient enfuis, au moment où l'action était en pleine<br />
violence.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 35<br />
les interpellait, leur criant de se rendre avant la<br />
nuit ; ils lui répondaient par de grossières injures<br />
(Chuffart) et redoublaient leurs décharges d'artillerie<br />
et, leurs traits d'arbalètes ; les assiégés faisaient<br />
« contre les assaillants de telles décharges de canons<br />
et d'autres machines de trait que force leur fut de<br />
reculer », prétend Chuffart.<br />
En réalité l'assaut était manqué. Monstrelet<br />
dit qu'il « dura sans discontinuer de quatre à cinq<br />
heures ou même plus », depuis dix heures environ,<br />
moment où il le fait commencer ; sans doute ne mentionne-t-il<br />
ainsi que la période ascendante de l'action ;<br />
l'attaque continua encore jusqu'à la nuit, mais vraisemblablement<br />
en décroissant de vigueur.<br />
Toutefois la Pucelle « ne voulait pas se retirer, et<br />
elle se donnait toute sorte de soins pour faire apporter<br />
et jeter fagots et bois dans le second fossé, dans l'espérance<br />
de passer jusqu'au mur. » (Chronique de la<br />
Pucelle). — « La nuit était proche — relate le Journal du<br />
siège d'Orléans ; — cependant elle se tenait toujours<br />
sur le fossé — (c'est-à-dire, comme le remarque<br />
Monstrelet, « derrière le revers du dos d'âne »,<br />
dans l'arrière-fossé; ne montant sur le boulevard que<br />
par intervalles) — ne voulant pas retourner ni se<br />
retirer en aucune manière, quelque prière et requête<br />
qui lui en fût faite par plusieurs qui, à diverses fois,<br />
vinrent la requérir de quitter ce lieu et lui remontrer<br />
qu'elle devait renoncer à l'entreprise. »<br />
« Après le soleil couchant — dit Cagny — la<br />
Pucelle fut frappée à la cuisse d'un trait d'arbalète à<br />
hausse pied » ; probablement entre 6 heures 1/2 et<br />
7 heures du soir (1). <strong>Jeanne</strong> était alors sur le « dos<br />
(1) Le 8 septembre, le soleil se couche, d'après les calendriers.
36 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
d'âne », interpellant les assiégés : « Vraiment, dit quelqu'un,<br />
paillarde, ribaude ! Et il lui envoie — raconte<br />
Chuffart — droit un trait de son arbalète qui lui perce<br />
la jambe d'outre en outre, et elle dut s'enfuir (ce n'est<br />
pas exact). Un autre perça d'outre en outre le pied<br />
de celui qui portait son étendard. Quand celui-ci se<br />
sentit blessé, il leva sa visière pour voir à ôter le vireton<br />
(trait d'arbalète), et un autre le vise, le saigne<br />
entre les deux yeux, et le blesse à mort ; ce dont la<br />
Pucelle et le duc d'Alençon jurèrent depuis qu'ils<br />
auraient aimé mieux perdre quarante des meilleurs<br />
hommes d'armes de leur compagnie. »<br />
Bien que blessée, <strong>Jeanne</strong> « ne voulut cependant pas<br />
sortir de l'arrière-fossé » (Chronique de Jean Chartier).<br />
« Elle s'efforçait plus fort de dire que chacun s'approchât<br />
des murs et que la place serait prise »<br />
(Cagny) ; mais « quelques conseillers du roi firent<br />
retirer leurs gens d'armes » (Chronique de Tournay).<br />
Jean Chartier prétend, dans sa Chronique latine, que<br />
la blessure de la Pucelle était très grave (quamquam<br />
atrocissime in crura cum sagitta vulneraretur) ;<br />
Monstrelet dit aussi que « la Pucelle fut très fort<br />
navrée (blessée) » ; c'est une erreur, puisque dès le<br />
lendemain <strong>Jeanne</strong> voulait retourner à l'attaque.<br />
Le Greffier de La Rochelle affirme qu'elle « fut promptement<br />
guérie ». <strong>Jeanne</strong> dira elle-même, à son procès,<br />
(séance du 23 février) qu'elle fut « guérie en cinq<br />
jours », alors que, blessée à Orléans à l'attaque des<br />
Tourelles, elle n'avait été guérie qu'en « quinze<br />
modernes, à 6h 19 du soir. L'écuyer du duc d'Alençon parle,<br />
non suivant les calculs astronomiques, mais selon ce qui frappe<br />
les sens ; c'est au moment où il lui a paru que le soleil disparaissait<br />
à l'horizon que <strong>Jeanne</strong> a été blessée.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 37<br />
jours», sans cesser pour cela « d'aller à cheval et de<br />
besogner » (procès, séance du 27 février).<br />
Les capitaines profitèrent de cette occasion pour<br />
ordonner la retraite : « parce qu'il était nuit, qu'elle<br />
(<strong>Jeanne</strong>) était blessée et que les gens étaient lassés<br />
du long assaut qu'ils avaient fait, le sire de Gaucourt<br />
et d'autres vinrent prendre la Pucelle et, contre son<br />
vouloir, l'emmenèrent hors des fossés » (Cagny).<br />
<strong>Jeanne</strong> opposait en vain de la résistance ; on l'emporta<br />
malgré elle « sous la tente du duc d'Alençon, qui<br />
l'envoya quérir » (Chronique de la Pucelle et Journal<br />
du siège d'Orléans). « Elle avait très grand regret<br />
d'ainsi se départir et disait : par mon martin, la place<br />
eût été prise. Ils la mirent à cheval et la ramenèrent à<br />
son logis, audit lieu de La Chapelle, où rentrèrent<br />
tous les autres de la compagnie du roi, le duc de Bar, le<br />
comte de Clermont, qui ce jour étaient venus de<br />
Saint-Denis » (Cagny).<br />
« Ainsy faillit l'assaut »,<br />
remarque assez mélancoliquement l'écuyer du duc<br />
d'Alençon.<br />
* *<br />
Le retraite commença et se poursuivit jusques assez<br />
avant dans la nuit. Fauquembergue note que c'est<br />
vers « dix ou onze heures de nuit qu'ils se départirent<br />
à leur dommage. » Le secrétaire du Chapitre de<br />
Notre-Dame dit que l'attaque s'est « prolongée<br />
jusques au milieu de la nuit », ce qu'il faut entendre,<br />
pensons-nous, de l'ensemble de l'opération, retraite<br />
comprise. Le Bourgeois de <strong>Paris</strong> affirme que la retraite<br />
fut dure et que les assiégés poursuivaient leurs adversaires<br />
de leurs canonnades : « Celui qui pouvait le
38 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
mieux s'en aller était le plus heureux. Ceux de <strong>Paris</strong><br />
avaient de grands canons qui largement atteignaient<br />
de la porte Saint-Denis jusqu'au delà de Saint-<br />
Lazare ; ils leur tiraient au dos, ce dont ils furent<br />
très épouvantés. Ils furent ainsi mis en fuite ; mais<br />
personne ne sortit de <strong>Paris</strong> pour les suivre par peur de<br />
leurs embûches » ; cette dernière phrase dit assez que<br />
la retraite ne fut pas la déroute ; les troupes étaient<br />
encore en mesure d'infliger une défaite aux assiégés,<br />
s'ils s'étaient avisés de les poursuivre en rase campagne,<br />
durant qu'elles se repliaient sur La Chapelle ;<br />
aussi « personne ne sortit de <strong>Paris</strong> pour les suivre par<br />
peur de leurs embûches. » Si l'on en croit encore<br />
Chuffart — mais il faut se défier de ses racontars —<br />
les hommes d'armes, en se retirant, « maudissaient<br />
beaucoup leur Pucelle qui leur avait promis que sans<br />
faute ils gagneraient de force à cet assaut la ville de<br />
<strong>Paris</strong> ; qu'elle y coucherait cette nuit ; qu'eux tous<br />
aussi ; que tous seraient enrichis des biens de la cité ;<br />
que l'on mettrait à l'épée ou que l'on brûlerait dans<br />
les maisons tous ceux qui y mettraient quelque<br />
opposition. » Les dernières de ces prétendues promesses<br />
sont invraisemblables et en opposition complète<br />
avec les instructions données par <strong>Jeanne</strong> à ses<br />
troupes (1).<br />
(1) L'allemand Eberhard de Windecken, trésorier de l'empereur<br />
Sigismond, remarque que <strong>Jeanne</strong> avait posé comme condition<br />
de ses campagnes, « qu on ne prendrait rien à personne et<br />
qu'on ne ferait aucune violence aux pauvres gens ». L'italien<br />
Pancrace Justiniani écrit de même le 9 juillet 1429 : « Créée<br />
capitaine et investie du gouvernement de toute l'armée du<br />
Dauphin, elle se hâta de promulguer que personne ne fût si hardi<br />
que de prendre quoi que ce soit des sujets du prince sans l'avoir<br />
payé et cela sous peine de la vie. Elle voulut que... dans tous les<br />
pays où il (le Dauphin) pénétrerait, ce fut pour y apporter bonne
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 39<br />
L'armée laissait sur le champ de bataille presque<br />
tout son matériel de siège, peut-être dans la précipitation<br />
du départ, peut-être aussi parce que quelquesuns<br />
des capitaines se proposaient de reprendre l'opération<br />
dès le jour suivant, comme le rapporte<br />
Cagny. « Ils laissèrent un très grand nombre de<br />
fascines — note le secrétaire du Chapitre de Notre-<br />
Dame, — abandonnèrent sur le lieu du combat six<br />
cent cinquante échelles et bien quatre milliers de<br />
claies. Ils avaient bien trois cents chars pour porter<br />
ce bagage... Ils ramenèrent à Saint-Denis plusieurs de<br />
ces charrois sur lesquels ils avaient étendu leurs<br />
blessés ; d'autres charrois furent le lendemain conduits<br />
dans <strong>Paris</strong>. Ils brûlèrent le reste ; car on trouva le<br />
lendemain plus de cent roues ; ce qui a fait présumer<br />
que, la nuit avant leur retraite, ils avaient brûlé ce<br />
qu'elles devaient supporter. »<br />
Quelles étaient, en hommes, les pertes de part et<br />
d'autres? Il est bien difficile de s'en faire quelque<br />
idée, tant est grande la divergence des chroniqueurs,<br />
dont chacun donne l'avantage à son parti.<br />
D'après ceux du parti français : « Il y eut plusieurs<br />
blessés, et comme pas un mort » (Chronique de la Puvelle).<br />
l Très peu furent atteints et portés à terre de<br />
coups de pierres de canon ; mais par la grâce de Dieu<br />
et l'heur de la Pucelle, nul homme n'en mourut, ni ne<br />
fut blessé au point de ne pouvoir revenir à son aise et<br />
sans aide à son logis » (Cagny). Nous avons déjà<br />
lu plus haut, dans le Greffier de La Rochelle, qu'il n'y<br />
eut « ni blessé, ni tué, du moins qu'on ait pu le savoir »,<br />
si ce n'est un bourgeois de La Rochelle. L'auteur<br />
paix, sans en tirer la moindre vengeance, soit sur les personnes,<br />
soit sur les biens » (Chronique Morosoni).
40 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
inconnu du fragment d'une Chronique de Normandie<br />
remarque que « ceux de la place firent grande résistance,<br />
en tirant fort de canons et grosses arbalètes,<br />
qui firent peu de mal. » Thomas Basin, évêque de<br />
Lisieux, est seul à affirmer le contraire : « Beaucoup,<br />
parmi les assaillants, sont tués ou blessés ».<br />
A l'étranger, nous avons l'appréciation du moine<br />
écossais Walter Bower : « Beaucoup d'hommes d'armes<br />
de l'armée du roi y périrent frappés par les projectiles<br />
lancés par les frondes, les arbalètes, les pierriers,<br />
atteints par les flèches » (1).<br />
D'après les chroniqueurs du parti anglo-bourguignon<br />
: « Plusieurs Français furent renversés et<br />
abattus, un très grand nombre furent tués et blessés...<br />
d'autre part il y eut plusieurs blessés parmi les<br />
défenseurs de la ville... les capitaines français firent<br />
soudainement sonner la retraite et retournèrent à<br />
leurs logis, en emportant les morts et les blessés »<br />
(Monstrelet). — « Parmi eux (les assaillants) il y eut<br />
plusieurs morts et navrés (blessés) de traits et de<br />
canons » (Fauquembergue). — Les assiégeants « ont<br />
blessé quelques Anglais et quelques Français ; ils<br />
n'en ont tué qu'un très petit nombre ; ils ont perdu,<br />
beaucoup des leurs ; on ne sait pas combien,<br />
parce que, dit-on, ils ont brûlé les cadavres » (Registres<br />
du Chapitre de Notre-Dame). — Enfin, Chuffart<br />
écrit dans son Journal : « En s'en allant, ils<br />
mirent le feu à la grange des Mathurins, près des<br />
Porcherons (2). Ils jetèrent dans les flammes, ainsi<br />
(1) Ce témoignage est particulièrement intéressant; voir<br />
ci-dessus, la note 4 de la page 17.<br />
(2) La grange des Mathurins se trouvait au point formé actuellement<br />
par l'angle des rues des Mathurins, Vîgnonet Tron-
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 41<br />
que jadis le faisaient les païens à Rome, ceux de leurs<br />
gens morts à l'assaut, qu'ils avaient troussés en<br />
grand nombre sur leurs chevaux... Le lendemain, ils<br />
vinrent nous sauf-conduit quérir leurs morts. Le héraut<br />
qui vint avec eux fut, par le capitaine de <strong>Paris</strong>, sommé<br />
de dire sous la foi du serment combien il y avait de<br />
blessés parmi leurs gens. Il jura qu'il y en avait bien<br />
quinze cents, dont bien cinq cents étaient morts ou<br />
blessés à mort ».<br />
De ces affirmations contradictoires, il résulte seulement<br />
qu'il y eut, de part et d'autre, des blessés et des<br />
tués, vraisemblablement en plus grand nombre du<br />
côté des assaillants. Les chiffres donnés par Chuffart<br />
ne sauraient être acceptés tels quels ; n'oublions pas<br />
que son parti-pris est évident ; Bourguignon passionné,<br />
il hait profondément les Armagnacs, le parti de<br />
Charles VII et, de tous les chroniqueurs, il est peutêtre,<br />
quand il s'agit de <strong>Jeanne</strong>, le plus fielleux ; par<br />
suite, bien souvent ses renseignements sont suspects.<br />
Nous n'avons aucun moyen de contrôler l'exactitude<br />
du nombre de tués et de blessés qu'il relate ; certains<br />
le croient très exagéré ; s'il eût été aussi élevé, les<br />
chroniqueurs du parti français n'auraient pu écrire<br />
que « nul homme n'en mourut, ni ne fut blessé »<br />
grièvement ; le mensonge eût été par trop patent.<br />
Monstrelet, bourguignon lui aussi, mais plus modéré<br />
dans son récit, assure qu'en se retirant, « les capitaines<br />
emportèrent leurs morts et leurs blessés ». Qu'ils<br />
aient emmené avec eux un millier de blessés, légèrement<br />
ou gravement atteints, à vrai dire il n'y a pas<br />
d'impossibilité absolue ; mais, au milieu de la nuit,<br />
chet. Le domaine des Porcherons était à l'endroit occupé<br />
aujourd'hui par l'avenue du Coq.
42 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
relever, charger et emporter près de cinq cents<br />
cadavres était une autre affaire, surtout si la retraite<br />
fut aussi dure que l'affirme Chuffart ; les assiégeants<br />
ne disposaient même plus de leurs trois cents charrettes,<br />
puisqu'ils en auraient brûlé une cinquantaine,<br />
nous dit-on, et qu'ils en avaient laissé sur le terrain<br />
plusieurs autres que vinrent enlever les <strong>Paris</strong>iens.<br />
Remplir, en pleine nuit, les chariots d'un aussi grand<br />
nombre de morts et de blessés et être prêt à recommencer<br />
l'attaque dès la première heure du jour, ne paraît<br />
pas vraisemblable. Chuffart prétend, il est vrai,<br />
qu'on a brûlé les cadavres dans la grange des Mathurins,<br />
en quoi le contredit son copartisan Monstrelet,<br />
lequel relate qu'on les a emportés et ne paraît nullement<br />
soupçonner qu'on les ait incinérés ; d'ailleurs<br />
Chuffart est seul à fournir ce renseignement ; sans<br />
doute les Registres du Chapitre de Notre-Dame rapportent,<br />
comme un on-dit, le même fait ; mais nous<br />
savons que Chuffart était chancelier du Chapitre et l'un<br />
des trois délégués de celui-ci, chargés de prendre toutes<br />
mesures utiles pendant la durée du siège ; le secrétaire<br />
du Chapitre ne tiendrait-il pas de lui cet on-dit,<br />
si tant est que sa rédaction n'ait pas été directement<br />
influencée par le chancelier? On peut le supposer.<br />
Toutefois il n'est guère croyable qu'un ecclésiastique<br />
aussi important, chancelier, non seulement du Chapitre,<br />
mais encore de l'Université et de la reine-mère, doyen<br />
de Saint-Germain-l'Auxerrois et de Saint-Marcel,<br />
curé de Saint-Laurent et de <strong>Sainte</strong>-Opportune, ait,<br />
quelle que soit sa passion politique, inventé de luimême<br />
une pareille fable. Le fait est-il vrai, ou controuvé?<br />
Ne serait-ce pas une de ces mille « fausses nouvelles<br />
», nées d'on ne sait qui, sorties d'on ne sait où,<br />
qui circulent si facilement dans une population su-
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 43<br />
rexcitée par les troubles qu'apporte la guerre? S'il était<br />
exact qu'en se retirant les hommes d'armes de la Pucelle<br />
eussent brûlé une cinquantaine de leurs chariots,<br />
avec ce qu'ils portaient, ne faudrait-il pas chercher là<br />
l'origine d'un bruit se grossissant de bouche en<br />
bouche, à mesure qu'il est colporté, jusqu'à transformer<br />
une flambée de quelques charrettes en un<br />
brasier de cadavres ? C'est bien possible ; ne trouvant<br />
pas de morts sur le champ de bataille, puisque l'armée<br />
les avait emportés avec elle, on en aura conclu un<br />
peu vite qu'elle les avait brûlés avec les chariots ;<br />
et si on ne trouva point de cadavres sur le terrain du<br />
combat, c'est que l'action n'avait point été aussi<br />
meurtrière que voudrait nous le faire croire Chuffart.<br />
* *<br />
Le lendemain, dès l'aube, <strong>Jeanne</strong> voulut reprendre<br />
l'opération. Lisons Perceval de Cagny ; il paraît le<br />
mieux renseigné sur les événements de cette journée :<br />
« Le vendredi, 9 e jour du même mois, la Pucelle,<br />
quoiqu'elle eût été blessée le jour précédent à l'assaut,<br />
se leva bien matin et fit venir son beau duc d'Alençon,<br />
par lequel elle donnait ses ordres ; et elle le pria de<br />
faire sonner les trompilles et de monter à cheval<br />
pour retourner <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>, et affirma par son martin<br />
que jamais elle n'en partirait sans avoir la ville. Le<br />
duc d'Alençon et d'autres capitaines avaient bien le<br />
vouloir de seconder son entreprise et de retourner ;<br />
mais quelques-uns ne le voulaient pas. Tandis qu'ils<br />
étaient en ces pourparlers, le baron de Montmorency,<br />
qui avoit toujours tenu le parti contraire au roi, vint<br />
de l'intérieur de la ville, accompagné de cinquante ou<br />
soixante gentilshommes, se mettre en compagnie de
44 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
la Pucelle ; ce qui donna plus de cœur et accrut le<br />
courage de ceux qui avaient la bonne volonté de<br />
retourner <strong>devant</strong> la ville. Tandis que se faisait le<br />
rapprochement, arrivèrent de la part du roi, qui était<br />
à Saint-Denis, le duc de Bar et le comte de Clermont.<br />
Ils prièrent la Pucelle que, sans aller plus loin, elle<br />
retournât auprès du roi, qui était à Saint-Denis.<br />
De la part du roi, ils prièrent aussi d'Alençon et<br />
commandèrent à tous les autres capitaines de venir<br />
et d'amener la Pucelle vers lui. La Pucelle et la plupart<br />
de ceux de la compagnie en furent très marris ; néanmoins<br />
ils obéirent à la volonté du roi, dans l'espérance<br />
qu'ils trouveraient entrée pour prendre <strong>Paris</strong><br />
par l'autre côté, en passant la Seine sur un pont que<br />
le duc d'Alençon avait fait jeter sur la rivière vis-à-vis<br />
de Saint-Denis et ils vinrent ainsi vers le roi ».<br />
La manière dont le Journal du siège d'Orléans<br />
raconte l'accueil fait à <strong>Jeanne</strong>, quand elle se présenta<br />
à la cour royale, ne manque pas de quelque ironie :<br />
« La Pucelle y fut fort louée de son bon vouloir et<br />
du hardi courage qu'elle avait montré de vouloir<br />
assaillir une cité aussi forte et bien garnie de gens et<br />
d'artillerie que l'était <strong>Paris</strong> ». Ainsi, malgré ses succès<br />
précédents, si merveilleux à tant d'égards, on n'avait<br />
plus foi en elle ; on ne croyait pas qu'elle put faire<br />
rentrer le roi dans sa capitale ; du moins affectait-on<br />
de ne pas le croire ; la vérité c'est qu'on ne le voulait<br />
pas. Perceval de Cagny en fournit une preuve, indépendamment<br />
de celles qui seront rapportées par la<br />
suite : « Le lendemain, samedi, une partie de ceux qui<br />
avaient été <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> pensèrent aller bien matin<br />
passer la Seine sur ledit pont, mais ils ne le purent,<br />
parce que le roi, ayant su l'intention de la Pucelle,<br />
du duc d'Alençon et des autres de bon vouloir,
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 45<br />
avait fait passer toute la nuit à le mettre en pièces.<br />
Et ils furent ainsi empêchés de passer. Ce jour, le roi<br />
tint conseil auquel plusieurs opinions furent émises ;<br />
il demeura à Saint-Denis jusqu'au mardi 13° jour de<br />
septembre, tendant toujours à revenir sur la Loire,<br />
au grand déplaisir de la Pucelle ». Et le brave écuyer<br />
conclut tristement :<br />
« Ainsy fut rompu le vouloir de la Pucelle ».
Les Causes de l'échec.<br />
Thomas Basin qualifie l'attaque de <strong>Paris</strong> une<br />
« affaire un peu témérairement engagée ». Il ne voit<br />
que l'échec ; il n'en a pas démêlé les causes, qui sont<br />
moins d'ordre militaire que d'ordre politique, s'il<br />
les eût bien connues, peut-être se fut-il prononcé<br />
autrement et plus sévèrement.<br />
Depuis Reims, « la Pucelle n'avait qu'un but, —<br />
lit-on dans la Chronique de Tournay — assaillir, elle<br />
et les siens, la ville de <strong>Paris</strong> ». Il importait, en effet,<br />
que le roi, une fois sacré, prit possession de sa capitale<br />
et allât se faire couronner à Saint-Denis. C'était<br />
tellement dans la logique des événements que, la<br />
veille du sacre, le 16 juillet, le duc de Bedfort, régent<br />
de France pour le roi d'Angleterre, écrivait : « Incontinent<br />
après son sacre, il (le Dauphin) a intention de<br />
venir <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> et il a espérance d'y avoir entrée » ;<br />
qu'il indique les mesures prises pour « garnir et<br />
défendre les cités, villes et passages de la France<br />
(de l'Ile-de-France), et par spécial la ville de <strong>Paris</strong> » ;<br />
qu'il assure qu'on peut compter sur le concours de<br />
Philippe, duc de Bourgogne, sans lequel « <strong>Paris</strong> et<br />
tout le remanent s'en allait » (1) ; que, le jour même<br />
(1) Le 10 juillet, alors que le Dauphin marchait sur Reims, le<br />
duc de Bourgogne était venu séjourner cinq jours à <strong>Paris</strong> et,<br />
dans une grande assemblée, avait fait « lever les mains au peuple<br />
que tous seraient bons et loyaux au régent et au duc de Bourgogne ;<br />
les seigneurs promirent par leur foi de garder la ville de <strong>Paris</strong> »
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 47<br />
du sacre, trois seigneurs angevins, écrivant de Reims<br />
à la reine Marie d'Anjou et à sa mère Yolande le récit<br />
de la cérémonie à laquelle ils venaient d'assister,<br />
ajoutaient : « Le roi doit en partir demain tenant son<br />
chemin droit à <strong>Paris</strong>... La Pucelle ne fait nul doute<br />
qu'elle ne mette <strong>Paris</strong> à l'obéissance » ; que Christine<br />
de Pisan écrivait, dans son poème, le 31 juillet de la<br />
même année : Charles « entrera (à <strong>Paris</strong>) qui qu'en<br />
groingne » ; la Pucelle le « lui a promis ; il n'est<br />
puissance qui puisse l'empêcher ; soumis tu seras,<br />
<strong>Paris</strong>, et ton outrecuidance ».<br />
* *<br />
Comment se fait-il que <strong>Jeanne</strong> ait échoué?<br />
Se serait-elle trompée sur l'étendue de sa mission?<br />
Son attaque sur <strong>Paris</strong> ne serait-elle que le résultat<br />
de l'enivrement, dans lequel ses triomphes rapides<br />
et prodigieux avaient jeté ses hommes d'armes?<br />
La Pucelle a toujours dit que <strong>Paris</strong> serait pris ;<br />
c'était dans sa mission, comme de libérer Orléans,<br />
faire sacrer le roi, bouter tous les Anglais hors<br />
de France, délivrer de captivité le duc d'Orléans ;<br />
elle n'a jamais varié dans ses dires ; bien plus, elle<br />
était assurée de s'emparer elle-même de cette ville.<br />
Avant la délivrance d'Orléans, elle écrit de Blois<br />
aux Anglais : « Vous ne tiendrez pas France du roi<br />
du ciel, le Fils de sainte Marie, mais la tiendra le<br />
roi Charles, vrai héritier, à qui Dieu l'a donnée,<br />
(Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>.) On avait ainsi paré aux défections,<br />
que la marche triomphante du Dauphin faisait prévoir ; sans le<br />
duc de Bourgogne « <strong>Paris</strong> et tout le remanent s'en allait à ce<br />
coup ».
48 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
lequel entrera à <strong>Paris</strong> en belle compagnie ». Avant le<br />
sacre, le 8 juin, les seigneurs Guy et André de Laval<br />
mandent à leurs mère et grand'mère : « après que nous<br />
fûmes descendus à Selles, j'allai la voir (la Pucelle)<br />
à son logis ; elle fit venir le vin et me dit qu'elle m'en<br />
ferait bientôt boire à <strong>Paris</strong> ». Le 14 juillet, <strong>Jeanne</strong><br />
exhorte par lettre les habitants de Troyes à faire<br />
« vraie obéissance et reconnaissance au gentil roy de<br />
France, qui sera bien brief (bientôt) à Reims et à<br />
<strong>Paris</strong>, qui que vienne contre ». La Chronique de Le<br />
Fèvre de Saint-Rémy se fait l'écho de ces projets :<br />
« Le roi, après avoir séjourné à Compiègne, prit avec<br />
son armée le chemin pour venir droit à <strong>Paris</strong>, la<br />
Pucelle lui ayant promis de l'y introduire et que de<br />
cela il ne devait concevoir aucun doute ». Le 5 août,<br />
dans une lettre à ses amis de Reims, à laquelle nous<br />
avons déjà fait allusion et qui nous fournira dans un<br />
instant de précieux renseignements, <strong>Jeanne</strong> dit positivement<br />
qu'elle ne sait si elle pourra attendre quinze<br />
jours pour entrer à <strong>Paris</strong>. Le 22 août, à la veille de son<br />
départ pour cette ville, elle fait écrire de Compiègne<br />
au comte d'Armagnac que, de <strong>Paris</strong>, elle lui donnera<br />
la réponse à la question qu'il lui pose. Les promesses<br />
de <strong>Jeanne</strong> s'étaient répandues jusqu'à l'étranger.<br />
Le doyen de Saint-Thibaud les mentionne dans la<br />
Chronique de Metz : « Elle conseillait bien d'aller<br />
<strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> et disait pour vrai qu'ils la prendraient ».<br />
Pancrace Justiniani écrivait, de Bruges, à son père<br />
résidant à Venise, le 10 mai 1429 (deux jours après<br />
la délivrance d'Orléans) : « Elle lui dit (au roi) que<br />
Dieu l'envoyait vers lui ; qu'elle pouvait lui affirmer<br />
avec certitude qu'avant la saint-Jean de juin prochain<br />
il entrerait à <strong>Paris</strong> ; qu'il livrerait bataille aux Anglais,<br />
serait indubitablement vainqueur et entrerait à <strong>Paris</strong>
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 49<br />
et qu'il serait couronné » (Chronique Morosini) (1).<br />
Après sa blessure <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>, <strong>Jeanne</strong> n'a pas un<br />
instant de doute ; elle est assurée, si on la laisse faire,<br />
de prendre la ville, ainsi qu'on l'a lu à plusieurs<br />
reprises dans les textes cités ci-dessus. On pourrait<br />
multiplier ces citations. « Le recouvrement de <strong>Paris</strong><br />
et la totale expulsion des Anglais, fait justement<br />
observer le P. Ayroles, étaient annoncés avec la même<br />
certitude que la délivrance d'Orléans et le sacre de<br />
Reims. Le lecteur n'a qu'à revoir les documents cités<br />
pour former sa conviction » (Op. cit., IV, p. 123).<br />
Les réponses de <strong>Jeanne</strong>, au cours de son procès<br />
à Rouen, pourraient cependant éveiller un doute.<br />
Le 13 mars, on lui demande : « Quand vous allâtes<br />
<strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>, est-ce par révélation de vos voix que<br />
vous vous y rendîtes? — Non, mais à la requête des<br />
gentilshommes qui voulaient faire une escarmouche<br />
ou une vaillance d'armes, et j'avais bien l'intention<br />
d'aller outre et de passer les fossés ». — Le 15 mars :<br />
« Au fait de la guerre, n'avez-vous rien fait sans le<br />
congé de vos voix? — Vous en êtes tous répondus ;<br />
lisez bien votre livre (le procès-verbal) et vous le<br />
trouverez. Toutefois à la requête des hommes d'armes<br />
fut faite une vaillance d'armes <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>, et j'allai<br />
aussi <strong>devant</strong> la Charité à la requête du roi ; ce ne fut<br />
ni contre ni par le commandement de mes voix».—<br />
le 26 février : « La voix me disait de rester à Saint-<br />
Denis en France ; je voulais y rester, mais contre ma<br />
volonté les seigneurs m'ont emmenée. Si cependant<br />
(1) Il importe de remarquer que Justiniani dit tenir ces renseignements<br />
de « lettres de marchands qui font le négoce en Bourgogne<br />
» : d'où des erreurs manifestes, telle celle où l'entrée du roi<br />
dans <strong>Paris</strong> est présentée comme l'objectif principal, Reims n'étant<br />
pas même nommé, bien qu'il soit question du couronnement.
50 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
je n'avais pas été blessée, je ne me fusse pas éloignée ».<br />
Le 28 mars, le promoteur du procès, Jean d'Estivet »<br />
l'accuse, dans son réquisitoire, d'avoir, en se retirant<br />
de Saint-Denis, désobéi à ses voix qui lui ordonnaient<br />
d'y rester ; elle répond : « Je m'en tiens à ce<br />
qu'autrefois, j'en ai répondu ; à mon parlement de<br />
Saint-Denis, j'en eus congé de m'en aller » (1).<br />
Ainsi, uniquement en ce qui concerne, non point<br />
la prise de <strong>Paris</strong>, mais l'opération militaire du 8 septembre,<br />
<strong>Jeanne</strong> n'a reçu aucune révélation spéciale ;<br />
elle l'entreprit « ni contre ni par le commandement<br />
de ses voix » ; Dieu lui laissait, cette fois comme bien<br />
d'autres, la liberté de ses actes et n'intervenait pas<br />
pour décider l'exécution de tel ou tel détail intéressant<br />
sa mission. Une fois cependant, le siège de <strong>Paris</strong><br />
commencé, ses voix lui ordonnent de ne pas abandonner<br />
cette entreprise, mais de rester à Saint-Denis ».<br />
Le roi entraîne son armée vers la Loire ; <strong>Jeanne</strong> veut<br />
demeurer ; on s'y oppose ; on l'emmène contre son<br />
gré ; placée entre l'obéissance due à ses voix et le<br />
départ de ses hommes d'armes, que peut faire la<br />
Pucelle? Elle interroge ses voix ; celles-ci lèvent alors<br />
leur défense et l'autorisent à suivre le roi. Voilà,<br />
semble-t-il, à quoi se réduisent les réponses de <strong>Jeanne</strong>.<br />
Il n'en ressort nullement que la prise de <strong>Paris</strong> n'était<br />
(1) Le promoteur l'accusa encore (art. 57) d'avoir usé de supercherie<br />
en affirmant à ses hommes d'armes que, par révélation,<br />
elle savait qu'elle les introduirait dans <strong>Paris</strong> ; à quoi elle répondit :<br />
« Si je suis avisée d'en dire plus avant, j'en répondrai volontiers<br />
plus avant ». Elle aurait eu, en effet, beaucoup à dire, comme on<br />
le verra, sur les causes de son échec. Pour l'histoire, il est regrettable<br />
qu'elle n'ait pas révélé ce qu'elle savait ; mais elle ne<br />
pouvait ni ne voulait découvrir le roi, si ses voix ne lui en faisaient<br />
point une obligation.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 51<br />
pas dans sa mission, sinon les voix ne lui auraient<br />
pas ordonné de rester à Saint-Denis pour continuer<br />
l'opération commencée. Ce qui, par contre, ressort<br />
très nettement, croyons-nous, c'est que l'opposition<br />
du parti royal n'a pas permis que la mission de <strong>Jeanne</strong><br />
eût, du moins sa vie durant, son plein accomplissement.<br />
« Elle fit des choses incroyables à ceux qui ne<br />
les avaient pas vues, et l'on peut dire — affirme<br />
Cagny — qu'elle en aurait fait encore, si le roi et ses<br />
conseillers se fussent bien conduits et bien maintenus<br />
envers elle ».<br />
Gerson avait prévu et craint ce qui arrivait ; dès le<br />
14 mai 1429, dans son traité en faveur De la Pucelle,<br />
il émettait ce sage conseil : « Que le parti qui a pour<br />
lui la justice se garde d'arrêter par incrédulité, ingratitude<br />
ou autres prévarications, l'effet d'un secours<br />
divin qui débute si manifestement et si merveilleusement<br />
». De même, Jacques Gelu, archevêque<br />
d'Embrun, terminait son traité sur la Pucelle, composé<br />
en mai 1429, en exhortant le roi à suivre humblement<br />
les avis de <strong>Jeanne</strong>, pour que le Seigneur n'eût pas<br />
motif de retirer sa main, mais bien de continuer sa<br />
grâce. Dans son Histoire de Charles VII, écrite cinquante<br />
ans après les événements, à Utrecht, durant<br />
le long exil auquel le condamna Louis XI, l'évêque<br />
de Lisieux, Thomas Basin, attribuait à la même cause<br />
le supplice de <strong>Jeanne</strong>, victime de l'ingratitude des<br />
grands : « Une grâce gratuite, accordée à ceux qui ne<br />
la méritaient pas, a été retirée à des indignes et à des<br />
ingrats ; souvent, en effet, l'ingratitude a fait retirer<br />
ce qui avait été donné par un pur effet de la divine<br />
miséricorde ».<br />
Pour que <strong>Jeanne</strong> put accomplir, en personne,<br />
toute sa mission, la collaboration humaine du prin-
52 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
cipal intéressé devait seconder l'intervention miraculeuse<br />
de la Providence ; après le sacre, non seulement<br />
cette collaboration a été défaillante, mais l'œuvre<br />
divine fut contrariée ; c'est là la véritable cause de<br />
l'échec de <strong>Jeanne</strong> <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>, comme de ceux qui<br />
ont suivi.<br />
* *<br />
A ne voir que les faits, « la profondeur de l'eau »<br />
remplissant le fossé du rempart fut l'occasion matérielle<br />
de l'insuccès. Au plus fort de l'assaut les assiégés<br />
« avaient comme abandonné la défense du mur, —<br />
avons-nous lu dans l'écrit de Pierre Cochon ; — il ne<br />
fallait que lever les échelles dont ils (les assiégeants)<br />
étaient bien pourvus, pour qu'ils eussent été dedans ».<br />
On ne put les dresser.<br />
<strong>Jeanne</strong> n'avait pas prévu cet obstacle ; quand, dans<br />
les escarmouches précédentes, elle s'approchait du<br />
mur d'enceinte, vers la porte Saint-Denis, il ne semblait<br />
pas qu'il y eût beaucoup d'eau dans le fossé ;<br />
peut-être même n'y en avait-il pas à cet endroit ;<br />
mais par suite de la déclivité du terrain, plus le rempart<br />
se rapprochait de la Seine, vers l'ouest, plus l'eau<br />
était profonde ; et la porte Saint-Honoré n'était pas<br />
éloignée du fleuve ; peut-être aussi, du moins on l'a<br />
supposé, une circonstance fortuite, une crue imprévue<br />
fit-elle monter le niveau ; toujours est-il que <strong>Jeanne</strong><br />
rencontra une difficulté à laquelle il ne semble pas<br />
qu'elle se soit attendue, mais que d'autres escomptaient.<br />
« <strong>Jeanne</strong> n'était pas bien informée de la profondeur<br />
de l'eau qu'il y avait dans les fossés —<br />
rapporte la Chronique de la Pucelle ; — il y en avait<br />
quelques-uns qui le savaient bien ; mais on pouvait
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 53<br />
voir que par envie ils eussent bien voulu qu'il lui<br />
arrivât male aventure ».<br />
Avec le grand nombre de fagots, de bois, de bourrées,<br />
de fascines apportés, la difficulté était loin d'être<br />
insurmontable ; il suffisait d'un labeur un peu vigoureux<br />
et actif pour combler le fossé, au moins par<br />
endroits. <strong>Jeanne</strong> ne put faire jeter que « quelques<br />
fascines, mais peu » (Registres du Chapitre de Notre-<br />
Dame) ; « elle n'avait pas assez de gens pour ce faire »<br />
(Journal du siège d'Orléans). Depuis qu'elle avait,<br />
pendant « un grand espace de temps », plongé « sa<br />
lance en divers lieux, tâtant et sondant la profondeur<br />
de l'eau et de la vase » (ibid), elle ne cessa, « jusqu'à<br />
environ l'heure du jour faillant » (Cagny), de<br />
réclamer du renfort ; de « prendre toutes sortes de<br />
soins pour faire apporter fagots et bois » (Chronique<br />
de la Pucelle) ; de se donner « grand mouvement pour<br />
faire jeter des fascines » (Jean Chartier) ; on restait<br />
sourd à ses commandements. Le lieutenant-général,<br />
qui a la conduite de l'armée avec ordre d'obéir à la<br />
Pucelle, le duc d'Alençon, n'est pas auprès d'elle ;<br />
il commande le corps de réserve, en embuscade<br />
derrière la butte. Dans l'arrière-fossé, près de <strong>Jeanne</strong>,<br />
sont postés le maréchal de Rais, le sire de Gaucourt<br />
et d'autres chevaliers ou écuyers ; ils ne répondent<br />
pas ou ne répondent que mollement à ses réclamations ;<br />
« elle était courroucée de ce qu'elle était peu secondée »,<br />
remarque la Chronique de Tournay. Quand elle fut<br />
blessée, « quelques conseillers du roi firent retirer leurs<br />
gens d'armes, — lit-on dans cette même Chronique, —<br />
ce qui contraignit la Pucelle à se retirer elle aussi ».<br />
Si <strong>Jeanne</strong> n'a pas été avertie, par ceux qui en<br />
étaient informés, de la profondeur de l'eau ; si les<br />
fascines n'ont pas été apportés en nombre suffisant ;
54 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
si les bras ont manqué pour combler le fossé ; si les<br />
échelles n'ont pu être dressées ; si les assaillants n'ont<br />
pu monter sur le mur d'enceinte, au moment où<br />
il était abandonné par ses défenseurs ; si l'assaut<br />
fut arrêté à l'instant où il allait réussir, ce fut par<br />
la mauvaise volonté manifeste de quelques-uns des<br />
plus importants capitaines. Qu'ils n'eussent point<br />
entravé l'action de <strong>Jeanne</strong> et la ville eût été prise ;<br />
car il s'en fallut de peu qu'elle ne le fût. Si la Pucelle<br />
« n'y fit aucun profit, — remarque dans la Chronique<br />
de Metz le doyen de Saint-Thibaud, —c'est qu'elle ne<br />
fut pas bien suivie. » — « Quelques uns ont dit depuis,<br />
— lit-on dans le Journal du siège d'Orléans, — que si<br />
les choses eussent été bien conduites, il y avait grande<br />
apparence qu'elle en fust venue à son vouloir. » Le<br />
bourguignon Gilles de Roye dit de même : « Si tous les<br />
hommes d'armes avaient eu son courage, <strong>Paris</strong> aurait<br />
été en grand danger d'être pris. » Un autre bourguignon<br />
est encore plus affirmatif : « Je crois qu'ils<br />
eussent gagné la ville de <strong>Paris</strong>, si on les eut laissé<br />
faire. » La Chronique de la Pucelle paraît assurée que,<br />
si le siège n'eut pas été interrompu, <strong>Paris</strong> était prêt à<br />
se rendre dès le lever du jour : « Si on y fut resté<br />
jusqu'au matin, il y en eut eu (dans la ville) qui se<br />
fussent avisés », c'est-à-dire qui eussent livré la<br />
capitale aux assiégeants.<br />
* *<br />
Pourquoi, par leur force d'inertie, les capitaines<br />
ont-ils fait échouer l'attaque? La jalousie et l'envie<br />
ont joué leur rôle, mais ne suffisent pas à tout expliquer.<br />
Que les exploits de la Pucelle aient suscité autour
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 55<br />
d'elle un certain nombre de mécontents, on n'en peut<br />
douter. Plus d'une fois elle se trouva en désaccord<br />
avec les commandants de l'armée et « se tint mal<br />
contente des chefs et capitaines de guerre », (Chronique<br />
de la Pucelle) qui contrariaient son action ou ses<br />
projets. Ceux-ci virent d'abord d'un mauvais œil<br />
que <strong>Jeanne</strong> revêtit l'habit des guerriers. « <strong>Jeanne</strong> allait<br />
cependant toujours armée de son harnais (armure),<br />
quoique ce fût contre la volonté et l'opinion des<br />
mêmes gens de guerre (les capitaines), observe Jean<br />
Chartier. Elle montait sur un coursier tout armée<br />
aussi prestement que chevalier qui fût en la cour<br />
du roi, ce dont les gens de guerre était ébahis et courroucés.<br />
» Puis ce furent ses succès multiples, rapides<br />
et prodigieux qui leur portèrent ombrage : « après la<br />
reddition de Troyes, — rapporte la Chronique des<br />
Cordeliers, — le Dauphin conquit beaucoup de villes<br />
et de forteresses par le moyen de la Pucelle, qui dès<br />
lors attira tout le renom des faits des capitaines,<br />
et des gens de sa compagnie ; ce dont quelques-uns<br />
de ces derniers ne furent nullement contents. »<br />
L'Abbréviateur du procès fait, vers 1550, la même<br />
remarque : « Ce dont quelques seigneurs et capitaines<br />
ainsi que je le trouve par écrit, conçurent grande<br />
haine et envie contre elle. » Vers la même époque,<br />
Alain Bouchard écrit dans ses Grandes annales de<br />
Bretagne : « Si ce n'eût été que toutes ses entreprises<br />
étaient à louer et venaient à l'honneur du roi et du<br />
royaume, on eut grandement murmuré contre elle et<br />
elle eût été renversée par envie. » Au moment de<br />
l'Attaque contre <strong>Paris</strong>, ces mauvais sentiments semblent<br />
portés, chez quelques-uns, à leur exaspération<br />
: « On pouvait voir que par envie, — venons-nous<br />
de lire dans la Chronique de la Pucelle — il y en avait
56 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
quelques-uns qui eussent bien voulu qu'il lui arrivât<br />
male aventure. » Peut-être, par la suite, les choses ne<br />
firent-elles que s'envenimer, car la Chronique de<br />
Tournay porte, sous forme de racontar, une accusation<br />
extrêmement grave : « Plusieurs ont dit et affirmé<br />
que, à cause de la jalousie des capitaines, que secondait<br />
la faveur dont quelques-uns du conseil du roi<br />
jouissaient auprès de Philippe de Bourgogne et de<br />
messire Jean de Luxembourg, on trouva couleur de la<br />
faire mourir par le feu, à Rouen. »<br />
Ces mécontents jaloux ou envieux n'avaient pas<br />
été sans s'apercevoir du peu d'empressement que<br />
Charles VII mettait à conquérir <strong>Paris</strong> ; pourquoi en<br />
auraient-ils mis davantage? N'avaient-ils pas là<br />
l'occasion favorable de faire à <strong>Jeanne</strong> une opposition<br />
efficace? Quand se posa la question de savoir si l'on<br />
donnerait ou non l'assaut à <strong>Paris</strong>, ils prirent le parti<br />
contraire à celui de la Pucelle. « Les capitaines ne<br />
s'accordèrent pas pour l'attaque de la ville », affirme<br />
la Chronique de Tournay ; « ils étaient en désaccord<br />
sur l'entreprise », écrit également un bourguignon,<br />
le bernardin Gilles de Roye. Les uns voulaient ne<br />
faire qu' une escarmouche, une vaillance d'armes » ;<br />
d'autres donner l'assaut. Il est assez remarquable<br />
que, fortuitement ou non, certains de ceux qui<br />
étaient de l'avis de <strong>Jeanne</strong>, comme le duc d'Alençon,<br />
furent maintenus à l'armée de réserve, et que quelquesuns<br />
des opposants, comme peut-être le maréchal<br />
de Rais et presque sûrement le sire de Gaucourt,<br />
furent affectés au corps d'attaque. Aussi, quand<br />
<strong>Jeanne</strong> prit l'initiative de l'assaut, lui laissèrent-ils<br />
ignorer ce qu'ils savaient bien, que la profondeur de<br />
l'eau empêchait d'accéder au rempart ; mirent-ils une<br />
négligence évidente à faire combler le fossé et à four-
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 57<br />
nir les gens nécessaires à cette besogne ; insistèrentils<br />
à plusieurs reprises pour faire cesser l'attaque ;<br />
emportèrent-ils, malgré elle, la Pucelle quand elle<br />
fut blessée et firent-ils retirer les troupes ; bref,<br />
secondèrent-ils si peu <strong>Jeanne</strong>, qu'on semble en droit<br />
de les rendre responsables de l'échec, au moment où<br />
l'entreprise allait réussir. Et quand, le jour suivant,<br />
la Pucelle, le duc d'Alençon et d'autres parlèrent de<br />
reprendre l'opération « quelques-uns (les mêmes<br />
sans doute ) ne le voulaient pas » (Cagny).<br />
Que certains des principaux capitaines aient, ainsi<br />
contribué à faire échouer une action d'un intérêt si<br />
capital pour l'avenir de la royauté et du royaume,<br />
sans avoir la conviction qu'ils ne seraient ni désavoués,<br />
ni blâmés par le roi, on a peine à le croire. Ils devaient<br />
bien avoir leurs raisons pour ne vouloir qu'une<br />
« escarmouche ou une vaillance d'armes » et se refuser<br />
à entreprendre l'assaut. Ils croyaient — ou savaient —<br />
qu'à la cour on ne verrait pas avec plaisir une pareille<br />
entreprise. Il était trop évident, même pour les moins<br />
clairvoyants, que Charles VII y était, sinon absolument<br />
opposé, du moins très peu favorable. Ils n'ignoraient<br />
pas que le roi, apprenant l'arrivée de la Pucelle<br />
et du duc d'Alençon à Saint-Denis, avait « à son grand<br />
regret » quitté Compiègne ; que, parvenu à Senlis,<br />
il avait interrompu son voyage, paraissant ne pas<br />
vouloir aller plus avant ; qu'il était resté près de<br />
sept jours dans cette ville (du 30 août au 7 septembre),<br />
sans répondre à l'appel de <strong>Jeanne</strong>, ni à la démarche<br />
du duc d'Alençon ; que ce dernier, revenant une<br />
seconde fois le chercher, l'avait, pour ainsi dire,<br />
comme entraîné malgré lui jusqu'à Saint-Denis ;<br />
que, fait plus significatif, au lieu de prendre la tête<br />
de ses troupes pour s'emparer de <strong>Paris</strong>, il restait loin
58 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
d'elles, à Saint-Denis. Aussi disait-on ouvertement<br />
qu'il ne tenait pas à prendre sa capitale : « Et il n'y<br />
avait personne, de quelque état qu'elle fût, qui ne<br />
dit : elle (la Pucelle) mettra le roi dans <strong>Paris</strong>, si à<br />
lui ne tient » (Cagny). Après l'échec, on sera encore<br />
plus catégorique : « Et l'on disait que par lâcheté<br />
de courage, il n'avait jamais voulu prendre <strong>Paris</strong><br />
d'assaut » (Chronique de la Pucelle). Une telle indifférence,<br />
mauvaise volonté ou opposition de la part du<br />
roi, servait de point d'appui à la résistance que<br />
faisaient à <strong>Jeanne</strong> quelques-uns des chefs de guerre<br />
et leur permettait, en même temps, de satisfaire leur<br />
rancune à son égard.<br />
* *<br />
Quand l'auteur de la Chronique de la Pucelle attribue,<br />
d'après des on-dit, l'attitude de Charles VII à sa<br />
lâcheté, à son défaut de courage, il commet une<br />
erreur, dont il est excusable ; il ignorait le véritable<br />
motif d'une telle conduite ; d'autres documents nous<br />
font connaître ce motif et éclairent, d'une manière<br />
lumineuse, les causes politiques de l'échec de<br />
<strong>Jeanne</strong> <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>.<br />
Le 28 août, alors que la Pucelle était déjà en escarmouches<br />
<strong>devant</strong> la capitale, Charles VII signait à<br />
Compiègne, une trêve avec le duc de Bourgogne ;<br />
elle devait durer depuis ce 28 août jusqu'à Noël,<br />
et s'étendait à « tout le pays qui est en deçà de la<br />
rivière de la Seine, depuis Nogent-sur-Seine jusqu'à<br />
Harfleur, sauf et réservées les villes, places et forteresses<br />
donnant passage sur cette même rivière de<br />
Seine, réservé aussi que, si bon lui semble, notre dit<br />
cousin de Bourgogne pourra durant ladite trêve
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 59<br />
s'employer lui et ses gens à la défense de la ville de<br />
<strong>Paris</strong>, et résister à ceux qui voudraient faire la guerre<br />
ou porter dommage à cette ville. » (Chronique des<br />
Cordeliers.)<br />
Ainsi jusqu'à Noël, Charles VII s'interdisait le<br />
droit d'attaquer <strong>Paris</strong>, mais reconnaissait au duc de<br />
Bourgogne, pendant le même temps, celui de défendre<br />
cette ville et de résister aux assaillants. Il est clair que,<br />
sous peine d'être accusé de félonie et de déloyauté,<br />
le roi ne pouvait renier sa signature et laisser ses<br />
soldats s'emparer de la capitale ; en refusant l'assaut,<br />
les capitaines restaient fidèles à leur prince ; en<br />
l'engageant, <strong>Jeanne</strong> restait fidèle à sa mission, mais<br />
compromettait le roi ; cette fois le conflit était manifeste<br />
entre la volonté royale et la mission de la Pucelle.<br />
Cette négociation n'était que l'aboutissant d'autres,<br />
dont <strong>Jeanne</strong> avait été bien informée ; elle considérait<br />
que Charles VII se laissait jouer ; elle n'avait pas<br />
tort ; les événements devaient le prouver. Pour<br />
comprendre toute la portée de la trêve du 28 août<br />
et sa répercussion sur l'attaque de <strong>Paris</strong>, il est indispensable<br />
de connaître ces tractations.<br />
L'alliance de Philippe, duc de Bourgogne, avec les<br />
Anglais, contre Charles VII, était néfaste au royaume ;<br />
dans le parti français, plusieurs cherchaient à la<br />
rompre et à ramener Philippe dans l'obédience de<br />
son cousin et souverain. <strong>Jeanne</strong> elle-même l'a tenté ;<br />
elle voulait d'abord la paix ; si on la refusait, elle se<br />
verrait réduite à l'imposer par les armes : « Je requérais<br />
premièrement qu'on fît la paix, et au cas où l'on ne<br />
voudrait pas faire la paix, j'étais toute prête à combattre.<br />
Quant à la paix, pour ce qui est du duc de Bourgogne,<br />
j'ai requis le duc de Bourgogne et (en m'adressant)<br />
à ses ambassadeurs, qu'il y eut paix. Quant aux Anglais,
60 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
la paix qu'il y faut, c'est qu'ils s'en aillent en leur pays,<br />
en Angleterre », répondait-elle, pendant son procès,<br />
aux fausses inculpations du réquisitoire (art. 25 et 18).<br />
A la fin de juin, au moment où l'armée se mettait<br />
en marche vers Reims, elle avait elle-même invité<br />
le duc de Bourgogne au sacre du Dauphin ; celui-ci<br />
n'avait ni répondu, ni renvoyé le héraut, porteur de<br />
la lettre ; mais mandé par le duc de Bedford, il s'était<br />
rendu à <strong>Paris</strong>, le 10 juillet, comme nous l'avons déjà<br />
vu, pour faire prêter aux habitants serment de fidélité<br />
; de là il s'était retiré à Laon. Toutefois, jouant<br />
déjà ce double jeu dont Charles VII sera dupe, et<br />
donnant tantôt aux Anglais, tantôt aux Français,<br />
des apparences de garantie, il avait envoyé au sacre<br />
du roi une ambassade, avec mission sans doute de<br />
pressentir la cour sur les conditions auxquelles la paix<br />
pourrait se conclure ; ne fallait-il pas prévoir le cas,<br />
où le roi de France étendrait ses conquêtes et redeviendrait<br />
le maître de la situation? Le jour même de<br />
la cérémonie, les trois seigneurs angevins écrivaient,<br />
dans une lettre que nous avons déjà citée : « On dît<br />
en cette ville (Reims) que le duc de Bourgogne y a<br />
été (à <strong>Paris</strong>) et s'en est retourné à Laon où il est à<br />
présent. Il a envoyé devers le roi une ambassade qui<br />
arriva hier (le samedi 16 juillet) en cette ville. A cette<br />
heure, nous espérons que bon traité s'y trouvera<br />
(fait) avant qu'ils partent ». Les pourparlers laissaient<br />
donc quelque espoir ; les ambassadeurs s'en retournèrent,<br />
emportant avec eux cette lettre de <strong>Jeanne</strong> :<br />
« † Jhésus Maria — Haut et redouté prince, duc<br />
de Bourgogne, Jehanne la Pucelle vous requiert de<br />
par le roi du ciel, mon droiturier et souverain Seigneur,<br />
que le roi de France et vous fassiez bonne paix ferme,<br />
qui dure longuement. Pardonnez l'un à l'autre de
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 61<br />
bon cœur, entièrement, ainsi que doivent faire loyaux<br />
chrétiens et, s'il vous plaît de guerroyer, allez sur les<br />
Sarrasins.<br />
« Prince de Bourgogne, je vous prie, supplie et<br />
requiers tant humblement que requérir vous puis,<br />
que vous ne guerroyez plus au saint royaume de<br />
France, et faites retirer incontinent et brièvement<br />
vos gens qui sont en aucunes places et forteresses<br />
dudit saint royaume. De la part du gentil roi de<br />
France, il est prêt de faire la paix avec vous, sauf<br />
son honneur ; cela ne tient qu'à vous.<br />
« Et je vous fais savoir de par le roi du ciel, mon<br />
droiturier et souverain Seigneur, pour votre bien et<br />
pour votre honneur et sur vos vies, que vous ne<br />
gagnerez point bataille à l'encontre des loyaux<br />
Français, et que tous ceux qui font la guerre audit<br />
saint royaume de France, font la guerre au roi Jhésus,<br />
roi du ciel et de tout le monde, mon droiturier et<br />
souverain Seigneur. Et je vous prie et requiers, à<br />
jointes mains, que nous ne fassiez nulle bataille, ni<br />
ne guerroyez contre nous, vous, vos gens ou sujets,<br />
et croyez sûrement que, quelque nombre de gens que<br />
vous ameniez contre vous, ils n'y gagneront rien, et<br />
ce sera gran pitié de la gran bataille et du sang qui<br />
y sera répandu de ceux qui y viendront contre nous.<br />
« Et il y a trois semaines que je vous avais écrit et<br />
envoyé bonnes lettres par un héraut, que vous fussiez<br />
au sacre du roi qui, aujourd'hui dimanche, 17 e jour<br />
de ce présent mois de juillet, se fait en la cité de<br />
Reims ; dont je n'ai point eu de réponse, ni ouï<br />
oncques depuis nouvelles dudit héraut.<br />
« A Dieu vous recommande, et qu'il soit garde de vous,<br />
s'il lui plaît, et prie Dieu qu'il y mette bonne paix.<br />
« Ecrit audit lieu de Reims, ledit 17 e jour de juillet. »
62 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Cependant, conduit par la Pucelle, le roi se met en<br />
marche sur <strong>Paris</strong> ; s'il s'empare de sa capitale, la<br />
situation du duc de Bourgogne en sera compromise ;<br />
vis-à-vis des Anglais, avec qui il a partie liée, celui-ci<br />
se trouvera en mauvaise posture ; vis-à-vis du roi, il<br />
sera, pour traiter, moins fort après qu'avant la conquête<br />
de cette ville. Philippe se résout alors à commencer<br />
les négociations ; les députés des deux partis entrent<br />
en conférence ; pendant ce temps, le roi se détourne<br />
du chemin de <strong>Paris</strong> et va résider à Provins (du 2 au<br />
5 août), prêt à se retirer sur la Loire, comme on l'a<br />
lu plus haut, si la paix se fait avec son cousin. « Il y<br />
eut — écrit l'auteur de la Chronique des Cordeliers,<br />
bourguignon déclaré — un conseil entre l'archevêque<br />
de Reims, le seigneur de La Trémoille, Poton et La<br />
Hire d'une part, et messire Jean de Luxembourg, les<br />
seigneurs de Croy et Lourdin de Saligny de l'autre ;<br />
mais, en conclusion, on n'en vint ni à une trêve ni à<br />
une paix. La journée fut tenue près de La Fère ».<br />
La paix ne fut pas conclue, c'est exact ; mais une<br />
trêve de quinze jours fut acceptée de part et d'autre,<br />
auquel terme le duc de Bourgogne promettait de<br />
remettre <strong>Paris</strong> au roi sans combat ; ainsi, sans l'intervention<br />
des armes, et par les seuls moyens de la<br />
diplomatie, Charles VII rentrerait en possession de<br />
la capitale de son royaume ; ce fut l'habileté de<br />
Philippe d'entretenir le roi et ses ineptes conseillers<br />
dans cette funeste illusion. <strong>Jeanne</strong> ne la partagea<br />
point, et c'est ce qui explique son désaccord avec la<br />
cour et plusieurs des capitaines.<br />
Cette trêve jeta les Rémois dans l'inquiétude,<br />
ainsi qu'il a été déjà dit. <strong>Jeanne</strong> leur répondit par une<br />
lettre datée du « 5 août, près d'un logis aux champs,<br />
au chemin de <strong>Paris</strong> :
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 63<br />
« Et est vrai que le roi a fait trêves au duc de Bourgogne<br />
quinze jours durant, par ainsi qu'il lui doit<br />
rendre la ville de <strong>Paris</strong> paisiblement au chef de quinze<br />
jours. Cependant ne vous donnez nulle merveille,<br />
si je n'y entre si brièvement (c'est-à-dire : point avant<br />
ce délai) combien que (quoique) des trêves qui ainsi,<br />
sont faites je ne suis point contente, et ne sais si je<br />
les tiendrai ; mais si je les tiens, ce sera seulement,<br />
pour garder l'honneur du roi ; encore qu'ils n'abuseront<br />
pas de nouveau le sang royal, car je tiendrai<br />
et maintiendrai ensemble l'armée du roi pour être<br />
prête au chef desdits quinze jours, s'ils ne font la<br />
paix ».<br />
Cette lettre est des plus instructives pour la suite<br />
des événements : le duc de Bourgogne promet de<br />
rendre <strong>Paris</strong> au roi, sans combat, à l'expiration des<br />
quinze jours de trêve. <strong>Jeanne</strong> est mécontente de cet<br />
arrangement ; ce qu'elle veut, c'est la paix, la réconciliation<br />
entre les deux cousins, et non une suspension.<br />
d'armes ; elle n'a point confiance que <strong>Paris</strong> soit<br />
rendu au roi dans ces conditions ; il lui paraît<br />
plutôt qu'on abuse de la crédulité du prince, qu'on<br />
abuse « le sang royal » ; s'il ne dépendait que d'elle,<br />
elle ne tiendrait pas compte d'une telle négociation,<br />
et de suite marcherait droit sur <strong>Paris</strong> ; mais l'honneur<br />
du roi exige qu'elle en respecte les clauses. Que les<br />
Rémois ne s'étonnent donc point de ne pas la voir<br />
entrer à <strong>Paris</strong> durant ces quinze jours ; mais qu'ils se<br />
rassurent ; elle ne permettra pas que le roi soit de<br />
nouveau victime d'une manœuvre du même genre ;<br />
qu'on abuse « de nouveau le sang royal » ; elle tiendra<br />
l'armée en mains et si, passés ces quinze jours, la<br />
paix n'est pas faite avec le duc de Bourgogne, elle ira<br />
mettre le siège <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>.
64 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Sa résolution était bien prise ; elle allait le faire<br />
comme elle venait de l'écrire.<br />
La trêve signée, mais non la paix, Charles VII<br />
remonte par Coulommiers, vers Compiègne, pour<br />
mieux continuer les négociations. Alarmé sans doute<br />
de ces tractations entre son allié et le roi, le duc<br />
de Bedford vient au <strong>devant</strong> de ce dernier pour lui<br />
fermer le chemin de <strong>Paris</strong> et lui offrir la bataille.<br />
Ni à Thieux, ni à Montépilloy, le combat ne put<br />
s'engager. Les Anglais s'étaient retranchés et attendaient<br />
que les Français les attaquassent ; mais l'armée<br />
royale fut maintenue sur l'expectative ; on ne voulait<br />
pas prendre l'initiative d'une lutte, dont l'issue était<br />
incertaine ; battu, le roi n'aurait plus été en situation<br />
de négocier utilement avec Philippe de Bourgogne<br />
qui, en cette occurrence, se fut retourné entièrement<br />
du côté des Anglais. D'ailleurs, les négociateurs<br />
étaient déjà en route et le 18 août, Charles VII allait<br />
à Compiègne attendre le résultat de ces nouvelles<br />
conférences.<br />
« Environ mi-août — dit la Chronique des Cordeliers<br />
— l'archevêque de Reims, chancelier dudit roi,<br />
et plusieurs autres ambassadeurs furent envoyés à<br />
Arras vers le duc de Bourgogne. Finalement des<br />
trêves furent conclues entre ces deux princes par<br />
l'entremise des ambassadeurs que le duc de Savoie<br />
avait envoyés vers eux afin d'y négocier le bien de<br />
la paix ». La paix fut bien près d'être conclue ; le duc<br />
de Bedford la fit échouer ; Monstrelet, protégé de<br />
l'un des négociateurs bourguignons, Jean de Luxembourg,<br />
va nous dire comment :<br />
« Les principaux de ces ambassadeurs (de<br />
Charles VII) étaient l'archevêque de Reims, Christophe<br />
de Harcourt, les seigneurs de Dampierre, de
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 65<br />
Gaucour et de Fontaines, chevaliers, avec d'autres<br />
gens d'état qui trouvèrent à Arras le duc et son<br />
conseil ». Ce fut Regnault de Chartres, chancelier<br />
de France et archevêque de Reims, qui « en présence<br />
de la chevalerie, du conseil et de plusieurs autres<br />
admis à cette audience » du duc, exposa l'objet de<br />
l'ambassade. « Il remontra, entre autres choses, la<br />
parfaite affection, le vrai désir du roi de faire la paix<br />
avec lui, et d'en venir à un traité ; ajoutant que, pour<br />
y parvenir, ce même roi était content de faire des<br />
avances et de condescendre, en faisant des offres de<br />
réparation plus qu'il n'appartenait à sa majesté<br />
royale. Il excusa le roi sur sa jeunesse de l'homicide<br />
perpétré autrefois en la personne de feu duc Jean<br />
de Bourgogne ». Ces considérations et d'autres furent<br />
favorablement écoutées par Philippe et les siens ;<br />
il promit de donner bientôt sa réponse. « Le duc de<br />
Bourgogne fut, durant plusieurs jours, en délibération<br />
avec son conseil privé ; et les affaires entre les parties<br />
furent très rapprochées ». Le traité était sur le point<br />
de se conclure, quand arrivèrent des messagers du<br />
régent anglais de France : « Maître Jean de Thoisey,<br />
évêque de Tournay, et messire Hue de Lannoy, qui<br />
venaient présentement de vers le duc de Bedford<br />
et étaient chargés par lui de faire des observations<br />
au duc de Bourgogne, de l'exhorter à tenir le serment<br />
fait au roi Henri, n'étaient pas bien contents que le<br />
traité se fit ; c'est sur leur parole que la conclusion<br />
fut retardée ». Il n'y eut pas alors d'accord arrêté ;<br />
mais il fut « convenu que le duc enverrait de son côté<br />
une ambassade vers le roi Charles pour avoir son avis<br />
et continuer les conférences ». Cette légation fut<br />
confiée « à messire Jean de Luxembourg, évêque<br />
d'Arras, à messire David de Brimeu et à d'autres
66 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
notables et discrètes personnes ». Les conférences<br />
allaient se poursuivre à Compiègne.<br />
La trêve de quinze jours était expirée et le duc<br />
de Bourgogne n'avait point rendu Pans au roi, comme<br />
il l'avait promis. Voyant les ambassadeurs de<br />
Charles VII revenir d'Arras, les mains vides, avec la<br />
perspective de nouveaux pourparlers, qui, à son sens,<br />
ne pouvaient aboutir, <strong>Jeanne</strong> résolut de demander<br />
aux armes ce que la diplomatie se montrait impuissante<br />
à procurer. Pour elle, il s'agissait, non de nouvelles<br />
trêves, mais de paix définitive, établie sur la<br />
réconciliation entre tes deux cousins ; les causes, qui<br />
avaient fait échouer cette dernière à Arras, se représenteraient<br />
les mêmes à Compiègne ; la duplicité<br />
du duc de Bourgogne devenait trop manifeste.<br />
<strong>Jeanne</strong> n'entendait pas que de nouveau, comme<br />
quinze jours auparavant, il « abusa du sang royal » ;<br />
ce dont elle venait d'être témoin l'avait pleinement<br />
convaincue qu'avec Philippe, on ne « trouverait<br />
point la paix, si ce n'est par le bout de la lance »<br />
(Procès, séance du 3 mars). Le 23 août, elle entraînait<br />
le duc d'Alençon et trois jours après elle commençait<br />
ses escarmouches contre la ville de <strong>Paris</strong>, prélude,<br />
dans ses desseins, d'une attaque décisive.<br />
Les ambassadeurs du duc de Bourgogne, arrivés<br />
à Compiègne, entrèrent en conférences avec les<br />
représentants du roi : René, duc de Bar, les comtes<br />
de Clermont et de Vendôme, le sire d'Albret, le<br />
chancelier-archevêque de Reims, l'évêque de Séez,<br />
le sire de La Trémoille, Christophe d'Harcourt,<br />
Dunois bâtard d'Orléans, les sires de Trèves, de<br />
Gaucourt, etc. Ainsi que <strong>Jeanne</strong> l'avait prévu, on<br />
ne put parvenir à signer un traité de paix ; on se<br />
contenta d'une nouvelle trêve de quatre mois, du
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 67<br />
28 août à la Noël. Cette trêve était désastreuse pour la<br />
cause royale et le parti français ; et par ses fallacieuses<br />
promesses Philippe réussissait une seconde fois — et<br />
ce ne devait pas être la dernière — à jouer le roi ;<br />
de nouveau il entravait sa marche sur <strong>Paris</strong> ; il se<br />
réservait le droit, ainsi qu'on l'a lu ci-dessus, de<br />
« s'employer à la défense de la ville de <strong>Paris</strong> », et de<br />
« résister à ceux qui voudraient faire la guerre ou<br />
porter dommage à cette ville », tandis que Charles VII,<br />
non seulement se laissait interdire toute action contre<br />
sa capitale, mais s'engageait à la rendre, dans le cas<br />
où elle serait prise indûment, en violation de la trêve.<br />
« Durant le temps de cette présente trêve — portait,<br />
en effet, cette convention — aucune des parties ne<br />
pourront dans les termes et limites ci-dessus désignées<br />
prendre, acquérir, conquérir l'une sur l'autre aucune<br />
des villes, places ou forteresses qui y sont comprises ;<br />
ils n'admettront l'obéissance d'aucune, au cas où ces<br />
villes, places ou forteresses voudraient se rendre à<br />
l'obéissance de l'une des parties » (Chronique des<br />
Cordeliers).<br />
Or, au moment où se signait ce contrat, <strong>Jeanne</strong> avait<br />
déjà, depuis deux ou trois jours, engagé ses opérations<br />
sur <strong>Paris</strong>. A son insu, elle allait à un échec certain ;<br />
elle était désavouée d'avance ; se fut-elle emparée de la<br />
ville, il aurait fallu, conformément aux clauses de la<br />
trêve, la rendre au duc de Bourgogne.<br />
Parmi les négociateurs de cette regrettable convention<br />
se trouvaient quelques-uns des capitaines qui<br />
devaient accompagner la Pucelle à l'attaque du<br />
8 septembre : le duc de Bar, les comtes de Clermont<br />
et de Vendôme, les sires d'Albret et de Gaucourt,<br />
ainsi que d'autres qui avaient négocié, près de La
68 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Fère, la précédente trève de quinze jours : Poton de<br />
Xaintrailles, Etienne Vignolles dit La Hire. Ainsi<br />
s'explique que, sachant l'inutilité de l'assaut, ils s'y<br />
soient d'abord opposés et aient contribué, une fois<br />
entrepris, à le faire échouer.<br />
Le duc de Bedford, inquiet sans doute d'une trêve<br />
qui, quelles qu'en fussent les conditions, suspendait<br />
momentanément les effets de l'alliance du parti<br />
bourguignon avec le parti anglais, et prévoyant que<br />
l'armée française, empêchée désormais d'opérer audessus<br />
de la Seine, allait vraisemblablement porter<br />
ses efforts vers la Basse-Normandie, quitta <strong>Paris</strong>, dès<br />
la fin d'août, et emmena son armée défendre cette<br />
province.<br />
Aussitôt, fort des clauses signées, le duc de Bourgogne<br />
envoyait quatre cents combattants et plusieurs<br />
gentilshommes, dont le maréchal de l'Isle-Adam,<br />
garder <strong>Paris</strong>, ainsi qu'il a déjà été dit. Quand il apprit<br />
que les troupes royales conduites par la Pucelle<br />
mettaient le siège <strong>devant</strong> cette ville, il s'empressa de<br />
rappeler à Charles VII ses engagements ; il était<br />
prêt à tenir les siens ; encore fallait-il que le roi ne<br />
violât pas ceux qu'il avait pris et qu'en conséquence<br />
il fit cesser cette opération. Charles VII dut s'exécuter<br />
: « Et aussi on disait que M. de Bourgogne avait<br />
envoyé un héraut devers ledit Charles en disant qu'il<br />
tiendrait l'appointement (la convention) qu'il avait<br />
fait avec le même Charles, et qu'il cessât lui et ses<br />
gens, — rapporte le notaire Pierre Cochon. — S'il<br />
y avait appointement entre eux, ni quel il était, je n'en<br />
saurais parler, mais toutefois il y eut trêves jusqu'à<br />
la Noël qui suivit. Charles fit ainsi sonner la retraite<br />
durant ledit assaut et ainsi ils se retirèrent ».
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 69<br />
* *<br />
Ces négociations et cette convention font comprendre<br />
la mauvaise grâce avec laquelle Charles VII avait<br />
répondu aux appels de la Pucelle et du duc d'Alençon ;<br />
sa répugnance à quitter Compiègne, à se rendre à<br />
Senlis, puis à Saint-Denis ; son inaction pendant<br />
l'attaque de <strong>Paris</strong> ; son empressement, après l'échec,<br />
à rappeler <strong>Jeanne</strong> auprès de lui ; les compliments<br />
pleins d'ironie avec lesquels celle-ci fut accueillie ;<br />
la hâte du roi à faire rompre le pont jeté sur la Seine,<br />
pour empêcher la reprise de l'opération.<br />
On s'explique moins qu'il n'ait pas usé de son autorité<br />
de souverain pour interdire, dès le 28 août, à<br />
<strong>Jeanne</strong> et au duc d'Alençon toute action contre sa<br />
capitale. La vérité, c'est qu'il ne gouvernait guère<br />
alors, mais était sous la domination de quelques<br />
conseillers, probablement assez satisfaits de voir la<br />
Pucelle engagée dans une affaire qui, quelle qu'en fût<br />
l'issue, ne pouvait que porter atteinte à son prestige.<br />
Parmi les mauvais conseillers qui contribuèrent le<br />
plus à d'aussi fâcheux événements, il faut mentionner<br />
deux des plus mal disposés à l'égard de <strong>Jeanne</strong> : le<br />
sire de la Trémoille et le chancelier de France, archevêque<br />
de Reims, Regnault de Chartres. Leur stupide<br />
diplomatie avait simplement abouti à ceci : <strong>Paris</strong><br />
était perdu pour le roi ; toute action armée contre<br />
cette ville était désormais interdite ; en échange on<br />
n'avait même pas ce pourquoi on négociait : un traité<br />
de paix ; l'habile Philippe avait réussi à l'éluder (1).<br />
(1) Par la suite, le duc de Bourgogne continua à jouer double<br />
jeu et à duper Charles VII. Le roi « pensait avoir accord avec le<br />
duc de Bourgogne, rapporte Gilles le Bouvier. Le duc de Bour-
70 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Au dire de divers chroniqueurs, le sire Georges de<br />
la Trémoille a une responsabilité évidente dans<br />
l'échec de <strong>Jeanne</strong>. C'était un bandit : brigand et<br />
meurtrier. D'abord bourguignon et favori de Jean<br />
sans Peur, il était passé au parti français, sans<br />
rompre avec ses anciens amis. Il avait épousé <strong>Jeanne</strong><br />
de Bourgogne, veuve du duc de Berry, de dix ans plus<br />
âgée que lui, s'était emparé de ses biens et l'avait<br />
reléguée loin de lui, où il la laissa végéter et mourir<br />
dans la gêne. On le soupçonne d'avoir participé à<br />
l'assassinat du premier chambellan du Dauphin,<br />
le sire de Giac, dont il épousa la veuve, environ cinq<br />
gogne lui avait mandé par le sire de Chagny, qui lui en avait<br />
porté les nouvelles, qu'il lui ferait avoir <strong>Paris</strong> et qu'il viendrait<br />
à <strong>Paris</strong> pour parler à ceux qui tenaient son parti ». Le Journal<br />
du siège d'Orléans, qui relate le même fait, ajoute : « A cette occasion<br />
le roi lui avait envoyé un sauf-conduit, pour qu'il pût passer<br />
sans contredit par les places et passages lui obéissant ; ainsi le<br />
fit-il ; mais arrivé à <strong>Paris</strong>, il ne tint rien de ce qu'il avait promis ;<br />
au contraire, il fit, à l'encontre du roi, avec le duc de Bedford, une<br />
alliance plus étroite qu'auparavant ; et, ce nonobstant, en vertu<br />
du sauf-conduit, il repassa sûrement et ouvertement par tous les<br />
pays, villes et passages de l'obéissance du roi, et il s'en retourna<br />
en ses pays de Picardie et de Flandre ». Cependant Charles VII<br />
attendait vainement à Gien, du 21 au 25 septembre, que Philippe<br />
lui donnât avis que <strong>Paris</strong> lui était rendu. Quelques jours après,<br />
le 13 octobre, le régent de Bedford nommait Philippe gouverneur<br />
de <strong>Paris</strong> et de l'Ile-de-France ; c'était une odieuse fourberie ;<br />
comme duc de Bourgogne, Philippe devait observer la trêve ;<br />
mais comme gouverneur « anglais » de l'Ile-deFrance, il n'avait<br />
nul compte à en tenir, puisque les Anglais s'étaient refusés à la<br />
contresigner ; malgré cela, Charles VII consentait à la prolongation<br />
de la trêve jusqu'à Pâques et s'engageait, durant ce temps,<br />
à « se tenir au delà de la rivière de la Seine ; ce qu'il fit ». (Chronique<br />
des Cordeliers.) Il était vraiment bien servi par son chancelier,<br />
Regnault de Chartres, le négociateur principal de toutes ces<br />
conventions !
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 71<br />
mois après. Le connétable de Richemont le présenta<br />
au Dauphin comme favori ; il ne pouvait plus mal<br />
choisir. La Trémoille, une fois bien en cour, se<br />
retourna contre Richemont et le brouilla avec<br />
Charles VII. Le roi était sans argent ; La Trémoille<br />
se constitua son argentier, mais avec usure ; il faisait<br />
des avances avec intérêt du quart ou du tiers par<br />
semestre. Grâce à son frère, le sire de Jonvelle, premier<br />
chambellan du duc de Bourgogne, ses biens, à Sully<br />
comme à <strong>Paris</strong>, étaient épargnés tant par les Anglais que<br />
par les Bourguignons. Le sire d'Albret, que nous<br />
avons vu prendre part aux négociations de la trêve<br />
et au siège de <strong>Paris</strong>, était son frère utérin.<br />
<strong>Jeanne</strong> rencontra en La Trémoille un adversaire<br />
constant et un adversaire puissant. En réalité, c'est lui<br />
qui régnait près de Charles VII. « A cette époque le sire<br />
de La Trémoille — écrit Jean Chartier — était auprès<br />
du roi de France, et l'on disait qu'il entrait trop avant<br />
dans le gouvernement du roi ». — « Il avait — dit<br />
également Cagny — seul et pour le tout, le gouvernement<br />
du corps du roi, de toutes ses finances, et<br />
des forteresses de son domaine estant en son obéissance<br />
». Gilles de Roye, la Chronique de la Pucelle<br />
s'expriment de même. C'est en vain que la Pucelle<br />
demanda au Dauphin de recevoir en grâce le connétable<br />
de Richemont qui, spontanément, avait levé<br />
1.500 combattants et pris part à la victoire de Patay ;<br />
La Trémoille ne le permit pas ; les grands en étaient<br />
contrariés : « Toutefois, ils n'en osaient parler, parce<br />
qu'ils voyaient que le roi faisait du tout en tout ce<br />
qu'il plaisait à ce seigneur de La Trémoille ; ce fut<br />
pour lui plaire qu'il ne voulut pas souffrir que le<br />
connétable vint devers lui » (Journal du siège d'Orléans).<br />
Il lit encore repousser d'autres concours qui s'of-
72 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
fraient : « Par le moyen de <strong>Jeanne</strong> la Pucelle, tant de<br />
gens venaient de toutes parts pour servir le roi, et à<br />
leurs dépens, que de La Trémoille et d'autres seigneurs<br />
du conseil étaient bien courroucés d'une telle<br />
multitude. Si le susdit de La Trémoille et d'autres du<br />
conseil avaient voulu recevoir tous ceux qui venaient<br />
au service du roi, on aurait pu aisément recouvrer<br />
tout ce que les Anglais occupaient au royaume de<br />
France ; mais on n'osait pas alors parler contre ledit<br />
de La Trémoille, quoique chacun vit clairement que<br />
de lui venait la faute » (Jean Chartier). A Auxerre,<br />
il fait encore échouer les projets de <strong>Jeanne</strong>. Le Dauphin<br />
marchait sur Reims. Auxerre lui ferme ses<br />
portes. La Pucelle veut que le roi y fasse son entrée ;<br />
aussi est-elle prête à donner l'assaut. Intervient<br />
La Trémoille ; il se fait secrètement octroyer par la<br />
ville douze mille écus, moyennant quoi il dispense les<br />
Auxerrois de faire leur soumission à Charles VII,<br />
« ce dont la Pucelle et les capitaines firent de grandes<br />
plaintes » (Gilles de Roye). C'est encore lui qui prit<br />
l'initiative de faire lever le siège de <strong>Paris</strong>, de rappeler<br />
de La Chapelle à Saint-Denis la Pucelle et ses troupes.<br />
<strong>Paris</strong> allait être pris, « mais il y fut avisé par un<br />
nommé messire de La Trémoille » (Pierre Cochon) ;<br />
« mais un sire appelé de La Trémouille, qui gouvernait<br />
le roi, dérangea icelle chose » (Doyen de S. Thibaud) ;<br />
« mais le sire de La Trémoille fit retourner les gens<br />
d'armes à Saint-Denis » (Gilles le Bouvier).<br />
Par la suite il continuera son opposition à La Pucelle,<br />
l'empêchera de rejoindre le duc d'Alençon et de<br />
reformer une armée. Il s'adjugera la capitainerie de<br />
Compiègne et prendra comme lieutenant Guillaume<br />
de Flavy, celui qui fera fermer les portes de la ville<br />
et sera cause — volontaire, suivant quelques chro-
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 73<br />
niqueurs (1) — de la prise de la Pucelle. Aussi<br />
certains en feront-ils rejaillir jusqu'à lui la responsabilité<br />
: « Un sire appelé de La Trémouille — écrit le<br />
Doyen de Saint-Thibaud — jaloux des faits qu'elle<br />
faisait, fut coupable de sa prise ». La Chronique de<br />
Tournay et la Chronique Morosini iront plus loin<br />
encore et laisseront entendre que si les Anglais brûlèrent<br />
<strong>Jeanne</strong>, c'est parce qu'ils avaient été secondés<br />
par « la faveur dont quelques-uns du conseil du roi<br />
jouissaient auprès de Philippe de Bourgogne et de<br />
messire Jean de Luxembourg » ; ce qui semble bien<br />
viser La Trémoille et peut-être aussi Regnault de<br />
Chartres.<br />
Chancelier de France, archevêque de Reims,<br />
Regnault de Chartres fut l'homme de la diplomatie,<br />
un personnage plus politique qu'ecclésiastique, il<br />
serait injuste de le placer au même rang que l'odieux<br />
La Trémoille ; mais, vis-à-vis de <strong>Jeanne</strong>, sa conduite<br />
est loin d'échapper à tout blâme. Il l'a examinée et<br />
interrogée à Chinon, a présidé la commission de<br />
Poitiers, fait sienne par conséquent la déclaration des<br />
docteurs favorable à la Pucelle. Au début, il se montre<br />
donc plutôt bien disposé ; mais peu à peu ses sentiments<br />
se modifient. Devant Troyes, lors de la marche<br />
sur Reims, il est d'avis, vu le dénûment de l'armée en<br />
vivres et en argent et la puissance de l'ennemi, de<br />
rétrograder vers Gien. <strong>Jeanne</strong> s'y oppose et assure<br />
que la ville se rendra dans deux ou trois jours ; le<br />
« chancelier lui répond : « <strong>Jeanne</strong>, qui serait certain<br />
de l'avoir (Troyes) dans six jours, on attendrait bien ;<br />
mais je ne sais si c'est vrai ce que vous dites » (Chro-<br />
(1) Mathieu Thomassin, Chronique de Normandie, l'Abbréviateur<br />
du procès, Alain Bouchard, Jean Bouchet.
74 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
nique de la Pucelle). Il n'avait plus foi en elle. Après<br />
le sacre, il oppose sa diplomatie aux projets de <strong>Jeanne</strong> ;<br />
c'est lui qui mène toutes les négociations avec le duc<br />
de Bourgogne ; en ses propres capacités et moyens<br />
diplomatiques, il a plus confiance que dans la mission<br />
de la Pucelle, qu'il contrarie ouvertement ; mais sa<br />
diplomatie est trop courte et Philippe de Bourgogne<br />
trop avisé ; il se laisse duper et ne paraît pas s'en apercevoir,<br />
tellement il met de ténacité à recourir aux<br />
mêmes procédés stériles ; au lieu de paix, il n'obtient<br />
près de La Fère qu'une trêve de quinze jours et une<br />
vague promesse que <strong>Paris</strong> sera rendu ; d'Arras, il ne<br />
rapporte que l'assurance de la prolongation des<br />
conférences ; à Compiègne il aboutit à perdre <strong>Paris</strong>.<br />
Le résultat de ses agitations fut que l'armée du roi<br />
dût se retirer sur la Loire ; que là les troupes se<br />
disloquèrent d'elles-mêmes, mécontentes que le<br />
siège de <strong>Paris</strong> fut levé et que les trêves les condamnassent<br />
à l'inaction ; et qu'il fallut les licencier.<br />
« Ainsy fut aussi rompue l'armée du roy » note<br />
Cagny. « L'histoire n'a rien à dissimuler, écrit le<br />
P. Ayroles. Elle a le regret de dire que l'âme de cette<br />
louche diplomatie fut l'archevêque-chancelier Regnaut<br />
de Chartres » (IV, p. 437). C'est lui qui, à la<br />
mission divine de <strong>Jeanne</strong>, a opposé les négociations<br />
fallacieuses, les conférences interminables, les trêves<br />
illusoires ; ce sont ses manœuvres qui ont interrompu<br />
les succès de la Pucelle et brisé son armée ; qui l'ont<br />
fait échouer <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> et ont prolongé la guerre<br />
près de 25 ans ; c'est lui qui, <strong>devant</strong> l'histoire, porte,<br />
avec le roi, l'effrayante responsabilité d'avoir entravé<br />
l'intervention céleste.<br />
Doit-on relever contre lui, comme contre La<br />
Trémoille, certaines vagues insinuations de quelques
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 75<br />
chroniqueurs ? Rien n'y autorise d'une manière formelle.<br />
Tout ce que l'on sait, c'est qu'il continua à se<br />
montrer défavorable à la Pucelle ; qu'avec La Trémoille<br />
il s'opposa à ce qu'elle rejoignit le duc d'Alençon,<br />
quand celui-ci, après le licenciement de l'armée à<br />
Gien, assembla des troupes pour entrer en Normandie ;<br />
que Guillaume de Flavy, lieutenant de La Trémoille<br />
à Compiègne — quand <strong>Jeanne</strong> y fut faite prisonnière<br />
— était son parent (1) et son protégé, en même temps<br />
qu'un des monstres féodaux les plus réussis de cette<br />
époque ; que l'on possède de l'archevêque le résumé<br />
d'une de ses lettres à ses diocésains qui, si ses allégations<br />
étaient exactes, serait pour <strong>Jeanne</strong> la plus<br />
accablante des accusations : par orgueil, elle serait<br />
devenue infidèle à sa mission, l'aurait fait échouer<br />
et Dieu, alors, l'aurait abandonnée :<br />
« Il (l'archevêque) donne pareillement avis — relate<br />
Jean Rogier, échevin de Reims — de la prise de<br />
<strong>Jeanne</strong> la Pucelle <strong>devant</strong> Compiègne, et comme elle<br />
ne voulait croire conseil, mais faisait tout à son<br />
plaisir ». Et, ayant conscience peut-être de l'énormité<br />
qu'il va avancer et pour ne pas paraître la prendre<br />
à son compte — mais le trait perfide n'en est pas<br />
moins lancé — l'archevêque rapporte les prétendues<br />
révélations d'un jeune pasteur du Gévaudan : « il<br />
répondait que Dieu avait souffert être prise <strong>Jeanne</strong><br />
la Pucelle, pour ce qu'elle s'était constituée en orgueil,<br />
et pour les riches habits qu'elle avait pris, et qu'elle<br />
n'avait pas fait ce que Dieu lui avait commandé,<br />
mais avait fait sa volonté » (2).<br />
(1) Son demi-frère, par sa mère Blanche de Nesle.<br />
(2) Il est assez significatif que le chancelier-archevêque se<br />
fasse ainsi l'écho de la cour royale d'Angleterre ; il reproduit le
76 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Quel motif pouvait bien avoir le chancelier de<br />
rejeter sur <strong>Jeanne</strong> l'échec apparent de sa mission?<br />
Il en était le principal responsable ; mais pourquoi<br />
se justifier <strong>devant</strong> ses diocésains, qui ne pouvaient<br />
soupçonner combien sa diplomatie avait été lamentable<br />
? Tenter d'expliquer le dernier supplice de la<br />
Pucelle en invoquant un châtiment providentiel,<br />
n'était-ce pas essayer de détourner l'attention de<br />
circonstances, que le chancelier ne désirait pas que<br />
les Rémois, amis de <strong>Jeanne</strong>, connussent trop en<br />
détail? Quel intérêt avait-il à ce qu'ils les ignorassent?<br />
* *<br />
Tel fut l'échec et telles ses causes, militaires, psychologiques<br />
et politiques, d'après les documents qui<br />
nous ont été conservés.<br />
Tandis qu'à La Chapelle, on élève une église à<br />
<strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> pour perpétuer le souvenir de son<br />
séjour en ce lieu, du 7 au 9 septembre ; dans le quartier<br />
Saint-Honoré rien ne rappelle son passage et son<br />
assaut, si ce n'est la belle statue équestre de Frémiet,<br />
place des Pyramides ; mais on se tromperait en localisant<br />
sur cette place l'attaque de <strong>Jeanne</strong> et le lieu de<br />
sa blessure. On sait, à quelques mètres près, l'endroit<br />
où elle fut frappée.<br />
En mars 1866, on mit à jour, en pratiquant des<br />
travaux d'égout, une partie des substructions de la<br />
porte Saint-Honoré ; on put alors s'assurer qu'elle<br />
même grief exposé dans la Lettre du 8 juin, envoyée par le roi<br />
d'Angleterre, aux rois de la chrétienté, pour justifier la condamnation<br />
de <strong>Jeanne</strong>. Une telle attitude paraît étrange et fait naître<br />
bien des soupçons. Voir infra p. 176.
BOULET DE PIERRE ET GROSSE BOMBARDE EN BRONZE<br />
AUX ARMES DE PlERRE D'AUBUSSON,<br />
GRAND-MAÎTRE DES HOSPITALIERS DE JÉRUSALEM, 1480.<br />
Poids : 3.325 kg. -— Diamètre de l'âme : 0 m. 58.<br />
Longueur de la bouche à feu : 1 m. 95.<br />
Le projectile en granit a 0 m. 568 de diamètre et pèse 261 kg.<br />
(Musée des Invalides.)
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 77<br />
mentirait 18 m ,50 sur 8 m ,34 ; la première de ces<br />
dimensions ne put cependant être exactement précisée,<br />
la moitié méridionale de l'édifice étant détruite,<br />
et le parement du mur septentrional engagé dans des<br />
caves ayant été précédemment entamé. La muraille,<br />
du côté de la ville avait une épaisseur de 1 m , 18 et<br />
celle, du côté du fossé, de 3 m. 60. On découvrit<br />
également à cet emplacement deux boulets de pierre,<br />
recueillis dans les remblais et paraissant provenir de<br />
l'attaque de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; l'un avait 0,175 de diamètre<br />
et l'autre seulement 0,083 ; tous deux avaient été<br />
fortement endommagés par leur choc contre les fortifications<br />
(BONNARDOT, Dissertation archéologique sur<br />
les anciennes enceintes de <strong>Paris</strong> ; appendice).(1)<br />
Quand, en 1912 et 1913, on fit, en vue de la construction<br />
de la ligne 7 du métropolitain, de nouvelles<br />
fouilles sous l'avenue de l'Opéra et la place du Théâtre-<br />
Français, on retrouva des vestiges du mur d'enceinte<br />
de Charles V, aux abords de l'ancienne porte Saint-<br />
Honoré. Connaissant la largeur du fossé, dont l'eau<br />
baignait le rempart — 16 toises, c'est-à-dire environ<br />
32 mètres — on put fixer l'endroit où courait le dos<br />
d'âne. Il ne restait plus qu'à prendre la direction de<br />
l'ancien « Marché aux pourceaux », place d'armes de la<br />
Pucelle, pour connaître approximativement le point<br />
du dos d'âne où <strong>Jeanne</strong> avait été blessée ; c'était à<br />
environ 60 mètres de la porte Saint-Honoré.<br />
M. Charles Magne, inspecteur des fouilles archéologiques,<br />
a précisé ce lieu en ces termes, dans le<br />
rapport qu'il présenta, en 1914, au nom de la 2 e souscommission<br />
:<br />
(1) Malgré nos recherches, nous n'avons pu découvrir où sont<br />
actuellement conservés ces deux boulets de pierre.
78 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
« D'après nos calculs, le lieu où fut blessée <strong>Jeanne</strong><br />
se trouverait ainsi déterminé par l'emplacement<br />
qu'occupe le numéro 2 de l'avenue de l'Opéra et<br />
par le trottoir qui s'étend <strong>devant</strong> cet immeuble »<br />
(Commission municipale du Vieux-<strong>Paris</strong>. Procès<br />
verbaux ; année 1914, p. 18).<br />
Il serait à souhaiter qu'en cet endroit, quelque<br />
indication rappelât au passant que là fut blessée la<br />
plus grande héroïne de notre histoire (1).<br />
(1) Le regretté Maurice BARRÈS avait favorablement accueilli<br />
ce projet. Le 4 octobre 1923, de Charmes il écrivait :<br />
« C'est une belle idée que vous avez de poser cette indication,<br />
cette pierre de mémoire, cette inscription pour servir de mémorial<br />
au passant, et je vous remercie de vouloir bien m'associer à cette<br />
initiative. Si vous avez une liste de souscription, je serai heureux<br />
de m'y inscrire et, l'heure venue, de signaler au public cette<br />
précision que vous lui donnez sur la sainte. »
SUR LES TRACES DE JEANNE<br />
D'ARC 1<br />
Pendant près de quinze jours, <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> a fait<br />
des escarmouches <strong>devant</strong> les murs de <strong>Paris</strong>. On peut<br />
relever avec certitude quelques-uns des endroits où<br />
sa présence est signalée, et présumer quelques autres<br />
où il est vraisemblable qu'elle a passé.<br />
C'est le 25 ou le 26 août 1429 (2) que, partis de<br />
Compiègne, <strong>Jeanne</strong> et le duc d'Alençon arrivèrent<br />
à Saint-Denis. « Le lendemain, ils couraient jusqu'aux<br />
portes de <strong>Paris</strong> (3). » Après l'échec du 8 septembre, ils<br />
retournèrent à Saint-Denis, le 9 du même mois.<br />
Entre ces deux dates, il y eut quotidiennement <strong>devant</strong><br />
<strong>Paris</strong> des engagements et « plusieurs beaux faits<br />
d'armes (4). » Perceval de Cagny, l'écuyer du duc<br />
d'Alençon, dit notamment : « Depuis que la Pucelle<br />
fut arrivée à Saint-Denis, deux ou trois fois par jour,<br />
nos gens étaient à l'escarmouche aux portes de <strong>Paris</strong>,<br />
tantôt en un lieu, tantôt en un autre, parfois au moulin<br />
à vent devers (entre) la porte Saint-Denis et La Cha-<br />
(1) Article publié dans la Semaine religieuse de <strong>Paris</strong>, n° du<br />
8 septembre 1923, pp. 306-311.<br />
(2) La première date est donnée par le Journal d'un Bourgeois de<br />
<strong>Paris</strong> ; la seconde par l'écuyer du duc d'Alençon, Perceval de<br />
Cagny.<br />
(3) Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>.<br />
(4) Journal du siège d'Orléans.
80 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
pelle. Il ne se passait pas de jour que la Pucelle ne<br />
vînt faire les escarmouches ; elle se plaisait beaucoup<br />
à considérer la situation de la ville et par quel endroit<br />
il lui semblerait convenable de donner un assaut. Le<br />
duc d'Alençon était le plus souvent avec elle. »<br />
* *<br />
Rien n'indique que <strong>Jeanne</strong> ait fait quelque incursion<br />
sur la rive gauche de la Seine ; ce n'est qu'après<br />
l'insuccès à la porte Saint-Honoré, que l'on songea<br />
à se porter de ce côté. Le 10 septembre au matin,<br />
la Pucelle, le duc d'Alençon et quelques autres capitaines<br />
se proposaient de réaliser ce projet, en passant<br />
la Seine sur le pont qu'ils avaient fait jeter, quelques<br />
jours auparavant, vis-à-vis de Saint-Denis, quand ils<br />
s'aperçurcnt que, durant la nuit, par ordre de<br />
Charles VII, le pont avait été détruit ; « et ils furent<br />
ainsi empêchés de passer (1) ».<br />
Pour « considérer la situation de la ville et par quel<br />
endroit il lui semblerait convenable de donner un<br />
assaut », <strong>Jeanne</strong> aura cherché ses postes d'observation<br />
vers les hauteurs de la rive droite.<br />
Sur la route qu'elle suivait fréquemment, « la<br />
chaussée pavée de Monseigneur saint Denys », se<br />
trouvait un plateau descendant, par une pente légère,<br />
du bourg de La Chapelle jusqu'au boulevard actuel<br />
de La Chapelle. De ce plateau, elle pouvait examiner<br />
les portes Saint-Denis, Saint-Martin et leurs environs.<br />
Montmartre, sur l'un des chemins qu'elle parcou-<br />
(1) Perceval de Cagny.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 81<br />
rait en venant de Saint-Denis et où elle fit cantonner<br />
une partie de ses troupes, était le meilleur des observatoires.<br />
Du haut de la colline, on distinguait le mur<br />
d'enceinte, ses portes, ses bastilles, ses tours, ses<br />
fossés, ses défenses extérieures et même quelque peu<br />
l'intérieur de la ville. On aime à penser que <strong>Jeanne</strong>,<br />
dont la dévotion est si formellement attestée par les<br />
témoins du procès de réhabilitation, a pu s'arrêter,<br />
avant ou après son examen stratégique des remparts,<br />
dans la vieille abbaye des Bénédictines et prier en<br />
cette antique église Saint-Pierre de Montmartre,<br />
consacrée par le pape Eugène III, Pierre le Vénérable,<br />
remplissant les fonctions de diacre et saint Bernard<br />
celles de sous-diacre.<br />
Si elle a passé par Aubervilliers, où quelques<br />
contingents de son armée étaient logés, elle aura suivi<br />
« le chemin d'Aubervilliers », aujourd'hui rue d'Aubervilliers,<br />
conduisant de ce village vers <strong>Paris</strong>, par le<br />
flanc de la colline de la Villette.<br />
Peut-être a-t-elle été aussi jusqu'au plateau de<br />
Monceau, où, rapporte Martial d'Auvergne, était<br />
campée une fraction des troupes qui vinrent à l'assaut<br />
« du 8 septembre ; de là elle apercevait sans doute la<br />
massive bâtisse de la porte Saint-Honoré.<br />
* *<br />
Les actions quotidiennes, préparatoires à l'attaque<br />
décisive, avaient lieu, dit le chroniqueur, « aux portes<br />
de <strong>Paris</strong>, tantôt en un lieu, tantôt en un autre ».<br />
Sur la rive droite, les portes de l'enceinte Caroline,<br />
véritables bastions fortifiés, étaient au nombre de<br />
six : la porte Saint-Antoine (place de la Bastille) ;
82 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
celle du Temple (à l'intersection actuelle de la rue<br />
et du boulevard du Temple) ; celles de Saint-Martin<br />
et de Saint-Denis (toutes deux à peu près à l'endroit<br />
actuel) ; celle de Montmartre (un peu au sud du<br />
point où la rue Montmartre traverse la rue d'Aboukir),<br />
et celle de Saint-Honoré (presqu'au lieu où la<br />
rue Saint-Honoré rencontre, à l'ouest, la place du<br />
Théâtre-Français).<br />
<strong>Jeanne</strong> a-t-elle fait quelque tentative du côté des<br />
portes du Temple et de Saint-Antoine ? Rien ne le<br />
dit, si ce n'est la vague allusion de Perceval de Cagny ;<br />
« aux portes de <strong>Paris</strong>, tantôt en un lieu, tantôt en un<br />
autre. » On ne peut le savoir ; il est cependant permis<br />
de supposer qu'elle a dû faire quelque excursion dans<br />
leurs parages, afin d'y examiner l'état du rempart<br />
et de supputer les chances de succès d'une attaque<br />
dirigée de ces côtés,<br />
« La vigile de saint Laurent, la porte Saint-Martin<br />
fut fermée », écrit le Bourgeois de <strong>Paris</strong>, qui mentionne<br />
les mesures prises pour la défense de la ville. <strong>Jeanne</strong>,<br />
l'ayant constaté, dut renoncer à la prendre ; il était<br />
plus indiqué de s'emparer d'une porte ouverte, dont<br />
on n'aurait qu'à abaisser le pont-levis pour donner<br />
accès à ceux des assiégeants n'ayant pas pris part à<br />
l'escalade du rempart.<br />
Du haut de Montmartre, <strong>Jeanne</strong> put remarquer que<br />
la porte de Montmartre, située dans le bas-fond<br />
de la vallée, non loin du ruisseau de Ménilmontant,<br />
paraissait moins accessible que celles de Saint-Denis<br />
et de Saint-Honoré ; <strong>devant</strong> cette porte s'étendaient<br />
les marais, peu favorables aux mouvements de troupes<br />
et au charroi de tout un matériel d'assaut ; dans son<br />
voisinage immédiat, il n'y avait nulle butte où placer<br />
l'artillerie qui devait battre le rempart ; un unique
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 83<br />
chemin, descendant de la colline des Martyrs, y<br />
accédait, franchissant, il est vrai, le ruisseau sur un<br />
pont de pierre ; mais le même avantage se retrouvait<br />
<strong>devant</strong> la porte Saint-Honoré (1).<br />
* *<br />
<strong>Jeanne</strong> a-t-elle attaqué la porte Saint-Denis? C'est<br />
assez probable ; une armée, descendant à <strong>Paris</strong> par<br />
la route pavée de Monseigneur-saint-Denys, rencontrait<br />
cette porte <strong>devant</strong> elle ; là surtout devait se<br />
prévoir l'attaque ; aussi était-elle bien gardée, si<br />
bien gardée que l'assiégé y avait concentré sa plus<br />
grosse artillerie ; « Ceux de <strong>Paris</strong>, relate le Bourgeois<br />
de <strong>Paris</strong>, avaient de grands canons qui, largement,<br />
atteignaient de la porte Saint-Denis jusqu'au delà<br />
de Saint-Lazare. »<br />
Le 7 septembre, le roi, vers le milieu de la journée,<br />
à l'heure du repas, étant enfin arrivé à Saint-Denis,<br />
<strong>Jeanne</strong> et les capitaines vinrent établir leur quartier<br />
général à La Chapelle. Dans un article intéressant et<br />
bien documenté (2), M. Ch. Gailly de Taurines a<br />
rappelé comment <strong>Jeanne</strong> avait occupé, du 7 au 9 septembre,<br />
le « logis de sainte Geneviève », au chevet de<br />
l'église actuelle de Saint-Denys de la Chapelle.<br />
Ce mercredi 7 septembre, l'armée royale entreprit<br />
contre <strong>Paris</strong> une action assez vive : « La vigile de la<br />
Nativité de Notre-Dame, en septembre, écrit le<br />
(1) En 1411, raconte le Bourgeois de <strong>Paris</strong>, toutes les portes<br />
avaient été fermées, murées « à plâtre », sauf, sur la rive droite,<br />
celles de Saint-Denis, Saint-Antoine et Saint-Honoré. La porte<br />
Montmartre ne fut rouverte qu'en septembre 1425.<br />
(2) Revue des Deux-Mondes, 15 avril 1923.
84 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Bourgeois de <strong>Paris</strong>, les Armagnacs vinrent assaillir<br />
les murs de <strong>Paris</strong> qu'ils croyaient emporter d'assaut. »<br />
Les Registres du Chapitre de Notre-Dame notent aussi<br />
que ce fut une « attaque contre la ville », dans le<br />
but de la prendre ; qu'elle se prolongea jusqu'au soir ;<br />
que l'alerte fut si grande dans la cité, qu'on fit « une<br />
procession solennelle à sainte Geneviève sur la montagne,<br />
pour obtenir la cessation de l'attaque ». Toutefois,<br />
ces rédacteurs ne nous fournissent aucune<br />
indication sur le point du rempart où fut dirigée<br />
cette opération ; mais Martial d'Auvergne rapporte<br />
que, la veille de l'affaire de la porte Samt-Honoré,<br />
c'est-à-dire le 7 septembre, <strong>Jeanne</strong> conduisit son<br />
armée de La Chapelle « au moulin à vent où y<br />
eust escarmouche belle » ; Perceval de Cagny dit<br />
aussi qu'il y eut « escarmouche aux portes de <strong>Paris</strong>...<br />
parfois au moulin à vent, entre la porte Saint-Denis<br />
et La Chapelle (1) ».<br />
Une vive tentative d'assaut pour prendre la ville,<br />
près d'un moulin à vent situé entre La Chapelle et<br />
la porte Saint-Denis, et durant jusqu'au soir : voilà<br />
les renseignements fournis par les documents de<br />
(1) La Chronique des Cordeliers relate « une de ces attaques,<br />
près de Saint-Laurent » ; il semble bien qu'il s'agit de celle du<br />
7 septembre ; elle aurait donc eu lieu du côté de la porte Saint-<br />
Martin ; mais le récit de cette Chronique, au sujet de cet épisode,<br />
est rempli d'erreurs. Elle dit que « le duc d'Alençon et la Pucelle<br />
furent repoussés et battus » ; ce qui est inexact, puisque ce fut la<br />
nuit qui interrompit l'opération ; elle parle de « six à sept cents<br />
morts » ; nul autre chroniqueur ne dit rien de semblable ; le Bourgeois<br />
de <strong>Paris</strong>, si partial cependant, ne signale que des blessés ;<br />
elle ajoute que l'armée battue se retira « à Senlis », avant de revenir<br />
à l'attaque de la porte Saint-Honoré, ce qui est encore plus manifestement<br />
faux. On ne peut donc tenir aucun compte de son<br />
indication.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 85<br />
l'époque ; pour le reste, nous en sommes réduits<br />
aux conjectures. Il faudrait pouvoir retrouver l'emplacement<br />
de ce moulin, du côté de la porte Saint-<br />
Denis, et assez proche du mur d'enceinte que <strong>Jeanne</strong><br />
se proposait d'escalader avec ses hommes d'armes ;<br />
diverses inductions ouvrent le champ aux hypothèses.<br />
Ce moulin doit évidemment être cherché sur quelque<br />
élévation de terrain, où ses ailes mouvantes<br />
pussent tourner au vent. M. Gailly de Taurines,<br />
dans l'article cité, le place « sur la crête militaire du<br />
plateau qui, depuis le point culminant de La Chapelle<br />
descend, par de légères ondulations, vers <strong>Paris</strong>, à peu<br />
près à l'endroit où, aujourd'hui, le haut de la rue du<br />
Faubourg-Saint-Denis atteint le boulevard extérieur »,<br />
par conséquent sur le boulevard de La Chapelle,<br />
derrière la gare du Nord (1). Il faudrait alors renoncer<br />
à voir, dans l'engagement qui aurait eu lieu à cette<br />
place, une attaque contre les murs de <strong>Paris</strong> ; ce ne<br />
serait qu'une « escarmouche » assez loin de l'enceinte ;<br />
ce qui semble en contradiction avec les textes rapportes<br />
ci-dessus ; mais, comme cet écrivain ne donne<br />
part sa référence, on ne voit pas la raison qui lui fait<br />
placer le moulin en ce lieu (2).<br />
Ne faut-il pas le chercher plus près du rempart?<br />
Jean Chartier, historiographe officiel de Charles VII,<br />
« religieux et chantre de l'église Monseigneur-Saint-<br />
Deny » — qui, peut-être a vu la Pucelle à Saint-<br />
Denis pendant la quinzaine de jours qu'elle y a logé, —<br />
(1) Page 902.<br />
(2) Peut-être se réfère-t-il à ce passage du Bourgeois de <strong>Paris</strong> :<br />
« le 16° jour d'octobre (1411) étaient les Armagnacs près le<br />
moulin à vent au-dessus de Saint-Ladre (Saint-Lazare) ».
86 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
écrit dans sa Chronique latine (1) que ce moulin était<br />
dans le voisinage de l'enceinte (urbis suburbia tangens),<br />
ce qui ne serait pas le cas s'il était — ou s'il<br />
s'agissait de celui qui se trouvait peut-être — à l'endroit<br />
indiqué par M. de Taurines.<br />
D'autre part, nous savons par divers chroniqueurs<br />
de l'époque, que le duc de Bedford n'avait laissé<br />
pour garder et défendre <strong>Paris</strong> qu' « environ deux mille »<br />
soldats anglais avec quelques gentilshommes (2) ;<br />
(« quarante ou cinquante anglais » seulement, prétend<br />
le Bourgeois de <strong>Paris</strong> ; mais cette fois, comme<br />
tant d'autres, son évaluation est fantaisiste) ; que le<br />
duc de Bourgogne renforça la garnison en envoyant,<br />
sous la conduite de capitaines, « quatre cents combattants<br />
» (3). Avec les habitants de la ville qui contribuèrent<br />
à la défense de leur cité, cela faisait une assez<br />
faible armée en face des dix ou douze mille guerriers<br />
de <strong>Jeanne</strong>. Nous savons encore que « par peur des<br />
embûches de l'ennemi » (4), les assiégés ne se hasardaient<br />
guère hors du boulevard et des barrières<br />
extérieures protégeant les approches des portes.<br />
Dès lors on ne s'expliquerait pas qu'en si petit nombre<br />
ils aient été chercher le combat au-<strong>devant</strong> des assiégeants,<br />
assez loin de la porte Saint-Denis, et sur une<br />
hauteur.<br />
D'anciens plans de <strong>Paris</strong> du seizième siècle (5)<br />
montrent, proche du rempart, à l'ouest de la porte<br />
(1) Avant sa chronique en français, Jean Chartier avait composé<br />
une chronique en latin.<br />
(2) Chronique de la Pucelle ; Chronique (française) de Jean<br />
Chartier.<br />
(3) Chronique de Monstrelet.<br />
(4) Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>.<br />
(5) Notamment ceux dits d'Arnoullet, de Braun, de Bâle.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 87<br />
Saint-Denis, une butte assez longue, surmontée de<br />
trois moulins à vent, bien espacés l'un de l'autre.<br />
Rien ne prouve, il est vrai, que ces moulins existaient<br />
déjà au temps de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; sur la butte, près<br />
de la porte Saint-Honoré, où <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> établit<br />
le 8 septembre son artillerie, les mêmes plans indiquent<br />
aussi deux moulins qui sans doute n'y étaient pas<br />
alors ; les chroniques, qui relatent l'attaque de cette<br />
porte, n'en font aucune mention. Rien non plus<br />
cependant ne permet d'établir une corrélation d'origine<br />
entre ces divers moulins ; les trois premiers,<br />
ou l'un seulement de ces trois, peuvent être beaucoup<br />
plus anciens. La vérité est que nous n'en savons<br />
rien et que nous sommes dans le plus pur domaine<br />
des hypothèses. Sur ces plans, le moulin à vent le<br />
plus rapproché de la porte Saint-Denis paraît occuper<br />
l'emplacement représenté aujourd'hui par l'élévation<br />
de terrain, qui se trouve entre la rue de Cléry et le<br />
boulevard de Bonne-Nouvelle, non loin de l'église<br />
de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.<br />
Ne serait-ce pas là l'endroit vaguement indiqué<br />
par nos chroniqueurs? Ce qui autorise à le supposer,<br />
c'est la similitude frappante qui se remarquerait<br />
ainsi, entre la manière dont fut conduite l'attaque de<br />
la porte Saint-Honoré et celle qu'on aurait employée,<br />
en ce cas, à la porte Saint-Denis,<br />
Observons tout d'abord qu'étant donnés les moyens<br />
dont on disposait alors, tant pour les assaillir que pour<br />
les défendre, les portes étaient directement imprenables<br />
; il fallait s'en emparer par l'intérieur de la<br />
ville. Tandis qu'une partie des assaillants agissait<br />
sur la porte elle-même, une autre prenait d'assaut le<br />
rempart, à un point assez rapproché de la porte, pénétrait<br />
par le rempart dans la ville, immobilisait les
88 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
portiers et la garnison, occupait la porte, abaissait le<br />
pont-levis et livrait passage au reste des assiégeants.<br />
C'est ainsi que <strong>Jeanne</strong> devait tenter son entreprise,<br />
le lendemain, à la porte Saint-Honoré ; si c'est ainsi<br />
qu'elle l'a tentée le 7 septembre, à la porte Saint-<br />
Denis, le moulin se trouvait sur la butte qui vient<br />
d'être indiquée.<br />
Dans les deux cas, <strong>Jeanne</strong> choisit un monticule,<br />
au voisinage de la porte ; derrière, elle embusque un<br />
corps de réserve ; au faîte, elle établit son artillerie<br />
pour balayer le rempart et préparer l'assaut ; rappelons-nous,<br />
en effet, la déposition d'un de ses plus<br />
fidèles compagnons d'armes, le duc d'Alençon :<br />
« On admirait surtout le parti qu'elle savait tirer de<br />
l'artillerie ; car c'est en cela qu'elle excellait (1) »;<br />
quand l'artillerie aura suffisamment fait son œuvre<br />
et que le moment propice sera arrivé, elle escaladera<br />
le mur d'enceinte, pénétrera dans la ville, s'emparera<br />
de la porte et l'ouvrira à ses troupes.<br />
Toutefois, rien n'établit d'une manière certaine<br />
ni que le moulin fut à l'endroit que nous proposons,<br />
ni même que l'attaque de la ville, le 7 septembre,<br />
ait eu lieu à la porte Saint-Denis ; ceci n'est qu'une<br />
conjecture.<br />
La nuit étant venu interrompre cette opération,<br />
<strong>Jeanne</strong> retourna à La Chapelle, au « logis de <strong>Sainte</strong>-<br />
Geneviève ».<br />
Le lendemain jeudi, 8 septembre, elle porta son<br />
effort sur la porte Saint-Honoré.<br />
(l) Et de hoc mirabantur omnes... et maxime in praeparatione<br />
de l'artillerie ; quia multum bene in hoc se habebat. »
GROSSE BOMBARDE DU xv e SIÈCLE<br />
TROUVÉE DANS LA LOIRE, PRES D'ORLEANS.<br />
Diamètre de l'âme : 0 m. 58. — Longueur totale : 2. mètres.<br />
(Musée des Invalides.)<br />
BOMBARDE (I) ET VEUGLAIRE (2) DES XIV e ET XV e SIÈCLES.<br />
(Musée des Invalides.)
NOTE<br />
SUR L'ARTILLERIE<br />
DE 1425 A 1450<br />
Nous avons rappelé ci-dessus le témoignage du<br />
duc d'Alençon, affirmant que <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> excellait<br />
à utiliser l'artillerie.<br />
L'artillerie lourde de cette époque se composait<br />
de bombardes et de veuglaires.<br />
Les pièces d'artillerie légère étaient les crapeaudeaux,<br />
les coulevrines, les ribaudequins et les orgues.<br />
Les bombardes étaient de gros canons en fer, formés de plusieurs<br />
pièces vissées, lançant des boulets de pierre. Elles pesaient<br />
de 7.000 à 30.000 livres et lançaient des boulets pesant de<br />
150 à 900 livres.<br />
Les veuglaires étaient des canons plus légers que les bombardes,<br />
pesant de 300 à 6.000 livres ; ils se chargeaient par l'arrière,<br />
au moyen de chambres mobiles (deux ou trois) préparées à<br />
l'avance et qui étaient coincées à l'arrière du canon. Le veuglaire<br />
était une pièce à tir relativement rapide.<br />
Les crapeaudeaux étaient de petits veuglaires dont le poids<br />
n'excédait pas 200 livres.<br />
Les coulevres ou coulevrines étaient de petits canons en fer, de<br />
12 à 50 livres ; elles se chargeaient par la bouche. Les<br />
plus petites étaient portées à la main, comme des fusils.<br />
Les ribaudequins étaient un ensemble de trois, quatre ou cinq<br />
canons de petit calibre (crapeaudeaux ou coulevrines),<br />
enchâssés dans du bois et placés avec leur fût sur une<br />
voiture attelée à l'arrière et qui portait, en outre, les boulets,<br />
les tampons de bois et la poudre ; chacun des canons<br />
du ribaudequin tirait séparément.
90 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Les orgues étaient une série de petits canons fondus ensemble,<br />
dont les lumières étaient en communication à la base<br />
par une rainure, dans laquelle la traînée de poudre faisait<br />
partir tous les coups à la fois. C'était une sorte de mitrailleuse,<br />
portée par un affût à roues et protégée par un mauvelet<br />
formant masque.
BOMBARDES DES XIV e ET XV e SIÈCLES<br />
(Musée des Invalides).
BOMBARDES (1), COULEVRINES (2) ET CRAPEAUDEAUX (3),<br />
AVEC LEUR CHAMBRE MOBILE (4) DES XIV e ET XV e SIÈCLES<br />
(Musée des Invalides)<br />
COULEVRINES PORTATIVES (1) ET COULEVRINIER (2) DU XV e SIÈCLE<br />
(Musée des Invalides).
LA MARCHE DE JEANNE D'ARC<br />
DE « LA CHAPELLE »<br />
A LA PORTE SAINT-HONORÉ 1<br />
Le chemin suivi par <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, de La Chapelle<br />
à la porte Saint-Honoré, lors de son attaque sur<br />
<strong>Paris</strong>, a été depuis enclos dans l'intérieur de la ville.<br />
Peut-on le reconstituer, approximativement du<br />
moins? On l'a tenté, et non sans quelque succès,<br />
semble-t-il (2).<br />
Pour aboutir à des conclusions acceptables, il nous<br />
paraît utile de se faire d'abord une idée aussi exacte<br />
que possible de la topographie de la banlieue nordouest<br />
et nord de <strong>Paris</strong>, au début du quinzième siècle ;<br />
— de relever ensuite, dans les documents concernant<br />
l'attaque de la capitale par l'héroïne, les points géographiques<br />
mentionnés ; — enfin de déduire, du<br />
rapprochement de ces deux ordres de faits, l'itinéraire<br />
probable de sa marche sur la ville.<br />
(1) Article publié dans la Semaine religieuse de Parts, n° du<br />
21 avril 1923, pp. 591-598.<br />
(2) Voir notamment, E. Eude : « L'itinéraire parisien de <strong>Jeanne</strong><br />
<strong>d'Arc</strong>, en la journée du 8 septembre 1429 » ; Revue des Etudes<br />
historiques, janvier-mars 1916, pp. 65-90.
92 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
<strong>Paris</strong> était enfermé dans une enceinte fortifiée.<br />
L'enceinte Caroline, commencée par Etienne Marcel<br />
et achevée par Charles V, suivait, dans la région qui<br />
nous intéresse, de la porte Saint-Honoré à la porte<br />
Saint-Denis, à peu près le tracé suivant :<br />
Elle commençait au fleuve vers l'endroit où est<br />
aujourd'hui le pont du Carrousel, traversait !a place<br />
du même nom, la rue de Richelieu, le jardin du Palais-<br />
Royal, les rues de Valois et des Bons-Enfants, la<br />
Banque de France, la place des Victoires et, par la<br />
rue d'Aboukir, rejoignait la porte Saint-Denis (1).<br />
Les anciens plans, dits de Tapisserie, de Braun,<br />
de Ducerceau, donnent une image de ce qu'était cette<br />
enceinte : un mur fortifié de tours et de bastides,<br />
dressé sur une butte de terre et protégé par un large<br />
fossé rempli d'eau : sur l'autre versant du fossé<br />
s'élevait une seconde butte « à dos d'âne », bordée,<br />
elle aussi, par un fossé à sec, avec un chemin de contrescarpe<br />
sur la campagne.<br />
Au delà s'étendaient des espaces vagues, formant<br />
une légère vallée, à travers laquelle s'écoulait le<br />
« ruisseau de Ménilmontant ». Descendant des hauteurs<br />
de Ménilmontant et de Belleville, et constituant<br />
ainsi pour la ville une seconde ligne de défense, ce<br />
ruisseau suivait un parcours marqué actuellement<br />
par les rues des Petites-Ecuries, Richer, de Provence,<br />
de Penthièvre, du Colisée, Marbœuf et se terminait<br />
(1) Elle suivait ensuite les rues <strong>Sainte</strong>-Apolline et de Meslay,<br />
les boulevards du Temple, des Filles-du-Calvaire, et Beaumarchais<br />
; traversait la place de la Bastille et, s'orientant dans la<br />
direction du canal Saint-Martin, rejoignait la Seine.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 93<br />
à la Seine, au quai Debilly, presqu'à la hauteur de la<br />
rue Debrousses (1).<br />
Sur la rive gauche, entre le ruisseau et l'enceinte,<br />
ce n'étaient que marais, transformés progressivement<br />
en cultures maraîchères. Par delà le ruisseau, sur la<br />
rive droite, se dressait au nord la colline de Montmartre,<br />
dont une partie des flancs était couverte de<br />
vignobles ; et, au nord-ouest, s'ouvrait la plaine de<br />
Monceau.<br />
Quelles étaient, dans cette région, les voies d'accès<br />
sur <strong>Paris</strong>?<br />
Deux grands chemins traversaient la ville ; l'un<br />
du sud au nord, par les rues Saint-Jacques et Saint-<br />
Denis, aboutissant à la porte Saint-Denis ; l'autre de<br />
l'est à l'ouest, par la rue Saint-Honoré, jusqu'à la<br />
porte du même nom. Entre ces deux portes, il y en<br />
avait une troisième, celle de Montmartre.<br />
Ces trois points de sortie indiquent les principales<br />
voies hors les murs. De la ville Saint-Denis, la « grande<br />
chaussée Saint-Denis », passant par La Chapelle,<br />
accédait à la porte Saint-Denis et se prolongeait,<br />
dans la ville, par la rue Saint-Denis. A la porte de<br />
Montmartre venait finir le chemin descendant de la<br />
colline des Martyrs. A la porte Saint-Honoré conduisaient<br />
deux chemins : d'une part, la « chaussée du<br />
Roule », venant presqu'en droite ligne du hameau<br />
de ce nom, représentée aujourd'hui par la rue du<br />
Faubourg Saint-Honoré et la rue Saint-Honoré jusqu'à<br />
la place du Théâtre-Français ; d'autre part, le « grand<br />
chemin d'Argenteuil », descendant de ce village<br />
par Asnières, la plaine Monceau, les rues du Rocher,<br />
de l'Arcade et d'Argenteuil, et traversant le ruisseau<br />
(1) Il existe encore à l'état d'égout.
94 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
sur le pont de la Ville-l'Évêque. Chacune de ces voies,<br />
en effet, rencontrait le ruisseau de Ménilmontant,<br />
qu'elle franchissait soit sur un pont en maçonnerie,<br />
soit grâce à une « chaussée », ou levée de terre.<br />
Ces voies « hors les murs » devaient être reliefs entre<br />
elles ; sans doute des sentiers, des chemins de traverse<br />
assuraient les communications ; mais ils étaient<br />
à peu près impraticables aux gros charrois. Et comme<br />
il arrivait que <strong>Paris</strong> fermât assez fréquemment ses<br />
portes, une route emp'errée était indispensable. Entre<br />
le ruisseau et l'enceinte, à travers les marais, nulle<br />
voie n'était possible ; la route ne pouvait se trouver<br />
que sur la rive droite ; et elle s'y trouvait effectivement,<br />
comme l'a établi M. E. Eude, dans l'étude<br />
déjà citée :<br />
« 1° Dès le treizième siècle, écrit-il (et, sans doute,<br />
antérieurement) il existait un chemin de Saint-Lazare,<br />
allant du Roule à Saint-Laurent, et dont la section<br />
orientale formait jonction entre le grand chemin<br />
d'Argenteuil et la chaussée Saint-Denis, pavée ;<br />
« 2° Cette section, au moins dès le commencement<br />
du quinzième siècle, était ferrée, c'est-à-dire revêtue<br />
d'un empierrement résistant, et praticable aux chevaux,<br />
aux troupes, en dépit de son étroitesse, qui<br />
n'était peut-être qu'intermittente ;<br />
« 3° Jusqu'au dix-septième siècle, dans le « marais<br />
« de <strong>Paris</strong> », parallèlement au ruisseau de Ménil montant<br />
ou grand égout de ceinture, il n'existait aucun autre<br />
vrai chemin entre ledit égout et l'enceinte caroline,<br />
dans la partie de l'enceinte qui courait de la porte<br />
Saint-Denis à la porte Saint-Honoré (1) ».<br />
Trois textes, antérieurs à l'attaque de <strong>Paris</strong> par la<br />
(l) Loc. cit, p. 72-73.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 95<br />
Pucelle en 1429, — deux datant de 1411, empruntés<br />
au Bourgeois de <strong>Paris</strong> et à Juvénal des Ursins ; l'autre<br />
de 1427, également extrait du Bourgeois de <strong>Paris</strong>, —<br />
ont permis à M. E, Eude « diverses inductions utiles<br />
touchant la section du chemin de Saint-Lazare<br />
comprise entre le pont de la Ville-l'Evêque et la<br />
chaussée Saint-Denis ». Nous ne le suivrons pas dans<br />
cette démonstration conduite avec beaucoup de<br />
sagacité, nous contentant de retenir ses conclusions.<br />
Ainsi, dès 1411, il existait un chemin empierré,<br />
situé sur la rive droite du ruisseau et reliant la chaussée<br />
Saint-Denis au grand chemin d'Argenteuil.<br />
Trouverons-nous dans les textes de l'époque<br />
quelques indications qui permettent d'inférer que<br />
c'est bien là le chemin pris par <strong>Jeanne</strong> et ses hommes<br />
d'armes?<br />
* *<br />
En ce court exposé, on ne peut songer à reproduire<br />
intégralement ces textes ; il suffira d'en extraire les<br />
précisions et de les grouper topographiquement.<br />
Martial d'Auvergne, procureur au Parlement de<br />
<strong>Paris</strong>, auteur d'une chronique rimée, Les Vigilles<br />
de la mort de Charles VII, dit que l'armée royale<br />
vint camper à La Chapelle ; ce que confirme un autre<br />
chroniqueur rapportant, dans la Chronique de la Pucelle,<br />
qu'après son échec « toute la susdite compagnie<br />
se retira au lieu de La Chapelle Sainct-Denys, où<br />
ils avaient logé la nuict d'avant ».<br />
L'armée n'était cependant pas concentrée tout<br />
entière en cet endroit ; nous savons par Monstrelet,<br />
prévot de Cambrai, que des contingents étaient distribués<br />
en divers lieux : « Et les gens se logèrent à
96 JEANNE D ARC DEVANT PARIS<br />
Aubervilliers, à Montmartre, et ès villages assez près<br />
de <strong>Paris</strong> », Martial d'Auvergne mentionne qu'une<br />
partie des troupes était campée à Mousseaux (qui a<br />
pris depuis le nom de Monceau), d'où elle gagna<br />
le Marché aux pourceaux :<br />
Le lendemain grant compagnie<br />
De l'ost (1) des Français à Mousseaux<br />
S'enviendrent faire une assaillie<br />
Jusques au Marché aux pourceaux.<br />
Clément de Fauquembergue, greffier au Parlement,<br />
relate que des « gens d'armes de messire Charles de<br />
Vallois assemblez en grant nombre emprès les murs<br />
de <strong>Paris</strong> lez la porte Sainct-Honoré... plusieurs d'iceux<br />
étant sur la place aux pourceaux et environ prez de<br />
la dicte porte » y commencèrent l'attaque qui se<br />
continua jusqu'à une heure avancée de la nuit.<br />
Jean Chartier, historiographe officiel de Charles VII,<br />
dit de même : « Vinrent lesdits seigneurs aux champs,<br />
vers la porte Sainct-Honoré sur une manière de butte<br />
ou de montagne qu'on nommait le Marché aux pourceaux<br />
».<br />
Le Journal du siège d'Orléans précise : « Les ducs<br />
d'Alençon et de Bourbon s'embusquèrent derrière<br />
la montagne qui est auprès et contre le Marché aux<br />
pourceaux ».<br />
Le Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong> ajoute qu'après<br />
leur échec les assaillants durent fuir assez rapidement<br />
« car ceulx de <strong>Paris</strong> avoient de grans cannons qui<br />
gectoient de la porte Sainct-Denis jusques par delà<br />
Sainct-Ladre (2) largement, qui leur gectoient au<br />
(1) Armée.<br />
(2) Saint-Lazare.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 97<br />
dos, dont moult furent épouvantez... En eulx en<br />
allant ils boutèrent le feu en la granche des Mathurins,<br />
emprès les Pocherons et mirent de leurs gens qui<br />
mors estoient à l'assault, qu'ilz avoient troussez sur<br />
leurs chevaulx, dedans cellui feu à grant foison ».<br />
Et il affirme plus loin que, dans leur fuite précipitée,<br />
les soldats de Charles VII ne purent sauver le convoi<br />
qui avait apporté le matériel au siège : « car la plus<br />
grant partie de leur charroy, en quoi ilz avoient<br />
admené leurs bourrées, ceulx de <strong>Paris</strong> leur osterent ».<br />
Alors, suivant divers chroniqueurs, l'armée « se retira<br />
au lieu de La Chapelle-Sainct-Denis, où ils avaient<br />
logé la nuict d'avant » (1).<br />
La Chapelle Saint-Denis, Aubervilliers, Montmartre<br />
Mousseaux et autres villages, Saint-Lazare, les Porcherons,<br />
la grange des Mathurins, la butte et le<br />
Marché aux pourceaux, la porte Saint-Honoré marquent<br />
différents points de l'itinéraire.<br />
Partie de la ville de Saint-Denis, une fraction de<br />
l'armée vint avec <strong>Jeanne</strong> camper à La Chapelle.<br />
D'autres effectifs se logèrent à Aubervilliers, Montmartre,<br />
Monceau et villages voisins. L'objectif était<br />
la porte Saint-Honoré. Il ne s'agissait, dans la pensée<br />
des capitaines, — <strong>Jeanne</strong> l'a déclaré au cours de son<br />
procès, — que de faire, ce jeudi 8 septembre, en la<br />
fête de la Nativité de la Vierge « une escarmouche<br />
ou une vaillance d'armes » ; mais elle, elle avait décidé<br />
« d'aller oultre » et d'entraîner après elle les hommes<br />
d'armes au delà des fossés qui protégeaient l'enceinte.<br />
Les divers contingents, campés aux villages mentionnés,<br />
rejoindraient le gros de la troupe en cours de<br />
(1) Chronique de la Pucelle, Journal du Siège d'Orléans, Chronique<br />
de Jean Chartier, Chronique de Perceval de Cagny.
98 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
route, pour se rendre ensemble à la Butte, près du<br />
Marché aux pourceaux, dans le voisinage de la porte<br />
Saint-Honoré.<br />
Or il n'y avait qu'une route, celle indiquée par<br />
M. E. Eude, qui se prétât sur ce parcours à une pareille<br />
concentration.<br />
Il reste à déduire de ces diverses indications l'itinéraire<br />
probable suivi par <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> dans cette<br />
journée du 8 septembre.<br />
* *<br />
L'armée se composait au dire du Bourgeois de<br />
<strong>Paris</strong>, d'au moins 12.000 hommes : « Et s'assemblèrent<br />
bien XII mil ou plus, et vindrent (environ)<br />
heure de grant messe, entre XI et XII, leur Pucelle<br />
avec culx et très grant foison chariots, charettes et<br />
chevaulx, tous chargez de grans bouréesàtroishars(l)<br />
pour emplir les fossez de <strong>Paris</strong> ; et commencèrent<br />
à assaillir entre la porte Sainct-Honoré et la porte<br />
Sainct-Denis ». Les divers chroniqueurs notent<br />
l'importance du matériel de siège dont disposait cette<br />
armée ; abondante artillerie : bombardes, veuglaires,<br />
coulevrines, etc. ; elle tramait, rapportent les Registres<br />
du Chapitre de Notre-Dame de <strong>Paris</strong>, dans 300 charrettes<br />
tirées par bricoles (2) une grande quantité de<br />
bourrées pour combler les fossés, des claies pour<br />
rendre le passage sur bourrées praticable et<br />
650 échelles. A une telle armée et un si important<br />
matériel, des sentiers à travers les marais étaient<br />
(1) Liens.<br />
(2) Tercentum quadrigas quas ipsimel ad colla trahentes adduxerunt.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 99<br />
incontestablement insuffisants ; il fallait nécessairement<br />
une route empierrée.<br />
De Saint-Denis, l'armée était venue s'établir à<br />
La Chapelle, bourg situé sur le « grand chemin de<br />
<strong>Paris</strong> à Saint-Denis », à peu près à mi-distance entre<br />
l'enceinte de la capitale et la vieille abbaye royale ;<br />
ce bourg tirait son nom d'une chapelle consacrée<br />
à saint Denis (1) et où la tradition rapporte que <strong>Jeanne</strong><br />
vint prier avant de partir à l'assaut. La veille de la<br />
Nativité (7 septembre) une attaque contre <strong>Paris</strong> fut<br />
entreprise sans succès, raconte le Bourgeois de <strong>Paris</strong> :<br />
mais il ne précise pas sur quel point de l'enceinte.<br />
L'affaire fut remise au lendemain et on revint cantonner<br />
à La Chapelle.<br />
D'après Perceval de Cagny, écuyer du duc d'Alençon,<br />
« le mieux instruit, le plus complet, le plus sincère<br />
» des chroniqueurs de l'héroïne, dit Quicherat, —<br />
le 8 septembre, <strong>Jeanne</strong> se mit en selle vers huit heures<br />
du matin. Le Bourgeois de <strong>Paris</strong> note que l'assaut à<br />
la porte Saint-Honoré fut donné entre onze heures et<br />
midi ; il n'aurait commencé qu'à deux heures de<br />
l'après-midi, suivant Clément de Fauquembergue (2) ;<br />
c'est donc au minimum trois heures que mit l'armée<br />
(1) Aujourd'hui église paroissiale de Saint-Denis de la Chapelle.<br />
« Six colonnes subsistent, écrit M. E. Eude, dans l'étude<br />
déjà citée, de l'église où <strong>Jeanne</strong> fit sa prière avant d'entreprendre<br />
la chevauchée du 8 septembre. Ce sont les trois premières colonnes<br />
de chaque côté de la nef, celles qu'on trouve en entrant par<br />
la grande porte, rue de la Chapelle. Elles sont en pierre dure,<br />
recouvertes d'un regrettable badigeon. Les chapiteaux accusent<br />
le quatorzième siècle. Ils ont donc vu passer <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; disons<br />
mieux c'est sur eux que s'est posé le regard de la céleste Pucelle ».<br />
(p. 66, texte et note).<br />
(2) « Environ deux heures après midi commencèrent à faire<br />
semblant de vouloir assaillir la ville »
100 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
pour se rendre de La Chapelle à la porte Saint-Honoré ;<br />
tout en faisant la part du ralentissement de la marche,<br />
occasionnée tant par les convois que par le ralliement<br />
des compagnies logées aux villages voisins, il faut bien<br />
reconnaître que l'armée a dû prendre un chemin<br />
assez détourné pour mettre un si long temps à parcourir<br />
un espace aussi restreint. Et cette remarque nous<br />
conduit à la même conclusion : la troupe a dû suivre<br />
une route longeant la rive droite du ruisseau de<br />
Ménilmontant.<br />
En quittant La Chapelle, <strong>Jeanne</strong> descendit directement<br />
par la « chaussée pavée de Monseigneur<br />
Saint Denis » (aujourd'hui, rue de la Chapelle et rue<br />
du Faubourg-Saint-Denis), jusqu'à la fourche du « chemin<br />
d'Aubervilliers » (aujourd'hui, carrefour des<br />
rues du Faubourg-Saint-Denis, de l'Aqueduc et de<br />
Lafayette), où la rejoignirent les effectifs campés<br />
à Aubervilliers.<br />
Continuant sa marche, l'armée longea la clôture de<br />
la célèbre léproserie Saint-Lazare, qu'elle contourna<br />
presqu'à angle droit, en empruntant le « chemin<br />
tendant à Saint-Lazare » (à l'angle actuel de la rue<br />
du Faubourg Saint-Denis et de la rue de Paradis).<br />
Le « chemin de Saint-Lazare », — nous l'avons<br />
déjà observé, — était vraisemblablement empierré<br />
et par suite pouvait supporter des charrois importants<br />
; allant de Saint-Laurent à la chapelle du<br />
Roule, il longeait, sur le côté droit de la vallée, le<br />
ruisseau de Ménilmontant, à flanc du coteau de<br />
Montmartre, et faisait communiquer la « chaussée<br />
Saint-Denis » avec le « grand chemin d'Argenteuil ».<br />
Il suivait le tracé actuel de la rue de Paradis et de la<br />
rue Bleue, jusqu'au carrefour du « chemin de Clignancourt<br />
» (au croisement des rues Cadet, Lafayette
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 101<br />
et Chateaudun). A ce carrefour, le chemin de Saint-<br />
Lazare remontait légèrement vers le nord et reprenait<br />
presque aussitôt la direction de l'ouest (par la rue<br />
actuelle de Lamartine) jusqu'au carrefour du « grand<br />
chemin de Montmartre ou des Martyrs » (à l'abside<br />
de l'église de Notre-Dame-de-Lorette).<br />
Là, l'armée de <strong>Jeanne</strong> dut retrouver les troupes<br />
descendues de Montmartre, où elles étaient cantonnées;<br />
et, grossie de ces nouveaux éléments, se remettre<br />
en route par le chemin de Saint-Lazare (aujourd'hui<br />
rue Saint-Lazare) qui, passant au carrefour du « chemin<br />
de Clichy » (place de la Trinité), longeait ensuite,<br />
sur sa gauche, le domaine des Porcherons (avenue<br />
du Coq) et coupait le carrefour du « grand chemin<br />
d'Argenteuil » (carrefour actuel des rues du Rocher,<br />
de Rome, de Saint-Lazare et de l'Arcade).<br />
A cet endroit les contingents réunis à Mousseaux<br />
(Monceau) rallièrent sans doute l'armée royale.<br />
<strong>Jeanne</strong> quitta alors le « chemin tendant à Saint-Lazare »<br />
et se dirigea vers le sud, par le « grand chemin d'Argenteuil<br />
». Comme son nom l'indique, ce chemin reliait<br />
<strong>Paris</strong> avec la ville et le monastère d'Argenteuil ; il<br />
traversait Monceau et suivait la voie représentée<br />
aujourd'hui par les rues du Rocher, de l'Arcade et<br />
d'Argenteuil ; entre ces deux dernières rues, il ne reste<br />
nul vestige de son tracé ; on en est réduit à conjecturer<br />
son parcours, d'après les plans les plus anciens,<br />
suivant une ligne se rapprochant plus ou moins des<br />
rues de Sèze, des Capucines, impasse et rue Gomboust.<br />
Le chemin d'Argenteuil franchissait le ruisseau de<br />
Ménilmontant sur un solide pont en maçonnerie,<br />
comme précisément il en fallait un pour le passage<br />
de troupes et de leur matériel de combat. <strong>Jeanne</strong><br />
s'engagea sur le pont de la Ville-l'Évêque (à la croisée
102 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
du boulevard Haussmann et de la rue de l'Arcade) et<br />
pénétra dans la région des cultures maraîchères.<br />
Légèrement à sa gauche, elle laissait la « Ferme des<br />
Mathurins » (à l'angle des rues des Mathurins, Vignon<br />
et Tronchet) ; un peu plus bas, sur sa droite, le domaine<br />
de la « Ville-l'Evêque», et arrivait bientôt en<br />
vue d'une butte (la Butte des moulins) au delà de<br />
laquelle se trouvait le « Marché aux pourceaux ».<br />
La « Butte des moulins » (ainsi nommée, plus tard,<br />
quand elle fut dominée par deux moulins) s'élevait<br />
sur un territoire que l'on peut se représenter ainsi :<br />
limitée au nord par la rue des Petits-Champs, elle<br />
s'étendait, à l'est, au delà de la rue <strong>Sainte</strong>-Anne<br />
jusqu'à la rue Villedo ; à l'ouest, jusqu'au côté<br />
impair de l'avenue de l'Opéra, à peu près au milieu<br />
de l'espace compris entre la rue Saint-Roch et la rue<br />
des Pyramides. Au delà de la rue <strong>Sainte</strong>-Anne, sur<br />
le prolongement de la rue Thérèse, entre la rue Villedo<br />
et la rue Molière, se tenait le « Marché aux pourceaux ».<br />
La porte Saint-Honoré, où venaient aboutir le<br />
« grand chemin d'Argenteuil » et la « chaussée du<br />
Roule », s'élevait à l'endroit occupé actuellement,<br />
sur la place du Théâtre-Français, par l'immeuble<br />
portant le numéro 163 de la rue Saint-Honoré,<br />
le trottoir et la chaussée qui bordent cet immeuble.<br />
Elle était en quelque sorte imprenable. <strong>Jeanne</strong> ne<br />
songea pas à l'attaquer directement ; elle porta son<br />
effort, un peu plus au nord-est, contre le mur d'enceinte<br />
.<br />
L'armée était divisée en deux corps ; tandis que<br />
l'un, commandé par le maréchal de Rais, Gaucourt<br />
et la Pucelle, devait entreprendre l'assaut ; l'autre,<br />
sous la direction des ducs d'Alençon et de Bourbon,<br />
vint s'embusquer derrière la Butte (des moulins)
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 103<br />
pour surveiller une sortie possible, par la porte Saint-<br />
Denis, de l'adversaire et l'empêcher de prendre à<br />
dos les assaillants (1).<br />
Commencée vers midi, l'attaque se prolongea<br />
jusqu'à la tombée du jour. Successivement la barrière<br />
fut forcée, le premier fossé (à sec) franchi, le boulevard<br />
« à dos d'asne » enlevé ; mais le second fossé,<br />
peut-être par suite d'une crue imprévue du fleuve,<br />
— car il y « avoit grande eaue », — opposait un obstacle<br />
sérieux. En voulant alors le faire combler de fascines,<br />
pour pouvoir « lever les échelles » contre la muraille,<br />
<strong>Jeanne</strong> fut blessée (à l'endroit occupé par le numéro 2<br />
de l'avenue de l'Opéra et le trottoir qui le longe) (2).<br />
« La retraite fut sonnée et l'entreprise faillie ». Jusqu'au<br />
delà de Saint-Lazare les canons de la ville<br />
poursuivirent de leurs boulets l'armée qui se retirait.<br />
* *<br />
Si les hypothèses précédentes sont exactes l'itinéraire<br />
suivi par <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> serait donc, dans l'état<br />
actuel de <strong>Paris</strong>, le suivant :<br />
Départ de l'église Saint-Denys-de-la-Chapelle ;<br />
rues de la Chapelle, du Faubourg-Saint-Denis, de<br />
Paradis, Bleue, Lafayette, Cadet, Lamartine, abside<br />
de Notre-Dame-de-Lorette, rue Saint-Lazare, place<br />
de la Trinité, rues Saint-Lazare, de Rome, de l'Ar-<br />
(1) Chronique de la Pucelle, Chronique de Jean Chartier, Journal<br />
du siège d'Orléans.<br />
(2) Charles Magne, Commission municipale du Vieux <strong>Paris</strong>, procès-verbaux,<br />
1914, pp. 12-20 ; l'enceinte de Charles V. Fouilles<br />
exécutées en 1912 et 1913.
104 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
cade, place de la Madeleine (rues de Sèze, des Capucines,<br />
impasse et rue Gomboust?) rue des Petits-<br />
Champs, rue <strong>Sainte</strong>-Anne, rue Thérèse, rue Molière,<br />
avenue de l'Opéra et place du Théâtre-Français.<br />
Retour à la Chapelle par le même chemin.<br />
Cet itinéraire traverse les 18 e , 10 e , 9 e , 8 e et 1 er<br />
arrondissements et les paroisses de Saint-Dénys-dela-Chapelle,<br />
Saint-Bernard, Saint-Vincent-de-Paul,<br />
Notre-Dame de Lorette, <strong>Sainte</strong>-Trinité, Saint-Louis<br />
d'Antin, <strong>Sainte</strong>-Madeleine et Saint-Roch.
MARCHE DE JEANNE D'ARC<br />
DE LA CHAPELLE A LA PORTE SAINT-HONORÉ<br />
TRACÉE SUR LE PLAN DE BÂLE.<br />
Chaussée de Saint-Denis ; —- Chemin de Saint-Lazare ; — Chemin d'Argenteuil<br />
; — Butte des moulins ; — Marché aux pourceaux ; — Porte Saint-Honoré
MARCHE DE JEANNE D'ARC<br />
DE LA CHAPELLE A LA PORTE SAINT-HONORÉ<br />
TRACÉE SUR UN PLAN MODERNE (1923).<br />
Le plan de Bâle étant tracs à vol d'oiseau ne comporte pas l'échelle rigoureuse<br />
du plan de 1923.
LA POPULATION PARISIENNE<br />
ET<br />
L'ATTAQUE DE PARIS PAR JEANNE D'ARC 1<br />
On aimerait connaître les sentiments des <strong>Paris</strong>iens,<br />
lors de l'attaque de leur ville par <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>. Les<br />
documents qui nous restent sont, à cet égard, peu<br />
explicites ; on trouve cependant des indications<br />
intéressantes, tant dans les notes du greffier du Parlement<br />
de <strong>Paris</strong>, Clément de Fauquembergue, et le<br />
Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>, que dans les Registres<br />
du Chapitre de Notre-Dame de <strong>Paris</strong>.<br />
On peut dire que, d'une manière générale, <strong>Paris</strong><br />
était bourguignon. Les événements étaient si troubles,<br />
depuis si longtemps que sévissait une sorte de guerre<br />
civile, qu'il était bien difficile à la plupart des <strong>Paris</strong>iens<br />
de savoir où était la vérité et le devoir. La sérénité<br />
de l'histoire, à six siècles de distance, nous<br />
permet de mieux juger ce qu'alors les esprits ne<br />
pouvaient discerner ; ce qui est clair pour nous<br />
restait très obscur à cette époque. Que certains<br />
« politiciens » aient su ce qu'ils voulaient et ce qu'ils<br />
faisaient, en jetant une partie de la France dans les<br />
(1) Article publié dans la Semaine religieuse de <strong>Paris</strong>, numéro<br />
du 6 octobre 1923, pp. 435-442.
106 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
bras du roi d'Angleterre et en s'appuyant sur le parti<br />
bourguignon, ne paraît pas contestable ; mais les<br />
autres, la foule des autres, étaient dans la bonne foi,<br />
en regardant Charles VII comme un usurpateur, et<br />
les Armagnacs comme une troupe de séditieux.<br />
Les historiens sont sévères, à juste titre, contre les<br />
meneurs qui ont ainsi égaré, par passion ou par intérêt,<br />
l'ensemble des braves gens ; mais leurs sévérités<br />
ne sauraient atteindre tous ceux, et ce fut le grand<br />
nombre, qui ont été, à leur insu, entraînés dans l'erreur<br />
; dans les corps constitués, Parlement, Université,<br />
clergé séculier et régulier, corps de marchands et<br />
de métiers, etc., comme dans la population, on suivait<br />
le mouvement, parce qu'on n'était pas suffisamment<br />
renseigné et qu'on ne pouvait l'être.<br />
Quand apparut <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, il semble que la<br />
rapidité et le merveilleux de ses exploits auraient dû<br />
ouvrir les yeux ; cela eût été possible, si la vérité<br />
eût été, aux yeux des <strong>Paris</strong>iens, aussi éclatante que<br />
pour nous. Or elle ne l'était pas ; il s'en faut. Rien<br />
n'est plus significatif à cet égard que le sermon<br />
prêché, au prieuré de Saint-Martin-des-Champs, le<br />
4 juillet 1431, pour la promulgation officielle de la<br />
condamnation de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> (1). Le prédicateur<br />
était le grand Inquisiteur du royaume, le dominicain<br />
Graverent ; à moins de le regarder comme un imposteur,<br />
qui délibérément veut tromper son auditoire,<br />
on ne peut pas ne pas être frappé de la profondeur<br />
de son ignorance ; et ceci donne la mesure de ce que<br />
devait être celle de la foule. Quand un personnage<br />
de cette importance, et dont rien ne nous permet de<br />
(1) Voir plus loin le chapitre : Promulgation à Saint-Martin<br />
des-Champs de la condamnation de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 107<br />
suspecter la sincérité, se représente la Pucelle comme<br />
une fille en révolte contre ses parents, qui préfère<br />
la société des hommes d'armes à celle de sa famille,<br />
« respirant le feu et le sang », ne se plaisant que dans<br />
les massacres, ne recherchant que « l'homicide de la<br />
chrétienté », profanant la sainte Eucharistie en communiant<br />
trois fois de suite le même jour, demandant<br />
au démon ses inspirations, etc. ; on s'imagine quelle<br />
répulsion devait éprouver la population pour une si<br />
terrible et sanguinaire guerrière.<br />
Il importe de bien se pénétrer de cet état d esprit,<br />
en parcourant les documents qui nous sont restés ;<br />
il faut les lire avec une âme de <strong>Paris</strong>ien du quinzième,<br />
et non du vingtième siècle, si l'on veut ne pas être<br />
injuste à l'égard de personnes honorables et qui<br />
n'avaient pas les moyens de connaître la vérité. La<br />
terreur régnait dans la ville ; sciemment ou non,<br />
l'autorité avait laissé se répandre des nouvelles affolantes.<br />
Pendant le siège, on disait que « le comte<br />
d'Armagnac et ses gens étaient sur un des côtés<br />
(de l'enceinte), afin que si quelqu'un de ladite ville<br />
s'en fut voulu sortir ou fuir on l'eut pris ou mis à<br />
mort » (notaire Pierre Cochon). — « On disait publiquement<br />
à <strong>Paris</strong> que ledit messire de Valois (Charles<br />
VII) avait abandonné à ses gens <strong>Paris</strong> et ses habitants,<br />
grands et petits, de tous états, hommes et femmes,<br />
et que son intention était de faire passer la charrue<br />
sur <strong>Paris</strong> » (Fauquembergue). — On disait que<br />
les hommes d'armes de la Pucelle s'étaient promis,<br />
s'ils s'emparaient de <strong>Paris</strong> « de mettre à mort les<br />
personnes de l'un et l'autre sexe qui leur tomberaient<br />
sous la main, ainsi qu'ils en avaient fait le<br />
serment et qu'ils s'en vantaient » (Registres du<br />
Chapitre de Notre-Dame).
108 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Ces remarques nous ont semblé nécessaires, pour<br />
qu'on ne juge pas avec trop de rigueur une passion,<br />
dont la violence parfois nous déconcerte.<br />
* *<br />
Toutefois, malgré la pression du pouvoir, malgré<br />
les nuages d'erreurs amoncelés, tous les <strong>Paris</strong>iens<br />
s'étaient pas bourguignons.<br />
« Il y avait alors dans <strong>Paris</strong>, lit-on dans le Journal<br />
du siège d'Orléans, plusieurs notables personnages<br />
qui reconnaissaient que le roi Charles, septième du<br />
nom, était leur souverain seigneur et le vrai héritier<br />
du royaume de France, que c'était à grand tort et par<br />
vengeance qu'on les avait séparés de sa seigneurie et<br />
enlevés à son obéissance pour les mettre en la main<br />
du roi Henri d'Angleterre. » Nous savons, par la<br />
découverte d'une conjuration qui eut lieu à la fin de<br />
mars 1430, que des « grands de <strong>Paris</strong>, du Parlement,<br />
du Châtelet, des marchands et gens de métier »<br />
(Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>) et « quarante dizainiers<br />
» (Chronique des Cordeliers) tenaient le parti<br />
de Charles VII (1).<br />
Ce furent quelques-uns d'entre eux, sans doute,<br />
qui, au moment de l'assaut du 8 septembre, secondèrent<br />
les assaillants en semant la panique dans la<br />
ville. « Et à cette heure, il y eut dans <strong>Paris</strong> gens<br />
affectés (effrayés) ou corrompus, qui poussèrent un<br />
cri en toutes les parties de la ville, de çà et de là les<br />
ponts, criant que tout était perdu, que les ennemis<br />
étaient entrés dans <strong>Paris</strong>, et que chacun se retirât<br />
et fît diligence de se sauver. Et à cette voix, à une<br />
(I) Voir plus loin, le chapitre : Un carme conspirateur.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 109<br />
même heure de l'approche des ennemis, tous les<br />
gens étant lors ès sermons sortirent des églises (1),<br />
furent très épouvantés, se retirèrent la plupart en leurs<br />
maisons et fermèrent leurs portes. » (Fauquembergue.)<br />
Dans le clergé, séculier et régulier, il y avait aussi<br />
quelques partisans du droit. Le chancelier du chapitre<br />
de Notre-Dame et de l'Université, Gerson,<br />
était tout acquis à la cause de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; mais les<br />
troubles politiques l'avaient obligé à fuir ; pendant<br />
son exil, il avait écrit, en mai 1429, un traité en faveur<br />
de la Pucelle. Frère Richard, franciscain, qui, en avril<br />
de la même année, soulevait par ses prédications<br />
l'enthousiasme des <strong>Paris</strong>iens, déserta le parti bourguignon<br />
pour s'attacher aux pas de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; en<br />
une circonstance au moins, il fut son confesseur (2).<br />
Un Carme de <strong>Paris</strong> fut l'âme du complot de 1430.<br />
Ce ne sont là que des cas isolés ; le plus grand nombre<br />
des ecclésiastiques de <strong>Paris</strong> paraît bien avoir suivi<br />
l'opinion générale ; et on retrouve l'écho de leur émoi,<br />
lors de l'attaque de leur ville par <strong>Jeanne</strong>, dans les<br />
Registres du Chapitre de Notre-Dame.<br />
* *<br />
Comme dans les autres corps constitués, les chanoines<br />
de Notre-Dame avaient, en majorité, adhéré<br />
au traité de Troyes et reconnaissaient le roi d'Angleterre<br />
pour légitime souverain de France et d'Angleterre.<br />
Il y avait cependant des dissidents. Quand, le<br />
(1) C'était fête chômée, celle de la Nativité de la Vierge Marie;<br />
(2) Voir plus loin le chapitre : Cordeliers du XV e siècle.
110 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
25 ou 26 août, <strong>Jeanne</strong> arriva à Saint-Denis et que,<br />
les jours suivants, les membres du Chapitre durent<br />
renouveler le serment de fidélité à Henri VI, plusieurs<br />
des vénérables chanoines disparurent ; se mirent-ils<br />
à l'abri, ou passèrent-ils dans le camp de Charles VII?<br />
Les chanoines Jean Pinchenot, chargé de distribuer<br />
les jetons de présence ; Jean Guenet, qui avait la<br />
garde du chef de saint Denis ; le chantre qui, en l'absence<br />
du chancelier Gerson, détenait le grand et le<br />
petit sceau, s'étaient éloignés sans autorisation du<br />
Chapitre, sine licentia Capituli.<br />
Ils furent remplacés, le 30 août, dans leurs fonctions<br />
; les chanoines Jean Regnaudot et Jean Pétillon<br />
reçurent les charges des deux premiers! Gerson<br />
étant mort, le chanoine Jean Chuffart, qui remplissait<br />
par intérim la fonction de chancelier, fut investi,<br />
le 29 août, de cette dignité et on lui remit les sceaux.<br />
Nous connaissons encore les noms des chanoines<br />
Pasquier, J. de Lanco, Clément, P. d'Orgemont.<br />
Nous sommes assez renseignés sur deux d'entre eux,<br />
Chuffart et Pasquier, avec lesquels il ne sera pas sans<br />
intérêt de faire plus ample connaissance.<br />
Jean Chuffart était né à Tournay ; il faisait partie<br />
de l'Université de <strong>Paris</strong> et appartenait à la Faculté des<br />
Décrets, de Droit canonique, dirions-nous aujourd'hui;<br />
son lieu d'origine le rattachait à la nation de Picardie,<br />
laquelle se montrait, ainsi que la Faculté des Décrets,<br />
des plus dévouées au parti bourguignon. Maître ès<br />
arts, licencié ès lois, Chuffart avait été, à son tour,<br />
en 1421, recteur de l'Université (1) ; sa haute situation<br />
(1) Le recteur, choisi parmi les maîtres ès-arts, n'était élu que<br />
pour trois mois, par les procureurs des quatre nations.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 111<br />
dans cette puissante corporation lui avait procuré<br />
rnaints bénéfices ; il cumulait les titres de curé de<br />
Saint-Laurent, chanoine et curé de <strong>Sainte</strong>-Opportune,<br />
chanoine et doyen de Saint-Marcel, chanoine et<br />
doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, chanoine de<br />
Notre-Dame-de-<strong>Paris</strong>. La dignité de chancelier du<br />
Chapitre lui valut en même temps celle de chancelier<br />
de l'Université, dignité éminente qui faisait reposer<br />
sur celui qui en était titulaire « le poids des bonnes<br />
études de l'Université tout entière. » Dans cette<br />
charge il se montra si inférieur à sa tâche que, plus<br />
tard, Gérard Machet, confesseur de Charles VII,<br />
le pressera vivement de la résigner ; le chancelier<br />
promit, mais sans se hâter de tenir sa promesse.<br />
Aussi a-t-on pensé qu'il dût d'obtenir un tel honneur<br />
plus à la politique qu'au mérite ; il fut, en effet, dans<br />
les bonnes grâces de la reine Isabeau de Bavière ;<br />
elle fit de lui un de ses conseillers, son propre chancelier<br />
et l'institua un de ses exécuteurs testamentaires..<br />
Quand Charles VII entrera à <strong>Paris</strong>, en 1437, Chuffart<br />
saura encore en tirer bénéfice et réussira à se faire<br />
nommer conseiller clerc au Parlement.<br />
M. Tuetey, éditeur du Journal d'un Bourgeois de<br />
<strong>Paris</strong> (1), est parvenu, par suite de sagaces recherches<br />
et d'ingénieuses inductions, à considérer Jean Chuffart<br />
comme l'auteur de cette chronique anonyme, qui<br />
s'étend de 1408 à 1449; son opinion, contestée par<br />
quelques auteurs, est cependant généralement admise.<br />
Or le rédacteur de ce Journal manifeste une profonde<br />
aversion pour ceux qu'il appelle les Arminags, c'està-dire<br />
les Armagnacs, le parti du Dauphin ; toutes<br />
(1) Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>. Edition A. Tuetey, Société<br />
de l'histoire de <strong>Paris</strong>, in-8° ; 1881.
112 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
les fois qu'il doit parler de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, il adopte<br />
toujours les bruits et les racontars les plus défavorables<br />
; il montre un parti-pris évident et note tout<br />
ce qui est de nature à rabaisser la Pucelle ; sa haine<br />
est si vivace qu'il va jusqu'à laisser échapper à propos<br />
d'elle ce propos injurieux : « Créature en forme de<br />
femme, ce que c'était, Dieu le sait. » Une seule citation<br />
établira comment il dénature le caractère de<br />
<strong>Jeanne</strong>, dont il fait un monstre odieux : « En plusieurs<br />
lieux elle fit tuer hommes et femmes, soit dans le<br />
combat, soit par esprit de vengeance, car qui n'obéissait<br />
pas aux lettres qu'elle envoyait, elle les faisait<br />
mourir sans pitié, aussitôt qu'elle en avait le pouvoir ».<br />
Son confrère, le chanoine Pasquier, semble bien<br />
être le même que Pasquier de Vaux. Pasquier de<br />
Vaux appartenait également à l'Université de <strong>Paris</strong> ;<br />
docteur en décret, chanoine de <strong>Paris</strong> et de Rouen,<br />
membre, ainsi que Cauchon évêque de Beauvais,<br />
du conseil royal d'Angleterre pour les affaires de<br />
France, il était si attaché au parti anglais, que plus<br />
tard, devenu évêque de Meaux, il préférera quitter<br />
son évêché plutôt que faire sa soumission à Charles VII.<br />
Il sera, à Rouen, un des assesseurs, et non l'un des<br />
moins sévères, au procès de <strong>Jeanne</strong> ; assitera à de<br />
nombreuses séances ; paraîtra même à l'un des<br />
interrogatoires faits en la prison. Quand, le 19 mai,<br />
Cauchon communiquera les qualifications portées<br />
par l'Université de <strong>Paris</strong> sur les douze articles résumant<br />
l'instruction du procès, et exigera l'avis de<br />
chacun des quarante-huit assesseurs présents, Pasquier<br />
de Vaux dira faire sien le jugement de l'Université<br />
; c'était adhérer à la condamnation de <strong>Jeanne</strong>.<br />
Après la prétendue rechute de l'accusée, il déclarera, le<br />
29 mai, qu'il faut la livrer au bras séculier ; mais, à
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 113<br />
l'encontre de la presque unanimité des autres consulteurs,<br />
il sera l'un des deux estimant qu'il ne convient<br />
pas de supplier la justice civile d'user de clémence à<br />
l'égard de la relapse. Etait-ce de sa part excès de<br />
sévérité, ou simplement sincérité, n'ignorant pas que<br />
de cette hypocrite formule, toute de style, il ne serait<br />
tenu aucun compte ?<br />
A ces mêmes séances, des 19 et 29 mai, est signalée<br />
la présence d'un autre chanoine de <strong>Paris</strong>, ainsi désigné<br />
: « maître Pinchon, licencié en droit canon,<br />
archidiacre de Josiac (1) chanoine des églises de<br />
<strong>Paris</strong> et de Rouen. » Lui aussi adoptera, le 19 mai,<br />
les conclusions de l'Université de <strong>Paris</strong> ; et, le 29 mai,<br />
votera la condamnation de <strong>Jeanne</strong> : « ladite femme est<br />
relapse ; pour la manière de procéder ultérieurement,<br />
il s'en rapporte à messieurs les théologiens » ; c'était<br />
avisé de la part d'un canoniste ! (2)<br />
On conçoit l'émotion causée dans la population<br />
parisienne par les randonnées quotidiennes de <strong>Jeanne</strong><br />
<strong>devant</strong> <strong>Paris</strong>, du 26 août au 8 septembre. Les Registres<br />
du Chapitre de Notre-Dame en gardent les traces.<br />
Nous avons déjà rappelé comment, d'après Clément<br />
de Fauquembergue, greffier du Parlement, messire<br />
Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne et<br />
chancelier de France pour le parti anglais convoqua<br />
(1) Ne faut-il pas lire Josas, titre d'un ancien archidiaconé du<br />
diocèse de <strong>Paris</strong>?<br />
(2) Voir plus loin, au chapitre Universitaire prévaricateur et<br />
schismatique, le rôle d'un autre ecclésiastique devenu par la suite<br />
doyen du Chapitre de <strong>Paris</strong>.<br />
* *
114 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
pour neuf heures, le vendredi 26 août, en la chambre<br />
du Parlement, les notabilités parisiennes, afin de leur<br />
faire renouveler le serment de fidélité au roi de France<br />
et d'Angleterre, déjà prêté le 15 juillet précédent.<br />
Etaient convoqués les présidents et conseillers des<br />
trois chambres du Parlement, les maîtres des requêtes<br />
de l'hôtel, l'évêque et le prévôt de <strong>Paris</strong>, les maîtres<br />
et clercs des comptes, les avocats et procureurs, des<br />
représentants de l'Université, des chanoines, abbés,<br />
prieurs, curés et autres personnalités. Le Chapitre,<br />
disent les Registres, désigna trois délégués, dont deux<br />
au moins devront se rendre à la réunion ; parmi les<br />
personnages présents, Fauquembergue signale maître<br />
Jean Chuffart et maître Pasquier de Vaux ; étaient-ils<br />
là comme délégués du Chapitre, de l'Université, ou<br />
des deux à la fois?<br />
Le même jour, messire Louis de Luxembourg et<br />
les conseillers royaux donnèrent mission à maître<br />
Philippe de Rully, trésorier de la <strong>Sainte</strong>-Chapelle et<br />
maître des requêtes de l'hôtel, et à maître Marc de<br />
Foras, archidiacre de Thérische (?) et maître des<br />
comptes du roi, d'aller recevoir le même serment, le<br />
lendemain et jours suivants, des gens d'église, séculiers<br />
et réguliers, dans les chapitres, couvents et<br />
églises de la ville. Le 27, ou un des jours qui suivirent,<br />
ils vinrent donc au Chapitre de Notre-Dame et les<br />
chanoines prêtèrent le serment ; c'est peut-être pour<br />
se soustraire à cette obligation que, comme nous<br />
l'avons vu, quelques chanoines s'éloignèrent sans<br />
l'autorisation du Chapitre.<br />
Les circonstances étaient graves ; le siège était<br />
mis <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> ; on fermait la porte Saint-Martin ;<br />
on se hâtait de renforcer les fortifications et de les<br />
munir d'artillerie. Il ne faisait doute pour personne
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 115<br />
que l'attaque serait menée durement; ébranlés par<br />
les victoires rapides de <strong>Jeanne</strong>, qui n'avait encore<br />
connu aucun échec, les pessimistes prévoyaient que<br />
la ville pourrait bien être emportée d'assaut,<br />
Le Chapitre se réunit pour arrêter les mesures<br />
opportunes.<br />
Le conseil royal d'Angleterre imposait des emprunts<br />
aux églises et personnes ecclésiastiques, aux bourgeois<br />
et habitants de <strong>Paris</strong>, destinés à payer et entretenir<br />
les gens d'armes, laissés à la défense de la ville par le<br />
duc de Belford ou envoyés par le duc de Bourgogne.<br />
Le Chapitre dût voter sa contribution ; il chargea ses<br />
trois délégués, Jean Chuffart, Pasquier de Vaux et<br />
un autre, déjà désignés pour la prestation du serment<br />
le 26 août, d'offrir au conseil royal quatre-vingts m. (?);<br />
dans le cas où le conseil trouverait cette somme insuffisante,<br />
les délégués étaient autorisés à l'élever jusqu'à<br />
cent m.<br />
Le 31 août, le Chapitre décide d'implorer plus particulièrement<br />
la protection de Notre Dame ; à cause<br />
des périls du temps, une messe sera célébrée chaque<br />
jour <strong>devant</strong> la Vierge, en dehors du chœur, extra<br />
chorum.<br />
Le 5 septembre, on revient sur les dispositions<br />
déjà prises pour la garde du cloître et de l'église ;<br />
les chanoines de Lanco, Chuffart et Clément reçoivent<br />
mission d'accroître, de restreindre ou de modifier<br />
ces mesures, comme ils jugeront le plus convenable ;<br />
deux d'entre eux au moins devront les assurer.<br />
Ces mêmes chanoines auront aussi à se préoccuper<br />
de la subsistance de leurs collègues du Chapitre. Il<br />
faut prévoir que le siège peut se prolonger, la ville être<br />
prise et livrée au massacre. Il convient donc qu'ils examinent<br />
s'il est expédient de déposer des provisions
116 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
de vivres dans les tours de l'église, pour l'entretien des<br />
chanoines qui voudraient se retirer dans ces tours et<br />
y chercher un abri.<br />
Il est décidé que les maîtres fabriciens, — des<br />
chanoines sans doute, — prendront toutes mesures<br />
conservatoires pour soustraire à la malice des assiégeants<br />
les saintes reliques et le trésor de l'église ;<br />
on laisse à leur conscience d'agir pour le mieux.<br />
Si le siège se prolonge, les ressources peuvent venir<br />
à manquer ; il importe de s'en procurer. Maître<br />
Pasquier déclare que ses collègues, maître J. de Lanco,<br />
maître P. d'Orgemont et lui-même ont retiré du<br />
trésor de l'église la statue de Saint-Denis, dont la<br />
description se trouve dans l'inventaire du trésor ; ils<br />
n'en ont vendu que le buste, d'après son poids, qui<br />
est de 5 marcas, 6 encias et 5 stertingas, au prix de<br />
56 saluts d'or la marca ; le pied, qui est en argent,<br />
la tête et le diadème de cette statue n'ont pas été<br />
aliénés.<br />
Jean Chuffart est chargé de louer, au mieux des<br />
intérêts de l'église, deux moulins qu'elle possède in<br />
coquina sancti Augustini ; quelque érudit du Chapitre<br />
actuel saura sans doute dire où se trouvait cette<br />
« cuisine » de saint Augustin (1).<br />
* *<br />
Cependant <strong>Jeanne</strong> resserre son étreinte. Le mercredi<br />
7 septembre, elle tente une action directe contre<br />
la ville. En ce jour, dit le Journal d'un Bourgeois de<br />
(1) Peut-être dans les dépendances de l'Hôtel-Dieu, tenu par<br />
les Augustines ; telle est l'hypothèse que nous a suggérée M. le<br />
chanoine PISANI, dont l'érudition est bien connue.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 117<br />
<strong>Paris</strong>, « les Armagnacs vinrent assaillir les murs de<br />
la ville qu'ils croyaient emporter d'assaut. » Il y eut<br />
grand émoi au Chapitre, ainsi que dans <strong>Paris</strong> ; on<br />
redoutait que l'armée de Charles VII ne se portât,<br />
au cas où elle réussirait, à toutes sortes d'excès contre<br />
les habitants ; on avait répandu de faux bruits dans<br />
la ville et on prêtait aux assiégeants les pires intentions.<br />
« Mercredi 7 septembre. Aujourd'hui on a fait,<br />
notent les Registres, une procession solennelle à<br />
<strong>Sainte</strong>-Geneviève sur la montagne pour obtenir la cessation<br />
des maux présents et de l'attaque des ennemis ;<br />
les chanoines du Palais (1) y prirent part avec la vraie<br />
croix. Les ennemis, en effet, ont attaqué <strong>Paris</strong> dans<br />
l'espoir de le prendre et de mettre à mort toutes les<br />
personnes de l'un et l'autre sexe qu'ils y rencontreraient,<br />
ainsi qu'ils en avaient fait le serment et qu'ils<br />
s'en vantaient. Le soir ils ont cessé leur attaque et<br />
se sont retirés. »<br />
Sur l'issue de cette affaire, le Journal d'un Bourgeois<br />
de <strong>Paris</strong> est plus explicite : « Ils y gagnèrent peu,<br />
remarque-t-il, si ce n'est de la douleur, de la honte et<br />
du malheur; car plusieurs d'entre eux en emportèrent<br />
blessures pour toute leur vie, qui auparavant étaient<br />
entièrement sains ; mais fou ne croit que lorsqu'il en<br />
tient. Je le dis pour eux, qui étaient si mal inspirés,<br />
étaient pleins d'une si folle créance que, sur la parole<br />
d'une créature en forme de femme, — ce que c'était,<br />
Dieu le sait, — le jour de la Nativité de Notre-Dame<br />
ils formèrent la résolution, tous d'un pareil accord,<br />
d'assaillir <strong>Paris</strong> à pareil jour. »<br />
Si Chuffart est l'auteur de ce Journal, on s'explique<br />
la concordance qui existe entre quelques parties de<br />
(1) Les chanoines de la <strong>Sainte</strong>-Chapelle.
118 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
sa relation et certaines de celle des Registres. On a<br />
déjà remarqué que toutes deux présentent l'attaque<br />
du 7 septembre, comme une tentative pour prendre<br />
<strong>Paris</strong>. Les similitudes, entre les deux récits de l'opération<br />
du 8, sont encore plus frappantes.<br />
Le Journal reproche aux assiégeants la plénitude de<br />
leur « folle créance » en <strong>Jeanne</strong> ; les Registres disent :<br />
« le lendemain (8 septembre) ils recommencèrent leur<br />
attaque avec leur Pucelle, en qui ils mettaient comme<br />
en leur dieu leur confiance, cum eorum Puella, in qua<br />
tanquam in deum suum confidebant. » Le Bourgeois se<br />
scandalise que l'on ait entrepris cette opération le<br />
jour même de la fête de la Nativité de Notre-Dame ;<br />
les Registres attribuent à la protection de la Vierge,<br />
en ce jour de sa fête, l'échec des assaillants : « La résistance<br />
des <strong>Paris</strong>iens, leur confiance en Dieu, et en la<br />
généreuse Vierge dont la fête se célébrait solennellement<br />
à <strong>Paris</strong>, les firent échouer... leur Pucelle<br />
fut blessée à la cuisse, et ce fut, je crois, la cause de<br />
leur retraite... ils furent contraints de se retirer honteusement.<br />
» Le Journal prétend qu'au cours de leur<br />
retraite, les assaillants firent brûler leurs morts dans<br />
la grange des Mathurins ; il est seul à le dire avec<br />
les Registres qui, plus circonspects, n'enregistrent ce<br />
fait que comme un on-dit : « Ils perdirent beaucoup des<br />
leurs ; on en ignore le nombre, parce que, dit-on,<br />
ils ont brûlé leurs cadavres. » Le Journal note que<br />
« ceux de <strong>Paris</strong> enlevèrent aux Armagnacs la plus<br />
grande partie de leurs charrois avec lesquels ils<br />
avaient amené leurs bourrées » ; les Registres disent :<br />
« ils ramenèrent à Saint-Denis plusieurs de ces charrois<br />
sur lesquels ils avaient étendu leurs blessés ;<br />
d'autres charrois furent le lendemain conduits dans<br />
<strong>Paris</strong>. » Comme ces divers faits ne nous sont fournis
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 119<br />
que par ces deux documents, il semble bien que ces<br />
concordances ne sont pas fortuites ; ces récits sont de la<br />
même inspiration et permettent de supposer que, dans<br />
sa rédaction, le secrétaire du Chapitre a subi l'influence<br />
de Chuffart.<br />
Les Registres donnent sur l'attaque de la porte<br />
Saint-Honoré quelques autres renseignements intéressants,<br />
qui ont déjà été relevés.<br />
* *<br />
Ces renseignements fournis par les Chroniques nous<br />
permettent, malgré leur petit nombre et leur brièveté,<br />
de nous faire quelque idée de l'émotion de la population<br />
parisienne, au moment où <strong>Jeanne</strong> semblait<br />
devoir s'emparer de la ville.
PLAN MODERNE<br />
DU QUARTIER DU PALAIS-ROYAL<br />
AVEC<br />
LE TRACÉ DES FORTIFICATIONS AU TEMPS<br />
DE JEANNE D'ARC
LIEU OU FUT BLESSÉE<br />
JEANNE D'ARC<br />
LE 8 SEPTEMBRE 1429 1<br />
Peut-on préciserons l'état actuel de <strong>Paris</strong>, l'endroit<br />
où <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> fut blessée le 8 septembre 1429?<br />
Nous avons quelques points de repère qui limitent<br />
le champ des investigations ; mais il faut circonscrire<br />
celui-ci encore plus étroitement, si l'on veut parvenir<br />
à déterminer, à quelques mètres près, le lieu recherché.<br />
* *<br />
Ces points de repère sont d'une part la porte Saint-<br />
Honoré et le mur d'enceinte, et d'autre part le Marché<br />
aux pourceaux et la Butte des moulins ; c'est dans<br />
l'espace qui sépare les deux premiers des deux derniers<br />
que <strong>Jeanne</strong> conduisit son opération militaire.<br />
On a déjà rappelé où se trouvaient la Butte et le<br />
Marché. La Butte occupait approximativement 1 emplacement<br />
compris entre l'avenue de l'Opéra (à la<br />
hauteur des rues Saint-Roch et des Pyramides), la<br />
rue des Petits-Champs, la rue <strong>Sainte</strong>-Anne et la rue<br />
(1) Article publié dans la Semaine religieuse de <strong>Paris</strong>, numéro du<br />
20 octobre 1923, pp. 501-505.
122 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Thérèse. Le Marché aux pourceaux était à l'est de<br />
cette Butte, à peu près entre les rues des Petits-<br />
Champs, Thérèse et de Richelieu.<br />
Nous savons également où s'élevait la seconde<br />
porte Saint-Honoré (1). En 1866, MM. Berty et<br />
Vacquer en ont reconnu les substructions, mises à<br />
à jour alors qu'on exécutait des travaux d'égout.<br />
L'immeuble portant le numéro 163 de la rue Saint-<br />
Honoré, le trottoir et la chaussée bordant cet immeuble<br />
sur la place du Théâtre-Français, représentent l'emplacement<br />
de cette porte. Elle mesurait 8 m. 34 de<br />
largeur et environ 18 m. 50 de longueur ; cette dernière<br />
dimension n'a pu être exactement calculée, la moitié<br />
méridionale de l'édifice étant détruite, et le parement<br />
septentrional, engagé dans les caves, étant entamé (2).<br />
Nous connaissons également le parcours, dans cette<br />
région, de l'enceinte Caroline. Son tracé peut se<br />
représenter par une ligne traversant en diagonale,<br />
depuis la porte, la place du Théâtre-Français ; laissant<br />
sur sa gauche la première fontaine et sur sa<br />
droite la seconde ; longeant le coin de cette place et<br />
de la rue de Richelieu ; pénétrant par l'angle sudouest<br />
dans le jardin du Palais-Royal et en sortant vers<br />
la rue Baillif.<br />
Nous possédons, en effet, à ce sujet, un document<br />
de première importance : un plan de cette partie<br />
des remparts, depuis la rue Saint-Honoré jusqu'à la<br />
place des Victoires, levé en 1695 (Archives nationales ;<br />
(1) La première, celle de l'enceinte de Philippe-Auguste, se<br />
trouvait au lieu occupé actuellement par le temple de l'Oratoire ;<br />
la troisième fut bâtie, au dix-septième siècle, à l'intersection<br />
actuelle de la rue Saint-Honoré et de la rue Royale.<br />
(2) Bonnardot, Dissertations archéologiques sur les anciennes<br />
enceintes de <strong>Paris</strong>. Appendice.
PLAN, LEVÉ EN 1695, D'UNE PARTIE DES ANCIENS REMPARTS ET FOSSÉS<br />
DE L'ENCEINTE CAROLINE<br />
(Archives Nationales, Seine, N III. 45).
Par arrêt en date du 19 juillet 1695, le Conseil d'Etat du roi fit lever ce plan<br />
à l'échelle par l'architecte Delespine.<br />
Ce plan est extrêmement instructif. Il donne le tracé du mur d'enceinte,<br />
depuis l'emplacement de la porte Saint-Honoré (intersection des rues Nicaise<br />
et Saint-Honoré) jusqu'à la place des Victoires. Le mur passait à l'angle ouest<br />
actuel du jardin du Palais-Royal et se dirigeait à l'est vers la rue Bailly. On y<br />
voit que la terrasse du rempart avait, à sa base, environ 25 mètres : et que le<br />
grand fossé était large d'environ 40 mètres. Aucun autre document ne fournit<br />
ces indications avec une telle précision.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 123<br />
Seine, N. III, 45). Une contestation de propriété,<br />
probablement, entre le chapitre Saint-Honoré et<br />
des propriétaires voisins, au sujet d'un fief de treize<br />
arpents limité par le rempart, détermina le Conseil<br />
d'Etat à prendre un arrêt, en date du 19 juillet 1695,<br />
ordonnant de faire dresser par un architecte les limites<br />
du fief et de ses dépendances. L'architecte a fait son<br />
plan à l'échelle ; le mur d'enceinte est nettement<br />
marqué et suit le parcours indiqué ci-dessus ; à<br />
l'intérieur de la ville, la base du rempart mesure<br />
environ 25 mètres ; le grand fossé est large de près<br />
de 40 mètres (1).<br />
Or les fouilles faites, en 1912 et 1913, sous l'avenue<br />
de l'Opéra, ont confirmé l'exactitude de ce plan ;<br />
on retrouva, en effet, des vestiges du mur de l'enceinte<br />
de Charles V, suivant exactement le même parcours.<br />
* *<br />
Les chroniqueurs nous disent que, lors de l'assaut,<br />
<strong>Jeanne</strong> cherchait à escalader le mur d'enceinte, aux<br />
approches de la porte Saint-Honoré ; sur quel point<br />
du rempart porta-t-elle son effort?<br />
Si l'on considère une carte, on verra que, partie du<br />
Marché aux pourceaux, elle devait arriver, en ligne<br />
droite, à peu près en face du lieu où se voit actuellement<br />
la fontaine placée à proximité de la Comédie-<br />
Française. Il paraît bien que ce fut dans ces parages<br />
qu'elle ait été blessée.<br />
De place en place le mur d'enceinte était garni de<br />
(1) Nous savons par le plan de Mérian que, dès avant 1615,<br />
l'arrière-fossé était comblé et remplacé par un boulevard bordé<br />
d'arbres.
124 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
tours, du haut desquelles les assiégés ripostaient<br />
facilement aux coups des assaillants. Vraisemblablement,<br />
c'est entre la porte Saint-Honoré et la tour<br />
voisine que <strong>Jeanne</strong> dut attaquer le rempart. Si l'on<br />
pouvait établir exactement l'emplacement de cette<br />
tour, on restreindrait ainsi le champ des recherches ;<br />
mais ici commence la difficulté.<br />
Les plus anciens plans de <strong>Paris</strong>, qui nous conservent<br />
le tracé et l'image de l'enceinte Caroline, ne concordent<br />
ni sur le nombre, ni sur la place de ces tours. Entre la<br />
porte Montmartre et la porte Saint-Honoré, le plan<br />
d'Arnoullet en montre cinq ; le plan de Braun,<br />
quatre ; et celui de Truschet et Hoyau (ou de Bâle)<br />
trois. Les deux premiers situent la tour, qui suit la<br />
porte Saint-Honoré, au même endroit, c'est-à-dire<br />
à peu près au point marqué par l'angle sud-ouest<br />
du jardin du Palais Royal ; l'autre la représente plus<br />
loin, à peu près à l'endroit où les deux premiers<br />
placent une seconde tour, c'est-à-dire au point où<br />
la rue Baillif rencontre la rue de Valois ; ce qui donne<br />
un écart d'environ 140 mètres. Mais l'examen du<br />
plan de Truschet et Hoyau conduit à cette déduction<br />
que, précieux à consulter pour un grand nombre<br />
d'emplacements dans le <strong>Paris</strong> du seizième siècle, il<br />
l'est moins pour certains détails, en particulier pour<br />
les tours de l'enceinte ; cela est vrai notamment pour<br />
celles de la courtine longeant la Seine, entre la Tour<br />
en Bois et la Tour du Coin ; aussi Berty adopte-t-il<br />
la restitution du plan de Braun, figurant sept tourelles,<br />
de forme carrée et donnant sur le fleuve (1). Il semble<br />
donc qu'on puisse s'en tenir à l'indication fournie par<br />
(1) Berty, Le Louvre et les Tuileries, I, p. 169.
FRAGMENT DU MUR DE L'ENCEINTE CAROLINE, RENCONTRÉ<br />
DANS LES FOUILLES DE 1912 ET 1913.<br />
La découverte d'une partie du mur de l'enceinte précise l'endroit, déjà<br />
fixé par le plan de 1695, où commençait le grand fossé.<br />
Déjà les fouilles de 1866 avaient mis à jour une partie des substructions<br />
de la porte Saint-Honoré, à la hauteur du n° 163 actuel de la rue Saint-Honoré<br />
et sur toute la largeur de cette rue, comme on le voit sur ce plan.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 125<br />
les plans de Braun et d'Arnoullet, qui placent la<br />
tour à l'entrée du jardin du Palais-Royal.<br />
M. Emile Eude, architecte du monument de <strong>Jeanne</strong><br />
<strong>d'Arc</strong> à Vaucouleurs, voit, lui aussi cette tour à<br />
« l'emplacement de l'angle sud-ouest » du jardin (1) ;<br />
mais il prétend — sans dire toutefois sur quoi il<br />
fonde son opinion — que <strong>Jeanne</strong> aurait dirigé son<br />
assaut contre cette tour ; cette assertion paraît discutable<br />
.<br />
Que se proposait la Pucelle? Elle voulait s'emparer<br />
de la porte Saint-Honoré pour l'ouvrir à ses troupes et,<br />
par là, les faire pénétrer dans la ville. Elle ne pouvait<br />
la prendre d'assaut, sinon elle l'eût directement<br />
attaquée. Les chroniqueurs s'accordent pour dire<br />
qu'elle voulait escalader la muraille avec quelquesuns<br />
de ses hommes d'armes, afin de se rendre ainsi<br />
maîtresse de cette porte. Il est vraisemblable, dans ces<br />
conditions, qu'elle a dû porter son effort, non sur un<br />
point assez éloigné (environ 140 mètres séparaient<br />
la tour de la porte), fortifié et bien défendu, comme<br />
devait l'être la tour ; mais sur un endroit de l'enceinte<br />
plus vulnérable et à proximité de la porte. Fauquembergue,<br />
d'ailleurs, le dit clairement, quand il rapporte<br />
que les soldats de <strong>Jeanne</strong> jetèrent des bourrées dans<br />
le fossé pour le franchir « non loin de la susdite porte ».<br />
Ceci nous ramène, par conséquent, dans le voisinage<br />
de la fontaine rapprochée de la rue de Richelieu, à<br />
une soixantaine de mètres de la porte Saint-Honoré.<br />
(1) « L'attaque de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> sur <strong>Paris</strong> », Cosmos, n° 504,<br />
22 septembre 1894, pp. 241-244.
126 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
* *<br />
Quand, « après le soleil couchant », <strong>Jeanne</strong> fut<br />
atteinte par un « vireton », ou trait d'arbalète, elle se<br />
trouvait sur le dos d'âne, c'est-à-dire sur le talus qui<br />
séparait les deux fossés. On peut facilement retrouver<br />
l'endroit où courait ce dos d'âne, parallèlement au<br />
mur d'enceinte ; il suffit de connaître la largeur du<br />
grand fossé, dont l'eau baignait le pied de la muraille.<br />
Dans l'étude déjà citée, M. E. Eude dit, en note,<br />
que d'après le capitaine d'artillerie Marin, ce fossé,<br />
rempli par une crue de la Seine, aurait présenté<br />
2 m . 50 environ de profondeur sur 20 mètres de<br />
largeur. L'opinion de M. Lucien Hoche paraît mieux<br />
établie ; il note, dans son intéressant <strong>Paris</strong> occidental :<br />
la rue Saint-Honoré (I), que la largeur des fossés de<br />
l'enceinte de Charles V était de 16 toises ou 32 mètres,<br />
et se réfère à une communication de M. Guillaumin,<br />
dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de France (2),<br />
relative à des fouilles, qui ont mis au jour des vestiges<br />
de la contrescarpe.<br />
Ainsi en comptant environ 32 mètres au-delà de<br />
l'enceinte, vis-à-vis de la fontaine voisine de la rue<br />
de Richelieu, on voit qu'une ligne droite, tirée du<br />
Marché aux pourceaux, rencontrerait le dos d'âne<br />
à peu près au point où est placé actuellement l'immeuble<br />
portant le n° 2 de l'avenue de l'Opéra.<br />
* *<br />
Or c'est là, précisément, la conclusion à laquelle<br />
a abouti la Commission municipale du Vieux-<strong>Paris</strong>.<br />
(1) Tome I er , p. 50, note 5. — <strong>Paris</strong>, Leclerc, 1912.<br />
(2) Année 1889, pp. 173-174.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 127<br />
Dans son rapport, présenté au nom de la 2 e Sous-<br />
Commission, M. Charles Magne, inspecteur des<br />
fouilles archéologiques de la Ville de <strong>Paris</strong>, dit, en<br />
effet (1) ;<br />
« Nous avons reporté sur notre plan d'ensemble,<br />
à la hauteur du numéro 2 de l'avenue de l'Opéra,<br />
une ligne pointillée. Celle-ci, tracée par M. Hoffbauër,<br />
indique approximativement l'état des fossés de la<br />
fortification de Charles V et figure entre eux le dos<br />
d'âne où se trouvait <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, lorsqu'elle reçut<br />
sa blessure au cours de l'assaut de 1429.<br />
« L'on sait, en effet, d'après les récits que nous<br />
ont laissés les anciens chroniqueurs, que <strong>Jeanne</strong>,<br />
marchant à la tête de ses troupes, après avoir traversé<br />
la place aux Pourceaux, avait franchi sans difficulté<br />
l'arrière-fossé. Arrêtée par le grand fossé qui était<br />
plein d'eau, elle s'efforçait d'en reconnaître la profondeur,<br />
lorsqu'elle fut atteinte à la cuisse par un<br />
trait. Elle devait alors se trouver, si l'on en croit les<br />
récits du temps, sur le dos d'âne qui séparait les<br />
deux fossés, à quelque distance en avant du mur<br />
que nous avons rencontré (2) et à 60 mètres environ<br />
de la porte Saint-Honoré. <strong>Jeanne</strong>, blessée, pour éviter<br />
de rester sous le feu des assiégés, dut aller s'appuyer<br />
contre le talus du dos d'âne qui regardait la campagne :<br />
la hauteur (3 mètres environ) de cette butte de terre,<br />
devait être, en effet, une protection suffisante contre<br />
les coups de la place.<br />
« D'après nos calculs, le lieu où fut blessée <strong>Jeanne</strong><br />
<strong>d'Arc</strong> se trouverait ainsi déterminé par l'emplacement<br />
(1) Procès-verbaux, année 1914, pp. 12-20.<br />
(2) Dans les fouilles de 1912 et de 1913.
128 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
qu'occupe le numéro 2 de l'avenue de l'Opéra et<br />
par le trottoir qui s'étend <strong>devant</strong> cet immeuble. »<br />
* *<br />
Dans une réunion qui s'est tenue le 9 novembre 1923<br />
à la Mairie du I er Arrondissement, et à la suite d'une<br />
conférence faite par l'auteur de ces lignes, sous les<br />
auspices du Centre de <strong>Paris</strong> (Société historique et<br />
archéologique des I er et II e arrondissements), le vœu<br />
suivant a été adopté et transmis à la Commission<br />
municipale du Vieux-<strong>Paris</strong> :<br />
« Les membres de la Société « le Centre de <strong>Paris</strong> »,<br />
réunis en séance publique du Comité le 9 novembre<br />
1923 ;<br />
« Considérant que la porte Saint-Honoré de l'enceinte<br />
de Charles V a été le principal théâtre de l'attaque<br />
de <strong>Paris</strong> par <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> le 8 septembre 1429 ;<br />
« Considérant que l'endroit où <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>,<br />
au cours de l'attaque, a été blessée, est déterminé avec<br />
précision ;<br />
« Estimant que ce glorieux épisode de la vie de<br />
<strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, intéressant l'histoire de <strong>Paris</strong>, doit<br />
être constamment rappelé au souvenir des <strong>Paris</strong>iens,<br />
des Français et des étrangers qui passent auprès de<br />
ces lieux ;<br />
« Emettent le vœu qu'une plaque commémorative<br />
avec plan de l'ancien état des lieux soit placée à<br />
l'angle sud de la maison portant le n° 2 de l'avenue de<br />
l'Opéra.<br />
« Et souhaitent que l'inauguration de cette plaque<br />
puisse avoir lieu lors de la prochaine fête nationale<br />
de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>. »
CORDELIERS DU XV e SIECLE<br />
Vers le 12 avril 1429 arriva à <strong>Paris</strong> un Cordelier<br />
revenant de Terre <strong>Sainte</strong> (1). Il fit courir toute la<br />
ville ; on allait l'entendre « aux Innocents et ailleurs<br />
» (2) ; « il commençait son sermon à cinq heures<br />
du matin et le terminait entre dix et onze heures ».<br />
Qu'en penseraient nos modernes auditoires, qui<br />
ne peuvent supporter une prédication d'une heure?<br />
Le Cordelier, il est vrai, exerçait un attrait particulier<br />
; pour l'entendre il venait jusqu'à cinq à six<br />
mille personnes ; ce qui laisse supposer qu'il parlait sur<br />
lu place publique. Il racontait des choses extraordinaires<br />
; en Terre <strong>Sainte</strong> il avait vu, assurait-il,<br />
une foule de Juifs s'en aller par troupes à Babylone y<br />
vénérer leur Messie qui venait de naître ; ce Messie,<br />
affirmait-il, n'était autre que l'Antéchrist ; aussi<br />
annonçait-il pour l'année suivante, 1430, les plus<br />
graves événements et prophétisait-il que le jour du<br />
Jugement était proche. Ses exhortations enflammées<br />
transformaient la population ; les <strong>Paris</strong>iens renon-<br />
(1) D'après la Chronique de la Pucelle ; le Greffier de La Rochelle<br />
; Jean Rogier, échevin de Reims ; le Journal d'un Bourgeois<br />
de <strong>Paris</strong> ; le Marteau des sorcières de Jean Nider ; les Procès-<br />
Verbaux du procès de <strong>Jeanne</strong> à Rouen, etc.<br />
(2) L'église et le cimetière des Innocents se trouvaient à 1 endroit<br />
occupé aujourd'hui par le square des Innocents, près des<br />
Halles.
130 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
çaient aux « jeux de tables, de boules, de dés, bref (à)<br />
tous ceux qu'il défendait » ; il leur faisait prendre<br />
« une médaille d'étain sur laquelle était empreint le<br />
nom de Jésus » ; les femmes brûlaient leurs atours.<br />
Le Bourgeois de <strong>Paris</strong>, qui nous fournit ces détails et<br />
auquel cet extraordinaire Cordelier paraît avoir été<br />
particulièrement antipathique, ajoute ironiquement,<br />
avec une intention malveillante, qu'il était, aux yeux<br />
de certaines dévotes » le « beau » Père.<br />
Soudain il disparut ; ses prédications n'avaient<br />
duré que dix jours » du samedi 16 au mardi 26 avril.<br />
Il devait prêcher, le dimanche 1 er mai, « au lieu, ou<br />
tout près, où Mgr saint Denis fut décollé avec maints<br />
autres martyrs », c'est-à-dire sur la colline Montmartre<br />
; l'annonce en fut publiée dans la ville, le<br />
dimanche 24 avril ; on se le répéta au cours de la<br />
semaine. « Il y alla plus de six mille personnes de<br />
<strong>Paris</strong> (1) ; la plupart partirent le samedi au soir par<br />
nombreuses bandes, pour avoir meilleure place le<br />
dimanche au matin ; elles couchèrent aux champs,<br />
dans de vieilles masures, le mieux qu'elles purent. »<br />
Le dimanche matin, on attendit vainement le Cordelier;<br />
il ne vint point ; brusquement il avait quitté <strong>Paris</strong><br />
entre le 26 et le 30 avril. Le Bourgeois de <strong>Paris</strong> ajoute :<br />
« son fait fut empêché. Comment? De cela je m'en<br />
tais ; mais il ne prêcha point ; ce dont les bonnes gens<br />
de <strong>Paris</strong> furent fort émus. Il ne prêcha plus de cette<br />
saison à <strong>Paris</strong>, d'où il dut partir. »<br />
Le canoniste Chuffart, auteur présumé du Journal<br />
d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>, ancien recteur de l'Université<br />
de <strong>Paris</strong> dont il devait devenir prochainement<br />
chancelier, savait à quoi s'en tenir sur la fuite préci-<br />
(1) La colline Montmartre était hors les murs.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 131<br />
pitée du Cordelier, frère Richard, mais ne jugeait pas<br />
opportun de le noter. Plus d'un demi-siècle après,<br />
l'évêque de Lisieux, Thomas Basin, exilé par Louis XI,<br />
employait à Utrecht ses loisirs à écrire une Histoire de<br />
Charles VII et de Louis XI ; « Il y a près de soixante<br />
ans, y dit-il, que faisant nos études à <strong>Paris</strong>, nous<br />
vîmes frère Richard, de l'Ordre de Saint-François,<br />
qui annonçait que l'Antéchrist était né et que le jour<br />
du jugement était proche. Il trouva tant de créance<br />
auprès du peuple qu'il comptait jusqu'à soixante<br />
mille auditeurs (1) ; mais comme il semait cette<br />
erreur (2) et quelques autres, il comprit que la Faculté<br />
de théologie allait procéder contre lui, et il se déroba<br />
secrètement. »<br />
Frère Richard retourna en Champagne, où il<br />
avait séjourné avant de venir s'exposer aux sévérités<br />
de l'Université de <strong>Paris</strong>. Au mois de décembre<br />
précédent, en effet, on le vit dans cette région, où<br />
il « allait prêchant par le pays » ; durant l'Avent il<br />
parlait à Troyes et y « disait tous les jours », dans son<br />
langage apocalyptique : « semez des fèves largement,<br />
celui qui doit venir viendra bientôt » ; faisant allusion<br />
à la fin du monde qu'il annonçait prochaine. Les<br />
gens de Troyes prirent son conseil au mot, sans trop<br />
s'attacher au sens symbolique ; ils semèrent « des<br />
fèves si largement que ce fut merveille » ; et quand, en<br />
(1) Sans nul doute, dans la totalité de ses prédications, à raison<br />
d'environ 6.000 par jour, pendant dix jours ; il n'y aurait pas<br />
d'orateur qui put se faire entendre à 60.000 personnes réunies ;<br />
un orateur ne peut être entendu que de 5.000 personnes au<br />
maximum, et ceci dans les meilleures conditions acoustiques<br />
réalisables pratiquement.<br />
(2) L'apparition de l'Antéchrist et l'approche du Jugement<br />
dernier.
132 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
juillet suivant, l'armée du Dauphin, dénuée de vivres,<br />
se présenta <strong>devant</strong> Troyes, elle trouva assez de fèves<br />
pour se nourrir « par quelque temps ; et toutefois ledit<br />
prêcheur ne songeait point à la venue du roi » (1),<br />
mais à celle du Fils de l'homme venant sur les nuées<br />
juger chacun selon ses œuvres.<br />
Troyes paraît avoir été, durant un certain temps,<br />
le principal centre d'action du frère Richard, avant<br />
et après son séjour à <strong>Paris</strong>. On le voit en bonnes<br />
relations avec les habitants de Châlons, qui 1' « estimaient<br />
un très bon prud'homme ». Vivant en plein<br />
parti bourguignon, peu au courant sans doute des<br />
sanglantes querelles entre Armagnacs et Bourguignons<br />
dont son voyage en Terre <strong>Sainte</strong> l'avait tenu<br />
éloigné, il est naturel qu'il ait épousé, plus ou moins<br />
passionnément, les opinions de ceux qu'il fréquentait ;<br />
à <strong>Paris</strong> comme en Champagne, il n'en a guère connu<br />
d'autres. Ses allées et venues le mirent en relations<br />
avec trois ou quatre bourgeois de Reims qui complotaient,<br />
rapporte l'échevin Jean Rogier, l'entrée du<br />
Dauphin dans leur ville ; frère Richard en avertit ses<br />
amis de Troyes, qui en firent rapport au duc de<br />
Bourgogne.<br />
Le 5 juillet, le Dauphin, <strong>Jeanne</strong> et l'armée royale,<br />
arrivaient <strong>devant</strong> Troyes, vers neuf heures du matin ;<br />
la ville ayant fermé ses portes, on commença le siège.<br />
C'est alors que les habitants, voulant savoir si <strong>Jeanne</strong><br />
venait de la part de Dieu ou du démon, envoyèrent<br />
frère Richard aux informations. La rencontre ne<br />
manque pas de pittoresque ; le Cordelier s'avance,<br />
faisant des signes de croix, aspergeant la Pucelle d'eau<br />
bénite, bref esquissant un exorcisme ; <strong>Jeanne</strong>, qu'une<br />
(1) Chronique de la Pucelle.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 133<br />
telle scène parait amuser, lui crie d'approcher sans<br />
crainte de la voir s'envoler ; elle le rapporte elle-même,<br />
au cours de son procès (séance du 3 mars), avec<br />
cette spontanéité pleine de charme qui lui est propre :<br />
« Ceux de la ville de Troyes, à ce que je pense, l'envoyèrent<br />
devers moi, disant qu'ils craignaient que<br />
mon fait ne fut pas chose de par Dieu ; et quand il<br />
vint devers moi, en approchant il faisait le signe de la<br />
croix et jetait de l'eau bénite, et je lui dis : Approchez<br />
hardiment, je ne m'envolerai pas. » Le Cordelier,<br />
satisfait de cette entrevue, revint à Troyes, avec une<br />
lettre de <strong>Jeanne</strong> pour les habitants, au dire de Jean<br />
Rogier, une autre probablement que celle qu'elle<br />
leur avait adressée, le 4 juillet, de Saint-Phal.<br />
Trois ou quatre jours après, le samedi 9 peut-être,<br />
tandis que l'évêque de Troyes parlementait avec<br />
le bailli et les notabilités pour les engager à ouvrir au<br />
Dauphin les portes de leur cité, frère Richard avait<br />
un long entretien avec la Pucelle. « Un saint prud'homme,<br />
Cordelier, rapporte le Greffier de La Rochelle,<br />
en qui tous ceux de la ville et du pays avaient grande<br />
foi et confiance, sortit de la ville pour aller voir la<br />
Pucelle. Sitôt qu'il la vit, et d'assez loin, il s'agenouilla<br />
<strong>devant</strong> elle ; et quand la Pucelle le vit, elle s'agenouilla<br />
pareillement <strong>devant</strong> lui ; ils se firent l'un à l'autre<br />
grand accueil et grande révérence, et parlèrent longtemps<br />
ensemble. » Cet entretien persuada le Cordelier<br />
de la divinité de la mission de <strong>Jeanne</strong>, de la puissance<br />
qui était en son pouvoir, de la légitimité du Dauphin,<br />
du devoir des habitants de reconnaître celui-ci comme<br />
leur véritable souverain ; car, de retour dans la ville,<br />
frère Richard « prêcha très grandement au peuple,<br />
en le pressant de faire son devoir envers le roi, lui<br />
remontrant comment Dieu dirigeait son fait et lui
134 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
avait baillé, pour l'accompagner et le conduire à son<br />
sacre, une sainte Pucelle qui, comme il le croyait<br />
fermement, savait autant et avait aussi grande puissance<br />
de savoir les secrets de Dieu que saint qui fut<br />
en paradis, après saint Jean l'évangéliste ; que, si<br />
elle voulait, elle avait assez de puissance pour faire<br />
entrer tous les gens d'armes du roi en la ville par<br />
dessus les murs, en quelque manière qu'elle voudrait ;<br />
et plusieurs autres choses. Incontinent tous crièrent<br />
à vive voix : Vive le roi Charles de France » (1).<br />
Interrogée à son procès sur ce sermon du Cordelier<br />
(séance du 3 mars), <strong>Jeanne</strong> répondit n'en rien savoir :<br />
« quant au sermon, je n'en sais rien. » L'intervention<br />
de l'évêque de Troyes, du doyen, et du Cordelier,<br />
décida les habitants à ouvrir au roi les portes de leur<br />
ville. Charles VII fit son entrée à Troyes, le 10 juillet.<br />
<strong>Jeanne</strong> répondit à son procès (même séance ) : « A<br />
mon avis, frère Richard entra avec nous à Troyes ;<br />
mais je ne suis pas souvenante si je le vis à l'entrée. »<br />
Les Bourguignons, en Champagne, n'apprirent pas<br />
sans stupéfaction la soudaine volte-face du Cordelier :<br />
« Les habitants de Châlons » rapporte Jean Rogier,<br />
mandèrent « aux habitants de Reims qu'ils avaient été<br />
fort ébahis du dit frère Richard, d'autant plus qu'ils<br />
estimaient que ce fut un très bon prud'homme ;<br />
mais qu'il était devenu sorcier. »<br />
A <strong>Paris</strong>, ce fut de la colère : « Pour vrai le Cordelier<br />
qui prêcha aux Innocents et assemblait tant de peuple<br />
à son sermon, comme il a été dit, raconte le Bourgeois<br />
de <strong>Paris</strong>, pour vrai il chevauchait avec les Armagnacs.<br />
Aussitôt que ceux de <strong>Paris</strong> furent certains qu'il<br />
chevauchait ainsi et que par ses discours il faisait<br />
(1) Greffier de La Rochelle.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 135<br />
ainsi tourner les cités qui avaient fait serment au<br />
régent de France ou à ses délégués, ils le maudissaient<br />
de Dieu et de ses saints, et qui pis est, par dépit de<br />
lui, ils recommencèrent les jeux de tables, de boules,<br />
dès, bref tous ceux qu'il avait défendus ; ils laissèrent<br />
même une médaille d'étain sur laquelle était empreint le<br />
nom de Jésus qu'il leur avait fait prendre, et prirent<br />
tous la croix de Saint-André» (1)<br />
Les Anglais n'étaient pas moins courroucés. Le<br />
duc de Bedford, régent de France pour l'Angleterre,<br />
dans une lettre adressée, le 7 août, à Charles VII pour<br />
lui offrir la bataille, lui reprochera de se faire « aider<br />
principalement par des gens superstitieux et condamnés,<br />
telle qu'une femme désordonnée, travestie,<br />
portant vêtement d'homme et de gouvernement<br />
dissolu, et aussi d'un Frère mendiant, apostat et<br />
séditieux. »<br />
Frère Richard s'était, en effet, attaché à la Pucelle.<br />
Il est à Reims, au sacre du roi, mais n'y a pas tenu<br />
l'étendard de <strong>Jeanne</strong>, comme on l'insinua faussement<br />
au procès (séance du 3 mars). Il est à Montépilloy,<br />
près de Senlis, lors de la rencontre des armées anglaise<br />
et française (15 et 16 août) ; c'est pendant les deux<br />
jours que l'armée campa en cet endroit, que <strong>Jeanne</strong><br />
s'est confessée à lui, d'après la déposition, au procès<br />
de réhabilitation, du sire Albert d'Ourches, chevalier,<br />
seigneur d'Ourches : « Je l'ai vue se confesser au<br />
frère Richard, <strong>devant</strong> la ville de Senlis et recevoir<br />
durant deux jours le corps du Christ. » Au moment de<br />
l'attaque de <strong>Paris</strong>, il est probable qu'il a dû se tenir<br />
prudemment à l'écart, attendant le résultat de l'entre-<br />
(1) La croix de Saint-André était l'insigne de la maison de Bourgogne.
136 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
prise, n'étant pas pressé de renouer connaissance<br />
avec une ville, dont il avait dû s'éloigner si précipitamment,<br />
ni avec les citadins que sa défection avait<br />
irrités ; ni de s'exposer aux poursuites de l'Université,<br />
dont les passions bourguignonnes ne feraient qu'exciter<br />
contre lui le zèle à défendre la foi.<br />
Désormais considéré par les Bourguignons comme<br />
sorcier, superstitieux, apostat, séditieux, frère Richard<br />
n'allait guère se trouver mieux de son passage au<br />
camp des Armagnacs ; il devait s'attirer d'autres<br />
histoires.<br />
Entendons d'abord le Bourgeois de <strong>Paris</strong> ; nous essaierons<br />
ensuite de démêler ce qu'il convient de retenir<br />
de ses allégations. Le 4 juillet 1431, conformément à<br />
un ordre de la cour anglaise, eut lieu, à <strong>Paris</strong>, à Saint-<br />
Martin-des-Champs, la promulgation officielle de la<br />
condamnation de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; le prédicateur était<br />
le grand inquisiteur lui-même, le dominicain Graverent<br />
; voici ce que lui fait dire le Bourgeois :<br />
« Dans son sermon, le prédicateur disait encore<br />
quelles étaient quatre, ces femmes, et que trois<br />
avaient été prises, à savoir cette Pucelle (<strong>Jeanne</strong>),<br />
Pierronne et sa compagne. La quatrième, nommée<br />
Catherine de La Rochelle, est avec les Armagnacs ;<br />
elle dit que lorsqu'on consacre le précieux corps de<br />
Notre-Seigneur, elle voit merveilles du haut mystère<br />
de Notre-Seigneur Dieu. Toutes les quatre pauvres<br />
femmes ont été gouvernées par le Cordelier, frère,<br />
Richard, celui qui attira après lui si grande multitude<br />
quand il prêcha aux Innocents et ailleurs. Il était leur<br />
beau Père. Le jour de Noël, à Jargeau, il donna trois<br />
fois le corps de Notre-Seigneur à cette dame <strong>Jeanne</strong><br />
la Pucelle ; ce dont il est fort à reprendre. Ce même jour<br />
il l'aurait donné deux fois à Pierronne, d'après le
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 137<br />
témoin des aveux de ces femmes et d'après quelquesuns<br />
qui furent présents aux heures où il leur donna<br />
ainsi le précieux sacrement. »<br />
Tout ce récit est un tissu de fables invraisemblables ;<br />
le Cordelier n'a jamais été le directeur de <strong>Jeanne</strong> ;<br />
il 1'a confessée une fois et peut-être quelques autres ;<br />
mais le confesseur régulier de la Pucelle était le moine<br />
augustin Jean Pâquerel. Que faut-il retenir de ses<br />
rapports avec Pierronne et Catherine de La Rochelle?<br />
Pour la première, c'est obscur ; pour la seconde, c'est<br />
nettement à son désavantage.<br />
Nous ne sommes renseignés sur Pierronne et sa<br />
compagne que par Chuffart et le dominicain allemand<br />
Jean Nider ; ce dernier dit tenir de Nicolas Lamy,<br />
licencié en théologie, député de l'Université de <strong>Paris</strong><br />
à l'assemblée de Bâle, ce qui suit : « Parurent dans les<br />
environs de <strong>Paris</strong> deux femmes disant hautement<br />
être envoyées par Dieu pour venir en aide à <strong>Jeanne</strong> la<br />
Pucelle. Ainsi que me l'a exposé de vive voix ledit<br />
maître Nicolas (Lamy), elles furent, comme magiciennes<br />
et sorcières, appréhendées par l'inquisiteur<br />
de la foi. Examinées par plusieurs docteurs en théologie,<br />
il fut établi que leurs extravagances étaient<br />
l'effet des tromperies du malin esprit ». Cette appréciation<br />
est suspecte, parce qu'elle émane de Nicolas<br />
Lamy, qui fut, à l'assemblée schismatique de Bâle,<br />
le collègue actif d'Erard, de Beaupré, de Courcelles,<br />
les mauvais juges de Rouen ; parce qu'elle suit immédiatement<br />
celle qu'il vient de formuler sur <strong>Jeanne</strong>,<br />
« une magicienne » justement livrée au bûcher. Rien<br />
ne prouve que le jugement, porté sur Pierronne et sa<br />
compagne par Lamy et rapporté par Nider, soit<br />
mieux fondé que celui qu'il émet sur <strong>Jeanne</strong>.<br />
Le témoignage de Chuffart est encore plus sujet
138 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
à caution, en raison de l'animosité manifeste qu'il<br />
accuse envers la Pucelle. Pierronne et sa compagne,<br />
se présentant comme envoyées de Dieu pour aider<br />
<strong>Jeanne</strong> dans sa mission, ne devaient pas être par lui<br />
mieux traitées qu'elle : « La plus âgée, Pierronne, qui<br />
était de Bretagne bretonnant, écrit-il, disait et soutenait<br />
que dame <strong>Jeanne</strong> qui s'armait avec les Armagnacs<br />
était bonne, que ce qu'elle faisait était bien fait et<br />
selon Dieu. Elle reconnut avoir reçu deux fois en un<br />
jour le précieux corps de Notre-Seigneur. Elle affirmait<br />
et jurait que Dieu lui apparaissait souvent en<br />
son humanité, et lui parlait comme un ami à son ami,<br />
que la dernière fois qu'elle l'avait vu, il était revêtu<br />
d'une longue robe blanche et avait par-dessous une<br />
huque vermeille, ce qui est comme un blasphème ».<br />
De tout ce racontar, une seule chose est digne d'attention<br />
; Pierronne soutenait la cause de <strong>Jeanne</strong> ; c'était<br />
là son principal crime aux yeux de certains Universitaires,<br />
entièrement dévoués au parti bourguignon.<br />
Pierronne et sa compagne « avaient été prises à<br />
Corbeil et amenées à <strong>Paris</strong> », dans les premiers mois<br />
de 1430. Condamnées par le tribunal ecclésiastique<br />
« comme magiciennes et sorcières », elles « furent<br />
prêchées au parvis Notre-Dame, le troisième jour<br />
de septembre, un dimanche ». La plus jeune « se<br />
reconnaissant séduite par l'ange de Satan, se repentit,<br />
sur les représentations des maîtres, de ses erreurs<br />
passées et les abjura comme c'était son devoir » ;<br />
elle « fut délivrée pour cette heure ». Pierronne<br />
« persistant dans son opiniâtreté », « ne voulut jamais<br />
rétracter l'affirmation de ce propos qu'elle voyait<br />
souvent Dieu sous cette forme ; sur quoi ce même<br />
jour elle fut condamnée à être brûlée, et elle le fut,<br />
et elle mourut en son dire ce même dimanche ».
LA PORTE SAINT-HONORÉ ET SES ENVIRONS VERS 1530.<br />
Plan d'Arnoulet.<br />
La porte est représentée sommairement. On voit très nettement que la baie<br />
de l'avant-porte n'est pas dans l'axe de celle de la porte même.<br />
L'enceinte est garnie de tourelles et de bastides, reliées entre elles par un<br />
chemin de ronde crénelé.<br />
On distingue facilement le grand fossé, le dos d'âne, l'arrière-fossé et la<br />
contrescarpe.<br />
L'extrémité de la Butte des moulins s'aperçoit au bas de la carte, sous la<br />
légende.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 139<br />
Voilà tout ce que, sur ces deux femmes, nous ont<br />
conservé ces témoignages douteux. Etaient-elles en<br />
relations avec <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, et quelles étaient ces<br />
relations? Pierronne a-t-elle été réellement dirigée<br />
par le frère Richard? Se trouvait-elle vraiment à<br />
Jargeau le 25 décembre 1429? Comment le savoir?<br />
Il paraît bien invraisemblable cependant que le<br />
Cordelier lui ait donné, au jour de Noël, deux fois,<br />
et à <strong>Jeanne</strong> trois fois, la communion ; s'il l'eut fait,<br />
il serait « fort à reprendre », comme dit Chuffart ;<br />
et alors, les juges de Rouen, qui ont tant chicané la<br />
Pucelle sur des faits de bien moindre importance,<br />
n'eussent pas manqué d'exploiter contre elle une<br />
telle violation des règles ecclésiastiques ; ils n'en ont<br />
rien dit. Et si, quand il s'agit de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, l'accusation<br />
du grand Inquisiteur est calomnieuse, elle<br />
ne paraît pas l'être moins à l'égard de Pierronne. Que<br />
celle-ci et sa compagne aient été des illuminées,<br />
on peut le supposer ; ce n'était pas une raison pour<br />
que, en une cérémonie solennelle, à Saint-Martindes-Champs,<br />
un prédicateur d'une telle importance<br />
se laissât aller contre frère Richard à de si graves<br />
imputations ; mais, pour justifier <strong>devant</strong> son auditoire,<br />
conformément à la volonté de la cour d Angleterre,<br />
la condamnation de la Pucelle, il était habile<br />
de confondre en une même réprobation Pierronne<br />
et sa compagne, « magiciennes et sorcières », Catherine<br />
la visionnaire, et l'innocente <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, en les<br />
montrant toutes quatre dominées et dirigées par<br />
une sorte d'imposteur, un Cordelier dont la doctrine<br />
était suspecte et dont l'attitude politique avait transformé<br />
en aversion profonde l'admiration des <strong>Paris</strong>iens.<br />
Le cas de Catherine de La Rochelle est moins bon<br />
pour le Cordelier ; il s'est laissé duper par une détra-
140 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
quée et a pris parti pour elle contre <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>.<br />
Nous savons par la Pucelle elle-même (procès, séance<br />
du 3 mars) qu'elle se rencontra avec cette femme à<br />
Montfaucon-en-Berry (dans la seconde quinzaine<br />
d'octobre ou au début de novembre 1429) et à Jargeau<br />
(à la Noël de la même année). C'était une aventurière,<br />
favorisée sans doute et peut-être même suscitée par<br />
quelques conseillers de Charles VII, qui attendaient<br />
de leur diplomatie, et non des armes, la paix avec le<br />
duc de Bourgogne ; elle était gagnée à leur cause et<br />
sut faire entrer le Cordelier dans ses vues. Le parti<br />
des diplomates de la paix boiteuse se renforçait ainsi<br />
d'une soi-disant envoyée de Dieu, patronnée par le<br />
Frère Mineur, et opposait à <strong>Jeanne</strong> une rivale dont<br />
les révélations ne s'accordaient pas avec les siennes.<br />
La manœuvre était adroite, à condition qu'elle<br />
réussit ; mais écoutons <strong>Jeanne</strong> (procès, séance du<br />
3 mars) :<br />
« Elle (Catherine) m'a dit que venait vers elle une<br />
dame blanche vêtue de drap d'or, qui lui disait d'aller<br />
par les bonnes villes, et de se faire bailler par le roi<br />
des hérauts et trompettes pour faire crier que<br />
quiconque aurait or, argent ou trésor caché, les<br />
apportât de suite (1) ; que ceux qui ne le feraient et<br />
en auraient de caché, elle les connaîtrait bien et saurait<br />
trouver lesdits trésors, et que ce serait pour payer<br />
mes gens d'armes. Je demandai à Catherine si cette<br />
dame venait toutes les nuits et que pour cela (pour le<br />
savoir) je coucherais avec elle. J'y couchai et veillai<br />
jusqu'à minuit et ne vis rien, puis m'endormis. Quand<br />
vint le matin, je lui demandai si elle était venue ;<br />
(1) L'usurier La Trémoille n'aurait-il pas suggéré ce moyen<br />
d'augmenter les ressources de la cassette royale?
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 141<br />
elle me répondît qu'elle était venue, qu'alors moi,<br />
<strong>Jeanne</strong>, je dormais et qu'elle n'avait pu m'éveiller.<br />
Alors je lui demandai si elle ne viendrait pas le lendemain,<br />
et Catherine me répondit que oui. Je dormis<br />
de jour, afin que je pusse veiller la nuit. Je couchai<br />
la nuit suivante avec Catherine et veillai toute la nuit ;<br />
mais je ne vis rien, encore que souvent je lui demandâsse<br />
: Viendra-t-elle point? Et Catherine me répondait<br />
: oui, bientôt ».<br />
Catherine avait appris l'expédition que <strong>Jeanne</strong> se<br />
proposait de faire contre La Charité. « Catherine ne<br />
me conseillait point d'y aller, qu'il faisait trop froid<br />
et qu'elle n'irait point. Je dis à Catherine, qui voulait<br />
aller devers le duc de Bourgogne pour faire la paix,<br />
qu'il me semblait qu'on n'y trouverait point de paix,<br />
si ce n'était par le bout de la lance ».<br />
L'opinion de <strong>Jeanne</strong> était faite. Catherine, qui<br />
soutenait le parti des conseillers du roi, artisans des<br />
trêves fallacieuses, et contrariait ainsi sa propre mission,<br />
n'était qu'une visionnaire, dont les révélations<br />
étaient imaginaires ou mensongères ; cependant elle<br />
voulut en avoir l'assurance. « Pour en avoir la certitude,<br />
je parlai à sainte Marguerite ou sainte Catherine, qui<br />
me dirent que le fait de cette Catherine n'était que<br />
folie et était tout néant. Je dis à Catherine qu'elle<br />
retournât à son mari, faire son ménage et nourrir ses<br />
enfants. J'écrivis à mon roi que je lui dirais ce qu'il<br />
en devait faire. Quand je vins vers lui, je lui dis que,<br />
pour cette Catherine, c'était folie et tout néant,<br />
toutefois, frère Richard voulait qu'on la mît en<br />
œuvre ; et ont été très mal (contents) de moi ledit<br />
frère Richard et ladite Catherine ».<br />
L'aventurière était démasquée, non aux yeux du<br />
Cordelier cependant, qui désormais se sépara de
142 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
<strong>Jeanne</strong>, vers la fin de décembre 1429 ou le commencement<br />
de janvier, irrité de ce que la Pucelle ne<br />
voulait pas accepter le concours de cette folle. Catherine<br />
se vengea en calomniant <strong>Jeanne</strong>, si tant est qu'on<br />
puisse s'en rapporter au Promoteur du procès, Jean<br />
d'Estivet, qui a tant de fois déformé les moindres<br />
faits pour en tirer matière à accusation. Dans son<br />
Réquisitoire, article 56, il prétend que Catherine,<br />
déposant <strong>devant</strong> l'official de <strong>Paris</strong>, après l'emprisonnement<br />
de <strong>Jeanne</strong>, affirmait que « <strong>Jeanne</strong> sortirait<br />
de prison par le secours du diable, si elle n'était pas<br />
bien gardée » ; à quoi <strong>Jeanne</strong> répondit : « Je le nie<br />
et j'affirme par mon serment que je ne voudrais pas<br />
que le diable m'eut tirée dehors de la prison ». D'ailleurs<br />
cette Rochelloise avait aussi calomnié, on ne sait<br />
pourquoi, les habitants de Tours et d'Angers, les<br />
accusant de travailler à trahir le roi.<br />
En 1430, nous trouvons frère Richard à Orléans,<br />
où il est venu prêcher, ainsi qu'il résulte des livres de<br />
comptes de cette ville ; une première fois, on lui<br />
paye les dépenses qu'il a faites pendant ses 33 jours<br />
de prédication, ses débours « tant en boisson, beurre<br />
comme autres choses », la « reliure d'un livre et un<br />
Jésus de cuivre » ; une autre fois ses frais d'hôtel<br />
« depuis la veille de Pasques Fleuries (8 avril) jusques<br />
au mercredi de Quasimodo » (26 avril) ; une troisième<br />
fois, ses dépenses du 16 mai, jour où il vint à Orléans<br />
à la suite de la reine (<strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> était alors en<br />
campagne vers Compiègne où elle devait être prise<br />
7 jours après); une quatrième fois ses dépenses<br />
d'hôtel, en juillet, pour lui « son frère et ses compagnons<br />
». Pourquoi frère Richard préférait-il l'hôtel»<br />
au couvent des Cordeliers d'Orléans?<br />
Enfin ce singulier Cordelier, qui vraiment manquait
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 143<br />
par trop de jugement, finit, l'année suivante, par se<br />
faire interner et interdire toute prédication. Il est<br />
probable que ce furent encore ses erreurs théologiques,<br />
ses fausses prophéties, qui lui valurent cette<br />
mésaventure ; l'Inquisiteur de la foi est, en etfet,<br />
intervenu contre lui. Il était alors à Poitiers. « Les<br />
Vicaires de l'évêque de Poitiers et l'Inquisiteur de la<br />
lui » interdirent « à frère Richard, de l'Ordre des<br />
frères mineurs, de s'entremettre de quelque fait de<br />
prédication » et donnèrent « leurs lettres pour qu'il<br />
soit arrêté en l'hôtel du couvent dudit Ordre à Poitiers. »<br />
Le vendredi 23 mars 1431, le même jour probablement<br />
où ils avaient pris ces mesures, ils communiquaient<br />
leur sentence « à la cour séant à Poitiers » (le Parlement)<br />
et requéraient « son aide et confort ». Le Cordelier<br />
fut mandé <strong>devant</strong> la Cour ; il s'abstint de paraître.<br />
La Cour confirma les « défenses et arrêts » de l'autorité<br />
ecclésiastique et ordonna qu'il en fut « donné<br />
lecture audit frère Richard » ; en outre, « de par la<br />
Cour », c'est-à-dire cette fois de par l'autorité civile,<br />
« il lui sera également défendu de faire fait de prédication<br />
et de partir dudit couvent, où il sera tenu en<br />
arrêt jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné » (1).<br />
Frère Richard réussit-il à s'enfuir de Poitiers,<br />
comme autrefois de <strong>Paris</strong>, pour échapper aux conséquences<br />
de cette sentence? Ce n'est pas probable.<br />
Ainsi, après avoir réussi à se soustraire aux sévérités<br />
des Bourguignons de <strong>Paris</strong>, l'agité Cordelier, malgré<br />
le crédit qu'il avait eu et avait peut-être encore à la<br />
cour du roi, était venu se faire prendre par les Armagnacs<br />
de Poitiers.<br />
(1) Cette pièce, découverte à la Bibliothèque impériale de<br />
Vienne, a été publiée par Siméon Luce, dans la Revue Bleue,<br />
13 février 1892.
144 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
* *<br />
Pendant le court séjour qu'il fit à <strong>Paris</strong>, en avril 1429,<br />
frère Richard résida vraisemblablement au couvent<br />
des Cordeliers de cette ville ; il n'avait point encore<br />
assez de liberté, ni de célébrité pour se permettrede<br />
vivre à l'hôtel, comme il le fit l'année suivante à<br />
Orléans. De ce couvent il subsiste aujourd'hui<br />
quelques parties, encloses dans l'Ecole pratique de<br />
médecine, entre la rue de l'Ecole-de-Médecine, la<br />
rue Racine et la rue Monsieur-le-Prince.<br />
Là, frère Richard rencontra des bourguignons<br />
avérés ; plusieurs Frères mineurs étaient maîtres de<br />
théologie de l'Université de <strong>Paris</strong>, entre autres<br />
Jacques de Touraine, que nous allons trouver dans le<br />
procès de <strong>Jeanne</strong> à Rouen. Peut-être dut-il à l'indiscrétion<br />
de l'un de ses confrères universitaires d'être,<br />
averti des poursuites que la Faculté de théologie<br />
s'apprêtait à exercer contre lui, et ainsi de pouvoir<br />
disparaître à temps.<br />
C'est aussi de ce couvent que provient la Chronique<br />
dite des Cordeliers, qui s'étend jusqu'à l'an 1433.<br />
L'auteur était-il lui-même cordelier? Il se montre<br />
ouvertement bourguignon ; mais il est remarquable<br />
qu'à l'égard de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> il ne partage pour ainsi<br />
dire point la violente animosité de ses copartisans ;<br />
quand il parle de la Pucelle, il s'abstient de tout mot<br />
ou de toute appréciation qui lui soit trop nettement<br />
défavorable ; il ne croit ni à sa mission, ni à ses révélations,<br />
mais reste relativement modéré dans ses<br />
appréciations ; il semble même par endroits laisser<br />
percer, sinon quelque sympathie secrète, du moins<br />
une vague admiration ; à propos de l'attaque de <strong>Paris</strong>,
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 145<br />
il écrira mieux qu'aucun autre, même du parti<br />
français : « Et là fit la Pucelle merveilles, tant de<br />
paroles et admonestations, comme de donner cœur<br />
et hardiesse à ses gens de monter à l'assaut ; et ellemême<br />
alla si près qu'elle fut blessée ». C'est par lui<br />
que nous connaissons un détail, qui réfute une des<br />
allégations mensongères du procès ; on y accusa<br />
<strong>Jeanne</strong> d'avoir tenté de se tuer par désespoir, en se<br />
jetant du haut de la tour de Beaurevoir (Réquisitoire,<br />
article 41). Il rétablit les faits ; <strong>Jeanne</strong> ne se précipita<br />
pas, mais se laissa glisser du haut d'une fenêtre, le<br />
lien se brisa, ce qui entraîna sa chute et sa blessure »;<br />
« mais ce par quoi elle se glissait rompit (1) et elle<br />
chut du haut à terre ; elle se rompit presque les reins<br />
et le dos et fut longtemps malade de ses blessures ».<br />
Si ce chroniqueur était lui-même Frère mineur, ne<br />
tenait-il pas ce détail d'un de ses confrères.<br />
Gérard Feuillet, un des assesseurs au procès, qui<br />
paraît n'avoir approuvé ni tout ce qui s'est dit, ni<br />
tout ce qui s'est fait à Rouen?<br />
* *<br />
Gérard Feuillet et Jacques de Touraine, tout deux<br />
Franciscains et maîtres en théologie, étaient au nombre<br />
des six docteurs réputés, envoyés à Rouen par l'Université<br />
de <strong>Paris</strong>, à la demande de l'evêque Cauchon,<br />
pour conduire et diriger le procès de <strong>Jeanne</strong>.<br />
Jacques de Touraine, dit Texier, paraît avoir été<br />
un des théologiens notables de son temps ; il est<br />
cité parmi les maîtres en théologie de son Ordre qui<br />
(1) « Mais ce à quoy elle s'avaloit rompy ».
146 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
prirent part au concile de Florence. Conseiller<br />
assidu de Cauchon, il interrogea <strong>Jeanne</strong> à plusieurs<br />
reprises et, au témoignage du greffier Manchon,<br />
se montra l'un des trois assesseurs les plus hostiles<br />
à l'accusée ; les deux autres furent Beaupère et Midi.<br />
Il revit la rédaction des douze articles, résumé de<br />
l'instruction et base des accusations ; il les refit même<br />
sur cinq feuilles de papier, écrites de sa main, indiquant<br />
de nombreuses corrections et additions, dont cependant<br />
on ne tint pas compte. Il fut chargé avec Beaupère,<br />
Midi et son frère en religion Feuillet, de venir soumettre<br />
à <strong>Paris</strong>, le 29 avril, ces articles à l'Université<br />
et lui demander à leur sujet une consultation ; il se<br />
fit délivrer copie, signée par notaire public, des qualifications<br />
portées sur ces articles par les deux Facultés<br />
de théologie et des décrets,<br />
Gérard Feuillet, reçu maître en théologie, le<br />
30 mars 1430, fut l'un des assesseurs les plus assidus<br />
aux interrogatoires subis par <strong>Jeanne</strong> ; il assista même<br />
à ceux de la prison.<br />
Ni l'un ni l'autre ne reparurent au procès, après<br />
la délibération de l'Université de <strong>Paris</strong> ; sans doute<br />
restèrent-ils à <strong>Paris</strong> et ne revinrent-ils pas à Rouen ;<br />
pourquoi? On se le demande et, faute de renseignements,<br />
on en est réduit aux conjectures.<br />
Jacques de Touraine, constatant qu'on n'avait fait<br />
aux douze articles aucune des corrections qu'il avait<br />
demandées, jugea-t-il qu'il n'avait plus rien à faire<br />
dans une cause où l'on tenait si peu compte de son<br />
avis? On serait tenté de le supposer ; mais alors on ne<br />
s'expliquerait pas pourquoi il s'est présenté <strong>devant</strong><br />
l'Université ; y a exposé, avec ses collègues, le sens<br />
de ces articles ; s'est fait délivrer une copie, certifiée<br />
conforme, de la consultation ; et a mérité les félici-
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 147<br />
tations chaleureuses de l'Université. S'il avait renoncé<br />
à suivre cette affaire, il l'eut fait dès son arrivée à<br />
<strong>Paris</strong>, et non après avoir été complimenté par ses<br />
collègues universitaires ; sa petite blessure d'amour<br />
propre, s'il y en eut une, était largement compensée<br />
par les marques de satisfaction dont il reçut alors<br />
le témoignage.<br />
Il est assez significatif que son confrère Gérard<br />
Feuillet est exclu des louanges adressées par<br />
l'Université à ses trois collègues. Les lettres que cette<br />
corporation adressa, à la fin de ses délibérations, le<br />
14 mai, au roi d'Angleterre et à l'évêque de Beauvais,<br />
font l'éloge de Touraine, Beaupère et Midi ; lui,<br />
n'est même pas nommé. A la séance plénière des<br />
deux Facultés, le 14 mai, il n'est pas fait mention de<br />
lui ; Beaupère, Midi et Touraine demandent chacun<br />
copie authentique des qualifications ; de lui il n'est<br />
pas question. Ou Feuillet a combattu <strong>devant</strong> l'Université<br />
l'opinion de ses collègues, la teneur des<br />
articles et la marche du procès ; ou il a adopté une<br />
altitude passive, réservant son sentiment ; ou, arrivé<br />
à <strong>Paris</strong>, il s'est abstenu de paraître à l'Université.<br />
Il semblerait qu'il y ait eu désaccord entre les<br />
deux cordeliers à propos du procès où ils remplissaient<br />
les fonctions d'assesseurs. Que se serait-il passé?<br />
Nous ne pouvons le savoir. Il paraît assez vraisemblable<br />
— et ceci expliquerait son attitude et le<br />
silence fait autour de lui — que les sentiments de<br />
Feuillet, d'abord hostiles à <strong>Jeanne</strong>, se fussent modifiés<br />
; d'autres assesseurs, Pierre Maurice, Jean<br />
Fontaine, avaient senti tomber leurs préjugés haineux,<br />
une fois en présence de l'accusée. Prévoyant la sentence<br />
de l'Université et en comprenant toute la<br />
portée, se refusa-t-il à collaborer davantage à un.
148 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
procès, dont l'iniquité ne pouvait lui échapper et dont<br />
il entrevoyait la terrible issue? Son refus de revenir<br />
à Rouen obligea-t-il son confrère Touraine à conformer<br />
sa conduite à la sienne? Mis au courant par<br />
Feuillet de ce qui se tramait à Rouen, l'Ordre conseillat-il<br />
à ses deux religieux de s'abstenir? Toutes ces<br />
hypothèses sont possibles.<br />
Une seule chose est certaine, les deux Cordeliers<br />
ne parurent plus au procès après leur voyage à <strong>Paris</strong>.<br />
Tous deux reçurent du gouvernement anglais 20 sols<br />
tournois, en dédommagement de leurs frais ; le fait<br />
que Feuillet ait reçu la même indemnité que ses trois<br />
collègues, Touraine, Beaupère et Midi, laisserait supposer<br />
qu'il a rempli sa mission jusqu'au bout et qu'il<br />
n'a pas eu sa part des félicitations parce qu'il aurait<br />
délibérément adopté une attitude effacée, offrant<br />
toutes les apparences d'une désapprobation.
LA PORTE SAINT-HONORÉ ET SES ENVIRONS VERS 1530.<br />
Plan de Georges Braun.<br />
Sur ce plan la porte est déjà mieux représentée, avec ses tourelles en encorbellement,<br />
rondes et à toit conique; sa toiture aiguë, au milieu de laquelle se<br />
détache une tourelle en saillie ; sa haute et large baie et son avant-porte.<br />
Le mur d'enceinte est garni de bâtiments rectangulaires, avant l'aspect de<br />
maisons, et reliés par un chemin de ronde crénelé.<br />
On distingue le grand fossé, le dos d'âne, l'arrière-fossé et la contrescarpe ;<br />
l'extrémité de la Butte des moulins et remplacement du Marché aux pourceaux,<br />
avec les deux potences destinées aux exécutions et le fourneau de pierre<br />
servant à faire « bouillir » les faux monnayeurs.
UN CARME CONSPIRATEUR 1<br />
Bien que la trêve du 28 août 1429, entre Charles VII<br />
et Philippe de Bourgogne, eut fait échouer son<br />
entreprise sur <strong>Paris</strong>, <strong>Jeanne</strong> n'avait pas renoncé à<br />
entrer dans cette ville et à la rendre au roi. En attendant<br />
que les circonstances fussent favorables, it semble<br />
qu'elle ait entretenu des intelligences avec quelquesuns<br />
des habitants ; elle s'intéressa particulièrement<br />
au sort de l'un d'eux, compromis dans une conjuration.<br />
Cependant le roi, ayant pris l'engagement de ne<br />
faire aucune opération sur la rive droite de la Seine,<br />
s'était retiré vers la Loire ; l'armée était licenciée.<br />
<strong>Jeanne</strong> souffrait d'autant plus de l'inaction à laquelle<br />
elle se trouvait condamnée, qu'elle savait ne pas durer<br />
longtemps. Le duc de Bourgogne continuait à duper<br />
son royal cousin et à l'entretenir dans l'illusion qu'il<br />
lui rendrait <strong>Paris</strong>.<br />
La trêve qui se terminait à Noël avait été prorogée<br />
d'un commun accord jusqu'à la fin de mars suivant.<br />
Quand elle fut sur son terme, <strong>Paris</strong> n'était pas rentré<br />
sous l'autorité du roi ; c'est alors qu'il se fit une<br />
(1) D'après la Lettre de grâce accordée à l'un des conjurés;<br />
le Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong> ; la Chronique des Cordeliers ;<br />
les Notes du greffier du Parlement, Cl. de Fauquembergue ; la<br />
Chronique Morosini.
150 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
conjuration pour remettre le souverain légitime en<br />
possession de sa capitale.<br />
Les habitants de <strong>Paris</strong> n'étaient pas tous bourguignons.<br />
Nous avons déjà lu qu' « il y avait alors dans<br />
<strong>Paris</strong> plusieurs notables personnages, qui reconnaissaient<br />
que le roi Charles, septième du nom, était<br />
leur souverain seigneur et le vrai héritier du royaume<br />
de France, que c'était à grand tort et par vengeance<br />
qu'on les avait séparés de sa seigneurie et enlevés à son<br />
obéissance, pour les mettre en la main du roi Henri<br />
d'Angleterre ». Au moment de l'assaut du 8 septembre,<br />
on avait espéré qu'ils seconderaient l'action militaire.<br />
Quelques-uns paraissent avoir tenté une « commotion »<br />
suivant l'expression de Fauquembergue ; ils ne<br />
réussirent qu'à augmenter l'épouvante, dans laquelle<br />
la violence de l'attaque avait jeté la population. Dès<br />
le lendemain, au matin « le baron de Montmorency,<br />
qui avait toujours tenu le parti contraire au roi, écrit<br />
Perceval de Cagny, vint de l'intérieur de la ville,<br />
accompagné de 50 ou 60 gentilshommes, se mettre<br />
en la compagnie de la Pucelle ». Cette défection était<br />
pleine de promesses et permettait d'en présager<br />
d'autres. Les partisans du roi attendaient une occasion<br />
propice ; la prochaine échéance de la trêve raviva<br />
leur ardeur.<br />
* *<br />
Dans le courant de mars 1430 (1429, ancien style)<br />
« quelques-uns des grands de <strong>Paris</strong>, du Parlement,<br />
du Châtelet, des marchands et gens de métier, — rapporte<br />
le Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong>, — firent ensemble<br />
la conjuration de mettre les Armagnacs dans <strong>Paris</strong>,<br />
quelque dommage qui pût leur en arriver ». La
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 151<br />
Chronique des Cordeliers note également : « Quarante<br />
dizainiers de cette ville avaient formé le complot et<br />
pris l'engagement, à ce qu'on disait, de livrer la ville<br />
au roi Charles ». La Chronique Morosini prétend que<br />
« quatre mille hommes au moins étaient impliqués »<br />
dans cette conspiration ; ce chiffre paraît très exagéré ;<br />
d'ailleurs cette Chronique est assez mal informée sur<br />
cette conjuration conduite, dit-elle, par un Frère<br />
mineur ; —les autres disent par un Carme ; —mais<br />
son témoignage est intéressant, parce qu'il nous montre<br />
l'intérêt avec lequel on suivait alors à l'étranger les<br />
affaires de France ; qu'il nous apprend que ce complot<br />
aurait été connu à Bruges avant le 22 mars et que la<br />
nouvelle en était parvenue à Venise le 16 avril, en la<br />
fêle de Pâques.<br />
Un Carme, nommé, d'après le Bourgeois de <strong>Paris</strong>,<br />
« Frère Pierre d'Allée » fut l'un des plus actifs conspirateurs<br />
; dès le début, on le trouve engagé dans des<br />
pourparlers secrets avec les conjurés ; il se déguise en<br />
laboureur pour les aborder et les entretenir ; il leur<br />
sert de messager auprès de Charles VII et fait, à deux<br />
et peut-être trois reprises, le voyage de <strong>Paris</strong> à la cour.<br />
Fut-il, à l'une de ces missions, en rapport avec<br />
<strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>? C'est très possible. <strong>Jeanne</strong> paraît,<br />
en effet, avoir été au courant de ce qui se complotait ;<br />
le 16 mars, elle écrivait à ses amis de Reims : « Je vous<br />
manderais encore quelques nouvelles dont vous<br />
seriez bien joyeux; mais je craindrais que les lettres<br />
ne fussent prises en chemin et que l'on ne vit lesdites<br />
nouvelles ». Le 28 mars, elle leur écrivait de nouveau :<br />
Vous ouïrez bientôt de mes bonnes nouvelles plus<br />
à plein ». On pense, non sans raison, qu'elle faisait<br />
ainsi allusion, au moins dans la première de ces<br />
lettres, à la conjuration et à la prochaine entrée du
152 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
roi dans <strong>Paris</strong>. Elle s'intéressait particulièrement à<br />
l'un des principaux conjurés ; dans son procès (séance<br />
du 14 mars) elle dira qu'elle voulait échanger Franquet<br />
d'Arras, fait prisonnier en avril, contre Jacquet Guillaume,<br />
seigneur de l'Ours, un des conspirateurs de<br />
<strong>Paris</strong> emprisonnés ; mais qu'ayant appris que celui-ci<br />
avait été exécuté, elle avait abandonné à la justice<br />
Franquet, « meurtrier, larron et traître ».<br />
L'affaire échoua ; par suite de circonstances restées<br />
inconnues, peut-être une imprudence du Carme,<br />
la conspiration fut découverte et le religieux dénonça<br />
ses complices. Ce fut « un autre Carme », d'après la<br />
Lettre de grâce — selon le Bourgeois de <strong>Paris</strong>, frère<br />
d'Allée lui-même — qui « fut pris et il en accusa<br />
beaucoup, à la suite de la torture à laquelle on le<br />
soumit... on en prit plus de cent cinquante ». L'arrestation<br />
eut lieu le 3 avril et les jours suivants ; aussi<br />
y a-t-il lieu de s'étonner que des lettres partant de<br />
Bruges pour Venise eussent pu annoncer, dès le<br />
22 mars, « qu'on a découvert à <strong>Paris</strong> une conjuration ».<br />
Il n'y a, semble-t-il, qu'une explication plausible ;<br />
le rédacteur de la Chronique Morosini dit qu'il résume<br />
les informations provenant de plusieurs lettres, les<br />
unes reçues par des Vénitiens et des Florentins, les<br />
autres envoyées à Venise par Pancrace Justiniani,<br />
et toutes parvenues dans cette ville en la fête de<br />
Pâques, le 16 avril ; incontestablement ces différentes<br />
lettres n'avaient pas été écrites toutes le même jour,<br />
22 mars ; certaines pouvaient même être très postérieures<br />
et, entre autres, celle qui faisait connaître la<br />
découverte du complot.<br />
Parmi les conspirateurs arrêtés se trouvait Jean de<br />
Calais. Le rôle qui lui était assigné le désigne comme<br />
un personnage assez important ; il avait des gens à
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 153<br />
son service, possédait des « vignobles à La Chapelle<br />
Saint-Denis », était réputé « homme de bonne vie,<br />
renommée et honnête conversation, sans avoir été<br />
atteint ou convaincu d'aucun autre vilain cas ou<br />
reproche » que celui d'avoir pris part à ce complot ;<br />
peut-être, si l'on en juge d'après les conjurés qu'il<br />
fréquente, était-il un des « marchands et gens de<br />
métier » compromis dans cette entreprise. Tout<br />
d'abord il avait fait quelque difficulté à entrer dans<br />
la conjuration ; les instances dont il fut l'objet à<br />
maintes reprises, sans doute parce qu'on tenait<br />
beaucoup à son concours, finirent par le décider.<br />
Il assiste aux conciliabules secrets ; donne un avis<br />
écouté sur la manière dont il faut introduire le roi<br />
dans <strong>Paris</strong> ; sur la lettre qu'il faut lui faire porter par<br />
le Carme ; signe le premier de tous cette lettre ; accepte<br />
de sortir de <strong>Paris</strong> pour aller « aux champs », au<br />
<strong>devant</strong> des gens du roi, le jour de l'exécution du<br />
projet ; de prendre « pour enseigne un panon blanc »<br />
ou de porter « la croix droite » des Armagnacs et de<br />
crier « la paix », en signe de ralliement, afin d'avertir<br />
les conjurés, chargés de surveiller la porte de la ville,<br />
de l'arrivée des gens du roi.<br />
Après s'être aussi pleinement compromis, Jean de<br />
Calais, emprisonné au Châtelet, ne pouvait se faire<br />
illusion sur le sort qui l'attendait ; la perspective<br />
du dernier supplice le jette dans de telles angoisses<br />
qu'il en tombe gravement malade, « en grande pauvreté<br />
et misère de son corps, en péril de bientôt<br />
finir misérablement ses jours, s'il n'est pas pourvu<br />
d'un remède gracieux et convenable ». Ce remède,<br />
le conspirateur l'a sollicité. Il adresse au roi d'Angleterre<br />
et de France une supplique en vue d'obtenir<br />
sa grâce ; il essaie, sinon de se justifier, du moins de
154 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
fléchir la clémence du souverain, en expliquant<br />
comment il a été attiré et entraîné dans le complot,<br />
comment celui-ci a été ourdi ; bref il charge plusieurs<br />
autres conjurés dont il dénonce les agissements.<br />
Le « remède gracieux et convenable » lui est octroyé ;<br />
le 5 avril, trois jours avant l'exécution de ses principaux<br />
complices, Jean de Calais obtint sa grâce ;<br />
à la suite de quelle influence, nous essaierons de le<br />
découvrir. La lettre royale de rémission nous a été<br />
conservée ; elle emprunte à la supplique la plupart<br />
des détails de la conspiration, et c'est par elle que<br />
nous sommes principalement renseignés sur cette<br />
affaire.<br />
* *<br />
Avec le Carme, frère Pierre d'Allée, Jacques Perdriel<br />
paraît avoir été l'âme de la conjuration. C'était<br />
vraisemblablement, lui aussi, un des « marchands<br />
et gens de métier » ; il reçoit Calais « à son comptoir » ;<br />
il est en conciliabules avec l'orfèvre Guillaume de Loir.<br />
Fervent Armagnac, il avait déjà été emprisonné<br />
« pour avoir parlé de paix et dit quelques paroles »<br />
contre les gens du conseil royal d'Angleterre.<br />
Perdriel et ses amis arrêtent les mesures préliminaires<br />
; il n'y a rien à faire, si les <strong>Paris</strong>iens n'ont pas<br />
l'assurance que Charles VII n'exercera contre eux<br />
aucunes représailles. Il faut donc lui députer un<br />
messager qui, en même temps qu'il l'entretiendra des<br />
moyens à prendre pour le faire pénétrer dans <strong>Paris</strong>,<br />
lui demandera « une abolition générale », c'est-à-dire<br />
une amnistie pour tout le passé. Frère Pierre d'Allée<br />
se charge de remplir cette mission.<br />
Le Carme se rendit près du roi bien avant le<br />
carême, commençant cette année le 5 mars, par suite
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 155<br />
dans le courant de février. Ni le roi, ni son conseil<br />
ne voulurent s'en rapporter aux seuls dires de ce<br />
religieux; ils ne pouvaient s'engager en une telle<br />
entreprise sans garanties suffisantes ; rien ne leur<br />
prouvait qu'ils n'avaient pas affaire à quelque illuminé?<br />
Le Carme nomma plusieurs <strong>Paris</strong>iens notables,<br />
sur lesquels il assurait qu'on pouvait compter ; il<br />
lui fut répondu qu'il procurât « des lettres de chacun<br />
d'eux », — c'était sans doute, dans la pensée des<br />
conseillers, un moyen de les engager plus irrémédiablement<br />
dans le complot — et un projet bien établi<br />
sur « la manière de faire ladite entrée » dans <strong>Paris</strong>.<br />
Avec cette réponse Pierre d'Allée rapporta-t-il<br />
« l'abolition générale », ou simplement une promesse,<br />
l'abolition ne lui ayant été remise qu'à un autre<br />
voyage? Le texte manque de clarté; il semble bien<br />
cependant qu'il revenait, non seulement avec une<br />
promesse, mais avec l'acte lui-même, lequel, en ce<br />
cas, lui aurait été accordé sans délai pour soutenir<br />
plus efficacement la conjuration et encourager plus<br />
vivement les conspirateurs.<br />
Tandis que le Carme remplissait ainsi sa mission,<br />
Perdriel s'occupait de recruter des adhérents à ce<br />
qu'il appelait « son alliance » ; il recherchait des<br />
répondants autorisés, des noms qui fissent impression<br />
et déterminassent d'autres adhésions ; ses amis et<br />
lui songèrent alors à Jean de Calais et à quelques<br />
autres. Perdriel se chargea de pressentir lui-même<br />
Calais ; mais, en conspirateur avisé, il se garda bien<br />
de découvrir ses batteries du premier coup ; il ne<br />
procéda que par avancées successives.<br />
Avant le carême, c'est-à-dire avant le 5 mars, il<br />
« aborda » donc Jean de Calais et « entre autres choses »,<br />
lui parla d'un projet d'introduire « dans cette bonne
156 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
ville de <strong>Paris</strong> » Charles VII et ses gens. « Par plusieurs<br />
fois et à diverses instances » il l'entretint de ce desseinet<br />
finit par lui demander « s'il voudrait être de son<br />
alliance dans laquelle se trouvaient plusieurs autres »<br />
Peut-être avait-on déjà parlé à Calais de projets<br />
semblables, qui lui paraissaient plus ou moins aventureux<br />
; il ne répondit pas aux ouvertures que lui<br />
faisait Perdriel. Celui-ci ne se tint pas pour battu ;<br />
il revint à la charge et lui démontra que lui, qui avait<br />
été « mis en prison seulement pour avoir parlé de paix<br />
et dit quelques paroles » contre le conseil royal<br />
anglais, ne s'exposerait pas de nouveau à de plus<br />
graves châtiments, si l'affaire ne lui paraissait pas<br />
sérieuse ; il ajouta que le roi avait 1'intention de<br />
« faire une abolition générale ».<br />
Alors quels sont vos projets ? De quelle manière<br />
comptez-vous « faire et bailler l'entrée susdite » au<br />
roi et à ses gens? demanda Calais, qui se laissait<br />
ébranler et en venait à l'examen des moyens d'exécution.<br />
— Il y a beaucoup de gens faisant partie de<br />
l'alliance, lui répondit Perdriel ; ils feront « publier par<br />
les carrefours de la ville l'amnistie à son de trompe,<br />
spécialement un jour de dimanche, à la porte Baudet,<br />
à l'heure où il y aurait grande foison de laboureurs<br />
» (1) ; je ne fais « nul doute que le peuple ne se<br />
tournât avec eux ; cela fait, ils iraient gagner la<br />
porte Saint-Antoine (2) et par icelle ils mettraient<br />
dans la ville » leurs amis de Bourges. — Ce projet<br />
parut enfantin à Calais ; il lui répondit « que c'étaient<br />
(1) Porte de l'ancienne enceinte de Philippe-Auguste, dans le<br />
quartier Saint-Antoine. Le texte cité semble indiquer que, le<br />
dimanche, il y avait là quelque marché de paysans.<br />
(2) Place de la Bastille.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 157<br />
là propos de commères et que cela ne se pouvait faire<br />
ainsi ; car lorsqu'ils compteraient se trouver vingt<br />
ensemble, ils ne seraient pas six ». — C'est votre<br />
avis, mais non celui de plusieurs autres, riposta<br />
Perdriel. — A quoi Calais répliqua par un refus de se<br />
mêler d'une affaire qui lui paraissait vouée d'avance<br />
à l'insuccès. Perdriel cependant ne rompit pas les<br />
chiens et dit qu'on attendrait encore avant de rien<br />
entreprendre ; « et sur ce, ils se séparèrent l'un de<br />
l'autre ».<br />
A quelque temps de là frère Pierre d'Allée, étant<br />
de retour, rendit compte du résultat de sa mission<br />
et exposa comment le roi exigeait des lettres et la<br />
communication de la manière dont on pensait l'introduire<br />
dans <strong>Paris</strong>.<br />
Perdriel retourna trouver Calais dans sa maison<br />
— c'était environ quinze jours après sa dernière entrevue<br />
— et lui raconta qu'un messager, dont il se garda<br />
bien de dévoiler la personnalité, revenait d'auprès<br />
Charles VII et que l'affaire prenait corps. Le fait<br />
que le roi ne se désintéressât pas d'un tel dessein,<br />
impressionna Calais. Perdriel en profita pour solliciter<br />
à nouveau son adhésion. Calais répondit qu'il<br />
ne la donnerait que « s'il y avait des gens notables qui<br />
s'entremissent ». Le conspirateur l'assura « que<br />
plusieurs personnes de pratique et d'autres états de<br />
bonne et grande autorité » étaient dans l'alliance et<br />
il lui en nomma quelques-unes ; d'ailleurs, ajoutat-il,<br />
pour que vous ayez plus de confiance en cette<br />
entreprise et plus de sécurité sur son exécution, vous<br />
devriez voir vous-même ce messager. Calais y consentit<br />
; il fut convenu que, pour détourner tout soupçon,<br />
la rencontre se ferait à Saint-Merry, d'où Calais<br />
ramènerait chez lui ce messager, afin de l'y entretenir
158 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
plus en sécurité. A Saint-Merry il se trouve en présence<br />
d'un homme « très bien et proprement habillé en état<br />
de laboureur ». Il le conduit dans sa demeure et là,<br />
dans le secret de l'intimité, le laboureur lui révèle<br />
qu'il est un « religieux carme », revenant d'auprès<br />
Charles VII, où Perdriel et ses alliés l'ont envoyé en<br />
mission ; il lui redit ce que veut le roi, notamment<br />
des lettres signées des conjurés. Avant de faire<br />
pareille lettre, Calais demande à réfléchir ; il s'en<br />
rapportera à Perdriel et agira d'accord avec lui. Cette<br />
fois il était bien engagé dans la conjuration. Sur le<br />
point de le quitter, le Carme lui dit encore qu'il<br />
enverrait à Perdriel un laboureur pour lui indiquer<br />
« le jour, l'heure et la manière » dont le roi et ses gens<br />
voudraient faire leur entrée à <strong>Paris</strong>.<br />
Un dimanche de carême —le premier ou le second,<br />
c'est-à-dire le 5 ou le 12 mars, on ne sait lequel —<br />
l'orfèvre Guillaume de Loir vint trouver Calais en sa<br />
maison et lui dire de la part de Perdriel que « le laboureur<br />
» était venu. Circonspect, Calais, qui n'avait<br />
soufflé mot de la conjuration à Guillaume de Loir,<br />
lui répondit qu'il ne savait ce qu'il voulait dire. Le<br />
lendemain, ses serviteurs l'informèrent que Perdriel<br />
l'avait demandé ; pensant bien que c'était pour affaire<br />
grave, Calais alla chez Perdriel et y rencontra Guillaume<br />
de Loir. Le conspirateur mit alors ses deux<br />
visiteurs au courant de la situation. « Le Carme avait<br />
apporté une abolition par laquelle tout était pardonné ».<br />
Il s'agissait maintenant de s'entendre sur le détail<br />
de l'exécution. On se trouvait en présence de trois<br />
projets, entre lesquels se partageaient les conjurés :<br />
Suivant les uns, tels que Pierre Morant, procureur<br />
au Châtelet, Jacquet Guillaume demeurant à l'Ours,<br />
à la porte Baudet, lui Perdriel et d'autres, on lirait
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 159<br />
l'abolition « un dimanche, à son de trompe, à la<br />
porte Baudet, en présence de soixante ou quatrevingts<br />
hommes de leur alliance. Après cette publication,<br />
eux et le peuple qui se joindrait à eux iraient<br />
gagner la porte Saint-Antoine, pour mettre et bouter<br />
par cette porte dans la ville » les gens du roi « qui<br />
seraient en embuscade près de là ». Les partisans de<br />
ce projet assuraient « qu'ils avaient avec eux quantité<br />
de gens d'icelle porte Baudet et des environs ».<br />
« Quelques-uns opinaient que certain nombre de<br />
gens fussent en embuscade à maisons prochaines de<br />
la porte de Bordelles (1) pour la gagner soudainement<br />
et par ce moyen faire ladite entrée par icelle. »<br />
Enfin : « il semblait aux autres que le plus expédient<br />
serait que quatre-vingts ou cent Ecossais (2),<br />
habillés comme les Anglais, portant la croix rouge (3),<br />
vinssent par petits troupeaux ou compagnies par le<br />
droit chemin de Saint-Denis en cette ville, et qu'amenant<br />
de la marée ou du bétail ils entrassent adroitement<br />
en la porte, et puis se rendissent maîtres des<br />
portiers ; alors une autre partie (des gens du roi),<br />
qui seraient embusqués près de là, viendraient<br />
avec puissance pour entrer dans cette dite ville et en<br />
avoir la maîtrise ».<br />
Consultés par Perdriel, Jean de Calais et Guillaume<br />
(1) Dans l'ancien quartier Saint-Marcel, derrière la montagne-<br />
<strong>Sainte</strong>-Geneviève, à l'endroit où actuellement la rue Descartes<br />
ici continue par la rue Mouffetard.<br />
(2) L'Écosse fournit de très nombreux mercenaires à Charles<br />
VII. Avec les Français, principalement des Gascons, l'armée<br />
royale se composait d'Espagnols, Aragonnais et Castillans, de<br />
Lombards et surtout d'Écossais. Ces troupes n'étaient pas régu-librement<br />
payées, le roi étant toujours à court d'argent ; d'où les,<br />
excès qu'elles commettaient sur leur passage.<br />
(3) Insigne des Anglais.
160 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
de Loir donnèrent leur préférence à ce dernier projet ;<br />
mais rien ne fut alors décidé. Il fut ensuite question des<br />
lettres exigées des conjurés par le roi et son conseil.<br />
Perdriel et Loir avaient préparé « deux cédules ;<br />
l'une était grande, écrite en parchemin ; l'autre<br />
petite, en papier. » Ni l'une ni l'autre ne plurent à<br />
Calais ; il en rédigea une troisième, petite elle aussi,<br />
qu'il leur laissa, afin que les autres conjurés pussent<br />
choisir celle des trois que leur paraîtrait la meilleure.<br />
Le lendemain, de très bon matin, Guillaume de<br />
Loir, accompagné du Carme, frère Pierre d'Allée et<br />
de deux autres « laboureurs ou en habits de laboureurs<br />
», que Calais ne connaissait pas (1), lui apportèrent<br />
la cédule qui avait eu la préférence des conspirateurs<br />
; on ne dit pas laquelle ; elle accréditait frère<br />
Pierre d'Allée auprès de Charles VII et de son conseil,<br />
et le chargeait de leur soumettre les trois projets,<br />
afin qu' « ils élussent des trois voies ci-<strong>devant</strong> exposées<br />
celle qui leur semblerait plus convenable, et<br />
qu'ils mandassent la manière, l'heure et le jour où<br />
ils voudraient qu'elle fût exécutée ». Calais « la signa<br />
le premier, puis la bailla à Guillaume, qui promit de<br />
la faire signer à d'autres de leur alliance, desquels<br />
il nomma quelques-uns, et cela fait les dessusdits<br />
se départirent d'avec lui ». Ce fut la dernière entrevue<br />
de Calais avec le Carme ; il ne devait plus le revoir.<br />
La lettre, une fois signée par de notables conjurés,<br />
entre autres Pierre Morant, procureur au Châtelet,<br />
frère Pierre d'Allée se remit en route pour la porter<br />
au roi.<br />
(1) On se demande si ce n'étaient pas des Carmes, confrères de<br />
Pierre d'Allée, qui paraît avoir une préférence pour ce déguisement,<br />
et qui dépêche, quand il le faut, « un laboureur » auprès<br />
des conjurés.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 161<br />
Trois ou quatre jours après ce conciliabule, Pierre<br />
Morant « rencontra en Grève » (1) Jean de Calais,<br />
s'entretint avec lui du complot et lui révéla qu'une<br />
autre réunion devait se tenir entre quelques conjurés,<br />
parmi lesquels maître Jean de La Chapelle et Regnault<br />
Chavin, le dimanche suivant, en un « déjeuner à la<br />
Pomme de Pin, en la Cité, pour avoir avis sur ce<br />
qu'il y aurait à faire sur cette entreprise ». On devait<br />
assigner à chacun le rôle qu'il aurait à remplir. Calais<br />
s'excusa de ne pouvoir s'y rendre ; mais le lendemain<br />
ou le surlendemain, il fut mis au courant des dispositions<br />
arrêtées. « Il avait été conclu qu'ils prendraient<br />
la voie avisée de faire l'entrée par la porte Saint-<br />
Denis, en la manière autrefois pourparlée entre eux. »<br />
Les conjurés se partageraient ainsi la besogne :<br />
Calais, s'il acceptait, « irait aux champs hors de ladite<br />
porte, porterait pour enseigne un panon blanc, et<br />
irait dire (aux gens de Charles VII) ce qu'ils devraient<br />
faire pour entrer. » Guillaume de Loir « se tiendrait<br />
à la porte pour le leur dire semblablement quand ils<br />
arriveraient » ; veillerait à ce que les Ecossais, habillés<br />
en Anglais et amenant avec eux de la marée ou du<br />
bétail, pussent pénétrer par la porte et se rendre<br />
maîtres des portiers. « Morant et les gens qu'il avair<br />
avec lui seraient es tavernes de la rue Saint-Denis,<br />
rapprochées de cette porte, pour saillir promptement<br />
dehors, et aider Qes gens du roi) aussitôt qu'ils seraient<br />
entrés », tandis que les soldats de Charles VII, embus-<br />
qués près de là, se précipiteraient à la suite des Ecossais.<br />
Calais approuva cette distribution des rôles et se<br />
chargea de remplir celui qu'on lui confiait ; « il dit<br />
que dès le matin où la besogne devrait être faite et<br />
(1) La place de Grève.
162 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
exécutée, il irait dehors, ferait semblant d'aller voir<br />
ses vignes à La Chapelle Saint-Denis », et porterait<br />
« la croix droite pareillement » aux Armagnacs (1) ;<br />
en arrivant près de la porte avec les Écossais, il crierait<br />
« la paix », en signe de ralliement, afin d'avertir<br />
les autres conjurés de se porter au secours des soldats<br />
du roi.<br />
A la suite de cet accord, Calais s'employa à recruter<br />
des adhérents, et y réussit ; il eut « conversations avec<br />
d'autres (nommés au procès [verbal] de sa confession)<br />
pour savoir si avec lui et les dessusdits ils voudraient<br />
consentir à faire l'entrée et la besogne dessusdite ;<br />
et par son moyen quelques-uns d'entre eux y ont<br />
consenti ».<br />
Les choses ainsi réglées, il n'y avait plus qu'à<br />
attendre le retour de frère Pierre d'Allée, pour<br />
connaître et le jour fixé et la manière décidée par le<br />
roi et son conseil ; les conjurés « s'attendaient tous<br />
que le dimanche suivant elle (l'entrée) fut faite et que<br />
ledit Carme devint ou envoyât dire la manière et ce<br />
que (Charles VII et ses gens) voudraient faire ».<br />
Le Carme ne revint pas et n'envoya rien dire. Il<br />
s'était fait prendre — lui, ou l'un de ses confrères<br />
déguisé en laboureur. Arrêté, il fut mis à la torture,<br />
avoua le complot et dénonça ses principaux complices<br />
qui furent jetés en prison.<br />
* *<br />
« Il y en eut un grand nombre de pris, note la<br />
Chronique des Cordeliers ; mais peu furent exécutés,<br />
parce que l'affaire s'arrangea et prit assez bonne fin. »<br />
(1) La croix droite et blanche était l'insigne des Armagnacs.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 163<br />
Nous trouvons des renseignements plus précis dans<br />
le Journal d'un Bourgeois de <strong>Paris</strong> : « Dans la semaine<br />
de la Passion, entre Pâques fleuries et le dimanche<br />
qui précède (c'est-à-dire le 3 avril et les jours suivants),<br />
on en prit plus de cent cinquante, et la vigile<br />
de Pâques fleuries (le samedi avant les Rameaux,<br />
8 avril) l'on coupa la tête à six aux halles ; on en noya ;<br />
quelques-uns moururent par la violence de la torture ;<br />
quelques autres s'en tirèrent par finances ; il y en eut<br />
qui s'enfuirent et ne revinrent pas. »<br />
Nous savons par Fauquembergue, greffier du<br />
Parlement, qu'un procureur au Châtelet et un clerc<br />
de la Cour des comptes furent parmi les six, auxquels<br />
on coupa la tête ; le procureur était sans doute Pierre<br />
Morant. La réponse de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, au cours de<br />
son procès (séance du 14 mars), semble suffisamment<br />
indiquer que son ami, Jacquet Guillaume, demeurant<br />
à l'Ours, fut également exécuté.<br />
Le Carme fut-il un de ceux qui « moururent par la<br />
violence de la torture? ». Ou le fait d'avoir dénoncé<br />
ses complices lui sauva-t-il la vie?<br />
Jean de Calais « s'en tira », comme dit le Bourgeois ;<br />
fut-ce « par finances? » C'est assez vraisemblable.<br />
Evidemment la Lettre de grâce ne le dit pas ; mais<br />
elle a des expressions étranges, qui le laissent supposer<br />
; le roi d'Angleterre pardonne au coupable<br />
« pour certaines causes justes et raisonnables, touchant<br />
le bien de nous et de notre seigneurie, qui ont mû<br />
et meuvent les gens de notre conseil » ; quoi de plus<br />
propre à émouvoir qu'une forte somme d'argent?<br />
Le roi lui remet toute peine, même l'amende et<br />
ordonne de lui restituer tous ses biens ; Calais n'a<br />
pas, en effet, à payer deux fois, s'il rachète sa grâce<br />
en bonnes espèces sonnantes. Le roi impose, en tout
164 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
ce qui concerne ce conjuré, un « silence perpétuel à<br />
notre procureur présent et à venir, et à tous les autres<br />
auxquels il appartiendra »; il est clair qu'un tel marché<br />
devait rester secret, faute de quoi la justice royale<br />
eût été déconsidérée. Si Jean de Calais a obtenu sa<br />
grâce « par finances », il a dû y mettre bon prix.<br />
Jacques Perdriel, conspirateur malin, fut de ceux<br />
« qui s'enfuirent » et réussirent à se soustraire aux<br />
rigueurs du tribunal.<br />
Le jour même de l'exécution, 8 avril, « le bâtard<br />
de Clarence, note la Chronique des Cordeliers, entra<br />
à <strong>Paris</strong> avec de grosses forces d'Anglais ; il avait été<br />
mandé par le seigneur de l'Isle-Adam et par d'autres »,<br />
à la suite de la découverte du complot, pour protéger<br />
la ville contre les entreprises de Charles VII, au cas<br />
où l'échec de la conjuration n'eût pas arrêté l'armée<br />
royale ; la trêve, en effet, avait pris fin depuis<br />
huit jours.<br />
Cette fois encore, <strong>Jeanne</strong> dut renoncer à voir <strong>Paris</strong><br />
rentrer en l'obédience de son roi.
LA PORTE SAINT-HONORÉ ET SES ENVIRONS EN 1560.<br />
Plan dit de « Tapisserie ».<br />
La porte y paraît une bâtisse encore plus massive que dans les plans précédents.<br />
Le premier étage est éclairé par quatre fenêtres ; au milieu se détache une<br />
tourelle plate et en saillie. Chaque tourelle d'angle est percée de deux meurtrières.
UNIVERSITAIRE<br />
PRÉVARICATEUR ET SCHISMATIQUE<br />
L'Université de <strong>Paris</strong> était trop inféodée au parti<br />
bourguignon pour ne pas s'alarmer, après le sacre à<br />
Reims, de la marche de Charles VII sur <strong>Paris</strong>,<br />
Quand, à la fin d'août, <strong>Jeanne</strong> vint mettre le siège<br />
<strong>devant</strong> cette ville, les universitaires qui avaient si<br />
activement collaboré au traité de Troyes, — ce dont<br />
certains, Cauchon entre autres, avaient tiré maints<br />
bénéfices, — ne devaient pas être très rassurés sur<br />
l'avenir qui leur serait réservé, au cas où cette entreprise<br />
aurait été couronnée de succès. Leurs craintes<br />
furent vaines ; <strong>Jeanne</strong> échoua. De cette alerte ils<br />
gardèrent sans doute quelque rancœur, si l'on en<br />
juge par la passion baineuse et violente dont, à Rouen,<br />
ils poursuivirent l'héroïne ; son procès fut, on le<br />
sait, conduit et dirigé par quelques-uns des maîtres<br />
les plus réputés de cette Université.<br />
L'un des agents les plus actifs de la condamnation<br />
de <strong>Jeanne</strong> devait devenir plus tard le doyen du Chapitre<br />
de Notre-Dame de <strong>Paris</strong>.<br />
* *<br />
Originaire d'Amiens, Thomas de Courcelles, était<br />
âgé d'environ trente ans, au moment du procès de<br />
Rouen, en 1431. Deux fois déjà, malgré sa jeunesse,
166 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
il avait exercé les fonctions de recteur de 1'Université<br />
de <strong>Paris</strong>. A la séance du 29 mai il est qualifié « chanoine<br />
de Laon et de Thérouanne ». Dans les « Informations<br />
posthumes » il est ainsi désigné : « Maître Thomas<br />
Courcelles, maître ès-arts et bachelier formé en théologie,<br />
âgé de trente ans ou environ ».<br />
On s'accorde à reconnaître en lui un homme remarquable<br />
; « d'une science éminente et d'une grande<br />
éloquence », lit-on sur sa pierre tombale. Æneas<br />
Sylvius Piccolomini a dépeint son extérieur modeste,<br />
aimable, vénérable ; ses yeux regardaient presque<br />
toujours à terre (1). Crevier le signale comme un<br />
« théologien aussi recommandable par sa piété que<br />
par son profond savoir » (2). M. Gabriel Hanotaux a<br />
écrit de lui : « Thomas de Courcelles est, peut-être,<br />
par l'intelligence, l'autorité et le caractère, l'homme<br />
le plus important de l'Université parisienne, dans<br />
la génération qui suit J. Gerson » (3), Son frère<br />
Jean, de deux ans plus âgé que lui, docteur ès-décrets<br />
et licencié en droit canonique, devait plus tard obtenir<br />
le titre d'archidiacre de Josas (4) et entrer dans les<br />
conseils du roi.<br />
La mémoire de Thomas de Courcelles reste entachée<br />
de deux fâcheuses interventions, où il fit preuve<br />
de passion plus que de jugement : il s'est tellement<br />
(1) Acta conciliorum. Hardouin, t. IX, col. 1423.<br />
(2) Histoire de l'Université de <strong>Paris</strong>, t. IV, p. 105.<br />
(3) <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, p. 289. — M. PETIT-DUTAILLIS le juge plus<br />
sévèrement : « Son plus fameux docteur (de l'Université), au temps<br />
de Charles VII est Thomas de Courcelles, pédant infatué de ses<br />
diplômes, hypocrite et méchant. Cet homme, qui dirigea le<br />
concile de Bâle, avait été l'un des juges de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>. » (Histoire<br />
de France, de Lavisse, IV, 2, p. 200-201).<br />
(4) Ancien archidiaconé du diocèse de <strong>Paris</strong>.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 167<br />
compromis dans le procès de la Pucelle que Quicherat<br />
voit en lui le bras droit du juge, l'évêque Cauchon ;<br />
il s'est posé en antagoniste déclaré des prérogatives<br />
du Souverain Pontife et est considéré comme le principal<br />
inspirateur des décrets schismatiques du concile<br />
de Bâle.<br />
* *<br />
Quand <strong>Jeanne</strong> fut remise aux mains des Anglais,<br />
l'Université de <strong>Paris</strong> se hâta de stimuler le zèle de<br />
l'évêque de Beauvais et du roi d'Angleterre ; à l'un<br />
et à l'autre elle adressa des lettres, demandant que la<br />
Pucelle fut mise rapidement en jugement et que le<br />
procès eût lieu à <strong>Paris</strong>, où le grand nombre de maîtres,<br />
docteurs et notables qui étaient en cette ville promettait<br />
une instruction plus approfondie et une sentence<br />
d'une plus grande autorité. Ces deux lettres,<br />
datées du 21 novembre 1430, ont été composées<br />
et expédiées sous le rectorat de Courcelles.<br />
Rouen choisi comme lieu du procès, Cauchon,<br />
ancien recteur de l'Université de <strong>Paris</strong> et « conservateur<br />
de ses privilèges », sollicite la collaboration de<br />
quelques-uns de ses maîtres les plus réputés ; l'Université<br />
lui délègue six de ses plus éminents docteurs,<br />
dont quatre anciens recteurs, Jean Beaupère, Nicolas<br />
Midi, Pierre Maurice et Thomas Courcelles, et deux<br />
Frères Mineurs, Jacques de Touraine et Gérard<br />
Feuillet. Le 18 février 1431, ils étaient à Rouen;<br />
ce sont ces six universitaires qui allaient conduire<br />
les interrogatoires et diriger tout le procès.<br />
Courcelles se montre parmi les assesseurs les plus<br />
assidus de l'évêque de Beauvais ; les vices de forme<br />
de la procédure n'ont donc pu lui échapper. Quand
168 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
maître Jean Lohier, « solennel clerc normand »,<br />
consulté par Cauchon, relève les irrégularités qui<br />
frappent d'invalidité le procès en cours, l'évêque<br />
indigné s'en vient trouver ses compères, les six<br />
universitaires : « Voilà Lohier, s'écrie-t-il, qui veut<br />
bailler belles interlocutoires en notre procès. Il<br />
veut tout calomnier et dit qu'il ne vaut rien. Qu'en le<br />
voudrait croire, il faudrait tout recommencer et<br />
tout ce que nous avons fait ne vaudrait rien... Par<br />
saint Jean, nous n'en ferons rien, ains continuerons<br />
notre procès, comme il est commencé » (1). Ni Courcelles,<br />
ni ses collègues ne paraissent s'être souciés<br />
de ces irrégularités.<br />
Courcelles assiste à plusieurs des interrogatoires<br />
qui eurent lieu dans la prison. A-t-il collaboré à la<br />
composition du Réquisitoire ? C'est assez probable ;<br />
en tous cas c'est lui, et non le promoteur, Jean<br />
d'Estivet, qui en donne lecture, en français, à la Pucelle<br />
et vraisemblablement accompagne sa lecture des<br />
commentaires utiles. Il parait avoir également coopéré<br />
à la rédaction des douze articles, résumé de l'instruction<br />
et base des accusations. Il est un des quinze<br />
professeurs de théologie qui, le 12 avril, signent le<br />
jugement doctrinal, dont l'autorité devait si grandement<br />
influencer les avis de ceux qui furent ensuite<br />
consultés. Douze conseillers sont appelés, le 12 mai,<br />
à formuler leur opinion sur l'opportunité de soumettre<br />
<strong>Jeanne</strong> à la torture ; neuf se montrent défavorables<br />
à cette mesure ; Courcelles est un des trois qui estiment<br />
utile d'appliquer à la Pucelle la question, pour<br />
lui arracher la vérité et lui faire rétracter ses prétendus<br />
(1) Déposition du .greffier Manchon, au procès de réhabilitation.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 169<br />
mensonges. Le 19 mai Cauchon soumet à l'appréciation<br />
de chacun des assesseurs les qualifications portées<br />
sur les douze articles par l'Université de <strong>Paris</strong> ;<br />
Courcelles confirme la délibération doctrinale qu'il<br />
a signée le 12 avril ; il ajoute qu'il faut de nouveau<br />
avertir <strong>Jeanne</strong>, lui déclarer la peine qui l'attend si,<br />
après monition, elle refuse d'obéir à l'Eglise, auquel cas<br />
elle doit être censée hérétique. Le 28 mai il est un<br />
des sept assesseurs chargés du procès dit de rechute.<br />
Le 29, à la séance de condamnation, il se range à<br />
l'avis de l'abbé de Fécamp, d'après lequel <strong>Jeanne</strong> est<br />
relapse ; il serait bon cependant de lui relire la formule<br />
d'abjuration, de lui en exposer le sens et de<br />
lui proposer la parole de Dieu ; les juges auront<br />
ensuite à la déclarer hérétique et à l'abandonner à la<br />
justice séculière, en priant celle-ci de se montrer<br />
indulgente. Courcelles ajoute que l'on doit avertir<br />
charitablement ladite femme de pourvoir au salut<br />
de son âme et qu'on lui dise qu'elle n'a plus rien à<br />
espérer pour le salut de son corps.<br />
Courcelles est encore l'un des sept qui, le matin<br />
du supplice (mercredi 30 mai), prirent part aux<br />
« Informations posthumes », selon lesquelles <strong>Jeanne</strong><br />
aurait déclaré que ses voix l'avaient trompée ; on<br />
sait que ces « Informations » sont sans valeur juridique<br />
et ne font que déceler les craintes du juge prévaricateur.<br />
Avec le greffier Guillaume Manchon, Courcelles<br />
fut chargé de traduire en latin la minute française du<br />
procès ; il en a fait disparaître plusieurs passages,<br />
notamment quelques-uns de ceux qui le concernaient<br />
personnellement, ce qui est l'œuvre d'un faussaire,<br />
préoccupé, sans doute, de n'être pas incriminé par<br />
la suite ; et ceci établit sa prévarication.
170 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
Bien que d'ordinaire, à cette époque, l'Eglise couvrît<br />
les frais des actions qu'elle intentait en matière<br />
de foi, ce fut le gouverment anglais, au dire de plusieurs,<br />
qui solda toutes les dépenses du procès de<br />
la Pucelle. Par ordre du roi, il était attribué 20 sols<br />
tournois aux six maîtres envoyés par l'Université,<br />
pour chacun des jours où ils avaient vaqué au procès.<br />
Courcelles et Midi furent les mieux rétribués, 113 livres<br />
pour 113 jours, du 18 février au 10 juin, c'està-dire<br />
en valeur actuelle environ 2.260 francs de notre<br />
monnaie, à raison de 20 francs par jour.<br />
<strong>Jeanne</strong> ayant été brûlée le 30 mai, pourquoi Courcelles<br />
et Midi furent-ils payés jusqu'au 10 juin?<br />
Onze jours durant après le supplice, que pouvaientils<br />
faire encore, sinon confectionner les « Informations<br />
posthumes », remanier les notes d'audience du<br />
greffier Manchon, fausser certaines parties du procès,<br />
et préparer la rédaction des lettres, dont le roi d'Angleterre<br />
allait inonder la chrétienté, afin de tromper<br />
princes, prélats et populations sur le véritable motif<br />
de la condamnation de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>?<br />
Quicherat résume ainsi la part de Courcelles dans<br />
le procès : « Il assista à presque toutes les séances,<br />
donna son avis dans toutes les délibérations, travailla<br />
au réquisitoire, le lut, déposa contre <strong>Jeanne</strong> huit<br />
jours après sa mort, fut rétribué au taux de vingt sous<br />
tournois par jour, d'une somme de cent treize livres,<br />
qui représente ainsi cent treize jours de travail... ;<br />
enfin il rédigea (en latin) l'instrument du procès.<br />
Il le rédigea et n'eut pas le courage dans cette rédaction<br />
de laisser son nom partout où il se trouve consigné<br />
sur la minute ; de sorte que, dès l'issue du procès,<br />
il regrettait d'y avoir tant travaillé, et l'on peut se<br />
demander si le sentiment qu'il en garda pour le
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 171<br />
reste de sa vie fut la honte d'avoir été dupe, ou le<br />
remords d'avoir capitulé par timidité, sur des points<br />
qui ne lui avaient jamais paru honnêtes » (1).<br />
* *<br />
Retracer le rôle joué au concile schismatique de<br />
Bâle par Courcelles et ses collègues de l'Université<br />
de <strong>Paris</strong>, n'entre pas dans le cadre de cette note.<br />
Il faut cependant en dire un mot. Un membre de<br />
cette assemblée, Æneas Sylvius Piccolomini a écrit :<br />
« Personne plus que Courcelles n'a dicté un plus<br />
grand nombre des articles du saint concile » (2).<br />
Sponde le désigne comme le principal artisan des<br />
décrets de Bâle : « Thomas de Courcelles decretorum<br />
Basileensium praecipuus fabricator » (3). Quicherat<br />
reconnaît « en lui le père des libertés gallicanes »,<br />
qu'il a « dictées l'une après l'autre à l'assemblée<br />
(de Bâle) » (4). Du Boulay l'appelle le défenseur très<br />
intrépide de ces libertés, l'ennemi irréconciliable des<br />
annates et autres exactions de la curie romaine,<br />
« in defendis Galliae libertatibus acerrimus, annatarum<br />
et aliarum ejusmodi exactionum curiae romanae infensissimus<br />
hostis » (5). Il fut l'un des trois prêtres délégués<br />
par l'assemblée pour désigner les trente-trois<br />
électeurs du futur Pontife. Il a soutenu, et peut-être<br />
fuit élire l'antipape Félix V; en retour celui-ci lui<br />
offrit le chapeau de cardinal, qu'il eut le bon sens<br />
de refuser.<br />
(1) Aperçus nouveaux sur <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, p. 106-107.<br />
(2) RAYNALDI, Annales ecclesiastici, an. 1463, n° 114-127.<br />
(3) SPONDE, Annales ecclesiastici, 1439, n° VII.<br />
(4) Aperçus nouveaux, p. 105.<br />
(5) Historia Univ. <strong>Paris</strong>iensis, t. V, p. 917.
172 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
* *<br />
Cité comme témoin, dans l'enquête préparatoire au<br />
procès de réhabilitation de <strong>Jeanne</strong>, en 1456, il est<br />
ainsi qualifié :<br />
« Vénérable et scientifique personne, maître<br />
Thomas de Courcelles, professeur de sacrée théologie,<br />
pénitentier et chanoine de <strong>Paris</strong>, âgé de cinquante-six<br />
ans ou environ. »<br />
Ses réponses furent alors déconcertantes ; il est<br />
extraordinaire combien les souvenirs précis, sur des<br />
événements qui ne datent que de vingt-cinq ans et<br />
auxquels il a pris une part si considérable, semblent<br />
faire défaut à un homme d'une telle valeur. Bien<br />
qu'il ait prêté serment de dire toute la vérité, il ne<br />
sait que balbutier : « J'ai ouï dire... j'ai perdu le souvenir...<br />
je ne sais... je ne me rappelle rien sur ces<br />
articles..., etc. »; sur ses lèvres ces expressions reviennent<br />
à maintes reprises. Quicherat, qui ne semble<br />
pourtant pas lui être défavorable, se sent obligé de<br />
qualifier sévèrement une telle déposition : « L'embarras<br />
qui règne dans toutes ses réponses, dit-il,<br />
est digne de pitié. Ce ne sont que réticences, hésitations,<br />
omissions : des circonstances qui devraient<br />
faire le tourment de sa mémoire, il ne se les rappelle<br />
pas ; d'autres qu'il avait consignées dans sa rédaction,<br />
il les nie. Toute son étude est de donner à entendre<br />
qu'il a pris peu de part au procès, mais cela n'est<br />
pas admissible » (1).<br />
« Si l'objet du procès (de réhabilitation) n'avait pas<br />
été étroitement circonscrit, écrit le P. Ayroles, et si<br />
(l) Aperçus nouveaux, p. 106.
JEANNE D'ARC DEVANT PARIS 173<br />
Charles VII n'avait pas publié une amnistie, Courcelïes<br />
aurait dû être mis en accusation » (1).<br />
Sans doute sa conscience n'était-elle pas absolument<br />
en paix. A mesure qu'il avançait en âge et que les<br />
événements l'éclairaient, se prenait-il à regretter les<br />
erreurs de ses trente ans ?<br />
Avait-il répudié ses opinions d'autrefois, comme<br />
son ami de Bâle, Æneas Sylvius Piccolomini, attaché<br />
alors, lui aussi, à des doctrines schismatiques, qu'une<br />
fois monté sur la chaire de saint Pierre, sous le nom<br />
de Pie II, il devait combattre et réfuter? (2)<br />
Ennemi de Charles VII, qu'avec ses complices<br />
il poursuivait à Rouen, par dessus <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>,<br />
avait-il renoncé à ses anciennes préférences politiques ?<br />
N'avait-il pas harangué le roi à son entrée à <strong>Paris</strong> et,<br />
toujours éloquent, ne devait-il pas prononcer l'oraison<br />
funèbre de Charles VII, en 1461? S'il se rallia au<br />
parti français, du moins ce ne fut pas pour en tirer<br />
bénéfices, comme son collègue de l'Université et<br />
du Chapitre, le chancelier Chuffart.<br />
Thomas de Courcelles mourut doyen du Chapitre<br />
de Notre-Dame de <strong>Paris</strong>, en 1469, âgé d'environ<br />
soixante-neuf ans.<br />
Sur la même pierre tombale sont représentés les<br />
deux frères, Thomas et Jean de Courcelles, tous deux<br />
assis dans une chaire d'où ils enseignent. On y lit :<br />
« Ci-gît Maître Thomas de Courcelles, homme<br />
d'une science éminente et d'une grande éloquence,<br />
(1) La vraie <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, t. V, p. 95.<br />
(2) Dans son Récit des événements mémorables, Pie II a consacré<br />
plusieurs pages sympathiques à <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> ; s'il a commis<br />
quelques erreurs, il n'en a pas moins affirmé la divinité de sa<br />
mission : « Elle a accompli, dit-il, de grandes choses par inspiration<br />
divine, divino afflata spiritu, sicut res gestae demonstrant ».
174 JEANNE D'ARC DEVANT PARIS<br />
professeur d'Ecriture sainte, doyen et chanoine de<br />
cette église, décédé l'an du Seigneur 1469, à l'âge<br />
de 76 ans » (1).<br />
(l) Bibliothèque nationale, Cabinet des Estampes : Pe. 11. a<br />
(fol, 31). — On remarquera que cette épitaphe vieillit Thomas<br />
de Courcelles de sept ans. Il aurait donc eu 37 ans et non 30, lors<br />
du procès de Rouen.
LA PORTE SAINT-HONORÉ ET SES ENVIRONS VERS 1615.<br />
Plan de Mathieu Mérian.<br />
L'aspect des lieux est modifié. L'avant-porte, le pont dormant et le pontlevis<br />
ont disparu : le fossé est comblé.<br />
L'arrière-fossé a été transformé en boulevard bordé d'arbres.<br />
A l'intérieur de la ville, la terrasse du mur d'enceinte, large et en pente<br />
douce, est très visible.
TABLE DES GRAVURES, PLANS ET CARTES<br />
Attaque de la Porte Saint-Honoré le 8 septembre 1429;<br />
reconstitution par J. Hoffauër 2<br />
La porte Saint-Honoré, d'après un petit médaillon de<br />
Saint-Victor , 21<br />
Boulet de pierre et grosse bombarde du XV° siècle 77<br />
Grosse bombarde du XV e siècle 89<br />
Bombarde et veuglaire 89<br />
Bombardes des XIV e et XV e siècles 91<br />
Bombardes, coulevrines, crapeaudeaux, etc 91<br />
Ribeaudequin et orgues 91<br />
Marche de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> de La Chapelle à la porte Saint-<br />
Honoré :<br />
1. — Tracée sur le plan de Bâle 105<br />
2. — Tracée sur un plan moderne 105<br />
Plan moderne du quartier du Palais-Royal avec le tracé<br />
des fortifications au temps de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> 121<br />
Plan du rempart levé en 1695 123<br />
Fouilles de 1912 et 1913 125<br />
La porte Saint-Honoré et ses environs vers 1530, d'après<br />
le plan d'Arnoulet 139<br />
La porte Saint-Honoré d'après le plan de Braun 149<br />
La porte Saint-Honoré d'après le plan de Truschet et Hoyau 159<br />
La porte Saint-Honoré d'après le plan dit de Tapisserie.. 165<br />
La porte Saint-Honoré d'après le plan de Mérian 175<br />
Le Quartier Saint-Honoré, d'après le plan de Gomboust.. 181
TABLE DES MATIÈRES<br />
Lettres de S. E. le Cardinal DUBOIS VII<br />
Au LECTEUR , 1<br />
L'échec de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> <strong>devant</strong> <strong>Paris</strong> 3<br />
Les sources 3<br />
L'opération militaire 6<br />
Les causes de l'échec 46<br />
Sur les traces de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> 79<br />
Note sur l'artillerie de 1425 à 1450 89<br />
La marche de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong>, de la Chapelle à la<br />
porte Saint-Honoré 91<br />
La population parisienne et l'attaque de <strong>Paris</strong>.. 105<br />
Lieu où fut blessée <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> 121<br />
Cordeliers du XV e siècle 129<br />
Un carme conspirateur 149<br />
Universitaire prévaricateur et schismatique 165<br />
Promulgation à Saint-Martin-des-Champs de la<br />
condamnation de <strong>Jeanne</strong> <strong>d'Arc</strong> 175<br />
Table des gravures, plans et cartes 181<br />
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'IMPRIMERIE D'ANGERS. — 4, rue GARNIER, ANGERS.