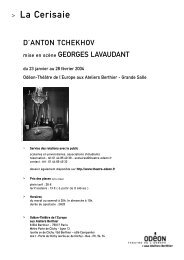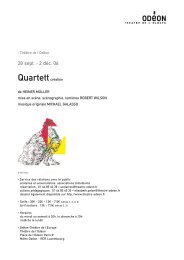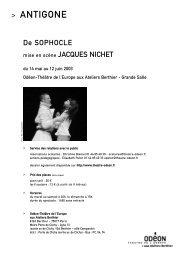l'Orestie d'Eschyle - Odéon Théâtre de l'Europe
l'Orestie d'Eschyle - Odéon Théâtre de l'Europe
l'Orestie d'Eschyle - Odéon Théâtre de l'Europe
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
><br />
L E THÉÂTRE GREC : STRUCTURE<br />
Toute œuvre dans le théâtre grec a une structure fixe, l’alternance <strong>de</strong> ses parties est<br />
réglée, les variations d’ordre sont infimes. Une tragédie grecque comprend: un prologue,<br />
scène préparatoire d’exposition (monologue ou dialogue); la parodos, ou chant<br />
d’entrée du chœur; <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s, assez analogues aux actes <strong>de</strong> nos pièces (quoique <strong>de</strong><br />
longueur très variée), séparés par <strong>de</strong>s chants dansés du chœur, appelés stasima (une<br />
moitié du chœur chantait les strophes, l’autre moitié les antistrophes); le <strong>de</strong>rnier épiso<strong>de</strong>,<br />
formé souvent par la sortie du chœur, s’appelait exodos.<br />
Quelles qu’en soient les variations (historiques ou d’auteur), cette structure a une<br />
constante, c’est à dire un sens: l’alternance réglée du parlé et du chanté, du récit et<br />
du commentaire. Peut-être, en effet, vaut-il encore mieux dire “récit” qu’ “action”;<br />
dans la tragédie, les épiso<strong>de</strong>s (nos actes) sont loin <strong>de</strong> représenter <strong>de</strong>s actions, c’està-dire<br />
<strong>de</strong>s modifications immédiates <strong>de</strong> situations; l’action est le plus souvent réfractée<br />
à travers <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s intermédiaires d’exposition, qui la distancent en la racontant;<br />
récits (<strong>de</strong> bataille ou <strong>de</strong> meurtre), confiés à un emploi typique, celui du Messager, ou<br />
scènes <strong>de</strong> contestation verbale, qui renvoyaient en quelque sorte l’action à sa surface<br />
conflictuelle. On voit ici poindre le principe <strong>de</strong> dialectique formelle qui fon<strong>de</strong> ce théâtre :<br />
la parole exprime l’action, mais aussi elle lui fait écran : le “ce qui se passe” tend toujours<br />
au “ce qui s’est passé”.<br />
Cette action récitée, le commentaire choral périodiquement la suspend et oblige le<br />
public à se reprendre sur un mo<strong>de</strong> à la fois lyrique et intellectuel. Car si le chœur commente<br />
ce qui vient <strong>de</strong> se passer sous ses yeux, ce commentaire est essentiellement<br />
une interrogation : au “ce qui s’est passé” <strong>de</strong>s récitants, répond le “qu’est-ce qui va se<br />
passer?” du chœur, en sorte que la tragédie grecque est toujours triple spectacle :<br />
d’un présent (on assiste à la transformation d’un passé en avenir), d’une liberté (que<br />
faire?) et d’un sens (la réponse <strong>de</strong>s dieux et <strong>de</strong>s hommes).<br />
Telle est la structure du théâtre grec : l’alternance <strong>de</strong> la chose interrogée (l’action, la<br />
scène, la parole dramatique) et <strong>de</strong> l’homme interrogeant (le chœur, le commentaire, la<br />
parole lyrique)... Le théâtre s’empare <strong>de</strong> la réponse mythologique et s’en sert comme<br />
d’une réserve <strong>de</strong> questions nouvelles : car interroger la mythologie, c’était interroger<br />
ce qui avait été en son temps pleine réponse. Interrogation lui-même, le théâtre grec<br />
prend ainsi place entre <strong>de</strong>ux autres interrogations : l’une, religieuse, la mythologie;<br />
l’autre, laïque, la philosophie (au IVe siècle av. J.-C.).<br />
Roland Barthes<br />
L’obvie et l’obtus<br />
Éditions du Seuil, 1982, pp 65/68<br />
‘<br />
oDeoN<br />
T H E A T R E D E L ´ E U R O P E