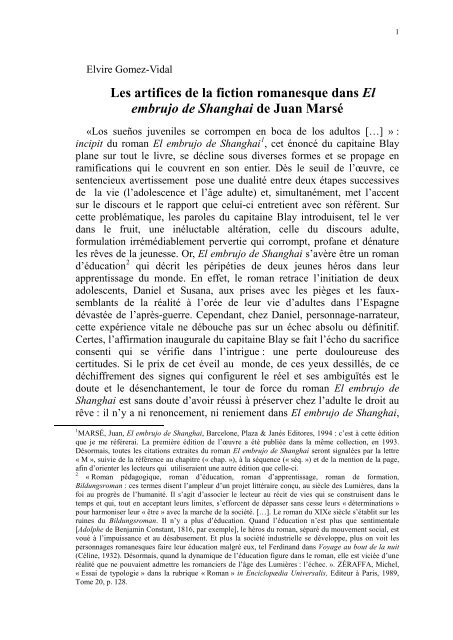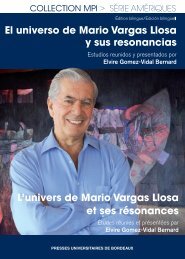You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Elvire</strong> <strong>Gomez</strong>-<strong>Vidal</strong><br />
Les artifices de la fiction romanesque dans El<br />
embrujo de Shanghai de Juan Marsé<br />
«Los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos […] » :<br />
incipit du roman El embrujo de Shanghai 1 , cet énoncé du capitaine Blay<br />
plane sur tout le livre, se décline sous diverses formes et se propage en<br />
ramifications qui le couvrent en son entier. Dès le seuil de l’œuvre, ce<br />
sentencieux avertissement pose une dualité entre deux étapes successives<br />
de la vie (l’adolescence et l’âge adulte) et, simultanément, met l’accent<br />
sur le discours et le rapport que celui-ci entretient avec son référent. Sur<br />
cette problématique, les paroles du capitaine Blay introduisent, tel le ver<br />
dans le fruit, une inéluctable altération, celle du discours adulte,<br />
formulation irrémédiablement pervertie qui corrompt, profane et dénature<br />
les rêves de la jeunesse. Or, El embrujo de Shanghai s’avère être un roman<br />
d’éducation 2<br />
qui décrit les péripéties de deux jeunes héros dans leur<br />
apprentissage du monde. En effet, le roman retrace l’initiation de deux<br />
adolescents, Daniel et Susana, aux prises avec les pièges et les fauxsemblants<br />
de la réalité à l’orée de leur vie d’adultes dans l’Espagne<br />
dévastée de l’après-guerre. Cependant, chez Daniel, personnage-narrateur,<br />
cette expérience vitale ne débouche pas sur un échec absolu ou définitif.<br />
Certes, l’affirmation inaugurale du capitaine Blay se fait l’écho du sacrifice<br />
consenti qui se vérifie dans l’intrigue : une perte douloureuse des<br />
certitudes. Si le prix de cet éveil au monde, de ces yeux dessillés, de ce<br />
déchiffrement des signes qui configurent le réel et ses ambiguïtés est le<br />
doute et le désenchantement, le tour de force du roman El embrujo de<br />
Shanghai est sans doute d’avoir réussi à préserver chez l’adulte le droit au<br />
rêve : il n’y a ni renoncement, ni reniement dans El embrujo de Shanghai,<br />
1 MARSÉ, Juan, El embrujo de Shanghai, Barcelone, Plaza & Janés Editores, 1994 : c’est à cette édition<br />
que je me référerai. La première édition de l’œuvre a été publiée dans la même collection, en 1993.<br />
Désormais, toutes les citations extraites du roman El embrujo de Shanghai seront signalées par la lettre<br />
« M », suivie de la référence au chapitre (« chap. »), à la séquence (« séq. ») et de la mention de la page,<br />
afin d’orienter les lecteurs qui utiliseraient une autre édition que celle-ci.<br />
2 « Roman pédagogique, roman d’éducation, roman d’apprentissage, roman de formation,<br />
Bildungsroman : ces termes disent l’ampleur d’un projet littéraire conçu, au siècle des Lumières, dans la<br />
foi au progrès de l’humanité. Il s’agit d’associer le lecteur au récit de vies qui se construisent dans le<br />
temps et qui, tout en acceptant leurs limites, s’efforcent de dépasser sans cesse leurs « déterminations »<br />
pour harmoniser leur « être » avec la marche de la société. […]. Le roman du XIXe siècle s’établit sur les<br />
ruines du Bildungsroman. Il n’y a plus d’éducation. Quand l’éducation n’est plus que sentimentale<br />
[Adolphe de Benjamin Constant, 1816, par exemple], le héros du roman, séparé du mouvement social, est<br />
voué à l’impuissance et au désabusement. Et plus la société industrielle se développe, plus on voit les<br />
personnages romanesques faire leur éducation malgré eux, tel Ferdinand dans Voyage au bout de la nuit<br />
(Céline, 1932). Désormais, quand la dynamique de l’éducation figure dans le roman, elle est viciée d’une<br />
réalité que ne pouvaient admettre les romanciers de l’âge des Lumières : l’échec. ». ZÉRAFFA, Michel,<br />
« Essai de typologie » dans la rubrique « Roman » in Enciclopædia Universalis, Editeur à Paris, 1989,<br />
Tome 20, p. 128.<br />
1
mais revendication passionnée des illusions de la jeunesse. Car Daniel,<br />
narrateur adulte qui raconte les événements clé d’une initiation parsemée<br />
d’embûches, parvient à contourner l’amère prédiction du capitaine Blay.<br />
Son récit, El embrujo de Shanghai, dissipe sans doute les chimères de la<br />
jeunesse, mais en extrait la quintessence et la conserve jalousement : cette<br />
transmutation, l’intégration lucide des rêves de jeunesse dans le vécu de<br />
l’adulte, est possible, mais elle passe immanquablement par le filtre d’un<br />
discours bien particulier, la fiction, qui, seule, autorise leur éclosion<br />
maîtrisée, leur reconquête éclairée.<br />
Roman placé sous le sceau de la mystification et de la trahison mais<br />
aussi de l’invincible espoir, El embrujo de Sanghai met en scène un rituel<br />
initiatique cruel mais salvateur tout en redéfinissant ces perméables et<br />
mouvantes frontières sur lesquelles s’articule non l’habituelle dichotomie<br />
réalité/ fiction, mais une complexe relation à plusieurs termes (qui inclut<br />
réalité, vérité, fiction, mensonge) dans un fervent hommage du texte écrit<br />
au récit oral et à son pouvoir d’envoûtement.<br />
2
I Le récit enchâssé et les deux narrateurs<br />
El embrujo de Shanghai (El embrujo, désormais) repose sur la<br />
juxtaposition alternée de deux récits (celui de Daniel, d’une part, et celui de<br />
Forcat, d’autre part), une alternance capricieuse d’ailleurs, qui n’obéit à<br />
aucune règle précise. Cette juxtaposition, qui, dans la présentation<br />
textuelle, semble égaliser les deux récits et les mettre sur le même plan<br />
masque en vérité un étagement énonciatif qui les hiérarchise. Il y a là une<br />
duplicité qui n’est pas sans avoir de fortes répercussions sur la réception de<br />
l’œuvre, comme nous allons le voir.<br />
Au vrai, le texte de El embrujo émane tout entier d’un seul et même<br />
narrateur, Daniel, adolescent dans l’histoire racontée, adulte au moment<br />
(non précisé) de l’énonciation 3 . Ce récit à la première personne, à caractère<br />
autobiographique, relate une série d’épisodes décisifs ancrés dans cette<br />
phase délicate de la vie et si fructueuse au plan romanesque : le passage de<br />
l’enfance à l’âge adulte, période privilégiée de tout roman d’apprentissage<br />
et d’éducation. Le récit de Daniel, personnage-narrateur écrivant à la<br />
première personne 4 et racontant sa propre histoire (« narrateur<br />
autodiégétique » selon la terminologie de Gérard Genette 5 ), abrite en son<br />
sein un autre récit, proféré par un autre personnage-narrateur, Nandu<br />
Forcat. Ce récit second, enchâssé dans celui de Daniel, est un discours oral<br />
élaboré par Forcat à l’intention de deux narrataires intradiégétiques :<br />
d’abord exclusivement adressé à Susana (la fille de el Kim dont Forcat<br />
raconte les aventures), il intègre peu à peu Daniel, simple témoin dans un<br />
premier temps, puis récepteur de plein droit lui aussi et reconnu comme tel<br />
par Forcat 6<br />
. Le récit de Forcat est un discours cité, précieusement recueilli,<br />
remémoré et rapporté par Daniel adulte qui l’a couché par écrit et qui, ce<br />
faisant, est passé du statut de narrataire à celui de narrateur. L’instance<br />
Daniel adolescent est un narrataire ébloui, l’instance Daniel adulte est un<br />
narrateur éclairé et désabusé et le subtil entrelacement entre ces deux<br />
instances du personnage Daniel se fait sentir dans toute l’œuvre (dans de<br />
fines prises de distance ponctuelles ou encore dans l’agencement même des<br />
3 Comme en font foi divers brefs passages au présent tels que celui-ci : « En qué estaría pensando<br />
[Forcat], me pregunto hoy, ya instalado como él entonces en la certeza de que todo es transitorio y es lo<br />
mismo, la máscara y la cara, el sueño y la vigilia […].» (M, chap. 9, séq. 1, p. 186 ; souligné par moi).<br />
4 Il est entendu que cette source énonciative, productrice du texte du roman, est fictive (même si certains<br />
faits de la jeunesse de Daniel peuvent être mis en rapport avec des données biographiques de Juan Marsé)<br />
et ne saurait être confondue avec l’instance narratrice supérieure qui a écrit le roman et qui n’est autre que<br />
l’auteur-narrateur.<br />
5 GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 253.<br />
6 « No era la rosa azul del olvido, muchachos, ojalá lo hubiera sido » (M, chap.6, séq.4, p.141), ou<br />
encore : « Una vez más, muchachos, parémonos ante el Kim […] » (M, chap. 8, séq. 3, p.179), souligné<br />
par moi.<br />
3
écits puisque Daniel revendique dans la séquence 2 du chapitre 8 la<br />
responsabilité de la transmission des récits de Forcat).<br />
Le statut de discours cité du récit de Forcat est nettement signalé dans le<br />
texte, puis habilement escamoté. Ainsi au chapitre 3, à la fin de la séquence<br />
2, Daniel rapporte pour la première fois au style direct, ce qui a posteriori<br />
apparaît comme le début du récit de Forcat, à la fois amorce et promesse :<br />
[…] bueno, dijo, se trata de una larga historia que arranca en Francia dos<br />
años atrás, en el cuartucho de una pensión de Toulouse que el Kim y yo<br />
compartíamos desde los años más duros, así que lo mejor será empezar por<br />
ahí, y luego iremos por partes…(M, chap.3, dernière phrase séq.2, p. 63 ; c’est<br />
moi qui souligne).<br />
Ce fragment initial du récit de Forcat clôturant la séquence sur des points<br />
de suspension est donc le signe avant-coureur d’une prise de parole<br />
ultérieure dont la forme vient d’être arrêtée : discours rapporté au style<br />
direct, enclavé dans le récit du narrateur Daniel et donc dépendant de la<br />
transmission de celui-ci.<br />
Or, lorsque Forcat reprend la parole (chap. 3, séq. 4), Daniel le<br />
transcripteur, l’intermédiaire entre narrateur intradiégétique 7 (Forcat, dans<br />
ce cas particulier), et narrataire extradiégétique 8<br />
s’est effacé. Il cède sans<br />
conditions le privilège de la fonction narratrice à Forcat : en effet, le récit<br />
de Forcat bénéficie d’un espace textuel en propre, une séquence complète,<br />
prérogative désormais fixée et inaliénable. En outre, cette première<br />
séquence, tout entière occupée par le récit de Forcat qui entre directement<br />
dans le vif du sujet, est séparée de sa prise de parole antérieure (citée plus<br />
haut), par la séquence 3 du chapitre 3, consacrée à une anecdote racontée<br />
par Daniel et sans rapport direct avec le récit de Forcat (conversation entre<br />
le capitaine Blay et monsieur Sucre). Le récit de Forcat, lorsqu’il survient<br />
donc pour la première fois dans le texte du roman sous ce qui sera sa forme<br />
définitive, est dépourvu de toute contextualisation immédiate et ne fait<br />
7 Le narrateur intradiégétique est un personnage narrateur qui narre à un deuxième niveau de récit tel<br />
Forcat dans El embrujo de Shanghai. Daniel, personnage narrateur lui aussi, est un narrateur<br />
autodiégétique car il raconte sa propre histoire et extradiégétique puisqu’il tient les rênes du premier<br />
niveau du récit, récit enchâssant celui de Forcat.<br />
8 Le narrataire « extradiégétique » (selon la terminologie de Gérard GENETTE dans Figures III, op.cit, p.<br />
266) ne désigne pas le lecteur particulier qui effectue la lecture de l’œuvre. Il est le « lecteur modèle »<br />
prévu par le texte (Umberto ECO, Lector in fabula, Paris, Editions Grasset & Fasquelle pour la traduction<br />
française, 1985, p. 64 et suivantes). On pourrait dire que le narrataire extradiégétique est un lecteur<br />
virtuel, une figure de lecteur construite par le livre lui-même en fonction des compétences qu’il exige<br />
pour être compris. A travers un exemple extrême de l’écart pouvant exister entre lecteur effectif d’une<br />
œuvre et narrataire extradiégétique, on saisira mieux ces notions : ainsi, le narrataire extradiégétique<br />
d’une étude scientifique de haut niveau telle que La théorie algébrique des nombres de P. SAMUEL, ce<br />
ne sera pas moi, ignare en ces matières, même si je m’entête à lire effectivement cet ouvrage : je ne serai<br />
jamais que le lecteur effectif de cette œuvre, lecteur non prévu par elle ! Cet écart peut être très variable et<br />
extrêmement affiné dans les récits de fiction, le lecteur effectif et le narrataire extradiégétique pouvant<br />
être très proches quant à leurs compétences culturelles ; cependant, le narrateur peut, dans certains cas,<br />
cultiver toute une échelle d’écarts entre eux.<br />
4
l’objet, dans la séquence qui le précède, d’aucun type de préambule ou<br />
d’introduction, ni dans celle qui le suit (chap. 3, séq. 5: rencontre Daniel/<br />
Mme Anita) d’une reprise en main de Daniel. Exonéré de tous ces signes<br />
qui disent « ceci est du discours rapporté », surgissant par surprise comme<br />
venu de nulle part, jamais interrompu par d’intempestives interventions des<br />
narrataires intradiégétiques ni même du narrateur extradiégétique, le récit<br />
de Forcat, dans sa mise en scène textuelle, est comme dégagé du patronage<br />
narratif de Daniel. Il s’érige en espace inviolable et autosuffisant jouissant<br />
d’une extraordinaire autonomie, d’une sorte d’immanence. En gommant<br />
son statut de transcripteur, Daniel semble s’incliner humblement devant le<br />
récit de Forcat, se voulant à jamais le simple narrataire de ses paroles<br />
captivantes, succombant encore et toujours à leur ensorcellement.<br />
Forcat énoncera dix récits au total, répartis sur dix séquences,<br />
irrégulièrement disposées dans le texte, présentant ces mêmes<br />
caractéristiques et couvrant environ ¼ de son extensité (54 pages sur les<br />
194 pages de texte de mon édition). Le découpage de chacun des dix récits<br />
de Forcat relève d’un système de fermetures et de clôtures qui fait de<br />
chacun d’eux un épisode cohérent mais non clos, autorisant et même<br />
nécessitant une suite. L’ensemble constitué par les dix récits de Forcat mis<br />
bout à bout forme une unité narrative qui comporte un dénouement interne<br />
(Lévy, démasqué, meurt) mais se prête néanmoins à d’éventuels<br />
prolongements :<br />
[…] yo juraría que sólo desea deshacerse de la pistola, así que<br />
tranquilízate, niña, que aquí no acaba la historia, bromeó Forcat guiñándole<br />
el ojo estrábico a Susana y cogiendo amorosamente su mano… 9<br />
(M, chap. 8,<br />
fin séq. 3, p. 180, c’est moi qui souligne)<br />
L’emplacement de ces dix récits de Forcat dans le roman ne semble pas<br />
obéir à une symétrie bien arrêtée qui aurait pu alimenter une attente du<br />
10<br />
lecteur quant à leur surgissement prévisible à intervalles réguliers . Le<br />
récit fragmenté, feuilletonesque, de Forcat jaillit donc par surprise dans le<br />
texte. L’imprévisibilité de sa survenance en augmente le suspense pour le<br />
seul narrataire extradiégétique. Car ce suspense-là n’existe pas pour les<br />
9 Il s’agit en fait du dernier récit de Forcat, bien que personne ne le sache encore à ce moment-là,<br />
l’irruption de el Denis dans la villa de Susana quelques instants plus tard (chap.9, séq.1) entraînant le<br />
départ de Daniel, puis celui de Forcat le lendemain. On voit comment, lors de ce qui s’avèrera être<br />
l’ultime prise de parole de Forcat, Daniel le narrateur signale à nouveau, comme au début, le statut de<br />
discours cité du récit de Forcat (« bromeó Forcat »).<br />
10 Voir le descriptif de la distribution des récits de Forcat dans le récit de Daniel à la fin de cet<br />
article. On constate simplement que le quatrième et le sixième récits sont placés à l’ouverture des<br />
chapitres 5 et 6 respectivement, ce qui leur octroie un relief particulier, puis que ces récits gagnent en<br />
intensité au chapitre 8, véritable chant du cygne de Forcat : sur les trois séquences que comporte ce<br />
chapitre, les deux séquences d’ouverture et de clôture sont dévolues à Forcat et la très brève séquence<br />
centrale (séq.2) émane de Daniel, narrateur adulte, qui dresse le bilan de sa transmission des récits de<br />
Forcat.<br />
5
narrataires intradiégétiques, Susana et Daniel, même si leur impatience est<br />
grande de connaître la suite des aventures des héros. En effet, il est précisé<br />
dans le roman que Forcat apparaît tous les après-midi sur le coup de cinq<br />
heures dans la véranda de Susana afin de poursuivre son fascinant récit<br />
durant une période de plusieurs mois, rendez-vous quotidien et sûr pour les<br />
deux adolescents. En revanche, l’imprévisible distribution des récits de<br />
Forcat dans le roman crée de fait un suspense qui n’existe pas dans la<br />
réalité extratextuelle de référence à laquelle Daniel se réfère ou feint de se<br />
référer. Ce suspense-là n’a pour cible que le narrataire extradiégétique et il<br />
est créé à son usage exclusif par un agencement textuel particulier.<br />
Par ailleurs, les dix récits de Forcat tels qu’ils sont exposés dans le<br />
roman ne peuvent être l’exacte reproduction des nombreux micro-récits<br />
qu’il aurait proférés pour ses narrataires intradiégétiques dans le cadre<br />
d’une réalité extratextuelle préexistante au roman et dans laquelle Daniel<br />
aurait entendu effectivement les énoncés de Forcat qu’il rapporterait tels<br />
quels. En fait, l’illusion de fidélité à des énoncés préexistants qui est celle<br />
entretenue par tous « les récits de parole » 11 au style direct s’évanouit ici à<br />
l’analyse puisque le narrateur extradiégétique, Daniel, a dû procéder à des<br />
retouches, à des remaniements, à une véritable recomposition de ces<br />
supposés récits oraux énoncés par Forcat 12<br />
. Lorsque Daniel, dans ce<br />
chapitre 8 qui est le chant du cygne de Forcat, dans la brève séquence<br />
centrale où il fait le bilan de son activité de narrateur/ transcripteur, laisse<br />
transparaître son souci de bien faire (« No sé si lo estoy contando bien » ;<br />
M, chap. 8, séq. 2, p. 175), il ne fait aucunement allusion aux difficultés<br />
qu’il aurait pu rencontrer pour synthétiser un grand nombre de petits récits<br />
oraux en dix récits écrits. Ce travail de refonte (absolument fictif je le<br />
répète, mais imposé par la vraisemblance de l’intrigue) a permis la<br />
transposition de multiples récits oraux très segmentés, étalés sur une durée<br />
assez longue, en dix récits de paroles écrits, plus compacts, qui ne<br />
s’adressent plus alors exactement à Susana et à Daniel, narrataires<br />
intradiégétiques, mais bien au narrataire extradiégétique puisqu’ils ont été<br />
recomposés à son intention exclusivement.<br />
A ceci s’ajoute le fait que la distribution de ces récits de Forcat dans le<br />
texte correspond à une stratégie narrative d’ensemble qui les soude aux<br />
11 « Si l’ « imitation » verbale d’événements non verbaux [des choses ou des faits] n’est qu’utopie ou<br />
illusion, le « récit de paroles » peut sembler au contraire a priori condamné à cette imitation absolue dont<br />
Socrate démontre à Cratyle que, si elle présidait vraiment à la création des mots, elle ferait du langage une<br />
réduplication du monde. », GENETTE, op.cit, p. 189 et suivantes.<br />
12 Si l’on s’en tient à la logique de l’intrigue, Forcat n’a pu prononcer tels quels les dix récits figurant<br />
dans l’œuvre. Il a dû faire un grand nombre de micro-récits échelonnés sur une période de plusieurs mois.<br />
Les dix récits figurant dans le roman constituent un dépôt verbal, donné pour véridique, au vrai<br />
absolument fictif. Grâce à l’affirmation de l’existence de ce dépôt verbal préalable à l’écriture du livre,<br />
Daniel assoit la réalité d’une situation de référence, antérieure à sa rédaction, qu’il se contenterait de<br />
« copier ». De fait, ce procédé censé accroître l’effet de réalité d’un récit de fiction en général, dévoile ici<br />
au contraire l’aspect profondément artificieux de la narration.<br />
6
écits de Daniel. La pertinence d’une stratégie narrative d’ensemble<br />
unissant les récits de Daniel et ceux de Forcat comme éléments solidaires<br />
d’une composition textuelle globale n’est d’ailleurs perceptible que pour le<br />
seul narrataire extradiégétique. Les récits de Forcat, ainsi dotés d’une<br />
intentionnalité qui dépasse l’entendement des narrataires intradiégétiques,<br />
affranchis des signes visant à rappeler la médiation de Daniel, enveloppent,<br />
happent directement dans leur réception une autre cible, le narrataire<br />
extradiégétique.<br />
Une autre particularité des récits de Forcat tient à ce que les récits de<br />
Daniel sont écrits au passé et donnent donc pour révolus les événements<br />
racontés. Or, les récits de Forcat, qui eux aussi se réfèrent à des événements<br />
passés, sont entièrement formulés au présent. Le choix du présent semble<br />
obéir à une volonté d’actualisation et de théâtralisation des aventures de el<br />
Kim à Shanghai, mais ce présent est aussi atemporel, immobilisant à jamais<br />
l’énonciation de Forcat dans la pérennité magique des légendes : « […] hoy<br />
como ayer la palabra la tiene Forcat », dit Daniel narrateur dans cette<br />
fameuse séquence 2 du chapitre 8 (p. 175). Le choix du présent s’inscrit<br />
également dans un ensemble de procédures oratoires et rhétoriques de<br />
Forcat visant à captiver ses jeunes auditeurs (adresses aux récepteurs,<br />
emploi de la première ou de la deuxième personne du pluriel, annonces<br />
quant à « l’à-venir » de l’histoire racontée sous forme de présages, etc.).<br />
Enfin, le présent installe les récits de Forcat dans « l’ici-maintenant » de la<br />
lecture si bien que le présent du récit et le présent de la lecture se fondent<br />
l’un dans l’autre. Là encore, le narrataire extradiégétique est circonvenu,<br />
pris dans les rets du récit de Forcat.<br />
Les récits de Forcat s’érigent ainsi peu à peu en récits autonomes, en<br />
récits émancipés et tendent vers un statut très proche de celui d’un récit<br />
premier. Voilà qui confère au récit de Forcat un degré d’authenticité<br />
supérieur à celui d’un récit second, le nombre d’intermédiaires entre récit et<br />
récepteur du récit étant inversement proportionnel au crédit que l’on peut<br />
accorder à l’histoire racontée. Ceci est d’autant plus paradoxal que les<br />
récits de Forcat enchâssés dans le récit de Daniel se présentent comme la<br />
fidèle transcription d’un autre récit encore, celui de el Kim lui-même 13<br />
. Le<br />
récit de Forcat apparaît donc comme une imbrication d’énoncés dans<br />
laquelle se fondent trois énonciations distinctes : celle de Kim, revendiquée<br />
13 Forcat, à plusieurs reprises, dit tenir l’histoire qu’il raconte de el Kim, le père de Susana trop longtemps<br />
absent, personnage légendaire, moderne chevalier errant au blason immaculé (Joaquim « Franch » i<br />
« Casablancas »), ancien combattant anti-franquiste, ancien résistant, militant clandestin exilé à Toulouse,<br />
séparé de sa fille chérie et de sa femme par un deuxième voyage à Shanghai (ultérieur à celui évoqué par<br />
Forcat dans ses récits) afin de préparer leurs retrouvailles définitives. Forcat insiste maintes fois sur sa<br />
fidélité à ce récit originel : « Todo lo que os voy contando lo supe por boca del propio Kim en el<br />
transcurso de una tarde de lluvia que pasamos juntos bebiendo cerveza en un cafetucho de la rue des Sept<br />
Troubadours, en Toulouse, la víspera de su regreso definitivo a Shanghai y del mío a Barcelona » (M,<br />
chap. 4, séq. 2, p. 81).<br />
7
par Forcat en tant que source du récit originel, celle de Forcat,<br />
omniprésente, celle de Daniel, oblitérée.<br />
Au bout du compte, le discours fragmenté de Forcat, malgré les<br />
évidences que l’analyse textuelle met en lumière, se dote d’un statut<br />
extrêmement ambigu et semble se situer sur le même plan que celui du<br />
narrateur extradiégétique, les processus indiquant le passage d’un niveau<br />
narratif à l’autre s’effaçant dans le courant de la lecture : il y a brouillage<br />
des hiérarchies énonciatives mais aussi réceptrices et ce brouillage<br />
contribue d’une part à intensifier l’effet de réalité de ce discours et d’autre<br />
part à attirer et à impliquer profondément le lecteur dans un récit qui ne lui<br />
était pas destiné.<br />
8
II Le « chaos » ou la représentation de la réalité sociale et politique de<br />
référence<br />
Les récits de Daniel font office de cadre préparant l’émergence des récits<br />
de Forcat et les rehaussant : sur ce fond terne et prosaïque, un morne et<br />
triste quotidien voué à la pauvreté, oscillant entre le désespoir, la<br />
résignation ou la folie, les aventures de el Kim brillent de mille feux.<br />
Morcelés eux aussi, leur nature est nettement différente de celle des récits<br />
de Forcat en ce qu’ils sont majoritairement des « récits d’événements » et<br />
non des « récits de paroles ».<br />
Je n’ai relevé qu’une date précise dans le roman qui se situe d’ailleurs au<br />
chap. 9, séq. 4, soit aux confins de l’œuvre :<br />
En febrero de 1951, tres años después de mi última visita a la torre, Finito<br />
Chacón […] me dijo que había visto a Susana fregando vasos detrás del<br />
mostrador del bar de fulanas del Denis en Río Rosas. (M, chap.9, séq.4, p.<br />
197)<br />
De telle sorte que les événements racontés par Daniel se situent dans le<br />
courant de l’année 1947 ou 48, dans cette Espagne exsangue de l’aprèsguerre<br />
que Juan Marsé met en scène dans la plupart de ses romans 14<br />
et qu’il<br />
a contribuée à préserver dans la mémoire de ses lecteurs, à édifier et à<br />
perpétuer dans leur imaginaire. Cependant, cette précision temporelle<br />
longuement différée ne fait que corroborer un faisceau très serré d’indices<br />
qui configurent la trame même de l’histoire racontée par Daniel et qui<br />
affectent également les péripéties de el Kim telles que les narre Forcat: les<br />
références à la guerre civile espagnole toute proche (le père mort ou disparu<br />
du narrateur Daniel durant la guerre ; les fils morts du capitaine Blay, etc.),<br />
au régime franquiste, à la répression, à l’asservissement des consciences<br />
(Blay se cachant des années durant dans un réduit derrière l’armoire de sa<br />
salle à manger, arrestation brutale des opposants, les passants figés dans le<br />
salut phalangiste, etc.), à la misère et à la faim permanente (les ruses et les<br />
tromperies des frères Chacón pour obtenir de la nourriture), à l’exil des<br />
républicains, à leur engagement dans la Deuxième Guerre mondiale, dans<br />
la Résistance française, aux liens entre les organisations politiques<br />
intérieures et extérieures, etc. L’histoire racontée par Daniel sanctionne la<br />
fin des illusions pour ces combattants et le récit de Forcat dit la nécessité<br />
d’un nouveau départ, le désir de recommencer à zéro une nouvelle<br />
existence qui sont le moteur même de l’histoire de el Kim. Cependant la<br />
collision finale incandescente (au chap. 9, séq. 1) entre le rêve et la réalité<br />
14 Y compris dans son dernier roman Rabos de lagartija, Barcelona, Editorial Lumen, 2000.<br />
9
se résout dans une dégradation sans espoir semble-t-il, dans une véritable<br />
déroute des valeurs éthiques qui avaient habité les personnages : dans ce<br />
monde irrémédiablement corrompu, Forcat cesse d’être l’habile<br />
falsificateur de la clandestinité, le magicien du verbe, pour devenir un<br />
imposteur et un parasite, el Kim, le preux sans peur et sans reproche se<br />
métamorphose en un pitoyable traître, el Denis, en un proxénète mû par de<br />
sombres desseins de vengeance. Les nobles héros dégringolent de leur<br />
piédestal, se muent en anti-héros gangrenés de l’intérieur par l’avilissement<br />
général. Et pourtant, de cet univers en ruines, Daniel le futur narrateur,<br />
l’apprenti bijoutier, saura extraire de leur gangue les trésors légués par ces<br />
hommes vaincus, apparemment terrassés.<br />
Les récits de Daniel sont unis, malgré leur fragmentation textuelle, par<br />
une avancée chronologique constamment signalée (« El jueves por la<br />
mañana » , M, chap. 1, séq. 2, p. 19; « A mediados de marzo», M, chap. 1,<br />
séq. 6, p. 31 ; « Al día siguiente por la mañana », M, chap. 2, séq. 2, p.38,<br />
etc.). Ces indications temporelles, dépourvues toutefois de la mention de<br />
l’année, vont édifiant une chronologie qui rend vraisemblables le<br />
mûrissement des actions et l’évolution des personnages. Elles s’inscrivent<br />
dans une période de dix mois au cours de laquelle le jeune Daniel, qui a<br />
arrêté l’école, attend pour la rentrée suivante un emploi d’apprenti dans une<br />
bijouterie. Afin de combler ce temps mort d’inactivité, sa mère le charge de<br />
s’occuper d’un voisin quelque peu dérangé, le capitaine Blay, personnage<br />
loufoque devenu la risée des gamins du quartier à cause de ses lubies et de<br />
son déguisement d’Homme Invisible. Or, ce personnage apparemment<br />
burlesque va jouer un rôle déterminant tant dans le cadre de l’histoire<br />
racontée qu’au plan des structures romanesques. Il est l’adjuvant<br />
indispensable de Daniel, celui qui rend possible toute l’histoire, son<br />
déclencheur. C’est bien son souci obsessionnel d’obtenir des signatures<br />
contre les émanations de gaz qui, autorisant de continuels déambulations et<br />
vagabondages dans les rues du quartiers, font éclore les différentes<br />
anecdotes dont se nourrit le récit de Daniel. Sans Blay, le livre n’existerait<br />
pas.<br />
Dans un premier temps, le récit de Daniel considéré dans son ensemble<br />
donne l’impression d’un assemblage hétéroclite d’anecdotes, de fragments<br />
narratifs sans autre unité apparente que la figure même de Daniel, une<br />
avancée chronologique dans une temporalité définie à grands traits, puis un<br />
balancement régulier entre deux espaces, la rue, espace ouvert et<br />
multiforme parcouru en compagnie de Blay et la véranda de la villa de<br />
Susana, espace clos, serre où fleuriront les récits de Forcat.<br />
Blay, dont le projet chimérique justifie cette juxtaposition de tableaux,<br />
de scènes de rue composant le récit de Daniel, est au vrai le fil conducteur<br />
de ce récit : ses errances donnent une unité et une cohérence à cet espace<br />
riche en rencontres qu’est le quartier et favorisent ces hasards qui font le<br />
10
grain de l’histoire. C’est encore le capitaine Blay qui ouvre à Daniel les<br />
portes de la maison de Susana puisqu’il souhaite que celui-ci, qui manifeste<br />
des penchants artistiques, fasse un dessin suggestif de la jeune tuberculeuse<br />
consumée par le fameux gaz et la fumée de l’usine proche afin d’inciter<br />
plus efficacement les voisins à signer sa pétition. Cette intervention vitale<br />
de Blay donne un puissant élan à la narration : chez Susana, Daniel<br />
deviendra le témoin et le narrataire des récits de Forcat, un narrataire de<br />
plus en plus impliqué et qui, au fil du temps, se transformera en narrateur<br />
de ce livre que nous lisons, El embrujo de Shanghai. Là encore, Blay<br />
apparaît comme un chaînon décisif, indispensable à l’expansion<br />
romanesque, essentiel à l’existence même du roman .<br />
La scène sur laquelle s’ouvre El embrujo est exemplaire à cet égard : la<br />
réalité de référence y est transmise au lecteur par le truchement de Blay. Le<br />
capitaine Blay perçoit une forte odeur de pourriture, de décomposition<br />
flottant dans l’air (« carroña », « descomposición de huevos », chap. 1, séq.<br />
1, p. 11). Ce premier passage d’ouverture du roman débouche sur la<br />
reconnaissance du produit toxique qui empuantit l’atmosphère du quartier :<br />
« ¡Ya sé lo que es ! ¡Gas ! » (p. 12). Peu après, Blay associe dans une<br />
même animosité ce gaz et la fumée de l’usine de plexiglass (chap. 2, séq. 1,<br />
p. 36). Or, ce personnage est présenté d’emblée comme un original farfelu<br />
dépouillé de tout prestige et de toute crédibilité et le narrateur n’hésite pas<br />
à démentir aussitôt ces propos extravagants : « la quimera del capitán »<br />
(p.11).<br />
Au vrai, Blay appréhende un niveau supérieur de réalité, il va au-delà<br />
des apparences pour mettre à nu la trame secrète et symbolique du réel. Si<br />
l’on parcourt l’œuvre en suivant le fil conducteur du « gaz », on constate<br />
tout d’abord que, pour le capitaine, entre le régime franquiste et le gaz<br />
existe une curieuse affinité, qu’ils ont partie liée, que le gaz est généré par<br />
le régime lui-même :<br />
-Es una miasma, un fluido - lo cortó el capitán-. Y hay muchas clases de<br />
gases. El grisú, por ejemplo, el gas de cloro, tóxico y asfixiante, que invade las<br />
trincheras. El gas doméstico, silencioso y rastrero. El gas verde de los<br />
pantanos y de los embalses, una especie de adormidera…¿Por qué cree usted<br />
que se inauguran tantos pantanos en este país ? (M, chap.4, séq.1, p.80,<br />
souligné par moi)<br />
Le capitaine laisse entendre là que la propagation du gaz est une vaste<br />
entreprise calculée, contrôlée, à caractère politique. Le régime aspire à un<br />
abrutissement des consciences, à une léthargie généralisée. Le « gaz » est<br />
chargé de rendre compte de l’enveloppant labeur idéologique auquel se<br />
livre le régime afin de plonger les Espagnols dans ses vapeurs soporifiques<br />
et délétères. L’illustration la plus frappante de ce phénomène est sans doute<br />
la rencontre pleine d’humour entre Blay et les passants pétrifiés dans le<br />
11
salut phalangiste. Tel un automate mû par un ressort invisible, un passant<br />
se fige soudain, le bras tendu, à l’imitation d’un autre peu plus loin, qui a<br />
lui-même imité la pose d’un autre quidam encore. Cette gesticulation<br />
incompréhensible, puis cette immobilité sans cause apparente, semblent<br />
s’être répandues de manière contagieuse, comme une épidémie:<br />
Súbitamente se le disparó el brazo derecho y se quedó saludando en<br />
dirección opuesta a nosotros y con la mirada fija en no sabíamos qué, hasta<br />
que llegamos a su lado : otro peatón igualmente esmirriado y cabizbajo estaba<br />
varado con el mismo ademán en la otra esquina […] donde, como en un juego<br />
de espejos que propiciara una ilusión óptica, se veía a un lejano tercer<br />
salutante que era el calco de los otros dos. (M, chap.4, séq.4, p. 94)<br />
L’hypothèse raisonnable de Daniel (sans doute, le premier passant, situé<br />
près de la caserne a-t-il entendu l’hymne national lorsqu’on a levé le<br />
drapeau) ne convainc guère le capitaine. Pour lui la cause est entendue : ces<br />
hommes ont été foudroyés par le gaz, ils sont tout simplement « gazés »<br />
(« El gas los ha fulminado », M, chap. 4, séq. 4, p. 94 ; « Usted está<br />
gaseado y bien gaseado, señor mío », M, idem, p. 95).<br />
Uniformisation, répétition d’actes dépourvus de sens, invincible torpeur,<br />
multitudes moutonnières paralysées par la peur, telle est l’œuvre létale des<br />
vainqueurs. Car il s’avère que les délires du capitaine Blay, que ce gaz<br />
fétide qu’il a été le premier à percevoir, reposent sur une réalité tangible.<br />
En effet, les ouvriers envoyés sur place par la Compagnie du Gaz ont fini<br />
par déceler que ce gaz existe même s’il ne provient pas d’une fuite, mais<br />
d’un cimetière, d’ossements anciens enfouis sous les rues du quartier<br />
(« debajo de esta plaza hay un cementerio lleno de muertos », M, chap. 1,<br />
séq. 2, p. 20) :<br />
No hay ninguna fuga de gas. Ese pestucio es el que sueltan los huesos de los<br />
muertos cuando se juntan muchos. También echan al aire una luz verde de<br />
fósforo, yo la he visto a veces en los cementerios, de noche…El olor se parece<br />
mucho al del gas, mismamente es un gas, el gas de los difuntos. (M, chap.1,<br />
séq.2, p. 21, souligné par moi)<br />
« El gas de los difuntos » se répand dans la ville car les morts oubliés sur<br />
lesquels le franquisme a assis son pouvoir sont là ; inéluctablement<br />
présents comme les deux fils du capitaine qui ne cessent de mourir dans ses<br />
divagations (« los hijos muertos que en su recurrente quimera junto a las<br />
brumas del Ebro nunca se acababan de caer ni de morir », M, chap. 7, séq.<br />
5, p. 170), ils rappellent leur existence. Sous l’ordre de fer imposé par le<br />
régime gisent les morts. L’Espagne n’est plus qu’un immense monument<br />
funéraire, un sépulcre qu’il est impossible de quitter parce que, quoi qu’on<br />
fasse, on le porte en soi (« No existen para ti otras tierras,otros mares,/ esta<br />
ciudad irá donde tú vayas », M, chap. 5, séq. 1, p. 102) : l’espace extérieur,<br />
12
funèbre (« frío sepulcro de mi sentimiento », M, chap. 5, séq. 1, p. 101),<br />
s’est logé dans l’intimité des consciences.<br />
Ainsi le mentor ridicule de Daniel, l’anti-héros par excellence, est bien le<br />
« fou », le « bouffon » 15<br />
doté d’une extraordinaire clairvoyance. Son<br />
déguisement d’Homme Invisible qui en fait un objet de risée doit être<br />
compris de manière littérale tout comme ses bizarreries. Ces bandelettes et<br />
pansements sous lesquels il se dissimule n’expriment pas seulement son<br />
désir de « disparaître », ils matérialisent et extériorisent aussi la blessure<br />
intérieure qui le ronge : une guerre perdue dans laquelle ses idéaux ont<br />
sombré et ses deux fils sont morts.<br />
Ainsi, la réalité perçue par Blay ne relève pas de l’absurde : sa vision<br />
exhibe les véritables enjeux du réel, en dévoile les obscurs engrenages, en<br />
éclaire les coulisses. Ce n’est que bien des années plus tard que Daniel,<br />
narrateur adulte, entend enfin le sens profond des enseignements du<br />
capitaine Blay qui, comme Forcat, ont été tous deux des figures paternelles<br />
de substitution, le guidant dans son apprentissage du monde et dans le<br />
déchiffrement de ses signes :<br />
Porque a fin de cuentas, hoy lo sé, entre ese gas quimérico que salía de las<br />
cloacas para adormecernos y su valeroso convencimiento [de Blay] de la<br />
existencia real de ese gas, no había sino un ligero malentendido. (M, chap.7,<br />
séq.4, p. 169, souligné par moi)<br />
En fait, les discours des personnages du roman, s’ils ne semblent pas en<br />
adéquation avec le réel convoqué, s’ils semblent le travestir de manière<br />
inappropriée, révèlent toujours finalement des vérités enfouies. La<br />
puissance des mots n’échappe ni à Blay, ni à monsieur Sucre, moins encore<br />
à Forcat. Au seuil du roman, le lien particulier qui unit les mots et le gaz est<br />
décelé :<br />
Cuidado con las miradas llameantes y con las ideas incendiarias y la mala<br />
leche que algunos todavía esconden .¡Mucho cuidado ! […] Una chispa o una<br />
palabra soez, y ¡bum ! todos al infierno. (M, chap.1, séq.1, p. 13)<br />
15 Parlant des fonctions du « fripon, du bouffon et du sot » dans le roman, Mikhaïl BAKHTINE affirme<br />
que, dès le Moyen Age, dans le fabliau, les saillies, les farces, « ces masques prennent un sens<br />
exceptionnel quand il s’agit du combat contre les conventions et l’inadéquation, pour l’homme véritable,<br />
de toutes les formes de vie existantes. Ils donnent le droit de ne pas comprendre, d’embrouiller,<br />
d’hypertrophier ; le droit de parodier la vie en paroles, de donner dans l’à-peu-près, de n’être pas soimême<br />
; […] ; le droit d’arracher le masque d’autrui, afin de rendre publique la vie privée, avec tous ses<br />
replis les plus secrets. », Esthétique et théorie du roman, Paris, Editions Gallimard, 1978, pour la<br />
traduction française, p. 308. Ces observations pourraient dans une large mesure s’appliquer au personnage<br />
de Blay, héritier de ces lointaines figures de la littérature populaire médiévale passées par le tamis de<br />
multiples transformations romanesques ultérieures (comme le « pícaro » ou Don Quichotte auxquels le<br />
personnage de Blay emprunte bien des traits) mais toujours animées par un rejet radical ou une<br />
« incompréhension » apparemment naïve des conventions sociales ou des idéologies dominantes.<br />
13
Les mots ou les idées incendiaires peuvent provoquer l’explosion finale,<br />
mettre le feu aux poudres, révéler concrètement l’existence du gaz délétère<br />
dans un mariage du littéral et du métaphorique. C’est pourquoi le rituel<br />
auquel procèdent quotidiennement Blay et Sucre constitue une tentative<br />
dérisoire peut-être mais hautement symbolique ; ils brûlent<br />
méthodiquement le journal du jour 16<br />
, porte-parole du discours officiel,<br />
chargé de modeler le réel selon les intérêts des vainqueurs :<br />
Al atardecer del quinto día, el capitán Blay compró el diario Solidaridad<br />
Nacional y le prendió fuego detrás del quiosco, muy cerca del portal. Dos<br />
mujeres que pasaban por allí fueron presa del pánico y echaron a correr<br />
chillando, pero no se produjo ninguna explosión. (M, chap.1, séq.1, p. 17)<br />
En brûlant le journal, Sucre et Blay détruisent une version fallacieuse du<br />
réel forgée par un discours officiel mensonger, mais en sous-main, ils<br />
abritent peut-être le rêve secret de rendre concret, tangible, ce gaz<br />
impalpable et invisible sécrété par le régime et, grâce à une explosion<br />
17<br />
apocalyptique, de démasquer aux yeux de tous la véritable nature de<br />
celui-ci.<br />
Le « gaz », stratégiquement situé au début de l’œuvre, motivant les<br />
déambulations de Blay, favorisant la rencontre de Daniel et de Susana,<br />
rendant possible l’écoute du récit de Forcat, est en fait la matrice volatile<br />
qui engendre tout le déploiement romanesque, et le roman est comme un<br />
pied de nez définitivement irrespectueux envers ceux qui avaient cru, grâce<br />
à lui, bâillonner à jamais les vaincus et faire disparaître les traces de leurs<br />
infamies. Car ce gaz que Blay a été le premier à détecter, à reconnaître, à en<br />
évaluer la dimension métaphorique, s’il exhibe les fondements monstrueux<br />
du régime (« el gas de los difuntos »), ou rend compte de son œuvre de<br />
propagation mortifère (« el gas que adormece »), recèle encore un autre<br />
niveau de significations qui tiennent à son étymologie : créé par un<br />
chimiste flamand du XVIIè siècle<br />
18<br />
16 Cérémonial connu de tous et maintes fois rapporté dans le roman : « Cuidado vosotros dos [Sucre et<br />
Blay], puñeta, que quemáis periódicos detrás del quiosco -replicó un tranviario socarrón-. Un día<br />
volaremos todos por los aires […] » (M, chap.1, séq.1, p. 13) ; ou encore (M, idem, p. 15) : « […] luego<br />
compra [Sucre] el periódico en el quiosco y lo quema con una cerilla sentado en un banco a veces en<br />
compañía del capitán. »<br />
17 Blay meurt lorsqu’il s’aperçoit qu’il a perdu sa précieuse chemise contenant sa pétition contre le gaz :<br />
on ne peut manquer d’établir un lien de cause à effet entre ces deux événements (M, chap.7, séq.4, p. 168<br />
et 169). « Croisade » contre le « gaz », sa lutte était bien un combat perdu d’avance contre les ignominies<br />
d’un régime honni (« la ignominia que muchos preferían olvidar », M, chap.7, séq.5, p. 171); mais Daniel<br />
reprendra le flambeau (« Pero algo no se perdió […], un paisaje moral grabado para siempre en mi<br />
memoria », M, chap.7, séq.4, p. 169).<br />
18 « Gas, 1817 : palabra inventada por el químico flamenco J.B. van Helmont (+ 1644), inspirándose en el<br />
latín chaos, ‘caos’, que sus predecesores alquimistas empleaban en el mismo sentido », COROMINAS,<br />
Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Editorial Gredos, 1994.<br />
14<br />
, le mot « gaz » fut forgé sur le terme<br />
latin chaos, déjà utilisé dans ce sens par les alchimistes. A l’origine (chaos<br />
provient du grec kháos, kháüs), le terme désignait l’abîme, l’espace
immense et ténébreux qui existait préalablement à la création du monde.<br />
L’étymologie du mot « gaz » révèle donc la nature profonde du régime<br />
franquiste qui le génère : sous le paravent de l’ordre officiel, ne règne que<br />
le néant, le vide, l’informe, le chaos 19<br />
.<br />
Si les paroles de Blay semblent dépourvues de liens avec leurs référents<br />
tant elles les revêtent d’oripeaux extravagants, tant la crédibilité du<br />
personnage est compromise par ses allures grotesques, on voit à l’analyse<br />
que paroles et actes du capitaine proviennent d’une lecture métaphorique<br />
du réel qui appréhende celui-ci avec une particulière acuité, une singulière<br />
justesse et que cette lecture métaphorique du réel est percutante,<br />
destructrice, et investie d’une mission dénonciatrice et démystifiante d’une<br />
implacable dureté.<br />
19 Sucre ne saisit pas que la croisade de Blay coïncide exactement avec ses propres et amères<br />
constatations : «Pero tu cruzada es de risa. ¿ Que no ves la magnitud de la nada que nos envuelve ? […].<br />
Una nada de sueños ahogándose en la nada, que dijo aquél… » (M, chap.3, séq.3, p. 63 ; souligné par<br />
moi).<br />
15
III « El cuento chino » et « Shanghai »<br />
Les récits de Forcat pourraient être qualifiés de « contes chinois » tant ils<br />
se réclament de la Chine. Une Chine stylisée, réduite à quelques accessoires<br />
de pacotille (l’éventail chinois offert à Susana, le kimono de Forcat, etc.) et<br />
passée par le filtre de ces films en noir et blanc des années 30 et 40 ayant<br />
Shanghai pour cadre 20 . Des liens qui s’affichent de manière tapageuse (le<br />
titre même du roman est l’exacte reprise du titre du film de Von Sternberg,<br />
The Shanghai gesture de 1941, diffusé en Espagne sous l’appellation El<br />
embrujo de Shanghai), mais qui exercent également une influence<br />
souterraine, plus diffuse, dans le récit de Forcat, puisque celui-ci leur<br />
emprunte l’essentiel des canevas de l’intrigue : femmes fatales comme la<br />
belle et mystérieuse Chen Jing Fang, aventuriers hardis comme l’inquiétant<br />
et si séduisant Kruger/ Omar Meiningen, héros désabusés comme el Kim ;<br />
les bals et les cocktails fastueux de l’Hotel Cathay qui, sur fond de<br />
révolution imminente, rassemblent une société trouble et mêlée lançant ses<br />
derniers feux à la veille de son effondrement ; le fumoir d’opium dans lequel<br />
el Kim rencontre Kruger ; le personnage de Su Tzu qui recueille les attributs<br />
stéréotypés des Orientaux, impassibilité et alarmante courtoisie. Toute la<br />
panoplie est là, sans compter le parfum de la trahison, la passion dévastatrice<br />
d’un Lévy, l’amertume et le blasement de el Kim dans une Chine objet de<br />
désir et source illusoire de dépaysement. Cette filiation aveuglante avec le<br />
cinéma (qui se manifeste encore sous d’autres formes 21<br />
) ne doit pas masquer<br />
un autre phénomène, textuel, fabriqué par la lettre même du roman :<br />
l’avènement de la double signification, littérale et métaphorique de<br />
20 Le roman El embrujo revendique sans ambages cet héritage : Patrick LISSORGUES dans son article<br />
« El embrujo de Shanghai, c’est du cinéma ! », Les langues néo-latines, n° 295, 1995, a mis en lumière<br />
l’influence indiscutable exercée sur le récit de Forcat par les nombreux films hollywoodiens mettant en<br />
scène Shanghai en tant qu’espace exotique et interlope. Les autres romans de Juan Marsé n’échappent<br />
pas non plus à cette emprise du cinéma. Geneviève CHAMPEAU analyse ces procédures dans « Récit et<br />
métarécit, Un día volveré et El embrujo de Shanghai de Juan Marsé », Cours du Télé-enseignement,<br />
Bordeaux, Université de Bordeaux 3, 1997, p. 31 à 35. Voir également l’article de Samuel AMELL,<br />
« Juan Marsé y el cine » in Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica, 1997.<br />
21 Ainsi, « el aire fumanchunesco » de Forcat (M, chap.6, séq. 4, p. 142) renvoie à une autre série de films<br />
des années 30 et 40 dont le personnage principal était le sinistre docteur chinois Fu-Manchu (voir mon<br />
article « Juegos de espejos y espejismos en El embrujo de Shanghai », Les langues néo-latines, n° 316,<br />
2001, p. 90) ; le déguisement d’Homme Invisible de Blay s’inspire du film The Invisible Man de James<br />
Whale (1933) ; il y a constante invasion réciproque entre réalité et fiction cinématographique dans l’esprit<br />
des adolescents (« Jesse James » et « la Madonna de las Siete Lunas » surgissant entre les arbres de la<br />
place Rovira, M, chap.1, séq.1, p. 16; Susana découpant des programmes de cinéma et rassemblant ainsi<br />
pêle-mêle les images de Schéhérazade, Quasimodo, Tarzan, etc., et le souvenir du dernier baiser de son<br />
père, M, chap.2, séq.6, p. 50 à 52) ; le fait que le père de Susana ait été représentant d’une marque de<br />
projecteurs pour cabines de cinéma, que sa mère travaille comme caissière au cinéma Mundial, poste<br />
qu’elle occupera elle-même plus tard, constituent encore d’autres indices de cette présence permanente et<br />
à divers niveaux, du cinéma qui parcourt en filigrane ce roman.<br />
16
l’expression « cuento chino », entrelacées, s’intermotivant de manière<br />
dynamique.<br />
Dire « cuento chino » en espagnol, ce n’est pas dire « conte chinois » ou<br />
du moins pas tout de suite, car ce premier sens, littéral, de l’expression se<br />
trouve relégué au second plan, rejeté dans le néant par la prééminence de<br />
son sens figuré. De telle sorte que ce que perçoit un Espagnol dans<br />
l’expression « cuento chino », c’est le sens « d’histoire ou de conte à<br />
dormir debout », supercherie, tromperie ou imposture. Or, dans El embrujo,<br />
le « conte chinois » et « le conte à dormir debout » à la fois, fusionnent<br />
dans l’expression « el cuento chino » qui rend compte avec une adéquation<br />
absolue de la nature du récit de Forcat : ce récit est d’abord un « conte<br />
chinois », puis devient « une histoire à dormir debout » avec les révélations<br />
de el Denis (chap. 9, séq. 1). Au vrai, le fait que le récit de Forcat soit « un<br />
conte chinois » littéral, fait naître un soupçon souterrain mais immédiat visà-vis<br />
de la véracité de ce récit dans l’esprit d’un lecteur espagnol qui ne<br />
peut dissocier le caractère « chinois » du récit de son caractère fallacieux 22<br />
.<br />
« Conte chinois » littéral car Forcat (« el curandero recién llegado de la<br />
China », raconte Blay aux voisines dévorées de curiosité, M, chap. 4, séq.<br />
1, p. 77) est le narrateur « chinois » d’une histoire qui se déroule dans une<br />
Chine onirique, regorgeant de tous les stéréotypes et de toutes les<br />
connotations qui y sont attachées. C’est précisément lorsqu’il fait sa<br />
première apparition déguisé en Chinois, c’est-à-dire revêtu d’un kimono et<br />
23<br />
chaussé de sandales à la chinoise , qu’il remet à Susana les accessoires<br />
chinois (l’éventail, la carte postale de Shanghai) qui assoiront la véracité de<br />
sa rencontre avec el Kim et son rôle de fidèle messager. Or, cette véracité<br />
est minée par tous ces signes à peine perceptibles qui chuchotent « ceci est<br />
une farce », et dont le lecteur ne saisit pleinement la portée que<br />
rétrospectivement. C’est également au cours de ce même entretien (chap. 3,<br />
fin séq. 1) qu’il promet le récit des aventures de el Kim qui va mener ses<br />
narrataires vers une Chine de rêve. Dans l’incise de cette promesse<br />
d’ailleurs, un jeu de mains avec les manches de son kimono ponctue son<br />
discours :<br />
-Es una larga historia. Yo diría…- Forcat se interrumpió y, antes de<br />
proseguir, ocultó las manos en las amplias mangas del quimono y se sentó en<br />
el borde de la cama sin apartar los ojos de Susana-. Yo diría que ha ido [a<br />
Shanghai] a buscar algo que olvidó precisamente aquí…Pero dejemos eso por<br />
22 Sentiment encore exacerbé par l’existence d’autres expressions en espagnol telles que : « tener (algo)<br />
más trampas que una película de chinos », « engañar a alguien como a un chino », « ¿somos chinos ? »<br />
qui mettent en rapport « le chinois » et la tromperie. (Voir l’analyse détaillée de ces connotations dans<br />
mon article « Juegos de espejos y espejismos … », op.cit, p. 91 et 92).<br />
23 « […] Forcat entró en la galería calzando unas extrañas sandalias de suela de madera y embutido en un<br />
largo batín negro de solapas rojas y adornado con una grafía china. […]. -Mira, este quimono de seda me<br />
lo regaló tu padre- dijo.» (M, chap.3, séq.1, p. 59).<br />
17
ahora. Vamos a tener mucho tiempo para contarnos cosas. (M, chap.3, séq.1,<br />
p. 60 ; souligné par moi)<br />
Ainsi, au moment même où il promet le récit (« larga historia »,<br />
« contar ») d’une histoire se déroulant en Chine (« un cuento chino »=« un<br />
conte chinois ») qui s’avèrera être un récit mensonger et mystificateur (« un<br />
cuento chino »=« une histoire à dormir debout »), Forcat, le futur conteur,<br />
apparaît revêtu métonymiquement des attributs concrets du « Chinois » et,<br />
de ses yeux bigles 24 (et l’on dit en espagnol de celui qui louche, « tiene un<br />
ojo aquí y el otro en Pekín ») contemple Susana. A maintes reprises<br />
ensuite, le narrateur souligne que Forcat a bien endossé son costume<br />
chinois lorsqu’il narre (M, chap. 3, séq. 2, p. 62 ; chap. 4, séq. 1, p. 80 ;<br />
chap. 7, séq. 2, p. 154 ; ces relevés ne sont pas exhaustifs), ou lorsqu’il se<br />
livre à des tours de magie (chauffer le verre de lait, M, chap. 5, séq. 3, p.<br />
110). Le costume chinois de Forcat est indissociable de son statut de<br />
narrateur, de magicien et de mystificateur. A ce propos, il convient de noter<br />
que el Denis, lorsqu’il pénètre dans la véranda armé de la terrible « verdad<br />
verdadera », remarque aussitôt l’étrange déguisement et dans une sorte de<br />
raccourci clairvoyant, comme s’il établissait un rapport de cause à effet,<br />
perce à jour les raisons de l’imposture 25<br />
:<br />
Forcat mantenía su extraño silencio y el Denis reparó en su quimono chino<br />
de amplias mangas y adornos en la espalda.<br />
-Vaya con el pintamonas de la Barceloneta –dijo-. […]. Me dijeron que<br />
estabas aquí gorroneando como siempre […]. (chap.9, séq.1, p. 183)<br />
Par connotation avec la Chine, la couleur jaune est omniprésente dans le<br />
récit de Forcat et scande de sa présence les étapes les plus décisives de<br />
cette histoire. Tel est le cas de ce livre « chinois » à couverture « jaune »<br />
(« se trata de un libro chino de un tal Li Yan, y tiene las tapas amarillas »,<br />
dit Levy ; M, chap. 4, séq. 2, p. 87) que el Kim doit dérober dans la cabine<br />
du capitaine du Nantucket, Su Tzu, ce qui favorise une confusion entre<br />
deux livres à couverture jaune (M, chap. 5, séq. 1, p. 101). Cette erreur<br />
26<br />
permet à el Kim de découvrir un magnifique poème « griego» et donc<br />
incompréhensible pour lui (« La ciudad » de Cavafis), mise en abyme de<br />
24 Caractéristique de Forcat mentionnée à plusieurs reprises (« nos envolvió a Susana y a mí con su<br />
mirada estrábica », M, chap.3, séq.2, p. 62), parfois associée au charme de sa voix, véritable chant des<br />
sirènes, (« la tupida red de su voz y la tenaza abierta de su mirada », M, chap.4, séq.1, p.81), voire<br />
nettement liée à son statut d’imposteur : « el estrábico embustero » (M, chap.9, séq.4, p. 200).<br />
25 Qui ne sont pas les seules pourtant : si Forcat est bien un pique-assiette vivant de la crédulité de Anita<br />
et de Susana (comme semble en faire foi le titre du seul livre que les adolescents trouvent dans sa valise,<br />
La conquista del pan, mise en abyme très crue de son parasitisme), il n’hésitera pas à se sacrifier pour<br />
sauver la jeune fille (version des faits retenue par Daniel, chap.9, séq.4), à qui il a toujours voulu épargner<br />
les épines de la réalité.<br />
26 « Griego » comme « chino » en espagnol signifient « langage incompréhensible » dans des expressions<br />
telles que « me hablas en griego » ou « esto me suena a chino ». Equivalents de « hébreu » ou<br />
« chinois » en français dans l’expression « c’est de l’hébreu (ou « du chinois ») pour moi ».<br />
18
son destin d’éternel errant fuyant vainement de ville en ville son propre<br />
tourment intérieur. C’est dans le cabaret de Kruger/ Omar Meiningen, le<br />
Yellow Sky Club [« le Club Ciel Jaune »] de Shanghai que se produit, dans<br />
un moment de tension culminant, le dénouement de l’histoire et que el Kim<br />
découvre une double trahison : celle de la belle Jing Fang infidèle à son<br />
mari et celle de Lévy qui s’est servi de lui, lui faisant croire qu’Omar était<br />
son ancien tortionnaire, un nazi nommé Kruger, afin qu’il élimine ce rival.<br />
Les tables du Yellow Sky Club sont d’ailleurs ornées de « roses jaunes » et<br />
ce détail prend toute son importance lorsque el Kim décèle sur le piano de<br />
l’appartement de la jeune Chinoise une « rose jaune » (M, chap. 6, séq. 3,<br />
p. 141). « La rosa amarilla del desencanto » (M, chap. 6, séq. 4, p. 141),<br />
que el Kim contemple longuement (« la mira obsesivamente, como si<br />
descifrara […] en su amarillo fuego apagado la clave del enigma », M,<br />
chap. 7, séq. 3, p. 155), est en fait l’indice révélateur du mensonge de la<br />
jeune femme et de son infidélité à son époux.<br />
Le texte va ainsi générant un réseau signifiant qui associe<br />
« chinoiseries » (que j’entends ici simplement comme « venant de Chine »<br />
et non dans le sens de « complication inutile et extravagante ») et<br />
tromperies. La couleur jaune s’infiltre aussi dans une moindre mesure dans<br />
le récit de Daniel et fleurit dans ces bouquets de genêts (« la floración<br />
amarilla », M, chap. 4, séq. 3, p. 89) que les frères Chacón, passés maîtres<br />
dans l’art de la duperie et qui se sont institués gardiens de Susana, lui<br />
offrent régulièrement ; elle se manifeste encore sous la forme d’un éclair<br />
jaune (« el garabato amarillo de un relámpago », M, chap. 3, séq. 3, p. 64)<br />
zébrant le ciel juste avant que Forcat ne débute son premier récit fallacieux;<br />
elle embellit Susana, représentée par Daniel dans son premier dessin avec<br />
un œillet jaune 27<br />
dans les cheveux (M, chap. 7, séq. 2, p. 152).<br />
Si les mailles de l’alliance chinoiseries/ tromperie sont plus lâches dans<br />
le récit de Daniel, elles enveloppent néanmoins Susana avec beaucoup<br />
d’insistance : selon Forcat, son père l’imagine souvent, se promenant à son<br />
bras sur les rives du fleuve Huang-p’u, « luciendo agujas de jade en el pelo<br />
y un vestido de seda verde, muy ceñido y abierto en los costados, como las<br />
jóvenes chinas elegantes… » (M, chap. 4, séq. 2, p. 88). Au fur et à mesure<br />
que le récit de Forcat progresse, Susana intègre cette image d’elle-même<br />
avec une conviction grandissante (« He pensado que en el otro dibujo, el<br />
bueno, quiero llevar un vestido como el de Chen Jing », M, chap. 5, séq. 6,<br />
27 Susana balance entre ces deux couleurs symboliques : « Después del verde, el amarillo era su color<br />
predilecto », (M, chap.4, séq.3, p. 89). Bien des indices textuels et intertextuels rendent compte de<br />
l’inéluctable cheminement de la jeune tuberculeuse vers un dénouement fatal. Ainsi, elle habite « calle de<br />
las Camelias » et le narrateur ne manque pas de signaler le lien qui l’unit à Marguerite Gautier, phtisique<br />
elle aussi, « la dame aux camélias » du roman éponyme d’Alexandre Dumas fils (« [Susana, qui porte<br />
d’ailleurs une « marguerite » dans ses cheveux, M, chap.2, séq.3, p. 42] exageraba la postura estilo dama<br />
de las camelias muriéndose », M, chap.2, séq.4, p. 46, souligné par moi). Voilà sans doute pourquoi les<br />
significations symboliques ambivalentes du vert la séduisent tout particulièrement : couleur de la<br />
putréfaction et de la mort, le vert est aussi la couleur du renouveau, du printemps et de l’espoir.<br />
19
p. 119). De sorte que, selon son vœu, le deuxième dessin de Daniel la<br />
représente vêtue en Chinoise ce qui engendre un processus de<br />
métamorphose troublant : « Susana empezaba a parecerse a una china de<br />
verdad », (M, chap. 7, séq. 2, p. 153). L’identification avec la belle et<br />
élégante Chen Jing est la raison la plus évidente de ce désir de Susana,<br />
mais ce n’est pas la seule et la lettre du texte fait jaillir de cette<br />
métamorphose d’autres effets de sens qui dépassent une simple explication<br />
tenant à la vraisemblance psychologique du personnage. Si le personnage<br />
de Forcat, narrateur « chinois », recueille en lui les motifs de la magie et de<br />
l’illusion par connotation intertextuelle 28<br />
et intratextuelle, le personnage de<br />
Susana est affecté par un autre réseau de connotations : Susana s’empare du<br />
raffinement et du mystère véhiculés par la belle Chinoise sans doute, mais<br />
en tant que narrataire privilégiée du récit de Forcat, en tant que réceptrice<br />
crédule d’un récit captieux, son déguisement de « Chinoise » fait aussi<br />
d’elle la dupe idéale. Par un processus de contamination métonymique,<br />
Susana revêt l’apparence du personnage le plus apte à être abusé en<br />
espagnol: ne dit-on pas « engañar a alguien como a un chino » ? D’ailleurs,<br />
Susana, une fois qu’elle a toutes les cartes en main, ne s’y trompe pas et<br />
refuse avec violence de jeter ne serait-ce qu’un regard au deuxième dessin<br />
enfin achevé que Daniel est venu tendrement lui apporter (M, chap. 9, séq.<br />
3, p. 194, c’est moi qui souligne : « me tenías que haber dibujado de otra<br />
manera, hombre, ¿es que no te das cuenta ? »): ce dessin qui avait<br />
longtemps été celui du rêve et de l’espérance n’est plus pour elle à présent<br />
que celui du leurre et de la supercherie.<br />
L’expression « cuento chino » qui n’apparaît jamais dans le roman,<br />
semble pourtant bien être le dispositif occulte qui, simultanément, propage<br />
à travers le texte le réseau littéral de « la chinoiserie » et diffuse le faisceau<br />
métaphorique de la mystification et de la tromperie sous forme de<br />
ramifications entrecroisées qui interfèrent entre elles mutuellement et<br />
s’entrelacent de manière dynamique. Elle gît dans le terreau textuel et ce<br />
sont ses diverses manifestations disséminées qui conduisent à son<br />
exhumation. Elle fait office de grand rassembleur car elle autorise la<br />
concentration cohérente d’une série d’éléments dispersés. Cette expression<br />
d’une grande adéquation ici, une fois découverte, agit, en ce sens qu’elle<br />
permet alors de dégager de nouveaux indices qui viennent enrichir<br />
28 Dans son roman El amante bilingüe (Barcelona, Editorial Planeta, 1990), Juan MARSÉ avait déjà<br />
ébauché un personnage d’illusionniste « chinois », dont il s’est sans doute servi pour modeler<br />
ultérieurement le personnage de Forcat dans El embrujo, « Fu-Ching, el gran ilusionista » (p. 37, El<br />
amante) : « El Mago Fu-Ching se llama en realidad Rafael Amat […]. El kimono y el gorro chino le<br />
sientan bien. […] Fu-Ching mueve los largos dedos con endiablada rapidez y exhibe unos dientes<br />
podridos ofreciendo a mi consideración diversos números de ilusionismo y prestidigitación .» (p. 42, El<br />
amante). Le narrateur de El amante bilingüe le qualifie un peu plus loin de « gran ilusionista » et de<br />
« embustero, pobre embustero » (p. 44, El amante). Ainsi, ce lien intertextuel, s’il est reconnu par le<br />
lecteur de El embrujo, ne peut manquer d’éclabousser de ses caractéristiques le personnage de Forcat,<br />
narrateur « chinois » aussi, et sape en sous-main la crédibilité de son discours.<br />
20
l’isotopie chinoiseries/ mystification. Elle autorise la détection de nouvelles<br />
marques textuelles apparemment fortuites auparavant, désormais en affinité<br />
avec elle : il devient alors possible de discerner par exemple<br />
l’omniprésence de la couleur jaune (« chino=amarillo ») dans le texte, ce<br />
qui à son tour, renforce la pertinence littérale de l’expression « cuento<br />
chino=conte chinois » en une incessante interaction porteuse de sens.<br />
L’expression « cuento chino » exhibe les mécanismes subtils de l’écriture<br />
fictionnelle, elle est le germe enfoui dans le texte qui ne prend corps que<br />
dans le rassemblement signifiant de ses manifestations éparses. Elle est au<br />
vrai une puissante matrice invisible et souterraine qui irrigue de sa sève le<br />
texte tout entier.<br />
Par ailleurs, Shanghai, l’espace mis en relief en tant que composante du<br />
titre, le lieu dans lequel évolue el Kim dans le récit de Forcat, s’avère être<br />
un lieu symbolique, défini par le texte même comme l’espace de l’illusion<br />
chimérique et de la tromperie. En effet, il existe dans le roman, perdu dans<br />
les replis du texte, un autre lieu nommé lui aussi « Shanghai », comme la<br />
ville où se déroulent les aventures apocryphes de el Kim. Daniel est le<br />
premier à le mentionner, bien avant que Forcat ne commence son récit :<br />
¿Es cierto eso que dicen de la señora Anita, que trabajaba en un baile-taxi<br />
llamado Shanghai y que el Kim la conoció allí ?(M, p. 48, chap.2, séq.5 ;<br />
souligné par moi)<br />
Forcat y revient à la fin de ses récits, dans la séquence 1 du chapitre 8,<br />
lorsque el Kim se trouve dans le Yellow Sky Club, et condense en quelque<br />
sorte la quintessence de cet endroit nommé « Shanghai »:<br />
[…] en los meandros alegres de la melodía [de la canción Continental] que<br />
un día ya lejano cobijó tanta ensoñación suya y de Anita, tantas expectativas<br />
de plenitud amorosa y de aventura, surge el recuerdo de otro cabaret, un<br />
baile-taxi situado en la Rambla de Cataluña y llamado precisamente<br />
Shanghai en la Barcelona invernal de 1938 bajo las bombas ; allí, una noche<br />
que el Kim disfrutaba de permiso, a una gitana resalada y embustera que iba<br />
de mesa en mesa diciendo la buenaventura le compró un falso mantón de<br />
Manila para Anita y le cambió su flamante cazadora militar de cuero por un<br />
collar de cuentas de vidrio…que él había creído muy valioso. (M, chap.8,<br />
séq.1, p. 173 ; souligné par moi)<br />
Forcat vient d’enchâsser « Shanghai », le dancing de Barcelone, dans la<br />
ville de Shanghai par le biais du souvenir nostalgique de el Kim. Il vient<br />
aussi de définir ce dancing comme le lieu de l’illusion amoureuse et de la<br />
supercherie. Le dancing « Shanghai » et les connotations qu’il véhicule le<br />
font apparaître rétrospectivement comme la miniature signifiante de la ville<br />
de Shanghai (où el Kim découvre qu’il a été abusé tout comme il l’avait été<br />
dans le dancing du même nom à Barcelone ; où Forcat situe une histoire<br />
21
mensongère) : le dancing « Shanghai » est la mise en abîme 29<br />
de la ville de<br />
Shanghai. Tel un avertissement chiffré destiné aux narrataires, le lieu<br />
nommé « Shanghai », où qu’il se situe, se présente de manière anticipée<br />
comme un espace frappé au coin de l’illusion trompeuse ainsi que le<br />
confirme ce dialogue entre le gangster chinois, Du « Grandes-Oreilles » et<br />
el Kim, soumis à une lecture littérale :<br />
-Nunca sueño despierto [dice el Kim].<br />
-No lo creo. No estaría [usted] en Shanghai si no lo hiciera. (M, chap.7,<br />
séq.3, p. 139)<br />
De telle sorte que l’on ne peut « rêver tout éveillé » que dans une contrée<br />
nommée « Shanghai », toponyme dont le caractère référentiel s’estompe et<br />
qui jouit alors d’une localisation non plus géographique mais imaginaire et<br />
onirique comme la Bagdad des Mille et une nuits, ou comme Cythère, l’île<br />
grecque devenue le pays de l’amour et du plaisir. « Shanghai » est partout ;<br />
« Shanghai » est désormais le nom d’une contrée dotée d’ubiquité,<br />
consacrée à la chimère, à l’illusion et à la mystification.<br />
La mise en abyme « Shanghai dans Shanghai », constitue une sorte<br />
30<br />
d’anticipation miniaturisée qui éclaire la nature du récit de Forcat . Mais<br />
elle ne peut être identifiée comme telle (c’est-à-dire en tant que mise en<br />
abyme signifiante) qu’a posteriori, à la rétrolecture, c’est-à-dire une fois<br />
que l’œuvre entière est connue et perçue en tant qu’ensemble d’éléments<br />
solidaires qui, mis en rapport, font sens. Cependant, ici, elle vient s’ajouter<br />
à un réseau d’autres indices qui ont pour objet, dans le cours de la lecture,<br />
de soulever des doutes ténus, d’alimenter de vagues soupçons quant à la<br />
véracité du récit de Forcat. Ce réseau signifiant qui dénonce le discours de<br />
Forcat comme récit mensonger ne se déclare résolument pertinent qu’au<br />
chapitre 9 : il sort alors de l’ombre et ses ramifications se dessinent avec un<br />
extraordinaire relief sur toute la surface du texte.<br />
Les liens qui unissent la miniature à l’ensemble textuel qu’elle reproduit<br />
en petit sont d’ordre analogique mais la miniature ne reprend pas forcément<br />
avec une exactitude absolue toutes les caractéristiques du modèle amplifié :<br />
elle peut exacerber ou minimiser, voire modifier, certains traits de cet<br />
ensemble. La mise en abyme la plus spectaculaire du texte de El embrujo<br />
de Shanghai est sans doute le récit de Forcat enchâssé dans le roman. Dans<br />
la dernière partie de cette étude, nous allons voir comment cette mise en<br />
abyme particulière, tout en reproduisant l’ensemble qui la contient, l’altère<br />
profondément.<br />
29 « Est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude avec l’œuvre qui la contient »,<br />
DÄLLENBACH, Lucien, Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil, 1977, p. 18.<br />
30 Dällenbach analyse, à travers de multiples exemples, les variantes de ce système d’enchâssement en<br />
modèle réduit de certaines facettes d’une œuvre qui peut avoir pour enjeu les coordonnées de l’intrigue,<br />
des motifs particuliers, des procédures de fonctionnement du texte telles que son organisation structurelle,<br />
etc.<br />
22
IV Les pactes<br />
En lisant El embrujo de Shanghai, on peut avoir le sentiment que les<br />
récits de Daniel ne sont qu’une toile de fond indépendante juxtaposée aux<br />
récits de Forcat. Ceux-ci d’ailleurs, ont l’air de pouvoir fonctionner de<br />
manière autonome et autosuffisante et semblent aspirer à eux seuls toute la<br />
magie du titre de l’œuvre, « el embrujo de Shanghai », toutes ses<br />
potentialités de mystère et d’onirisme. Or, à l’analyse, on constate qu’il<br />
n’en est pas ainsi. Des liens très profonds unissent les deux récits et ce, à<br />
différents niveaux. Tout d’abord, le récit de Daniel prépare, dans la trame<br />
de l’intrigue, dans ses structures, l’émergence des récits de Forcat. Il<br />
constitue un écrin, savamment assombri, habilement distribué et aménagé<br />
pour que les récits de Forcat y scintillent avec éclat. Le récit de Daniel est<br />
également chargé de rendre compte de l’écoute émerveillée des deux jeunes<br />
narrataires intradiégétiques, de leur impatience grandissante, de l’influence<br />
de ces récits sur leur vie quotidienne et c’est dans ces répercussions que les<br />
récits de Forcat prennent toute leur valeur et se colorent d’une intensité<br />
émotionnelle et d’une dimension affective. Par ailleurs, les deux récits sont<br />
complémentaires au plan des informations : ainsi, par exemple, les<br />
bavardages de Blay et les rumeurs du quartier permettent de reconstituer<br />
une biographie abrégée de Forcat et de el Kim qui corrobore et complète les<br />
renseignements figurant dans le récit de Forcat. En outre, les deux récits<br />
fusionnent au sein d’ une économie romanesque qui est une unité<br />
d’éléments solidaires : au plan de l’intrigue, ils sont unis par tout un<br />
système d’échos et de réverbérations mutuelles qui débouche sur<br />
l’incandescente confrontation de la séq. 1 du chap. 9. Enfin, tous deux se<br />
fondent sur une même structuration souterraine mais puissamment<br />
agissante : l’articulation mystification/ démystification, moteur secret de<br />
l’écriture, immédiatement opératoire dans le récit de Daniel, longuement<br />
différée dans le cas du récit de Forcat.<br />
Des indices nombreux et divers, dosés avec soin, émaillent le récit de<br />
Forcat et constituent un réseau visant à introduire des doutes sur sa<br />
véracité. Toutefois, à mon sentiment, ces indices ne sont pas suffisamment<br />
tangibles pour que le lecteur prévu par le texte (le narrataire<br />
extradiégétique) en tire les conclusions qui s’imposent dans le cours d’une<br />
première lecture. Absorbé par l’habile enchaînement des événements, par le<br />
passage pendulaire d’un récit à l’autre, par le désir de connaître la suite des<br />
aventures de el Kim, le lecteur entérine ces indices qui déclenchent<br />
cependant de fugaces « pressentiments » ou « intuitions ». Il me semble<br />
d’ailleurs que le narrateur a soupesé et agencé ces indices avec un doigté<br />
particulier, une très grande délicatesse, afin que le narrataire<br />
23
extradiégétique ne puisse en aucune manière concevoir des certitudes<br />
tangibles à ce sujet et que ce ne soit que rétrospectivement, a posteriori,<br />
qu’il parvienne à les percevoir et à les rassembler en une constellation<br />
signifiante, comme un réseau de sentiers soudain illuminés émergeant d’un<br />
paysage obscur. Ceci afin de préserver l’intensité du coup de théâtre qui se<br />
produit dans la séquence 1 du dernier chapitre (chapitre 9) où, avec<br />
l’arrivée de el Denis, la vérité éclate: retournement de situation qui met à<br />
nu sans équivoque possible désormais l’imposture de Forcat et le caractère<br />
fallacieux de ses récits.<br />
A cet égard, il est à noter que dans la séq. 2 du chap. 8, axe de symétrie<br />
des deux derniers récits de Forcat, Daniel, narrateur adulte, fait le bilan de<br />
son activité de transcripteur de ces récits : « No sé si lo estoy contando<br />
bien », se demande-t-il. Installé dans le présent de son énonciation,<br />
indéterminée temporellement mais postérieure aux faits, Daniel connaît<br />
parfaitement la suite des événements. Pourtant, en cet ultime instant, s’il<br />
fait allusion aux inévitables variations qu’a subies le récit dans le cours de<br />
ses transmissions, il ne révèle à aucun moment sa nature mensongère. Bien<br />
au contraire, il étaye l’existence d’un récit originel de el Kim à Forcat, et<br />
insiste sur la véracité des aventures de el Kim à Shanghai :<br />
Desde el primordial y seguramente apresurado testimonio recogido por él<br />
de los labios del propio Kim y luego recreado para sí mismo quién sabe la de<br />
veces […], esta azarosa intriga que llevó al Kim desde su refugio en el sur de<br />
Francia a una cálida alcoba enardecida por el opio y la traición había hecho<br />
un viaje tan largo y accidentado que era imposible que la imaginación no<br />
hubiese contagiado la memoria, confundiendo la peripecia vivida y la soñada.<br />
(M, chap.8, séq.2, p. 175, souligné par moi)<br />
Certes, Daniel admet les inévitables érosions du souvenir, les<br />
gauchissements de l’imagination, les correctifs et les infléchissements que<br />
le rêve et le désir ont imprimé au récit de Forcat, mais il ne remet<br />
nullement en cause les données de base de ce récit (aventures de el Kim à<br />
Shanghai, récit originel de el Kim à Forcat). Or, ce sont ces mêmes données<br />
de base qui volent en éclats neuf pages plus loin. El Kim n’est jamais allé à<br />
Shanghai, jamais il ne s’est trouvé dans cette « tiède alcôve embrasée<br />
d’opium et de trahison » où s’étreignent les deux amants (Omar et Chen<br />
Jing) et donc n’a jamais fait ce récit originel revendiqué par Forcat et<br />
corroboré par Daniel dans la citation ci-dessus : ces soubassements ont été<br />
inventés de toutes pièces par Forcat dans ce qui n’est plus un<br />
« témoignage » légèrement retouché mais bel et bien une création<br />
artificieuse absolue. En cet ultime instant, juste avant que n’éclate « la<br />
verdad verdadera », Daniel, avec une pointe de perfidie, se fait le garant de<br />
la crédibilité du récit de Forcat afin d’amplifier l’impact des révélations qui<br />
vont suivre. L’économie du roman exigeait cette omission ou plutôt cette<br />
24
fable délibérée et méditée de Daniel narrateur adulte afin de préserver le<br />
caractère heuristique du segment narratif suivant, le chapitre final.<br />
Par ailleurs, ce bilan de Daniel narrateur au chapitre 8 remplit une autre<br />
fonction : il vient couronner tout un faisceau de procédures narratives<br />
visant à impliquer directement le narrataire extradiégétique dans la<br />
réception du récit de Forcat. En gommant juste avant les révélations de el<br />
Denis ces « intuitions » de défiance que les signes discrets d’autodénonciation<br />
inclus dans ce récit auraient pu susciter, Daniel fait en sorte<br />
que le narrataire extradiégétique tombe dans le panneau lui aussi tout<br />
comme les narrataires intradiégétiques. Le texte prévoit que le narrataire<br />
extradiégétique fera la même expérience que Daniel et Susana alors, qu’il<br />
vivra lui aussi l’initiation des adolescents aux pouvoirs ensorcelants et aux<br />
mirages du discours.<br />
Avec solennité, le narrateur cède une dernière fois la parole à Forcat :<br />
« Por eso, hoy como ayer, la palabra la tiene Forcat » (M, chap. 8, séq. 2, p.<br />
175). Et le narrataire extradiégétique est pris au piège, il succombe au<br />
leurre lui aussi. Le narrateur de El embrujo réactualise cette ruse éculée, ce<br />
stratagème aussi vieux que le récit lui même : faire passer un discours feint<br />
pour un discours vrai. Et il réussit ce tour de passe-passe grâce à un<br />
trompe-l’œil d’une redoutable efficacité : enchâsser un discours soi-disant<br />
référentiel, un témoignage véridique (le récit de Forcat), dans un récit de<br />
fiction (le roman El embrujo de Shanghai).<br />
Quels sont donc ces indices en sommeil qui sortent de leur<br />
engourdissement après les révélations de el Denis dans la première<br />
séquence du chapitre 9 et configurent a posteriori un réseau serré<br />
d’avertissements didactiquement essaimés dans le texte ? Ces indices se<br />
trouvent tout autant dans les récits de Daniel que dans ceux de Forcat mais<br />
présentent une différence fondamentale. Ainsi, Daniel est confronté à de<br />
multiples épreuves qui le contraignent à tâtonner, à soupeser puis à trier les<br />
informations en sa possession, afin de tracer de nettes frontières entre la<br />
réalité et l’apparence : les cigares que sa mère dit offrir à doña Conxa (M,<br />
chap. 1, séq. 4, p. 28) ; les supercheries des frères Chacón afin d’obtenir de<br />
la nourriture des voisines apitoyées (M, chap. 1, séq. 3, p. 24 et 25) ; les<br />
délires et les élucubrations constants du capitaine Blay qui mettent à<br />
l’épreuve sa propre appréhension du monde 31<br />
; le mouchoir taché de sang de<br />
Susana, en réalité barbouillé de rouge à lèvres (« el pañuelo embaucador »,<br />
M, chap. 5, séq. 6, p. 121) ; les mystères de l’armoire du capitaine Blay<br />
(« la engañifa del negro armario ropero », M, chap. 7, séq. 4, p. 164), etc.<br />
31 «Mi talante timorato, aprensivo y crédulo hizo que al principio me tragara todas las paridas del capitán,<br />
todas sus manías y extravagancias, pero poco a poco fui aprendiendo a lidiar a tan estrambótico<br />
personaje. » (M, chap.1, séq.4, p. 27).<br />
25
Si le récit de Daniel est émaillé de mystifications récurrentes, celles-ci sont<br />
toujours perçues et aussitôt dénoncées comme telles 32<br />
. Le schéma<br />
mystification/ démystification y est immédiatement opératoire.<br />
En revanche, dans le récit de Forcat, ces signes sont beaucoup plus<br />
allusifs car ils ne sont pas régis par l’articulation mystification/<br />
démystification immédiate. La mystification est longuement entretenue, la<br />
démystification retardée jusqu’au chapitre final, et les signes d’une autodénonciation<br />
sont d’une grande subtilité. Pour une grande part, ces signes<br />
tiennent à ce que le récit de Forcat, discours prétendument référentiel,<br />
emprunte en fait aux récits de fiction tout l’éventail de leurs artifices : il est<br />
truffé de marqueurs de fictionnalité. Il utilise massivement les procédures<br />
propres aux récits de fiction en général : recours à des mises en abyme<br />
telles que « Shanghai dans Shanghai » ou que le poème de Cavafis,<br />
dramatisation des événements racontés, création de suspenses répétés<br />
(signes de mauvais augure, interruptions stratégiques), appel aux<br />
stéréotypes ou aux clichés de la fiction (personnages archétypaux, scénario<br />
du triangle amoureux, topique de la splendeur d’une société corrompue à la<br />
veille d’une catastrophe imminente, etc.). Toutes ces procédures dévoilent<br />
un véritable travail de fictionnalisation mené par Forcat et mettent à nu la<br />
fabrique d’une authentique composition narrative qui intègre une forte dose<br />
d’intertextualité. De plus, il existe une autre catégorie de signes qui<br />
tiennent aux ressorts sur lesquels se fonde l’intrigue, à sa dynamique<br />
même, aux thèmes qui parcourent le récit, aux rôles qu’y jouent les<br />
personnages. Forcat y est le falsificateur, celui qui, dans la clandestinité,<br />
fabrique les faux documents d’identité de ses camarades ; il se pourrait bien<br />
aussi qu’il soit le traître : «[…] el informe sugiere la posibilidad de una<br />
delación mía » (M, chap. 4, séq. 2, p. 82). La trahison occupe une place<br />
prépondérante dans l’histoire racontée, elle rôde dans tout le récit,<br />
longtemps impalpable, comme cette nuée « preñada por la fetidez de la<br />
traición » (M, chap. 5, séq. 1, p. 100), longtemps impossible à localiser<br />
(« El Kim intuye que algo no encaja ; que tal vez es la hora de la traición,<br />
pero ¿de quién ? » ; M, chap. 8, séq. 3, p. 176). Enfin les trahisons éclatent<br />
au grand jour : celle de Chen Jing Fang, infidèle à son époux, celle plus<br />
grave de Michel Lévy, l’ancien héros de la Résistance qui a manipulé son<br />
32 Sauf la très belle image du père mort de Daniel, enseveli sous la neige, qui survient dès le seuil du<br />
livre : « Así empieza mi historia, y me habría gustado que hubiese en ella un lugar para mi padre, tenerlo<br />
cerca para aconsejarme, para no sentirme tan indefenso ante los delirios del capitán Blay y ante mis<br />
propios sueños, pero en aquella época a mi padre ya le daban definitivamente por desaparecido, y nunca<br />
volvería a casa. Pensé otra vez en él, vi su cuerpo tirado en la zanja y los copos de nieve cayendo<br />
lentamente sobre él y cubriéndole […]. » (M, chap.1, séq.1, p.11). Cette image revient tout à la fin du<br />
roman , juste avant que Daniel ne parte faire son service militaire et qu’il n’aille voir Susana une dernière<br />
fois. Cette ultime résurgence sanctionne en fait le passage définitif de Daniel à l’âge adulte : « […] la<br />
imagen se me quedó inesperadamente desprovista de emoción, revelando su origen artificioso. » (M,<br />
chap.9, séq.4, voir tout ce passage de la p. 201.). Daniel se défait alors de cette fantasmagorie touchant la<br />
figure du Père dont il n’a plus besoin : son initiation est achevée.<br />
26
ami el Kim, afin de le pousser à commettre un meurtre pour le débarrasser<br />
d’un rival. Les tromperies et les mensonges mis à jour lors du dénouement<br />
du récit de Forcat (séq. 3, dernière séquence du chapitre 8) ne sont au vrai<br />
que l’écho assourdi, le reflet légèrement déformé, l’anticipation de la réalité<br />
diégétique telle que la dévoile el Denis. Ces similitudes sont encore<br />
exacerbées par le fait que ces révélations (séq.1, première séquence du<br />
chapitre 9) suivent immédiatement dans le texte le dénouement du récit de<br />
Forcat. Une réalité faite elle aussi de deux trahisons : la forfaiture de el Kim<br />
qui n’est jamais revenu à Toulouse avec la femme de el Denis et leur fils 33<br />
,<br />
mais qui s’est enfui avec eux, déloyal envers son ami, envers sa fille<br />
gravement malade, la félonie de Forcat qui a caché à Susana et à sa mère<br />
l’abandon de el Kim, et qui, surtout, mi par compassion, mi par intérêt, a<br />
alimenté en elles de faux espoirs quant à d’heureuses retrouvailles<br />
familiales.<br />
Après avoir démasqué Forcat, après avoir dévoilé l’échafaudage de son<br />
discours fallacieux, après avoir mis à nu les rouages grâce auxquels la triste<br />
34<br />
et sordide réalité s’est transmuée en un éblouissant récit mensonger ,<br />
Daniel recueille le legs de Forcat et, se faisant son héritier, lui rend<br />
hommage. En quoi le rôle de Daniel, apparemment illogique ou<br />
contradictoire, jette-t-il des lumières sur l’essence de la fiction ?<br />
Daniel n’a pas scellé avec ses narrataires l’un de ces pactes si usuels qui<br />
font de ceux-ci ses complices aux dépens des narrataires intradiégétiques<br />
dupés qu’ils peuvent alors considérer avec une gratifiante condescendance :<br />
ici, il n’y a pas eu ce décalage dans les informations qui favorise le<br />
récepteur de l’œuvre, en lui donnant une longueur d’avance sur les<br />
narrataires intradiégétiques, ignorants de ce qui se trame à leur insu. A<br />
l’intérieur de la fiction romanesque, fiction « légale », leurre consenti en<br />
toute connaissance de cause, le récit de Forcat a été présenté comme un<br />
discours vrai, un discours référentiel, un témoignage rapportant le réel au<br />
plus près même s’il a subi les inévitables altérations dues à l’érosion des<br />
souvenirs, s’il a été enjolivé sous la pression du rêve et du désir, s’il a été<br />
poli par des accommodements rhétoriques nécessaires à tout récit (« Si algo<br />
invento, serán pequeños detalles digamos ambientales y garabatos del<br />
33 Contrairement aux affirmations préalables de Forcat au chap. 3, séq. 4 et 6 : « La misión ha fracasado,<br />
pero el Kim cumplirá la promesa hecha al Denis de traer a su compañera y a su hijo sanos y salvos hasta<br />
Toulouse. » (M, dernière phrase du chap.3, séq.6, p. 74, ce qui lui donne un relief particulier).<br />
34 A cet égard, ce passage de la séq. 1 du chap. 9 est particulièrement révélateur : « Hoy pienso que el<br />
gran embaucador siempre supo que lo suyo con esta mujer crédula y desdichada y vulnerable [Mme<br />
Anita] duraría lo que durase la débil llama que alumbraba el sueño de Susana, el tiempo justo que la<br />
muchacha tardase en descubrir que el Nantucket no había existido nunca y que si acaso existía no podía<br />
ser otra cosa que un decrépito y carcomido buque que ahora mismo estaría pudriéndose en alguna<br />
apestosa dársena de la Barceloneta donde me gusta imaginar que él lo vio casualmente una brumosa<br />
noche de invierno mientras deambulaba por los muelles sin saber qué hacer con su vida y sus recuerdos y<br />
que fue allí mismo, sentado en un amarre del puerto frente a ese buque fantasma que emergía de la niebla,<br />
cuando empezó a urdir la trama de su pacífico asalto a la torre y la tela de araña sentimental con la que<br />
atraparía a la madre y a la hija… » (M, p. 187).<br />
27
ecuerdo […] pero nada esencial añado ni quito a su narración », dit Forcat<br />
en se référant au récit originel de el Kim, M, chap. 4, séq. 2, p. 81) et ceci,<br />
tant pour les uns que pour les autres. Daniel a cautionné jusqu’au dernier<br />
chapitre les dires de Forcat. Daniel narrateur adulte a été le complice de<br />
Forcat, il l’a couvert jusqu’au bout, attendant que la vérité éclate dans la<br />
diégèse pour que ses narrataires extradiégétiques en soient alors informés.<br />
Le narrataire extradiédétique a été insidieusement enveloppé dans la<br />
réception d’un discours vrai au sein du monde fictionnel et découvre avec<br />
stupéfaction, quelque dépit, et un véritable émerveillement qu’il a été berné<br />
lui aussi : Daniel narrateur lui a démontré de manière percutante la<br />
puissance suggestive des mots et du discours, miroirs aux alouettes qui<br />
peuvent prendre au piège les récepteurs les plus avertis, même s’il a<br />
parsemé le roman de « cailloux du Petit Poucet », ces signes discrets<br />
d’auto-dénonciation qui sont autant d’avertissements chiffrées, de clés<br />
permettant de décoder ultérieurement les discours.<br />
Si Daniel démasque finalement Forcat « el embaucador », il n’adhère pas<br />
pour autant à la « vérité vraie » que el Denis introduit dans la maison de<br />
Susana :<br />
Pero aun cuando el Denis mereciera cierta consideración por eso, por los<br />
ideales que había compartido con el Kim y por traer a la torre la verdad<br />
verdadera, desanmascarando a Forcat, denunciando su impostura, yo no<br />
podía dejar de pensar entonces que esa verdad verdadera había arrojado a<br />
Forcat a la calle […]. (M, chap.9, séq.3, p. 195 ; souligné par moi)<br />
Le pléonasme « la vérité vraie » saborde l’idée même de vérité. Elle<br />
laisse entendre que la vérité pourrait être autre chose que vraie : Daniel en<br />
dénonce les ravages puisqu’elle apparaît ici comme l’écran d’une terrible<br />
vengeance. El Denis plonge Anita dans la déchéance et prostitue la fille de<br />
l’ami qui l’avait trahi. « La vérité vraie » dans le roman n’est pas pure,<br />
mais dévastatrice car elle ne sert qu’à masquer les troubles desseins de el<br />
Denis ; elle détruit l’espoir et porte un coup mortel au récit illusoire mais<br />
bienfaisant de Forcat qui doit s’éteindre.<br />
La mise en abyme que constitue le récit de Forcat dans le roman n’est<br />
pas simple réplique réduite des mécanismes et des enjeux d’un récit: d’un<br />
côté, il y a un récit oral, de l’autre un récit écrit ; d’un côté, une<br />
mystification, de l’autre une fiction. En outre, la mise en abyme ici n’est<br />
pas inerte mais dynamique, agissante : elle se résout en collision frontale<br />
entre la miniature et son modèle amplifié, choc au cours duquel la<br />
miniature est dissoute, anéantie. Et pourtant, tout au long du roman, Daniel<br />
s’est employé à lui redonner vie, en opacifiant les relations entre fiction,<br />
réalité, vérité et mensonge, car la dichotomie réalité/ fiction n’est pas<br />
absente de El embrujo, mais elle s’emboîte dans une relation à plusieurs<br />
termes qui la nuancent : s’y intègrent le mensonge, la vérité, le désir et son<br />
28
cortège de rêves et d’illusions. Daniel dégage non pas tant les oppositions<br />
qui séparent les termes de cette relation que leurs entrecroisements<br />
inéluctables dans une sorte de contamination et d’invasion réciproques.<br />
Si Daniel le narrateur sauve les récits de Forcat de l’anéantissement,<br />
c’est sans doute parce que l’immolation finale de celui-ci 35<br />
Aux vaincus, Forcat, comme Blay, comme Daniel plus tard, il ne leur<br />
restait plus rien, rien que les mots pour refaire le réel : « Me queda la<br />
palabra », dit la voix poétique de Pido la paz y la palabra de Blas de<br />
Otero<br />
29<br />
autorise sa<br />
rédemption. S’il invalide le discours de Forcat en tant que témoignage, le<br />
narrateur sauvegarde le legs en rendant hommage à son labeur de<br />
fictionnalisation.<br />
36<br />
. La parole est une arme, une arme à double tranchant, apte à<br />
susciter des chimères, apte aussi à les dissiper. Et Daniel, dans El embrujo<br />
de Shanghai, s’il cultive la nuance, s’il condamne « la vérité vraie »,<br />
s’emploie néanmoins à distinguer avec opiniâtreté le récit de fiction d’une<br />
autre création verbale très proche, le récit mensonger. C’est bien la mise en<br />
abyme « récit de Forcat dans roman El embrujo de Shanghai» qui met en<br />
évidence le point de fracture radical qui les sépare l’un de l’autre. Le récit<br />
de Forcat apparaît comme la réplique miniaturisée d’un récit de fiction,<br />
mais une réplique profondément adultérée parce qu’elle présente une faille<br />
constitutive insurmontable dans sa facture : une insidieuse distorsion des<br />
pactes passés entre le narrateur et le narrataire.<br />
Le récit mensonger diffère profondément du récit de fiction non en ce<br />
qu’il travestit le réel (ce que la fiction fait aussi), non en ce qu’il se prétend<br />
véridique (ce que la fiction fait aussi très souvent) mais en ce que les pactes<br />
passés avec les narrataires ne sont pas les mêmes. Le récit mensonger, aussi<br />
charitable soit-il, est un leurre qui ne s’avoue pas comme tel, une feintise,<br />
une manipulation qui aveugle et asservit le narrataire, irrémédiablement<br />
dupé, floué, dépouillé de son libre arbitre. En revanche, la fiction est un<br />
simulacre, un leurre qu’une série de conventions définissent comme tel tant<br />
dans l’esprit du narrateur que dans celui du lecteur, un leurre librement<br />
consenti par le récepteur qui accepte de suspendre son incrédulité le temps<br />
de la lecture. Elle scelle une complicité entre ces deux acteurs et débouche<br />
sur la gratitude et l’admiration du récepteur qui s’interroge émerveillé sur<br />
les moyens mis en œuvre pour l’appâter, le séduire, l’envoûter. La fiction,<br />
35<br />
Forcat endosse le meurtre de el Denis afin de sauver Susana, la véritable coupable de ce meurtre, de la<br />
prison. Il existe une autre version de l’histoire, la version officielle, plus répandue, selon laquelle Forcat<br />
serait effectivement le meurtrier. Le narrateur donne sa préférence à la version selon laquelle Forcat a été<br />
le sauveur de la jeune fille : « Me gusta ese desvarío […]. Pero más que una hipótesis era un sentimiento.<br />
Porque así, rematando el cadáver para exculpar a la niña, el estrábico embustero culminaba su<br />
impostura. » (M, chap.9, séq.4, p. 200). Il est à noter toutefois que dans l’un ou l’autre cas, Forcat s’est<br />
fait le défenseur de la jeune fille, même si cette deuxième version est plus exaltante parce qu’elle repose<br />
sur un véritable sacrifice et fait à nouveau de Forcat un héros, en adéquation avec sa légende.<br />
36<br />
OTERO, Blas de, « En el principio », Pido la paz y la palabra, in Expresión y reunión, Madrid,<br />
Alianza editorial, 1981, (1955).
semble nous dire le narrateur de El embrujo, est un jeu empreint de gravité<br />
et fait de connivences partagées.<br />
Conclusion<br />
Ce roman d’éducation met en scène deux adolescents affrontant les<br />
dangers du discours. Susana en sera mortellement atteinte : elle<br />
s’immobilisera éternellement au seuil des mondes fictionnels, même si elle<br />
demeure « le passeur » invitant les autres à y pénétrer (puisqu’elle est<br />
postée au guichet du cinéma « Mundial » dans la dernière séquence du<br />
livre). Daniel, lui, saura en tirer d’autres leçons et incitera son lecteur à les<br />
partager. Le roman remet en question le pouvoir de la parole dans un<br />
monde où la parole a été confisquée par les vainqueurs dans la réalité<br />
extratextuelle de référence: le discours officiel est rituellement brûlé par le<br />
capitaine Blay et monsieur Sucre. Le livre de Daniel est une entreprise<br />
iconoclaste qui enseigne le doute, la circonspection systématique vis-à-vis<br />
de tout discours, aussi digne de foi soit-il. Dans un souci didactique, les<br />
récits de Daniel sont structurés par le mécanisme de la mystification/<br />
démystification, mécanisme qui, dans sa récurrence, contamine en sourdine<br />
le récit de Forcat, et finit par y devenir opérant. Le récit de Forcat, quant à<br />
lui, est imprégné par l’ambivalence de l’expression espagnole « cuento<br />
chino » qui préside à son élaboration, massivement parcouru par des<br />
marqueurs de fictionnalité, traversé par une mise en abyme dénonciatrice<br />
(Shanghai dans Shanghai), et sourdement travaillé par le thème de la<br />
trahison. Tous ces signes rassemblés en un faisceau convergent découvrent<br />
les artifices de l’envoûtement et se prêtent a posteriori à leur<br />
reconnaissance et à leur déchiffrement. Car la dynamique qui sous-tend le<br />
roman démontre que c’est seulement à cette condition, c’est-à-dire au prix<br />
d’une lucidité durement conquise, que le narrataire, à son tour, peut accéder<br />
au statut de créateur de fictions : ce n’est qu’après avoir percé à jour les<br />
dessous et les enjeux du discours que Daniel devient producteur de fictions<br />
réservées à son propre usage ou destinées à être divulguées. Il convient de<br />
souligner que de ce renversement de situation, de cette réversibilité des<br />
rôles qui fait d’un narrataire un narrateur en puissance, se dégage une<br />
vision prométhéenne de la parole, feu sacré dont les pouvoirs doivent faire<br />
l’objet d’une redistribution après une nécessaire initiation.<br />
Si la parole est un voile qui peut occulter le réel, elle est aussi<br />
l’instrument permettant de l’exhiber crûment et sans doute également le<br />
plus sûr moyen de le transfigurer, de le contrebalancer et de le racheter.<br />
Daniel, l’héritier des legs conjoints de Blay et de Forcat, ne renonce pas à<br />
la magie des mots, mais déclare solennellement que l’envoûtement ne peut<br />
résulter d’une servile soumission à leur pouvoir de suggestion. L’adhésion<br />
à la fiction doit être le fruit d’un choix, un choix éclairé. La fiction ne peut<br />
30
être goûtée que lorsqu’elle a été identifiée comme telle, c’est-à-dire en tant<br />
qu’artefact verbal créant l’illusion, et en tant que telle acceptée par son<br />
récepteur : c’est seulement ainsi qu’elle devient jeu, lieu de plaisir et défi<br />
lumineux au réel. Alors, ceci étant posé, la fiction est libre de déployer ses<br />
mirages et le lecteur convié à un embarquement pour « Shanghai »,<br />
devenue à jamais l’une de ces contrées dévolues au rêve et à l’illusion :<br />
« Hoy como ayer, rumbo a Shanghai », tels sont les derniers mots du<br />
roman.<br />
<strong>Elvire</strong> GOMEZ-VIDAL<br />
« Les artifices de la fiction romanesque dans El embrujo de Shanghai de Juan<br />
Marsé », Lectures d’une œuvre, El embrujo de Shanghai, Juan Marsé/Fernando<br />
Trueba, Collectif coordonné par Jean-Pierre CASTELLANI, Editions du Temps,<br />
Nantes, 2003, p. 11 à 49.<br />
31