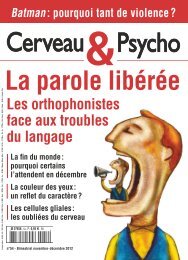compensation articulatoire dans la production des occlusives du ...
compensation articulatoire dans la production des occlusives du ...
compensation articulatoire dans la production des occlusives du ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE I-Université de Provence<br />
U.F.R. L.A.C.S<br />
Formation Doctorale : Langage et Parole<br />
Discipline : Phonétique<br />
COMPENSATION ARTICULATOIRE<br />
DANS LA PRODUCTION DES<br />
OCCLUSIVES DU FRANÇAIS<br />
Thèse de doctorat présentée par<br />
Sandrine C<strong>la</strong>iret<br />
Le 18 Novembre 2004<br />
Sous <strong>la</strong> direction <strong>du</strong> professeur<br />
Noël Nguyen.<br />
Jury composé de :<br />
Danielle Duez, Directrice de recherche CNRS, Université de Provence<br />
Yves Laprie, Chargé de recherches CNRS Université H. Poincaré, Nancy (rapporteur)<br />
Noël Nguyen, Professeur, Université de Provence<br />
Rudolph Sock, Professeur, Université Marc Bloch, Strasbourg (rapporteur)
Même le désert a <strong>des</strong> présents<br />
Pour ceux qui essayent de le traverser.<br />
Le chameau progresse à sa juste allure.<br />
Tracez votre route.<br />
Organisez votre voyage.<br />
Perdez-vous <strong>dans</strong> les tours et détours de <strong>la</strong> vie.<br />
Suivez le chemin le moins emprunté et<br />
Atteignez chaque jour votre but.<br />
S’égarer est question de point de vue.<br />
Soyez prêtes, mais voyagez avec peu de bagages.<br />
Le Tao de <strong>la</strong> Femme, Voyager, 1995.
5<br />
REMERCIEMENTS<br />
Avant tout, Merci tout particulièrement à mon Ange-gardien qui m’a tant donné de sa<br />
force, de sa personne, de sa patience. Merci, Ange, de continuer à me convaincre avec ton<br />
optimisme que le monde est ‘bo’ et que tout est si simple !<br />
Merci ma métou et mon pétou pour leur ENORMESQUE soutien,<br />
MERCI, MERCI, MERCI et encore bien plus que ça, une phrase ne pourrait suffire…<br />
Merci à mon papa de m’avoir fait confiance <strong>dans</strong> tous mes choix de vie, de loin et de<br />
près…pour son soutien, pour sa patience, et à sa Clo aussi…<br />
Merci à ma Steph qui a toujours su m’écouter et me rassurer, me conseiller sagement<br />
depuis tout ce temps…et qui m’a donné deux beaux petits fruits frais…<br />
Merci ma KK-dorée pour avoir été plus que présente et plus que constante, tout<br />
simplement, merci de <strong>la</strong> confiance que tu as mise en moi et Merci mon Faïli-Faïli pour tes<br />
aisselles, tes rigolos gadgets et compagnie hihihi…<br />
Merci à mon Heckell qui m’a souvent aidée à ramer pour faire avancer ma barque, à écoper<br />
pour éviter plus d’un naufrage…plus d’une fois…pour tout ce que nous avons franchement<br />
partagé <strong>du</strong>rant ces loooongues années d’entraide et d’encouragements.<br />
Merci ma Miweille pour avoir toujours été là <strong>du</strong>rant tout ce temps, avec son sourire et ses<br />
encouragements.<br />
Merci à <strong>la</strong> Fabulous Fig’ Team pour toutes les rigo<strong>la</strong><strong>des</strong>, tapena<strong>des</strong> et figo<strong>la</strong><strong>des</strong> en tout<br />
genre et pour avoir été sacrément patients…<br />
Merci à toutes les Cocottes pour les «apéros-re-faisons-un-monde-meilleur-d’amour-et-de-<br />
partage, pour leur énorme soutien.
Merci à tous les amis l’autre coté de l’océan, Elsa, Lour<strong>des</strong>, Manuel, Nina, Berenice, Hubert<br />
pour qui j’ai fidèlement œuvré avec grand grand p<strong>la</strong>isir, merci de m’avoir franchement fait<br />
6<br />
confiance.<br />
Merci à Elsa pour m’avoir montré <strong>la</strong> face cachée <strong>des</strong> difficultés de façon simple et sage,<br />
avec toujours un ENORME sourire.<br />
Merci à mon super-PIT pour avoir toujours trouvé un peu de son temps, pour prodiguer ses<br />
précieux, aimables et judicieux conseils…<br />
Merci mon super-Yoh pour m’avoir aussi longtemps écoutée, rassurée, supportée et pour les<br />
conversations articulesques, epgiques et jenpasse et surtout pour les nombreuses et<br />
nombreuses corrections…<br />
Merci mon Super-Cyril pour avoir volé à mon secours, très souvent et très<br />
sûrement…toujours prêt !!! Il y aura toujours une bonne soupe …<br />
Merci super-Robert pour les nombreux coups de pouces…<br />
Merci Christine et Merci Christian pour les bons conseils et les encouragements<br />
Merci Ben et Yo d’avoir accepter de baver à outrance sous <strong>la</strong> menace <strong>des</strong> pa<strong>la</strong>is, mèches et<br />
bite-blocks en tout genres…<br />
Merci Will pour le portable, ouffff…<br />
Merci à mes amis <strong>du</strong> <strong>la</strong>bo qui se reconnaîtront (surtout ma voisine !!!) et avec qui j’ai<br />
volontiers taillé un bout de chemin <strong>du</strong>rant ces années…<br />
Merci à Bernard Teston pour m’avoir permis de squater son bureau pour brico<strong>la</strong>ges et bite-<br />
blocages.<br />
Merci à Jacqueline et Louis pour leur constante gentillesse.
Merci à M. El Ahmadi pour avoir gentiment accepté de partager son expérience en<br />
7<br />
statistiques.<br />
Merci M. Di Cristo de m’avoir donné le virus de <strong>la</strong> phonétique, depuis <strong>la</strong> licence, qui m’a<br />
embarquée jusqu’ici<br />
Merci à Rudolph Sock et Pascal Perrier pour les nombreuses recommandations et les<br />
discussions constructives …<br />
Merci à Didier Demolin pour m’avoir assistée <strong>dans</strong> le choix de ce sujet…<br />
Merci surtout aux membres <strong>du</strong> jury d’avoir accepté de critiquer et de juger ce travail et<br />
d’avoir été présents.<br />
Merci M. Nguyen d’avoir accepté de diriger ce travail.
TABLE DES MATIERES<br />
TABLE DES MATIERES.............................................................................................. 9<br />
INTRODUCTION ........................................................................................................ 17<br />
PREMIERE PARTIE................................................................................................... 21<br />
ASPECTS THÉORIQUES : CONTRÔLE MOTEUR ET PROCESSUS DE<br />
COMPENSATION DANS LA PAROLE ................................................................... 21<br />
CHAPITRE 1 ................................................................................................................ 21<br />
LA PRODUCTION DE LA PAROLE........................................................................ 21<br />
1.1 DES REPRÉSENTATIONS MENTALES AUX SONS ....................................................... 22<br />
1.1.1 Quelques rappels sur <strong>la</strong> neurophysiologie de <strong>la</strong> parole................................ 22<br />
1.1.2 P<strong>la</strong>nification : <strong>des</strong> représentations phonétiques aux ordres ......................... 22<br />
1.1.3 Exécution : <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s au signal de sortie..................... 23<br />
1.2 LES THÉORIES DE PRODUCTION DE LA PAROLE....................................................... 25<br />
1.2.1 Les théories orientées sortie acoustique........................................................ 25<br />
1.2.2 Les théories orientées système....................................................................... 30<br />
1.2.3 Le modèle Hypo-articu<strong>la</strong>tion Hyper-articu<strong>la</strong>tion de Lindblom..................... 34<br />
1.3 CONCLUSION ......................................................................................................... 37<br />
CHAPITRE 2 ................................................................................................................ 41<br />
COMPENSATIONS ET STRUCTURES COORDINATIVES................................ 41<br />
2.1 PRÉSENTATION DE LA NOTION DE COMPENSATION................................................. 41<br />
2.1.1 Définition générale : perturbation et <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> ................ 41<br />
2.1.2 Définition neurophysiologique ...................................................................... 43<br />
2.2 LES INFORMATIONS SENSORIELLES ........................................................................ 45<br />
2.2.1 Modèle à boucle ouverte................................................................................ 45<br />
2.2.2 Modèle à boucle fermée................................................................................. 45<br />
2.2.3 Les différents feedbacks................................................................................. 46<br />
2.3 MODÈLE DE SIMULATION PRÉDICTIVE DE LINDBLOM............................................. 48<br />
2.3.1 Rôle <strong>des</strong> Modèles internes ............................................................................. 49<br />
9
2.3.2 Les avantages de cette conception <strong>des</strong> modèles internes...............................51<br />
2.4 STRUCTURES COORDINATIVES ET ÉQUIVALENCES FONCTIONNELLES......................52<br />
2.4.1 Structures coordinatives.................................................................................52<br />
2.4.2 Equivalences fonctionnelles ...........................................................................54<br />
CHAPITRE 3.................................................................................................................59<br />
COMPENSATIONS ET COMPLEXE MÂCHOIRE/LANGUE.............................59<br />
3.1 LES COMPENSATIONS DANS LES ÉTUDES ANTÉRIEURES ..........................................59<br />
3.1.1 Les étu<strong>des</strong> avec perturbation dynamique .......................................................60<br />
3.1.2 Les étu<strong>des</strong> avec perturbation statique : les bite-blocks..................................62<br />
3.1.3 Propriétés <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s........................................................................70<br />
3.2 LE COMPLEXE LANGUE / MÂCHOIRE .......................................................................71<br />
3.2.1 La <strong>la</strong>ngue et ses mouvements .........................................................................71<br />
3.2.2 Le rôle phonétique de <strong>la</strong> mâchoire.................................................................73<br />
3.3 CONCLUSION SUR LES COMPENSATIONS INTER-ARTICULATOIRES...........................78<br />
DEUXIEME PARTIE...................................................................................................81<br />
PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODE EXPÉRIMENTALE ....................................81<br />
CHAPITRE 4.................................................................................................................81<br />
PROBLÉMATIQUE.....................................................................................................81<br />
4.1 LES CONSONNES OBSERVÉES : LES OCCLUSIVES LINGUALES /T/ ET /D/. ..................82<br />
4.1.1 La formation d’une occlusive linguale...........................................................82<br />
4.1.2 Occlusive linguale et segments adjacents ......................................................84<br />
4.2 LES QUESTIONS SUR LES MOUVEMENTS LINGUAUX ................................................85<br />
4.2.1 Le timing inter-gestuel ...................................................................................85<br />
4.2.2 Le timing intra-gestuel ...................................................................................85<br />
4.2.3 Les dép<strong>la</strong>cements linguaux.............................................................................86<br />
4.3 A PROPOS DES CONTRAINTES DE PRODUCTION .......................................................86<br />
CHAPITRE 5.................................................................................................................89<br />
MÉTHODE EXPÉRIMENTALE................................................................................89<br />
5.1 INTRODUCTION.......................................................................................................89<br />
5.2 DESCRIPTION DU CORPUS .......................................................................................89<br />
10
5.2.1 Cadre expérimental........................................................................................ 89<br />
5.2.2 Le corpus........................................................................................................ 90<br />
5.2.3 La réalisation <strong>des</strong> bite-blocks........................................................................ 94<br />
5.3 L’ÉLECTROPALATOGRAPHIE .................................................................................. 97<br />
5.3.1 Les plus et les moins de l’EPG ...................................................................... 99<br />
5.3.2 Les caractéristiques <strong>des</strong> consonnes linguales ............................................. 101<br />
5.3.3 Le traitement <strong>des</strong> données............................................................................ 103<br />
5.4 LES MESURES ÉLECTROPALATOGRAPHIQUES ....................................................... 107<br />
5.4.1 Les paramètres spatiaux. ............................................................................. 108<br />
5.4.2 Les paramètres temporels............................................................................ 110<br />
5.4.3 Les paramètres spatio-temporels................................................................. 111<br />
5.5 LA MÉTHODE STATISTIQUE D’ANALYSE DES VARIATIONS .................................... 112<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX ............................... 115<br />
CHAPITRE 6 : LES RÉSULTATS SPATIAUX ..................................................... 115<br />
6.1 ASPECTS QUANTITATIFS DE LA RÉPARTITION DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX 116<br />
6.1.1 Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux (LP) sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is ........................ 116<br />
6.1.2 Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire.............................. 119<br />
6.1.3 Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région vé<strong>la</strong>ire................................... 122<br />
6.1.4 Sur les variations d’amplitude <strong>des</strong> contacts LP........................................... 124<br />
6.2 L’ASPECT QUALITATIFS DE LA RÉPARTITION DES CONTACTS : LES PATRONS DE<br />
CONTACTS.................................................................................................................. 126<br />
6.2.1 Les patrons de contacts <strong>du</strong> locuteur BL....................................................... 127<br />
6.2.2 Les patrons de contacts <strong>du</strong> locuteur YM...................................................... 131<br />
6.3 RÉSUMÉ SUR LES RÉSULTATS SPATIAUX .............................................................. 135<br />
CHAPITRE 7 : LES RÉSULTATS TEMPORELS................................................. 139<br />
7.1 LE CONTRÔLE DES DURÉES................................................................................... 139<br />
7.2 DURÉE TOTALE DES CONSONNES.......................................................................... 142<br />
7.2.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> consonnes ..................... 142<br />
7.2.2 Durées <strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur BL......................................................... 143<br />
7.2.3 Durées <strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur YM........................................................ 145<br />
7.3 DURÉE DES FERMETURES LINGUO-PALATALES (LP)............................................. 146<br />
11
7.3.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> geste de fermeture linguopa<strong>la</strong>tale..................................................................................................................146<br />
7.3.2 Durées <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales (LP) <strong>du</strong> locuteur BL .....................147<br />
7.3.3 Durées <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales (LP) <strong>du</strong> locuteur YM ....................149<br />
7 4. DURÉE DES TENUES .............................................................................................151<br />
7.4.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue...........................151<br />
7.4.2 Durées <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur BL................................................................152<br />
7.4.3 Durées <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur YM...............................................................154<br />
7.5. DURÉE DES MAXIMA............................................................................................156<br />
7.5.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum de contacts.....156<br />
7.5.2 Durées <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur BL .............................................................157<br />
7.5.3 Durées <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur YM ............................................................159<br />
7. 6 DURÉE DES OCCLUSIONS .....................................................................................161<br />
7.6.1 Durée de l’occlusion <strong>du</strong> locuteur BL ...........................................................161<br />
7.6.2 Durée de l’occlusion <strong>du</strong> locuteur YM ..........................................................163<br />
7.7 DURÉE DE L’OUVERTURE LINGUO-PALATALE (LP)...............................................165<br />
7.7.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale<br />
...............................................................................................................................165<br />
7.6.2 Durée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP) <strong>du</strong> locuteur BL .........................166<br />
7.6.3 Durée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP) <strong>du</strong> locuteur YM ........................168<br />
7.7 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TEMPORELS...................................................................170<br />
7.7.1 Les résultats temporels <strong>du</strong> locuteur BL........................................................170<br />
7.7.2 Les résultats temporels <strong>du</strong> locuteur YM.......................................................171<br />
QUATRIEME PARTIE..............................................................................................175<br />
INTERPRETATION ET DISCUSSION...................................................................175<br />
CHAPITRE 8...............................................................................................................175<br />
LES RÉSULTATS SPATIO-TEMPORELS ............................................................175<br />
8.1 L’AMPLITUDE DES MOUVEMENTS ARTICULATOIRES .............................................176<br />
8.1.1 La pente de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP).................................................176<br />
8.1.2 La pente d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP) ..................................................179<br />
8.2 LES VITESSES D’ÉLABORATION DES PENTES .........................................................182<br />
8.2.1 La vitesse de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale.......................................................182<br />
12
8.2.2 La vitesse d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP)................................................ 183<br />
8. 3 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS SPATIAUX ET TEMPORELS ............................................ 185<br />
8.3.1 Le locuteur BL ............................................................................................. 185<br />
8.3.2 Le locuteur YM............................................................................................. 187<br />
CHAPITRE 9 : DISCUSSION................................................................................... 191<br />
9.1 LES VARIATIONS INTER-INDIVIDUELLES............................................................... 191<br />
9.1.1 Stratégie de <strong>compensation</strong> <strong>du</strong> locuteur BL.................................................. 193<br />
9.1.2. Stratégie de <strong>compensation</strong> <strong>du</strong> locuteur YM ................................................ 193<br />
9.1.3 Re<strong>la</strong>tions entre morphologie et articu<strong>la</strong>tion................................................ 194<br />
9.1.4 Re<strong>la</strong>tions avec une perturbation dite ‘naturelle’......................................... 195<br />
9.2 PHÉNOMÈNE D’APICALISATION............................................................................ 196<br />
9.3 HIÉRARCHIE DE LA COMPENSATION ..................................................................... 200<br />
9.3.1 En fonction de <strong>la</strong> pertinence <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s........................ 200<br />
9.3.2 En fonction <strong>du</strong> poids <strong>des</strong> contraintes........................................................... 202<br />
9.3.3 Une hiérarchie <strong>dans</strong> le contrôle moteur...................................................... 205<br />
9.4 ADAPTATION IMMÉDIATE OU APPRENTISSAGE : RÔLE DES FEEDBACKS................ 206<br />
CONCLUSION ........................................................................................................... 211<br />
BIBLIOGRAPHIE...................................................................................................... 217<br />
TABLE DES ILLUSTRATIONS .............................................................................. 229<br />
ANNEXES ................................................................................................................... 237<br />
ANNEXE 1 : TABLEAU DE RECENSEMENT DE QUELQUES ÉTUDES<br />
UTILISANT DES PERTURBATIONS EXPÉRIMENTALES.............................. 238<br />
ANNEXE 2 : LES DURÉES MOYENNES DE LA PHRASE PORTEUSE, DE LA<br />
VOYELLE ET DE LA CONSONNE C1 DANS LES QUATRE CONDITIONS<br />
D’ENREGISTREMENT............................................................................................ 243<br />
YM................................................................................................................................ 243<br />
ANNEXE 3 : TABLEAUX DES DURÉES MOYENNES DE CHAQUE PHASE DE<br />
LA CONSONNE. ........................................................................................................ 244<br />
♦Durées consonnes BL puis YM. ......................................................................... 244<br />
♦Durée fermeture de BL ...................................................................................... 245<br />
13
♦Durée fermeture de YM......................................................................................245<br />
♦Durée tenue BL...................................................................................................246<br />
♦Durée tenue YM..................................................................................................246<br />
♦Durée maximum de contacts BL........................................................................247<br />
♦Durée maximum de contacts YM........................................................................247<br />
♦Durée occlusion BL............................................................................................248<br />
♦Durée occlusion YM...........................................................................................248<br />
♦Durée ouverture BL............................................................................................249<br />
♦Durée ouverture YM...........................................................................................249<br />
ANNEXE 4 : LES MOYENNES DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX .......250<br />
♦Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de BL...................................................................250<br />
♦Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de YM :................................................................251<br />
ANNEXE 5 : LES MOYENNES DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX À<br />
CHAQUE SESSION D’ENREGISTREMENT........................................................252<br />
ANNEXE 6 : LES PATRONS DE COARTICULATION DANS LES QUATRE<br />
CONDITIONS D’ENREGISTREMENT..................................................................255<br />
Locuteur BL...........................................................................................................255<br />
Locuteur YM..........................................................................................................256<br />
ANNEXE 7 :LES MESURES DES PALAIS DES LOCUTEURS..........................258<br />
ANNEXE 8 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /D/ SANS<br />
BITE-BLOCK, LOCUTEUR BL...............................................................................261<br />
Séquence /dad/.......................................................................................................261<br />
ANNEXE 9 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /D/ AVEC<br />
LE B3, LOCUTEUR BL.............................................................................................262<br />
Séquence /dad/.......................................................................................................262<br />
ANNEXE 10 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /D/ SANS<br />
BITE-BLOCK, LOCUTEUR YM .............................................................................263<br />
Séquence /dad/.......................................................................................................263<br />
14
ANNEXE 11 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /D/ AVEC<br />
LE B3, LOCUTEUR YM ........................................................................................... 264<br />
Séquence /dad/ ...................................................................................................... 264<br />
ANNEXE 12 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /T/ SANS<br />
BITE-BLOCK, LOCUTEUR BL. ............................................................................. 265<br />
Séquence /tat/........................................................................................................ 265<br />
ANNEXE13 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /T/ AVEC<br />
B3, LOCUTEUR BL................................................................................................... 266<br />
Séquence /tat/........................................................................................................ 266<br />
ANNEXE 14 : COURBE DE CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /T/ SANS<br />
BITE-BLOCK, LOCUTEUR YM............................................................................. 267<br />
Séquence /tat/........................................................................................................ 267<br />
ANNEXE 15 : COURBE DES CONTACTS LINGUO-PALATAUX DE /T/ AVEC<br />
LE B3, LOCUTEUR YM. .......................................................................................... 268<br />
Séquence /tat/........................................................................................................ 268<br />
15
INTRODUCTION<br />
17<br />
INTRODUCTION<br />
La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole est considérée comme un acte à <strong>la</strong> fois cognitif et social. Par<br />
cognitif nous entendons que toute <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> phonétique est liée à l’activité motrice <strong>des</strong><br />
organes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, activité régie par les processus mentaux. Acte social car il est<br />
reconnu que <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole répond aux exigences communicatives <strong>du</strong><br />
locuteur qui choisit les énoncés qui répondent le mieux à ses intentions. L’approche de<br />
ce travail présenté ici est fondée sur l’idée que <strong>la</strong> parole en tant que phénomène<br />
biologique répond fermement à une organisation adaptative. Son intelligibilité dépend,<br />
en partie <strong>du</strong> contenu et de <strong>la</strong> qualité <strong>du</strong> signal et, en partie <strong>des</strong> connaissances<br />
linguistiques et situationnelles présentes <strong>dans</strong> le cerveau de l’auditeur comme <strong>du</strong><br />
locuteur.<br />
Les travaux re<strong>la</strong>tifs au contrôle de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole montrent que cette faculté<br />
d’adaptation aboutit à une certaine variabilité <strong>dans</strong> l’expression linguistique d’un<br />
énoncé. Cette variabilité est <strong>du</strong>e à <strong>la</strong> fois aux nombreuses contraintes<br />
physiques/mécaniques <strong>du</strong> système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> et bien sûr à l’objectif énonciatif <strong>du</strong><br />
locuteur. Afin d'éc<strong>la</strong>irer les connaissances à propos de cette variabilité de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, il<br />
existe notamment un paradigme fort intéressant basé sur les phénomènes de<br />
<strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Pour illustrer cette notion de <strong>compensation</strong>, nous pouvons<br />
citer l’exemple bien connu <strong>des</strong> fumeurs de pipe pour lesquels une élocution correcte et<br />
intelligible reste possible même avec une pipe coincée entre les dents. Certains travaux<br />
portant sur ces phénomènes de <strong>compensation</strong> montrent que le système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> est<br />
intrinsèquement organisé pour permettre à un groupe d’articu<strong>la</strong>teurs d’effectuer une<br />
action même si un articu<strong>la</strong>teur est indisponible.<br />
L’objectif de cette étude est d’observer et de quantifier ces phénomènes de<br />
<strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. A plus <strong>la</strong>rge échéance, nous espérons confirmer qu’une<br />
même stratégie d’encodage peut commander plusieurs réponses <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s pour<br />
atteindre un unique but communicationnel. D’autre part nous tenterons de valider<br />
l’hypothèse que le contrôle <strong>du</strong> système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole peut varier selon le<br />
niveau de traitement : un contrôle orienté sortie existe au niveau sous jacent<br />
(préparation conceptuelle <strong>du</strong> traitement de l’information) puisque le but <strong>du</strong> locuteur est<br />
effectivement de se faire comprendre. Un contrôle orienté système existe au niveau
iomécanique, le but <strong>du</strong> locuteur étant de réaliser les constrictions conformes à ce qu’il<br />
cherche à pro<strong>du</strong>ire <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal en dép<strong>la</strong>çant ses articu<strong>la</strong>teurs. Grâce à <strong>la</strong> mise<br />
en p<strong>la</strong>ce de stratégies de <strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, <strong>la</strong> variabilité <strong>des</strong> signaux de<br />
parole pourrait être mieux expliquée et mieux comprise, aussi bien en parole normale<br />
qu’en parole perturbée, voire en parole pathologique.<br />
Concernant ces aspects, peu d’étu<strong>des</strong> portent sur le français, et sur les consonnes,<br />
segments qui requièrent un agencement complexe <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs supra-glottiques et<br />
<strong>du</strong> <strong>la</strong>rynx. Pour notre part, nous avons choisi d'étudier les mouvements compensatoires<br />
qu’effectue <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue lorsque <strong>la</strong> mâchoire est fixée par <strong>des</strong> « bite-blocks » (cales interdentales).<br />
Nous comparons les mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue en parole normale et en parole<br />
intentionnellement perturbée. Nous nous sommes penchée plus particulièrement sur <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes <strong>occlusives</strong> /t /et /d/ <strong>du</strong> français en position initiale d’une<br />
séquence CVC, intégrée <strong>dans</strong> une phrase porteuse. Nous exploitons <strong>la</strong> dimension<br />
spatiale (amplitude <strong>des</strong> mouvements) et <strong>la</strong> dimension temporelle (timing <strong>des</strong><br />
mouvements) <strong>des</strong> mouvements linguaux au moyen de <strong>la</strong> méthode d’analyse qu’est<br />
l’électropa<strong>la</strong>tographie.<br />
Notre thèse est composée de quatre parties sous-divisées en neuf chapitres.<br />
La première partie présente les aspects théoriques re<strong>la</strong>tifs à notre étude. Dans le chapitre<br />
1, nous proposons une présentation générale <strong>des</strong> théories de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole.<br />
Dans le chapitre 2, nous présentons les différentes conceptions qui s’articulent autour<br />
<strong>des</strong> phénomènes de <strong>compensation</strong>s. Dans le chapitre 3, nous proposons un recensement<br />
<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> ayant mis à jour <strong>des</strong> phénomènes de <strong>compensation</strong>. Nous insistons notament<br />
sur les étu<strong>des</strong> soulignant le lien fonctionnel entre <strong>la</strong> mâchoire et <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
La deuxième partie présente <strong>la</strong> problématique et les choix expérimentaux. Dans le<br />
chapitre 4, nous exposons <strong>la</strong> problématique qui synthétise les questions posées par les<br />
parties précédentes et présente nos hypothèses de travail. Nous justifions notre choix<br />
<strong>des</strong> <strong>occlusives</strong> linguales comme terrain d’investigation. Le chapitre 5 est consacré à <strong>la</strong><br />
méthode expérimentale choisie pour rechercher <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s <strong>dans</strong><br />
les mouvements linguaux, le corpus, le protocole expérimental et <strong>la</strong> méthode d’analyse<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> qu’est l’électropa<strong>la</strong>tographie.<br />
La troisième partie se consacre à <strong>la</strong> présentation <strong>des</strong> résultats expérimentaux. Le<br />
chapitre 6 aborde les aspects spatiaux de <strong>la</strong> variation <strong>des</strong> mouvements linguaux en<br />
parole normale et perturbée. Les aspects temporels de cette variation sont traités <strong>dans</strong> le<br />
chapitre 7.<br />
18
19<br />
INTRODUCTION<br />
La quatrième partie est consacrée à l’interprétation générale de nos résultats. Le chapitre<br />
8 présente les aspects spatio-temporels. Il met en re<strong>la</strong>tion les deux niveaux d’analyse<br />
cités ci-<strong>des</strong>sus et propose un bi<strong>la</strong>n interprétatif <strong>des</strong> résultats. Le chapitre 9 propose une<br />
discussion plus é<strong>la</strong>rgie de nos interprétations.
PREMIERE PARTIE<br />
21<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
Aspects théoriques : contrôle moteur et processus de<br />
<strong>compensation</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole<br />
______________________________________________________________________<br />
CHAPITRE 1<br />
La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
Oha<strong>la</strong> (1983) définit le mécanisme de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole comme un mécanisme qui<br />
convertit l’énergie muscu<strong>la</strong>ire en énergie acoustique. Effectivement, <strong>la</strong> parole rassemble<br />
contenu linguistique et signal acoustique, le tout, engendré et contrôlé par un système<br />
biomécanique contrôlé par le Système Nerveux Central.<br />
Représentation<br />
mentale<br />
Activation<br />
muscle<br />
Position<br />
articu<strong>la</strong>teur<br />
Forme<br />
con<strong>du</strong>it<br />
vocal<br />
Signal<br />
acoustique<br />
Figure n°1.1 : Schéma simplifié de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole : de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification aux mouvements.<br />
Si l’on shématise, <strong>la</strong> première étape de préparation conceptuelle implique <strong>la</strong> préparation<br />
d’une intention de communication. A un niveau sous jacent, existent <strong>des</strong> représentations<br />
mentales phonétiques stockées <strong>dans</strong> le cerveau. Ces représentations requièrent<br />
l’existence de cibles <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, acoustiques et perceptives. Une commande motrice<br />
issue <strong>du</strong> système nerveux central, est transmise par voie nerveuse efférente vers les<br />
muscles <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs. L’activation <strong>des</strong> muscles modifie l’état initial <strong>des</strong><br />
articu<strong>la</strong>teurs en fonction de l’ordre établi. Les mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs entraînent<br />
<strong>des</strong> modifications de forme <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal. Ainsi, les transformations <strong>des</strong> cavités de<br />
résonance tout le long <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal se tra<strong>du</strong>iront par <strong>des</strong> changements <strong>du</strong> signal
acoustique exprimés par <strong>des</strong> variations <strong>des</strong> valeurs <strong>des</strong> formants. On obtient alors le<br />
signal de parole en sortie. Un retour de l’information auditive est alors pro<strong>du</strong>it vers le<br />
système nerveux central par voie afférente grâce au feedback externe. Il peut y avoir<br />
alors correction et genèse d’une nouvelle commande <strong>du</strong> système nerveux central si le<br />
but de départ n’est pas réalisé.<br />
1.1 Des représentations mentales aux sons<br />
1.1.1 Quelques rappels sur <strong>la</strong> neurophysiologie de <strong>la</strong> parole<br />
Les impulsions nerveuses venant <strong>du</strong> cerveau sont omniprésentes <strong>dans</strong> notre corps. Le<br />
système nerveux peut être divisé en deux grands axes. Le système nerveux central qui<br />
comprend le cerveau et <strong>la</strong> colonne vertébrale. Le système nerveux périphérique<br />
constitué de nerfs crâniens, qui émergent <strong>du</strong> cerveau pour ravitailler <strong>la</strong> région de <strong>la</strong> tête<br />
et de nerfs spinaux, partant de <strong>la</strong> colonne pour alimenter le reste <strong>du</strong> corps. Les neurones<br />
apportent les influx <strong>du</strong> système nerveux central vers les organes périphériques par les<br />
nerfs efférents. D’autres neurones sont dits afférents, ils apportent les informations sur<br />
l’état <strong>des</strong> organes périphériques vers le système nerveux central par voie sensorielle.<br />
1.1.2 P<strong>la</strong>nification : <strong>des</strong> représentations phonétiques aux ordres<br />
La parole est générée en deux étapes essentielles, p<strong>la</strong>nification et exécution, comme<br />
d’ailleurs l’ensemble <strong>des</strong> actions contrôlées que nous effectuons. Les processus<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ont lieu <strong>du</strong>rant l’étape d’exécution. Rappelons rapidement <strong>la</strong> phase de<br />
p<strong>la</strong>nification pré-motrice. Quand on parle, on ajuste constamment les paramètres<br />
caractéristiques de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> (<strong>du</strong>rées <strong>des</strong> segments, pauses, schémas intonatifs,<br />
rapidité d’élocution, force d’articu<strong>la</strong>tion), en fonction de l’auditoire (Lindblom 1996).<br />
La connaissance partagée permet un nombre de variations <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong><br />
phrases. Ces variations se font en fonction de <strong>la</strong> connaissance implicite que l’on a de <strong>la</strong><br />
situation d’énonciation et aussi en fonction <strong>des</strong> facultés de l’auditeur. En l’état actuel<br />
<strong>des</strong> recherches sur les processus de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, il est présumé que <strong>la</strong> programmation a<br />
pour objet de spécifier <strong>des</strong> séquences de segments phonétiques discrets, par exemple <strong>des</strong><br />
cibles, qui incluent les informations sur le rég<strong>la</strong>ge temporel (timing). Les séquences de<br />
22
23<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
cibles intro<strong>du</strong>isent les modifications <strong>des</strong> caractéristiques acoustiques et <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
<strong>des</strong> formes canoniques stockées <strong>dans</strong> le cerveau (Perkell 1995). Les processus<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont <strong>des</strong> actes moteurs qui convertissent les séquences discrètes de cibles<br />
en mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. La résultante acoustique, le son, est le pro<strong>du</strong>it de ces<br />
conversions. Ainsi, ces cibles discrètes peuvent être caractérisées en terme de<br />
mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs et de paramètres acoustiques. Nous pouvons considérer<br />
que <strong>la</strong> sortie de <strong>la</strong> phase de programmation est en même temps l’entrée de <strong>la</strong> phase<br />
d’exécution.<br />
1.1.3 Exécution : <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s au signal de sortie<br />
Nous savons que l’exécution d’un énoncé oral implique l’utilisation coordonnée d’une<br />
centaine de muscles permettant ainsi <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de quinze sons à <strong>la</strong> seconde. La<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole est un processus moteur complexe, régi par une orchestration<br />
temporelle <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs, organisés <strong>dans</strong> le temps et aussi <strong>dans</strong> l’espace, pour<br />
contribuer à l’émergence <strong>des</strong> sons spécifiques d’une <strong>la</strong>ngue. En termes fonctionnels, le<br />
processusde pro<strong>du</strong>ciotn de parole consiste en l’utilisation <strong>des</strong> systèmes respiratoire et<br />
<strong>la</strong>ryngé. Ces deux systèmes opèrent ensemble pour <strong>la</strong> génération <strong>des</strong> sons de <strong>la</strong> parole.<br />
L’air expiré <strong>des</strong> poumons est converti en vibrations audibles grâce aux différents<br />
organes à l’intérieur <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal. La source de vibration <strong>la</strong> plus importante est <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> région inférieure <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal, le <strong>la</strong>rynx, là ou sont logées les cor<strong>des</strong> vocales dont<br />
les mouvements d’ouverture et de fermeture dépendent <strong>des</strong> vibrations d’air. Une fois<br />
que le flux d’air est passé à travers le <strong>la</strong>rynx, il entre <strong>dans</strong> les cavités supra glottiques où<br />
il est affecté par l’action de plusieurs articu<strong>la</strong>teurs mobiles comme <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, le pa<strong>la</strong>is<br />
mou, les lèvres et <strong>la</strong> mâchoire.<br />
La parole en tant qu’activité motrice volontaire est régie par un système très complexe<br />
qui se doit de tenir compte d’une multitude de contraintes. Nous proposons un résumé<br />
de ces contraintes d’après Zerling (1993b) c<strong>la</strong>ssées par niveau d’apparition <strong>dans</strong> le<br />
processus de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>.<br />
Les contraintes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s pèsent globalement sur l’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> sons, c’est à dire<br />
sur <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong> cibles, et peuvent voir plusieurs origines :<br />
-phonologiques et linguistiques quand elles sont imposées par le système phonologique<br />
à travers les phénomènes et leurs traits distinctifs. Elles sont propres à chaque <strong>la</strong>ngue.
-physiologiques et bio-mécaniques quand elles proviennent <strong>des</strong> limites <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s <strong>du</strong><br />
con<strong>du</strong>it vocal, les limites de dép<strong>la</strong>cement <strong>des</strong> organes phonatoires.<br />
-acoustico-perceptives <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où les sons émis ne présentent un intérêt que s’ils<br />
peuvent être enten<strong>du</strong>s et perçus comme distincts les uns <strong>des</strong> autres par notre appareil<br />
auditif.<br />
Les contraintes co<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ou combinatoires découlent nécessairement de<br />
l’enchaînement <strong>des</strong> sons sur le p<strong>la</strong>n temporel. Ceux-ci ne sont pas réalisés de <strong>la</strong> même<br />
manière que s’ils étaient articulés indivi<strong>du</strong>ellement : ils sont soumis à l’influence <strong>des</strong><br />
sons voisins et leur réalisation va différer en fonction <strong>du</strong> contexte phonétique.<br />
Les contraintes prosodiques agissent aussi sur le p<strong>la</strong>n temporel. Les phénomènes<br />
d’accentuation et d’intonation vont imposer <strong>des</strong> contraintes dépendant en partie de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue parlée. Les contraintes prosodiques s’appliquent à <strong>la</strong> fois sur l’ensemble de <strong>la</strong><br />
chaîne parlée mais aussi indivi<strong>du</strong>ellement à chaque maillon.<br />
Les contraintes situationnelles sont liées à <strong>la</strong> fois aux dispositions <strong>du</strong> locuteur, à son<br />
environnement, au milieu, à <strong>la</strong> situation globale, à <strong>la</strong> présence interactive d’un interlocuteur.<br />
Zerling (Zerling1993b) les qualifie de « contraintes libres » <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où<br />
elles peuvent être contrôlées et modifiées par le locuteur.<br />
Les contraintes stratégiques découlent de <strong>la</strong> « base <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> » ( Zerling 1991) de<br />
chacun. Elles sont qualifiées de stratégiques <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où elles découlent <strong>des</strong> lois,<br />
<strong>des</strong> habitu<strong>des</strong> et <strong>des</strong> tendances <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s propres à <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue mais surtout propres à<br />
chaque indivi<strong>du</strong>. Ces contraintes sont néanmoins essentielles puisque responsables <strong>du</strong><br />
rég<strong>la</strong>ge affiné de l’émission <strong>des</strong> sons.<br />
Nous concluons que <strong>des</strong> influences de toutes sortes agissent sous formes de contraintes<br />
à tous les niveaux de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Cet état donne un aperçu <strong>des</strong> difficultés<br />
rencontrées par les phonéticiens pour mettre en œuvre <strong>des</strong> modèles visant à fournir une<br />
re<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> complète <strong>des</strong> caractéristiques <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et acoustiques de <strong>la</strong> parole. En<br />
réponse à ces nombreuses contraintes le système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> fait preuve d’une <strong>la</strong>rge<br />
variabilité <strong>dans</strong> ses réalisations. Cette variabilité est l’objet de nombreuses questions à<br />
propos <strong>du</strong> contrôle <strong>des</strong> mouvements de <strong>la</strong> parole. La dialectique de l’invariant et de <strong>la</strong><br />
variabilité a débouché sur de nombreux courants théoriques. Quand les contraintes<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et acoustiques le permettent, <strong>la</strong> cible est atteinte. Quand les contraintes<br />
pèsent au point d’empêcher l’atteinte de <strong>la</strong> cible, le message peut tout de même être<br />
discriminé car les cibles sont intégrées de manière intuitive et inconsciente par les<br />
24
25<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
locuteurs. Autrement, l’articu<strong>la</strong>tion est compensée afin d’atteindre au minimum <strong>la</strong> cible<br />
acoustique à défaut de <strong>la</strong> cible <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Si aucune <strong>des</strong> deux n’est atteinte, <strong>la</strong><br />
perception et <strong>la</strong> compréhension sont alors sérieusement altérées. Le processus de<br />
décodage de <strong>la</strong> perception de <strong>la</strong> parole permet de reconnaître une cible acoustique même<br />
quand il y a <strong>des</strong> « undershoots » et « overshoots » (Lindblom 1990). Une <strong>des</strong><br />
orientations spécifiques <strong>des</strong> théories phonétiques est de se demander quels sont les<br />
invariants <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Il existerait <strong>des</strong> points de passage obligés<br />
<strong>dans</strong> les régions cibles sous forme d’invariants spatio-temporels. Nous pouvons associer<br />
à cette tâche abstraite un chemin <strong>dans</strong> l’espace spatio-temporel qui respecterait certaines<br />
contraintes locales.<br />
1.2 Les théories de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
Les théories de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> tentent de décrire les problèmes de base de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de<br />
<strong>la</strong> parole : les cibles, le contrôle moteur, le timing <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs, les contraintes…<br />
Diverses théories de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole se proposent de définir <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong><br />
parole de deux façons correspondant à deux grands courants de pensée. Les théories<br />
orientées sortie prônent que le but <strong>du</strong> locuteur est de se faire comprendre. Les théories<br />
orientées système prêchent l’idée que le but de <strong>la</strong> parole est de pro<strong>du</strong>ire <strong>des</strong><br />
mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs.<br />
1.2.1 Les théories orientées sortie acoustique<br />
A l’image de <strong>la</strong> pensée de Jakobson (1963), le locuteur parle pour être enten<strong>du</strong> et ce<strong>la</strong><br />
<strong>dans</strong> le but d’être compris. Quand le locuteur parle, il cherche avant tout à faire<br />
comprendre à son auditoire les concepts et informations qu’il veut exprimer par <strong>la</strong><br />
parole, de même que <strong>des</strong> informations sur son état. Il cherche ainsi à atteindre une cible<br />
acoustique et perceptive. Les théories orientées sorties donnent à supposer qu’il y a peu<br />
de variabilité sur le p<strong>la</strong>n acoustique.
1.2.1.1 La théorie de Lindblom<br />
Une <strong>des</strong> théories les plus exploitées concernant <strong>la</strong> variabilité <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole est celle de<br />
Lindlom (1971, 1983, 1990, 1996) qu’il reprend et réactualise avec près de trente ans de<br />
recul et d’expériences et qui fait toujours foi en phonétique. Les locuteurs ont pour<br />
habitude d’ajuster leurs <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s en fonction de <strong>la</strong> situation de communication : ce<br />
que Lindblom appelle « l’organisation adaptative » de <strong>la</strong> parole. Le locuteur choisit <strong>la</strong><br />
forme grammaticale ou lexicale qui sert le mieux ses intentions communicatives. Dans<br />
chaque situation, ce choix dépend d’une façon cruciale de l’information qui est<br />
disponible à l’auditeur. De nombreuses données expérimentales montrent que<br />
l’intelligibilité de <strong>la</strong> parole dépend, en partie de <strong>la</strong> qualité et <strong>du</strong> contenu <strong>du</strong> signal et, en<br />
partie <strong>du</strong> fait que ce signal engage <strong>des</strong> processus dont l’origine est <strong>dans</strong> les<br />
connaissances linguistiques et situationnelles présentes <strong>dans</strong> le cerveau de l’auditeur au<br />
moment <strong>du</strong> traitement perceptuel. Autrement dit, il faut supposer qu’une unité<br />
phonétique ne reste jamais constante mais subit continuellement <strong>des</strong> fluctuations. En<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> et perception de <strong>la</strong> parole, <strong>la</strong> variabilité <strong>des</strong> signaux de <strong>la</strong> parole est le<br />
résultat de présuppositions phonétiques.<br />
Les expressions les moins c<strong>la</strong>ires sont dites « ré<strong>du</strong>ites » <strong>dans</strong> le sens où quelques uns<br />
<strong>des</strong> traits acoustiques peuvent être modifiés ou occultés. Les auditeurs sont capables de<br />
comprendre sans avoir accès à <strong>la</strong> totalité <strong>des</strong> paramètres acoustiques car ils utilisent leur<br />
connaissance pour retrouver les informations manquantes. Ainsi un locuteur agit en<br />
évaluant de manière continue <strong>la</strong> capacité qu’a l’auditeur à comprendre ce qui est dit. Le<br />
locuteur transmet son message le plus efficacement possible tout en contrô<strong>la</strong>nt les<br />
mouvements de ses articu<strong>la</strong>teurs le plus aisément possible. De ce point de vue, autant<br />
l’auditeur que le locuteur ont un rôle actif <strong>dans</strong> l’interaction. Ils évaluent tous deux <strong>la</strong><br />
qualité <strong>du</strong> bruit environnant, <strong>la</strong> familiarité avec <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue... Les variations <strong>des</strong><br />
expressions <strong>des</strong> paramètres qui définissent les catégories de sons sont connues et<br />
reconnues par les deux parties. Dans <strong>des</strong> cas extrêmes de ré<strong>du</strong>ction, les frontières <strong>des</strong><br />
régions <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et acoustiques entre les segments peuvent être franchies ou<br />
modifiées. En conséquence, l’expression <strong>des</strong> paramètres acoustiques responsables <strong>des</strong><br />
contrastes <strong>des</strong> sons n’est pas invariante. Les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont<br />
programmés pour contraindre les variations acoustiques parmi les situations différentes,<br />
<strong>dans</strong> <strong>des</strong> limites perceptuelles acceptables qui peuvent être assez <strong>la</strong>rges. L’entrée <strong>du</strong><br />
système de programmation motrice de <strong>la</strong> parole consiste en <strong>des</strong> cibles qui sont définies<br />
26
27<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
en terme de paramètres acoustiques et/ou <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s (Lindblom et al. 1979). Ces<br />
cibles sont <strong>des</strong> corré<strong>la</strong>ts <strong>des</strong> traits distinctifs qui spécifient les items lexicaux. Une autre<br />
proposition de Lindblom (1983) à propos de <strong>la</strong> formation <strong>des</strong> sons de <strong>la</strong> parole est que<br />
les valeurs <strong>des</strong> paramètres acoustiques sont déterminées par deux principes : le principe<br />
de contraste suffisant et le principe d’effort <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> minimal. Ces principes sont<br />
expliqués <strong>dans</strong> le paragraphe 1.2.3 concernant <strong>la</strong> théorie Hypo-articu<strong>la</strong>tion et Hyperarticu<strong>la</strong>tion<br />
de Lindblom (1996) défend l’idée que <strong>la</strong> perception est basée sur <strong>des</strong> cibles<br />
acoustiques et non <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Cette théorie de <strong>la</strong> perception favorise une<br />
représentation de <strong>la</strong> parole en termes acoustiques et perceptifs. Elle semble négliger le<br />
fait que les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s aient aussi un rôle actif quant à <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong><br />
sons et surtout en ce qui concerne l’atteinte ou non <strong>des</strong> cibles <strong>du</strong> locuteur.<br />
1.2.1.2 La théorie quantale de Stevens<br />
Le phonéticien ne peut ignorer <strong>la</strong> théorie quantale de <strong>la</strong> parole quand il évoque les<br />
théories traitant d’articu<strong>la</strong>tion, de cible, de <strong>compensation</strong>s <strong>du</strong> contrôle moteur. Le cadre<br />
théorique instauré par Stevens à propos de l’existence <strong>des</strong> invariants phonétiques est<br />
appelé théorie quantale, théorie notable qui re<strong>la</strong>te de <strong>la</strong> formation <strong>des</strong> traits acoustiques<br />
et de l’existence de l’invariance acoustico-auditive. Elle est proposée par Stevens dès<br />
1972, puis il <strong>la</strong> reprendra en 1985, 1989 et 1991. Les cibles sont définies comme <strong>des</strong><br />
régions <strong>dans</strong> l’espace acoustique et <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, par les principes quantal, dynamique et<br />
distributionnel.<br />
L’espace de contrôle en parole est acoustique <strong>dans</strong> le sens où le locuteur fait de son<br />
mieux pour doter le signal de parole <strong>des</strong> indices temporels et <strong>des</strong> propriétés spectrales<br />
invariants en association directe avec le code phonologique. Stevens et Blumstein<br />
(1991) montrent l’existence de propriétés acoustiques invariantes permettant de<br />
caractériser le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne indépendamment <strong>du</strong> contexte<br />
vocalique, suite à une série d’expériences sur <strong>la</strong> perception <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong><br />
plosives /b/, /d/ et /g/ <strong>dans</strong> <strong>des</strong> stimuli de synthèse Consonne-Voyelle. Les propriétés<br />
acoustiques restent invariantes à travers les locuteurs et les contextes phonétiques et ont<br />
un rôle perceptuel démontré. Cette théorie prône l’existence d’une re<strong>la</strong>tion non linéaire<br />
entre l’articu<strong>la</strong>tion et les propriétés acoustiques <strong>des</strong> sons en sortie <strong>du</strong> système de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Lorsqu’un paramètre <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> varie de manière linéaire, il arrive que les
conséquences acoustiques varient de façon non linéaire. Autrement dit, <strong>dans</strong> certaines<br />
zones <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s on peut observer <strong>des</strong> mouvements qui peuvent être sans<br />
conséquence acoustique (le résultat acoustique est stable). Inversement, il existe <strong>des</strong><br />
zones <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s <strong>dans</strong> lesquelles une petite variation <strong>du</strong> paramètre <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong><br />
implique une variation abrupte <strong>du</strong> paramètre acoustique. Les re<strong>la</strong>tions articu<strong>la</strong>toriacoustiques<br />
sont de nature quantale <strong>dans</strong> le sens où les variations acoustiques se font par<br />
paliers et les variations <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s se font de manière continue. Le même type de<br />
re<strong>la</strong>tion quantale existe aussi entre l’onde acoustique et les sons perçus. La théorie<br />
suggère que ces re<strong>la</strong>tions quantales entre les paramètres acoustiques, perceptifs et<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont un facteur déterminant <strong>dans</strong> le choix <strong>des</strong> attributs <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et<br />
acoustiques utilisés à <strong>des</strong> fins distinctives <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole. Cette théorie rend compte <strong>des</strong><br />
facteurs qui façonnent l’ensemble <strong>des</strong> attributs acoustiques et <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s utilisés par<br />
le locuteur pour signaler les distinctions <strong>du</strong> <strong>la</strong>ngage. C’est une théorie <strong>des</strong> traits<br />
distinctifs qui donne une explication sur l’origine <strong>des</strong> traits à partir de l’observation <strong>des</strong><br />
phénomènes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et <strong>des</strong> résultats acoustiques associés. La théorie quantale<br />
présente l’avantage de corréler <strong>la</strong> sortie acoustique et le niveau <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Ladefoged<br />
(1983) quant à lui fait remarquer que certains objets peuvent être regroupés en famille<br />
car ils ont un « air de famille » (family resemb<strong>la</strong>nce) mais ne sont pas pour autant<br />
corrélés. Si les <strong>la</strong>ngues <strong>du</strong> monde favorisent certains sons sur l’échelle <strong>des</strong> réalisations<br />
possibles, ce n’est en aucun cas parce que ces sons sont de nature quantale, mais<br />
simplement parce qu’ils sont plus faciles à réaliser. Il n’existerait pas de qualité<br />
vocalique préférentielle, à l’exception peut être <strong>des</strong> voyelles [i, u, a]. Elles ne sont pas<br />
préférées parce qu’elles seraient <strong>des</strong> voyelles quantales pour lesquelles <strong>des</strong> variations<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s importantes n’auraient que peu de conséquences acoustiques, mais parce<br />
qu’elles sont <strong>des</strong> points extrêmes de l’espace <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et offrent un maximum de<br />
distinctions entre elles. Browman et Goldstein (1989), quant à eux, admettent en partie<br />
<strong>la</strong> théorie quantale de Stevens car elle pourrait permettre non seulement d’expliquer les<br />
gestes que les <strong>la</strong>ngues peuvent choisir à <strong>des</strong> fins contrastives mais également comment<br />
ces gestes peuvent s’organiser.<br />
28
1.2.1.3 Les théories de Guenther et Perkell<br />
29<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
Pour Guenther (1995), les cibles sont spécifiées <strong>dans</strong> un espace acoustique. Elles<br />
prennent <strong>la</strong> forme d’un ensemble de valeurs acceptables de patrons formantiques mais<br />
aussi de trajectoires formantiques. Il s’oppose à <strong>la</strong> traditionnelle présentation <strong>des</strong> cibles<br />
<strong>du</strong> « tout ou rien ». Son modèle DIVA fait l’hypothèse de l’existence d’un contrôleur de<br />
haut niveau qui permettrait à tout instant de viser vers <strong>la</strong> cible à atteindre. C’est un<br />
modèle de contrôle où <strong>la</strong> trajectoire distale est caractérisée par un ensemble discret de<br />
cibles <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal. Le contrôleur prend en compte <strong>la</strong> position de l’effecteur<br />
final (constriction <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal), <strong>la</strong> compare à <strong>la</strong> position cible désirée et fait<br />
évoluer les variables de contrôle de façon à ré<strong>du</strong>ire <strong>la</strong> distance séparant les deux<br />
positions. Les positions <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs sont donc associées à <strong>la</strong> trajectoire de<br />
l’effecteur final <strong>dans</strong> l’espace <strong>des</strong> variables géométriques <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal. La chaîne<br />
de phonèmes est pro<strong>du</strong>ite par <strong>des</strong> mouvements continus <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs.<br />
Pour Perkell et al. (1993, 2000) les séquences de segments qui constituent les mots sont<br />
représentées <strong>dans</strong> le système nerveux central comme <strong>des</strong> régions auditives spatiotemporelles.<br />
Les mécanismes de contrôle moteur visant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de sons de parole<br />
sont basés sur <strong>des</strong> cibles auditives. Les cibles sont <strong>des</strong> régions <strong>dans</strong> un espace<br />
dimensionnel acoustique perceptif. (En terminologie <strong>du</strong> contrôle moteur, c’est le task<br />
space). Il existe plusieurs cibles acoustiques pour chaque son de parole. Par exemple,<br />
les cibles <strong>des</strong> voyelles sont une source de son voisé et une région particulière <strong>dans</strong><br />
l’espace formantique. Les cibles acoustiques les plus stables sont celles <strong>des</strong> voyelles. Il<br />
peut y avoir <strong>des</strong> variabilités à cause de l’effet quantal, à cause de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion non linéaire<br />
entre les paramètres d’entrée et de sortie : il existe une région <strong>dans</strong> <strong>la</strong>quelle le paramètre<br />
de sortie est stable. Pour les consonnes obstruantes, <strong>la</strong> cible est un bruit <strong>du</strong> burst avec<br />
certaines caractéristiques spectrales. Différents style de parole peuvent faire varier<br />
l’espace de cibles : pour une parole plus rapide, l’échelle de temps <strong>des</strong> régions <strong>des</strong><br />
cibles serait compressée. Pour une parole plus lente, <strong>la</strong> dimension acoustique serait plus<br />
<strong>la</strong>rge. Perkell et al (1993) postulent que les cibles sont <strong>des</strong> combinaisons de paramètres<br />
acoustiques et <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Ainsi, ils argumentent aussi en faveur d’un contrôle orienté<br />
vers <strong>des</strong> cibles acoustiques, contestant l’hypothèse de Browman et Goldstein (1989 et<br />
1992) et de Kelso et al. (1986) qui prônent <strong>des</strong> cibles seulement <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s.
1.2.2 Les théories orientées système<br />
« La parole s’assimile davantage à une séquence de mouvements ren<strong>du</strong>s audibles qu’à<br />
une séquence de sons engendrés par <strong>des</strong> mouvements » (Stetson 1928). Pour les tenants<br />
de cette conception, le but <strong>du</strong> système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> serait d’activer les articu<strong>la</strong>teurs. Le<br />
but de l’acte de parole <strong>du</strong> locuteur serait de faire bouger ses articu<strong>la</strong>teurs d’où <strong>la</strong><br />
prédominance <strong>des</strong> cibles <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Dans ces modèles, on n’observe pas autant de<br />
considérations sur le p<strong>la</strong>n acoustique et perceptif que <strong>dans</strong> les modèles orientés sortie.<br />
1.2.2.1 La théorie de Chomsky et Halle<br />
Chomsky et Halle (1968) définissent les mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs en terme de traits<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Le trait correspond à un ensemble universel de capacités que les locuteurs<br />
ont à pro<strong>du</strong>ire, permettant de percevoir les sons avec <strong>des</strong> propriétés linguistiques<br />
distinctives. La théorie <strong>des</strong> traits <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s admet que les items lexicaux sont<br />
représentés phonologiquement comme <strong>des</strong> séquences de segments discrets caractérisés<br />
en terme de primitives appelées traits distinctifs. Ces traits sont composés (i) d’un lieu<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, défini par <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs particuliers (par exemple, le trait <strong>la</strong>bial pour les<br />
lèvres, coronal pour <strong>la</strong> <strong>la</strong>me de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue) et (ii) d’un mode <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> (par exemple<br />
constrictif pour /z/, <strong>la</strong>téral pour /l/, vibrant pour /r/). Ces traits nous informent sur les<br />
dép<strong>la</strong>cements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs et sur les propriétés acoustiques qui en résultent. Définis<br />
de cette façon, mode et lieu d’articu<strong>la</strong>tion permettent de décrire les sons de toutes les<br />
<strong>la</strong>ngues <strong>du</strong> monde sous forme d’une c<strong>la</strong>ssification dont l’Alphabet Phonétique<br />
International se sert. La génération d’un segment exige habituellement <strong>la</strong> coordination<br />
de mouvements de plusieurs articu<strong>la</strong>teurs. Dans le cas d’une consonne, le trait<br />
segmental spécifie l’articu<strong>la</strong>teur majeur (par exemple les lèvres, le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue,<br />
l’apex) qui forme <strong>la</strong> constriction <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal. D’autres traits spécifient les<br />
mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs secondaires (comme <strong>la</strong> glotte, le velum) qui doivent être<br />
coordonnés avec le premier articu<strong>la</strong>teur. Le trait premier génère <strong>des</strong> repères acoustiques<br />
et les traits secondaires sont repérables au voisinage de ces repères acoustiques ou<br />
bornes. Quand les traits spécifiques d’une expression sont convertis en sons, les cibles<br />
finales <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont <strong>des</strong> patrons acoustiques qui permettent à<br />
l’auditeur de comprendre ce qui est dit. Dans le mécanisme de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, les cibles<br />
sont définies avec plus d’un type de paramètres et leur nature peut varier d’un segment à<br />
30
31<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
l’autre. Ainsi, quand une expression est pro<strong>du</strong>ite, certains traits spécifiques ou cibles<br />
peuvent être modifiés ce qui affecte alors <strong>la</strong> taille et <strong>la</strong> localisation de leur région <strong>dans</strong><br />
l’espace articu<strong>la</strong>tori-acoustique.<br />
La théorie <strong>des</strong> gestes postule que ce sont les gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ren<strong>du</strong>s audibles qui<br />
sont à l’origine de <strong>la</strong> parole articulée. Dans cette théorie les primitives correspondent à<br />
<strong>des</strong> gestes dynamiques définis en terme de lieu et de degré de constriction <strong>dans</strong> le<br />
con<strong>du</strong>it vocal, en terme de configurations spatiales. Les propriétés dynamiques <strong>du</strong> geste<br />
déterminent les aspects <strong>du</strong> timing <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et de <strong>la</strong> cinématique. (Saltzman et<br />
Munhall, 1989). La coordination inter-gestuelle (timing re<strong>la</strong>tif et magnitude <strong>du</strong> geste)<br />
est spécifiée par une partition gestuelle (Browman et Goldstein, 1989).<br />
1.2.2.2 La Phonologie Articu<strong>la</strong>toire<br />
La phonologie <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> commence avec l’acceptation <strong>des</strong> domaines physique et<br />
cognitif de <strong>la</strong> parole comme points forts pour <strong>la</strong> <strong>des</strong>cription d’un système complexe.<br />
L’importance de cette approche est l’identification <strong>des</strong> unités phonologiques avec <strong>des</strong><br />
unités spécifiques dynamiques de l’action <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> appelées gestes. Ainsi, une<br />
émission d’un son est décrite comme un acte qui peut être décomposé en petit nombre<br />
d’unités primitives (gestes) à l’intérieur d’une configuration spatio-temporelle<br />
particulière. L'unité phonologique de base est le geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> qui est défini comme<br />
un système dynamique spécifié par un ensemble caractéristique de paramètres. Pour<br />
l’articu<strong>la</strong>tion d'un son, les tâches sont distribuées à chaque ensemble d'articu<strong>la</strong>teurs<br />
différents à l’intérieur <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal (lèvres, <strong>la</strong>ngue, glotte, velum…). Pour les<br />
tenants de <strong>la</strong> Phonologie Articu<strong>la</strong>toire, le geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est invariant. Les variables<br />
de contrôle sont le lieu et le degré de consriction, donc <strong>des</strong> paramètres géométriques.<br />
Cette théorie gestuelle est basée essentiellement sur le niveau <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Browman et<br />
Goldstein (1989, 1992, 1993) exploitent <strong>la</strong> possibilité de ré<strong>du</strong>ire l’étude de<br />
l’organisation de <strong>la</strong> parole à l’étude de l’organisation <strong>des</strong> gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Les<br />
gestes sont considérés comme ayant une spécification temporelle et spatiale. Ils sont<br />
définis <strong>dans</strong> l’espace <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal en terme de lieu et d’aire de constriction<br />
maximale. Pour un phonème donné, les positions <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs sont variables selon<br />
le contexte d’exécution car il est possible que certains articu<strong>la</strong>teurs puissent contribuer à
<strong>la</strong> réalisation de plusieurs segments à <strong>la</strong> fois. Ainsi, l’articu<strong>la</strong>tion d’un son est modelée<br />
comme une constel<strong>la</strong>tion de plusieurs gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s qui peuvent potentiellement<br />
s’imbriquer et/ou se chevaucher <strong>dans</strong> une partition gestuelle. Chaque cible fonctionnelle<br />
pour un geste est réalisée par une action coordonnée d’un ensemble d’articu<strong>la</strong>teurs,<br />
autrement dit par une structure gestuelle coordinatrice. Ces chevauchements et<br />
recouvrements de gestes tra<strong>du</strong>isent <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion entre segments.<br />
1.2.2.3 Le modèle de <strong>la</strong> Dynamique <strong>des</strong> Tâches<br />
Avec le modèle de <strong>la</strong> Dynamique <strong>des</strong> Tâches (Task Dynamics), Kelso et ses<br />
col<strong>la</strong>borateurs (Kelso et al. 1986) visent à réconcilier l’invariance profonde de <strong>la</strong> parole,<br />
dégagée <strong>des</strong> analyses linguistiques traditionnelles, et <strong>la</strong> variabilité de surface telle<br />
qu’elle est observée <strong>dans</strong> les expériences acoustico-<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Les unités<br />
phonologiques de base, concaténées pour former les mots <strong>du</strong> <strong>la</strong>ngage sont de nature<br />
gestuelle. Les formes canoniques de <strong>la</strong> parole sont <strong>des</strong> structures coordinatives ou<br />
groupements fonctionnels <strong>des</strong> muscles recrutés en fonction de <strong>la</strong> tâche à effectuer. La<br />
trajectoire <strong>dans</strong> l’espace distal est décrite par un ensemble d’objectifs <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
discret (p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> constriction, ouverture de <strong>la</strong> glotte…). Cet ensemble est spécifié par<br />
<strong>des</strong> variables d’activation gestuelle dont l’évolution est donnée par ce que Browman et<br />
Godstein (Browman et Goldstein 1992) appellent <strong>la</strong> partition gestuelle. Associés à <strong>la</strong><br />
phonologie <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, Kelso et al. (1986) mettent en avant les propriétés dynamiques<br />
inhérentes au système <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et soulignent l’importance <strong>des</strong> re<strong>la</strong>tions de phase<br />
entre les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Le modèle de <strong>la</strong> Dynamique <strong>des</strong> Tâches a pour but<br />
de rendre compte de <strong>la</strong> cinématique <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs, de comprendre les actions dirigées<br />
vers une cible, de révéler le rôle <strong>des</strong> synergies entre les articu<strong>la</strong>teurs lors de <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole.<br />
Dans le modèle, les actions sont définies initialement en termes fonctionnels, c’est-àdire<br />
en terme de tâche à atteindre. Kelso et al. (1986) expliquent comment l’action<br />
acquiert et maintient son caractère «dirigé vers une cible » (goal-directed). Afin<br />
d’essayer d’expliquer simplement le modèle de <strong>la</strong> dynamique <strong>des</strong> tâches, prenons<br />
l’exemple de <strong>la</strong> réalisation d’un /b/. Les diverses actions discrètes qui tendent vers <strong>la</strong><br />
fermeture bi<strong>la</strong>biale sont décrites <strong>dans</strong> un espace <strong>des</strong> tâches (task space). Le contrôle<br />
dynamique qui implémente une action est premièrement fonctionnel et l’atteinte d’une<br />
32
33<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
cible discrète, <strong>la</strong> fermeture bi<strong>la</strong>biale, est caractérisée par un point d’attraction. Un<br />
système de points attracteurs possède <strong>des</strong> points de stabilité, les trajectoires <strong>du</strong> système<br />
sont attirées par un point où le système est en équilibre. Dans le cas de <strong>la</strong> fermeture<br />
bi<strong>la</strong>biale : le système d’aperture <strong>des</strong> lèvres est attiré vers le point où les lèvres se<br />
rencontrent. La fermeture est alors caractérisée par ce point qui est le point d’équilibre<br />
<strong>du</strong> système.<br />
1.2.2.4 Le modèle de Bell-Berti et Harris<br />
Pour Bell-Berti et Harris (Bell-berti et Harris 1981) aussi les gestes sont invariants et<br />
re<strong>la</strong>tifs à chaque segment. C’est en se chevauchant plus ou moins partiellement par les<br />
phénomènes de coarticu<strong>la</strong>tion que les gestes donnent lieu à une certaine variabilité de<br />
surface. Le processus d’anticipation est vu comme le résultat d’un processus « timelocked<br />
» entre les gestes sous-jacents. Dans cette conception, l’anticipation résulte <strong>du</strong><br />
chevauchement de deux gestes consécutifs. L’influence, par anticipation, <strong>du</strong> second<br />
geste débute alors que le premier est encore en cours de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. L’initiation <strong>du</strong><br />
second geste est re<strong>la</strong>tivement stable par rapport à l’instant où se finira le premier geste.<br />
L’anticipation <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> <strong>du</strong> geste est re<strong>la</strong>tivement fixe (time locked) par rapport à son<br />
début acoustique. Ceci est possible car chaque segment est muni d’une dimension<br />
temporelle intrinsèque. Le recouvrement <strong>des</strong> gestes associé à deux segments voisins se<br />
fait de façon partielle. Les effets d’anticipation sont donc à <strong>du</strong>rée fixe. Les conflits entre<br />
gestes sont résolus en ce qui concerne <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification. Le début d’un mouvement<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est indépendant de <strong>la</strong> longueur de <strong>la</strong> chaîne phonétique antérieure et<br />
commence à un instant fixe avant le début acoustique <strong>du</strong> segment auquel il est associé.<br />
Dans le même esprit, Löfqvist (1990) envisage les gestes comme invariants, re<strong>la</strong>tifs et<br />
propres à chaque segment. Lorsque les gestes se chevauchent partiellement, on observe<br />
une variabilité de surface. Les gestes phonétiques sont définis dynamiquement et ont<br />
une dimension temporelle intrinsèque, à condition qu’ils ne soient pas en concurence<br />
avec les voisins. Durant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, <strong>la</strong> variabilité observable <strong>dans</strong> l’activité <strong>du</strong><br />
con<strong>du</strong>it vocal (associée à un geste) résulte d’un chevauchement temporel entre<br />
gestes. Ainsi, l’influence <strong>des</strong> gestes associée à plusieurs segments adjacents présente<br />
<strong>des</strong> traces <strong>dans</strong> le continuum acoustique et <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. La dimension temporelle<br />
intrinsèque permet une organisation <strong>dans</strong> le temps : le même geste de recouvrement
couvre les effets d’anticipation (influence <strong>des</strong> segments suivants) et de persévération<br />
(influence <strong>des</strong> segments antécédents).<br />
Nous tenons à souligner les avantages <strong>des</strong> théories orientées système. Ces modèles dits<br />
biomécaniques ou neurophysiologiques, s’inscrivent <strong>dans</strong> un cadre dynamique pour<br />
expliquer les contraintes de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole et les variations qu’elles<br />
in<strong>du</strong>isent. La parole étant une activité motrice humaine, elle résulte de l’évolution<br />
temporelle d’un système physique comprenant <strong>des</strong> éléments de masse, viscosité et<br />
é<strong>la</strong>sticité, comme chaque activité motrice humaine. Ces éléments pourraient contribuer<br />
à expliquer un certain nombre de phénomènes fondamentaux de <strong>la</strong> parole comme<br />
l’anticipation, <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> réponse aux perturbations et <strong>la</strong> coordination interarticu<strong>la</strong>teurs.<br />
Il nous semble aussi fondamental de garder à l’esprit les concepts <strong>des</strong><br />
théories orientées sorties, <strong>la</strong> sortie acoustique et <strong>la</strong> perception étant une finalité absolue<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> communication.<br />
1.2.3 Le modèle Hypo-articu<strong>la</strong>tion Hyper-articu<strong>la</strong>tion de Lindblom<br />
Cette théorie propose un compromis entre les deux conceptions précédentes : elle<br />
propose un système de contrôle de <strong>la</strong> parole orienté sortie acoustique qui est capable<br />
d’expliquer <strong>la</strong> <strong>la</strong>rge variabilité observée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. La théorie de <strong>la</strong><br />
variabilité adaptative souligne l’existence de deux principes antagonistes spécifiques <strong>du</strong><br />
contrôle moteur de <strong>la</strong> parole : l’exigence d’une distinction perceptive <strong>du</strong> point de vue de<br />
l’auditeur et <strong>la</strong> demande d’économie <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> <strong>du</strong> point de vue <strong>du</strong> locuteur. Le<br />
concours de ces deux principes est à l’origine d’un grand nombre de phénomènes de<br />
variabilité en parole. Cette variabilité peut s’exprimer par le paradigme d’hypoarticu<strong>la</strong>tion<br />
et d’hyper-articu<strong>la</strong>tion. Le locuteur est obligé d’adopter une stratégie de<br />
variabilité adaptative en essayant de trouver un compromis entre les exigences pour <strong>la</strong><br />
compréhension et son effort d’articu<strong>la</strong>tion. Cette théorie se fonde sur <strong>la</strong> notion<br />
d’adaptabilité <strong>du</strong> locuteur afin de permettre <strong>la</strong> récupération de l’information de<br />
l’auditeur. Ainsi, cette théorie explique pourquoi les paramètres physiques de<br />
<strong>des</strong>cription de <strong>la</strong> parole peuvent être variables à tous les niveaux pour un message<br />
linguistique invariant.<br />
Le <strong>la</strong>ngage et <strong>la</strong> parole sont <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its de l’évolution et y sont soumis. La théorie<br />
Hypo-articu<strong>la</strong>tion et Hyper-articu<strong>la</strong>tion est compatible avec le modèle Darwiniste de<br />
34
35<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
l’évolution prônant <strong>la</strong> variation et <strong>la</strong> sélection biologique et culturelle. Dans un tel<br />
cadre, <strong>la</strong> théorie Hypo-articu<strong>la</strong>tion et Hyper-articu<strong>la</strong>tion a pour but d'approfondir <strong>la</strong><br />
nature systématique de <strong>la</strong> variation phonétique intra-locuteur et aussi inter-locuteurs.<br />
Elle présume que les communicants doivent accorder leurs performances en harmonie<br />
avec les exigences situationnelles, d’une part, et avec les connaissances linguistiques et<br />
phonétiques, d’autre part. Le but commun <strong>des</strong> inter-locuteurs est toujours de pro<strong>du</strong>ire<br />
une parole intelligible. Les facteurs qui influencent <strong>la</strong> variation phonétique intra<br />
locuteur sont basés sur un continuum Hypo-Hyper. Le locuteur fait une estimation<br />
continuelle de l’information qu’il doit mettre <strong>dans</strong> le signal et il adapte sa <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de<br />
parole selon cette évaluation. Cette parole adaptative se manifeste par <strong>des</strong> formes hyperarticulées<br />
avec plus de force (force <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>) et par <strong>des</strong> formes hypo-articulées<br />
pro<strong>du</strong>ites moins vigoureusement. La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole nécessite un contrôle <strong>des</strong><br />
acteurs de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> et <strong>des</strong> contraintes de sortie (signal acoustique) : elle répond à un<br />
système d’organisation adaptative. Les segments phonétiques constituant <strong>la</strong> chaîne de<br />
parole sont gérés par une chaîne de comman<strong>des</strong> distribuées sur un temps très court.<br />
Elles peuvent toujours bouger d’une cible à une autre. L’action <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs se<br />
trouve restreinte <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole rapide ou face à une autre contrainte <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> ce qui<br />
fait que les articu<strong>la</strong>teurs ne peuvent pas toujours compléter une réponse donnée avant <strong>la</strong><br />
commande de <strong>la</strong> configuration <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> suivante. Ainsi, les articu<strong>la</strong>teurs n’atteignent<br />
pas toujours <strong>la</strong> cible voulue et répondent simultanément à plus d’un signal d’entrée<br />
(phénomène d’undershoot ou d’overshoot).<br />
1.2.3.1 L’Hypo-articu<strong>la</strong>tion<br />
Le système moteur tend à engendrer un comportement de moindre effort. Il répond à un<br />
principe biomécanique d’économie, principe qui régit tous les mouvements, pas<br />
seulement ceux spécifiques à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Cette notion est associée avec<br />
le concept d’atteinte de cible phonétique. Prenons une cible vocalique. Premièrement,<br />
plus <strong>la</strong> voyelle est courte, plus l’extension <strong>du</strong> mouvement vers <strong>la</strong> cible sera ré<strong>du</strong>ite. De<br />
<strong>la</strong> même façon, quand une commande arrive trop vite ou que l’extension d’un<br />
mouvement n’est pas suffisante, alors <strong>la</strong> cible visée est manquée (undershoot) et le<br />
système est réorganisé afin de pointer sur une autre. Mais le locuteur a le «choix» de<br />
pouvoir éviter les undershoots, il a alors recours à <strong>des</strong> manœuvres compensatoires au
détriment de <strong>la</strong> loi <strong>du</strong> moindre effort. Par exemple, si le timing d’une commande est<br />
trop rapide, alors le locuteur peut augmenter <strong>la</strong> vélocité de <strong>la</strong> commande par<br />
augmentation de l’amplitude <strong>du</strong> geste. En définitive, il s’adapte aux contraintes de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> tout en faisant en sorte de conserver une parole compréhensible. Si le<br />
système de parole opère pour minimiser les efforts <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, nous pouvons attendre<br />
à ce qu’il s’écarte <strong>des</strong> cibles phonétiques par undershoot assez souvent. L’exemple de <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> voyelle fermée /i/ illustre ce principe d’économie, car pour prendre <strong>la</strong><br />
configuration requise par le /i/, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue dévie très peu de sa configuration neutre de<br />
repos.<br />
1.2.3.2 L’Hyper-articu<strong>la</strong>tion<br />
Il existe un principe de p<strong>la</strong>sticité adaptative orienté vers une cible. Ce principe est un<br />
<strong>des</strong> traits généraux <strong>du</strong> contrôle moteur. Nous venons de voir que le locuteur peut<br />
compenser ou non (en terme de réajustements). Notons que plus les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong><br />
segments seront petites, plus le locuteur devra redoubler d’effort (en terme de coût<br />
biomécanique) au détriment de <strong>la</strong> loi <strong>du</strong> moindre effort. L’é<strong>la</strong>boration de <strong>la</strong><br />
représentation de <strong>la</strong> sortie (finalité) précède l’exécution d’un ensemble de mouvements.<br />
Ici, les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s apparaissent comme étant un but. Le locuteur choisit<br />
de « sur-articuler » pour s’adapter aux conditions de communication qui jouent un rôle<br />
décisif. L’atteinte de <strong>la</strong> cible est en accord avec <strong>la</strong> demande de l’auditeur et <strong>la</strong> situation<br />
de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Les contraintes de perception sont décisives. Dans ce cas, le locuteur<br />
prend en compte le bénéfice de <strong>la</strong> boucle de feedback perceptif et utilise les<br />
informations sensorielles. Pour illustrer ce principe de p<strong>la</strong>sticité, prenons l’exemple de<br />
<strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> voyelle fermée /i/ en présence d’un bite-block (Lindblom et Sunberg<br />
1971). Le système est capable de compenser, <strong>la</strong> sortie acoustique (formants) est<br />
simi<strong>la</strong>ire à celle d’un /i/ normal, ce sont les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s qui sont<br />
différents. Lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’un /i/ perturbé, si le système est capable de réaliser<br />
<strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s, c’est qu’il est gouverné par un principe de p<strong>la</strong>sticité adaptative.<br />
36
37<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 1 : La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole<br />
1.2.3.3 Les avantages <strong>du</strong> modèle Hypo-Hyper articu<strong>la</strong>tion.<br />
Les avantages de <strong>la</strong> théorie de Lindblom, s’agissant <strong>des</strong> phénomènes de <strong>compensation</strong>,<br />
sont nombreux. Les variations intra-locuteurs ne sont pas considérées comme <strong>des</strong><br />
invariants enchâssées <strong>dans</strong> une variabilité linguistique devenue peu pertinente, elles sont<br />
plutôt de réelles adaptations en ligne au grand nombres de deman<strong>des</strong> fonctionnelles<br />
satisfaites par <strong>la</strong> parole. Le paradigme Hypo-Hyper montre <strong>la</strong> capacité <strong>du</strong> locuteur à<br />
répondre à de nombreuses contraintes, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong> parole est un acte<br />
volontaire. Les principes traditionnels bio-mécaniques qui régissent tous nos<br />
mouvements, à savoir ceux de p<strong>la</strong>sticité, de flexibilité et de moindre effort, sont utilisés<br />
pour expliquer <strong>la</strong> variabilité de <strong>la</strong> parole. Pour définir <strong>la</strong> variabilité <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole, ce<br />
modèle est très sé<strong>du</strong>isant car il est capable d’expliquer toutes les perturbations <strong>du</strong><br />
système : <strong>des</strong> plus naturelles (effets de l’action d’un articu<strong>la</strong>teur sur un autre) aux plus<br />
provoquées (par un expérimentateur) sur un même paradigme : parole Hypo-articulée et<br />
Hyper-articulée.<br />
1.3 Conclusion<br />
Dans les pages qui précèdent, nous avons présenté un ensemble de théories et modèles<br />
qui concernent le contrôle moteur de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Nous avons vu, d’une<br />
part, un contrôle qui serait orienté-sortie reposent sur <strong>des</strong> cibles acoustiques, d’autre<br />
part un contrôle qui serait orienté-système, basé sur <strong>des</strong> cibles <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Nous<br />
n’avons pas le projet d’opposer de manière drastique ces deux types de contrôle car il se<br />
pourrait qu’ils oeuvrent de concert à <strong>des</strong> étapes différentes <strong>du</strong> contrôle de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
de <strong>la</strong> parole. Nous avons constaté que <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole passe par deux gran<strong>des</strong><br />
étapes: <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification et l’exécution. Au moment de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification le but <strong>du</strong> locuteur<br />
est effectivement de communiquer et de se faire comprendre par son entourage : les<br />
cibles qu’il cherche à atteindre sont de nature acoustique. Ainsi <strong>la</strong> boucle p<strong>la</strong>nificationexécution<br />
admet un contrôle orienté-sortie. Le contrôle <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs serait plutôt<br />
fondé sur <strong>des</strong> critères définis <strong>dans</strong> un espace distal, l’espace perceptif désiré pour un<br />
locuteur estimé, un espace caractérisé par exemple par <strong>des</strong> valeurs formantiques. A
partir <strong>des</strong> trajectoires formantiques perçues, il est possible d’inférer les comman<strong>des</strong><br />
motrices envoyées aux muscles.<br />
Au niveau biomécanique, pour permettre l’exécution <strong>des</strong> mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs,<br />
le but <strong>du</strong> locuteur est de réaliser les constrictions correctes <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal et/ou<br />
de bien p<strong>la</strong>cer les articu<strong>la</strong>teurs. Durant cette étape d’exécution <strong>du</strong> mouvement, les cibles<br />
sont spécifiées <strong>dans</strong> une partition gestuelle et peuvent être <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et ne<br />
constituent pas une finalité mais un passage obligé vers les paramètres acoustiques<br />
demandés. Un contrôle orienté-système se ferait au niveau physique <strong>des</strong> mouvements<br />
<strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs. Cependant un contrôle acoustique donne plus d’importance à l’objectif<br />
<strong>du</strong> locuteur.<br />
38
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
CHAPITRE 2<br />
Compensations et Structures Coordinatives<br />
2.1 Présentation de <strong>la</strong> notion de <strong>compensation</strong><br />
La définition de <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> <strong>du</strong> Larousse consiste à dire que l’on compense quand<br />
on « équilibre un effet par un autre ». Si nous apposons cette définition au système de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole, l’action de compenser est une habileté <strong>du</strong> système à réagir face à<br />
une perturbation qui peut être statique (bite-blocks pour fixer <strong>la</strong> mâchoire <strong>dans</strong> une<br />
position ouverte) ou dynamique (ressort qui tire aléatoirement <strong>la</strong> mâchoire). Des<br />
perturbations statiques existent <strong>dans</strong> <strong>la</strong> vie de tous les jours <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong><br />
parole, par exemple il nous est facile de parler en tenant un stylo ou une paille entre les<br />
dents. Cette situation de perturbation, à condition que l’objet ne soit pas démesuré,<br />
n’empêche pas <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> intelligible <strong>des</strong> sons de parole. Ainsi, déjà l’expérience<br />
quotidienne nous informe sur le fait que les <strong>compensation</strong>s face à <strong>des</strong> perturbations<br />
inatten<strong>du</strong>es, s’opèrent rapidement et de manière fonctionnelle.<br />
Un <strong>des</strong> précieux paradigmes expérimentaux pour aider à comprendre le contrôle et <strong>la</strong><br />
coordination <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s est d’intro<strong>du</strong>ire <strong>des</strong> perturbations<br />
inhabituelles. Nous pouvons ainsi observer comment le système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> se<br />
comporte pour pallier ces perturbations. La nature de <strong>la</strong> réponse, et le temps de réponse,<br />
peuvent dévoiler <strong>la</strong> nature de l’organisation de l’acte moteur. Un certain nombre<br />
d’étu<strong>des</strong> a utilisé ce paradigme par le biais d’expérimentations afin de connaître mieux<br />
le contrôle moteur de <strong>la</strong> parole. (Folkins et Abbs 1975, Folkins et Zimmerman, 1982,<br />
Kelso et Tuller 1983, Munhall, Löfqvist et Kelso, 1994, Shaiman, 2001).<br />
2.1.1 Définition générale : perturbation et <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong><br />
Les phénomènes de <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> sont définis en terme de mouvements<br />
compensatoires <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs. Pour parler de <strong>compensation</strong> nous avons besoin de<br />
deux ou plusieurs articu<strong>la</strong>teurs qui fonctionnent ensemble, dépendant les uns <strong>des</strong> autres,<br />
41
comme une synergie. Si l’activité d’un articu<strong>la</strong>teur est diminuée ou neutralisée<br />
complètement, un autre articu<strong>la</strong>teur, qui de coutume travaille en association avec lui,<br />
peut réaliser une action souvent inhabituelle pour pallier cette défail<strong>la</strong>nce. Ainsi, sur le<br />
p<strong>la</strong>n <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, on peut dire que les <strong>compensation</strong>s sont effectuées grâce à l’existence<br />
de cette coordination inter-articu<strong>la</strong>teurs. En terme plus fonctionnel, <strong>la</strong> trajectoire initiale<br />
exigée par le système nerveux central étant changée et le but reste, tant bien que mal,<br />
d’atteindre <strong>la</strong> cible acoustique requise, grâce à <strong>la</strong> synergie entre articu<strong>la</strong>teurs. Un<br />
articu<strong>la</strong>teur bloqué ou gêné va générer un message d’erreur via le feedback<br />
proprioceptif et va entraîner une nouvelle commande motrice vers un autre articu<strong>la</strong>teur.<br />
Comment ce phénomène est-il appréhendé par le système nerveux central ? Nous<br />
savons que <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole naturelle, et pas seulement face à une perturbation extérieure,<br />
<strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s s’opèrent entre les articu<strong>la</strong>teurs. Geumann et al. (1999) montrent,<br />
grâce à <strong>des</strong> enregistrements électromagnétiques, qu’en parole forte, <strong>la</strong> mâchoire adopte<br />
<strong>des</strong> positions plus basses, forçant ainsi <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue à adopter <strong>des</strong> patrons différents pour<br />
garder <strong>la</strong> constriction nécessaire à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes alvéo<strong>la</strong>ires alleman<strong>des</strong>.<br />
Ils observent <strong>des</strong> changements <strong>dans</strong> <strong>la</strong> coordination inter-<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et confirment<br />
aussi les résultats de Schulman (1989) qui observe les même changements. Gay (1981)<br />
montre aussi que lorsque le débit de parole est rapide, les comman<strong>des</strong> motrices ne<br />
subissent pas une simple accélération linéaire mais sont réorganisées temporellement de<br />
manière non linéaire. Il dé<strong>du</strong>it cette conclusion <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> précédentes qui ont montré<br />
qu’en cas de débit rapide, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> voyelles est plus ré<strong>du</strong>ite que celles <strong>des</strong><br />
consonnes. La coarticu<strong>la</strong>tion qui influence <strong>la</strong> coordination inter-articu<strong>la</strong>teurs et/ou le<br />
changement de force d’articu<strong>la</strong>tion et de vitesse d’articu<strong>la</strong>tion peut être désignée comme<br />
perturbation naturelle (Lindblom 1990).<br />
En phonétique <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, les procédés compensatoires sont <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>tions<br />
différentes qui permettent d’obtenir le même effet acoustique. Ainsi <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
prononciation de <strong>la</strong> voyelle [ø], réalisée habituellement comme une voyelle<br />
re<strong>la</strong>tivement antérieure, semi-ouverte et arrondie, le trait d’arrondissement peut<br />
disparaître sans que ce<strong>la</strong> se tra<strong>du</strong>ise par une modification acoustique, s’il est remp<strong>la</strong>cé<br />
par un léger retrait de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Ce retrait a pour effet d’augmenter le volume de <strong>la</strong><br />
cavité buccale et d’abaisser sa fréquence propre entraînant une bémolisation <strong>du</strong> timbre<br />
vocalique. Ainsi, au niveau acoustico-perceptif, nous percevons une seule et même<br />
voyelle même si ses réalisations vocaliques sont caractérisées par <strong>des</strong> formants voisins.<br />
42
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
A cette alternative acoustique, correspond nécessairement une alternative <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>:<br />
<strong>la</strong> même <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> acoustique peut être obtenue à l’aide de positions différentes <strong>des</strong><br />
articu<strong>la</strong>teurs les uns par rapport aux autres. Tout mouvement <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> peut être<br />
compensé par un autre afin que les conséquences acoustiques et perceptuelles<br />
demeurent inchangées.<br />
Déjà au début <strong>du</strong> siècle Rousselot (1901) par<strong>la</strong>it <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et <strong>des</strong><br />
contraintes extérieures imposées artificiellement. Il exprimait ces concepts en d’autres<br />
termes, soixante-dix ans avant les premières étu<strong>des</strong> avec <strong>des</strong> perturbations qui ont fait<br />
date (Lindblom et al. 1971, 1977) : «…on peut, en effet, très bien arriver à émettre<br />
toutes les voyelles <strong>la</strong>biales en les écartant (les lèvres) avec les doigts…» (Rousselot,<br />
1901, p.689).<br />
2.1.2 Définition neurophysiologique<br />
Les étu<strong>des</strong> en physiologie et en pathologie montrent que <strong>la</strong> p<strong>la</strong>sticité et l’adaptation sont<br />
deux propriétés phares <strong>des</strong> réseaux centraux et périphériques impliqués <strong>dans</strong><br />
l’organisation de l’acte moteur. Ces fonctions servent à caractériser les réseaux<br />
corticaux impliqués <strong>dans</strong> l’organisation de l’acte moteur. Ces réseaux ont été façonnés<br />
par l’expérience et par l’apprentissage pour (i) prédire les conséquences de l’action et<br />
(ii) anticiper par les comman<strong>des</strong> appropriées (Massion 2001). C’est un mécanisme qui<br />
réconcilie l’infinie variabilité <strong>des</strong> entrées sensorielles et <strong>des</strong> sorties motrices, comme<br />
nous l’explique Lindblom <strong>dans</strong> sa théorie Hypo-articu<strong>la</strong>tion et Hyper-articu<strong>la</strong>tion.<br />
(Lindblom 1990). Pour expliquer <strong>la</strong> p<strong>la</strong>sticité <strong>du</strong> contrôle moteur de <strong>la</strong> parole, un<br />
modèle de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> devrait avoir les trois mo<strong>des</strong> d’opération suivants :<br />
-contrôle à boucle ouverte<br />
-contrôle à boucle fermée adaptative<br />
-contrôle à boucle fermée prédictive pour <strong>la</strong> capacité à prédire les nouvelles comman<strong>des</strong><br />
motrices sans pratique préa<strong>la</strong>ble et pour justifier de <strong>la</strong> flexibilité <strong>du</strong> système.<br />
Les mécanismes de vicariance éc<strong>la</strong>irent sur les capacités <strong>du</strong> système nerveux central à<br />
compenser les déficits (mise hors service de certaines structures cérébrales par<br />
exemple). Ce qui est défini comme vicariant se substitue à autre chose. Un système<br />
vicariant est doté d’une pluralité de processus redondants, vicariants c’est-à-dire<br />
susceptibles d’être substitués les uns aux autres pour remplir une même fonction. Une<br />
43
même fonction adaptative peut fréquemment être assurée par plusieurs processus. En<br />
somme, ce sont ces processus vicariants qui génèrent de <strong>la</strong> variabilité et qui accordent<br />
fiabilité et flexibilité au système. La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole est donc un système vicariant.<br />
Le traitement de l’information peut se faire par une aire corticale qui n’a pas l’habitude<br />
de le faire, l’apprentissage moteur provoque un remode<strong>la</strong>ge <strong>des</strong> cartes corticales<br />
sensorielles et motrices. Les stratégies de substitution utilisent <strong>des</strong> circuits peu utilisés<br />
auparavant et permettent <strong>la</strong> réalisation de <strong>la</strong> tâche à partir d’autres entrées sensorielles.<br />
La commande centrale est le résultat de l’acquisition <strong>des</strong> modèles internes de<br />
l’environnement, <strong>des</strong> caractéristiques biomécaniques <strong>du</strong> corps et de leurs interactions.<br />
Les réseaux centraux sont façonnés par l’expérience et l’apprentissage, ils peuvent<br />
prédire les conséquences de l’action et anticiper sur les perturbations. Deux propriétés<br />
distinctes caractéristiques <strong>du</strong> contrôle moteur émergent <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> en physiologie: (i) le<br />
codage <strong>du</strong> contexte sensoriel de l’auditeur et (ii) <strong>la</strong> génération d’une commande motrice<br />
de p<strong>la</strong>sticité. Ces propriétés sont propres à une <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale de parole, mais elles<br />
jouent aussi un rôle <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>tions de <strong>compensation</strong>. Elles sont<br />
fortement impliquées pour <strong>la</strong> conception « d’équivalence motrice » (MacNei<strong>la</strong>ge<br />
1970) : comment les événements moteurs dirigés vers une cible peuvent être générés<br />
face à une situation nouvelle, comme une perturbation statique momentanée (biteblock).<br />
Nous nous retrouvons confrontés à une information sensorielle qui n’a jamais<br />
été éprouvée auparavant et qui n’est donc pas stockée <strong>dans</strong> le cerveau <strong>du</strong> locuteur. Afin<br />
de tenter d’expliquer l’existence <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>tions compensatoires, une hypothèse est<br />
posée : <strong>la</strong> programmation de <strong>la</strong> parole est déjà complètement compensatoire par<br />
essence. Le contrôle moteur est organisé pour avoir <strong>des</strong> fonctions de <strong>compensation</strong><br />
inhérentes, pas seulement concernant les gestes de <strong>la</strong> parole mais l’ensemble <strong>des</strong> gestes<br />
<strong>du</strong> corps. Ces situations sont omniprésentes. Les différences entre les articu<strong>la</strong>tions<br />
normales et compensatoires ne dépendraient pas de différentes stratégies d’encodage.<br />
Les deux comportements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s réc<strong>la</strong>ment <strong>des</strong> réponses muscu<strong>la</strong>ires différentes<br />
et variables en fonction <strong>du</strong> contexte imposé et ont pour but le même résultat, <strong>la</strong> même<br />
cible.<br />
44
2.2 Les informations sensorielles<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
Le rôle <strong>des</strong> différents feedbacks peut être présenté selon trois modèles existants. Le<br />
modèle à boucle ouverte issu d’une conception centraliste, le modèle à boucle fermée et<br />
le modèle de simu<strong>la</strong>tion prédictive basé sur l’existence <strong>des</strong> modèles internes.<br />
2.2.1 Modèle à boucle ouverte<br />
Cette conception traditionaliste de type centraliste voit le programme moteur comme<br />
unique responsable de l’organisation de l’action motrice. Cette conception nous dit que<br />
le cerveau et les aires spécialisées <strong>du</strong> cortex cérébral sont responsables de<br />
l’enchaînement <strong>des</strong> opérations liées au but de l’action, à l’intention de <strong>la</strong> réaliser, à sa<br />
préparation et à son exécution. Des réseaux spécifiques fonctionnent en parallèle, et<br />
spécifient les paramètres <strong>des</strong> mouvements volontaires. Ces réseaux sont activés même<br />
quand le locuteur fait une simu<strong>la</strong>tion de l’action, quand il imagine l’action. Ce dernier<br />
point confirme le fait que le cerveau soit le principal responsable de l’organisation <strong>du</strong><br />
mouvement puisque les réseaux impliqués <strong>dans</strong> l’organisation peuvent fonctionner en<br />
l’absence de mouvement réel. Le système nerveux central serait un système capable<br />
d’agir sans le recours d’un mécanisme de régu<strong>la</strong>tion et pourrait seul définir les schémas<br />
moteurs à envoyer aux muscles <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs afin de réaliser une cible <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong><br />
donnée. Ce modèle procède « aveuglément » sans que les conséquences sensorielles<br />
d’un geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> jouent un rôle. Il opère seul une sorte de tra<strong>du</strong>ction d’un patron<br />
d’une cible sensorielle en un patron de commande motrice. Ce type de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>,<br />
directement issue <strong>du</strong> contrôle moteur fonctionne lors <strong>des</strong> exécutions très rapi<strong>des</strong> qui<br />
nécessitent une synchronisation tout aussi rapide. Cependant, par sa rapidité d’exécution<br />
et l’insuffisance <strong>des</strong> conséquences sensorielles, ce modèle ne semble pas pouvoir<br />
prendre en compte les cas de réajustements immédiats <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs.<br />
2.2.2 Modèle à boucle fermée<br />
Ce modèle est basé sur un principe qui va <strong>dans</strong> un sens opposé de celui présenté<br />
précédemment. Il trouve ses origines <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cybernétique (Fairbanks 1974) et se base<br />
sur le fait que les feedbacks peuvent provoquer <strong>des</strong> modifications <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Dans le<br />
45
contrôle en boucle fermée, une information sensorielle a une influence évidente sur les<br />
formes <strong>des</strong> signaux moteurs. Autrement dit, <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole serait un<br />
mécanisme régulé par feedback. Le système nerveux central tient compte <strong>des</strong><br />
informations sensorielles pour é<strong>la</strong>borer et envoyer un nouvel ordre. (MacNei<strong>la</strong>ge 1970,<br />
1979).<br />
Si nous décomposons le processus, une cible sensorielle est convertie en commande<br />
motrice qui est envoyée aux muscles par le système nerveux central. La réponse <strong>des</strong><br />
récepteurs périphériques est renvoyée au système nerveux central via un feedback<br />
proprioceptif. Ces conséquences sensorielles permettent de transformer <strong>la</strong> commande<br />
motrice en signal d’erreur. Ce signal d’erreur est <strong>la</strong> différence entre <strong>la</strong> cible visée et les<br />
effets sensoriels de <strong>la</strong> commande et sera utilisée pour générer une nouvelle commande<br />
adaptée. Les comman<strong>des</strong> vers l’organe articu<strong>la</strong>teur prennent en compte sa position préphonatoire,<br />
et seulement ensuite, calculent les moyens pour atteindre une position<br />
demandée.<br />
Cette théorie semble présenter l’inconvénient d’une lenteur semb<strong>la</strong>nt peu compatible<br />
avec <strong>la</strong> rapidité nécessaire aux ajustements effectués en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole. Ce<br />
mécanisme semble être trop long pour expliquer les réajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
immédiats.<br />
2.2.3 Les différents feedbacks<br />
La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole requiert l’utilisation coordonnée et simultanée <strong>des</strong> mécanismes<br />
de respiration, de phonation et d’articu<strong>la</strong>tion. Cette activité complexe s’accompagne de<br />
feedbacks différenciés aussi complexes. Les feedbacks nous avertissent si les cibles<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et acoustiques sont atteintes ou non. Il existe quatre sortes d’informations<br />
disponibles qui peuvent être utilisées <strong>dans</strong> un contrôleur par feedback : auditive, tactile,<br />
proprioceptive et centrale. A chaque phase de traitement de l’information, il y a un<br />
feedback. Ainsi, plusieurs sortes d’informations sont disponibles pour le locuteur à<br />
partir <strong>des</strong> feedbacks central, proprioceptif et externe.<br />
Premièrement, le feedback interne ou central. Ce système opère rapidement <strong>dans</strong> le<br />
système nerveux central au niveau <strong>des</strong> comman<strong>des</strong> motrices. Il sert à transmettre<br />
l’information sur <strong>la</strong> commande motrice (antérieure à <strong>la</strong> réponse motrice elle-même). Il<br />
est capable de prédiction rapide à un niveau élevé de préparation de <strong>la</strong> commande<br />
46
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
motrice (feedforward). Il opère un va et vient incessant entre les comman<strong>des</strong> motrices et<br />
les informations spatio-temporelles <strong>des</strong> patrons de parole stockés <strong>dans</strong> le cerveau.<br />
Deuxièmement, le feedback proprioceptif. Ce système est moyennement rapide, c’est<br />
lui qui apporte les réponses proprioceptives <strong>du</strong> système nerveux périphérique vers le<br />
système nerveux central. Il est capable d’un bon contrôle <strong>du</strong> mouvement <strong>dans</strong> les<br />
activités motrices exigeant de <strong>la</strong> précision. Les nerfs résidant <strong>dans</strong> les fuseaux<br />
muscu<strong>la</strong>ires transmettent, <strong>dans</strong> les deux sens, l’information motrice autant que<br />
l’information sensorielle. Les nerfs afférents portent le feedback proprioceptif <strong>des</strong><br />
périphéries vers le système nerveux central. Les nerfs efférents portent l’information<br />
motrice <strong>du</strong> système nerveux central vers les organes périphériques concernés. Ce<br />
système de feedback opère aussi bien pour <strong>des</strong> gestes réflexes que pour <strong>des</strong> gestes<br />
volontaires.<br />
Enfin, le feedback externe. Ce système rend compte <strong>des</strong> effets externes <strong>des</strong> actes<br />
moteurs qui peuvent se tra<strong>du</strong>ire par le signal acoustique, les variations de pression d’air<br />
et/ou les contacts entre les articu<strong>la</strong>teurs. C’est un feedback plus lent que ceux<br />
précédemment cités. Le feedback tactile se fait par l’intermédiaire <strong>des</strong> récepteurs<br />
sensoriels de surface et le feedback auditif se fait via <strong>la</strong> cochlée. Quand le système est<br />
arrivé à maturité, le feedback auditif joue deux rôles essentiels: (i) maintenir une<br />
stabilité <strong>des</strong> paramètres <strong>des</strong> cadres phonémiques (ii) assurer une intelligibilité adéquate.<br />
Système Nerveux Central Système Nerveux Central<br />
sensations activité<br />
motrice<br />
Figure n° 2.1: Schémas comparant les contrôles en boucle ouverte, à gauche, avec le contrôle en<br />
boucle fermée, à droite.<br />
Un troisième modèle de contrôle est proposé afin d’expliquer <strong>la</strong> faculté d’adaptation <strong>du</strong><br />
système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Ce modèle de simu<strong>la</strong>tion prédictive (Lindblom 1979) adhère au<br />
47<br />
sensations activité<br />
motrice<br />
feedbacks
fait que le feedback joue un rôle important (à <strong>la</strong> différence <strong>du</strong> modèle à boucle ouverte)<br />
<strong>dans</strong> le contrôle <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs. Cependant, il ajoute une dimension de simu<strong>la</strong>tion qui<br />
fait qu’il est rapide à exécuter (à <strong>la</strong> différence <strong>du</strong> modèle à boucle fermée). Il est aussi<br />
entièrement en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> conception <strong>des</strong> modèles internes.<br />
2.3 Modèle de simu<strong>la</strong>tion prédictive de Lindblom<br />
Ce modèle est proposé par Lindblom et al. (1977, 1979) et nous l’illustrons par <strong>la</strong> figure<br />
2.2. suivante. Le processus de contrôle est le même que celui en boucle fermée mais<br />
présente un simu<strong>la</strong>teur de <strong>la</strong> boucle périphérique: <strong>la</strong> commande motrice est simulée. La<br />
différence entre <strong>la</strong> cible sensorielle et les effets sensoriels pro<strong>du</strong>it une erreur qui génère<br />
les instructions motrices ultérieures. Cette fonction est attribuée au système de parole<br />
afin d’accroître ses performances, avec <strong>la</strong> rapidité d’exécution et l’aptitude à modifier<br />
une commande motrice avant que ses conséquences sensorielles soient devenues<br />
disponibles par le feedback périphérique. Ainsi, ce mode de simu<strong>la</strong>tion prédictive<br />
contribuerait à donner au système <strong>la</strong> faculté de sélectionner les réponses motrices<br />
adéquates avec flexibilité et p<strong>la</strong>sticité. Le système est capable d’apprendre lui-même ses<br />
erreurs (simulées) qui lui donnent accès à bien plus d’informations qu’un seul modèle à<br />
boucle fermée périphérique. A l’origine de ce modèle, nous retrouvons aussi les travaux<br />
d’Eccles (1969) qui intro<strong>du</strong>it l’idée que le cervelet fonctionne comme un simu<strong>la</strong>teur de<br />
<strong>la</strong> boucle « commande-action-sensation-correction ». Ainsi cette simu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> boucle<br />
« commande-action-sensation-correction » opère un gain de temps par rapport à <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée d’un feedback réel mais ne correspond pas pour autant à un modèle à boucle<br />
ouverte. L’expérience de Lindblom et al. (1979) sur le /i/ pro<strong>du</strong>it avec un <strong>la</strong>rge bitebite-block<br />
de 22.5mm illustre parfaitement cette idée. L’information sensorielle<br />
revenant au système nerveux central constitue une nouvelle situation pour aider à <strong>la</strong><br />
genèse de <strong>la</strong> voyelle. De nouvelles questions émergent : comment sont recrutés les<br />
muscles adéquats et comment <strong>la</strong> qualité de <strong>la</strong> contraction muscu<strong>la</strong>ire peut elle être<br />
régulée automatiquement. La difficulté <strong>du</strong> système est de recruter les muscles activés en<br />
parole normale et de leur faire exécuter <strong>des</strong> contractions plus ou moins amples pour<br />
provoquer <strong>des</strong> configurations <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s différentes avec un même but. Une réponse<br />
à ces questions pourra aussi être fournie par l’existence <strong>des</strong> équivalences motrices.<br />
48
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
Figure n° 2.2: Schéma <strong>du</strong> modèle de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole par simu<strong>la</strong>tion prédictive de<br />
Lindblom et al.1977<br />
Il apparaît que <strong>la</strong> stratégie de simu<strong>la</strong>tion prédictive offre une approche intéressante pour<br />
les étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Ce modèle de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> présente<br />
l’avantage de pouvoir améliorer les performances sur <strong>des</strong> tâches non familières avec <strong>la</strong><br />
rapidité et <strong>la</strong> précision nécessaire à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole. Il permet au système de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de s’adapter à <strong>des</strong> perturbations.<br />
En résumé, ce modèle attractif présente une composante de simu<strong>la</strong>tion qui opère une<br />
confrontation entre les sensations afférentes réelles et leurs simu<strong>la</strong>tions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong><br />
commande motrice. Il permettrait donc un réajustement immédiat de <strong>la</strong> commande pour<br />
développer <strong>des</strong> réponses face à <strong>des</strong> situations nouvelles.<br />
2.3.1 Rôle <strong>des</strong> Modèles internes<br />
La conception <strong>du</strong> geste volontaire régi par l’apprentissage <strong>des</strong> modèles internes est<br />
attirante pour aborder <strong>la</strong> parole comme acte moteur. Comment le système moteur<br />
contrôle-t-il les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ? Comment suivent-ils une trajectoire<br />
acoustique ? Comment le locuteur est-il sûr que <strong>la</strong> trajectoire est bien suivie ? Une<br />
hypothèse serait de dire que <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole évite les problèmes de lenteur d’un<br />
contrôleur par feedback, grâce à l’utilisation <strong>des</strong> modèles internes. Avec les modèles<br />
49
internes, il n’y aurait pas besoin de feedback auditif direct <strong>dans</strong> le contrôle <strong>des</strong><br />
mouvements de parole. Les modèles internes sont appris <strong>du</strong>rant l’apprentissage avec<br />
l’aide <strong>des</strong> feedbacks auditifs, somato-sensoriels et visuels (Massion 2001). Le feedback<br />
auditif aide à maintenir les modèles internes et fournit <strong>des</strong> informations pour réguler les<br />
aspects suprasegmentaux (Laboissière et al. 1995). Le système de contrôle trouve un<br />
moyen d’expliquer les interactions entre les mécanismes suprasegmentaux et<br />
segmentaux : <strong>la</strong> trajectoire acoustique p<strong>la</strong>nifiée est influencée par les ajustements <strong>des</strong><br />
paramètres suprasegmentaux qui affectent l’intelligibilité. Nous savons bien que le<br />
locuteur utilise le feedback auditif pour évaluer les facteurs tels le bruit, <strong>la</strong> qualité de<br />
parole, <strong>la</strong> fréquence fondamentale. Cependant ce feedback auditif n’est pas employé<br />
pour les ajustements rapi<strong>des</strong> <strong>des</strong> postures et <strong>des</strong> mécanismes de respiration, <strong>du</strong> <strong>la</strong>rynx et<br />
<strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs supra-glottiques : c’est là un <strong>des</strong> rôles <strong>des</strong> modèles internes. Arrivés à<br />
maturation, les modèles internes deviennent plus précis et le feedback auditif est utilisé<br />
pour les maintenir stables. Le feedback auditif ne serait alors utilisé qu’avec<br />
intermittence. Les modèles internes directs sont une représentation <strong>du</strong> monde extérieur,<br />
<strong>du</strong> système musculo-squelettique et <strong>des</strong> interactions qui en résultent. Ainsi ils informent<br />
sur les caractéristiques prévisibles <strong>du</strong> mouvement. Ils sont prédictifs et évaluatifs, ils<br />
permettent de p<strong>la</strong>nifier l’action et de prévoir son déroulement. Pour un mouvement<br />
volontaire précis, le modèle interne permet l’analyse de <strong>la</strong> position <strong>dans</strong> l’espace en<br />
calcu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> position initiale d’un articu<strong>la</strong>teur et <strong>la</strong> trajectoire à établir pour atteindre <strong>la</strong><br />
cible demandée (par l’intermédiaire <strong>des</strong> réseaux corticaux associatifs).<br />
De ce modèle interne prédictif, se construisent <strong>des</strong> modèles internes inverses qui<br />
assurent les comman<strong>des</strong> muscu<strong>la</strong>ires appropriées afin de diriger le mouvement vers son<br />
but en façonnant les dép<strong>la</strong>cements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s (cinématique inverse) et les forces<br />
muscu<strong>la</strong>ires appropriées (dynamique inverse). Ainsi, l’exécution de <strong>la</strong> trajectoire <strong>du</strong><br />
mouvement repose sur les modèles internes inverses.<br />
A partir de l’existence de ces modèles internes, s’est fondée <strong>la</strong> théorie <strong>du</strong> point<br />
d’équilibre qui se base sur les propriétés visco-é<strong>la</strong>stiques <strong>des</strong> muscles. Perrier et al.<br />
(1996) ainsi que Laboissière et al. (1995) s’appuient sur <strong>la</strong> théorie <strong>du</strong> point d’équilibre<br />
pour expliquer le contrôle <strong>des</strong> mouvements <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Le cerveau<br />
dispose de modèles internes et donc de points d’équilibre ou points de stabilité vers<br />
lesquels les trajectoires <strong>du</strong> système sont attirées pour maintenir le système stable. Ces<br />
représentations permettent au système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de prédire les différentes<br />
50
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
configurations posturales. La commande centrale prévoit <strong>des</strong> postures nouvelles<br />
déterminées par <strong>des</strong> points d’équilibre définis par <strong>la</strong> contraction <strong>des</strong> muscles. Ces points<br />
d’équilibre ou points attracteurs <strong>du</strong> système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> définissent <strong>des</strong><br />
configurations posturales indépendamment de <strong>la</strong> dynamique (forces actives et forces<br />
passives d’interaction entre les segments qui peuvent faire changer <strong>la</strong> trajectoire<br />
initialement p<strong>la</strong>nifiée). Ainsi, les perturbations <strong>du</strong> système peuvent être minimisées par<br />
<strong>la</strong> raideur articu<strong>la</strong>ire et les circuits automatiques de correction.<br />
2.3.2 Les avantages de cette conception <strong>des</strong> modèles internes<br />
En résumé, nous pouvons dire que les modèles internes directs sont prédictifs et<br />
représentent l’état actuel de l’environnement et <strong>des</strong> positions <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Alors que<br />
les modèles internes indirects sont responsables de l’exécution <strong>du</strong> mouvement en<br />
fonction de <strong>la</strong> prédiction faite par le modèle interne direct. La commande centrale est le<br />
résultat de l’acquisition de modèles internes de l’environnement, <strong>des</strong> caractéristiques<br />
biomécaniques <strong>du</strong> corps et de leurs interactions. Cette conception <strong>des</strong> modèles internes<br />
insiste sur les propriétés biomécaniques <strong>du</strong> corps et sur les interactions de celui-ci avec<br />
l’extérieur. Les caractéristiques <strong>des</strong> forces externes sont déterminantes pour <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>des</strong> performances et le système nerveux central doit les apprendre pour<br />
pouvoir exercer son action. La commande nerveuse s’adapte aux contraintes<br />
mécaniques associées à l’exécution <strong>du</strong> mouvement par le jeu d’activation <strong>des</strong> muscles<br />
agonistes et antagonistes.<br />
Revenons sur l’idée de synergie. Nous avons vu qu’il existe <strong>des</strong> sous-ensembles<br />
fonctionnels muscu<strong>la</strong>ires régulés en bloc. Après l’apprentissage, les synergies<br />
permettent de corriger les effets d’une éventuelle perturbation : il y a anticipation de <strong>la</strong><br />
commande par rapport aux effets mécaniques qu’elle est susceptible de pro<strong>du</strong>ire.<br />
L’anticipation suppose que le système nerveux central a construit un modèle interne <strong>du</strong><br />
monde extérieur, <strong>des</strong> propriétés <strong>du</strong> corps et de leurs interactions qui permet de prédire<br />
les effets de <strong>la</strong> commande adéquate. Tout porte à penser que les modèles internes<br />
participent à <strong>la</strong> boucle de simu<strong>la</strong>tion prédictive <strong>du</strong> modèle de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole de<br />
Lindblom (1971, 1977, 1979) : les anticipations et les réajustements peuvent être<br />
réalisés rapidement grâce à l’existence <strong>des</strong> modèles internes. Les stratégies de<br />
51
<strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s pourraient être alors générées à partir de cette boucle de<br />
simu<strong>la</strong>tion prédictive.<br />
2.4 Structures coordinatives et équivalences fonctionnelles<br />
2.4.1 Structures coordinatives<br />
2.4.1.1 La co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
Fowler et al. (1980, 1995) présentent une théorie de <strong>la</strong> co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. A l’origine de<br />
cette théorie, se trouvent les notions de synergie et de coordination entre les<br />
articu<strong>la</strong>teurs. Le pilier de cette théorie de <strong>la</strong> co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> est <strong>la</strong> notion de structures<br />
coordinatives. Si l’action d’un articu<strong>la</strong>teur est neutralisée, les autres articu<strong>la</strong>teurs vont<br />
subir une réorganisation spatio-temporelle de manière à atteindre ensemble <strong>la</strong> cible<br />
visée. Les structures coordinatives révèlent <strong>des</strong> dépendances fonctionnelles entre les<br />
articu<strong>la</strong>teurs. Par exemple, prenons <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une consonne bi<strong>la</strong>biale exigeant le<br />
geste de fermeture <strong>la</strong>biale. Un lien fonctionnel est établi entre <strong>la</strong> lèvre supérieure, <strong>la</strong><br />
lèvre inférieure et <strong>la</strong> mâchoire. Une diminution de <strong>la</strong> contribution d’un articu<strong>la</strong>teur est<br />
automatiquement compensée par l’augmentation de <strong>la</strong> contribution d’un autre.<br />
Les manœuvres compensatoires trouvent leur racine <strong>dans</strong> <strong>la</strong> coordination entre<br />
articu<strong>la</strong>teurs pour pro<strong>du</strong>ire un but gestuel. Pour expliquer <strong>la</strong> co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> entre les<br />
gestes, il est évident qu’il est préférable de se fonder sur l’idée de coordination entre les<br />
articu<strong>la</strong>teurs. Le chevauchement entre les gestes est le reflet de <strong>la</strong> coordination<br />
temporelle exprimée comme étant un phasage inter-gestuel. Le phasage entre les gestes<br />
est contrôlé à un niveau de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification : si on note un agrandissement <strong>du</strong><br />
chevauchement inter-gestuel, on observera une baisse <strong>des</strong> <strong>du</strong>rées segmentales et les<br />
effets de <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion seront moindres. Les changements quantitatifs <strong>du</strong><br />
chevauchement peuvent justifier <strong>des</strong> différences de coarticu<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> parole lente et<br />
<strong>la</strong> parole rapide. Le plus souvent, les processus de parole continue, comme<br />
l’assimi<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> ré<strong>du</strong>ction vocalique ou <strong>la</strong> délétion, sont <strong>du</strong>s à <strong>des</strong> modifications telles<br />
que <strong>la</strong> diminution de <strong>la</strong> magnitude <strong>du</strong> geste et/ou l’augmentation <strong>du</strong> chevauchement<br />
temporel (Browman et Goldstein 1992, Farnetani et al. 1999). Par exemple, sur le p<strong>la</strong>n<br />
52
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
spatial, Fowler et Saltzman (1993) ont étudié <strong>la</strong> séquence /VbV/. Sur cette séquence, les<br />
gestes de constriction consonantique et vocalique impliquent plusieurs articu<strong>la</strong>teurs: le<br />
corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et les lèvres dont l’action est portée par <strong>la</strong> mâchoire. Les gestes<br />
vocaliques ont besoin à <strong>la</strong> fois <strong>du</strong> dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et de <strong>la</strong> mâchoire. L’effet de cette<br />
interférence est un changement <strong>du</strong> lieu de constriction. L’idée générale de <strong>la</strong><br />
co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> vue par ces auteurs est de dire que les gestes mé<strong>la</strong>ngent leurs influences<br />
sur l’articu<strong>la</strong>teur standard avec <strong>des</strong> sorties variées possibles.<br />
2.4.1.2 La théorie de l’action<br />
Fowler et Turvey (1980) montrent que les phénomènes de <strong>compensation</strong> s’interprètent<br />
mieux à <strong>la</strong> lumière de <strong>la</strong> théorie de l’action. La théorie de l’action fait aussi référence à<br />
un ensemble de muscles participant à une fonction et qui forment une structure<br />
autonome à l’intérieur de <strong>la</strong>quelle chaque mouvement est régi par une ou plusieurs<br />
équations de contraintes internes jouant sur les voies efférentes et afférentes. Les<br />
auteurs voient <strong>la</strong> notion de structures coordinatrices comme <strong>la</strong> conception <strong>la</strong> plus<br />
adéquate pour <strong>la</strong> <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> unités phonologiques comme <strong>des</strong> unités de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
et pour expliquer <strong>la</strong> variabilité. Il est difficile d’expliquer les réajustements immédiats<br />
(<strong>compensation</strong>s) si l’on s’en tient aux théories traditionnelles de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Il est<br />
légitime d’envisager un mécanisme de contrôle et d’exécution basé sur un ensemble de<br />
muscles qui s’ajustent en fonction de l’état de chacun. Cet ensemble fonctionnerait par<br />
autorégu<strong>la</strong>tion interne (Bonnot et Bothorel 1989). Tuller et al. (1979) voient <strong>dans</strong> ces<br />
synergies un comportement typique d’un système masse-ressort qui serait<br />
intrinsèquement équilibré <strong>dans</strong> le sens où chaque cible finale est atteinte en regard de<br />
l’état <strong>des</strong> modalités initiales. S’agissant d’un système de ressorts supportant une masse,<br />
<strong>la</strong> modification de <strong>la</strong> tension de l’un <strong>des</strong> ressorts a pour conséquence le dép<strong>la</strong>cement <strong>du</strong><br />
centre de gravité <strong>du</strong> système. Les re<strong>la</strong>tions tension-longueur entre les ressorts modifient<br />
les positions résultantes, mais pas les coordonnées spatiales, ni <strong>la</strong> trajectoire <strong>du</strong><br />
mouvement. Du point de vue de <strong>la</strong> dynamique, leur expérience montre que l’ab<strong>la</strong>tion ou<br />
<strong>la</strong> ré<strong>du</strong>ction de certaines sources afférentes ne dérange pas forcément <strong>la</strong> capacité d’un<br />
collectif de muscle à atteindre un état stable grâce au fait que le système soit justement<br />
autorégulé.<br />
53
2.4.2 Equivalences fonctionnelles<br />
MacNei<strong>la</strong>ge (1970) présente une théorie d’équivalence motrice, inspirée <strong>des</strong> idées de<br />
Hebb (1961) qui défini le phénomène psychologique appelé « équivalence motrice »<br />
comme «… a variability of specific muscu<strong>la</strong>r response, with circumstance, in such a<br />
way as to pro<strong>du</strong>ce a single result …» (Hebb, 1961, pp.153-154). Cette théorie se base<br />
sur l’existence de structures coordinatives. La notion d’équivalence motrice renvoie au<br />
recrutement de plusieurs articu<strong>la</strong>teurs pour atteindre une seule cible acoustique<br />
invariante. Un <strong>des</strong> exemples qui illustrent parfaitement cette notion est appelé le «pipe<br />
speech» chez les fumeurs de pipe. C’est une capacité <strong>du</strong> locuteur à parler bien que<br />
l’activité de l’un de ses articu<strong>la</strong>teurs supra-glottique soit altérée. Pour chaque segment<br />
particulier, le locuteur peut montrer <strong>des</strong> formes <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal correspondant à<br />
différentes positions. Dans le cerveau, nous l’avons vu, nous avons une représentation<br />
spatiale <strong>des</strong> zones <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal, grâce notamment aux modèles internes. Pour<br />
atteindre une cible voulue, le locuteur doit ajuster <strong>des</strong> positions variées <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs<br />
vers <strong>la</strong> position cible. Cette théorie pose <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole comme étant un<br />
système à boucle ouverte, avec une série de cibles spécifiées à l’avance. Ce concept de<br />
cible est explicité aussi par Lindblom (1971, 1977) à partir de ses expériences sur les<br />
ré<strong>du</strong>ctions vocaliques en terme de fréquence de formant (cible acoustique). Le locuteur<br />
vise <strong>des</strong> cibles acoustiques invariantes mais il se peut qu’elles soient dép<strong>la</strong>cées lors d’un<br />
débit de parole rapide. Le locuteur est capable de rétablir les cibles <strong>des</strong> voyelles et ainsi<br />
de se corriger. La cible est une idéalisation psychologique de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong><br />
voyelle. Pour Perkell et al. (1994), le but <strong>du</strong> locuteur est d’être compris et <strong>la</strong> cible serait<br />
donc premièrement acoustique. Les cibles spatiales peuvent varier puisque différentes<br />
configurations <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it peuvent pro<strong>du</strong>ire à un même phonème. Par contre, les cibles<br />
perceptuelles seront les mêmes grâce aux représentations internes de l’espace perceptif<br />
auditif. Le cerveau utilise <strong>des</strong> règles re<strong>la</strong>tives à ces représentations spatiales et auditives<br />
pour calculer <strong>la</strong> commande motrice nécessaire à l’atteindre d’une cible depuis l’état<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> stable. Perkell et al (1993 et 2000), <strong>dans</strong> leur étude sur les répétitions <strong>du</strong><br />
/u/, observent que l’élévation <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, couplée à l’arrondissement <strong>des</strong><br />
lèvres contribue à faire baisser les valeurs de F2. Ils soulignent l’existence de<br />
contraintes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s par le fait que les locuteurs rétractent <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue vers une<br />
constriction pa<strong>la</strong>to-vé<strong>la</strong>ire. Ils suggèrent qu’il est physiquement difficile de pro<strong>du</strong>ire une<br />
constriction <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie vélo-pharyngale <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it et c’est pour ce<strong>la</strong> que les<br />
54
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 2 : Compensations et structures coordinatives.<br />
locuteurs font leur constriction <strong>du</strong> /u/ <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie pa<strong>la</strong>to-vé<strong>la</strong>ire. Pour ces auteurs,<br />
cette stratégie relèverait plus d’une préférence <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, peut être liée à <strong>la</strong> loi <strong>du</strong><br />
moindre effort, que d’une limitation physiologique.<br />
Une autre expérience de Guenther et collègues (1999) sur l répétition <strong>du</strong> /r/ a permis de<br />
conclure sur deux positions de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue pour pro<strong>du</strong>ire /r/. Les sept sujets présentent une<br />
re<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> longueur de <strong>la</strong> cavité antérieure et <strong>la</strong> longueur de <strong>la</strong> zone de<br />
constriction, ce qui permettrait de maintenir un F3 assez bas, caractéristique <strong>du</strong> /r/.<br />
Ainsi, <strong>la</strong> cible acoustique est achevée par différentes configurations de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>dans</strong><br />
différentes situations. Se basant sur ces observations, ils en concluent que <strong>la</strong> cible est<br />
plus acoustique qu’<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>.<br />
Deux constrictions contrôlées et indépendantes <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal peuvent atteindre<br />
<strong>la</strong> même cible acoustique par le biais <strong>des</strong> équivalences motrices. Ces équivalences<br />
motrices articulo-acoustiques véhiculent l’idée que les cibles acoustiques sont <strong>des</strong><br />
variables contrôlées en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Un mécanisme de contrôle qui utilise les re<strong>la</strong>tions<br />
d’équivalence motrice augmenterait <strong>la</strong> stabilité acoustique, particulièrement <strong>dans</strong> <strong>des</strong><br />
situations ou une telle stabilité ne résulte pas d’un effet de saturation. Quand de forts<br />
effets de saturation biomécaniques ou acoustiques existent, il y a une moindre nécessité<br />
à ce que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion d’équivalence motrice préserve <strong>la</strong> stabilité acoustique.<br />
Perkell et al. (2000) argumentent en faveur <strong>des</strong> équivalences motrices mais envisagent<br />
le contrôle moteur de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole comme un regroupement de principes<br />
essentiels pour l’atteinte <strong>des</strong> cibles acoustiques.<br />
(i) L’effet de saturation aide à définir <strong>des</strong> cibles acoustiques et simplifie le contrôle<br />
moteur. Les cibles sont aussi déterminées en partie par l’effet de saturation défini<br />
comme une re<strong>la</strong>tion non linéaire entre le degré d’activation <strong>des</strong> muscles et les fonctions<br />
d’aire <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal. Il existe un effet de saturation biomécanique lorsqu’un<br />
articu<strong>la</strong>teur entre en contact avec un autre. Les changements continus <strong>des</strong> comman<strong>des</strong><br />
motrices <strong>des</strong> muscles con<strong>du</strong>isent à une saturation ou stabilisation de <strong>la</strong> position <strong>des</strong><br />
articu<strong>la</strong>teurs, d’où une saturation ou stabilisation <strong>des</strong> paramètres acoustiques. Ainsi, cet<br />
effet de saturation biomécanique peut aider à atteindre une cible acoustique stable pour<br />
<strong>la</strong> voyelle /i/ fermée mais aussi au moment <strong>du</strong> barrage pour les consonnes obstruantes<br />
(les plus résistantes face à d’éventuelles dégradations), malgré d’éventuelles variabilités<br />
<strong>dans</strong> l’entrée motrice. Par exemple, en pressant les côtés <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
fermement sur le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r on obtient une fonction d’aire stable <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal <strong>dans</strong><br />
55
<strong>la</strong> région pa<strong>la</strong>tale qui correspondrait aux patrons formantiques de <strong>la</strong> voyelle /i/<br />
(contraction <strong>du</strong> genioglossus postérieur pour réaliser <strong>la</strong> pression). Cependant, certains<br />
sons tels que les voyelles centrales ou ouvertes ne sont pas caractérisées par un effet de<br />
saturation biomécanique. Ces sons sont réalisés plus <strong>la</strong>rgement de façon plus variable et<br />
sont plus sujets aux distorsions, par dégradation <strong>dans</strong> leurs modèles internes.<br />
(ii) Le système nerveux central contrôle <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> en se basant sur les modèles<br />
internes <strong>des</strong> re<strong>la</strong>tions entre les formes <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal et leurs conséquences<br />
acoustiques.<br />
(iii) La re<strong>la</strong>tion entre les variations temporelles <strong>des</strong> comman<strong>des</strong> motrices et les<br />
caractéristiques cinématiques <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s est influencée par les<br />
contraintes biomécaniques : collision inter-articu<strong>la</strong>teur, anatomie indivi<strong>du</strong>elle,<br />
propriétés dynamiques <strong>du</strong> systèmes. Les contraintes biomécaniques sont prises en<br />
compte quand a lieu <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>du</strong> mouvement pour <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de séquences de<br />
sons. Ces contraintes peuvent aussi justifier un comportement proche <strong>du</strong> principe<br />
d’économie de l’effort.<br />
Un système dynamique tel celui de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole semble être gouverné par<br />
plusieurs mécanismes complexes qui opèrent de concert. Un mécanisme de simu<strong>la</strong>tion<br />
prédictive anticipe les situations (Lindblom et al. 1979) avec l’assistance d’un feedback<br />
périphérique en boucle fermée (par les récepteurs tactile sur les articu<strong>la</strong>teurs) (Abbs,<br />
1986). Nous soulignons l’existence de structures coordinatives comme seules unités<br />
auto-régulées pour permettre <strong>des</strong> réajustements immédiats. Le principe d’équivalence<br />
motrice, couplé à l’effet de saturation et à <strong>la</strong> loi <strong>du</strong> moindre effort, influence les<br />
trajectoires <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s à travers l’espace acoustique et les cibles acoustiques. Quand<br />
<strong>la</strong> trajectoire acoustique aboutit sur une fermeture <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal, les contraintes<br />
biomécaniques, les propriétés <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs puis l’effet de saturation, entrent en jeu.<br />
56
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
CHAPITRE 3<br />
Compensations et complexe mâchoire/<strong>la</strong>ngue<br />
Dans cette partie, nous présentons <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> utilisant une méthodologie basée sur<br />
l’utilisation de perturbations expérimentales dynamiques ou statiques. Différents<br />
moyens d’analyse sont exposés et pas seulement les analyses <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, toujours <strong>dans</strong><br />
le but d’étudier les phénomènes de <strong>compensation</strong>. Nous invitons le lecteur à se référer<br />
aussi au tableau de l’annexe 1 pour un recensement plus exhaustif <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> concernant<br />
les perturbations expérimentales.<br />
3.1 Les <strong>compensation</strong>s <strong>dans</strong> les étu<strong>des</strong> antérieures<br />
La littérature concernant le contrôle moteur de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole est axée<br />
notamment sur l’importance de <strong>la</strong> variabilité et de <strong>la</strong> dépendance <strong>du</strong> contexte. Beaucoup<br />
de théories de l’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> parole (contrôle moteur) intro<strong>du</strong>isent, <strong>la</strong> notion<br />
d’équivalence motrice c'est-à-dire que plusieurs patrons de réponses muscu<strong>la</strong>ires<br />
peuvent être orientés vers un seul et même mouvement. Cette capacité <strong>du</strong> système<br />
expliquerait l’ensemble <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>tions compensatoires issues de perturbations <strong>dans</strong><br />
l’environnement oral.<br />
Les étu<strong>des</strong> concernant les phénomènes de <strong>compensation</strong> se sont révélées fondamentales<br />
pour l’analyse <strong>des</strong> processus de parole, dès les années 70. C’est alors le début de <strong>la</strong><br />
conceptualisation <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s en tant que phénomène omniprésent <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole. Abbs (Abbs et al. 1984) nous affirme qu’il suffit de parler pour<br />
que les échanges fonctionnels inter-<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s s’opèrent constamment et<br />
spontanément. Cette nature compensatoire ne peut être expliquée ni par le modèle de<br />
boucle ouverte, ni par le modèle de boucle fermée seulement.<br />
Le premier modèle qui tient compte <strong>des</strong> phénomènes de <strong>compensation</strong> est le modèle de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> par prédiction de Lindblom, Lubker et Mc Allister (1977) Il est le résultat de<br />
plusieurs expériences. La première est menée en 1971 par Lindblom et Sunberg<br />
(Lindblom et Sunberg 1971) qui développent un modèle <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> <strong>des</strong> corré<strong>la</strong>ts<br />
59
acoustiques <strong>des</strong> voyelles <strong>du</strong> suédois. La plupart <strong>des</strong> auteurs préconisent qu’il existe <strong>des</strong><br />
possibilités de <strong>compensation</strong> à chaque niveau de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> : <strong>des</strong> configurations<br />
muscu<strong>la</strong>ires différentes (Abbs et Gracco 1984), <strong>des</strong> positions <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s différentes<br />
(Lindblom et Sunberg 1971), et une géométrie différente <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal (Maeda<br />
1990), qui peuvent être à priori associées à un seul patron formantique. Face à ces<br />
nombreuses possibilités, les difficultés à comprendre les stratégies de contrôle de <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole sont réelles. Concernant <strong>la</strong> nature <strong>des</strong> paramètres contrôlés, on<br />
peut se demander auquel de ces niveaux ils sont re<strong>la</strong>tifs. Cette question est directement<br />
liée au débat sur <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> cible et aux interprétations <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> avec <strong>des</strong><br />
perturbations, dynamiques ou statiques.<br />
3.1.1 Les étu<strong>des</strong> avec perturbation dynamique<br />
Certaines étu<strong>des</strong> examinent les <strong>compensation</strong>s en intro<strong>du</strong>isant <strong>des</strong> perturbations<br />
dynamiques sur les articu<strong>la</strong>teurs de <strong>la</strong> parole. Dans l’étude de Kelso et al. (1984), une<br />
masse a été attachée à <strong>la</strong> mandibule et est activée par l’expérimentateur aux dépens <strong>du</strong><br />
locuteur. Les réponses compensatoires de <strong>la</strong> lèvre inférieure, de <strong>la</strong> lèvre supérieure et de<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sont examinées avec <strong>des</strong> enregistrements électromyographiques. Les<br />
expérimentateurs tirent <strong>la</strong> mâchoire vers le bas <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une fricative<br />
dentale. Ils remarquent un renforcement de l’activité <strong>du</strong> muscle génioglosse 20 à 30 ms<br />
après le début de <strong>la</strong> perturbation. De <strong>la</strong> même manière, lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une<br />
consonne bi<strong>la</strong>biale, l’activité de <strong>la</strong> lèvre supérieure est renforcée 35 à 60 ms après le<br />
début de <strong>la</strong> perturbation. Ce retard n’est pas fixe, mais dépend <strong>du</strong> moment où <strong>la</strong><br />
perturbation agit en re<strong>la</strong>tion avec le début de l’activité de <strong>la</strong> lèvre supérieure (Abbs et<br />
Gracco 1984). Un court retard implique que les réponses ne sont pas <strong>du</strong>es à un<br />
processus lié au temps de réaction les sujets puisqu’ils ne sont pas conscients de leurs<br />
<strong>compensation</strong>s. Les auteurs précédemment cités s’accordent à dire que les<br />
<strong>compensation</strong>s sont fonctionnelles et flexibles. Les réponses ne sont pas stéréotypées<br />
mais adaptées aux exigences de l’acte moteur en cours. Par exemple, si <strong>la</strong> mâchoire est<br />
tirée au moment de <strong>la</strong> transition entre une voyelle et une occlusive bi<strong>la</strong>biale, alors les<br />
réponses compensatoires sont observées en ce qui concerne les deux lèvres. Une telle<br />
réponse cherche à atteindre <strong>la</strong> cible de l’acte moteur, c’est-à-dire <strong>la</strong> fermeture bi<strong>la</strong>biale.<br />
Si <strong>la</strong> mâchoire est tirée au moment de <strong>la</strong> transition entre une voyelle et une consonne<br />
60
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
dentale, <strong>la</strong> réponse srea trouvée <strong>dans</strong> l’activité essentielle de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue pour effectuer <strong>la</strong><br />
constriction.<br />
Munhall et al. (1994) tirent <strong>la</strong> lèvre inférieure pendant <strong>la</strong> transition entre /i/ et le premier<br />
/p/ <strong>dans</strong> <strong>la</strong> séquence /ipip/. Ils ont enregistré <strong>la</strong> pression intra-orale pour montrer qu’en<br />
situation perturbée, <strong>la</strong> coordination normale entre les gestes oraux et <strong>la</strong>ryngaux est<br />
interrompue au moment <strong>du</strong> relâchement de l’occlusion. Ils observent que le système est<br />
capable de réaliser l’occlusion exigée en augmentant <strong>la</strong> pression d’air <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité<br />
orale. Ainsi, le phasage entre les gestes oraux et <strong>la</strong>ryngaux est un principe crucial pour<br />
maintenir l’intégrité d’un segment. Leur conclusion est que <strong>la</strong> coordination normale<br />
entre les gestes oraux et <strong>la</strong>ryngaux est interrompue au moment <strong>du</strong> relâchement de<br />
l’occlusion et que les <strong>compensation</strong>s sont effectives : c’est-à-dire que <strong>la</strong> cible prévue par<br />
l’acte moteur est atteinte. Avec <strong>la</strong> perturbation, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> voyelle précédant <strong>la</strong><br />
consonne est allongée. Cet allongement est reflété par un retard <strong>du</strong> geste d’ab<strong>du</strong>ction de<br />
<strong>la</strong> glotte. Ils confirment ainsi les résultats obtenus par Folkins et Abbs en 1976. Le but<br />
de l’activité motrice qu’est <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole est de pro<strong>du</strong>ire un signal acoustique<br />
qui transmet l’information. Dans les occurrences perturbées, aucune déviation<br />
acoustique sail<strong>la</strong>nte n’est perceptible.<br />
Oha<strong>la</strong> (2003) intro<strong>du</strong>it <strong>des</strong> perturbations aérodynamiques selon deux techniques : un<br />
tube coincé entre les joues et les mo<strong>la</strong>ires supérieures (the buccal vent method), un<br />
cathéter <strong>dans</strong> le pharynx par voie nasale (the nasal vacuum method). Avec les deux<br />
métho<strong>des</strong> de perturbation, il observe que <strong>la</strong> pression pharyngale est plus basse <strong>dans</strong> le<br />
cas <strong>des</strong> consonnes voisées. Les variations de F0 <strong>des</strong> voyelles suivant les consonnes<br />
voisées et non voisées ne sont pas significativement affectées par les perturbations<br />
aérodynamiques. (variation de <strong>la</strong> pression trans-glottale) Il en conclut que <strong>la</strong> tension <strong>des</strong><br />
cor<strong>des</strong> vocales jouerait un plus grand rôle <strong>dans</strong> les différences de contours de F0 que les<br />
variations de <strong>la</strong> pression à travers <strong>la</strong> glotte. Ses résultats préliminaires montrent que les<br />
variations phonétiques seraient <strong>du</strong>es aux variations de <strong>la</strong> pression trans-glottique ou à<br />
<strong>des</strong> variations de <strong>la</strong> pression <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité buccale. Il souligne aussi que certaines<br />
variations contextuelles peuvent être <strong>du</strong>es à <strong>des</strong> causes physiques et phonétiques.<br />
61
3.1.2 Les étu<strong>des</strong> avec perturbation statique : les bite-blocks<br />
Les étu<strong>des</strong> sur <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole avec <strong>des</strong> bite-blocks qui ré<strong>du</strong>isent les<br />
mouvements de <strong>la</strong> mâchoire s’accordent à indiquer que les locuteurs peuvent<br />
rapidement ajuster les mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue ou <strong>des</strong> lèvres. Si les bite-blocks<br />
perturbent réellement <strong>la</strong> position de <strong>la</strong> mâchoire inférieure, ils n’empêchent pas les<br />
effecteurs finaux, tels <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue ou les lèvres, d’atteindre les configurations<br />
géométriques <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal nécessaires aux constrictions propres à <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong><br />
segments phonétiques.<br />
Une <strong>des</strong> plus anciennes étu<strong>des</strong> acoustiques est celle de Lindblom et Sunberg (1971). La<br />
position de <strong>la</strong> mâchoire détermine <strong>la</strong> valeur <strong>des</strong> trois premiers formants : plus<br />
l’ouverture de <strong>la</strong> mâchoire est grande, plus les valeurs de formants augmentent (surtout<br />
notable sur F1). Leurs prédictions, par rapport à leur modèle, sont testées en étudiant les<br />
spectres <strong>des</strong> voyelles pro<strong>du</strong>ites et enregistrées avec <strong>des</strong> bite-blocks, ce qui oblige les<br />
locuteurs à parler avec un écart inter-incisives non naturel. Les auteurs ont choisi un<br />
bite-block est de 2,5 mm d’épaisseur pour les voyelles /a/ et /o/ (l’écart est plus étroit<br />
que de coutume pour leur réalisation), et un bite-block de 22,5 mm d’épaisseur pour les<br />
voyelles /i/ et /u/ (l’écart plus <strong>la</strong>rge que de coutume pour leur réalisation). Malgré une<br />
ouverture inhabituelle de <strong>la</strong> mâchoire, les spectres <strong>des</strong> voyelles avec bite-block sont<br />
analogues à ceux sans bite-block. Pour que cette rapidité soit effective, différentes<br />
postures possibles de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et autres articu<strong>la</strong>teurs supra-glottiques ont pu être<br />
utilisées. Les spectrogrammes analysés écartent <strong>la</strong> possibilité qu’un feedback auditif<br />
puisse être utilisé pour effectuer une <strong>compensation</strong> directe. De plus, les réalisations<br />
optimales <strong>des</strong> voyelles suédoises peuvent être obtenues en l’absence de feedback tactile,<br />
par blocage <strong>des</strong> récepteurs buccaux, et ceci, sans entraînement. Ainsi, le processus<br />
moteur utilise un contrôle prédictif pour développer de nombreux profils <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
appropriés aux changements de <strong>la</strong> position de <strong>la</strong> mandibule : <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> est<br />
immédiate et ne nécessite aucun apprentissage, ni de feedback auditif et tactile.<br />
Warren et al. (1980) étudient les fricatives /s, f, v, z/, avec bite-blocks et masquage<br />
auditif. Généralement, <strong>des</strong> adaptations sont pro<strong>du</strong>ites de façon satisfaisante puisque <strong>la</strong><br />
dimension de l’orifice vélo-pharyngé reste constante quels que soient les aspects<br />
expérimentaux et les degrés d’ouverture (tailles <strong>des</strong> bite-blocks). Par contre, concernant<br />
le phonème /s/, ces adaptations sont moins précises, surtout en cas de masquage auditif<br />
et le taux d’erreurs s’accroît avec l’augmentation de l’ouverture de <strong>la</strong> mâchoire. Les<br />
62
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
adaptations sont améliorées avec le temps sur les conversations sans masquage auditif.<br />
Pour ces auteurs, à l’image <strong>du</strong> modèle de Lindblom et al.(1979), c’est le contrôle<br />
continu qui permet d’anticiper un problème de modification spatiale et d’initier une<br />
tactique de <strong>compensation</strong> structurale précédant <strong>la</strong> phonation.<br />
Gay, Lindblom et Lubker (1981) vont <strong>dans</strong> le même sens en montrant que pour les<br />
voyelles /i/ et /u/ <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> est plus évidente. Les formants <strong>des</strong> voyelles pro<strong>du</strong>ites<br />
avec bite-blocks sont très proches <strong>des</strong> formants <strong>des</strong> voyelles en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale.<br />
Leurs données X-ray montrent cependant <strong>des</strong> configurations différentes <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it<br />
vocal avec les bite-blocks. La constriction pour /i/ est préservée, notamment par un<br />
mouvement de « super-pa<strong>la</strong>talisation » de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (contraction plus forte <strong>du</strong><br />
génioglosse) et par le recul de l’os hyoïde. Ils observent aussi un mouvement<br />
compensatoire d’arrondissement <strong>des</strong> lèvres et une baisse de <strong>la</strong> hauteur <strong>du</strong> <strong>la</strong>rynx sur <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>des</strong> voyelles /u/ et /o/ perturbées. La plus minime différence entre les deux<br />
conditions se note au point de constriction maximale, c’est à ce moment que <strong>la</strong><br />
<strong>compensation</strong> serait <strong>la</strong> plus complète. Leur conclusion est que les écarts non compensés<br />
par rapport aux positions normales sont aux points où l’aire <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal est <strong>la</strong> plus<br />
grande. La <strong>compensation</strong> serait sélective. Ces auteurs estiment que leurs données<br />
argumentent en faveur d’un mécanisme d’atteinte de cible perceptuelle. L’étroite<br />
constriction pourrait fournir une augmentation de l’excitation sensorielle entre les<br />
récepteurs tactiles, ce qui pourrait faciliter l’atteinte de <strong>la</strong> cible.<br />
Folkins et Zimmerman (1981) ont effectué une stimu<strong>la</strong>tion électrique <strong>des</strong> muscles qui<br />
abaissent les lèvres pendant <strong>la</strong> transition d’une voyelle et d’une consonne occlusive<br />
bi<strong>la</strong>biale /pQ/, séquence répétée en série. L’activité <strong>des</strong> muscles de <strong>la</strong> mâchoire est<br />
enregistrée par électromyographie avec et sans bite-block. La présence d’un bite-block<br />
n’élimine pas l’activité <strong>du</strong> masseter et <strong>des</strong> ptérygoïdiens (le ptérygoïdien <strong>la</strong>téral est<br />
responsable <strong>du</strong> mouvement d’avancement de <strong>la</strong> mandibule et le ptérygoïdien médial est<br />
responsable <strong>du</strong> mouvement d’élévation). La <strong>du</strong>rée de l’occlusion est augmentée de 300<br />
à 500 ms. Le résultat de l’activité muscu<strong>la</strong>ire est identique avec et sans bite-block. Les<br />
auteurs cités ci-<strong>des</strong>sus en dé<strong>du</strong>isent qu’une réorganisation complète de l’activité motrice<br />
aurait pour effet <strong>la</strong> suppression de toute activité muscu<strong>la</strong>ire inutile. La contraction<br />
muscu<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> mâchoire existe bien même s’il est évident que <strong>la</strong> force muscu<strong>la</strong>ire ne<br />
suffit pas à bouger <strong>la</strong> mâchoire. Ces résultats infirment l’existence d’une stratégie<br />
centrale de simu<strong>la</strong>tion qui coordonne l’action <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs lèvre et <strong>la</strong>ngue avec<br />
63
l’action de <strong>la</strong> mâchoire. Si les mouvements compensatoires de <strong>la</strong> lèvre et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue,<br />
<strong>dans</strong> les expériences en bite-blocks, sont accomplis par une réorganisation centrale <strong>du</strong><br />
mouvement, alors on s’attend à ce que cette simu<strong>la</strong>tion centrale modifie aussi les<br />
patrons de l’activité <strong>des</strong> muscles de <strong>la</strong> mâchoire. Ainsi, quand <strong>la</strong> mâchoire est fixée, <strong>la</strong><br />
simu<strong>la</strong>tion centrale devrait éliminer l’activité muscu<strong>la</strong>ire inefficace. Si les mouvements<br />
compensatoires de <strong>la</strong> lèvre et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sont contrôlés à un niveau périphérique, les<br />
patrons d’activité <strong>des</strong> muscles de <strong>la</strong> mâchoire ne sont pas nécessairement influencés par<br />
le blocage de <strong>la</strong> mâchoire. Folkins et Zimmerman appuient l’importance <strong>des</strong><br />
mécanismes périphériques <strong>dans</strong> le contrôle <strong>des</strong> mouvements compensatoires <strong>des</strong> lèvres<br />
et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Cette étude, ainsi que d’autres travaux de Folkins (Folkins et Lindville 1983) expliquent<br />
les coordinations inter-articu<strong>la</strong>teurs par l’existence d’un système de contrôle moteur à<br />
un niveau périphérique. Une interprétation de leurs résultats est que le processus<br />
neuromoteur périphérique n’implique pas de simu<strong>la</strong>tion centrale et les procé<strong>du</strong>res<br />
d’erreur-correction sont importantes pour <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>des</strong> lèvres et<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Putnam, Shelton et Kastner (1986) mesurent les changements de pression sous glottique<br />
<strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une fricative sourde alvéo<strong>la</strong>ire <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> réalisation de <strong>la</strong> syl<strong>la</strong>be<br />
/si/ avec et sans bite-block. Ils observent que le flux d’air oral augmente avec<br />
l’accroissement <strong>des</strong> bite-blocks qui augmentent <strong>la</strong> l’ouverture buccale. La pression<br />
intra-orale, par contre, ne montre pas de changements pertinents. Le flux d’air émis<br />
<strong>du</strong>rant <strong>la</strong> voyelle /i/ ne subit pas systématiquement les effets <strong>des</strong> bite-blocks mais <strong>des</strong><br />
changements sont observés en fonction <strong>des</strong> performances <strong>des</strong> locuteurs. Ils confirment<br />
aussi les expériences de Warren et al. (1980, 1984) sur <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>du</strong> /s/ avec biteblock<br />
<strong>dans</strong> lesquelles les pressions d’air sont gardées re<strong>la</strong>tivement constantes. Les<br />
ajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont possibles pour normaliser les conditions aéromécaniques<br />
et l’habileté à compenser une ouverture plus grande de <strong>la</strong> mâchoire par <strong>la</strong><br />
pression intra- orale est variable selon les locuteurs.<br />
L’étude de McFar<strong>la</strong>nd et Baum (1995) porte sur les voyelles /i, u, a/ et les consonnes /p,<br />
t, k, s/ <strong>du</strong> français <strong>du</strong> Québec. Ils ont effectué leurs enregistrements tout de suite après<br />
l’insertion <strong>du</strong> bite-block et après 15 min de pratique. Pour ces auteurs, les<br />
<strong>compensation</strong>s ne sont ni immédiates, ni complètes <strong>dans</strong> le sens où ils observent de<br />
petites différences significatives en ce qui concerne les paramètres acoustiques <strong>des</strong><br />
64
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
voyelles et <strong>des</strong> consonnes pro<strong>du</strong>ites en condition normale et avec bite-block. Avec bitebite-block,<br />
<strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> bruit de friction <strong>du</strong> /s/ non voisé est plus courte alors que le bruit<br />
de friction <strong>du</strong> /s/ est plus long sans bite-block. Pour les voyelles, les valeurs de F1 et de<br />
F2 (surtout pour /u/) sont relevées avec les bite-blocks. La constriction incomplète <strong>du</strong><br />
con<strong>du</strong>it vocal et l’agrandissement de <strong>la</strong> cavité antérieure font augmenter les valeurs<br />
formantiques. Les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> voyelles et <strong>des</strong> consonnes ne sont pas grandement<br />
affectées par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks. Il en va de même concernant les résultats de<br />
Flege et al. (1988) qui ne rapportent pas d’effet significatif <strong>des</strong> bite-blocks sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée<br />
de [e]. La <strong>compensation</strong> serait incomplète <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où les stratégies se<br />
développent avec le temps. McFar<strong>la</strong>nd et Baum (1995) observent que les valeurs<br />
formantiques <strong>des</strong> voyelles pro<strong>du</strong>ites avec bite-block sont plus proches <strong>des</strong> valeurs<br />
normales après 15 min de pratique. Les petites différences non significatives <strong>des</strong> valeurs<br />
de F1 et F2 trouvées entre les deux conditions pourraient indiquer que les stratégies de<br />
<strong>compensation</strong> se développent <strong>dans</strong> le même temps que se déroule <strong>la</strong> conversation. Ces<br />
auteurs argumentent en faveur d’un feedback sensoriel qui permettrait de corriger les<br />
erreurs pour l’exécution <strong>des</strong> gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Ils soulignent ainsi le rôle potentiel <strong>du</strong><br />
feedback sensoriel <strong>dans</strong> les développements <strong>des</strong> processus de <strong>compensation</strong>. Par contre,<br />
les consonnes réc<strong>la</strong>meraient une plus longue période d’adaptation que les voyelles car<br />
ils n’ont pas observé de similitu<strong>des</strong> acoustiques même après dix minutes d’adaptation.<br />
Les consonnes nécessitent une plus grande précision <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Les sons <strong>des</strong> c<strong>la</strong>sses<br />
différentes de phonèmes ne sont pas affectés de <strong>la</strong> même manière. Leur conclusion est<br />
qu’il existe moins de flexibilité <strong>dans</strong> l’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> consonnes que <strong>dans</strong> celle <strong>des</strong><br />
voyelles. Les auteurs confirment l’importance <strong>du</strong> rôle <strong>du</strong> feedback sensoriel. Les<br />
théories d’un contrôle moteur comptant uniquement sur <strong>la</strong> prédiction (Lindblom et al.<br />
1979) ne peuvent justifier facilement les progrès compensatoires <strong>dans</strong> le temps lors de<br />
<strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> voyelles avec bite-block. La variabilité indivi<strong>du</strong>elle <strong>dans</strong> les aptitu<strong>des</strong><br />
à compenser apporte une preuve aussi de <strong>la</strong> façon dont chacun va exploiter ses canaux<br />
sensoriels pour adapter sa propre <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole.<br />
McFar<strong>la</strong>nd, Baum et Chabot (1996) reprennent l’expérience de 1995 mais seulement<br />
avec les pa<strong>la</strong>is qu’ils considèrent comme étant déjà <strong>des</strong> perturbations : un pa<strong>la</strong>is de 3<br />
mm et un pa<strong>la</strong>is de six mm. Les enregistrements sont faits immédiatement après<br />
insertion de <strong>la</strong> perturbation et après quinze minutes de pratique. Il y a <strong>des</strong> différences<br />
acoustiques et perceptuelles significatives sur les voyelles et les consonnes entre les<br />
65
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales et les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s avec une perturbation (que ce soient <strong>des</strong> biteblock<br />
ou <strong>des</strong> pa<strong>la</strong>is) Les <strong>compensation</strong>s semblent améliorées avec le temps ce qui<br />
apporte un argument en faveur <strong>du</strong> rôle <strong>du</strong> feedback sensoriel <strong>dans</strong> l’adaptation <strong>des</strong><br />
gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Les auteurs confirment leur conclusion de l’expérience<br />
précédente : les sons <strong>des</strong> c<strong>la</strong>sses de phonèmes sont différemment atteints par <strong>la</strong><br />
perturbation (les sibi<strong>la</strong>ntes sont les plus affaiblies) et <strong>la</strong> façon de compenser dépend <strong>des</strong><br />
variabilités indivi<strong>du</strong>elles. Notons que les écarts relevés sont beaucoup plus importants et<br />
significatifs entre les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales et les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s avec bite-block qu’entre<br />
les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales et les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s avec pa<strong>la</strong>is artificiel.<br />
Savariaux, Perrier, Orliaguet (1995) observent <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> voyelle arrondie<br />
/u/ avec un tube tenu entre les lèvres qui empêche de pro<strong>du</strong>ire un son perceptible, et<br />
avec un bite-block. Le but de leur étude est d’évaluer les exigences acoustiques et<br />
géométriques (<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s) <strong>du</strong> contrôle de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Les changements<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s qui résultent de ces perturbations sont différents selon les locuteurs. Les<br />
auteurs les ont c<strong>la</strong>ssés en trois catégories de réponses : (i) un mouvement de recul de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue qui n’est pas suffisant pour permettre d’atteindre le patron formantique adéquat<br />
même si F2 décroît, (ii) un recul de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue qui bascule d’une constriction vélopa<strong>la</strong>tale<br />
à une constriction vélo-pharyngale ; les patrons formantiques de F1 et F2<br />
correspondent à ceux observés en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, (iii) aucun geste de recul de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue, pas de <strong>compensation</strong> en dépit de <strong>la</strong> dégradation <strong>du</strong> résultat acoustique (F2 est<br />
trop élevé). L’observation <strong>des</strong> variabilités inter-locuteur amène les auteurs à conclure<br />
que ces mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont activement contrôlés. De plus, ce contrôle<br />
dépend de l’habileté de chacun à réexploiter une re<strong>la</strong>tion articulo-acoustique déjà<br />
éprouvée et mémorisée <strong>dans</strong> ses modèles internes. Après écoute <strong>du</strong> signal acoustique,<br />
une amélioration <strong>des</strong> patrons formantiques pour F1 et F2 est observée. L’écoute<br />
permettrait de réaliser une <strong>compensation</strong> plus complète. Ils concluent au regard <strong>des</strong><br />
équivalences motrices, <strong>dans</strong> le même sens que les conclusions de Perkell et collègues<br />
(1993). La capacité d’effectuer une <strong>compensation</strong> sur les articu<strong>la</strong>teurs, effecteurs finaux,<br />
n’est pas toujours suivie avec succès, et ne permet pas une interprétation <strong>du</strong> contrôle<br />
moteur en terme <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> uniquement. Le contrôle moteur doit tenir compte de <strong>la</strong><br />
tâche vocalique définie <strong>dans</strong> l’espace acoustique (valeurs formantiques). Le rôle de<br />
l’apprentissage permet au locuteur d’associer une configuration <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal à un<br />
patron acoustique donné. Les régu<strong>la</strong>rités <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s observées chez onze locuteurs<br />
66
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
sur douze (Savariaux et al. 1999) sont les conséquences de mécanisme volontaire de<br />
contrôle de <strong>la</strong> parole. Leur hypothèse, qui est aussi celle de Gay et al. (1981), est de dire<br />
qu’il subsiste une amélioration <strong>des</strong> stratégies <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s acquises <strong>du</strong>rant<br />
l’apprentissage pour permettre un lien entre le contrôle <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et les exigences<br />
auditives.<br />
Demolin et al. (1997) étudient avec l’IRM les articu<strong>la</strong>tions compensatoires quand les<br />
locuteurs tiennent une bouteille de deux centimètres de diamètre entre les dents <strong>du</strong>rant<br />
<strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de /uiu/. Le <strong>la</strong>rynx est maintenu <strong>dans</strong> une position stable quand <strong>la</strong><br />
mâchoire inférieure est bloquée. Ils observent une déformation de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue : seul le<br />
corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue bouge de l’avant vers l’arrière de <strong>la</strong> cavité buccale. Même si l’activité<br />
<strong>des</strong> lèvres est neutralisée, ils perçoivent un arrondissement quand <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue passe de <strong>la</strong><br />
position de /i/ à <strong>la</strong> position pour /u/. Cette technique est très prometteuse pour observer<br />
les mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs <strong>dans</strong> les trois dimensions (coronal, transversal et<br />
oblique), mais aussi pour étudier <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion, et les articu<strong>la</strong>tions compensatoires.<br />
On peut se rendre compte <strong>des</strong> effets d’anticipation et de rétention entre les consonnes et<br />
le contexte vocalique adjacent.<br />
3.1.2.1 Les bite-blocks et l’électropa<strong>la</strong>tographie.<br />
D’autres travaux ont attaché un intérêt à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes sous l’emprise de<br />
bite-blocks en utilisant <strong>la</strong> technique de l’électropa<strong>la</strong>tographie, travaux dont nous nous<br />
sommes inspirée. Flege et al. (1988) se sont penchés sur les paramètres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s <strong>du</strong><br />
/s/ et <strong>du</strong> /t/ arabe et ang<strong>la</strong>is. Concernant le /t/ arabe, les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sont<br />
ré<strong>du</strong>its et <strong>du</strong>rent moins longtemps avec le bite-block. Alors que pour les sujets ang<strong>la</strong>is,<br />
ils observent une augmentation <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux. Ces auteurs ont montré<br />
qu’une <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> adéquate <strong>du</strong> /t/ afin qu’il soit perçu comme tel ne nécessite pas<br />
forcément une constriction complète de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Une constriction partielle est<br />
suffisante pour générer l’information acoustique nécessaire pour une bonne<br />
identification de <strong>la</strong> consonne <strong>dans</strong> <strong>des</strong> tests de perception. La constriction <strong>du</strong> /s/ arabe<br />
est rétrécie par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks, alors que <strong>la</strong> constriction <strong>du</strong> /s/ ang<strong>la</strong>is reste<br />
inchangée. Ils concluent de leurs résultats, que <strong>la</strong> constriction complète <strong>du</strong> /t/ n’est pas<br />
un paramètre critique alors que <strong>la</strong> rainure <strong>du</strong> /s/ l’est. Les paramètres critiques sont<br />
encodés <strong>dans</strong> le système nerveux central et sont préservés quand <strong>la</strong> mâchoire est<br />
67
loquée avec un bite-block. Ils soulignent aussi l’existence d’un lien entre les<br />
<strong>compensation</strong>s et le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne : le /t/ ang<strong>la</strong>is est réalisé sur <strong>la</strong><br />
partie <strong>la</strong> plus arrière <strong>des</strong> alvéoles. Les <strong>compensation</strong>s <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes<br />
ne sont pas immédiates : il a été montré que dix minutes de pratique permettent une<br />
amélioration <strong>des</strong> réponses. Les locuteurs ont utilisé leur feedback afférent pour<br />
améliorer leur <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Ils ajoutent qu’il existe <strong>des</strong> stratégies indivi<strong>du</strong>elles de<br />
<strong>compensation</strong> <strong>du</strong>es à <strong>des</strong> facteurs biomécaniques. Pour leurs conclusions, <strong>la</strong><br />
<strong>compensation</strong> est incomplète et non instantanée.<br />
Horga (2002) étudie les phonèmes <strong>du</strong> croate pro<strong>du</strong>its avec <strong>des</strong> bite-blocks. Les <strong>du</strong>rées<br />
de /ts/ et /s/ ont tendance à être ré<strong>du</strong>ites par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks mais pas les<br />
<strong>du</strong>rées de /t/. Sur le p<strong>la</strong>n acoustique, il est noté une influence significative de <strong>la</strong> présence<br />
<strong>du</strong> bite-block sur les valeurs formantiques. Les valeurs de F1 <strong>du</strong> /i/ sont plus hautes et<br />
celles <strong>du</strong> F2 sont plus basses, ce qui tra<strong>du</strong>it une prononciation plus ouverte. Les valeurs<br />
formantiques <strong>du</strong> F1 de /a/ sont plus basses et celles de F2 sont inchangées ce qui tra<strong>du</strong>it<br />
une articu<strong>la</strong>tion plus avancée. L’énergie spectrale <strong>des</strong> fricatives tend vers <strong>des</strong> valeurs<br />
plus faibles, exepté pour /s/ pro<strong>du</strong>it avec entraînement. L’intensité <strong>des</strong> fricatives est<br />
ré<strong>du</strong>ite et l’intensité <strong>des</strong> voyelles augmente sous l’influence de bite-block. Son étude<br />
montre qu’au moyen d’un simple contrôle orosensoriel immédiat, certains paramètres<br />
temporels sont immédiatement réorganisés, soulignant le rôle important de<br />
l’entraînement. Durant <strong>la</strong> période d’adaptation, l’articu<strong>la</strong>tion est en cours de<br />
réorganisation et c’est pour ce<strong>la</strong> qu’elle montre un caractère instable. Après une période<br />
d’adaptation plus longue, <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> avec bite-block peut être améliorée.<br />
3.1.2.1 Les bite-blocks avec blocage sensoriel<br />
Afin d’affiner l’interprétation <strong>du</strong> rôle <strong>des</strong> feedbacks <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>des</strong> stratégies<br />
de <strong>compensation</strong>, d’autres étu<strong>des</strong> ont conçu <strong>des</strong> enregistrements en neutralisant<br />
complètement certaines informations sensorielles. La <strong>compensation</strong> est immédiate si le<br />
feedback sensoriel ne joue pas de rôle particulier. Lindblom et al. (1977) intro<strong>du</strong>isent,<br />
en plus <strong>des</strong> bite-blocks, un anesthésiant (<strong>la</strong> xylocaïne) <strong>dans</strong> leur protocole expérimental.<br />
Ce coup<strong>la</strong>ge de deux perturbations n’empêche aucunement les locuteurs de pro<strong>du</strong>ire <strong>des</strong><br />
voyelles avec <strong>des</strong> patrons formantiques proches <strong>des</strong> valeurs de référence. Ils en<br />
68
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
concluent que c’est <strong>la</strong> diminution <strong>du</strong> feedback tactile qui aurait un effet sur les mo<strong>des</strong> de<br />
<strong>compensation</strong> par l’intermédiaire de récepteurs tactiles.<br />
Moon et Folkins (1991) perturbent le feedback auditif lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’un /s/. Ils<br />
agissent par une dégradation de 30 décibels de l’intensité <strong>du</strong> bruit de friction. Ils<br />
observent que <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s aérodynamiques sont réalisées en réponse à cette<br />
perturbation. Les changements qui tra<strong>du</strong>isent un comportement compensatoire se voient<br />
sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée et sur les pics de <strong>la</strong> pression intra-orale. Cependant, ils n’observent pas de<br />
changement systématique quand ils font de plus petites manipu<strong>la</strong>tions auditives<br />
(inférieures à trente décibels). Ces changements sont très variables en fonction <strong>des</strong><br />
sujets. La priorité de <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion auditive sur <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion aérodynamique n’est qu’en<br />
partie vérifiée. Dans l’étude de Kelso et Tuller (1983), les différents feedbacks sont<br />
neutralisés par plusieurs anesthésies. Les enregistrements sont effectués avec bite-block<br />
et avec anesthésiant de l’articu<strong>la</strong>tion temporo-mandibu<strong>la</strong>ire qui ré<strong>du</strong>it les informations<br />
proprioceptives, et avec un anesthésiant sur <strong>la</strong> muqueuse afin de ré<strong>du</strong>ire l’information<br />
tactile. Leur expérience montre que les F1 et F2 <strong>des</strong> voyelles perturbées sont très<br />
proches <strong>des</strong> valeurs pro<strong>du</strong>ites sans perturbation. Cette stabilité est observée aussi bien<br />
quand les re<strong>la</strong>tions entre articu<strong>la</strong>teurs sont empêchées par le bite-block, que quand les<br />
informations sensorielles sont ré<strong>du</strong>ites. La suppression <strong>du</strong> feedback sensoriel ne<br />
perturbe pas davantage les mouvements. Leurs résultats ne vont pas <strong>dans</strong> le sens d’un<br />
contrôle à boucle fermée ou par simu<strong>la</strong>tion prédictive qui requièrent l’information<br />
sensorielle. Ils sont plus en adéquation avec les travaux indiquant que les buts <strong>des</strong><br />
mouvements seraient atteints par un collectif de muscles en coopération. L’anesthésie<br />
afférente empêche le système nerveux central de programmer <strong>des</strong> comman<strong>des</strong> tenant<br />
compte <strong>des</strong> modifications engendrées par <strong>la</strong> présence <strong>du</strong> bite-block. La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
d’items exigeant une <strong>compensation</strong> ne pose pas de problème : si une partie <strong>du</strong> système<br />
est bloquée, les autres parties remédient à ce blocage. Ils ont souligné le caractère<br />
instantané <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>dans</strong> le but de conserver une intelligibilité maximale. Les<br />
<strong>compensation</strong>s étant immédiates, le rôle <strong>du</strong> feedback paraît bien secondaire. Comme<br />
<strong>dans</strong> l’étude de Fowler et Turvey (1980), les <strong>compensation</strong>s apparaissent réussies<br />
immédiatement et avec peu ou pas <strong>du</strong> tout de pratique. Fowler et Turvey (1980) ont<br />
effectué <strong>des</strong> tests de perception qui ont révélé que 71 à 90 % <strong>des</strong> voyelles ang<strong>la</strong>ises<br />
pro<strong>du</strong>ites avec bite-block sont très bien identifiées. Cependant ce résultat s’oppose à<br />
69
celui de Flege et al. (1988), qui concluent de leurs tests de perception que les jugements<br />
perceptifs sont moins bons sur les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s avec perturbation.<br />
3.1.3 Propriétés <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s<br />
Nous avons distingué de nombreuses expérimentations fondées sur l’observation de<br />
divers paramètres : les pressions d’air qui fournissent l’énergie nécessaire à <strong>la</strong> formation<br />
de sons de parole, les contacts entre articu<strong>la</strong>teurs qui modifient les formes <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it<br />
vocal et enfin <strong>la</strong> sortie acoustique. A chaque niveau, <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s plus ou moins<br />
complètes sont observées de manière systématique par tous les auteurs. Nous avons vu<br />
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s complètes absolues, ou parfaites.<br />
Elles doivent cependant être suffisantes pour maintenir l’intégrité <strong>du</strong> signal acoustique<br />
d’autant plus que <strong>la</strong> perception catégorielle <strong>des</strong> sons prend en compte <strong>la</strong> variabilité<br />
acoustique. Ces étu<strong>des</strong> confortent le fait que le but <strong>du</strong> système de parole est de pro<strong>du</strong>ire<br />
un message le plus stable possible afin de rester <strong>dans</strong> une fenêtre acoustique ré<strong>du</strong>ite.<br />
Nous avons vu aussi que les informations sensori-motrices à court terme jouent un rôle<br />
mais le feedback auditif n’est pas essentiel pour achever une <strong>compensation</strong> à succès en<br />
temps réel. D’un point de vue physiologique, il est légitime d’envisager que les<br />
articu<strong>la</strong>tions <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s présupposent le besoin d’une information intacte<br />
provenant <strong>des</strong> sens tactiles comme le préconisent Kelso et al. (1986). Alors que<br />
McFar<strong>la</strong>nd et Baum (1995) estiment que les <strong>compensation</strong>s nécessitent plutôt de <strong>la</strong><br />
pratique pour être réalisées de <strong>la</strong> manière <strong>la</strong> plus complète possible.<br />
En résumé, les <strong>compensation</strong>s en réponse aux perturbations (aussi bien dynamique que<br />
statique) sont instantanées et rapi<strong>des</strong>, même si elles peuvent être incomplètes. Du fait<br />
qu’elles sont fonctionnelles et effectives, le but de l’acte moteur est réalisé. Les<br />
réponses ne sont pas stéréotypées mais façonnées par les besoins de l’acte. Nous avons<br />
remarqué aussi que ces <strong>compensation</strong>s sont sélectives, elles s’opèreraient plus<br />
pleinement aux points de constriction maximale <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal.<br />
70
3.2 Le complexe <strong>la</strong>ngue / mâchoire<br />
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
Nous venons de voir que nombre d’étude se sont penchées sur <strong>la</strong> problématique de<br />
l’interaction entre <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et <strong>la</strong> mâchoire par l’étude <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
avec <strong>des</strong> bite blocks. Ces deux articu<strong>la</strong>teurs sont reliés mécaniquement et de façon<br />
fonctionnelle et oeuvrent ensemble pour pro<strong>du</strong>ire une constriction <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal.<br />
Afin de souligner l’importance de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion fonctionnelle existant entre <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et <strong>la</strong><br />
mâchoire, nous nous attarderons sur les mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et le rôle phonétique<br />
de <strong>la</strong> mâchoire <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Nous tentons ainsi de légitimer notre<br />
choix de travailler sur les mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue quand <strong>la</strong> mâchoire est bloquée.<br />
3.2.1 La <strong>la</strong>ngue et ses mouvements<br />
La <strong>la</strong>ngue est sans aucun doute le plus important et le plus actif <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs supraglottiques.<br />
Elle œuvre pour modifier les formes <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal et ainsi les résonances<br />
caractéristiques de <strong>la</strong> cavité orale et <strong>du</strong> pharynx. Elle agit pour couper ou canaliser le<br />
courant d’air en contactant ou en avoisinant les dents, les alvéoles, le pa<strong>la</strong>is, le voile <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is ou le pharynx.<br />
Il existe un découpage fonctionnel de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue en plusieurs sections. La pointe de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue <strong>la</strong> plus proche <strong>des</strong> dents de devant est l’apex. La distinction entre les<br />
articu<strong>la</strong>tions de l’apex et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue vient de Ladefoged (1971): un<br />
paramètre qu’il appelle apicalité. Ensuite de l’avant vers l’arrière de <strong>la</strong> cavité buccale,<br />
se trouvent <strong>la</strong> <strong>la</strong>me (sous les alvéoles), le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (sous le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r) et <strong>la</strong><br />
racine en vis-à-vis avec le pharynx.<br />
Comme nous le voyons sur <strong>la</strong> figure 3.1, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est accrochée <strong>dans</strong> sa partie<br />
pharyngale à l’os hyoïde et au styloïde. Notons que <strong>la</strong> racine étant attachée à <strong>la</strong> structure<br />
squelettique, elle est forcément moins mobile que <strong>la</strong> partie antérieure, <strong>la</strong> <strong>la</strong>me et l’apex.<br />
Il est important de souligner que ses mouvements sont <strong>du</strong>s aussi aux rotations de <strong>la</strong><br />
mâchoire car elle est attachée à <strong>la</strong> surface interne de <strong>la</strong> mandibule. Elle peut donc<br />
bouger avec <strong>la</strong> mandibule ou <strong>dans</strong> <strong>des</strong> directions opposées en même temps car les côtés<br />
et <strong>la</strong> pointe peuvent bouger indépendamment de sa masse principale. Elle a un grand<br />
nombre de degrés de liberté <strong>du</strong> fait qu’elle est considérée comme ayant plusieurs<br />
sections.<br />
71
La <strong>la</strong>ngue est capable d’effectuer différentes configurations très rapidement car elle est<br />
grandement innervée. Ses mouvements sont <strong>du</strong>s à l’activité <strong>des</strong> muscles extrinsèques,<br />
qui <strong>la</strong> raccrochent aux autres structures adjacentes <strong>du</strong> squelette (<strong>la</strong> mandibule, l’os<br />
hyoïde, le styloïde) et intrinsèques, qui sont entièrement à l’intérieur.<br />
Figure n° 3.1 : Les muscles de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, d’après Zemlin, 1981<br />
Les muscles intrinsèques sont les suivants.<br />
Le muscle longitudinal supérieur (superior lingualis) agit pour relever l’apex.<br />
Le muscle longitudinal inférieur (inferior lingualis) agit lors <strong>du</strong> relâchement <strong>des</strong><br />
consonnes alvéo<strong>la</strong>ires.<br />
Le muscle transversal (transverse lingualis) aide à former le sillon <strong>des</strong> fricatives.<br />
Le muscle vertical (vertical lingualis) ap<strong>la</strong>nit <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Les muscles extrinsèques sont les suivants.<br />
Le génioglosse agit pour presser <strong>la</strong> pointe de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue contre les dents ou les<br />
alvéoles ou <strong>la</strong> rétracter. IL tire <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue vers le bas.<br />
Le styloglosse tire <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue vers le haut et vers l’arrière, antagoniste <strong>du</strong><br />
génioglosse.<br />
Le pa<strong>la</strong>toglosse remonte l’arrière de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Le hyoglosse élève l’os hyoïde<br />
Chaque modification de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est le fruit d’une combinaison de contractions de<br />
muscles complémentaires. Un ou deux muscles principaux assurent les modifications<br />
72
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
<strong>des</strong> mouvements et en même temps, les autres muscles coopèrent pour stabiliser <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue, à <strong>la</strong> fois <strong>dans</strong> son mouvement et au sein <strong>des</strong> structures adjacentes.<br />
Hardcastle (1976) recense sept paramètres qui pourraient expliquer l’ensemble <strong>des</strong><br />
positions de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> phonation.<br />
Le mouvement horizontal <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (arrière-bas / avant-haut)<br />
correspondant à un mouvement /a/-/i/, est exécuté par <strong>la</strong> partie postérieure <strong>du</strong><br />
génioglosse.<br />
Le mouvement vertical <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue propre aux voyelles centrales et<br />
aux consonnes pa<strong>la</strong>tales, est exécuté par le styloglosse et le pa<strong>la</strong>toglosse en synergie<br />
avec les muscles inférieurs longitudinaux.<br />
Le mouvement horizontal d’avant en arrière de l’apex et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me est réalisé<br />
par l’activité <strong>des</strong> fibres transversales et postérieures <strong>du</strong> génioglosse (ce mouvement peut<br />
aussi effectuer les articu<strong>la</strong>tions rétroflexes).<br />
Le mouvement vertical de l’apex et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me qu permet le contact, partiel ou<br />
total, avec les alvéoles et les incisives supérieures, est activé par le muscle supérieur<br />
longitudinal ([s], [t], [d] ou [l]). Le mouvement d’avancée/rétraction de l’apex permet <strong>la</strong><br />
distinction avant /arrière comme pour différencier /s/ et /S/ par rexemple.<br />
La configuration convexe /concave <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sur le p<strong>la</strong>n transversal<br />
est réalisée par les muscles styloglosse, pa<strong>la</strong>toglosse et transversal.<br />
La configuration <strong>du</strong> sillon central par l’activité <strong>du</strong> transversal et <strong>du</strong> vertical, <strong>du</strong><br />
styloglosse et <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>toglosse.<br />
L’étirement/ap<strong>la</strong>nissement <strong>du</strong> dos <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue qui lui permet de se ramasser en<br />
boule vers l'arrière, comme pour le son /u/ ou de se détendre pour le son /a/, est activé<br />
par le muscle transversal et le hyoglosse.<br />
3.2.2 Le rôle phonétique de <strong>la</strong> mâchoire<br />
Avant <strong>la</strong> seconde moitié de notre siècle, le manque de moyens techniques n’a pas<br />
permis de souligner le rôle <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> important de <strong>la</strong> mâchoire. Dans <strong>la</strong> mesure où<br />
l’immobilité de <strong>la</strong> mâchoire n’entravait pas <strong>la</strong> communication, comme chez les fumeurs<br />
de pipe notamment, son rôle était considéré comme secondaire. Rares ont été les étu<strong>des</strong><br />
re<strong>la</strong>tives à ses dép<strong>la</strong>cements <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> sons de parole. Cependant,<br />
Rousselot (1901), met en évidence le quasi-parallélisme entre l’ouverture buccale et<br />
73
l’aperture vocalique et établit l’existence d’une re<strong>la</strong>tion entre l’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire<br />
consonantique et le lieu d’articu<strong>la</strong>tion buccale. Puis, Straka (1963) dé<strong>du</strong>it de documents<br />
cinématographiques ses affirmations sur l’opposition <strong>des</strong> voyelles et <strong>des</strong> consonnes :<br />
l’amplitude <strong>des</strong> dép<strong>la</strong>cements de <strong>la</strong> mâchoire dépend <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion pour les<br />
consonnes et <strong>du</strong> degré d’aperture pour les voyelles. Depuis, <strong>la</strong> mâchoire est considérée<br />
comme un articu<strong>la</strong>teur non négligeable participant à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Elle<br />
permet aussi <strong>la</strong> distinction entre <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> voyelles et <strong>des</strong> consonnes. De<br />
nombreux modèles de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> ont alors inclus cet articu<strong>la</strong>teur <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de<br />
<strong>la</strong> parole (Bognar 1983).<br />
Durant l’acte de parole, <strong>la</strong> mâchoire modifie les résonances caractéristiques <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it<br />
vocal. Son dép<strong>la</strong>cement antéro-postérieur est de 2 à 3 mm et son dép<strong>la</strong>cement vertical<br />
est de 7 à 18 mm. Son ouverture maximale peut cependant dépasser 50mm. Sa rapidité<br />
de dép<strong>la</strong>cement est aussi surprenante, car c’est une structure massive et parmi tous les<br />
articu<strong>la</strong>teurs seul l’apex, est capable de mouvements plus rapi<strong>des</strong>.<br />
La mâchoire est un articu<strong>la</strong>teur rigide et porteur <strong>des</strong> dents, de <strong>la</strong> lèvre inférieure et de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue. Son mouvement d’avancée/rétraction est un paramètre essentiel, par exemple<br />
pour pro<strong>du</strong>ire les consonnes <strong>la</strong>bio-dentales pour lesquelles <strong>la</strong> lèvre inférieure vient en<br />
contact avec les incisives supérieures. Son mouvement de rotation (ouverture/fermeture)<br />
entraîne un mouvement de bascule de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
La mâchoire est un articu<strong>la</strong>teur rythmique. On sait que les suites de syl<strong>la</strong>bes répétées<br />
sont pro<strong>du</strong>ites par une alternance rythmique d’ouverture et de fermeture de <strong>la</strong> bouche,<br />
accompagnée de phonation. Pendant <strong>la</strong> phonation, un con<strong>du</strong>it vocal re<strong>la</strong>tivement ouvert<br />
caractérise <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> voyelles, tandis qu’un con<strong>du</strong>it vocal re<strong>la</strong>tivement fermé est<br />
plus typique de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> sons consonantiques. Pour MacNei<strong>la</strong>ge et Davis<br />
(1990) ce cycle d’oscil<strong>la</strong>tions de <strong>la</strong> mâchoire fournit <strong>la</strong> base <strong>du</strong> babil<strong>la</strong>ge et rend compte<br />
de <strong>la</strong> forme de ses <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s. Ainsi s’expliqueraient les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s de type /bababa/,<br />
/dadada/ ou /mamama/ <strong>du</strong> début <strong>du</strong> babil<strong>la</strong>ge par le mouvement re<strong>la</strong>tivement simple<br />
d’une succession d’ouvertures et de fermetures de <strong>la</strong> mâchoire. L’oscil<strong>la</strong>tion<br />
mandibu<strong>la</strong>ire fournirait le cadre <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> dont le contenu serait ensuite donné par les<br />
mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Le babil<strong>la</strong>ge, avec <strong>des</strong> syl<strong>la</strong>bes répétées, refléterait <strong>la</strong><br />
formation de ces cadres <strong>dans</strong> lesquels les différents segments phonétiques seront insérés<br />
au fur et à mesure qu’ils deviendront accessibles à l’enfant.<br />
74
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
3.2.2.1 La mâchoire et <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> voyelles.<br />
Nous précisons que cette partie concernant les voyelles se veut non exhaustive. Elle a<br />
pour but d’argumenter en faveur <strong>du</strong> rôle important de <strong>la</strong> mâchoire qui conditionne<br />
l’aperture vocalique. Il est noté l’existence d’un parallélisme entre les catégories<br />
fermées, mi-fermées, mi-ouvertes et ouvertes qui définissent les voyelles cardinales et<br />
l’écartement croissant de <strong>la</strong> mâchoire. L’observation <strong>des</strong> résultats de nombreuses étu<strong>des</strong><br />
a permis de mettre en évidence <strong>la</strong> rareté <strong>des</strong> fluctuations entre les catégories linguales et<br />
l’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire. Cependant à l’intérieur de ces catégories aucun phénomène<br />
général ne se <strong>des</strong>sine, si ce n’est <strong>la</strong> plus grande fermeture de /u/ par rapport à /i/. Les<br />
mouvements verticaux favorisent les mouvements linguaux, malgré leur incapacité à<br />
tra<strong>du</strong>ire toutes les oppositions vocaliques. Ladefoged et al. (1972) observent que <strong>la</strong><br />
plupart de leurs locuteurs n’utilisent pas <strong>la</strong> mâchoire comme mécanisme primaire de<br />
distinction de <strong>la</strong> hauteur vocalique. Nous allons maintenant orienter notre attention sur<br />
le rôle de <strong>la</strong> mâchoire <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes, notamment <strong>des</strong> <strong>occlusives</strong>,<br />
objets directs de notre étude.<br />
3.2.2.2 La mâchoire et <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes<br />
Nous présentons ci-<strong>des</strong>sous en figure 3.2 un tableau de comparaison <strong>des</strong> positions de<br />
certaines consonnes par rapport à l’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire.<br />
75
Simon<br />
1967<br />
Français Breton<br />
Zerling<br />
1979<br />
76<br />
Bothorel<br />
1978<br />
z<br />
Z<br />
p S<br />
f s<br />
t d t<br />
z d<br />
v<br />
s<br />
S<br />
Z<br />
d<br />
j j<br />
¯ b<br />
b ¯<br />
m m<br />
k g k<br />
n g<br />
l l<br />
R R<br />
n<br />
b f<br />
Figure n°3.2 : Tableau comparatif de l’amplitude d’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire <strong>des</strong> consonnes<br />
françaises. De haut en bas, <strong>des</strong> plus ouvertes aux plus fermées. (d’après Bognar 1983).<br />
Malgré l’hétérogénéité <strong>des</strong> consonnes présentées, ces étu<strong>des</strong> montrent que<br />
l’augmentation de l’écartement inter-maxil<strong>la</strong>ire est fonction <strong>du</strong> recul progressif <strong>du</strong> lieu<br />
v
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
d’articu<strong>la</strong>tion (en dehors de certaines exceptions : /t/ plus ouvert que le /s/ et /S/ chez<br />
Bothorel (1978) pour le breton. En français, les consonnes les plus antérieures comme<br />
les bi<strong>la</strong>biales, les <strong>la</strong>biodentales et les dento-alvéo<strong>la</strong>ires nécessitent une petite ouverture<br />
mandibu<strong>la</strong>ire. La plupart <strong>des</strong> auteurs notent que le /p/ est réalisé avec une grande<br />
ouverture mandibu<strong>la</strong>ire qui se tra<strong>du</strong>it par le fait que cette consonne est <strong>la</strong> plus ouverte<br />
<strong>des</strong> <strong>occlusives</strong> (Abbs et al. 1971 et Gay 1974). Bothorel (1978) effectue une étude à<br />
propos de <strong>la</strong> dispersion re<strong>la</strong>tive aux consonnes et aux voyelles <strong>du</strong> parler breton d’Argol.<br />
Il met en évidence que les consonnes réalisées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie antérieure de <strong>la</strong> cavité<br />
buccale sont extrêmement stables, que <strong>la</strong> plupart <strong>des</strong> autres consonnes et voyelles<br />
fermées et mi-fermées sont moyennement stables et que les voyelles ouvertes et nasales<br />
et les consonnes bruitées, comme /f/, par exemple sont particulièrement instables. On<br />
peut dé<strong>du</strong>ire que le maxil<strong>la</strong>ire joue un rôle important <strong>dans</strong> leur réalisation puisqu’il se<br />
révèle moins sensible aux articu<strong>la</strong>tions environnantes.<br />
Lindblom et Sunberg (1971) aussi se sont particulièrement intéressés au rôle de <strong>la</strong><br />
mâchoire pour <strong>la</strong> détermination <strong>des</strong> formes <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal et surtout pour <strong>la</strong><br />
spécification vocalique. Les travaux de Perkell (1969) et Tuller et al. (1979) confirment<br />
aussi le fait que les consonnes alvéo<strong>la</strong>ires soient plus hautes que les <strong>la</strong>biales, les<br />
<strong>la</strong>biodentales et les pa<strong>la</strong>tales. Le /t/ est <strong>la</strong> consonne <strong>la</strong> plus robuste face aux effets<br />
contextuels, /p/ et /k/ varient en fonction <strong>du</strong> contexte vocalique, mais /f/ et /t/ non.<br />
L’étude de Keating et al. (1994) concerne l’observation de l’élévation de <strong>la</strong> mâchoire (à<br />
l’aide <strong>du</strong> movetrack) lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes de l’ang<strong>la</strong>is et <strong>du</strong> suédois. Ces<br />
auteurs montrent que <strong>la</strong> hauteur de <strong>la</strong> mâchoire varie en fonction de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue étudiée :<br />
les consonnes <strong>du</strong> suédois sont légèrement plus ouvertes que celles de l’ang<strong>la</strong>is. La<br />
hauteur de <strong>la</strong> mâchoire est aussi fonction <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne. Dans les<br />
deux <strong>la</strong>ngues, les alvéo<strong>la</strong>ires obstruentes /s/, /t/, /d/ et <strong>la</strong> <strong>la</strong>biodentale /f/ sont réalisées<br />
avec une position de <strong>la</strong> mâchoire plus haute que les autres consonnes. Le lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion joue un rôle important <strong>dans</strong> le positionnement de <strong>la</strong> mâchoire. Ces auteurs<br />
soulignent aussi l’effet <strong>du</strong> contexte vocalique sur <strong>la</strong> hauteur de <strong>la</strong> mâchoire. La voyelle<br />
/i/ fermée a une plus forte influence sur <strong>la</strong> hauteur de <strong>la</strong> mâchoire lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
d’une consonne que les autres voyelles. Cependant il est paradoxal de constater que les<br />
consonnes pro<strong>du</strong>ites avec une position haute de <strong>la</strong> mâchoire sont encore plus hautes au<br />
voisinage de <strong>la</strong> voyelle basse /a/ qu’au voisinage de <strong>la</strong> voyelle haute /i/. Keating et al.<br />
(1994) relient ce phénomène à <strong>la</strong> vélocité nécessaire à <strong>la</strong> mâchoire pour effectuer un<br />
77
trajet d’une position basse à une position haute. La vitesse d’exécution pousserait <strong>la</strong><br />
mâchoire à dépasser <strong>la</strong> hauteur initiale nécessaire à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’un /t/ ou d’un /s/. On<br />
se trouve alors face à un phénomène d’overshoot, effet direct d’une forte coarticu<strong>la</strong>tion.<br />
La question <strong>du</strong> lien entre les consonnes sour<strong>des</strong> et sonores et l’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire<br />
peut être aussi évoquée. Fujimura et Miller (1979) ont montré que pour les couples<br />
d’<strong>occlusives</strong> sour<strong>des</strong>/sonores, les sour<strong>des</strong>, étant plus ten<strong>du</strong>es, par <strong>des</strong> contraintes<br />
aérodynamiques plus importantes, sont réalisées avec une fermeture mandibu<strong>la</strong>ire plus<br />
nette. Cette tendance est appuyée par les données de Simon (1967) et de Perkell (1969).<br />
Concernant les dép<strong>la</strong>cements antéro-postérieurs de <strong>la</strong> mandibule nous avons<br />
connaissance de l’étude <strong>des</strong> voyelles anglo-américaines de Kaneko (1957). Cette étude<br />
porte l’idée que l’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire reflète l’aperture linguale. Les voyelles<br />
postérieures <strong>la</strong>bialisées [u :], [u], [o :], et [o] sont réalisées avec une protraction<br />
mandibu<strong>la</strong>ire d’autant plus prononcée que <strong>la</strong> voyelles est fermée. Les réalisations<br />
antérieures non <strong>la</strong>bialisées [i :], [I], [e] et [a] sont pro<strong>du</strong>ites avec une rétraction de <strong>la</strong><br />
mâchoire et les voyelles centrales comme [´] sont pro<strong>du</strong>ites avec une position neutre de<br />
<strong>la</strong> mandibule.<br />
3.3 Conclusion sur les <strong>compensation</strong>s inter-<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
Les étu<strong>des</strong> avec <strong>des</strong> protocoles expérimentaux différents s’accordent à conclure que<br />
l’aptitude à compenser dépend de nombreux facteurs : <strong>des</strong> caractéristiques<br />
physiologiques propres à chacun, de l’apprentissage <strong>des</strong> modèles internes, mais aussi de<br />
<strong>la</strong> facilité avec <strong>la</strong>quelle chaque personne a accès à sa propre base de données, de<br />
variabilité intra-indivi<strong>du</strong>elle et surtout inter-indivi<strong>du</strong>elle.<br />
D’autre part, nombreuses étu<strong>des</strong> sur <strong>la</strong> parole perturbée montrent l’existence d’une forte<br />
cohésion gestuelle. L’intégrité d’un acte moteur est maintenue quand une partie <strong>du</strong><br />
système est mécaniquement perturbé, ce qui illustre parfaitement l’existence de<br />
structures coordinatives comme par exemple <strong>la</strong> mâchoire et ses articu<strong>la</strong>teurs portés<br />
(<strong>la</strong>ngue, lèvres). Depuis l’achèvement <strong>des</strong> nombreuses étu<strong>des</strong> sur les liens entre <strong>la</strong><br />
physiologie et <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> sons, <strong>la</strong> mâchoire est considérée comme étant un<br />
articu<strong>la</strong>teur non négligeable <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. L’amplitude de ses<br />
dép<strong>la</strong>cements dépend <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion pour les consonnes et <strong>du</strong> degré d’aperture<br />
78
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES<br />
CHAPITRE 3 : Compensations et complexe <strong>la</strong>ngue/mâchoire.<br />
pour les voyelles. De nombreuses étu<strong>des</strong> s’accordent à mettre en avant l’existence d’un<br />
fort lien fonctionnel entre les deux articu<strong>la</strong>teurs <strong>la</strong>ngue et mâchoire. Outre le fait que <strong>la</strong><br />
mâchoire soit un articu<strong>la</strong>teur rythmique et porteur, <strong>la</strong> commande de ses mouvements est<br />
tra<strong>du</strong>ite par une activité muscu<strong>la</strong>ire contrôlée, au même titre que d’autres articu<strong>la</strong>teurs<br />
spécifiques à <strong>la</strong> parole. Cependant nous savons, sur <strong>la</strong> base de nombreuses étu<strong>des</strong> sur les<br />
bite-blocks <strong>dans</strong> les années 1970-1980, que sa contribution n’est pas toujours nécessaire<br />
puisque même quand son activité est ré<strong>du</strong>ite ou bloquée, <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, <strong>la</strong> perception et<br />
<strong>la</strong> reconnaissance <strong>des</strong> sons de paroles peuvent être préservées.<br />
L’ensemble <strong>des</strong> travaux et considérations à propos <strong>des</strong> coordinations inter-<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
et <strong>du</strong> lien fonctionnel existant entre <strong>la</strong> mâchoire et <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue ont contribué aussi à<br />
affirmer notre choix d'étude : rechercher <strong>des</strong> effets de <strong>compensation</strong> <strong>dans</strong> l’activité<br />
linguale quand <strong>la</strong> mâchoire est inactivée.<br />
79
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 4 : Problématique.<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
Problématique et méthode expérimentale<br />
______________________________________________________________________<br />
CHAPITRE 4<br />
Problématique<br />
Dans les parties précédentes, nous avons vu qu’en parole, évoquer <strong>des</strong> théories traitant<br />
d’articu<strong>la</strong>tion, de coarticu<strong>la</strong>tion, de cibles demande nécessairement que l’on évoque les<br />
théories sur le contrôle moteur. On considère l’acte de parole comme étant un acte<br />
moteur nécessitant toutes les particu<strong>la</strong>rités <strong>du</strong> système moteur. Nous avons résumé les<br />
problèmes relevés par les étu<strong>des</strong> avec perturbations : les différences entre les<br />
articu<strong>la</strong>tions normales et compensatoires ne dépendraient pas de différentes stratégies<br />
d’encodage. Or, les deux comportements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s réc<strong>la</strong>ment <strong>des</strong> réponses<br />
muscu<strong>la</strong>ires différentes et variables en fonction <strong>du</strong> contexte imposé et ont pour but le<br />
même résultat en terme de cible acoustique. Cette faculté d’adaptation est possible grâce<br />
à une importante composante de flexibilité <strong>du</strong> système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>.<br />
L’observation <strong>des</strong> phénomènes de <strong>compensation</strong> en tant qu’effets directs de <strong>la</strong><br />
variabilité en parole est certes reconnue, mais nous ne tenons que peu de résultats<br />
quantitatifs et encore moins de résultats concernant <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue française. Il existe peu<br />
d’étu<strong>des</strong> sur les consonnes alors que leur traitement par le système nerveux central<br />
semble plus complexe que le traitement <strong>des</strong> voyelles, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où les<br />
mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs supra-glottiques sont plus complexes. Les consonnes<br />
<strong>occlusives</strong> notamment sont réalisées en plusieurs phases <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, chacune étant<br />
caractérisée par <strong>des</strong> configurations différentes <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs.<br />
81
Nous nous attachons à observer en détail comment <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue compense l’immobilisation<br />
de <strong>la</strong> mâchoire (par <strong>des</strong> bite-blocks). Il est nécessaire de chercher à savoir si les<br />
nombreuses contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> peuvent mo<strong>du</strong>ler l’effet de cette perturbation.<br />
Nous proposons une observation <strong>des</strong> réajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s (<strong>compensation</strong>s) de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue par le biais d’une double analyse, spatiale et temporelle, de ses mouvements.<br />
Grâce à <strong>la</strong> technique d’électropa<strong>la</strong>tographie, nous parvenons à examiner l’évolution<br />
spatio-temporelle <strong>des</strong> mouvements linguaux <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes<br />
<strong>occlusives</strong> en français, plus précisément lors de l’établissement et <strong>du</strong> relâchement de <strong>la</strong><br />
constriction ainsi que pendant <strong>la</strong> constriction.<br />
Dans un premier temps, nous présentons explicitement pourquoi nous avons choisi les<br />
<strong>occlusives</strong> linguales comme objet d’investigation, d’après leur <strong>des</strong>cription et <strong>la</strong><br />
coarticu<strong>la</strong>tion avec les segments suivants. Dans un second temps, nous présentons <strong>dans</strong><br />
cette problématique les hypothèses et questions qui ont motivé ce travail.<br />
4.1 Les consonnes observées : les <strong>occlusives</strong> linguales /t/ et /d/.<br />
Les consonnes observées <strong>dans</strong> cette étude sont les <strong>occlusives</strong> linguales /t/ et /d/. Afin de<br />
justifier notre choix, nous proposons une présentation de leurs caractéristiques<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s.<br />
4.1.1 La formation d’une occlusive linguale<br />
On pro<strong>du</strong>it les consonnes, voyelles, et approximantes lorsque le passage de l'air venant<br />
<strong>des</strong> poumons est partiellement ou totalement fermé. Il existe deux grands types<br />
d'articu<strong>la</strong>tions consonantiques orales :<br />
Soit le passage de l’air se rétrécit mais n'est pas interrompu, on parle <strong>dans</strong> ce cas<br />
de consonnes continues, dont les fricatives sont les plus représentatives, qu’elles soient<br />
voisées ou non voisées. Un rétrécissement en un point précis <strong>du</strong> canal buccal permet<br />
l’apparition <strong>du</strong> bruit de friction lors <strong>du</strong> passage de l’air, ce qui donne naissance aux<br />
articu<strong>la</strong>tions consonantiques constrictives.<br />
Soit le passage de l'air est fermé donnant lieu à une obstruction totale <strong>du</strong> flux<br />
d’air buccal, on a alors affaire à <strong>des</strong> consonnes <strong>occlusives</strong>.<br />
82
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 4 : Problématique.<br />
La réalisation d’une consonne occlusive se fait en trois étapes : attaque, tenue et<br />
relâchement. Ces trois phases d’articu<strong>la</strong>tion seront étudiées en détail.<br />
-L’attaque correspond au moment où les organes entrent en contact et<br />
rétrécissent ou ferment le con<strong>du</strong>it. C’est <strong>la</strong> phase de mise en position <strong>des</strong> organes qui<br />
passent, sous l’effet d’une contraction muscu<strong>la</strong>ire, d’un état indifférent ou de <strong>la</strong> position<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> précédente, à <strong>la</strong> phase centrale <strong>du</strong> son à réaliser.<br />
-La tenue est <strong>la</strong> phase centrale, celle de <strong>la</strong> position <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> caractéristique<br />
<strong>du</strong> son <strong>du</strong>rant <strong>la</strong>quelle les organes restent en position au point culminant de<br />
l’articu<strong>la</strong>tion. L’air accumulé <strong>dans</strong> <strong>la</strong> bouche gagne en pression. Simon (1967) donne<br />
une définition plus formelle de <strong>la</strong> tenue. Pendant <strong>la</strong> tenue les articu<strong>la</strong>teurs ne sont pas<br />
« à l’arrêt », <strong>la</strong> quantité de l’occlusion peut varier à l’intérieur de <strong>la</strong> tenue. Pour une<br />
consonne occlusive, on y trouve le maximum de contacts et l’occlusion complète. On<br />
peut assister à un dép<strong>la</strong>cement <strong>du</strong> contact occlusif sans rupture de l’occlusion qui<br />
dépend de l’articu<strong>la</strong>tion précédente antérieure ou postérieure. Pour Simon (1967), <strong>la</strong><br />
tenue d’une consonne peut être dégradée mais existe toujours.<br />
-Le relâchement se fait quand les articu<strong>la</strong>teurs responsables de <strong>la</strong> fermeture <strong>du</strong><br />
con<strong>du</strong>it se séparent, abandonnant <strong>la</strong> position typique et passent soit à l’état initial, soit à<br />
l’articu<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> son qui suit. L’air sous pression emmagasiné pendant une fraction de<br />
seconde <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal est relâché brusquement donnant lieu à une explosion.<br />
Souvent cette explosion est accompagnée d’un bruit de friction qui fait partie de <strong>la</strong><br />
consonne occlusive.<br />
Il est à noter que <strong>la</strong> phase essentielle est <strong>la</strong> tenue, les deux autres sont <strong>des</strong> phases de<br />
« passage » (Simon 1967). La <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue consonantique n’est jamais inférieure à<br />
<strong>la</strong> moitié de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale de <strong>la</strong> consonne.<br />
Les <strong>occlusives</strong> alvéo<strong>la</strong>ires /t/ et /d/ sont caractérisées par une mise en contact de l’apex<br />
ou de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue avec <strong>la</strong> face interne <strong>des</strong> dents ou le bourrelet formé par les<br />
alvéoles. Pour pro<strong>du</strong>ire une occlusion, il est nécessaire de manipuler le corps de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue en accord avec les mouvements de <strong>la</strong> mâchoire (Stevens 1998). Par exemple, si<br />
on veut pro<strong>du</strong>ire une occlusion de l’apex contre les alvéoles, le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est<br />
plutôt <strong>dans</strong> une position avancée et <strong>la</strong> mandibule est relevée. Cette articu<strong>la</strong>tion est<br />
propre aux <strong>occlusives</strong> alvéo<strong>la</strong>ires que nous étudions.<br />
83
4.1.2 Occlusive linguale et segments adjacents<br />
Bien sûr, le lieu d’articu<strong>la</strong>tion d’une consonne linguale dépend aussi <strong>des</strong> segments<br />
adjacents. Nous proposons une rapide présentation de <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion linguale à partir<br />
d’un article de Recasens (1999) afin d’illustrer le fait que nous avons choisi deux<br />
contextes vocaliques, ouvert avec /a/ et fermé avec /i/ pour observer nos consonnes<br />
alvéo<strong>la</strong>ires. Nous nous demandons si les variations observées avec les perturbations<br />
sont aussi <strong>du</strong>es à <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle adjacente.<br />
Concernant <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion entre consonne et voyelle, le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de<br />
l’occlusion <strong>du</strong> [t] est plus avancé lorsque le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est abaissé sous l’effet de<br />
l’articu<strong>la</strong>tion d’une voyelle ouverte adjacente [a]. Lorsque <strong>la</strong> voyelle adjacente est<br />
fermée, comme un [i] par exemple, l’occlusion est plus reculée et est réalisée par <strong>la</strong><br />
partie <strong>la</strong>minale de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue rétractée, le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est plus élevé. Par contre le [t]<br />
dental italien est plus résistant à ces effets de coarticu<strong>la</strong>tion, sûrement car il est articulé<br />
plus loin avec <strong>la</strong> <strong>la</strong>me de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (Farnetani et al. 1989). Citons un autre exemple avec<br />
le [l] cata<strong>la</strong>n : quand le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est relevé par <strong>la</strong> présence d’un [i], <strong>la</strong><br />
constriction est avancée et devient <strong>la</strong>mino-alvéo<strong>la</strong>ire. Quand le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est<br />
abaissée par <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’un [a], <strong>la</strong> constriction est arrière et devient vé<strong>la</strong>ire<br />
(Recasens et al. 1993a). Le degré de coarticu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> consonnes dento-alvéo<strong>la</strong>ires est<br />
tra<strong>du</strong>it par le coup<strong>la</strong>ge entre l’apex et le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Soulignons que <strong>la</strong> variabilité <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> <strong>des</strong> consonnes dento-alvéo<strong>la</strong>ires est moins<br />
grande que pour les <strong>la</strong>biales et <strong>la</strong>bio-dentales. Durant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> dentoalvéo<strong>la</strong>ires,<br />
<strong>la</strong> hauteur <strong>du</strong> dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et l’éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> contact dorso-pa<strong>la</strong>tal<br />
changent habituellement en fonction de <strong>la</strong> voyelle d’après <strong>la</strong> progression suivante : [i]<br />
>[u]>[a]. Ce<strong>la</strong> a été étudié comme étant le cas chez plusieurs auteurs et <strong>dans</strong> plusieurs<br />
<strong>la</strong>ngues.<br />
Le voisement est aussi une autre contrainte dont dépendent les effets de <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion<br />
linguale. En effet le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est plus sensible aux effets contextuels pour les<br />
consonnes voisées dento-alvéo<strong>la</strong>ires et <strong>la</strong>biales que pour les non voisées. L’aire de <strong>la</strong><br />
cavité orale est plus grande et on observe moins de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux pour les<br />
voisées que pour les non voisées (Perkell 1969, Farnetani 1990).<br />
L’anticipation consonantique est plus forte quand <strong>la</strong> voyelle est ouverte [a] car une<br />
voyelle basse facilite un effet de forte coarticu<strong>la</strong>tion <strong>dans</strong> l’activité linguale. Ces effets<br />
dépendent de <strong>la</strong> distance <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> entre les deux segments phonétiques. Concernant<br />
84
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 4 : Problématique.<br />
le [t], le début de l’activité apicale apparaît plus tôt s’il précède une voyelle basse que<br />
s’il précède une voyelle haute (Gay 1977).<br />
4.2 Les questions sur les mouvements linguaux<br />
4.2.1 Le timing inter-gestuel<br />
Notre corpus est constitué de phrases porteuses <strong>des</strong> séquences CVC <strong>dans</strong> lesquelles<br />
nous étudions <strong>la</strong> consonne d’attaque. Dans un premier temps, nous examinons<br />
l’influence <strong>des</strong> bite-blocks sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> phrase. Puis nous nous demandons si les<br />
bite-blocks ont un effet sur les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> séquences CVC, sur les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> consonnes<br />
étudiées et sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> voyelles. La coordination <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s estelle<br />
modifiée par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks? Nous sommes tentée de préconiser un<br />
allongement temporel dû à <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> perturbations extérieures parce qu’il faudra<br />
plus de temps au locuteur pour s’adapter à cette nouvelle situation. A l’inverse, si nous<br />
observons une stabilité <strong>dans</strong> le timing inter-gestuel, alors nous pourrons conclure que<br />
<strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s sur le p<strong>la</strong>n temporel s’opèrent rapidement.<br />
4.2.2 Le timing intra-gestuel<br />
A l’aide de l’électropa<strong>la</strong>tographie, nous avons segmenté les consonnes en plusieurs<br />
pério<strong>des</strong> : l’établissement de <strong>la</strong> constriction, <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, <strong>la</strong> constriction<br />
maximale et le relâchement de <strong>la</strong> constriction. Nous nous demandons si le bite-block a<br />
un effet sur chacune de ces phases de <strong>la</strong> consonne. Si <strong>la</strong> présence <strong>du</strong> bite-block allonge<br />
<strong>la</strong> consonne, cet allongement est-il marqué différemment selon <strong>la</strong> phase de <strong>la</strong><br />
consonne ? La présence <strong>des</strong> bite-blocks modifie-t-elle les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> phases<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, de fermeture, de tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, de constriction maximale,<br />
d’occlusion complète, et d’ouverture ?<br />
Quelle serait alors <strong>la</strong> phase de <strong>la</strong> consonne qui ne subit que peu ou pas de changements<br />
temporels ? En supposant que <strong>la</strong> phase médiane (tenue et constriction maximale) est <strong>la</strong><br />
plus pertinente pour une bonne <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> et une bonne perception de <strong>la</strong> consonne, nous<br />
ne devrions pas observer beaucoup de changements temporels entre <strong>la</strong> parole normale et<br />
85
<strong>la</strong> parole perturbée. Autrement dit, <strong>la</strong> phase médiane résisterait mieux que les autres<br />
phases à <strong>la</strong> présence d’une perturbation.<br />
4.2.3 Les dép<strong>la</strong>cements linguaux<br />
Les mesures spatiales sont prises au moment où <strong>la</strong> constriction (<strong>la</strong>ngue pa<strong>la</strong>is) est à son<br />
maximum <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal. L’amplitude <strong>des</strong> contacts est définie <strong>dans</strong> cette étude<br />
comme étant le plus grand nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux. Nous nous demandons<br />
si <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks modifie l’amplitude <strong>des</strong> gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Nous avons<br />
vu <strong>dans</strong> le chapitre 3 que <strong>la</strong> mâchoire et <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sont mécaniquement liées. Nous<br />
pensons que <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, devenue moins mobile quand <strong>la</strong> mâchoire est bloquée, ne pourra<br />
pas réaliser une aussi <strong>la</strong>rge constriction qu’en parole normale. Plus l’ouverture<br />
mandibu<strong>la</strong>ire est importante, plus <strong>la</strong> constriction devrait être ré<strong>du</strong>ite et l’amplitude <strong>des</strong><br />
contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux ré<strong>du</strong>ite. Si <strong>la</strong> trajectoire de <strong>la</strong> constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale est<br />
modifiée, alors le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne est dép<strong>la</strong>cé. Nous nous demandons<br />
si les bite-blocks incitent à une postériorisation ou à une antériorisation <strong>des</strong> contacts<br />
linguo-pa<strong>la</strong>taux.<br />
Des aspects spatiaux (amplitude de contacts) et temporels (<strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture et de<br />
l’ouverture) nous avons dé<strong>du</strong>it les vitesses de fermeture et d’ouverture. La présence <strong>des</strong><br />
bite-blocks modifie-t-elle <strong>la</strong> rapidité d’exécution de l’établissement et <strong>du</strong> relâchement<br />
de <strong>la</strong> constriction ? Si avec les bite-blocks nous supposons un allongement temporel et<br />
une ré<strong>du</strong>ction de l’amplitude, alors nous pouvons dire les mouvements linguaux sont<br />
plus lents. Si nous supposons un racourcissement temporel, alors les mouvements<br />
linguaux seraient plus rapi<strong>des</strong>.<br />
4.3 A propos <strong>des</strong> contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
Les consonnes étudiées sont /d/ et /t/ suivies alternativement <strong>des</strong> voyelles /a/ et /i/. Bien<br />
que nous ayons conscience qu’il existe en parole normale déjà une éten<strong>du</strong>e de<br />
réalisations, <strong>du</strong>e en grande partie à <strong>la</strong> co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de deux ou plusieurs segments, nous<br />
cherchons à faire ressortir <strong>la</strong> variabilité <strong>dans</strong> le geste consonantique qui serait propre à<br />
<strong>la</strong> seule présence <strong>des</strong> bite-blocks. Nous nous demandons si les effets <strong>des</strong> bite-blocks<br />
dépendent de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle subséquente et <strong>du</strong> voisement de <strong>la</strong> consonne. Pour<br />
86
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 4 : Problématique.<br />
répondre à cette question nous devons isoler les effets <strong>des</strong> bite-blocks et voir s’ils sont<br />
significatifs.<br />
D’autre part, nous nous attendons à observer <strong>des</strong> différences de réaction entre nos deux<br />
locuteurs. Nous supposons que <strong>la</strong> stratégie de réponse aux perturbations sera fonction de<br />
leurs caractéristiques physiologiques propres, <strong>des</strong> contraintes phonologiques,<br />
aérodynamiques et/ou <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Mais nous espérons parvenir à isoler <strong>des</strong> réponses<br />
communes aux deux locuteurs, <strong>des</strong> régu<strong>la</strong>rités qui pourront être citées comme <strong>des</strong><br />
principes en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole afin de préserver <strong>la</strong> viabilité de l’acte linguistique<br />
malgré <strong>la</strong> perturbation.<br />
Enfin, nous cherchons <strong>des</strong> effets d’adaptation à <strong>la</strong> perturbation. Est-ce que<br />
l’apprentissage, ou le fait que <strong>la</strong> tâche soit répétée plusieurs fois, aide le locuteur à<br />
réaliser plus facilement ses réajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ? Nous avons enregistré douze<br />
répétitions de chaque séquence à étudier sur trois sessions d’enregistrement. Pour<br />
prendre conscience d’un éventuel effet d’adaptation, nous comparons les résultats de <strong>la</strong><br />
première session aux résultats de <strong>la</strong> dernière session. Ainsi, nous tentons de savoir si les<br />
réajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s repérés sont une réaction innée et spontanée <strong>du</strong> système<br />
(pas de différence significative entre <strong>la</strong> première et <strong>la</strong> dernière session) ou sont issus<br />
d’un processus de contrôle volontaire qui s’améliore avec le temps, l’apprentissage et <strong>la</strong><br />
mémoire.<br />
87
5.1 Intro<strong>du</strong>ction<br />
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
CHAPITRE 5<br />
Méthode expérimentale<br />
Nous rappelons que nous voulons quantifier et qualifier les variations <strong>des</strong> mouvements<br />
linguaux en réponse à une perturbation extérieure : blocage de l’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire<br />
au moyen de bite-blocks. Nous effectuons une analyse spatio-temporelle <strong>des</strong><br />
mouvements linguaux à l’aide de l’électropa<strong>la</strong>tographie. Le bon déroulement d’un<br />
travail de recherche repose en grande partie sur les moyens et métho<strong>des</strong> dont nous<br />
disposons pour répondre à <strong>la</strong> problématique posée. Nous présentons donc <strong>dans</strong> ce<br />
chapitre <strong>la</strong> méthodologie choisie. Nous commençons par exposer comment nous avons<br />
constitué le corpus et comment nous avons réalisé les enregistrements<br />
l’électropa<strong>la</strong>tographiques. Ensuite nous présentons de quelle manière nous avons traité<br />
le corpus. Nous l’avons segmenté et étiqueté afin d’obtenir les mesures <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
<strong>des</strong> mouvements linguaux de chaque locuteur. Nous justifions nos choix expérimentaux<br />
et de proposons <strong>des</strong> solutions aux problèmes rencontrés.<br />
5.2 Description <strong>du</strong> corpus<br />
5.2.1 Cadre expérimental<br />
Les mouvements linguaux compensatoires <strong>des</strong> locuteurs sont appréhendés en<br />
fonction de plusieurs variables. Ces variables indépendantes font partie <strong>des</strong> contraintes<br />
de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> dont il faudra tenir compte lors de l’interprétation <strong>des</strong> résultats :<br />
-le lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> consonnes<br />
-<strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion en fonction <strong>du</strong> contexte vocalique ouvert/fermé<br />
-le voisement<br />
-<strong>la</strong> configuration <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is de chaque locuteur<br />
89
Les variables dépendantes sont les événements observés sur le p<strong>la</strong>n spatial et temporel :<br />
l’amplitude et le positionnement <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux, les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> segments<br />
consonantiques et les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> différentes phases de <strong>la</strong> consonne. Nous pouvons<br />
dé<strong>du</strong>ire de ces observations spatio-temporelles <strong>la</strong> vitesse avec <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue atteint<br />
le point de constriction et <strong>la</strong> vitesse avec <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue revient <strong>dans</strong> sa position<br />
initiale.<br />
5.2.2 Le corpus<br />
5.2.2.1 Préliminaires et limites de notre étude<br />
Seules les consonnes linguo-pa<strong>la</strong>tales, qui nécessitent <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue comme articu<strong>la</strong>teur,<br />
retiennent notre attention. Les consonnes bi<strong>la</strong>biales et <strong>la</strong>biodentales /p, b, f, v, et m/ sont<br />
ainsi exclues de l’analyse de cette thèse. Au départ de l’investigation, nous avons<br />
enregistré un <strong>la</strong>rge corpus qui contenait l’ensemble <strong>des</strong> consonnes linguales <strong>du</strong> français:<br />
les <strong>occlusives</strong> orales et nasale /n, t, d, k, g/, les fricatives /s, z, S, Z/. Nous avons tenu à<br />
travailler sur les deux gran<strong>des</strong> macro-c<strong>la</strong>sses <strong>du</strong> système consonantique français : les<br />
<strong>occlusives</strong> et les fricatives. Dans le tableau suivant, nous avons regroupé sous le terme<br />
« Avant » les consonnes qui s’articulent <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région antérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is (dentale,<br />
alvéo<strong>la</strong>ire, pré-pa<strong>la</strong>tale) et sous le terme « Arrière » celles qui s’articulent <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
région postérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is.<br />
Mode d’articu<strong>la</strong>tion Lieu d’articu<strong>la</strong>tion<br />
Avant Arrière<br />
Occlusive n, t, d k, g<br />
Fricative s, z, S, Z<br />
Latérale l<br />
Figure n° 5.1: Tableau de toutes les consonnes enregistrées pour notre corpus.<br />
90
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
5.2.2.2 Constitution <strong>du</strong> corpus<br />
Afin de ré<strong>du</strong>ire certaines variables qui risqueraient de nous in<strong>du</strong>ire en erreur ou de<br />
fausser nos interprétations (débit de parole, accentuation), nous avons choisi de<br />
travailler sur un corpus contrôlé. Une étude <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, comme <strong>la</strong> nôtre, demande <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce d’un protocole expérimental particulier, notamment pour utiliser<br />
l’électropa<strong>la</strong>tographie. Nous avons donc constitué un corpus dit « de <strong>la</strong>boratoire » par<br />
opposition à <strong>des</strong> corpus oraux plus spontanés comme <strong>des</strong> entretiens guidés ou <strong>des</strong><br />
dialogues. Le corpus est constitué de séquences Consonne-Voyelle-Consonne (CVC)<br />
Chaque consonne étudiée est initiale de <strong>la</strong> séquence CVC <strong>dans</strong> <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> voyelle est<br />
alternativement <strong>la</strong> plus ouverte, /a/, et <strong>la</strong> plus fermée, /i/. Ces deux voyelles extrêmes <strong>du</strong><br />
système vocalique français sollicitent deux positions différentes de <strong>la</strong> mandibule. La<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> voyelle /a/ exige que <strong>la</strong> mandibule soit en position basse alors que <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’un /i/ se fait en relevant <strong>la</strong> mandibule en position haute.<br />
Ensuite, nous avons inséré ces séquences à l’intérieur de <strong>la</strong> phrase porteuse « il ne dit<br />
pas CVC encore ». La construction de phrases porteuses permet au locuteur de pro<strong>du</strong>ire<br />
<strong>la</strong> séquence étudiée à l’intérieur d’un schéma rythmique inchangé, sans que ces<br />
séquences ne soient isolées afin de neutraliser les effets de liste, notamment re<strong>la</strong>tifs à<br />
l’intensité et à <strong>la</strong> finalité. La syl<strong>la</strong>be cible CV est p<strong>la</strong>cée au milieu de <strong>la</strong> phrase. Nous<br />
avons affecté symétriquement <strong>la</strong> voyelle /a/ de part et d’autre de <strong>la</strong> séquence CVC pour<br />
que le contexte vocalique <strong>des</strong> séquences CVC soit ouvert (a CVC a). Le choix de cette<br />
voyelle repose sur le fait qu’elle est communément décrite comme étant <strong>la</strong> voyelle qui<br />
exerce le moins d’influence sur les segments contigus. Observée avec<br />
l’électropa<strong>la</strong>tographie, <strong>la</strong> voyelle /a/ se caractérise par une quasi-absence de contacts<br />
linguo-pa<strong>la</strong>taux, si ce n’est parfois quelques contacts <strong>la</strong>téraux postérieurs. Cette<br />
articu<strong>la</strong>tion ouverte facilite le repérage <strong>du</strong> début et de <strong>la</strong> fin <strong>des</strong> constrictions linguopa<strong>la</strong>tales<br />
<strong>des</strong> segments consonantiques. Ainsi, au début et à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> séquence CVC,<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est en position basse. En résumé, notre corpus compte 20 phrases, et nous<br />
avons étudié les suivantes<br />
Il ne dit pas tit encore<br />
Il ne dit pas tat encore<br />
Il ne dit pas did encore<br />
Il ne dit pas dad encore<br />
91
Dans un second temps, nous avons procédé à une ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> corpus. Finalement nous<br />
nous sommes concentrée sur l’observation affinée <strong>des</strong> paramètres spatiaux et temporels<br />
<strong>des</strong> consonnes /t/ et /d/. Nous avons retenu les <strong>occlusives</strong> alvéo<strong>la</strong>ires orales pour<br />
plusieurs raisons. Ce sont <strong>des</strong> consonnes antérieures pour lesquelles l’analyse<br />
électropa<strong>la</strong>tographique donne une information complète. L’analyse temporelle de<br />
l’évolution d’une consonne occlusive peut se faire sur les trois phases <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
(attaque, tenue, relâchement) permettant ainsi d’estimer le timing intra-segmental. Face<br />
aux variations naturelles <strong>dans</strong> <strong>la</strong> chaîne parlée (coarticu<strong>la</strong>tion, débit, accent) les<br />
<strong>occlusives</strong> sont <strong>des</strong> consonnes très résistantes et donc moins déformées. En les<br />
choisissant, nous pensions avoir plus de chance de trouver <strong>des</strong> variations qui soient <strong>du</strong>es<br />
à <strong>la</strong> présence de <strong>la</strong> perturbation expérimentale.<br />
Nous avons exclu les consonnes vé<strong>la</strong>ires car avec une voyelle ouverte comme le /a/,<br />
nous ne pouvons pas distinguer <strong>la</strong> constriction au-delà de <strong>la</strong> limite <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r et en<br />
dé<strong>du</strong>ire une analyse <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> complète<br />
Nous avons analysé <strong>la</strong> consonne C1 accentuée de <strong>la</strong> séquence C1VC2. Nous justifions<br />
ce choix en faisant référence aux travaux déjà existants sur <strong>la</strong> force <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Une<br />
hypothèse serait de dire que l’accent provoque un renforcement <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> local issue<br />
d’une activité muscu<strong>la</strong>ire plus importante (Ellis et Hardcastle 1999, Fougeron 1998).<br />
Les consonnes initiales sont plus robustes à <strong>la</strong> coarticu<strong>la</strong>tion et aux changements :<br />
effacement de beaucoup de consonnes finales mais préservation <strong>des</strong> consonnes initiales.<br />
Straka (1963) rend compte que <strong>la</strong> parole en tant qu’acte biologique est caractérisée par<br />
<strong>la</strong> mo<strong>du</strong><strong>la</strong>tion de l’activité muscu<strong>la</strong>ire et énergétique accrue en fonction <strong>des</strong> impératifs<br />
linguistiques tels l’accent, ou extralinguistiques tels une prononciation très marquée. Ce<br />
processus de renforcement par <strong>la</strong> force <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> rend compte <strong>des</strong> phénomènes de<br />
variations phonétiques et phonologiques.<br />
5.2.2.3 Les locuteurs<br />
Le plus gros écueil rencontré en ce qui concerne <strong>la</strong> formation <strong>du</strong> corpus était de trouver<br />
<strong>des</strong> locuteurs qui avaient déjà leur propre pa<strong>la</strong>is artificiel. Les pa<strong>la</strong>is artificiels doivent<br />
être réalisés par mou<strong>la</strong>ge sur le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r de chaque locuteur et le coût de <strong>la</strong> réalisation<br />
est très élevé. Nous avons pu enregistrer deux jeunes hommes de 29 ans et 30 ans, de<br />
<strong>la</strong>ngue maternelle française et résidant à Aix-en-Provence pendant les enregistrements.<br />
92
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
Lors d’une étude antérieure sur les voyelles nasales <strong>du</strong> français méridional (C<strong>la</strong>iret,<br />
1997), nous recherchions <strong>des</strong> locuteurs à l’accent particulièrement marqué à opposer à<br />
<strong>des</strong> locuteurs ayant un accent plus neutre. Or, les résultats <strong>du</strong> test de validation réalisé<br />
par dix auditeurs ont donné ces deux locuteurs (YM et BL) comme n’ayant pas d’accent<br />
régional marqué. Nous soulignons que nos locuteurs n’avaient pas de problème de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> ou de perception de <strong>la</strong> parole, ni d’anomalie physiologique au moment <strong>des</strong><br />
enregistrements.<br />
5.2.2.4 Les conditions d’enregistrement<br />
C’est par l’intermédiaire de <strong>la</strong> station de travail PHYSIOLOGIA que nous avons pu<br />
recueillir nos données électropa<strong>la</strong>tographiques. Cette station de travail a été développée<br />
à l'Institut de Phonétique d'Aix-en-Provence par Bernard Teston, Benoît Galindo et<br />
A<strong>la</strong>in Ghio (Teston et al. 1990, 1999). Les enregistrements ont eu lieu à l’Hopital<br />
Pasteur d’Aix-en-Provence, où une annexe <strong>du</strong> <strong>la</strong>boratoire Parole et Langage est installée<br />
<strong>dans</strong> le service Neurologie-Réé<strong>du</strong>cation Fonctionnelle <strong>du</strong> Dr Viallet. Nous avons réalisé<br />
3 sessions d’enregistrement : une première en décembre 1999, une seconde en<br />
septembre 2000 et <strong>la</strong> dernière en janvier 2001. Les locuteurs étaient enregistrés avec un<br />
micro-casque, leur pa<strong>la</strong>is artificiel respectif et leurs bite-blocks respectifs (trois tailles<br />
de bite-blocks). Une période d’adaptation au pa<strong>la</strong>is artificiel d’environ trente minutes<br />
était prévue pour chaque locuteur. Durant cette période, nous discutions avec lui et lui<br />
faisions lire le corpus une fois en même temps que nous réalisions les rég<strong>la</strong>ges<br />
nécessaires sur l’appareil<strong>la</strong>ge de <strong>la</strong> station de travail. Nous estimions que le locuteur<br />
n’était plus gêné lorsqu’il il ne présentait plus de zézaiement ni de salivation engendrés<br />
par le port <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is artificiel <strong>dans</strong> <strong>la</strong> bouche. Les deux locuteurs avaient une certaine<br />
expérience <strong>du</strong> port <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is artificiel car ils avaient déjà fait l’objet d’autres<br />
expérimentations avec l’EPG. Par contre nous n’avons pas prévu de phase d’adaptation<br />
avec les bite-blocks. Dès que les bite-blocks étaient mis en p<strong>la</strong>ce <strong>dans</strong> <strong>la</strong> bouche, nous<br />
demandions au locuteur de commencer à lire le corpus.<br />
La tâche demandée était <strong>la</strong> suivante. Les locuteurs devaient lire les 20 phrases, le plus<br />
naturellement possible, avec un débit normal et sans pause. Si phrase nous semb<strong>la</strong>it lue<br />
trop rapidement ou trop lentement nous pouvions <strong>la</strong> réenregistrer à notre guise afin<br />
d’essayer de contrôler le débit de parole. Dans les cas de réalisations présentant une<br />
93
hésitation, une erreur segmentale ou prosodique (intonation interrogative sur une<br />
assertion ou insertion de pause…) ou d’un problème technique pendant l’acquisition, <strong>la</strong><br />
phrase était relue et réenregistrée.<br />
Chaque phrase était lue par le locuteur <strong>dans</strong> un ordre aléatoire. Les bite-blocks étaient<br />
aussi présentés de façon aléatoire puisque le locuteur les choisissait sans les voir. Nous<br />
avons réalisé trois épaisseurs de bite-blocks. Ainsi, avec <strong>la</strong> condition de référence sans<br />
bite-block, nous avions quatre conditions expérimentales:<br />
B0 : sans bite-block, enregistrement de référence<br />
B1 : avec bite-block1 (fin)<br />
B2 : avec bite-block2 (moyen)<br />
B3 : avec bite-block3 (<strong>la</strong>rge)<br />
5.2.3 La réalisation <strong>des</strong> bite-blocks<br />
Le choix de l’épaisseur <strong>des</strong> bite-block s’est fait en référence à ceux trouvés <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
littérature. Nous rapportons ici un échantillon <strong>des</strong> différentes épaisseurs de bite-blocks<br />
que nous avons pu recenser à partir <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> antérieures. Nous avons choisi nos trois<br />
épaisseurs parmi <strong>la</strong> gamme proposée <strong>dans</strong> le tableau ci-<strong>des</strong>sous, figure 5.2, en essayant<br />
de rester le plus cohérente possible et de respecter les mêmes écarts d’épaisseur entre<br />
les bite-blocks, mais aussi en fonction <strong>des</strong> outils et possibilités techniques dont nous<br />
disposions.<br />
94
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
Etu<strong>des</strong> Epaisseur <strong>des</strong> bite-blocks<br />
Lindblom et al. 1977, 1979<br />
95<br />
2,5, 6, 21,<br />
22,5 et 25 mm<br />
Warren et al. 1980, 1984 1, 3 et 6 mm<br />
Fowler et Turvey 1980 10 et 14 mm<br />
Folkins et Zimmerman 1981 5 et 15 mm<br />
Gay et al. 1981 2,5 et 25 mm<br />
Kelso et Tuller 1983 5, 17, 23 mm<br />
Putman et al. 1986 2, 4 et 6 mm<br />
Flege et al.1988 5, 8, 9, 14mm<br />
McFar<strong>la</strong>nd et Baum 1995 10 et 22,5mm<br />
Savariaux et al. 1995 3, 5 et 8 mm<br />
McFar<strong>la</strong>nd et al. 1996 Pa<strong>la</strong>is 3 et 6mm<br />
Demolin et al. 1997 Bouteille 2 cm diamètre<br />
Horga 2002 3 et 25 mm<br />
Figure n° 5.2 : Tableau <strong>des</strong> différentes épaisseurs <strong>des</strong> bite-blocks utilisés <strong>dans</strong> les étu<strong>des</strong><br />
antérieures.<br />
La réalisation <strong>des</strong> bite-blocks a été faite manuellement avec <strong>la</strong> pâte de KERR, réservée à<br />
l’usage bucco-dentaire. Cette pâte est une résine dentale thermo-malléable qui sert<br />
habituellement à faire les empreintes dentaires et qui se présente sous forme de tablettes<br />
de 5 mm d’épaisseur. Nous l’avons faite ramollir en <strong>la</strong> trempant quelques minutes <strong>dans</strong><br />
l’eau bouil<strong>la</strong>nte. Ensuite, devenue facilement malléable, nous lui avons donné <strong>la</strong> forme<br />
voulue. Nous l’avons roulée en boudins d’environ quatre centimètres de long et l’avons<br />
calée entre les mo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur. Ensuite, le locuteur fermait <strong>la</strong> mâchoire sur <strong>des</strong><br />
mèches tenues coincées entre les incisives, sans bouger, <strong>du</strong>rant les quelques secon<strong>des</strong><br />
nécessaires au <strong>du</strong>rcissement de <strong>la</strong> pâte.<br />
Cette méthode a permis de garder les empreintes <strong>des</strong> dents sur les bite-blocks pour<br />
éviter ainsi les glissements quand le sujet par<strong>la</strong>it de façon continue. Une fois le biteblock<br />
installé, nous avons mesuré l’intervalle inter-dental <strong>des</strong> incisives à l’aide d’un<br />
pied à coulisse. Les mèches utilisées étaient de 5, 10 et 16 mm d’épaisseur pour chaque
locuteur. Cependant, les intervalles mesurés entre les incisives ont été soumis à de<br />
légères variations en fonction <strong>des</strong> dentures de nos locuteurs.<br />
Mèches Locuteur YM Locuteur BL<br />
5 mm<br />
10 mm<br />
16 mm<br />
5,5 mm<br />
10 mm<br />
17 mm<br />
96<br />
6 mm<br />
11 mm<br />
17 mm<br />
Figure n° 5.3 : Tableau <strong>des</strong> intervalles inter-incisives de nos locuteurs.<br />
Afin d’obtenir l’aspect final <strong>du</strong> bite-block il a était nécessaire de raboter et de limer<br />
finement le surplus de pâte qui retombait sur les côtés internes et externes <strong>des</strong> gencives.<br />
En effet, ce dernier ajustement permit aux locuteurs de ne pas sentir les bite-blocks avec<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Ils n’avaient donc aucun risque de se râper <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et d’entraver ses<br />
mouvements. Après plusieurs tests, nous obtenions l’aspect final <strong>des</strong> bite-blocks<br />
présentés <strong>dans</strong> <strong>la</strong> figure ci-<strong>des</strong>sous.<br />
Figure n° 5.4 : Les trois épaisseurs de bite-blocks : de gauche à droite, <strong>des</strong> plus épais aux<br />
moins épais.
5.3 L’électropa<strong>la</strong>tographie<br />
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
L’électropa<strong>la</strong>tographie dynamique (EPG) est une technique qui permet d’enregistrer à<br />
intervalles réguliers le contact de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sur le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r. Cette technique fournit <strong>des</strong><br />
informations spatio-temporelles sur l’articu<strong>la</strong>tion linguale <strong>des</strong> sons de <strong>la</strong> parole, <strong>dans</strong> les<br />
p<strong>la</strong>ns coronal et sagittal. C’est le seul instrument de mesure qui donne <strong>des</strong> informations<br />
spatiales et temporelles <strong>des</strong> patrons de contacts entre <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et le pa<strong>la</strong>is (Stone 1997).<br />
Les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ne sont pas directement détectés mais sont inférés par les<br />
changements <strong>des</strong> configurations <strong>des</strong> patrons linguo-pa<strong>la</strong>taux.<br />
Figure n° 5.5: Un exemple d’un pa<strong>la</strong>is artificiel (modèle de Reading) moulé sur le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r,<br />
d’après Meynadier (2003).<br />
L’EPG se compose d’un pa<strong>la</strong>is artificiel fabriqué en résine acrylique d’une épaisseur<br />
d’environ un millimètre et demi à partir d’une empreinte <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is de chaque sujet. Il est<br />
moulé pour couvrir tout le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r. 62 électro<strong>des</strong> sont arrangées symétriquement en<br />
ligne sur l’axe coronal. Au moyen d’une électrode externe, un courant électrique de bas<br />
voltage est envoyé <strong>dans</strong> le corps <strong>du</strong> locuteur porteur <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. L’électrode externe et les<br />
électro<strong>des</strong> <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is constituent deux pôles <strong>du</strong> circuit électrique. La <strong>la</strong>ngue agit comme<br />
un commutateur. Lorsqu’elle touche une électrode, le circuit est fermé et le contact est<br />
détecté grâce au passage <strong>du</strong> courant (Marchal 1988, Nguyen et Marchal 1993). Le<br />
système EPG dont nous disposons à Aix-en-Provence est le système de Reading. Il est<br />
possible d’acquérir un signal émis par les 62 électro<strong>des</strong> toutes les 5 millisecon<strong>des</strong>.<br />
(Hardcastle 1972, 1984, Hardcastle et al. 1989) Comme illustré <strong>dans</strong> <strong>la</strong> figure 5.6 ci<strong>des</strong>sous,<br />
les électro<strong>des</strong> contactées sont noircies et les électro<strong>des</strong> non contactées sont en<br />
b<strong>la</strong>nc. Plus il y a d’électro<strong>des</strong> contactées, plus <strong>la</strong> constriction est importante et<br />
inversement. L’on peut se référer aux nombreux travaux de Hardcastle (1991) et de<br />
97
Nico<strong>la</strong>idis et al. (1993) pour une revue complète <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> EPG. La concentration <strong>des</strong><br />
électro<strong>des</strong> est plus grande sur les régions antérieures alvéo<strong>la</strong>ire et pré-pa<strong>la</strong>tale. L’écart<br />
entre les électro<strong>des</strong> varie en fonction de leur localisation sur le pa<strong>la</strong>is et donc de <strong>la</strong><br />
morphologie <strong>du</strong> sujet. Il n’existe donc pas deux pa<strong>la</strong>is identiques.<br />
Figure n° 5.6 : Un pa<strong>la</strong>is artificiel et sa représentation graphique à droite.En noir,nous voyons<br />
les électro<strong>des</strong> contactées pour <strong>la</strong> constriction maximale de /t/, d’après Meynadier (2003).<br />
Pour le linguiste il existe plusieurs applications essentielles de l’EPG. Les données<br />
pa<strong>la</strong>tographiques peuvent être utilisées pour caractériser l’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> sons <strong>du</strong><br />
<strong>la</strong>ngage (Marchal 1985) à partir de l’observation de <strong>la</strong> localisation et de l’éten<strong>du</strong>e <strong>des</strong><br />
contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux. Ainsi on peut définir le mode et le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de<br />
chaque segment phonétique. L’EPG nous permet aussi de différencier les différentes<br />
parties de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (l’apex, <strong>la</strong> <strong>la</strong>me, le corps ou <strong>la</strong> partie postérieure) qui entrent en<br />
contact avec les différentes régions <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is (Nguyen et al.1996). L’EPG renseigne sur<br />
tous les sons linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>des</strong> <strong>la</strong>ngues <strong>du</strong> monde qui sont réalisés à partir de contacts<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sur le pa<strong>la</strong>is : les sons alvéo<strong>la</strong>ires, tels [t, d, l, n, s, z], post-alvéo<strong>la</strong>ires, [Z,<br />
S], les f<strong>la</strong>ps, et les trills, pour le japonais (Fujimura et al. 1973), pour l’Italien<br />
(Farnetani, 1986), pour le cata<strong>la</strong>n (Recasens, 1991, 1993b), pour l’ang<strong>la</strong>is (Hardcastle<br />
1984). Les sons vé<strong>la</strong>ires comme [k, g, N ] sont moins étudiés car le pa<strong>la</strong>is traditionnel de<br />
Reading s’arrête habituellement avant le pa<strong>la</strong>is mou.<br />
Pour les fricatives, l’EPG fournit <strong>des</strong> informations sur <strong>la</strong> <strong>la</strong>rgeur et <strong>la</strong> longueur <strong>du</strong> sillon<br />
formé par <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue caractéristique de ce mode d’articu<strong>la</strong>tion. (Flege et al. 1988).<br />
98
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
L’effet de coarticu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> voyelles adjacentes sur les contacts de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is pendant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes révèle <strong>la</strong> façon dont nous réalisons les<br />
séquences <strong>des</strong> sons et quelles sont les stratégies de contrôle (Farnetani 1990, 1991,<br />
Marchal 1983, Recasens 1984, 1999, Gibbon et al. 1993).<br />
Dans l’étude <strong>des</strong> désordres <strong>la</strong>ngagiers, l’EPG est utilisé pour étudier aussi les sujets<br />
pathologiques. C’est un instrument de choix car il est assez peu invasif. Une revue <strong>des</strong><br />
aspects clinique de l’utilisation de l’EPG peut être trouvée chez Nico<strong>la</strong>idis et al. (1993).<br />
Pour l’étude <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>tions compensatoires de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue en réponse à une perturbation<br />
<strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal, Flege et al. (1988) ont utilisé l’EPG pour observer les<br />
mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> /t/ et /S/ ang<strong>la</strong>is et arabe quand <strong>la</strong><br />
mâchoire était bloquée. Nous pouvons aussi référer aux travaux de Hamlet et Stone<br />
(1988), McFar<strong>la</strong>nd et Baum (1995) et certaines étu<strong>des</strong> recensées <strong>dans</strong> le chapitre 3. Au<br />
cours de travaux précédents (C<strong>la</strong>iret 2000), nous avons aussi utilisé l’EPG pour<br />
observer les mouvements compensatoires de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sur les consonnes <strong>occlusives</strong> et<br />
fricatives <strong>du</strong> français en situation de mâchoire bloquée.<br />
5.3.1 Les plus et les moins de l’EPG<br />
Les avantages de l’EPG sont notamment que l’acquisition <strong>des</strong> données peut se faire sur<br />
le p<strong>la</strong>n spatial et temporel. La représentation dynamique est sur trois dimensions : sur<br />
l’axe antéro-postérieur, sur l’axe gauche-droite et sur l’axe temporel.<br />
Les données peuvent être rapi<strong>des</strong> à acquérir<br />
Cette technique est peu invasive et sans risque pour les sujets. Elle permet <strong>des</strong><br />
enregistrements sur plusieurs sessions.<br />
Le signal acoustique est retransmis en simultané et peut permettre une analyse<br />
acoustique parallèle.<br />
Reste que les inconvénients de l’EPG sont les suivants.<br />
Le coût élevé de chaque pa<strong>la</strong>is et le peu de fabricants rend <strong>la</strong> démarche longue et<br />
difficile et a pour effet de limiter le nombre de locuteurs.<br />
L’EPG donne <strong>des</strong> informations seulement quand <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue touche le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r. Les<br />
mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité buccale entre deux réalisations pa<strong>la</strong>tines ne sont<br />
pas connus, notamment quand <strong>la</strong> mâchoire s’abaisse fortement et que <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue bouge<br />
loin <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. L’EPG ne permet pas d’obtenir <strong>des</strong> informations directes sur les<br />
99
caractéristiques cinématiques <strong>des</strong> mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue comme <strong>la</strong> vélocité ou le<br />
dép<strong>la</strong>cement <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Les articu<strong>la</strong>tions postérieures sur le pa<strong>la</strong>is mou ne sont pas toujours visibles. Il est<br />
difficile d’observer <strong>des</strong> consonnes vé<strong>la</strong>ires telles que /k/ et /g/ sans penser qu’il y a peutêtre<br />
<strong>des</strong> contacts qui ne sont pas visibles, car trop postérieurs.<br />
La question de l’influence d’un pa<strong>la</strong>is artificiel a été étudiée, entre autres, par Hamlet et<br />
Stone (1978). Ces auteurs montrent que <strong>la</strong> mandibule s’abaisse davantage <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole<br />
sans pa<strong>la</strong>is que <strong>dans</strong> <strong>la</strong> parole avec pa<strong>la</strong>is. Hamlet et Stone (1978) montrent que les<br />
consonnes alvéo<strong>la</strong>ires les plus affectées restent les fricatives même après une période<br />
d’adaptation de quinze minutes : le pa<strong>la</strong>is in<strong>du</strong>it une diminution de <strong>la</strong> dépression<br />
centrale caractéristique de <strong>la</strong> réalisation normale de /s/ bien que le lieu d’articu<strong>la</strong>tion ne<br />
soit pas changé. Il est important de noter que ces auteurs utilisent un pa<strong>la</strong>is artificiel de<br />
3 à 6 mm d’épaisseur et que le port d’un pa<strong>la</strong>is d’un millimètre et demi d’épaisseur leur<br />
sert de valeur de référence. L’étude de McFar<strong>la</strong>nd et al. (1996) confirme aussi <strong>la</strong><br />
fragilité <strong>du</strong> /s/ par rapport aux autres consonnes alvéo<strong>la</strong>ires, face au port <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is.<br />
Cependant ces étu<strong>des</strong> s’accordent à conclure que l’utilisation d’un pa<strong>la</strong>is artificiel de<br />
moins d’un millimètre et demi d’épaisseur ne constitue pas une entrave importante à<br />
l’articu<strong>la</strong>tion normale. Le débit et <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> phonèmes ne sont pas significativement<br />
affectés par le port <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is artificiel (Hamlet et Stone 1978, McFar<strong>la</strong>nd et al.1996).<br />
Concernant <strong>la</strong> question d’un éventuel blocage <strong>des</strong> récepteurs tactiles <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r, les<br />
étu<strong>des</strong> de Hardcastle (1972, 1976) confirment que le pa<strong>la</strong>is ne contient que très peu de<br />
récepteurs tactiles. En effet, c’est une région si pauvre en nerfs qu’elle ne joue pas de<br />
rôle sensoriel. Les informations tactiles sont émises par les nombreux capteurs<br />
sensoriels de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue : c’est elle qui renvoie le feedback tactile et peut aisément<br />
compenser le port d’un pa<strong>la</strong>is artificiel.<br />
Nous avons conscience <strong>des</strong> éventuelles carences que présente cette technique<br />
d’investigation qu’est l’EPG. D’une part nous avons orienté <strong>la</strong> formation <strong>du</strong> corpus sur<br />
<strong>des</strong> consonnes dont nous sommes certaine de <strong>la</strong> viabilité de l’analyse<br />
électropa<strong>la</strong>tographique. D’autre part, nous savons par exemple qu’il sera impossible de<br />
rendre compte <strong>des</strong> vitesses brutes de l’exécution <strong>des</strong> gestes linguaux. Mais nous<br />
arrivons à dé<strong>du</strong>ire quand même le temps que <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue met pour effectuer le passage<br />
d’une cible <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> à l’autre. L’EPG nous semble un instrument de choix pour<br />
étudier l’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> sons linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>dans</strong> les trois p<strong>la</strong>ns, coronal, sagittal et<br />
100
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
temporel. L’EPG permet <strong>des</strong> analyses multiples sur l’axe spatial (amplitude <strong>des</strong><br />
contacts), temporel (timing inter-gestuel et intra-gestuel) et spatio-temporel (vitesse<br />
d’établissement <strong>des</strong> gestes).<br />
5.3.2 Les caractéristiques <strong>des</strong> consonnes linguales<br />
5.3.2.1 Sur le p<strong>la</strong>n spatial<br />
Les informations sur le p<strong>la</strong>n spatial permettent de définir le mode et le lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne, autrement dit de voir quelle partie de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue contacte le<br />
pa<strong>la</strong>is pour <strong>la</strong> réalisation d’un segment phonétique. Les différentes parties <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is sont<br />
délimitées en zones de façon empirique avec de fines variations (Recasens 1990,<br />
Hardcastle 1991, Gibbon et Nico<strong>la</strong>idis 1999). Les différentes parties de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue sont<br />
aussi divisées en sections de manière plus fonctionnelle, comme nous l’avons détaillé<br />
<strong>dans</strong> le chapitre 4 de <strong>la</strong> deuxième partie (Laver 1994, Hardcastle 1976). De ces<br />
informations, nous obtenons l’amplitude <strong>des</strong> gestes linguo-pa<strong>la</strong>taux qui correspond à<br />
l’aire de contact entre l’articu<strong>la</strong>teur actif (<strong>la</strong>ngue) et l’articu<strong>la</strong>teur passif (pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r).<br />
Physiquement l’amplitude de contacts correspond au nombre d’électro<strong>des</strong> contactées au<br />
moment de <strong>la</strong> constriction maximale <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité buccale. Quand <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est relevée<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité buccale, l’amplitude de ses contacts contre le pa<strong>la</strong>is est importante, quand<br />
elle est abaissée, l’amplitude <strong>des</strong> contacts est nulle. Ce degré d’élévation de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
dépend de <strong>la</strong> nature <strong>du</strong> segment réalisé, mais aussi <strong>du</strong> contexte vocalique environnant,<br />
<strong>des</strong> phénomènes accentuels et prosodiques, <strong>du</strong> débit et <strong>du</strong> style de parole.<br />
Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne correspond à l’endroit sur le pa<strong>la</strong>is où les<br />
électro<strong>des</strong> contactées sont les plus nombreuses : c’est le point de constriction maximale.<br />
Les consonnes alvéo<strong>la</strong>ires montrent <strong>des</strong> contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région dento-alvéo<strong>la</strong>ire, ou<br />
alvéo<strong>la</strong>ire, caractérisés par un contact de l’apex et/ou de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me (geste coronal). Les<br />
consonnes pa<strong>la</strong>tales montrent <strong>des</strong> contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région pa<strong>la</strong>tale (centrale) ou <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
région pré-vé<strong>la</strong>ire, et sont caractérisées par le mouvement <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Les<br />
consonnes vé<strong>la</strong>ires sont articulées avec le dos de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région <strong>la</strong> plus<br />
postérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is correspondant à <strong>la</strong> limite entre le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong>r et le pa<strong>la</strong>is mou. Le<br />
mode d’articu<strong>la</strong>tion est dé<strong>du</strong>it par <strong>la</strong> répartition <strong>des</strong> contacts sur l’axe gauche-droite. De<br />
101
nombreux contacts centraux tra<strong>du</strong>isent une constriction étroite. Les <strong>occlusives</strong> sont les<br />
consonnes qui ont le plus de contacts centraux puisque leur <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> exige un barrage<br />
total <strong>du</strong> flux d’air. A l’inverse, peu de contacts centraux tra<strong>du</strong>isent une constriction plus<br />
<strong>la</strong>rge. Les fricatives ont moins de contacts centraux parce que leur réalisation doit se<br />
faire de façon à <strong>la</strong>isser libre le passage <strong>du</strong> flux d’air. Concernant les voyelles qui sont,<br />
généralement plus ouvertes que les consonnes, les informations EPG peuvent s’avérer<br />
pauvres. En effet, seules les voyelles les plus fermées qui nécessitent une plus grande<br />
fermeture mandibu<strong>la</strong>ire, telles /i, y, u/ admettent quelques contacts visibles alors que les<br />
voyelles ouvertes ne montrent pas de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux.<br />
Figure n° 5.7 : Illustration de différentes consonnes <strong>du</strong> français prises au moment de <strong>la</strong><br />
constriction maximale, en contexte a_a, d’après Meynadier (2003).<br />
102
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
5.3.2.2 Sur le p<strong>la</strong>n temporel<br />
L’EPG peut aussi montrer quelle est l’évolution temporelle <strong>des</strong> mouvements linguopa<strong>la</strong>taux<br />
que nous venons de décrire. L’EPG ne montre pas le début et <strong>la</strong> fin de<br />
d’élévation ou d’abaissement de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, mais donne les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux à<br />
partir <strong>du</strong> moment où <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue contacte le pa<strong>la</strong>is. Pour le timing intra-gestuel, il est<br />
possible de délimiter et de quantifier les différentes phases d’un geste de constriction :<br />
attaque, constriction maximale et relâchement et aussi l’occlusion totale. Pour le timing<br />
inter-gestuel, on peut quantifier les effets de <strong>la</strong> coordination inter-gestuelle<br />
correspondant à <strong>la</strong> co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> entre les différents segments adjacents <strong>dans</strong> <strong>la</strong> chaîne<br />
parlée.<br />
5.3.3 Le traitement <strong>des</strong> données<br />
Dans cette partie, nous expliquons de quelle façon nous avons effectué les mesures<br />
spatiales et temporelles <strong>des</strong> consonnes <strong>des</strong> séquences CVC avec le logiciel M.E.S.<br />
(Espesser 1996). Notamment nous exposons nos critères de segmentation, les problèmes<br />
rencontrés et les solutions proposées. Les mesures sont fondées sur <strong>la</strong> reconnaissance<br />
<strong>des</strong> différents événements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s appréhendés de manière discrète et qui nous<br />
semblent les plus pertinents <strong>dans</strong> <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong> consonnes étudiées.<br />
5.3.3.1 Le logiciel MES<br />
Nous avons pu analyser les paramètres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s enregistrés avec le logiciel M.E.S,<br />
développé par Robert Espesser, sous environnement UNIX (Espesser 1996). Ce logiciel<br />
permet d’effectuer <strong>des</strong> mesures à partir de l’observation <strong>des</strong> courbes intonatives (F0) et<br />
d’intensité, les sonagrammes, les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux (EPG), les mouvements<br />
E.M.A (Articulograph ou Movetrack). Il permet surtout d’effectuer un marquage en<br />
unités discrètes <strong>des</strong> courbes temporelles grâce à <strong>la</strong> segmentation, et <strong>la</strong> création de<br />
fichiers d’étiquettes.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n spatial, le pa<strong>la</strong>is dynamique nous présente directement les électro<strong>des</strong><br />
activées au fur et à mesure que nous dép<strong>la</strong>çons le curseur sur le signal de parole, avec<br />
une image <strong>des</strong> profils de contacts toutes les 5 ms. Il permet d’observer en détail chaque<br />
103
configuration <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> (modification spatiale <strong>des</strong> contacts) propre à chaque phase<br />
consonantique à un moment choisi.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n temporel, les événements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s peuvent aussi être représentés par<br />
<strong>des</strong> courbes d’évolution <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux. Ces courbes nous donnent un<br />
aperçu continu de l’évolution <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux lors de <strong>la</strong> réalisation d’un ou<br />
plusieurs gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Nous pouvons alors mesurer <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’é<strong>la</strong>boration de<br />
<strong>la</strong> constriction, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> constriction, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> relâchement de <strong>la</strong> constriction.<br />
Nous pouvons voir sur <strong>la</strong> figure 5.8 ci-<strong>des</strong>sous, un exemple de courbe <strong>des</strong> contacts<br />
d’une séquence /tat/ synchronisée avec le signal acoustique.<br />
Figure n° 5.8 : Evolution temporelle d’une courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sur une<br />
séquence /tat/, locuteur YM. En abscisse, le temps et en ordonnées, le nombre de contacts.<br />
5.3.3.2 La segmentation pa<strong>la</strong>tographique<br />
Afin d’isoler les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone d’articu<strong>la</strong>tion propre à chaque<br />
occlusive, nous avons défini les zones EPG en fonction <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong><br />
consonnes, autrement dit selon le lieu de concentration maximale <strong>des</strong> électro<strong>des</strong><br />
104
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
contactées,. La zone alvéo<strong>la</strong>ire correspond aux trois premières rangées antérieures <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is. La zone antérieure est définie par les quatre premières rangées. La zone vé<strong>la</strong>ire<br />
correspond aux trois rangées postérieures <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is et <strong>la</strong> postérieure par les quatre<br />
dernières. Afin de poser <strong>des</strong> marqueurs, il faut définir un certain nombre de critères de<br />
segmentation. Ces critères sont utilisés pour traiter toutes les séquences CVC, aussi bien<br />
avec les bite-blocks que sans. L’illustration 5.9 ci-<strong>des</strong>sous représente <strong>la</strong> courbe<br />
d’évolution schématisée <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux d’une consonne /t/ suivie de /a/ et<br />
<strong>la</strong> segmentation <strong>des</strong> ses différentes phases.<br />
A<br />
B<br />
C D<br />
E<br />
F<br />
Figure n° 5.9 : Un exemple de segmentation manuelle d’une séquence /dad/, locuteur BL.<br />
105
A : Le début de <strong>la</strong> constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale correspond au point initial <strong>des</strong> contacts<br />
linguo-pa<strong>la</strong>taux. A ce moment il y a au moins une électrode activée indiquant au moins<br />
un contact <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone d’articu<strong>la</strong>tion observée sur le pa<strong>la</strong>is. Ce<strong>la</strong> se tra<strong>du</strong>it sur <strong>la</strong><br />
courbe <strong>des</strong> contacts par un pourcentage de contacts strictement supérieur à zéro.<br />
B : Le début de <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne est<br />
identifié par <strong>la</strong> première image EPG qui donne le taux de contacts le plus élevé <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
consonne : le plus souvent un p<strong>la</strong>teau <strong>des</strong> valeurs maximales <strong>du</strong> contact linguo-pa<strong>la</strong>tal.<br />
Bien sûr, les critères changent en fonction <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> consonnes<br />
observées. Concernant /t/ et/d/, le début de <strong>la</strong> tenue est marqué dès que commencent les<br />
contacts <strong>la</strong>téraux et dento-alvéo<strong>la</strong>ires : le premier p<strong>la</strong>teau <strong>des</strong> valeurs sur <strong>la</strong> courbe.<br />
C : Le début de <strong>la</strong> constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale maximale <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone d’articu<strong>la</strong>tion de<br />
<strong>la</strong> consonne est identifié dès que nous observons un maximum absolu de contacts (un<br />
maximum d’électro<strong>des</strong> activées). L’occlusion complète (sur le pa<strong>la</strong>is dynamique,<br />
barrage total <strong>du</strong> flux d’air <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne) peut apparaître<br />
superposée avec le maximum absolu de contacts, totalement ou en partie.<br />
D : La fin de <strong>la</strong> constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale maximale est réalisée dès que nous<br />
observons <strong>la</strong> fin <strong>des</strong> contacts maximum absolus, c’est à dire que <strong>la</strong> courbe commence à<br />
<strong>des</strong>cendre.<br />
E : La fin de <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est <strong>la</strong> dernière image EPG d’un p<strong>la</strong>teau plus ou moins<br />
stable <strong>des</strong> valeurs maximales. Pour les <strong>occlusives</strong> d’avant /t/ et /d/, <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> tenue se<br />
note juste avant que les derniers contacts <strong>la</strong>téraux et dento-alvéo<strong>la</strong>ires disparaissent.<br />
F : La fin de <strong>la</strong> constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale correspond à <strong>la</strong> dernière image EPG qui<br />
montre au moins une électrode activée, quand <strong>la</strong> consonne est suivie de /a/. Avec /i/, <strong>la</strong><br />
constriction n’est pas finie car il reste toujours les contacts <strong>du</strong> /i/. Pour passer de <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une occlusive alvéo<strong>la</strong>ire à <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’un /i/, l’apex se décolle et <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>me est relevée. Nous avons marqué <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> constriction dès <strong>la</strong> perte de contacts<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> région dento-alvéo<strong>la</strong>ire (deux premiers rangs), et l’apparition <strong>des</strong> contacts <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> région postalvéo<strong>la</strong>ire (troisième et quatrième rang) et <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région pa<strong>la</strong>tale.<br />
En résumé, <strong>la</strong> consonne entière est délimitée par les points A et F. La fermeture est<br />
limitée par les points A et C). L’ouverture est délimitée par les points D et F. La<br />
constriction maximale est délimitée par les point C et D. La tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est<br />
délimitée par les points B et E. Comme Simon (1967), nous considérons que <strong>du</strong>rant <strong>la</strong><br />
106
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
tenue, « <strong>la</strong> partie <strong>des</strong> organes qui intervient plus spécialement <strong>dans</strong> <strong>la</strong> réalisation d’un<br />
phonème, en le rendant distinct d’un autre, reste en position, mais il peut y avoir, et il y<br />
a en général, <strong>des</strong> modifications par ailleurs » (Simon 1967 p.150). Cette définition<br />
souligne l’indépendance entre l’apex et le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. En effet, l’apex peut rester<br />
contactée contre les alvéoles alors que le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est sujet à <strong>des</strong> micromouvements.<br />
Inversement, quand le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est immobile ce<strong>la</strong> n’empêche<br />
pas l’apex de bouger seul, c’est par exemple le cas <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une séquence<br />
/tit/.<br />
5.3.3.3 La segmentation acoustique<br />
La phrase porteuse et toutes les séquences CVC sont segmentées et étiquetées à l’aide<br />
<strong>du</strong> sonagramme caractérisé par une bande passante à 300Hz et une hauteur maximale de<br />
6000Hz. Les critères de segmentation utilisés sont les suivants :<br />
Le début de <strong>la</strong> consonne est noté dès <strong>la</strong> fin <strong>des</strong> formants de <strong>la</strong> voyelle /a/ qui précède <strong>la</strong><br />
séquence.<br />
La fin de <strong>la</strong> consonne, et le début de <strong>la</strong> voyelle, est notée aussitôt qu’apparaissent les<br />
formants de <strong>la</strong> voyelle centrale de <strong>la</strong> séquence CVC.<br />
La fin de <strong>la</strong> voyelle est notée dès <strong>la</strong> fin <strong>des</strong> formants.<br />
La <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> séquence CVC est notée au début de <strong>la</strong> première consonne et à <strong>la</strong> fin de<br />
<strong>la</strong> seconde.<br />
La <strong>du</strong>rée de le phrase porteuse est délimitée par <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> signal acoustique.<br />
5.4 Les mesures électropa<strong>la</strong>tographiques<br />
Rappelons que le but <strong>du</strong> travail est de déterminer les caractéristiques spatio-temporelles<br />
<strong>des</strong> gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s en parole normale tout d’abord. Ensuit il s’agit de comparer<br />
ces caractéristiques <strong>dans</strong> les situations de parole perturbée par les bite-blocks. Toutes les<br />
mesures spatiales, temporelles et spatio-temporelles sont effectuées sans bite-block afin<br />
de fournir un cadre de valeurs référentielles, et avec les trois bite-blocks de différentes<br />
épaisseurs. A partir de <strong>la</strong> segmentation <strong>du</strong> signal EPG, plusieurs types de mesures ont<br />
été faites. Les mesures re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> temporalité <strong>des</strong> gestes sont <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée et <strong>la</strong> proportion<br />
107
<strong>des</strong> différentes phases de <strong>la</strong> consonne. Les mesures re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> spatialité <strong>des</strong> gestes<br />
sont l’amplitude <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux et leur localisation.<br />
5.4.1 Les paramètres spatiaux.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n spatial, nous avons recours au repérage <strong>des</strong> contacts maximaux pour évaluer<br />
l’amplitude <strong>des</strong> courbes de contacts, à l’extraction <strong>des</strong> centres de gravité, et <strong>des</strong> patrons<br />
moyens de contacts.<br />
L’amplitude est re<strong>la</strong>tive au nombre de contacts maximum qui a été relevé<br />
manuellement <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> segmentation pa<strong>la</strong>tographique. L’endroit évalué comme étant le<br />
plus pertinent pour ce relevé se situe, au moment de <strong>la</strong> constriction maximale <strong>dans</strong> le<br />
con<strong>du</strong>it vocal. Le nombre de contact maximum est pris sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
zone d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne (région alvéo<strong>la</strong>ire) mais aussi <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région<br />
postérieure et <strong>dans</strong> <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Nous avons ensuite calculé le pourcentage<br />
moyen <strong>des</strong> électro<strong>des</strong> activées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone EPG concernée, par rapport à <strong>la</strong> totalité <strong>des</strong><br />
électro<strong>des</strong> <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is (62 sur le pa<strong>la</strong>is de Reading).<br />
Le taux de remplissage alvéo<strong>la</strong>ire et vé<strong>la</strong>ire est mesuré <strong>dans</strong> chacune <strong>des</strong> zones <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is. Exprimé en pourcentage, ce taux oscille entre 0 et 1 : 0 quand <strong>la</strong> zone est vide de<br />
contact et 1 quand toutes les électro<strong>des</strong> de <strong>la</strong> zones sont contactées.<br />
Le centre de gravité nous permet de quantifier les dép<strong>la</strong>cements <strong>des</strong> contacts sur l’axe<br />
antéro-postérieur <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Cet indice informe sur <strong>la</strong> localisation <strong>du</strong> lieu d’articu<strong>la</strong>tion<br />
linguo-pa<strong>la</strong>tal de <strong>la</strong> consonne. Il est aussi mesuré sur <strong>la</strong> constriction maximale. Le pa<strong>la</strong>is<br />
est divisé en huit trames réparties sur deux zones, antérieure et postérieure contenant<br />
quatre rangées d’électro<strong>des</strong> chacune. La limite médiane horizontale est un axe zéro de<br />
référence. Les rangées antérieures sont notées de –1 à –4 en partant de l’axe zéro et les<br />
rangées postérieures sont notées de +1 à +4 en partant de l’axe zéro. Plus <strong>la</strong> valeur est<br />
négative, plus le centre de gravité se dép<strong>la</strong>ce vers l’avant <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Plus <strong>la</strong> valeur est<br />
positive, plus le centre de gravité se dép<strong>la</strong>ce vers l’arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Nous devons <strong>la</strong><br />
réalisation de cet indice à R. Espesser qui a confectionné les scripts nécessaires sous<br />
UNIX en s’inspirant <strong>des</strong> indices de Hardcastle et al. (1991) et Rouco et Recasens<br />
(1996).<br />
108
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
Les patrons moyens découlent d’une moyenne <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sur les<br />
douze répétitions. Les contacts sont moyennés sur chacune <strong>des</strong> électro<strong>des</strong> <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is au<br />
moment de <strong>la</strong> constriction maximale. Nous obtenons un patron de contacts<br />
caractéristique de chaque consonne, <strong>dans</strong> chaque condition d’enregistrement et pour<br />
chaque locuteur. Nous présentons, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> figure 5.10 ci-<strong>des</strong>sous le patron de contacts<br />
de <strong>la</strong> consonne /d/ <strong>du</strong> locuteur YM lors de <strong>la</strong> réalisation de <strong>la</strong> séquence /did/ en<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale. Les électro<strong>des</strong> en b<strong>la</strong>nc sur les patrons n’ont jamais été contactées<br />
(0%), les noires ont toujours été contactées (100%). Trois niveaux de gris sont utilisés<br />
pour définir les différents degrés de contact : gris c<strong>la</strong>ir pour les contacts jusqu’à 25% ;<br />
gris moyen pour les contacts jusqu’à 50% et gris foncé pour les contacts jusqu’à 75%.<br />
Figure n° 5.10 : Patron moyen pris au moment de <strong>la</strong> constriction maximale <strong>du</strong> /d/ de <strong>la</strong> séquence<br />
/did/, locuteur YM.<br />
Les patrons de résistance sont issus de <strong>la</strong> soustraction <strong>des</strong> patrons moyens avec chaque<br />
bite-block (B1, B2 et B3) aux patrons moyens en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale. Ces patrons de<br />
résistance montrent seulement les contacts qui per<strong>du</strong>rent malgré <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> biteblocks.<br />
Nous exposons ci-<strong>des</strong>sous un exemple de patron de résistance B0-B3 de <strong>la</strong><br />
consonne /d/ de /did/ pro<strong>du</strong>ite par le locuteur BL.<br />
Figure n°5.11 : Patron de <strong>la</strong> différence de contacts entre B0 et B3, au moment de <strong>la</strong> constriction<br />
maximale <strong>du</strong> /d/ de <strong>la</strong> séquence /did/, locuteur BL.<br />
109
Les patrons de coarticu<strong>la</strong>tion sont issus de <strong>la</strong> différence entre les patrons moyens <strong>des</strong><br />
séquences avec /i/ et les patrons moyens <strong>des</strong> séquences avec /a/. La figure 5.12 ci<strong>des</strong>sous<br />
illustre un patron de coarticu<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> /t/ <strong>du</strong> locuteur YM en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
normale.<br />
Figure n° 5.12 : Patron de coarticu<strong>la</strong>tion d’un /t/ <strong>du</strong> locuteur YM.<br />
Pour <strong>la</strong> confection de ces patrons, nous avons mesuré <strong>la</strong> distance entre chaque électrode<br />
sur le pa<strong>la</strong>is de chaque locuteur. Nous tenons à remercier tout particulièrement Noël<br />
Nguyen qui a réalisé les patrons moyens, les patrons de résistance et les patrons de<br />
coarticu<strong>la</strong>tion à partir de ces mesures.<br />
5.4.2 Les paramètres temporels<br />
Les mesures de timing intra-segmental concernent l’articu<strong>la</strong>tion indépendante <strong>des</strong><br />
consonnes. Les <strong>du</strong>rées de chaque phase de <strong>la</strong> consonne sont calculées à partir <strong>des</strong><br />
différences temporelles entre les marqueurs préa<strong>la</strong>blement posés. Dans un premier<br />
temps, il s’agit de calculer les <strong>du</strong>rées absolues en ms <strong>des</strong> événements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s.<br />
Pour l’illustration, le lecteur peut se référer à <strong>la</strong> figure 5.9.<br />
-<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> geste consonantique en sa totalité : xF-xA<br />
-<strong>du</strong>rée de l’établissement de <strong>la</strong> constriction : xC-xA<br />
-<strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue : xE-xB<br />
-<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum de contacts : xD-xC et de l’occlusion complète<br />
-<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> relâchement de <strong>la</strong> constriction : xF-xD<br />
Ensuite, nous avons établi <strong>la</strong> proportion de chaque phase par rapport à <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale de<br />
<strong>la</strong> consonne :<br />
110
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE ET METHODE EXPERIMENTALE.<br />
CHAPITRE 5 : Méthode expérimentale..<br />
-Proportion de <strong>la</strong> tenue <strong>dans</strong> <strong>la</strong> consonne : xE-xB/xF-xA * 100<br />
-Proportion <strong>du</strong> maximum de contacts : xD-xC/ xF-xA *100 et de l’occlusion<br />
complète<br />
-Proportion de <strong>la</strong> fermeture <strong>dans</strong> <strong>la</strong> consonne : xC-xA/ xF-xA * 100<br />
-Proportion de l’ouverture est calculée : xF-xD/ xF-xA * 100<br />
5.4.3 Les paramètres spatio-temporels<br />
Pour calculer <strong>la</strong> portée de <strong>la</strong> pente de fermeture, nous avons dé<strong>du</strong>it le nombre de<br />
contacts relevés au début <strong>du</strong> geste de fermeture, <strong>du</strong> nombre de contacts relevé au début<br />
de <strong>la</strong> constriction maximale: yC-yA.<br />
Pour calculer <strong>la</strong> portée de <strong>la</strong> pente d’ouverture, nous avons dé<strong>du</strong>it le nombre de contacts<br />
relevé à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> constriction maximale, <strong>du</strong> nombre de contacts relevé à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong><br />
geste de relâchement : yF-yD.<br />
A partir <strong>des</strong> valeurs d’amplitude <strong>des</strong> pentes, nous sommes en mesure de dé<strong>du</strong>ire les<br />
vitesses d’ouverture et de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale de <strong>la</strong> consonne d’après <strong>la</strong> formule<br />
traditionnelle <strong>du</strong> calcul de <strong>la</strong> vitesse : Vitesse =Amplitude/Temps. Ces vitesses sont<br />
re<strong>la</strong>tives aux mouvementx de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue :<br />
-vitesse d’établissement de <strong>la</strong> fermeture : yC-yA/xC-xA<br />
-vitesse d’établissement de l’ouverture : yF-yD /xF-xD .<br />
Ces mesures fournissent un indice de <strong>la</strong> rapidité avec <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> constriction linguopa<strong>la</strong>tale<br />
s’établit ou se relâche.<br />
A de stade de l’évolution <strong>du</strong> travail, nous avons mis en p<strong>la</strong>ce un protocole expérimental<br />
qui répond à nos besoins : procéder à une analyse comparative de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong><br />
consonnes linguales alvéo<strong>la</strong>ires avec et sans perturbation. Nous avons préparé notre<br />
corpus en vue d’une analyse électropa<strong>la</strong>tographique <strong>des</strong> mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
<strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes /t/ et /d/ en contextes vocalique différents /a/ et /i/.<br />
111
5.5 La méthode statistique d’analyse <strong>des</strong> variations<br />
Dans ce paragraphe, nous présentons <strong>la</strong> méthode d’analyse statistique choisie pour<br />
étudier les variations <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s linguo-pa<strong>la</strong>tales <strong>dans</strong> les quatre conditions<br />
expérimentales. La méthode utilisée est l’analyse de <strong>la</strong> variance ANOVA avec le<br />
logiciel Statview (Statview 1996). L’analyse est faite par l’ANOVA factorielle puisque<br />
nous considérons l’ensemble <strong>des</strong> variables secondaires comme ayant le même poids.<br />
Dans un premier temps de l’analyse nous cherchons à montrer quels sont seuls les effets<br />
de <strong>la</strong> variable principale sur l’organisation spatio-temporelle de <strong>la</strong><br />
consonne. La variable indépendante ou principale de notre p<strong>la</strong>n expérimental est <strong>la</strong><br />
condition d’enregistrement : sans bite-block (B0) avec le bite-block de 5 mm (B1), avec<br />
le bite-block de 10 mm (B2) et avec le bite-block de 16 mm (b3). La variable<br />
dépendante est tour à tour chaque paramètre mesuré : <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne, de <strong>la</strong><br />
fermeture, de <strong>la</strong> tenue, de <strong>la</strong> constriction maximale, de l’ouverture, l’amplitude <strong>des</strong><br />
contacts, <strong>la</strong> vitesse de fermeture et <strong>la</strong> vitesse d’ouverture.<br />
Dans un second temps, nous cherchons à voir si l’effet de <strong>la</strong> variable principale <br />
est influencé par les autres variables secondaires comme ,<br />
, < contexte vocalique>. Nous effectuons une étude <strong>des</strong><br />
interactions entre les différentes variables.<br />
Dans un troisième temps, l’analyse se fait plus précise sur chaque locuteur<br />
indépendamment, toujours en essayant de distinguer les effets <strong>des</strong> bite-blocks <strong>des</strong> effets<br />
<strong>des</strong> autres variables. Nous pourrons alors confirmer que les comportements <strong>des</strong> deux<br />
sujets sont différents. L’analyse indivi<strong>du</strong>elle tiendra compte <strong>du</strong> fait que l’effectif total<br />
<strong>des</strong> données N (380) sera alors divisé par deux (380/2=190 données par locuteur).<br />
112
113
114
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS<br />
EXPERIMENTAUX<br />
______________________________________________________________________<br />
CHAPITRE 6 : Les résultats spatiaux<br />
Nous présentons <strong>dans</strong> cette partie les résultats qui découlent de l’analyse spatiale <strong>des</strong><br />
mouvements linguaux <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> <strong>occlusives</strong>. Nous avons relevé le nombre<br />
d’électro<strong>des</strong> contactées et leur distribution au moment où <strong>la</strong> constriction est au<br />
maximum (au moment de l’amplitude maximale), sur chaque séquence et <strong>dans</strong> les<br />
quatre conditions d’enregistrement, B0, B1, B2 et B3. Les contacts sur chaque électrode<br />
sont moyennés sur douze répétitions, afin de déterminer <strong>des</strong> patrons de contacts <strong>des</strong><br />
<strong>occlusives</strong> de chaque locuteur.<br />
Voici un récapitu<strong>la</strong>tif <strong>des</strong> questions que nous nous posons à propos de l’observation <strong>des</strong><br />
paramètres spatiaux. Les constrictions maximales sont-elles ré<strong>du</strong>ites ou saturées par <strong>la</strong><br />
présence <strong>des</strong> bite-blocks ? Si nous supposons que <strong>la</strong> constriction est plus faible avec les<br />
bite-blocks, les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux seraient moins nombreux. L’amplitude <strong>des</strong><br />
contacts serait donc diminuée. Est-ce que le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne est<br />
dép<strong>la</strong>cé, le cas échéant, en avant ou en arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is ? L’influence <strong>des</strong> bite-blocks<br />
est-elle mo<strong>du</strong>lée <strong>la</strong> nature <strong>des</strong> voyelles et/ ou par le voisement? Observe-t-on un effet<br />
d’adaptation en réponse aux perturbations ? Les locuteurs réagissent-ils de <strong>la</strong> même<br />
façon ? En premier lieu, nous présentons les aspects quantitatifs <strong>des</strong> données spatiales,<br />
représentés par un dénombrement précis <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux. En second lieu,<br />
nous présentons les aspects qualitatifs sous forme de patrons de contacts afin de<br />
localiser exactement le lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> consonnes.<br />
115
6.1 Aspects quantitatifs de <strong>la</strong> répartition <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux<br />
Nous cherchons à déterminer <strong>dans</strong> quelle mesure les variations de l’amplitude <strong>des</strong><br />
contacts peuvent être expliquées par les effets <strong>des</strong> bite-blocks, de <strong>la</strong> voyelle et <strong>du</strong><br />
voisement. Avec L’ANOVA factorielle, nous pouvons voir si les interactions entre les<br />
facteurs sont significatives: une interaction entre au moins deux facteurs signifie que<br />
l’effet de l’un <strong>des</strong> facteurs varie en fonction de l’autre facteur.<br />
6.1.1 Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux (LP) sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is<br />
Cell Mean<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour TOTAL<br />
Effet : loc * cond * cvc<br />
Barres d'erreur: 95% Intervalle de confiance<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n°6.1: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur le nombre de contacts. Les<br />
barres représentent les écart-types. En abscisse, les locuteurs et les conditions d’enregistrement. En<br />
ordonnée, le nombre de contacts.<br />
Les bite-blocks ont une influence sur le nombre total <strong>des</strong> contacts [F(3,380)=3,125 ; p<<br />
0,0259]. Nous voyons, d’après <strong>la</strong> figure 7.1 que l’effet <strong>des</strong> bite-blocks n’est pas le<br />
même en fonction <strong>des</strong> locuteurs. En effet, l’interaction entre les variables locuteur et<br />
condition est fortement significative [F(3,352)=36.56 ; p< 0.0001]. Nous observons<br />
qu’avec les bite-blocks, les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>du</strong> locuteur BL diminuent. Les<br />
contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>du</strong> locuteur YM augmentent légèrement excepté sur <strong>la</strong><br />
séquence /dad/, pour <strong>la</strong>quelle les contacts diminuent aussi. L’effet <strong>des</strong> bite-blocks<br />
dépend donc <strong>du</strong> locuteur mais aussi de <strong>la</strong> séquence étudiée puisque l’interaction entre<br />
les deux variables et , est fortement significative<br />
116<br />
Y, b0<br />
Y, b1<br />
Y, b2<br />
Y, b3<br />
dad<br />
did<br />
tat<br />
tit
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
[F(9,352)=14.935 ; p
<strong>la</strong> séquence /tit/ perd 3,92 contacts. Par contre le voisement de <strong>la</strong> consonne ne semble<br />
pas interférer les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(3,184) = 0,803 ; p< 0,4939].<br />
Nombre de contacts<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
6.1.1.2 Les contacts <strong>du</strong> locuteur YM.<br />
La totalité <strong>des</strong> contacts de YM<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°6.3: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts LP totaux <strong>du</strong> locuteur YM. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de contacts<br />
D’une manière générale, il semble que les bite-blocks n’ont pas d’effet significatif sur le<br />
nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de ce locuteur [F(3,188) = 0,892 ; p=0,4462]. Nous<br />
n’avons pas trouvé d’interaction entre l’effet <strong>des</strong> bite-blocks et les effets de <strong>la</strong> voyelle<br />
[F(3,184) = 2,228 ; p=0,0865]. Mais l’effet <strong>des</strong> bite-blocks dépend de <strong>la</strong> séquence<br />
[F(9,176)=18,124 ; p
Cell Mean<br />
32,5<br />
30<br />
27,5<br />
25<br />
22,5<br />
20<br />
17,5<br />
15<br />
12,5<br />
10<br />
7,5<br />
5<br />
C o ur be d e s inte raction s p o ur A V T<br />
Effet : loc * cond * cvc<br />
Barre s d 'e rre ur : 95% Inte r valle d e co n fian ce<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
6.1.2 Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire<br />
Cell<br />
Figure n° 6.4 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur le nombre de contacts<br />
alvéo<strong>la</strong>ires. Les barres représentent les écart-types. En abscisse, les locuteurs et les conditions<br />
d’enregistrement. En ordonnée, le nombre de contacts.<br />
Premièrement, nous remarquons que le bite-block seul a un effet significatif sur le<br />
nombre de contacts alvéo<strong>la</strong>ires [F(3,380)=5,251 ; p< 0.0015]. Nous voyons sur <strong>la</strong> figure<br />
7.4 que l’effet <strong>des</strong> bite-blocks est différent pour chaque locuteur. En effet nous avons<br />
trouvé une forte interaction entre les effets <strong>des</strong> bite-blocks et les locuteurs<br />
[F(3,352)=39.39 ; p< 0.0001]. Les contacts alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL diminuent et les<br />
contacts alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM tendent à augmenter légèrement, excepté<br />
concernant <strong>la</strong> séquence /dad/. Nous retenons aussi que l’effet <strong>des</strong> bite-blocks dépend<br />
aussi fortement de <strong>la</strong> séquence [F(9,352)=10,454 ; p< 0.0001].<br />
L’interaction significative entre <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence et le locuteur [F(3,352) =<br />
22.504 ; p< 0.0001] indique que les réalisations phonétiques sont propres à chaque<br />
locuteur. D’une manière générale, les effets <strong>des</strong> bite-blocks sur le nombre de contacts<br />
LP alvéo<strong>la</strong>ires dépendent fortement <strong>des</strong> séquences étudiées. Nous détaillons ci-<strong>des</strong>sous<br />
les changements observés chez chaque locuteur.<br />
119<br />
Y, b0<br />
Y, b1<br />
Y, b2<br />
Y, b3<br />
dad<br />
did<br />
tat<br />
tit
Nombre de contacts<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
6.1.2.1 Les contacts alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Nombre de contacts alvéo<strong>la</strong>ires de BL<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 6.5: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts LP alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de contacts<br />
Les bite-blocks seuls ont une forte influence sur les contacts alvéo<strong>la</strong>ires de ce locuteur<br />
[F(3,188) = 14,459 ; p< 0,0001]. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks dépendent de <strong>la</strong> séquence<br />
étudiée [F(9,176) = 4,760 ; p
6.1.2.2 Les contacts alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM.<br />
Nombre de contacts<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
Nombre de contacts alvéo<strong>la</strong>ires de YM<br />
dad did tat tit<br />
séquences<br />
Figure n°6.6: Graphique <strong>des</strong> moyennes de contacts alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de contacts<br />
Les bite-blocks n’ont pas d’influence significative sur le nombre de contacts alvéo<strong>la</strong>ires<br />
de ce locuteur [F(3,188)=1,193 ; p=0,3136]. L’effet <strong>des</strong> bite bloks dépend fortement de<br />
<strong>la</strong> séquence étudiée [F(9,176) = 8,999 ; p
6.1.3 Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région vé<strong>la</strong>ire<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour ARR<br />
Effet : loc * cond * cvc<br />
Bar r e s d 'e r r e u r : 95% In te r valle d e co n fian ce<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Y, b0<br />
Figure n° 6.7 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur le nombre de contacts<br />
postérieurs. Les barres représentent les écart-types. En abscisse, les locuteurs et les conditions<br />
d’enregistrement. En ordonnée, le nombre de contacts.<br />
De façon générale, l’effet seul <strong>du</strong> bite-block n’a pas d’influence réelle sur le nombre de<br />
contacts vé<strong>la</strong>ires [F(3,380)=0,855 ; p=0,464]. Nous notons que l’interaction entre les<br />
deux variables et est significative [F(3,352)=14,092;<br />
p
Nombre de contacts<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
6.1.3.1 Les contacts vé<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Nombre de contacts vé<strong>la</strong>ires de BL<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°6.8: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts vé<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de contacts<br />
Les bite-blocks seuls ont un effet sur le nombre de contacts vé<strong>la</strong>ires de ce locuteur<br />
[F(3,188) = 3,073 ; p= 0,0290]. Concernant ce locuteur, l’effet <strong>des</strong> bite-blocks dépend<br />
de <strong>la</strong> séquence [F(9,176= 2,440 ; p=0,0122]. La tendance à <strong>la</strong> diminution <strong>des</strong> contacts<br />
vé<strong>la</strong>ires sous l’effet <strong>des</strong>bite-blocks est observée aussi sur les contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région<br />
postérieure. Cependant cette tendance est manifestement moindre que <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région<br />
antérieure. Le changement le plus important se pro<strong>du</strong>it sur <strong>la</strong> séquence /dad/. Les<br />
séquences avec les consonnes non voisées n’observent pas de réels changements. Le<br />
voisement n’influence pas les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(3,184) = 1,292 ; p=0,2785]. Les<br />
effets <strong>des</strong> bite-blocks ne dépendent pas de <strong>la</strong> voyelle [F(3,184) = 1,679 ; p= 0,1731]<br />
123<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
Nombre de contacts<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
6.1.3.2 Les contacts vé<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Nombre de contacts vé<strong>la</strong>ires de YM<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°6.9: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts vé<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de contacts<br />
Les bite-blocks n’ont pas d’effet significatif sur le nombre de contacts vé<strong>la</strong>ires de ce<br />
locuteur [F(3,188) = 0,723 ; p=0,5392]. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks pour ce locuteur<br />
dépendent de <strong>la</strong> séquence [F(9,176=11,808 ; p
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
différences de nombre de contacts avec et sans bite-block ne sont pas statistiquement<br />
significatives, et ce <strong>dans</strong> les différentes zones <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Nous pouvons aussi affirmer<br />
que <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle et le trait de voisement sont deux variables qui jouent un rôle<br />
décisif <strong>dans</strong> <strong>la</strong> réaction de nos locuteurs face à <strong>la</strong> perturbation : le voisement n’a d’effet<br />
que chez YM alors que <strong>la</strong> voyelle a de l’effet chez les deux. Malgré le fait que nos<br />
locuteurs montrent <strong>des</strong> manœuvres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s différentes, ils montrent tous les deux<br />
une importante perte <strong>des</strong> contacts LP sur <strong>la</strong> consonne voisée de <strong>la</strong> séquence /dad/. Nous<br />
proposons un bi<strong>la</strong>n <strong>des</strong> différences observées entre les conditions normales et avec les<br />
bite-blocks, séquence par séquence pour chaque locuteur.<br />
Locuteur BL :<br />
/dad / Dans <strong>la</strong> partie alvéo<strong>la</strong>ire, nous observons une perte de 10,66 contacts de B0 à<br />
B3 : B0 (19,58) ≥ B1 (13,17) ≥ B2 (10,42)≥ B3 (8,92). Dans <strong>la</strong> partie vé<strong>la</strong>ire, nous<br />
observons une perte de 4,83 contacts de b0 à B3 : B0 (6,5) ≥ B1 (3,33) ≥ B2 (2,58) ≥ B3<br />
(1,67).<br />
/tat/ Dans <strong>la</strong> partie alvéo<strong>la</strong>ire nous comptons une différence de 8,17 contacts entre B0<br />
et B3 : B0 (21,50) ≥ B1 (18,17) ≥ B2 (17)≥ B3 (13,33). Dans <strong>la</strong> partie vé<strong>la</strong>ire, il n’est<br />
pas observé pas de réelle différence : B0 (8,5) ≥ B1 (7,67) = B2 (7,67) = B3 (7,5).<br />
/did/ Dans <strong>la</strong> zone alvéo<strong>la</strong>ire, on a une différence de 3.67 contacts entre B0 et B3 : B0<br />
(25) ≥ B1 (23,17) ≥ B2 (22,25)≥ B3 (21,33). Dans <strong>la</strong> zone vé<strong>la</strong>ire on a une différence de<br />
3,58 contacts entre B0 et B3 : B0 (14,33) ≥ B2 (12,67) ≥ B1 (10,67) = B3 (10,75).<br />
/tit/ Dans <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire, <strong>la</strong> consonne perd 3.58 contacts : B0 (25,58) ≥ B1<br />
(22,17) = B2 (22,17)= B3 (22) Dans <strong>la</strong> région vé<strong>la</strong>ire il y a 2,17 contacts de moins entre<br />
B0 et B1: B0 (14,5) = B2 (14)= B3 (14,17) ≥ B1 (11,83).<br />
Locuteur YM :<br />
/dad/ Dans <strong>la</strong> partie alvéo<strong>la</strong>ire, nous observons une perte de 5,25 contacts de B0 à B3 :<br />
B0 (19) ≥ B1 (18,75) ≥ B2 (14,17) ≥ B3 (13,75).Dans <strong>la</strong> partie vé<strong>la</strong>ire, nous observons<br />
une perte de 4,59 contacts de B0 à B3 : B0 (7,17) = B1 (7,75) ≥ B2 (2,83) = B3 (2,58)<br />
/did/ Dans <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire, nous notons peu de différences entre B0 et B3 : B0<br />
(25,83) ≤ B2 (26,42) ≤ B1 (27,92) = B3 (27,5). Dans <strong>la</strong> région vé<strong>la</strong>ire les contacts sont<br />
aussi stables : B0 (15,67) ≤ B1 (16,67) = B2 (16) = B3 (16,08)<br />
125
tat/ Dans <strong>la</strong> partie alvéo<strong>la</strong>ire nous observons un gain de +3,75 contacts entre B0 et<br />
B3 : B0 (23,67) ≤ B1 (26,92) = B2 (26) ≤ B3 (27,42). Dans <strong>la</strong> partie vé<strong>la</strong>ire, on observe<br />
un gain de +2,75 contacts : B0 (9,33) ≤ B1 (10,25) ≤ B2 (11) ≤ B3 (12,08).<br />
/tit/ Dans <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire il est relevé peu de différence entre les conditions : B0<br />
(26,42) ≤ B1 (28,25) = B2 (28,17) = B3 (28,25). Dans <strong>la</strong> partie vé<strong>la</strong>ire, on observe un<br />
gain de +2,75 contacts : B0 (15,58) ≤ B1 (16,92) ≤ B2 (17,33) ≤ B3 (19,33).<br />
Sur l’ensemble <strong>des</strong> séquences étudiées, nous remarquons que le locuteur BL perd plus<br />
de contacts LP avec les bite-blocks que le locuteur YM pour qui au contraire, les<br />
contacts LP peuvent s’accroître avec les bite-blocks. Nous soulignons aussi que les deux<br />
locuteurs perdent <strong>des</strong> contacts sur le /d/ suivi de /a/. Notons que les changements se font<br />
surtout <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie alvéo<strong>la</strong>ire <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> consonnes.<br />
6.2 L’aspect qualitatifs de <strong>la</strong> répartition <strong>des</strong> contacts : les patrons de<br />
contacts.<br />
Nous présentons les patrons moyennés sur les 12 répétitions et <strong>dans</strong> chacune <strong>des</strong><br />
conditions d’enregistrement.<br />
Les électro<strong>des</strong> en b<strong>la</strong>nc sur les patrons n’ont jamais été contactées (0%), les noires ont<br />
toujours été contactées (100%). Trois niveaux de gris sont utilisés pour définir les<br />
différents degrés de contact : gris c<strong>la</strong>ir pour les contacts jusqu’à 25% ; gris moyen pour<br />
les contacts jusqu’à 50% et gris foncé pour les contacts jusqu’à 75%.<br />
Pour chaque séquence et chaque locuteur, nous montrons de gauche à droite les patrons<br />
de contacts sans bite-block (patron de référence), avec le fin bite-block (B1=5 mm), le<br />
moyen (B2=10 mm) et le plus épais (B3=16 mm).<br />
126
6.2.1 Les patrons de contacts <strong>du</strong> locuteur BL<br />
6.2.1.1 Séquence /dad/<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
Figure n° 6.10 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /dad/, locuteur BL.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les électro<strong>des</strong> <strong>des</strong> deux 1 ères rangées alvéo<strong>la</strong>ires sont totalement<br />
contactées par l’apex. On remarque quatre contacts <strong>la</strong>téraux sur <strong>la</strong> 3 ème rangée (colonnes<br />
1, 2, 7 et 8, les plus <strong>la</strong>térales de chaque coté <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is) sûrement effectués par <strong>la</strong> partie<br />
<strong>la</strong>minale <strong>la</strong>térale de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Les contacts <strong>la</strong>téraux sont symétriques et se prolongent<br />
jusqu’à <strong>la</strong> dernière rangée postérieure.<br />
Avec les bite-blocks, les contacts alvéo<strong>la</strong>ires diminuent au fur et à mesure que<br />
l’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks augmente. Avec le B1, <strong>la</strong> deuxième rangée alvéo<strong>la</strong>ire est<br />
moins souvent contactée entièrement et les contacts <strong>la</strong>téraux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région pa<strong>la</strong>tale se<br />
font aussi plus rares. Avec le B2, les occurrences <strong>des</strong> contacts diminuent encore excepté<br />
sur <strong>la</strong> 1 ère rangée d’électro<strong>des</strong>. Avec les B3, seulement les électro<strong>des</strong> de <strong>la</strong> 1 ère rangée<br />
alvéo<strong>la</strong>ire (dentale) sont encore contactées. L’aire de contacts est rétrécie. L’amplitude<br />
<strong>des</strong> contacts est ré<strong>du</strong>ite par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks. Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> /d/ est<br />
avancé par rapport à son lieu d’articu<strong>la</strong>tion de référence B0 : seulement l’apex peut<br />
rester en contact <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo-dentale, juste derrière les dents. Pour effectuer <strong>la</strong><br />
constriction sur <strong>la</strong> première rangée antérieure d’électro<strong>des</strong>, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue doit s’incurver de<br />
plus en plus de sorte que le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue soit en position basse et permette à l’apex<br />
de s’é<strong>la</strong>ncer vers les dents. L’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks est distinctive <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où<br />
plus le bite-blocks est épais, plus <strong>la</strong> mâchoire est ouverte, plus le locuteur perd <strong>des</strong><br />
contacts.<br />
127
6.2.1.2 Séquence /tat/<br />
Figure n° 6.11: Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tat/, locuteur BL.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les deux 1 ère rangées alvéo<strong>la</strong>ires sont contactées totalement par<br />
l’apex. La 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire est aussi souvent contactée (colonnes 1, 2, 3, 6, 7 et 8)<br />
par <strong>la</strong> partie <strong>la</strong>minale de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. Les contacts <strong>la</strong>téraux sont symétriques.<br />
Avec lesbite-blocks les contacts de <strong>la</strong> 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire se raréfient, mais les<br />
contacts persistent toujours sur les deux 1 ères rangées alvéo<strong>la</strong>ires et sur les bords <strong>la</strong>téraux<br />
de façon symétrique. La 2 ème rangée d’électrode perd seulement un contact en B3. Les<br />
patrons sont les mêmes <strong>dans</strong> les quatre conditions, seulement <strong>la</strong> fréquence de contact de<br />
<strong>la</strong> 2 ème et 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire diminue. L’amplitude n’est pas diminuée de façon<br />
drastique. Ce patron est très proche de celui de <strong>la</strong> consonne voisée, à deux électro<strong>des</strong><br />
près sur <strong>la</strong> 3 ième rangée (colonnes 3 et 6 contactées en plus pour <strong>la</strong> non voisée). Avec les<br />
bite-blocks, nous observons moins de perte de contacts que sur <strong>la</strong> voisée<br />
correspondante. Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion est le même en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale et avec les<br />
bite-blocks. L’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks n’est pas distinctive : B0≥ B1= B2=B3.<br />
L’activité de <strong>la</strong> partie antérieure de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (apex et <strong>la</strong>me) est encore réalisée malgré<br />
les perturbations. Les différences observées entre les conditions normale et bloquées<br />
sont moins marquées que pour <strong>la</strong> séquence voisée /dad/ : nous notons ici peu de perte de<br />
contacts et de changement de lieu d’articu<strong>la</strong>tion. Malgré <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> perturbations,<br />
l’amplitude <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux semble rester stable. L’articu<strong>la</strong>tion conserve<br />
mieux les contacts <strong>la</strong>téraux que sur <strong>la</strong> voisée /d/ pour <strong>la</strong>quelle l’amplitude est c<strong>la</strong>irement<br />
ré<strong>du</strong>ite par les bite-blocks.<br />
128
6.2.1.3 Séquence /did/<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
Figure n°6.12: Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /did, locuteur BL.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les électro<strong>des</strong> <strong>des</strong> deux 1 ères rangées alvéo<strong>la</strong>ires sont toutes<br />
contactées. La 3 ième rangée est contactée à l’exception <strong>des</strong> électro<strong>des</strong> de <strong>la</strong> colonne 5;<br />
(75%). On remarque <strong>des</strong> contacts <strong>la</strong>téraux sur <strong>la</strong> 4 ème rangée (colonnes 1, 2, 7 et 8) qui<br />
s’étendent symétriquement de l’avant vers l’arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Avec les bite-blocks, on<br />
note seulement une baisse de fréquence de contacts sur les électro<strong>des</strong> de <strong>la</strong> 3 ième rangée<br />
(colonne 4, 5 et 6). Les contacts <strong>la</strong>téraux sont conservés. Les patrons sont quasi les<br />
mêmes en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale et en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> avec bite-blocks, seule <strong>la</strong> fréquence de<br />
contact diminue. D’une manière générale, on observe peu de perte de contacts entre <strong>la</strong><br />
condition normale et les conditions avec bite-blocks. L’amplitude <strong>des</strong> contacts de /d/<br />
suivi de /i/ diminue peu avec les bite-blocks. On n’observe pas de changement de lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion, comme on l’a observé pour /d/ suivi de /a/. Nous supposons que c’est<br />
grâce à <strong>la</strong> forte influence co<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> de <strong>la</strong> voyelle /i/ subséquente que l’occlusive<br />
alvéo<strong>la</strong>ire est résistante, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure ou les deux segments ont le même lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion. On n’observe pas de différence drastique en fonction de l’épaisseur <strong>des</strong><br />
bite-blocks.<br />
129
6.2.1.4 Séquence /tit/<br />
Figure n° 6.13: Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tit/, locuteur BL.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, toutes les électro<strong>des</strong> sont contactées sur les trois 1 ères rangées<br />
(totalité de <strong>la</strong> partie alvéo<strong>la</strong>ire). Les électro<strong>des</strong> sur les bords <strong>la</strong>téraux <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is (colonne<br />
1, 2, 7 et 8) ont aussi une fréquence de contacts élevée. On constate que ces patrons sont<br />
quasi les mêmes que ceux de <strong>la</strong> consonne de <strong>la</strong> séquence /did/ (figure 6.12).<br />
Avec les bite-block, les contacts s’amenuisent seulement sur <strong>la</strong> 3 ième rangée (colonne 4,<br />
5 et 6). Les patrons sont identiques aux patrons en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, seulement <strong>la</strong><br />
fréquence de contacts diminue avec B1 et B2. Avec B3 <strong>la</strong> fréquence <strong>des</strong> contacts<br />
<strong>la</strong>téraux est même renforcée, nous remarquons que les électro<strong>des</strong> <strong>des</strong> colonnes 2 et 7<br />
sont plus souvent contactées. La voyelle fermée /i/ permet de garder plus de contacts<br />
que <strong>la</strong> voyelle ouverte /a/. L’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks ne semble pas être distinctive.<br />
Certes le locuteur réagit à l’intrusion d’une perturbation, mais ensuite le nombre de<br />
contacts est identique en B0, B2 et B3. Nous ne notons pas de changement fort<br />
d’amplitude, ni de changement de lieu d’articu<strong>la</strong>tion. Sur le /t/ de /tit/, on observe moins<br />
de perte de contacts que sur le /d/ de /did/ : <strong>la</strong> consonne non voisée semble plus robuste.<br />
Les contacts de <strong>la</strong> consonne non voisée sont mieux préservés que ceux de <strong>la</strong> consonne<br />
voisée, ce qui est également le cas en contexte CaC.<br />
6.2.1.5 Comportement général <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Les consonnes voisées perdent plus de contacts que les consonnes non voisées.<br />
L’épaisseur <strong>des</strong>bite-blocks est pertinente seulement pour <strong>la</strong> séquence voisée + /a/. Les<br />
consonnes voisées suivies de /a/ perdent plus de contacts que celles suivies de /i/. Nous<br />
130
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
proposons un c<strong>la</strong>ssement en fonction <strong>du</strong> nombre de contacts per<strong>du</strong>s sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is entre les conditions B0 et les autres: Voisée + /a/ (-15,5) ≥ non voisée +/a/ (-9,17)<br />
≥ voisée + /i/ (-7,41) ≥ non voisée +/i/ (-3,92).<br />
6.2.2 Les patrons de contacts <strong>du</strong> locuteur YM<br />
6.2.2.1 Séquence /dad/<br />
Figure n° 6.14 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /dad/, locuteur YM.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les contacts se situent sur les électro<strong>des</strong> <strong>des</strong> deux 1 ères rangées<br />
alvéo<strong>la</strong>ires, sur les colonnes 1, 2, 7 et 8 de <strong>la</strong> 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire et sur les bords<br />
<strong>la</strong>téraux (colonne 1 et 8). A partir de B2, le patron de contacts est le même que celui <strong>du</strong><br />
locuteur BL (figure 6.10) en utilisant plus les côtés.<br />
Avec le B1, les électro<strong>des</strong> <strong>la</strong>térales sont plus souvent contactées alors que celles de <strong>la</strong><br />
2 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire le sont moins souvent sur les colonnes 4, 5 et 6 (75%). Les<br />
contacts alvéo<strong>la</strong>ires diminuent au fur et à mesure que l’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks<br />
augmente. Les contacts <strong>la</strong>téraux diminuent dès le B2 et disparaissent avec le B3. Seule<br />
<strong>la</strong> première rangée de <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire reste contactée en toalité ainsi que les bords<br />
<strong>des</strong> trois rangées suivantes. L’apex reste contactée sur <strong>la</strong> partie alvéo-dentale. D’une<br />
manière globale, le nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux diminue avec B2 et B3.<br />
Comme pour le locuteur BL, l’amplitude <strong>des</strong> contacts est diminuée, et le lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion est changé sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks. L’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks<br />
joue un rôle particulier : plus les bite-blocks sont épais, plus <strong>la</strong> mâchoire est ouverte et<br />
131
plus les contacts diminuent : B0 ≥ B1 ≥ B2 ≥ B3. L’articu<strong>la</strong>tion s’avance sûrement sur<br />
<strong>la</strong> région dentale en même temps qu’on observe un affaiblissement <strong>des</strong> contacts<br />
alvéo<strong>la</strong>ires : l’occlusion est moins <strong>la</strong>rge.<br />
6.2.2.2 Séquence /tat/<br />
Figure n° 6.15 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tat/, locuteur YM.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire est entièrement contactée. La 4 ième rangée<br />
admet <strong>des</strong> contacts symétriques sur les colonnes 1, 2, 7 et 8. Les contacts <strong>la</strong>téraux sont<br />
symétriques et vont de l’avant vers l’arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, sur les colonnes 1 et 8. La<br />
consonne non voisée admet <strong>la</strong> 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire contactée en plus par rapport à <strong>la</strong><br />
consonne voisée. Si on compare avec <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> même séquence <strong>du</strong> locuteur<br />
BL (figure6.11), on voit bien que YM contacte <strong>la</strong> 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire en plus.<br />
Avec les bite-blocks, les patrons sont les mêmes que sans bite-block. On constate un<br />
gain de <strong>la</strong> fréquence de contact avec B2 et B3 <strong>la</strong> troisième rangée est totalement<br />
contactée. Sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, l’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> séquence /tat/ de YM<br />
semble renforcée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire par l’apex et <strong>la</strong> <strong>la</strong>me. Les bords de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
ont alors tendance à contacter plus les bords <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, on en dé<strong>du</strong>it que le corps de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue adopterait une forme moins concave. En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, l’amplitude <strong>des</strong><br />
contacts est supérieure à celle de <strong>la</strong> voisée /d/. Avec les bite-blocks on observe un gain<br />
de contacts alors qu’on avait une perte de contacts sur <strong>la</strong> voisée /d/. L’amplitude n’est<br />
pas altérée par l’insertion <strong>des</strong> bite-blocks, certains contacts sont même renforcés <strong>dans</strong> le<br />
sens où ils sont plus fréquents. Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion reste inchangé mais on observe une<br />
petite éten<strong>du</strong>e <strong>des</strong> contacts vers l’arrière ce qui est <strong>la</strong> marque d’un renforcement<br />
132
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> (Fougeron 1998). La consonne non voisée gagne <strong>des</strong> contacts alors que <strong>la</strong><br />
consonne voisée en perd.<br />
6.2.2.3 Séquence /did/<br />
Figure n° 6.16 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /did/, locuteur YM.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les deux 1 ères rangées alvéo<strong>la</strong>ires ont les électro<strong>des</strong> contactées<br />
pleinement. La 3 ième rangée alvéo<strong>la</strong>ire est presque entièrement contactée, il manque<br />
seulement <strong>la</strong> colonne 4. La 4 ème rangée est contactée de façon symétrique, colonnes 1, 2,<br />
3, 6, 7, 8. Les contacts <strong>la</strong>téraux sont symétriques de l’avant vers l’arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is sur<br />
les colonnes 1 et 8 et sont moins fréquents sur les colonnes 2 et 7. Par rapport à <strong>la</strong><br />
séquence /dad/, <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire admet plus de contacts. En comparaison avec <strong>la</strong><br />
même séquence <strong>du</strong> locuteur BL, YM contacte en plus <strong>la</strong> troisième et <strong>la</strong> quatrième<br />
rangée.<br />
Avec les bite-blocks, les patrons de contacts sont les mêmes qu’en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale.<br />
Les trois premières rangées alvéo<strong>la</strong>ires sont totalement contactées. Les électro<strong>des</strong> <strong>des</strong><br />
troisième et quatrième rangées gagnent en fréquence de contact, de même que les<br />
électro<strong>des</strong> <strong>des</strong> bords <strong>la</strong>téraux <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is : les contacts postérieurs sont aussi augmentés.<br />
On peut conclure que sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, l’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> séquence /did/<br />
de YM semble renforcée <strong>dans</strong> le sens où <strong>la</strong> consonne suivie de <strong>la</strong> voyelle /i/ permet de<br />
gagner en fréquence de contacts <strong>la</strong>téraux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire par l’apex et <strong>la</strong> <strong>la</strong>me<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, mais aussi <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région pré-pa<strong>la</strong>tale par les contacts <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue. Les patrons ne montrent pas de différence <strong>dans</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>des</strong> contacts, mais<br />
<strong>des</strong> différences sur <strong>la</strong> fréquence de contacts.<br />
133
6.2.2.4 Séquence /tit/<br />
Figure n° 6.17 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tit/, locuteur YM.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les trois 1 ères rangées alvéo<strong>la</strong>ires ont leurs électro<strong>des</strong> contactées.<br />
La 4 ème rangée est contactée de façon symétrique, colonnes 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Les<br />
électro<strong>des</strong> <strong>la</strong>térales sont totalement contactées de façon quasi symétrique de l’avant<br />
jusqu’à l’arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, sur les colonnes 1, 2, 7 et 8. Ce patron est quasi le même que<br />
le patron de <strong>la</strong> consonne de <strong>la</strong> séquence /did/ (figure6.16). YM contacte en plus <strong>la</strong><br />
troisième et quatrième rangée antérieure par rapport à <strong>la</strong> même consonne pro<strong>du</strong>ite par le<br />
locuteur BL (figure 6.13).<br />
Avec les bite-blocks, les électro<strong>des</strong> sont plus souvent contactées sur les trois 1 ères<br />
rangées alvéo<strong>la</strong>ires. Les contacts <strong>la</strong>téraux persistent aussi. Ce locuteur gagne<br />
principalement en fréquence de contacts sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, le lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion n’est pas modifié et l’amplitude n’admet pas de changement drastique.<br />
6.2.2.5 Comportement général <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Nous soulignons ici encore que les consonnes suivies de /a/ perdent plus de contacts que<br />
celles suivies de /i/. Cependant, nous n’observons pas de perte de contacts si marquée<br />
que pour les consonnes <strong>du</strong> locuteur BL. Nous n’avons pas relevé de différences<br />
statistiquement significatives et les patrons de contacts sont les mêmes avec et sans biteblock.<br />
Seule <strong>la</strong> consonne /d/ de <strong>la</strong> séquence /dad/ subit <strong>des</strong> pertes de contacts, alors que<br />
les autres séquences ont plutôt tendance à voir <strong>la</strong> fréquence de contacts renforcée par <strong>la</strong><br />
présence <strong>des</strong> bite-blocks. Le c<strong>la</strong>ssement <strong>des</strong> séquences selon le nombre de contacts<br />
134
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 6 : Résultats spatiaux<br />
per<strong>du</strong>s ou gagnés serait le suivant : Voisée + /a/ (-10) ≥ non voisée +/a/ (+6,42) ≥ voisée<br />
+ /i/ (+2,95) ≥ non voisée +/i/ (+2,41). Soulignons que selon cette même échelle, le<br />
locuteur BL perd <strong>des</strong> contacts et le locuteur YM en gagne : <strong>la</strong> séquence <strong>la</strong> plus variable<br />
est /d/ suivi de /a/ et <strong>la</strong> plus stable est /t/ suivi de /i/.<br />
6.3 Résumé sur les résultats spatiaux<br />
Nous confirmons ici que les locuteurs ont deux comportements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s différents<br />
en réponse aux situations de perturbations.<br />
De manière générale, le locuteur BL pro<strong>du</strong>it ses <strong>occlusives</strong> en contactant les deux<br />
premières rangées alvéo<strong>la</strong>ires avec /a/ et les trois premières avec /i/. Le locuteur BL a<br />
une <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> très apicale et en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> bloquée il semble renforcer son habitude<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> ce qui expliquerait en partie l’avancement et <strong>la</strong> perte <strong>des</strong> contacts. Plus <strong>la</strong><br />
mâchoire est écartée, plus les contacts apico-alvéo<strong>la</strong>ires sont ré<strong>du</strong>its.<br />
Le locuteur YM pro<strong>du</strong>it ses <strong>occlusives</strong> sur les trois premières rangées alvéo<strong>la</strong>ires avec<br />
/a/ et sur les quatre premières rangées avec /i/. Il apparaît que le locuteur YM contacte<br />
plus d’électro<strong>des</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire que le locuteur BL : l’articu<strong>la</strong>tion est plutôt<br />
apico-<strong>la</strong>minale. En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> bloquée, non seulement il conserve ses contacts, mais il<br />
est aussi susceptible d’augmenter l’aire d’articu<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> partie <strong>la</strong>minale de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue : l’action couplée de l’apex et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me est conservée. Il est certain qu’il faut<br />
mettre en re<strong>la</strong>tion ces articu<strong>la</strong>tions différentes avec les différences physiologiques.<br />
Précisément, le pa<strong>la</strong>is <strong>du</strong> locuteur YM est plus étroit que celui <strong>du</strong> locuteur BL, ce qui<br />
peut aussi contribuer au fait que les contacts soient plus rassemblés <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie<br />
alvéo<strong>la</strong>ire, partie <strong>la</strong> plus étroite <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is.<br />
Le locuteur BL accuse une perte de contacts significative avec les bite-blocks sur /d/<br />
suivi de <strong>la</strong> voyelle /a/. Les consonnes suivies de <strong>la</strong> voyelle /i/ ont aussi tendance à<br />
perdre <strong>des</strong> contacts mais de manière beaucoup moins sévère. Pour ce locuteur, les effets<br />
<strong>des</strong> bite-block sont significatifs sur le nombre de contacts.<br />
Le locuteur YM accuse une perte de contacts seulement sur <strong>la</strong> consonne de <strong>la</strong> séquence<br />
/dad/ à partir <strong>du</strong> B2. Nous avons observé une tendance à l'accroissement <strong>des</strong> contacts<br />
alvéo<strong>la</strong>ires sur les autres séquences : l’articu<strong>la</strong>tion semble être renforcée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone<br />
135
d’articu<strong>la</strong>tion. Les contacts alvéo<strong>la</strong>ires sont maintenus. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks ne<br />
sont pas significatifs sur l’amplitude <strong>des</strong> contacts.<br />
Nous remarquons que les effets <strong>des</strong> bite-blocks se font fortement ressentir sur /d/ suivi<br />
de /a/ concernant les deux locuteurs. Avec lesbite-blocks et surtout le B3, <strong>la</strong> séquence<br />
/dad/ perd <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux aussi bien <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire que <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
région vé<strong>la</strong>ire. L’épaisseur <strong>des</strong> bite-blocks est pertinente <strong>dans</strong> le sens où plus <strong>la</strong><br />
mâchoire est ouverte, moins les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sont possibles. L’articu<strong>la</strong>tion<br />
apico-<strong>la</strong>minale <strong>du</strong> /d/ de BL suivi de /a/ devient apicale au fur et à mesure que nous<br />
écartons <strong>la</strong> mâchoire. Le barrage <strong>du</strong> flux d’air phonatoire sur <strong>la</strong> première rangée<br />
d’électro<strong>des</strong> est conservé. Nous en dé<strong>du</strong>isons que seule l’activité de l’apex persiste pour<br />
permettre <strong>la</strong> constriction nécessaire, alors que les contacts <strong>des</strong> autres parties de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
disparaissent. L’articu<strong>la</strong>tion s’affaiblit puisque <strong>la</strong> zone de contacts ne s’étend plus <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> partie arrière <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. La forme de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue est devenue plus concave projetant<br />
l’apex vers <strong>la</strong> région dentale directement. Ce résultat confirme <strong>la</strong> forte indépendance de<br />
l’apex par rapport au corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue mais aussi par rapport à l’activité de <strong>la</strong><br />
mâchoire.<br />
La baisse d’amplitude s’accompagne donc d’un avancement de lieu d’articu<strong>la</strong>tion <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> région dentale. Nous reconnaissons que ce résultat commun n’est pas surprenant. En<br />
effet, nous avons vu que les consonnes voisées sont moins résistantes que les non<br />
voisées face aux variations contextuelles ce qui contribue au fait qu’elles résistent<br />
moins bien face aux perturbations extérieures. En tout état de cause, nous pouvons nous<br />
demander si nous avons toujours affaire à <strong>la</strong> réalisation d’un segment /d/. En effet, il<br />
devient si faible qu’il peut être réalisé comme un autre segment de type « f<strong>la</strong>p » ou<br />
« tap ». Comme l’explique Ladefoged (1998), un « tap » est caractérisé par <strong>des</strong> contacts<br />
extrêmement brefs entre les articu<strong>la</strong>teurs et «…made by a direct movement of the<br />
tongue tip to a contact location in the dental or alveo<strong>la</strong>r region » (p.231), exactement<br />
comme nous l’observons. Nous allons vérifier cette hypothèse en examinant les<br />
résultats <strong>des</strong> données temporelles <strong>dans</strong> le chapitre 7 suivant : si <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong><br />
constriction maximale est plus courte et si le geste de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale est plus<br />
rapide avec les bite-blocks, alors nous pourrons conclure à <strong>la</strong> réalisation d’un « tap ».<br />
136
137
138
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
CHAPITRE 7 : Les résultats temporels<br />
L’organisation temporelle <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s est un souci central en<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. On sait qu’elle exige un contrôle en temps réel et très précis<br />
mais on se demande encore de quelle manière. Nous cherchons à montrer que<br />
l’organisation temporelle <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s peut être modifiée sous<br />
l’influence <strong>des</strong> perturbations ce qui reviendrait à affirmer que nous assistons à une<br />
réorganisation temporelle.<br />
Voisi un résumé <strong>des</strong> questions que nous nous posons à propos de l’observation <strong>des</strong><br />
paramètres temporels. Avec <strong>la</strong> perturbation, observe-t-on un allongement de <strong>la</strong> phrase<br />
porteuse, de <strong>la</strong> séquence CVC, de <strong>la</strong> consonne d’attaque et de <strong>la</strong> voyelle (CVC) ?<br />
Concernant le timing intra-gestuel, les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> phases de <strong>la</strong> consonne évoluent-elles<br />
de <strong>la</strong> même façon que <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale de <strong>la</strong> consonne ?<br />
Nous présentons les <strong>du</strong>rées absolues et les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives et nous essayerons de<br />
distinguer les différences ou points communs exhibés par cette double observation.<br />
Rappelons que nous entendons par <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives le rapport de chacune <strong>des</strong> phases sur<br />
<strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne entière. Le lecteur pourra se référer aux nombreux tableaux <strong>des</strong><br />
moyennes qui sont présentés en annexe afin de ne pas surcharger <strong>la</strong> présentation.<br />
7.1 Le contrôle <strong>des</strong> <strong>du</strong>rées<br />
Avant d’examiner si les gestes linguaux sont compressés ou é<strong>la</strong>rgis sous l’influence <strong>des</strong><br />
bite-blocks, il est juste de vérifier si les bite-blocks in<strong>du</strong>isent une variation de <strong>la</strong> vitesse<br />
d’élocution en général. Dans un premier temps, nous avons calculé <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> énoncés<br />
complets sans bite-block et avec bite-block. Ces <strong>du</strong>rées de référence permettent de<br />
discerner si on observe <strong>des</strong> changements importants de <strong>la</strong> vitesse d’élocution qui<br />
pourraient influencer d’une manière générale le timing inter-gestuel et le timing-intra<br />
gestuel. Nous avons calculé le rapport de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée acoustique de <strong>la</strong> consonne et de <strong>la</strong><br />
voyelle, sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> séquence. Nous avons fait un regroupement en fonction <strong>des</strong><br />
conditions pour dégager les tendances chez les deux locuteurs.<br />
139
temps en ms<br />
1420<br />
1400<br />
1380<br />
1360<br />
1340<br />
1320<br />
1300<br />
1280<br />
1260<br />
1240<br />
1220<br />
1200<br />
<strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> phrase<br />
B0 B1 B2 B3<br />
conditions<br />
Figure n° 7.1 : Durée de <strong>la</strong> phrase porteuse <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En<br />
abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En observant <strong>la</strong> figure 7.1, nous pouvons constater que <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks a<br />
tendance à ralentir le débit de <strong>la</strong> phrase pour les deux locuteurs. Plus le bite-block est<br />
épais, plus l’allongement est grand : nous voyons un allongement de 100ms en moyenne<br />
entre <strong>la</strong> situation normale B0 et <strong>la</strong> situation B3.<br />
temps en ms<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
<strong>du</strong>rée voyelle de <strong>la</strong> séquence CVC<br />
B0 B1 B2 B3<br />
condition<br />
Figure n° 7.2 : Durée de <strong>la</strong> voyelle centrale de CVC <strong>dans</strong> les quatre conditions<br />
d’enregistrement. En abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
La figure 7.2 montre que <strong>la</strong> voyelle centrale de CVC est allongée de 25 ms en moyenne<br />
avec les bite-blocks pour le locuteur BL et de seulement 8 ms pour le locuteur YM.<br />
Déjà, nous remarquons deux réactions différentes de nos locuteurs, mais cette tendance<br />
reste à confirmer <strong>dans</strong> l’analyse postérieure.<br />
140<br />
YM<br />
BL<br />
YM<br />
BL
temps en ms<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
<strong>du</strong>rée consonne C1 de CVC<br />
B0 B1 B2 B3<br />
conditions<br />
Figure n° 7.3 : Durée de <strong>la</strong> consonne C1 <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En<br />
abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
La figure 7.3 concerne <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale de <strong>la</strong> consonne étudiée. Pour le locuteur YM, avec<br />
les bite-blocks, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de C1 reste inchangée. Pour le locuteur BL, nous notons un<br />
faible allongement de 10 ms.<br />
%<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
rapport C1/CVC<br />
B0 B1 B2 B3<br />
conditions<br />
Figure n°7.4 : La proportion de <strong>la</strong> consonne C1 ans <strong>la</strong> séquence CVC <strong>dans</strong> les quatre conditions<br />
d’enregistrement. En abscisse, les conditions. En ordonnée, le pourcentage de C1 sur CVC.<br />
La figure 7.4 montre que <strong>la</strong> consonne étudiée représente environ 40% de <strong>la</strong> séquence<br />
CVC. Nous ne voyons pas de gran<strong>des</strong> variations entre les différentes conditions : <strong>la</strong><br />
proportion de <strong>la</strong> consonne semble rester <strong>la</strong> même malgré <strong>la</strong> perturbation.<br />
Avec les bite-blocks, <strong>la</strong> phrase est prononcée plus lentement par les locuteurs,<br />
cependant, ni <strong>la</strong> séquence CVC ni <strong>la</strong> consonne étudiée C1 ne sont allongées.<br />
141<br />
YM<br />
BL<br />
YM<br />
BL
7.2 Durée totale <strong>des</strong> consonnes<br />
7.2.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> consonnes<br />
Cell Mean<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dc1<br />
Effe t : loc * cond * cvc<br />
Barr e s d 'e r r e u r : 95% In te r valle d e co n fian ce<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n°7.5: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> consonnes. En<br />
abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (B0, B1, B2 et B3).<br />
En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
De manière globale, <strong>la</strong> variable (d’enregistrement) influence <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong><br />
consonnes [F(3,352)=4,223 ; p=0,006]. L’effet de <strong>la</strong> condition expérimentale, les biteblocks,<br />
dépend faiblement <strong>du</strong> locuteur [F (3,352)=2,849 ; p=0,0374]. En effet, nous<br />
remarquons que les locuteurs ont <strong>des</strong> réactions différentes : nous observons une plus<br />
grande variation <strong>des</strong> valeurs chez le locuteur BL. L’effet de <strong>la</strong> condition expérimentale<br />
dépend fortement de <strong>la</strong> séquence puisque nous relevons une interaction entre ces deux<br />
facteurs [F(9,352)=4,221 ; p
7.2.2 Durées <strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur BL.<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.6: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale (B0), on confirme d’une manière générale que les consonnes<br />
non voisées sont plus longues que les voisées. Les contraintes aérodynamiques sont plus<br />
fortes sur les <strong>occlusives</strong> voisées, comme nous l’avons souligné <strong>dans</strong> chapitre 4. Les<br />
consonnes avec /i/ sont plus longues que leurs homologues avec /a/ : /ti/ (144,85) ≥ /di/<br />
(13,31) ≥ /ta/ (128,56) ≥ /da/ (104,11)<br />
Sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, on remarque que seules les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> séquences avec<br />
/i/ sont allongées, et cet allongement semble se faire au fur et à mesure que l’épaisseur<br />
<strong>des</strong> bite-blocks augmente. Cet allongement est plus marqué sur <strong>la</strong> non voisé /t/ avec /i/<br />
(45,8 ms entre B0 et B3), que sur <strong>la</strong> voisée /d/, (+19,8 ms entre B0 et B3).<br />
/di/ : B0 (135,31) = B1 (137,71) ≤ B2 (149,54) ≤ B3 (155,12)<br />
/ti/ : B0 (144,85) ≤ B1 (160,25) ≤ B2 (166,62) ≤ B3 (190,76)<br />
Les séquences avec <strong>la</strong> voyelle /a/ n’admettent que très peu de variations temporelles. La<br />
voisée /d/ perd 17,55 ms entre B0 et B2 . La consonne non voisée /t/ perd 14,7 ms entre<br />
B0 et B1.<br />
/da/ : B0 (104,11) ≥ B1 (95,78) = B3 (97,12) ≥ B2 (86,56).<br />
/ta/ : B0 (128,54) ≥ B3(122,87) = B2 (119,02) ≥ B1 (113,84).<br />
143<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
Comme on le voit sur <strong>la</strong> figure 7.7, l’interaction entre <strong>la</strong> condition expérimentale et <strong>la</strong><br />
nature de <strong>la</strong> voyelle est fortement significative [F(3,184)=6,030; p=0,0006]. L’effet <strong>des</strong><br />
bite-blocks est différent en fonction de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle.<br />
Moy. c ell<br />
180<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dc1<br />
Effet : cond * voyelle<br />
b0 b1 b2 b3<br />
Cell<br />
Figure n° 7.7: Graphe <strong>des</strong> interactions entre les variables et . En<br />
abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
Moy. c ell<br />
180<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dc1<br />
Effet : cond * voisem ent<br />
b0 b1 b2 b3<br />
Cell<br />
144<br />
a<br />
i<br />
nonvoisé<br />
voisé<br />
Figure n°7.8: Graphe <strong>des</strong> interactions entre les variables et . En<br />
abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
Comme nous pouvons le constater sur <strong>la</strong> figure 7.8, l’interaction entre le voisement et<br />
les effets <strong>des</strong> bite-blocks n’est pas significative [F(3,184)=0,411 ; p=0,7452]. L’effet <strong>du</strong><br />
bite-block ne dépend pas <strong>du</strong> fait que <strong>la</strong> consonne soit voisée ou non voisé.
7.2.3 Durées <strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Moy. <strong>des</strong> <strong>du</strong>rées<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
dad did tat tit<br />
séquences<br />
Figure n°7.9: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> consonnes de YM. En abscisse, chaque séquence <strong>dans</strong><br />
ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les consonnes non voisées sont plus longues que les consonnes<br />
voisées comme nous l’avons souligné aussi concernant les consonnes <strong>du</strong> locuteur BL.<br />
Les consonnes <strong>des</strong> séquences avec /i/ sont plus longues que celles <strong>des</strong> séquences avec<br />
/a/ : /ti/ (144,56) ≥ /di/ (135,75) = /ta/ (131,26) ≥ /da/ (114,21).<br />
Avec les bite-blocks, on remarque un allongement de 17,61 ms entre B0 et B3 sur <strong>la</strong><br />
séquence /did/. Par contre, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> non voisée reste stable en fonction les<br />
conditions.<br />
/di/ : B0 (135,75) = B1( 133,26) = B2 (138,098) ≤ B3 (153,36).<br />
/ti/ : B0 ( 144,56)= B1 ( 145,58) = B2 ( 148,91) = B3 ( 147,11)<br />
Les séquences avec <strong>la</strong> voyelle /a/ affichent un légère diminution de leur <strong>du</strong>rée. La<br />
voisée perd 6,08 ms entre B0 et B alors qu’il n’y a pas de différence ente B0, B1 et B2.<br />
La consonne non voisée perd 11,05 ms entre B0 et B3.<br />
/da/ : B0 (114,21) = B1 (116,13) = B2 (113,20) ≥ B3 (108,13)<br />
/ta/: B0 (131,26) ≥ B1 (127,94) =B2 (126,63) ≥ B3 (120,21)<br />
145<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
Ce<strong>la</strong> nous parait insuffisant pour conclure à <strong>des</strong> changements temporels pertinents sous<br />
l’effet <strong>des</strong> bite-blocks, alors que pour le locuteur BL, on remarquait une tendance plus<br />
marquée à l’allongement <strong>des</strong> consonnes suivies de /i/.<br />
L’effet général de <strong>la</strong> variable principale bite-blocks sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> consonnes de ce<br />
locuteur n’est pas significatif [F(3,188)=0,071 ; p=0,9754]. L’interaction entre <strong>la</strong><br />
variable et <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence est significative [F(9,176) =2,654 ;<br />
p=0,0066]. On soulignera que l’interaction entre les variables et <br />
est aussi significative [F(3,184) =4,385 ; p=0,0052]. Le voisement de <strong>la</strong> consonne<br />
n’influence pas les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(3,184)=0,929 ; p=0,4324].<br />
7.3 Durée <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales (LP)<br />
7.3.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> geste de<br />
fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale<br />
Cell Mean<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dinim ax<br />
Effe t : loc * cond * cvc<br />
Barr e s d 'e r r e u r : 95% In te r valle d e co n fian ce<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n° 7.10 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> geste de<br />
fermeture LP. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives<br />
(b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
La variable principale a un léger effet sur les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> fermetures<br />
[F(3,352)=2,686 ; p=0,0464] (seuil de significativité p≤0,05.) Les effets <strong>des</strong> bite-blocks<br />
dépendent fortement <strong>du</strong> locuteur [F(3,352)=9,087 ; p
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
7.10 que les valeurs <strong>du</strong> locuteur BL sont plus éten<strong>du</strong>es que celles <strong>du</strong> locuteur YM. Les<br />
effets <strong>des</strong> bite-blocks dépendent aussi de <strong>la</strong> séquence [F(9,352)=2,56 ; p=0,0073].<br />
L’interaction entre les variables et est significative<br />
[F(3,352)=15,129 ; p
Les distinctions entre les conditions sont bien plus marquées sur les séquences avec /i/<br />
que sur les séquences avec /a/. En effet, <strong>la</strong> voisée /d/ admet un allongement de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée<br />
de fermeture de 8,91 ms seulement avec le B3 et <strong>la</strong> non voisée /t/ a un allongement de <strong>la</strong><br />
fermeture de 10,75 ms avec le B2.<br />
/da/ : B0 (26,06) =B1 (29,64) = B2 (29,80) ≤ B3(34,97)<br />
/ta/ : B0 (38,98) = B1 (36,05) ≤ B2 (49,73) = B3 (43,97)<br />
Pour ce locuteur, l’influence de <strong>la</strong> variable principale seule est significative<br />
[F(3,188)=5,356 ; p=0,0015]. Les variables secondaires n’influencent pas l’effet <strong>des</strong><br />
bite-blocks : * [F(9,176) =1,278 ; p=0,2515] et *<br />
[F(3,184)=2,038 ; p=0,1102]. L’interaction entre les variables et<br />
n’est pas significative [F(3,184)=0,135 ; p=0,9391]. Les bite-blocks ont<br />
pour conséquence d’allonger de manière significative les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> fermetures de ce<br />
locuteur, et ce indépendamment <strong>des</strong> autres variables considérées.<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
24,60<br />
30,63<br />
33,85<br />
35,49<br />
Fermeture de BL<br />
32,26<br />
40,82<br />
49,91<br />
43,29<br />
148<br />
29,86<br />
32,13<br />
42,05<br />
35,55<br />
35,30<br />
36,51<br />
39,18<br />
38,54<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 7.12: Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> fermetures <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les séquences et en<br />
ordonnées les %.<br />
Au regard de <strong>la</strong> figure n° 7.12, en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale <strong>la</strong> fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale<br />
représente environ un tiers de <strong>la</strong> consonne pour les quatres séquences. Il semble que<br />
cette proportion augmente avec les bite-blocks : /dad/ B0 (24,6%) ≤ B3 (35.49%) ; /did/<br />
B0 (32.26%) ≤ B2 (49.91%), /tat/ B0 (29.86%)≤ B2 (42.05%) mais semble stable sur<br />
/tit/.<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
7.3.3 Durées <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales (LP) <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.13 : Durées moyennes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale de YM. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les fermetures sont plus longues sur les <strong>occlusives</strong> non voisées<br />
que sur les voisées comme nous l’avons vu chez le locuteur BL. La fermeture linguopa<strong>la</strong>tale<br />
<strong>des</strong> voisées est identique avec <strong>la</strong> voyelle /a/ et <strong>la</strong> voyelle /i/.<br />
/ta/ (47,60)≥ /ti/ ( 42,80) ≥ /da/ (39,35) = /di/ (38,23)<br />
Avec les bite blocs, les séquences avec /a/ montrent une fermeture plus courte. La<br />
fermeture de <strong>la</strong> voisée perd 20,86 ms entre B0 et B3. La fermeture de <strong>la</strong> non voisée /t/<br />
perd 15,4 ms entre B0 et B3.<br />
/da/ : B0 (39,35) = B1(39,11) = B2 (34,32) ≥ B3 (18,49).<br />
/ta/: B0 (47,60) B1 ≥ B1 (43,92) = B2 (41,13) ≥ B3 (32,20).<br />
Concernant les séquences avec /i/, <strong>la</strong> réaction est différente en fonction <strong>du</strong> voisement.<br />
La fermeture de <strong>la</strong> voisée est allongée de 13,92 ms entre B0 et B3 alors que l’on<br />
n’observe pas de différence entre B0 et B1. La fermeture de <strong>la</strong> non voisée /t/ admet une<br />
ré<strong>du</strong>ction de 6,99 ms entre les conditions B0 et B3.<br />
/di/: B0 (38,23) = B1 (37,04) ≤ B2 (42,35) ≤ B3 (52,15).<br />
/ti/ : B0 (42,8) = B1 (40,12) = B2 (39,20 = B3 (35,81)<br />
149<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
Alors que pour BL, les bite-blocks allongent le geste de fermeture <strong>des</strong> séquences avec<br />
/i/, pour YM <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle ne semble pas être aussi importante.<br />
En fait, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale de ce locuteur n’est pas influencée de<br />
manière significative par les bite-blocks [F(3,188)=1,738 ; p=0,1607]. Les faibles écarts<br />
observés entre les conditions B0 et les autres ne sont pas significatifs. Les effets <strong>des</strong><br />
bite-blocks dépendent de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence [F(9,176)=2,807; p=0,0042]. Par voie<br />
de conséquence les effets <strong>des</strong> bite-blocks dépendent de <strong>la</strong> voyelle [F(3,184)=5,278;<br />
p=0,0016]. Par contre le voisement n’a pas de rôle significatif sur les effets <strong>des</strong> biteblocks<br />
[F(3,184)=0,657; p=0,5798]. Nous observons tout de même un raccourcissement<br />
plus marqué de <strong>la</strong> fermeture concernant <strong>la</strong> séquence /dad/, avec le B3.<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
% 50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
34,52<br />
33,16<br />
29,73<br />
18,62<br />
27,79<br />
27,74<br />
Fermeture de YM<br />
30,99<br />
34,53<br />
150<br />
36,29<br />
33,85<br />
32,46<br />
26,90<br />
29,59<br />
27,37<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°7.14 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse,<br />
les séquences et en ordonnées les %.<br />
Les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives nous montrent que sans bite-blocks <strong>la</strong> fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale<br />
occupe en moyenne un tiers de <strong>la</strong> totalité de <strong>la</strong> consonne. La fermeture de /dad/ perd<br />
15,9 % de B0 à B3, <strong>la</strong> fermeture de /tat/ perd 9,39% de B0 à B3. Seule <strong>la</strong> séquence /did/<br />
voit sa fermeture s’allonger avec les bite-blocks : <strong>la</strong> différence entre B0 et B3 est plus<br />
significative qu’avec les autres bite-blocks : 6,74%. La fermeture de /t/ suivi de /i/ est <strong>la</strong><br />
plus stable face aux bite-blocks, comme pour le locuteur BL (figure 7.12).<br />
26,61<br />
24,02<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7 4. Durée <strong>des</strong> tenues<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
7.4.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue<br />
Cell Mean<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dtenuc1<br />
Effe t : loc * cond * cvc<br />
Bar r e s d 'e rr e u r : 95% In te r valle d e co n fian ce<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n°7.15: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue. En<br />
abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3).<br />
En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
La variable principale a une forte influence sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue<br />
[F(3,352)=10,149 ; p
7.4.2 Durées <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.16 : Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> tenues pour le locuteur BL. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En condition normale, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue de <strong>la</strong> séquence /dad/ est nettement plus<br />
courte que celle <strong>des</strong> autres séquences : /da/ (69,80) ≤ /di/ (90,46) = /ta/ (90,79) ≤ /ti/<br />
(98,15). Sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, nous observons les mêmes manifestations que<br />
pour les <strong>du</strong>rées totales <strong>des</strong> consonnes et les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales :<br />
seules les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> séquences avec /i/ sont allongées au fur et à mesure que l’épaisseur<br />
<strong>des</strong> bite-blocks augmente. La tenue de <strong>la</strong> voisée est allongée de 19,32ms entre B0 et B2<br />
et <strong>la</strong> tenue de <strong>la</strong> non voisée est allongée de 25,93 ms.<br />
/di/ : B0 (90,46) ≤ B1 (89,71) ≤ B2 (104,99) = B3 (109,98 )<br />
/ti/ : B0 (98,15) = B1 (95,93) ≤ B2 (113,18) ≤ B3 (124,08)<br />
On notera une tendance au raccourcissement de <strong>la</strong> tenue avec <strong>la</strong> voyelle /a/ avec<br />
toujours moins de variation temporelle qu’avec <strong>la</strong> voyelle /i/. La tenue de <strong>la</strong> voisée<br />
diminue de 8,97 ms entre b0 et B2 et <strong>la</strong> tenue de <strong>la</strong> non voisée diminue de 15,11 ms<br />
entre B0 et B2.<br />
/da/ : B0 (69,89) = B3 (68,21) ≥ (62,72) = B2(60,92)<br />
/ta/ : B0 (90,79) = B3 (86,61) ≥ B2 (80,43) = B1 (75,68)<br />
La variable (condition d’enregistrement ou bite-block) seule a un effet<br />
significatif sur les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> tenues de ce locuteur [F(3,188)=3,307 ; p=0,0213]. Par<br />
contre <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence n’influence pas les effets <strong>des</strong> bite-blocks<br />
[F(9,176)=1,774; p=0,0761]. On remarque aussi que les effets <strong>des</strong> bite-blocks sont<br />
152<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
influencés par <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle. [F(3,184)=4,501 ; p=0,0045]. L’interaction entre<br />
condition et voisement n’est pas significative [F(3,184)=0,135 ; p=0,9393].<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
67,90<br />
65,63<br />
70,05<br />
69,86<br />
Tenue de BL<br />
67,48<br />
65,06<br />
69,91<br />
70,28<br />
153<br />
71,46<br />
66,56<br />
67,46<br />
70,33<br />
67,71<br />
60,16<br />
67,63<br />
65,33<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 7.17 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les séquences et en<br />
ordonnées les %.<br />
La tenue de ce locuteur BL représente les deux tiers de <strong>la</strong> consonne. Alors qu’en<br />
proportion de <strong>la</strong> tenue avec <strong>la</strong> voyelle /i/, les données re<strong>la</strong>tives ne montrent pas de<br />
différences entre les conditions ni en fonction <strong>du</strong> voisement, ni en fonction de <strong>la</strong><br />
voyelle. Ici, <strong>la</strong> proportion de <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> semble rester re<strong>la</strong>tivement stable.<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7.4.3 Durées <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.18 : Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> tenues de YM. En abscisse, chaque séquence <strong>dans</strong> ses<br />
quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue de /dad/ est nettement à celles <strong>des</strong> autres<br />
séquences. /ti/ (95,74) ≥ /di/ (88,95) = /ta/ (86,21) ≥ /da/ (71,88). La tenue est <strong>la</strong> plus<br />
longue sur <strong>la</strong> consonne non voisée suivie de /i/. Les tenues sont en accord avec les<br />
<strong>du</strong>rées totales <strong>des</strong> consonnes. Nous avons fait <strong>la</strong> même observation à propos <strong>des</strong> tenues<br />
<strong>du</strong> locuteur BL.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> bloquée, nous observons une légère tendance à <strong>la</strong> hausse de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong><br />
tenue, excepté pour <strong>la</strong> séquence /tat/. Concernant les séquences avec /i/, <strong>la</strong> tenue de <strong>la</strong><br />
voisée s’allonge de 21,51 ms entre B0 et B3 mais il n’y a pas de différence entre B0, B1<br />
et B2. La tenue de <strong>la</strong> non voisée varie moins augmente seulement de 9,75 ms entre B0<br />
et B3 sans différence entre B0, B1 et B2.<br />
/di/ : B0 (88,95) = B1 (91,56) = B2 (92,76) ≤ B3 (110,46).<br />
/ti/ : B0 (95,74) ≤ B1 (102,94) = B2 (101,12) = B3 (105,49)<br />
Concernant les séquences avec /a/, seulement <strong>la</strong> tenue de <strong>la</strong> voisée admet un léger<br />
allongement de 9,76 ms entre B0 et B3, et nous n’observons pas de différence entre B0,<br />
B1 et B2. Les tenues de <strong>la</strong> non voisée montrent une certaine stabilité entre les<br />
conditions.<br />
/da/ : B0 (71,88) = B1 (71,66) = B2 (71,87) ≤ B3 (81,64)<br />
/ta/ B0 (86,22) = B1 (84,31) = B2 (82,73) = B3 (84,79)<br />
154<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
Nous avons observé plus de variation en fonction <strong>des</strong> bite-blocks sur les tenues <strong>du</strong><br />
locuteur BL. Pour YM, on observe une hausse de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue seulement sur <strong>la</strong><br />
séquence /did/. Il n’y a pas de variation temporelle remarquable concernant les <strong>du</strong>rées<br />
<strong>des</strong> tenues <strong>des</strong> autres séquences alors que les effets <strong>des</strong> bite-blocks sont significatifs :<br />
[F(3,188)= 3,575 ; p=0,0150]. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks ne dépendent pas de <strong>la</strong> voyelle<br />
[F(3,184)= 1,570 ; p=0,1982] et ne dépendent pas de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence<br />
[F(9,176)= 1,573 ; p=0,1265]. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks ne dépendent pas non plus <strong>du</strong><br />
voisement [F(3,184)=1,659 ; p=0,1774].<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
62,90<br />
61,95<br />
63,92<br />
74,26<br />
65,90<br />
68,84<br />
Tenue de YM<br />
66,85<br />
71,85<br />
155<br />
65,80<br />
66,10<br />
65,32<br />
70,09<br />
66,08<br />
70,75<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°7.19 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les séquences et en<br />
ordonnées les %. En abscisse, les séquences et en ordonnées les %.<br />
Nous remarquons que pour les 4 séquences, les tenues occupent un peu moins <strong>des</strong> 2/3<br />
(entre 60% et 70%) de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale de <strong>la</strong> consonne. De plus, cette proportion reste <strong>la</strong><br />
même avec les bite-blocks, ce qui nous pousse à croire que cette phase est re<strong>la</strong>tivement<br />
stable face aux perturbations. En <strong>du</strong>rée re<strong>la</strong>tive (comme nous l’avons observé en <strong>du</strong>rée<br />
absolue), nous observons quand même une différence significative de <strong>du</strong>rée sur <strong>la</strong><br />
séquence /dad/, B0(62,90) ≤ B3 (74,26). Les autres séquences ne présentent pas de<br />
variations temporelles aussi drastiques.<br />
67,89<br />
71,96<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7.5. Durée <strong>des</strong> maxima<br />
contacts.<br />
7.5.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum de<br />
Cell Mean<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dm axc1<br />
Effet : loc * cond * cvc<br />
Barre s d'e rreur: 95% Inte rvalle de confiance<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n° 7.20 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum de<br />
contacts. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1,<br />
b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
La variable principale n’a que très peu d’influence sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong><br />
maximum : [F(3,352)=0,831 ; p=0,04776]. L’effet <strong>des</strong> bite-blocks n’est pas le même<br />
chez les deux locuteurs [F(3,352)=8,472 ; p
7.5.2 Durées <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.21: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> maxima pour le locuteur BL. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En parole normale, le maximum est plus long pour <strong>la</strong> séquence /tat/ que pour les autres<br />
séquences. On remarque que le maximum de contacts ne varie pas en fonction de <strong>la</strong><br />
voyelle : /ta/ (44,28) ≥ /da/ (36,58) = /di/ (36,21) ≥ /ti/ (27,87).<br />
Avec les bite-blocks, on remarque que les maximums de contacts <strong>du</strong>rent plus longtemps<br />
que sans bite-block, excepté concernant <strong>la</strong> séquence /tit/ pour <strong>la</strong>quelle le maximum de<br />
contacts est plus long en B3.<br />
Sur les séquences avec <strong>la</strong> voyelle /a/, le maximum de <strong>la</strong> voisée raccourcit de 9,12 ms<br />
ente B0 et B1, B2, B3 et le maximum de <strong>la</strong> non voisée raccourcit de 17,96 ms entre B0<br />
et B2, B3.<br />
/da/ : B0 (36,58) ≥ B1 (27,63) = B2 (27,32 ) = B3 (28,28)<br />
/ta/ : B0 (44.28) ≥ B1 (36.52) ≥ B3 (29.78) = B2 (26.32)<br />
Avec <strong>la</strong> voyelle /i/, le maximum de <strong>la</strong> voisée /d/ est diminué de 16,5 ms entre B0 et B1,<br />
B2, B3. Le maximum de <strong>la</strong> voisée est augmenté de 11,54 ms entre B0 et B3 et de 19 ms<br />
entre B1 et B3.<br />
/di/ : B0 (36,21) ≥ B1 (20,94) = B3 (22,98)= B2 (19,71)<br />
/ti/ : B1 (20,35) = B2 (21,18) ≤ B0 (27,87) ≤ B3 (39,41)<br />
L’influence <strong>des</strong> bite-blocks est significative sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum de ce locuteur<br />
[F(3,188)= 6,406 ; p=0,0004]. Il semble que <strong>la</strong> nature de l’identité phonétique n’ait pas<br />
d’influence sur les effets <strong>des</strong>bbite-blocks. [F(9,176)= 1,667 ; p=0,1001]. La nature de <strong>la</strong><br />
157<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
voyelle n’influence pas non plus <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum [F(3,184)=1,657 ; p=0,1778].<br />
L’interaction entre les variables et n’est pas significative<br />
[F(3,184)=0,817; p=0,4861]. Avec les bite-blocks, <strong>la</strong> tendance de ce locuteur est bien à<br />
<strong>la</strong> ré<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> maximums de contacts, excepté pour <strong>la</strong> séquence /tit/.<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
35,42<br />
29,17<br />
32,42<br />
30,13<br />
26,51<br />
Maximum de BL<br />
15,30<br />
12,87<br />
14,91<br />
158<br />
35,04<br />
31,18<br />
21,85<br />
24,51<br />
19,25<br />
12,78<br />
dad did tat tit<br />
12,79<br />
18,79<br />
Figure n° 7.22 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les séquences et en<br />
ordonnées les %.<br />
En B0, le maximum absolu de contacts représente environ un tiers <strong>des</strong> consonnes exepté<br />
pour <strong>la</strong> consonne /t/ suivie de /i/. Les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives sont toujours plus faibles avec les<br />
bite-blocks. Nous constatons <strong>des</strong> écarts qui tra<strong>du</strong>isent <strong>la</strong> tendance à <strong>la</strong> diminution de <strong>la</strong><br />
proportion <strong>du</strong> maximum.<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7.5.3 Durées <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.23: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> maxima de YM. En abscisse, chaque séquence <strong>dans</strong> ses<br />
quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, on constate que les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> maxima de /t/ et /d/ sont<br />
équivalentes, que les consonnes soient suivies de /i/ ou de /a/ : /ti/ (30.07) = /ta/ (33.07)<br />
= /di/ (35.82) = /da/ ( 32.47).<br />
Avec les bite-blocks, les séquences avec /a/ ne répondent pas de <strong>la</strong> même façon. La<br />
voisée /d/ voit son maximum ré<strong>du</strong>ire de 12,19 ms entre B0 et B3. On constate que les<br />
<strong>du</strong>rées en B0, B1 et B2 sont identiques. La non voisée /t/ voit son maximum s’allonger<br />
de 10,39 ms avec le B3 alors qu’il n’y a pas de différences entre B0, B1 et B2.<br />
/da/ : B0 (32,45) = B1 (32,10) = B2 (35,54) ≥ B3 (20,26).<br />
/ta/ : B0 (33,07) = B1(32,10) = B2(35,54) ≤ B3 (43,46).<br />
Les maxima <strong>des</strong> séquences avec /i/, sont allongés. Le maximum de <strong>la</strong> voisée /d/ est<br />
allongé de 23 ms avec le B1 et le B3 et de 18,24 ms avec le B2. Le maximum de <strong>la</strong> non<br />
voisée est allongée de 11,83 ms avec le B1 et le B3 et de 5,97 ms avec le B2. Sous<br />
l’influence <strong>des</strong> bite-blocks les maxima <strong>des</strong> consonnes suivies de /i/ admettent une<br />
évolution identique <strong>des</strong> <strong>du</strong>rées.<br />
/ti/ :B0 (30,03) ≤ B2 (48,27) ≤ B1 (53,92) = B3 (52,83)<br />
/di/ : B0 (35,82) ≤ B2 (41,79) ≤ B1 (47,47) = B3 (47,63)<br />
159<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
L’effet seul <strong>des</strong> bite-blocks n’est pas significatif [F(3,188)= 2,522 ; p=0,592].<br />
Cependant, on peut conclure que <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle peut jouer sur les effets <strong>des</strong><br />
bite-blocks [F(3,184)= 3,004 ; p=0,0317]. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks dépendent aussi de<br />
<strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence [F(9,176)= 2,217 ; p=0,0230]. Par contre, le voisement<br />
n’influence pas les effets <strong>des</strong> bite-blocks. [F(3,184)=1,846 ; p=0,1404].<br />
100<br />
%<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
28,28<br />
28,25<br />
31,45<br />
18,70<br />
Maximum de YM<br />
26,94<br />
35,47<br />
29,92<br />
30,68<br />
160<br />
25,10<br />
27,01<br />
27,69<br />
35,74<br />
20,83<br />
37,09<br />
31,88<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 7.24 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les séquences et en<br />
ordonnées les %.<br />
En B0, on peut évaluer <strong>la</strong> part <strong>du</strong> maximum de contacts à environ un peu moins d’1/3<br />
de <strong>la</strong> consonne. Les données re<strong>la</strong>tives indiquent aussi que seulement <strong>la</strong> séquence /da/<br />
voit ses maxima raccourcis de 9,58% avec B3. Une tendance à l’allongement <strong>des</strong><br />
maxima sur les autres séquences se dégage plus c<strong>la</strong>irement : + 8,53% entre B0 et B1<br />
pour /di/ ; +10,64% entre B3 et B0 pour /ta/ et + 15,52% pour /ti/.<br />
36,35<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7. 6 Durée <strong>des</strong> occlusions<br />
7.6.1 Durée de l’occlusion <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n°7.25: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, l’occlusion <strong>la</strong> plus longue est sur <strong>la</strong> séquence /tat/, <strong>la</strong> plus<br />
courte est sur <strong>la</strong> séquence /dad/. Alors que les occlusions <strong>des</strong> séquences avec /i/ sont les<br />
mêmes, indépendamment <strong>du</strong> trait de voisement : /ta/ (90,68) ≥ /di/ (76,24) ≥/ti/ (76,25)<br />
≥ /da/ (68,27). Les occlusions <strong>des</strong> séquences avec /a/ racourcissent avec les bite-blocks.<br />
L’occlusion de <strong>la</strong> voisée /d/ diminue de 27,17 ms entre B0 et B2 par contre, nous<br />
n’observons pas de différence importante entre <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> en B0 (68,28 ms) et avec<br />
B3 (64,22 ms). L’occlusion de <strong>la</strong> consonne non voisée /t/ perd 24 ms entre B0 et B2 et<br />
perd 11,37 ms entre B0 et B3.<br />
/da/ : B0 (68,28) = B3 (64,22) ≥ B1 (59,05) ≥ B2 (41,63)<br />
/ta/ : B0 (90,68) ≥ B3 (79,37) = B1 (75,34) ≥ B2 (66,67)<br />
Les occlusions <strong>des</strong> séquences avec /i/, sont plus longues avec B3 que sans bite-block.<br />
L’évolution <strong>des</strong> <strong>du</strong>rées d’occlusion est <strong>la</strong> même pour les deux séquences avec /i/ : <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée est stable en B0, B1 et B2 puis augmente de avec B3. L’occlusion de <strong>la</strong> voisée<br />
161<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
s’allonge de 9,98 ms entre B0 et B3 et l’occlusion de <strong>la</strong> non voisée s’allonge de 16,11<br />
ms entre B0 et B3.<br />
/di/ : B0 (76,24) = B1 (76,69)=B2 (79,45) ≤ B3 (86,22)<br />
/ti/ : B0 (76,25) =B1 (73,36) =B2 (79,45) ≤ b3 (92,36)<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
67,13<br />
61,99<br />
46,50<br />
67,33<br />
Occlusion de BL<br />
56,12<br />
54,71<br />
51,69<br />
54,86<br />
162<br />
70,91<br />
65,93<br />
56,10<br />
63,43<br />
52,95<br />
45,24<br />
47,66<br />
49,15<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°7.26 : Les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les séquences et<br />
en ordonnées les %.<br />
Les occlusions représentent un peu plus de <strong>la</strong> moitié <strong>des</strong> consonnes. Les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives<br />
montrent peu de différences de <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> occlusions de /did/ et /tit/. Alors que les<br />
<strong>du</strong>rées absolues montraient un allongement, <strong>la</strong> proportion de l’occlusion reste constante<br />
avec les bite-blocks. On notera une différence plus marquée avec <strong>la</strong> voyelle /a/.<br />
/da/ : B0 (67,13) = B3 (67,33) = B1 (61,99) ≥ B2 (46,50)<br />
/ta/: B0 (70,91) ≥ B1 (65,93) = B3 (63,43) ≥ B2 (56,10)<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7.6.2 Durée de l’occlusion <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n°7.27 : Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, l’occlusion de <strong>la</strong> non voisée suivie de /a/ est plus longue que<br />
l’occlusion de <strong>la</strong> non voisée suivie de /i/ : /ta/ (77,71) = /di/ (73,51) ≥ /da/ (67,10) = /ti/<br />
(65,58).<br />
Avec les bite-blocks, les consonnes suivie de /a/ réagissent différemment. La voisée voit<br />
raccourcir son occlusion de 7,99 ms entre B0 et B3, alors qu’il n’y a pas de différence<br />
ente B0 et B2. Concernant <strong>la</strong> non voisée, les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> occlusions sont identiques <strong>dans</strong><br />
les quatre conditions d’enregistrement : <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’occlusion reste stable :<br />
/da/ : B0 (67,01)= B2 (63,96) ≥ B1 (53,91) = B3 (59,02)<br />
/ta/: B0 (77,71) = B2 (77,56) = B1 (74,33) = B3 (74,38)<br />
Les occlusions <strong>des</strong> consonnes suivies de /i/, réagissent de manière contradictoire. Les<br />
occlusions de /d / sont simi<strong>la</strong>ires en B0, B1 et B2 et s’allongent de 19,49 ms avec le B3.<br />
Les occlusions de /d/ raccourcissent de 19,19 ms entre B0 et B1, B2, B3, elles sont de<br />
même longueur <strong>dans</strong> les trois situations de perturbation.<br />
/di/ : B0 (73,51) = B1 (72,44) = B2 (76,05) ≤ B3 (93)<br />
/ti/ : B0 (65,58) ≤ B1 (82,27)=B2 (82,49) = B3( 84,77)<br />
163<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
% 50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
58,56<br />
46,58<br />
56,27<br />
62,35<br />
54,31<br />
Occlusion de YM<br />
54,99<br />
54,66<br />
60,39<br />
164<br />
59,01<br />
57,73<br />
61,10<br />
61,09<br />
45,29<br />
56,39<br />
55,26<br />
57,83<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 7.28 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les séquences et<br />
en ordonnées les %.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives nous montrent que les occlusions occupent<br />
bien <strong>la</strong> moitié de <strong>la</strong> consonne, et un peu moins pour /t/ suivi de /i/. Elles <strong>du</strong>rent plus<br />
longtemps que les maxima de contacts qui représentaient environ un tiers de <strong>la</strong><br />
consonne. Avec les bite-blocks, on note peu de différences sur <strong>la</strong> proportion de<br />
l’occlusion de /d/ suivi de /i/ et /t/ suivi de /a/. Notons que les occlusions de /t/ suivi de<br />
/i/ gagnent 12,54% avec B3. Les occlusions de /d/ suivi de /a/ perdent 11,98 % avec B1<br />
et ensuite rejoignent <strong>la</strong> proportion sans bite-block.<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7.7 Durée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP)<br />
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
7.7.1 Influence générale <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’ouverture<br />
linguo-pa<strong>la</strong>tale<br />
Cell Mean<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour dm axend<br />
Effe t : loc * cond * cvc<br />
Barr e s d 'e r r e u r : 95% In te r valle d e co n fian ce<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n° 7.29: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’ouverture LP.<br />
En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et<br />
b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
Pour les deux locuteurs confon<strong>du</strong>s, les bite-blocks influencent les <strong>du</strong>rées d’ouverture LP<br />
[F(3,352)=3,205 ; p=0,0233]. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks dépendent <strong>des</strong> locuteurs<br />
[F(3,352)=2,821 ; p=0,0389] : nous remarquons effectivement que les valeurs<br />
correspondantes à BL sont plus é<strong>la</strong>rgies, admettent plus de variabilité que celles de YM.<br />
L’interaction entre et est fortement significative [F(3,352)=22,864 ;<br />
p
7.6.2 Durée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP) <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n°7.30 : Les <strong>du</strong>rées moyennes de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur BL. En<br />
abscisse, chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale est plus longue sur les séquences<br />
avec <strong>la</strong> voyelle /i/ et <strong>la</strong> consonne non voisée. L’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>des</strong> séquences<br />
avec <strong>la</strong> voyelle /a/ a quasiment <strong>la</strong> même <strong>du</strong>rée pour <strong>la</strong> voisée et <strong>la</strong> non voisée.<br />
/da/ (41,47) = /ta/ (45,29) ≤ /di/ (54,9) ≤ /ti/ (66,06)<br />
Avec les bite-blocks, l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale a tendance à s’allonger sur les<br />
séquences avec /i/. L’ouverture de <strong>la</strong> voisée s’allonge de 10,41 ms entre B0 et B3, alors<br />
qu’il n’y a pas de différence entre B0 et B2. L’ouverture LP de <strong>la</strong> non voisée /t/<br />
s’allonge de 16,27 ms entre B0 et B3 mais nous n’observons pas de différence de <strong>du</strong>rées<br />
entre B1, et B2.<br />
/di/ : B0 (54,90) = B2(54,79) ≤ B1 (60,07) ≤ B3 (65,31)<br />
/ti/ : B0 (66,06) ≤ B2 (79,17) = B1 (80,51) = B3 (82,33)<br />
Sur les séquences avec /a/, <strong>la</strong> voisée /d/ admet une ouverture LP plus courte de 12,04 ms<br />
entre B0 et B3 alors que <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée l’ouverture en B0 est identique à celle en B1. En B3,<br />
La <strong>du</strong>rée de l’ouverture LP de <strong>la</strong> non voisée /t/ <strong>du</strong>re 3,83 ms en moins qu’en B0 et 7,86<br />
ms en moins qu’en B1.<br />
/da/ : B0 (41,47) = B1 (38,51) ≥ B3 (33,86) ≥ B2 (29,43)<br />
/ta/ : B1 (41,26) = B2 (42,97) ≤ B0 (45,29) ≤ B3 (49,12)<br />
166<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
En fait, ces différences entre les conditions sont minimes puisque l’ouverture LP ne<br />
subit pas de changement significatif de <strong>du</strong>rées sous m<strong>la</strong> ; seule influence <strong>des</strong> bite-blocks<br />
[F(3,188)=0,851 ; p=0,4678]. La nature de <strong>la</strong> séquence ne joue pas un rôle particulier<br />
sur les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(9,176)=1,633 ; p=0,1091], pas plus d’ailleurs que <strong>la</strong><br />
voyelle [F(3,184)=2,279 ; p=0,0810], et le voisement F(3,184)=0,727 ; p=0,5370]. Les<br />
variations observées avec les bite-blocks, ne sont apparemment pas suffisantes pour<br />
conclure à une véritable distinction entre les conditions d’enregistrement.<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
39,97<br />
40,20<br />
33,73<br />
34,38<br />
Ouverture de BL<br />
41,23<br />
43,87<br />
37,22<br />
41,81<br />
167<br />
35,11<br />
36,69<br />
36,09<br />
39,94<br />
45,45<br />
50,71<br />
48,03<br />
43,83<br />
dad did tat tit<br />
Figure n°7.31 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> ouvertures linguo-pa<strong>la</strong>tales <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse,<br />
les séquences et en ordonnées les %.<br />
En B0, le mouvement d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale représente plus d’1/3 de <strong>la</strong> consonne.<br />
Il semble que <strong>la</strong> proportion que l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale occupe <strong>dans</strong> <strong>la</strong> consonne<br />
reste stable avec les bite-blocks : les fluctuations <strong>des</strong> valeurs ne semblent pas être <strong>du</strong>es<br />
aux bite blocks.<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3
7.6.3 Durée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP) <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Moy. <strong>des</strong> cellules<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
dad did tat tit<br />
Cellule<br />
Figure n° 7.32 : Les <strong>du</strong>rées moyennes de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale de YM. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.<br />
En <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale, l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale est plus lente sur les consonnes<br />
voisées que les non voisées. Les séquences avec /i/ montrent une ouverture LP plus<br />
lente que celles avec /a/. B0 : /da/ (42,39) ≤ /ta/ (50,59) ≤ /di/ (61,71) ≤ /ti/ (71,72).<br />
Rappelons que nous avons fait <strong>la</strong> même remarque concernant le locuteur BL.<br />
Avec les bite-blocks, l’ouverture LP <strong>des</strong> séquences avec /i/ est raccourcie. L’ouverture<br />
LP de <strong>la</strong> voisée diminue de 12,95 ms entre B0 et B1 et de 7,22 ms entre B0 et B3. La<br />
non voisée diminue de 20,18 ms entre B0 et B1 et diminue de 14,78 ms entre B0 et B2.<br />
/di/ : B0 (61,71) ≥ B2 (53,96) = B3 (54,49) ≥ B1 (48,76).<br />
/ti/ : B0 (71,72) ≥ B2 (61,57) ≥ B3 (56,94) = B1 (51,54).<br />
Seule <strong>la</strong> consonne /d/ suivi de /a/ voit son ouverture LP allongée de 27,48 ms entre B0<br />
et B3 alors que nous observons <strong>la</strong> même <strong>du</strong>rée entre B0, B1 et B2.<br />
/da/: B0 (42,38) = B1 (44,92) = B2 (43,33) ≤ B3 (69,86).<br />
/ta/: B0 (50,59) = B1 (49,68) = B2 (50,12) ≥ B3 (44,55).<br />
A l’inverse, l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale de <strong>la</strong> non voisée /t/ diminue avec le B3 bien<br />
qu’aucune différence ne soit remarquée entre B0, B1 et B2.<br />
La seule séquence qui ralentit de façon drastique le mouvement d’ouverture LP est <strong>la</strong><br />
séquence /d/ suivi de /a/ et encore l’écart type est beaucoup plus fort.<br />
168<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
Les <strong>du</strong>rées de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur YM sont influencées par <strong>la</strong><br />
présence <strong>des</strong> bite-blocks [F(3,188)=3,410 ; p=0,0187]. Cette influence est donnée<br />
surtout par les changements observés sur <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/. Les effets <strong>des</strong><br />
bite-blocks dépendent de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence [F(9,176)=6,246 ; p
7.7 Résumé <strong>des</strong> résultats temporels<br />
Nous venons de confirmer que les perturbations n’ont pas un effet systématique sur<br />
l’organisation temporelle de <strong>la</strong> constriction linguale <strong>du</strong>ant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes<br />
/d/ et /t/. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks sur le timing de <strong>la</strong> consonne peuvent dépendre<br />
effectivement d’autres facteurs comme le contexte phonétique environnant au sens<br />
<strong>la</strong>rge. Les différences bien marquées entre les réactions <strong>des</strong> deux locuteurs confirment<br />
de fortes variations-interindivi<strong>du</strong>elles. Chacun appréhende les perturbations à sa façon,<br />
en fonction de sa moprphologie, de ses acquis et semble réagir de façon appropriée à ses<br />
propres habitu<strong>des</strong> de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, ce que Zerling (1991) appelle <strong>la</strong> base <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>.<br />
7.7.1 Les résultats temporels <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> consonnes <strong>occlusives</strong> observées ne sont pas modifiées par les biteblocks.<br />
Par contre les variations observées sont plutôt <strong>du</strong>es à <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle et à<br />
<strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence. Les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> consonnes voisées et non voisées sont plus<br />
longues avec <strong>la</strong> voyelle /i/ qu’avec <strong>la</strong> voyelle /a/ ce qui n’est pas surprenant puisque <strong>la</strong><br />
voyelle /i/ est allongeante.<br />
Les variations temporelles observées sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale sont<br />
vraiment <strong>du</strong>es aux bite-blocks, indépendamment <strong>des</strong> autres facteurs. Les fermetures <strong>des</strong><br />
consonnes, voisées et non voisées, avec /i/ et avec /a/, sont ralenties sous l’influence <strong>des</strong><br />
bite-blocks. L’établissement de <strong>la</strong> constriction nécessite plus de temps. Le locuteur a<br />
surement besoin d'un dé<strong>la</strong>i plus long pour adapter <strong>la</strong> trajectoire de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue vers <strong>la</strong><br />
constriction.<br />
Les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> tenues sont en partie influencées par les bite-blocks puisque <strong>la</strong> voyelle et<br />
a aussi une influence. Comme pour les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> consonnes /t/ et /d/, les <strong>du</strong>rée <strong>des</strong><br />
tenues sont allongées quand elles sont suivies de /i/ et raccourcies quand elles sont<br />
suivies de /a/.<br />
Les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> contacts maximaux sont modifiées seulement par les bite-blocks, les<br />
autres facteurs n’influencent pas les <strong>du</strong>rées. La tendance est plutôt au raccourcissement<br />
<strong>du</strong> maximum. La difficulté à tenir <strong>la</strong> constriction avec <strong>la</strong> mâchoire ouverte se fait<br />
ressentir par le raccourcissement de <strong>la</strong> constriction maximale. Le locuteur atteint <strong>la</strong><br />
constriction mais a <strong>des</strong> difficultés à <strong>la</strong> tenir aussi longtemps qu’en parole normale.<br />
170
TROISIEME PARTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX<br />
CHAPITRE 7 : Résultats temporels<br />
Les occlusions <strong>des</strong> consonnes voisées et non voisées avec /a/, sont raccourcies, les<br />
occlusions <strong>des</strong> consonnes avec /i/ sont allongées, comme pour <strong>la</strong> tenue et <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée totale.<br />
La <strong>du</strong>rée de l’ouverture n’est pas changée de façon significative par les bite-blocks, ni<br />
même par <strong>la</strong> voyelle.<br />
La fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale et <strong>la</strong> constiction maximale de <strong>la</strong> consonne sont affectées<br />
par les perturbations. La tenue est affectée aussi mais toujours en rapport avec <strong>la</strong> voyelle<br />
qui suit. La phase de relâchement de <strong>la</strong> constriction ne semble pas influencée par les<br />
perturbations.<br />
7.7.2 Les résultats temporels <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> consonnes ne sont pas modifiées par les bite-blocks. Les variations<br />
temporelles observées sont <strong>du</strong>es à <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle subséquente. Les consonnes /t/<br />
et /d/ sont allongées quand elles sont suivies de /i/ et raccourcies quand elles sont<br />
suivies de /a/. Il est à noter cependant que les différences sont moins importantes que<br />
chez le locuteur BL.<br />
Les variations temporelles observées sur <strong>la</strong> fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale ne dépendent pas<br />
significativement <strong>des</strong> bite-blocks, par contre, elles dépendent de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle.<br />
La fermeture est raccourcie pour les consonnes suivies de /a/ et pour /t/ suivi de /i/.<br />
Seule <strong>la</strong> fermeture de <strong>la</strong> voisée /d/ suivie de /i/ est allongée.<br />
La <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> tenues est changée sous l’influence seule <strong>des</strong> bite-blocks, elle est allongée.<br />
La tenue <strong>du</strong>re plus longtemps avec les bite-blocks que sans : une tenue plus longue<br />
tra<strong>du</strong>irait un effort de contrôle plus précis de <strong>la</strong> part <strong>du</strong> locuteur.<br />
La <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maximum de contacts n’est pas modifiée significativement par <strong>la</strong> présence<br />
<strong>des</strong> bite-blocks. Par contre, les variations temporelles observées seraient <strong>du</strong>es à <strong>la</strong> nature<br />
de <strong>la</strong> voyelle subséquente : les maxima <strong>des</strong> consonnes suivies de /i/ sont allongés.<br />
Le maximum de <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ est diminué. Seul le maximum de <strong>la</strong><br />
consonne /t/ suivie de /a/ reste stable.<br />
Les occlusions <strong>des</strong> consonnes voisées et non voisées avec /i/ sont allongées, comme <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne et de <strong>la</strong> fermeture.<br />
La <strong>du</strong>rée de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale est influencée par les bite-blocks mais pas<br />
entièrement puisque <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle joue aussi un rôle : l’ouverture <strong>des</strong><br />
171
consonnes suivies de /i/ est diminuée et l’ouverture de <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ est<br />
allongée. Seule l’ouverture de <strong>la</strong> consonne /t/ suivie de /a/ reste stable.<br />
La tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est <strong>la</strong> seule phase sur <strong>la</strong>quelle on observe <strong>des</strong> effets directs <strong>des</strong><br />
perturbations. Le geste d’ouverture est aussi modifié mais les effets <strong>des</strong> bite-blocks<br />
dépendent de <strong>la</strong> voyelle. La phase d’établissement de <strong>la</strong> constriction et <strong>la</strong> phase médiane<br />
(constriction maximale) de <strong>la</strong> consonne sont plus résistantes aux perturbations que les<br />
autres phases.<br />
En réponse aux perturbations, les points communs aux deux locuteurs sont le caractère<br />
stable de <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne et l’allongement de <strong>la</strong> tenue. Les autres phases de <strong>la</strong><br />
consonne évoluent différemment pour chacun d’eux.<br />
172
173
174
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
QUATRIEME PARTIE<br />
INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
______________________________________________________________________<br />
CHAPITRE 8<br />
Les résultats spatio-temporels<br />
Nous présentons <strong>dans</strong> cette partie les aspects spatio-temporels <strong>des</strong> mouvements<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s <strong>des</strong> consonnes observées. Nous avons calculé les indices de pente<br />
d’ouverture et de fermeture à partir <strong>des</strong> résultats spatiaux et <strong>des</strong> résultats temporels. La<br />
pente de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale correspond à l’établissement de <strong>la</strong> constriction. La<br />
pente d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale correspond au relâchement de <strong>la</strong> constriction. Nous<br />
nous demandons maintenant si <strong>la</strong> portée <strong>des</strong> pentes de fermeture et d’ouverture est<br />
modifiée par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks.<br />
Rappelons que pour avoir un indice de <strong>la</strong> pente de fermeture, nous avons dé<strong>du</strong>it le<br />
nombre de contacts relevés au début <strong>du</strong> geste de fermeture, <strong>du</strong> nombre de contacts<br />
relevé au début de <strong>la</strong> constriction maximale. Pour calculer <strong>la</strong> portée de <strong>la</strong> pente<br />
d’ouverture, nous avons dé<strong>du</strong>it le nombre de contacts relevé à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> constriction<br />
maximale, <strong>du</strong> nombre de contacts relevé à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> geste de relâchement. (cet indice<br />
sera donc négatif). A partir <strong>des</strong> indices <strong>des</strong> pentes, nous sommes en mesure de dé<strong>du</strong>ire<br />
approximativement les vitesses d’ouverture (<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue se détache <strong>du</strong> point de<br />
constriction et retourne en position basse) et de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale (<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue va<br />
atteindre <strong>la</strong> constriction maximale) de <strong>la</strong> consonne, d’après <strong>la</strong> formule traditionnelle <strong>du</strong><br />
calcul de <strong>la</strong> vitesse : Vitesse =Amplitude/Temps.<br />
175
8.1 L’amplitude <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
8.1.1 La pente de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP).<br />
Cell Mean<br />
,045<br />
,04<br />
,035<br />
,03<br />
,025<br />
,02<br />
,015<br />
,01<br />
,005<br />
0<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour pinimax<br />
Effet : loc * cond * cvc<br />
Barres d'erreur: 95% Intervalle de confiance<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n°8.1: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur l’inclinaison de <strong>la</strong> pente de<br />
fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement<br />
respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l’indice de <strong>la</strong> pente.<br />
Globalement, il semble que les bite-blocks ont un effet significatif sur l’amplitude <strong>des</strong><br />
pentes de fermeture LP [F(3,380)=4,650 ; p=0,0033]. L’effet <strong>des</strong> bite-blocks dépend<br />
fortement <strong>des</strong> locuteurs [F(3,352)=11,498 ; p
Moy. cell<br />
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
8.1.1.1 La pente de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> Locuteur BL<br />
,04<br />
,02<br />
0<br />
Graphique <strong>des</strong> interactions pour pinimax<br />
Effet : cvc * cond<br />
Barres d'erreur: ± 1 Déviation(s) standard<br />
dad did tat tit<br />
Cell<br />
Figure n° 8.2 : L’amplitude <strong>des</strong> pentes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse,<br />
les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En<br />
ordonnée, l’indice de <strong>la</strong> pente.<br />
Les pentes de fermeture <strong>du</strong> locuteur BL sont influencées par les bite-blocks<br />
[F(3,188)=26,097 ; p
pro<strong>du</strong>ite en parole normale. C’est surtout vrai pour <strong>la</strong> séquence /dad/. Pour les autres<br />
séquences, les patrons moyens résistent plutôt bien, voire très bien pour /tit/.<br />
Moy. cell<br />
8.1.1.2 La pente de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> Locuteur YM<br />
,04<br />
,02<br />
0<br />
Graphique <strong>des</strong> interactions pour pinimax<br />
Effet : cvc * cond<br />
Barres d'erreur: ± 1 Erreur(s) standard<br />
dad did tat tit<br />
Cell<br />
Figure n° 8.3 : L’amplitude <strong>des</strong> pentes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur Y.M. En<br />
abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3).<br />
En ordonnée, l’indice de <strong>la</strong> pente.<br />
Les pentes de fermeture de ce locuteur YM, ne sont pas influencées par les bite-blocks<br />
[F(3,188)=1,909; p=0,1295]. Cependant, les variations observées dépendraient de <strong>la</strong><br />
nature de <strong>la</strong> séquence [F(9,176)=1,945; p=0,0485] (<strong>la</strong> significativité n’est cependant pas<br />
forte puisque le p est très proche <strong>du</strong> seuil de significativité p=0.05). L’interaction entre<br />
les variables et n’est pas significative [F(3,184)=1,269;<br />
p=0,2863], pas plus que l’interaction entre les variables et <br />
[F(3,184)=2,474; p=0,0630].<br />
Nous pouvons dire que les variations <strong>des</strong> pentes de fermetures de ce locuteur<br />
dépendraient plus de <strong>la</strong> nature <strong>des</strong> séquences que <strong>des</strong> bite-blocks seuls. En même temps,<br />
nous avons vu (chapitre 7) que <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale n’est pas<br />
influencée de manière significative par les bite-blocks. Au moment de <strong>la</strong> fermeture LP<br />
<strong>des</strong> consonnes, ce locuteur paraît moins sensible aux perturbations que le locuteur BL.<br />
Concernant <strong>la</strong> consonne /t/, plus le bite-block est épais, plus <strong>la</strong> pente de fermeture est<br />
178<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
abrupte. Nous notons que <strong>la</strong> pente de fermeture LP de <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/<br />
augmente d’amplitude avec le B3 en même temps que <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture LP est<br />
ré<strong>du</strong>ite (par <strong>la</strong> voyelle /a/). A l’inverse <strong>du</strong> locuteur BL, le mouvement de fermeture LP<br />
est plus rapide avec les bite-blocks. Notre hypothèse de réalisation d’un « f<strong>la</strong>p » paraît<br />
être confirmée par l’observation <strong>des</strong> ces paramètres supplémentaires. Avec les<br />
perturbations, nous supposons que <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, par un mouvement plus rapide, va se<br />
projeter sur <strong>la</strong> partie dentale, l’apex contacte directement les dents. Il se pourrait donc<br />
bien que ce locuteur « overshoot » <strong>la</strong> constriction effectuée en parole normale. Nous<br />
pourrions même imaginer que sans le barrage dental, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue serait projetée en dehors<br />
de <strong>la</strong> bouche. Le lieu d’articu<strong>la</strong>tion est bien dép<strong>la</strong>cé vers les dents, et passe d’alvéo<strong>la</strong>ire<br />
ou dento-alvéo<strong>la</strong>ire à dental.<br />
8.1.2 La pente d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP)<br />
Cell Mean<br />
0<br />
-,003<br />
-,005<br />
-,008<br />
-,01<br />
-,013<br />
-,015<br />
-,018<br />
-,02<br />
-,023<br />
-,025<br />
-,027<br />
Courbe <strong>des</strong> interactions pour pmaxend<br />
Effet : loc * cond * cvc<br />
Barres d'erreur: 95% Intervalle de confiance<br />
B, b0<br />
B, b1<br />
B, b2<br />
B, b3<br />
Cell<br />
Figure n° 8.4 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur l’inclinaison de <strong>la</strong> pente<br />
d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tal. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement<br />
respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l’indice de <strong>la</strong> pente.<br />
Pour les deux locuteurs confon<strong>du</strong>s, l’analyse statistique ne montre pas d’effet<br />
significatif <strong>des</strong> bite-blocks sur l’amplitude <strong>des</strong> pentes d’ouverture [F(3,380)=1,139 ;<br />
p=0,3331],. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks dépendent <strong>des</strong> locuteurs [F(3,352)=11,498 ;<br />
179<br />
Y, b0<br />
Y, b1<br />
Y, b2<br />
Y, b3<br />
dad<br />
did<br />
tat<br />
tit
p
Moy. cell<br />
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
8.1.2.2 La pente d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur YM<br />
0<br />
-,01<br />
-,02<br />
-,03<br />
Graphique <strong>des</strong> interactions pour pmaxend<br />
Effet : cvc * cond<br />
Barres d'erreur: ± 1 Erreur(s) standard<br />
dad did tat tit<br />
Cell<br />
Figure n° 8.6 : Les pentes d’ouverture <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les deux locuteurs (B et L)<br />
et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l‘indice de <strong>la</strong> pente.<br />
Les bite-blocks seuls n’influencent pas les pentes d’ouverture <strong>du</strong> locuteur YM<br />
[F(3,188)=0,874 ; p=0,4554]. Par contre <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence a une influence<br />
significative sur les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(9,176)=3,321 ; p=0,0009]. La voyelle a<br />
aussi influence sur les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(3,184)=3,060 ; p=0,0295]. Le voisement<br />
a aussi une influence sur les effets <strong>des</strong> bite-blocks [F(3,184)=3,663 ; p=0,0134].<br />
Rappelons que les <strong>du</strong>rées <strong>du</strong> geste d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tales <strong>du</strong> locuteur YM sont<br />
influencées par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks (chapitre 7). Nous avons observé un<br />
allongement <strong>du</strong> geste d’ouverture sur <strong>la</strong> séquence /dad/ en meme temps que l’amplitude<br />
da <strong>la</strong> pente diminue et un raccourcissement sur les séquences avec /i/ en même temps<br />
que l’amplitude <strong>des</strong> pentes augmente.<br />
181<br />
b0<br />
b1<br />
b2<br />
b3
8.2 Les vitesses d’é<strong>la</strong>boration <strong>des</strong> pentes<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
8.2.1 La vitesse de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale<br />
Vitesse de fermeture<br />
SB<br />
B1<br />
B2<br />
B3<br />
SB<br />
B1<br />
B2<br />
B3<br />
SB<br />
B1<br />
B2<br />
B3<br />
SB<br />
B1<br />
B2<br />
B3<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 8.7: La vitesse de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>des</strong> deux locuteurs. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> vitesse en nombre de contacts par<br />
ms.<br />
Pour le locuteur BL (gris foncé), <strong>la</strong> tendance générale est au ralentissement. La<br />
fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale est toujours plus rapide sans perturbation qu’avec les<br />
perturbations et elle diminue régulièrement au fur et à mesure que l’épaisseur <strong>des</strong> biteblocks<br />
augmente. L'exécution de <strong>la</strong> constriction est ralentie avec les bite-blocks sur<br />
toutes les consonnes, avec un ralentissement plus marqué de <strong>la</strong> fermeture <strong>du</strong> /d/ suivi de<br />
/a/.<br />
Concernant le locuteur YM, aucun penchant général ne se dégage. Avec /a/, <strong>la</strong><br />
fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale accélère avec les bite-blocks. Notons une accélération plus<br />
sévère sur <strong>la</strong> consonne /d/ avec le B3. Concernant les consonnes suivies de /i/, <strong>la</strong><br />
tendance est inversée selon le voisement : <strong>la</strong> fermeture de /d/ ralentit avec les bite<br />
blocks et <strong>la</strong> fermeture de /t/ a tendance à accélerer.<br />
182<br />
BL<br />
YM
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
8.2.2 La vitesse d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale (LP)<br />
0<br />
Vitesse d'ouverture<br />
SB B1 B2 B3 SB B1 B2 B3 SB B1 B2 B3 SB B1 B2 B3<br />
dad did tat tit<br />
Figure n° 8.8 : La vitesse de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>des</strong> deux locuteurs. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> vitesse en nombre de contacts par<br />
ms..<br />
La tendance <strong>du</strong> locuteur BL (en gris foncé) est au ralentissement de l’ouverture sous<br />
l’influence <strong>des</strong> bite-blocks. Avec <strong>la</strong> voyelle /a/, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue relâche <strong>la</strong> constriction de plus<br />
en plus lentement au fur et à mesure que l’épaisseur <strong>du</strong> bite-block augmente. Avec <strong>la</strong><br />
voyelle /i/ <strong>la</strong> vitesse d’ouverture est simi<strong>la</strong>ire pour B1, B2 et B3 mais toujours inférieure<br />
à <strong>la</strong> vitesse d’ouverture observée sans bite-block. Toutes consonnes confon<strong>du</strong>es, avec <strong>la</strong><br />
voyelle /a/ l’ouverture est toujours plus lente qu’avec <strong>la</strong> voyelle /i/ : <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue doit<br />
effectuer une trajectoire plus longue pour retourner à <strong>la</strong> position basse exige paour<br />
pro<strong>du</strong>ire un /a/.<br />
Concernant le locuteur YM, seule <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ admet un ralentissement<br />
de l’ouverture comparable à celle de BL. Les autres séquences ne présentent pas de<br />
différences aussi évidentes. Nous observons une nette accélération de <strong>la</strong> vitesse<br />
d’ouverture sur <strong>la</strong> consonne /t/ suivie de /a/ avec le B3 et sur <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de<br />
/i/ avec le B1.<br />
183<br />
BL<br />
YM
En résumé, sous l’emprise de <strong>la</strong> perturbation, <strong>la</strong> stratégie <strong>du</strong> locuteur BL est de ralentir<br />
ses mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s de fermeture et d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale. L’amplitude<br />
<strong>des</strong> contacts diminue en même temps que <strong>la</strong> constriction est ré<strong>du</strong>ite. Il lui faut plus de<br />
temps pour réaliser une constriction qui se trouve ré<strong>du</strong>ite spatialement et<br />
temporellement et cette ré<strong>du</strong>ction est plus marquée sur <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/.<br />
D’autre part, le locuteur YM accélère son mouvement de fermeture excepté pour /d/<br />
suivie de /i/ : <strong>la</strong> vitesse de fermeture dépend <strong>des</strong> séquences étudiées. Une fermeture plus<br />
rapide, ajoutée à un renforcement spatio-temporel de <strong>la</strong> constriction maximale tra<strong>du</strong>irait<br />
un comportement de renforcement <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. La <strong>la</strong>ngue va rapidement sur le pa<strong>la</strong>is<br />
pour trouver une constriction qui s’en trouve alors plus éten<strong>du</strong>e. Il semblerait que pour<br />
ce locuteur, les bite-blocks n’ont pas d’effet aussi nets et récurrents pour le locuteur BL.<br />
184
8. 3 Résumé <strong>des</strong> résultats spatiaux et temporels<br />
8.3.1 Le locuteur BL<br />
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
Locuteur BL dad did tat tit<br />
Durée totale<br />
absolue<br />
fermeture<br />
tenue<br />
maximum<br />
occlusion<br />
ouverture<br />
Contacts totaux<br />
Contacts<br />
alvéo<strong>la</strong>ires<br />
Contacts<br />
vé<strong>la</strong>ires<br />
Lieu<br />
articu<strong>la</strong>tion<br />
Pente<br />
fermeture<br />
B0(104,11) ≥<br />
B1 (95,78) = B3<br />
(97,12) ≥ B2<br />
(86,56)<br />
B0 ≤ B1 ≤ B2 ≤<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 = B3 ≥ B1 ≥<br />
B2<br />
B0 = B1 ≥B2 =<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 (135,31) =<br />
B1 (137,71) ≤<br />
B2 (149,54) ≤<br />
B3 (155,12)<br />
B0 ≤ B1 ≤ B3 ≤<br />
B2<br />
B0 = B1 = B2<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0=B1=B2 =<br />
B3<br />
B0 = B1 =B3 ≥<br />
B2<br />
B0 ≥ B1 = B2 ≥<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 ≥ B2 ≥ B1 =<br />
B3<br />
185<br />
B0 (128,54) ≥<br />
B3(122,87) =<br />
B2 (119,02) ≥<br />
B1 (113,84)<br />
B0 =B1 ≤ B3 ≤<br />
B2<br />
B0 = B1 = B3 =<br />
B2<br />
B0 ≥ B1 ≥ B3 ≥<br />
B2<br />
B0 ≥ B1 = B3 ≥<br />
B2<br />
B0 = B1 = B2 ≥<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2≥<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 (144,85) ≤<br />
B1 (160,25) ≤<br />
B2 (166,62) ≤<br />
B3 (190,76))<br />
B0 = B1 ≤ B2 =<br />
B3<br />
B0 = B2 = B3 ≥<br />
B1<br />
B0 = B3 ≥ B1 =<br />
B2<br />
B0 = B3 ≥ B1 =<br />
B2<br />
B0 = B3 ≤ B1 =<br />
B2<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2 =<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 = B2 = B3 ≥<br />
Avancé Inchangé Inchangé Inchangé<br />
B0≥B1≥B2≥B3 B0≥B1=B2=B3 B0≥ B1≥B2=B3 B0≥ B1≥B2=B3<br />
Pente ouverture B0≥B1≥B2≥B3 B0=B1=B2=B3 B0≥B1≥B2≥B3 B0≥B1=B2=B3<br />
Figure n°8.9 : Tableau récapitu<strong>la</strong>tif <strong>des</strong> résultats spatiaux et temporels <strong>du</strong> locuteur BL.<br />
B1
La <strong>du</strong>rée totale de <strong>la</strong> consonne n’est pas influencée de manière significative par les<br />
bite-blocks. Une légère tendance à l’allongement de <strong>la</strong> consonne est <strong>du</strong>e à <strong>la</strong> présence<br />
de <strong>la</strong> voyelle /i/ allongeante.<br />
Le nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sur <strong>la</strong> constriction maximale diminue de<br />
manière significative sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is et <strong>dans</strong> les régions alvéo<strong>la</strong>ire et vé<strong>la</strong>ire.<br />
Cette diminution se note sur toutes les séquences mais plus fortement sur les séquences<br />
avec /a/. Plus <strong>la</strong> mâchoire est basse, plus il est difficile de tenir une constriction <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
région alvéo<strong>la</strong>ire <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is.<br />
La fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale est ré<strong>du</strong>ite en amplitude par les bite-blocks de manière<br />
significative et sur toutes les séquences. En même temps <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture est<br />
allongée de manière significative sur toutes les consonnes avec les bite-blocks. La<br />
vitesse d’établissement de <strong>la</strong> fermeture est ralentie sur toutes les consonnes<br />
indépendamment <strong>du</strong> voisement et de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> séquence.<br />
La phase médiane : La tenue consonantique est allongée de manière significative par<br />
les bite-blocks concernant les séquences avec <strong>la</strong> voyelle /i/, voyelle allongeante. La<br />
nature de <strong>la</strong> séquence influence les effets <strong>des</strong> bite-blocks. La <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> constriction<br />
maximale est diminuée de manière significativement avec les bite-blocks. La <strong>du</strong>rée de<br />
l’occlusion totale augmente avec /i/ et diminue avec /a/.<br />
L’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale est diminuée en amplitude de manière significative par les<br />
bite-blocks mais l’influence de <strong>la</strong> voyelle est importante puisque cette diminution se fait<br />
surtout concernant les consonnes avec /a/. En même temps, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’ouverture n’est<br />
pas modifiée de manière significative par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks. Elle est cependant<br />
sujette à un allongement concernant <strong>la</strong> consonne de <strong>la</strong> séquence /dad/. L’ouverture<br />
linguo-pa<strong>la</strong>tale est ralentie pour les consonnes suivies de /a/.<br />
186
8.3.2 Le locuteur YM<br />
QUATRIEME PARTIE :INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 8 : Résultats spatio- temporels<br />
Locuteur YM dad did tat tit<br />
Durée totale<br />
absolue<br />
Fermeture<br />
Tenue<br />
Maximum<br />
Occlusion<br />
Ouverture<br />
Contacts totaux<br />
Contacts<br />
alvéo<strong>la</strong>ires<br />
Contacts<br />
vé<strong>la</strong>ires<br />
Lieu<br />
articu<strong>la</strong>tion<br />
Pente<br />
fermeture<br />
B0 (114,21) =<br />
B1 (116,13) =<br />
B2 (113,20) ≥<br />
B3 (108,13)<br />
B0 = B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 ≤<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 ≥<br />
B3<br />
B0 = B2 ≥ B1 =<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 = B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 = B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 = B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 (135,75) =<br />
B1(133,26) =<br />
B2 (138,098) ≤<br />
B3 (153,36).<br />
B0 = B1 ≤ B2 ≤<br />
B3<br />
B0= B1 = B2 ≤<br />
B3<br />
B0 ≤ B2 = B3 ≤<br />
B1<br />
B0 = B1 = B2 ≤<br />
B3<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2<br />
≥B3<br />
B0 = B2 ≤ B1 =<br />
B3<br />
B0 = B2 ≤ B1 =<br />
B3<br />
B0 ≤ B1 ≤ B2 ≤<br />
B3<br />
187<br />
B0 (131,26) ≥<br />
B1 (127,94)<br />
=B2 (126,63) ≥<br />
B3 (120,21)<br />
B0 ≥ B1 ≥ B2 ≥<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 ≤<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 ≤<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 = B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 ≤ B2 ≤ B1 ≤<br />
B3<br />
B0 ≤ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 ≤ B1 ≤ B2 ≤<br />
B3<br />
B0 (144,56)=<br />
B1(45,58) = B2<br />
(148,91) = B3<br />
(147,11)<br />
B0 ≤ B1 ≤ B2 ≤<br />
B3<br />
B0 = B2 ≤ B1 =<br />
B3<br />
B0 ≤ B2 ≤ B1 =<br />
B3<br />
B0 ≤ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 ≥ B2 ≥ B3 ≥<br />
B1<br />
B0 = B1 = B2 ≤<br />
B3<br />
B0 ≤ B1 = B2 =<br />
B3<br />
B0 ≤ B1 ≤ B2 ≤<br />
Avancé Inchangé Inchangé Inchangé<br />
B1≤B2≤B0≤B1 B0=B1≥B2≥B3 B0≤ B1≤B2≤B3 B0≤B1≤B2≤B3<br />
Pente ouverture B0≥B1≥B2≥B3 B0≤B1≤B2≤B3 B0≤B1≤B2≤B3 B0≤B1=B3≤B3<br />
Figure n° 8.10 : Tableau récapitu<strong>la</strong>tif <strong>des</strong> résultats spatiaux et temporels <strong>du</strong> locuteur YM.<br />
B3
La <strong>du</strong>rée totale de <strong>la</strong> consonne est inchangée par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks. Il semble<br />
que ce soit plutôt <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle qui joue un rôle <strong>dans</strong> les variations observées.<br />
Les consonnes sont allongées quand elles sont suivies de /i/ et sont raccourcies quand<br />
elles sont suivies de /a/.<br />
Le nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> constriction maximale n’est pas<br />
changé de manière significative par les bite-blocks. Seul le /d/ de <strong>la</strong> séquence /dad/ perd<br />
<strong>des</strong> contacts avec les bite-blocks. Les consonnes <strong>des</strong> autres séquences ont plutôt<br />
tendance à conserver, voire à augmenter, l’aire de contact linguo-pa<strong>la</strong>tal. L’influence de<br />
<strong>la</strong> voyelle sur le nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux est plus importante que l’influence<br />
<strong>des</strong> bite-blocks eux-mêmes.<br />
La fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale n’est pas significativement influencée <strong>dans</strong> son<br />
amplitude par les bite-blocks. Notons une baisse drastique d’amplitude avec le B3<br />
seulement concernant <strong>la</strong> séquence /dad/. Avec les voyelles /i/, l’amplitude de <strong>la</strong><br />
fermeture <strong>des</strong> consonnes a tendance à être diminuée. La <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> fermeture n’est pas<br />
modifiée significativement par les bite-blocks, mais là encore c’est <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong><br />
voyelle qui suit qui entraîne les variations. Avec <strong>la</strong> voyelle /a/, <strong>la</strong> fermeture <strong>du</strong>re moins<br />
longtemps qu’avec <strong>la</strong> voyelle /i/. La fermeture est plus rapide sur les consonnes suivies<br />
de /a/, notamment sur <strong>la</strong> séquence /dad/ chez qui le changement est très marqué. Par<br />
contre avec <strong>la</strong> voyelle /i/ nous ne notons pas de changements aussi drastiques.<br />
La phase médiane : La <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue est allongée de façon significative par <strong>la</strong><br />
présence de <strong>la</strong> perturbation. L’influence de <strong>la</strong> voyelle subséquence n’est pas impliquée<br />
ici. La <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> constriction maximale n’est pas influencée par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> biteblocks.<br />
Les variations observées sont <strong>du</strong>es à <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle : <strong>la</strong> constriction<br />
maximale de <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ est raccourcie. La <strong>du</strong>rée de l’occlusion totale<br />
augmente seulement sur les consonnes suivies de <strong>la</strong> voyelle /i/.<br />
L’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale n’est pas significativement modifiée <strong>dans</strong> son amplitude<br />
par les bite-blocks. Les variations observées dépendent fortement de <strong>la</strong> séquence :<br />
l’amplitude de l’ouverture <strong>du</strong> /d/ suivi de /a/ est très ré<strong>du</strong>ite avec le B3. La <strong>du</strong>rée de<br />
l’ouverture est influencée par les bite-blocks mais aussi par <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle :<br />
l’ouverture de <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ est fortement ralentie avec le B3.<br />
L’ouverture est plus lente seulement sur le /d/ suivi de /a/.<br />
188
189
190
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
CHAPITRE 9 : DISCUSSION<br />
Au terme de notre étude, nous reprenons les questions de <strong>la</strong> problématique et au regard<br />
<strong>des</strong> résultats, nous essayons d’étayer une discussion. Dans un premier temps nous<br />
soulignerons les différences observées entre les deux locuteurs. Dans un second temps<br />
nous reviendrons sur l’importance <strong>des</strong> contraintes en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole quand on<br />
parle de <strong>compensation</strong> ou d’adaptation à une situation nouvelle. Puis, nous discuterons<br />
nos résultats à <strong>la</strong> lumière <strong>des</strong> théories de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>.<br />
Nous pensons avoir réussi à discerner et à quantifier <strong>des</strong> effets de <strong>compensation</strong> linguale<br />
<strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes avec <strong>la</strong> mâchoire bloquée. La perturbation choisie,<br />
bite-blocks, s’est révélée être efficace <strong>dans</strong> le sens où nous avons observé <strong>des</strong><br />
changements spatio-temporels <strong>dans</strong> l’organisation <strong>des</strong> mouvements linguaux. Nous<br />
observons bien <strong>des</strong> différences entre les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales et les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s avec<br />
les bite-blocks. Même si ces différences ne sont pas toujours statistiquement validées,<br />
elles permettraient de confirmer l’existence de stratégies de <strong>compensation</strong> au niveau<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et d’en dé<strong>du</strong>ire de quelle façon les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont<br />
contrôlés.<br />
9.1 Les variations inter-indivi<strong>du</strong>elles<br />
Tout au long de l’étude, nous avons relevé, <strong>des</strong> différences entre les réactions <strong>des</strong><br />
locuteurs concernent <strong>la</strong> façon d’ajuster les mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue en réponse aux<br />
perturbations. Nous estimons qu’il y a peu de chance pour que ces différences interindivi<strong>du</strong>elles<br />
soient expliquées seulement comme un résultat <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> bite-blocks<br />
sur les distances inter-incisives. Si c’était le cas on aurait systématiquement une plus<br />
petite zone de contact linguo-pa<strong>la</strong>taux avec les bite-blocks, partant de l’hypothèse que<br />
plus <strong>la</strong> mâchoire est basse, moins les contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région antérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is sont<br />
nombreux. Or <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire, notre locuteur YM tend à augmenter ses<br />
contacts alors que le locuteur BL tend à les diminuer avec les bite-blocks. Rappelons<br />
que <strong>dans</strong> notre étude, nous avons pris soin de mesurer le même écart inter-incisif chez<br />
191
les deux locuteurs pour contrôler que les bite-blocks agrandissaient l’écart inter-incisive<br />
de manière identique pour chacun.<br />
Nous nous sommes volontiers rapprochée de l’étude de Flege et al. (1988). Leur travail<br />
concerne <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> <strong>occlusives</strong> de l’ang<strong>la</strong>is et de l’arabe avec <strong>des</strong> bite-blocks.<br />
Leur investigation a porté essentiellement sur <strong>la</strong> phase de constriction maximale <strong>des</strong><br />
consonnes et montre que le /t/ arabe est plus antérieur que le /t/ ang<strong>la</strong>is, et que plus <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> est antérieure, plus les contacts diminuent avec les bite-blocks. Nous notons<br />
<strong>des</strong> similitu<strong>des</strong> avec nos résultats. Effectivement le nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux<br />
<strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur BL est diminué sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, alors que<br />
nous avons noté que ses <strong>occlusives</strong> sont plus antérieures que celles de YM pour qui le<br />
nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux est augmenté. La constriction maximale <strong>du</strong> /t/<br />
arabe, plus antérieur, est raccourcie avec les bite-blocks (en même temps que le nombre<br />
de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux diminue). La constriction <strong>du</strong> locuteur BL est aussi ré<strong>du</strong>ite.<br />
Par contre, <strong>la</strong> constriction <strong>du</strong> /t/ ang<strong>la</strong>is (plus postérieure) n’est pas raccourcie et les<br />
contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sont plus nombreux. Dans notre étude, nous observons les<br />
mêmes effets <strong>des</strong> bite-blocks sur <strong>la</strong> constriction <strong>du</strong> /t/ <strong>du</strong> locuteur YM. Flege et al.<br />
(1988) ont conclu que les locuteurs ang<strong>la</strong>is parviennent à compenser plus complètement<br />
car l’articu<strong>la</strong>tion normale <strong>du</strong> /t/ est pro<strong>du</strong>ite plus en arrière <strong>dans</strong> le pa<strong>la</strong>is. De <strong>la</strong> même<br />
façon, le locuteur YM semble effectuer une <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> plus complète<br />
que BL <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où il présente moins de différences entre les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s<br />
normales et bloquées, tant sur le p<strong>la</strong>n spatial que temporel. Nos résultats confirment <strong>la</strong><br />
conclusion de Flege et al. (1988) sur <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s incomplètes puisque ils ont<br />
trouvé <strong>des</strong> petites différences mais significatives (sur <strong>la</strong> zone et <strong>la</strong> longueur de <strong>la</strong><br />
constriction) entre les consonnes pro<strong>du</strong>ites avec et sans bite-blocks.<br />
Les bite-blocks n’ont pas empêché nos locuteurs de faire une constriction, qu’elle soit<br />
ré<strong>du</strong>ite, renforcée ou délocalisée. Dans <strong>la</strong> même situation de perturbation, nous avons<br />
relevé une ré<strong>du</strong>ction de <strong>la</strong> consonne chez le locuteur BL et un renforcement chez le<br />
locuteur YM.<br />
192
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
9.1.1 Stratégie de <strong>compensation</strong> <strong>du</strong> locuteur BL<br />
Les bite-blocks ont un effet sur les mouvements linguaux de ce locuteur. Cependant, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne peut aussi être sujette à <strong>des</strong> variations qui dépendent de <strong>la</strong> nature<br />
de <strong>la</strong> voyelle subséquente et non de <strong>la</strong> perturbation seule : <strong>la</strong> voyelle /a/ a tendance à<br />
raccourcir <strong>la</strong> consonne et <strong>la</strong> voyelle /i/ à l’allonger.<br />
La fermeture est ralentie par <strong>la</strong> perturbation, ce locuteur a besoin de plus de temps pour<br />
é<strong>la</strong>borer <strong>la</strong> trajectoire vers <strong>la</strong> constriction. De plus, nous avons vu que le nombre de<br />
contacts au moment de <strong>la</strong> constriction maximale est ré<strong>du</strong>it, en même temps que <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée<br />
de <strong>la</strong> constriction diminue : sa mâchoire étant différemment positionnée que de<br />
coutume, nous pouvons penser que BL rencontre une réelle difficulté à réaliser et à<br />
maintenir une constriction inhabituelle avec l’apex. La <strong>la</strong>ngue met plus de temps pour<br />
contacter le pa<strong>la</strong>is : le locuteur a besoin de temps pour réorganiser son mouvement<br />
lingual.<br />
Seule <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est plus longue avec les bite-blocks, au détriment de <strong>la</strong><br />
constriction maximale qui est ré<strong>du</strong>ite. Durant <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> il se peut que le<br />
contrôle <strong>du</strong> mouvement soit plus minutieux et plus précis, <strong>du</strong> fait que c’est <strong>la</strong> phase<br />
médiane essentielle de <strong>la</strong> consonne, de ce fait il lui faut plus de temps. Pour répondre à<br />
<strong>la</strong> perturbation, BL déploie une manœuvre de ré<strong>du</strong>ction globale <strong>du</strong> geste consonantique,<br />
ré<strong>du</strong>ction à <strong>la</strong> fois spatiale et temporelle. Cependant, il réalise quand même une<br />
constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale digne d’une occlusive mais avec <strong>des</strong> caractéristiques spatiotemporelles<br />
différentes de celles observées en parole normale. En d’autres termes, il<br />
« undershoote » <strong>la</strong> constriction en générant une autre trajectoire linguale que de<br />
coutume.<br />
9.1.2. Stratégie de <strong>compensation</strong> <strong>du</strong> locuteur YM<br />
Avec les bite-blocks, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne reste inchangée et <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue<br />
varie en fonction de <strong>la</strong> voyelle : allongée avec /i/ et raccourcie avec /a/. La fermeture de<br />
ce locuteur ne subit pas de modifications, ni temporelle, ni spatiale. Les contacts linguopa<strong>la</strong>taux<br />
sur <strong>la</strong> constriction maximale sont conservés, <strong>la</strong> zone d’articu<strong>la</strong>tion est même<br />
saturée, excepté sur <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ pour qui le maximum est ré<strong>du</strong>it<br />
(spatialement et temporellement). La tenue est allongée par les bite-blocks, comme pour<br />
193
le locuteur BL, il semble que cette phase essentielle de <strong>la</strong> consonne soit contrôlée plus<br />
singulièrement.<br />
Ce locuteur YM ajuste immédiatement <strong>la</strong> trajectoire linguale pour atteindre <strong>la</strong><br />
constriction qu’il parvient d’ailleurs à garder de <strong>la</strong> même façon que sans bite-block,<br />
excepté pour <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/. Nous avons relevé que les changements<br />
observés sont davantage <strong>du</strong>s à <strong>la</strong> nature phonétique <strong>des</strong> séquences, notamment à<br />
l’influence de <strong>la</strong> voyelle subséquente, que par les bite-blocks eux-mêmes. Il semble<br />
donc que <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s soient opérées de façon plus complète. Nous<br />
avons vu que <strong>la</strong> séquence /dad/ est <strong>la</strong> plus sujette aux variations de part les contraintes<br />
de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> qui gouvernent sa réalisation. Il apparaît que face à de fortes contraintes,<br />
ce locuteur YM réagit de <strong>la</strong> même façon que le locuteur BL : <strong>la</strong> trajectoire linguale est<br />
modifiée, mais <strong>la</strong> fermeture est accélérée, il est alors incapable de réaliser <strong>des</strong><br />
<strong>compensation</strong>s <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s aussi complètes que sur les autres séquences. Gay en 1981<br />
explique que <strong>la</strong> vitesse de mouvement <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs varie en fonction de<br />
l’articu<strong>la</strong>teur et <strong>du</strong> locuteur. Il précise que les dé<strong>la</strong>is d’activation <strong>des</strong> muscles qui<br />
contrôlent les différents articu<strong>la</strong>teurs varient de manière non uniforme, ce qui pourrait<br />
nous aider à comprendre pourquoi, avec les bite-blocks, sur /d/ suivie de /a/, <strong>la</strong><br />
fermeture de BL est plus lente et celle de YM est plus rapide.<br />
9.1.3 Re<strong>la</strong>tions entre morphologie et articu<strong>la</strong>tion<br />
Revenons aux conclusions de Flege et al. (1988) pour qui <strong>la</strong> stratégie utilisée pour<br />
compenser dépendrait de <strong>la</strong> magnitude de l’augmentation. Ils suggèrent qu’il est biomécaniquement<br />
plus facile pour les ang<strong>la</strong>is que pour les arabes de maintenir <strong>des</strong><br />
contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux normaux avec les bite-blocks car le /t/ ang<strong>la</strong>is est plus<br />
postérieur que le /t/ arabe. Plus <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue bouge vers l’avant, relevant l’apex et <strong>la</strong> <strong>la</strong>me,<br />
plus les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux vont être augmentés. Pour les Ang<strong>la</strong>is, l’éten<strong>du</strong>e de <strong>la</strong><br />
constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale augmente en même temps que <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce de constriction<br />
avance <strong>dans</strong> le pa<strong>la</strong>is. Nous observons l’inverse <strong>dans</strong> notre étude puisque seule <strong>la</strong><br />
séquence /dad/ qui montre un avancement de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> constriction montre en<br />
même temps une ré<strong>du</strong>ction de <strong>la</strong> constriction à cause <strong>du</strong> voisement de <strong>la</strong> consonne et <strong>du</strong><br />
/a/. Pourtant nous observons <strong>des</strong> différences chez nos locuteurs <strong>dans</strong> <strong>la</strong> manière de<br />
compenser : ces différences entre sujets de même <strong>la</strong>ngue maternelle confirment<br />
194
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
l’existence de stratégies indivi<strong>du</strong>elles de <strong>compensation</strong>. Ces différences peuvent aussi<br />
s’expliquer en fonction de <strong>la</strong> forme <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, de <strong>la</strong> profondeur de <strong>la</strong> cavité buccale, plus<br />
généralement <strong>des</strong> différences morphologiques.<br />
Nous sommes consciente qu’il manque <strong>des</strong> mesures exactes de longueur, <strong>la</strong>rgeur et<br />
profondeur <strong>des</strong> pa<strong>la</strong>is pour avoir une vue précise en trois dimensions de <strong>la</strong> morphologie<br />
de chacun. Nous avons pu constater cependant que le pa<strong>la</strong>is de BL est plus <strong>la</strong>rge et<br />
moins incurvé que celui de YM, qui est plus étroit et plus incurvé. Khuen et Moll<br />
(1976) rapportent que <strong>la</strong> taille de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et de <strong>la</strong> mâchoire est positivement corrélée<br />
avec les dép<strong>la</strong>cements et <strong>la</strong> rapidité de ces mêmes articu<strong>la</strong>teurs : les plus <strong>la</strong>rges mesures<br />
sont celles <strong>des</strong> hommes qui ont un plus <strong>la</strong>rge pa<strong>la</strong>is. Honda et al. (1996) ainsi que<br />
Earnest et Max (2001) soulignent <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion existant entre l’anatomie et <strong>la</strong> taille <strong>des</strong><br />
structures et <strong>la</strong> cinématique <strong>des</strong> mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Avec <strong>la</strong> méthode <strong>des</strong> rayons<br />
X, ils effectuent <strong>des</strong> mesures <strong>du</strong> crâne, <strong>du</strong> maxil<strong>la</strong>ire, <strong>des</strong> incisives, de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue, <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de consonnes linguo-alvéo<strong>la</strong>ires. Il en résulte qu’une <strong>la</strong>rge<br />
mandibule est associée à une brève fermeture linguale, une brève phase d’accélération<br />
de <strong>la</strong> fermeture. Ainsi, <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole est caractérisée par <strong>des</strong> interactions<br />
complexes entre l’anatomie oro-faciale et les mouvements de <strong>la</strong> mâchoire. Les variables<br />
cinématiques (pics de vitesse de l’ouverture et de <strong>la</strong> fermeture) sont influencées par les<br />
différences de genre et de morphologie <strong>dans</strong> les stratégies de contrôle propres à chaque<br />
locuteur. La re<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> morphométrie orofaciale et <strong>la</strong> cinématique <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est<br />
importante en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Ajoutons que Tiede (1998) rapporte que <strong>la</strong> profondeur de <strong>la</strong><br />
cavité buccale et <strong>la</strong> forme <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is affecte l’axe de dép<strong>la</strong>cement <strong>du</strong> corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
et de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> constriction linguo-pa<strong>la</strong>tale.<br />
En résumé, nous devons concevoir ici le rôle <strong>des</strong> contraintes physiologiques et biomécaniques<br />
qui se tra<strong>du</strong>iraient par les limites de dép<strong>la</strong>cement <strong>des</strong> organes phonatoires et<br />
par les caractéristiques anatomiques de chacun. Ainsi, le lieu d’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong><br />
consonne et l’existence <strong>des</strong> limitations physiologiques <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal peuvent être<br />
aussi à l’origine de <strong>la</strong> réalisation plus ou moins complète de <strong>la</strong> <strong>compensation</strong>.<br />
9.1.4 Re<strong>la</strong>tions avec une perturbation dite ‘naturelle’<br />
Les perturbations naturelles observables en parole donnent aussi <strong>des</strong> pistes <strong>dans</strong> l’étude<br />
<strong>du</strong> contrôle moteur. De façon un peu moins directe, nous pouvons entrevoir <strong>des</strong><br />
195
similitu<strong>des</strong> avec les étu<strong>des</strong> qui ont considéré un changement un débit de parole comme<br />
perturbation naturelle. Vaxe<strong>la</strong>ire (1994) ou encore Sock et Lofqvist (1995) et Sock et<br />
Vaxe<strong>la</strong>ire (2001) font varier le débit de parole comme une variable contrôlée. Ils<br />
observent <strong>des</strong> réajustements <strong>dans</strong> l’action <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs : les articu<strong>la</strong>teurs font preuve<br />
d’adaptation à un débit de parole plus rapide par <strong>des</strong> modifications spatio-temporelles.<br />
Vaxe<strong>la</strong>ire a souligné <strong>dans</strong> sa thèse (1993) <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre le débit de parole et le<br />
schéma dynamique <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs: plus le débit est rapide, plus le geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong><br />
est temporellement ré<strong>du</strong>it. Rappelons que nous avons constaté, <strong>dans</strong> notre étude, que <strong>la</strong><br />
présence de bite-blocks ralentissait le débit : <strong>la</strong> phrase porteuse est rallongée jusqu’à<br />
100 ms avec le plus gros bite-block.<br />
Un autre exemple de perturbation naturelle peut se retrouver <strong>dans</strong> une perspective<br />
développementale. Les transformations anatomiques <strong>du</strong>rant <strong>la</strong> croissance <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it<br />
vocal peuvent être envisagées comme une sorte de perturbation. En effet, chaque phase<br />
de développement « brouille » <strong>la</strong> cartographie <strong>des</strong> liens sensori-moteurs déjà établis à<br />
un stade antérieur. Les capacités de contrôle étant immatures, l’enfant doit<br />
« compenser » avec <strong>des</strong> moyens limités et les <strong>compensation</strong>s sont donc incomplètes.<br />
Ménard et al. (2000) montrent que <strong>des</strong> stratégies permettant de compenser <strong>la</strong> différence<br />
morphologique <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal <strong>du</strong> bébé donnent lieu à <strong>des</strong> comman<strong>des</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
différentes. Les voyelles /i, u, y, a/ sont réalisées par <strong>des</strong> manœuvres visant à modifier le<br />
lieu ou l’aire de constriction. C’est au moyen de l’imitation que l’enfant pourra calibrer<br />
ce qu’il perçoit et ce qu’il pro<strong>du</strong>it afin d’ajuster l’éten<strong>du</strong>e de ses mouvements<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, d’où l’importance <strong>du</strong> coup<strong>la</strong>ge entre <strong>la</strong> perception visuelle et auditive.<br />
(comme par exemple le fait de montrer l’arrondissement <strong>des</strong> lèvres pour pro<strong>du</strong>ire une<br />
voyelle arrondie).<br />
9.2 Phénomène d’apicalisation<br />
Nous commentons ici le phénomène d’apicalisation observé lors de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ition <strong>du</strong> /d/<br />
suivi de /a/, phénomène commun aux deux locuteurs. Avec les bite-blocks, nous avons<br />
considéré que le mouvement lingual est différent de celui sans bite-block : nous sommes<br />
confrontés à un autre geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. En effet, seule <strong>la</strong> première rangée d’électro<strong>des</strong><br />
est contactée par l’apex et non plus par l’apex et <strong>la</strong> <strong>la</strong>me comme on l’a remarqué sans<br />
bite-block. Ainsi, sans bite-block, <strong>la</strong> partie antérieure de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me supporte et<br />
196
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
accompagne les mouvements de l’apex vers <strong>la</strong> région dento-alvéo<strong>la</strong>ire <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Avec<br />
les bite-blocks, <strong>la</strong> <strong>la</strong>me n’est plus le support de l’apex. En effet, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue ne peut plus<br />
monter autant <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité buccale puisqu’elle est raccrochée à une mandibule trop<br />
abaissée. La <strong>la</strong>ngue prend ainsi une forme plus incurvée et ce<strong>la</strong> va permettre seulement<br />
à l’apex, plus mobile et indépendant que le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, d’être « projeté » et de<br />
pouvoir s’étendre jusque vers <strong>la</strong> région dentale.<br />
Nous proposons une validation de ces considérations par le calcul d’une régression<br />
entre le centre de gravité <strong>des</strong> contacts qui indique <strong>la</strong> répartition <strong>des</strong> contacts sur le pa<strong>la</strong>is<br />
sur l’axe avant-arrière (voir chaitre 5 : Méthode) et le taux de remplissage <strong>des</strong> zones de<br />
contacts, alvéo<strong>la</strong>ire et vé<strong>la</strong>ire. Nous avons effectué une régression simple sur <strong>des</strong><br />
paramètres deux à deux, afin de voir s’ils étaient corrélés. Commençons par décrire <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tion entre le centre de gravité et le nombre de contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie postérieure <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is. Rappelons le sens de variation de l’indice <strong>du</strong> centre de gravité : plus l’indice est<br />
négatif, plus le centre de ravité est avancé <strong>dans</strong> le pa<strong>la</strong>is.<br />
1<br />
,5<br />
0<br />
-,5<br />
cdg<br />
ma<br />
-1<br />
x -1,5<br />
-2<br />
-2,5<br />
-3<br />
-3,5<br />
-4<br />
Graphe de régression<br />
Exclusion de lignes : param etresA_nuitA.xls (im porté).svd<br />
-,1 0 ,1 ,2 ,3<br />
txvel<br />
,4 ,5 ,6 ,7<br />
Y = -2,2 + 3,596 * X; R^2 = ,764<br />
Figure n° 9.1 : Graphe de régression entre le centre de gravité et le taux de remplissage <strong>des</strong><br />
contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région vé<strong>la</strong>ire. En abscisse, le taux de contacts vé<strong>la</strong>ires. En ordonnée, le centre de<br />
gravité<br />
Dans <strong>la</strong> partie postérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, le taux de remplissage, est corrélé avec le centre de<br />
gravité : plus le centre de gravité recule <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie postérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is, plus le taux<br />
de remplissage vé<strong>la</strong>ire augmente. Plus l’articu<strong>la</strong>tion est postérieure, plus <strong>la</strong> zone de<br />
contact (vé<strong>la</strong>ire) est remplie. Ceci tra<strong>du</strong>it que le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue ne peut dissocier ses<br />
mouvements, le remplissage de <strong>la</strong> zone de contacts se fait progressivement. Observons<br />
197
maintenant les re<strong>la</strong>tions existant entre le centre de gravité et le nombre de contacts <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> partie antérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is.<br />
1<br />
,5<br />
0<br />
-,5<br />
cdg<br />
ma -1<br />
x -1,5<br />
-2<br />
-2,5<br />
-3<br />
-3,5<br />
-4<br />
Graphe de régression<br />
Exclusion de lignes : param etresA_nuitA.xls (im porté).svd<br />
,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6<br />
txalv<br />
,7 ,8 ,9 1 1,1<br />
Y = -2,452 + 1,662 * X; R^2 = ,329<br />
Figure n° 9.2: Graphe de régression entre le centre de gravité et le taux de remplissage <strong>des</strong><br />
contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire. En abscisse, le taux de contacts alvéo<strong>la</strong>ires. En ordonnée, le centre de<br />
gravité<br />
Le taux de remplissage <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie antérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is n’est pas corrélé avec le<br />
centre de gravité : ces deux variables évoluent beaucoup moins <strong>dans</strong> un rapport de<br />
proportionnalité comme on l’a vu précédemment sur <strong>la</strong> figure 9.1. Dans <strong>la</strong> région<br />
antérieure, l’apex peut contacter directement les alvéoles sans forcément toucher les<br />
bords <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. Les contacts ne se font pas de façon progressive mais directement sur<br />
les alvéoles <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is. La <strong>la</strong>ngue prend effectivement une forme incurvée ce qui permet<br />
à l’apex de se dép<strong>la</strong>cer seul. Ces résultats confirment que <strong>la</strong> partie antérieure de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue est plus mobile que <strong>la</strong> partie postérieure et attestent aussi de l’indépendance de<br />
l’apex par rapport au corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Nos résultats spatiaux ont montré, qu’avec les bite-blocks, <strong>la</strong> trajectoire de l’apex est<br />
dirigée vers une articu<strong>la</strong>tion plus en avant <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is lors de l’articu<strong>la</strong>tion de l’occlusive<br />
/d/. Des résultats temporels, nous avons dé<strong>du</strong>it que <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et <strong>la</strong><br />
constriction maximale sont raccourcies et que l’amplitude <strong>du</strong> geste est diminuée.<br />
Ladefoged et Maddieson (1998) définissent le tap alvéo<strong>la</strong>ire comme “…a sound in<br />
which a brief contact between the articu<strong>la</strong>tors is made by moving the active articu<strong>la</strong>tor<br />
198
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
directly towards the roof of the mounth....Taps are more typically made by a direct<br />
movement of the tongue tip to a contact location in the dental or alveo<strong>la</strong>r region”<br />
(p.231). Avec les bite-blocks, les locuteurs effectuent un geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> de type<br />
‘tap’, différent de celui de /d/. Partant de cette définition, nous pouvons dire que le /d/<br />
pro<strong>du</strong>it avec les bite-blocks par nos locuteurs est alors réalisé comme un /R/. Laver<br />
(1994) ajoute à cette <strong>des</strong>cription une dimension dynamique en y incluant le concept de<br />
vélocité “...in the case of a tapped stop, the tongue moves very fast through the onset<br />
phase, the closure is extremely brief, and the tongue then retreats from closure in a very<br />
fast offset phase. (p. 224). Nous avons vu que <strong>la</strong> fermeture <strong>du</strong> locuteur YM est accélérée<br />
avec les bite-blocks. Si on considère cette définition nous pouvons aisément conclure<br />
que ce locuteur réalise bien un « tap ». Par contre, ça ne semble plus être le cas <strong>du</strong><br />
locuteur BL pour qui l’établissement de <strong>la</strong> fermeture est plus lent avec les bite-blocks.<br />
Les étu<strong>des</strong> de Duez (1995) sur <strong>la</strong> parole spontanée ont souligné que ce phénomène de<br />
ré<strong>du</strong>ction peut avoir lieu sans perturbation extérieure. En effet, quand le poids <strong>des</strong><br />
contraintes de coarticu<strong>la</strong>tion se fait ressentir en parole continue, les <strong>occlusives</strong> peuvent<br />
se réaliser comme <strong>des</strong> « taps » alvéo<strong>la</strong>ires simplement par <strong>des</strong> procédés d’assimi<strong>la</strong>tion<br />
et/ou de ré<strong>du</strong>ction indissociables de <strong>la</strong> parole continue.<br />
D’un point de vue moteur, nous allons <strong>dans</strong> le sens <strong>des</strong> conclusions de Recasens (1991)<br />
qui fournit une précision concernant <strong>la</strong> réalistion <strong>du</strong> “tap” alvéo<strong>la</strong>ire : “Manner<br />
requirements for the tap (i.e, the execution of a very short apico-alveo<strong>la</strong>r closure)<br />
suggest that the positioning of the tongue body does not involve much articu<strong>la</strong>tory<br />
control” (p. 279). Ainsi, les muscles intrinsèques qui relèvent l’apex, seraint moins<br />
fortement activés pour pro<strong>du</strong>ire un /R/ que pour pro<strong>du</strong>ire un /d/. /R/ n’est pas un<br />
phonème de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue française, en l’occurrence il peut être une réalisation contextuelle<br />
<strong>du</strong> /d/. L’action muscu<strong>la</strong>ire ne serait alors pas aboutie complètement à cause <strong>des</strong><br />
perturbations, quelles soient naturelles, comme un débit rapide, ou expérimentales,<br />
comme les bite-blocks. Dans notre étude, avec les bite-blocks, <strong>la</strong> commande motrice a<br />
toujours pour but de réaliser <strong>la</strong> constriction d’un /d/, mais <strong>la</strong> contraction muscu<strong>la</strong>ire est<br />
plus faible et entraîne alors un changement de trajectoire <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs, d’où une<br />
ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Dans ce cas de figure, le système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de<br />
parole se trouve en hypo-activité à cause <strong>des</strong> contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, mais <strong>la</strong> viabilité<br />
de l’acte linguistique est conservée.<br />
199
9.3 Hiérarchie de <strong>la</strong> <strong>compensation</strong><br />
Rappelons que nous avons utilisé le terme de <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> lorsqu’il n’y a<br />
pas ou peu de différence significative entre les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales et avec les biteblocks.<br />
Nous avons observé que certaines phases <strong>des</strong> consonnes sont touchées par <strong>la</strong><br />
perturbation, d’autres sont plus résistantes. Même si <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne n’est pas<br />
modifiée par les bite-blocks, les <strong>du</strong>rées de certaines phases le sont. Il s’opère alors un<br />
phénomène de <strong>compensation</strong> intra-gestuelle de manière sélective : les phases touchées<br />
par <strong>la</strong> perturbation sont cachées <strong>dans</strong> le geste global de <strong>la</strong> consonne. Nous cherchons à<br />
comprendre pourquoi certaines phases sont épargnées au profit d’autres. Nous<br />
supposons que c’est grâce à l’existence de micro-gestes, au sens où l’entendent les<br />
tenants <strong>des</strong> théories de contrôle orienté-système (Browman et Goldstein, 1989). Il existe<br />
<strong>des</strong> micro-gestes pour structurer <strong>la</strong> coordination entre les articu<strong>la</strong>teurs puisque <strong>la</strong><br />
génération d’un segment consonantique exige <strong>la</strong> coordination <strong>des</strong> mouvements de<br />
plusieurs articu<strong>la</strong>teurs.<br />
Nous estimons que l’organisation hiérarchique <strong>des</strong> stratégies de <strong>compensation</strong> est en<br />
fonction de <strong>la</strong> pertinence <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et <strong>du</strong> poids <strong>des</strong> contraintes de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>.<br />
9.3.1 En fonction de <strong>la</strong> pertinence <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
Nous ne pouvons pas conclure à un simple ralentissement ou une accélération <strong>du</strong> geste<br />
consonantique. Ce<strong>la</strong> semble bien plus compliqué puisque on doit tenir compte de<br />
l’évolution de chaque phase de <strong>la</strong> consonne. Sur les paramètres les moins critiques de <strong>la</strong><br />
consonne, le locuteur se permet <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s incomplètes alors que sur <strong>la</strong> phase<br />
critique, phase médiane (tenue et constriction maximale) les <strong>compensation</strong>s sont plus<br />
complètes (peu de différences observées entre les conditions d’enregistrement). Flege et<br />
al. (1988) pensent que <strong>la</strong> phase médiane n’est pas une phase critique, mais redondante<br />
de <strong>la</strong> consonne. Leur analyse a montré que les changements observés <strong>dans</strong> les<br />
paramètres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s suggèrent que l’information acoustique, basée sur une analyse<br />
formantique, est suffisante pour <strong>la</strong> reconnaissance d’un /t/. Ils qualifient <strong>la</strong> phase<br />
d’occlusion complète de paramètre redondant se refusant de <strong>la</strong> considérer comme un<br />
paramètre critique de <strong>la</strong> consonne. La zone de rétrécissement maximal (constriction) est<br />
200
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
jugée comme étant <strong>la</strong> plus significative au moins d’un point de vue acoustique mais pas<br />
forcément d’un point de vue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>.<br />
En terme de cible <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, ce n’est pas l’endroit <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal où <strong>la</strong><br />
constriction est <strong>la</strong> plus étroite qui prime, mais il semble que ce soit <strong>la</strong> trajectoire <strong>des</strong><br />
articu<strong>la</strong>teurs et <strong>la</strong> tenue globale de <strong>la</strong> consonne qui importent. Finalement, <strong>la</strong> tenue<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> globale résiste mieux que <strong>la</strong> constriction maximale puisque nous n’avons<br />
pas observé de différence sur <strong>la</strong> tenue.<br />
Nous nous référons à une autre définition de <strong>la</strong> tenue, fondée sur les contraintes. Pour<br />
Zerling (1991 et 1993) <strong>la</strong> tenue <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est caractérisée par le maintien d’un certain<br />
nombre de contraintes sur tous les articu<strong>la</strong>teurs pendant toute <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de l’émission <strong>du</strong><br />
son. La tenue apparaît comme un passage obligé <strong>dans</strong> une zone déterminée de l’espace<br />
acoustique qui serait perceptuellement identifiable. Cette zone correspond à ce que l’on<br />
appelle généralement cible acoustico-perceptive. Le processus de décodage lors de <strong>la</strong><br />
perception permet de reconnaître une cible acoustique même lorsqu’elle n’est pas<br />
atteinte complètement ou au contraire quand elle est dépassée. Cette définition<br />
expliquerait que les overshoots et les undershoots puisent être reconnus<br />
perceptuellement car ils sont directement en périphérie <strong>des</strong> cibles <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s.<br />
Chaque phase évolue différemment et il semble que les phases d’attaque et de tenue de<br />
<strong>la</strong> constriction bénéficient d’un contrôle plus précis permettant <strong>des</strong> ajustements<br />
immédiats <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs, sûrement par <strong>des</strong> manœuvres d’hyper-articu<strong>la</strong>tion. Alors<br />
que <strong>la</strong> phase de relâchement ne semble pas être aussi pertinente <strong>dans</strong> le sens où le<br />
contrôle de ce geste relèverait d’une manœuvre d’hypo-articu<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong>rgement soutenue<br />
par <strong>la</strong> loi <strong>du</strong> moindre effort. Le système privilégie <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> par <strong>compensation</strong> <strong>des</strong><br />
caractéristiques les plus distinctives de <strong>la</strong> consonne : <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> est à <strong>la</strong> fois<br />
sélective et hiérarchique.<br />
Le geste de fermeture volontaire serait contrôlé plus finement que le geste d’ouverture.<br />
Le locuteur consacre plus d’énergie à adapter un nouveau mouvement de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, dont<br />
<strong>la</strong> position initiale est changée par les bite-blocks, pour essayer d’atteindre une<br />
constriction <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal même si elle est ré<strong>du</strong>ite. Le geste d’ouverture serait<br />
moins parfaitement contrôlé puisque le locuteur a réalisé sa constriction. Le<br />
relâchement est le chemin de retour à l’état initial et serait plus une trajectoire<br />
balistique. A ce moment là, ce sont sûrement les propriétés visco-é<strong>la</strong>stiques inhérentes<br />
201
au système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> qui entrent en jeu par le biais <strong>du</strong> relâchement de <strong>la</strong> contraction<br />
<strong>des</strong> muscles élévateurs de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
9.3.2 En fonction <strong>du</strong> poids <strong>des</strong> contraintes<br />
De faibles contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> permettent au locuteur de mettre en p<strong>la</strong>ce plus<br />
facilement <strong>des</strong> stratégies de <strong>compensation</strong> complète. Nous savons que le nombre de<br />
contraintes qui œuvrent pour permettre <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole est très grand, nous les<br />
avons recensées sommairement <strong>dans</strong> <strong>la</strong> première partie de ce travail d’après Zerling<br />
(1991).<br />
9.3.2.1 Les effets <strong>du</strong> voisement<br />
Les consonnes non voisées ont un plus grand nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux que<br />
les consonnes voisées. Nous avons pu constater, tout au long de cette analyse spatiale<br />
que les consonnes voisées sont moins résistantes aux bite-blocks que les consonnes non<br />
voisées. Sous l’influence <strong>des</strong> bite-blocks, les voisées perdent plus de contacts que les<br />
non voisées : <strong>la</strong> différence de contacts entre les voisées et les non voisées s’agrandit au<br />
fur et à mesure que l’épaisseur <strong>du</strong> bite-block augmente.<br />
La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une consonne voisée est plus complexe que <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> d’une<br />
consonne non voisée <strong>dans</strong> le sens où elle engage plus de contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Pour<br />
qu’il y ait vibration <strong>des</strong> cor<strong>des</strong> vocales, il est difficile mais nécessaire de maintenir un<br />
différentiel de pression entre les cavités sous-glottique et intra-orale puisque l’occlusion<br />
a pour effet d’équilibrer les deux pressions de part et d’autre de <strong>la</strong> glotte. Cependant,<br />
nos résultats montrent que le rôle <strong>du</strong> voisement ne parait pas autant influer les effets <strong>des</strong><br />
bite-blocks que celui de <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle. D’après l’analyse de l’ANOVA, <strong>la</strong><br />
variable n’a pas eu d’influence significative sur les effets <strong>des</strong> bite-blocks,<br />
au contraire de <strong>la</strong> variable <br />
9.3.2.2 Les effets <strong>du</strong> contexte vocalique<br />
Nous savons que sans perturbation, <strong>la</strong> voyelle /i/ fermée allonge les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong><br />
consonnes et <strong>la</strong> voyelle ouverte /a/ raccourcit les <strong>du</strong>rées <strong>des</strong> consonnes. Nous rejoignons<br />
202
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
les suppositions de Sock et Lofqvist (1995) concernant l’occlusion de /d/. L’occlusion<br />
de <strong>la</strong> voisée /d/ est progressivement plus longue quand elle précède <strong>la</strong> voyelle /u/ puis /i/<br />
puis /a/. Ce phénomène connu est confirmé ici en parole normale mais aussi en parole<br />
perturbée. Les effets <strong>des</strong> bite-blocks sont plus mis en évidence sur les consonnes suivies<br />
de <strong>la</strong> voyelle /a/. Les séquences avec <strong>la</strong> voyelle /i/ résistent mieux à <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> biteblocks.<br />
Effectivement pour pro<strong>du</strong>ire une consonne alvéo<strong>la</strong>ire suivie d’une voyelle<br />
fermée l’apex évolue <strong>dans</strong> un espace ré<strong>du</strong>it puisque les deux segments ont le même lieu<br />
d’articu<strong>la</strong>tion antérieur <strong>dans</strong> le con<strong>du</strong>it vocal. Seul l’apex doit modifier ses mouvements<br />
et pas le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue qui reste en position élevée <strong>du</strong>rant l’émission <strong>des</strong> deux<br />
segments. Même avec <strong>la</strong> mâchoire bloquée en position ouverte, les mouvements de<br />
l’apex et de <strong>la</strong> <strong>la</strong>me sont encore possibles et optimisés grâce à leur indépendance entre<br />
elles et par rapport à <strong>la</strong> mâchoire.<br />
Lorsqu’on pro<strong>du</strong>it une consonne alvéo<strong>la</strong>ire suivie d’une voyelle ouverte /a/, ce n’est<br />
plus l’apex seul qui modifie son mouvement mais aussi le corps de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. La <strong>la</strong>ngue<br />
évolue <strong>dans</strong> un espace plus grand donc ses mouvements sont susceptibles de présenter<br />
plus de variations. La <strong>la</strong>ngue doit effectuer une trajectoire plus ample pour passer d’une<br />
articu<strong>la</strong>tion avant/fermée/apico-alvéo<strong>la</strong>ire à une articu<strong>la</strong>tion arrière/ouverte/dorsale. Le<br />
poids <strong>des</strong> contraintes de co<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> est plus lourd quand <strong>la</strong> voyelle adjacente requiert<br />
l’action d’une autre partie de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. L’apex et <strong>la</strong> <strong>la</strong>me sont sollicités mais le corps de<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, très dépendant de <strong>la</strong> position de <strong>la</strong> mâchoire, favorise <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong><br />
voyelle ouverte /a/.<br />
En résumé, nous proposons un c<strong>la</strong>ssement <strong>des</strong> séquences observées <strong>dans</strong> notre étude en<br />
fonction <strong>du</strong> poids <strong>des</strong> contraintes co<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s : <strong>des</strong> contraintes les plus forte aux plus<br />
faibles : Consonne Voisée et Voyelle Ouverte /da/ > Consonne Voisée et Voyelle<br />
Fermée /di/ > Consonne Non Voisée et Voyelle Ouverte /ta/ > Consonne Non Voisée et<br />
Voyelle Fermée /ti/.<br />
D’autre part, nous avons calculé un indice de coarticu<strong>la</strong>tion pour chacune <strong>des</strong> séquences<br />
de chaque locuteur. Cet indice est basé sur les mesures spatiales effectuées, notamment<br />
le nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux relevé sur <strong>la</strong> constriction maximale. La<br />
différence de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux entre consonne + /a/ et consonne + /i/ nous donne<br />
l’indice de coarticu<strong>la</strong>tion. Plus <strong>la</strong> différence de contacts entre /a/ et /i/ est grande plus<br />
l’indice est élevé. Nous nous demandons quelle est l’influence <strong>des</strong> bite-blocks sur cet<br />
indice de coarticu<strong>la</strong>tion.<br />
203
INDICE DE COARTICULATION<br />
DE YM<br />
204<br />
INDICE DE COARTICULATION<br />
DE BL<br />
partie antérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is partie antérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is<br />
cond /d/ /t/ cond /d/ /t/<br />
b0 6,83 2,75 b0 5,42 4,08<br />
b1 9,17 1,33 b1 10,00 4,00<br />
b2 12,25 2,17 b2 11,83 5,17<br />
b3 13,75 0,83 b3 12,42 8,67<br />
partie postérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is partie postérieure <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is<br />
cond /d/ /t/ cond /d/ /t/<br />
b0 8,50 6,25 b0 7,83 6,00<br />
b1 8,92 6,67 b1 7,33 4,17<br />
b2 13,17 6,33 b2 10,08 6,33<br />
b3 13,50 7,25 b3 9,08 6,67<br />
totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is<br />
cond /d/ /t/ cond /d/ /t/<br />
b0 16,17 12,17 b0 13,25 10,00<br />
b1 18,08 8,33 b1 17,42 8,17<br />
b2 25,33 12,25 b2 21,08 11,33<br />
b3 27,42 3,83 b3 21,33 15,25<br />
Figure n° 9.3 : Tableau <strong>des</strong> indices de coarticu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> deux locuteurs.<br />
L’indice de coarticu<strong>la</strong>tion est plus élevé sur les consonnes voisées que sur les non<br />
voisées et l’augmentation est aussi plus marquée sur les voisées. La différence de<br />
contacts entre /a/ et /i/ est plus grande concernant les consonnes voisées. Nous<br />
remarquons que chez les deux locuteurs, plus <strong>la</strong> mâchoire est en position basse plus<br />
l’indice de coarticu<strong>la</strong>tion augmente. Autrement dit, les bite-blocks ont tendance à faire<br />
augmenter l’indice de coarticu<strong>la</strong>tion. donc il y a plus de différences entre les contacts<br />
<strong>des</strong> consonnes suivies de /i/ et les contacts <strong>des</strong> consonnes suivies de /a/.
9.3.3 Une hiérarchie <strong>dans</strong> le contrôle moteur<br />
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
Quand un sujet compense complètement, le contrôle <strong>des</strong> mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs<br />
est plus précis et l’ajustement est immédiat : le geste initial commandé semble être<br />
conservé, avec toutefois une variabilité naturelle <strong>dans</strong> <strong>la</strong>quelle l’acte linguistique reste<br />
viable. Pour éviter de faire <strong>des</strong> undershoots et les overshoots, il met en œuvre une<br />
stratégie d’hyper-articu<strong>la</strong>tion directement réalisable grâce à <strong>la</strong> faculté d’adaptation <strong>du</strong><br />
système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>.<br />
Inversement, plus les contraintes sont fortes, plus le locuteur a <strong>du</strong> mal à mettre en œuvre<br />
<strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s complètes : les différences entre les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales et<br />
perturbées sont alors plus marquées. Nous n’observons pas de <strong>compensation</strong> complète,<br />
mais une recherche d’un trajet plus facile pour atteindre plus ou moins le même but<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone cible, d’où un changement de mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs. Le geste<br />
devient trop difficile à cause <strong>du</strong> lourd poids <strong>des</strong> contraintes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et temporelles.<br />
Le système opère donc une réorganisation spatio-temporelle totale qui donne lieu à un<br />
autre geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, réellement proche <strong>du</strong> geste exigé mais qui peut dép<strong>la</strong>cer<br />
légèrement son lieu d’articu<strong>la</strong>tion. Nous avons vu l’exemple <strong>du</strong> /d/ réalisé comme un<br />
/R/. Les changements de mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs sont re<strong>la</strong>tifs aux contraintes<br />
biomécaniques de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> : le système ne peut aller contre les lois physiques et<br />
mécaniques <strong>des</strong> contacts entre les articu<strong>la</strong>teurs ni contre les limitations physiques et<br />
physiologiques. Il n’a donc pas d’autre choix que de se soumettre à <strong>la</strong> loi <strong>du</strong> moindre<br />
effort ou d’économie <strong>du</strong> geste soulignée par Lindblom (1983), et effectue <strong>des</strong><br />
undershoot en développant <strong>des</strong> manœuvres d’hypo-articu<strong>la</strong>tion. Nous proposons le<br />
graphique ci-<strong>des</strong>sous pour résumer de manière globale ces dernières suppositions<br />
appuyées par notre travail. Nous pouvons penser que le rapport entre le degré de <strong>la</strong><br />
<strong>compensation</strong> et le poids <strong>des</strong> contraintes est un rapport d’inversement proportionnel.<br />
205
Hyperspeech<br />
Hypospeech<br />
Poids <strong>des</strong> contraintes<br />
Figure n° 9.4: La re<strong>la</strong>tion entre degré de <strong>compensation</strong> et poids <strong>des</strong> contraintes.<br />
9.4 Adaptation immédiate ou apprentissage : rôle <strong>des</strong> feedbacks<br />
Flege et al. (1988) n’ont pas observé de <strong>compensation</strong> instantanée. Dans leur deuxième<br />
enregistrement, les patrons <strong>des</strong> contacts avec bite-blocks sont plus ressemb<strong>la</strong>nts aux<br />
patrons <strong>des</strong> contacts sans bite-block que ceux <strong>du</strong> premier enregistrement. Le signal<br />
d’erreur renvoyé par les feedbacks tactiles, proprioceptifs, kinesthésique, auditif semble<br />
permettre de réaliser un patron « normal ». Les locuteurs usent le feedback afférent pour<br />
améliorer leur réponse. Les valeurs spécifiques <strong>des</strong> paramètres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont<br />
encodées <strong>dans</strong> les représentations centrales. Seul le feedback proprioceptif est<br />
responsable <strong>des</strong> réajustements immédiats, <strong>la</strong> mise en oeuvre <strong>des</strong> autres feedbacks est<br />
plus longue. Une récente étude de Honda et al. (2002) confirme aussi que <strong>la</strong><br />
<strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> s’opère au fur et à mesure que l’on parle : ils observent un<br />
temps de réponse adaptative à <strong>la</strong> perturbation dès <strong>la</strong> seconde syl<strong>la</strong>be, entre 75 et 200 ms.<br />
La réponse rapide suggère que le feedback tactile entre <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et le pa<strong>la</strong>is artificiel est<br />
premièrement utilisé pour développer <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s rapi<strong>des</strong> alors que le feedback<br />
auditif est finalement utilisé quand l’adaptation est insuffisante pour ajuster plus<br />
finement l’articu<strong>la</strong>tion, alors avec un temps plus long.<br />
Dans notre étude, il nous a semblé intéressant de voir si <strong>des</strong> effets adaptatifs se font<br />
ressentir à long terme puisque les sessions sont espacées de dix mois environ.<br />
206<br />
<strong>compensation</strong>
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
Rappelons que <strong>du</strong>rant chaque session, 4 répétitions <strong>du</strong> corpus ont été enregistrées, <strong>dans</strong><br />
les quatre situations expérimentales : B0, B1, B2 et B3. Nous avons comparé les<br />
moyennes <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux maximaux <strong>du</strong>rant chaque session. Nous posons<br />
<strong>la</strong> question de savoir si un effet d’adaptation à long terme, un effet d’apprentissage, se<br />
fait ressentir sur <strong>la</strong> réaction <strong>des</strong> locuteurs face aux perturbations. Inversement, si on<br />
postule l’existence d'une adaptation instantanée, alors nous n’observerions que peu de<br />
variations <strong>des</strong> valeurs entre les 3 sessions d’enregistrement.<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
5<br />
dad BL<br />
b0 b1 b2 b3<br />
tat BL<br />
b0 b1 b2 b3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
207<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
did BL<br />
b0 b1 b2 b3<br />
tit BL<br />
b0 b1 b2 b3<br />
Figure n°9.5 : Evolution <strong>du</strong> nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux à travers les trois sessions<br />
d‘enregistrement pour le locuteur BL. En abscisse, les conditions d’enregistrement. En ordonnée, les<br />
contacts maximaux.<br />
Nous remarquons que les courbes l’évolution <strong>des</strong> 3 sessions sont re<strong>la</strong>tivement simi<strong>la</strong>ires<br />
et confon<strong>du</strong>es pour le locuteur BL. Nous devons reconnaître que les variations sont<br />
assez faibles. Seul le nombre de contacts de <strong>la</strong> consonne /d/ suivie de /a/ diminue sur <strong>la</strong><br />
2 ème et 3 ème session avec le B3. La consonne /t/ suivie de /i/ montre une perte de contacts<br />
sur <strong>la</strong> 3 ème session avec le B3. Ces résultats confirment, comme nous l’avons montré<br />
<strong>dans</strong> les précédentes parties, <strong>la</strong> tendance de ce locuteur BL à perdre <strong>des</strong> contacts avec<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3
les bite-blocks mais il a aussi <strong>du</strong> mal à stabiliser ses <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s à travers les sessions<br />
avec le bite-block le plus épais.<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
dad YM<br />
b0 b1 b2 b3<br />
tat YM<br />
b0 b1 b2 b3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
208<br />
did YM<br />
b0 b1 b2 b3<br />
tit YM<br />
b0 b1 b2 b3<br />
Figure n 9.6 : Evolution <strong>du</strong> nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux à travers les trois sessions<br />
d‘enregistrement pour le locuteur YM. En abscisse, les conditions d’enregistrement. En ordonnée, les<br />
contacts maximaux.<br />
Les courbes représentant les trois sessions sont pratiquement confon<strong>du</strong>es concernant<br />
l’ensemble <strong>des</strong> séquences <strong>du</strong> locuteur YM. Ce locuteur a le même nombre de contacts<br />
linguo-pa<strong>la</strong>taux à travers les trois sessions d’enregistrement. Cette stabilité <strong>dans</strong><br />
l’amplitude <strong>des</strong> contacts à travers les sessions dénote d’une adaptation directe. Ce<br />
locuteur n’a pas besoin d’un temps d’apprentissage à long terme pour améliorer ses<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s : il apparaît que <strong>la</strong> tâche demandée est réalisée tout de suite. Ceci réaffirme<br />
aussi le fait que ce locuteur soit moins sensible aux perturbations que le locuteur<br />
précédent. Ce résultat confirme les théories qui s’attachent à <strong>la</strong> représentation d’un<br />
système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> qui aurait sa propre auto-régu<strong>la</strong>tion interne permettant <strong>des</strong><br />
réajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s instantanés, sans l’aide de l’apprentissage et de <strong>la</strong> mémoire<br />
(chapite 2 sur les structures coordinatives).<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3
QUATRIEME PARTIE : INTERPRETATION ET DISCUSSION<br />
CHAPITRE 9 : Discussion<br />
D’autre part, nous avons remarqué, <strong>dans</strong> les chapitres 6 et 7 de résultats, que les écarttypes<br />
calculés sur les moyennes sont plus élevés et irréguliers <strong>du</strong>rant les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s<br />
avec bite-blocks que <strong>du</strong>rant les <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>s normales. Ce<strong>la</strong> dénote de variations<br />
spatiales et temporelles intra-indivi<strong>du</strong>elles plus importantes que sans bite-block. Nous<br />
pensons que ces variations sont justement <strong>du</strong>es au fait que le système est en cours<br />
d’auto-réorganisation, en référence au terme d’auto-régu<strong>la</strong>tion interne de Bothorel<br />
(1989). Le système opère si rapidement puisqu’il n’a recours qu’aux informations<br />
sensori-tactiles, que nous observons forcément <strong>des</strong> variations <strong>dans</strong> ses réalisations<br />
phonétiques, variations déjà nombreuses en parole normale. Cependant, il faut que le<br />
locuteur prenne le temps d’adapter les nouvelles trajectoires <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s générées par<br />
<strong>la</strong> présence <strong>des</strong> perturbations même si cette adaptation se fait de façon automatique et<br />
interne.<br />
Concernant les deux locuteurs et par rapport aux bases théoriques que nous venons<br />
d’évoquer, les répétitions ne paraissent pas constituer pas un facteur très influent sur le<br />
nombre d’électro<strong>des</strong> contactées. Il semble qu’il n’y ait pas d’effet d’apprentissage<br />
marqué face à <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks. A l’image <strong>des</strong> travaux de Abbs et al. (1984)<br />
nous pensons que s’effectue une réorganisation sous-jacente <strong>du</strong> processus de contrôle,<br />
grâce à une connaissance antérieure <strong>des</strong> muscles groupés en synergie. L’atteinte d’une<br />
cible phonétique associée à chaque phone reste possible. Le système nerveux central n’a<br />
pas le temps de recevoir l’information sensorielle et de renvoyer une autre commande.<br />
L’adaptation est possible grâce à un système parallèle qui entrerait en jeu et permettrait<br />
d’effectuer rapidement un mouvement automatique contrôlé d’une manière encore<br />
inconnue, mais pas par le système nerveux central. Nos données appuieraient ici<br />
l’existence de <strong>la</strong> boucle de « simu<strong>la</strong>tion prédictive » préconisée par Lindblom (1983,<br />
1990) qui permet une facile adaptation à toutes les situations, et ce, le plus rapidement<br />
possible. Le système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> possèderait bien une composante de simu<strong>la</strong>tion<br />
interne qui lui permettrait d’opérer spontanément.<br />
209
210
CONCLUSION<br />
211<br />
CONCLUSION<br />
Cette étude, orientée sur <strong>la</strong> recherche <strong>des</strong> phénomènes de <strong>compensation</strong>, portait sur une<br />
comparaison <strong>des</strong> mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> normale et avec <strong>la</strong> mâchoire<br />
bloquée. Nous savons que les deux articu<strong>la</strong>teurs (<strong>la</strong>ngue et mâchoire) sont<br />
mécaniquement liés, l’absence d’activité de l’un entraîne un changement d’activité de<br />
l’autre. Nous avons montré qu’il s’opère bien un changement spatio-temporel <strong>des</strong><br />
mouvements de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue quand <strong>la</strong> mâchoire est bloquée par <strong>des</strong> bite-blocks.<br />
L’articu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> consonne est donc différente en parole perturbée : nous avons<br />
observé <strong>des</strong> ré<strong>du</strong>ctions comme <strong>des</strong> consolidations de <strong>la</strong> consonne. Cette expérience<br />
témoigne de l’existence de stratégies de <strong>compensation</strong> <strong>du</strong> système de contrôle <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n méthodologique, l’utilisation de l’EPG s’est avérée satisfaisante pour<br />
observer les mouvements linguaux <strong>des</strong> consonnes <strong>occlusives</strong> alvéo<strong>la</strong>ires sur les deux<br />
p<strong>la</strong>ns spatial et temporel. Ces consonnes se réalisent en plusieurs phases bien distinctes<br />
aisément segmentables avec l’EPG. Même si cet outil ne fournit pas un enregistrement<br />
direct <strong>du</strong> mouvement lingual, cette technique nous a permis justement de restituer les<br />
dép<strong>la</strong>cements et le timing <strong>des</strong> gestes <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Les consonnes <strong>occlusives</strong> choisies<br />
résistent aux variabilités inhérentes au processus de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, nous avons concentré<br />
nos efforts pour distinguer l’influence <strong>des</strong> bite-blocks de l’influence d’autres facteurs<br />
secondaires comme <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> voyelle, le voisement, le locuteur. Nous avons<br />
cherché à baser nos interprétations le plus possible sur les effets seuls <strong>des</strong> perturbations<br />
(bite-blocks), objets directs de notre étude. Grâce à l’analyse de variance par l’ANOVA,<br />
nous pensons avoir pu faire cette distinction primordiale.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n spatial, nous avons analysé <strong>la</strong> phase de constriction maximale de <strong>la</strong><br />
consonne. Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux et l’amplitude <strong>du</strong> mouvement sont modifiés par<br />
le présence <strong>des</strong> bite-blocks mais nous n’avons pas observé de régu<strong>la</strong>rités prégnantes. En<br />
effet, les contacts peuvent tout aussi bien être renforcés que diminués, comme nous<br />
l’avons observé chez nos locuteurs YM et BL, respectivement. Le geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est<br />
certes modifié mais pas de façon uniforme. Les raisons de cette différence <strong>dans</strong> les<br />
résultats sont <strong>du</strong>es en partie au poids <strong>des</strong> contraintes phonotactiques et <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, de
<strong>la</strong> base <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> de chaque locuteur, à l’ensemble <strong>des</strong> nombreuses variables qui<br />
régulent <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole <strong>dans</strong> sa totalité.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n temporel, nous avons comparé le timing inter-segmental et le timing intra<br />
segmental <strong>des</strong> évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s en parole normale et en parole perturbée. Nous<br />
avons souligné que <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> consonne n’est pas influencée par les bite-blocks, par<br />
contre le timing intra-segmental, ou <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de chacune <strong>des</strong> phase de <strong>la</strong> consonne,<br />
parait être sujet à <strong>des</strong> modifications temporelles. Les allongements et les<br />
raccourcissements <strong>des</strong> phases sont en fait noyés <strong>dans</strong> le geste global de <strong>la</strong> consonne,<br />
comme si ces phases répondaient à <strong>des</strong> micro-gestes qui constituent les différentes<br />
parties de <strong>la</strong> consonne.<br />
Cette étude a permis de souligner l’importance de <strong>la</strong> variabilité inter-indivi<strong>du</strong>elle <strong>dans</strong><br />
les étu<strong>des</strong> concernant <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole. Les variations observées sont<br />
<strong>la</strong>rgement soumises aux stratégies et à <strong>la</strong> variété inter- et intra-indivi<strong>du</strong>elle, comme tout<br />
phénomène re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> parole et plus généralement à tous les processus naturels. Les<br />
caractéristiques physiologiques indivi<strong>du</strong>elles, <strong>la</strong> base <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, les stratégies de<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de chaque sujet peuvent expliquer certaines <strong>des</strong> différences observées.<br />
Certes, nos résultats d’analyse inter-indivi<strong>du</strong>elle ne permettent pas de saisir <strong>des</strong><br />
stratégies de <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> récurrentes puisque nos deux locuteurs<br />
réagissent de façon opposée. Néanmoins concernant <strong>la</strong> réalisation de <strong>la</strong> consonne /d/<br />
suivie de /a/, les deux locuteurs montrent le même affaiblissement <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> avec les<br />
bite-blocks.<br />
Ce phénomène <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> assez résistant à <strong>la</strong> variabilité inter-locuteur peut constituer<br />
une information basique pour <strong>la</strong> conception <strong>des</strong> stratégies de <strong>compensation</strong> en rapport<br />
avec le poids <strong>des</strong> contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> et peut aussi faciliter <strong>la</strong> compréhension <strong>des</strong><br />
processus de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole.<br />
L’analyse de nos données <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s nous permet de confirmer certaines <strong>des</strong><br />
propriétés <strong>des</strong> <strong>compensation</strong>s déjà exploitées par <strong>des</strong> protocoles expérimentaux<br />
différents (chapitre 3). Les <strong>compensation</strong>s sont sélectives, elles s’opèrent plus<br />
complètement sur <strong>la</strong> phase médiane de <strong>la</strong> consonne. En effet, c’est sur l’attaque et <strong>la</strong><br />
tenue de <strong>la</strong> consonne que nous avons observé les plus faibles différences entre les<br />
situations de parole normale et perturbée. La mise en p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> constriction et <strong>la</strong> tenue<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> sont deux phases clés pour <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong> consonnes <strong>occlusives</strong> puisque<br />
c’est sur elles que les locuteurs opèrent les <strong>compensation</strong>s les plus complètes,<br />
212
213<br />
CONCLUSION<br />
certainement par une manœuvre d’hyperspeech, et ce toujours pour permettre <strong>la</strong><br />
viabilité de l’acte linguistique. La tenue de <strong>la</strong> consonne est très résistante au détriment<br />
<strong>des</strong> autres phases. Le timing gestuel qui reste inchangé malgré <strong>la</strong> présence <strong>des</strong><br />
perturbations permet de compenser le timing inter-gestuel (<strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong> différentes<br />
phases de <strong>la</strong> consonne) qui est modifié.<br />
Les <strong>compensation</strong>s se mettent en p<strong>la</strong>ce de façon hiérarchique. Cette hiérarchie de <strong>la</strong><br />
<strong>compensation</strong> est fonction de l’importance <strong>des</strong> contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> en général. Le<br />
phénomène d’apicalisation commun aux deux sujets (sur <strong>la</strong> consonne /d/ suivi de /a/),<br />
s’avère être un exemple de <strong>compensation</strong> incomplète puisque le geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est<br />
différent. Rappelons que les locuteur pro<strong>du</strong>isent un tap alvéo<strong>la</strong>ire en lieu et p<strong>la</strong>ce de /d/.<br />
La mise en p<strong>la</strong>ce de stratégie de <strong>compensation</strong> est influencée par l’existence de<br />
multiples contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> innées et universelles qui influencent les<br />
représentations phonétiques à tous les niveaux de traitement, de l’acquisition <strong>des</strong><br />
représentations mentales à <strong>la</strong> sortie acoustique. Plus les contraintes sont faibles, plus les<br />
<strong>compensation</strong>s peuvent tendre à être complètes.<br />
Nous avons vu le c<strong>la</strong>ssement <strong>des</strong> séquences étudiées en fonction <strong>du</strong> degré de<br />
coarticu<strong>la</strong>tion, de <strong>la</strong> séquence <strong>la</strong> plus « contrainte » à <strong>la</strong> moins, ou d’une <strong>compensation</strong><br />
incomplète vers une <strong>compensation</strong> complète pour les deux locuteurs :<br />
Consonne Voisée et Voyelle Ouverte /da/ > Consonne Voisée et Voyelle Fermée /di/ ><br />
Consonne Non Voisée et Voyelle Ouverte /ta/ > Consonne Non Voisée et Voyelle<br />
Fermée /ti/.<br />
D’autre part, nous avons relevé, <strong>dans</strong> notre étude, que l’apprentissage ne semble pas<br />
jouer un rôle fondateur. Le fait d’avoir réalisé l’expérience en plusieurs fois n’a pas<br />
influencé les réponses de nos locuteurs. Contre toute attente, l’analyse spatiale <strong>des</strong><br />
évènements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s a révélé une stabilité <strong>dans</strong> le nombre de contacts linguopa<strong>la</strong>taux<br />
sur <strong>la</strong> constriction maximale, notamment chez le locuteur YM. Cette stabilité<br />
<strong>dans</strong> l’amplitude <strong>des</strong> contacts à travers les sessions dénote d’une adaptation immédiate :<br />
les <strong>compensation</strong>s, complètes ou incomplètes, sont immédiates. Au niveau <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>,<br />
les mouvements <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs seraient bien auto-régulés <strong>dans</strong> le sens où l’entendent<br />
Perkel et al. (1995), pour qui ces réajustements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s immédiats confirment<br />
l’existence <strong>des</strong> structures coordinatives. Dans <strong>la</strong> mesure où l’on soutient l’existence de<br />
ces ré-ajustements prédictifs <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s, <strong>la</strong> présence d’un feedback externe auditif ne<br />
serait alors plus essentielle. Pour éc<strong>la</strong>irer cette décision, citons l’étude de Baum et al.
(1997) qui ont observé les mêmes comportements compensatoires chez <strong>des</strong> sujets<br />
aphasiques que chez <strong>des</strong> sujets sains. Leurs enregistrements sont réalisés avec <strong>des</strong> biteblocks<br />
et l’analyse repose sur <strong>des</strong> observations acoustiques et perceptives. Leurs<br />
données suggèrent qu’un déficit au niveau moteur (exhibé par les patients aphasiques)<br />
n’affecte pas leur capacité à compenser une perturbation <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Ces résultas<br />
contribuent à suggérer que <strong>la</strong> capacité à s’adapter à une perturbation <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> serait<br />
arbitrée de manière périphérique.<br />
Les réajustements, ajoutés à <strong>la</strong> flexibilité requise pour réguler un système dynamique<br />
complexe, comme le système <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>, permettent une bonne <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole<br />
<strong>dans</strong> n’importe quelle situation. Les locuteurs sont capables d’atteindre un but<br />
programmé, vraisemb<strong>la</strong>blement sur le p<strong>la</strong>n spatial et sur le p<strong>la</strong>n temporel lorsqu’on leur<br />
impose <strong>des</strong> contraintes extérieures. Les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s sont programmés<br />
pour atteindre <strong>des</strong> cibles en terme de paramètres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et acoustiques. Ces cibles<br />
sont alors influencées par un savant compromis entre les principes de contraste<br />
suffisant pour <strong>la</strong> perception et d’économie de l’effort, si chers au paradigme hyperhypoarticu<strong>la</strong>tion.<br />
Au terme de cette étude, nous présentons brièvement l’orientation <strong>du</strong> travail <strong>dans</strong> un<br />
futur proche, les résultats obtenus ici n’étant qu’une partie de notre <strong>la</strong>rge projet. En<br />
premier lieu, nous allons examiner les caractéristiques acoustiques <strong>des</strong> consonnes /t/ et<br />
/d/ afin d’étudier quels sont les changements entraînés par les nouvelles configurations<br />
linguales <strong>dans</strong> <strong>la</strong> cavité buccale, notamment par l’observation <strong>du</strong> V.O.T., <strong>des</strong><br />
trajectoires de formants.<br />
Deuxièmement, un test de perception devrait être effectué afin de discerner si les<br />
consonnes perturbées sont aussi bien reconnues que les consonnes normales. Nous<br />
chercherons à monter un test qui permettrait de calculer le temps de réaction <strong>des</strong><br />
auditeurs<br />
Troisièmement et de manière plus générale, nous aimerions exploiter <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong><br />
corpus enregistré. A partir de <strong>la</strong> méthodologie développée <strong>dans</strong> ce présent travail et en<br />
utilisant d’autres métho<strong>des</strong> d’investigation (comme <strong>des</strong> images aux rayons x ou l’IRM),<br />
il s’agira d’analyser les mouvements compensatoires de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
<strong>des</strong> consonnes linguales fricatives /s/, /z/, /S/ et /Z/.<br />
214
215
216
BIBLIOGRAPHIE<br />
Abbs, J.H. & Gracco, V.L. (1984) Control of complex motor gestures: orofacial muscle<br />
responses to load perturbations of lip <strong>du</strong>ring speech, Journal of Neurophysiology, 51,<br />
pp. 705-723.<br />
Abbs, J.H., Netsell, R. W., & Hixon, T.J. (1971) Variation in mandibu<strong>la</strong>r disp<strong>la</strong>cement,<br />
velocity and acceleration as a function of phonetic context, Journal of the Acoustical<br />
Society of America, 51..<br />
Abbs, J.H., Gracco, V.L., & Cole, K.J. (1984) Control of multimovement coordination:<br />
Sensorimotor mechanism in speech motor programming, Journal of Motor Behaviour,<br />
16, pp.195-232.<br />
Abbs, J. H. (1986) Invariance and variability in speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>: a distinction<br />
between linguistic intent and its neuromotor implementation. In PERKELL, Joseph S. ;<br />
KLATT, Dennis H. (eds), Invariance And Variability In Speech Processes, pp. 202-219<br />
Baum, S.R., Kim, J. A., Katz, W.F. (1997) Compensation for jaw fixation by aphasic<br />
patients, Brain and Language, 56, pp. 354-376.<br />
Bell-Berti, K. & Harris, K.S. (1981) Temporal patterns of coarticu<strong>la</strong>tion : lip rounding.<br />
Status Report on Speech Research, Haskins Laboratories, New Haven, CT, USA, juil.déc.<br />
1981, pp. 41-56<br />
Bognar, E. (1983) Direction <strong>des</strong> recherches phonétiques consacrées à <strong>la</strong> mâchoire.<br />
Bulletin de l’Institut Phonétique de Grenoble, 12, pp. 1-45.<br />
Bonnot, J.F. & Bothorel, A. (1989) Co-dépendance <strong>des</strong> traits phonétiques, sensibilité au<br />
contexte et variabilité paramétrique, Mé<strong>la</strong>nges de phonétique générale et expérimentale<br />
offerts à Pé<strong>la</strong> Simon, Publications de l’Institut de Phonétique de Strasbourg.<br />
Bothorel, A (1982) Etude phonétique et phonologique <strong>du</strong> breton palé à Argol (sud<br />
Finistère). Thèse de doctorat, Strasbourg.<br />
Browman, C.P. & Goldstein, L. (1989) Articu<strong>la</strong>tory gestures as phonological units,<br />
Phonology 6, pp.201-251.<br />
Browman, C.P. & Goldstein, L. (1992) Articu<strong>la</strong>tory phonology: an overview, Phonetica<br />
49, pp. 155-180.<br />
Browman, C.P. & Goldstein, L. (1993) Dynamics and articu<strong>la</strong>tory phonology, Haskins<br />
Laboratories Status Report on Speech research, 113, pp. 51-62.<br />
C<strong>la</strong>iret, S. (1997) Caractérisation <strong>des</strong> voyelles nasales en français méridional: essai<br />
méthodologique pour une étude aérodynamique et acoustique, Mémoire de DEA sous <strong>la</strong><br />
direction de M. Di Cristo, Université de Provence.<br />
217
C<strong>la</strong>iret S. (2000) Compensating for perturbations in speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> : corpus,<br />
instrumentation and analytical tools », Workshop PROCOPE : Métho<strong>des</strong> et formalismes<br />
pour <strong>la</strong> linguistique de corpus, Aix en Provence.<br />
Chomsky, N. & Halle, M. (1968) The sound patterns of English, New York, Harper &<br />
Row.<br />
Demolin, D. & al. (1997) Coarticu<strong>la</strong>tion and articu<strong>la</strong>tory <strong>compensation</strong> studies by<br />
dynamic MRI, Proceeding of Eurospeech 97, Rho<strong>des</strong>.<br />
Duez, D. (1995) On spontaneous french speech: aspects of the re<strong>du</strong>ction and contextual<br />
assimi<strong>la</strong>tion of voiced stops. WALLEY, A. C. & FLEGE, J. E. pp. 407-427.<br />
Earnest, M.M., Max, L. (2001) Maxi<strong>la</strong>ry and mandibu<strong>la</strong>r morphometry and the re<strong>la</strong>tion<br />
to articu<strong>la</strong>tory kinematics, The Fourth International Congress on Speech Motor Control<br />
in Normal and Disordered Speech, Nijmegen, The Nether<strong>la</strong>nds.<br />
Eccles, J.C. (1969) The dynamic loop hypothesis of movement control, In K.N. Leibovic<br />
(Eds.) Information Processing in the Nervous system, N.Y. Springer Ver<strong>la</strong>g, pp. 245-<br />
269.<br />
Ellis, L., Hardcastle W.J. (1999) An instrumental study of alveo<strong>la</strong>r to ve<strong>la</strong>r assimi<strong>la</strong>tion<br />
in careful and fast speech, ICPhS vol.3, San Francisco, pp. 2425-2428.<br />
Espesser, R. Nishinuma Y. (1986) Unix, premier contact, Eyrolles (eds), Paris.<br />
Espesser, R. (1996) MES : un environnement de traitement <strong>du</strong> signal, Actes <strong>des</strong><br />
XXIièmes Journées d’Etude sur <strong>la</strong> Parole, Avignon, 10-14 juin 1996.<br />
Fairbanks, G. (1974) A theory of the speech mechanism as a servo system, LASS,<br />
Norman, J. (Eds.), Speech and Hearing Science: Selected Readings, pp. 178-184.<br />
Farnetani, E. (1986) A pilot study of articu<strong>la</strong>tion of /n/ in Italian using<br />
electropa<strong>la</strong>tography and airflow measurements, Quaderni del Centro Studio per <strong>la</strong><br />
Ricerche di Fonetica del C.N.R. di Universita de Padova, 5, pp. 277-282.<br />
Farnetani, E. Hardcastle W. & Marchal, A. (1989) Cross-<strong>la</strong>nguage investigation of<br />
lingual coarticu<strong>la</strong>tory processes using EPG, Proceedings of the European Conference<br />
on Speech Communication and Technology, Paris, pp. 229-232.<br />
Farnetani, E. (1990) VCV lingual coarticu<strong>la</strong>tion and its spatiotemporal domain, in<br />
Speech Pro<strong>du</strong>ction and Speech Modelling, HardcastleW.J. & Marchal A. (eds), Kluwer<br />
Academic Publisher, pp. 93-130.<br />
Farnetani E. (1991) Coarticu<strong>la</strong>tion and re<strong>du</strong>ction in coronal consonants comparing<br />
iso<strong>la</strong>ted words and continuous speech. Quaderni del Centro Studio per <strong>la</strong> Ricerche di<br />
Fonetica del C.N.R. di Universita de Padova,10, pp. 105-110.<br />
218
Farnetani, E. Recasens, D. (1999) Coarticu<strong>la</strong>tion models in recent speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong><br />
theories in Coarticu<strong>la</strong>tion, theory and technics, eds Hardcastle, W.J. & Hewlett N.<br />
C.U.P. pp. 31-68.<br />
Flege, J., Fletcher, S. & Homiedan, A. (1988) Compensating for a bite-block in /s/ and<br />
/t/ <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> : pa<strong>la</strong>tographic, acoustic et perceptual data, Journal of the Acoustical<br />
Society of America, 83(1), pp. 212-228.<br />
Folkins, J.W. & Zimmerman, G.N. (1981) Jaw muscle activity <strong>du</strong>ring speech with the<br />
mandible fixed, Journal of the Acoustical Society of America 69, pp. 1441-1445.<br />
Folkins, J.W. & Abbs, J.H. (1976) Lip and jaw motor control <strong>du</strong>ring speech : response<br />
to resistive loading of the jaw, Journal of Speech and Hearing Research, 18, pp. 207-<br />
220.<br />
Folkins, J.W. (1981) Muscle activity for jaw closing <strong>du</strong>ring speech, Journal of Speech<br />
and Hearing Research, 24, pp. 601-615.<br />
Folkins, J.W. & Lindville R.N. (1983) The effects of varying lower lip disp<strong>la</strong>cement on<br />
upper lip movement: implication for the coordination of speech movements, Journal of<br />
Speech and Hearing Research, 26, pp. 209-217.<br />
Fougeron, C. (1998) Variations <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s en début de constituant prosodique de<br />
différents niveaux en français, Thèse de Doctorat en Phonétique, Université de Paris 3,<br />
Sorbonne Nouvelle, Paris.<br />
Fowler, C.A. (1995) Speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, In Miller, J. & Eimas, P.(eds) Handbook of<br />
perception and cognition : speech, <strong>la</strong>nguage and communication, 11, New York<br />
Academic Press.<br />
Fowler, C.A. & Turvey, M. (1980) Immediate <strong>compensation</strong> in bite-block speech,<br />
Phonetica 37, pp. 306-326.<br />
Fowler, C.A. & Saltzman E. (1993) Coordination and coarticu<strong>la</strong>tion in speech<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, Language and Speech, 36, pp. 171-195.<br />
Fujimura, O. & Miller, J.E. (1979) Mandibule height and syl<strong>la</strong>ble-final tenseness,<br />
Phonetica, 36, pp. 263-272.<br />
Fujimura O., Tatsumi I. & Kagaya R. (1973) Computational processing of pa<strong>la</strong>tographic<br />
patterns. Journal of Phonetics, 1(1), pp. 47-54.<br />
Gay, T. (1977) Cinefluorographic and electromyographic studies of articu<strong>la</strong>tory<br />
organization, Status Report on Speech Research, Haskins Laboratories, New Haven, pp.<br />
77-92.<br />
Gay, T. (1974) Jaw movements <strong>du</strong>ring speech : a cinefluorographic investigation, Status<br />
Report on Speech Research, Haskins Laboratories 39-40, Juillet-Décembre 1974, pp.<br />
219-230.<br />
219
Gay, T., Lindblom, B. & Lubker, J. (1981) Pro<strong>du</strong>ction of bite-block vowels : acoustic<br />
equivalence by selective <strong>compensation</strong>, Journal of the Acoustical Society of America,<br />
69, pp. 802-810.<br />
Gay, T. (1981) Mechanism in the control of speech rate, Phonetica 38, pp.148-158.<br />
Geumann A. Kroos C. Tillman H.G.(1999) Are there compensatory effects in natural<br />
speech ? ICPhS 99, San Francisco, pp. 399-402.<br />
Gibbon F., Hardcastle W. & Nico<strong>la</strong>idis K. (1993) Temporal and spatial aspects of<br />
lingual coarticu<strong>la</strong>tion in /kl/ sequences: a cross-linguistic investigation. Language and<br />
Speech, 36 (2-3), pp. 261-277.<br />
Gibbon, F.& Nico<strong>la</strong>idis, K. (1999) Pa<strong>la</strong>tography in coarticu<strong>la</strong>tion, theory, data and<br />
technics, Hardcastle W. J. & Hewlet N. (Eds) Cambridge University Press pp. 226-245.<br />
Guenther, F.H. (1995) A modelling framework for speech motor development and<br />
kinematic articu<strong>la</strong>tor control, ICPhS, 1995, Stockholm, vol.2, pp. 93-99.<br />
Guenther, F.H. & al. (1999) Articu<strong>la</strong>tory trade offs re<strong>du</strong>ce acoustic variability <strong>du</strong>ring<br />
american english /r/ <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, Journal of the Acoustical Society of America, 105, pp.<br />
2854-2865.<br />
Hamlet, S.L. & Stone, M. (1978) Compensatory alveo<strong>la</strong>r consonant <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> in<strong>du</strong>ced<br />
by wearing a dental prothesis, Journal of Phonetics, 6, pp. 227-248.<br />
Hardcastle W. (1972) The use of electropa<strong>la</strong>tography in phonetic research. Phonetica,<br />
25(4), pp. 197-215.<br />
Hardcastle W.J. (1976) Physiology of speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, an intro<strong>du</strong>ction for speech<br />
scientists, Academic Press, London, pp. 88-111.<br />
Hardcastle W. (1984) New methods of profiling lingual pa<strong>la</strong>tal contact patterns with<br />
electropa<strong>la</strong>tography. Speech Research Laboratory of University of Reading Work in<br />
Progress, 4, pp. 1-40.<br />
Hardcastle W., Jones W., Knight C., Trudgeon A. & Calder G. (1989) New<br />
developments in electropa<strong>la</strong>tography: A state-of-the-art report. Clinical Linguistics and<br />
Phonetics, 3, pp. 1-38.<br />
Hardcastle W.J. & al. (1991) EPG data re<strong>du</strong>ction methods and their implications for<br />
studies of lingual coarticu<strong>la</strong>tion, Journal of Phonetic, 19, pp. 251-266.<br />
Hebbs, D.O. (1961) The organization of behaviour, Wiley (Eds.), NewYork.<br />
Honda, K., Maeda, S., Hashi, M., Dembowski, J.S. & Westbury, J.R. (1996) Human<br />
pa<strong>la</strong>te and re<strong>la</strong>ted structures: their articu<strong>la</strong>tory consequences, Proceedings of the fourth<br />
international conference on spoken <strong>la</strong>nguage processing, 2, pp. 784-787.<br />
220
Honda, M., Fujino, A., Kaburagi, T. (2002) Compensatory responses of articu<strong>la</strong>tors to<br />
unexpected perturbation of the pa<strong>la</strong>te shape, Journal of Phonetics, 30, pp. 281-302.<br />
Horga, D. (2002) The influence of bite-blocks on continuous speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>,<br />
Phonetics and its applications, A.Braun & H.R. Masthoff (Eds).<br />
Jakobson, R. (1963) Essais de Linguistique Générale, les fondations <strong>du</strong> <strong>la</strong>ngage, Les<br />
Editions de Minuit, Paris.<br />
Kaneko, N. (1957) Specific x-ray observations on the movements of the lower jaw, lips<br />
and tongue in pronunciation, Study of Sound, 8, pp. 1-18.<br />
Keating P.A. & Lindblom, B., Lubker, J.& Kreiman, J. (1994) Variability in jaw height<br />
for segments in English end Swedish VCVs, Journal of Phonetics, 22, pp. 407-422.<br />
Kelso, J.A.S. & Tuller, B. (1983) Compensatory articu<strong>la</strong>tion under conditions of<br />
re<strong>du</strong>ced afferent information: a dynamic formu<strong>la</strong>tion, Journal of Speech and Hearing<br />
Research, 26, pp. 217-224.<br />
Kelso, J.A.S., Tuller, B., Vatikiotis-Bateson, E. & Fowler, C. A. (1984) Fonctionallyspecific<br />
cooperation following jaw perturbation <strong>du</strong>ring speech: Evidence for<br />
coordinative structures, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and<br />
Performance, 10, pp. 812-832.<br />
Kelso, J.A.S., Saltzman, E.L. & Tuller, B. (1986) The dynamical perspective on speech<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> : data and theory, Journal of Phonetics, 14, pp. 29-59.<br />
Kuehn D.P. Moll K.L.(1976) A cineradiographic study of VC and CV articu<strong>la</strong>tory<br />
velocities, Jounal of Phonetics, 4, pp. 303-320.<br />
Laboissière, R., Ostry, D.J. & Perrier, P. (1995) A model of human jaw and hyoid<br />
motion and its implications for speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, ICPhS 1995 vol. 2, Stocholm.<br />
Ladefoged P. (1971) Preliminaries to linguistic phonetics,: The University of Chicago<br />
Press, Chicago, USA.<br />
Ladefoged, P., De Clerk, J., Lindau, M. & Papcun, G. (1972) An auditory-motor theory<br />
of speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, UCLA Working Papers in Phonetics 22, University of California,<br />
Phonetics Laboratory, Los Angeles, pp. 48-75.<br />
Ladefoged, P. (1983) The limits of biological exp<strong>la</strong>nation in phonetics, UCLA Working<br />
Papers in Phonetics, University of California, Phonetics Laboratory, Avril 1983, Los<br />
Angeles C.A., U.S.A, pp. 1-10.<br />
Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1998) Some of the sounds of the world's <strong>la</strong>nguages,<br />
UCLA Working Papers in Phonetics, 64, University of California, Phonetics<br />
Laboratory, Los Angeles C.A.; U.S.A.<br />
221
Laver, J. (1994) Principles of Phonetics, Coll. Cambridge Textbooks in Linguistics,<br />
Cambridge University Press, Cambridge, Grande Bretagne,.<br />
Lindblom, B. & Sunberg, J. (1971) Acoustical consequences of lip, tongue, jaw and<br />
<strong>la</strong>rynx movement, Journal of the Acoustical Society of America, 50, pp. 1166-1179.<br />
Lindblom, B., Lubker, J. & Mc Allister, R. (1977) Compensatory articu<strong>la</strong>tion and the<br />
modelling of normal speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> behaviour. Carré, R., Descout, R. & Wajskop,<br />
M., (eds), Articu<strong>la</strong>tory Modelling and Phonetics, Proceeding from Symposium at<br />
Grenoble, Groupe Aixois Linguistique Française, pp. 147-160.<br />
Lindblom, B., Lubker, J. & Gay, T. (1979) Formant frequencies of some fixed mandible<br />
vowels and a model of speech motor programming by predictive simu<strong>la</strong>tion, Journal of<br />
Phonetics, 7, pp. 147-161.<br />
Lindblom, B. (1983) Economy of speech gesture, in Speech Pro<strong>du</strong>ction, MacNei<strong>la</strong>ge<br />
P.F. eds Springer Ver<strong>la</strong>g, New York, pp. 217-245.<br />
Lindblom, B. (1990) Exp<strong>la</strong>ining phonetic variations : a sketch of the H & H theory. In<br />
Speech Pro<strong>du</strong>ction and Speech Modelling, Hardcastlle, W.J., Marchal, A.(eds.) pp 403-<br />
439.<br />
Lindblom, B. (1996) Approche intégrée de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> et de <strong>la</strong> perception, in<br />
Fondements et perspectives en traitement automatique de <strong>la</strong> parole, AUPELF UREF,<br />
Eds. H Meloni.<br />
Löfqvist A. (1990) Speech as audible gestures in speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> and speech<br />
modelling, in Speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> and speech modelling, eds Hardcastle W.J. & Marchal<br />
A., Kluwer Academic Publisher, pp. 289-322.<br />
Lubker, J. (1979) The reorganisation time of bite-blocks vowels, Phonetica 36, pp. 273-<br />
293.<br />
MacNei<strong>la</strong>ge, P. (1970) The motor control of serial ordering of speech, Psychological<br />
Review, 77, pp. 182-196.<br />
MacNei<strong>la</strong>ge, (1979) Speech Pro<strong>du</strong>ction, Plenary Status Report, 9ièmes ICPhS, vol.1, pp.<br />
11-39.<br />
MacNei<strong>la</strong>ge, P. & Davis, B. (1990) Acquisition of speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>: The achievement<br />
of segmental independence. In HARDCASTLE, William J.; MARCHAL, A<strong>la</strong>in (eds),<br />
Speech Pro<strong>du</strong>ction And Speech Modelling, pp. 55-68.<br />
Maeda S. (1990) Compensating articu<strong>la</strong>tion <strong>du</strong>ring speech, evidence from the analysis<br />
and synthesis of vocal tract shapes using an articu<strong>la</strong>tory model, Hardcastle W.J and<br />
Marchal A., K.A.P (Eds), Speech Pro<strong>du</strong>ction and Speech Modelling, pp. 131-150.<br />
Marchal A. (1983) Coarticu<strong>la</strong>tory pattern in stop sequences: EPG evidence.<br />
Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences Ultrecht: Foris.<br />
222
Marchal, A. (1985) Description <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> et acoustique <strong>des</strong> groupes d’<strong>occlusives</strong>,<br />
Travaux de l’Institut de Phonétique d’Aix en Provence 10, pp. 13-61.<br />
Marchal, A. & Espesser, R. (1987) L’assymétrie <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>tins, 16ièmes<br />
Journées d’Etude sur <strong>la</strong> Parole, Hammamet.<br />
Marchal, A. (1988) La pa<strong>la</strong>tographie.: Editions <strong>du</strong> C.N.R.S. Marseille<br />
Massion J. (2001) Organisation générale <strong>du</strong> geste volontaire, Journal de réadaptation<br />
médicale, 21, 1, pp. 9-18.<br />
McFar<strong>la</strong>nd, D.H., Baum, S.R (1995) Incomplète <strong>compensation</strong> to articu<strong>la</strong>tory<br />
perturbation, Journal of the Acoustical Society of America, 97(3), pp. 1865-1873.<br />
McFar<strong>la</strong>nd, D.H., Baum, S.R., Chabot, C. (1996) Speech <strong>compensation</strong> to structural<br />
modifications of the oral cavity, Journal of the Acoustical Society of America, 100 (2),<br />
pp.1093-1104.<br />
Ménard, L. Boë, L.J. & Maeda, S. (2000) Croissance <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it vocal et stratégies<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> vocalique. 23ièmes Journées d’Etude sur <strong>la</strong> Parole,<br />
Aussois, 19-23 Juin, pp. 421-425.<br />
Meynadier, Y.(2003) Interaction entre prosodie et (co)articu<strong>la</strong>tion linguopa<strong>la</strong>tale en<br />
français, Thèse de doctorat, Université de Provence.<br />
Moon, J.B. & Folkins, J.W. (1991) The effect of the auditory feedback on the regu<strong>la</strong>tion<br />
of intra oral air pressure <strong>du</strong>ring speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, Journal of the Acoustical Society of<br />
America, 90, pp. 2992-2999.<br />
Muhnall, K., Löfqvist, A. & Kelso, J.A.S. (1994) Lip-<strong>la</strong>rynx coordination in speech:<br />
Effects of mechanical perturbation on the lower lip, Journal of the Acoustical Society of<br />
America, 95, pp. 3605-3616.<br />
Nico<strong>la</strong>idis K., Hardcastle W. & Gibbon F. (1993) Bibliography of electropa<strong>la</strong>tographic<br />
studies in English, Speech Research Laboratory of University of Reading Work in<br />
Progress, 7, pp. 26-106.<br />
Nittrouer (1991) Phase re<strong>la</strong>tions of jaw and tongue tip movements in the <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of<br />
VCV utterances, Journal of Phonetics, 904/1 oct. pp. 1806-1815.<br />
Nguyen, N. & Marchal, A. (1993) Assessment of an electromagnetic system for the<br />
investigation of articu<strong>la</strong>tory movement in speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, Journal of the Acoustical<br />
Society of America, 94, pp. 1152-1155.<br />
Nguyen, N., Marchal, A., Content, A. (1996) Modelling tongue pa<strong>la</strong>te contact patterns<br />
in the <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of speech, Journal of Phonetics, 24, pp. 77-97.<br />
223
Oha<strong>la</strong>, J.J. (1983) The origin of the sound patterns in vocal tract constraints, in P.F<br />
MacNei<strong>la</strong>ge Eds. The Pro<strong>du</strong>ction of Speech, Springer-Ver<strong>la</strong>g, New-York.<br />
Oha<strong>la</strong> J.J. (2003) Effects on speech of intro<strong>du</strong>cing aerodynamics perturbation, 15ième<br />
ICPhS, Barcelone, 3-9 Août 2003, pp.2913-2916.<br />
Perkell, J. S. (1969) Physiology of speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>. Results and implications of a<br />
quantitative cineradiographic study. MIT Press, Cambridge, Mass.<br />
Perkell, J.S., Matthies, M.L., Svirsky, M.A. Jordan, M.I. (1993) Trading re<strong>la</strong>tions<br />
between tongue body raising and lip rounding in <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of the vowel /u/: a pilot<br />
“motor equivalence” study, Journal of the Acoustical Society of America 93(5), pp2948-<br />
2971.<br />
Perkell, J.S. & al. (1994) Articu<strong>la</strong>tory evidence for acoustic goals for consonants,<br />
Journal of the Acoustical Society of America 95(5).<br />
Perkell, J.S, Matthies, M.L., Svirsky, M.A. Jordan, M.I. (1995) Goal-based speech<br />
motor control: a theorical framework and some preliminary data, Journal of Phonetics,<br />
23, pp. 23-35.<br />
Perkell, J.et al. (2000) A theory of speech motor control and supporting data from<br />
speakers with normal hearing and with profound hearing loss, Journal of Phonetics, 28,<br />
pp. 233-272.<br />
Perrier, P. Loevenbruck, H., Payan, Y. (1996) Control of tongue movements in speech :<br />
the Equilibrium Point Hypothesis perspective, Journal of Phonetics n°24, pp. 53-75.<br />
Putman, A.H.B., Chelton, R.L. & Kastner, C.U. (1986) Intraoral air pressure and oral<br />
air flow under differents bleed and bite-block conditions, Journal of Speech and<br />
Hearing Research, 29, pp. 37-49.<br />
Recasens D. (1984) Timing constraints and coarticu<strong>la</strong>tion: alveolo-pa<strong>la</strong>tals and<br />
sequences of alveo<strong>la</strong>r + [j] in Cata<strong>la</strong>n. Phonetica, 41(3), pp. 125-139.<br />
Recasens D (1990) The articu<strong>la</strong>tory characteristics of pa<strong>la</strong>tal consonants. Journal of<br />
Phonetics, 18(2), pp. 267-280.<br />
Recasens D. (1991) On the <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> characteristics of apicoalveo<strong>la</strong>r taps and trills.<br />
Journal of Phonetics, 19(3-4), pp. 267-280.<br />
Recasens D. (1999) Lingual coarticu<strong>la</strong>tion, Coarticu<strong>la</strong>tion, theory and technics,<br />
Hardcastle W.J. and Hewlett N.(eds) C.U.P. pp. 80-104.<br />
Recasens D., Fontdevi<strong>la</strong> J. & Pal<strong>la</strong>rès M.D. (1995). Ve<strong>la</strong>rization degree and<br />
coarticu<strong>la</strong>tion resistance for /l/ in Cata<strong>la</strong>n and German. Journal of Phonetics, 23(1-2),<br />
pp. 37-52.<br />
224
Recasens D., Fontdevi<strong>la</strong> J., Pal<strong>la</strong>rès M.D. & So<strong>la</strong>nas A. (1993a). An<br />
electropa<strong>la</strong>tographic study of stop consonant clusters. Speech Communication, 12(4),<br />
pp. 335-355.<br />
Recasens D., Farnetani E. & Pal<strong>la</strong>rès M-D. (1993b). An electropa<strong>la</strong>tographic study of<br />
alveo<strong>la</strong>r and pa<strong>la</strong>tal consonants in Cata<strong>la</strong>n and Italian, Language and Speech, 36(2-3),<br />
pp. 213-234.<br />
Rouco A. & Recasens D. (1996) Reliability of electromagnetic midsagittal<br />
articulometry and electropa<strong>la</strong>tography data acquired simultaneously, Journal of the<br />
Acoustical Society of America, 100(5), pp. 3384-3389.<br />
Rousselot, P.J. (1901) Principes de phonétique expérimentale, vol.1, H. Welter (Eds.),<br />
Paris.<br />
Saltzman, E L. Munhall, K.G. (1989) A dynamical approach to gestural patterning in<br />
speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, Ecological Psychology, 1, pp. 333-382.<br />
Savariaux, C., Perrier. P. & Orliaguet, J.P. (1995) Compensation strategies for the<br />
perturbation of the rounded vowel [u] using a lip tube : a study of the control space in<br />
speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, Journal of the Acoustical Society of America, 98, pp. 2428-2442.<br />
Savariaux, C., Perrier. P., Orliaguet, J.P. & Schwartz, J.L. (1999) Compensation<br />
strategies for the perturbation of french [u] using a lip tube II : perceptual analysis,<br />
Journal of the Acoustical Society of America, 106(1), pp. 381-393.<br />
Shaiman, S. (2001) Kinematics of compensatory vowel shortening the effect of<br />
speaking rate and coda composition on intra- and inter-articu<strong>la</strong>tory timing, Journal of<br />
Phonetics, 29, 1, Academic Press, pp. 89-107.<br />
Schulman, R. (1989) Articu<strong>la</strong>tory dynamics of loud and normal speech, Journal of the<br />
Acoustical Society of America, 85, pp. 295-312.<br />
Simon, P. (1967) Les consonnes <strong>du</strong> français: mouvements et positions <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s à <strong>la</strong><br />
lumière de <strong>la</strong> cinéradiographie, Klincksiesk (Eds.), Paris.<br />
Sock, R. Vaxe<strong>la</strong>ire, B. (2001) Réflexions sur le timing de <strong>la</strong> quantité, Travaux de<br />
l’Institut de Phonétique de Strasbourg, n°331, pp. 89-126.<br />
Sock , R., Lofqvist, A., (1995) Some timing constraints in the <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of bi<strong>la</strong>bial<br />
stops, In Walley, A., Flege J.E (eds), Speech Pro<strong>du</strong>ction : Models and data, pp. 129-<br />
138.<br />
Stat View, Manuel de référence (1996) Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA.<br />
Stetson, R., H. (1928) Motor Phonetics. A study of speech movements in action,<br />
Oberlin, Ohio, USA.<br />
225
Stevens K., N. (1972) The Quantal Nature of Speech : Evidence from Articu<strong>la</strong>tory-<br />
Acoustic Data, in DAVID, Edward E., Jr.; DENES, Peter B. (eds), Human<br />
Communication: A Unified View, McGraw-Hill, New York, pp. 51-66.<br />
Stevens, K., N. & Blumstein (1991) Invariant cues for p<strong>la</strong>ce of articu<strong>la</strong>tion in stop<br />
consonants. In MILLER, J. L. KENT, R. D. ATAL, Bishnu S. (eds), Papers In Speech<br />
Communication: Speech Perception, pp. 281-291.<br />
Stevens, K., N. (1989) On the quantal nature of speech, Journal of Phonetics, 17, pp.3-<br />
45.<br />
Stevens, K., N., (1998) Acoustic phonetics, MIT Press, Cambridge.<br />
Stevens, K., N., (1998) The basic stop consonants: bursts and formant transitions, in<br />
Acoustic phonetics, MIT Press, Cambridge, pp. 323-327.<br />
Straka, G. (1963) La division <strong>des</strong> sons <strong>du</strong> <strong>la</strong>ngage en voyelles et consonnes peut-elle<br />
être justifiée? Travaux de linguistique et de littérature, vol., Strasbourg, pp. 17-99.<br />
Stone M. (1997) Laboratory techniques for investigating speech articu<strong>la</strong>tion, In W.<br />
Hardcastle & J. Laver (eds), The Handbook of Phonetic Sciences, Oxford: B<strong>la</strong>ckwell<br />
Publishers, pp. 11-32.<br />
Teston, B. & Galindo B. (1990a) Physiologia : un logiciel d'analyse <strong>des</strong> paramètres<br />
physiologiques de <strong>la</strong> parole. Travaux de l’Institut de Phonétique d'Aix en Provence<br />
1989-1990, pp. 197-217.<br />
Teston, B. & Galindo B. (1990b) Design and development of a workstation for speech<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> analysis. Proceedings of VERBA 90 : International conference on speech<br />
technology, Rome, pp. 400-408.<br />
Tuller, B., Harris, K. S. & Gross, B. (1979) Electromyographic study of the jaw muscles<br />
<strong>du</strong>ring speech, Status Report on Speech Research, Haskins Laboratories, 59-60, pp. 83-<br />
102.<br />
Vaxe<strong>la</strong>ire, B. (1993) Etude comparée <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variations de débit lent-rapide sur<br />
les paramètres <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s à partir de <strong>la</strong> cinéradiographie (sujets français). Thèse de<br />
Doctorat Nouveau Régime, Université <strong>des</strong> Sciences Humaines de Strasbourg.<br />
Vaxe<strong>la</strong>ire, B. (1994) Variation de geste et débit. Contribution à une base de données sur<br />
<strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole, Mesures cinéradiographiques de groupes consonantiques en<br />
français. Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg, 24, pp. 109-146.<br />
Wajskop, M. (1972) Identification <strong>des</strong> <strong>occlusives</strong> intervocaliques en français, Rapport<br />
d’activité de l’Institut de Phonétique de l’Université Libre de Bruxelles, Janvier 1972,<br />
pp. 102-111.<br />
226
Warren, D.W., Nelson, G.R. & Allen, G. (1980) Effects of increased vertical dimension<br />
on size of constriction port and fricative sound intelligibility, Journal of the Acoustical<br />
Society of America,67, pp. 1828-1831.<br />
Warren, D.W., Allen, G. & King H.A. (1984) Physiologic and perceptual effects of<br />
in<strong>du</strong>ced anterior open bite, Folia Phoniatrica, 36, pp. 164-173.<br />
Zemlin, W.R. (1981) Speech and hearing sciences, anatomy and physiology, Prentice<br />
Hall Englewood Gliffs (eds), New Jersey, pp. 247-260.<br />
Zerling, J.P. (1991) Articu<strong>la</strong>tion, coarticu<strong>la</strong>tion et contraintes: quelques points de vue<br />
d’auteurs, Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg 22, pp. 87-104.<br />
Zerling, J.P. (1993a) Tenue, invariance et <strong>compensation</strong>, aspects <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et<br />
acoustiques, Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg, 23, pp.155-176.<br />
Zerling, J.P. (1993b) Les contraintes en <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole, Travaux de l’Institut de<br />
Phonétique de Strasbourg, 23, pp.177-181.<br />
227
228
TABLE DES ILLUSTRATIONS<br />
Figure n°1.1 : Schéma simplifié de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole : de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification aux<br />
mouvements............................................................................................................ 21<br />
Figure n° 2.1: Schémas comparant les contrôles en boucle ouverte, à gauche, avec le<br />
contrôle en boucle fermée, à droite......................................................................... 47<br />
Figure n° 2.2: Schéma <strong>du</strong> modèle de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de parole par simu<strong>la</strong>tion prédictive de<br />
Lindblom et al.1977................................................................................................ 49<br />
Figure n° 3.1 : Les muscles de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, d’après Zemlin, 1981.................................... 72<br />
Figure n°3.2 : Tableau comparatif de l’amplitude d’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire <strong>des</strong><br />
consonnes françaises. De haut en bas, <strong>des</strong> plus ouvertes aux plus fermées. (d’après<br />
Bognar 1983). ......................................................................................................... 76<br />
Figure n° 5.1: Tableau de toutes les consonnes enregistrées pour notre corpus............ 90<br />
Figure n° 5.2 : Tableau <strong>des</strong> différentes épaisseurs <strong>des</strong> bite-blocks utilisés <strong>dans</strong> les étu<strong>des</strong><br />
antérieures............................................................................................................... 95<br />
Figure n° 5.3 : Tableau <strong>des</strong> intervalles inter-incisives de nos locuteurs......................... 96<br />
Figure n° 5.4 : Les trois épaisseurs de bite-blocks : de gauche à droite, <strong>des</strong> plus épais<br />
aux moins épais....................................................................................................... 96<br />
Figure n° 5.5: Un exemple d’un pa<strong>la</strong>is artificiel (modèle de Reading) moulé sur le pa<strong>la</strong>is<br />
<strong>du</strong>r, d’après Meynadier (2003). .............................................................................. 97<br />
Figure n° 5.6 : Un pa<strong>la</strong>is artificiel et sa représentation graphique à droite.En noir,nous<br />
voyons les électro<strong>des</strong> contactées pour <strong>la</strong> constriction maximale de /t/, d’après<br />
Meynadier (2003). .................................................................................................. 98<br />
Figure n° 5.7 : Illustration de différentes consonnes <strong>du</strong> français prises au moment de <strong>la</strong><br />
constriction maximale, en contexte a_a, d’après Meynadier (2003). ................... 102<br />
Figure n° 5.8 : Evolution temporelle d’une courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux sur une<br />
séquence /tat/, locuteur YM. En abscisse, le nombre de contacts et en ordonnées, le<br />
temps en secon<strong>des</strong>................................................................................................. 104<br />
Figure n° 5.9 : Un exemple de segmentation manuelle d’une séquence /dad/, locuteur<br />
BL. ........................................................................................................................ 105<br />
229
Figure n° 5.10 : Patron moyen pris au moment de <strong>la</strong> constriction maximale <strong>du</strong> /d/ de <strong>la</strong><br />
séquence /did/, locuteur YM. ................................................................................109<br />
Figure n°5.11 : Patron de <strong>la</strong> différence de contacts entre B0 et B3, au moment de <strong>la</strong><br />
constriction maximale <strong>du</strong> /d/ de <strong>la</strong> séquence /did/, locuteur BL. ..........................109<br />
Figure n° 5.12 : Patron de coarticu<strong>la</strong>tion d’un /t/ <strong>du</strong> locuteur YM. ..............................110<br />
Figure n°6.1: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur le nombre de contacts.<br />
Les barres représentent les écart-types. En abscisse, les locuteurs et les conditions<br />
d’enregistrement. En ordonnée, le nombre de contacts. .......................................116<br />
Figure n° 6.2 : Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts LP totaux <strong>du</strong> locuteur BL. Les<br />
barres représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le<br />
nombre de contacts................................................................................................117<br />
Figure n°6.3: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts LP totaux <strong>du</strong> locuteur YM. Les<br />
barres représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le<br />
nombre de contacts................................................................................................118<br />
Figure n° 6.4 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur le nombre de<br />
contacts alvéo<strong>la</strong>ires. Les barres représentent les écart-types. En abscisse, les<br />
locuteurs et les conditions d’enregistrement. En ordonnée, le nombre de contacts.<br />
...............................................................................................................................119<br />
Figure n° 6.5: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts LP alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL. Les<br />
barres représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le<br />
nombre de contacts................................................................................................120<br />
Figure n°6.6: Graphique <strong>des</strong> moyennes de contacts alvéo<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM. Les<br />
barres représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le<br />
nombre de contacts................................................................................................121<br />
Figure n° 6.7 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur le nombre de<br />
contacts postérieurs. Les barres représentent les écart-types. En abscisse, les<br />
locuteurs et les conditions d’enregistrement. En ordonnée, le nombre de contacts.<br />
...............................................................................................................................122<br />
Figure n°6.8: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts vé<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur BL. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de<br />
contacts..................................................................................................................123<br />
230
Figure n°6.9: Graphique <strong>des</strong> moyennes <strong>des</strong> contacts vé<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> locuteur YM. Les barres<br />
représentent les écart-types. En abscisse, les séquences. En ordonnée, le nombre de<br />
contacts ................................................................................................................. 124<br />
Figure n° 6.10 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /dad/, locuteur BL.<br />
.............................................................................................................................. 127<br />
Figure n° 6.11: Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tat/, locuteur BL. . 128<br />
Figure n°6.12: Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /did, locuteur BL. .. 129<br />
Figure n° 6.13: Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tit/, locuteur BL.... 130<br />
Figure n° 6.14 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /dad/, locuteur YM.<br />
.............................................................................................................................. 131<br />
Figure n° 6.15 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tat/, locuteur YM. 132<br />
Figure n° 6.16 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /d/, séquence /did/, locuteur YM.<br />
.............................................................................................................................. 133<br />
Figure n° 6.17 : Les patrons moyens de <strong>la</strong> consonne /t/, séquence /tit/, locuteur YM. 134<br />
Figure n° 7.1 : Durée de <strong>la</strong> phrase porteuse <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement.<br />
En abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée............................................... 140<br />
Figure n° 7.2 : Durée de <strong>la</strong> voyelle centrale de CVC <strong>dans</strong> les quatre conditions<br />
d’enregistrement. En abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.................. 140<br />
Figure n° 7.3 : Durée de <strong>la</strong> consonne C1 <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En<br />
abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. ................................................... 141<br />
Figure n°7.4 : La proportion de <strong>la</strong> consonne C1 ans <strong>la</strong> séquence CVC <strong>dans</strong> les quatre<br />
conditions d’enregistrement. En abscisse, les conditions. En ordonnée, le<br />
pourcentage de C1 sur CVC. ................................................................................ 141<br />
Figure n°7.5: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>des</strong><br />
consonnes. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions<br />
d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée............... 142<br />
Figure n° 7.6: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> consonnes <strong>du</strong> locuteur B. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée.... 143<br />
Figure n° 7.7: Graphe <strong>des</strong> interactions entre les variables et . En<br />
abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. ................................................... 144<br />
Figure n°7.8: Graphe <strong>des</strong> interactions entre les variables et .<br />
En abscisse, les conditions. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée............................................... 144<br />
231
Figure n°7.9: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> consonnes de YM. En abscisse, chaque<br />
séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. ...145<br />
Figure n° 7.10 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> geste<br />
de fermeture LP. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions<br />
d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. ..............146<br />
Figure n°7.11: Les <strong>du</strong>rées moyennes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale de BL. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée......................................................................................................................147<br />
Figure n° 7.12: Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> fermetures <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les<br />
séquences et en ordonnées les %...........................................................................148<br />
Figure n° 7.13 : Durées moyennes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale de YM. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée......................................................................................................................149<br />
Figure n°7.14 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> fermetures linguo-pa<strong>la</strong>tales <strong>du</strong> locuteur YM. En<br />
abscisse, les séquences et en ordonnées les %. .....................................................150<br />
Figure n°7.15: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de <strong>la</strong> tenue.<br />
En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement<br />
respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. ..........................................151<br />
Figure n° 7.16 : Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> tenues pour le locuteur BL. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée......................................................................................................................152<br />
Figure n° 7.17 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les séquences<br />
et en ordonnées les %............................................................................................153<br />
Figure n° 7.18 : Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> tenues de YM. En abscisse, chaque séquence<br />
<strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée....................154<br />
Figure n°7.19 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> tenues <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les séquences<br />
et en ordonnées les %. En abscisse, les séquences et en ordonnées les %............155<br />
Figure n° 7.20 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong><br />
maximum de contacts. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions<br />
d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. ..............156<br />
Figure n° 7.21: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> maxima pour le locuteur BL. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée......................................................................................................................157<br />
232
Figure n° 7.22 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les séquences<br />
et en ordonnées les %............................................................................................ 158<br />
Figure n° 7.23: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> maxima de YM. En abscisse, chaque séquence<br />
<strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée. .................. 159<br />
Figure n° 7.24 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> maxima <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les<br />
séquences et en ordonnées les %. ......................................................................... 160<br />
Figure n°7.25: Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée...................................................................................................................... 161<br />
Figure n°7.26 : Les <strong>du</strong>rées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les<br />
séquences et en ordonnées les %. ......................................................................... 162<br />
Figure n°7.27 : Les <strong>du</strong>rées moyennes <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée...................................................................................................................... 163<br />
Figure n° 7.28 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> occlusions <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les<br />
séquences et en ordonnées les %. ......................................................................... 164<br />
Figure n° 7.29: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée de<br />
l’ouverture LP. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions<br />
d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée............... 165<br />
Figure n°7.30 : Les <strong>du</strong>rées moyennes de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur BL. En<br />
abscisse, chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En<br />
ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée................................................................................................. 166<br />
Figure n°7.31 : Durées re<strong>la</strong>tives <strong>des</strong> ouvertures linguo-pa<strong>la</strong>tales <strong>du</strong> locuteur BL. En<br />
abscisse, les séquences et en ordonnées les %...................................................... 167<br />
Figure n° 7.32 : Les <strong>du</strong>rées moyennes de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale de YM. En<br />
abscisse, chaque séquence <strong>dans</strong> ses quatre conditions d’enregistrement. En<br />
ordonnée, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée................................................................................................. 168<br />
Figure n°7.33: Durées re<strong>la</strong>tives de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur YM. En<br />
abscisse, les séquences et en ordonnées les %...................................................... 169<br />
Figure n°8.1: Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur l’inclinaison de <strong>la</strong><br />
pente de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs<br />
conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l’indice de<br />
<strong>la</strong> pente.................................................................................................................. 176<br />
233
Figure n° 8.2 : L’amplitude <strong>des</strong> pentes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur BL. En<br />
abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement<br />
respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l’indice de <strong>la</strong> pente..........................177<br />
Figure n° 8.3 : L’amplitude <strong>des</strong> pentes de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>du</strong> locuteur Y.M.<br />
En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs conditions d’enregistrement<br />
respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l’indice de <strong>la</strong> pente..........................178<br />
Figure n° 8.4 : Graphe <strong>des</strong> interactions <strong>des</strong> effets <strong>des</strong> variables sur l’inclinaison de <strong>la</strong><br />
pente d’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tal. En abscisse, les deux locuteurs (B et L) et leurs<br />
conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En ordonnée, l’indice de<br />
<strong>la</strong> pente. .................................................................................................................179<br />
Figure n° 8.5 : Les pentes d’ouverture <strong>du</strong> locuteur BL. En abscisse, les deux locuteurs<br />
(B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En<br />
ordonnée, l‘indice de <strong>la</strong> pente. ..............................................................................180<br />
Figure n° 8.6 : Les pentes d’ouverture <strong>du</strong> locuteur YM. En abscisse, les deux locuteurs<br />
(B et L) et leurs conditions d’enregistrement respectives (b0, b1, b2 et b3). En<br />
ordonnée, l‘indice de <strong>la</strong> pente. ..............................................................................181<br />
Figure n° 8.7: La vitesse de fermeture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>des</strong> deux locuteurs. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
vitesse en nombre de contacts par ms. ..................................................................182<br />
Figure n° 8.8 : La vitesse de l’ouverture linguo-pa<strong>la</strong>tale <strong>des</strong> deux locuteurs. En abscisse,<br />
chaque séquence <strong>dans</strong> les quatre conditions d’enregistrement. En ordonnée, <strong>la</strong><br />
vitesse en nombre de contacts par ms.. .................................................................183<br />
Figure n°8.9 : Tableau récapitu<strong>la</strong>tif <strong>des</strong> résultats spatiaux et temporels <strong>du</strong> locuteur BL.<br />
...............................................................................................................................185<br />
Figure n° 8.10 : Tableau récapitu<strong>la</strong>tif <strong>des</strong> résultats spatiaux et temporels <strong>du</strong> locuteur<br />
YM. .......................................................................................................................187<br />
Figure n° 9.1 : Graphe de régression entre le centre de gravité et le taux de remplissage<br />
<strong>des</strong> contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région vé<strong>la</strong>ire. En abscisse, le taux de contacts vé<strong>la</strong>ires. En<br />
ordonnée, le centre de gravité ...............................................................................197<br />
Figure n° 9.2: Graphe de régression entre le centre de gravité et le taux de remplissage<br />
<strong>des</strong> contacts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région alvéo<strong>la</strong>ire. En abscisse, le taux de contacts alvéo<strong>la</strong>ires.<br />
En ordonnée, le centre de gravité..........................................................................198<br />
Figure n° 9.3 : Tableau <strong>des</strong> indices de coarticu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> deux locuteurs.....................204<br />
234
Figure n° 9.4: La re<strong>la</strong>tion entre degré de <strong>compensation</strong> et poids <strong>des</strong> contraintes......... 206<br />
Figure n°9.5 : Evolution <strong>du</strong> nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux à travers les trois<br />
sessions d‘enregistrement pour le locuteur BL. En abscisse, les conditions<br />
d’enregistrement. En ordonnée, les contacts maximaux....................................... 207<br />
Figure n 9.6 : Evolution <strong>du</strong> nombre de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux à travers les trois<br />
sessions d‘enregistrement pour le locuteur YM. En abscisse, les conditions<br />
d’enregistrement. En ordonnée, les contacts maximaux....................................... 208<br />
235
236
ANNEXES<br />
237
ANNEXE 1 : Tableau de recensement de quelques étu<strong>des</strong> utilisant <strong>des</strong> perturbations expérimentales.<br />
Légende : EMG = électromyographie ; EPG = éléctropa<strong>la</strong>tographie ; PIO = pression intra-orale<br />
Auteurs But Corpus<br />
Fledge,<br />
Flecher et<br />
Homiedan,<br />
1987<br />
Folkins 1981<br />
Les paramètres<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s<br />
devraient disparaître<br />
avec le BB<br />
Comment l’action<br />
d’élévation de <strong>la</strong><br />
mâchoire est<br />
répartie entre<br />
les muscles ?<br />
Re<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong><br />
synchronisation <strong>des</strong><br />
muscles et les<br />
mouvements de<br />
fermeture de <strong>la</strong><br />
mâchoire :<br />
organisation sousjacente<br />
<strong>du</strong> contrôle<br />
moteur<br />
Bite-block<br />
(BB)<br />
Méthode Résultats<br />
/s/ et /t/ résine EPG Les BB é<strong>la</strong>rgissent le chenal fricatif <strong>du</strong> /s/ et tendent<br />
<strong>dans</strong> 5.8.9.14 et<br />
à postérioriser les contacts linguo pa<strong>la</strong>taux (LP)<br />
phrases<br />
porteusesa<br />
15 mm<br />
ng<strong>la</strong>is<br />
arabe<br />
et<br />
/ip/ /Ip/<br />
/ep/ /Ap/<br />
/Qp/ /Qb/<br />
/Qm/<br />
/Qk/ /Qt/<br />
/Qi/ /pI/,<br />
ang<strong>la</strong>is<br />
EMG<br />
masseter<br />
gauche,<br />
temporal<br />
antérieur,<br />
ptérygoï<strong>des</strong><br />
médial et <strong>la</strong>téral<br />
238<br />
Le ptérygoïde médial est présent <strong>dans</strong> tous les<br />
mouvements de fermeture, le masseter et le temporalis<br />
sont présents <strong>dans</strong> les mouvements plus <strong>la</strong>rges; l’activité<br />
<strong>du</strong> ptérygoïde médial <strong>du</strong>re un peu plus longtemps. Dans<br />
un ensemble de syl<strong>la</strong>bes, les muscles restent actifs au<br />
même niveau mais les pics EMG varient. Flexibilité <strong>dans</strong><br />
l’utilisation de différentes combinaisons <strong>des</strong> muscles<br />
pour un même mouvement : structures coordinatives
Auteurs But Corpus<br />
Bite-block<br />
(BB)<br />
Folkins et Importance <strong>des</strong> /pI/ et résine<br />
Zimmerman<br />
1980<br />
mécanismes<br />
/pQ/<br />
5 et 15 mm<br />
périphériques <strong>dans</strong><br />
le contrôle <strong>des</strong><br />
isolées;<br />
mouvements<br />
locution<br />
compensatoires de<br />
lente et<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue et <strong>des</strong><br />
rapide<br />
Fowler et<br />
Turvey 1980<br />
Gay,<br />
Lindblom et<br />
Lubker, 1981<br />
lèvres<br />
Calcul <strong>du</strong> temps de<br />
réaction, réponse<br />
générative ?<br />
Mesure de <strong>la</strong><br />
perceptibilité <strong>des</strong><br />
voyelles<br />
Quelles stratégies<br />
pour pro<strong>du</strong>ire les<br />
<strong>compensation</strong>s<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s ?<br />
Des mouvements de<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue exagérés<br />
peuvent-ils <strong>la</strong>isser <strong>la</strong><br />
fonction d’aire<br />
inchangée par une<br />
équivalence<br />
acoustique ?<br />
/i E a ç u/<br />
isolées.<br />
2 groupes<br />
de<br />
locuteurs(<br />
1)sans et<br />
(2)avec<br />
temps de<br />
réaction<br />
voyelles<br />
longues<br />
<strong>du</strong><br />
Suédois<br />
/i/, /a/, /u/,<br />
/o/<br />
Bois<br />
10 et 14 mm<br />
BB 2,5 et<br />
22,5 mm<br />
Méthode Résultats<br />
EMG<br />
temporal<br />
antérieur,<br />
masseter,<br />
ptérygoï<strong>des</strong>,<br />
bursts, timing,<br />
magnitude<br />
239<br />
Pas de différence pertinente avec les BB (concernant <strong>la</strong><br />
présence <strong>des</strong> bursts, le timing, et <strong>la</strong> magnitude). Le<br />
processus neuromoteur périphérique n’est pas impliqué<br />
en simu<strong>la</strong>tion centrale. Il existe une procé<strong>du</strong>re erreurcorrection<br />
pour les <strong>compensation</strong>s <strong>la</strong>ngue/lèvres.<br />
F1 et F2 Les sujets sous l’emprise <strong>du</strong> temps sont plus affectés par<br />
les BB que les autres. Les sujets reconnaissent de 71 à<br />
90% <strong>la</strong> qualité <strong>des</strong> voyelles pro<strong>du</strong>ites avec les BB:<br />
l’intelligibilité est conservée au maximum.<br />
F1 et F2<br />
et<br />
rayons x<br />
Réorganisation de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue pour effectuer les voyelles.<br />
La <strong>compensation</strong> est au maximum sur <strong>la</strong> constriction<br />
maximale et elle est minimale quand l’aire <strong>du</strong> con<strong>du</strong>it<br />
vocal est plus <strong>la</strong>rge : <strong>compensation</strong> sélective.<br />
La cible de <strong>la</strong> voyelle est codée neurologiquement en<br />
terme de fonction d’aire re<strong>la</strong>tive au point de constriction<br />
maximale.<br />
Les différences inter-locuteurs sont obervées <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
manière de compenser. Le contrôle est sensoriel :<br />
excitation sensorielle <strong>des</strong> récepteurs lors d’une<br />
constriction, ce qui facilite l’atteinte d’une cible<br />
acoustique.
Auteurs But Corpus<br />
Geumann,<br />
Kroos et<br />
Tillman, 1999<br />
Horga Damir,<br />
2002<br />
Kelso et<br />
Tuller, 1983<br />
La parole forte est<br />
une forme de<br />
perturbation<br />
naturelle : ouverture<br />
plus grande de <strong>la</strong><br />
mâchoire.<br />
Influence <strong>des</strong> BB<br />
sur <strong>la</strong> parole<br />
continue ? Rôle de<br />
l’épaisseur <strong>des</strong> BB,<br />
de l’entraînement,<br />
de <strong>la</strong> vitesse<br />
d’élocution.<br />
Pas besoin de<br />
feedback auditif<br />
pour pro<strong>du</strong>ire une<br />
« bonne voyelle »<br />
Bite-block<br />
(BB)<br />
Méthode Résultats<br />
/s/, /S/, /l/, EMG : 4 Interaction entre Utilisation de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue pour garder <strong>la</strong> constriction<br />
/n/, /d/, /t/, électro<strong>des</strong> <strong>la</strong> hauteur de <strong>la</strong> constante lors de <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> <strong>des</strong> consonnes.<br />
allemand sur <strong>la</strong> mâchoire et <strong>la</strong> La position de <strong>la</strong> mâchoire si précise sur lesfricatives<br />
avec /a/, <strong>la</strong>ngue, 3 hauteur<br />
/e/, /i/ sur <strong>la</strong> l’apex.<br />
mâchoire<br />
de qu’il n’apparaît pas de <strong>compensation</strong><br />
Variabilité : fricative
Auteurs But Corpus<br />
Lindblom,<br />
Lubker et<br />
McAllister<br />
1977<br />
Lindblom,<br />
Lubker, Gay,<br />
1979<br />
Putman,<br />
Shelton et<br />
Kastner, 1986<br />
Bite-block<br />
(BB)<br />
Méthode Résultats<br />
La <strong>compensation</strong> est [i] et Bouts de [i] : BB seuls Les BB et <strong>la</strong> xylocaïne n’ont pas empêché le locuteur de<br />
immédiate, ni liée [ab:a] <strong>du</strong> bois 6 et puis couplés pro<strong>du</strong>ire <strong>des</strong> patrons formantiques proches <strong>des</strong> valeurs<br />
au feedback auditif à suédois 21mm pour avec xylocaïne sasn BB. Avec le BB de 21 mm et <strong>la</strong> xylocaïne :<br />
court terme, ni à<br />
[i] [ab:a] : déviation <strong>des</strong> formants qui disparaît au bout de 6<br />
l’apprentissage.<br />
25 mm pour masquage <strong>du</strong> répétitions. C’est <strong>la</strong> diminution <strong>du</strong> feedback tactile<br />
[ab :a] : feedback, puis (récepteurs tactiles) qui a un effet sur le mode de<br />
xylocaïne, puis <strong>compensation</strong>. La <strong>compensation</strong> reste possible sans<br />
les deux.<br />
F1 et F2<br />
feedback auditif ni muscu<strong>la</strong>ire.<br />
La <strong>compensation</strong> est<br />
un système<br />
instantané, pas lié au<br />
feedback auditif.<br />
Re<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong><br />
taille de l’ouverture<br />
orale et <strong>la</strong> PIO,<br />
perturbation <strong>du</strong> flux<br />
d’air oral : fuite par<br />
une plus grande<br />
ouverture.<br />
/i,u,o,a/<br />
isolées<br />
suédois<br />
/p√/ avec<br />
fuite d’air,<br />
/si/ avec<br />
BB<br />
Bouts de<br />
bois 2,5 mm<br />
pour /a, o/<br />
et 22,5mm<br />
pour /i, u/.<br />
BB résine<br />
2,4 et 6 mm<br />
F1 et F2 La déviation <strong>des</strong> formants est systématique : pas besoin<br />
d’apprentissage pour compenser. Rôle <strong>des</strong> informations<br />
tactiles <strong>dans</strong> les muqueuses mais pas <strong>du</strong> feedback auditif.<br />
La qualité de <strong>la</strong> voyelle est corrélée avec <strong>la</strong> forme <strong>du</strong><br />
Amplitude de<br />
PIO<br />
Fuite orale<br />
correspond au<br />
pic de pression<br />
mesurée<br />
Flux oral<br />
pendant les<br />
voyelles<br />
/s/ calcul de <strong>la</strong><br />
zone de<br />
constriction<br />
241<br />
con<strong>du</strong>it vocal.<br />
La PIO baisse et le flux d’air oral augmente quand <strong>la</strong><br />
fuite d’air augmente.<br />
Pendant <strong>la</strong> voyelle, le flux oral ne varie pas.<br />
Les valeurs <strong>des</strong> pressions différentielles sur /s/ varient<br />
peu.<br />
Les résultats sont en fonction <strong>des</strong> indivi<strong>du</strong>s.
Auteurs But Corpus<br />
Bite-block<br />
(BB)<br />
Méthode Résultats<br />
Savariaux, Flux d’air et /u/ Tube en RayonsX, Les variations inter-locuteurs montrent que les<br />
Perrier et ouverture<br />
plexig<strong>la</strong>sse coupes changements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s associés à l’ouverture <strong>des</strong><br />
Orliaguet en fonction <strong>des</strong><br />
20 mm de sagittales lèvres ne sont pas inhérentes à l’anatomie et <strong>la</strong><br />
1995, 1999 sujets, contexte<br />
diam + BB successives, neurophysiologie de l’appareil de parole. La compétence<br />
phonétique<br />
3,5 et 8 mm F1 et F2 <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est en fonction de l’expérience de chacun.<br />
Warren<br />
Nelson, Allen<br />
et Hall 1979<br />
Warren, Allen<br />
et Nelson,<br />
1980<br />
Warren, Allen<br />
et<br />
King<br />
1984<br />
Les performances<br />
<strong>des</strong> locuteurs sontelles<br />
altérées par les<br />
BB ?<br />
Quelles sont les<br />
conséquences <strong>du</strong> BB<br />
en conversation ?<br />
Les conséquences<br />
<strong>des</strong> BB avec et sans<br />
contrôle auditif.<br />
/s v z S/<br />
isolées,<br />
puis <strong>dans</strong><br />
phrase<br />
porteuse.<br />
/sat/ /zat/<br />
/vat/<br />
/fat/<br />
phrases<br />
porteuses<br />
/s v z S/<br />
Résine<br />
1, 3 et 6 mm<br />
Résine<br />
1, 3 et 6 mm<br />
Résine<br />
dentaire 1, 3<br />
et 6 mm<br />
Pression<br />
différentielle et<br />
flux d’air oral<br />
enregistré<br />
simultanément<br />
Pression<br />
différentielle à<br />
travers<br />
ouverture orale<br />
et flux d’air oral<br />
enregistré<br />
simultanément<br />
Pt de<br />
constriction<br />
entre <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
et pa<strong>la</strong>is,<br />
pression<br />
différentielle,<br />
flux d’air oral.<br />
242<br />
L’aire de constriction est plus <strong>la</strong>rge sur consonnes isolées<br />
qu’en phrases porteuses, plus <strong>la</strong>rge aussi pour les<br />
alvéo<strong>la</strong>ires et les non voisées.<br />
La différence d’ouverture mandibu<strong>la</strong>ire est significative<br />
entre BB et sans BB. La capacité d’adaptation serait<br />
compromise avec une plus <strong>la</strong>rge ouverture. Re<strong>la</strong>tion<br />
linéaire entre taille de l’ouverture et taux <strong>du</strong> flux d’air<br />
La dimension de l’orifice vélo-pharyngé reste constante<br />
quelque soit le BB : adaptation <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Le contrôle<br />
continu de l’environnement buccal est satisfaisant.<br />
Les locuteurs anticipent et initient une tactique de<br />
<strong>compensation</strong> structurale. Le feedback auditif est<br />
nécessaire pour <strong>la</strong> qualité mais pas pour <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong><br />
comepnsations.
ANNEXE 2 : Les <strong>du</strong>rées moyennes de <strong>la</strong> phrase porteuse, de <strong>la</strong> voyelle et de <strong>la</strong> consonne C1 <strong>dans</strong> les<br />
quatre conditions d’enregistrement.<br />
BL B0 B1 B2 B3<br />
Moy. Ecart Moy. Ecart Moy. Ecart Moy. Ecart<br />
phrase 1293,13 85,30 1304,50 44,01 1342,13 65,28 1398,50 76,60<br />
voyelle 91,13 10,30 102,25 7,76 106,38 8,98 115,00 9,38<br />
consonne 113,50 14,05 121,25 26,86 121,38 19,94 113,88 14,57<br />
c1/cvc 40,56 3,35 41,56 11,47 40,16 9,20 37,82 3,39<br />
YM B0 B1 B2 B3<br />
Moy. Ecart Moy. Ecart Moy. Ecart Moy. Ecart<br />
phrase 1264,38 45,58 1294,88 33,44 1312,50 29,31 1382,75 32,81<br />
voyelle 92,63 1,41 95,50 2,12 98,00 13,44 99,25 4,24<br />
consonne 109,13 17,68 108,63 13,44 108,13 16,26 112,25 1,41<br />
c1/cvc 40,42 4,05 40,23 2,81 39,68 2,67 39,98 0,41<br />
243
ANNEXE 3 : Tableaux <strong>des</strong> <strong>du</strong>rées moyennes de chaque phase<br />
de <strong>la</strong> consonne.<br />
♦Durées consonnes BL puis YM.<br />
Tableau de moyennes pour dc1 BL<br />
Effet : cvc * cond<br />
dad, b0<br />
dad, b1<br />
dad, b2<br />
dad, b3<br />
did, b0<br />
did, b1<br />
did, b2<br />
did, b3<br />
tat, b0<br />
tat, b1<br />
tat, b2<br />
tat, b3<br />
tit, b0<br />
tit, b1<br />
tit, b2<br />
tit, b3<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
12 104,109 17,915 5,172<br />
12 95,786 16,537 4,774<br />
12 86,557 18,415 5,316<br />
12 97,120 19,988 5,770<br />
12 135,307 20,641 5,959<br />
12 137,713 15,366 4,436<br />
12 149,537 22,899 6,610<br />
12 155,125 32,188 9,292<br />
12 128,547 15,487 4,471<br />
12 113,839 15,717 4,537<br />
12 119,021 12,292 3,549<br />
12 122,875 9,762 2,818<br />
12 144,844 19,225 5,550<br />
12 160,255 25,695 7,418<br />
12 166,620 26,886 7,761<br />
12 191,156 32,549 9,396<br />
Tableau de moyennes pour dc1 YM<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
dad, b0<br />
12 114,210 8,781 2,535<br />
dad, b1<br />
12 116,134 13,625 3,933<br />
dad, b2<br />
12 113,198 10,776 3,111<br />
dad, b3<br />
12 109,204 13,799 3,983<br />
did, b0<br />
12 135,755 16,734 4,831<br />
did, b1<br />
12 133,267 12,437 3,590<br />
did, b2<br />
12 138,096 19,300 5,571<br />
did, b3<br />
12 153,361 13,760 3,972<br />
tat, b0<br />
12 131,263 9,308 2,687<br />
tat, b1<br />
12 127,939 14,487 4,182<br />
tat, b2<br />
12 126,627 8,576 2,476<br />
tat, b3<br />
12 120,214 11,672 3,370<br />
tit, b0<br />
12 144,562 13,405 3,870<br />
tit, b1<br />
12 145,583 7,317 2,112<br />
tit, b2<br />
12 148,911 14,625 4,222<br />
tit, b3<br />
12 147,113 14,591 4,212<br />
244
♦Durée fermeture de BL<br />
Tableau de moyennes pour dinimax<br />
Effet : cvc * cond<br />
dad, b0<br />
dad, b1<br />
dad, b2<br />
dad, b3<br />
did, b0<br />
did, b1<br />
did, b2<br />
did, b3<br />
tat, b0<br />
tat, b1<br />
tat, b2<br />
tat, b3<br />
tit, b0<br />
tit, b1<br />
tit, b2<br />
tit, b3<br />
♦Durée fermeture de YM.<br />
dad, b0<br />
dad, b1<br />
dad, b2<br />
dad, b3<br />
did, b0<br />
did, b1<br />
did, b2<br />
did, b3<br />
tat, b0<br />
tat, b1<br />
tat, b2<br />
tat, b3<br />
tit, b0<br />
tit, b1<br />
tit, b2<br />
tit, b3<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
12 26,056 8,644 2,495<br />
12 29,635 12,274 3,543<br />
12 29,797 12,020 3,470<br />
12 34,967 15,356 4,433<br />
12 44,197 13,958 4,029<br />
12 56,697 13,421 3,874<br />
12 75,032 24,448 7,058<br />
12 66,823 20,558 5,935<br />
12 38,979 16,572 4,784<br />
12 36,052 10,195 2,943<br />
12 49,728 8,841 2,552<br />
12 43,969 18,473 5,333<br />
12 50,906 11,761 3,395<br />
12 59,385 20,029 5,782<br />
12 66,259 22,539 6,506<br />
12 73,374 33,181 9,578<br />
Tableau de moyennes pour dinimax<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
12 39,349 13,563 3,915<br />
12 39,113 12,894 3,722<br />
12 34,325 16,902 4,879<br />
12 20,053 13,987 4,038<br />
12 38,230 18,085 5,221<br />
12 37,039 13,035 3,763<br />
12 42,346 14,331 4,137<br />
12 52,150 17,126 4,944<br />
12 47,605 12,502 3,609<br />
12 43,918 15,789 4,558<br />
12 41,134 13,904 4,014<br />
12 32,204 10,980 3,170<br />
12 42,803 12,418 3,585<br />
12 40,119 14,751 4,258<br />
12 39,203 10,626 3,067<br />
12 35,809 17,600 5,081<br />
245
♦Durée tenue BL.<br />
Tableau de moyennes pour dtenuc1<br />
Effet : cvc * cond<br />
dad, b0<br />
dad, b1<br />
dad, b2<br />
dad, b3<br />
did, b0<br />
did, b1<br />
did, b2<br />
did, b3<br />
tat, b0<br />
tat, b1<br />
tat, b2<br />
tat, b3<br />
tit, b0<br />
tit, b1<br />
tit, b2<br />
tit, b3<br />
♦Durée tenue YM.<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
12 69,896 8,491 2,451<br />
12 62,724 11,954 3,451<br />
12 60,917 14,794 4,271<br />
12 68,208 17,945 5,180<br />
12 90,463 12,269 3,542<br />
12 89,714 17,116 4,941<br />
12 104,995 21,393 6,176<br />
12 109,984 29,445 8,500<br />
12 90,792 8,604 2,484<br />
12 75,687 14,760 4,261<br />
12 80,432 13,499 3,897<br />
12 86,604 13,423 3,875<br />
12 98,151 16,080 4,642<br />
12 95,932 15,149 4,373<br />
12 113,177 23,021 6,646<br />
12 122,542 38,113 11,002<br />
Tableau de moyennes pour dtenuc1<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
dad, b0 12 71,885 10,012 2,890<br />
dad, b1 12 71,678 8,833 2,550<br />
dad, b2 12 71,869 10,656 3,076<br />
dad, b3 12 81,492 15,260 4,405<br />
did, b0 12 88,953 10,564 3,050<br />
did, b1 12 91,559 9,060 2,615<br />
did, b2 12 92,757 17,905 5,169<br />
did, b3 12 110,456 14,035 4,052<br />
tat, b0 12 86,218 8,098 2,338<br />
tat, b1 12 84,315 9,125 2,634<br />
tat, b2 12 82,726 11,514 3,324<br />
tat, b3 12 84,790 15,048 4,344<br />
tit, b0 12 95,737 15,984 4,614<br />
tit, b1 12 102,941 9,314 2,689<br />
tit, b2 12 101,119 13,229 3,819<br />
tit, b3 12 105,494 13,051 3,767<br />
246
♦Durée maximum de contacts BL.<br />
Tableau de moyennes pour dmaxc1<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
dad, b0 12 36,583 6,651 1,920<br />
dad, b1 12 27,635 12,319 3,556<br />
dad, b2 12 27,328 10,870 3,138<br />
dad, b3 12 28,286 14,822 4,279<br />
did, b0 12 36,208 11,424 3,298<br />
did, b1 12 20,948 7,679 2,217<br />
did, b2 12 19,708 10,769 3,109<br />
did, b3 12 22,984 9,615 2,775<br />
tat, b0 12 44,281 16,761 4,839<br />
tat, b1 12 36,521 18,178 5,247<br />
tat, b2 12 26,323 12,068 3,484<br />
tat, b3 12 29,781 15,656 4,520<br />
tit, b0 12 27,875 13,824 3,991<br />
tit, b1 12 20,365 10,048 2,901<br />
tit, b2 12 21,188 10,616 3,065<br />
tit, b3 12 37,500 30,686 8,858<br />
♦Durée maximum de contacts YM.<br />
Tableau de moyennes pour dmaxc1<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
dad, b0 12 32,474 16,049 4,633<br />
dad, b1 12 32,102 10,915 3,151<br />
dad, b2 12 35,543 16,037 4,630<br />
dad, b3 12 19,998 17,537 5,063<br />
did, b0 12 35,819 16,626 4,800<br />
did, b1 12 47,468 19,760 5,704<br />
did, b2 12 41,790 18,673 5,390<br />
did, b3 12 47,629 18,125 5,232<br />
tat, b0 12 33,071 8,906 2,571<br />
tat, b1 12 34,336 10,296 2,972<br />
tat, b2 12 35,369 20,567 5,937<br />
tat, b3 12 43,459 21,631 6,244<br />
tit, b0 12 30,036 9,232 2,665<br />
tit, b1 12 53,921 18,235 5,264<br />
tit, b2 12 48,275 17,910 5,170<br />
tit, b3 12 52,826 18,774 5,420<br />
247
♦Durée occlusion BL.<br />
b0, dad<br />
b0, did<br />
b0, tat<br />
b0, tit<br />
b1, dad<br />
b1, did<br />
b1, tat<br />
b1, tit<br />
b2, dad<br />
b2, did<br />
b2, tat<br />
b2, tit<br />
b3, dad<br />
b3, did<br />
b3, tat<br />
b3, tit<br />
♦Durée occlusion YM.<br />
b0, dad<br />
b0, did<br />
b0, tat<br />
b0, tit<br />
b1, dad<br />
b1, did<br />
b1, tat<br />
b1, tit<br />
b2, dad<br />
b2, did<br />
b2, tat<br />
b2, tit<br />
b3, dad<br />
b3, did<br />
b3, tat<br />
b3, tit<br />
Nombre Moy. Dév. Std Err. Std<br />
11 68,278 9,541 2,877<br />
12 76,245 16,017 4,624<br />
12 90,682 8,381 2,419<br />
12 76,255 15,920 4,596<br />
12 59,047 12,560 3,626<br />
11 76,688 18,498 5,577<br />
12 75,339 13,659 3,943<br />
12 73,359 18,213 5,258<br />
10 41,631 19,272 6,094<br />
12 79,448 31,847 9,193<br />
12 66,667 20,141 5,814<br />
11 81,642 22,758 6,862<br />
9 64,222 18,167 6,056<br />
10 86,219 18,533 5,861<br />
10 79,375 11,154 3,527<br />
9 92,361 29,531 9,844<br />
Nombre Moy. Dév. Std Err. Std<br />
12 67,010 8,409 2,428<br />
12 73,515 8,765 2,530<br />
12 77,707 13,052 3,768<br />
12 65,580 10,655 3,076<br />
12 53,911 11,712 3,381<br />
11 72,444 13,478 4,064<br />
12 74,327 16,680 4,815<br />
12 82,274 18,878 5,450<br />
7 63,959 8,969 3,390<br />
12 76,054 17,149 4,950<br />
12 77,576 11,618 3,354<br />
12 82,488 13,316 3,844<br />
10 59,020 28,512 9,016<br />
11 93,007 13,324 4,017<br />
12 74,380 19,988 5,770<br />
12 84,768 12,945 3,737<br />
248
♦Durée ouverture BL.<br />
♦Durée ouverture YM.<br />
Tableau de moyennes pour dmaxend<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
dad, b0 12 41,469 8,700 2,511<br />
dad, b1 12 38,513 8,736 2,522<br />
dad, b2 12 29,433 9,238 2,667<br />
dad, b3 12 33,866 16,201 4,677<br />
did, b0 12 54,901 8,649 2,497<br />
did, b1 12 60,069 7,692 2,220<br />
did, b2 12 54,795 16,479 4,757<br />
did, b3 12 65,315 27,995 8,081<br />
tat, b0 12 45,287 9,138 2,638<br />
tat, b1 12 41,266 6,199 1,790<br />
tat, b2 12 42,968 7,393 2,134<br />
tat, b3 12 49,125 15,687 4,528<br />
tit, b0 12 66,064 18,773 5,419<br />
tit, b1 12 80,505 10,076 2,909<br />
tit, b2 12 79,172 10,971 3,167<br />
tit, b3 12 82,327 26,730 7,716<br />
Tableau de moyennes pour dmaxend<br />
Effet : cvc * cond<br />
Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.<br />
dad, b0 12 42,387 7,008 2,023<br />
dad, b1 12 44,918 9,153 2,642<br />
dad, b2 12 43,328 11,186 3,229<br />
dad, b3 12 69,748 29,688 8,570<br />
did, b0 12 61,707 12,847 3,708<br />
did, b1 12 48,759 9,708 2,802<br />
did, b2 12 53,963 9,641 2,783<br />
did, b3 12 54,495 11,792 3,404<br />
tat, b0 12 50,588 7,410 2,139<br />
tat, b1 12 49,686 5,017 1,448<br />
tat, b2 12 50,122 7,582 2,189<br />
tat, b3 12 44,551 9,722 2,806<br />
tit, b0 12 71,721 12,257 3,538<br />
tit, b1 12 51,544 11,173 3,225<br />
tit, b2 12 61,568 8,682 2,506<br />
tit, b3 12 56,944 9,875 2,851<br />
249
ANNEXE 4 : Les moyennes <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux<br />
♦Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de BL<br />
contacts alvéo<strong>la</strong>ires contacts vé<strong>la</strong>ires<br />
dad did tat tit dad did tat tit<br />
b0 19,58 25,00 21,50 25,58 6,50 14,33 8,50 14,50<br />
b1 13,17 23,17 18,17 22,17 3,33 10,67 7,67 11,83<br />
b2 10,42 22,25 17,00 22,17 2,58 12,67 7,67 14,00<br />
b3 8,92 21,33 13,33 22,00 1,67 10,75 7,50 14,17<br />
Contacts LP sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong><br />
pa<strong>la</strong>is<br />
dad did tat tit<br />
26,08 39,33 30,00 40,00<br />
16,42 33,83 25,83 34,00<br />
13,00 34,08 24,83 36,17<br />
10,58 31,92 20,83 36,08<br />
250
♦Les contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de YM :<br />
contacts alvéo<strong>la</strong>ires contacts vé<strong>la</strong>ires<br />
dad did tat tit dad did tat tit<br />
b0 19,00 25,83 23,67 26,42 7,17 15,67 9,33 15,58<br />
b1 18,75 27,92 26,92 28,25 7,75 16,67 10,25 16,92<br />
b2 14,17 26,42 26,00 28,17 2,83 16,00 11,00 17,33<br />
b3 13,75 27,50 27,42 28,25 2,58 16,08 12,08 19,33<br />
Contacts LP sur <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> pa<strong>la</strong>is<br />
dad did tat tit<br />
26,17 42,33 33,00 45,17<br />
26,50 44,58 37,17 45,50<br />
17,08 42,42 35,33 47,58<br />
16,17 43,58 39,42 43,25<br />
251
ANNEXE 5 : Les moyennes <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux à<br />
chaque session d’enregistrement.<br />
répétitions de dad <strong>du</strong> locuteur BL<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 25,00 3,46 26,75 1,50 26,50 1,41<br />
b1 16,75 2,12 14,75 4,79 17,75 1,41<br />
b2 13,00 4,95 10,25 3,77 15,75 3,77<br />
b3 15,00 9,19 8,50 3,11 8,25 3,54<br />
répétitions de did <strong>du</strong> locuteur BL<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 39,50 0,71 40,50 2,65 38,00 1,41<br />
b1 34,00 4,24 34,25 1,41 33,25 4,95<br />
b2 31,75 0,71 35,50 4,43 35,00 2,12<br />
b3 29,25 7,78 32,00 0,71 34,50 4,95<br />
répétitions de tat <strong>du</strong> locuteur BL<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 29,00 1,41 30,75 1,5 30,25 0,71<br />
b1 24,25 2,83 26,5 2,08 26,75 0,00<br />
b2 23,50 0,00 25,25 2,5 28,00 1,41<br />
b3 20,50 1,41 20,5 6,19 23,50 0,71<br />
252
épétitions de tit <strong>du</strong> locuteur BL<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 41,50 0,71 40 0 38,50 0,71<br />
b1 31,75 2,12 34 4,24 36,25 1,41<br />
b2 34,75 9,90 37,25 2,83 36,50 0,00<br />
b3 38,75 5,66 37,25 10,6 32,25 0,71<br />
répétitions de dad <strong>du</strong> locuteur YM<br />
de 1 à 4 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy ecart moy écart<br />
b0 25,25 3,77 27,75 0 25,50 0,00<br />
b1 25,50 3,54 27,25 2,09 25,00 0,00<br />
b2 18,00 6,36 16,75 3,59 16,50 4,24<br />
b3 16,75 12,73 15,5 3,87 16,25 4,24<br />
répétitions de did <strong>du</strong> locuteur YM<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 42,00 2,83 43,00 2,45 42,00 0,71<br />
b1 43,25 0,00 45,75 2,36 44,75 0,71<br />
b2 42,75 0,00 42,50 1,00 42,00 2,83<br />
b3 44,25 1,41 43,50 1,00 43,00 1,41<br />
253
épétitions de tat <strong>du</strong> locuteur YM<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 33,75 2,83 32,25 5,06 33,00 3,54<br />
b1 39,50 3,11 35,75 0,50 36,25 0,71<br />
b2 37,50 1,41 34,25 2,87 34,25 2,12<br />
b3 40,00 9,90 39,25 3,86 39,00 0,00<br />
répétitions de tit <strong>du</strong> locuteur YM<br />
de 1 à 4 de 5 à 8 de 9 à12<br />
moy écart moy écart moy écart<br />
b0 42,50 0,00 42,25 0,50 42,50 0,00<br />
b1 45,50 2,12 45,00 1,41 45,00 0,72<br />
b2 45,00 0,00 45,75 2,22 45,75 0,00<br />
b3 49,50 0,00 48,00 2,94 45,25 1,53<br />
254
ANNEXE 6 : Les patrons de coarticu<strong>la</strong>tion <strong>dans</strong> les quatre<br />
Locuteur BL.<br />
conditions d’enregistrement.<br />
255
Locuteur YM.<br />
256
257
ANNEXE 7 :Les mesures <strong>des</strong> pa<strong>la</strong>is <strong>des</strong> locuteurs.<br />
La prise de mesures s’est faite électrode par électrode sur un axe orthonormé (x’x ; y’y)<br />
afin de pouvoir réaliser les patrons de contacts propres à chaque locuteur.<br />
Locuteur BL<br />
258<br />
Locuteur YM<br />
x y x y<br />
e1 20 85 14 79<br />
e2 27 86 20 80<br />
e3 34 87 26 81<br />
e4 42 87 34 82<br />
e5 50 86 42 81<br />
e6 58 85 50 81<br />
e7 16 79 10 73<br />
e8 22 80 15 74<br />
e9 27 81 21 75<br />
e10 35 82 27 75<br />
e11 43 82 34 76<br />
e12 50 81 41 75<br />
e13 57 80 48 75<br />
e14 64 78 54 74<br />
e15 16 72 9 65<br />
e16 21 75 15 67<br />
e17 27 77 22 69<br />
e18 35 78 27 70<br />
e19 42 78 34 70<br />
e20 50 77 42 70<br />
e21 57 75 49 69<br />
e22 65 72 57 68
e23 15 64 9 58<br />
e24 20 69 15 61<br />
e25 27 73 22 63<br />
e26 35 75 27 66<br />
e27 43 75 35 66<br />
e28 51 73 43 64<br />
e29 58 69 50 62<br />
e30 66 63 57 61<br />
e31 11 51 6 45<br />
e32 18 59 11 49<br />
e33 25 66 20 55<br />
e34 35 67 28 58<br />
e35 44 67 36 58<br />
e36 57 64 45 56<br />
e37 63 59 53 52<br />
e38 70 49 59 49<br />
e39 10 35 6 32<br />
e40 15 42 13 38<br />
e41 24 49 18 44<br />
e42 35 52 29 49<br />
e43 46 50 36 49<br />
e44 60 47 46 47<br />
e45 65 40 54 42<br />
e46 71 36 61 37<br />
e47 5 20 5 16<br />
e48 12 22 11 23<br />
e49 22 31 17 28<br />
e50 33 35 29 34<br />
e51 46 34 39 34<br />
e52 63 32 49 31<br />
e53 69 26 56 26<br />
e54 77 19 65 21<br />
259
e55 0 0 0 0<br />
e56 8 8 9 7<br />
e57 17 13 16 14<br />
e58 31 17 28 20<br />
e59 50 17 40 19<br />
e60 64 13 52 15<br />
e61 72 6 60 8<br />
e62 84 0 68 0<br />
260
ANNEXE 8 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /d/ sans<br />
Séquence /dad/<br />
bite-block, locuteur BL.<br />
261
ANNEXE 9 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /d/ avec<br />
Séquence /dad/<br />
le B3, locuteur BL<br />
262
ANNEXE 10 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /d/<br />
Séquence /dad/.<br />
sans bite-block, locuteur YM<br />
263
ANNEXE 11 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /d/<br />
Séquence /dad/<br />
avec le B3, locuteur YM<br />
264
ANNEXE 12 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /t/ sans<br />
Séquence /tat/<br />
bite-block, locuteur BL.<br />
265
Annexe13 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /t/ avec<br />
Séquence /tat/<br />
B3, locuteur BL.<br />
266
ANNEXE 14 : Courbe de contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /t/ sans<br />
Séquence /tat/<br />
bite-block, locuteur YM.<br />
267
ANNEXE 15 : Courbe <strong>des</strong> contacts linguo-pa<strong>la</strong>taux de /t/ avec<br />
Séquence /tat/<br />
le B3, locuteur YM.<br />
268
Compensation Articu<strong>la</strong>toire <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Pro<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> Occlusives <strong>du</strong> Français.<br />
La <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole se caractérise par une organisation spatio-temporelle hautement<br />
complexe <strong>des</strong> articu<strong>la</strong>teurs. De nombreux travaux visent encore aujourd'hui à mieux<br />
comprendre <strong>la</strong> façon dont le système <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est gouverné. L'une <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> utilisables<br />
consiste à perturber de manière artificielle les mouvements <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s. Les étu<strong>des</strong> basées sur<br />
ce paradigme ont démontré que le système <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> présente une p<strong>la</strong>sticité fonctionnelle<br />
remarquable en s’adaptant rapidement à ces perturbations. Nous présentons les résultats d'une<br />
étude centrée sur <strong>la</strong> mise en relief <strong>des</strong> mouvements compensatoires de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue quand <strong>la</strong><br />
mandibule est bloquée par <strong>des</strong> bite-blocks <strong>dans</strong> une certaine position ouverte. Un corpus de 12<br />
répétitions de séquences CVC (<strong>occlusives</strong> linguo-pa<strong>la</strong>tales /t/ et /d/ et /a/, /i/) <strong>dans</strong> phrases<br />
porteuses, est enregistré avec l'électropa<strong>la</strong>tographie par deux sujets français avec et sans bite<br />
block. Les mesures sont prises sur <strong>la</strong> base d’une segmentation manuelle <strong>des</strong> évènements<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s et permettent une analyse spatiale et temporelle <strong>des</strong> mouvements linguaux. Nous<br />
avons effectivement constaté <strong>des</strong> modifications spatio-temporelles: le geste <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est<br />
modifié par <strong>la</strong> présence <strong>des</strong> bite-blocks et constitue un témoignage de <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce de<br />
stratégies de <strong>compensation</strong> <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>. Les résultats font apparaître que ces stratégies diffèrent<br />
selon le locuteur. Les <strong>compensation</strong>s sont immédiates et sélectives. Les réajustements ont lieu<br />
de suite et les variations temporelles intra-segmentales sont cachées <strong>dans</strong> le geste global de <strong>la</strong><br />
consonne. Une hiérarchie de <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> existe et semble régir <strong>la</strong> <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> de <strong>la</strong> parole :<br />
quand les contraintes de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> sont fortes, <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> est incomplète, quand elles<br />
sont faibles, <strong>la</strong> <strong>compensation</strong> tend à être complète. D'une manière générale, cette étude confirme<br />
que <strong>la</strong> variabilité <strong>articu<strong>la</strong>toire</strong> est une caractéristique inhérente au système de <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, et<br />
qu'elle lui confère <strong>la</strong> capacité de pro<strong>du</strong>ire les sons désirés <strong>dans</strong> une grande variété de situations.<br />
_____________________________________________________________________________________<br />
Articu<strong>la</strong>tory Compensation in the Pro<strong>du</strong>ction of French Stop Consonants.<br />
The <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of speech is caracterized by a hightly complex spatio-temporal organization of<br />
the articu<strong>la</strong>tors. Lot of work still aim at understand better how the articu<strong>la</strong>tory system is<br />
governed. One of method consists on perturbing artificially articu<strong>la</strong>tory movements of the<br />
<strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of speech. Studies based on this paradigm proved that the articu<strong>la</strong>tory system<br />
presents a noteworthy p<strong>la</strong>sticity fonctional to reinstate a rapid adapted response. We know,<br />
according to studies on bite blocks, that it is possible to retain the intelligibility of the<br />
consonants by pro<strong>du</strong>cing unusual configurations of the vocal tract in order to overcome the<br />
removal of the activity of an articu<strong>la</strong>tor. So, we neutralised the jaw activity by means of bite<br />
blocks in order to observe the movements of the tongue (with Reading’s EPG system). A corpus<br />
of twelve repetitions of CVC sequences, of /t/ and /d/ with /a/ or /i/ vowels was recorded with<br />
the EPG system by two French native speakers, with and without bite blocks. Measures are<br />
taken on the basis of a manual segmentation of articu<strong>la</strong>tory events, allowing a spatial and<br />
temporal analysis of the tongue movements. Therefore, spatial and temporal changes of the<br />
tongue configurations palliate the immobilization of the mandibule: <strong>du</strong>ration and amplitude of<br />
the articu<strong>la</strong>tory gesture are modified by the bite-blocks to compensate the jaw immobility.<br />
Compensations are immediate and selective. A hierarchy of <strong>compensation</strong> could exists and<br />
seems to govern the <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> of speech: strong constraints involve incomplete <strong>compensation</strong>,<br />
weak constraints allow complete <strong>compensation</strong>. The nature of the <strong>compensation</strong> seems to<br />
depend on interspeaker variability. Implications of these results for studies on motor control in<br />
speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> can be discussed. Also, results confirm that the articu<strong>la</strong>tory variability is an<br />
inherant characteristic of the speech <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong> system.<br />
Formation Doctorale : Langage et Parole Discipline : Phonétique<br />
Mots Clés : <strong>pro<strong>du</strong>ction</strong>, occlusive, <strong>compensation</strong>, électropa<strong>la</strong>tographie, contrôle moteur, gestes<br />
<strong>articu<strong>la</strong>toire</strong>s.<br />
Contact : c<strong>la</strong>iret@lpl.univ-aix.fr Laboratoire Parole et Langage, UMR 6057 CNRS, Université de<br />
Provence, 29, avenue Robert Schuman, 13621 Aix en Provence.