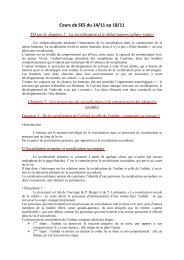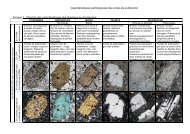De la société industrielle à la société de communication
De la société industrielle à la société de communication
De la société industrielle à la société de communication
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
H I 4 - A <strong>la</strong> recherche d’un nouvel ordre mondial,<br />
<strong>de</strong>puis les années 1970<br />
La confrontation Est-Ouest, qui semb<strong>la</strong>it s’atténuer dans les années 1970, connaît un certain regain d’activité au début<br />
<strong>de</strong>s années 1980. Ces tensions font disparaître l’ordre bipo<strong>la</strong>ire qui avait organisé le mon<strong>de</strong> pendant les quarante années<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong><br />
L’ordre bipo<strong>la</strong>ire <strong>la</strong>isse-t-il <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce au désordre ou <strong>à</strong> un nouvel ordre mondial ? Sur quelles bases un nouvel équilibre<br />
mondial peut-il être fondé ?<br />
L’équilibre bipo<strong>la</strong>ire du mon<strong>de</strong> est remis en cause dans les années 70 provoquant un retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> entre<br />
1979 et 1987 et aboutissant <strong>à</strong> l’effondrement du bloc communiste entre 1989 et 1991. <strong>De</strong>puis les années 1990, le système<br />
international doit donc être totalement repensé et réorganisé.<br />
I. La remise en cause <strong>de</strong> l’équilibre international dans les années<br />
1970<br />
Dans les années 1970, le contexte économique et politique difficile pour les <strong>de</strong>ux Grands permet l’apparition <strong>de</strong><br />
nouvelles puissances régionales.<br />
A. Un mon<strong>de</strong> perturbé par <strong>la</strong> crise économique<br />
Le système économique mondial se dérègle au début <strong>de</strong>s années 1970, avec <strong>la</strong> suspension <strong>de</strong> <strong>la</strong> convertibilité du dol<strong>la</strong>r<br />
en or (1971), puis le premier choc pétrolier (1973). Les « Trente Glorieuses » du capitalisme sont terminées (<strong>la</strong> part <strong>de</strong>s<br />
Etats-Unis dans le PNB mondial passe <strong>de</strong> 25% <strong>à</strong> 20%) mais les Etats socialistes sont aussi touchés, parce que les pays<br />
occi<strong>de</strong>ntaux réduisent leurs achats. A l’intérieur <strong>de</strong> chaque bloc, les solidarités s’affaiblissent.<br />
Mais surtout, <strong>la</strong> tension Nord-Sud semble se substituer <strong>à</strong> <strong>la</strong> confrontation Est-Ouest. En augmentant le prix du baril et<br />
en frappant d’embargo les Etats-Unis et d’autres pays, alliés d’Israël, les Etats <strong>de</strong> l’OPEP font du pétrole une arme, dans<br />
le contexte <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre du Kippour (73). Le Tiers-mon<strong>de</strong> hausse le ton et essaie <strong>de</strong> peser davantage dans les re<strong>la</strong>tions<br />
internationales.<br />
B. <strong>De</strong>s superpuissances affaiblies<br />
Ce contexte n’est guère favorable aux <strong>de</strong>ux Grands, qui contrôlent moins bien le mon<strong>de</strong>. En avril 1975, <strong>la</strong> prise <strong>de</strong><br />
Saigon par les communistes vietnamiens et <strong>de</strong> Phnom Penh par les Khmers rouges marque l’échec <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie<br />
américaine. Désormais traumatisés par leur défaite au Vietnam, les Etats-Unis sont réticents <strong>à</strong> intervenir (« no more<br />
Vietnam »). La prési<strong>de</strong>nce est affaiblie par <strong>la</strong> démission <strong>de</strong> Nixon suite au scandale du Watergate (72-74) et par l’amnistie<br />
octroyée <strong>à</strong> Nixon. Jimmy Carter, élu prési<strong>de</strong>nt en novembre 1976, prône une diplomatie moins « impériale », plus «<br />
morale » ou « angélique » pour ses détracteurs, fondée sur <strong>la</strong> défense <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme. Ainsi, les Etats-Unis<br />
réduisent leur soutien financier aux dictatures anticommunistes d’Amérique <strong>la</strong>tine et renoncent <strong>à</strong> leurs opérations secrètes<br />
(ex : coup d’Etat <strong>de</strong> Pinochet en 73 au Chili avec le soutien <strong>de</strong> <strong>la</strong> CIA). En 73, le Power Act interdit au prési<strong>de</strong>nt<br />
d’engager <strong>de</strong>s troupes sans l’accord du Congrès. Cette politique permet quelques succès comme les accords <strong>de</strong> Camp<br />
David mettant fin <strong>à</strong> <strong>la</strong> guerre entre Israël et l’Egypte ou les accords SALT II en 79.<br />
L’URSS <strong>de</strong> Brejnev, même si elle est très active dans le Tiers-mon<strong>de</strong>, voit aussi son crédit diminuer. La critique du<br />
régime soviétique par les dissi<strong>de</strong>nts (écrivain Soljenitsyne, écrits c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stins ou samizdat) touche <strong>de</strong> plus en plus<br />
l’opinion publique mondiale sans pour autant avoir beaucoup <strong>de</strong> succès en URSS. Le prix Nobel <strong>de</strong> <strong>la</strong> paix est décerné en<br />
1975 <strong>à</strong> Andreï Sakharov (physicien et dissi<strong>de</strong>nt politique, défenseur <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l’Homme). L’Acte final d’Helsinki<br />
(1975), en mettant en avant les droits <strong>de</strong> l’homme, alimente <strong>la</strong> contestation dans le bloc communiste. Celui-ci est aussi<br />
affaibli par <strong>la</strong> Chine, qui s’affirme comme une puissance autonome <strong>de</strong>puis son entrée <strong>à</strong> l’ONU en 1971. En mettant sur le<br />
même p<strong>la</strong>n les <strong>de</strong>ux Grands et en se posant en lea<strong>de</strong>r du Tiers-mon<strong>de</strong>, <strong>la</strong> Chine conteste radicalement l’ordre bipo<strong>la</strong>ire.<br />
C. Nouveaux acteurs et nouveaux conflits<br />
D’autres Etats veulent s’affirmer dans un mon<strong>de</strong> qui semble <strong>de</strong>venir multipo<strong>la</strong>ire. Ainsi, l’Irak <strong>de</strong> Saddam Hussein ou<br />
<strong>la</strong> Libye du colonel Kadhafi cherchent <strong>à</strong> se doter <strong>de</strong> l’arme atomique et <strong>à</strong> <strong>de</strong>venir les lea<strong>de</strong>rs du mon<strong>de</strong> arabe. Ces<br />
puissances régionales contribuent au développement <strong>de</strong> conflits mal maîtrisés par les <strong>de</strong>ux Grands. Le Vietnam, prorusse,<br />
réunifié envahit en décembre 1978 le Cambodge et renverse le régime <strong>de</strong>s Khmers rouges, prochinois.<br />
<strong>De</strong> nouveaux acteurs apparaissent sur <strong>la</strong> scène internationale, qui n’est plus réservée aux seuls Etats. La médiatisation<br />
<strong>de</strong>s événements, comme <strong>la</strong> guerre du Vietnam puis le drame <strong>de</strong>s boat people, fait <strong>de</strong> l’opinion publique une donnée <strong>de</strong><br />
plus en plus importante dans les re<strong>la</strong>tions internationales. Cependant, <strong>la</strong> médiatisation faible <strong>de</strong>s conflits <strong>de</strong> faible<br />
intensité réduit cette influence. Les ONG se développent, comme par exemple Mé<strong>de</strong>cins sans frontières. C’est aussi pour<br />
sensibiliser l’opinion mondiale <strong>à</strong> leur cause que les Palestiniens inventent <strong>de</strong> nouvelles formes <strong>de</strong> terrorisme comme les<br />
1/10
détournements d’avions. Alors que les idéologies sont remises en cause, les religions jouent un rôle croissant. Le pape<br />
polonais Jean-Paul II (élu en octobre 1978) veut restaurer l’influence <strong>de</strong> l’Eglise catholique dans le mon<strong>de</strong> et lutter contre<br />
l’athéisme communiste. L’is<strong>la</strong>misme trouve un modèle dans <strong>la</strong> révolution qui porte au pouvoir l’ayatol<strong>la</strong>h Khomeiny en<br />
Iran en 1979.<br />
Les difficultés <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux Grands aboutissent <strong>à</strong> une reprise en main du mon<strong>de</strong> et donc <strong>à</strong> un retour <strong>à</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>.<br />
II. 1979-1987 : La guerre fraîche ou <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> guerre froi<strong>de</strong><br />
Les années 80 voient le renouveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> puissance américaine <strong>la</strong>quelle pousse l’URSS dans un nouvel affrontement<br />
indirect sans pour autant arrêter l’effritement <strong>de</strong>s blocs.<br />
A. « America is back » (R. Reagan)<br />
Sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Carter, les Etats-Unis semblent <strong>la</strong>isser le champ libre <strong>à</strong> l’URSS, qui profite <strong>de</strong> <strong>la</strong> « détente » et<br />
du statu quo en Europe garanti par Helsinki pour soutenir les mouvements révolutionnaires dans le Tiers-mon<strong>de</strong>, comme<br />
au Salvador et au Guatema<strong>la</strong>. <strong>De</strong>s régimes socialistes s’installent en Ango<strong>la</strong> et au Mozambique en 75, en Ethiopie en 77<br />
(renversement du negus Haïle Se<strong>la</strong>ssiée) tandis que <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> coopération sont signés avec <strong>la</strong> Guinée, le Congo, le<br />
Bénin, le Mali, l’Algérie et <strong>la</strong> Libye. A <strong>la</strong> même époque, l’URSS prend position au Proche-Orient en Irak et en Syrie. En<br />
Asie, le Laos <strong>de</strong>vient communiste en 75, le Vietnam rejoint le CAEM en 1978. L’année 1979 est une année noire pour<br />
l’Amérique. La révolution is<strong>la</strong>mique en Iran provoque un <strong>de</strong>uxième choc pétrolier et entraîne une prise d’otages <strong>à</strong><br />
l’ambassa<strong>de</strong> américaine <strong>de</strong> Téhéran. Au Nicaragua, un régime marxiste soutenu par Cuba nargue les Etats-Unis. Enfin,<br />
l’Armée rouge occupe l’Afghanistan pour soutenir un régime prosoviétique en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>puis 73 mais en difficulté face <strong>à</strong><br />
l’opposition religieuse. Pour <strong>la</strong> première fois, l’URSS intervient en <strong>de</strong>hors du bloc soviétique. Entre 1975 et 1980, 100<br />
millions <strong>de</strong> personnes passent sous l’influence <strong>de</strong> l’URSS, soit autant qu’entre 1945 et 1949.<br />
Carter réagit en entamant un rattrapage militaire, en ne ratifiant pas les accords SALT II en 1979. En 1980, il décrète<br />
un embargo contre l’URSS (céréales, technologies) et en appe<strong>la</strong>nt au boycott <strong>de</strong>s Jeux olympiques <strong>de</strong> Moscou. Mais c’est<br />
le républicain Ronald Reagan, élu prési<strong>de</strong>nt en novembre 1980 (et réélu en 1984), qui incarne le retour d’une Amérique<br />
sûre d’elle-même. Il annonce que partout les Etats-Unis soutiendront les « combattants <strong>de</strong> <strong>la</strong> liberté », contre l’URSS,<br />
qualifiée d’« Empire du Mal ». Il dénonce <strong>la</strong> « stratégie oblique » <strong>de</strong> l’URSS cherchant <strong>à</strong> rompre son encerclement et <strong>à</strong><br />
couper l’approvisionnement en pétrole <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt. Sa stratégie consiste <strong>à</strong> p<strong>la</strong>cer les Etats-Unis en position <strong>de</strong> force,<br />
pour négocier ensuite avec Moscou.<br />
B. Un nouveau bras <strong>de</strong> fer entre les superpuissances<br />
Cette stratégie met un terme <strong>à</strong> <strong>la</strong> détente : il n’y a plus aucun sommet américano-soviétique entre juin 1979 (Carter -<br />
Brejnev) et novembre 1985 (Reagan – Gorbatchev). Cette politique va <strong>à</strong> l’encontre <strong>de</strong>s règles tacites <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>.<br />
La course aux armements (budget militaire <strong>de</strong>s Etats-Unis multiplié par 2) reprend, comme le montre <strong>la</strong> crise <strong>de</strong>s<br />
euromissiles. Les accords SALT I impliquaient une limitation du nombre <strong>de</strong> vecteurs intercontinentaux aussi les <strong>de</strong>ux<br />
Grands contournent-ils ces accords en développant le mirvage (plusieurs têtes nucléaires par vecteurs) et les armes <strong>à</strong> plus<br />
courte portée. En 1977, l’URSS a déployé 3 000 missiles intermédiaires SS-20 en Europe <strong>de</strong> l’Est contre 0 pour les Etats-<br />
Unis. Ceux-ci déploient, <strong>à</strong> partir <strong>de</strong> novembre 83 et après l’échec <strong>de</strong> négociations visant au retrait <strong>de</strong>s SS-20, <strong>de</strong>s missiles<br />
Pershing II et Cruise. L’IDS, annoncé par Reagan en mars 1983, est un défi <strong>la</strong>ncé <strong>à</strong> l’URSS : elle remet en cause le traité<br />
ABM (notion <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction mutuelle assurée) et surtout elle oblige l’économie soviétique <strong>à</strong> accomplir d’énormes efforts<br />
technologiques (15% du PNB dans dépenses militaires) même si les Etats-Unis <strong>de</strong>viennent l’Etat le plus en<strong>de</strong>tté du<br />
mon<strong>de</strong> <strong>à</strong> partir <strong>de</strong> 1985.<br />
Les <strong>de</strong>ux superpuissances ne respectent plus <strong>la</strong> logique <strong>de</strong>s blocs : elles n’hésitent pas <strong>à</strong> s’ingérer dans les affaires<br />
intérieures <strong>de</strong> l’autre camp. Les Soviétiques et les Cubains s’aventurent en Amérique <strong>la</strong>tine, en Afrique (20 000 soldats<br />
cubains soit ¼ <strong>de</strong> l’armée cubaine en Afrique en 79) et en Asie. Les Etats-Unis répliquent en armant <strong>la</strong> guéril<strong>la</strong><br />
antimarxiste au Nicaragua, en soutenant l’UNITA en Ango<strong>la</strong> contre le MPLA communiste, en réprimant par <strong>la</strong> force le<br />
régime socialiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Grena<strong>de</strong> (1983). Ils s’opposent <strong>à</strong> une intervention militaire <strong>de</strong> l’URSS en Pologne (1981) et<br />
financent le syndicat d’opposition Solidarnosc.<br />
La détérioration du climat international est évi<strong>de</strong>nte, quand <strong>la</strong> chasse soviétique abat un avion civil sud-coréen égaré<br />
(1983) ou quand les Etats-Unis bombar<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> Libye, proche <strong>de</strong> l’URSS et accusée <strong>de</strong> soutenir le terrorisme (1986).<br />
C. L’effritement <strong>de</strong>s blocs<br />
Mais tout ce<strong>la</strong> ne doit pas masquer les limites du système bipo<strong>la</strong>ire, déj<strong>à</strong> visibles au cours <strong>de</strong>s années 1970. Les<br />
tensions s’accentuent <strong>à</strong> l’intérieur <strong>de</strong>s blocs. L’URSS, dont les dirigeants meurent les uns après les autres (Brejnev en<br />
1982, Andropov en 1984, Tchernenko en 1985), s’enlise dans <strong>la</strong> guerre d’Afghanistan (1 million <strong>de</strong> soldats ont participé <strong>à</strong><br />
<strong>la</strong> guerre). Elle connaît son Vietnam avec <strong>la</strong> démoralisation <strong>de</strong>s soldats, l’opposition <strong>de</strong> l’opinion publique (comité <strong>de</strong>s<br />
mères <strong>de</strong> soldats), les condamnations internationales, une guéril<strong>la</strong> patriotique et religieuse. Au sein du bloc occi<strong>de</strong>ntal, <strong>la</strong><br />
concurrence économique entre les Etats-Unis, le Japon et l’Europe s’exacerbe. La guerre <strong>de</strong>s Malouines oppose en 1982<br />
2/10
<strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne, pilier <strong>de</strong> l’OTAN, et l’Argentine, le plus fidèle allié <strong>de</strong> Washington en Amérique <strong>la</strong>tine. En soutenant<br />
les Britanniques, les Etats-Unis per<strong>de</strong>nt une bonne partie <strong>de</strong> leur crédibilité sur le continent américain<br />
Certains conflits dans le Tiers-mon<strong>de</strong> échappent totalement <strong>à</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion bipo<strong>la</strong>ire. Le meilleur exemple est <strong>la</strong> guerre<br />
Iran - Irak, qui fait un million <strong>de</strong> morts entre 1980 et 1988. En effet, l’Irak est soutenu par les Occi<strong>de</strong>ntaux, cherchant <strong>à</strong><br />
protéger Israël et <strong>à</strong> se protéger contre <strong>la</strong> république is<strong>la</strong>mique iranienne, et par les Soviétiques, luttant contre l’expansion<br />
is<strong>la</strong>misme en Asie centrale et contre l’anticommunisme <strong>de</strong> l’Iran.<br />
Le retour <strong>à</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> épuise l’Union soviétique et permet <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’opposition Est-Ouest.<br />
III. La fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> (1987-1991)<br />
En cherchant <strong>à</strong> sauver l’URSS en crise, Mikhaïl Gorbatchev met fin <strong>à</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> et provoque <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong><br />
l’Union soviétique.<br />
A. Les réformes <strong>de</strong> Gorbatchev...<br />
Mikhaïl Gorbatchev, jeune dirigeant <strong>de</strong> 54 ans et premier a n’avoir pas connu <strong>la</strong> Révolution <strong>de</strong> 17, <strong>de</strong>vient secrétaire<br />
général du parti communiste en mars 1985, dans une URSS en crise. L’économie soviétique est affaiblie par les carences<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification et par <strong>la</strong> compétition militaire avec les Etats-Unis. La presse officielle dénonce <strong>la</strong> corruption, <strong>la</strong><br />
délinquance et l’alcoolisme. La majorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion vit dans une économie <strong>de</strong> pénurie. Enfin, un déca<strong>la</strong>ge profond<br />
existe entre les principes (selon <strong>la</strong> Constitution <strong>de</strong> 77, « tout le pouvoir appartient au peuple ») et <strong>la</strong> réalité (application<br />
d’un néostalinisme). L’acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> centrale nucléaire <strong>de</strong> Tchernobyl (26 avril 1986) symbolise aux yeux du mon<strong>de</strong><br />
entier l’état catastrophique du pays.<br />
Le projet <strong>de</strong> Gorbatchev est <strong>de</strong> « sauver » l’URSS en <strong>la</strong> réformant en profon<strong>de</strong>ur. Gorbatchev prétend revenir aux<br />
sources du léninisme : jusqu’<strong>à</strong> <strong>la</strong> fin, il s’est dit socialiste et a cherché <strong>à</strong> préserver le parti communiste. Mais en fait, il<br />
abandonne peu <strong>à</strong> peu tous les principes du régime soviétique. La perestroïka introduit l’économie <strong>de</strong> marché et <strong>la</strong> g<strong>la</strong>snost<br />
le multipartisme et <strong>la</strong> liberté d’expression.<br />
B. ... entraînent <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>...<br />
Pour réussir, Gorbatchev doit mettre un terme <strong>à</strong> <strong>la</strong> confrontation ruineuse avec les Etats-Unis. La « nouvelle pensée »<br />
qui règne <strong>à</strong> Moscou permet <strong>la</strong> reprise du dialogue avec Washington. Les résultats sont spectacu<strong>la</strong>ires. Le processus <strong>de</strong><br />
désarmement nucléaire est amorcé en 1987 par le traité <strong>de</strong> Washington sur les euromissiles (7 décembre). En 88, l’URSS<br />
met fin <strong>à</strong> toutes ai<strong>de</strong>s extérieures. Le pacte <strong>de</strong> Varsovie reconnaît en 1989 « le droit <strong>de</strong> chaque nation <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r librement<br />
<strong>de</strong> sa politique ». L’URSS enterre ainsi <strong>la</strong> doctrine <strong>de</strong> <strong>la</strong> « souveraineté limitée » et libère ses anciens satellites européens.<br />
La « Maison commune européenne » souhaitée par Gorbatchev <strong>de</strong>vient une réalité, avec <strong>la</strong> chute du ri<strong>de</strong>au <strong>de</strong> fer et <strong>la</strong><br />
réunification alleman<strong>de</strong> (traité 2+4 [RFA, RDA ; Etats-Unis, Royaume-Uni, France et URSS], le 3 octobre 90). Le traité<br />
<strong>de</strong> Paris <strong>de</strong> novembre 90 prévoit <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s forces conventionnelles du Pacte <strong>de</strong> Varsovie et <strong>de</strong> l’OTAN. Le pacte <strong>de</strong><br />
Varsovie et le CAEM décrètent leur dissolution en 1991. La même année, les <strong>de</strong>ux Grands signent les accords START I<br />
(juin) visant <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction d’1/3 <strong>de</strong>s arsenaux soviétique et américain. La guerre froi<strong>de</strong> est bel et bien terminée. Le<br />
nouveau prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Etats-Unis, George Bush (élu en novembre 1988), annonce en 1990 l’avènement d’un « nouvel<br />
ordre mondial ».<br />
Cette dynamique <strong>de</strong> dialogue permet le renouveau <strong>de</strong> l’ONU, puisque les <strong>de</strong>ux Grands cessent d’en bloquer le<br />
fonctionnement. <strong>De</strong> nombreux conflits régionaux sont réglés en 1988, avec <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> paix au Nicaragua, le retrait<br />
<strong>de</strong>s troupes soviétiques d’Afghanistan et <strong>de</strong>s troupes vietnamiennes du Cambodge et même <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre entre l’Irak<br />
et l’Iran. <strong>De</strong> 1988 <strong>à</strong> 1993, l’ONU a <strong>la</strong>ncé plus d’opérations que pendant les quarante années précé<strong>de</strong>ntes. Elle tente<br />
d’imposer son « droit d’ingérence humanitaire » (Kouchner). Cependant, <strong>la</strong> réussite <strong>de</strong> ces opérations nécessite l’accord<br />
<strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions.<br />
C. ... et <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong> l’URSS<br />
Mais l’URSS ne survit pas <strong>à</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>. Popu<strong>la</strong>ire en Occi<strong>de</strong>nt, Gorbatchev l’est beaucoup moins dans son propre<br />
pays, malgré ses nouvelles fonctions <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’URSS (mars 1990) et le prix Nobel <strong>de</strong> <strong>la</strong> paix en 1990. Sa politique<br />
multiplie les mécontents qui s’expriment grâce <strong>à</strong> <strong>la</strong> g<strong>la</strong>snost : les « radicaux » réc<strong>la</strong>ment l’accélération <strong>de</strong>s réformes,<br />
tandis que les « conservateurs » mobilisent les nostalgiques du système brejnévien.<br />
Mais surtout, Gorbatchev a sous-estimé le problème <strong>de</strong>s nationalités, qui paralyse les réformes. Les pays baltes<br />
proc<strong>la</strong>ment leur indépendance dès 1990. Pendant ce temps, les troubles se multiplient dans <strong>la</strong> région caucasienne, où<br />
l’Armée rouge doit s’interposer entre Arméniens et Azéris. Afin d’enrayer ces forces centrifuges, Gorbatchev propose une<br />
« nouvelle Union ». Mais pour s’opposer <strong>à</strong> celle-ci, les conservateurs tentent un putsch <strong>à</strong> Moscou en août 1991. Boris<br />
Eltsine, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> république <strong>de</strong> Russie <strong>de</strong>puis juin 91, fait échouer le coup <strong>de</strong> force et organise en décembre 1991 <strong>la</strong><br />
CEI, ce qui signifie <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> l’URSS, entérinée par <strong>la</strong> démission <strong>de</strong> Gorbatchev (25 décembre 1991).<br />
Avec <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>, l’URSS disparaît <strong>la</strong>issant le champ libre <strong>à</strong> <strong>la</strong> domination américaine.<br />
3/10
IV. <strong>De</strong>puis <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>, un mon<strong>de</strong> instable<br />
La fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> ne permet pas <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un « nouvel ordre mondial » (Brett Scrowcroft, conseiller<br />
<strong>de</strong> Bush senior, avril 90) mais plutôt d’un désordre mondial provoqué par les replis i<strong>de</strong>ntitaires qui sont <strong>à</strong> l’origine d’une<br />
multiplication <strong>de</strong>s conflits et <strong>de</strong> nouvelles menaces pesant sur les gran<strong>de</strong>s puissances.<br />
A. Les replis i<strong>de</strong>ntitaires<br />
La fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> a réveillé les i<strong>de</strong>ntités culturelles - religieuses, nationales, linguistiques - aux quatre coins <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète. La confrontation idéologique entre libéralisme et socialisme avait fait passer au second p<strong>la</strong>n ces i<strong>de</strong>ntités, qui<br />
reviennent sur le <strong>de</strong>vant <strong>de</strong> <strong>la</strong> scène et se prêtent <strong>à</strong> toutes les manipu<strong>la</strong>tions politiques. La mondialisation, avec les craintes<br />
d’uniformisation culturelle qu’elle peut susciter, a aussi favorisé ces replis i<strong>de</strong>ntitaires.<br />
Le nationalisme fait un retour spectacu<strong>la</strong>ire en Europe (pays basque, Ulster, Corse, unité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique et du<br />
Royaume-Uni). En Afrique, les ethnies constituent souvent <strong>la</strong> base <strong>de</strong> mouvements politiques qui luttent pour le pouvoir<br />
(presque un coup d’Etat par an entre 1960 et 1990), <strong>la</strong> religion peut aussi être instrumentalisée enfin les gran<strong>de</strong>s<br />
puissances y jouent souvent un rôle actif. L’is<strong>la</strong>misme, qui s’est développé <strong>de</strong>puis 1970, prétend revenir aux sources <strong>de</strong><br />
l’is<strong>la</strong>m en renversant <strong>de</strong>s régimes jugés trop éloignés <strong>de</strong> <strong>la</strong> vraie foi et trop conciliants avec l’Occi<strong>de</strong>nt. En In<strong>de</strong>, le<br />
communautarisme engendre <strong>de</strong> nombreuses violences, surtout entre hindouistes et musulmans.<br />
B. La multiplication <strong>de</strong>s conflits<br />
Ce réveil <strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntités tend <strong>à</strong> affaiblir les Etats en multipliant les tensions internes et les guerres civiles. En 2000, 68<br />
conflits ont éc<strong>la</strong>té contre une moyenne annuelle <strong>de</strong> 35 conflits <strong>de</strong>puis 1945. C’est le cas en Europe, avec l’implosion <strong>de</strong>s<br />
Etats multiethniques qu’étaient l’URSS (guerres <strong>de</strong> Tchétchénie en 94-96 et <strong>de</strong>puis 99), <strong>la</strong> Tchécoslovaquie (scission le<br />
31/12/92) et <strong>la</strong> Yougos<strong>la</strong>vie (90-95 guerre entre <strong>la</strong> Croatie, <strong>la</strong> Serbie et <strong>la</strong> Bosnie Herzégovine s’achevant avec les accords<br />
<strong>de</strong> Dayton ; 99 guerre pour le Kosovo). C’est aussi nettement visible en Afrique, dans <strong>de</strong>s Etats issus <strong>de</strong> <strong>la</strong> décolonisation,<br />
où le processus <strong>de</strong> construction nationale n’est pas encore achevé. Les conflits interethniques se sont multipliés (Sierra<br />
Leone, Libéria, Côte d’Ivoire... faisant 7,5 millions <strong>de</strong> morts <strong>de</strong>puis 45), embrasant parfois toute une région comme celle<br />
<strong>de</strong>s Grands Lacs. La lutte entre les Hutus et les Tutsis, en effet, a ensang<strong>la</strong>nté le Burundi, engendré un génoci<strong>de</strong> au<br />
Rwanda (1994), puis contribué <strong>à</strong> <strong>la</strong> déstabilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> république démocratique du Congo (ex-Zaïre), (1996-1998).<br />
La communauté internationale reste re<strong>la</strong>tivement passive face <strong>à</strong> ces guerres, pour <strong>de</strong>ux raisons. D’abord parce qu’elle<br />
peut difficilement intervenir : <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> ces conflits ont lieu <strong>à</strong> l’intérieur d’un Etat, alors que le droit international reste<br />
fondé sur <strong>la</strong> souveraineté nationale. Ensuite, parce qu’elle ne veut pas forcément agir : les gran<strong>de</strong>s puissances ne<br />
s’intéressent plus qu’aux régions jugées vitales pour leur sécurité, alors qu’au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> elles étaient<br />
obligées <strong>de</strong> maintenir partout un certain équilibre <strong>de</strong>s forces.<br />
C. <strong>De</strong> nouvelles menaces<br />
C’est souvent dans ces Etats en décomposition ou failed states (Soudan, Somalie, Afghanistan), dans les « zones<br />
grises » <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète, que les réseaux terroristes ou mafieux trouvent refuge. Ils savent utiliser les moyens mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong><br />
<strong>communication</strong>. Le narcotrafic dégage d’énormes profits qui permettent <strong>de</strong> corrompre les gouvernements, <strong>de</strong> financer les<br />
guerres, <strong>de</strong> gangrener les économies (b<strong>la</strong>nchiment <strong>de</strong> l’argent « sale »). Al Qaida est un réseau terroriste qui maîtrise les<br />
techniques <strong>de</strong> médiatisation ; il peut frapper l’Etat le plus puissant du mon<strong>de</strong>, comme l’ont montré les attentats du 11<br />
septembre 2001 contre le World Tra<strong>de</strong> Center <strong>à</strong> New York et contre le Pentagone <strong>à</strong> Washington. Certains redoutent que<br />
<strong>de</strong>s armes <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction massive (nucléaires, chimiques ou bactériologiques) et <strong>de</strong>s missiles ne tombent aux mains d’un<br />
mouvement terroriste ou d’Etats bellicistes. Ainsi, on assiste <strong>à</strong> une prolifération nucléaire en Asie : le Pakistan et l’In<strong>de</strong><br />
sont <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s puissances nucléaires en 98. Un Etat, comme <strong>la</strong> Corée du Nord, utilise d’ailleurs le chantage nucléaire<br />
pour obtenir une ai<strong>de</strong> américaine (93-94) puis pour se protéger contre une éventuelle attaque <strong>de</strong>s Etats-Unis (2003-2005).<br />
Le premier acte <strong>de</strong> terrorisme chimique est l’attentat au gaz sarin contre le métro <strong>de</strong> Tokyo perpétré en 1995 par <strong>la</strong> secte<br />
Aum. Les principales menaces, dans le mon<strong>de</strong> actuel, ne sont plus les guerres « c<strong>la</strong>ssiques » entre Etats.<br />
La disparition du mon<strong>de</strong> bipo<strong>la</strong>ire et l’échec du « nouvel ordre mondial » américain permettent l’apparition <strong>de</strong><br />
nouvelles menaces qui posent <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète d’un point <strong>de</strong> vue politique.<br />
4/10
V. Quel nouvel ordre mondial pour le XXI e siècle ?<br />
Le mon<strong>de</strong> <strong>à</strong> l’aube du XXI e siècle paraît particulièrement divisé et l’on peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière gran<strong>de</strong><br />
puissance, les Etats-Unis, va réussir <strong>à</strong> imposer sa domination ou si <strong>la</strong> direction du mon<strong>de</strong> va être partagée entre plusieurs<br />
puissances.<br />
A. Un mon<strong>de</strong> encore divisé<br />
La multiplication <strong>de</strong>s conflits locaux, le développement <strong>de</strong> nouvelles menaces comme le terrorisme ren<strong>de</strong>nt nécessaire<br />
<strong>de</strong> repenser les questions <strong>de</strong> sécurité <strong>à</strong> l’échelle mondiale. Il faut aussi é<strong>la</strong>rgir <strong>la</strong> notion même <strong>de</strong> sécurité, en prenant en<br />
compte tous les problèmes qui pèsent sur l’avenir <strong>de</strong> l’humanité. Mais pour imposer <strong>de</strong>s règles aux Etats, il faut dépasser<br />
<strong>la</strong> souveraineté nationale, qui est encore <strong>la</strong> base du droit international. Ce<strong>la</strong> n’est possible que si l’on parvient <strong>à</strong> définir <strong>de</strong>s<br />
valeurs universelles, communes <strong>à</strong> une humanité ainsi considérée comme supérieure aux Etats.<br />
Par ailleurs, <strong>la</strong> démocratie libérale est loin d’être considérée partout comme un modèle. Le marxisme inspire encore<br />
<strong>de</strong>s Etats comme Cuba et <strong>la</strong> Corée du Nord. Engagée <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 1970 dans un processus <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation,<br />
<strong>la</strong> Chine s’est ouverte aux investissements étrangers et a récupéré les enc<strong>la</strong>ves capitalistes <strong>de</strong> Hong-Kong (1997) et <strong>de</strong><br />
Macao (1999). Mais le régime est toujours aux mains du parti communiste et refuse toute ouverture politique, comme l’a<br />
montré <strong>la</strong> répression du « Printemps <strong>de</strong> Pékin » en 1989. Cette puissance nucléaire, spatiale, économique, marquée par un<br />
passé impérialiste, peut représenter une menace <strong>à</strong> <strong>la</strong> domination mondiale <strong>de</strong>s Etats-Unis.<br />
Les tensions Nord-Sud n’ont pas disparu. La domination <strong>de</strong>s pays riches sur l’économie mondiale, <strong>à</strong> travers le G7<br />
notamment, est dénoncée par les altermondialistes. Ils accusent l’OMC d’organiser <strong>la</strong> mondialisation au seul bénéfice du<br />
« club » <strong>de</strong>s pays occi<strong>de</strong>ntaux. Beaucoup d’Etats du Sud refusent d’accepter <strong>de</strong>s normes « universelles » qu’ils<br />
considèrent comme « occi<strong>de</strong>ntales ».<br />
B. Un mon<strong>de</strong> unipo<strong>la</strong>ire ou multipo<strong>la</strong>ire ?<br />
Cette méfiance <strong>à</strong> l’égard <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt, en général, se double d’une peur <strong>de</strong>s Etats-Unis, en particulier. Aucune<br />
puissance n’est capable aujourd’hui <strong>de</strong> rivaliser avec les Etats-Unis. On peut donc parler d’un mon<strong>de</strong> unipo<strong>la</strong>ire, dominé<br />
par l’hyperpuissance américaine. Le « nouvel ordre mondial » est d’ailleurs une expression inventée par George Bush<br />
(père) en 1990 pour légitimer l’intervention contre l’Irak, coupable d’avoir annexé le Koweït. Cette guerre du Golfe s’est<br />
faite en janvier 1991 avec l’accord <strong>de</strong> l’ONU et <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> nombreux Etats. Mais ce re<strong>la</strong>tif consensus s’est vite<br />
dissipé. Jusqu’en 1992, les Etats-Unis veulent rester une gran<strong>de</strong> puissance au milieu <strong>de</strong>s petites nations et cherchent <strong>à</strong><br />
observer une certaine retenue. Clinton (1991-2001) est partisan <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité collective du mon<strong>de</strong> mais sa volonté <strong>de</strong><br />
préserver les intérêts américains provoque une évolution vers un « multi<strong>la</strong>téralisme dégradé » : il intervient au Kosovo<br />
malgré l’opposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie et opte pour une politique d’en<strong>la</strong>rgement – promotion <strong>de</strong> <strong>la</strong> démocratie et<br />
<strong>de</strong> l’économie <strong>de</strong> marché. Cependant, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion américaine est réticente <strong>à</strong> ses interventions coûteuses, financièrement<br />
et humainement, ce qui pousse les Etats-Unis <strong>à</strong> utiliser leurs alliés (financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre en Irak par le Japon et les<br />
pétromonarchies ou intervention militaire au Rwanda pour <strong>la</strong> France). Les attentats du 11 septembre changent <strong>la</strong> donne.<br />
Les Américains acceptent les sacrifices pour préserver leur territoire (« America first ») en développant une puissance<br />
militaire suffisante pour lutter contre le terrorisme et les Etats voyous (« Rogue state ») dans <strong>de</strong>s guerres asymétriques<br />
(entre <strong>de</strong>s puissances <strong>de</strong> forces inégales). Les Etats-Unis sont prêts <strong>à</strong> se passer <strong>de</strong> l’ONU quand celle-ci ne veut pas<br />
autoriser leur action. L’opération militaire menée en 2003 en Irak pour renverser le régime <strong>de</strong> Saddam Hussein est un<br />
exemple <strong>de</strong> cet uni<strong>la</strong>téralisme.<br />
Beaucoup d’Etats qui se sont opposés <strong>à</strong> cette intervention souhaitent préserver le multi<strong>la</strong>téralisme et sortir l’ONU <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
crise où elle est plongée. Une fois réformée, l’ONU pourrait représenter l’humanité et faire appliquer un droit d’ingérence<br />
qui lui permettrait d’intervenir dans une guerre civile. Mais les Etats ne peuvent plus régler seuls tous les problèmes <strong>à</strong><br />
l’heure <strong>de</strong> <strong>la</strong> mondialisation. Ils doivent prendre en compte les autres acteurs <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions internationales. C’est l’idée<br />
d’une gouvernance globale, qui permettrait <strong>de</strong> régler les problèmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète d’une manière plus démocratique. Les<br />
ONG sont en effet <strong>de</strong> plus en plus étroitement associées au fonctionnement <strong>de</strong>s organisations internationales. Les<br />
organisations régionales semblent appelées <strong>à</strong> jouer un rôle croissant et l’ONU pourrait se « décentraliser » en s’appuyant<br />
dans chaque continent sur une organisation régionale qui disposerait d’une force militaire permanente, ce qui n’est pas le<br />
cas actuellement avec les Casques bleues. C’est peut-être aujourd’hui <strong>la</strong> solution <strong>la</strong> plus efficace pour assurer <strong>la</strong> paix dans<br />
une partie du mon<strong>de</strong> : l’Europe en apporte <strong>la</strong> preuve. <strong>De</strong> <strong>la</strong> même façon, l’action <strong>de</strong> l’AIEA (Agence Internationale <strong>de</strong><br />
l’Energie Atomique), dans le cadre du contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> prolifération atomique (prix Nobel <strong>de</strong> <strong>la</strong> paix en 2005), montre<br />
l’utilité d’agences spécialisées. Enfin, l’espoir d’une justice internationale, capable <strong>de</strong> traquer les criminels contre<br />
l’humanité par-<strong>de</strong>l<strong>à</strong> les frontières, s’est concrétisé avec <strong>la</strong> CPI (Cour pénale internationale) fondée en 1998 mais non<br />
ratifiée par les Etats-Unis, <strong>la</strong> Chine et les Etats du Proche-Orient.<br />
5/10
<strong>De</strong>s années 70 jusqu’<strong>à</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 80, <strong>la</strong> confrontation Est – Ouest subit <strong>de</strong>s phases d’accalmie puis <strong>de</strong> tensions<br />
qui conduisent <strong>à</strong> <strong>la</strong> disparition du bloc soviétique. Les Etats-Unis, désormais seule gran<strong>de</strong> puissance mondiale, doivent<br />
faire face <strong>à</strong> l’émergence <strong>de</strong> nouvelles menaces. Vont-ils réussir <strong>à</strong> imposer un nouvel ordre mondial, seuls ou avec le<br />
soutien <strong>de</strong> l’ONU, ou bien échouer <strong>la</strong>issant le mon<strong>de</strong> dans un désordre mondial.<br />
Les changements importants que connaissent les re<strong>la</strong>tions internationales <strong>de</strong>puis les années 70 ont donné lieu <strong>à</strong><br />
plusieurs interprétations :<br />
- Au début <strong>de</strong>s années 90, le philosophe américain Fukuyama parle d’une « fin <strong>de</strong> l’histoire » avec l’arrêt <strong>de</strong>s<br />
guerres en Occi<strong>de</strong>nt et <strong>la</strong> victoire d’une « mondialisation heureuse » et démocratique ;<br />
- Une autre vision est celle du « choc <strong>de</strong>s civilisations » <strong>de</strong> Huntington, expliquant les conflits par les différences<br />
entre les civilisations mais cette vision est trop réductrice car niant les différences internes aux civilisations ;<br />
- D’autres interprètent ces changements comme <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong> déliquescence <strong>de</strong> l’Etat ;<br />
- Enfin, certains expliquent ces changements par les inégalités nord-sud.<br />
6/10
7/10
La guerre fraîche<br />
Fiche chronologique : Les re<strong>la</strong>tions internationales<br />
du milieu <strong>de</strong>s années 70 jusqu’<strong>à</strong> nos jours.<br />
1977-1983 Crise <strong>de</strong>s euromissiles<br />
1978 décembre Intervention vietnamienne au Cambodge<br />
1979 février Révolution iranienne<br />
mars Accords <strong>de</strong> Camp David entre l’Egypte et Israël<br />
juin Accords SALT II<br />
juillet Victoire sandiniste (communiste) au Nicaragua<br />
octobre Election <strong>de</strong> Jean-Paul II<br />
décembre Invasion soviétique en Afghanistan<br />
Second choc pétrolier<br />
1980-1988 Guerre Iran-Irak<br />
1980 septembre Solidarnosc en Pologne<br />
novembre Election <strong>de</strong> R. Reagan<br />
1981 décembre Coup <strong>de</strong> force <strong>de</strong> Jaruzelski en Pologne<br />
1982 novembre Mort <strong>de</strong> Brejnev<br />
1983 mars Reagan <strong>la</strong>nce le programme « guerre <strong>de</strong>s Etoiles » ou IDS<br />
novembre Déploiement <strong>de</strong>s premiers Pershing américains en Allemagne<br />
1984 février Mort d’Andropov<br />
1985 mars Mort <strong>de</strong> Tchernenko, arrivée au pouvoir <strong>de</strong> Gorbatchev<br />
novembre Premier sommet Reagan - Gorbatchev<br />
Gorbatchev <strong>la</strong>nce <strong>la</strong> g<strong>la</strong>snost et <strong>la</strong> perestroïka<br />
1987 décembre Traité <strong>de</strong> Washington sur les euromissiles<br />
décembre Première Intifada<br />
L’effondrement <strong>de</strong>s blocs<br />
1989 février Retrait soviétique d’Afghanistan<br />
Chute <strong>de</strong>s démocraties popu<strong>la</strong>ires<br />
9 novembre Chute du mur <strong>de</strong> Berlin<br />
1990 3 octobre Réunification alleman<strong>de</strong><br />
Abolition <strong>de</strong> l’apartheid en Afrique du Sud<br />
1991 janvier Ec<strong>la</strong>tement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Yougos<strong>la</strong>vie et début <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre<br />
janvier - mars Guerre du Golfe<br />
juin - juillet Dissolution du Pacte <strong>de</strong> Varsovie et du CAEM<br />
décembre Disparition <strong>de</strong> l’URSS<br />
Le nouvel ordre mondial<br />
1992 Intervention <strong>de</strong> l’ONU en Bosnie<br />
1993 septembre Accords d’Oslo : reconnaissance mutuelle d’Israël et <strong>de</strong> l’OLP<br />
1994 mai Nelson Man<strong>de</strong><strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Afrique du Sud<br />
1995 novembre Accords <strong>de</strong> Dayton pour le retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> paix en Bosnie<br />
1996 mai Retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> droite israélienne au pouvoir<br />
1997 mai signature <strong>de</strong> l’Acte fondateur entre l’OTAN et <strong>la</strong> Russie<br />
1 er juillet Rétrocession <strong>de</strong> Hong Kong <strong>à</strong> <strong>la</strong> Chine<br />
décembre Protocole international <strong>de</strong> Kyoto sur l’environnement et le<br />
changement climatique<br />
Les talibans victorieux en Afghanistan<br />
1999 mars L’OTAN intervient militairement contre <strong>la</strong> Serbie au Kosovo<br />
mars E<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> l’OTAN <strong>à</strong> trois anciens Etats communistes<br />
(Hongrie, Pologne, République Tchèque)<br />
Novembre intervention russe en Tchétchénie<br />
31 décembre Démission <strong>de</strong> Eltsine remp<strong>la</strong>cé par Poutine<br />
2001 11 septembre Attentats aux Etats-Unis<br />
octobre Début <strong>de</strong> l’intervention en Afghanistan<br />
2002 1 er janvier Création <strong>de</strong> <strong>la</strong> monnaie unique dans <strong>la</strong> zone euro<br />
Création <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour Pénale Internationale permanente <strong>de</strong> La Haye<br />
Accords <strong>de</strong> Moscou sur le désarmement nucléaire et <strong>la</strong> nouvelle<br />
re<strong>la</strong>tion stratégique entre Etats-Unis et Russie.<br />
2003 Premier taïkonaute chinois<br />
Intervention en Irak<br />
8/10
L’is<strong>la</strong>m est une religion pratiquée par 1,2 milliards <strong>de</strong> fidèles dans le mon<strong>de</strong><br />
(20% popu<strong>la</strong>tion). Cette religion monothéiste a été fondée au VII e siècle par<br />
Mahomet en Arabie. Elle propose une vision juridique et sociale basée sur le Coran<br />
et d’autres textes fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradition (<strong>la</strong> Sunna). Les musulmans forment une<br />
communauté solidaire, l’Umma, qui transcen<strong>de</strong> les appartenances nationales,<br />
raciales, culturelles. Cependant, cette communauté <strong>de</strong>s croyants est divisée, en<br />
particulier entre sunnites et chiites.<br />
I. Aux origines : le choc <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt au<br />
XIXe s.<br />
A <strong>la</strong> fin du XIX e , <strong>la</strong> pénétration occi<strong>de</strong>ntale dans l’empire ottoman et dans le<br />
mon<strong>de</strong> musulman, suite <strong>à</strong> <strong>la</strong> colonisation provoque <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’équilibre entre<br />
l’Occi<strong>de</strong>nt et le mon<strong>de</strong> musulman. Face <strong>à</strong> cette situation, <strong>de</strong>ux réponses sont<br />
observées.<br />
ISLAM, FONDAMENTALISME, ISLAMISME<br />
A. Le fondamentalisme, réponse <strong>de</strong>s autorités<br />
religieuses traditionnelles<br />
Le fondamentalisme prône un retour aux textes fondateurs <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m qui<br />
doivent régir le comportement religieux, servir <strong>de</strong> co<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> vie sociale afin <strong>de</strong><br />
lutter contre l’Occi<strong>de</strong>nt. La <strong>société</strong> <strong>de</strong>s premiers temps <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m est considérée<br />
comme l’âge d’or. Un <strong>de</strong>s principaux objectifs du fondamentalisme est <strong>la</strong><br />
reconstitution <strong>de</strong> l’Umma. Cependant, il n’implique pas une conquête du pouvoir.<br />
Les principaux exemples du fondamentalisme sont le wahhabisme pratiquée en<br />
Arabie Saoudite <strong>de</strong>puis 1932 et le mouvement indien du Tabligh créé dans les<br />
années 20 – 30.<br />
B. Le mo<strong>de</strong>rnisme, réponse <strong>de</strong>s élites urbaines<br />
occi<strong>de</strong>ntalisées<br />
Le mo<strong>de</strong>rnisme prend trois formes différentes : <strong>la</strong> création d’Etats-nations<br />
mo<strong>de</strong>rnes (Turquie <strong>de</strong> Mustapha Kemal…) grâce <strong>à</strong> <strong>de</strong>s régimes autoritaires ; le<br />
développement d’une idéologie panarabe qui donnera naissance au mouvement<br />
Baas et au Nassérisme ; <strong>la</strong> Sa<strong>la</strong>fiya, le retour <strong>à</strong> l’unité <strong>de</strong> l’Umma, avec une<br />
perspective réformiste et mo<strong>de</strong>rniste, attitu<strong>de</strong> panis<strong>la</strong>mique.<br />
L’ouverture <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m <strong>à</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnité occi<strong>de</strong>ntale contribuera <strong>à</strong> <strong>la</strong> lutte contre<br />
l’impérialisme européen.<br />
9/10<br />
II. Le premier is<strong>la</strong>misme : une idéologie<br />
politique totalisante antiocci<strong>de</strong>ntale<br />
A. L’entre <strong>de</strong>ux-guerres : matrice idéologique <strong>de</strong><br />
l’is<strong>la</strong>misme<br />
En raison d’un contexte difficile (colonisation, suppression du califat, début <strong>de</strong><br />
transition démographique), les premiers penseurs is<strong>la</strong>mistes font leur apparition. Le<br />
premier mouvement is<strong>la</strong>miste, les Frères musulmans, fait son apparition en Egypte<br />
en 1928 sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Hassan al-Banna. Le <strong>de</strong>uxième mouvement <strong>à</strong> faire son<br />
apparition est <strong>la</strong> Jamaat-Is<strong>la</strong>mi (« <strong>société</strong> is<strong>la</strong>mique »), en 1941, en In<strong>de</strong>, visant <strong>à</strong><br />
créer un Etat autoritaire reposant sur <strong>la</strong> loi coranique. Ces mouvements se p<strong>la</strong>cent<br />
dans <strong>la</strong> continuité <strong>de</strong> <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>fiyya mais rompent avec elle en proposant une pensée<br />
politique originale faisant <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m un système idéologique global et totalisant,<br />
réunifiant le religieux et le politique.<br />
B. Les différentes stratégies pour instaurer un Etat<br />
is<strong>la</strong>mique<br />
Le premier is<strong>la</strong>misme présente différents courants en fonction <strong>de</strong> leur stratégie<br />
pour arriver au pouvoir :<br />
- is<strong>la</strong>misme sunnite modéré (Frères musulmans, Jamaat-Is<strong>la</strong>mi) : <strong>la</strong><br />
prédication et l’occupation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>société</strong> par <strong>de</strong>s mouvements socioculturels<br />
doivent amener les is<strong>la</strong>mistes au pouvoir grâce <strong>à</strong> un compromis<br />
avec les gouvernants ;<br />
- is<strong>la</strong>misme sunnite révolutionnaire (Al Takfir, Al Jihad) : après l’échec <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
stratégie <strong>de</strong> compromis, les is<strong>la</strong>mistes adoptent une stratégie<br />
révolutionnaire, légitimant le Jihad contre <strong>de</strong>s gouvernements musulmans<br />
opposés <strong>à</strong> eux (assassinat du prési<strong>de</strong>nt Sadate en 1981.<br />
- Is<strong>la</strong>misme chiite radical : mené par l’ayatol<strong>la</strong>h Khomeiny, il repose sur le<br />
primat du politique sur le religieux et sur <strong>la</strong> lutte <strong>de</strong>s opprimés contre<br />
l’Occi<strong>de</strong>nt.<br />
La répression menée contre les premiers is<strong>la</strong>mistes sunnites les pousse <strong>à</strong> se<br />
rapprocher <strong>de</strong>s fondamentalistes saoudiens. Dans les années 70, une is<strong>la</strong>misation se<br />
diffuse instituant <strong>la</strong> charia comme base juridique (Egypte en 72). Cette diffusion a<br />
lieu parmi les déçus <strong>de</strong> <strong>la</strong> décolonisation qui n’a apporté que misère et dictature.
Les mouvements is<strong>la</strong>mistes pallient les carences <strong>de</strong> l’Etat par leurs actions<br />
sociales. <strong>De</strong> plus, ces mouvements critiquent les choix <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s<br />
jeunes Etats trop inspirés <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt (<strong>la</strong>ïcité, urbanisation accélérée, hausse <strong>de</strong>s<br />
inégalités). Enfin, les échecs <strong>de</strong>s Etats arabes face <strong>à</strong> Israël sont utilisés comme<br />
preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong> ces régimes. Le 1 er février 79, <strong>la</strong> révolution iranienne<br />
permet <strong>la</strong> première réalisation <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>misme politique avec <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une<br />
« théocratie constitutionnelle ». L’ayatol<strong>la</strong>h donne les orientations politiques tandis<br />
que l’Assemblée et le prési<strong>de</strong>nt sont chargés <strong>de</strong> les appliquer. Le clergé chiite<br />
contrôle <strong>la</strong> <strong>société</strong>. Ce régime va sortir renforcer <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre contre l’Irak (80-88)<br />
qui n’a pas connu <strong>de</strong> vainqueur malgré le soutien massif <strong>de</strong>s Occi<strong>de</strong>ntaux <strong>à</strong><br />
Saddam Hussein.<br />
III. L’is<strong>la</strong>misme <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> vague : le néofondamentalisme<br />
ou jihadisme sa<strong>la</strong>fiste<br />
A. La matrice afghane<br />
Les années 80 sont marquées par l’expansion <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>misme et l’opposition<br />
entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. L’is<strong>la</strong>misme se diffuse dans les années 80<br />
bénéficiant <strong>de</strong> l’échec du panarabisme et du discrédit du modèle soviétique. La<br />
crise économique et le chômage, <strong>la</strong> corruption et l’autoritarisme politique font <strong>de</strong><br />
l’is<strong>la</strong>misme un espace <strong>de</strong> liberté pour <strong>la</strong> jeunesse <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses moyennes dont les<br />
aspirations ne sont pas possibles dans <strong>la</strong> <strong>société</strong>. <strong>De</strong>s mouvements armés se<br />
mettent en p<strong>la</strong>ce. En Afghanistan, les Moudjahiddins luttent contre les Soviétiques<br />
et l’athéisme communiste. L’Iran soutient un terrorisme international <strong>à</strong> défaut <strong>de</strong><br />
pouvoir développer une révolution mondiale is<strong>la</strong>mique.<br />
B. La radicalisation <strong>de</strong>s années 90<br />
Les années 90 voient une forte diversification <strong>de</strong>s mouvements is<strong>la</strong>mistes.<br />
Certains s’impliquent dans le domaine social en créant <strong>de</strong>s associations <strong>à</strong> but<br />
humanitaire ou éducatif. D’autres intègrent <strong>la</strong> vie politique (Les Frères musulmans<br />
en Jordanie, l’AKP en Turquie). Enfin, <strong>de</strong>s groupes ont recours <strong>à</strong> <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s<br />
violentes (Hezbol<strong>la</strong>h au Liban, Hamas et Djihad is<strong>la</strong>mique en Palestine).<br />
L’exemple <strong>de</strong> l’Algérie montre cette diversité. Le Front Is<strong>la</strong>mique du Salut (FIS)<br />
10/10<br />
remporte en 1992 les élections et prend ainsi <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du FLN, le parti au pouvoir<br />
<strong>de</strong>puis l’indépendance. Cependant, cette victoire est <strong>de</strong> courte durée puisque<br />
l’armée suspend le processus électoral marquant le début d’une guerre civile ayant<br />
causée plus <strong>de</strong> 100 000 morts.<br />
<strong>De</strong>s événements favorisent <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>misme. Ainsi, le départ <strong>de</strong>s<br />
Soviétiques d’Afghanistan (88) qui n’ont pu vaincre une résistance soutenu par<br />
l’Arabie Saoudite et <strong>la</strong> solidarité <strong>de</strong> l’Umma permet l’arrivée au pouvoir <strong>de</strong>s<br />
talibans et l’instauration d’un régime is<strong>la</strong>mique en 1996. <strong>De</strong> plus, <strong>la</strong> présence<br />
occi<strong>de</strong>ntale et surtout américaine dans <strong>la</strong> péninsule arabique, sur <strong>la</strong> terre <strong>de</strong>s lieux<br />
saints <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m suscite un fort mécontentement chez les musulmans.<br />
C’est pourquoi, un is<strong>la</strong>misme radical fait son apparition <strong>à</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 90<br />
prônant <strong>la</strong> guerre sainte contre les Occi<strong>de</strong>ntaux et contre les gouvernements arabes<br />
impies, corrompus et inféodés aux Occi<strong>de</strong>ntaux. Cet is<strong>la</strong>misme recrute ses<br />
membres dans les communautés musulmanes émigrées, déracinées, recherchant<br />
une i<strong>de</strong>ntité, subissant <strong>de</strong>s difficultés sociales et économiques. En effet, les<br />
is<strong>la</strong>mistes se présentent comme les défenseurs <strong>de</strong>s valeurs originelles <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m,<br />
s’appuyant sur les humiliations, les inégalités sociales que subissent les croyants.<br />
Pour eux, <strong>la</strong> guerre contre les infidèles est une guerre juste menant au paradis.<br />
C. Le tournant du 11 septembre 2000<br />
Le 11 septembre marque le début d’une lutte menée par les Etats-Unis contre<br />
l’is<strong>la</strong>misme. Ainsi, en 2001, les Etats-Unis soutenus par une coalition<br />
internationale renversent le gouvernement <strong>de</strong>s talibans en Afghanistan sans pour<br />
autant, toutefois, réussir <strong>à</strong> rétablir <strong>la</strong> paix dans ce pays. En 2003, <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> guerre<br />
d’Irak visait aussi <strong>à</strong> attaquer <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> terroristes is<strong>la</strong>mistes se trouvant sur le<br />
territoire irakien. Les Etats-Unis sont soutenus dans cette lutte contre le terrorisme<br />
is<strong>la</strong>miste par le mon<strong>de</strong> musulman, ce qui prouve <strong>la</strong> faiblesse, le manque <strong>de</strong> base<br />
sociale et d’appui étatique <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>misme radical. Ces difficultés <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>misme<br />
violent permettent une nationalisation <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>misme, une certaine banalisation<br />
favorisant sa participation <strong>à</strong> <strong>la</strong> vie politique. Si les partis is<strong>la</strong>mistes sont, <strong>à</strong> présent,<br />
tolérés il ne faut pas oublier que l’is<strong>la</strong>misme reste une idéologie <strong>de</strong> mobilisation<br />
contre l’Occi<strong>de</strong>nt et contre <strong>la</strong> mondialisation et qu’il est <strong>à</strong> l’origine d’une certains<br />
nombre <strong>de</strong> conflits en cours (Tchétchénie, Cachemire, Algérie, Soudan).