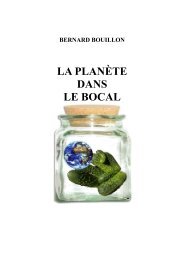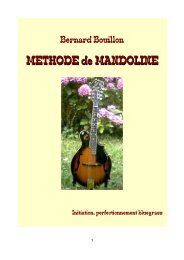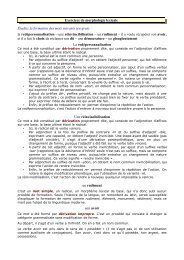LES FONCTIONS SYNTAXIQUES
LES FONCTIONS SYNTAXIQUES
LES FONCTIONS SYNTAXIQUES
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’énoncé secondaire que constitue l’apposition se trouve lié par des rapports logiques à l’énoncé premier, ce qui lui confère bien<br />
souvent une valeur circonstancielle. Cette valeur sera mise en évidence par une transformation phrastique :<br />
1) Classe grammaticale :<br />
• Parce qu'il est rusé, le renard se méfie. (subordonnée circonstancielle de cause)<br />
• Ce renard, qui était rusé, ne se méfia pourtant point. > Ce renard, bien qu'il fût rusé, ne se méfia<br />
pourtant point. (subordonnée circonstancielle de concession)<br />
C. 2 – L’APPOSITION NOMINALE<br />
Bien que ce soit une fonction adjectivale, il s'agit ici d'un constituant de type nominal, nom, groupe ou syntagme :<br />
• Le maire, un paysan du village, connaissait bien ses administrés.<br />
Les substituts habituels du syntagme nominal peuvent être apposés, sous certaines conditions. En fait, le nom propre, ne possédant a<br />
priori aucune valeur qualificative, peut rarement assumer cette fonction, de même que la plupart des pronoms :<br />
L’infinitif pose sans doute moins de problèmes :<br />
• Un seul invité, Maurice, n’avait pas apprécié la tarte à la crème.<br />
• Un seul chapeau, celui de Justine, n’était pas de couleur sombre.<br />
• Un grand regret, n’avoir jamais eu d’enfant, l’avait tourmentée toute sa vie.<br />
On notera la nécessité d’une tournure d’insistance pour que ces éléments puissent être apposés.<br />
Peut-on dans certains cas analyser des conjonctives pures comme apposées ?<br />
• Il n’avait qu’une crainte : qu’on puisse percer son secret.<br />
La subordonnée présente-t-elle vraiment une co-référence avec le nom crainte, ou ne s’agit-il pas plutôt de la crainte de…, c'est-à-dire<br />
d’un complément du nom, mis en relief ?<br />
2) Aspects morphologiques :<br />
Un nom ou syntagme apposé ne portera le genre et le nombre du nom recteur que s'il y a consubstantialité, identité complète, comme<br />
pour l'attribut ; ceci exclut les accords dans les cas d'apposition métaphorique (fréquente en poésie) :<br />
3) Aspects distributionnels :<br />
• Les yeux, miroir de l’âme selon les poètes,…<br />
L’apposition se place dans le cadre du syntagme nominal.<br />
Un élément nominal apposé se situe généralement dans le contexte droit immédiat du nom recteur, détaché par une ponctuation faible :<br />
virgules, parenthèses ou deux points. Les risques de confusion interdisent à un syntagme complet d’être antéposé, ce qui entraînerait<br />
une inversion des fonctions. Un groupe nominal, non déterminé donc, peut être antéposé à un sujet :<br />
• Ancien paysan, le maire du village connaissait bien ses administrés.<br />
Un syntagme apposé peut se trouver plus loin dans la phrase :<br />
• Notre oncle a encore eu, le pauvre, un accident de voiture.<br />
On trouve apparemment des cas d'appositions sans pause, sur lesquels il faut s’interroger :<br />
• Le roi Henri IV<br />
• Mon ami le cordonnier<br />
L’apposition a en principe pour rôle d’apporter une caractérisation : on peut se demander si c’est celui de mon ami, ou du syntagme le<br />
cordonnier.<br />
D’autre part, l’apposition possède bien des points communs avec l’attribut ; or, il existe des cas de noms propres attributs, avec un<br />
pronom personnel nécessairement sujet, le nom propre servant à indiquer l’identité du sujet :<br />
• Je suis Patrick Dupont.<br />
Il est donc difficile de trancher : l’apposition est-elle le roi, ou Henri IV ?<br />
On trouve de la même façon des appositions indirectes, reliées au nom par de, qui ne joue plus son rôle de préposition ; en particulier<br />
en géographie, avec un nom propre :<br />
• La ville de Paris<br />
• Notre beau pays de France<br />
Si notre beau pays semble bien apporter une caractérisation à France, et peut être analysé comme apposition antéposée, on ne peut en<br />
dire autant de la ville, dont le nom propre donne l’identité. Le débat reste donc ouvert.<br />
30