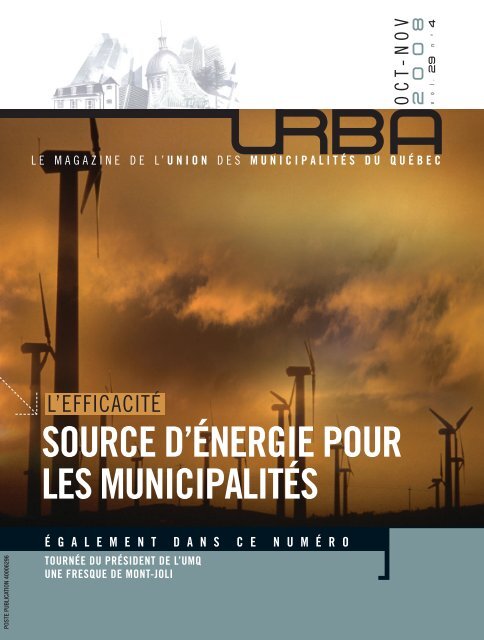Octobre/Novembre 2008 - Union des municipalités du Québec
Octobre/Novembre 2008 - Union des municipalités du Québec
Octobre/Novembre 2008 - Union des municipalités du Québec
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
POSTE PUBLICATION 40006296<br />
TOURNÉE DU PRÉSIDENT DE L’UMQ<br />
UNE FRESQUE DE MONT-JOLI<br />
OCT-NOV<br />
2 0 0 8<br />
URBA<br />
LE MAGAZINE DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC<br />
L’EFFICACITÉ<br />
SOURCE D’ÉNERGIE POUR<br />
LES MUNICIPALITÉS<br />
[É G A L E M E N T D A N S C E N U M É R O<br />
29 4<br />
v o l . n o
4/6 URBA<br />
URBA EST UNE PUBLICATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC<br />
Les avis de changement d’adresse<br />
doivent être envoyés à :<br />
<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
680, rue sherbrooke Ouest,<br />
bureau 680<br />
Montréal (<strong>Québec</strong>) H3A 2M7<br />
Téléphone : (514) 282-7700<br />
Télécopieur : (514) 282-8893<br />
Dépôt légal : Bibliothèque nationale <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.<br />
Bibliothèque nationale <strong>du</strong> Canada.<br />
ISSN 1490-2427<br />
PUBLIÉE SIX FOIS PAR ANNÉE<br />
ET RÉALISÉE PAR SA DIRECTION DES COMMUNICATIONS<br />
SOMMAIRE<br />
P] 18 L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE<br />
L’expression est sur toutes les lèvres,<br />
les <strong>municipalités</strong> en sont interpellées,<br />
l’heure est à l’efficacité énergétique.<br />
LE MAGAZINE<br />
DE L’ UNION<br />
DES MUNICIPALITÉS<br />
DU QUÉBEC<br />
À travers la complexité de l’enjeu et la multitude<br />
<strong>des</strong> acteurs impliqués, un objectif prend<br />
lentement les devants de la parade: la cohésion.<br />
Un dossier à lire en page 18 à 30<br />
PRÉSIDENT<br />
DE L’UMQ<br />
Robert Coulombe<br />
DIRECTRICE GÉNÉRALE<br />
Peggy Bachman<br />
RÉDACTRICE<br />
EN CHEF<br />
Mélanie Destrempes<br />
RÉDACTION<br />
Dominique Bulan<br />
Yves Gagnon<br />
Amélie Guilbault<br />
Eva Lotta Schmidt<br />
Josée Maryse Sauvageau<br />
PHOTO DE LA<br />
COUVERTURE<br />
Megapress/Bilderberg<br />
DESIGN GRAPHIQUE<br />
www.bertuch.ca<br />
TIRAGE<br />
7300<br />
IMPRESSION<br />
Communimedia<br />
DISTRIBUTION<br />
Traitement postal Express<br />
PUBLICITÉ<br />
Louis Blackburn<br />
(514) 282-7700 poste 232<br />
lblackburn@umq.qc.ca<br />
La repro<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> textes et photos est autorisée avec mention de la<br />
source. Des frais de photocopie et de manutention sont facturés aux<br />
non membres. Abonnement : 50 $ + taxes = 56,44 $. URBA n’est pas<br />
responsable <strong>des</strong> erreurs de contenu de la chronique juridique. Les<br />
pro<strong>du</strong>its, métho<strong>des</strong> et services annoncés sous forme publicitaire dans<br />
URBA ne sont en aucune façon approuvés, recommandés, ni garantis<br />
par l’UMQ. De plus, URBA se réserve le droit de refuser toute publicité,<br />
sans explication. Les dénominations d’indivi<strong>du</strong>s englobent le féminin et le<br />
masculin dans le seul but d’alléger la présentation de cette publication.<br />
MOT DU PRÉSIDENT<br />
P] 04 La Tournée <strong>du</strong> Président<br />
à l’heure <strong>des</strong> choix<br />
TOURNÉE DU PRÉSIDENT<br />
P] 06 Sur la route <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
ACTUALITÉ<br />
P] 10 Journée de la ruralité <strong>2008</strong><br />
P] 14 Amorce de décentralisation<br />
TOUR DE VILLE<br />
P] 32 Mont-Joli, de fresque<br />
en fresque<br />
GESTION MUNICIPALE<br />
P] 36 Les indicateurs de gestion<br />
en ressources humaines<br />
LA CHRONIQUE<br />
ENTREPRENARIAT<br />
P] 40 Ce que les riches savent que<br />
les pauvres ne savent pas
MOT DU PRÉSIDENT URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]4<br />
Depuis le 18 septembre dernier, je sillonne le <strong>Québec</strong><br />
dans le cadre de ma tournée <strong>des</strong> régions sur le thème:<br />
L’occupation dynamique <strong>du</strong> territoire rural et urbain :<br />
tout le monde y gagne!<br />
Pour moi, l’occupation dynamique <strong>du</strong> territoire, c’est<br />
plus qu’un concept. Cela signifie, d’abord et avant tout,<br />
de permettre aux gens, qu’ils soient jeunes ou moins<br />
jeunes, d’habiter le territoire. De leur permettre de<br />
demeurer dans leur milieu de vie et d’y développer leur<br />
plein potentiel. Pour cela, les <strong>municipalités</strong> doivent être<br />
en mesure d’assurer la vitalité économique et sociale de<br />
leur milieu, d’offrir <strong>des</strong> infrastructures modernes et de<br />
bénéficier de la richesse engendrée par l’activité économique<br />
créée.<br />
La Tournée revêt une importance particulière à mes yeux,<br />
car elle se réalise dans un contexte préélectoral à tous<br />
les niveaux de gouvernement. C’est donc une occasion<br />
unique d’échanger sur les enjeux nationaux, régionaux et<br />
locaux qui nous interpellent et sur les moyens pour nous<br />
de participer, dans le cadre d’un véritable partenariat<br />
économique avec les deux autres ordres de gouvernement,<br />
à la prospérité <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et <strong>du</strong> Canada.<br />
La Tournée <strong>du</strong> Président<br />
À L’HEURE DES CHOIX<br />
D’ailleurs, le conseil d’administration de l’UMQ a résolu unanimement d’interpeller les<br />
chefs de parti de la scène fédérale sur les enjeux suivants: la diversification <strong>des</strong> sources<br />
de revenus municipaux et la création d’une source de revenus stable et permanente<br />
pour les infrastructures ; le transport collectif et les changements climatiques ; le<br />
financement de la culture et <strong>des</strong> organismes de développement économique à but non<br />
lucratif et les investissements dans le logement.<br />
L’<strong>Union</strong> poursuivra ses représentations auprès <strong>du</strong> nouveau gouvernement canadien<br />
conservateur, réélu le 14 octobre dernier. Aussi, à l’aube d’une campagne électorale<br />
provinciale, l’<strong>Union</strong> entend bien être proactive et de mettre à l’ordre <strong>du</strong> jour <strong>des</strong> partis<br />
provinciaux les priorités <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> et notamment la question de la diversification<br />
<strong>des</strong> sources de revenus municipaux.<br />
En lien direct avec le thème de la Tournée, l’UMQ croit en la nécessité d’un meilleur<br />
partage de la richesse et d’une diversification <strong>des</strong> sources de revenus pour l’ensemble<br />
<strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> québécoises.<br />
Selon une étude récente réalisée pour le compte de la Fédération canadienne <strong>des</strong><br />
<strong>municipalités</strong>, pour chaque dollar investi dans les infrastructures, et financé en parts<br />
égales entre les trois paliers de gouvernements, <strong>Québec</strong> et Ottawa se partagent 35 cents<br />
en retours fiscaux directs, alors que les <strong>municipalités</strong> reçoivent 0 cent. Nous demandons<br />
que les <strong>municipalités</strong> bénéficient désormais <strong>du</strong> tiers de ces retours fiscaux. Cela pourrait<br />
prendre plusieurs formes et l’UMQ est prête à faire <strong>des</strong> propositions intéressantes qui<br />
répondraient au besoin <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> de plus d’autonomie et d’une diversification<br />
de leurs sources de revenus.<br />
Aujourd’hui, l’<strong>Union</strong> souhaite un véritable partenariat économique avec les gouvernements<br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et <strong>du</strong> Canada. Il s’agit d’une condition essentielle pour que les<br />
<strong>municipalités</strong> participent pleinement à la prospérité économique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, en assurant<br />
<strong>des</strong> services publics de qualité. Pour y arriver, elles doivent se doter d’infrastructures<br />
performantes, tout en respectant la capacité de payer <strong>du</strong> citoyen.<br />
Au plaisir de vous voir bientôt à Chute-aux-Outar<strong>des</strong>, Roberval, La Sarre, Val-<strong>des</strong>-Monts,<br />
Chibougamau, Bécancour, Lac-Etchemin, Kirkland, Rivière-Rouge, Louiseville et Laval.<br />
Le président,<br />
ROBERT COULOMBE<br />
MAIRE DE MANIWAKI
DMR.CA<br />
ELLE CONTRIBUE À<br />
L’AMÉLIORATION DE<br />
LA PERFORMANCE<br />
DES MUNICIPALITÉS.<br />
Nicole Senay – Directrice <strong>du</strong> développement<br />
<strong>des</strong> affaires, secteur municipal<br />
Leader en géomatique, notre équipe de<br />
spécialistes aide les <strong>municipalités</strong> à optimiser<br />
la gestion de leur territoire.<br />
Que ce soit pour administrer <strong>des</strong> propriétés<br />
foncières ou un territoire, pour gérer <strong>des</strong><br />
ressources naturelles, <strong>des</strong> réseaux ou <strong>des</strong><br />
services, ou encore pour connaître les habitu<strong>des</strong><br />
d’une clientèle répartie sur un vaste territoire,<br />
nos experts en géomatique mettent leurs<br />
connaissances à votre service.<br />
VOUS AVEZ UN PROJET?<br />
NOUS AVONS L’ÉQUIPE.<br />
INTÉGRATEUR-CONSEIL<br />
Affaires et TI
Le président de l’UMQ<br />
À LA RENCONTRE DES<br />
INTERVENANTS MUNICIPAUX<br />
De septembre à janvier, Robert Coulombe<br />
visitera l’ensemble <strong>des</strong> régions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
Le président de l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et maire de Maniwaki, M. Robert<br />
Coulombe, a donné le coup d’envoi à la «Tournée bisannuelle <strong>du</strong> président de l’UMQ»,<br />
le 18 septembre dernier, à Mont-Joli.<br />
Il s’agissait d’un premier arrêt d’une série de 18 dans <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> de toutes<br />
les régions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Cette année, Robert Coulombe visitera <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> se<br />
trouvant hors <strong>des</strong> circuits habituels, ce qui donne toute sa pertinence au thème de sa<br />
tournée: L’occupation dynamique <strong>du</strong> territoire rural et urbain: tout le monde y gagne !<br />
Depuis son lancement à Mont-Joli, la Tournée a fait <strong>du</strong> chemin, s’arrêtant à <strong>Québec</strong><br />
le 24 septembre, à Varennes le 30 septembre, à Farnham le 1 er octobre, à Lac-<br />
Mégantic le 22 octobre et à Percé le 29 octobre.<br />
En plus de représenter un moment privilégié pour rencontrer les élus, les acteurs<br />
socio-économiques <strong>des</strong> régions et les membres <strong>des</strong> caucus régionaux de l’<strong>Union</strong>,<br />
cette tournée est l’occasion pour le président d’aborder les dossiers prioritaires de<br />
l’UMQ, notamment la diversification <strong>des</strong> sources de revenus municipaux, la gestion<br />
<strong>des</strong> matières rési<strong>du</strong>elles, la complémentarité rurale urbaine, l’avenir de l’in<strong>du</strong>strie<br />
forestière, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la relève politique et administrative<br />
dans le milieu et les nombreux sujets d’actualité qui préoccupent ses membres et<br />
qui doivent trouver <strong>des</strong> solutions au bénéfice <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> et <strong>des</strong> contribuables.<br />
PROCHAINS ARRÊTS<br />
URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]6<br />
Mardi 11 novembre Chute-aux-Outar<strong>des</strong><br />
Mercredi 12 novembre Roberval<br />
Jeudi 13 novembre La Sarre<br />
Mercredi 19 novembre Val-<strong>des</strong>-Monts<br />
Mardi 25 novembre Chibougamau<br />
Mercredi 26 novembre Bécancour<br />
Jeudi 27 novembre Lac-Etchemin<br />
Jeudi 4 décembre L’Assomption<br />
(à confirmer)<br />
Mardi 9 décembre Sainte-Anne-de-Bellevue<br />
Mercredi 10 décembre Rivière-Rouge<br />
Jeudi 11 décembre Louiseville<br />
Date à confirmer Laval
URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]7<br />
«L’occupation dynamique <strong>du</strong> territoire c’est plus qu’un thème pour moi. Cela signifie,<br />
d’abord et avant tout, de permettre aux gens, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes<br />
d’habiter le territoire. De leur permettre de rester dans leur milieu de vie et d’y développer<br />
»<br />
leur plein potentiel. À titre de président de l’UMQ, je m’engage à faire toutes les<br />
représentations nécessaires pour que les <strong>municipalités</strong> aient accès à de nouveaux outils<br />
fiscaux et financiers pour assurer la vitalité économique de toutes les communautés.<br />
– Robert Coulombe, président de l’UMQ et maire de Maniwaki<br />
Le président de l’UMQ a donné le coup d’envoi de sa tournée en compagnie <strong>du</strong><br />
trésorier de l’<strong>Union</strong>, administrateur pour la région <strong>du</strong> Bas Saint-Laurent et maire<br />
de Rimouski, M. Éric Forest, <strong>du</strong> maire de Mont-Joli, M. Jean Bélanger et de la<br />
directrice générale de l’UMQ, M me Peggy Bachman.<br />
Le maire de Mont-Joli était très heureux d’accueillir le président de l’UMQ pour<br />
le lancement de sa tournée. On les aperçoit ici sur la photo, dont l’arrière-plan<br />
représente une <strong>des</strong> fresques faisant la réputation de la ville.<br />
M. Coulombe a répon<strong>du</strong> aux questions <strong>des</strong> journalistes présents au lancement à Mont-Joli concernant les priorités de l’<strong>Union</strong>.
URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]8<br />
La Tournée <strong>du</strong> président s’est arrêtée à <strong>Québec</strong> le 24 septembre. Lors de sa conférence de presse, Robert Coulombe a pu compter sur la présence <strong>du</strong> maire de <strong>Québec</strong>,<br />
M. Régis Labeaume, <strong>du</strong> maire de Val-<strong>des</strong>-Monts et administrateur de l’<strong>Union</strong> pour la région de la Capitale-Nationale, M. Marc Carrière, <strong>du</strong> Vice-président <strong>du</strong> comité<br />
exécutif à la Ville de <strong>Québec</strong> et membre <strong>du</strong> conseil d’administration de l’UMQ, M. François Picard et de la directrice générale de l’UMQ, M me Peggy Bachman.<br />
La réunion <strong>des</strong> membres <strong>du</strong> caucus de la région de la Capitale-Nationale<br />
s’est déroulée sur le site Huron de Wendake, en banlieue de <strong>Québec</strong>. Le<br />
chef <strong>du</strong> Conseil de la nation huronne de Wendake, M. Max Gros-Louis, était<br />
présent pour accueillir l’UMQ. Rappelons qu’il y a plus de trois ans, l’<strong>Union</strong><br />
a mis en place le Caucus <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> voisines <strong>des</strong> Premières Nations<br />
dont le rôle est de travailler sur <strong>des</strong> enjeux et préoccupations communs aux<br />
<strong>municipalités</strong> qui sont en relation avec les autochtones.<br />
ERRATUM<br />
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée lors <strong>du</strong> montage de<br />
notre numéro précédent (Août-septembre <strong>2008</strong>) dans le<br />
dossier portant sur la mobilité et le transport <strong>du</strong>rables. Dans le<br />
3 e graphique à droite en haut de la page 26 (Part <strong>des</strong> mo<strong>des</strong><br />
de transport <strong>des</strong> marchandises au Canada), l’icône rouge<br />
aurait <strong>du</strong> être associé au Trafic aérien et l’icône gris pâle au<br />
Trafic ferroviaire.
M. Michel Morin, maire de Rivière-<strong>du</strong>-Loup<br />
HYDRO-QUÉBEC REND<br />
HOMMAGE AU GRAND LAURÉAT<br />
DU CONCOURS EXCELLENCE<br />
MIEUX CONSOMMER<br />
Par ce nouveau concours, Hydro-<strong>Québec</strong> tient à encourager les<br />
entreprises qui se sont illustrées en réalisant <strong>des</strong> projets performants<br />
et novateurs dans le cadre de ses programmes d’e cacité énergétique.<br />
Hydro-<strong>Québec</strong> félicite tous les intervenants et responsables qui ont<br />
fait de ce projet d’aréna une réalisation exemplaire.<br />
Prix : Excellence MIEUX CONSOMMER<br />
Catégorie : Client d’aaires – Projet institutionnel<br />
Lauréat <strong>2008</strong> et grand lauréat : Ville de Rivière-<strong>du</strong>-Loup<br />
Projet : Centre Premier Tech<br />
Innovation : Combinaison de diérentes mesures pour optimiser<br />
le système de réfrigération et de chau age.<br />
Économie d’énergie : Ré<strong>du</strong>ction de 59 % de la consommation<br />
moyenne d’électricité par rapport à celle d’un aréna standard.<br />
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, UN CHOIX D’AFFAIRES<br />
RENTABLE ET RESPONSABLE.
ACTUALITÉ URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]10<br />
Une 2e JOURNÉE DE LA RURALITÉ<br />
édition placée sous<br />
LE SIGNE DE LA CONTINUITÉ<br />
Le 11 septembre dernier, la MRC <strong>des</strong> Sources accueillait la Journée de la ruralité au Camp musical d’Asbestos en<br />
Estrie. Deux ans après la 1 ère édition, qui avait alors con<strong>du</strong>it à l’élaboration de l’actuelle Politique nationale de la<br />
ruralité, cet événement a été l’occasion pour les 150 intervenants municipaux et acteurs <strong>du</strong> monde rural qui y<br />
étaient rassemblés de jeter un regard sur le chemin parcouru depuis la mise en œuvre de la politique.<br />
Organisée par le ministère <strong>des</strong> Affaires municipales et<br />
<strong>des</strong> Régions en collaboration avec les partenaires de la<br />
ruralité : l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (UMQ),<br />
l’Association <strong>des</strong> centres locaux de développement <strong>du</strong><br />
<strong>Québec</strong> (ACLD), la Fédération québécoise <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
(FQM) et Solidarité rurale <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (SRQ),<br />
cette 2 e édition de la Journée nationale de la ruralité a<br />
permis d’évaluer la réponse <strong>des</strong> communautés rurales<br />
aux diverses mesures mises en place et d’échanger sur<br />
les enjeux actuels et sur les conditions propres à assurer<br />
la vitalité de tout le <strong>Québec</strong> rural.<br />
Une délégation de 21 membres et employés de l’UMQ,<br />
incluant le président de l’<strong>Union</strong> et maire de Maniwaki,<br />
M. Robert Coulombe, ainsi que le vice-président <strong>du</strong><br />
Caucus <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> de centralité et maire de<br />
Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, était sur place<br />
pour participer aux discussions. Il a notamment été<br />
question de deux appels de projets pour les laboratoires<br />
ruraux, de la mesure <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its de spécialité, <strong>des</strong><br />
groupes de travail, <strong>des</strong> pactes ruraux 2002-2007 et<br />
2007-2014 et <strong>du</strong> partage de l’enveloppe de 59 millions<br />
de dollars concernant les pactes ruraux pour la période<br />
de <strong>2008</strong> à 2014, enveloppe d’ailleurs confirmée par la<br />
ministre <strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau, le 25<br />
septembre dernier (voir encadré ci-<strong>des</strong>sous).<br />
PACTES RURAUX : 59 MILLIONS DE DOLLARS<br />
ADDITIONNELS AUX MRC<br />
Le 25 septembre, la ministre <strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions, Nathalie<br />
Normandeau, annonçait qu’une enveloppe de 59 millions de dollars additionnels<br />
serait distribuée aux 91 MRC et villes-MRC signataires de pactes ruraux.<br />
Initialement, une enveloppe de 213 millions de dollars avait été attribuée aux<br />
pactes ruraux dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014.<br />
De ce montant, 154 millions de dollars ont déjà été distribués, sur la base <strong>des</strong><br />
statistiques <strong>du</strong> recensement de 2001.<br />
La nouvelle enveloppe budgétaire de 59 millions de dollars sera répartie sur la<br />
base <strong>du</strong> recensement de 2006. Cette répartition a fait l’objet d’un consensus<br />
au sein <strong>du</strong> Comité <strong>des</strong> partenaires de la ruralité, formé de l’UMQ, de la FQM, de<br />
l’ACLD et de la SRQ. Elle prévoit une première allocation de 200 000 $ pour<br />
chaque signataire de pacte rural. À ce montant, s’ajoute une somme déterminée<br />
en fonction de la population rurale <strong>du</strong> territoire concerné et un autre montant,<br />
qui lui est fonction de la population de ce territoire vivant en milieu dévitalisé.<br />
Photo : MAMR
P]11 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> ACTUALITÉ<br />
L’<strong>Union</strong>, dont près de 65% de ses membres proviennnent <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> rurales,<br />
appuie et participe à la mise en œuvre <strong>des</strong> mesures qui favoriseront l’atteinte <strong>des</strong><br />
objectifs de la Politique nationale de la ruralité et la diversification de l’économie <strong>des</strong><br />
collectivités rurales et l’occupation dynamique <strong>du</strong> territoire.<br />
«Je suis maire d’une communauté de 4 000 personnes<br />
au cœur de la Vallée-de-la-Gatineau, qui s’est<br />
bâtie à partir de l’exploitation forestière, et qui est<br />
confrontée aujourd’hui au défi de la diversification<br />
de son économie. Les enjeux de la ruralité sont<br />
grands : défi démographique, défi économique, défi<br />
de gouvernance, défi de développement <strong>du</strong>rable.<br />
Pour les relever et occuper le territoire de façon dynamique<br />
et <strong>du</strong>rable, j’ai besoin, comme maire, d’un<br />
coffre à outils dans les domaines tels que la fiscalité,<br />
les infrastructures, l’environnement, la forêt et<br />
l’agriculture », a déclaré le président de l’UMQ lors<br />
de son allocution devant les partenaires.<br />
Rappelons que l’<strong>Union</strong> a pris <strong>des</strong> engagements fermes<br />
dans le cadre de l’Entente de partenariat rural, signée<br />
le 7 décembre 2006, pour favoriser et renforcer la<br />
complémentarité rurale urbaine. Elle a également<br />
adopté, en mai 2007, un Plan d’action pour l’occupation<br />
de tout le territoire québécois : pour un avenir<br />
viable de l’ensemble <strong>du</strong> territoire.<br />
Photo Credit : City of Montréal<br />
Fédération canadienne <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
Fonds municipal vert MC<br />
Appel de deman<strong>des</strong> : Transports<br />
www.collectivitesviables.fcm.ca<br />
10 M$ disponibles en prêts à faible taux d’intérêts<br />
1,5 M$ disponible en subventions<br />
Pour <strong>des</strong> projets exceptionnels dans le secteur <strong>des</strong><br />
transports <strong>du</strong>rables<br />
projets.transports@fcm.ca | 613-907-6357<br />
Photo : MAMR
ACTUALITÉ URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]12<br />
JOURNÉE DE LA RURALITÉ<br />
Le milieu rural célébré<br />
La Journée de la ruralité <strong>2008</strong> s’est conclue par la cérémonie<br />
de remise <strong>des</strong> premiers Grands Prix de la ruralité.<br />
Ces distinctions soulignent l’engagement, les contributions<br />
et les réalisations les plus marquantes pour la ruralité québécoise<br />
d’aujourd’hui et de demain.<br />
La ministre Nathalie Normandeau et le Comité <strong>des</strong> partenaires de la ruralité<br />
ont dévoilé le nom <strong>des</strong> personnes et <strong>des</strong> organismes lauréats dans les<br />
quatre catégories: Excellence – Innovation, Mobilisation, Organisme rural<br />
de l’année et Agent rural de l’année.<br />
La ministre a aussi souligné l’engagement exceptionnel d’une personne<br />
dévouée au développement <strong>des</strong> communautés rurales, soit M. Jacques<br />
Proulx, ancien président <strong>du</strong> Syndicat <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>cteurs agricoles de l’Estrie,<br />
puis de l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>cteurs agricoles. M. Jacques Proulx a aussi été<br />
l’instigateur <strong>des</strong> États généraux <strong>du</strong> monde rural, qui a con<strong>du</strong>it quelque<br />
1200 leaders à adopter la Déclaration <strong>du</strong> monde rural, encore considérée<br />
comme la pierre d’assise de la ruralité québécoise. C’est aussi à cette<br />
époque qu’il a créé Solidarité rurale, une coalition toujours à l’avant-scène<br />
<strong>du</strong> développement <strong>des</strong> milieux ruraux.<br />
35 ans d’expérience,<br />
ça fait toute une différence.<br />
Parce que nos conseils sont judicieux,<br />
parce que nous sommes intègres,<br />
parce que nos interventions sont efficaces,<br />
les <strong>municipalités</strong> peuvent se développer<br />
en toute tranquillité d’esprit.<br />
Ça fait toute une différence.<br />
AUTREFOIS POTHIER DELISLE<br />
w w w . m o r e n c y a v o c a t s . c o m<br />
SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC<br />
QUÉBEC - LÉVIS (418) 651-9900 • MONTRÉAL (514) 845-3533 • ST-JEAN-SUR-RICHELIEU (450) 347-5317<br />
SOCIÉTÉ D'AVOCATS DEPUIS PLUS DE 35 ANS • MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL GLOBALAW<br />
M. Robert Coulombe, président de l’UMQ, a attribué le prix Excellence –<br />
Innovation à TransporAction Pontiac, un organisme sans but lucratif voué au<br />
transport collectif et au transport adapté en milieu rural. TransporAction se<br />
distingue par la progression et la diversification de ses services.<br />
L’équipe municipale Morency<br />
Des gens de savoir et d’expérience.<br />
Des gens impliqués dans leurs communautés.<br />
Des gens présents avec et pour vous aux quatre coins <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.<br />
Photo : MAMR
Lauréats <strong>des</strong><br />
rands Prix<br />
de la ruralité<br />
Lauréat <strong>du</strong> prix Mobilisation :<br />
Mes félicitations les plus sincères aux lauréats de<br />
cette première édition <strong>des</strong> Grands Prix de la ruralité qui<br />
s’est tenue le jeudi 11 septembre <strong>2008</strong>, à Saint-Camille<br />
dans la MRC <strong>des</strong> Sources.<br />
Cet événement annuel d’envergure nationale, résultat<br />
d’une collaboration entre le Comité <strong>des</strong> partenaires de la<br />
ruralité et le gouvernement <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, a permis de vous<br />
honorer, vous qui avez concrétisé les pactes ruraux et autres mesures<br />
issues de la Politique nationale de la ruralité.<br />
Je salue votre engagement et votre volonté à accomplir <strong>des</strong> projets décisifs<br />
pour votre communauté et qui rayonnent sur l’ensemble <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.<br />
Nathalie Normandeau<br />
Vice-première ministre et ministre <strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions<br />
Société de développement <strong>du</strong> Témiscamingue<br />
Le président de la Fédération québécoise <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong>, M. Bernard Généreux, le préfet de la<br />
MRC <strong>du</strong> Témiscamingue, M. Jean-Pierre Charron, la vice-première ministre et ministre <strong>des</strong><br />
Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau, et le préfet de la MRC <strong>des</strong><br />
Sources, M. Jacques Hémond.<br />
Lauréat <strong>du</strong> prix Excellence – Innovation :<br />
TransporAction Pontiac<br />
Le président de l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, M. Robert Coulombe, le président de<br />
TransporAction Pontiac, M. Robert Dupuis, la vice-première ministre et ministre <strong>des</strong> Affaires<br />
municipales et <strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau, et le préfet de la MRC <strong>des</strong> Sources,<br />
M. Jacques Hémond.<br />
Lauréat <strong>du</strong> prix Organisme rural de l’année :<br />
Coalition <strong>du</strong> Pacte rural de Saint-Joachim-de-Shefford<br />
La présidente de Solidarité rurale <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, M me Claire Bol<strong>du</strong>c, le président de la Coalition <strong>du</strong><br />
Pacte rural de Saint-Joachim-de-Shefford, M. Jacques Sauvé, la vice-première ministre et ministre<br />
<strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau, et le préfet de la MRC <strong>des</strong><br />
Sources, M. Jacques Hémond.<br />
Lauréat <strong>du</strong> prix Agent rural de l’année :<br />
Jean Bergeron<br />
Le président de l’Association <strong>des</strong> centres locaux de développement <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, M. Jean Fortin, le<br />
lauréat, M. Jean Bergeron, agent de développement de la Corporation de développement<br />
économique de Petit-Saguenay, la vice-première ministre et ministre <strong>des</strong> Affaires municipales et<br />
<strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau, et le préfet de la MRC <strong>des</strong> Sources, M. Jacques Hémond.<br />
Lauréat <strong>du</strong> prix Hommage :<br />
Jacques Proulx<br />
Le lauréat, M. Jacques Proulx, et la vice-première ministre et ministre <strong>des</strong> Affaires municipales<br />
et <strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau.
ACTUALITÉ URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]14<br />
AMORCE DE DÉCENTRALISATION<br />
L’UMQ signe une entente<br />
AVEC LE GOUVERNEMENT<br />
Le 24 septembre dernier, l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et la Fédération québécoise <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> ont<br />
signé une entente de décentralisation avec le gouvernement provincial visant à confier aux <strong>municipalités</strong> régionales<br />
de comté (MRC) de nouvelles responsabilités.<br />
Cette entente permettra à chacune <strong>des</strong> régions administratives<br />
de prendre en charge la gestion de certains droits fonciers (baux<br />
de villégiature, d’abri sommaire et d’occupation temporaire) et<br />
de l’exploitation <strong>du</strong> sable et <strong>du</strong> gravier sur les terres <strong>du</strong> domaine<br />
de l’État au profit <strong>des</strong> MRC. Pour l’UMQ, il s’agit d’un projet<br />
potentiellement intéressant qu’elle suivra de très près pour s’assurer<br />
qu’il soit avantageux pour les régions.<br />
« Cette entente concrétise la volonté <strong>du</strong> gouvernement et <strong>des</strong><br />
associations municipales de travailler ensemble dans le but de<br />
rapprocher les services <strong>du</strong> citoyen, de manière efficace et au<br />
meilleur coût possible. Cette entente apportera un soutien additionnel<br />
aux gouvernements locaux pour la mise en valeur de leur<br />
territoire », a déclaré Robert Coulombe, président de l’UMQ et<br />
maire de Maniwaki. Il ajoute toutefois que « pour l’<strong>Union</strong>, il ne<br />
s’agit que d’un premier pas qui guidera nos discussions avec le<br />
gouvernement vers l’identification d’autres activités de décentralisation<br />
porteuses de développement économique et <strong>du</strong>rable pour<br />
l’ensemble <strong>des</strong> régions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ».<br />
Dans son allocution, le président de l’UMQ a d’ailleurs rappelé<br />
que l’enjeu principal pour la vitalité <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> demeurait<br />
l’investissement dans les infrastructures et qu’un véritable partenariat<br />
économique avec le gouvernement s’imposait pour faire<br />
face aux besoins croissants <strong>des</strong> villes.<br />
PHOTO CI-HAUT : La signature de l’entente s’est déroulée lors d’une conférence<br />
de presse en présence <strong>du</strong> président de l’UMQ, M. Robert Coulombe, de<br />
la ministre <strong>des</strong> Ressources naturelles et de la Faune, M me Julie Boulet, de la<br />
ministre <strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions, M me Nathalie Normandeau,<br />
et <strong>du</strong> président de la FQM, M. Bernard Généreux.
P]15 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> ACTUALITÉ<br />
BILAN ENVIRONNEMENTAL DES ASSISES <strong>2008</strong><br />
117 tonnes de CO2 émises,<br />
705 arbres à être plantés… à Saint-Hyacinthe!<br />
En avril dernier, les Assises annuelles de<br />
l’UMQ amorçaient leur tournant vert en<br />
adhérant au programme ZERØCO2, un programmes<br />
québécois dont l’un <strong>des</strong> objectifs<br />
est de compenser les émissions de CO2 émises<br />
lors de certaines activités par la plantation<br />
d’arbres et la surveillance de leur croissance<br />
qui profitera aux citoyens, à l’environnement<br />
et à l’embellissement urbain.<br />
Le bilan environnemental <strong>des</strong> Assises se dresse comme<br />
suit: les déplacements <strong>des</strong> 2164 participants pour l’ensemble<br />
<strong>des</strong> trois jours d’activités, incluant les exposants,<br />
les employés, les invités spéciaux et les conférenciers,<br />
ont généré 117 tonnes de CO2. Pour neutraliser ces<br />
émissions, 705 arbres devront être plantés.<br />
Plusieurs <strong>municipalités</strong> ont manifesté leur intérêt à<br />
accueillir ces arbres. Après avoir évalué différents terrains<br />
dans diverses régions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, le choix s’est<br />
finalement porté sur la Ville de Saint-Hyacinthe, en<br />
Montérégie. La plantation <strong>des</strong> 705 arbres se fera cet<br />
automne au Parc <strong>des</strong> Stalines, dans le cadre d’une<br />
vaste opération où la Ville s’est aussi engagée à planter <strong>des</strong> arbres additionnels afin<br />
de compenser pour ses émissions de CO2. Il s’agit d’une première pour la Ville de<br />
Saint-Hyacinthe, qui abritera ainsi l’un <strong>des</strong><br />
parcs municipaux, sinon le seul, le plus<br />
boisé de la Montérégie.<br />
Si l’UMQ est fière que la tenue de ses Assises<br />
annuelles et de ses autres activités contribuent<br />
dorénavant à générer de nouveaux<br />
espaces verts, elle rappelle toutefois que<br />
cette initiative doit faire partie d’un ensemble<br />
de mesures environnementales contribuant<br />
avant tout à ré<strong>du</strong>ire à la source les émissions<br />
de gaz à effet de serre et autres polluants.<br />
En plus de modifier ses pratiques lors de la<br />
tenue de ses activités, l’UMQ intervient<br />
régulièrement auprès <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong><br />
<strong>Québec</strong> sur les questions reliées à l’environnement<br />
et au développement <strong>du</strong>rable et<br />
encourage ses membres à développer <strong>des</strong><br />
politiques innovantes et à poser <strong>des</strong> gestes<br />
tangibles pour protéger l’environnement.<br />
Fédération canadienne <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> 20 M$ disponibles en prêts à faible taux d’intérêts<br />
Fonds municipal vert Pour <strong>des</strong> projets <strong>du</strong>rables exceptionnels dans le<br />
secteur de la réhabilitation de sites contaminés<br />
projets.sites.contamines@fcm.ca | 613-907-6357<br />
MC<br />
Appel de deman<strong>des</strong> : Sites contaminés<br />
www.collectivitesviables.fcm.ca<br />
Photo : ZERØCO2
EAUX SOUTERRAINES URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]16<br />
Programme d’acquisition de connaissances<br />
SUR LES EAUX SOUTERRAINES DU QUÉBEC<br />
UN PROGRAMME CONCERNANT<br />
L’EAU SOUTERRAINE, POURQUOI ?<br />
Au <strong>Québec</strong>, l’eau souterraine est la ressource en eau<br />
potable la plus sollicitée. Elle sert d’approvisionnement<br />
en eau sur près de 90 % <strong>du</strong> territoire habité et alimente<br />
20% de la population. Elle constitue souvent l’unique<br />
source économiquement exploitable en raison de sa<br />
qualité et de sa facilité d’accès, tant pour le captage<br />
que pour sa distribution. Pourtant, malgré l’importance<br />
qu’elle revêt pour le <strong>Québec</strong>, sa connaissance est fragmentaire.<br />
Aussi, le gouvernement a décidé de parfaire la connaissance<br />
sur cette ressource en élaborant le Programme<br />
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines<br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Ce programme vise principalement à<br />
dresser un portrait complet de la ressource en eaux<br />
souterraines <strong>des</strong> territoires municipalisés <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
méridional dans le but ultime de la protéger et d’en<br />
assurer la pérennité.<br />
Dans le contexte <strong>des</strong> activités de planification et de<br />
gestion <strong>du</strong> territoire, l’élaboration de portraits sur la<br />
ressource en eaux souterraines s’ajoutera aux connaissances<br />
nécessaires à une meilleure occupation <strong>du</strong>rable<br />
<strong>du</strong> territoire. Les connaissances acquises à l’aide de ce<br />
programme fourniront aux <strong>municipalités</strong> <strong>des</strong> données<br />
essentielles quant au potentiel d’utilisation ainsi<br />
qu’aux risques de contamination et de surexploitation<br />
de cette ressource. Ces données permettront aux autorités<br />
municipales de voir à une meilleure conciliation<br />
<strong>des</strong> usages et de localiser adéquatement le développement<br />
de pôles d’activité sur leur territoire.<br />
QUELS SONT LES OBJECTIFS VISÉS ?<br />
Les objectifs <strong>du</strong> Programme sont les suivants :<br />
• Dresser un portrait de la ressource en eaux souterraines<br />
à l’échelle d’un bassin versant, d’une municipalité<br />
régionale de comté (MRC) ou d’un regroupement de MRC contiguës afin de soutenir<br />
les besoins d’information sur cette ressource.<br />
• Développer les partenariats entre les acteurs de l’eau et les gestionnaires <strong>du</strong> territoire<br />
dans l’acquisition <strong>des</strong> connaissances sur la ressource en eaux souterraines<br />
afin de favoriser une saine gestion de la ressource.<br />
QUEL EST LE BUDGET ATTRIBUÉ ?<br />
Le Programme a une <strong>du</strong>rée de cinq ans et il est doté d’une enveloppe budgétaire globale<br />
de 7 500 000 $. Il prendra fin le 31 mars 2013 ou à l’épuisement <strong>des</strong> budgets.<br />
QUI EST ADMISSIBLE ?<br />
Les organismes admissibles au Programme sont les établissements de recherche<br />
universitaire. Ces établissements doivent obligatoirement s’associer avec l’un ou<br />
l’autre <strong>des</strong> organismes suivants : organisme de bassin versant ou tout autre organisme<br />
ayant une compétence reconnue, MRC ou conférence régionale <strong>des</strong> élus. Une<br />
MRC peut donc être associée à l’élaboration d’un projet soumis par un établissement<br />
de recherche universitaire dans le cadre de ce programme.<br />
QUELS SONT LES PROJETS ADMISSIBLES ?<br />
Pour être admissibles au Programme, les projets soumis doivent respecter les exigences<br />
suivantes:<br />
• Établir le portrait <strong>des</strong> eaux souterraines, y compris la qualité et la quantité de la<br />
ressource de même que l’utilisation et les pressions humaines qui s’exercent sur<br />
celle-ci, de manière à évaluer le potentiel d’utilisation ainsi que les risques de<br />
contamination et de surexploitation <strong>des</strong> aquifères. Pour cela, les projets devront<br />
être conformes à la démarche indiquée dans le Guide <strong>des</strong> conditions générales <strong>du</strong><br />
Programme.<br />
• Être développés à l’échelle d’un bassin versant, d’une MRC ou d’un regroupement<br />
de MRC contiguës.<br />
• Avoir une <strong>du</strong>rée maximale de 3 ans.<br />
• Développer un partenariat avec <strong>des</strong> organismes <strong>du</strong> milieu dont la contribution<br />
financière minimale devra équivaloir à 10 % <strong>du</strong> coût total <strong>du</strong> projet.<br />
QUELLE EST L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE ?<br />
L’aide financière maximale accordée correspond au plus petit <strong>des</strong> deux montants<br />
suivants :<br />
• montant équivalant au nombre de km 2 correspondant à la superficie <strong>du</strong> bassin<br />
versant, de la MRC ou <strong>du</strong> regroupement de MRC contiguës visé par le projet, multiplié<br />
par 240 $;<br />
• montant équivalant à 80 % <strong>du</strong> coût total estimé <strong>du</strong> projet.<br />
QUELLE EST LA DATE LIMITE DE DÉPÔT<br />
DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE ?<br />
Les deman<strong>des</strong> d’aide financière doivent être postées au plus tard le 15 janvier 2009,<br />
le cachet de la poste faisant foi.<br />
Pour toute information, consultez le site Internet :<br />
www.mddep.gouv.qc.ca
P]17 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> GAZ NATUREL
DOSSIER ÉNERGIE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]18<br />
L’efficacité : source d’énergie<br />
pour les <strong>municipalités</strong><br />
À peu près inexistante il y a quatre ans, l’expression est aujourd’hui<br />
sur toutes les lèvres. Le message qu’elle véhicule martèle les<br />
<strong>municipalités</strong> qui sont fortement conviées à l’intégrer: l’efficacité<br />
énergétique.<br />
L’enjeu est complexe, les intervenants nombreux, les priorités<br />
divergentes.<br />
Si les économies qu’elle fait miroiter sont bien réelles, les investissements<br />
nécessaires à son virage le sont tout autant. Dans un<br />
contexte où les <strong>municipalités</strong> grattent leur fond de tiroir tout en<br />
cherchant à diversifier leurs sources de revenus, les possibilités<br />
qu’offre l’énergie sont attrayantes. Mais encore faut-il y voir plus<br />
clair… et trouver consensus sur la direction à prendre.
P]19 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
L’énergie selon <strong>Québec</strong><br />
En 2006, le gouvernement Charest rendait public la Stratégie énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
2006-2015 L’énergie pour construire le <strong>Québec</strong> de demain, dont l’objectif est de<br />
positionner la province en tant que leader sur le plan énergétique et en matière de<br />
développement <strong>du</strong>rable tout en renforçant la sécurité <strong>des</strong> approvisionnements en<br />
énergie et en soutenant l’innovation.<br />
Parmi les orientations de la stratégie, la pro<strong>du</strong>ction d’énergie renouvelable a la cote,<br />
étant bien sûr en ligne avec les objectifs de ré<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> gaz à effet de serre. La<br />
relance et l’accélération <strong>du</strong> développement <strong>du</strong> patrimoine hydroélectrique québécois<br />
(4 500 MW de nouveaux projets et accroissement <strong>des</strong> exportations) et le développement<br />
de la filière éolienne (trois appels d’offres totalisant 3 500 MW) sont à l’avant-plan <strong>des</strong><br />
priorités avec en toile de fond, l’efficacité énergétique. La cible d’économie d’énergie<br />
est ambitieuse: 3 610 000 tonnes équivalent pétrole (tep) à atteindre d’ici 2015. La<br />
majorité de ces économies devront être générées par une meilleure utilisation <strong>des</strong><br />
carburants et combustibles et de l’électricité.<br />
Pour enclencher le processus et le mener à terme, le gouvernement a confié à l’Agence<br />
de l’efficacité énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (AEE) de nouvelles responsabilités. La première,<br />
élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi d’un Plan d’ensemble triennal en efficacité<br />
énergétique et nouvelles technologies, qui prônera également l’utilisation de sources<br />
d’énergie multiples. Ce Plan d’ensemble, qui couvre un horizon de 10 ans, regroupe<br />
tous les efforts qui seront engagés par les acteurs concernés (distributeurs d’énergie,<br />
ministères et organismes gouvernementaux, <strong>municipalités</strong>, etc.) pour atteindre les<br />
cibles fixées par le gouvernement. La tâche est colossale car son succès dépend<br />
grandement de la capacité de l’Agence à mettre en place une action concertée et<br />
encadrée dont les mouvements devront être cohérents les uns avec les autres.<br />
UNE CULTURE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE<br />
Dans cette optique, le besoin de développer une culture de l’efficacité énergétique au<br />
<strong>Québec</strong>, en mettant en place <strong>des</strong> initiatives favorisant l’adoption de comportements<br />
indivi<strong>du</strong>els et collectifs plus responsables, devient primordial. Afin qu’un message<br />
cohérent émane de ces efforts, l’Agence a le mandat d’assumer un rôle de guichet<br />
unique d’information afin que les démarches nécessaires pour s’informer et bénéficier<br />
<strong>des</strong> programmes d’aide financière en efficacité énergétique initiés tant par l’Agence et<br />
les distributeurs d’énergie, que par les ministères et organismes gouvernementaux,<br />
soient simplifiées. Tous distributeurs confon<strong>du</strong>s, il existe présentement une cinquantaine<br />
de programmes dont pourraient se prévaloir les entreprises, <strong>municipalités</strong> et<br />
citoyens. L’existence et surtout, les bénéfices financiers<br />
associés à ces programmes demeurent trop souvent<br />
méconnus ou dispersés, d’où l’importance d’un guichet<br />
unique pour harmoniser le tout et assurer la pérennité<br />
<strong>des</strong> programmes les plus performants.<br />
L’idée semble aller de soi, mais les priorités <strong>des</strong> uns ne<br />
reflètent pas les priorités <strong>des</strong> autres. Malgré le vaste<br />
processus de consultations mené au printemps dernier,<br />
rallier l’ensemble <strong>des</strong> intervenants autour <strong>du</strong> Plan et <strong>du</strong><br />
mandat de l’Agence de l’efficacité énergétique ne se<br />
fait pas sans haussements de sourcils, en particulier<br />
<strong>du</strong> côté <strong>des</strong> distributeurs qui voient leur autonomie<br />
menacée. La présidente de l’Agence de l’efficacité énergétique,<br />
M me Luce Asselin se fait pourtant rassurante: «Il y a encore un manque de<br />
compréhension et une mauvaise perception quant au rôle de l’Agence. Soyons clairs,<br />
l’Agence n’a pas la prétention, ni la volonté de prendre la place <strong>des</strong> distributeurs<br />
d’énergie. Mais nos offres doivent être rapprochées car nous avons la responsabilité<br />
de présenter une offre globale, qui met de l’avant <strong>des</strong> sources d’énergie multiples et<br />
qui soit la plus facilitante pour les consommateurs.»<br />
Il faut dire qu’avec l’obtention d’un mandat plus fort,<br />
l’Agence est perçue comme un nouveau joueur dans<br />
l’arène de l’énergie. « Avant on chuchotait, aujourd’hui<br />
on crie un peu plus fort », précise M me Asselin. «La<br />
complémentarité de nos actions n’est pas une option.<br />
Lorsque nous débattrons de notre Plan à la Régie de<br />
l’Énergie en début d’année*, cette dernière s’attendra à<br />
ce que tous les joueurs soient réunis autour d’une<br />
cause commune en matière d’efficacité énergétique. Il<br />
en va de notre crédibilité vis-à-vis les consommateurs»<br />
ET LES MUNICIPALITÉS ?<br />
En élaborant sa proposition d’offre globale avec ses<br />
partenaires, l’Agence de l’efficacité énergétique ne perd<br />
pas de vue les <strong>municipalités</strong>, vecteurs de changements<br />
<strong>des</strong> comportements citoyens et dont les activités sont<br />
dans la mire <strong>des</strong> programmes d’efficacité énergétique.<br />
Pour les <strong>municipalités</strong>, cela veut dire prendre un virage<br />
où toutes ne sont pas prêtes à s’engager, par manque<br />
de ressources ou d’énergie devant ce qui semble être<br />
un processus complexe. Parmi ses nouvelles responsabilités<br />
issues de la Stratégie énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,<br />
l’Agence a le mandat d’accompagner les <strong>municipalités</strong><br />
dans leurs démarches visant à mettre en place un plan<br />
d’action en efficacité énergétique. Elle peut s’intégrer<br />
aux projets municipaux dès leurs débuts et assurer un<br />
suivi tout au long de leur implantation, en plus de les<br />
guider sur les programmes d’aide financière disponibles.<br />
Encore une fois, son objectif est le même : assurer une<br />
cohérence <strong>des</strong> programmes d’efficacité énergétique<br />
pour l’ensemble <strong>des</strong> régions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.<br />
[SUITE EN PAGE 20]<br />
* Au printemps <strong>2008</strong>, l’Agence de l’efficacité énergétique entamait un vaste<br />
processus de consultations auprès <strong>des</strong> distributeurs d’énergie et autres intervenants<br />
actifs dans le domaine. Les constats et recommandations formulés<br />
par les différents participants ont con<strong>du</strong>it à l’élaboration <strong>du</strong> Plan d’ensemble<br />
en efficacité énergétique et nouvelles technologies 2007-2010.<br />
En juillet dernier, ce Plan d’ensemble a été déposé à la Régie de l’énergie où il<br />
sera analysé et débattu dans le cadre d’audiences publiques prévues au début<br />
de janvier 2009. La décision de la Régie quant à son adoption sera ren<strong>du</strong>e<br />
dans les deux ou trois mois suivants les audiences.
DOSSIER ÉNERGIE P]20<br />
« Il y a <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> qui sont ren<strong>du</strong>es très loin<br />
dans leurs démarches, alors que pour d’autres, l’efficacité<br />
énergétique est en bas de la liste <strong>des</strong> priorités, ce<br />
qui est compréhensible dans la mesure où chaque<br />
municipalité ne fonctionne pas avec le même cadre<br />
financier», souligne Luce Asselin. «Si un travail de sensibilisation<br />
reste à faire, il est aussi important que nous<br />
réussissions à harmoniser les actions <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
pour obtenir <strong>des</strong> résultats positifs. Pour l’instant, tout le<br />
monde nage en eaux différentes.»<br />
« L’AGENCE N’A PAS LA PRÉTENTION, NI LA VOLONTÉ<br />
DE PRENDRE LA PLACE DES DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE.<br />
MAIS NOS OFFRES DOIVENT ÊTRE RAPPROCHÉES CAR NOUS<br />
AVONS LA RESPONSABILITÉ DE PRÉSENTER UNE OFFRE<br />
GLOBALE, QUI MET DE L’AVANT DES SOURCES D’ÉNERGIE<br />
MULTIPLES ET QUI SOIT LA PLUS FACILITANTE POUR LES<br />
CONSOMMATEURS. »<br />
– M me Luce Asselin, présidente de<br />
l’Agence de l’efficacité énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
PARTENAIRE<br />
AVEC VOUS<br />
AU SERVICE<br />
DES CITOYENS<br />
> www.mamr.gouv.qc.ca<br />
Selon l’Agence, l’harmonisation <strong>des</strong> actions pourra contribuer à la pérennité <strong>des</strong> projets<br />
mis en place, assurant ainsi un retour sur les investissements nécessaires à la<br />
mise en place de programmes d’efficacité énergétique. C’est pourquoi elle mise sur<br />
le volet conseil qu’elle peut offrir aux <strong>municipalités</strong>, en collaboration avec les distributeurs<br />
d’énergie afin que tous travaillent ensemble pour que les programmes d’efficacité<br />
énergétique s’inscrivent dans la cohérence.<br />
« L’Agence se veut un catalyseur pour offrir les meilleurs services pouvant aider les<br />
<strong>municipalités</strong> à ré<strong>du</strong>ire leur facture d’énergie. Je crois sincèrement que tout le monde,<br />
sur ce terrain de jeu, saura trouver sa zone de confort», conclut Luce Asselin.<br />
[SUITE EN PAGE 22]<br />
Photo : Agence de l’efficacité énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>
P]21 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
LA VILLE DE QUÉBEC AU<br />
PREMIER RANG DE L’EFFICACITÉ<br />
La Ville de <strong>Québec</strong> est un exemple de municipalité s’étant résolument<br />
engagée sur la voie de l’efficacité énergétique. Ses initiatives, appuyées<br />
par un programme d’aide prévu au Plan global en efficacité énergétique<br />
d’Hydro-<strong>Québec</strong>, lui ont permis de réaliser <strong>des</strong> économies d’énergie<br />
importantes… et de ré<strong>du</strong>ire ses factures !<br />
Ne voulant pas tuer dans l’œuf son virage par l’implantation de projets<br />
ambitieux et de longue haleine, la Ville a plutôt choisi de miser sur une<br />
série de projets de petite envergure visant <strong>des</strong> économies d’électricité<br />
inférieures à 100 000 kilowattheures par année. Additionnées une à<br />
une, ces économies en viennent cependant à totaliser 4,5 millions de<br />
kilowattheures, ce qui représente plus de 18% de toutes les économies<br />
prévues à ce jour dans le secteur municipal.<br />
Certaines de ces initiatives sont frappantes de simplicité. Un dispositif<br />
de fermeture de porte à distance a été installé dans les camions. Les<br />
chauffeurs n’ont donc qu’à l’actionner pour fermer la porte <strong>du</strong> garage<br />
municipal lors de leur sortie et éviter que la porte ne reste ouverte<br />
inutilement, surtout en hiver. Les employés municipaux ont aussi été<br />
sensibilisés à l’importance d’éteindre leur ordinateur en quittant. Bref,<br />
plus d’une trentaine d’actions <strong>du</strong> genre, et d’autres plus élaborées,<br />
comme le remplacement <strong>des</strong> feux de circulation, permettront à la Ville<br />
de <strong>Québec</strong> d’économiser 500 000 $ annuellement !<br />
Photo : Ville de <strong>Québec</strong><br />
14 e édition 17 au 19 novembre<br />
Loews Le Concorde <strong>Québec</strong><br />
À l’intention <strong>des</strong> élus, <strong>des</strong> gestionnaires<br />
et <strong>des</strong> ingénieurs municipaux<br />
> Défis de la gestion <strong>des</strong> actifs<br />
> Préoccupations <strong>des</strong> élus en matière d’infrastructure<br />
> Coordination <strong>des</strong> travaux d’enfouissement dans les emprises publiques<br />
> Gestion <strong>des</strong> eaux pluviales et changements climatiques<br />
> Sessions techniques en entretien, réhabilitation et auscultation<br />
Conférenciers internationaux<br />
de grande renommée<br />
> S. Burn CRIRO Land and Water Australie<br />
> R. Hass University of Waterloo Canada<br />
> S. Allbee The United States Environmental Protection Agency États-Unis<br />
> E. S. Kelly Seattle Public Utilities États-Unis<br />
> A. Vanrenterghem-Raven The Polytechnic University États-Unis<br />
> F. A. Léautier The Fezembat Group France<br />
Découvrez la programmation www.ceriu.qc.ca<br />
Soirée réseautage <strong>des</strong> prix<br />
en infrastructures municipales<br />
Mardi 18 novembre <strong>2008</strong> Capitole de <strong>Québec</strong><br />
Sous la présidence d’honneur de madame<br />
Nathalie Normandeau, vice-première ministre<br />
et ministre <strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions<br />
Venez souligner et reconnaître les projets<br />
d’infrastructure qui mettent de l’avant le savoir-faire<br />
et la créativité <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> et <strong>des</strong> étudiants pour<br />
assurer un développement <strong>du</strong>rable <strong>du</strong> réseau !<br />
Prix Innovation • en infrastructures municipales<br />
<strong>du</strong> ministère <strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions<br />
Prix Relève • en infrastructures municipales<br />
Inscrivez-vous www.ceriu.qc.ca
DOSSIER ÉNERGIE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]22<br />
Les <strong>municipalités</strong> pro<strong>du</strong>ctrices d’énergie<br />
La diversification <strong>des</strong> sources de revenus demeure un enjeu de premier plan pour la majorité <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong>,<br />
qu’ont aussi <strong>des</strong> visées importantes sur le développement économique régional et la valorisation <strong>des</strong> ressources. À<br />
juste titre, les régions riches en ressources naturelles sont emportées par le vent énergétique qui souffle sur le<br />
<strong>Québec</strong>. À l’heure <strong>du</strong> développement <strong>du</strong>rable et avec une capacité de pro<strong>du</strong>ction d’énergie renouvelable à plus de<br />
95 %, les orientations annoncées dans la Stratégie énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> sont on ne peut plus claires : augmenter<br />
la pro<strong>du</strong>ction d’énergie. Des projets sont amorcés, <strong>des</strong> appels d’offres sont lancés et à travers toute cette frénésie,<br />
les <strong>municipalités</strong> s’organisent pour que les retombées ne soient pas qu’un courant d’air.<br />
L’hydro, une connexion établie<br />
<strong>Québec</strong> veut relancer et accélérer le développement hydroélectrique avec la mise en<br />
œuvre de 4 500 megawatts (MW) de nouveaux projets d’ici les cinq prochaines<br />
années, un rythme équivalent à celui de la deuxième phase de développement de la<br />
Baie-James et supérieur au total <strong>des</strong> 15 dernières années. Ces 4 500 MW serviront à<br />
répondre à la demande à long terme <strong>du</strong> marché québécois, à susciter le développement<br />
in<strong>du</strong>striel et à l’exportation.<br />
Malgré certaines contestations, il ne serait pas surprenant de constater au fil de<br />
cette vaste opération l’augmentation de petites centrales hydroélectriques gérées<br />
par les <strong>municipalités</strong>, les MRC ou les communautés autochtones qui y voient une<br />
valeur pour le développement de leur région.<br />
À cet égard, le ministère <strong>des</strong> Ressources naturelles et de la Faune a publié, le 1 er octobre<br />
dernier, le projet de règlement relatif à la capacité maximale de pro<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> petites<br />
centrales hydroélectriques sur le territoire québécois, qui fixe à 50 MW et moins la<br />
capacité maximale de ces installations. Ce règlement permettra qu’un programme<br />
d’achat visant un bloc de 150 MW soit mis en place par Hydro-<strong>Québec</strong>, qui achètera<br />
à prix fixe, l’énergie pro<strong>du</strong>ite par les petites centrales. L’appel d’offres sera lancé cet<br />
automne et <strong>des</strong> promoteurs locaux et régionaux ont déjà manifesté leur intérêt.<br />
GUIDE DE RÉFÉRENCE<br />
POUR L’IMPLANTATION<br />
DES PETITES CENTRALES<br />
Le ministère <strong>des</strong> Ressources naturelles et de la<br />
Faune a lancé un guide de référence à l’intention<br />
<strong>des</strong> communautés locales et autochtones désireuses<br />
d’implanter de petites centrales hydroélectriques<br />
sur leur territoire. Ce guide présente<br />
<strong>des</strong> balises à suivre dans l’élaboration <strong>des</strong> projets<br />
de même que les dix étapes d’un développement de<br />
petite centrale. Il précise aussi les autorisations et<br />
démarches nécessaires, de l’avis de faisabilité à<br />
l’analyse <strong>du</strong> projet et les lois en vigueur. Il comporte<br />
aussi un volet sur la préoccupation citoyenne.<br />
Le guide de référence Octroi <strong>des</strong> forces hydrauliques<br />
<strong>du</strong> domaine de l’État pour les centrales de<br />
50 MW et moins est disponible sur le site Internet<br />
<strong>du</strong> Ministère:<br />
www.mrnf.gouv.qc.ca
P]23 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
LES ÉOLIENNES : BRISE OU VENT DOMINANT ?<br />
Les <strong>municipalités</strong> qui se lanceront dans <strong>des</strong> projets de<br />
petites centrales hydroélectriques pourront compter sur<br />
une expertise québécoise forte et établie. Il en va autrement<br />
pour les projets de développement de l’énergie<br />
éolienne qui en est à ses premiers battements d’hélices<br />
au <strong>Québec</strong> et dont le rendement en laisse plusieurs<br />
sceptiques.<br />
Le potentiel éolien québécois, de par la configuration <strong>du</strong><br />
territoire est peu discutable, même si l’effet <strong>du</strong> climat<br />
rigoureux sur la fiabilité à long terme <strong>des</strong> éoliennes n’est<br />
pas encore démontré. <strong>Québec</strong> évalue qu’à l’horizon 2015,<br />
le potentiel d’énergie éolienne économiquement intégrable<br />
au réseau d’Hydro-<strong>Québec</strong> sera de 4 000 MW (la<br />
puissance actuelle installée au <strong>Québec</strong> est de 422, 5 MW),<br />
soit environ 5 à 6 % <strong>des</strong> besoins <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, ce qui<br />
représentera plus <strong>du</strong> tiers de la puissance installée au<br />
Canada et près de 9 milliards de dollars d’investissements.<br />
Des dizaines de millions de dollars et <strong>des</strong> centaines<br />
d’emplois retomberont dans plusieurs régions<br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.<br />
3000 MW ont déjà été octroyés dans le cadre de deux<br />
appels d’offres et très bientôt, Hydro-<strong>Québec</strong> lancera<br />
[SUITE EN PAGE 24]
DOSSIER ÉNERGIE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]24<br />
deux autres appels d’offres de 250 MW chacun, réservés aux communautés et aux<br />
autochtones (la capacité maximale par projet est de 25 MW). Plusieurs <strong>municipalités</strong><br />
et leurs partenaires tenteront leur chance sur ce prochain appel qui promet d’être<br />
aussi compétitif que les deux précédents, étant donné que 43 MRC sur les 90 MRC<br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> recèlent un potentiel éolien. Pour certaines, ce sera une deuxième tentative,<br />
malgré l’amertume d’avoir vu leur projet collectif rejeté lors de l’appel d’offres de<br />
2000 MW en mai dernier (51 <strong>des</strong> 66 propositions présentées n’ont pas été retenues).<br />
Sans vouloir décourager les initiatives – car il faut bien<br />
semer pour récolter – force est de constater que la voie<br />
de l’éolienne représente un processus ar<strong>du</strong> et coûteux<br />
pour qui s’y engage. Les groupes communautaires doivent<br />
s’entourer de personnes d’expérience dans le secteur<br />
éolien qui pourront les accompagner dans l’appel d’offres<br />
afin qu’elles puissent être en mesure d’obtenir <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>
P]25 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
de faisabilité soli<strong>des</strong> et crédibles, <strong>des</strong> contacts avec les<br />
fournisseurs de turbine et autres éléments indispensables.<br />
Le tout, avec <strong>des</strong> moyens financiers limités qui risquent de<br />
ne jamais accorder de retour si le projet n’est pas retenu.<br />
Et s’il est retenu? Alors il faut prévoir 60 M$ à 65 M$ pour<br />
la réalisation <strong>du</strong> parc éolien, dont 30% doit être financé<br />
par le groupe communautaire, (environ 5, 6 M$), ce qui<br />
est en soit une bonne chose puisqu’elle assure à ce dernier<br />
de garder le contrôle sur son projet et de veiller aux<br />
intérêts locaux. Cependant, malgré la création d’emplois<br />
et la stimulation de l’économie locale, les retombées<br />
économiques ne représentent pas l’eldorado : pour un<br />
parc de 25 MW, on parle d’un retour en loyer de 50 000 $<br />
par année pour les <strong>municipalités</strong> et de 100 000 $ pour<br />
les propriétaires terriens*, d’où l’importance d’accompagner<br />
le projet d’un plan de développement maximisant<br />
les retombées économiques locales. Enfin, à ne<br />
pas oublier, le remplacement <strong>des</strong> turbines et autres<br />
pièces d’équipement <strong>du</strong> parc éolien, lesquelles, après<br />
20 ans, seront devenues désuètes.<br />
En toile de fond de ce vaste processus, l’acceptabilité<br />
sociale, nécessaire à la viabilité <strong>du</strong> projet. Mais c’est là<br />
un tout autre dossier…<br />
* source : Goal Capital inc.<br />
UN ATELIER POUR ORIENTER LES MUNICIPALITÉS<br />
Le 24 septembre dernier, l’Atelier sur l’énergie éolienne et les <strong>municipalités</strong><br />
réunissait à <strong>Québec</strong> <strong>des</strong> chefs de file qui se sont penchés sur le développement<br />
de l’in<strong>du</strong>strie éolienne et sur ses répercussions et avantages pour les <strong>municipalités</strong><br />
québécoises. Organisée en partenariat par l’Association canadienne de<br />
l’énergie éolienne, le TechnoCentre éolien, l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
et la Fédération Québécoise <strong>des</strong> Municipalités, la journée a été l’occasion de<br />
mettre en lumière les enjeux et les défis pour les <strong>municipalités</strong> dans l’élaboration<br />
de projets d’énergie éolienne, et plus particulièrement <strong>des</strong> projets de 25 MW ou<br />
moins, dans le cadre <strong>du</strong> prochain appel d’offres d’Hydro-<strong>Québec</strong>.<br />
Par ses orientations pratiques, l’atelier a offert aux <strong>municipalités</strong>, de même<br />
qu’aux promoteurs et aux autres intervenants, les outils dont ils ont besoin<br />
pour assurer la viabilité de la filière éolienne au <strong>Québec</strong>, et ce, dans le respect<br />
<strong>des</strong> communautés et de l’environnement.<br />
Les personnes n’ayant pu assister à cet atelier fort enrichissant peuvent se<br />
procurer le contenu <strong>des</strong> documents présentés lors de l’événement à l’adresse<br />
suivante :<br />
www.canwea.ca<br />
[SUITE EN PAGE 26]
DOSSIER ÉNERGIE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]26<br />
Inspiration allemande<br />
La voie de l’éolienne est un chemin abrupt, mais tout grand projet implique une part de risque et d’audace enrichissant<br />
pour le futur <strong>des</strong> collectivités. La filière éolienne est en développement au <strong>Québec</strong>, mais bien implantée<br />
dans d’autres régions <strong>du</strong> monde. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?<br />
Du 9 au 13 septembre, une délégation québécoise s’est<br />
ren<strong>du</strong>e en Allemagne pour participer au HUSUM Wind-<br />
Energy <strong>2008</strong>. Le salon, qui se déroulait à Husum, ville<br />
de 22,300 habitants et capitale de l’éolien en Allemagne,<br />
est le plus grand salon au monde entièrement voué à<br />
l’énergie éolienne. Il accueille plus de 23 000 visiteurs<br />
professionnels de 40 pays et 640 exposants de 30<br />
pays. L’énergie éolienne constitue le deuxième secteur<br />
économique en importance derrière le tourisme dans le<br />
Land de Schleswig-Holstein (2,8 million d’habitants).<br />
2,565 éoliennes y pro<strong>du</strong>isent 2,423 MW, ce qui représente<br />
35,98 % de la consommation nette d’électricité<br />
dans le Land. D’ailleurs, les 15 projets retenus au <strong>Québec</strong><br />
pour la pro<strong>du</strong>ction de 2,000 MW d’énergie éolienne font<br />
appel aux turbines <strong>des</strong> manufacturiers allemands<br />
Enercon et REpower, qui ouvreront tous les deux <strong>des</strong><br />
installations d’assemblage en Gaspésie.<br />
Grace à la collaboration <strong>du</strong> ministère, 25 représentants<br />
de neuf entreprises, institutions et <strong>municipalités</strong><br />
québécoises (Ville de Matane, Ville de New Richmond<br />
EO-Synchro, Genivar, Groupe Collegia, Groupe Delom, PH Windsolutions, TM4, Total<br />
Lubrifiants Canada,) ont participé à la mission économique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et ont pu<br />
être présents au salon afin de faire valoir leur expertise en matière d’énergie éolienne et<br />
de développer <strong>des</strong> partenariats avec les leaders de cette in<strong>du</strong>strie. La mission était<br />
accompagnée par M. René Paquette, directeur <strong>du</strong> développement électrique au ministère<br />
<strong>des</strong> Ressources naturelles et de la Faune. Outre l’exposition <strong>des</strong> brochures <strong>des</strong><br />
participants québécois au kiosque <strong>du</strong> Gouvernement <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> au salon HUSUM<br />
WindEnergy <strong>2008</strong>, elle comprenait <strong>des</strong> visites de sites et un maillage indivi<strong>du</strong>el où<br />
les participants québécois ont eu l’occasion de présenter leurs services, pro<strong>du</strong>its ou<br />
occasions d’affaires aux entreprises alleman<strong>des</strong>.<br />
Les visites de sites organisées par la Chambre canadienne allemande incluait une<br />
visite <strong>du</strong> site de pro<strong>du</strong>ction de l’entreprise allemande REpower et une présentation<br />
sur le modèle <strong>des</strong> parcs communautaires très répan<strong>du</strong> dans la région de Husum<br />
(95% <strong>des</strong> parcs s’y trouvent entre les mains <strong>des</strong> citoyens). La journée se poursuivait par<br />
une visite <strong>du</strong> développeur <strong>des</strong> projets offshore GEO et la visite <strong>du</strong> centre de formation<br />
<strong>des</strong> techniciens dans le secteur éolien BZEE.<br />
La conférence internationale «Wind Energy – Developments in North America » a<br />
mis un accent particulier sur l’énergie éolienne au <strong>Québec</strong>. Le dîner commandité par le<br />
Gouvernement <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, le ministère <strong>du</strong> Développement économique, de l’Innovation<br />
Photo : Chambre canadienne Allemande de l’in<strong>du</strong>strie et <strong>du</strong> commerce à Montréal
P]27 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
25 participants de neuf entreprises, institutions et <strong>municipalités</strong> ont participé à la mission économique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> à Husum.<br />
et de l’Exportation et Investissement <strong>Québec</strong> était suivi<br />
d’une conférence de M. Paquette soulignant les excellentes<br />
opportunités de l’éolien au <strong>Québec</strong>.<br />
Même si les retombés directs de la participation ne<br />
sont pas encore directement estimables, plusieurs participants<br />
québécois ont déjà déclaré que la mission à<br />
Husum était un succès et qu’ils souhaitent se déplacer<br />
soit au salon en énergie éolienne à Hanovre, Allemagne,<br />
en 2009 (20 au 24 avril) ou au prochain salon à Husum,<br />
Allemagne, en 2010 (7 au 13 septembre).<br />
Rappelons que le ministère <strong>du</strong> Développement économique,<br />
de l’Innovation et de l’Exportation avait mandaté<br />
la Chambre canadienne allemande de l’in<strong>du</strong>strie et <strong>du</strong><br />
commerce à Montréal de mettre en place cette mission<br />
économique. La Chambre canadienne allemande, un<br />
organisme bilatéral privé à but non lucratif qui soutient<br />
les relations commerciales entre les entreprises alleman<strong>des</strong><br />
et canadiennes, travaille intensément dans le<br />
secteur de l’énergie éolienne depuis plusieurs années afin<br />
d’assister <strong>des</strong> entreprises à accéder au nouveau marché<br />
respectif. Le but principal est de créer et d’intensifier<br />
<strong>des</strong> coopérations entre <strong>des</strong> entreprises canadiennes et<br />
alleman<strong>des</strong> dans le secteur <strong>des</strong> énergies renouvelables,<br />
<strong>des</strong> technologies environnementales et de l’efficacité<br />
énergétique dans les bâtiments en promouvant l’exportation<br />
et en établissant <strong>des</strong> joint-ventures ainsi que<br />
<strong>des</strong> partenariats.<br />
Est-ce que votre municipalité sait<br />
ce que pense la population?<br />
Ipsos Descarie est le chef de file en recherche<br />
municipale au <strong>Québec</strong> et au Canada.<br />
Nous offrons aux <strong>municipalités</strong> une approche scientifique<br />
de consultation publique qui garantit que vous<br />
serez à l’écoute de l’ensemble de vos citoyens plutôt<br />
que d’entendre seulement une minorité. Nous sommes<br />
une société de recherche de plein exercice et nous<br />
offrons de l’expertise dans les enquêtes sur mesure,<br />
multi-intérêts et omnibus. Nous sommes aussi <strong>des</strong><br />
experts <strong>des</strong> groupes de consultation, de l’organisation<br />
d’ateliers et <strong>des</strong> consultations publiques. Nous offrons<br />
<strong>des</strong> normes municipales qui permettent aux <strong>municipalités</strong><br />
de situer leurs résultats dans un contexte plus<br />
global et ainsi de mesurer leur performance relative.<br />
Pour en savoir plus sur les solutions de recherche<br />
qu’offre Ipsos Descarie, veuillez communiquer avec<br />
Daniel Boutin, directeur principal de la recherche au<br />
514-904-4328 ou à daniel.boutin@ipsos.com.<br />
Photo : Chambre canadienne Allemande de l’in<strong>du</strong>strie et <strong>du</strong> commerce à Montréal
DOSSIER ÉNERGIE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]28<br />
De nouvelles énergies pour les <strong>municipalités</strong><br />
Si l’hydroélectricité, le gaz naturel, le mazout, le charbon et maintenant l’énergie éolienne font partie de notre<br />
paysage énergétique, de nouveaux procédés y apparaissent de plus en plus. Ces nouvelles sources d’énergie<br />
gagnent en intérêt et malgré qu’elles soient encore peur répan<strong>du</strong>es, promettent <strong>des</strong> possibilités intéressantes pour<br />
les <strong>municipalités</strong>.<br />
PUISER À MÊME LE SOL<br />
L’énergie <strong>du</strong> sol ou la géothermie pourrait représenter une troisième avenue pour les<br />
<strong>municipalités</strong>, en particulier celles qui ne sont riches ni en vent ni en cours d’eau. À<br />
mi-chemin entre la pro<strong>du</strong>ction classique d’une énergie et l’efficacité énergétique, la<br />
géothermie offrira la possibilité aux <strong>municipalités</strong> de développer une nouvelle filière<br />
énergétique. Plusieurs <strong>municipalités</strong> sont très intéressées par l’utilisation de la géothermie<br />
dans <strong>des</strong> projets de services collectifs. Cette approche permettrait à la fois<br />
d’encadrer et d’optimiser l’utilisation de la géothermie dans le développement résidentiel.<br />
En pro<strong>du</strong>isant elle-même cette énergie (puits et distribution de la géothermie)<br />
pour <strong>des</strong> services collectifs en géothermie, les <strong>municipalités</strong> s’inscrivent dans les<br />
orientations <strong>du</strong> développement <strong>du</strong>rable tout en profitant d’une source de revenus<br />
intéressante.<br />
La géothermie utilise le sol, la nappe phréatique ou un plan d’eau comme source de<br />
chaleur pour chauffer l’hiver et comme évacuateur de chaleur pour climatiser l’été.<br />
La chaleur est donc puisée dans le sol l’hiver et y est évacuée l’été.<br />
Un système géothermique comporte un circuit souterrain<br />
et une thermopompe à laquelle est jumelé un système de<br />
distribution, tous deux situés à l’intérieur de la maison.<br />
Un service de géothermie en service collectif correspond<br />
à un regroupement de plusieurs résidences reliées à un<br />
même système géothermique.<br />
Le chauffage et la climatisation coûtent généralement<br />
de trois à quatre fois moins chers avec la géothermie<br />
qu’avec les technologies conventionnelles. Cependant,<br />
le coût élevé de cette technologie, principalement dû à<br />
l’installation de l’échangeur de chaleur géothermique,<br />
comparativement aux systèmes de chauffage<br />
conventionnels, représente une barrière importante à<br />
son adoption dans le marché. La <strong>du</strong>rée de vie utile de<br />
Photo : Ville de Salaberry-de-Valleyfield
P]29 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
CUEILLETTE DE DONNÉES<br />
En mars <strong>2008</strong>, Hydro-<strong>Québec</strong> lançait d’ailleurs un appel d’offres PISTE APP<br />
<strong>2008</strong> / 01. Terminé le 25 juillet, il s’adressait spécifiquement à la géothermie<br />
résidentielle en service collectif pour la nouvelle construction et la construction<br />
existante. Hydro-<strong>Québec</strong> souhaitait ainsi recevoir <strong>des</strong> propositions de projets<br />
pilotes dans le but de tester auprès de la clientèle résidentielle <strong>des</strong> approches<br />
commerciales novatrices et originales pour favoriser l’implantation <strong>des</strong> technologies<br />
liées à l’utilisation de la géothermie dans <strong>des</strong> projets de services collectifs<br />
au secteur résidentiel. Hydro-<strong>Québec</strong> désire acquérir un ensemble de<br />
données techniques et commerciales sous-jacentes au marché résidentiel de<br />
la géothermie au <strong>Québec</strong>.<br />
Sans favoriser aucune <strong>des</strong> possibilités actuellement recensées en matière de<br />
conception <strong>des</strong> systèmes géothermiques en services collectifs et de distribution<br />
de l’énergie, cette approche permettra à Hydro-<strong>Québec</strong>, dans l’éventualité où les<br />
résultats seront concluants, d’entreprendre une démarche élargie à l’échelle<br />
provinciale dans le cadre de ses programmes d’efficacité énergétique.<br />
l’échangeur de chaleur est d’environ 50 ans, tandis que les pompes à chaleur <strong>du</strong>rent<br />
environ 20 ans.<br />
Au Canada, on retrouve deux types d’installation dans le cadre de projets résidentiels<br />
utilisant la géothermie en service collectif. Par exemple, le projet domiciliaire Halcyon<br />
Meadows1 situé à Chilliwack en Colombie-Britannique utilise <strong>des</strong> puits communs<br />
reliés à <strong>des</strong> pompes à chaleur dans chacune <strong>des</strong> résidences,<br />
tandis que le centre de villégiature Pacific<br />
Sands, situé sur l’île de Vancouver, utilise une centrale<br />
de chauffage géothermique qui distribue l’énergie thermique<br />
à chacune <strong>des</strong> résidences.<br />
Hydro-<strong>Québec</strong> veut encourager les intervenants <strong>du</strong> secteur<br />
résidentiel à offrir la géothermie dans <strong>des</strong> projets<br />
de services collectifs afin de ré<strong>du</strong>ire, voire éliminer les<br />
barrières économiques à l’adoption de cette énergie<br />
renouvelable.<br />
Photo : Megapress
DOSSIER ÉNERGIE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]30<br />
L’UMQ redouble d’énergie<br />
Dans ce vaste dossier qu’est l’énergie, l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>municipalités</strong> a toujours été en faveur <strong>du</strong> développement<br />
d’une politique énergétique axée sur la diversification<br />
de la ressource, tant conventionnelle que <strong>des</strong> nouvelles<br />
filières. Elle souhaite aussi que les <strong>municipalités</strong> puis-<br />
sent davantage gérer leurs besoins et l’usage de la ressource énergétique pour leur<br />
propre consommation et pour l’épanouissement économique <strong>du</strong> territoire. Elle garde<br />
aussi en perspective l’équilibre entre le développement économique et le respect de<br />
l’environnement.<br />
En 2005, l’UMQ a adopté une plateforme en matière de<br />
gestion de l’énergie et de l’efficacité énergétique touchant<br />
notamment la question de l’aménagement <strong>du</strong><br />
territoire. Elle a participé aux différentes consultations<br />
gouvernementales qui ont donné naissance à la Stratégie<br />
énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> 2006-2015.<br />
Dans la filière éolienne, l’UMQ a toujours préconisé la<br />
prise en charge de la pro<strong>du</strong>ction éolienne par les <strong>municipalités</strong><br />
et la communauté. L’UMQ a oeuvré au sein de<br />
la Table de travail sur la définition <strong>des</strong> projets communautaires<br />
et a fait notamment valoir l’importance de la<br />
rentabilité <strong>des</strong> projets et <strong>des</strong> retombées <strong>du</strong>rables pour<br />
les localités. L’UMQ avait d’ailleurs réussi à faire modifier<br />
la grille de sélection applicable à l’appel d’offres<br />
pour le second bloc d’énergie éolienne de 2 000 MW. La<br />
modification touchait le critère de sélection accordant<br />
plus de points aux projets éoliens dont la participation<br />
<strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> et <strong>des</strong> MRC est de 10%. Dans l’appel<br />
d’offres de 250 MW, l’<strong>Union</strong> avait demandé à ce que<br />
les MRC ou le promoteur communautaire détiennent<br />
une participation représentant un minimum de 30%<br />
de la capitalisation et <strong>du</strong> contrôle <strong>du</strong> projet, ce qui a<br />
été enten<strong>du</strong>.
P]31 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DOSSIER ÉNERGIE<br />
Comptoir de services en énergie<br />
L’UMQ, en partenariat avec Hydro-<strong>Québec</strong>, Gaz Métro, le Fond en efficacité<br />
énergétique et l’Agence de l’efficacité énergétique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, a mis à la<br />
disposition <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> un comptoir de services en énergie et en environnement.<br />
Les services de première ligne offerts permettent aux <strong>municipalités</strong><br />
d’améliorer leur efficacité énergétique, d’améliorer leur gestion <strong>des</strong> tarifs<br />
et même de développer <strong>des</strong> projets de pro<strong>du</strong>ction d’énergie. À ce chapitre,<br />
les services d’accompagnement et de soutien sont également offerts pour les<br />
seconder dans la pro<strong>du</strong>ction d’énergie éolienne.<br />
Les <strong>municipalités</strong> ont accès à un<br />
service téléphonique en composant<br />
le 450 904-4625 et à un service<br />
de courrier électronique yhc@videotron.ca<br />
pour faire leurs deman<strong>des</strong>.
TOUR DE VILLE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]32<br />
Mont-Joli de<br />
fresque en fresque<br />
Le lancement de la Tournée <strong>du</strong> président le 18 septembre dernier aura été l’occasion pour les représentants<br />
de l’UMQ de refaire connaissance avec la Ville de Mont-Joli. Depuis quelques années, la municipalité est en<br />
pleine effervescence, tant au niveau culturel et familial qu’au niveau économique. Une <strong>des</strong> clés de son succès :<br />
afficher clairement ses couleurs. Tour de ville de la capitale de la MRC de la Mitis, Mont-Joli.
P]33 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> TOUR DE VILLE
TOUR DE VILLE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]34<br />
Au carrefour <strong>du</strong> développement<br />
Juchée entre terre et mer dans la région <strong>du</strong> Bas-Saint-Laurent, à une<br />
trentaine de kilomètres à l’Est de Rimouski, Mont-Joli est devenue au<br />
fil <strong>des</strong> années un véritable carrefour d’échanges en matière de<br />
transport, d’in<strong>du</strong>strie et de culture.<br />
Carrefour <strong>du</strong> transport aérien et ferroviaire, la Ville compte sur un<br />
aéroport régional administré par une régie intermunicipale, en plus<br />
d’accueillir le siège social <strong>du</strong> Chemin de fer <strong>du</strong> Golfe et de la Matapédia,<br />
qui gère l’expédition <strong>des</strong> marchandises vers la Côte-Nord, la<br />
Gaspésie, les provinces maritimes et Montréal. Un nouvel embranchement<br />
se joindra au carrefour car d’ici la fin de l’automne, le point<br />
terminal de l’autouroute 20 y sera établi. La Ville prépare activement<br />
son arrivée – et celui <strong>des</strong> 6000 à 7000 véhicules que la route entraînera<br />
dans son sillage quotidiennement – en coordonnant la mise en place<br />
d’un pôle d’accueil multiservices (accueil touristique, halte routière,<br />
restauration, hébergement). « Nous avons le choix : attendre les<br />
retombées positives de l’autoroute 20 les pieds sur la bavette <strong>du</strong> poêle<br />
ou mettre en place les conditions nécessaires afin que l’ensemble de<br />
la collectivité en bénéficie. Sans être une baguette magique, l’autoroute<br />
20 peut s’avérer le déclencheur d’un développement intéressant<br />
pour Mont-Joli et la région», souligne le maire de Mont-Joli, M. Jean<br />
Bélanger.<br />
Mont-Joli est au cœur d’une activité in<strong>du</strong>strielle croissante. La<br />
métallurgie, la transformation <strong>du</strong> bois et l’écologie in<strong>du</strong>strielle<br />
représentent les piliers économiques de la Ville, avec la présence<br />
d’entreprises phares dans ces domaines, dont le siège social de Bois<br />
Bsl et la fonderie Norcast. Mont-Joli est aussi la terre d’accueil de<br />
l’Institut Maurice-Lamontagne, le seul institut de recherche océanographique<br />
francophone au Canada. Forte de ses 15 années d’expérience<br />
en matière de récupération et de recyclage de matériel non toxique, la<br />
Ville opère également un important centre de tri et de transbordement.<br />
Avec ses 700 employés, le Centre de santé et de services sociaux est<br />
le plus gros employeur de la région. Construit <strong>du</strong>rant l’ère Duplessis,<br />
cet ancien sanatorium, puis institut psychiatrique, a vu sa vocation<br />
évoluer aux fils <strong>des</strong> années. Il offre aujourd’hui <strong>des</strong> soins de longue<br />
<strong>du</strong>rée, auquel est joint un centre régional de réadaptation physique<br />
et de traumatologie.<br />
Et cette croissance se poursuit richement car pour répondre aux<br />
besoins et deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> gens d’affaires, la Ville ouvrira prochainement<br />
à proximité de l’aéroport un parc in<strong>du</strong>striel de 13, 6 millions de<br />
pieds carrés pour un investissement d’un million de dollars.<br />
L’UMQ tient à remercier la Ville de de Mont-Joli pour son accueil chaleureux.<br />
Sur la photo, apparaissent le maire de Mont-Joli, M. Jean Bélanger, M, Robert<br />
Coulombe, président de l’UMQ et maire de Maniwaki et Mme Peggy Bachman,<br />
directrice générale de l’UMQ.<br />
INNOVATEURS ET<br />
ENTREPRENEURS DE VISION<br />
La croissance de Mont-Joli s’est appuyée sur de soli<strong>des</strong> racines<br />
entrepreneuriales. Des hommes de vision y laissent encore<br />
aujourd’hui leur trace. Saviez-vous que Mont-Joli était la patrie<br />
de l’inventeur de l’autoneige? Durant l’hiver 1919-1920, Joseph-<br />
Adalbert Landry a été le premier à mettre au point l’autoneige,<br />
s’inspirant <strong>du</strong> modèle de tank utilisé lors de la première guerre<br />
mondiale. Le modèle a été breveté au Canada et aux États-Unis<br />
et le procédé sera utilisé 11 ans plus tard par Joseph-Armand<br />
Bombardier. On connaît la suite…<br />
Le Mont-Jolien avait aussi une autre idée sous le chapeau. Un<br />
an avant d’avoir inventé l’autoneige, il s’associe avec son frère<br />
Louis-Philippe et son ami Antoine Morisset pour équiper une<br />
station de radiodiffusion appelée CJMC Mont-Joli. À Mont-Joli,<br />
on affirme que cette histoire aurait commencée avant même<br />
l’entrée en on<strong>des</strong> de CKAC-Montréal, considérée comme la première<br />
station de radio au <strong>Québec</strong>.<br />
Les bas-culottes de Mont-Joli ont couvert les jambes de femmes<br />
<strong>des</strong> quatre coins <strong>du</strong> globe. En 1954, Bertrand Dandonneau<br />
relance une petite in<strong>du</strong>strie de tricotage de bas d’origine allemande.<br />
À la fin <strong>des</strong> années 60, l’entreprise comptait 400<br />
employés et devenait le plus important fabricant de bas-culottes<br />
sur le marché canadien, avec <strong>des</strong> exportations aux Antilles, en<br />
Australie et en Nouvelle-Zélande.<br />
Et plus récemment…<br />
Mont-Joli est le berceau <strong>du</strong> fondateur de la plus importante<br />
chaîne indépendante de marchés d’alimentation au <strong>Québec</strong>,<br />
M. Germain Pelletier.<br />
Dans les années 1988 à 1990, l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong><br />
<strong>Québec</strong> a pu compter sur l’expérience d’un éminent citoyen de<br />
Mont-Joli, le D r Jean-Louis Desrosiers, à sa vice-présidence<br />
puis sa présidence.
P]35 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> TOUR DE VILLE<br />
Mouvements migratoires<br />
En parallèle avec son essor économique, Mont-Joli a aussi le vent dans<br />
les voiles côté famille. L’arrivée massive de nouveaux citoyens, attirés<br />
par les perspectives d’emplois, le coffret promotionnel de 12 000 $<br />
<strong>des</strong>tiné aux personnes qui construisent une résidence, le programme<br />
de crédit de taxes foncières et la qualité de vie de Mont-Joli, se tra<strong>du</strong>it<br />
par une hausse importante <strong>des</strong> investissements dans le secteur<br />
domiciliaire. En 2007, la Ville a enregistré une augmentation de<br />
300 % <strong>du</strong> nombre de permis de construction et de 420 % de leur<br />
valeur. Des permis de rénovation d’une valeur de près de 8 millions<br />
de dollars ont été délivrés, soit une hausse de 75 %.<br />
Des murs qui racontent <strong>des</strong> histoires<br />
Relais culturel, la Ville permet à ses citoyens et visiteurs de découvrir<br />
le patrimoine culturel de son territoire. Située sur la Route <strong>des</strong> arts de<br />
Sainte-Flavie, elle est aussi tout près <strong>des</strong> célèbres Jardins de Métis.<br />
Elle abrite une Galerie d’art extérieur et le Carrefour de la littérature,<br />
<strong>des</strong> arts et de la culture.<br />
Mais ce qui fait avant tout la renommée de Mont-Joli, ce sont ses<br />
murs. Au centre-ville, les murs se sont transformés en véritables<br />
conteurs. L’histoire de Mont-Joli se déploie de fresque en fresque sur<br />
les bâtiments publics et privés. Une idée originale qui a vu le jour en<br />
2002 et qui ne cesse de prendre <strong>des</strong> couleurs depuis. Le circuit<br />
muséal «Les murmures», regroupe aujourd’hui 18 œuvres mettant<br />
en évidence tant <strong>des</strong> pans de vie et d’histoire que le patrimoine et le<br />
potentiel artistique de la Ville. Passé et modernité s’y mélangent<br />
dans une harmonie de couleurs, de textures et d’images qui donnent<br />
aux infrastructures <strong>du</strong> centre-ville de Mont-Joli un éclat <strong>des</strong> plus<br />
vifs. « De concert avec nos partenaires socio-économiques, nous<br />
déployons une stratégie de développement commercial où l’animation<br />
<strong>du</strong> centre-ville sera accentuée. L’image de la ville, sa couleur<br />
distinctive, repose en grande partie sur la présence de notre galerie<br />
de fresques extérieures dont la notoriété s’affirme de jour en jour. »<br />
Et pour que ce rayonnement régional, québécois et même international<br />
prenne encore plus de lustre, Mont-Joli entreprendra sous peu<br />
<strong>des</strong> démarches afin qu’elle soit reconnue « Capitale <strong>des</strong> peintures<br />
murales de l’Est <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>».<br />
Complémentarité de voisinage<br />
Une <strong>des</strong> clés <strong>du</strong> succès de la Ville réside dans sa capacité à trouver<br />
son propre créneau et à éviter de vaines compétitions avec sa grande<br />
voisine Rimouski. Mont-Joli a pris un virage qui se révèle gagnant. «Il<br />
était inutile de chercher compétition à notre voisine sur ses propres<br />
terrains, qui bénéficient de ressources plus imposantes. L’important<br />
pour nous était de développer nos propres champs de compétences,<br />
qui souvent s’avèrent complémentaires avec celles de Rimouski »,<br />
explique le maire de Mont-Joli. En effet, de nombreuses familles travaillant<br />
dans la «grande ville» viennent s’installer à Mont-Joli pour<br />
la qualité de vie et la tranquillité, alors que le centre régional de<br />
réadaptation physique vient se greffer aux soins offerts par l’Hôpital<br />
Les 6 650 résidants de Mont-Joli ont de quoi enrichir leur qualité de<br />
vie, ne serait-ce que par la beauté <strong>des</strong> panoramas qu’offre la région,<br />
ses nombreux espaces verts et sa vue imprenable sur le fleuve. Les<br />
jeunes peuvent y développer leur potentiel académique, sportif et<br />
artistique. L’école secondaire Le Mistral rassemble 900 élèves dont<br />
35% sont inscrits dans <strong>des</strong> programmes sports-arts-étu<strong>des</strong>. Le hockey<br />
et le soccer ont la cote chez certains jeunes, alors que d’autres ont<br />
l’oreille plus musicale. Pour être au diapason <strong>des</strong> mouvements de<br />
ses nouveaux citoyens, Mont-Joli a entrepris d’élaborer sa première<br />
politique familiale, laquelle devrait être déposée cet automne.<br />
Illustrée par le célèbre bédéiste Molinari, cette fresque commémore la 9 e École<br />
de tir et de bombardement de Mont-Joli, la plus importante <strong>du</strong> Commonwealth<br />
britannique. Cette école, implantée lors de la Seconde Guerre mondiale, a formé<br />
plus de 6000 aviateurs pour soutenir l’effort <strong>des</strong> alliés contre le régime nazi.<br />
Quelque 2300 personnes y travaillaient.<br />
de Rimouski. « Mont-Joli représente un<br />
carrefour de communications qui prennent<br />
différentes formes: développement<br />
in<strong>du</strong>striel et culturel, mo<strong>des</strong> de transport,<br />
services de santé, é<strong>du</strong>cation, sports et<br />
loisirs. C’est en misant sur nos forces<br />
que nous innovons et que nous pouvons<br />
se féliciter de connaître aujourd’hui un<br />
essor remarquable qui profite à l’ensemble<br />
de nos citoyens », conclut le<br />
maire Bélanger.<br />
Le maire Jean Bélanger, devant<br />
une fresque représentant l’évolution<br />
<strong>des</strong> communications à<br />
travers les âges)
GESTION MUNICIPALE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]36<br />
La gestion <strong>des</strong> ressources humaines<br />
AU CŒUR DU CHANGEMENT<br />
Dans un contexte où près de 40 % <strong>des</strong> budgets municipaux sont consacrés à la masse salariale, la mobilisation et la<br />
motivation <strong>des</strong> employés devant les orientations <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> demeurent à l’avant-plan <strong>des</strong> préoccupations.<br />
En avril dernier, un sondage effectué par l’UMQ et le Centre de ressources municipales (CRM) auprès de leurs<br />
membres révélait d’ailleurs que le maintien d’un bon climat de travail et la formation <strong>des</strong> cadres municipaux en<br />
gestion <strong>des</strong> ressources humaines étaient identifiés comme une priorité par toutes les <strong>municipalités</strong> participantes.<br />
L’appréhension d’une pénurie de main d’œuvre d’ici les 10 prochaines années force<br />
aussi les gestionnaires à réévaluer leurs métho<strong>des</strong> d’évaluation et de gestion de leur<br />
personnel. Si les activités <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> ne poursuivent pas les mêmes objectifs<br />
que celles de l’entreprise privé, elles n’en ont pas moins à relever <strong>des</strong> défis de performance<br />
et d’efficacité, ne serait-ce que pour contrôler leurs coûts. À cet égard, les<br />
indicateurs de gestion deviennent un outil fort utile pour les soutenir dans leur<br />
démarche et leur permettre d’avoir une vue d’ensemble sur les différents aspects de<br />
gestion et ainsi éclairer la prise de décision.<br />
Le monde municipal, à l’instar de plusieurs autres secteurs d’activité <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,<br />
doit faire face aux changements en matière d’attraction, de mobilisation et de rétention<br />
<strong>du</strong> personnel alors qu’une forte proportion <strong>des</strong> employés municipaux sera admissible<br />
à la retraite dans les prochaines années. L’évolution combinée <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong><br />
citoyens et <strong>des</strong> technologies ne cesse de pousser les <strong>municipalités</strong> à investir davantage<br />
dans le développement <strong>des</strong> talents et <strong>des</strong> compétences de leurs employés.<br />
DE NOUVEAUX INDICATEURS<br />
À VALEUR AJOUTÉE<br />
L’intro<strong>du</strong>ction d’indicateurs en gestion<br />
<strong>des</strong> ressources humaines sur l’écran<br />
radar de la gestion municipale constitue<br />
la reconnaissance <strong>du</strong> rôle stratégique<br />
de la fonction de la gestion <strong>des</strong><br />
ressources humaines à l’intérieur <strong>du</strong><br />
système de gestion municipale. Il<br />
s’agit, sans l’ombre d’un doute, de la<br />
valeur ajoutée la plus significative<br />
au tableau de bord <strong>des</strong> responsables<br />
de l’administration municipale pour<br />
améliorer la prestation <strong>des</strong> services<br />
offerts aux citoyens. C’est pourquoi il importe d’être en mesure d’analyser les données<br />
<strong>des</strong> ressources humaines, trop souvent noyées dans l’ensemble <strong>des</strong> autres activités<br />
municipales.<br />
LES INDICATEURS RH ET LES PRIORITÉS POUR LES MUNICIPALITÉS<br />
Deux <strong>des</strong> quatre indicateurs obligatoires développés sont en relation avec la formation<br />
<strong>des</strong> employés:<br />
1. Effort de formation par employé, qui mesure le nombre d’heures<br />
de formation par employé, toutes catégories d’emploi confon<strong>du</strong>es.<br />
2. Pourcentage <strong>du</strong> coût de la formation par rapport à la rémunération totale.<br />
Ils sont utilisés pour évaluer et démontrer le temps investi et les sommes consacrées<br />
par l’organisation municipale au développement de ses ressources humaines et à<br />
l’amélioration <strong>des</strong> compétences pour le maintien d’une offre de services municipaux<br />
de qualité aux citoyens. Selon les rapports <strong>des</strong> indicateurs de 2007 déjà déposés, la<br />
moyenne <strong>des</strong> résultats de l’indicateur Effort de formation par employé est de 18 heures<br />
pour l’année et le Pourcentage <strong>du</strong> coût de la formation par rapport à la rémunération<br />
Yves Gagnon, FCGA, OMA, consultant en gestion municipale (à<br />
gauche), et Pierre Joron MAP, CRHA, vice-président Aon conseil.<br />
totale de 3,75 %. L’ensemble <strong>des</strong> résultats, lorsqu’ils<br />
seront connus, permettront de mieux comparer l’importance<br />
accordée à la formation.<br />
Chacun de ces indicateurs représente un résultat global<br />
pour l’organisation municipale. Lorsqu’ils sont ventilés<br />
par catégorie d’emploi, avec le même budget de formation,<br />
il est possible d’établir ou de rajuster la stratégie<br />
ou le plan de formation <strong>des</strong> groupes d’employés municipaux<br />
selon les besoins et les priorités <strong>des</strong> opérations<br />
et <strong>des</strong> services.<br />
ALLONS AU-DELÀ DES<br />
INDICATEURS OBLIGATOIRES<br />
Les travaux d’un groupe de travail composé de représentants<br />
d’associations de fonctionnaires et d’élus<br />
municipaux, appuyé par un banc d’essai avec un<br />
échantillon représentatif de <strong>municipalités</strong>, ont con<strong>du</strong>it<br />
à l’élaboration de 15 indicateurs pour la gestion <strong>des</strong><br />
ressources humaines, dont quatre obligatoires et deux<br />
facultatifs.<br />
Il est souhaitable que les administrations municipales<br />
mettent en place une méthode pour la collecte <strong>des</strong> données<br />
de base qui serviront au calcul <strong>des</strong> 15 indicateurs<br />
qui ont été développés.<br />
En effet, se limiter à l’utilisation <strong>des</strong> quatre indicateurs<br />
obligatoires serait se priver d’informations et d’indices<br />
qui sont incontournables en <strong>2008</strong> pour une gestion efficace<br />
et performante.
P]37 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> GESTION MUNICIPALE<br />
À titre d’exemple, l’indicateur facultatif Taux de présence<br />
au travail <strong>des</strong> employés réguliers exprime le pourcentage<br />
de présence par rapport aux heures de travail atten<strong>du</strong>es,<br />
excluant les vacances, les congés fériés et mobiles et<br />
les congés à long terme autorisés par l’employeur. L’interprétation<br />
de cet indicateur est très révélatrice <strong>du</strong><br />
rendement <strong>des</strong> équipes de travail et de l’utilisation <strong>des</strong><br />
budgets pour rendre efficacement les services aux<br />
citoyens. Selon les rapports de 2007 traités, les pourcentages<br />
pour cet indicateur varient entre 77 % et 93 %.<br />
Comme vous pouvez le constater avec cette comparaison<br />
et tout en se gardant une réserve sur ces résultats<br />
partiels, l’indicateur de certaines <strong>municipalités</strong> identifie<br />
clairement la nécessité de développer <strong>des</strong> mécanismes<br />
pour améliorer la présence <strong>des</strong> employés réguliers<br />
au travail. Un faible taux de présence au travail a une<br />
relation directe sur l’efficacité <strong>des</strong> services ou engendre<br />
une augmentation <strong>des</strong> coûts pour maintenir la qualité<br />
<strong>des</strong> opérations.<br />
Les indicateurs de gestion RH, appliqués et intégrés<br />
adéquatement dans le processus budgétaire annuel,<br />
serviront à mieux définir les orientations, à faciliter les<br />
choix et à améliorer la gestion budgétaire et <strong>des</strong> ressources<br />
humaines. Surtout, ils contribueront à la mobilisation<br />
<strong>des</strong> ressources humaines de nos organisations<br />
municipales.<br />
UNE MISE À JOUR MAJEURE<br />
Trois ans après l’implantation en 2004 <strong>des</strong> indicateurs de gestion, le ministère<br />
<strong>des</strong> Affaires municipales et <strong>des</strong> Régions (MAMR), attentif aux suggestions et<br />
recommandations <strong>des</strong> différents partenaires <strong>du</strong> monde municipal qui ont testé<br />
« sur le terrain » les 19 indicateurs obligatoires de gestion municipaux, a procédé<br />
à leur mise à jour. Les travaux menés rigoureusement par le comité de<br />
suivi ont permis de cerner certaines difficultés et de dégager les points forts<br />
<strong>des</strong> expériences vécues par le milieu municipal. Cette phase d’harmonisation a<br />
con<strong>du</strong>it à l’élaboration de quatre nouveaux indicateurs dédiés à la gestion <strong>des</strong><br />
ressources humaines et au retrait de 9 <strong>des</strong> 19 indicateurs obligatoires.<br />
De plus, quelque treize indicateurs facultatifs, dont deux façonnés spécialement<br />
pour la gestion <strong>des</strong> ressources humaines, font partie <strong>des</strong> nouvelles activités<br />
d’indicateurs à calculer. Ils touchent entre autres la sécurité incendie, les loisirs<br />
et la culture, ainsi que les matières rési<strong>du</strong>elles.<br />
Les <strong>municipalités</strong> régionales de comté (MRC) et les régies intermunicipales<br />
procèdent présentement au rodage <strong>des</strong> nouveaux indicateurs obligatoires de<br />
gestion avec les données de 2007, tel que l’avaient fait les <strong>municipalités</strong> en<br />
2004. L’obligation de communiquer leurs résultats de <strong>2008</strong> s’applique en 2009.
LA CHRONIQUE DU CRM URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]38<br />
Obligation d’accommodement<br />
en raison de problèmes de<br />
santé d’un employé : la notion<br />
de contrainte excessive<br />
Dans un jugement ren<strong>du</strong> en juillet dernier, Hydro-<strong>Québec</strong><br />
c. Syndicat <strong>des</strong> employé-e-s de techniques professionnelles<br />
et de bureau d’Hydro-<strong>Québec</strong>, section locale 2000<br />
(SCFP-FTQ) 1 , la Cour suprême s’est penchée sur le<br />
devoir de l’employeur d’accommoder un employé en raison<br />
de problèmes de santé. Dans cette affaire, Hydro-<strong>Québec</strong><br />
avait mis fin à l’emploi d’une salariée qui présentait un<br />
absentéisme très élevé, soit 960 jours d’absence en<br />
sept ans et demie de travail, en raison de plusieurs<br />
problèmes de santé physique et mentale. La Cour<br />
suprême a confirmé la validité de la décision de l’employeur<br />
de congédier la salariée en raison de son<br />
absentéisme, de son incapacité à fournir une prestation<br />
de travail régulière ainsi que de la faible probabilité que<br />
la situation ne s’améliore dans l’avenir. La Cour a souligné<br />
tout d’abord que l’obligation d’accommodement a<br />
pour effet de permettre à un salarié, qui ne peut fournir<br />
sa prestation de travail selon les conditions normales de<br />
son poste, d’être en mesure de fournir cette prestation<br />
de travail grâce à <strong>des</strong> aménagements adaptés à ses<br />
caractéristiques. En rappelant le principe selon lequel<br />
ce nouvel aménagement ne doit pas entraîner pour<br />
l’employeur une contrainte excessive, la Cour a précisé<br />
l’interprétation et l’application de ce principe en matière<br />
de maladie d’un employé:<br />
Lorsque les caractéristiques d’une maladie sont<br />
telles que la bonne marche de l’entreprise est<br />
entravée de façon excessive ou lorsque l’employeur<br />
a tenté de convenir de mesures d’accommodement<br />
avec l’employé aux prises avec une telle maladie,<br />
mais que ce dernier demeure néanmoins incapable<br />
de fournir sa prestation de travail dans un avenir<br />
raisonnablement prévisible, l’employeur aura<br />
satisfait à son obligation 2 .<br />
PAR M E AMÉLIE GUILBAULT, CONSEILLÈRE ANALYSTE EN DROIT,<br />
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL<br />
EN COLLABORATION AVEC MAUDE GENDRON-ROLLAND,<br />
STAGIAIRE EN RELATIONS INDUSTRIELLES<br />
Alors qu’il s’agissait ici d’un dossier impliquant une grande société comme Hydro-<br />
<strong>Québec</strong>, la jurisprudence en matière de droit <strong>du</strong> travail en milieu municipal révèle<br />
que les <strong>municipalités</strong> de toutes tailles sont également confrontées à <strong>des</strong> questions<br />
d’accommodement en raison de maladie ou handicap d’un employé. Nous présenterons<br />
ici deux exemples de décision, l’une impliquant une grande municipalité et la seconde,<br />
une municipalité de petite taille.<br />
Dans Montréal (Ville de) et Syndicat <strong>des</strong> fonctionnaires municipaux de Montréal<br />
(SCFP) 3 , la Ville a congédié la plaignante, une secrétaire souffrant de fibromyalgie.<br />
Le syndicat a déposé un grief contestant son congédiement. La Ville soutient qu’au<br />
cours <strong>des</strong> neuf ans de service de la plaignante, on compte 70 % d’absences, ce qui<br />
représente un absentéisme excessif. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas de postes à<br />
temps partiel pour de telles fonctions et que le retour de la plaignante à un horaire de<br />
travail régulier n’était ni probable ni prévisible. Dans sa décision, l’arbitre rappelle<br />
tout d’abord que la plaignante avait l’obligation de fournir sa prestation de travail et<br />
que l’employeur avait une obligation d’accommodement à l’égard de celle-ci. Il précise<br />
néanmoins que cette obligation d’accommodement ne diffère pas d’intensité en<br />
fonction de la nature publique ou privée de l’entreprise. Le fait que l’employeur<br />
soit la Ville de Montréal ne saurait justifier une augmentation substantielle de<br />
cette obligation. En effet, l’approche contraire aurait pour effet de détourner<br />
indirectement la mission première de la Ville à titre de gestionnaire de fonds<br />
publics et de services municipaux aux citoyens. Puisque la Ville a pris plusieurs<br />
mesures afin de faciliter le retour au travail de la plaignante, notamment en aménageant<br />
son bureau, en lui offrant l’aide d’une autre personne et en faisant preuve de souplesse<br />
quant à son horaire et sa présence au travail, et que le retour à <strong>des</strong> conditions<br />
normales dans un délai raisonnable était peu probable, l’arbitre a rejeté le grief.
P]39 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> LA CHRONIQUE DU CRM<br />
Une autre décision énonce par ailleurs que la petite taille de la municipalité doit être<br />
prise en compte dans l’appréciation de ce qui constitue une contrainte excessive<br />
dans un cas donné. Dans Notre-Dame-<strong>du</strong>-Laus (Ville de) et Syndicat <strong>des</strong> travailleuses<br />
et travailleurs de la Lièvre-Sud – CSN 4 , le plaignant, qui travaillait à titre de mécanicien<br />
pour la Municipalité de 1400 habitants comptant douze ou treize salariés, a subi<br />
un accident de travail. Suite à cet accident, il souffre d’une blessure l’empêchant de<br />
soulever plus de deux kilogrammes et de travailler plus de vingt heures par semaine.<br />
Après avoir confié au plaignant un poste temporaire respectant ses limitations fonctionnelles,<br />
la municipalité l’a congédié. Elle soutient qu’elle n’avait d’autre choix,<br />
puisque tous les postes qui auraient permis de respecter les limitations fonctionnelles<br />
<strong>du</strong> plaignant étaient comblés, qu’il était impossible de garder le plaignant comme<br />
salarié pour seize ou vingt heures par semaine sans enlever <strong>du</strong> travail aux autres<br />
salariés, et que créer un nouveau poste spécifiquement pour lui constituerait une<br />
contrainte excessive, notamment en raison de la taille de la municipalité. L’arbitre<br />
rejette le grief, concluant que le fait pour la municipalité de garder le plaignant à<br />
son emploi engendrerait pour elle une contrainte excessive, considérant sa taille,<br />
ses contraintes financières et l’importance de ne pas porter atteinte aux droits<br />
<strong>des</strong> autres employés.<br />
Votre expert pour<br />
vos infrastructures<br />
municipales<br />
Des services complets en ingénierie<br />
<strong>des</strong> chaussées et <strong>des</strong> matériaux,<br />
en géotechnique et en<br />
géo-environnement<br />
GROUPE QUALITAS INC.<br />
www.qualitas.qc.ca Tél. : 514-255-0613<br />
Nous vous rappelons que les professionnels <strong>du</strong> Centre<br />
de ressources municipales (CRM) de l’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> sont disponibles pour répondre aux<br />
questions de ses membres en matière de droit <strong>du</strong> travail<br />
et de gestion <strong>des</strong> ressources humaines et pour les<br />
assister professionnellement dans leurs démarches.<br />
1. <strong>2008</strong> CSC 43.<br />
2. Ibid., au para. 18.<br />
3. T.A., 15 octobre 2007, décision de M e Fernand Morin<br />
4. T.A., le 20 février <strong>2008</strong>, décision de M e Jean M. Gagné.<br />
DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ :<br />
Le présent texte ne constitue nullement une opinion juridique. L’éditeur et<br />
l’auteur ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises<br />
sur la base de l’information contenue dans cet article, pas plus qu’ils ne<br />
peuvent être tenus responsables <strong>des</strong> erreurs ou <strong>des</strong> omissions qui auraient<br />
pu s’y glisser. La consultation d’un professionnel <strong>du</strong> CRM est fortement<br />
recommandée si <strong>des</strong> conseils s’avéraient nécessaires.<br />
Une équipe compétente et<br />
expérimentée de 650 employés<br />
dont 100 professionnels<br />
Ingénierie <strong>des</strong> chaussées<br />
• Évaluation <strong>des</strong> chaussées<br />
• Étude de réfection et conception de chaussées<br />
• Gestion <strong>des</strong> chaussées (plan directeur)<br />
Ingénierie <strong>des</strong> matériaux<br />
• Expertise sur matériaux<br />
• Auscultation et évaluation d’infrastructures<br />
• Surveillance et contrôle de la qualité <strong>des</strong> matériaux<br />
• Toitures et étanchéité<br />
Géotechnique et géo-environnement<br />
• Étude géotechnique<br />
• Évaluation environnementale, phases I et II<br />
• Expertise de fondation<br />
• Stabilité <strong>des</strong> pentes<br />
• Sondages au piézocône<br />
• Technique d’investigation innovante<br />
• Géo-caméras (optique et acoustique)<br />
Baie-Comeau • Brossard • Gatineau • Granby • Laval • Mirabel • Montréal • <strong>Québec</strong> • Roberval • Saguenay • Saint-Jean-sur-Richelieu<br />
Saint-Jérôme • Sept-Îles • Sorel-Tracy • Trois-Rivières • Val-d’Or • Vaudreuil-Dorion
LA CHRONIQUE AFFAIRES URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]40<br />
Ce que les riches savent<br />
que les pauvres ne savent pas<br />
Ce que les riches savent que les pauvres ne savent pas ou, en version<br />
originale anglaise, What rich people know that poorer don’t, est le titre<br />
d’une conférence à laquelle j’ai assisté l’hiver dernier sur le campus<br />
<strong>du</strong> prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston.<br />
La salle était pleine à craquer: au moins 150 jeunes étaient présents à<br />
cet événement organisé par nulle autre que la «Rich Dad Foundation».<br />
Histoire d’avoir en main quelque chose de concret pour témoigner de<br />
mon expérience à mon retour au pays, j’ai demandé aux organisateurs<br />
une brochure promotionnelle. Ils m’ont plutôt donné un DVD intitulé :<br />
« Comment choisir les bons projets pour optimiser vos investissements<br />
? » Décidément, j’allais être plongée dans une dimension de la<br />
culture entrepreneuriale américaine fort étrangère à la nôtre : celle de<br />
l’argent et de l’enrichissement.<br />
Pendant cette semaine à Boston, j’ai assisté à d’autres conférences et<br />
j’ai enten<strong>du</strong> à plusieurs reprises le même discours : l’objectif de créer<br />
une entreprise est de tirer le maximum de valeurs d’une opportunité.<br />
Il est important de s’investir de façon intensive pour donner à la nouvelle<br />
entreprise une réelle chance de prendre son envol. Pas question<br />
d’embrasser l’entrepreneuriat pour améliorer sa qualité de vie. « Vous<br />
profiterez de votre argent après », nous a dit un professeur.<br />
Les Américains sont parfaitement à l’aise avec le fait de s’enrichir<br />
parce qu’ils nous le présentent comme le fruit <strong>des</strong> efforts et <strong>du</strong> risque<br />
investis pour y arriver. Ils n’ont absolument aucun complexe et n’hésitent<br />
pas à afficher leur réussite et à en parler aux pauvres.<br />
Je me suis posé cette question : pourrions-nous imaginer un instant<br />
qu’une conférence <strong>du</strong> genre se tienne dans l’une ou l’autre de nos<br />
institutions d’enseignement québécoise? Je crois que non. Certes, je<br />
sais que s’enrichir et tirer profit d’une entreprise constitue l’un <strong>des</strong><br />
PAR NATHALY RIVERIN, VICE-PRÉSIDENTE RECHERCHE,<br />
VIGIE ET DÉVELOPPEMENT DE LA FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP<br />
WWW.ENTREPRENEURSHIP.QC.CA<br />
nombreux facteurs de motivation <strong>des</strong> entrepreneurs, en plus <strong>du</strong> besoin de s’accomplir, d’autonomie et de<br />
liberté. Quand même, j’étais abasourdie! D’une part, quel titre! Nous ne polarisons pas les gens en fonction<br />
de leur compte en banque. Surtout, j’ai la nette impression qu’une conférence qui affirme que les pauvres<br />
savent quelque chose que les riches ne savent pas serait plus populaire au <strong>Québec</strong>… Il y a un petit<br />
«quelque chose» concernant l’essence même et le sens de la vie, bien enraciné dans nos valeurs judéochrétiennes,<br />
évidemment.<br />
Lorsque Jean-Marc Léger a lancé la 10 e édition <strong>du</strong> Concours québécois en entrepreneuriat, au dernier Colloque<br />
annuel de la Fondation de l’entrepreneurship, il a posé la question suivante à une salle bondée d’acteurs<br />
<strong>du</strong> milieu socioéconomique et <strong>des</strong> affaires : combien d’entre vous pensez devenir millionnaire un jour?<br />
Quelques mains timi<strong>des</strong> se sont levées parmi les 500 participants. Pourtant, Loto-<strong>Québec</strong> a un chiffre<br />
d’affaires annuel de 3,8 milliards de dollars et nous sommes moins de huit millions au <strong>Québec</strong> !<br />
Monsieur Léger, pour que les Québécois s’affirment, la question n’était pas la bonne ! Il suffisait de<br />
demander combien d’entre eux avait, au cours de la dernière année, rêvé de devenir millionnaire en achetant<br />
un billet de loto! Toutes les mains se seraient alors levées.<br />
Devant le succès de l’émission sur les Lavigueur et la fascination <strong>des</strong> Québécois face à leur histoire, je me<br />
rappelle cette conférence à Boston et l’attitude de la foule devant la question de M. Léger.<br />
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que pour l’émancipation entrepreneuriale <strong>des</strong> Québécois et pour le<br />
développement économique <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> par l’entrepreneuriat, nous devons inévitablement passer par une<br />
réconciliation avec l’argent et l’enrichissement. Pas l’argent provenant <strong>du</strong> fruit <strong>du</strong> hasard, mais plutôt<br />
celui provenant de l’effort, <strong>du</strong> dynamisme et de l’entrepreneuriat.<br />
À PROPOS DE LA FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP<br />
La Fondation de l’entrepreneurship s’est donné pour mission de promouvoir la culture entrepreneuriale<br />
comme moyen privilégié pour assurer le plein développement économique et social de toutes les régions<br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Elle offre <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its et services incontournables pour les entrepreneurs tels le mentorat<br />
d’affaires, un service de haut calibre et disponible partout au <strong>Québec</strong>, une série de conférences ainsi que<br />
la plus vaste collection de livres de langue française dédiée au démarrage, à la gestion et à la croissance<br />
<strong>des</strong> entreprises. De plus, son centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale, unique au<br />
monde, pro<strong>du</strong>it recherches, analyses et bulletins d’information sur les tendances mondiales et pratiques<br />
exemplaires en matière de sensibilisation et d’é<strong>du</strong>cation à l’entrepreneurship.<br />
Pour de plus amples renseignements: www.entrepreneurship.qc.ca
P]41 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> LA CHRONIQUE ÉNERGIE<br />
L’heure <strong>des</strong> comptes<br />
L’été tire à sa fin et la période de préparation <strong>des</strong> budgets municipaux pointe le bout de son nez.<br />
C’est le moment où jamais de penser à l’efficacité énergétique et de prévoir la mise en œuvre d’initiatives<br />
qui apporteront <strong>des</strong> avantages financiers <strong>du</strong>rables.<br />
Dans les <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, la consommation d’énergie<br />
coûte en moyenne chaque année quelque 45 dollars par habitant.<br />
Ce n’est pas énorme, mais cette facture pourrait être ré<strong>du</strong>ite substantiellement<br />
en adoptant <strong>des</strong> mesures simples. Il suffit de bien<br />
les planifier et de les prévoir au budget.<br />
Si votre municipalité compte entreprendre <strong>des</strong> projets d’envergure<br />
en efficacité énergétique, il serait sage dans un premier temps de<br />
prévoir une enveloppe budgétaire en vue de la réalisation d’une<br />
analyse <strong>du</strong> potentiel d’économies et d’une étude de faisabilité. De<br />
telles étu<strong>des</strong> seront souvent essentielles pour bien orienter votre<br />
démarche.<br />
Dès cette étape, vous pouvez obtenir un appui financier d’Hydro-<strong>Québec</strong>. En effet, le programme Appui aux<br />
initiatives – Optimisation énergétique <strong>des</strong> bâtiments prévoit un montant forfaitaire de 1 000 dollars pour<br />
la préparation de votre projet par un partenaire professionnel agréé. Si le projet est accepté, le partenaire<br />
professionnel pourra recevoir en outre 10 pour cent de l’appui financier accordé par Hydro-<strong>Québec</strong>, jusqu’à<br />
concurrence de 20 000 dollars.<br />
Afin de bien orienter le travail préparatoire <strong>des</strong> professionnels qui vous secondent, il est important de leur<br />
communiquer les orientations de votre municipalité quant à l’utilisation future <strong>des</strong> différents bâtiments et<br />
équipements. Cela permettra d’éviter l’application de mesures d’efficacité énergétique à <strong>des</strong> aménagements<br />
qui pourraient être modifiés à court ou à moyen terme.<br />
VENDRE UN PROJET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE<br />
Tous les projets n’exigent pas la réalisation d’une étude de faisabilité. Des initiatives simples peuvent être<br />
proposées au conseil municipal et intégrées au budget de la municipalité.<br />
Pour être autorisés, de tels projets doivent démontrer <strong>des</strong> avantages tangibles pour la municipalité et les<br />
citoyens: économies d’énergie, ré<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> coûts d’exploitation et d’entretien, fiabilité et confort accrus, etc.<br />
Le document de présentation <strong>du</strong> projet devrait donc fournir aux décideurs <strong>des</strong> informations détaillées sur<br />
le potentiel d’économies d’énergie, le coût <strong>des</strong> mesures envisagées, leur impact sur les coûts d’exploitation<br />
et d’entretien, la période de récupération de l’investissement et le mode de réalisation <strong>du</strong> projet.<br />
À ce chapitre, les entreprises de services éconergétiques (ESÉ) offrent <strong>des</strong> contrats assortis d’une garantie<br />
d’économies d’énergie qui facilitent le financement et permettent de partager les risques.<br />
L’ESÉ analysera les installations et leur exploitation afin d’établir avec précision le potentiel d’économies<br />
d’énergie. En tenant compte <strong>des</strong> résultats de cette vérification, elle planifiera et mettra en œuvre un projet<br />
d’efficacité énergétique en offrant divers services, notamment la conception, le financement, la gestion <strong>des</strong><br />
travaux, le suivi <strong>du</strong> projet pendant toute la période de garantie, la formation <strong>des</strong> responsables de l’entretien<br />
et de l’exploitation, de même que la sensibilisation <strong>du</strong> personnel à l’efficacité énergétique, à l’environnement<br />
et au développement <strong>du</strong>rable.<br />
En vertu de ce mode de réalisation, les coûts directs et indirects <strong>du</strong> projet sont remboursés à même les<br />
économies d’énergie selon les termes <strong>du</strong> contrat intervenu entre l’ESÉ et son client. Un contrat de type clé<br />
en main confie la responsabilité de la conception et <strong>du</strong> rendement<br />
technique et financier <strong>du</strong> projet à l’ESÉ, qui s’engage à réaliser le<br />
projet à même ses propres moyens financiers.<br />
FAIRE D’UNE PIERRE DEUX COUPS<br />
Dans un contexte où les <strong>municipalités</strong> doivent relever le défi de la<br />
pérennité de leurs infrastructures, il peut être avantageux de faire<br />
coïncider un projet d’efficacité énergétique avec un projet de remplacement<br />
d’équipements ou de rénovation d’un bâtiment jugé prioritaire.<br />
En effet, malgré leur rentabilité évidente, les initiatives en efficacité<br />
énergétique ne présentent pas toujours le même attrait que certains<br />
projets permettant de contribuer plus directement à la qualité de vie<br />
<strong>des</strong> citoyens.<br />
En jumelant <strong>des</strong> mesures d’efficacité énergétique à un projet prioritaire,<br />
on est assurer de gagner sur les deux tableaux. La prestation de services<br />
aux citoyens est améliorée et la facture énergétique est ré<strong>du</strong>ite.<br />
PENSER AUX FEUX DE SIGNALISATION<br />
Dans la catégorie <strong>des</strong> mesures rentables n’exigeant pas une longue<br />
analyse, le programme d’Optimisation <strong>des</strong> feux de signalisation mis<br />
en œuvre par Hydro-<strong>Québec</strong> présente une occasion unique.<br />
Chaque feu de signalisation conventionnel utilisant une lampe à<br />
incan<strong>des</strong>cence coûte annuellement près de 90 dollars en énergie.<br />
Avec un feu à dio<strong>des</strong> électroluminescentes, le coût annuel tombe à<br />
environ neuf dollars. Il suffit d’un simple remplacement pour réaliser<br />
<strong>des</strong> économies annuelles de 81 dollars multipliées par le nombre de<br />
feux en exploitation.<br />
À compter <strong>du</strong> 1 er janvier 2009, le programme prévoit le versement aux<br />
<strong>municipalités</strong> d’un appui financier de 50 dollars par feu. En effet,<br />
l’aide financière de 100 dollars par feu prendra fin le 31 décembre<br />
<strong>2008</strong>. Malgré cette ré<strong>du</strong>ction, l’aide accordée par Hydro-<strong>Québec</strong> permet<br />
de couvrir une part importante <strong>du</strong> coût <strong>des</strong> travaux, assurant<br />
ainsi la rentabilité <strong>des</strong> projets de conversion.<br />
Depuis son lancement en 2004, ce programme a permis de <strong>des</strong> économies<br />
de 37 millions de kilowattheures et donné lieu au versement<br />
d’appuis financiers totalisant près de 12 millions de dollars.
De la suite dans les idées<br />
Les enjeux qui animent le milieu municipal évoluent au fil <strong>des</strong> semaines et le magazine URBA en fait état d’une<br />
façon plus systématique en présentant dans la chronique De la suite dans les idées les plus récents développements<br />
sur une foule de sujets d’actualité.<br />
Entente de novembre 2005 sur la taxe<br />
fédérale d’accise sur l’essence<br />
En vertu de l’entente de la taxe sur l’essence Canada – <strong>Québec</strong>,<br />
signée le 28 novembre 2005, les <strong>municipalités</strong> ont jusqu’au<br />
31 décembre 2009 pour dépenser les sommes qui vous ont<br />
été dédiées.<br />
La <strong>du</strong>rée d’application <strong>des</strong> modalités de transfert aux <strong>municipalités</strong><br />
d’une partie de ces revenus est <strong>du</strong> 28 novembre<br />
2005, date de la signature de l’entente, au 31 décembre<br />
2009, date de la fin de la réalisation <strong>des</strong> travaux admissibles.<br />
Chantiers Canada<br />
Depuis plusieurs mois, l’<strong>Union</strong> interpelle le gouvernement <strong>du</strong><br />
Canada et <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> afin qu’ils concluent rapidement une<br />
entente sur Chantiers Canada dont la création a été annoncée<br />
lors <strong>du</strong> budget fédéral 2007. L’<strong>Union</strong> se réjouit de la<br />
signature de l’entente-cadre entre les gouvernements <strong>du</strong><br />
Canada et <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, le 3 septembre dernier, prévoyant le<br />
transfert de près de 4 milliards de dollars au cours <strong>des</strong> sept<br />
prochaines années.<br />
Il s’agit là d’une étape importante. Toutefois, l’<strong>Union</strong> souhaite<br />
que les critères pour le transfert <strong>des</strong> sommes vers les <strong>municipalités</strong><br />
soient souples et qu’ils soient connus rapidement<br />
afin que ces dernières puissent entreprendre les travaux planifiés<br />
en matière d’infrastructures.
Projet de loi 92 sur le statut de l’eau<br />
L’<strong>Union</strong> <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> a présenté ses commentaires<br />
concernant le projet de loi n o 92, Loi affirmant le<br />
caractère collectif <strong>des</strong> ressources en eau et visant à renforcer<br />
leur protection, dans le cadre <strong>des</strong> consultations publiques.<br />
L’<strong>Union</strong> se réjouit de la volonté <strong>du</strong> gouvernement de reconnaître<br />
l’eau comme patrimoine commun <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Elle soulève,<br />
par ailleurs, les besoins en ressources matérielles et<br />
financières <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> qui sont les principales gestionnaires<br />
de l’eau. À ce titre, elles doivent maintenir et<br />
renouveler les infrastructures d’approvisionnement en eau<br />
potable et de traitements <strong>des</strong> eaux usées. L’UMQ réclame de<br />
nouveaux outils pour le maintien et le renouvellement <strong>des</strong><br />
infrastructures de l’eau.<br />
MONTRÉAL<br />
LAVAL<br />
LONGUEUIL<br />
BLAINVILLE<br />
JOLIETTE<br />
De la suite dans les idées<br />
Femmes et politique municipale :<br />
un couple peu banal<br />
Le Comité Femmes et gouvernance locale de l’UMQ en partenariat<br />
avec le Secrétariat à la condition féminine <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
a mis sur pied une série de conférences conçues pour susciter<br />
l’intérêt <strong>des</strong> femmes pour la politique municipale. Sur le<br />
thème: Femmes et politique municipale: un couple peu banal,<br />
cette initiative vise notamment les femmes d’affaires et les<br />
femmes œuvrant dans <strong>des</strong> milieux professionnels.<br />
Les conférencières, toutes <strong>des</strong> mairesses, sillonneront les<br />
régions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> d’ici les prochaines élections municipales<br />
qui auront lieu en novembre 2009.<br />
VOTRE PASSION<br />
c'est de servir vos concitoyens et votre communauté.<br />
NOTRE PASSION<br />
c’est d’avoir réuni la plus vaste équipe de professionnels<br />
en droit municipal et <strong>du</strong> travail au service <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Nos 175 employés, dont 90 professionnels,<br />
vous accompagnent quotidiennement dans la recherche<br />
de l’efficacité et de l’excellence.<br />
LA FORCE D’UNE PASSION<br />
514.866.6743
DE CHOSES ET D’AUTRES URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]44<br />
Nouvelles publications pour<br />
GUIDER LES MUNICIPALITÉS<br />
Depuis le début de l’automne, ministères et organismes publient <strong>des</strong> documents à l’intention <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> afin<br />
de leur présenter de nouvelles informations pertinentes qui contribueront à les guider dans leur prise de décisions<br />
ou à leur fournir une mise à jour <strong>des</strong> dernières réglementations. En voici deux exemples.<br />
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ)<br />
Un complément au Guide de détermination <strong>des</strong> limites de vitesse<br />
sur les chemins <strong>du</strong> réseau routier municipal<br />
Afin d’aider les <strong>municipalités</strong> à remplir leurs responsabilités en matière de détermination<br />
<strong>des</strong> limites de vitesse sur le réseau routier municipal, la Table québécoise<br />
de la sécurité routière a mis en place un groupe de travail sur la Vitesse en milieu<br />
municipal. Dans le cadre de ses travaux, le ministère <strong>des</strong> Transports publiera un<br />
document qui résume les principaux aspects techniques ainsi que les nouvelles<br />
modalités réglementaires.<br />
Des modifications apportées au Code de la sécurité routière en décembre 2007 ont<br />
intro<strong>du</strong>it de nouvelles dispositions en la matière. Une municipalité qui adopte un<br />
règlement pour modifier une limite de vitesse sur un chemin public sous sa responsabilité<br />
n’est plus tenue de le faire approuver par le ministre <strong>des</strong> Transports. Depuis<br />
le 21 décembre 2007, elle doit transmettre le règlement au Ministre dans un délai de<br />
15 jours suivant son adoption, accompagné d’un plan d’information et de signalisation.<br />
À moins d’un désaveu publié dans la Gazette officielle <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, le règlement entre<br />
en vigueur 90 jours après son adoption.<br />
Sous une forme très synthétique et illustrée, le document rappelle les principes de<br />
base en matière de détermination <strong>des</strong> limites de vitesse et présente <strong>des</strong> exemples de<br />
situations correspondant à chaque limite de vitesse. Il aide les intervenants à orienter<br />
rapidement leurs décisions et accompagne ainsi le Guide de détermination <strong>des</strong> limites<br />
de vitesse sur les chemins <strong>du</strong> réseau routier municipal 1 , qui fournit <strong>des</strong> indications<br />
détaillées pour déterminer la limite de vitesse la plus appropriée en fonction <strong>du</strong><br />
milieu environnant.<br />
Cette nouvelle publication s’adresse aux élus, aux gestionnaires et au personnel<br />
technique <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong>, <strong>du</strong> ministère <strong>des</strong> Transports <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et <strong>des</strong> firmes de<br />
consultants.<br />
Le document sera envoyé sous peu en version imprimée à toutes les <strong>municipalités</strong>. Il<br />
sera également disponible en version électronique sous la rubrique Partenaires<br />
(Municipalités) – Sécurité routière <strong>du</strong> site Internet <strong>du</strong> ministère <strong>des</strong> Transports :<br />
www.mtq.gouv.qc.ca<br />
1. Ministère <strong>des</strong> Transports <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Guide de détermination <strong>des</strong> limites de vitesse sur les chemins <strong>du</strong><br />
réseau routier municipal, 2002, 68 pages (document actuellement en révision). Disponible en ligne à<br />
www.mtq.gouv.qc.ca
P]45 URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> DE CHOSES ET D’AUTRES<br />
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION<br />
DE LA CRIMINALITÉ (CIPC)<br />
Premier Rapport international sur la prévention de la criminalité<br />
et la sécurité quotidienne<br />
Le CIPC a publié un premier rapport révélant que la prévention est un outil plus efficace<br />
que la répression pour lutter contre la criminalité dans le monde. Le Rapport international<br />
sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne, une première<br />
mondiale en son genre pro<strong>du</strong>it à Montréal, fait le point sur la prévention et son rôle<br />
important comme réponse à la criminalité et l’insécurité.<br />
« Malgré le <strong>du</strong>rcissement <strong>des</strong> politiques pénales dans certains pays, la prévention<br />
sociale, locale, situationnelle et la réinsertion sociale constituent <strong>des</strong> meilleures<br />
réponses à la criminalité», explique Valérie Sagant, directrice générale <strong>du</strong> CIPC.<br />
Selon le Rapport, la violence et la criminalité doivent être contrées par <strong>des</strong> actions<br />
locales inscrites dans <strong>des</strong> stratégies globales. De plus en plus de pays adoptent <strong>des</strong><br />
stratégies de prévention intégrées : près de 40, dont le Canada et une multitude de<br />
villes sur tous les continents privilégient la prévention, le partenariat et une approche<br />
pluridisciplinaire.<br />
Le Rapport met l’accent sur les types de criminalité quotidienne qui touchent le plus<br />
directement les citoyens: les atteintes à la sécurité <strong>des</strong> jeunes, <strong>des</strong> femmes, et dans<br />
les espaces publics. Il est illustré par plus de 65 pratiques en provenance de 27 pays.<br />
Le Rapport est disponible sur le site Internet <strong>du</strong> CIPC au :<br />
www.crime-prevention-intl.org
LA CHRONIQUE JURIDIQUE URBA OCT-NOV <strong>2008</strong> P]46<br />
Les nouvelles dispositions <strong>du</strong> Règlement sur<br />
l’évacuation et le traitement <strong>des</strong> eaux usées <strong>des</strong><br />
résidences isolées: l’art de compliquer les choses?<br />
Le 1 er janvier 2006 entrait en vigueur la toute nouvelle Loi sur les<br />
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1, ci-après « L.C.M. »).<br />
Cette loi devait marquer un changement majeur de philosophie quant<br />
aux pouvoirs réglementaires <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> qui dorénavant<br />
auraient « <strong>des</strong> pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins<br />
municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population »<br />
(art. 2 L.C.M.). Aussi, les pouvoirs habilitants <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong><br />
devaient maintenant être interprétés de façon large et libérale, laissant<br />
plus de latitude aux conseils municipaux pour adopter <strong>des</strong> mesures<br />
réglementaires adaptées aux impératifs locaux.<br />
Dorénavant, la Loi sur les compétences municipales octroyait donc<br />
aux <strong>municipalités</strong> une compétence spécifique en matière d’« environnement<br />
» (art. 4 L.C.M.). Dans l’exercice de cette compétence, une<br />
municipalité peut adopter tout règlement (art. 19 L.C.M.) et prévoir<br />
toute prohibition (art. 6 L.C.M.). Une municipalité peut également,<br />
dans l’exercice <strong>des</strong> ses compétences, « adopter toute mesure non<br />
réglementaire» (art. 4, al. 2 L.C.M.).<br />
Pour ajouter à ces pouvoirs déjà éten<strong>du</strong>s, la Loi ajoutait à son article 95<br />
notamment que « [t]oute municipalité locale peut installer sur un<br />
immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires<br />
à l’exercice de ses compétences», permettant, <strong>du</strong> même souffle,<br />
aux employés de la municipalité ou aux personnes qu’elle autorise à<br />
entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable<br />
(art. 95. al. 2).<br />
Forts de ces toutes nouvelles dispositions et en nous en remettant à la<br />
nouvelle philosophie de la Loi, nous avions eu l’occasion de conseiller<br />
certaines <strong>municipalités</strong>: dans le contexte de la lutte contre les algues<br />
bleues, notamment, nous estimions qu’une municipalité pouvait<br />
adopter un règlement en matière d’environnement portant sur le<br />
contrôle de la conformité et l’entretien <strong>des</strong> installations septiques se<br />
trouvant sur <strong>des</strong> propriétés privées sur son territoire<br />
Néanmoins, pour ajouter à ces pouvoirs, le législateur adoptait et<br />
mettait en vigueur, le 13 décembre 2007, l’article 25.1 qui prévoit<br />
que « [t]oute municipalité locale peut, aux frais <strong>du</strong> propriétaire de<br />
l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement <strong>des</strong> eaux<br />
usées d’une résidence isolée au sens <strong>du</strong> Règlement sur l’évacuation<br />
et le traitement <strong>des</strong> eaux usées <strong>des</strong> résidences isolées (R.R.Q., 1981,<br />
chapitre Q-2, r. 8) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut<br />
aussi procéder à la vidange <strong>des</strong> fosses septiques de tout autre<br />
immeuble. »<br />
PAR M E JEAN-FRANÇOIS GIRARD, AVOCAT<br />
Constatons ainsi que les <strong>municipalités</strong> ont dorénavant clairement le pouvoir d’installer et d’entretenir<br />
tout système de traitement <strong>des</strong> eaux usées d’une résidence isolée se trouvant sur leur territoire.<br />
L’ajout de cette disposition aurait notamment été ren<strong>du</strong> nécessaire afin de permettre la mise en application<br />
<strong>des</strong> nouvelles dispositions <strong>du</strong> Règlement sur l’évacuation et le traitement <strong>des</strong> eaux usées <strong>des</strong> résidences<br />
isolées (R.Q., c. Q-2, r.8; ci-après le «Q-2, r.8») concernant les traitements tertiaires de désinfection par<br />
rayonnement ultraviolet, particulièrement quant aux obligations <strong>des</strong> <strong>municipalités</strong> qui désirent autoriser<br />
l’installation de tels systèmes sur leur territoire.<br />
Avant de permettre l’installation de ce type de systèmes sur son territoire, le nouvel article 87.14.1 <strong>du</strong> Q-2,<br />
r.8 exige en effet que la municipalité concernée effectue elle-même – ou fasse effectuer par un tiers –<br />
l’entretien de ceux-ci, sur les propriétés privées, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article<br />
25.1 L.C.M.<br />
Bref, il appert qu’aucun système tertiaire de traitement <strong>des</strong> eaux usées faisant appel au rayonnement<br />
ultraviolet ne peut dorénavant être installé pour <strong>des</strong>servir une résidence isolée sans que la municipalité<br />
concernée ait adopté, au préalable, un règlement par lequel elle déclare prendre charge de l’entretien de<br />
ce type de système de traitement.<br />
Ainsi, en vertu <strong>des</strong> nouvelles dispositions <strong>du</strong> Q-2, r.8, nous estimons que les <strong>municipalités</strong> sont obligatoirement<br />
appelées à se substituer au fabricant en ce qui concerne l’entretien de ces systèmes (art. 3.3, al. 1<br />
<strong>du</strong> Q-2, r.8) si elles désirent en autoriser l’installation sur leur territoire, quitte à faire elles-mêmes appel<br />
aux services de ce fabricant au moment de l’entretien. Cette obligation ne s’applique cependant pas aux<br />
systèmes installés avant le 4 octobre 2006 1 .<br />
Si nous comprenons, à certains égards, les précautions <strong>du</strong> législateur quant aux systèmes tertiaires de<br />
traitement <strong>des</strong> eaux usées faisant appel au rayonnement ultraviolet dans la mesure où le bon fonctionnement<br />
de ces systèmes nécessite un entretien spécialisé et régulier, nous questionnons la façon dont il s’y prend.<br />
Nous sommes en effet informés que la vente d’un tel système de traitement <strong>des</strong> eaux usées d’une résidence<br />
isolée est obligatoirement assortie d’un contrat d’entretien pendant toute la <strong>du</strong>rée de vie utile <strong>des</strong> équipements.<br />
La garantie <strong>du</strong> fabricant est entre autres liés à l’existence d’un tel contrat d’entretien valide en<br />
tout temps entre le citoyen qui achète un tel système et son fabricant. Le premier alinéa de l’article 3.3 <strong>du</strong><br />
Q-2, r.8 reprend d’ailleurs cette exigence qui nous apparaît appropriée.<br />
Cependant, en obligeant dorénavant les <strong>municipalités</strong> qui désirent permettre l’installation de tels systèmes<br />
sur leur territoire à se substituer au fabricant pour effectuer l’entretien, le législateur s’insère directement<br />
dans la relation contractuelle qui existe entre le citoyen et le fabricant <strong>du</strong> système sans préciser, notamment,<br />
ce qu’il doit advenir de la garantie <strong>du</strong> fabricant. Cette immixtion <strong>du</strong> législateur dans les relations contractuelles<br />
nous apparaît excéder ce qui était requis pour protéger l’environnement en cette matière. Ainsi,<br />
nous sommes d’avis qu’il aurait été suffisant de demander aux <strong>municipalités</strong> d’intervenir à titre supplétif<br />
en cas de défaut d’entretien de certaines installations septiques sur leur territoire, plutôt que de leur<br />
demander d’agir au premier chef.<br />
1. Les propriétaires de ces systèmes sont donc tenus de les faire entretenir conformément aux dispositions <strong>des</strong><br />
trois premiers alinéas de l’article 3.3. <strong>du</strong> Q-2, r.8.<br />
* Avocat et biologiste spécialisé en droit de l’environnement et droit municipal chez Dufresne Hébert Comeau,<br />
M e Girard est également président <strong>du</strong> conseil d’administration <strong>du</strong> Centre québécois <strong>du</strong> droit de l’environnement<br />
(CQDE).
GROUPE<br />
FEMMES, POLITIQUE ET DÉMOCRATIE
DÉNEIGEMENT<br />
VENTE > DISTRIBUTION > INSTALLATION > SERVICE<br />
Votre spécialiste en<br />
équipements de travail<br />
pour camions au <strong>Québec</strong><br />
AVEC PLUS DE “40” SOUS-DISTRIBUTEURS À TRAVERS LA PROVINCE !<br />
TREUILS REMORQUAGE / TRANSPORTEURS<br />
HAYONS HYDRAULIQUES<br />
GRUES ARTICULÉES ET TÉLESCOPIQUES NACELLES / BOÎTES DE SERVICE REMORQUES ET FARDIERS<br />
AUTRES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES BOÎTES ET PLATEAUX DOMPEURS / INSERTION SYSTÈMES DE LEVAGE À CROCHET / PLATEAUX FIXES<br />
Visitez notre site WEB à www.equipementstwin.ca<br />
info@equipementstwin.ca<br />
10401, boul.Parkway, Villed’Anjou(<strong>Québec</strong>) H1J1R4 Tél.: (514)353-1190 Téléc.: (514)353-1119 Sansfrais: 1-877-300-8946<br />
81007-TWIN