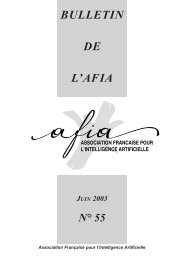La maladie de Verneuil Épidémiologie - Étiopathogénie
La maladie de Verneuil Épidémiologie - Étiopathogénie
La maladie de Verneuil Épidémiologie - Étiopathogénie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dossier thématique<br />
pour les régions axillaire et inguino-périnéale.<br />
Les hommes et les femmes peuvent présenter<br />
la <strong>maladie</strong>, et la plupart <strong>de</strong>s séries soulignent<br />
une prépondérance féminine, avec un ratio<br />
pouvant atteindre 4 pour 1 (8). <strong>La</strong> localisation<br />
axillaire – encore que, sur ce point, l’accord<br />
ne soit pas fait (9) – serait plus fréquente chez<br />
la femme, alors que la localisation anopérinéale<br />
le serait chez l’homme (1). Le pic<br />
d’apparition correspond à l’élévation <strong>de</strong> la<br />
sécrétion androgénique. C’est dire que la MV<br />
s’observe après la puberté (<strong>de</strong>uxième, troisième<br />
ou quatrième déca<strong>de</strong> <strong>de</strong> la vie), bien que<br />
d’exceptionnelles formes prépubertaires aient<br />
été décrites (10), faisant discuter un statut<br />
d’hyperandrogénie prépubertaire (1). L’avis<br />
n’est pas unanime quant à l’influence éventuelle<br />
<strong>de</strong> la race, la <strong>maladie</strong> paraissant plus fréquente<br />
chez les Noirs dans quelques séries<br />
(11). L’usage <strong>de</strong> cosmétique, la contraception<br />
orale, l’in<strong>de</strong>x <strong>de</strong> masse corporelle ne sont pas<br />
apparus comme <strong>de</strong>s facteurs déterminants (9).<br />
Enfin, le tabac est considéré comme favorisant<br />
(12, 13).<br />
ÉTIOPATHOGÉNIE<br />
L’étiopathogénie <strong>de</strong> la <strong>maladie</strong> <strong>de</strong> <strong>Verneuil</strong><br />
reste encore incertaine. Elle relève <strong>de</strong> multiples<br />
facteurs, d’influence et d’importance<br />
variables, que nous allons essayer <strong>de</strong> passer en<br />
revue.<br />
Les facteurs génétiques ont été avancés par<br />
Fitzsimmons et al. qui émirent l’hypothèse<br />
d’une transmission autosomique dominante<br />
(7). Khönig et al. ont supposé une hérédité <strong>de</strong><br />
type polygénique (12). Récemment, von <strong>de</strong>r<br />
Werth et al. ont confirmé la possibilité d’une<br />
hérédité autosomique dominante associée à<br />
une pénétrance variable et à une éventuelle<br />
influence hormonale sur l’expressivité du<br />
gène. Ils ont aussi soulevé la question <strong>de</strong> l’intervention<br />
possible <strong>de</strong> plusieurs gènes (14).<br />
Cela posé, il reste que la question essentielle<br />
autour <strong>de</strong> laquelle débats et controverses se<br />
sont organisés <strong>de</strong>meure, à savoir : la MV estelle<br />
une affection suppurative <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s apocrines<br />
?<br />
<strong>La</strong> mise en cause <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s apocrines tenait<br />
initialement à la localisation <strong>de</strong>s lésions qui ne<br />
s’observaient que dans le territoire <strong>de</strong> ces<br />
glan<strong>de</strong>s. Toutefois, cela ne disait rien du primum<br />
movens <strong>de</strong> la <strong>maladie</strong>. Était-elle une<br />
affection primitive <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s apocrines ? Si<br />
tel était le cas, il fallait s’en remettre à l’hypothèse<br />
d’une obstruction du canal glandulaire,<br />
car Morgan et Hughes avaient montré<br />
que les glan<strong>de</strong>s apocrines <strong>de</strong>s sujets atteints ne<br />
se différenciaient pas <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s témoins<br />
dans leur forme et leur nombre (15). Une telle<br />
théorie s’appuyait sur les travaux <strong>de</strong> Shelley<br />
et Cahn (16), qui avaient provoqué une occlusion<br />
<strong>de</strong>s canaux apocrines par l’application <strong>de</strong><br />
produits dépilatoires au niveau <strong>de</strong>s creux axillaires.<br />
Cependant, les lésions ne s’observaient<br />
que dans 26 % <strong>de</strong>s cas et n’évoluaient pas vers<br />
la chronicité comme dans l’hidradénite suppurative<br />
(HS) : le tableau réalisé ne pouvait<br />
donc constituer un modèle expérimental <strong>de</strong> la<br />
<strong>maladie</strong>. D’ailleurs, la seule <strong>maladie</strong> connue<br />
où existe une oblitération isolée du canal apocrine<br />
– la <strong>maladie</strong> <strong>de</strong> Fox Fordyce – ne se présente<br />
pas comme une MV. En fait, et Yu et<br />
Cook furent parmi les premiers à l’avancer,<br />
l’obstruction existait bien, mais elle se trouvait<br />
en amont, au niveau du follicule pileux<br />
(5). Attanoos et al., par l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> biopsies<br />
cutanées <strong>de</strong> patients atteints <strong>de</strong> MV, le confirmèrent<br />
en montrant que l’occlusion <strong>de</strong>s follicules<br />
par <strong>de</strong> la kératine était l’étape initiale <strong>de</strong><br />
la <strong>maladie</strong>, suivie d’une inflammation folliculaire<br />
et d’une <strong>de</strong>struction secondaire <strong>de</strong>s<br />
annexes (17). Ainsi la MV est-elle plutôt<br />
considérée comme secondaire à une anomalie<br />
<strong>de</strong> la tige folliculaire <strong>de</strong> follicules dans lesquels<br />
s’abouchent <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s apocrines (1).<br />
Cette analyse se trouve confirmée par l’étu<strong>de</strong><br />
ultrasonographique <strong>de</strong>s follicules pileux qui,<br />
dans la MV, présentent <strong>de</strong>s anomalies caractéristiques<br />
<strong>de</strong> forme dans leur partie profon<strong>de</strong><br />
(18). L’association possible avec une <strong>maladie</strong><br />
<strong>de</strong> Dowling-Degos (19) a aussi été avancée<br />
pour démontrer la nature folliculaire <strong>de</strong> la MV.<br />
Cependant, on ne peut éliminer ici une association<br />
fortuite.<br />
Cette hypothèse admise, il reste à essayer <strong>de</strong><br />
préciser le rôle éventuel <strong>de</strong>s androgènes car,<br />
nous l’avons vu, la MV est, dans la quasitotalité<br />
<strong>de</strong>s cas, une <strong>maladie</strong> <strong>de</strong> la postpuberté.<br />
Cette participation androgénique se retrouve<br />
chez les femmes atteintes qui décrivent une<br />
aggravation <strong>de</strong>s lésions lors <strong>de</strong>s règles et une<br />
amélioration pendant la grossesse, suivie<br />
d’une aggravation dans le post-partum (20).<br />
<strong>La</strong> <strong>maladie</strong> <strong>de</strong> <strong>Verneuil</strong> n’existe d’ailleurs pas<br />
chez les eunuques (21). De plus, les androgènes<br />
facilitent la production <strong>de</strong> kératine, et<br />
les étu<strong>de</strong>s chez l’animal ont montré que<br />
11<br />
l’occlusion folliculaire pouvait être accrue par<br />
adjonction systémique d’androgènes (1). Toutefois,<br />
il est <strong>de</strong>s auteurs qui discutent le rôle<br />
<strong>de</strong>s androgènes dans la MV, arguant <strong>de</strong> l’absence<br />
d’hyperandrogénisme biologique. En<br />
fait, il est probable que chez les sujets porteurs<br />
<strong>de</strong> MV existe une sensibilité anormale <strong>de</strong> la<br />
glan<strong>de</strong> apocrine aux androgènes (10). Cependant<br />
il n’a pas été montré, entre sujets atteints<br />
et contrôles, <strong>de</strong> différence d’activité enzymatique<br />
vis-à-vis <strong>de</strong>s androgènes au niveau <strong>de</strong>s<br />
glan<strong>de</strong>s apocrines axillaires (22). On le voit,<br />
la relation androgène-<strong>maladie</strong> <strong>de</strong> <strong>Verneuil</strong><br />
n’est pas encore éclaircie. Cette incertitu<strong>de</strong> se<br />
retrouve dans les effets inconstants <strong>de</strong>s traitements<br />
antiandrogéniques <strong>de</strong> la MV chez la<br />
femme.<br />
Qu’en est-il <strong>de</strong> l’infection ? On le sait, la MV<br />
est suppurative, mais l’infection n’est ici que<br />
secondaire. Comme dans l’acné, il s’agit d’une<br />
colonisation bactérienne <strong>de</strong> glan<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> leur<br />
contenu. Une preuve indirecte du caractère<br />
secondaire <strong>de</strong> l’infection est apportée par l’incapacité<br />
<strong>de</strong>s antibiotiques à traiter la MV sur<br />
le fond. Dans une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 41 patients porteurs<br />
<strong>de</strong> MV, seules 50 % <strong>de</strong>s cultures étaient positives<br />
avec l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> Staphylococcus<br />
aureus, S. epi<strong>de</strong>rmidis et S. hominis, Streptococcus<br />
milleri, Corynebacterium spp, Acinetobacter,<br />
<strong>La</strong>ctobacillus spp (23). Ce travail n’a<br />
pas confirmé l’hypothèse d’un éventuel rôle<br />
causal <strong>de</strong> S. milleri qui avait été avancée par<br />
Highet et al. en 1980 (24). Dans une autre<br />
étu<strong>de</strong> (25), la même équipe ne retrouvait pas<br />
d’arguments pour confirmer le travail <strong>de</strong><br />
Bendahan et al. (26), faisant <strong>de</strong> Chlamydozoon<br />
trachomatis un agent causal <strong>de</strong> MV périanale.<br />
De même, l’association entre MV et <strong>maladie</strong>s<br />
vénériennes s’est avérée fortuite.<br />
TENTATIVE DE SYNTHÈSE<br />
Au terme <strong>de</strong> cette revue <strong>de</strong> la littérature, on<br />
peut retenir que la MV n’est pas une <strong>maladie</strong><br />
primitivement infectieuse, qu’elle se développe<br />
dans le territoire <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s apocrines,<br />
mais qu’il est probable qu’il n’existe pas à son<br />
origine une atteinte première <strong>de</strong> ces glan<strong>de</strong>s.<br />
Le primum movens en serait l’obstruction folliculaire<br />
d’amont dans un contexte hormonal<br />
d’une éventuelle sensibilité à l’imprégnation<br />
androgénique. À cela il faut ajouter la vraisemblable<br />
transmission autosomique<br />
Le Courrier <strong>de</strong> colo-proctologie (II) - n° 1 - mars 2001