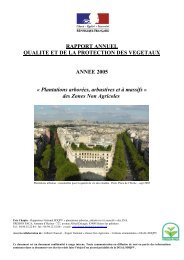GUIDE de BONNES PRATIQUES DESHERBAGE EN ZNA
GUIDE de BONNES PRATIQUES DESHERBAGE EN ZNA
GUIDE de BONNES PRATIQUES DESHERBAGE EN ZNA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
M IN IS T E R E D E L ’A G R IC U L T U R E ,<br />
D E L ’A L IM E N T A T IO N , D E L A P E C H E E T D E S A F F A IR E S R U R A L E S<br />
<strong>GUIDE</strong> <strong>de</strong> <strong>BONNES</strong> <strong>PRATIQUES</strong><br />
<strong>DESHERBAGE</strong><br />
<strong>EN</strong> <strong>ZNA</strong><br />
1
INTRODUCTION<br />
………………………………….…………………………………………….…………..….p3<br />
I/ NUISANCES PERCUES ET FLORE SPONTANEE <strong>EN</strong> ZONES NON<br />
AGRICOLES……………………………………………………………………………….p4<br />
II/ <strong>PRATIQUES</strong> DES ZONES NON<br />
AGRICOLES………………………………...……………………………………….…….p8<br />
1/ Evolution <strong>de</strong> la<br />
réglementation……………………………………………….……….…………………….p8<br />
2/ Evolution <strong>de</strong>s<br />
produits………………………………………………………...……….……….….p9<br />
3/ Evolution <strong>de</strong>s<br />
pratiques……………………………………….……………………………………….p10<br />
III/ TRANSFERTS DES HERBICIDES DANS<br />
L’<strong>EN</strong>VIRONNEM<strong>EN</strong>T……...………………………………………………………..…...p13<br />
1/ Transferts vers<br />
l’atmosphère…………………………..…………..…………………….………….……...p14<br />
2/ Transferts vers les<br />
eaux…………………………..……………….………………………………….....……...p15<br />
3/ Rétention et dégradation dans le<br />
sol……………….…………………………..……..……………………………………….p16<br />
4/ Conséquences <strong>de</strong>s transferts d’herbici<strong>de</strong>s dans<br />
l’environnement….….……….………………………………………………………..….p17<br />
IV/ EFFETS DES HERBICIDES SUR LA SANTE<br />
HUMAINE………………………………………………………………………………..p19<br />
STRATEGIE POUR LA GESTION DES ADV<strong>EN</strong>TICES SELON UNE EVALUATION<br />
DES RISQUES DOMINANTS………………………………………………..……..….p22<br />
ETAPE 1 : REALISER UN INV<strong>EN</strong>TAIRE DES<br />
SURFACES….……………………………………..…………………..……………..….p22<br />
ETAPE 2 : ID<strong>EN</strong>TIFIER LA FLORE<br />
PRES<strong>EN</strong>TE….……………………………………...………………………………....….p23<br />
ETAPE 3 : ID<strong>EN</strong>TIFIER LE NIVEAU D’<strong>EN</strong>TRETI<strong>EN</strong> SOUHAITE<br />
POUR CHAQUE SITE….………………..………………………………………….….p25<br />
ETAPE 4 : ID<strong>EN</strong>TIFIER LES RISQUES……..……………………………...….....….p27<br />
1/ Evaluer les risques <strong>de</strong> contamination du public selon la fréquentation du<br />
site……………………………………………………………………………………….p27<br />
2/ Evaluer le risque pour les<br />
eaux….…….…………………….……………………………………….….………...….p30<br />
2
3/ Evaluation du risque pour la<br />
biodiversité….…….…………………….………………………………………...……...p35<br />
4/ Evaluation du risque pour les<br />
plantations….…….…………………….………………………………………….……..p36<br />
ETAPE 5 : PR<strong>EN</strong>DRE <strong>EN</strong> COMPTE LES<br />
PRECONISATIONS…………………………………………………………………….p38<br />
1/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour la santé<br />
publique………….…………………………………………………………………....….p38<br />
2/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour les<br />
eaux……………………..………………………………………………...…………...….p40<br />
3/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour la<br />
biodiversité……………...……………………………………………………..……...….p41<br />
4/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour les<br />
plantations……………..……………………………………………………….………...p42<br />
PREVOIR LE <strong>DESHERBAGE</strong> DES LA CONCEPTION DES<br />
ESPACES…………………………………………………………………………………p43<br />
I/ CONCEVOIR DES SURFACES LAISSANT PEU DE PLACE A LA FLORE<br />
ADV<strong>EN</strong>TICE………………………………….…..……………………………………..p43<br />
II/ IMPLANTER UNE VEGETATION COMPETITIVE QUI LAISSERA PEU DE<br />
PLACE AUX<br />
ADV<strong>EN</strong>TICES……………..…………………………….………………………..……...p45<br />
1/ Utiliser <strong>de</strong>s plantes<br />
couvrantes……………….………………………………………………………………...p45<br />
2/ Engazonner les<br />
surfaces…………………………………….……………………………………………...p45<br />
III/ GERER LA VEGETATION DANS LES <strong>EN</strong>DROITS INACCESSIBLES A LA<br />
TONTE OU A LA<br />
FAUCHE……………………………………………………………………………...p46<br />
1/ Créer <strong>de</strong>s<br />
bordures………………………...………………...………………………….…….....p46<br />
2/ Aménager la base <strong>de</strong>s<br />
équipements……………………….……………...………...………………………...p46<br />
3/ Eviter <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s zones<br />
inaccessibles……………………..………………...……………………………….…p48<br />
IV/ CONCEVOIR DES ESPACES OU LA VEGETATION SPONTANEE SERA<br />
MIEUX<br />
TOLEREE………………………...………………………………………………….p49<br />
1/ Mettre en place <strong>de</strong>s prairies<br />
fleuries……………………………………...………………………………..….….…p49<br />
3
2/ Composer <strong>de</strong>s massifs<br />
diversifiés………………………………………...………………………….….….…p49<br />
LES TECHNIQUES ALTERNATIVES DE <strong>DESHERBAGE</strong>…………..…………p50<br />
I/ TECHNIQUES PREV<strong>EN</strong>TIVE…………………………………………….…...…p50<br />
1/ Les paillages……..…………………………………………………..…...…p50<br />
2/ Métho<strong>de</strong>s prophylactiques pour la gestion <strong>de</strong>s pelouses………...…….…p56<br />
II/ TECHNIQUES CURATIVES..…………………………………….………….…p61<br />
1/ Désherbage thermique..…………….…………………………………..…p61<br />
2/ Désherbage mécanique…..……………….………………………………..p72<br />
3/Autres techniques…..……………….………………………………………p78<br />
4/Eléments <strong>de</strong> comparaison <strong>de</strong>s différentes techniques…..……………..….p81<br />
5/ Eléments <strong>de</strong> raisonnement <strong>de</strong> l’impact environnemental <strong>de</strong>s différentes<br />
techniques…………………………………………………………………………….p83<br />
LA MISE <strong>EN</strong> ŒUVRE DU <strong>DESHERBAGE</strong> CHIMIQUE…………………….….p89<br />
I/ MODES D’ACTION DES HERBICIDES……………………………... ….….….p89<br />
II/ USAGES…..…………………………………………………………………..……p89<br />
III/ AGREM<strong>EN</strong>T ET FORMATION….……………………….…………………...p90<br />
IV/ S’INFORMER AVANT LA MISE <strong>EN</strong> OEUVRE…..…..…...………………...p90<br />
1/ Lire les étiquettes…………………………...……………………………....p90<br />
2/ Lire les fiches <strong>de</strong> données <strong>de</strong> sécurité…..………….……………………..p92<br />
V/ PROTECTION DE L’OPÉRATEUR…………..……….…...…………………..p93<br />
VI/ STOCKAGE…..…...…………………………………...…………….…………..p94<br />
1/ Local <strong>de</strong><br />
stockage…..……………………...………………………………….….………...…..p94<br />
2/ Emballages vi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produits phytosanitaires (EVPP)……… ….……...p96<br />
3/ Les produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) …………………..p96<br />
VII/ LE PULVERISATEUR…..…………………………………….….…………..p96<br />
1/ L’entretien…..………………………..…………………….……………....p96<br />
2/ L’étalonnage……………………………….……………....……………....p97<br />
VIII/ LE DOSAGE…..……………………………………….…...…………………..p97<br />
IX/ LE REMPLISSAGE DE LA CUVE…..……………….………………….……..p98<br />
1/ Eviter les débor<strong>de</strong>ments…..…………………………………..……………..p98<br />
2/ Eviter les retours vers le système d’alimentation…..…….………………..p98<br />
3/ Aire <strong>de</strong> remplissage…..……………………………….…………...………..p98<br />
4
4/ Incorporation…..…………………….…….……………………..………...p98<br />
X/ PRECAUTIONS A PR<strong>EN</strong>DRE LORS DU TRAITEM<strong>EN</strong>T…..……………..…p99<br />
1/ Conditions météorologiques…..…………………………………...…….....p99<br />
2/ Respecter les résultats <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> risque…..………...……....…..…..p99<br />
3/ Enregistrer les pratiques…..………...…………………….…………..…..p100<br />
XI/ GESTION DES EFFLU<strong>EN</strong>TS………..……………………………………..…..p100<br />
1/ Fonds <strong>de</strong> cuve…..…...………………….……………………………..…....p100<br />
2/ Eaux <strong>de</strong> rinçage…..………...……………..…………………..………..…..p100<br />
3/ Gestion <strong>de</strong>s eaux souillées stockées par la plate-forme <strong>de</strong> remplissage...p100<br />
XII/ TECHNOLOGIES FACILITANT LE <strong>DESHERBAGE</strong> CHIMIQUE……....p101<br />
1/ Pompes doseuses ……………………….………………………..…...…....p101<br />
2/ Détection automatique <strong>de</strong>s adventices………………………….…...…....p101<br />
3/ Détection automatique <strong>de</strong>s équipements………….....…………………...p101<br />
CONCLUSION……………………...….....………………………………………….p102<br />
BIBLIOGRAPHIE………………………………..………………………………….p103<br />
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES……………………………………………...….p106<br />
5
INTRODUCTION<br />
Les Zones Non Agricoles sont définies comme « <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> nature où les végétaux ne<br />
sont pas cultivés pour un commerce alimentaire » (AFPP, 1999).<br />
Elles regroupent entre autres :<br />
- Les espaces communaux (espaces verts, voirie, terrains <strong>de</strong> sport, cimetières…)<br />
- Les réseaux <strong>de</strong> communication (routes et autoroutes, chemin <strong>de</strong> fer, aéroports…)<br />
- Les zones engazonnées (terrains <strong>de</strong> sports collectifs, golfs, hippodromes)<br />
- Les zones industrielles (centrales EDF-GDF, usines, zones <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> produits<br />
inflammables…)<br />
- Les enceintes militaires<br />
En agriculture, la présence <strong>de</strong> plantes adventices est jugée comme nuisible lorsqu’elle<br />
entraîne une concurrence pour l’espace et les éléments vitaux (eau, éléments minéraux). En<br />
zone non agricole, les adventices causent d’autres types <strong>de</strong> nuisances : nuisances esthétiques,<br />
sanitaires (plantes allergènes…), sécuritaires (propagation possible d’incendie)…<br />
Pendant longtemps, la végétation spontanée <strong>de</strong>s zones non agricoles a été gérée par la<br />
mise en œuvre du désherbage chimique, avec pour seul objectif une efficacité et une<br />
persistance d’action maximales. Cependant, à partir <strong>de</strong>s années 80, une évolution <strong>de</strong> la<br />
réglementation, couplée à une prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong>s impacts sur l’environnement <strong>de</strong>s<br />
herbici<strong>de</strong>s, a entraîné une remise en question <strong>de</strong>s pratiques.<br />
Actuellement, <strong>de</strong> nombreuses actions se mettent en place, notamment sur l’initiative <strong>de</strong>s<br />
Groupes Régionaux d’Action contre la Pollution par les Produits Phytosanitaires. Ces actions<br />
impliquent les agriculteurs mais aussi les gestionnaires <strong>de</strong>s zones non agricoles.<br />
Dans ce contexte, les gestionnaires <strong>de</strong> zones non agricoles sont en <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’outils leur<br />
permettant <strong>de</strong> raisonner le désherbage.<br />
1 Adventice s en zone urbaine<br />
Ce gui<strong>de</strong> a pour objectif <strong>de</strong> proposer une métho<strong>de</strong> pour le raisonnement du désherbage<br />
qui tend à minimiser les risques pour la santé humaine, pour l’environnement et pour les<br />
plantations ornementales (arbres d’alignements, massifs…), et <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s informations<br />
sur les différentes métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s adventices.<br />
6
I/ NUISANCES PERCUES ET FLORE SPONTANEE <strong>EN</strong> ZONES NON AGRICOLES<br />
Les zones non agricoles présentent <strong>de</strong>s caractéristiques variées (géomorphologie,<br />
ensoleillement, type <strong>de</strong> substrat..), qui permettent le développement d’une végétation<br />
spontanée diversifiée.<br />
Lors d’une enquête réalisée en 2003 dans 44 villes <strong>de</strong> France, Sylvie Llados a inventorié les<br />
plantes se développant dans différents compartiments urbains (154 trottoirs, 79 cuvettes<br />
d’arbres, 42 cimetières, 38 parcs, 32 parkings, 13 îlots directionnels, 13 sites divers).<br />
Un total <strong>de</strong> 457 espèces différentes a été i<strong>de</strong>ntifié, avec 145 espèces représentant 90 % <strong>de</strong> la<br />
flore inventoriée. Cependant, il existe une flore dominante : 25 espèces représentent 50% <strong>de</strong><br />
l’effectif total <strong>de</strong>s plantes inventoriées.<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Poa annua<br />
Senecio vulgaris<br />
Taraxacum officinale<br />
Sonchus asper<br />
Conyza sumatrensis<br />
Sonchus oleracerus<br />
Stellaria media<br />
Epilobium tetragonum<br />
Lactuca serriola<br />
Polygonum aviculare<br />
Plantago major<br />
Figure 1 : Fréquence <strong>de</strong>s 25 principales espèces d’adventices parmi les relevés faits par<br />
Sylvie Llados en milieu urbain<br />
De plus, Sylvie Llados a mis en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s espèces caractéristiques <strong>de</strong> certains sites :<br />
- Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana et Linaria cymbalaria pour les cimetières<br />
- Sonchus asper et Lactuca serriola pour les trottoirs imperméables<br />
- Daucus carota, Plantago major, Plantago lanceolata et Polygonum aviculare pour les<br />
cuvettes d’arbres.<br />
Sagina apetala<br />
Veronica arvensis<br />
Cardamine hirsuta<br />
Conyza cana<strong>de</strong>nsis<br />
Capsellabursa-pastoris<br />
Medicago lupulina<br />
Cerastium glomeratum<br />
Euphorbia peplus<br />
Arabidospsis thaliana<br />
Lapsana communis<br />
Trifolium repens<br />
Daucus carota<br />
7<br />
Chenopodium album<br />
Picris heracioi<strong>de</strong>s
Cette végétation occasionne un certain nombre <strong>de</strong> nuisances, perçues avec plus ou<br />
moins d’acuité selon le type <strong>de</strong> public : citoyens, responsables politiques ou professionnels en<br />
charge <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s espaces.<br />
- Nuisances esthétiques<br />
C’est l’une <strong>de</strong>s principales problématiques en zone non agricole. La présence d’adventices<br />
peut être jugée comme inesthétique ; elle implique aux yeux du public une notion <strong>de</strong> désordre,<br />
<strong>de</strong> saleté : on peut définir une mauvaise herbe comme « une plante qui n’est pas à la bonne<br />
place » : dans l’esprit du public, il faut donc éliminer les adventices pour éviter les<br />
disharmonies et les impressions <strong>de</strong> saleté ou <strong>de</strong> négligence (Menozzi M-J, 2004). Dans une<br />
enquête réalisée en 2004 par Emilie Zadjan sur la nuisance <strong>de</strong>s mauvaises herbes en zone<br />
urbaine, il ressort que plus d’un quart <strong>de</strong>s personnes interrogées ont défini la mauvaise herbe<br />
comme « une plante inesthétique ». La nuisance esthétique d’une plante dépend en partie <strong>de</strong><br />
sa hauteur et <strong>de</strong> son développement volumique, mais son importance varie essentiellement<br />
selon la nature et l’emplacement du site (fréquentation, esthétique du site en lui-même…).<br />
La nuisance esthétique est également variable selon la perception qu’a le public <strong>de</strong>s<br />
adventices, et plus généralement <strong>de</strong> la vision qu’il a <strong>de</strong> la place <strong>de</strong> l’homme par rapport aux<br />
éléments naturels qui l’entourent.<br />
La nuisance esthétique causée par les adventices dépend <strong>de</strong> leur emplacement et <strong>de</strong> la<br />
perception qu’en a le public (2 adventices au pied d’un muret, 3 au pied d’un arbre, 4<br />
dans un cimetière)<br />
- Nuisances sécuritaires<br />
2 3 4<br />
La présence <strong>de</strong> végétation spontanée peut, par exemple, masquer la signalisation : c’est<br />
le cas le long <strong>de</strong>s routes et autoroutes. C’est aussi le cas dans les aéroports, où la signalisation<br />
routière (pour les véhicules circulant dans l’enceinte) et aérienne, notamment lumineuse, doit<br />
rester parfaitement visible.<br />
Sur les voies ferrées, la végétation peut modifier les propriétés du ballast, et donc<br />
perturber la signalisation lumineuse qui fonctionne à l’ai<strong>de</strong> d’un courant alternatif faible<br />
circulant dans le ballast.<br />
Une végétation sèche peut favoriser la propagation d’incendies. C’est une problématique<br />
importante, en particulier pour les zones industrielles où la manipulation <strong>de</strong> substances très<br />
inflammables (hydrocarbures…) <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s précautions particulières.<br />
8
5 Désherbage au pied <strong>de</strong> panneaux dans<br />
un aéroport<br />
- Nuisances sanitaires<br />
6 Détail d’un train désherbeur utilisé par<br />
la<br />
SNCF<br />
Le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'environnement, dans son article L 220-1 prévoit que: "L’État et ses<br />
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que<br />
les personnes privées concourent, chacun dans le domaine <strong>de</strong> sa compétence et dans les<br />
limites <strong>de</strong> sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit<br />
reconnu à chacun <strong>de</strong> respirer un air qui ne nuise pas à sa santé". Ceci implique donc, entre<br />
autres, une lutte contre les plantes à pollen allergisant.<br />
7 Ambroisie à feuilles<br />
d’armoise<br />
(Ambrosia artemisiifolia L.)<br />
En effet, plus <strong>de</strong> 20% <strong>de</strong> la population est allergique aux<br />
pollens, et les chiffres sont en augmentation. C’est pourquoi il<br />
est recommandé d’éliminer les plantes les plus allergènes<br />
avant leur floraison.<br />
Par exemple, l’ambroisie à feuilles d’armoise, une plante à<br />
fort pouvoir allergisant qui se développe le long <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong><br />
communication, fait l’objet <strong>de</strong> démarches <strong>de</strong> gestion<br />
spécifiques <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> certaines DDE.<br />
Certains végétaux comportent <strong>de</strong>s parties toxiques qui peuvent être responsables<br />
d’empoisonnements en cas d’ingestion. Ce risque concerne surtout les enfants et les<br />
animaux domestiques ; les plantes présentant <strong>de</strong>s baies toxiques sont plus dangereuses car<br />
elles attirent plus les enfants. On peut citer la morelle noire (Solanum nigrum L.), dont les<br />
fruits immatures et les feuilles contiennent <strong>de</strong>s alcaloï<strong>de</strong>s pouvant provoquer <strong>de</strong>s troubles<br />
allant <strong>de</strong> simples désordres digestifs à <strong>de</strong>s paralysies respiratoires, <strong>de</strong>s dommages rénaux, <strong>de</strong>s<br />
anémies… selon les quantités ingérées. Cependant, les cas d’intoxication sont rares. C’est<br />
surtout dans les parcs, où les enfants sont moins surveillés par leurs parents, qu’une<br />
intoxication peut avoir lieu ; mais il semble que les baies <strong>de</strong>s végétaux d’ornement sont plus<br />
susceptibles d’être consommées.<br />
- Nuisances incommodantes<br />
Certaines plantes peuvent occasionner <strong>de</strong>s gênes pour le public : irritation, urtication,<br />
piqûres, coupures... On peut notamment citer le cas <strong>de</strong>s orties, <strong>de</strong>s ronces…ou bien la Berce<br />
du Caucase, Heracleum mantegazzianum, qui a un fort pouvoir photosensibilisant, et peut<br />
provoquer <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmites sur les parties <strong>de</strong> peau exposées au soleil après avoir été en contact<br />
9
avec la plante. Les adventices peuvent aussi possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s sucs ou latex poisseux, <strong>de</strong>s parties<br />
végétales s’accrochant aux vêtements, entraînant une salissure. Ces nuisances sont moins<br />
graves que les problèmes <strong>de</strong> toxicité par ingestion mais bien plus fréquentes. L’importance <strong>de</strong><br />
la nuisance dépend notamment <strong>de</strong> l’emplacement et <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s adventices<br />
incommodantes : plus elles sont susceptibles d’érafler les passants, plus la nuisance est<br />
importante.<br />
- Nuisances fonctionnelles<br />
Les adventices peuvent entraver l’utilisation <strong>de</strong> certains sites : par exemple, sur les trottoirs<br />
ou les pistes cyclables, elles peuvent gêner la circulation <strong>de</strong> par leur hauteur et créer <strong>de</strong>s<br />
réactions d’évitement. Le développement important <strong>de</strong> plantes, sur une surface pavée par<br />
exemple, peut faire craindre les glissa<strong>de</strong>s et les chutes, notamment pour les personnes âgées.<br />
Les adventices ne doivent pas gêner la circulation <strong>de</strong>s trains sur les voies ferrées, ni celle <strong>de</strong>s<br />
agents sur les chemins, notamment en cas d’urgence. De même, la présence <strong>de</strong> mauvaises<br />
herbes ne doit pas gêner les manœuvres sur les sites industriels.<br />
Les touffes <strong>de</strong> vivaces peuvent provoquer <strong>de</strong>s chutes sur les terrains <strong>de</strong> sport collectif, ou<br />
avoir un impact sur le jeu en modifiant la trajectoire <strong>de</strong> la balle…Elles peuvent notamment<br />
gêner la frappe <strong>de</strong> la balle sur un terrain <strong>de</strong> golf. L’importance <strong>de</strong> la nuisance dépend aussi du<br />
niveau <strong>de</strong> jeu : les exigences seront plus fortes si le terrain est utilisé pour <strong>de</strong>s compétitions<br />
nationales ou internationales.<br />
- Nuisances vis-à-vis <strong>de</strong>s infrastructures<br />
Certaines plantes ont une aptitu<strong>de</strong> à coloniser le bâti, et peuvent causer une dégradation <strong>de</strong>s<br />
infrastructures. Cette dégradation peut se faire <strong>de</strong> plusieurs façons : par <strong>de</strong>s mécanismes<br />
d’actions directes ou indirectes, et par <strong>de</strong>s procédés chimiques et physiques.<br />
Les actions directes <strong>de</strong>s végétaux sont dues aux pressions induites par la croissance <strong>de</strong>s<br />
racines, qui peuvent entraîner une fracture <strong>de</strong>s matériaux. La dégradation du substrat est<br />
principalement la conséquence d’une action chimique due par exemple à <strong>de</strong>s secrétions<br />
racinaires. Enfin, les végétaux peuvent être indirectement à l’origine <strong>de</strong> dégradations en<br />
favorisant la rétention et la stagnation d’eau, ce qui peut entraîner une dissolution du<br />
substrat et <strong>de</strong>s effets mécaniques dus aux cycles <strong>de</strong> gel-dégel. (Pynson B., 2005)<br />
- Concurrence vis-à-vis <strong>de</strong> la végétation ornementale<br />
Les adventices peuvent entrer en concurrence avec la végétation ornementale pour<br />
l’eau, notamment. Ce peut être le cas sur les pelouses, dans les massifs, et sur les jeunes<br />
plantations.<br />
En milieu forestier, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s montrent que, bien que les racines explorent <strong>de</strong>s couches<br />
différentes du sol, un couvert herbacé peut causer une compétition importante pour <strong>de</strong>s arbres<br />
(la présence <strong>de</strong> graminées a réduit le diamètre <strong>de</strong> merisiers âgés <strong>de</strong> 10 ans <strong>de</strong> 30%) (Balandier<br />
P., 2004). Cette concurrence est sans doute accentuée en milieu urbain, où les systèmes<br />
racinaires sont souvent superficiels. En zone non agricole, le but n’est pas la production <strong>de</strong><br />
bois comme dans un système forestier, mais une concurrence importante peut porter préjudice<br />
à <strong>de</strong> jeunes arbres, en particulier en conditions <strong>de</strong> sécheresse.<br />
Cependant, le seuil d’intervention pour la nuisance esthétique est généralement atteint<br />
avant le seuil d’intervention pour la concurrence.<br />
10
Les nuisances occasionnées par la végétation spontanée dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
<strong>de</strong>s adventices (pollen allergisant, propriétés urticantes, capacité à coloniser et détériorer les<br />
infrastructures…) mais aussi du site où elles se développent : exigences <strong>de</strong> sécurité<br />
(visibilité <strong>de</strong> la signalisation routière, lutte contre les incendies), exigences <strong>de</strong> fonctionnalité<br />
(par exemple, propriétés que doit avoir un gazon <strong>de</strong> sport pour permettre le jeu dans <strong>de</strong><br />
bonnes conditions), type d’esthétique du site (par exemple vocation « <strong>de</strong> prestige » ou<br />
« champêtre »), etc. L’importance <strong>de</strong> la fréquentation du site a elle aussi un impact :<br />
tolérance <strong>de</strong> la végétation, impact <strong>de</strong>s nuisances sanitaires et incommodantes…<br />
11
II/ <strong>PRATIQUES</strong> DES ZONES NON AGRICOLES<br />
1/ Evolution <strong>de</strong> la réglementation<br />
Dans les années 80, les pratiques <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s zones non agricoles étaient inspirées <strong>de</strong>s<br />
pratiques agricoles : l’efficacité et la persistance d’action étaient les critères <strong>de</strong> choix<br />
prédominants.<br />
Cependant, les pratiques <strong>de</strong> désherbage ont beaucoup évolué <strong>de</strong>puis. Ceci est dû notamment à<br />
une évolution du cadre réglementaire :<br />
- L’arrêté du 5 juillet 1985 entraîne une modification en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> l’utilisation<br />
<strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques : les produits ne peuvent être utilisés que pour l’usage<br />
pour lequel ils sont homologués. Désormais, il existe <strong>de</strong>s usages et <strong>de</strong>s doses spécifiques<br />
aux espaces non agricoles : désherbage PJT (allées <strong>de</strong> parcs, jardins et trottoirs), désherbage<br />
total (utilisation pour les réseaux <strong>de</strong> communication, les zones industrielles et les emprises<br />
militaires), désherbage gazon <strong>de</strong> graminées et désherbage plantations.<br />
- Le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 fixe les normes <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> produits<br />
phytopharmaceutiques dans les eaux potables à 0,1 µg par substance active et à 0.5 µg<br />
pour le total <strong>de</strong>s substances actives. Ce décret entraîna <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur les transferts <strong>de</strong>s<br />
herbici<strong>de</strong>s dans les eaux, et une adaptation <strong>de</strong>s pratiques selon le type <strong>de</strong> surface (perméable<br />
ou imperméable).<br />
- En 1991, la directive européenne 91/414 institue un examen à l’échelle<br />
européenne <strong>de</strong>s matières actives en fonction <strong>de</strong>s exigences vis-à-vis <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong><br />
l’environnement et <strong>de</strong> l’applicateur.<br />
- La loi n°92-533 du 17 juin 1992 rend obligatoire un agrément pour la vente <strong>de</strong><br />
produits phytosanitaires et pour leur application par <strong>de</strong>s prestataires à titre onéreux ;<br />
ceci permet un meilleur encadrement <strong>de</strong>s pratiques.<br />
- L’avis du Journal Officiel du 4 juillet 1997 interdit l’utilisation d’atrazine et <strong>de</strong><br />
simazine en zone non agricole, entraînant la disparition d’un grand nombre <strong>de</strong> produits. La<br />
dose d’emploi du diuron est réduite à 3000 g/ha/an.<br />
De plus, <strong>de</strong>s arrêtés préfectoraux sont pris en Bretagne en mai 1998 pour réglementer<br />
l’emploi du diuron en zones non agricoles; celui-ci ne peut être utilisé que du premier janvier<br />
au 31 mars, uniquement sur <strong>de</strong>s surfaces perméables.<br />
- La loi d’Orientation Agricole <strong>de</strong> 1999 (loi n°99-574 du 9 juillet 1999) rend<br />
l’utilisation non conforme <strong>de</strong> tout produit antiparasitaire passible <strong>de</strong> sanctions et donne<br />
pouvoir <strong>de</strong> police aux agents <strong>de</strong>s Services Régionaux <strong>de</strong> la Protection <strong>de</strong>s Végétaux.<br />
- L’arrêté du 23 décembre 1999 institue une mention obligatoire « Emploi autorisé<br />
dans les jardins », délivrée par le Ministère <strong>de</strong> l’Agriculture et <strong>de</strong> la Pêche, pour tout produit<br />
entrant dans le cadre <strong>de</strong> la loi du 2 novembre 1943 vendu à <strong>de</strong>s particuliers. Cet arrêté<br />
entraîne une séparation dans les points <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong>stinés aux amateurs, aux<br />
professionnels espaces verts et aux agriculteurs.<br />
- Un avis au journal officiel du 19 mai 2002 interdit l’utilisation du diuron en zone non<br />
agricole entre le 1 er novembre et le 1 er mars. D’autre part, la distribution <strong>de</strong>s spécialités<br />
contenant du diuron seul est interdite <strong>de</strong>puis le 1er octobre 2002. De plus, la dose maximale<br />
autorisée est réduite à 1500 g/ha/an. Ceci a entraîné le retrait <strong>de</strong> nombreuses spécialités et la<br />
baisse <strong>de</strong>s doses homologuées pour les spécialités restantes.<br />
12
- Un avis au journal officiel du 21 septembre 2002 interdit les mélanges n’ayant pas<br />
fait l’objet d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’enregistrement.<br />
- Un avis au journal officiel du 21 janvier 2003 incite les applicateurs nonprestataires<br />
<strong>de</strong> service comme les structures publiques à s’engager dans <strong>de</strong>s démarches<br />
volontaires <strong>de</strong> certification.<br />
- En 2004, la Directive Préparations Dangereuses 99/45/CE réglemente <strong>de</strong> façon<br />
plus drastique la classification <strong>de</strong>s produits, l’emballage, l’étiquetage, et les fiches <strong>de</strong> sécurité<br />
<strong>de</strong>s produits. En particulier, le symbole N (dangereux pour l’environnement) <strong>de</strong>vra apparaître<br />
sur l’étiquette <strong>de</strong> certains produits. Ceci permet une meilleure information <strong>de</strong>s applicateurs<br />
concernant les dangers pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation <strong>de</strong>s produits.<br />
- De plus un avis au journal officiel du 8 octobre 2004 réduit les doses maximales<br />
homologuées pour les spécialités commerciales à base <strong>de</strong> glyphosate. Elle implique<br />
l’adaptation <strong>de</strong> la dose en fonction <strong>de</strong>s adventices à désherber.<br />
En 20 ans, la réglementation a beaucoup évolué, avec un encadrement <strong>de</strong> plus en plus<br />
précis <strong>de</strong>s pratiques phytosanitaires. La réglementation va dans le sens d’une protection<br />
accrue <strong>de</strong> l’applicateur et <strong>de</strong> l’environnement (en particulier <strong>de</strong>s ressources en eau), par<br />
une réévaluation <strong>de</strong>s produits, une réduction <strong>de</strong>s doses maximales autorisées, une<br />
réglementation <strong>de</strong>s pratiques…<br />
2/ Evolution <strong>de</strong>s produits<br />
Depuis les années 80, on remarque un renouvellement <strong>de</strong>s substances actives, ainsi qu’une<br />
forte réduction <strong>de</strong>s doses d’emploi. En effet, <strong>de</strong> nombreuses substances actives ont été<br />
retirées (notamment l’atrazine et la simazine). De nouvelles substances actives sont apparues,<br />
souvent homologuées à <strong>de</strong> faibles doses d’emploi par hectare : on observe globalement une<br />
division par 10 <strong>de</strong>s doses apportées en comparant les herbici<strong>de</strong>s présents sur le marché avant<br />
1986 et les substances actives <strong>de</strong> prélevée homologuées plus récemment. On peut citer<br />
notamment le cas du flazasulfuron, homologué en 2000 à 50 g/ha.<br />
De plus, les nouvelles substances actives homologuées en zones non agricoles ont une<br />
meilleure sélectivité vis-à-vis <strong>de</strong>s zones plantées. Par exemple, les substances actives<br />
homologuées pour le désherbage sélectif <strong>de</strong>s plantations et pépinières sont souvent<br />
homologuées également en désherbage DT-PJT à <strong>de</strong>s doses i<strong>de</strong>ntiques. C’est le cas par<br />
exemple du mélange isoxaben + oryzalin.<br />
Enfin, on observe une augmentation <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s foliaires, dont les<br />
principales substances actives sont le glyphosate, l’aminotriazole, le sulfosate et le glufosinate<br />
ammonium ; ces matières actives sont souvent utilisées sous forme <strong>de</strong> spécialités mixtes<br />
(association avec une substance active préventive) lors du premier passage <strong>de</strong> printemps, et<br />
sont utilisées seules pour les rattrapages estivaux.<br />
Ces <strong>de</strong>rnières années ont été marquées par le retrait <strong>de</strong> nombreuses substances actives. Les<br />
nouvelles substances actives apparues sur le marché présentent souvent <strong>de</strong> faibles<br />
grammages hectares, et une meilleure sélectivité vis-à-vis <strong>de</strong>s plantations ornementales.<br />
13
3/ Evolution <strong>de</strong>s pratiques<br />
Depuis 20 ans, on remarque une spécialisation du personnel et une meilleure formation <strong>de</strong><br />
celui-ci. En effet, <strong>de</strong> nombreuses actions <strong>de</strong> formation et d’information ont été menées<br />
(Groupes Régionaux d’Action contre les Pollutions Phytosanitaires, Services Régionaux <strong>de</strong><br />
Protection <strong>de</strong>s Végétaux, Agences <strong>de</strong> l’Eau, structures associatives, firmes phytosanitaires…).<br />
Ces actions portent avant tout sur une connaissance <strong>de</strong> la réglementation, une maîtrise <strong>de</strong>s<br />
pollutions ponctuelles (stockage, gestion <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> cuve et <strong>de</strong>s emballages vi<strong>de</strong>s), la<br />
maîtrise <strong>de</strong> l’application (choix <strong>de</strong>s produits, dosage, étalonnage…) et la protection <strong>de</strong>s<br />
applicateurs (port <strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong> protection individuels ).<br />
Sous l’impulsion <strong>de</strong> la loi sur l’agrément, les structures prestataires (paysagistes applicateurs,<br />
Sncf…) ont dû obtenir une certification, ce qui implique souvent une formation<br />
supplémentaire du personnel. Cette démarche <strong>de</strong> certification est mise en place <strong>de</strong> plus en plus<br />
fréquemment <strong>de</strong> façon volontaire par <strong>de</strong>s structures non-prestataires (communes, DDE…).<br />
De plus, une évolution du matériel <strong>de</strong> pulvérisation (pompes doseuses, buses anti-dérive,<br />
rampes et lances adaptées, systèmes <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la pression et du débit…) permet une<br />
meilleure maîtrise <strong>de</strong> l’application. Ceci est accentué par la directive « machine » <strong>de</strong> 1995,<br />
relative aux dispositions minimales <strong>de</strong> sécurité pour les équipements <strong>de</strong> travail mobiles,<br />
automoteurs ou non ; <strong>de</strong>ux normes, la norme <strong>EN</strong> 907 « sécurité pulvérisateurs » et la norme<br />
<strong>EN</strong> 1553 « sécurité – prescriptions générales machines mobiles » permettent une mise en<br />
conformité <strong>de</strong>s pulvérisateurs avec cette directive. La norme <strong>EN</strong> 12761 « environnement –<br />
pulvérisateurs » publiée fin 2001 comporte <strong>de</strong>s prescriptions intéressantes pour la gestion <strong>de</strong>s<br />
pollutions ponctuelles. Ces normes ne sont pas obligatoires, seul le respect <strong>de</strong> la<br />
directive « machine » est réglementaire. Cependant, elles marquent une tendance à la<br />
construction d’un matériel plus performant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la sécurité <strong>de</strong> l’applicateur et <strong>de</strong><br />
l’environnement.<br />
Une prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> l’impact <strong>de</strong>s transferts d’herbici<strong>de</strong>s sur les eaux <strong>de</strong> surface a eu<br />
lieu et a entraîné <strong>de</strong>s démarches volontaires. Ainsi, un certain nombre <strong>de</strong> villes ont mis en<br />
place <strong>de</strong>s plans et <strong>de</strong>s chartes <strong>de</strong> désherbage, à l’exemple <strong>de</strong>s communes <strong>de</strong> Bretagne. Cette<br />
prise <strong>de</strong> conscience concerne aussi les réseaux <strong>de</strong> communication : la SNCF prévoit la<br />
réalisation d’un accord-cadre avec le Ministère <strong>de</strong> l’Ecologie et du Développement Durable et<br />
le Ministère <strong>de</strong> l’Agriculture. Des démarches sont mises en place par les DDE, comme c’est le<br />
cas pour celles <strong>de</strong> l’Isère et <strong>de</strong> l’Aveyron. Des solutions alternatives au désherbage<br />
chimique sont proposées <strong>de</strong> plus en plus couramment aux gestionnaires <strong>de</strong>s zones non<br />
agricoles.<br />
Le personnel est maintenant plus spécialisé qu’il y a 20 ans ; il est aussi mieux formé, en<br />
raison <strong>de</strong> la certification obligatoire <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> service et <strong>de</strong>s nombreuses actions <strong>de</strong><br />
formation et d’information qui ont été initiées.<br />
Le matériel employé a évolué aussi, permettant une meilleure maîtrise <strong>de</strong> l’application. Des<br />
techniques <strong>de</strong> désherbage alternatives sont apparues.<br />
La volonté <strong>de</strong> préservation <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface a entraîné la mise en place <strong>de</strong> plans et <strong>de</strong><br />
chartes <strong>de</strong> désherbage d’un nombre croissant <strong>de</strong> communes.<br />
- Quelques chiffres sur les pratiques actuelles<br />
14
Pour se faire une idée sur les utilisations d’herbici<strong>de</strong>s en zone non agricole, on peut consulter<br />
les chiffres issus <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> produits phytosanitaires. Ces données sont regroupées <strong>de</strong><br />
façon nationale par l’Union <strong>de</strong>s entreprises pour la Protection <strong>de</strong>s Jardins et <strong>de</strong>s espaces verts<br />
(UPJ). Cependant, ces données peuvent être sous-estimées car elles ne tiennent compte que<br />
<strong>de</strong>s ventes par les firmes adhérentes ; il n’y a pas <strong>de</strong> prise en compte, notamment, <strong>de</strong>s produits<br />
agricoles qui pourraient être vendus pour <strong>de</strong>s fins non agricoles (bien que cela soit interdit).<br />
Tableau 1 : Distribution <strong>de</strong>s produits phytosanitaires vendus en France en 2000, selon les<br />
trois utilisateurs principaux.<br />
Tonnages<br />
estimés<br />
%<br />
Agriculture (céréaliculture, maraîchage, pépinières, arboriculture…) :<br />
Exploitants agricoles<br />
95 100 90,6%<br />
Spécialités « Jardinage » :<br />
Particuliers<br />
8500 8,1%<br />
Spécialités « Entretien <strong>de</strong>s espaces verts »<br />
collectivités, sociétés exploitantes <strong>de</strong> réseaux <strong>de</strong><br />
transport…<br />
1400 1,3%<br />
Total 105 000 100%<br />
Ces valeurs comprennent <strong>de</strong>s tonnages <strong>de</strong> substances actives organiques <strong>de</strong> synthèse et les<br />
pestici<strong>de</strong>s minéraux.<br />
Source : UPJ (Union <strong>de</strong>s entreprises pour la Protection <strong>de</strong>s Jardins et espaces verts)<br />
On remarque que les quantités <strong>de</strong> produits utilisées en zone non agricole (hors particuliers) ne<br />
représentent que 1,3% <strong>de</strong>s produits phytosanitaires vendus. Or, parmi les produits<br />
phytosanitaires vendus dans le secteur espaces verts, la plus gran<strong>de</strong> partie (87 %) est<br />
représentée par les herbici<strong>de</strong>s.<br />
Tableau 2 : Distribution <strong>de</strong>s produits phytosanitaires vendus en France dans le secteur<br />
« espaces verts » en 2001<br />
ESPACES VERTS : TONNAGES<br />
Année Fongici<strong>de</strong><br />
s<br />
Insecticid<br />
es<br />
Herbicid<br />
es<br />
DT/PJT<br />
Herbicid<br />
es<br />
sélectifs<br />
gazon<br />
Herbicid<br />
es<br />
sélectifs<br />
arbres/ar<br />
bustes<br />
Herbicid<br />
es<br />
débroussaillants<br />
Autres<br />
(*)<br />
Total (t) DIURO<br />
N<br />
2000 16 13 917 81 63 147 137 1374 284<br />
2001 22 11 1105 116 106 142 178 1680 296<br />
% 1 1 66 7 8 6 11 100<br />
Source : UPJ<br />
Total herbici<strong>de</strong>s + débroussaillants : 87 %<br />
15
Herbici<strong>de</strong>s<br />
DT/PJT<br />
66%<br />
Fongici<strong>de</strong>s<br />
1%<br />
Insectici<strong>de</strong>s<br />
1%<br />
Autres (*)<br />
11%<br />
Herbici<strong>de</strong>s<br />
sélectifs gazon<br />
7%<br />
Herbici<strong>de</strong>s<br />
débroussaillants<br />
8%<br />
Figure 2 : Répartitions <strong>de</strong>s tonnages <strong>de</strong> matières actives<br />
« Espaces verts » en 2001<br />
Herbici<strong>de</strong>s<br />
sélectifs<br />
arbres/arbustes<br />
6%<br />
D’après une analyse <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s enquêtes régionales menées entre 1998 et 2000 par les<br />
GRAP (Groupes Régionaux d’Action contre les pollutions Phytosanitaires) sur les pratiques<br />
phytosanitaires en zone non agricoles, Adrien Boulet (2005) a pu estimer la répartition <strong>de</strong>s<br />
utilisations <strong>de</strong> produits phytosanitaires par les différents acteurs <strong>de</strong>s zones non agricoles :<br />
C<br />
- Communes : 1000t (10%)<br />
- SNCF : 200t (2%)<br />
D- DDE : 60 à 70t (1%)<br />
Particuliers<br />
86%<br />
(La catégorie « autres » représente les forêts, les terrains <strong>de</strong> golf, les<br />
autoroutes sous concession, les canaux, les aérodromes)<br />
Autres<br />
14%<br />
communes<br />
10%<br />
SNCF<br />
2%<br />
DDE<br />
1%<br />
Autres<br />
1%<br />
Figure 3 : Répartition <strong>de</strong>s tonnages <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s non<br />
agricoles selon les utilisateurs<br />
Tableau 3 : Détail <strong>de</strong> l’emploi <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s par les professionnels <strong>de</strong>s zones non agricoles<br />
16
Communes<br />
Gestionnaires <strong>de</strong> voies<br />
<strong>de</strong> transport<br />
Gestionnaire <strong>de</strong><br />
terrains <strong>de</strong> sport et <strong>de</strong><br />
loisirs<br />
Prestataires <strong>de</strong><br />
services d’entretien<br />
d’espaces verts<br />
(Boulet A., 2005)<br />
Sur les 36 000 communes françaises, autour <strong>de</strong> 90% utilisent <strong>de</strong>s<br />
produits phytosanitaires (désherbage <strong>de</strong> la voirie et <strong>de</strong>s<br />
infrastructures communales, entretien <strong>de</strong>s espaces verts…)<br />
(SNCF, DDE, sociétés d’autoroutes, terrains militaires, terrains<br />
d’aviation civile et militaire…). La SNCF traite environ 50 000 ha<br />
<strong>de</strong> voies chaque année, et le réseau routier français représente près<br />
d’un million <strong>de</strong> km linéaires <strong>de</strong> routes et d’autoroutes.<br />
Les terrains <strong>de</strong> sport et <strong>de</strong> loisir <strong>de</strong> plein air comptent environ 30<br />
000 terrains <strong>de</strong> grands jeux (dont une partie est à la charge <strong>de</strong>s<br />
communes) et 550 golfs (représentant plus <strong>de</strong> 20 000 hectares <strong>de</strong><br />
parcours).<br />
Au 4 avril 2005, 3 900 structures étaient agréées par les DRAF,<br />
comme « traitement <strong>de</strong>s espaces verts ». Toutes ces structures ne<br />
sont pas <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services, mais elles le sont en majorité.<br />
Les zones non agricoles ne sont donc pas les principaux consommateurs <strong>de</strong> produits<br />
phytosanitaires. Cependant les produits utilisés représentent un tonnage non négligeable<br />
(1680t en 2001), et sont répartis sur l’emprise urbaine, qui représente 4,8% du territoire<br />
français, et les voies <strong>de</strong> communication qui en représentent 5%.<br />
On remarque que le désherbage tient une place très prépondérante dans les pratiques<br />
phytosanitaires <strong>de</strong>s villes.<br />
17
SOL<br />
Photodécomposition<br />
Érosion<br />
par le vent<br />
ATMOSPHERE<br />
III/ TRANSFERTS DES HERBICIDES DANS L’<strong>EN</strong>VIRONNEM<strong>EN</strong>T<br />
Lorsqu’un produit phytopharmaceutique est appliqué, seule une partie du produit atteint sa<br />
cible (dans le cas d’un herbici<strong>de</strong>, il s’agit <strong>de</strong> la plante indésirable) ; le reste du produit<br />
appliqué se disperse dans l’environnement par divers processus <strong>de</strong> transfert.<br />
A la surface du sol, les herbici<strong>de</strong>s se distribuent selon trois phases : soli<strong>de</strong>, liqui<strong>de</strong> et<br />
vapeur, selon <strong>de</strong>s constantes d'équilibres d'adsorption, <strong>de</strong> désorption et <strong>de</strong> volatilisation. Ces<br />
constantes sont caractéristiques <strong>de</strong> chaque produit, mais elles sont modifiées en fonction <strong>de</strong>s<br />
conditions édapho-climatiques (température, humidité, teneur en matières organiques et<br />
profon<strong>de</strong>ur du sol ; température et hygrométrie <strong>de</strong> l'air ; vitesse du vent…).. La part du produit<br />
la plus mobile est celle localisée dans les phases liqui<strong>de</strong> et vapeur et constitue la part<br />
disponible. Ce concept <strong>de</strong> disponibilité du produit est fondamental. En effet, l'augmentation<br />
<strong>de</strong> la rétention <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sur la phase soli<strong>de</strong> du sol diminue le risque <strong>de</strong> dispersion et <strong>de</strong><br />
contamination <strong>de</strong>s autres compartiments <strong>de</strong> l'environnement, mais peut rendre difficile sa<br />
complète élimination.<br />
Dérive<br />
Volatilisation<br />
Adsorption –<br />
désorption<br />
Rétention sur les<br />
particules du sol<br />
Absorption<br />
racinaire<br />
Dégradation puis<br />
minéralisation<br />
Application herbici<strong>de</strong><br />
Infiltration<br />
Transport local ou<br />
sur <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
distances<br />
Absorption<br />
foliaire<br />
Ruissellement<br />
Drainage<br />
Volatilisation<br />
EAUX<br />
DE SURFACE<br />
Échanges<br />
Précipitations<br />
NAPPE D’EAU<br />
SOUTERRAINE<br />
Figure 4 : Transferts et <strong>de</strong>venir dans l’environnement <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s appliqués en zone non agricole<br />
18
1/ Transferts vers l’atmosphère<br />
Dès l’application, une partie <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong> peut être transférée vers l’atmosphère par<br />
dérive avant même d’atteindre le sol ou la plante visée. D’autres processus ultérieurs<br />
peuvent aussi entraîner les produits phytopharmaceutiques appliqués dans l’atmosphère. Une<br />
fois dans l’atmosphère, le produit subira <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> transport puis <strong>de</strong> dépôt.<br />
- Dérive<br />
La dérive intervient lors du traitement, au moment où les gouttelettes sont encore en<br />
suspension dans l’air. Pendant ce laps <strong>de</strong> temps, elles peuvent être soumises à <strong>de</strong>s processus<br />
<strong>de</strong> transfert vers l’atmosphère : évaporation rapi<strong>de</strong> ou entraînement par <strong>de</strong>s courants d’air.<br />
Lors <strong>de</strong> l’épandage, les dérives sont estimées entre 1 et 30% en utilisant <strong>de</strong>s rampes <strong>de</strong><br />
pulvérisateur (Van <strong>de</strong>r Werf H.G.M., 1997). La dérive dépend notamment <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s<br />
gouttes (les gouttes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 100 µm sont fortement soumises au risque <strong>de</strong> dérive), <strong>de</strong>s<br />
conditions atmosphériques et notamment du vent. La dérive peut occasionner <strong>de</strong>s pollutions<br />
importantes <strong>de</strong>s eaux superficielles, si le produit est entraîné vers elles. C’est particulièrement<br />
le cas si le traitement est effectué près d’un cours d’eau ou d’un fossé, sans précautions<br />
adaptées.<br />
- Volatilisation<br />
La volatilisation est le passage dans la phase gazeuse atmosphérique du produit présent<br />
sur le sol et les feuilles <strong>de</strong>s plantes-cibles. Ce phénomène peut arriver dès que la bouillie est<br />
pulvérisée, mais le processus peut continuer pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois<br />
pour les produits les plus persistants. La volatilisation peut atteindre jusqu’à 90% dans<br />
certains cas (Bedos C. et al., 2002). C’est un phénomène important en zones non<br />
agricoles, où les herbici<strong>de</strong>s peuvent être pulvérisés sur <strong>de</strong>s surfaces imperméables composées<br />
<strong>de</strong> matériaux qui sont soumis à <strong>de</strong>s élévations importantes <strong>de</strong> température.<br />
L’un <strong>de</strong>s principaux facteurs est la volatilité <strong>de</strong> la substance active. Celle-ci peut être mesurée<br />
par la constante <strong>de</strong> Henry, calculée en fonction <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> vapeur et <strong>de</strong> la solubilité. On<br />
considère qu’une substance active est volatile lorsque sa constante <strong>de</strong> Henri dépasse<br />
largement 2,5.10 -5 .<br />
- Erosion éolienne<br />
Le vent peut emporter <strong>de</strong>s particules <strong>de</strong> sol avec <strong>de</strong>s molécules <strong>de</strong> substances actives fixées<br />
<strong>de</strong>ssus, ainsi que les herbici<strong>de</strong>s appliqués sous forme <strong>de</strong> microgranulés ou <strong>de</strong> poudres. C’est<br />
un phénomène minoritaire en zones non agricoles, où le sol est souvent imperméabilisé.<br />
- Transport dans l’atmosphère et dépôt<br />
Une fois dans l’air, les produits sont dilués par les turbulences atmosphériques. La substance<br />
active peut alors être incorporée sous forme liqui<strong>de</strong> ou soli<strong>de</strong> dans les gouttelettes <strong>de</strong><br />
brouillard, les nuages ou librement dans l’atmosphère (aérosol liqui<strong>de</strong>) et être transportée<br />
sur <strong>de</strong> longues distances.<br />
Les produits présents dans l’atmosphère peuvent alors soit subir une dégradation (notamment<br />
sous l’action du rayonnement solaire ), soit retomber sous forme <strong>de</strong> dépôt. On parle <strong>de</strong> dépôt<br />
sec (particules…) ou humi<strong>de</strong> (pluies). De nombreuses étu<strong>de</strong>s attestent la présence <strong>de</strong><br />
19
pestici<strong>de</strong>s dans les eaux <strong>de</strong> pluie (Lig’air, 2001 ; Hüskes R. et Levson K., 1997 ; Siebers J et<br />
al, 1994).<br />
2/ Transferts vers les eaux<br />
Les étu<strong>de</strong>s se rapportant aux transferts <strong>de</strong>s produits vers les eaux opposent souvent le<br />
ruissellement qui alimente les eaux <strong>de</strong> surface (cours d’eau, lacs…), à l’infiltration qui<br />
alimente les eaux souterraines (nappes phréatiques). Cependant, en pratique, les eaux <strong>de</strong><br />
surface et les eaux souterraines communiquent, et la pollution <strong>de</strong>s unes peut entraîner la<br />
pollution <strong>de</strong>s autres.<br />
- Infiltration<br />
Si la perméabilité est suffisante, et s’il n’existe pas <strong>de</strong> couches imperméables en sous-sol,<br />
toute l’eau <strong>de</strong> pluie qui n’est pas absorbée par les plantes est entraînée en profon<strong>de</strong>ur<br />
vers les nappes phréatiques.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux types d’infiltration : une infiltration rapi<strong>de</strong> suivant <strong>de</strong> près un événement<br />
pluvieux, et une infiltration plus lente <strong>de</strong> moindre intensité (Corpen, 1999).<br />
L’infiltration rapi<strong>de</strong> se produit par <strong>de</strong>s circuits d’écoulement préférentiels.<br />
Elle est donc favorisée par la présence <strong>de</strong> macroporosités favorisant un écoulement gravitaire<br />
<strong>de</strong> l’eau : fissures, galeries <strong>de</strong> vers <strong>de</strong> terres, passage <strong>de</strong> racines... (ex : milieu karstique).<br />
L’infiltration lente dépend notamment <strong>de</strong>s propriétés <strong>de</strong>s substances actives utilisées<br />
(potentiel <strong>de</strong> mouvement, mesuré par l’indice <strong>de</strong> Gustafson : GUS)<br />
- Ruissellement <strong>de</strong> surface<br />
Si la surface du sol est peu perméable, une partie <strong>de</strong> l’eau apportée par les pluies<br />
s’écoule à la surface du sol et alimente directement les eaux <strong>de</strong> surface. Le ruissellement<br />
<strong>de</strong> surface est un phénomène particulièrement important en zone non agricole où les<br />
surfaces sont souvent imperméabilisées. Des applications non rationnelles en plein sur <strong>de</strong>s<br />
surfaces imperméabilisées peuvent ainsi entraîner <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> transfert importants dépassant<br />
les trois quarts <strong>de</strong>s quantités apportées (Banink A.D., 2004).<br />
Le ruissellement peut aussi avoir lieu sur <strong>de</strong>s surfaces perméables compactées ou présentant<br />
une croûte <strong>de</strong> battance. Par exemple, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mini-bassin versant dans la commune <strong>de</strong><br />
Pacé (35) montrent <strong>de</strong>s pics <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> substances actives plus importants dans les<br />
eaux <strong>de</strong> ruissellement sur une surface sablée compactée que sur une surface bétonnée<br />
(Angoujard G et al., 2001a).<br />
La rapidité <strong>de</strong>s transferts par ruissellement est accentuée par la collecte <strong>de</strong>s eaux via le réseau<br />
d’assainissement et par la présence <strong>de</strong> pente.<br />
- Ruissellement hypo<strong>de</strong>rmique<br />
Il s’agit d’un ruissellement souterrain lié à la présence d’une rupture <strong>de</strong> perméabilité<br />
(couche imperméable) à faible profon<strong>de</strong>ur. Cet écoulement souterrain est susceptible <strong>de</strong> se<br />
transformer en ruissellement <strong>de</strong> surface à la faveur d’une rupture <strong>de</strong> pente (remontée <strong>de</strong> la<br />
couche imperméable).<br />
- Drainage<br />
20
Les drains collectent l’eau infiltrée et l’acheminent vers les eaux <strong>de</strong> surface. Les quantités<br />
d’eau qui circulent rapi<strong>de</strong>ment dans les drains sont importantes et présentent donc souvent un<br />
risque <strong>de</strong> transfert non négligeable.<br />
En zone non agricole, on peut rencontrer <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> drainage par exemple dans les<br />
terrains <strong>de</strong> sport et <strong>de</strong> golf, certains parcs et jardins, et les cimetières. Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s résidus<br />
d’herbici<strong>de</strong>s présents dans les eaux <strong>de</strong> ruissellement et <strong>de</strong> drainage <strong>de</strong> 3 cimetières <strong>de</strong> la<br />
région toulousaine montre que ces transferts peuvent être très importants : selon le<br />
cimetière, la proportion d’échantillons relevés dont la concentration en substance active était<br />
supérieure à 0,1µg/L variait <strong>de</strong> 64,2% à 89,7% ; 2,3 à 10,6% <strong>de</strong>s échantillons dépassaient cent<br />
fois (soit 10µg/L) les teneurs maximales admises pour l’eau potable (Chauvel G. et al., 2001).<br />
3/ Rétention et dégradation dans le sol<br />
Dans le cas d’une infiltration lente, l’eau pénètre dans le sol et peut y subir différents<br />
processus. Une partie du produit présent dans le sol peut être absorbé par les racines <strong>de</strong> la<br />
végétation (voie <strong>de</strong> pénétration <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s racinaires). Cependant, une autre partie <strong>de</strong><br />
l’herbici<strong>de</strong> peut subir divers processus (dégradation, fixation sur les particules du sol…)<br />
dans le sol.<br />
- Dégradation<br />
Elle peut être due à <strong>de</strong>s réactions chimiques (hydrolyse…), ou être le fait <strong>de</strong> microorganismes<br />
du sol. Attention, les produits issus <strong>de</strong> la dégradation (métabolites) peuvent<br />
eux aussi avoir <strong>de</strong>s effets nocifs (cas <strong>de</strong> l’AMPA, produit <strong>de</strong> dégradation du glyphosate).<br />
L’aptitu<strong>de</strong> à la dégradation d’un produit est mesurée par sa <strong>de</strong>mi-vie, ou DT50. Cependant,<br />
les sols urbains étant squelettiques et pauvres en matière organique, avec une micro-flore peu<br />
abondante, les processus <strong>de</strong> dégradation sont probablement ralentis.<br />
- Adsorption et relargage<br />
L’herbici<strong>de</strong> peut être fixé par les particules du sol (adsorption). Dans cette situation, les<br />
produits ont tendance à perdre leur activité biologique et donc à ne pas se dégra<strong>de</strong>r.<br />
Ils peuvent par la suite subir un relargage, c’est-à-dire repasser dans la solution <strong>de</strong> sol, et<br />
être réabsorbés par les plantes ou entraînés dans les eaux. Par exemple, lors <strong>de</strong> mesures faites<br />
sur les eaux <strong>de</strong> drainage du cimetière <strong>de</strong> Terre-Caba<strong>de</strong> (Toulouse), les 47 analyses portant sur<br />
l’atrazine faites entre 1995 et 1997 montrent <strong>de</strong>s niveaux détectables d’atrazine (≤ 0.1 µg/L<br />
pour 19 analyses et 0,1 à 10 µg/L pour 28 analyses), alors que le produit n’était plus utilisé<br />
<strong>de</strong>puis 1988 (Chauvel G. et al., 2001).<br />
21
4/ Conséquences <strong>de</strong>s transferts d’herbici<strong>de</strong>s dans l’environnement<br />
La présence <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques dans l’environnement (air, sol, eau) n’est<br />
pas sans conséquences pour la faune et la flore ainsi que pour la santé humaine.<br />
- Les transferts <strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques dans l’air<br />
Les transferts <strong>de</strong> matières actives dans l’air peuvent entraîner une contamination par<br />
respiration <strong>de</strong>s populations humaines et animales. De même, les plantes peuvent être<br />
affectées par les vapeurs d’herbici<strong>de</strong>s. Or, les zones non agricoles sont particulièrement<br />
fréquentées par le public, qui peut respirer les vapeurs herbici<strong>de</strong>s à son insu.<br />
- Les transferts <strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques dans le sol<br />
L’accumulation <strong>de</strong>s substances actives dans le sol peut entraîner <strong>de</strong>s changements dans la<br />
microflore et la microfaune active dans le sol. Il peut par exemple y avoir une contamination<br />
<strong>de</strong>s vers <strong>de</strong> terre.<br />
- La contamination <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface<br />
La contamination <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface peut entraîner <strong>de</strong>s risques pour la faune et la flore<br />
aquatiques ; il suffit parfois <strong>de</strong> faibles concentrations pour affecter certains organismes<br />
sensibles. Les herbici<strong>de</strong>s affectent principalement les algues ; or il s’agit du premier<br />
maillon <strong>de</strong>s chaînes alimentaires aquatiques.<br />
Par exemple, le flazasulfuron a une écotoxicité (toxicité d’une substance active pour<br />
différents être vivants) relativement faible pour les poissons :<br />
- toxicité aiguë comprise entre CL50 1 =22 mg/L (Oncorhynchus mykiss) et CL50 > 98<br />
mg/L (Lepomis macrochirus) ;<br />
- toxicité chronique : CSEO 2 =5 mg/L (Oncorhynchus mykiss ).<br />
La toxicité est également assez faible pour certains invertébrés aquatiques :<br />
- toxicité aiguë : CE50 3 > 106 mg/L (Daphnia sp.)<br />
- toxicité chronique : CSEO = 6,25 mg/L<br />
Mais il peut être plus toxique pour d’autres invertébrés aquatiques plus sensibles:<br />
- toxicité chronique pour Chironomus riparius : CSEO =0.1 mg/L<br />
Et à très faible dose il peut affecter la croissance <strong>de</strong>s certaines algues et végétaux aquatiques :<br />
- Anabaena flos-aquae : CE50 >0.005 mg/L<br />
- Pseudokirchneriella subcapitata : CE50 >0.045 mg/L<br />
- Lemna gibba : CE50 =0.00004 mg/L<br />
1<br />
Pour un organisme aquatique, la CL50 est la Concentration Létale pour 50% <strong>de</strong>s organismes exposés, en<br />
général poissons ainsi que quelques invertébrés aquatiques.<br />
2<br />
La CSEO est la Concentration Sans Effet Observé pour la totalité <strong>de</strong>s organismes exposés. Elle est plus connue<br />
sous le terme anglais NOEC.<br />
3<br />
La CE50 est la Concentration d'Effet pour 50% <strong>de</strong>s organismes exposés, en général daphnies et autres<br />
invertébrés aquatiques, algues et plantes aquatiques. Pour les invertébrés, l'effet est l'immobilisation. Pour les<br />
algues et plantes, sont mesurés les effets sur la biomasse (b), le taux <strong>de</strong> croissance (r) ou la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> fron<strong>de</strong> (df)<br />
(exemple : CEb50).<br />
22
Par ailleurs, la contamination <strong>de</strong>s eaux peut les rendre impropres à la consommation<br />
humaine. D’après le bilan réalisé par l’Institut français <strong>de</strong> l’Environnement (Ifen), sur les 838<br />
prises d’eau <strong>de</strong> surface utilisées pour l’alimentation en eau potable, près <strong>de</strong> 59% contiennent<br />
<strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s, dont 39% ont <strong>de</strong>s teneurs nécessitant un traitement spécifique et 1% présentent<br />
<strong>de</strong>s teneurs qui ne permettent pas une utilisation sans autorisation du Ministère <strong>de</strong> la Santé ;<br />
sur les 2 603 captages d’eaux souterraines utilisées pour l’alimentation en eau potable, 55%<br />
contiennent <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s, dont 21 %, ont <strong>de</strong>s teneurs nécessitant un traitement spécifique<br />
(Ifen, 2004).<br />
Même à <strong>de</strong> faibles concentrations, la présence <strong>de</strong> produits phytosanitaires dans<br />
l’environnement peut être dommageable pour la faune et la flore sauvage. En effet, certains<br />
sont concentrés dans la chaîne alimentaire par un effet <strong>de</strong> bioaccumulation :<br />
Il s’agit <strong>de</strong> la propension d’un produit à s’accumuler dans les graisses végétales ou animales<br />
tout au long <strong>de</strong> la chaîne alimentaire ; elle est mesurée par le Kow (coefficient <strong>de</strong> partage noctanol<br />
-eau) : plus celui-ci est élevé, plus la substance active est lipophile, plus le risque <strong>de</strong><br />
bioaccumulation est grand.<br />
De plus, on ne connaît pas bien les effets que pourrait avoir la synergie <strong>de</strong> plusieurs produits,<br />
ou bien la synergie <strong>de</strong> produits phytosanitaires avec d’autres polluants.<br />
23
IV/ EFFETS DES HERBICIDES SUR LA SANTE HUMAINE<br />
Il existe <strong>de</strong>ux sources d’exposition possibles aux herbici<strong>de</strong>s :<br />
- L’exposition professionnelle <strong>de</strong>s applicateurs durant les différentes phases du<br />
traitement. Cette exposition est celle qui comporte les risques les plus importants. Le<br />
port d’équipements <strong>de</strong> protection adaptés est indispensable pour assurer la sécurité <strong>de</strong><br />
l’applicateur.<br />
- L’exposition du public qui fréquente les sites traités. L’exposition du public aux<br />
herbici<strong>de</strong>s est nettement plus faible que celle <strong>de</strong>s applicateurs. Une étu<strong>de</strong> menée dans<br />
14 villes nord-américaines sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 ans a permis d’évaluer la teneur <strong>de</strong>s<br />
pestici<strong>de</strong>s dans l’air au sein et autour <strong>de</strong>s chantiers <strong>de</strong> traitement en espaces verts (<br />
Yeary R.A. et Leonard J.A., 1993).<br />
Tableau 4 : Présence <strong>de</strong> divers pestici<strong>de</strong>s dans l’air après un chantier <strong>de</strong> traitement<br />
(proportion d’échantillons comportant <strong>de</strong>s substances actives en quantité supérieure à la<br />
limite <strong>de</strong> détection)<br />
Substances<br />
actives<br />
2,4D<br />
MCPA<br />
Pendimethaline<br />
Usage<br />
Désherbage<br />
<strong>de</strong>s gazons<br />
Désherbage<br />
<strong>de</strong>s gazons <strong>de</strong><br />
graminées,<br />
DT-PJT<br />
Désherbage<br />
<strong>de</strong>s arbres et<br />
arbustes<br />
d’ornements<br />
Nombre d’échantillons > limite <strong>de</strong> détection (0,001 mg/m 3 ) /<br />
Nombre total d’échantillons<br />
Bâtiments<br />
publics<br />
Air intérieur<br />
<strong>de</strong>s<br />
rési<strong>de</strong>nces<br />
(mg/m 3 )<br />
Air extérieur <strong>de</strong>s<br />
rési<strong>de</strong>nces<br />
(température :<br />
20°C, humidité<br />
relative : 90%)<br />
(mg/m 3 )<br />
Air<br />
environnant<br />
<strong>de</strong>s<br />
applicateurs<br />
(mg/m 3 )<br />
(bureaux,<br />
magasins,<br />
salles<br />
publiques)<br />
(mg/m 3 )<br />
8/26 (0.034) 5/16 (0,025) 15/76 (0,004) 2/25 (0,005)<br />
- - 0/25 0/3<br />
- - 0/8 1/1 (0,0063)<br />
Remarque : L’étu<strong>de</strong> portait aussi sur l’acéphate, le carbaryl, le chlorpyriphos, le diazinon, le<br />
dicofol, et le malathion, qui sont <strong>de</strong>s insectici<strong>de</strong>s, et sur l’atrazine, qui n’est plus autorisée ;<br />
Seules les données concernant <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s actuellement homologués pour les zones non<br />
agricoles ont été retranscrites ici.<br />
Il n’existe pas à ce jour <strong>de</strong> niveau maximal autorisé pour la présence d’un pestici<strong>de</strong> dans l’air.<br />
Ici, les niveaux d’exposition restent généralement faibles (la majorité sont en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> la<br />
limite <strong>de</strong> détection). Cependant, on remarque que le 2,4D est détecté à plusieurs reprises avec<br />
<strong>de</strong>s valeurs dépassant jusqu’à 30 fois le seuil <strong>de</strong> détection <strong>de</strong> 0,001 mg/m 3 .<br />
24
Selon la source d’exposition, la contamination peut se faire par différentes voies (qui peuvent<br />
être simultanées).<br />
Tableau 5 : Voies d’exposition possibles pour les applicateurs et le public<br />
Source d’exposition<br />
Voie <strong>de</strong><br />
contamination<br />
Voie respiratoire<br />
Voie cutanée et<br />
conjonctive (yeux)<br />
Voie digestive<br />
Applicateur<br />
(précautions<br />
insuffisantes)<br />
Inhalations <strong>de</strong><br />
poussières, aérosols<br />
et vapeurs lors <strong>de</strong><br />
l’application<br />
Contact avec le<br />
produit lors <strong>de</strong> la<br />
préparation ou <strong>de</strong><br />
l’application, contact<br />
avec une surface<br />
traitée<br />
Consommation <strong>de</strong><br />
boisson, <strong>de</strong> nourriture<br />
ou <strong>de</strong> tabac pendant<br />
l’application ;<br />
déglutition <strong>de</strong><br />
particules inhalées,<br />
contact avec <strong>de</strong>s<br />
mains souillées<br />
Public présent à<br />
proximité <strong>de</strong><br />
l’applicateur lors du<br />
traitement<br />
Inhalation <strong>de</strong><br />
poussières, aérosols<br />
et vapeurs liées à une<br />
dérive <strong>de</strong><br />
pulvérisation<br />
Contact avec la<br />
bouillie lors <strong>de</strong><br />
l’application, contact<br />
avec une surface<br />
traitée<br />
Consommation <strong>de</strong><br />
boisson, <strong>de</strong> nourriture<br />
ou <strong>de</strong> tabac pendant<br />
l’application ;<br />
déglutition <strong>de</strong><br />
particules inhalées,<br />
contact avec <strong>de</strong>s<br />
mains souillées<br />
Public fréquentant le<br />
site après traitement<br />
Inhalation <strong>de</strong><br />
poussières, aérosols et<br />
vapeurs en suspension<br />
dans l’air suite à <strong>de</strong>s<br />
phénomènes <strong>de</strong><br />
volatilisation ou <strong>de</strong><br />
dérive<br />
Contact avec une<br />
surface traitée,<br />
notamment pelouse<br />
Contact main-bouche<br />
(enfants notamment) ;<br />
éventuellement par<br />
ingestion <strong>de</strong> granulés<br />
herbici<strong>de</strong>s par les<br />
enfants<br />
L’exposition à ces produits herbici<strong>de</strong>s peut avoir <strong>de</strong>s conséquences sur la santé, selon le<br />
niveau d’exposition.<br />
Si l’exposition est importante, comme dans le cas d’une exposition directe au produit lors <strong>de</strong><br />
l’application (concerne surtout l’applicateur), la personne exposée peut développer en<br />
quelques heures à quelques jours <strong>de</strong>s troubles généraux, oculaires, respiratoires, cutanés,<br />
digestifs, nerveux… On parle <strong>de</strong> la toxicité aiguë du produit.<br />
La toxicité aiguë d’un produit est évaluée notamment par la DL50 (dose létale 50). Il s’agit <strong>de</strong><br />
la dose <strong>de</strong> matière active qui tue 50% <strong>de</strong>s animaux d’une population à qui elle est administrée<br />
en une seule fois. Elle est calculée par ingestion et par pénétration cutanée.<br />
Pour étudier la toxicité lors <strong>de</strong> l’inhalation, on calcule la CL50 (concentration létale 50).<br />
25
Tableau 6 : Classement toxicologique <strong>de</strong>s produits en fonction <strong>de</strong> la DL50 ou <strong>de</strong> la CL50 sur<br />
rat, selon l’arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions <strong>de</strong> classement, d'étiquetage et<br />
d'emballage <strong>de</strong>s préparations pestici<strong>de</strong>s<br />
Valeur <strong>de</strong><br />
référence<br />
DL50 (orale, rat) (mg/kg) DL50 (cutanée, rat) (mg/kg) CL50<br />
(inhalatoire,<br />
rat) (mg/l<br />
d'air)<br />
Pestici<strong>de</strong> Liqui<strong>de</strong> Soli<strong>de</strong> Liqui<strong>de</strong> Soli<strong>de</strong> Gaz ou<br />
assimilé<br />
Très<br />
toxique<br />
Les effets <strong>de</strong> la toxicité chronique sont discutés en raison <strong>de</strong> la difficulté <strong>de</strong> les mesurer.<br />
Cependant, diverses étu<strong>de</strong>s permettent <strong>de</strong> soupçonner <strong>de</strong>s risques accrus <strong>de</strong> cancer, <strong>de</strong>s<br />
troubles <strong>de</strong> la fertilité, <strong>de</strong>s malformations congénitales…Concernant les enfants, les étu<strong>de</strong>s<br />
semblent converger vers un risque accru <strong>de</strong> tumeur du cerveau et <strong>de</strong> leucémie chez les enfants<br />
exposés aux produits phytopharmaceutiques (Van<strong>de</strong>rlin<strong>de</strong>n L., et al., 2002).<br />
On rapporte aussi qu’une exposition régulière à <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques peut<br />
entraîner une hypersensibilité aux produits chimiques, avec développement <strong>de</strong> symptômes<br />
même lors d’une exposition à <strong>de</strong> faibles doses.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux sources d’exposition aux produits phytopharmaceutiques : celle <strong>de</strong>s<br />
applicateurs professionnels, et celle du public fréquentant les zones traitées. Les personnes<br />
exposées peuvent être contaminées par différentes voies (respiratoire, cutanée, digestive).<br />
Une exposition importante pourra entraîner rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s symptômes (toxicité aiguë du<br />
produit) ; elle concerne surtout l’applicateur. Une exposition plus faible mais régulière peut<br />
elle aussi avoir <strong>de</strong>s conséquences (toxicité chronique) ; elle peut concerner l’applicateur mais<br />
aussi le public.<br />
STRATEGIE POUR LA GESTION DES ADV<strong>EN</strong>TICES SELON UNE EVALUATION<br />
DES RISQUES DOMINANTS<br />
Le choix <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> désherbage doit se faire <strong>de</strong> manière raisonnée. Pour cela, il faut<br />
prendre en compte le niveau d’entretien souhaité, le type <strong>de</strong> flore présente, et réaliser<br />
une analyse <strong>de</strong>s différents risques que pourrait entraîner l’utilisation <strong>de</strong> produits<br />
phytopharmaceutiques sur le site considéré. C’est une démarche complexe, qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s compétences en matière d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> la flore, en agronomie (type <strong>de</strong> sol…), ainsi<br />
qu’une connaissance du terrain (choix du niveau d’entretien par exemple). L’application <strong>de</strong><br />
cette démarche <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un certain investissement <strong>de</strong> temps et d’argent, notamment pour la<br />
réalisation du plan <strong>de</strong> désherbage (et en particulier si les surfaces ne sont pas connues). Dans<br />
certains cas, il existe <strong>de</strong>s possibilités d’obtenir <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s financières, notamment auprès <strong>de</strong><br />
l’agence <strong>de</strong> l’eau : prendre contact avec le Groupe Régional d’Action pour la réduction <strong>de</strong>s<br />
pollutions Phytosanitaires.<br />
Trois risques principaux ont été i<strong>de</strong>ntifiés selon les spécificités <strong>de</strong>s zones non agricoles :<br />
risques pour la santé du public (toxicité <strong>de</strong>s produits), risques pour l’environnement<br />
(notamment transferts vers les eaux), risques pour les végétaux d’ornement (phytotoxicité).<br />
ETAPE 1 : REALISER UN INV<strong>EN</strong>TAIRE DES SURFACES<br />
La première démarche d’évaluation du risque environnemental consiste en un inventaire <strong>de</strong>s<br />
zones désherbées ou non, et un recensement <strong>de</strong>s pratiques sur cette zone.<br />
Les sites doivent être cartographiés ; sur cette cartographie seront reportées les surfaces en<br />
m². Puis, selon les résultats <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> risque, les différentes surfaces considérées<br />
27
comme « à risque » pourront y être reportées, avec un co<strong>de</strong> couleur différent selon le<br />
risque dominant. Lors <strong>de</strong> l’analyse, il faudra prendre en compte les caractéristiques liées au<br />
site (type <strong>de</strong> surfaces, fréquentation, plantations en place…) et à son environnement immédiat<br />
(bâtiments à proximité, plantations à proximité…).<br />
Cette première étape est fondamentale ; en effet, il est nécessaire <strong>de</strong> connaître les surfaces<br />
traitées :<br />
- pour comman<strong>de</strong>r les quantités d‘herbici<strong>de</strong>s adaptées aux surfaces à entretenir<br />
- pour gérer le temps <strong>de</strong> travail<br />
- pour proportionner l’investissement matériel<br />
- pour préparer les quantités adaptées <strong>de</strong> bouillie<br />
- pour éviter d’oublier <strong>de</strong> désherber certaines surfaces<br />
De plus, cette étape est nécessaire pour i<strong>de</strong>ntifier les sites où l’analyse <strong>de</strong> risque sera faite.<br />
ETAPE 2 : ID<strong>EN</strong>TIFIER LA FLORE PRES<strong>EN</strong>TE<br />
Il est important d’évaluer la flore présente, ainsi que ses caractéristiques biologiques. Elle<br />
donnera <strong>de</strong>s indications précieuses pour le choix d’un niveau d’entretien et pour le choix<br />
d’une technique <strong>de</strong> désherbage. Cet inventaire n’est pas définitif : l’évolution <strong>de</strong> la flore<br />
<strong>de</strong>vra être suivie avec soin.<br />
La flore présente est-elle à l’origine <strong>de</strong> nuisances importantes ?<br />
En fonction <strong>de</strong>s nuisances particulières qu’elles peuvent occasionner, certaines espèces<br />
peuvent nécessiter un seuil d’intervention plus bas. C’est le cas notamment <strong>de</strong> certaines<br />
plantes allergènes comme l’ambroisie, qui doit être combattue dans les sites où le public<br />
risque d’être exposé.<br />
Un indice <strong>de</strong> nuisance en ville a été attribué aux plantes couramment trouvées dans le milieu<br />
urbain par Emilie Zadjan (voir annexe 1). Cet indice prend en compte la nuisance<br />
esthétique (en fonction du développement volumique et <strong>de</strong> la hauteur maximale),<br />
l’allergénicité, la toxicité, la présence <strong>de</strong> suc collant ou poisseux, et la capacité à coloniser les<br />
bâtis.<br />
Par ailleurs, certaines plantes ont un fort pouvoir colonisant en raison d’une production <strong>de</strong><br />
quantités importantes <strong>de</strong> graines ou d’un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> multiplication végétative lui permettant<br />
d’occuper rapi<strong>de</strong>ment l’espace. Dans ce cas, on peut vouloir anticiper le désherbage <strong>de</strong> ces<br />
plantes pour éviter un développement ultérieur trop important. Ce peut aussi être le cas <strong>de</strong><br />
certaines plantes envahissantes que l’on cherche à contenir, comme le séneçon du Cap.<br />
Une liste d’ espèces faisant l’objet <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> lutte obligatoire ou recommandée (plantes<br />
envahissantes) pouvant être rencontrées en zone non agricole est présentée en annexe 2.<br />
Quelles sont les caractéristiques <strong>de</strong> la flore présente ?<br />
La plupart <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> désherbage, alternatives ou chimiques, sont plus efficaces sur<br />
<strong>de</strong>s plantes <strong>de</strong> jeune sta<strong>de</strong>. Les herbici<strong>de</strong>s ont une efficacité variable d’une plante à l’autre;<br />
<strong>de</strong> même, les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désherbage alternatif peuvent être plus efficaces sur certaines<br />
28
plantes que d’autres (par exemple, le brossage est moins efficace sur les plantes vivaces à<br />
rhizomes ou racines profon<strong>de</strong>s).<br />
De plus, dans le cas du désherbage chimique, une connaissance <strong>de</strong> la flore présente permet<br />
d’ajuster la dose (voir annexe 11 pour connaître la sensibilité <strong>de</strong>s adventices aux<br />
herbici<strong>de</strong>s).<br />
Par exemple, pour les spécialités à base <strong>de</strong> glyphosate seul, en désherbage total et en<br />
désherbage <strong>de</strong>s allées <strong>de</strong> parcs, jardins et trottoirs, la dose homologuée dépend du cycle<br />
biologique <strong>de</strong> la flore. En effet, selon l’avis au journal officiel du 8 octobre 2004, les doses<br />
maximales homologuées sont :<br />
Tableau 7 : Doses maximales <strong>de</strong> glyphosate homologuées en DT-PJT sur zones perméables<br />
en zones non agricoles, d’après l’avis au journal officiel du 8 octobre 2004.<br />
FLORE GLYPHOSATE ACIDE<br />
En g ma/ha<br />
Doses maximales homologuées<br />
En annuelles et bisannuelles 1800<br />
En vivaces 2880 par taches<br />
Les homologations pour les spécialités commerciales peuvent être encore plus précises.<br />
Homologation pour Cosmic PJT, spécialité à base <strong>de</strong> glyphosate à 360 g/L :<br />
Tableau 8 : Doses maximales homologuées pour le Cosmic PJT<br />
FLORE COSMIC PJT<br />
Annuelles 3 L/ha<br />
Bisannuelles 6 L/ha<br />
Vivaces 12 L/ha<br />
- Les annuelles ont un cycle végétatif inférieur à douze mois et peuvent même accomplir<br />
plusieurs cycles dans l’année comme le pâturin annuel, le séneçon commun, le laiteron <strong>de</strong>s<br />
maraîchers, la cardamine, les matricaires… D’autres germent au printemps et se développent<br />
en été (annuelles estivales) comme les amarantes, le chénopo<strong>de</strong> blanc, la digitaire sanguine, la<br />
sétaire, la renoué <strong>de</strong>s oiseaux… Les mauvaises herbes annuelles se reproduisent uniquement<br />
par graine.<br />
- Les bisannuelles nécessitent plus <strong>de</strong> douze mois pour accomplir leur cycle végétatif. Elles<br />
germent généralement au printemps comme le lamier pourpre, l’érigeron du Canada ou le<br />
chardon commun. Les bisannuelles se reproduisent elles aussi uniquement par graine.<br />
- Les vivaces se développent sur plusieurs années et apparaissent soit au printemps soit en<br />
automne. Elles se reproduisent tout aussi bien par graine que par organes <strong>de</strong> propagation :<br />
29
stolons, rhizomes, bulbes, bulbilles, tubercules. Au cours <strong>de</strong> la mauvaise saison, les vivaces se<br />
conservent ainsi en touffes, en rosettes ou par <strong>de</strong>s organes souterrains.<br />
Tableau 9 : Types d’organes <strong>de</strong> conservation pour les adventices vivaces<br />
Organes <strong>de</strong><br />
conservation<br />
Espèces d’adventices vivaces<br />
Stolons Potentille rampante, renoncule rampante<br />
Rhizomes Chien<strong>de</strong>nt rampant, liseron <strong>de</strong>s champs<br />
Drageons Cresson sauvage<br />
Bulbilles Ail <strong>de</strong>s vignes, oxalis en corymbe<br />
Tubercules Gesse tubéreuse, souchet<br />
Le type <strong>de</strong> cycle biologique <strong>de</strong>s espèces relevées par Sylvie Llados est donné dans l’annexe<br />
3.<br />
30
ETAPE 3 : ETABLIR LE NIVEAU D’<strong>EN</strong>TRETI<strong>EN</strong> SOUHAITE POUR CHAQUE<br />
SITE<br />
Pour adapter les pratiques <strong>de</strong> désherbage à un site donné, il faut préalablement évaluer le<br />
niveau d’entretien recherché.<br />
Selon la vocation du site, les adventices sont plus ou moins tolérées. Ainsi, lorsque le<br />
désherbage est pratiqué pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> sécurité (aéroports, enceintes militaires…), la<br />
tolérance est minime. Par opposition, lorsque les objectifs du désherbage sont essentiellement<br />
esthétiques, comme c’est souvent le cas en zone non agricole, la tolérance varie beaucoup<br />
avec la perception que le public a du lieu.<br />
8 Désherbage d’un cimetière<br />
Pour les cimetières, lieux <strong>de</strong> recueillement, la flore spontanée<br />
est très peu tolérée en France, et peut être interprétée comme<br />
un manque <strong>de</strong> respect aux morts (Zadjan E., 2004).<br />
Par contre, dans un parc à caractère plus « champêtre » (par opposition à un parc « <strong>de</strong><br />
prestige »), la flore spontanée sera mieux acceptée. Il semble en effet que l’enherbement<br />
choque plus dans les lieux anthropisés.<br />
De même, <strong>de</strong>s mauvaises herbes seront plus apparentes dans un massif en monoculture, que<br />
dans un massif avec un agencement plus libre (plantes variées <strong>de</strong> hauteurs différentes…).<br />
Le tableau suivant donne un aperçu global <strong>de</strong> la tolérance envers la flore spontanée selon<br />
différents compartiments ; il a été établi d’après l’enquête d’Emilie Zadjan et complété grâce<br />
aux rencontres qui ont été faites avec les responsables du désherbage <strong>de</strong>s différentes zones<br />
non agricoles.<br />
31
Tableau 10 : Nuisances <strong>de</strong> la flore dans les différentes zones non agricoles :<br />
Site Nuisance(s) <strong>de</strong> la flore Tolérance envers les adventices<br />
Trottoirs,<br />
allées <strong>de</strong><br />
parcs et<br />
jardins<br />
Cuvettes<br />
d’arbres<br />
Pelouses<br />
Plantations<br />
(arbres,<br />
arbustes et<br />
massifs)<br />
Esthétique, éventuellement<br />
gêne au déplacement et<br />
dégradation <strong>de</strong>s structures.<br />
Essentiellement esthétique.<br />
Concurrence éventuelle pour les<br />
arbres récemment plantés.<br />
Essentiellement esthétique.<br />
Essentiellement esthétique ;<br />
concurrence éventuelle pour les<br />
arbres récemment plantés.<br />
Cimetières Essentiellement esthétique ;<br />
accélération <strong>de</strong> la dégradation<br />
Terrains <strong>de</strong><br />
sport et<br />
golfs<br />
Routes et<br />
autoroutes<br />
Voies<br />
ferrées<br />
<strong>de</strong>s tombes.<br />
Fonctionnelle, gênes<br />
éventuelles pour le jeu<br />
(notamment sur terrains <strong>de</strong><br />
golf).<br />
Sécuritaire (visibilité <strong>de</strong> la<br />
signalisation…) et esthétique.<br />
Sécuritaire (pourrait perturber<br />
la signalisation électrique).<br />
L’enherbement est mieux toléré côté<br />
habitations (verticalité, éventuellement<br />
végétation ornementale) que dans le caniveau.<br />
L’enherbement est mieux accepté sur les<br />
trottoirs perméables, que sur les trottoirs<br />
imperméabilisés, où l’on ressent une<br />
recherche <strong>de</strong> netteté.<br />
Les herbes sont tolérées car elles sont<br />
éclipsées par la verticalité du tronc, mais elles<br />
ne doivent pas dépasser <strong>de</strong> la cuvette.<br />
Elle dépend <strong>de</strong> la vocation <strong>de</strong> la pelouse ; on<br />
distingue les pelouses d’ornement (tolérance<br />
faible), les pelouses <strong>de</strong> loisirs fréquentées par<br />
le public (meilleure tolérance)<br />
La tolérance varie beaucoup selon la<br />
vocation et l’aspect <strong>de</strong> l’aménagement.<br />
Quasiment nulle en France, en raison <strong>de</strong> la<br />
vocation symbolique du lieu. Le cimetière<br />
doit être impeccable à la toussaint.<br />
Très faible. Pour les golfs, les règles <strong>de</strong> jeu<br />
sont très strictes ; cependant, le niveau<br />
d’entretien n’est pas le même partout (greens,<br />
fairways, roughs…). Dans le cas <strong>de</strong>s terrains<br />
<strong>de</strong> sport, la tolérance dépend aussi du niveau<br />
<strong>de</strong>s joueurs : elle est plus faible si le terrain<br />
est utilisé par une équipe professionnelle.<br />
La signalisation doit être visible ; la<br />
nuisance esthétique est généralement plus<br />
importante dans les villes qu’en campagne.<br />
Quasi nulle sur les voies, c’est une question<br />
majeure <strong>de</strong> sécurité ; faible sur la piste (il ne<br />
faut pas que le déplacement soit gêné en cas<br />
d’urgence) ; meilleure sur les talus (il faut<br />
juste laisser l’espace au train <strong>de</strong> passer).<br />
Quasi nulle, les exigences <strong>de</strong> sécurité sont<br />
Aéroports Sécuritaire (visibilité <strong>de</strong> la<br />
signalisation…).<br />
strictes.<br />
Industries Sécuritaire (pourrait propager Faible lorsque <strong>de</strong>s produits inflammables sont<br />
les incendies) et fonctionnelle manipulés ou stockés. Meilleure tolérance<br />
(pourrait gêner la circulation du dans les autres cas.<br />
personnel)<br />
Enceintes Sécuritaire (pourrait propager Nulle, les exigences <strong>de</strong> sécurité sont strictes.<br />
militaires les incendies) et fonctionnelle<br />
(pourrait gêner la circulation du<br />
personnel)<br />
32
Pour les espaces où les nuisances sont avant tout esthétiques, il faut aussi tenir compte<br />
du niveau <strong>de</strong> fréquentation par le public.<br />
Par ailleurs, le public tolère mieux la végétation spontanée dans les lieux où il n’est que <strong>de</strong><br />
passage, et est généralement plus exigeant quand il s’agit <strong>de</strong>s lieux où il rési<strong>de</strong>. Ainsi le public<br />
n’est pas uniquement sensible à la présence <strong>de</strong> plantes adventices en centre-ville, mais<br />
également dans les banlieues rési<strong>de</strong>ntielles (Zadjan E., 2004). La tolérance du public peut être<br />
améliorée grâce à <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> communication (qui pourront porter sur les risques liés à<br />
l’emploi d’herbici<strong>de</strong>s, sur la biodiversité…).<br />
On pourra donc adapter le niveau d’entretien aux besoins réels par le choix judicieux <strong>de</strong>s<br />
techniques d’intervention et <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong> passage.<br />
D’après son enquête, Emilie Zadjan a mis au point <strong>de</strong>s seuils d’intervention en fonction <strong>de</strong><br />
la hauteur et du taux <strong>de</strong> recouvrement <strong>de</strong>s adventices sur trottoir et sur allée <strong>de</strong> parc ou <strong>de</strong><br />
jardin, selon le type <strong>de</strong> revêtement (perméable ou imperméable) et le niveau d’entretien<br />
recherché (modéré ou soigné). (voir annexe 4)<br />
ETAPE 4 : ID<strong>EN</strong>TIFIER LES RISQUES<br />
Afin d’adapter la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> désherbage (et l’éventuel choix du produit) aux risques réels, il<br />
est nécessaire d’i<strong>de</strong>ntifier les risques dominants pour chaque site désherbé. Une fois les<br />
risques i<strong>de</strong>ntifiés, un certain nombre <strong>de</strong> précautions pourront être mises en œuvre.<br />
1/ Evaluer les risques <strong>de</strong> contamination du public selon la fréquentation du site<br />
9 : Joueurs fréquentant<br />
un terrain <strong>de</strong> golf<br />
Eléments à prendre en compte :<br />
Les zones non agricoles ont pour particularité d’être plus ou<br />
moins fréquentées par le public. Bien que l’exposition du<br />
public semble généralement faible, on soupçonne <strong>de</strong>s effets<br />
chroniques lors d’une exposition régulière à <strong>de</strong> petites quantités<br />
<strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques, se traduisant par <strong>de</strong>s<br />
symptômes non discriminants ou peu perceptibles.<br />
Certaines indications sur la fréquentation <strong>de</strong>s lieux sont<br />
donc importantes pour le choix <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong><br />
désherbage.<br />
Y a-t-il un public important ?<br />
Si le lieu est très fréquenté, il faut prendre en compte les risques liés à l’exposition du public<br />
aux produits phytopharmaceutiques.<br />
Ce public reste-t-il présent ou est-il <strong>de</strong> passage ? Y a-t-il <strong>de</strong>s habitations ou d’autres locaux à<br />
proximité immédiate (écoles, bureaux, hôpitaux etc.) ?<br />
Une personne présente en permanence sur un lieu sera exposée plus longtemps à<br />
l’herbici<strong>de</strong> qu’une personne qui se contente <strong>de</strong> le traverser.<br />
33
Il est à noter que l’exposition du public peut aussi s’opérer à l’intérieur <strong>de</strong>s<br />
bâtiments ; en effet, les produits peuvent pénétrer les bâtiments, soit en étant transportés par<br />
l’air via les fenêtres ou les systèmes d’aération, soit en étant transportés par les vêtements ou<br />
sous les chaussures, ou même par les animaux domestiques. Une fois présents dans les<br />
bâtiments, les produits, peu exposés aux phénomènes <strong>de</strong> dégradation, s’accumulent dans l’air<br />
et la poussière. Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2001 a estimé qu’après un traitement <strong>de</strong> la pelouse, les niveaux<br />
d’exposition au 2,4-D pour les jeunes enfants à l’intérieur d’une maison étaient 10 fois<br />
supérieurs aux niveaux d’exposition avant traitement (Nishioka et al., 2001). Différents cas<br />
d’intoxication dans <strong>de</strong>s écoles par <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s introduits dans les bâtiments par les réseaux<br />
d’aération sont reportés dans une étu<strong>de</strong> américaine <strong>de</strong> la Northwest Coalition for Alternatives<br />
to Pestici<strong>de</strong>s (NCAP, 2000) : on peut citer par exemple le cas <strong>de</strong> 12 élèves et membres du<br />
personnel d’une école d’Orégon qui ont ressenti <strong>de</strong>s maux <strong>de</strong> têtes et <strong>de</strong>s nausées après que<br />
<strong>de</strong>s vapeurs d’herbici<strong>de</strong>s (2,4D et glyphosate) aient pénétré dans les classes par les prises<br />
d’airs (16 mai 1997).<br />
Est-ce une population sensible ? (femmes enceintes et bébés, enfants, personnes âgées,<br />
mala<strong>de</strong>s…)<br />
Les experts <strong>de</strong> la santé s’accor<strong>de</strong>nt sur le fait que, du fait <strong>de</strong> leurs comportement et<br />
physiologie particuliers, certains groupes <strong>de</strong> population sont plus sensibles aux produits<br />
phytopharmaceutiques que d’autres.<br />
Par exemple, les jeunes enfants sont considérés comme une population particulièrement<br />
sensible. En effet, leur comportement favorise les expositions (par exemple, déplacement par<br />
rampement sur les surfaces traitées, habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> porter les mains à la bouche, tentation <strong>de</strong><br />
manipuler ou <strong>de</strong> porter à la bouche <strong>de</strong>s particules traitées ou même <strong>de</strong>s granulés<br />
herbici<strong>de</strong>s…). De plus, ils sont plus vulnérables en raison <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> leur<br />
organisme (quantité d’air inspiré plus importante vis-à-vis du poids, immaturité <strong>de</strong>s organes).<br />
D’autres populations sensibles peuvent être les femmes enceintes, les bébés, les personnes<br />
âgées, les personnes atteintes <strong>de</strong> certaines maladies (certaines maladies <strong>de</strong> peau peuvent<br />
augmenter l’absorption <strong>de</strong>s produits, par exemple) (Jackson et al., 2001).<br />
De quelle façon le public risque-t-il d’être exposé ?<br />
Le public peut être exposé par voie respiratoire, cutanée ou digestive (voir introduction).<br />
Généralement, la voie respiratoire est la principale voie d’exposition.<br />
Cependant, le contact cutané peut aussi être important, notamment sur les pelouses : le<br />
public peut marcher, s’asseoir, etc…sur une pelouse traitée. Dans une étu<strong>de</strong> faite avec <strong>de</strong>s<br />
adultes volontaires, <strong>de</strong> faibles quantités <strong>de</strong> 2,4D ont été détectées dans les urines <strong>de</strong> 3<br />
personnes (portant <strong>de</strong>s shorts, <strong>de</strong>s t-shirts, et marchant pied nus) qui avaient fréquenté pendant<br />
une heure une pelouse traitée au 2,4D une heure après l’application (Solomon et al., 1993).<br />
Evaluation du risque :<br />
voir arbre <strong>de</strong> décision<br />
34
Arbre <strong>de</strong> décision pour l’évaluation <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> contamination du public selon la fréquentation du site<br />
Zone à<br />
classer<br />
Absence <strong>de</strong> public<br />
Ex : zones <strong>de</strong> fret <strong>de</strong>s<br />
aéroports…<br />
Présence <strong>de</strong> public<br />
Public uniquement<br />
<strong>de</strong> passage<br />
Public présent sur une<br />
durée plus longue /<br />
proximité d’habitations<br />
Population normalement<br />
sensible<br />
Population<br />
particulièrement sensible<br />
Enfants, femmes enceintes,<br />
personnes âgées, mala<strong>de</strong>s…<br />
Population normalement<br />
sensible<br />
Population<br />
particulièrement sensible<br />
Enfants, femmes enceintes,<br />
personnes âgées, mala<strong>de</strong>s…<br />
Risque<br />
réduit<br />
Risque<br />
modéré<br />
Risque<br />
élevé<br />
Risque<br />
élevé<br />
Risque<br />
très élevé<br />
Si le choix d’un<br />
traitement<br />
chimique est fait :<br />
- traiter <strong>de</strong><br />
préférence en<br />
l’absence <strong>de</strong><br />
public<br />
- ou l’informer <strong>de</strong>s<br />
précautions à<br />
prendre<br />
- choisir <strong>de</strong>s<br />
herbici<strong>de</strong>s peu<br />
toxiques et peu<br />
volatiles<br />
Eviter tout traitement<br />
chimique ou traiter en<br />
l’absence <strong>de</strong> public<br />
36
10 Désherbage à proximité d’eaux <strong>de</strong><br />
surface : une pratique à proscrire !<br />
2/ Evaluer le risque pour les eaux<br />
- Evaluation du risque pour les eaux superficielles<br />
En zones non agricoles, le risque <strong>de</strong><br />
pollution <strong>de</strong>s eaux superficielles est l’un <strong>de</strong>s<br />
plus importants en raison <strong>de</strong><br />
l’imperméabilisation <strong>de</strong>s surfaces et <strong>de</strong>s<br />
réseaux <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s eaux.<br />
Cependant, dans certains cas il peut aussi y<br />
avoir <strong>de</strong>s risques liés à l’infiltration vers les<br />
eaux souterraines.<br />
La préservation <strong>de</strong>s eaux est essentielle,<br />
pour protéger les ressources en eau potable et<br />
pour sauvegar<strong>de</strong>r les écosystèmes aquatiques.<br />
Le risque <strong>de</strong> transfert vers les eaux superficielles peut être évalué à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la démarche <strong>de</strong><br />
plan <strong>de</strong> désherbage mise au point par le Corpep (Corpep, 2002).<br />
Pour cette analyse, on considère que les transferts vers les eaux <strong>de</strong> surface se font avant<br />
tout par ruissellement ; cependant, les cours d’eau sont au moins partiellement alimentés par<br />
les nappes, tout particulièrement pendant les pério<strong>de</strong>s sèches. C’est pourquoi la qualité <strong>de</strong>s<br />
eaux <strong>de</strong> surface dépendra, dans <strong>de</strong>s proportions très variables, à la fois <strong>de</strong>s quantités <strong>de</strong><br />
matières actives transférées par ruissellement et <strong>de</strong> celles contenues dans les eaux<br />
souterraines.<br />
Eléments à prendre en compte<br />
- Le site est-il à proximité d’un point d’eau<br />
(ou connecté à un point d’eau) ?<br />
Lorsqu’un site à désherber se trouve à proximité d’un point d’eau, le risque <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong><br />
substances actives par ruissellement est très important.<br />
On considère comme un point d’eau :<br />
• les cours d’eau ou les fossés circulants<br />
• les points <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment au réseau hydrographique ou pluvial (avaloirs<br />
d’eau pluviale…)<br />
• autres : sources, bassins <strong>de</strong> rétention, puisards…<br />
On considère qu’une zone située autour du point d’eau sur une largeur <strong>de</strong> 15 m est à<br />
proximité du point d’eau.<br />
On considère qu’une zone qui recueille les eaux <strong>de</strong> pluie et les concentre vers un point<br />
d’eau est connectée à ce point. Ce peut être le cas, par exemple, d’une zone en pente qui<br />
concentre les eaux en direction d’un avaloir d’eaux pluviales.<br />
Sens d’écoulement <strong>de</strong><br />
l’eau Dans l’exemple ci-contre, un<br />
avaloir est présent en bas <strong>de</strong><br />
pente. L’écoulement <strong>de</strong> l’eau<br />
se faisant vers ce point, toute<br />
la zone située en amont <strong>de</strong><br />
l’avaloir sera considérée<br />
comme connectée.<br />
38
Avaloir d’eau pluviale<br />
(connexion à un point d’eau)<br />
Les surfaces drainées (terrains <strong>de</strong> sport, cimetières…) sont considérées comme connectées à<br />
un point d’eau. En effet, la présence d’un réseau <strong>de</strong> drainage favorise les transferts rapi<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
substances actives vers les eaux (Corpep, 2002).<br />
- Quelle est la capacité d’infiltration <strong>de</strong> la surface ?<br />
La capacité d’infiltration <strong>de</strong> la surface dépend beaucoup <strong>de</strong> son revêtement :<br />
Tableau 11 : Types <strong>de</strong> surfaces perméables et imperméables<br />
Surface imperméables Surfaces perméables<br />
Surface bitumée (enrobée ou bicouche) Surfaces sablée<br />
Surface sablée cimentée Surfaces gravillonnées<br />
Surface dallée (1) Terre nue<br />
Surface pavée (pavée en granite ou en ciment) Association terre/graves (2)<br />
Surface stabilisée (3) Surface enherbée<br />
(1) concerne différentes natures <strong>de</strong> dallage : calcaire, marbre, granit, porphyre, grès,<br />
ardoise, quartzite, schiste<br />
(2) mélange <strong>de</strong> terre et <strong>de</strong> cailloux 0/60<br />
(3) aire sablée constituée d’une sous couche <strong>de</strong> gravier (0/30) puis d’une couche <strong>de</strong><br />
finition<br />
(Corpep, 2002)<br />
Ce classement permet une première approche <strong>de</strong> la perméabilité d’une surface. Cependant, la<br />
perméabilité d’une surface ne dépend pas uniquement <strong>de</strong> son revêtement :<br />
• Un sol compacté et tassé peut former une croûte <strong>de</strong> battance, et se comportera<br />
comme un sol imperméable.<br />
• Un sol saturé en eau peut entraîner un ruissellement par refus d’infiltration.<br />
Une surface constituée d’un matériau à priori perméable peut donc se comporter comme une<br />
surface imperméable.<br />
Il faut donc compléter l’évaluation <strong>de</strong> la perméabilité par <strong>de</strong>s observations <strong>de</strong> terrain : la<br />
présence <strong>de</strong> traces <strong>de</strong> ruissellement indique que la surface se comporte comme une surface<br />
imperméable. La présence <strong>de</strong> flaques d’eau après une pluie permet <strong>de</strong> déduire que<br />
l’infiltration est faible, et que la zone peut être considérée comme imperméable.<br />
Evaluation du risque :<br />
voir arbre <strong>de</strong> décision<br />
Figure 5 : Connexion à un point d’eau<br />
39
Arbre <strong>de</strong> décision pour le risque pour les eaux superficielles<br />
Zone à<br />
classer<br />
Proximité ou<br />
connexion à un point<br />
d’eau<br />
- zone à moins <strong>de</strong> 15m d’un point<br />
d’eau / en pente vers un point d’eau /<br />
connectée au réseau pluvial /drainée…<br />
Absence <strong>de</strong><br />
proximité ou <strong>de</strong><br />
connexion à un point<br />
d’eau<br />
Surface<br />
imperméable<br />
Bitume, ciment, pavage,<br />
stabilisé…<br />
Surface perméable<br />
Sables, gravillons, terre…<br />
Sol compacté<br />
Présence <strong>de</strong> flaques ou <strong>de</strong><br />
traces <strong>de</strong> ruissellement<br />
après une pluie<br />
Sol non compacté<br />
Risque<br />
élevé<br />
Risque<br />
élevé<br />
Risque<br />
élevé<br />
Risque réduit<br />
Pas <strong>de</strong> traitement<br />
chimique<br />
Si le choix d’un<br />
traitement<br />
chimique est fait :<br />
- choisir <strong>de</strong>s<br />
spécialités à faible<br />
dosage, en<br />
pério<strong>de</strong> sèche<br />
- préférer <strong>de</strong>s<br />
herbici<strong>de</strong>s peu<br />
rémanents et peu<br />
toxiques<br />
40
- Evaluation du risque pour les eaux souterraines<br />
Eléments à prendre en compte<br />
Quelles sont les caractéristiques <strong>de</strong> la nappe phréatique ?<br />
Une nappe d’eau peut être atteinte par les pollutions issues <strong>de</strong> la surface du sol si elle n’est<br />
pas protégée par une couche imperméable (aquifère « libres ») ; on dit alors qu’elle est<br />
« vulnérable » à la pollution.<br />
Certaines caractéristiques <strong>de</strong> la nappe phréatique peuvent la rendre plus sensible aux transferts<br />
par infiltration : une nappe sera plus sensible si elle est peu profon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> petite taille. Il<br />
est intéressant aussi <strong>de</strong> connaître le mo<strong>de</strong> d’alimentation (recharge, en mm d’eau/an ) <strong>de</strong> la<br />
nappe : l’alimentation d’un aquifère libre s’effectue en majeure partie par l’infiltration d’une<br />
partie <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> pluie dans le sol, mais pour les nappes alluviales la contribution <strong>de</strong>s cours<br />
d’eau est importante. L’alimentation par infiltration <strong>de</strong>s nappes se fait essentiellement en fin<br />
d’automne et en début <strong>de</strong> printemps, lorsque l’eau peut circuler par gravité dans le sol et le<br />
sous-sol et atteindre la nappe.<br />
Pour avoir <strong>de</strong>s renseignements sur les caractéristiques d’une nappe phréatique, il est utile <strong>de</strong><br />
contacter l’agence <strong>de</strong> l’eau concernée.<br />
Quelles sont les caractéristiques du sol ?<br />
Les textures argileuses favorisent l’infiltration préférentielle par les macroporosités ; les<br />
textures plus sableuses (sols dits « filtrants »), du fait <strong>de</strong> leur faible capacité <strong>de</strong> rétention en<br />
eau, sont favorables aux transferts verticaux.<br />
Un sol pauvre en matière organique, avec une faible activité biologique, comme c’est très<br />
souvent le cas en zones non agricoles, sera aussi favorable aux transferts.<br />
Y a-t-il <strong>de</strong>s voies d’infiltration rapi<strong>de</strong> ?<br />
Dans certains cas particuliers, l’infiltration peut être rapi<strong>de</strong> et causer une pollution rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
nappes phréatiques. C’est le cas s’il y a <strong>de</strong>s circuits préférentiels d’infiltration <strong>de</strong> l’eau :<br />
fissures… Par exemple, il existe <strong>de</strong>s voies d’engouffrement <strong>de</strong> l’eau en profon<strong>de</strong>ur dans un<br />
milieu <strong>de</strong> type karstique.<br />
Evaluation du risque :<br />
voir arbre <strong>de</strong> décision<br />
41
Zone à<br />
classer<br />
Arbre <strong>de</strong> décision pour le risque pour les eaux souterraines<br />
Pas <strong>de</strong> voies<br />
d’infiltration<br />
préférentielles<br />
Présence <strong>de</strong> voies<br />
d’infiltration<br />
préférentielles<br />
(fissures…)<br />
Nappe phréatique peu<br />
sensible<br />
Nappe phréatique<br />
sensible<br />
Nappe phréatique peu<br />
sensible<br />
Nappe phréatique<br />
sensible<br />
Risque réduit<br />
Risque modéré lié à<br />
l’infiltration lente<br />
Risque élevé lié à<br />
l’infiltration rapi<strong>de</strong><br />
Risque très élevé<br />
lié à l’infiltration<br />
rapi<strong>de</strong><br />
Si désherbage<br />
chimique, choisir <strong>de</strong>s<br />
substances actives à<br />
faible potentiel <strong>de</strong><br />
mouvement<br />
Si désherbage<br />
chimique, choisir <strong>de</strong>s<br />
spécialités à faible<br />
dosage et peu<br />
rémanentes<br />
Eviter autant que<br />
possible le désherbage<br />
chimique ; choisir <strong>de</strong>s<br />
spécialités à faible<br />
dosage et peu<br />
rémanentes<br />
43
3/ Evaluation du risque pour la biodiversité<br />
- Ce site présente-t-il un caractère environnemental particulier ?<br />
Le site se trouve-t-il sur, ou à proximité d’une zone protégée ?<br />
Par exemple, une commune peut se trouver sur un parc national, et les différentes voies <strong>de</strong><br />
communication (routes, autoroutes, voies ferrées) peuvent traverser <strong>de</strong>s réserves naturelles ou<br />
<strong>de</strong>s parcs nationaux, ou bien passer à proximité <strong>de</strong> zones protégées (y compris aquatiques).<br />
Le réseau d’espaces protégés avec ses 7 parcs nationaux, ses 156 réserves naturelles, ses 600<br />
arrêtés <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> biotope et plus <strong>de</strong> 70 000 ha <strong>de</strong> terrains du conservatoire du littoral<br />
représente 1,5% <strong>de</strong> la superficie <strong>de</strong> la France.<br />
Il existe <strong>de</strong> nombreux types <strong>de</strong> zones protégées pour la préservation <strong>de</strong> la biodiversité et <strong>de</strong>s<br />
écosystèmes en France, <strong>de</strong> portée internationale, nationale, régionale, ou départementale.<br />
Leur statut juridique est très variable (conventions internationales, arrêtés préfectoraux,<br />
associations..).<br />
Ces zones ont en commun <strong>de</strong> définir un patrimoine naturel à préserver, souvent fragile ; c’est<br />
pourquoi il faut tout mettre en œuvre pour éviter <strong>de</strong> perturber ces écosystèmes.<br />
En particulier, il est important <strong>de</strong> savoir si une flore protégée est présente sur le site à<br />
désherber.<br />
Vous trouverez en annexe 5 une liste <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> zones protégées, et une liste <strong>de</strong><br />
la flore protégée. Consulter la Diren (Direction <strong>de</strong> l’environnement) <strong>de</strong> votre région pour plus<br />
d’information sur les zones protégées qui vous concernent.<br />
44
4/ Evaluation du risque pour les plantations<br />
Dans le cas d’une végétation ornementale (massifs, arbres d’alignement, haies…) présente à<br />
proximité d’une zone entretenue par désherbage chimique, <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> phytotoxicité<br />
peuvent survenir. On peut rencontrer cette problématique pour les arbres d’alignement, les<br />
arbres et plantations dans les cimetières, les parcs et jardins ou les golfs…<br />
Les herbici<strong>de</strong>s à action racinaire peuvent atteindre les racines <strong>de</strong> l’arbre par plusieurs<br />
phénomènes, notamment :<br />
- Application dans les zones <strong>de</strong> prospection racinaire,<br />
- Ruissellement vers le système racinaire <strong>de</strong>s plantations,<br />
- Lessivage <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s en profon<strong>de</strong>ur vers le système racinaire.<br />
Les herbici<strong>de</strong>s à action foliaire peuvent atteindre les plantations <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux façons :<br />
- Absorption foliaire suite à une dérive <strong>de</strong> pulvérisation<br />
- Absorption <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong> passé en phase gazeuse par volatilisation, surtout par<br />
temps chaud (ex : esters méthyliques du 2,4D, très volatils)<br />
Les symptômes peuvent être variés et sont peu caractéristiques et souvent difficiles à<br />
interpréter (voir annexe 6) ; une analyse <strong>de</strong> sol (pour les herbici<strong>de</strong>s à action racinaire) et/ou<br />
du végétal (pour les herbici<strong>de</strong>s à action foliaire) peut être une ai<strong>de</strong> au diagnostic.<br />
La dose d’herbici<strong>de</strong> entraînant <strong>de</strong>s dégâts est très variable selon l’espèce végétale, l’herbici<strong>de</strong><br />
utilisé, les conditions d’application, le type <strong>de</strong> sol...<br />
Eléments à prendre en compte<br />
Y a-t-il une végétation ornementale qui pourrait être atteinte par le désherbage ?<br />
Y a-t-il une végétation ornementale à proximité d’une zone totalement désherbée ? Y a-t-il un<br />
risque <strong>de</strong> ruissellement <strong>de</strong> l’éventuel traitement herbici<strong>de</strong> vers les plantations (cuvettes<br />
aux pieds <strong>de</strong>s arbres, ravinement, présence d’une rigole pouvant transporter le produit) ?<br />
Le sol est-il propice à une infiltration en profon<strong>de</strong>ur du produit (sols « filtrants », à texture<br />
sableuse par exemple) ?<br />
Les plantations sont-elles sensibles aux herbici<strong>de</strong>s ?<br />
La sensibilité <strong>de</strong>s plantations aux herbici<strong>de</strong>s dépend <strong>de</strong> divers facteurs ; l’espèce joue un rôle<br />
important (les herbici<strong>de</strong>s sont plus ou moins sélectifs vis-à-vis <strong>de</strong>s différentes espèces<br />
ornementales). (voir annexe 11). Si les plantations ont déjà montré <strong>de</strong>s symptômes <strong>de</strong><br />
phytotoxicité, il faudra être particulièrement pru<strong>de</strong>nt.<br />
Quelles sont les caractéristiques du système racinaire ?<br />
Pour les arbres, la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> l’enracinement est aussi à prendre en compte ; elle<br />
dépend <strong>de</strong> l’espèce, <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> l’arbre, mais aussi du type <strong>de</strong> sol, <strong>de</strong>s pratiques culturales<br />
(arrosage, fertilisation, taille…).<br />
On peut toutefois affirmer que la plupart <strong>de</strong>s systèmes racinaires se trouvent dans les 50<br />
premiers centimètres du sol et que les racines sont d’autant plus superficielles que l’on<br />
s’éloigne du tronc <strong>de</strong> l’arbre, <strong>de</strong> l’aplomb <strong>de</strong> la couronne et que le sol est compacté. De plus,<br />
les conditions <strong>de</strong> sol réservées aux arbres en milieu urbain (sol compacté, pauvre en oxygène)<br />
accentuent en général la superficialité <strong>de</strong>s enracinements.<br />
L’extension horizontale du système souterrain est comprise entre une fois et une fois et<br />
<strong>de</strong>mie la hauteur <strong>de</strong>s arbres pour le platane, le chêne, le frêne, le marronnier, le châtaignier,<br />
le pommier, le poirier et le robinier alors qu’elle peut atteindre 1 fois et <strong>de</strong>mie à 2 fois la<br />
hauteur <strong>de</strong>s arbres pour le peuplier, saule, orme et pour la majorité <strong>de</strong>s variétés <strong>de</strong> prunus.<br />
45
Zone à<br />
classer<br />
Arbre <strong>de</strong> décision pour le risque pour les plantations ornementales<br />
Pas <strong>de</strong><br />
plantations à<br />
proximité<br />
Plantations à<br />
proximité<br />
Pas <strong>de</strong> voies <strong>de</strong><br />
ruissellement vers<br />
d’autres plantations<br />
Présence <strong>de</strong> voies <strong>de</strong><br />
ruissellement vers<br />
d’autres plantations<br />
Ex : arbres plantés dans <strong>de</strong>s<br />
cuvettes dans une zone<br />
imperméabilisée<br />
Désherbage hors <strong>de</strong> la<br />
zone racinaire<br />
A une distance du tronc<br />
supérieure à 2 fois le<br />
diamètre du houppier<br />
Désherbage dans la<br />
zone racinaire<br />
A une distance du tronc<br />
inférieure à 2 fois le<br />
diamètre du houppier<br />
Enracinement<br />
profond<br />
Enracinement<br />
superficiel<br />
Risque réduit<br />
Risque<br />
modéré<br />
Risque élevé<br />
Risque élevé<br />
Risque très<br />
élevé<br />
Choisir <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
foliaires ou <strong>de</strong>s<br />
herbici<strong>de</strong>s racinaires peu<br />
rémanents, alterner les<br />
substances actives<br />
Si désherbage<br />
chimique, choisir<br />
un herbici<strong>de</strong><br />
foliaire dans <strong>de</strong><br />
bonnes<br />
conditions<br />
climatiques, ou<br />
un herbici<strong>de</strong><br />
sélectif <strong>de</strong> la<br />
plantation<br />
- préférer une technique<br />
alternative (mulch,<br />
plantes couvre-sols…)<br />
46
ETAPE 5 : PR<strong>EN</strong>DRE <strong>EN</strong> COMPTE LES PRECONISATIONS<br />
En fonction du type <strong>de</strong> risque i<strong>de</strong>ntifié pour chaque site lors <strong>de</strong> l’étape 4, un certain nombre<br />
<strong>de</strong> précautions <strong>de</strong>vront être mises en œuvre. Ces précautions porteront notamment sur le choix<br />
<strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désherbage (métho<strong>de</strong>s chimiques ou alternatives), et, dans le cas d’un<br />
désherbage chimique, sur le choix <strong>de</strong>s substances actives selon leurs propriétés physicochimiques,<br />
et sur les conditions <strong>de</strong> traitement.<br />
Un site peut cumuler plusieurs types <strong>de</strong> risques ; dans ce cas, on choisira <strong>de</strong> prendre en<br />
compte le risque dominant (risque le plus élevé). Il est tout à fait possible qu’un site cumule<br />
plusieurs types <strong>de</strong> risques à un niveau élevé (ex : hôpital, avec plantations <strong>de</strong> valeur et sol<br />
imperméabilisé). Dans ce cas, il faudra se tourner autant que possible vers d’autres moyens <strong>de</strong><br />
maîtrise <strong>de</strong> la végétation que les métho<strong>de</strong>s chimiques.<br />
Si aucun risque particulier n’est dégagé lors <strong>de</strong> l’analyse, le choix <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
traitement se fera en fonction d’autres critères : niveau d’entretien, flore en place, etc.<br />
1/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour la santé publique<br />
- Zones à risque très élevé<br />
Il s’agit <strong>de</strong>s zones fréquentées sur <strong>de</strong> longues durées par <strong>de</strong>s populations sensibles ou à<br />
proximité d’habitations ou <strong>de</strong> locaux fréquentés par <strong>de</strong>s populations sensibles. Il peut d’agir<br />
par exemple <strong>de</strong> crèches, d’établissements scolaires, <strong>de</strong> terrains <strong>de</strong> sport utilisés par <strong>de</strong>s<br />
enfants, d’aires <strong>de</strong> jeux, d’hôpitaux, <strong>de</strong> maisons <strong>de</strong> retraite, <strong>de</strong> certains parcs municipaux, <strong>de</strong><br />
certains quartiers rési<strong>de</strong>ntiels…<br />
Dans ce cas, il est recommandé d’éviter tout traitement chimique en présence <strong>de</strong> ce public<br />
sensible. Plusieurs solutions sont possibles :<br />
- Choisir <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s non chimiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la végétation spontanée<br />
- Choisir <strong>de</strong> traiter à un moment où le public est absent (exemple : pour les<br />
écoles, traiter le vendredi soir ou le samedi ou pendant les vacances<br />
scolaires ; traiter les lotissements rési<strong>de</strong>ntiels aux heures <strong>de</strong> bureau)<br />
- Fermer l’accès au site, avec un délai <strong>de</strong> réentrée <strong>de</strong> 48h ; ceci est plus aisé si<br />
le public a déjà été sensibilisé aux risques liés à l’application <strong>de</strong>s produits<br />
(campagnes <strong>de</strong> sensibilisation pouvant être mises en oeuvre dans les<br />
communes par exemple).<br />
Si aucune <strong>de</strong> ces solutions n’est envisageable, il est important d’informer clairement le public<br />
<strong>de</strong>s précautions à prendre et <strong>de</strong> traiter avec pru<strong>de</strong>nce (voir recommandations pour les zones à<br />
risque modéré ou élevé).<br />
- Zones à risque modéré ou élevé<br />
Il peut s’agir <strong>de</strong> zones à proximité d’habitations, <strong>de</strong> bureaux ou <strong>de</strong> magasins, ou bien <strong>de</strong> zones<br />
où circule un public qui n’est pas considéré comme particulièrement sensible. Si le choix d’un<br />
désherbage chimique est fait sur ces zones :<br />
- Autant que possible, il serait souhaitable d’informer la population <strong>de</strong>s<br />
précautions à prendre.<br />
- Choisir <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s peu toxiques (voir annexe 10) et employer <strong>de</strong>s<br />
doses faibles.
- Si la contamination risque <strong>de</strong> se faire essentiellement par voie<br />
respiratoire, traiter dans <strong>de</strong>s conditions qui minimisent les transferts vers<br />
l’atmosphère, surtout la volatilisation et la dérive : traiter en conditions non<br />
ventées et éviter l’application par fortes chaleurs (traiter <strong>de</strong> préférence en<br />
soirée, ou éventuellement tôt le matin, si les journées sont chau<strong>de</strong>s par<br />
exemple). Choisir une substance active peu volatile (constante <strong>de</strong> Henry<br />
inférieure à 2,5.10 -5 ). Voir annexe 10 pour connaître les propriétés <strong>de</strong>s<br />
différentes substances actives.<br />
- Si la contamination par voie cutanée peut être importante, comme ce peut<br />
être le cas sur une pelouse notamment, il est préférable d’éviter une<br />
fréquentation <strong>de</strong> celle-ci dans la journée qui suit le traitement.<br />
- Si le désherbage se fait à proximité d’habitations ou <strong>de</strong> locaux où le<br />
public est présent : s’assurer que les portes et fenêtres sont fermées, ne pas<br />
traiter près <strong>de</strong>s prises d’air.<br />
Comment informer le public ?<br />
La communication peut être faite par une distribution <strong>de</strong> courrier (habitations), par une prise<br />
<strong>de</strong> contact avec une personne responsable <strong>de</strong> l’établissement (direction d’une école par<br />
exemple), par un affichage dans un point clé (entrée d’un parc, d’un cimetière…). Par<br />
exemple, on signalera par un panneau qu’une pelouse a été traitée, comme c’est obligatoire<br />
maintenant dans certaines villes du Québec.<br />
Il convient <strong>de</strong> rappeler autant que possible la nécessité du désherbage, <strong>de</strong> préciser la<br />
date et l’heure du traitement, et <strong>de</strong> préciser les précautions à prendre :<br />
- Dans le cas d’habitations ou <strong>de</strong> locaux à proximité <strong>de</strong> la zone désherbée :<br />
fermer les fenêtres, éviter <strong>de</strong> rester à l’extérieur au moment <strong>de</strong> désherbage.<br />
- Dans le cas d’un public <strong>de</strong> passage sur le site désherbé : éviter <strong>de</strong> passer à<br />
proximité du personnel en train <strong>de</strong> désherber ou <strong>de</strong> rester sur les zones qui<br />
viennent d’être traitées.<br />
L’information du public peut être facilitée si le public a déjà été averti que <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong><br />
désherbage vont avoir lieu, par exemple dans le journal municipal.<br />
XLVIII
2/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour les eaux<br />
- Gestion du risque pour les eaux superficielles<br />
- Surfaces en contact direct avec les points d’eau<br />
11 Ne pas désherber<br />
chimiquement les zones<br />
connectées à un point d’eau !<br />
- Surfaces à risque élevé non connectées à <strong>de</strong>s points d’eau<br />
Toutes les surfaces en contact direct avec les points d’eau<br />
(cours d’eau, fossés, avaloirs d’eau pluviale…) ne doivent<br />
pas être désherbées chimiquement. De même, il faut éviter<br />
le désherbage chimique <strong>de</strong>s caniveaux.<br />
Si un traitement chimique est fait à proximité <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong><br />
surface, ne le faire que dans les meilleures conditions<br />
météorologiques, en tenant compte notamment du vent (éviter<br />
la dérive). De plus, il faut respecter les zones <strong>de</strong> non<br />
traitement qui <strong>de</strong>vront bientôt être précisées sur les étiquettes<br />
<strong>de</strong> produits.<br />
Les éléments qui influent <strong>de</strong> façon déterminante le taux <strong>de</strong> transfert sont la dose <strong>de</strong> produit<br />
utilisée et la durée entre le traitement et la première pluie.<br />
Il faut donc choisir une spécialité homologuée à faible dosage et l’appliquer en pério<strong>de</strong><br />
sèche sans risque <strong>de</strong> pluie importante dans un délai <strong>de</strong> cinq jours.<br />
On pourra choisir <strong>de</strong> préférence <strong>de</strong>s produits peu rémanents, ayant une faible persistance<br />
d’action (voir durée <strong>de</strong> vie DT50, bien que la durée <strong>de</strong> vie sur les sols imperméabilisée soit<br />
nettement supérieure à la DT50 mesurée sur <strong>de</strong>s sols agricoles).<br />
Par ailleurs, pour limiter l’impact <strong>de</strong>s produits transférés, on pourra choisir <strong>de</strong>s produits ayant<br />
un faible classement toxicologique et écotoxicologique. (voir annexe 10)<br />
Enfin, on privilégiera les produits n’étant pas classés comme dangereux pour les organismes<br />
aquatiques (mention AQUA sur l’étiquette du produit).<br />
Des informations complémentaires sur les substances actives, en particulier sur leur<br />
écotoxicité pour divers organismes aquatiques, peuvent être trouvées sur la base <strong>de</strong> données<br />
en ligne Agritox. (http://www.inra.fr/Internet/Produits/agritox/)<br />
- Utiliser les ban<strong>de</strong>s enherbées pour protéger la ressource en eau <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
Les ban<strong>de</strong>s enherbées sont utilisées pour limiter l’érosion et les transferts (azote, produits<br />
phytosanitaires) vers les eaux <strong>de</strong> surface. En effet, elles permettent <strong>de</strong> ralentir le<br />
ruissellement, jouent un rôle <strong>de</strong> filtre doté une microflore active, et favorisent la dégradation<br />
<strong>de</strong>s substances actives.<br />
XLIX
Ces caractéristiques peuvent être intéressantes également pour la protection <strong>de</strong>s points d’eau<br />
en zones non agricoles ; en particulier, il est préférable <strong>de</strong> maintenir enherbés les berges <strong>de</strong><br />
cours d’eau et les fossés.<br />
En agriculture, on recomman<strong>de</strong> une largeur minimale <strong>de</strong> 5m le long d’un cours d’eau<br />
(conditionnalité <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la PAC). Cette largeur peut être augmentée en zone non agricole,<br />
dans <strong>de</strong>s conditions où un ruissellement fort est favorisé (zones imperméabilisées, pentues…).<br />
Pour protéger les eaux <strong>de</strong> surface, il est recommandé <strong>de</strong> ne pas utiliser <strong>de</strong> traitements<br />
phytosanitaires ou d’engrais sur ces ban<strong>de</strong>s enherbées.<br />
- Gestion du risque pour les eaux souterraines<br />
- Risque vis-à-vis <strong>de</strong> l’infiltration lente<br />
Dans le cas d’un risque lié à une infiltration lente, il est préférable <strong>de</strong> privilégier <strong>de</strong>s<br />
substances actives ayant un faible potentiel <strong>de</strong> mouvement (GUS, indice <strong>de</strong> Gustafson), et<br />
une faible rémanence (<strong>de</strong>mi-vie). (Voir annexe 10). On notera cependant, que cet indice a<br />
été développé pour <strong>de</strong>s sols agricoles et n’est pas forcément adapté pour un choix pertinent<br />
<strong>de</strong>s substances actives <strong>de</strong>stinées à être appliquées en sols urbains squelettiques et pauvres en<br />
matière organique.<br />
- Risque vis-à-vis d’une infiltration rapi<strong>de</strong><br />
Dans le cas <strong>de</strong> transferts rapi<strong>de</strong>s, comme en zone karstique, choisir une métho<strong>de</strong> alternative<br />
au désherbage ou choisir <strong>de</strong>s spécialités homologuées à faible dose d’utilisation, et peu<br />
rémanentes. Encore une fois, la consultation <strong>de</strong>s prévisions météorologique permettra d’éviter<br />
<strong>de</strong> traiter si un risque <strong>de</strong> pluie est annoncé dans un délai <strong>de</strong> 5 jours.<br />
3/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour la biodiversité<br />
Si le site à entretenir est reconnu contenir <strong>de</strong>s espèces végétales protégées, les traitements<br />
chimiques doivent être interdits afin <strong>de</strong> ne pas mettre en péril ces écosystèmes fragiles. Il faut<br />
privilégier une gestion extensive pour ce type <strong>de</strong> site ; on préférera par exemple une prairie à<br />
une pelouse.<br />
On choisira <strong>de</strong> maîtriser la flore par <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s non chimiques.<br />
L
4/ Eléments <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour les plantations<br />
Si le choix d’un désherbage chimique est fait dans un site où il existe un risque pour les<br />
plantations, certaines précautions <strong>de</strong>vront être prises :<br />
- Recommandations générales<br />
Il est préférable <strong>de</strong> réserver pour le désherbage un appareil <strong>de</strong> pulvérisation différent <strong>de</strong>s<br />
appareils utilisés pour les applications fertilisantes, fongici<strong>de</strong>s ou insectici<strong>de</strong>s, ou être<br />
particulièrement attentif au rinçage <strong>de</strong> la cuve et <strong>de</strong> l’appareil.<br />
Il faut éviter <strong>de</strong> traiter les lieux où il y a <strong>de</strong>s arbres et arbustes d’ornement à<br />
enracinement superficiel avec <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s à action racinaire, et préférer <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
à action foliaire.<br />
Il est important <strong>de</strong> prendre en compte la sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s employés pour le<br />
désherbage sélectif <strong>de</strong>s plantations. Dans certains cas, <strong>de</strong>s spectres <strong>de</strong> sélectivité peuvent<br />
aussi être donnés sur les fiches techniques pour les herbici<strong>de</strong>s totaux en cas d’emploi à<br />
proximité <strong>de</strong> plantations (voir annexe 12). On trouve aussi souvent sur les fiches techniques<br />
<strong>de</strong>s produits les précautions à prendre vis-à-vis <strong>de</strong>s plantations ornementales. En cas <strong>de</strong> doute,<br />
contacter vos fournisseurs.<br />
- Herbici<strong>de</strong>s à action racinaire<br />
Il faut éviter les arrosages après traitement et s’assurer qu’aucune pluie ne surviendra dans<br />
les jours suivant le traitement.<br />
Il faut éviter d’appliquer <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s très solubles à proximité <strong>de</strong> zones arborées,<br />
sachant que les racines <strong>de</strong>s arbres peuvent s’étendre très loin à partir du tronc.<br />
Il est recommandé <strong>de</strong> choisir <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s peu rémanents, et alterner, d’année en année,<br />
les substances actives.<br />
Par ailleurs, il est préférable <strong>de</strong> diminuer autant que possible la dose employée en fonction<br />
<strong>de</strong> la sensibilité <strong>de</strong> la flore présente. (voir annexe 11)<br />
Enfin, il faut éviter les traitements ou les accumulations <strong>de</strong> granulés aux alentours<br />
immédiats <strong>de</strong>s arbres ; ceci est possible par exemple en y installant un paillage, ou en y<br />
plantant une végétation couvrante. Cette solution est intéressante aussi bien pour <strong>de</strong>s arbres<br />
d’alignement que dans le cas <strong>de</strong> plantations installées au sein <strong>de</strong> pelouses ou <strong>de</strong>s zones<br />
herbeuses (le paillage évitera le développement d’herbes hautes autour <strong>de</strong> l’arbre).<br />
- Herbici<strong>de</strong>s à action foliaire<br />
Il faut traiter par temps parfaitement calme, sans pluie, à une température inférieure à 20°C,<br />
<strong>de</strong> préférence en fin <strong>de</strong> journée.<br />
On privilégiera <strong>de</strong>s substances actives peu volatiles (constante <strong>de</strong> Henry inférieure à 2,5.10 -<br />
5 ). (voir annexe 10)<br />
Enfin, le traitement pourra être effectué à faible pression, en équipant les buses <strong>de</strong><br />
pulvérisation d’un écran <strong>de</strong> protection pour empêcher toute projection sur le feuillage ou sur<br />
les écorces insuffisamment lignifiées.<br />
LI
PREVOIR LE <strong>DESHERBAGE</strong> DES LA CONCEPTION DES ESPACES<br />
Une démarche importante pour la réduction <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> désherbage consiste à prévoir la<br />
gestion <strong>de</strong>s adventices dès la conception <strong>de</strong>s espaces en limitant le développement <strong>de</strong> la<br />
végétation spontanée ou en diminuant leur nuisance visuelle.<br />
I/ CONCEVOIR DES SURFACES LAISSANT PEU DE PLACE A LA FLORE<br />
ADV<strong>EN</strong>TICE<br />
Certaines surfaces sont plus propices au développement <strong>de</strong> végétation spontanée que d’autres.<br />
De façon générale, on distingue trois types <strong>de</strong> surfaces :<br />
Tableau 12 : Les 3 catégories <strong>de</strong> surfaces, selon leur perméabilité :<br />
Surface imperméables Surfaces imperméables avec<br />
joints<br />
Asphalte<br />
Pavages<br />
Béton<br />
Dallages<br />
…<br />
…<br />
12 Développement d’adventices dans le<br />
joint entre une bordure <strong>de</strong> trottoir et la<br />
route<br />
Surfaces semi-perméables<br />
Graviers<br />
Surfaces sablées<br />
...<br />
Les surfaces imperméables sont, à priori,<br />
inadaptées au développement <strong>de</strong>s plantes.<br />
Les lieux propices au développement <strong>de</strong>s<br />
adventices sont les zones <strong>de</strong> rupture <strong>de</strong><br />
revêtement, comme les joints entre les pavés, les<br />
caniveaux, les bordures...<br />
Le fait d’avoir <strong>de</strong>s joints épais et correctement réalisés permet <strong>de</strong> diminuer l’installation <strong>de</strong>s<br />
plantes.<br />
Par ailleurs, il faut essayer d’éliminer au maximum les joints, par exemple en utilisant <strong>de</strong>s<br />
caniveaux moulés aux bordures. L’emploi <strong>de</strong> caniveaux centraux en béton plutôt que <strong>de</strong><br />
caniveaux en granit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux côtés <strong>de</strong> la route permet :<br />
- <strong>de</strong> diminuer le nombre <strong>de</strong> joints (pas <strong>de</strong> joint caniveau-bordure) ; la présence d’un seul<br />
caniveau central plutôt que <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux caniveaux entraîne une longueur totale <strong>de</strong> joints<br />
moindre<br />
- d’avoir un joint <strong>de</strong> meilleure qualité entre l’enrobé et le caniveau (raccord plus facile)<br />
De même, pour les pavages, l’enherbement varie selon la largeur <strong>de</strong>s joints et <strong>de</strong> leur<br />
longueur par m², qui dépend <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s pavés utilisés : il y a moins <strong>de</strong> joints, donc moins<br />
d’espaces propices à l’installation <strong>de</strong>s adventices, entre les dalles <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> taille qu’entre <strong>de</strong><br />
petits pavés.<br />
LII
Tableau 13 : Longueur <strong>de</strong> joints pour différents types <strong>de</strong> pavages couramment utilisés<br />
Type d’élément Dimensions Surface<br />
par pavé<br />
Pavé<br />
Pierre ornementale<br />
Dalle<br />
Dalle<br />
20 * 10 cm²<br />
10*10 cm²<br />
30*30 cm²<br />
60*40 cm²<br />
13 Développement<br />
d’adventices sur un chemin<br />
gravillonné<br />
200 cm²<br />
100 cm²<br />
900 cm²<br />
2400 cm²<br />
Nombre<br />
<strong>de</strong> pavés<br />
par m²<br />
50<br />
100<br />
11<br />
4<br />
Longue<br />
ur <strong>de</strong><br />
joints<br />
par m²<br />
1700 cm<br />
2200 cm<br />
800 cm<br />
500 cm<br />
% <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong><br />
surface <strong>de</strong> joints par<br />
rapport à un pavage<br />
standard<br />
Standard<br />
Augmentation <strong>de</strong> 29%<br />
53%<br />
71%<br />
Les surfaces semi-perméables permettent un développement<br />
important <strong>de</strong>s adventices si aucune mesure <strong>de</strong> contrôle n’est<br />
prise.<br />
Les surfaces sablées sont particulièrement propices au<br />
développement <strong>de</strong>s adventices ; il faut donc les éviter dans les<br />
endroits où la tolérance à la flore adventice est faible.<br />
Par ailleurs l’enherbement sur les surfaces semi-perméables et perméables avec joints dépend<br />
aussi <strong>de</strong> la fréquentation : les adventices se développeront moins sur une surface<br />
régulièrement piétinée.<br />
Enfin, on rappelle qu’une surface imperméabilisée est plus propice au transfert <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
par ruissellement. C’est pourquoi il faudra être pru<strong>de</strong>nt lors <strong>de</strong> l’implantation <strong>de</strong> celle-ci, et<br />
prendre en compte sa situation vis-à-vis <strong>de</strong>s points d’eau.<br />
LIII
II/ IMPLANTER UNE VEGETATION COMPETITIVE QUI LAISSERA PEU DE<br />
PLACE AUX ADV<strong>EN</strong>TICES<br />
Une solution pour limiter le développement <strong>de</strong> la végétation spontanée consiste à implanter<br />
<strong>de</strong>s espèces ornementales dans les espaces qui auraient pu être colonisés par celles-ci ou<br />
bien à favoriser le recouvrement du sol par les espèces en place.<br />
1/ Utiliser <strong>de</strong>s plantes couvrantes<br />
Il existe une large gamme <strong>de</strong> plantes que l’on peut considérer comme couvrantes :<br />
vivaces à tiges rampantes, vivaces stolonifères, arbustes à port couvrant…<br />
Ces plantes occupent l’espace et limitent l’implantation <strong>de</strong>s adventices. Elles peuvent être<br />
utilisées :<br />
- au sein <strong>de</strong>s massifs <strong>de</strong> fleurs<br />
- au sein <strong>de</strong>s massifs arbustifs<br />
- en bordure <strong>de</strong> haies<br />
- au pied <strong>de</strong>s arbres<br />
- sur les talus<br />
- sur toute zone que l’on cherche à recouvrir <strong>de</strong> végétation et où l’emploi d’une pelouse<br />
n’est pas satisfaisant<br />
Les plantes doivent être choisies selon leurs exigences culturales : elles doivent être<br />
adaptées au site où elles sont plantées : exposition, type <strong>de</strong> sol…L’aspect esthétique est<br />
important afin <strong>de</strong> l’intégrer dans la composition paysagère, en particulier dans le cas <strong>de</strong>s<br />
massifs.<br />
Voir tableau en annexe 7 pour le choix <strong>de</strong>s espèces.<br />
On remarquera que l’utilisation <strong>de</strong> plantes couvrantes limite les nuisances esthétiques<br />
causées par les adventices, mais pas forcément les nuisances dues à la concurrence : les<br />
espèces plantées peuvent elles-mêmes entrer en concurrence avec la plantation. Peu d’étu<strong>de</strong>s<br />
permettent <strong>de</strong> connaître l’impact véritable <strong>de</strong> cette concurrence en milieu urbain. Par<br />
précaution, on peut choisir <strong>de</strong>s espèces couvrantes peu consommatrices en eau, en<br />
particulier dans le cas <strong>de</strong> plantations jeunes.<br />
Enfin, il est préférable <strong>de</strong> choisir <strong>de</strong>s plantes couvrantes ayant <strong>de</strong>s exigences phytosanitaires<br />
faibles ; en effet, il ne serait pas judicieux d’installer <strong>de</strong>s plantes nécessitant <strong>de</strong>s traitements<br />
fongici<strong>de</strong>s et/ou insectici<strong>de</strong>s alors qu’on se soucie <strong>de</strong> diminuer les risques liés à l’emploi <strong>de</strong><br />
produits phytopharmaceutiques.<br />
2/ Engazonner les surfaces<br />
Afin <strong>de</strong> limiter la nuisance esthétique causée par le développement d’adventices, on peut<br />
choisir d’enherber certaines zones habituellement laissées nues.<br />
Ainsi, à Vézin-le-Coquet (35), certains accotements sont enherbés : l’empierrement a été<br />
retiré et les bas-côtés recouverts d’un mélange pierreux (0/315) et terreux (fine). De plus, <strong>de</strong>s<br />
dalles en polypropylène « nid d’abeille » également préensemencées seront posées à la sortie<br />
<strong>de</strong>s habitations.<br />
Un autre exemple concerne l’utilisation <strong>de</strong> parkings enherbés.<br />
LIV
III/ GERER LA VEGETATION DANS LES <strong>EN</strong>DROITS INACCESSIBLES A LA<br />
TONTE OU A LA FAUCHE<br />
La présence <strong>de</strong> divers éléments (équipements, plantations, murs..) dans <strong>de</strong>s zones<br />
herbeuses peut poser problème : en effet, ils ne permettent pas une tonte ou une fauche avec<br />
le matériel habituel. Une végétation haute peut alors se développer dans ces endroits<br />
inaccessibles. Il existe <strong>de</strong>s solutions qui permettent d’éviter une gestion ultérieure <strong>de</strong> cette<br />
flore.<br />
Ces aménagements peuvent paraître coûteux au premier abord, mais il faut prendre en<br />
compte les économies qu’ils permettent : ils diminuent fortement la maintenance que<br />
nécessitera le site. Si elles ne sont pas aménagées <strong>de</strong> façon appropriée, le temps passé pour la<br />
gestion <strong>de</strong> la végétation dans ces zones pourrait être considérable.<br />
1/ Créer <strong>de</strong>s bordures<br />
Les zones enherbées peuvent côtoyer différents espaces : chemins, parkings, massifs,<br />
bâtiments…L’interface entre les zones enherbées et ces espaces peut poser <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong><br />
gestion, en raison d’une acceptation <strong>de</strong> la végétation différente : par exemple, il est<br />
préférable qu’une pelouse n’empiète pas sur un chemin.<br />
La création <strong>de</strong> bordures est une solution à ce type <strong>de</strong> situation. Ces bordures peuvent être<br />
constituées <strong>de</strong> divers matériaux, selon les objectifs esthétiques recherchés (béton, briques…).<br />
Une bordure doit être assez profon<strong>de</strong> pour éviter le passage <strong>de</strong>s rhizomes. Les jointures<br />
doivent être imperméabilisées afin d’éviter que la végétation ne s’y développe.<br />
Il est important <strong>de</strong> maintenir correctement par <strong>de</strong>s tontes ou <strong>de</strong>s fauches la végétation à<br />
proximité d’une zone que l’on souhaite laisser nue (chemin, zone pavée ou semi-perméable),<br />
afin d’éviter une propagation <strong>de</strong> celle-ci.<br />
14 Désherbage au pied d’une glissière<br />
2/ Aménager la base <strong>de</strong>s équipements<br />
En aménageant correctement différents<br />
équipements, on peut éviter une maintenance<br />
ultérieure <strong>de</strong> la flore spontanée.<br />
En effet, la végétation qui se développe autour<br />
et/ou sous les équipements peut entraîner une<br />
nuisance visuelle, voire causer <strong>de</strong>s problèmes<br />
<strong>de</strong> sécurité (visibilité <strong>de</strong> la signalisation…).<br />
Ce problème concerne <strong>de</strong> nombreuses zones non agricoles :<br />
- Parcs et jardins : rambar<strong>de</strong>s, clôtures, bancs, tables <strong>de</strong> piques-niques, poubelles,<br />
panneaux, luminaires, et autre mobilier urbain<br />
- Routes et autoroutes : signalisation, glissières…<br />
LV
- Aéroports : signalisation, lampes, clôtures…<br />
- Terrains <strong>de</strong> sport : gradins, clôtures…<br />
etc.…<br />
Or, lorsqu’ils sont implantés sur une pelouse ou une zone herbeuse, la végétation qui se<br />
développe sous et immédiatement autour <strong>de</strong> ces éléments est inaccessible, et notamment elle<br />
ne peut être tondue. Il existe <strong>de</strong>s solutions simples pour limiter cette végétation :<br />
- Imperméabiliser au pied <strong>de</strong> ces éléments permet d’éviter une maintenance future.<br />
Ceci peut se faire à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> divers matériaux : béton, asphalte, pavage…(dans le cas<br />
d’un pavage, veiller à ce que les joints soient imperméables). Le cas échéant, on peut<br />
aussi utiliser un paillage sous certains équipements (par exemple, sous les bancs, les<br />
tables <strong>de</strong> pique-nique…)<br />
15 Dalle <strong>de</strong> béton au pied<br />
d’un panneau <strong>de</strong><br />
signalisation routière<br />
- Lorsqu’ils sont situés près d’une surface imperméabilisée, les éléments peuvent y<br />
être inclus.<br />
Ce peut être le cas pour les panneaux <strong>de</strong> signalisation et les glissières situés en bord <strong>de</strong><br />
route, les éléments <strong>de</strong> mobilier urbain en bord <strong>de</strong> chemin, ou encore les lampes en<br />
bord <strong>de</strong> piste dans les aéroports…<br />
LVI
16 Désherbage autour <strong>de</strong> la signalisation<br />
lumineuse dans un aéroport<br />
17 Signalisation lumineuse incluse dans la<br />
piste : pas <strong>de</strong> désherbage nécessaire<br />
- Pour les éléments qui ne doivent pas nécessairement être dégagés, il est possible<br />
d’implanter une végétation ornementale. Ce peut être le cas en pied <strong>de</strong> mur ou <strong>de</strong> clôture<br />
par exemple. Les plantations doivent être assez couvrantes pour qu’il ne soit pas nécessaire <strong>de</strong><br />
les désherber.<br />
Dans certaines zones non agricoles, ce type <strong>de</strong> technique pourrait même permettre <strong>de</strong><br />
s’affranchir du désherbage.<br />
Ainsi, dans les aéroports, le placement <strong>de</strong>s lampes sur les pistes et l’imperméabilisation au<br />
pied <strong>de</strong>s clôtures, ainsi que l’utilisation <strong>de</strong> dalles en béton au pied <strong>de</strong> la signalisation<br />
permettraient <strong>de</strong> réduire considérablement les opérations <strong>de</strong> désherbage, voire <strong>de</strong> les éliminer.<br />
Il en est <strong>de</strong> même pour les routes en ce qui concerne l’emploi <strong>de</strong> dalles en béton au pied <strong>de</strong>s<br />
panneaux et le placement <strong>de</strong>s glissières sur <strong>de</strong>s accotements imperméabilisés.<br />
3/ Eviter <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s zones inaccessibles<br />
De façon générale, si l’on aménage une zone qui <strong>de</strong>vra être tondue ou fauchée, il faut<br />
éviter <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s endroits inaccessibles aux outils d’entretien : éviter les angles trop<br />
brusques, les pentes trop importantes, ne pas placer les éléments trop près les uns <strong>de</strong>s autres<br />
ou trop près d’une bordure…<br />
Eviter autant que possible d’isoler <strong>de</strong>s équipements au sein <strong>de</strong> la pelouse, inclure les arbres<br />
dans un aménagement où une herbe plus haute pourra être tolérée (au sein d’un massif<br />
d’arbustes par exemple).<br />
Lorsque certaines zones sont difficilement accessibles à la tonte ou à la fauche, il convient<br />
d’adapter leur aménagement. Si l’on ne veut pas qu’une végétation haute s’y développe, il<br />
vaut mieux éviter <strong>de</strong> laisser cette zone enherbée, par exemple en y implantant <strong>de</strong>s plantes<br />
couvre-sol.<br />
LVII
IV/ CONCEVOIR DES ESPACES OU LA VEGETATION SPONTANEE SERA<br />
MIEUX TOLEREE<br />
La végétation spontanée est particulièrement visible dans les espaces uniformes : pelouses,<br />
massifs en monoculture, surfaces imperméables…En installant <strong>de</strong>s espèces végétales<br />
diversifiées, on limite l’impact visuel <strong>de</strong>s adventices.<br />
1/ Mettre en place <strong>de</strong>s prairies fleuries<br />
Les prairies fleuries sont <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> végétation composés <strong>de</strong> graminées et <strong>de</strong> plantes<br />
à fleurs. Elles sont maintenues par fauchage (voire par pâturage). De ce fait, les plantes<br />
adventices sont mieux acceptées que dans une pelouse, en raison <strong>de</strong> la diversité et <strong>de</strong> la<br />
hauteur <strong>de</strong> la végétation. Par ailleurs, ces prairies constituent <strong>de</strong>s refuges pour <strong>de</strong><br />
nombreuses espèces animales et végétales et sont <strong>de</strong> véritables réserves <strong>de</strong> biodiversité.<br />
Les prairies fleuries peuvent être mises en place dans les endroits gérés <strong>de</strong> façon extensive,<br />
comme certains parcs à vocation champêtre, les talus, les bords <strong>de</strong> routes, les zones<br />
d’activités…<br />
Pour installer une prairie à partir d’une pelouse, il faut tout d’abord laisser pousser la<br />
végétation et tondre six à sept fois par an pour amaigrir le sol. La première coupe se fera en<br />
mars à 4 cm du sol puis les suivantes à 7 ou 8 cm. Puis on pourra passer au fauchage.<br />
Si l’on cherche à installer une prairie sur une zone nue, on effectuera un semis d’un<br />
mélange composé <strong>de</strong> plantes sauvages <strong>de</strong> la région.<br />
L'entretien <strong>de</strong> la prairie sera réalisé par fauchage (sans broyage), à une hauteur <strong>de</strong> 10 cm<br />
minimum pour éviter <strong>de</strong> favoriser l’installation <strong>de</strong> plantes indésirables comme le chardon ou<br />
l'ortie. Afin <strong>de</strong> préserver <strong>de</strong>s zones refuges pour la faune, on fauchera <strong>de</strong> préférence en<br />
plusieurs fois. La fauche peut être faite une à <strong>de</strong>ux fois par an : un fauchage vers juin, et un<br />
<strong>de</strong>uxième fin septembre pour une prairie printanière ; un seul fauchage fin septembre dans le<br />
cas d’une prairie estivale. La foin issu <strong>de</strong> la fauche doit être laissé sur place plusieurs jours<br />
pour permettre aux graines <strong>de</strong> se déposer, puis sera exporté pour éviter une accumulation <strong>de</strong><br />
matière organique (un enrichissement du sol n’est pas souhaitable pour le maintien <strong>de</strong> la<br />
prairie).<br />
2/ Composer <strong>de</strong>s massifs diversifiés<br />
Les adventices sont moins tolérées dans les massifs en monoculture que dans les massifs<br />
en polyculture. En effet, elles sont moins apparentes au sein d’un massif <strong>de</strong> conception plus<br />
libre, comprenant <strong>de</strong>s plantes <strong>de</strong> hauteurs et d’apparences variées, que dans un massif <strong>de</strong><br />
conception plus uniforme.<br />
LVIII
Les techniques alternatives <strong>de</strong> désherbage<br />
I/ TECHNIQUES PREV<strong>EN</strong>TIVES<br />
1/ Les paillages<br />
Le paillage consiste à placer un matériau, appelé paillis, organique ou non, au pied d’une<br />
plantation. Il peut avoir diverses fonctions, en particulier le contrôle <strong>de</strong>s adventices. Il peut<br />
être employé dans les massifs, les jardinières, ou autour <strong>de</strong>s arbres (cuvettes d’arbres<br />
d’alignements, arbres <strong>de</strong> parcs, haies…).<br />
On différencie habituellement les paillis synthétiques en plastique, les paillis organiques<br />
(généralement à base <strong>de</strong> débris végétaux), et les paillis minéraux. Le paillis peut se présenter<br />
sous forme « flui<strong>de</strong> », c’est-à-dire composée <strong>de</strong> particules libres entre elles (graviers, écorce<br />
<strong>de</strong> pin, copeaux…) ou sous forme « cohérente » (toiles ou dalles).<br />
Selon leur composition, les caractéristiques <strong>de</strong>s paillis sont très variables.<br />
Le choix du paillis doit être raisonné<br />
- selon les contraintes du site : pente, type <strong>de</strong> sol, caractéristiques <strong>de</strong> la plantation (arbre,<br />
massif d’annuelles..), accessibilité…<br />
- selon la vocation <strong>de</strong> l’aménagement : aspect horticole ou naturel, couleurs, intégration<br />
paysagère<br />
- en tenant comptes <strong>de</strong>s contraintes telles que le niveau <strong>de</strong> maintenance ultérieure ou la<br />
disponibilité du produit, et son coût.<br />
- Il existe différents types <strong>de</strong> paillis<br />
Paillis synthétiques<br />
Il s’agit <strong>de</strong> bâches en plastiques. Elles sont généralement utilisées à la plantation plutôt que<br />
pour <strong>de</strong>s longues durées. Il est conseillé <strong>de</strong> les couvrir avec une couche <strong>de</strong> matériau organique<br />
afin <strong>de</strong> les protéger du soleil (diminution <strong>de</strong> l’absorption <strong>de</strong> chaleur et <strong>de</strong> la dégradation à la<br />
lumière). Ceci a aussi un intérêt esthétique. Les bâches réduisent l’évaporation <strong>de</strong> l’eau, ce qui<br />
permet <strong>de</strong> diminuer les besoins d’arrosage.<br />
Les paillis synthétiques ne sont pas toujours faciles à mettre en place. De plus, ils doivent être<br />
retirés après <strong>de</strong>ux à trois ans. Ces FPAU (films plastiques agricoles usagés) ne doivent ni être<br />
enfouis, ni être brûlés, mais être collectés par <strong>de</strong>s organismes habilités.<br />
On trouve notamment <strong>de</strong>s bâches en polypropylène tissées et <strong>de</strong>s bâches en<br />
polyéthylène (sous forme <strong>de</strong> films noirs). Elles sont imperméables.<br />
Les géotextiles sont constitués <strong>de</strong> fibres tissées, thermocollées ou aiguilletées (feutres). Les<br />
géotextiles thermocollés sont les plus efficaces vis-à-vis <strong>de</strong>s adventices car ils ne laissent pas<br />
<strong>de</strong> place à l’enracinement. Ils sont perméables à l’eau et à l’air.<br />
LIX
Paillis organiques « cohérents » (toiles ou dalles)<br />
Les matériaux organiques ont la particularité <strong>de</strong> se décomposer en apportant <strong>de</strong> la matière<br />
organique. Le fait que ces matériaux soient tissés ou agglomérés permet <strong>de</strong> s’affranchir <strong>de</strong>s<br />
problèmes <strong>de</strong> dispersion que l’on peut rencontrer avec les paillis « flui<strong>de</strong>s ».<br />
Les « toiles » végétales sont <strong>de</strong>s feutres constitués <strong>de</strong> jute, fibre <strong>de</strong> coco, chanvre,<br />
fibres <strong>de</strong> bois…elles s’utilisent comme les bâches plastiques, mais ont l’avantage d’être<br />
biodégradables. Ce n’est donc pas la peine <strong>de</strong> les enlever. Par ailleurs, elles laissent mieux<br />
passer l’eau, apportent <strong>de</strong> la matière organique au sol et s’intègrent mieux du point <strong>de</strong> vue<br />
esthétique.<br />
On voit aussi apparaître sur le marché <strong>de</strong>s films à base d’amidon <strong>de</strong> maïs, cependant leur<br />
durée <strong>de</strong> vie n’est encore compatible qu’avec <strong>de</strong>s cultures annuelles.<br />
Enfin, il existe <strong>de</strong>s paillis multicouches, combinant une couche <strong>de</strong> plastique, avec une couche<br />
<strong>de</strong> fibre végétale mais, ces matériaux ne sont pas complètement biodégradables.<br />
Les dalles végétales sont constituées <strong>de</strong> fibres végétales agglomérées par <strong>de</strong>s liants<br />
naturels. Elles ont une bonne longévité et un aspect net. Elles sont réservées aux sujets isolés.<br />
Paillis organiques « flui<strong>de</strong>s »<br />
Les paillis flui<strong>de</strong>s ont <strong>de</strong> nombreux avantages : apport <strong>de</strong> matière organique, amélioration <strong>de</strong><br />
la structure du sol, régulation <strong>de</strong> la température et <strong>de</strong> l’humidité…Ils permettent aussi <strong>de</strong><br />
protéger les racines <strong>de</strong>s arbres du piétinement et <strong>de</strong>s éventuels dégâts que pourrait causer une<br />
ton<strong>de</strong>use.<br />
Les rémanents d’espaces verts sont les déchets <strong>de</strong> tontes, <strong>de</strong> feuilles, et d’élagage.<br />
Les aiguilles <strong>de</strong> conifères ont un aspect esthétique et une stabilité intéressante. Les rémanents<br />
ont l’intérêt d’être facilement disponibles. Ils peuvent être compostés ou non. Les déchets<br />
d’élagage nécessitent un broyage. La longévité est variable : <strong>de</strong> quelques semaines pour les<br />
tontes à plus d’un an pour les broyats <strong>de</strong> branches. Elle dépend du taux <strong>de</strong> lignine du<br />
matériau. Il faut les renouveler suffisamment régulièrement si on veut obtenir une bonne<br />
efficacité contre les adventices.<br />
Il faut être pru<strong>de</strong>nt, car les broyats d’élagage peuvent contenir <strong>de</strong>s pathogènes. Peu d’étu<strong>de</strong>s<br />
permettent d’apprécier le risque réel <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong> maladies. Par précaution, on évitera<br />
d’utiliser <strong>de</strong>s bois en provenance d’arbres mala<strong>de</strong>s ou sujets à une épidémie (chancre coloré<br />
sur platane…).<br />
Les rémanent peuvent améliorer la structure du sol, et éventuellement apporter une<br />
fertilisation (celle-ci dépend <strong>de</strong> la composition en carbone et en azote du produit, voir plus<br />
loin).<br />
Les écorces sont <strong>de</strong>s matériaux utilisés <strong>de</strong>puis longtemps pour le paillage. Les plus<br />
utilisées sont les écorces <strong>de</strong> pin. D’autres types d’écorces sont disponibles sur le marché,<br />
comme les écorces <strong>de</strong> peuplier. La durée <strong>de</strong> vie peut être <strong>de</strong> 1 à 3 ans. Les écorces <strong>de</strong> pin<br />
peuvent acidifier le sol ; il faut donc les privilégier pour <strong>de</strong>s plantes <strong>de</strong> terre <strong>de</strong> bruyère.<br />
LX
Les copeaux <strong>de</strong> bois sont intéressants d’un point <strong>de</strong> vue esthétique car ils tiennent<br />
bien en place et ont un aspect très net. De plus, ils existent en différentes couleurs ; ils<br />
peuvent même servir à créer <strong>de</strong>s motifs ou <strong>de</strong>s logos ! Ils ont une bonne longévité (3-4 ans)<br />
Les cosses <strong>de</strong> fèves <strong>de</strong> cacao ont une bonne valeur esthétique. Elles dégagent une<br />
o<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> cacao quand elles sont humi<strong>de</strong>s (cette o<strong>de</strong>ur peut être dérangeante dans certains cas).<br />
Comme elles sont légères, elles risquent d’être emportées par le vent. Pour palier à cela, il est<br />
conseillé <strong>de</strong> les mouiller lors <strong>de</strong> la mise en place ; ceci permettrait <strong>de</strong> les fixer grâce à la<br />
gomme naturelle qu’elles contiennent. Par contre, elles peuvent être dispersées par les<br />
oiseaux. Ce paillis est aussi commercialisé comme un amen<strong>de</strong>ment organique.<br />
18 Mulch à base <strong>de</strong> fèves <strong>de</strong> cacao<br />
Les paillettes <strong>de</strong> chanvre ou <strong>de</strong> lin forment un paillage <strong>de</strong> couleur assez claire. Cela<br />
permet <strong>de</strong> mettre en valeur les plantations par contraste. Les paillettes sont légères, mais<br />
peuvent être solidarisées si on les arrose au moment <strong>de</strong> la mise en place. Il est recommandé<br />
d’enfouir les paillettes après 2 ans. Ce paillis constitue un amen<strong>de</strong>ment et améliore la<br />
structure du sol. Les paillettes <strong>de</strong> lin peuvent contenir <strong>de</strong>s graines susceptibles <strong>de</strong> germer.<br />
D’autres sous-produits organiques issus <strong>de</strong> l’industrie ou <strong>de</strong> l’agriculture peuvent<br />
être utilisés, il est difficile <strong>de</strong> les lister tous. Certains sous-produits végétaux comme les<br />
cosses <strong>de</strong> blé noir, les sciures <strong>de</strong> bois, les écorces <strong>de</strong> noix et autres fruits secs peuvent<br />
notamment être utilisés.<br />
Paillages minéraux<br />
Les matériaux minéraux se dégra<strong>de</strong>nt plus lentement, mais n’ont pas les propriétés<br />
fertilisantes <strong>de</strong>s paillis organiques. C’est pourquoi il est conseillé <strong>de</strong> bien préparer le sol avant<br />
<strong>de</strong> les utiliser. Ils ont l’avantage <strong>de</strong> ne pas être inflammables.<br />
La pouzzolane est une roche volcanique expansée. Son aspect régulier et sa coloration<br />
brune lui donnent une esthétique intéressante. Relativement inerte, elle ne change pas les<br />
propriétés chimiques du sol. La pouzzolane a une longévité <strong>de</strong> plusieurs années. Elle doit être<br />
appliquée en une couche 5 cm minimum pour être efficace.<br />
LXI
19 Pouzzolane<br />
Des graviers ou galets divers et variés peuvent être utilisés. On soupçonne certains<br />
matériaux d’augmenter l’alcalinité du sol ; ceci peut être intéressant si l’on cherche à corriger<br />
un pH aci<strong>de</strong>. Le choix du matériau peut être fait selon la disponibilité, l’aspect esthétique, et<br />
l’image <strong>de</strong> la région (emploi <strong>de</strong> morceaux d’ardoise dans les Pays <strong>de</strong> Loire..) S’ils présentent<br />
<strong>de</strong>s arrêtes pointues, on peut craindre qu’ils ne blessent les plantations par frottement.<br />
Les dalles métalliques ont un aspect net, mais ont pour inconvénient d’être rigi<strong>de</strong>s,<br />
imperméables et <strong>de</strong> refléter la lumière (risque <strong>de</strong> brûlure).<br />
Les mélanges à base <strong>de</strong> graviers et <strong>de</strong> résine ne sont pas réellement <strong>de</strong>s paillis ;<br />
cependant, ils sont utilisés au pied <strong>de</strong>s arbres d’alignement afin d’éviter le développement les<br />
adventices. Ils ont l’intérêt d’avoir un aspect assez net, et <strong>de</strong> faciliter le nettoyage. Cependant,<br />
ils sont peu perméables, et leur rigidité peut gêner le développement <strong>de</strong> l’arbre.<br />
20 Pied d’arbre<br />
avec mélange<br />
graviers-résine<br />
Les paillages permettent <strong>de</strong> contrôler la pousse <strong>de</strong>s adventices<br />
Le contrôle <strong>de</strong> la pousse <strong>de</strong>s adventives par les paillages peut être dû à plusieurs facteurs, tels<br />
que l’obscurcissement vis-à-vis <strong>de</strong>s graines présentes dans le sol, l’absence <strong>de</strong> substrat et<br />
<strong>de</strong> prise pour les racines au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s paillages (toiles), et l’éventuelle libération <strong>de</strong><br />
LXII
composés inhibant la germination ou la croissance, tels que <strong>de</strong>s phénols ou <strong>de</strong>s tanins pour les<br />
écorces.<br />
La capacité d’un paillage à contrôler les adventices dépend <strong>de</strong> ses caractéristiques<br />
intrinsèques, mais aussi <strong>de</strong> la façon dont il est appliqué. Par exemple, pour les paillis<br />
flui<strong>de</strong>s, une épaisseur plus importante aura une meilleure efficacité contre les adventices. Pour<br />
les paillis synthétiques comme les géotextiles, l’efficacité sera bonne à condition qu’il n’y ait<br />
pas <strong>de</strong> déchirure, qui serait alors très propice au développement <strong>de</strong> plantes adventices.<br />
Les paillis organiques se décomposant rapi<strong>de</strong>ment en matière fertilisante n’auront pas une<br />
gran<strong>de</strong> efficacité s’ils ne sont pas renouvelés suffisamment souvent.<br />
Certains paillis peuvent contenir <strong>de</strong>s graines susceptibles <strong>de</strong> germer, comme les tontes <strong>de</strong><br />
pelouse, les fumiers ou les paillettes <strong>de</strong> lin.<br />
- D’autres éléments peuvent être pris en compte lors du choix d’un paillage<br />
Durée <strong>de</strong> vie et stabilité<br />
La durée <strong>de</strong> vie d’un paillage peut être très variable. Pour les matériaux organiques, plus<br />
la teneur en lignine est importante, et plus le matériau se décomposera lentement. Ainsi, les<br />
tontes <strong>de</strong> pelouse <strong>de</strong>vront être rapi<strong>de</strong>ment renouvelées, alors que l’écorce <strong>de</strong> pin durera plus<br />
longtemps.<br />
La stabilité est la capacité à rester en place d’un paillage ; en effet, certains paillis trop<br />
légers peuvent être dispersés par le vent, ou risquent <strong>de</strong> glisser, notamment si le terrain est en<br />
pente. Il est à noter que certains paillages peuvent être dispersés par les oiseaux ; sur une<br />
pelouse, les paillages risquent d’être éparpillés lors <strong>de</strong>s tontes.<br />
Aspect esthétique<br />
L’esthétique est un critère important, en particulier en espaces verts. L’aspect du paillis<br />
(couleur, texture…) participe à l’harmonie globale <strong>de</strong> l’espace. Certains paillis peuvent avoir<br />
un aspect discret, se rapprocher <strong>de</strong> la couleur <strong>de</strong> la terre. D’autres peuvent, <strong>de</strong> par leurs<br />
couleurs, être un élément <strong>de</strong> décoration à part entière : c’est le cas <strong>de</strong>s copeaux <strong>de</strong> bois<br />
colorés. Ici encore, tout dépend <strong>de</strong> l’effet que l’on espère obtenir, et donc <strong>de</strong> la vocation du<br />
site….<br />
Effets sur le sol<br />
Humidité<br />
Les paillis organiques et plastiques permettent <strong>de</strong> limiter l’évaporation <strong>de</strong> l’eau du sol. Ceci<br />
peut permettre <strong>de</strong> diminuer les besoins en arrosage. Par contre, un paillage <strong>de</strong> ce type, et en<br />
particulier les paillis plastiques, sont à éviter sur les sols engorgés. Dans ce cas on préférera<br />
<strong>de</strong>s paillis minéraux (pouzzolane, graviers…). Certains paillis organiques et minéraux<br />
peuvent améliorer l’infiltration <strong>de</strong> l’eau dans le sol.<br />
Température<br />
LXIII
Il semble que les paillis organiques jouent un rôle <strong>de</strong> tampon vis-à-vis <strong>de</strong> la température du<br />
sol, en limitant les chutes thermiques en hiver et au printemps et en régulant les<br />
augmentations <strong>de</strong> température l’été.<br />
Par contre, les paillis plastiques noirs absorbent la chaleur.<br />
Les paillis clairs (paillettes <strong>de</strong> lin, graviers clairs…) peuvent augmenter la température au<strong>de</strong>ssus<br />
du sol en reflétant les radiations et éventuellement causer <strong>de</strong>s brûlures sur les<br />
plantations <strong>de</strong> faible hauteur.<br />
Fertilité<br />
Certains paillis minéraux peuvent apporter une fertilisation au sol. En revanche, d’autres<br />
paillis à fort rapport carbone/nitrate (C/N) (écorces <strong>de</strong> pin, copeaux <strong>de</strong> bois, paille…) peuvent<br />
entraîner une concurrence pour l’azote entre les microorganismes du sol et la plante ; ceci<br />
entraîne un déficit <strong>de</strong> l’azote disponible. Par contre, les matériaux à fort C/N comme les tontes<br />
<strong>de</strong> pelouses compostées ont un bon apport fertilisant.<br />
pH<br />
Certains paillis peuvent avoir une influence sur le pH du sol. Ainsi, on dit souvent que les<br />
écorces <strong>de</strong> pin acidifient le sol. Ceci pourrait provoquer <strong>de</strong>s chloroses chez certaines plantes<br />
en raison du manque <strong>de</strong> disponibilité du fer. Certains paillis minéraux, au contraire,<br />
augmenteraient le pH. Il s’agit donc <strong>de</strong> bien adapter le type <strong>de</strong> paillage au type <strong>de</strong> sol et aux<br />
besoins <strong>de</strong> la plante (un effet acidifiant peut être intéressant pour les plantes <strong>de</strong> terre <strong>de</strong><br />
bruyère).<br />
Changement <strong>de</strong> la structure du sol<br />
Certains paillis (en particulier organiques) modifient et améliorent la structure du sol en<br />
limitant la compaction et en limitant les phénomènes <strong>de</strong> battance dans les sols argileux.<br />
Substances libérées dans le sol<br />
Certains paillis peuvent libérer diverses substances dans le sol, ce qui peut avoir un impact sur<br />
la plantation.<br />
- Composés <strong>de</strong> type phénols et tanins déjà évoqués, qui peuvent avoir un effet<br />
phytotoxique (écorces..)<br />
- Sel (paillages en fibre <strong>de</strong> coco non nettoyés)<br />
- Résidus <strong>de</strong> produits phytosanitaires, notamment herbici<strong>de</strong>s (paillages préalablement<br />
traités comme les pailles…)<br />
- Autres composés polluants ; on peut citer le cas <strong>de</strong>s feuilles d’arbres urbains qui peuvent<br />
contenir <strong>de</strong>s métaux lourds.<br />
Coût<br />
En plus du coût à l’achat, il faut tenir compte <strong>de</strong> la longévité (fréquence <strong>de</strong> remplacement) et<br />
<strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> mise en place et <strong>de</strong> maintenance ; par exemple, dans le cas d’un paillis<br />
plastique, il faut prendre en compte le fait que le paillis <strong>de</strong>vra être retiré. Par ailleurs, les<br />
rémanents d’espaces verts sont gratuits (sauf investissement dans un broyeur) et permettent <strong>de</strong><br />
recycler un déchet vert.<br />
LXIV
Voir annexe 8 pour connaître les propriétés <strong>de</strong> divers paillages<br />
LXV
2/ Métho<strong>de</strong>s prophylactiques pour la gestion <strong>de</strong>s pelouses<br />
Un certain nombre <strong>de</strong> techniques d’entretien ont un effet sur la compétitivité du gazon et<br />
sur la présence d’adventices. L’emploi <strong>de</strong> ces techniques est à adapter selon le niveau<br />
d’entretien recherché <strong>de</strong> la pelouse.<br />
- Eléments à prendre en compte lors <strong>de</strong> la construction<br />
Une réflexion au moment <strong>de</strong> la conception et <strong>de</strong> la mise en place peut s’avérer déterminante<br />
pour la santé du gazon. En effet, il convient parfois d’améliorer le sol avant l’installation <strong>de</strong>s<br />
graminées. C’est particulièrement le cas pour les terrains <strong>de</strong> sport et les golfs, qui sont soumis<br />
à un piétinement intense et à <strong>de</strong> fortes exigences <strong>de</strong> qualité.<br />
Il convient <strong>de</strong> faire une analyse <strong>de</strong> sol préalable pour évaluer les améliorations nécessaires.<br />
Ainsi, il est préférable que le sol soit suffisamment drainant ; si ce n’est pas le cas, on peut<br />
modifier sa structure, par <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> sable par exemple. Par exemple, la présence <strong>de</strong><br />
pâturin annuel (Poa annua ), <strong>de</strong> céraistes communs (Cerastium vulgatum), ou <strong>de</strong> véroniques<br />
filiformes (Veronica filiformis) peut être due à un défaut <strong>de</strong> drainage. Le terrain doit être<br />
configuré <strong>de</strong> façon à éviter les creux dans lesquelles l’eau pourrait s’accumuler.<br />
Par ailleurs, il peut être nécessaire d’améliorer la fertilité du sol (fumure <strong>de</strong> fond),<br />
notamment pour le phosphore et le potassium. Ceux-ci sont importants pour l’installation du<br />
gazon.<br />
De même, une mesure du pH est importante, car celui-ci influe sur la disponibilité <strong>de</strong>s<br />
éléments minéraux et sur l’activité microbienne. Par exemple, l’agrosti<strong>de</strong> stolonifère (Agrostis<br />
stolonifera) et la petite oseille (Rumex acetosella) se montrent plus compétitifs en conditions<br />
aci<strong>de</strong>s, tandis que les plantains (Plantago sp.) se montrent plus compétitifs en conditions<br />
basiques. Un pH idéal pour une pelouse doit être compris entre 6,7 et 7,2.<br />
- Sélection <strong>de</strong>s graminées<br />
Une pelouse saine passe par la sélection d’une espèce ou d’un mélange d’espèces en fonction<br />
<strong>de</strong>s contraintes du milieu.<br />
- Adaptation aux conditions climatiques : résistance à la sécheresse, à la<br />
submersion, à la chaleur, au froid, à l’ombre…<br />
- Adaptation au sol : texture, pH, salinité<br />
- Adaptation à l’utilisation du site : résistance au piétinement, à l’arrachement…<br />
Un autre facteur à prendre en compte pour un gazon compétitif est la résistance aux maladies.<br />
Il existe <strong>de</strong> nombreux cultivars <strong>de</strong>s espèces <strong>de</strong> graminées pour gazon, chacun ayant <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques propres. Il serait trop long <strong>de</strong> lister les caractéristiques <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s<br />
variétés, le mieux est <strong>de</strong> se renseigner auprès <strong>de</strong> son fournisseur. L’annexe 9 présente<br />
cependant quelques éléments pour le choix <strong>de</strong> l’espèce.<br />
Il faut s’assurer que les semences que l’on utilise soient in<strong>de</strong>mnes <strong>de</strong> toute semence<br />
adventice ; il existe une certification variétale contrôlée par le Service Officiel <strong>de</strong> contrôle et<br />
<strong>de</strong> Certification (SOC) du Groupement National Interprofessionnel <strong>de</strong>s Semences et plants<br />
(GNIS). Cette certification garantit la pureté variétale <strong>de</strong>s semences ; une certification<br />
technologique, qui garantit la pureté spécifique et la faculté germinative, existe également.<br />
LXVI
- La tonte<br />
21 Différentes hauteurs <strong>de</strong> tonte sur un<br />
golf<br />
La hauteur <strong>de</strong> coupe se raisonne en fonction <strong>de</strong> l’état<br />
physiologique du gazon (pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance ou<br />
dormance), <strong>de</strong>s espèces utilisées et <strong>de</strong> l’utilisation<br />
qu’on fait du gazon, pour les terrains <strong>de</strong> sport<br />
notamment : pour un hippodrome, la hauteur peut<br />
être comprise entre 8 et 10 cm, tandis que pour un<br />
terrain <strong>de</strong> rugby la hauteur réglementaire est <strong>de</strong> 4 cm,<br />
et que sur un green <strong>de</strong> golf la hauteur réglementaire<br />
est <strong>de</strong> 3 à 6 mm seulement (16 mm sur les fairways et<br />
départs, et <strong>de</strong>s hauteurs supérieures sur semi-rough et<br />
rough)<br />
Une tonte trop rase favorise l’apparition <strong>de</strong> certaines dicotylédones : pâquerette (Bellis<br />
perennis), pissenlit (Taraxacum officinale), plantain (Plantago sp.)… et graminées<br />
adventices : pâturin annuel (Poa annua). Une tonte trop radicale diminue la synthèse et le<br />
stockage <strong>de</strong> substances organiques, la largeur <strong>de</strong>s feuilles, la croissance <strong>de</strong>s racines, la<br />
résistance aux maladies et la qualité esthétique. En règle générale, on recomman<strong>de</strong> d’éviter<br />
d’enlever plus d’un tiers <strong>de</strong> la hauteur <strong>de</strong> la feuille. De plus, il est recommandé d’utiliser<br />
une lame suffisamment affûtée et d’éviter <strong>de</strong> tondre sur une herbe mouillée.<br />
La fréquence <strong>de</strong> tonte est raisonnée en fonction :<br />
- <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> pousse (qui est le facteur le plus important ),<br />
- <strong>de</strong>s conditions d’environnement (notamment irrigation et fertilisation),<br />
- <strong>de</strong> la hauteur <strong>de</strong> coupe (plus la hauteur <strong>de</strong> coupe est basse, plus la fréquence doit<br />
augmenter),<br />
- <strong>de</strong> l’utilisation faite du gazon et du matériel <strong>de</strong> tonte utilisé.<br />
Le choix <strong>de</strong> ramasser ou <strong>de</strong> laisser les résidus <strong>de</strong> tonte doit être fait en fonction <strong>de</strong> la<br />
vocation <strong>de</strong> la pelouse. Par exemple, sur les terrains <strong>de</strong> sport (football ou rugby), laisser les<br />
déchets <strong>de</strong> tonte peut engendrer <strong>de</strong>s problèmes liés à l’esthétique, l’utilisation, le feutrage et<br />
les maladies ; il n’y est envisageable qu’en cas <strong>de</strong> tontes fréquentes en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> forte<br />
végétation (2 à 3 fois par semaine).<br />
Par contre, il peut être intéressant <strong>de</strong> laisser les résidus <strong>de</strong> tonte sur un gazon dont l’entretien<br />
est peu intensif. En effet, laisser les résidus <strong>de</strong> tonte sur la pelouse permet un apport en<br />
matière organique, et <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong> temps. Ceci peut permettre <strong>de</strong> diminuer les quantités<br />
d’engrais azoté <strong>de</strong> 20 à 30 %. Il faut alors choisir un matériel adapté : les ton<strong>de</strong>uses « à<br />
mulching » broient les déchets <strong>de</strong> tonte, ce qui les rend moins visibles. Il faut éviter d’avoir<br />
une trop grosse couche <strong>de</strong> déchets <strong>de</strong> tonte, qui pourrait être propice au développement <strong>de</strong><br />
maladies ; ceci implique un entretien régulier. Le ramassage peut être permanent ou<br />
épisodique (par exemple une fois sur <strong>de</strong>ux). Les déchets issus <strong>de</strong> la tonte <strong>de</strong>vront être<br />
valorisés en tant que déchets verts (loi du 13 juillet 1992).<br />
LXVII
Il peut être utile, pour éviter la propagation <strong>de</strong> plantes indésirables, <strong>de</strong> réduire la<br />
hauteur <strong>de</strong> tonte au moment <strong>de</strong> leur floraison et d’exporter les déchets <strong>de</strong> tonte ; c’est le<br />
cas notamment pour diverses graminées annuelles estivales comme la digitaire sanguine<br />
(Digitaria sanguinalis), l’éleusine <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s (Eleusine indica), les sétaires (Setaria glauca et<br />
Setaria viridis), le panic pied-<strong>de</strong>-coq (Echinochloa crus-galli), le panic d’automne (Panicum<br />
dichotomiflorum)…<br />
- L’arrosage<br />
Il est important <strong>de</strong> doser précisément l’arrosage ; un arrosage trop important peut favoriser<br />
l’apparition <strong>de</strong> maladies et <strong>de</strong> certaines adventices, et un arrosage insuffisant ne permet pas un<br />
bon développement du système racinaire. Dans les <strong>de</strong>ux cas, <strong>de</strong>s adventices mieux adaptées<br />
peuvent entrer en compétition avec les graminées du gazon :<br />
Certaines adventices se développent particulièrement lorsqu’un gazon est stressé par un<br />
arrosage insuffisant, par exemple Euphorbia supina.<br />
Par contre, dans certains cas il peut être utile <strong>de</strong> diminuer l’arrosage ; c’est le cas pour le<br />
pâturin annuel (Poa annua), qui est plus sensible au stress hydrique que la plupart <strong>de</strong>s<br />
graminées <strong>de</strong> gazon étant donné qu’il n’est pas capable d’entrer en dormance : il peut alors<br />
être utile <strong>de</strong> diminuer l’arrosage jusqu’à une entrée en dormance <strong>de</strong> la pelouse, qui pourra être<br />
générée une fois arrosée <strong>de</strong> nouveau, tandis que le pâturin sera détruit.<br />
En général, il vaut mieux arroser <strong>de</strong> façon moins fréquente, mais plus en profon<strong>de</strong>ur<br />
(mouiller le sol sur 10 à 20 cm <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur) afin <strong>de</strong> permettre un développement correct <strong>de</strong>s<br />
racines. Des arrosages plus fréquents et moins importants entraîneraient un développement<br />
racinaire en surface, ce qui rendrait le gazon vulnérable à la sécheresse, au froid et aux<br />
problèmes phytosanitaires.<br />
Il est préférable d’arroser tôt le matin ; l’arrosage le soir laisse la pelouse mouillée trop<br />
longtemps, ce qui pourrait entraîner le développement <strong>de</strong> maladies. Dans le cas <strong>de</strong>s terrains <strong>de</strong><br />
sport, il faut néanmoins laisser assez <strong>de</strong> temps pour que l’eau soit drainée avant l’utilisation.<br />
- La fertilisation et le pH<br />
Comme toute plante, les graminées <strong>de</strong> gazon ont <strong>de</strong>s besoins précis en azote, phosphore,<br />
potassium, calcium, magnésium, et soufre, et en plus faibles quantités d’oligo-éléments (fer,<br />
zinc, cuivre, manganèse, bore et molybdène). Si ces éléments ne sont pas apportés dans les<br />
quantités appropriés, le gazon peut être affaibli par <strong>de</strong>s carences. Un bon dosage <strong>de</strong> la<br />
fertilisation azotée est particulièrement important pour la maîtrise <strong>de</strong>s trèfles (Trifolium sp.) et<br />
<strong>de</strong>s autres fabacées comme la luzerne (Medicago lupulina), qui ne se révélera pas<br />
envahissante si un bon équilibre entre le phosphore et l’azote est maintenu.<br />
Une fertilisation en azote excessive n’est pas justifiée, étant donné qu’elle induit une<br />
réduction <strong>de</strong> la vigueur, une augmentation <strong>de</strong> la sensibilité à certaines maladies, à la<br />
sécheresse et au froid, et un feutrage excessif, et peut provoquer une pollution <strong>de</strong>s eaux.<br />
LXVIII
La fertilisation doit être raisonnée à partir d’une analyse <strong>de</strong> sol, qui doit être répétée au<br />
moins tous les <strong>de</strong>ux ans. Les réserves d’azote doivent être renouvelées tous les ans, tandis que<br />
les teneurs en phosphore et potassium restent plus stables. Les engrais à diffusion lente sont à<br />
privilégier car les éléments nécessaires au gazon sont disponibles sur une plus longue pério<strong>de</strong>.<br />
- Défeutrage<br />
Le feutre est une couche <strong>de</strong> matière organique composée <strong>de</strong> tiges et <strong>de</strong> feuilles mortes ainsi<br />
que d’un entrelacs <strong>de</strong> racines, qui se forme entre la pelouse et le sol. Si la couche <strong>de</strong> feutre<br />
<strong>de</strong>vient trop épaisse (au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 2,5 cm), elle gêne l’infiltration <strong>de</strong> l’eau dans le sol,<br />
favorise un enracinement superficiel, augmente le risque <strong>de</strong> problèmes phytosanitaires<br />
et la sensibilité à la chaleur, au froid et à la sécheresse. De plus, les désherbants <strong>de</strong> prélevée<br />
sont plus phytotoxiques dans ces conditions en raison d’une plus gran<strong>de</strong> mobilité du<br />
désherbant dans le feutre que dans le sol, et d’un contact direct avec les racines <strong>de</strong>s graminées<br />
du gazon.<br />
Certaines opérations culturales permettent <strong>de</strong> limiter l’apparition du feutre : tontes régulières,<br />
arrosage et fertilisation adéquats.<br />
Le défeutrage peut être effectué à l’ai<strong>de</strong> d’un appareil <strong>de</strong> verticutting, qui possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s lames<br />
effectuant un « peignage » sur les premiers mm du sol. Le défeutrage doit être fait <strong>de</strong><br />
préférence durant les pério<strong>de</strong>s où les graminées se développent bien, c’est-à-dire au printemps<br />
et à l’automne. Sur les surfaces tondues haut, cette opération peut être effectuée une ou <strong>de</strong>ux<br />
fois par an ; sur les surfaces tondues court comme les greens, où le feutrage gêne le jeu, le<br />
gazon peut être défeutré jusqu’à <strong>de</strong>ux fois par semaine. Sur <strong>de</strong>s surfaces moins exigeantes, le<br />
défeutrage n’est nécessaire qu’occasionnellement.<br />
Le défeutrage peut entraîner le développement d’adventices, en ramenant <strong>de</strong>s graines à la<br />
surface et en dégageant <strong>de</strong>s espaces ; c’est pourquoi il est conseillé d’effectuer ensuite un<br />
semis <strong>de</strong> regarnissage.<br />
- Aération et décompactage<br />
Les gazons fortement fréquentés sont sujets à la compaction, qui entraîne une pénétration<br />
insuffisante <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’air dans le sol.<br />
Une décompaction du sol par aération ou éventuellement par scarification peut permettre <strong>de</strong><br />
rendre le gazon plus compétitif vis-à-vis <strong>de</strong> certaines adventices qui se développent bien sur<br />
un sol compacté, comme l’éleusine <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s (Eleusine indica) ou le pâturin annuel (Poa<br />
annua).<br />
Différents appareils existent pour aérer le sol. Il existe <strong>de</strong>ux métho<strong>de</strong>s principales :<br />
- L’aérateur à louchets creux retire <strong>de</strong>s carottes <strong>de</strong> terre du sol, tandis que l’aérateur à<br />
louchets pleins crée <strong>de</strong>s cheminées dans le sol sans retirer <strong>de</strong> matière. Ce type d’aération peut<br />
LXIX
atteindre les 15 premiers centimètres du sol, mais est généralement pratiquée à une<br />
profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 7-8 cm. Elle permet <strong>de</strong> lutter efficacement contre la compaction du sol,<br />
améliore sa structure, et apporte <strong>de</strong> l’air aux racines. L’aération à louchets creux a aussi une<br />
action <strong>de</strong> défeutrage en enlevant <strong>de</strong> la matière. Cette opération est généralement suivie d’un<br />
sablage, et <strong>de</strong> roulages. Elle ne permet pas une tonte immédiate, il faut un certain temps pour<br />
que la pelouse soit <strong>de</strong> nouveau praticable. Ce type d’aération peut être faite une à <strong>de</strong>ux fois<br />
par an (au printemps et à l’automne par exemple) pour les pelouses d’agrément fréquentées ou<br />
les greens et les départs <strong>de</strong> golfs ; par contre, elle peut se faire une fois par mois pour les<br />
terrains <strong>de</strong> rugby ou <strong>de</strong> football.<br />
- L’aérateur à lames (ou spiker) effectue <strong>de</strong>s fentes pouvant <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10 à 40 cm <strong>de</strong><br />
profon<strong>de</strong>ur en fonction du type <strong>de</strong> lames utilisées (scarification). Il permet une aération du sol<br />
et un défeutrage. L’aération à lames touche moins la structure du sol qu’une aération à<br />
louchets ; il faut 5 à 7 aérations à lames pour obtenir une efficacité équivalente à une aération<br />
à louchets. Cela a cependant l’avantage <strong>de</strong> permettre une réutilisation presque immédiate <strong>de</strong> la<br />
surface engazonnée. Cette opération peut donc être effectuée plus souvent, par exemple <strong>de</strong><br />
façon hebdomadaire, en alternance avec le défeutrage, dans le cas d’un entretien important<br />
(golfs et terrains <strong>de</strong> sport). Sur une pelouse d’agrément, <strong>de</strong>ux interventions par an, l’une au<br />
printemps et l’autre à l’automne, sont suffisantes.<br />
Cependant, l’aération <strong>de</strong> sol ou la scarification peuvent entraîner le développement <strong>de</strong>s<br />
adventices dans les espaces libres créés, c’est pourquoi il vaut mieux éviter <strong>de</strong> réaliser<br />
ces opération pendant les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> germination <strong>de</strong> certaines adventices, comme<br />
l’herbe <strong>de</strong> Dallis (Paspalum dilatatum Poir.) qui germe lorsque la température à la surface du<br />
sol atteint 15 à 18°C, ou pour <strong>de</strong> nombreuses graminées annuelles estivales (Digitaria<br />
sanguinalis, Eleusine indica, Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa crus-galli, Panicum<br />
dichotomiflorum) qui germent lorsque le sol atteint environ 13°C.<br />
- Regarnissage et top-dressing<br />
Le dégarnissement d’une pelouse est un facteur <strong>de</strong> mécontentement ; c’est aussi une<br />
surface laissée libre à l’envahissement par les adventices. Il est important <strong>de</strong> conserver une<br />
pelouse suffisamment <strong>de</strong>nse pour être compétitive.<br />
Regarnir les zones ou le gazon s’est mal développé peut être une stratégie particulièrement<br />
utile pour contenir certaines adventices, comme pour la passerage <strong>de</strong> Virginie (Lepidium<br />
virginicum).<br />
Les problèmes <strong>de</strong> dégarnissement peuvent être prévenus par un entretien régulier <strong>de</strong> la<br />
pelouse (remise en place <strong>de</strong>s mottes arrachées…).<br />
Un regarnissage peut être fait par un semi manuel ou mécanique. Pour améliorer la levée, on<br />
peut terreauter le gazon (apport d’une couche <strong>de</strong> compost, <strong>de</strong> tourbe…). Le regarnissage<br />
peut être fait après un défeutrage ou une aération. Une regarnisseuse mécanique peut être<br />
utilisée sur les terrains <strong>de</strong> sport à l’intersaison.<br />
Un regarnissage doit être suivi d’une irrigation conséquente les premières semaines.<br />
LXX
II/ TECHNIQUES CURATIVES<br />
1/ Désherbage thermique<br />
Le désherbage thermique désigne un ensemble <strong>de</strong> techniques qui détruisent les adventices<br />
grâce à l’action <strong>de</strong> la chaleur. En effet, celle-ci peut entraîner une coagulation <strong>de</strong>s protéines<br />
qui provoque un éclatement <strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> la plante et une vaporisation <strong>de</strong> l’eau contenue<br />
dans les cellules. Ceci pourra entraîner une mort <strong>de</strong> l’adventice si le point végétatif est atteint.<br />
La chaleur peut être apportée <strong>de</strong> différentes manières : par exposition directe <strong>de</strong>s<br />
adventices aux flammes, par exposition à un rayonnement infra-rouge, par apport d’eau<br />
chau<strong>de</strong> éventuellement additionnée <strong>de</strong> mousse.<br />
- Principe<br />
Le désherbage thermique à flamme directe :<br />
Il s’agit d’entraîner un choc thermique et <strong>de</strong> provoquer l’éclatement <strong>de</strong>s cellules en<br />
approchant une flamme <strong>de</strong> la plante.<br />
Il existe plusieurs types <strong>de</strong> dispositifs :<br />
- <strong>de</strong>s dispositifs à lance<br />
- <strong>de</strong>s dispositifs avec <strong>de</strong>s brûleurs fixés sur une rampe<br />
Les systèmes à lance peuvent être adaptés sur <strong>de</strong>s appareils portatifs à dos, placés sur un<br />
chariot, ou tractés ; les dispositifs à brûleurs peuvent se présenter sous forme <strong>de</strong> châssis<br />
adaptés à un quad ou à un microtracteur.<br />
Le combustible employé est le propane ou le butane (GPL). L’alimentation peut se faire <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux façons :<br />
- En phase vapeur : le gaz se trouve sous forme vapeur dans les tuyaux avant<br />
d’arriver aux brûleurs ; la bouteille <strong>de</strong> gaz est maintenue verticale.<br />
- En phase liqui<strong>de</strong> : le gaz se trouve sous forme liqui<strong>de</strong> dans les tuyaux. La<br />
bouteille <strong>de</strong> gaz est couchée ou tête en bas. Ce type d’alimentation permet<br />
d’obtenir directement et d’une manière constante une puissance importante.<br />
- Efficacité<br />
Il est important d’intervenir sur <strong>de</strong>s adventices au sta<strong>de</strong> plantule afin d’obtenir une bonne<br />
efficacité, dans le cas contraire il est préférable d’augmenter le temps d’application.<br />
Le désherbage thermique n’atteint que les parties aériennes <strong>de</strong>s adventices ; les graines et les<br />
organes souterrains ne sont pas atteints. Les plantes ayant leur point végétatif près ou sous la<br />
surface du sol ne sont donc pas éliminées.<br />
LXXI
Ascar a divisé les espèces <strong>de</strong> plantes adventices en 4 groupes selon leur tolérance au<br />
désherbage à flamme :<br />
Tableau 14 : Tolérance <strong>de</strong>s adventices au désherbage thermique (Ascar J,1995)<br />
Espèces sensibles<br />
avec points<br />
végétatifs non<br />
protégés et feuilles<br />
fines, pouvant être<br />
contrôlées par un<br />
seul passage<br />
Chenopodium<br />
album L.<br />
Stellaria media (L.)<br />
Vill.<br />
Espèces modérément<br />
sensibles, pouvant être<br />
contrôlées en un seul<br />
passage, mais avec plus<br />
d’énergie<br />
Polygonum sp.<br />
Senecio vulgaris L.<br />
Espèces tolérantes,<br />
ne pouvant être<br />
complètement tuées<br />
en un passage qu’au<br />
sta<strong>de</strong> jeune<br />
Capsella bursapastoris<br />
(L) Medic.<br />
Chamomilla<br />
suaveolens (P) Rydb.<br />
Espèces très<br />
tolérantes, avec un<br />
port rampant et <strong>de</strong>s<br />
points végétatifs<br />
protégés, ne pouvant<br />
pas être détruites en<br />
un seul passage.<br />
Poa annua L.<br />
Elymus repens L.<br />
Equisetum arvene L.<br />
Taraxacum vulgare L.<br />
Selon <strong>de</strong>s essais menés par le Corpep (Cellule d’Organisation Régionale pour la Protection<br />
<strong>de</strong>s Eaux contre les Pestici<strong>de</strong>s) :<br />
- Sur pavés, cette technique a une efficacité intéressante sur pâturin annuel, plantain<br />
lancéolé, et sagine apétale une semaine après le passage, mais l’efficacité et<br />
insuffisante par la suite ;<br />
- Sur caniveaux, cette technique est efficace sur la sagine apétale, mais ne permet<br />
pas <strong>de</strong> contrôler le pâturin annuel et les plantes plus résistantes comme le plantain<br />
majeur<br />
(Angoujard et al., 1999).<br />
- Mise en œuvre<br />
Le nombre <strong>de</strong> passages peut varier, entre 5 et 8 passages selon l’enherbement.<br />
La vitesse d’avancement est <strong>de</strong> 1,5 à 5 km/h.<br />
On recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> traiter par temps sec, éventuellement à la rosée pour diminuer les risque<br />
d’incendie. Il est possible <strong>de</strong> traiter par temps <strong>de</strong> pluie, mais il faut réduire la vitesse<br />
d’avancement.<br />
Le temps passé pour désherber une surface dépend <strong>de</strong> l’enherbement ; 600 m²/h selon Krüger<br />
W. et Völkel G., 2001 ; 1200 m²/h. selon Saft R.J. et Staats N., 2002…<br />
- Contraintes<br />
Risque d’incendie<br />
Le risque d’incendie est important à prendre en compte, en particulier sur adventices sèches<br />
ou très ligneuses ; il faut être pru<strong>de</strong>nt vis-à-vis <strong>de</strong> la végétation ornementale (pieds <strong>de</strong><br />
LXXII
haies…), <strong>de</strong>s paillages inflammables (écorces…), <strong>de</strong>s flaques d’hydrocarbures à proximité<br />
<strong>de</strong>s voitures, <strong>de</strong>s clôtures en plastique, <strong>de</strong>s bâtiments en préfabriqué (présence <strong>de</strong> laine <strong>de</strong><br />
verre)…Le détail <strong>de</strong>s précautions est donné dans le manuel d’utilisation.<br />
Les appareils à alimentation gazeuse seraient moins dangereux que les appareils à<br />
alimentation liqui<strong>de</strong>, car en cas <strong>de</strong> fuite ou d’inci<strong>de</strong>nt ils libèrent moins <strong>de</strong> gaz dans<br />
l’atmosphère (Picard, 2005a). Cependant cette affirmation reste contestée (Picard, 2005b).<br />
Dégradation <strong>de</strong>s infrastructures<br />
Le désherbeur thermique peut être utilisé sur les caniveaux et bordures <strong>de</strong> trottoir, les pavés<br />
auto-bloquants, les briques, les marbres, les schistes…<br />
Un désherbeur à flamme directe peut faire fondre le macadam si l’appareil est stationné<br />
<strong>de</strong>ssus ; en cas <strong>de</strong> désherbage sur ce type <strong>de</strong> surface, il est préférable <strong>de</strong> circuler avec<br />
l’appareil sans rester au même endroit.<br />
Risque <strong>de</strong> brûlure<br />
Les appareils à flamme directe distribués actuellement sont généralement peu dangereux s’ils<br />
sont utilisés correctement (éviter <strong>de</strong> laisser l’appareil stationner sur le pied).<br />
Bruit<br />
Les appareils sont relativement bruyants : 80-90 dB<br />
- Effets sur l’environnement<br />
Lors <strong>de</strong> sa combustion complète, le propane ne génère que l’eau et du dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone<br />
(qui est néanmoins un gaz à effet <strong>de</strong> serre). Mais en pratique, les équipements <strong>de</strong> lutte<br />
thermique peuvent produire <strong>de</strong>s quantités non négligeables <strong>de</strong> monoxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone, <strong>de</strong><br />
dioxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soufre et d’oxy<strong>de</strong> d’azote, particulièrement lorsque l’apport d’oxygène aux<br />
brûleurs est insuffisant.<br />
Par ailleurs, ces techniques consomment <strong>de</strong> façon importante <strong>de</strong>s combustibles fossiles non<br />
renouvelables.<br />
- Coûts<br />
Des modèles à lance portables sont disponibles à partir <strong>de</strong> 400 €.<br />
Les modèles à rampe sont disponibles à partir <strong>de</strong> 3000€.<br />
15 kg <strong>de</strong> GPL par h pour 1200 m²/h selon Saft R.J. et Staats N., 2002.<br />
Les coûts d’utilisation (main d’œuvre, consommables et amortissement du matériel compris)<br />
calculés en 1999 sont <strong>de</strong> 2280F (soit environ 348 €) par km linéaire et par an, ou 1520 F (soit<br />
environ 232 €) pour 1000 m² et par an, pour 7 passages avec un désherbeur à flamme directe<br />
poussé (Angoujard G. et al., 1999).<br />
- Evaluation globale<br />
LXXIII
Le désherbage thermique à flamme directe est l’une <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désherbage non<br />
chimique les plus répandues et les moins chères à l’achat. Cependant, elle nécessite <strong>de</strong>s<br />
passages réguliers. Il faut être pru<strong>de</strong>nt dans le maniement en raison <strong>de</strong>s risques d’incendie.<br />
Le désherbage à flamme a une consommation importante <strong>de</strong> GPL, dégage <strong>de</strong>s quantités<br />
importantes <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone, gaz à effet <strong>de</strong> serre.<br />
LXXIV
- Principe<br />
Le désherbage thermique à infrarouges :<br />
Tout comme le désherbage thermique à flamme directe, le désherbage à infrarouges crée un<br />
choc thermique qui détruit les cellules <strong>de</strong> la plante. Cependant, dans ce système, la flamme<br />
<strong>de</strong>s brûleurs est dirigée avec une surface en métal ou en céramique, utilisée comme une<br />
source <strong>de</strong> rayonnement infrarouge réfléchi vers les adventices (« four»).<br />
Il existe <strong>de</strong> nombreux modèles : <strong>de</strong> petits modèles portés sur chariot pour les bordures et<br />
petites surfaces, <strong>de</strong>s modèles pour surfaces moyennes poussés sur chariots à 4 roues, jusqu’à<br />
<strong>de</strong>s modèles « plate-formes » pouvant être montés sur un motoculteur ou un tracteur pour les<br />
gran<strong>de</strong>s surfaces…<br />
- Efficacité<br />
Tout comme pour le désherbage à flamme directe, les adventices sont plus sensibles<br />
lorsqu’elles sont jeunes (3 à 4 feuilles). Cette technique est efficace sur les annuelles et les<br />
plantes à port érigé et avec <strong>de</strong>s feuilles peu épaisses (chénopo<strong>de</strong>, mouron…)<br />
Par contre, les plantes ligneuses, ou ayant un point végétatif près du sol ou protégé peuvent<br />
repousser (pâturin, capselle, plantain, pissenlit…).<br />
Des essais <strong>de</strong> la FREDEC Rhône-Alpes montrent que <strong>de</strong>s repousses <strong>de</strong> chardons et<br />
d’helminthie peuvent apparaître en cas <strong>de</strong> pluie après le désherbage. Globalement, cette<br />
métho<strong>de</strong> permet davantage <strong>de</strong> contrôler la hauteur <strong>de</strong>s adventices que d’éradiquer réellement<br />
la végétation. (Achard J., 2005).<br />
- Mise en œuvre<br />
Cette technique nécessite 6 à 8 passages par an pour contenir la végétation ; ainsi, <strong>de</strong>s essais<br />
réalisés par la Fere<strong>de</strong>c Bretagne (2002) ont montré que pour obtenir une efficacité supérieure<br />
à 70%, il fallait :<br />
- 8 passages par an en surface imperméable (caniveaux et pavés)<br />
- 6 passages par an sur surface sablée<br />
- 7 passages par an sur remblai<br />
(Angoujard et al., 2001b)<br />
La vitesse d’avancement est <strong>de</strong> 2 à 3 km/h pour les appareils poussés.<br />
Une attente <strong>de</strong> plusieurs secon<strong>de</strong>s par touffe d’herbe est nécessaire en fonction <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité<br />
végétale pour assurer une action optimale <strong>de</strong> la chaleur. Le temps d’application est donc<br />
variable selon l’enherbement.<br />
- Contraintes<br />
Tout comme pour le désherbage à flamme directe, il faut être pru<strong>de</strong>nt vis-à-vis du risque<br />
d’incendies.<br />
- Effet sur l’environnement<br />
Tout comme le désherbage à flamme directe, le désherbage à infra-rouges utilise du GPL, et<br />
dégage donc <strong>de</strong>s gaz à effets <strong>de</strong> serre. Cependant, sa consommation est moindre que celle du<br />
désherbage à flamme directe grâce à un meilleur confinement <strong>de</strong> la chaleur.<br />
LXXV
- Coûts<br />
Des appareils <strong>de</strong> désherbage à infrarouges sont disponibles à partir <strong>de</strong> 3500 environ.<br />
Consommation <strong>de</strong> gaz : 0,75 kg/brûleur/heure (Hatey L., 2003).<br />
- Evaluation globale<br />
Le fonctionnement est globalement le même que pour le désherbage à flamme directe, si<br />
ce n’est que la chaleur est confinée et apportée <strong>de</strong> façon indirecte par rayonnement.<br />
Un nombre <strong>de</strong> passages importants est nécessaire pour contrôler la pousse <strong>de</strong> la végétation.<br />
Le risque d’incendie est à prendre en compte. La consommation <strong>de</strong> gaz est moindre<br />
qu’avec le désherbage à flamme directe mais reste élevée.<br />
LXXVI
- Principe<br />
Le désherbage thermique à l’eau chau<strong>de</strong>:<br />
Cette fois, le choc thermique est créé en apportant <strong>de</strong> l’eau chau<strong>de</strong> sur la plante-cible.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux systèmes sur le marché actuellement : le système allemand Weed Cleaner et<br />
le système canadien Aquaci<strong>de</strong>.<br />
Tous <strong>de</strong>ux fonctionnent avec une rampe émettant une eau à environ 90°C. Dans le cas <strong>de</strong><br />
Weed Cleaner, une lance permet d’atteindre le points difficiles.<br />
- Efficacité<br />
Il faut <strong>de</strong> préférence travailler sur <strong>de</strong>s plantes jeunes (3 à 4 feuilles). La <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s<br />
adventices au sta<strong>de</strong> 6 feuilles (diminution <strong>de</strong> 90% du poids <strong>de</strong> matière fraîche) <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un<br />
tiers d’énergie en plus que pour la <strong>de</strong>struction à même efficacité d’adventices au sta<strong>de</strong> 2<br />
feuilles. (Hansson D, 2002)<br />
Les différents essais ont montré <strong>de</strong>s résultats satisfaisants sur pâturin annuel, une bonne<br />
efficacité sur les dicotylédones annuelles (euphorbe, géranium, pissenlit, véronique, sagine<br />
apétale…), une efficacité plus variable sur les vivaces (asters, armoises, chardons, pissenlit,<br />
trèfle blanc…), et <strong>de</strong>s difficultés notamment pour le contrôle <strong>de</strong>s plantains (Angoujard G. et<br />
al., 1999 ; Achard J., 2005 ; Dours O., 2004a et 2004b ; Krüger W. et Völkel G, 2001).<br />
Des levées <strong>de</strong> dormances, dues à l’apport <strong>de</strong> chaleur et d’eau ont été observées lors <strong>de</strong><br />
différentes étu<strong>de</strong>s : helminthies, chardons, digitaires. (Achard J., 2005 ; Dours O., 2004a et<br />
2004b )<br />
- Mise en œuvre<br />
Cette technique <strong>de</strong>man<strong>de</strong> entre 3 et 6 passages par an pour contrôler la végétation :<br />
<strong>de</strong>s essais réalisés par la Fere<strong>de</strong>c Bretagne ont montré que pour obtenir une efficacité<br />
supérieure à 70%, il fallait :<br />
- 3 passages par an sur caniveaux<br />
- 4 passages par an sur pavés<br />
- 6 passages par an sur surface sablée et remblai<br />
(Angoujard et al., 2001b)<br />
La vitesse d’avancement est <strong>de</strong> 3 à 5 km/h.<br />
Le désherbage à eau chau<strong>de</strong> peut être utilisé indépendamment <strong>de</strong> la température (<strong>de</strong>s essais<br />
sur <strong>de</strong>s plants <strong>de</strong> moutar<strong>de</strong> blanche au sta<strong>de</strong> 4-6 feuilles ont montré que l’efficacité était la<br />
même à 7 ou 18°C). Par contre, il est préférable d’éviter les pluies importantes (lors <strong>de</strong>s<br />
essais, l’énergie requise était 20% supérieure pour désherber <strong>de</strong>s plants <strong>de</strong> moutar<strong>de</strong> mouillés<br />
que pour <strong>de</strong>s plants <strong>de</strong> moutar<strong>de</strong> secs ). Par contre, cette technique est plus efficace lorsque<br />
les adventices sont en stress hydrique. (Hansson D, 2002)<br />
Des expérimentations en laboratoire montrent une meilleure efficacité avec <strong>de</strong>s gouttes <strong>de</strong><br />
plus grand diamètre (probablement en raison du fait que les grosses gouttes refroidissent<br />
moins vite), ainsi qu’avec un flux d’eau plus important. (Hansson D, 2002)<br />
LXXVII
La surface désherbée par heure dépend fortement du taux d’enherbement ; elle peut varier <strong>de</strong><br />
50 m²/h à plus <strong>de</strong> 500 m²/h (par exemple : <strong>de</strong> 60 à 130 m²/h selon Achard J., 2005 (28 à 60<br />
min pour désherber 60 m²) ; 525 m²/h selon Saft R.J. et Staats N., 2002; 600 m²/h selon<br />
Krüger W. et Völkel G, 2001 ).<br />
- Contraintes<br />
L’emploi d’eau évite les risques d’incendies que posent les systèmes <strong>de</strong> désherbage à<br />
flamme.<br />
- Effet sur l’environnement<br />
Ce système emploie uniquement <strong>de</strong> l’eau pour désherber, il peut donc être utilisé sur les zones<br />
où le risque <strong>de</strong> transfert est important. Cependant, il consomme <strong>de</strong>s quantités importantes<br />
<strong>de</strong> fuel pour faire fonctionner la chaudière, ainsi que <strong>de</strong>s quantités importantes d’eau.<br />
- Coûts<br />
Aquaci<strong>de</strong> : prix <strong>de</strong> l’appareil à partir <strong>de</strong>12000 € HT<br />
Consommation d’eau : 400 à 600 L/h (Hatey L., 2003 ).<br />
Gazole : 5,5 L/h.<br />
Les coûts d’utilisation (main d’œuvre, consommables et amortissement du matériel compris)<br />
calculés en 1999 sont <strong>de</strong> 810 F (soit environ 124 €) par km linéaire et par an, ou 850 F (soit<br />
environ 130 €) pour 1000 m² et par an, pour 4 passages avec le Weedcleaner (modèle avec<br />
une rampe frontale <strong>de</strong> 1 m <strong>de</strong> large) (Angoujard G. et al., 1999).<br />
- Evaluation globale<br />
Ce système est efficace, notamment sur surfaces imperméables où il ne <strong>de</strong>man<strong>de</strong> que 4<br />
passages. L’investissement est élevé, et la consommation en eau et en gazole est<br />
importante. Ce système peut être intéressant pour <strong>de</strong>s communes assez importantes ou pour<br />
<strong>de</strong>s groupements <strong>de</strong> communes, dans le contexte d’une ressource en eau à préserver.<br />
LXXVIII
- Principe<br />
Le désherbage thermique à mousse :<br />
Il s’agit du système néo-zélandais connu sous le nom <strong>de</strong> Waïpuna.<br />
Cette technique consiste en une amélioration du système <strong>de</strong> désherbage à eau chau<strong>de</strong> : à l’eau<br />
est ajouté un produit, le « foam », à base d’amidon <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> noix <strong>de</strong> coco, dosé à 0,2%<br />
du mélange pour les surfaces imperméables et 0,4% pour les surfaces perméables. Ce mélange<br />
est ensuite chauffé à 96 °C et produit une mousse chau<strong>de</strong> qui reste au sol quelques minutes.<br />
Cette mousse permet <strong>de</strong> conserver la chaleur plus longtemps à la sortie <strong>de</strong> la lance (plus<br />
<strong>de</strong> 90°C pendant 30 s environ), assurant une meilleure efficacité (Hatey L. et Bras C., 2004).<br />
Il existe 2 types d’équipement : une machine équipée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux lances <strong>de</strong> 25 cm, qui peut être<br />
utilisée pour les panneaux ou les bordures <strong>de</strong> trottoir par exemple (2 applicateurs + un<br />
chauffeur) ; et une machine avec une lance <strong>de</strong> 50 cm, intéressante pour les gran<strong>de</strong>s surfaces<br />
(un applicateur + 1 chauffeur).<br />
- Efficacité<br />
La meilleure efficacité est observée sur les plantes au sta<strong>de</strong> plantule (jusqu’à 4 à 5 feuilles).<br />
D’après les essais <strong>de</strong> la FREDEC Rhône-Alpes, l’efficacité est satisfaisante pendant 3-4<br />
semaines. La plupart <strong>de</strong>s plantes sont détruites, seules les armoises disparaissent avec plus <strong>de</strong><br />
difficulté (Achard J., 2005).<br />
Tableau 15 : Efficacité du Waïpuna sur différentes espèces adventices<br />
Résultat bon<br />
(au moins 80% <strong>de</strong> la<br />
végétation est détruite sans<br />
repousse dans les 20 jours qui<br />
suivent le traitement )<br />
Résultat moyen<br />
(entre 50 et 80% <strong>de</strong> la<br />
végétation est détruite sans<br />
repousse dans les 20 jours qui<br />
suivent le traitement )<br />
Graminées <strong>de</strong> printemps Mouron<br />
(Anagallis sp.)<br />
Amaranthe<br />
(Amaranthus sp.)<br />
Armoise vulgaire<br />
(Artemisia vulgaris)<br />
Erigéron (2 passages<br />
nécessaires)<br />
(Conyza cana<strong>de</strong>nsis)<br />
Laiteron<br />
(Sonchus)<br />
Lierre<br />
(He<strong>de</strong>ra helix)<br />
Plantain majeur<br />
Résultat faible<br />
(moins <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> la<br />
végétation est détruite sans<br />
repousse dans les 20 jours qui<br />
suivent le traitement )<br />
Liseron <strong>de</strong>s champs<br />
(Convolvulus arvensis)<br />
Chardon Pourpier<br />
(Portulaca oleracea)<br />
Pissenlit<br />
(Taraxacum vulgare)<br />
Potentille rampante<br />
(Potentilla reptans)<br />
LXXIX
(Plantago major)<br />
Renouée <strong>de</strong>s oiseaux<br />
(Polygonum aviculare)<br />
Séneçon vulgaire<br />
(Senecio vulgaris)<br />
(Hatey L. et Bras C., 2004).<br />
Des levées <strong>de</strong> dormance ont été observées pour les chardons et les helminthies, et dans une<br />
moindre mesure pour les digitaires (Achard J., 2005).<br />
- Mise en œuvre<br />
Vitesse d’avancement : 3-5 km/h<br />
Nombre <strong>de</strong> passages : entre 2 et 3 passages en général, jusqu’à 5 dans certains cas.<br />
Cette technique est utilisable sur les surfaces perméables et imperméables.<br />
Le Waïpuna est moins efficace s’il est appliqué sur un revêtement très humi<strong>de</strong> et froid.<br />
La durée du désherbage dépend du taux <strong>de</strong> recouvrement par les adventices. Exemples :<br />
Tableau 15 : Ren<strong>de</strong>ment moyen <strong>de</strong> désherbage au Waïpuna lors d’une expérimentation en<br />
Auvergne durant l’année 2003 (3 passages) : (Hatey L. et Bras C., 2004 )<br />
Surface totale d’expérimentation 10 500 m²<br />
Nombre total d’heures <strong>de</strong> désherbage 83h*<br />
Nombre total d’heures <strong>de</strong> travail 98h (soit 14 jours)<br />
Ren<strong>de</strong>ment moyen <strong>de</strong> traitement pour une lance par rapport à la surface 353 m²/h<br />
Ren<strong>de</strong>ment moyen du traitement pour une lance par rapport au linéaire 1,41 km/h<br />
* Soit un total <strong>de</strong> 126 m²/h pour l’année avec 3 passages, donc environ 42 m²/h lors d’un<br />
passage).<br />
Lors d’une expérimentation <strong>de</strong> la SRPV Rhône-Alpes sur terrain gravillonné, le temps<br />
d’application était <strong>de</strong> 26 à 27 minutes pour 60 m² (soit environ 136 m²/h lors d’un passage).<br />
Quatre passages ont été effectués. (Achard J., 2005 )<br />
- Contraintes<br />
Le matériel <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une certaine formation avant d’être mis en œuvre. Cependant, une fois<br />
que l’on sait l’utiliser, il est assez maniable.<br />
Ce type <strong>de</strong> matériel est difficile à appliquer sur les endroits trop escarpés car la mousse<br />
s’écoule le long <strong>de</strong> la pente et ne reste pas suffisamment en contact avec la végétation.<br />
Comme le savon, la mousse est irritante pour les yeux. Lors <strong>de</strong> la manipulation du surfactant<br />
concentré, il est recommandé <strong>de</strong> porter <strong>de</strong>s gants et <strong>de</strong>s vêtements <strong>de</strong> protection pour éviter un<br />
contact <strong>de</strong>rmique répété et prolongé. (Quarles W., 2001)<br />
LXXX
Les risques <strong>de</strong> brûlure pour le public sont faibles car il y a peu <strong>de</strong> pression à la sortie <strong>de</strong> la<br />
lance. Il est possible que l’applicateur s’éclabousse en faisant une fausse manœuvre (exemple<br />
classique : enjamber un mur bas ou une glissière en tenant la lance et s’asperger la jambe). Par<br />
précaution, on pourra porter <strong>de</strong>s bottes ou <strong>de</strong>s chaussures étanches, et surtout il faut apprendre<br />
à manipuler la lance avec précaution (la poser avant d’enjamber le muret). De même, la lance<br />
est isolée mais <strong>de</strong>s raccords métalliques peuvent occasionner <strong>de</strong> légères brûlures, on<br />
conseillera donc <strong>de</strong> porter <strong>de</strong> gants <strong>de</strong> travail résistants à la chaleur.<br />
- Effet sur l’environnement<br />
Le Foam a été examiné par le comité permanent <strong>de</strong> la chaîne alimentaire et <strong>de</strong> la sécurité<br />
animale (section pestici<strong>de</strong>s) qui a acté que la substance correspondante n’entre pas dans le<br />
champ <strong>de</strong> la directive 91/414/CEE et n’est donc pas un produit phytopharmaceutique (Hatey<br />
L., Bras C., 2004)<br />
Des essais <strong>de</strong> toxicité du foam ont été effectués par l’entreprise. On a constaté peu <strong>de</strong> risque<br />
pour les vers <strong>de</strong> terre Eisenia sp. (CL50 : 654 mg/kg) ; le foam inhibe la reproduction <strong>de</strong>s<br />
daphnies à une concentration dans l’eau <strong>de</strong> 1 mg/L et peut être toxique pour les poissons à <strong>de</strong>s<br />
concentrations <strong>de</strong> 3 mg/L. C’est pourquoi le foam ne <strong>de</strong>vrait pas être appliqué directement à<br />
la surface <strong>de</strong> l’eau. (Quarles W., 2001)<br />
Par ailleurs, tout comme pour les techniques <strong>de</strong> désherbage à l’eau chau<strong>de</strong>, le système<br />
Waïpuna consomme <strong>de</strong>s quantités importantes d’eau et <strong>de</strong> fuel.<br />
- Coûts<br />
L'appareil est disponible uniquement en location, pour une durée minimale d'une semaine En<br />
plus <strong>de</strong> son coût à la location, cette technique consomme <strong>de</strong> l’eau, du foam, du fuel<br />
(chaudière), et <strong>de</strong> l’essence (groupe électrogène).<br />
Dans le cas d’une prestation <strong>de</strong> service, on peut compter environ 1000 € par jour, auxquels il<br />
faut rajouter la mise à disposition <strong>de</strong> l’eau.<br />
Quelques exemples pour une évaluation <strong>de</strong>s coûts et consommations :<br />
Consommations du Waïpuna par jour : (entreprise Piveteau)<br />
0,5 à 5L d’eau par m² selon l’enherbement<br />
Eau : 6 à 10 000L/jour<br />
Foam : 12 à 20L (2L pour 1000L d’eau) par jour<br />
Fuel : 50 à 80L/jour<br />
Essence : 20 à 30 L/par jour<br />
Tableau 16 : Coût d’utilisation du Waïpuna en Auvergne en 2003<br />
(10 500 m² ; 2 ou 3 passages en général, 5 passages pour une place)<br />
LXXXI
Pour<br />
l’ensemble <strong>de</strong><br />
la surface<br />
91m 3<br />
(91000<br />
L)<br />
Consommations,<br />
par m²<br />
Coûts moyens<br />
Quantité totale d’eau<br />
consommée<br />
Soit 8,6 L/m²/an 182 €*<br />
Quantité totale <strong>de</strong> foam 264 L Soit 0.025 1852 €<br />
consommé<br />
L/m²/an<br />
Quantité totale <strong>de</strong> fuel<br />
consommé<br />
869 L Soit 0,08 L/m²/an 348 €<br />
Quantité totale d’essence<br />
consommée<br />
198 L Soit 0,02 L/m²/an 198 €<br />
Durée <strong>de</strong> location <strong>de</strong> la<br />
machine<br />
1 mois 4620/ 3 350 €**<br />
TOTAL 7200 € (0,68 € / m²/an)<br />
/ 5930 € (0.32 €/m²/an)<br />
**<br />
* pour un prix moyen <strong>de</strong> l’eau à 2 /m²<br />
** pour un camion / une remorque, comprenant le coût <strong>de</strong> formation et <strong>de</strong> mise en route <strong>de</strong> la<br />
machine<br />
Le coût total calculé ne tient pas compte <strong>de</strong> la main d’œuvre (en moyenne 2 agents par<br />
traitement).<br />
(Hatey L. et Bras C., 2004).<br />
Tableau 17 : Coût d’utilisation du Waïpuna à Etables-sur-Mer en 2003 :<br />
(15 km linéaires, 3 passages)<br />
Waïpuna (base 2003) Traitements chimiques (base 2002)<br />
Location (3semaines)<br />
+ produit (465L) : 10 200 <br />
carburant (30L)<br />
combustible pour la chaudière (3000L)<br />
eau (215 m 3 )<br />
Main d’œuvre (600 h)<br />
Coût d’utilisation d’un véhicule communal<br />
(175 h <strong>de</strong> travail à 36 €)<br />
Produits (3800 € facturés)<br />
Carburant (250 L)<br />
Eau (15 m 3 à 4 €)<br />
Main d’œuvre (350 €)<br />
Coût global : 24 680 Coût global : 17 100 <br />
(surface totale traitée : 15 km avec 3 (surface totale traitée : 30 km en 1 passage)<br />
passages)<br />
Coût global d’utilisation du Waïpuna: 24 680 €, soit 1645 € /km/an<br />
(Bretagne Eau Pure, 2004)<br />
Tableau 18 : Consommations d’eau et <strong>de</strong> foam lors d’une expérimentation menée par le<br />
SRPV Rhône-Alpes :<br />
(pour un terrain gravillonné <strong>de</strong> 60m² ; 4 passages )<br />
Consommation<br />
<strong>de</strong> foam pour 60<br />
m²<br />
..Soit une<br />
consommation <strong>de</strong><br />
foam par m²<br />
Consommation<br />
d’eau pour 60 m²<br />
…Soit une<br />
consommation<br />
d’eau par m²<br />
Temps<br />
d’application<br />
LXXXII
3,6 L Foam 0,06 L/m² 900L eau 15 L/m² 26 min<br />
(2 applicateurs)<br />
2,2 L Foam 0,03 L/m² 550 L eau 9,1 L/m² 26 min<br />
1,8 L Foam 0,03 L/m² 450 L eau 7,5 L/m² 27 min<br />
3,6 L Foam 0,06 L/m² 900 L eau 15 L/m² 27 min<br />
(2 applicateurs)<br />
(Achard J., 2005)<br />
Soit en moyenne 8 L d’eau (et 0,003 L <strong>de</strong> foam) par m² lors d’un passage avec un seul<br />
applicateur, et 15 L d’eau (et 0,06 L <strong>de</strong> foam) par m² lors d’un passage avec <strong>de</strong>ux<br />
applicateurs.<br />
- Evaluation globale<br />
C’est une technique efficace, qui requiert seulement 2 ou 3 passages, guère plus qu’un<br />
traitement chimique. Cependant, l’investissement est élevé, et, comme pour le désherbage à<br />
eau chau<strong>de</strong>, cette technique consomme <strong>de</strong>s quantités importantes d’eau. Elle consomme<br />
également <strong>de</strong>s quantités non négligeables d’essence et <strong>de</strong> fuel.<br />
La mousse contient <strong>de</strong>s extraits végétaux, mais ceux-ci étant très dilués, l’impact sur la faune<br />
terrestre et aquatique <strong>de</strong>vrait être faible.<br />
LXXXIII
2/ <strong>DESHERBAGE</strong> MECANIQUE<br />
Le désherbage mécanique désigne l’ensemble <strong>de</strong>s techniques qui ont une action physique sur<br />
les adventices, entraînant leur coupe ou leur arrachement ; ce résultat peut être obtenu <strong>de</strong><br />
façon manuelle, ou bien à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> diverses machines, selon le type <strong>de</strong> surface (balayeuses<br />
pour les caniveaux, brosseuses pour les surfaces imperméables, sabot rotatif pour les surfaces<br />
sablées)<br />
- Principe<br />
Le désherbage manuel :<br />
C’est une métho<strong>de</strong> encore largement utilisée, qui consiste à désherber à désherber à l’ai<strong>de</strong><br />
d’outils manuels comme la binette. Elle est très employée dans les massifs et éventuellement<br />
au pied <strong>de</strong>s arbres d’alignement. En raison <strong>de</strong>s préoccupations actuelles <strong>de</strong> diminution <strong>de</strong><br />
l’emploi <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s, elle est parfois aussi utilisée sur les surfaces imperméables.<br />
- Efficacité<br />
Ce type <strong>de</strong> désherbage ne permet pas toujours un arrachage <strong>de</strong>s organes souterrains, en<br />
particulier lorsqu’il est pratiqué sur zone imperméable. C’est pourquoi certaines vivaces<br />
seront moins bien contrôlées par cette métho<strong>de</strong>.<br />
Le désherbage manuel peut entraîner une propagation <strong>de</strong> certaines adventices par<br />
fragmentation <strong>de</strong>s rhizomes.<br />
- Mise en œuvre<br />
Cette technique <strong>de</strong> travail est longue et coûteuse en main d’œuvre.<br />
On peut utiliser <strong>de</strong>s binettes, <strong>de</strong>s ratissoires, <strong>de</strong>s sarcloirs, <strong>de</strong>s « couteaux à désherber »…<br />
Des outils mo<strong>de</strong>rnes comme la motobinette permettent une meilleure ergonomie.<br />
Le désherbage manuel peut nécessiter entre 3 et 5 passages par an (208 h/ha, pour 2<br />
passages, soit 416 h/h/an (Krüger W., Völkel G., 2001)).<br />
Lorsqu’ils sont utilisés sur surfaces imperméables, les outils <strong>de</strong> désherbage manuel peuvent<br />
parfois causer <strong>de</strong>s détériorations du revêtement (par exemple sur enrobés).<br />
- Contraintes<br />
La principale contrainte est la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> importante <strong>de</strong> main d’œuvre.<br />
LXXXIV
- Effet sur l’environnement<br />
Ce type <strong>de</strong> désherbage ne dépense pas d’énergie (autre que humaine) et ne génère pas <strong>de</strong><br />
déchets autres que les plantes arrachées. On considère que cette technique n’a pas d’impact<br />
négatif sur l’environnement.<br />
- Coûts<br />
Les coûts correspon<strong>de</strong>nt au coût <strong>de</strong> la main d’œuvre employée.<br />
- Evaluation globale<br />
Le désherbage manuel est la technique la plus intéressante du point <strong>de</strong> vue<br />
environnemental ; elle ne dépense pas d’énergie autre qu’humaine et ne produit pas <strong>de</strong><br />
déchets. Les inconvénients principaux à sa mis en œuvre restent le temps passé et la main<br />
d’œuvre requise.<br />
LXXXV
- Principe<br />
Le balayage :<br />
Il s’agit d’effectuer <strong>de</strong>s passages réguliers à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s balayeuses municipales pour<br />
supprimer la partie aérienne (par dilacération) <strong>de</strong>s adventices. Afin d’être efficace, il faut<br />
une vitesse d’avancement plus lente et une rotation plus rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s brosses que pour un<br />
balayage classique.<br />
Le balayage supprime la terre et les déchets qui s’accumulent dans les caniveaux, limitant le<br />
développement <strong>de</strong>s adventices. De plus, il permet une meilleure circulation <strong>de</strong> l’eau, qui peut<br />
entraîner les graines avec elle.<br />
Des brosses métalliques spécifiques pour le désherbage peuvent être adaptées sur une<br />
balayeuse voirie. L’emploi <strong>de</strong>s balayeuses se limite généralement au caniveau.<br />
- Efficacité<br />
22 Balayeuse équipée pour le désherbage<br />
La balayeuse est plus efficace sur plantules.<br />
Les essais du Corpep ont permis d’observer une efficacité globale intéressante sur sagine<br />
apétale, pâturin annuel et plantain majeur (Angoujard et al., 1999).<br />
23 Adventices subsistant<br />
après un balayage<br />
LXXXVI
- Mise en œuvre<br />
(brosse métallique)<br />
Il faut entre 8 et 10 interventions pour obtenir une efficacité <strong>de</strong> 70% (Angoujard et al.,<br />
1999 ).<br />
La vitesse d’avancement est <strong>de</strong> 5 km/h environ.<br />
- Risques et contraintes<br />
Cette technique permet d’atteindre les caniveaux, voir la chaussée, mais généralement<br />
pas sur les trottoirs (en l’absence <strong>de</strong> bras articulé). Elle ne permet donc pas d’atteindre les<br />
joints entre le trottoir et le mur, et entre le trottoir et la bordure.<br />
La présence d’obstacles (véhicules en stationnement...) peut gêner le balayage.<br />
Selon les essais du Corpep et <strong>de</strong> la FEREDEC Bretagne (Angoujard et al., 2001b), cette<br />
technique dégra<strong>de</strong> peu les revêtements si les joints ne sont pas détériorés.<br />
Le désherbage peut générer beaucoup <strong>de</strong> poussière malgré le système d’aspiration, et<br />
nécessiter un nettoyage supplémentaire (notamment en cas d’enherbement important).<br />
La machine est bruyante mais le bruit est supportable et temporaire (70-75 db).<br />
- Effet sur l’environnement<br />
La balayeuse consomme <strong>de</strong> l’eau (humectation <strong>de</strong> la turbine pour éviter le rejet <strong>de</strong><br />
poussières) et <strong>de</strong> l’énergie.<br />
- Coûts<br />
Dans le cas d’une prestation il faut compter environ 75 €/h.<br />
Les coûts d’utilisation (main d’œuvre, consommables et amortissement du matériel compris)<br />
calculés en 1999 sont <strong>de</strong> 890 F (soit environ 136 €) par km linéaire et par an, pour 8 passages<br />
avec une balayeuse automotrice employée à vitesse lente (3-5 km/h) avec une vitesse <strong>de</strong><br />
rotation <strong>de</strong>s brosses élevée. (Angoujard G. et al., 1999).<br />
- Evaluation globale<br />
L’intérêt <strong>de</strong> cette technique provient du fait qu’il permet une action préventive. Le nombre<br />
<strong>de</strong> passages est élevé mais permet aussi un entretien <strong>de</strong>s rues. L’inconvénient majeur est que<br />
cette technique ne permet d’atteindre que le caniveau ; par ailleurs, elle ne permet<br />
généralement pas un arrachement total <strong>de</strong>s adventices.<br />
LXXXVII
- Principe<br />
Le brossage :<br />
Différents appareils sont équipés <strong>de</strong> brosses rotatives à axe vertical ou horizontal. Les<br />
brosses métalliques décapent le sol en déchiquetant et / ou en arrachant les plantes.<br />
Ils sont utilisables uniquement sur zone imperméable.<br />
- Efficacité<br />
Le brossage est plus efficace sur les jeunes sta<strong>de</strong>s. Les plantes pérennes sont favorisées, car<br />
seuls les organes situés au-<strong>de</strong>ssus du sol sont supprimés (Kortenhoff A. et al., 2001).<br />
Les essais du CORPEP ont montré une bonne efficacité sur sagine apétale et sur plantain<br />
majeur. Une efficacité moindre a été constatée sur pâturin annuel, car il se situe dans les<br />
anfractuosités <strong>de</strong>s joints qui ne peuvent pas être atteintes par les brosses. (Angoujard G. et al.,<br />
1999).<br />
- Mise en œuvre<br />
Les essais du Corpep ont montré la nécessité <strong>de</strong> 4 interventions pour une efficacité <strong>de</strong> 70%<br />
avec un appareil équipé <strong>de</strong> 6 brosses métalliques rotatives à axe vertical (Angoujard G. et al.,<br />
1999).<br />
Des essais réalisés par la FERREDEC <strong>de</strong> Bretagne ont déterminé le nombre <strong>de</strong> passages à 3<br />
sur les caniveaux et à 4 sur les surfaces pavées pour obtenir une efficacité <strong>de</strong> 70%<br />
(machine équipée <strong>de</strong> 6 brosses métalliques à axe vertical) (Angoujard et al., 2001b)<br />
Le nombre <strong>de</strong> passages peut être plus élevé pour certain type d’appareil.<br />
1200 m²/h (8 h/ha) selon Saft R.J. et Staats N., 2002<br />
- Risques et contraintes<br />
Il est généralement nécessaire d’effectuer un balayage à la suite d’un brossage afin<br />
d’enlever la terre et les résidus végétaux.<br />
Le brossage avec <strong>de</strong>s brosses métalliques entraîne une dégradation <strong>de</strong>s surfaces et <strong>de</strong>s<br />
joints.<br />
Le brossage entraîne une nuisance sonore non négligeable (>90 dB)<br />
- Effet sur l’environnement<br />
Le principal impact est dû à la consommation d’énergie fossile.<br />
- Coûts<br />
La nécessité <strong>de</strong> faire un balayage après l’intervention entraîne un surcoût.<br />
Consommation <strong>de</strong> gasoil (5L/h) pour une productivité 1200 m²/h (Saft R.J. et Staats N., 2002)<br />
Les coûts d’utilisation (main d’œuvre, consommables et amortissement du matériel compris)<br />
calculés en 1999 sont <strong>de</strong> 2550 F (soit environ 389 €) par km linéaire et par an, ou 960 F (soit<br />
environ 146 €) pour 1000 m² et par an, pour 4 passages avec une machine à brosses rotatives<br />
composée <strong>de</strong> 6 brosses à axe vertical équipées <strong>de</strong> lamelles métalliques souples sur un mètre <strong>de</strong><br />
large (lors <strong>de</strong> chaque désherbage, un passage est effectué dans un sens, puis un second dans le<br />
sens inverse ; un balayage est ensuite effectué) (Angoujard G. et al., 1999).<br />
LXXXVIII
- Evaluation globale<br />
Le brossage est relativement efficace (3 à 4 passages pour une efficacité <strong>de</strong> 70%), mais il a<br />
pour inconvénient principal <strong>de</strong> provoquer une dégradation importante <strong>de</strong>s surfaces.<br />
LXXXIX
- Principe<br />
Sabot rotatif :<br />
Des sabots rotatifs (ou <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts arrondies) grattent la surface du sol, entraînant un<br />
déchaussement <strong>de</strong>s adventices. Ce désherbeur ne fonctionne que sur surfaces filtrantes <strong>de</strong><br />
type sable, graviers, revêtements souples…<br />
- Efficacité<br />
A l’heure actuelle, cet appareil n’a pas fait l’objet d’expérimentation.<br />
Le désherbage doit être fait dans <strong>de</strong>s conditions météorologiques sèches pour éviter la<br />
repousse <strong>de</strong>s adventices.<br />
- Mise en œuvre<br />
La vitesse d’avancement recommandée par l’entreprise est <strong>de</strong> 1 à 2 km/h en fonction <strong>de</strong><br />
l’enherbement.<br />
Il faut songer à bien régler la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts selon la nature <strong>de</strong> la flore adventice en<br />
place (profon<strong>de</strong>ur d’enracinement), le type <strong>de</strong> surface, et l’époque du désherbage (un réglage<br />
plus superficiel sera fait dans le cas d’une première intervention).<br />
- Risques et contraintes<br />
Cet appareil s’utilise uniquement sur <strong>de</strong>s surfaces perméables et nécessite un damage <strong>de</strong> la<br />
surface après son passage.<br />
- Effet sur l’environnement<br />
Pas d’évaluation <strong>de</strong>s impacts connue à l’heure actuelle.<br />
- Coûts<br />
Selon le type d’appareil, les coûts peuvent être <strong>de</strong> 3000 à 5500 €<br />
- Evaluation globale<br />
Peu <strong>de</strong> données expérimentales sont disponibles à propos <strong>de</strong> cette technique, ce qui ne<br />
permet pas d’en évaluer l’efficacité et l’impact environnemental.<br />
XC
- Principe<br />
3/ Autres techniques<br />
Le désherbage avec <strong>de</strong>s produits d’origine naturelle :<br />
Il s’agit <strong>de</strong> substances dites « d’origine naturelle » (par opposition aux produits<br />
chimiques <strong>de</strong> synthèse) qui peuvent être utilisées comme désherbant. Par exemple, on teste<br />
actuellement l’huile essentielle <strong>de</strong> citronnelle, et l’aci<strong>de</strong> acétique (vinaigre). La bouillie est<br />
fournie « prête à l’emploi » et est pulvérisée sur les plantes.<br />
Ces substances sont encore étudiées au sta<strong>de</strong> expérimental et ne sont pas encore mises sur le<br />
marché.<br />
En général, ces désherbants « naturels » sont <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s <strong>de</strong> contact non systémiques et<br />
non sélectifs, avec un mo<strong>de</strong> d’action basé sur une <strong>de</strong>struction immédiate <strong>de</strong>s cellules ; c’est<br />
pourquoi une majeure partie <strong>de</strong>s tissus doit être atteinte par le produit pour entraîner une<br />
<strong>de</strong>struction <strong>de</strong> la plante (Young S.L., 2003).<br />
Des essais d’efficacité sont actuellement effectués en France sur l’huile essentielle <strong>de</strong><br />
citronnelle et sur l’aci<strong>de</strong> acétique. A l’échelle internationale, d’autres substances sont testées :<br />
huile <strong>de</strong> noix <strong>de</strong> coco, aci<strong>de</strong>s gras, huiles essentielles <strong>de</strong> plantes… etc. (Young S.L., 2003).<br />
- Efficacité<br />
L’efficacité du produit est strictement foliaire, ce qui impose <strong>de</strong>s passages réguliers (environ 6<br />
dans le cas <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong> acétique).<br />
Dans le cas <strong>de</strong> l’huile essentielle <strong>de</strong> citronnelle, la substance active est efficace sur la<br />
plupart <strong>de</strong>s adventices présentes, sauf les prêles (contact produit-plante insuffisant). 4<br />
passages, ceux sont révélés nécessaires lors <strong>de</strong> l’essai. Des levées très importantes <strong>de</strong><br />
digitaires ont été remarquées. Ceci pourrait être dû à une acidification du sol par la citronnelle<br />
(Achard J., 2005).<br />
Tableau 19 : Efficacité herbici<strong>de</strong> <strong>de</strong> différentes substances dites « d’origine naturelle » sur<br />
différentes adventices<br />
Traitemen<br />
t a<br />
Aci<strong>de</strong><br />
acétique<br />
Huiles<br />
essentielles<br />
<strong>de</strong> plantes<br />
Huile <strong>de</strong><br />
pin<br />
Glyphosat<br />
e<br />
Avena<br />
barbata<br />
L.<br />
Erodium<br />
botrys<br />
Bromus<br />
mollis<br />
Efficacité herbici<strong>de</strong><br />
Hor<strong>de</strong>um<br />
leporinu<br />
m<br />
Elymus<br />
caputmedusae<br />
36 à 54% 60 à 94% 23 à 60% 54 à 68% 60 à<br />
100%<br />
59 à 86% 96 à<br />
100%<br />
53 à 80% 68 à 94% 84 à<br />
100%<br />
49 à 78% 71 à 99% 41 à 61% 41 à 93% 80 à<br />
100%<br />
100% 75 à<br />
100%<br />
60 à<br />
100%<br />
Anagalis<br />
arvensis<br />
100% 100% 21 à<br />
100%<br />
Eremoca<br />
r-pus<br />
setigerus<br />
58 à 91% 70 à 85%<br />
100% 99 à<br />
100%<br />
50 à 95% 88 à 93%<br />
0 à 53%<br />
XCI
Tous les traitements ont été effectués avec un volume total <strong>de</strong> bouillie <strong>de</strong> 100 gal/A (935<br />
L/ha). L’aci<strong>de</strong> acétique (BurnOut ® ) à une solution à 100%, les huiles essentielles à 25%<br />
(Bioganic ®), l’huile <strong>de</strong> pin (Organic Interceptor ®) à 71% (680 g/L), et Glyphosate<br />
(Roundup ® ) à 41% (360g/L).<br />
Pour les herbici<strong>de</strong>s « d’origine naturelle », 4 passages sont faits : l’un dès l’émergence (10<br />
gal/A, soit 93,5 L/ha), le <strong>de</strong>uxième 30 jours après l’émergence (15 gal/A soit 140,2 L <strong>de</strong><br />
substance active par hectare), le troisième 52 jours après l’émergence (25 gal/A soit 233,7<br />
L/ha) et le quatrième 79 jours après l’émergence (25 gal/A soit 233,7 L/ha). Les résultats<br />
correspon<strong>de</strong>nt à une fourchette dans laquelle sont comprises les efficacités mesurées après ces<br />
4 traitements.<br />
Pour le glyphosate, seuls 2 traitements ont été effectués, l’un post-émergence et l’autre 79<br />
jours après l’émergence (14 L/ha) ; dans ce cas les mesures d’efficacité ont été prises après<br />
émergence (suite au premier traitement), 30 jours après l’émergence, 52 jours après<br />
l’émergence, et 79 jours après l’émergence (suite au <strong>de</strong>uxième traitement).<br />
(Young S.L., 2003)<br />
- Mise en œuvre<br />
La bouillie prête à l’emploi est pulvérisée avec un pulvérisateur classique. 4 applications sont<br />
réalisées.<br />
Temps d’application : entre 1 min 30 et 1 min 35 pour 60 m², soit 4h /ha. (Achard J., 2005)<br />
- Risques et contraintes<br />
Bien qu’il s’agisse <strong>de</strong> produits dits « naturels », ces produits peuvent être plus ou moins<br />
irritants et toxiques. Par exemple, l’huile <strong>de</strong> noix <strong>de</strong> coco, l’aci<strong>de</strong> pelargonique, et certains<br />
mélanges d’huiles essentielles, peuvent causer une irritation <strong>de</strong> la peau et <strong>de</strong>s yeux, ainsi que<br />
<strong>de</strong>s voies respiratoires ; il est recommandé <strong>de</strong> porter <strong>de</strong>s gants et <strong>de</strong>s lunettes <strong>de</strong> protection, et<br />
éventuellement un <strong>de</strong>mi-masque.<br />
- Effet sur l’environnement<br />
Encore inconnu ; il est généralement recommandé <strong>de</strong> prendre les précautions nécessaires pour<br />
éviter une contamination <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface.<br />
- Coûts<br />
Non encore disponible.<br />
Les essais faits à l’étranger montrent que bien que la plupart <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s non chimiques<br />
soient moins chers à l’achat, le coût total <strong>de</strong> l’application peut être jusqu’à dix fois plus<br />
élevé en raison <strong>de</strong>s quantités importantes <strong>de</strong> produit utilisées.<br />
- Evaluation globale<br />
Les désherbants dits d’origine naturelle ont pour intérêt d’être facilement applicables avec le<br />
matériel utilisé pour le désherbage chimique ; le mo<strong>de</strong> d’action étant uniquement foliaire,<br />
le nombre d’applications peut varier <strong>de</strong> 4 à 6. Tout comme pour les herbici<strong>de</strong>s chimiques,<br />
le port d’équipements <strong>de</strong> protection peut être nécessaire. Les impacts environnementaux<br />
XCII
sont encore à évaluer. Pour l’instant, ces substances ne sont pas encore disponibles sur le<br />
marché français.<br />
XCIII
- Principe<br />
L’électrocution :<br />
L’énergie électrique est transmise à la plante sous forme <strong>de</strong> chaleur, provoquant un<br />
éclatement <strong>de</strong>s cellules (Vignaut et Benoît, 2000). Cette technologie n’est qu’au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
recherche actuellement, aucun prototype n’est disponible pour les zones non agricoles.<br />
- Efficacité<br />
Elle dépend <strong>de</strong> l’espèce, la taille, la pérennité <strong>de</strong> la plante, <strong>de</strong> sa composition chimique (teneur<br />
en lignine et cellulose), <strong>de</strong> sa structure racinaire et du sol. Le traitement sera plus efficace si le<br />
sol est sec, le système racinaire peu développé et la plante jeune. L’efficacité dépend aussi <strong>de</strong><br />
la <strong>de</strong>nsité et <strong>de</strong> la différence <strong>de</strong> taille entre les plantes et les adventices : pour pouvoir traiter il<br />
faut qu’il y ait au moins 10 cm <strong>de</strong> différence entre les <strong>de</strong>ux (Vignaut et Benoît, 2000).<br />
Les plantes ayant <strong>de</strong>s organes souterrains développés sont peu touchées : les rhizomes du<br />
chien<strong>de</strong>nt (Elymus repens L. Beauv.) survivent ; la petite bardane (Arctium minus Hilll.<br />
Bernh.) n’est pas contrôlée efficacement en culture <strong>de</strong> plein champ, car les tiges situées au<br />
niveau du sol ne sont pas touchées par l’électro<strong>de</strong>. Le chardon vulgaire (Cirsium vulgare<br />
(Savi) Tenore) et le chardon <strong>de</strong>s champs (Cirsium arvensis (L.) Scop.) échappent à la<br />
<strong>de</strong>struction grâce à la repousse <strong>de</strong>s tiges à partir du système racinaire non endommagé.<br />
(Vignaut et Benoît, 2000)<br />
- Mise en œuvre<br />
Pas d’appareil existant pour le moment<br />
- Risques et contraintes<br />
En champ, 3 passages par an sont recommandés (Vignaut et Benoît, 2000)<br />
- Effet sur l’environnement<br />
La manipulation est délicate en raison du haut voltage utilisé (Hatey L., 2003).<br />
L’électrocution ne produit aucun résidu au sol. Cependant, elle consomme beaucoup<br />
d’énergie (Vignaut et Benoît, 2000)<br />
- Coûts<br />
Non disponible.<br />
- Evaluation globale<br />
Cette métho<strong>de</strong> n’est pas encore pratiquée. Elle semble intéressante mais n’est pour l’instant<br />
pas efficace sur les plantes à organes souterrains développés. Elle est très consommatrice en<br />
énergie.<br />
XCIV
4/ Eléments <strong>de</strong> comparaison <strong>de</strong>s différentes techniques<br />
Le choix d’une technique alternative <strong>de</strong> désherbage est difficile car il faut prendre <strong>de</strong><br />
nombreux paramètres en compte : coût (investissement et utilisation), nombre d’interventions<br />
et facilité d’emploi, impacts environnementaux, contraintes diverses…<br />
Voici un tableau récapitulatif qui résume les principales caractéristiques <strong>de</strong>s différentes<br />
métho<strong>de</strong>s disponibles :<br />
Tableau 20 : Tableau récapitulatif <strong>de</strong>s techniques alternatives <strong>de</strong> désherbage (curatives)<br />
Technique <strong>de</strong><br />
désherbage<br />
Technique<br />
s<br />
thermique<br />
s<br />
Technique<br />
s<br />
mécanique<br />
s<br />
à flamme<br />
directe<br />
à<br />
infrarouges<br />
à l’eau<br />
chau<strong>de</strong><br />
à mousse<br />
(Waïpuna)<br />
Désherbage<br />
manuel<br />
Sabots<br />
rotatifs<br />
Autres Désherbant<br />
s « non<br />
chimiques<br />
»<br />
Type <strong>de</strong><br />
surface<br />
Perméables ou<br />
imperméables<br />
(sauf asphalte)<br />
Perméables ou<br />
imperméables<br />
Perméables ou<br />
imperméables<br />
Perméables ou<br />
imperméables<br />
Perméables ou<br />
imperméables<br />
Balayage Imperméables<br />
(caniveau)<br />
Nombre<br />
d’interven<br />
-<br />
tions<br />
5 à 8<br />
Facilité<br />
d’emplo<br />
i<br />
Coût<br />
*<br />
Remarques<br />
+++ XXX Risque d’incendie<br />
Consommation<br />
d’énergie fossile et<br />
pollution<br />
atmosphérique<br />
6 à 8 + à ++ XXX Consommation<br />
d’énergie fossile et<br />
pollution<br />
3 à 6 ++ X à<br />
XX<br />
2 à 4 ++ X à<br />
XX<br />
3 à 5 +++ X à<br />
XX<br />
atmosphérique<br />
Consommation<br />
d’énergie fossile et<br />
d’eau<br />
Consommation<br />
d’énergie fossile et<br />
d’eau ; emploi <strong>de</strong><br />
foam pour la mousse<br />
Pénibilité, main<br />
d’œuvre importante<br />
requise<br />
8 à 10 + X Ne permet<br />
généralement<br />
d’atteindre que le<br />
caniveau ; bruit<br />
Brossage Imperméables 4 + X Dégradation <strong>de</strong>s<br />
revêtements ;<br />
balayage nécessaire<br />
Perméables Non évalué + X<br />
après passage<br />
Nécessite un damage<br />
<strong>de</strong> la surface<br />
Perméables et 4 à 6 +++ X Prendre <strong>de</strong>s<br />
imperméables<br />
précautions vis à vis<br />
<strong>de</strong> la toxicité et <strong>de</strong><br />
l’écotoxicité <strong>de</strong> ces<br />
substances<br />
XCV
* à noter qu’il s’agit ici <strong>de</strong>s coûts d’emploi <strong>de</strong>s techniques et non <strong>de</strong> l’investissement initial ;<br />
ils sont évalués notamment à partir <strong>de</strong>s évaluations <strong>de</strong> Angoujard G. et al., 1999.<br />
+++ : très facile - ++ moyennement facile - + : peu facile<br />
XXX : élevé – XX : moyen – X : faible<br />
Par ailleurs il est important <strong>de</strong> connaître l’efficacité <strong>de</strong> ces métho<strong>de</strong>s pour les adventices<br />
rencontrées ; voici un tableau rappelant les résultats d’efficacité <strong>de</strong> certaines techniques pour<br />
diverses adventices obtenus par le SRPV Rhône-Alpes lors d’un essai en 2004 :<br />
Tableau 21 : efficacité <strong>de</strong> certaines techniques alternatives <strong>de</strong> désherbage pour différentes<br />
adventices (calculée par la réduction du pourcentage <strong>de</strong> recouvrement <strong>de</strong> l’adventice)<br />
Référenc<br />
e<br />
chimique<br />
Juil No<br />
Brûleurs<br />
à gaz<br />
Aquaci<strong>de</strong> Waïpuna Citronnel<br />
le<br />
Juil No Juil No Juil No Juil Nov<br />
let v. let v. let v. let v. let .<br />
Euphorbe 95 100 100 100 100 60 87 100 100 100<br />
Géranium 100 100 100 97 100 64 100 92 100 100<br />
Annuelles Pissenlit - 89 - 55 - 85 - 53 - 80<br />
Veroniqu<br />
e<br />
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />
Dicotylédones<br />
Bisannuelle<br />
s<br />
Helminthi<br />
e<br />
Armoise<br />
Aster sp.<br />
( A. novi<br />
36<br />
0<br />
98<br />
100<br />
52<br />
-<br />
55<br />
-<br />
52<br />
-<br />
55<br />
-<br />
99<br />
0<br />
97<br />
100<br />
87<br />
-<br />
99<br />
-<br />
Vivaces belgi et<br />
A. novae<br />
Anglicae)<br />
49 99 94 100 94 100 88 99 100 100<br />
Chardon 0 99 96 71 96 71 88 76 - -<br />
Monocotylédone<br />
s<br />
Annuelles Digitaire 100 100 100 90 100 90 0 0 0 0<br />
Ptéridophytes Vivaces Prêle 0 65 100 100 100 100 100 100 69 53<br />
Notations globales sur l’ensemble <strong>de</strong> la<br />
surface<br />
47 99 81 60 81 60 98 65 55 65<br />
- : valeur du témoin nulle, le calcul <strong>de</strong> l’efficacité impossible<br />
0 : pas d’efficacité proprement dite car les effectifs <strong>de</strong> la parcelle traitée sont plus importants<br />
que ceux <strong>de</strong>s témoins<br />
(Achard J., 2005)<br />
XCVI
- Pour le désherbage chimique, 1 passage avec la spécialité commerciale Kid<br />
Allées 2 (20% glyphosate aci<strong>de</strong>, 20% oxadiazon, 1,2% diflufenican) à 15 kg/ha a<br />
été effectué le 22 avril, puis <strong>de</strong>ux rattrapages avec la spécialité commerciale Final<br />
Way (120 g/L glufosinate ammonium) à 8,3 L/ha ont été effectués respectivement<br />
le 30 juillet et le premier octobre.<br />
- Pour le désherbage thermique à flamme directe (brûleurs à gaz), 5 passages<br />
ont été effectués (le 15 avril, le 11 mai, le 18 juin, le 19 août, le premier octobre)<br />
- Pour le désherbage thermique à eau chau<strong>de</strong> (Aquaci<strong>de</strong>), 4 passages ont été<br />
effectués (le 15 avril, le 3 juin, le 6 juillet, le 8 septembre)<br />
- Pour le désherbage thermique à mousse (Waïpuna), 5 passages ont été<br />
effectués (le 28 avril, le 18 juin, le 6 août, le 6 octobre)<br />
- Pour le désherbage avec la citronnelle, 4 passages ont été effectués (le 22 avril,<br />
le 25 mai, le 11 mai, le 22 octobre).<br />
L’expérimentation a eu lieu sur une surface gravillonnée.<br />
Les relevés <strong>de</strong> pourcentages <strong>de</strong> recouvrement <strong>de</strong> juillet ont été faits pendant les semaines 26 et<br />
27 du calendrier civil ; ceux <strong>de</strong> novembre ont été faits pendant la semaine 45 du calendrier<br />
civil.<br />
XCVII
5/ Eléments <strong>de</strong> raisonnement <strong>de</strong> l’impact environnemental <strong>de</strong>s différentes techniques<br />
Une étu<strong>de</strong> hollandaise <strong>de</strong> 2002 propose une approche <strong>de</strong>s facteurs décisionnels dans le<br />
désherbage <strong>de</strong>s revêtements minéraux. Cette étu<strong>de</strong> évalue les impacts environnementaux <strong>de</strong><br />
différentes techniques (chimique ou alternatives) grâce à une analyse du cycle <strong>de</strong> vie, mais<br />
prend également en compte les risques locaux pour la biodiversité, les coûts, la facilité<br />
d’emploi et les gênes occasionnées pour les habitants.<br />
L’analyse du cycle <strong>de</strong> vie (ACV) est une métho<strong>de</strong> reconnue sur le plan international (norme<br />
ISO 14040). Selon la norme, il s'agit <strong>de</strong> la ''compilation et évaluation <strong>de</strong>s consommations<br />
d'énergie, <strong>de</strong>s utilisations <strong>de</strong> matières premières, et <strong>de</strong>s rejets dans l'environnement, ainsi que<br />
<strong>de</strong> l'évaluation <strong>de</strong> l'impact potentiel sur l'environnement associé à un produit, ou un procédé,<br />
ou un service, sur la totalité <strong>de</strong> son cycle <strong>de</strong> vie''..<br />
L’impact environnemental <strong>de</strong> ces techniques est évalué grâce à l’impact sur 12 grands<br />
thèmes :<br />
Epuisement abiotique (épuisement <strong>de</strong>s ressources d’énergie comme le fuel, le gaz<br />
…)<br />
Effet <strong>de</strong> serre (émissions <strong>de</strong> CO2)<br />
Dégradation <strong>de</strong> la couche d’ozone<br />
Formation <strong>de</strong> smog (émissions <strong>de</strong> CO, <strong>de</strong> NOx et d’hydrocarbures)<br />
Toxicité humaine<br />
Ecotoxicité aquatique / sédimentaire / terrestre<br />
Acidification atmosphérique (émissions <strong>de</strong> SO2 et <strong>de</strong> NOx)<br />
Eutrophisation (émissions <strong>de</strong> phosphates et <strong>de</strong> NOx)<br />
Lifesupport<br />
Biodiversité<br />
Dans cette étu<strong>de</strong>, l’unité prise est « le désherbage sur 1000 mètres carrés <strong>de</strong> trottoir à<br />
dalles 30x30 cm au cours d’une année (moyenne sur le plan climatique), résultant dans<br />
un enherbement très faible » On suppose un ruissellement <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> substance active et<br />
une infiltration <strong>de</strong> 50% (vers les égouts).<br />
Les différentes métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désherbage étudiées sont :<br />
- Désherbage chimique par taches<br />
Il s’agit d’un appareil relié à un quad, possédant <strong>de</strong>s capteurs détectant les adventices grâce à<br />
leur chlorophylle, afin <strong>de</strong> déclencher les buses au moment du passage sur les adventices<br />
repérées. Pour les endroits moins accessibles (autour et sous les obstacles, <strong>de</strong> type panneaux,<br />
voitures…), on utilise une lance connectée au quad. L’herbici<strong>de</strong> appliqué est du glyphosate<br />
(Roundup).<br />
- Brossage + rotofil<br />
Il s’agit d’une brosseuse automotrice avec <strong>de</strong>s brosses en acier. Pour les endroits moins<br />
accessibles, un rotofil est employé. Le brossage est suivi d’un balayage mécanique en<br />
combinaison ou non avec un souffleur à feuilles.<br />
- Brossage + chimique<br />
XCVIII
Il s’agit <strong>de</strong> la même brosseuse que précé<strong>de</strong>mment, mais on utilise un pulvérisateur à dos à la<br />
place du rotofil (ici aussi la substance active est le glyphosate).<br />
- Désherbage à l’eau chau<strong>de</strong><br />
L’eau est portée à 140°C dans une unité <strong>de</strong> chauffage et est guidée par un bras hydraulique<br />
vers un réservoir qui la disperse sur les adventices ; à la sortie, l’eau est à une température <strong>de</strong><br />
94°C. La flexibilité du bras hydraulique permet d’atteindre le pourtour <strong>de</strong>s obstacles.<br />
- Désherbage avec un désherbeur à flamme directe<br />
On utilise une rampe avec une largeur <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> 1m. Le pourtour <strong>de</strong>s obstacles est atteint<br />
avec un désherbeur thermique à main.<br />
Pour chaque technique <strong>de</strong> désherbage, à partir d’une évaluation <strong>de</strong>s polluants émis durant<br />
toute la durée du cycle <strong>de</strong> vie, un score est obtenu pour la contribution <strong>de</strong> chaque technique<br />
aux 12 thèmes environnementaux choisis.<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Epuisement abiotique<br />
Effet <strong>de</strong> serre<br />
Ebranlement couche<br />
d'ozone<br />
Création <strong>de</strong> smog<br />
Toxicité humaine<br />
Ecotoxicité aquatique<br />
eau douce<br />
Ecotoxicité sédiments<br />
Ecotoxicité terrestre<br />
Acidification<br />
Saturation du sol<br />
Lifesupport<br />
Biodiversité<br />
Chimique<br />
Brossage/Débroussaillage<br />
Brossage/chimique<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Combustion<br />
Figure 6 : Scores caractérisés 4 <strong>de</strong>s ensembles <strong>de</strong>s différentes techniques <strong>de</strong> désherbage pour<br />
les 12 thèmes environnementaux<br />
4 La caractérisation permet <strong>de</strong> mettre sur une même échelle <strong>de</strong>ux polluants différents ayant <strong>de</strong>s effets sur la<br />
même catégorie d’impact. Ainsi, cette étape permet d’ajouter les tonnes <strong>de</strong> NO2 et <strong>de</strong> CO2 rejetés, au vu <strong>de</strong> leur<br />
impact sur le réchauffement global, en leur affectant un facteur <strong>de</strong> caractérisation.<br />
XCIX
(Note pour l’axe <strong>de</strong>s ordonnées : pour chaque thème écologique, la métho<strong>de</strong> ayant le plus<br />
grand score indique 100% afin <strong>de</strong> faciliter la comparaison avec les autres métho<strong>de</strong>s. Plus le<br />
score est élevé et plus la métho<strong>de</strong> utilisée a <strong>de</strong>s impacts environnementaux importants).<br />
On remarque que le traitement au glyphosate obtient les scores maximaux pour l’écotoxicité<br />
sédimentaire et l’écotoxicité aquatique. Pour les autres thèmes environnementaux, ce sont les<br />
autres techniques qui ont <strong>de</strong>s scores plus élevés. En particulier, le désherbage thermique à<br />
flamme directe obtient <strong>de</strong>s scores très élevés pour la plupart <strong>de</strong>s compartiments.<br />
900000<br />
800000<br />
700000<br />
600000<br />
500000<br />
400000<br />
300000<br />
200000<br />
100000<br />
0<br />
Chimique<br />
Brossage +<br />
rotofil<br />
Brossage +<br />
chimique<br />
Eau<br />
chau<strong>de</strong><br />
Brûleurs<br />
900000<br />
800000<br />
700000<br />
600000<br />
500000<br />
400000<br />
300000<br />
200000<br />
100000<br />
0<br />
Pour l’écotoxicité aquatique et sédimentaire, c’est le désherbage chimique qui obtient les<br />
scores les plus importants, en raison <strong>de</strong>s transferts <strong>de</strong> glyphosate.<br />
Pour l’écotoxicité terrestre, les scores sont surtout corrélés avec l’émission d’hydrocarbures et<br />
<strong>de</strong> métaux lourds.<br />
300000<br />
250000<br />
200000<br />
150000<br />
100000<br />
50000<br />
0<br />
Figure 7 : Scores caractérisés<br />
pour l’écotoxicité aquatique<br />
Chimique<br />
Brossage + rotofil<br />
Brossage + chimique<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Brûleurs<br />
Figure 9 : Scores caractérisés<br />
pour l’épuisement abiotique<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
0<br />
Chimique<br />
Brossage + rotofil<br />
Chimique<br />
Brossage + chimique<br />
Brossage +<br />
rotofil<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Brossage +<br />
chimique<br />
Brûleurs<br />
Eau<br />
chau<strong>de</strong><br />
Figure 10 : Scores caractérisés<br />
pour l’effet <strong>de</strong> serre<br />
Brûleurs<br />
Figure 8 : Scores caractérisés<br />
pour l’écotoxicité sédimentaire<br />
C
Pour l’épuisement <strong>de</strong>s ressources abiotiques (énergies non renouvelables), l’effet <strong>de</strong> serre,<br />
mais aussi la production <strong>de</strong> smog, l’acidification atmosphérique…, les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
désherbage alternatives obtiennent <strong>de</strong>s scores élevés en raison <strong>de</strong> la consommation <strong>de</strong><br />
combustible.<br />
45000<br />
40000<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Chimique<br />
Brossage +<br />
rotofil<br />
Brossage +<br />
chimique<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Figure 11 : Scores caractérisés<br />
pour la biodiversité<br />
Brûleurs<br />
Les scores pour la toxicité humaine, la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> la couche d’ozone, la biodiversité …<br />
sont dus aux substances émises lors <strong>de</strong> la production <strong>de</strong> gasoil. On notera que la toxicité du<br />
glyphosate ne semble pas avoir été prise en compte dans cette étu<strong>de</strong> pour l’évaluation <strong>de</strong> la<br />
toxicité humaine.<br />
0,2<br />
0,18<br />
0,16<br />
0,14<br />
0,12<br />
0,1<br />
0,08<br />
0,06<br />
0,04<br />
0,02<br />
0<br />
Chimique<br />
Brossage +<br />
rotofil<br />
Brossage +<br />
chimique<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Brûleurs<br />
Figure 12 : Scores caractérisés pour<br />
la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> la couche d’ozone<br />
CI
Ces scores caractérisés sont ensuite normalisés, c’est-à-dire qu’ils sont comparés à la<br />
charge environnementale globale <strong>de</strong>s Pays-Bas pour chacun <strong>de</strong>s thèmes.<br />
Epuisement abiotique<br />
Effet <strong>de</strong> serre<br />
Ebranlement couche<br />
d'ozone<br />
Création <strong>de</strong> smog<br />
Toxicité humaine<br />
Ecotoxicité aquatique<br />
eau douce<br />
Ecotoxicité sédiments<br />
Ecotoxicité terrestre<br />
Chimique<br />
Brossage/Débroussaillage<br />
Brossage/chimique<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Combustion<br />
Figure 13 : Scores normalisés <strong>de</strong>s ensembles <strong>de</strong>s différentes techniques <strong>de</strong> désherbage pour<br />
les 12 thèmes environnementaux (infiltration 50%)<br />
Note pour l’axe <strong>de</strong>s ordonnées : pour chaque thème écologique, la métho<strong>de</strong> ayant le plus<br />
grand score indique 100% afin <strong>de</strong> faciliter la comparaison avec les autres métho<strong>de</strong>s. Ce<br />
graphique a pour but <strong>de</strong> mieux visualiser les différences entre les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désherbage<br />
pour un même thème <strong>de</strong> l’analyse du cycle <strong>de</strong> vie.<br />
Lorsque l’on regar<strong>de</strong> les scores normalisés vis-à-vis <strong>de</strong> la charge environnementale<br />
globale au Pays Bas, on se rend compte que c’est pour l’écotoxicité aquatique et<br />
sédimentaire que le désherbage revêtements minéraux (dans le cas d’une infiltration <strong>de</strong><br />
50%) a l’impact le plus important pour ce pays.<br />
Acidification<br />
Saturation du sol<br />
Lifesupport<br />
Biodiversité<br />
CII
Par contre, les résultats sont différents dans le cas d’une infiltration <strong>de</strong> 100% (ex : talus<br />
enherbé qui recueille les eaux <strong>de</strong> la surface désherbée) :<br />
Epuisement abiotique<br />
Effet <strong>de</strong> serre<br />
Ebranlement couche<br />
d'ozone<br />
Création <strong>de</strong> smog<br />
Toxicité humaine<br />
Ecotoxicité aquatique<br />
eau douce<br />
Ecotoxicité sédiments<br />
Ecotoxicité terrestre<br />
Acidification<br />
Saturation du sol<br />
Lifesupport<br />
Biodiversité<br />
Chimique<br />
Brossage/Débroussaillage<br />
Brossage/chimique<br />
Eau chau<strong>de</strong><br />
Combustion<br />
Figure 14 : Scores normalisés <strong>de</strong>s ensembles <strong>de</strong>s différentes techniques <strong>de</strong> désherbage pour<br />
les 12 thèmes environnementaux (infiltration 100%)<br />
Dans le cas d’une infiltration <strong>de</strong> 100%, les scores d’écotoxicité du glyphosate sont<br />
nettement inférieurs. Dans ce cas, le profil écologique du désherbage chimique serait le<br />
meilleur.<br />
CIII
LA MISE <strong>EN</strong> ŒUVRE DU <strong>DESHERBAGE</strong> CHIMIQUE<br />
I/ MODES D’ACTION DES HERBICIDES<br />
Le désherbage chimique consiste en l’emploi <strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques (herbici<strong>de</strong>s).<br />
Un produit phytopharmaceutique est composé d’une substance active qui agit sur l’organisme<br />
visé (dans le cas d’un herbici<strong>de</strong>, il s’agira <strong>de</strong> la substance qui va détruire la végétation)<br />
associée à <strong>de</strong>s formulants (qui améliorent la dispersion, la stabilité, etc..).<br />
Les herbici<strong>de</strong>s peuvent avoir différents mo<strong>de</strong>s d’action :<br />
Les herbici<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prélevée<br />
Ces herbici<strong>de</strong>s ont une action préventive. Ils sont incorporés au sol avant la levée <strong>de</strong>s<br />
adventices. Ces herbici<strong>de</strong>s se dissolvent dans la solution <strong>de</strong> sol et sont absorbés par les racines<br />
<strong>de</strong>s adventices ou les radicules <strong>de</strong>s graines en cours <strong>de</strong> germination.<br />
Ce type d’herbici<strong>de</strong> est appliqué « en plein » sur la surface à désherber.<br />
Les herbici<strong>de</strong>s <strong>de</strong> post-levée<br />
Ces herbici<strong>de</strong>s sont utilisés sur <strong>de</strong>s adventices déjà levées : ils ont une action curative. Ils<br />
doivent être utilisés « par taches », uniquement sur la végétation déjà présente. Ils peuvent<br />
agir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux manières différentes :<br />
• herbici<strong>de</strong>s <strong>de</strong> contact<br />
Ce type d’herbici<strong>de</strong> est absorbé par les organes aériens <strong>de</strong> la plante et détruit les tissus avec<br />
lesquels il est entré en contact. L’effet est immédiat. Cependant, il n’affecte pas les organes<br />
souterrains, ce qui peut entraîner une repousse (en particulier <strong>de</strong>s espèces pluriannuelles).<br />
• herbici<strong>de</strong>s systémiques<br />
Ce type d’herbici<strong>de</strong> est absorbé par les parties aériennes ou souterraines <strong>de</strong> la plante. Il est<br />
transporté à l’intérieur <strong>de</strong> la plante grâce à la sève et atteint tous les organes. L’effet n’est<br />
donc pas immédiat, mais la plante est entièrement détruite.<br />
II/ USAGES<br />
En zones non agricoles, le désherbage vise différents objectifs :<br />
Eradiquer les plantes spontanées s’étant développées dans <strong>de</strong>s sites où elles ne sont pas<br />
souhaitées, ou bien avoir une action sélective sur les adventices d’une pelouse, ou encore<br />
avoir une action sélective sur les adventices se développant dans <strong>de</strong>s massifs et au pied<br />
d’arbres.<br />
Ces différentes utilisations correspon<strong>de</strong>nt à différents usages :<br />
- TRAITEM<strong>EN</strong>TS G<strong>EN</strong>ERAUX * <strong>DESHERBAGE</strong> * ALLEES DE PARCS, JARDINS<br />
PUBLICS ET TROTTOIRS (utilisation en ville)<br />
- TRAITEM<strong>EN</strong>TS G<strong>EN</strong>ERAUX * <strong>DESHERBAGE</strong> TOTAL (utilisation pour les réseaux <strong>de</strong><br />
communication, les zones industrielles et les emprises militaires)<br />
- GAZONS DE GRAMINEES * <strong>DESHERBAGE</strong><br />
- ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEM<strong>EN</strong>T * <strong>DESHERBAGE</strong> * PLANTATIONS<br />
A chacun <strong>de</strong> ces usages correspond une liste <strong>de</strong> produits homologués pour une dose précise.<br />
Le produit doit être utilisé uniquement pour les usages pour lesquels il est homologué.<br />
III/ AGREM<strong>EN</strong>T ET FORMATION<br />
CIV
Un agrément est obligatoire pour tout prestataire <strong>de</strong> service qui applique <strong>de</strong>s produits<br />
phytopharmaceutiques à titre onéreux (Loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution<br />
et à l'application par <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services <strong>de</strong>s produits antiparasitaires à usage agricole<br />
et <strong>de</strong>s produits assimilés).<br />
La certification d’un salarié se fait : par obtention <strong>de</strong> certains diplômes, par validation <strong>de</strong>s<br />
acquis professionnels (justification <strong>de</strong> 5 ans d’activité et présentation d’un dossier à un jury),<br />
ou par une formation spécifique validée par un examen. Le certificat est valable 5 ans et<br />
atteste <strong>de</strong> la qualification pour encadrer et former 10 personnes.<br />
Une entreprise peut être agréée si elle dispose en emploi permanent d’un salarié titulaire<br />
d’un certificat pour 10 salariés, et si elle justifie d’une police d’assurance couvrant sa<br />
responsabilité civile professionnelle.<br />
D’autre part, la certification n’est pas obligatoire pour les personnes publiques appliquant<br />
<strong>de</strong>s produits antiparasitaires pour l’entretien <strong>de</strong> leurs espaces verts ou <strong>de</strong> leurs voiries .<br />
Cependant, un avis au journal officiel du 21 janvier 2003 incite les services publics recourant<br />
à l'utilisation <strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques à s'engager dans une démarche volontaire <strong>de</strong><br />
certification <strong>de</strong> leurs agents et d'agrément <strong>de</strong> leurs unités concernées. Des formations sont<br />
proposées dans les centres <strong>de</strong> formation professionnelle et par les entreprises qui fournissent<br />
les produits chimiques.<br />
Enfin, dans l’idéal, toute personne appliquant <strong>de</strong>s produits phytosanitaires <strong>de</strong>vrait avoir<br />
suivi au moins une formation sur ce thème. La manipulation <strong>de</strong> ces produits est dangereuse<br />
pour l’utilisateur, le public et l’environnement, elle requiert certaines connaissances.<br />
IV/ S’INFORMER AVANT LA MISE <strong>EN</strong> OEUVRE<br />
1/ Lire les étiquettes<br />
L’étiquette comporte un certain nombre d’informations sur le produit :<br />
- Le nom et la teneur <strong>de</strong>s substances actives<br />
- Le numéro d’autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché en France<br />
- Les usages homologués et doses respectives<br />
- Le mo<strong>de</strong> d’application du produit<br />
- Des instructions sur l’élimination du produit et <strong>de</strong> son emballage<br />
- Le type <strong>de</strong> préparation (poudre mouillable, concentré émulsionnable…)<br />
- Le type d’action du produit (herbici<strong>de</strong> dans le cas présent)<br />
- Des instructions pour la préparation <strong>de</strong> la bouillie<br />
- Des informations sur les conditions <strong>de</strong> stockage<br />
- Des précautions d’emploi : phrases <strong>de</strong> risque<br />
- Le nom et l’adresse du fabriquant<br />
- Le symbole <strong>de</strong> classement<br />
CV
T+ - Très toxique<br />
Produit qui, par<br />
inhalation, ingestion ou<br />
pénétration cutanée en<br />
très petite quantité<br />
entraîne la mort ou <strong>de</strong>s<br />
risques aigus ou<br />
chroniques.<br />
T - Toxique<br />
Produit qui, par<br />
inhalation, ingestion ou<br />
pénétration cutanée en<br />
petite quantité entraîne<br />
la mort ou <strong>de</strong>s risques<br />
aigus ou chroniques.<br />
Xn - Nocif<br />
Produit qui, par<br />
inhalation, ingestion ou<br />
pénétration cutanée<br />
peut entraîner la mort<br />
ou <strong>de</strong>s risques aigus ou<br />
chroniques.<br />
Xi – Irritant<br />
Produit non corrosif<br />
qui, par contact<br />
immédiat, prolongé ou<br />
répété avec la peau ou<br />
les muqueuses peut<br />
provoquer une réaction<br />
inflammatoire.<br />
C - Corrosif<br />
Produit qui, en contact<br />
avec <strong>de</strong>s tissus vivants<br />
peut exercer une action<br />
<strong>de</strong>structrice sur ces<br />
<strong>de</strong>rniers.<br />
Figure 5 : Signification <strong>de</strong>s symboles <strong>de</strong> danger<br />
N – Dangereux pour<br />
l’environnement<br />
Produit qui présenterait<br />
ou pourrait présenter, un<br />
risque immédiat ou<br />
différé pour<br />
l'environnement.<br />
E- Explosif<br />
Produit qui peut exploser<br />
par action d’un choc,<br />
d’un frottement, <strong>de</strong> la<br />
chaleur...<br />
F+ - Extrêmement<br />
inflammable<br />
Produit qui peut<br />
s’enflammer très<br />
facilement sous l’action<br />
d’une source d’énergie<br />
même en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 0 °C<br />
F – Facilement<br />
inflammable<br />
Produit qui peut<br />
s’enflammer très<br />
facilement sous l’action<br />
d’une source d’énergie à<br />
température ambiante<br />
O – Comburant<br />
Produit qui, au contact<br />
d'autres substances,<br />
notamment<br />
inflammables, présente<br />
une réaction fortement<br />
exothermique.<br />
Ces symboles sont accompagnés <strong>de</strong> phrases <strong>de</strong> risque qui précisent la nature du risque. Elles<br />
sont symbolisées par la lettre R suivie d’un nombre.<br />
CVI
Par exemple, un symbole signalant un produit classé très toxique peut être accompagné <strong>de</strong>s<br />
phrases <strong>de</strong> risque R26 (très toxique par inhalation), R27 (très toxique par contact avec la<br />
peau), et R28 (très toxique en cas d’ingestion).<br />
Des conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce peuvent aussi figurer sur l’étiquette : ils sont symbolisés par la<br />
lettre S suivie d’un nombre. Par exemple, on trouvera sur l’étiquette les conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce<br />
S2 (conserver hors <strong>de</strong> portée <strong>de</strong>s enfants), S 20/21 (ne pas manger, boire ou fumer pendant<br />
l'utilisation) et S13 (conserver à l'écart <strong>de</strong>s aliments et boissons y compris ceux pour<br />
animaux).<br />
(voir annexe 13)<br />
2/ Lire les fiches <strong>de</strong> données <strong>de</strong> sécurité<br />
Les fiches techniques et les fiches <strong>de</strong> données <strong>de</strong> sécurité donnent un certain nombre<br />
d’informations sur les propriétés physiques, toxicologiques et environnementales d’un<br />
produit.<br />
Les fiches <strong>de</strong> sécurité doivent être mises à disposition par le fournisseur ; ceci est notamment<br />
possible via Internet sur le site : http://www.quickfds.com/<br />
Les fiches <strong>de</strong> sécurité comprennent les rubriques suivantes :<br />
1- I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> la substance, <strong>de</strong> la préparation et du fournisseur<br />
Nom commercial du produit<br />
Utilisation<br />
Nom et adresse <strong>de</strong> la société (fournisseur)<br />
2- Composition et informations sur les composants<br />
Formulation (poudre mouillable, concentré émulsionnable…)<br />
Substance(s) active(s) et concentration<br />
Concentration et classement toxicologique <strong>de</strong>s différents composants dangereux présents dans<br />
le produit<br />
3- I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s dangers<br />
Toxicologie, effets possibles sur la santé et l’environnement….<br />
4- Premiers secours<br />
Secours à apporter en cas d’acci<strong>de</strong>nt selon le type d’exposition, traitement (avis au<br />
mé<strong>de</strong>cin)…<br />
5- Mesures <strong>de</strong> lutte contre l’incendie<br />
Moyens d’extinction appropriés<br />
Dangers spécifiques dans la lutte contre l’incendie<br />
Equipements spéciaux à porter lors <strong>de</strong> la lutte contre l’incendie…<br />
6- Mesures à prendre en cas <strong>de</strong> dispersion acci<strong>de</strong>ntelle<br />
Conseils pour la protection <strong>de</strong> l’environnement et <strong>de</strong>s personnes en cas <strong>de</strong> dispersion<br />
acci<strong>de</strong>ntelle du produit<br />
Métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nettoyage<br />
7- Manipulation et stockage<br />
CVII
Précautions <strong>de</strong> manipulation et d’entreposage<br />
8- Contrôle <strong>de</strong> l’exposition/protection individuelle<br />
Recommandations concernant les équipements <strong>de</strong> protection<br />
Autres précautions d’hygiène<br />
9- Propriétés physiques et chimiques<br />
Aspect (couleur, forme, o<strong>de</strong>ur)<br />
Point éclair<br />
Inflammabilité<br />
Densité spécifique<br />
Solubilité<br />
PH…<br />
10- Stabilité et réactivité<br />
Décomposition thermique<br />
Description <strong>de</strong>s réactions dangereuses<br />
11- Informations toxicologiques<br />
DL50 orale et <strong>de</strong>rmique<br />
Effets irritants ou sensibilisants<br />
Effets cancérogènes, tératogènes…<br />
12- Informations écologiques<br />
DL50, CL50, ou CE50 pour diverses espèces…<br />
13- Considérations relatives à l’élimination<br />
Précautions relatives à l’élimination <strong>de</strong>s produits et <strong>de</strong>s emballages<br />
14- Informations relatives au transport<br />
Classification <strong>de</strong> la marchandise<br />
15- Informations réglementaires<br />
Notamment classification toxicologique et phrases <strong>de</strong> risque…<br />
16- Autres informations<br />
Eventuelles précisions apportées par le fournisseur.<br />
De plus, <strong>de</strong>s informations concernant les propriétés chimiques, toxicologiques et<br />
écotoxicologiques <strong>de</strong> nombreux produits peuvent être trouvées sur la base agritox <strong>de</strong> l’INRA :<br />
http://www.inra.fr/agritox/ ;<br />
V/ PROTECTION DE L’OPÉRATEUR<br />
L’applicateur du désherbage est la personne la plus exposée aux produits<br />
phytopharmaceutiques lors du traitement. Il est indispensable que l’applicateur se protège lors<br />
<strong>de</strong> la préparation <strong>de</strong> la bouillie et lors <strong>de</strong>s traitements. Les vêtements <strong>de</strong> sécurité doivent être<br />
fournis, entretenus et remplacés par l’employeur, qui doit également veiller à ce qu’ils soient<br />
portés (co<strong>de</strong> du travail, articles R-233-1 et R 233-42 ; décret n°87-361 du 27 mai 1987).<br />
CVIII
Les équipements <strong>de</strong> protection individuelle doivent porter le marquage CE.<br />
- Utiliser une combinaison <strong>de</strong> protection étanche, qui doit répondre aux exigences <strong>de</strong><br />
la norme CE <strong>EN</strong> 468 <strong>de</strong> type 4 (vêtements <strong>de</strong> protection contre les produits chimiques<br />
liqui<strong>de</strong>s, avec <strong>de</strong>s liaisons étanches aux pulvérisations) ;cette combinaison peut être<br />
jetable ou non. Elle doit être portée par-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s vêtements, et au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s bottes<br />
et <strong>de</strong>s gants.<br />
Ces vêtements possè<strong>de</strong>nt ce logo et « type 4 »<br />
- Il faut utiliser un masque spécial, avec filtre (<strong>de</strong>mi-masque jetable ou à cartouches,<br />
masque panoramique ou à cartouches, masque à ventilation assistée ou à adduction<br />
d’air autonome) ; utiliser les cartouches appropriées et vérifier leur date <strong>de</strong><br />
péremption. Pour l’utilisation <strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques, il est recommandé<br />
d’utiliser au minimum un masque à cartouche A2P3 ; les masques à poussière sont<br />
insuffisants.<br />
- Les gants conformes à la norme <strong>EN</strong> 374 sont i<strong>de</strong>ntifiés par le même logo que pour les<br />
combinaisons. On recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong>s gants en nitrile ou en néoprène.<br />
- Les lunettes <strong>de</strong> protection doivent répondre aux exigences <strong>de</strong> la norme CE <strong>EN</strong> 166-<br />
168 <strong>de</strong> type 3 (protection contre les gouttelettes) : le chiffre 3 est gravé sur la monture.<br />
- Les bottes doivent être conformes aux normes CE <strong>EN</strong> 345-346-347 (marquage S5 ou<br />
P5) pour être imperméables aux produits phytopharamceutiques.<br />
- Pendant le traitement<br />
Il est impératif <strong>de</strong> ne pas fumer, manger ou boire durant le traitement, pour éviter une<br />
contamination par ingestion <strong>de</strong> la substance active.<br />
Etre équipé d’une trousse <strong>de</strong> secours, d’un rince l’œil et <strong>de</strong>s fiches techniques et <strong>de</strong>s fiches <strong>de</strong><br />
sécurité <strong>de</strong>s produits.<br />
- Après le traitement<br />
- Rincer dans l’ordre : les gants, puis la combinaison, puis les bottes ;<br />
- Retirer le masque et les cartouches et les ranger (noter le temps d’utilisation) ou éliminer les<br />
saturées, nettoyer et ranger le masque ;<br />
- Retirer la combinaison et la rincer ou la jeter ;<br />
- Retirer les bottes ;<br />
- Oter les gants en les retournant et les faire sécher (ou éliminer les gants jetables).<br />
- Se laver les mains et le visage, prendre une douche.<br />
Les équipements <strong>de</strong> protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoirevestiaire<br />
individuelle <strong>de</strong>stinée à ce seul usage et située dans un local autre que celui servant<br />
au stockage <strong>de</strong>s produits.<br />
VI/ STOCKAGE<br />
Le stockage <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques doit répondre à <strong>de</strong>s conditions particulières.<br />
Certaines <strong>de</strong> ces précautions font même l’objet d’obligations réglementaires.<br />
CIX
1/ Local <strong>de</strong> stockage<br />
De manière générale, le stockage ne doit pas dépasser<br />
- 15 tonnes <strong>de</strong> produits phytosanitaires<br />
- 200 kg <strong>de</strong> produits très toxiques (T+) soli<strong>de</strong>s<br />
- 50 kg <strong>de</strong> produits très toxiques (T+) liqui<strong>de</strong>s<br />
Une dérogation autorise le stockage d’une tonne maximum <strong>de</strong> produits T+ pendant une durée<br />
maximale <strong>de</strong> 10 jours lors d’un chantier <strong>de</strong> traitement. Dans ce cas, les conditions <strong>de</strong> stockage<br />
dépen<strong>de</strong>nt du co<strong>de</strong> du travail (notamment décret n° 87-361 du 27 mai 1987) et du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
santé publique.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces quantités, le stockage relève du régime <strong>de</strong>s installations classées pour la<br />
protection <strong>de</strong> l’environnement (co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement, article 511-1 et suivants).<br />
Les produits phytopharmaceutiques doivent être stockés dans un local phytosanitaire<br />
réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé, fermé à clé et « hors gel ». On doit<br />
y stocker également les matériels <strong>de</strong>stinés aux traitements (articles 4, 5 et 8 du décret n° 87-<br />
361 du 27 mai 1987).<br />
Les produits doivent être conservés dans leur emballage d’origine (article 3 du décret n° 87-<br />
361 du 27 mai 1987), dans les conditions adéquates signalées par les fiches <strong>de</strong> sécurité (R<br />
231-53). Les consignes <strong>de</strong> sécurité et les numéros d’urgence doivent être affichés.<br />
Concernant les risques d’incendie ou d’explosion : un extincteur doit être disposé à proximité<br />
(Article R232-12-17) ; les installations électriques doivent être conformes aux<br />
normes (R232 12-13 ; norme NF-15-100) ; il faut éviter toute source d’ignition, et en<br />
particulier ne pas fumer ; l’interdiction <strong>de</strong> fumer doit être signalée <strong>de</strong> façon conforme<br />
(obligatoire en cas <strong>de</strong> présence <strong>de</strong> substances explosives, combustibles ou extrêmement<br />
inflammables, R232-12-14).<br />
Il doit y avoir à proximité du local <strong>de</strong> stockage une douche, un rince-œil et une armoire à<br />
pharmacie, correctement signalés (R232-1-6).<br />
Par ailleurs, il est recommandé que le sol soit étanche, et que soient à disposition <strong>de</strong>s<br />
matières absorbantes (vermiculite, perlite, litière pour chats…) en cas <strong>de</strong> déversement. Les<br />
produits <strong>de</strong>vraient être isolés du sol et classés par catégorie. Un document <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
stocks <strong>de</strong>vrait être tenu à jour.<br />
CX
Figure 5 : Organisation d’un local <strong>de</strong> stockage<br />
(Source : GRAMIP, groupe régional d'action pour la réduction <strong>de</strong>s pollutions par les<br />
produits phytosanitaires<br />
en Midi-Pyrénées )<br />
1- local fermé à clef spécifique aux produits<br />
phytosanitaires (r)<br />
2- local aéré ou ventilé et frais (r)<br />
3- installation électrique conforme<br />
4- numéro d'appel d'urgence visible et liste <strong>de</strong>s<br />
produits homologués en stock (à jour)<br />
5- sol étanche avec récupération <strong>de</strong>s eaux<br />
6- la marchandise ne touche pas le sol<br />
7- matière absorbantes (sciures, sables...)<br />
8- extincteur tous feux à l'extérieur<br />
9- point d'eau à proximité<br />
(r = réglementaire)<br />
10- local éloigné <strong>de</strong>s habitations<br />
11- interdiction <strong>de</strong> fumer dans le local (r)<br />
12- produits très toxiques dans une armoire<br />
fermée à clé<br />
13- produits rangés par famille<br />
14- équipement <strong>de</strong> sécurité à portée <strong>de</strong><br />
mains (extérieur au local)<br />
15- étagères fixées en matériaux<br />
imperméables<br />
16-stocker les produits dangereux à hauteur<br />
d'homme<br />
17- conserver les produits dans leur<br />
emballage d'origine (r)<br />
2/ Emballages vi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produits phytosanitaires (EVPP)<br />
Les emballages <strong>de</strong> produits phytosanitaires doivent être collectés et valorisés dans une<br />
filière adaptée (directive 98/98 <strong>de</strong> la Commission du 15 décembre 1998, transposée en droit<br />
français par l'arrêté du 27 juin 2000, notamment)<br />
Les emballages vi<strong>de</strong>s peuvent être collectés par la société ADIVALOR 5 ; pour cela, le bidon<br />
doit avoir été rincé : soit le rincer 3 fois <strong>de</strong> façon manuelle (remplir le bidon d’eau claire<br />
jusqu’au tiers, l’agiter pendant 30 secon<strong>de</strong>s, et renouveler l’opération 3 fois), soit le rincer à<br />
l’ai<strong>de</strong> d’un rince-bidon pendant au minimum 30 secon<strong>de</strong>s. En faisant ce rinçage au moment<br />
du remplissage <strong>de</strong> la cuve, les eaux <strong>de</strong> rinçage peuvent être retournées à la cuve, ce qui permet<br />
5 ADIVALOR : 0810 12 18 85<br />
CXI
d’économiser du produit et <strong>de</strong> protéger l’environnement. Egoutter le bidon, conserver le<br />
bouchon à part.<br />
3/ Les produits phytosanitaires non utilisables (PPNU)<br />
Ce sont les produits qui ne sont plus homologués, qui n’ont plus d’étiquette, ou qui ont été<br />
altérés par le temps ou ayant subi un mauvais stockage. Ces PPNU <strong>de</strong>vraient être isolés <strong>de</strong>s<br />
autres produits. Des opérations <strong>de</strong> collecte ont lieu par la société ADIVALOR, qui<br />
revalorise aussi les emballages vi<strong>de</strong>s. A défaut, il est obligatoire d’en assurer ou d’en faire<br />
assurer le traitement (apport à une usine d’incinération ou à une installation classée pour<br />
l’environnement appropriée..)<br />
VII/ LE PULVERISATEUR<br />
1/ L’entretien<br />
Un entretien du pulvérisateur doit être fait avant chaque campagne <strong>de</strong> traitement :<br />
- Enlever les buses et les filtres et les nettoyer à l’eau avec une brosse nylon (une vieille<br />
brosse à <strong>de</strong>nts convient) ; ne pas employer d’objet métallique, ne pas souffler avec la bouche.<br />
Vérifier qu’il n’y a pas d’obstructions. Contrôler le débit <strong>de</strong>s buses, il faut les remplacer si<br />
l’écart est supérieur à 10%.<br />
- Vérifier le treuil et les articulations, les graisser.<br />
- Vérifier la cloche à air : regar<strong>de</strong>r si la membrane est intacte, et si la pression <strong>de</strong> gonflage est<br />
suffisante (1/2 à 1/3 <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> travail)<br />
- Vérifier et calibrer le manomètre (à faire par le fournisseur ou un technicien professionnel)<br />
Un contrôle du pulvérisateur en l’utilisant avec <strong>de</strong> l’eau claire permet <strong>de</strong> détecter les fuites<br />
et <strong>de</strong> vérifier le fonctionnement <strong>de</strong>s buses.<br />
Lors du stockage pour l’hiver, il est préférable <strong>de</strong> graisser les différentes articulations ; le<br />
pulvérisateur doit <strong>de</strong> préférence être conservé hors gel ; le cas échéant, démonter la pompe et<br />
bien vidanger la tuyauterie, ou introduire une solution antigel dans les tuyaux. Le manomètre<br />
doit <strong>de</strong> préférence être conservé hors gel ; les antigouttes peuvent être démontés et conservés<br />
dans un local hors gel dans un récipient d’eau.<br />
Il n’y a pas à ce jour <strong>de</strong> contrôle obligatoire, bien que <strong>de</strong>s discussions soient engagées en ce<br />
sens. Cependant, les professionnels proposent <strong>de</strong>s démarches volontaires auxquelles il est<br />
utile <strong>de</strong> participer.<br />
Penser à se référer au livret d’instruction du pulvérisateur.<br />
2/ L’étalonnage<br />
Il doit être fait à tout changement d’opérateur ou <strong>de</strong> matériel.<br />
- Evaluer le débit <strong>de</strong> la buse (L/min) en la faisant fonctionner avec <strong>de</strong> l’eau claire et en<br />
recueillant l’eau pulvérisée pendant une minute à l’ai<strong>de</strong> d’un pot gradué.<br />
CXII
- Pulvériser <strong>de</strong> l’eau claire au sol en avançant à une vitesse normale pendant une minute, et<br />
évaluer la surface couverte par l’eau au sol. On obtient la surface traitée par minute (m²/min)<br />
Le volume d’eau à appliquer sur la surface à traiter est obtenu en divisant le débit par la<br />
surface traitée en une minute :<br />
Volume débité (L/m²) = débit (L/min) / surface traitée (m²/min)<br />
ou<br />
Volume débité (L/ha) = [débit (L/min) * 10 000] / surface traitée (m²/min)<br />
(car 1 ha= 10 000 m²)<br />
VIII/ LE DOSAGE<br />
La dose homologuée (que l’on trouve sur l’in<strong>de</strong>x phytosanitaire Acta ou sur http://ephy.agriculture.gouv.fr/<br />
) correspond à la dose maximale pouvant être utilisée pour un<br />
usage donné.<br />
La dose doit être adaptée aux circonstances :<br />
- Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s adventices présentes : les adventices à un sta<strong>de</strong> jeune sont généralement<br />
plus sensibles aux herbici<strong>de</strong>s ; <strong>de</strong> plus, les feuilles <strong>de</strong>s adventices plus développées<br />
peuvent protéger les parties basses <strong>de</strong> la plante (effet parapluie)<br />
- Espèces dominantes (pour certaines adventices plus sensibles, une dose réduite <strong>de</strong><br />
produit est suffisante ; voir fiche technique du produit) ; (voir annexe 11)<br />
- Densité <strong>de</strong> l’enherbement : quand l’enherbement est faible, une dose inférieure est<br />
souvent suffisante pour contrôler la végétation.<br />
- Type <strong>de</strong> sol : pour les herbici<strong>de</strong>s racinaires, il est possible d’ajuster la dose en<br />
fonction du sol un herbici<strong>de</strong> aura une durée d’action plus longue dans un sol argileux<br />
(rétention sur le complexe argilo-humique) ; les sols pauvres, comme les sols sableux<br />
(et la plupart <strong>de</strong>s sols urbains) augmentent les risque <strong>de</strong> lessivage et <strong>de</strong> phytotoxicité,<br />
et se prêtent bien au phénomène <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> dose.<br />
- Adjuvants : l’emploi <strong>de</strong> certains adjuvants peut permettre d’augmenter l’efficacité du<br />
produit et <strong>de</strong> diminuer sa dose<br />
Pour connaître la quantité <strong>de</strong> produit à utiliser, il faut évaluer la surface à traiter<br />
(attention, en cas <strong>de</strong> traitement par taches, évaluer seulement la surface enherbée).<br />
Quantité <strong>de</strong> produit = dose (L/m²) * surface à traiter (m²)<br />
ou<br />
Quantité <strong>de</strong> produit = dose (L/ha) * surface à traiter (ha)<br />
Pour connaître le volume <strong>de</strong> bouillie à utiliser, il faut se servir du volume débité calculé lors<br />
<strong>de</strong> l’étalonnage :<br />
Volume (L) = volume débité (L/m²) * surface à traiter (m²)<br />
ou<br />
Volume (L) = volume débité (L/ha) * surface à traiter (ha)<br />
Le matériel utilisé pour le dosage doit être précis et réservé à cet usage.<br />
IX/ LE REMPLISSAGE DE LA CUVE<br />
1/ Eviter les débor<strong>de</strong>ments<br />
Le remplissage <strong>de</strong> la cuve doit impérativement être fait sous la surveillance <strong>de</strong> l’applicateur.<br />
CXIII
La jauge du pulvérisateur doit être bien visible. Certains matériels permettent <strong>de</strong><br />
diminuer les risques <strong>de</strong> débor<strong>de</strong>ment : en particulier, un volucompteur à arrêt automatique<br />
peut couper l’alimentation automatiquement au volume souhaité ; on peut aussi employer un<br />
bulbe <strong>de</strong> trop-plein ou un capteur <strong>de</strong> niveau <strong>de</strong> remplissage relié à une électrovanne….<br />
2/ Eviter les retours vers le système d’alimentation<br />
Il faut empêcher un retour <strong>de</strong> la bouillie dans le réseau ou dans le milieu dans lequel on<br />
prélève (forage, cours d’eau, lac…). Attention, le pompage direct d’eau dans un milieu<br />
naturel est facteur <strong>de</strong> risque, c’est une pratique déconseillée.<br />
- La solution la plus simple et la plus économique consiste à effectuer un remplissage par<br />
surverse : le tuyau <strong>de</strong> remplissage est maintenu au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la cuve par une potence. Il faut<br />
veiller à ce que le tuyau ne pen<strong>de</strong> pas dans la cuve.<br />
- Il est aussi possible d’utiliser certains dispositifs comme les clapets anti-retour. Un<br />
disconnecteur (appareil qui empêche un siphonage <strong>de</strong> la bouillie dans le réseau en cas <strong>de</strong><br />
chute <strong>de</strong> pression) est obligatoire en cas <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment avec un réseau d’eau potable.<br />
- L’emploi d’une cuve intermédiaire permet d’éviter les retours d’eau ; elle permet aussi<br />
<strong>de</strong> gagner du temps lors du remplissage grâce à un plus haut débit. Pour éviter les<br />
débor<strong>de</strong>ments, la cuve <strong>de</strong> remplissage ne doit pas avoir un volume supérieur à la cuve du<br />
pulvérisateur ; l’aménagement d’un flotteur permet d’arrêter le remplissage <strong>de</strong> la cuve<br />
intermédiaire au volume souhaité.<br />
3/ Aire <strong>de</strong> remplissage<br />
Elle doit se trouver le plus près possible <strong>de</strong>s locaux <strong>de</strong> stockage, à l’écart <strong>de</strong>s habitations.<br />
Il est préférable <strong>de</strong> faire le remplissage sur une aire <strong>de</strong> remplissage bétonnée, reliée à un<br />
bassin étanche, qui recueillera les éventuels débor<strong>de</strong>ments. Cette aire <strong>de</strong> remplissage doit<br />
comporter un dispositif séparant les eaux pluviales, <strong>de</strong>s eaux souillées.<br />
En l’absence d’aire bétonnée et isolée, effectuer le remplissage sur une surface <strong>de</strong><br />
préférence enherbée, non connectée à un point d’eau.<br />
4/ Incorporation<br />
L’étiquette du produit donne souvent <strong>de</strong>s précisions sur la marche à suivre pour<br />
l’incorporation du produit. De façon générale, pour les produits liqui<strong>de</strong>s, emplir la cuve<br />
jusqu’au tiers du volume souhaité; verser le produit et compléter le remplissage.<br />
L’utilisation d’un incorporateur permet <strong>de</strong> limiter le contact avec le produit concerné.<br />
> Dans le cas d’un mélange :<br />
- Un mélange <strong>de</strong> produits phytopharmaceutiques consiste à associer dans le cadre <strong>de</strong>s<br />
pulvérisations plusieurs spécialités phytopharmaceutiques. Ces spécialités doivent<br />
obligatoirement bénéficier, préalablement à une utilisation en mélange, d’une<br />
homologation en bonne et due forme à titre individuel et d’une inscription sur une liste<br />
provisoire pour le mélange extemporané.<br />
- Vérifier sur l’étiquetage <strong>de</strong>s produits qu’il n’y a pas été noté d’incompatibilité à<br />
réaliser le mélange.<br />
CXIV
- Respecter <strong>de</strong> manière générale l’ordre suivant d’introduction <strong>de</strong>s produits en fonction<br />
<strong>de</strong> leur formulation :<br />
• En premier : les sachets hydrosolubles (puis attendre leur dissolution<br />
complète)<br />
• SC puis EC (SC : suspension concentrée, EC : émulsion concentrée)<br />
• SL puis EC (SL : concentré soluble)<br />
• SC puis WP (déjà dilué dans <strong>de</strong> l’eau) (WP : poudre mouillable)<br />
• SL puis WP (déjà dilué dans <strong>de</strong> l’eau)<br />
• WP puis EC au <strong>de</strong>rnier moment en agitant (souvent <strong>de</strong>s problèmes).<br />
- Il faut éviter les mélanges incluant <strong>de</strong>s produits microcapsulés (EC) : risque <strong>de</strong><br />
détruire les microcapsules.<br />
- Faire un test dans un récipient à moitié rempli d’eau en ajoutant successivement les<br />
produits à mélanger (respecter les proportions d’utilisation), agiter et laisser reposer<br />
environ un quart d’heure ; si le produit qui en résulte est instable, non uniforme ou a<br />
pris en masse : bannir ce mélange.<br />
- Les autres conditions d’utilisation <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s produits doivent être également<br />
compatibles : type <strong>de</strong> matériel d’application et <strong>de</strong> buses, volume et pression <strong>de</strong><br />
pulvérisation, taille <strong>de</strong>s gouttes …<br />
X/ PRECAUTIONS A PR<strong>EN</strong>DRE LORS DU TRAITEM<strong>EN</strong>T<br />
1/ Conditions météorologiques<br />
Le traitement ne sera efficace que s’il est effectué dans <strong>de</strong> bonnes conditions<br />
météorologiques :<br />
- Une pluie survenant trop rapi<strong>de</strong>ment (quelques jours) après le traitement lessivera<br />
l’herbici<strong>de</strong>, ce qui entraînera une contamination <strong>de</strong>s eaux superficielles et rendra le<br />
traitement inefficace<br />
- Une chaleur trop forte augmentera les risques <strong>de</strong> volatilisation, tout particulièrement<br />
sur zone imperméable. La température doit être <strong>de</strong> préférence comprise entre 5 et<br />
20°C.<br />
- Un vent supérieur à un <strong>de</strong>gré 2 sur l’échelle <strong>de</strong> Beaufort (6-11 km/h) au moment du<br />
traitement causera <strong>de</strong>s risques importants <strong>de</strong> dérive, entraînant <strong>de</strong>s risques pour<br />
l’applicateur, le public, et les cultures ornementales proches.<br />
- Il est préférable <strong>de</strong> traiter avec une hygrométrie <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 60%, le matin ou en soirée ;<br />
en effet, un temps trop sec augmente la volatilisation.<br />
Il est donc important <strong>de</strong> consulter les services météorologiques avant le traitement pour<br />
connaître le temps qu’il fera au moment du traitement et dans les 5 jours suivants : traiter<br />
sans pluie, sans vent, et en évitant les fortes chaleurs.<br />
2/ Respecter les résultats <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> risque<br />
Respecter les zones <strong>de</strong> non-traitement et les zones sensibles i<strong>de</strong>ntifiées lors <strong>de</strong> l’analyse<br />
<strong>de</strong> risque (proximité <strong>de</strong> locaux et d’habitations, zones connectées à un point d’eau, végétation<br />
ornementale …). Traiter uniquement les zones i<strong>de</strong>ntifiées lors du diagnostic ; veiller à ne<br />
CXV
pas repasser <strong>de</strong>ux fois au même endroit. Respecter les distances <strong>de</strong> zones non traitées<br />
signalées sur l’étiquette du produit.<br />
3/ Enregistrer les pratiques<br />
Enregistrer sur une fiche-type la date, la localisation du chantier, les conditions<br />
météorologiques, le produit et la dose employée, les noms <strong>de</strong>s opérateurs, la surface traitée, la<br />
quantité <strong>de</strong> produit utilisé, la vitesse d’avancement et la pression, les observations diverses…<br />
XI/ GESTION DES EFFLU<strong>EN</strong>TS<br />
1/ Fonds <strong>de</strong> cuve<br />
Si l’estimation <strong>de</strong> la surface et le calcul <strong>de</strong> la quantité <strong>de</strong> produit nécessaire ont été faits<br />
correctement, le fond <strong>de</strong> cuve <strong>de</strong>vrait être très faible. Bien le diluer avec <strong>de</strong> l’eau (ajouter un<br />
volume d’eau propre égal à au moins 5 fois le volume résiduel) et repasser sur la surface<br />
traitée ou sur une surface à traiter. Ne JAMAIS vidanger un fonds <strong>de</strong> cuve sur une surface<br />
imperméable, dans un égout, ou un cours d’eau : cette pratique est strictement interdite et<br />
extrêmement préjudiciable à l’environnement.<br />
2/ Eaux <strong>de</strong> rinçage<br />
La cuve et la tuyauterie doivent être rincées après chaque traitement.<br />
Les eaux <strong>de</strong> rinçage contiennent <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s dilués. Le rinçage doit donc être effectué<br />
sur une surface à faible risque ; cela peut se faire sur une plate-forme <strong>de</strong> remplissage<br />
conçue aussi pour le rinçage.<br />
3/ Gestion <strong>de</strong>s eaux souillées stockées par la plate-forme <strong>de</strong> remplissage<br />
Il existe <strong>de</strong>s solutions actuellement à l’étu<strong>de</strong> pour le retraitement <strong>de</strong>s eaux polluées :<br />
- bacs <strong>de</strong> décantation-évaporation<br />
- traitements physico-chimiques (coagulation et déshuilage)<br />
- dégradation biologique par <strong>de</strong>s bactéries<br />
- photocatalyse (dégradation à la lumière en présence <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> titane)<br />
- électrolyse …<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> ces cas, les eaux souillées peuvent aussi être reprises par une société<br />
spécialisée en déchets toxiques.<br />
CXVI
XII/ TECHNOLOGIES FACILITANT LE <strong>DESHERBAGE</strong> CHIMIQUE<br />
1/ Pompes doseuses<br />
Il existe sur le marché <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> pompes doseuses, qui effectuent le mélange au fur et<br />
à mesure <strong>de</strong> la pulvérisation. Ce type <strong>de</strong> matériel offre <strong>de</strong> multiples avantages :<br />
- Le remplissage <strong>de</strong> cuve se fait à l’eau<br />
claire ; la manipulation <strong>de</strong>s produits est réduite,<br />
permettant une meilleure sécurité <strong>de</strong><br />
l’applicateur ; ceci permet aussi <strong>de</strong> minimiser les<br />
risques <strong>de</strong> débor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> bouillie ou <strong>de</strong> retour<br />
dans le système d’alimentation lors du<br />
24 : Pompe doseuse adaptée sur un<br />
appareil <strong>de</strong> la DDE<br />
remplissage ;<br />
- Plus <strong>de</strong> problème <strong>de</strong> fond <strong>de</strong> cuve à<br />
gérer ; le mélange se fait au fur et à mesure,<br />
selon les besoins ;<br />
- Pas <strong>de</strong> nettoyage <strong>de</strong> la cuve ; il suffit, 2 à<br />
3 minutes avant la fin du traitement, <strong>de</strong><br />
remplacer les bidons <strong>de</strong> produit par <strong>de</strong>s bidons<br />
d’eau pour nettoyer le circuit ;<br />
- Bonne maîtrise du dosage.<br />
Exemple : Dosatron® ; plus d’informations sur http://www.dosatron.com/<br />
2/ Détection automatique <strong>de</strong>s adventices<br />
Ces appareils permettent une détection automatique <strong>de</strong>s adventices afin <strong>de</strong> cibler précisément<br />
les traitements chimiques foliaires.<br />
Un capteur à infrarouge détecte les adventices grâce à leur chlorophylle et déclenche<br />
automatiquement les vannes au moment où elles passent sur les adventices détectées.<br />
Ceci automatise les traitements par taches, et permet <strong>de</strong> n’utiliser que la quantité minimale<br />
d’herbici<strong>de</strong>.<br />
Exemple : Weedseeker® ; plus d’information sur http://www.ntechindustries.com/<br />
3/ Détection automatique <strong>de</strong>s équipements<br />
Dans certains cas, le désherbage se fait surtout au pied <strong>de</strong> certains équipements, comme le<br />
long <strong>de</strong>s routes, où ceux sont surtout les pieds <strong>de</strong> panneaux qui sont traités.<br />
Il est possible <strong>de</strong> monter un système qui détecte les pieds <strong>de</strong> panneaux et déclenche les buses<br />
au moment où elles passent <strong>de</strong>vant le panneau ; ce système est utilisé par la DDE <strong>de</strong><br />
l’Aveyron.<br />
CXVII
CONCLUSION<br />
25 Technique <strong>de</strong> détection employée par la DDE <strong>de</strong> l’Aveyron<br />
Le désherbage chimique reste souvent la solution la plus applicable et la plus efficace.<br />
Cependant, il implique la manipulation <strong>de</strong> produits toxiques : un certain nombre <strong>de</strong><br />
précautions sont indispensables (et souvent obligatoires) pour protéger la santé <strong>de</strong>s<br />
utilisateurs, du public, et <strong>de</strong> l’environnement. Le désherbage chimique doit être utilisé <strong>de</strong><br />
façon raisonnée, en fonction <strong>de</strong>s éléments dégagés lors <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> risque. Il convient <strong>de</strong><br />
limiter autant que possible les quantités employées, notamment en adaptant les dosages à la<br />
végétation.<br />
CXVIII
BIBLIOGRAPHIE<br />
Achard J, 2005 - Comparaison d'efficacité entre plusieurs techniques <strong>de</strong> désherbage<br />
thermique (Waïpuna, Aquaci<strong>de</strong>, brûleurs à gaz), ainsi que le produit UKS100 (huile <strong>de</strong><br />
citronnelle), par rapport à celle d'un programme <strong>de</strong> référence avec <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s ; Compterendu<br />
d'essai officiel (essai ML04171, thème MZPJPJ604). 34p<br />
Angoujard G., Gaigeard W., Blanchet P., 1999 – Désherbage non agricole : Techniques<br />
alternatives <strong>de</strong> désherbage en zone urbaine (surfaces imperméabilisées). Etu<strong>de</strong> Corpep 99/12.<br />
Bretagne Eau Pure. 26p.<br />
Angoujard G., Le Go<strong>de</strong>c N., Blanchet P., Lefevre L., 2001a - Etu<strong>de</strong> sur un mini bassin<br />
versant expérimental urbain, sur béton et compacté sablé in 18èmes conférences du Columa,<br />
Journées Internationales <strong>de</strong> la Lutte contre les Mauvaises Herbes, les 5,6 et 7 décembre 2001<br />
(Toulouse)<br />
Angoujard G., Le Go<strong>de</strong>c N., Blanchet P., Lefevre L., 2001b - Techniques alternatives au<br />
désherbage chimique en zone urbaine. in 18èmes conférences du Columa, Journées<br />
Internationales <strong>de</strong> la Lutte contre les Mauvaises Herbes, les 5,6 et 7 décembre 2001<br />
(Toulouse)<br />
Ascar J,1995 - Effects of flame weeding on weed species at different <strong>de</strong>velopmental stages.<br />
Weed research 35, 377-411.<br />
Balandier P., 2004 - Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s interactions arbre-végétation herbacée ou arbustive :<br />
compétition pour les ressources du milieu et conséquences en termes <strong>de</strong> gestion. Rapport en<br />
vue <strong>de</strong> l’obtention d’une Habilitation à Diriger <strong>de</strong>s Recherches présenté le 29 septembre<br />
2004 ; 180 p.<br />
Bannink A.D., 2004 - How Dutch drinking water production is affected by the use of<br />
herbici<strong>de</strong>s on pavements. Water Sciences and Technologies (3), 49, 173-181.<br />
Boulet A., 2005 – Lutte contre la pollution <strong>de</strong>s eaux par les pestici<strong>de</strong>s utilisés en zones non<br />
agricoles : analyse et synthèse <strong>de</strong>s actions engagées et recommandations. Mémoire <strong>de</strong> fin<br />
d’étu<strong>de</strong>s, soutenu à l’INA-Paris Grignon, 54 p.<br />
Bretagne Eau Pure, 2004 – Etables-sur-mer : les accotements reverdissent. La Lettre <strong>de</strong><br />
Bretagne Eau Pure, 15, p2.<br />
Chauvel G., Gilles A., Bourgouin B., Larroque T., Monriozes L., Pomies C., Bataillon<br />
C., 2001 – Les transferts vers les eaux superficielles d’herbici<strong>de</strong>s utilisés dans les cimetières :<br />
importance et facteurs favorisants in 18èmes conférences du Columa, Journées Internationales<br />
<strong>de</strong> la Lutte contre les Mauvaises Herbes, les 5,6 et 7 décembre 2001 (Toulouse)<br />
Corpen (Comité d’Orientation pour la Réduction <strong>de</strong> la Pollution <strong>de</strong>s Eaux par les<br />
Nitrates, les Phosphates et les produits phytosanitaires provenant <strong>de</strong>s zones agricoles),<br />
1999 - Désherbage : éléments <strong>de</strong> raisonnement pour une maîtrise <strong>de</strong>s adventices limitant les<br />
risques <strong>de</strong> pollution <strong>de</strong>s eaux par les produits phytosanitaires, Groupe Phytoprat, 162p.<br />
CXIX
Corpep, 2002 – Plan <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s espaces communaux : Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en place et<br />
préconisations et Consignes. Bretagne Eau Pure, 21p.<br />
Dours O., 2004a – appréhen<strong>de</strong>r la date optimale d’intervention en situation PJT : Zones non<br />
cultivées*aquacid : eau chau<strong>de</strong> PJT, réduction <strong>de</strong> dose pour Kid allées 2 (comparer à la<br />
référence (EPSILON à la dose <strong>de</strong> 0.2 kg/ha + ROUNDUP BIOVERT DT à la dose <strong>de</strong><br />
0.5L/hL) différentes stratégies <strong>de</strong> désherbage (réduction <strong>de</strong> doses) pour Kid allées 2 et<br />
métho<strong>de</strong>s alternatives en Zone PJT selon le taux <strong>de</strong> salissement). Compte-rendu d’essai<br />
officiel en date du 06-02-04, essai (ML03099) à Ramonville Saint Agne, libellé du thème :<br />
MZPJPJ103, 31p.<br />
Dours O., 2004b – appréhen<strong>de</strong>r la date optimale d’intervention en situation PJT : Zones non<br />
cultivées*aquacid : eau chau<strong>de</strong> PJT, Intérêt et faisabilité <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> dose <strong>de</strong> diuron.<br />
(comparer à la référence (EPSILON à la dose <strong>de</strong> 0.2 kg/ha + ROUNDUP BIOVERT DT à la<br />
dose <strong>de</strong> 0.5L/hL) différentes stratégies <strong>de</strong> désherbage (réduction <strong>de</strong> doses) pour Canyon et<br />
métho<strong>de</strong>s alternatives en Zone PJT selon le taux <strong>de</strong> salissement). Compte-rendu d’essai<br />
officiel en date du 06-02-04, essai (ML03320) à Ramonville Saint Agne, libellé du thème :<br />
MZPJPJ103, 19p.<br />
Groupe <strong>de</strong> travail Zones Non Agricoles <strong>de</strong> l’ANPP, 1999 – Traitements raisonnés : bien<br />
gérer les herbici<strong>de</strong>s dans les espaces non agricoles. Phytoma, 518, 37-40.<br />
Hansson D., 2002 – Hot Water Weed control on Hard surface Areas; doctoral thesis,<br />
Swedish university of Agricultural Sciences in Acta universitatis agriculturae agraria, 323,<br />
34p.<br />
Hatey L., 2003 - Etu<strong>de</strong> sur les techniques alternatives utilisables en milieu urbain (inventaire<br />
<strong>de</strong>s brevets internationaux) ; http://www.zones-non-agricoles.com/web/brevet1/rap.htm,<br />
(<strong>de</strong>rnière consultation le 6/12/2005)<br />
Hatey L. et Bras C., 2004 - Nouvelle technique alternative <strong>de</strong> désherbage "Waïpuna", in<br />
19èmes conférences du Columa, Journées Internationales <strong>de</strong> la Lutte contre les Mauvaises<br />
Herbes, les 8, 9 et 10 décembre 2004 (Dijon)<br />
Hüskes R. et Levsen K., 1997 - Pestici<strong>de</strong>s in rain. Chemosphere (12), 35, 3013-3024.<br />
Ifen, 2004 – Les pestici<strong>de</strong>s dans les eaux, sixième bilan annuel (données 2002). Ifen, Etu<strong>de</strong>s<br />
et Travaux ,42, 33p.<br />
Jackson R. J., Rubin C. H., McGeehin M., 2000 – Sensitive Population Groups. Handbook<br />
of Pestici<strong>de</strong> Toxicology, 1, 783-798.<br />
Kortenhoff A., Kempenaar C., Lotz L.A.P., Beltman W. et <strong>de</strong>n Boer L., 2001- Rational<br />
Weed Management on hard surfaces; phase I – Further i<strong>de</strong>ntification of objectives and<br />
elements that should be part of a DSS and Certification System. Note 69A, Plant Research<br />
International, Wageningen, 37p.<br />
Kruger W., Völkel G., 2001 - Wildkrautbeseitigung auf kommunalen Flächen. (Désherbage<br />
sur les surfaces communales)<br />
http://www.weedcleaner.<strong>de</strong>/Bericht%20HDLGN.htm (<strong>de</strong>rnière consultation le 6/12/2005)<br />
CXX
Lig’air, 2001 - Les pestici<strong>de</strong>s en milieu atmosphérique : Etu<strong>de</strong> en région centre (France).<br />
Lig’Air, Réseau <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’Air en Région Centre, 57p.<br />
Llados S., 2003 - Inventaire <strong>de</strong> la flore adventice en milieu urbain. Mémoire <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong>s,<br />
soutenu à l’<strong>EN</strong>SA Montpellier, 25 p.<br />
Menozzi M-J, 2004 - L’homme, la mauvaise herbe et la ville, in Deuxièmes rencontres<br />
régionales sur la lutte biologique en ville : une nouvelle approche du désherbage en milieu<br />
urbain et péri-urbain, Arteb Rhône-Alpes, 4-8.<br />
Nishioka M. G., Lewis R. G., Brinkman M. C., Burkhol<strong>de</strong>r H. M., Hines C. E.,<br />
Menkedick J. R., 2001 - Distribution of 2,4-D in Air and on Surfaces insi<strong>de</strong> Resi<strong>de</strong>nces after<br />
Lawn Applications: Comparing Exposure Estimates from Various Media for Young Children.<br />
Environmental Health Perspectives (11), 109, 1985-1191<br />
Northwest Coalition for Alternatives to Pestici<strong>de</strong>s, 2000 – Unthinkable Risk : How<br />
children are exposed and harmed when pestici<strong>de</strong>s are used at school.<br />
http://www.pestici<strong>de</strong>.org/UnthinkableRisk.html (<strong>de</strong>rnière consultation le 6/12/2005)<br />
Picard B., 2005a – Désherbage thermique : le choix <strong>de</strong>s armes. PHM, 472, p14-18<br />
Picard B., 2005b – Désherbage thermique : l’offre <strong>de</strong> 5 constructeurs. PHM, 475, p 40-46<br />
Pynson B., 2005 – La flore colonisant les structures bâties à valeur patrimoniale. Mémoire <strong>de</strong><br />
fin d’étu<strong>de</strong>s, soutenu à l’INA-Paris Grignon, 35 p.<br />
Quarles W., 2001 - Improved Hot water weed control system : IPM Practitioner, XXIII (1),<br />
p1-4; http://www.waipuna.com/releases/JAN2001.PDF (<strong>de</strong>rnière consultation le 6/12/2005)<br />
Saft R.J., Staats N., 2002 - Beslisfactoren voor onkruidbestrijding op verhardingen; 'Lca,<br />
risico-analyse, kostenanalyse en hin<strong>de</strong>rbelevering' (Facteurs décisionnels pour le désherbage<br />
<strong>de</strong>s revêtements minéraux) ; 79 p<br />
Siebers J., Gottschield D. et Nolting H-G, 1994 - Pestici<strong>de</strong>s in precipitations in Northern<br />
Germany. Chemosphere (8), 28, 1559-1570<br />
Unsworth, Wauchope, Klein, Dorn, Zeeh, Yeh, Akerblom, Racke et Rubin, 1999 -<br />
Significance of the long range transport of pestici<strong>de</strong>s in the atmosphere. Pure and Applied<br />
Chemistry, 71, 1359-1383.<br />
Van <strong>de</strong>r Werf H.M.G., 1997 - Evaluer l'impact <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s sur l'environnement. Courrier<br />
<strong>de</strong> l’Environnement n°31, INRA, p5-22.<br />
Van<strong>de</strong>rlin<strong>de</strong>n L., Clark K., Ursitti F., Gingrich S., Campbell M., 2002- Lawn and Gar<strong>de</strong>n<br />
Pestici<strong>de</strong>s : A review of Human Exposure and Health Effects Research. Basrur S. V., Toronto<br />
Public Health, 71p.<br />
CXXI
Vigneault, C. et D. Benoît, 2000 - Electrocution <strong>de</strong>s mauvaises herbes: théorie et<br />
électrocution, pp.183-197 In C. Vincent, B. Panneton et F. Fleurat-Lessard (Eds.) La lutte<br />
physique en phytoprotection, INRA Editions, Paris, 347 p.<br />
Young S.L., 2003 – Exploring alternative methods for vegetation control and maintenance<br />
along roadsi<strong>de</strong>s. Final report for California Department of Transportation. Disponible sur<br />
http://teamarundo.org/control_manage/docs/alt_veg_control_2003.pdf (<strong>de</strong>rnière consultation<br />
le 6/12/2005)<br />
Zadjian E., 2004 - Nuisances <strong>de</strong>s mauvaises herbes et propositions <strong>de</strong> seuils d’intervention<br />
pour le désherbage en zone urbaine. Mémoire <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong>s, soutenu à l’<strong>EN</strong>SA Montpellier,<br />
37 p.<br />
Crédits photographiques<br />
Adrien Boulet : photo 8<br />
Hélène Charpentier : photo 11<br />
Stéphanie Hamon : photos 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25<br />
Emilie Zadjian : photos 1, 2, 3, 4, 7, 13<br />
CXXII
Table <strong>de</strong>s annexes<br />
Annexe 1 : Indice <strong>de</strong> nuisance <strong>de</strong>s adventices pouvant être rencontrées<br />
en zones non agricoles…………………………………………………………..…………………pII<br />
Annexe 2 : Adventices faisant l’objet <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> lutte particulières………………….…pXV<br />
Annexe 3 : Cycles biologiques <strong>de</strong>s adventices pouvant être rencontrées<br />
en zones non agricoles …………………………………………...……………………………pXVII<br />
Annexe 4 : Seuils d’intervention préconisés pour le désherbage en ville ...………….pXXXIII<br />
Annexe 5 : Sites protégés……………………………………………………….……….p XXXVII<br />
Annexe 6 : Types <strong>de</strong> symptômes <strong>de</strong> phytotoxicité pouvant être<br />
causés par certains herbici<strong>de</strong>s sur les arbres et arbustes d’ornement…………….….…….pXL<br />
Annexe 7 : Critères <strong>de</strong> choix pour les plantes ornementales pouvant<br />
être utilisées comme couvre-sols…………………………………………………….……..….pXLII<br />
Annexe 8 : Critères <strong>de</strong> choix pour les paillages…………………………..………………. .pXLVI<br />
Annexe 9 : Critères <strong>de</strong> choix pour les espèces à gazon…………………………..………….pL<br />
Annexe 10 : Propriétés physico-chimiques influant les transferts <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
toxicologie et écotoxicologie <strong>de</strong> ces produits …………………………..……………………...pLII<br />
Substances actives holomoguées DT-PJT…………………………..……………………….pLVII<br />
Substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s gazons………………………….pLIX<br />
Substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s<br />
arbres et arbustes d’ornement……………………….…………………………………………...pLXII<br />
Substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s cultures florales……………...pLXV<br />
Annexe 11 : Efficacité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sur diverses adventices pouvant<br />
être rencontrées en zone non agricole………….………………………..………………….pLXVII<br />
Substances actives holomoguées DT-PJT …………………………………………….…....pLXVIII<br />
Substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s gazons………………………pLXXIII<br />
Substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s<br />
arbres et arbustes d’ornement..………………………………………………………………..pLXXV<br />
Annexe 12 : Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s pour différentes plantations ornementales..….pLXXIX<br />
Sélectivité <strong>de</strong>s substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s<br />
arbres et arbustes d’ornement pour différentes espèces <strong>de</strong> ligneux<br />
à feuilles caduques……………………………………….....…………………………pLXXX<br />
Sélectivité <strong>de</strong>s substances actives holomoguées pour le désherbage <strong>de</strong>s<br />
arbres et arbustes d’ornement pour différentes espèces <strong>de</strong> conifères…...……pLXXXIV<br />
Sélectivité <strong>de</strong> certaines substances actives holomoguées DT-PJT<br />
pour différentes espèces d’arbres à feuilles caduques…………….……………pLXXXV<br />
Sélectivité <strong>de</strong> certaines substances actives holomoguées DT-PJT<br />
pour différentes espèces d’arbustes…………….…………………………………pLXXXVI<br />
Sélectivité <strong>de</strong> certaines substances actives holomoguées DT-PJT<br />
pour différentes espèces <strong>de</strong> confières…………….………………………………pLXXXVI<br />
Annexe 13 : Phrases <strong>de</strong> risque et conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce indiqués sur<br />
les étiquettes <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques…………………………………….….pLXCI<br />
CXXIII
Annexe 1<br />
Indice <strong>de</strong> nuisance <strong>de</strong>s adventices pouvant être rencontrées en zones non agricoles<br />
D’après Emilie Zadjian, 2004<br />
CXXIV
Espèce<br />
Résultats<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV<br />
Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Achillea millefolium L. XX 3 3 6 3 0 0 0 0 9<br />
Achillea nobilis L. X 5 4 9 3 1 0 0 0 13<br />
Aegopodium podagraria L. X 4 3 7 0 0 1 1 0 9<br />
Agrostis capillaris L. XX 3 4 7 2 0 0 0 0 9<br />
Agrostis stolonifera L. XXX 4 4 8 2 0 0 0 1 11<br />
Aira caryophyllea L. X 3 4 7 2 0 0 0 0 9<br />
Aira praecox L. X 1 1 2 2 0 0 0 0 4<br />
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Gran<strong>de</strong> XX 5 4 9 0 0 0 0 1 10<br />
Allium polyanthum Schultes & Schultes fil. in Roemer & XX<br />
Schultes<br />
5 4 9 0 0 0 0 0 9<br />
Allium vineale L. X 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Alopecurus myosuroi<strong>de</strong>s Hudson XX 4 4 8 5 0 0 0 0 13<br />
Amaranthus albus L. X 5 4 9 2 0 1 0 0 12<br />
Amaranthus blitum L. X 3 3 6 2 0 0 0 0 8<br />
Amaranthus <strong>de</strong>flexus L. XXX 5 4 9 2 0 0 0 1 12<br />
Amaranthus retroflexus L. XX 4 5 9 2 0 0 0 0 11<br />
Ambrosia artemisiifolia L. local 3 3 6 5 0 0 0 0 11<br />
Anagallis arvensis L. XXX 3 3 6 0 1 0 0 0 7<br />
Andryala integrifolia L. X 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Angelica sylvestris L. X 5 4 9 0 0 3 0 0 12<br />
Anthemis arvensis L. X 2 1 3 3 0 0 0 0 6<br />
Anthemis cotula L. X 2 2 4 3 0 0 0 0 7<br />
Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum L. X 3 1 4 2 0 0 0 0 6<br />
Anthoxantum odoratum L. X 3 1 4 2 0 0 0 0 6<br />
Apera spica-venti (L.) P. Beauv. X 4 3 7 2 0 0 0 1 10<br />
Aphanes arvensis L. X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh. XXX 4 3 7 0 0 0 0 1 8<br />
Arctium lappa L. X 4 5 9 3 1 1 0 0 14<br />
Arenaria serpyllifolia L. XXX 2 3 5 0 0 0 0 1 6<br />
Argemone mexicana L. X 2 1 3 0 0 1 0 0 4<br />
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & X 5 5 10 0 0 0 0 0 10<br />
CXXV
Martens<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P. Beauv. X 5 5 10 0 0 0 0 0 10<br />
Artemisia annua L. X 1 1 2 3 1 1 0 0 7<br />
Artemisia vulgaris L. XXX 5 5 10 4 0 0 0 1 15<br />
Arum maculatum L. X 4 4 8 0 2 1 0 0 11<br />
Asparagus officinalis L. X 5 4 9 0 3 0 0 0 12<br />
Atriplex patula L. XX 4 4 8 2 0 0 0 0 10<br />
Atriplex prostata Boucher ex DC. in Lam. & DC. X 3 3 6 2 0 0 0 0 8<br />
Avena barbata Link. X 5 5 10 4 0 1 0 0 15<br />
Avena fatua L. X 4 4 8 4 0 1 0 0 13<br />
Avena sterilis subsp. sterilis L. X 3 2 5 4 0 1 0 0 10<br />
Avenula pubescens (Hudson) Dumort. X 5 4 9 4 0 0 0 0 13<br />
Barbarea vulgaris R. Br. in Aiton fil. X 4 3 7 0 0 0 0 0 7<br />
Bellis perennis L. XXX 3 3 6 3 0 0 0 0 9<br />
Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton X 3 2 5 0 2 3 0 0 10<br />
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. X 3 3 6 2 0 0 0 0 8<br />
Brassica napus L. XX 5 5 10 3 0 0 0 1 14<br />
Brassica nigra (L.) Koch in Röhling X 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham in Clapham al. X 4 2 6 3 0 0 0 0 9<br />
Bromus catharticus Vahl X 4 4 8 5 0 0 0 0 13<br />
Bromus diandrus Roth X 3 3 6 5 0 0 0 0 11<br />
Bromus erectus Hudson X 5 2 7 5 0 0 0 0 12<br />
Bromus hor<strong>de</strong>aceus L. XX 5 4 9 5 0 0 0 0 14<br />
Bromus madritensis L. X 4 4 8 5 0 0 0 0 13<br />
Bromus rubens L. X 2 1 3 5 0 0 0 0 8<br />
Bromus sterilis L. XXX 5 5 10 5 0 1 0 1 17<br />
Bromus tectorum L. X 4 4 8 5 0 0 0 0 13<br />
Bryonia dioica Jacq. XX 5 4 9 0 3 3 1 0 16<br />
Buddleja davidii Franchet XXX 5 5 10 0 1 0 0 3 14<br />
Calamintha ascen<strong>de</strong>ns Jordan X 1 3 4 0 0 0 0 0 4<br />
Calamintha nepeta (L.) Savi X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
CXXVI
Calendula arvensis L. X 2 3 5 3 0 0 0 0 8<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Calystegia sepium (L.) R. Br. XX 1 3 4 0 2 1 1 3 11<br />
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. XXXX 4 4 8 0 0 0 0 1 9<br />
Cardamine hirsuta L. XXXX 4 4 8 0 0 0 0 3 11<br />
Cardamine impatiens L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Cardaria draba (L.) Desv. X 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Carduus pycnocephalus L. X 2 4 6 3 0 3 1 0 13<br />
Carex divulsa Stokes in With. X 3 3 6 3 0 1 0 1 11<br />
Carex pendula Hudson X 3 5 8 3 0 1 0 0 12<br />
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard in Dony XX 2 4 6 2 0 0 0 0 8<br />
Centaurea jacea L. X 4 4 8 3 0 0 0 0 11<br />
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
Cerastium arvense L. X 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Cerastium fontanum Baumg. XX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Cerastium glomeratum Thuill. XXXX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Chaenorrhinum minus (L.) Lange in Willk. & Lange XXX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Chelidonium majus L. XXX 4 4 8 0 2 1 1 3 15<br />
Chenopodium album L. XXX 5 5 10 3 0 0 0 1 14<br />
Chenopodium polyspermum L. XX 2 3 5 2 0 0 0 0 7<br />
Chondrilla juncea L. XX 5 5 10 3 0 0 0 1 14<br />
Cirsium arvense (L.) Scop. XXX 5 5 10 3 0 1 0 0 14<br />
Cirsium vulgare (Savi) Ten. XXX 5 5 10 3 0 1 0 0 14<br />
Clematis vitalba L. XXX 5 4 9 0 0 1 1 3 14<br />
Coincya monensis (L.) Greuter & Bur<strong>de</strong>t in Greuter & Raus X 4 3 7 0 0 0 0 0 7<br />
Conium maculatum L. X 5 5 10 0 2 1 1 0 14<br />
Consolida regalis S. F. Gray X 3 3 6 0 2 0 0 0 8<br />
Convallaria majalis L. X 2 1 3 0 3 0 1 0 7<br />
Convolvulus arvensis L. XXX 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Conyza cana<strong>de</strong>nsis (L.) Cronquist XXXX 4 4 8 3 0 0 0 3 14<br />
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker XXXXX 5 5 10 3 0 0 0 3 16<br />
Coronopus didymus (L.) Sm. XXX 2 4 6 0 0 0 0 0 6<br />
CXXVII
Crepis biennis L. X 3 3 6 3 0 0 0 0 9<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodant<br />
es<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Crepis bursifolia L. XX 4 3 7 3 0 0 0 0 10<br />
Crepis capillaris (L.) Wallr. XXX 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Crepis foetida L. X 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Crepis sancta (L.) Bornm. XXX 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Crepis setosa Haller fil. X 5 5 10 3 0 0 0 1 14<br />
Crepis vesicaria subsp taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & XXX<br />
R. Keller<br />
5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Cymbalaria muralis G. Gaertner, B. Meyer & Scherb. XXX 2 4 6 0 1 0 0 3 10<br />
Cynodon dactylon (L.) Pers. XX 2 4 6 2 0 0 0 0 8<br />
Dactylis glomerata L. X 5 4 9 5 0 0 0 0 14<br />
Datura stramonium L. X 5 5 10 0 3 1 0 0 14<br />
Daucus carota L. XXX 5 5 10 0 0 1 0 0 11<br />
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. X 5 2 7 0 0 0 0 0 7<br />
Dianthus armeria L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Dianthus barbatus L. X 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. XXX 4 5 9 2 0 0 0 1 12<br />
Diplotaxis muralis (L.) DC. X 2 1 3 0 0 0 0 1 4<br />
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. XX 5 5 10 0 0 0 0 1 11<br />
Dittrichia viscosa subsp. viscosa (L.) W. Greuter X 3 3 6 3 0 0 0 0 9<br />
Duchesnea indica (Andrews) Focke in Engler & Prantl XX 1 2 3 0 0 0 0 1 4<br />
Echinochloa colona (L.) Link. X 4 2 6 2 0 0 0 0 8<br />
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. XX 2 4 6 2 0 1 0 0 9<br />
Echium vulgare L. X 5 5 10 0 0 1 0 0 11<br />
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski X 4 4 8 3 0 0 0 0 11<br />
Epilobium angustifolium L. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Epilobium hirsutum L. XXX 5 5 10 0 0 0 0 0 10<br />
Epilobium parviflorum Schreber X 3 1 4 0 0 0 0 0 4<br />
Epilobium roseum Schreber X 3 2 5 0 0 0 0 1 6<br />
Epilobium tetragonum L. XXXX 5 5 10 0 0 0 0 1 11<br />
Equisetum arvense L. XXX 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link X 2 1 3 2 0 0 0 0 5<br />
CXXVIII
Eragrostis minor Host XX 3 4 7 2 0 0 0 0 9<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Erigeron annuus (L.) Desf. XX 5 4 9 3 0 0 0 0 12<br />
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. in Aiton XX 2 4 6 0 0 0 0 0 6<br />
Erophila verna (L.) Chevall. XXX 3 2 5 0 0 0 0 1 6<br />
Erysimum cheiri (L.) Crantz X 3 2 5 0 1 0 0 3 9<br />
Eschscholzia californica Cham. in Nees X 3 2 5 0 0 0 1 0 6<br />
Eupatorium cannabinum L. X 5 4 9 3 0 0 0 0 12<br />
Euphorbia exigua L. XX 2 2 4 0 1 0 1 1 7<br />
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti X 3 2 5 0 1 0 1 0 7<br />
Euphorbia helioscopa L. XX 3 3 6 0 1 0 1 0 8<br />
Euphorbia lathyris L. X 3 3 6 0 2 0 1 0 9<br />
Euphorbia maculata L. XX 1 3 4 0 1 0 1 0 6<br />
Euphorbia peplus L. XXXX 3 3 6 0 1 0 1 1 9<br />
Euphorbia prostrata Aiton X 1 2 3 0 1 0 1 0 5<br />
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve XX 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Festuca arundinacea Schreber X 4 4 8 5 0 0 0 0 13<br />
Festuca ovina L. X 3 2 5 5 0 0 0 1 11<br />
Festuca rubra subsp. rubra L. XX 5 4 9 5 0 0 0 1 15<br />
Foeniculum vulgare subsp. vulgare Miller X 5 5 10 0 0 1 0 0 11<br />
Fumaria officinalis L. XX 4 5 9 0 1 0 0 0 10<br />
Fumaria parviflora Lam. X 3 3 6 0 1 0 0 0 7<br />
Galactites elegans (All.) Soldano X 3 4 7 3 0 1 0 0 11<br />
Galinsoga parviflora Cav. X 4 5 9 3 0 0 0 0 12<br />
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon XXX 4 4 8 3 0 0 0 1 12<br />
Galium aparine L. XXX 5 5 10 0 0 0 0 1 11<br />
Galium mollugo L. X 2 2 4 0 0 0 0 0 4<br />
Geranium columbinum L. X 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Geranium dissectum L. XX 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Geranium molle L. XX 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Geranium pusillum L. XX 2 4 6 0 0 0 0 1 7<br />
Geranium robertianum L. XXX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
CXXIX
Geranium rotundifolium L. XXX 2 4 6 0 0 0 0 1 7<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Geum urbanum L. XXX 5 5 10 0 0 0 0 0 10<br />
Glechoma he<strong>de</strong>racea L. X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
He<strong>de</strong>ra helix L. XXX 3 4 7 0 3 1 1 3 15<br />
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier X 5 5 10 0 1 3 1 0 15<br />
Heracleum sphondylium L. X 3 4 7 3 0 1 0 0 11<br />
Herniaria hirsuta L. X 1 3 4 0 0 0 0 1 5<br />
Hieracium murorum L. X 5 3 8 3 0 0 0 1 12<br />
Hieracium pilosella L. X 3 3 6 3 0 0 0 0 9<br />
Holcus lanatus L. XX 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Hor<strong>de</strong>um murinum L. XXX 5 5 10 4 0 1 0 1 16<br />
Hypericum perforatum L. XX 4 4 8 0 0 1 0 1 10<br />
Hypochaeris radicata L. XXX 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Impatiens parviflora DC. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Juncus bufonius L. X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
Kickxia elatine (L.) Dumort. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Lactuca perennis L. X 4 4 8 3 1 1 1 0 14<br />
Lactuca serriola L. XXXX 5 5 10 3 1 1 1 1 17<br />
Lactuca virosa L. XX 5 5 10 3 1 1 1 0 16<br />
Lamium album L. X 4 4 8 0 0 0 0 0 8<br />
Lamium amplexicaule L. XXX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Lamium hybridum Vill. X 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Lamium maculatum (L.) L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Lamium purpureum L. XXX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Lapsana communis L. XXX 5 5 10 3 0 0 0 1 14<br />
Lathyrus pratensis L. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Leontodon autumnalis L. X 2 2 4 3 0 0 0 0 7<br />
Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Lam. X 2 1 3 3 0 0 0 1 7<br />
Leonurus marrubiastrum L. X 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
Lepidium graminifolium L. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
CXXX
Lepidium ru<strong>de</strong>rale L. X 2 1 3 0 0 0 0 1 4<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Lepidium virginicum L. XX 4 5 9 0 0 0 0 1 10<br />
Leucanthemum vulgare Lam. XX 4 4 8 3 0 0 0 0 11<br />
Linaria repens (L.) Miller X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Linaria simplex Desf. XX 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
Linaria vulgaris Miller X 4 1 5 0 1 0 0 1 7<br />
Lobularia maritima (L.) Desv. X 1 1 2 0 0 0 0 1 3<br />
Lolium multiflorum Lam. X 3 4 7 4 0 0 0 0 11<br />
Lolium perenne L. XXX 5 5 10 4 0 0 0 0 14<br />
Lolium rigidum Gaudin XX 4 4 8 4 0 0 0 0 12<br />
Lotus corniculatus L. X 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Lythrum salicaria L. X 4 4 8 0 1 0 0 0 9<br />
Malva neglecta Wallr. XX 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
Malva sylvestris L. X 2 4 6 0 0 0 0 1 7<br />
Matricaria discoi<strong>de</strong>a DC. XXX 2 4 6 3 0 0 0 1 10<br />
Matricaria perforata Mérat XX 3 4 7 3 0 0 0 0 10<br />
Matricaria recutita L. XXX 4 5 9 3 0 0 0 0 12<br />
Medicago arabica (L.) Hudson XX 2 4 6 0 0 0 0 0 6<br />
Medicago lupulina L. XXXX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Medicago polymorpha L. X 1 2 3 0 0 0 0 0 3<br />
Medicago sativa L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Melilotus officinalis Lam. XX 5 5 10 0 1 0 0 0 11<br />
Mentha arvensis L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Mentha suaveolens Ehrh. X 4 3 7 0 0 0 0 0 7<br />
Mercurialis annua L. XXX 5 5 10 2 1 0 0 0 13<br />
Mimulus moschatus Douglas ex Lindley in Edwards X 1 1 2 0 1 0 0 0 3<br />
Minuartia hybrida subsp. hybrida (Vill.) Schischkin in<br />
XX<br />
Komarov<br />
2 3 5 0 0 0 0 1 6<br />
Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen X 1 1 2 0 0 0 0 1 3<br />
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Misopates orontium (L.) Rafin. X 5 5 10 0 0 0 0 1 11<br />
Montia fontana L. X 2 2 4 0 0 0 0 0 4<br />
CXXXI
Muscari neglectum Guss. ex Ten. XX 4 2 6 0 3 0 0 0 9<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Mycelis muralis (L.) Dumort. XX 5 5 10 3 1 1 1 1 17<br />
Myosotis arvensis Hill XX 4 4 8 0 0 0 0 0 8<br />
Myosotis discolor Pers. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Myosotis sylvatica Hoffm. X 3 1 4 0 0 0 0 0 4<br />
Nigella damascena L. X 3 2 5 0 2 0 0 0 7<br />
Ononis spinosa L. X 2 1 3 0 0 1 0 0 4<br />
Ornithogalum umbellatum L. XX 2 3 5 0 3 0 0 0 8<br />
Oxalis corniculata L. XXX 2 4 6 0 1 0 0 1 8<br />
Panicum dichotomiflorum Michaux X 4 3 7 2 0 0 0 0 9<br />
Papaver dubium L. X 3 3 6 0 1 0 0 0 7<br />
Papaver rhoeas L. XXX 5 4 9 0 1 0 0 0 10<br />
Parietaria judaica L. XXX 5 5 10 4 0 0 0 3 17<br />
Paspalum dilatatum Poiret in Lam. X 5 3 8 3 0 0 0 0 11<br />
Pastinaca sativa L. XX 3 3 6 0 2 3 1 0 12<br />
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood X 2 1 3 0 0 0 0 1 4<br />
Petunia violacea Lindley in Edwards X 1 1 2 0 2 0 0 0 4<br />
Phleum pratense subsp. serotinum (Jordan) Berher in L. Louis X 3 2 5 5 0 0 0 0 10<br />
Picris echioi<strong>de</strong>s L. XXX 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Picris hieracioi<strong>de</strong>s L. XXX 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Plantago coronopus L. XX 2 3 5 3 0 0 0 1 9<br />
Plantago lagopus L. X 2 3 5 3 0 0 0 0 8<br />
Plantago lanceolata L. XXX 5 5 10 3 0 0 0 1 14<br />
Plantago major L. XXXX 3 4 7 3 0 0 0 1 11<br />
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcangelli X 2 3 5 3 0 0 0 0 8<br />
Poa annua L. XXXXX 3 3 6 5 0 0 0 3 14<br />
Poa bulbosa L. X 3 2 5 5 0 0 0 0 10<br />
Poa pratensis L. XX 3 4 7 5 0 0 0 1 13<br />
Poa trivialis L. XXX 4 4 8 5 0 0 0 1 14<br />
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. XXX 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Polygala vulgaris L. X 2 1 3 0 1 0 0 0 4<br />
CXXXII
Polygonum aviculare L. XXXX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Polygonum lapathifolium L. XX 4 3 7 0 0 0 0 0 7<br />
Polygonum persicaria L. XXX 4 4 8 0 0 0 0 0 8<br />
Portulaca oleracea L. XXX 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Potentilla erecta (L.) Räuschel X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Potentilla reptans L. XX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Prunella vulgaris L. XXX 2 4 6 0 0 0 0 0 6<br />
Ranunculus acris L. X 5 5 10 0 2 0 1 0 13<br />
Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus L. X 2 2 4 0 2 0 1 0 7<br />
Ranunculus ficaria L. XX 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Ranunculus repens L. XX 2 4 6 0 2 0 1 1 10<br />
Ranunculus sardous Crantz X 3 4 7 0 2 0 1 0 10<br />
Ranunculus sceleratus L. X 3 3 6 0 2 0 1 0 9<br />
Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier XX<br />
& Layens<br />
2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Reseda alba L. X 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Reseda lutea L. XX 4 5 9 0 0 0 0 1 10<br />
Reseda luteola L. X 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Reynoutria japonica Houtt. X 5 5 10 0 0 0 0 0 10<br />
Ricinus communis L. X 5 5 10 0 3 3 1 0 17<br />
Rorippa palustris (L.) Besser X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
Rorippa sylvestris (L.) Besser X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Rostraria cristata (L.) Tzvelev XX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Rubia tinctorum L. X 2 2 4 0 0 0 0 0 4<br />
Rubus fruticosus L. X 4 4 8 0 0 3 0 1 12<br />
Rumex acetosa L. X 4 3 7 3 0 0 0 0 10<br />
Rumex acetosella L. XX 2 3 5 2 0 0 0 0 7<br />
Rumex crispus L. XX 5 5 10 2 1 0 0 0 13<br />
Rumex obtusifolius L. XX 5 5 10 2 0 0 0 0 12<br />
Sagina apetala Ard. XXXX 3 3 6 0 0 0 0 3 9<br />
Sagina procumbens L. XXX 2 1 3 0 0 0 0 3 6<br />
Sanguisorba minor Scop. X 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
CXXXIII
Saponaria officinalis L. X 2 3 5 0 0 0 0 1 6<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Saxifraga tridactylites L. XXX 2 3 5 0 0 0 0 3 8<br />
Scleranthus annuus L. X 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfler X 1 2 3 0 2 0 0 0 5<br />
Sedum acre L. XX 1 1 2 0 1 0 0 3 6<br />
Sedum album L. XX 2 2 4 0 1 0 0 3 8<br />
Sedum anglicum Hudson X 1 1 2 0 1 0 0 1 4<br />
Sedum sediforme (Jacq.) Pau X 2 2 4 0 1 0 0 1 6<br />
Senecio cineraria DC. X 4 4 8 3 1 0 0 0 12<br />
Senecio inaequi<strong>de</strong>ns DC. XX 5 5 10 3 1 0 0 0 14<br />
Senecio jacobaea L. XXX 5 4 9 3 1 0 0 1 14<br />
Senecio ovatus subsp. ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) X<br />
Willd.<br />
3 3 6 3 1 0 0 0 10<br />
Senecio viscosus L. XXX 5 5 10 3 1 0 0 1 15<br />
Senecio vulgaris L. XXXXX 5 4 9 3 1 0 0 1 14<br />
Setaria italica (L.) P. Beauv. X 4 2 6 3 0 1 0 0 10<br />
Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes X 4 4 8 3 0 1 0 0 12<br />
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. XX 3 4 7 3 0 1 0 0 11<br />
Setaria viridis (L.) P. Beauv. XX 3 3 6 3 0 1 0 0 10<br />
Sherardia arvensis L. XXX 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter & Bur<strong>de</strong>t in Greuter X<br />
& Raus<br />
5 5 10 0 0 0 0 0 10<br />
Silene vulgaris (Moench) Garcke X 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
Sinapis arvensis L. XX 4 3 7 0 1 0 0 0 8<br />
Sison amomum L. X 4 4 8 0 1 1 0 0 10<br />
Sisymbrium irio L. XX 5 5 10 0 0 0 0 1 11<br />
Sisymbrium officinale (L.) Scop. XX 5 4 9 0 0 0 0 0 9<br />
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Bur<strong>de</strong>t in Greuter & Raus X 2 1 3 3 0 0 0 0 6<br />
Solanum dulcamara L. XX 5 5 10 0 3 0 0 1 14<br />
Solanum nigrum L. XXX 4 4 8 0 3 0 0 0 11<br />
Solidago cana<strong>de</strong>nsis L. XX 5 3 8 3 1 0 0 0 12<br />
Sonchus arvensis L. XX 5 4 9 3 1 1 1 0 15<br />
CXXXIV
Sonchus asper (L.) Hill XXXXX 5 5 10 3 1 1 1 1 17<br />
Sonchus oleraceus L. XXXXX 5 5 10 3 1 1 1 0 16<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Sonchus tenerrimus L. X 3 4 7 3 1 1 1 0 13<br />
Stachys ocymastrum (L.) Briq. X 2 2 4 0 0 0 0 0 4<br />
Stachys recta L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Stachys sylvatica L. X 3 3 6 0 1 0 0 0 7<br />
Stellaria media (L.) Vill. XXXXX 3 4 7 0 0 0 0 3 10<br />
Symphytum officinale L. X 4 4 8 0 0 1 0 0 9<br />
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. X 3 3 6 3 1 0 0 0 10<br />
Tanacetum vulgare L. XX 4 3 7 3 1 0 0 1 12<br />
Taraxacum officinale G.H. Weber in Wiggers XXXXX 5 5 10 3 0 0 1 1 15<br />
Thesium alpinum L. X 2 1 3 0 1 0 0 0 4<br />
Torilis arvensis subsp. arvensis (Hudson) Link. XX 3 2 5 0 0 1 0 0 6<br />
Torilis nodosa (L.) Gaertner XX 5 4 9 0 0 0 0 0 9<br />
Tragopogon pratensis L. X 5 5 10 3 0 0 1 0 14<br />
Trifolium arvense L. X 2 2 4 0 0 0 0 0 4<br />
Trifolium campestre Schreber in Sturm X 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Trifolium dubium Sibth. XX 3 2 5 0 0 0 0 0 5<br />
Trifolium pratense L. XX 2 4 6 0 0 0 0 0 6<br />
Trifolium repens L. XXX 3 4 7 0 0 0 0 1 8<br />
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. X 4 1 5 3 0 0 0 0 8<br />
Triticum aestivum L. X 5 4 9 4 0 1 0 0 14<br />
Tussilago farfara L. XX 2 3 5 3 0 0 0 0 8<br />
Urtica dioica L. X 5 4 9 1 0 3 0 1 14<br />
Urtica urens L. X 3 2 5 1 0 3 0 0 9<br />
Valeriana dioica L. X 5 5 10 0 1 0 0 0 11<br />
Valeriana officinalis L. X 4 4 8 0 1 0 0 0 9<br />
Valerianella locusta (L.) Laterra<strong>de</strong> XXX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Verbascum lychnitis L. X 5 4 9 0 0 1 0 0 10<br />
Verbascum thapsus L. X 5 5 10 0 0 1 0 0 11<br />
Verbena officinalis L. XX 4 3 7 0 0 0 0 0 7<br />
CXXXV
Veronica arvensis L. XXXX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Veronica filiformis Sm. X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
Espèce<br />
Présence<br />
généralisée<br />
Hauteur<br />
max.<br />
IDV Nuisances<br />
esthétiques<br />
Allergénicit<br />
é<br />
Toxicité<br />
Nuisances<br />
incommodantes<br />
Présence <strong>de</strong><br />
suc collant<br />
ou poisseux<br />
Capacité à<br />
coloniser les<br />
bâtis<br />
Indice potentiel<br />
<strong>de</strong> nuisance en<br />
ville<br />
Veronica he<strong>de</strong>rifolia L. XXX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Veronica peregrina L. XX 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Veronica persica Poiret in Lam. XXX 3 3 6 0 0 0 0 1 7<br />
Veronica polita Fries XX 2 3 5 0 0 0 0 0 5<br />
Veronica serpyllifolia L. X 2 2 4 0 0 0 0 0 4<br />
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray XX 4 4 8 0 0 0 0 0 8<br />
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh XX 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Vicia tetrasperma (L.) Schreber X 3 4 7 0 0 0 0 0 7<br />
Viola alba Besser X 1 1 2 0 0 0 0 0 2<br />
Viola canina L. X 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Viola hirta L. XX 3 3 6 0 0 0 0 0 6<br />
Viola odorata L. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Viola riviniana Reichenb. X 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Viola tricolor L. XX 2 1 3 0 0 0 0 0 3<br />
Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort. X 5 5 10 3 0 0 0 0 13<br />
Vulpia bromoi<strong>de</strong>s (L.) S. F. Gray X 3 3 6 3 0 0 0 0 9<br />
Vulpia ciliata Dumort. X 2 1 3 3 0 0 0 0 6<br />
Vulpia myuros (L.) C. C. Gelin XXX 4 5 9 3 0 0 0 1 13<br />
idv : indice <strong>de</strong> <strong>de</strong>veloppement volumique<br />
CXXXVI
Annexe 2<br />
Adventices faisant l’objet <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> lutte particulières<br />
CXXXVII
ESPECE NOM FRANCAIS FAMILLE Statut<br />
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'armoise ASTERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Bi<strong>de</strong>ns frondosa L. Bi<strong>de</strong>nt à fruits noirs ASTERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Cenchrus incertus M.A.CURTIS POACEAE « Invasive » OEPP<br />
Centaurea repens L<br />
(= Acroptilon repens )<br />
Centaurée aux amères ASTERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Cirsium arvense<br />
Chardon <strong>de</strong>s champs ASTERACEES 2000/29 CE<br />
Cuscuta spp. Cuscute CONVOLVULACEAE 2000/29 CE<br />
Cyperus esculentus L. Aman<strong>de</strong> <strong>de</strong> terre, souchet comestible CYPERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Helianthus tuberosus L. Topinambour ASTERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Heracleum mantegazzianum SOMMERAUER & Berce du Caucase APIACEAE « Invasive » OEPP<br />
LEVEILLE<br />
Heracleum sosnowskyi MAND<strong>EN</strong>OVA APIACEAE « Invasive » OEPP<br />
Impatiens glandulifera ROYLE Balsamine <strong>de</strong> l'Himalaya BALSAMINACEAE « Invasive » OEPP<br />
Lupinus polyphyllus LINDLEY Lupin pérenne FABACEAE « Invasive » OEPP<br />
Lysichiton americanus HULT. & ST.JOHN ARACEAE Action OEPP (A2)<br />
Orobancha minor, Orobancha cernua, Orobancha<br />
crenata, Orobancha ramosa<br />
Orobanches OROBANCHACEAE 2000/29 CE<br />
Pueraria montana var. lobata Alerte OEPP<br />
Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrteková<br />
(= Fallopia ×bohemica )<br />
POLYGONACEAE « Invasive » OEPP<br />
Reynoutria japonica HOUT.<br />
(= Fallopia japonica )<br />
Renouée du Japon POLYGONACEAE « Invasive » OEPP<br />
Reynoutria sachalinensis<br />
Renouée géante, R. <strong>de</strong> Sakhaline POLYGONACEAE « Invasive » OEPP<br />
(=Fallopia sachalinensis)<br />
Senecio inaeqi<strong>de</strong>ns DC. Séneçon du Cap ASTERACEAE Alerte OEPP<br />
Sicyos angulatus L. Concombre anguleux CUCURBITACEAE Alerte OEPP<br />
Solanum elaeagnifolium CAVARA SOLANACEAE « Invasive » OEPP<br />
Solidago cana<strong>de</strong>nsis L. Verge d’or du Canada ASTERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Solidago gigantea Aiton Verge d’or tardive ASTERACEAE « Invasive » OEPP<br />
Solidago nemoralis AIT. ASTERACEAE Alerte OEPP<br />
Viscum album L. Gui VISCACEAE 2000/29 CE<br />
OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection <strong>de</strong>s plantes) ; liste d’alerte <strong>de</strong> l’OEPP : liste dont l’objectif est d’attirer l’attention <strong>de</strong>s pays membres<br />
<strong>de</strong>l’OEPP sur certaines espèces pouvant consituer un risque pour eux. Liste <strong>de</strong>s plantes dites « invasives » <strong>de</strong> l’OEPP : liste <strong>de</strong> plantes invasives présentant un risque pour la<br />
santé, l’environnement , la biodiversité, dans les pays membres <strong>de</strong> l’OEPP ; il est recommandé <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s mesures pour en éviter leur popagation. Liste d’action <strong>de</strong><br />
CXXXVIII
l’OEPP : la liste A1 contient <strong>de</strong>s espèces réglementées dans les pays membres <strong>de</strong> l’OEPP sur la recommandation <strong>de</strong> celles-ci, et qui sont absentes <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> l’OEPP ; la<br />
liste A2 comprend <strong>de</strong>s espèces présentes localement dans la région <strong>de</strong> l’OEPP ; l’OEPP recomman<strong>de</strong> à ses membres <strong>de</strong> prendre en compte ces espèces dans la<br />
réglementation. La liste présentée ici est non exhaustive, pour avoir la liste complète consulter http://www.eppo.org/QUARANTINE/quarantine.htm.<br />
La directive 2000/29 CE est une liste <strong>de</strong> quarantaine qui liste les organismes <strong>de</strong> lutte obligatoire en Union Européenne. Les espèces citées ici sont <strong>de</strong> lutte obligatoire sous<br />
certaines conditions (arrêté préfectoral pour une pério<strong>de</strong> et une zone déterminée)<br />
CXXXIX
Annexe 3<br />
Cycles biologiques <strong>de</strong>s adventices pouvant être rencontrées en zones non agricoles<br />
D’après Sylvie Llados, 2003<br />
CXLI
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Achillea millefolium Achillée millefeuille ASTERACEES V<br />
Achillea nobilis Achillée noble ASTERACEES B<br />
Aegopodium podagraria Egopo<strong>de</strong> podagraire POACEES V<br />
Aethusia cynapium Petite cigüe APIACEES A/B<br />
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire ROSACEES V<br />
Agropyron repens Chien<strong>de</strong>nt commun POACEES V<br />
Agrostis canina Agrosti<strong>de</strong> <strong>de</strong>s chiemps POACEES V<br />
Agrostis capillaris Agrosti<strong>de</strong> capillaire POACEES V<br />
Agrostis gigantea Agrosti<strong>de</strong> géante POACEES V<br />
Agrostis sp. Agrosti<strong>de</strong> sp. POACEES ?<br />
Agrostis stolonifera Agrosti<strong>de</strong> stolonifère POACEES V<br />
Aira caryophyllea Canche caryophyllée POACEES A<br />
Aira praecox Canche précoce POACEES A<br />
Ajuga reptans Bugle rampante LAMIACEES V<br />
Alchemilla arvensis Alchémille <strong>de</strong>s champs ROSACEES A<br />
Alliaria officinalis Alliaire officinale BRASSICACEES B<br />
Allium polyanthum Poireau <strong>de</strong>s vignes ALIACEES V<br />
Allium scorodoprasum Ail rocambole ALLIACEES V<br />
Allium sp. Ail sp. ALIACEES V<br />
Allium vineale Ail <strong>de</strong>s vignes ALLIACEES V<br />
Alopecurus myosuroi<strong>de</strong>s Vulpin <strong>de</strong>s champs POACEES A<br />
Alyssum maritimum Alysse maritime BRASSICACEES V<br />
Amaranthus albus Amarante blanche AMARANTHACEES A<br />
Amaranthus blitum Amarante blite AMARANTHACEES A<br />
Amaranthus cruentus Amarante étalée AMARANTHACEES A<br />
Amaranthus <strong>de</strong>flexus Amarante couchée AMARANTHACEES V<br />
Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie AMARANTHACEES A<br />
Amaranthus sp. Amarante sp. AMARANTHACEES ?<br />
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d'armoise ASTERACEES A<br />
Anagallis arvensis Mouron <strong>de</strong>s champs PRIMULACEES A<br />
Anagallis minima Senténille naine PRIMULACEES A<br />
Andryala integrifolia Andryala à feuilles entières ASTERACEES A/B<br />
Anethum foeniculum Fenouil APIACEES V<br />
Anethum graveolens Aneth APIACEES A<br />
Angelica sylvestris Angélique sylvestre APIACEES V<br />
Anthemis arvensis Anthémis <strong>de</strong>s champs ASTERACEES A<br />
Anthemis cotula Anthémis cotule ASTERACEES A<br />
Anthemis sp. Anthémis sp. ASTERACEES A<br />
Anthirrinum orontium<br />
Anthoxanthum odoratum ssp.<br />
Muflier rubicond SCROPHULARIACEES V<br />
odoratum Flouve odorante POACEES A/V<br />
Apera spica-venti Agrostis jouet du vent POACEES A<br />
Aphanes arvensis Alchémille <strong>de</strong>s champs ROSACEES A<br />
Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire R<strong>EN</strong>ONCULACEES V<br />
Arabidopsis thaliana Arabette <strong>de</strong> Thalius BRASSICACEES A<br />
Arctium lappa Gran<strong>de</strong> bardane ASTERACEES B/V<br />
Arenaria serpyllifolia Sabline à feuille <strong>de</strong> serpolet CARYOPHYLLACEES A<br />
Argemone sp. Argémone sp. PAPAVERACEES ?<br />
Arnoseris minima<br />
Arrhenatherum elatius ssp.<br />
Arnoséris minime ASTERACEES B<br />
bulbosus Arrhénatère bulbeuse POACEES V<br />
Arrhenatherum elatius ssp. elatius Avoine élevée POACEES V<br />
CXLII
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Artemisia annua Armoise annuelle ASTERACEES A<br />
Artemisia campestris Armoise <strong>de</strong>s champs ASTERACEES V<br />
Artemisia sp. Armoise sp. ASTERACEES ?<br />
Artemisia vulgaris Armoise commune ASTERACEES V<br />
Arum italicum Gouet d'Italie ARACEES V<br />
Arum maculatum Gouet maculé, Pied <strong>de</strong> veau ARACEES V<br />
Arundo donax Canne <strong>de</strong> Provence POACEES V<br />
Asparagus officinalis Asperge ASPARAGACEES V<br />
Aster annuus Aster annuel ASTERACEES A<br />
Atriplex hastata Arroche hastée CH<strong>EN</strong>OPODIACEES A<br />
Atriplex patula Arroche étalée CH<strong>EN</strong>OPODIACEES A<br />
Avena barbata Avoine barbue POACEES A<br />
Avena elator Avoine élevée POACEES A<br />
Avena fatua Avoine folle POACEES A<br />
Avena ludoviciana Avoine stérile ludovicienne POACEES A<br />
Avena pubescens Avoine velue POACEES V<br />
Avena sativa Avoine cultivée POACEES A<br />
Avena sp. Avoine sp. POACEES ?<br />
Avena sterilis ssp. sterilis Avoine stérile POACEES A<br />
Avenochloa pratensis Avoine <strong>de</strong>s prés POACEES V<br />
Barbarea vulgaris Barbarée commune BRASSICACEES B<br />
Bellis perennis Pâquerette ASTERACEES V<br />
Bituminaria bituminosa Psoralée bitumineuse FABACEES V<br />
Brachypodium pinnatum Brachypo<strong>de</strong> palène POACEES V<br />
Brachypodium ramosum Brachypo<strong>de</strong> rameux POACEES V<br />
Brachypodium sp. Brachypo<strong>de</strong> sp. POACEES ?<br />
Brachypodium sylvaticum Brachypo<strong>de</strong> POACEES ?<br />
Brassica napus Colza BRASSICACEES A/B<br />
Brassica nigra Moutar<strong>de</strong> BRASSICACEES A<br />
Brassica rapa ssp. campestris Navet sauvage BRASSICACEES A<br />
Briza sp. Brize sp. POACEES ?<br />
Bromus arvensis Brome POACEES A<br />
Bromus catharticus Brome cathartique POACEES A/V<br />
Bromus diandrus Brome rai<strong>de</strong> POACEES A<br />
Bromus erectus Brome érigé POACEES V<br />
Bromus hor<strong>de</strong>aceus Brome mou POACEES A<br />
Bromus madritensis Brome <strong>de</strong> Madrid POACEES A<br />
Bromus mollis Brome mou POACEES A<br />
Bromus rubens Brome rougeâtre POACEES A<br />
Bromus secalinus Brome faux-seigle POACEES A<br />
Bromus sp. Brome sp. POACEES ?<br />
Bromus sterilis Brome stérile POACEES A<br />
Bromus tectorum Brome <strong>de</strong>s toits POACEES A<br />
Brunella vulgaris Brunelle <strong>de</strong>s champs LAMIACEES A/V<br />
Bryonia dioica Bryone dioique<br />
Buddleja du père David, Arbre aux<br />
CUCURBITACEES V<br />
Buddleja davidii<br />
papillons BUDDLEJACEES P<br />
Calamintha acinos Pouliot <strong>de</strong>s champs LAMIACEES A<br />
Calamintha ascen<strong>de</strong>ns Sariette ascendante LAMIACEES ?<br />
Calendula arvensis Souci <strong>de</strong>s champs ASTERACEES A<br />
Calluna vulgaris Bruyère callune ERICACEES V<br />
Calystegia sepium Liseron <strong>de</strong>s haies CONVOLVULACEES V<br />
Campanula sp. Campanule sp. CAMPANULACEES ?<br />
CXLIII
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur BRASSICACEES A<br />
Cardamine hirsuta Cardamine hérissée BRASSICACEES A<br />
Cardamine impatiens Cardamine impatiente BRASSICACEES A<br />
Cardaria draba Passerage drave BRASSICACEES V<br />
Carduus acanthoi<strong>de</strong>s Chardon à feuilles d'acanthe ASTERACEES V<br />
Carduus nutans Chardon penché ASTERACEES B<br />
Carduus sp. Chardon sp. ASTERACEES ?<br />
Carduus tenuiflorus Chardon à petites fleurs ASTERACEES A/B<br />
Carex divulsa Laiche écartée CYPERACEES V<br />
Carex pendula Laiche à épis penchants CYPERACEES V<br />
Carex sp. Laiche sp. CYPERACEES ?<br />
Catapodium rigidum Paturin rigi<strong>de</strong> POACEES A<br />
Cenchrus ciliaris Cenchrus cilié POACEES V<br />
Cenchrus echinatus Herbe ru<strong>de</strong> POACEES A<br />
Centaurea jacea Centaurée jacée ASTERACEES V<br />
Centaurea nigra Centaurée noire ASTERACEES V<br />
Centaurea sp. Centaurée sp. ASTERACEES ?<br />
Centranthus calcitrapae Centranthe chausse-trappe VALERIANACEES V<br />
Cerastium arvense Céraiste <strong>de</strong>s champs CARYOPHYLLACEES V<br />
Cerastium glomeratum Céraiste agglomérée CARYOPHYLLACEES A<br />
Cerastium sp. Céraiste sp. CARYOPHYLLACEES ?<br />
Chaenorrhinum minus Petite linaire SCROPHULARIACEES A<br />
Cheiranthus cheiri Giroflée BRASSICACEES V<br />
Chelidonium majus Chélidoine majeure PAPAVERACEES A<br />
Chenopodium album Chénopo<strong>de</strong> blanc CH<strong>EN</strong>OPODIACEES A<br />
Chenopodium ambrosioi<strong>de</strong>s Chénopo<strong>de</strong> ambroisine CH<strong>EN</strong>OPODIACEES A<br />
Chenopodium polyspermum Chénopo<strong>de</strong> polysperme CH<strong>EN</strong>OPODIACEES A<br />
Chondrilla juncea Chondrille à tige <strong>de</strong> jonc ASTERACEES V<br />
Chrysanthemum segetum Chrysanthème <strong>de</strong>s moissons ASTERACEES A<br />
Chrysanthemum vulgare Gran<strong>de</strong> marguerite ASTERACEES V<br />
Cichorium intybus Chicorée sauvage ASTERACEES A/V<br />
Cirsium arvense Chardon <strong>de</strong>s champs ASTERACEES V<br />
Cirsium sp. Cirse sp. ASTERACEES ?<br />
Cirsium vulgare Cirse à feuilles lancéolées ASTERACEES V<br />
Clematis vitalba Clématite vigne-blanche R<strong>EN</strong>ONCULACEES A/V<br />
Coincya monensis BRASSICACEES A/V<br />
Conium maculatum Gran<strong>de</strong> cigüe APIACEES B<br />
Convallaria majalis Muguet JACINTHACEES V<br />
Convolvulus arvensis Liseron <strong>de</strong>s champs CONVOLVULACEES V<br />
Conyza cana<strong>de</strong>nsis Erigéron du Canada ASTERACEES A<br />
Conyza sp. Erigéron ASTERACEES ?<br />
Conyza sumatrensis Erigeron <strong>de</strong> Sumatra ASTERACEES A<br />
Coronilla varia Coronille variée FABACEES V<br />
Coronopus didymus Sénebière didyme BRASSICACEES A/B<br />
Crepis biennis Crépi<strong>de</strong> bisannuelle ASTERACEES B<br />
Crepis bursifolia Crépi<strong>de</strong> à feuilles <strong>de</strong> capselle ASTERACEES B<br />
Crepis capillaris Crépi<strong>de</strong> à tige capillaire ASTERACEES A/B<br />
Crepis foetida Crépi<strong>de</strong> féti<strong>de</strong> ASTERACEES A<br />
Crepis sancta Crépi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Nice ASTERACEES A<br />
Crepis setosa Crépi<strong>de</strong> hérissée ASTERACEES A<br />
Crepis sp. Crépi<strong>de</strong> sp. ASTERACEES ?<br />
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia Crépi<strong>de</strong> à feuilles <strong>de</strong> pissenlit ASTERACEES A/B<br />
CXLIV
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Cynodon dactylon Chien<strong>de</strong>nt pied <strong>de</strong> poule POACEES V<br />
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré POACEES V<br />
Daucus carota Carotte sauvage APIACEES A/B<br />
Delphinium consolida Dauphinelle consou<strong>de</strong> R<strong>EN</strong>ONCULACEES A<br />
Deschampsia caespitosa Canche cespiteuse POACEES V<br />
Desmazeria rigida Scleropoa rai<strong>de</strong> POACEES A<br />
Dianthus armeria Œillet velu CARYOPHYLLACEES A/V<br />
Dianthus barbatus Œillet barbu CARYOPHYLLACEES A/V<br />
Dianthus caryophyllus Œillet giroflé CARYOPHYLLACEES A<br />
Dicanthium ischaemum Barbon ischème POACEES V<br />
Digitaria ischaemum Digitaire ischème POACEES A<br />
Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine POACEES A<br />
Digitaria sp. Digitaire sp. POACEES ?<br />
Diplotaxis erucoi<strong>de</strong>s Fausse-roquette BRASSICACEES A<br />
Diplotaxis muralis Roquette <strong>de</strong>s murailles BRASSICACEES A/V<br />
Diplotaxis sp. Roquette sp. BRASSICACEES ?<br />
Diplotaxis tenuifolia Roquette à feuilles ténues BRASSICACEES A/V<br />
Dipsacus fullonum Cabaret <strong>de</strong>s oiseaux DIPSACACEES B<br />
Draba verna Drave printanière BRASSICACEES A<br />
Duchesnea indica Faux-fraisier ROSACEES V<br />
Echinochloa colonum Panic <strong>de</strong>s cultivateurs POACEES A<br />
Echinochloa crus-galli Panic pied <strong>de</strong> coq POACEES A<br />
Echinochloa oryzoi<strong>de</strong>s Panic faux-riz POACEES A<br />
Echium plantagineum Vipérine faux-plantain BORAGINACEES B<br />
Echium vulgare Vipérine commune BORAGINACEES B<br />
Eleusine indica Eleusine <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s POACEES A<br />
Elytrigia intermedia POACEES V<br />
Elytrigia repens Chien<strong>de</strong>nt rampant POACEES V<br />
Epilobium angustifolium Epilobe à feuilles étroites ONAGRACEES V<br />
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute ONAGRACEES V<br />
Epilobium palustre Epilobe <strong>de</strong>s marais ONAGRACEES V<br />
Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs ONAGRACEES V<br />
Epilobium roseum Epilobe rose ONAGRACEES V<br />
Epilobium sp. Epilobe sp. ONAGRACEES ?<br />
Epilobium spicatum Epilobe à feuilles étroites ONAGRACEES V<br />
Epilobium tetragonum Epilobe à tiges carrées ONAGRACEES A/V<br />
Equisetum arvense Prêle <strong>de</strong>s champs EQUISETACEES V<br />
Equisetum sp. Prêle sp. EQUISETACEES ?<br />
Eragrostis cilianensis Eragrosti<strong>de</strong> à gros épi POACEES A<br />
Eragrostis minor Eragrostis mineur POACEES A<br />
Eragrostis virescens POACEES A<br />
Erica cinerea Bruyère cendrée ERICACEES V<br />
Erica tetralix Bruyère tétragone ERICACEES V<br />
Erigeron annuus Erigéron annuel ASTERACEES A<br />
Erigeron floribundus Erigéron blanc ASTERACEES A<br />
Erodium cicutarium Bec <strong>de</strong> grue commun GERANIACEES A<br />
Erodium sp. Erodium sp. GERANIACEES ?<br />
Erophila verna Drave printanière BRASSICACEES A<br />
Eryngium campestre Chardon roulant APIACEES V<br />
Erysimum cheiranthoi<strong>de</strong>s Vélar fausse-giroflée BRASSICACEES A/V<br />
Erythraea centaurium Petite centaurée G<strong>EN</strong>TIANACEES A<br />
Eschcscholzia californica Pavot <strong>de</strong> Californie PAPAVERACEES V<br />
CXLV
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Eupatorium cannabinum Chanvre d'eau ASTERACEES V<br />
Eupatorium sp. Eupatoire sp. ASTERACEES ?<br />
Euphorbia bithageri EUPHORBIACEES ?<br />
Euphorbia cyparissias Euphorbe petit cyprès EUPHORBIACEES V<br />
Euphorbia exigua Euphorbe exiguë EUPHORBIACEES A<br />
Euphorbia helioscopa Euphorbe réveil-matin EUPHORBIACEES A<br />
Euphorbia lathyris Euphorbe épurge EUPHORBIACEES A<br />
Euphorbia maculata Euphorbe maculée EUPHORBIACEES A<br />
Euphorbia peplus Euphorbe <strong>de</strong>s jardins EUPHORBIACEES A<br />
Euphorbia prostate EUPHORBIACEES ?<br />
Euphorbia serpens EUPHORBIACEES A<br />
Euphorbia sp. Euphorbe sp. EUPHORBIACEES ?<br />
Fallopia convolvulus Renouée liseron POLYGONACEES A<br />
Fallopia japonica Renouée du Japon, Renouée bambou POLYGONACEES V<br />
Festuca arundinacea Fétuque faux roseau POACEES V<br />
Festuca glauca Fétuque bleue POACEES V<br />
Festuca ovina Fétuque ovine POACEES V<br />
Festuca pratensis Fétuque <strong>de</strong>s prés POACEES V<br />
Festuca rubra ssp rubra Fétuque rouge POACEES V<br />
Festuca sp. Fétuque sp. POACEES ?<br />
Ficaria ranunculoi<strong>de</strong>s Ficaire fausse renoncule R<strong>EN</strong>ONCULACEES V<br />
Filago arvensis Cotonnière <strong>de</strong>s champs ASTERACEES A<br />
Filago sp. Cotonnière sp. ASTERACEES ?<br />
Foeniculum vulgare Fenouil commun APIACEES A/V<br />
Fumaria officinalis Fumeterre officinal PAPAVERACEES A<br />
Fumaria parviflora Fumeterre à petites fleurs PAPAVERACEES A<br />
Galactites elegans Chardon laiteux ASTERACEES A<br />
Galeopsis tetrahit Ortie royale LAMIACEES A<br />
Galinsoga parviflora Scabieuse <strong>de</strong>s champs ASTERACEES A<br />
Galinsoga quadriradiata Galinsoga cilié ASTERACEES A<br />
Galium aparine Gaillet gratteron RUBIACEES A<br />
Galium cruciata Gaillet croisette RUBIACEES V<br />
Galium mollugo Gaillet mou RUBIACEES V<br />
Galium sp. Gaillet sp. RUBIACEES ?<br />
Galium verum Gaillet vrai RUBIACEES V<br />
Gaudinia fragilis Gaudine fragile POACEES A<br />
Geranium columbinum Géranium <strong>de</strong>s colombes GERANIACEES A/B<br />
Geranium dissectum Géranium découpé GERANIACEES A<br />
Geranium molle Géranium mou GERANIACEES A<br />
Geranium pusillum Géranium fluet GERANIACEES A<br />
Geranium robertianum Géranium Herbe à Robert GERANIACEES A<br />
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles ron<strong>de</strong>s GERANIACEES A<br />
Geranium sp. Géranium sp. GERANIACEES ?<br />
Geum urbanum Benoîte <strong>de</strong>s villes ROSACEES V<br />
Glechoma he<strong>de</strong>racea Lierre terrestre LAMIACEES V<br />
Gnaphalium sp. ASTERACEES ?<br />
Gypsophila muralis Gypsophile <strong>de</strong>s murs CARYOPHYLLACEES A<br />
He<strong>de</strong>ra helix Lierre commun ARALIACEES P<br />
Hedysarium onobrychis FABACEES A<br />
Heliotropium europaeum Héliotrope d'Europe BORAGINACEES A<br />
Heracleum sp. Berce sp. ASTERACEES ?<br />
Heracleum sphondylium Berce spondyle APIACEES A/V<br />
CXLVI
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Herniaria glabra Herniaire glabre CARYOPHYLLACEES A<br />
Herniaria hirsuta Herniaire velue CARYOPHYLLACEES A<br />
Hieracium lachenalii Epervière commune ASTERACEES V<br />
Hieracium murorum Epervière <strong>de</strong>s murailles ASTERACEES A<br />
Hieracium pilosella Epervière piloselle ASTERACEES V<br />
Hieracium sp. Epervière sp. ASTERACEES ?<br />
Holcus lanatus Houlque laineuse ASTERACEES V<br />
Holcus mollis Houlque molle ASTERACEES V<br />
Holcus sp. Houlque sp. ASTERACEES ?<br />
Holosteum umbellatum Holostée en ombelle CARYOPHYLLACEES A<br />
Hor<strong>de</strong>um murinum Orge queue-<strong>de</strong>-rat POACEES A<br />
Hypericum perforatum Herbe à mille trous CLUSIACEES V<br />
Hypochoeris radicata Porcelle enracinée ASTERACEES V<br />
Hypochoeris sp. Porcelle sp. ASTERACEES ?<br />
Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs BALSAMINACEES A<br />
Impatiens sp. Balsamine sp. BALSAMINACEES ?<br />
Inula conyza Inule squarreuse ASTERACEES V<br />
Inula graveolens Inule odorante ASTERACEES A<br />
Inula helenium Gran<strong>de</strong> aunée ASTERACEES V<br />
Inula salicina Inule à feuilles <strong>de</strong> saule ASTERACEES V<br />
Inula sp. Inule sp. ASTERACEES ?<br />
Inula viscosa Inule visqueuse ASTERACEES V<br />
Iris sp. Iris sp. IRIDACEES V<br />
Isatis tinctoria Pastel <strong>de</strong>s teinturiers BRASSICACEES B<br />
Juncus bufonius Jonc <strong>de</strong>s crapauds JONCACEES A<br />
Juncus sp. Jonc sp. JONCACEES ?<br />
Kickxia elatine Linaire élatine SCROPHULARIACEES A<br />
Kickxia sp. Linaire sp. SCROPHULARIACEES ?<br />
Kickxia spuria Linaire bâtar<strong>de</strong> SCROPHULARIACEES A<br />
Knautia arvensis Scabieuse <strong>de</strong>s champs DIPSACACEES V<br />
Knautia sp. Scabieuse sp. DIPSACACEES ?<br />
Lactuca muralis Laitue <strong>de</strong>s murs ASTERACEES V<br />
Lactuca perennis Laitue vivace ASTERACEES V<br />
Lactuca serriola Laitue scariole ASTERACEES A<br />
Lactuca virosa Laitue vireuse ASTERACEES A<br />
Lamium album Ortie blanche LAMIACEES V<br />
Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule LAMIACEES A<br />
Lamium hybridum Lamier hybri<strong>de</strong> LAMIACEES A<br />
Lamium maculatum Lamier maculé LAMIACEES V<br />
Lamium purpureum Lamier pourpre LAMIACEES A<br />
Lamium sp. Lamier sp. LAMIACEES ?<br />
Lapsana communis Lapsane commune ASTERACEES A<br />
Lathyrus pratensis Gesse <strong>de</strong>s prés FABACEES V<br />
Lathyrus sp. Gesse sp. FABACEES ?<br />
Lathyrus sylvestris Gesse sauvage FABACEES A<br />
Lathyrus tuberosus Gesse tubéreuse FABACEES V<br />
Legousia speculum-veneris Légousie miroir-<strong>de</strong>-Vénus CAMPANULACEES A<br />
Leontodon autumnalis Dent <strong>de</strong> lion automnale ASTERACEES V<br />
Leontodon hispidus Lion<strong>de</strong>nt hispi<strong>de</strong> ASTERACEES A<br />
Leontodon taraxacoi<strong>de</strong>s Lion<strong>de</strong>nt à tige nue ASTERACEES V<br />
Leonurus marrubiastrum LAMIACEES ?<br />
Lepidium campestre Passerage champêtre BRASSICACEES A/B<br />
CXLVII
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Lepidium graminifolium Petite passerage BRASSICACEES V<br />
Lepidium perfoliatum Passerage perfoliée BRASSICACEES B<br />
Lepidium ru<strong>de</strong>rale Cresson puant BRASSICACEES A/B<br />
Lepidium sp. Passerage sp. BRASSICACEES ?<br />
Lepidium virginicum Passerage <strong>de</strong> Virginie BRASSICACEES A/B<br />
Leucanthemum vulgare Gran<strong>de</strong> marguerite ASTERACEES V<br />
Linaria cymbalaria Linaire cymbalaire, Ruine <strong>de</strong> Rome SCROPHULARIACEES V<br />
Linaria repens Linaire rampante SCROPHULARIACEES V<br />
Linaria simplex Linaire simplex SCROPHULARIACEES A<br />
Linaria sp. Linaire sp. SCROPHULARIACEES ?<br />
Linaria vulgaris Linaire commun SCROPHULARIACEES V<br />
Linum sp. Lin sp. LINACEES ?<br />
Lolium multiflorum Ray-grass d' Italie POACEES A<br />
Lolium perenne Ray-grass anglais POACEES V<br />
Lolium rigidum Ivraie rai<strong>de</strong> POACEES A<br />
Lolium sp. Ivraie sp. POACEES ?<br />
Lotus angustifolius FABACEES V<br />
Lotus corniculatus Trèfle cornu FABACEES V<br />
Lotus sp. Lotus sp. FABACEES ?<br />
Lythrum salicaria Salicaire commune LYTHRACEES V<br />
Malva neglecta Mauve <strong>de</strong>s chemins MALVACEES A/V<br />
Malva sp. Mauve sp. MALVACEES ?<br />
Malva sylvestris Gran<strong>de</strong> mauve MALVACEES A/V<br />
Marrubium vulgare Marrube commun LAMIACEES V<br />
Matricaria chamomilla Petite camomille ASTERACEES A<br />
Matricaria discoi<strong>de</strong>a Camomille odorante ASTERACEES A<br />
Matricaria inodora Matricaire inodore ASTERACEES A<br />
Matricaria sp. Matricaire sp. ASTERACEES ?<br />
Medicago arabica Luzerne d'Arabie FABACEES A<br />
Medicago lupulina Luzerne lupuline FABACEES A/V<br />
Medicago minima Luzerne naine FABACEES A<br />
Medicago orbicularis Luzerne orbiculaire FABACEES A<br />
Medicago polymorpha Luzerne hérissée FABACEES A/B<br />
Medicago sativa Luzerne cultivée FABACEES V<br />
Medicago sp. Luzerne sp. FABACEES ?<br />
Melilotus albus Mélilot blanc FABACEES B<br />
Melilotus officinalis Mélilot <strong>de</strong>s champs FABACEES B<br />
Melilotus sp. Mélilot sp. FABACEES ?<br />
Mentha arvensis Menthe <strong>de</strong>s champs LAMIACEES A<br />
Mentha piperata Menthe poivrée LAMIACEES V<br />
Mentha sp. Menthe sp. LAMIACEES ?<br />
Mentha suavolens Menthe à feuilles ron<strong>de</strong>s LAMIACEES V<br />
Mercurialis annua Mercuriale annuelle EUPHORBIACEES A<br />
Mibora minima Mibore du printemps POACEES A<br />
Mibora sp. Mibore sp. POACEES ?<br />
Mimulus moschatus Mimule tacheté SCROPHULARIACEES ?<br />
Minuartia hybrida ssp hybrida Minuartia à feuilles menues CARYOPHYLLACEES A<br />
Minuartia hybrida ssp tenuifololia Minuartia à feuilles menues CARYOPHYLLACEES A<br />
Minuartia setacea CARYOPHYLLACEES V<br />
Molinia coerulea Molinie bleue POACEES V<br />
Montia fontana Montie à graines cartilagineuses CARYOPHYLLACEES A/V<br />
CXLVIII
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Muscari neglectum Muscari en grappe JACINTHACEES V<br />
Myosotis arvensis Myosotis <strong>de</strong>s champs BORAGINACEES A<br />
Myosotis discolor Myosotis bicolore BORAGINACEES A<br />
Myosotis sp. Myosotis sp. BORAGINACEES ?<br />
Myosotis sylvestris Myosotis <strong>de</strong>s bois BORAGINACEES A/V<br />
Myosurus minimus Queue <strong>de</strong> souris R<strong>EN</strong>ONCULACEES A<br />
Nardus stricta Nard rai<strong>de</strong> POACEES V<br />
Nigella sp. Nigelle sp. R<strong>EN</strong>ONCULACEES ?<br />
Oenothera biennis Onagre bisannuelle ONAGRACEES B/V<br />
Ononis repens Bugrane rampante FABACEES V<br />
Ononis sp. Ononis sp. FABACEES ?<br />
Ononis spinosa Bugrane épineuse FABACEES V<br />
Onopordum acanthium Onopor<strong>de</strong> faux-acanthe ASTERACEES B<br />
Origanum vulgare Marjolaine sauvage LAMIACEES V<br />
Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle JACINTHACEES V<br />
Ornithopus compressus Pied d'oiseau comprimé FABACEES A<br />
Oxalis corniculata Oxalis corniculé OXALIDACEES V<br />
Panicum capillare Panic capillaire POACEES A<br />
Panicum dichotomiflorum Panic dichotome POACEES A<br />
Panicum miliaceum Panic dichotome POACEES A<br />
Panicum sp. Panic sp. POACEES ?<br />
Papaver dubium Pavot douteux PAPAVERACEES A<br />
Papaver rhoeas Coquelicot PAPAVERACEES A<br />
Papaver sp. Pavot sp. PAPAVERACEES V<br />
Parietaria officinalis Pariétaire vitriole URTICACEES V<br />
Paspalum dilatatum Herbe <strong>de</strong> Dallis POACEES V<br />
Pastinaca sativa Panais cultivé APIACEES B<br />
Petasites hybridus Pétasite hybri<strong>de</strong> ASTERACEES V<br />
Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère CARYOPHYLLACEES A<br />
Petunia sp. Petunia sp. SOLANACEES ?<br />
Phacelia sp. Phacélie sp. BORAGINACEES ?<br />
Phleum pratense ssp serotinum Fléole noueuse POACEES V<br />
Phragmites australis Roseau Common POACEES V<br />
Picris echioi<strong>de</strong>s Picris fausse-vipérine ASTERACEES A/V<br />
Picris hieracioi<strong>de</strong>s Picris Fausse-Épervière ASTERACEES A/V<br />
Picris sp. Picris sp. ASTERACEES ?<br />
Plantago coronopus Plantain pied-<strong>de</strong>-corbeau PLANTAGINACEES A<br />
Plantago cynops Plantain <strong>de</strong>s chiens PLANTAGINACEES A/V<br />
Plantago lagopus Plantain pied-<strong>de</strong>-lièvre FABACEES A/V<br />
Plantago lanceolata Plantain lancéolé PLANTAGINACEES A/V<br />
Plantago major Plantain majeur PLANTAGINACEES A/V<br />
Plantago media Plantain moyen PLANTAGINACEES A/V<br />
Plantago serpentina Plantain serpentant PLANTAGINACEES V<br />
Plantago sp. Plantain sp. PLANTAGINACEES ?<br />
Poa alpina Pâturin <strong>de</strong>s Alpes POACEES V<br />
Poa annua Pâturin annuel POACEES A<br />
Poa bulbosa Pâturin bulbeux POACEES A/V<br />
Poa pratensis Pâturin <strong>de</strong>s prés POACEES V<br />
Poa sp. Pâturin sp. POACEES ?<br />
Poa trivialis Pâturin commun POACEES A/V<br />
Polycarpon tetraphyllum Polycarpe à quatre feuilles CARYOPHYLLACEES A<br />
Polygala vulgaris Polygala commun POLYGALACEES V<br />
CXLIX
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Polygonum aviculare Renouée <strong>de</strong>s oiseaux POLYGONACEES A<br />
Polygonum lapathifolium Renouée à feuilles <strong>de</strong> patience POLYGONACEES A<br />
Polygonum persicaria Renouée persicaire POLYGONACEES A<br />
Portulaca oleracea Pourpier maraîcher PORTULACACEES A<br />
Portulaca sp. Pourpier sp. PORTULACACEES V<br />
Potentilla anserina Potentille ansérine ROSACEES V<br />
Potentilla erecta Tormentille, Potentille érigée ROSACEES V<br />
Potentilla reptans Potentille rampante ROSACEES V<br />
Potentilla sp. Potentille sp. ROSACEES ?<br />
Poterium sanguisorba Pimprenelle ROSACEES A<br />
Primula grandiflora Primevère à gran<strong>de</strong>s fleurs PRIMULACEES V<br />
Primula sp. Primevère sp. PRIMULACEES ?<br />
Pseudognaphalium sp. Gnaphale sp. ASTERACEES ?<br />
Pteridium aquilinum Fougère aigle commune PTERIDACEES V<br />
Ranunculus acris Renoncule âcre R<strong>EN</strong>ONCULACEES A<br />
Ranunculus arvensis<br />
Ranunculus bulbosus ssp.<br />
Renoncule <strong>de</strong>s champs R<strong>EN</strong>ONCULACEES A<br />
bulbosus Renoncule bulbeuse R<strong>EN</strong>ONCULACEES V<br />
Ranunculus repens Renoncule rampante R<strong>EN</strong>ONCULACEES V<br />
Ranunculus sardous Renoncule <strong>de</strong>s marais R<strong>EN</strong>ONCULACEES A<br />
Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate R<strong>EN</strong>ONCULACEES A<br />
Ranunculus sp. Renoncule sp. R<strong>EN</strong>ONCULACEES ?<br />
Raphanus raphanistrum ssp. landraRaifort sauvage BRASSICACEES A<br />
Rapistrum rugosum Rapistre rugueux BRASSICACEES A<br />
Reseda alba Réséda blanc RESEDACEES V<br />
Reseda lutea Réséda jaune RESEDACEES A/V<br />
Reseda luteola Réséda <strong>de</strong>s teinturiers RESEDACEES B<br />
Reseda phyteuma Réséda fausse-raiponce RESEDACEES A/V<br />
Rorippa palustris Cresson <strong>de</strong>s marais BRASSICACEES A<br />
Rorippa sylvestris Cresson <strong>de</strong>s bois BRASSICACEES V<br />
Rostraria cristata Koelérie fausse fléole POACEES A<br />
Rubia tinctorum Garance sauvage RUBIACEES V<br />
Rubus caesius Ronce bleuâtre ROSACEES V<br />
Rubus fruticosus Ronce frutescente ROSACEES P<br />
Rubus obtusifolius ROSACEES P<br />
Rubus sp. Ronce sp. ROSACEES P<br />
Rumex acetosa Oseille <strong>de</strong>s prés POLYGONACEES A/V<br />
Rumex acetosella Petite oseille POLYGONACEES V<br />
Rumex crispus Rumex crépu POLYGONACEES A/V<br />
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses POLYGONACEES A/V<br />
Rumex sp. Oseille POLYGONACEES ?<br />
Sagina apetala Sagine apétale CARYOPHYLLACEES A<br />
Sagina procumbens Sagine couchée CARYOPHYLLACEES V<br />
Sagina sp. Sagine sp. CARYOPHYLLACEES ?<br />
Salvia pratensis Sauge <strong>de</strong>s prés LAMIACEES V<br />
Sanguisorba minor Sanguisorbe pimprenelle ROSACEES A/V<br />
Sanguisorba officinalis Sanguisorbe officinale ROSACEES V<br />
Saponaria officinalis Saponaire officinale CARYOPHYLLACEES V<br />
Satureja acinos Pouliot <strong>de</strong>s champs LAMIACEES A<br />
Satureja calamintha Vrai calament LAMIACEES A<br />
Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts SAXIFRAGACEES A<br />
Scabiosa atropurpurea Scabieuse <strong>de</strong>s jardins DIPSACACEES A/V<br />
Scabiosa maritima Scabieuse colombaire ASTERACEES A/V<br />
CL
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Scabiosa sp. Scabieuse sp. ASTERACEES ?<br />
Scleranthus annuus Scléranthe annuel CARYOPHYLLACEES A<br />
Securigera coronilla Coronille variable FABACEES V<br />
Sedum acre Orpin âcre CRASSULACEES V<br />
Sedum album Vermiculaire CRASSULACEES V<br />
Sedum anglicum Orpin d'Angleterre CRASSULACEES V<br />
Sedum sediforme Orpin élevé CRASSULACEES V<br />
Sedum sp. Orpin sp. CRASSULACEES ?<br />
Senebiera coronopus Senebière corne <strong>de</strong> cerf BRASSICACEES A<br />
Senecio cineraria Séneçon cinéraire ASTERACEES V<br />
Senecio inaequi<strong>de</strong>ns Séneçon du Cap ASTERACEES A/V<br />
Senecio jacobaea Séneçon jacobée ASTERACEES B<br />
Senecio nemorensis ssp fuchsii Séneçon <strong>de</strong> Fuchs ASTERACEES ?<br />
Senecio sp. Séneçon sp. ASTERACEES ?<br />
Senecio viscosus Séneçon visqueux ASTERACEES A<br />
Senecio vulgaris Séneçon commun ASTERACEES A<br />
Setaria italica Millet <strong>de</strong>s oiseaux POACEES A<br />
Setaria pumila Queue <strong>de</strong> chat POACEES A<br />
Setaria sp. Sétaire POACEES ?<br />
Setaria verticillata Sétaire verticillée POACEES A<br />
Setaria viridis Sétaire verte POACEES A<br />
Sherardia arvensis Gratteron fleuri, Shérardie <strong>de</strong>s champs RUBIACEES A<br />
Silene conica Silène conique CARYOPHYLLACEES A<br />
Silene inflata Silène enflé CARYOPHYLLACEES V<br />
Silene latifolia Silène enflé CARYOPHYLLACEES V<br />
Silene sp. Silène sp. CARYOPHYLLACEES ?<br />
Silene vulgaris Silène enflé CARYOPHYLLACEES V<br />
Sinapis arvensis Moutar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s champs BRASSICACEES A<br />
Sinapis nigra Moutar<strong>de</strong> noire BRASSICACEES A<br />
Sison amomum Sison amome BRASSICACEES ?<br />
Sisymbrium irio Sisymbre irio BRASSICACEES A/B<br />
Sisymbrium officinale Herbe au chantre BRASSICACEES A<br />
Sisymbrium sp. Sisymbre sp. BRASSICACEES ?<br />
Solanum dulcamara Douce-amère SOLANACEES V<br />
Solanum nigrum Morelle noire SOLANACEES A/V<br />
Solanum sp. Morelle sp. SOLANACEES ?<br />
Solidago cana<strong>de</strong>nsis Verge d'or du Canada ASTERACEES A/V<br />
Sonchus arvensis Laiteron <strong>de</strong>s champs ASTERACEES V<br />
Sonchus asper Laiteron ru<strong>de</strong> ASTERACEES A<br />
Sonchus oleraceus Laiteron maraicher ASTERACEES A<br />
Sonchus sp. Laiteron sp. ASTERACEES ?<br />
Sonchus tenerrimus Laiteron délicat ASTERACEES A/V<br />
Spergula arvensis Spergule <strong>de</strong>s champs CARYOPHYLLACEES A<br />
Spergularia segetalis Spergulaire <strong>de</strong>s moissons CARYOPHYLLACEES A<br />
Spergularia sp. Spergularia sp. CARYOPHYLLACEES ?<br />
Stachys ocymastrum Epiaire hérissée LAMIACEES V<br />
Stachys recta Epiaire droite LAMIACEES V<br />
Stachys sylvatica Epiaire <strong>de</strong>s bois LAMIACEES V<br />
Stellaria cupaniana CARYOPHYLLACEES A<br />
Stellaria holostea Stellaire holostée CARYOPHYLLACEES V<br />
Stellaria media Mouron <strong>de</strong>s oiseaux CARYOPHYLLACEES A<br />
Stellaria sp. Stellaire sp. CARYOPHYLLACEES ?<br />
CLI
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Suaeda maritima Sou<strong>de</strong> maritime CH<strong>EN</strong>OPODIACEES A<br />
Symphytum officinale Gran<strong>de</strong> consou<strong>de</strong> BORAGINACEES V<br />
Tanacetum parthenium Gran<strong>de</strong> camomille ASTERACEES V<br />
Tanacetum vulgare Tanaisie commune ASTERACEES V<br />
Taraxacum officinale Pissenlit ASTERACEES A/V<br />
Teucrium scorodonia Germandrée sauvage LAMIACEES V<br />
Thesium alpinum Thésium <strong>de</strong>s Alpes SANTALACEES V<br />
Thlaspi arvense Herbe aux écus BRASSICACEES A<br />
Thymus serpyllum Thym serpolet LAMIACEES V<br />
Thymus vulgaris Thym commun LAMIACEES V<br />
Tordylium apulum APIACEES A<br />
Tordylium maximum Tordyle majeur APIACEES A<br />
Torilis arvensis ssp arvensis Torilis <strong>de</strong>s champs APIACEES A<br />
Torilis nodosa Torilis noueux APIACEES A<br />
Torilis sp. Torilis sp. APIACEES ?<br />
Tragopogon pratensis Salsifis <strong>de</strong>s prés ASTERACEES B<br />
Tragus racemosus Bardanette à grappes POACEES A<br />
Trifolium arvense Trèfle <strong>de</strong>s champs FABACEES A<br />
Trifolium campestre Trèfle jaune FABACEES A<br />
Trifolium dubium Trèfle douteux FABACEES A<br />
Trifolium incarnatum Trèfle anglais FABACEES A<br />
Trifolium leucanthum Trèfle à fleurs blanches FABACEES A<br />
Trifolium pratense Trèfle <strong>de</strong>s prés FABACEES V<br />
Trifolium purpureum Trèfle pourpre FABACEES A<br />
Trifolium repens Trèfle blanc FABACEES V<br />
Trifolium sp. Trèfle sp. FABACEES ?<br />
Trisetum flavescens Avoine dorée POACEES V<br />
Triticum sp. Blé sp. POACEES ?<br />
Tussilago farfara Pas d'âne ASTERACEES V<br />
Umbilicus pendulinus Nombril <strong>de</strong> vénus CRASSULACEES V<br />
Urtica dioica Ortie dioïque URTICACEES V<br />
Urtica sp. Ortie sp. URTICACEES ?<br />
Urtica urens Ortie brûlante URTICACEES A/B<br />
Valeriana dioica Valériane dioïque VALERIANACEES V<br />
Valeriana officinalis Herbe aux chats VALERIANACEES V<br />
Valerianella discoi<strong>de</strong>a Mâche discoï<strong>de</strong> VALERIANACEES A<br />
Valerianella locusta Mâche potagère VALERIANACEES A<br />
Verbascum lychnitis Molène lychni<strong>de</strong> SCROPHULARIACEES B<br />
Verbascum sp. Molène sp. SCROPHULARIACEES ?<br />
Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc SCROPHULARIACEES B<br />
Verbena officinalis Verveine officinale VERB<strong>EN</strong>ACEES A/V<br />
Verbena sp. Verveine sp. VERB<strong>EN</strong>ACEES ?<br />
Veronica acinifolia Véronique à feuilles d'Acinos SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica agrestis Véronique agreste SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica arvensis Véronique <strong>de</strong>s champs SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica filiformis Véronique filiforme SCROPHULARIACEES V<br />
Veronica he<strong>de</strong>rifolia Véronique à feuilles <strong>de</strong> lierre SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica peregrina Véronique voyageuse SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica persica Véronique <strong>de</strong> Perse SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica polita Véronique luisante SCROPHULARIACEES A<br />
Veronica serpyllifolia Véronique à feuilles <strong>de</strong> serpolet SCROPHULARIACEES V<br />
Veronica sp. Véronique sp. SCROPHULARIACEES ?<br />
CLII
Espèce Nom français Famille<br />
Cycle<br />
biologique<br />
Vicia cracca Vesce <strong>de</strong>s oiseaux FABACEES A<br />
Vicia hirsuta Vesce hérissée FABACEES A<br />
Vicia sativa subsp. nigra Vesce à feuilles étroites FABACEES A<br />
Vicia sepium Vesce <strong>de</strong>s haies FABACEES V<br />
Vicia sp. Vesce sp. FABACEES ?<br />
Vicia tenuifolia Vesce à feuilles fines FABACEES V<br />
Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines FABACEES A<br />
Viola alba Violette blanche VIOLACEES V<br />
Viola arvensis Pensée <strong>de</strong>s champs VIOLACEES A<br />
Viola canina Violette <strong>de</strong>s chiens VIOLACEES V<br />
Viola hirta Violette hérissée VIOLACEES V<br />
Viola odorata Violette odorante VIOLACEES V<br />
Viola riviniana Violette commune VIOLACEES V<br />
Viola sp. Violette sp. VIOLACEES ?<br />
Viola tricolor Pensée sauvage VIOLACEES A<br />
Vulpia alopecuros POACEES A<br />
Vulpia bromoi<strong>de</strong>s Vulpie faux-brome POACEES A<br />
Vulpia ciliata Vulpie ambiguë POACEES A<br />
Vulpia myuros Vulpie queue-<strong>de</strong>-rat POACEES A<br />
Vulpia sp. Vulpie sp. POACEES ?<br />
Légen<strong>de</strong> :<br />
A : annuelle<br />
B : bisannuelle<br />
V : vivace<br />
CLIII
Annexe 4<br />
Seuils d’intervention préconisés pour le désherbage en ville<br />
D’après Emilie Zadjan, 2004<br />
CLIV
SEUILS D’INTERV<strong>EN</strong>TION PRECONISES POUR LE <strong>DESHERBAGE</strong> <strong>EN</strong> VILLE<br />
Rem : les enherbements présentés sur les illustrations ne tiennent pas compte du niveau d’entretien recherché du site ni du taux d’occupation du sol par les mauvaises herbes. Leur utilité est <strong>de</strong> donner une idée <strong>de</strong>s classes <strong>de</strong> hauteur d’enherbement évoquées.<br />
Compartiment Revêtement<br />
TROTTOIR<br />
imperméable<br />
Localisation <strong>de</strong>s<br />
Niveau d'entretien recherché: soigné Niveau d'entretien recherché: modéré<br />
MHs sur le site < 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm < 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm<br />
bordure côté<br />
caniveau (1)<br />
passage 3 m lin./10m²<br />
bordure côté muret ou<br />
mur d'habitation (1)<br />
passage et bordure<br />
côté caniveau<br />
semi-perméable/<br />
perméable bordure côté muret ou<br />
mur d'habitation (1)<br />
(1) seuils exprimés en pourcentage <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong> la bordure occupée par les<br />
mauvaises herbes<br />
Trottoir imperméable<br />
(Toulouse)<br />
Trottoir perméable<br />
(Castres)<br />
FREDEC Midi-Pyrénées<br />
FREDEC Midi-Pyrénées<br />
Trottoir imperméable<br />
(Toulouse, 10 juin 2004)<br />
50% 20% 5% 0% 100% 50% 25% 5%<br />
0,5 m<br />
lin./10m²<br />
0 m lin./10m² 0 m lin./10m²<br />
100% 50% 20% 5%<br />
15% 5%<br />
1%<br />
15 m<br />
lin./10m²<br />
100%<br />
3 m lin./10m² 1 m lin./10m²<br />
0,5 m<br />
lin./10m²<br />
100%<br />
100% 30%<br />
0% 75% 25% 5% 1%<br />
50% 20% 5% 0% 100% 50% 25% 5%<br />
Trottoir perméable<br />
(Rangueil)<br />
FREDEC Midi-Pyrénées<br />
E. ZADJIAN<br />
Bordure <strong>de</strong> trottoir côté caniveau<br />
(Moissac, 10 juin 2004)<br />
Bordure trottoir côté muret<br />
(Moissac, 17 juin 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
E. ZADJIAN<br />
Bordure <strong>de</strong> trottoir côté caniveau<br />
(Moissac, 8 juillet 2004)<br />
Bordure trottoir côté muret<br />
(Moissac, 17 juin 2004)<br />
Bordure trottoir côté muret<br />
(Moissac, 16 juillet 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
E. ZADJIAN<br />
E. ZADJIAN<br />
CLV
Compartiment Revêtement<br />
Localisation <strong>de</strong>s<br />
Niveau d'entretien recherché: soigné Niveau d'entretien recherché: modéré<br />
MHs sur le site < 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm < 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm<br />
ALLEE DE PARC/<br />
imperméable 5 m lin./10m² 1 m lin./10m² 0 m lin./10m² 0 m lin./10m²<br />
15 m<br />
lin./10m²<br />
3 m lin./10m² 1 m lin./10m²<br />
0,5 m<br />
lin./10m²<br />
JARDIN semi-perméable/<br />
perméable<br />
25% 10% 2% 0% 75% 25% 5% 1%<br />
Allée perméable<br />
(Thonon-les-Bains, 26 juin 2004)<br />
Allée imperméable<br />
(Toulouse, 17 mai 2004)<br />
Compartiment Revêtement Seuils proposés<br />
ESPLANADE/<br />
imperméable mêmes seuils que pour un trottoir imperméable sur le passage<br />
SQUARE/ PLACE semi-perméable/<br />
perméable<br />
mêmes seuils que pour un trottoir semi-perméable/ perméable sur le passage<br />
E. ZADJIAN<br />
E. ZADJIAN<br />
Allée perméable<br />
(Toulouse, 11 mai 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
Allée perméable<br />
(Toulouse, 05 juillet 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
Allée perméable<br />
(Montauban, 08 juin 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
CLVI
Compartiment Revêtement<br />
CUVETTE<br />
D'ARBRE<br />
semi-perméable/<br />
perméable<br />
(2) à condition que les herbes soient proches du tronc <strong>de</strong> l'arbre<br />
Compartiment Revêtement<br />
CIMETIERE (3)<br />
imperméable<br />
semiperméable/<br />
perméable<br />
Allée <strong>de</strong> cimetière perméable<br />
(Toulouse, 6 juillet 2004)<br />
Localisation <strong>de</strong>s<br />
Niveau d'entretien recherché: soigné Niveau d'entretien recherché: modéré<br />
MHs sur le site < 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm < 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm<br />
Cuvette d’arbre perméable<br />
(Albi)<br />
Localisation <strong>de</strong>s<br />
MHs sur le site<br />
allée principale et<br />
pourtour <strong>de</strong> tombes<br />
attenantes<br />
allée secondaire et<br />
pourtour <strong>de</strong> tombes<br />
attenantes<br />
allée principale et<br />
pourtour <strong>de</strong> tombes<br />
attenantes<br />
allée secondaire et<br />
pourtour <strong>de</strong> tombes<br />
attenantes<br />
100% 25%<br />
< 7 cm 7-15 cm 15-30 cm > 30 cm<br />
3 m lin./10m²<br />
0,5 m<br />
lin./10m²<br />
5 m lin./10m² 1 m lin./10m²<br />
5% 1%<br />
25%<br />
10%<br />
0 m lin./10m²<br />
0,5 m<br />
lin./10m²<br />
0%<br />
2%<br />
5% (2) 0% 100% 100% 25%<br />
0 m<br />
lin./10m²<br />
0 m<br />
lin./10m²<br />
arrière <strong>de</strong> tombes 75% 25% 5% 1%<br />
E. ZADJIAN<br />
FREDEC Midi-Pyrénées<br />
Allée <strong>de</strong> cimetière perméable<br />
(Rennes, 22 juin 2004)<br />
Cuvette d’arbre perméable<br />
(Toulouse, 25 mai 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
0%<br />
0%<br />
E. ZADJIAN<br />
(3) Désherbage complet (tolérance 0) avant la Toussaint<br />
Allée <strong>de</strong> cimetière perméable<br />
(Montauban, 13 juillet 2004)<br />
5% (2)<br />
E. ZADJIAN<br />
Cuvette d’arbre perméable<br />
(Toulouse, 5 juillet 2004)<br />
Allée <strong>de</strong> cimetière perméable,<br />
(Cornebarrieu, 16 juillet 2004)<br />
E. ZADJIAN<br />
E. ZADJIAN<br />
CLVII
Annexe 5<br />
Sites protégés<br />
CLIX
Type <strong>de</strong> site Autori<br />
té Sites en France<br />
Réserves <strong>de</strong><br />
Biosphère<br />
Sites du Patrimoine<br />
mondial<br />
Réserves<br />
Biogénétiques<br />
Zones <strong>de</strong> Protection<br />
Spéciale pour la<br />
Méditerranée<br />
Unesco -Atoll <strong>de</strong> Taiaro, Gua<strong>de</strong>loupe, Lubéron, Mont Ventoux, Pays <strong>de</strong><br />
Fontainebleau, Camargue, Iroise, Vallée du Fango, Cévennes,<br />
Vosges du Nord<br />
Voir sur http://www.euromab.org/<br />
Unesco Sites classés au titre naturel en France :<br />
- Mont Perdu (Pyrénées)<br />
- Caps <strong>de</strong> Girolata et <strong>de</strong> Porto et réserve naturelle <strong>de</strong> Scandola,<br />
calanches <strong>de</strong> Piana (Corse)<br />
Voir sur http://www.unesco.org<br />
et http://www.mab-france.org/<br />
Réseau européen <strong>de</strong>s<br />
réserves<br />
biogénétiques<br />
(constitué par le<br />
Conseil <strong>de</strong> l'Europe)<br />
Comité permanent<br />
<strong>de</strong> la convention <strong>de</strong><br />
Barcelone<br />
Sites RAMSAR Secrétariat <strong>de</strong> la<br />
Convention <strong>de</strong><br />
Zones Importantes<br />
pour la Conservation<br />
<strong>de</strong>s Oiseaux (ZICO)<br />
Zones d'Intérêt<br />
Communautaire<br />
(Réseau Natura<br />
2000)<br />
RAMSAR<br />
Ministère <strong>de</strong><br />
l’Environnement<br />
Ministère <strong>de</strong><br />
l’Environnement<br />
Parcs Nationaux Conseil<br />
d’Administration du<br />
Parc<br />
Parcs Naturels<br />
Régionaux<br />
Il y a 35 sites en France qui sont tous <strong>de</strong>s Réserves Naturelles.<br />
(voir plus loin)<br />
Il y a actuellement 70 sites en France.<br />
Voir sur http://www.unepmap.gr/<br />
Voir sur http://www.ramsar.org/<br />
Les sites <strong>de</strong>mandant <strong>de</strong>s mesures particulières <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong><br />
protection ont été désignés Zones Spéciale <strong>de</strong> Conservation.<br />
L'ensemble <strong>de</strong>s ZPS a été intégré dans la liste <strong>de</strong>s sites proposés<br />
par la France dans le cadre <strong>de</strong> Natura 2000.<br />
Consulter http://natura2000.environnement.gouv.fr/<br />
(1428 sites au 22 mars 2005)<br />
7 parcs nationaux :<br />
Cévennes, Ecrins, Gua<strong>de</strong>loupe, Mercantour, Port-Cros,<br />
Pyrénées,Vanoise<br />
Voir http://www.parcsnationaux-fr.com/<br />
Syndicat mixte Il existe 44 PNR.<br />
Voir http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/<br />
Remarque<br />
Label <strong>de</strong>stiné à créer un réseau mondial pour la conservation <strong>de</strong>s<br />
ressources <strong>de</strong> la biosphère, selon le programme MAB (Man And<br />
Biosphere)<br />
Les sites du patrimoine mondial peuvent concerner un patrimoine<br />
culturel aussi bien qu’un patrimoine naturel.<br />
Conservation <strong>de</strong>s écosystèmes uniques en Europe<br />
L'objectif est la gestion conservatoire d'un réseau <strong>de</strong> sites renfermant<br />
<strong>de</strong>s écosystèmes méditerranéens caractéristiques.<br />
Convention relative aux zones humi<strong>de</strong>s d’importance internationale,<br />
particulièrement comme habitat <strong>de</strong>s oiseaux d’eau.<br />
Application <strong>de</strong> la directive européenne sur la conservation <strong>de</strong>s<br />
oiseaux sauvages (1979)<br />
Directive oiseaux (1979) et directive Habitats-Faune-Flore (1992)<br />
Chaque parc est créé par un décret qui délimite les zones centrales et<br />
périphériques.<br />
Territoire ruraux qui présentent une i<strong>de</strong>ntité forte, au patrimoine<br />
naturel et culturel riche, mais à l’équilibre fragile et menacé. Ils sont<br />
créés par décret et renouvelés à l’initiative <strong>de</strong>s régions et l’Etat est<br />
propriétaire <strong>de</strong> la marque collective « Parc naturel régional ». Chaque<br />
parc est régi par sa charte, approuvée par l’Etat.<br />
Réserves Naturelles Organisme Il existe actuellement 147 RN et 140 RNV en France. Il s’agit <strong>de</strong> protéger, gérer et faire découvrir <strong>de</strong>s milieux naturels<br />
CLX
(RN) et Réserves<br />
Naturelles<br />
Volontaires (RNV)<br />
gestionnaire Voir http://www.reserves-naturelles.org/<br />
Type <strong>de</strong> site Autori<br />
té Sites en France<br />
Sites du<br />
Conservatoire <strong>de</strong><br />
l'Espace littoral et<br />
<strong>de</strong>s Rivages<br />
lacustres<br />
Réserves<br />
Biologiques<br />
Domaniales et Forêts<br />
<strong>de</strong> Protection<br />
Sites relevant d'un<br />
Arrêté Préfectoral <strong>de</strong><br />
Biotope (APB)<br />
Zones Naturelles<br />
d'Intérêt Écologique<br />
Faunistique et<br />
Floristique<br />
(ZNIEFF)<br />
Conservatoires<br />
botaniques nationaux<br />
Conservatoires<br />
d’Espaces Naturels<br />
Le diplôme européen<br />
<strong>de</strong>s espaces naturels<br />
Conservatoire <strong>de</strong><br />
l'Espace littoral et<br />
<strong>de</strong>s Rivages lacustres<br />
Office National <strong>de</strong>s<br />
Forêts<br />
Mesures fixées par<br />
les préfets du<br />
département<br />
Ministère <strong>de</strong><br />
l’Environnement<br />
Fédération <strong>de</strong>s<br />
Conservatoires<br />
Botaniques<br />
Nationaux<br />
La fédération <strong>de</strong>s<br />
espaces naturels<br />
Réseau du Conseil<br />
d’Europe<br />
Au 1er juin 2005, le Conservatoire du littoral a acquis :<br />
73 610 hectares, 880 km <strong>de</strong> rivages, 300 sites naturels.<br />
Voir http://www.conservatoire-du-littoral.fr/<br />
exceptionnels et très variés<br />
Remarque<br />
Protéger, par la maîtrise foncière, le littoral en France métropolitaine<br />
et d’outremer.<br />
143 900 ha Parcelles <strong>de</strong> forêts domainiales où les activités <strong>de</strong> gestion sont<br />
exclusivement tournées vers la biodiversité<br />
9 en France en 205 :<br />
- Brest (29), Nancy (54), Porquerolles (83), Bailleul (59), Cap-<br />
Charance (05), Mascarin (97- Ile <strong>de</strong> la Réunion), Bassin Parisien<br />
(75), Massif Central (43), Midi-Pyrénées (65)<br />
Voir leurs coordonnées sur<br />
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=2792<br />
21 Conservatoires régionaux et 8 Conservatoires départementaux<br />
74000 ha dont 5% acquis, répartis sur 1700 sites<br />
Voir http://www.enf-conservatoires.org/<br />
6 zones diplômées en France en 2003 :<br />
- Réserve Nationale <strong>de</strong> Camargue (13)<br />
- Parc National <strong>de</strong>s Ecrins (05)<br />
- Parc National du Mercantour (06)<br />
- Parc National <strong>de</strong> Port-Cros (83)<br />
- Réserve Naturelle <strong>de</strong> Scandola (20)<br />
- Parc National <strong>de</strong> la Vanoise (73)<br />
http://www.coe.int/T/F/Coopération_culturelle/Environnement/Nat<br />
ure_et_diversité_biologique/Réseaux_écologiques/<br />
Inventaire à caractère scientifique, qui recense les zones <strong>de</strong> territoire<br />
naturel où <strong>de</strong>s éléments du patrimoine ont été i<strong>de</strong>ntifiés<br />
Etablissements à caractère scientifique, les conservatoires botaniques<br />
nationaux poursuivent quatre objectifs :<br />
connaissance <strong>de</strong> l’état et <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> la flore sauvage et <strong>de</strong>s<br />
habitats naturels et semi-naturels ; i<strong>de</strong>ntification et conservation <strong>de</strong>s<br />
éléments rares et menacés <strong>de</strong> la flore sauvage; concours technique et<br />
scientifique (missions d’expertise); information et l’éducation du<br />
public<br />
Sauvegar<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s sites naturels par la maîtrise foncière, la maîtrise<br />
d’usage ou les conventions <strong>de</strong> gestion<br />
«...Le Diplôme est attribué à <strong>de</strong>s espaces protégés en raison <strong>de</strong><br />
qualités remarquables du point <strong>de</strong> vue scientifique, culturel ou<br />
esthétique, à condition toutefois que ces espaces bénéficient<br />
également d’un régime <strong>de</strong> protection adéquat, éventuellement associé<br />
à <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> développement durable... »<br />
Les plans <strong>de</strong> Ministère <strong>de</strong> 18 pour la faune et 2 pour la flore en 2005 Documents d’orientation pour la conservation <strong>de</strong>s espèces,<br />
CLXI
estauration l’environnement s’inscrivant dans le cadre du « Programme d'action pour la<br />
diversité biologique en France – faune et flore sauvage »<br />
La taxe<br />
Conseil Général 71 départements concernés en 2005 Il s’agit d’une taxe dont le produit est essentiellement <strong>de</strong>stiné à<br />
départementale sur<br />
l’acquisition et à l’aménagement d’espaces naturels en vue d’en<br />
les Espaces Naturels<br />
assurer la protection et l’ouverture au public ; cette taxe concerne les<br />
Sensibles<br />
communes faisant partie d’un périmètre départemental dit<br />
« sensible ».<br />
Aires Spécialement<br />
Régies par un protocole faisant suite à la convention <strong>de</strong> Barcelone :<br />
Protégées (ASP) et<br />
les Etats sont invités à créer <strong>de</strong>s aires spécialement protégées dans <strong>de</strong>s<br />
Aires Spécialement<br />
zones marines ou côtières soumises à leur juridiction.<br />
Protégées<br />
Concerne les zones marines, zones côtières terrestres et zones<br />
d’Importance<br />
Méditerranéenne<br />
(ASPIM)<br />
humi<strong>de</strong>s.<br />
Cette liste est non exhaustive ; pour plus <strong>de</strong> renseignements contactez la direction <strong>de</strong> l’environnement (diren) <strong>de</strong> votre région.<br />
CLXII
Annexe 6<br />
Types <strong>de</strong> symptômes <strong>de</strong> phytotoxicité pouvant être causés par certains herbici<strong>de</strong>s sur les arbres et arbustes d’ornement<br />
CLXIV
Matières Usages Mo<strong>de</strong> Types <strong>de</strong> symptômes Remarques<br />
actives<br />
d’absorption<br />
Dicamba Désherbage gazons <strong>de</strong> racinaire Suppression drastique <strong>de</strong> la croissance, cloquage <strong>de</strong>s feuilles, enroulement (*) en cas <strong>de</strong> contamination<br />
graminées<br />
<strong>de</strong> l’extrémité <strong>de</strong>s pousses, jaunissement <strong>de</strong>s nouvelles feuilles, avortement<br />
<strong>de</strong>s bourgeons, brunissement ou noircissement du feuillage (selon l’espèce<br />
végétale), défoliation, parfois mort <strong>de</strong>s plantes.<br />
Sur épicéas (Picea glauca, Picea pungens) : décoloration, puis chute <strong>de</strong>s<br />
aiguilles et mort <strong>de</strong>s branches (*)<br />
Dépérissements <strong>de</strong> branches sur chênes, tilleuls, tulipiers <strong>de</strong> virginie, féviers<br />
d’Amérique (*)<br />
Déformations <strong>de</strong> feuilles sur érables, frênes, noyers, arbre <strong>de</strong> Judée (*).<br />
Sur platane (Platanus x acerifolia) : élongation et croissance <strong>de</strong>s feuilles<br />
stoppée ; avortement <strong>de</strong>s bourgeons, feuilles torsadées déformées et<br />
chlorotiques.<br />
importante<br />
Phytohormones<br />
(2,4D – 2,4DB –<br />
2,4MCPA –<br />
MCPP)<br />
Benzonitiriles<br />
(dichlobénil)<br />
Urées<br />
substituées<br />
(diuron)<br />
Uraciles<br />
(bromacil)<br />
Désherbage gazons <strong>de</strong><br />
graminées<br />
(et DT-PJT pour<br />
2,4MCPA)<br />
Arbres et arbustes<br />
d’ornement (plantations),<br />
DT-PJT<br />
Surtout par<br />
absorption<br />
foliaire suite<br />
à une dérive<br />
Conifères peu sensibles, mais il peut y avoir recourbement <strong>de</strong>s pousses<br />
(notamment chez pin) et chute d’aiguilles.<br />
Sur feuillus : cloquages, incurvations et recurvations <strong>de</strong>s feuilles ;<br />
avortements <strong>de</strong> bourgeons ; déformations <strong>de</strong>s pétioles, <strong>de</strong>s rachis ou <strong>de</strong>s<br />
nervures principales ; nervures anormalement proéminentes ou nervation<br />
parallèle <strong>de</strong>s feuilles ; atrophie du tissu foliaire internervaire…Pour les cas<br />
les plus graves : mort <strong>de</strong>s bourgeons, durcissement ou nécrose <strong>de</strong>s feuilles,<br />
retard du débourrement au printemps, arrêt <strong>de</strong> la dominance apicale,<br />
coloration anormalement pourpre <strong>de</strong>s jeunes pousses vertes (frêne, érable,<br />
noyer…), lésions sur écorces, suppression <strong>de</strong> la croissance racinaire.<br />
Racinaire Ils causent souvent <strong>de</strong>s raccourcissements et épaississements racinaires, et<br />
<strong>de</strong>s chloroses marginales pouvant évoluer en chloroses et brunissements<br />
généralisés.<br />
La présence <strong>de</strong> granulés <strong>de</strong> ces herbici<strong>de</strong>s au pied <strong>de</strong> certains conifères (pin<br />
sylvestre, pin laricio, douglas ou mélèze) peut entraîner <strong>de</strong>s boursouflements<br />
à la base <strong>de</strong>s tiges (provoque la mort du cambium au niveau du sol,<br />
entraînant une inhibition <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong> la tige au niveau du sol et<br />
parfois le dépérissement <strong>de</strong>s plants)<br />
DT-PJT Racinaire Elles entraînant souvent <strong>de</strong>s chloroses nervaires, <strong>de</strong>venant rapi<strong>de</strong>ment<br />
nécrotiques jusqu’à envahir la totalité <strong>de</strong>s limbes.<br />
DT-PJT Racinaire Symptômes i<strong>de</strong>ntiques à ceux <strong>de</strong>s urées substituées ; peuvent par exemple<br />
entraîner <strong>de</strong>s blanchiments sur feuilles <strong>de</strong> pommiers et <strong>de</strong>s rougissements<br />
<strong>de</strong>s aiguilles âgées sur épicéa.<br />
Aminotriazole DT-PJT Racinaire L’aminotriazole agit par blocage <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> la chlorophylle et<br />
Parmi les arbres à feuilles caduques,<br />
l’érable negundo et l’arbre <strong>de</strong> Judée<br />
sont particulièrement sensibles et<br />
peuvent être utilisés comme plantes<br />
indicatrices en cas <strong>de</strong> dégât<br />
suspecté.<br />
Les dégâts <strong>de</strong> 2,4D, MCPA<br />
(déformation, recroquevillement <strong>de</strong>s<br />
feuilles) peuvent être confondus<br />
avec <strong>de</strong>s symptômes résultant <strong>de</strong><br />
fortes attaques d’acariens ou <strong>de</strong><br />
pucerons, bien la déformation <strong>de</strong>s<br />
pétioles permette <strong>de</strong> les reconnaître.<br />
Les dégâts dus aux urées substituées<br />
et aux uraciles sont caractérisés, à<br />
leur sta<strong>de</strong> ultime, par <strong>de</strong>s nécroses<br />
totales <strong>de</strong>s feuilles pouvant être<br />
confondues avec celles dues à la<br />
sécheresse.<br />
CLXV
entraîne un blanchiment du feuillage, entraînant une mort <strong>de</strong>s rameaux<br />
affectés.<br />
Glyphosate DT-PJT Foliaire En cas d’atteinte acci<strong>de</strong>ntelle par dérive,<br />
- sur érable : graves rabougrissements et déformation <strong>de</strong>s jeunes<br />
pousses<br />
- sur bouleau : défoliation et mort<br />
- sur épicéa et mélèze : blanchiment puis nécrose <strong>de</strong> l’extrémité <strong>de</strong> la<br />
couronne ; en cas <strong>de</strong> contamination sévère, les branches et les<br />
pousses laissent apparaître <strong>de</strong>s écoulements pendant toute la saison<br />
qui suit l’application.<br />
CLXVI
Annexe 7<br />
Critères <strong>de</strong> choix pour les plantes ornementales pouvant être utilisées comme couvre-sols<br />
CLXVIII
Plantes vivaces couvre-sol<br />
Nom Aspect Dimensions Type <strong>de</strong> sol Exposition Emplacement Exigences d’entretien<br />
recommandé phytosanitaire<br />
Alchemille<br />
Feuilles palmées, vert 30-40 cm <strong>de</strong> haut Frais à humi<strong>de</strong> Mi-ombre à soleil (en Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Alchemilla sp.) clair et duveteuses ;<br />
sol frais)<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
fleurs jaunes verdâtres<br />
bordure <strong>de</strong> haie<br />
Asperule odorante Floraison blanche, très 40 cm Frais Ombre à mi-ombre Massifs arbustifs, X<br />
(Asperula odorata) fine et parfumée<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
Bergenia<br />
Feuillage ample et 35 cm Frais à humi<strong>de</strong> Mi-ombre à soleil Massifs arbustifs, X<br />
(Bergenia cordifolia) coriace, floraison rose<br />
pieds d’arbres<br />
Bugle rampant Feuilles en rosette, 51 cm <strong>de</strong> haut Frais à humi<strong>de</strong>, pas Ombre à soleil (en sol Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Ajuga repens) fleurs bleutées formant<br />
trop compact frais)<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
<strong>de</strong>s épis dressés ; il<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
existe <strong>de</strong>s variétés à<br />
feuillage panaché.<br />
d’arbres<br />
Campanule naine Feuilles cordiformes 10 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais<br />
Ombre à soleil (en sol Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Campanula muralis) persistantes ;<br />
frais)<br />
fleurs, bordure <strong>de</strong> haie,<br />
floraison :<br />
violettes<br />
clochettes<br />
pieds d’arbres<br />
Céraiste<br />
Feuilles persistantes 10-20 cm <strong>de</strong> haut Indifférent Plein soleil<br />
Pieds d’arbres et X<br />
(Cerastium arvense) grisâtres et<br />
d’arbustes<br />
duveteuses ; floraison<br />
blanche<br />
Ciste<br />
Feuilles lancéolées, 50-80 cm Sec Plein soleil Massifs d’arbustes, X<br />
(Cistus crispus) fleures roses à pétales<br />
larges<br />
pieds d’arbres<br />
Coussin d’argent Feuillage gris, petites 10-15 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Mi-ombre à plein Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Cerastium<br />
fleurs blanches<br />
soleil<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
tomentosum)<br />
pieds d’arbres<br />
Euphorbe <strong>de</strong> Corse Feuillage gris-bleu 20 cm Sec à frais Soleil Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Euphorbia myrsinites) légèrement succulent,<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
fleurs jaune-vert<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
Géranium <strong>de</strong>s bois La floraison peut avoir 70 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Plein soleil Massifs <strong>de</strong> fleurs, X<br />
(Geranium sylvaticum) <strong>de</strong>s couleurs diverses<br />
d’arbustes, bordure <strong>de</strong><br />
selon la variété (blanc,<br />
bleu, mauve, rose…)<br />
haie, pieds d’arbres<br />
Géranium à grosses Feuillage persistant, 30 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Ombre à soleil (en sol Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
racines<br />
aromatique, vert teinté<br />
frais)<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
(Geranium<br />
<strong>de</strong> rouge à l'automne.<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
macrorrhyzum)<br />
d’arbres<br />
Geranium oxonianum Il existe <strong>de</strong>s variétés à 40-50 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Mi-ombre à soleil (en Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
CLXIX
(Geranium<br />
oxonianum)<br />
feuillage décoratif, par<br />
exemple marqué <strong>de</strong><br />
pourpre<br />
sol frais) fleurs, d’arbustes,<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
Nom Aspect Dimensions Type <strong>de</strong> sol Exposition Emplacement Exigences<br />
recommandé phytosanitaires<br />
Géranium sanguin Fleurs roses, blanches, 20-40 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Plein soleil Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Geranium<br />
bleues…selon la<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
sanguineum) variété<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
Geranium <strong>de</strong>s prés De nombreuses 20-50 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Mi-ombre à soleil Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Geranium pratense) variétés, à feuillage<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
décoratif (pourpre..) et<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
à fleurs <strong>de</strong> différentes<br />
couleurs<br />
d’arbres<br />
Lamier<br />
Petites tiges carrées, 20 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Ombre à mi-ombre Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Lamium maculata) feuilles ondulées ou<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
<strong>de</strong>ntées, panachées<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
Myosotis du Caucase Floraison bleue et 30-40 cm <strong>de</strong> haut Indifférent Ombre à soleil (en sol Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong> X<br />
(Brunnera sp.) légère, tiges dressées ;<br />
frais)<br />
fleurs, d’arbustes,<br />
feuillage large, vert<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
foncé<br />
d’arbres<br />
Nepeta<br />
Fleurs bleues 30-70 cm <strong>de</strong> haut Sec Mi-ombre à plein Massifs <strong>de</strong> fleurs et <strong>de</strong> X<br />
(Nepeta musinii)<br />
soleil<br />
rosiers, pieds d’arbres<br />
Origan<br />
Tiges rougeâtres 30-70 cm Sec à frais Mi-ombre à plein<br />
X<br />
(Origanum majorana) dressées, petites<br />
soleil<br />
feuilles<br />
arrondies<br />
grisâtres<br />
Pachysandra<br />
Feuilles persistantes 30 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Ombre ou mi-ombre Massifs d’arbustes, X<br />
(Pachysandra vertes ou panachées ;<br />
bordure <strong>de</strong> haie<br />
terminalis)<br />
installation assez lente<br />
Petite pervenche Fleurs bleues 15-20 cm <strong>de</strong> haut Indifférent Ombre à mi-ombre Massifs <strong>de</strong> fleurs, X<br />
CLXX
(Vinca minor) violacées, feuillage<br />
vert brillant (il existe<br />
<strong>de</strong>s variétés à feuillage<br />
Pulmonaire<br />
(Pulmonaria<br />
officinalis)<br />
Saponaire<br />
(Saponaria ocymoi<strong>de</strong>s)<br />
Sedum lydium<br />
(Sedum lydium)<br />
ornemental)<br />
Feuilles cordées, fleurs<br />
roses puis violettes<br />
Feuillage persistant,<br />
floraison rose<br />
abondante<br />
Feuilles charnues, très<br />
serrées à l’extrémité<br />
rouge. Petites<br />
inflorescences en<br />
plateaux <strong>de</strong> couleur<br />
blanche.<br />
Sedum spurium Feuilles charnues<br />
ovales, vert-bleutées ;<br />
Vegerette<br />
(Erigeron glaucus)<br />
Grimpantes<br />
inflorescences roses<br />
Touffes <strong>de</strong> feuillage<br />
glauque ; gran<strong>de</strong>s<br />
fleurs roses à cœur<br />
jaune (astéracée).<br />
d’arbustes, bordure <strong>de</strong><br />
haie<br />
20-30 cm <strong>de</strong> haut Indifférent Ombre à mi-ombre Massifs <strong>de</strong> rosiers,<br />
d’arbustes, bordure <strong>de</strong><br />
15 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Plein soleil Bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
5 cm Sec à frais Soleil Massifs <strong>de</strong> rosiers ou<br />
<strong>de</strong> fleurs, pieds<br />
d’arbres<br />
1 cm Sec à frais Soleil Massifs <strong>de</strong> rosiers ou<br />
<strong>de</strong> fleurs, pieds<br />
25 cm <strong>de</strong> haut Sec à frais Mi-ombre à plein<br />
soleil<br />
haie<br />
d’arbres<br />
Massifs <strong>de</strong> rosiers, <strong>de</strong><br />
fleurs, d’arbustes,<br />
bordure <strong>de</strong> haie, pieds<br />
d’arbres<br />
Nom Aspect Dimensions Type <strong>de</strong> sol Exposition Emplacement Exigences<br />
recommandé phytosanitaires<br />
Lierre<br />
Il existe <strong>de</strong>s variétés à - Sec à frais Indifférent Massifs arbustifs, X<br />
(He<strong>de</strong>ra helix) feuillage panaché<br />
bordures <strong>de</strong> haies,<br />
pieds d’arbres<br />
Liseron <strong>de</strong> Mauritanie Petites feuilles vert- 1m Frais Soleil Massifs arbustifs, X<br />
(Convolvulus sabatius) argenté ; fleurs bleues<br />
bordures <strong>de</strong> haies,<br />
en entonnoir<br />
pieds d’arbres<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
CLXXI
Arbustes couvre-sol<br />
Nom Aspect Dimensions Type <strong>de</strong> sol Exposition Emplacement Exigences<br />
recommandé phytosanitaires<br />
Cotoneaster adpressus Fleurs rosées 50 cm Sec à frais Mi-ombre à soleil Massifs d’arbustes, X<br />
solitaires ; fruits rouge<br />
vif à l’automne<br />
pieds d’arbres<br />
Ctoneaster dammeri Fleurs blanches, 20 cm Sec à frais Mi-ombre à soleil Massifs d’arbustes, X(X) selon la<br />
solitaires, fruits rouge<br />
pieds d’arbres sensibilité du cultivar<br />
vif à l’automne<br />
au feu bactérien.<br />
Cotoneaster<br />
Revers <strong>de</strong>s feuilles 50 cm Sec à frais Mi-ombre à soleil Massifs<br />
«’Eichholz » est une<br />
variété donnée comme<br />
résistante.<br />
d’arbustes, X<br />
horizontalis<br />
tomenteux, glauques ;<br />
fleurs blanches rosées<br />
solitaires ou par 2,<br />
fruits rouges vifs<br />
pieds d’arbres<br />
Cytise rampante Arbuste très feuillu ; 0,5 moyen Plein soleil Massifs d’arbustes, X<br />
(Cytisus procumbens) tiges ailées ; feuilles à<br />
un foliole, linéaires,<br />
pieds d’arbres<br />
abondante floraison<br />
jaune au printemps<br />
Fusains rampants Feuilles persistantes, Selon taille (2m) Indifférent Ombre à mi-ombre Pieds d’arbres X(X)<br />
(Euonymus sp.) parfois panachées<br />
Hebe carnosula Feuilles en tuiles <strong>de</strong> 40 cm<br />
toit, bleu-gris ; fleurs<br />
Sec à frais soleil Pieds d’arbres X (climat doux)<br />
blanches en tête<br />
terminales<br />
l’été<br />
compactes<br />
Millepertuis à gran<strong>de</strong>s Feuillage vert intense 40 cm sec mi-ombre Massifs d’arbustes, X<br />
fleurs<br />
sessile, coriace ; fleurs<br />
pieds d’arbres<br />
(Hypericum<br />
7-8 cm <strong>de</strong> large jaunes<br />
calycinum)<br />
vifs<br />
Millepertuis grec Feuilles sessiles, vert 30 cm sec mi-ombre Massifs d’arbustes, X<br />
(Hypericum<br />
grisâtre ; fleurs jaunes<br />
pieds d’arbres<br />
olympicum)<br />
vifs, 1-5 cm<br />
Symphorine<br />
Feuilles caduques Selon taille (1 à 2m) moyen soleil Pieds d’arbres X<br />
(Symphoricarpos sp.) arrondies, petites fleurs<br />
roses, fruits en eptites<br />
boules blanches<br />
Légen<strong>de</strong> : X : faible ; XX : moyen ; XXX : important<br />
CLXXII
Annexe 8<br />
Critères <strong>de</strong> choix pour les paillages<br />
CLXXIV
Type <strong>de</strong> paillis<br />
Contrôle<br />
<strong>de</strong>s<br />
adventices<br />
Durée <strong>de</strong> vie<br />
Valeur esthétique Compartiment(s)<br />
adapté(s)<br />
Film propylène +++ Plusieurs années 0 - Peu cher<br />
Bâche plastique tissée +++ Plusieurs années 0 - Peu cher<br />
- Plus poreux et plus résistant<br />
Avantages Inconvénients<br />
que les films plastiques<br />
Géotextiles +++ Plusieurs années 0 - Peu cher<br />
- Perméable à l’air et à l’eau<br />
Toiles <strong>de</strong> fibres<br />
végétales<br />
Paillages multicouches<br />
(plastique – fibres<br />
végétales)<br />
Dalles <strong>de</strong> matières<br />
végétales<br />
+++ Quelques années<br />
(2 ans en<br />
moyenne)<br />
Bâches papier +++ Enterré : 3 à 4<br />
semaines<br />
Non enterré : 8 à<br />
12 semaines<br />
++ - Meilleure esthétique que<br />
pour les toiles synthétiques<br />
- Pas <strong>de</strong> problème <strong>de</strong><br />
dispersion<br />
- Biodégradables<br />
+++ Plusieurs années ++ - Meilleure esthétique que<br />
pour les toiles synthétiques<br />
- Pas <strong>de</strong> problème <strong>de</strong><br />
dispersion<br />
- Mise en place<br />
- Se dégra<strong>de</strong> à la lumière, il est<br />
conseillé <strong>de</strong> recouvrir avec un<br />
paillage flui<strong>de</strong> (écorces,<br />
graviers)<br />
- Peut provoquer <strong>de</strong>s élévations<br />
<strong>de</strong> température importantes<br />
- Imperméable, l’arrosage doit<br />
être fait au goutte-à-goutte<br />
- Déchirures, trous <strong>de</strong><br />
cigarettes…<br />
- Doit être retiré après usage<br />
- Mise en place<br />
- Doit être retirée après usage<br />
- Risque d’obturation <strong>de</strong>s pores<br />
par les particules <strong>de</strong> sol<br />
- Doit être retiré après usage<br />
- Blanchiment<br />
- Aspect lors <strong>de</strong> la dégradation<br />
- Blanchiment<br />
- Aspect lors <strong>de</strong> la dégradation<br />
- Pas totalement biodégradable<br />
+++ Plusieurs années ++ - Aspect propre - Adapté surtout aux sujets isolés<br />
sur sol plat<br />
0 - Aspect propre<br />
- biodégradable<br />
- perméable à l’eau e à l’air<br />
- Risque <strong>de</strong> déchirure<br />
- Inflammable<br />
- durée <strong>de</strong> vie très courte<br />
CLXXV
Type <strong>de</strong> paillis<br />
Contrôle<br />
<strong>de</strong>s<br />
adventices<br />
Durée <strong>de</strong> vie<br />
Tontes <strong>de</strong> pelouses + Quelques<br />
semaines<br />
Valeur esthétique Compartiment(s)<br />
adapté(s)<br />
0 - Libère <strong>de</strong> l’azote lors <strong>de</strong> la<br />
décomposition<br />
- Améliore la structure du sol<br />
- Gratuit, valorisation d’un<br />
déchet vert<br />
Feuilles mortes ++ Un an ++ - Libère <strong>de</strong> l’azote lors <strong>de</strong> sa<br />
décomposition<br />
- Gratuit, valorisation d’un<br />
déchet vert<br />
Aiguilles <strong>de</strong> conifères<br />
+++ 1 à 2 ans +++ - Décomposition lente<br />
- O<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> résine<br />
- Gratuit, valorisation d’un<br />
déchet vert<br />
Avantages Inconvénients<br />
- Peut contenir <strong>de</strong>s résidus<br />
d’herbici<strong>de</strong>s (nécessité <strong>de</strong> 2<br />
tontes avant utilisation)<br />
- Peut former un « paillasson »<br />
compact imperméable à l’eau et<br />
à l’air<br />
- Peut développer une souscouche<br />
humi<strong>de</strong>, favorisant les<br />
maladies<br />
- Peut dégager <strong>de</strong> la chaleur et<br />
<strong>de</strong>s mauvaises o<strong>de</strong>urs en se<br />
décomposant si non composté<br />
- Durée <strong>de</strong> vie très courte<br />
- Peut former une couche<br />
imperméable à l’eau et à l’air :<br />
préférable <strong>de</strong> broyer ou <strong>de</strong><br />
composter<br />
- Contient <strong>de</strong>s métaux lourds<br />
polluants<br />
- La ville <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux rapporte<br />
avoir rencontré <strong>de</strong>s problèmes<br />
d’augmentation du pH avec <strong>de</strong>s<br />
feuilles <strong>de</strong> platanes<br />
- Certaines feuilles peuvent<br />
contenir <strong>de</strong>s pathogènes (ex :<br />
oeufs <strong>de</strong> Camemaria)<br />
- Acidification<br />
- Peut empêcher la circulation <strong>de</strong><br />
l’eau et <strong>de</strong> l’air si couche trop<br />
importante<br />
Broyat <strong>de</strong> bois +++ 2 ans + - Facile à appliquer - éventuelle présence <strong>de</strong><br />
CLXXVI
d’élagage - Les copeaux grossiers sont<br />
moins sujets à la compaction<br />
- Gratuit, valorisation d’un<br />
déchet vert<br />
Type <strong>de</strong> paillis<br />
Contrôle<br />
<strong>de</strong>s<br />
adventices<br />
Durée <strong>de</strong> vie<br />
Valeur esthétique Compartiment(s)<br />
adapté(s)<br />
Ecorces <strong>de</strong> pin +++ 1 à 3 ans +++ - Facile à appliquer<br />
- Plusieurs tailles disponibles<br />
Copeaux <strong>de</strong> bois +++ Jusqu’à 4-5 ans +++ - Stable<br />
- Différents coloris<br />
disponibles<br />
- Permet la création d’une<br />
dalle poreuse pour entourer<br />
Cosses <strong>de</strong> fèves <strong>de</strong><br />
cacao<br />
Paillettes <strong>de</strong> chanvre et<br />
<strong>de</strong> lin<br />
Paille 0 Quelques<br />
semaines ?<br />
les arbres<br />
+++ 1 an +++ - aspect esthétique<br />
-stable si arrosé lors <strong>de</strong> la<br />
mise en place<br />
- o<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> cacao<br />
ravageurs ou <strong>de</strong> pathogènes<br />
- aspect grossier<br />
- consommation d’azote à la<br />
décomposition<br />
- éventuelle allélopathie<br />
Avantages Inconvénients<br />
- amen<strong>de</strong>ment organique<br />
+++ 1 an +++ - couleur claire esthétique<br />
- stable si arrosé à la<br />
plantation<br />
- fertilisation ( ?)<br />
+ - peu cher<br />
- favorise la structure du sol<br />
- atténue les variations <strong>de</strong><br />
température<br />
Pouzzolane +++ Plusieurs années +++ - esthétique<br />
- poreux<br />
- améliore la structure du sol<br />
graviers +++ Plusieurs années ++ - le choix du type <strong>de</strong> gravier<br />
peut permettre une bonne<br />
Mélange gravier /<br />
résine<br />
intégration paysagère<br />
+++ Plusieurs années +++ - aspect propre<br />
- facilite l’entretien<br />
- acidification du sol<br />
- consommation d’azote à la<br />
décomposition<br />
- coût assez élevé<br />
- couleur peu résistante (1-2 ans)<br />
- assez coûteux<br />
- assez coûteux<br />
- peut être éparpillé par les<br />
oiseaux<br />
- assez coûteux<br />
- couleur pas toujours adaptée à<br />
l’effet recherché<br />
- réverbération<br />
- à réserver au parcs à caractère<br />
champêtre<br />
- inflammable<br />
- consomme <strong>de</strong> l’azote en se<br />
décomposant<br />
- favorise Phytophtora sp. <strong>de</strong>s<br />
racines et collets<br />
- assez coûteux<br />
- nécessite plus <strong>de</strong> 5 cm<br />
d’épaisseur pour être efficace<br />
- peut blesser les plantations<br />
- porosité diminue dans le temps<br />
- matériau rigi<strong>de</strong> qui empêche la<br />
croissance radiale <strong>de</strong> l’arbre<br />
- mise en œuvre contraignante<br />
CLXXVII
(décaissement pour installer un<br />
massif drainant)<br />
CLXXVIII
Annexe 9<br />
Critères <strong>de</strong> choix pour les espèces à gazon<br />
CLXXX
Nom<br />
commun<br />
Agrosti<strong>de</strong><br />
ténue ou<br />
commune,<br />
stolonifère<br />
Fétuque<br />
élevée<br />
Fétuque<br />
ovine<br />
durette<br />
Fétuque<br />
rouge <strong>de</strong>mi-<br />
traçante<br />
Fétuque<br />
rouge<br />
gazonnante<br />
Fétuque<br />
rouge<br />
traçante<br />
Fléole<br />
bulbeuse<br />
Pâturin <strong>de</strong>s<br />
prés<br />
Ray Grass<br />
anglais<br />
Esthétique <br />
Comportement<br />
hivernal<br />
Comportement<br />
estival<br />
Tolérance à<br />
l’ombre<br />
5 - 6 2,5 - 5,8 2,5 - 4 faible<br />
4,2 - 6,8 3,2 - 5,2 4,5 - 6,8 faible<br />
5,5 - 6,5 4,2 - 7 3,5 - 6 faible<br />
4,6 - 7 5 - 6 4 - 6,5 bonne<br />
Type <strong>de</strong> sol<br />
Supporte les sols<br />
aci<strong>de</strong>s, résiste à la<br />
submersion<br />
Résiste aux excès<br />
d’eau, tolère les<br />
sols un peu salés<br />
Accepte les sols<br />
pauvres<br />
Résiste assez bien<br />
aux excès <strong>de</strong><br />
salinité<br />
Résistance<br />
au<br />
piétinement<br />
Vitesse<br />
d’installation<br />
Densité<br />
Fil rouge<br />
Maladies<br />
5 - 7 5 - 5,5 7,2 - 8,5 6,8 -7,5 5,2 - 7<br />
4,2 - 7.2 4,2 - 6,8 5,5 - 8,5 7,5 - 8 5,6 -8,9 7 - 9<br />
3,2 - 5 5,1 - 7,1 7,5 - 9 7 - 9 6,5 - 8 7,5 - 9<br />
3 - 5,5 5,5 - 7 7,5 - 9 6 - 8 4,5 - 8 6,5 -8,5<br />
5,5 - 7 3 - 6,5 3 - 4 bonne 3 - 5,3 6 - 7,8 7,5 - 9 6 - 7,5 5,2 -7,5 6 - 9<br />
4,2 - 5,8 4 - 6 3 - 4,5 faible 1,2 - 4 6 - 8 6,5 - 8 6 - 7 5 - 7,8 6,5 -8,2<br />
6 - 7 6 - 7 3,2 - 4 faible<br />
4,5 - 5,2 4,2 - 7 3,5 - 4,8 bonne<br />
Semer sur un sol<br />
bien préparé<br />
Tolère les sols<br />
salés<br />
7 - 8 6,5 - 7 7 - 8<br />
4,5 - 7,5 3,5 - 5,8 5,5 - 8 6 - 7 5,8 - 8 3 - 7<br />
5,2 - 7 4,5 - 6 3,5 - 5 modérée 6,5 - 8 7,5 - 8 6,5 - 9 6 - 8,5 4,5 - 8 5,5 - 9<br />
Les données proviennent du Groupement National Interprofessionnel <strong>de</strong>s Semences et plants (GNIS) ; les notes correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s notes sur 9 (9 étant la plus élevée et 1 la<br />
plus faible). Pour plus d’informations : http://www.gnis-pedagogie.org/. Ce tableau ne récapitule que les propriétés <strong>de</strong>s principales espèces ; il existe <strong>de</strong> nombreuses variétés<br />
améliorées <strong>de</strong> ces espèces.<br />
D’autres espèces sont disponibles également, notamment la canche gazonnante (bonne résistance à l’ombre, bonne <strong>de</strong>nsité, feuillage fin, tolérance à l’ombre) et le koeleria<br />
(espèce à faible repousse <strong>de</strong>mandant un faible entretien, adaptée aux sols pauvres).<br />
Fusariose<br />
Rouille<br />
CLXXXI
Annexe 10<br />
Propriétés physico-chimiques favorisant les transferts <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
Toxicologie et écotoxicologie <strong>de</strong> ces produits<br />
CLXXXII
Propriétés physico-chimiques favorisant les transferts <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques ; toxicologie et<br />
écotoxicologie <strong>de</strong> ces produits<br />
Propriétés physico-chimiques influant la volatilisation <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques<br />
La volatilisation à partir du sol et <strong>de</strong>s plantes dépend essentiellement <strong>de</strong>s propriétés physico-chimiques du<br />
pestici<strong>de</strong> et principalement <strong>de</strong> :<br />
La tension <strong>de</strong> vapeur :<br />
La tension <strong>de</strong> vapeur caractérise l’aptitu<strong>de</strong> d’une substance active à se volatiliser et donc à passer <strong>de</strong> la phase<br />
aqueuse dans le sol ou sur le végétale dans l'atmosphère.<br />
Plus la tension <strong>de</strong> vapeur est importante, plus la volatilisation est importante. Les produits considérés comme<br />
volatiles sont ceux dont la tension <strong>de</strong> vapeur est <strong>de</strong> l’ordre du Pascal, les produits peu volatiles sont ont une<br />
tension <strong>de</strong> vapeur <strong>de</strong> quelques milli-Pascals.<br />
La solubilité :<br />
Lors <strong>de</strong> l'évaporation à partir du sol ou <strong>de</strong>s plantes, elle conditionne le passage dans l'air. La solubilité influence<br />
la répartition <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s entre les différentes phases <strong>de</strong> l'atmosphère (nuages et brouillards, phase gazeuse).<br />
La constante <strong>de</strong> Henry (H) :<br />
C'est le rapport <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> vapeur à la solubilité dans l'eau. Elle indique la tendance d'un produit à se<br />
déplacer <strong>de</strong> l'eau vers l'air ou vice-versa. Les pestici<strong>de</strong>s dont la constante <strong>de</strong> Henry est supérieure à 2.5.10 -5<br />
Pa.m 3 .mole -1 sont volatiles. La constante <strong>de</strong> Henry dépend <strong>de</strong> la température et <strong>de</strong>s variations journalières et<br />
saisonnières.<br />
Propriétés physico-chimiques influant le transfert <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques vers les eaux superficielles<br />
ou souterraines<br />
Les principaux critères inhérents aux principaux produits utilisés en espaces verts et pouvant conditionner<br />
l'aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces produits à passer dans les eaux superficielles et souterraines seront résumés dans les tableaux <strong>de</strong><br />
synthèse .<br />
Le coefficient d'adsorption par unité <strong>de</strong> masse <strong>de</strong> carbone organique (Koc) :<br />
La mobilité ou l'affinité <strong>de</strong>s produits pour le sol est donnée par le coefficient d'adsorption par unité <strong>de</strong> masse <strong>de</strong><br />
carbone organique. Il dépend seulement <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> la matière organique et pratiquement pas du type <strong>de</strong> sol.<br />
Le plus souvent, cette valeur est mesurée en laboratoire. Expérimentalement, l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'adsorption d'une<br />
substance sur un sol consiste à mesurer le coefficient <strong>de</strong> partage sol-eau pour différentes concentrations initiales.<br />
Koc = Cs × 1<br />
(en cm 3 /g) Cw Foc<br />
Cs = Concentration en pestici<strong>de</strong> dans la phase soli<strong>de</strong> du sol en µg/g <strong>de</strong> sol<br />
Cw = Concentration en pestici<strong>de</strong> dans la phase liqui<strong>de</strong> du sol en µg/cm 3<br />
Foc = Fraction <strong>de</strong> carbone organique présent dans le sol<br />
Plus la valeur Koc est élevée, plus la mobilité du produit est limitée.<br />
La <strong>de</strong>mi-vie (DT50) :<br />
CLXXXIII
La <strong>de</strong>mi-vie d’une substance active, ou DT50 correspond au temps au bout duquel il reste, statistiquement, la<br />
moitié <strong>de</strong> la quantité initiale d’une substance. Elle donne une indication <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong> la<br />
substance active dans le sol.<br />
La vitesse d’hydrolyse<br />
L'hydrolyse est la réaction d'une substance R-X dans l'eau (qui peut être une matière active phytosanitaire) dans<br />
laquelle le groupement X est échangé avec un groupement OH - . Le pH et la température sont les facteurs les plus<br />
importants qui influencent l'hydrolyse <strong>de</strong>s molécules phytosanitaires.<br />
La vitesse d’hydrolyse est évaluée par le temps <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong> la substance active (DT50) dans l'eau,<br />
exprimé en jours ou en heures à un pH donné et déterminé par un test <strong>de</strong> laboratoire.<br />
La solubilité<br />
La solubilité est définie comme la quantité maximale <strong>de</strong> matière active pouvant se dissoudre dans un volume<br />
d'eau à une température donnée. La gran<strong>de</strong> solubilité d'une substance active dans l'eau lui permet <strong>de</strong> suivre les<br />
mouvements d'eau dans le sol et à sa surface. Cette propriété conditionne la tendance d'un produit à être entraîné<br />
en solution par les eaux <strong>de</strong> pluie ou d'irrigation. La solubilité n'est toutefois pas un critère suffisant à lui seul<br />
pour décrire le mouvement d'un produit dans le sol. En effet, le comportement <strong>de</strong>s molécules n'est pas déterminé<br />
uniquement par leurs caractéristiques mais aussi par l'interaction <strong>de</strong>s ces <strong>de</strong>rnières avec le milieu.<br />
Interprétation<br />
Chaque matière active peut ainsi être classée favorable ou défavorable pour quelques-uns <strong>de</strong>s critères retenus en<br />
fonction <strong>de</strong>s classes (fixées par le comité <strong>de</strong> liaison) qui sont reportés dans les tableaux ci-<strong>de</strong>ssous. Les critères<br />
retenus dits variables d'exposition : le Koc, la <strong>de</strong>mi-vie (T1/2), l'hydrolyse et la solubilité sont indépendants <strong>de</strong><br />
l'échelle considérée (surface traitée, dose moyenne apportée/ha) qui est variable s'il s'agit d'usages agricoles ou<br />
non agricoles.<br />
Chaque critère a été hiérarchisé par rapport aux autres et classé selon trois niveaux d'inci<strong>de</strong>nce sur la<br />
qualité <strong>de</strong>s eaux :<br />
- faible ou pas défavorable : 0.<br />
- moyen ou moyennement défavorable : m.<br />
- fort ou défavorable : d.<br />
Classes <strong>de</strong>s critères pour les eaux souterraines :<br />
Koc (cm 3 /g)<br />
niveau Siris<br />
T 1/2 (jours)<br />
Hydrolyse (jours)<br />
Hydrosolubilité (ppm)<br />
Gus<br />
Koc (cm 3 /g)<br />
niveau Siris<br />
défavorable (d) 100 moyen (m) 500 peu défavorable (0)<br />
><br />
peu défavorable (0) 30 moyen (m) 120 défavorable (d)<br />
><br />
peu défavorable (0) 30 moyen (m) 60 défavorable (d)<br />
><br />
peu défavorable (0) 10 moyen (m) 200 défavorable (d)<br />
peu défavorable (0) 1,8 moyen (m) 2,8 défavorable (d)<br />
><br />
Classes <strong>de</strong>s critères pour les eaux superficielles :<br />
défavorable (d) 100 moyen (m) 1000 peu défavorable (0)<br />
><br />
CLXXXIV
DT50 (jours) peu défavorable (0) 8 moyen (m) 30 défavorable (d)<br />
><br />
Hydrolyse (jours)<br />
Hydrosolubilité (ppm)<br />
L'indice <strong>de</strong> mobilité <strong>de</strong> Gustafson<br />
peu défavorable (0) 30 moyen (m) 60 défavorable (d)<br />
><br />
peu défavorable (0) 10 moyen (m) 200 défavorable (d)<br />
><br />
L'indice <strong>de</strong> mobilité <strong>de</strong> Gustafson est calculé à partir <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mi-vie et du Koc :<br />
GUS = Log (DT50)x (4-log(Koc))<br />
avec DT50 = la durée nécessaire à la disparition <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> la quantité appliquée,<br />
Koc = coefficient d'adsorption par unité <strong>de</strong> masse <strong>de</strong> carbone organique.<br />
Ainsi, les produits retrouvés dans les eaux présentent généralement <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong> l'indice GUS<br />
supérieures à 2,8 alors qu'elles sont inférieures à 1,8 pour ceux qui n'ont pas été détectés.<br />
Remarque importante : La plupart <strong>de</strong> ces propriétés (Koc, Gus, T1/2…) sont calculées pour un sol agricole.<br />
Elles ne sont pas adaptées à un sol urbain, qui peut être squelettique et très pauvre en matière organique. Ces<br />
données sont donc à manier avec précaution.<br />
CLXXXV
Propriétés toxicologiques et écotoxicologiques <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques<br />
Ecotoxicité<br />
Les effets potentiels biologiques (écotoxicité) ou variables d'effets ont été classés sur les limites <strong>de</strong> classes<br />
suivantes :<br />
Classes pour l’écotoxicité<br />
Limites <strong>de</strong>s classes en mg/l<br />
Nom<br />
classe<br />
<strong>de</strong> la<br />
ECOTOX < 0,001 a<br />
0,001 ≤ ECOTOX < 0,01 b<br />
0,01 ≤ ECOTOX < 0,1 c<br />
0,1 ≤ ECOTOX < 1 d<br />
ECOTOX ≥ 1 e<br />
Pour l'écotoxicité, c'est la plus faible valeur <strong>de</strong> toxicité à court terme entre 3 maillons importants <strong>de</strong> la chaîne<br />
trophique (algues, daphnies, poissons) qui est prise en compte.<br />
Les résultats sont présentés dans le tableau récapitulatif <strong>de</strong>s matières actives herbici<strong>de</strong>s homologuées en PJT.<br />
Toxicité humaine<br />
L'évaluation <strong>de</strong> la toxicité d'une matière active sur la santé humaine à long terme est réalisée par le calcul <strong>de</strong> la<br />
dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme (DJA ou DJT). C'est la quantité d'une matière active par<br />
kilo <strong>de</strong> poids corporel, que pourrait absorber une personne quotidiennement, durant toute sa vie, sans que cela lui<br />
pose <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> santé. Elle s'exprime en milligramme par kilo <strong>de</strong> poids corporel <strong>de</strong> la personne et par jour.<br />
Elle est calculée en divisant la dose sans effet pour un animal d'expérience (DSE) par trois coefficients :<br />
- Un coefficient <strong>de</strong> variabilité inter-espèce égal à 10<br />
- Un coefficient <strong>de</strong> variabilité intra-espèce égal à 10<br />
- Un coefficient <strong>de</strong> sécurité supplémentaire égal à 10<br />
La DSE est la dose la plus élevée d'une matière active qui ne provoque aucun effet décelable chez <strong>de</strong>ux<br />
générations d'animaux (souris, rat, lapin..) soumis à expérimentation.<br />
Les effets potentiels biologiques (DJA) ou variables d'effet ont été classés sur les limites <strong>de</strong> classes suivantes :<br />
Classes pour la toxicité<br />
Limites <strong>de</strong>s classes en mg/kg<br />
pv<br />
Nom <strong>de</strong> la classe<br />
DJA < 0,0001 A<br />
0,0001 ≤ DJA < 0,001 B<br />
0,001 ≤ DJA < 0,01 C<br />
0,01 ≤ DJA < 0,1 D<br />
DJA ≥ 0,1 E<br />
Pour la santé humaine, la DJA est considérée comme un indicateur global <strong>de</strong> toxicité chronique.<br />
CLXXXVI
Matières actives<br />
homologuées DT/PJT<br />
2,4 D (sels diméthylamine) Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
2,4 MCPA (esters) Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Aclonifen* Diphényl-éther<br />
Amitrole Triazole<br />
Carbétami<strong>de</strong>* Carbamate<br />
Dichlobénil Benzonitrile<br />
Diflufenicanil * Pyridine-carboxami<strong>de</strong><br />
Diuron Urée substituée<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
Foliaire (possible<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
action racinaire)<br />
AIA<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
Foliaire (possible<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
action racinaire)<br />
AIA<br />
Inhibiteurs <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
caroténoï<strong>de</strong>s,<br />
pigments protecteurs<br />
<strong>de</strong>s chlorophylles<br />
Inhibiteurs <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
caroténoï<strong>de</strong>s,<br />
pigments protecteurs<br />
<strong>de</strong>s chlorophylles<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire à<br />
la métaphase<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong> la<br />
cellulose <strong>de</strong> la paroi<br />
pecto-cellulosique<br />
Inhibiteurs <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
caroténoï<strong>de</strong>s,<br />
pigments protecteurs<br />
<strong>de</strong>s chlorophylles<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
photosynthèse par<br />
blocage <strong>de</strong> la<br />
protéine D1 du<br />
photosystème II<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée<br />
Foliaire<br />
(principalement) et<br />
racinaire<br />
Racinaire entre la<br />
germination et la<br />
levée Foliaire sur<br />
plantules<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
ou le développement<br />
végétatif (vivaces) et<br />
la levée<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Foliaire<br />
Racinaire, foliaire<br />
réduite<br />
Propriétés <strong>de</strong>s substances actives homologuées DT-PJT<br />
Systémie<br />
Persistance<br />
dans le sol<br />
DT 50 plein<br />
champ (en<br />
jours)<br />
Solubilité dans l'eau<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
Importante 10 (2-16) 23180 mg/l à 34196 mg/l à 25 °C 20 2,7 e D 1,86.10-2 mPa à 25 °C 1,32.10-5<br />
Importante 25 (6-43) 5 mg/l 1000 1,4 d D 164 mPa à 25°c 4,9.10-5<br />
Peu importante 118 (92-150) 2,5 mg/l à 20 °C 5400 0,55 b D 3,23.10-2 mPa à 25 °C 32.10-4<br />
Importante 4 (3-5) 280000 mg/l à 23 °C 66 1,31 e C 3,3.10-5 mPa à 20°C 1,76.10-8<br />
Peu importante 22 (19-28) 3500 mg/l à 20 °C 88 2,76 e D
Matières actives<br />
homologuées DT/PJT<br />
Flazasulfuron Sulfonylurée<br />
Glufosinate d'ammonium Amino-phosphonate<br />
Glyphosate Amino-phosphonate<br />
Isoxaben Benzami<strong>de</strong><br />
Oryzalin Toluidine<br />
Oxadiazon * Oxadiazole<br />
Sulfosate Amino-phosphonate<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration Systémie<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme ALS<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s<br />
aminés ramifiés<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme glutamine<br />
synthase conduisant à Foliaire<br />
la synthèse <strong>de</strong> la<br />
glutamine<br />
Racinaire<br />
principalement et<br />
foliaire<br />
Persistance<br />
dans le sol<br />
DT 50 plein<br />
champ (en<br />
jours)<br />
Solubilité dans l'eau<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
Importante 7 (2-18) 2100 mg/l à 25°C 46 1,98 b D
Dicotylédones, dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces<br />
Matières actives<br />
homologuées gazon<br />
2,4 D (sels diméthylamine) Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
2,4 MCPA (esters) Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Bifénox Diphényl-éther<br />
Bromoxynil (octanoate?) Hydroxy-benzonitrile<br />
Clopyralid Aci<strong>de</strong> picolinique<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration Systémie<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Inhibiteurs <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
caroténoï<strong>de</strong>s,<br />
pigments protecteurs<br />
<strong>de</strong>s chlorophylles<br />
Dérègle le pH <strong>de</strong>s<br />
différents<br />
compartiments<br />
cellulaires + action<br />
secondaire sur la<br />
photosynthèse<br />
Action auxinique :<br />
agit sur l’élongation<br />
cellulaire et perturbe<br />
la croissance<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Foliaire (légère action<br />
racinaire)<br />
Foliaire<br />
Propriétés <strong>de</strong>s matières actives homologuées pour le désherbage <strong>de</strong>s gazons<br />
Persistance<br />
dans le sol<br />
DT 50 plein<br />
champ (en<br />
jours)<br />
Solubilité dans l'eau<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
Importante 10 (2-16) 23180 mg/l à 34196 mg/l à 25 °C 20 2,7 e D 1,86.10-2 mPa à 25 °C 1,32.10-5<br />
Importante 25 (6-43) 5 mg/l 1000 1,4 d D 164 mPa à 25°c 4,9.10-5<br />
Peu importante 9 (-3-35) 0,36 mg/l à 25°C 4000 0,38 d D 323 µPa à 30 °C 0,3<br />
Peu importante<br />
(contact)<br />
2 (1-10) 0,03 mg/l à 25°C 192 0,52 c D < 0.1 µPa à 25 °C<br />
Foliaire Importante 40 (12-70) 10000 mg/l à 25°C 6 5,16 e D 1,33 mPa à 24°C 3,1.10-5<br />
Dicamba Aci<strong>de</strong> benzoïque Action auxinique Racinaire et foliaire Importante 26 (11-37) 8310 mg/l à 25°C 7 4,46 e D 1,231 mPa à 25 °C 4,43.10-10<br />
Dichlorprop-p Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Fluroxypyr Aci<strong>de</strong> picolinique Action auxinique Foliaire Importante 10 (5-15)<br />
Matières actives<br />
homologuées DT/PJT<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration Systémie<br />
Importante 10 (8-12) 590 mg/l à 20°C 1000 1 e E 62 µPa à 20 °C 2,5.10-5<br />
Persistance<br />
dans le sol<br />
DT 50 plein<br />
champ (en<br />
jours)<br />
5.7 g/l à 20 °C et au pH <strong>de</strong> 5<br />
7.3 g/l à 20 °C et au pH <strong>de</strong> 9<br />
Solubilité dans l'eau<br />
34 2,47 d E 3,78.10-9 Pa à 20°C 10,06.10-8<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
CLXXXIX
Ioxynil Hydroxy-benzonitrile<br />
Mecoprop Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Mecoprop-p Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Oxadiazon Oxadiazole<br />
Dérègle le pH <strong>de</strong>s<br />
différents<br />
compartiments<br />
cellulaires + action<br />
secondaire sur la<br />
photosynthèse<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme PPO<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
chlorophylles<br />
Foliaire Faible (contact) 7 (1,5 - 8) 539 mg/l à 20 °C et au pH <strong>de</strong> 5 263 1,34 e D 2,04 µPa à 20 °C 1,5.10-5<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Foliaire<br />
Importante 12 (3-20) >250000 mg/l à 20 °C 85 2,23 e D 1,6 mPa à 25°C 2,18.10-4<br />
Importante 12 (3-20) 860 mg/L à 20°C au pH <strong>de</strong> 3,1 85 2,23 e D 0,23 mPa à 23°C 5,7.10-5<br />
Peu importante<br />
130 (115-<br />
145)<br />
1 mg/l à 20°C 2360 1,33 b C 1044 µPa à 25 °C 3,57.10-7<br />
CXC
Dicotylédones, dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces<br />
Matières actives<br />
homologuées gazon<br />
Dimethénami<strong>de</strong><br />
Fenoxaprop-p-éthyl<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration Systémie<br />
Acétami<strong>de</strong><br />
(chloroacétami<strong>de</strong>)<br />
Aryloxyphénoxypropionate<br />
(FOPS)<br />
Méfempyr-diéthyl Pyrazole<br />
Isoxaben Benzami<strong>de</strong><br />
Oryzalin Toluidine<br />
Oxadiazon Oxadiazole<br />
Dicotylédones (D) ; Graminées (G)<br />
Inhibition <strong>de</strong>s<br />
elongases, et <strong>de</strong>s<br />
enzymes <strong>de</strong><br />
cyclisation du ggpp<br />
conduisant aux<br />
gibberellines<br />
Inhibition <strong>de</strong><br />
l'enzyme accase<br />
Agent<br />
phytoprotecteur qui<br />
préserve le gazon <strong>de</strong><br />
l’action du<br />
fénoxaprop-p-éthyl<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong> la<br />
cellulose <strong>de</strong> la paroi<br />
pecto-cellulosique<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire à<br />
la métaphase<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme PPO<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
chlorophylles<br />
Empêche la levée <strong>de</strong><br />
adventices par une<br />
pénétration rapi<strong>de</strong> au<br />
niveau <strong>de</strong><br />
l’hypocotyle, du<br />
coléoptile et du<br />
mesocotyle)<br />
Persistance<br />
dans le sol<br />
DT 50 plein<br />
champ (en<br />
jours)<br />
Solubilité dans l'eau<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
Importante 14 (7-21) 1389 mg/l à 22 °C 253 1,83 c D 37,15 mPa à 25°C 8,63.10-3<br />
Foliaire Importante 9 (1-9) 1.3 mg/l à 22 °C et au pH <strong>de</strong> 8 9490 0,02 d D 1,4 µPa à 25 °C 7,24.10-4<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Surtout<br />
racinaire sur plantes<br />
levées<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Foliaire<br />
7 20 mg/l à 20 °C et au pH <strong>de</strong> 6.2 825 0,92 e E 14 µPa à 25 °C 2,614.10-4<br />
Peu importante 105 (90-120) 0,8 mg/l à 25 °C 608 2,46 e D
Matières<br />
actives<br />
homologuées<br />
DT/PJT<br />
Amitrole (G et<br />
D)<br />
Butraline (G et<br />
D)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (G<br />
et D)<br />
Dichlobénil (G<br />
et D)<br />
Diflufenicanil<br />
(G et D)<br />
Diquat (G)<br />
Fluazifop-pbutyl<br />
(G)<br />
Matières<br />
actives<br />
homologuées<br />
DT/PJT<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration Systémie<br />
Triazole<br />
Toluidine (dinitroaniline)<br />
Carbamate<br />
Benzonitrile<br />
Pyridine-carboxami<strong>de</strong><br />
Ammonium quaternaire<br />
(bipyridile)<br />
Aryloxyphénoxypropionates<br />
Inhibiteurs <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
caroténoï<strong>de</strong>s,<br />
pigments protecteurs<br />
<strong>de</strong>s chlorophylles<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire à<br />
la métaphase<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong> la<br />
cellulose <strong>de</strong> la paroi<br />
pecto-cellulosique<br />
Inhibition <strong>de</strong><br />
l'enzyme pds<br />
(phytoène désaturase<br />
)<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
photosynthèse<br />
Bloque la synthèse<br />
<strong>de</strong>s lipi<strong>de</strong>s<br />
Foliaire<br />
(principalement) et<br />
racinaire<br />
Méristèmes<br />
radiculaires <strong>de</strong>s<br />
graines en<br />
germination<br />
Racinaire entre la<br />
germination et la<br />
levée Foliaire sur<br />
plantules<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
ou le développement<br />
végétatif (vivaces) et<br />
la levée<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Foliaire<br />
Persistance dans<br />
le sol DT 50<br />
plein champ (en<br />
jours)<br />
Solubilité dans l'eau<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
Importante 4 (3-5) 280000 mg/l à 23 °C 66 1,31 e C 3,3.10-5 mPa à 20°C 1,76.10-8<br />
0,3 mg/l à 25°C d D 1,7 mPa à 25°C<br />
Peu importante 22 (19-28) 3500 mg/l à 20 °C 88 2,76 e D
Glufosinate<br />
d'ammonium (G<br />
et D)<br />
Glyphosate (G<br />
et D)<br />
Isoxaben (G et<br />
D)<br />
Oryzalin (G et<br />
D)<br />
Oxadiazon (G<br />
et D)<br />
Oxyfluorfène<br />
(G et D)<br />
Pendiméthaline<br />
(G et D)<br />
Matières<br />
actives<br />
homologuées<br />
DT/PJT<br />
Amino-phosphonate<br />
Amino-phosphonate<br />
Benzami<strong>de</strong><br />
Toluidine<br />
Oxadiazole<br />
Diphényl-éther<br />
Toluidine (dinitroanaline)<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme glutamine<br />
synthase conduisant à<br />
la synthèse <strong>de</strong> la<br />
glutamine<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> l'EPSP<br />
synthase conduisant à<br />
la synthèse <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s<br />
aminés aromatiques<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong> la<br />
cellulose <strong>de</strong> la paroi<br />
pecto-cellulosique<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire à<br />
la métaphase<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme PPO<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
chlorophylles<br />
inhibiteurs <strong>de</strong><br />
l'enzyme PPO<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s<br />
chlorophylles<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire<br />
Foliaire Peu importante (contact) 7 (7-40) 1370000 mg/l à 22°C 100 1,69 e D < 0,1 mPa à 20°C 1,18.10-9<br />
Foliaire importante 25 (5-35) 11600 mg/l à 25°C >1000 1,4 e E 1,31.10-2 mPa à 25°C 2,1.10-7<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Surtout<br />
racinaire sur plantes<br />
levées<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
et la levée - Foliaire<br />
Peu importante 105 (90-120) 0,8 mg/l à 25 °C 608 2,46 e D
Propyzami<strong>de</strong> (G<br />
et D)<br />
Quizalofop-péthyl<br />
Trifluraline (G<br />
et D)<br />
Benzami<strong>de</strong>s<br />
Aryloxyphénoxypropionates<br />
Toluidine (dinitroanaline)<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
carboxylase Acetyl<br />
CoA et <strong>de</strong> la synthèse<br />
<strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s gras<br />
Inhibe l’enzyme<br />
acétolactate<br />
synthétase (ALS)<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s<br />
aminés ramifiés<br />
Propriétés <strong>de</strong>s matières actives homologuées pour le désherbage <strong>de</strong>s cultures florales<br />
Matières actives<br />
homologuées<br />
DT/PJT<br />
2,4 D (sels<br />
diméthylamine)<br />
2,4 MCPA<br />
(esters)<br />
Famille chimique Mo<strong>de</strong> d'action Pénétration Systémie<br />
Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Aryloxy-aci<strong>de</strong><br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Perturbateur <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> l'auxine<br />
AIA<br />
Racinaire Importante 60 (10-112) 9,0 mg/l à 20 °C et au pH <strong>de</strong> 7 800 1,95 e D 26,7 µPa à 20 °C 7,6.10-4<br />
Foliaire Importante 7 (6-8) 0,4 mg/l à 25°C 476 1,12 d D 0,11 µPa à 20 °C 6,7.10-5<br />
Foliaire et racinaire Importante 221 (186255) 0.221 mg/l à 20 °C 8000 0,23 b C 13,7 mPa à 25°C 16,8<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Foliaire (possible<br />
action racinaire)<br />
Persistance dans<br />
le sol DT 50<br />
plein champ (en<br />
jours)<br />
Solubilité dans l'eau<br />
Koc GUS<br />
Classe<br />
écotox<br />
Classe<br />
DJA<br />
Tension <strong>de</strong> vapeur<br />
Constante <strong>de</strong><br />
Henry<br />
(Pa.m3.mole-<br />
1)<br />
Importante 10 (2-16) 23180 mg/l à 34196 mg/l à 25 °C 20 2,7 e D 1,86.10-2 mPa à 25 °C 1,32.10-5<br />
Importante 25 (6-43) 5 mg/l 1000 1,4 d D 164 mPa à 25°c 4,9.10-5<br />
CXCIV
Butraline<br />
Toluidine<br />
(dinitroaniline)<br />
Carbétami<strong>de</strong> Carbamate<br />
Dichlobénil Benzonitrile<br />
Glufosinate<br />
d'ammonium<br />
Amino-phosphonate<br />
Isoxaben Benzami<strong>de</strong><br />
Oryzalin Toluidine<br />
Matières actives<br />
homologuées<br />
DT/PJT<br />
Oxadiazon Oxadiazole<br />
Oxyfluorfène Diphényl-éther<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire à<br />
la métaphase<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong> la<br />
cellulose <strong>de</strong> la paroi<br />
pecto-cellulosique<br />
Inhibiteur <strong>de</strong><br />
l'enzyme glutamine<br />
synthase conduisant à<br />
la synthèse <strong>de</strong> la<br />
glutamine<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
synthèse <strong>de</strong> la<br />
cellulose <strong>de</strong> la paroi<br />
pecto-cellulosique<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire à<br />
la métaphase<br />
Méristèmes<br />
radiculaires <strong>de</strong>s<br />
graines en<br />
germination<br />
Racinaire entre la<br />
germination et la<br />
levée Foliaire sur<br />
plantules<br />
Organes souterrains<br />
entre la germination<br />
ou le développement<br />
végétatif (vivaces) et<br />
la levée<br />
0,3 mg/l à 25°C o d D 1,7 mPa à 25°C<br />
Peu importante 22 (19-28) 3500 mg/l à 20 °C 88 2,76 e D
Propyzami<strong>de</strong> Benzami<strong>de</strong>s<br />
Quizalofop-péthyl<br />
Trifluraline<br />
Aryloxyphénoxypropionates<br />
Toluidine<br />
(dinitroanaline)<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
division cellulaire<br />
Inhibiteur <strong>de</strong> la<br />
carboxylase Acetyl<br />
CoA et <strong>de</strong> la synthèse<br />
<strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s gras<br />
Inhibe l’enzyme<br />
acétolactate<br />
synthétase (ALS)<br />
conduisant à la<br />
synthèse <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s<br />
aminés ramifiés<br />
Racinaire importante 60 (10-112) 9,0 mg/l à 20 °C et au pH <strong>de</strong> 7 800 1,95 e D 26,7 µPa à 20 °C 7,6.10-4<br />
Foliaire Importante 7 (6-8) 0,4 mg/l à 25°C 476 1,12 d D 0,11 µPa à 20 °C 6,7.10-5<br />
Foliaire et racinaire Importante 221 (186255) 0.221 mg/l à 20 °C 8000 0,23 b C 13,7 mPa à 25°C 16,8<br />
CXCVI
Annexe 11<br />
Efficacité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sur diverses adventices pouvant être rencontrées en zone non agricole<br />
Note : ces données ne sont qu’indicatives ; il est recommandé <strong>de</strong> vérifier sur les fiches techniques <strong>de</strong>s produits<br />
leur efficacité pour les adventices rencontrées ; pour toute question, contacter la firme phytosanitaire qui<br />
produit l’herbici<strong>de</strong>.<br />
CXCVII
composition<br />
Aminotriazole (226,5 g/L), aclonifen<br />
(87,5 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium<br />
herbici<strong>de</strong>s homologués DT- PJT (désherbage total – parcs, jardins et trottoirs) sur différentes adventices<br />
Aminotriazole (167 g/L ); diuron (150<br />
g/L )<br />
2% aminotriazole, 1,875% Diuron<br />
Aminotriazole (200 g/L), isoxaben<br />
(55,6 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium (synergisant <strong>de</strong><br />
l'amminotriazole)<br />
Aminotriazole (240 g/L), Thiocyanate<br />
d'ammonium (215 g/L)<br />
Amitrole (120 g/L), dichlorprop-p<br />
(50g/L), diuron (150 g/L), contient du<br />
thiocyanante d'ammonium<br />
Amitrole (160g/L), glyphosate (60 g/L),<br />
contient du thyocyanate d'ammonium<br />
(prélevée |<br />
(pré-levée |<br />
postlevée)<br />
post-levée)<br />
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille ts s<br />
Agropyron sp. Gaertn. chien<strong>de</strong>nt s s ms s s<br />
Agrostis sp. L. Agrosti<strong>de</strong> ms s s s<br />
Allium vineale L. Ail <strong>de</strong>s vignes ms s<br />
Alopercurus sp. L. Vulpin s s s ts<br />
Alopecurus myosuroi<strong>de</strong>s Huds Vulpin <strong>de</strong>s champs ts s<br />
Amaranthus sp. L. Amarante s - |s s s à ts s s s ts s s ts<br />
Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie s ts | r s s s s<br />
Ambrosia artemisiifolia L.<br />
Ambroisie à feuilles<br />
d'armoise s ts ts<br />
Anagallis sp. L. Mourons s ts s s s s s<br />
Anagallis arvensis L. Mouron <strong>de</strong>s champs s | s ts | - s s s s ms s ts<br />
Aphanes arvensis L. Alchemille <strong>de</strong>s champs r s<br />
Arabidopsis thaliana (L.)<br />
Heynhold<br />
Arabette <strong>de</strong> Thalius<br />
ts s<br />
Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles <strong>de</strong> serpolet<br />
s s<br />
Aristolochia sp. L. Aristoloche ms s<br />
Artemisia sp. L. Armoises s ms | - ts s s s r s<br />
Arundo donax L. Canne <strong>de</strong> Provence s ms s<br />
Atriplex sp. Arroche r s ts<br />
Avena fatua L. Folle avoine ts r ts s à ts s s ts<br />
Bromus sp. L.<br />
Bromus hor<strong>de</strong>aceus Maire &<br />
Brôme s ts ts ts ts ts s s s<br />
Weill.<br />
ts ts<br />
Bromus sterilis L. Brôme stérile - | s ms s s s ts<br />
Capsella bursa-pastoris (L.)<br />
Medicus<br />
Capselle bourse à pasteur<br />
s ts s ts | s s ts s s s s s ts<br />
Cardamine sp. L. Cardamine ts ms s s s s<br />
Cardamine hirsuta L. Cardamine hisute ms ts<br />
Cerastium sp. L. Ceraiste s | - ts s s s s<br />
Cerastium glomeratum Thuill Ceraiste aggloméré s ts ts ms ts s ts s s s s<br />
Chenopodium sp. L. Chénopo<strong>de</strong> - | s s s à ts s* ms ts s ts<br />
Chenopodium album L. Chénopo<strong>de</strong> blanc s ts ts s ts | - ms s s s<br />
Chondrilla sp. L. Chondrille s s s<br />
Chondrilla juncea L. Chondrille effilée r r r<br />
Dichlobénil (6,75%)<br />
Diuron (75 g/L), Glyphosate (54 g/L),<br />
MCPA (54 g/L)<br />
Diuron (72g/L), glyphosate (54g/L),<br />
MCPA (54g/L)<br />
Flazasulfuron (25%)<br />
Glufonsinate-ammonium (120g/L)<br />
Glyphosate (360 g/L), contient 180g/L<br />
<strong>de</strong> polyoxyethylène amine, adjuvant du<br />
glyphosate<br />
glyphosate (72g/L), MCPA (54 g/L),<br />
dichlorprop-P (54 g/L)<br />
Glyphosate (250 g/L), diflufénicanil (40<br />
g/L)<br />
Glyphosate (112 g/L), diuron (71 g/L),<br />
diflufénican (15 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L), isoxaben (107 g/L)<br />
Glyphosate (20%), oxadiazon (20%),<br />
diflufenican (1,2%)<br />
Oxadiazon (48%), carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
diflufénicanil (2,4%)<br />
Sulfosate (480 g/L)<br />
CXCVIII
composition<br />
Aminotriazole (226,5 g/L), aclonifen<br />
(87,5 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium<br />
Aminotriazole (167 g/L ); diuron (150<br />
g/L )<br />
2% aminotriazole, 1,875% Diuron<br />
Aminotriazole (200 g/L), isoxaben<br />
(55,6 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium (synergisant <strong>de</strong><br />
l'amminotriazole)<br />
Aminotriazole (240 g/L), Thiocyanate<br />
d'ammonium (215 g/L)<br />
Amitrole (120 g/L), dichlorprop-p<br />
(50g/L), diuron (150 g/L), contient du<br />
thiocyanante d'ammonium<br />
Amitrole (160g/L), glyphosate (60 g/L),<br />
contient du thyocyanate d'ammonium<br />
Chrysanthemum segetum L. Chrysanthème <strong>de</strong>s moissons s ts | -<br />
Cichorium intybus L. Chicorée sauvage s s s<br />
Cirsium sp. Chardons s s s à ts s s s s s<br />
Cirsium arvense (L) Scopoli Chardon <strong>de</strong>s champs s ts ts ms ms s s* ms ms s<br />
Convolvulus sp. L. Liserons ms à s s ms s<br />
Convolvulus arvensis L. Liseron <strong>de</strong>s champs s r ts r r s s s<br />
Crepis sp. Crépi<strong>de</strong> s ts ts s | - ts ts ts s s ts s ts<br />
Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépi<strong>de</strong> à tige capillaire s s ms ms<br />
Crepis sancta Babc. Crépi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Nîmes ts ts ts r | ms<br />
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia<br />
(Thuill.) Thell.<br />
Dichlobénil (6,75%)<br />
Diuron (75 g/L), Glyphosate (54 g/L),<br />
MCPA (54 g/L)<br />
Crépi<strong>de</strong> à feuilles <strong>de</strong><br />
pissenlit s s ms ms<br />
Cynodon dactylon (L.) Pers. Chien<strong>de</strong>nt pied <strong>de</strong> poule ms s s<br />
Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais s à ts s s s ms<br />
Dactylis sp. L. Dactyle ts s s s<br />
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré s s s s s<br />
Daucus carota L. Carotte sauvage s ms r s | ms ts ts s à ts s s ts | s ts s ms s ms ms s<br />
Digitaria sp. Haller Digitaire s s à ts s s* ms s ts ts<br />
Digitaria sanguinalis (L.) Scop Digitaire sanguine s ts | - s s s s s<br />
Diplotaxis sp. DC Roquette s | s s s | ts ts<br />
Drymaria cordata Mouron blanc ts<br />
Echinochloa crus-galli (L.)<br />
P.Beauv<br />
Panic Pied <strong>de</strong> Coq<br />
s ts s ts<br />
Echium sp. L. Vipérine s s<br />
Elytrigia repens (L) Nevski Chien<strong>de</strong>nt rampant s à ts s s s<br />
Epilobium sp. L. Epilobe s s | ms s ts s s s ts | ts s s s s s s* s s s<br />
Equisetum sp. L. Prêle ms à s s ms s ms s ms<br />
Erigeron sp. L. Erigéron, vergerette s | ms s ts s s ts s ts<br />
Erigeron cana<strong>de</strong>nsis L. Erigéron du Canada ts ts s ts ts | ms s ms s s s s<br />
Erigeron longipes DC. Erigeron blanc ms s s s<br />
Erodium sp. L'HERIT. Erodium, bec-<strong>de</strong>-grue s s | - s ts s<br />
Erodium cicutarium (L.) L'Heritier Erodium à feuilles <strong>de</strong> ciguë<br />
ms ts | s ms s ms s<br />
Euphorbia sp. L. Euphorbe s ms | s s s ts s s s s s s ts<br />
Festuca sp.L. Fétuque ts ts ts s s ts s ts<br />
Fumaria officinalis L. Fumeterre officinal ms | s s ts<br />
Galium aparine L. Gaillet gratteron s ts ts ts s à ts s<br />
Gaudinia sp. P.Beauv. Gaudinie s s s<br />
Geranium sp. L. Géraniums s ts ts s | ms s ts ts s s s | ts ts s s s s s s<br />
Diuron (72g/L), glyphosate (54g/L),<br />
MCPA (54g/L)<br />
Flazasulfuron (25%)<br />
Glufonsinate-ammonium (120g/L)<br />
Glyphosate (360 g/L), contient 180g/L<br />
<strong>de</strong> polyoxyethylène amine, adjuvant du<br />
glyphosate<br />
glyphosate (72g/L), MCPA (54 g/L),<br />
dichlorprop-P (54 g/L)<br />
Glyphosate (250 g/L), diflufénicanil (40<br />
g/L)<br />
Glyphosate (112 g/L), diuron (71 g/L),<br />
diflufénican (15 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L), isoxaben (107 g/L)<br />
Glyphosate (20%), oxadiazon (20%),<br />
diflufenican (1,2%)<br />
Oxadiazon (48%), carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
diflufénicanil (2,4%)<br />
Sulfosate (480 g/L)<br />
CXCIX
composition<br />
Aminotriazole (226,5 g/L), aclonifen<br />
(87,5 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium<br />
Aminotriazole (167 g/L ); diuron (150<br />
g/L )<br />
2% aminotriazole, 1,875% Diuron<br />
Aminotriazole (200 g/L), isoxaben<br />
(55,6 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium (synergisant <strong>de</strong><br />
l'amminotriazole)<br />
Aminotriazole (240 g/L), Thiocyanate<br />
d'ammonium (215 g/L)<br />
Amitrole (120 g/L), dichlorprop-p<br />
(50g/L), diuron (150 g/L), contient du<br />
thiocyanante d'ammonium<br />
Amitrole (160g/L), glyphosate (60 g/L),<br />
contient du thyocyanate d'ammonium<br />
He<strong>de</strong>ra helix L. ssp. Helix Lierre commun ms<br />
Holcus sp. L. Houlque s ts s s s s | - s s<br />
Hor<strong>de</strong>um murinum L. Orge <strong>de</strong>s rats ts s ts<br />
Hypericum perforatum L.<br />
Millepertuis à feuilles<br />
perforées r r ms s s ts r s ms r s<br />
Hypochoeris sp. L. Porcelle ts s s s<br />
Inula viscosa (L) Ait./Dryand. Inule visqueuse s à ts s s ts | -<br />
Juncus sp. L. Joncs ms s s<br />
Koeleria sp. Pers. Koélérie s s s<br />
Lactuca serriola L/Torn. Laitue scariole s ts ts s | s ts ms | r ts s s s ms<br />
Lamium sp. L Lamier ms | s ts<br />
Lamium amplexicaule L. Lamier amplexicaule s ms<br />
Lamium purpureum L. Lamier pourpre ts s s<br />
Lapsana communis L. Lampsane commune s s<br />
Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse s<br />
Lepidium sp. L. Passerage s s<br />
Linaria vulgaris Mill. Linaire commune s ms s s ms s<br />
Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie ts ts r ts | s<br />
Lolium perenne L. Ray-grass, ivraie vivace s ms | ms s s s s s ts s s s s s s ts<br />
Lotus sp. L. Lotier s s s s<br />
Malva sp. L. Mauve s ts s s s s | ts s s<br />
Matricaria sp. L. Matricaire s | s ts ts s s s s s ts<br />
Medicago sp. L. Luzernes s ts s s s ts s s s s s s<br />
Melilotus sp. Mélilot ts ms ts<br />
Mentha sp. L. Menthe r s<br />
Mercurialis sp. L. Mercuriale s - | s ts ts | - s ts<br />
Muscari sp. L. Muscari s r s<br />
Myosotis sp. L. Myosotis s s s s s<br />
Oxalis corniculata L. Oxalis corniculé s s s s<br />
Panic sp. L. Panics s ts s s* ms s<br />
Papaver rhoeas L. Coquelicot s ts ts ts s s s<br />
Paspalum sp. L. Paspale ms<br />
Phragmites sp. Adans Roseau s ms<br />
Picris sp. L. Picri<strong>de</strong>, helminthie s ts ts s | - s ts ts s s ts | r ts s s s<br />
Plantago sp. L. Plantains s ts s s s ts s s<br />
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé ts ts ts r | - s s s<br />
Plantago major L. Plantain majeur s s s s<br />
Poa sp. L. Pâturin s | s s ts s s s<br />
Poa annua L. Pâturin annuel s ts s s ts s s ms | r s ts s s s s s ts<br />
Dichlobénil (6,75%)<br />
Diuron (75 g/L), Glyphosate (54 g/L),<br />
MCPA (54 g/L)<br />
Diuron (72g/L), glyphosate (54g/L),<br />
MCPA (54g/L)<br />
Flazasulfuron (25%)<br />
Glufonsinate-ammonium (120g/L)<br />
Glyphosate (360 g/L), contient 180g/L<br />
<strong>de</strong> polyoxyethylène amine, adjuvant du<br />
glyphosate<br />
glyphosate (72g/L), MCPA (54 g/L),<br />
dichlorprop-P (54 g/L)<br />
Glyphosate (250 g/L), diflufénicanil (40<br />
g/L)<br />
Glyphosate (112 g/L), diuron (71 g/L),<br />
diflufénican (15 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L), isoxaben (107 g/L)<br />
Glyphosate (20%), oxadiazon (20%),<br />
diflufenican (1,2%)<br />
Oxadiazon (48%), carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
diflufénicanil (2,4%)<br />
Sulfosate (480 g/L)<br />
CC
composition<br />
Aminotriazole (226,5 g/L), aclonifen<br />
(87,5 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium<br />
Aminotriazole (167 g/L ); diuron (150<br />
g/L )<br />
2% aminotriazole, 1,875% Diuron<br />
Aminotriazole (200 g/L), isoxaben<br />
(55,6 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium (synergisant <strong>de</strong><br />
l'amminotriazole)<br />
Aminotriazole (240 g/L), Thiocyanate<br />
d'ammonium (215 g/L)<br />
Amitrole (120 g/L), dichlorprop-p<br />
(50g/L), diuron (150 g/L), contient du<br />
thiocyanante d'ammonium<br />
Amitrole (160g/L), glyphosate (60 g/L),<br />
contient du thyocyanate d'ammonium<br />
Poa trivalis L. Pâturin commun s s s s s s<br />
Polygonum sp. L. Renouée s s s ts<br />
Polygonum amphibium L. Renouée amphibie ms s<br />
Polygonum aviculare L. Renouée <strong>de</strong>s oiseaux s - | ms r s s | - ts s s ms ms s<br />
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire s - | s<br />
Portulaca sp. L. Pourprier s - | s ts s | - s s<br />
Potentilla reptens L. Potentille rampante ts r ms s r ms r r s<br />
Ranunculus sp. L. Renoncules s ms | s s s<br />
Ranunculus arvensis L. Renoncule <strong>de</strong>s champs s<br />
Ranunculus sardous Crantz Renoncule <strong>de</strong>s marais r<br />
Raphanus raphanistrum L. Ravenelle s s ts<br />
Rubus fruticosus L. Ronce commune s s s s ms s s s<br />
Rumex sp. L. Oseilles s ms | s ms à s s s à ms s s s s s s<br />
Sagina sp. L. Sagine ts s s s ms s<br />
Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle r<br />
Satureja sp. L. Sariette s s<br />
Saxifraga tridactylites L. Saxifrage à trois doigts r s s r<br />
Sedum rubens L. r<br />
Senecio sp.L. Séneçon s s | ms s ts s s s ts s ms s<br />
Senecio inaeqi<strong>de</strong>ns DC. s r<br />
Senecio vulgaris L. Séneçon vulgaire ts ts ts ts ts | s ms s s s ts<br />
Setaria sp. P.Beauv. Sétaires s s s à ts s s* s* s | - s ts s ts<br />
Silene sp. L. Silène r ts s s s<br />
Sinapsis arvensis L. Moutar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s champs s | s s s s ts<br />
Solanum nigrum L. Morelle noire s - | s s r | - ts s s s s s ts<br />
Sonchus sp. L. Laiterons s s | s s ts s s s s ts s s ts<br />
Sonchus arvensis L. Laiteron <strong>de</strong>s champs ts s<br />
Sonchus asper (L) Hill Laiteron ru<strong>de</strong> ts ms | r s s s s<br />
Sonchus oleracerus L. Laiteron maraîcher ts ts ms | r s s s s<br />
Sorghum halepense (L.) Persoon Sorgho d'Alep s à ts ms s<br />
Spergula arvensis L. s s<br />
Stellaria sp. L. Stellaires s ts<br />
Stellaria media (L.) Vill./Cyr Mouron <strong>de</strong>s oiseaux ts ts - | s ts ts | ts s s s s ms s<br />
Taraxacum officinale Pissenlit s ts s s | s ts ts ts s à ms ts | ts s s s s ms s<br />
Tordylium sp. L. Tordyle s s | ms ts<br />
Torilis sp. Adans Torilis ms ms s | ms ts<br />
Trifolium sp. L. Trèfles s s | s ts ts ts s s ms | - s s s s s s s<br />
Urtica sp. L. Ortie s | s s s s<br />
Dichlobénil (6,75%)<br />
Diuron (75 g/L), Glyphosate (54 g/L),<br />
MCPA (54 g/L)<br />
Diuron (72g/L), glyphosate (54g/L),<br />
MCPA (54g/L)<br />
Flazasulfuron (25%)<br />
Glufonsinate-ammonium (120g/L)<br />
Glyphosate (360 g/L), contient 180g/L<br />
<strong>de</strong> polyoxyethylène amine, adjuvant du<br />
glyphosate<br />
glyphosate (72g/L), MCPA (54 g/L),<br />
dichlorprop-P (54 g/L)<br />
Glyphosate (250 g/L), diflufénicanil (40<br />
g/L)<br />
Glyphosate (112 g/L), diuron (71 g/L),<br />
diflufénican (15 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L), isoxaben (107 g/L)<br />
Glyphosate (20%), oxadiazon (20%),<br />
diflufenican (1,2%)<br />
Oxadiazon (48%), carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
diflufénicanil (2,4%)<br />
Sulfosate (480 g/L)<br />
CCI
composition<br />
Aminotriazole (226,5 g/L), aclonifen<br />
(87,5 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium<br />
Aminotriazole (167 g/L ); diuron (150<br />
g/L )<br />
2% aminotriazole, 1,875% Diuron<br />
Aminotriazole (200 g/L), isoxaben<br />
(55,6 g/L), contient du thiocyanante<br />
d'ammonium (synergisant <strong>de</strong><br />
l'amminotriazole)<br />
Aminotriazole (240 g/L), Thiocyanate<br />
d'ammonium (215 g/L)<br />
Amitrole (120 g/L), dichlorprop-p<br />
(50g/L), diuron (150 g/L), contient du<br />
thiocyanante d'ammonium<br />
Amitrole (160g/L), glyphosate (60 g/L),<br />
contient du thyocyanate d'ammonium<br />
Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ms r<br />
Veronica sp. L. Véroniques s ts ts s | s ts ts ts s s s r | r s ts s s s s s s ts<br />
Vicia sp. L. Vesce s s | s r ts s s s s<br />
Viola tricolor ssp. tricolor L. Pensée sauvage s s<br />
Vulpia myuros (L) C.C.GMEL. Vulpie queue-<strong>de</strong>-rat ts s<br />
Dichlobénil (6,75%)<br />
Diuron (75 g/L), Glyphosate (54 g/L),<br />
MCPA (54 g/L)<br />
Diuron (72g/L), glyphosate (54g/L),<br />
MCPA (54g/L)<br />
Flazasulfuron (25%)<br />
Glufonsinate-ammonium (120g/L)<br />
Glyphosate (360 g/L), contient 180g/L<br />
<strong>de</strong> polyoxyethylène amine, adjuvant du<br />
glyphosate<br />
glyphosate (72g/L), MCPA (54 g/L),<br />
dichlorprop-P (54 g/L)<br />
Glyphosate (250 g/L), diflufénicanil (40<br />
g/L)<br />
Glyphosate (112 g/L), diuron (71 g/L),<br />
diflufénican (15 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L), isoxaben (107 g/L)<br />
Glyphosate (20%), oxadiazon (20%),<br />
diflufenican (1,2%)<br />
Oxadiazon (48%), carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
diflufénicanil (2,4%)<br />
Sulfosate (480 g/L)<br />
CCII
composition<br />
2,4D (400 g/L)<br />
Efficacité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sélectifs pour gazons sur différentes adventices<br />
2,4D (150g/L), 2,4-<br />
MCPA (175 g/L),<br />
clopyralid (35 g/L)<br />
2,4D (60 g/L), 2,4<br />
MCPA (60 g/L),<br />
Mecoprop (440 g/L)<br />
2,4 MCPA (102 g/L),<br />
MCPP (96 g/L),<br />
dicamba (15 g/L),<br />
ioxynil (6g/L) + urée<br />
(83,5 g/L)<br />
Achillea sp.L. Achillées s ms ms ms<br />
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille s s<br />
Ajuga sp. L. Bugle s s<br />
Ambrosia artemisiifolia L Ambroisie à feuilles d'armoise s<br />
Anagallis arvensis L. Mouron <strong>de</strong>s champs ts ts s<br />
Anthemis sp. Anthémis s ts<br />
Arabis sp. Arabette ts ts<br />
Atriplex sp. L. Arroche s ts<br />
Bellis perenis L. Pâquerette s s s ts s s s s<br />
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Capselle bourse à pasteur s s ts s ts s s s<br />
Cardamine sp. L. Cardamine ts ts s<br />
Centaurea sp. L. Centaurées s s s<br />
Cerastium sp. L. Céraiste ts s ts s s<br />
Chenopodium sp. L. Chénopo<strong>de</strong>s s s<br />
Cirsium sp. Chardon s s s ts ts s<br />
Cirsium arvense (L) Scopoli Chardon <strong>de</strong>s champs s s s s<br />
Convolvulus sp.L. Liserons s s s ts s<br />
Crepis sp. Crépi<strong>de</strong> s s s<br />
Daucus carota L. Carotte sauvage s s s<br />
Digitaria sp. Haller Digitaires s s s<br />
Equisetum sp. L. Prêle r<br />
Galium sp. L. Gaillet ts s s s s<br />
Geranium sp. L. s ts s<br />
He<strong>de</strong>ra helix L. Lierre ms<br />
Hypochoeris sp. L. Porcelle s s<br />
Lamium sp. L. Lamiers s s ts s s<br />
Leucanthemum vulgare Lamarck Gran<strong>de</strong> marguerite s s<br />
Lotus sp. L. lotier s s<br />
Matricaria sp. L. Matricaire s s s s s<br />
Matricaria chamomilla L. Matricaire camomille s<br />
Matricaria inodora L Matricaire inodore s<br />
Medicago sp. L. luzernes s s s s<br />
Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle ts s<br />
Myosotis sp. L. Myosotis s ts s<br />
Panicum sp. s<br />
Papaver rhoeas L. Coquelicot s ts s s<br />
Picris sp. L. s ms à s s<br />
Picris hieracioi<strong>de</strong>s L. Helminthie fausse-epervière ts s<br />
Plantago sp. L. s s s ts s s s<br />
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé s ms à s s<br />
Plantago major L. Plantain majeur s s<br />
2,4D (0,7%), dicamba<br />
(0,1%)<br />
2,4 MCPA (360 g/L),<br />
Dicamba (30 g/L)<br />
Bifénox (240 g/L),<br />
Ioxynil (73,6 g/L),<br />
MCPP-P (208 g/L)<br />
Dicamba aci<strong>de</strong> (24<br />
g/L), bromoxynil (120<br />
g/L), mécoprop (360<br />
g/L)<br />
Dicamba (aci<strong>de</strong>) (60<br />
g/L), Ioxynil (70 g/L),<br />
Mécoprop (215 g/L)<br />
Dichlorprop-p (500<br />
g/L), ioxynil (116 g/L<br />
sous forme <strong>de</strong> sels <strong>de</strong><br />
sodium)<br />
Diméthénamid (900<br />
g/L)<br />
Fénoxaprop-P-éthyl<br />
(69 g/L), méfempyrdiéthyl<br />
(18,75 g/L)<br />
Fluroxypyr (40 g/L),<br />
clpopyralid (20g/L),<br />
2,4MCPA (200 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L),<br />
isoxaben (107 g/L)<br />
Mécoprop (400 g/L),<br />
2,4D (100 g/L)<br />
CCIII
composition<br />
2,4D (400 g/L)<br />
2,4D (150g/L), 2,4-<br />
MCPA (175 g/L),<br />
clopyralid (35 g/L)<br />
2,4D (60 g/L), 2,4<br />
MCPA (60 g/L),<br />
Mecoprop (440 g/L)<br />
2,4 MCPA (102 g/L),<br />
MCPP (96 g/L),<br />
dicamba (15 g/L),<br />
ioxynil (6g/L) + urée<br />
(83,5 g/L)<br />
Polygonum sp. L. Renouée ts<br />
Polygonum aviculare L. Renouée <strong>de</strong>s oiseaux s ts s<br />
Potentilla sp. L. Potentille s s<br />
Prunella sp. L. Brunelle s s ms s<br />
Ranunculus sp. L. Renoncules s s s ts ts ms s<br />
Ranunculus sp. L. Bouton d'or s<br />
Ranunculus acris L. Bassinet d'or s<br />
Ranunculus arvensis L. Renoncule <strong>de</strong>s champs s s<br />
Ranunculus sardous Crantz. Renoncule <strong>de</strong>s marais s s s<br />
Raphanus raphanistrum L. Ravenelle s ts s s<br />
Rubus fruticosus L. Ronce ts s<br />
Rumex sp. L. Oseilles s s ts s s ts s s<br />
Rumex acetosella L. Petite oreille s<br />
Senecio sp. L. Séneçons s ts<br />
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée s<br />
Senecio vulgaris L. Séneçon vulgaire s s<br />
Setaria sp. P.Beauv. Sétaires s s<br />
Sinapsis sp. Moutar<strong>de</strong> s ts ts<br />
Sinapsis arvensis L. Moutar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s champs ts ts s<br />
Sonchus sp. L. Laiterons s s ts s s<br />
Sonchus asper (L) Hill Laiteron ru<strong>de</strong> ts<br />
Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ts<br />
Stellaria sp. Stellaire s s s s<br />
Stellaria media (L.) Vill./Cyr Mouron <strong>de</strong>s oiseaux s s<br />
Taraxacum officinale Weber Pissenlit s s s ts s s s s s s<br />
Trifolium sp. L. Trèfles ms s ts s s<br />
Trifolium repens L. Trèfle blanc s s s s s<br />
Urtica sp.L. Ortie s s ts s<br />
Veronica sp. L. s s ts s s ms s<br />
Veronica filiformis SM. Véronique filiforme s ms<br />
Veronica he<strong>de</strong>rifolia L. Véronique à feuilles <strong>de</strong> lierre ms à s<br />
Vicia ap. Vesce ts ts<br />
Vicia sativa L. Vesce fourragère s s<br />
Viola tricolor L. Pensée, violette ms ts<br />
2,4D (0,7%), dicamba<br />
(0,1%)<br />
2,4 MCPA (360 g/L),<br />
Dicamba (30 g/L)<br />
Bifénox (240 g/L),<br />
Ioxynil (73,6 g/L),<br />
MCPP-P (208 g/L)<br />
Dicamba aci<strong>de</strong> (24<br />
g/L), bromoxynil (120<br />
g/L), mécoprop (360<br />
g/L)<br />
Dicamba (aci<strong>de</strong>) (60<br />
g/L), Ioxynil (70 g/L),<br />
Mécoprop (215 g/L)<br />
Dichlorprop-p (500<br />
g/L), ioxynil (116 g/L<br />
sous forme <strong>de</strong> sels <strong>de</strong><br />
sodium)<br />
Diméthénamid (900<br />
g/L)<br />
Fénoxaprop-P-éthyl<br />
(69 g/L), méfempyrdiéthyl<br />
(18,75 g/L)<br />
Fluroxypyr (40 g/L),<br />
clpopyralid (20g/L),<br />
2,4MCPA (200 g/L)<br />
Oryzalin (429 g/L),<br />
isoxaben (107 g/L)<br />
Mécoprop (400 g/L),<br />
2,4D (100 g/L)<br />
CCIV
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong>(1,5%),<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (1%);<br />
difflufénicanil (0,10%),<br />
oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil (2,4%),<br />
oxadiazon (48%)<br />
Efficacité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sélectifs pour arbres et arbustes d’ornement sur différentes adventices<br />
Butraline (480 g/L)<br />
Dichlobénil (4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
difflufénicanil (1,20%),<br />
oxadiazon (20%)<br />
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille s ms ms<br />
Agrostis sp. Gaertn. Agrosti<strong>de</strong> s s s s s<br />
Agrostis spica-venti (L.) Beauv. Agrosti<strong>de</strong> jouet <strong>de</strong> vent s s s s s s s<br />
Ajuga reptans L. Bugle rampant s s s<br />
Alopercurus sp. L. Vulpin s s s s s s s s<br />
Alopecurus myosuroi<strong>de</strong>s Huds Vulpin <strong>de</strong>s champs s s<br />
Amaranthus sp. L. Amarantes s s s s s<br />
Amaranthus albus L. Amarante blanche s<br />
Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie s s s s s s s s s s<br />
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie s s<br />
Anagallis sp. Mourons s s<br />
Anagallis arvensis L. Mouron <strong>de</strong>s champs s s s s s s s s s s<br />
Anthemis sp. L. Anthemis ms s s s s s s s s<br />
Aphanes arvensis L. Alchemille ms s s s s ms ms s<br />
Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold Arabette <strong>de</strong> Thalius<br />
s s<br />
Aristolochia sp. L. Aristoloche ms ms s r r (s*)<br />
Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire ms s r r (s*)<br />
Arrhenatherum elatius ssp.<br />
bulbosum (Willd.) Hyl<br />
Avoine à chapelet<br />
s s s<br />
Atriplex sp. Arroche s s s s s<br />
Atriplex patula L. Arroche étalée s s s s s s<br />
Avena fatua L. Folle avoine s ms s s s s<br />
Bromus sp. L. Brôme s s s<br />
Capsella bursa-pastoris (L.)<br />
Capselle bourse à pasteur<br />
Medicus s s s s s s s s s s s s s s<br />
Cardamine sp. L. Cardamine s s s s<br />
Cardamine hirsuta L. Cardamine s s s s** s s<br />
Cardaria draba (L) Desvaux Passerage drave s s s r r<br />
Carex sp.L. Laiche, carex r<br />
Cerastium sp. L. Céraiste s s s s s s<br />
Cerastium glomeratum Thuill. Ceraiste aggloméré s s s s s s<br />
Chenopodium sp.L. Chénopo<strong>de</strong> s s s s s s<br />
Chenopodium album L. Chenopo<strong>de</strong> blanc s s s s s ms s s s<br />
Chrysanthemum segetum L.<br />
Chrysanthème <strong>de</strong>s<br />
moissons s s s s s s<br />
Cirsium arvense (L) Scopoli Chardon <strong>de</strong>s champs s s s* s s ms à r ms à r s*<br />
Convolvulus sp. L. Liseron s s<br />
Convolvulus arvensis L. Liseron <strong>de</strong>s champs s* ms s ms r r<br />
Isoxaben (107 g/L), oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Ocyfluorphène (0,5%),<br />
prpyzami<strong>de</strong> (1,4%)<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Oxyfluorfen (23-25%);<br />
Propyzami<strong>de</strong> (17-19%)<br />
Oxyfluorfène (134 g/L),<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L)<br />
Pendiméthaline (400 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong> (1,4%),<br />
oxyfluorfène (0,5%)<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L),<br />
oxyfluorfène (134 g/L)<br />
Tifluraline (2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCV
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong>(1,5%),<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (1%);<br />
difflufénicanil (0,10%),<br />
oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil (2,4%),<br />
oxadiazon (48%)<br />
Butraline (480 g/L)<br />
Dichlobénil (4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
difflufénicanil (1,20%),<br />
oxadiazon (20%)<br />
Cuscuta sp. L. Cuscute r r<br />
Cynodon dactylon (L.) Pers. Chien<strong>de</strong>nt pied <strong>de</strong> poule s r ms à r<br />
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré s s s s<br />
Datura stramonium L. Datura ms<br />
Daucus carota L. Carotte sauvage ms ms s<br />
Digitaria sp.Haller Digitaire s s s s s s s s<br />
Digitaria sanguinalis (L.) Scop Digitaire sanguine s s ts s s<br />
Diplotaxis sp. DC Diplotaxis ms s s<br />
Echinochloa crus-gali (L) P.Beauv. Panic pied <strong>de</strong> coq<br />
s s s ts s s s s ms s s s<br />
Epilobium sp. L. Epilobe<br />
s s s s ms* s s s<br />
ms à r<br />
(s*) ms*<br />
Elytrigia repens (L) Nevski chien<strong>de</strong>nt rampant ms s s s* s<br />
Equisetum sp.L. Prêle ms ms<br />
Erigeron cana<strong>de</strong>nsis L. Erigéron du Canada s s s s s s s ms ms ms s<br />
Erodium spp. L'Herit. Erodium s s<br />
Euphorbia sp. L. Euphorbe s s s s s s s s s s s<br />
Festuca sp. L. Fétuque ms s s s s s<br />
Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale s s s s ? s s s s s s s s s s<br />
Galeopsis tetrahit L. Ortie royale s s<br />
Galinsoga sp. Ruiz & Pav. Galinsoga s s s s s s s s s<br />
Galium sp. L. Gaillet s s s s s<br />
Galium aparine L. Gaillet gratteron ts ? s s s<br />
Geranium sp. L. Géranium s s s s s s s<br />
Geranium dissectum L.<br />
Géranium à feuilles<br />
découpées s s s s<br />
Holcus sp. L. Houlque s s<br />
Hypericum sp. L. Millepertuis s ms<br />
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc <strong>de</strong>s bois<br />
s<br />
Juncus bufonius L. Jonc <strong>de</strong>s crapauds s s s s<br />
Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré r<br />
Kickxia sp. Dum. Linaire annuelle s ms<br />
Lamium sp. L. Lamier s s s<br />
Lamium purpureum L. Lamier pourpre s s s s s s s s<br />
Lapsana communis L. Lampsane commune s s s s s s s<br />
Linaria sp. Liniaire s s<br />
Linaria vulgaris Mill. Linaire commune<br />
s s ms à r<br />
ms à r<br />
(s*) s<br />
Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie s ts s<br />
Lolium perenne L. Ray-grass (anglais) s s s* s s s s s s s<br />
Isoxaben (107 g/L), oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Ocyfluorphène (0,5%),<br />
prpyzami<strong>de</strong> (1,4%)<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Oxyfluorfen (23-25%);<br />
Propyzami<strong>de</strong> (17-19%)<br />
Oxyfluorfène (134 g/L),<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L)<br />
Pendiméthaline (400 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong> (1,4%),<br />
oxyfluorfène (0,5%)<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L),<br />
oxyfluorfène (134 g/L)<br />
Tifluraline (2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCVI
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong>(1,5%),<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (1%);<br />
difflufénicanil (0,10%),<br />
oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil (2,4%),<br />
oxadiazon (48%)<br />
Butraline (480 g/L)<br />
Dichlobénil (4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
difflufénicanil (1,20%),<br />
oxadiazon (20%)<br />
Lychnis sp. L. s ms<br />
Malva sp. L. Mauve s s s s s s<br />
Matricaria sp. L. Matricaire s s* s s s s s s s** s à r s à r s<br />
Medicago lupulina L. Luzerne lupuline s s<br />
Mercurialis sp. L. Mercuriale s s s ms s s s s s s s s s<br />
Myosotis sp. L. Myosotis s s s s s s s s<br />
Oxalis corniculata L. Oxalis corniculé s r r<br />
Panicum sp. s s<br />
Papaver rhoeas L. Coquelicot s s s s s s s s s s s<br />
Picris sp. L. Helminthie s s<br />
Plantago sp. L. Plantains ms s<br />
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé s s s s s<br />
Plantago major L. Plantain majeur s r r<br />
Poa sp.L. Pâturin s s s<br />
Poa annua L. Pâturin annuel s s s s s s s s s s s s<br />
Poa trivalis L. Pâturin commun s s ts s s ms s s<br />
Polygonum sp. Renouées s s s s s<br />
Polygonum sp. Renouées annuelles s s s s<br />
Polygonum aviculare L. Renouée <strong>de</strong>s oiseaux s s s ms s ms<br />
Polygonum convolvulus L. Renouée liseron s s<br />
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire s s s<br />
Potentilla reptens L. Potentille rampante ms ms<br />
Portulaca sp. L. Pourpier s s s s s s s s s s<br />
Portulaca oleracea L. Pourpier potager ts s s s<br />
Ranunculus sp. L. Renoncules s<br />
Ranunculus arvensis L. Renoncule <strong>de</strong>s champs ms* s s s s s s s<br />
Ranunculus repens L. Renoncule rampante s r r<br />
Raphanus raphanistrum L. Ravenelle s s s s s s s s s s<br />
Reseda sp. L. Réséda s s s s s s<br />
Rorippa sylvestris (L.) Bess. Cresson <strong>de</strong>s bois ms s s r r s<br />
Rubus fruticosus L. Ronce r r<br />
Rumex sp. L. Oseilles s* s s s<br />
Rumex acetosa L. Gran<strong>de</strong> oseille s<br />
Rumex acetosella L. Petite oseille ms* s s s s s<br />
Rumex crispus L.<br />
Rumex crépu, patience<br />
crépue, oseille à feuilles<br />
<strong>de</strong> patience ts* s ms à r ms à r<br />
Sagina procumbens L.<br />
Sagine couchée, S.<br />
rampante s s s s<br />
Senecio sp. L. Séneçon s ms ms<br />
Senecio vulgaris L. Séneçon vulgaire s s* s ms s s s à r s à r<br />
Isoxaben (107 g/L), oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Ocyfluorphène (0,5%),<br />
prpyzami<strong>de</strong> (1,4%)<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Oxyfluorfen (23-25%);<br />
Propyzami<strong>de</strong> (17-19%)<br />
Oxyfluorfène (134 g/L),<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L)<br />
Pendiméthaline (400 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong> (1,4%),<br />
oxyfluorfène (0,5%)<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L),<br />
oxyfluorfène (134 g/L)<br />
Tifluraline (2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCVII
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong>(1,5%),<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (1%);<br />
difflufénicanil (0,10%),<br />
oxadiazon (2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil (2,4%),<br />
oxadiazon (48%)<br />
Butraline (480 g/L)<br />
Dichlobénil (4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
difflufénicanil (1,20%),<br />
oxadiazon (20%)<br />
Setaria sp. P.Beauv. Sétaire s s s ts s s s s s s s s s<br />
Silene latifolia subsp. alba (Mil)<br />
Greuter & Bur<strong>de</strong>t<br />
Lychnis dioïque<br />
s ms s<br />
Sinapsis arvensis L. Moutar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s champs s s s s s s s s s s<br />
Solanum nigrum L. Morelle noire s s s ms s s s s ms s s s s s<br />
Sonchus sp. Laiteron<br />
s s* s s s s s s<br />
Sonchus asper (L) Hill Laiteron ru<strong>de</strong> s s<br />
Sonchus oleracerus L. Laiteron maraîcher s<br />
Isoxaben (107 g/L), oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Ocyfluorphène (0,5%),<br />
prpyzami<strong>de</strong> (1,4%)<br />
Oxadiazon (2%)<br />
Oxyfluorfen (23-25%);<br />
Propyzami<strong>de</strong> (17-19%)<br />
Oxyfluorfène (134 g/L),<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L)<br />
Pendiméthaline (400 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong> (1,4%),<br />
oxyfluorfène (0,5%)<br />
ms à r<br />
(s*)<br />
Propyzami<strong>de</strong> (375 g/L),<br />
oxyfluorfène (134 g/L)<br />
Tifluraline (2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
ms à r<br />
(s*) s<br />
Sorghum halepense (L.) Persoon Sorgho d'Alep ms<br />
Spergula sp. L. Spergule s s s s s s s s s s s<br />
Stellaria media (L.) Vill./Cyr Mouron <strong>de</strong>s oiseaux s s s s s s s s s s s s<br />
Taraxacum officinale Weber in<br />
Wiggers<br />
Pissenlit<br />
ms* s s s ms à r ms à r<br />
Thlaspi arvense L. Tabouret <strong>de</strong>s champs s s s s s s s<br />
Trifolium sp. L. Trèfle s* s s ms à r s<br />
Trifolium repens L. Trèfle blanc s ms<br />
Urtica dioica L. Ortie dioïque s r r<br />
Urtica urens L. Ortie annuelle s s ms s s s s s s<br />
Veronica sp. L. Véroniques s s ms s s s s s s<br />
Veronica arvensis L. Véronique <strong>de</strong>s champs s s<br />
Veronica he<strong>de</strong>rifolia<br />
Véronique à feuilles <strong>de</strong><br />
lierre s ts<br />
Veronica persica Poir Véronique <strong>de</strong> Perse s ts s s<br />
Vicia sp. L. Vesce s s s s ms ms<br />
Viola tricolor ssp. tricolor L. Pensée sauvage s s s s s s s s s s<br />
CCVIII
Annexe 12<br />
Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s pour différentes plantations ornementales<br />
CCIX
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong><br />
(1,5%),<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s homologués pour arbres et arbustes d’ornement pour différentes espèces ligneuses à feuilles caduques<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil<br />
(2,4%), Oxadiazon<br />
(48%)<br />
Butraline<br />
(480 g/L)<br />
Dichlobénil<br />
(4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
Diflufénicanil (1,20%),<br />
Oxadiazon (20%)<br />
Isoxaben<br />
(107 g/L),<br />
Oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Oxyfluorfen<br />
(23-25%),<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(17-19%)<br />
Pendiméthaline<br />
(400 g/L)<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(375 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong><br />
(1,4%),<br />
Oxyfluorfène<br />
(0,5%)<br />
Abelia sp. Abelia V R R R R R R R<br />
Acacia retino<strong>de</strong>s Mimosa <strong>de</strong>s 4 saisons R R R R R R R<br />
Acer sp. Erables R R R R R R R R R<br />
Acer campestre Erable champêtre R R2 R<br />
Acer negundo Erable noir R R R R R R<br />
Acer palmatum Erable palmé, E. du Japon R<br />
Acer platanoi<strong>de</strong>s Erable plane R R R R R R<br />
Acer pseudoplatanus Erable sycomore<br />
Erable argenté, E. blanc,<br />
R R R R R R R<br />
Acer saccharinum<br />
E. dur R R R R<br />
Acer saccharum Erable à sucre R<br />
Aesculus sp. Marronnier R R R R R R R R R R R<br />
Ailanthus sp. Ailanthe R R R R R<br />
Albizia sp. R R R<br />
Albizia julibrissin Arbre à soie R R R R<br />
Alnus sp. Aulnes R R R R R R R<br />
Alnus cordata Aulne à feuilles en cœur R R<br />
Alnus glutinosa Aulne glutineux R R<br />
Amelanchier lamarckii Amélanchier R R R<br />
Ampelopsis sp. Vigne vierge S R R R<br />
Arbutus sp. Arbousier R R R R<br />
Arbutus uneo Arbousier commun V S R R<br />
Aucuba sp. Aucuba R R R<br />
Azalea sp. Azalée V R S R V V<br />
Berberis sp. Epine vinette R R R V R R R R R R R<br />
Betula sp. Bouleau R R R R R R R R R R<br />
Buddleia sp. R V R R<br />
Buddleia davidii Arbre aux papillons R R R R R R<br />
Buxus sp. Buis R R R R<br />
Buxus sempervirens Buis commun R R R V* R R<br />
Callistemon sp. Callistémon R R R R<br />
Calluna vulgaris Callune fausse-bruyère R S R V V R<br />
Camelia sp. Camelia S R R R R R R<br />
Campsis sp. Bignone R R2 R R R R R<br />
Carpinus sp. Charme R R R R R R R R R R<br />
Caryopteris sp. Spirée bleue V R R R R R<br />
Castanea sativa Chataigner R R R R R R R R<br />
Catalpa bignonioi<strong>de</strong>s Catalpa R R R R R R R R R<br />
Ceanothus sp. Céanothe R MS V R R R R<br />
Celtis australis Micocoulier <strong>de</strong> Provence R R R<br />
Trifuraline<br />
(2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCX
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong><br />
(1,5%),<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil<br />
(2,4%), Oxadiazon<br />
(48%)<br />
Butraline<br />
(480 g/L)<br />
Dichlobénil<br />
(4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
Diflufénicanil (1,20%),<br />
Oxadiazon (20%)<br />
Isoxaben<br />
(107 g/L),<br />
Oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Oxyfluorfen<br />
(23-25%),<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(17-19%)<br />
Pendiméthaline<br />
(400 g/L)<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(375 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong><br />
(1,4%),<br />
Oxyfluorfène<br />
(0,5%)<br />
Cercis siliquastrum Arbre <strong>de</strong> Judée R R R R R R R R R<br />
Chaenomeles sp.. Cognassier R R R R R R R R<br />
Choisya ternata Oranger du Mexique R R R R<br />
Cistus sp. Cystes R R<br />
Clematis sp. Clématites R R<br />
Colutea sp. Baguenaudier R2 R R<br />
Cornus sp. Cornouillers V S R MS R R R R R<br />
Corta<strong>de</strong>ria selloana Herbe <strong>de</strong>s Pampas R R R<br />
Corylus sp. Noisetier R R R R2 R R R R R R<br />
Cotinus coggygria Arbre à perruques R R R R R R R<br />
Cotoneaster sp. R R R R R R R R<br />
Cotoneaster franchetii R R R R<br />
Cotoneaster horizontalis Cotoneaster nain R R R<br />
Crataegus sp. Aubépine R R2 R R R<br />
Cryptomeria japonica Cryptomère du Japon R R R R R R R<br />
Cytisus scoparius Genêt à balais R R R R R R R<br />
Danae racemosa Laurier d'Alexandrie R R<br />
Deutzia sp. Deutzia R V R R R R R R R<br />
Elaeagnus sp. Chalef R R R R R R R R R<br />
Erica sp. Bruyère R S R R V V R<br />
Escallonia sp. Escallonia R R R R R R R<br />
Eucalyptus sp. Eucalyptus R R R R R R R<br />
Euonymus sp. Fusain R V V R R V R R R R<br />
Fagus sp. Hêtre R R R R R R V R R R<br />
Forsythia sp. Forsythia R R R R R R R R R R R<br />
Fraxinus sp. Frêne R R R R R R R R R R R R<br />
Genista sp. Genêt R R R R R R R<br />
Gleditsia sp. Févier R R R R R R R<br />
Hamamelis sp. R R R<br />
Hebe sp. Véronique R R R R<br />
He<strong>de</strong>ra helix Lierre R R2 R R R R<br />
Hibiscus syriacus Althéa R R R R R R R R<br />
Hippophae sp. Argousier R R R R<br />
Hydrangea sp. Hortensia S S S S S<br />
Hypericum sp. Millepertuis R R S R R R R R R<br />
Ilex aquifolium L. Houx commun S R R R R R R<br />
Jasminum sp. Jasmin R R R R R R<br />
Juglans sp. Noyer R R R R R R R<br />
Kerria japonica Corète du Japon V V R R R R R R R<br />
Kolkwitzia sp. Buisson <strong>de</strong> beauté R R R R<br />
Laburnum sp. Cytise R R R R R R R<br />
Lagerstroemia sp. Lilas d'été V R R R R R R R<br />
Laurus nobilis Laurier-sauce R R R R R<br />
Lavandula sp. Lavan<strong>de</strong> R R R R R R R R R<br />
Ligustrum sp. Troène R R R R MS R R R R R R<br />
Trifuraline<br />
(2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCXI
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong><br />
(1,5%),<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil<br />
(2,4%), Oxadiazon<br />
(48%)<br />
Butraline<br />
(480 g/L)<br />
Dichlobénil<br />
(4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
Diflufénicanil (1,20%),<br />
Oxadiazon (20%)<br />
Isoxaben<br />
(107 g/L),<br />
Oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Oxyfluorfen<br />
(23-25%),<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(17-19%)<br />
Pendiméthaline<br />
(400 g/L)<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(375 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong><br />
(1,4%),<br />
Oxyfluorfène<br />
(0,5%)<br />
Liquidambar styraciflua Copalme R R R R R R<br />
Lirio<strong>de</strong>ndron tulipifera Tulipier <strong>de</strong> Virginie R R R R R R R<br />
Lonicera sp. R R R R R R<br />
Lonicera japonica Chèvrefeuille du japon R<br />
Lonicera nitida R R R R R R R<br />
Magnolia sp. Magnolia S R R R R R R R<br />
Magnolia grandiflora Magnolia à gran<strong>de</strong>s fleurs<br />
Magnolia, hybri<strong>de</strong>s<br />
R<br />
Magnolia X soulangiana Soulangiana R R<br />
Magnolia stellata Magnolia étoilé R R<br />
Mahonia sp. Mahonie R R R R R R R R R R<br />
Malus sp. Pommier d'ornement R R R R R R R R R R<br />
Mespilus germanica Néflier commun R R<br />
Morus alba Mûrier R R R R R R R<br />
Myricaria germanica Myricaire d'Allemagne R R R<br />
Myrtus sp. Myrte R R<br />
Nandina domestica Nandine fruitière R R R R<br />
Nerium olean<strong>de</strong>r Laurier-rose R R R R R R R R R R<br />
Olea europea Olivier R R R<br />
Osmanthus sp. Osmanthe R<br />
Parthenocissus sp. Vigne vierge<br />
Passiflore, fleur <strong>de</strong> la<br />
R R R2 R R R R R<br />
Passiflora sp.<br />
passion R R<br />
Paulownia sp. Paulownia R R R R R R R R<br />
Perovskia sp. Perovskia R R<br />
Phila<strong>de</strong>lphus sp. Seringat R R R R R R R<br />
Phila<strong>de</strong>lphus coronarius Seringat <strong>de</strong>s jardins R R R<br />
Phoenix sp. Dattier R R R R R R<br />
Photinia sp. Photinia R R R<br />
Pieris sp. Andromè<strong>de</strong> du Japon V R S R R<br />
Pittosporum sp. Pittosporum R R R R R R R R R<br />
Platanus sp. Platane R R R R R R R R R R R<br />
Populus sp. Peuplier R R R R R V R R R<br />
Potentilla sp. Potentille R R R R R R R R<br />
Prunus sp. R R R R<br />
Prunus avium Cerisier <strong>de</strong>s bois R R R R R R<br />
Prunus cerasifera Prunier cerisier R R R2 R R R R R R<br />
Prunus laurocerasus Laurier cerise R R R R R R R R R R<br />
Prunus lusitanica Laurier du Portugal R R R R R R R R<br />
Prunus serrulata Cerisier à fleurs R R R R<br />
Prunus triloba Prunus trilobé R R R R R R R R<br />
Punica sp. Grenadier R R R<br />
Pyracantha sp. Buisson ar<strong>de</strong>nt R R R R R R V* R R R<br />
Quercus sp. Chêne R R R R R R R R R<br />
Trifuraline<br />
(2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCXII
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong><br />
(1,5%),<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil<br />
(2,4%), Oxadiazon<br />
(48%)<br />
Butraline<br />
(480 g/L)<br />
Dichlobénil<br />
(4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
Diflufénicanil (1,20%),<br />
Oxadiazon (20%)<br />
Isoxaben<br />
(107 g/L),<br />
Oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Oxyfluorfen<br />
(23-25%),<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(17-19%)<br />
Pendiméthaline<br />
(400 g/L)<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(375 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong><br />
(1,4%),<br />
Oxyfluorfène<br />
(0,5%)<br />
Quercus rubra Chêne rouge R R R<br />
Rhodo<strong>de</strong>ndron Rhodo<strong>de</strong>ndron R R S R R R R R<br />
Rhus typhina Sumac <strong>de</strong> Virginie R R R R R<br />
Ribes sp. Groseiller à fleurs R R R R R R R R<br />
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia R R R R R R R R<br />
Rosa sp. Rosier<br />
Eglantier; roses 'Mme<br />
R S R R R<br />
Rosa canina Meilland', 'Pfan<strong>de</strong>r',<br />
'Rusticana' …<br />
roses ('Inemis Orange<br />
R S R R<br />
Rosa multiflora sensation", 'Ruth<br />
Leuwerick')<br />
R S R<br />
Rosa rugosa Rosier rugueux V R<br />
Rosmarinus officinalis Romarin officinal R R R R R R R R<br />
Salix sp. Saule R R R R R R R R R R<br />
Sambucus sp. Sureau R S R R R R<br />
Santolina sp. Santoline R R R<br />
Skimmia sp. S R R<br />
Sophora sp. Sophora R R R<br />
Sophora japonica Sophora du Japon R R R R R<br />
Sorbus sp. Sornier R R R R R R R<br />
Spartium junceum Genêt d'Espagne R S R R V<br />
Spiraea sp. Spirée R V S R V R V R R<br />
Spiraea japonica S R<br />
Spiraea x vanhouttei R R R<br />
Symphoricarpos sp. Symphorine R R S R R R R R<br />
Syringa sp. Lilas R R R R R R R R R<br />
Tamarix sp. Tamaris R R R R2 R R R R<br />
Teucrium sp Germandrée R R V*<br />
Tilia sp. Tilleul R R R R R R R R R R R R<br />
Ulmus sp. Orme R R R R R R R<br />
Viburnum sp. Viorne R R R R V R R R R<br />
Viburnum opulus Boule <strong>de</strong> neige R R R R<br />
Viburnum tinus Laurier-tin R R V R R<br />
Weigelia sp. Weigelia R R S R R R R R R<br />
Wisteria sinensis Glycine V S R R R R R R<br />
Yucca sp. Yucca R R R R<br />
S : sensible, ne pas traiter<br />
V : variable<br />
V* : variable sur jeunes plants<br />
R: résistant<br />
R2 : résistant (plantation <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans)<br />
Trifuraline<br />
(2%), Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCXIII
Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s homologués pour arbres et arbustes d’ornement pour différentes espèces <strong>de</strong> conifères<br />
composition<br />
Carbétami<strong>de</strong><br />
(1,5%),<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Carbétami<strong>de</strong> (24%),<br />
Diflufénicanil<br />
(2,4%), Oxadiazon<br />
(48%)<br />
Butraline<br />
(480 g/L)<br />
Dichlobénil<br />
(4%)<br />
Glyphosate (20%),<br />
Difflufénicanil<br />
(1,20%), Oxadiazon<br />
(20%)<br />
Isoxaben (107<br />
g/L), Oryzalin<br />
(429 g/L)<br />
Oxadiazon<br />
(2%)<br />
Oxyfluorfen<br />
(23-25%) ,<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(17-19%)<br />
Pendiméthaline<br />
(400 g/L)<br />
Propyzami<strong>de</strong><br />
(375 g/L)<br />
Propysami<strong>de</strong><br />
(1,4%),<br />
oxyfluorfène<br />
(0,5%)<br />
Abies sp. Sapin R R R R R R R R<br />
Araucaria araucana Désespoir du singe R R R R<br />
Cedrus sp. Cèdre V R S R R R R R<br />
Chamaecyparis sp. Faux cyprès V R R R R R R R R R R R<br />
Cupressosyparis<br />
leylandii<br />
Cyprès <strong>de</strong> Leyland R R R R R R R R R<br />
Cupressus sp. Cyprès S R R R R R R<br />
Cupressus arizonica Cyprès <strong>de</strong> l'Arizona R R<br />
Cupressus macrocarpa Cyprès <strong>de</strong> Monterey R R<br />
Cupressus sempervirens Cyprès d’Italie V R R<br />
Ginkgo biloba Arbre aux 40 écus R R R R R R R R<br />
Juniperus sp. Genévrier V R R R R R R R R R<br />
Metasequoia sp. R R R R R<br />
Picea sp. Epicéa R R R R R R R R R<br />
Picea abies.<br />
Epicéa sapin, épicéa<br />
commun<br />
V R R<br />
Picea pungens Epicéa du Colorado R R<br />
Pinus sp. Pin R R R R R R R R R<br />
Pinus halepensis Pin d'Alep, P. blanc R R<br />
Pinus nigra Pin noir V R R<br />
Pseudotsuga sp. Sapin <strong>de</strong> Douglas V R R R R R R R<br />
Sequoia sp. Séquoia géant R R R R R<br />
Taxodium sp. Cyprès chauve R R R R<br />
Taxus sp. L. If R R R R R<br />
Taxus baccata l. If commun V R R R R R R R<br />
Thuja sp. L. Thuyas R R R R R R R R R<br />
Thuja occi<strong>de</strong>ntalis l. Thuya du canada V R R R R<br />
Thuja orientalis l. Thuya <strong>de</strong> chine V R R<br />
Thuja plicata<br />
Thuya géant, T.<br />
plissé<br />
V R R R R<br />
Thujopsis sp. Thuya du japon R R R<br />
Tsuga sp. Tsuga R R<br />
S : sensible, ne pas traiter<br />
V : variable<br />
R : résistant<br />
Trifuraline<br />
(2%),<br />
Isoxaben<br />
(0,5%)<br />
CCXIV
composition<br />
Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s homologués pour le désherbage DT-PJT pour différentes espèces d’arbres à feuilles caduques<br />
Dichlobénil Isoxaben + Oryzalin<br />
Carbétamine + Glyphosate + Diflufenicanil 2,4 MCPA + Diuron<br />
Diflufenicanil + Oxadiazon + Oxadiazon<br />
+ Glyphosate<br />
Amitrole + Glyphosate<br />
Acacia floribunda Mimosa <strong>de</strong>s 4 saisons R R<br />
Acacia longifolia V<br />
Acer Erable R R R R R<br />
Acer campestre Erable champêtre R R<br />
Acer negundo Érable noir R R R<br />
Acer platanoï<strong>de</strong>s Erable plane R R R<br />
Acer pseudoplatanus Erable sycomore R R<br />
Acer saccharinum Erable argenté R R<br />
Aesculus hippocastanum Marronnier R R R R<br />
Aesculus x carnea Marronnier rouge R<br />
Ailanthus altissima Faux vernis du Japon R<br />
Albizia julibrissin Arbre à soie R<br />
Alnus Aulnes V R V<br />
Alnus cordata Aulne à feuilles en cœur R<br />
Alnus glutinosa Aulne glutineux R<br />
Betula Bouleau R R R R<br />
Betula jacquemontii R<br />
Betula nigra R<br />
Betula pendula elegans Bouleau pleureur R<br />
Betula verrucosa Bouleau blanc d'Europe R R R<br />
Carpinus betulus Charme R R R R R<br />
Castanea sativa Châtaignier R R<br />
Catalpa bignonioi<strong>de</strong>s Catalpa commun R R R R<br />
Catalpa sp R<br />
Cercis siliquastrum Arbre <strong>de</strong> Judée R R R<br />
Eucalyptus Eucalyptus R R<br />
Fagus sylvatica Hêtre R R R R R R<br />
Fraxinus Frênes R R R R<br />
Fraxinus excelsior Frêne commun R V R<br />
Gleditsia triacanthos Févier d'Amérique S R R R<br />
Gleditsia japonica R<br />
Juglans Noyers R R<br />
Juglans nigra Noyer noir d'Amérique R R<br />
Koelreuteria paniculata Savonnier R<br />
Liquidambar styraciflua Copalme d'Amérique R R R<br />
Lirio<strong>de</strong>ndron tulipifera Tulipier <strong>de</strong> Virginie R R R<br />
Magnolia R R<br />
Magnolia grandiflora Magnolia à gran<strong>de</strong>s fleurs R<br />
Magnolia x soulangiana Magnolia, hybri<strong>de</strong>s Soulangiana R<br />
Magnolia stellata Magnolia étoilé R<br />
Malus Pommiers d'ornement R R R<br />
Malus pumila R<br />
Melia aze<strong>de</strong>ra R<br />
CCXV
ESPECES TESTEES<br />
composition<br />
Dichlobénil Isoxaben + Oryzalin<br />
Carbétamine + Glyphosate + Diflufenicanil 2,4 MCPA + Diuron<br />
Diflufenicanil + Oxadiazon + Oxadiazon<br />
+ Glyphosate<br />
Amitrole + Glyphosate<br />
Mespilus germanica Néflier commun R<br />
Morus Mûriers R R R<br />
Morus bombycis R<br />
Morus nigra Mûrier noir R R<br />
Olea europaea Olivier R<br />
Paulownia Paulownia R R R<br />
Platanus Platanes R R R R<br />
Platanus x acerifolia Platane R R R<br />
Populus Peupliers R R R<br />
Populus alba Peuplier blanc <strong>de</strong> Hollan<strong>de</strong> R R<br />
Populus nigra Peuplier noir R R R<br />
Prunus avium Merisier <strong>de</strong>s oiseaux R R R R R<br />
Prunus caucasia R<br />
Prunus cerasifera Prunier cerisier R R R R R<br />
Prunus cerasus 'New Red' R<br />
Prunus padus R<br />
Prunus serrulata Prunier trilobé R R<br />
Prunus triloba Prunier à fleurs R R<br />
Pyrus communis Poirier R<br />
Quercus Chênes R R R R<br />
Quercus robur Chên pédonculé V<br />
Quercus rubra Chêne rouge R R<br />
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia R R R R R R<br />
Salix Saules R R R<br />
Salix alba R<br />
Salix matsudana Saule <strong>de</strong> Pékin R<br />
Salix vinimallis R<br />
Sambucus nigra Sureau noir S R R<br />
Sophora japonica Sophora du Japon R R R R<br />
Sorbus Sorbiers R R R R<br />
Sorbus aria R<br />
Sorbus intermedia R<br />
Tilia Tilleuls R R R R<br />
Tilia cordata Tilleul à petites feuilles R R<br />
Ulmus Ormes R R R<br />
R : résistante<br />
V : variable<br />
CCXVI
ESPECES TESTEES<br />
composition<br />
Dichlobénil<br />
Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s homologués pour le désherbage DT-PJT pour différentes espèces d’arbustes<br />
Isoxaben +<br />
Oryzalin<br />
Carbétamine +<br />
Diflufenicanil +<br />
Oxadiazon<br />
Glyphosate +<br />
Diflufenicanil +<br />
Oxadiazon<br />
2,4 MCPA + Diuron +<br />
Glyphosate<br />
Amitrole + Glyphosate<br />
Abelia Abélia R R<br />
Amelanchier cana<strong>de</strong>nsis R R R<br />
Ampelopsis Vigne vierge R R<br />
Arbutus Arbousiers S<br />
Atriplex hortensis Arroche cultivée S<br />
Aucuba japonica R<br />
Azalea Azalées V V<br />
Azalea mollis R R<br />
Berberis Epine vinette R R R R<br />
Buddleja davidii Arbre aux papillons R V R<br />
Buxus Buis R R R S<br />
Callistemon rigidus Callistémon R R<br />
Callicarpa R R<br />
Calluna vulgaris Callune fausse bruyère S R R<br />
Camellia Camélias R R<br />
Caryopteris incana Spirée bleue R S<br />
Ceanothus Céanothes R V R<br />
Chamaecerasus nitida R R R<br />
Choisya ternata Oranger du Mexique S R V<br />
Cistus Cistes V<br />
Cornus Cornouillers R R V<br />
Corylus Noisetiers R R R R<br />
Cotinus coggygria Arbres à perruques R R R<br />
Cotoneaster Cotoneaster V R V R<br />
Cotoneaster dammeri V<br />
Cotoneaster franchetii R R<br />
Cotoneaster horizontalis V<br />
Cytisus scoparius Genêt à balais R R R<br />
Deutzia Deutzia R R R<br />
Elaeagnus pungens Chalef R R R<br />
Elaeagnus x ebbingei R R<br />
Erica Bruyère S R<br />
Escallonia R R<br />
Euonymus Fusains R R V<br />
Euonymus europaeus Fusain d'Europe R<br />
Euonymus fortunei Fusain <strong>de</strong> Chine V<br />
Euonymus japonicus Fusain du Japon V<br />
Forsythia Forsythia R R V R R<br />
Genista Genêts R R<br />
Hamamelis R R<br />
Hebe Véronique R R<br />
He<strong>de</strong>ra helix Lierre commun R R<br />
Hypericum Millepertuis R R<br />
CCXVII
ESPECES TESTEES<br />
composition<br />
Dichlobénil<br />
Isoxaben +<br />
Oryzalin<br />
Carbétamine +<br />
Diflufenicanil +<br />
Oxadiazon<br />
Glyphosate +<br />
Diflufenicanil +<br />
Oxadiazon<br />
2,4 MCPA + Diuron +<br />
Glyphosate<br />
Amitrole + Glyphosate<br />
Hypericum patulum R R<br />
Ilex aquifolium Houx commun R R S<br />
Ilex crenata S<br />
Ilex vomitoria S<br />
Kerria japonica Corète du Japon R R V<br />
Kolkwitzia amabilis Buisson <strong>de</strong> beauté R R<br />
Laburnum anagyroi<strong>de</strong>s Cytise R R R R<br />
Laurus nobilis Laurier sauce R<br />
Lavandula angustifolia Lavan<strong>de</strong> R R R<br />
Ligustrum Troènes R V R R<br />
Lonicera R R R<br />
Mahonia aquifolium Mahonia commun R R R<br />
Nerium olean<strong>de</strong>r Laurier-rose R R R<br />
Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge R R R<br />
Phila<strong>de</strong>lphus coronarius Seringat R R R R<br />
Pieris japonica Andromè<strong>de</strong> du Japon R V<br />
Pittosporum tobira Pittosporum R R<br />
Potentilla Potentille R R R<br />
Prunus laurocerasus Laurier-cerise R R R R R<br />
Prunus lusitanica Laurier du Portugal R V R<br />
Pyracantha V R R<br />
Rhamnus frangula Bourdaine S<br />
Rhodo<strong>de</strong>ndron Rhodo<strong>de</strong>ndron R R R<br />
Rhus typhina Sumac <strong>de</strong> Virginie R R<br />
Ribes Groseillier à fleurs R R R<br />
Rosa Rosiers R V<br />
Rosa canina Eglantier commun S R<br />
Rosa multiflora Rosier multiflore S<br />
Rosa pimpinellifolia spinosissima Rose d'Ecosse S<br />
Rosa rugosa Rosier rugueux S R<br />
Rosmarinus officinalis Romarin officinal R R<br />
Santolina Santoline R R<br />
Senecio greyi S R<br />
Skimmia R R<br />
Spartium junceum Genêt d'Espagne V V<br />
Spiraea Spirées R R<br />
Spirea bumulda V R<br />
Spiraea x vanhouttei R R<br />
Symphoricarpos Symphorine S R R<br />
Syringa vulgaris Lilas commun R R R<br />
Tamarix Tamaris R R R R<br />
Viburnum Viornes R R V<br />
Viburnum opulus Viorne obiers R R R<br />
Viburnum tinus Laurier tin R R V R<br />
Weigela Weigelia R R V R R<br />
Wisteria sinensis Glycine R S<br />
R : résistant V : variable S : sensible<br />
CCXVIII
Sélectivité <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s homologués pour le désherbage DT-PJT pour différentes espèces <strong>de</strong> conifères<br />
ESPECES TESTEES<br />
Dichlobénil<br />
Isoxaben +<br />
Oryzalin<br />
Carbétamine +<br />
Diflufenicanil +<br />
Oxadiazon<br />
Glyphosate +<br />
Diflufenicanil +<br />
Oxadiazon<br />
2,4 MCPA + Diuron<br />
+ Glyphosate<br />
Amitrole + Glyphosate<br />
Abies sapins R R R<br />
Araucaria R<br />
Calocedrus <strong>de</strong>currens V<br />
Cedrus cèdres V R R<br />
Chamaecyparis faux cyprès R R R R R<br />
Chamaecyparis lawsoniana cyprès <strong>de</strong> Lawson R R<br />
Cryptomeria japonica sugi R R R<br />
Cupressocyparis leylandii cyprès <strong>de</strong> Leyland R R R R R<br />
Cupressus cyprès R R R R<br />
Cupressus arizonica R<br />
Cupressus macrocarpa cyprès <strong>de</strong> lambert R<br />
Cupressus sempervirens cyprès d'Italie R<br />
Ginkgo biloba arbre aux 40 écus R R<br />
Juniperus genévriers R R R<br />
Larix mélèzes V R R<br />
Metasequoia glyptostroboi<strong>de</strong>s R R R<br />
Picea épicéas R R R<br />
Picea abies épicéa commun R<br />
Picea pungens épicéa du Colorado R R<br />
Picea sitchensis épicéa <strong>de</strong> Sitka R R<br />
Pinus pins R R R<br />
Pinus halepensis pin d'Alep R<br />
Pinus nigra austriaca pin noir d'Autriche R<br />
Pinus nigra laricio pin <strong>de</strong> Corse R<br />
Podocarpus R<br />
Pseudotsuga R R<br />
Sequoïa sempervirens R<br />
Sequoia<strong>de</strong>ndron giganteum sequoia géant R<br />
Taxodium R R<br />
Taxus baccata if commun R R<br />
Thuja thuyas R R R R S<br />
Thuja occi<strong>de</strong>ntalis thuya du Canada R R R<br />
Thuja plicata thuya géant R R R<br />
Thujopsis <strong>de</strong>labrata thujopsis R<br />
R : résistant<br />
V : variable<br />
CCXIX
Annexe 13<br />
Phrases <strong>de</strong> risque et conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce indiqués sur les étiquettes <strong>de</strong>s produits phytopharmaceutiques<br />
220
Phrases <strong>de</strong> risque<br />
Sur l'étiquette <strong>de</strong>s préparations pestici<strong>de</strong>s considérées comme dangereuses au sens du présent arrêté doivent<br />
figurer, selon la nature <strong>de</strong>s risques, une ou plusieurs mentions relatives à la nature <strong>de</strong>s risques particuliers<br />
correspondants.<br />
Si plusieurs mentions sont requises, elles peuvent être combinées conformément à l'arrêté du 10 octobre 1983.<br />
INDICATIONS <strong>de</strong>s dangers NUMÉRO <strong>de</strong> l'annexe III <strong>de</strong> M<strong>EN</strong>TIONS RELATIVES à la nature <strong>de</strong>s<br />
la directive 67/548/C.E.E. risques particuliers<br />
Très toxique (T +) R26 Très toxique par inhalation.<br />
R27 Très toxique par contact avec la peau.<br />
R28 Très toxique en cas d'ingestion.<br />
Toxique (T) R 23 Toxique par inhalation.<br />
R24 Toxique par contact avec la peau.<br />
R25 Toxique en cas d'ingestion.<br />
Nocif (Xa) R20 Nocif par inhalation.<br />
R21 Nocif par contact avec la peau.<br />
R22 Nocif en cas d'ingestion.<br />
Irritant (Xi) R36 Irritant pour les yeux.<br />
R37 Irritant pour les voies respiratoires.<br />
R38 Irritant pour la peau.<br />
Corrosif (C) R34 Provoque <strong>de</strong>s brûlures.<br />
R35 Provoque <strong>de</strong> graves brûlures.<br />
Facilement inflammable (F) R11 Très inflammable.<br />
R12 Extrêmement inflammable.<br />
R13 Gaz liquéfié extrêmement inflammable.<br />
R15 Au contact <strong>de</strong> l'eau, dégage <strong>de</strong>s gaz très<br />
inflammables.<br />
Explosif (E) R16 Peut exploser en mélange avec <strong>de</strong>s<br />
substances comburantes.<br />
Annexe IV : Mentions relatives à la nature <strong>de</strong>s risques particuliers<br />
Arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions <strong>de</strong> classement, d'étiquetage et d'emballage <strong>de</strong>s préparations<br />
pestici<strong>de</strong>s (JO du 18 avril 1989)<br />
http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3332.htm<br />
Conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce<br />
Pour les pestici<strong>de</strong>s qui sont classés comme très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs ou irritants, les conseils <strong>de</strong><br />
pru<strong>de</strong>nce suivants sont obligatoires :<br />
NUMÉRO <strong>de</strong> l'annexe IV <strong>de</strong><br />
la directive 67/548/C.E.E.<br />
S 2<br />
M<strong>EN</strong>TIONS TYPES<br />
Conserver hors <strong>de</strong> la portée <strong>de</strong>s enfants.<br />
S 20/21 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.<br />
221
S 13 Conserver à l'écart <strong>de</strong>s aliments et boissons y compris ceux pour animaux.<br />
Pour les pestici<strong>de</strong>s nocifs :<br />
S 44 En cas <strong>de</strong> malaise, consulter un mé<strong>de</strong>cin (si possible lui montrer l'étiquette).<br />
Pour les pestici<strong>de</strong>s très toxiques et toxiques :<br />
S 45 En cas d'acci<strong>de</strong>nt ou <strong>de</strong> malaise, consulter immédiatement un mé<strong>de</strong>cin (si<br />
possible lui montrer l'étiquette).<br />
Selon les natures particulières <strong>de</strong>s risques du pestici<strong>de</strong>, les conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce suivants doivent être mentionnés<br />
en supplément :<br />
S 22 Ne pas respirer les poussières.<br />
S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.<br />
S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.<br />
S 36 Porter un vêtement <strong>de</strong> protection approprié.<br />
S 37 Porter <strong>de</strong>s gants appropriés.<br />
S 42 Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire<br />
approprié.<br />
Lorsque le pestici<strong>de</strong> est classé comme corrosif, les conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce suivants doivent être mentionnés en<br />
supplément :<br />
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec...<br />
(produits appropriés à indiquer par le fabricant).<br />
S 37 Porter <strong>de</strong>s gants appropriés.<br />
S 39 Porter un appareil <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s yeux / du visage.<br />
Lorsque le pestici<strong>de</strong> contient <strong>de</strong>s esters d'aci<strong>de</strong> phosphorique, le conseil <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce suivant doit être mentionné<br />
en supplément :<br />
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec...<br />
(produits appropriés à indiquer par le fabricant).<br />
Si plusieurs mentions sont requises, elles peuvent être combinées conformément à l'arrêté du 10 octobre 1983.<br />
Annexe V : Conseils <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce<br />
Arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions <strong>de</strong> classement, d'étiquetage et d'emballage <strong>de</strong>s préparations<br />
pestici<strong>de</strong>s (JO du 18 avril 1989)<br />
http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3332.htm<br />
222