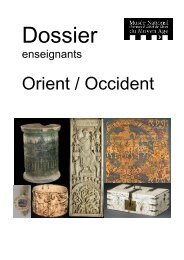Télécharger le document - Musée national du Moyen Âge
Télécharger le document - Musée national du Moyen Âge
Télécharger le document - Musée national du Moyen Âge
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
J a n v i e r<br />
2 0 0 8<br />
Tissus orientaux<br />
des trésors d’églises<br />
6 place Paul Pain<strong>le</strong>vé, 75005 Paris<br />
Service culturel. Tél. 01 53 73 78 16<br />
www.musee-moyenage.fr<br />
Fragment au Samson de la cathédra<strong>le</strong> de Coire<br />
Byzance, VIII e sièc<strong>le</strong> ; samit de soie façonné ; H. 31 cm, l. 35,6 cm ; Cl. 3055<br />
Fragment au quadrige de la cathédra<strong>le</strong> d’Aix-la-Chapel<strong>le</strong><br />
Byzance, VIII e sièc<strong>le</strong> ; samit de soie façonné ; H. 73 cm, l. 72,5 cm ; Cl. 13289<br />
Fragment de suaire de saint Lazare de la cathédra<strong>le</strong> d’Autun<br />
Andalousie, XI e sièc<strong>le</strong> ; taffetas brodé de soie et d’or ; H. 55 cm, l. 30 cm ; Cl. 21865<br />
Fragment à inscription coufique de l’abbaye de Saint-Martin-<strong>du</strong>-Canigou<br />
Andalousie, XI e sièc<strong>le</strong> ; toi<strong>le</strong> de lin brodée de soie ; H. 23 cm, l. 60,3 cm ; Cl. 3164<br />
Fragment de l’aube de l’abbé Biure<br />
Andalousie, XI e sièc<strong>le</strong> ; tapisserie de soie et d’or ; H. 10 cm, l. 31,3 cm ; Cl. 22819<br />
Fragment de la chasub<strong>le</strong> de saint Exupère de la basilique Saint-Sernin de Toulouse<br />
Andalousie, XII e sièc<strong>le</strong> ; samit façonné ; H. 45 cm, l. 21,6 cm ; Cl. 12869<br />
Chaperon aux guépards de la collégia<strong>le</strong> de Chinon<br />
Andalousie, XII e sièc<strong>le</strong> ; samit façonné ; H. 18 cm, l. 37 cm ; Cl. 22018<br />
Fragment de dalmatique de la cathédra<strong>le</strong> de Brandebourg<br />
Iran, XIV e sièc<strong>le</strong> ; lampas en soie et fils d’or ; H. 26,6 cm, l. 13,4 cm ; Cl. 3086<br />
La constitution de trésors d’églises, accumulation d’œuvres précieuses dédiées au<br />
culte, fut l’un des faits spirituels et artistiques <strong>le</strong>s plus importants <strong>du</strong> <strong>Moyen</strong> <strong>Âge</strong> occidental. À la<br />
sp<strong>le</strong>ndeur et à la rareté des matières, constitutives de tout trésor, s’ajoutait pour <strong>le</strong> fidè<strong>le</strong> une<br />
dimension métaphysique comparab<strong>le</strong> à cel<strong>le</strong> évoquée par l’abbé Suger (XIIe sièc<strong>le</strong>) devant <strong>le</strong>s<br />
gemmes <strong>du</strong> trésor de Saint-Denis : “une nob<strong>le</strong> méditation (…) transférant ce qui est matériel en<br />
immatériel“.<br />
Composé des objets <strong>du</strong> culte (ministerium) et d’un ensemb<strong>le</strong> d’œuvres dont la vocation est<br />
plus décorative (ornamentum), <strong>le</strong> faste des trésors d’églises se caractérisait en premier lieu par<br />
l’orfèvrerie mais aussi, très souvent, par de chatoyantes soieries orienta<strong>le</strong>s. Des sources très<br />
anciennes témoignent de la présence de tissus dans <strong>le</strong>s trésors. À la fin <strong>du</strong> VIe sièc<strong>le</strong>, Grégoire de<br />
Tours (In gloria martyrum, LXXII) relate que <strong>le</strong> roi Sigebert “vint à la basilique de saint Denys non<br />
pour y prier mais pour y faire quelque butin. Il osa porter une main téméraire sur un voi<strong>le</strong> de soie<br />
orné d’or et de pierreries qui couvrait <strong>le</strong> saint tombeau“. Livrant une des premières descriptions de<br />
trésor, Bernard d’Angers contempla à Conques “<strong>le</strong>s richesses <strong>du</strong> trésor où bril<strong>le</strong>nt dans une gracieuse<br />
variété tant de bijoux d’or et d’argent, tant d’ornements et de manteaux, tant de pierreries“ (Liber<br />
miraculorum sanctae Fidis, 1010-1012). Considérées comme des pro<strong>du</strong>its d’un luxe d’autant plus inouï<br />
qu’il était lointain, <strong>le</strong>s soieries enveloppaient <strong>le</strong> plus souvent de saintes reliques.<br />
Si nombre de ces tissus appartiennent toujours aux trésors d’établissements religieux,<br />
certains d’entre eux ont rejoint <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctions de musées. Au XIXe sièc<strong>le</strong>, <strong>le</strong> musée de Cluny s’est<br />
enrichi de prestigieux tissus provenant de trésors, malheureusement dispersés pour tout ou partie.<br />
En 1860, un lot de près de soixante tissus fut ainsi acheté par Edmond Du Sommerard à Franz Bock,<br />
chanoine qui, ayant mis la main sur des tissus d’églises (par exemp<strong>le</strong> à Aix-la-Chapel<strong>le</strong> ou à Coire)
pour constituer une col<strong>le</strong>ction personnel<strong>le</strong>, fournissait plusieurs grands musées européens.<br />
Aujourd’hui, la col<strong>le</strong>ction <strong>du</strong> musée de Cluny permet de mesurer la variété et la richesse des tissus<br />
orientaux remployés en contexte chrétien au <strong>Moyen</strong> <strong>Âge</strong>.<br />
Dès <strong>le</strong> IVe sièc<strong>le</strong>, l’art <strong>du</strong> tissage de la soie (venu de Chine par l’intermédiaire des Perses) fut<br />
maîtrisé par <strong>le</strong>s Grecs. Au VIe sièc<strong>le</strong>, la dynastie justinienne de Constantinop<strong>le</strong> développa la sériciculture<br />
dans l’Empire byzantin et encouragea la création d’ateliers de soieries au sein de la cour. Ainsi, <strong>le</strong><br />
contrô<strong>le</strong> de la pro<strong>du</strong>ction (dont l’apogée fut atteint sous la dynastie macédonienne, 867-1056) mais aussi<br />
<strong>le</strong> port de ces riches soieries étaient-ils l’apanage de la seu<strong>le</strong> élite impéria<strong>le</strong>. Cette dimension, illustrée<br />
par des motifs comme l’aig<strong>le</strong> ou la victoire à l’hippodrome, explique sans doute que <strong>le</strong>s tissus byzantins<br />
aient été privilégiés pour accompagner la mémoire carolingienne au <strong>Moyen</strong> <strong>Âge</strong>. À Aix-la-Chapel<strong>le</strong>, <strong>le</strong><br />
corps de Char<strong>le</strong>magne fut peut-être enveloppé dans un texti<strong>le</strong> au motif de quadrige (Cl. 13289) et <strong>le</strong><br />
trésor possède encore une exceptionnel<strong>le</strong> représentation tissée d’éléphants. À Metz, une chape à motif<br />
d’aig<strong>le</strong> sur fond pourpre était réputée avoir été <strong>le</strong> manteau de Char<strong>le</strong>magne. À Auxerre, la précieuse<br />
relique de saint Germain fut recouverte d’un admirab<strong>le</strong> samit à motif d’aig<strong>le</strong>, offrant aux pè<strong>le</strong>rins la<br />
vision des ors de l’Orient recouvrant un des premiers saints de l’Eglise.<br />
Les conquêtes territoria<strong>le</strong>s des civilisations de l’Islam dans des territoires aux traditions<br />
artisana<strong>le</strong>s anciennes (comme la Mésopotamie ou la Syrie) amenèrent <strong>le</strong>s Musulmans à <strong>le</strong>s adopter. Des<br />
ateliers musulmans <strong>du</strong> sud de l’Espagne sont issues certaines œuvres fameuses de l’art texti<strong>le</strong> islamique.<br />
Le fragment d’une étoffe hispano-mauresque (Cl. 21865) provenant <strong>du</strong> suaire de saint Lazare d’Autun<br />
revêt une importance particulière en raison de l’inscription, visib<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> morceau conservé à Autun, qui<br />
permet de relier ce tissu au gouverneur Abd-al-Malik, victorieux en 1007 d’une batail<strong>le</strong> contre <strong>le</strong>s Chrétiens.<br />
La présence d’œuvres au caractère musulman révélé par des inscriptions en écriture<br />
coufique (Cl. 3164), ou à l’inspiration orienta<strong>le</strong> soulignée par l’exotisme des sujets représentés tels <strong>le</strong>s<br />
oiseaux ou <strong>le</strong>s fauves affrontés (Cl. 22819, 12869, 22018), illustre donc la fécondité des échanges<br />
artistiques et <strong>le</strong>s modes de transmission des savoirs à la période médiéva<strong>le</strong>.<br />
Emerveillant <strong>le</strong>s fidè<strong>le</strong>s par <strong>le</strong>ur aspect chatoyant, <strong>le</strong>s tissus orientaux enrichissaient <strong>le</strong> trésor<br />
d’un Orient assimilé par <strong>le</strong> rituel chrétien et contribuaient à l’aspiration à la transcendance devant <strong>le</strong>s<br />
reliques. Un somptueux lampas iranien formant robe pour Notre-Dame-sous-Terre de Chartres venait<br />
ainsi conférer un aspect luxueux à la statue de culte tout en rappelant au chrétien l’orientation de sa religion.<br />
Aisément transportab<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s tissus <strong>document</strong>ent de façon privilégiée <strong>le</strong>s apports de l’Orient à<br />
l’art occidental. Ainsi, <strong>le</strong> fameux “suaire“ aux éléphants de Saint-Josse-sur-Mer compta-t-il parmi <strong>le</strong>s<br />
sources d’inspiration des sculpteurs romans, tandis que son remploi en enveloppe de relique lui a permis<br />
de traverser <strong>le</strong> temps pour désormais être admiré comme un témoignage insigne de l’art islamique.<br />
Isabel<strong>le</strong> Bardiès-Fronty, conservateur<br />
Comparaisons<br />
Tissu aux éléphants. Iran, X e sièc<strong>le</strong>, samit de soie façonné, Paris, musée <strong>du</strong> Louvre.<br />
Tissu aux éléphants. Byzance, vers 1000, samit de soie façonné, Aix-la-Chapel<strong>le</strong>, cathédra<strong>le</strong>.<br />
Chape dite de Char<strong>le</strong>magne. Byzance, vers 1000, samit de soie façonné, Metz, cathédra<strong>le</strong>.<br />
Suaire de saint Germain. Byzance, vers 1000, samit de soie façonné, Auxerre, église Saint-Eusèbe.<br />
Robe de Notre-Dame-Sous-Terre. <strong>Moyen</strong>-Orient, XIV e sièc<strong>le</strong>, lampas, Chartres, trésor de la cathédra<strong>le</strong>.<br />
Bibliographie<br />
[Exposition, Paris, musée des arts décoratifs, 1965], Trésors des églises de France.<br />
PANOFSKY E., Abbot Suger on the Abbey Church of Saint-Denis and its Treasure, Princeton, 1979.<br />
[Exposition, Paris, musée <strong>du</strong> Louvre, 1991], Le Trésor de Saint-Denis.<br />
[Exposition, Paris, musée <strong>du</strong> Louvre, 2001], Le Trésor de Conques.<br />
DESROSIERS S., Soieries et autres texti<strong>le</strong>s de l’Antiquité au XVI e sièc<strong>le</strong>, Paris, 2004.<br />
[Exposition, Paris, musée <strong>du</strong> Louvre, 2005], La France romane.