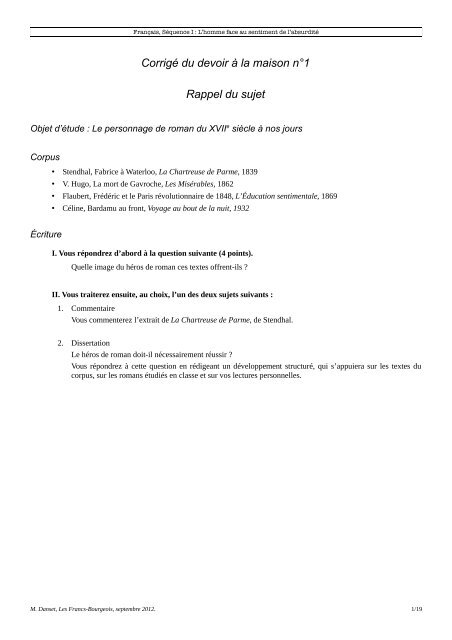Corrigé du DM n°1 - Lettrines
Corrigé du DM n°1 - Lettrines
Corrigé du DM n°1 - Lettrines
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
<strong>Corrigé</strong> <strong>du</strong> devoir à la maison <strong>n°1</strong><br />
Rappel <strong>du</strong> sujet<br />
Objet d’étude : Le personnage de roman <strong>du</strong> XVII e siècle à nos jours<br />
Corpus<br />
Écriture<br />
• Stendhal, Fabrice à Waterloo, La Chartreuse de Parme, 1839<br />
• V. Hugo, La mort de Gavroche, Les Misérables, 1862<br />
• Flaubert, Frédéric et le Paris révolutionnaire de 1848, L’É<strong>du</strong>cation sentimentale, 1869<br />
• Céline, Bardamu au front, Voyage au bout de la nuit, 1932<br />
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (4 points).<br />
Quelle image <strong>du</strong> héros de roman ces textes offrent-ils ?<br />
II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des deux sujets suivants :<br />
1. Commentaire<br />
Vous commenterez l’extrait de La Chartreuse de Parme, de Stendhal.<br />
2. Dissertation<br />
Le héros de roman doit-il nécessairement réussir ?<br />
Vous répondrez à cette question en rédigeant un développement structuré, qui s’appuiera sur les textes <strong>du</strong><br />
corpus, sur les romans étudiés en classe et sur vos lectures personnelles.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 1/19
Rappel de la question<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Méthodologie de la question préalable<br />
Quelle image <strong>du</strong> héros de roman ces textes offrent-ils ?<br />
Le corpus présente toujours un intérêt particulier<br />
Ayez à l’esprit que le corpus défini par votre professeur ou par le jury <strong>du</strong> Bac n’est pas une addition aléatoire de<br />
textes, mais un groupement qui a un intérêt et un sens. Tel corpus témoigne de l’évolution de la relation entre maître et<br />
valet dans la comédie, tel autre de la façon dont la poésie permet d’exprimer l’indicible, tel autre des différentes voies<br />
qu’emprunte le texte argumentatif pour toucher son lecteur, etc.<br />
Quelle que soit sa formulation, la question posée vous amène toujours à réfléchir à l’intérêt <strong>du</strong> corpus. Elle revient,<br />
peu ou prou, à répondre à cette interrogation : pourquoi avoir réuni ces textes ?<br />
La question de l'image <strong>du</strong> héros<br />
Vous connaissez déjà ces textes, et même la problématique qui sous-tend leur groupement, car nous l'avons énoncée<br />
en classe : nous essayons de voir si le héros de roman, aux XIXe et XXe siècles, demeure fidèle à son origine épique<br />
lorsqu’il est sur le champ de bataille. Au Bac, vous n’aurez bien sûr pas d’indications aussi précises : ce sera à vous de<br />
comprendre quel intérêt présente le corpus proposé.<br />
La question qui vous est posée prend essentiellement en compte le personnage, et laisse de côté le champ de<br />
bataille à proprement parler. Implicitement, elle suppose des points communs (une certaine image <strong>du</strong> héros propre à<br />
plusieurs textes), et des divergences (nécessairement, puisqu'il y a plusieurs textes).<br />
Un corpus, une carte d’identité<br />
Au brouillon, avec la question en tête, faites rapidement la carte d’identité de chaque texte.<br />
• Genre<br />
• Auteur<br />
• Date<br />
• (Registre = ton – comique, tragique, satirique, didactique, polémique, pathétique, lyrique, épique...)<br />
• Thème(s)...<br />
Vous verrez ainsi apparaître des points communs (par exemple, votre premier devoir ne comprend que des extraits<br />
de romans, tous à peu près sur le même thème : un héros en pleine bataille) et des différences (des champs de bataille de<br />
nature différente, des héros aux visages divers).<br />
Relisez votre question, qui porte ici sur l’image <strong>du</strong> héros véhiculée par chaque texte, et cherchez les ressemblances<br />
et les différences entre les protagonistes de ces romans. En procédant ainsi, vous pourrez construire une réponse en deux<br />
parties, en terminant par ce qui domine (soit les similitudes, soit les divergences). Si, en revanche, vous dégagez trois<br />
éléments caractéristiques de ces personnages, votre réponse s’articulera autour de ces trois axes d’analyse.<br />
Comment rédiger la réponse ?<br />
Une intro<strong>du</strong>ction (un paragraphe) présente le corpus. Elle indique le nom des auteurs et des œuvres, ainsi que le<br />
genre et l’époque auxquels ils appartiennent. Elle s’achève par l’annonce <strong>du</strong> plan.<br />
Structurée en deux ou trois parties et autant de paragraphes, la réponse proprement dite met systématiquement les<br />
textes en relation les uns avec les autres. Une réponse texte par texte sera pénalisée.<br />
Chaque partie ne permet pas toujours d’évoquer tous les textes <strong>du</strong> corpus. Mais, en fin d’analyse, aucun texte ne<br />
devra avoir été laissé à l’écart.<br />
Les textes sont cités, les références à chaque fois indiquées (avec les numéros de ligne). Les crochets [ ] isolent les<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 2/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
éléments ajoutés, les points de suspension … signalent l’existence de passages supprimés.<br />
Une ou deux phrases de conclusion closent la réponse (un dernier paragraphe, donc). On peut les orienter vers le<br />
travail d’écriture, particulièrement lorsqu’il s’agit de la dissertation, mais ce n’est pas obligatoire.<br />
Suggestions de débuts d’intro<strong>du</strong>ction et de conclusion<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
Notre corpus comprend quatre extraits de romans, qui mettent en évidence un héros en pleine bataille : …<br />
OU<br />
Les quatre extraits de romans proposés à notre analyse montrent un héros en pleine bataille : …<br />
Conclusion<br />
Ainsi, ce corpus révèle… / témoigne de… / met au jour…<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 3/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
<strong>Corrigé</strong> de la question sur corpus<br />
Suggestion de plan 1 (voir éléments rédigés ci-dessous)<br />
1. Sur le champ de bataille, un héros mis en échec / en décalage avec la scène (similitudes)<br />
• L’incompréhension de Fabrice (verbes de perception, « il n’y comprenait rien <strong>du</strong> tout »)<br />
• La mort tragique de Gavroche (imparfaits, figure de l’enfant désarmé face aux soldats)<br />
• L’effacement de Frédéric (disparition <strong>du</strong> héros)<br />
• La révolte et la fuite de Bardamu (le héros dépassé par la brutalité de la guerre, la clôture de l'extrait sur la<br />
désertion)<br />
2. Des héros paradoxaux et des antihéros (différences)<br />
• Des scènes de spectacle, mais des rôles différents : Gavroche est le spectacle ; Fabrice, Frédéric et Bardamu<br />
sont des spectateurs.<br />
• Gavroche, une mort en chantant / un sacrifice une mort héroïque (portrait de Gavroche en action), sous les yeux<br />
d’un lecteur omniscient + une vision ludique, insouciante et surnaturelle <strong>du</strong> combat. Mais un héros-enfant : un<br />
personnage étonnant à travers le sacrifice <strong>du</strong>quel lequel Hugo réécrit le combat de David et Goliath.<br />
• Bardamu, la remise en question des valeurs héroïques traditionnelles (reprise ironique <strong>du</strong> lexique de l’héroïsme,<br />
figures d’opposition), la fuite en riant (rire cynique), mise en évidence par le monologue intérieur.<br />
• Fabrice, à mi-chemin entre héros et antihéros, comme un point d'équilibre dans ce corpus : le regard tendrement<br />
ironique de Stendhal-narrateur (marques de l’ironie, personnage horrifié à juste titre ; une ironie qui dévalorise<br />
aussi les autres soldats, et par là forme contrepoint au ridicule de Fabrice) + désillusion / image idéalisée de la<br />
guerre.<br />
Suggestion de plan 2<br />
1. Un corpus qui témoigne de la destitution progressive <strong>du</strong> héros<br />
• Fabrice, la fin <strong>du</strong> héros épique<br />
• Frédéric, un héros... qui disparaît <strong>du</strong> texte<br />
• Bardamu, un antihéros<br />
2. … à quelques nuances près<br />
• Fabrice est l’objet d’une ironie bienveillante de la part <strong>du</strong> narrateur, et gagne en humanité, ce qui en fait un<br />
personnage original, autrement dit, une autre forme de héros.<br />
• Pour paradoxal qu’il soit, le personnage de Gavroche témoigne de la permanence <strong>du</strong> personnage héroïque dans<br />
le roman.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 4/19
Réponse rédigée (suivant le plan 1)<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
Notre corpus comprend quatre extraits de romans<br />
des XIXe et XXe siècles, qui mettent en scène un héros<br />
en pleine bataille. Le texte issu de La Chartreuse de<br />
Parme de Stendhal montre Fabrice del Dongo à<br />
Waterloo. Dans l’extrait des Misérables de Victor Hugo,<br />
Gavroche s’illustre puis meurt sur la barricade. Frédéric<br />
Moreau, personnage principal de L’É<strong>du</strong>cation<br />
sentimentale de Flaubert, assiste dans le troisième texte à<br />
une autre scène de révolution parisienne, en 1848. Le<br />
corpus se clôt sur un passage de Voyage au bout de la<br />
nuit de Céline, dans lequel Bardamu se trouve au front<br />
lors la guerre de 14. Ces textes ont en commun d’offrir<br />
l’image d’un héros mis en échec. Mais ils montrent aussi<br />
des protagonistes très divers, entre héros et antihéros.<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Présentation <strong>du</strong> corpus : l'essentiel est dans la<br />
première phrase, avec le genre, l'époque, le thème.<br />
Les titres et les auteurs sont cités, chaque texte<br />
présenté succinctement.<br />
Le terme « image <strong>du</strong> héros », élément clé de la<br />
question, est rappelé. Il aurait également été possible de<br />
rappeler la question, mais la solution choisie ici s’avère<br />
plus concise. En effet, le plan est ici annoncé en deux<br />
phrases.<br />
Plutôt que d'annoncer 1) Points communs, 2)<br />
Divergences, l'annonce <strong>du</strong> plan se veut précise : le point<br />
commun principal et les différences sont déjà esquissés.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 5/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Exemple de développement rédigé avec la première partie<br />
Ces textes mettent d’abord en scène une forme<br />
d’échec <strong>du</strong> héros, qui ne paraît pas à sa place dans la<br />
bataille. Fabrice rêvait de combattre au côté de<br />
Napoléon : parvenu à Waterloo, il n'y « [comprend] rien<br />
<strong>du</strong> tout », et se trouve toujours décalé par rapport à la<br />
troupe (« Fabrice s'aperçut qu'il était à vingt pas sur la<br />
droite en avant des généraux, et précisément <strong>du</strong> côté ou<br />
ils regardaient avec leurs lorgnettes »). L'abondance de<br />
verbes de perception (« il remarqua », « il vit », « il<br />
entendit »...) témoigne par ailleurs de son inaction : il ne<br />
participe même pas à la bataille, et se trouve au fond<br />
également en décalage avec l'Histoire, qui voit la défaite<br />
de son héros en ce 18 juin 1815. L’extrait des Misérables<br />
se termine sur la mort tragique de Gavroche (« Il s'abattit<br />
la face contre le pavé », « Cette petite grande âme venait<br />
de s'envoler »). Apparition surnaturelle, l’enfant ne<br />
devrait pas être sur la barricade. La description <strong>du</strong> héros<br />
tend à la fois à le valoriser et à signaler son étrangeté<br />
(« étrange gamin fée », « Antée », « pygmée »). La<br />
« fusillade » longtemps défiée a donc logiquement raison<br />
de lui, à la fin. Les imparfaits <strong>du</strong> début <strong>du</strong> texte<br />
semblaient prolonger indéfiniment l'insolence de<br />
« l'enfant feu follet », mais c'est le passé simple, associé<br />
à des phrases plus brèves, qui domine le dernier<br />
paragraphe : « On vit Gavroche chanceler, puis il<br />
s'affaissa » ; « Il n'acheva point ». Frédéric Moreau,<br />
quant à lui, ne meurt pas : pire, peut-être, pour un<br />
personnage romanesque, il s'efface au profit de la scène,<br />
tant elle lui échappe : son nom n’apparaît qu'une fois au<br />
fil des deux derniers paragraphes. C’est que, comme<br />
Fabrice à Waterloo, il est dépassé par le mouvement de<br />
la bataille : le narrateur rapporte que « Frédéric, pris<br />
entre deux masses profondes, ne bougeait pas ». Et lui<br />
non plus ne comprend pas ce qu’il voit : ainsi, c’est au<br />
lecteur d’identifier le « vieillard » qui tient « un rameau<br />
vert » et « un papier » comme un négociateur. Chez<br />
Céline, enfin, la scène envahit l’écriture : « Et puis ce fut<br />
tout. Après ça, rien que <strong>du</strong> feu et puis <strong>du</strong> bruit avec. »<br />
Paradoxalement, le choix de la première personne va de<br />
pair avec une scène de bataille encore moins intelligible<br />
pour Bardamu que pour ses prédécesseurs, Fabrice et<br />
Frédéric. Le héros perçoit toujours plus, mais comprend<br />
toujours moins. Et c’est « en titubant », « les jambes un<br />
peu drôles », que Bardamu quitte le champ de bataille –<br />
acte de désertion emblématisé par l’emploi <strong>du</strong> niveau de<br />
langue familier : « J'ai quitté ces lieux sans insister,<br />
joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour<br />
foutre le camp ». L’incompréhension jusqu’à la<br />
désertion, le sentiment de perdition, la fuite signent tour<br />
à tour ici le décalage et l’échec des personnages. Mais<br />
toutes les défaites ne sont pas exemptes d’héroïsme.<br />
Une phrase d’intro<strong>du</strong>ction rappelle l'idée<br />
principale de la première partie.<br />
Les textes font l'objet d’un commentaire succinct,<br />
mais précis, étayé de citations, en relation avec cette<br />
idée principale. Ils sont mentionnés dans l'ordre <strong>du</strong><br />
corpus, sauf si une présentation plus pertinente est<br />
possible.<br />
Surtout, ils sont systématiquement mis en relation<br />
les uns avec les autres.<br />
Ici, c’est bien sûr l'idée que les personnages sont<br />
décalés par rapport au combat qui guide le propos.<br />
L’incompréhension est également partagée par<br />
Fabrice, Frédéric et Bardamu : faire le parallèle montre<br />
au correcteur que vous répondez bien à une question de<br />
synthèse.<br />
Une phrase permet de conclure la première<br />
partie ; ici, une dernière phrase amorce une transition<br />
vers la seconde.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 6/19
Conclusion<br />
Ainsi ce corpus met au jour la grande diversité<br />
des personnages de roman, enfants au beau milieu de la<br />
bataille, entre héros et antihéros, célébrés avec lyrisme<br />
ou croqués avec cynisme par la voix narrative. Il montre<br />
aussi la distance, plus ou moins importante, qui sépare le<br />
héros de roman de son origine épique.<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
La conclusion commence par un bilan.<br />
Idéalement, elle s’achève sur une ouverture vers<br />
le sujet choisi par la suite (si c'est possible). Ici, cette<br />
ouverture fonctionne avec le sujet de dissertation, mais<br />
également avec le commentaire <strong>du</strong> texte de Stendhal.<br />
Lecture faite de ce corrigé, vous vous dites peut-être que de nombreux éléments ne sont pas vus, et c’est vrai : c’est<br />
l’essentiel de ce qu’il fallait dire dans la première partie de cette réponse, et seulement cela, qui est proposé ici, compte<br />
tenu <strong>du</strong> temps limité de l'épreuve. La réponse à la question sur corpus ne peut donner lieu à des commentaires littéraires<br />
successifs, même en ré<strong>du</strong>ction, de chacun de textes.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 7/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
<strong>Corrigé</strong> <strong>du</strong> commentaire sur le texte de Stendhal<br />
Perspective de lecture (retenue pour ce corrigé)<br />
Plan<br />
Une scène de bataille et un héros très loin de l’épopée<br />
I. Une scène de bataille loin de l’épopée<br />
1) Une scène réaliste, voire très crue...<br />
2) inintelligible pour un héros naïf et inexpérimenté.<br />
II. La désillusion <strong>du</strong> héros.<br />
1) L’ironie <strong>du</strong> narrateur.<br />
2) La fin des illusions.<br />
Autre perspective de lecture<br />
Plan<br />
La désillusion <strong>du</strong> héros<br />
I. Les rêves <strong>du</strong> héros...<br />
1) La bataille tant rêvée.<br />
2) L’ironie <strong>du</strong> narrateur.<br />
II. brisés par la réalité de la guerre.<br />
1) Une scène réaliste, voire très crue.<br />
2) La fin des illusions.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 8/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Développement (rédigé et commenté pour la 1ère sous-partie de la 1ère partie)<br />
I. Une scène de bataille loin de l’épopée<br />
1) Une scène réaliste, voire très crue.<br />
Ce passage offre une représentation très réaliste de la guerre, et donc<br />
fort éloignée <strong>du</strong> tableau épique. D’une part, la scène est décrite de façon très<br />
crue ; d’autre part, elle est inintelligible pour le héros, trop naïf et<br />
expérimenté.<br />
Il s’agit d’une scène de bataille – et pas n’importe laquelle : l’ultime<br />
bataille de Napoléon. Or, elle s’avère très éloignée <strong>du</strong> topos 1 de l’épopée.<br />
Le champ de bataille devient, sous les yeux de Fabrice, une « grande pièce<br />
de terre labourée ». Le « fond des sillons », « plein d’eau », la terre, « fort<br />
humide », le sang qui coule « dans la boue » : autant de détails prosaïques<br />
qui révèlent un champ de bataille surprenant pour le héros. C’est un<br />
« champ jonché de cadavres », des « cadavres … vêtus de rouge ». La<br />
reprise <strong>du</strong> terme « champ », sans son complément atten<strong>du</strong> (de bataille), est<br />
porteuse d’une certaine ironie. La répétition <strong>du</strong> mot « cadavres », ainsi que<br />
le mélange entre le sang et la couleur de l’uniforme, devenus indissociables<br />
l’un de l’autre, insistent sur l’aspect bien réel, très concret, de la scène.<br />
Même effet avec le détail sur « le cheval tout sanglant » qui se débat, là<br />
encore, « sur la terre labourée », et « dans ses propres entrailles ». Avec ce<br />
cheval mourant et à terre, Stendhal renverse l’un des éléments habituels <strong>du</strong><br />
tableau épique : le cheval au galop, emportant son cavalier vers la gloire.<br />
Cette horreur généralisée, il n’y a guère que le héros pour s’en offusquer : le<br />
narrateur suggère qu’il est normal que les soldats passent à côté des blessés<br />
(« beaucoup … vivaient encore, ils criaient évidemment pour demander <strong>du</strong><br />
secours, et personne ne s’arrêtait pour leur en donner »). L’emploi de<br />
l’adverbe « évidemment » emblématise cette volonté de donner à voir<br />
plutôt que de peindre la guerre, c’est-à-dire de la montrer telle qu’elle est,<br />
dans toute son horreur, sans lyrisme ni place pour la pitié. La voix <strong>du</strong><br />
narrateur, qui se fait entendre ici, marque également l’écart entre la<br />
représentation littéraire, donc imaginaire, <strong>du</strong> combat, et la réalité très crue<br />
de la guerre. Significativement, ce n’est pas sur une vision, mais par <strong>du</strong><br />
« bruit » que s’ouvre l’extrait, comme si le tumulte empêchait de voir. Le<br />
vacarme, « le ronflement égal et continu pro<strong>du</strong>it par les coups de canon »,<br />
les « décharges » choquent Fabrice (« il était surtout scandalisé ») et lui font<br />
« mal aux oreilles » : l’abondance de précisions sur le volume sonore de la<br />
bataille souligne le caractère assourdissant de la scène. Ce passage est donc<br />
marqué par un net refus d’esthétiser la guerre.<br />
1 Un topos est un lieu commun <strong>du</strong> discours, ici, un thème récurrent en littérature.<br />
Une phrase d’intro<strong>du</strong>ction<br />
rappelle l’idée directrice de la 1ère<br />
partie ; les axes qui commandent les<br />
deux sous-parties sont annoncés.<br />
La première phrase de la<br />
première sous-partie, là aussi, en<br />
rappelle l’idée essentielle.<br />
Votre propos suivra en général<br />
l’ordre suivant : idée / citation brève /<br />
analyse. Par « analyse », il faut<br />
entendre qu’il ne suffit pas<br />
d’interpréter le texte, mais de montrer<br />
comment il fonctionne, comme la<br />
forme (= les procédés d’écriture) sert<br />
le sens. Prenez l’habitude de<br />
construire des phrases sur le modèle :<br />
« Tel procédé révèle / met en relief /<br />
souligne / indique... telle<br />
interprétation ». Ou bien : « Telle<br />
interprétation est mise en évidence<br />
par tel procédé ».<br />
Repérez dans le texte ci-contre<br />
les différentes manières d’insérer les<br />
citations, directement au fil <strong>du</strong><br />
commentaire ou entre parenthèses.<br />
Les points de suspension signalent le<br />
texte non cité, les crochets le texte<br />
modifié (le temps des verbes doit<br />
souvent être changé, par exemple).<br />
La dernière phrase dresse un<br />
premier bilan.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 9/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
2) … inintelligible pour un héros naïf et inexpérimenté.<br />
Le combat est non seulement assourdissant, mais il est de surcroît absurde : en effet, perçue par le jeune novice<br />
qu’est Fabrice, la scène semble n’avoir aucun sens.<br />
• Choix <strong>du</strong> point de vue interne 2 , plutôt qu’omniscient : la scène est vue par Fabrice. Impossible, donc, de<br />
l’embrasser <strong>du</strong> regard pour le lecteur ; impossible également de lui donner sens, Fabrice étant novice sur un<br />
champ de bataille.<br />
• Ainsi s’expliquent nombre de détails qui sont incompréhensibles pour lui (« Il n’y comprenait rien <strong>du</strong> tout »),<br />
comme l’effet pro<strong>du</strong>it par les boulets de canon sur la terre, « remuée d’une façon singulière » (l’adjectif marque<br />
l’étonnement de Fabrice ; répété, il invite le lecteur à s’arrêter un instant pour imaginer et reconstituer la scène ;<br />
porteur d’ironie, il est marqué par l’empreinte moqueuse <strong>du</strong> narrateur). De même lorsqu’il aperçoit les soldats<br />
touchés et projetés loin de lui.<br />
• C’est pourquoi il est « scandalisé » : la guerre ne correspond pas à la vision léguée... par la littérature.<br />
• La métonymie « les habits rouges », le décalage constant de Fabrice (« Il entendit un cri sec... »), son<br />
incompréhension : il faudrait relever ici tous les procédés qui montrent que la scène est non seulement crue, mais<br />
aussi inintelligible.<br />
« Scandaleusement » éloignée de la vision traditionnelle de la guerre que lui a léguée la littérature, inintelligible et<br />
assourdissante, la bataille de Waterloo con<strong>du</strong>it donc le héros à la désillusion.<br />
II. La désillusion <strong>du</strong> héros.<br />
L’écart entre la réalité de la guerre et les idéaux de Fabrice est mis en relief, tout au long <strong>du</strong> passage, par l’ironie de<br />
la voix narrative 3 . C’est pour le héros une désillusion et un désenchantement.<br />
1) L’ironie <strong>du</strong> narrateur.<br />
L’ensemble <strong>du</strong> passage est marqué par une ironie très sensible.<br />
• Intrusions <strong>du</strong> narrateur (ex. : « Nous avouerons que... », « évidemment »).<br />
• Répétitions <strong>du</strong> mot héros, avec le dét. Possessif « notre » ; antithèse héros / fort humain.<br />
• Jeu sur le décalage entre Fabrice et les événements (connecteurs temporels qui indiquent qu’il est toujours en<br />
retard sur l’action ; verbes de perception qui le montrent en spectateur ; réactions décalées : il est horrifié... par la<br />
vue <strong>du</strong> cheval).<br />
• « Il n’y comprenait rien <strong>du</strong> tout » ; « admiration enfantine » (noter le lexique de l’enfance, voire de<br />
l’infantilisation, avec « gourmander », « réprimande »).<br />
• Deux descriptions antagonistes <strong>du</strong> maréchal Ney, d’abord ridicule (c’est tout de même le point de vue interne,<br />
autrement dit, la première vision de Fabrice), puis idéalisé par Fabrice (« le brave des braves » : Fabrice paraît<br />
réviser son jugement une fois identifié le personnage <strong>du</strong> maréchal). L’ironie touche ici à la fois le maréchal Ney et<br />
l’admiration béate que le héros a pour lui.<br />
• Polysémie de « feu » (revoyez vos notes en classe sur ce point) = allégorie <strong>du</strong> combat glorieux / sens réel : feu<br />
des canons, « fumée blanche » / sens métaphorique : le feu <strong>du</strong> désir (tout ce qui reste à Fabrice).<br />
2 Associé au réalisme de la scène, le choix de ce point de vue participe <strong>du</strong> « réalisme subjectif » cher à Stendhal. Ce réalisme est différent de<br />
celui des romans de Balzac, par exemple, qui privilégie une narration avec le « point de vue » omniscient.<br />
3 Voix narrative est synonyme de narrateur.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 10/19
2) La fin des illusions.<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Pour Fabrice, c’est la fin des illusions. Mais ce désenchantement fonctionne aussi comme une initiation à la réalité<br />
– ou <strong>du</strong> moins, à une certaine réalité.<br />
• Descriptions peu valorisantes <strong>du</strong> maréchal et des soldats (qui, par contrepoint, rendent le héros sympathique, et<br />
surtout, lui offrent d’abord une image éloignée de ses rêves de communion sur le champ de bataille).<br />
• Prise de conscience de l’horreur de la guerre (attention à ne pas se répéter ici dans l’analyse <strong>du</strong> texte par rapport<br />
à la 1ère sous-partie)<br />
• Décalage entre la conception <strong>du</strong> héros selon Fabrice (portrait <strong>du</strong> maréchal, des soldats) et sa perception de luimême,<br />
le tout vécu sur le mode <strong>du</strong> stéréotype (le héros a d’abord un physique : cf. lexique <strong>du</strong> portrait physique).<br />
• Fin de l’extrait, ou la conclusion de Fabrice (« Jamais je ne serai un héros ») fait écho à la remarque ironique <strong>du</strong><br />
narrateur (« Notre héros était fort peu héros en ce moment ») au début de l’extrait. Finalement, héros et narrateur<br />
se rejoignent, d’une certaine manière. Stendhal n’épargne pas son personnage, mais ne le blâme pas non plus. La<br />
richesse de ce héros, c’est ce mélange étonnant entre une certaine lucidité à la fin <strong>du</strong> passage, et un décalage<br />
persistant (s’il estime ne jamais pouvoir être un héros, c’est uniquement par rapport à une représentation physique<br />
et stéréotypée <strong>du</strong> héros).<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 11/19
Intro<strong>du</strong>ction<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Repérez bien les étapes de l’intro<strong>du</strong>ction.<br />
Présentation de l’auteur...<br />
de son œuvre,<br />
de l’œuvre d’ou est tiré l’extrait à commenter,<br />
de l’extrait,<br />
de la perspective de lecture adoptée (on dit aussi projet de lecture, problématique...),<br />
annonce <strong>du</strong> plan.<br />
Stendhal, romancier et essayiste français, né en 1783 et mort en 1842, est l’un des plus grands écrivains français.<br />
Après Le Rouge et le Noir, il publie son autre chef-d’œuvre et dernier roman, La Chartreuse de Parme, en 1839. Fabrice<br />
del Dongo, en qui on reconnaît nombre des traits <strong>du</strong> jeune Henri Beyle, est le principal protagoniste de La Chartreuse. Ce<br />
personnage est né des amours d’un lieutenant français et de la marquise del Dongo ; il grandit dans la période glorieuse<br />
des conquêtes napoléoniennes, et fait de l’empereur son héros. En 1815, il s’enfuit <strong>du</strong> château familial pour combattre<br />
sous sa bannière et arrive à Waterloo l’après-midi même de la bataille. En réalité, cette scène se révèle très éloignée de<br />
l’épopée imaginée par le héros, qui voit dès lors ses rêves de gloire littéralement partir en fumée. En effet, Stendhal offre<br />
ici une représentation très réaliste de la guerre ; et pour Fabrice, objet d’une ironie constante, la désillusion l’emporte sur<br />
l’élan héroïque.<br />
L’annonce <strong>du</strong> plan, ci-dessus, se veut concise. Vous pouvez opter pour une formulation plus claire, quitte à alourdir<br />
quelque peu votre texte. Mieux vaut manquer de légèreté que de clarté. Cela pourrait donner :<br />
Nous verrons en premier lieu que Stendhal offre ici une représentation très réaliste de la guerre. Puis, nous<br />
examinerons la façon dont Fabrice, objet d’une ironie constante, passe de la fougue à la désillusion.<br />
Conclusion<br />
Bilan<br />
Ouverture : la fin de la conclusion, rappelons-le, est l’occasion de montrer au correcteur que vous avez acquis une<br />
culture. Vous savez repérer des échos entre les œuvres et tisser des liens entre elles.<br />
En conclusion, tous les motifs <strong>du</strong> tableau épique sont ici renversés : feu, champ de bataille, bravoure... C’est une<br />
scène de guerre montrée dans sa réalité crue, perçue par les yeux <strong>du</strong> personnage. Ainsi le jeune Fabrice découvre-t-il, en<br />
spectateur bien plus qu’en héros, « le feu » bien réel <strong>du</strong> combat : c’est pour lui l’occasion de remiser ses rêves d’âme<br />
« enfantine » dans les livres, encore que la scène soit si inintelligible qu’il en revient toujours à sa rêverie. L’ironie qui<br />
caractérise l’ensemble <strong>du</strong> passage est toutefois mâtinée de bienveillance de la part <strong>du</strong> narrateur, d’une part parce que les<br />
autres soldats ne sont pas non plus épargnés, d’autre part parce que le désenchantement est aussi une forme d’initiation<br />
pour le héros : il n’y a plus d’exploit à accomplir, et le feu <strong>du</strong> désir qui l’anime ne rencontre que <strong>du</strong> vide et de la<br />
déception. Fabrice gagne ici en humanité ce qu’il perd en illusions. Au beau milieu de ce champ de bataille assourdissant,<br />
qui préfigure la guerre absurde dénoncée par Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, le héros stendhalien suscite la<br />
sympathie <strong>du</strong> lecteur, en ne se départissant pas de cet enthousiasme mélancolique qui fait toute sa singularité.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 12/19
Rappel <strong>du</strong> sujet<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Rappels méthodologiques et corrigé de la dissertation<br />
Le héros de roman doit-il nécessairement réussir ?<br />
Analyse <strong>du</strong> sujet<br />
En analysant le sujet, vous avez intérêt à noter, au fur et à mesure, les exemples issus de vos lectures. Si vous en<br />
trouvez peu dès cette étape <strong>du</strong> devoir, disons dans les vingt premières minutes de votre réflexion, préférez le commentaire<br />
ou l’invention : vous éviterez ainsi de perdre un temps précieux. C'est ce que nous avons fait en classe.<br />
Pour ce premier devoir, je vous propose en premier lieu un retour et des compléments à notre séance de travail. Il<br />
s’agit, au brouillon, de noter les premières idées, les premiers exemples, qui nourriront le devoir par la suite. Bien sûr,<br />
pour votre propre brouillon, ne rédigez pas ces éléments.<br />
• La difficulté d’un tel sujet tient à sa concision et donc à la part importante que revêt l’implicite dans le libellé. Il<br />
faut donc bien examiner les termes clés et leurs relations sous tous les angles.<br />
• Le sujet invite à s’interroger sur le lien qui unit les notions de « héros » et de « réussite », comme si elles<br />
étaient, d’évidence, indissociables l’une de l’autre (c’est ce qu’exprime le verbe « devoir », renforcé par l’adverbe<br />
« nécessairement »). D’emblée, on a en effet tendance à les associer : le nom « héros », par définition, est<br />
synonyme de succès. Cependant, on le sait, certains héros échouent, parfois même <strong>du</strong> début à la fin <strong>du</strong> roman<br />
(songeons aux nombreux personnages de La comédie humaine de Balzac), et nous continuons pourtant de les<br />
appeler héros – même quand ils appartiennent à la famille des « antihéros » ; personne ne dit : « Meursault est<br />
l’antihéros <strong>du</strong> roman L’Étranger ».<br />
• En fait, le « héros de roman » n’est pas le héros tout court, et c’est pourquoi la question se pose de savoir s’il<br />
doit « réussir » ou non. La réflexion va donc nous con<strong>du</strong>ire à interroger la notion de « héros de roman », notion<br />
sans doute plus complexe que celle de héros.<br />
• S’agit-il de l’héritier <strong>du</strong> héros de l’épopée ? Les premiers romans appartiennent au cycle arthurien : les héros<br />
sont alors des chevaliers, nobles de naissance et de cœur, dont Lancelot et Perceval sont les plus fameux<br />
exemples. D’eux descendent ensuite tous les personnages romanesques que des qualités particulières ont élevés<br />
au rang de héros : courage, détermination, intelligence chez les héros des romans de cape et d’épée, avec Les<br />
Trois Mousquetaires, par exemple. Mêmes qualités pour les héros des temps modernes que sont les détectives des<br />
romans policiers, au premier rang desquels figure le Sherlock Holmes de Conan Doyle. Qualités morales ensuite :<br />
persévérance, abnégation, dévouement, dépassement de soi : la princesse de Clèves, le chevalier des Grieux dans<br />
Manon Lescaut, Jean Valjean dans Les Misérables sont des héros par leur grandeur d’âme. Enfin, forts de ces<br />
qualités, tous ces personnages accomplissent un certain nombre d'exploits qui les distinguent <strong>du</strong> commun des<br />
autres personnages.<br />
• Faut-il entendre, par « héros de roman », personnage principal, moteur de l’action (ce serait non plus une<br />
perspective symbolique, comme ci-dessus, mais uniquement fonctionnelle <strong>du</strong> héros) ? Une telle définition<br />
permettrait aisément d'inclure des héros qui ne sont pas héroïques : Georges Duroy connaît une ascension sociale<br />
exemplaire, mais il s’assoit allègrement sur la morale. Zola écrit que « le premier homme qui passe est un héros<br />
suffisant » : ainsi sont ses héros, pour lesquels le déterminisme social (le poids <strong>du</strong> milieu d'origine) constitue une<br />
sorte de nouvelle fatalité. Nana est une courtisane qui réussit !<br />
• Cela nous amène à réfléchir au sens <strong>du</strong> verbe « réussir », et à l’ensemble verbal « devoir nécessairement<br />
réussir ». De quelle réussite s’agit-il ? Parle-t-on d’exploits hérités de l’épopée ? On reviendrait aux exemples de<br />
héros cités ci-dessus. De réussite sociale ? Ce serait Bel-Ami, évoqué plus haut. Que faire alors des antihéros ?<br />
• Pour aller plus loin, faisons comme s’il devait y avoir un complément, manquant dans le libellé : « le héros de<br />
roman doit-il nécessairement réussir » pour quoi ? Au nom de quoi ? Pour être, justement, un héros ? Pour exister<br />
aux yeux <strong>du</strong> lecteur ? Frédéric Moreau, dans L’É<strong>du</strong>cation sentimentale, n’est pas un héros : il est velléitaire,<br />
faible, sensible jusqu’à être impressionnable. Cependant, ce personnage est par là même ordinaire, et c’est<br />
justement parce qu’il n’est pas idéalisé que l’on peut se reconnaître en lui. On pourrait dire qu’il réussit auprès <strong>du</strong><br />
lecteur. Si la réussite est d’ordre social, Julien Sorel, à ce compte, est lui aussi un antihéros, incapable, en<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 13/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
définitive, de renverser l’ordre établi. Il y a bien l’amour, mais Mathilde et Mme de Rênal reviennent à lui trop<br />
tard. Sur quel plan réussit-il donc ? Il devient un héros par le discours de refus et de fierté qu’il tient à ses juges,<br />
mais aussi lorsqu’il accepte la mort, et c’est ainsi qu’à nos yeux il accède à ce statut. À défaut de le maîtriser, il<br />
accepte son destin. Meursault n’est pas très éloigné de lui de ce point de vue. Et s’il faut un personnage pour dire<br />
nos fuites, nos peurs, nos dégoûts, l’on peut aussi faire confiance à Bardamu. La gloire des champs de bataille<br />
s’éteint définitivement avec lui, dont la langue, grâce au choix de la première personne, révèle la monstruosité et<br />
l’horreur. La seule gloire de Bardamu, c’est l’efficacité de son verbe, qui dévoile la réalité de façon inouïe, et<br />
restitue ainsi la complexité humaine.<br />
• Si c’est donc à l’aune <strong>du</strong> lecteur qu’on juge, non plus de la réussite, mais de l’accomplissement de soi <strong>du</strong> héros,<br />
les plus fous ou les plus étranges sont peut-être les plus grands. Bouvard et Pécuchet échouent dans tout ce qu’ils<br />
entreprennent, pour la joie <strong>du</strong> lecteur, qui tient entre ses mains le « livre sur rien » dont rêvait Flaubert. Le roman<br />
semble reposer uniquement sur le ridicule et la persévérance dans l’échec des deux amis : c’est notre bêtise à<br />
laquelle ces héros donnent vie. Meursault, encore lui, ne permet guère qu’on s’identifie à lui, ou qu’on se<br />
reconnaisse en lui, de prime abord en tout cas. Mais il ne laisse aucun lecteur indifférent : son étrangeté nous<br />
ébranle dès les premières lignes. Et s’il annonce, pour certains, le Nouveau Roman, c’est qu’on distingue<br />
nettement, dans L’Étranger, le refus de l’illusion réaliste. C’est bien un personnage et non l’illusion d’une<br />
personne auquel on a affaire. Un être de papier, dont la seule, mais peut-être la plus grande réussite qui soit est<br />
d’être parvenu à bousculer nos certitudes de lecteur, et, partant, d’homme. Un Don Quichotte, pour remonter aux<br />
origines <strong>du</strong> roman moderne, fait de même : sa folie déconcerte et fait rire le lecteur comme les autres<br />
personnages ; mais son idéalisme, sa résistance au désenchantement forcent l’admiration. Il en accède au mythe,<br />
comme Emma Bovary, dont l’existence, vaine jusqu’au bout, nous lègue le nom commun « bovarysme » (le<br />
terme désigne une certaine propension à fuir l’insatisfaction dans l’imaginaire). Voilà donc des êtres de papier<br />
devenus modèles d’attitudes humaines.<br />
Résumons : héros et réussite paraissent aller de pair ; cependant, le roman est riche d’antihéros et autres<br />
personnages paradoxaux, qui ont leur intérêt, voire, qui réussissent d’une certaine façon. Cela nous amènera à situer la<br />
réussite, et son caractère obligatoire, sur un autre plan que celui de l’exploit que se doit d’accomplir le héros traditionnel.<br />
Attention, en termes de méthode, un piège apparaît : il ne s’agit pas de refaire l’histoire <strong>du</strong> roman des héros épiques<br />
aux antihéros, autrement dit de faire visiter le musée <strong>du</strong> roman au lecteur d’une copie descriptive proche <strong>du</strong> catalogue.<br />
Une dissertation doit demeurer réflexive. En outre, ce serait donner une idée fausse : même si le héros de roman a pour<br />
ascendant le héros épique, l’histoire <strong>du</strong> roman n’est pas celle d’une longue dégradation <strong>du</strong> personnage. Frère Jean des<br />
Entommeures et Don Quichotte sont des héros de roman des XVIe et XVIIe siècles, et ce sont déjà des personnages pour<br />
le moins paradoxaux.<br />
Déjà une idée de la réponse<br />
Pour que votre devoir suive un fil directeur clair, il faut avoir d’emblée une idée de votre réponse finale, qui<br />
formera la conclusion : cette idée oriente le plan puis la rédaction <strong>du</strong> devoir.<br />
Voici trois réponses possibles, donc trois devoirs légèrement différents.<br />
• Le héros ne doit pas nécessairement réussir : il existe des antihéros qui ont leur intérêt, et peut-être même plus<br />
d’intérêt que les héros traditionnels. Plan en deux parties : I / Héros et réussite vont de pair ; II / Mais les<br />
antihéros et autres personnages paradoxaux, pas moins fréquents que les héros, ont leur intérêt.<br />
• Le héros doit nécessairement réussir, mais cette « réussite » prend des formes très variées. Plan en deux ou trois<br />
parties : I / Héros et réussite vont de pair ; II / Mais les antihéros et autres personnages paradoxaux ont leur<br />
intérêt ; III / Ces antihéros réussissent aussi, mais à leur manière propre.<br />
• Le héros s’accomplit toujours nécessairement, plus qu’il ne réussit, et cet accomplissement est celui d’un être de<br />
papier qui réussit en définitive surtout aux yeux de son lecteur. Plan en trois parties : I / Héros et réussite vont de<br />
pair ; II / Mais les antihéros et autres personnages paradoxaux, pas moins fréquents que les héros, ont leur intérêt ;<br />
III / Le héros et l’antihéros réussissent surtout en s’accomplissant aux yeux <strong>du</strong> lecteur.<br />
Le troisième devoir est détaillé ci-dessous.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 14/19
Les exemples<br />
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Comment insérer les exemples ? Comment construire les sous-parties ?<br />
Vous avez trouvé et noté des exemples et des idées, idéalement dès l’étape de l’analyse <strong>du</strong> sujet. Souvent, les idées<br />
sont dé<strong>du</strong>ites des livres auxquels vous avez pensé. Mais dans votre développement, chaque sous-partie s’ouvre d’abord<br />
sur une idée, avant que vous n’étayiez cette même idée d’un exemple. La démarche de rédaction fonctionne donc dans<br />
l’ordre inverse <strong>du</strong> travail de réflexion initial. Chaque sous-partie, formant un paragraphe, sera constituée d’une phrase<br />
d’intro<strong>du</strong>ction consacrée à votre idée, puis d’un exemple développé, et enfin d’une brève phrase de conclusion et/ou de<br />
transition vers la sous-partie suivante.<br />
Combien d’exemples insérer ?<br />
Il vous faut au moins deux parties, comprenant deux sous-parties chacune, soit quatre exemples au total (une souspartie<br />
= un exemple). Mais cela sera assez maigre au Bac, d’autant que le corpus vous fournit déjà potentiellement trois à<br />
cinq exemples.<br />
Le plan proposé ci-dessous s’articule en trois parties comprenant chacune trois sous-parties. Toutefois, pour vous<br />
donner <strong>du</strong> grain à moudre, plusieurs exemples vous sont proposés ; en rédigeant, il faudrait d’en retenir qu’un par souspartie<br />
(ou bien, on construit un devoir à trois étages : parties, sous-parties, sous-sous-parties).<br />
Seules les idées clés de la première sous-partie ont été rédigées à titre indicatif.<br />
Plan détaillé (devoir 3)<br />
Rappel de la réponse envisagée :<br />
Le héros s’accomplit toujours nécessairement, plus qu’il ne réussit, et cet accomplissement est celui d’un être de<br />
papier qui réussit en définitive surtout aux yeux de son lecteur.<br />
I. Héros et réussite semblent liés, par définition (le héros est d’abord un personnage héroïque, qui doit<br />
nécessairement réussir).<br />
II. Échecs et réussites des héros paradoxaux et des antihéros (certains personnages ne réussissent pas au sens<br />
ordinaire <strong>du</strong> terme : ces héros paradoxaux et antihéros réussissent autrement).<br />
III. Peut-on donc parler d’une nécessaire réussite pour tous les héros de roman ? De quelle nature serait un tel<br />
impératif ? (héros, antihéros, personnages paradoxaux doivent surtout s’accomplir aux yeux <strong>du</strong> lecteur).<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 15/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
I. Héros et réussite semblent liés, par définition.<br />
Phrase d’intro, avec éventuellement annonce des axes de la 1ère partie (l’essentiel, c’est déjà de faire l’intro) :<br />
Le roman étant issu de l’épopée, il convient de s’interroger sur l’héritage dont le héros de roman est porteur. Le<br />
chevalier <strong>du</strong> roman médiéval fait preuve d’un certain nombre des qualités héroïques ; au-delà de lui, noblesse d’âme et<br />
intelligence de cœur caractérisent les héritiers modernes des héros épiques ; enfin, le dépassement de soi et la capacité à<br />
transformer son destin continuent de distinguer certains héros jusque dans le roman contemporain.<br />
Les sous-parties ne sont pas rédigées ici.<br />
• Historiquement, le héros est celui qui réussit. Des premiers héros de roman à nos jours, on note une certaine<br />
permanence <strong>du</strong> héros épique. Dans le roman médiéval, le héros est un héritier <strong>du</strong> héros épique de la mythologie<br />
antique. Exemples possibles (en choisir un) : cycle des romans arthuriens, héros chevaleresques. Tristan et Iseut ;<br />
Lancelot, Perceval... Ces héros comptent des héritiers dans des romans bien plus récents : citer ici un héros de<br />
roman de cape et d’épée : d’Artagnan, Les Trois Mousquetaires.<br />
• Certains romans, de par leur genre, exigent la présence d’un héros qui réussit. Que serait un détective qui ne<br />
résout aucune énigme ? Cf Sherlock Holmes de Conan Doyle. Les lecteurs ont réclamé à cor et à cri la<br />
« résurrection » de leur personnage favori alors que le romancier l’avait tué : voilà un héros qui ne devait pas<br />
mourir. Le héros, en réussissant, s’attire la sympathie <strong>du</strong> lecteur, et doit donc continuer à réussir.<br />
• C’est que joue plus profondément, au cœur <strong>du</strong> roman, un processus d’identification <strong>du</strong> lecteur au héros. S’il doit<br />
réussir, c’est peut-être d’abord pour cela : le héros de roman est un personnage idéalisé. Dans le sillage <strong>du</strong> héros<br />
épique originel, nombreux sont ceux qui accèdent à ce statut en faisant preuve de qualités exceptionnelles, et/ou<br />
en transformant leur destin, suscitant ainsi l’admiration <strong>du</strong> lecteur. Exemples possibles :<br />
La Princesse de Clèves : la scène de l’aveu et le renoncement à l’amour à la fin <strong>du</strong> roman font de ce personnage<br />
une héroïne.<br />
Le chevalier des Grieux et le dévouement qui est le sien dans Manon Lescaut.<br />
Jean Valjean dans Les Misérables. Ce dernier fait preuve, par exemple, de certaines qualités morales, d’une force<br />
physique impressionnante, et connaît une réussite sociale qui lui permet d’échapper (longtemps) à sa vie d’ancien<br />
forçat, de transformer son destin.<br />
Phrase de conclusion et de transition vers la seconde partie :<br />
Un certain nombre de héros de roman se distinguent comme donc tels en accomplissant des exploits qui rappellent<br />
ceux des héros de l’épopée : par définition, ils doivent réussir : c’est le fil <strong>du</strong> roman dont ils sont le centre. Pourtant, tous<br />
n’y parviennent pas.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 16/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
II. Mais l’antihéros et le héros paradoxal réussissent à leur manière propre.<br />
Phrase d’intro (et éventuelle annonce des axes) :<br />
Certains « héros de roman » sont marqués <strong>du</strong> sceau de l’échec : peut-on encore parler de réussite, nécessaire qui<br />
plus est, s’agissant de ces antihéros et autres héros paradoxaux ? Échec et succès coïncident parfois sur le chemin de<br />
l’ascension sociale ; certains héros, perdent tout, mais leur échec leur donne de l’envergure ; enfin, les plus misérables<br />
réussissent peut-être encore en ceci qu’ils portent jusqu’au bout les valeurs qui sont les leurs.<br />
• La réussite sociale, une épopée paradoxale<br />
Georges Duroy dans Bel-Ami : ascension sociale aux dépens de toute morale.<br />
Nana de Zola : comment une « comédienne » prostituée réussit grâce aux charmes de son corps et règne par le<br />
pouvoir <strong>du</strong> sexe sur un Tout-Paris subjugué.<br />
Le voleur de Georges Darien : héros de ce roman, Randal devient, pour survivre puis réussir, un voleur<br />
professionnel.<br />
• Un héros en échec, mais qui demeure un héros par son envergure.<br />
Gavroche dans Les Misérables, « petite grande âme » qui refait le combat de David et Goliath et s’attire la<br />
sympathie <strong>du</strong> lecteur. Ce n’est pas un antihéros, mais un personnage presque surnaturel qui meurt en héros.<br />
Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir : échec social, mais réussite en amour et acceptation de la mort ; révolte<br />
devant ses juges, représentants d’une société fermée, colère et dignité qui peuvent susciter l’admiration <strong>du</strong> lecteur.<br />
Stendhal pensait que le temps était venu des héros venus des classes sociales inférieures (et non plus de l’aristocratie), qui<br />
s’élèveraient dans la société par leur énergie et leur mérite. Le Rouge est la chronique de cet espoir avorté. Julien Sorel<br />
n’en est peut-être que plus grand.<br />
• Des antihéros qui nous touchent et qui portent efficacement la vision d’un monde qui va à vau-l’eau. Comme les<br />
précédents, ces antihéros, nécessairement, doivent ne pas réussir s’il leur faut parvenir à nous toucher.<br />
Bouvard et Pécuchet dans le roman <strong>du</strong> même nom, dernière œuvre de Flaubert : deux personnages qui provoquent<br />
le rire <strong>du</strong> lecteur ; un « livre sur rien », sans action ; des héros qui nous amusent et prennent une certaine consistance au<br />
fur et à mesure de leurs échecs.<br />
Gohar, le rire subversif de Cossery dans Mendiants et orgueilleux. Gohar demeure mendiant et orgueilleux à la fin<br />
<strong>du</strong> roman (et telle est sa réussite en tant que personnage dans l’histoire, en plus d’être parvenu à convertir le policier à sa<br />
conception de l’existence). Surtout, ce héros change le regard <strong>du</strong> lecteur sur le monde.<br />
Fama, héros des Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma. Personnage dont le ridicule, le pathétique et la<br />
folie révèlent au lecteur le naufrage d’un monde, pour lequel l’indépendance n’est pas plus synonyme de liberté ou de<br />
bonheur que la colonisation.<br />
Phrase de conclusion et de transition vers la dernière partie :<br />
Il n’y a donc pas un héros de roman, mais des héros, des antihéros, des personnages paradoxaux. Chacun « réussit »<br />
à sa manière propre. Peut-on dès lors leur assigner à tous un même impératif de « réussite » ?<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 17/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
III. C’est peut-être aux yeux <strong>du</strong> lecteur que le héros de roman, quel qu’il soit, doit réussir.<br />
Phrase d’intro :<br />
Au fond, la seule « réussite » exigible <strong>du</strong> héros n’est-elle pas à situer dans le rapport de ce dernier avec le lecteur ?<br />
Certains antihéros, plus proches de nous que le héros épique, favorisent paradoxalement l’identification <strong>du</strong> lecteur.<br />
D’autres bouleversent et donc reconfigurent nos habitudes de lecture. Enfin, peut-être existe-t-il pour certains d’entre eux<br />
un au-delà <strong>du</strong> roman.<br />
• L’antihéros, un personnage ordinaire dans lequel il est aisé de se reconnaître : à rebours <strong>du</strong> héros traditionnel,<br />
l’identification marche aussi quand (et parce que) le héros n’est pas idéalisé, et demeure ainsi.<br />
Fabrice à Waterloo : naïveté ridicule (il faut lire le Journal de Stendhal, marqué par une autodérision certaine) qui<br />
évoque notre propre ridicule. Frédéric Moreau, le héros velléitaire de L’É<strong>du</strong>cation sentimentale. Bardamu dans Voyage au<br />
bout de la nuit : un personnage dont la gouaille, associée à l’emploi de la première personne, restitue toute la complexité<br />
de la nature humaine.<br />
• Des personnages qui nous sont étrangers et qui résistent à nos habitudes de lecture : vers et au-delà <strong>du</strong> procès <strong>du</strong><br />
héros.<br />
Meursault dans L’Étranger : le lecteur en position de juge lira d’autant mieux qu’il ne jugera pas le personnage.<br />
Les héros <strong>du</strong> Nouveau Roman, nés <strong>du</strong> refus de l’illusion réaliste, nous obligent à lire le roman autrement. C’est la<br />
quasi mort <strong>du</strong> héros, et sa « quête » se vide de sens : ainsi de Wallas dans Les Gommes, qui enquête sur un crime qui n’a<br />
pas encore été commis. Peut-être ces êtres de papiers, revendiqués par tels par leurs auteurs, qui mettent en cause la<br />
confusion entre personnages et personnes réelles (cf. Balzac et son ambition de « faire concurrence à l’état civil ») nous<br />
permettent-ils en réalité de mieux approcher la complexité de la vie humaine que leurs prédécesseurs. L’aventure est peutêtre<br />
désormais celle de notre lecture...<br />
Dans Si par une nuit d’hiver un voyageur, Italo Calvino s’amuse d’ailleurs à faire <strong>du</strong> lecteur le héros <strong>du</strong> roman,<br />
rendant ainsi l’identification au personnage à la fois totalement impossible et tout à fait complète.<br />
• Ces antihéros qui, devenant modèles d’une attitude humaine, accèdent au rang de mythes.<br />
Meursault, incarnation de l’homme absurde, accède au statut de héros à la veille de mourir, en acceptant l’absurdité<br />
de la vie et se trouve ainsi réconcilié avec « la tendre indifférence <strong>du</strong> monde ». Il incarne la condition de l’homme<br />
moderne face à un monde dans lequel aucune signification (sur le sens de la vie) n’a valeur de certitude absolue.<br />
Autre façon d’exploiter cet exemple (plus personnelle) : Meursault est une affirmation romanesque <strong>du</strong> caractère<br />
irré<strong>du</strong>ctiblement énigmatique de chaque homme. N’allons pas lire dans l’âme d’autrui : tel semble être une des « leçons »<br />
de ce roman. Avec la narration omnisciente, on savait tout sur le héros <strong>du</strong> XIXe, qui incarnait une forme<br />
d’accomplissement de l’indivi<strong>du</strong> (au plan social, souvent) ; avec ce croisement étrange entre première personne et point de<br />
vue quasi externe, on en sait très peu sur Meursault, qui incarne une autre forme d’aboutissement de l’indivi<strong>du</strong> : il est celui<br />
qui n’accepte aucun compromis avec la société, dont la vérité est tout entière dans les sensations. Il est celui qui refuse<br />
d’être « interprété », et qui donne chair, ainsi, au désir de liberté et de révolte de l’homme moderne pensé par Camus.<br />
Emma Bovary, existence qui demeure vaine, donne naissance au bovarysme, cette fuite <strong>du</strong> réel dans l’imaginaire le<br />
plus stéréotypé. Le nom est passé dans le langage courant.<br />
Don Quichotte prend conscience de sa folie, mais c’est sa folie que nous conservons pourtant (l’épisode des<br />
moulins à vent demeure le plus emblématique) et que, peut-être, nous admirons en souriant. Ce héros, l’un des tout<br />
premiers personnages romanesques, devient un modèle de lecture <strong>du</strong> monde, il incarne un appel fou – quoique lucide, à la<br />
fin <strong>du</strong> roman – à le ré-enchanter. Et, signe de sa réussite, dans le second livre de ses aventures, il rencontre des<br />
personnages qui ont lu... le premier ouvrage. Cervantès joue de la notoriété de son personnage par ce procédé de mise en<br />
abyme qui montre, dès le début <strong>du</strong> XVIIe siècle, le grand succès de son héros par-delà le texte. Son (anti)héros fait partie<br />
de la réalité, et n’appartient plus exclusivement au champ littéraire.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 18/19
Français, Séquence I : L’homme face au sentiment de l’absurdité<br />
Repérez bien les différentes étapes de l’intro<strong>du</strong>ction :<br />
Amorce<br />
Présentation <strong>du</strong> sujet<br />
Formulation de la problématique (ici, reprise de la question posée)<br />
Annonce <strong>du</strong> plan.<br />
« À nous deux, Paris ! » lance Rastignac, à la fin <strong>du</strong> Père Goriot, tel un héros surplombant le champ de bataille à la<br />
veille d'une conquête. Mais si conquête il y a, c’est de celle <strong>du</strong> « monde » qu’il s’agit : une épopée que Balzac appellera<br />
La comédie humaine. C’est dire si les termes « héros », au sens de héros épique, et « héros de roman » ne sont pas<br />
synonymes. Que le premier, au nom de son ascendance mythologique, doive accomplir des exploits, cela va de soi ; mais<br />
le héros de roman, lui, doit-il nécessairement réussir ? Héros et réussite paraissant liés par définition, nous verrons en<br />
premier lieu de quoi est faite l’étoffe léguée au héros de roman. Puis, nous nous interrogerons sur ce qui fait le succès des<br />
antihéros et autres personnages paradoxaux. Enfin, puisque changement de nature il y a entre héros et héros de roman,<br />
nous nous demanderons si l’exigence de réussite n’est pas elle aussi à envisager sur un autre plan.<br />
Conclusion<br />
Là aussi, repérez bien les différentes étapes.<br />
Bilan de la réflexion, qui reprend l’essentiel des conclusions de chaque partie, et qui propose une réponse claire à la<br />
question posée.<br />
Ouverture : vous prenez <strong>du</strong> champ par rapport à votre réflexion ; vous considérez le sujet sous un angle plus vaste ;<br />
vous faites le lien avec votre culture personnelle.<br />
Du héros de l’épopée, reste... un mot : celui de héros, qui désigne des réalités littéraires diverses. Héros et héros de<br />
roman se croisent, parfois, mais ne se confondent plus. La coexistence de deux traditions romanesques – permanence et<br />
remise en question <strong>du</strong> héros épique – paraît même essentielle au développement <strong>du</strong> genre. De ce fait, l’impératif de<br />
l’exploit ne peut plus être assigné à tous les héros de roman. Mais si la réussite n’est plus une obligation, reste que le<br />
héros, quel qu’il soit, doit s’accomplir, c’est-à-dire réussir aux yeux <strong>du</strong> lecteur. Il lui faut assumer jusqu’au terme de<br />
l’œuvre les valeurs dont l’a chargé le romancier, fût-ce des contre-valeurs. Ainsi devenus des modèles d’attitudes<br />
humaines, les héros de roman accèdent au rang de nouveaux mythes. Ils devancent la réalité : on lit mieux la bêtise<br />
humaine depuis Emma Bovary. L’aventure est donc celle de notre lecture. La place croissante accordée à l’intériorité <strong>du</strong><br />
personnage depuis le XXe siècle, dans le sillage d’À la recherche <strong>du</strong> temps per<strong>du</strong>, en témoigne : la conscience <strong>du</strong> héros de<br />
roman s’offre aujourd’hui comme un espace qu’il revient au lecteur de conquérir.<br />
M. Danset, Les Francs-Bourgeois, septembre 2012. 19/19