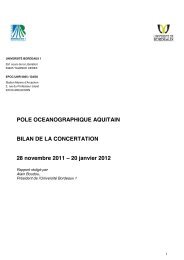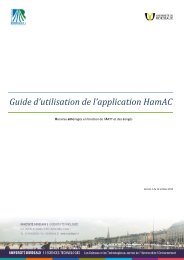Diversité procaryote de flores d'intérêt écologique en zone ...
Diversité procaryote de flores d'intérêt écologique en zone ...
Diversité procaryote de flores d'intérêt écologique en zone ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Diversité</strong> <strong>procaryote</strong> <strong>de</strong> <strong>flores</strong> <strong>d'intérêt</strong> <strong>écologique</strong> <strong>en</strong> <strong>zone</strong> b<strong>en</strong>thique côtière<br />
Doctorant :<br />
Guillaume Meisterhans<br />
Encadrants :<br />
Frédéric Garabetian (Pr Université Bor<strong>de</strong>aux 1, UMR EPOC)<br />
Flor<strong>en</strong>ce Ju<strong>de</strong> (MCF Université Bor<strong>de</strong>aux 1, UMR EPOC)<br />
Natalie Raymond (MCF Université Bor<strong>de</strong>aux 1, UMR EPOC)<br />
Sujet :<br />
Parties intégrantes <strong>de</strong>s écosystèmes, les <strong>procaryote</strong>s (bactéries, archées) sont impliqués dans <strong>de</strong>s<br />
interactions avec les composantes abiotiques et biotiques <strong>de</strong> l’écosystème. De leurs interactions avec<br />
la composante abiotique découle une <strong>de</strong> leurs propriétés reconnues: leur implication dans les cycles<br />
biogéochimiques (carbone, azote, soufre, phosphore…). Par ailleurs au cours <strong>de</strong> l’évolution certains<br />
<strong>procaryote</strong>s ont noué <strong>de</strong>s relations symbiotiques plus ou moins étroites et plus ou moins bénéfiques<br />
(mutualisme, comm<strong>en</strong>salisme, parasitisme) avec d’autres organismes (animaux ou végétaux) hors<br />
relations trophiques. Ces interactions sont susceptibles d’affecter, positivem<strong>en</strong>t ou négativem<strong>en</strong>t la<br />
dynamique <strong>de</strong> population d’organismes ingénieurs <strong>de</strong> l’écosystème ou d’une ressource vivante. Dans<br />
ce contexte il est important <strong>de</strong> caractériser la diversité <strong>procaryote</strong> d’une <strong>zone</strong> marine côtière (Bassin<br />
d’Arcachon, France) située à l’interface Océan / Contin<strong>en</strong>t (<strong>zone</strong> d’écotone) et soumise aux apports<br />
anthropiques (milieu récepteur). La caractérisation <strong>de</strong> cette diversité portera sur les <strong>procaryote</strong>s i) <strong>de</strong>s<br />
sédim<strong>en</strong>ts connus pour être le siège d’une minéralisation importante <strong>de</strong> la matière organique et ii) <strong>de</strong><br />
bivalves fouisseurs (coques, palour<strong>de</strong>s) <strong>en</strong> tant que ressources exploitées sur lesquelles ri<strong>en</strong> n’est<br />
docum<strong>en</strong>té à l’exception d’informations sanitaires sur la flore contaminante souv<strong>en</strong>t d’origine<br />
anthropique. Les travaux permettront <strong>de</strong> caractériser d’une part la diversité <strong>de</strong>s espèces au sein d’une<br />
même station (diversité alpha) par la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> clonage-séqu<strong>en</strong>çage et d’autre part les différ<strong>en</strong>ces<br />
<strong>de</strong> diversité <strong>en</strong>tre plusieurs stations choisies selon un gradi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> qualité (diversité bêta) par typage<br />
moléculaire (ARISA ou DGGE).<br />
ILLUSTRATION : caractérisation par ARISA (Automated Ribosomal Interg<strong>en</strong>ic Spacer Analysis) <strong>de</strong><br />
la flore bactéri<strong>en</strong>ne comm<strong>en</strong>sale <strong>de</strong> coques (Cerasto<strong>de</strong>rma edule) du Banc d’Arguin<br />
L’ARISA est une technique <strong>de</strong> typage moléculaire utilisant la taille du fragm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’intergène ADNr<br />
16S et ADNr 23S (ITS)(Figure 1) comme marqueur taxonomique <strong>de</strong> l’espèce <strong>procaryote</strong>. Elle permet<br />
d’établir <strong>de</strong>s similitu<strong>de</strong>s ou différ<strong>en</strong>ces dans la composition <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes communautés que l’on<br />
cherche à comparer (diversité bêta).<br />
Figure 1 : schema <strong>de</strong> l’intergène ADNr 16S ADNr23S
Taille <strong>de</strong> l’ITS <strong>en</strong> nombre <strong>de</strong> paires <strong>de</strong> bases<br />
Figure 2: Profils <strong>de</strong> tailles <strong>de</strong> fragm<strong>en</strong>ts intergéniques 16S-23S (ARISA)<br />
<strong>procaryote</strong>s issus <strong>de</strong> coques (Vert cohorte 2006 ; bleu cohorte 2007)<br />
Chacune <strong>de</strong>s empreintes correspondant à<br />
chacune <strong>de</strong>s coques analysées,a été compilée<br />
sous forme d’une matrice. A partir <strong>de</strong> cette<br />
matrice, la distance <strong>de</strong> Jaccards <strong>en</strong>tre les<br />
différ<strong>en</strong>tes empreintes a été calculée. Le<br />
nMDS (non metric dim<strong>en</strong>sional scaling) est<br />
une représ<strong>en</strong>tation graphique <strong>de</strong> cette distance<br />
qui nous a permis <strong>de</strong> visualiser <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ces<br />
au niveau <strong>de</strong> la composition <strong>de</strong>s communautés<br />
bactéri<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> 2 cohortes <strong>de</strong> coques (2006 et<br />
2007) (Figure 3). Une ANOSIM basée sur<br />
100 000 permutations nous a permis <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r<br />
la significativité <strong>de</strong> ces différ<strong>en</strong>ces (p= 8x10 -5 ).<br />
Int<strong>en</strong>sité <strong>de</strong> fluoresc<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> UA<br />
Après avoir vérifié son statut (parasité ou non<br />
parasité par Bucephalus minimus) chaque<br />
bivalve collecté a été broyé, afin <strong>de</strong> préparer<br />
l’extraction <strong>de</strong> l’ADN. L’amplification sélective<br />
<strong>de</strong>s fragm<strong>en</strong>ts d’intérêt (ITS <strong>de</strong>s populations<br />
bactéri<strong>en</strong>nes prés<strong>en</strong>tes) a <strong>en</strong>suite été réalisée<br />
sur une fraction <strong>de</strong> cet ADN extrait. Puis<br />
l’analyse automatisée <strong>de</strong> l’amplicon a été<br />
effectuée sur un séqu<strong>en</strong>ceur capillaire<br />
ABI3730 Applied Biosystems <strong>de</strong> la plateforme<br />
Génome Transcriptome <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux. Pour<br />
chaque coque, un profil <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts ITS<br />
prés<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> leurs abondances relatives<br />
(empreinte génétique) a été obt<strong>en</strong>u. A titre<br />
d’illustration, <strong>de</strong>ux profils correspondant à <strong>de</strong>s<br />
coques appart<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>ux cohortes sont ici<br />
superposés ; la courbe rouge représ<strong>en</strong>te<br />
l’étalonnage interne : taille du brin <strong>en</strong> fonction<br />
<strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> migration électrophorétique<br />
(Figure2).<br />
cohorte 2006<br />
individus non<br />
parasités par<br />
B.minimus<br />
cohorte 2006<br />
individus<br />
parasités par<br />
B.minimus<br />
cohorte 2007<br />
individus non<br />
parasités par<br />
B.minimus<br />
cohorte 2007<br />
individus<br />
parasités par<br />
B.minimus<br />
Figure 3 : Représ<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> nMDS <strong>de</strong>s distances <strong>en</strong>tre les<br />
profils génétiques <strong>de</strong>s communautés bactéri<strong>en</strong>nes<br />
prés<strong>en</strong>tes chez <strong>de</strong>s coques appart<strong>en</strong>ant à <strong>de</strong>ux cohortes<br />
(2006 et 2007)