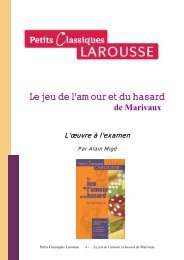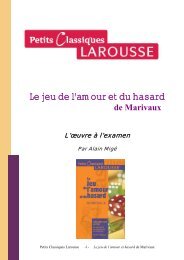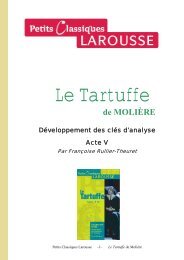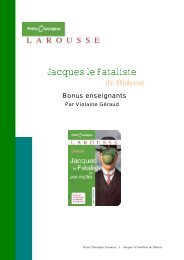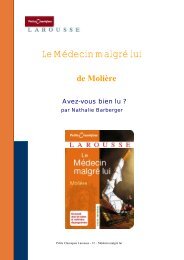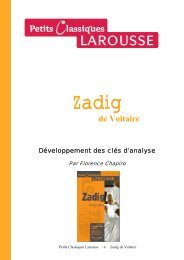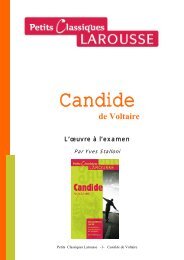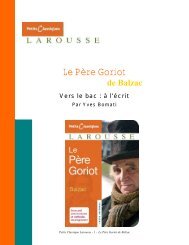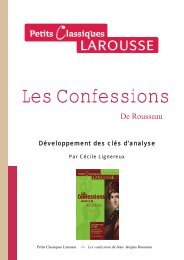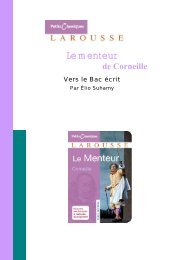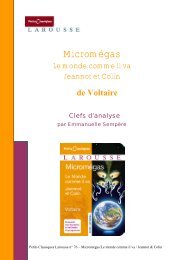vers le bac (PDF) - Les Petits Classiques Larousse
vers le bac (PDF) - Les Petits Classiques Larousse
vers le bac (PDF) - Les Petits Classiques Larousse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Les</strong> Fausses Confidences<br />
de Marivaux<br />
par VIOLAINE GÉRAUD
Vers <strong>le</strong> <strong>bac</strong><br />
À l’écrit<br />
Objet d’étude : étude d’un genre et de son évolution au tra<strong>vers</strong> du temps, la comédie au<br />
XVIII e sièc<strong>le</strong><br />
Corpus <strong>bac</strong> : la comédie au XVIII e sièc<strong>le</strong><br />
TEXTE 1<br />
Marivaux, <strong>Les</strong> Fausses Confidences,<br />
acte I, scène 7, 1737.<br />
TEXTE 2<br />
<strong>Les</strong>age, Turcaret,<br />
acte II, scène 14, 1709.<br />
LA BARONNE. Monsieur, voilà <strong>le</strong> garçon que je veux vous donner.<br />
M. TURCARET. II paraît un peu innocent.<br />
LA BARONNE. Que vous vous connaissez bien en physionomie !<br />
M. TURCARET. J'ai <strong>le</strong> coup d'œil infaillib<strong>le</strong>... (À Frontin.) Approche, mon ami : dis-moi un<br />
peu, as-tu déjà quelques principes ?<br />
FRONTIN. Qu'appe<strong>le</strong>z-vous des principes ?<br />
M. TURCARET. Des principes de commis ; c'est-à-dire, si tu sais comment on peut empêcher<br />
<strong>le</strong>s fraudes ou <strong>le</strong>s favoriser ?<br />
FRONTIN. Pas encore, monsieur ; mais je sens que j'apprendrai cela fort faci<strong>le</strong>ment.<br />
M. TURCARET. Tu sais, du moins, l'arithmétique ? Tu sais faire des comptes à parties<br />
simp<strong>le</strong>s ?<br />
FRONTIN. Oh ! oui, monsieur ; je sais même faire des parties doub<strong>le</strong>s. J'écris aussi de deux<br />
écritures, tantôt de l'une et tantôt de l'autre.<br />
M. TURCARET. De la ronde, n'est-ce pas ?<br />
FRONTIN. De la ronde, de l'oblique.<br />
M. TURCARET. Comment, de l'oblique ?<br />
FRONTIN. Hé ! oui, d'une écriture que vous connaissez... là... d'une certaine écriture qui n'est<br />
pas légitime.<br />
M. TURCARET, à la Baronne. II veut dire de la bâtarde.<br />
FRONTIN. Justement : c'est ce mot-là, que je cherchais.<br />
M. TURCARET, à la Baronne. Quel<strong>le</strong> ingénuité !... Ce garçon-là, madame, est bien niais.<br />
LA BARONNE. II se déniaisera dans vos bureaux.<br />
M. TURCARET. Oh ! qu'oui, madame, oh ! qu'oui. D'ail<strong>le</strong>urs un bel esprit n'est pas nécessaire<br />
pour faire son chemin. Hors moi et deux ou trois autres, il n'y a parmi nous que des génies<br />
assez communs. Il suffit d'un certain usage, d'une routine que l'on ne manque guère d'attraper.<br />
Nous voyons tant de gens ! Nous nous étudions à prendre ce que <strong>le</strong> monde a de meil<strong>le</strong>ur ;<br />
voilà toute notre science.<br />
TEXTE 3<br />
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro,<br />
acte III, scène 5, 1784.
FIGARO, à part. Ah ! ma femme, s'il vous plaît.<br />
LE COMTE, se retourne. Hein ? quoi ? qu'est-ce que c'est ?<br />
FIGARO, s'avance. Moi, qui me rends à vos ordres.<br />
LE COMTE. Et pourquoi ces mots ?<br />
FIGARO. Je n'ai rien dit.<br />
LE COMTE répète. Ma femme, s'il vous plaît ?<br />
FIGARO. C'est... la fin d'une réponse que je faisais : Al<strong>le</strong>z <strong>le</strong> dire à ma femme, s'il vous plaît.<br />
LE COMTE se promène. Sa femme !... Je voudrais bien savoir quel<strong>le</strong> affaire peut arrêter<br />
Monsieur, quand je <strong>le</strong> fais appe<strong>le</strong>r ?<br />
FIGARO, feignant d'assurer son habil<strong>le</strong>ment. Je m'étais sali sur ces couches en tombant ; je me<br />
changeais.<br />
LE COMTE. Faut-il une heure ?<br />
FIGARO. Il faut <strong>le</strong> temps.<br />
LE COMTE. <strong>Les</strong> domestiques ici... sont plus longs à s'habil<strong>le</strong>r que <strong>le</strong>s maîtres !<br />
FIGARO. C'est qu'ils n'ont point de va<strong>le</strong>ts pour <strong>le</strong>s y aider.<br />
LE COMTE. ... Je n'ai pas trop compris ce qui vous avait forcé tantôt de courir un danger<br />
inuti<strong>le</strong>, en vous jetant...<br />
FIGARO. Un danger ! on dirait que je me suis engouffré tout vivant...<br />
LE COMTE. Essayez de me donner <strong>le</strong> change en feignant de <strong>le</strong> prendre, insidieux va<strong>le</strong>t ! Vous<br />
entendez fort bien que ce n'est pas <strong>le</strong> danger qui m'inquiète, mais <strong>le</strong> motif.<br />
I. Question préliminaire (sur 4 points)<br />
Vous observerez comment chacun de ces extraits de comédie représente la relation de pouvoir<br />
entre un maître ou une maîtresse et un personnage qui lui est socia<strong>le</strong>ment inférieur, va<strong>le</strong>t ou<br />
intendant : pouvez-vous en déduire quel<strong>le</strong> vision de la société reflète chaque comédie ?<br />
<strong>Les</strong> trois comédies appartiennent toutes au XVIII e sièc<strong>le</strong> : Turcaret ou <strong>le</strong> Financier date de<br />
1709 ; on se souvient que <strong>Les</strong> Fausses Confidences ont été représentées pour la première fois<br />
en 1737 ; et Le Mariage de Figaro, longtemps (environ quatre ans) censuré, en 1784. <strong>Les</strong><br />
pièces ne montrent pas <strong>le</strong> même type de relation selon la position qu’el<strong>le</strong>s occupent dans <strong>le</strong><br />
sièc<strong>le</strong>. <strong>Les</strong>age est encore l’héritier des va<strong>le</strong>urs du XVII e sièc<strong>le</strong>. On sent dans sa pièce la<br />
prégnance de l’idéologie de l’Ancien Régime, pour laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s castes sont fondées sur la<br />
naissance et donc, en quelque sorte, naturel<strong>le</strong>s. Un va<strong>le</strong>t est par essence méprisab<strong>le</strong>, aux yeux<br />
de ceux qui l’emploient. Mais <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>ts sont rusés et peuvent réussir (comme <strong>le</strong>s servantes de<br />
Molière) à échapper à <strong>le</strong>ur condition par <strong>le</strong>ur intelligence et <strong>le</strong>ur sens de la repartie. Turcaret<br />
joue l’innocent et se moque hypocritement de ses maîtres : <strong>le</strong>s rieurs sont de son côté. Avec<br />
Marivaux et <strong>Les</strong> Fausses Confidences, nous nous situons à l’aube des Lumières. <strong>Les</strong><br />
intel<strong>le</strong>ctuels et <strong>le</strong>s savants s’interrogent sur ce qui fonde l’ordre social et sur la manière de <strong>le</strong><br />
faire évoluer de sorte qu’il devienne plus juste. Marivaux, dans ses utopies et ses journaux,<br />
montre combien il est lucide. Il voudrait rendre la société plus humaine, à l’image<br />
d’Araminte, héroïne généreuse qui parvient à se hausser au-dessus des préjugés de son temps.<br />
Face à son futur intendant, el<strong>le</strong> est d’une grande courtoisie. Le respect de tout un chacun est<br />
un principe moral absolu pour Marivaux. Enfin, avec Beaumarchais, nous nous rapprochons<br />
de la Révolution française et de la contestation de l’ordre social de l’Ancien Régime. La<br />
comparaison entre maîtres et va<strong>le</strong>ts, sur <strong>le</strong> plan de l’habillage et du temps qu’il prend, est<br />
inso<strong>le</strong>nte. El<strong>le</strong> montre que désormais <strong>le</strong>s préjugés des aristocrates peuvent être contestés.<br />
II. Travaux d’écriture (sur 16 points) – au choix :<br />
Sujet 1 : Commentaire.
Vous ferez <strong>le</strong> commentaire composé du texte 3.<br />
Le Mariage de Figaro appartient à une trilogie, « la trilogie espagno<strong>le</strong> ». Il y est précédé du<br />
Barbier de Sévil<strong>le</strong> et suivi par un drame sérieux, La Mère coupab<strong>le</strong>. Dans cette pièce, Figaro,<br />
un va<strong>le</strong>t audacieux et beau par<strong>le</strong>ur, doub<strong>le</strong> du dramaturge lui-même, doit épouser une certaine<br />
Suzanne. Mais son maître, <strong>le</strong> comte Almaviva, la convoite aussi et veut user sur el<strong>le</strong> du « droit<br />
du Seigneur ». Almaviva est donc un grand seigneur libertin qui incarne la crise des va<strong>le</strong>urs<br />
aristocratiques, face à Figaro, va<strong>le</strong>t d’intrigue d’un nouveau genre, qui catalyse toutes <strong>le</strong>s<br />
espérances du tiers état bafoué. Notre extrait se situe dans la première partie de la scène 5 de<br />
l’acte III, dans laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s deux hommes s’affrontent. La scène précédente était un<br />
monologue du comte, s’avouant ne rechercher Suzanne que par « fantaisie ». Or la fin de ce<br />
monologue est surprise par Figaro, qui comprend de la sorte quel<strong>le</strong> sera la stratégie de son<br />
maître. Peu après <strong>le</strong> début de la scène 5, c’est un aparté qui est surpris par <strong>le</strong> comte.<br />
Beaumarchais transgresse donc <strong>le</strong>s usages propres au théâtre, comme nous <strong>le</strong> verrons dans un<br />
premier temps. Il réinvente la dramaturgie comme <strong>le</strong> dialogue théâtral, sur <strong>le</strong>quel nous<br />
focaliserons notre attention dans un second temps. Nous verrons enfin que ce dialogue<br />
d’affrontement met en question la relation maître-va<strong>le</strong>t.<br />
1. L’aparté surpris : une transgression des usages propres au théâtre.<br />
L’aparté est destiné, comme son nom l’indique, a être dit « à part », à ne pas être entendu des<br />
personnages présents sur scène, mais seu<strong>le</strong>ment du public. Beaumarchais joue avec <strong>le</strong>s<br />
conventions, s’amuse avec l’illusion théâtra<strong>le</strong>, prend à contre-pied <strong>le</strong>s spectateurs. La<br />
répétition du comte oblige Figaro à trouver une stratégie d’évitement, el<strong>le</strong>-même destinée à<br />
montrer son habi<strong>le</strong>té tacticienne.<br />
Dans <strong>le</strong> théâtre de Beaumarchais tout est possib<strong>le</strong>. <strong>Les</strong> péripéties s’enchaînent à vive allure<br />
pour griser <strong>le</strong>s spectateurs.<br />
On observera <strong>le</strong> grand nombre de didascalies : la gestuel<strong>le</strong> est importante dans une pièce qui<br />
doit donner une impression de naturel.<br />
2. Le dialogue théâtral, dans cette scène d’affrontement à f<strong>le</strong>urets mouchetés.<br />
Il faut observer <strong>le</strong>s particularités de l’écriture qui dynamisent l’échange :<br />
- <strong>le</strong>s interruptions que marquent <strong>le</strong>s points de suspension, nombreux dans cet extrait (<strong>le</strong><br />
si<strong>le</strong>nce précède par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> reproche et <strong>le</strong> met en va<strong>le</strong>ur : « <strong>Les</strong> domestiques ici … sont<br />
plus longs à s’habil<strong>le</strong>r que <strong>le</strong>s maîtres ») ;<br />
- <strong>le</strong>s phrases directement enchaînées sur la réplique précédente et qui fusent : « C’est qu’ils<br />
n’ont point de va<strong>le</strong>ts pour <strong>le</strong>s y aider » ;<br />
- <strong>le</strong>s enchaînements : « Faut-il une heure ? - Il faut <strong>le</strong> temps. » Le dialogue associe <strong>le</strong>s<br />
répliques deux à deux (paires adjacentes). <strong>Les</strong> enchaînements sont soignés et variés.<br />
3. La relation maître-va<strong>le</strong>t.<br />
Figaro doit donner <strong>le</strong> change (« Essayez de me donner <strong>le</strong> change ») et se battre contre son<br />
maître, mais pas ouvertement ; il doit feindre de continuer à lui obéir.<br />
L’aparté surpris a aussi une signification socia<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s espaces des deux personnages<br />
s’interpénètrent. Le monde des maîtres n’est plus clairement opposé à celui des va<strong>le</strong>ts, <strong>le</strong>ur<br />
langage est semblab<strong>le</strong>, ils ont pareil<strong>le</strong>ment de l’esprit (Figaro en a même davantage et<br />
emporte la partie par sa réplique du tac au tac sur <strong>le</strong> fait que personne n’aide un va<strong>le</strong>t à<br />
s’habil<strong>le</strong>r).<br />
<strong>Les</strong> apostrophes qu’utilise <strong>le</strong> comte montrent qu’il craint son va<strong>le</strong>t : il l’appel<strong>le</strong> ironiquement<br />
« Monsieur » ; ensuite il <strong>le</strong> traite d’« insidieux va<strong>le</strong>t ».
Cela montre combien la relation entre maître et va<strong>le</strong>t est devenue comp<strong>le</strong>xe, à l’image de cel<strong>le</strong><br />
entre <strong>le</strong>s différentes classes socia<strong>le</strong>s à la veil<strong>le</strong> de la Révolution française. Si Le Mariage de<br />
Figaro est longtemps resté censuré, c’est parce que la pièce est séditieuse. El<strong>le</strong> pose en effet<br />
ouvertement la question de la légitimité de la hiérarchie socia<strong>le</strong> (comme <strong>le</strong> fait avec plus de<br />
douceur Araminte dans la scène 7 de l’acte I des Fausses Confidences). Ces deux pièces<br />
témoignent chacune à <strong>le</strong>ur façon d’une époque où la pensée devient autonome et ne saurait se<br />
contenter de préjugés : qu’est-ce qui doit fonder une hiérarchie socia<strong>le</strong>, la naissance ou <strong>le</strong>s<br />
qualités que chacun développe au long de sa vie et par ses actions singulières ?<br />
Sujet 2. Dissertation.<br />
Michel Gilot et Jean Serroy, auteurs de La Comédie à l’âge classique, ont écrit : « La comédie<br />
est allée plus loin que la tragédie dans l’exploration du monde intérieur : états d’âme ambigus<br />
et fragi<strong>le</strong>s, moments de ‘‘distraction’’, de ‘‘rêverie’’ ou de fausses absences, toute cette<br />
métaphysique du sentiment dont on créditait Marivaux sous <strong>le</strong> Régence. » Vous vous<br />
demanderez dans quel<strong>le</strong> mesure <strong>le</strong>s trois extraits proposés et ce que vous savez par ail<strong>le</strong>urs<br />
des grandes comédies du XVIII e sièc<strong>le</strong> illustrent ce propos.<br />
On peut partir du fait qu’au XVIII e sièc<strong>le</strong>, l’idéal de l’homme sensib<strong>le</strong> succède à celui de<br />
l’honnête homme. Une plus grande importance est accordée aux sentiments. La philosophie<br />
sensualiste (Condillac) met du reste <strong>le</strong>s sentiments en continuité avec <strong>le</strong>s sensations et en fait<br />
<strong>le</strong> fondement des opérations d’intel<strong>le</strong>ction. On ne s’étonnera donc pas que la littérature (en<br />
cela préromantique) en général et la comédie en particulier accordent une grande importance<br />
aux mouvements, surtout <strong>le</strong>s plus subtils, du cœur humain.<br />
Marivaux et Beaumarchais illustrent différemment ce propos, ne donnant pas <strong>le</strong> même sens à<br />
la rêverie. Dans la scène d’affrontement entre <strong>le</strong>s deux hommes, <strong>le</strong>s temps de si<strong>le</strong>nce<br />
(aposiopèses, réticences) marquent surtout l’embarras, la difficulté à concilier tactique et<br />
obligation socia<strong>le</strong>. Mais si l’on songe à la pauvre Rosine, épouse délaissée, la rêverie va<br />
permettre à Beaumarchais de laisser entendre qu’el<strong>le</strong> pourrait être séduite par <strong>le</strong> page<br />
Chérubin (acte II, scène 1). La comtesse est en permanence rêveuse dans la pièce. El<strong>le</strong> est de<br />
ce fait fort différente de la Rosine du Barbier de Sévil<strong>le</strong>, ingénue p<strong>le</strong>ine d’esprit et de gaieté.<br />
Chez Marivaux, la rêverie est la marque de l’égarement. Tout personnage marivaldien surpris<br />
par l’amour tombe dans un abîme de rêverie, perd ses mots et ses moyens. Pour <strong>le</strong> public,<br />
cette plongée en soi-même révè<strong>le</strong> la montée en puissance, qui sera fina<strong>le</strong>ment inexorab<strong>le</strong>, de<br />
l’amour.<br />
La construction de l’action reste toutefois souveraine chez Beaumarchais et <strong>Les</strong>age, ce dernier<br />
visant surtout la satire des mœurs. Chez <strong>Les</strong>age comme chez Beaumarchais, c’est la<br />
construction de l’action qui l’emporte sur la psychologie des personnages. On a pu d’ail<strong>le</strong>urs<br />
reprocher à Beaumarchais l’incohérence de certains caractères : Marceline est d’abord<br />
l’odieuse riva<strong>le</strong> de Suzanne. El<strong>le</strong> devient ensuite, après la scène de reconnaissance (acte III,<br />
scène 16), la mère plus que parfaite de Figaro. D’abord furieusement antipathique, Marceline<br />
se transforme en un coup de théâtre en personnage absolument aimab<strong>le</strong>. Chez Beaumarchais,<br />
<strong>le</strong> libertinage, <strong>le</strong> désir et <strong>le</strong>ur répercussion sur l’action dramatique l’emportent sur <strong>le</strong>s affects.<br />
Quant à <strong>Les</strong>age, il vise surtout dans son théâtre un réalisme satirique. Il reprend <strong>le</strong>s attaques<br />
de La Bruyère contre <strong>le</strong>s financiers en inventant un personnage fort sombre, Turcaret. Celui-ci<br />
est un ancien va<strong>le</strong>t qui s’est enrichi par des affaires louches. Turcaret est sans pitié pour toute<br />
sa famil<strong>le</strong>, il se montre sans cœur et évolue dans un monde tout aussi corrompu que lui. C’est
donc à une vision particulièrement sombre de la condition humaine que la pièce, malgré <strong>le</strong>s<br />
rires qu’el<strong>le</strong> suscite, nous convie.<br />
<strong>Les</strong> deux dramaturges, à la différence de Marivaux, posent sur la société qu’ils peignent un<br />
regard satirique aigu. Beaumarchais écrit une pièce qui remet en cause <strong>le</strong> pouvoir de<br />
l’aristocratie, et <strong>Les</strong>age, celui des bourgeois enrichis malhonnêtement.<br />
Marivaux, seul dramaturge à fonder l’action sur la métaphysique du cœur.<br />
Chez Marivaux aussi <strong>le</strong> réalisme social est présent. <strong>Les</strong> questions d’argent sont loin d’être<br />
escamotées. Mais el<strong>le</strong>s ne sont pas essentiel<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong>s servent surtout à problématiser la<br />
relation amoureuse, à montrer sa comp<strong>le</strong>xité. C’est sur <strong>le</strong>s stratagèmes inventés par Dubois<br />
pour faire évoluer <strong>le</strong>s sentiments d’Araminte que toute l’action dramatique est fondée.<br />
L’intrigue amène ainsi Araminte à vivre toute une gamme de sentiments que Marivaux réussit<br />
à retranscrire au moyen d’un sty<strong>le</strong> qui vise <strong>le</strong> naturel. Surtout, <strong>Les</strong> Fausses Confidences<br />
révè<strong>le</strong>nt une métaphysique du sentiment en fondant l’action sur la lutte entre <strong>le</strong> principe de<br />
réalité et <strong>le</strong> principe de plaisir (pour reprendre ces concepts à Freud). Le comte et Mme<br />
Argante incarnent ensemb<strong>le</strong> <strong>le</strong> principe de réalité, tandis que Dubois permet au principe de<br />
plaisir, qui conduit au choix de Dorante comme époux, de l’emporter.<br />
L’action procède aussi d’un jeu extrêmement subtil entre vérité et fiction, entre mensonge et<br />
sincérité. <strong>Les</strong> confidences sont à la fois fausses (el<strong>le</strong>s constituent une stratégie) et vraies en<br />
cela que l’amour de Dorante est véritab<strong>le</strong>. Toute l’intrigue, de dévoi<strong>le</strong>ment en dévoi<strong>le</strong>ment,<br />
permet à la vérité de l’être et de ses sentiments de fina<strong>le</strong>ment triompher.<br />
<strong>Les</strong> propos de MM. Gilot et Serroy s’appliquent surtout à Marivaux. Ce qui fait en effet la<br />
spécificité de son théâtre, ce qui permet à ce dramaturge de renouve<strong>le</strong>r la comédie, c’est la<br />
relation qu’il crée entre action et émotion, et entre langage et sensibilité. Si l’on a pu lui<br />
reprocher cette préciosité nouvel<strong>le</strong>, c’est parce qu’el<strong>le</strong> était neuve et singulière. <strong>Les</strong> réponses<br />
distraites, <strong>le</strong>s paro<strong>le</strong>s machina<strong>le</strong>s sont selon Frédéric Deloffre des inventions de Marivaux.<br />
Personne avant lui n’avait donné la même importance aux mots, et à ce moment où ils se<br />
dérobent. Chez Marivaux, <strong>le</strong> langage laisse transparaître l’inconscient : c’est pourquoi son<br />
théâtre est si proche de nous.<br />
Sujet 3 : Écriture d’invention.<br />
Réécrivez <strong>le</strong> texte 1, première rencontre entre Dorante et Araminte, en <strong>le</strong> transformant en<br />
extrait de roman du XVIII e sièc<strong>le</strong>.<br />
Pour réussir cette transformation, il faut observer de plus près <strong>le</strong> sty<strong>le</strong> des romans au XVIII e<br />
sièc<strong>le</strong>. La <strong>le</strong>cture de La Vie de Marianne s’impose. À cette époque, la mode des faux<br />
mémoires invite à utiliser cette forme : un récit à la première personne mais au passé simp<strong>le</strong>.<br />
Le roman accorde une grande importance à l’analyse des sentiments, mais presque aucune<br />
aux décors, à la réalité qui entoure <strong>le</strong>s personnages. Il faudra donc que <strong>le</strong>s élèves se focalisent<br />
sur l’analyse psychologique.