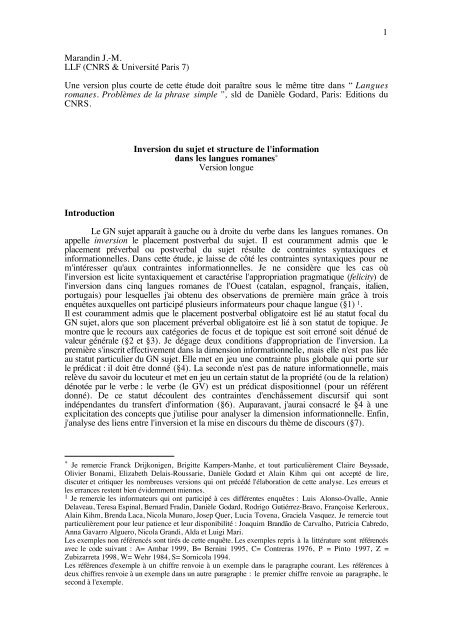Version longue en PDF - Laboratoire de Linguistique Formelle - CNRS
Version longue en PDF - Laboratoire de Linguistique Formelle - CNRS
Version longue en PDF - Laboratoire de Linguistique Formelle - CNRS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Marandin J.-M.<br />
LLF (<strong>CNRS</strong> & Université Paris 7)<br />
Une version plus courte <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> doit paraître sous le même titre dans “ Langues<br />
romanes. Problèmes <strong>de</strong> la phrase simple ”, sld <strong>de</strong> Danièle Godard, Paris: Editions du<br />
<strong>CNRS</strong>.<br />
Introduction<br />
Inversion du sujet et structure <strong>de</strong> l'information<br />
dans les langues romanes *<br />
<strong>Version</strong> <strong>longue</strong><br />
Le GN sujet apparaît à gauche ou à droite du verbe dans les langues romanes. On<br />
appelle inversion le placem<strong>en</strong>t postverbal du sujet. Il est couramm<strong>en</strong>t admis que le<br />
placem<strong>en</strong>t préverbal ou postverbal du sujet résulte <strong>de</strong> contraintes syntaxiques et<br />
informationnelles. Dans cette étu<strong>de</strong>, je laisse <strong>de</strong> côté les contraintes syntaxiques pour ne<br />
m'intéresser qu'aux contraintes informationnelles. Je ne considère que les cas où<br />
l'inversion est licite syntaxiquem<strong>en</strong>t et caractérise l'appropriation pragmatique (felicity) <strong>de</strong><br />
l'inversion dans cinq langues romanes <strong>de</strong> l'Ouest (catalan, espagnol, français, itali<strong>en</strong>,<br />
portugais) pour lesquelles j'ai obt<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s observations <strong>de</strong> première main grâce à trois<br />
<strong>en</strong>quêtes auxquelles ont participé plusieurs informateurs pour chaque langue (§1) 1 .<br />
Il est couramm<strong>en</strong>t admis que le placem<strong>en</strong>t postverbal obligatoire est lié au statut focal du<br />
GN sujet, alors que son placem<strong>en</strong>t préverbal obligatoire est lié à son statut <strong>de</strong> topique. Je<br />
montre que le recours aux catégories <strong>de</strong> focus et <strong>de</strong> topique est soit erroné soit dénué <strong>de</strong><br />
valeur générale (§2 et §3). Je dégage <strong>de</strong>ux conditions d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion. La<br />
première s'inscrit effectivem<strong>en</strong>t dans la dim<strong>en</strong>sion informationnelle, mais elle n'est pas liée<br />
au statut particulier du GN sujet. Elle met <strong>en</strong> jeu une contrainte plus globale qui porte sur<br />
le prédicat : il doit être donné (§4). La secon<strong>de</strong> n'est pas <strong>de</strong> nature informationnelle, mais<br />
relève du savoir du locuteur et met <strong>en</strong> jeu un certain statut <strong>de</strong> la propriété (ou <strong>de</strong> la relation)<br />
dénotée par le verbe : le verbe (le GV) est un prédicat dispositionnel (pour un référ<strong>en</strong>t<br />
donné). De ce statut découl<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s contraintes d'<strong>en</strong>châssem<strong>en</strong>t discursif qui sont<br />
indép<strong>en</strong>dantes du transfert d'information (§6). Auparavant, j'aurai consacré le §4 à une<br />
explicitation <strong>de</strong>s concepts que j'utilise pour analyser la dim<strong>en</strong>sion informationnelle. Enfin,<br />
j'analyse <strong>de</strong>s li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre l'inversion et la mise <strong>en</strong> discours du thème <strong>de</strong> discours (§7).<br />
* Je remercie Franck Drijkonig<strong>en</strong>, Brigitte Kampers-Manhe, et tout particulièrem<strong>en</strong>t Claire Beyssa<strong>de</strong>,<br />
Olivier Bonami, Elizabeth Delais-Roussarie, Danièle Godard et Alain Kihm qui ont accepté <strong>de</strong> lire,<br />
discuter et critiquer les nombreuses versions qui ont précédé l'élaboration <strong>de</strong> cette analyse. Les erreurs et<br />
les errances rest<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t mi<strong>en</strong>nes.<br />
1 Je remercie les informateurs qui ont participé à ces différ<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>quêtes : Luis Alonso-Ovalle, Annie<br />
Delaveau, Teresa Espinal, Bernard Fradin, Danièle Godard, Rodrigo Gutiérrez-Bravo, Françoise Kerleroux,<br />
Alain Kihm, Br<strong>en</strong>da Laca, Nicola Munaro, Josep Quer, Lucia Tov<strong>en</strong>a, Graciela Vasquez. Je remercie tout<br />
particulièrem<strong>en</strong>t pour leur pati<strong>en</strong>ce et leur disponibilité : Joaquim Brandão <strong>de</strong> Carvalho, Patricia Cabredo,<br />
Anna Gavarro Alguero, Nicola Grandi, Alda et Luigi Mari.<br />
Les exemples non référ<strong>en</strong>cés sont tirés <strong>de</strong> cette <strong>en</strong>quête. Les exemples repris à la littérature sont référ<strong>en</strong>cés<br />
avec le co<strong>de</strong> suivant : A= Ambar 1999, B= Bernini 1995, C= Contreras 1976, P = Pinto 1997, Z =<br />
Zubizarreta 1998, W= Wehr 1984, S= Sornicola 1994.<br />
Les référ<strong>en</strong>ces d'exemple à un chiffre r<strong>en</strong>voie à un exemple dans le paragraphe courant. Les référ<strong>en</strong>ces à<br />
<strong>de</strong>ux chiffres r<strong>en</strong>voie à un exemple dans un autre paragraphe : le premier chiffre r<strong>en</strong>voie au paragraphe, le<br />
second à l'exemple.<br />
1
1. Domaine <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong><br />
La notion <strong>de</strong>scriptive d’inversion du sujet est imprécise. Le singulier inversion donne à<br />
p<strong>en</strong>ser qu’il s’agit d’un phénomène unifié au plan syntaxique ; ce n’est pas le cas. Tout<br />
d’abord, le terme subsume <strong>de</strong>s constructions où le GN postverbal prés<strong>en</strong>te les propriétés<br />
du GN sujet préverbal et la construction inaccusative où le GN postverbal prés<strong>en</strong>te les<br />
propriétés <strong>de</strong> l'objet direct (§1.1). D’autre part, il existe plusieurs types <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t<br />
postverbal du GN sujet. Par exemple, le français connaît <strong>de</strong>ux cas : l'inversion stylistique<br />
(syntaxiquem<strong>en</strong>t licite dans un contexte d'extraction) et l'inversion élaborative, qui<br />
s'appar<strong>en</strong>te à un cas d'inversion du GN lourd (heavy NP shift), syntaxiquem<strong>en</strong>t licite dans<br />
tout type <strong>de</strong> phrase (§1.4). Je prés<strong>en</strong>te aux §1.2 et 1.3 trois constructions dans les autres<br />
langues ; je ne repr<strong>en</strong>ds pour les caractériser que les traits saillants reçus dans la<br />
littérature. L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s constructions prés<strong>en</strong>tées dans ce paragraphe ne prét<strong>en</strong>d pas à<br />
l’exhaustivité et constitue le domaine empirique <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>.<br />
1.1. Sujet et premier argum<strong>en</strong>t du verbe<br />
Je repr<strong>en</strong>ds, à titre <strong>de</strong> concept <strong>de</strong>scriptif, la distinction systématiquem<strong>en</strong>t mise <strong>en</strong> œuvre<br />
dans HPSG, <strong>en</strong>tre le statut argum<strong>en</strong>tal d'un constituant (statut défini par rapport à la<br />
propriété lexicale <strong>de</strong> sous-catégorisation d'une tête lexicale) et son statut combinatoirefonctionnel<br />
(sujet, objet, complém<strong>en</strong>t). Je distingue donc la notion <strong>de</strong> premier argum<strong>en</strong>t<br />
d'un verbe et celle <strong>de</strong> sujet 2 . Les statuts combinatoires-fonctionnels sont associés à <strong>de</strong>s<br />
<strong>en</strong>sembles <strong>de</strong> propriétés différ<strong>en</strong>tielles dans les dim<strong>en</strong>sions <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong>s mots, du cas, du<br />
liage, etc. Ces propriétés peuv<strong>en</strong>t être utilisées comme <strong>de</strong>s critères pour déterminer le statut<br />
fonctionnel <strong>de</strong>s constituants dans les énoncés.<br />
Le premier argum<strong>en</strong>t d'un verbe peut <strong>en</strong>trer dans <strong>de</strong>ux schémas <strong>de</strong> combinaison : il peut<br />
être combiné avec le verbe soit comme un sujet soit comme un objet. Le premier cas<br />
correspond à la construction transitive (avec un verbe à plus d'un argum<strong>en</strong>t) ou à la<br />
construction inergative (avec un verbe avec un seul argum<strong>en</strong>t GN) ; le second correspond à<br />
la construction inaccusative 3 . Dans le premier cas, le GN réalisant le premier argum<strong>en</strong>t a<br />
les propriétés caractéristiques du sujet ; dans le second, il a les propriétés caractéristiques<br />
<strong>de</strong> l'objet (c'est-à-dire les mêmes propriétés que l'objet d'un verbe transitif). J'illustre ce<br />
point avec le français.<br />
La construction inaccusative du premier argum<strong>en</strong>t est bi<strong>en</strong> connue pour l'itali<strong>en</strong> (<strong>en</strong>tre<br />
autres, Perlmutter 1983, Burzio 1986, Belletti 1988). Il est moins connu que le français la<br />
prés<strong>en</strong>te égalem<strong>en</strong>t (Kampers-Manhe 1998, Marandin 2001). On la r<strong>en</strong>contre<br />
ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t dans <strong>de</strong>ux contextes, la complétive au subjonctif et la phrase racine :<br />
(1) F a. Je voudrais que vi<strong>en</strong>ne Marie.<br />
b. Alors sont arrivés trois hommes <strong>en</strong> armes.<br />
La famille <strong>de</strong> verbes qui autoris<strong>en</strong>t cette construction <strong>en</strong> français ne peut être caractérisée<br />
que sémantiquem<strong>en</strong>t (la sélection <strong>de</strong> l'auxiliaire être n'est pas un critère <strong>de</strong> la construction<br />
inaccusative <strong>en</strong> français à la différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l'itali<strong>en</strong>) : ils dénot<strong>en</strong>t une relation non ag<strong>en</strong>tive<br />
(le premier argum<strong>en</strong>t n'est pas un ag<strong>en</strong>t). Dans la construction inaccusative, le GN<br />
réalisant le premier argum<strong>en</strong>t a les propriétés d'un objet. Les propriétés diagnostiques <strong>de</strong><br />
l'objet sont rec<strong>en</strong>sées pour le français dans Abeillé (1997) et systématiquem<strong>en</strong>t exploitées<br />
dans Bonami et Godard (2001), Bonami et al. (2001) : l'objet est le seul constituant à<br />
requérir la cliticisation <strong>de</strong> <strong>en</strong> sur le verbe lorsqu'il est indéfini et à pouvoir pr<strong>en</strong>dre la forme<br />
2 Cette notion recouvre dans la plupart <strong>de</strong>s cas celle <strong>de</strong> sujet logique <strong>de</strong> la tradition. Mais pas toujours,<br />
tout dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> l'analyse que l'on donne du pronom dit explétif dans la construction impersonnelle (par<br />
exemple : il est v<strong>en</strong>u trois hommes ce matin).<br />
3 J’adopte ici l’approche constructionnelle proposée par Dini 1995.<br />
2
<strong>de</strong> N dans un contexte négatif 4 . Le paradigme (2) illustre ces propriétés avec l'objet d'un<br />
verbe transitif et (3) avec l'objet d'un verbe inaccusatif :<br />
(2) F a. [<strong>de</strong>s chi<strong>en</strong>s] J'<strong>en</strong> ai vu trois / * J'ai vu trois.<br />
b. Je n'ai pas vu <strong>de</strong> chi<strong>en</strong>.<br />
(3) Fa. [Des chi<strong>en</strong>s] Alors <strong>en</strong> sont <strong>en</strong>trés trois autres. / * Alors sont <strong>en</strong>trés trois<br />
autres.<br />
a'. [Des plombiers]. Je voudrais qu'<strong>en</strong> vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t trois autres. / * Je voudrais<br />
que vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t trois autres.<br />
b. Je regrette que ne vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t plus d'étudiants.<br />
b'. [On <strong>en</strong>ferma les sectateurs.] Alors n'apparur<strong>en</strong>t plus <strong>de</strong> signes<br />
prophétiques.<br />
Si on admet une notion <strong>de</strong> réalisation canonique, l'inversion du sujet est non canonique au<br />
regard <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong>s constituants dans les langues qui compt<strong>en</strong>t le placem<strong>en</strong>t préverbal au<br />
titre <strong>de</strong>s propriétés différ<strong>en</strong>tielles du sujet. C'est le cas <strong>en</strong> français et <strong>en</strong> itali<strong>en</strong>, c'est <strong>en</strong><br />
débat pour l'espagnol, le portugais et le catalan 5 . La construction inaccusative est non<br />
canonique au regard <strong>de</strong> l'association <strong>en</strong>tre argum<strong>en</strong>ts et fonctions <strong>en</strong> ce que le premier<br />
argum<strong>en</strong>t est réalisé comme un objet.<br />
Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> lisibilité, je continuerai à employer le terme inversion au s<strong>en</strong>s <strong>de</strong><br />
placem<strong>en</strong>t postverbal du premier argum<strong>en</strong>t du verbe. Lorsque le statut fonctionnel du<br />
constituant réalisant le premier argum<strong>en</strong>t sera pertin<strong>en</strong>t, j'emploierai les termes inversion<br />
du GN sujet ou construction inaccusative.<br />
1.2. Inversion libre et inversion prés<strong>en</strong>tative<br />
Je prés<strong>en</strong>te <strong>de</strong>ux cas <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t postverbal du premier argum<strong>en</strong>t communs aux langues<br />
romanes, mis à part le français. Le critère d'id<strong>en</strong>tification, repris à la littérature, n'est pas<br />
syntaxique : il est informationnel dans l'inversion libre, et lexical dans l'inversion<br />
prés<strong>en</strong>tative.<br />
1.2.1. L'inversion libre<br />
L'inversion libre s'observe dans une phrase racine <strong>en</strong> réponse à une question <strong>en</strong> qui 6 . Le<br />
GN postverbal est étroitem<strong>en</strong>t focalisé :<br />
(4) Qui a mangé la pomme ?<br />
C Se l'ha m<strong>en</strong>jat la Maria.<br />
E Se la comió María.<br />
I L'ha mangiata Maria.<br />
P Comeu-a a Maria.<br />
Marie l'a mangée<br />
La propriété caractéristique <strong>de</strong> cette inversion est que le GN sujet se trouve <strong>de</strong> façon<br />
obligatoire sur la frontière droite <strong>de</strong> l'énoncé. Le contraste (5) illustre la propriété <strong>en</strong><br />
espagnol :<br />
(5) Qui t'a donné la bouteille <strong>de</strong> vin ?<br />
Ea. Me regaló la botella <strong>de</strong> vino María.<br />
b. * Me regaló María la botella <strong>de</strong> vino. (= ex. 77, Z.: 126)<br />
Marie m'a donné la bouteille <strong>de</strong> vin<br />
4 Le GN attribut peut être associé au clitique <strong>en</strong> (Un grand avocat, c'<strong>en</strong> est un) mais ne pr<strong>en</strong>d pas la forme<br />
<strong>de</strong> N (* Pierre n'est pas d'avocat) ; le sujet inversé peut pr<strong>en</strong>dre la forme "<strong>de</strong> N" (une maison où ne dort pas<br />
d'<strong>en</strong>fant), mais n'est jamais associé à <strong>en</strong> (* les chi<strong>en</strong>s qu'<strong>en</strong> vir<strong>en</strong>t trois).<br />
5 Voir Ambar 1998, Suñer 2001, Vallduví 1993, Zubizarreta 1998, <strong>en</strong>tre autres.<br />
6 L'étiquette inversion libre n'est pas <strong>de</strong>s plus heureuses. Libre s'interprète comme non soumise à une<br />
contrainte <strong>de</strong> légitimation syntaxique (à la différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l'inversion stylistique du français par exemple).<br />
3
Les quatre langues prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ces que je ne peux étudier <strong>en</strong> détail dans cette<br />
étu<strong>de</strong>. Par exemple, le portugais autorise la réalisation préverbale <strong>de</strong> l'objet (6) 7 :<br />
(6) Qui a mangé le gâteau ?<br />
P Meta<strong>de</strong> comeu a Maria, o resto não sei.<br />
La moitié a mangé Maria, le reste je ne sais pas<br />
Marie <strong>en</strong> a mangé la moitié, le reste, je ne sais pas.<br />
L'espagnol autorise la réalisation postverbale <strong>de</strong> l'objet, l'itali<strong>en</strong> l'admet sous condition<br />
(l'itali<strong>en</strong> préfère la cliticisation). Le phénomène est illustré <strong>en</strong> (7) 8 :<br />
(7) Qui a mangé la pomme ?<br />
I a) ? ha mangiato la mela Gianni.<br />
b) L'ha mangiata Gianni. (= ex. 108, Z: 135)<br />
E Ha comido la manzana Juan. (= ex. 109, Z: 135)<br />
La notion d'inversion libre recouvre donc <strong>de</strong>s constructions ayant <strong>de</strong>s propriétés<br />
différ<strong>en</strong>tes selon les langues (voir par exemple Zubizarreta 1998 qui donne une analyse<br />
comparée <strong>de</strong> l'itali<strong>en</strong> et <strong>de</strong> l'espagnol). De plus, elle ne distingue pas <strong>en</strong>tre construction<br />
inergative / transitive et construction inaccusative dans ce contexte. Les exemples <strong>de</strong><br />
l'itali<strong>en</strong> <strong>en</strong> (8) illustr<strong>en</strong>t ce point :<br />
(8) I a. Chi ha pianto ? (= ex 7, P: 17)<br />
Ha pianto Beatrice.<br />
Béatrice a pleuré<br />
b. Chi è arrivato ? (= ex 8, P: 18)<br />
E' arrivato Dante.<br />
Dante est arrivé<br />
1.2.2. L'inversion prés<strong>en</strong>tative<br />
L'inversion que j'appelle prés<strong>en</strong>tative 9 s'observe avec une famille <strong>de</strong> verbes que l'on<br />
appelle verbes prés<strong>en</strong>tatifs (Hatcher 1956) ou verbes d'exist<strong>en</strong>ce ou d'apparition<br />
dynamique (Exist<strong>en</strong>z-Verb<strong>en</strong> und Verb<strong>en</strong> <strong>de</strong>s In-Erscheinung-Tret<strong>en</strong>s, Wehr (1984 : 6)).<br />
On la r<strong>en</strong>contre dans trois types <strong>de</strong> contexte : dans les réponses à une question du type<br />
qu'est-ce qui se passe ? (9), dans les énoncés d'annonce réalisés hors <strong>de</strong> tout contexte<br />
conversationnel (10) et dans le discours suivi (11) ; (11) est un exemple <strong>de</strong> récit oral :<br />
(9) Qu'est-ce qu'il y a ?<br />
C Toqu<strong>en</strong> les campanes.<br />
E Están tocando las campanas.<br />
P Estão a tocar os sinos<br />
I. Suona il campanello.<br />
Les cloches sonn<strong>en</strong>t<br />
(10) I a. E' morto Gianni !<br />
b. Ha telefonato Gianni !<br />
7 Je repr<strong>en</strong>ds l'observation à Ambar 1999. Les informateurs jug<strong>en</strong>t l'illustration donnée par Ambar (i) ci<strong>de</strong>ssous<br />
mal formée. J'avancerai une explication au §5.2.3.<br />
(i) P Quem comeu a tarte?<br />
A tarte comeu a Joana (= ex. 7.b, A: 27)<br />
8 Le contraste itali<strong>en</strong> (7.i/ii) est dû à Rizzi (Rizzi 1991: 19). Zubizarreta (ibid.: 135) le rapporte à une<br />
contrainte d’ordre prosodique (la lour<strong>de</strong>ur relative du groupe “ verbe +dép<strong>en</strong>dants ” et du GN sujet).<br />
9 Il n'y a pas <strong>de</strong> terme vraim<strong>en</strong>t reçu pour ce type d'inversion. Le terme prés<strong>en</strong>tatif est repris à Hetzron<br />
(1975: 374), cité dans Lambrecht (1994: 177).<br />
4
11) I [ha <strong>de</strong>tto lei / eh può darsi che è sucesso così /comunque ci siamo chiariti /<br />
alla fine ho capito / vabbè / alla fine ti sei confusa /] è <strong>en</strong>trato il marito / ha <strong>de</strong>tto /<br />
no / è stato meglio così (= ex 26, S : 47)<br />
Elle a dit / peut-être que ça s'est passé comme ça / <strong>de</strong> toute façon on s'est<br />
expliqué / à la fin j'ai compris / bon / à la fin tu t'es embrouillée / son mari est<br />
<strong>en</strong>tré / il a dit / non / ç'est mieux comme ça<br />
L'inversion prés<strong>en</strong>tative n'affecte que <strong>de</strong>s verbes intransitifs (c'est-à-dire <strong>de</strong>s verbes qui<br />
n'ont qu'un seul argum<strong>en</strong>t GN). Son analyse pose <strong>de</strong>ux problèmes : (a) la caractérisation<br />
<strong>de</strong> la famille <strong>de</strong> verbes qui l'autoris<strong>en</strong>t et (b) son analyse syntaxique 10 . Est-elle limitée aux<br />
seuls verbes inaccusatifs ? Est-elle toujours une instance <strong>de</strong> construction inaccusative ?<br />
Selon Pinto 1997, l'inversion prés<strong>en</strong>tative est possible avec <strong>de</strong>s verbes réputés inergatifs (et<br />
prés<strong>en</strong>tant la propriété distinctive d'une construction inergative <strong>en</strong> itali<strong>en</strong> : l'auxiliaire avoir)<br />
(12.b). Par ailleurs, elle n'est pas possible avec tous les verbes qui autoris<strong>en</strong>t la<br />
construction inaccusative ((12.c) et (12.d)). Je repr<strong>en</strong>ds les données <strong>de</strong> Pinto dans les<br />
réponses à focalisation large 11 :<br />
(12) I Che cosa è sucesso ?<br />
Que s'est-il passé ?<br />
a. E' <strong>en</strong>trata Beatrice. (= ex. 12, P: 20)<br />
Béatrice est <strong>en</strong>trée<br />
b. Ha telefonato Dante. (= ex. 17, P: 22)<br />
Dante a téléphoné<br />
c. # E' impallidito Berlusconi.(= ex. 13, P: 20)<br />
Berlusconi a pâli<br />
d. # Si è stufata P<strong>en</strong>elope. (id.)<br />
Pénélope s'est <strong>en</strong>nuyée<br />
On rapprochera (12) <strong>de</strong> (8) ci-<strong>de</strong>ssus : la distinction <strong>en</strong>tre inversion libre et inversion<br />
prés<strong>en</strong>tative ne recoupe pas l'opposition <strong>en</strong>tre construction inergative et construction<br />
inaccusative <strong>en</strong> itali<strong>en</strong>. Il n'est donc pas possible d'associer l'inversion prés<strong>en</strong>tative à la<br />
construction inaccusative <strong>en</strong> toute généralité, même s'il y a une forte affinité <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux.<br />
La caractérisation sémantique <strong>de</strong> ce type d'inversion a fait l'objet <strong>de</strong> nombreux travaux<br />
<strong>de</strong>scriptifs. Hatcher 1956 reste un <strong>de</strong>s plus complets. Sur la base d'une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> corpus <strong>en</strong><br />
espagnol, elle rec<strong>en</strong>se sept groupes <strong>de</strong> verbes qui l’autoris<strong>en</strong>t (ibid: 8-11) 12 . Je donne<br />
quelques exemples <strong>en</strong> traduction française, afin <strong>de</strong> montrer que ce sont s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t les<br />
mêmes verbes que l'on retrouve dans les langues considérées 13 :<br />
(13) exist<strong>en</strong>ce-prés<strong>en</strong>ce : exister, se r<strong>en</strong>contrer, se trouver, avoir lieu<br />
abs<strong>en</strong>ce : manquer<br />
comm<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>t : comm<strong>en</strong>cer<br />
continuation : suivre, rester, continuer, <strong>de</strong>meurer<br />
production : naître, se produire, croître<br />
occurr<strong>en</strong>ce : se passer, arriver<br />
apparition : apparaître, émerger<br />
mouvem<strong>en</strong>t vers un lieu (coming) : v<strong>en</strong>ir, <strong>en</strong>trer, arriver, s'interposer, suivre<br />
10 Les <strong>de</strong>ux problèmes se recoup<strong>en</strong>t dans les cadres qui ont une approche lexicale <strong>de</strong> l'inaccusativité. Ils ne<br />
se recoup<strong>en</strong>t pas nécessairem<strong>en</strong>t dans l'approche constructionnelle que j'ai adoptée pour prés<strong>en</strong>ter la<br />
construction inaccusative au §1.1.<br />
11 "All verbs allow subject inversion with the narrow focus reading of the subject. Wh<strong>en</strong> focus involves<br />
the whole clause (wi<strong>de</strong> focus), only certain verbs allow inversion" (Pinto, id.: 120).<br />
12 Pour un classem<strong>en</strong>t similaire <strong>en</strong> itali<strong>en</strong>, voir Bernini (ibid.: 55) ou Wandruszka 1982, cité dans Bernini<br />
(ibid.: 57).<br />
13 Ce sont les verbes qu'on retrouve dans la construction inaccusative du français, <strong>en</strong> particulier dans la<br />
complétive à sujet inversé au subjonctif (Marandin 2000).<br />
5
La question est <strong>de</strong> savoir si on peut isoler une propriété <strong>de</strong> nature lexicale commune à<br />
l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> verbes énumérés <strong>en</strong> (13). De ce point <strong>de</strong> vue, il est remarquable<br />
que toutes les t<strong>en</strong>tatives aboutiss<strong>en</strong>t au même constat : l'impossibilité <strong>de</strong> cerner sur une<br />
base lexicale (le type référ<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> la propriété dénotée par le verbe) la classe légitimant<br />
cette inversion. Elles finiss<strong>en</strong>t toutes, plus ou moins explicitem<strong>en</strong>t, par glisser d'une<br />
caractérisation purem<strong>en</strong>t lexicale à une glose qui porte sur l'énoncé tout <strong>en</strong>tier où apparaît<br />
ce type d'inversion. C'est par exemple le cas <strong>de</strong> Hatcher 1956 : “ les verbes nous dis<strong>en</strong>t<br />
seulem<strong>en</strong>t ou principalem<strong>en</strong>t que le [référ<strong>en</strong>t du] sujet existe ou est prés<strong>en</strong>t, comm<strong>en</strong>ce,<br />
continue ” (Hatcher 1956: 7, cité dans Wehr ibid.: 53; j'ajoute la précision <strong>en</strong>tre crochets).<br />
On peut néanmoins avancer <strong>de</strong>ux généralisations empiriques. Les verbes qui <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t dans<br />
l'inversion prés<strong>en</strong>tative sont faiblem<strong>en</strong>t ag<strong>en</strong>tifs ou non ag<strong>en</strong>tifs (d'où l'affinité avec la<br />
construction inaccusative) 14 . D'autre part, on peut distinguer <strong>de</strong>ux classes d'énoncés où<br />
apparaît cette inversion. La première se caractérise par une relation étroite <strong>en</strong>tre le verbe et<br />
le premier argum<strong>en</strong>t (semantic solidarity selon un terme repris à Coseriu 1967, cité dans<br />
Bernini (ibid.: 56)) : la propriété dénotée par le verbe est stéréotypique du sujet.<br />
J'appellerai ce cas, par conv<strong>en</strong>tion, énoncé à verbe stéréotypique (14) :<br />
(14) I a. Suonavano le campane.<br />
Les cloches sonnai<strong>en</strong>t<br />
b. Abbaiavano i cani.<br />
Les chi<strong>en</strong>s aboyai<strong>en</strong>t<br />
La secon<strong>de</strong> met <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s verbes <strong>de</strong> mouvem<strong>en</strong>t décrivant une apparition/disparition dans<br />
un lieu. J'appellerai ce cas, par conv<strong>en</strong>tion, énoncé à verbe d'apparition/disparition (15) 15 :<br />
(15) I E' <strong>en</strong>trato il marito.<br />
E Llega el tr<strong>en</strong>.<br />
Le train arrive<br />
L'analyse que je donnerai au §6 <strong>de</strong> l'inversion prés<strong>en</strong>tative repr<strong>en</strong>dra cette distinction <strong>en</strong><br />
<strong>de</strong>ux classes d'énoncés ; j'unifierai leur analyse sur une base non lexicale.<br />
1.3. L'ordre emphatique <strong>de</strong> l'espagnol<br />
Contreras 1976 distingue <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t postverbal du sujet <strong>en</strong> espagnol :<br />
l'inversion libre et l'ordre emphatique (je repr<strong>en</strong>ds ce terme à défaut d'un autre un peu<br />
moins marqué). L'ordre emphatique s'observe dans le cas où un dép<strong>en</strong>dant du verbe est<br />
réalisé <strong>en</strong> position préverbale (position distincte d'une position <strong>de</strong> dislocation gauche) et<br />
porteur d'un acc<strong>en</strong>t. Pour Contreras, le constituant préverbal est focalisé ; pour Zubizarreta,<br />
il est focalisé ou emphatique (ibid.: 118) 16 . Le tour est illustré <strong>en</strong> (16) et (17) avec un<br />
constituant préverbal étroitem<strong>en</strong>t focalisé : un GN objet (eso mismo <strong>en</strong> (16)) et un GP (<strong>de</strong><br />
la sala <strong>en</strong> (17)) 17 :<br />
(16) Qu'as-tu fait ?<br />
EEso MISMO hice yo. (= ex (10.9), C.: 90)<br />
cela même fis je<br />
14 Dans la lignée d'Hetzron 1975, Lambrecht 1994 associe ce trait à une construction prés<strong>en</strong>tative (ibid.:<br />
180). "There is an upper limit to the <strong>de</strong>gree of ag<strong>en</strong>tivity a predicate can have to be exploitable as<br />
pres<strong>en</strong>tational and thus to be able to appear with pres<strong>en</strong>tational syntax or prosody" (ibid.: 181).<br />
15 Certains énoncés sont mixtes ; le verbe d'apparition/disparition est spécifique d'un type <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>t :<br />
(i) I Si alza il sole. Cala il v<strong>en</strong>to.<br />
Trad.: le soleil se lève, le v<strong>en</strong>t tombe<br />
16 Zubizarreta ne définit pas la notion d'emphase. Selon Contreras, cette construction est limitée à la<br />
phrase racine (ibid.: 89). Zubizarreta (ibid.) distingue <strong>de</strong>ux marquages prosodiques distincts selon que le<br />
constituant focalisé est postverbal ou préverbal.<br />
17 Cette construction est possible avec un sujet étroitem<strong>en</strong>t focalisé :<br />
(i) Qui a retiré ses éperons <strong>de</strong> la salle ?<br />
E Don FERMíN sacó sus espalas <strong>de</strong> la sala (= ex (10.20), C.: 91)<br />
6
Trad.: J'ai fait la même chose<br />
(17) D'où est-ce que don Fermín a retiré ses éperons ?<br />
Ea. De la SALA sacó don Fermín sus espuelas.<br />
<strong>de</strong> la salle a retiré don Firmín ses éperons<br />
b. De la SALA sacó sus espuelas don Fermín. (= ex (10.12), C: 90)<br />
Trad.: Don Fermín a retiré ses éperons <strong>de</strong> la salle<br />
Comme le montre la paire (17.a)/(17.b), le sujet n'a pas <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t fixe dans le domaine<br />
postverbal (Contreras, id.: 90), ce qui constitue une propriété discriminant l'ordre<br />
emphatique et l'inversion libre.<br />
1.4. Les inversions du français<br />
Le français connaît <strong>de</strong>ux cas d'inversion du sujet : l'inversion stylistique (terme forgé par<br />
Kayne 1973) et l'inversion élaborative. Elles se distingu<strong>en</strong>t nettem<strong>en</strong>t au plan syntaxique.<br />
L'inversion stylistique n'est syntaxiquem<strong>en</strong>t légitime que dans les contextes d'extraction<br />
(interrogative qu, relative, coda <strong>de</strong> clivée, topicalisation <strong>de</strong> GP) 18 . Lorsque la contrainte <strong>de</strong><br />
légitimation est vérifiée, l'inversion est attestée dans la phrase racine du français, à savoir<br />
les interrogatives directes (18.a) et les phrases avec topicalisation <strong>de</strong> GP (18.b/c) :<br />
(18) F a. A qui a parlé Paul ?<br />
b. A Paul est rev<strong>en</strong>u le premier prix.<br />
c. Sur la place se dresse une cathédrale.<br />
Bonami et al. 2001 montr<strong>en</strong>t que le GN sujet prés<strong>en</strong>te toutes les propriétés du sujet<br />
préverbal dans cette construction. Ils montr<strong>en</strong>t aussi que le sujet ne connaît pas <strong>de</strong><br />
placem<strong>en</strong>t fixe dans le domaine postverbal ; <strong>de</strong> plus, on observe dans cette construction un<br />
cas unique (<strong>en</strong> français) <strong>de</strong> scrambling <strong>en</strong>tre le sujet et les dép<strong>en</strong>dants <strong>de</strong> l'infinitif<br />
complém<strong>en</strong>t. Dans (19), repris à Bonami & Godard 2001, le GN sujet le professeur <strong>de</strong><br />
philosophie peut apparaître à l'extérieur du GV complém<strong>en</strong>t <strong>de</strong> vouloir (19.a) ou bi<strong>en</strong> mêlé<br />
aux constituants <strong>de</strong> ce GV (19.b/c) 19 :<br />
(19) Fa. le livre que veut recomman<strong>de</strong>r à ses étudiants pour l'exam<strong>en</strong> le<br />
professeur <strong>de</strong> philosophie<br />
b. le livre que veut recomman<strong>de</strong>r à ses étudiants le professeur <strong>de</strong><br />
philosophie pour l'exam<strong>en</strong><br />
c. le livre que veut recomman<strong>de</strong>r le professeur <strong>de</strong> philosophie à ses<br />
étudiants pour l'exam<strong>en</strong><br />
Le français connaît un autre type d'inversion que j'appelle inversion élaborative. Elle se<br />
r<strong>en</strong>contre dans la phrase matrice et dans la subordonnée. Elle se distingue d'un cas<br />
18 Une autre contrainte pèse sur l'inversion stylistique : elle met <strong>en</strong> jeu le type du complém<strong>en</strong>t extrait et<br />
celui du ou <strong>de</strong>s complém<strong>en</strong>ts canoniques réalisés dans la phrase (Korz<strong>en</strong> 1983). Je l'illustre sous (i) et (ii)<br />
ci-<strong>de</strong>ssous. L'analyse <strong>de</strong> cette contrainte reste un problème ouvert (Korz<strong>en</strong> 1983 et 1992, Kayne 1986).<br />
(i) F a. le ca<strong>de</strong>au qu'a <strong>en</strong>voyé Jean à Marie<br />
b. * le jour où a écrit Jean à Marie<br />
(ii) F a. la fille <strong>de</strong> qui s'est plaint Jean à Marie<br />
b. * la fille à qui s'est plaint Jean <strong>de</strong> Marie<br />
19 On notera que l'ordre emphatique <strong>de</strong> l'espagnol prés<strong>en</strong>te le même comportem<strong>en</strong>t :<br />
(i) E El esbozo quiere recom<strong>en</strong>dar María a sus estudiantes para el exam<strong>en</strong>.<br />
El esbozo quiere recom<strong>en</strong>dar a sus estudiantes María para el exam<strong>en</strong>.<br />
El esbozo quiere recom<strong>en</strong>dar a sus estudiantes para el exam<strong>en</strong> María;<br />
Le professeur <strong>de</strong> linguistique veut recomman<strong>de</strong>r L'Esquisse à ses étudiants pour l'exam<strong>en</strong>.<br />
Costa 2000 signale le phénomène dans les interrogatives du portugais :<br />
(ii) P a. A quem tinha o João estado a dizer que vai <strong>de</strong> férias ?<br />
b. A quem tinha estado a dizer o João que vai <strong>de</strong> férias ?<br />
c. A quem tinha estado o João a dizer que vai <strong>de</strong> férias ?<br />
A qui João a-t-il dit qu’il irait <strong>en</strong> vacance<br />
7
classique d'inversion <strong>de</strong> GN lourd <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>tant une contrainte qui ne se réduit pas à la<br />
seule lour<strong>de</strong>ur phonologique ou à la complexité syntagmatique. J'illustre cette propriété <strong>en</strong><br />
(20). Le GN lourd l'élève <strong>de</strong> troisième C qui a été surpris (…) hier soir ne légitime pas<br />
l'inversion <strong>en</strong> (20.a) à la différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s GN <strong>de</strong> (20.b/c). L'inversion élaborative n'est jamais<br />
appropriée avec un GN dénotant un particulier singulier ; elle met <strong>en</strong> jeu une contrainte <strong>de</strong><br />
pluralité sémantique que je ne précise pas ici :<br />
(20) Fa. ?? Passera <strong>de</strong>vant le conseil <strong>de</strong> discipline l'élève <strong>de</strong> troisième C qui a<br />
été surpris <strong>en</strong> train <strong>de</strong> fumer un joint dans les toilettes <strong>de</strong> la cour hier<br />
soir.<br />
b. Passeront <strong>de</strong>vant le conseil <strong>de</strong> discipline les élèves suivants : Pierre<br />
Dupond, Marie Dubois et Paul Personne.<br />
c. Passera <strong>de</strong>vant le conseil <strong>de</strong> discipline tout élève <strong>de</strong> l'établissem<strong>en</strong>t au<br />
comportem<strong>en</strong>t incivil.<br />
Les <strong>de</strong>ux principales caractéristiques qui distingu<strong>en</strong>t l'inversion élaborative <strong>de</strong> l'inversion<br />
stylistique sont les suivantes : l'inversion élaborative autorise l'occurr<strong>en</strong>ce d'un GN objet<br />
(21) et elle requiert le placem<strong>en</strong>t obligatoire du GN sujet sur la frontière droite <strong>de</strong> l'énoncé<br />
(22). Ce <strong>de</strong>rnier trait rapproche l'inversion élaborative du français <strong>de</strong> l'inversion libre (cf.<br />
(5) ci-<strong>de</strong>ssus) :<br />
(21) Fa. * Voici le jour où r<strong>en</strong>dront un <strong>de</strong>voir supplém<strong>en</strong>taire les élèves qui ont<br />
raté l'exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> chimie n'est pas arrivé.<br />
b. R<strong>en</strong>dront un <strong>de</strong>voir les élèves qui ont raté l'exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> chimie.<br />
(22) Fa. Iront <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce tous les élèves <strong>de</strong> 3ème C (qui ont raté le contrôle<br />
<strong>de</strong> physique).<br />
b. * Iront tous les élèves <strong>de</strong> 3ème C (qui ont raté le contrôle <strong>de</strong> physique)<br />
<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce.<br />
2. Le placem<strong>en</strong>t du sujet et l'articulation fond-focus<br />
L'hypothèse la plus couramm<strong>en</strong>t admise est que l'inversion est liée à l'articulation fondfocus<br />
<strong>de</strong> l'énoncé. Elle reçoit ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ux formulations ; la première est formulée<br />
dans l'approche dite Gouvernem<strong>en</strong>t et Liage (GB) ou Principes et paramètres (PP) :<br />
(1) L'inversion est obligatoire quand le sujet est étroitem<strong>en</strong>t focalisé.<br />
La secon<strong>de</strong> est partagée par les cadres pragmatiques (je l'exprime <strong>en</strong> empruntant la<br />
terminologie <strong>de</strong> Lambrecht 1994) :<br />
(2) a. L'inversion est interdite dans une articulation à focalisation sur le prédicat<br />
(Predicate Focus).<br />
b. L'inversion est possible dans une articulation à focalisation sur un argum<strong>en</strong>t<br />
(Argum<strong>en</strong>t Focus).<br />
c. L'inversion est possible dans une articulation à focalisation sur la phrase (S<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce<br />
Focus).<br />
Dans le cadre GB / PP, la généralisation (1) a pour domaine d’application l’inversion libre<br />
(cf. §.1.2.1) ; l’analyse informationnelle <strong>de</strong>s autres cas d’inversion n'a pas fait l'objet d'une<br />
analyse systématique dans ce cadre. De manière générale, la généralisation (1) peut être<br />
vue comme un cas particulier <strong>de</strong> (2.b) <strong>en</strong> ce qu’elle distingue l’argum<strong>en</strong>t réalisé comme le<br />
sujet. Dans cette section, j’examine (1) et (2) pour elles-mêmes indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du cadre<br />
théorique où elles sont acceptées.<br />
Je mainti<strong>en</strong>s dans ce paragraphe la définition commune <strong>de</strong>s notions <strong>de</strong> fond et <strong>de</strong> focus :<br />
le constituant focus est le constituant qui apporte une information nouvelle, alors que le ou<br />
les constituants constitutifs du fond repr<strong>en</strong>d ou repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une information dans le<br />
8
contexte (cette information est dite présupposée pragmatiquem<strong>en</strong>t) 20 . Deux questions se<br />
pos<strong>en</strong>t : la première porte sur la vérité <strong>de</strong>s généralisations (1) et (2) et la secon<strong>de</strong> sur leur<br />
adéquation <strong>de</strong>scriptive. A l’horizon se pose une question plus générale : est-ce que<br />
l’inversion est liée à l’articulation fond-focus, c’est-à-dire au partage du cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong><br />
l’énoncé <strong>en</strong> cont<strong>en</strong>u nouveau et cont<strong>en</strong>u anci<strong>en</strong>, que l’on conçoive l’inversion comme un<br />
effet <strong>de</strong> ce partage ou bi<strong>en</strong> comme sa marque ?<br />
2.1. Inversion libre prototypique<br />
La généralisation (1) est vérifiée dans les exemples prototypiques d'inversion libre dans les<br />
réponses à une question <strong>en</strong> qui :<br />
(3) Qui a mangé la pomme ?<br />
C Se l'ha m<strong>en</strong>jat la Maria.<br />
E Se la comió María.<br />
I L'ha mangiata Maria.<br />
P Comeu-a a Maria.<br />
F * L'a mangé Marie<br />
Marie l'a mangée<br />
Dans (3.C, E, I, P), le constituant Marie apporte l’information nouvelle et reçoit la marque<br />
prosodique du focus : l’acc<strong>en</strong>t proémin<strong>en</strong>t dans la phrase 21 . En (3.F), le constituant<br />
Marie apporte l'information nouvelle et reçoit la marque du focus spécifique du français :<br />
le ton <strong>de</strong> frontière (boundary tone) associé à l’assertion (L%) (Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002a, b).<br />
Il ne peut pourtant pas être postverbal : le français doit donc être exclu du champ<br />
d’application <strong>de</strong> (1). On admet que l’agrammaticalité <strong>de</strong> (3.F) a une étiologie syntaxique :<br />
l'inversion n'est pas légitimée dans la phrase racine canonique du français 22 . L’explication<br />
doit être raffinée : l’inversion stylistique est agrammaticale alors que l’inversion<br />
élaborative est syntaxiquem<strong>en</strong>t licite et pragmatiquem<strong>en</strong>t appropriée dans une réponse à<br />
une question <strong>en</strong> qui avec focalisation étroite du GN sujet 23 :<br />
(4) F Qui a mangé <strong>de</strong>s pommes ?<br />
Ont mangé <strong>de</strong>s pommes tous ceux qui ont pu <strong>en</strong> acheter.<br />
La généralisation (1) étant vérifiée dans le contexte particulier <strong>de</strong> (3), on doit se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
si elle connaît <strong>de</strong>s contre-exemples dans les langues où elle s’applique.<br />
2.2. Inversion libre <strong>en</strong> portugais<br />
Ambar (1988,1999) note le contraste <strong>en</strong>tre (5) et (6) <strong>en</strong> portugais : le sujet doit être<br />
postverbal <strong>en</strong> (5), alors qu'il doit être préverbal <strong>en</strong> (6) bi<strong>en</strong> que, dans les <strong>de</strong>ux cas, la<br />
réponse soit une réponse appropriée à la question <strong>en</strong> qui :<br />
20 Dans les approches dynamiques (Vallduví 1991 par exemple), le constituant focal apporte le cont<strong>en</strong>u<br />
<strong>de</strong> la mise à jour du contexte(update) opérée par l’énoncé (déclaratif). Les définitions que je rappelle ici<br />
s’inscriv<strong>en</strong>t dans l’approche “ atomiste ” <strong>de</strong> l’information (“ the segm<strong>en</strong>tation view of information in<br />
which the information conveyed by a proposition is factored out and matched with individual s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce<br />
constitu<strong>en</strong>ts ” (Lambrecht, 1994: 49)).<br />
21 Les analyses dans le cadre GP / PP admett<strong>en</strong>t que le catalan, l'espagnol, l'itali<strong>en</strong> et le portugais<br />
connaiss<strong>en</strong>t une règle id<strong>en</strong>tique ou analogue à la règle prosodique <strong>de</strong> l’anglais connue sous le nom <strong>de</strong><br />
“ nuclear stress rule ” : le constituant le plus <strong>en</strong>châssé ou le plus à droite dans la phrase reçoit l’acc<strong>en</strong>t<br />
proémin<strong>en</strong>t. Elles admett<strong>en</strong>t que le placem<strong>en</strong>t postverbal du sujet est lié à cette règle : le sujet postverbal<br />
peut recevoir cet acc<strong>en</strong>t <strong>de</strong> par sa position.<br />
22 Cette étiologie peut être corrélée à la différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> marquage prosodique du focus : le placem<strong>en</strong>t du ton<br />
<strong>de</strong> frontière illocutoire n’est pas fixe <strong>en</strong> français.<br />
23 Le GN sujet dans cette configuration n'est pas prosodiquem<strong>en</strong>t détaché <strong>de</strong> la phrase intonative :<br />
l'intonème terminal assertif (qui est la marque du domaine focal <strong>en</strong> français) est réalisé sur la frontière<br />
droite du GN ou bi<strong>en</strong> sur sa tête (dans ce cas, les expansions droites sont réalisées prosodiquem<strong>en</strong>t comme<br />
une énumération). L'inversion élaborative ne prés<strong>en</strong>te donc pas les propriétés <strong>de</strong> la dislocation droite (que<br />
le français connaît par ailleurs : Ils sont v<strong>en</strong>us hier, les <strong>en</strong>fants). Je remercie Elizabeth Delais-Roussarie<br />
pour son ai<strong>de</strong> dans l'analyse intonative <strong>de</strong> ce type d'inversion.<br />
9
(5) PQuem comeu a tarte ?<br />
a. (A tarte) comeu a Joana .<br />
b. # A Joana comeu (a tarte). (= ex 7, A: 27)<br />
Joana a mangé le gâteau<br />
(6) Quem comeu a tarte ?<br />
a. # (A tarte) comeu a Joana (about the others I do not know).<br />
b. A Joana comeu (about the others I do not know). (= ex 8, A.: 27)<br />
Ambar 1999 décrit ce contraste à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la notion d'incomplétu<strong>de</strong> : une réponse complète<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> un sujet postverbal, une réponse incomplète requiert un sujet préverbal. Elle<br />
analyse l'opposition <strong>en</strong>tre complétu<strong>de</strong> et incomplétu<strong>de</strong> <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> focus exhaustif vs non<br />
exhaustif (ibid.: 27) : la réponse spécifie ou non l'<strong>en</strong>semble complet <strong>de</strong>s particuliers<br />
vérifiant le prédicat <strong>de</strong> la phrase. Dans cette analyse, la réponse à sujet postverbal <strong>en</strong><br />
portugais aurait une interprétation analogue à celle que l’on associe aux phrases clivées<br />
standards (<strong>de</strong> l'anglais ou du portugais selon Costa (1998: 240)). Si l'analyse est correcte,<br />
nous serions face à un trait particulier du portugais et l'on pourrait sauver la généralisation<br />
(1) <strong>en</strong> posant que l'inversion libre <strong>en</strong> portugais est décl<strong>en</strong>chée par la focalisation étroite du<br />
sujet, mais qu'elle n'est appropriée que dans le cas d'un focus exhaustif (focus<br />
id<strong>en</strong>tificationnel dans Kiss 1998).<br />
Deux indices conduis<strong>en</strong>t à douter <strong>de</strong> l’analyse d'Ambar. Tout d’abord, elle ne passe pas<br />
un <strong>de</strong>s tests reçus pour id<strong>en</strong>tifier le focus exhaustif : le test <strong>de</strong> Farkas (cité dans Kiss,<br />
1998: 251). Selon ce test, un énoncé négatif introduisant une nouvelle instanciation du<br />
focus est naturel à la suite d’un énoncé cont<strong>en</strong>ant un focus exhaustif, il ne l'est pas à la<br />
suite d’un énoncé cont<strong>en</strong>ant un focus non exhaustif. En effet, la négation <strong>en</strong>chaînant et<br />
contredisant l'implication d'exhaustivité ne peut pas être interprétée si l'énoncé ne<br />
décl<strong>en</strong>che pas cette implication. C’est par exemple le cas <strong>en</strong> (7) qui met <strong>en</strong> jeu un<br />
constituant syntaxiquem<strong>en</strong>t topicalisé <strong>en</strong> anglais où cette construction est associée à une<br />
lecture exhaustive :<br />
(7) A: A HAT, Mary picked for herself.<br />
B: # No, she picked for herself a coat, too.<br />
Or, l’<strong>en</strong>chaînem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Não, o Pedro também (non, Pedro aussi) est aussi naturel <strong>en</strong> (8.a)<br />
qu’<strong>en</strong> (8.b) :<br />
(8) P Quem comeu a tarte ?<br />
a. A : Comeu a Joana.<br />
B : Não, o Pedro também.<br />
b. A : A Joana comeu.<br />
B : Não, o Pedro também.<br />
Ensuite, Costa (1998: 237 et sq) montre que la position postverbale où peut se réaliser tout<br />
constituant étroitem<strong>en</strong>t focalisé n’est pas associée à la lecture exhaustive ; Costa le montre<br />
pour le constituant objet. Or, on ne voit pas comm<strong>en</strong>t le statut fonctionnel pourrait<br />
interférer <strong>en</strong> requérant une lecture exhaustive pour le GN sujet sans le faire égalem<strong>en</strong>t<br />
pour le GN objet.<br />
Si le recours à la notion <strong>de</strong> focus exhaustif ne permet pas d’analyser le contraste <strong>en</strong>tre (5)<br />
et (6), il faut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si un autre facteur que la focalisation étroite intervi<strong>en</strong>t dans<br />
l’appropriation <strong>de</strong> l’inversion <strong>en</strong> portugais. Je généralise l’observation afin <strong>de</strong> mettre ce<br />
contraste <strong>en</strong> perspective.<br />
2.3. Placem<strong>en</strong>t du sujet dans une réponse incomplète<br />
J'introduis une donnée qui, à ma connaissance, n'a jamais été discutée dans la littérature : le<br />
placem<strong>en</strong>t du sujet dans une réponse incomplète à une question <strong>en</strong> qui. En (9), le locuteur<br />
10
donne une réponse partielle : la question porte sur la personne qui a repeint la table et la<br />
réponse apporte une information sur la personne qui l'a poncée, le ponçage représ<strong>en</strong>tant<br />
une partie du procès global <strong>de</strong> peinture :<br />
(9) Qui a repeint la table ?<br />
C a. La Maria l'ha esmerilat. (..)<br />
b. # L'ha esmerilat la Maria.<br />
Ea. María la preparó. (..)<br />
b. # La preparó Maria.<br />
Ia. Maria l'ha levigato. (..)<br />
b. # L'ha levigato Maria.<br />
Pa. A Maria lixou-a. (..)<br />
b. # Lixou-a a Maria.<br />
Marie l'a poncée.<br />
Aucun informateur dans les langues considérées n'hésite <strong>en</strong> donnant une réponse à sujet<br />
préverbal et tous jug<strong>en</strong>t qu’une réponse avec un sujet postverbal serait inappropriée ; cette<br />
donnée a été maintes fois vérifiée.<br />
T<strong>en</strong>tons dans un premier temps <strong>de</strong> sauver la généralisation (1). Il est possible <strong>de</strong> dire que<br />
les réponses <strong>en</strong> (9) sont <strong>de</strong>s réponses à focalisation large (S<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce Focus dans la<br />
terminologie <strong>de</strong> Lambrecht). En effet, les constituants <strong>de</strong> (9), correspondant à Marie et à<br />
poncer la table, fourniss<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s informations nouvelles (relativem<strong>en</strong>t au contexte).<br />
Admettons cette analyse : les réponses <strong>en</strong> (9) tomb<strong>en</strong>t dès lors sous la généralisation (2.c).<br />
Cette généralisation établit que l’inversion est possible dans une phrase à focalisation large<br />
Or, le point ici est que le sujet doit être préverbal <strong>en</strong> (9), aussi sûrem<strong>en</strong>t qu'il doit être<br />
postverbal <strong>en</strong> (3). Sur ce fait, la généralisation (2.c) n’apporte aucun élém<strong>en</strong>t<br />
d’explication. En particulier, elle ne permet pas <strong>de</strong> capter la ressemblance <strong>en</strong>tre les<br />
réponses <strong>de</strong> (9) et la réponse <strong>en</strong> (6) où le sujet doit être préverbal : dans les <strong>de</strong>ux cas, il<br />
s’agit <strong>de</strong> réponses incomplètes. En effet, si on peut analyser les réponses <strong>de</strong> (9) comme<br />
<strong>de</strong>s énoncés à focalisation large, on ne peut pas adopter la même analyse pour la réponse a<br />
Joana comeu <strong>en</strong> (6) : la propriété comeu a tarte est reprise au contexte (elle n'est pas<br />
nouvelle).<br />
Nous sommes donc face à <strong>de</strong>ux problèmes : on ne peut pas décrire le placem<strong>en</strong>t préverbal<br />
obligatoire du sujet dans une réponse incomplète à une question <strong>en</strong> qui (9) et l’on ne peut<br />
pas dégager une analyse commune pour les réponses <strong>en</strong> (6) et (9). En particulier, on ne<br />
peut pas apprécier ce que recouvre le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> réponse incomplète dont font état les<br />
informateurs. Par ailleurs, le caractère trop général <strong>de</strong> la généralisation (2.c) apparaît<br />
nettem<strong>en</strong>t : elle établit une condition générale d'appropriation, mais elle ne permet pas <strong>de</strong><br />
spécifier les conditions précises du placem<strong>en</strong>t préverbal ou postverbal.<br />
2.4. Placem<strong>en</strong>t du sujet dans une phrase à focalisation sur un argum<strong>en</strong>t<br />
Selon la généralisation (2.b), la focalisation étroite d'un argum<strong>en</strong>t autorise le placem<strong>en</strong>t<br />
postverbal du sujet. L’illustration prototypique <strong>de</strong> cette généralisation nous est fournie par<br />
l'ordre emphatique <strong>de</strong> l'espagnol ; je repr<strong>en</strong>ds une <strong>de</strong>s illustrations <strong>de</strong> Contreras introduite<br />
au §1.3 :<br />
(10) D'où est-ce que don Fermín a retiré ses éperons ?<br />
EDe la SALA sacó don Fermín sus espuelas (= ex (10.12), C: 90)<br />
don Fermín a retiré ses éperons <strong>de</strong> la salle<br />
Mais, la généralisation (2.b) prés<strong>en</strong>te le même défaut que (2.c) : elle ne spécifie pas la<br />
condition précise <strong>de</strong> l'inversion. Or il y a clairem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s contextes où l'inversion n'est pas<br />
appropriée. C’est ce que montre le contraste <strong>en</strong>tre (11) et (12). En (11), le sujet peut être<br />
postverbal, alors qu’il doit être préverbal <strong>en</strong> (12) (cf. le contraste <strong>en</strong>tre (12.a) et (12.b)) :<br />
11
(11) E ¿ A quién le dió su carro María ?<br />
A qui Marie a-t-elle donné sa voiture ?<br />
A PABLO se lo dió (la probrecita)<br />
Elle / la pauvre l'a donnée à Pablo<br />
(12) E ¿ A quién le dió su carro María ?<br />
a. ?? A PABLO se lo prestó (la pobrecita).<br />
b. (La pobrecita) se lo prestó a Pablo.<br />
Elle / la pauvre l'a prêtée à Pablo<br />
La réponse <strong>en</strong> (12) ressemble aux réponses <strong>de</strong> (9) : elle ne repr<strong>en</strong>d pas le verbe <strong>de</strong> la<br />
question (donner vs prêter). On pourrait t<strong>en</strong>ter le même sauvetage que pour (9) <strong>en</strong> disant<br />
que la réponse <strong>en</strong> (11) est un énoncé à focalisation étroite sur un argum<strong>en</strong>t a Pablo et que<br />
la réponse <strong>en</strong> (12) est une phrase à focalisation large, puisque les constituants a Pablo et<br />
se lo prestó fourniss<strong>en</strong>t une information nouvelle. Ce n'est pas incorrect, mais que gagnet-on<br />
<strong>en</strong> proposant cette analyse ? Elle fait tomber (12) sous le coup <strong>de</strong> la généralisation<br />
(2.c). Or, (2.c) ne permet pas d’expliquer pourquoi le sujet doit être préverbal <strong>en</strong> (12). Par<br />
ailleurs, <strong>en</strong> se focalisant sur l’articulation fond-focus, on risque <strong>de</strong> laisser <strong>de</strong> côté un point<br />
commun <strong>en</strong>tre les réponses <strong>en</strong> (12) et (9) : dans les <strong>de</strong>ux cas, le verbe dans la réponse est<br />
différ<strong>en</strong>t du verbe dans la question. On notera que si l'exemple (12) ressemble à (9) sous<br />
le chef <strong>de</strong> la non-id<strong>en</strong>tité <strong>de</strong>s verbes, il ne ressemble pas à l'exemple (6) : <strong>en</strong> effet, (12) ne<br />
décl<strong>en</strong>che pas d’effet d’incomplétu<strong>de</strong>.<br />
Pour résumer, la généralisation (1) r<strong>en</strong>contre <strong>de</strong>s contre-exemples que le recours aux<br />
généralisations (2) ne permett<strong>en</strong>t pas d’éclairer. Par ailleurs, on a mis à jour <strong>de</strong>ux<br />
phénomènes qui pourrai<strong>en</strong>t interv<strong>en</strong>ir dans l’appropriation <strong>de</strong> l’inversion : le fait d’être<br />
une réponse incomplète et le fait pour une réponse d’introduire un verbe distinct <strong>de</strong> celui<br />
<strong>de</strong> la question. Ces <strong>de</strong>ux phénomènes, à première vue, ne se recoup<strong>en</strong>t pas ; il faut donc les<br />
analyser plus <strong>en</strong> détail. Qu’est-ce qui se cache <strong>de</strong>rrière l’effet d’incomplétu<strong>de</strong> et la<br />
modification <strong>de</strong> la question par la réponse ? Cela r<strong>en</strong>voie-t-il à un phénomène commun ?<br />
Peut-on trouver un facteur commun qui permettrait d’analyser <strong>en</strong>semble (par une même<br />
généralisation) le placem<strong>en</strong>t postverbal obligatoire <strong>en</strong> (3) et le placem<strong>en</strong>t préverbal<br />
obligatoire <strong>en</strong> (6), (9) et (12) ?<br />
2.5. Critique du socle empirique <strong>de</strong> la généralisation (1)<br />
Il faut rev<strong>en</strong>ir sur la généralisation (1) et se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si (3), qui constitue la principale<br />
(voire la seule) donnée qui la vali<strong>de</strong>, est suffisamm<strong>en</strong>t analysée. En effet, il n’est pas sûr<br />
du tout que la focalisation du sujet soit seule <strong>en</strong> jeu dans l’appropriation <strong>de</strong> l’inversion,<br />
puisqu’on vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> voir que d’autres facteurs que la focalisation pouvai<strong>en</strong>t interv<strong>en</strong>ir dans<br />
le placem<strong>en</strong>t préverbal obligatoire.<br />
Repr<strong>en</strong>ons un cas prototypique où s'observe l'inversion libre :<br />
(13) E a. ¿ Quién comió la manzana?<br />
b. Ha comido la manzana María.<br />
Cet échange conversationnel est tout à fait particulier. Tous les informateurs s'accord<strong>en</strong>t<br />
pour reconnaître que l'échange (13) est peu naturel et que la réponse att<strong>en</strong>due dans un<br />
contexte ordinaire est une réponse elliptique :<br />
(14) E a. ¿ Quién comió la manzana?<br />
b. María.<br />
L'observation pragmatique est importante, mais elle ne doit pas occulter un trait crucial <strong>de</strong><br />
l'échange (13) : la propriété ha comido la manzana est reprise au contexte (ce qui permet<br />
l'ellipse <strong>en</strong> (14)). Or, précisém<strong>en</strong>t, c'est dans les contextes où la propriété n’est pas reprise<br />
à la question, que l’on observe le placem<strong>en</strong>t préverbal obligatoire. C’est le cas <strong>en</strong> (9) et<br />
(12). Une hypothèse se prés<strong>en</strong>te donc : c’est le statut informationnel <strong>de</strong> la propriété<br />
12
dénotée par le verbe (le GV) qui est mis <strong>en</strong> jeu dans l’appropriation <strong>de</strong> l’inversion et non<br />
pas le statut du GN sujet. Mais, du coup, le contraste portugais (5)-(6) <strong>de</strong>meure<br />
mystérieux. Je repr<strong>en</strong>drai l’analyse <strong>de</strong>s données que je vi<strong>en</strong>s d’introduire au §5 après<br />
avoir montré au §3 qu'on ne peut <strong>en</strong> r<strong>en</strong>dre compte à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> topique.<br />
2.6. L'inversion dans les subordonnées<br />
Les analyses que je vi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ter conduis<strong>en</strong>t à disqualifier l’articulation fond-focus<br />
dans l’analyse <strong>de</strong> l’appropriation pragmatique <strong>de</strong> l’inversion : (a) la focalisation étroite du<br />
sujet ne suffit pas pour r<strong>en</strong>dre l'inversion appropriée (même dans l'inversion libre) et (b)<br />
les généralisations (2) rest<strong>en</strong>t muettes face aux contextes où s'observe le caractère<br />
obligatoire du placem<strong>en</strong>t préverbal. Je prés<strong>en</strong>te un <strong>de</strong>rnier argum<strong>en</strong>t général qui souti<strong>en</strong>t<br />
cette conclusion.<br />
2.6.1. L’inversion dans les subordonnées<br />
L’inversion s’observe dans les phrases subordonnées dans les cinq langues considérées.<br />
J’illustre brièvem<strong>en</strong>t ce fait. L'inversion est grammaticale dans la relative restrictive dans<br />
les cinq langues considérées :<br />
(15) C La poma que li ha donat <strong>en</strong> Pau és sobre la taula.<br />
E La manzana que le dió Pablo está sobre la mesa.<br />
F La pomme que lui a donné Paul est sur la table.<br />
I La mela che gli ha dato Paolo è sulla tavola.<br />
P A maçã que lhe <strong>de</strong>u o Pedro está em cima da mesa.<br />
Elle est égalem<strong>en</strong>t grammaticale dans la subordonnée temporelle dans les cinq langues. En<br />
(16), il s’agit d’une inversion avec un verbe à construction transitive et <strong>en</strong> (17) d'une<br />
inversion avec un verbe à construction inaccusative 24 :<br />
(16) C <strong>de</strong>sprés que van haver m<strong>en</strong>jat el pastís els n<strong>en</strong>s<br />
E <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que comieran su pastel los niños<br />
F [un gâteau] après que l'eur<strong>en</strong>t mangé les <strong>en</strong>fants<br />
I [un gâteau] dopo che l'ebbero mangiato i bambini,<br />
P <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> terem as crianças comido o bolo<br />
(17) C quan surt el sol<br />
E cuando salga el sol<br />
F dès que se lève le soleil<br />
I non app<strong>en</strong>a si alza il sole<br />
P assim que se levante o sol<br />
Enfin, on observe que l'inversion est grammaticale dans la coda d'une clivée dans les cinq<br />
langues 25 :<br />
24 On notera les contrastes suivants <strong>en</strong> français et <strong>en</strong> itali<strong>en</strong> :<br />
(i) I i) [un gâteau] dopo che l'ebbero mangiato i bambini, ...<br />
ii) * dopo che ebbero mangiato il dolce i bambini, ...<br />
F i) [un gâteau] après que l'eur<strong>en</strong>t mangé les <strong>en</strong>fants, ...<br />
ii) * après qu'eur<strong>en</strong>t mangé le gâteau les <strong>en</strong>fants, ...<br />
On peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si l'itali<strong>en</strong> dans ce contexte connaît comme le français une contrainte <strong>de</strong> redondance<br />
fonctionnelle (cf. ex §1-(21)) ou bi<strong>en</strong> si on a affaire à la même contrainte que dans l'inversion libre (cf. ex<br />
§1-(7)). L'inversion élaborative est égalem<strong>en</strong>t grammaticale dans ce contexte <strong>en</strong> français :<br />
(ii) F Après qu'eur<strong>en</strong>t prononcé un discours les porte-parole <strong>de</strong>s corps constitués et les<br />
représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>s églises, le présid<strong>en</strong>t prit la parole.<br />
25 Le français n'y connaît que l'inversion stylistique (cf. la faible acceptabilité <strong>de</strong> (F.ii)) :<br />
(i) F i) C'est à <strong>de</strong>ux heures qu'arriva Paul.<br />
ii) ?? C'est à <strong>de</strong>ux heures qu'<strong>en</strong> arrivèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ux.<br />
E Fue a las dos cuando llegaron los dos.<br />
C Es a les 2 que n'arribaran dos.<br />
I E' alle due che ne arrivarono due.<br />
13
(18) C Són grana<strong>de</strong>s el que llanc<strong>en</strong> els policies contra els manifestants.<br />
E Son granadas lo que lanzan los policías contra los manifestantes.<br />
F Ce sont <strong>de</strong>s gr<strong>en</strong>a<strong>de</strong>s que lanc<strong>en</strong>t les policiers contre les manifestants.<br />
I Sono granate quelle che lanciano i poliziotti contro i manifestanti.<br />
P São granadas que lançam os policias contra os manifestantes.<br />
2.6.2. L'inversion dans la subordonnée : un problème distinct ?<br />
Si la généralisation (1) est limitée à l'inversion libre et donc à la phrase racine, les<br />
généralisations (2), théoriquem<strong>en</strong>t, s'appliqu<strong>en</strong>t à toutes les phrases. Si on repr<strong>en</strong>d les<br />
analyses courantes, les phrases subordonnées <strong>en</strong> (15)-(18) apport<strong>en</strong>t un cont<strong>en</strong>u qui<br />
apparti<strong>en</strong>t au fond <strong>de</strong> l’énoncé. Elles échapp<strong>en</strong>t donc toutes à (2) 26 . La question se pose<br />
donc <strong>de</strong> savoir si l’inversion constitue un phénomène distinct selon qu’elle s’observe dans<br />
la phrase racine ou bi<strong>en</strong> dans la phrase subordonnée. Or, on constate que l’inversion n’est<br />
pas toujours appropriée dans la subordonnée. Je pr<strong>en</strong>ds un seul exemple que j'analyserai<br />
au §5.4.2 ; il concerne la relative restrictive <strong>en</strong> français. En (19), l’inversion est appropriée<br />
(voire préférée) dans la relative, elle ne l’est pas dans la relative <strong>en</strong> (20) :<br />
(19) F Que sont <strong>de</strong>v<strong>en</strong>us les étudiants dont Bernard s'est occupé ?<br />
a. Les étudiants dont s'est occupé Bernard ont tous brillamm<strong>en</strong>t réussi.<br />
b. Les étudiants dont Bernard s'est occupé ont tous brillamm<strong>en</strong>t réussi.<br />
(20) Que sont <strong>de</strong>v<strong>en</strong>us les étudiants dont Bernard s'est occupé ?<br />
a. Les étudiants que Bernard a <strong>en</strong>traînés ont tous réussi aux Olympia<strong>de</strong>s<br />
universitaires, ceux <strong>de</strong> Jean-Marie ont repris un cursus normal.<br />
b. # Les étudiants qu'a <strong>en</strong>traîné Bernard ont tous réussi aux Olympia<strong>de</strong>s<br />
universitaires, ceux <strong>de</strong> Jean-Marie ont repris un cursus normal.<br />
On observe les mêmes facteurs que ceux qu’on a isolés dans l’analyse <strong>de</strong> (6), (9) et (12).<br />
En (19), la réponse est complète et la relative dans la réponse prés<strong>en</strong>te le même verbe que<br />
celui qui apparaît dans la relative <strong>de</strong> la question. Par contre, <strong>en</strong> (20), la réponse est partielle<br />
et la relative dans la réponse prés<strong>en</strong>te un verbe différ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> celui qui apparaît dans la<br />
relative <strong>de</strong> la question.<br />
L’hypothèse que l’inversion puisse être soumise aux mêmes conditions d’appropriation<br />
dans la phrase racine et dans la subordonnée doit donc être considérée. Bi<strong>en</strong> que cela soit<br />
l'objet <strong>de</strong> controverses, j’admettrai que l'articulation fond-focus concerne le cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> la<br />
phrase <strong>en</strong>tière. Autrem<strong>en</strong>t dit, les phrases subordonnées ne sont pas associées à une<br />
articulation fond-focus autonome (<strong>en</strong> un mot, l'articulation fond-focus n'est pas récursive).<br />
Si tel est le cas et si le facteur impliqué dans l'appropriation <strong>de</strong> l'inversion est id<strong>en</strong>tique<br />
dans la phrase racine et dans la subordonnée, alors ce facteur ne peut pas être l'articulation<br />
fond-focus elle-même ou bi<strong>en</strong> un aspect <strong>de</strong> l'articulation fond-focus.<br />
2.7. Synthèse<br />
Les généralisations qui li<strong>en</strong>t le placem<strong>en</strong>t préverbal ou postverbal du sujet à l'articulation<br />
fond-focus connaiss<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s contre-exemples. De plus, l'articulation fond-focus elle-même<br />
ne semble pas la bonne notion pour dégager une analyse générale <strong>de</strong> l'inversion. Par<br />
contre, on a isolé <strong>de</strong>ux facteurs liés au caractère obligatoire du placem<strong>en</strong>t préverbal (le fait<br />
d'apparaître dans une réponse incomplète, le fait que le prédicat dans une réponse ne soit<br />
P Foi ás duas (horas) que chegaram dois.<br />
26 Lambrecht 1994 r<strong>en</strong>contre le même problème dans son analyse <strong>de</strong>s ressemblances dans l’intonation <strong>de</strong>s<br />
phrases matrices et <strong>de</strong>s circonstancielles temporelles <strong>en</strong> anglais (ibid. : 126). Lambrecht & Michaelis<br />
1998 aboutiss<strong>en</strong>t à la conclusion suivante : “ the pragmatic relations betwe<strong>en</strong> predicates and their<br />
argum<strong>en</strong>ts can be m<strong>en</strong>tally construed in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tly of the information status of the proposition as<br />
[pragmatically] presupposed or asserted ” (ibid.: p. 24 ; j’ajoute la précision <strong>en</strong>tre crochets). Autrem<strong>en</strong>t<br />
dit, le statut informationnel <strong>de</strong>s facteurs pertin<strong>en</strong>ts pour l’intonation doit être analysé indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
l’articulation fond-focus. C’est à la même conclusion que l’on aboutit ici dans l’analyse <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>s<br />
constituants.<br />
14
pas id<strong>en</strong>tique à celui <strong>de</strong> la question) et un facteur lié au caractère fortem<strong>en</strong>t préféré du<br />
placem<strong>en</strong>t postverbal (le fait que le prédicat dans la réponse soit id<strong>en</strong>tique à celui <strong>de</strong> la<br />
question). Avant <strong>de</strong> passer à leur analyse, je repr<strong>en</strong>ds l'autre gran<strong>de</strong> généralisation<br />
proposée dans les étu<strong>de</strong>s consacrées à l'inversion, celle qui met <strong>en</strong> jeu la notion <strong>de</strong> topique.<br />
L'exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> cette généralisation permettra <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> faire apparaître que l’on doit<br />
<strong>en</strong>visager <strong>de</strong>ux conditions d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion.<br />
3. Le placem<strong>en</strong>t du sujet et la notion <strong>de</strong> topique<br />
Les analyses <strong>de</strong> toute obédi<strong>en</strong>ce montr<strong>en</strong>t un cons<strong>en</strong>sus remarquable à propos <strong>de</strong> la<br />
généralisation (1), malgré l’ambiguïté foncière qui s’attache à la notion <strong>de</strong> topique :<br />
(1) Un GN sujet topique doit être préverbal.<br />
La généralisation (1) peut être illustrée dans un contexte comme (2). En (2), le constituant<br />
Marie est nécessairem<strong>en</strong>t préverbal :<br />
(2) Et Marie, tu as <strong>de</strong>s nouvelles ?<br />
E Maria llegó esta mañana.<br />
I Maria è arrivata questa mattina<br />
P A Maria chegou esta manhã<br />
Marie est arrivée ce matin<br />
Le catalan doit être exclu du champ d’application <strong>de</strong> (1). En effet, le constituant la Maria<br />
ne peut pas être un sujet préverbal dans ce contexte (cf. (3) ci-<strong>de</strong>ssous) ; je r<strong>en</strong>voie aux<br />
analyses <strong>de</strong> Vallduví (<strong>en</strong>tre autres, Vallduví 1991) qui montre qu'<strong>en</strong> catalan, les constituants<br />
remplissant le rôle <strong>de</strong> "link" ne peuv<strong>en</strong>t être réalisés qu’à l’extérieur du noyau phrastique<br />
dans une position <strong>de</strong> dislocation 27 :<br />
(3) Et Marie, tu as <strong>de</strong>s nouvelles ?<br />
C a. * La Maria arribat aquest matí.<br />
b. ? La Maria, ha arribat aquest matí<br />
c. Ha arribat aquest matí, la Maria<br />
Plusieurs questions se pos<strong>en</strong>t à propos <strong>de</strong> la généralisation (1). Tout d’abord, permet-elle<br />
d’éclairer les cas <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t préverbal obligatoire que nous avons rec<strong>en</strong>sés au<br />
paragraphe précéd<strong>en</strong>t (dans les langues où elle s’applique) ? Ensuite, quelle est sa<br />
pertin<strong>en</strong>ce ? La notion <strong>de</strong> topique intervi<strong>en</strong>t-elle <strong>en</strong> tant que telle dans le placem<strong>en</strong>t du<br />
sujet ? Afin <strong>de</strong> répondre <strong>de</strong> façon précise, je comm<strong>en</strong>ce par préciser la notion <strong>de</strong> topique.<br />
3.1. La notion <strong>de</strong> topique<br />
Le cont<strong>en</strong>u ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> topique est la relation ‘à propos <strong>de</strong>’ (aboutness).<br />
Cette relation peut être établie <strong>en</strong>tre un discours et un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours (topique <strong>de</strong><br />
discours) ou bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre un prédicat et un argum<strong>en</strong>t dans le cadre <strong>de</strong> la phrase (topique <strong>de</strong><br />
phrase). L'ambiguïté <strong>de</strong> (1) découle <strong>de</strong> cette double possibilité. En effet, ces <strong>de</strong>ux statuts<br />
ne se recouvr<strong>en</strong>t pas toujours comme <strong>en</strong> (2). Par exemple, <strong>en</strong> (4), le discours est à propos<br />
<strong>de</strong> Marie et la prédication porte sur Paul :<br />
(4) À propos <strong>de</strong> Marie, Paul est mala<strong>de</strong>. [Elle est <strong>en</strong> souci.]<br />
On distinguera donc le topique <strong>de</strong> discours dont je mainti<strong>en</strong>s dans ce paragraphe la<br />
définition usuelle, l’individu à propos duquel se ti<strong>en</strong>t le discours, et le topique <strong>de</strong> phrase<br />
que j’assimile à celle <strong>de</strong> sujet catégorique 28 . Par ailleurs, toutes les approches admett<strong>en</strong>t<br />
une corrélation forte <strong>en</strong>tre topiques <strong>de</strong> discours, sujets catégoriques d'une part et GN<br />
27 La notion <strong>de</strong> link dans le système <strong>de</strong> Vallduví est ambiguë : elle recouvre la plupart du temps celle <strong>de</strong><br />
topique.<br />
28 Je préciserai le contraste <strong>en</strong>tre jugem<strong>en</strong>t thétique et catégorique au §6.1.2 plus bas.<br />
15
associés à un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours actif (ou anci<strong>en</strong> dans le discours dans la terminologie <strong>de</strong><br />
Prince 1981) d'autre part. On peut donc analyser le cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> (1) avec les trois<br />
propositions <strong>en</strong> (5) ci-<strong>de</strong>ssous :<br />
(5) a. Un sujet catégorique est nécessairem<strong>en</strong>t préverbal.<br />
b. Un sujet représ<strong>en</strong>tant le topique <strong>de</strong> discours est nécessairem<strong>en</strong>t préverbal.<br />
c. Un GN sujet associé à un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours actif est préfér<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
préverbal.<br />
Notons que (5.c) est égalem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>t dans la littérature (ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t pragmatique)<br />
sous la forme <strong>de</strong> sa converse :<br />
(6) Un GN sujet associé à un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours inactif est préfér<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
postverbal.<br />
3.2. Topique et placem<strong>en</strong>t préverbal<br />
Toutes les analyses qui admett<strong>en</strong>t (1) admett<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t que le statut <strong>de</strong> topique et celui<br />
<strong>de</strong> focus sont incompatibles : un constituant topique apparti<strong>en</strong>t nécessairem<strong>en</strong>t au fond.<br />
On ne peut donc pas recourir à (1) pour expliquer le placem<strong>en</strong>t préverbal du sujet dans<br />
(§2-6) et (§2-9). Pour t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> sauver (1), admettons les propositions <strong>de</strong> (5) qui, elles,<br />
peuv<strong>en</strong>t être conçues indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'articulation fond-focus.<br />
Repr<strong>en</strong>ons le contraste du portugais que je répète ci-<strong>de</strong>ssous sous forme cond<strong>en</strong>sée :<br />
(7) PQuem comeu a tarte?<br />
a. (A tarte) comeu a Joana (et elle seule).<br />
b. A Joana comeu (pour les autres, je ne sais pas).<br />
Il n'y a pas <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s intuitif à sout<strong>en</strong>ir que a Joana soit un sujet catégorique <strong>en</strong> (7.b) et non<br />
<strong>en</strong> (7.a) 29 . Par ailleurs, s'il y a un topique <strong>de</strong> discours dans l'échange (au s<strong>en</strong>s maint<strong>en</strong>u<br />
dans ce paragraphe), c'est le référ<strong>en</strong>t désigné par a tarte ; donc on ne peut pas rapporter la<br />
variation <strong>en</strong> (7) à une différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> statut thématique du référ<strong>en</strong>t désigné par a Joana.<br />
Enfin, on sait que la focalisation est indiffér<strong>en</strong>te au statut d'activation <strong>de</strong>s référ<strong>en</strong>ts <strong>de</strong><br />
discours dans le discours et, <strong>de</strong> toute façon, il est id<strong>en</strong>tique dans les <strong>de</strong>ux réponses. Donc,<br />
(5.c) et (6) ne sont d’aucun recours pour expliquer le contraste. Le même comm<strong>en</strong>taire<br />
s'applique aux <strong>de</strong>ux autres cas isolés au paragraphe précéd<strong>en</strong>t (§2-9) et (§2-12). On doit<br />
donc conclure que les généralisations (5) ne sont d'aucun secours pour r<strong>en</strong>dre compte du<br />
placem<strong>en</strong>t préverbal obligatoire observé au paragraphe précéd<strong>en</strong>t. De plus, il faut admettre<br />
qu'un sujet catégorique puisse être postverbal, ce qui remet <strong>en</strong> cause la généralisation<br />
implicite dans nombre d'analyses selon lesquelles un sujet préverbal n'est pas<br />
nécessairem<strong>en</strong>t catégorique, mais qu'un sujet catégorique est nécessairem<strong>en</strong>t préverbal 30 .<br />
29 La négation n'est pas acceptable dans les énoncés à lecture thétique (Horn 1989) ; <strong>de</strong> fait, elle n'est<br />
acceptable que dans les énoncés à verbe stéréotypique. Si l'énoncé à sujet postverbal exprimait une<br />
proposition thétique, on s'att<strong>en</strong>drait à ce qu'une réponse négative soit malformée, ce qui n'est pas le cas :<br />
(i) P Quem é que não comeu ontem à noite ?<br />
Não comeram o Pedro e a Maria.<br />
30 Cette conclusion s'oppose à la généralisation (§2-2.a) : “l'inversion est interdite dans une articulation à<br />
focalisation du prédicat (Predicate Focus)”. Dans l'approche <strong>de</strong> Lambrecht, la notion <strong>de</strong> focalisation du<br />
prédicat et celle <strong>de</strong> proposition catégorique se recouvr<strong>en</strong>t. Toujours dans le même cadre, la réponse (7.b)<br />
est analysable soit comme un énoncé à focalisation sur un argum<strong>en</strong>t ou à focalisation sur la phrase : dans<br />
les <strong>de</strong>ux cas, la proposition est catégorique. Le français offre, par ailleurs, un contre-exemple très net à la<br />
généralisation (§2-2.a) : les énoncés (i) exprim<strong>en</strong>t une proposition catégorique, or ils prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un sujet<br />
postverbal (inversion élaborative) :<br />
(i) F a. Ne sont pas considérés comme pièce d'id<strong>en</strong>tité les papiers suivants : les quittances <strong>de</strong> loyer et<br />
les bulletins <strong>de</strong> salaire.<br />
b. Est sujet tout acte distinct et accessoire qui, dans l'int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> celui qui parle, souti<strong>en</strong>t<br />
l'énoncé principal (Séchehaye, cité dans Le Bidois, 1950: 26).<br />
16
3.3. Placem<strong>en</strong>t préverbal dans un énoncé à focalisation large<br />
J'ai admis <strong>en</strong> introduction à ce paragraphe que le placem<strong>en</strong>t préverbal <strong>de</strong> Marie <strong>en</strong> (2) est<br />
dû à son statut <strong>de</strong> topique. Cette analyse est contestable au regard <strong>de</strong> l'observation générale<br />
<strong>de</strong>s énoncés à focalisation large dans le contexte d'une question qu'est-ce qui se passe ?<br />
3.3.1. Placem<strong>en</strong>t dans un énoncé à focalisation large<br />
De façon massive, les énoncés à focalisation large sont <strong>de</strong>s énoncés où l'inversion n'est<br />
pas appropriée. J'illustre ce point avec les réponses (9) à la question (8.b) dans le contexte<br />
décrit <strong>en</strong> (8.a) :<br />
(8) a. La question est posée au téléphone par un journaliste qui regar<strong>de</strong> un moniteur <strong>de</strong><br />
surveillance à une personne qui se trouve sur les lieux d'une manifestation.<br />
b. Que se passe-t-il <strong>en</strong> bas <strong>de</strong> la rue ?<br />
(9) C Els estudiants s'aprop<strong>en</strong> a la cruïlla.<br />
ELos estudiantes están avanzando hacia el cruce.<br />
I Gli stud<strong>en</strong>ti si muovono verso l'incrocio.<br />
POs estudantes estão-se aproximando do cruzam<strong>en</strong>to.<br />
Les étudiants s'avanc<strong>en</strong>t vers le carrefour.<br />
Les réponses <strong>en</strong> (9) sont prés<strong>en</strong>tées par les informateurs comme les seules possibles dans<br />
ce contexte : les GN sujet ne représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pas un topique <strong>de</strong> discours, ils ne sont pas actifs<br />
(le fait qu'ils ne puiss<strong>en</strong>t pas être pronominalisés <strong>en</strong> est l'indice). De plus, on peut<br />
considérer que les énoncés <strong>en</strong> (9) exprim<strong>en</strong>t une proposition thétique.<br />
On doit donc conclure qu'il existe <strong>de</strong>s cas où un sujet doit être préverbal bi<strong>en</strong> qu'il ne soit<br />
pas un topique au s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> la généralisation (1) ou bi<strong>en</strong> qu'il ne prés<strong>en</strong>te aucune <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques d'un topique au s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l'analyse synthétisée <strong>en</strong> (5). A ce sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l'analyse, ri<strong>en</strong> n'empêche <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser que Marie est préverbal <strong>en</strong> (2) pour les mêmes raisons<br />
que les étudiants <strong>en</strong> (9). Un trait a émergé dans les analyses prés<strong>en</strong>tées au paragraphe<br />
précéd<strong>en</strong>t (cf. §2.5) : l'inversion s’observe dans une réponse lorsqu’elle repr<strong>en</strong>d le<br />
prédicat <strong>de</strong> la question. Ce n'est évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t jamais le cas dans une réponse à une question<br />
"ouverte" <strong>de</strong> type qu'est-ce qui se passe ? On peut donc rapprocher le placem<strong>en</strong>t préverbal<br />
obligatoire <strong>en</strong> (9) <strong>de</strong> ceux qu'on a observés au §2.<br />
3.3.2. L'inversion prés<strong>en</strong>tative dans une réponse à focalisation large<br />
On est donc conduit à s'interroger à nouveau sur la pertin<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la généralisation (§2-2.c)<br />
que je répète : “ l'inversion est possible dans une articulation à focalisation sur la<br />
phrase ”. Il faut examiner <strong>de</strong> près les cas <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t postverbal dans une réponse à une<br />
question appelant une focalisation large dans la réponse. Considérons (10) qui repr<strong>en</strong>d le<br />
même contexte que (3) :<br />
(10) Et Marie, tu as <strong>de</strong>s nouvelles ?<br />
C i) El seu marit s'ha mort aquest matí.<br />
ii) Aquest matí ha mort el seu marit<br />
E i) Su marido murió hoy <strong>en</strong> la mañana.<br />
ii) Hoy <strong>en</strong> la mañana murió su marido.<br />
I i) Suo marito è morto questa mattina.<br />
ii) E' morto suo marito questa mattina.<br />
P Morreu-lhe o marido esta manhã.<br />
Son mari est mort ce matin.<br />
On s'att<strong>en</strong>d au placem<strong>en</strong>t préverbal du sujet comme <strong>en</strong> (9), ce qu'on observe dans les<br />
réponses (i). Mais, le GN peut être postverbal, ce qu'illustr<strong>en</strong>t les réponses <strong>en</strong> (ii). Or, une<br />
observation est cruciale : les énoncés à inversion <strong>en</strong> (10) prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t l'inversion<br />
prés<strong>en</strong>tative. Les équival<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mourir sont typiquem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s verbes prés<strong>en</strong>tatifs dans les<br />
langues considérées. Autrem<strong>en</strong>t dit, l'inversion prés<strong>en</strong>tative est appropriée dans un énoncé<br />
à focalisation large, mais cela ne signifie pas que l'inversion <strong>en</strong> général le soit.<br />
17
Si on admet <strong>de</strong> dissocier l'inversion prés<strong>en</strong>tative <strong>de</strong>s autres cas d'inversion, ce qui est<br />
sout<strong>en</strong>u par le fait qu'elle appelle <strong>de</strong> toute façon une condition d'appropriation spécifique<br />
liée au choix du verbe, toutes les observations effectuées tant au §2 que dans ce paragraphe<br />
conduis<strong>en</strong>t à la généralisation <strong>de</strong>scriptive suivante :<br />
(11) L'inversion est inappropriée si la propriété dénotée par le verbe ou le groupe verbal<br />
dans la phrase apporte une information nouvelle dans le discours.<br />
La généralisation (11) s'applique quel que soit le statut du GN sujet, qu'il soit topique <strong>de</strong><br />
discours ou pas, catégorique ou pas, actif ou pas. Au regard <strong>de</strong> (11), les généralisations (1)<br />
et (5) sont donc sans objet. Bi<strong>en</strong> sûr, la question <strong>de</strong> l'appropriation <strong>de</strong> l'inversion<br />
prés<strong>en</strong>tative dans ce contexte est un problème <strong>en</strong> soi qui échappe pour le mom<strong>en</strong>t à la<br />
généralisation ; j'<strong>en</strong> susp<strong>en</strong>ds l'analyse jusqu'au §6. On doit bi<strong>en</strong> mesurer le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> la<br />
généralisation (11). Elle n’est pas équival<strong>en</strong>te à (12) :<br />
(12) L'inversion est inappropriée dans un énoncé à focalisation large (focalisation sur<br />
la phrase).<br />
En effet, (11) peut s’appliquer dans la phrase subordonnée, dont on admet qu’elle n’est<br />
pas associée à une articulation fond-focus autonome. De plus, la pertin<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> (12)<br />
dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> l'analyse informationnelle <strong>de</strong>s énoncés cruciaux prés<strong>en</strong>tés au §2. Repr<strong>en</strong>ons un<br />
seul cas pour l'explicitation :<br />
(13) [Qui a repeint la table ?]<br />
E María la preparó.<br />
J'ai laissé <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>s l'analyse <strong>de</strong> l'articulation fond-focus d'un énoncé comme (13) <strong>en</strong><br />
admettant qu'elle pouvait être <strong>de</strong> type focalisation sur la phrase, mais je n'ai pas récusé<br />
l'analyse selon laquelle elle pouvait être <strong>de</strong> type focalisation étroite sur le sujet. De fait, le<br />
problème ne pourrait être tranché que par une analyse <strong>de</strong> l'intonation <strong>de</strong> (13). Si (13)<br />
manifeste ce que Contreras appelle l'ordre emphatique (cf. §1.3), María recevant une<br />
acc<strong>en</strong>tuation forte, il faudrait bi<strong>en</strong> admettre que cet énoncé est à focalisation étroite. Le<br />
placem<strong>en</strong>t préverbal du sujet <strong>en</strong> (13) serait donc bi<strong>en</strong> indép<strong>en</strong>dant <strong>de</strong> l’articulation fondfocus.<br />
3.4. Inversion et statut du référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours<br />
On a montré que (5.a) r<strong>en</strong>contre <strong>de</strong>s contre-exemples. Je laisse ici <strong>de</strong> côté (5.b) car je ne<br />
repr<strong>en</strong>drai pas la notion <strong>de</strong> topique <strong>de</strong> discours telle qu’elle a été définie dans ce<br />
paragraphe. Considérons un peu plus <strong>en</strong> détail (5.c). Les analyses pragmatiques attach<strong>en</strong>t<br />
un grand prix au statut discursif <strong>de</strong>s référ<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> discours (RD dorénavant). J'ai repris<br />
l'ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong>s généralisations <strong>de</strong>scriptives <strong>en</strong> (5.c) et (6) que je répète sous (14) ci-<strong>de</strong>ssous<br />
:<br />
(14) a. Un GN sujet associé à un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours actif est préfér<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
préverbal.<br />
b. Un GN sujet associé à un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours inactif est préfér<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
postverbal.<br />
Le soubassem<strong>en</strong>t empirique ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> (14) semble être l'exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s tours clivés (par<br />
exemple : il y a <strong>de</strong>s GN qui /que, etc.). Je l'illustre par la donnée (15) produite dans le<br />
contexte (8) (le contexte <strong>de</strong>s réponses à focalisation large) 31 :<br />
(15) C i) Uns joves estan cremant un cotxe<br />
31 On observe la même variation <strong>en</strong> français (i). Je susp<strong>en</strong>ds l'analyse <strong>de</strong> l'espagnol.<br />
(i) F i) Des jeunes brûl<strong>en</strong>t une voiture.<br />
ii) Il y a <strong>de</strong>s jeunes qui brûl<strong>en</strong>t une voiture.<br />
18
ii) Hi ha uns joves que crem<strong>en</strong> un cotxe.<br />
E Unos jóv<strong>en</strong>es están quemando un coche.<br />
I i) Dei (/ alcuni) ragazzi stanno bruciando una macchina<br />
ii) Ci son <strong>de</strong>i ragazzi che stanno bruciando una macchina.<br />
P i) Estan uns jov<strong>en</strong>s a queimar um carro.<br />
ii) Há uns jov<strong>en</strong>s a queimar um carro.<br />
La question est <strong>de</strong> savoir si le statut du RD est un facteur qui peut interv<strong>en</strong>ir dans<br />
l'inversion. En (15), la condition pour l'inversion n'est pas remplie (cf. (11) ci-<strong>de</strong>ssus). Le<br />
choix ne s'opère donc pas <strong>en</strong>tre un énoncé à inversion et un énoncé clivé, mais <strong>en</strong>tre un<br />
énoncé à sujet préverbal et un énoncé clivé. Si on peut admettre que, dans l'usage, les sujets<br />
préverbaux sont préfér<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s GN associés à <strong>de</strong>s RD actifs (et préalablem<strong>en</strong>t<br />
id<strong>en</strong>tifiés), il n'<strong>en</strong> découle pas que le statut du RD soit un facteur pertin<strong>en</strong>t interv<strong>en</strong>ant dans<br />
l'appropriation <strong>de</strong> l'inversion 32 . On peut sout<strong>en</strong>ir ce point <strong>en</strong> observant qu'<strong>en</strong> toute<br />
généralité, les énoncés prés<strong>en</strong>tant un GN sujet préverbal associé à un RD inactif (et non<br />
id<strong>en</strong>tifié) sont bi<strong>en</strong> formés et appropriés dans certains contextes (cf. (15) ci-<strong>de</strong>ssus) et que<br />
les énoncés prés<strong>en</strong>tant un GN sujet postverbal associé à un RD actif le sont égalem<strong>en</strong>t. Je<br />
n'ai rec<strong>en</strong>sé dans l'<strong>en</strong>quête aucune inversion interdisant un GN défini interprété <strong>de</strong> façon<br />
coréfér<strong>en</strong>tielle ; or, le GN défini à interprétation coréfér<strong>en</strong>tielle est le parangon du GN<br />
associé à un RD actif 33 .<br />
De fait, il faut être plus précis et distinguer les types d’inversion. Les analyses qui attir<strong>en</strong>t<br />
l'att<strong>en</strong>tion sur le statut discursif <strong>de</strong>s RD privilégi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fait les énoncés prés<strong>en</strong>tant une<br />
inversion prés<strong>en</strong>tative 34 . On observe bi<strong>en</strong> dans le discours que ces énoncés prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t le<br />
plus fréquemm<strong>en</strong>t un GN postverbal associé à un RD inactif et/ou non id<strong>en</strong>tifié (autrem<strong>en</strong>t<br />
dit, un GN indéfini). La question se pose donc <strong>de</strong> savoir si la condition d'appropriation <strong>de</strong><br />
l'inversion prés<strong>en</strong>tative inclut spécifiquem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> plus d'une contrainte sur le verbe, une<br />
contrainte sur le statut discursif du RD associé au GN postverbal. Je repr<strong>en</strong>drai cette<br />
question au §6.4.2.<br />
3.5. Synthèse<br />
Les analyses que je vi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> proposer reçoiv<strong>en</strong>t le r<strong>en</strong>fort <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> l'inversion<br />
effectuées à partir <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> corpus, le plus souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> textes écrits et ceci, bi<strong>en</strong><br />
que les résultats obt<strong>en</strong>us soi<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>tés <strong>de</strong> manière non conclusive 35 . L'analyse<br />
philologique se fixe pour but <strong>de</strong> déterminer les facteurs qui sont corrélés à l'inversion et<br />
32 On peut consulter Lambrecht 1987 <strong>en</strong>tre autres pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong>s GN associés à un RD<br />
inactif dans le discours oral.<br />
33 Cela est vrai aussi bi<strong>en</strong> dans la phrase matrice que dans la phrase subordonnée. Je donne une seule<br />
illustration dans la relative ; dans les relatives <strong>de</strong> (i) ci-<strong>de</strong>ssous, la diva est coréfér<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> la Callas :<br />
(i) [La Callas était déprimée.]<br />
C El vestit negre que portava la diva estava tacat <strong>de</strong> llàgrimes.<br />
E El vestido negro que llevaba la diva estaba <strong>en</strong>tachado <strong>de</strong> lágrimas.<br />
I Il vestito nero che portava la diva era macchiato di lacrime.<br />
P O vestido que levava a diva estava manchado <strong>de</strong> lágrimas.<br />
F La robe noire que portait la diva était maculée <strong>de</strong> larmes.<br />
34 C'est par exemple le cas du contraste (i), sans cesse cité (Calabrese 1992, repr<strong>en</strong>ant Vanelli 1981) :<br />
(i) I a. # Mario mi ha scritto una lettera. E' arrivata la lettera ieri.<br />
b. Mario mi ha scritto una lettera. La lettera é arrivata ieri.<br />
Il est adapté pour l'espagnol par Martí 2000 :<br />
(ii) E a. # Juan me escribió una carta. Llegó la carta ayer.<br />
b. Juan me escribió una carta. La carta llegó ayer.<br />
L'inappropriation <strong>de</strong> l'inversion <strong>en</strong> (i) et (ii) m'a été confirmée par les informateurs. Pourtant, l'un d'<strong>en</strong>tre<br />
eux note que (iii) est un discours bi<strong>en</strong> formé :<br />
(iii) Mario mi ha scritto una lettera sei mesi fa. Ieri, finalm<strong>en</strong>te, é arrivata la lettera.<br />
Mario m'a écrit une lettre il y a six mois. La lettre est arrivée hier finalem<strong>en</strong>t<br />
On ne peut donc pas tirer <strong>de</strong> (i) et (ii) la conclusion générale que l'inversion est incompatible avec le statut<br />
actif du RD associé au GN postverbal. Je repr<strong>en</strong>ds l’analyse du contraste <strong>en</strong>tre (i.a) et (iii) au §6.4.2<br />
35 Atkinson 1973, Bernini 1995, Hatcher 1956, Jonare 1976, Le Bidois 1950, Ocampo 1992, Sornicola<br />
1994, 1995, Wall 1980, Wehr 1984.<br />
19
qui pourrai<strong>en</strong>t être analysés comme décl<strong>en</strong>chant ou motivant le placem<strong>en</strong>t préverbal ou<br />
postverbal du sujet (plus généralem<strong>en</strong>t du premier argum<strong>en</strong>t du verbe). Sornicola 1994<br />
représ<strong>en</strong>te la synthèse la plus explicite <strong>de</strong> ces approches ; elle conclut son étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
manière suivante : “ l'inversion est un phénomène non déterministe ” (ibid.: 27). Cette<br />
proposition a un double cont<strong>en</strong>u :<br />
(16) a. Il n'y a pas <strong>de</strong> facteur unique décl<strong>en</strong>chant l'inversion (aucun facteur n'explique à<br />
lui seul une inversion dans un énoncé donné).<br />
b. Le "jeu complexe <strong>de</strong> facteurs" liés à l'inversion doit être analysé dans le<br />
discours.<br />
La proposition (16.a) est partiellem<strong>en</strong>t vraie. On vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> voir que l'inversion prés<strong>en</strong>tative<br />
requiert une condition d'appropriation qui lui est propre. Ensuite, (16.a) est correcte quand<br />
on considère les facteurs ret<strong>en</strong>us par Sornicola et les <strong>de</strong>scripteurs <strong>de</strong> corpus <strong>en</strong> général.<br />
Ces facteurs touch<strong>en</strong>t au verbe (l'intransitivité et/ou l'abs<strong>en</strong>ce d'un complém<strong>en</strong>t d'objet<br />
canonique) et au GN postverbal (le fait d'être focalisé étroitem<strong>en</strong>t ou topique <strong>de</strong> discours,<br />
son état d'activation (nouveau ou anci<strong>en</strong> dans le discours), sa détermination (défini vs<br />
indéfini). Le résultat est qu'aucun <strong>de</strong> ces facteurs pris isolém<strong>en</strong>t ou pris <strong>en</strong>semble ne<br />
constitue un facteur décisif <strong>de</strong> l'inversion. C'est le résultat auquel j'aboutis avec une<br />
méthodologie <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>te. Maint<strong>en</strong>ant, si on change <strong>de</strong> perspective comme j'ai<br />
comm<strong>en</strong>cé à le faire dans les <strong>de</strong>ux paragraphes précéd<strong>en</strong>ts, il semble bi<strong>en</strong> que<br />
l'appropriation <strong>de</strong> l'inversion (l’inversion prés<strong>en</strong>tative étant mise à part) soit s<strong>en</strong>sible à un<br />
facteur unique, le caractère informatif du prédicat (cf. la généralisation (11)).<br />
La proposition (16.b) doit être précisée. Tout d'abord, l'idée qu'il y ait plusieurs facteurs ne<br />
fait que refléter le choix <strong>de</strong>s facteurs étudiés. Même s'il n'y a qu'un seul facteur, <strong>de</strong>meure<br />
l'idée que l'analyse doit pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte le discours. L'impératif est évid<strong>en</strong>t dès que l'on<br />
parle <strong>de</strong> contraintes <strong>de</strong> nature informationnelle, puisqu'elles mett<strong>en</strong>t nécessairem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu<br />
un contexte et le statut dans ce contexte <strong>de</strong> l'information véhiculée par l'énoncé. Ceci étant<br />
admis, on doit bi<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>dre gar<strong>de</strong> à ne pas mélanger <strong>de</strong>ux plans : (a) la condition<br />
d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion et (b) l'usage <strong>de</strong> l'inversion (le choix par un locuteur dans un<br />
contexte donné du placem<strong>en</strong>t préverbal ou postverbal du sujet). J'étudierai quelques cas où<br />
un énoncé satisfait une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux conditions d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion et prés<strong>en</strong>te le<br />
placem<strong>en</strong>t préverbal du sujet. L'analyse <strong>de</strong> ces cas montre que les conditions<br />
d'appropriation autoris<strong>en</strong>t l'inversion, mais ne la requièr<strong>en</strong>t pas. Enfin, s'il est bi<strong>en</strong> exact<br />
que les conditions d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion doiv<strong>en</strong>t pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte le discours,<br />
cela exige que l'on dispose d'outils explicites pour saisir les traits du contexte qui sont<br />
pertin<strong>en</strong>ts dans l'inversion. Ce sont ces outils qui sont introduits au §4.<br />
4. Cadre notionnel<br />
Je précise dans ce paragraphe quelques élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> l'analyse du contexte. Je repr<strong>en</strong>ds<br />
pour l'ess<strong>en</strong>tiel le cadre que propose Büring (1997, 1998). Ce cadre permet une approche<br />
unifiée <strong>de</strong> trois notions qui me seront indisp<strong>en</strong>sables : (a) thème <strong>de</strong> discours, (b) cont<strong>en</strong>u<br />
informatif et (c) cont<strong>en</strong>u donné. La notion c<strong>en</strong>trale est celle <strong>de</strong> thème <strong>de</strong> discours ; elle est<br />
modélisée à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sémantique <strong>de</strong>s questions proposée par Hamblin (1973). Cette<br />
sémantique est certainem<strong>en</strong>t critiquable et limitée pour r<strong>en</strong>dre compte <strong>en</strong> toute généralité <strong>de</strong><br />
la sémantique <strong>de</strong>s questions (Ginzburg 1996, Ginzburg & Sag 2000), mais elle me suffit<br />
ici pour isoler et formuler les conditions d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion.<br />
4.1. Thème <strong>de</strong> discours<br />
La définition traditionnelle <strong>de</strong> topique <strong>de</strong> discours, utilisée au §3, est dénuée <strong>de</strong> toute<br />
généralité : elle ne s'applique qu'aux segm<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> discours que la grammaire du discours<br />
appelle chaîne thématique (topic chaining). Je la généralise donc sous le nom <strong>de</strong> thème <strong>de</strong><br />
discours (TD dorénavant) <strong>en</strong> passant d'une définition où le TD est l'individu à propos<br />
duquel se ti<strong>en</strong>t le discours à une définition où le TD est la question <strong>en</strong> débat dans le<br />
segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours. J'illustre directem<strong>en</strong>t cette redéfinition avec un exemple <strong>de</strong> chaîne<br />
thématique :<br />
20
(1) Marie vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> passer le bac. Elle a été acceptée <strong>en</strong> mé<strong>de</strong>cine. La jeune fille est<br />
promise à un av<strong>en</strong>ir brillant.<br />
Ce qui permet <strong>de</strong> dire que Marie est le thème <strong>de</strong> discours dans (1), c'est que le segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
discours prés<strong>en</strong>te les propriétés <strong>de</strong> Marie. On peut donc proposer une explicitation<br />
propositionnelle du TD <strong>de</strong> (1) 36 :<br />
(2) Marie P<br />
Donner une forme propositionnelle au TD, cela équivaut à repr<strong>en</strong>dre une conception<br />
traditionnelle (dans la littérature pragmatique) où le TD est défini et modélisé comme une<br />
question. En effet, si on admet que la dénotation d'une question est un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong><br />
propositions (contextuellem<strong>en</strong>t pertin<strong>en</strong>tes), le TD tel qu’il est défini <strong>en</strong> (2) correspond<br />
aussi à un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> propositions. On peut donc expliciter le TD développé dans le<br />
discours (1) <strong>de</strong>s trois manières suivantes :<br />
(3) a. Marie, que <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t-elle ?<br />
b. Marie P<br />
c. {Marie vi<strong>en</strong>t d’avoir vingt ans, elle a passé le bac, elle s’est décoloré les<br />
cheveux,…}<br />
Ce faisant, on constitue la paire question-réponse (paire Q-R dorénavant) comme un<br />
modèle réduit du discours et on peut utiliser les paires Q-R effectives comme domaine<br />
d'investigation empirique <strong>de</strong>s marques linguistiques dans l'énoncé <strong>de</strong> l'informativité et du<br />
développem<strong>en</strong>t thématique. En effet, répondre à une question, c'est développer le TD<br />
délimité par la question. C'est ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t la stratégie que suit Büring pour étudier les<br />
aspects <strong>de</strong> l'intonation s<strong>en</strong>sibles à l'informativité et au développem<strong>en</strong>t thématique <strong>en</strong><br />
allemand. C'est cette stratégie que je repr<strong>en</strong>ds pour étudier le placem<strong>en</strong>t du sujet et<br />
déterminer quels sont les aspects <strong>de</strong> l'informativité ou du développem<strong>en</strong>t thématique<br />
pertin<strong>en</strong>t dans le placem<strong>en</strong>t du sujet.<br />
4.2. L'informativité<br />
On admettra ici que toute réponse est informative. Autrem<strong>en</strong>t dit, toute réponse modifie le<br />
contexte d'énonciation par l'apport d'une information. Considérons <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong> vue le<br />
li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre l'informativité et l'articulation fond-focus.<br />
On définit généralem<strong>en</strong>t l'articulation fond-focus <strong>en</strong> distinguant dans le cont<strong>en</strong>u véhiculé<br />
par la phrase la partie qui est une information nouvelle <strong>de</strong> la partie qui est une information<br />
anci<strong>en</strong>ne. On distingue donc les énoncés à focalisation étroite dont le cont<strong>en</strong>u est<br />
partiellem<strong>en</strong>t informatif. Par exemple, la réponse (4.a) peut être analysée <strong>en</strong> une<br />
proposition ouverte (4.b) qui représ<strong>en</strong>te son cont<strong>en</strong>u anci<strong>en</strong> (il est repris à la question) et<br />
une proposition <strong>de</strong> forme id<strong>en</strong>tificationnelle (4.c) qui représ<strong>en</strong>te son cont<strong>en</strong>u<br />
nouveau (Lambrecht 1994, Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002a,b) :<br />
(4) Qui est v<strong>en</strong>u ?<br />
a. Marie (est v<strong>en</strong>ue).<br />
b. Fond: quelqu'un est v<strong>en</strong>u<br />
c. Focus: le x qui est v<strong>en</strong>u est Marie<br />
On dira que le constituant Marie apporte l'information focale (explicitée <strong>en</strong> (4.c)) et que la<br />
proposition (4.b) représ<strong>en</strong>te l'information <strong>de</strong> fond.<br />
Les énoncés à focalisation large ont un cont<strong>en</strong>u <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t informatif. C'est le cas, par<br />
exemple, <strong>de</strong> la réponse (5.a) ; dans ce cas, il n'y a pas partition du cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> l'énoncé :<br />
36 Pour faciliter la lecture, j'adopte une écriture informelle. Les propositions sont représ<strong>en</strong>tées par les<br />
énoncés qui les véhicul<strong>en</strong>t. La proposition ouverte est représ<strong>en</strong>tée comme une phrase <strong>en</strong> français où les<br />
variables sont prés<strong>en</strong>tées <strong>en</strong> italique et les constantes <strong>en</strong> gras.<br />
21
(5) Que s'est-il passé ?<br />
a. Marie est v<strong>en</strong>ue.<br />
b. Focus: Marie est v<strong>en</strong>ue<br />
Le recours au contraste “ information nouvelle / information anci<strong>en</strong>ne ” pour définir<br />
l'articulation fond-focus est pourtant délicat. Considérons la paire Q-R (6). On peut<br />
répondre à la question avec (6.a), (6.b) ou (6.c). Le ton <strong>de</strong> frontière illocutoire (L%), qui<br />
est la marque <strong>de</strong> la focalisation <strong>en</strong> français, est réalisé sur oui <strong>en</strong> (6.a) et sur gâteau <strong>en</strong> fin<br />
d'énoncé <strong>en</strong> (6.c) : c'est la marque habituelle <strong>de</strong> la focalisation large. Il est réalisé sur<br />
Bernard <strong>en</strong> (6.b) : c'est la marque usuelle d'une focalisation étroite :<br />
(6) C'est Bernard qui a mangé le gâteau ?<br />
a. Oui (L%)<br />
b. Bernard a mangé le gâteau (L%)<br />
c. Bernard (L%) a mangé le gâteau (L%)<br />
Je privilégie ici (6.b). Si on applique la définition informationnelle, la phrase tout <strong>en</strong>tière<br />
constitue l'information <strong>de</strong> fond, alors que si on suit le marquage intonatif, la phrase tout<br />
<strong>en</strong>tière contribue l'information focale. Ce qui donne lieu à l'analyse paradoxale explicitée<br />
<strong>en</strong> (7) :<br />
(7) a. Fond : Bernard a mangé le gâteau<br />
b. Focus: Bernard a mangé le gâteau<br />
Si on suit l'intuition, l'énoncé (6.b) est prés<strong>en</strong>té par son énonciateur comme globalem<strong>en</strong>t<br />
informatif : il repr<strong>en</strong>d à son compte le cont<strong>en</strong>u propositionnel anci<strong>en</strong> et il l'asserte.<br />
Autrem<strong>en</strong>t dit, un cont<strong>en</strong>u anci<strong>en</strong> peut être informatif. Ce sont <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> ce type qui<br />
conduis<strong>en</strong>t Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002a à décrocher la définition <strong>de</strong> l’articulation fond-focus du<br />
contraste “ information nouvelle / information anci<strong>en</strong>ne ” et à lui donner une définition<br />
illocutoire : le focus est le cont<strong>en</strong>u propositionnel spécifiquem<strong>en</strong>t affecté par la force<br />
illocutoire associée à la phrase 37 . Dans une assertion, le focus est le cont<strong>en</strong>u asserté : <strong>en</strong><br />
(6.b), l’assertion porte sur la totalité du cont<strong>en</strong>u propositionnel, ce qui donne lieu au<br />
marquage prosodique <strong>de</strong> la focalisation large et ce qui revi<strong>en</strong>t à traiter une information<br />
anci<strong>en</strong>ne comme informative.<br />
4.3. Le développem<strong>en</strong>t thématique<br />
Büring a attiré l'att<strong>en</strong>tion sur les réponses incomplètes dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'intonation et du<br />
marquage <strong>de</strong>s statuts informationnels. Pourquoi ces exemples sont-ils cruciaux ? Je<br />
rappelle qu'on a admis <strong>de</strong> définir le TD comme une question. L'analyse <strong>de</strong>s réponses<br />
incomplètes fournit un modèle réduit du phénomène <strong>de</strong> remo<strong>de</strong>lage d'un TD (TD shift).<br />
Büring 1997 montre que le remo<strong>de</strong>lage d'un TD est obligatoirem<strong>en</strong>t marqué dans<br />
l’intonation <strong>en</strong> allemand et que ce marquage est indép<strong>en</strong>dant du marquage <strong>de</strong> l'articulation<br />
fond-focus. Je laisse ici <strong>de</strong> côté l'intonation. Mais ce sont précisém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong><br />
réponses incomplètes qui ont permis <strong>de</strong> constituer <strong>de</strong>s cas récalcitrants aux généralisations<br />
associant l'inversion et l'articulation fond-focus au §2. Il faut donc analyser <strong>en</strong> détail ce qui<br />
se passe dans ce type d'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t discursif.<br />
Une réponse peut être complète ou incomplète. Par exemple, la réponse (9.a) à la question<br />
(8) est complète. La réponse (9.b) est incomplète : la question (8) porte sur les chanteurs<br />
<strong>de</strong> rock dans leur <strong>en</strong>semble et la réponse (9.b) porte sur un sous-<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> chanteurs,<br />
les chanteurs anglais :<br />
(8) Que fumai<strong>en</strong>t les chanteurs <strong>de</strong> rock ?<br />
(9) a. Les chanteurs <strong>de</strong> rock fumai<strong>en</strong>t du haschisch.<br />
37 La définition illocutoire du focus a été initialem<strong>en</strong>t proposée par Jacobs 1984.<br />
22
. Les chanteurs <strong>de</strong> rock anglais fumai<strong>en</strong>t du haschisch.<br />
La réponse (9.b) est associée à un effet discursif bi<strong>en</strong> particulier : elle appelle une<br />
poursuite du discours sur le thème initié par la question <strong>de</strong> départ que l'on peut expliciter<br />
par une nouvelle question : et les autres chanteurs <strong>de</strong> rock, que fumai<strong>en</strong>t-ils ?<br />
Büring 1998 (repr<strong>en</strong>ant Roberts 1996) fait appel à la notion <strong>de</strong> stratégie <strong>de</strong> discours. La<br />
réponse (9.a) illustre une stratégie simple où le locuteur accepte la question initiale et le<br />
TD défini par l'interlocuteur. La réponse (9.b) illustre une stratégie complexe où le<br />
locuteur accepte la question initiale mais redéfinit la question et partant le TD : au lieu <strong>de</strong><br />
pr<strong>en</strong>dre le thème globalem<strong>en</strong>t, il l'éclate <strong>en</strong> introduisant un sous-thème (pertin<strong>en</strong>t au regard<br />
<strong>de</strong> la question). Puisqu'on a admis <strong>de</strong> définir le TD comme une question, on modélise le<br />
remo<strong>de</strong>lage du TD à l'ai<strong>de</strong> d'une question : le locuteur introduit <strong>de</strong> façon non explicite une<br />
question subordonnée à la question initiale que fumai<strong>en</strong>t les chanteurs <strong>de</strong> rock (cdr<br />
dorénavant) anglais ? On peut égalem<strong>en</strong>t capter l'effet <strong>de</strong> discours appelé par une série <strong>de</strong><br />
questions non explicites : que fumai<strong>en</strong>t les cdr américains ? que fumai<strong>en</strong>t les cdr<br />
français? etc. On peut figurer graphiquem<strong>en</strong>t un contexte façonné par une stratégie<br />
complexe comme un arbre r<strong>en</strong>dant explicite la hiérarchie <strong>de</strong> questions et <strong>de</strong> sous-questions<br />
(appelant <strong>de</strong>s réponses partielles au regard <strong>de</strong> la question initiale) :<br />
(10)<br />
En (9.b), la réponse est une réponse complète au regard <strong>de</strong> la question subordonnée,<br />
partielle au regard <strong>de</strong> la question initiale et qui a pour effet <strong>de</strong> partitionner le TD. On peut<br />
imaginer le mouvem<strong>en</strong>t inverse : la réponse introduit une question (implicite) superordonnée<br />
(au regard <strong>de</strong> la question initiale) et a pour effet d'élargir le TD. J'illustre ce cas<br />
avec la paire Q-R (11), dont l'analyse discursive est graphiquem<strong>en</strong>t représ<strong>en</strong>tée <strong>en</strong> (12) :<br />
(11) Que fumai<strong>en</strong>t les Beatles dans les années soixante ?<br />
Les chanteurs pop fumai<strong>en</strong>t du haschisch à cette époque.<br />
(12)<br />
Les paires (8/9.b) et (11) sont <strong>de</strong>s exemples prototypiques <strong>de</strong> discours où un énoncé<br />
modifie le TD dans lequel il s'insère et projette une suite pour le discours à v<strong>en</strong>ir : <strong>en</strong><br />
(8/9.b), l'énoncé appelle la poursuite du développem<strong>en</strong>t thématique où seront considérées<br />
d'autres espèces <strong>de</strong> chanteurs ; <strong>en</strong> (11), l'énoncé projette la clôture du développem<strong>en</strong>t<br />
thématique.<br />
23
Nous pouvons donner maint<strong>en</strong>ant un cont<strong>en</strong>u au s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> réponse incomplète<br />
décl<strong>en</strong>ché par certaines réponses analysées au §2 : ce sont <strong>de</strong>s réponses partielles que l'on<br />
analysera comme <strong>de</strong>s réponses qui modifi<strong>en</strong>t le TD.<br />
4.4. Le cont<strong>en</strong>u donné<br />
La notion <strong>de</strong> cont<strong>en</strong>u donné (Giv<strong>en</strong>) a pris récemm<strong>en</strong>t une place prépondérante dans les<br />
analyses <strong>de</strong> l'intonation ; je r<strong>en</strong>voie à Schwarzchild 1999 et Büring 1998 qui montr<strong>en</strong>t<br />
qu'elle constitue le facteur pertin<strong>en</strong>t dans l'intonation liée à l'informativité (F-marking). Je<br />
repr<strong>en</strong>ds ici la définition proposée dans Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002a. De façon intuitive, le<br />
cont<strong>en</strong>u donné est défini comme <strong>en</strong> (14) :<br />
(14) Le donné est la proposition ouverte exprimant le cont<strong>en</strong>u commun du TD.<br />
Dans une réponse complète, le cont<strong>en</strong>u donné recouvre le cont<strong>en</strong>u constitutif du fond.<br />
Repr<strong>en</strong>ons la réponse (9.a) sous (15.a). Le TD initié par la question est explicité <strong>en</strong> (15.b).<br />
Le fond et le donné sont id<strong>en</strong>tiques comme le montr<strong>en</strong>t (15.c) et (15.d) :<br />
(15) a. Les chanteurs <strong>de</strong> rock fumai<strong>en</strong>t du haschisch.<br />
b. TD: {les cdr fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la marijuana, les cdr fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la cocaïne, ...}<br />
c. Fond: les-cdr fumai<strong>en</strong>t x<br />
d. Donné: les-cdr fumai<strong>en</strong>t x<br />
Dans une réponse incomplète qui modifie le TD initié par la question, le donné ne<br />
recouvre pas le fond. Repr<strong>en</strong>ons la réponse (9.b) sous (16.a). Le TD initié par la question<br />
est explicité <strong>en</strong> (16.b) ; le TD modifié par la réponse est explicité <strong>en</strong> (16.c). Le fond et le<br />
donné ne sont pas id<strong>en</strong>tiques comme le montr<strong>en</strong>t (16.d) et (16.e) :<br />
(16) a. Les chanteurs <strong>de</strong> rock anglais fumai<strong>en</strong>t du haschisch.<br />
b. TD (initié par la question): {les cdr fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la marijuana, les cdr fumai<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> la cocaïne, ...} .<br />
c. TD (modifié par la réponse): { {les cdr anglais fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la marijuana, les cdr<br />
anglais fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la cocaïne, les cdr anglais fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s gitanes, ....}, {les cdr<br />
français fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la marijuana, les cdr français fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s gauloises, ..}, {les<br />
cdr américains fumai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la cocaïne, ..}, }<br />
d. Donné (dans le TD) : les-cdr Q fumai<strong>en</strong>t x 38<br />
e. Fond (dans la réponse) : les-cdr anglais fumai<strong>en</strong>t x<br />
Le donné (16.d) prés<strong>en</strong>te plusieurs variables : l'une est instanciée par le constituant focal,<br />
l’autre (qui est liée au remo<strong>de</strong>lage du TD) est directem<strong>en</strong>t introduite dans le fond. Ce sont<br />
les constituants qui instanci<strong>en</strong>t une variable introduite dans le fond à la suite d’une<br />
modification du TD qui sont susceptibles d'un marquage prosodique spécifique (Tmarking).<br />
Par exemple, le constituant anglais dans la réponse (9.a) instanciant la variable<br />
Q (dans l'explicitation (16.d)) reçoit obligatoirem<strong>en</strong>t un acc<strong>en</strong>t <strong>en</strong> français 39 . J'appellerai<br />
shifteur thématique (ST dorénavant) les constituants qui instanci<strong>en</strong>t cette sorte <strong>de</strong> variable<br />
dans le donné.<br />
Nous disposons maint<strong>en</strong>ant d'un cadre pour analyser le fait observé au §2 lié à la reprise<br />
ou non d'un prédicat au contexte. La notion <strong>de</strong> donné va se révéler cruciale : lorsqu’une<br />
réponse ne repr<strong>en</strong>d pas le verbe <strong>de</strong> la question, le verbe n’<strong>en</strong>tre pas dans la composition <strong>de</strong><br />
la proposition donnée ; on dira qu’il n’est pas donné. Par contre, lorsqu’une réponse<br />
repr<strong>en</strong>d le verbe <strong>de</strong> la question, le verbe est donné. C’est ce contraste qui est pertin<strong>en</strong>t pour<br />
r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> l’appropriation <strong>de</strong> l’inversion.<br />
38 De façon plus technique, on peut définir le donné pour (16.a) <strong>de</strong> la manière suivante :<br />
λy λQ ∀x (Chanteur <strong>de</strong> rock (x) & Q (x) ) → fumer (x, y))<br />
39 Il <strong>en</strong> est <strong>de</strong> même <strong>en</strong> allemand selon Büring 1997. Je r<strong>en</strong>voie à Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002b, Marandin et al.<br />
2002 pour cet aspect <strong>de</strong> l’intonation <strong>en</strong> français.<br />
24
5. Condition du prédicat donné<br />
Je prés<strong>en</strong>te dans ce paragraphe la première condition d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion : celle<br />
qui s'applique à tout énoncé sans considération du li<strong>en</strong> sémantique <strong>en</strong>tre le verbe et son<br />
premier argum<strong>en</strong>t. Il nous faut tout d'abord isoler le facteur pertin<strong>en</strong>t dans l'appropriation<br />
<strong>de</strong> l'inversion ; je le fais <strong>en</strong> analysant avec les notions introduites au §4 les contextes où<br />
l'on a observé au §2 et §3 un placem<strong>en</strong>t préverbal obligatoire ou un placem<strong>en</strong>t postverbal<br />
approprié. Ensuite, je falsifie l'analyse <strong>en</strong> considérant d'autres contextes.<br />
5.1. Analyse <strong>de</strong>s contextes<br />
On peut distinguer quatre contextes. Le premier (C-I) est celui où l'inversion libre est<br />
appropriée : la paire (§2-3) répétée sous (1).<br />
(1) a. ¿ Quién comió la manzana ?<br />
b. Ha comido la manzana María.<br />
La réponse (1.a) est une réponse complète opérant selon une stratégie simple sans<br />
remo<strong>de</strong>lage du TD. J'explicite son analyse discursive <strong>en</strong> (2) : le TD initié par la question<br />
est explicité <strong>en</strong> (2.a) ; dans ce cas, le fond et le donné se recouvr<strong>en</strong>t :<br />
(2) a. TD: {Marie a mangé la pomme, Pierre a mangé la pomme, ...}<br />
b. Fond = x a-mangé la-pomme<br />
Le second (C-II) est un contexte où l'inversion est inappropriée. C'est une paire Q-R où la<br />
réponse est incomplète, mettant <strong>en</strong> œuvre une stratégie complexe avec remo<strong>de</strong>lage du TD :<br />
la paire (§2-9) répétée sous (3) dans sa version espagnole :<br />
(3) a. Qui a repeint la table ?<br />
b. María la preparó.<br />
On peut figurer graphiquem<strong>en</strong>t la stratégie <strong>de</strong> discours dans laquelle s'inscrit (3.b) sous<br />
(4) : la réponse introduit une question intermédiaire qui a poncé la table ? et appelle la<br />
poursuite du dialogue sur la peinture <strong>de</strong> la table :<br />
(4)<br />
L'analyse discursive <strong>de</strong> (3.b) est explicitée sous (5) : le fond et le donné ne se recouvr<strong>en</strong>t<br />
pas comme le montr<strong>en</strong>t (5.b) et (5.c) :<br />
(5) a. TD (modifié par la réponse): { {Marie a poncé la table, Pierre a poncé la table,<br />
...} {Marie a peint la table, Paul a peint la table, ...},...}<br />
b. Donné: x P.la-table<br />
c. Fond: x a-poncé la-table<br />
Le troisième contexte (C-III) est égalem<strong>en</strong>t un contexte où l'inversion est inappropriée.<br />
C'est une paire Q-R où la réponse est complète, mettant <strong>en</strong> œuvre une stratégie simple sans<br />
remo<strong>de</strong>lage du TD : la paire (§3-2) que je répète sous (6) :<br />
(6) a. Et Marie, tu as <strong>de</strong>s nouvelles ?<br />
b. Maria llegó esta mañana.<br />
25
Son analyse est explicitée sous (7). Le fond et le donné se recouvr<strong>en</strong>t comme le montr<strong>en</strong>t<br />
(7.d) et (7.c) :<br />
(7) a. TD: {Marie est arrivée, Marie a téléphoné, ...}<br />
c. Donné: Marie P<br />
d. Fond: Marie P<br />
Le quatrième (C-IV), égalem<strong>en</strong>t, n'autorise pas l'inversion : c'est une réponse complète<br />
mettant <strong>en</strong> œuvre une stratégie simple : la paire (§3-9) que je répète sous (8) et dont<br />
j'explicite l'analyse sous (9) 40 :<br />
(8) a. Que se passe-t-il <strong>en</strong> bas <strong>de</strong> la rue ?<br />
b.: Los estudiantes están avanzando hacia el cruce.<br />
(9) a. TD: {les étudiants avanc<strong>en</strong>t, les policiers attaqu<strong>en</strong>t, ri<strong>en</strong> ne se passe, ...}<br />
b. Donné: x P <strong>en</strong>-bas-<strong>de</strong> la-rue<br />
c. Fond: x P <strong>en</strong>-bas-<strong>de</strong> la-rue<br />
L'analyse du contexte fournit trois paramètres : (a) la réponse est complète ou incomplète,<br />
(b) le fond et le donné se recouvr<strong>en</strong>t ou non et (c) le prédicat <strong>en</strong>tre ou n'<strong>en</strong>tre pas dans la<br />
proposition donnée. Afin d'isoler le paramètre pertin<strong>en</strong>t, je synthétise l'analyse sous forme<br />
d'un tableau :<br />
(10)<br />
Contexte Réponse<br />
Fond Prédicat<br />
complète = donné dans le donné<br />
C-I oui oui oui oui<br />
C-II non non non non<br />
C-III oui oui non non<br />
C-IV oui oui non non<br />
Inversion<br />
appropriée<br />
Comme le montre (10), le paramètre univoquem<strong>en</strong>t associé au placem<strong>en</strong>t préverbal ou<br />
postverbal est le troisième : le prédicat <strong>en</strong>tre dans la proposition donnée. J'<strong>en</strong> tire la<br />
première condition d'appropriation que j'appelle condition du prédicat (propriété ou<br />
relation) donnée :<br />
(11) Condition du prédicat donné (CPD) :<br />
L’inversion est appropriée si le prédicat est donné.<br />
La condition (11) ne fait pas référ<strong>en</strong>ce à l'articulation fond-focus et n'est associée à aucune<br />
forme syntaxique particulière. Elle peut donc être satisfaite dans la phrase racine comme<br />
dans la phrase subordonnée. Elle est indiffér<strong>en</strong>te aux différ<strong>en</strong>ts types d'articulation fondfocus<br />
distingués <strong>en</strong> (2-(2)) (focalisation sur le prédicat, sur un argum<strong>en</strong>t ou sur la<br />
phrase) 41 .<br />
5.2. CPD hors <strong>de</strong> l'inversion libreComme on vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> le noter, la condition CPD n'est<br />
pas associée à un substrat syntaxique particulier. On s'att<strong>en</strong>d donc à la voir satisfaite par<br />
d'autres types d'inversion que l'inversion libre, ce qui est le cas. L'inversion élaborative du<br />
français est appropriée avec focalisation étroite du sujet (12.a) (cf. égalem<strong>en</strong>t (§2-4)).<br />
40 C'est le contexte où l'inversion prés<strong>en</strong>tative est appropriée.<br />
41 Je rappelle que j'ai laissé <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>s l'analyse <strong>de</strong> l'articulation fond-focus <strong>de</strong> (2-(9)) répété partiellem<strong>en</strong>t<br />
sous (3). La réponse <strong>en</strong> français dans ce contexte (Marie l’a poncée) semble susceptible <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux marquages<br />
prosodiques : focalisation étroite sur le constituant Marie et focalisation large sur la phrase. Je ne dispose<br />
pas <strong>de</strong> données prosodiques suffisantes pour affirmer que ces <strong>de</strong>ux possibilités sont ouvertes dans les autres<br />
langues romanes, mais les comm<strong>en</strong>taires <strong>de</strong>s informateurs me conduis<strong>en</strong>t à p<strong>en</strong>ser qu'un marquage<br />
prosodique <strong>de</strong> Marie comme focus étroit ne r<strong>en</strong>drait pas l'inversion appropriée. Je subodore que c'est ce qui<br />
est capté dans les analyses actuelles sous le chef non analysé <strong>de</strong> contraste.<br />
26
Comme le montre (12), elle doit satisfaire CPD : dans une réponse qui ne repr<strong>en</strong>d pas le<br />
verbe <strong>de</strong> la question (et qui remodèle le TD), elle n'est pas appropriée (12.b) :<br />
(12) F Qui est reçu à l'exam<strong>en</strong> final ?<br />
a. Sont reçus tous les étudiants <strong>de</strong> Pierre.<br />
b. # Ont échoué tous les étudiants <strong>de</strong> Pierre.<br />
J'explicite l'analyse du TD remo<strong>de</strong>lé par (12.b) dans les termes du §4 :<br />
(13) a. TD (remo<strong>de</strong>lé par (12.b): {{Marie est reçue, Pierre est reçu, ...}, {Paul a échoué,<br />
Bernard a échoué, ...}}<br />
b. Donné: x P à l'exam<strong>en</strong>-final<br />
De même, on a déjà vu que l'ordre emphatique <strong>de</strong> l'espagnol n'est approprié que si le verbe<br />
est id<strong>en</strong>tique dans la question et la réponse (cf. le contraste (§2-(11)/(12)) ; je donne une<br />
nouvelle illustration ci-<strong>de</strong>ssous : <strong>en</strong> (14.a), le placem<strong>en</strong>t du sujet est approprié, il ne l'est<br />
pas <strong>en</strong> (14.b) :<br />
(14) E ¿ Don<strong>de</strong> trabajan Pierre y Paul ?<br />
Où travaill<strong>en</strong>t Pierre et Paul ?<br />
a. Los pobres <strong>de</strong>sgraciados trabajan <strong>en</strong> Jussieu.<br />
a'. En JUSSIEU trabajan los pobres <strong>de</strong>sgraciados.<br />
Les pauvres travaill<strong>en</strong>t à Jussieu<br />
b. ?? EN JUSSIEU pierd<strong>en</strong> el tiempo (los pobres <strong>de</strong>sgraciados).<br />
b'. (Los pobres <strong>de</strong>sgraciados) pierd<strong>en</strong> el tiempo <strong>en</strong> Jussieu.<br />
Ils / les pauvres perd<strong>en</strong>t leur temps à Jussieu.<br />
J’analyserai au §5.4 un contraste dans la relative <strong>en</strong> français afin <strong>de</strong> montrer que CPD<br />
r<strong>en</strong>d compte <strong>de</strong> l’inversion dans la subordonnée.<br />
5.3. Forme du donné<br />
J’ai considéré jusqu’à prés<strong>en</strong>t qu’un verbe est donné quand il est repris au contexte.<br />
C’était une facilité d’exposition. Je précise donc à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux contextes, qui pourrai<strong>en</strong>t<br />
sembler fournir <strong>de</strong>s contre-exemples à CPD, le cont<strong>en</strong>u effectif <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> donné.<br />
5.3.1. Le donné n'est pas le m<strong>en</strong>tionné<br />
J'ai assimilé le cont<strong>en</strong>u donné à un cont<strong>en</strong>u repris verbatim au contexte. Ce n'est qu'un cas<br />
particulier <strong>de</strong> la définition sémantique <strong>de</strong> donné (4-(14)) : “ le donné est la proposition<br />
ouverte exprimant le cont<strong>en</strong>u commun du TD ”. On observe que l'inversion peut être<br />
appropriée dans une réponse qui ne repr<strong>en</strong>d pas le verbe <strong>de</strong> la question. Le cas<br />
emblématique est (15) 42 :<br />
(15) Qui a assassiné K<strong>en</strong>nedy ?<br />
C El va matar l'Oswald.<br />
E. Lo mató Oswald.<br />
I L'ha uciso Oswald.<br />
P Matou-o o Oswald.<br />
Oswald l'a tué<br />
Les informateurs donn<strong>en</strong>t l'ordre postverbal <strong>de</strong> façon unanime. Assurém<strong>en</strong>t, tuer est un<br />
verbe différ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> assassiner. Mais, tuer et assassiner sont dans un rapport sémantique<br />
42 L'inversion libre n'est pas limitée au dialogue ; on la r<strong>en</strong>contre dans le discours suivi. C'est par<br />
exemple le cas <strong>de</strong> (i) ci-<strong>de</strong>ssous tiré d'un flash d'information : l'inversion dans cet énoncé est susceptible <strong>de</strong><br />
la même analyse que (5) :<br />
(i) IA Parigi è stato assassinato R.B. Lo ha ucciso uno squilibrato. (= ex. 40, B: 64<br />
[RAIUNO 8.6.93])<br />
27
particulier : toute <strong>de</strong>scription d'une év<strong>en</strong>tualité comme un assassinat implique une<br />
<strong>de</strong>scription où quelqu'un tue quelqu'un. La question qui l'a tué ? peut être traitée comme<br />
une question sémantiquem<strong>en</strong>t et pragmatiquem<strong>en</strong>t équival<strong>en</strong>te à qui l'a assassiné ?<br />
J'explicite l'analyse contextuelle <strong>de</strong> (15) <strong>en</strong> (16) ; on note SC le savoir partagé par les<br />
interlocuteurs :<br />
(16) TD : {Oswald a assassiné K<strong>en</strong>nedy, la CIA a assassiné K<strong>en</strong>nedy, ...}<br />
SC: ∀e ∀x ∀y (Assassiner (e,x,y) ⇒ tuer (e,x,y) )<br />
L'équival<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s questions <strong>en</strong> (15) repose sur une quasi-synonymie lexicale. Le donné<br />
peut mettre <strong>en</strong> œuvre une équival<strong>en</strong>ce beaucoup moins générale et uniquem<strong>en</strong>t<br />
pragmatique. C'est par exemple le cas <strong>de</strong> l'exemple <strong>en</strong> espagnol attesté (17) (tiré d'un film<br />
<strong>de</strong> Pedro Almodovar) qui a été analysé par Lambrecht 2001. Le locuteur répond à la<br />
question qui te l'a dit ? qu'il traite comme équival<strong>en</strong>te à comm<strong>en</strong>t tu le sais ? dans une<br />
situation où savoir quelque chose (concernant la vie intime <strong>de</strong>s personnes) revi<strong>en</strong>t à ce que<br />
quelqu'un vous le dise :<br />
(17) Comm<strong>en</strong>t tu le sais ?<br />
E.: a. Me lo ha contado Huma<br />
b. # Huma me lo ha contado (= ex. 21, Lambrecht 2001)<br />
Huma me l'a dit<br />
La nature sémantique / pragmatique du donné peut donner lieu à une variation <strong>en</strong>tre<br />
placem<strong>en</strong>t préverbal et postverbal du sujet. C'est le cas <strong>en</strong> (18) 43 . Les informateurs<br />
donn<strong>en</strong>t les <strong>de</strong>ux placem<strong>en</strong>ts pour le sujet :<br />
(18) Qui s'est occupé <strong>de</strong>s coureurs ?<br />
C a. Els ha <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>at <strong>en</strong> Pau.<br />
b. En Pau els ha <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>at.<br />
E a. Los <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>ó Pablo.<br />
b. Pablo los <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>ó.<br />
I a. Li ha all<strong>en</strong>ati Paul.<br />
b. Paul li ha all<strong>en</strong>ati.<br />
P a. O Paulo treinou-os.<br />
b. Treinou-os o Paulo.<br />
Paul les a <strong>en</strong>traînés<br />
La double possibilité s'explique <strong>de</strong> la manière suivante : s'occuper <strong>de</strong> et <strong>en</strong>traîner peuv<strong>en</strong>t<br />
être traités comme synonymes ou non. Dans une situation où les <strong>de</strong>ux verbes peuv<strong>en</strong>t être<br />
pris comme étant synonymes, les coureurs dont Paul s'occupe sont les coureurs que Paul<br />
<strong>en</strong>traîne. Dans ce cas, la question qui s'est occupé <strong>de</strong>s coureurs ? est équival<strong>en</strong>te à la<br />
question qui a <strong>en</strong>traîné les coureurs ? L’analyse du contexte est donnée sous (19) :<br />
(19) SC: ∀e ∀x ∀y (Entraîneur (x) & S'occuper-<strong>de</strong> (e,x,y) ⇒ Entraîner (e,x,y) )<br />
Dans une situation où Paul est un <strong>en</strong>traîneur et où il y a plusieurs catégories <strong>de</strong> personnes<br />
s’occupant <strong>de</strong>s coureurs (les <strong>en</strong>traîneurs, les soigneurs, etc.), les <strong>de</strong>ux verbes peuv<strong>en</strong>t être<br />
43 Je donne ci-<strong>de</strong>ssous un autre exemple, tiré <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>quête, qui est <strong>de</strong> la même eau :<br />
(i) Qui a préparé les pommes au four ?<br />
C La Maria les ha pelat.<br />
E María las peló.<br />
P A Maria <strong>de</strong>scascou-as. / Descascou-as a Maria.<br />
I Maria le ha sbucciate. / Le ha sbucciate Maria.<br />
Marie les a épluchées.<br />
La variation (inégale selon les informateurs) r<strong>en</strong>voie à une situation où la question qui a préparé les<br />
pommes au four ? peut être traitée ou non comme pragmatiquem<strong>en</strong>t équival<strong>en</strong>te à qui a épluché les<br />
pommes ? au regard <strong>de</strong> la quantité <strong>de</strong> travail requise pour ce g<strong>en</strong>re <strong>de</strong> plat : <strong>en</strong> effet, les pommes étant<br />
épluchées, il ne reste pas grand-chose à faire pour obt<strong>en</strong>ir le plat final.<br />
28
considérés comme n’étant pas synonymes : les coureurs que Paul <strong>en</strong>traîne form<strong>en</strong>t un<br />
sous-groupe <strong>de</strong>s coureurs <strong>en</strong> question. Dans ce cas, les questions qui s'est occupé <strong>de</strong>s<br />
coureurs ? et qui a <strong>en</strong>traîné les coureurs ? ne sont pas équival<strong>en</strong>tes ; on retrouve un<br />
contexte <strong>de</strong> stratégie complexe et <strong>de</strong> modification du TD comme l’explicite (20) :<br />
(20) a. TD (modifié par la question): { {Paul a <strong>en</strong>traîné les coureurs, Pierre a <strong>en</strong>traîné les<br />
coureurs,..} {Paul a soigné les coureurs, Pierre a soigné les coureurs,...}<br />
b. Donné : x P les-coureurs<br />
La condition pour l'inversion n'est pas remplie (cf. (20.b)), les réponses sans inversion<br />
décl<strong>en</strong>ch<strong>en</strong>t l’effet <strong>de</strong> réponse partielle et appell<strong>en</strong>t la poursuite <strong>de</strong> l’échange à propos <strong>de</strong>s<br />
relations <strong>en</strong>tre les coureurs et leur <strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t. On verra le même phénomène et le même<br />
effet sur le placem<strong>en</strong>t du sujet dans l'inversion stylistique dans les relatives plus bas.<br />
5.3.2. Le m<strong>en</strong>tionné peut ne pas être traité comme donné<br />
On a vu au §4.2 (cf. ex (§4-5)) qu'un verbe peut être repris au contexte et ne pas compter<br />
comme un prédicat donné. On s'att<strong>en</strong>d donc qu'il puisse y avoir une variation dans le<br />
placem<strong>en</strong>t du sujet dans ce type <strong>de</strong> contexte. C'est effectivem<strong>en</strong>t le cas. Pr<strong>en</strong>ons les<br />
réponses (22) dans le contexte (21) où est produit une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> confirmation avec<br />
focalisation sur le sujet (21.b) :<br />
(21) a. Contexte : Quelqu'un a fait disparaître le gâteau. Une mère s'adresse à un groupe<br />
d'<strong>en</strong>fants. [Répondre sans utiliser <strong>de</strong> clivée].<br />
b. Est-ce que c'est Pierre qui a mangé le gâteau ?<br />
On vérifie tout d'abord que l'inversion est inappropriée lorsque les locuteurs confirm<strong>en</strong>t le<br />
rôle <strong>de</strong> Pierre dans la disparition du gâteau, mais introduis<strong>en</strong>t un prédicat distinct <strong>de</strong> celui<br />
<strong>de</strong> la question :<br />
(22) Est-ce que c'est Pierre qui a mangé le gâteau ?<br />
C a. En Pere l’ha amagat. / b. # L'ha amagat <strong>en</strong> Pere<br />
E a. No, Pedro la escondió. / b. # No, la escondió Pedro.<br />
I a. Pietro l'ha nascoto. / b. # L'ha nascoto Pietro.<br />
P a. Não, o Pedro escon<strong>de</strong>u-o. / b. # Não, escon<strong>de</strong>u-o o Pedro.<br />
Pierre l'a caché.<br />
Lorsque les locuteurs confirm<strong>en</strong>t le rôle <strong>de</strong> Pierre dans la disparition du gâteau et le fait<br />
qu'il l'ait mangé, les informateurs considèr<strong>en</strong>t les <strong>de</strong>ux placem<strong>en</strong>ts du sujet comme naturels<br />
tout <strong>en</strong> associant à la version avec sujet préverbal un effet confirmatif plus fort :<br />
(23) Est-ce que c'est Pierre qui a mangé le gâteau ?<br />
C a. Sí, <strong>en</strong> Pere se l'ha m<strong>en</strong>jat.<br />
b. Sí, se l'ha m<strong>en</strong>jat <strong>en</strong> Pere.<br />
E a. Sí, Pedro se la comió.<br />
b. Sí, se la comió Pedro.<br />
I a. Si, Pietro l'ha mangiato.<br />
b. Si, l'ha mangiato Pietro.<br />
P a. Sim, comeu-o o Pedro.<br />
b. Sim, o Pedro comeu-o.<br />
Oui, Pierre l'a mangé.<br />
Le locuteur <strong>en</strong> choisissant le placem<strong>en</strong>t préverbal ne traite pas la propriété comme donnée.<br />
Il pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> charge et asserte le cont<strong>en</strong>u propositionnel <strong>en</strong>tier, ce qui décl<strong>en</strong>che l’effet <strong>de</strong><br />
confirmation plus forte dont font part les informateurs.<br />
5.4. Analyses particulières<br />
Je repr<strong>en</strong>ds dans ce paragraphe l'analyse <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux contrastes particuliers introduits au §2 et<br />
montre comm<strong>en</strong>t CPD permet <strong>de</strong> les expliquer.<br />
29
5.4.1. L’inversion <strong>en</strong> portugais<br />
On a laissé <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>s l'analyse du contraste relevé <strong>en</strong> portugais par Ambar (cf. §2.2) que<br />
je répète :<br />
(24) PQuem comeu a tarte?<br />
a. # (A tarte) comeu a Joana (about the others I do not know).<br />
b. A Joana comeu (about the others I do not know).<br />
La réponse (14.b) repr<strong>en</strong>d verbatim une proposition du contexte (p[ x a mangé le gâteau])<br />
et est associée à un effet <strong>de</strong> réponse incomplète dont est c<strong>en</strong>sée r<strong>en</strong>dre compte la <strong>de</strong>uxième<br />
partie <strong>de</strong> la réponse <strong>en</strong>tre par<strong>en</strong>thèses. Nous pouvons maint<strong>en</strong>ant r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> cet<br />
effet grâce à la notion <strong>de</strong> stratégie complexe.<br />
L'exemple est discursivem<strong>en</strong>t ambigu. La réponse peut mettre <strong>en</strong> jeu une stratégie<br />
d'élargissem<strong>en</strong>t du TD (les autres (Pierre, Paul, ...) n'ont pas mangé le gâteau, ils l'ont<br />
repoussé, ils ont mangé autre chose, etc.) ou d'éclatem<strong>en</strong>t du TD (Jeanne a mangé la<br />
quasi totalité du gâteau, Pierre a mangé les miettes, etc.). Admettons que la première<br />
stratégie soit la plus vraisemblable, elle est id<strong>en</strong>tique à celle que l'on a décrite pour (18) <strong>en</strong><br />
(20). Je l'explicite ci-<strong>de</strong>ssous :<br />
(25) a. TD (<strong>de</strong> la question): {Jeanne a mangé le gâteau, Pierre a mangé le gâteau, ..}<br />
b. TD (modifié par la réponse): {{Jeanne a mangé le gâteau, Pierre a mangé le<br />
gâteau, ..}, {Pierre a mangé un fruit, Paul a mangé un fruit, ..}, {Pierre a repoussé<br />
le gâteau, Paul a repoussé le gâteau,.. } }<br />
Donné: x P y<br />
Le TD modifié par la question ne dégage pas <strong>de</strong> proposition donnée : CPD n'est pas<br />
satisfaite, l'inversion n'est pas appropriée. Considérons la secon<strong>de</strong> stratégie d'éclatem<strong>en</strong>t du<br />
TD <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant une réponse qui l'explicite (26). On observe <strong>en</strong> (26) que l'inversion n'est<br />
pas appropriée :<br />
(26) P Quem comeu a tarte?<br />
A Maria comeu meta<strong>de</strong> e as crianças o resto.<br />
Trad.: Maria <strong>en</strong> a mangé la moitié et les <strong>en</strong>fants le reste<br />
Dans ce type <strong>de</strong> contexte, le portugais ne fait pas exception ; l'inversion n'est appropriée<br />
dans aucune <strong>de</strong>s langues considérées :<br />
(27) Qui a mangé le gâteau ?<br />
C La Maria <strong>en</strong> va m<strong>en</strong>jar la meitat i els n<strong>en</strong>s la resta.<br />
EMaría se comió la mitad y los niños se comieron el resto.<br />
I Maria ne ha mangiato la metà, e i bambini il resto.<br />
Marie <strong>en</strong> a mangé la moitié et les <strong>en</strong>fants le reste.<br />
On doit ici introduire une donnée propre au portugais : l'objet peut apparaître, dans ce<br />
contexte, <strong>en</strong> position préverbale ; du coup, le sujet est postverbal. C’est la donnée (1-(6))<br />
que je répète sous (28) :<br />
(28) PQuem comeu a tarte ?<br />
Meta<strong>de</strong> comeu a Maria, o resto não sei.<br />
On montre tout d’abord que (28) satisfait CPD. Afin <strong>de</strong> disposer d’un contraste plus net,<br />
je fais varier le contexte et considère le contraste (29)-(30). L’inversion est appropriée<br />
lorsque le verbe dans la réponse est id<strong>en</strong>tique à celui <strong>de</strong> la question (29) ; elle ne l’est pas<br />
<strong>en</strong> (30) où le verbe est différ<strong>en</strong>t. La relation dénotée par le verbe peindre doit être donnée<br />
pour autoriser le placem<strong>en</strong>t préverbal <strong>de</strong> l'objet :<br />
30
(29) P Quem pintou a mesa ?<br />
Qui a peint la table ?<br />
a. O topo pintou a Maria e o Paulo os pés.<br />
b. O topo pintou a Maria e os pés o Paulo.<br />
Marie a peint le <strong>de</strong>ssus et Paul les pieds<br />
(30) Quem pintou a mesa ?<br />
a. # O topo poliu a Maria e o Paulo pintou tudo.<br />
b. A Maria poliu o topo e o Paulo pintou tudo.<br />
Marie a poncé le <strong>de</strong>ssus et Paul a peint le tout<br />
Analysons maint<strong>en</strong>ant le placem<strong>en</strong>t préverbal <strong>de</strong> l’objet <strong>en</strong> (29) <strong>en</strong> explicitant le contexte<br />
<strong>de</strong> (29) sous (31) :<br />
(31) a. TD (initié par la question): {Marie a peint la table, Paul a peint la table, ...}<br />
b. TD (modifié par la réponse): {{Marie a poncé le <strong>de</strong>ssus, Paul a poncé les pieds,<br />
...}{Marie a peint les pieds, Paul a peint les pieds, ...}<br />
c. Donné: x P y<br />
Les constituants o topo ou os pés <strong>en</strong> (29) instanci<strong>en</strong>t la variable y postulée dans l'analyse<br />
du cont<strong>en</strong>u donné <strong>en</strong> (31.c) : ce sont <strong>de</strong>s shifteurs thématiques au s<strong>en</strong>s introduit au §4.4.<br />
On sait que la prosodie est s<strong>en</strong>sible à ce statut particulier <strong>en</strong> français ou <strong>en</strong> allemand. On<br />
peut donc formuler l'hypothèse que l'ordre <strong>de</strong>s mots <strong>en</strong> portugais est égalem<strong>en</strong>t s<strong>en</strong>sible à<br />
ce statut. Plus précisém<strong>en</strong>t, un constituant (autre que le sujet) jouant le rôle <strong>de</strong> shifteur<br />
thématique peut être préverbal 44 . Cette s<strong>en</strong>sibilité au rôle <strong>de</strong>s constituants dans le<br />
développem<strong>en</strong>t thématique pourrait r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> l'impression <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> plasticité <strong>de</strong><br />
l'ordre <strong>de</strong>s constituants que donne le portugais quand on le compare aux autres langues<br />
considérées.<br />
5.4.2. CPD dans la relative <strong>en</strong> français<br />
Je repr<strong>en</strong>ds l'analyse du contraste dans la relative du français introduit au §2.6.2, afin <strong>de</strong><br />
montrer que l'inversion stylistique du français, qui connaît une condition <strong>de</strong> légitimation<br />
syntaxique stricte (l'extraction), est s<strong>en</strong>sible à CPD tout comme l'inversion libre.<br />
Considérons les réponses à (32) et le contraste dans la relative <strong>en</strong>tre (33) et (34). En (33),<br />
le placem<strong>en</strong>t du sujet est libre et il ne semble pas y avoir <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s ou <strong>de</strong><br />
différ<strong>en</strong>ce pragmatique <strong>en</strong>tre (33.a) et (33.b) :<br />
(32) F Que sont <strong>de</strong>v<strong>en</strong>us les étudiants dont Bernard s'est occupé ?<br />
(33) a. Les étudiants dont s'est occupé Bernard ont tous brillamm<strong>en</strong>t réussi.<br />
b. Les étudiants dont Bernard s'est occupé ont tous brillamm<strong>en</strong>t réussi.<br />
En (34) ci-<strong>de</strong>ssous, la réponse met <strong>en</strong> œuvre une stratégie complexe <strong>en</strong> introduisant<br />
plusieurs groupes d'étudiants distingués par la propriété dénotée par la relative (les<br />
étudiants que Bernard a <strong>en</strong>traînés, ceux qu’il a dissuadés, etc.) ; l'inversion n'est plus<br />
appropriée :<br />
(34) Fa. # Les étudiants qu'a <strong>en</strong>traîné Bernard ont intégré l'équipe <strong>de</strong> France, ceux<br />
qu'il a dissuadés <strong>de</strong> poursuivre une carrière sportive ont repris un cursus<br />
normal.<br />
44 Cette hypothèse permettrait d’expliquer le jugem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s informateurs à propos <strong>de</strong> l’exemple <strong>de</strong> Ambar<br />
(voir note (7)) que je répète ci-<strong>de</strong>ssous ; a tarte n’est pas un shifteur thématique :<br />
(i) P Quem comeu a tarte?<br />
A tarte comeu a Joana (= ex. 7.b, A: 27)<br />
31
. Les étudiants que Bernard a <strong>en</strong>traînés ont intégré l'équipe <strong>de</strong> France,<br />
ceux qu'il a dissuadés <strong>de</strong> poursuivre une carrière sportive ont repris un<br />
cursus normal.<br />
Le contraste <strong>en</strong>tre (33) et (34) reçoit la même explication : l’inversion est appropriée si le<br />
prédicat est donné, elle ne l'est pas si le prédicat ne l'est pas. On confirme l’analyse <strong>en</strong><br />
montrant que la relative donne lieu à la même variation que la phrase racine (cf. (18) ci<strong>de</strong>ssus).<br />
A la différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> (33), les réponses <strong>en</strong> (35) ci-<strong>de</strong>ssous sont associées à une<br />
différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s. En (35.a), la propriété dénotée par la relative à sujet postverbal est<br />
interprétée comme différ<strong>en</strong>te <strong>de</strong> celle qui est dénotée dans la question : a réussi un sousgroupe<br />
du groupe d'étudiants introduit dans la question. La réponse (35.a) appelle une<br />
poursuite du discours à propos du groupe ou <strong>de</strong>s groupes complém<strong>en</strong>taires. En (35.b),<br />
l’inversion conduit les informateurs à interpréter la relative comme dénotant la même<br />
propriété que la relative <strong>de</strong> la question : a réussi le groupe d'étudiants introduit dans la<br />
question. La réponse (35.b) est complète, elle n’appelle pas la poursuite <strong>de</strong> l’échange sur<br />
le thème <strong>de</strong> discours introduit par la question :<br />
(35) F a. Les étudiants que Bernard a <strong>en</strong>traînés ont tous réussi aux Olympia<strong>de</strong>s<br />
universitaires.<br />
b. Les étudiants qu'a <strong>en</strong>traîné Bernard ont tous réussi aux Olympia<strong>de</strong>s<br />
universitaires.<br />
5.5. Synthèse<br />
La condition CPD repose crucialem<strong>en</strong>t sur la notion <strong>de</strong> donné, indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
l’articulation fond-focus. Elle se prés<strong>en</strong>te comme un principe unifié qui permet d'expliquer<br />
les cas <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>t obligatoire préverbal et postverbal. De plus, elle permet <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre<br />
compte <strong>de</strong>s contextes où le double placem<strong>en</strong>t est approprié. On a isolé <strong>de</strong>ux cas qui<br />
doiv<strong>en</strong>t être distingués. Dans le premier, une proposition peut être introduite dans le thème<br />
<strong>de</strong> discours, mais le locuteur choisit <strong>de</strong> se la réapproprier et <strong>de</strong> la traiter comme la<br />
contribution informative <strong>de</strong> son énoncé au contexte (l’assertion <strong>en</strong> quelque sorte annule le<br />
caractère donné <strong>de</strong> la proposition). Dans le second, le même matériel lexical peut donner<br />
lieu à une équival<strong>en</strong>ce sémantique / pragmatique ou non. Il est remarquable que le<br />
placem<strong>en</strong>t du GN sujet puisse jouer pour les locuteurs le rôle d’indice direct <strong>de</strong> ce<br />
contraste.<br />
6. Condition <strong>de</strong> la disposition présupposée<br />
Je passe à la secon<strong>de</strong> classe d'inversions. Nous l'avons repérée pour le mom<strong>en</strong>t avec <strong>de</strong>s<br />
énoncés prés<strong>en</strong>tant une inversion prés<strong>en</strong>tative (à faire). Je reti<strong>en</strong>s <strong>de</strong>ux traits associés à ce<br />
type d'inversion : (a) le référ<strong>en</strong>t du sujet et la propriété décrite par le verbe sont dans une<br />
certaine relation que la tradition appelle solidarité sémantique 45 et (b) elle est associée à<br />
un effet prés<strong>en</strong>tatif : l'énoncé introduit dans l'univers du discours une év<strong>en</strong>tualité et/ou un<br />
participant à cette év<strong>en</strong>tualité. Je propose d'analyser l'idée <strong>de</strong> solidarité à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la notion<br />
<strong>de</strong> disposition (Bourdieu 1995) et <strong>de</strong> dériver l'effet prés<strong>en</strong>tatif <strong>de</strong> la nature thétique <strong>de</strong> la<br />
proposition véhiculée par l'énoncé (<strong>en</strong>tre autres, Kuroda 1973). Ce type d'inversion<br />
présuppose (<strong>en</strong> un s<strong>en</strong>s pragmatique) l'attribution <strong>de</strong> la disposition décrite par le prédicat<br />
au référ<strong>en</strong>t du sujet. L'effet thétique découle <strong>de</strong> cette présupposition : l'énoncé décrit une<br />
manifestation <strong>de</strong> la disposition sur la base d'une attribution que présuppose le locuteur. La<br />
notion <strong>de</strong> disposition est donc au coeur <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> condition d'appropriation, la<br />
condition <strong>de</strong> la disposition présupposée (CDpr). Il y a au moins trois mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
présupposition <strong>de</strong> la disposition. Elle peut appart<strong>en</strong>ir au savoir <strong>en</strong>cyclopédique que<br />
possè<strong>de</strong> le locuteur sur la classe à laquelle apparti<strong>en</strong>t le référ<strong>en</strong>t du sujet : c'est le cas pour<br />
un sous-<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s inversions prés<strong>en</strong>tatives (§3.2). Elle peut appart<strong>en</strong>ir au savoir que<br />
possè<strong>de</strong> le locuteur sur le référ<strong>en</strong>t du sujet et qu'il suppose partagé dans la situation <strong>de</strong><br />
discours (§3.2). Je ferai l'hypothèse qu'elle peut appart<strong>en</strong>ir au co<strong>de</strong> narratif pour traiter un<br />
45 Le terme et l'observation sembl<strong>en</strong>t dus à Coseriu 1967, je r<strong>en</strong>voie égalem<strong>en</strong>t à Bernini (1995: 56) qui<br />
m<strong>en</strong>tionne d'autres travaux.<br />
32
type récalcitrant d'inversion prés<strong>en</strong>tative (§3.4). Le recours à la notion <strong>de</strong> théticité est<br />
justifiée au §3.3. L'hypothèse prés<strong>en</strong>tée dans cette étu<strong>de</strong> est donc que CPpr n'est pas<br />
cantonnée à l'inversion prés<strong>en</strong>tative : CDpr est une condition qui trouve à s'appliquer aux<br />
inversions <strong>en</strong> général sous <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s distincts.<br />
6.1 Préliminaires<br />
6.1.1. Les énoncés à inversion prés<strong>en</strong>tative. J'établis une distinction grossière <strong>en</strong>tre<br />
<strong>de</strong>ux types d'énoncés à inversion prés<strong>en</strong>tative : les énoncés où le verbe décrit une propriété<br />
stéréotypique du référ<strong>en</strong>t du sujet (1) et ceux où le verbe décrit la prés<strong>en</strong>ce, l'apparition ou<br />
la disparition du référ<strong>en</strong>t du sujet dans un lieu (2) :<br />
(1) I a. Suonavano le campane.<br />
Les cloches sonnai<strong>en</strong>t<br />
b. Abbaiavano i cani.<br />
Les chi<strong>en</strong>s aboyai<strong>en</strong>t<br />
(2) I E' <strong>en</strong>trato il marito.<br />
Le mari est <strong>en</strong>tré<br />
E Llega el tr<strong>en</strong>.<br />
Le train arrive<br />
La même distinction peut être établie sur les énoncés qui prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une inversion<br />
locative 46 . On appelle inversion locative la configuration <strong>de</strong> surface "GPlocatif V<br />
GNthème", le terme (qui a seulem<strong>en</strong>t une valeur <strong>de</strong>scriptive) ne préjuge pas <strong>de</strong> l'analyse<br />
syntaxique <strong>de</strong> cette configuration dans chacune <strong>de</strong>s langues.<br />
(3) F a. Dans le salon papotait un groupe <strong>de</strong> femmes.<br />
b. Sur la place poussait un grand figuier.<br />
I a. In questo palazzo ha vissuto un poeta (= 43c, Pinto, 1997: 68)<br />
Dans ce palais a vécu un poète<br />
b. In questa università hanno studato molti linguisti. (= ex 43e, id.: 68)<br />
Dans cette université ont étudié <strong>de</strong> nombreux linguistes<br />
(4) F a. De la maison sortit un groupe d'hommes cagoulés.<br />
I a. Dalla commissione v<strong>en</strong>gono due comm<strong>en</strong>ti. (= 39, Bernini 1995: 63)<br />
Du comité sont arrivés <strong>de</strong>ux comm<strong>en</strong>taires<br />
b. Sul palato artificiale v<strong>en</strong>gono fissati 62 elettrodi d'arg<strong>en</strong>to (= 11,<br />
Sornicola 1994: 39)<br />
Sur le palais artificiel sont attachés 62 électro<strong>de</strong>s d'arg<strong>en</strong>t<br />
On notera l'hétérogénéité lexicale dans les exemples ci-<strong>de</strong>ssus : les énoncés (1) ou (3)<br />
prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s verbes réputés inergatifs, ceux <strong>de</strong> (2) <strong>de</strong>s verbes réputés inaccusatifs.<br />
L'inversion locative <strong>en</strong> français est une inversion stylistique ordinaire (topicalisation <strong>de</strong><br />
GP) (Bonami et al. 1998).<br />
6.1.2. La notion <strong>de</strong> disposition. Attribuer une disposition à un individu, c'est poser qu'il<br />
aura un comportem<strong>en</strong>t particulier quand sont remplies les conditions <strong>de</strong> la manifestation<br />
<strong>de</strong> ce comportem<strong>en</strong>t. Dire que Jean est jaloux, c'est dire que Jean aura le comportem<strong>en</strong>t<br />
typique d'une personne jalouse lorsqu'il se trouvera dans une situation pouvant décl<strong>en</strong>cher<br />
ce type <strong>de</strong> comportem<strong>en</strong>t. On dit que le prédicat jaloux décrit une disposition. Les<br />
analyses philosophiques distingu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> disposition : les dispositions fortes (ou<br />
t<strong>en</strong>dance) et les dispositions faibles (ou capacité) (Ryle 1949). "Attribuer une t<strong>en</strong>dance à<br />
un individu, c'est prédire qu'il se comportera comme le veut cette t<strong>en</strong>dance si certaines<br />
circonstances sont réunies, alors qu'attribuer une capacité, c'est nier que s'il a l'occasion<br />
d'agir conformém<strong>en</strong>t à cette capacité, il soit nécessaire que l'individu ne le fasse pas"<br />
46 Par prud<strong>en</strong>ce, je me limite ici à l'inversion locative du français et <strong>de</strong> l'itali<strong>en</strong>.<br />
33
(d'après Bourdieu (1995 : 65)). Ainsi, on admet que les cloches ont la t<strong>en</strong>dance <strong>de</strong> sonner<br />
(les cloches sonn<strong>en</strong>t dans les circonstances où elles peuv<strong>en</strong>t sonner) et que Pierre a la<br />
capacité <strong>de</strong> jouer au t<strong>en</strong>nis (Pierre joue au t<strong>en</strong>nis quand les circonstances le permett<strong>en</strong>t et<br />
que ri<strong>en</strong> ne s’oppose à ce qu’il le fasse). Dans un cas, on prédit un fait, dans l'autre la<br />
possibilité d'un fait.<br />
La notion <strong>de</strong> t<strong>en</strong>dance (disposition forte) permet <strong>de</strong> capter au plus près l'effet<br />
stéréotypique que l'on a reconnu aux inversions illustrées <strong>en</strong> (1) et (3). Pr<strong>en</strong>ons un<br />
exemple : les cloches sonn<strong>en</strong>t. Cet énoncé décrit une propriété qu'il est crucial <strong>de</strong> connaître<br />
pour un emploi approprié du substantif cloche, <strong>de</strong> la même manière que l'emploi du terme<br />
citron présuppose que le locuteur connaît les propositions "les citrons sont jaunes, aci<strong>de</strong>s,<br />
leur jus est idéal pour étancher la soif etc." (Putnam 1975). La notion <strong>de</strong> capacité<br />
(disposition faible) permet <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre compte d'un cas d'inversion que j'illustrerai avec<br />
l'inversion stylistique du français (§6.3). Pour le mom<strong>en</strong>t reste <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>s la<br />
caractérisation <strong>de</strong>s énoncés prés<strong>en</strong>tant un verbe <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ce, apparition ou disparition<br />
illustrés <strong>en</strong> (2) et (4) ; je ne la repr<strong>en</strong>drai qu'<strong>en</strong> fin <strong>de</strong> section (§6.4).<br />
Bourdieu souligne la dim<strong>en</strong>sion conditionnelle <strong>de</strong> l'attribution dispositionnelle : la<br />
disposition ne se manifeste que si certaines circonstances spécifiques sont réunies. Il<br />
l'explicite dans la définition (5) où "
La première classe d'inversions légitimée par CDpr est exemplifiée dans le petit discours<br />
(9) : elle met <strong>en</strong> jeu une disposition forte dans le savoir <strong>en</strong>cyclopédique du locuteur :<br />
(9) I [Alle sette di sera ri<strong>en</strong>trò al villaggio.] Suonavano le campane.<br />
[Abbaiavano i cani. Si diresse verso la chiesa.]<br />
A sept heures du soir il r<strong>en</strong>tra au village. Les cloches sonnai<strong>en</strong>t. Les<br />
chi<strong>en</strong>s aboyai<strong>en</strong>t. Il se dirigea vers l'église<br />
Deux facteurs r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t l'inversion appropriée : (a) le locuteur connaît (6) et (b) la situation<br />
décrite dans le contexte est une situation où la disposition trouve à se manifester : <strong>en</strong> (9),<br />
le mon<strong>de</strong> décrit est celui d'un village à l'heure <strong>de</strong> l'angélus.<br />
La forme particulière <strong>de</strong> CPD dans ce cas est explicitée <strong>en</strong> (10) : (10a) est une condition<br />
sur le savoir du locuteur (qui est dans ce cas quasim<strong>en</strong>t assimilable à son savoir lexical) et<br />
(10b) est une condition sur l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t discursif :<br />
(10) Condition <strong>de</strong> la disposition forte présupposée :<br />
a. Le locuteur connaît une disposition forte id<strong>en</strong>tificatoire du référ<strong>en</strong>t du sujet :<br />
[∀x (P(x) & Se trouver dans la situation <strong>de</strong> Q(x) ⇒ Q(x))] où P est la propriété<br />
id<strong>en</strong>tifiant le référ<strong>en</strong>t du sujet 47 .<br />
b. Le contexte décrit une situation appropriée <strong>de</strong> manifestation <strong>de</strong> Q(x).<br />
Le petit discours (9) fournit une secon<strong>de</strong> illustration : abbaiavano i cani. La même<br />
condition légitime la construction inaccusative dans les phrases racines que l'on r<strong>en</strong>contre<br />
<strong>en</strong> français dans le discours suivi (le récit) 48 . Le français se distingue <strong>de</strong>s autres langues<br />
romanes <strong>en</strong> ce que ce type <strong>de</strong> construction connaît une contrainte supplém<strong>en</strong>taire ; <strong>en</strong> effet,<br />
(9) ne peut pas être traduit comme <strong>en</strong> (11) :<br />
(11) F * [Pierre r<strong>en</strong>tra au village à 7 sept heures.] Sonnai<strong>en</strong>t les cloches,<br />
aboyai<strong>en</strong>t les chi<strong>en</strong>s.<br />
Le procès doit dénoter une transition comme le montre (12) 49 :<br />
47 Le sujet peut être un nom propre : dans ce cas, P est implicite (je dois cette observation à Olivier<br />
Bonami) :<br />
(i) Le sil<strong>en</strong>ce se fit. Alors comm<strong>en</strong>ça à sonner Big B<strong>en</strong>.<br />
48 La construction inaccusative dans la phrase racine ne se r<strong>en</strong>contre pas dans le discours adressé (comparer<br />
avec (4) ci-<strong>de</strong>ssus) :<br />
(i) F a. [Que se passait-il ?] * Sonnai<strong>en</strong>t les cloches.<br />
b. [Que se passa-t-il ?] * Se mir<strong>en</strong>t à sonner les cloches.<br />
Je donne ci-<strong>de</strong>ssous quelques exemples d'énoncés prés<strong>en</strong>tant une construction inaccusative: (a,b,c) sont<br />
repris au rec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Atkinson (1973) : les énoncés (d,e) sont construits à partir d'exemples tirés <strong>de</strong> la<br />
base Frantext.<br />
(i) F a. A 10 heures, il tonna très fort. Aussitôt, tout autour <strong>de</strong> moi, s'aplatir<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
arges gouttes <strong>de</strong> pluie.<br />
b. Le bruit d'une auto lancée à toute vitesse se rapprochait. Et soudain déboucha du<br />
porche une Ford kaki où trois bras parallèles faisai<strong>en</strong>t le salut fasciste.<br />
c. Pierre se leva. Aussitôt se réveilla une douleur anci<strong>en</strong>ne.<br />
d. Le sil<strong>en</strong>ce se fit. Alors <strong>en</strong>trèr<strong>en</strong>t plusieurs soldats <strong>en</strong> armes. Ils prir<strong>en</strong>t<br />
rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t position dans l'assemblée.<br />
e. On signa la paix. Aussitôt apparur<strong>en</strong>t les premiers signes <strong>de</strong> discor<strong>de</strong>. Les factions se<br />
multiplièr<strong>en</strong>t, les prêtres appelèr<strong>en</strong>t à la sécession.<br />
49 Cette contrainte ne vaut que pour la phrase racine comme le montre (i) :<br />
(i) F Je voudrais bi<strong>en</strong> que n'aboi<strong>en</strong>t plus les chi<strong>en</strong>s.<br />
Je r<strong>en</strong>voie à Za<strong>en</strong><strong>en</strong> 1993 pour les li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre ce type <strong>de</strong> restriction aspectuelle et la construction<br />
inaccusative. Dans la phrase racine du français contemporain, la phrase doit égalem<strong>en</strong>t comporter un<br />
connecteur temporel (alors, aussitôt, auparavant, etc.) qui n'est pas nécessairem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> tête <strong>de</strong> phrase (ce qui<br />
r<strong>en</strong>d douteuse toute analyse <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> focalisation <strong>de</strong> l'adverbial) :<br />
(ii) F On éteignit les lumières. Se mit aussitôt à aboyer une meute <strong>de</strong> chi<strong>en</strong>s.<br />
Cette contrainte ne vaut pas dans les circonstancielles temporelles ou dans les indications scéniques :<br />
35
(12) F a. ??# On éteignit les lumières. Aussitôt aboyèr<strong>en</strong>t les chi<strong>en</strong>s.<br />
b. On éteignit les lumières. Aussitôt se mir<strong>en</strong>t à aboyer les chi<strong>en</strong>s.<br />
La même condition (10) s'applique à l'inversion locative avec une petite différ<strong>en</strong>ce qui<br />
concerne (10b) 50 . Selon (10a), l'état ou l'activité décrite par le verbe doit dénoter une<br />
disposition du référ<strong>en</strong>t du sujet. C'est ce qu'illustr<strong>en</strong>t les contrastes <strong>en</strong> (13) et (14) ci<strong>de</strong>ssous.<br />
En (13), papoter peut être considéré comme une t<strong>en</strong>dance <strong>de</strong>s femmes (elles<br />
papot<strong>en</strong>t dès que l'occasion s’<strong>en</strong> prés<strong>en</strong>te) et non pas crier 51 :<br />
(13) F a. Il <strong>en</strong>tra dans le château. Dans le salon papotait un groupe <strong>de</strong> femmes.<br />
b. # Il r<strong>en</strong>tra dans le château. Dans le salon criait un groupe <strong>de</strong> femmes.<br />
En (14), se dresser est une t<strong>en</strong>dance <strong>de</strong>s cathédrales et non pas s'écrouler ; par contre, c'est<br />
une t<strong>en</strong>dance avérée <strong>de</strong>s châteaux <strong>de</strong> sable :<br />
(14) F a. Il <strong>en</strong>tra dans la ville. Sur la place se dressait une cathédrale.<br />
a'.# Il <strong>en</strong>tra dans la ville. Sur la place s'écroulait une cathédrale.<br />
b. Sur la plage s'écroulait un château <strong>de</strong> sable.<br />
De plus, le lieu décrit par le GP doit dénoter un lieu qui est un lieu typique <strong>de</strong><br />
manifestation <strong>de</strong> la t<strong>en</strong>dance. C’est ce que montre (15) : la cour d'un château n'est pas un<br />
lieu typique <strong>de</strong> repos pour un cadavre alors qu'elle est l’<strong>en</strong>droit typique où se trouve le<br />
puits d'un château :<br />
(15) F a. ? # Il <strong>en</strong>tra dans le château. Dans la cour se trouvait un cadavre.<br />
b. Il <strong>en</strong>tra dans le château. Dans la cour se trouvait un puits.<br />
Cette propriété explique la différ<strong>en</strong>ce d'<strong>en</strong>châssem<strong>en</strong>t discursif <strong>en</strong>tre les énoncés<br />
prés<strong>en</strong>tant une inversion prés<strong>en</strong>tative (ou une construction inaccusative <strong>en</strong> français) et<br />
ceux qui prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une inversion locative. Les premiers <strong>de</strong>mand<strong>en</strong>t que soit introduit un<br />
contexte qui autorise la manifestation <strong>de</strong> la disposition, ce qui les r<strong>en</strong>d inappropriés <strong>en</strong><br />
début <strong>de</strong> récit 52 . Cette contrainte peut être satisfaite directem<strong>en</strong>t par le GN <strong>de</strong> l'inversion<br />
locative, ce qui explique que les seconds puiss<strong>en</strong>t apparaître <strong>en</strong> début <strong>de</strong> récit, comme<br />
l'illustre l'exemple bi<strong>en</strong> connu dans les étu<strong>de</strong>s consacrées au français :<br />
(16) F Dans une forêt lointaine vivait un vieil ermite.<br />
6.3. La disposition faible dans le savoir d'arrière-plan<br />
La secon<strong>de</strong> classe d'inversion met <strong>en</strong> jeu une disposition faible (capacité) du référ<strong>en</strong>t du<br />
sujet dans le savoir d'arrière-plan. Elle est illustrée par le contraste (17) dans la relative du<br />
français considérée <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> tout contexte 53 . L'inversion est possible dans les<br />
(iii) F a. Tandis qu'aboyai<strong>en</strong>t les chi<strong>en</strong>s, Pierre travaillait.<br />
b. Acte II, scène 3, <strong>en</strong>tre Paul.<br />
50 L'inversion locative connaît égalem<strong>en</strong>t une restriction portant sur l'id<strong>en</strong>tifiabilité relative <strong>de</strong>s RD<br />
associés au GN locatif et au GN thème. Je ne les expose pas ici (voir Marandin 1997).<br />
51 L'attribution <strong>de</strong> disposition est le vecteur privilégié du politiquem<strong>en</strong>t incorrect.<br />
52 Ce fait a été relevé par les <strong>de</strong>scripteurs <strong>de</strong> la tradition grammaticale. Par exemple, Le Bidois 1950<br />
note : “ ce type d'inversion [l’inversion absolue dans la taxinomie <strong>de</strong> Le Bidois] ne se r<strong>en</strong>contre qu'à<br />
l'intérieur d'un récit. Il faut reconnaître, <strong>en</strong> effet, que ces inversions absolues se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t "généralem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> cours d'un récit", pour la raison bi<strong>en</strong> simple que l'on n'a guère l'occasion d'énoncer l'arrivée d'un<br />
événem<strong>en</strong>t avant d'avoir exposé les circonstances dans lesquelles il se produit (ibid.: 21). La situation<br />
d'énonciation peut jouer ce rôle, ce qui explique qu'on peut avoir <strong>de</strong>s annonces où l'inversion est légitimée<br />
par CDpr (cf. §4.4.2).<br />
53 Je n'ai pas étudié <strong>en</strong> détail cette modalité <strong>de</strong> présupposition dans l'<strong>en</strong>quête ; je ne peux donc pas décrire<br />
d'autres cas dans les autres langues romanes. Je signale seulem<strong>en</strong>t le contraste suivant <strong>en</strong> itali<strong>en</strong> où<br />
contrast<strong>en</strong>t les <strong>de</strong>ux propriétés 'porter une robe' et 'chiffonner nerveusem<strong>en</strong>t une robe' :<br />
(i) I [La Callas era <strong>de</strong>pressa.]<br />
La Callas était déprimée<br />
36
elatives <strong>en</strong> (17a), elle ne l'est pas <strong>en</strong> (17b) ; ce qui différ<strong>en</strong>cie ces <strong>de</strong>ux relatives, c'est la<br />
propriété dénotée par le GV (lire, écrire, acheter <strong>de</strong>s livres vs brûler <strong>de</strong>s livres).<br />
(17) F a. La liste <strong>de</strong>s livres qu'a lu (acheté, écrit) Proust à l'automne 1917 ne<br />
nous est pas parv<strong>en</strong>ue.<br />
a'. La liste <strong>de</strong>s livres que Proust a lus (achetés, écrits) à l'automne 1917<br />
ne nous est pas parv<strong>en</strong>ue.<br />
b. ? # La liste <strong>de</strong>s livres qu'a brûlé Proust à l'automne 1917 ne nous est<br />
pas parv<strong>en</strong>ue.<br />
b'. La liste <strong>de</strong>s livres que Proust a brûlés à l'automne 1917 ne nous est pas<br />
parv<strong>en</strong>ue.<br />
On notera que l'inversion <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t possible avec brûler <strong>de</strong>s livres si l'énoncé apparaît dans<br />
un discours où a été introduit le fait que Proust a effectivem<strong>en</strong>t brûlé <strong>de</strong>s livres, c'est ce<br />
qu'illustre le petit discours (18) 54 :<br />
(18) F Proust et Mallarmé étai<strong>en</strong>t très déprimés par leurs échecs, ils détruisai<strong>en</strong>t<br />
manuscrits sur manuscrits. On ne connaîtra jamais la liste <strong>de</strong>s livres qu'a<br />
brûlé Proust à l'automne 1917.<br />
La possibilité <strong>de</strong> l'inversion dans le discours (18) montre bi<strong>en</strong> que l'inversion est s<strong>en</strong>sible à<br />
une information accessible dans l'univers d'énonciation. Reste à caractériser le contraste<br />
<strong>en</strong>tre lire, écrire, acheter et brûler (<strong>de</strong>s livres). Je propose <strong>de</strong> le caractériser <strong>en</strong> termes <strong>de</strong><br />
t<strong>en</strong>dance faible : on s'att<strong>en</strong>d à ce que Proust (qui est un écrivain) lise, écrive, achète <strong>de</strong>s<br />
livres, mais non qu'il les détruise <strong>en</strong> les brûlant. Nul n'est besoin d'avoir <strong>de</strong> connaissance<br />
particulière concernant Proust pour construire la propriété id<strong>en</strong>tifiante d'un ou plusieurs<br />
livre(s) sur la base d'une disposition faible. Construire une propriété sur la base d'une<br />
capacité exceptionnelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qu'elle ait été introduite dans l'univers d'énonciation. Une<br />
capacité générique (les écrivains écriv<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s livres) légitime l'inversion sans qu'il soit<br />
besoin qu'elle soit rappelée dans le contexte, alors qu'une capacité exceptionnelle doit avoir<br />
fait l'objet d'une introduction explicite dans le contexte immédiat.<br />
Je ne donne pas d'explicitation <strong>de</strong> la forme particulière <strong>de</strong> CDpr dans ce cas, car cela<br />
requiert la construction d'un modèle <strong>de</strong> l'état épistémique du locuteur qui nous <strong>en</strong>traînerait<br />
trop loin dans cette étu<strong>de</strong> consacrée aux langues romanes (je r<strong>en</strong>voie par exemple à<br />
Ginzburg <strong>en</strong> prép. ou Marandin <strong>en</strong> prép.).<br />
On compr<strong>en</strong>d maint<strong>en</strong>ant pourquoi il est impossible <strong>de</strong> donner une caractérisation lexicale<br />
<strong>de</strong> l'inversion légitimée par CDpr : si l'inversion prés<strong>en</strong>tative, l'inversion locative et la<br />
construction inaccusative du français sont limitées aux verbes intransitifs, ce n'est pas le<br />
cas pour l'inversion stylistique légitimée par CDpr (écrire, acheter sont <strong>de</strong>s verbes<br />
transitifs). S'il est exact que l'inversion prés<strong>en</strong>tative et la construction inaccusative du<br />
français sont limitées à <strong>de</strong>s verbes non ag<strong>en</strong>tifs (ce qu'illustre <strong>en</strong>tre autres (19)), ce n'est<br />
pas le cas dans l'inversion stylistique (le sujet reste ag<strong>en</strong>tif dans les relatives <strong>de</strong> (17)).<br />
(19) F a. Pierre se leva. Aussitôt se réveilla une douleur anci<strong>en</strong>ne. (Atkinson<br />
1973)<br />
b. * Pierre se leva. Aussitôt se réveilla Marie.<br />
a. Il vestito nero che la diva portava / che portava la diva era macchiato di lacrime.<br />
La robe noire que portait la diva était maculée <strong>de</strong> larmes<br />
b. Il vestito nero che la diva stropicciava (nervosam<strong>en</strong>te) / # che stropicciava la diva era<br />
macchiato di lacrime.<br />
La robe noire que la diva chiffonnait nerveusem<strong>en</strong>t était maculée <strong>de</strong> larmes<br />
Par ailleurs, il semble bi<strong>en</strong> que ce soit généralem<strong>en</strong>t cette présupposition qui légitime l'inversion dans les<br />
interrogatives partielles dans les phrases racines <strong>en</strong> français (cf. (1b.i) ci-<strong>de</strong>ssus).<br />
54 Le petit discours (18) est purem<strong>en</strong>t fictionnel ! L'inversion est égalem<strong>en</strong>t appropriée si on change le<br />
référ<strong>en</strong>t du sujet :<br />
(i) On ne connaîtra jamais le nombre <strong>de</strong>s livres qu'ont brûlé les nazis dans les années 30.<br />
37
6.4. La théticité<br />
Les énoncés qui prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une inversion légitimée par CDpr sont thétiques. Je rappelle<br />
qu'on oppose la proposition catégorique et la proposition thétique sur la base <strong>de</strong> la<br />
prédication : dans la proposition catégorique, une propriété est attribuée au référ<strong>en</strong>t du<br />
sujet (le sujet est catégorique ou <strong>en</strong>core un predicatum). Il n'y a pas d'attribution d'une<br />
propriété au sujet dans la proposition thétique : il dénote un participant à l'év<strong>en</strong>tualité au<br />
même titre que les autres constituants <strong>de</strong> l'énoncé.<br />
J'avance l'hypothèse que l'effet thétique <strong>de</strong> l'inversion légitimée par CDpr est liée au fait<br />
que la disposition décrite par le prédicat n'est pas attribuée "dans l'énoncé", mais<br />
présupposée par le locuteur. On peut sout<strong>en</strong>ir l'intuition <strong>en</strong> comparant les petits discours<br />
(20) et (21) : les informateurs préfèr<strong>en</strong>t nettem<strong>en</strong>t le placem<strong>en</strong>t préverbal du sujet <strong>en</strong> (20),<br />
alors qu'ils préfèr<strong>en</strong>t le placem<strong>en</strong>t postverbal <strong>en</strong> (21). En (20), l'énoncé s'inscrit dans un<br />
contexte où les cloches avai<strong>en</strong>t perdu leur disposition à sonner ; l'énoncé la leur ré-attribue,<br />
alors qu'<strong>en</strong> (21), l'énoncé décrit une sonnerie <strong>de</strong> cloche dans un contexte tout à fait<br />
prototypique (un village, l'heure <strong>de</strong> l'angélus, etc.) :<br />
(20) C L'església havia estat reconstruïda <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong>l terratrèmol. Les campanes<br />
tornav<strong>en</strong> a tocar. La porta era completam<strong>en</strong>t nova.<br />
EDespués <strong>de</strong>l terremoto habían reconstruido la iglesia. Las campanas<br />
volvieron a tocar, la puerta era nuevecita.<br />
I La chiesa era stata ricostruita dopo il terremoto. Le campane suonavano di<br />
nuovo. La porta era nuova fiammante.<br />
PA igreja fora reconstruída após o terramoto. Os sinos badalavam<br />
novam<strong>en</strong>te. A porta estava novinha em folha.<br />
L'église avait été reconstruite après le tremblem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> terre. Les cloches<br />
sonnai<strong>en</strong>t [à nouveau]. La porte était flambant neuve.<br />
(21) C Va tornar al poble a les set <strong>de</strong>l vespre. Tocav<strong>en</strong> les campanes, els gossos<br />
bordav<strong>en</strong>. Es va dirigir cap a l'església.<br />
ERegresó al pueblo a las siete <strong>de</strong> la noche. Estaban tocando las campanas,<br />
ladraban los perros. Se dirigió hacia la iglesia.<br />
I Alle sette di sera ri<strong>en</strong>tró al villaggio. Suonavano le campane. Abbaiavano i<br />
cani. Si diresse verso la chiesa.<br />
PVoltou à al<strong>de</strong>ia pelas sete horas da tar<strong>de</strong>. Badalavam os sinos, ladravam os<br />
cães. Dirigiu-se à igreja.<br />
Il r<strong>en</strong>tra au village à sept heures du soir. Les cloches sonnai<strong>en</strong>t, les chi<strong>en</strong>s<br />
aboyai<strong>en</strong>t. Il se dirigea vers l'église.<br />
Le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre inversion et théticité dans les langues romanes a fait l'objet d'une étu<strong>de</strong><br />
importante : Matras & Sasse 1995. L'étu<strong>de</strong> conclut que l'inversion n'est pas un marqueur<br />
<strong>de</strong> théticité. La conclusion est correcte puisque les énoncés prés<strong>en</strong>tant une inversion<br />
légitimée par CPD véhicul<strong>en</strong>t généralem<strong>en</strong>t une proposition catégorique. L'hypothèse que<br />
je prés<strong>en</strong>te ici est que seuls les énoncés prés<strong>en</strong>tant une inversion légitimée par CDpr sont<br />
obligatoirem<strong>en</strong>t thétiques 55 .<br />
6.4.1 Critères. On peut avancer <strong>de</strong>ux argum<strong>en</strong>ts supplém<strong>en</strong>taires pour sout<strong>en</strong>ir<br />
l'hypothèse. Tout d'abord, un énoncé dispositionnel (cf. (7a)) ne peut jamais prés<strong>en</strong>ter<br />
l'inversion du sujet :<br />
(22) Quel est le cri <strong>de</strong>s chi<strong>en</strong>s ?<br />
I a. I cani abbaiono.<br />
55 On admet généralem<strong>en</strong>t que le référ<strong>en</strong>t du sujet ne doit pas être id<strong>en</strong>tifié et actif dans l'énoncé véhiculant<br />
la proposition thétique. On lie donc théticité et statut du référ<strong>en</strong>t du sujet dans le discours et on <strong>en</strong> fait un<br />
critère <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong> la proposition thétique. Cette généralisation n'est pas toujours vérifiée comme<br />
on le verra plus bas ; elle me paraît non ess<strong>en</strong>tielle pour caractériser la théticité.<br />
38
. # Abbaiono i cani.<br />
Les chi<strong>en</strong>s aboi<strong>en</strong>t<br />
Ensuite, les énoncés prés<strong>en</strong>tant une inversion légitimée par CDpr n'autoris<strong>en</strong>t pas<br />
l'anaphore régressive dans la phrase complexe : l'inversion apparaît dans une adverbiale<br />
temporelle antéposée ou une relative dans un GX antéposé 56 . On observe la même<br />
impossibilité dans les <strong>de</strong>ux cas d'inversion reconnus ci-<strong>de</strong>ssus :<br />
(23) I a. Quando [i cani]i abbaiono, [e]i fanno paura a tutto il vicinato.<br />
b. Quando abbaiono [i cani]i, [e]*i fanno paura a tutto il vicinato.<br />
E a. Cuando [mis perros]i ladran, [e]i asustan a todo el vecindario.<br />
b. Cuando ladran [mis perros]i, [e]*i asustan a todo el vecindario.<br />
Quand mes chi<strong>en</strong>s aboi<strong>en</strong>t, ils effrai<strong>en</strong>t tout le voisinage<br />
(24) F a. Dans les pages que [Proust]i rédigea vers la fin <strong>de</strong> sa vie, [il]i mit tout sa<br />
haine <strong>de</strong> l'aristocratie.<br />
b. Dans les pages que rédigea [Proust]i vers la fin <strong>de</strong> sa vie,[il]*i mit tout<br />
sa haine <strong>de</strong> l'aristocratie.<br />
La possibilité <strong>de</strong> l'anaphore régressive est liée au caractère catégorique du sujet, elle est<br />
donc impossible si le sujet est thétique 57 .<br />
6.4.2 L'effet prés<strong>en</strong>tatif. La notion <strong>de</strong> théticité permet <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> l'effet<br />
prés<strong>en</strong>tatif attaché à ce type d'inversion. Sasse 1987 oppose <strong>de</strong>ux valeurs <strong>de</strong>s énoncés<br />
thétiques dans le discours : ils introduis<strong>en</strong>t une év<strong>en</strong>tualité ou bi<strong>en</strong> un participant à<br />
l'év<strong>en</strong>tualité 58 . De fait, il ne s'agit pas véritablem<strong>en</strong>t d'une opposition : le second effet est<br />
<strong>en</strong> effet subordonné au premier comme l’établit l'analyse <strong>de</strong> Ladusaw 1994 que je<br />
repr<strong>en</strong>ds.<br />
“ Dans un jugem<strong>en</strong>t thétique [un chat dort] 59 , seule l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’év<strong>en</strong>tualité est l’objet<br />
<strong>de</strong> l’assertion, mais asserter cette <strong>de</strong>scription oblige indirectem<strong>en</strong>t, obliquem<strong>en</strong>t<br />
(obliquely), le locuteur à reconnaître l’exist<strong>en</strong>ce du chat. Le chat a une exist<strong>en</strong>ce beaucoup<br />
plus floue dans un jugem<strong>en</strong>t thétique que dans un jugem<strong>en</strong>t catégorique où son exist<strong>en</strong>ce<br />
est posée préalablem<strong>en</strong>t, avant <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à la prédication. De cette manière, la conception<br />
<strong>de</strong> Br<strong>en</strong>tano du mo<strong>de</strong> thétique <strong>de</strong> jugem<strong>en</strong>t met au premier plan un objet, l’év<strong>en</strong>tualité, tout<br />
<strong>en</strong> impliquant l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s sous-parties <strong>de</strong> cet objet complexe ” (d’après Ladusaw,<br />
1994 : 255).<br />
L'énoncé thétique décrit une év<strong>en</strong>tualité et l'assertion <strong>de</strong> la proposition décrivant cette<br />
év<strong>en</strong>tualité implique l'exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ses participants. L'emploi d'un énoncé thétique permet<br />
donc d'introduire un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours <strong>de</strong> façon indirecte (cf. l'emploi <strong>de</strong> oblique dans<br />
l’analyse <strong>de</strong> Ladusaw) <strong>en</strong> introduisant une év<strong>en</strong>tualité dans l'univers <strong>de</strong> discours. C'est ce<br />
qui explique la fonction discursive que joue généralem<strong>en</strong>t ce type d'énoncés dans le<br />
discours : ils permett<strong>en</strong>t que soi<strong>en</strong>t introduits un protagoniste ou une circonstance<br />
pertin<strong>en</strong>ts pour le récit à v<strong>en</strong>ir. D'où leur parfum méta-narratif qui a été bi<strong>en</strong> repéré par les<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> corpus <strong>de</strong> discours attestés 60 .<br />
56 Ils autoris<strong>en</strong>t que le GN sujet soit tête d'une chaîne d'anaphorique dans le discours suivi, ce qui n'est pas<br />
inatt<strong>en</strong>du étant donné la préval<strong>en</strong>ce du processus d'accommodation dans le discours (Kamp & Reyle<br />
1973) :<br />
(i) F Le sil<strong>en</strong>ce se fit. Aussitôt <strong>en</strong>tra [un soldat <strong>en</strong> armes]i. [Il]i avait fière allure.<br />
57 Je réinterprète ici une observation <strong>de</strong> Zubizarreta (1998 : 9).<br />
58 On retrouve la même opposition dans Wehr 1984 qui oppose "Topik-Introduktion" et "neutrale<br />
Beschreibung" (ibid. : 95).<br />
59 Ladusaw repr<strong>en</strong>d l’exemple <strong>en</strong> japonais <strong>de</strong> Kuroda : neko ga asoko <strong>de</strong> nemutte iru (Un / le chat dort là).<br />
60 Ainsi Bernini (1995 : 69) note pour le corpus qu'il étudie : “ In non-initial clauses, VS or<strong>de</strong>r [...] is<br />
employed only if the clause does not <strong>de</strong>scribe one of the subev<strong>en</strong>ts constituting the main line of the news<br />
item ”.<br />
39
L'analyse permet <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre compte d'une observation, fréquemm<strong>en</strong>t faite dans les étu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> discours attestés, concernant le statut contextuel du référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours (RD) associé<br />
au GN sujet : ce n'est pas un référ<strong>en</strong>t actif, ce qui est fréquemm<strong>en</strong>t illustré avec le petit<br />
discours (25)<br />
(25) I a. # Maria mi ha scritto una lettera. E' arrivata la lettera ieri.<br />
b. Maria mi ha scritto una lettera. La lettera é arrivata ieri.<br />
E a. # María me escribió una carta. Llegó la carta ayer.<br />
b. María me escribió una carta. La carta llegó ayer.<br />
Marie m'a écrit une lettre. La lettre est arrivée hier<br />
Si on raisonne <strong>en</strong> termes narratifs, le RD associé au GN postverbal ne correspond pas à<br />
un protagoniste <strong>de</strong> la narration effectuée dans le segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours qui précè<strong>de</strong><br />
immédiatem<strong>en</strong>t. Il y aurait <strong>en</strong> effet une sorte <strong>de</strong> contradiction pragmatique à introduire<br />
indirectem<strong>en</strong>t un protagoniste qui est déjà “ prés<strong>en</strong>t sur la scène du discours ” 61 .<br />
On notera toutefois que l'on ne peut pas associer à ce type d'inversion une contrainte<br />
générale qui interdirait que le sujet soit associé à un RD actif. En effet, l'énoncé peut être<br />
utilisé pour ré-introduire un RD actif dans un nouveau segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours : <strong>en</strong> (26a), le<br />
RD est ré-introduit dans le même espace narratif, <strong>en</strong> (26b) il est ré-introduit dans un autre<br />
espace spatio-temporel (ce que marque l’opposition <strong>en</strong>tre il y a six mois et hier) 62 :<br />
(26) I a. # Maria mi ha scritto una lettera. E' arrivata la lettera ieri. (= 74I.a)<br />
b. Maria mi ha scritto una lettera sei mesi fa. Ieri, finalm<strong>en</strong>te, é arrivata la<br />
lettera.<br />
Marie m'a écrit une lettre. Hier, <strong>en</strong>fin, la lettre est arrivée<br />
6.5. Disposition narrative<br />
Il nous reste à r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong>s énoncés (2) et (4) qui mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s verbes <strong>de</strong><br />
prés<strong>en</strong>ce, apparition et disparition (<strong>en</strong>trer, arriver, sortir, mourir, etc.). A première vue,<br />
on ne peut pas leur appliquer une analyse <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> disposition, alors même que ces<br />
énoncés prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une forte ressemblance <strong>de</strong> famille avec ceux où l'inversion est légitimée<br />
par les <strong>de</strong>ux variantes <strong>de</strong> CDpr prés<strong>en</strong>tées ci-<strong>de</strong>ssus. Je pose une troisième variante <strong>de</strong><br />
CDpr qui permet <strong>de</strong> capter cette ressemblance : l'inversion est légitimée par l'attribution<br />
d'une disposition faible (capacité) caractéristique non pas du référ<strong>en</strong>t du sujet, mais du<br />
protagoniste <strong>de</strong> récit.<br />
6.5.1. Ressemblance. Les énoncés illustrés par (2) et (4) ont le même parfum métanarratif<br />
<strong>en</strong> discours que ceux qui sont illustrés par (1) et (3) : ils décriv<strong>en</strong>t une év<strong>en</strong>tualité,<br />
ce qui permet d'introduire un participant à cette év<strong>en</strong>tualité. Ils ont la même distribution<br />
61 Cela a été noté par Wehr 1984 quand elle définit la notion <strong>de</strong> Topik-Introduktion [sa notion <strong>de</strong> Konzept<br />
est grosso modo équival<strong>en</strong>te dans ma terminologie à celle <strong>de</strong> RD et celle <strong>de</strong> Topik à RD actif] : "Das<br />
Konzept das mit Hilfe <strong>de</strong>r Topik-Introduktion eingeführt wird, ist im Aug<strong>en</strong>blick <strong>de</strong>r Einführung noch<br />
nicht Topik. Der Satz di<strong>en</strong>t allein dazu, es als Topik zu etablier<strong>en</strong>" (Wehr, ibid. : 16). La notion <strong>de</strong> Topik<br />
peut prêter à confusion : le RD introduit n'est pas obligatoirem<strong>en</strong>t au c<strong>en</strong>tre du développem<strong>en</strong>t thématique<br />
à v<strong>en</strong>ir. Comme le note Wehr elle-même, il s'agit simplem<strong>en</strong>t d'un RD pertin<strong>en</strong>t pour la suite du<br />
discours. Je revi<strong>en</strong>s sur ce point au §5.<br />
62 Je dois le contraste (26) à Luigi Mari. Nous t<strong>en</strong>ons là un exemple <strong>de</strong> phrase thétique où le RD est actif<br />
et id<strong>en</strong>tifié, ce qui montre que la théticité peut être indiffér<strong>en</strong>te au statut discursif du RD du sujet. On peut<br />
faire la même observation dans la phrase à inversion locative. C'est illustré dans les petits discours (i) ci<strong>de</strong>ssous<br />
qui mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu un passage <strong>en</strong>tre un segm<strong>en</strong>t narratif et un segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>scriptif :<br />
(i) F Pierre <strong>en</strong>tra dans le salon où la Callas r<strong>en</strong>contrait Picasso pour la première fois. A la<br />
droite du piano se trouvait la diva, à gauche se t<strong>en</strong>ait le maître.<br />
I Li celebrano gli ottant'anni di Picasso. Nel salone tronejjava il maestro attorniato da una<br />
folla di ammiratori.<br />
On célébra les quatre-vingts ans <strong>de</strong> Picasso. Dans le salon trônait le maître <strong>en</strong>touré<br />
d'une foule d'admirateurs<br />
40
discursive que les énoncés légitimés par la variante (10) <strong>de</strong> CDpr : ils ne peuv<strong>en</strong>t pas<br />
apparaître <strong>en</strong> début absolu <strong>de</strong> récit. Et ceci apparemm<strong>en</strong>t pour la même raison : le<br />
protagoniste apparaît ou disparaît dans une situation qui doit avoir été préalablem<strong>en</strong>t<br />
introduite 63 . Enfin, ils n'autoris<strong>en</strong>t pas l'anaphore régressive 64 :<br />
(27) C a. Quan [la Maria]i va arribar, [e]i estava furiosa.<br />
b. Quan va arribar [la Maria]i, [e]*i estava furiosa.<br />
E a. Cuando [María]i llegó, [e]i estaba furiosa.<br />
b. Cuando llegó [María]i, [e]*i estaba furiosa.<br />
Fa. Quand [les <strong>en</strong>fants]i sont arrivés, [ils]i étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> pleurs.<br />
b. Quand sont arrivés [les <strong>en</strong>fants]i, [ils]*i étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> pleurs.<br />
I a. Quando [Maria]i arrivó, [e]i era in collera.<br />
b. Quando arrivò [Maria]i, [e]*i era in collera.<br />
P a. Quando [a Maria]i chegou, [e]i estava zangada.<br />
b. Quando chegou [a Maria]i, [e]*i estava zangada.<br />
Quand Marie est arrivée, elle était furieuse<br />
Je conclus donc que ces énoncés véhicul<strong>en</strong>t une proposition thétique à l'instar <strong>de</strong>s énoncés<br />
(1) et (3).<br />
6.5.2. Disposition narrative. Pour r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> ces énoncés, j'admets une<br />
disposition narrative : tout protagoniste <strong>de</strong> récit ou <strong>de</strong> discours <strong>en</strong> tant qu'il est objet du<br />
discours ou <strong>de</strong> la narration a la capacité d'apparaître dans le discours ou d'<strong>en</strong> disparaître<br />
quand les circonstances (qui sont intrinsèquem<strong>en</strong>t liées au discours lui-même) ne<br />
l'empêch<strong>en</strong>t pas. La capacité est attachée non pas au référ<strong>en</strong>t <strong>en</strong> tant que tel, mais au<br />
référ<strong>en</strong>t <strong>en</strong> tant qu'on le raconte. On peut formuler cette capacité comme <strong>en</strong> (28) :<br />
(28) ∀x ((Participant-au récit (x) & Se trouver-à-un-mom<strong>en</strong>t-du-récit <strong>de</strong> Q) ⇒ Q(x))<br />
où Q ∈{verbes <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ce, apparition ou disparition}<br />
J'admets <strong>de</strong> plus que la disposition (28) apparti<strong>en</strong>t à la compét<strong>en</strong>ce narrative du locuteur.<br />
On peut dès lors poser que la variante <strong>de</strong> CDpr légitimant l'inversion est tout à fait<br />
parallèle à la variante (29) :<br />
(29) Condition <strong>de</strong> la disposition narrative :<br />
a. Le locuteur connaît la disposition faible caractéristique <strong>de</strong> tout protagoniste <strong>de</strong><br />
discours ou <strong>de</strong> récit :<br />
∀x ((Participant-au récit (x) & Se trouver-à-un-mom<strong>en</strong>t-du-récit <strong>de</strong> Q) ⇒ Q(x))<br />
où Q ∈{verbes <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ce, apparition ou disparition}<br />
b. Le contexte décrit une situation appropriée <strong>de</strong> manifestation <strong>de</strong> Q(x).<br />
Le parallélisme <strong>en</strong>tre (10) et (29) n'est pas fortuit : il souligne la ressemblance dans<br />
l'emploi discursif <strong>de</strong> ces énoncés. L'emploi d'un verbe <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ce, apparition ou<br />
disparition se substitue à l'emploi d'un verbe stéréotypique toutes les fois que la m<strong>en</strong>tion<br />
d'une propriété dispositionnelle du référ<strong>en</strong>t du sujet serait non pertin<strong>en</strong>te dans le cadre du<br />
63 Je rappelle que la situation d'énonciation peut jouer dans le discours oral le rôle du contexte dans le<br />
discours suivi. Il semble que la contrainte s'ét<strong>en</strong>d aux énoncés prés<strong>en</strong>tant une inversion locative et un<br />
verbe <strong>de</strong> mouvem<strong>en</strong>t : le lieu doit avoir être préalablem<strong>en</strong>t introduit dans l'univers <strong>de</strong> discours. L'énoncé<br />
(i) n'est pas un énoncé possible <strong>en</strong> début <strong>de</strong> récit :<br />
(i) F D'une forêt lointaine sortait un vieil ermite.<br />
64 L'impossibilité <strong>de</strong> l'anaphore régressive ne peut être rapportée au placem<strong>en</strong>t postverbal du GN sujet. Le<br />
GN sujet postverbal dans une inversion élaborative est une source possible d'anaphore régressive <strong>en</strong><br />
français :<br />
(i) F Après qu'eur<strong>en</strong>t parlé [les députés et les sénateurs]i, [ils]i se dirigèr<strong>en</strong>t vers le buffet.<br />
41
écit ou bi<strong>en</strong> si elle fait défaut (ce qui est massivem<strong>en</strong>t le cas pour les protagonistes<br />
humains).<br />
La condition (29) a un fort caractère conv<strong>en</strong>tionnel ; ce caractère se marque dans le choix<br />
<strong>de</strong>s verbes qui donn<strong>en</strong>t lieu à cet emploi. Je donne un seul exemple : telefonare <strong>en</strong> itali<strong>en</strong>,<br />
verbe qui n'est pas <strong>de</strong>scriptible <strong>de</strong> façon isolée comme un verbe d'apparition. Je repr<strong>en</strong>ds<br />
ici l'analyse qu'<strong>en</strong> donne Lambrecht 1994 :<br />
(30) I Ha telefonato Gianni.<br />
Gianni a téléphoné<br />
“ Cet énoncé peut être prononcé pour informer un interlocuteur qu’<strong>en</strong> son abs<strong>en</strong>ce, la<br />
personne appelée Gianni a essayé <strong>de</strong> le joindre. L’énoncé est une manière d’introduire<br />
Gianni dans l’univers du discours <strong>en</strong> m<strong>en</strong>tionnant le fait qu’il a appelé ” (Lambrecht,<br />
1994 : 181). Autrem<strong>en</strong>t dit, telefonare peut fonctionner comme un verbe d'apparition au<br />
regard <strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tions d'introduction <strong>de</strong>s RD. On touche là aux limites <strong>de</strong> toute approche<br />
lexicale : telefonare n'est pas référ<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t un verbe d'apparition ni un verbe <strong>de</strong><br />
mouvem<strong>en</strong>t. Ce verbe permet <strong>de</strong> décrire une év<strong>en</strong>tualité prototypique (dans le mon<strong>de</strong><br />
contemporain) où se manifeste une personne ; c'est à ce titre qu'il autorise l'inversion du<br />
sujet.<br />
6.6. Synthèse<br />
La condition CDpr n'est pas liée à l'informativité <strong>de</strong> l'énoncé, c'est-à-dire au statut <strong>de</strong><br />
l'information dans l'échange. On peut constater que ces énoncés sont toujours à<br />
focalisation large dans la phrase matrice que ce soit dans le dialogue ou dans le discours<br />
suivi. Mais, ce n'est pas la focalisation large qui les r<strong>en</strong>d appropriés. En effet, ils sont<br />
appropriés dans les circonstancielles <strong>de</strong> temps où leur cont<strong>en</strong>u contribue au fond. Le trait<br />
ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> ces énoncés est <strong>de</strong> véhiculer une proposition thétique : le sujet et le verbe<br />
form<strong>en</strong>t une unité informationnelle solidaire. Du fait même <strong>de</strong> cette propriété, ils ne<br />
peuv<strong>en</strong>t donner lieu qu'à une focalisation large quand ils constitu<strong>en</strong>t une phrase matrice ou<br />
indép<strong>en</strong>dante. C'est égalem<strong>en</strong>t cette propriété qui les r<strong>en</strong>d particulièrem<strong>en</strong>t aptes à<br />
l'introduction d'un référ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours. Si l'analyse <strong>de</strong>s énoncés à verbe<br />
d'apparition/disparition que j'ai développée ci-<strong>de</strong>ssus est correcte, la fonction discursive<br />
s'est <strong>en</strong> quelque sorte grammaticalisée <strong>en</strong> une construction dans ce cas 65 . Cette aptitu<strong>de</strong> à<br />
introduire <strong>de</strong> façon oblique un RD se reflète dans l'usage où le GN postverbal est<br />
généralem<strong>en</strong>t un RD inactif ou semi-actif.<br />
7. L'inversion et le discours<br />
La condition CPD met <strong>en</strong> jeu le caractère donné <strong>de</strong> la proposition constitutive du fond et,<br />
dans l'analyse proposée ici, les propositions constitutives du TD, alors que CDpr met <strong>en</strong><br />
jeu un certain savoir du locuteur. Je montre tout d'abord que les inversions dans les<br />
annonces sont susceptibles <strong>de</strong> la même analyse que les inversions dans les énoncés qui<br />
pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t place dans la conversation ou le discours suivi. Dans un <strong>de</strong>uxième temps, je<br />
caractérise le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre l'inversion et le développem<strong>en</strong>t du thème <strong>de</strong> discours.<br />
7.1. L'inversion dans les annonces<br />
Une annonce est un discours produit hors <strong>de</strong> tout tour <strong>de</strong> parole dans une situation ("out<br />
of the blue") : une annonce est généralem<strong>en</strong>t constituée d'un seul énoncé, elle peut être<br />
constituée d'un énoncé d'introduction suivi d'une explication (ce que l'analyse <strong>de</strong><br />
conversation appelle un account). L'inversion s'observe dans l'énoncé introductif et dans<br />
l'account 66 . Je me limite ici aux inversions dans l’énoncé introductif. L'inversion dans ce<br />
contexte est analysable exactem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la même manière que dans le discours suivi ou dans<br />
la paire question-réponse : soit par CPD soit par CDpr.<br />
65 Bi<strong>en</strong> évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t, les énoncés à verbe stéréotypique peuv<strong>en</strong>t aussi jouer ce rôle. Les énoncés <strong>de</strong> (9) ci<strong>de</strong>ssus<br />
peuv<strong>en</strong>t avoir pour seul effet discursif celui d'introduire les cloches dans l'univers <strong>de</strong> discours.<br />
66 Ce fait a été observé par Wehr 1984.<br />
42
7.1.1. CPD dans les annonces<br />
Un certain nombre d'annonces, illustrées <strong>en</strong> (1), prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les traits <strong>de</strong> l'inversion<br />
légitimée par la condition CPD :<br />
(1) C Es crema el pastís !<br />
E ¡ Se está quemando la torta !<br />
I Brucia il dolce!<br />
P Está-se a queimar o bolo!<br />
Le gâteau brûle !<br />
Dans ce cas, le GV peut faire l'objet d'une ellipse et elles sont pragmatiquem<strong>en</strong>t<br />
équival<strong>en</strong>tes à un énoncé constitué d'un seul GN 67 :<br />
(2) a. i. Le bébé pleure !<br />
ii. Le bébé !<br />
b. i. La tarte brûle !<br />
ii. La tarte !<br />
Nous t<strong>en</strong>ons la possibilité <strong>de</strong> l'ellipse <strong>de</strong> GV comme un indice que son cont<strong>en</strong>u est donné.<br />
Or il n'est pas donné dans le mouvem<strong>en</strong>t thématique (les annonces n'<strong>en</strong>chaîn<strong>en</strong>t pas sur un<br />
discours préalable). Les informateurs observ<strong>en</strong>t que les annonces du type exemplifié <strong>en</strong><br />
(2) ne sont appropriées que si les interlocuteurs <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t le bébé pleurer ou s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une<br />
o<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> tarte brûlée (ou voi<strong>en</strong>t une horloge indiquant que le temps <strong>de</strong> cuisson programmé<br />
est largem<strong>en</strong>t dépassé, etc.). On peut donc avancer l'hypothèse qu'il est donné dans la<br />
situation. En admettant que la situation d'énonciation puisse jouer le même rôle que le TD<br />
(3a), on peut caractériser la configuration contextuelle présidant à l'inversion comme celle<br />
que requiert CPD, le prédicat y est donné (3b) 68 :<br />
(3) a. Situation : {la tarte brûle, ...} ou bi<strong>en</strong> {quelque chose brûle, ...}<br />
b. Donné : la-tarte brûle ou bi<strong>en</strong> x brûle<br />
Je n'élabore pas davantage l'analyse <strong>de</strong> ce type d'annonce ici : il faut <strong>en</strong> effet construire une<br />
notion <strong>de</strong> TD qui puisse intégrer la situation d'énonciation, ce qui nous <strong>en</strong>traînerait dans<br />
<strong>de</strong>s développem<strong>en</strong>ts qui ne sont pas propres à l'analyse <strong>de</strong>s langues romanes.<br />
7.1.2. CDpr dans les annonces<br />
La plupart <strong>de</strong>s annonces ne permett<strong>en</strong>t pas l'ellipse du verbe ; par ailleurs, on y observe les<br />
mêmes <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> verbe que l'on a associées à CDpr. Elles serv<strong>en</strong>t à<br />
introduire une év<strong>en</strong>tualité ou un participant comme dans le discours suivi. Je donne sous<br />
(4) <strong>de</strong>s annonces avec un verbe d'apparition/disparition <strong>en</strong> itali<strong>en</strong> :<br />
(4) I a. E' arrivato Gianni<br />
b. E' morto Gianni<br />
c. Ha telefonato Gianni<br />
L'annonce (4.c) est susceptible du même comm<strong>en</strong>taire que (6-(30)) ci-<strong>de</strong>ssus. L'emploi <strong>de</strong><br />
l'inversion prés<strong>en</strong>tative dans les annonces est strictem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tique à celui que l'on observe<br />
dans le discours suivi. Les mêmes manières <strong>de</strong> faire narratives peuv<strong>en</strong>t être partagées dans<br />
<strong>de</strong>s registres <strong>de</strong> discours différ<strong>en</strong>ts : le discours ordinaire ou le discours journalistique<br />
peuv<strong>en</strong>t mettre <strong>en</strong> jeu les mêmes moy<strong>en</strong>s et les mêmes conv<strong>en</strong>tions que le discours<br />
littéraire.<br />
7.1.3. Comparaison avec l'anglais<br />
67 Je dois cette observation à Claire Beyssa<strong>de</strong>. Je remercie égalem<strong>en</strong>t Alda Mari qui m'a mis sur la voie <strong>de</strong><br />
cette analyse par ses gloses <strong>de</strong>s annonces <strong>en</strong> itali<strong>en</strong>.<br />
68 Il n'y a pas <strong>de</strong> contrainte sur le RD associé au sujet : il peut être id<strong>en</strong>tifié ou non.<br />
43
On peut comparer le contraste (5) <strong>en</strong>tre un énoncé à focalisation large (5.a) et un énoncé à<br />
inversion prés<strong>en</strong>tative (5.b) <strong>en</strong> itali<strong>en</strong> et le célèbre contraste (6) dû à Schmerling (1976) <strong>en</strong><br />
anglais, qui met <strong>en</strong> jeu un contraste dans le marquage prosodique et non dans l'ordre <strong>de</strong><br />
mot 69 :<br />
(5) I a. Truman é morto !<br />
b. E' morto Johnson !<br />
(6) A a. Truman DIED !<br />
b. JOHNson died !<br />
Je rappelle l'analyse que je propose <strong>de</strong> (5). La variation dans le placem<strong>en</strong>t du GN <strong>en</strong> (5)<br />
s'explique <strong>de</strong> la même manière que la variation que l'on a observée dans les réponses <strong>en</strong><br />
(3-(10)). En (5.a), le placem<strong>en</strong>t préverbal du sujet est approprié parce que CPD n'est pas<br />
remplie dans le contexte. En (5.b), le placem<strong>en</strong>t postverbal s'explique par le fait que le<br />
locuteur utilise la stratégie d'introduction d'un participant avec le verbe mourir. Il s'agit du<br />
même verbe mourir dans les <strong>de</strong>ux énoncés : <strong>en</strong> (5.a), il est traité comme un prédicat<br />
ordinaire et <strong>en</strong> (5.b), il est associé à la stratégie narrative où il est traité comme un prédicat<br />
dispositionnel attribué à un objet <strong>de</strong> discours 70 .<br />
Le contraste anglais, c'est-à-dire la variation dans le placem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'acc<strong>en</strong>t saillant dans<br />
l'énoncé, a reçu trois types d'explication. La première (proposée par Schmerling) met <strong>en</strong><br />
avant le statut thématique du RD associé au GN postverbal. En (6.a), Truman est topique<br />
<strong>de</strong> discours, il est associé à un RD actif (dans la situation). En (6.b), Johnson n'est pas un<br />
topique <strong>de</strong> discours, il n'est pas associé à un RD actif dans la situation. J'ai montré au §3<br />
que le statut d'activation du RD ne joue pas <strong>de</strong> rôle dans l'inversion. Les propriétés<br />
discursives <strong>de</strong>s annonces ne justifi<strong>en</strong>t pas qu'on puisse lui faire jouer un rôle dans le<br />
contraste (5). Je rappelle l'argum<strong>en</strong>t. La condition CPD met <strong>en</strong> jeu le seul GV sans que<br />
cela interfère avec le statut d'activation du RD associé au GN (cf. l'analyse <strong>de</strong> (3-(2)) au<br />
§3.3). La condition CDpr <strong>en</strong> elle-même, est égalem<strong>en</strong>t indiffér<strong>en</strong>te au statut d'activation du<br />
RD associé au GN postverbal (je rappelle que les GN associés à un RD actif n'y sont pas<br />
interdits) 71 On s'att<strong>en</strong>d donc à ce qu'un énoncé comme (5.b) ne soit approprié que dans<br />
un contexte où la mort <strong>de</strong> Johnson ne fasse pas partie du contexte. Ce qui recoupe la glose<br />
pragmatique donnée par Schmerling.<br />
Le second type d'explication est avancé par Zubizarreta qui pr<strong>en</strong>d égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> compte <strong>de</strong>s<br />
contrastes comme (7) ou la prosodie <strong>de</strong>s énoncés <strong>en</strong> (8) :<br />
(7) A a. The baby's CRYing.(= ex. (95.a), Z: 68)<br />
b. The BAby's crying. (= ex. (97.a) id.)<br />
(8) A a. The SUN came out. (= ex. (96), id.)<br />
b. The MAIL has arrived. (id)<br />
Elle repr<strong>en</strong>d une hypothèse avancée par Birner 1994, 1995 pour l'inversion locative <strong>de</strong><br />
l'anglais : <strong>en</strong> (7.b), l'information véhiculée par le GN sujet est plus remarquable ou<br />
pertin<strong>en</strong>te que celle qui est apportée par le verbe 72 . Ce type d'explication n'a pas <strong>de</strong><br />
69 Selon Schmerling, l'énoncé (6.a) a été produit dans un contexte où la mort <strong>de</strong> Truman était att<strong>en</strong>due<br />
(les journaux ayant rapporté les progrès <strong>de</strong> sa maladie) ; l'énoncé (6.b), au contraire, a été produit dans un<br />
contexte où ri<strong>en</strong> ne laissait prévoir la mort <strong>de</strong> Johnson.<br />
70 Le verbe mourir, nonobstant son cont<strong>en</strong>u lexical, peut donc être un verbe d'introduction d'un<br />
protagoniste <strong>de</strong> discours.<br />
71 Si l'on ti<strong>en</strong>t à raisonner <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> RD, la seule condition qui ti<strong>en</strong>ne est que le RD associé à<br />
l'év<strong>en</strong>tualité ne doit pas avoir été introduit dans l'univers <strong>de</strong> discours.<br />
72 "It could very well be that the unavailability of a prosodic structure with Nuclear Stress on the<br />
predicate is due to the "pragmatic lightness" of the predicate involved. The subject being more noteworthy<br />
or relevant than the predicate, stress on the subject is preferred. (Note that the fact that pragmaticaly based<br />
44
cont<strong>en</strong>u intuitif : on ne voit pas, par exemple, <strong>en</strong> quel s<strong>en</strong>s le GN the sun apporte une<br />
information "plus remarquable ou pertin<strong>en</strong>te" que le prédicat se lever <strong>en</strong> (8.a). De même,<br />
on ne voit pas <strong>en</strong> quoi le GN Johnson <strong>en</strong> (6.b) pourrait apporter une information plus<br />
pertin<strong>en</strong>te que celle qu'apporte le GN Truman <strong>en</strong> (6.a).<br />
La troisième explication (proposée par Lambrecht) fait appel à l'opposition <strong>en</strong>tre le<br />
jugem<strong>en</strong>t thétique et le jugem<strong>en</strong>t catégorique. Cette explication est donc beaucoup plus<br />
proche <strong>de</strong> celle que j'ai avancée. Mais elle est problématique pour l'anglais et <strong>de</strong> manière<br />
générale. On peut sout<strong>en</strong>ir que (6.a) est un énoncé exprimant un jugem<strong>en</strong>t catégorique<br />
associé à l'intonation att<strong>en</strong>due (<strong>en</strong> anglais) <strong>de</strong>s énoncés à focalisation sur le prédicat. On<br />
peut admettre que (6.b) exprime un jugem<strong>en</strong>t thétique. Mais, tous les énoncés exprimant<br />
un jugem<strong>en</strong>t thétique ne prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pas la prosodie <strong>de</strong> (8) où le GN sujet reçoit l’acc<strong>en</strong>t<br />
saillant <strong>de</strong> la phrase intonative : il faut une relation particulière <strong>en</strong>tre le sujet et le verbe<br />
(Bolinger 1972). A première vue, il y a une famille <strong>de</strong> verbes, id<strong>en</strong>tique <strong>en</strong> anglais et dans<br />
les langues romanes, qui autoris<strong>en</strong>t l'alternance intonative et l'inversion prés<strong>en</strong>tative<br />
respectivem<strong>en</strong>t. On peut donc légitimem<strong>en</strong>t se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si CDpr ou une contrainte<br />
analogue à CDpr n'est pas opératoire <strong>en</strong> anglais dans l'alternance observée dans (6), (7) et<br />
(8). Je ne peux pas développer ce point ici, mais il est <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importance : il conduit à<br />
p<strong>en</strong>ser que la condition CDpr n'est attachée à aucun substrat linguistique et peut avoir un<br />
impact sur différ<strong>en</strong>tes dim<strong>en</strong>sions structurales (syntaxe, ordre <strong>de</strong>s mots ou prosodie) selon<br />
les langues.<br />
7.2. Placem<strong>en</strong>t du sujet et développem<strong>en</strong>t thématique<br />
La condition CPD met <strong>en</strong> jeu le statut donné du prédicat dénoté par le verbe. On a eu<br />
crucialem<strong>en</strong>t recours à la notion <strong>de</strong> TD pour définir la notion <strong>de</strong> donné : le cont<strong>en</strong>u donné<br />
constitue le noyau propositionnel stable du TD dans le segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> discours. Il nous faut<br />
donc expliciter les li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre l'inversion et le développem<strong>en</strong>t du Thème <strong>de</strong> Discours.<br />
Les différ<strong>en</strong>tes analyses que j'ai prés<strong>en</strong>tées autoris<strong>en</strong>t les observations suivantes :<br />
(9) a. L'inversion n'est jamais appropriée dans un énoncé qui initie une modification<br />
du TD.<br />
b. L'inversion (lorsqu'elle est légitimée par CPD) est appropriée dans un énoncé<br />
qui élabore directem<strong>en</strong>t le TD.<br />
On comparera tout d'abord les généralisations avec les généralisations (10) qui sont reçues<br />
dans la littérature pragmatique :<br />
(10) a. L'ordre préverbal marque la continuité thématique.<br />
b. L'ordre postverbal marque la discontinuité thématique.<br />
La généralisation (10.b) s'oppose diamétralem<strong>en</strong>t à (9.b). En effet, l’inversion est<br />
appropriée dans un énoncé qui repr<strong>en</strong>d directem<strong>en</strong>t le cont<strong>en</strong>u du TD. On peut ajouter aux<br />
analyses précéd<strong>en</strong>tes un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> faits tirés <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong>s énoncés qui suiv<strong>en</strong>t<br />
un énoncé qui initie une modification du TD. Il est remarquable que l'inversion y soit<br />
appropriée dès que le prédicat est donné. J’<strong>en</strong> donne trois illustrations avec <strong>de</strong>s types<br />
d’inversion distincts. Tout d’abord, les réponses <strong>en</strong> espagnol et <strong>en</strong> portugais à la question<br />
(11.b) dans le contexte (11.a) :<br />
(11) a. Un malfrat, qui vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> s'apercevoir que le coup <strong>en</strong>visagé est év<strong>en</strong>té, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à un<br />
<strong>de</strong> ses complices :<br />
b. Qui a parlé à la police ?<br />
(12) E a. Pedro habló con los periodistas. A la policía nadie la informó.<br />
Pedro a parlé aux journalistes. Personne n’a informé la police<br />
notions such as "noteworthy" or "relevant" are difficult to <strong>de</strong>fine rigourously does not mean that they are<br />
not real)" (ibid.: 69).<br />
45
. Pedro habló con los periodistas. Con la policía no habló nadie.<br />
Pedro a parlé aux journalistes. Personne n’a parlé à la police<br />
P a) O Pedro falou com os jornalistas. Ninguém prev<strong>en</strong>iu a polícia.<br />
Pedro a parlé aux journalistes. Personne n’a informé la police<br />
b) O Pedro falou com os jornalistas. Com a polícia não falou ninguém.<br />
Pedro a parlé aux journalistes. Personne n’a parlé à la police<br />
On observe le même phénomène <strong>en</strong> français avec <strong>de</strong>s inversions élaboratives : je rappelle<br />
que la notion <strong>de</strong> donné met <strong>en</strong> jeu une équival<strong>en</strong>ce pragmatique et pas seulem<strong>en</strong>t<br />
sémantique (dans un contexte où l'on connaît les candidats et où ils sont <strong>en</strong> petit nombre,<br />
la question qui a réussi ? est équival<strong>en</strong>te à qui a échoué ?) :<br />
(13) F a. Qui est reçu ?<br />
b. # Ont échoué les <strong>de</strong>ux élèves que prés<strong>en</strong>tait Paul.<br />
c. Sont reçus tous les élèves <strong>de</strong> Marie, ont échoué les <strong>de</strong>ux élèves que<br />
prés<strong>en</strong>tait Paul.<br />
d. Tous les élèves <strong>de</strong> Marie ont échoué, sont reçus les <strong>de</strong>ux élèves que<br />
prés<strong>en</strong>tait Paul.<br />
Enfin, on observe le même phénomène dans la relative : l'inversion qui est inappropriée<br />
dans la relative du premier énoncé (qui initie la modification du DT) re<strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t appropriée<br />
dans les énoncés qui suiv<strong>en</strong>t :<br />
(14) F a. Les étudiants que Bernard a <strong>en</strong>traînés ont tous réussi aux Olympia<strong>de</strong>s<br />
universitaires, ceux qu'a <strong>en</strong>traîné Jean-Marie ont repris un cursus normal.<br />
b. Les étudiants que Bernard a <strong>en</strong>traînés ont tous réussi aux Olympia<strong>de</strong>s<br />
universitaires, ceux qu'a pris <strong>en</strong> charge Jean-Marie ont repris un cursus<br />
normal.<br />
J'ajoute que la généralisation (10.b) n'est pas correcte non plus dans le cas <strong>de</strong>s énoncés<br />
prés<strong>en</strong>tant une inversion satisfaisant CDpr. En effet, la satisfaction <strong>de</strong> la contrainte<br />
contextuelle (cf. (6-(10b) ou (29.b)) : “ Le contexte décrit une situation <strong>de</strong> manifestation<br />
<strong>de</strong> Q(x) ”) implique une forte cohér<strong>en</strong>ce discursive qui fait que nombre <strong>de</strong> ces énoncés<br />
<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t dans une relation d'élaboration avec leur cotexte (c'est le cas dans le petit discours<br />
(6-(21)) par exemple). Seuls les énoncés recourant à la version narrative <strong>de</strong> CDpr peuv<strong>en</strong>t<br />
donner l'impression qu'ils introduis<strong>en</strong>t une discontinuité lorsqu'ils sont employés pour<br />
introduire un protagoniste majeur dans la narration. Mais ce n'est pas toujours le cas<br />
puisqu'ils peuv<strong>en</strong>t introduire un protagoniste accessoire pour le déroulem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />
narration comme l'illustre (15) par exemple :<br />
(15 F Pierre <strong>en</strong>tra dans la ville. Sur la place se pressait une foule <strong>en</strong> colère. Il se<br />
dirigea vers le palais.<br />
La généralisation (10.a) n'a pas grand cont<strong>en</strong>u, puisqu'elle est vérifiée à la fois dans <strong>de</strong>s<br />
énoncés qui ne modifi<strong>en</strong>t pas le TD (les discours du type "chaîne thématique" qui sont<br />
ceux qui manifest<strong>en</strong>t intuitivem<strong>en</strong>t la plus gran<strong>de</strong> continuité thématique (cf. (4-(1)) et ceux<br />
qui modifi<strong>en</strong>t le TD. On peut objecter que les énoncés que nous avons analysés comme<br />
modifiant le TD prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t aussi une certaine continuité thématique : l’énoncé développe<br />
un aspect du TD général défini par la question. C’est exact. Le parti-pris méthodologique<br />
adopté dans cette étu<strong>de</strong> (le recours à la paire Q-R pour modéliser le TD) ne nous a pas<br />
permis d’étudier <strong>de</strong>s énoncés qui chang<strong>en</strong>t radicalem<strong>en</strong>t le TD. Or, ces énoncés sembl<strong>en</strong>t<br />
bi<strong>en</strong> ne pas permettre l’inversion. Donc, le placem<strong>en</strong>t du sujet est indép<strong>en</strong>dant du contraste<br />
“ continuité / discontinuité thématique ”.<br />
De la même manière, le placem<strong>en</strong>t préverbal n’est pas la marque d’une modification du<br />
TD. Ce n’est pas le cas, par exemple, dans les réponses à la question (3-(8)). Donc, on<br />
doit conclure que l'inappropriation <strong>de</strong> l'inversion est une conséqu<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la modification<br />
46
du TD, et non pas la marque <strong>de</strong> cette modification. De même, l'appropriation <strong>de</strong> l'inversion<br />
est une conséqu<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l'élaboration directe du TD et non pas la marque <strong>de</strong> cette<br />
élaboration. Autrem<strong>en</strong>t dit, le placem<strong>en</strong>t préverbal et postverbal du GN sujet n’est pas un<br />
marqueur discursif. Il <strong>en</strong> est tout autrem<strong>en</strong>t, par exemple, d'un certain type d'acc<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
français qui semble, lui, directem<strong>en</strong>t dévolu au marquage <strong>de</strong> la modification du TD 73 .<br />
Nous avons donc ici clairem<strong>en</strong>t une différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre "ordre <strong>de</strong>s mots" et prosodie <strong>en</strong> ce<br />
qui concerne le marquage du discours 74 .<br />
8. Conclusion<br />
L'étu<strong>de</strong> a permis <strong>de</strong> dégager <strong>de</strong>ux conditions d'appropriation <strong>de</strong> l'inversion : la première, la<br />
condition du prédicat donné (CPD), met crucialem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu un cont<strong>en</strong>u informationnel<br />
donné dans le thème <strong>de</strong> discours (TD), alors que la secon<strong>de</strong>, la condition du prédicat<br />
dispositionnel (CDpr), met crucialem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu le savoir du locuteur. Seule CPD peut donc<br />
être qualifiée <strong>de</strong> contrainte informationnelle. Mais, CPD, comme CDpr, mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu<br />
l'<strong>en</strong>châssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'énoncé dans un contexte discursif et d'énonciation. CPD est<br />
étroitem<strong>en</strong>t soumise à une configuration contextuelle, le thème <strong>de</strong> discours <strong>en</strong> cours, tout<br />
<strong>en</strong> n'étant pas une marque <strong>de</strong> cette configuration. CDpr est beaucoup plus libre quant à<br />
son lieu d'occurr<strong>en</strong>ce discursive, mais elle requiert aussi un contexte approprié à l’emploi<br />
d’un énoncé décrivant un certain type d’év<strong>en</strong>tualité (la manifestation d’une disposition).<br />
L'analyse <strong>de</strong> l'appropriation <strong>de</strong> l'inversion requiert donc que l’on articule grammaire <strong>de</strong> la<br />
phrase et grammaire du discours.<br />
CPD et CDpr partag<strong>en</strong>t un trait : elles mett<strong>en</strong>t l'acc<strong>en</strong>t sur le prédicat <strong>en</strong> considérant soit<br />
son statut informationnel dans le discours, soit sa relation au référ<strong>en</strong>t du GN sujet. Le<br />
choix du placem<strong>en</strong>t préverbal ou postverbal du GN réalisant le premier argum<strong>en</strong>t n'est<br />
jamais lié à un statut particulier, autonomisable, du GN pris isolém<strong>en</strong>t. Ce résultat est d'une<br />
très gran<strong>de</strong> importance dans l'évaluation <strong>de</strong>s modèles contemporains <strong>de</strong> l'interface<br />
syntaxe/information. En effet, il vi<strong>de</strong> <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s le recours à une modélisation du placem<strong>en</strong>t à<br />
l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> positions accueillant <strong>de</strong>s constituants au statut spécifique, par exemple : les<br />
positions définies dans les projections TopicP ou FocusP proposées dans le cadre GB/PP<br />
(Rizzi 1997). Plus profondém<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core, on a montré que l'articulation fond-focus ne joue<br />
pas <strong>de</strong> rôle dans l'appropriation du placem<strong>en</strong>t postverbal du sujet. On ne peut donc pas<br />
espérer réduire “ l’interface syntaxe / contexte ” à la seule articulation fond-focus.<br />
Il existe une corrélation forte <strong>en</strong>tre la condition CPD et le placem<strong>en</strong>t postverbal du sujet<br />
d'une part, <strong>en</strong>tre la condition CDpr et la construction inaccusative d'autre part. Si la<br />
corrélation avait été univoque, on aurait pu proposer une approche constructionnelle simple<br />
: l'inversion au s<strong>en</strong>s strict, l'inversion du sujet, est liée à CPD et la construction<br />
inaccusative, c'est-à-dire la réalisation du premier argum<strong>en</strong>t comme un objet, à CDpr. Mais,<br />
ce n'est pas le cas. On a vu qu’<strong>en</strong> itali<strong>en</strong>, les verbes donnant lieu à l’inversion prés<strong>en</strong>tative<br />
peuv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter une syntaxe inergative et que tous les verbes autorisant une syntaxe<br />
inaccusative ne peuv<strong>en</strong>t y donner lieu. De même, <strong>en</strong> français, CDpr est associée à la<br />
construction inaccusative et aux <strong>de</strong>ux types d'inversion du sujet. On doit donc conclure<br />
que les <strong>de</strong>ux conditions CPD et CDpr ne sont pas intrinsèquem<strong>en</strong>t liées à une<br />
construction particulière.<br />
Enfin, la condition CPD est commune à toutes les langues romanes considérées, alors que<br />
les propriétés syntaxiques <strong>de</strong> ces inversions sont diverses. CDpr est commune à toutes les<br />
langues romanes considérées dans cette étu<strong>de</strong> et l’anglais semble la connaître. Ces <strong>de</strong>ux<br />
conditions ne peuv<strong>en</strong>t donc pas être invoquées comme <strong>de</strong>s principes motivant une forme<br />
syntaxique particulière ni dans les langues romanes ni <strong>de</strong> manière générale.<br />
73 Je r<strong>en</strong>voie sur ce point à Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002a,b, Marandin et al. 2002 qui montr<strong>en</strong>t que l'acc<strong>en</strong>t C du<br />
français marque la modification du TD. De même, Lambrecht analyse l'acc<strong>en</strong>t B <strong>de</strong> l'anglais comme une<br />
marque <strong>de</strong> ratification <strong>de</strong> thème <strong>de</strong> discours (proposition constitutive du TD).<br />
74 Cette conclusion ne s’ét<strong>en</strong>d peut-être pas au portugais si l’hypothèse qui a été avancée au §5.4.1 est<br />
vérifiée.<br />
47
Référ<strong>en</strong>ces<br />
Abeillé Anne. 1997. "Fonction ou position Objet ?" Le gré <strong>de</strong>s langues, 11 : 8-33.<br />
Adger David. 1996. "Economy and optionality of subjects in Italian" Probus, 8 : 117-135.<br />
Ambar Manuela. 1988. Para uma Sintaxe da inversão sujeito-verbo em português.<br />
Lisbonne : Colibri.<br />
Ambar Manuela. 1999. "Focus in Portuguese" in Rebuschi Georges & Tuller Laurie (eds)<br />
The grammar of Focus. Amsterdam / Phila<strong>de</strong>lphie : J. B<strong>en</strong>jamins.<br />
Atkinson James C.. 1973. The two forms of subject inversion in Fr<strong>en</strong>ch. The Hague :<br />
Mouton.<br />
Ballantyne Cohan J. 2000. The realization of focus in spok<strong>en</strong> English. Thèse <strong>de</strong> Phd,<br />
Université du Texas à Austin.<br />
Belletti Adriana. 1988. "The case of unaccusatives" Linguistic Inquiry, 19-1 : 1-34.<br />
Bernini Giuliano. 1995. "Verb-subject or<strong>de</strong>r in Italian : an investigation of short<br />
annoucem<strong>en</strong>ts and telecast news" in Matras Yaron & Sasse Hans-Jürg<strong>en</strong> (eds)<br />
1995 : 44-71.<br />
Beyssa<strong>de</strong> Claire, Marandin Jean-Marie, Rialland Annie. 2002a. "Ground / Focus revisited.<br />
A perspective from Fr<strong>en</strong>ch". Proceedings of LSRL 31.<br />
Beyssa<strong>de</strong> et al. 2002b. "Prosody and information in Fr<strong>en</strong>ch" in <strong>de</strong> Swart H. & Corblin F.,<br />
(eds) titre à préciser<br />
Birner Betty. 1994. "Information status and word or<strong>de</strong>r: an analysis of English inversion"<br />
Language, 70 : 233-259.<br />
Birner Betty. 1995. "Pragmatic constraints on the verb in English inversion" Lingua, 97 :<br />
233-256.<br />
Bolinger Dwight. 1972, "Acc<strong>en</strong>t is predictable (if you are a mind rea<strong>de</strong>r)" Language, 48 :<br />
633-644.<br />
Bonami Olivier & Godard Danièle. 2001. "Inversion du sujet, constituance et ordre <strong>de</strong>s<br />
mots" in Marandin Jean-Marie (ed.) Cahier Jean-Clau<strong>de</strong> Milner. Paris : Verdier.<br />
Bonami Olivier, Godard Danièle & Marandin Jean-Marie.1998. "Fr<strong>en</strong>ch subject inversion<br />
in extraction contexts" in Bouma Gosse et al. (eds). Université <strong>de</strong> Sarrebruck :<br />
101-112.<br />
Bonami Olivier, Godard Danièle & Marandin Jean-Marie. 2001, "Constitu<strong>en</strong>cy and word<br />
or<strong>de</strong>r in Fr<strong>en</strong>ch subject inversion" in Bouma Gosse et al. (eds) Constraints and<br />
Resources in Natural Language syntax and semantics. Stanford : CSLI.<br />
Bourdieu Emmanuel. 1995. Dispositions et croyances dans la tradition pragmatiste, thèse<br />
<strong>de</strong> doctorat (EHESS), np. [Bourdieu Emmanuel. 1998. Savoir faire. Paris :<br />
Editions du Seuil].<br />
Bresnan Joan. 1994. "Locative inversion and the architecture of universal grammar"<br />
Language, 70 : 72-131.<br />
Büring Daniel. 1997. The 59th street bridge acc<strong>en</strong>t : the meaning of topic and focus.<br />
Londres : Routledge.<br />
Büring Daniel.1998. Focus and topic in a complex mo<strong>de</strong>l of Discourse, np.<br />
Büring Daniel & Gutiérrez-Bravo Rodrigo. 2000. Focus-related or<strong>de</strong>r variation without<br />
the NSR: a prosody-based crosslinguistic analysis, Workshop Topic & Focus,<br />
Utrecht.<br />
Burzio Luigi. 1986. Italian syntax : a Governem<strong>en</strong>t-Binding approach. Dordrecht : Rei<strong>de</strong>l.<br />
Calabrese A. 1992. "Some remarks on Focus and Logical Form in Italian" Harvard<br />
Working Papers in Linguistics, 1 : 91-127.<br />
Contreras Heles. 1976. A theory of word or<strong>de</strong>r with special refer<strong>en</strong>ce to Spanish.<br />
Amsterdam: North-Holland.<br />
Cooper R. et al., 1994, Describing the approach, FraCas <strong>de</strong>liverable D8, C<strong>en</strong>ter for<br />
Cognitive Sci<strong>en</strong>ce, Université d’Edinbourg.<br />
Corblin F., 2001, Défini et génitif : le cas <strong>de</strong>s définis défectifs, [Marandin J.-M., ed.],<br />
Cahier Jean-Clau<strong>de</strong> Milner, Paris : Verdier.<br />
Coseriu Eug<strong>en</strong>io. 1967. "Lexikalische Solidarität<strong>en</strong>" Poetica, 1 : 293-303.<br />
Costa João.1998. Word or<strong>de</strong>r variation. The Hague : Holland Aca<strong>de</strong>mic Graphics.<br />
Costa J., 2000, Multiple focus in European Portuguese : appar<strong>en</strong>t optionality and subject<br />
positions, Exemplier Workshop on Topic and Focus, Going Romance, Utrecht.<br />
48
Dini Luca. 1995. "Unaccusative behaviours" Qua<strong>de</strong>rni <strong>de</strong>l laboratorio <strong>de</strong> linguistica, 9 :<br />
92-122.<br />
Drijkoning<strong>en</strong> Franck. 1990. "Functional heads and the unification of Fr<strong>en</strong>ch word or<strong>de</strong>r"<br />
Probus, 2.3 : 291-320.<br />
Fuchs Catherine (éd). 1997. La place du sujet <strong>en</strong> français contemporain. Louvain-la-<br />
Neuve : Duculot.<br />
Ginzburg Jonathan & Sag Ivan.A.. 2000. Interrogative investigations. Stanford : CSLI<br />
Publications.<br />
Ginzburg Jonathan. <strong>en</strong> prep. A semantics for interactions in dialogue (ftp://<br />
ftp.cogsci.ed.ac.uk:pub/ginzburg).<br />
Grupo di Padova. 1974. "L'ordine <strong>de</strong>i sintagmi nella frase" in Medici Mario &<br />
Sangregorio Antonella (eds) F<strong>en</strong>om<strong>en</strong>i morfologici e sintattici nell'italiano<br />
contemporaneo. Atti <strong>de</strong>l sesto congresso internazionale di studi : 147-61, Roma.<br />
Gutiérrez-Bravo Rodrigo. 2000. Subjects, left periphery and word or<strong>de</strong>r in Mexican<br />
Spanish, [papier prés<strong>en</strong>té au Second Joint Stanford-UCSC Workshop on Optimal<br />
Typology, December 7] np.<br />
Hamblin, C.L. 1973. “Questions in Montague Grammar” Foundations of Language, 10 :<br />
41-53.<br />
Hatcher Anna. 1956. Theme and un<strong>de</strong>rlying question. Two studies of Spanish word or<strong>de</strong>r,<br />
Suppl. to Word vol. 12, Monograph 3, New-York.<br />
Hetzron Robert.1975. "The pres<strong>en</strong>tative movem<strong>en</strong>t or why the i<strong>de</strong>al word or<strong>de</strong>r is<br />
V.S.O.P" in Li Charles (ed) Word or<strong>de</strong>r and word or<strong>de</strong>r change. Austin-<br />
Londres : 345-388.<br />
Horn L., 1989, A natural history of negation, Chicago : The University of Chicago Press.<br />
Hulk Aafke & Pollock Jean-Yves. 2001. Subject Inversion in Romance and the theory of<br />
Universal Grammar. Oxford. : Oxford University Press.<br />
Jacobs Joachim. 1984. "Funktionale Satzperspektive und Illokutionsemantik"<br />
Linguistische Berichte, 91 : 25-58.<br />
Jacobs Joachim. 1993. "Integration" in Reis Marga (ed) Wortstellung und<br />
Informationstruktur. Tubing<strong>en</strong> : Niemeyer.<br />
Jonare Birgitta. 1976. L'inversion dans la principale non interrogative <strong>en</strong> français<br />
contemporain. Acta Universitatis Upsal<strong>en</strong>sis 16.<br />
Kamp Hans & Reyle Uwe. 1993. From discourse to logic. Dordrecht : Kluwer.<br />
Kampers-Manhe Brigitte. 1998. "Je veux que parte Paul : a neglected construction" in<br />
Schegler A. et al.(eds) Romance Linguistics : theoretical perspectives,<br />
Amsterdam : J. B<strong>en</strong>jamins.<br />
Kayne Richard. 1973. "L'inversion du sujet <strong>en</strong> français dans les propositions<br />
interrogatives" Français Mo<strong>de</strong>rne : 10-42 (partie 1).<br />
Kayne Richard. 1986. "Connexité et inversion du sujet" in Ronat Mitsou & Couquaux<br />
Daniel (eds) Grammaire modulaire : 127-147. Paris : Minuit.<br />
Kayne Richard & Pollock Jean-Yves. 1978. "Stylistic inversion, successive cylicity and<br />
move NP in Fr<strong>en</strong>ch" Linguistic Inquiry, 9 : 595-621.<br />
Kim Yookyung, 1996, A situation theoretic account of exist<strong>en</strong>tial s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ces, PhD<br />
dissertation, Stanford University.<br />
Kiss K.1998. "Id<strong>en</strong>tificational Focus versus Information Focus" Language, 74-2 : 245-<br />
273.<br />
Korz<strong>en</strong> Hanne. 1983. "Réflexions sur l'inversion dans les propositions interrogatives <strong>en</strong><br />
français" in Herslund Michael et al. (eds) Analyses grammaticales du français,<br />
Revue romane, numéro spécial, 24 : 50-85.<br />
Korz<strong>en</strong> Hanne. 1992. "The predicative unit and subject-verb inversion in mo<strong>de</strong>rn Fr<strong>en</strong>ch"<br />
in Herslund Michael (ed) Word Or<strong>de</strong>r. Cop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong> Studies in Language 15.<br />
Kuroda Shigeyuki. 1973. "Le jugem<strong>en</strong>t catégorique et le jugem<strong>en</strong>t thétique. Exemples<br />
tirés <strong>de</strong> la syntaxe japonaise" Langages, 30 : 81-110.<br />
Ladusaw William. 1994. "Thetic and categoric, stage and individual, weak and strong"<br />
SALT IV : 220-229. Cornel U. P.<br />
Lambrecht Knud. 1987. "The status of SVO s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ces in Fr<strong>en</strong>ch discourse" in Tomlin<br />
Russell L. (ed) Coher<strong>en</strong>ce and grounding in discourse. Typological Studies in<br />
Language vol. XI, Amsterdam : John B<strong>en</strong>jamins.<br />
49
Lambrecht Knud. 1988. "Pres<strong>en</strong>tational cleft constructions in spok<strong>en</strong> Fr<strong>en</strong>ch" in Haiman<br />
John & Thompson Sandra (eds) Combining in grammar and discourse.<br />
Amsterdam / Phila<strong>de</strong>phie : J. B<strong>en</strong>jamins.<br />
Lambrecht Knud.1994. Information structure and s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce form. Cambridge (Mas) :<br />
Cambridge UP.<br />
Lambrecht Knud. 2000. "Wh<strong>en</strong> subjects behave like objects. An analysis of the merging<br />
of S and O in S<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce-focus constructions across languages" Studies in<br />
Language, 24-3 : 611-682.<br />
Lambrecht Knud. 2001. Un système pour l’analyse <strong>de</strong> la structure informationnelle <strong>de</strong>s<br />
phrases. L’exemple <strong>de</strong>s constructions clivées [Exemplier, confér<strong>en</strong>ce donnée à<br />
Paris 3, 15 juin 2001] np.<br />
Le Bidois Robert. 1950. L'inversion du sujet dans la prose contemporaine. Paris : Editions<br />
d'Artey.<br />
Longobardi Giuseppe,.2000. "Postverbal subjects and the mapping hypothesis" Linguistic<br />
Inquiry, 31 : 691-702.<br />
Marandin Jean-Marie. 1988. "A propos <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> thème <strong>de</strong> discours. Elém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong><br />
récit dans le récit" Langue Française, 78 : 67-87. Paris : Larousse.<br />
Marandin Jean-Marie. 1997. Dans le titre se trouve le sujet, Mémoire d'habilitation, U. <strong>de</strong><br />
Paris 7, np.<br />
Marandin Jean-Marie. 2000. Semantics of unaccusative inversion in Fr<strong>en</strong>ch. A<br />
constructional approach [papier prés<strong>en</strong>té à LSRL 30] np.<br />
Marandin Jean-Marie. 2001. "Unaccusative inversion in Fr<strong>en</strong>ch" in Yves D'Hulst, Johan<br />
Rooryck & Jan Schrot<strong>en</strong> (eds) Going Romance 1999 : selected papers.<br />
Amsterdam : John B<strong>en</strong>jamins.<br />
Marandin Jean-Marie et al. 2002. "Discourse marking in Fr<strong>en</strong>ch: C acc<strong>en</strong>ts and discourse<br />
moves" in Bernard Bel & Isabelle Marli<strong>en</strong> (eds) Proceedings of the Speech<br />
Prosody 2002 confer<strong>en</strong>ce. Aix-<strong>en</strong>-Prov<strong>en</strong>ce (<strong>Laboratoire</strong> Parole et Langage) :<br />
471-474.<br />
Marandin Jean-Marie. à par. "Pour une approche dialogique du contexte et <strong>de</strong> la structure<br />
informationnelle" in Francis Corblin titre à préciser.<br />
Martí Luisa. 2001. Topic ambiugity with why-questions in Spanish [papier prés<strong>en</strong>té au<br />
Workshop on topic and focus, Going Romance] np.<br />
Matras Yaron & Sasse Hans-Jürg<strong>en</strong> (eds). 1995. Verb-subject or<strong>de</strong>r and theticity in<br />
European languages, Sprachtypologie und Universali<strong>en</strong> Forschung. Berlin :<br />
Aka<strong>de</strong>mie Verlag GmbH.<br />
Ocampo Francisco. 1992. "The word or<strong>de</strong>r of construction with a verb, a subject and a<br />
direct object in spok<strong>en</strong> Spanish" in Jon Amastae et al. (eds) Contemporary<br />
research in Romance linguistics. Amsterdam / Phila<strong>de</strong>lphia : J. B<strong>en</strong>jamins.<br />
Ordoñez F. 1998. The inversion construction in interrogatives in Spanish and Catalan,<br />
[Lema J; et al., eds] Theoretical Analysis on Romance languages, Amsterdam : J.<br />
B<strong>en</strong>jamins.<br />
Pinto Manuela. 1997. Lic<strong>en</strong>sing and interpretation of inverted subjects in italian. Utrecht :<br />
LED.<br />
Perlmutter David, 1983, Studies in relational grammar (I), Chicago: University of Chicago<br />
Press.<br />
Pollard Carl & Sag Ivan A. 1994. Head-driv<strong>en</strong> phrase structure grammar. Chicago &<br />
Stanford : University of Chicago Press and CSLI Publications.<br />
Putnam Hilary. 1975. "The "meaning" of meaning" in Philosophical papers II.<br />
Cambridge : Cambridge University Press.<br />
Prince E. 1981. "Toward a Taxonomy of Giv<strong>en</strong>-New information" in P. Cole (ed) Radical<br />
Pragmatics : 223-255. New-York : Aca<strong>de</strong>mic Press.<br />
R<strong>en</strong>zi Lor<strong>en</strong>zo (ed). 1988. Gran<strong>de</strong> grammatica italiana di consultazione. Bologna : Il<br />
Mulino.<br />
Rizzi Luigi. 1982. Italian syntax. Dordrecht : Fortis.<br />
Rizzi Luigi. 1991. Residual verb second and the Wh-Criterion. Technical Reports in<br />
Formal and Computational Linguistics 2, Faculté <strong>de</strong>s Lettres, Université <strong>de</strong><br />
G<strong>en</strong>ève.<br />
50
Rizzi Luigi. 1997. "The fine structure of the left-periphery" in Haegeman Liliane (ed)<br />
Elem<strong>en</strong>ts of Grammar. Dordrecht : Kluwer.<br />
Ryle Gilbert. 1949. The concept of mind. New-York : Barnes and Noble.<br />
Sasse Hans-Jürg<strong>en</strong>. 1987. "The thetic/categorical distinction revisited" Linguistics, 25 :<br />
511-580.<br />
Suñer Margarita. 2001. The lexical preverbal subject in a Romance null subject language<br />
[papier prés<strong>en</strong>té à LSRL 31] np.<br />
Schmerling Susan. 1976. Aspects of English s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce stress. Austin : University of Texas<br />
Press.<br />
Schwarzchild Roger.1999. "Giv<strong>en</strong>ness, avoid F and other constraints on the placem<strong>en</strong>t of<br />
acc<strong>en</strong>t" Natural Language Semantics, 7 : 141-177.<br />
Sornicola Rosanna. 1994. "On word-or<strong>de</strong>r variability: a study from a corpus of Italian"<br />
Lingua et stile : 25-58.<br />
Sornicola Rosanna. 1995. "Theticity, VS or<strong>de</strong>r and the interplay of syntax, semantics and<br />
pragmatics" in Yaron Matras et al. : 72-83.<br />
Stalnacker R. 1972. Pragmatics in Davidson D. & Harmann G. (eds) Semantics of natural<br />
language : 380-97. Dordrecht : Rei<strong>de</strong>l.<br />
Vallduví Enric. 1991. The informational compon<strong>en</strong>t. New-York : Garland.<br />
Vallduví Enric.1993. "Catalan as VOS : Evid<strong>en</strong>ce from Information Packaging" in William<br />
J. Ashby, et al. (eds) Linguistics Perspectives on the Romance Languages.<br />
Amsterdam : J. B<strong>en</strong>jamins.<br />
Vallduví Enric & Engdahl Elisabet. 1995. "Information packaging and grammar<br />
architecture" in Beckman J. (ed) Proceedings of the North East Linguistic<br />
Society : 519-533, U. of P<strong>en</strong>nsylvania.<br />
Vallduví Enric & Vilkuna Maria. 1998. "On rheme and Kontrast" in Peter Culicover &<br />
Louise McNally (eds) The limits of syntax. New-york : Aca<strong>de</strong>mic Press.<br />
Wall Kerstin. 1980. L'inversion dans la subordonnée <strong>en</strong> français contemporain. Acta<br />
Universitatis Upsal<strong>en</strong>sis 30.<br />
Wehr Barbara. 1984. Diskusstrategi<strong>en</strong> im Romanisch<strong>en</strong>. Tübing<strong>en</strong> : Gunter Narr Verlag.<br />
Vanelli Laura. 1981. "Il mecanismo dittico" Studi di Grammatica Italiana, 10 : 293-311.<br />
Za<strong>en</strong><strong>en</strong> Annie. 1993. "Unaccusativity in Dutch: integrating syntax and lexical semantics"<br />
in Pustejovsky James (ed) Semantics and the lexicon : 129-161. Dordrecht :<br />
Kluwer.<br />
Zubizarreta Maria Luisa. 1998. Prosody, Focus and Word Or<strong>de</strong>r. Cambridge (Mas.) :<br />
MIT Press.<br />
51