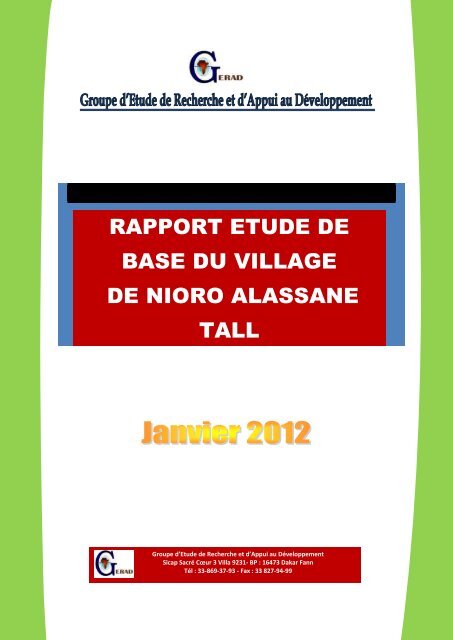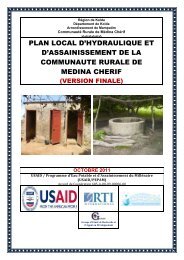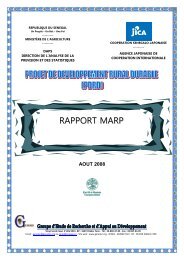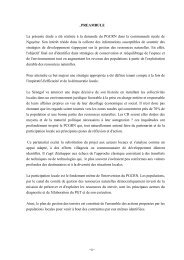You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
RAPPORT ETUDE DE<br />
BASE DU VILLAGE<br />
DE NIORO ALASSANE<br />
TALL<br />
Groupe d’Etude de Recherche et d’Appui au Développement<br />
Sicap Sacré Cœur 3 Villa 9231- BP : 16473 Dakar Fann<br />
Tél : 33-869-37-93 - Fax : 33 827-94-99<br />
Email : geradsn@geradsn.org ou gerad@orange.sn<br />
1
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
SOMMAIRE<br />
INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 4<br />
A. CONTEXTE ...................................................................................................................................................... 4<br />
B. OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................................................................................................... 5<br />
C. METHODOLOGIE ............................................................................................................................................ 5<br />
PREMIERE PARTIE : SITUATION GENERALE DU VILLAGE ................................................................ 7<br />
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ..................................................................................................................... 7<br />
1.2 SITUATION DEMOGRAPHIQUE ................................................................................................................. 7<br />
1.3 NIVEAU D’EQUIPEMENT ............................................................................................................................ 9<br />
1.3.1. Equipements sociaux de base ....................................................................................................................... 9<br />
1.3.2. Niveau d’équipement des ménages ............................................................................................................. 10<br />
1.4 ACCES A L’EAU .......................................................................................................................................... 12<br />
1.4.1. Sources d’approvisionnement ..................................................................................................................... 12<br />
1.4.2. Différents usages de l’eau ........................................................................................................................... 12<br />
1.4.3. Conditions d’accès pendant la saison sèche ................................................................................................ 13<br />
1.4.4. Conditions d’accès pendant l’hivernage ..................................................................................................... 13<br />
1.5 STRUCTURE DU VILLAGE ET CONSCIENCE DES GENS .................................................................... 14<br />
1.5.1. Rôles des différents groupes d’âge ............................................................................................................. 14<br />
1.5.2. Participation à la vie associative ................................................................................................................. 15<br />
1.5.3. Cohésion sociale ......................................................................................................................................... 16<br />
1.6 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE .......................................................................................................... 16<br />
1.6.1. Activités économiques ................................................................................................................................ 16<br />
1.6.2. Production agricole ..................................................................................................................................... 17<br />
1.6.3. Revenus des ménages ................................................................................................................................. 18<br />
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE DE LA DEGRADATION DES SOLS ................................. 21<br />
2.1 MILIEU NETUREL ....................................................................................................................................... 21<br />
2.1.1. Climat et végétation .................................................................................................................................... 21<br />
2.1.2. Types de sols .............................................................................................................................................. 21<br />
2.2 DEGRADATION DES SOLS ........................................................................................................................ 22<br />
2.2.1. Situation de la dégradation des sols ............................................................................................................ 22<br />
2.2.2. Causes de la dégradation ............................................................................................................................ 23<br />
2.3 ACTIVITES DE PROTECTION ET DE SONSERVATION DES SOLS ..................................................... 23<br />
2.3.1. Activités de protection des sols dans le passée ........................................................................................... 23<br />
2.3.2. Activités actuelles de protection des sols .................................................................................................... 24<br />
2.3.3. Participation des populations ...................................................................................................................... 25<br />
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................. 26<br />
2
Liste des tableaux<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Tableau 1 : Accessibilité du village ........................................................................................................................ 7<br />
Tableau 2: Poids démogrphique ............................................................................................................................. 7<br />
Tableau 3: Nombre de personnes par ménage ........................................................................................................ 7<br />
Tableau 4: Commidités dont disposent les ménages ............................................................................................ 10<br />
Tableau 5 : Sources d'eau potable du village ........................................................................................................ 12<br />
Tableau 6 : Principaux usages eau de puits .......................................................................................................... 12<br />
Tableau 7 : Principaux usages eau de forage ........................................................................................................ 13<br />
Tableau 8: Rôles des hommes .............................................................................................................................. 14<br />
Tableau 9: Rôles des femmes ............................................................................................................................... 15<br />
Tableau 10 : Rôles des enfants ............................................................................................................................. 15<br />
Tableau 11 : Groupements existants ..................................................................................................................... 15<br />
Tableau 12: Disposez-vous d'une propriété terrienne ........................................................................................... 16<br />
Tableau 13: Superficie exploitée l'année dernière ................................................................................................ 17<br />
Tableau 14 Principales spéculations ..................................................................................................................... 18<br />
Tableau 15: Montant des revenus liés à l'agriculture ............................................................................................ 19<br />
Tableau 16: Montant des revenus liés au transfert des émigrés ............................................................................ 19<br />
Tableau 17: Montant des revenus liés aux autres activités ................................................................................... 19<br />
Tableau 18 : Existence de terres dégradées .......................................................................................................... 22<br />
Tableau 19: Situation des dégradations ................................................................................................................ 23<br />
Tableau 20: Utilisation des terres dégradées ........................................................................................................ 23<br />
Tableau 21: Causes de la dégradation des terres .................................................................................................. 23<br />
Tableau 22: Activités menées dans le passé ......................................................................................................... 23<br />
Tableau 23: Activités collectives menées actuellement ........................................................................................ 24<br />
Tableau 24: Responsables des activités actuelles de conservation ....................................................................... 24<br />
Tableau 25: Activités de conservation menées par les chefs de ménage .............................................................. 24<br />
Tableau 26: Pouvez-vous participer par cotisation ............................................................................................... 25<br />
Tableau 27: Montant de la cotisation .................................................................................................................... 25<br />
Liste des graphiques<br />
Graphique 1 : Age chef de ménage ......................................................................................................................... 8<br />
Graphique 2 : Ethnie chef de ménage ..................................................................................................................... 8<br />
Graphique 3 : Sources d’éclairage des ménages ................................................................................................... 10<br />
Graphique 4 : Existence de toilettes dans les ménages ......................................................................................... 11<br />
Graphique 5 : Existence de téléphone portable..................................................................................................... 11<br />
Graphique 6 : Fréquence écoute radio .................................................................................................................. 11<br />
Graphique 7 : Fréquence suivi télévision ............................................................................................................. 12<br />
Graphique 8 : Source d’approvisionnement en eau de boisson en saison sèche ................................................... 13<br />
Graphique 9: Source d’approvisionnement en eau de boisson pendant l’hivernage ............................................. 14<br />
Graphique 10: Activités principales des chefs de ménages .................................................................................. 16<br />
Graphique 11: Mode d’acquisition des terres ....................................................................................................... 17<br />
Graphique 12: Revenus annuels des chefs de ménage .......................................................................................... 18<br />
Graphique 13: Principaux postes de dépenses ...................................................................................................... 20<br />
Graphique 14 : Montant des dépenses mensuelles ............................................................................................... 20<br />
Graphique 15: Résultats des activités de conservation des chefs de ménage ....................................................... 25<br />
3
A. CONTEXTE<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
INTRODUCTION<br />
La terre est une ressource capitale au Sénégal. Soixante-dix pour-cent (70%) de la population<br />
rurale tirent leurs moyens d’existence (consommation alimentaire et revenus) directement des<br />
ressources foncières. Cependant la dégradation des terres dans les zones sèches constitue une<br />
menace importante pour la production agricole et la sauvegarde de l’environnement au<br />
Sénégal. 34 % de la superficie du pays sont en proie à une dégradation. 24% des superficies<br />
dégradées subissent une accélération du processus dans les dix dernières années.<br />
Les régions de Fatick et de Kaolack sont fortement touchées par le phénomène. L’expansion<br />
des terres nues ou terres à faible couvert végétal, la salinisation et l’affaiblissement du sol<br />
constituent des facteurs de dégradation. A cela s’ajoutent une forte teneur en acide sulfurique<br />
et l’affaiblissement des terres arables.<br />
En vue de lutter efficacement contre ce phénomène, il est important de pouvoir évaluer et<br />
suivre son extension, ses causes et ses conséquences sur la vie des populations notamment<br />
rurales. Afin d’atteindre cet objectif, le Sénégal participe à toutes les initiatives<br />
internationales en relation avec la Convention de lutte contre la désertification et plusieurs<br />
projets de lutte contre la dégradation des sols ont été mis en œuvre.<br />
Cependant, les activités et les techniques introduites ont été mises en œuvre dans le cadre<br />
d’interventions isolées. Par ailleurs, les activités menées au niveau des villages stagnent<br />
souvent avec l’achèvement des projets. Il en résulte des problèmes liés à la recrudescence de<br />
la dégradation des sols ou de la non propagation des activités et des techniques au niveau des<br />
autres villages d’où la nécessité de renforcer les capacités des agents forestiers afin<br />
d’accumuler et de mettre en ordre les données et les informations acquises par ces projets.<br />
C’est dans ce contexte qu’est mis en œuvre avec l’appui de la JICA un nouveau programme<br />
dénommé Projet de renforcement des capacités pour le contrôle de la dégradation des<br />
terres et la promotion de leur valorisation dans les zones de sols dégradés (CODEVAL).<br />
Les zones ciblées par le présent projet sont 4 départements (Foundiougne, Fatick, Kaolack et<br />
<strong>Nioro</strong> du Rip) des régions de Fatick et Kaolack confrontés à des problèmes de dégradation<br />
des sols et nécessitant en priorité un appui dans le cadre de la mise en œuvre du projet.<br />
L’objectif du CODEVAL est de mener des activités pour le contrôle de la dégradation des<br />
terres et la promotion de leur valorisation.<br />
Les résultats attendus dans le cadre de ce programme sont:<br />
Les zones prioritaires dans lesquelles les activités de mesure du contrôle de la<br />
dégradation des terres et de la promotion de leur valorisation seront menées ;<br />
Les techniques nécessaires pour le contrôle de la dégradation des terres et la<br />
promotion de leur valorisation sont conçues et améliorées ;<br />
Les techniques et des mesures efficaces pour le contrôle de la dégradation des terres et<br />
la promotion de leur valorisation sont identifiées à travers la mise en œuvre des<br />
projets pilotes ;<br />
Le niveau de conscience des personnes concernées en dehors des sites des projets<br />
pilotes dans les zones prioritaires sur les mesures du contrôle de la dégradation des<br />
terres et de la promotion de leur valorisation est haussé.<br />
4
B. OBJECTIFS DE L’ETUDE<br />
B.1 Objectif Global<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
L’étude de base vise une meilleure connaissance de la zone d’intervention. Il s’agit de recueillir des<br />
informations sur de multiples aspects de la vie sociale et économique villageoise, dont l’analyse<br />
permettra de caractériser le profil des sites d’intervention du projet. Elle s’appuie principalement<br />
sur une enquête quantitative avec l’administration d’un questionnaire auprès des ménages et une<br />
enquête qualitative basée sur l’utilisation d’un guide d’entretien pour les focus-groups et entretiens<br />
avec des personnes ressources ( chefs de villages, notables, membre OCB, services techniques<br />
locaux…).<br />
B.2 Objectifs Spécifiques<br />
De manière spécifique, le diagnostic effectué au niveau du village cible a permis :<br />
l’identification d’informations générales notamment par une présentation des<br />
localités, des caractéristiques démographiques, les conditions financières des<br />
populations, le niveau d’équipement et l’état de la migration ;<br />
l’identification des activités économiques des populations : secteurs d’activités,<br />
utilisation des terres, revenus des ménages ;<br />
l’identification de la Structure du village et conscience des gens par l’étude des<br />
Rôles des différents groupes d’âge, le diagnostic du tissu associatif et des activités<br />
menées en groupe ;<br />
l’établissement d’un bilan de l’accès à l’eau potable avec les sources<br />
d’approvisionnement, les différents types d’usage (usage domestique, usage productif,<br />
abreuvement du cheptel), la qualité de l’eau, les conditions d’accès en saison sèche et<br />
en saison des pluies ;<br />
la problématique de la dégradation des sols pour apprécier la situation et les causes<br />
de la dégradation des sols, les activités de protection et de conservation des sols, la<br />
participation des populations à l’effort de protection.<br />
C. METHODOLOGIE<br />
Sur le plan méthodologique, la réalisation de l’étude a nécessité des recherches à plusieurs<br />
niveaux :<br />
Les enquêtes quantitatives au niveau des ménages<br />
Il s’agit d’une enquête quantitative au niveau du village avec l’utilisation d’un questionnaire<br />
administré aux chefs de ménage ;<br />
L'unité d'observation est constituée des ménages (1 carré = 1 ménage), l'unité répondante est<br />
le chef de ménage ou toute autre personne adulte et capable de fournir avec exactitude les<br />
informations recherchées. Le plan de sondage qui est appliqué permet de s’assurer une<br />
représentativité spatiale avec un pas d’enquête de 1 sur 5 concessions : l’enquêteur qui fait<br />
un carré saute 4 concessions pour enquêter le 5 ieme carré. Dans chaque concession, un seul<br />
ménage est tiré au hasard. Une concession pouvant renfermer plusieurs ménages, il faut<br />
éviter de concentrer tous les questionnaires dans une ou deux concessions.<br />
5
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
L’échantillonnage a été effectué sur la base des données démographiques fournies par le CR.<br />
Au total, 20 ménages ont été enquêtés sur les 47 que compte le village.<br />
Les enquêtes qualitatives<br />
Les enquêtes qualitatives ont été facilitées par l’utilisation d’un guide d’entretien et<br />
l’organisation de focus group avec le chef de village, les notables et les organisations<br />
villageoises intervenant dans le domaine des ressources naturelles. Ces entretiens ont donné<br />
lieu à des discussions ouvertes permettant d’apprécier les conditions de vie des populations et<br />
la situation de la dégradation des sols.<br />
Les services déconcentrés, Eaux et forêts, CADL ont été rencontrés pour recueillir des<br />
données qualitatives portant sur la problématique de la dégradation des terres sur les villages<br />
cibles.<br />
Les difficultés rencontrées<br />
La collecte des données a coincidé avec les vacances de noël et de nouvel an. Ainsi, la<br />
mission n’a pu rencontré les responsables de l’éducation au niveau local (directeurs d’écoles),<br />
départemental et régional (inspecteurs de l’éducation). De ce fait, elle n’a pu collecté les<br />
données relatives aux taux de scolarisation et d’alphabétisation.<br />
6
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
PREMIERE PARTIE : SITUATION GENERALE DU VILLAGE<br />
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE<br />
Le village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong> est le chef lieu de la communauté rurale du même nom<br />
appartenant à l’arrondissement de Toubacouta, dans le département de Foundiougne, région<br />
de Fatick. Accessible à la ville de Sokone par une piste latéritique très dégradée sur environ<br />
12 km, il est très proche des villages de Keur Amadi Diallo (1, km), de Keur Aly Kany et de<br />
Ngayène situés à 2 km. Entres ces localités, les déplacements sont faits par pied, par<br />
charrette, par moto et souvent par véhicule.<br />
Tableau 1 : Accessibilité du village<br />
Locaités proches Distances(en km)<br />
Village de Keur Amadi Diallo 1,5<br />
Village de Keur Aly Kany 2<br />
Village de Ngayène 2<br />
Ville de Sokone 12<br />
Source: Focus group avec chef de village et notables, questions 9, 10, 13, 14, 15 et 16.<br />
1.2 SITUATION DEMOGRAPHIQUE<br />
Le village est peuplé de 577 habitants selon les données de 2010 recueillies au niveau du<br />
SRSD de Kaolack. Avec 283 hommes et 294 femmes, ces dernières restent légèrement<br />
prédominantes. La population est répartie en 47 ménages et 35 concessions.<br />
Tableau 2: Poids démogrphique<br />
Population Totale 577<br />
Nombre de ménages 47<br />
Nombre d'hommes 283<br />
Nombre de femmes 294<br />
Source: Focus group chef de village et notables, questions 19, 20, 21 et 22<br />
Cette petite taille démographique reflète par ailleurs une grande taille des ménages à l’image<br />
du milieu rural. La taille moyenne des ménages est de 17 personnes/ménage avec surtout des<br />
disparités profondes. En effet, 40% a 20 personnes et plus alors que seul 10% a moins de 10<br />
personnes.<br />
Tableau 3: Nombre de personnes par ménage<br />
Nombre de personnes Nb. Cit Freq(%)<br />
Moins de 10 2 10<br />
10 à 12 3 15<br />
12 à 14 1 5<br />
14 à 16 4 20<br />
16 à 18 1 5<br />
18 à 20 1 5<br />
20 et plus 8 40<br />
Total obs 20 100<br />
Source: Enquête ménage, question 13<br />
7
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Les chefs de ménages sont le plus souvent des adultes (40% ayant entre 46 et 60 ans) avec<br />
une présence conséquente des personnes de troisième âge (plus de 60 ans) qui représentent<br />
35%. Cependant, la population est caractérisée par sa jeunesse relative qui s’illustre par les<br />
35% de Chefs de ménage ayant en deçà de 36 ans.<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
40%<br />
35%<br />
20%<br />
5%<br />
46 à 60 ans Plus de 60 ans 35 à 45 ans Moins de 35<br />
ans<br />
Source : Enquête ménage, question 7<br />
Graphique Graphique 1 : Age 1 chef : Age de ménage chef de ménage<br />
La composition ethnique est très variée avec la présence des ethnies dominantes du pays.<br />
Derrière les wolofs qui sont largement majoritaires avec 80% de l’échantillon, il y’a les<br />
sérères (10%), le groupe pulaar et les bambaras qui représentent respectivement 5%. D’autres<br />
ethnies sont notées telles que les socés, les soussous et les diolas.<br />
Graphique 2 : Ethnie chef de ménage<br />
On note une homogénéité religieuse car le village est entièrement peuplé de musulmans.<br />
Le taux de scolarisation calculé sur la base de la population scolarisable (7 à 14 ans) et non<br />
scolarisée de l’échantillon est de 68,25%. Ce qui est insuffisant compte tenu des équipements<br />
scolaires qui existent dans le village. Il faudra sans doute tenir en compte l’enseignement<br />
arabe et coranique qui absorbe l’essentiel des autres enfants qui ne vont pas à l’école.<br />
8
1.3 NIVEAU D’EQUIPEMENT<br />
1.3.1. Equipements sociaux de base<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Le niveau d’équipement du village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong> est étroitement lié à son statut de<br />
chef lieu de CR. Ce qui lui confère l’essentiel des équipements sociaux de base.<br />
Sur le plan scolaire, le village est doté d’une école primaire, d’un collège et d’une école<br />
arabe.<br />
Sur le plan sanitaire, un poste de santé dessert le village et son environnant tandis que<br />
l’existence d’une pharmacie et d’un vétérinaire permet d’acquérir certains médicaments sans<br />
se déplacer jusqu’à Toubacouta ou Sokone.<br />
Sur le plan hydraulique, notons l’existence d’un forage connecté à un réseau de 4 bornes<br />
fontaine et d’un abreuvoir. De plus 3 puits viennent compléter le système<br />
d’approvisionnement en eau dans le village.<br />
Les équipements marchands ou de production se résument essentiellement aux boutiques (3),<br />
aux moulins (3), aux menuiseries métalliques (2) et à une quincaillerie.<br />
Notons par ailleurs la présence d’équipements cultuels tels que la mosquée et la grande<br />
mosquée.<br />
9
1.3.2. Niveau d’équipement des ménages<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
La radio, important outil de communication et financièrement accessible, est très fréquente<br />
dans les ménages (85%). Grâce à l’électrification du village dont 55% des ménages ont<br />
bénéficié, on retrouve un certain nombre d’équipements de confort dont les magnétophones<br />
qui existent dans 40% des ménages, les téléviseurs (45%) et les ventilateurs (45%).<br />
Les équipements de transports sont représentés par les motos et bicyclettes utilisées par 35%<br />
des chefs de ménage, un seul véhicule mais surtout les charrettes détenues par 90% des<br />
ménages. La fonction des charrettes est non seulement pour les déplacements mais surtout<br />
pour les activités agricoles.<br />
En effet, les équipements agricoles restent encore rudimentaires. L’utilisation des houes et<br />
semoir artisanaux est très fréquente. Mais quelques exceptions sont faites avec la présence de<br />
tracteur dans deux ménages.<br />
Tableau 4: Commidités dont disposent les ménages<br />
Commodités Nb.Cit Freq(%)<br />
Poste radio 17 85<br />
Charrette 18 90<br />
Fourneau à gaz 4 20<br />
Magnétophone 8 40<br />
Mobilette/moto 6 30<br />
Bicyclette 1 5<br />
Véhicule 1 5<br />
Téléviseur 9 45<br />
Ventilateur 5 25<br />
Tracteur 2 10<br />
Total Obs 20<br />
Source: Enquête ménage, question 32<br />
Les sources d’éclairages sont en majorité l’électricité. Des ménages abonnés à la SENELEC<br />
où connectés sur leur voisin forment 70% de l’échantillon. Les autres sources d’éclairage sont<br />
les lampes chinoises utilisées par 25% des ménages. Selon le niveau financier de quelques<br />
rares ménages, on retrouve le solaire comme source d’éclairage. Mais, il faut noter que la<br />
bougie est utilisée par 15% des ménages.<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Graphique 3 : Sources d'éclairage des ménages<br />
Graphique 3 : Sources d’éclairage des ménages<br />
70%<br />
Non réponse Lampe<br />
chinoise<br />
Source : Enquête ménage, question 29<br />
25%<br />
15%<br />
5%<br />
Bougie Solaire<br />
10
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Les ménages sont faiblement équipés de toilettes comme en attestent les enquêtes : 67% n’en<br />
dispose pas. Seul 28% affirme avoir des toilettes dans le village.<br />
Graphique 5 : Existence de toilette dans les ménages<br />
Graphique 4 : Existence de toilettes dans les ménages<br />
Non<br />
67%<br />
Source: Enquête ménage, question 27<br />
Oui<br />
28%<br />
Le village est couvert par les réseaux téléphoniques offrant aux populations des moyens de<br />
communication efficaces. Ainsi 90% des chefs de ménages possède un téléphone portable.<br />
Graphique 5 : Existence de téléphone portable<br />
NR<br />
5%<br />
Source: Enquête ménage, question 30<br />
Non<br />
5%<br />
Oui<br />
90%<br />
Les radios sont disponibles dans la quasi-totalité des ménages comme attesté précédemment,<br />
mais tous les chefs de ménage ne sont pas pour autant intéressés car 30% ne l’écoute que<br />
rarement.<br />
100%<br />
50%<br />
0%<br />
70%<br />
Source : enquête ménage, question 35<br />
Tous les jours rarement<br />
30%<br />
NR<br />
5%<br />
Graphique 5 : Existence de téléphone portable<br />
Graphique 6 : fréquence 6 : Fréquence écoute radio écoute radio<br />
11
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Pour ce qui est de la télévision, notons que seul 30% la regarde tous les jours. Les ménages<br />
qui en sont équipés sont fréquentés par les voisins faisant que plus de la moitié des chefs de<br />
ménage regarde rarement la télévision. En effet, 10% ne regarde jamais la télévision.<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
55%<br />
30%<br />
Rarement Tous les<br />
jours<br />
source : Enquête ménage, question 34<br />
1.4 ACCES A L’EAU<br />
1.4.1. Sources d’approvisionnement<br />
Graphique Graphique 7 : fréquence 7 : Fréquence suivi suivi télévision<br />
10%<br />
5%<br />
Jamais Non<br />
Réponse<br />
Le village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong> est suffisamment doté en équipements hydrauliques. L’eau<br />
du forage et des puits permet aux habitants de s’approvisionner convenablement en eau<br />
potable.<br />
1.4.2. Différents usages de l’eau<br />
Tableau 5 : Sources d'eau potable du village<br />
Sources d'eau potable Nombre Freq (%)<br />
Puits 3 100<br />
Bornes fontaines 4 100<br />
Forages 1 100<br />
Total 1 100%<br />
Source: Focus group chef de village et notables, questions 32, 33 et MARP<br />
L’eau du puits sert à tous les usages : la boisson, les usages domestiques, le maraîchage et<br />
l’abreuvement du bétail.<br />
Tableau 6 : Principaux usages eau de puits<br />
Usage eau de puits Nb Cit Freq(%)<br />
Eau de boisson 1 100<br />
Eau à usage domestique 1 100<br />
Culture maraîchère 1 100<br />
Abreuvement du bétail 1 100<br />
Pépinière 0 0<br />
Total obs 1<br />
Source: Focus group chef de village et notables, question 34<br />
12
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
L’eau du forage plus abondante et accessible subit les mêmes destinations mais à des degrés<br />
variant selon les usages. Contrairement à l’eau des puits dont l’accès est gratuit le plus<br />
souvent, l’utilisation de l’eau du forage pour des activités de maraîchage est relativement<br />
réduite.<br />
Par ailleurs, l’abreuvement du bétail est favorisé par l’existence de l’abreuvoir.<br />
Tableau 7 : Principaux usages eau de forage<br />
Usage eau de forage Nb Cit Freq(%)<br />
Eau de boisson 1 100<br />
Eau à usage domestique 1 100<br />
Culture maraîchère 1 100<br />
Abreuvement du bétail 1 100<br />
Pépinière 0 0<br />
Autres 0 0<br />
Total obs 1<br />
Source : Focus group chef de village et notables, question 37<br />
1.4.3. Conditions d’accès pendant la saison sèche<br />
En saison sèche, les enquêtes tirées de l’échantillon révèlent que 80% des ménages<br />
s’approvisionne à partir des bornes fontaines. Mais aussi durant cette période, les puits<br />
constituent la principale source d’approvisionnement en eau pour 75% des ménages. Notons<br />
que les ménages utilisent à la fois les deux sources pour réduire les dépenses liées à l’eau du<br />
forage.<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Graphique Graphique 8 : source 8 d'approvisionnement : Source d’approvisionnement en eau de boisson en eau de<br />
pendant boisson la saison séche en saison sèche<br />
80% 75%<br />
30%<br />
Bornes fontaines Puits Branchements particuliers<br />
Source : Enquête ménage, question 23<br />
1.4.4. Conditions d’accès pendant l’hivernage<br />
On retrouve les mêmes tendances en hivernages sur l’utilisation des différentes sources<br />
d’eau. Aussi bien pour les puits que les autres points d’eau, on retrouve le même niveau de<br />
fréquentation qu’en saison sèche. L’utilisation de l’eau des pluies n’a pas été soulignée.<br />
13
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Graphique 8 : source d'approvisionnement en eau de boisson<br />
Graphique 9: Source d’approvisionnement en eau de<br />
pendant l'hivernage<br />
boisson pendant l’hivernage<br />
80% 75%<br />
30%<br />
Bornes fontaines Puits Branchements particuliers<br />
Source : Enquête ménage, question 23<br />
1.5 STRUCTURE DU VILLAGE ET CONSCIENCE DES GENS<br />
1.5.1. Rôles des différents groupes d’âge<br />
Selon le point de vue de la totalité des personnes interrogées, les activités agricoles et<br />
communautaires (participation aux réunions) sont prioritairement inscrites dans le calendrier<br />
journalier des hommes. Les autres activités telles que la commercialisation des produits<br />
agricoles et les soins du bétail y sont inscrites aussi, mais au second plan. D’ailleurs certaines<br />
tâches (puiser d’eau, garder des enfants) d’habitude réservées à la femme sont pratiquées par<br />
des hommes comme en atteste les chiffres du tableau ci-après.<br />
Notons qu’enfin, après les travaux agricoles, les chefs de ménages s’attellent aux métiers de<br />
de maçon, de menuiserie et de réfection de palissade pour la réhabilitation des maisons.<br />
Tableau 8: Rôles des hommes<br />
Rôles des hommes Nb. Cit Freq(%)<br />
Travail agricole 20 100<br />
Participation aux réunions 20 100<br />
Vente de produits agricoles 13 65<br />
Soins de bétail 13 65<br />
Garder des enfants 11 55<br />
Puiser d’eau 5 25<br />
Autres 6 30<br />
Total obs 20<br />
Source: Enquête ménage, question 131<br />
Près des hommes, les femmes assument certaines activités semblables : travaux agricoles<br />
(90%), commercialisation des produits agricoles (60%), soins du bétail (5%), réunions<br />
villageoise (70%). Mais aussi, elles constituent les principales actrices des activités<br />
ménagères où elles sont citées à 90% dans les taches de quête d’eau, de préparation des repas<br />
et de nettoyage. Un calendrier surchargé qui atteste de la place majeure qu’elles occupent<br />
dans les fonctions ménagères et productives.<br />
14
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Tableau 9: Rôles des femmes<br />
Rôles des femmes Nb. Cit Freq(%)<br />
Travail agricole 18 90<br />
Puiser de l'eau 18 90<br />
Préparation des repas 18 90<br />
Débarrasser après le repas 13 65<br />
Néttoyage 18 90<br />
Lavage 19 95<br />
Garder des enfants 12 60<br />
Participation aux réunions 14 70<br />
Vente de produits agricoles 12 60<br />
Soins de bétail 1 5<br />
Total obs 20<br />
Source: Enquête ménage, question 133<br />
Les enfants ont un rôle prépondérant dans l’exécution des tâches ménagères et productives.<br />
Au même titre que les hommes et les femmes, garçons et filles sont fortement impliqués dans<br />
les travaux agricoles. En ce qui concerne les filles, elles assistent les femmes dans les tâches<br />
ménagères et dans l’entretien des enfants.<br />
Tableau 10 : Rôles des enfants<br />
Rôles des enfants Nb. Cit Freq(%)<br />
Travail agricole 18 90<br />
Puiser de l'eau 14 70<br />
Préparation des repas 6 30<br />
Débarrasser après le repas 12 60<br />
Néttoyage 11 55<br />
Lavage 14 70<br />
Garder des enfants 5 25<br />
Participation aux réunions 2 10<br />
Vente de produits agricoles 2 10<br />
Soins de bétail 5 25<br />
Autres 2 10<br />
Total obs 20<br />
Source: Enquête ménage, question 135<br />
1.5.2. Participation à la vie associative<br />
Le village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong> connait une vie associative assez dynamique grâce à<br />
l’existence de plusieurs associations dont les plus dynamiques sont les GIE (Groupement<br />
d’Intérêt Economique), le GPF (Groupement de Promotion Féminine) et l’ASC (Association<br />
Sportive de Culturelle). Les GIE sont regroupés en groupement de producteurs qui bénéficie<br />
de l’appui de l’ONG Wulanafa dans le domaine de l’agriculture.<br />
Tableau 11 : Groupements existants<br />
Type de groupement Nombre Freq(%)<br />
GPF 1 25<br />
GIE 2 50<br />
ASC 1 25<br />
Total 4 100%<br />
Source: Focus group chef de village et notables, questions 77 et 79<br />
Comme activités, les groupements procèdent à la distribution de semence à leur membre et<br />
bénéficie d’appui organisationnel par l’ONG Wulanafa.<br />
15
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
On note aussi l’existence d’autres associations dont l’ASUFOR (Association des Usagers de<br />
Forage), les Dahira, le comité de santé et l’APE (Association des parents d’Elève).<br />
1.5.3. Cohésion sociale<br />
Malgré le caractère pluri-ethnique du village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong>, on note une cohésion<br />
sociale relative. Les wolofs largement majoritaire gardent une parfaite entente avec les<br />
minorités ethniques. Cependant, quelques conflits sont souvent notés liés à la divagation des<br />
animaux.<br />
1.6 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE<br />
1.6.1. Activités économiques<br />
A l’image de la plupart des villages, l’économie villageoise est essentiellement agricole.<br />
L’agriculture occupe 95% des chefs de ménage interrogés. Les autres activités menées sont<br />
le commerce et l’artisanat qui constituent des activités d’appoint permettant aux agriculteurs<br />
de générer des revenus supplémentaires.<br />
Graphique 9 : Activités principales des chefs de ménage<br />
Graphique 10: Activités principales des chefs de ménages<br />
Autres<br />
5%<br />
Source: Enquête ménage, question 11<br />
Commerce<br />
5%<br />
Agriculture<br />
95%<br />
Les ménages, agriculteurs pour la quasitotalité de l’échantillon disposent tous de proprièté<br />
terrienne allant de 1 jusqu’à 8 ha.<br />
Tableau 12: Disposez-vous d'une propriété terrienne<br />
Propriété terrienne Nb cit Freq(%)<br />
OUI 20 100<br />
NON 0 0<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 36<br />
Pour la majorité, le mode d’acquisition des terres relève de l’héritage (85%). Certains qui<br />
n’en ont pas suffisamment ont procédé au prêt (25%) et/ou à la location (15%).<br />
16
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
1.6.2. Production agricole<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Graphique Graphique 10 : Mode 11: Mode d'acquisition d’acquisition des terresdes<br />
terres<br />
85%<br />
25%<br />
30%<br />
Héritage Prêt Location<br />
source : Enquête ménage, question 37<br />
La disponibilité de terres en quantité et en qualité constitue un des facteurs de production<br />
agricole. Les terres restent insuffisantes compte tenu de la grande taille des ménages notée<br />
précédemment mais surtout par rapport à la moyenne qui est de 4,65 ha. Les plus grandes<br />
exploitations agricoles sont de 8 ha alors qu’ailleurs, il est question de dizaines d’hectares.<br />
Ainsi, le tableau ci-après montre une disparité des superficies allant de 2 à 8 ha.<br />
Tableau 13: Superficie exploitée l'année dernière<br />
Superficie cultivée(en ha) Nb cit Freq(%)<br />
Moins de 2 4 20<br />
2 à 4 2 10<br />
4 à 6 6 30<br />
6 à 8 8 40<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 40<br />
Avec une production moyenne de 1413,7kg / an, le mil est destiné à plus de 80% à la<br />
consommation. La finalité d’autoconsommation donne au mil une place spéciale. Quelques<br />
ménages ayant un surplus ou confronté à des déficits financiers ont vendu leur mil<br />
représentant en moyenne près de 20% de la production. D’autres céréales telles que le maïs et<br />
le sorgho, ont été produits. Le maïs avec 994,5kg / an a une forte part tant dans la<br />
consommation (plus de la moitié) qu’en revenu. Avec beaucoup moins d’importance des<br />
variétés de sorgho sont produites dont certaines sont destinées à la nourriture des chevaux.<br />
Avec une quantité de 500 kg en moyenne entièrement destinée à la consommation, le riz est<br />
produit faiblement.<br />
L’arachide enregistre une production moyenne de 1866,2 kg. En dehors des 25,3% de<br />
l’arachide destinée à la consommation et souvent d’une autre partie réservée pour la semence,<br />
on note près de 75% qui est destinée à la vente. L’arachide est vendue en moyenne à 175 F au<br />
niveau du secco du village (65%), mais certains paysans préfèrent aller au marché (55%) où<br />
l’arachide est écoulée sans subir de sélection. Selon certains paysans, la sélection des graines<br />
réduit le poids de l’arachide. Selon 75% des chefs de ménage, l’arachide est traitée avant la<br />
vente. Le reste des chefs de ménage vend sans traitement, le jugeant pas nécessaire.<br />
17
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Les cultures maraîchères sont dominées par la tomate, l’aubergine, le gombo. C’est la<br />
spécialité des femmes qui entretiennent le plus souvent des potagers derrières les<br />
concessions. Les femmes prennent aussi en charge la culture de niébé qui est associé le plus<br />
souvent au mil et à l’arachide.<br />
Nom<br />
Tableau 14 Principales spéculations<br />
a) Production<br />
environ<br />
b)<br />
consommation<br />
personnelle<br />
vente<br />
1.Riz 500 kg/ an 100% 0%<br />
1. Mil 1413,7kg / an 80,6% 19,4%<br />
2. Maïs 994,5kg / an 53,1% 46,9%<br />
3. Sorgho 375 kg/ an 60% 40%<br />
4. Arachide 1866,2 kg / an 25,3% 74,7%<br />
5. Gombo 38 kg / an 42,1% 57,9%<br />
6. Tomate 35 kg / an 57,1% 42,9%<br />
Source : Enquête ménage, questions 41, 42, 43, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 89, 90, 9197, 98, 99, 105, 106, 107<br />
1.6.3. Revenus des ménages<br />
Selon les enquêtes, le revenu moyen annuel est de 519 200 F soit un montant mensuel de<br />
43 000 F, très dérisoire compte tenu des nombreuses charges familiales. Un niveau très bas<br />
confirmé par le graphique ci-après qui montre que 50% des ménages ayant entre 300 000 et<br />
600 000 par an et 20% n’ayant pas 300 000 par année. Les niveaux de revenu les plus élevés<br />
sont les tranches 600 000-900 000 F et 1800 000 F et plus qui regroupent seulement 15% des<br />
ménages.<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Graphique 10 : Revenus 12: Revenus annuels annuels des chefs des de chefs ménages de ménage<br />
50%<br />
300000 à<br />
600000<br />
25%<br />
600000 à<br />
700000<br />
20%<br />
Moins de<br />
300000<br />
Source : Enquête ménage, question 121<br />
15%<br />
900000 à<br />
1200000<br />
10%<br />
600000 à<br />
900000<br />
5%<br />
1800000 et<br />
plus<br />
L’agriculture contribue à environ 200 000 F en moyenne dans les revenus des ménages. Cette<br />
contribution est variable selon les ménages. Elle est moins de 100 000 F pour 25% des<br />
ménages alors que 15% en tire plus de 400 000 F.<br />
18
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Tableau 15: Montant des revenus liés à l'agriculture<br />
Montant agriculture Nb cit Freq(%)<br />
Moins de 100000 5 25<br />
100000 à 200000 7 35<br />
200000 à 300000 5 25<br />
300000 à 400000 0 0<br />
400000 à 500000 1 5<br />
600000 et plus 2 10<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 122<br />
La part des transferts d’émigrés est très faible. En effet, 20% ne profite que moins de 100 000<br />
par année alors que seuls deux ménages ont 600 000 F et plus. D’ailleurs 70% des ménages<br />
de l’échantillon ne bénéficie pas de ces transferts.<br />
Tableau 16: Montant des revenus liés au transfert des émigrés<br />
Montant transfert Nb cit Freq(%)<br />
Non réponse 14 70<br />
Moins de 100000 4 20<br />
100000 à 200000 1 5<br />
600000 et plus 2 5<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 123<br />
Les populations s’adonnent à la pluri-activité pour venir à bout des aléas de l’agriculture. Il<br />
s’agit le plus souvent du petit commerce, des métiers de maçon, de menuiserie, de vente de<br />
bétail, etc. Cependant, certains ménages comme illustré par 10% des ménages, n’ont aucune<br />
autre source de revenu hormis l’agriculture. Cependant 30% tire entre 160 000 et 320 000 F<br />
par an à travers ces activités. Seuls deux ménages ont 480 000 F et plus.<br />
Tableau 17: Montant des revenus liés aux autres activités<br />
Montant autres activités Nb cit Freq(%)<br />
Non réponse 2 10<br />
Moins de 80000 3 15<br />
160000 à 240000 2 10<br />
240000 à 320000 4 20<br />
320000 à 400000 0 0<br />
400000 à 480000 0 0<br />
480000 et plus 2 10<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 124<br />
L’alimentation est à 100% le principal poste de dépense des ménages. Elle est suivie par les<br />
autres dépenses telles que la santé (90%), l’habillement (65%). l’éducation (60%) et les<br />
autres dépenses liées aux paiements d’eau, d’électricité, aux frais de transport, aux dons<br />
effectués, etc.<br />
19
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Graphique 11 13: : Principaux Principaux postes postes de dépenses de dépenses<br />
100%<br />
90%<br />
60%<br />
65%<br />
40%<br />
Alimentation Santé Education Habillement Autres<br />
Source : Enquête ménage, question 125<br />
La moyenne mensuelle des dépenses est très faible avec seulement 41 915 F par ménage.<br />
Avec toutefois de fortes disparités allant de 15000 F au minimum à 90 000 F au maximum.<br />
Les dépenses mensuelles les plus élevées (30% des ménages) sont de 70 000 F et plus, alors<br />
que 40% des ménages ont entre 30 000 et 40 000 F.<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Graphique 12 : Montants des dépenses mensuelles<br />
Graphique 14 : Montant des dépenses mensuelles<br />
10%<br />
15%<br />
40%<br />
5%<br />
30%<br />
Moins de 20000 20000 à 30000 30000 à 40000 40000 à 50000 60000 et plus<br />
Source : Enquête ménage, question 127<br />
Les dépenses sont minimisées par la consommation de produits agricoles locaux (mil, maïs,<br />
arachide, légume, etc.) mais aussi la solidarité villageoise qui permet aux plus pauvres de<br />
recevoir des dons de divers natures.<br />
20
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
DEUXIEME PARTIE : PROBLEMATIQUE DE LA DEGRADATION<br />
DES SOLS<br />
2.1 MILIEU NETUREL<br />
2.1.1. Climat et végétation<br />
Le village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong> appartient à la zone du bassin arachidier. Le site est situé<br />
entre les isohyètes 500 et 600 mm avec un climat de type Soudano Sahélien dominé par une<br />
saison sèche caractérisée par l’harmattan, vent chaud et sec et une saison humide ou<br />
hivernage avec des pluies allant de Juin à Octobre.<br />
La végétation est de type arboré à arbustif. Elle est essentiellement constituée de Nguer<br />
(Nguiéra Sénégalensis) de Sékhao (Combretum) et de Darkasu ou anacardier (Anacardium<br />
occidental). Cependant, s'y ajoutent d'autres espèces telles que le Dimb (Cordylia pinnata) et le<br />
Gouye (adansonia digitata).<br />
2.1.2. Types de sols<br />
La carte des sols réalisés à l’issu des focus groupe permet de distinguer cinq (5) principaux<br />
types de sols : les sols « diors », les sols « deck » ou argile dur, le sol « deck-dior », ou sémiargileux,<br />
le sable hydromorphe ou « diabong » et enfin les carrières de sable.<br />
- Les sols « diors » occupe la moitié du terroir. Il s’agit de sols ferrugineux tropicaux<br />
non lessivés, pauvres en humus et en matières organiques et, de couleur jaune ou<br />
rouge. Ce sont des sols très épuisés, domaine de prédilection des cultures du mil, de<br />
l’arachide, du maïs, etc. Ce type de sol est surtout victime de l’invasion de la striga,<br />
herbe très nuisibles aux cultures mais aussi d’une forte érosion hydrique par<br />
infiltration.<br />
- Les sols « deck-dior »ou sémi-argileux occupe la partie Sud-Est du terroir sur environ<br />
20% du village. C’est du sol noir épuisé domaine de la striga, et zone de culture du<br />
mil, d’arachide, du maïs et du riz.<br />
- Les sols decks, hydromorphes, avec forte teneur en argile représente près de 10% du<br />
terroir dans la partie sud. C’est le domaine du mil, d’arachide, du maïs, du riz et du<br />
niébé.<br />
- Le sable hydromorphe ou « diabong » en langue locale sur environ 5% du terroir au<br />
sud du terroir est le domaine du maraîchage et de la riziculture.<br />
- Enfin on note les carrières de sable qui limite le « diabong » au sud-ouest.<br />
21
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
2.2 DEGRADATION DES SOLS<br />
2.2.1. Situation de la dégradation des sols<br />
La dégradation des sols du terroir de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong> est un phénomène largement<br />
partagé par les populations comme en attestent les résultats de l’enquête avec la quasi-totalité<br />
des chefs de ménages interrogés. L’épuisement de sols aurait été constaté à partir des années<br />
1980. L’augmentation progressive de la population a conduit à l’arrêt des jachères.<br />
Tableau 18 : Existence de terres dégradées<br />
Dégradation des terres Nb Cit Freq(%)<br />
Oui 20 100<br />
Non 0 0<br />
Ne sais pas 0 0<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 141<br />
Le constat majeur demeure l’épuisement des sols qui se manifeste par la baisse continue des<br />
rendements. Les résultats de l’échantillon montrent que l’érosion ainsi que les ravinements en<br />
sont essentiellement les facteurs. Le couvert végétal est visiblement réduit. D’autres<br />
situations sont soulignées telles que la prolifération des adventices comme la striga ou<br />
« Ndoukhoum » qui fait beaucoup de ravage au niveau surtout des sols « dior » et « deckdior<br />
»<br />
22
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Tableau 19: Situation des dégradations<br />
Situation dégradation Nb Cit Freq(%)<br />
Erosion 6 30<br />
Ravinements 6 30<br />
Récolte de plus en plus mauvaises 12 60<br />
Diminution des arbres 7 35<br />
Autres 15 75<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 142<br />
Ces terres, malgré leur niveau de dégradation, sont toutes affectées aux cultures sauf au<br />
niveau de moindres superficies occupées par des carrières de sable.<br />
2.2.2. Causes de la dégradation<br />
Tableau 20: Utilisation des terres dégradées<br />
Utilisation terres dégradées Nb Cit Freq(%)<br />
Reboisement 0 0<br />
Terres cultivées 1 100<br />
Total obs 1<br />
Source: Focus group chef de village et notables, question 54<br />
L’appréciation faite par le chef du CADL de Toubacouta sur le phénomène de dégradation<br />
place au premier plan une érosion hydrique très poussée sur les terres cultivables. Selon lui<br />
cette érosion est aussi le facteur de destruction des routes et des pistes de production.<br />
L’appréciation des populations locales met essentiellement en cause l’absence de jachère qui<br />
a conduit à l’épuisement généralisé des sols.<br />
Tableau 21: Causes de la dégradation des terres<br />
Causes possibles Nb Cit Freq(%)<br />
Pluies 0 0<br />
Absence de jachère 1 100<br />
Vent 0 0<br />
Total obs 1<br />
Source: Focus group chef de village et notables, question 53<br />
2.3 ACTIVITES DE PROTECTION ET DE SONSERVATION DES SOLS<br />
2.3.1. Activités de protection des sols dans le passée<br />
Selon les populations, le reboisement est pratiqué à partir de 1974 dans le terroir. Mais<br />
l’activité la plus importante est l’utilisation du fumier.<br />
Tableau 22: Activités menées dans le passé<br />
Activités passées Nwb Cit Freq<br />
Reboisement 1 100<br />
Utilisation du fumier 1 100<br />
Parcage du bétail 0 0<br />
Autres 0 0<br />
Total obs 1 100%<br />
Source: Focus group chef de village et notables, questions 62 et 63<br />
23
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
2.3.2. Activités actuelles de protection des sols<br />
Actuellement, on retrouve les mêmes activités à savoir le reboisement et l’utilisation du<br />
fumier. Ces activités sont plutôt individuelles que collectives. Les ménages qui ont du bétail<br />
et les moyens de transport font convenablement l’amendement de leurs terres avec de la<br />
fumure. Pour ce qui est du reboisement, d’une manière individuelle, les paysans font des<br />
pépinières pour aller les replanter dans leurs champs.<br />
Tableau 23: Activités collectives menées actuellement<br />
Activités actuelles Nb Cit Freq(%)<br />
Reboisement 1 100<br />
Installation des digues 0 0<br />
Utilisation du fumier 1 100<br />
Arrêt utilisation culture sur brulis 0 0<br />
Parcage du bétail 0 0<br />
Total obs 1 100%<br />
Source: Focus group chef de village et notables, questions 56<br />
Le conseil rural a initier des activités de reboisement et fait des restrictions sur le coupe<br />
d’arbre mais il y’a des contraintes de clôture pour préserver la flore. L’ONG Wulanafa qui est<br />
entrain d’appuyer et d’organiser le village dans le domaine de l’agriculture est encore dans le<br />
stade des procédures organisationnelles. C’est pourquoi aucune activité de protection des sols<br />
n’est menée pour l’instant de manière collective.<br />
Tableau 24: Responsables des activités actuelles de conservation<br />
Responsable activités passées Nb Cit Freq<br />
Villageois 1 1<br />
Services administratifs 0 0<br />
Organisme d'aide 0 0<br />
Autres 0 0<br />
Total obs 1<br />
Source: Focus group chef de village et notables, questions 57<br />
Les ménages ont adopté des stratégies individuelles d’amélioration de la fertilité des sols et<br />
de lutte contre les facteurs de dégradation des sols. Ainsi l’utilisation des fertilisants constitue<br />
la pratique la plus fréquente. Certains pratiquent le reboisement alors que d’autre ont<br />
préconisé la pratique de la jachère qu’il juge une des meilleures alternatives. Pour se faire,<br />
trois chefs de ménages ont opté pour la sensibilisation.<br />
Tableau 25: Activités de conservation menées par les chefs de ménage<br />
Activités actuelles Nb Cit Freq(%)<br />
Non réponse 1 5<br />
Reboisement 10 50<br />
Utilisation de fertilisant 19 95<br />
Sensibilisation 3 15<br />
Autres 3 15<br />
Total obs 20<br />
Source: Enquête ménage, question 145 et 146<br />
Des stratégies jugées diversement. En effet 45% les trouve assez bon alors que seul un<br />
ménage les trouve très bon et moyen. Il faut noter que 45% de chefs de ménage ne s’est pas<br />
prononcé sur l’efficacité de ces stratégies. Ce qui pourrait correspondre au manque<br />
d’information sur les différentes techniques de conservation des sols.<br />
24
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
Graphique Graphique 13 : Résultats 15: Résultats des activités des de activités conservation de conservation des chefs des<br />
de chefs ménage de ménage<br />
45% 45%<br />
5% 5%<br />
Assez bon NR Très bon Moyen<br />
Source : Enquête ménage, question 147<br />
Malgré la faible étendue des terres, certains chefs de ménages ont préconisé la jachère<br />
comme d’autres ont rejeté toute idée de mise en défens pour des raisons d’insuffisance de<br />
terres de cultures. Tout compte fait, l’utilisation d’engrais est la technique la plus souhaitée.<br />
Et tous se sont accordés que la pratique de cette stratégie dépendra de la dotation suffisante<br />
en engrais.<br />
2.3.3. Participation des populations<br />
Les chefs de ménages interrogés sont prêtes à 85% à adhérer en participant par cotisation<br />
pour la conservation. Un seul chef de ménage est contre alors que deux ont été réticents.<br />
Tableau 26: Pouvez-vous participer par cotisation<br />
Participation Nb Cit Freq(%)<br />
Oui 17 85<br />
Non 1 5<br />
ne sais pas 2 1 0<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 152<br />
Les montants proposés varient de moins de 300 F jusqu’à plus de 3000 F. Si trois chefs de<br />
ménages ne se sont pas prononcés, 50% compte contribuer à plus de 3000 F.<br />
Tableau 27: Montant de la cotisation<br />
Montant cotisation Nb Cit Freq(%)<br />
Non réponse 3 15<br />
Moins de 300 1 5<br />
300 à 500 1 5<br />
500 à 1000 1 5<br />
1000 à 2000 0 0<br />
2000 à 3000 4 20<br />
Plus de 3000 10 50<br />
Total obs 20 100%<br />
Source: Enquête ménage, question 153<br />
25
RAPPORT ETUDE DE BASE NIORO ALASSANE TALL<br />
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS<br />
Le phénomène de dégradation des terres est une réalité durement vécu par les populations du<br />
village de <strong>Nioro</strong> <strong>Alassane</strong> <strong>Tall</strong>. Mais, il faut noter une certaine passivité des villageois sur le<br />
plan collectif. Les actions de préservation sont beaucoup plus individuelles que collectives.<br />
Les partenaires sont presque inexistants hormis l’ONG Wulanafa qui actuellement reste le<br />
seul partenaire qui est entrain d’organiser les producteurs. Ce dernier est cependant dans le<br />
stade procédural. Ainsi, le village manque d’encadrement et les paysans, tentent de mener<br />
des actions isolées. Le reboisement est ancien dans la zone mais ne connait pas actuellement<br />
une grande ampleur. Pour mener des activités de conservation des sols les populations<br />
envisagent un certain nombre d’actions dont la plus fréquente est l’utilisation de fertilisants<br />
(fumier animal, engrais, etc.)<br />
Certains ont préconisé l’organisation d’activités de reboisement et la sensibilisation sur les<br />
techniques de jachère.<br />
Les enquêtes ont aussi révélé la gravité des problèmes d’adventices dont la striga est l’une<br />
des espèces les plus menaçantes. Une solution adéquate pour lutter contre cette espèce serait<br />
bien accueillie.<br />
En plus de cela, retenons ici les recommandations mises en avant par le chef du CADL de<br />
Toubacouta :<br />
Vulgariser toutes les techniques de conservations ;<br />
Outiller et mettre les moyens pour les populations ;<br />
Mobiliser beaucoup de main d’œuvre ;<br />
Généraliser les techniques au niveau de toutes les localités ;<br />
Renforcer les capacités par des sessions de formation.<br />
26