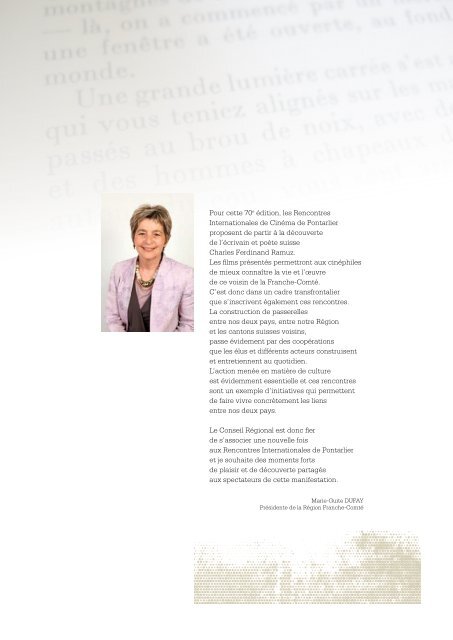Pour cette 70e édition, les Rencontres Internationales de ... - Ccjb.fr
Pour cette 70e édition, les Rencontres Internationales de ... - Ccjb.fr
Pour cette 70e édition, les Rencontres Internationales de ... - Ccjb.fr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Pour</strong> <strong>cette</strong> 70 e <strong>édition</strong>, <strong>les</strong> <strong>Rencontres</strong><br />
Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong> Cinéma <strong>de</strong> Pontarlier<br />
proposent <strong>de</strong> partir à la découverte<br />
<strong>de</strong> l’écrivain et poète suisse<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz.<br />
Les films présentés permettront aux cinéphi<strong>les</strong><br />
<strong>de</strong> mieux connaître la vie et l’œuvre<br />
<strong>de</strong> ce voisin <strong>de</strong> la Franche-Comté.<br />
C’est donc dans un cadre trans<strong>fr</strong>ontalier<br />
que s’inscrivent également ces rencontres.<br />
La construction <strong>de</strong> passerel<strong>les</strong><br />
entre nos <strong>de</strong>ux pays, entre notre Région<br />
et <strong>les</strong> cantons suisses voisins,<br />
passe évi<strong>de</strong>ment par <strong>de</strong>s coopérations<br />
que <strong>les</strong> élus et différents acteurs construisent<br />
et entretiennent au quotidien.<br />
L’action menée en matière <strong>de</strong> culture<br />
est évi<strong>de</strong>mment essentielle et ces rencontres<br />
sont un exemple d’initiatives qui permettent<br />
<strong>de</strong> faire vivre concrètement <strong>les</strong> liens<br />
entre nos <strong>de</strong>ux pays.<br />
Le Conseil Régional est donc fier<br />
<strong>de</strong> s’associer une nouvelle fois<br />
aux <strong>Rencontres</strong> Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong> Pontarlier<br />
et je souhaite <strong>de</strong>s moments forts<br />
<strong>de</strong> plaisir et <strong>de</strong> découverte partagés<br />
aux spectateurs <strong>de</strong> <strong>cette</strong> manifestation.<br />
Marie-Guite DuFay<br />
Prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Région Franche-Comté
Pierre Blon<strong>de</strong>au, prési<strong>de</strong>nt du Ciné-Club Jacques Becker<br />
et sa « Belle Équipe » vont ravir, une fois <strong>de</strong> plus, <strong>les</strong> amoureux<br />
du Septième art. Les 13, 14 et 15 mai, ils lancent une nouvelle <strong>édition</strong><br />
<strong>de</strong>s <strong>Rencontres</strong> Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong> Cinéma <strong>de</strong> Pontarlier.<br />
Fidè<strong>les</strong> et passionnés, ils s’attachent, <strong>de</strong>puis près d’un <strong>de</strong>mi-siècle,<br />
à faire découvrir au grand public <strong>les</strong> plus bel<strong>les</strong> productions du grand<br />
écran. Cette fois, c’est la Suisse que Pierre Blon<strong>de</strong>au met à l’affiche,<br />
en nous présentant <strong>les</strong> œuvres <strong>de</strong> l’écrivain et poète suisse Char<strong>les</strong><br />
Ferdinand Ramuz. El<strong>les</strong> sont adaptées pour certaines par l’illustre<br />
réalisateur Francis Reusser, qui nous fait l’honneur d’être présent<br />
à <strong>cette</strong> 70 e Rencontre.<br />
La guerre dans Le Haut Pays, Le règne <strong>de</strong> L’esPrit maLin, adam<br />
et eve, <strong>de</strong>rborence… Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz, fervent défenseur<br />
<strong>de</strong> la latinité, évoque admirablement <strong>les</strong> terres vaudoises et nous livre<br />
ses confessions sur la poésie <strong>de</strong> la terre, le drame <strong>de</strong>s collectivités<br />
villageoises, la liberté, l’argent, le travail, la nature, la guerre.<br />
Son talent sera reconnu par <strong>les</strong> plus grands noms <strong>de</strong> la littérature :<br />
Paulhan, Gi<strong>de</strong>, Clau<strong>de</strong>l, Cocteau, aragon.<br />
Le cinéaste Francis Reusser a découvert l’écrivain tardivement,<br />
mais <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux créateurs vaudois ne se sont plus quittés <strong>de</strong>puis.<br />
Francis Reusser trouve dans <strong>les</strong> ouvrages <strong>de</strong> Ramuz <strong>les</strong> réponses<br />
aux questions qu’il se pose. Cette véritable rencontre l’incitera à porter<br />
ses plus grands écrits à l’écran, à commencer par <strong>de</strong>rborence,<br />
qui lui vaut le César du meilleur film étranger.<br />
ainsi, défenseur d’une culture exigeante, Pierre Blon<strong>de</strong>au nous invite<br />
à revisiter <strong>les</strong> œuvres <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz : el<strong>les</strong> racontent<br />
la Suisse roman<strong>de</strong> avec nostalgie. Ce sera également l’occasion<br />
<strong>de</strong> redécouvrir adam et eve, l’œuvre <strong>de</strong> l’ami Michel Soutter trop tôt<br />
disparu, accueilli à Pontarlier en mars 1990 lors <strong>de</strong> la 35 e Rencontre.<br />
si Le soLeiL ne revenait Pas sera également à l’affiche, pour faire<br />
revivre le talent <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Goretta.<br />
Les bobines du Ciné-Club <strong>de</strong> Pontarlier tournent, <strong>cette</strong> année encore,<br />
pour le plus grand plaisir <strong>de</strong> tous. Je remercie Pierre Blon<strong>de</strong>au, Simone<br />
et sa « Belle équipe » <strong>de</strong> servir ainsi le cinéma comme ils le font.<br />
N’oubliez pas <strong>de</strong> réserver un accueil <strong>de</strong>s plus chaleureux à Francis<br />
Reusser dans notre beau pays comtois.<br />
Clau<strong>de</strong> JEaNNERot<br />
Prési<strong>de</strong>nt du Conseil général<br />
Sénateur du Doubs
au nom <strong>de</strong> la Municipalité, je tiens à féliciter et à remercier<br />
le Ciné-Club Jaques Becker ainsi que le Cercle d’Étu<strong>de</strong>s<br />
et <strong>de</strong> Recherches Filmographiques (CERF) pour la réussite <strong>de</strong><br />
leurs <strong>Rencontres</strong>. Nous en sommes déjà aux 70 e<br />
et en re<strong>de</strong>mandons, tant leurs programmations sont riches<br />
et <strong>les</strong> invités talentueux !<br />
Que <strong>de</strong> rencontres, à chaque fois, inoubliab<strong>les</strong> !<br />
Les 13, 14 et 15 mai prochains, la Suisse, voisine et amie,<br />
est à l’honneur, avec la projection d’œuvres remarquab<strong>les</strong><br />
<strong>de</strong> l’écrivain Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz.<br />
Son aptitu<strong>de</strong>, sa rigueur, lui ont valu <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s œuvres<br />
littéraires. très vite, il est reconnu par <strong>les</strong> grands noms<br />
<strong>de</strong> la littérature <strong>fr</strong>ançaise tels que Gi<strong>de</strong>, Clau<strong>de</strong>l, Cocteau, aragon.<br />
Ses écrits relatent <strong>de</strong>s thèmes mythiques<br />
tels que la nature, l’homme ou encore la liberté.<br />
Il faut reconnaître que ces thèmes plaisent aux professionnels<br />
<strong>de</strong> l’audiovisuel ; <strong>les</strong> romans <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz<br />
sont ainsi rapi<strong>de</strong>ment adaptés au cinéma. Char<strong>les</strong> Ferdinand<br />
Ramuz <strong>de</strong>viendra la source d’inspiration <strong>de</strong> Francis Reusser,<br />
réalisateur suisse. Ce <strong>de</strong>rnier, présent ce week-end,<br />
pourra nous faire découvrir le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ramuz.<br />
avant <strong>de</strong> fêter à l’automne <strong>les</strong> 50 ans du Ciné-Club,<br />
<strong>cette</strong> Rencontre s’annonce une nouvelle fois<br />
étonnante et passionnante.<br />
Vive le cinéma – vive le Ciné-Club !<br />
Patrick GENRE<br />
Maire <strong>de</strong> Pontarlier<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Communauté <strong>de</strong> Communes du Larmont<br />
Conseiller régional
4<br />
Ramuz lors du tournage <strong>de</strong> RAPT
sommaire<br />
Ramuz au présent, par Francis Reusser 6<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz, biographie 8<br />
Le cinéma dans l’œuvre <strong>de</strong> Ramuz 11<br />
LoNGS MÉtRaGES<br />
Rapt 14<br />
Farinet, l’or dans la montagne 20<br />
adam et Ève 34<br />
Derborence 38<br />
Si le soleil ne revenait pas 46<br />
La Guerre dans le Haut Pays 58<br />
FILMS INaCHEVÉS<br />
Le Règne <strong>de</strong> l’esprit malin 68<br />
Derborence 70<br />
CouRtS Et MoyENS MÉtRaGES<br />
Vagabondages 71<br />
Conformisme 72<br />
C.F. Ramuz, l’apparition <strong>de</strong> la beauté 75<br />
5
6<br />
RAMUZ<br />
AU PRÉSENT<br />
Il y a l’occasion : Gallimard et sa Pléia<strong>de</strong> qui font<br />
entrer l’écrivain et ses romans dans le panthéon<br />
littéraire, aux côtés <strong>de</strong> Marcel Proust et <strong>de</strong> L.F.<br />
Céline, qui avait repéré Ramuz, lui concédant<br />
« une petite plume, comme lui », beau compliment<br />
d’un styliste à un autre. En Suisse, <strong>les</strong> <strong>édition</strong>s<br />
Slatkine reprennent <strong>les</strong> œuvres complètes,<br />
le journal au complet lui aussi. Tant mieux pour<br />
Ramuz. C’est qu’à nos yeux, <strong>cette</strong> belle actualité<br />
du texte, cet hommage éditorial rendu à nouveau<br />
au plus grand <strong>de</strong> nos écrivains (et <strong>cette</strong> gran<strong>de</strong>urlà<br />
ne relève pas <strong>de</strong> la métrique <strong>de</strong>s honneurs),<br />
ne saurait être isolée <strong>de</strong> ce qui a <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong><br />
septante années (l’année du Rapt <strong>de</strong> Kirsanoff)<br />
accompagné le cheminement <strong>de</strong> l’œuvre écrite:<br />
Sa « transsubstantiation » sur le terreau du<br />
cinéma, qui a valu à l’œuvre <strong>de</strong> C.F. Ramuz d’être<br />
accompagnée, revisitée, « objectivée »<br />
en images et en sons <strong>de</strong> 1933 jusqu’à nos jours,<br />
<strong>cette</strong> lecture / écriture parallèle, ce voisinage<br />
créatif, n’étant pas bouclés, loin s’en faut.<br />
C’est que le cinéma rô<strong>de</strong> partout chez l’écrivain,<br />
il est le sujet sulfureux <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ses romans<br />
« L’Am o u r d u m o n d e », il est dans l’écriture<br />
même, ses découpages, ses lumières. Il s’incarne<br />
dans la vision, le point <strong>de</strong> vue, celui <strong>de</strong> l’aigle,<br />
souvent. Il est rappelé par certains écrits, ou<br />
une correspondance, l’horizontal et le vertical<br />
<strong>de</strong>s regards, sujet d’aimable polémique avec<br />
Gustave Roud. Ramuz a couché sur le papier<br />
désamorces <strong>de</strong> scénario, <strong>de</strong> l’écrit séquentiel<br />
à la manière qui est la nôtre, incisive et matérielle,<br />
dialogues serrés et didascalies sèches.<br />
J’ai toujours considéré que la lumière était<br />
le premier <strong>de</strong>s sujets pour un cinéaste, le signe<br />
fondateur (il y a eu le Lumière <strong>de</strong> l’invention<br />
du cinématographe, <strong>les</strong> Lumières du siècle<br />
du même nom, heureuses coïnci<strong>de</strong>nces).<br />
C’est dans la lumière que s’entrechoquent<br />
sentiments et conflits. C’est dans la lumière<br />
que se <strong>de</strong>ssine un climat, que se construisent<br />
une émotion esthétique ou une douleur paysanne.<br />
Nous en avons, nous cinéastes, <strong>les</strong> outils, en<br />
maîtrisons la mesure, nous pouvons dans <strong>les</strong><br />
ténèbres <strong>de</strong>s sal<strong>les</strong> obscures, donner sens à<br />
ce beau mot, faire la lumière littéralement,<br />
ce que certains d’entre nous hélas, ont parfois<br />
confondu avec l’éclairage et sa quincaillerie.<br />
Lorsqu’en 1984, passant la nuit à Derborence<br />
dans un chalet ami, je choisis d’entre <strong>de</strong>ux livres<br />
(le second <strong>de</strong>vait être le Li v r e d u So L d A t , mauvais<br />
départ pour le sommeil !) le <strong>de</strong> r b o r e n c e édité<br />
par Mermod, il y a une phrase qui se rappellera<br />
à mon souvenir, une fois l’aube allumée :<br />
« La dalle du ciel s’est écartée… Le ciel se soulève<br />
<strong>de</strong> nouveau : alors une bienheureuse lumière<br />
en ruisselle jusque sur nous. C’est comme si<br />
on levait la dalle d’un tombeau. La vie rentre.<br />
La vie touche ce qui est mort et qui tressaille<br />
à ce contact. La lumière à présent vient sur vous,<br />
non plus seulement <strong>de</strong> côté, mais d’en haut, et<br />
qu’on s’y voit <strong>les</strong> uns <strong>les</strong> autres, on s’y voit tout<br />
entiers, reconstruits, remis <strong>de</strong>bout ». Ce rayon<br />
métaphore, source <strong>de</strong> renaissance à soi-même,<br />
ôté <strong>de</strong> son apparente religiosité, a guidé mes choix<br />
<strong>de</strong> cinéaste. D’où vient la lumière, pourquoi,<br />
pour montrer qui et quoi, <strong>de</strong> quel endroit,<br />
toutes ces questions sont <strong>les</strong> miennes à jamais,<br />
el<strong>les</strong> font partie <strong>de</strong> mon quotidien avec <strong>les</strong> acteurs<br />
et <strong>les</strong> actrices, avec <strong>les</strong> électriciens comme<br />
<strong>les</strong> chefs opérateurs.<br />
Et c’est cela, je crois, ajouté à une manière<br />
<strong>de</strong> parler qui vient <strong>de</strong> loin, d’une véritable langue<br />
d’ici, retravaillée, remise en musique par Ramuz,<br />
et ajouté encore à <strong>de</strong>s « cadrages », une découpe<br />
<strong>de</strong>s actions et <strong>de</strong>s lieux, le haut vu du bas ou<br />
le bas vu du haut, ou <strong>de</strong> côté, en travers, qui a<br />
séduit <strong>les</strong> artistes <strong>de</strong> l’image animée.<br />
Qui a donné envie aux uns et aux autres, un<br />
Russe, <strong>de</strong>s Genevois, un Vaudois presque Bernois,<br />
un russe encore, d’ascendance, <strong>de</strong> s’installer<br />
<strong>de</strong>rrière leur caméra, une petite ou une gran<strong>de</strong>,<br />
une Debrie 35 mm., une Eclair 16 mm., voire<br />
une Panavision venue tout droit d’Hollywood
(c’est dire l’aura du bonhomme), et <strong>de</strong> filmer<br />
le verbe et la lumière ramuziens, <strong>de</strong> donner corps<br />
aux personnages <strong>de</strong> l’écrivain, d’incarner<br />
<strong>les</strong> passions et <strong>les</strong> tragédies singulières<br />
ou collectives <strong>de</strong>s romans qu’ils adaptaient<br />
à cet étrange langage, celui du cinématographe.<br />
Drôle d’architecture que le cinéma, où l’on peut<br />
rô<strong>de</strong>r tout près ou très loin <strong>de</strong>s sujets, dans le bruit<br />
et la fureur ou le silence ténu <strong>de</strong> l’espace à peine<br />
troublé par un souffle d’air, ou <strong>les</strong> pleurs<br />
d’une femme délaissée.<br />
Je reviens à l’occasion : elle est trop belle.<br />
On va reparler <strong>de</strong> Ramuz, le relire surtout.<br />
Une nouvelle génération va découvrir un auteur<br />
qui lui parle d’ici et d’aujourd’hui, un auteur<br />
débarrassé <strong>de</strong> son costume <strong>de</strong> Comman<strong>de</strong>ur<br />
<strong>de</strong>s Arts et Lettres Roman<strong>de</strong>s dans lequel on l’avait<br />
confit, après l’avoir trop longtemps ignoré<br />
ou maltraité pour dire <strong>les</strong> choses aimablement.<br />
Il aurait été dommage que le cinéma et<br />
<strong>les</strong> cinéastes, et je veux dire parmi eux, ceux qui<br />
déclinent véritablement leur vision du mon<strong>de</strong><br />
via le filtre <strong>de</strong> la mise en scène, n’emboîtent leur<br />
pas à celui <strong>de</strong>s éditeurs, ne participent pas à leur<br />
manière à la ré<strong>édition</strong> du grand œuvre ramuzien<br />
<strong>de</strong> ce début <strong>de</strong> nouveau siècle. Nos enfants auront<br />
ainsi à lire tous <strong>les</strong> livres et ce qui en a jailli dans<br />
l’imaginaire du cinéma, qui est <strong>de</strong> leur temps :<br />
le temps trop souvent, <strong>de</strong>s images accumulées<br />
jusqu’à la nausée, du foisonnement tapageur<br />
et aliénant <strong>de</strong> la société <strong>de</strong>s marchandises et<br />
<strong>de</strong> la publicité. Ici, aux côtés <strong>de</strong> Thérèse et<br />
d’Antoine, <strong>les</strong> jeunes amants <strong>de</strong> DeRboRence<br />
qui sont <strong>de</strong> leur âge, <strong>de</strong> Christine et Jean-Luc,<br />
<strong>de</strong> Firmin et Frieda, <strong>les</strong> coup<strong>les</strong> tragiques <strong>de</strong> Jean-<br />
Luc peRsécuté, ils feront l’expérience <strong>de</strong> la rareté<br />
et du silence. Ici, s’engouf<strong>fr</strong>e le souffle d’un auteur<br />
complet, d’un homme qui a creusé en profon<strong>de</strong>ur<br />
là où il tenait, à la fois dans son sol et dans l’âme<br />
humaine.<br />
Nous avons été nous-mêmes, cinéastes interprètes<br />
<strong>de</strong> l’un ou <strong>de</strong> l’autre <strong>de</strong> ses romans, plongés<br />
dans <strong>cette</strong> exigence altière. Il me semble qu’il<br />
en est resté quelque chose, une trace forcément,<br />
dans <strong>les</strong> films ici rassemblés. C’est qu’on n’échappe<br />
pas à la puissance <strong>de</strong> l’imagination ramuzienne,<br />
elle a à voir indéniablement avec notre métier<br />
à nous, qui est <strong>de</strong> commenter ce qui est vécu,<br />
vu ou entendu, et lu bien sûr.<br />
Le vendredi 9 novembre 1934, C.F. Ramuz était<br />
présent à la première publique <strong>de</strong> Rapt, le film<br />
<strong>de</strong> Kirsanoff. Il y parla longuement du cinéma,<br />
<strong>de</strong> la montagne qui en était à <strong>cette</strong> occasion<br />
le sujet : « Je n’insiste pas pour le moment sur<br />
quelques beautés cinématographiques qu’elle<br />
(la montagne) présente incontestablement et<br />
<strong>de</strong> toute façon : j’entends la limpidité <strong>de</strong> son air,<br />
l’extraordinaire éclat <strong>de</strong> sa lumière, la netteté<br />
et la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ses ombres, la sonorité<br />
exceptionnelle <strong>de</strong> ses étendues étagées.<br />
Ces beautés vous seront présentées tout à l’heure,<br />
mais ce ne sont encore que <strong>de</strong>s beautés accessoires<br />
parce qu’el<strong>les</strong> dépen<strong>de</strong>nt toutes d’une seule cause :<br />
l’altitu<strong>de</strong>, et vous voyez où je veux en venir :<br />
la montagne est l’espace en hauteur. La gran<strong>de</strong><br />
question qu’elle pose est celle <strong>de</strong> la verticale.<br />
Considérez que si <strong>les</strong> écrans sont horizontaux,<br />
c’est sans doute parce qu’ils ont été inventés dans<br />
<strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> plaine.<br />
Le problème est donc <strong>de</strong> faire rentrer la montagne<br />
dans un cadre plus large que haut, alors qu’ellemême<br />
est plus haute que large. Il peut paraître<br />
assez dommage que le cinéma n’ait pas été doté<br />
d’un écran carré où <strong>les</strong> vues se projetteraient<br />
tantôt en hauteur, tantôt en largeur. […] Il est bien<br />
entendu que le problème n’est pas que mécanique<br />
et que l’auteur a à s’accommo<strong>de</strong>r du cinéma tel<br />
qu’il est. La montagne, qui est verticale, et toutes<br />
ces gran<strong>de</strong>s vues <strong>de</strong> haut en bas et <strong>de</strong> bas en haut,<br />
dont elle abon<strong>de</strong>, ont à tenir sur l’écran<br />
en longueur. Le problème n’est que déplacé,<br />
c’est un problème <strong>de</strong> mise en page. La montagne<br />
si je puis dire, a ainsi à re<strong>de</strong>scendre dans<br />
la plaine, mais c’est à condition qu’elle ne<br />
cesse pas pour cela d’être la montagne et que<br />
<strong>les</strong> vertica<strong>les</strong>, pour être autrement encadrées,<br />
continuent <strong>de</strong> jouer plastiquement leur rôle<br />
qui est <strong>de</strong> présenter <strong>les</strong> choses et <strong>les</strong> hommes<br />
superposés et non plus juxtaposés ».<br />
Je ne peux que souhaiter d’avoir <strong>de</strong> tels<br />
enseignants, aux jeunes gens qui apprennent ici<br />
7<br />
ou là <strong>les</strong> rudiments scolaires et normatifs<br />
du cinéma <strong>de</strong>s scripts doctors en vogue.<br />
La jeunesse du cinéma est sans fin. Elle tient<br />
d’abord à la jeunesse <strong>de</strong> ceux et cel<strong>les</strong> qui en<br />
ont compris l’essence. Je ne parle pas ici <strong>de</strong><br />
la jeunesse d’âge, trop sujette au détournement<br />
et au vieillissement précoce, mais <strong>de</strong> la jeunesse<br />
<strong>de</strong> la pensée et <strong>de</strong> l’imaginaire. Que <strong>de</strong> fierté, pour<br />
résumer, à se tenir pour <strong>les</strong> cinéastes que nous<br />
sommes ou avons été, pas loin du grand Ramuz,<br />
pas loin du papier bible <strong>de</strong> la Pléia<strong>de</strong> et<br />
du Garamond corps 12 qui composent page après<br />
page <strong>les</strong> séquences écrites <strong>de</strong> <strong>de</strong> r b o r e n c e,<br />
<strong>de</strong> Je A n-Lu c p e r S é c u t é, d’Ad A m e t Èv e, du pA S S A g e<br />
d’u n p o È t e, <strong>de</strong> Si L e S o L e i L n e r e v e n A i t pA S ,<br />
<strong>de</strong> LA g u e r r e d A n S L e HA u t pAy S , <strong>de</strong> rA p t.<br />
Je rêve <strong>de</strong> <strong>cette</strong> bibliothèque qui verrait alignés<br />
dans l’ordre et se côtoyant sans animosité,<br />
<strong>de</strong>s livres et <strong>de</strong>s films. Il y aurait parfois un peu<br />
<strong>de</strong> désordre, une partie du rayon se verrait<br />
couchée, parce que l’un ou l’autre <strong>de</strong> la famille<br />
chez qui elle est lirait be S o i n d e g r A n d e u r dans<br />
la cuisine, ou projetterait dans le clair-obscur<br />
du salon, <strong>les</strong> images et <strong>les</strong> sons numérisés<br />
<strong>de</strong>s paysages ramuziens, <strong>les</strong> vrais, le lac ou<br />
la montagne, et <strong>les</strong> autres vrais, l’amour<br />
d’une femme, <strong>de</strong> la peinture ou d’un enfant à<br />
MONTAGNE…<br />
venir. On a eu envie <strong>de</strong> participer à ce brassage<br />
UNE :<br />
<strong>de</strong>s écritures, en toute mo<strong>de</strong>stie.<br />
C’est notre manière à nous <strong>de</strong> saluer l’artiste.<br />
Francis ReusserRAMUZ
8<br />
BIO<br />
char<strong>les</strong> Ferdinand RaMuZ<br />
(1878-1947)<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz, né le 24 septembre 1878 dans le petit village <strong>de</strong> Cully, est le fils du commerçant<br />
Émile Ramuz et <strong>de</strong> Louise Davel, arrière-petite-nièce du Major Davel. Ses parents le baptisent ainsi en<br />
souvenir <strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>ux premiers enfants décédés : Char<strong>les</strong> et Ferdinand. Louise Ramuz Davel se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ra<br />
d’ailleurs souvent si la nature introspective et mélancolique <strong>de</strong> son troisième fils n’est pas en rapport avec<br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>uils qui ont précédé sa naissance.<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand a une enfance choyée et malgré plusieurs déménagements <strong>de</strong> ses parents, il reste en<br />
pension à Lausanne et y finit ses étu<strong>de</strong>s. Il se passionne déjà pour l’écriture et cherche par tous <strong>les</strong> moyens à<br />
décrire le plus fidèlement possible tout ce qu’il ressent et observe. Il découvre parallèlement la vie paysanne,<br />
qu’il affectionne particulièrement, pendant ses vacances dans la maison familiale <strong>de</strong> Cheseaux.<br />
après son baccalauréat, il entreprend une licence <strong>de</strong> Lettres, qu’il obtient en 1900. Écrire <strong>de</strong>vient une<br />
véritable obsession. Grâce à sa mère, qui convainc Émile, Char<strong>les</strong> Ferdinand part faire un doctorat à Paris,<br />
afin <strong>de</strong> rédiger une thèse sur Maurice <strong>de</strong> Guérin. Parti pour six mois, Ramuz y restera finalement douze ans,<br />
et sa thèse ne verra jamais le jour.<br />
Complètement fasciné par Paris, Ramuz s’imprègne <strong>de</strong> tout ce que lui of<strong>fr</strong>e ce nouvel environnement.<br />
Il modifie sa façon d’écrire et prend progressivement confiance en lui. Malgré tout, il ne parvient pas à trouver<br />
d’éditeur pour publier ses poésies. après quelques allers et retours entre Lausanne et Paris et plusieurs<br />
remises en question, Ramuz, encouragé par son ami alexandre Cingria, se dirige vers l’éditeur Eggimann.<br />
Celui-ci accepte <strong>de</strong> lui donner une chance : Le Petit village, premier livre <strong>de</strong> Ramuz, sort en novembre 1903.<br />
L’œuvre du jeune écrivain est saluée comme l’aube d’une époque nouvelle <strong>de</strong>s lettres roman<strong>de</strong>s.<br />
très inspiré par la musique et la peinture (Cézanne notamment), Ramuz se démarque très vite par un style qui<br />
lui est propre, à la fois réaliste et nostalgique. Encouragé par l’écrivain Edouard Rod, il obtient au cours <strong>de</strong>s<br />
années suivantes un certain succès avec <strong>de</strong>s ouvrages tels qu’aline ou La gran<strong>de</strong> guerre du son<strong>de</strong>rbond.<br />
Chaque séjour à Paris permet à Ramuz <strong>de</strong> retrouver ses nombreux amis qui évoluent en majorité dans<br />
le milieu artistique. Entre Cingria, le poète adrien Bovy, al<strong>fr</strong>ed Jarry, le peintre René auberjonois, andré Gi<strong>de</strong>
ou Jean Cocteau, Ramuz accor<strong>de</strong> beaucoup d’importance à ces amitiés<br />
enrichissantes.<br />
En 1907, il manque <strong>de</strong> peu le Prix Goncourt pour Les circonstances<br />
<strong>de</strong> la vie. Malgré la reconnaissance <strong>de</strong> la presse <strong>fr</strong>ançaise et du mon<strong>de</strong><br />
littéraire, la notoriété <strong>de</strong> Ramuz peine à atteindre le grand public :<br />
on lui reproche régulièrement ses tournures trop lour<strong>de</strong>s et ses entorses<br />
à la syntaxe.<br />
Ramuz sera profondément bouleversé, en 1910, par la mort <strong>de</strong> son ami<br />
Edouard Rod, suivie <strong>de</strong> près par celle <strong>de</strong> son père Émile. Sa souf<strong>fr</strong>ance<br />
est telle qu’il peine à trouver la motivation pour continuer à écrire.<br />
Il épouse en 1913 l’artiste-peintre neuchâteloise Cécile Cellier, rencontrée<br />
huit ans plus tôt à Paris. La même année naît leur fille Marianne et toute<br />
la famille s’installe à Cully, avant d’emménager à Lausanne.<br />
En 1915, Ramuz publie La guerre dans le Haut Pays, il rencontre<br />
Igor Stravinsky, qui contribue à la libération créatrice <strong>de</strong> l’auteur.<br />
De leur amitié naîtra Histoire du soldat (1918), sur une musique<br />
du compositeur et <strong>les</strong> décors du peintre auberjonois.<br />
Il fon<strong>de</strong>, en 1916, avec ses amis Edmond Gilliard et Paul Budry,<br />
la revue <strong>de</strong>s Cahiers vaudois où il publiera ses nouveaux romans,<br />
Le grand printemps (1917) et salutation paysanne (1921).<br />
La carrière <strong>de</strong> l’auteur prend un nouvel essor après sa rencontre<br />
avec Henry-Louis Mermod, en 1923. Cet ami fidèle l’ai<strong>de</strong> à publier<br />
et l’encourage à libérer son expression. Leur collaboration dans l’<strong>édition</strong><br />
débute en 1926. C’est aussi grâce à Mermod que seront publiées<br />
(par la suite) <strong>les</strong> œuvres complètes <strong>de</strong> Ramuz.<br />
La pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’entre-<strong>de</strong>ux guerres est particulièrement fécon<strong>de</strong> et<br />
donne le jour à <strong>de</strong>s œuvres importantes : La gran<strong>de</strong> Peur dans la<br />
montagne (1926), La beauté sur la terre (1927), Farinet ou la Fausse<br />
monnaie (1932), adam et ève (1932), <strong>de</strong>rborence (1934) et si le soleil<br />
ne revenait pas (1937). <strong>Pour</strong>tant, le style ramuzien est loin <strong>de</strong> faire<br />
l’unanimité. Décrié par certains et magnifié par d’autres, le langage<br />
<strong>de</strong> Ramuz malmène la syntaxe et brutalise le rythme <strong>de</strong> phrases,<br />
ce qui choque <strong>de</strong> nombreux lecteurs et lui vaut <strong>de</strong> mauvaises critiques<br />
dans la presse. En 1926, Henry Poulaille récolte d’ailleurs un certain<br />
nombre <strong>de</strong> témoignages qui seront publiés sous le titre <strong>de</strong> « <strong>Pour</strong> ou<br />
contre C.F. Ramuz » dans Les Cahiers <strong>de</strong> la Quinzaine. Ramuz exprimera<br />
souvent son regret d’être mal interprété : soucieux <strong>de</strong> reproduire<br />
le langage qu’on utilise autour <strong>de</strong> lui, avec ses distorsions et ses<br />
maladresses, il fuit le plus possible la langue littéraire académique qui,<br />
selon lui, est trop parfaite pour avoir une âme. Mais ce style particulier<br />
sera <strong>fr</strong>équemment perçu comme du mauvais <strong>fr</strong>ançais.<br />
alors qu’il peine à s’en sortir financièrement, Ramuz se voit attribuer<br />
le Prix Romand en 1930, ce qui lui permet d’acheter une vieille maison<br />
vigneronne à Pully, – La Muette –, où il séjournera jusqu’à la fin <strong>de</strong> sa vie.<br />
Ses journées y sont organisées <strong>de</strong> façon très régulière entre <strong>de</strong>s matinées<br />
consacrées uniquement à l’écriture, et <strong>de</strong>s après-midi rythmés par<br />
<strong>les</strong> nombreux visiteurs (amis ou jeunes admirateurs) qu’il accueille<br />
toujours dans son bureau.<br />
En 1940 naît son petit-fils, Guido (dit “Monsieur Paul”), auquel Ramuz<br />
voue une affection immense. Il lui consacre d’ailleurs <strong>de</strong> nombreuses<br />
pages <strong>de</strong> son Journal et ne se remet que très difficilement du départ<br />
<strong>de</strong> Guido et <strong>de</strong> ses parents pour l’Italie. Sa santé décline sérieusement<br />
à partir <strong>de</strong> 1943, ce qui l’oblige à passer plus <strong>de</strong> temps en clinique qu’à<br />
La Muette. Ces mois d’hôpital le ruinent financièrement et il<br />
se voit con<strong>fr</strong>onté à la mort <strong>de</strong> plusieurs amis. Il entame la rédaction <strong>de</strong>s<br />
Hommes posés <strong>les</strong> uns à côté <strong>de</strong>s autres, qu’il ne finira jamais : en mai<br />
1947, il est transporté d’urgence en clinique. Il y meurt le 23 mai 1947.<br />
La jeunesse, l’épouse, Lausanne, la famille…<br />
9<br />
RAMUZ : BIOGRAPHIE
10<br />
c.F. RaMuZ<br />
au cInéMa et a La téLéVIsIon<br />
1933 Rapt <strong>de</strong> Dimitri Kirsanoff<br />
1938 Farinet, l’or dans la Montagne<br />
<strong>de</strong> Max Haufler<br />
1961 Ramuz, passage d’un poète<br />
d’alain tanner<br />
1965 Jean-Luc persécuté <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Goretta<br />
1966 La gran<strong>de</strong> peur dans la Montagne<br />
<strong>de</strong> Pierre Cardinal<br />
1966 Le Garçon savoyard<br />
<strong>de</strong> Jean-Clau<strong>de</strong> Diserens<br />
1966 aline <strong>de</strong> François Weyergans<br />
1968 La Fille sauvage<br />
<strong>de</strong> Maya Simon (film 16 mm perdu)<br />
1968 La beauté sur la terre <strong>de</strong> Pierre Cardinal<br />
1982 La Gran<strong>de</strong> Guerre du son<strong>de</strong>rbond<br />
d’alain Bloch<br />
1983 adam et eve <strong>de</strong> Michel Soutter<br />
1984 Le Rapt <strong>de</strong> Pierre Koralnik<br />
1985 Derborence <strong>de</strong> Francis Reusser<br />
1987 si le soleil ne revenait pas<br />
<strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Goretta<br />
1996 Farinet, héros et hors-la-loi d’yvan Butler<br />
1997 char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz : l’apparition<br />
<strong>de</strong> la beauté <strong>de</strong> P.a. thiébaud<br />
1998 La Guerre dans le Haut pays<br />
<strong>de</strong> Francis Reusser.<br />
2000 La beauté sur la terre,<br />
dirigé par antoine Plantevin (tV)<br />
2006 La Gran<strong>de</strong> peur dans la Montagne<br />
<strong>de</strong> Claudio tonelli (tV)<br />
Films non terminés<br />
1948 Derborence<br />
1956 Le Règne <strong>de</strong> l’esprit malin
Le cinéma fait irruption en 1895, au<br />
moment où Ramuz sort <strong>de</strong> l’ado<strong>les</strong>cence.<br />
L’écrivain suivra par conséquent l’évolution<br />
du Septième art, qui ne le laisse pas<br />
indifférent. Il consacrera trois textes au<br />
cinéma : une lettre <strong>de</strong> 3 octobre 1925 à<br />
la revue Les Cahiers du Mois, une autre,<br />
très brève, à la revue Mon Ciné, en 1928,<br />
et un texte intitulé « Vicissitu<strong>de</strong>s », paru<br />
dans la revue Formes et Couleurs en<br />
avril 1947. À chaque reprise, Ramuz est<br />
très critique vis-à-vis du cinéma : dans<br />
la lettre <strong>de</strong> 1928, il déclare même : « Le<br />
cinéma (ou plutôt ce qu’on nous présente<br />
sous ce nom actuellement) me<br />
dégoûte à tel point que j’aime mieux<br />
(par hygiène) n’y plus penser pour<br />
le moment. » Dans le texte <strong>de</strong> 1947, il<br />
condamne principalement l’évolution<br />
technique et rappelle le « beau temps<br />
du muet, <strong>de</strong> ses ferveurs, <strong>de</strong> ses audaces<br />
».<br />
Cependant, Ramuz n’évoque presque<br />
jamais <strong>les</strong> films qu’il a vus pour s’être<br />
fondé un tel jugement sur le Septième art.<br />
Seule son œuvre romanesque nous fournit<br />
quelques indices. Dans L’Amour du<br />
mon<strong>de</strong>, « l’irruption <strong>de</strong> l’imaginaire jette<br />
le trouble dans une paisible localité. or,<br />
parmi <strong>les</strong> composantes <strong>de</strong> ce phénomène<br />
<strong>de</strong> psychologie collective, l’installation<br />
d’un cinéma joue un rôle important.<br />
Mais il y a, dans L’Amour du mon<strong>de</strong>,<br />
une influence plus structurelle du film :<br />
la narration est littéralement construite<br />
comme un découpage cinématographique.<br />
[…] Certains débuts <strong>de</strong> chapitres<br />
ressemblent d’ailleurs étonnamment<br />
à <strong>de</strong>s intertitres <strong>de</strong> films muets : « Le<br />
même soir » ou « Le soir du même jour »<br />
ou encore « alors, le len<strong>de</strong>main ». C’est<br />
en effet ainsi qu’on indiquait aux spectateurs<br />
la simultanéité ou la succession<br />
<strong>de</strong>s événements montrés, dans <strong>les</strong> films<br />
muets <strong>de</strong>s vingt ou vingt-cinq premières<br />
années <strong>de</strong> notre siècle ». Il y a également<br />
dans le texte une négation du temps et <strong>de</strong><br />
l’espace : « […] une fenêtre a été ouverte,<br />
au fond <strong>de</strong> la salle, sur le mon<strong>de</strong> ». « Car<br />
maintenant le mon<strong>de</strong> entier est à nous,<br />
si on veut ; tous <strong>les</strong> sièc<strong>les</strong> sont à nous,<br />
tout l’espace ; ayant le vertige, mais c’est<br />
bon, ayant la tête qui leur tournait, mais<br />
c’est bon […] ». Dans le roman, <strong>les</strong> personnages<br />
voient <strong>de</strong>s films exotiques, <strong>de</strong>s<br />
westerns, <strong>de</strong>s documentaires, une vie <strong>de</strong><br />
Jésus. Mais il reste difficile d’i<strong>de</strong>ntifier<br />
véritablement <strong>de</strong>s films, on ne peut que<br />
caractériser une époque et un style.<br />
Le personnage <strong>de</strong> thérèse est également<br />
révélateur : pour vaincre la monotonie <strong>de</strong><br />
la vie quotidienne, thérèse élabore <strong>de</strong><br />
véritab<strong>les</strong> scénarios romanesques. « Elle<br />
Le cinéma dans l’œuvre <strong>de</strong> Ramuz<br />
imagine une île déserte, où son héroïne<br />
vit avant d’être rejointe par un jeune premier<br />
en costume d’explorateur, dans une<br />
nature sauvage, mais si idyllique que <strong>les</strong><br />
lions ne font plus peur (on pense à <strong>de</strong>s<br />
épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Male and Female <strong>de</strong> Cécil<br />
B. De Mille, 1919) […] thérèse se prépare<br />
aussi une gran<strong>de</strong> scène <strong>de</strong> séduction<br />
bien réelle, en se fixant à elle-même un<br />
découpage cinématographique à suivre<br />
plan par plan, <strong>les</strong> plans étant d’ailleurs<br />
numérotés, comme cela se pratique chez<br />
<strong>les</strong> gens du métier ».<br />
on observe ainsi que Ramuz avait sans<br />
doute regardé attentivement <strong>de</strong> nombreux<br />
films et qu’il ne négligeait aucun<br />
genre. S’étant intéressé <strong>de</strong> près aux<br />
possibilités offertes par le Septième art,<br />
il en avait pénétré <strong>les</strong> techniques narratives<br />
et <strong>de</strong>scriptives essentiel<strong>les</strong>. Mais<br />
cela concerne uniquement <strong>les</strong> vingt premières<br />
années du XX e siècle (L’Amour<br />
du mon<strong>de</strong> a été achevé en 1924). après<br />
cela, Ramuz cesse visiblement <strong>de</strong> s’intéresser<br />
aux films qui se font.<br />
une longue série <strong>de</strong> projets n’a finalement<br />
jamais vu le jour. C’est le cas,<br />
notamment <strong>de</strong> L’Amour du mon<strong>de</strong>,<br />
dont le cinéaste Marcel l’Herbier a acheté<br />
<strong>les</strong> droits d’adaptation en 1937. Mais<br />
<strong>de</strong>s problèmes financiers font échouer<br />
le projet. Il en va <strong>de</strong> même pour l’adaptation<br />
<strong>de</strong> Derborence, dont le tournage<br />
débute en 1946. Mais l’équipe, en majorité<br />
italienne, est très vite con<strong>fr</strong>ontée à<br />
<strong>de</strong>s grosses difficultés, autant juridiques<br />
que financières. Il ne reste <strong>de</strong> <strong>cette</strong> entreprise<br />
que quelques dizaines <strong>de</strong> minutes<br />
<strong>de</strong> rushes et <strong>de</strong>s factures impayées.<br />
En 1954, le jeune Guido Wurth doit très<br />
vite abandonner le tournage du Règne<br />
<strong>de</strong> l’Esprit malin, faute d’appuis financiers.<br />
Le film Rapt <strong>de</strong> Dimitri Kirsanoff, sorti<br />
en 1934, est la première adaptation qui<br />
soit arrivée à terme. Kirsanoff utilise <strong>les</strong><br />
techniques expressives du cinéma muet<br />
(<strong>les</strong> acteurs étant d’origine diverses, <strong>les</strong><br />
dialogues du film sont réduits au strict<br />
minimum) et accor<strong>de</strong> par contre une<br />
gran<strong>de</strong> importance à la musique (la partition<br />
musicale est confiée à Honegger<br />
et Hoérée, musiciens <strong>de</strong> qualité). Ramuz<br />
semble avoir suivi <strong>de</strong> près l’adaptation et<br />
le tournage, et accepte <strong>les</strong> modifications<br />
apportées à l’intrigue <strong>de</strong> son roman. Il<br />
tient même un petit rôle <strong>de</strong> villageois.<br />
on ne saura par contre jamais réellement<br />
comment il a jugé le film une fois<br />
terminé.<br />
C’est peut-être l’expérience <strong>de</strong> ce tournage<br />
qui donne à Ramuz l’envie <strong>de</strong> faire<br />
lui-même <strong>de</strong> la mise en scène <strong>de</strong> cinéma.<br />
Il semble en effet avoir projeté <strong>de</strong> porter<br />
une <strong>de</strong> ses œuvres à l’écran, La Beauté<br />
sur la terre, et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> même à Michel<br />
Simon d’y participer. Mais en 1934, il<br />
abandonne provisoirement ce projet. Par<br />
la suite, il sera question à plusieurs reprises<br />
<strong>de</strong> le remettre en route, mais toutes<br />
<strong>les</strong> démarches resteront in<strong>fr</strong>uctueuses.<br />
Emilie Bovet<br />
Le bureau <strong>de</strong> Ramuz :<br />
un fauteuil, une table… <strong>de</strong> montage. Les dialogues avec ses visiteurs. Comme au cinéma.<br />
11
12§
LonGs<br />
MétRaGes<br />
Rapt 14<br />
Farinet, l’or dans la montagne 20<br />
Adam et Ève 34<br />
Derborence 38<br />
Si le soleil ne revenait pas 46<br />
La Guerre dans le Haut Pays 58<br />
13
14<br />
« première adaptation <strong>de</strong> Ramuz<br />
à l’écran, équipe internationale<br />
avec forte dominante slave,<br />
utilisation subtile du bilinguisme<br />
à l’aube du sonore »
RAPT<br />
Suisse/France, 1933, 81 mn<br />
Scénario : Benjamin Fondane, Stefan Markus<br />
Photo : Nicolas Toporkoff, Victor Gluck, Oskar<br />
Schnirch<br />
Musique : Arthur Honegger, Arthur Hoérée<br />
Montage : Jacques Witta<br />
Décors : Erwin Scharf<br />
Son : André Reinhard<br />
Maurice Carrouet<br />
Scripte : Corinna Bille<br />
Tournage : septembre-octobre 1933<br />
Intérieurs : Nicéa-Films, Saint-Laurent du Var<br />
Extérieurs : Lens, Mondralège (VS), Torrentalp,<br />
Kan<strong>de</strong>rsteg, col <strong>de</strong> la Gemmi, (Oberland bernois).<br />
Interprètes :<br />
Dita Parlo (Elsi)<br />
Geymond Vital (Firmin)<br />
Nadia Sibirskaïa (Jeanne)<br />
Lucas Gridoux (Mânu, l’idiot)<br />
Auguste Bovério (Mathias, le colporteur)<br />
Dyk Ru<strong>de</strong>ns (Hans)<br />
Hans-Kaspar Ilg (Gott<strong>fr</strong>ied)<br />
Jeanne-Marie Laurent (la mère <strong>de</strong> Firmin)<br />
C.F. Ramuz (un Valaisan)<br />
et la population <strong>de</strong> Lens<br />
DIMITRI KIRSANOFF<br />
d’après le roman « La séparation <strong>de</strong>s races » <strong>de</strong> C.F. Ramuz (1922)<br />
Tout sépare <strong>les</strong> pâtres <strong>de</strong> l’Oberland bernois<br />
<strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> Cheyseron, la religion,<br />
la richesse. Et la montagne, dont le col n’est<br />
praticable que pendant quelques mois <strong>de</strong> l’année.<br />
Sur le versant bernois, Hans, le fiancé<br />
<strong>de</strong> la ravissante Elsi, tue d’un jet <strong>de</strong> pierre<br />
le chien du berger valaisan Firmin. Firmin se<br />
venge la nuit suivante en emportant Elsi <strong>de</strong><br />
force ; Gott<strong>fr</strong>ied, le jeune <strong>fr</strong>ère d’Elsi, tente <strong>de</strong><br />
<strong>les</strong> suivre et se tue dans un ravin. Sincèrement<br />
amoureux, Firmin séquestre Elsi à Cheyseron,<br />
mais Mânu, un débile pyromane, <strong>les</strong> a aperçus.<br />
La Bernoise captive attise la haine générale ;<br />
Firmin refuse <strong>de</strong> la rendre aux siens et l’hiver<br />
a bloqué le col. La mère <strong>de</strong> Firmin déménage<br />
tandis que sa fiancée délaissée, Jeanne, se<br />
morfond <strong>de</strong> jalousie. Au printemps, Mathias,<br />
le colporteur que Hans a envoyé à la recherche<br />
<strong>de</strong> sa fiancée, contacte Elsi grâce à Mânu et<br />
l’avertit <strong>de</strong> sa délivrance imminente. La belle<br />
prisonnière convainc Mânu – troublé par ses<br />
charmes – d’incendier le village le jour <strong>de</strong> son<br />
évasion, quand la population sera montée à<br />
l’alpage pour une fête. Ainsi sa vengeance sera<br />
totale. Ce jour-là, Firmin ne peut se séparer<br />
d’Elsi et <strong>de</strong>meure à la maison, prêt à exaucer<br />
tous ses vœux. Mânu boute le feu aux mazots,<br />
mais lorsqu’il surprend celle qu’il adule émue<br />
dans <strong>les</strong> bras <strong>de</strong> son ravisseur, il enferme le<br />
couple dans la maison en flammes…<br />
R<br />
A<br />
P<br />
T<br />
15
16<br />
§<br />
C.F. Ramuz (La séparation <strong>de</strong>s races)<br />
Il y a ces pâturages qui sont sous le col à <strong>de</strong>ux<br />
mille cinq cents mètres, et c’est seulement vers<br />
la fin <strong>de</strong> l’été qu’ils y montent, à cause que leur<br />
vie va <strong>de</strong> bas en haut comme l’oeil fait.<br />
Tout là-haut, au milieu <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière pente<br />
d’herbe, on voyait le chalet ; ils étaient <strong>de</strong>vant le<br />
chalet, assis par terre, parce qu’il n’y avait même<br />
pas <strong>de</strong> banc, se tenant adossés au mur <strong>de</strong> pierres<br />
sèches, en face et au-<strong>de</strong>ssus du vi<strong>de</strong>.<br />
Vu <strong>de</strong> <strong>cette</strong> hauteur, le fleuve, au fond <strong>de</strong> la vallée,<br />
n’était plus qu’un bout <strong>de</strong> fil gris apparaissant<br />
à travers une brume bleue, comme si ce n’eût<br />
pas été <strong>de</strong> l’air, mais <strong>de</strong> l’eau, dans laquelle on<br />
aurait mis fondre du savon, qui remplissait cet<br />
immense bassin <strong>de</strong> fontaine ; - ils se tenaient là<br />
sans parler, parce qu’on se sent tellement petits,<br />
c’est tellement trop grand pour nous.<br />
.../...<br />
La séparation <strong>de</strong>s races :<br />
un suisse, un Russe, une<br />
alleman<strong>de</strong> et quelques inconnus<br />
réunis en silence<br />
Rapt, qui aligne <strong>les</strong> noms prestigieux <strong>de</strong> Ramuz et <strong>de</strong><br />
Honegger, est le <strong>fr</strong>uit d’une conjoncture artistique exceptionnelle.<br />
Son élaboration remonte au retour du « magnat<br />
lettré » zurichois Stefan Markus, établi <strong>de</strong>puis 1924 à<br />
Paris où il s’est distingué plus d’une fois dans la superproduction<br />
internationale. En fondant la Mentor-Film avec<br />
un mini-capital <strong>de</strong> 20 000 Frs (1.2.1933), Markus, mûri par<br />
sa longue expérience <strong>de</strong>s milieux cinématographiques<br />
<strong>fr</strong>ançais, cherche, lui aussi, à établir <strong>les</strong> bases d’une<br />
industrie durable, mais <strong>de</strong> format européen. Esprit littéraire<br />
d’une vaste culture, auteur dramatique et romancier<br />
à ses heures, Markus souhaite placer sa nouvelle société<br />
sous le signe <strong>de</strong>s lettres suisses. Il déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> commencer<br />
avec La séparation <strong>de</strong>s races rebaptisée Rapt avec<br />
l’accord du romancier vaudois. Rapt présente cinq singularités<br />
qui le sortent du lot : première adaptation <strong>de</strong><br />
Ramuz à l’écran, équipe internationale avec forte dominante<br />
slave, utilisation subtile du bilinguisme à l’aube du<br />
sonore, partition musicale signée Honegger-Hoérée, style<br />
suggestif lié à l’esthétique du muet.<br />
Dans un article mi-bouta<strong>de</strong>, mi-rêve à voix haute, le jeune<br />
critique <strong>de</strong> cinéma (et futur réalisateur) Jean Choux avait<br />
en 1921 imaginé que <strong>de</strong>ux ans plus tard, sous l’égi<strong>de</strong><br />
d’une « Helvetia-Film » fictive, il porterait à l’écran « Le<br />
feu à Cheyseron » (premier titre <strong>de</strong> « La séparation <strong>de</strong>s<br />
races ») - « une sorte d’Ilia<strong>de</strong> villageoise et montagnar<strong>de</strong> »<br />
… Ramuz avait été intéressé par le projet <strong>de</strong> Choux et<br />
avait lui-même travaillé à un scénario <strong>de</strong> son roman vers<br />
1925/1926...<br />
Le scénario <strong>de</strong> Rapt respecte l’intrigue d’assez près, ne<br />
se permettant que trois légères « infidélités ». L’inci<strong>de</strong>nt<br />
initial du chien tué permet <strong>de</strong> justifier plus concrètement<br />
le rapt commis par Firmin. Sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> Kirsanoff,<br />
Markus introduit aussi un nouveau personnage – la petite<br />
fiancée pathétique <strong>de</strong> Firmin – dévolu à la compagne<br />
du cinéaste, Sibirskaïa … Enfin, la conclusion du roman<br />
montre Frieda/Elsi récupérée par <strong>les</strong> siens tandis que le<br />
village est incendié sur son ordre. Kirsanoff, en revanche,<br />
fait périr dans <strong>les</strong> flammes la jeune Bernoise avec<br />
son ravisseur valaisan, introduisant une passionnante<br />
ambiguïté : piégée, Elsi enlace son « ennemi » avant <strong>de</strong><br />
mourir...<br />
Invité par Markus à assister au tournage à Lens, l’écrivain<br />
– alors attelé à Derborence - cautionne <strong>cette</strong> première<br />
adaptation <strong>de</strong> ses œuvres en y faisant un bout <strong>de</strong> figuration<br />
(six plans, une réplique), puis en présidant la<br />
première mondiale du film à Lausanne. Immédiatement<br />
après Rapt, Ramuz exprimera le souhait <strong>de</strong> diriger luimême<br />
Michel Simon dans La beauté suR La teRRe,<br />
sur une musique d’Igor Markevitch (une coproduction<br />
<strong>fr</strong>anco-suisse programmée pour l’été 1934). Corinna<br />
Bille (1912-1979) occupe le poste <strong>de</strong> script-girl ; celle<br />
qui allait <strong>de</strong>venir la gran<strong>de</strong> poétesse valaisanne va
s’éprendre du jeune premier dauphinois Geymond Vital<br />
(du « Théâtre <strong>de</strong> l’Atelier » <strong>de</strong> Dullin), l’épouser et le<br />
suivre à Paris...<br />
En dépit <strong>de</strong> son label <strong>de</strong> fabrication suisse, Rapt, porte<br />
l’empreinte du cinéma russe. La constitution <strong>de</strong> l’équipe<br />
technique et artistique n’est pas le <strong>fr</strong>uit d’un caprice. Si<br />
Markus remet le film au metteur en scène russe établi en<br />
France, Kirsanoff, et à son épouse Nadia Sibirskaïa, c’est<br />
que <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux ont déjà tourné pour lui sabLes en 1927 et<br />
que Kirsanoff possè<strong>de</strong> un sens <strong>de</strong> l’image lyrique alliée<br />
au décor naturel qui a fait forte impression parmi l’avantgar<strong>de</strong><br />
<strong>fr</strong>ançaise... Afin <strong>de</strong> satisfaire Kirsanoff, Markus se<br />
réserve l’appui <strong>de</strong> l’opérateur Toporkoff, un maître <strong>de</strong><br />
l’image délicatement ciselée qui, <strong>de</strong>puis 1919, a travaillé<br />
avec toute la colonie russe blanche exilée à Paris (Tourjanski,<br />
Volkoff, Protozanoff, Na<strong>de</strong>jkine, Malikoff, Litvak).<br />
Tous <strong>les</strong> paysans bernois sont joués par <strong>de</strong>s Suisses alémaniques<br />
(l’Alleman<strong>de</strong> Dita Parlo exceptée), <strong>les</strong> Valaisans<br />
par <strong>de</strong>s acteurs <strong>fr</strong>ançais encore peu connus comme Vital,<br />
Bovério et l’inquiétant Lucas Gridoux (formidable Mânu<br />
sautillant et glapissant, <strong>les</strong> yeux en fièvre). <strong>Pour</strong> la musique,<br />
Kirsanoff introduit Hoérée, le compositeur <strong>de</strong> son<br />
film bRuMe D’autoMne en 1928...<br />
On a assez dit à quel point Rapt obéit au langage du<br />
muet. Ses dialogues <strong>de</strong>meurent très rares, brefs, secs (en<br />
<strong>fr</strong>ançais comme en allemand) et font la part belle au jeu<br />
expressif <strong>de</strong>s acteurs. Kirsanoff articule son récit selon<br />
<strong>les</strong> principes <strong>de</strong> montage court développés par l’école<br />
soviétique <strong>de</strong>s années vingt et une architecture d’ang<strong>les</strong><br />
insolites... Mais, loin <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sservir, la simplification<br />
réfléchie du muet, avec ses images sensuel<strong>les</strong> et directes,<br />
n’est pas sans parenté avec la simplicité recherchée<br />
<strong>de</strong> Ramuz. Kirsanoff y surajoute une pincée d’onirisme<br />
fougueux : il y a dans Rapt un mélange <strong>de</strong> fantastique,<br />
d’érotisme violent et <strong>de</strong> cruauté proprement envoûtant ;<br />
l’environnement est <strong>fr</strong>uit d’une contraction tonique <strong>de</strong><br />
vérisme brut et d’irréalité (somme toute assez proche<br />
d’un Daniel Schmid) ; <strong>les</strong> nuages « dansent » en accéléré<br />
sur un air goguenard <strong>de</strong> bal musette que traverse<br />
le leitmotiv déchirant d’Honegger, <strong>les</strong> rochers se lamentent,<br />
la Mort (la silhouette hagar<strong>de</strong> du colporteur) surgit<br />
subrepticement au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la falaise d’où est tombé<br />
Gott<strong>fr</strong>ied ; Firmin arrache à Elsi un baiser dans une obscurité<br />
totale, zébrée d’éclairs ; Elsi, à <strong>de</strong>mi-nue, remplace<br />
le crucifix par un miroir. A la fin, le récit se lézar<strong>de</strong> sous<br />
l’assaut <strong>de</strong>s flammes, la fumée noircit l’écran au son d’un<br />
rire dément : le film se clôt sur l’exultation cauchemar<strong>de</strong>sque<br />
<strong>de</strong> Mânu. La caméra dynamique du Russe parvient<br />
à briser l’aura <strong>de</strong> respect qui sépare d’habitu<strong>de</strong> l’homo<br />
helveticus (version cinéma) <strong>de</strong> son cadre majestueux et,<br />
Ramuz sur le tournage. Cautionnant le film, il y donna aussi une réplique.<br />
R<br />
A<br />
P<br />
T<br />
17
18<br />
exceptionnellement, à le montrer en correspondance<br />
intime avec « sa » région, sans affectation mystique ni<br />
accords fatalistes. Le réalisme prohibe tout folklore, le<br />
plan rapproché détruit l’emphase...<br />
Les recherches esthétiques <strong>de</strong> Kirsanoff recouvrent cel<strong>les</strong><br />
effectuées par Hoérée et Honegger pour le contrepoint<br />
sonore. Ce <strong>de</strong>rnier – auteur d’une « illustration sonore »<br />
pour La Roue De Gance – développe dès 1931 l’idée<br />
d’une œuvre cinématographique basée sur la coïnci<strong>de</strong>nce<br />
d’un montage contrasté avec la continuité <strong>de</strong><br />
l’orchestration musicale. Dans Rapt, <strong>de</strong>s strophes puissamment<br />
évocatrices remplacent maintes fois la parole<br />
ou le bruitage (l’orage), enrichissant l’impact visuel <strong>de</strong><br />
leur expressivité propre tout en introduisant d’ingénieuses<br />
innovations (le son à l’envers, <strong>les</strong> étranges « on<strong>de</strong>s<br />
Martenot »). Honegger, dont c’est le premier film sonore,<br />
se charge <strong>de</strong>s scènes bucoliques (le matin, le lavoir, le<br />
bal populaire), Hoérée <strong>de</strong>s passages plus véhéments (la<br />
poursuite du chien, le rapt, l’orage, l’incendie final)...<br />
Rapt est l’œuvre suisse la plus attachante et surtout la<br />
plus foncièrement originale <strong>de</strong>s cinq premières décennies.<br />
Sans doute trop original, car en dépit d’une presse<br />
élogieuse, le film est un échec public retentissant : le<br />
ren<strong>de</strong>ment n’atteint pas 50% <strong>de</strong> la garantie minimale.<br />
Privé <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>ttes, situé à l’écart du bavardage boulevardier<br />
et <strong>de</strong>s poncifs alpestres à la mo<strong>de</strong>, Rapt laisse<br />
<strong>les</strong> fou<strong>les</strong> indifférentes... Seule Dita Parlo profitera du<br />
lancement <strong>de</strong> Rapt, inaugurant une carrière <strong>fr</strong>ançaise<br />
qui comporte quelques titres <strong>de</strong> gloire comme L’ata-<br />
Lante <strong>de</strong> Vigo (1934) ou La GRanDe ILLusIon <strong>de</strong><br />
Renoir (1937)...<br />
La séparation <strong>de</strong>s races fait l’objet d’une secon<strong>de</strong><br />
adaptation en octobre 1983, <strong>de</strong>stinée au petit écran<br />
(coproduction TSR-Telvétia-A2). Le téléfilm couleur Le<br />
Rapt <strong>de</strong> Pierre Koralnik diffusé le 26.11.1984 sur TSR<br />
est interprété par Pierre Clémenti (Firmin), Daniela Silverio<br />
(Frieda) et Heinz Bennent (le colporteur). Hésitant<br />
entre l’onirisme kitsch et le naturalisme léché, Koralnik<br />
suit la trame <strong>de</strong> Ramuz <strong>de</strong> très près mais finit sur<br />
une note hystérique : Firmin est lynché par <strong>les</strong> Bernois,<br />
Frieda lapidée par l’idiot du village.<br />
Histoire du cinéma suisse / Hervé Dumont<br />
§<br />
… Il avait paru et il l’avait trouvée. Il<br />
l’avait trouvée et il la portait.<br />
Il la portait dans ses <strong>de</strong>ux bras, <strong>les</strong><br />
jambes qui pendaient le gênaient, et<br />
la tête et <strong>les</strong> bras pendaient. Ce qui le<br />
gênait aussi, c’est qu’ainsi elle pendait<br />
toute, l’attirant sans cesse en avant ;<br />
pourtant il était venu.<br />
Puis il s’était trouvé <strong>de</strong>vant la pente : là<br />
il s’était arrêté tout à fait :<br />
« Ah ! On ne m’avait pas cru, on ne voulait<br />
pas me croire ; eh bien, regar<strong>de</strong>z ! »<br />
Il se redressait.<br />
Il amena la fille à lui, il la soulevait<br />
par en <strong>de</strong>ssous ; <strong>les</strong> forces ne lui manquaient<br />
pas.<br />
Elle avait <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> nues, ses cheveux<br />
traînaient par terre. Parce qu’elle avait<br />
dû se défendre, son corsage et sa chemise<br />
<strong>de</strong> mousseline avaient été arrachés <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ssus elle, par lambeaux ; ses bras<br />
étaient nus, ses épau<strong>les</strong> : il a levé alors<br />
dans ses <strong>de</strong>ux bras jusque dans le ciel<br />
<strong>cette</strong> blancheur qui a éclaté.<br />
C. F. Ramuz (La séparation <strong>de</strong>s races)
Ban<strong>de</strong>-son :<br />
une partition à trois<br />
Nous <strong>de</strong>vons nous louer d’avoir pu collaborer, en ce qui<br />
concerne la sonorisation <strong>de</strong> RAPT, avec Dimitri Kirsanoff,<br />
artiste complet qui fut au surplus musicien professionnel.<br />
C’est dire que son scénario, en maints endroits, assignait à<br />
la musique une fonction essentielle ; qu’à notre <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,<br />
il tâchait toujours <strong>de</strong> concilier <strong>les</strong> exigences symphoniques<br />
avec cel<strong>les</strong> <strong>de</strong> son montage. Nous <strong>de</strong>vons d’ailleurs à la<br />
vérité <strong>de</strong> reconnaître qu’il fut l’instigateur <strong>de</strong> plus d’une<br />
combinaison sonore parmi <strong>les</strong> plus origina<strong>les</strong> du film.<br />
En ce qui concerne la structure musicale, nous avons évité<br />
le développement symphonique, l’harmonie <strong>de</strong>scriptive,<br />
préférant gar<strong>de</strong>r à notre partition son autonomie afin <strong>de</strong> ne<br />
point empiéter sur le domaine <strong>de</strong> l’écran et vice-versa. C’est<br />
pourquoi nous avons fait appel, chaque fois que le permettait<br />
la situation, à <strong>de</strong>s formes classiques, c’est-à-dire dont le<br />
développement est issu <strong>de</strong> leur propre substance musicale<br />
et non inféodé à un plan littéraire ou psychologique. C’est<br />
ainsi que le prélu<strong>de</strong> accompagnant le générique (titres),<br />
est constitué par une ouverture construite sur le thème <strong>de</strong><br />
chacun <strong>de</strong>s principaux personnages : Elsi, la jeune fille ;<br />
Firmin, son ravisseur ; Jeanne, la fiancée abandonnée ;<br />
Mânu, l’idiot du village...<br />
Les particularités sonores <strong>de</strong> RAPT ont été possib<strong>les</strong> grâce à<br />
la collaboration compréhensive <strong>de</strong> Dimitri Kirsanoff, au fait<br />
que l’un <strong>de</strong> nous a surveillé la délicate opération du mixage<br />
et a assuré, au surplus, le montage <strong>de</strong> la pellicule-son.<br />
§ R<br />
HONEGGER ET HéROéE<br />
(ExTRAITS DE «PARTICULARITéS SONORES DU FILM Rapt»,<br />
DANS LA REVUE MUSICALE N°151, DéCEMBRE 1934)<br />
«Au feu !»<br />
Une autre voix, une voix d’homme ; et elle a vu par la fenêtre une<br />
gran<strong>de</strong> fumée qui vient et qui a rempli tout le ciel.<br />
«Au feu ! Au feu ! Au feu !»<br />
On court le long <strong>de</strong>s rues en appelant : Firmin se porte <strong>de</strong> côté<br />
pour sortir, elle s’est jetée après lui, elle l’a repris dans ses bras,<br />
elle pèse à son cou avec tout le poids <strong>de</strong> son corps.<br />
« Firmin, c’est que tu ne m’aimes pas, sans quoi tu laisserais brûler ... »<br />
Et, par trois fois, dans le même moment, là-haut sur la pente,<br />
le cornet, - et il a dû en reconnaître le son, parce qu’il a dit<br />
encore :<br />
«Vous enten<strong>de</strong>z ? ...»<br />
Mais elle :<br />
«Qu’est-ce que ça fait ?... Qu’est-ce que ça fait ?» …<br />
C. F. Ramuz (La séparation <strong>de</strong>s races)<br />
BIO<br />
DIMITRI<br />
KIRSANOFF<br />
Dorpat, EstoniE, 6 mars 1899 /<br />
paris, 11 févriEr 1957<br />
David Kaplan (Dimitri) Kirsanoff<br />
arrive à paris à l’âge <strong>de</strong> vingt ans<br />
pour étudier le violoncelle à l’Ecole<br />
normale <strong>de</strong> musique. il restera<br />
dans la capitale <strong>fr</strong>ançaise jusqu’à<br />
sa mort. pour gagner sa vie, il<br />
joue du violoncelle sur <strong>de</strong>s films<br />
muets dans <strong>les</strong> cinémas parisiens.<br />
Dès ses premiers films, Kirsanoff<br />
est très vite associé au cercle <strong>de</strong><br />
la jeune avant-gar<strong>de</strong> <strong>fr</strong>ançaise<br />
« impressionniste » et <strong>de</strong>vient<br />
indépendant en réalisant <strong>de</strong>s films<br />
à petits budgets. Ménilmontant<br />
(1926), moyen métrage décrivant<br />
la vie, entre joies et peines, d’un<br />
quartier pauvre <strong>de</strong> paris, lui vaut<br />
une réputation considérable<br />
auprès <strong>de</strong> la critique. Les premiers<br />
films, muets, <strong>de</strong> Kirsanoff (où<br />
joue la plupart du temps sa<br />
première femme nadia sibirskaia)<br />
sont considérés comme ses<br />
meilleures œuvres. Kirsanoff<br />
atteint le sommet <strong>de</strong> sa carrière <strong>de</strong><br />
réalisateur avec Rapt (1933). par<br />
la suite, réduit à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
beaucoup plus commercia<strong>les</strong>,<br />
il dirigera jusqu’en 1956 une<br />
quinzaine <strong>de</strong> films d’un intérêt<br />
médiocre.<br />
APT<br />
19
FARINET<br />
L’OR DANS LA MONTAgNE<br />
Suisse/France, 1938, 91 mn<br />
Scénario : Char<strong>les</strong> Ferdinand Vaucher<br />
Collaborateurs scénaristiques :<br />
Max Haufler, Louis Robert<br />
Dialogues : Char<strong>les</strong> A. Brun<br />
Image : Georges Million, Maurice Barry<br />
Son : Constantin<br />
Décors : Paul Artaria<br />
Montage Jacques Grassi<br />
Musique : Arthur Honegger<br />
Direction musicale : Arthur Hoérée<br />
Interprètes <strong>de</strong> la « Chanson <strong>de</strong><br />
Farinet » : Jean-Louis Barrault,<br />
Suzy Prim<br />
Interprètes :<br />
Jean-Louis Barrault (Maurice Farinet)<br />
Suzy Prim (Joséphine Pellanda)<br />
Alexandre Rignault (Baptiste Rey)<br />
André Alerme (Romailler)<br />
Jim Gérald (Crittin, l’aubergiste)<br />
Janine Crispin (Thérèse Romailler)<br />
Heinrich Gretler (Charrat)<br />
Walburga Gmür (Marie Coudray)<br />
Georges Dimeray (Théodore <strong>de</strong> Sépibus)<br />
Edouard Delmont (Fontana)<br />
Sinoël (Ardévoz)<br />
Charlie Gerval (Le maître)<br />
Jean Dimeray (cdt. Théodore <strong>de</strong> Sépibus)<br />
Jean-Mario Bertschy (Félicien)<br />
Al<strong>fr</strong>ed Penay (le père Bruchet)<br />
Julien Zermatten (un gendarme)<br />
Max Haufler (un gendarme)<br />
Paul Marville (Coudray)<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand Vaucher (un villageois)<br />
Tournage : 16 août au 13 octobre 1938<br />
Intérieurs : Filmsonor, Paris-Epinay<br />
Extérieurs : Granois, Saint-Léonard,<br />
carrières <strong>de</strong> Saxon, gorges <strong>de</strong> la<br />
Sallentze, prieuré <strong>de</strong> Leytron, gorges<br />
<strong>de</strong> la Borgne, Savièse et Sion, Alpe<br />
<strong>de</strong> Louvie (val <strong>de</strong> Bagnes), massif du<br />
Combin.<br />
Sortie en Suisse : 9 février 1938<br />
Sortie en France : 12 mai 1939<br />
MAX HAUFLER<br />
d’après le roman <strong>de</strong> C.F. Ramuz : « Farinet ou la fausse monnaie » (1932)<br />
Echappé <strong>de</strong> la prison <strong>de</strong> Sion où il purgeait une peine pour<br />
faux-monnayage, Farinet longe <strong>les</strong> murs <strong>de</strong> Miège, dans<br />
la vallée du Rhône, et vient se restaurer à l’auberge <strong>de</strong><br />
Crittin ; sa maîtresse Joséphine, une sommelière, le cache.<br />
Entouré <strong>de</strong> nombreux amis, Farinet exhibe fièrement ses<br />
pièces d’or, supérieures en titre à cel<strong>les</strong> <strong>de</strong> l’Etat. L’accueil<br />
<strong>de</strong> la population lui fait oublier toute pru<strong>de</strong>nce et il est<br />
arrêté pendant la fête <strong>de</strong>s vendanges.<br />
Joséphine organise sa nouvelle évasion, à la joie <strong>de</strong>s villageois.<br />
Seuls le postier médisant, Baptiste qui convoite<br />
la sommelière, et le syndic Romailler, anxieux à cause <strong>de</strong>s<br />
prochaines élections, <strong>fr</strong>oncent <strong>les</strong> sourcils. Farinet gagne<br />
l’Alpe, d’où il peut surveiller <strong>les</strong> allées et venues dans le<br />
village avec sa longue-vue et railler la gendarmerie, lancée<br />
à sa poursuite. Après avoir extrait suffisamment d’or <strong>de</strong> sa<br />
mine, le fugitif re<strong>de</strong>scend dans sa tour, reliée à un souterrain,<br />
pour y fabriquer <strong>de</strong>s pièces. Joséphine l’approvisionne<br />
discrètement.<br />
Un soir au village, Farinet est intercepté par Romailler qui<br />
lui fait part d’une proposition secrète du gouvernement :<br />
le pardon et une peine minimale contre l’arrêt <strong>de</strong> son trafic<br />
illégal. Le hors-la-loi épris <strong>de</strong> liberté se montre récalcitrant,<br />
mais la rencontre avec la fille du syndic, Thérèse, le trouble.<br />
Il la revoit en cachette et envisage finalement <strong>de</strong> se rendre<br />
aux autorités. Le postier surprend <strong>les</strong> amoureux et s’empresse<br />
<strong>de</strong> tout raconter à Joséphine, qui somme l’amant<br />
infidèle <strong>de</strong> quitter le pays avec elle. La sommelière jalouse a<br />
subtilisé l’argent du bureau <strong>de</strong> poste pour s’enfuir. Comme<br />
Farinet refuse <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r au chantage, elle le dénonce à la<br />
police, mettant le cambriolage à son compte. Le repaire<br />
du faux-monnayeur est encerclé ; la fusilla<strong>de</strong> commence.<br />
Farinet nargue ses adversaires, cherche la mort. Réalisant<br />
son crime, Joséphine l’innocente publiquement. Trop tard :<br />
grièvement b<strong>les</strong>sé, Farinet est transporté chez Romailler,<br />
où, se voyant à nouveau enfermé entre quatre murs, il brise<br />
le mobilier et s’effondre, terrassé par une hémorragie.<br />
21<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne
22<br />
« Contrairement à la<br />
Monnaie fédérale,<br />
il <strong>fr</strong>appait ses pièces<br />
dans <strong>de</strong> l’or pur »
!<br />
Porter à l’écran<br />
Farinet en 1938<br />
relève <strong>de</strong> la double<br />
provocation.<br />
D’une part, Ramuz vient <strong>de</strong> se faire beaucoup d’ennemis<br />
dans son propre pays en osant mettre publiquement en<br />
doute l’unité culturelle <strong>de</strong> la Suisse : « Comment pourraisje<br />
parler d’un pays qui n’existe pas ? » remarque-t-il dans<br />
sa lettre restée célèbre à Denis <strong>de</strong> Rougemont (Esprit,<br />
octobre 1937) ; défenseur d’un régionalisme sans oeillères,<br />
le poète y conteste non seulement l’image unificatrice<br />
<strong>de</strong> la patrie propagée par la Défense spirituelle nationale,<br />
mais il vitupère chez ses compatriotes un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie<br />
purement utilitaire, dépourvu <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur et <strong>de</strong> dimensions<br />
éthiques. Ces paro<strong>les</strong> lui coûtent le prix Nobel, le<br />
Conseil fédéral refusant <strong>de</strong> soutenir sa candidature, et<br />
déchaînant une polémique <strong>de</strong> presse haineuse en Suisse<br />
alémanique, région avec laquelle le poète avoue n’avoir<br />
guère <strong>de</strong> points communs.<br />
Provocation d’autre part, parce que Farinet est un peu<br />
« un pavé dans la mare » exaltant, fût-ce involontairement,<br />
la révolte anarchiste, l’individualisme à tous crins et<br />
le rejet <strong>de</strong> l’ordre policier à l’instant même où pour <strong>de</strong>s raisons<br />
d’opportunité politique, le gouvernement encourage<br />
<strong>les</strong> valeurs inverses. Selon la légen<strong>de</strong>, le contrebandier<br />
du Val d’Aoste, Joseph Samuel Farinet (1845-1880), dont<br />
la tête fut mise à prix par <strong>les</strong> autorités italiennes et valaisannes<br />
parce qu’il fabriquait <strong>de</strong> la fausse monnaie, était<br />
très populaire par sa prodigalité, son audace (3 évasions)<br />
et ses aventures féminines. Contrairement à la Monnaie<br />
fédérale, il <strong>fr</strong>appait ses pièces dans <strong>de</strong> l’or pur, ce qui en<br />
faisait un « vrai-monnayeur » plus digne <strong>de</strong> confiance aux<br />
yeux <strong>de</strong>s montagnards que la lointaine et impénétrable<br />
Banque nationale ! Filmer <strong>les</strong> exploits <strong>de</strong> ce bandit bienaimé,<br />
petit-cousin volage <strong>de</strong> Robin <strong>de</strong>s Bois, en pleine<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> rassemblement patriotique, <strong>de</strong> fortification <strong>de</strong><br />
l’esprit civique et <strong>de</strong> dirigisme vertueux tombe très mal à<br />
propos.<br />
Ces remarques préliminaires soulèvent la question <strong>de</strong><br />
la paternité du film, dont l’origine remonte globalement<br />
aux cerc<strong>les</strong> <strong>de</strong> la bohème bâloise du « club 33 », nid <strong>de</strong><br />
la contestation et <strong>de</strong> l’avant-gar<strong>de</strong> artistique. Précisons<br />
d’emblée que le poste <strong>de</strong> réalisateur <strong>de</strong> FaRInet est<br />
initialement scindé en <strong>de</strong>ux : l’Allemand exilé en France<br />
Paul Falkenberg ¹ est chargé <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>r <strong>les</strong> pas du novice<br />
Max Haufler. Mais la Police <strong>de</strong>s étrangers lui ayant refusé<br />
l’entrée en Suisse (août 1938), Haufler assume seul la<br />
mise en scène du film. L’anecdote a son importance, car<br />
elle atténue <strong>les</strong> interprétations trop « auteuristes » <strong>de</strong>s<br />
thuriféraires <strong>de</strong> Haufler, en qui la jeune cinéphilie veut<br />
voir l’artiste « maudit », le martyr du conformisme helvé-<br />
¹ Le monteur-réalisateur Paul Victor Falkenberg (1903 Berlin – 1986 uSa) gagne la France en 1933 et <strong>les</strong> Etats-unis en 1938. Il monte plusieurs « classiques »<br />
(West<strong>fr</strong>ont 1918 et Don Quichotte <strong>de</strong> Pabst, Die grosse Liebe <strong>de</strong> Preminger, M et Manhunt <strong>de</strong> Lang), dirige <strong>les</strong> dialogues <strong>de</strong> Vampyr <strong>de</strong> Dreyer. En amérique,<br />
il réalise surtout <strong>de</strong>s films d’art.<br />
23<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne
24<br />
tique, et par conséquent son « père spirituel ». Comme<br />
le remarque R. Cosan<strong>de</strong>y dans son analyse du « mythe<br />
Haufler », la consécration posthume <strong>de</strong> ce cinéaste auto<strong>de</strong>structeur<br />
par la nouvelle génération tient plus à une<br />
crise d’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s récents créateurs eux-mêmes qu’à<br />
une reconnaissance intrinsèque.<br />
En fait, l’homme-pivot <strong>de</strong> FaRInet est le prolifique<br />
gentleman-bohémien neuchâtelois Char<strong>les</strong> Ferdinand<br />
Vaucher, un homme <strong>de</strong> lettres lié avec Hemingway qui<br />
se dit mo<strong>de</strong>stement « dandy et gastronome ». Proche<br />
du parti communiste, il s’est engagé dans <strong>les</strong> briga<strong>de</strong>s<br />
internationa<strong>les</strong> pour combattre Franco ; son audace fait<br />
date : secondé par <strong>de</strong>s camara<strong>de</strong>s du PCF, Vaucher est<br />
parvenu à passer la <strong>fr</strong>ontière <strong>fr</strong>anco-espagnole avec<br />
trois wagons chargés <strong>de</strong> fusils Bührle après avoir soûlé<br />
<strong>les</strong> douaniers <strong>fr</strong>ançais ! Vaucher est décidément pré<strong>de</strong>stiné<br />
pour concevoir et produire FaRInet. Il y arrive en<br />
effectuant quelques détours non moins provocateurs :<br />
lorsqu’il revient d’Espagne, Vaucher fon<strong>de</strong> avec ses<br />
amis cinéphi<strong>les</strong> Haufler, Rasser et Roettges l’association<br />
« Clarté-Filmgemeinschaft » (été 1937) dans le but <strong>de</strong><br />
promouvoir un cinéma progressiste. Les premiers projets<br />
du quatuor portent déjà sur la révolte tous azimuts, allant<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux textes incendiaires <strong>de</strong> Kleist et Zola à une adaptation<br />
marxiste du Règne <strong>de</strong> l’esprit malin <strong>de</strong> Ramuz.<br />
Jean-Louis barrault incarne<br />
le faux-monnayeur anarchiste<br />
<strong>de</strong> Ramuz<br />
Le 15 juin 1938, Vaucher investit la fortune familiale dans<br />
la création <strong>de</strong> la « Clarté-Film AG Basel », société avec un<br />
bureau à Paris. Entre-temps, <strong>les</strong> cinéastes changent une<br />
fois <strong>de</strong> plus d’avis et portent leur choix sur un roman plus<br />
mouvementé <strong>de</strong> Ramuz, Farinet ou la fausse monnaie.<br />
Honegger et Hoérée – le tan<strong>de</strong>m musical <strong>de</strong> Rapt – sont<br />
<strong>de</strong> la partie, et le rôle du hors-la-loi échoit au fougueux<br />
Jean-Louis Barrault, une étoile montante à Paris, avec à<br />
son actif 18 films déjà et une importante carrière théâtrale.<br />
Vaucher est par ailleurs contraint d’engager plusieurs<br />
ve<strong>de</strong>ttes <strong>fr</strong>ançaises, en raison <strong>de</strong>s garanties exigées par<br />
ses distributeurs parisiens, ce qui gonfle gravement le<br />
budget. Il prend Suzy Prim, rencontrée comme Barrault<br />
sur le plateau <strong>de</strong> VIsIon LoIntaIne à Bâle, Alerme (qui<br />
vient <strong>de</strong> jouer à Montreux dans accoRD FInaL), l’acteur<br />
pagnolien Delmont, Sinoël, le jovial Jim Gérald, Harry-<br />
Marc du Casino-Théâtre <strong>de</strong> Genève, etc. L’adaptateur<br />
<strong>de</strong> Pagnol et <strong>de</strong> Giono, Char<strong>les</strong> A. Brun peaufine <strong>les</strong><br />
dialogues et la caméra est confiée à un spécialiste <strong>de</strong>s<br />
extérieurs exotiques, Million (caïn, bRaZZa). Les rares<br />
décors sont attribués à l’oncle maternel <strong>de</strong> Haufler, l’architecte<br />
bâlois du « groupe 33 » Paul Artaria.
Inquiet du résultat, Ramuz (qui cè<strong>de</strong> ses droits le 9 juin<br />
1938) prie le jeune écrivain valaisan Maurice Zermatten<br />
<strong>de</strong> défendre ses intérêts sur le terrain, en sillonnant la<br />
vallée du Rhône aux côtés <strong>de</strong>s Bâlois. FaRInet connaît<br />
<strong>les</strong> mêmes déboires que accoRD FInaL : extérieurs<br />
terminés à la sauvette en raison <strong>de</strong> l’affaire tchécoslovaque,<br />
mobilisation <strong>de</strong> Barrault et <strong>de</strong>s techniciens <strong>fr</strong>ançais ;<br />
d’autres retards provoqués par un incendie dans <strong>les</strong><br />
studios Filmsonor, suivi d’un conflit entre <strong>les</strong> bailleurs<br />
<strong>de</strong> fonds <strong>fr</strong>ançais – réticents à payer – et Vaucher, font<br />
grimper <strong>les</strong> coûts à 321 500 Frs, soit autant qu’ont coûté<br />
Le FusILIeR WIpF et Le bRIGaDIeR stuDeR réunis.<br />
Administrateur médiocre, Vaucher engloutit ses <strong>de</strong>rnières<br />
liquidités, puis perd le contrôle du film. La copie est tripatouillée<br />
à Paris et subit quelques coupures dramatiques<br />
qui dénaturent <strong>les</strong> intentions premières <strong>de</strong>s Bâlois tout en<br />
défigurant le dénouement.<br />
Vaucher gomme le rousseauisme mystique du livre en<br />
faveur d’une révolte plus incisive. Le héros ramuzien<br />
tombe sous <strong>les</strong> bal<strong>les</strong> <strong>de</strong> la gendarmerie en hurlant :<br />
« Vive la liberté ! ». Mais selon le scénario (approuvé par<br />
l’écrivain), Farinet reste en vie ; il est recueilli chez <strong>les</strong><br />
Romailler, soigné et dorloté par Thérèse. Elle tente <strong>de</strong><br />
l’apprivoiser, tandis que son père cherche à le réconcilier<br />
avec <strong>les</strong> lois. Allergique à toute forme d’embriga<strong>de</strong>ment,<br />
l’aventurier guéri renonce cependant à l’amour, escala<strong>de</strong><br />
la fenêtre et disparaît dans <strong>les</strong> montagnes où il se sait<br />
hors d’atteinte <strong>de</strong> la société. Le début <strong>de</strong> <strong>cette</strong> conclusion<br />
mythifiée <strong>de</strong>meure dans <strong>les</strong> copies retrouvées – mais le<br />
récit s’achève par le décès abrupt <strong>de</strong> Farinet (photo fixe)<br />
chez le syndic, un épiso<strong>de</strong> superflu tel quel et visiblement<br />
rafistolé in extremis. L’évasion périlleuse du hors-la-loi,<br />
au début (filmée au château <strong>de</strong> Valère), est aussi ampu-<br />
tée, comme si l’exploit ternissait l’image <strong>de</strong>s autorités. Le<br />
suici<strong>de</strong> <strong>de</strong> Joséphine après sa délation n’apparaît pas.<br />
Tout porte à croire qu’on ait voulu atténuer la portée<br />
provocatrice du film, faisant par là mieux ressortir le personnage<br />
<strong>de</strong> Charrat, seule concession à l’esprit du temps.<br />
De simple silhouette chez Ramuz, Charrat <strong>de</strong>vient ici le<br />
porte-parole <strong>de</strong> l’officialité ; il est revenu d’Amérique où<br />
il a connu la ruée vers l’or et sa folie dévastatrice ; parmi<br />
<strong>les</strong> proches <strong>de</strong> Farinet, c’est le plus sceptique : « Tant<br />
que ton or ne profitera pas à tous, ce que tu appel<strong>les</strong> la<br />
liberté n’est que <strong>de</strong> la fumée, une liberté qui mène aux<br />
galères ». Il est significatif que ce rôle moralisateur ait été<br />
confié au père fouettard du cinéma confédéré, Heinrich<br />
Gretler, encore imprégné du paternalisme <strong>de</strong> son fusilier<br />
Leu (WIpF). On y décèle une trace <strong>de</strong> l’antagonisme qui<br />
divise <strong>les</strong> Suisses allemands, respectueux <strong>de</strong> l’ordre, et<br />
<strong>les</strong> Romands, plus bohèmes ; c’est oublier que, le texte<br />
<strong>de</strong> Ramuz mis à part, l’apport romand dans la confection<br />
du film est inexistant, celui-ci ayant été mo<strong>de</strong>lé entre<br />
Bâle et Paris. De toute manière, l’intervention <strong>de</strong> Gretler<br />
ne trompe personne : <strong>les</strong> montagnards valaisans du<br />
film se rangent tacitement aux côtés <strong>de</strong> leur « original au<br />
grand cœur ». La population refuse <strong>de</strong> collaborer avec la<br />
gendarmerie, le syndic est dépeint comme un imbécile<br />
opportuniste. Si Farinet périt, c’est pour une affaire <strong>de</strong><br />
cœur et non parce que « le crime ne paie pas ». L’Alpe<br />
n’est plus ici symbole d’autorité inébranlable, mais le <strong>de</strong>rnier<br />
refuge <strong>de</strong> l’anarchie. Ce fait unique dans <strong>les</strong> anna<strong>les</strong><br />
<strong>de</strong> l’ancien cinéma confère à FaRInet un statut particulier.<br />
Aux yeux <strong>de</strong> la majorité suisse alémanique, le caractère<br />
latin du film autorise une certaine licence qui n’eût pas<br />
été tolérée par exemple dans une ban<strong>de</strong> zurichoise. Du<br />
reste, aucun journal d’époque ne relève explicitement cet<br />
25<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne
26<br />
aspect <strong>fr</strong>on<strong>de</strong>ur, l’adhésion quasi unanime se créant au<br />
niveau <strong>de</strong> la facture, <strong>de</strong> l’esthétique et <strong>de</strong> la révélation <strong>de</strong><br />
Haufler-cinéaste.<br />
commercialement, FaRInet est<br />
poursuivi par la malchance.<br />
Le film sort à la mauvaise saison. En introduisant l’œuvre<br />
à Genève, Vaucher se laisse aller à dire quelques mots<br />
acerbes sur le cinéma <strong>de</strong>s pays totalitaires, provoquant<br />
le départ du représentant du consulat d’Italie. L’accueil<br />
<strong>de</strong> la presse va <strong>de</strong> positif en Romandie à dithyrambique<br />
Outre-Sarine où l’on est surtout sensible à sa coloration<br />
pagno<strong>les</strong>que. Les grands espaces <strong>de</strong>s pâturages ont<br />
rarement été évoqués à l’écran avec une telle pureté, une<br />
telle limpidité d’atmosphère. Mais le public s’abstient,<br />
effarouché par <strong>les</strong> mots désobligeants sur nos juges qui<br />
« sentent mauvais », le gouvernement « noué <strong>de</strong> rhumatismes<br />
» ou <strong>les</strong> gendarmes « trop bien nourris ». « Ban<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> numérotés ! Votre liberté, elle est écrite sur vos murs,<br />
mais ça s’appelle <strong>de</strong>s règlements, <strong>de</strong>s décrets, <strong>de</strong>s lois,<br />
<strong>de</strong>s permis, <strong>de</strong>s autorisations ! Moi, je suis autorisé à<br />
mourir ! » clame le hors-la-loi face aux fusils. La feuille<br />
<strong>de</strong> gauche « Travail » constate amusée : « Ainsi se tiennent<br />
d’étranges propos sur l’écran tandis que dans la<br />
salle, <strong>les</strong> autorités constituées, médusées, ahuries et<br />
indécises, laissent inactifs ordonnances et décrets. La<br />
personnalité puissante et créatrice <strong>de</strong> Ramuz a vaincu<br />
le conformisme ». Mais l’outsi<strong>de</strong>r-né ne trouve ni écho<br />
ni sympathie parmi <strong>les</strong> spectateurs désécurisés par la<br />
dégradation <strong>de</strong> la situation politique. « On a un peu trop<br />
appuyé sur le rôle plus ou moins odieux qui est réservé<br />
à la police cantonale. La vraie liberté peut très bien se<br />
concilier avec la soumission aux lois du pays », regrette<br />
L’Echo lausannois.<br />
En Suisse alémanique, où il sort sous l’égi<strong>de</strong> du cinéclub,<br />
Farinet crée un malaise certain parmi le public non<br />
averti ; la publicité maquille le produit embarrassant en<br />
« bouleversant drame <strong>de</strong> la liberté » ; <strong>de</strong>s critiques organisent<br />
à Zurich une soirée <strong>de</strong> discussion « pour ou contre<br />
FaRInet » avec un débat sur « un film suisse doit-il être<br />
sage et correct ? » En revanche, la sortie parisienne<br />
<strong>de</strong> FaRInet passe inaperçue ; <strong>les</strong> journaux font la fine<br />
bouche, fustigeant <strong>les</strong> maladresses <strong>de</strong> <strong>cette</strong> « production<br />
régionaliste » candi<strong>de</strong>. La carrière ultérieure du film est<br />
à l’avenant : projeté à l’Exposition Nationale, annoncé à<br />
Cannes (le Festival est annulé), présenté sans tambour<br />
ni trompette à la Biennale <strong>de</strong> Venise. « L’Osservatore<br />
romano » (Vatican) fulmine contre « l’amoralisme inacceptable<br />
du héros ». Enfin, la guerre déclarée annihile<br />
presque toutes <strong>les</strong> perspectives <strong>de</strong> diffusion à l’étranger.<br />
Le temps a patiné l’ouvrage, <strong>de</strong>venu une sorte <strong>de</strong> « classique<br />
», et permet d’en mieux dégager faib<strong>les</strong>ses et<br />
lignes <strong>de</strong> force. Cinématographiquement parlant, FaRInet<br />
n’est guère plus qu’une <strong>de</strong>mi-réussite, une œuvre<br />
sympathique dans ses intentions mais souvent boiteuse<br />
dans son exécution.<br />
Le scénario souf<strong>fr</strong>e d’une structure inégale. Le film ne
commence à bouger qu’à partir <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième moitié et<br />
<strong>les</strong> motivations <strong>de</strong>s protagonistes ne sont pas toujours<br />
suffisamment développées : l’interprétation peu homogène<br />
dérange surtout le public <strong>fr</strong>ancophone qui regrette<br />
l’inauthenticité chez Suzy Prim par exemple, titi montmartrois<br />
déguisé en Valaisanne, ou ces vieux routiers du<br />
cinéma <strong>fr</strong>ançais du samedi soir mélangés à la figuration<br />
indigène. Haufler, encore inexpérimenté, leur laisse la<br />
bri<strong>de</strong> sur le cou, comme il se contente <strong>de</strong> suivre sans le<br />
diriger le bouillonnant Jean-Louis Barrault, à la physionomie<br />
d’halluciné et à la <strong>fr</strong>êle stature. Barrault campe un<br />
hors-la-loi cérébral, nerveux, tourmenté et exalté – assez<br />
lointain du Valdotain sec et <strong>fr</strong>uste <strong>de</strong> Ramuz ; quand il<br />
mime la simplicité du montagnard, ses efforts sentent<br />
le théâtre ; en revanche, il transmet au film ce que <strong>les</strong><br />
images tranquil<strong>les</strong> <strong>de</strong> Haufler ne parviennent pas à communiquer<br />
: le tempérament et la fougue indispensab<strong>les</strong><br />
au propos incendiaire.<br />
A l’opposé <strong>de</strong> la stylisation distanciatrice d’un Kirsanoff<br />
(Rapt), Haufler, grand admirateur du réalisme poétique<br />
<strong>fr</strong>ançais, s’est délibérément placé dans l’optique commune<br />
à Renoir et à Pagnol (ce qu’accentuent le cadre<br />
régional et <strong>les</strong> acteurs typés <strong>de</strong> ses auteurs-modè<strong>les</strong>).<br />
Cette approche répond surtout à sa sensibilité visuelle et<br />
à son passé <strong>de</strong> peintre. Tournant à 80% en extérieurs, il<br />
fignole sans ostentation <strong>de</strong>s tableaux enchanteurs, capte<br />
amoureusement le reflet du soleil au détour d’une ruelle,<br />
la magie <strong>de</strong>s vieil<strong>les</strong> pierres et <strong>de</strong>s vignes baignées <strong>de</strong><br />
lumière. A ces qualités pictura<strong>les</strong> s’ajoute un sens inné<br />
du récit et <strong>de</strong> l’atmosphère qui tranche avec <strong>les</strong> tâtonnements<br />
<strong>de</strong> ses con<strong>fr</strong>ères. Si le débit est lent et réfléchi<br />
(au point <strong>de</strong> négliger <strong>les</strong> temps forts), le style narratif luimême<br />
reste agréablement flui<strong>de</strong>, en dépit <strong>de</strong> son manque<br />
d’éclat : cadrages expressifs et variés, composition spatiale<br />
habile. L’écriture reste encore impersonnelle, mais<br />
on décèle dans FaRInet un talent en gestation, un talent<br />
attachant qui ne <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qu’à s’épanouir au fil d’une<br />
carrière nourrie.<br />
BIO<br />
Max Haufler<br />
(1910-1965),<br />
max Haufler est né à Bâle en 1910.<br />
il est le fils du peintre sur verre bâlois<br />
<strong>fr</strong>itz Haufler. Dès 17 ans, il commence<br />
à peindre en autodidacte, puis suit <strong>de</strong>s<br />
cours <strong>de</strong> peinture chez paul Camenisch.<br />
il expose pour la première fois en 1928<br />
<strong>de</strong>s toi<strong>les</strong> d’inspiration expressionniste.<br />
il se lie d’amitié avec Coghuf et parcourt<br />
l’Europe avec son chevalet. après un<br />
séjour à paris à l’académie ozenfant<br />
(1935), il renie ses toi<strong>les</strong> et se tourne<br />
vers le cabaret à Bâle. La passion du<br />
cinéma le saisit vers 1936. En 1938, il<br />
réalise son meilleur film, FARINET, L’OR<br />
DANS LA MONTAGNE.<br />
sa malchance <strong>de</strong> cinéaste après 1942<br />
le contraint à la besogne publicitaire, au<br />
documentaire <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> et surtout<br />
à une carrière abhorrée <strong>de</strong> comédien au<br />
cours <strong>de</strong> laquelle, véritable champion<br />
<strong>de</strong> l’«un<strong>de</strong>rplay » à l’américaine avec<br />
une prédilection exhibitionniste à<br />
l’enlaidissement, il révèle un talent <strong>de</strong><br />
mime stupéfiant. De 1949 à 1957, il<br />
joue au cabaret « fe<strong>de</strong>ral » et dans<br />
divers autres cabarets <strong>de</strong> Zürich et <strong>de</strong><br />
Darmstadt. Dès 1957, <strong>les</strong> tv zurichoise<br />
et berlinoise le sollicitent, ainsi que <strong>de</strong>s<br />
compagnies <strong>de</strong> cinéma britanniques,<br />
alleman<strong>de</strong>s et américaines (White<br />
Cradle Inn d’Harold <strong>fr</strong>ench ; Ein Mann<br />
geht durch die Wand <strong>de</strong> L. vajda ;<br />
Le Procès d’orson Wel<strong>les</strong>, Morituri<br />
<strong>de</strong> B. Wicki, etc.). Enclin à <strong>de</strong>s accès<br />
<strong>de</strong> dépression, Haufler met fin à ses<br />
jours en 1965 peu après son retour <strong>de</strong><br />
Hollywood, où il venait <strong>de</strong> décliner une<br />
of<strong>fr</strong>e <strong>de</strong> la 20th Century fox.<br />
il est redécouvert au début <strong>de</strong>s années<br />
80 à l’occasion <strong>de</strong> la sortie du film <strong>de</strong><br />
richard Dindo, Max Haufler – <strong>de</strong>r<br />
Stumme.<br />
27<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne
28<br />
FaRInet ou la fausse monnaie<br />
roman valaisan <strong>de</strong> c.F. RaMuZ<br />
anDRé RoZ<br />
composa ces images<br />
gravées sur bois par<br />
PauL BauDIER<br />
Remerciements à alain Pellissier,<br />
membre actif du Ciné-Club<br />
Jacques Becker, pour le prêt<br />
<strong>de</strong> cet ouvrage <strong>de</strong> 1938.<br />
« Farinet a été un faux-monnayeur véritable. Il<br />
a même eu son heure <strong>de</strong> célébrité (très locale)<br />
aux environs <strong>de</strong> 80, dans tout le pays qui s’étend<br />
<strong>de</strong> Martigny à Sion …<br />
Farinet a été un homme <strong>de</strong> bonne foi ; Farinet<br />
croyait à son or et on y croyait autour <strong>de</strong> lui.<br />
Ce qui explique l’amitié <strong>de</strong> la population <strong>de</strong> la<br />
contrée, où il est mort glorieusement, seul<br />
contre cinquante gendarmes et où on parle<br />
encore <strong>de</strong> lui, après plus d’un <strong>de</strong>mi-siècle, avec<br />
considération et regrets…<br />
Farinet (le livre) est donc un mélange <strong>de</strong> vérité<br />
et <strong>de</strong> poésie dont on voudra bien pardonner à<br />
l’auteur <strong>de</strong> s’être rendu coupable. »<br />
Pully, 5 janvier 1938 C.F. Ramuz
(…) Cette nuit-là, et comme l’horloge <strong>de</strong> la cathédrale<br />
venait <strong>de</strong> sonner douze coups, Farinet<br />
n’ avait point fait <strong>de</strong> bruit, mais il avait quitté le<br />
cadre en bois <strong>de</strong> chêne scellé dans le mur où il<br />
couchait sur une paillasse. Le gardien-chef avait<br />
fait sa tournée un moment avant. Il avait rabattu<br />
le guichet grillagé qui ouvrait à l’extérieur dans<br />
la porte doublée <strong>de</strong> fer et, ayant vu que Farinet<br />
était étendu bien sagement sous sa couverture,<br />
il avait été dormir, lui aussi. (…)<br />
(…) C’était la secon<strong>de</strong> fois que Farinet s’évadait.<br />
Il n’y avait pas encore une année qu’il s’était<br />
échappé <strong>de</strong>s prisons d’Aoste, où il avait été<br />
enfermé à cause <strong>de</strong> ses pièces.<br />
Ah ! Il se rappelait assez <strong>les</strong> duretés et <strong>les</strong> difficultés<br />
<strong>de</strong> <strong>cette</strong> première entreprise, encore qu’il<br />
l’eût menée à bien. Il lui avait fallu s’engager<br />
en pleine montagne, au-<strong>de</strong>ssus du passage qui<br />
est gardé et qu’il avait fini par apercevoir dans<br />
l’après-midi avec son petit lac et l’hospice, à plusieurs<br />
centaines <strong>de</strong> mètres au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> lui,<br />
se cachant <strong>de</strong>rrière un quartier <strong>de</strong> roc, puis se<br />
glissant en rampant jusqu’au quartier <strong>de</strong> roc le<br />
plus voisin, tandis que l’eau suintait <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssous<br />
chaque dalle ; et il avait <strong>les</strong> mains et <strong>les</strong> genoux<br />
dans l’eau et partout où il y avait une dépression<br />
elle était encore pleine <strong>de</strong> neige (bien qu’on fût en<br />
été). N’ayant rien mangé <strong>de</strong>puis la veille au soir ;<br />
et nulle part ici rien ne se présente qui puisse<br />
prêter secours à l’homme qui a faim : nul arbuste,<br />
ni la moindre baie, ni aucune <strong>de</strong>s productions <strong>de</strong><br />
la terre. Ce qui le soutenait, c’est qu’il comptait<br />
bien arriver à la nuit chez lui où il pensait qu’il<br />
pourrait se remplir le ventre et dormir son saoul<br />
en compensation. (…)<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne<br />
29
30<br />
(…) Il avait fait à Miège la connaissance d’un<br />
vieil homme, nommé Sage, qui s’occupait à aller<br />
cueillir dans la montagne toute espèce d’herbes<br />
et <strong>de</strong> plantes qu’il vendait aux pharmaciens. Le<br />
père Sage… passait pour un peu sourcier, et aussi<br />
sorcier, et on disait qu’outre ses plantes, il cherchait<br />
<strong>de</strong> l’or, et il en avait trouvé et souvent. Il<br />
y avait, paraît-il, dans le sommet <strong>de</strong> la chaîne<br />
qui domine Miège du côté nord, une veine que<br />
Sage avait découverte ; mais il se faisait un peu<br />
vieux pour courir la montagne ayant plus <strong>de</strong><br />
soixante-dix ans ; et il cherchait justement un<br />
ai<strong>de</strong>. Farinet s’était offert ; il avait été accepté.<br />
Même, finalement, le père Sage s’était tellement<br />
affectionné à lui qu’il lui avait montré sa<br />
cachette. Farinet s’était mis à chercher l’or, lui<br />
aussi, et à en trouver lui aussi. C’était <strong>de</strong>venu son<br />
métier… Farinet avait eu l’idée <strong>de</strong> confectionner<br />
<strong>de</strong>s mou<strong>les</strong> <strong>de</strong> plâtre et d’acheter un chalumeau.<br />
Et, à la mort du vieux, il avait commencé à fabriquer<br />
ses pièces. Il y avait tout près <strong>de</strong> là, dans la<br />
gorge <strong>de</strong> la Salenche, une belle grotte bien sèche,<br />
laquelle communiquait avec la cave <strong>de</strong> la maison ;<br />
il y avait installé son atelier pour être à l’abri <strong>de</strong><br />
toute surprise. Alors il n’avait plus eu qu’à mettre<br />
ses pièces en circulation et avait trouvé facilement<br />
dans le pays à <strong>les</strong> écouler ; étant bien vu <strong>de</strong><br />
la plupart <strong>de</strong>s gens, parce qu’ils croyaient à son<br />
or et que Farinet était généreux. Et il y croyait,<br />
lui aussi, à son or ; le malheur était seulement<br />
que le gouvernement avait déjà le sien. Il y a<br />
une convention ayant force <strong>de</strong> loi qui fait que le<br />
gouvernement a seul le droit <strong>de</strong> mettre en circulation<br />
ses pièces : Farinet l’avait bien vu. Il avait<br />
eu beau dire : « Les miennes sont meilleures » ;<br />
on ne l’en avait pas moins jeté en prison, un jour<br />
qu’il avait passé la <strong>fr</strong>ontière, ayant beaucoup <strong>de</strong><br />
pièces à écouler ; et il venait <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong><br />
prison à Aoste, qui est sur le territoire italien, <strong>de</strong><br />
l’autre côté du col du Grand Saint-Bernard. (…)<br />
(…) Les gendarmes arrivèrent <strong>de</strong>ux heures plus tard.<br />
Le maître était en train <strong>de</strong> faire le <strong>fr</strong>omage ; <strong>les</strong><br />
hommes dans le pâturage s’occupaient à rassembler<br />
le troupeau, appelant <strong>les</strong> bêtes dans le pâturage<br />
en levant leur fouet comme tous <strong>les</strong> soirs (et el<strong>les</strong><br />
viennent ou s’attar<strong>de</strong>nt, et el<strong>les</strong> font <strong>de</strong>s groupes<br />
ou sont isolées ; el<strong>les</strong> font <strong>de</strong>s points bruns dans<br />
l’herbe encore épaisse et douce <strong>de</strong>s commencements<br />
<strong>de</strong> l’été, au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s grands rochers blancs ;<br />
quelques-unes parmi <strong>les</strong> plus jeunes, prises <strong>de</strong> folie,<br />
partent au galop en faisant sonner leur cloche, il<br />
fallait courir après) ; et hô !<br />
Ils ont eu l’air (ceux du chalet) tout étonnés <strong>de</strong> voir<br />
<strong>les</strong> gendarmes.<br />
Le maître, le premier, semblait tout étonné, tandis<br />
qu’il s’avançait jusque sur le pas <strong>de</strong> la porte.<br />
Il leur a dit bonjour parmi sa grosse barbe ; mais il<br />
a fallu qu’il poussât sa voix, à cause <strong>de</strong>s sonnail<strong>les</strong><br />
venant dans l’air toutes ensemble avec un bruit<br />
comme une chute d’eau. Le sergent s’était arrêté ;<br />
le maître et le sergent avaient commencé une<br />
conversation… Lui, calme dans sa barbe ; le sergent<br />
tout rouge et tout en sueur sous le képi, avec sa<br />
moustache tombante, le col <strong>de</strong> sa tunique dégrafé<br />
et <strong>les</strong> trois boutons d’en haut <strong>de</strong> sa tunique défaits<br />
<strong>de</strong> même sur sa chemise, blanc <strong>de</strong> poussière comme<br />
ses hommes ; et le maître :<br />
- Bien sûr qu’on l’a vu, mais vous arrivez trop tard…<br />
Il riait.<br />
- Si vous croyez qu’il va se laisser prendre comme<br />
ça. (…)
(…) Car il était remonté tout <strong>de</strong> suite à<br />
sa veine et s’était remis sur le dos, dans<br />
son trou, en haut <strong>de</strong> la chaîne, aggravant<br />
encore son cas : c’est-à-dire qu’il récidivait.<br />
(…)<br />
(…) « Heureusement, s’est-il dit tout à coup,<br />
que j’ai un moyen <strong>de</strong> me faire entendre. »<br />
A un trou <strong>de</strong> mine pendait une mèche<br />
imbibée <strong>de</strong> salpêtre, longue, fine et grise<br />
comme une queue <strong>de</strong> rat. Il n’a eu qu’à<br />
<strong>fr</strong>otter une allumette. (…)<br />
(…) Il prenait l’or dans le creux <strong>de</strong> sa main.<br />
Il prenait <strong>cette</strong> fine poudre ; il le faisait<br />
couler <strong>de</strong> sa main droite dans sa main<br />
gauche. Ah ! C’est liqui<strong>de</strong>, ah ! C’est doux.<br />
N’est-ce pas que c’est agréable à toucher ?<br />
C’est beau, c’est caressant comme <strong>de</strong>s<br />
cheveux <strong>de</strong> femme…<br />
…C’est beau <strong>de</strong> couleur comme du fendant<br />
d’une bonne année. C’est doux, c’est caressant,<br />
c’est fin ; et puis, quoi ? C’est la<br />
liberté, et ça lui chantait dans le cœur.<br />
Mais qu’est-ce que la liberté, se disait-il,<br />
pendant qu’il regardait autour <strong>de</strong> lui ?<br />
Qu’est-ce que ça veut dire ?<br />
C’est quand on fait ce qu’on veut, comme<br />
on veut, quand ça vous chante ; est-ce<br />
tout ?<br />
C’est quand on ne dépend que <strong>de</strong> soi. C’est<br />
quand tous <strong>les</strong> comman<strong>de</strong>ments partent<br />
<strong>de</strong> vous. Tu veux rester couché, reste<br />
couché ; tu veux te lever, lève-toi. Tu veux<br />
manger, eh bien, mange ; tu ne veux pas<br />
manger, ne mange pas… Et tu veux faire<br />
<strong>de</strong> la monnaie, eh bien, tu n’as qu’à faire <strong>de</strong><br />
la monnaie. (…)<br />
(…) C’était dans la cuisine <strong>de</strong> l’auberge, après la<br />
fermeture <strong>de</strong> l’établissement. Les portes <strong>de</strong> la<br />
maison avaient été fermées à clé et toutes <strong>les</strong><br />
lumières éteintes sauf la lampe qui <strong>les</strong> éclairait,<br />
mais elle ne pouvait pas se voir <strong>de</strong> <strong>de</strong>hors, à cause<br />
<strong>de</strong>s contrevents qui étaient <strong>de</strong> bois plein. <strong>Pour</strong> un<br />
peu qu’on fût venu et qu’il eût fallu aller ouvrir,<br />
Farinet aurait eu tout le temps <strong>de</strong> s’échapper par<br />
<strong>les</strong> greniers, car tout avait été prévu. (…)<br />
(…) - Est-ce que mon or est faux ou non ? Ce n’est<br />
pas seulement une fois, c’est <strong>de</strong>ux, c’est trois, c’est<br />
quatre fois, que <strong>les</strong> experts l’ont examiné. C’est <strong>de</strong><br />
l’or, c’est même du tout bon, <strong>de</strong> l’or pur, <strong>de</strong> l’or<br />
vierge, mais le gouvernement est jaloux. Est-ce<br />
qu’on ne pourrait pas s’organiser une bonne petite<br />
vie à nous, par ici, avec notre monnaie à nous et<br />
pas la sienne ? (...)<br />
31<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne
32<br />
(…) - J’ai été chargé <strong>de</strong> te dire que tu<br />
<strong>de</strong>vrais te rendre ; c’est la bonne solution…<br />
Le gouvernement t’en tiendrait compte.<br />
Tu as déjà fait six mois <strong>de</strong> galères, ils te<br />
seraient décomptés… Dieu sait, tu n’en<br />
aurais peut-être plus que pour six mois et<br />
six mois d’hiver, c’est vite passé… Tu pourrais<br />
rentrer tranquillement dans ta maison ;<br />
tu ne <strong>de</strong>vrais plus rien à personne. Mais ce<br />
serait à une condition…<br />
Romailler s’arrêta <strong>de</strong> nouveau :<br />
- Ce serait à la condition, que tu t’engagerais<br />
à renoncer à fabriquer, et à mettre<br />
en circulation tes pièces, ça c’est la gran<strong>de</strong><br />
condition…<br />
Alors Farinet avait dit :<br />
- Ma foi, non ! (...)<br />
(…) Si on pouvait avoir la liberté et vivre en<br />
même temps comme tout le mon<strong>de</strong> ; mais,<br />
voilà, si je me rends, ça va me faire six<br />
mois au moins à être privé du bon air et<br />
<strong>de</strong>s choses qui sont <strong>de</strong>dans, et sont à vous,<br />
à vous tout seul : une feuille mouillée, un<br />
brin d’herbe avec ses per<strong>les</strong>, un bouquet <strong>de</strong><br />
baies rouges qu’on met à son chapeau ; six<br />
mois et puis… Et il se dit en même temps :<br />
« Peut-être bien que ce ne serait pas trop<br />
cher », l’ayant vue elle aussi qui venait ; et<br />
c’est à considérer, toute fine et ron<strong>de</strong> sous<br />
ses cheveux blonds…<br />
Il y a <strong>de</strong>ux libertés, comme il voit : il y en<br />
a une qui est douce, il y en a une qui est<br />
sauvage… (…)<br />
(…) Il avait relevé la tête, il a regardé tout<br />
autour <strong>de</strong> lui. Tout à coup, il revient en<br />
arrière ; il dit tout haut :<br />
- Jamais ! Moi, j’ai choisi la sauvage. (…)<br />
(…) – Ah ! Farinet, c’est vrai, tu ne sais rien… Eh<br />
bien, j’ai <strong>de</strong> l’argent… Tu disais que tu n’en avais<br />
pas… Eh bien, moi, j’en ai à présent, tant qu’il<br />
nous en faut, huit cents <strong>fr</strong>ancs… On a volé la<br />
buraliste. Oui, on lui a pris ses billets ; on <strong>les</strong> a<br />
remplacés par <strong>de</strong>s pièces, <strong>de</strong> tes pièces… Et tu ne<br />
sais pas qui a fait le coup ? Farinet ; non, c’est<br />
vrai, tu ne sais rien, tu vis dans ton trou…<br />
Il ne trouve rien à répondre. D’ailleurs elle parle<br />
trop et trop vite.<br />
- Tu ne sais pas ? Eh bien, c’est moi… (…)<br />
(…) – Alors, monsieur le commandant, vous comprenez,<br />
il n’y avait qu’à la prendre, <strong>cette</strong> clé, et<br />
puis j’ai ouvert le tiroir, et j’ai pris <strong>les</strong> billets et<br />
j’ai mis <strong>les</strong> pièces à leur place… Et c’est pas lui,<br />
c’est moi. Oh ! Qu’est-ce que vous allez lui faire ?<br />
Oh ! Ne lui faites rien ; il est innocent, je vous<br />
dis. Je voulais l’obliger à venir avec moi, il disait<br />
qu’il n ’avait point d’argent. Et moi je m’étais dit :<br />
« Quand il aura <strong>de</strong> l’argent, il viendra. » Et il n’ a<br />
pas voulu venir… (…)
(…) – Votre liberté, qu’est-ce que c’est ? Ah !<br />
Emprisonnés que vous êtes, ah ! Numérotés !<br />
Et il y a la liberté écrite sur vos murs, mais<br />
regar<strong>de</strong>z ce qu’il y a <strong>de</strong>ssous… Ça s’appelle <strong>de</strong>s<br />
règlements, <strong>de</strong>s décrets, <strong>de</strong>s lois, <strong>de</strong>s permis,<br />
ça s’appelle <strong>de</strong>s autorisations ; moi je suis<br />
autorisé à mourir…<br />
Alors, <strong>de</strong> différents côtés dans la gorge, <strong>les</strong><br />
pierres se sont mises à tomber en abondance<br />
:<br />
- Vous ne savez pas qui je suis ! Le roi d’Italie<br />
ne le savait pas non plus ; il l’a su ! Et, vous,<br />
vous aviez cru me gar<strong>de</strong>r dans vos galères :<br />
je n’y suis pas resté longtemps ! Maintenant<br />
venez me prendre !...<br />
Alors il s’est mis <strong>de</strong>bout, un coup <strong>de</strong> feu<br />
éclate ; il lève son chapeau au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> sa<br />
tête, il a crié :<br />
- Manqué !<br />
Il recommence :<br />
- Et dites bien encore à tout le mon<strong>de</strong> que<br />
mon or est bon, que…<br />
Un coup <strong>de</strong> feu ; et lui s’est avancé alors sur<br />
la corniche, <strong>de</strong> sorte qu’on lui tirait <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong><br />
tout côté : mais on l’a manqué encore.<br />
- Que c’est du vrai, et même du tout vrai ; que<br />
je n’ai jamais volé personne… (…)<br />
(…) – Vive la liberté ! A-t-il crié ensuite,<br />
s’étant engagé sur une autre corniche qui<br />
allait d’amont en aval ; mais là il s’est trouvé<br />
en face <strong>de</strong>s gendarmes qui étaient postés à<br />
l’autre extrémité <strong>de</strong> la gorge.<br />
Il y a eu une décharge générale. (…)<br />
(…) Tout doux, tout simple, tout facile… Oh !<br />
<strong>Pour</strong>quoi ? Qu’est-ce qu’il leur avait fait ? Et ils<br />
étaient trente contre un ! <strong>Pour</strong>quoi ? Il ne nous<br />
avait jamais fait que du bien. Tu te souviens (on<br />
était trois fil<strong>les</strong>, c’était à la fête du Patron) <strong>les</strong><br />
pièces qu’il nous avait données. Une à chacune.<br />
Ah ! Il était généreux…<br />
Et bon ! Un garçon <strong>de</strong> nos montagnes. Et grand !<br />
(…)<br />
(…) Ah ! Qu’est-ce qu’ils ont fait <strong>de</strong> lui, un garçon<br />
<strong>de</strong> chez nous, un enfant <strong>de</strong> nos montagnes, un<br />
chasseur, un bon compagnon…<br />
Car le village tout entier était venu à sa rencontre,<br />
tandis qu’il montait et était porté. Il y<br />
avait en effet un gendarme à sa tête ; il y avait<br />
un gendarme à ses pieds. Il venait sous sa couverture<br />
bien bordée ; ces messieurs <strong>de</strong> la justice<br />
étaient là qui attendaient ; nous, on se tenait<br />
éparpillés, faisant <strong>de</strong>s groupes plus en arrière.<br />
(…)<br />
(…) Ah ! Bon pourtant, beau, grand, fort, généreux,<br />
complaisant, vous vous souvenez, un garçon <strong>de</strong><br />
nos montagnes ! Et il a passé <strong>de</strong>vant nous. Les<br />
gendarmes suivaient avec leurs fusils, ces messieurs<br />
<strong>de</strong> la justice se sont mis à aller à leur<br />
suite ; nous, on est allé <strong>de</strong>rrière, tandis que le<br />
glas sonnait toujours. (…)<br />
33<br />
farinet<br />
l’or<br />
dans<br />
la<br />
montagne
34<br />
© Christiane Grimm<br />
« Est-ce que soi-même<br />
on est mal fait,<br />
ou bien est-ce que<br />
c’est le mon<strong>de</strong><br />
qui est mal fait ? »
Scénario : Pascal Lainé<br />
Directeur photo : Jean Zeller<br />
Décors : Pierre-Alain Croisier<br />
Son : Michel Morier<br />
Production : TSR Genève, A2<br />
ADAM ET ÈVE<br />
Suisse/France, 1983, 64 mn<br />
Interprètes :<br />
Véronique Genest (Lydie)<br />
Jean-François Stévenin (Louis Bolomey)<br />
Roger Jendly (Gourdou)<br />
Juliette Brac (M me Chappaz)<br />
Marcel Robert<br />
Anne-Laure Luisani (Adrienne)<br />
Pierre Walker<br />
Naara Salomon<br />
Moreno Macchi<br />
Caroline Deriaz<br />
Tournage : 13 juin / 6 juillet 1983, Allaman, Aubonne, Orbe.<br />
“ « un silence comme avant<br />
le commencement <strong>de</strong> la vie<br />
ou après la fin <strong>de</strong> la vie »<br />
Cela aurait pu s’appeler « une histoire simple ». Louis<br />
Bolomey rentre chez lui et trouve une lettre laissée<br />
par sa femme, Adrienne, qui l’a quitté. Il survit, s’interroge,<br />
noue une liaison avec Lydie, une jeune fille,<br />
mais attend toujours le retour <strong>de</strong> la fugitive.<br />
Cela rappelle une histoire vieille comme le mon<strong>de</strong>.<br />
La femme trahit ; l’homme déchu du paradis tente <strong>de</strong><br />
le reconstruire sur terre, dans son jardin. Gourdou,<br />
un ami, explique à Louis pourquoi il doit souf<strong>fr</strong>ir :<br />
« C’est dans le livre. Parce qu’on n’était pas comme<br />
ça avant. On a été chassé une fois, il y a longtemps,<br />
et on oublie ».<br />
Pétulante, obstinée, Lydie veut ramener Louis à<br />
la vie : « Cette histoire, c’est trop ancien pour être<br />
vrai ». Ou plus crûment : « Vous êtes un homme, je<br />
suis une femme. Faudrait pas l’oublier ! » Bolomey,<br />
s’il est encore meurtri par le départ d’Adrienne, peut<br />
être sauvé. Nietzsche l’a écrit : « Un homme qui<br />
souf<strong>fr</strong>e n’a pas encore droit au pessimisme ».<br />
Il règne dans ce film un profond silence. « Un silence<br />
comme avant le commencement <strong>de</strong> la vie ou après<br />
la fin <strong>de</strong> la vie » dit Gourdou.<br />
Les paro<strong>les</strong> sont rares, plutôt murmurées que prononcées,<br />
sans faux-semblant. La révolte <strong>de</strong> Louis<br />
est muette. « Vous ne l’auriez pas vue ? » parvient-il<br />
à répéter comme un automate, sans y croire.<br />
MICHEL SOUTTER<br />
d’après le roman <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz « Adam et Eve » (1932)<br />
adam et Ève participe d’une série intitulée<br />
« Les péchés originaux » , produite<br />
par la TSR avec Antenne 2, tirée <strong>de</strong> cinq<br />
auteurs contemporains (Alberto Moravia,<br />
Witold Gombrowicz, Adolfo Bioy Casarès,<br />
Joyce Carol Oates, et C. F. Ramuz) adaptée<br />
pour la télévision par l’écrivain Pascal<br />
Lainé signataire <strong>de</strong> plusieurs romans dont<br />
La Dentellière (Prix Goncourt 1974), porté<br />
à l’écran par Clau<strong>de</strong> Goretta en 1977.<br />
Freddy Buache dans « Michel Soutter »<br />
Cinémathèque Suisse/L’Âge d’Homme 2001<br />
« le réalisateur a tiré,<br />
dans un esprit<br />
parfaitement ramuzien,<br />
un conte moral,<br />
voire métaphysique »<br />
© Christiane Grimm<br />
adam<br />
et<br />
ève<br />
35
© Christiane Grimm<br />
« il éprouve avec ef<strong>fr</strong>oi<br />
:<br />
l’impossibilité métaphysique<br />
36 <strong>de</strong> retrouver par la chair l’unité<br />
perdue...»<br />
© Christiane Grimm<br />
Bolomey était en train <strong>de</strong> creuser <strong>de</strong>s trous dans<br />
la terre … <strong>Pour</strong>quoi est-ce qu’on serait condamné,<br />
en effet ? <strong>Pour</strong>quoi est-ce qu’on ne serait pas<br />
libre <strong>de</strong> faire chacun sa vie ? Il avait mangé à<br />
midi <strong>de</strong> bon appétit dans sa cuisine, puis s’est<br />
remis tout <strong>de</strong> suite à sa besogne sous le grand<br />
soleil. Il creuse <strong>de</strong>s trous.<br />
C.F. Ramuz (Adam et Ève)<br />
Le roman <strong>de</strong> Ramuz date <strong>de</strong> 1932 ; il raconte une histoire<br />
simple, hors <strong>de</strong>s catastrophes ou chimères montagnar<strong>de</strong>s,<br />
située en plaine vaudoise vers la même époque : <strong>les</strong> villageois<br />
découvrent la radio, le poste à galène qui leur donne<br />
l’impression <strong>de</strong> se sentir liés au mon<strong>de</strong> entier, le disque sur<br />
le gramophone avec <strong>de</strong>s musiques ou <strong>de</strong>s voix venues<br />
<strong>de</strong>s lointains horizons, mais l’écrivain l’a profilée sur le sentiment<br />
religieux <strong>de</strong> la culpabilité dont l’explication figure<br />
aux premières pages <strong>de</strong> la Genèse : l’homme est séparé<br />
<strong>de</strong> la femme (et <strong>de</strong>s autres hommes), punition engendrée<br />
par la faute sous le pommier <strong>de</strong> la Connaissance, faute qui<br />
doit être corrigée par l’amour. Mais celui-ci, par malheur, à<br />
cause <strong>de</strong> ce fait fondamental, ne dure qu’un instant … Louis<br />
Bolomey, le personnage principal, y vit la douloureuse expérience<br />
<strong>de</strong> la séparation. Non seulement parce que sa jeune<br />
épouse, Adrienne, le quitte (il était marié <strong>de</strong>puis six mois, au<br />
len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> la mort <strong>de</strong> sa mère), mais parce que, suite à<br />
ce qu’il apprend <strong>de</strong> sa lecture <strong>de</strong> la Bible grâce à Gourdou,<br />
le prêcheur <strong>de</strong> bistrot, il éprouve avec ef<strong>fr</strong>oi l’impossibilité<br />
métaphysique <strong>de</strong> retrouver par la chair l’Unité perdue...<br />
Chassée <strong>de</strong> l’E<strong>de</strong>n, la créature a perdu l’Unité, qu’il faut<br />
reconquérir, d’où la passion <strong>de</strong> Louis qui s’acharne à bâtir,<br />
<strong>de</strong>vant sa maison, en plantant <strong>de</strong>s barrières neuves, ce<br />
jardin, signe pathologique et magique d’un retour possible<br />
<strong>de</strong> <strong>cette</strong> Unité perdue...<br />
Lainé reprend fidèlement <strong>les</strong> passages essentiels et <strong>les</strong><br />
phrases du texte originel sans éviter une miniaturisation<br />
<strong>de</strong> l’intrigue à peine esquissée où la très longue absence<br />
d’Adrienne, captée par <strong>les</strong> mots <strong>de</strong> l’écrivain, se dresse à<br />
chaque pas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription du lieu <strong>de</strong> l’action au cours<br />
du livre : le café, la vaisselle non lavée, l’existence journalière<br />
difficile en face <strong>de</strong> l’innocence <strong>de</strong>s oiseaux, une<br />
fenêtre ouverte, une porte fermée, une réplique banale et<br />
qui porte loin.<br />
A <strong>cette</strong> ébauche <strong>de</strong> scénario …, le réalisateur apporte <strong>les</strong><br />
transformations et compléments qu’il juge cinématographiquement<br />
nécessaires à son montage plus géométrique<br />
et abstrait que folkloriquement illustratif ; il <strong>de</strong>vient photographe<br />
et motocycliste, mais il ne cesse, pour autant,<br />
d’appartenir à la cohorte <strong>de</strong>s colporteurs prophétiques ou<br />
vieillards divinateurs qui hantent <strong>les</strong> romans <strong>de</strong> Ramuz. En<br />
outre, Soutter choisit <strong>de</strong> quitter la campagne vaudoise pour<br />
installer la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> ce drame à la Pêcherie<br />
d’Allaman surtout, c’est-à-dire aux abords du lac, <strong>de</strong>venu,<br />
face au pauvre Louis, le sensuel acteur principal du film :<br />
son impassibilité envahissante, ses vagues rapi<strong>de</strong>s qui se<br />
fon<strong>de</strong>nt vite en immobilité bleue, permettent <strong>de</strong> conjurer<br />
la malédiction qui nimbe l’ambiguïté <strong>de</strong> son plan d’ouverture<br />
et <strong>de</strong> son dénouement (différent <strong>de</strong> celui du récit qui<br />
montre Adrienne repartie, accompagnée à la gare pour le<br />
train <strong>de</strong> 9 h 15 par Louis, revenant seul...).<br />
Le film s’ouvre sur la barque <strong>de</strong> Louis qui monte <strong>de</strong> l’horizon<br />
brumeux et qui montre ensuite le pêcheur dans sa<br />
chambre. Il déchif<strong>fr</strong>e à peine la lettre d’adieu d’Adrienne,<br />
se cherche <strong>de</strong>s excuses, ne comprend rien, puis en parle,<br />
forçant sa timidité, à Madame Chappaz, la tenancière<br />
du Café du Tilleul, à Lydie, à Gourdou qui lui répond par<br />
<strong>de</strong>s citations bibliques. Soutter s’efforce <strong>de</strong> remplacer<br />
l’intensité lyrique <strong>de</strong> l’écrivain, qui procè<strong>de</strong>, particularité<br />
remarquable, non <strong>de</strong>s mots, mais <strong>de</strong>s silences installés<br />
entre eux. Sa transposition le conduit, par un principe<br />
i<strong>de</strong>ntique, à déceler son apouvoir d’énergie expressive<br />
entre <strong>les</strong> images plutôt qu’en el<strong>les</strong>, même si chaque plan<br />
<strong>de</strong> <strong>cette</strong> parabole inscrit, <strong>de</strong>vant l’objectif, la matérialité du<br />
paysage et <strong>de</strong> ses détails, plastiquement composés en<br />
fonction du vi<strong>de</strong> qu’ils dispensent : <strong>les</strong> fleurs, le chemin,<br />
<strong>les</strong> vergers verdoyants, <strong>les</strong> prairies, <strong>les</strong> moissons, <strong>les</strong> branches<br />
en mouvement <strong>de</strong> travelling sans insistance lors du<br />
retour d’Adrienne, et le Léman jamais rendu mieux qu’ici<br />
(en exceptant Godard). A l’enjolivement qui précipiterait ce<br />
conte, immanquablement, du côté du pittoresque naturaliste,<br />
il préfère l’insaisissable allusivité d’un <strong>fr</strong>émissement<br />
<strong>de</strong> lumière ou d’un geste à peine indiqué …<br />
Freddy Buache dans « Michel Soutter »<br />
Cinémathèque suisse / L’Âge d’Homme 2001
§<br />
C.F. Ramuz (Adam et Ève)<br />
Ah ! C’est que nous sommes d’avant la faute, nous autres, par notre seule volonté. La malédiction pèse<br />
sur ceux qui y croient. Il voyait que ceux-ci se condamnent eux-mêmes (et pas nous), puis recommençait<br />
à creuser ses trous, levant le pic, enfonçant d’un coup <strong>de</strong> semelle dans l’herbe haute la pelle<br />
plate. Il voyait que nous sommes nos propres maîtres ; c’est nous qui créons la réalité. Nous autres,<br />
on se fait notre vie ; on se la fait comme on l’entend. Gran<strong>de</strong> ou petite, claire ou sombre, belle ou<br />
triste, - vous allez voir, c’est un travail. Alors il fait bon travailler, parce qu’on a besoin <strong>de</strong> dépenser<br />
sa force et <strong>de</strong> la faire servir à quelque chose, c’est-à-dire <strong>de</strong> transformer, c’est-à-dire d’amener ce qui<br />
vous entoure à être à votre ressemblance, - vous allez voir ...<br />
LA PRESSE<br />
Cette fidélité à l’esprit <strong>de</strong> Ramuz<br />
dont l’œuvre a pu être qualifiée à<br />
juste titre <strong>de</strong> « ru<strong>de</strong> et inquiète », était<br />
le plus difficile <strong>de</strong>s paris engagés<br />
par Michel Soutter, qui connaît bien<br />
l’écrivain vaudois. Beaucoup <strong>de</strong> ses<br />
récits ont été adaptés à l’écran, mais<br />
la plupart comportaient un élément<br />
spectaculaire, le plus souvent une<br />
catastrophe en montagne, qui servait<br />
<strong>les</strong> impératifs <strong>de</strong> la mise en scène.<br />
Rien <strong>de</strong> tel dans adam et ève,<br />
où seuls <strong>les</strong> personnages sont<br />
titanesques. Michel Soutter a filmé<br />
au ras du lac <strong>de</strong> Genève, enveloppé<br />
d’un brouillard qui semble cacher<br />
l’au-<strong>de</strong>là, et est parvenu à créer<br />
dans <strong>les</strong> quelques lieux où il situe<br />
l’action, bien qu’ils soient extérieurs,<br />
l’impression tragique d’un huis clos.<br />
<strong>Pour</strong>tant, <strong>de</strong> <strong>cette</strong> œuvre<br />
refermée sur elle-même, <strong>de</strong><br />
ce naturalisme brutal, <strong>de</strong> ces<br />
dialogues délicieusement empreints<br />
d’helvétisme, le réalisateur a<br />
BIO<br />
tiré, dans un esprit parfaitement<br />
ramuzien, un conte moral, voire<br />
métaphysique. trouver, comme<br />
William Blake, « l’univers dans un<br />
brin d’herbe » est le privilège <strong>de</strong>s<br />
poètes. Le reproche <strong>de</strong> régionalisme<br />
vaudois que l’on fit, sans peur du<br />
ridicule, à Ramuz, serait tout aussi<br />
déplacé ici.<br />
Les comédiens, dans cet esprit, font<br />
preuve <strong>de</strong> la même retenue. Jean-<br />
François Stevenin, Véronique Genest<br />
ou Roger Jendly (mais tous <strong>les</strong> autres<br />
seraient à citer) incarnent avec<br />
une sobriété « bressonienne », <strong>de</strong>s<br />
personnages marginaux, en butte à<br />
la vie, mais libres. « Puisqu’on n’est<br />
plus dans le jardin, remarque Lydie,<br />
le moins c’est qu’on ait la liberté ».<br />
Michel Soutter a fait une œuvre<br />
traversée d’inquiétu<strong>de</strong>s, que Ramuz<br />
résuma lui-même : « Est-ce que soimême<br />
on est mal fait, ou bien est-ce<br />
que c’est le mon<strong>de</strong> qui est mal fait ? »<br />
Sommes-nous, comme le prétend<br />
Gourdou, « condamnés à faire puis à<br />
défaire, jusqu’à ce que nous soyons<br />
nous-mêmes défaits ? »<br />
MICHEL SOUTTER<br />
(GEnèvE, 1932 – 1991)<br />
adam et ève n’est pas, on l’aura<br />
compris, un film « facile » mais<br />
contemplatif. on y retrouve <strong>les</strong><br />
thèmes qui obsédaient Ramuz : la<br />
solitu<strong>de</strong>, le sentiment <strong>de</strong> culpabilité,<br />
l’impossibilité d’être heureux. Mais<br />
il ne s’en dégage aucun ennui, car<br />
le mystère et l’attente retiennent<br />
l’attention. La lenteur <strong>de</strong>s plans<br />
appelle la réflexion. La simplicité et<br />
l’universalité <strong>de</strong> l’histoire en font la<br />
force. on ne dira pas si « Eve » revient<br />
au foyer et si « adam » retrouve<br />
son paradis perdu. En tout cas, il<br />
croit bon <strong>de</strong> clore son jardin, « pour<br />
l’empêcher <strong>de</strong> sortir quand elle<br />
sera là ». Il va, pour la première fois,<br />
contre l’ordre naturel <strong>de</strong>s choses.<br />
Le dénouement est inattendu.<br />
Suggérons simplement que Ramuz<br />
aurait pu conclure son œuvre sur<br />
<strong>cette</strong> autre citation <strong>de</strong> Nietzsche,<br />
qu’il releva dans ses carnets :<br />
« Prendre sur soi, non pas la punition,<br />
mais la faute, c’est cela qui serait<br />
véritablement divin ».<br />
François Montpezat (Le Mon<strong>de</strong>)<br />
michel soutter est le cinéaste ayant contribué à la renommée du<br />
cinéma suisse <strong>fr</strong>ancophone <strong>de</strong>s débuts aux côtés d’alain tanner<br />
et <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Goretta. ses premiers films réalisés avec peu <strong>de</strong><br />
moyens ont <strong>fr</strong>appé par leur originalité et une forme d’humour<br />
très personnelle, en particulier Les Arpenteurs (1972). il put<br />
ainsi tourner en coproduction avec la <strong>fr</strong>ance <strong>de</strong>s comédies<br />
où cohabitent sensualité, détachement, émotion et ironie :<br />
L’Escapa<strong>de</strong>, Repérages, L’Amour <strong>de</strong>s femmes, Adam et Ève,<br />
Signé Renart.<br />
michel soutter est venu à pontarlier présenter ses films en mars<br />
1990 lors <strong>de</strong> la 35 e rencontre internationale <strong>de</strong> Cinéma<br />
Filmographie : mick et arthur (1965), La lune avec <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>nts (1966), La pomme (1969), James ou pas (1970), Les<br />
arpenteurs (1972), L’Escapa<strong>de</strong> (1974), repérages (1977),<br />
L’amour <strong>de</strong>s femmes (1982), adam et ève (1983), signé renart<br />
(1984), Condorcet (1989)<br />
adam<br />
et<br />
ève<br />
37
38<br />
« Il a été le premier<br />
écrivain qui nous<br />
permette d’aller<br />
dans la nature,<br />
à l’époque où tout<br />
le mon<strong>de</strong> filmait<br />
son coin <strong>de</strong> rue.»
En compétition internationale à Cannes en 1985<br />
César du meilleur film <strong>fr</strong>ancophone, France 1986<br />
Scénario : Francis Reusser, Christiane Grimm,<br />
Jacques Baynac<br />
Image : Emmanuel Machuel<br />
Décors : Jean-Marc Stehle<br />
Costumes : Geneviève Joliat, Lysiane Guerrier,<br />
Rose Mary Melka<br />
Son : François Musy, Bernard Leroux<br />
Montage : Francis Reusser, Christine Benoît<br />
Script : Françoise Thouvenot<br />
Musique : Maria Carta<br />
Interprètes<br />
Isabel Otéro (Thérèse)<br />
Jacques Penot (Antoine)<br />
Maria Machado (Aline)<br />
Jean-Marc Bory (Nendaz)<br />
Bruno Cremer (Séraphin)<br />
Jean-Pierre Sentier (Plan)<br />
Jean-Noël Broute (Drozet)<br />
Teco Celio (Biolla)<br />
André Steiger (Loutre)<br />
Eric Imseng (Justin)<br />
Nersès Boyadjian (Carrupt)<br />
François Berthet (Udry)<br />
Michèle Foucher (Marie)<br />
Armen Go<strong>de</strong>l (Le curé)<br />
Christian Mayor (Ferdinand)<br />
DERBORENCE<br />
Suisse / France, 1985, 94 mn<br />
Tournage : du 13 août au 15 octobre 1984,<br />
Derborence, Evolène, mayens <strong>de</strong> la Forclaz,<br />
<strong>les</strong> Haudères, le Rawyl (scène <strong>de</strong> l’éboulement),<br />
Val d’Hérens.<br />
Sortie : 27 avril 1985<br />
Derborence, le mot chante doux ; il<br />
vous chante doux et un peu triste<br />
dans la tête. Il commence assez dur<br />
et marqué, puis hésite et retombe,<br />
pendant qu’on se le chante encore,<br />
Derborence, et finit à vi<strong>de</strong>, comme s’il<br />
voulait signifier par là la ruine, l’isolement,<br />
l’oubli.<br />
FRANCIS REUSSER<br />
d’après le roman <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz, « Derborence » paru en 1934 (<strong>édition</strong>s grasset et Fasquelle)<br />
C.- F. Ramuz (Derborence)<br />
A Derborence, au XVIII e siècle, la montagne<br />
s’écroule, ensevelissant sous d’énormes blocs<br />
<strong>de</strong> rochers un groupe <strong>de</strong> chalets. Antoine<br />
Pont, un berger miraculeusement épargné par<br />
le cataclysme, réussit à remonter à l’air libre<br />
après plusieurs semaines d’efforts. Au moment<br />
<strong>de</strong> l’éboulement, Antoine parlait au coin du<br />
feu avec le vieux Séraphin, tout en réalisant<br />
qu’il l’aimait comme un père. Lorsqu’ Antoine<br />
re<strong>de</strong>scend au village, en haillons, amaigri et<br />
méconnaissable, <strong>les</strong> habitants le prennent<br />
d’abord pour un revenant, puis l’accueillent et<br />
le réintègrent dans la communauté. Mais lui,<br />
ne pouvant oublier Séraphin resté sous <strong>les</strong> pierres,<br />
n’a qu’une obsession : aller sous le chaos<br />
d’éboulis afin <strong>de</strong> le sauver. Il perd la raison et<br />
repart seul vers le lieu du drame. Thérèse, sa<br />
femme enceinte, l’y suit.<br />
<strong>de</strong>r<br />
bo<br />
ren<br />
ce<br />
39
40<br />
La coutume <strong>de</strong>s gens d’Aïre est <strong>de</strong> monter<br />
avec leurs bêtes, vers le quinze juin, dans <strong>les</strong><br />
pâturages d’en haut, dont fait partie celui <strong>de</strong><br />
Derborence, où ils étaient justement, <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux,<br />
ce soir-là, Séraphin ayant pris Antoine avec<br />
lui pour le mettre au courant, parce que luimême<br />
commençait à se faire vieux. Il boitait,<br />
il avait une jambe rai<strong>de</strong>. Et, <strong>les</strong> rhumatismes<br />
s’étant portés <strong>de</strong>puis peu dans son épaule<br />
gauche, celle-ci commençait à lui refuser<br />
aussi ses services, d’où toute espèce d’inconvénients,<br />
vu que l’ouvrage n’attend guère dans<br />
ces chalets <strong>de</strong> la montagne où il faut traire <strong>les</strong><br />
bêtes <strong>de</strong>ux fois par jour et, chaque jour, faire<br />
le beurre ou le <strong>fr</strong>omage. Séraphin avait donc<br />
pris Antoine avec lui dans l’espoir qu’Antoine<br />
serait bientôt en mesure <strong>de</strong> le remplacer…<br />
Là-haut … la neige, en se retirant, faisait <strong>de</strong><br />
gros bourrelets ; ils découvraient sur leurs<br />
bords, dans l’humidité noire que la vieille<br />
herbe recouvrait mal d’une espèce <strong>de</strong> feutre<br />
terne, toute espèce <strong>de</strong> petites fleurs s’ouvrant<br />
à l’extrême limite d’une <strong>fr</strong>ange <strong>de</strong> glace plus<br />
mince que du verre à vitre. Toute espèce<br />
<strong>de</strong> petites fleurs <strong>de</strong> la montagne avec leur<br />
extraordinaire pureté, leurs extraordinaires<br />
couleurs : plus blanches que la neige, plus<br />
bleues que le ciel, ou orange vif, ou violettes<br />
: <strong>les</strong> crocus, <strong>les</strong> anémones, <strong>les</strong> primevères<br />
<strong>de</strong>s pharmaciens. El<strong>les</strong> faisaient <strong>de</strong> loin, entre<br />
<strong>les</strong> taches grises <strong>de</strong> la neige qui allaient se<br />
rétrécissant, <strong>de</strong>s taches éclatantes… Le vert<br />
éclatait <strong>de</strong> partout : c’est la sève qui repart,<br />
c’est l’herbe qui se montre à nouveau …<br />
Ah ! Derborence, tu étais belle, en ce temps-là,<br />
belle et plaisante et accueillante, te tenant<br />
prête dès le commencement <strong>de</strong> juin pour <strong>les</strong><br />
hommes qui allaient venir …<br />
Quand Derborence était encore habitée, c’està-dire<br />
avant que la montagne fût tombée.<br />
Mais à présent elle vient <strong>de</strong> tomber.<br />
C.- F. Ramuz (Derborence)<br />
;<br />
Les faits sont connus : le 23 septembre 1714, la montagne<br />
<strong>de</strong>s Diablerets s’écroulait, recouvrant sous une<br />
immense masse <strong>de</strong> rochers une partie <strong>de</strong>s alpages <strong>de</strong><br />
Derborence… Bergers, bétail et mayens furent ensevelis<br />
sous l’énorme pierrier. Trente-cinq ans plus tard, en 1749,<br />
un nouvel éboulement donnait à la vallée son contour<br />
d’aujourd’hui.<br />
C’est la catastrophe <strong>de</strong> 1714 qui marqua <strong>les</strong> imaginations<br />
: le peuple y vit la main du diable, le moyen pour<br />
lui <strong>de</strong> se faire quelques âmes à bon compte. La région<br />
s’y prêtait. Le nom du massif ne témoigne-t-il pas d’une<br />
longue <strong>fr</strong>équentation <strong>de</strong>s puissances sataniques ? Comment<br />
résister aux charmes <strong>de</strong>s Diablerets ? Surtout si<br />
l’on a eu la chance d’entendre <strong>les</strong> diablotins rater pitoyablement<br />
leur cible, la Quille-du-Diable, et faire retentir le<br />
cirque <strong>de</strong> Derborence du gron<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s chutes <strong>de</strong> pierres.<br />
En 1714, le Valais coule <strong>de</strong>s jours paisib<strong>les</strong> sous la haute<br />
protection du prince-évêque François-Joseph.<br />
Seu<strong>les</strong> ombres au tableau : <strong>de</strong>ux catastrophes. L’incendie<br />
<strong>de</strong> Monthey, début juillet. Et, le 23 septembre, l’éboulement<br />
<strong>de</strong>s Diablerets.<br />
… Il faudra attendre près <strong>de</strong> trois quarts <strong>de</strong> siècle pour<br />
que l’un <strong>de</strong>s précurseurs du reportage dans ce pays, le<br />
doyen Bri<strong>de</strong>l, pasteur <strong>de</strong> Montreux, reprenne l’histoire <strong>de</strong><br />
la catastrophe et l’enrichisse d’un élément nouveau. Dans<br />
son « Excursion <strong>de</strong> Bex à Sion par le mont Anzeindaz en<br />
1789 », Bri<strong>de</strong>l rapporte le témoignage d’un rescapé, un<br />
homme du village d’Aven : « On fonda un service pour le<br />
repos <strong>de</strong> son âme, ses enfants furent déclarés orphelins<br />
et sa femme veuve. Trois mois après, la veille <strong>de</strong> Noël,<br />
il reparaît pâle, défait <strong>de</strong> maigreur, pouvant à peine se<br />
soutenir, <strong>les</strong> cheveux hérissés, couvert <strong>de</strong> quelques sa<strong>les</strong><br />
lambeaux, avec tout l’air et le costume d’un spectre. On<br />
lui ferme la porte <strong>de</strong> sa maison : tout le village s’épouvante<br />
; on court au curé pour le faire exorciser : mais enfin<br />
il parvient à leur persua<strong>de</strong>r qu’il est en vie ». …<br />
Extraits <strong>de</strong> l’article <strong>de</strong> Gérard Delaloye paru dans l’Hebdo, le 19 juillet<br />
1984
§<br />
… On entendait s’écrouler <strong>les</strong> baquets à <strong>fr</strong>omage, on entendait<br />
<strong>les</strong> bancs tomber à terre ; <strong>les</strong> portes étaient secouées comme<br />
si on <strong>les</strong> avait prises à <strong>de</strong>ux mains. En même temps ça bouge<br />
et ça gron<strong>de</strong> ; en même temps ça craque, en même temps ça<br />
siffle ; ça se passait à la fois dans <strong>les</strong> airs, à la surface <strong>de</strong> la<br />
terre, dans une confusion <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> éléments où on ne distinguait<br />
plus ce qui était bruit <strong>de</strong> ce qui était mouvement, ni<br />
ce que ces bruits signifiaient, ni d’où ils venaient, ni où ils<br />
allaient, comme si c’eût été la fin du mon<strong>de</strong> …<br />
C. F. Ramuz (Derborence)<br />
ENTRETIEN AVEC FRANCIS REUSSER<br />
ExTRAITS D’UN ENTRETIEN DE FRANCIS REUSSER AVEC FREDDY BUACHE (LAUSANNE, 28 FéVRIER 1985)<br />
Freddy Buache : Après SEULS (1980-1981),<br />
film très proche <strong>de</strong> toi, nourri d’autobiographie,<br />
tu choisis d’adapter un roman <strong>de</strong> C. F. Ramuz<br />
qui date <strong>de</strong> 1934. <strong>Pour</strong>quoi ?<br />
Francis Reusser : Nous pourrions, curieusement,<br />
pour répondre à ta question, revenir à notre<br />
dialogue <strong>de</strong> l’époque, à propos <strong>de</strong> SEULS. Je te<br />
disais qu’un léger fil, je crois, relie mes films,<br />
que la fin <strong>de</strong> l’un, toujours, entraîne le début <strong>de</strong><br />
l’autre. Et j’ai le sentiment que moi, l’orphelin, je<br />
n’ai cessé, je ne cesse <strong>de</strong> travailler sur l’image du<br />
père, y compris dans LE GRAND SOIR, si l’on admet<br />
que le groupe politique était un substitut <strong>de</strong> la<br />
famille. Tout cela ne cesse <strong>de</strong> bouger en moi, donc<br />
doit passer dans mes films. Disons que le cinéma<br />
constitue l’endroit où je peux parler, transférer et<br />
comprendre. Ecrire pour tourner, m’impliquer à<br />
tous <strong>les</strong> sta<strong>de</strong>s d’un tournage, c’est ma façon <strong>de</strong><br />
conduire ma psychanalyse. Je commence à saisir<br />
clairement ce mouvement <strong>de</strong> ma subjectivité.<br />
… J’ajoute qu’un autre fil se déroule en même<br />
temps : le rapport au territoire, « <strong>les</strong> lieux ».<br />
En effet, dans SEULS, nous avons la présence<br />
enveloppante du lac … et, déjà, la montagne…<br />
Celle <strong>de</strong> Ramuz n’est donc pas loin.<br />
Francis Reusser : Ramuz, en ce point très précis,<br />
n’y est peut-être pas pour grand’chose. Je le<br />
connaissais mal. Or, lorsque nous avons terminé<br />
le tournage <strong>de</strong> SEULS, au Pas <strong>de</strong> Cheville, nous<br />
sommes logiquement <strong>de</strong>scendus à Derborence.<br />
Et là, fatigués, nous avons choisi d’y rester, avec<br />
Christiane et Jean, notre enfant qui n’avait pas<br />
encore un an. Dans la bibliothèque du chalet, j’ai<br />
trouvé le roman <strong>de</strong> Ramuz. Je l’ai lu, parce que<br />
Derborence me semblait être un lieu magique.<br />
Dans mon enfance, à Bex, j’en avais souvent<br />
entendu parler comme d’un endroit mythique.<br />
Ramuz et son livre, par conséquent, m’attiraient<br />
moins que ce qui, dans <strong>cette</strong> histoire, court entre<br />
<strong>les</strong> lignes… on retombait là sur ce que j’appelle<br />
l’ambivalence <strong>de</strong>s pères et <strong>de</strong>s mères. Ça m’a<br />
beaucoup touché. En outre, comme nous étions<br />
sur place, la menace <strong>de</strong> l’éboulement <strong>de</strong>meurait<br />
présente. Nous avions la trouille, quand, la nuit,<br />
le tonnerre craquait. Une sorte <strong>de</strong> symbiose<br />
pouvait s’accomplir : je vivais ou m’apprêtais à<br />
vivre ce que je lisais. J’ai commencé <strong>de</strong> filmer la<br />
montagne en super 8. Nous étions comme Thérèse<br />
et Antoine, sauf que j’avais l’enfant sur le dos.<br />
Je me suis dit : ne perdons pas une secon<strong>de</strong>, je<br />
dois filmer ça. Bien sûr, je voyais toujours dans ce<br />
roman <strong>cette</strong> sorte <strong>de</strong> double paternité, <strong>de</strong> double<br />
naissance <strong>de</strong> l’enfant dans <strong>les</strong> pierres, et vers ce<br />
moment-là, j’appris que mes parents s’étaient<br />
beaucoup aimés à la montagne.<br />
Voici la production qui, lentement, se met en place,<br />
et tu choisis <strong>de</strong> tourner à Derborence, bien sûr, mais<br />
aussi <strong>de</strong> l’autre côté <strong>de</strong> la vallée, à Evolène, aux<br />
Haudères, aux mayens qui dominent La Forclaz,<br />
créant <strong>de</strong> la sorte une géographie imaginaire, datant<br />
l’action à une époque indéterminée, bannissant<br />
le folklore local afin <strong>de</strong> recréer sur l’écran l’unité<br />
poétique <strong>de</strong> <strong>cette</strong> action et <strong>de</strong> son ancrage dans<br />
une réalité définie.<br />
Francis Reusser : Il n’y avait pas la moindre<br />
raison d’être infidèle à la métho<strong>de</strong> qui fut celle<br />
<strong>de</strong> Ramuz. La seule infidélité qu’on peut lui faire,<br />
c’est <strong>de</strong> l’obliger à dire ce qu’il nous cache<br />
dans son texte. Il y développe, lui aussi, une<br />
géographie imaginaire ; il a mélangé <strong>de</strong>s lieux, <strong>de</strong>r<br />
bo<br />
écrivant <strong>de</strong> toute évi<strong>de</strong>nce chez lui. Mermod, ren<br />
son éditeur, a dit que Ramuz n’est allé qu’une ce<br />
41
42<br />
fois à Derborence, en 1937, trois ans après la<br />
publication du livre. Il ne s’est pas appuyé sur<br />
<strong>de</strong>s souvenirs. A partir <strong>de</strong> l’événement, tiré d’une<br />
chronique, il inventa. Nous <strong>de</strong>vions procé<strong>de</strong>r<br />
comme lui, recréer un village, une région, en<br />
prenant <strong>de</strong>s éléments par ci, par là, tout en<br />
conservant le lieu d’origine, Derborence, comme<br />
point central : pas question <strong>de</strong> déplacer la<br />
montagne, l’éboulis, le lac … Autour, nous avons<br />
recomposé <strong>de</strong>s parcours en prenant ce qui nous<br />
convenait le mieux dans <strong>les</strong> paysages, <strong>les</strong> villages,<br />
<strong>les</strong> habitations. <strong>Pour</strong> la datation, c’est pareil.<br />
J’ai lu « DERBORENCE » en 1981 et c’est mon<br />
rapport au livre à ce moment-là qui déclencha<br />
mon envie <strong>de</strong> réaliser ce film. J’ai longtemps<br />
cherché le moyen d’inscrire ce récit dans un<br />
moment <strong>de</strong> la mémoire, même si tout ce qui s’y<br />
joue est éternel : <strong>les</strong> hommes fuient quand leur<br />
compagne est enceinte, <strong>les</strong> femmes ont peur<br />
<strong>de</strong> dire qu’el<strong>les</strong> sont enceintes parce qu’el<strong>les</strong><br />
risquent <strong>de</strong> perdre l’homme qu’el<strong>les</strong> aiment,<br />
l’enfant qui est dans le ventre prend la place<br />
<strong>de</strong> l’autre. J’ai voulu dire comment cela nous<br />
intéresse aujourd’hui. Puis j’ai pensé qu’une<br />
telle actualisation n’ajouterait rien. Mais allaisje<br />
me retrouver à tourner un film en costumes ?<br />
A rechercher une authenticité <strong>de</strong> surface qui<br />
m’enfermerait dans <strong>les</strong> illusions séduisantes<br />
<strong>de</strong> la couleur locale ? J’ai refusé le problème,<br />
optant pour une vérité parabolique, notant <strong>les</strong><br />
détails véridiques dans le son, l’encadrement, <strong>les</strong><br />
gestes, une typologie. Le début et la fin situent<br />
l’action dans la mémoire, ce qui est conforme à<br />
Ramuz. Sa première et sa <strong>de</strong>rnière page évoquent<br />
effectivement la réminiscence : c’était il y a <strong>de</strong>ux<br />
cents ans à peu près, et la vallée est retombée<br />
dans le <strong>fr</strong>oid et la mort. C’est ça que nous avons<br />
filmé, aujourd’hui.<br />
Pas <strong>de</strong> naturalisme, mais la transfiguration d’une<br />
réalité <strong>de</strong>meurant totalement elle-même en<br />
<strong>de</strong>venant totalement autre dans la poésie.<br />
Francis Reusser : Ramuz est pour moi plus notre<br />
Beckett que notre Giono ; cynique, pessimiste,<br />
cruel, misogyne… mais il a vu juste. Il a su<br />
finement analyser <strong>les</strong> rapports <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s<br />
femmes, le surgissement <strong>de</strong> l’amour et <strong>de</strong> l’enfant.<br />
Dans le roman, pas un objet n’est décrit, pas <strong>de</strong><br />
notations ethnographiques : <strong>les</strong> femmes sont dans<br />
<strong>les</strong> champs et s’il indique cela, c’est uniquement<br />
pour parler <strong>de</strong> la solitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Thérèse. Il donne,<br />
à la fin, <strong>cette</strong> précision : « c’était il y a <strong>de</strong>ux<br />
cents ans à peu près » … Moi, quand je lisais, je<br />
croyais que la catastrophe datait <strong>de</strong>s années 20<br />
ou 30... C’est juste, par conséquent, <strong>de</strong> conserver<br />
l’imprécision. Rien ne la contredit à l’écran, rien,<br />
sauf la lumière.<br />
La lumière fut un sujet <strong>de</strong> controverse avec<br />
l’opérateur, <strong>les</strong> décorateurs. Fallait-il éclairer<br />
à la bougie, à la lampe à pétrole ? Nous avons<br />
répondu : Non ! Fausse question. Nous avons<br />
mis <strong>de</strong>s bougies, <strong>de</strong>s lampes à pétrole vieil<strong>les</strong> ou<br />
pas vieil<strong>les</strong> quand cela nous paraissait normal,
et au bistrot, il y a <strong>de</strong>s ampou<strong>les</strong> électriques. Le<br />
spectateur ne <strong>de</strong>vrait pas <strong>les</strong> percevoir comme <strong>de</strong>s<br />
anachronismes, plutôt comme <strong>de</strong>s compléments<br />
qui ne datent pas un moment, qui traversent le<br />
temps parce que nous avons toujours été, dans<br />
chaque situation, respectueux <strong>de</strong>s choses prises<br />
sur place (et pas chez <strong>les</strong> antiquaires!) pour <strong>les</strong><br />
réorganiser avec sensibilité. Nous avons procédé<br />
<strong>de</strong> la même manière avec <strong>les</strong> bruits authentiques<br />
intégrés à la poétique du son …<br />
Au Festival <strong>de</strong> Berlin, d’où je reviens, le naturalisme<br />
facile qui se manifeste partout me <strong>fr</strong>appa. La TV,<br />
productrice, dicte un tel style, même lorsqu’elle<br />
prétend laisser la liberté …<br />
Francis Reusser : Nous avons désiré violemment<br />
résister à cet abâtardissement <strong>de</strong>s images ;<br />
d’où l’écran large (format idéal <strong>de</strong>s Américains<br />
filmant <strong>les</strong> plaines), pour tenter d’exprimer, nous,<br />
la verticalité <strong>de</strong> la montagne ! Cette organisation<br />
d’un espace ouvert à l’horizontale m’a révélé vite<br />
l’importance du déplacement <strong>de</strong>s interprètes.<br />
J’ai mis l’accent sur eux. N’est-ce pas judicieux<br />
d’élargir l’horizon lorsque chacun doit le rétrécir ?<br />
Et le dolby s’imposait … Ramuz est l’homme d’un<br />
cinéma non-parlant, peut-être, mais richement<br />
sonore. Nous avons eu recours au texte et non à<br />
notre imagination pour établir la partition, la<br />
ponctuer d’un son <strong>de</strong> cloche, d’un char qui passe<br />
au loin.<br />
LA PRESSE<br />
La première fois que Francis Reusser<br />
lit Ramuz, à 40 ans révolus,<br />
c’est par hasard et par élimination.<br />
Sur l’étagère du chalet <strong>de</strong><br />
Derborence où séjourne le cinéaste<br />
ne traînent que <strong>de</strong>ux ouvrages :<br />
Le livre du soldat et <strong>de</strong>rborence.<br />
Le choix est vite fait. Reusser<br />
trouve dans le texte <strong>de</strong>s réponses<br />
aux questions qu’il se pose sur<br />
la paternité, le rapport hommesfemmes.<br />
C’est une «vraie rencontre».<br />
L’année suivante, le cinéaste porte<br />
à l’écran <strong>de</strong>rborence, qui lui vaut<br />
le César du meilleur film étranger...<br />
«Nous, <strong>les</strong> enfants du western,<br />
trouvons un souffle épique chez<br />
Ramuz. Il a été le premier écrivain<br />
qui nous permette d’aller dans<br />
la nature, à l’époque où tout<br />
le mon<strong>de</strong> filmait son coin <strong>de</strong> rue.»<br />
Extraits <strong>de</strong> l’article d’Antoine Duplan<br />
paru dans l’Hebdo, le 13 avril 2000<br />
Cette histoire, qui prend place dans<br />
un paysage majestueux, lui donne<br />
l’occasion « d’exprimer la jouissance<br />
<strong>de</strong>s lieux, la jouissance du territoire »<br />
et <strong>de</strong> se libérer d’« une certaine<br />
mauvaise conscience » face<br />
à la nature helvétique.<br />
Si l’écriture du roman est<br />
très travaillée, Reusser trouve en<br />
revanche que <strong>les</strong> personnages…<br />
« sont <strong>de</strong>s traces, <strong>de</strong>s emblèmes,<br />
presque <strong>de</strong>s signes purs.<br />
D’où la nécessité d’induire du roman<br />
certaines tensions. ainsi toute<br />
la recherche du père par l’orphelin<br />
antoine a-t-elle été ajoutée pour<br />
expliquer son acharnement à vouloir<br />
retourner vers la montagne ».<br />
Ce travail ne concerne pas<br />
<strong>les</strong> dialogues qui sont, à quelques<br />
retouches et coupures près,<br />
ceux <strong>de</strong> Ramuz.<br />
Le réalisateur se met ensuite en<br />
quête <strong>de</strong>s acteurs et <strong>de</strong>s figurants.<br />
une centaine d’habitants <strong>de</strong><br />
la région répon<strong>de</strong>nt à son appel.<br />
Il réunit enfin une équipe technique<br />
<strong>de</strong> vingt-cinq personnes.<br />
Durant toute la durée du tournage,<br />
Et la musique ?<br />
Francis Reusser : Il y a déjà une voix, celle<br />
<strong>de</strong> Maria Carta, puis un parti pris pour lutter,<br />
là aussi, contre le naturalisme : un mélange<br />
<strong>de</strong> musiques d’origines diverses, choisies<br />
uniquement pour leur pouvoir émotionnel.<br />
Cela risque <strong>de</strong> soulever <strong>de</strong>s polémiques.<br />
Les Valaisans n’y reconnaîtront pas leur folklore,<br />
mais en-<strong>de</strong>ssous ils <strong>de</strong>vraient sentir leur propre<br />
intériorité. Je n’ai su qu’exprimer ma singularité<br />
dans un milieu retranscrit fidèlement avec<br />
amour ; et transcendé par l’amour.<br />
il bénéficie <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’armée :<br />
transport <strong>de</strong> matériel par hélicoptère,<br />
prêt <strong>de</strong> l’intendance <strong>de</strong> cuisine,<br />
tentes militaires, appareils<br />
<strong>de</strong> communication et figuration<br />
<strong>de</strong> soldats. La scène la plus difficile<br />
à tourner, celle <strong>de</strong> l’éboulement,<br />
doit être reproduite en studio pour<br />
<strong>les</strong> vues généra<strong>les</strong>, avec maquette<br />
et effets spéciaux en transparence.<br />
Neuf semaines sont nécessaires pour<br />
le tournage du film, réalisé en Scope<br />
et Dolby. La rencontre du réalisateur<br />
avec le producteur Jean-Marc<br />
Henchoz a été déterminante pour<br />
l’élaboration du projet :<br />
« Je n’ai jamais autant travaillé<br />
sur un film, jamais autant cherché<br />
la qualité. Le cinéma, c’est entretenir<br />
une relation avec un producteur.<br />
y compris violences, débats,<br />
polémiques » disait Reusser<br />
au magazine L’Hebdo en 1985.<br />
Histoire du cinéma suisse 1966-2000<br />
(sous la direction d’Hervé Dumont<br />
et <strong>de</strong> Maria Tortajada)<br />
<strong>de</strong>r<br />
bo<br />
ren<br />
ce<br />
43
44<br />
§ §<br />
une journée<br />
avec Reusser<br />
C’était le printemps, c’était hier, c’était la première fois que je rencontrais Francis<br />
Reusser, à l’occasion <strong>de</strong> la sortie <strong>de</strong> DeRboRence. Il y avait quelque chose<br />
<strong>de</strong> joyeux dans l’air, une excitation, pas le Grand Soir, non, plutôt le Matin<br />
du Mon<strong>de</strong>, c’était la gran<strong>de</strong> réconciliation <strong>de</strong> Ramuz et du cinéma d’auteur<br />
suisse marqué à gauche, comme le rêve <strong>de</strong> pouvoir faire <strong>de</strong>s westerns à notre<br />
manière. Il y avait <strong>de</strong>s len<strong>de</strong>mains qui chantent dans l’air…<br />
C’était hier, c’était il y a vingt et un ans… Ce printemps appartient à l’Histoire<br />
désormais, et nous aussi. Ramuz est entré dans la Pléïa<strong>de</strong>, DeRboRence <strong>de</strong><br />
Reusser figure dans un cof<strong>fr</strong>et DVD avec six autres films adaptés <strong>de</strong> l’œuvre du<br />
romancier vaudois. <strong>Pour</strong> parler <strong>de</strong> ce Ramuz cinéma, je suis allé trouver Francis<br />
Reusser à Bex où il habite.<br />
Il m’attendait sur le quai <strong>de</strong> la gare. Ses cheveux sont blancs à présent, mais il<br />
a gardé son œil d’aigle, et sa facon<strong>de</strong>, et sa faculté à s’indigner, et à s’enthousiasmer...<br />
Nous sommes allés sur <strong>les</strong> hauts <strong>de</strong> la ville où il rési<strong>de</strong>. Nous avons<br />
bu un café, flatté son chat, regardé VaGabonDaGes, la méditation filmée qui<br />
sert <strong>de</strong> bonus au cof<strong>fr</strong>et. Nous nous sommes installés sur la terrasse pour<br />
parler <strong>de</strong> sa rencontre avec Ramuz, <strong>de</strong> leur «parcours croisé».<br />
L’herbe était verte, comme la brume qui montait <strong>de</strong> la vallée, et <strong>les</strong> Dentsdu-Midi<br />
d’une blancheur éclatante. Le printemps faisait chanter ses premiers<br />
forsythias, ses primevères, ses pâquerettes et affolait <strong>les</strong> oiseaux.<br />
Et puis nous avons roulé à travers Bex, admirant ces maisonnettes biscornues<br />
témoignant <strong>de</strong> l’architecture bernoise. Reusser m’a montré la maison <strong>de</strong><br />
son enfance. Nous nous sommes arrêtés à l’Auberge du Bouillet, un restaurant<br />
situé à l’écart du mon<strong>de</strong>, au bout <strong>de</strong> la Route <strong>de</strong>s Mines <strong>de</strong> Sel...<br />
Nous avons déjeuné sur la terrasse en contrebas <strong>de</strong> la falaise sur laquelle se<br />
ganguillent <strong>les</strong> chamois venus lécher le sel qui affleure. C’était le premier jour<br />
du printemps, le premier jour où l’on peut s’asseoir <strong>de</strong>hors. La sala<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts<strong>de</strong>-lion<br />
avait la <strong>fr</strong>aîcheur du talus, juste <strong>de</strong>rrière.<br />
Nous avons parlé, beaucoup parlé. De cinéma. De comédiens. D’Isabel Otero,<br />
si lumineuse dans DeRboRence... Du Val d’Hérens. De Derborence. De l’enfance.<br />
D’Anzeindaz... Nous avons plongé dans la mémoire <strong>de</strong> la culture et du<br />
pays. Une classe enfantine a traversé le pré, au-<strong>de</strong>ssus, la maîtresse nous a fait<br />
bonjour <strong>de</strong> la main, comme sur <strong>les</strong> vieil<strong>les</strong> affiches que <strong>les</strong> Offices du Tourisme<br />
punaisaient dans <strong>les</strong> gares.<br />
Nous étions là… revenus du Grand Soir... heureux d’être en vie. Vieux, sans<br />
doute pas. Assagis, pas vraiment… En tout cas, en harmonie avec le paysage,<br />
<strong>les</strong> gens, l’histoire, la nature…<br />
Je pensais aux photos que Gustave Roud faisait <strong>de</strong> Ramuz, créateur ombrageux<br />
arpentant le Lavaux drapé dans sa cape, clope aux lèvres, assis sur un<br />
muret <strong>de</strong> pierre, face au Léman immense, sombre silhouette dans la lumière<br />
solaire. Un simple cliché qui fon<strong>de</strong> une mythologie. Et nous <strong>de</strong>ux, toutes proportions<br />
gardée, et Thierry Lang aussi qui scrutait à présent la falaise avec <strong>de</strong>s<br />
jumel<strong>les</strong>, nous étions là, vivants, témoins <strong>de</strong> notre temps, <strong>de</strong> notre patrimoine<br />
culture, <strong>de</strong> notre région. Plus tard, un <strong>de</strong>s gosses qui traversait le pré dira peutêtre<br />
« Quand j’étais petit, j’ai vu le cinéaste Reusser sur <strong>cette</strong> terrasse »…<br />
En ces moments où l’amitié fait entendre une musique enivrante, je me dis la<br />
lumière qui nous accompagne lorsque nous sommes avec un cinéaste, c’est<br />
encore la lumière du cinéma, et <strong>les</strong> mots pour dire <strong>cette</strong> lumière, ici, chez nous,<br />
c’est encore <strong>les</strong> mots <strong>de</strong> Ramuz.<br />
Antoine Duplan, 12 avril 2006<br />
Derborence, le mot chante<br />
triste et doux dans la tête<br />
pendant qu’on se penche sur<br />
le vi<strong>de</strong>, où il n’y a plus rien, et<br />
on voit qu’il n’y a plus rien.<br />
C’est l’hiver au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong><br />
vous, c’est la morte-saison<br />
tout le long <strong>de</strong> l’année. Et si<br />
loin que le regard porte, il n’y<br />
a plus que <strong>de</strong>s pierres et toujours<br />
<strong>de</strong>s pierres.<br />
Depuis <strong>de</strong>ux cents ans à peu<br />
près.<br />
Seul, quelquefois, un troupeau<br />
<strong>de</strong> moutons se montre dans<br />
ces solitu<strong>de</strong>s, à cause d’un peu<br />
d’herbe qui y pousse, là où la<br />
roche lui laisse la place <strong>de</strong><br />
percer ; il y erre longuement<br />
comme l’ombre d’un nuage.<br />
Il y fait un bruit comme celui<br />
d’une grosse averse quand il<br />
se déplace.<br />
Il fait, quand il broute, un<br />
bruit comme celui <strong>de</strong>s toutes<br />
petites vagues qui viennent,<br />
<strong>les</strong> soirs <strong>de</strong> beau temps, à<br />
coups rapi<strong>de</strong>s et rapprochés,<br />
heurter la rive.<br />
La mousse, d’un pinceau lent<br />
et minutieux, a peint en jaune<br />
vif, en gris sur gris, en toute<br />
sorte <strong>de</strong> verts, <strong>les</strong> plus gros<br />
<strong>de</strong>s quartiers <strong>de</strong> roc ; ils nourrissent<br />
dans leurs fissures<br />
plusieurs espèces <strong>de</strong> plantes<br />
et <strong>de</strong> buissons, airelle, myrtille,<br />
épine-vinette, aux feuil<strong>les</strong><br />
dures, aux <strong>fr</strong>uits ligneux, qui<br />
tintent dans le vent doucement<br />
comme <strong>de</strong>s clochettes.<br />
C.-F. Ramuz (Derborence, <strong>de</strong>rnière page)
BIO<br />
FRANCIS REUSSER<br />
né à vEvEy En 1942.<br />
formation à l’école <strong>de</strong> photographie <strong>de</strong> vevey<br />
& à la télévision suisse roman<strong>de</strong>. Création avec<br />
<strong>fr</strong>ançois albera <strong>de</strong> la section audio-visuelle <strong>de</strong> l’école<br />
supérieure <strong>de</strong>s arts visuels à Genève. réalisation<br />
<strong>de</strong> nombreux magazines tv. anime <strong>de</strong>puis 1999<br />
un atelier cinéma à l’école <strong>de</strong> théâtre <strong>de</strong>s teintureries<br />
à Lausanne.<br />
Courts métrages<br />
ANTOINE ET CLÉOPATRE 1964<br />
UN FILM EN CHANTIER 1974<br />
BLEU NUIT 1978<br />
avec le peintre Gérard thalman<br />
DOUCE NUIT 2001<br />
vidéo, blow-up 35mm.<br />
avec yan fuchs et nicole vautier. image :<br />
séverine Bar<strong>de</strong>. son : Christophe Giovannoni<br />
UNE FEMME BLESSÉE 2005<br />
fiction réalisée dans le cadre <strong>de</strong> l’atelier cinéma<br />
<strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> théâtre <strong>de</strong>s teintureries.<br />
Coproduction vps prod. tsr idée suisse<br />
Longs métrages<br />
QUATRE D’ENTRE ELLES 1965<br />
mention au festival <strong>de</strong> Locarno.<br />
VIVE LA MORT 1967<br />
Cannes, sélection <strong>de</strong> la Quinzaine <strong>de</strong>s réalisateurs.<br />
avec Edouard niermans, <strong>fr</strong>ançoise prouvost<br />
image: renato Berta.<br />
BILADI, UNE RÉVOLUTION 1971<br />
mention au festival <strong>de</strong> Locarno.<br />
LE GRAND SOIR 1976<br />
Léopard d’or du festival <strong>de</strong> Locarno,<br />
Grand prix du festival <strong>de</strong> Hyères.<br />
avec niels arestrup, Jacqueline parent<br />
image: renato Berta.<br />
SEULS 1981<br />
Cannes, sélection <strong>de</strong> la Quinzaine <strong>de</strong>s réalisateurs.<br />
avec niels arestrup, Christine Boisson, michael Lonsdale,<br />
Bulle ogier. image: renato Berta.<br />
DERBORENCE 1984<br />
Cannes, sélection officielle en compétition, César<br />
1985 du meilleur film <strong>fr</strong>ancophone.<br />
avec isabelle otero, Bruno Cremer, Jacques penot,<br />
image : Emmanuel machuel, son : <strong>fr</strong>ançois musy.<br />
LA LOI SAUVAGE 1987<br />
avec michel Constantin, Hélène Lapiower, Lucas Belvaux<br />
image : Emmanuel machuel, son : <strong>fr</strong>ançois musy.<br />
JACQUES & FRANÇOISE 1991<br />
avec Geneviève pasquier, <strong>fr</strong>ançois florey, roland amstutz<br />
image : Joel David, son : <strong>fr</strong>ançois musy<br />
PASSAGES DE LA RECHERCHE 1994<br />
Documentaire <strong>de</strong> création (artE, tsr) sélection<br />
festival <strong>de</strong> la tour Eiffel.<br />
LA GUERRE DANS LE HAUT PAYS 1998<br />
sélection suisse pour l’oscar 1999 du meilleur film<br />
étranger. sélection officielle en compétition Berlin<br />
1999. prix d’interprétation pour marion Cotillard,<br />
festival d’autrans 1999<br />
avec Laurent terzieff, marion Cotillard, antoine Basler,<br />
yann tregouët, <strong>fr</strong>ançois morel, <strong>fr</strong>ançois marthouret.<br />
HISTOIRES DE FÊTE 2000<br />
film à sketches<br />
4e acte: LA FILLE A LA CAMERA<br />
avec patrick Le mauff, Julien Basler, anne Christelle Demierre<br />
image : séverine Bar<strong>de</strong>, son : Christophe Giovannoni<br />
DOUCE NUIT 2001<br />
Court métrage vidéo, blow-up 35mm.<br />
avec yan fuchs et nicole vautier.<br />
image : séverine Bar<strong>de</strong>. son : Christophe Giovannoni<br />
LES PRINTEMPS DE NOTRE VIE 2002<br />
film documentaire<br />
1968-1981, Les années-lumière à Lausanne<br />
Une histoire personnelle du mouvement politique.<br />
festival <strong>de</strong> nyon 2003<br />
Prix LEENAARDS 2003<br />
prix <strong>de</strong> la fondation Leenaards accordé au cinéaste pour<br />
l’ensemble <strong>de</strong> son œuvre.<br />
RAMUZ CINÉMA 2005<br />
<strong>édition</strong> et restauration <strong>de</strong> sept films adaptés <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> C. f.<br />
ramuz en cof<strong>fr</strong>et DvD, en liaison avec<br />
l’<strong>édition</strong> pléia<strong>de</strong> / Gallimard <strong>de</strong>s œuvres complètes <strong>de</strong> l’écrivain.<br />
Court métrage inclus : vaGaBonDaGEs<br />
VOLTAIRE ET L’AFFAIRE CALAS 2006<br />
film <strong>de</strong> télévision - scénario alain moreau,<br />
avec Clau<strong>de</strong> rich et Barbara schulz<br />
production Bel ombre paris & point prod Genève<br />
Coproduction tsr - <strong>fr</strong>ance 2 - artE<br />
Projets en cours<br />
LA TRINITÉ 2010-2011<br />
film <strong>de</strong> fiction adapté du roman <strong>de</strong> Jacques Chessex.<br />
scénario Jean-Clau<strong>de</strong> Carrière & <strong>fr</strong>ancis reusser<br />
Coproduction tipimages Genève, Les films du triangle paris.<br />
MA NOUVELLE HÉLOÏSE<br />
(LA PASSION SELON JEAN-JACQUES)<br />
Long métrage <strong>de</strong> fiction - scénario <strong>fr</strong>ancis reusser<br />
& Gabriel Galice. soutenu par la ville <strong>de</strong> Genève<br />
dans le cadre du 300 e anniversaire <strong>de</strong> la naissance<br />
<strong>de</strong> l’écrivain.<br />
<strong>de</strong>r<br />
bo<br />
ren<br />
ce<br />
45
46<br />
« On dirait aujourd’hui que ce<br />
sont <strong>de</strong>s “paumés”. Ce qui est<br />
beau, c’est qu’il <strong>les</strong> a choisis<br />
chez <strong>les</strong> hommes <strong>de</strong> la terre.»
SI LE SOLEIL<br />
NE REVENAIT PAS<br />
Suisse/France, 1987, 120 mn<br />
Réalisation-Scénario : Clau<strong>de</strong> Goretta.<br />
Image : Bernard Zitzermann.<br />
Musique : Antoine Auberson.<br />
Son : Etienne Metrailler.<br />
Décors : Alex Ghassem, Lani Weber.<br />
Montage : Eliane Guignet.<br />
Production : Jean-Marc Henchoz,<br />
Alain Sar<strong>de</strong>, TSR Genève, Canal +.<br />
Interprètes :<br />
Char<strong>les</strong> Vanel (Anzévui),<br />
Catherine Mouchet (Isabelle Anti<strong>de</strong>),<br />
Philippe Léotard (Arlettaz),<br />
Raoul Billerey (Denis Revaz),<br />
Clau<strong>de</strong> Evrard (Follonier),<br />
Fred Ulysse (Tissières),<br />
Jacques Mathou (Cyprien Métrailler),<br />
Julien Verdier (Martin Métrailler).<br />
CLAUDE gORETTA<br />
d’après le roman <strong>de</strong> C.F. Ramuz, « Si le soleil ne revenait pas » (1937)<br />
Dans ce village alpestre, perdu au fond<br />
d’une vallée et privé <strong>de</strong> soleil plusieurs<br />
mois par année, le vieil Anzévui, prophète<br />
et sorcier, annonce la fin du mon<strong>de</strong>. D’après<br />
ses calculs, le soleil ne reviendra pas et le<br />
village s’enfoncera dans une nuit éternelle.<br />
La menace <strong>de</strong> mort va désormais peser<br />
sur <strong>cette</strong> communauté. Chacun réagit à<br />
sa manière : Arlettaz, abandonné par sa<br />
fille, vend à Follonier, l’opportuniste, ses<br />
<strong>de</strong>rniers champs à moitié prix et noie son<br />
chagrin dans l’alcool. Le conseiller Revaz<br />
entasse du bois jusque dans sa chambre<br />
à coucher. Seule Isabelle ne cè<strong>de</strong> pas à la<br />
panique. Elle réussit à convaincre ceux qui<br />
hésitent encore à lutter contre la fatalité.<br />
Le 13 avril, jour où le soleil revient chaque<br />
année au village, elle <strong>les</strong> entraîne à sa suite<br />
au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la couche <strong>de</strong> brouillard qui<br />
recouvre la vallée. A l’aube, le soleil est au<br />
ren<strong>de</strong>z-vous et Jean, le jeune beau-<strong>fr</strong>ère<br />
d’Isabelle, souffle dans sa corne <strong>de</strong> chevrier<br />
pour annoncer la lumière et la chaleur<br />
retrouvées.<br />
Séparés du mon<strong>de</strong> par l’hiver, ceux <strong>de</strong> Saint-<br />
Martin étaient séparés du soleil à cause <strong>de</strong><br />
la hauteur <strong>de</strong>s montagnes.<br />
Chaque année, le 25 octobre à l’heure <strong>de</strong><br />
midi, au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la crête qui est au sud,<br />
on apercevait encore une traînée <strong>de</strong> feu,<br />
comme une vague gerbe d’étincel<strong>les</strong>… et<br />
puis c’était fini pour six mois.<br />
47<br />
si<br />
le<br />
soleil<br />
ne<br />
revenait<br />
pas
48<br />
§<br />
« Car, même au gros <strong>de</strong> l’hiver, même dans ces villages où le soleil ne se montre pas<br />
<strong>de</strong> tout le jour, rien n’est plus beau à voir, d’ordinaire, que la pureté du ciel et l’éclat<br />
<strong>de</strong> la neige. Même ici où on ne voit pas le soleil pendant six mois, on le sent qui est<br />
là, <strong>de</strong>rrière <strong>les</strong> montagnes, et envoie en délégation ses couleurs, qui sont le rose pâle,<br />
le jaune clair, le roux, dont un pinceau minutieux revêt autour <strong>de</strong> vous <strong>les</strong> pentes.<br />
La neige sur <strong>les</strong> toits est comme du linge qu’on vient <strong>de</strong> passer au bleu ; elle est<br />
sur <strong>les</strong> côtés <strong>de</strong>s toits comme <strong>de</strong>s pi<strong>les</strong> <strong>de</strong> draps <strong>de</strong> lit pliés en quatre dont on voit<br />
<strong>les</strong> épaisseurs <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> débor<strong>de</strong>nt ; et la masse dépassant, <strong>de</strong> temps en temps, se<br />
rompt et tombe, avec un bruit d’écrasement, comme un <strong>fr</strong>uit mûr. La neige est à la<br />
pointe <strong>de</strong>s pieux comme <strong>de</strong>s bonnets en laine d’agneau. L’air est à la fois immobile<br />
et animé d’un mouvement secret ; il ne se respire pas, il se boit. »<br />
C.F. Ramuz
NoTE d’INTENTIoN<br />
« En 1965, lorsque la télévision suisse m’a proposé <strong>de</strong> réaliser un film d’après<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz, j’ai hésité entre Si L e S o L e i L n e r e v e n A i t pA S et<br />
Je A n-Lu c p e r S é c u t é. J’ai finalement choisi <strong>cette</strong> <strong>de</strong>rnière œuvre<br />
qui me paraissait plus simple à adapter pour un premier long métrage,<br />
avec une structure dramatique plus classique, plus linéaire.<br />
Je suis heureux <strong>de</strong> ce choix car aujourd’hui, avec le recul, Si L e S o L e i L<br />
n e r e v e n A i t pA S me paraît d’une actualité singulière. Présence <strong>de</strong> la mort<br />
sous toutes ses formes. Angoisse qui désagrège peu à peu la vie quotidienne :<br />
peur du cancer, peur du nucléaire, peur du chômage, solitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
vil<strong>les</strong>, pollution, agonie <strong>de</strong> la nature, peur <strong>de</strong> vieillir dans une société<br />
<strong>de</strong> performance.<br />
Toutes <strong>les</strong> manifestations <strong>de</strong> l’angoisse humaine me semblent être réunies<br />
dans ce roman allégorique <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz.<br />
Il y a ceux qui per<strong>de</strong>nt confiance dans la relation humaine, ceux qui ont<br />
peur <strong>de</strong> vivre et ceux qui, comme Isabelle, se dressent instinctivement contre<br />
le désespoir par simple amour <strong>de</strong> la vie.<br />
Nous vivons aujourd’hui dans un mon<strong>de</strong> perturbé et sombre. C’est pourquoi<br />
la fin optimiste <strong>de</strong> Si L e S o L e i L n e r e v e n A i t pA S , avant-<strong>de</strong>rnier roman<br />
<strong>de</strong> Char<strong>les</strong> Ferdinand Ramuz, me touche particulièrement, sensible<br />
au combat d’Isabelle, femme libre et solitaire qui défie la mort et qui,<br />
par son action spontanée, dénonce le désespoir stérile.<br />
Si L e S o L e i L n e r e v e n A i t pA S , poème dramatique, véhicule <strong>les</strong> symbo<strong>les</strong><br />
et malgré l’apparence <strong>de</strong> réalisme, c’est une image épurée constamment<br />
poétique <strong>de</strong> l’homme qui nous est proposée dans le roman. Il faut donc<br />
faire éclater <strong>les</strong> structures littéraires ou <strong>les</strong> prolonger par <strong>de</strong>s résonances<br />
purement cinématographiques.<br />
Malgré leur simplicité, <strong>les</strong> personnages sont toujours surprenants. En marge<br />
<strong>les</strong> uns <strong>de</strong>s autres, comme désaccordés. A partir du moment où la présence<br />
<strong>de</strong> la mort pèse sur le village, chacun <strong>de</strong> leurs gestes <strong>de</strong>vient étrange.<br />
<strong>Pour</strong> situer <strong>cette</strong> histoire qui se déroule en 1937, il fallait disposer d’un décor<br />
naturel exceptionnellement préservé. Nous avons découvert dans le Haut-<br />
Valais, au fond d’une vallée, dans le Binnthal, Imfeld, village complètement<br />
isolé dans un cadre naturel intact. On dirait le village décrit par Char<strong>les</strong><br />
Ferdinand Ramuz. Une trentaine <strong>de</strong> maisons accrochées à la pente.<br />
Pas <strong>de</strong> lignes électriques, pas <strong>de</strong> télésièges, aucune construction gênante. »<br />
CLAUDE GORETTA<br />
49<br />
si<br />
le<br />
soleil<br />
ne<br />
revenait<br />
pas
50<br />
ENTRETIEN AVEC CLAUdE goRETTA<br />
Le texte <strong>de</strong> C.F. Ramuz m’a semblé être un bon<br />
scénario.<br />
Chez Ramuz, le grand piège c’est <strong>de</strong> ne pas<br />
sombrer dans l’illustration <strong>de</strong>s états d’âme à<br />
travers le paysage. Il faut savoir s’il y a <strong>de</strong>s<br />
personnages et il y a <strong>de</strong>s personnages magnifiques<br />
dans l’œuvre <strong>de</strong> Ramuz. Ce sont <strong>de</strong>s personnages<br />
finalement très mo<strong>de</strong>rnes parce qu’ils dérapent.<br />
On dirait aujourd’hui que ce sont <strong>de</strong>s « paumés ».<br />
Ce qui est beau, c’est qu’il <strong>les</strong> a choisis chez <strong>les</strong><br />
hommes <strong>de</strong> la terre. Que ce soit à la campagne<br />
vaudoise ou dans la montagne valaisanne, il a<br />
trouvé ses personnages qui sont à la fois habités<br />
et qui ont un vertige. Ils sont habités par un rêve<br />
non réalisé, par le non-accompli ou bien par un<br />
pari qui leur fait faire l’erreur fondamentale qui<br />
<strong>les</strong> conduit à leur perte. C’est ça que je trouve très<br />
beau dans l’œuvre <strong>de</strong> Ramuz. Ce sont <strong>les</strong> gens <strong>de</strong><br />
la terre et <strong>de</strong> la montagne et non pas <strong>les</strong> intellos<br />
citadins qui vivent ces vertiges.<br />
Ils sont philosophes, <strong>les</strong> paysans <strong>de</strong> Ramuz…<br />
Philosophes, oui et non. Ils subissent. Si vous<br />
prenez Jean-Luc dans JEAN-LUC pERSéCUTé et<br />
le garçon savoyard, dans LE GARçON SAvOyARD,<br />
le vieux pêcheur dans LA BEAUTé SUR LA<br />
TERRE, qu’est-ce qui se passe ? C’est peut-être<br />
helvétique… Ils pensent que la première solution<br />
à la vie <strong>de</strong> l’homme c’est la femme, c’est le couple,<br />
c’est former le couple. Et quand le couple se<br />
déglingue, c’est le grand vertige. L’homme <strong>de</strong>vient<br />
fou. Il se suici<strong>de</strong> et avant <strong>de</strong> se suici<strong>de</strong>r, il met<br />
le feu aux habitations. Donc ce ne sont pas <strong>de</strong>s<br />
gens qui philosophent. Il ne faut pas confondre<br />
<strong>les</strong> textes. Dans <strong>les</strong> romans, il y a <strong>de</strong>s moments où<br />
tout d’un coup ils sont inspirés ! Mais c’est très<br />
proche d’une perception primitive <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s éléments. La nature, et l’homme dans la<br />
nature. L’homme dans sa solitu<strong>de</strong>. C’est très<br />
primitif. C’est ça que je trouve beau et fort !<br />
LE MAGAZINE SUISSE DES ARTS, PROPOS RECUEILLIS PAR YVES TENRET<br />
Le génie <strong>de</strong> Ramuz, c’est <strong>de</strong> percevoir peut-être,<br />
comme ça, <strong>de</strong> loin, dans <strong>les</strong> conversations <strong>de</strong><br />
bistrot, <strong>de</strong>s individus et puis <strong>de</strong> rêver et d’écrire<br />
un texte… La gran<strong>de</strong> difficulté <strong>de</strong> l’adaptation <strong>de</strong><br />
Ramuz, que ce soit dans Jean-Luc peRsécuté ou<br />
dans le <strong>de</strong>rnier, c’est <strong>de</strong> ne pas essayer <strong>de</strong> trouver<br />
une équivalence photographique <strong>de</strong>s paysages.<br />
Mais que <strong>les</strong> paysages soient à l’intérieur <strong>de</strong>s<br />
gens. C’est <strong>de</strong>s paysages mentaux pour moi…<br />
Alors il n’y a pas <strong>de</strong> brouillard. On ne le voit<br />
quasiment jamais, le brouillard ! On le voit au<br />
début. On passe à travers le brouillard et on<br />
voit que le village est dans le brouillard. On le<br />
voit <strong>de</strong>ux fois. Autrement, il est en eux. C’est un<br />
symbole. C’est une fable.<br />
Ramuz décrit différents états <strong>de</strong> la neige aux yeux<br />
et aux pieds.<br />
Ça, je l’ai ! J’ai trouvé un lieu qui nous a permis<br />
<strong>de</strong> retourner aux sources. C’est-à-dire aux sources<br />
du son ! Ça c’est important. L’hiver, dans cet<br />
endroit que nous avons trouvé et qui est très<br />
isolé parce qu’il n’y a dans ce village que cent<br />
habitants en été et quatre ou cinq en hiver, on<br />
redécouvrait le silence. Et dans le silence, on<br />
redécouvrait <strong>les</strong> bruits, la respiration. Le bruit<br />
<strong>de</strong>s pas dans la neige, le vol d’un oiseau. Ce n’est<br />
pas simplement le chant, le bruit d’un oiseau<br />
mais c’est le « pfuitt » <strong>de</strong>s ai<strong>les</strong>. On s’est arrêtés<br />
<strong>de</strong> filmer une fois parce qu’il y avait un oiseau<br />
qui passait au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> nous et qu’on entendait<br />
ça. C’était <strong>de</strong>s retrouvail<strong>les</strong> avec <strong>de</strong>s choses<br />
fondamenta<strong>les</strong>. Le bruit <strong>de</strong> l’eau d’une fontaine<br />
qui perce le silence à trois cents mètres ! Ce sont<br />
<strong>de</strong>s notions que j’essaie <strong>de</strong> retrouver. J’ai tourné<br />
synchrone. C’est presque entièrement synchrone.<br />
Et l’humour ? Le livre lourd par son contenu…<br />
Choisir Char<strong>les</strong> Vanel, qui a nonante-cinq ans,<br />
pour Anzévui, c’est aller vers une certaine vérité
du personnage. Donc, quand il prend un livre, il<br />
ne le prend pas comme un acteur <strong>de</strong> cinquante<br />
ans. Et, s’il redresse le livre et qu’on voit ses<br />
mains, c’est une équivalence purement humaine<br />
au lyrisme <strong>de</strong> Ramuz. Il fallait faire un bon<br />
choix. Philippe Léotard est admirable dans le<br />
film… Léotard donne une dimension… Il y a <strong>de</strong>s<br />
dimensions permanentes dans <strong>cette</strong> œuvre-là <strong>de</strong><br />
Ramuz. La souf<strong>fr</strong>ance du père qui a vu partir<br />
sa fille à la ville ou dans la vallée, et dont c’est<br />
<strong>de</strong>venu l’obsession. On peut retrouver en soi <strong>les</strong><br />
sources <strong>de</strong> ça dès qu’on a dépassé la quarantaine.<br />
Un village qui ne voit pas le soleil pendant six mois,<br />
est-ce possible ?<br />
C’est évi<strong>de</strong>nt. Les Haudères par exemple, dans<br />
le Val d’Hérens, c’est certainement inspiré <strong>de</strong>s<br />
Haudères et non pas <strong>de</strong> Saint-Martin. Là où nous<br />
avons tourné, on ne voit pas le soleil pendant<br />
plusieurs mois. Et quand le soleil réapparaît, le<br />
premier rayon <strong>fr</strong>appe le haut <strong>de</strong> l’église. C’est<br />
curieux, n’est-ce pas ? Les superstitions sont encore<br />
assez vivaces en Valais. Il y a encore <strong>de</strong>s jeteurs <strong>de</strong><br />
sorts. A ce propos, j’ai fait un gros travail sur la<br />
superstition. Ce sont <strong>de</strong>ux connaissances parallè<strong>les</strong>,<br />
si vous voulez, le catholicisme et la superstition…<br />
J’ai quand même beaucoup travaillé dans le Valais.<br />
Ce n’est pas le premier film que j’y fais. J’ai fait pas<br />
mal <strong>de</strong> reportages.<br />
Le Valais n’est-il pas un canton particulier ?<br />
Vous avez un décor adoucissant, qui est le<br />
bassin lémanique, et puis l’Ukraine vaudoise,<br />
<strong>les</strong> blés à perte <strong>de</strong> vue. Ce n’est pas angoissant<br />
à première vue. Il y a quelque chose <strong>de</strong> mortel,<br />
<strong>de</strong>rrière. C’est la lumière qu’il peut y avoir dans<br />
le canton <strong>de</strong> Vaud sur l’architecture classique<br />
<strong>de</strong> certaines petites vil<strong>les</strong>, <strong>de</strong> certains villages, à<br />
midi, en été, qui fait peur. Ce n’est pas la violence.<br />
Nous sommes allés tourner dans un fond <strong>de</strong><br />
vallée. Il n’y a personne en hiver. <strong>Pour</strong>quoi ?<br />
A cause <strong>de</strong>s avalanches. Il y a quatre couloirs<br />
d’avalanches ! C’est dangereux. Il n’y a pas <strong>de</strong><br />
poteaux télégraphiques. <strong>Pour</strong>quoi ? Parce que<br />
<strong>les</strong> avalanches <strong>les</strong> arracheraient. Il y a <strong>cette</strong><br />
violence qui apparaît tout <strong>de</strong> suite. Vous savez,<br />
si vous habitez dans un fond <strong>de</strong> vallée, vous avez<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux côtés <strong>de</strong>s parois, vous ne vivez pas <strong>de</strong><br />
la même manière que si vous avez <strong>de</strong>ux fois le<br />
soleil en face <strong>de</strong> vous, une fois dans le lac et une<br />
fois en haut. C’est plus dur. L’isolement est plus<br />
permanent, il est plus violent. Les pêcheurs et <strong>les</strong><br />
montagnards sont très proches parce qu’ils ont en<br />
face d’eux une nature indomptable, la mer et la<br />
tempête, la montagne, le brouillard, le <strong>fr</strong>oid. C’est<br />
implacable. Ça forge <strong>de</strong>s tempéraments résistants,<br />
durs. La Suisse est un pays extrêmement difficile<br />
à cerner. Est-ce que le Valais est plus dur que le<br />
canton <strong>de</strong> Schwyz ou d’Uri ou d’Appenzell ?<br />
LE FoU, L’INVITATIoN, LA dENTELLIÈRE étaient <strong>de</strong>s films<br />
exprimant le désenchantement. Maintenant vous<br />
parlez <strong>de</strong> magie. C’est exactement l’inverse.<br />
Non, c’est une réponse à L’INvITATION où tout<br />
commence dans l’agitation et tout finit<br />
dans l’immobilité. Là, tout commence dans<br />
l’immobilité et tout finit dans l’agitation.<br />
Vous ne réenchantez pas le mon<strong>de</strong> ?<br />
Je n’ai pas à réenchanter le mon<strong>de</strong>. D’abord, si<br />
le mon<strong>de</strong> ne m’enchantait pas, je ne serais pas<br />
là pour vous parler. Et je ne ferais pas mes films.<br />
Si je fais ce métier c’est pour être plus heureux,<br />
malgré tout, malgré le constat <strong>de</strong> désespoir, <strong>de</strong><br />
détresse, <strong>de</strong> structures fâcheuses <strong>de</strong> notre société.<br />
C’est Haldas qui dit : « Je suis un optimiste<br />
désespéré ».<br />
Ce n’est pas optimisme ou pessimisme.<br />
Le texte <strong>de</strong> Ramuz est euphorique.<br />
Oui… A partir d’un certain moment, j’ai fait<br />
<strong>de</strong>s films trop didactiques. Dans L’INvITATION, il<br />
y avait une forme <strong>de</strong> drôlerie, <strong>de</strong> poésie. Dans<br />
51<br />
si<br />
le<br />
soleil<br />
ne<br />
revenait<br />
pas
52<br />
LE JOUR DES NOCES aussi. Mais, après, j’ai voulu<br />
placer une sorte <strong>de</strong> discours qui exprimait mon<br />
malheur face à la société, dans lequel je sousestimais<br />
l’impact du lyrisme. J’avais peur qu’on<br />
masque le discours. Et, tout d’un coup, je me<br />
suis dit : « Mais qu’est-ce que tu es en train <strong>de</strong><br />
faire ? Ne dis pas trop <strong>les</strong> choses. Raconte ! Laisse<br />
venir la poésie. Ne la cherche pas. Chercher la<br />
poésie, ce n’est pas possible. Si tu diriges juste<br />
<strong>les</strong> personnages, si tu dépasses le réalisme, la<br />
psychologie et tout, tu trouveras autre chose ».<br />
J’ai essayé, là.<br />
LES PETITES FUgUES d’Yves Yersin, est-ce le bon<br />
rapport à la campagne ?<br />
Avant LES pETITES FUGUES, j’avais fait LE JOUR DES<br />
NOCES qui est un vrai rapport à la campagne,<br />
qui est inspiré d’Une partie <strong>de</strong> campagne <strong>de</strong><br />
Maupassant. Si je prends pAS SI MéCHANT QUE çA,<br />
c’est dans le canton <strong>de</strong> Vaud autour d’Aubonne<br />
et aux pieds du Jura, avec une lumière très<br />
curieuse. Dans la campagne helvétique, je l’avais<br />
dans l’œil <strong>de</strong>puis très longtemps.<br />
Ça ne m’a pas empêché <strong>de</strong> passer <strong>les</strong> <strong>fr</strong>ontières.<br />
Moi, j’aime beaucoup le film <strong>de</strong> Yersin.<br />
C’est superbe, vaudois, vraiment enraciné.<br />
L’ÂME SŒUR <strong>de</strong> Mürer aussi.<br />
Il n’y a pas <strong>de</strong> héros dans le roman <strong>de</strong> Ramuz ?<br />
Oui. Isabelle… c’est l’héroïne.<br />
Y a-t-il dans le film <strong>de</strong>s acteurs mis en avant ?<br />
Non, non. Je ne crois pas. La participation <strong>de</strong><br />
Char<strong>les</strong> Vanel n’est pas plus importante que<br />
celle <strong>de</strong> Cyprien ou d’Arlettaz. J’ai respecté une<br />
certaine ordonnance <strong>de</strong>s choses. Le personnage<br />
d’Anzévui ne bouge quasiment pas. Il est dans<br />
son fauteuil, il est fatigué. Je n’ai jamais cédé à<br />
l’attrait du ve<strong>de</strong>ttariat. (…) Vanel, c’est l’acteur<br />
exemplaire parce que c’est l’humilité absolue,<br />
la connaissance du métier, l’enthousiasme et<br />
le professionnalisme, le travail sur le détail du<br />
costume, enfin le regard sur tous <strong>les</strong> éléments du<br />
jeu. Il ne fait pas un numéro, Vanel. Et puis, si<br />
François Simon avait été vivant, c’est François<br />
qui aurait interprété le personnage d’Arlettaz.<br />
Mais je ne voyais pas dans le cinéma actuel<br />
parlant <strong>fr</strong>ançais, un acteur qui véhicule une sorte<br />
<strong>de</strong> vertige, à la Artaud si vous voulez, en <strong>de</strong>hors<br />
<strong>de</strong> Philippe Léotard.<br />
Vous avez choisi ce Ramuz parce qu’il est serein ?<br />
Absolument. J’ai une certaine confiance dans la<br />
vie aussi.<br />
Ramuz est-il un grand écrivain ou un grand écrivain<br />
suisse ?<br />
Alors moi, je crois que c’est un grand écrivain,<br />
tout simplement.<br />
BIO<br />
CLAUDE GORETTA<br />
(GEnèvE - 23 JUin 1929)<br />
Clau<strong>de</strong> Goretta étudie le droit à l’Université<br />
<strong>de</strong> Genève puis part se former au British film<br />
institute à Londres. De retour à Genève,<br />
il travaille pour la télévision roman<strong>de</strong> comme<br />
réalisateur et producteur, entre autres pour<br />
le programme Continents sans visa.<br />
En 1968, il fon<strong>de</strong> le Groupe <strong>de</strong>s 5<br />
(réalisation et production) avec alain tanner,<br />
Jean-Louis rey, Clau<strong>de</strong> soutter et yves yersin,<br />
amis et collègues à la tv. son long métrage<br />
L’invitation (prix du jury, Cannes 1973) le révèle<br />
et La Dentellière lui vaut un succès public.<br />
Clau<strong>de</strong> Goretta est venu à pontarlier présenter<br />
ses films en mars 2001 lors <strong>de</strong> la 58 e riCp.<br />
FILMOGRAPHIE<br />
1966 Jean-Luc persécuté<br />
1970 Le fou<br />
1971 Le jour <strong>de</strong>s noces<br />
1973 L’invitation<br />
1974 Le fils prodigue<br />
1975 Pas si méchant que ça<br />
1977 La Dentellière<br />
1980 La Provinciale<br />
1983 La mort <strong>de</strong> Mario Ricci<br />
1986 Le rapport du gendarme<br />
1988 Si le soleil ne revenait pas<br />
1991 La fouine<br />
Maigret et la gran<strong>de</strong> perche<br />
1992 L’ombre<br />
1995 Maigret a peur<br />
1996 Le <strong>de</strong>rnier chant<br />
1997 Vivre avec toi<br />
Le <strong>de</strong>rnier été<br />
2001 Thérèse et Léon<br />
2004 La fuite <strong>de</strong> Monsieur Mon<strong>de</strong><br />
2006 Sartre, l’âge <strong>de</strong>s passions
LA PRESSE<br />
Si ce film est forcément très<br />
physique, notamment en privilégiant<br />
l’enracinement <strong>de</strong> l’homme à<br />
la nature, il possè<strong>de</strong> également<br />
un aspect mystique, presque<br />
fantastique, dont la mise en scène<br />
rend compte. Le surgissement du<br />
visage d’anzévui dans la nuit, le<br />
regard d’Isabelle au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s<br />
flammes, l’exp<strong>édition</strong> <strong>de</strong> Denis pour<br />
voir le soleil sont autant <strong>de</strong> plans ou<br />
séquences qui procè<strong>de</strong>nt d’une mise<br />
en liaison entre le réel et le divin.<br />
Les magnifiques premiers plans<br />
du film relèvent d’une démarche<br />
i<strong>de</strong>ntique : la caméra, après avoir<br />
parcouru <strong>les</strong> paysages neigeux,<br />
découvre le village désert et endormi,<br />
comme si elle était l’œil d’un<br />
observateur venu <strong>de</strong> l’extérieur,<br />
en l’occurrence d’en haut.<br />
si Le soLeiL ne revenait<br />
Pas est une admirable réussite<br />
à l’actif du cinéma suisse,<br />
tentative <strong>de</strong> conciliation entre le<br />
patrimoine culturel et une écriture<br />
cinématographique originale, belle,<br />
surtout très belle.<br />
pASCAL GAvILLET. CINéMA SUISSE<br />
Clau<strong>de</strong> Goretta, dans sa passion <strong>de</strong>s<br />
lieux ou <strong>de</strong>s êtres marginalisés, s’est<br />
toujours intéressé à <strong>cette</strong> œuvre <strong>de</strong><br />
son compatriote Char<strong>les</strong> Ferdinand<br />
Ramuz. Dans ce village, comme<br />
abandonné <strong>de</strong>s dieux, il filme le<br />
doute, l’abandon <strong>de</strong>s sans-espoir,<br />
la lâcheté et la persévérance.<br />
Paysages et visages se mélangent<br />
quand le brouillard s’installe aussi<br />
dans <strong>les</strong> têtes. Habillé <strong>de</strong> noir,<br />
recouvert <strong>de</strong> neige, le combat est<br />
permanent entre la vie et la mort. a<br />
l’image du mon<strong>de</strong>, ces montagnards<br />
vivent dans l’angoisse du len<strong>de</strong>main.<br />
Imprégné par leur solitu<strong>de</strong>, Clau<strong>de</strong><br />
Goretta a su capter leur démarche à<br />
travers une série <strong>de</strong> portraits – c’est<br />
sa force – mais il manque parfois<br />
<strong>de</strong> recul – c’est sa faib<strong>les</strong>se. Et<br />
<strong>de</strong>s flash-back nous montrant <strong>les</strong><br />
souvenirs <strong>de</strong> lumière, alourdissent<br />
son propos, brisent l’enfermement<br />
et la peur qui nous envoûte. Mais<br />
Catherine Mouchet gar<strong>de</strong> toute sa<br />
<strong>fr</strong>aîcheur, Philippe Léotard, une fois<br />
<strong>de</strong> plus épave, n’en est pas moins<br />
plus touchant et sa recherche la plus<br />
prenante, Char<strong>les</strong> Vanel est d’une<br />
présence étonnante.<br />
FICHE DU CINéMA<br />
N° 936<br />
En 1957, Alain Tanner et Clau<strong>de</strong><br />
Goretta présentaient au Festival<br />
<strong>de</strong> Venise un court métrage qu’ils<br />
venaient <strong>de</strong> réaliser ensemble,<br />
pauvrement à Londres, la nuit,<br />
avec la pellicule offerte aux<br />
débutants par le British Film<br />
Institute : nice time. trente<br />
ans plus tard, <strong>de</strong>venus cinéastes<br />
professionnels (grâce, en particulier,<br />
à l’appui <strong>de</strong> la télévision roman<strong>de</strong>),<br />
ils se retrouvent chacun à Venise<br />
avec leur <strong>de</strong>rnière œuvre :<br />
La vaLLÉe FantÔme et<br />
si Le soLeiL ne revenait Pas.<br />
Les <strong>de</strong>ux films qu’ils signent en<br />
même temps n’ont, apparemment,<br />
rien <strong>de</strong> commun, et pourtant ils se<br />
ressemblent par leur façon <strong>de</strong> refuser<br />
la dégradation du cinéma-spectacle<br />
et d’affirmer, contre la démagogie<br />
<strong>de</strong>s produits industriels standardisés,<br />
propre au décervelage, la primauté<br />
d’un style.<br />
Dans ces récits, leur mouvement se<br />
veut intérieur et indépendamment<br />
<strong>de</strong> leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> réussite esthétique,<br />
ils ren<strong>de</strong>nt au cinéma ce qui va lui<br />
manquer chaque jour davantage :<br />
la dignité…<br />
En 1937, précisément, parce que<br />
la radio nouvellement installée au<br />
café, diffuse <strong>de</strong>s communiqués<br />
alarmants à propos <strong>de</strong> la guerre civile<br />
d’Espagne en laissant également<br />
supposer que le mon<strong>de</strong>, en bas,<br />
au loin, va très mal et roule peut-être<br />
à sa perte, <strong>les</strong> habitants prennent<br />
au sérieux <strong>les</strong> prédictions du vieil<br />
anzévui.<br />
Ce vieillard, capable <strong>de</strong> guérir <strong>les</strong><br />
maladies ou d’effacer <strong>les</strong> douleurs<br />
physiques grâce aux vertus<br />
<strong>de</strong>s herbes <strong>de</strong>puis longtemps<br />
suspendues en bouquets au plafond<br />
<strong>de</strong> sa chambre, lit d’anciens livres<br />
et ne cesse <strong>de</strong> répéter que, <strong>cette</strong> fois,<br />
le soleil disparu <strong>de</strong>rrière <strong>les</strong> crêtes<br />
ne reviendra pas au printemps.<br />
a <strong>cette</strong> fin du mon<strong>de</strong>, il croit<br />
profondément car il l’i<strong>de</strong>ntifie à<br />
sa propre disparition (qu’il sait<br />
prochaine) au point qu’en lui-même<br />
s’ancre la persuasion d’incarner<br />
l’astre du jour tant désiré.<br />
Ses concitoyens prennent peur et<br />
s’installent dans un lâche fatalisme<br />
qui change <strong>les</strong> chagrins d’arlettaz,<br />
un voisin, en désespérance auto<strong>de</strong>structrice<br />
; elle jette <strong>les</strong> uns vers<br />
une révolte <strong>de</strong> velléitaires et <strong>les</strong><br />
autres en pleine résignation. Isabelle,<br />
seule, résiste, avec une douceur<br />
sans véhémence, mais intensément<br />
assumée qui fait sa force et qui lui<br />
vaudra <strong>de</strong> vaincre : figure attachante<br />
que Goretta, subtil, n’isole pas du<br />
groupe qui reste le personnage<br />
principal en face du mage, messager<br />
d’apocalypse.<br />
Le cinéaste sculpte l’espace autour<br />
<strong>de</strong> <strong>cette</strong> collectivité prisonnière<br />
<strong>de</strong> l’ombre et <strong>de</strong> l’angoisse,<br />
développant l’ensemble comme<br />
un oratorio plutôt qu’à la façon d’un<br />
conte. Chaque nuance <strong>de</strong> la direction<br />
<strong>de</strong>s interprètes (Char<strong>les</strong> Vanel, dès<br />
<strong>les</strong> premiers mots, donne le ton juste)<br />
répond à l’inflexion à peine indiquée<br />
d’un geste, d’une mise en place dans<br />
le cadre, d’un silence, d’une sombre<br />
béance ouverte sous la couleur.<br />
Il a choisi <strong>de</strong> ponctuer la narration<br />
par <strong>de</strong> brèves résurgences <strong>de</strong><br />
souvenirs, toujours organiquement<br />
accordées à l’unité poétique<br />
<strong>de</strong> la composition : la plus longue,<br />
voulue telle, égrenant <strong>les</strong> couplets<br />
<strong>de</strong> « la chanson du petit chevrier »<br />
<strong>de</strong>vient l’axe autour duquel<br />
s’ordonne le champ magnétique<br />
<strong>de</strong>s émotions qui, pudiques et<br />
tremblantes, convergent vers<br />
ce linge déployé sur un visage,<br />
vers <strong>cette</strong> clarté sur une photo<br />
jaunie tandis que près <strong>de</strong>s cimes<br />
retentissent <strong>les</strong> coups du fusil<br />
joyeux <strong>de</strong> la confiance retrouvée :<br />
à tous, dorénavant, il appartient<br />
d’en avoir conscience et d’en faire<br />
un usage <strong>fr</strong>aternel dans le respect<br />
<strong>de</strong>s humains, <strong>de</strong>s animaux,<br />
<strong>de</strong>s choses.<br />
FREDDy BUACHE<br />
LE CINéMA SUISSE 1898-1998<br />
53<br />
si<br />
le<br />
soleil<br />
ne<br />
revenait<br />
pas
54<br />
sI Le soLeIL<br />
ne ReVenaIt pas<br />
projet d’illustrations réalisées<br />
en 1939 par<br />
anDRé RoZ<br />
Collection Pellissier<br />
… La porte s’était refermée ; Anzévui<br />
s’avança <strong>de</strong>vant Revaz en traînant<br />
<strong>les</strong> pieds. Il prit un escabeau qu’il<br />
plaça en face du fauteuil <strong>de</strong>vant le<br />
feu : «Assieds-toi là», avait-il dit ;<br />
ensuite il avait regagné sa place ;<br />
mais alors on avait vu qu’elle était<br />
occupée par un gros livre à reliure<br />
<strong>de</strong> parchemin veinée <strong>de</strong> rouge, usée<br />
aux nervures, rongée dans <strong>les</strong> coins,<br />
qu’Anzévui souleva avec lenteur et<br />
respect, puis posa sur la table, <strong>les</strong><br />
feuillets en <strong>de</strong>ssous. Il avait une<br />
gran<strong>de</strong> barbe blanche ; il avait <strong>de</strong><br />
longs cheveux blancs qui lui tombaient<br />
sur <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> ...
… Il n’était pas si mal<br />
habillé non plus, et pourtant<br />
on avait déjà peur <strong>de</strong><br />
lui nous autres. On s’était<br />
cachées <strong>de</strong>rrière <strong>de</strong>s troncs.<br />
Et voilà qu’un peu plus loin<br />
il y avait Brigitte, la vieille<br />
Brigitte, mais elle n’était pas<br />
si vieille non plus, et elle<br />
était en train <strong>de</strong> ramasser<br />
du bois ...<br />
... Elle le tenait dans ses<br />
bras, c’était un bébé en<br />
sucre. C’était un bébé tout<br />
en sucre, tellement il était<br />
bien enveloppé dans une<br />
couverture en grosse laine<br />
blanche ; elle lui ôtait <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ssus la figure un mouchoir<br />
dont elle l’avait<br />
couvert à cause du <strong>fr</strong>oid ...<br />
... Il avait vu enfin paraître<br />
le village ; et le village,<br />
blanc sur blanc, aurait été<br />
pareil à rien du tout, s’il n’y<br />
avait pas eu le bois noir <strong>de</strong><br />
ses faça<strong>de</strong>s ...<br />
55<br />
si<br />
le<br />
soleil<br />
ne<br />
revenait<br />
pas
56<br />
... Et c’est là qu’ enfin,<br />
en effet, il était paru, le<br />
soleil, ou ce qui aurait<br />
pu être le soleil, mais<br />
alors on a vu Métrailler<br />
qui reculait. Car c’était<br />
une boule rouge et <strong>les</strong><br />
rochers autour <strong>de</strong> vous<br />
étaient tout rouges ; et le<br />
soleil ne se montrait pas,<br />
mais c’était comme si on<br />
le montrait ; le soleil ne<br />
se soulevait pas <strong>de</strong> luimême,<br />
on le soulève :<br />
échevelé, et tout enrubanné,<br />
tout enserpenté <strong>de</strong><br />
nuées qui étaient el<strong>les</strong>mêmes<br />
rouges comme<br />
<strong>de</strong>s caillots <strong>de</strong> sang. Tout<br />
à fait pareil à une tête<br />
coupée autour <strong>de</strong> quoi la<br />
barbe et <strong>les</strong> cheveux pendraient,<br />
encore fumants ;<br />
- et déjà le brouillard<br />
et l’obscurité avaient<br />
repris la place qu’il avait<br />
occupée ...<br />
(…) On n’ avait ouvert la route qu’avec le<br />
petit triangle, <strong>de</strong> sorte qu’elle était beaucoup<br />
plus étroite que dans la belle saison,<br />
n’ ayant guère plus qu’un mètre <strong>de</strong> large ;<br />
en outre, c’est un chemin <strong>de</strong> surface,<br />
parce qu’il ne <strong>de</strong>scend pas jusqu’à l’empierrement.<br />
(…)<br />
(…) Trois vieil<strong>les</strong>, tout en noir, toutes<br />
petites et voûtées (…) Penchées en avant,<br />
<strong>les</strong> mains jointes, la tête dans un fichu<br />
noir, un châle <strong>de</strong> laine épais croisé sur<br />
la poitrine et noué dans le dos ; el<strong>les</strong> ne<br />
disaient rien. (…)<br />
(…) Et, dans la petite lumière, il y avait<br />
à présent <strong>les</strong> femmes qui venaient, puis<br />
venaient <strong>les</strong> fil<strong>les</strong>. (…)
... Et, le len<strong>de</strong>main<br />
matin, ils sont partis<br />
pour Saint- Martin-d’En-<br />
Bas où <strong>les</strong> morts sont<br />
enterrés dans le petit<br />
cimetière qui entoure<br />
l’église. Il continuait à<br />
geler dur ; la neige sous<br />
le pas <strong>de</strong>s porteurs, plaignait<br />
comme un enfant<br />
mala<strong>de</strong>. Le chemin avait<br />
été ouvert à la pelle une<br />
fois <strong>de</strong> plus ; il était bordé<br />
par places <strong>de</strong> murs <strong>de</strong><br />
neige <strong>de</strong> plus d’un mètre<br />
et il avait peu <strong>de</strong> largeur ;<br />
alors ils soulevaient le<br />
brancard à bout <strong>de</strong> bras<br />
et la caisse noire là-haut<br />
balançait d’arrière en<br />
avant, semblable, tout<br />
parmi le moutonnement<br />
<strong>de</strong> la neige, à un petit<br />
bateau sur une petite<br />
mer ...<br />
... Jeanne Émery avait<br />
pris son centimètre. Isabelle<br />
a ôté son corsage. Il<br />
s’était mis à faire clair<br />
dans la chambre comme<br />
si le soleil était déjà<br />
revenu ...<br />
57<br />
si<br />
le<br />
soleil<br />
ne<br />
revenait<br />
pas
58<br />
Le fond d’une vallée est rallié aux idées<br />
<strong>de</strong>s Lumières confortées par l’arrivée <strong>de</strong>s<br />
troupes <strong>fr</strong>ançaises, <strong>les</strong> hameaux d’altitu<strong>de</strong><br />
figés dans la rigidité <strong>de</strong> leur culture<br />
calviniste restent soumis à Berne.
LA gUERRE<br />
DANS LE HAUT PAYS<br />
Suisse/France, 1998, 105 mn<br />
Scénario : Francis Reusser, Jean-Clau<strong>de</strong> Carrière,<br />
Emmanuelle <strong>de</strong> Ridmatten<br />
Image : Christophe Beaucarne<br />
Décors et costumes : Jean-Clau<strong>de</strong> Maret,<br />
Guillaume Watrinet, Stéphane Lévy,<br />
Daniel Bugmann<br />
Son : François Musy<br />
Musique : Jean-François Monot<br />
Montage : Jacques Witta<br />
Script : Elodie Van Beuren<br />
Production : CAB productions<br />
Interprètes :<br />
Marion Cotillard (Julie Bonzon)<br />
Yann Tregouët (David Aviolat)<br />
François Marthouret (Josias Aviolat)<br />
Antoine Basler (Ansermoz)<br />
Patrick Le Mauff (Tille)<br />
Jacques Michel (Jean Bonzon)<br />
François Morel (Devenoge)<br />
Laurent Terzieff (Isaie)<br />
Jean-Pierre Gos (le pasteur)<br />
Daniela Bisconti (femme <strong>de</strong> Bonzon)<br />
Maurice Aufair (Moïse Pittet)<br />
Michel Voïta (Fornerod)<br />
Sortie : 7 octobre 1998 Suisse, 28 avril 1999 Paris<br />
Tournage : 3 février au 30 mars 1998,<br />
Ballenberg, Aigle, La Croix, gorges <strong>de</strong> la<br />
Gran<strong>de</strong>-Eau, Ponts-<strong>de</strong>-la-Tine, La Tréchadèze,<br />
vallée <strong>de</strong>s Ormonts, Savoie.<br />
FRANCIS REUSSER<br />
d’après le roman <strong>de</strong> C.F. Ramuz, « La guerre dans le Haut-Pays » (1915)<br />
Janvier 1798. Le Haut Pays <strong>de</strong>s Ormonts, à<br />
l’ouest <strong>de</strong>s Alpes suisses, ne suit pas la majorité<br />
<strong>de</strong>s Vaudois ralliée aux troupes <strong>de</strong> la<br />
Révolution <strong>fr</strong>ançaise. Les rigoristes calvinistes,<br />
menés par Josias et le pasteur, soutiennent <strong>les</strong><br />
Bernois, pourchassent <strong>les</strong> idées <strong>de</strong>s « Lumières<br />
», persécutent ceux qui s’en réclament,<br />
comme le naïf et enflammé précepteur Devenoge.<br />
David, le fils <strong>de</strong> Josias, orphelin <strong>de</strong> mère,<br />
« fait la poste », et sa mule le conduit souvent<br />
« en bas », où <strong>les</strong> Français se trouvent déjà. Il<br />
y retrouve Ansermoz, qui quitta le Haut Pays<br />
après la mort <strong>de</strong> son père, domestique méprisé<br />
par Josias, puis s’engagea dans <strong>les</strong> rangs<br />
<strong>fr</strong>ançais. Ansermoz « remonte », déclenche la<br />
fureur <strong>de</strong>s notab<strong>les</strong> en plantant un « arbre <strong>de</strong><br />
la Liberté » : David le sauve. Julie, fille aînée<br />
du tolérant Bonzon, aime David : tous <strong>de</strong>ux<br />
se donnent l’un à l’autre. Chassé par Josias,<br />
David rejoint son ami Ansermoz aux côtés <strong>de</strong>s<br />
Français. Julie, désespérée, attend son retour.<br />
Il gui<strong>de</strong> une colonne vers un passage où Josias<br />
a placé ses hommes qui massacrent le détachement<br />
; et c’est <strong>de</strong> sang-<strong>fr</strong>oid que Josias tue<br />
son fils. Sur un autre <strong>fr</strong>ont, <strong>les</strong> Français ont<br />
vaincu : <strong>les</strong> notab<strong>les</strong> se rallient à eux, Josias<br />
s’est pendu. Ansermoz a ramené le corps <strong>de</strong><br />
David, Julie ne veut pas voir qu’il est mort. Elle<br />
ne le croira jamais …<br />
la<br />
guerre<br />
dans<br />
le<br />
haut<br />
pays<br />
59
60<br />
C’est une race âpre et dure, comme le sol d’où elle sort, que <strong>cette</strong> race <strong>de</strong> là-haut. Plus patients que<br />
soup<strong>les</strong> et moins vifs que têtus, ils se méfiaient <strong>de</strong>s vagues idées par quoi on voulait remplacer chez<br />
eux leurs convictions <strong>de</strong> toujours. Il faut un Dieu et un Maître ; ils avaient le Dieu <strong>de</strong> leur Bible, et un<br />
Maître aussi ils l’avaient, mais tellement lointain qu’il ne <strong>les</strong> gênait guère. Là-bas, du côté du nord,<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la Becca d’Audon, sont nos Magnifiques Seigneurs, comme on <strong>les</strong> appelle, mais on ne <strong>les</strong><br />
voit pas souvent ; et ils ont bien un représentant parmi nous, mais c’est un représentant choisi par<br />
nous ; pour le reste, on vit à notre guise : on fait ses foins quand on veut, on coupe son bois quand<br />
on veut, on trait ses vaches quand on veut. Ces arrangements-là, on s’en est toujours accommodé,<br />
nous, nos pères, nos grands-pères, et si loin qu’on puisse voir en arrière dans le temps ; ne valentils<br />
pas mieux que ce qu’il y a <strong>de</strong>ssus ces papiers imprimés qui viennent <strong>de</strong> Paris, qu’on ne peut pas<br />
seulement comprendre ? Si ceux du bord du lac veulent en tâter, <strong>de</strong> ces nouveautés, rien ne <strong>les</strong> en<br />
empêche ; nous pas. Nous, on a, pour le présent, <strong>les</strong> Dix Comman<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> la Bible expliqués et<br />
commentés, outre l’enseignement <strong>de</strong>s Ecritures qu’on lit chaque soir en famille ; plus tard, quand le<br />
Grand Jour viendra, chacun sera jugé selon ses mérites ; il y aura le ciel pour <strong>les</strong> uns, l’enfer pour<br />
<strong>les</strong> autres ; la gran<strong>de</strong> affaire, en attendant, est <strong>de</strong> se bien conduire. Et le reste n’ est que <strong>de</strong>s mots,<br />
voyez-vous. Nous, on a la foi ; ça nous suffit. Continuons donc <strong>de</strong> faire comme on a toujours fait. Ne<br />
nous occupons pas <strong>de</strong> savoir ce qui se passe par le mon<strong>de</strong>, où peut-être bien que Satan règne, mais,<br />
nous, heureusement, nous sommes à l’abri, parce que nous sommes une vallée reculée, et <strong>les</strong> passages<br />
qui y conduisent sont faci<strong>les</strong> à gar<strong>de</strong>r.<br />
Voilà ce qu’à peu près tous pensaient, n’importe : il n’y avait pas unanimité ; déjà <strong>les</strong> idées nouvel<strong>les</strong><br />
comptaient <strong>de</strong>s partisans jusque dans la paroisse ; entre autres, un nommé Pierre Ansermoz, qui avait<br />
servi longtemps dans un <strong>de</strong>s régiments <strong>de</strong> France, et cinq ou six ans auparavant, il était revenu au<br />
pays ; alors il avait commencé à tout gâter autour <strong>de</strong> lui, comme une pomme pourrie fait pourrir<br />
cel<strong>les</strong> qui l’entourent. »<br />
« J’ai voulu le scénariste le plus connu»<br />
Quatorze ans après DeRboRence, le cinéaste romand<br />
retrouve Ramuz. L’idée d’une fiction adaptée <strong>de</strong> La<br />
guerre dans le Haut pays, écrit en 1915, naît en 1993 lors<br />
d’une conversation entre Pierre Starobinski, directeur <strong>de</strong><br />
l’Office du tourisme <strong>de</strong> Leysin, et l’écrivain Nicolas Bouvier.<br />
La création d’une association <strong>de</strong> soutien, réunissant<br />
<strong>de</strong>s personnalités influentes, permet l’avancée du projet<br />
qui est retenu par <strong>les</strong> instances cantona<strong>les</strong> vaudoises<br />
pour célébrer le bicentenaire <strong>de</strong> sa révolution. Le nom<br />
<strong>de</strong> Francis Reusser est rapi<strong>de</strong>ment évoqué pour mener à<br />
bien le projet : « L’adaptation <strong>de</strong> ce roman m’a intéressé,<br />
explique le cinéaste, car il abor<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sujets universels,<br />
notamment le rapport père-fils, l’obstination amoureuse<br />
<strong>de</strong>s femmes ou le thème <strong>de</strong> la liberté. Ces thèmes ne<br />
sont pas à l’écart <strong>de</strong> nos préoccupations actuel<strong>les</strong> ». « J’ai<br />
voulu le scénariste le plus connu » explique Reusser qui<br />
déci<strong>de</strong> d’engager Jean-Clau<strong>de</strong> Carrière. « Jean-Clau<strong>de</strong><br />
Carrière et moi avons pris beaucoup <strong>de</strong> libertés par rapport<br />
au livre, notamment avec <strong>les</strong> dialogues ». Le tournage<br />
a lieu aux mois <strong>de</strong> février et mars 1998, dans <strong>les</strong> cantons<br />
<strong>de</strong> Vaud et <strong>de</strong> Berne, ainsi qu’en Haute-Savoie. L’équipe<br />
reçoit l’autorisation <strong>de</strong> tourner au musée Ballenberg où<br />
l’on trouve <strong>de</strong>s maisons vaudoises et bernoises d’époque<br />
C.F. RAMUZ, La Guerre dans le Haut Pays<br />
...<br />
parfaitement reconstituées, mobilier d’intérieur compris.<br />
Seul problème : la neige, élément du décor aussi incontournable<br />
que difficile à gérer, est acheminée tous <strong>les</strong><br />
matins <strong>de</strong> Grimsel par dizaines <strong>de</strong> camions pendant le<br />
tournage.<br />
Histoire du cinéma suisse (1966-2000)<br />
sous la direction d’Hervé Dumont et <strong>de</strong> Maria Tortajada
,<br />
La chair et la peau<br />
Le cinéma se donne idéalement <strong>de</strong> sa peau jusqu’à sa<br />
chair. Si l’on parle <strong>de</strong> sa peau, disons que La GueRRe<br />
Dans Le Haut pays est un film où la lumière rayonne en<br />
toute splen<strong>de</strong>ur, exaltée par un son vaste et précis. Mais<br />
ajoutons que <strong>cette</strong> lumière est soumise aux principes du<br />
contre-jour, faisant voir au spectateur l’ombre <strong>de</strong>s êtres<br />
et la part d’ombre qui <strong>les</strong> dévore ou <strong>les</strong> dissimule à soi.<br />
La peau <strong>de</strong> ce cinéma-là nous oblige donc à sa chair. Si<br />
vous prenez La GueRRe Dans Le Haut pays comme<br />
un récit romantique et costumé, qui nous documente sur<br />
l’Histoire <strong>de</strong> quelques Vaudois résistant au progrès <strong>de</strong>s<br />
idées révolutionnaires venues <strong>de</strong> France au tournant du<br />
XVIIIe siècle, vous n’aurez pas tort – mais vous n’aurez<br />
pas regardé.<br />
Plongez donc dans la matière <strong>de</strong>s personnages et percevez<br />
ses palpitations comme <strong>les</strong> éléments d’un langage<br />
atteignant notre époque. Ramuz rendait Julie cataleptique<br />
après la mort <strong>de</strong> son amant David, alors que Reusser<br />
et son co-scénariste Carrière la font marcher dans <strong>les</strong><br />
fleurs, moins figée dans son chagrin que mise en flottement<br />
par lui dans le mon<strong>de</strong> et dans le temps. La rigidité<br />
d’un cadavre social chez l’écrivain, une grâce étrangement<br />
subversive chez ceux qui s’en inspirent. Le présent<br />
s’est glissé d’un récit jusqu’à l’autre.<br />
Aujourd’hui, tandis que <strong>les</strong> hommes persistent à<br />
s’entre-tuer pour s’aligner plus fidèlement dans l’ordre<br />
<strong>de</strong>s idéologies et <strong>de</strong>s religions, <strong>les</strong> femmes savent et<br />
sauvent le corps, le leur, celui <strong>de</strong>s autres et celui <strong>de</strong> l’exis-<br />
– « Ecoute bien, David, tu ne m’as pas compris<br />
peut-être ; on dit qu’on va être attaqué, alors il<br />
faudra nous défendre ; et le serment qu’on prête<br />
c’est pour notre patrie ; tu dois venir, David, sans<br />
quoi ...»<br />
« Je n’irai pas. »<br />
– « David, est-ce que tu as oublié que tu es mon<br />
fils … (il eut un vacillement dans la voix comme<br />
quand le souffle vous manque) que tu es mon fils<br />
malgré tout … Et que le fils doit écouter son père,<br />
et être obéissant à son père et le suivre » …<br />
Ici <strong>de</strong> nouveau la voix chancela, elle reprit :<br />
« David ! », elle recommença : « David ! » et c’était<br />
comme une prière, mais lui pour la troisième<br />
fois :<br />
« Je n’irai pas. »<br />
Alors on vit Josias-Emmanuel se redresser.<br />
« As-tu bien réfléchi ? »<br />
Et ainsi par trois fois, comme l’autre avait fait ; puis<br />
lentement il étendit le bras, et, montrant la porte :<br />
« Va-t’en. » David ne répondit rien, il avait baissé la<br />
tête. Josias reprit : « Tu n’es plus mon fils. »<br />
C.F. RAMUZ La guerre dans le Haut Pays<br />
tence humaine intime et collective, comme seul témoin<br />
<strong>de</strong> l’avenir. L’amour agile contre l’amour déraisonnable.<br />
Gagnez donc ces lieux que nous désigne ces temps-ci la<br />
curiosité médiatique, <strong>de</strong> l’Algérie jusqu’au Kosovo, partout<br />
où le rapport foncier <strong>de</strong>s êtres et <strong>de</strong>s sexes n’est<br />
pas momentanément voilé par <strong>les</strong> hurlements <strong>de</strong> nos<br />
boursicoteurs affolés, et revenez donc me dire si <strong>de</strong>s<br />
films animés <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> indications sont <strong>de</strong>s entreprises<br />
artistiques régiona<strong>les</strong>, vouées à la gloire d’un passé vernaculaire<br />
et malignement excusées par le Cinémascope.<br />
la<br />
guerre<br />
Dossier <strong>de</strong> presse, CHRISTOPHE GALLAZ dans<br />
le<br />
haut<br />
pays<br />
61
62<br />
LETTRE dE JEAN-CLAUdE CARRIÈRE<br />
à FRANCIS REUSSER<br />
Paris, le 4 août 1997<br />
Cher Francis,<br />
J’ai relu attentivement, une fois encore, le livre <strong>de</strong> Ramuz,<br />
et la <strong>de</strong>rnière version du scénario. Je crois que nous approchons enfin,<br />
après un an <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong> ce que nous avons imaginé au tout début:<br />
« Un film historique d’aujourd’hui » …<br />
Cela paraît contradictoire, et pourtant. Ce qui me <strong>fr</strong>appe toujours,<br />
quand on abor<strong>de</strong> par le vivant la pério<strong>de</strong> révolutionnaire, c’est<br />
le tourbillon incessant et la permanente nouveauté <strong>de</strong>s idées qui<br />
s’ébranlèrent à ce moment-là, et qui transformèrent le mon<strong>de</strong>.<br />
Tout semble avoir été dit, discuté, éprouvé, rêvé, combattu en quelques<br />
années, tout aussi bien la force irrésistible <strong>de</strong> l’idée nouvelle - une idée<br />
jusqu’à en mourir - que la <strong>fr</strong>agilité <strong>de</strong> ces mêmes lumières, <strong>fr</strong>agilité<br />
si clairement sensible partout aujourd’hui en Europe.<br />
Que Ramuz ait choisi <strong>de</strong> nous présenter ce combat nécessaire et sans<br />
fin, <strong>cette</strong> guerre véritable entre nous et nous, dans un tout petit coin<br />
<strong>de</strong> Suisse, qu’il l’ait fait avec <strong>de</strong>s personnages simp<strong>les</strong> et jeunes,<br />
qui en per<strong>de</strong>nt vie et raison, qu’il ait si bien établi le contraste entre<br />
le haut et le bas, entre le mouvant et le stable, entre hier et <strong>de</strong>main,<br />
entre Dieu et <strong>les</strong> hommes, entre l’intégrisme et l’intelligence, tout<br />
cela m’a toujours paru donner à ce conflit fondamental une<br />
concentration particulière, inoubliable, bien plus efficace que<br />
<strong>de</strong> longues dissertations généralistes.<br />
Qu’en plus l’apport extrêmement graphique du paysage, le fond blanc<br />
<strong>de</strong> la neige, qui semble attendre telle ou telle écriture, la ru<strong>de</strong>sse<br />
<strong>de</strong>s visages et <strong>de</strong>s vêtements, notre recherche d’un découpage abrupt,<br />
inattendu, qui jamais cependant ne violerait le passé par la présence<br />
trop visible d’une caméra, tout cela me paraît très favorable à<br />
l’apparition <strong>de</strong> ce qu’on appelle habituellement le cinéma.<br />
Je vois peu <strong>de</strong> dangers, ou <strong>de</strong> réserves. Bien sûr, mais nous le savons,<br />
nous <strong>de</strong>vons nous méfier d’un certain mélo, et même d’un kitsch,<br />
toujours à portée <strong>de</strong> l’œil quand le passé paysan se ramène. Mais bon,<br />
nous sommes prévenus. Nous savons bien que c’est la vraie vie, toujours,<br />
qui doit l’emporter, d’autant plus vraie qu’elle est naturelle. Nous avons<br />
beaucoup réfléchi à tout ce que nous aimerions mettre dans le film,<br />
entre la montagne et la plaine, le brouillard et le soleil, la tradition<br />
et l’impatience, la clameur et le murmure. Je te fais gran<strong>de</strong> confiance<br />
là-<strong>de</strong>ssus.<br />
En toute amitié<br />
Jean-Clau<strong>de</strong> Carrière
:« Le film terminé, Reusser<br />
s’est aperçu qu’en dépit <strong>de</strong>s<br />
modifications, Ramuz résistait».<br />
… Tourné entre février et mars 1998 à Ballenberg, à Aigle,<br />
dans la vallée <strong>de</strong>s Ormonts et en Savoie, La GueRRe<br />
Dans Le Haut pays constitue pour Francis Reusser son<br />
troisième film en costumes après Jacques et FRançoIse,<br />
opéra rural, et DeRboRence. C’est un hasard,<br />
puisqu’il s’agit d’une œuvre <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>. Quelques<br />
personnalités voulaient marquer d’une pierre cinématographique<br />
le bicentenaire <strong>de</strong> l’Indépendance vaudoise.<br />
El<strong>les</strong> ont fait appel à Reusser, qui avait fait ses preuves. Il<br />
n’avait jamais lu le roman. Il s’est donné le temps <strong>de</strong> trouver<br />
dans <strong>les</strong> pages <strong>de</strong> l’écrivain vaudois <strong>les</strong> « éléments<br />
suffisamment forts pour justifier un nouveau film adapté<br />
<strong>de</strong> Ramuz »...<br />
L’aspect commémoratif laisse le cinéaste plutôt indifférent.<br />
Et comme il ne trouve guère d’intérêt à se «bala<strong>de</strong>r<br />
dans l’Histoire», il s’est concentré sur <strong>de</strong>ux thèmes qui<br />
résonnent en lui, à savoir la relation amoureuse entre<br />
David et Julie et <strong>les</strong> rapports père-fils. Ainsi l’authentique<br />
superproduction helvétique a <strong>de</strong>s grâces <strong>de</strong> film<br />
d’auteur.<br />
Si La GueRRe Dans Le Haut pays n’échappe pas toujours<br />
au didactisme théâtralisé indissociable <strong>de</strong>s films<br />
évoquant la pério<strong>de</strong> révolutionnaire, il réussit à dépeindre<br />
sans caricature l’âpre traditionalisme <strong>de</strong>s uns, qui ne<br />
voient pas ce que la liberté d’expression pourrait ajouter<br />
aux bienfaits <strong>de</strong> la terre nourricière, et l’effervescence<br />
révolutionnaire <strong>de</strong>s autres. Echappant aux contraintes<br />
qu’impose le débat d’idées, le cinéaste s’autorise <strong>de</strong>s<br />
scènes plus comiques (l’instituteur Devenoge aux prises<br />
avec sa mégère <strong>de</strong> femme) ou s’of<strong>fr</strong>e un plan somptueux<br />
(voir <strong>cette</strong> neige qui glisse sur la crête <strong>de</strong>s monts comme<br />
un souffle tellurique).<br />
Dans DeRboRence, la nature, le territoire, le mythe sont<br />
plus prégnants que dans La GueRRe... qui s’articule<br />
autour <strong>de</strong> passions humaines... Si dans son premier travail<br />
sur Ramuz, le cinéaste s’était montré d’une «fidélité<br />
absolue au livre tout en exhumant le sens», il a pris <strong>cette</strong><br />
fois-ci <strong>de</strong>s libertés. Moins «confit <strong>de</strong> respect», il a inventé<br />
<strong>de</strong>s situations (l’arbre <strong>de</strong> la Liberté), développé <strong>de</strong>s<br />
personnages comme Ansermoz, réécrit la plupart <strong>de</strong>s<br />
dialogues... Cette idée que la relation amoureuse est un<br />
levier sur le mon<strong>de</strong> par-<strong>de</strong>là la mort, est essentielle dans<br />
le film. En accédant à l’écran, Félicie-Julie s’est métamorphosée.<br />
La vierge tombée en catalepsie (« Chez Ramuz,<br />
quand il y a défaut d’amour, il y a <strong>fr</strong>équemment maladie »)<br />
est <strong>de</strong>venue une femme <strong>de</strong> chair, forte, désirable, désirée<br />
qui ne sombrera dans la folie qu’après avoir défendu son<br />
exclusivité amoureuse jusqu’au bout.<br />
Le film terminé, Reusser s’est aperçu qu’en dépit <strong>de</strong>s<br />
modifications, Ramuz résistait. « On ne peut pas l’entraîner<br />
n’importe où, et c’est bien. » Les enjeux du spectacle<br />
cinématographique ne réduisent en rien la gravité, la<br />
profon<strong>de</strong>ur, la dignité <strong>de</strong> l’écrivain. Et, d’un point <strong>de</strong> vue<br />
esthétique, le cinéaste s’est ingénié à recréer en lumière<br />
naturelle ces ombres que le poète peint avec génie : «La<br />
pauvreté <strong>de</strong> l’éclairage remplissait tous <strong>les</strong> creux...»<br />
Antoine Duplan L’Hebdo 1998-10-01<br />
Et, quand ce fusil là-haut se leva, il fut seul à se lever. C’était au milieu <strong>de</strong> la barrica<strong>de</strong>, tout à coup<br />
l’homme qui le tenait se montra tout entier, étant monté <strong>de</strong>ssus comme pour être plus sûr <strong>de</strong> son coup,<br />
et très lentement, … son arme se levait <strong>de</strong>puis par terre vers en haut …<br />
« Josias ! »<br />
Josias visait toujours.<br />
« Josias, c’est votre fils, vous ne l’avez pas reconnu ? »<br />
Mais le bras n’ avait pas tremblé, l’arme ne s’était point abaissée. Ils furent quelques-uns alors dans le<br />
retranchement qui se levèrent et coururent à Josias, tandis qu’on criait <strong>de</strong> nouveau : « C’est votre fils !<br />
Josias, c’est David ! » Josias visait toujours. Et ceux-là mêmes qui avaient couru à lui, quand ils furent<br />
plus près et virent qu’il gardait son calme (et le canon du fusil montait toujours), ceux-là s’arrêtèrent<br />
soudain.<br />
L’homme n’ avait point bougé. Le coup partit, il tomba sur <strong>les</strong> genoux.<br />
C.F. RAMUZ, La Guerre dans le Haut Pays<br />
la<br />
guerre<br />
dans<br />
le<br />
haut<br />
pays<br />
63
64<br />
LA PRESSE<br />
« Classique : conforme à la tradition »<br />
dit le Petit Larousse. En ce sens,<br />
F. Reusser a réalisé un film fort<br />
classique. Drame amoureux, trame<br />
historique. avec, côté opportunisme<br />
<strong>de</strong>s notab<strong>les</strong>, un fumet <strong>de</strong> Kermesse<br />
Héroïque, côté intégrisme huguenot,<br />
un soupçon <strong>de</strong> Dreyer, et l’idylle<br />
tragique pourrait s’appeler « Roméo<br />
et ophélie » ! La montagne est<br />
sauvage et belle, Julie belle et tendre,<br />
David tendre et <strong>fr</strong>agile.<br />
En dépit <strong>de</strong> ces conventions parfois<br />
pesantes, on retrouve çà et là le<br />
lyrisme faussement <strong>fr</strong>oid <strong>de</strong> Ramuz.<br />
Passion brisée et histoire d’amitié<br />
finissent par être attachantes. Et une<br />
reconstitution rigoureuse révèle un<br />
moment peu connu où notre <strong>de</strong>venir<br />
se mêla à celui <strong>de</strong> la Suisse, incarné<br />
par quelques personnages-types que<br />
F. Marthouret, J. Michel et a. Basler<br />
habitent avec talent. « Classique :<br />
qui est un modèle du genre », dit<br />
aussi le dictionnaire.<br />
LES FICHES DU CINéMA<br />
Le dossier <strong>de</strong> presse qui<br />
accompagnait le film à Berlin<br />
présentait <strong>les</strong> comédiens et <strong>les</strong><br />
techniciens du film en accolant à<br />
leur nom un i<strong>de</strong>ntifiant généralement<br />
collé à l’arrière <strong>de</strong>s automobi<strong>les</strong>,<br />
F, CH, ou B. a l’intérieur du cadre<br />
européen élargi à la Confédération,<br />
La guerre dans Le Haut Pays,<br />
adapté <strong>de</strong> Ramuz par Jean-Clau<strong>de</strong><br />
Carrière, roule explicitement pour<br />
la <strong>fr</strong>ancophonie.<br />
Il s’agit d’un récit historique localisé<br />
au pays vaudois en 1798. Le fond<br />
d’une vallée est rallié aux idées <strong>de</strong>s<br />
Lumières confortées par l’arrivée <strong>de</strong>s<br />
troupes <strong>fr</strong>ançaises, (qui ne sont pas<br />
encore <strong>les</strong> troupes napoléoniennes,<br />
comme l’assure le même dossier,<br />
mais cel<strong>les</strong> du Directoire,<br />
commandées par Brune, Bonaparte<br />
rêve alors d’aventures pyramida<strong>les</strong>),<br />
<strong>les</strong> hameaux d’altitu<strong>de</strong> figés dans<br />
la rigidité <strong>de</strong> leur culture calviniste<br />
restent soumis à Berne.<br />
L’amour est i<strong>de</strong>ntifié aux<br />
« Lumières », et af<strong>fr</strong>onte l’autorité<br />
(du père, <strong>de</strong>s pères) fondée par une<br />
lecture dogmatique, intégriste, <strong>de</strong> la<br />
?<br />
Francis Reusser signe sans doute<br />
un <strong>de</strong> ses meilleurs films et un grand film<br />
du cinéma suisse.<br />
La lecture réveille immanquablement <strong>de</strong>s paysages intérieurs. La découverte<br />
du texte <strong>de</strong> C-F Ramuz Guerre dans le Haut pays fut pour moi une<br />
révélation. D’abord parce qu’on y sent déjà tout ce qui fera le style <strong>de</strong><br />
Ramuz (le roman est écrit en 1913 au retour <strong>de</strong> Paris, c’est donc un roman<br />
<strong>de</strong> jeunesse), ensuite parce que ce texte gar<strong>de</strong> une incroyable actualité.<br />
S’il s’agit bien <strong>de</strong> la « révolution vaudoise et <strong>de</strong> l’amour mo<strong>de</strong>rne » on<br />
retrouve <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> ce texte dans notre quotidien <strong>de</strong> <strong>cette</strong><br />
fin <strong>de</strong> siècle.<br />
D’emblée, il m’a paru indispensable d’utiliser comme excuse la date<br />
du bicentenaire <strong>de</strong> <strong>cette</strong> révolution vaudoise (1998) pour dépasser le<br />
contexte et of<strong>fr</strong>ir au cinéma suisse l’occasion <strong>de</strong> mettre en valeur ce très<br />
beau texte <strong>de</strong> Ramuz. Quand <strong>les</strong> dates peuvent servir la culture et que <strong>les</strong><br />
raisons sont réunies pour ne pas manquer l’occasion <strong>de</strong> le faire...<br />
Cinq années <strong>de</strong> travail auront été nécessaires pour rassembler réalisateur,<br />
scénaristes, producteurs et personnes influantes afin <strong>de</strong> garantir un<br />
avenir à ce qui était au départ un rêve : susciter la réalisation d’un long<br />
métrage <strong>de</strong> dimension européenne. Dépasser par l’expression culturelle<br />
et artistique la géographie d’un canton et donner à voir une partie <strong>de</strong><br />
notre patrimoine au plus large public possible.<br />
Le tournage est achevé, le montage est en phase terminale. Francis<br />
Reusser signe sans doute un <strong>de</strong> ses meilleurs films et un grand film du<br />
cinéma suisse.<br />
Pierre Starobinski<br />
Bible. Le délire <strong>de</strong>s pasteurs induit<br />
la violence, la mort, la folie.<br />
Ça monte et ça <strong>de</strong>scend. Les images<br />
léchées renvoient, malgré la couleur<br />
et le Scope, au cinéma <strong>de</strong>s années<br />
cinquante, <strong>les</strong> hommes en chapeau<br />
noir sont photogéniques sur la neige<br />
blanche tous <strong>les</strong> jours <strong>de</strong> la semaine.<br />
Les acteurs maudissent le progrès<br />
dans le style odéon 1910, le fantôme<br />
<strong>de</strong> terzieff en prêcheur illuminé <strong>de</strong><br />
l’obscurantisme vaut le déplacement.<br />
pOSITIF, avril 1999<br />
Guerre et amour, conservatisme et<br />
progrès : jamais ce film ne s’écarte<br />
<strong>de</strong> ce canevas dialectique. Inspiré<br />
par le (magnifique) roman <strong>de</strong> Ramuz,<br />
il relate la conquête du pays <strong>de</strong><br />
Vaud au cours <strong>de</strong> l’hiver 1797-98 par<br />
<strong>les</strong> troupes napoléoniennes, alliées<br />
aux révolutionnaires locaux, qui se<br />
heurtent aux habitants du « haut<br />
pays », fanatisés par <strong>de</strong>s prédicateurs<br />
cinglés – la Bible dans une main, le<br />
fusil dans l’autre. Dans la tempête<br />
<strong>de</strong> la guerre civile naît l’amour entre<br />
David (fils d’un <strong>de</strong>s meneurs <strong>de</strong> la<br />
résistance aux laïques Lumières) et<br />
Julie (fille d’un modéré) : inutile <strong>de</strong><br />
préciser que cet amour s’avèrera<br />
impossible. Chaque plan semble<br />
inspiré <strong>de</strong>s maîtres flamands,<br />
avec ses contrastes <strong>de</strong> lumières<br />
au « pinceau-brosse » … Reusser<br />
fait preuve d’un véritable sens <strong>de</strong><br />
l’espace lorsqu’il filme <strong>les</strong> soldats<br />
se battant sur le col enneigé, face à<br />
l’ennemi invisible, lors <strong>de</strong> l’attaque<br />
finale, dans une scène fort réussie.<br />
Enfin, il faut saluer Marion Cotillard<br />
(Julie), vive et naturelle.<br />
LES CAHIERS DU CINéMA, avril 1999
« Cependant au village, tout était re<strong>de</strong>venu<br />
tranquille ; <strong>les</strong> morts avaient été enterrés.<br />
Ils dorment aujourd’hui encore dans le petit<br />
cimetière qui entoure l’église ; la mousse<br />
s’est mise sur <strong>les</strong> croix <strong>de</strong> pierre, on ne peut<br />
plus lire <strong>les</strong> noms.<br />
Ils vous montrent bien dans la porte d’un<br />
vieux chalet le trou qu’y a fait une balle<br />
et ils enfoncent un clou <strong>de</strong>dans pour vous<br />
faire voir qu’elle est entrée profond, mais<br />
quand on leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s renseignements,<br />
ils ne savent plus. « Il vous faudra aller à<br />
la Maison <strong>de</strong> la commune ; c’est là que se<br />
trouvent <strong>les</strong> papiers ».<br />
Tout a repris son calme au village. Il y a<br />
<strong>de</strong>s femmes autour <strong>de</strong> la fontaine ; <strong>de</strong>s<br />
petites fil<strong>les</strong> timi<strong>de</strong>s, quand vous vous<br />
approchez d’el<strong>les</strong>, se cachent la tête dans<br />
leurs tabliers ; vous enten<strong>de</strong>z tout à coup<br />
un grand cri venir <strong>de</strong> la scierie, c’est quand<br />
le tronc mordu tressaille et on dirait qu’il<br />
hurle <strong>de</strong> douleur.<br />
Mais il vous faudra peut-être pousser plus<br />
haut, où c’est encore plus beau et encore<br />
plus calme. Si vous venez jamais chez nous,<br />
venez au commencement <strong>de</strong> mai. Mai, c’est<br />
le mois <strong>de</strong>s fleurs à la montagne, partout<br />
autour <strong>de</strong> vous el<strong>les</strong> seront écloses, <strong>de</strong>s<br />
bleues, <strong>de</strong>s blanches, <strong>de</strong>s rouges, <strong>de</strong>s jaunes.<br />
Si, par hasard, vous levez <strong>les</strong> yeux, vous<br />
verrez venir un petit nuage. Il glissera, il s’en<br />
ira, et le grand ciel <strong>de</strong> nouveau sera vi<strong>de</strong> ;<br />
ainsi nos vies, ainsi là-haut, après tout ce<br />
bruit et ces guerres ; mais qu’importe aux<br />
hautes murail<strong>les</strong> ? Et rien n’ a jamais terni<br />
la pureté du bleu <strong>de</strong> la gentiane qui vient <strong>de</strong><br />
s’ouvrir comme un petit œil. »<br />
Dernière page du livre «La guerre dans le Haut Pays »<br />
<strong>de</strong> C. F. Ramuz<br />
la<br />
guerre<br />
dans<br />
le<br />
haut<br />
pays<br />
65
couRts et<br />
Moyens<br />
MétRaGes<br />
Vagabondages 71<br />
Conformisme 72<br />
C.F. Ramuz, L’apparition <strong>de</strong> la beauté 74<br />
FILMs<br />
InacHeVés<br />
Le Règne <strong>de</strong> l’esprit malin 68<br />
Derborence 70
68<br />
« la population<br />
le prend d’abord<br />
pour Jésus<br />
revenu sur terre »
LE RÈgNE<br />
DE L’ESPRIT MALIN<br />
Suisse / 1958 / 22 mn (inachevé) gUIDO WÜRTH<br />
Scénario : Guido Würth, Friedrich J. Schrag<br />
Image : Friedrich J. Schrag<br />
Son : Paul Wartmann, Hans Schoop<br />
Textes additionnels : Roger Burckhardt<br />
Musique : Sandor Veress<br />
Montage : G. Würth, F.J. Schrag, René Martinet<br />
Interprètes : <strong>les</strong> habitants <strong>de</strong> Leytron<br />
« Ils étaient tellement enfoncés<br />
dans leur joie et tellement<br />
fermés à tout le reste qu’ils<br />
n’aperçurent même pas, comme<br />
ils passaient près <strong>de</strong> l’église,<br />
le pauvre Lhôte seul épargné,<br />
parce que seul pur d’intentions,<br />
mais qui s’était laissé<br />
tomber dans un coin, la tête<br />
cachée au creux <strong>de</strong> son bras. »<br />
C. F. Ramuz «Le Règne <strong>de</strong> l’esprit malin »<br />
d’après le roman <strong>de</strong> C.F. Ramuz, « Le Règne <strong>de</strong> l’esprit malin » (1910)<br />
Arrivé <strong>de</strong> nulle part, Branchu s’installe<br />
dans un village valaisan où il<br />
ouvre une échoppe <strong>de</strong> cordonnier. Sa<br />
sympathie et sa générosité lui valent<br />
très vite d’être apprécié <strong>de</strong> tous. Il fait<br />
si bien son travail que son concurrent<br />
indigène se pend. Branchu, doté <strong>de</strong><br />
mystérieux pouvoirs, opère plusieurs<br />
mirac<strong>les</strong>, et la population le prend<br />
d’abord pour Jésus revenu sur terre.<br />
Cependant, peu à peu, un mal étrange<br />
s’abat sur <strong>les</strong> lieux, épargnant uniquement<br />
<strong>les</strong> partisans du nouveau<br />
Maître, qui se vautrent dans la débauche<br />
à l’auberge du village, alors que<br />
le reste <strong>de</strong> la population vit cloîtrée<br />
et apeurée. La plupart <strong>de</strong>s habitants,<br />
totalement affamés et gagnés par la<br />
maladie, cè<strong>de</strong>nt progressivement à la<br />
tentation en se joignant à Branchu et<br />
ses discip<strong>les</strong>, qui vivent dans l’abondance<br />
grâce aux pouvoirs du Maître.<br />
La communauté perd alors définitivement<br />
tout sens <strong>de</strong> la morale et<br />
sombre dans le blasphème. Seule la<br />
petite Marie sera capable <strong>de</strong> vaincre<br />
le Malin et <strong>de</strong> sauver le village <strong>de</strong> son<br />
emprise.<br />
Œuvre conçue par un étudiant zurichois en<br />
musicologie, Guido Würth, et par l’opérateur<br />
bernois Friedrich Schrag, un élève<br />
d’auguste Kern. tous <strong>les</strong> rô<strong>les</strong> sont tenus<br />
par <strong>de</strong>s dilettantes <strong>de</strong> la région.<br />
Roger Burckhardt <strong>de</strong>vait diriger quelques<br />
scènes dialoguées qui ne seront jamais<br />
tournées. on filme durant six semaines,<br />
et le tournage s’arrête, faute d’argent.<br />
courts et moyens métrages<br />
69
70<br />
DERBORENCE<br />
Suisse-Italie / 1946 / inachevé<br />
Réalisation : Mattia Pinoli<br />
Scénario : Mattia Pinoli<br />
Image : Massimo Dallamano, Fernand Reymond,<br />
Piero Petricciuole<br />
Musique : Mario Nascimbene ;<br />
Production : Montblanc Film (Brescia)<br />
Enrico Camplani<br />
Interprètes :<br />
Valentina Cortese (Thérèse)<br />
Vittorio Duse (Antoine)<br />
Gilda Marchio (Philomène)<br />
Egisto Olivieri (Nendaz)<br />
Luigi Almirante (Séraphin)<br />
Giovanni Barrella (Rebord)<br />
et <strong>les</strong> habitants du Val Derborence<br />
Tournage 9 au 15 octobre 1946.<br />
Lieux <strong>de</strong> tournage : Derborence (VS),<br />
Les Diablerets (refuge « Flotteron »)<br />
Le film <strong>de</strong>vait être produit par la Chambre<br />
Syndicale <strong>de</strong> Milan, mais la genèse <strong>de</strong><br />
l’entreprise semble confuse. L’éboulement a été<br />
reconstitué à grands <strong>fr</strong>ais. après douze jours<br />
d’extérieur, le producteur annonce qu’il est à<br />
bout <strong>de</strong> ressources. Le tournage est suspendu.<br />
Le producteur et le réalisateur disparaissent<br />
en Italie sans laisser <strong>de</strong> traces, en omettant <strong>de</strong><br />
payer leurs collaborateurs.<br />
MATTIA PINOLI<br />
d’après le roman <strong>de</strong> C.F. Ramuz, « Derborence » (1934)<br />
Au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> Derborence (Valais),<br />
au XVIII e siècle, un éboulement<br />
dans la montagne engloutit une<br />
vingtaine <strong>de</strong> bergers. Après un<br />
long mois d’attente, <strong>les</strong> villageois<br />
voient soudain réapparaître l’un<br />
<strong>de</strong>s disparus, Antoine Pont. Le<br />
berger «venu d’ailleurs» conte son<br />
odyssée souterraine mais ne parvient<br />
pas à briser le sortilège dont<br />
il est la proie ; un jour, il retourne<br />
sur ses pas pour rejoindre le mystérieux<br />
tombeau <strong>de</strong> ses camara<strong>de</strong>s.<br />
Thérèse, son épouse enceinte,<br />
réussit à l’arracher à la mort.
Derborence 1946<br />
VAgABONDAgES<br />
Suisse, 2006, 21 mn<br />
Pensé, écrit et réalisé par :<br />
Francis Reusser, Jean Reusser et<br />
Emmanuelle Riedmatten<br />
Figuration :<br />
Lamisse Wahib<br />
Rosemon<strong>de</strong> Mignot<br />
Dominique Turin<br />
Le Chat et son Restaurant « Au<br />
Bouillet »<br />
Technique et production :<br />
Jérôme Cuen<strong>de</strong>t, Le CinéAtelier<br />
Sarl, Pierre-Alain Frey, Xavier et<br />
Martine Grin, Grégoire Montangero<br />
Production : Cin&Lettres<br />
FRANCIS REUSSER, JEAN REUSSER,<br />
EMMANUELLE DE RIEDMATTEN<br />
Court voyage, avec ses arrêts, ses<br />
mouvements. Cartes posta<strong>les</strong>, instantanés<br />
<strong>de</strong> l’éditeur Mermod, <strong>de</strong><br />
la scripte d’occasion et futur écrivain<br />
Corinna Bille. Lumières, lieux,<br />
gens proches <strong>de</strong> Ramuz, écrivains,<br />
peintres, amis <strong>de</strong> passage. On y<br />
croise La Beauté sur la Terre, le<br />
Rhône et son vapeur, Derborence<br />
et ses rocs, toujours menaçants.<br />
Carte <strong>de</strong> visite, faire-part <strong>de</strong> <strong>de</strong>uil,<br />
confi<strong>de</strong>nces d’un cinéaste que<br />
Ramuz habite encore, et pour longtemps.<br />
Vagabondages inclut <strong>de</strong>s extraits<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux films inachevés, le Derborence<br />
(1946) et Le règne <strong>de</strong><br />
l’esprit malin (1956).<br />
Derborence 1946<br />
71<br />
courts et moyens métrages
72<br />
CONFORMISME<br />
Suisse, inédit FRANCIS REUSSER<br />
« Le conformisme repose sur un<br />
ensemble <strong>de</strong> conventions, d’espèce<br />
religieuse, morale, politique, sociale,<br />
un ensemble <strong>de</strong> goûts et d’habitu<strong>de</strong>s<br />
qui en découlent, mais ce qu’il a <strong>de</strong><br />
propre est d’être d’usage public, plus<br />
que privé ; c’est <strong>de</strong> consister dans<br />
l’observation publique <strong>de</strong> certains<br />
préceptes ou même d’un certain<br />
co<strong>de</strong> qu’il impose, beaucoup plus que<br />
dans une foi ou une conviction ; il<br />
est en quelque manière une opinion<br />
moyenne sur toute chose, à quoi tout<br />
le mon<strong>de</strong> précisément, parce qu’elle<br />
est moyenne, peut officiellement<br />
adhérer, mais qui comporte aussi la<br />
condamnation immédiate, et définitive,<br />
<strong>de</strong> celui qui ne se conforme pas,<br />
ou du moins laisse voir qu’il ne se<br />
conforme pas. […] Étant une attitu<strong>de</strong><br />
collective, il a besoin d’unanimité. […]<br />
Le conformisme n’ admet pas d’état<br />
net, il n’ a rien autant en horreur que<br />
<strong>de</strong>s genres tranchés. […] Tout ce qui<br />
ne lui ressemble pas exactement, il<br />
l’ignore, tout ce qui n’ est pas exactement<br />
conforme. […] Il ne faut pas<br />
que rien puisse changer au sein d’un<br />
petit univers où <strong>de</strong>puis longtemps<br />
tout est à sa place, ni dans cet état<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>mi-torpeur où le conformisme<br />
se complaît. »<br />
C.F. Ramuz<br />
(Le texte complet original a été publié en 1931 dans<br />
aujourd’hui, un hebdomadaire paru <strong>de</strong> 1929 à 1931 à Lausanne)<br />
S’appuyant sur sa propre définition du<br />
conformisme, Ramuz, dans son texte,<br />
brosse le portrait <strong>de</strong>s Vaudois. Selon lui, ce<br />
peuple aisé ne manque <strong>de</strong> rien (hôpitaux,<br />
éco<strong>les</strong>, banques, bel<strong>les</strong> maisons, assurances)<br />
et ne court par conséquent plus aucun<br />
risque, ce qui crée un réel vi<strong>de</strong> au fond <strong>de</strong><br />
chaque être. <strong>Pour</strong> ceux qui quittent <strong>cette</strong><br />
ambiance « renfermée », il est très difficile<br />
<strong>de</strong> revenir au pays, car il y manque<br />
une chose essentielle : la gran<strong>de</strong>ur. Le fait<br />
d’être neutre et <strong>de</strong> ne pas toucher la mer<br />
leur empêche toute aventure, toute découverte,<br />
tout accès au rêve et à l’imagination.<br />
La vie est-elle par conséquent réellement<br />
présente dans ce pays où tout est si bien<br />
organisé ? Selon Ramuz, <strong>les</strong> Vaudois ne<br />
sont pas totalement dupes <strong>de</strong> leur situation,<br />
et c’est ce qui rend leur conformisme<br />
tragique.<br />
objet<br />
filmé<br />
non<br />
i<strong>de</strong>ntifié
NoTE d’INTENTIoN<br />
C’est à partir <strong>de</strong> ce texte, l’un <strong>de</strong>s nombreux qu’il a consacrés au canton qui<br />
l’a vu naître, écrire et mourir, à la fois analyse d’un territoire, « anthropologie<br />
poétique » d’un peuple et réflexion parfois sévère sur une mentalité,<br />
un comportement social, politique et culturel, que m’est venue l’idée<br />
d’une « rêverie filmée d’un lecteur solitaire ». Je m’imagine parcourir, carnet<br />
<strong>de</strong> notes (la caméra-stylo à l’ancienne) à la main, <strong>les</strong> lieux <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> fiction<br />
<strong>de</strong> l’écrivain, souvent mêlés, dans l’entrelacs complexe <strong>de</strong> l’imaginaire et<br />
du vécu, <strong>de</strong> la vie intérieure et <strong>de</strong> l’expérience <strong>de</strong> la nature.<br />
Le Pays <strong>de</strong> Vaud, mais aussi le Valais, le Paris <strong>de</strong>s débuts, le lac, le vignoble<br />
et la montagne surtout, sont <strong>les</strong> lieux <strong>de</strong> fiction privilégiés <strong>de</strong> l’écrivain.<br />
Il en travaille le matériau humain, le paysage, la lumière, en tire récits<br />
et métaphores.<br />
La nature est une véritable « patrie <strong>de</strong> la fiction » pour reprendre le mot<br />
<strong>de</strong> Jean-Luc Godard à propos <strong>de</strong> l’URSS et <strong>de</strong> la naissance du cinéma muet,<br />
qu’affectionnait Ramuz. Il y aurait donc ce voyage, avec ses arrêts,<br />
ses mouvements, on y feuilletterait parfois d’anciennes cartes posta<strong>les</strong> ou<br />
<strong>de</strong>s instantanés <strong>de</strong> l’éditeur Mermod, donnant à voir <strong>les</strong> lieux au temps <strong>de</strong><br />
l’écriture ramuzienne ou <strong>de</strong> ses passages. Il y aurait <strong>les</strong> lumières, <strong>les</strong> cadrages,<br />
le rappel <strong>de</strong>s peintres auxquels s’intéressait l’écrivain, Cézanne, Auberjonois.<br />
Il y aurait la musique <strong>de</strong> Stravinski, le village du soldat <strong>de</strong> l’histoire.<br />
On y entendra la voix <strong>de</strong> l’auteur, lisant la beauté sur la terre, tandis qu’on<br />
s’y promènerait justement, du côté <strong>de</strong> St Sulpice sans doute.<br />
Il y aurait surtout ce qui intéresse le cinéma d’aujourd’hui, un dialogue<br />
imaginaire avec Ramuz, touchant à la représentation <strong>de</strong>s choses et <strong>de</strong>s êtres,<br />
à la vision, au point <strong>de</strong> vue ainsi assumé sur le mon<strong>de</strong>, tout ce qui fait le style,<br />
qui rassemble l’idée <strong>de</strong> création, une idée qui n’est plus trop <strong>de</strong> mise dans<br />
un métier plus souvent soumis aux lois du marché et du succès contraint.<br />
Ce journal ouvert, qui n’aurait pas <strong>de</strong> fin, mais juste un commencement,<br />
serait filmé à la manière d’un touriste, éclairé un peu plus qu’à l’habitu<strong>de</strong>.<br />
J’y réfléchirai à haute voix, au hasard d’une table <strong>de</strong> bistrot vaudois,<br />
ou d’un coin <strong>de</strong> rocher valaisan. Ce serait comme une sorte <strong>de</strong> roman<br />
d’après <strong>les</strong> romans, un lexique léger <strong>de</strong> la géographie d’un écrivain,<br />
mélangeant lieux <strong>de</strong> vie et d’appétit, lieux rêvés, décrits et écrits,<br />
avec la puissance <strong>de</strong> l’imagination.<br />
Il y aura ce court métrage, dont le début est un matin, jaune d’abord, puis<br />
bleu ou gris, et l’aboutissement, crépuscule, bleu encore, puis la pénombre,<br />
<strong>fr</strong>ontière <strong>de</strong> l’inconscient et du rêve, et la nuit enfin, qui clôt le regard et éteint<br />
la pellicule la plus retorse, l’argentique comme l’électronique.<br />
FRANCIS REUSSER<br />
73<br />
courts et moyens métrages
74<br />
Char<strong>les</strong> Ferdinand, ses parents, Stravinski…<br />
« une manière <strong>de</strong> parler<br />
qui vient <strong>de</strong> loin, d’une<br />
véritable langue d’ici,<br />
retravaillée, remise en<br />
musique par Ramuz »
C.F. RAMUZ<br />
L’APPARITION<br />
DE LA BEAUTÉ<br />
France-Suisse<br />
1997 / 46 mn documentaire<br />
Scénario : François Baumberger,<br />
Pierre-André Thiébaud<br />
Directeur <strong>de</strong> la photographie :<br />
Patrice Cologne<br />
Son : Christophe Giovannoni<br />
Montage : Alain Robiche<br />
Musique : Antoine Auberson<br />
Lecteur : Jean-Quentin Châtelain<br />
Avec :<br />
Jacques Chessex (écrivain)<br />
Jérôme Meizoz (critique)<br />
Jean Starobinski (écrivain)<br />
Pierre-André<br />
THIEBAUD<br />
né En 1954 à GranGEs<br />
(vaLais-sUissE)<br />
formé au marketing et aux<br />
sciences économiques,<br />
pierre-andré thiébaud<br />
s’initie à l’art du cinéma à<br />
l’institut national <strong>de</strong>s arts<br />
et du spectacle (insas) à<br />
Bruxel<strong>les</strong>, avec le réalisateur<br />
andré Delvaux.<br />
Les films qui traversent<br />
l’itinéraire <strong>de</strong> producteur<br />
<strong>de</strong> pierre-andré thiébaud<br />
d’abord chez amiDon<br />
patErson avec pierrealain<br />
meier puis en tant<br />
que producteur délégué<br />
pour sa société pCt<br />
cinéma – télévision sa ont<br />
obtenu une reconnaissance<br />
internationale.<br />
parallèlement à son activité<br />
<strong>de</strong> production, il réalise<br />
<strong>de</strong>puis 1981, principalement<br />
<strong>de</strong>s documentaires.<br />
PIERRE-ANDRÉ THIÉBAUD<br />
Pierre-André Thiébaud a réalisé un portrait<br />
biographique et littéraire où l’écrivain apparaît<br />
comme le personnage central, authentiquement<br />
vivant du film. A travers <strong>les</strong> lieux emblématiques,<br />
<strong>les</strong> témoignages privilégiés, <strong>les</strong> pages significatives<br />
<strong>de</strong> ses écrits, <strong>les</strong> films <strong>de</strong> fictions adaptés<br />
<strong>de</strong> ses romans, nous nous rendons compte <strong>de</strong> la<br />
vitalité toujours actuelle <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Ramuz.<br />
Précurseur d’une gran<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnité, inventeur<br />
<strong>de</strong> «l’écriture parlée», il se place en auteur véritablement<br />
révolutionnaire.<br />
« Je suis né en 1878, mais ne le dites pas.<br />
Je suis né en Suisse, mais ne le dites pas.<br />
Dites que je suis né dans le Pays-<strong>de</strong>-Vaud, qui est un vieux<br />
pays savoyard, c’est-à-dire <strong>de</strong> langue d’oc, c’est-à-dire<br />
<strong>fr</strong>ançais et <strong>de</strong>s bords du Rhône, non loin <strong>de</strong> sa source.<br />
Je suis licencié-és-lettres classiques, ne le dites pas.<br />
Dites que je me suis appliqué à ne pas être licencié-éslettres<br />
classiques, ce que je ne suis pas au fond, mais bien<br />
un petit-fils <strong>de</strong> vignerons et <strong>de</strong> paysans que j’aurais voulu<br />
exprimer.<br />
Mais exprimer, c’est agrandir.<br />
Mon vrai besoin, c’est d’agrandir...<br />
Je suis venu à Paris tout jeune ; c’est à Paris que je me suis<br />
connu et à cause <strong>de</strong> Paris.<br />
J’ai passé pendant douze ans, chaque année, plusieurs mois<br />
au moins à Paris ; et <strong>les</strong> voyages <strong>de</strong> Paris chez moi et <strong>de</strong><br />
chez moi à Paris ont été tous mes voyages !<br />
(Outre celui que j’ai fait par religion jusqu’à la mer, ma mer,<br />
<strong>de</strong>scendant le Rhône.) »<br />
(Lettre <strong>de</strong> Ramuz à Henry Poulaille, mai 1924)<br />
75<br />
documentaire
76<br />
remerciements<br />
CoNCEPtIoN Du CataLoGuE :<br />
alain et Edmée Moreau,<br />
Pierre et Simone Blon<strong>de</strong>au,<br />
Emmanuel Chagrot<br />
CoNCEPtIoN DE L’aFFICHE<br />
Et Du PRoGRaMME :<br />
Emmanuel Chagrot, CERF<br />
RELECtuRE :<br />
Simone Blon<strong>de</strong>au,<br />
Marie-Clau<strong>de</strong> Colin, Danièle Martin,<br />
Edmée et alain Moreau.<br />
DoCuMENtatIoN,<br />
PHotoGRaPHIES, aFFICHES :<br />
Francis Reusser,<br />
Collection CERF - Ciné-Club Jacques Becker,<br />
Clau<strong>de</strong> Bertin-Denis,<br />
la Cinémathèque Suisse.<br />
EDItEuR :<br />
C.E.R.F.<br />
28 rue Maurice Cordier<br />
25300 Pontarlier<br />
tél. 00 33 (0)3 81 39 18 69<br />
ou 00 33 (0)3 81 69 12 63<br />
E-mail : cerf.sa@wanadoo.<strong>fr</strong><br />
Site web : www.ccjb.<strong>fr</strong><br />
N° éditeur : 2-9509598<br />
CoMPoSItIoN Et IMPRESSIoN :<br />
Imprimerie Simon 25290 ornans<br />
Dépôt légal mai 2011<br />
ISBN 2-914146-27-2<br />
NouS REMERCIoNS tout PaRtICuLIÈREMENt<br />
Francis Reusser<br />
Swiss Films, M. Marcel Müller<br />
La Cinémathèque Suisse <strong>de</strong> Lausanne<br />
Jean-Louis Porchet, CaB Productions, Lausanne<br />
alain Pellissier<br />
“La Belle Équipe” du Ciné-Club Jacques Becker, totalement bénévole,<br />
sans qui <strong>les</strong> <strong>Rencontres</strong> Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong> Cinéma <strong>de</strong> Pontarlier<br />
n’existeraient pas.<br />
NouS REMERCIoNS PouR LEuR aIDE PRÉCIEuSE<br />
Le Ministère <strong>de</strong> la Culture / Direction Régionale <strong>de</strong>s affaires Culturel<strong>les</strong><br />
Le Centre National <strong>de</strong> la Cinématographie<br />
La Région Franche-Comté<br />
Le Conseil Général du Doubs<br />
La Ville <strong>de</strong> Pontarlier<br />
L’administration <strong>de</strong>s Douanes<br />
Le Rectorat <strong>de</strong> l’académie <strong>de</strong> Besançon<br />
Le Crédit agricole <strong>de</strong> Franche-Comté<br />
La distillerie Les fils d’Emile Pernot, La Cluse et Mijoux<br />
L’association Cin&Lettres a publié,<br />
en collaboration avec la Cinémathèque Suisse,<br />
un cof<strong>fr</strong>et DVD<br />
réunissant une sélection <strong>de</strong> sept films<br />
adaptés <strong>de</strong> l’œuvre romanesque<br />
<strong>de</strong> C. F. Ramuz.<br />
Le cof<strong>fr</strong>et comprend également<br />
<strong>de</strong> nombreux bonus<br />
(documentaires, courts métrages,<br />
films inachevés).