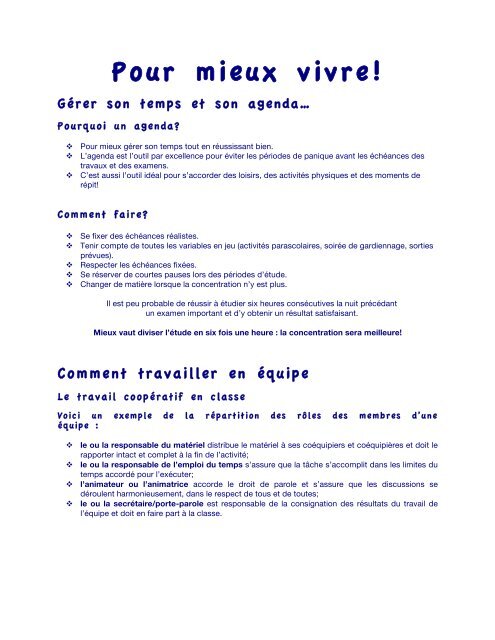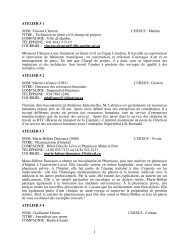methodologie - École Secondaire Mont-Saint-Sacrement
methodologie - École Secondaire Mont-Saint-Sacrement
methodologie - École Secondaire Mont-Saint-Sacrement
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pour mieux vivre!<br />
Gérer son temps et son agenda…<br />
Pourquoi un agenda?<br />
Pour mieux gérer son temps tout en réussissant bien.<br />
L’agenda est l’outil par excellence pour éviter les périodes de panique avant les échéances des<br />
travaux et des examens.<br />
C’est aussi l’outil idéal pour s’accorder des loisirs, des activités physiques et des moments de<br />
répit!<br />
Comment faire?<br />
Se fixer des échéances réalistes.<br />
Tenir compte de toutes les variables en jeu (activités parascolaires, soirée de gardiennage, sorties<br />
prévues).<br />
Respecter les échéances fixées.<br />
Se réserver de courtes pauses lors des périodes d’étude.<br />
Changer de matière lorsque la concentration n’y est plus.<br />
Il est peu probable de réussir à étudier six heures consécutives la nuit précédant<br />
un examen important et d’y obtenir un résultat satisfaisant.<br />
Mieux vaut diviser l’étude en six fois une heure : la concentration sera meilleure!<br />
Comment travailler en équipe<br />
Le travail coopératif en classe<br />
Voici un exemple de la répartition des rôles des membres d’une<br />
équipe :<br />
le ou la responsable du matériel distribue le matériel à ses coéquipiers et coéquipières et doit le<br />
rapporter intact et complet à la fin de l’activité;<br />
le ou la responsable de l’emploi du temps s’assure que la tâche s’accomplit dans les limites du<br />
temps accordé pour l’exécuter;<br />
l’animateur ou l’animatrice accorde le droit de parole et s’assure que les discussions se<br />
déroulent harmonieusement, dans le respect de tous et de toutes;<br />
le ou la secrétaire/porte-parole est responsable de la consignation des résultats du travail de<br />
l’équipe et doit en faire part à la classe.
Conseils pour mieux étudier<br />
RECONNAÎTRE LES FACTEURS QUI FAVORISENT L’ÉTUDE<br />
EST DÉJÀ EN SOI UNE FAÇON D’AMÉLIORER SES HABITUDES D’ÉTUDE<br />
Facteurs de l’environnement favorisant l’étude<br />
1. Le fait d’étudier toujours au même endroit augmente la concentration et le rendement.<br />
2. L’absence de distractions visuelles et sonores dans l’entourage immédiat améliore la<br />
concentration.<br />
3. Une pièce fraîche et aérée favorise le fonctionnement du cerveau.<br />
4. Un éclairage suffisant et adéquat réduit la fatigue visuelle et mentale.<br />
5. Avant de commencer l’étude d’une matière, il faut placer sur la table de travail tout le matériel<br />
nécessaire afin d’éviter les déplacements, causes de distraction.<br />
6. Pour étudier efficacement, il faut une table de travail suffisamment grande pour pouvoir y étaler<br />
tout le matériel nécessaire à l’étude d’une matière.<br />
7. Étudier couché ou dans un fauteuil trop confortable porte à la somnolence et nuit à la<br />
concentration.<br />
8. Le silence et le calme sont essentiels à un travail efficace.<br />
9. L’étude en équipe n’est efficace que pour la révision après l’apprentissage individuel.<br />
Facteurs favorisant un meilleur fonctionnement des facultés<br />
mentales<br />
1. Trois repas quotidiens équilibrés, un sommeil suffisant et de l’exercice physique favorisent le<br />
fonctionnement du cerveau.<br />
2. Les activités qui risquent d’énerver et d’exciter sont à éviter avant de commencer à étudier.<br />
3. Une période d’étude entrecoupée d’émissions de télévision ou de jeux à l’ordinateur perd<br />
beaucoup de son efficacité.<br />
4. Regarder la télévision ou jouer à des jeux à l’ordinateur immédiatement avant ou après une<br />
période d’étude nuit au processus d’apprentissage.<br />
5. Afin d’allonger le temps de concentration, il faut faire une courte pause lorsque l’esprit se met à<br />
rêvasser puis se remettre au travail.<br />
6. Laisser les préoccupations diverses envahir sa pensée pendant une période d’étude est<br />
nuisible à la concentration. Mieux vaut régler les préoccupations avant l’étude.<br />
7. Maintenir un rythme constant pendant les périodes d’étude pour ne pas les prolonger<br />
inutilement.<br />
8. Les moments les plus favorables à l’étude sont dans l’ordre : le matin, l’avant-midi, le milieu de<br />
l’après-midi ainsi que le milieu de la soirée.<br />
9. Étudier régulièrement chaque jour à heure fixe prédispose à l’étude et améliore la<br />
concentration.<br />
10. Au retour de l’école, il est préférable de s’oxygéner le cerveau par une activité extérieure que<br />
de se mettre immédiatement à l’étude.
Organisation et planification de l’étude<br />
1. Comprendre n’est pas apprendre. Ce n’est que la première phase de l’apprentissage.<br />
2. Pour bien apprendre, il faut bien comprendre.<br />
3. Chaque jour, le plan d’étude doit être fait en rapport avec les cours de la journée.<br />
4. Les matières demandant plus de concentration devraient être étudiées en premier lieu.<br />
5. Une présentation claire et aérée des notes de cours et des résumés favorise l’apprentissage.<br />
6. Les périodes d’étude doivent être entrecoupées de courtes pauses pour aider à la<br />
concentration, 20 à 30 minutes par exemple.<br />
7. Utiliser plus d’une approche, comme l’écriture, améliore la capacité de mémorisation.<br />
8. L’étude d’un examen sommatif se planifie sur plusieurs jours, en coupant la matière par<br />
sections d’apprentissage. La veille de l’examen est une révision.<br />
9. Pour assurer la maîtrise de la matière, les questions échouées à un examen doivent être<br />
étudiées à nouveau.<br />
En résumé<br />
Pensez à…<br />
Le silence et le calme sont essentiels à un travail efficace…<br />
La gestion de l’agenda<br />
• Noter les dates de tous les travaux et examens;<br />
• Planifier les périodes d’étude;<br />
• Planifier la révision quotidienne;<br />
• Planifier les devoirs;<br />
• Planifier les travaux;<br />
• Planifier les loisirs et les périodes de repos;<br />
• Prévoir les activités physiques;<br />
• Prévoir… l’imprévu.<br />
Lorsque l’échéancier n’est pas respecté en raison de difficultés contextuelles (fatigue, maladie,<br />
contretemps, incident, etc.), il faut reporter ailleurs dans l’agenda ce qui avait été planifié.<br />
Évidemment, il est impossible d’inventer du temps.<br />
Alors, il faut garder en tête l’atteinte d’objectifs réalistes en fonction du temps disponible!
Gérer son temps d’étude…<br />
Comment étudier<br />
efficacement?<br />
Rédiger des résumés, des synthèses, des<br />
schémas.<br />
Reprendre les exercices les plus<br />
difficiles.<br />
Compléter les informations manquantes des<br />
résumés ou des schémas à l’aide des notes de<br />
cours.<br />
Reproduire de mémoire les schémas et<br />
les dessins associés à la matière.<br />
Se questionner.<br />
Se fabriquer un examen.<br />
Se faire questionner.<br />
Expliquer la matière à une autre<br />
personne.<br />
Ce que je retiens…<br />
Pyramide de la mémorisation
Pour les travaux à long terme?<br />
Inscrire l’activité afin de ne rien oublier lorsque l’enseignant donne une date de remise (devoir,<br />
examen, exposé oral ou recherche) la journée de la remise ou du déroulement.<br />
Élaborer un échéancier concernant l’épreuve sur une feuille mobile insérée dans le cartable propre<br />
à la matière.<br />
Indiquer aux dates appropriées dans l’agenda, le travail à effectuer quotidiennement.<br />
Consulter l’agenda chaque jour pour connaître le travail à produire.<br />
Respecter l’horaire ainsi créé.<br />
En résumé<br />
Pour bien vivre ses apprentissages, il faut :<br />
Planifier l’étude globale des examens en divisant la matière en sous-sections.<br />
Évaluer le temps disponible pour l’étude et se réserver une période pour tout réviser avant la<br />
passation de l’examen.<br />
Survoler rapidement les nouvelles notions vues dans la journée.<br />
Réserver un temps pour faire les devoirs quotidiens.<br />
S’avancer dans les travaux de longue haleine, en fonction du temps disponible et des exigences<br />
requises par l’enseignant.<br />
Se distraire et se détendre entre chacune des activités pour reposer l’esprit et permettre de<br />
stimuler la concentration.<br />
Faire des activités physiques trois fois par semaine pour garder un esprit sain dans un corps sain.<br />
Revoir la planification régulièrement pour contrer les oublis.
Présentation d’un devoir (Travail court)<br />
Jean Explore 2008-09-22<br />
<br />
<br />
Géographie — 104<br />
(Début de travail)<br />
Façons d’écrire la date :<br />
Mon territoire urbain<br />
(titre souligné)<br />
Mardi 1 er septembre 2009<br />
Le 1 er septembre ou 1 er septembre 2009<br />
2009-09-01<br />
• Il n’y a aucune ponctuation lorsqu’on écrit une date.<br />
• Les mois de l’année et les jours de la semaine ne<br />
requièrent pas de majuscule.
Présentation d’un travail écrit (Travail long)<br />
La mémorisation<br />
( titre souligné)<br />
Par<br />
Hilet Studieu<br />
104<br />
Travail présenté à<br />
MONSIEUR DU PROF<br />
Pour le cours de<br />
Méthode de travail intellectuel<br />
<strong>École</strong> secondaire <strong>Mont</strong>-<strong>Saint</strong>-<strong>Sacrement</strong><br />
2009-10-23<br />
N. B. La première page du travail commence par le titre souligné, au centre de la première ligne.<br />
Les travaux faits à l’ordinateur doivent généralement respecter les<br />
consignes suivantes :<br />
Police Times New Roman, taille 12 points (même les titres),<br />
justification à gauche et à droite ainsi qu’à interligne et demi (ou<br />
double) selon l’enseignant (e).<br />
Selon les situations d’apprentissage, l’enseignant (e) peut exiger<br />
différentes particularités en fonction du type de travail demandé.
Les règles de la présentation écrite<br />
Qualité du français et des travaux scolaires<br />
Importance<br />
L'<strong>École</strong> secondaire <strong>Mont</strong>-<strong>Saint</strong>-<strong>Sacrement</strong> considère important d'assurer la qualité de la langue<br />
d'enseignement, tant sur le plan de l'écrit que sur celui de l'oral. Dans toutes les matières, la qualité des<br />
travaux sur le plan de l'écriture, de la propreté et de la présentation est exigée.<br />
Concertation<br />
L'<strong>École</strong> secondaire <strong>Mont</strong>-<strong>Saint</strong>-<strong>Sacrement</strong> considère comme essentielle la participation de tous les<br />
intervenants dans l'application de la politique : parents, enseignants, animateurs et directeurs. Il s'agit de<br />
développer une attitude de préoccupation qui se manifeste régulièrement auprès des élèves.<br />
Langue parlée<br />
En toutes circonstances, un langage incorrect sera suivi d'une intervention de l'éducateur-témoin.<br />
Langue écrite<br />
Tout travail faisant l'objet d'évaluation doit être présenté correctement, selon les modèles de présentation<br />
de notre établissement, avec une écriture lisible, sur du papier propre et dans un français correct. Tous<br />
les enseignants exigent le respect de cette consigne. Dans le cas contraire, diverses mesures peuvent<br />
s'appliquer (sauf les tests cycliques et les examens de session) :<br />
copie jugée irrecevable : à refaire;<br />
correction de fautes exigée (retard ou refus (fiche d'aide (geler la note);<br />
perte de points (jusqu'à 10 %) définitive (2 e cycle);<br />
majoration du résultat (bonus) dans le cas d'une copie impeccable ou à la suite d'une bonne<br />
correction des fautes;<br />
toute autre mesure visant à promouvoir la qualité du français écrit et parlé dans le cadre des activités<br />
pédagogiques et étudiantes de notre école.<br />
Chaque comité de niveau peut se concerter dans l'application d'un seul moyen.<br />
Présentation des travaux<br />
Qualités d’ordre général<br />
1. Propreté et clarté<br />
Présenter, quand cela est demandé, un travail au traitement de texte (interligne et demi, police de<br />
caractère à 12). Sinon, utiliser un stylo à l'encre (sauf quand il s'agit d'exercices). Ne pas multiplier<br />
les couleurs : généralement, une seule suffit.<br />
2. Ordre<br />
Si le travail comporte des divisions (paragraphes, changement de problèmes), marquer ces<br />
divisions en passant au moins une ligne. On gagne beaucoup en subdivisant son travail.
Remise des travaux<br />
Tout travail exigé d'un enseignant doit être fait par l'élève dans les délais prévus et remis à la date<br />
déterminée par l'enseignant.<br />
Tout travail jugé incomplet par l'enseignant sera considéré comme non fait.<br />
Dans le cas de la non-remise d'un travail à la date prévue, il appartiendra à l'enseignant de juger de la<br />
situation en termes de :<br />
négligence de la part de l'élève;<br />
circonstances l'empêchant d'effectuer son travail;<br />
par contre, c'est la responsabilité de l'enseignant d'agir sur-le-champ, pour faire effectuer le travail<br />
ou imposer des sanctions. Le comité de niveau ou le titulaire agira si la situation se répète dans<br />
plusieurs cours.<br />
Dans l'hypothèse où le relevé de la fiche d'aide, quant aux travaux en retard, est suffisamment sérieux, le<br />
titulaire, à la demande du comité de niveau, portera le cas au directeur de cycle où les procédures de<br />
classe habituelles s'appliqueront.<br />
Les parents et les élèves seront informés des retards dans la remise des travaux lorsque la situation<br />
l'exigera.<br />
Négligence de la part de l’élève<br />
Travaux journaliers :<br />
pointage à la fiche d'aide et sanctions prévues par les enseignants du niveau;<br />
si des résultats sont attachés à ce travail, l'élève pourra avoir la cote « 1 »;<br />
les procédures de classe pourront s'appliquer.<br />
Travaux d'envergure :<br />
pointage à la fiche d'aide;<br />
une retenue possible le midi à 12 h 35, de 16 h à 17 h 30, ou durant une journée pédagogique;<br />
un délai raisonnable peut être consenti;<br />
après ce délai, le travail doit être remis, sinon l'élève pourra avoir la cote « 1 »;<br />
l'enseignant pourra utiliser divers moyens pour récupérer le travail dans les délais raisonnables<br />
consentis : communication aux parents, rencontre avec l'élève.<br />
Circonstances empêchant l’élève d’effectuer son travail<br />
L'élève en informe l'enseignant.<br />
Une entente intervient entre l'enseignant et l'élève.
La table des matières<br />
QU’est-ce que c’est une table des matières?<br />
Elle est utile pour les travaux d’envergure puisqu’elle présente un aperçu de l’ensemble du travail. Elle<br />
contient les titres de chapitres, les subdivisions, la pagination correspondante, etc., et se retrouve au<br />
début du travail.<br />
Comment faire?<br />
La table des matières doit donner au lecteur une connaissance immédiate de la structure<br />
d’ensemble du travail. Elle en présente le contenu par l’indication, en ordre logique, de ses<br />
différents titres en lettres minuscules précédés de leur numéro d’ordre (en chiffres arabes).<br />
Les numéros des pages, correspondant au début de chacune de ces parties, sont alignés à la<br />
marge droite. La table des matières reproduit également, s’il y a lieu, les titres des pages liminaires<br />
(préface, prologue).<br />
Dans la plupart des cas, la table des matières ne doit pas excéder une page.<br />
Le titre TABLE DES MATIÈRES est dactylographié en lettres majuscules ou en caractère plus<br />
gros et centré en haut de la page.<br />
Après les titres, il faut mettre des points continus jusqu’au chiffre de la page.<br />
Il ne faut pas mettre le mot « page » (ou « p. ») devant le chiffre de la page.<br />
L’ordre de présentation des différentes parties du travail :<br />
la page titre;<br />
la table des matières;<br />
la liste des tableaux, des figures ou des illustrations (s’il y a lieu);<br />
le texte lui-même (introduction : 1 page, développement, conclusion : 1 page);<br />
la liste des notes et des références (s’il y a lieu);<br />
les annexes (s’il y a lieu);<br />
la bibliographie (sources différentes);<br />
la page de garde (page blanche à la fin).<br />
Les annexes<br />
Les annexes consistent en des parties additionnelles qui complètent le corps du travail de recherche.<br />
Elles ne sont pas intégrées au travail parce qu’elles l’alourdiraient inutilement.<br />
En annexe, on peut retrouver les éléments suivants :<br />
des renseignements, des textes ou des notes complémentaires;<br />
des données statistiques;<br />
des citations trop longues pour être intégrées au texte (1 page et plus);<br />
des formules, des cartes, des plans, des photos, etc.<br />
On indique l’ordre des annexes par des chiffres romains.<br />
Ainsi, l’expression ANNEXE I, en lettres majuscules, se place en haut de la feuille, au centre. Plus bas, on<br />
écrit le titre de l’annexe en lettres minuscules.<br />
TRÈS IMPORTANT<br />
Dans un travail, on ne remet pas une annexe ou autres parties avec un collage;<br />
il faut faire une photocopie du montage effectué.
La pagination<br />
On utilise les chiffres arabes (ex. : 1, 2, 3, 4) pour numéroter les pages du texte, depuis<br />
l’introduction jusqu’à la bibliographie ou jusqu’à la dernière page du travail, incluant les pages des<br />
annexes (s’il y a lieu).<br />
Le chiffre indiquant la page doit être placé en haut à droite.<br />
***<br />
E X E M P L E<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………… 1<br />
1. Les poèmes d’Anne Hébert……………………………………………………………………………… 2<br />
1.1. Son œuvre poétique…………………………………………………………………………….. 2<br />
1.2. Sa vision de la poésie…………………………………………………………………………… 3<br />
1.3. Son cheminement et sa façon d’écrire……………………………………………………….. 4<br />
2. Les romans d’Anne Hébert………………………………………………………………………………. 5<br />
2.1. Son œuvre romanesque………………………………………………………………………... 5<br />
2.2. Ouverture sur le monde : entre le Québec et la France…………………………………….. 5<br />
2.3. Les divers prix remis à Anne Hébert………………………………………………………….. 6<br />
3. Anne Hébert, une artiste complète : un grand nom de la littérature québécoise…………………. 6<br />
3.1. Scénariste et scriptrice………………………………………………………………………… 6<br />
3.2. Auteure de pièces de théâtre………………………………………………………………….. 7<br />
3.3. La diversité des activités d’Anne Hébert……………………………………………………... 8<br />
CONCLUSION………………………………………………………………………………………………….. 9<br />
ANNEXE I……………………………………………………………………………………………………….. 10<br />
ANNEXE II………………………………………………………………………………………………………. 11<br />
ANNEXE III……………………………………………………………………………………………………… 12<br />
BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………………………………………. 13<br />
Les citations<br />
Qu’est-ce qu’une citation?<br />
Une citation est un extrait puisé dans les documents consultés lors de l’élaboration du travail de<br />
recherche. Quoiqu’il soit préférable pour préserver l’unité du texte de résumer la pensée d’un auteur, il<br />
peut être nécessaire parfois de le citer textuellement.
Les citations indirectes<br />
Une citation indirecte s’emploie lorsque l’on reprend ou lorsque l’on emprunte les idées d’un auteur sans<br />
la ou le citer textuellement, c’est-à-dire mot à mot. C’est, pour ainsi dire, lorsque l’on reformule les idées<br />
exprimées ou écrites par un auteur.<br />
Exemple : Tiré de Jocelyn Lapointe, «La recherche qualitative : par delà la synthèse de la phénoménologie<br />
et de l’ethnométhodologie », dans La recherche qualitative : études comparatives, sous la direction de<br />
Pierrette Bouchard, Les Cahiers du Labraps, vol. 16, Université Laval, 1994, p.1.<br />
De tout temps, l’être humain a cherché à comprendre comment sa vie s’organisait, s’édifiait<br />
et se construisait avec ses semblables. Ironiquement, il a d’abord découvert les grandes lois<br />
qui régissent la nature et l’univers. Au fil des ans, un ensemble de connaissances et de<br />
recherches se sont développées autour des phénomènes dits de la nature. À la fin du XIXe<br />
siècle, après avoir passé par l’état théologique, des origines au XIIIe siècle, et par l’état<br />
métaphysique, du XIVe siècle au XVIIIe siècle 1 , s’installe un état dit positif, c’est-à-dire un<br />
état dans lequel la pensée scientifique est considérée comme étant la connaissance<br />
absolue 2 . Dès lors, on a assisté au règne de la connaissance des faits, le règne du<br />
scientisme, dont Auguste Comte et son positivisme en sont l’illustration.<br />
________________<br />
1 Vladimir Grigorieff, Philo de base…, Verviers, Marabout, 1983, p. 264.<br />
2 Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1964, p. 280.<br />
Les citations directes<br />
La citation directe est une citation qui reprend textuellement les mots de l’auteur. Tout extrait doit<br />
correspondre exactement à l’original quant aux mots, à l’orthographe et à la ponctuation. Les mots que<br />
l’on désire reproduire sont placés entre guillemets « texte »; les mots que l’on ne veut pas reproduire sont<br />
remplacés par des points de suspension entre crochets […]. Les mots que l’on désire ajouter sont placés<br />
entre parenthèses (texte). Si l’on désire signaler une erreur dans le texte cité, on inscrit, après la faute, le<br />
mot « sic » (du latin ainsi) entre parenthèses (sic).<br />
Une citation brève, c’est-à-dire de trois lignes ou moins, est introduite dans le texte, entre guillemets. Une<br />
citation longue, qui compte plus de trois lignes, mais moins d’une page, s’inscrit en retrait du texte à cinq<br />
espaces des limites gauche et droite, à interligne simple, sans guillemets.<br />
Une citation d’une page ou plus, toutefois, se placera en annexe à la fin du travail.<br />
3
Modèle de citation directe de moins de trois lignes<br />
avec modèle d’appel de note et de références<br />
Il doit premièrement tenter de se débrouiller avec la douleur que provoque la perte d’un<br />
parent et doit également : « […] négocier avec la faiblesse et la tristesse que leurs parents<br />
n’arrivent pas à dissimuler. » 2 . Il n’est alors pas surprenant que l’enfant se replie sur lui-<br />
même puisqu’il est à peu près seul, les parents étant très occupés avec leurs propres<br />
problèmes.<br />
On peut remarquer un vieillissement prématuré chez les enfants du divorce. Ils ne veulent<br />
pas montrer leur souffrance. Ces mûrissements trop hâtifs ne sont pas nécessairement<br />
positifs. « Cet effort tendu vers l’apparence laisse des traces dans le coeur. Des traces<br />
parfois béantes. » 3<br />
La peine que ressentent les enfants peut les amener à avoir des comportements<br />
dangereux. «Le sentiment d’insécurité est un signe constant des difficultés psychologiques<br />
de l’enfant confronté à la rupture parentale.» 4 Il a pour effet de provoquer chez l’enfant ou<br />
l’adolescent, un découragement extrême mettant parfois en cause sa propre vie, selon<br />
Philippe Fuguet, auteur du livre Les parents, le divorce et l’enfant. L’insécurité pousse parfois<br />
le sujet au suicide. Dans plusieurs de ces cas, le suicide est une réponse à la peur<br />
provoquée par le départ d’un parent.<br />
___________<br />
2 Marie Winn, Enfants sans enfance, Ottawa, Éditions de Mortagne, 1985, p. 147.<br />
3 Philippe Fuguet, Les parents, le divorce et l’enfant, Paris, Éditions ESF, 1985, p. 72.<br />
4 Ibid., p. 89.<br />
Signification<br />
Ibidem : Mot latin signifiant « dans le même ouvrage ». Pour ne pas répéter le nom de<br />
l’auteur (e) et son adresse bibliographique complète de la note de bas de page<br />
précédente, nous inscrivons Ibid.<br />
4
3. Les solutions<br />
Modèle de citation directe de plus de trois lignes<br />
avec modèle d’appel de note de références<br />
La recherche de solutions pour atténuer les effets du divorce chez l’enfant a mené<br />
les chercheurs à envisager trois pistes principales : une éthique du divorce centrée<br />
sur l’enfant, le recours au soutien des autres personnes adultes dans l’entourage<br />
de l’enfant et une approche humaniste de la part des juges et de la loi en matière<br />
du divorce. Citons d’abord le point de vue de George Cvetkovitch :<br />
Dans le but d’atténuer les effets du divorce sur les enfants, bon<br />
nombre de conseillers et de chercheurs ont contribué à favoriser une<br />
éthique du divorce centrée sur les besoins de l’enfant (par exemple,<br />
Wallerstein et Kelley, 1977). 10<br />
Nous avons déjà signalé que les législations de 1968 et de 1985 ont rendu le<br />
divorce plus facile et plus abordable pour les couples québécois.<br />
_______________<br />
10 George Cvetkovich et al., op.cit., p. 88.<br />
Signification :<br />
et al : Abréviation latine de l’expression et alii, signifiant « et les autres ».<br />
op.cit. : Abréviation latine de l’expression opere citato signifiant «dans l’ouvrage déjà<br />
mentionné ».<br />
L’appel de note<br />
Pour indiquer les références bibliographiques (les notes de bas de page), l’appel de note est signifié par<br />
un chiffre arabe (1, 2, etc.) en exposant d’un demi-interligne; ce chiffre d’appel se situe immédiatement<br />
après les guillemets (cit. courte) ou le texte (cit. longue) que l’on désire commenter et avant la<br />
ponctuation de la phrase (s’il y en a une).<br />
Les appels de note sont numérotés consécutivement du début à la fin du travail (ils s’additionnent de<br />
page en page).<br />
Références en bas de page<br />
Lorsque tu ajoutes des citations à un texte, tu te dois d’en indiquer la provenance (la source). Ainsi, toute<br />
citation, qu’elle soit directe (extrait repris textuellement) ou indirecte (résumé du texte d’un auteur), exige<br />
une référence bibliographique.<br />
Cette référence est insérée au bas de chaque page qui contient une citation avec un appel de note.<br />
7
Voici ce que la référence bibliographique doit contenir, dans l’ordre, pour un livre dans une note au<br />
bas d’une page :<br />
1. le prénom de l’auteur;<br />
2. son nom;<br />
3. le titre en italique;<br />
4. l’adresse bibliographique complète (le lieu de publication, l’éditeur, le numéro de l’édition s’il<br />
y a lieu, la collection s’il y a lieu, la date de publication, le tome ou le volume s’il y a lieu) ;<br />
5. la page correspondant à la citation.<br />
Tous ces éléments sont séparés par des virgules (sauf le prénom et le nom) et le dernier est suivi d’un<br />
point (voir exemples à la page suivante).<br />
À l’ordinateur, la note de bas de page se fait automatiquement selon les consignes à respecter.<br />
Démarche à suivre : Insertion, Note, Note de bas de page (les notes de bas de page doivent se<br />
trouver physiquement au bas de la page, même si la page n’est pas utilisée au complet), OK.<br />
* Lorsque les travaux sont faits à l’ordinateur, les titres doivent être en italique. Si le travail est<br />
fait à la main, il faut souligner le titre.<br />
Il y a quelques différences entre les références en bas de page et les références bibliographiques.<br />
La bibliographie<br />
Qu’est-ce qu’une bibliographie?<br />
Il s’agit de la présentation, en ordre alphabétique, de toutes les sources citées ou consultées qui<br />
ont servi à la rédaction du travail de recherche.<br />
La bibliographie se retrouve à la fin du travail.<br />
Généralement, on expose la bibliographie par ordre alphabétique des noms d’auteurs.<br />
De plus, on peut classer les ouvrages en les subdivisant selon la nature des ouvrages consultés :<br />
dictionnaires, encyclopédies, ouvrages généraux, ouvrages spécialisés, articles de revues ou de<br />
journaux, films, sites Internet, cédéroms, etc.<br />
On doit transcrire la liste des ouvrages à simple interligne. De plus, entre les descriptions<br />
bibliographiques, on passe 2 interlignes.<br />
Il est essentiel de rédiger correctement ses fiches bibliographiques dès le début du travail :<br />
l’élaboration de la bibliographie n’en sera que simplifiée !<br />
Comment faire?<br />
La première page de la bibliographie est titrée BIBLIOGRAPHIE (le titre est en lettres majuscules,<br />
centré et non souligné). De plus, il ne faut pas mettre le numéro de la page dans le coin supérieur droit (il<br />
faut le sous-entendre pour compléter la table des matières).
Pour un livre dans la bibliographie :<br />
le nom de l’auteur en lettres majuscules, suivi de son prénom en lettres minuscules;<br />
le titre et le sous-titre (s’il y a lieu) en italique;<br />
l’adresse bibliographique complète (le lieu de publication, l’éditeur, le numéro de l’édition s’il y a<br />
lieu, la collection s’il y a lieu, la date de publication, le tome ou le volume s’il y a lieu) ;<br />
o si la date n’apparaît pas, on indique s.d. (sans date)<br />
o si le lieu n’apparaît pas, on indique s.l. (sans lieu)<br />
o si ni la date ni le lieu ne sont indiqués, on écrit s.d.n.l. (sans date ni lieu)<br />
le nombre total de pages.<br />
Exemples pour la description d’un livre :<br />
1 auteur<br />
2 auteurs<br />
3 auteurs<br />
Plus de 3 auteurs<br />
Sans auteur<br />
GORZ, André. Les métamorphoses du travail, Paris, Galilée, 1991, 250 p.<br />
BOUCHARD, Régent, et Roger DIONNE. Découvertes – Manuel<br />
d’apprentissage, <strong>Mont</strong>réal, Lidec inc., 1992, 617 p.<br />
NOM, Prénom, Prénom NOM et Prénom NOM. Titre du volume en italique,<br />
lieu de publication, éditeur, date de publication, nombre total de pages.<br />
NOM, Prénom, et al. Titre du livre en italique, lieu de publication, éditeur,<br />
date de publication, nombre total de pages.<br />
Titre du livre en italique, lieu de publication, éditeur, date de publication,<br />
nombre total de pages.<br />
Pour un article de journal ou une revue :<br />
le nom de l’auteur en lettres majuscules, suivi de son prénom en lettres minuscules;<br />
le titre de l’article au complet entre guillemets;<br />
le titre en italique de la revue ou du journal précédé de « dans »;<br />
le volume de la revue ou du journal, le numéro de la revue ou du journal;<br />
la date de publication;<br />
les pages de l’article.<br />
Exemples pour la description d’un article de journal ou de revue :<br />
BERNARD, Michel. « Vers des romans de l’âge adulte », dans <strong>École</strong> des lettres,<br />
vol. 60, n o 9, août 1969, p. 491-492.<br />
PONTAUT, Alain. « Poussière sur la ville devient film », dans Le Devoir, vol. 56,<br />
n o 43, 22 février 1965, p. 5.
Pour un cédérom, logiciel ou un document électronique :<br />
NOM, Prénom ou organisme. (année de publication). Titre du document en italique (mention de l’édition<br />
ou de la version du logiciel), [Type de support]. Lieu de publication, éditeur.<br />
Exemples :<br />
DURAND, Jean. (1995). L’atome et le tableau périodique (version 4.0),<br />
[Logiciel]. <strong>Mont</strong>réal, DLE.<br />
(1997). Oxford Hachette French Dictionary, (Windows version 1.0), [CD-ROM].<br />
Oxford, Oxford University Press and Technology.<br />
Pour une source trouvée dans une source (exemple : un article de journal ou de revue trouvé dans<br />
Internet).<br />
Exemple :<br />
Notes :<br />
Types de support :<br />
BRETON, Brigitte. « “Les gars doivent apprendre à travailler”, dit une<br />
chercheuse », dans Le Soleil, (14 octobre 1999), p. A1, [En ligne].<br />
[http://newscan.com/], (Page consultée le 12 janvier 2000).<br />
[En ligne] : lecture<br />
[CD-ROM] : cédérom<br />
[Discussion] : session de clavardage<br />
[Courriel] : courrier électronique<br />
Pour un site Internet :<br />
[Disquette d’ordinateur]<br />
[Clé USB]<br />
[Cassette]<br />
[Vidéocassette]<br />
[Logiciel]<br />
NOM, Prénom ou ORGANISME. (date de la conception ou de la consultation par l’usager). Titre de la page<br />
d’accueil en italique, [Type de support]. Adresse URL complète de la ressource (sans point à la fin pour ne<br />
pas confondre l’internaute)<br />
Notes :<br />
• Si la date de conception n’est pas indiquée, vous n’avez qu’à mettre la date qui correspond au<br />
moment de votre consultation.<br />
• S’il n’y a pas d’auteur ou d’organisme, vous débutez avec les parenthèses et le reste de la référence.<br />
Exemples :<br />
CARON, Rosaire. (Page consultée le 15 octobre 1997). Comment citer un document<br />
électronique?, [En ligne]. Adresse URL : http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html<br />
UNIVERSITÉ LAVAL. (Page consultée le 8 mai 1996). Site de la Bibliothèque de<br />
l’Université Laval, [En ligne]. Adresse URL : http://www.bibl.ulaval.ca/
Pour les films, vidéos et émissions télévisées (documents audiovisuels) :<br />
NOM du réalisateur, Prénom. Titre du film en italique, maison de production, année de la sortie du film,<br />
sorte de film, noir et blanc ou couleur, langue (la version originale ou traduite), la durée.<br />
Exemple :<br />
THIBAULT, Margaret. Ma langue et ses difficultés, Office national du film du<br />
Canada, 1994, vidéocassette VHS, couleur, français, 50 minutes.<br />
Pour le courrier électronique :<br />
NOM, Prénom de l’auteur. (date d’envoi). Sujet du message en italique [courrier électronique à la personne<br />
qui reçoit le message], [Type de support]. Adresse par courrier électronique : adresse électronique de la<br />
personne qui reçoit le message<br />
Exemple :<br />
Pour une entrevue :<br />
BOURGAULT, Thérèse. (9 janvier 1999). Production d’étiquettes [courrier<br />
électronique à Rosaire Caron], [En ligne]. Adresse par courrier électronique :<br />
rosaire.caron@bibl.ulaval.ca<br />
Titre de l’entrevue en italique. (date de l’entrevue), [Type de support]. Personne interviewée, titre de la<br />
personne, organisme ou entreprise s’il y a lieu. Entrevue par nom de la personne (durée si disponible).<br />
Exemple :<br />
Les rayons X. (2 octobre 2002), [Vidéocassette]. Oliver Magnan, radiologiste au<br />
CHUS. Entrevue par Josée Grandmont (60 minutes).<br />
Pour des notes de cours :<br />
NOM, Prénom de l’enseignant. « Chapitre N o , Module N o », titre du cours en italique, année de la rédaction<br />
des notes, pages consultées.<br />
Exemple :<br />
RICHARD, Marc. « Chapitre 8, Module 4 », Cours de chimie 534, 2004, p. 22-23.
Adapté et modifié par François Laplante,<br />
de l’école d’Éducation internationale de Laval,<br />
d’un texte de François-Pierre Gingras de l’Université d’Ottawa<br />
avec la permission de l’auteur<br />
(Les textes publiés ainsi que les textes trouvés sur Internet)<br />
COMMENT ÉVITER LE PLAGIAT<br />
PLAGIER : c’est voler ou emprunter les mots (parlés ou écrits), les idées, les théories, les faits (qui ne sont pas<br />
considérés comme des connaissances générales), les statistiques, les œuvres d’art, etc. d’une personne en les<br />
faisant passer pour les nôtres. Plagier c’est omettre de mentionner la provenance de ses sources. La traduction et la<br />
modification partielle ou totale des textes d’autrui constituent une forme de plagiat si la source n’est pas indiquée<br />
correctement. Lorsque vous citez vos sources, vous devez le faire en respectant les règles de présentation matérielle<br />
généralement acceptées.<br />
Évidemment, on ne peut pas toujours être original et réinventer la roue… Il est donc tout à fait normal de s’inspirer<br />
des écrits, des pensées, des théories et des paroles des autres. Cependant, il faut le faire de façon acceptable afin de<br />
ne pas vous livrer à un acte de plagiat.<br />
« Votre diplôme doit refléter les connaissances et les habiletés acquises durant vos études. Il n’en tient qu’à vous qu’il<br />
représente aussi un sens des valeurs élevé et un grand souci d’intégrité et dont il témoigne, en somme, de votre<br />
savoir-faire » (Copier c’est plagier, HEC <strong>Mont</strong>réal). Le plagiat porte atteinte à votre réputation ainsi qu’à celle de votre<br />
école. N’oubliez pas, plagier c’est frauder!<br />
PRINCIPES<br />
Tout emprunt cité textuellement doit être placé entre guillemets et accompagné d’une référence complète<br />
(nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, éditeur, année, page).<br />
Il est inacceptable de paraphraser (reprendre les idées ou opinions, mais en utilisant des synonymes),<br />
quelqu’un en faisant passer ces propos pour les vôtres. Et ce, qu’il s’agisse de texte (incluant les statistiques<br />
et les images) provenant d’un livre, d’une revue, d’un quotidien ou d’un site provenant d’Internet.<br />
Tout emprunt d’idées, de théories ou d’opinions doit être accompagné d’une référence complète.<br />
Le plagiat et la fraude ont plusieurs visages, par exemple : c’est utiliser un travail effectué par une autre<br />
personne; c’est utiliser du matériel non autorisé pendant un examen; c’est jeter un coup d’œil sur la copie<br />
d’examen d’un collègue. Toutes ces pratiques relèvent du plagiat et de la fraude.<br />
Dans le cas d’un travail d’équipe, lorsque votre nom figure sur le travail, vous en partagez la responsabilité.<br />
N’oubliez pas, vous triomphez en équipe, mais vous périssez également en équipe! Soyez vigilants.<br />
Le plagiat peut entraîner des conséquences graves : l’attribution de la note zéro pour tout travail contenant<br />
toute forme de plagiat. Le plagiat peut même mener jusqu’au renvoi de l’école.
Vous voulez vous servir du texte suivant :<br />
EXEMPLES<br />
Feux dans l’ouest, inondations. Vagues de chaleur. Le climat lui-même est-il en train de changer ? Fort probablement, mais ce sont<br />
nos enfants et nos petits-enfants, dans leurs vieux jours, qui seront en mesure de le dire avec certitude. Le climat, c’est une<br />
moyenne sur 30 ans, dit Claude Villeneuve, biologiste et grand vulgarisateur des changements climatiques. Toutefois, les<br />
spécialistes s’entendent : la sécheresse en Colombie-Britannique, les orages violents provoquant des inondations dans les Bois-<br />
Francs et la sécheresse en Europe illustrent exactement ce que l’avenir nous réserve. L’extrême pourrait devenir la norme. Cela colle<br />
parfaitement aux prévisions de ce qui va se passer, si l’on continue à envoyer des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. […]<br />
Résultat : la concentration de gaz à effet de serre augmente chaque année. En 1765, il y avait 279 parties par millions (ppm) de CO 2<br />
dans l’atmosphère. Aujourd’hui, la concentration est de 370 ppm, une augmentation de 30 %.*<br />
*Côté, Charles. « Sécheresses, déluges, canicules… », La Presse (<strong>Mont</strong>réal), vol. 119, no 285 (samedi 9 août 2003), cahier B, p.3.<br />
Ce qui est INACCEPTABLE<br />
Vous avez écrit * : Inacceptable parce que :<br />
Nous sommes en droit de nous demander si [I] le climat luimême<br />
est (…) en train de changer? Fort probablement,<br />
mais ce sont nos enfants et nos petits-enfants, dans<br />
leurs vieux jours, qui seront en mesure de le dire avec<br />
certitude. Le climat, c’est une moyenne sur 30 ans, dit<br />
Claude Villeneuve, biologiste et grand vulgarisateur des<br />
changements climatiques. Toutefois, les spécialistes<br />
s’entendent : la sécheresse en Colombie-Britannique, les<br />
orages violents provoquant des inondations dans les<br />
Bois-Francs et la sécheresse en Europe illustrent<br />
exactement ce que l’avenir nous réserve. L’extrême<br />
pourrait devenir la norme. Cela colle parfaitement aux<br />
prévisions de ce qui va se passer si l’on continue à<br />
envoyer des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. […]<br />
Résultat : la concentration de gaz à effet de serre<br />
augmente chaque année. En 1765, il y avait 279 parties<br />
par millions (ppm) de CO 2 dans l’atmosphère.<br />
Aujourd’hui, la concentration est de 370 ppm, une<br />
augmentation de 30 %.<br />
L’extrait a simplement été recopié, sans guillemets ni<br />
indication de la source.<br />
Vous avez écrit : Inacceptable parce que :<br />
Nous nous posons la question : est-ce que le climat est en<br />
train de changer? Il faut se rendre à l’évidence que ce sont<br />
seulement nos descendants qui seront fixés avec certitude.<br />
Pour en être certain, il faut observer le climat sur 30 ans,<br />
expliquent les spécialistes. Toutefois, selon ces mêmes<br />
spécialistes, les sécheresses extrêmes, les pluies<br />
diluviennes et les inondations, qui souvent s’en suivent, ne<br />
sont qu’un avant-goût de ce que notre futur nous réserve.<br />
La météo catastrophe fera désormais partie de notre<br />
quotidien. C’est ce que les prévisions scientifiques<br />
entrevoient si la tendance se maintient. Cela signifie que les<br />
GES augmentent tous les ans. Depuis le 18 e siècle, il y avait<br />
279 parties par millions (ppm) de CO 2 dans l’air. Maintenant,<br />
cette concentration est en hausse de 30 %, se situant audélà<br />
de 300 ppm.<br />
* Les mots en caractères gras sont ceux du texte source<br />
(du texte de l’auteur).<br />
Les mots sont changés, mais les idées sont empruntées et il<br />
n’y a aucune référence. On ne peut pas simplement<br />
remplacer les mots de l’auteur par sa propre composition ou<br />
par des synonymes.
Vous avez écrit * : Inacceptable parce que :<br />
Nous nous posons la question : le climat lui-même est-il<br />
en train de changer ? Fort probablement! Il faut se rendre<br />
à l’évidence que ce sont seulement nos descendants qui<br />
seront fixés avec certitude. Pour en être certain, il faut<br />
observer le climat sur 30 ans dit Claude Villeneuve,<br />
biologiste et grand vulgarisateur des changements<br />
climatiques. Toutefois, selon ces mêmes spécialistes, les<br />
sécheresses extrêmes, les pluies diluviennes et les<br />
inondations, qui souvent s’en suivent, illustrent exactement<br />
ce que l’avenir nous réserve. C’est ce que les prévisions<br />
scientifiques entrevoient si la tendance se maintient.<br />
L’extrême pourrait devenir la norme. C’est ce que les<br />
prévisions scientifiques entrevoient si la tendance se<br />
maintient. Cela signifie que les GES augmentent tous les<br />
ans. En 1765, il y avait 279 parties par millions (ppm) de<br />
CO 2 dans l’atmosphère. Maintenant, cette concentration<br />
est en hausse de 30 %, se situant au-délà de 300 ppm.<br />
____________________<br />
Charles Côté. « Sécheresses, déluges, canicules… »,<br />
La Presse (<strong>Mont</strong>réal), vol. 119, no 285 (samedi 9 août 2003),<br />
Cahier B, p.3.<br />
Même si l’auteur, son texte et les pages sont indiqués, les<br />
mots en caractères gras sont ceux de l’auteur et ils ne sont<br />
pas placés entre guillemets. Vous ne pouvez pas seulement<br />
indiquer dans votre bibliographie, à la fin de votre travail,<br />
votre source. Elle doit absolument se trouver en bas de<br />
page et mentionner précisément la page de consultation.<br />
Vous avez écrit * : Inacceptable parce que :<br />
« Feux dans l’ouest, inondations. Vagues de chaleur. Le<br />
climat lui-même est-il en train de changer ? Fort<br />
probablement, mais ce sont nos enfants et nos petitsenfants,<br />
dans leurs vieux jours, qui seront en mesure de<br />
le dire avec certitude. Le climat, c’est une moyenne sur<br />
30 ans, dit Claude Villeneuve, biologiste et grand<br />
vulgarisateur des changements climatiques. » 1 . Il<br />
m’apparaît clair que nous devrons, dans le futur, s’habituer à<br />
ces phénomènes climatiques. La météo catastrophe fera<br />
désormais partie de notre quotidien. Cela colle parfaitement<br />
aux prévisions de ce qui va se passer si l’on continue à<br />
envoyer des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. […]<br />
Résultat : la concentration de gaz à effet de serre augmente<br />
chaque année. Les statistiques parlent d’elles-mêmes :<br />
Gaz à effet de serre<br />
En 1765 279 ppm de CO 2<br />
En 2003 370 ppm de CO 2<br />
___________________<br />
1. Charles Côté. « Sécheresses, déluges, canicules… »,<br />
La Presse (<strong>Mont</strong>réal), vol. 119, no 285 (samedi 9 août 2003),<br />
Cahier B, p.3.<br />
Même si le premier passage est entre guillemets et la source<br />
indiquée, la suite du texte est paraphrasée, les idées sont<br />
empruntées. Il n’y a aucune référence. Ce même passage<br />
contient une opinion que vous faites passer pour la vôtre<br />
(souligné). Enfin, vous utilisez des statistiques sans en<br />
mentionner la source.
Ce qui est ACCEPTABLE<br />
Vous avez écrit : Acceptable parce que :<br />
Le journaliste Charles Côté, du journal La Presse, se pose<br />
aussi la même question : « Le climat lui-même est-il en train<br />
de changer ? Fort probablement, mais ce sont nos enfants<br />
et nos petits-enfants, dans leurs vieux jours, qui seront en<br />
mesure de le dire avec certitude. » 1 .<br />
____________________<br />
1. Charles Côté. « Sécheresses, déluges, canicules… »,<br />
La Presse (<strong>Mont</strong>réal), vol. 119, no 285 (samedi 9 août 2003),<br />
Cahier B, p.3.<br />
Le texte de l’auteur est placé entre guillemets et la source<br />
est citée.<br />
Vous avez écrit : Acceptable parce que :<br />
Tout comme le mentionne Côté, le climat nous réserve des<br />
surprises à l’avenir et « ce sont nos enfants et nos petitsenfants,<br />
dans leurs vieux jours, qui seront en mesure de le<br />
dire avec certitude. » 1 .<br />
____________________<br />
1. Charles Côté. « Sécheresses, déluges, canicules… »,<br />
La Presse (<strong>Mont</strong>réal), vol. 119, no 285 (samedi 9 août 2003),<br />
Cahier B, p.3.<br />
Vous avez brièvement exprimé en vos propres termes<br />
l’essentiel de ce que l’auteur affirme et vous avez appuyé<br />
vos dires par une citation entre guillemets en mentionnant<br />
votre source.<br />
Vous avez écrit : Acceptable parce que :<br />
Selon Côté, le climat exceptionnel que nous subissons<br />
depuis quelque temps laisse présager un avenir incertain. Il<br />
est trop tôt pour qu’il s’agisse d’une certitude. C’est plutôt la<br />
génération qui suivra qui sera plus en mesure de juger des<br />
changements climatiques à long terme 1 .<br />
En fait, les statistiques à ce sujet sont inquiétantes : « En<br />
1765, il y avait 279 parties par millions (ppm) de CO 2 dans<br />
l’atmosphère. Aujourd’hui, la concentration est de 370 ppm,<br />
une augmentation de 30 %. » 2 . Dans le futur, comme<br />
l’accroissement semble s’accélérer, le taux de CO 2 pourrait<br />
atteindre près de 500 ppm dans une centaine d’années.<br />
____________________<br />
1. Charles Côté. « Sécheresses, déluges, canicules… »,<br />
La Presse (<strong>Mont</strong>réal), vol. 119, no 285 (samedi 9 août 2003),<br />
Cahier B, p.3.<br />
2. Ibid., p.3.<br />
Les propos de l’auteur sont résumés dans vos propres<br />
mots, mais en respectant le sens de ses affirmations (rien<br />
d’ajouté, rien de retiré). Enfin, le plus important à la fin du<br />
paragraphe, vous avez indiqué votre source d’inspiration.<br />
Dans le deuxième paragraphe, vous citez votre source et<br />
vous terminez par une extrapolation personnelle.