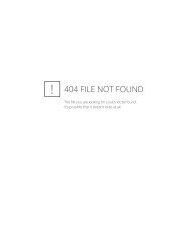Marion Vicart. « Regards croisés entre l'animal et - Ethnographiques ...
Marion Vicart. « Regards croisés entre l'animal et - Ethnographiques ...
Marion Vicart. « Regards croisés entre l'animal et - Ethnographiques ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(Grundmann & Ruoso, 2002), elle est difficilement tolérable dans la durée pour<br />
nous, êtres humains. Nous recherchions d’ailleurs les moyens d’y échapper (<strong>«</strong> je<br />
réfléchis déjà de quel côté m’en aller le plus rapidement au cas où elle se j<strong>et</strong>terait<br />
sur moi »). Chaque changement de posture devient une épreuve qui suppose une<br />
évaluation des mouvements de la part de chacun, allant du coup d’œil de<br />
surveillance au regard focalisé. Comme l’a d’ailleurs sur ce point montré D. Sudnow<br />
(1972), ce regard focalisé perm<strong>et</strong> aux individus de trouver les ressources suffisantes<br />
pour réduire l’incertitude qui pèse sur le comportement d’autrui [5]. Mais les écarts<br />
produits par un mouvement brusque, comme celui de rattraper le stylo au vol, ne<br />
sont pas tolérés <strong>et</strong> réclament d’être résorbés par l’adoption d’une nouvelle posture<br />
de soumission : nous baissons les yeux <strong>et</strong> contrôlons nos gestes. L’intranquillité<br />
dans laquelle nous nous trouvons, plongés face à l’imprévisibilité de nos actes en<br />
chaîne, nous fait prendre conscience de l’enjeu social dans lequel nos corps sont<br />
réciproquement liés, enjeu que nous devons respectivement négocier sur la base<br />
d’agencements de l’agir à partir d’un répertoire de comportements élémentaires de<br />
la vie sociale (Kaufmann & Clément, 2003), que nous mobilisons plus ou moins<br />
inconsciemment pour désambiguïser nos actes, <strong>et</strong> ainsi réduire tant bien que mal<br />
l’incertitude de sens qui pèse sur c<strong>et</strong>te interaction. Croiser le regard d’un macaque<br />
japonais nous conduit ainsi progressivement à la critique d’une sociologie sans<br />
obj<strong>et</strong> : celle des courants interactionnistes qui, on le voit, s’appliquent beaucoup<br />
mieux à l’analyse de l’interaction non marquée avec un singe, dont la<br />
compréhension reste liée à un strict enjeu de sens, qu’à l’analyse des interactions<br />
avec d’autres humains, ces dernières étant largement stabilisées par diverses<br />
extériorités.<br />
<strong>«</strong> Négociation comportementale » lors d’un moment tendu (<strong>Vicart</strong>, 2007)<br />
Par ailleurs, c’est peut être ici que nous pourrions situer la limite <strong>entre</strong> lien social <strong>et</strong><br />
attachement. En eff<strong>et</strong>, la construction de ce lien social <strong>entre</strong> la femelle macaque <strong>et</strong><br />
nous, ne tient scrupuleusement que par notre travail respectif d’acteurs vigilants <strong>et</strong><br />
suppose que chacun de nous compose pour lui-même la totalité dans laquelle il se<br />
situe (Latour, 1994). C’est pourquoi ce lien social tissé avec l’animal non familier<br />
demeure fragile, non sécurisé, donc relativement angoissant, car dépourvu de<br />
moyens formels ou informels pour garantir la confiance : il reste inscrit dans la<br />
<strong>et</strong>hnographiques.org, numéro 17, novembre 2008 version pdf, page 8