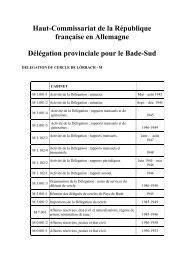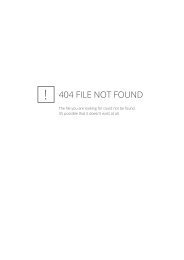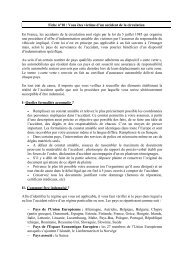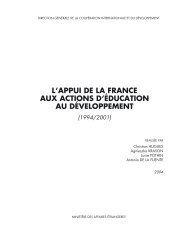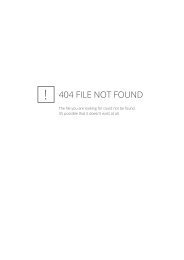Protéger la mère et l'enfant - France-Diplomatie-Ministère des ...
Protéger la mère et l'enfant - France-Diplomatie-Ministère des ...
Protéger la mère et l'enfant - France-Diplomatie-Ministère des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
thèmes<br />
01<br />
<strong>Protéger</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> l’enfant<br />
Maison ou hôpital, <strong>la</strong> femme accouche toujours dans un lieu clos <strong>et</strong> protégé.<br />
Elle doit être à l’abri <strong>des</strong> regards, <strong>des</strong> ma<strong>la</strong>dies ainsi que <strong>des</strong> forces maléfi ques. De nombreux<br />
obj<strong>et</strong>s, disposés dans l’espace d’accouchement, p<strong>la</strong>cés sur les vêtements ou à même le<br />
corps jouent ce rôle de protection.<br />
En Kabylie, les femmes reçoivent en cadeau de mariage, ou<br />
lors de leur première grossesse, de <strong>la</strong>rges ceintures rouges<br />
qui entourent <strong>la</strong> taille plusieurs fois. Elles sont surtout portées<br />
par les femmes enceintes car elles soutiennent le ventre <strong>et</strong> le<br />
protègent <strong>des</strong> coups accidentels. La ceinture joue aussi un rôle<br />
de protection magique, assurant à <strong>la</strong> femme <strong>et</strong> à son enfant un<br />
rempart effi cace contre les sortilèges <strong>et</strong> les mauvais esprits.<br />
Au Maghreb, on considère que <strong>la</strong> ceinture féminine concentre les<br />
pouvoirs magiques, d’autant plus puissants que <strong>la</strong> ceinture est<br />
longue. On pose parfois <strong>la</strong> ceinture de grossesse sur <strong>la</strong> tombe<br />
d’un saint afi n que son énergie rende <strong>la</strong> grossesse <strong>et</strong> <strong>la</strong> délivrance<br />
plus facile.<br />
Lorsqu’une grossesse s’annonce diffi cile, certaines femmes<br />
sénéga<strong>la</strong>ises portent une cordel<strong>et</strong>te à nœuds autour du ventre<br />
pour se protéger <strong>des</strong> complications. Celle-ci doit être rompue<br />
au moment de l’accouchement. Symboliquement, c<strong>et</strong>te rupture<br />
de <strong>la</strong> cordel<strong>et</strong>te évoque <strong>la</strong> délivrance, <strong>la</strong> libération <strong>et</strong> donc un<br />
accouchement qui se passera sans encombres.<br />
D’une culture à une autre, on r<strong>et</strong>rouve le même souci de<br />
purifi cation de l’espace d’accouchement. L’air doit être sain<br />
pour préserver l’accouchée <strong>et</strong> le nouveau-né <strong>des</strong> ma<strong>la</strong>dies, <strong>des</strong><br />
démons <strong>et</strong> autres.<br />
Au Maghreb, on j<strong>et</strong>te du sel <strong>et</strong> du henné aux quatre coins de<br />
<strong>la</strong> pièce pour éloigner les mauvais génies. Près de <strong>la</strong> porte, on<br />
utilise un kanoun (brasero) pour faire brûler de l’encens, qui est<br />
réputé bénéfi que.<br />
Au Vi<strong>et</strong>nam, on brûle <strong>des</strong> écorces d’orange <strong>et</strong> <strong>des</strong> épices pour<br />
s’assurer de <strong>la</strong> bienveil<strong>la</strong>nce <strong>des</strong> dieux.<br />
Ces rites trouvent un parallèle dans l’attention accordée dans les<br />
hôpitaux pour éliminer les microbes en employant <strong>des</strong> produits<br />
désinfectants ; ils ont souvent <strong>des</strong> odeurs caractéristiques que<br />
l’on associe à c<strong>et</strong>te idée de propr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> d’hygiène.<br />
Ceinture de grossesse, Kabylie<br />
Cordel<strong>et</strong>te à noeuds, Sénégal 1990<br />
Kanoun : braséro pour encens, Maghreb
thèmes<br />
02<br />
Un intérêt tardif<br />
de <strong>la</strong> médecine occidentale<br />
Jusqu’au début du 18 e siècle, <strong>la</strong> médecine occidentale ne s’est presque pas intéressée aux<br />
accouchements. Il est d’usage à l’époque d’accoucher chez soi ; seules les femmes les plus<br />
pauvres accouchent dans les hôpitaux.<br />
Les accouchements à domicile sont alors réalisés par <strong>des</strong> femmes qui ne possèdent pas<br />
de connaissance médicale particulière : les matrones. Aucune réglementation n’existe à<br />
ce suj<strong>et</strong> <strong>et</strong> ces « bonnes <strong>mère</strong>s », souvent d’âge mûr, assistent les naissances avec plus<br />
ou moins d’expérience <strong>et</strong> de savoir-faire. Il n’est pas rare que les <strong>mère</strong>s <strong>et</strong> les enfants en<br />
sortent mutilés.<br />
Vers 1700, on réalise fi nalement que chaque accouchement m<strong>et</strong> en danger deux vies <strong>et</strong> qu’il<br />
faut former <strong>des</strong> personnes compétentes pour accompagner chaque naissance.<br />
C<strong>et</strong>te prise de conscience a lieu pendant <strong>la</strong> période <strong>des</strong> Lumières ; les philosophes vont<br />
affi rmer que chaque être humain mérite d’être heureux <strong>et</strong> d’être bien traité, quelle que soit<br />
son origine, ce qui est révolutionnaire pour l’époque. Certains vont également insister sur<br />
l’importance de l’éducation de l’enfant.<br />
Ces idées vont jouer un rôle très important dans l’évolution <strong>des</strong> mentalités en Europe.<br />
De nombreux livres sur l’accouchement vont alors être publiés <strong>et</strong> l’on va commencer à<br />
former sérieusement <strong>des</strong> sages-femmes mais, hé<strong>la</strong>s, en trop p<strong>et</strong>it nombre.<br />
En 1759, Madame Du Coudray décide d’aller dans toute <strong>la</strong> <strong>France</strong> pour former <strong>des</strong><br />
accoucheuses en leur apprenant les manipu<strong>la</strong>tions à suivre, dans les cas diffi ciles, pour<br />
sauver <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> l’enfant. Elle a publié un traité sur l’accouchement <strong>et</strong> c’est une maîtresse<br />
sage-femme reconnue.<br />
Louis XV soutient son initiative en <strong>la</strong> payant pour ses services <strong>et</strong> elle va sillonner <strong>la</strong> <strong>France</strong><br />
durant 25 ans pour former <strong>des</strong> accoucheuses dans toutes les régions.<br />
Pour ce faire, elle utilise <strong>des</strong> mannequins en tissu qui perm<strong>et</strong>tent d’expliquer les principes<br />
de l’accouchement <strong>et</strong> de donner <strong>des</strong> rudiments d’anatomie aux accoucheuses.<br />
Sa “ machine ” se compose d’un bassin de femme en grandeur nature <strong>et</strong> de plusieurs<br />
accessoires dont <strong>des</strong> poupées représentant l’enfant à différents sta<strong>des</strong> de <strong>la</strong> grossesse. Le<br />
mannequin peut être ouvert pour l’observation <strong>des</strong> organes <strong>et</strong> il peut contenir les poupées<br />
qui perm<strong>et</strong>tent ainsi de simuler les différentes situations d’accouchement, naturels ou<br />
diffi ciles.<br />
Les élèves sages-femmes peuvent ainsi apprendre à palper le corps de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> pour sentir<br />
<strong>la</strong> position de l’enfant dans son ventre <strong>et</strong> s’entraîner aux gestes à effectuer, aux soins à<br />
donner à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> à l’enfant. L’enseignement de Madame Du Coudray comporte aussi<br />
un vol<strong>et</strong> moral pour responsabiliser les futures sages-femmes <strong>et</strong> l’explication <strong>des</strong> règles<br />
d’hygiène à respecter. Madame Du Coudray a joué un rôle essentiel dans l’amélioration <strong>des</strong><br />
conditions <strong>des</strong> accouchements en <strong>France</strong>.<br />
On a utilisé un mannequin identique à celui qu’elle a inventé pour former les accoucheuses<br />
jusque vers 1950.
thèmes<br />
03<br />
Les choix d’accouchement<br />
L’Accouchement Sans Douleur : ne pas subir<br />
1951, voyage d’étude à Léningrad : le médecin Fernand Lamaze - 60 ans passés, 30 ans de<br />
pratique - voit, bouleversé, une femme accoucher sans aucun signe de souffrance.<br />
C’est le début d’une aventure humaine, sociale <strong>et</strong> politique, celle de <strong>la</strong> préparation à<br />
l’accouchement sans douleur.<br />
Ce que ces militants proposent aux femmes <strong>des</strong> années 50 est totalement nouveau pour<br />
l’époque : connaître son corps, comprendre les phases de l’accouchement, fi xer son esprit<br />
sur <strong>la</strong> détente <strong>et</strong> <strong>la</strong> respiration afi n de désamorcer <strong>la</strong> douleur.<br />
Pas de rec<strong>et</strong>te magique : certaines femmes souffrent quand même tandis que, pour d’autres,<br />
c’est une révé<strong>la</strong>tion. Trente ans avant <strong>la</strong> péridurale, à <strong>la</strong> maternité <strong>des</strong> Blu<strong>et</strong>s à Paris, un<br />
proj<strong>et</strong> d’émancipation féminine est né.<br />
Penser l’accouchement autrement<br />
Dans les pays riches, obstétrique <strong>et</strong> pédiatrie ont réussi à procurer à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> à l’enfant<br />
un niveau de sécurité inégalé dans l’histoire. Il est alors redevenu possible de penser<br />
l’accouchement autrement que comme un acte médical. Des accoucheurs, <strong>des</strong> sagesfemmes<br />
<strong>et</strong> de futurs parents ont ainsi successivement réc<strong>la</strong>mé :<br />
La présence du père,<br />
L’accueil du nouveau-né dans le calme <strong>et</strong> <strong>la</strong> douceur,<br />
La péridurale en libre choix pour <strong>la</strong> femme,<br />
La possibilité de choisir sa position d’accouchement,<br />
La re<strong>la</strong>xation dans l’eau,<br />
Les techniques corporelles de préparation, de communication avec le bébé avant sa<br />
naissance,<br />
La naissance à domicile ou en maison de naissance,<br />
L’abandon du recours systématique à l’épisiotomie,<br />
La limitation de <strong>la</strong> césarienne aux situations qui l’exigent vraiment.<br />
Archives de l’Hôpital <strong>des</strong> Métallurgistes Pierre Rouquès,<br />
Les Blu<strong>et</strong>s Institut d’Histoire sociale - CGT Métallurgie, Paris.
thèmes<br />
04<br />
Les positions<br />
d’accouchement<br />
Si aujourd’hui <strong>la</strong> position allongée est <strong>la</strong> plus répandue, c<strong>et</strong>te pratique est re<strong>la</strong>tivement jeune :<br />
elle est apparue au 18 e siècle en Europe <strong>et</strong> a été imposée aux femmes accouchant dans les<br />
hôpitaux. Mais il existe en fait de multiples positions d’accouchement : assise, accroupie,<br />
sur le côté, à quatre pattes <strong>et</strong> même debout...<br />
Si l’obstétrique se m<strong>et</strong> en p<strong>la</strong>ce durant le 19 e siècle, on continue<br />
cependant à pratiquer <strong>des</strong> accouchements à domicile. En eff<strong>et</strong> les<br />
taux de mortalité en hôpitaux sont alors dramatiques en raison<br />
du manque d’hygiène. Il faut attendre les années 1870 pour que<br />
l’on comprenne enfi n le rôle fondamental de l’hygiène pour éviter<br />
les infections <strong>et</strong> les ma<strong>la</strong>dies post-natales. Dans <strong>la</strong> maison,<br />
les femmes sont installées en position assise <strong>et</strong> demeurent<br />
habillées lors du travail pour <strong>des</strong> raisons de pudeur. La découpe<br />
particulière du siège perm<strong>et</strong> à <strong>la</strong> sage-femme <strong>et</strong> au médecin<br />
d’intervenir si nécessaire durant <strong>la</strong> délivrance sans pour autant<br />
forcer l’accouchée à se dévêtir. C<strong>et</strong>te chaise est pliante ; elle peut<br />
ainsi être transportée par <strong>la</strong> sage-femme ou le médecin d’une<br />
maison à une autre.<br />
Dans les campagnes, les accouchements ont souvent lieu<br />
dans les maisons, jusque dans les années 60. Au Vi<strong>et</strong>nam,<br />
l’accouchement s’effectue aussi traditionnellement en position<br />
accroupie. Celle-ci facilite <strong>la</strong> naissance : l’enfant va avoir tendance<br />
à bien se positionner dans le col de l’utérus <strong>et</strong> va <strong>des</strong>cendre<br />
plus facilement. De plus, le temps de travail est plus bref qu’en<br />
position allongée.<br />
C<strong>et</strong>te position est liée aux contraintes de <strong>la</strong> vie rurale : lorsqu’une<br />
femme travaille aux champs <strong>et</strong> doit accoucher en urgence, c<strong>et</strong>te<br />
position lui perm<strong>et</strong> d’accoucher sur p<strong>la</strong>ce <strong>et</strong> elle ne nécessite<br />
aucun matériel particulier. Cependant, une bonne force physique<br />
est nécessaire afi n de se maintenir dans c<strong>et</strong>te même posture<br />
durant tout le travail. La position accroupie était aussi très<br />
répandue dans les zones rurales européennes.<br />
On accrochait une corde à un arbre ou à une poutre, corde à<br />
<strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> future <strong>mère</strong> s’agrippait durant le travail. Au Maghreb,<br />
on utilisait fréquemment les ceintures, accrochées à une poutre<br />
lorsque l’accouchement se faisait à domicile. La ceinture était<br />
alors choisie en raison <strong>des</strong> forces bénéfi ques qui s’y concentrent ;<br />
elle pouvait être celle que l’accouchée avait portée pendant sa<br />
grossesse, mais aussi celle de son mari ou d’une femme connue<br />
pour ses accouchements faciles. Depuis les années cinquante,<br />
les mouvements pour l’accouchement sans douleur, <strong>et</strong> d’autres<br />
militants pour l’accouchement libre, réc<strong>la</strong>ment le droit pour <strong>la</strong><br />
<strong>mère</strong> de choisir sa position <strong>et</strong> sa manière d’accoucher : certaines<br />
femmes souhaitent accoucher de nouveau chez elles, dans l’eau,<br />
avec ou sans péridurale, mais également choisir <strong>la</strong> position dans<br />
<strong>la</strong>quelle elles se sentent le plus à l’aise.<br />
Chaise d’accouchement, <strong>France</strong> 19 e siècle<br />
Barre horizontale en bambou pour l’accouchement,<br />
Vi<strong>et</strong>nam
thèmes<br />
05<br />
Une transmission rituelle<br />
<strong>des</strong> informations<br />
D’autres moyens sont aussi employés pour transm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> informations sur les<br />
accouchements. Lorsque les tabous empêchent les explications <strong>et</strong> les discussions sur le<br />
suj<strong>et</strong>, les rites peuvent transm<strong>et</strong>tre ce qui ne peut être dit.<br />
Vidéo : “La danse de jeunes fi lles” , Guinée 1995<br />
images de Sylvie Bouvier<br />
Ainsi, selon les coutumes peules, les jeunes fi lles ne peuvent pas être informées oralement<br />
du déroulement d’une maternité <strong>et</strong> d’un accouchement.<br />
Tout ce qui touche à <strong>la</strong> sexualité <strong>et</strong> à <strong>la</strong> reproduction est en eff<strong>et</strong> délicat à exprimer librement<br />
<strong>et</strong> sans gêne ; le suj<strong>et</strong> est donc tabou chez les Peuls, tout comme il l’était encore très<br />
récemment en Europe.<br />
Ne pouvant raconter directement aux plus jeunes comment les accouchements ont lieu,<br />
leurs aînées leur transm<strong>et</strong>tent c<strong>et</strong>te expérience de manière codifi ée, par le biais de danses.<br />
La musique, l’aspect rituel <strong>et</strong> traditionnel de ces danses perm<strong>et</strong>tent de désamorcer le tabou :<br />
rien n’est dit mais tout est mimé. C’est une initiation rituelle aux mystères de <strong>la</strong> maternité,<br />
une mise en scène symbolique de <strong>la</strong> naissance qui perm<strong>et</strong> d’informer les jeunes fi lles sans<br />
enfreindre les interdits.
thèmes<br />
06<br />
Le p<strong>la</strong>centa<br />
Le p<strong>la</strong>centa joue un rôle essentiel durant <strong>la</strong> grossesse : c’est par son intermédiaire que<br />
<strong>la</strong> <strong>mère</strong> va transm<strong>et</strong>tre les nutriments <strong>et</strong> l’oxygène à son enfant. Il transm<strong>et</strong> les défenses<br />
immunitaires de <strong>la</strong> maman au fœtus, qui est ainsi protégé contre certains microbes.<br />
Le p<strong>la</strong>centa reçoit en échange le gaz carbonique <strong>et</strong> les déch<strong>et</strong>s de l’enfant car les poumons,<br />
les reins <strong>et</strong> l’intestin ne fonctionnent pas encore chez l’embryon. L’enfant est relié au p<strong>la</strong>centa<br />
par le biais du cordon ombilical.<br />
Le p<strong>la</strong>centa est souvent considéré comme le double de l’enfant<br />
car il l’accompagne durant toute sa gestation. A ce titre, on prête<br />
souvent une grande attention au p<strong>la</strong>centa : il est examiné après son<br />
expulsion hors du ventre maternel, par <strong>des</strong> femmes d’expérience<br />
ou <strong>des</strong> médecins, selon les contextes d’accouchement.<br />
Ensuite, on lui rend souvent hommage lors de rites religieux.<br />
Ainsi, les Bobos enterrent le p<strong>la</strong>centa pour le protéger. Il est<br />
aspergé d’eau afi n de le fertiliser <strong>et</strong> de recréer l’atmosphère<br />
humide qui existait dans le ventre de <strong>la</strong> <strong>mère</strong>.<br />
Au Vi<strong>et</strong>nam, on procède aussi à l’enterrement du p<strong>la</strong>centa.<br />
Celui-ci est p<strong>la</strong>cé à proximité de <strong>la</strong> maison, où il joue un rôle<br />
bénéfi que.<br />
On observe donc c<strong>et</strong> échange symbolique, s’il est p<strong>la</strong>cé sous <strong>la</strong><br />
protection de <strong>la</strong> famille qui l’honore comme une partie d’ellemême,<br />
le p<strong>la</strong>centa assure en r<strong>et</strong>our <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> famille<br />
qui l’a “ mis au monde ” . On lui confère aussi <strong>des</strong> vertus<br />
fertilisatrices, il nourrira <strong>la</strong> terre comme il a nourri l’enfant <strong>et</strong><br />
perm<strong>et</strong>tra <strong>la</strong> production de nombreuses récoltes.<br />
Autrefois, on honorait le p<strong>la</strong>centa de <strong>la</strong> même manière en<br />
l’enterrant dans les campagnes françaises. Il était aussi utilisé<br />
dans le traitement <strong>des</strong> brûlures. On a récemment constaté qu’il<br />
pouvait également transm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> infections. Après son examen,<br />
il est aujourd’hui détruit ; certains hôpitaux proposent cependant<br />
aux familles qui le désirent de l’emporter pour l’enterrer sur leur<br />
terre natale, selon <strong>la</strong> tradition.<br />
Vidéo : “Accoucher au vil<strong>la</strong>ge” Burkina, 2003<br />
images de Jasmine Abel Jessen<br />
Poterie avec couvercle pour enterrer le p<strong>la</strong>centa<br />
Vi<strong>et</strong>nam
thèmes<br />
07<br />
Identifi er l’enfant<br />
Une fois que l’enfant est né, il doit être reconnu – au propre comme au fi guré – par sa famille<br />
<strong>et</strong> par son père.<br />
Pour ce<strong>la</strong>, il existe différentes pratiques mê<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> symbolique à l’aspect pratique.<br />
Dès <strong>la</strong> naissance, l’enfant est enveloppé dans un morceau<br />
du pagne de sa <strong>mère</strong>. Ce<strong>la</strong> perm<strong>et</strong> bien entendu à tous de<br />
l’identifi er, mais ce<strong>la</strong> doit aussi avoir un aspect rassurant pour le<br />
nouveau-né. Il peut ainsi sentir l’odeur de sa <strong>mère</strong> qui lui est très<br />
rapidement familière. Le tissu joue aussi un rôle de protection<br />
contre les agressions extérieures.<br />
Autrefois, en <strong>France</strong> métropolitaine <strong>et</strong> à <strong>la</strong> Réunion, le nouveauné<br />
était enveloppé dans <strong>la</strong> chemise de son père. L’importance du<br />
père, son rôle dans <strong>la</strong> création de c<strong>et</strong>te vie étaient ainsi c<strong>la</strong>irement<br />
signifi és.<br />
Lors d’une naissance en maternité, l’identifi cation de l’enfant est<br />
tout aussi indispensable. Les bracel<strong>et</strong>s bleus <strong>et</strong> roses désignent<br />
les garçons <strong>et</strong> les fi lles, le numéro inscrit sur le bracel<strong>et</strong><br />
correspond au numéro du bracel<strong>et</strong> porté par <strong>la</strong> <strong>mère</strong>. Si le lien<br />
est plus impersonnel, il n’empêche que l’enfant reconnaît sa<br />
<strong>mère</strong> les yeux fermés grâce à sa voix <strong>et</strong> à son odeur.<br />
Pagne, Afrique de l’Ouest<br />
Bracel<strong>et</strong>s d’identifi cation, <strong>France</strong> 2007
thèmes<br />
08<br />
Nourrir l’enfant <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong><br />
Après <strong>la</strong> naissance, l’alimentation du nouveau-né <strong>et</strong> de l’accouchée joue un rôle de premier<br />
p<strong>la</strong>n.<br />
Les premiers repas doivent les aider à reprendre <strong>des</strong> forces tout en les purifi ant.<br />
Le repas de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> est particulièrement codifi é.<br />
La <strong>mère</strong> doit non seulement se rem<strong>et</strong>tre de l’accouchement mais<br />
aussi produire du <strong>la</strong>it pour nourrir son enfant.<br />
Au Maghreb, ses premiers repas consistent en un bouillon, qui lui<br />
<strong>la</strong>vera <strong>et</strong> lui réhydratera le corps ; celui-ci est très pimenté pour<br />
purifi er <strong>et</strong> comporte de <strong>la</strong> viande grasse, du miel <strong>et</strong> du beurre<br />
pour que l’accouchée se reconstitue. Selon <strong>la</strong> coutume, les p<strong>la</strong>ts<br />
sont préparés spécialement pour elle <strong>et</strong> lui sont servis dans un<br />
récipient en terre cuite, protégé par un couvercle afi n d’éviter<br />
que <strong>des</strong> esprits malins ne s’y glissent. La présence du couvercle<br />
s’explique aussi par <strong>des</strong> raisons hygiéniques : il faut absolument<br />
éviter toute contamination de sa nourriture, l’accouchée étant<br />
très vulnérable les premiers temps après <strong>la</strong> naissance.<br />
C’est l’invention de <strong>la</strong> pasteurisation du <strong>la</strong>it <strong>et</strong> de <strong>la</strong> stérilisation<br />
<strong>des</strong> biberons qui a permis une alimentation artifi cielle <strong>des</strong><br />
bébés.<br />
Avant le début du 20 e siècle en Europe, le <strong>la</strong>it n’était pas conservé<br />
dans <strong>des</strong> conditions d’hygiène satisfaisantes <strong>et</strong> il était donc très<br />
dangereux de nourrir un enfant au biberon.<br />
Le problème demeure aujourd’hui partout où l’on ne peut ni<br />
stériliser ni pasteuriser, ce qui demande un matériel assez<br />
important, du temps <strong>et</strong> surtout <strong>la</strong> connaissance <strong>des</strong> procédés de<br />
stérilisation.<br />
Vaisselle pour l’accouchée, Maghreb<br />
Biberons anciens, Br<strong>et</strong>agne
thèmes<br />
09<br />
Naissances prématurées<br />
C’est entre 37 <strong>et</strong> 42 semaines de grossesse que le risque de mortalité pour le fœtus est le<br />
plus faible. Lorsque <strong>la</strong> naissance se produit avant, on considère qu’elle est prématurée.<br />
Il y a bien sûr <strong>des</strong> degrés dans c<strong>et</strong>te prématurité :<br />
un enfant né entre 34 <strong>et</strong> 36 semaines est dit simplement prématuré,<br />
de 33 à 28 semaines, c’est un grand prématuré (poids indicatif : 2 000 grammes),<br />
de 28 à 26 semaines, un très grand prématuré (1200 grammes) ;<br />
à 25 semaines le prématurissime pèse environ 600 grammes.<br />
Chaque année en <strong>France</strong>, 10 000 enfants voient le jour avant 32 semaines.<br />
Quels sont les problèmes physiologiques du prématuré ?<br />
Quels sont leurs remè<strong>des</strong> ?<br />
Respiration<br />
Pour pouvoir fonctionner correctement, le fœtus doit sécréter en suffi sance un surfactant,<br />
sorte de mucus qui perm<strong>et</strong> aux alvéoles pulmonaires de se gonfl er <strong>et</strong> de ne pas s’ap<strong>la</strong>tir à<br />
l’expiration.<br />
C’est seulement vers 32 semaines de grossesse que c<strong>et</strong>te sécrétion est au point.<br />
Au prématuré de 28 ou 29 semaines (ou pesant moins de 900 g) on fournira du surfactant<br />
par intubation. On peut aussi prescrire à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>des</strong> corticoï<strong>des</strong> pendant <strong>la</strong> grossesse, ils<br />
accélèrent <strong>la</strong> production de surfactant par le fœtus.<br />
Température<br />
Un nouveau-né prématuré n’a pas d’autonomie thermique. Sa température centrale qui est<br />
à 37°C en sortant de sa <strong>mère</strong>, tombera en quelques minutes à 35°C, ou moins. La première<br />
<strong>et</strong> <strong>la</strong> plus ancienne fonction de <strong>la</strong> couveuse est bien de maintenir l’enfant au chaud, dans un<br />
air pas trop sec.<br />
Nutrition<br />
Avant 32 à 34 semaines, un enfant ne peut s’alimenter seul : ses muscles intestinaux <strong>et</strong><br />
buccaux ne sont pas prêts à assurer le transit digestif <strong>et</strong> une déglutition coordonnée.<br />
On pallie ce<strong>la</strong> en « gavant » le bébé via une sonde, permanente ou intermittente.<br />
Régu<strong>la</strong>tion du métabolisme<br />
Les réserves du bébé en sucre (glycogène), en calcium <strong>et</strong> en graisses se constituent dans le<br />
dernier trimestre de <strong>la</strong> grossesse. Un prématuré présente donc souvent un défi cit dans ces<br />
substances ; un apport par perfusion viendra corriger ce manque.<br />
Certains prématurés souffrent également d’ictère (jaunisse) car leur foie n’élimine pas<br />
correctement <strong>la</strong> bilirubine, déch<strong>et</strong> issu de <strong>la</strong> bile <strong>et</strong> toxique pour le cerveau s’il s’accumule<br />
dans l’organisme. Aujourd’hui, <strong>la</strong> bilirubine en excès peut être détruite rapidement à travers<br />
<strong>la</strong> peau, sans traumatisme, en exposant l’enfant quelques jours à <strong>la</strong> lumière. Des tubes de<br />
lumière bleue équipent certaines couveuses - parfois même sur 360 degrés, irradiant ainsi<br />
le bébé sans que l’on ait à le bouger.
thèmes<br />
09<br />
Les causes de prématurité<br />
Les naissances prématurées sont en forte augmentation. La moitié de ces naissances est<br />
due à <strong>des</strong> grossesses multiples, issues pour <strong>la</strong> plupart de femmes ayant bénéfi cié d’une<br />
assistance médicale à <strong>la</strong> procréation.<br />
Prématurité spontanée<br />
Elle peut se produire à cause d’une malformation utérine (l’utérus ne peut se distendre),<br />
d’infections génitales, d’un col « incompétent », par suite d’IVG ou de fausse-couche (fréquent<br />
dans les pays de l’Est), par fatigue de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> ou pour causes psychologiques.<br />
Prématurité induite<br />
Lorsque l’enfant est en danger ou lorsqu’il présente une malformation opérable, on déclenche<br />
l’accouchement ou on pratique une césarienne. Dans les gran<strong>des</strong> maternités plus de 50 %<br />
<strong>des</strong> naissances prématurées sont ainsi induites.<br />
Quelle chance de survie, quelle vie possible ?<br />
Pour chaque cas particulier une décision à assumer en commun<br />
Les progrès techniques n’ont pas supprimé, <strong>et</strong> ont peut-être même rendu plus fréquente,<br />
une diffi culté essentielle : <strong>la</strong> problématique de <strong>la</strong> décision. Doit-on engager un protocole de<br />
réanimation ? A quel degré ? Jusqu’à quand ?<br />
La réponse à c<strong>et</strong>te question ne peut aujourd’hui résulter que d’une réfl exion commune au<br />
sein de l’équipe soignante <strong>et</strong> avec les parents de l’enfant. Lorsque c<strong>et</strong>te décision suppose<br />
une prise de risque, celle-ci doit être assumée par tous.<br />
Le dialogue parents-médecin est parfois biaisé lorsque les parents, s’étant documentés -<br />
notamment par Intern<strong>et</strong> - au suj<strong>et</strong> de <strong>la</strong> santé de leur enfant prématuré, arrivent à l’entr<strong>et</strong>ien<br />
médical avec un avis déjà arrêté sur le diagnostic <strong>et</strong> <strong>la</strong> conduite médicale à tenir.<br />
L’enjeu de <strong>la</strong> prise de décision est qu’au-delà <strong>des</strong> possibles échecs directs (mort de l’enfant),<br />
réanimer un nouveau-né ouvre sur <strong>la</strong> question très grave <strong>des</strong> éventuelles séquelles qui<br />
peuvent se révéler pour lui par <strong>la</strong> suite.<br />
S’il survit, à quelle vie le <strong>des</strong>tine-t-on ?<br />
Les séquelles frappant certains grands prématurés sont surtout neurologiques. Il peut s’agir<br />
d’un r<strong>et</strong>ard psycho-moteur (handicap de <strong>la</strong> parole), d’un défaut de tonus ou d’une raideur<br />
muscu<strong>la</strong>ire (handicap pour <strong>la</strong> marche), de convulsions, d’hémiplégie ; ou encore d’un défi cit<br />
auditif, d’un strabisme.<br />
Quelques chiffres repères :<br />
- parmi les enfants nés à 25 semaines, 50 % survivent <strong>et</strong> sur ces survivants,<br />
50 % n’auront pas (ou peu) de séquelles.<br />
- parmi les enfants nés à 26 semaines, 60 % survivent <strong>et</strong> sur ces survivants,<br />
60 % n’auront pas (ou peu) de séquelles.<br />
- parmi les enfants nés à 28 semaines, 80 % survivent <strong>et</strong> sur ces survivants,<br />
80 % n’auront pas (ou peu) de séquelles.<br />
Rappelons-nous :<br />
Réanimer ne m<strong>et</strong> pas, en soi, un point fi nal aux soins dus à l’enfant prématuré. On doit<br />
penser <strong>et</strong> accompagner ses jours futurs, au moins pendant sa première année. L’espoir<br />
pour demain n’est pas tant de battre encore d’autres records de prématurité : le progrès<br />
c’est de tout faire pour qu’il y ait moins de prématurés.
thèmes<br />
10<br />
Al<strong>la</strong>itement <strong>et</strong> sida :<br />
un terrible dilemme<br />
Lorsqu’une <strong>mère</strong> déjà séropositive al<strong>la</strong>ite son enfant, le risque pour le nourrisson de le<br />
devenir aussi est de 15 %. Il est beaucoup plus élevé si une <strong>mère</strong> rencontre le virus pendant<br />
qu’elle al<strong>la</strong>ite.<br />
L’al<strong>la</strong>itement au sein a <strong>des</strong> atouts : anticorps maternels, qualité nutritionnelle, moindre<br />
coût, haute valeur sociale, mais... épuisement de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> risque, croissant au fi l <strong>des</strong> mois,<br />
qu’elle transm<strong>et</strong>tre le virus du sida au bébé.<br />
Le seul moyen de supprimer ce risque est le <strong>la</strong>it industriel.<br />
Or, quand les conditions d’hygiène sont médiocres, un autre danger gu<strong>et</strong>te le bébé :<br />
l’infection respiratoire ou <strong>la</strong> diarrhée. Les bébés nourris au biberon meurent alors deux à<br />
cinq fois plus que ceux nourris au sein.<br />
L’al<strong>la</strong>itement au bol peut constituer une alternative : aucun risque de transmission du virus<br />
du sida, mais... plusieurs règles strictes à respecter :<br />
un bol (facile à n<strong>et</strong>toyer), une eau bouillie, un dosage correct de <strong>la</strong> poudre de <strong>la</strong>it.<br />
Diffi culté supplémentaire : dans les pays où l’al<strong>la</strong>itement maternel est <strong>la</strong> norme,<br />
<strong>la</strong> femme qui ne nourrit pas son enfant au sein risque d’être cataloguée par son<br />
entourage comme une ma<strong>la</strong>de <strong>et</strong> une mauvaise <strong>mère</strong>.<br />
Proj<strong>et</strong> World Vision, district de Chi Linh, Vi<strong>et</strong>nam 2004<br />
«Il faut al<strong>la</strong>iter l’enfant le plus tôt possible,<br />
dès <strong>la</strong> première heure après <strong>la</strong> naissance.<br />
Puis l’al<strong>la</strong>iter pendant six mois à l’exclusion<br />
de toute autre alimentation ou boisson.»<br />
L’Organisation mondiale de <strong>la</strong> Santé préconise<br />
l’al<strong>la</strong>itement au sein ; en témoigne c<strong>et</strong>te<br />
brochure <strong>des</strong>tinée aux agents de santé.
thèmes<br />
11<br />
La mort <strong>des</strong> nouveaux-nés<br />
dans <strong>la</strong> loi française<br />
Dans un grand nombre de cultures, l’enfant à sa naissance est considéré comme un être<br />
entre deux mon<strong>des</strong>. En m<strong>et</strong>tant ce bébé à l’épreuve par <strong>la</strong> réclusion, on tente tout à <strong>la</strong> fois de<br />
le soustraire aux puissances mauvaises <strong>et</strong> de perm<strong>et</strong>tre que se manifeste en lui sa nature<br />
humaine, sa force de vie.<br />
Si malgré toutes ces précautions le bébé meurt, ou s’il naît non-viable, son sort n’est guère<br />
facile à régler : vers quel monde le renvoyer ? Lui qui n’a pas accompli sa vie, qui n’a pas<br />
de nom, est souvent considéré comme dangereux. D’où <strong>des</strong> funérailles hâtives, loin <strong>des</strong><br />
endroits consacrés aux “bons morts”.<br />
Le chagrin <strong>des</strong> parents peut être grand, mais <strong>la</strong> réaction sociale, l’obligation de deuil, fait<br />
défaut ou est réduite au minimum. Il n’existe d’ailleurs pas de terme pour désigner l’état de<br />
parents d’un enfant mort, ni l’état d’enfant dont le frère ou <strong>la</strong> sœur sont décédés.<br />
La loi française<br />
L’évolution du “statut de l’enfant” - lequel, schématiquement, est passé de “don de Dieu”<br />
à celui de “proj<strong>et</strong> réfl échi <strong>et</strong> programmé” - a généré une modifi cation progressive de <strong>la</strong><br />
loi française. Le développement de <strong>la</strong> contraception a pris une part importante dans ce<br />
changement. De plus, les progrès <strong>des</strong> techniques de réanimation néonatale ont permis de<br />
survivre à <strong>des</strong> bébés jusqu’ici “non-viables légalement” (c’est-à-dire nés avant le 181 e jour<br />
de gestation).<br />
Avant 1993<br />
Pour les enfants nés morts :<br />
- après 6 mois (180 jours) de gestation : on établissait un acte d’enfant déc<strong>la</strong>ré sans vie<br />
(enfant mort-né). Les parents avaient <strong>la</strong> possibilité d’enterrer leur enfant ou de demander à<br />
l’hôpital de se charger du corps de leur enfant en signant un “abandon de corps”.<br />
- avant 6 mois (180 jours) de gestation : le fœtus mort avait le statut de produit innommé.<br />
Certains départements, par arrêté préfectoral, autorisaient les parents à récupérer le corps<br />
de leur bébé pour l’enterrer, après une déc<strong>la</strong>ration administrative transcrite sur un registre<br />
de police où sont notés les avortements survenus à partir de six semaines de gestation (article<br />
462 du Code civil). Mais jusqu’en 1992 c<strong>et</strong>te possibilité n’existait pas partout, notamment à<br />
Paris.<br />
À partir de 1993<br />
Après <strong>la</strong> loi 093-2 du 8 janvier modifi ant le Code civil, re<strong>la</strong>tif à l’état civil, <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire n°50 du<br />
22 juill<strong>et</strong> 1993, précise que le seuil de viabilité à r<strong>et</strong>enir comme limite basse d’enregistrement<br />
<strong>des</strong> enfants nés vivants, est le terme de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids de 500<br />
grammes.
thèmes<br />
11<br />
En conséquence, lorsque l’enfant naît vivant puis meurt :<br />
- si le terme est supérieur à 22 semaines d’aménorrhée ou si le poids est supérieur à 500<br />
grammes, un certifi cat médical d’enfant né vivant <strong>et</strong> viable rédigé par le médecin ou <strong>la</strong><br />
sage-femme précisera le jour <strong>et</strong> l’heure de <strong>la</strong> naissance <strong>et</strong> de son décès. Il sera alors dressé<br />
un acte de naissance <strong>et</strong> un acte de décès.<br />
- si le terme est inférieur à 22 semaines d’aménorrhée, ou si l’enfant pèse moins de<br />
500 grammes, un certifi cat d’enfant né vivant <strong>et</strong> non viable perm<strong>et</strong>tra de dresser un acte<br />
d’enfant sans vie.<br />
Lorsque l’enfant naît mort :<br />
- après 181 jours de gestation, il sera dressé un acte d’enfant sans vie.<br />
- avant 181 jours, seule l’inscription sur le registre de police est possible.<br />
Arrêté publié au JO du 6 août 2002<br />
Il fi xe les modèles de livr<strong>et</strong> de famille <strong>et</strong> apporte une modifi cation notable pour les parents<br />
ayant conçu un enfant que le droit <strong>et</strong> l’administration qualifi ent“d’enfant sans vie”.<br />
“L’indication d’enfant sans vie, avec énonciation <strong>des</strong> jour, heure <strong>et</strong> lieu de l’accouchement, peut,<br />
à <strong>la</strong> demande <strong>des</strong> parents être apposée par l’offi cier de l’état civil qui a établi l’acte sur le livr<strong>et</strong><br />
de famille qu’ils détiennent. C<strong>et</strong>te indication est possible si l’acte d’enfant sans vie a été dressé<br />
antérieurement à <strong>la</strong> délivrance du livr<strong>et</strong> de famille.”<br />
Enjeu social de ces mesures<br />
.un acte de naissance <strong>et</strong> un acte de décès confèrent à l’enfant une personnalité juridique<br />
à part entière <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent l’inscription sur le livr<strong>et</strong> de famille, avec les conséquences<br />
sociales qui en découlent, pour les r<strong>et</strong>raites par exemple.<br />
.un acte d’enfant sans vie confère à l’enfant une certaine p<strong>la</strong>ce administrative <strong>et</strong> à ses<br />
parents certains droits sociaux, tels que le risque maternité <strong>et</strong> les congés maternité (que<br />
l’on ne peut pas imposer) ; mais l’enfant n’est pas une personne au sens juridique du<br />
terme.<br />
.une absence d’acte signifi e sa non-reconnaissance <strong>et</strong> ne donne aucun droit social à ses<br />
parents.<br />
Ouvrages<br />
Accès facile<br />
Bébé est mort Joël Clerg<strong>et</strong> - Éditions Erès,<br />
Collection Mille <strong>et</strong> un bébés, 2005<br />
Ces bébés passés sous silence -<br />
À propos <strong>des</strong> interruptions médicales de grossesse<br />
Frédérique Authier-Roux - Éditions Erès,<br />
Collection Mille <strong>et</strong> un bébés, 1999<br />
Mort d’un bébé, deuil périnatal -<br />
Témoignages <strong>et</strong> réfl exions<br />
Dossier coordonné par Joël Clerg<strong>et</strong> -<br />
Editions Erès, Revue Spirale, n°31 Sept. 2004<br />
Pour approfondir ou é<strong>la</strong>rgir le suj<strong>et</strong><br />
L ’Arbre <strong>et</strong> le Fruit.<br />
La naissance dans l’Occident moderne, XVIe- XIXe<br />
Jacques Gélis - Éditions Fayard, 1984<br />
Mourir avant de n’être ?<br />
Colloque Gynécologie Psychologie, Ouvrage collectif<br />
Éditions Odile Jacob, 1997<br />
Le fœtus, le nourrisson <strong>et</strong> <strong>la</strong> mort<br />
Ouvrage collectif - Éditions l’Harmattan, 1998<br />
Le dernier portrait<br />
Catalogue d’exposition du Musée d’Orsay<br />
Éditions Réunion <strong>des</strong> Musées Nationaux, 2002
thèmes<br />
12<br />
La mortalité <strong>des</strong> femmes<br />
pendant <strong>et</strong> après l’accouchement<br />
L’OMS estime que plus de 500 000 femmes meurent chaque année <strong>des</strong> complications de<br />
leur grossesse ou de leur accouchement.<br />
Dans les pays en voie de développement, c<strong>et</strong>te mortalité maternelle peut atteindre 2 000 cas<br />
pour 100 000 naissances. Dans les pays développés, elle varie de 5 à 30 cas pour 100 000<br />
naissances.<br />
D’où vient le risque de mort maternelle ?<br />
Première cause, l’hémorragie grave. La moitié <strong>des</strong> décès maternels surviennent par<br />
saignement excessif dans les 24 heures, que ce soit après <strong>la</strong> délivrance, après une<br />
césarienne, un avortement ou une grossesse extra-utérine.<br />
Pourtant, selon toutes les enquêtes européennes, 90 % de ces décès sont habituellement<br />
évitables.<br />
Par ailleurs, le risque de décès de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> est n<strong>et</strong>tement corrélé à son âge : il est douze fois<br />
plus élevé à 45 ans qu’à 20 ou 25.Les autres causes sont les complications de l’hypertension<br />
artérielle, les infections sévères <strong>et</strong> les embolies.<br />
Dans les pays industrialisés : vigi<strong>la</strong>nce à maintenir<br />
En <strong>France</strong>, <strong>la</strong> mortalité maternelle concerne 80 femmes par an. Il y a 250 ans, son taux était<br />
supérieur à 1 000 cas pour 100 000 naissances.<br />
Une étude de l’OMS (1987) a montré que <strong>la</strong> mortalité ne <strong>des</strong>cend en <strong>des</strong>sous du seuil de<br />
100 cas pour 100 000 naissances que lorsque plus de 95 % de celles-ci sont réalisées en<br />
maternité. Aujourd’hui en Europe, <strong>la</strong> plupart <strong>des</strong> naissances n’ont plus lieu à domicile mais<br />
dans <strong>des</strong> structures médicalisées. Parallèlement à l’accouchement en milieu médicalisé,<br />
se sont développées les consultations prénatales obligatoires, puis <strong>la</strong> préparation à <strong>la</strong><br />
naissance.<br />
Les progrès sont là mais l’effort est loin d’être fi nalisé. La vigi<strong>la</strong>nce doit rester intacte car<br />
les répercussions de certaines évolutions sociales ou médicales ne sont pas encore bien<br />
connues. Ainsi les travaux du Comité national de <strong>la</strong> naissance, créé en 2005, devraient<br />
pouvoir évaluer l’impact :<br />
- de l’augmentation de l’âge de conception du premier enfant,<br />
- du nombre croissant de grossesses gémel<strong>la</strong>ires,<br />
- de celui <strong>des</strong> grossesses tardives,<br />
- de celui <strong>des</strong> césariennes.
thèmes<br />
12<br />
Dans les pays en voie de développement :<br />
recentrer l’effort sur <strong>la</strong> formation en obstétrique<br />
Une femme court aujourd’hui mille fois plus de risque de mourir <strong>des</strong> complications de ses<br />
grossesses si elle vit en Afrique sub-saharienne, ou dans certains pays d’Asie, que si elle est<br />
européenne. Depuis plusieurs années, <strong>des</strong> programmes de lutte contre <strong>la</strong> mortalité infantile<br />
<strong>et</strong> maternelle ont été développés mais, bien que leurs ressources soient notables, le taux de<br />
mortalité maternelle demeure stable <strong>et</strong> souvent très élevé. Il faut donc s’interroger sur les<br />
stratégies de lutte contre <strong>la</strong> mortalité maternelle dans les pays en développement.<br />
Après <strong>la</strong> conférence de Nairobi de 1987, on s’est rendu compte que <strong>la</strong> stratégie fondée<br />
exclusivement sur l’amélioration du statut <strong>des</strong> femmes avait montré ses limites.<br />
En eff<strong>et</strong> l’éducation féminine, <strong>la</strong> limitation <strong>des</strong> naissances <strong>et</strong> l’établissement de consultations<br />
prénatales ont eu pour conséquence une triple démobilisation : celle <strong>des</strong> bailleurs de fonds<br />
qui n’ont pas investi suffi samment, celle <strong>des</strong> politiques qui n’ont pas mis au premier p<strong>la</strong>n un<br />
programme de santé adapté <strong>et</strong> celle <strong>des</strong> obstétriciens dont le rôle est capital.<br />
Par contre, une analyse menée en 2000 au Sénégal a montré le rôle primordial de <strong>la</strong><br />
qualifi cation du personnel qui assiste <strong>la</strong> femme lors de l’accouchement, car de là dépend <strong>la</strong><br />
capacité à détecter les complications obstétricales sévères <strong>et</strong> à prévenir <strong>la</strong> mort maternelle.<br />
Une autre étude, réalisée au Surinam, relève que l’évitabilité du décès repose en grande<br />
partie sur les obstétriciens, sur l’hospitalisation, l’organisation <strong>des</strong> soins <strong>et</strong> sur les soins de<br />
santé primaire.<br />
Ainsi, plus que <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce prénatale, <strong>la</strong> qualité <strong>des</strong> soins obstétricaux au moment<br />
de l’accouchement apparaît être <strong>la</strong> pièce essentielle du dispositif dans <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong><br />
mortalité maternelle.<br />
Il faut donc, à l’échelle mondiale, que les autorités politiques m<strong>et</strong>tent sur pied <strong>des</strong><br />
structures capables d’assurer aux obstétriciens :<br />
- une formation de base<br />
- <strong>des</strong> conditions de travail correctes, garantissant leur maintien dans les hôpitaux<br />
de proximité.<br />
Ouvrages<br />
La question en <strong>France</strong> :<br />
Rapport du Comité National d’Experts sur <strong>la</strong> Mortalité<br />
Maternelle 1955-2001.<br />
<strong>Ministère</strong> de l’Emploi <strong>et</strong> de <strong>la</strong> Solidarité, Paris, 2001<br />
http://www.sante.gouv.fr/<br />
Pour approfondir ou é<strong>la</strong>rgir le suj<strong>et</strong><br />
Donnons une chance à chaque <strong>mère</strong> <strong>et</strong> à chaque<br />
enfant<br />
Rapport sur <strong>la</strong> santé dans le monde -OMS, 2005<br />
http://www.who.int/whr/2005/fr/index.html
thèmes<br />
13<br />
Les muti<strong>la</strong>tions<br />
génitales féminines<br />
Aujourd’hui, dans le monde, 100 à 140 millions de femmes sont victimes de muti<strong>la</strong>tions<br />
génitales. L’excision, c’est-à-dire l’ab<strong>la</strong>tion du clitoris <strong>et</strong> <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites lèvres, <strong>et</strong> l’infi bu<strong>la</strong>tion<br />
qui consiste à coudre les gran<strong>des</strong> lèvres du sexe <strong>des</strong> jeunes fi lles pour le fermer, subsistent<br />
dans une trentaine de pays, en Afrique <strong>et</strong> dans quelques régions d’Asie.<br />
Sans pour autant cautionner ces pratiques, il est important de prêter attention au sens<br />
qu’elles revêtent dans les sociétés concernées. Ainsi, par exemple, dans nombre de traditions<br />
africaines, les organes sexuels manifestent <strong>la</strong> double nature de l’être humain : le clitoris,<br />
élément masculin, doit être ôté à <strong>la</strong> fi ll<strong>et</strong>te pour qu’elle puisse être femme <strong>et</strong> le prépuce doit<br />
être ôté au garçon afi n qu’il devienne homme.<br />
Actuellement, <strong>la</strong> justifi cation de ces pratiques est mise en rapport avec <strong>des</strong> canons soit<br />
disant imposés par l’Is<strong>la</strong>m, alors que <strong>la</strong> majorité <strong>des</strong> théologiens contestent formellement<br />
c<strong>et</strong>te obligation. Au-delà de justifi cations précises, il s’agit de perpétuer <strong>la</strong> tradition, de<br />
reproduire à l’identique les pratiques <strong>des</strong> générations antérieures.<br />
Se manifeste également ici une représentation de l’hygiène où <strong>la</strong> rencontre du propre <strong>et</strong> du<br />
pur imposerait d’agir ainsi.<br />
Pratiquée le plus souvent à vif sur <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites fi lles, l’excision présente <strong>des</strong> risques importants<br />
d’hémorragie <strong>et</strong> d’infection, parfois mortels, <strong>et</strong> à long terme générateurs d’accouchements<br />
compliqués, voire de stérilités.<br />
En <strong>France</strong>, trois p<strong>et</strong>ites fi lles, excisées alors qu’elles étaient encore bébés, sont mortes de<br />
c<strong>et</strong>te façon dans les années 80. De plus, lorsque le couteau ou le rasoir n’est pas désinfecté,<br />
l’excision favorise <strong>la</strong> propagation du sida, particulièrement fréquent en Afrique subsaharienne.
thèmes<br />
13<br />
Le clitoris étant un organe essentiel du p<strong>la</strong>isir féminin, son ab<strong>la</strong>tion constitue un grave<br />
traumatisme physique <strong>et</strong> psychique, qui peut créer <strong>des</strong> cicatrices rendant les rapports<br />
sexuels douloureux. L’infi bu<strong>la</strong>tion oblige à “ouvrir <strong>la</strong> femme au couteau” lors de sa nuit de<br />
noces.<br />
Les accouchements sont souvent plus diffi ciles <strong>et</strong> l’on observe une souffrance fœtale plus<br />
importante. Les déchirures sont plus fréquentes <strong>et</strong> entraînent parfois <strong>des</strong> troubles très<br />
graves : incontinence, fi stules, c’est-à-dire communications anormales entre les voies<br />
urinaires <strong>et</strong> le vagin, voire entre vagin <strong>et</strong> rectum, que seule <strong>la</strong> chirurgie peut réparer.<br />
Chaque année dans le monde, 2 millions de fi ll<strong>et</strong>tes sont mutilées. Initiée il y a une trentaine<br />
d’années, <strong>la</strong> lutte contre l’excision <strong>et</strong> l’infi bu<strong>la</strong>tion commence aujourd’hui à porter ses fruits<br />
sous <strong>la</strong> pression d’associations africaines, de médecins, de juristes, d’ONG nationales <strong>et</strong><br />
internationales.<br />
Plusieurs gouvernements, en Afrique <strong>et</strong> ailleurs, ont pris <strong>des</strong> mesures pour éliminer <strong>la</strong><br />
pratique <strong>des</strong> muti<strong>la</strong>tions génitales féminines dans leurs pays. Ces mesures vont de lois<br />
pénalisant l’acte à <strong>des</strong> programmes d’éducation <strong>et</strong> de sensibilisation.<br />
En Guinée, au Sénégal, se multiplient les cérémonies durant lesquelles <strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges entiers<br />
décident de déposer les couteaux. Les griots, les imams s’engagent à faire reculer un usage<br />
qui n’a aucun fondement religieux.<br />
Il faudra beaucoup de temps pour faire disparaître complètement <strong>la</strong> coutume <strong>des</strong><br />
muti<strong>la</strong>tions sexuelles, car au-delà <strong>des</strong> statistiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> discours offi ciels, elle se<br />
perpétue encore dans de nombreux milieux.<br />
En <strong>France</strong>, il semble que c<strong>et</strong>te pratique, qui avait occasionné <strong>des</strong> procès <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
condamnations r<strong>et</strong>entissantes, ait disparu.<br />
Mais qu’en est-il <strong>des</strong> fi ll<strong>et</strong>tes ou <strong>des</strong> jeunes fi lles élevées en Europe qui r<strong>et</strong>ournent au<br />
pays de leurs parents dans <strong>des</strong> milieux encore exciseurs ?
thèmes<br />
14<br />
Oser être <strong>mère</strong><br />
handicap moteur <strong>et</strong> maternité<br />
Attendre un enfant lorsqu’on est femme handicapée motrice : s’agit-il d’une maternité<br />
ordinaire ou extraordinaire ? Comment conjuguer <strong>la</strong> maternité <strong>et</strong> le handicap ?<br />
Que faut-il pour que <strong>la</strong> femme se sente confi ante dans son proj<strong>et</strong>, eu égard aux exigences<br />
médicales, <strong>et</strong> que de leur côté les professionnels de santé soient attentifs à sa situation ?<br />
Comment rendre accessible le lieu d’accouchement, revoir <strong>la</strong> hauteur <strong>des</strong> tables d’examen<br />
<strong>et</strong> l’équipement <strong>des</strong> chambres de maternité ?<br />
En général, il n’y a pas de raison de surmédicaliser les grossesses <strong>des</strong> femmes ayant une<br />
pathologie motrice.<br />
Il faut l’accepter, <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre en p<strong>la</strong>ce une équipe pluridisciplinaire, au cas par cas.<br />
Peu de sages-femmes ont l’expérience de l’accompagnement de femmes handicapées<br />
motrices, aussi doivent-elles comprendre comment chacune se débrouille avec son<br />
handicap - blessure médul<strong>la</strong>ire, spina bifi da, infi rmité motrice cérébrale, poliomyélite,<br />
sclérose en p<strong>la</strong>ques, p<strong>et</strong>ite taille, polyarthrite rhumatoïde ou ma<strong>la</strong>die neuromuscu<strong>la</strong>ire.<br />
Quand il n’y a pas de contre-indication, l’accouchement par les voies naturelles est<br />
privilégié. La césarienne n’est donc pas systématique.<br />
En eff<strong>et</strong>, l’utérus est un muscle fort, indépendant d’une éventuelle faiblesse de <strong>la</strong> ceinture<br />
abdominale ou de troubles sensitifs. Les contractions utérines sont autonomes <strong>et</strong><br />
automatiques ; elles échappent aux comman<strong>des</strong> volontaires. Et si l’effort d’expulsion<br />
est défi cient, une aide médicale à l’extraction de l’enfant (ventouse ou forceps) peut être<br />
proposée.<br />
L’al<strong>la</strong>itement est un choix personnel, sous réserve de contre-indications (médicaments,<br />
fatigue).<br />
Les soins à l’enfant seront appris pendant le séjour à <strong>la</strong> maternité.
thèmes<br />
14<br />
Ouvrages<br />
Oser être <strong>mère</strong> : maternité <strong>et</strong> handicap moteur<br />
Delphine Siegrist - Mission Handicaps de l’Assistance<br />
Publique - Hôpitaux de Paris -Éditions Doin, 2003<br />
Associations françaises<br />
Réponses initiatives femmes handicapées (RIFH)<br />
Association de femmes handicapées motrices<br />
BP 46 - 92404 Courbevoie cedex<br />
webmaster@rifh.org<br />
www.rifh.org<br />
Être parent<br />
Association rassemb<strong>la</strong>nt <strong>des</strong> parents handicapés<br />
69 rue Baraban - 69000 Lyon<br />
Tél. : 04 78 53 74 02 <strong>et</strong> 04 67 55 12 19<br />
<strong>et</strong>re-parent@handicapweb.com<br />
www.multimania.com/<strong>et</strong>reparent<br />
Association <strong>des</strong> personnes de p<strong>et</strong>ites tailles (APPT)<br />
35 avenue Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi<br />
Tél. : 01 48 52 33 94<br />
contact@appt.asso.fr<br />
www.appt.asso.fr<br />
Centre d’information, de documentation <strong>et</strong> de<br />
conseils sur les ai<strong>des</strong> techniques (CICAT)<br />
Les ClCAT informent sur les ai<strong>des</strong> techniques. Des<br />
ergothérapeutes peuvent intervenir pour conseiller<br />
<strong>des</strong> adaptations <strong>et</strong> <strong>des</strong> aménagements. Leur<br />
intervention <strong>et</strong> son coût varient d’un CICAT à un autre,<br />
selon leur statut.<br />
Service de maintien à domicile <strong>des</strong> handicapés<br />
(SMHD)<br />
77 rue Foch - 57680 Novéant-sur-Moselle<br />
Tél. : 03 87 52 80 10<br />
Association <strong>des</strong> paralysés de <strong>France</strong> (APF)<br />
17 boulevard Auguste-B<strong>la</strong>nqui, 75013 Paris<br />
www.apfasso.fr<br />
Groupe de parents handicapés (APF)<br />
Christine Durand 40 rue Danton - 35700 Rennes<br />
Tél. : 02 99 84 26 66<br />
Association française contre les myopathies (AFM)<br />
1 rue de l’Internationale, BP 59 - 91002 Evry<br />
Son site donne toutes les adresses <strong>des</strong> consultations<br />
spécialisées <strong>et</strong> <strong>des</strong> associations en région<br />
www.afm-france.org<br />
Polyarthrite rhumatoïde - Andar<br />
8 rue Gustave-Eiffel - 34570 Pignan<br />
Tél. : 04 67 47 61 76<br />
Association pour <strong>la</strong> recherche sur <strong>la</strong> sclérose en<br />
p<strong>la</strong>ques (ARSEP)<br />
4 rue Chéreau - 75013 Paris<br />
Tél. : 01 45 65 00 36<br />
arsep@medcostfrwww.arsep.org<br />
Association de l’ostéogénèse imparfaite (AOI)<br />
BP 075 - 80082 Amiens cedex 2<br />
www.aoi.asso.fr<br />
Ma<strong>la</strong>dies rares Infos Services<br />
Centre national d’information sur les ma<strong>la</strong>dies<br />
génétiques.<br />
Il est ouvert à toute personne confrontée à une<br />
ma<strong>la</strong>die génétique (familles <strong>et</strong> professionnels).<br />
L’échange téléphonique perm<strong>et</strong> de mieux comprendre<br />
les besoins.<br />
Une réponse écrite rédigée par un généticien, adaptée<br />
aux deman<strong>des</strong>, est envoyée sous forme de l<strong>et</strong>tre. C’est<br />
un service mis en p<strong>la</strong>ce conjointement par <strong>la</strong> CNAMTS<br />
<strong>et</strong> l’AFM, grâce au soutien du Téléthon.<br />
N° Azur : 0 810 63 19 20<br />
Orphan<strong>et</strong><br />
C’est une base de données sur les ma<strong>la</strong>dies rares. Ce<br />
service informe sur les consultations spécialisées, les<br />
<strong>la</strong>boratoires de diagnostic, les proj<strong>et</strong>s de recherche en<br />
cours, les associations de ma<strong>la</strong><strong>des</strong> <strong>et</strong> les autres sites<br />
web dans le monde. Il dispose d’un forum, perm<strong>et</strong>tant<br />
de <strong>la</strong>isser un message, de poser <strong>des</strong> questions ou de<br />
témoigner.<br />
Orphan<strong>et</strong> est fi nancé conjointement par l’INSERM, <strong>la</strong><br />
Direction générale de <strong>la</strong> Santé, <strong>la</strong> CNAMTS <strong>et</strong> l’AFM.<br />
www.orpha.n<strong>et</strong>
thèmes<br />
15<br />
La naissance sociale<br />
Lorsque l’enfant est né, qu’il a été soigné <strong>et</strong> nourri, reconnu par son père, il faut annoncer<br />
à <strong>la</strong> famille, aux proches <strong>et</strong> aux amis son existence <strong>et</strong> leur apprendre le nom qui a été choisi<br />
pour lui.<br />
Les faire-parts jouent un rôle symbolique très fort : tout s’est bien passé, l’enfant <strong>et</strong> sa<br />
maman sont en en bonne santé, <strong>la</strong> famille s’est agrandie, chacun va changer de statut (les<br />
parents devenant grands-parents, par exemple) <strong>et</strong> les jeunes parents vont découvrir leur<br />
bébé <strong>et</strong> l’accompagner dans <strong>la</strong> vie.<br />
C’est un bonheur immense, plein d’euphorie que l’on partage avec le faire-part qui est donc<br />
souvent formulé de manière enthousiaste <strong>et</strong> humoristique.<br />
En matière de faire-part, toutes les excentricités sont permises.<br />
Le faire-part de Jules Lefevre le représente littéralement « venant<br />
au monde », dans un jeu de mot qui est moins léger qu’il n’y<br />
paraît. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te expression décrit bien tout le processus<br />
d’apprentissage lié à <strong>la</strong> naissance : l’enfant va devoir découvrir le<br />
monde qui l’entoure <strong>et</strong> ses co<strong>des</strong> tandis que le monde dans lequel<br />
il est né (<strong>la</strong> famille) va devoir apprendre à connaître l’enfant qui<br />
vient de naître.<br />
Dans le faire-part de Nathan, deux gran<strong>des</strong> l<strong>et</strong>tres tiennent<br />
par <strong>la</strong> main deux l<strong>et</strong>tres plus p<strong>et</strong>ites : on comprend bien vite<br />
que les deux parents sont plein d’amour <strong>et</strong> d’attention pour<br />
leurs deux enfants. C<strong>et</strong>te image poétique <strong>et</strong> tendre annonce de<br />
manière douce <strong>la</strong> naissance d’un enfant. Il y a autant de manières<br />
d’annoncer <strong>la</strong> naissance que de parents. Leur point commun<br />
est, sans aucun doute, tout l’amour <strong>et</strong> <strong>la</strong> compréhension qu’ils<br />
sauront donner à leurs enfants.<br />
Faire-part de Jules Lefevre<br />
Faire-part de Nathan
animations<br />
01<br />
Mythes <strong>et</strong> légen<strong>des</strong>...<br />
d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs, pour comprendre le mystère de <strong>la</strong> naissance<br />
Pour les 6/12 ans<br />
Des versions pour tous les goûts sur l’origine <strong>des</strong> bébés ! Un voyage par <strong>la</strong> pensée <strong>et</strong><br />
l’imaginaire dans le monde. Les histoires s’inscrivent dans <strong>la</strong> représentation de <strong>la</strong> naissance<br />
du monde <strong>et</strong> de son fonctionnement.<br />
A l’origine, l’œuf ou <strong>la</strong> poule ? Comme l’animal, mammifère, le p<strong>et</strong>it d’homme sort bien du<br />
ventre de sa <strong>mère</strong>, <strong>et</strong> sa <strong>mère</strong> de sa <strong>mère</strong>...<br />
Et le père ? Quel rôle a-t-il ? Les hommes depuis toujours ont déchiffré dans l’observation<br />
de <strong>la</strong> nature les mille <strong>et</strong> une façons de se reproduire.<br />
Un bon peu d’inspiration, un zest d’expériences <strong>et</strong> le tour est joué.<br />
La rec<strong>et</strong>te est multiple :<br />
Tantôt, le nouveau-né est apporté par un ibis ou bien c’est <strong>la</strong> cigogne, messagère d’une<br />
déesse germanique, qui l’a trouvé dans l’eau où il séjourne : une source, un puits...<br />
Tantôt, le bébé, comme <strong>la</strong> Terre, notre <strong>mère</strong> universelle, est issu d’une graine, <strong>la</strong> plus p<strong>et</strong>ite<br />
chose au monde, qui après avoir éc<strong>la</strong>té aurait donné naissance aux ancêtres de l’humanité,<br />
sur une arche de terre pure formée d’une partie de p<strong>la</strong>centa.....<br />
La formation de l’embryon répète l’acte primordial <strong>et</strong> exemp<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> création du monde<br />
au Mali.<br />
Tantôt, le p<strong>et</strong>it d’homme est façonné à partir de l’argile, ou bien il a été trouvé dans <strong>la</strong> terre :<br />
“ On dit qu’il y a très longtemps, à l’aube <strong>des</strong> temps, les femmes étaient stériles..<br />
<strong>et</strong> qu’elles cherchaient les enfants de <strong>la</strong> terre.. .Il leur fal<strong>la</strong>it chercher longtemps<br />
pour trouver les garçons... ” (Extrait d’un conte inuit).<br />
Tantôt, l’enfant est déjà formé en miniature dans les organes sexuels de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> ou du<br />
père...<br />
A vous de communiquer votre rec<strong>et</strong>te, si vous en avez une, tirée de votre chapeau ou de vos<br />
lectures !<br />
Et nous verrons si votre version est si loin <strong>des</strong> explications biologiques d’aujourd’hui !
animations<br />
02<br />
Berceau-berceuses<br />
Jusqu’à 6 ans<br />
L’univers du nouveau-né reconstitué autour d’obj<strong>et</strong>s choisis se raconte <strong>et</strong> s’écoute à travers<br />
de belles histoires <strong>et</strong> de jolies berceuses d’ici <strong>et</strong> de là.<br />
L’enfant peut ainsi donner un sens à <strong>des</strong> gestes <strong>et</strong> paroles qui lui sont déjà familiers <strong>et</strong><br />
s’ouvrir à <strong>des</strong> enfances différentes.<br />
Tchou-ou tchou-ou gbovi , dada mou <strong>la</strong> ruémé... gbonou gbonou kpo.<br />
Ne pleure pas bébé, ta maman n’est pas là, ne pleure pas<br />
Berri, yanah ya nerged, vera nari ou erged li benti fi , hamaiedec ya el ali.<br />
O toi, berce ma fi lle bien-aimée <strong>et</strong> protège-<strong>la</strong> pendant son sommeil<br />
Dodo l’enfant do l’enfant dormira bien vite, dodo l’enfant do l’enfant dormira bientôt<br />
A vos oreilles les bambins ! Et si vous ne comprenez pas le sens <strong>des</strong> paroles, partagez<br />
l’émotion qui se dégage de ces comptines.<br />
Elles vous invitent à entrer dans l’intimité de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de tendresse entre <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong><br />
l’enfant <strong>et</strong> par magie dans d’autre pays, d’autres cultures !<br />
Une occasion pour vous de mieux communiquer entre enfants de toutes origines dès le<br />
berceau ! Il s’agit toujours d’apaiser le nouveau-né qui pleure ou de l’endormir.<br />
Pour ce<strong>la</strong>, rien de mieux qu’une mélodie aux phrases courtes <strong>et</strong> ba<strong>la</strong>ncées, <strong>des</strong> sons égrenés<br />
en douceur.<br />
A vos crayons maintenant s’il vous vient <strong>des</strong> images plein <strong>la</strong> tête.<br />
(Cf CD <strong>des</strong> 20 berceuses)
animations<br />
03<br />
Qui suis-je ? D’où viens-je ?<br />
Pour les 6/12 ans<br />
Qu’est-ce qui me défi nit ? Le nom, le prénom, le fait que je suis un garçon, une fi lle, le fait<br />
d’être un être humain, <strong>et</strong> tout différent d’un autre, il suffi t de me regarder !<br />
Mais il faut regarder encore plus près, disent les scientifi ques, <strong>et</strong> ils m’expliquent que je suis<br />
même unique au monde ! Ils me disent pourquoi.<br />
Bonne pioche<br />
Si vous vous voulez bien vous prêter à <strong>des</strong> jeux de tirage au sort, vous comprendrez, en<br />
vous amusant, le rôle du hasard dans <strong>la</strong> transmission <strong>des</strong> gènes ainsi que les raisons pour<br />
lesquelles, vos frères <strong>et</strong> sœurs, nés du même père <strong>et</strong> de <strong>la</strong> même <strong>mère</strong>, ne se ressemblent<br />
pas tant que ce<strong>la</strong> !<br />
Et pour imaginer le nombre infi ni d’individus différents sur <strong>la</strong> Terre, assemblez <strong>des</strong> traits du<br />
visage, par exemple, 2 couleurs d’yeux, 2 formes de menton, de nez, <strong>et</strong> de bouche <strong>et</strong> vous<br />
obtiendrez, en les combinant de toutes les manières possibles, 16 visages différents. Avec 5<br />
caractères, vous en aurez 32 !<br />
Si on joue avec 32 traits, on obtient plus de visages différents qu’il y a d’hommes sur <strong>la</strong><br />
Terre. Avec seulement une dizaine de caractères morphologique que vous êtes invités à<br />
comptabiliser, le constat s’impose : vous êtes unique !<br />
Et maintenant, confectionnez votre portrait, celui dont vous rêvez, à partir du nez, de <strong>la</strong><br />
bouche, du menton, <strong>des</strong> yeux <strong>et</strong> <strong>des</strong> oreilles de votre choix , à découper dans <strong>des</strong> magazines<br />
!<br />
Jeu de devin<strong>et</strong>tes !<br />
Agathe, Alexandre, Aziza, Chung, Clémentine, My thu, Nico<strong>la</strong>s... Dupont, Cissé, Nguyen,<br />
Benfougal...<br />
Des prénoms <strong>et</strong> <strong>des</strong> noms en vrac, ils évoquent une origine culturelle ! Le choix <strong>des</strong> prénoms<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> noms n’est pas le fait du hasard, mais du milieu social <strong>et</strong> culturel qui accueille l’enfant.<br />
A chaque participant de donner, s’il le veut bien, son idée sur l’origine de son prénom <strong>et</strong> de<br />
son nom !<br />
Le prénom représente une composante essentielle de <strong>la</strong> personne dans certaines sociétés.<br />
L’enfant entre dans le <strong>la</strong>ngage du monde <strong>et</strong> a une existence propre à partir du moment où il est<br />
nommé. Une cérémonie différente selon les cultures, accompagne c<strong>et</strong>te naissance sociale.<br />
Le nom fait entrer le nouveau né dans le lignage familial, dans son histoire généalogique. Il<br />
témoigne de l’importance donnée à <strong>la</strong> fi liation dans <strong>la</strong> plupart <strong>des</strong> sociétés. Parfois, l’enfant<br />
a même un troisième prénom !<br />
Chaque enfant est invité à reconnaître son identité <strong>et</strong> à découvrir celle <strong>des</strong> autres.<br />
On s’interroge, on interroge l’ordinateur pour en savoir plus !<br />
Une rencontre interculturelle très instructive !
animations<br />
04<br />
Naissance...<br />
Hasard <strong>et</strong> société<br />
Pour les plus grands, à partir de 12 ans<br />
Chaque élève renaît de façon aléatoire dans <strong>la</strong> peau d’un autre. Le hasard d’une naissance<br />
que personne ne choisit au départ. Puis, au fur <strong>et</strong> à mesure que le profi l de <strong>la</strong> naissance se<br />
précise, le déterminisme culturel <strong>et</strong> social devient de plus en plus fort. Les chances ne sont<br />
pas les mêmes selon le pays où l’on naît ou selon <strong>la</strong> couleur de sa peau !<br />
- Pèle mêle.<br />
Naissance/renaissance,<br />
natalité/mortalité,<br />
fertilité/stérilité,<br />
maternité/paternité,<br />
fécondation/sexualité,<br />
création/procréation,<br />
conception/contraception,<br />
inné/acquis,<br />
normalité/anormalité,<br />
vie/mort.<br />
Autant de notions abordées dans l’exposition que l’on pourra approfondir à <strong>la</strong> demande <strong>des</strong><br />
enseignants.<br />
- Naissances : thème <strong>et</strong> variations.<br />
Présentation de l’événement dans ce qu’il a d’universel, son processus biologique, <strong>et</strong> dans<br />
ce qu’il a de particulier, l’évolution ou l’adoption de pratiques techniques ou culturelles <strong>et</strong> le<br />
rôle <strong>des</strong> acteurs de <strong>la</strong> naissance, hier <strong>et</strong> aujourd’hui, ici <strong>et</strong> ailleurs.<br />
- Sciences <strong>et</strong> mythes.<br />
Les sciences biologiques <strong>et</strong> médicales <strong>et</strong> les applications pratiques face aux mythes de<br />
création <strong>et</strong> de procréation. Problématiques liées au respect <strong>des</strong> rituels de l’enfantement qui<br />
s’inscrivent dans les représentations du monde de chaque communauté.<br />
- La naissance : un “ sacré ” moment dans <strong>la</strong> vie biologique <strong>et</strong> sociale.<br />
Un rite de passage, semb<strong>la</strong>ble à celui qui marque l’initiation au monde adulte <strong>et</strong> celui qui<br />
accompagne le mort dans un autre monde, manifesté par l’usage d’obj<strong>et</strong>s, d’incantations ou<br />
de gestes divers selon les sociétés présentées.
annexes<br />
01<br />
Bienvenue !<br />
Présentation générale de l’exposition<br />
Il s’agit de rendre compte <strong>des</strong> naissances dans leurs diversités culturelles <strong>et</strong> sociales à<br />
travers le monde. Si c<strong>et</strong> acte est le même pour tous, il est vécu, exprimé, mis en scène de<br />
différentes manières en fonction <strong>des</strong> cultures <strong>et</strong> <strong>des</strong> sociétés. Le pluriel <strong>des</strong> « Naissances »<br />
montre les diversités culturelles <strong>et</strong> sociales vécues autour <strong>des</strong> questions de l’enfantement.<br />
L’exposition a pour objectif de constituer un miroir où se refl ètent les naissances d’aujourd’hui<br />
<strong>et</strong> d’hier, les pratiques en vigueur en <strong>France</strong> <strong>et</strong> les traditions culturelles venues d’ailleurs :<br />
le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest, le Vi<strong>et</strong>nam <strong>et</strong> <strong>la</strong> Réunion.<br />
Le parcours principal est chronologique ; il couvre <strong>la</strong> venue au monde de l’enfant, de<br />
l’imminence de l’accouchement, jusqu’à ses premiers quarante jours correspondant à sa<br />
venue sociale au monde. Il s’agit donc de <strong>la</strong> venue au monde d’un enfant né à terme, sans<br />
problèmes dans un contexte médicalisé, ici <strong>et</strong> maintenant. S’ajoutent <strong>des</strong> parcours parallèles<br />
d’hier <strong>et</strong> d’ailleurs, <strong>des</strong> vécus <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques issues de ces autres cultures, <strong>des</strong> traditions<br />
de générations précédentes ainsi que <strong>des</strong> naissances plus problématiques.<br />
C’est une exposition très <strong>et</strong>hnographique, moins biologique qu’elle n’aurait pu l’être.<br />
L’aspect médical, qui est important, est vu comme une pratique au même titre que les autres<br />
pratiques traditionnelles <strong>des</strong> différentes cultures évoquées.<br />
La collecte <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s s’est faite dans les différents pays en question, auprès d’ institutions en<br />
<strong>France</strong> <strong>et</strong> également auprès de collections privées.<br />
Pour les témoignages, <strong>des</strong> interviews ont étés réalisés par <strong>des</strong> associations ; ils constituent<br />
une contre-culture par rapport au discours <strong>des</strong> scientifi ques surtout, concernant <strong>la</strong> douleur<br />
<strong>et</strong> les soins <strong>des</strong> l’accouchées.<br />
L’exposition vise à amener chaque visiteur à réfl échir sur ses expériences personnelles<br />
autant qu’à comprendre les enjeux culturels, sociaux, médicaux liés à <strong>la</strong> naissance.<br />
Le centre de ressources en ligne<br />
Le site intern<strong>et</strong> http://www.mnhn.fr/naissances est conçu comme un véritable centre de<br />
ressources en ligne, composé d’une base documentaire multimédia : photos, vidéos, audio,<br />
sites...<br />
Bonne visite !
annexes<br />
02<br />
P<strong>la</strong>n de l’exposition<br />
Légen<strong>des</strong><br />
P : poster V : vitrine A : album F : fi che DVD ou CD<br />
F Annexes01 : Bienvenue !<br />
L es fi ches annexes 01 à 04 v<br />
ous aideront à F Annexes02 : P<strong>la</strong>n de l’exposition<br />
prendre en ma in <strong>et</strong> à appré hender l’exposit ion. F<br />
Annexes03 : Les vitrines<br />
F Annexes04 : Inventaire détaillé<br />
L es fi ches annexes 05 à 08<br />
seront <strong>des</strong> annexes F Annexes05 : Le glossaire<br />
utiles pour toutes les étapes de discussions.<br />
F<br />
Annexes06 : Les mots de <strong>la</strong> naissance<br />
F Annexes07 : Repères chronologiques<br />
F Annexes08 : Bibliographie<br />
1- PRELUDE<br />
P01 : introduction<br />
DVD 1 : Prélude (milk <strong>et</strong> fo<strong>et</strong>oscopie)<br />
2- ACCOUCHER<br />
P02 : <strong>des</strong> lieux où naître, où m<strong>et</strong>tre au monde<br />
P03 : le besoin d’un lieu sûr (F Thèmes01 : <strong>Protéger</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> l’enfant)<br />
P04 : de <strong>la</strong> matrone à <strong>la</strong> sage-femme (F Thèmes02 : Un intérêt tardif de <strong>la</strong> médecine occidentale)<br />
P05 : le lien de confi ance<br />
P06 : travail <strong>des</strong> mains, travail d’écoute<br />
P07 : affaires de femmes, présence du père<br />
DVD 2 : Présence <strong>des</strong> pères<br />
P08 : pour faciliter l’accouchement<br />
V1 : L’accouchement<br />
V 1-1 Les outils de <strong>la</strong> sage-femme<br />
V 1-2 Eloigner les dangers<br />
V 1-2.1 Pour inciter l’enfant à sortir<br />
V 1-2.2 Faciliter le passage<br />
V 1-2.3 Pour faciliter le passage (F Thèmes03 : Les choix d’accouchement)<br />
P09 : assise, accroupie, debout, ... (F Thèmes04 : Les positions d’accouchement)<br />
P10 : douleur en soi, douleur devant les autres<br />
DVD 2 : Le travail, <strong>la</strong> douleur<br />
La danse <strong>des</strong> jeunes fi lles (F Thèmes05 : Une transmission rituelle <strong>des</strong> informations)<br />
P11 : césarienne : <strong>la</strong> médaille <strong>et</strong> son revers<br />
P12 : <strong>la</strong> venue au monde, rencontre<br />
DVD 2 : La venue au monde<br />
(F Activités01 : Mythes <strong>et</strong> légen<strong>des</strong> ... d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs)
annexes<br />
02<br />
3- L’ENFANT EST LÀ<br />
P13 : Cordon <strong>et</strong> p<strong>la</strong>centa (F Thèmes06 : Le p<strong>la</strong>centa)<br />
V2 : Cordon <strong>et</strong> p<strong>la</strong>centa<br />
2-1 Cordon <strong>et</strong> p<strong>la</strong>centa<br />
2-1.1 Couper le cordon<br />
2-1.2 Conserver le cordon, enterrer le p<strong>la</strong>centa<br />
P14 : Les premiers gestes (F Thèmes07 : Identifi er l’enfant)<br />
V3 : Premiers gestes vitaux <strong>et</strong> symboliques<br />
3-1 Identifi er le nouveau-né<br />
3-2 Les premières saveurs<br />
DVD 3 : Premiers gestes vitaux <strong>et</strong> symboliques<br />
P15 : Un temps pour se relever<br />
A1 - La soupe de l’accouchée : Rec<strong>et</strong>tes<br />
P16 : Devenir <strong>mère</strong>, devenir père<br />
P17 : Rites <strong>et</strong> soins au nouveau-né (F Thèmes08 : Nourrir l’enfant <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong>)<br />
V4 : <strong>Protéger</strong> le nouveau-né<br />
4-1 Bijoux <strong>et</strong> amul<strong>et</strong>tes protectrices<br />
4-2 <strong>Protéger</strong> un bébé vi<strong>et</strong>namien<br />
DVD 3 : Rites <strong>et</strong> soins au nouveau-né<br />
CD Son : Berceuses (F Activités02 : Berceau, berceuses)<br />
A2 - L’art d’accommoder les bébés<br />
A3 - Les jumeaux font rêver<br />
Ouverture : Les Naissances particulières (F Thèmes09 à 14 )<br />
- F09 Naissances prématurées<br />
- F10 Al<strong>la</strong>itement <strong>et</strong> sida<br />
- F11 La mort <strong>des</strong> nouveaux-nés dans <strong>la</strong> loi française<br />
- F12 La mortalité <strong>des</strong> femmes pendant <strong>et</strong> après l’accouchement<br />
- F13 Les muti<strong>la</strong>tions génitales féminines<br />
- F14 Oser être <strong>mère</strong>, handicap moteur <strong>et</strong> maternité<br />
DVD 3 : Adaïa, p<strong>et</strong>ite enfant mort-née<br />
4- ACCOMPLIR LA NAISSANCE<br />
P18 : Choisir un prénom (F Activités03 : Qui sui-je? D’où viens-je?)<br />
A4 - Prendre p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> famille<br />
A5 - Apprendre les règles familiales<br />
P19 : Les visites / Annoncer <strong>la</strong> naissance (F Thèmes15 : La naissance sociale)<br />
P20 : Célébrer <strong>la</strong> naissance<br />
DVD 4 : Cérémonies de naissances<br />
Grandir (F Activités04 : Naissance... Hasard <strong>et</strong> société)
annexes<br />
04<br />
Inventaire détaillé<br />
Etui<br />
L’étui contient l’ensemble <strong>des</strong> 20 panneaux souples :<br />
- 1 panneau d’introduction<br />
- Partie 1, “ accoucher ” 10 panneaux numérotés de 02 à 11<br />
- 1 panneau intermédiaire numéroté 12<br />
- Partie 2, “ l’enfant est là ” 5 panneaux numérotés de 13 à 17<br />
- Partie 3, “ accomplir <strong>la</strong> naissance ” 3 panneaux numérotés de 18 à 20<br />
Tiroir<br />
- 15 fi ches “ thèmes ” recto-verso<br />
- 4 fi ches “ animations ”<br />
- 8 fi ches “ annexes ”<br />
- 4 DVDs : le prélude, accoucher, l’enfant est là, accomplir <strong>la</strong> naissance<br />
- 1 CD : parcours sonore virtuel <strong>et</strong> berceuses<br />
- 1 CDrom : visite virtuelle pour enfants<br />
- 5 albums A3 : prendre p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> famille, les jumeaux font rêver, apprendre<br />
les règles familiales, l’art d’accomoder les bébés, <strong>la</strong> soupe de l’accouchée.<br />
- 1 CD contenant le livre de texte de l’exposition pour sa traduction,<br />
le visuel de l’exposition pour <strong>la</strong> communication <strong>et</strong> <strong>la</strong> promotion<br />
Vitrines<br />
Vitrine 1 :<br />
- 1 stéthoscope en bambou<br />
- 1 ensemble de matériel de sage-femme ( <strong>France</strong> ) composé de 8 éléments<br />
- 1 cordon béni de Saint-Joseph<br />
- 1 statu<strong>et</strong>te de <strong>la</strong> Vierge<br />
- 2 images votives : Saint-Expédit <strong>et</strong> Dieu Mourouga<br />
- 1 bonn<strong>et</strong> de nuit d’homme<br />
- 1 can<strong>et</strong>te de limonade-citron<br />
- 1 boîte contenant de <strong>la</strong> tisane ( girofl e, menthe, thym, cannelle )<br />
- 1 bouteille d’huile d’olive P<strong>la</strong>gniol<br />
- 1 boîte contenant <strong>des</strong> grains de sésame<br />
- 1 seringue de gel vaginal « prostine E »
annexes<br />
04<br />
Vitrine 2 :<br />
- 1 fac-similé d’un fœtus dans sa matrice<br />
- 1 <strong>la</strong>me de bambou<br />
- 1 <strong>la</strong>me de rasoir<br />
- 2 barr<strong>et</strong>tes à cheveux<br />
- 1 nécessaire pour les soins du cordon ( Vi<strong>et</strong>nam ) composé de 5 éléments<br />
- 1 tube pour le sang du cordon ombilical<br />
- 1 amul<strong>et</strong>te du lonbri composée d’ 1 amul<strong>et</strong>te en tissu <strong>et</strong> 2 médailles<br />
- 1 spathe d’aréquier plié <strong>et</strong> cousu<br />
- 1 sac à déch<strong>et</strong>s hospitaliers<br />
Vitrine 3 :<br />
- 2 bracel<strong>et</strong>s d’identifi cation : 1 rose & 1 bleu<br />
- 1 chemise<br />
- 2 j<strong>et</strong>ons à numéros<br />
- 1 fac-similé de noix de co<strong>la</strong><br />
- 1 boîte contenant <strong>des</strong> morceaux de sucre<br />
- 1 sach<strong>et</strong> de sel<br />
- 1 fac-similé de poupée<br />
- 1 fac-similé d’un rameau de dattes<br />
- 1 boîte contenant de <strong>la</strong> réglisse séchée<br />
- 1 boîte contenant un mé<strong>la</strong>nge de p<strong>la</strong>ntes séchées<br />
Vitrine 4 :<br />
- 1 bracel<strong>et</strong> d’argent à grelot<br />
- 1 jeu de 4 bracel<strong>et</strong>s<br />
- 1 main de Fatma<br />
- 2 amul<strong>et</strong>tes protectrices<br />
- 1 ours en peluche<br />
- 1 couteau<br />
- 1 bagu<strong>et</strong>te en bambou<br />
- 1 rouge à lèvres<br />
- 1 bande ombilicale<br />
- 1 bandeau protège-fontanelle<br />
- 1 voile<br />
vitrine 1<br />
vitrine 2<br />
vitrine 3<br />
vitrine 4
annexes<br />
05<br />
Glossaire<br />
Accouchement sans douleur<br />
La méthode mise au point par Fernand Lamaze en<br />
1951 comporte deux parties.<br />
La première est pédagogique, <strong>la</strong> femme prenant<br />
connaissance de son corps <strong>et</strong> de son fonctionnement ;<br />
<strong>la</strong> seconde est technique, avec l’apprentissage de<br />
métho<strong>des</strong> de maîtrise corporelle, l’une sous <strong>la</strong> forme<br />
d’une respiration superfi cielle accélérée qui doit<br />
remp<strong>la</strong>cer l’association entre contractions <strong>et</strong><br />
douleurs, qui relève d’un conditionnement culturel<br />
négatif. Pour <strong>la</strong> dernière phase de l’accouchement,<br />
les femmes apprennent une méthode de poussée qui<br />
accompagne les contractions utérines.<br />
Asepsie<br />
Hygiène médico-chirurgicale ; l’asepsie perm<strong>et</strong><br />
de protéger les patients contre les contaminations<br />
microbiennes. En somme, on prend toutes les<br />
mesures pour éviter l’apparition <strong>et</strong> le développement<br />
<strong>des</strong> microbes.<br />
Antisepsie<br />
Destruction <strong>des</strong> microbes par <strong>la</strong> désinfection <strong>des</strong><br />
p<strong>la</strong>ies, notamment. L’antisepsie doit éviter tout risque<br />
d’infection.<br />
Chaire<br />
Poste de professeur à l’université. Créer une chaire<br />
dans une discipline, c’est perm<strong>et</strong>tre à <strong>la</strong> discipline<br />
d’être enseignée à l’université.<br />
Délivrance<br />
Dernier stade de l’accouchement durant lequel<br />
l’enfant va naître.<br />
Fac-similé<br />
Reproduction d’un obj<strong>et</strong> existant ou ayant existé.<br />
Matrone<br />
Chez les Romains, <strong>la</strong> matrone était une femme<br />
mariée ou une <strong>mère</strong> de famille. On appelle matrones<br />
les femmes qui aident à l’accouchement avant que <strong>la</strong><br />
profession de sage-femme ne soit réglementée.<br />
Médicalisation<br />
Depuis le 19 e siècle, les progrès de <strong>la</strong> médecine<br />
l’ont conduite à prendre toujours plus de p<strong>la</strong>ce dans<br />
<strong>la</strong> vie de chacun, à chaque instant. Ce phénomène<br />
s’est accéléré ces quarante dernières années. La<br />
médicalisation désigne c<strong>et</strong>te évolution vers une<br />
société où <strong>la</strong> médecine <strong>et</strong> les médecins jouent un rôle<br />
fondamental, car on y a recours systématiquement.<br />
Certaines personnes considèrent que <strong>la</strong> médicalisation<br />
de notre société est trop poussée <strong>et</strong> que ce n’est<br />
pas une nécessité ; certaines <strong>mère</strong>s souhaitent<br />
donc accoucher hors du milieu médical, souvent à<br />
domicile.<br />
Obstétrique<br />
L’obstétrique est <strong>la</strong> partie de <strong>la</strong> gynécologie qui a<br />
pour obj<strong>et</strong> le déroulement de <strong>la</strong> grossesse <strong>et</strong> de<br />
l’accouchement. L’obstétricien doit donc veiller à <strong>la</strong><br />
bonne santé de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> de son bébé.<br />
Parturiente<br />
Femme qui va accoucher.<br />
Pasteurisation<br />
La pasteurisation est un procédé employé pour <strong>la</strong><br />
conservation <strong>des</strong> aliments. Il a été inventé par Louis<br />
Pasteur en 1856. Celui-ci avait remarqué que les<br />
microbes disparaissaient au-delà d’une certaine<br />
température. Pour éliminer les bactéries, un aliment<br />
est donc chauffé à une température défi nie <strong>et</strong>, ce,<br />
pendant un temps précis. Le temps de chauffage<br />
dépend de <strong>la</strong> nature <strong>des</strong> bactéries à éliminer.<br />
Péridurale<br />
Anesthésie locale du bassin qui perm<strong>et</strong> d’éliminer ou<br />
d’atténuer les douleurs lors d’un accouchement.<br />
P<strong>la</strong>centa<br />
Le p<strong>la</strong>centa est l’organe qui relie <strong>la</strong> <strong>mère</strong> à l’embryon,<br />
via le cordon ombilical. Il est éphé<strong>mère</strong> mais<br />
indispensable aux échanges entre <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> son bébé.<br />
Il pèse environ 600 grammes à <strong>la</strong> fi n de <strong>la</strong> grossesse.<br />
Sage-femme<br />
Profession médicale ayant pour vocation de surveiller<br />
les grossesses <strong>et</strong> de pratiquer les accouchements.<br />
Stérilisation<br />
Destruction <strong>des</strong> micro-organismes dans une pièce,<br />
dans un produit que l’on souhaite consommer, sur<br />
un instrument chirurgical... Différents procédés<br />
perm<strong>et</strong>tent <strong>la</strong> stérilisation : élever <strong>la</strong> température<br />
<strong>et</strong> faire bouillir (pasteurisation), employer <strong>des</strong><br />
désinfectants (antisepsie)....<br />
On y a recours systématiquement.
annexes<br />
06<br />
Les mots de <strong>la</strong> naissance<br />
EN ARABE DU MAGHREB<br />
Sage-femme El Qâb<strong>la</strong><br />
Les contractions, <strong>la</strong> douleur El w’jaa<br />
P<strong>la</strong>centa El kh’<strong>la</strong>ss<br />
Nouveau-né El mazioud<br />
Couper le cordon K’taa el sarra<br />
Perte <strong>des</strong> eaux Tay’hat al mâ<br />
Donner le nom Ism<br />
EN VIETNAMIEN<br />
Sage-femme « femme - aider - naissance »<br />
Les contractions, <strong>la</strong> douleur « contracter - ventre - enfant »<br />
P<strong>la</strong>centa « légume -fo<strong>et</strong>us »<br />
Nouveau-né « enfant juste né »<br />
Couper le cordon<br />
Perte <strong>des</strong> eaux « casser - eau »<br />
Donner le nom « poser - nom »
annexes<br />
06<br />
EN BAMANANKAN, <strong>la</strong>ngue <strong>des</strong> Bambara du Mali<br />
Sage-femme Mùso jigin na « femme - faire accoucher - celle qui »<br />
Les contractions, <strong>la</strong> douleur Tin dimi « travail - douleur »<br />
P<strong>la</strong>centa Fi<strong>la</strong>n<br />
Nouveau-né Den<br />
Le cordon ombilical Bàrà juru<br />
Donner le nom Kùn di « tête - raser »<br />
EN CRÉOLE RÉUNNIONAIS<br />
Sage-femme Fanm saj<br />
Les contractions, <strong>la</strong> douleur Et an douleur<br />
P<strong>la</strong>centa Déliv<br />
Nouveau-né In baba tand<br />
Le cordon ombilical Lonbri<br />
Mauvais sorts Mové sor
annexes<br />
07<br />
Repères chronologiques<br />
Dès 1348 : mention dans le registre <strong>des</strong> délibérations<br />
de l’Hôtel-Dieu d’une “ventrière” <strong>des</strong> accouchées <strong>et</strong><br />
d’un département spécialement réservé aux femmes<br />
en couches.<br />
Les femmes enceintes qui sont accueillies sont <strong>des</strong><br />
fi lles-<strong>mère</strong>s <strong>et</strong> <strong>des</strong> femmes mariées pauvres, dans<br />
l’impossibilité de faire leurs couches à domicile.<br />
1581 : François Rouss<strong>et</strong> donne <strong>la</strong> première <strong>des</strong>cription<br />
de <strong>la</strong> technique de <strong>la</strong> césarienne sur femme vivante<br />
(bien qu’il n’eût jamais pratiqué ou même assisté<br />
à une telle intervention) dans son traité intitulé<br />
“Enfantement césarien”.<br />
1609 : Louyse Bourgeois, qui a mis au monde Louis<br />
XIII quelques années auparavant, publie le premier<br />
traité d’obstétrique publié en <strong>France</strong> par une sagefemme<br />
: “ Observations diverses sur <strong>la</strong> stérilité, perte<br />
de fruit, fécondité, accouchements <strong>et</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>des</strong><br />
femmes <strong>et</strong> enfants nouveau-nés ”.<br />
1660 : les sages-femmes sont agréées par l’Académie<br />
de Chirurgie.<br />
1668 : François Mauriceau, un maître chirurgien,<br />
publie son “ Traité <strong>des</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>des</strong> femmes grosses<br />
<strong>et</strong> de celles qui sont accouchées ”. Selon l’histoire<br />
offi cielle, il est le “fondateur de l’obstétrique en<br />
<strong>France</strong>” <strong>et</strong> le créateur <strong>des</strong> premières maternités<br />
dignes de ce nom.<br />
Vers 1700 : prise de conscience dans toute l’Europe<br />
de l’importance <strong>des</strong> accouchements qui doivent être<br />
pratiqués de manière appropriée par <strong>des</strong> personnes<br />
bien formées pour éviter de m<strong>et</strong>tre en danger <strong>la</strong> vie<br />
de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> de son enfant.<br />
1757 : Louis XV accorde à Madame Du Coudray un<br />
brev<strong>et</strong> avec mission de tenir <strong>des</strong> cours d’instruction<br />
publique dans toutes les provinces du royaume afi n de<br />
former <strong>des</strong> sages-femmes compétentes.<br />
1759 : Madame Du Coudray publie son “ Abrégé de<br />
l’art <strong>des</strong> accouchements ”.<br />
1782 : Jean-Louis Beaudeloque codifi e l’obstétrique<br />
dans “ L’art <strong>des</strong> accouchements ” <strong>et</strong> en organise<br />
l’enseignement.<br />
1806 : Napoléon crée <strong>la</strong> première chaire<br />
d’obstétrique, tenue par Beaudeloque.<br />
1848 : le médecin hongrois Ignaz Philipp<br />
Semmelweis (1818-1865) comprend que les ma<strong>la</strong>dies<br />
post-natales <strong>des</strong> accouchées sont dues à un manque<br />
d’hygiène à l’hôpital. Ses idées sont rej<strong>et</strong>ées par ses<br />
confrères médecins.<br />
1853 : <strong>la</strong> reine Victoria accouche de son fi ls<br />
Léopold en étant anesthésiée avec du chloroforme.<br />
L’accouchement sans souffrance va créer de<br />
véritables polémiques religieuses <strong>et</strong> culturelles qui<br />
vont durer jusqu’au milieu du 20 e siècle.<br />
1857-1858 : Louis Pasteur (1822-1895) découvre<br />
l’existence <strong>des</strong> micro-organismes <strong>et</strong> <strong>des</strong> microbes.<br />
1867 : Joseph Lister (1827-1912), qui suit<br />
attentivement les travaux de Pasteur, trouve une<br />
technique de désinfection effi cace ; c’est l’invention<br />
de l’asepsie.<br />
1874 : Pasteur enjoint aux chirurgiens français de<br />
prendre <strong>des</strong> mesures d’asepsie avant d’opérer les<br />
p<strong>la</strong>ies <strong>et</strong> <strong>des</strong> mesures d’antisepsie pour les soigner.<br />
1878 : Pasteur énonce les conditions idéales de<br />
stérilisation.<br />
1880 : Emile Duc<strong>la</strong>ux m<strong>et</strong> au point <strong>la</strong> pasteurisation.<br />
1882 : Max Sänger développe une technique de<br />
suture qui perm<strong>et</strong> d’abaisser très n<strong>et</strong>tement <strong>la</strong><br />
mortalité maternelle à <strong>la</strong> suite de césariennes.<br />
1951 : suite à un voyage en URSS durant lequel il<br />
voit une femme accoucher sans souffrir, le docteur<br />
Fernand Lamaze m<strong>et</strong> au point une technique<br />
d’accouchement sans douleur.<br />
Depuis les années 1960 : <strong>la</strong> technique de<br />
l’anesthésie péridurale s’est développée dans les<br />
pays anglo-saxons puis dans toute l’Europe.<br />
La péridurale est aujourd’hui rentrée dans les<br />
mœurs ; on <strong>la</strong> propose dorénavant à toutes les<br />
femmes qui accouchent en <strong>France</strong>.
annexes<br />
08<br />
Bibliographie<br />
Angle historique<br />
Naître <strong>et</strong> après<br />
Drina Candilis-Huisman, Découvertes Gallimard,<br />
2002<br />
Pratique pour aborder l’histoire de <strong>la</strong> naissance <strong>et</strong> de<br />
l’enfance en Occident.<br />
La “machine” de Madame Du Coudray, ou l’art <strong>des</strong><br />
accouchements au 18 e siècle<br />
Ed Points de vue, - Musée F<strong>la</strong>ubert <strong>et</strong> d’histoire de <strong>la</strong><br />
médecine, Rouen - CHU hôpitaux de Rouen, 2004<br />
Monographie très joliment illustrée, passionnante.<br />
L’heureux événement<br />
Musée de l’Assistance publique, catalogue de<br />
l’exposition 1995<br />
Bon compromis entre approfondissement <strong>et</strong><br />
accessibilité.<br />
Histoire <strong>des</strong> <strong>mère</strong>s <strong>et</strong> de <strong>la</strong> maternité<br />
en Occident de Yvonne Knibiehler, Que sais-je, 2002<br />
La naissance en Occident<br />
P. Cesbron <strong>et</strong> Y. Knibiehler, Albin Michel, 2004<br />
Ecrit par un gynéco-obstétricien <strong>et</strong> une historienne,<br />
très analytique.<br />
L’arbre <strong>et</strong> le fruit<br />
Jacques Gélis, Ed Fayard, Ouvrage de référence,<br />
lecture facile <strong>et</strong> passionnante.<br />
L’amour en plus - histoire de l’amour maternel,<br />
17 e -20 e siècle de Elisab<strong>et</strong>h Badinter,<br />
Champs F<strong>la</strong>mmarion, 1980<br />
L’accouchement sans douleur, une révolution oubliée<br />
Marianne Caron-Leulliez <strong>et</strong> Jocelyne George, 2004<br />
Excellente monographie historique sur <strong>la</strong> naissance,<br />
le développement puis <strong>la</strong> dissolution progressive de <strong>la</strong><br />
“méthode psycho-prophy<strong>la</strong>ctique” mise au point par<br />
Fernand Lamaze à <strong>la</strong> maternité <strong>des</strong> Blu<strong>et</strong>s.<br />
La naissance dans le monde moderne Jacques Gélis<br />
Quand nos grands-<strong>mère</strong>s donnaient <strong>la</strong> vie<br />
Françoise Thébaud, Ed Presses Universitaires de<br />
Lyon<br />
Entrer dans <strong>la</strong> vie - Naissances <strong>et</strong> enfances dans <strong>la</strong><br />
<strong>France</strong> traditionnelle<br />
Ed Collection archives<br />
L’accouchement<br />
Visages de l’aube photos de Valérie Winckler,<br />
texte de Nancy éd Actes sud, 2001<br />
Des photos de visages de nouveau-nés associées à<br />
une nouvelle littéraire m<strong>et</strong>tant en scène une sagefemme<br />
<strong>et</strong> une adolescente suicidaire.<br />
Au monde. Ce qu’accoucher veut dire<br />
Chantal Birman, éd. La Martinière, 2003<br />
Témoignages <strong>et</strong> réfl exions d’une sage-femme<br />
passionnée ; très intéressant, lecture facile.<br />
L<strong>et</strong>tre à une <strong>mère</strong><br />
René Frydman, Ed. Odile Jacob<br />
Réfl exion intime <strong>et</strong> sensible d’un accoucheur.<br />
Naître tout simplement<br />
Jacqueline Lavillonniere <strong>et</strong> Elizab<strong>et</strong>h Clementz,<br />
Ed. L’Harmattan<br />
Choisir son accouchement<br />
de Barbara Harper, Ed Vivez Soleil<br />
La sage-femme ou le médecin, une nouvelle<br />
conception de <strong>la</strong> vie. La biologie de l’amour de<br />
Arthur Janov, Ed du Rocher<br />
« L’art de naître » Minkowski, Paris, 1989<br />
Angle anthropologique<br />
Bébés du monde<br />
Béatrice Fontanel <strong>et</strong> C<strong>la</strong>ire d’Harcourt,<br />
Ed. de La Martinière, 1998<br />
Beau livre, nombreuses photos commentées par <strong>des</strong><br />
textes courts.<br />
Bébés d’ici, parents d’ailleurs<br />
Catherine-Juli<strong>et</strong> Delpy, Ed Erès-Mille <strong>et</strong> un bébés, 2003<br />
Ouvrage d’initiation.<br />
Enfances d’ailleurs, d’hier <strong>et</strong> d’aujourd’hui<br />
Michèle Guid<strong>et</strong>ti, Suzanne Lallemand, Marie-<strong>France</strong><br />
Morel, Ed. Armand Colin, 1997<br />
Excellente initiation à l’anthropologie, à l’histoire <strong>et</strong> à<br />
<strong>la</strong> psychologie de l’enfance.<br />
Des familles face à <strong>la</strong> naissance<br />
Bernad<strong>et</strong>te Til<strong>la</strong>rd, Ed. l’Harmattan, 2002<br />
Ouvrage dense, mais peut-être utile à découvrir car<br />
l’ enquête anthropologique qu’il re<strong>la</strong>te a lieu dans le<br />
quartier d’une grande ville française.
annexes<br />
08<br />
Naître sur <strong>la</strong> terre africaine<br />
J.P. Eschlimann, INADES Edition, Abidjan 1982<br />
Texte de vulgarisation vivant.<br />
Enfants d’hier, l’éducation de l’enfant en milieu<br />
traditionnel algérien<br />
Nefi ssa Zerdoumi, Maspero 1970<br />
Attachant car précis <strong>et</strong> narratif.<br />
Naître, vivre <strong>et</strong> mourir<br />
de Van Gennep, Neuchatel 1981<br />
La naissance, un voyage.<br />
L’accouchement à travers les peuples.<br />
de Muriel Bonn<strong>et</strong> del Valle, 1950<br />
Naissances <strong>et</strong> infans à At Yanni, Kabylie 1998<br />
Naître <strong>et</strong> grandir chez les Moosé traditionnels<br />
Amadou Bodin, Ouagadougou, 1994<br />
Les mythes de <strong>la</strong> création<br />
J.P. Otte, 1996<br />
L’exercice de <strong>la</strong> parenté<br />
Françoise Héritier, Ed. du Seuil, 1981<br />
Masculin/Féminin/ La pensée de <strong>la</strong> différence<br />
Françoise Héritier, Ed. Odile Jacob, 1996<br />
Temps de naître, temps d’être ; <strong>la</strong> couvade<br />
Patrick Meng<strong>et</strong>.<br />
La couvade, rite de maternité<br />
de Patrick Meng<strong>et</strong>.<br />
Autour de <strong>la</strong> naissance<br />
Le bébé imaginaire<br />
Patrick Ben Soussan, Ed Erès-Mille <strong>et</strong> un bébés, 1999<br />
Ouvrage d’initiation, 73 p.<br />
Devenir père, devenir <strong>mère</strong> ouvrage collectif,<br />
dir. Michel Dugnat, Ed. Erès, 1999<br />
L’art d’accommoder les bébés<br />
Suzanne Lallemand <strong>et</strong> Geneviève De<strong>la</strong>isi de Parseval.<br />
Analyse critique de l’évolution de <strong>la</strong> puériculture en<br />
<strong>France</strong>, devenu un c<strong>la</strong>ssique.<br />
Le père : acte de naissance<br />
Bernard This, Ed. Seuil, 1980<br />
Nombreuses références aux mythes, aux textes<br />
historiques, à l’étymologie <strong>et</strong> au sens psychanalytique<br />
<strong>des</strong> mots.<br />
Accompagner <strong>la</strong> naissance dossier<br />
“Journal <strong>des</strong> Professionnels de l’Enfance” 2005<br />
Etre père, être <strong>mère</strong>, être enfant : La part de <strong>la</strong> <strong>mère</strong><br />
Geneviève De<strong>la</strong>isi de Parseval, Ed. Odile Jacob.<br />
La naissance d’une <strong>mère</strong><br />
Daniel N. Stern <strong>et</strong> Nadia B.-Stern, Ed. Odile Jacob.<br />
Oser être <strong>mère</strong> au foyer<br />
Marie-Pascale Delp<strong>la</strong>ncq-Nobécourt,<br />
Ed. Albin Michel.<br />
Les instincts maternels<br />
B<strong>la</strong>ffer Hrdy, Ed. Payot.<br />
L’instinct maternel apprivoisé – <strong>la</strong> clé d’un<br />
maternage plus heureux<br />
Monique Morin <strong>et</strong> Nicole Marinier, Ed. Stanké.<br />
Les cinq dimensions de <strong>la</strong> sexualité féminine<br />
Danièle Starenkyj, Ed. Orion.<br />
Naissances particulières<br />
J’aime avoir peur avec toi<br />
Catherine Chaine, Ed. du Seuil, 2004<br />
Témoignage d’une maman d’enfant trisomique non<br />
diagnostiqué avant <strong>la</strong> naissance.<br />
Naître différent ouvrage collectif, Erès, 1997-2004<br />
Ouvrage d’initiation.<br />
Aux marges de <strong>la</strong> vie ouvrage collectif, Erès, 1999<br />
Ouvrage d’initiation.<br />
A ce soir<br />
Laure Adler, Ed. Gallimard, 2001<br />
Témoignage d’une <strong>mère</strong> sur <strong>la</strong> mort à l’hôpital de<br />
son enfant de quelques mois.<br />
Saskia ou le deuil d’un bébé Distilbène<br />
Anne-Françoise Lof, Ed. Frison-Roche, 2000<br />
Témoignage d’une <strong>mère</strong>.<br />
Une aussi longue naissance<br />
Françoise Loux, Ed. Stock/Laurence Pernoud, 1983<br />
Témoignage d’une <strong>mère</strong> de grand prématuré, elle<br />
même anthropologue de l’enfance.<br />
Les signes de <strong>la</strong> naissance<br />
Etude <strong>des</strong> représentations symboliques associées<br />
aux naissances singulières de Nicole Belmont, 1971<br />
L’enfant interrompu<br />
Ed. F<strong>la</strong>mmarion, 2004<br />
Abandon, accouchement sous x :<br />
Le bébé face à l’abandon, le bébé face à l’adoption<br />
Ed. Albin Michel, 2000<br />
Contribution à l’anthropologie <strong>des</strong> naissances<br />
monstrueuses<br />
O. Roux, 2000<br />
Naissances <strong>et</strong> abandon en Algérie.<br />
Les naissances extraordinaires Dakar, 1980.<br />
Stérilités mystérieuses <strong>et</strong> naissances maléfi ques<br />
dans l’antiquité c<strong>la</strong>ssique<br />
M. Delcourt, Paris, 1986.