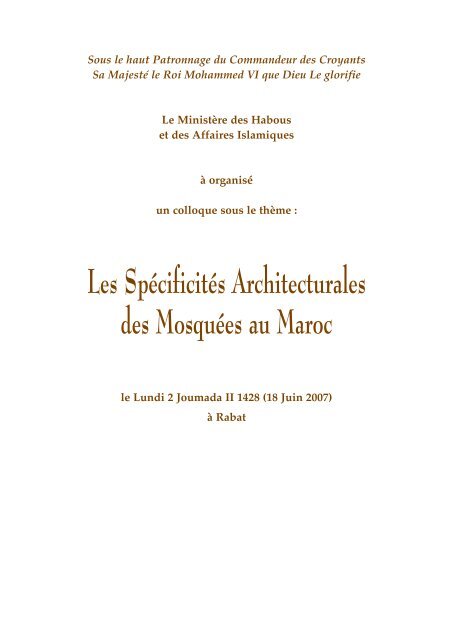Les Spécificités Architecturales des Mosquées au Maroc
Les Spécificités Architecturales des Mosquées au Maroc
Les Spécificités Architecturales des Mosquées au Maroc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 1<br />
Sous le h<strong>au</strong>t Patronnage du Commandeur <strong>des</strong> Croyants<br />
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le glorifie<br />
Le Ministère <strong>des</strong> Habous<br />
et <strong>des</strong> Affaires Islamiques<br />
à organisé<br />
un colloque sous le thème :<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
le Lundi 2 Joumada II 1428 (18 Juin 2007)<br />
à Rabat
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 2<br />
Conception & mise en page :<br />
XXXXXX<br />
Impression :<br />
XXXXX<br />
Dépôt légal : 0000000<br />
ISSN : 00000000
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 3<br />
Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu Le Glorifie
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 4
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 5<br />
SOMMAIRE<br />
Allocution de Mr. Ahmed Toufiq ................................ 7<br />
Ministre <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong> Affaires Islamiques (Traduction)<br />
Allocution de Mr. El Montacir Bensaïd .......................... 9<br />
Directeur de l’Ecole Nationale d’Architecture<br />
Normes juridico religieuses pour la construction <strong>des</strong> mosquées ........ 13<br />
M. Ismail alkhatib (Traduction)<br />
<strong>Les</strong> mosquées marocaines : étude de l’organisation spatiale ........... 22<br />
MM. A. Touri, A. Tahiri et A. Elkhammar<br />
Le mur de la qibla et la nef axiale fonction et symbolique ............ 43<br />
Mme Mina Lamghari<br />
<strong>Les</strong> mosquées marocaines : tendances historiques<br />
et contemporaines ............................................ 51<br />
M. Derouiche Abdelaziz, Directeur <strong>des</strong> mosquées (Traduction)<br />
La mosquée marocaine en milieu rural :<br />
Cas de la province de Tata. ..................................... 81<br />
M. M. Belatik et M. Atki<br />
<strong>Les</strong> mosquées du Sud. ......................................... 105<br />
Mme.Salima Najji<br />
Architectures <strong>des</strong> Minarets, prototypes, évolution esthétique<br />
à travers le monde musulman ................................... 119<br />
M. A. Rhaddioui<br />
La mosquée : un repère dans la ville .............................. 125<br />
M. Hassan kharmich<br />
Localisation <strong>des</strong> mosquées dans la trame urbaine eu égard<br />
<strong>au</strong>x mobilités quotidiennes <strong>des</strong> usagers. ........................... 131<br />
M. M. Achour<br />
Equipement en mosquées : Nouvelles normes urbaines ............... 141<br />
M. Derouiche Abdelaziz<br />
Recommandations (Traduction) ................................... 163<br />
Texte du message adresse à Sa Majeste Mohammed VI,<br />
que dieu l’assiste (Traduction) .................................... 165
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 6
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 7<br />
Allocution du Professeur Ahmed Taoufik<br />
Ministre <strong>des</strong> Habous et Affaires Islamiques<br />
Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux ;<br />
Que la prière et la paix soient avec le plus Noble <strong>des</strong> Messagers d'Allah, notre<br />
Seigneur Sidna Mohammed, ainsi qu'avec Sa Famille et Ses Compagnons.<br />
Messieurs les Ministres,<br />
Honorables Oulémas,<br />
Ingénieurs, Architectes et Enseignants Chercheurs,<br />
Mesdames, Messieurs,<br />
Il m'est agréable, à l'ouverture <strong>des</strong> trav<strong>au</strong>x de ce colloque scientifique qui bénéficie<br />
du H<strong>au</strong>t patronage de Sa majesté Le Roi que Dieu Le Glorifie, de vous souhaiter la<br />
bienvenue et de vous remercier pour avoir répondu à l'invitation <strong>des</strong> organisateurs. Je<br />
suis convaincu que votre participation donnera un caractère particulier à ce colloque qui<br />
s'inscrit dans le cadre de «la Journée <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong>», dont la célébration a été lancée par<br />
Sa Majesté Le Roi, à Marrakech, à l'occasion de la fête du «Mawlid al-Nabawi».<br />
Mesdames et Messieurs,<br />
L'édification <strong>des</strong> mosquées est fortement liée <strong>au</strong> culte et à la foi <strong>des</strong> musulmans.<br />
Elle est l'expression de l'identité musulmane et de la civilisation islamique largement<br />
répandue dans le temps et l'espace. Le Saint Coran accorde une grande importance <strong>au</strong>x<br />
mosquées et incite à leur construction. L'injonction divine y est sans équivoque<br />
lorsqu'Allah dit: «dans <strong>des</strong> demeures dont Allah a <strong>au</strong>torisé l'édification et que Son Nom<br />
y soit invoqué». Pour sa part, la tradition de notre prophète insiste sur la construction<br />
et la multiplication <strong>des</strong> mosquées dans toutes les contrées pour que celles-ci procurent<br />
<strong>au</strong> fidèle la paix de l'âme et la tranquillité de l'esprit.<br />
Au <strong>Maroc</strong>, comme vous le savez et depuis l'arrivée de l'Islam, la mosquée a pris une<br />
place de choix dans le CCEur <strong>des</strong> marocains. Elle représente pour eux, à la fois un lieu<br />
de prière, une institution d'enseignement et de formation où l'on acquiert la science et<br />
la connaissance et un espace de convivialité, d'échange et de resserrement <strong>des</strong> liens<br />
d'amour et d'amitié.<br />
Allocution du Professeur Ahmed Taoufik<br />
7
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 8<br />
<strong>Les</strong> souverains de la glorieuse dynastie alaouite ont de tout temps manifesté le plus<br />
grand intérêt envers les mosquées, leur accordant la plus grande <strong>des</strong> attentions que ce<br />
soit <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de l'édification, de l'équipement ou de l'encadrement. Suivant la<br />
tradition de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu Le<br />
Glorifie, n'avait pas manqué d'ordonner, dans son discours du Trône de l'année 2000<br />
«de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rendre à la mosquée sa mission<br />
de lieu de prière, d'institution d'enseignement, de formation, de prédication et de<br />
conseil et d'en faire <strong>au</strong>ssi un centre où les oulémas, hommes et femmes,<br />
entreprendraient l'encadrement <strong>des</strong> citoyens pour qu'ils soient mieux intégrés dans une<br />
société saine, consciente et solidaire». Il avait de même ordonné, que Dieu l'Assiste,<br />
dans son discours du vendredi 30 avril 2004 à Casablanca, prononcé à l'occasion de<br />
l'institution <strong>des</strong> Conseils <strong>des</strong> Oulémas et la réorganisation du champ religieux, la<br />
révision et la refonte de la législation relative <strong>au</strong>x lieux de culte afin qu'elle soit en<br />
phase avec les normes architecturales et permette la pratique religieuse dans un climat<br />
de quiétude.<br />
Comment nos mosquées peuvent-elles donc être <strong>des</strong> centres de formation culturelle<br />
et d'orientation religieuse et humanitaire, jouant pleinement leur rôle? Comment<br />
adapter l'architecture marocaine <strong>au</strong> développement de la vie et <strong>des</strong> besoins spirituels<br />
<strong>des</strong> fidèles qui fréquentent les mosquées tout en lui préservant son âme et son<br />
<strong>au</strong>thenticité et en faisant en sorte, dans le même temps, qu'elle accompagne les<br />
nouve<strong>au</strong>tés qui apparaissent dans les domaines de la construction et de l'architecture?<br />
Ce sont là quelques unes <strong>des</strong> questions <strong>au</strong>xquelles tenteront de répondre les diverses<br />
communications de ce colloque que je souhaite voir enrichi par vos interventions, vos<br />
remarques et vos propositions.<br />
8<br />
Mesdames et Messieurs,<br />
Si l'on se penche sur l'architecture de nos mosquées, nous remarquerons que nous<br />
nous trouvons face à un patrimoine précieux, qui a su garder sa personnalité et sa<br />
spécificité et qui a su réussir son développement, en résistant à travers les âges, à tout<br />
ce qui, dans les courants culturels et idéologiques extérieurs <strong>au</strong>xquels il était exposé,<br />
pouvait l'altérer; il sut rester solidement ancré dans son originalité, perpétuant pour les<br />
générations successives les glorieux apports de nos ancêtres et l'éclat de la civilisation<br />
qu'ils ont légué.<br />
Le modèle marocain utilisa <strong>des</strong> formes et <strong>des</strong> éléments architectur<strong>au</strong>x qui lui<br />
donnèrent une originalité singulière sans qu'il vienne à perdre les caractéristiques de<br />
l'architecture islamique. Architectes et artistes développèrent par la suite le modèle par<br />
<strong>des</strong> innovations produites dans diverses directions. Il m'est donc agréable, à cette<br />
occasion, d'inviter les chercheurs marocains à réserver <strong>au</strong>x mosquées la part qui doit<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 9<br />
être la leur dans leurs étu<strong>des</strong>, leurs analyses et leurs recherches, afin qu'ils découvrent<br />
et qu'ils fassent connaître le patrimoine architectural si riche que renferme notre pays.<br />
Mesdames et Messieurs,<br />
L'édification <strong>des</strong> lieux de culte, comme vous savez, compte parmi les services<br />
fondament<strong>au</strong>x et urgents que réclament les citoyens dans tout nouve<strong>au</strong> lotissement,<br />
toute extension urbaine ou tout complexe d'habitation. La non obtention de cette<br />
demande ou le retard à la concrétiser pousse les citoyens à créer <strong>des</strong> oratoires souvent<br />
dépourvus de toute condition adéquate de sécurité et d'encadrement, sans que l'on<br />
omette les problèmes que peuvent entrainer certains de ces cas et qui nécessitent la<br />
conjugaison <strong>des</strong> efforts afin d'en extirper les racines et en éradiquer les c<strong>au</strong>ses.<br />
Pour remédier à de telles situations et éviter que de semblables ne se produisent à<br />
l'avenir, le Ministère a mis en place, en collaboration avec le Ministère délégué <strong>au</strong>près<br />
du Premier Ministre chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme, <strong>des</strong> normes nouvelles pour<br />
la production de mosquées, et ce, dans le souci de répondre <strong>au</strong>x besoins <strong>des</strong> habitants<br />
<strong>des</strong> nouvelles zones urbaines en oratoires et en gran<strong>des</strong> mosquées, respectant les<br />
conditions de réalisation et garantissant la présence de toutes les composantes d'un lieu<br />
de culte. Ceci en plus <strong>des</strong> deux programmes lancés par le Ministère, le plan normal et<br />
le plan exceptionnel, qui visent à réduire le déficit en mosquées et satisfaire les besoins<br />
futurs.<br />
Aussi bien, Mesdames et Messieurs, devrons nous faire de l'occasion qui nous est<br />
offerte, un moment de réflexion et un point de départ pour mobiliser les volontés et<br />
stimuler les énergies en vue de mettre en CEuvre les directives éclairées de Sa Majesté<br />
le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu Le Glorifie, concernant le<br />
domaine.<br />
Encore une fois je vous réitère la bienvenue et prie Dieu pour qu'II bénisse votre<br />
rencontre et couronne vos trav<strong>au</strong>x de succès et de réussite.<br />
Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction d'Allah soient avec vous.<br />
Allocution du Professeur Ahmed Taoufik<br />
9
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 10<br />
10<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 11<br />
Allocution M. El Montacir BENSAÏD<br />
Directeur de l’Ecole Nationale d’Architecture<br />
MM. les Ministres,<br />
Mesdames et Messieurs,<br />
Je voudrais, pour commencer, en mon nom et <strong>au</strong> nom de l’école Nationale<br />
d’Architecture, saluer l’initiative du Ministère <strong>des</strong> Affaires Islamiques pour l’organisation<br />
de cette journée, doublement, d’une part pour nous avoir donner l’occasion de débattre<br />
d’un sujet qui est extrêmement important <strong>au</strong>ssi bien dans notre paysage urbain que dans<br />
notre culture et notre foi : celui de la mosquée et d’<strong>au</strong>tre part, de nous permettre, nous qui<br />
sommes en amont de la formation <strong>des</strong> concepteurs de nous sensibiliser sur la nécessité,<br />
urgente, de donner une enveloppe, un visage spécifiquement ou typiquement marocain à<br />
nos édifices religieux. Cela dit, la mosquée a une double dimension : Elle est d’abord le<br />
centre spirituel vers lequel nous nous dirigeons pour trouver le calme, la sérénité et le<br />
recueillement, nécessaires à la pratique de nos croyances, loin <strong>des</strong> nuisances et <strong>des</strong> bruits<br />
de la ville. Cette dimension spirituelle en fait un bâtiment qui ne peut, en <strong>au</strong>cun cas, être<br />
anodine ou comparable à un tout <strong>au</strong>tre bâtiment que l’architecte conçoit. La 2ème<br />
dimension de cet édifice est sa présence dans le paysage urbain, en tant que repère, en tant<br />
que noy<strong>au</strong>, en tant que centre de rayonnement spirituel dont la silhouette caractéristique se<br />
détache dans le ciel marocain. D’abord par son volume ; et deuxièmement par son<br />
minaret, qui en fait un repère tel un phare qui dirigerait les navires. C’est pourquoi je<br />
voudrais attirer l’attention de cette honorable assemblée sur ces caractéristiques qui<br />
doivent être traitées avec le plus grand respect et la<br />
Plus grande préc<strong>au</strong>tion. En tant que concepteur, un architecte ne peut en <strong>au</strong>cun cas<br />
travailler, débattre, ou se pencher sur la conception d’un tel édifice sans avoir en mémoire,<br />
d’une façon permanente, sa composante essentiellement religieuse. Donc l’exercice ne<br />
peut se faire d’une façon classique ou routinière tel que nous le faisons pour le traitement<br />
d’un immeuble, d’un bâtiment administratif, ou d’une villa. Il va,donc, être important,<br />
pour nous, d’avoir un certain nombre de repères, de normes et de dimensions <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de<br />
la conception, qui seront nos axes d’orientation dans l’élaboration de ce h<strong>au</strong>t lieu du culte<br />
qu’est la mosquée marocaine, dans le rite malékite, que nous pratiquons,tout en attirant<br />
l’attention sur la nécessité pour nous tous, de garder la créativité et la liberté que doit avoir<br />
un concepteur face <strong>au</strong> défi qui lui est lancé dans une quelconque démarche architecturale.<br />
Allocution de M. El Montacir Bensaïd<br />
11
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 12<br />
C’est pourquoi, <strong>au</strong>jourd’hui, à l’occasion de cette journée, tout en écoutant les débats,<br />
en discutant <strong>des</strong> différentes composantes, <strong>des</strong> différentes problématiques <strong>des</strong> mosquées,<br />
il m’apparaît essentiel que pour nous, en tant que formateurs, de nous retrouver, à la fin,<br />
avec <strong>des</strong> orientations claires et pratiques, à même de nous servir de garde-fou, dans les<br />
conceptions à venir.<br />
Par ailleurs ces orientations ou recommandations ne doivent pas entraver la créativité<br />
mais la guider. Mon inquiétude serait de traduire l’exercice, de la conception de la<br />
mosquée, en un exercice purement mathématique, qui donnerait une normalisation<br />
anodine, monotone, d’un bâtiment qui doit refléter une dimension spirituelle unique.<br />
Nous allons, donc, écouter avec be<strong>au</strong>coup d’attention les interventions, nous allons y<br />
contribuer, nous allons transmettre <strong>au</strong>ssi le message, dans la formation et nous avons<br />
l’ambition, grâce <strong>au</strong> soutien du ministère <strong>des</strong> affaires islamiques et en partenariat avec lui,<br />
d’aller plus loin et d’arriver peut être dans un temps assez court, à l’élaboration d’un<br />
cahier de charges et d’un guide pour la conception <strong>des</strong> édifices religieux.<br />
Nous devons nous rappeler, à tous, que l’usager principal de la mosquée est la<br />
spiritualité et que le second en est l’homme. Comment ces deux composantes, totalement<br />
différentes, l’une immatérielle et l’<strong>au</strong>tre matérielle doivent entrer les unes avec les <strong>au</strong>tres,<br />
en symbiose, en harmonie dans un cadre qui lui est propice. Dans les églises du 14ème<br />
siècle, du 15ème et du 16ème siècle l’acte de construire, de <strong>des</strong>siner ou de bâtir une église<br />
était un acte religieux en soi, c’est-à-dire que le concepteur était, lui-même,engagé<br />
spirituellement dans le processus, pas seulement en tant que concepteur mais en tant que<br />
croyant,que fidèle, il serait important que pour les mosquées, de h<strong>au</strong>ts nive<strong>au</strong>x, de gran<strong>des</strong><br />
tailles, une démarche que je ne dirai pas analogue mais empreinte d’un même esprit et un<br />
même engagement puissent accompagnés l’exercice, de façon à ce que le reflet du<br />
bâtiment, en phase finale, soit le reflet d’une spiritualité et d’une religion qui est la notre.<br />
Je vous souhaite be<strong>au</strong>coup de courage, je souhaite <strong>au</strong>x intervenants de garder en tête<br />
l’importance de la normalisation mais en même temps l’importance de la liberté dans la<br />
conception et dans la créativité et que ces deux choses ne sont pas incompatibles. Cela a<br />
été fait un peu partout en occident : il y a <strong>des</strong> normes pour tous les bâtiments publics, il<br />
y a <strong>des</strong> normes pour tous les lieux de culte<br />
Je pense que nous pouvons faire, de même, tout en gardant, en préservant, un<br />
patrimoine architectural qui est le patrimoine, encore une fois je le dis et je le redis, qui<br />
est le patrimoine nord- africain et qui est un patrimoine marocain, qui est un patrimoine<br />
particulier où le minaret a une symbolique particulière, le mihrab en a une <strong>au</strong>tre, le sahn,<br />
et la dimension de la mosquée avec les matéri<strong>au</strong>x qui la composent, en sont d’<strong>au</strong>tres<br />
éléments, tout <strong>au</strong>ssi, spécifiques<br />
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, et je vous souhaite à tous, plein de succès<br />
lors de cette journée.<br />
12<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 13<br />
L’ARCHITECTURE DES MOSQUÉES<br />
Professeur Ismail Khatib<br />
Membre du Conseil Local <strong>des</strong> Oulémas de TETOUAN<br />
<strong>Les</strong> mosquées sont les lieux les plus aimés de Dieu, dont le Tout Puissant a <strong>au</strong>torisé<br />
qu’elles soient édifiées et que Son Nom y soit invoqué. Quand une mosquée est bâtie et<br />
que les prières y sont invoquées, que le coran y est récité, le Nom du Clément invoqué,<br />
la science y est répandue ainsi que d’<strong>au</strong>tres glorieux services, alors tout ceux qui ont<br />
participé à son édifice et à la continuation <strong>des</strong> bonnes vertus pour laquelle elle a été<br />
érigée, que ce soit par leurs ressources financières ou leurs conseils, ou par n’importe<br />
quels <strong>au</strong>tres efforts fournis dans ce sens, sont récompensés par Dieu.<br />
Etant donné le rang élevé <strong>des</strong> mosquées et leur h<strong>au</strong>te position, Dieu les a mise dans<br />
Sa h<strong>au</strong>te estime. Le Tout Puissant a dit : «Y a-t-il plus outrageant que celui qui<br />
s’oppose à l’invocation du nom d’Allah dans Ses mosquées et qui œuvre à leurs<br />
<strong>des</strong>tructions» (Al Baqaara 114).<br />
Dieu a dit <strong>au</strong>ssi : «Seuls sont admis à fréquenter les mosquées d’Allah ceux qui<br />
croient en lui et <strong>au</strong> jugement Ultime. (Attoubah, 18). Et le Très H<strong>au</strong>t a dit encore : <strong>Les</strong><br />
mosquées ont pour vocation le culte d’Allah, ne priez d’<strong>au</strong>tre qu’Allah.<br />
De nombreux textes d’ordre général ont porté sur les mosquées, comme la parole<br />
divine : «Vous n’atteindrez pas la piété sans faire de dons charitables <strong>des</strong> biens que vous<br />
chérissez, et quelque charité que vous faite Dieu en a connaissance. (Al omrane, 92)<br />
Ce verset coranique invite à dépenser dans le bien, et la construction de mosquée<br />
est sans nul doute, l’un <strong>des</strong> meilleurs moyens de faire le bien.<br />
D’<strong>au</strong>tres textes, citent les mosquées d’une façon plus explicite, tels que la parole du<br />
Très H<strong>au</strong>t : «[Sa Lumière éclaire] <strong>des</strong> édifices érigés selon Sa permission et où Son<br />
Nom sera invoqué ; là Allah sera glorifié, matin et soir».<br />
Dieu a <strong>au</strong>torisé la construction et l’édification <strong>des</strong> mosquées d’une manière qui sied<br />
à leur place et leur objectif, ainsi il en est de leur maintenance et entretien.<br />
Dieu le Clément a instruit que l’édification de mosquées est une activité [digne] de<br />
prophète quand Il a dit : «Et rappelle-toi lorsqu’Abraham et Ismaïl, après avoir mené<br />
L’architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
13
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 14<br />
à bien la construction <strong>des</strong> assises du Temple, ont fait cette prière : Seigneur, daigne<br />
accepter de nous ce mo<strong>des</strong>te ouvrage : Tu es Celui qui entend tout et dont le savoir est<br />
Transcendant.»<br />
L’édification de mosquée étant un bienfait gratifiant, Abraham et Ismaïl prièrent<br />
Dieu d’accepter leur labeur. Ainsi, toute personne, contribuant de quelques façons que<br />
ce soit, à l’édification d’une mosquée, devrait croire qu’elle a réalisé une bonne action<br />
qui mérite récompense, et prier Dieu de l’accepter.<br />
Le texte coranique certifie que les bâtisseurs de mosquées sont de vrais croyants<br />
Ainsi, Dieu a dit : «seuls sont admis à fréquenter les mosquées d’Allah ceux qui croient<br />
en Lui et <strong>au</strong> jugement Ultime..» La fréquentation <strong>des</strong> mosquées est manifestée soit par<br />
la présence permanente dans la mosquée, sa grande fréquentation ou par sa<br />
construction et son entretien. Or, la fréquentation, que ce soit pour la prière ou pour la<br />
récitation du Coran et <strong>des</strong> textes sacrés, ne peut se réaliser sans qu’il y ait eu<br />
préalablement construction et entretien de mosquée.<br />
Be<strong>au</strong>coup de Hadiths du prophète, que le Salut et la Prière soient sur lui, ont porté<br />
sur la fréquentation et l’édification de mosquées. L’un de ces Hadiths dit : «celui qui<br />
construit une mosquée, petite ou grande soit elle, Dieu lui construira une demeure <strong>au</strong><br />
Paradis». De plus, l’édification de mosquée est une action gratifiante même à titre<br />
posthume, se perpétue et rejoint le croyant jusqu’après sa mort. Le Hadith dit, dans ce<br />
sens : «ce qui atteint le croyant de ses bonnes actions et bienfaits, même à titre outretombe,<br />
est : une science qu’il a enseigné et diffusé, un Livre dont il a hérité, une<br />
<strong>des</strong>cendance qu’il a laissé dans le droit chemin ou une mosquée qu’il a bâti».<br />
Vu que la mosquée occupe une place prépondérante dans la religion musulmane, le<br />
Prophète Sidna Mohamed (P.S) s’est attelé, dès les premiers jours de l’Hégire, à la<br />
construction de la première mosquée de l’Islam. Cette noble action, a donné le départ<br />
<strong>au</strong> processus d’édification de multitude de mosquées partout dans le monde. Ce<br />
processus ne s’est pas arrêté jusqu’à nos jours.<br />
D’<strong>au</strong>tre part, étant donnée que le musulman est tenu de se conformer à la légalité<br />
islamique et à la morale religieuse, avant toute action, et vu la place prépondérante de la<br />
mosquée dans la cité musulmane et que de nombreux textes sont venus organiser et<br />
réglementer l’édification <strong>des</strong> mosquées, plusieurs Oulémas se sont attelés à préciser et<br />
expliquer dans le détail tous ces différents textes.<br />
Ainsi, non seulement, on trouve de nombreux écrits émanant <strong>des</strong> Oulémas,<br />
expliquant et détaillant les différents textes se rapportant à la construction de mosquées,<br />
mais <strong>au</strong>ssi d’<strong>au</strong>tres contenant <strong>des</strong> volets complets sur les Hadiths de Sidna Mohamed<br />
(P.S). Parmi ces écrits on peut citer dans Sahih Moslim «le Livre <strong>des</strong> mosquées et <strong>des</strong><br />
lieux de culte», le volet : «de la construction <strong>des</strong> mosquées et ses obligations».<br />
14<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 15<br />
Par ailleurs, dans «le Livre de prière» de Sahih El Boukhari, on trouve plusieurs<br />
chapitres sur la construction de mosquées comme : «de la construction <strong>des</strong> mosquées»<br />
et «de l’entraide dans la construction de mosquées» ou encore «Du recours <strong>au</strong>x<br />
menuisiers et artisans pour le bois du «Minbar» et mosquée», et la section «du<br />
bâtisseur de mosquée».<br />
<strong>Les</strong> Fqihs et Oulémas ont, ainsi, largement étudié les orientations de la religion<br />
musulmane traitant de la construction <strong>des</strong> mosquées. <strong>Les</strong> textes de la Doctrine<br />
Malékites, entre <strong>au</strong>tres, contiennent diverses règles et dispositions concernant le sujet.<br />
Parmi ces textes, on peut déceler dans le Livre «Annawazel», une vision claire de se<br />
qu’a été la construction <strong>des</strong> mosquées à l’Occident Islamique durant différentes<br />
époques.<br />
Enfin, pour clarifier davantage les propos en ce qui concerne l’édification et la<br />
rénovation <strong>des</strong> mosquées, du point de vue de la loi musulmane, on va traiter le sujet<br />
selon les sections suivantes :<br />
L’architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
15
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 16<br />
SECTION I :<br />
EMPLACEMENT DE LA MOSQUEE<br />
Nul doute que, pour construire une mosquée, il f<strong>au</strong>drait lui choisir l’emplacement<br />
idéal, la mosquée ayant une relation étroite avec le paysage urbanistique. Le Prophète<br />
(P.S) a précisé le sens de ce paysage. Dans les textes de Aicha, il est dit que le prophète<br />
a ordonné que «la mosquée soit bâtie dans les demeures et qu’elle soit nettoyée et<br />
parfumée»<br />
L’environnement immédiat de la mosquée doit être pris en considération, la<br />
mosquée devrait être érigée dans un espace propre, loin de tout endroit produisant <strong>des</strong><br />
déchets ou saletés. Sa place devrait être <strong>au</strong> cœur <strong>des</strong> agglomérations pour qu’elle<br />
puisse jouer son rôle de centre de rayonnement <strong>au</strong>tour duquel s’aggloméreraient les<br />
résidences et les différentes institutions et être ainsi l’objet d’intérêt du voisinage.<br />
<strong>Les</strong> Oulémas ont insisté sur la salubrité de la mosquée et de celle de son<br />
environnement.<br />
Cheikh Al Wazzani, dans son Livre «Al miyar El Jadid», citant la réponse de<br />
Cheikh Ben Nacer sur la possibilité d’accomplir la prière dans une mosquée dans<br />
laquelle s’infiltre <strong>des</strong> poussières entrainées par les vents, a rapporté qu’il f<strong>au</strong>t clore, si<br />
possible, les issues d’où proviennent ces poussières, <strong>au</strong>trement, si l’endroit comporte<br />
<strong>des</strong> impuretés mêlées à ces poussières. La prière ne serait valable que sur un linge<br />
propre.<br />
A priori, l’une <strong>des</strong> préc<strong>au</strong>tions à prendre pour la construction d’une mosquée est le<br />
choix du site adéquat afin d’éviter de clore les issues. Le site devrait être, <strong>au</strong>ssi, loin<br />
de toute source de pollution, les salles d’e<strong>au</strong> devraient être en dehors de la mosquée<br />
comme stipulé dans le Hadith du prophète (P.S) : «Il est conseillé de tenir loin de vos<br />
mosquée vos jeunes enfants, vos différents, vos aliénés, vos commerces, et de ne pas<br />
h<strong>au</strong>sser vos voix, de ne pas poser de limites ni brandir vos sabres et de prévoir les<br />
salles d’e<strong>au</strong> <strong>au</strong>x entrées».<br />
La doctrine Malékite institut, comme stipulé dans «Miyar Al Wanchiri (p. 422, v. 8),<br />
recommande de mettre les salles d’e<strong>au</strong> à l’extérieur <strong>des</strong> mosquées.<br />
Par ailleurs, les musulmans se sont évertués dans l’art de construction <strong>des</strong><br />
mosquées, espaces aimés par Dieu, ont montré un intérêt particulier pour leur<br />
édification. Pour cela, ils ont fourni de larges moyens et de grands efforts.. La Dynastie<br />
Alaouite, particulièrement, a, dans ce sens de tout temps, le mérite dans l’édification,<br />
la maintenance de mosquées, ainsi que la prise en charge <strong>des</strong> personnes qui s’en<br />
occupent.<br />
16<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 17<br />
L’architecte musulman, sans dévier de la structure générale du model établi par le<br />
Prophète, a tenu compte de tous les détails dans le <strong>des</strong>ign de mosquées. Il a fait usage<br />
de coupoles pour les toitures, a fait preuve d’innovation en ce qui concerne les<br />
volumes, les formes et l’ornement <strong>des</strong> arca<strong>des</strong> et <strong>des</strong> voutes, et s’est intéressé<br />
spécialement <strong>au</strong>x faça<strong>des</strong> et <strong>au</strong>x entrées.<br />
<strong>Les</strong> chercheurs en matière d’architecture de mosquées dénombrent sept types<br />
architectur<strong>au</strong>x de mosquées, parmi lesquels on trouve, en premier lieu, le modèle<br />
marocain. Ce dernier se distingue principalement par sa valorisation <strong>des</strong> oratoires et<br />
l’approfondissement de son intérieur jusqu’à la forme quadrilatère ou presque, tout en<br />
valorisant le «Sahn». <strong>Les</strong> caractéristiques du modèle marocain, s’approchent<br />
considérablement de l’architecture de la mosquée du Prophète que la Prière et le Salut<br />
soient sur Lui.<br />
L’architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
17
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 18<br />
SECTION II :<br />
PRECEPTES DES CONSTRUCTIONS DES MOSQUEES<br />
Le Prophète (P.S) a établi les règles générales relatives <strong>au</strong> <strong>des</strong>ign et l’édification <strong>des</strong><br />
mosquées, quand il a planifié et construit la mosquée de «QIBAA» et la mosquée de<br />
Médine. L’Imam Bokhari, dans son Livre «Sahib», a cité que d’après une information<br />
provenant de NAFII, Abdellah a dit que la mosquée du Prophète a été, de son vivant,<br />
construite de briques, les toitures de palmes et les piliers de bois de palmier. Alors que<br />
ABOU BAKR, compagnon du prophète, n’y a rien ajouté, OMAR IBN KHATTAB,<br />
<strong>au</strong>tre compagnon du prophète, l’a reconstruite selon les mêmes procédés que du temps<br />
du prophète. Tandis que le compagnon OTHMANE l’a modifié en y ajoutant d’<strong>au</strong>tres<br />
matéri<strong>au</strong>x : les murs ont été construites de pierres taillées et de plâtres, les toitures<br />
remplacées par du bois précieux provenant de l’Inde (saj)»<br />
Si la structure générale de la mosquée établie par le prophète a été maintenue par<br />
Ses Compagnons et ceux qui leur ont succédé, son architecture a be<strong>au</strong>coup évolué<br />
depuis l’ère du Calife OTHMANE. L’architecture de la mosquée s’est inspirée de<br />
l’environnement qui l’entoure, que ce soit par la forme quadrilatère ou par les<br />
matéri<strong>au</strong>x utilisés. <strong>Les</strong> modifications et <strong>au</strong>tres élargissements apportés durant l’ère<br />
d’OTHOMANE s’expliquent par la disponibilité <strong>des</strong> ressources financières suites <strong>au</strong>x<br />
conquêtes. Ainsi, la mosquée du Prophète a été élargie, les matéri<strong>au</strong>x améliorés, et<br />
même, depuis l’époque de AL WALID BEN ABDELMALEK IBN MARWANE lors<br />
du règne <strong>des</strong> derniers Compagnons, ornementée. Cependant, certains Oulémas ont<br />
récusé tout ornement de mosquées en s’appuyant sur <strong>des</strong> paroles de prophètes<br />
prohibant de tels actes, alors que d’<strong>au</strong>tres les ont <strong>au</strong>torisé à condition que le but<br />
escompté soit de reh<strong>au</strong>sser et ennoblir la mosquée. Dans ce sens, IBN MOUNIR a dit<br />
dans son Livre «FATH EL BARI» : «si les gens bâtissent leurs demeures et les<br />
embellissent, la mosquée en est plus digne afin de lui éviter la mésestimation.<br />
Enfin, les caractéristiques architecturales <strong>des</strong> mosquées sont restées immuables de<br />
par leurs significations et philosophies et de par les exigences d’être <strong>des</strong> espaces de<br />
culte et de sciences.<br />
18<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 19<br />
SECTION III :<br />
LES ELEMENTS ARCHITECTURAUX FONDAMENTAUX<br />
<strong>Les</strong> styles architectur<strong>au</strong>x, ont varié malgré qu’ils aient tous gardé le cachet de<br />
l’architecture Islamique. Jusqu’<strong>au</strong> quatrième siècle, la majorité de mosquées, y compris<br />
celles marocaines, comportèrent un «Sahn» (Patio) non couvert cerné de deux ou trois côtés<br />
de pavillons tout en élargissant le pavillon de la Qibla et celui qui lui fait face.<br />
<strong>Les</strong> architectes musulmans ont tenu à prendre en considération, dans leur <strong>des</strong>ign de la<br />
mosquée, les orientations du Prophètes (P.S) et surtout celle consistant à valoriser le<br />
premier rang, telle cette orientation rapportée par ABI HOUREIRA citant le prophète : «Si<br />
les gens savaient l’importance de l’appel et du premier rang, ils se seraient rués vers la<br />
première rangée». Le premier rang est l’élément essentiel définissant les plans <strong>des</strong><br />
mosquées sous sa forme longitudinale avec un axe principal parallèle à l’orientation du mur<br />
de la Qibla conformément <strong>au</strong> Hadith du prophète. <strong>Les</strong> <strong>au</strong>tres rangées viennent en<br />
complémentarité selon le prolongement de la première.<br />
L’architecte musulman a <strong>au</strong>ssi, pris en compte l’orientation du prophète : «Si le passant<br />
entre les rangées savait ce qu’il lui en coûtait, il se serait figé 40 fois <strong>au</strong> lieu de le faire». Pour<br />
cela, le <strong>des</strong>igner a placé les portes de la mosquée selon <strong>des</strong> normes architecturales ne<br />
permettant pas le passage entre les rangées. C’est pour cette raison que la plupart <strong>des</strong> entrées<br />
se situent soit à l’arrière, soit sur les côtés.<br />
Le nombre élevé de poutres est <strong>au</strong>ssi un facteur qui divise les rangées, obstrue la vue de<br />
l’orateur, alors qu’il est conseillé d’être en face de celui-ci. Toutes ces contraintes ont<br />
poussé le <strong>des</strong>igner à éviter <strong>au</strong> maximum la mise en place de poutre. Dans les textes du<br />
«Miyar Al Jadid», il est rapporté qu’il y avait plusieurs mosquées d’Andalousie dépourvues<br />
de toitures afin d’éviter toute poutre.<br />
Le «Minbar» l’oratoire prend une place prépondérante dans l’architecture <strong>des</strong><br />
mosquées, on le trouve mobile dans certains cas, fixe dans d’<strong>au</strong>tres. <strong>Les</strong> oratoires mobiles<br />
sont connus dans l’Occident Islamique, tandis que les mosquées d’Orient utilisent souvent<br />
<strong>des</strong> balcons en guise d’oratoire. Le <strong>Maroc</strong>, Quand à lui, a conservé le modèle de l’oratoire<br />
du prophète sous sa forme générale, avec <strong>des</strong> escaliers, le tout casé dans une niche du côté<br />
droit du Mihrab. Quand à l’oratoire mobile, il constitue une solution importante pour la<br />
visibilité de la première rangée. L’industrie marocaine <strong>des</strong> oratoires a progressé durant<br />
l’époque <strong>des</strong> Almoahad, l’exemple en est l’oratoire de la mosquée Al Koutoubia qui date<br />
de l’époque suscitée.<br />
L’architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
19
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 20<br />
Si dans toute architecture l’orientation est un critère très important et dépend de<br />
plusieurs paramètres, l’orientation <strong>des</strong> mosquées, quand à elle, ne peut dépendre de certains<br />
de ces paramètres puisqu’elle est régie par la parole divine qui dit : «Orientes toi vers la<br />
Mosquée Sacrée, et où que vous soyez, orientez-vous vers Lui». L’orientation vers la Qibla<br />
est une condition de validité de la prière et, par conséquent, l’architecte de la mosquée doit<br />
s’assurer avant tout de la direction de la Qibla pour que l’oratoire soit orienté exactement<br />
vers elle.<br />
L’oratoire est devenu une partie primordiale dans l’architecture <strong>des</strong> mosquées. Il<br />
n’existait pas du temps du prophète, ni durant celui <strong>des</strong> Califes. Le premier qui le créa fût<br />
OMAR BEN ABDELAZIZ. Par la suite, l’oratoire prit be<strong>au</strong>coup d’ampleur de la part <strong>des</strong><br />
<strong>des</strong>igners et architectes <strong>des</strong> mosquées, à tel point que certains oratoires sont devenus<br />
célèbres et caractéristiques de leurs créateurs ou de leurs époques.<br />
Comme il a porté son intérêt sur l’oratoire, l’architecte s’est intéressé <strong>au</strong>ssi à la partie en<br />
face de cet oratoire en créant une coupole couvrant cette partie importante de la mosquée<br />
qui englobe le «Minbar» et la chambre de l’orateur. La coupole fit son entrée dans les<br />
mosquées, avec be<strong>au</strong>coup de variétés dans sa géométrie et ses ornements, durant la fin du<br />
premier siècle, et est devenue partie essentielle.<br />
Nul doute que le Sahn (patio) de la mosquée est considérée comme un élément<br />
fondamental dans la mosquée, puisque il y en avait un, non couvert, dans la mosquée du<br />
prophète. L’architecte musulman est resté fidèle à cette tradition car on a rarement trouvé<br />
une mosquée, grande ou petite soit-elle, sans Sahn correspondant à sa taille. Le Sahn est<br />
sources de lumière et d’air pour les <strong>au</strong>tres parties de la mosquée. Comme il est espace<br />
supplémentaire pour les croyants quand il n’y en a plus dans les parties couvertes. Le sahn<br />
est généralement doté de fontaines à partir <strong>des</strong>quelles coule de l’e<strong>au</strong> douce utilisée pour la<br />
salubrité et donnant <strong>au</strong> Sahn une touche de be<strong>au</strong>té comme c’est le cas dans la mosquée Al<br />
Qaraouyine.<br />
20<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 21<br />
SECTION IV :<br />
LES ELEMENTS ARCHITECTURAUX<br />
COMPLEMENTAIRES<br />
En plus <strong>des</strong> éléments fondament<strong>au</strong>x de la mosquée, d’<strong>au</strong>tres éléments ont été<br />
introduits et sont devenus partie intégrante de la mosquée.<br />
En premier lieu, on trouve le minaret qui fut introduit, comme il est dit, par<br />
MOAWIYA BEN ABI SOUFIANE dans la mosquée de Damas. Alors que OMAR<br />
BEN ABDELAZIZ fut le premier à l’inclure dans la mosquée du prophète, en<br />
construisant un minaret dans chacun <strong>des</strong> quatre coins, mesurant soixante «DIRAA»<br />
(Bras) de longueur et huit «DIRAA» (Bras) de largeur.<br />
<strong>Les</strong> <strong>des</strong>igners ont donné plusieurs formes <strong>au</strong>x minarets, ronde, carré ou hexagonale.<br />
<strong>Les</strong> géométries <strong>des</strong> minarets ont <strong>au</strong>ssi varié selon les époques ainsi que les ornements<br />
et les parures. Certains minarets ont atteint un nive<strong>au</strong> inégalé de be<strong>au</strong>té de par leurs<br />
architectures et leurs ornements. <strong>Les</strong> minarets, <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>, se sont caractérisés par leur<br />
forme carrée, cette forme qui fut prise, comme on croit, du modèle du premier minaret<br />
à partir duquel BILAL appelait à la prière, à l’<strong>au</strong>be de l’Islam.<br />
SAMHOUDI a cité dans son ouvrage «Wafae Al Wafae» : «Dans la demeure de<br />
Abdellah Ben Omar» se trouvait une esplanade orientée vers la Qibla d’où Bilal<br />
appelait à la prière en y accédant à l’aide d’escaliers en paille. Cette esplanade était<br />
carrée.»<br />
Sans <strong>au</strong>cun doute, les premiers minarets étaient carrés ressemblant à celui de la<br />
mosquée du Prince <strong>des</strong> Croyants Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu le<br />
glorifie et guide ses pas. Sa Majesté qui suit les traces de ses glorieux ancêtres, que<br />
Dieu lui confère le triomphe et la victoire. Que Dieu comble Sa Majesté en la personne<br />
de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, S.A.R le Prince Moulay Rachid et<br />
l’ensemble de l’illustre famille Chérifienne.<br />
Que Dieu agrée l’action de quiconque a contribué dans la construction d’une<br />
mosquée, a participé à sa préservation. Dieu est omni-<strong>au</strong>dient et ex<strong>au</strong>ce les prières de<br />
Ses serviteurs.<br />
Louanges à Dieu Souverain et Maitre <strong>des</strong> Mon<strong>des</strong>.<br />
L’architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
21
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 22<br />
ANNEXES<br />
1. MOSLIM, livre <strong>des</strong> Moquées et lieux de culte, chapitre : Des bienfaits de la<br />
construction de mosquées, Tarmoudi Hadith 318.<br />
2. Tarmoudi (Jamâa)- Hadith 819<br />
3. Par Ahmed, preuve à l'appui et par Abou Daoud<br />
4. Tome 1, page 69<br />
5. Sahih AL BOUKHARI - Hadith 446<br />
6. En expliquant le Hadith 446<br />
7. AL BOUKHARI<br />
8. Par AL BOUKHARI- Hadith 510, et MOSLIM – Hadith 507<br />
9. 1:537<br />
10. ASSAMHOUDI – Wafâa Al Wafa, 1:370<br />
11. Precedent 1:526<br />
12. Wafâa Al Wafa 1:530<br />
22<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 23<br />
APERÇU SUR L'ORGANISATION SPATIALE<br />
DES MOQUÉES MAROCAINES<br />
Introduction<br />
Abdalaziz TOURI<br />
Ahmed S. ETTAHIRI<br />
& Abdallatif EL KHAMMAR<br />
<strong>Les</strong> mosquées marocaines ne sont pas bâties suivant la même ordonnance architecturale.<br />
Elles présentent, <strong>au</strong> cours <strong>des</strong> siècles et selon les tendances régionales, <strong>des</strong> plans divers.<br />
Ceux-ci varient également en fonction de la superficie du terrain à construire, de son<br />
implantation dans le tissu urbain et de sa disposition topographique. Néanmoins, les<br />
éléments constitutifs du plan restent presque les mêmes dans la plupart <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
mosquées, et leur schéma-type se compose <strong>des</strong> masses architecturales suivantes : une<br />
salle de prière à nefs et à travées, une salle pour la remise du minbar, une chambre pour<br />
l’imam, une cour à ciel ouvert bordée ou non de galeries, un minaret, une salle<br />
d’ablutions-latrines. Ces édifices peuvent contenir d’<strong>au</strong>tres annexes : une chambre<br />
funéraire, bayt al-gnâyz, pouvant prendre <strong>des</strong> dimensions importantes et porter alors le<br />
nom de Gami’ al-Gana’iz (mosquée <strong>des</strong> morts) une chambre pour le muwaqqit, une <strong>au</strong>tre<br />
pour le muezzin, une bibliothèque, une madrasa et une fontaine.<br />
1- Des mosquées monumentales et deux écoles<br />
architecturales<br />
Nos connaissances sur les mosquées datant <strong>des</strong> premiers temps de l’Islam <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
restent limitées en raison de l’indigence <strong>des</strong> indications textuelles et de l’insuffisance<br />
<strong>des</strong> données archéologiques.<br />
<strong>Les</strong> informations textuelles dont on dispose sont majoritairement rapportées par le<br />
géographe andalou Abû ‘Ubayd al-Bakrî (5e /11e siècle). Elles sont sommaires et<br />
portent principalement sur certaines mosquées de villes assez importantes comme<br />
celles d’Asila, d’al-Basra, de Jrâwa Maknâsa et de Fès.<br />
A Asila, Abû ‘Ubayd al-Bakrî fait état de la présence d’une grande mosquée. Il<br />
signale que celle-ci fut l’œuvre du gouverneur idrisside d’al-Basra et Tanger al-Qâsim,<br />
fils d’Idrîs II 1 . Cette grande mosquée se trouve à l’intérieur de l’enceinte de la ville qui<br />
1 Abû ‘Ubayd Al-Bakrî, Description de l’Afrique Septentrionale, texte arabe, Paris, 1965, p. 124.<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
23
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 24<br />
se creuse de cinq portes 2 et abrite un souk hebdomadaire très prospère. Al-Bakrî<br />
précise, en outre, que cet édifice religieux comporte cinq nefs et se situe à proximité<br />
de la mer dont les vagues atteignent les murs pendant les pério<strong>des</strong> de tempête 3 . <strong>Les</strong><br />
dires d’al-Bakr? concernant l’édifice sont entièrement reprises et confirmées, quatre<br />
siècles plus tard, par le géographe arabe Ibn ‘Abd al-Mun‘im al-Himyarî dans son<br />
Rawd al-Mi‘târ 4 .<br />
La grande mosquée d’al-Basra<br />
Abû ‘Ubayd al-Bakrî qualifie al-Basra 5 de madîna et note que celle-ci est<br />
circonscrite dans une enceinte bâtie en pierre et terre (tûb) et percée de dix portes. Il<br />
écrit que la ville dispose d’une grande mosquée qui renferme sept nefs 6 . Toutefois,<br />
l’<strong>au</strong>teur ne fournit <strong>au</strong>cun détail historique sur l’édifice et se contente de signaler que<br />
celui-ci se dresse à proximité de deux hammams.<br />
La grande mosquée de Jrâwa Maknâsa<br />
Dans sa <strong>des</strong>cription de Jrâwa Maknâsa 7 , Abû ‘Ubayd al-Bakrî souligne l’existence<br />
d’une grande mosquée dans cette localité, la décrit très sommairement, et note que ce<br />
jâmi‘ se compose de cinq nefs dont les arcs sont supportés par <strong>des</strong> colonnes en pierre 8 .<br />
Il qualifie Jrâwa Maknâsa de madîna et signale que celle-ci fut fondée en 259 H./ 872<br />
J.C. par l’émir idrisside Abû al-‘Aych ‘Îsâ Ibn Idrîs Ibn Muhammad Ibn Sulaymân Ibn<br />
‘Abdallâh Ibn Hassan. Outre le Jâmi‘, la ville renfermait cinq hammams qui étaient<br />
implantés à l’intérieur d’une enceinte en briques (tûb) 9 .<br />
<strong>Les</strong> mosquées primitives de Fès :<br />
<strong>Les</strong> indications relatives <strong>au</strong>x gran<strong>des</strong> mosquées de Fès concernent quatre édifices,<br />
à savoir jâmi‘ al-Achyâkh, Jâmi‘ al-Churafâ’, Jâmi‘ al-Qarawiyîn et Jâmi’ al-Andalus.<br />
2 Ibn Hawqal souligne dans sa configuration de la terre (S?rat al-Ard) que cette enceinte est bâtie en pierre et<br />
suspendue <strong>au</strong> sommet d’une falaise qui s’étend de l’Océan <strong>au</strong> continent du Maghreb, cf. A. Siraj (1995), L’image<br />
de la Tingitane, l’historiographie arabe médiévale et l’antiquité nord-africaine, Collection de l’Ecole Française de<br />
Rome, n° 209, Rome, p. 80.<br />
3 Abû ‘Ubayd Al-Bakrî, Op. cit…, p. 111.<br />
4 Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’im Al-Himyarî, Al-Rawd al-mi’târ fî khabar al-aqtâr, Dâr al-’ilm li al-tibâ’a, Liban,<br />
1975, p. 42.<br />
5 Al-Charîf al-Idrîsî situe la ville d’Al-Basra à moins d’une étape, à dos de monture, de Tuchummuch et note que<br />
celle-ci est une ville moyenne, pourvue d’un rempart peu solide et <strong>au</strong>tour de laquelle existent <strong>des</strong> villages et <strong>des</strong><br />
fermes où l’on cultive du blé et <strong>au</strong>tres céréales, cf. Al-Idr?s?, Le Ma?rib <strong>au</strong> 12e siècle de l’hégire …, p. 168-169.<br />
Pour plus de détails sur cette ville, cf. Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique…, p. 259.<br />
6 Abû ‘Ubayd Al-Bakrî, Op. cit…, p. 110.<br />
7 Selon Abû ‘Ubayd al-Bakrî, la localité de Jrâwa Maknâsa se situe à l’est de Fès sur l’itinéraire reliant Fès à<br />
Kairouan, cf. Ibid., p. 142.<br />
8 Ibid. p. 142<br />
9 Ibid. p. 142<br />
24<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 25<br />
• La mosquée d’al-Achyâkh :<br />
Si l’on en croit Abû ‘Ubayd al-Bakrî, la mosquée d’al-Achyâkh fut construite par<br />
le prince Idrîs II (187-213 H./803-829 J.C.) dans la cité ancienne <strong>des</strong> Andalous à Fès.<br />
L’<strong>au</strong>teur ne précise pas la date exacte du commencement <strong>des</strong> trav<strong>au</strong>x de construction<br />
du jâmi‘, mais nous apprend, par contre, que le noy<strong>au</strong> primitif de cette cité fut fondé<br />
par le même prince vers 192 H./807 J.C. 10 . L’édifice <strong>au</strong>rait été élevé dans la même<br />
année que la fondation du noy<strong>au</strong> primitif du quartier <strong>des</strong> Andalous: il renfermait six<br />
nefs transversales <strong>au</strong> mur de qibla, qui se dirigent de l’est vers l’ouest, et il possède un<br />
grand sahn qui fut planté d’arbres et était alimenté en e<strong>au</strong> par la seguia de Masmûda 11 .<br />
<strong>Les</strong> récits d’Ibn Abî Zar‘ al-Fâsî et de ‘Alî al-Jaznâ’î <strong>au</strong> VIIIe/XIVe siècle concordent<br />
bien avec le témoignage d’Abû ‘Ubayd al-Bakrî sur la date de fondation de jâmi‘ al-<br />
Achyâkh. <strong>Les</strong> deux <strong>au</strong>teurs relatent, en outre, que celui-ci abrita la prière et la khutba<br />
du vendredi tout <strong>au</strong> long de l’époque idrisside. Toutefois, l’édifice perdit be<strong>au</strong>coup de<br />
son importance historique et devint <strong>au</strong> début du IVe/IXe siècle un simple masjid de<br />
quartier sous les Zénètes. Ce fut l’émir chiite Hâmid Ibn Hamadân al-Hamadânî,<br />
gouverneur de Fès pour le compte du prince fatimide ‘Ubayd Allâh al-Chî‘î, qui décida<br />
de cesser la célébration de la prière du vendredi dans cette mosquée vers 321 H./ 933<br />
J.C., et transféra la khutba à la mosquée <strong>des</strong> Andalous 12 .<br />
• La mosquée d’al-Churafâ’ :<br />
Selon le témoignage d’Abû ‘Ubayd al-Bakrî, la mosquée d’al-Churafâ’ fut fondée<br />
par le prince Idrîs II dans la cité ancienne <strong>des</strong> Kairouanais à Fès (‘adwat al-Qarawiyîn).<br />
Comme pour celle de la rive <strong>des</strong> Andalous, l’<strong>au</strong>teur ne précise pas la date exacte de<br />
l’édification de cette mosquée idrisside, mais rapporte que les trav<strong>au</strong>x de construction<br />
de la cité de la rive g<strong>au</strong>che commencèrent vers l’année 193 H./ 808 J.C., c’est-à-dire<br />
un an après la fondation de l’ancien quartier <strong>des</strong> Andalous (‘Adwat al-Andalus) 13 .<br />
L’édifice <strong>au</strong>rait été bâti dès les débuts de ces trav<strong>au</strong>x et pourrait, par conséquent, dater<br />
de 193 H./ 808 J.C. Abû ‘Ubayd Al-Bakrî nous apprend également que cet ancien jâmi‘<br />
renfermait trois nefs transversales allant de l’est à l’ouest, et disposait d’un sahn de<br />
gran<strong>des</strong> proportions qui était planté d’arbres d’oliviers et bordé de galeries. <strong>Les</strong> dires<br />
d’al-Bakrî furent corroborées, trois siècles plus tard, par Ibn Abî Zar‘ al-Fâsî dans son<br />
Rawd al-Qirtâs et ‘Alî al-Jaznâ’î dans son Zahrat al-âs. <strong>Les</strong> deux historiens de Fès<br />
10 Abû ‘Ubayd al-Bakrî, Op. cit., (texte arabe), p. 115-116.<br />
11 Ibid., p. 116.<br />
12 Ibn Abî Zar’ al-Fâsî, Al-Anîs al-mutrib birawd al-qirtâs fî mulûk Al-Maghrib wa târîkh madînat Fâs, Dâr al-<br />
Mansûr li al-tibâ’a wa al-wirâqa, Rabat, 1972-1973, p. 54-55 ; ‘Alî Al-Jaznâ’î, Zahrat al-âs fî binâ’ madînat Fâs,<br />
Imprimerie Royale, Rabat, 1991, p. 45 et 92.<br />
13 Abû ‘Ubayd al-Bakrî, Desription..., texte arabe, p. 115-116.<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
25
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 26<br />
rapportent, en outre, que l’édifice gardait la fonction de grande mosquée (masjid jâmi‘)<br />
et abritait la prière et la khutba du vendredi durant toute l’époque idrisside 14 .<br />
Sous les Zénètes, la grande mosquée d’al-Churafâ’devint trop étroite pour contenir<br />
le nombre sans cesse en <strong>au</strong>gmentation <strong>des</strong> fidèles. Pour cette raison, racontent les<br />
chroniqueurs, le chiite Hâmid Ibn Hamadân al-Hamadânî, le gouverneur du prince<br />
fatimide ‘Ubayd Allâh al-Chî‘î, décida de ne plus organiser la prière et la khutba du<br />
vendredi dans ce jâmi‘ vers 321 H./933 J.C. Le jâmi‘ al-Churafâ’ devint donc une<br />
simple mosquée de quartier et sa khutba fut transférée à la nouvelle mosquée de la<br />
Qarawiyîn 15 .<br />
• <strong>Les</strong> mosquées de la Qarawiyîn et d’al-Andalus à Fès :<br />
<strong>Les</strong> mosquées d’al-Qarawiyîn et d’al-Andalus sont l’œuvre de deux sœurs, Fâtima<br />
al-Fihriya pour la première, et Maryam al-Fihriya pour la seconde. <strong>Les</strong> trav<strong>au</strong>x de<br />
construction de la Qarawiyîn furent entamés <strong>au</strong> mois de ramadan de l’année 245 H./<br />
859 J.C. Ceux de la mosquée d’al-Andalus n’ont débuté qu’un an plus tard. Le<br />
bâtiment dont les matéri<strong>au</strong>x de construction furent extraits du sol même du terrain,<br />
comptait à l’époque 150 empans de l’est à l’ouest. Il va d’ailleurs constituer le noy<strong>au</strong><br />
primitif de la célèbre mosquée al-Qarawiyîn. L’oratoire <strong>des</strong>sine un quadrilatère<br />
régulier, plus large que profond dont la salle de prière renfermait quatre nefs parallèles<br />
<strong>au</strong> mur de la qibla. Sous les Zénètes, l’édifice subit <strong>des</strong> trav<strong>au</strong>x d’agrandissement sur<br />
ordre de l’émir Ahmad Ibn Abî al-Sa‘îd (345 H./956 J.C.) pour le compte du calife<br />
omeiyyade de Cordoue, ‘Abd al-Rahmân al-Nâsir. Sa superficie fut presque doublée<br />
en profondeur comme en largeur. <strong>Les</strong> quatre nefs furent prolongées de quatre travées<br />
à l’ouest et de cinq travées à l’est. Trois <strong>au</strong>tres nefs furent ajoutées sur l’emplacement<br />
de la cour et du minaret de la mosquée de fatima (245H/859 J.C.), en suivant le modèle<br />
de la mosquée primitive. Au XIIe siècle, l’émir almoravide Alî Ibn Yûsuf fit agrandir<br />
la mosquée zénète en direction de la qibla de trois nefs transversales, respectant ainsi<br />
la disposition du plan primitif de l’édifice.<br />
La mosquée de la Qarawiyyîn se caractérise ainsi par la présence de nefs parallèles <strong>au</strong><br />
mur de la qibla, à l’image de sa contemporaine, la mosquée <strong>des</strong> Andalous, érigée sur<br />
l’<strong>au</strong>tre rive et œuvre de Maryam al-Fihriya (sœur de Fâtima) (Fig. 1). La salle de prière<br />
de cette dernière mosquée est plus large que profonde. Elle se compose de sept nefs<br />
parallèles <strong>au</strong> mur de la qibla, recoupées <strong>au</strong> centre par une nef médiane à sept travées qui<br />
sont délimitées par <strong>des</strong> piliers à quatre dosserets. Précédant la salle de prière, le sahn<br />
<strong>des</strong>sine un plan trapézoïdal. Il est doté d’une vasque d’ablutions qui se trouve dans le<br />
14 Ibn Abî Zar’ al-Fâsî, Al-Anîs, p 54 ; ‘Alî Al-Jaznâ’î, Zahrat al-As..., p. 25 et 46.<br />
15 Ibn Abî Zar’ al-Fâsî, Op. Cit., p. 55 ; ‘Alî Al-Jaznâ’î, Op. Cit., p. 46.<br />
26<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 27<br />
même axe de symétrie que la nef axiale et le mihrab à plan pentagonal de la salle de<br />
prière. Ses côtés est et ouest sont bordés par deux galeries à multiples nefs.<br />
Bâtie à l’époque du calife almohade al-Nâsir, la salle d’ablutions-latrines se trouve<br />
à l’extérieur du bâtiment. Elle constitue ainsi une entité isolée par rapport <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres<br />
masses architecturales de la mosquée. De forme sensiblement rectangulaire, la cour de<br />
cette dâr al-wudû’ est pourvue <strong>au</strong> centre d’un bassin rectangulaire occupant une grande<br />
surface, et entourée de plusieurs latrines.<br />
1-1 La première école : les salles de prière à nefs transversales<br />
(parallèles <strong>au</strong> mur de la qibla) :<br />
<strong>Les</strong> mosquées monumentales <strong>des</strong> villes impériales, et plus particulièrement celles <strong>des</strong><br />
dynasties idrisside, almoravide et almohade, ont été longuement décrites et analysées. <strong>Les</strong><br />
deux célèbres mosquées de Fès, al-Qarawiyîn et al-Andalus, ont fait l’objet de plusieurs<br />
étu<strong>des</strong> et monographies menées par H. Terrasse 16 et par L. Golvin 17 . Le premier<br />
consacre, avec H. Basset, une étude <strong>au</strong>x « sanctuaires et forteresses almoha<strong>des</strong> » dont<br />
les premiers résultats ont été publiés dans les premiers volumes de Hespéris avant de<br />
paraître dans un ouvrage abondamment illustré 18 . En 1971, H. Terrasse récidive et<br />
publie une monographie entièrement consacrée à la grande mosquée de Taza 19 . B.<br />
Maslow établit, <strong>au</strong> début <strong>des</strong> années 30 du siècle dernier, un inventaire <strong>des</strong> mosquées<br />
de Fès et du Nord du <strong>Maroc</strong> 20 . A la même époque, J. Caillé, dans une thèse consacrée<br />
à la ville de Rabat, étudie toutes les mosquées de la ville depuis sa fondation jusqu’<strong>au</strong><br />
protectorat français 21 . A partir de 1980, suivront d’<strong>au</strong>tres trav<strong>au</strong>x sous forme de thèses<br />
académiques : la première est consacrée <strong>au</strong>x oratoires de quartier de la ville de Fès 22 ,<br />
la seconde <strong>au</strong>x mosquées de Moulay Slimane 23 et la dernière à celles de la ville de<br />
Meknès 24 .<br />
De ces recherches consacrées à l’analyse <strong>des</strong> plans et <strong>des</strong> masses architecturales et<br />
décoratives <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> mosquées marocaines, se dégagent deux gran<strong>des</strong> écoles<br />
16 H. Terrasse, la mosquée al-Qaraouiyine à Fès, Archéologie méditerranéenne, III, C. Clincksieck, Paris, 1968 ; H.<br />
Terrasse, La mosquée <strong>des</strong> Andalous à Fès, éditions d’art et d’histoire, Paris, 1942.<br />
17 L. Golvin, Essai sur l’architecture religieuse musulmane, 4 tomes, éditions Klincksieck, Paris, tome 4, 1979.<br />
18 H. Basset & H. Terrasse, Sanctuaires et forteresses almoha<strong>des</strong>, coll. Hesperis, I.H.E.M., Larose éditeur, Paris,<br />
1932.<br />
19 H. Terrasse, «la grande mosquée de Taza», les éditions d'art et d'histoire, Paris, 1971.<br />
20 B. Maslow, <strong>Les</strong> mosquées de Fès et du Nord du <strong>Maroc</strong>, les éditions d'art et d'histoire, Paris, 1937.<br />
21 J. Caillé, La ville de Rabat jusqu'<strong>au</strong> protectorat français, Paris, 1949.<br />
22 A. Touri, <strong>Les</strong> oratoires de quartier à Fès: essai d'une typologie, thèse de doctorat de 3ème cycle, université de<br />
Paris-Sorbonne (Paris IV), 1980.<br />
23 M. Mghari, <strong>Les</strong> mosquées de Moulay Slimane, thèse de doctorat de 3ème cycle, université de Paris-Sorbonne<br />
(Paris IV), 1986.<br />
24 A. El khammar, <strong>Mosquées</strong> et oratoires de Meknès (IX-XVIII siècles) : Géographie religieuse, architecture et<br />
problème de la qibla, Thèse de doctorat nouve<strong>au</strong> régime, Université Lumière-Lyon II, 2005<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
27
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 28<br />
architecturales: la première a adopté une salle de prière à nefs transversales ou parallèles <strong>au</strong><br />
mur de la qibla et la seconde s’est développée en optant pour une disposition<br />
perpendiculaire (longitudinale) <strong>au</strong> mur de la qibla.<br />
Par leurs formes, les mosquées de la Qarawiyîn et d’al-Andalus à Fès s’inspirent<br />
<strong>des</strong> gran<strong>des</strong> mosquées omeyya<strong>des</strong> de l’Orient, notamment celle de Damas (Fig. 1).<br />
Elles sont les seuls édifices religieux qui nous renseignent sur l’architecture et le décor<br />
<strong>des</strong> premiers siècles de l’Islam <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>. On a donc tout lieu de croire que les nefs<br />
transversales faisaient école dans les mosquées primitives du <strong>Maroc</strong>.<br />
Cette organisation spatiale est adoptée, par la suite, par plusieurs mosquées<br />
médiévales et post-médiévales du <strong>Maroc</strong>. Citons, entre <strong>au</strong>tres, les mosquées de<br />
Meknès à travers toutes les époques historiques (la mosquée almoravide d’al-Najjârîn,<br />
la grande mosquée almohade (al-jâmi‘ al-Kabîr), la mosquée mérinide de Tûta, les<br />
gran<strong>des</strong> mosquées alaouites d’al-Zaytûna et d’al-Rwâ, pour ne citer que les plus<br />
célèbres d’entre ces mosquées), les mosquées mérini<strong>des</strong> d’al-Zhar à Fès et de la<br />
nécropole de Chella, et les mosquées alaouites d’al-Rsîf et de Bâb al-Gîsa à Fès, et de<br />
Mûlây Slîmân à Rabat.<br />
1-2 La seconde école : les salles de prière à nefs longitudinales :<br />
A côté de cette école architecturale qui perpétue le souvenir lointain de la grande<br />
mosquée de Damas existe une <strong>au</strong>tre tendance : celle de la salle de prière hypostyle à<br />
nefs perpendiculaires <strong>au</strong> mur de la qibla. Cette ordonnance s’apparente à celle de la<br />
mosquée d’al-Aqsâ à Jérusalem et semble arriver <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> à travers les mosquées de<br />
l’Ifriqiya et d’al-Andalus, notamment la grande mosquée de Kairouan et la grande<br />
mosquée de Cordoue. Elle se manifeste dans le plus grand nombre <strong>des</strong> mosquées<br />
almoha<strong>des</strong> et dans quelques mosquées mérini<strong>des</strong> et saâdiennes.<br />
• La tendance almohade :<br />
La grande mosquée de Tinmal :<br />
Placée chronologiquement après la Kutubiya primitive, la grande mosquée de<br />
Tinmal fut édifiée par le calife ‘Abd al-Mûmin vers 1153 J.C (Fig. 2). Cette mosquée,<br />
plus large que profonde, renferme une salle de prière à neuf nefs longitudinales et une<br />
cour barlongue, de petites dimensions, délimitée par deux galeries que forme le<br />
prolongement <strong>des</strong> deux nefs extrêmes de chaque côté de la salle de prière. Le<br />
“transept” de la qibla est recouvert par trois coupoles. Cette nef transversale détermine<br />
avec la nef axiale un plan en T et, avec les nefs extrêmes, un dispositif en forme de U.<br />
Tout souligne dans ce plan l’importance du mur de la qibla et du mihrab. Celui-ci<br />
devient le centre de toute l’ordonnance architecturale et décorative. La hiérarchie du<br />
décor almohade met en valeur le mihrab et ses abords.<br />
28<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 29<br />
L’entrée à cette mosquée se fait par sept portes. La porte principale, percée dans le mur<br />
nord, se trouve dans le même axe de symétrie que la nef centrale et le mihrab. Précédées<br />
par <strong>des</strong> porches en saillie, les six <strong>au</strong>tres portes sont symétriquement creusées dans<br />
l’épaisseur <strong>des</strong> murs latér<strong>au</strong>x. Le minaret est exceptionnellement de forme rectangulaire.<br />
Il est implanté en arrière du mihrab et fait donc saillie sur le mur de la qibla.<br />
La mosquée de la Kutubiya<br />
En 541 H./1147 J.C., ‘Abd al-Mûmin commença les trav<strong>au</strong>x de construction de la<br />
mosquée de la Kutubiya de Marrakech. Peu d’années après sa fondation, cette première<br />
mosquée fut détruite et remplacée par la Kutubiya actuelle (553 H./1158 J.C.). <strong>Les</strong><br />
raisons d’un tel acte sont loin d’être clairs, mais pourraient s’expliquer par la m<strong>au</strong>vaise<br />
orientation du mihrab par rapport à l’axe de la Ka‘ba. Or, les maîtres-maçons n’ont pas<br />
réussi à corriger cette erreur, et l’ont même aggravée en orientant vers le Sud le mihrab<br />
de cinq degré de plus que ne l’était le mihrab de la Kutubiya primitive.<br />
Quoi qu’il en soit, la Kutubiya actuelle, de forme trapézoïdale, se compose<br />
principalement d’une salle de prière plus large que profonde, précédée d’une cour<br />
barlongue bordée de deux galeries à quatre nefs. La salle de prière compte dix-sept<br />
nefs perpendiculaires <strong>au</strong> mur de la qibla, dont celle du centre est plus large que les nefs<br />
latérales. Couvert par cinq coupoles, le “transept” de la qibla est de même largeur que<br />
la nef médiane. L’entrée à la mosquée se fait par huit portes latérales, creusées dans les<br />
murs est et ouest, qui font vis-à-vis. Le minaret est de forme carrée et se dresse dans<br />
l’angle nord-est de la mosquée comme c’est le cas <strong>des</strong> mosquées almoravi<strong>des</strong><br />
algériennes et de la mosquée almohade de Taza.<br />
La mosquée de Hassan<br />
Fondée par le calife Abû Yûsuf Ya‘qûb en 1191 J.C., la mosquée de Hassan est<br />
considérée comme le plus grand bâtiment de l’Occident musulman médiéval et l’un<br />
<strong>des</strong> plus grands en terre d’Islam (185 mètres de longueur sur 140 mètres de largeur).<br />
Sa superficie atteint presque 25 000 m 2 . elle est circonscrite dans une enceinte<br />
flanquée de contreforts et percée de 14 portes qui y donnent accès.<br />
La salle de prière épouse une forme sensiblement carrée et comporte 21 nefs<br />
longitudinales et 3 nefs transversales longeant le mur de la qibla, interrompues <strong>au</strong><br />
centre par une nef médiane (Fig. 4). La nef centrale et les deux nefs extrêmes sont<br />
be<strong>au</strong>coup plus larges que les <strong>au</strong>tres. Cette salle est munie de deux cours latérales<br />
symétriques de forme barlongue qui se déploient sur la largeur de trois nefs et sur la<br />
longueur de huit travées. Ils sont certainement aménagés dans le but d’assurer<br />
davantage d’éclairage et de ventilation à l’édifice, et évoquent, par leur ordonnance, le<br />
souvenir de la mosquée fatimide de Mahdiya. <strong>Les</strong> sahns multiples sont donc un <strong>des</strong><br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
29
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 30<br />
caractères distinctifs <strong>des</strong> mosquées de la fin du 12e siècle : on les retrouve également<br />
dans la mosquée de la Qasba almohade à Marrakech (Fig. 3) et dans la grande mosquée<br />
de Ya’qûb al-Mansûr à Salé.<br />
Le sahn principal, de forme barlongue, s’étend sur la largeur de 11 nefs et sur la<br />
largeur de cinq travées. La nef médiane sert d’axe de symétrie pour cette cour qui est<br />
bordée par deux galeries latérales. Au centre du mur nord et en face du mihrab se<br />
dresse le minaret qui rappelle, par cet emplacement, les minarets de la grande mosquée<br />
de Kairouan et de la mosquée de la Qarawiyîn (mosquée primitive) à Fès et la mosquée<br />
almoravide de Tlemcen.<br />
Par leur organisation spatiale, ces salles de prière <strong>des</strong> mosquées almoha<strong>des</strong> se<br />
rattachent <strong>au</strong>x traditions maghrébines et andalouses <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> antérieures. Elles<br />
reproduisent quelques éléments caractéristiques <strong>des</strong> mosquées almoravi<strong>des</strong> d’Algérie<br />
(Nédroma, Tlemcen et Alger). <strong>Les</strong> nefs sont dirigées perpendiculairement <strong>au</strong> mur de la<br />
qibla et s’inspirent ainsi, par cette disposition, <strong>des</strong> mosquées tunisiennes de Kairouan,<br />
Zaytûna et Sfax, et <strong>des</strong> mosquées andalouses de Cordoue et Madînat al-Zahrâ’.<br />
En revanche, ces mosquées se distinguent de leurs antécédentes par plusieurs points<br />
origin<strong>au</strong>x. D’une symétrie frappante, elles sont marquées par un plan en T qui s’obtient<br />
par la rencontre de la nef axiale et la nef transversale longeant le mur de la qibla. <strong>Les</strong><br />
deux nefs, responsables de ce dispositif, sont be<strong>au</strong>coup plus larges et décorées que les<br />
<strong>au</strong>tres. Le mihrab sert, par conséquent, de point central et d’axe de symétrie du plan en<br />
T et de l’édifice tout entier. Une telle disposition met en valeur l’importance de la nef de<br />
la qibla qui se signale également par la présence de plusieurs coupoles, l’une devant le<br />
mihrab et les <strong>au</strong>tres étant disposées de part et d’<strong>au</strong>tre de la coupole centrale. <strong>Les</strong> maîtres<br />
maçons almoha<strong>des</strong> adoptèrent ce système dans le but de reh<strong>au</strong>sser le mur de la qibla. La<br />
présence de trois ou cinq coupoles <strong>au</strong> chevet ne détermine pas le plan <strong>des</strong> mosquées<br />
almoha<strong>des</strong> ; elles ne sont qu’un embellissement. Leur construction ne soulève <strong>au</strong>cun<br />
problème architectonique. Leur décor de plâtre léger, accroché à une armature de briques<br />
et de bois, n’exerce presque <strong>au</strong>cune poussée sur les murs qui les supportent. Coupoles,<br />
nefs majeures, ne sont pas à vrai dire <strong>des</strong> éléments architectur<strong>au</strong>x.<br />
Un <strong>au</strong>tre trait distinctif de ces mosquées almoha<strong>des</strong> est la multiplication et la<br />
disposition symétrique <strong>des</strong> portes latérales qui se font vis-à-vis et sont précédées par<br />
<strong>des</strong> avants-corps proéminents.<br />
Quant <strong>au</strong>x organes de support, les Almoha<strong>des</strong> firent recours <strong>au</strong>x piliers,<br />
généralement de brique, pour la retombée <strong>des</strong> arcs. Seule la mosquée de Hassan à<br />
Rabat nous offre un exemple probant de l’emploi de colonnes à tambours de pierre.<br />
L’utilisation de la pierre dans cet édifice pourrait s’expliquer par la proximité de Rabat<br />
<strong>des</strong> carrières de Salé. Dans les <strong>au</strong>tres mosquées, la colonne de marbre est réservée <strong>au</strong>x<br />
30<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 31<br />
parties qui occupent une place de choix dans l’architecture de ces édifices, en<br />
particulier le mihrab. <strong>Les</strong> piliers almoha<strong>des</strong> sont caractérisés par les colonnettes<br />
engagées qui se disposent suivant le sens et le nombre d’arcs qu’elles supportent. Leur<br />
forme varie suivant leur emplacement dans le bâtiment. Ils affectent <strong>des</strong> formes carrées<br />
ou rectangulaires dans les nefs latérales et se compliquent dans les parties qui sont<br />
mises en valeurs : la nef médiane, la nef transversale de la qibla, la “galerie-nartex”<br />
marquant la transition entre la salle de prière et le sahn. On note l’emploi de piliers à<br />
un dosseret en forme de T, de piliers à deux dosserets à plan cruciforme et de piliers à<br />
décrochements multiples.<br />
Dans les arca<strong>des</strong> de ses mosquées, <strong>au</strong>x grands arcs de ses portes, <strong>au</strong>x baies de ses<br />
minarets, l’art almohade emploie presque toujours l’arc brisé outrepassé. A l’oratoire<br />
de la Kutubiya, les arca<strong>des</strong> <strong>des</strong> nefs ont, avec une absolue pureté de lignes, <strong>au</strong>tant de<br />
largeur que d’élan. Ils sont disposés suivant une exacte et expressive hiérarchie : dans<br />
les nefs communes, <strong>des</strong> arcs lisses ; sous les coupoles et à l’entrée <strong>des</strong> nefs qui y<br />
conduisent, <strong>des</strong> arcs flor<strong>au</strong>x à lambrequins ; entre le transept et les nefs communes ou<br />
dans le prolongement de la limite du sahn, <strong>des</strong> arcs lobés simples ou tréflés.<br />
• La tendance mérinide :<br />
La tradition <strong>des</strong> nefs longitudinales (perpendiculaires) s’observent également dans<br />
plusieurs mosquées mérini<strong>des</strong>, comme celles de Fâs Jdîd et d’al-Hamrâ à Fès et de<br />
Jami’ al-Kbir à Rabat (Fig.5).<br />
La grande mosquée de Fâs Jdîd :<br />
Dans l’état actuel de nos connaissances, la première mosquée édifiée par le<br />
pouvoir mérinide est celle de Fâs Jdîd (Fig.6). <strong>Les</strong> chantiers de construction de ce<br />
jâmi‘ commencèrent, d’après l’<strong>au</strong>teur de la Dhakhîra al-Sâniya, <strong>au</strong> mois de<br />
Chawwâl de l’année 674 H/1275 J.C. et furent terminés <strong>au</strong> mois de ramadan de l’année<br />
677 H./1278 J.C.<br />
D’une régularité remarquable, cette mosquée s’inscrit dans un rectangle de 53m de<br />
profondeur sur 33m de large. La salle de prière embrasse une forme presque carrée et<br />
compte sept nefs longitudinales dont la nef centrale forme avec la “nef-transept” de la<br />
qibla un plan en T. Deux coupoles s’élèvent dans l’axe de cette salle, l’une devant le<br />
mihrab et l’<strong>au</strong>tre à la limite de la “galerie-nartex”, dispositif qui nous rappelle la<br />
grande mosquée de Kairouan. Plus large que profonde, la cour est encadrée par <strong>des</strong><br />
galeries et pourvue <strong>au</strong> centre d’un bassin d’ablutions. Dans ce sahn, la qibla est<br />
indiquée par une échancrure pratiquée dans le seuil d’accès à la salle de prière. Le<br />
minaret se dresse dans l’angle nord-ouest de l’édifice. A ces masses architecturales<br />
s’ajoute une salle funéraire (jâma‘ al-janâ’iz), située derrière le mur de la qibla.<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
31
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 32<br />
La mosquée al-Hamrâ :<br />
Dans la même ville de Fâs Jdîd, le sultan Abû al-Hasan (1331H-1351 AP.J.C.) fonda<br />
la mosquée d’al-Hamrâ, dont le plan d’ensemble est presque identique à ceux de la<br />
grande mosquée et <strong>des</strong> deux mosquées mérini<strong>des</strong> de Tlemcen, à savoir celles d’al-<br />
Ubbâd et de Sîdî al-Halwî. De dimensions réduites, cette mosquée se déploie selon un<br />
rectangle plus profond que large, et se compose essentiellement d’une salle de prière,<br />
d’une cour, d’un minaret et d’une salle funéraire. La salle de prière, légèrement plus<br />
large que profonde, compte cinq nefs longitudinales presque de même largeur qui<br />
débouchent sur la travée-nef de la qibla. De part et d’<strong>au</strong>tre du mihrab, s’ouvrent la<br />
chambre de l’imam et la salle du minbar. En arrière de la partie sud-est de la qibla se<br />
dresse une salle <strong>des</strong>tinée à la réception <strong>des</strong> cercueils <strong>des</strong> morts. Devant le mihrab s’élève<br />
une coupole dont l’emplacement évoque le souvenir <strong>des</strong> mosquées almoravi<strong>des</strong>.<br />
Précédant la salle de prière, la cour affecte une forme un peu plus large que profonde,<br />
munie <strong>au</strong> centre d’une vasque d’ablutions et encadrée par <strong>des</strong> galeries qui ne sont que<br />
le prolongement <strong>des</strong> nefs extrêmes. Dans le même axe que le mihrab, une cavité<br />
polygonale est entaillée dans le seuil d’accès à la salle de prière, orientant vers la qibla<br />
les fidèles accomplissant leur prière dans le sahn. Le minaret, à plan polygonal, occupe<br />
l’angle nord-ouest du bâtiment, comme c’est le cas à la grande mosquée de Fâs Jdîd.<br />
<strong>Les</strong> mosquées mérini<strong>des</strong> sont ainsi caractérisées par plusieurs traits distinctifs. Elles<br />
sont, tout d’abord, le plus souvent be<strong>au</strong>coup plus exigües que les mosquées fondées<br />
par le pouvoir almohade. <strong>Les</strong> dimensions très réduites <strong>des</strong> mosquées datant de cette<br />
époque s’expliquent peut-être par le budget limité consacré par l’Etat mérinide dont la<br />
politique visait, en premier lieu, à édifier <strong>des</strong> madrasas dans la plupart <strong>des</strong> villes<br />
marocaines. Contrairement <strong>au</strong>x mosquées almoravi<strong>des</strong> et almoha<strong>des</strong>, les mosquées<br />
mérini<strong>des</strong> <strong>des</strong>sinent majoritairement <strong>des</strong> rectangles plus profonds que larges. Le sahn<br />
n’affecte pas la forme d’un rectangle plus large que profond, mais s’inscrit dans un<br />
quadrilatère presque carré. <strong>Les</strong> galeries qui l’encadrent sont formées par le<br />
prolongement <strong>des</strong> deux nefs extrêmes de la salle de prière, et non pas par <strong>des</strong> nefs<br />
multiples comme c’était le cas pour les mosquées almoha<strong>des</strong>. D’<strong>au</strong>tre part, l’accès à<br />
ces édifices religieux se fait par le biais d’un nombre limité de portes qui sont, le plus<br />
souvent, dissymétriques, à l’encontre <strong>des</strong> mosquées almoha<strong>des</strong>. <strong>Les</strong> coupoles couvrant<br />
“la nef-transept” <strong>des</strong> mosquées almoha<strong>des</strong> se réduisent à une seule coupole installée<br />
devant le mihrab dans les mosquées mérini<strong>des</strong>.<br />
L’architecture <strong>des</strong> minarets mérini<strong>des</strong> ne va pas sans présenter <strong>des</strong> analogies avec<br />
celle <strong>des</strong> minarets almoha<strong>des</strong>. Le minaret de la Qasba de Marrakech est d’ailleurs celui<br />
qui servira le plus certainement de modèle <strong>au</strong>x architectes <strong>des</strong> XIII et XIVe siècles.<br />
Tout l’effort <strong>des</strong> artistes mérini<strong>des</strong> porta sur la décoration du minaret, et plus<br />
particulièrement sur les jeux qu’introduit le zellige polychromé.<br />
32<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 33<br />
• La tendance saâdienne :<br />
Partout <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>, les Saâdiens ont bâti un nombre considérable de mosquées.<br />
Marrakech, leur capitale, garde encore les traces de deux grands édifices religieux<br />
datant de cette période post-médiévale, à savoir la mosquée de Bâb Dukkâla et la<br />
mosquée d’al-Muwâsîn. L’étude de ces deux monuments est susceptible d’éclairer<br />
certaines <strong>des</strong> spécificités architecturales <strong>des</strong> mosquées saâdiennes.<br />
La mosquée de Bâb Dukkâla :<br />
Elle fut construite en 965 H./1557 J.C. par Lalla Mas’ûda, mère d’Ahmad al-<br />
Mansûr (Fig. 7). La salle de prière compte sept nefs dirigées en profondeur et<br />
constituées de quatre travées, plus deux nefs dirigées transversalement : l’une suivant<br />
le mur de la qibla et l’<strong>au</strong>tre longeant la façade sur la cour. Elles sont séparées par de<br />
lourds piliers décorés de colonnes engagées, supportant <strong>des</strong> arcs monument<strong>au</strong>x. Ici les<br />
traditions almoha<strong>des</strong> sont très visibles. Le transept a trois coupoles à l’image de la<br />
mosquée almohade de Tinmal (Fig. 2) : une médiane <strong>au</strong>-<strong>des</strong>sus du mihrab et deux<br />
latérales dans les angles.<br />
Le sahn, à peu près carrée, est encadré de galeries simples. L’angle nord-est de cette<br />
cour est occupé par le minaret dont le décor rappelle, une fois encore, celui du minaret<br />
de la mosquée almohade de la Qasba à Marrakech (Fig. 3).<br />
Si la proportion carrée de la cour s’affirme comme un legs de l’architecture <strong>des</strong><br />
mosquées mérini<strong>des</strong>, la multiplicité <strong>des</strong> coupoles et leur distribution sont le<br />
développement plus ou moins logique du thème almohade, très vivace encore à<br />
Marrakech.<br />
La répartition <strong>des</strong> divers genres d’arcs contribue à enrichir les points importants de<br />
la mosquée. Tandis que les nefs ne sont bordées que par de simples arcs en fer à cheval,<br />
la coupole précédant le mihrab est portée par <strong>des</strong> arcs à muqarnas. <strong>Les</strong> tambours <strong>des</strong><br />
<strong>au</strong>tres coupoles sont encadrés par <strong>des</strong> arcs bordés de petits lobes dans la partie<br />
inférieure, de muqarnas <strong>au</strong>-<strong>des</strong>sus. Là encore la tradition almohade se manifeste<br />
fortement.<br />
La mosquée al-Muwâsîn :<br />
D’après al-Ifrânî, la mosquée al-Muwâsîn fut construite par le sultan Mûlây<br />
‘Abdallâh sur l’ensemble d’un ancien quartier juif entre 970 et 980 H./1562-1573 J.C.<br />
Elle est de proportions plus amples que celle de Bâb Dukkâla, mais elle est plus simple<br />
de plan (Fig. 8). L’oratoire se compose de sept nefs longitudinales qui aboutissent à<br />
une nef transversale de la qibla dont les plafonds sont pareillement jalonnés de trois<br />
coupoles ; la nef axiale étant un peu plus large que les <strong>au</strong>tres. Un riche plafond de bois<br />
va de la coupole du mihrab jusqu’à la ‘anza épigraphique. La nef-travée du mihrab a<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
33
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 34<br />
le même be<strong>au</strong> plafond de bois, mais elle se termine à chaque extrémité par une<br />
nouvelle coupole. <strong>Les</strong> nefs latérales se prolongent de chaque côté de la cour en une<br />
galerie. Le mihrab est une copie de celui de la mosquée de la Qasba. C’est le même<br />
<strong>des</strong>sin général, la même disposition <strong>des</strong> riches chapite<strong>au</strong>x et leur même nombre, les<br />
mêmes caractères coufiques <strong>des</strong> inscriptions, les mêmes ouvertures de part et d’<strong>au</strong>tre<br />
de la retombée <strong>des</strong> arcs. La tradition almohade se rencontre <strong>au</strong>ssi dans les plafonds qui<br />
témoignent encore d’une habileté incontestable et constituent la plus belle <strong>des</strong> réussites<br />
du sanctuaire. La cour est carrée. Le minaret se décroche en saillie sur la façade à<br />
l’angle nord-ouest.<br />
En fait, les deux mosquées de Bâb Dukkâla et de Muwâsîn s’inspirent, par leur<br />
disposition architecturale et leur ordonnance décorative, <strong>des</strong> mosquées almoha<strong>des</strong>,<br />
notamment celles de la Qasba à Marrakech, de la grande mosquée à Taza et de celle de<br />
Tinmal : le plan en T, la répartition <strong>des</strong> coupoles sur la nef de la qibla, le décor du<br />
mihrab et du minaret. En revanche, les deux bâtiments offrent <strong>des</strong> particularités. La<br />
salle de prière a diminué de profondeur <strong>au</strong> profit du sahn qui prend à cette époque <strong>des</strong><br />
proportions be<strong>au</strong>coup plus importantes que celles <strong>des</strong> sahn-s médiév<strong>au</strong>x. Cette<br />
tendance deviendra trop apparente dans les mosquées alaouites comme à la mosquée<br />
al-Rwa à Meknès (Fig. 9), la mosquée al-Rsif à Fès, les mosquées de Moulay Slimane<br />
(Fig. 10) et d’al-Sunna à Rabat. Le nombre <strong>des</strong> nefs se réduit et oscille entre deux et<br />
quatre nefs. Celles-ci sont parallèles <strong>au</strong> mur de la qibla, une disposition qui marque un<br />
retour <strong>au</strong> plans anciens, ceux de la mosquée du Prophète à Médine, de la mosquée<br />
omeyyade à Damas et <strong>des</strong> deux mosquées al-Karawiyin et al-Andalus à Fès. La nef<br />
axiale perd la majesté dont elle a hérité depuis <strong>des</strong> siècles. <strong>Les</strong> sahn-s <strong>des</strong> mosquées<br />
saâdiennes et alaouites, contrairement à ceux <strong>des</strong> mosquées médiévales qui restent de<br />
proportions moins importantes, se développent et perpétuent, par leurs dimensions<br />
grandioses, le souvenir lointain <strong>des</strong> grands sahn-s <strong>des</strong> mosquées de l’Orient musulman<br />
médiéval. Leur superficie s’est agrandie <strong>au</strong> détriment de celle de la salle de prière dans<br />
les mosquées chérifiennes, et plus particulièrement à partir du XVIIIe siècle. <strong>Les</strong><br />
exemples les plus éloquents à cet égard sont représentés par la mosquée de Ben Yûsuf<br />
à Essaouira, la grande mosquée de Tétouan (œuvres du sultan alaouite Mûlây Slîmân),<br />
et notamment par la mosquée alaouite d’al-Rwâ à Meknès (époque du sultan Sîdî<br />
Muhammad Ibn ‘Abdallâh) dont le sahn occupe environ les deux tiers de la superficie<br />
totale de l’édifice.<br />
2 - Eléments pour une mosquée marocaine-type<br />
Quelle que soit la disposition <strong>des</strong> nefs, celles-ci sont couvertes, dans la quasitotalité<br />
<strong>des</strong> mosquées marocaines, de toits en bâtière. Au mur du fond de la salle de<br />
prière, se creuse le mihrab qui indique la direction de la ka‘ba, et prend, dans la<br />
34<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 35<br />
majorité <strong>des</strong> cas, la forme d’une niche à section polygonale. Le mihrab occupe<br />
généralement le centre du mur de la qibla, et se trouve dans le même axe de symétrie<br />
que la porte médiane de la salle de prière.<br />
De part et d’<strong>au</strong>tre du mihrab s’ouvrent habituellement deux salles, l’une est <strong>des</strong>tinée<br />
à la remise du minbar tandis que l’<strong>au</strong>tre est réservée à l’imam. Une pièce est aménagée<br />
derrière le mur de la qibla pour recevoir les cercueils <strong>des</strong> morts (bayt al-mawtâ ou<br />
jâmi‘ al-gnâyz). Cet espace prend parfois la forme d’un véritable oratoire à nefs et<br />
travées, comme c’est le cas dans quelques mosquées de Fès (la Qarawiyîn, al-Andalus<br />
et al-Gîsa… etc.).<br />
La salle de prière <strong>des</strong> mosquées se caractérise, en outre, par la présence de la<br />
maqsûra, un enclos spécial réservé <strong>au</strong> souverain et son entourage, situé <strong>au</strong>x alentours<br />
du mihrab. Elle prend la forme d’une loge délimitée par <strong>des</strong> cloisons en bois sculpté<br />
ou peint. La partie centrale de cet enclos est percée d’une porte s’ouvrant directement<br />
sur le mihrab.<br />
La salle de prière de la quasi-totalité <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> mosquées marocaines est précédée<br />
d’un sahn à ciel ouvert qui occupe une place de choix dans l’architecture de ces<br />
édifices religieux en raison du climat ensoleillé du <strong>Maroc</strong>. Le sol est légèrement<br />
surbaissé par rapport à celui de la salle de prière dans le but de faciliter l’écoulement<br />
<strong>des</strong> e<strong>au</strong>x pluviales. Il est pavé de carre<strong>au</strong>x de terre cuite (le zellij). Le centre en est doté<br />
d’une vasque, le plus souvent en marbre, qui sert <strong>au</strong>x ablutions <strong>des</strong> fidèles. Celle-ci se<br />
trouve généralement dans le même axe de symétrie que le mihrab, la nef axiale et la<br />
porte principale de la mosquée. <strong>Les</strong> cours <strong>des</strong> mosquées antérieures <strong>au</strong>x mérini<strong>des</strong><br />
<strong>des</strong>sinent un rectangle plus large que profond, et sont bordées par <strong>des</strong> galeries<br />
couvertes composées de nefs multiples. Celles <strong>des</strong> mosquées mérini<strong>des</strong> affectent<br />
généralement une forme presque carrée, et les galeries qui encadrent le sahn sont<br />
formées par le prolongement <strong>des</strong> deux nefs extrêmes de la salle de prière, et non pas<br />
par <strong>des</strong> nefs multiples comme c’était le cas pour les mosquées almoha<strong>des</strong>. A cette<br />
époque, on constate l’emploi fréquent de ‘anza-s en bois qui s’accompagnent le plus<br />
souvent d’une cavité polygonale ou circulaire taillée dans le seuil séparant le sahn de<br />
la salle de prière. Ces échancrures servent de mihrabs secondaires vers lesquels les<br />
fidèles faisant leurs prières dans la cour doivent se diriger.<br />
Le minaret se trouve généralement à côté du sahn, et son emplacement diffère d’une<br />
mosquée à une <strong>au</strong>tre. Dans les mosquées almoha<strong>des</strong> de Taza et de la Kutubiyya, il<br />
occupe l’angle nord-est de la mosquée à l’image <strong>des</strong> mosquées almoravi<strong>des</strong><br />
algériennes (Nédroma, Tlemcen et Alger). Dans la mosquée de la première Qarawiyyîn<br />
à Fès et dans la mosquée de Hassan à Rabat, le minaret se dresse <strong>au</strong> centre du mur<br />
nord, dans le même axe où se trouve le mihrab, comme c’est le cas de la grande<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
35
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 36<br />
mosquée de Kairouan. Dans les mosquées mérini<strong>des</strong> de Fâs Jdîd, d’al-Hamrâ et d’Abû<br />
al-Hasan, le minaret est implanté dans l’angle nord-ouest. A la mosquée almohade de<br />
Tinmel, l’emplacement du minaret demeure original : il se dresse derrière le mur de la<br />
qibla.<br />
Certaines gran<strong>des</strong> mosquées sont pourvues d’une chambre pour le muwaqqit qui<br />
s’élève sur la terrasse et se trouve le plus souvent accolée <strong>au</strong> minaret. Elle servait de<br />
logement pour le muwaqqit, et abritait jadis <strong>des</strong> horloges, <strong>des</strong> astrolabes et <strong>des</strong> sabliers.<br />
C’est une pièce très simple par son architecture : elle est carrée ou rectangulaire, et<br />
couverte soit par une terrasse, soit par un toit en pente (barchla). Cette pièce n’est<br />
apparue dans l’architecture <strong>des</strong> mosquées marocaines qu’à l’époque mérinide, car la<br />
tâche du muwaqqit pendant la période antérieure était déléguée <strong>au</strong> muezzin de la<br />
grande mosquée de la ville qui devait avoir <strong>des</strong> connaissances élémentaires en<br />
astronomie. Celle de la Qarawiyîn paraît être la plus ancienne <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> ; si l’on en<br />
croit l’<strong>au</strong>teur de la Zahrât al-âs, elle fut ajoutée à l’édifice vers 685 H./1286 J.C., à la<br />
fin du règne du sultan mérinide Abû Yûsuf Ya‘qûb.<br />
La salle d’ablutions-latrines (dâr al-wudû’) <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> mosquées marocaines se<br />
présente comme un bâtiment indépendant, implanté - pour une bonne partie d’édificesà<br />
l’extérieur du jâmi‘, comme à la Qarawiyîn, à al-Andalus à Fès, à la grande mosquée<br />
de Meknès, à jami’ Lakbir à Rabat et à la mosquée Mouassine à Marrakech, pour ne<br />
citer que quelques exemples <strong>des</strong> plus célèbres. <strong>Les</strong> plus gran<strong>des</strong> d’entre ces salles<br />
d’ablutions comportent une cour, le plus souvent de forme rectangulaire, occupée <strong>au</strong><br />
centre par un bassin et entourée par un ensemble de latrines.<br />
<strong>Les</strong> mosquées post-médiévales se caractérisent, en outre, par la présence d’<strong>au</strong>tres<br />
annexes, formant ainsi <strong>des</strong> complexes : une madrasa, une bibliothèque, une école<br />
coranique (msîd), une fontaine publique, un abreuvoir pour les bêtes, et parfois un<br />
hammam.<br />
36<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 37<br />
Conclusion :<br />
Le présent travail a tenté de donner un aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong><br />
mosquées marocaines. Il ne peut avoir la prétention d’être exh<strong>au</strong>stif puisque nous ne<br />
disposons pas encore d’étu<strong>des</strong> couvrant toutes les régions du pays et toutes les<br />
réalisations <strong>des</strong> dynasties marocaines. Il s’est proposé d’étudier l’organisation spatiale<br />
<strong>des</strong> mosquées marocaines <strong>au</strong> fil du temps selon une approche historico-archéologique<br />
et a tenté de combler -dans la mesure du possible- un vide documentaire, dû à<br />
l’insuffisance, voire la rareté <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de synthèse sur ces édifices religieux. <strong>Les</strong><br />
conclusions <strong>au</strong>xquelles nous sommes parvenus ne sont pas définitives et devraient<br />
donc être complétées et nuancées par <strong>des</strong> recherches ultérieures. L’intérêt de notre<br />
travail réside dans le fait qu’il fournit <strong>des</strong> éléments de réponse à certaines<br />
interrogations et ouvre, en outre, de nouvelles pistes de recherches qui devraient porter<br />
un éclairage particulier sur les mosquées anté et post-almoha<strong>des</strong> (surtout saâdiennes)<br />
et s’intéresser <strong>au</strong>x mosquées <strong>des</strong> petites villes et <strong>des</strong> régions rurales et lointaines. De<br />
telles investigations permettront sans <strong>au</strong>cun doute d’approfondir nos connaissances<br />
<strong>des</strong> espaces religieux encore insuffisamment connus, de dégager, bien évidemment,<br />
une typologie quasi-complète <strong>des</strong> édifices en question et de relever leurs spécificités<br />
architecturales et décoratives.<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
37
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 38<br />
38<br />
Fig. 1- Fès : Mosquée al-Karawiyin<br />
Fig. 2- Mosquée de Tinmal<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 39<br />
Fig. 3- Marrakech : Mosquée al-Qasba<br />
Fig. 4- Rabat : Mosquée Hassan<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
39
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 40<br />
40<br />
Fig. 5- Rabat : al-Jami' al-Kbir<br />
Fig. 6- Fès Jdid : al-Jami' al-Kbir<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 41<br />
Fig. 7- Marrakech : Jami' Bab Doukkala<br />
Fig. 8- Marrakech : Jami' al-Mouassine<br />
Aperçu sur l’organisation spatiale <strong>des</strong> moquées marocaines<br />
41
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 42<br />
42<br />
Fig. 9- Meknès : Jami' al-Rwa<br />
Fig. 10- Rabat : Jami' Moulay Slimane<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 43<br />
LE MUR DE LA QIBLA ET LA NEF AXIALE<br />
FONCTION ET SYMBOLIQUE<br />
Introduction<br />
Professeur Mina El Mghari<br />
S.G. du Comité National <strong>Maroc</strong>ain de l’Education,<br />
la Culture et les Sciences<br />
<strong>Les</strong> mosquées 1 ont toujours représenté une partie intégrante du tissu urbain <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> 2 .<br />
Lieux de réunion <strong>des</strong> fidèles, elles ont été de tout temps les édifices les plus importants<br />
de la cité musulmane. Lieux dédiés à Dieu, elles sont de ce fait les bâtiments <strong>au</strong>xquels<br />
on accorde le plus d’égards.<br />
Selon les époques et les aires géographiques, l’architecture et le décor <strong>des</strong><br />
mosquées répondent à <strong>des</strong> styles spécifiques. Ils obéissent à <strong>des</strong> critères qui, dès le<br />
VIIIe siècle, caractérisent l’ornementation islamique : goût du décor tapissant, de la<br />
symétrie, de la stylisation et parfois de la couleur.<br />
Le plan architectural de base d’une mosquée comporte une cour que prolonge une salle<br />
de prière allongée, divisée en nefs disposées dans le sens de la largeur. L’orientation vers<br />
la Mecque, qui diffère selon les époques 3 , est marquée par le mihrab qui se situe<br />
généralement <strong>au</strong> centre du mur qibla. <strong>Les</strong> zones particulièrement mises en valeur sont le<br />
mihrab 4 , parfois tout le mur-qibla et la nef centrale menant <strong>au</strong> Mihrab. La richesse<br />
décorative <strong>des</strong> monuments dénote une immense force créatrice, qui puise dans <strong>des</strong> sources<br />
multiples 5 . Nous allons à partir d’exemples de mosquées rappeler les caractéristiques de<br />
ces zones particulièrement mises en valeur et essayer d’en approcher la symbolique.<br />
1 PEDERSON «Masgid» in Encyclopédie de l’Islam. T.VI . Paris, 1991 pp. 629-695.<br />
2 Sur quelques importants exemples de mosquées <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> cf:<br />
- Boris MASLOW, <strong>Les</strong> mosquées de Fès et du Nord du <strong>Maroc</strong><br />
- Lucien GOLVIN, Essai sur l’architecture religieuse musulmane. T.IV l’art hispano - musulman. Série<br />
Archéologie Méditerranéenne, n°V. Ed. Klincksieck. Paris, 1979.<br />
3 Une excellente étude démontre les différentes orientations <strong>des</strong> mosquées marocaines cf:<br />
Michael BONNINE, “ The sacred direction and city structure a preliminary analysis of the Islamic cities of<br />
Morocco.” In “Muqarnas” 7,1990, p. 51 & map, p. 53.<br />
4 <strong>Les</strong> spécialistes ont vainement tenté de retrouver et d’interpréter l’étymologie du mot mihrâb (pluriel mahârib).<br />
Parfois le mot est rapproché de la racine arabe trilitère h.b.r. qui donne le sens de colère ou de lutte. La littérature<br />
préislamique attribue <strong>au</strong> mihrâb divers sens : niche, rentrant, chambre, endroit le plus élevé et le plus important<br />
dans un palais ou dans une chambre, ou encore espace séparant deux colonnes ou lieu de sépulture. Ces trois<br />
derniers sens se sont maintenus <strong>au</strong> début de l’ère islamique.<br />
5 Papadopoulo A., l’Islam et l’art musulman, Mazenod, 1976. (Magnifiques planches de mihrâb).<br />
Introduction<br />
43
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 44<br />
Etymologie d’un mot :<br />
Le mot «mosquée» 6 , en arabe masjid, peut définir un simple oratoire (un masjid de<br />
quartier, par exemple), mais <strong>au</strong>ssi la grande mosquée, où toute la commun<strong>au</strong>té <strong>des</strong><br />
croyants se réunit pour la prière liée à la khotba, et <strong>au</strong>ssi à <strong>des</strong> actes politiques ou<br />
militaires.<br />
Masjid, en langue arabe, veut dire littéralement «le lieu où l'on se prosterne» et<br />
désigne tout <strong>au</strong>ssi bien le simple oratoire privé que la grande mosquée.<br />
Caractéristiques de la mosquée<br />
Il est difficile de dresser un portrait-type du monument le plus caractéristique de<br />
l'islam, car les mosquées présentent dans leur ensemble une très grande diversité<br />
architecturale.<br />
Le premier masjid, exemplaire à plus d'un titre, a été celui que le Prophète<br />
Muhammad avait fait aménager chez lui à Médine. Il était constitué d'une salle de<br />
prière, couverte par une terrasse elle-même soutenue par <strong>des</strong> troncs de palmiers. Audelà<br />
de la salle de prière s'étendait une vaste cour. Cet édifice, dont l'agencement a<br />
servi de modèle <strong>au</strong>x mosquées ultérieures, avait avant tout pour fonction de permettre<br />
à la commun<strong>au</strong>té de se retrouver, une vocation que le terme conservera jusqu'à<br />
<strong>au</strong>jourd'hui.<br />
Dans les premiers temps de l'Islam, les territoires sacrés de la Mecque et d’Al Qods<br />
sont désignés comme : al-masjid al –harâm et, al-masjid al-aqsa (al haram al-sharîf).<br />
Et avec l'extension de la nouvelle religion, à partir de VIIe siècle, de très nombreux<br />
masjid ont été édifiés en terre d’Islam.<br />
La grande mosquée, al-masjid al-Jami’ s'est imposée comme le lieu où l'on célèbre<br />
officiellement la prière du vendredi, précédée par le sermon (khotba) de l'imam. Pour<br />
accueillir un maximum de fidèles, de nombreux édifices ont dû être étendus ou<br />
modifiés <strong>au</strong> cours de leur existence.<br />
Particularités architecturales <strong>des</strong> mosquées marocaines<br />
<strong>Les</strong> mosquées historiques ont joué un rôle primordial dans la perpétuation <strong>des</strong><br />
particularités architecturales et artistiques 7 .<br />
Des origines de l'islam <strong>au</strong> XVIe siècle, l'organisation spatiale de la grande mosquée<br />
a considérablement évolué. Dès le VIIe siècle, le masjid comme simple oratoire privé,<br />
6 TOURI Abdelaziz, <strong>Les</strong> oratoires de quartier à Fès. Essai d’une typologie. Thèse dactylographiée sous la direction<br />
de Janine SOURDEL-THOMINE. Paris IV, 1980.<br />
7 Joudia HASSAR-BENSLIMANE, Christian EWERT, Abdelaziz TOURI &J.Peter WISSHAK, «Tinmal 1981,<br />
fouilles de la mosquée almohade» in : BAM.T. XIV, 1981-1982.,p.277-330.<br />
44<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 45<br />
et le masjid al-jami, sont clairement distingués. Le premier, l’oratoire de quartier, est<br />
surtout un lieu de prière, tandis que le second est l'édifice public par excellence, le seul<br />
à réunir un maximum de fidèles pour la prière commune.<br />
Mais, outre un lieu de prière, la grande mosquée masjid al-jami est <strong>au</strong>ssi un pôle<br />
important du pouvoir temporel, car le prône qui précède la prière s'achève par la<br />
mention du calife ou sultan pour lequel les fidèles présents demandent la grâce divine.<br />
Le politique et le religieux y sont donc indissolublement liés.<br />
La mosquée est sans doute le monument qui a donné naissance <strong>au</strong>x œuvres les plus<br />
grandioses que la civilisation islamique ait léguées. En Occident musulman, <strong>Les</strong><br />
«gran<strong>des</strong> mosquées» de Kairouan, Cordoue, Marrakech, Séville et Rabat(Hassan) en<br />
sont une belle illustration.<br />
La grande mosquée de Cordoue, un puzzle complexe, juxtapose six pério<strong>des</strong> de<br />
construction avant que Charles Quint ne la transforme en cathédrale.<br />
Le plan de la salle de prière de la mosquée de Cordoue est celui d'une basilique 8 -<br />
une nef axiale élargie entre deux groupes de cinq vaisse<strong>au</strong>x - achevée jadis par son<br />
mihrâb. Cette caractéristique architecturale vient du monde antique, via l’exemple de<br />
Damas <strong>au</strong> début du VIIe siècle.<br />
Abd al-Rahman 1er, en élevant cette première mosquée de Cordoue avait ainsi<br />
marqué son rôle d'émir. Parallèlement, une esthétique nouvelle était née, le modèle de<br />
la mosquée de l’Occident musulman a été établi. Quatre coupoles nervées marquent<br />
l’espace (maqsûra) réservé <strong>au</strong> calife.<br />
Ce modèle est repris par les dynasties almoravide puis almohade <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> :<br />
L’almoravide ‘Ali b. Yusuf d’abord, construit à Marrakech une grande mosquée sur<br />
le modèle de Cordoue. Cette grande mosquée est détruite plus tard par les almoha<strong>des</strong><br />
qui ont élevé à sa place la grande mosquée koutoubiyya. La Koutoubiyya est le<br />
monument religieux le plus célèbre de Marrakech. Elle se distingue par son plan<br />
innovateur qui donne une importance capitale <strong>au</strong> mur de la qibla.<br />
Retenons seulement dans cet édifice deux éléments importants : le plan en «T» et<br />
la maqsûra mécanique qui a marqué l’imaginaire <strong>des</strong> <strong>au</strong>teurs de la période 9 .La nef<br />
centrale, plus large que les <strong>au</strong>tres, est ponctuée de dômes. Elle se joint <strong>au</strong> large<br />
vaisse<strong>au</strong> longeant le mur qibla qui est marqué également par cinq coupoles faites<br />
d’encorbellements successifs de «muqarnas».Cet agencement était apparu à Kairouan<br />
en 836 de l’ère chrétienne 10 .<br />
8 SAUVAGET, Jean, La mosquée Ommeyade de Médine, Edition Van Oest, 1947.<br />
9 Al Murrakuchi, Al hullal al mushiyya.,p.120.<br />
10 Voir Schéma en annexe.<br />
Introduction<br />
45
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 46<br />
Source : Brigitte Hintzen-Bohlen, Art et Architecture : Andalousie, Cologne, 1999. p.443<br />
<strong>Les</strong> astuces liant architecture et politique prouvent que l’art monumental était<br />
devenu un langage et, par là, un moyen <strong>au</strong> service du pouvoir.<br />
Selon un <strong>au</strong>teur de l'époque 11 , c'est à la grande mosquée qu'avait lieu la cérémonie<br />
de remise <strong>des</strong> étendards.<br />
Au-delà de son aspect monumental et de ses dimensions imposantes, la grande<br />
mosquée présente quelques caractéristiques essentielles que l'on retrouve fréquemment<br />
dans les édifices d’époques ultérieures<br />
La Mosquée <strong>au</strong> temps de Hassan II<br />
D’importants monuments sont édifiés durant le règne de feu Hassan II. Ils<br />
s'inscrivent dans la tradition <strong>des</strong> monuments religieux, dans les étapes de leur histoire,<br />
dans la recherche de l'art architectural, en le portant <strong>au</strong> sommet de sa gloire, en le<br />
renouvelant, en l'adaptant <strong>au</strong>x moyens qui lui permettent de s'émanciper de l'empreinte<br />
<strong>des</strong> villes d'un <strong>au</strong>tre âge.<br />
La disposition <strong>des</strong> nefs dirigées en profondeur, perpendi-culaires <strong>au</strong> mur de la<br />
Qibla, disposition dite "basilicale" qu'avait déjà adoptée les mosquées du XII ème siècle,<br />
se perpétuera dans les mosquées de cette période. Avec le règne de feu Hassan II, naît<br />
<strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> une profusion de projet novateur qui permet de retrouver, les ambitions <strong>des</strong><br />
plus grands bâtisseurs.<br />
11 Ibn Hayyan.<br />
46<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 47<br />
<strong>Les</strong> mosquées de cette période<br />
marquent indéniablement la continuité<br />
d'un art ancestral renouvelé et portent le<br />
signe d'innovations dues non seulement à<br />
<strong>des</strong> raisons techniques mais <strong>au</strong>ssi à la<br />
féconde exploration de nouvelles<br />
possibilités esthétiques.<br />
A cet état, nous relevons comme<br />
innovations et particula-rités de cette<br />
période, les galeries extérieures et les<br />
sahns couverts de dômes mécaniques.<br />
C’est la vocation double de la grande<br />
mosquée qui explique la variété formelle<br />
<strong>des</strong> espaces et caractéristiques<br />
architecturales.<br />
A cet égard on a déjà be<strong>au</strong>coup écrit<br />
sur la structure d'une mosquée typique.<br />
Mais en y découvrant le rôle primordial<br />
d'une nef médiane élargie, surélevée, tout particulièrement ornée, qui dominait, on saisit<br />
les rapports de l'édifice ainsi conçu avec les salles d'<strong>au</strong>dience palatine, de formule<br />
également basicale, que les souverains omeyya<strong>des</strong> avaient rencontrées dans les<br />
traditions antérieures pour abriter tout cérémonial <strong>au</strong>lique: ce fut en s'efforçant d'imiter<br />
de telles constructions qu'ils finirent par ajouter à la mosquée si simple, voulue jadis par<br />
le Prophète, la note d'édifice souverain qu'elle n'allait ensuite plus jamais perdre.<br />
L’axe central, <strong>au</strong>tour duquel s'ordonna son évolution ultérieure, de manière à<br />
accueillir le déploiement <strong>des</strong> cortèges souverains et non plus seulement les rangées de<br />
fidèles s'alignant pour la Prière face à la direction de la Mekke mais cet axe fut complété<br />
de la présence d'un mihrab, réplique réduite de l'abside palatine, et celle d'un minbar<br />
servant à l'origine de trône encore plus que de chaire: c'était là que le calife se tenait<br />
lorsqu'il s'agissait d'accomplir l'acte le plus solennel de son règne, la réception du<br />
serment d'allégeance prêté par les membres éminents de la commun<strong>au</strong>té; c'était là encore<br />
que lui-même ou son représentant prenaient la parole pour ces allocutions politiques ou<br />
religieuses où s'affirmait la <strong>des</strong>tination essentielle <strong>des</strong> mosquée à khotba. C’est ce qui<br />
explique que les mosquées à khotba étaient <strong>des</strong> monuments d'abord urbains, bâtis <strong>au</strong><br />
nombre d'un seul par localité, variant de surface selon l'importance de l'agglomération<br />
dont ils devaient pouvoir accueillir toute la population mâle musulmane.<br />
Un évident recours à <strong>des</strong> habitu<strong>des</strong> plus anciennes avait permis l'équilibre savant du<br />
Introduction<br />
47
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 48<br />
Source :Golvin lucien, L’architecture<br />
48<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
plan rayonnant de la mosquée, de son<br />
élévation non moins savante à partir de<br />
calculs et de constructions géométriques<br />
reconstituables, l'organisation enfin de<br />
son décor amorçant une recherche qui<br />
n'allait cesser de s'amplifier. Ce sont les<br />
premiers exemples, les gran<strong>des</strong> mosquées<br />
(Damas ou de Médine) qui tracèrent un<br />
programme architectural, qui s’est<br />
perpétué sous forme de grande mosquée<br />
dans le reste du monde islamique et que<br />
nous venons d'évoquer.<br />
Source : Atelier Histoire d’architecture Islamique Encadré par M. El Mghari. ESAI, Rabat, 2004<br />
Plan de la Koutoubia
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 49<br />
L’Art de l’islam, Unesco/Flammarion, 1990<br />
- Hintzen-Bohlen Brigitte, Art et Architecture : Andalousie,Cologne,1999<br />
- BLOOM Jonathan, Minaret, symbol of Islam, Published by Oxford university Press for<br />
the Board of the Faculty of Oriental Studies, 1989.<br />
- BOONINE, Michael, «The Sacred Direction and City Structure : A Preliminary Analysis<br />
of the Islamic Cities of Morocco», Muqarnas, 7, 1990, p. 50-72.<br />
- EL MGHARI-BAIDA, Mina, <strong>Les</strong> mosquées à Khotba de Moulay Slimane 1792-1822,<br />
Thèse de 3ème Cycle, sous la direction de J.SOURDEL-THOMINE, Paris IV, Paris-<br />
Sorbonne, 1987 (inédite).<br />
- FRISHMAN, M., & KHAN, H.-U. (eds.), The Mosque : History, Architectural<br />
development and Regional Diversity, London, Thames and Hudson, 1994.<br />
- GOLVIN, Lucien, Essai sur l’architecture religieuse musulmane. T.IV, l’art<br />
hispano–musulman, série Archéologie Méditerranéenne, Ed. Klincksieck, Paris, 1979.<br />
- Irwin Robert, Le monde islamique, Flammarion, 1997.<br />
- LUCCIONI Joseph, <strong>Les</strong> fondations pieuses «Habous <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>» depuis les origines<br />
jusqu’à 1956, imprimerie royale, Rabat.<br />
- MASLOW, Boris, <strong>Les</strong> mosquées de Fès et du Nord du <strong>Maroc</strong>, Publications de l’Institut<br />
<strong>des</strong> H<strong>au</strong>tes Etu<strong>des</strong> <strong>Maroc</strong>aines, T. XXX, Paris, 1937.<br />
- Papadopoulo A., l’Islam et l’art musulman, Mazenod, 1976. (magnifiques planches de<br />
mihrâb).<br />
- PEDERSON, «Masgid», E.I., T. VI, Paris, 1991, p. 629-695.<br />
- SAUVAGET, Jean, La mosquée Ommeyade de Médine, Edition Van Oest, 1947.<br />
- TERRASSE, Henri, «La mosquée al Qaraouiyin à Fès», Archéologie Méditerranéenne,<br />
III, Paris, Klincksieck, 1968.<br />
- TOURI, Abdelaziz, «L’oratoire de Quartier», Fès Méditerranéenne entre légende et<br />
histoire, un carrefour de l’Orient à l’apogée d’un rêve, Autrement, Série Mémoire, n°.<br />
13, Février 1992, p. 100-108.<br />
- TOURI, Abdelaziz, <strong>Les</strong> oratoires de quartier à Fès. Essai d’une typologie. Thèse<br />
dactylographiée sous la direction de Janine SOURDEL-THOMINE, Paris IV, 1980.<br />
- TRIKI, Hamid, HASSAR-BENSLIMANE, Joudia, TOURI, Abdelaziz, Tinmel, l’épopée<br />
almohade, fondation ONA, 1992, 263p.<br />
Introduction<br />
49
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 50<br />
50<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 51<br />
Préambule :<br />
LES TENDANCES DE L’ARCHITECTURE<br />
DES MOSQUÉES MAROCAINES<br />
Abdelaziz DEROUICHE<br />
Directeur <strong>des</strong> mosquées<br />
Ministère <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong> Affaires Islamiques<br />
Dieu a révelé dans sourate annoûr : (la lumière) Allah a permis que ses lumi res se<br />
perp tuent dans <strong>des</strong> difices lev s sa gloire et que, matin et soir son nom soit voqu<br />
et glorifi .<br />
<strong>Les</strong> mosquées sont les maisons de dieu, elles sont les plus vénérées à Dieu. Le<br />
prophète Sidna Mohamed a dit : les terres les plus ch res Dieu sont les mosqu es .<br />
L'histoire révèle que okba ben Nafea lorsqu'il est parvenu <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> lors de sa<br />
conquête, il a bâti une mosquée à Dràa et une <strong>au</strong>tre à Souss.<br />
Certes, tout conquérant parvenu <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> ultérieurement se voue pour ériger <strong>des</strong><br />
mosquées, cette tradition a été suivi à la trace par les conquérants en vocation du<br />
prophète Sidna Mohamed.<br />
Par exemple : Moussa ben Noussaîr qui a bâti une mosquée dans la tribu de Beni<br />
Hassaine à l'ouest de chefchaoun, elle a subsisté jusqu'à présent, elle est connue sous<br />
le nom de la mosquée <strong>des</strong> anges, Tarek ben Ziad a érigé une mosquée <strong>des</strong> nobles<br />
(Chourafa) qui en porte le nom.<br />
<strong>Les</strong> Rois qui se sont succédés <strong>au</strong> Roy<strong>au</strong>me se sont penchées sur les mosquées. Ils<br />
ont également bâti tout <strong>au</strong>tour <strong>des</strong> écoles et <strong>des</strong> universités, de tel que toute ruelle est<br />
munie d'une ou plusieurs mosquées.<br />
<strong>Les</strong> mosquées embellissent nos cités et nos villages et donnent un charme naturel et<br />
une be<strong>au</strong>té spirituelle, les <strong>Maroc</strong>ains y ont fourni tout leur savoir artistique eu égard de<br />
leur place, leur génie y a prévalu également.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées dans notre pays est un riche patrimoine et un long<br />
registre dans le quel s'épanouit la diversité <strong>des</strong> formes d'expression et de be<strong>au</strong>té. La<br />
be<strong>au</strong>té de la foi et celle de la pensée architecturale.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
51
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 52<br />
Cependant, L'évolution technique accélérée, dans une époque changeante, met en<br />
péril ces acquis, si la tendance de l'architecture future reste l'adoption, la reproduction<br />
et l'importation de styles nouve<strong>au</strong>x, et l'hybridation <strong>des</strong> modèles sans <strong>au</strong>cune identité.<br />
Le présent exposé relate une bibliographie sur les tendances de l'organisation<br />
spatiale <strong>des</strong> mosquées marocaines à travers l'histoire et les tendances de l'architecture<br />
contemporaine.<br />
I- Organisation spaciale <strong>des</strong> mosquées à travers l'histoire<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées à été influencée par <strong>des</strong> circonstances et facteurs<br />
différents, elle a pris plusieurs tendances dont :<br />
52<br />
• La tendance Arabe ou le régime prophétique que les oumaya<strong>des</strong> et les Abyssi<strong>des</strong><br />
ont fait évoluer ;<br />
• Le style <strong>Maroc</strong>ain avec <strong>des</strong> apports andalus qui est préalablement issu de la<br />
tendance arabe ;<br />
• La tendance perse ou le régime à dômes ;<br />
• La tendance Ottomane ou le schéma Basilique.<br />
Ces tendances ont été clairement influencées par l'environnement, l'espace et le<br />
temps. Chaque tendance a pris un caractère particulier.<br />
Le style marocain s'est basé sur le modèle prophétique bâti à Médine. A l'origine,<br />
la mosquée du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, est une parcelle de terre<br />
dégagée, couverte de caillasses et cernée d'un mûr composé de brique d'argile,<br />
entourée sur l'un de ses côtés par neuf salles consacrées <strong>au</strong>x épouses du prophète. La<br />
mosquée est dotée d'un toit orienté vers le nord, lorsque la «qibla» était orientée vers<br />
Bayt Al Kodsse. Une <strong>au</strong>tre toiture a vu le jour, le long du mur sud, lorsqu'il y a eu le<br />
changement de la «Qibla» vers la Mecque ;<br />
<strong>Les</strong> larges <strong>au</strong>vents couvert de feuilles de palmier enduites d'argile et soutenu par <strong>des</strong><br />
troncs de palmiers prodigeaient de l'ombre.<br />
La mosquée a connu <strong>des</strong> élargissements (sous le règne d'Omar Ben Khatab,<br />
Othmane Ben Affane, que la paix soit sur eux), elle a pris une forme architecturale<br />
spécifique consistant en une cours (sahn) découverte entourée de quatre galeries dont la<br />
plus grande galerie est celle dressée vers la «Qibla», ce qui a ultérieurement influencé<br />
la conception <strong>des</strong> plans <strong>des</strong> mosquées dans tout le monde islamique de façon générale<br />
et le <strong>Maroc</strong> en particulier ;<br />
Le Régime du prophète s'est démarqué par son extension horizontale et par le<br />
régime <strong>des</strong> salles hypostyles et les galeries qui cernent le sahn, ainsi que par son<br />
échelle humaine.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 53<br />
<strong>Les</strong> mosquées <strong>des</strong> conquêtes Islamiques <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> se sont caractérisées par les<br />
mêmes spécificités mais ont évolué rapidement pour atteindre une grande splendeur<br />
architecturale.<br />
Cet art spécifiquement marocain avec <strong>des</strong> apports andalus se distingue, entre <strong>au</strong>tre,<br />
par les particularités suivantes :<br />
• L'ordonnancement de l'oratoire qui se constitue <strong>des</strong> nefs transversales ou<br />
longitudinales <strong>au</strong> mur de qibla ;<br />
• Le sahn ou la cour à ciel ouvert ;<br />
• L'hypostyle avec une multiplication <strong>des</strong> piliers ou <strong>des</strong> pote<strong>au</strong>x ;<br />
• <strong>Les</strong> toits inclinés ;<br />
• <strong>Les</strong> minarets concue sous forme de tour quadrilatère ou octogonale;<br />
• L'utilisation fréquente <strong>des</strong> arcs lambrequin ou fer à cheval;<br />
• La décoration <strong>des</strong> murs par les stucs sculptés et zelliges traditionnels ;<br />
• La mise en relief de la nef axiale qui dans certains cas est plus large et plus h<strong>au</strong>te ;<br />
• Un nombre limité de coupoles dans la nef axiale ou la travée transversale du<br />
Mihrab;<br />
• L'intégration de la mosquée dans le tissu urbain ;<br />
• Clôture de de l'espace mosquée par l'intérieur;<br />
• L'échelle (ou standart) humaine ;<br />
• Intégration de la dimension environnementale par la plantation de certains sahns.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
53
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 54<br />
54<br />
Mosquée et .............<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Duran Coban<br />
1.1- Plans et masses <strong>des</strong> mosquées sous le règne <strong>des</strong> Idrissi<strong>des</strong> et <strong>des</strong> Zénatis<br />
1- <strong>Les</strong> premières mosquées à Fès ont été conçues selon les traditions de modèles<br />
orient<strong>au</strong>x précoces, munis de nefs dressées de l'est vers l'ouest;<br />
2- L'oratoire est plus large que profond ;<br />
3- L'architecture Idrisside dans la mosquée «Qarawiyîn», la mosquée «Al-andalus» et<br />
la mosquée antique de «Chellah» est reconnue par ces nefs dressées parallèles <strong>au</strong><br />
mur de la qibla ;<br />
4- L'architecture <strong>des</strong> Idrissi<strong>des</strong> a fait usage de l'arc dit «Fer de cheval» ;<br />
5- Le sahn est plus petit que son équivalent d'orient, en concordance avec<br />
l'environnement, la situation géographique et les conditions climatiques. Au <strong>Maroc</strong>,<br />
la saison hivernale étant en général plus longue, les intempéries plus gran<strong>des</strong> et les
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 55<br />
températures plus basses, le sahn se devait d'être plus petit pour une plus grande<br />
tiédeur <strong>des</strong> lieux.<br />
6- <strong>Les</strong> piliers et les éléments porteurs <strong>des</strong> arcs <strong>des</strong> oratoires sont moins longs, pour la<br />
même raison qui est de garantir plus de chaleur et d'établir l'équilibre nécessaire<br />
entres les différents éléments architectur<strong>au</strong>x ;<br />
7- La première forme <strong>des</strong> minarets a été conçue sous forme de tour quadrilatère<br />
surmontée du l'anternon ou «azri» <strong>au</strong> balcon du minaret ou «Afrak». <strong>Les</strong> plus<br />
connues sont celles <strong>des</strong> Zenatis :<br />
• Minaret de la mosquée «Qarawiyîn» ;<br />
• Minaret de la mosquée Al-andalus ;<br />
• Minaret de la mosquée antique de Chellah;<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
55
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 56<br />
56<br />
...............<br />
...............<br />
.......... de la mosqué Qarawiyîn<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Minaret de la mosqué Qarawiyîn
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 57<br />
1.2- Plans et masses <strong>des</strong> mosquées sous le règne <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong><br />
1- Des mosquées amples et riches, avec <strong>des</strong> éléments porteurs <strong>des</strong> arcs en briques, ou<br />
en argile couvert d'enduit (apparues <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> et en Algérie);<br />
2- L'oratoire est plus large que profond comme on le voit dans la mosquée Qarawiyîn ;<br />
3- Henry terrasse pense que les mosquées Almoravi<strong>des</strong> étaient munies de nefs<br />
perpendiculaires <strong>au</strong> mur de la qibla ;<br />
4/ La nef axiale, qui est la nef du «Mihrab», était, dans les mosquées <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong><br />
plus spacieuse et d'une plus grande capacité par rapport <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres nefs, selon une<br />
tradition immuable ;<br />
5- La travée du Mihrab s'élargit parfois jusqu'à atteindre la portée de la nef axiale. Ce<br />
phénomène résultant du fait de la rencontre de la nef centrale avec la travée du<br />
mihrab, est devenu une exigence architecturale à la mosquée «Qarawiyîn» lorsque<br />
les Aghalibas s'apprêtaient à ériger la coupole du mihrab sur la base d'une superficie<br />
carrée ;<br />
6- Le plan <strong>des</strong> mosquée <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong> ne s'est pas caractérisé par la régularité et la<br />
symétrie ;<br />
7- Ressemblance dans la construction. <strong>Les</strong> chercheurs se référent dans cette question<br />
à la création marocaine qui consiste en l'utilisation de piliers unifiés porteurs <strong>des</strong><br />
arcs <strong>des</strong> mosquées de vendredi ;<br />
8- Etroitesse <strong>des</strong> dimensions du sahn par rapport <strong>au</strong>x oratoires chez les Almoravi<strong>des</strong><br />
surtout dans la «Qarawiyîn» ;<br />
9- Le sahn <strong>des</strong>sine un plan généralement carrée lorsque l'oratoire était plus large que<br />
profond. Ses cotés nord, est et ouest sont bordés par <strong>des</strong> galeries à une ou multiples<br />
nefs (Mosquée Almoravide de Tlemcen) ;<br />
10- <strong>Les</strong> Almoravi<strong>des</strong> ont construit les arcs de leurs mosquées de façon perpendiculaire<br />
et en même temps parallèle <strong>au</strong> mur de la qibla ;<br />
11- <strong>Les</strong> arcs <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong> dans le «Mihrab» étaient sans exception de type plein<br />
cintre ;<br />
12- <strong>Les</strong> arcs les oratoires <strong>des</strong> mosquées d'Almoravi<strong>des</strong> sont diversifiés on peut en citer :<br />
• Le plein cintre outrepassé ;<br />
• L'arc à feston ;<br />
• L'arc brisé par le h<strong>au</strong>t, et outrepassé reflétant ainsi l'influence orientale appelée<br />
arcs Makhmousse ;<br />
• <strong>Les</strong> Almoravi<strong>des</strong> ont connu les arcs dits Brisé Simple qui n'outrepasse pas le demi<br />
cercle et l'ont utilisé dans les ouvertures, les portes et les passages étroits.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
57
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 58<br />
13- <strong>Les</strong> toitures sont <strong>des</strong> charpentes pyramidales couvertes de l'extérieur de tuiles<br />
vertes étanches <strong>au</strong>x e<strong>au</strong>x pluviales ;<br />
14- La charpente intérieure, appelée dans l'artisanat marocain «berchla», est composée<br />
de volige «Warka» surh<strong>au</strong>ssait les solives «Gayeza» ;<br />
15- <strong>Les</strong> mosquées <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong> ont connu le régime de la mosquée <strong>des</strong> morts<br />
derrière le mur de la qibla suivant une pratique Andalou comme pensait Boris<br />
Maslon ;<br />
16- <strong>Les</strong> stalactites, dit «Mkarnas» est une création pittoresque <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong> tant <strong>au</strong><br />
<strong>Maroc</strong> qu'en Algérie ;<br />
17- <strong>Les</strong> Almoravi<strong>des</strong> ont excellés dans les ornements <strong>des</strong> coupoles de «Mihrab» par<br />
utilisation <strong>des</strong> feuilles d'or, pierre d'azur et différentes peintures. Ils ont fait usage<br />
de couleurs, du rouge vif, du bleu clair et du violet foncé en excellant dans les styles<br />
de sculpture, et la distribution <strong>des</strong> lumières et <strong>des</strong> ombres ;<br />
18- Un élément nouve<strong>au</strong> apparaît dans l'architecture <strong>Maroc</strong>aine dit «élément<br />
serpentiforme». Sa première apparition s'est manifestée dans les portes <strong>des</strong><br />
mosquées <strong>des</strong> morts annexées à la mosquée <strong>des</strong> Qarawiyîn pour <strong>des</strong> raisons<br />
architecturales dont celle de servir de porteurs <strong>des</strong> racines <strong>des</strong> arcs ;<br />
19- Existence de deux coupoles limitant la nef du Mihrab par le nord et le sud.<br />
58<br />
............<br />
Plan Mosquée Quarawiyne - Fès<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
............<br />
...........................
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 59<br />
.............<br />
.............<br />
Plan Mosquée Kalâa Beni Hammad<br />
Plan Grande Mosquée à Alger...........<br />
............. ............. ..............................<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
59
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 60<br />
60<br />
1.3- <strong>Les</strong> plans et masses <strong>des</strong> mosquées sous le règne <strong>des</strong> Almoha<strong>des</strong><br />
1- Contrairement à celui <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong>, le plan <strong>des</strong> mosquées <strong>des</strong> Almohade se<br />
caractérise par la régularité et la symétrie parfaite ;<br />
2- L'élargissement du sahn comme c'est le cas de la mosquée «Tinmel»<br />
(Abdelmounem Ben Ali en 548 de l'Hégire), et la mosquée de Taza Almohade<br />
(Abdelmoumen Ben Ali). Dans certains cas spécifiques, on trouve plus d'un sahn,<br />
tel le cas <strong>des</strong> mosquées «Kasba» à Marrakech, «Hassan» à Rabat et les sahns<br />
latér<strong>au</strong>x de la Grande mosquée de Salé ;<br />
3- Réalisation de la symétrie et de la similitude dans les plans <strong>des</strong> cours et <strong>des</strong> Salles<br />
de prière par la mise de tout les annexes à l'extérieur de la mosquée ;<br />
4- La salle de prière est plus large que profonde chez les Almoha<strong>des</strong>, selon les<br />
premières pratiques Islamiques ;<br />
5- Elargissement de la nef et de la travée du Mihrab, qui a été nécessaire pour la<br />
construction d'une coupole <strong>au</strong> devant du «Mihrab» ;<br />
6- Existence de trois on cinq coupoles sur la travée du «Mihrab» devant le mur de la<br />
qibla ;<br />
7- de part et d'<strong>au</strong>tre <strong>des</strong> «Mihrab» <strong>des</strong> Almoravi<strong>des</strong> apparairent deux portières<br />
latérales l'une réservée <strong>au</strong> minbar, l'<strong>au</strong>tre à l'Imam ;<br />
8- <strong>Les</strong> plans <strong>des</strong> mosquées ont été enrichis par de nouvelles organisations de l'espace<br />
comme c'est le cas de la mosquée de Hassan à Rabat et la répartition de ses cours<br />
internes <strong>au</strong>tour de la salle de prière et l'étrange répartition <strong>des</strong> cours à la mosquée<br />
du Kasba à Marrakech ;<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 61<br />
9- <strong>Les</strong> oratoires se distinguent par une multitude de piliers rectangulaires sur les<br />
quelles se collent <strong>des</strong> moitiés de colonne pour porter les arcs de la mosquée ;<br />
10- <strong>Les</strong> arcs <strong>des</strong> Almoha<strong>des</strong> étaient perpendiculaire <strong>au</strong> mur de la qibla pour donner plus<br />
de lumière à l'oratoire ;<br />
11- <strong>Les</strong> arcs étaient, toujours, du genre outrepassé brisé, appelé également le fer de<br />
cheval brisé, à l'intérieur <strong>des</strong> oratoires, dans les gran<strong>des</strong> portières et les arca<strong>des</strong> <strong>des</strong><br />
minarets. <strong>Les</strong> arcs <strong>des</strong> mosquées prennent <strong>au</strong>ssi la forme de festons tel qu'on peut<br />
le remarquer à «Tinmel» d'un <strong>au</strong>tre côté, les Almoha<strong>des</strong> faisaient usage <strong>des</strong> arcs<br />
brisés non Outrepassés pour les portières et les passages étroits. On trouve souvent<br />
<strong>des</strong> arcs à stalactites cernant les deux côtés du Mihrab comme c'est le cas dans la<br />
mosquée Koutoubia à Marrakech. <strong>Les</strong> Amoha<strong>des</strong> ont perpétué l'arc lisse. <strong>Les</strong> arcs<br />
<strong>des</strong> Almoha<strong>des</strong> étaient h<strong>au</strong>tement placés comparées à celles <strong>des</strong> mérini<strong>des</strong> qui<br />
viendront ultérieurement.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
61
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 62<br />
62<br />
1.4- Plans et masses <strong>des</strong> mosquées sous le règne <strong>des</strong> Mérini<strong>des</strong><br />
1- <strong>Les</strong> mosquées Mérini<strong>des</strong> sont reconnues par l'étroitesse de leur taille et l'exiguïté de<br />
leur superficie en comparaison à l'ampleur de celles <strong>des</strong> Almoha<strong>des</strong> ;<br />
2- <strong>Les</strong> Mérini<strong>des</strong> ont porté un grand intérêt à la nef axiale du Mihrab, qui est la nef<br />
axiale étant donné ses ornements et ses deux coupoles, la première placée <strong>au</strong>x<br />
<strong>au</strong>vents du Mihrab, la seconde placée à son extrémité sur la façade donnant <strong>au</strong> sahn;<br />
<strong>Les</strong> salles de prière étaient plus profonde que large ;<br />
3- L'intérêt, <strong>des</strong> Mérini<strong>des</strong>, était orienté, contrairement <strong>au</strong>x Almoha<strong>des</strong>, vers la nef du<br />
Mihrab qui concentre tout leur prestigieux ornements. Ils ont construit sur cette nef<br />
axiale même, deux coupoles orientées vers la qibla. La première coupole est placée<br />
<strong>au</strong> devant du Mihrab, la seconde à l'extrémité de la nef axiale du côté du Sahn ;<br />
4- Placement d'un Mihrab supplémentaire (Anza), à l'entrée de la nef centrale ;<br />
5- Le sahn a acquis une meilleure étendue et les annexes ont été placées à l'intérieur<br />
avec un nombre réduit de portes ;<br />
6- <strong>Les</strong> mosquées Mérini<strong>des</strong> ont tous un point commun, celui <strong>des</strong> piliers construits avec<br />
de la brique ;<br />
7- <strong>Les</strong> annexes <strong>des</strong> mosquées <strong>des</strong> Mérini<strong>des</strong> se trouvaient à l'interieur, la salle<br />
d'ablution est placé soigneusement dans un endroit donnant sur la façade nord prés<br />
de l'entrée principale, les logements <strong>des</strong> Muezzins et <strong>des</strong> personnes qui s'occupent<br />
<strong>des</strong> mosquées, sont placés parmi les cloisons de l'oratoire et les passages qui<br />
l'entourent. Sur les toitures, pratiquement <strong>au</strong> pied du minaret, se trouve la chambre<br />
du «Mouakit» ;<br />
8- Le fer de cheval, était une pratique courante dans les arcs <strong>des</strong> mosquées Mérini<strong>des</strong>,<br />
cependant le plein cintre outrepassé est utilisée pour l'exécution <strong>des</strong> grands arca<strong>des</strong><br />
ou l'entre-nu <strong>des</strong> piliers porteurs est plus grand.<br />
A été <strong>au</strong>ssi utilisé l'arc du fer de cheval brisé dans les portes ornementées tel que<br />
c'est le cas à Chellah ;<br />
9- <strong>Les</strong> arcs étaient <strong>des</strong> premières mosquées mérini<strong>des</strong> étaient perpendiculaire <strong>au</strong> mur<br />
de la quibla ;<br />
10- <strong>Les</strong> édifices <strong>des</strong> Mérini<strong>des</strong> étaient de superficie réduites de petite taille, il s'est<br />
avéré alors nécessaire d'y remédier <strong>au</strong> moyen d'ornement architectur<strong>au</strong>x qui<br />
revêtent l'ensemble <strong>des</strong> terrasses, <strong>des</strong> colonnes, <strong>des</strong> arcs et <strong>des</strong> toitures. Une variété<br />
et une richesse de couleur a été acquise mettant en harmonie de tout les éléments et<br />
les unités ornementales d'où émane les couleurs bleue, grise, verte et noire.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 63<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
63
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 64<br />
64<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 65<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
65
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 66<br />
66<br />
1.5- Plans et masses <strong>des</strong> mosquées sous le règne <strong>des</strong> Saadistes<br />
1- <strong>Les</strong> Saadistes ont commencé par prendre soin de la réfection, l'élargissement et la<br />
rénovation de plusieurs monuments architectur<strong>au</strong>x religieux et historiques. Ainsi, la<br />
mosquée koutoubia a repris son élégance, sa vivacité, la mosquée «Qaraouiyin» a<br />
regagné sa place et ses annexes et dépendances se sont multipliées ;<br />
2- D'<strong>au</strong>tres établissements ont été construites pour renforcer l'épanouissement spirituel;<br />
Le nombre de mosquées rurales a <strong>au</strong>gmenté à Souss ;<br />
3- <strong>Les</strong> «Zaouia» ont évolué pour devenir <strong>des</strong> agglomérations humaines se développant<br />
en un villages ou cités ;<br />
4- Le plan général <strong>des</strong> mosquées «Saadistes» nous rappelle celui <strong>des</strong> mosquées<br />
«Mérini<strong>des</strong>» du fait de la profondeur <strong>des</strong> oratoires dépassant la (ligne à garder) ;<br />
5- <strong>Les</strong> arcs <strong>des</strong> mosquées sont perpendiculaire <strong>au</strong> mur du mihrab ;<br />
6- L'oratoire se compose de nefs perpendiculaires <strong>au</strong> mur de la qibla et comprend<br />
également <strong>des</strong> travées. La travée transversale du mihrab arrête les arcs<br />
perpendiculaires <strong>des</strong> nefs et comprend <strong>des</strong> coupoles ;<br />
7- Le sahn <strong>des</strong>sine un carré et est entouré de galeries à nef unique, par l'est, l'ouest et<br />
le nord ;<br />
8- Le minaret rentre dans le <strong>des</strong>ign rectangulaire général de la mosquée ;<br />
9- <strong>Les</strong> arcs sont si diversifiés qu'on les trouve sous la forme de fer à cheval, de<br />
stalactites porteuses de la coupole du Mihrab, et sous forme d'arc à feston lobées<br />
qui portent les <strong>au</strong>tres coupoles ;<br />
10- <strong>Les</strong> Saadistes, ont ajouté deux pavillons dans le sahn de la «Qarwiyine» à Fès, qui<br />
rappellent la cour <strong>des</strong> lions de l'Alhambra à Granada.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 67<br />
1.6- Plans et masses <strong>des</strong> mosquées sous le règne <strong>des</strong> Alaouites<br />
1- Retour <strong>au</strong>x premières sources dans l'organisation spatiale <strong>des</strong> mosquées Alaouites<br />
dont le premier noy<strong>au</strong> a été mis en place par les Chérifiens Idrissi<strong>des</strong> ;<br />
2- Des oratoires sont plus large que profonds comme c'est le cas de la mosquée du<br />
Sunna (1199 de hégire, 1785), la mosquée Moulay Souleymane en 1812, la<br />
mosquée de Sidi-Fateh en 1270 de l'hégire (1854) et dans la mosquée Nakhla en<br />
1815 ;<br />
3- Le nombre réduit de nefs à l'intérieur de la salle de prière : deux ou trois nefs<br />
seulement ;<br />
4- <strong>Les</strong> arcs sont parallèles <strong>au</strong> mur de la qibla ;<br />
5- La nef du Mihrab ne se distingue pas par son ampleurs <strong>des</strong> <strong>au</strong>tre nefs de la<br />
mosquées ;<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
67
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 68<br />
68<br />
Il est à signaler, également que les Mihrabs de cet ensemble de mosquées Alaouites,<br />
sans exception, ont été construit sous la forme de plan à angles ;<br />
6- Des piliers étaient utilisés pour porter les arcs (<strong>au</strong>tre que les colonnes) à la mosquée<br />
«Sunna», Moulay Slimane et la mosquée «Gazarine» ;<br />
7- Le Sahn est dépourvu de galeries dans la mosquée «Sunna» «Atiya», La mosquée<br />
«Nakhla» et Sidi Fatteh ;<br />
8- Présence d'un ensemble de salles sur l'un <strong>des</strong> côtés du Sahn Consacrées comme<br />
drottoirs <strong>au</strong>x étudiants «Toulbas» qu'on remarque dans les mosquées Alaouites à<br />
Fès ;<br />
9- La conservation de la pratique générale, en ce qui concerne le choix de<br />
l'emplacement du minaret à l'instar de la mosquée «Sunna» qui occupe le coin nord<br />
du plan de la mosquée dans l'angle du Sahn, la mosquée Zaouia Nassirite et la<br />
mosquée Nakhla ont fait usage de la même pratique Alaouite ;<br />
10- Une <strong>au</strong>tre caractéristique spécifique, à la mosquées «Mouline» et les mosquées<br />
«Alssina, Nakhla et Sidi Fatteh, à titre d'exemple, la face de l'oratoire donne sur le<br />
sahn à la mosquée Mouline par trois arcs seulement, tandis que le reste de la face<br />
est barré par la construction d'un mur qui sépare l'oratoire et le sahn sur les deux<br />
côtés <strong>des</strong> arcs ;<br />
L'idée de la séparation est expliquée par le souhait de créer une atmosphère de<br />
sérénité dans la salle de prière malgré la présence <strong>des</strong> chambres <strong>des</strong> étudiants<br />
«Toulba».<br />
11- Consolidation <strong>des</strong> constructions et fortification en vue de résister à la charge <strong>des</strong><br />
toitures.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
¢ªDOj ±ºπb ∞ö´uœ… °LJMU” ¢ªDOj §U±l ±uôÍ ´∂b «∞Kt °HU”
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 69<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
69<br />
§U±l «∞Ad«°KOOs °HU”, ¢ªDOj «∞Lºπb ¢ªDOj §U±l ±KOMW °d°U◊ «∞H∑`<br />
¢ªDOj §U±l ±KOMW °d°U◊ «∞H∑` ¢ªDOj ±ºπb ±uôÍ ßKOLUÊ °d°U◊ «∞H∑`<br />
¢ªDOj ±ºπb ßObÍ ≠U¢` °d°U◊ «∞H∑` ¢ªDOj §U±l ≤ªKW °d°U◊ «∞H∑`
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 70<br />
70<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
¢ªDOj §U±l «∞πe«¸¥s °d°U◊ «∞H∑` ¢ªDOj §U±l ´πOºW °HU”<br />
±ºπb ±∫Lb «∞ªU±f, ¢ªDOj<br />
«_ßUØOV Ë«∞∂ö©U‹ œ«îq °OX «∞Bö…<br />
¢ªDOj §U±l ±KOMW °d°U◊ «∞H∑` ¢ªDOj ±ºπb ±uôÍ ßKOLUÊ °d°U◊ «∞H∑`
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 71<br />
II- <strong>Les</strong> tendances de l'architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
contemporaines<br />
De ce qui a précédé, on peut voir que l'architecture <strong>des</strong> mosquées à travers l'histoire,<br />
avait en général une tendance unique qui a réussi à satisfaire les besoins selon les<br />
circonstances générales et spécifiques relatives à chaque environnement.<br />
A l'heure actuelle, l'architecture <strong>des</strong> mosquées se confronte à plusieurs tendances<br />
qui peuvent être différentes de celles rencontrées à travers l'histoire.<br />
La présente partie de l'exposé relate quelques exemples cités par les spécialistes<br />
en la matière pour clarifier leur influence sur l'architecture <strong>des</strong> mosquées<br />
contemporaines.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
71<br />
¢ªDOj ±ºπb ßObÍ ≠U¢` °d°U◊ «∞H∑` ¢ªDOj §U±l ≤ªKW °d°U◊ «∞H∑`
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 72<br />
2.1/ La tendance traditionnelle locale : se caractérise par l'utilisation de<br />
matéri<strong>au</strong>x naturels issus du milieu local (Argile, pierres, bois…) et l'utilisation<br />
également de procédés loc<strong>au</strong>x hérités <strong>des</strong> anciennes générations et polies par<br />
l'expérience de l'homme à travers les siècles et les âges, tout en conservant les formes,<br />
les éléments traditionnels, <strong>des</strong> termes du patrimoine local (arcs, coupoles, toitures,<br />
toits, carrelets, <strong>au</strong>vents…) La construction proprement dite est faite par <strong>des</strong> artisans<br />
loc<strong>au</strong>x.<br />
<strong>Les</strong> pionniers de cette tendance classique ont tenu à garantir toutes les exigences<br />
vivrières de l'homme par les moyens propres sans avoir recours à la nouvelle<br />
technologie et le renouve<strong>au</strong> selon les exigences de l'époque.<br />
72<br />
2.2 Tendance traditionnelle amélioré<br />
Cette tendance se caractérise, comme la précédente, par l'utilisation de composants<br />
architectur<strong>au</strong>x traditionnels, par la reprise <strong>des</strong> formes et éléments hérités du passé<br />
(Forme <strong>des</strong> portes, <strong>des</strong> minarets, <strong>au</strong>vents et carrelets ….), avec une expression parfois<br />
très simple orientée vers le présent. Ainsi il en est <strong>des</strong> procédés de construction et leurs<br />
styles traditionnels (murs porteurs, coupoles, toitures et arcs ….) se basant sur l'énergie<br />
humaine et l'habilité <strong>des</strong> artisans.<br />
Cette tendance diffère, comparée à la première, uniquement par l'introduction <strong>des</strong><br />
améliorations en ce qui concerne les matéri<strong>au</strong>x issus du milieu naturel et local (comme<br />
l'ajout de quelques ciments dans le mélange d'argile pour une plus grande résistance ou<br />
l'usage de briques creuses cuites par les nouve<strong>au</strong>x procédés pour réduire les poids <strong>des</strong><br />
toits et toitures construits selon la forme et la dimension traditionnelles) et ce, sans<br />
modifier le fond <strong>des</strong> apparences architecturales ou de la dimension humaine.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 73<br />
Tout cela pour exprimer la personnalité locale et permettre la continuité<br />
civilisationnelle.<br />
2.3/ La tendance conservatrice<br />
Cette tendance se caractérise par l'utilisation <strong>des</strong> styles et éléments architectur<strong>au</strong>x<br />
simplifiés de l'architecture islamique (arcs, coupoles, stalactites, ornements, piliers …)<br />
sans tenir compte <strong>des</strong> anciens matéri<strong>au</strong>x et mo<strong>des</strong> de construction. Cette tendance<br />
prône de tirer profit de l'application <strong>des</strong> nouve<strong>au</strong>x mo<strong>des</strong> et produits ce qui donne une<br />
souplesse et facilité plus grande à l'architecture <strong>des</strong> constructions de différentes tailles<br />
et d'utilisations variées.<br />
De cette façon est née une architecture contemporaine par les matéri<strong>au</strong>x et les<br />
mo<strong>des</strong> de construction, mais traditionnelle par son style.<br />
2.4/ La tendance néo-classique<br />
Cette tendance est représentée par l'utilisation <strong>des</strong> nouve<strong>au</strong>x matéri<strong>au</strong>x et styles<br />
récents de construction, et par l'utilisation <strong>des</strong> éléments d'architecture Islamique<br />
traditionnel tout en les simplifiant et les employés dans <strong>des</strong> formes nouvelles et <strong>des</strong><br />
styles perfectionnés montrant une certaine créativité et renouve<strong>au</strong>.<br />
Cette tendance d'architecture n'est pas<br />
qualifiée de «conservatrice» par ce qu'elle est<br />
novatrice, ni de «Moderniste» puis qu'elle<br />
diffère de par les termes de l'architecture<br />
contemporaine.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
73
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 74<br />
74<br />
2.5/ Tendance vers le contemporain<br />
Jadis, l'architecture Islamique était le résultat d'œuvres manuels reposant sur la<br />
rencontre entre la construction (l'architecture) et l'artisan, et était régie par les<br />
traditions issues de la foi.<br />
L'architecture est devenue actuellement, le résultat d'une machine imposant <strong>des</strong><br />
bases esthétiques.<br />
Dans les pays Islamiques, les mo<strong>des</strong> et métho<strong>des</strong> de construction se devaient de<br />
rattraper et se mettre <strong>au</strong> diapason avec l'expansion urbaine. Ce qui a accéléré la<br />
propagation <strong>des</strong> nouvelles technologiques occidentales en vue de réaliser la célérité et<br />
la performance.<br />
Ceci a eu une grande influence sur l'architecture de la mosquée, puisqu'on assiste à<br />
une naissance de plusieurs tendances vers le contemporain :<br />
• Tendance contemporaine avec appartenance historique.<br />
• Tendance ultra-contemporaine.<br />
• Tendance symbolique.<br />
A- Tendance ultra-contemporaine<br />
Cette tendance reflète l'architecture contemporaine, et est manifeste par l'utilisation<br />
de matéri<strong>au</strong>x, a procédés modernes techniques modernes traduisant l'essence et la<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 75<br />
nature de l'époque actuelle. Ont été introduites les formes géométriques abstraites<br />
(Cube, cylindre et cône) et les lignes aérodynamiques et les nouvelles théories<br />
artistiques et esthétiques.<br />
En conséquence, cette tendance ne traduit pas la personnalité architecturale<br />
historique ou locale dans l'édification, mais plutôt un effort de création et de simplicité,<br />
plus que dans les tendances précédentes.<br />
B- Tendance contemporaine avec l'appartenance historique<br />
Cette tendance du modernisme prend en considération tout les progrès en matière<br />
<strong>des</strong> nouve<strong>au</strong>x matéri<strong>au</strong>x, <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> récentes de construction et <strong>des</strong> nouvelles<br />
technologies, mais tient <strong>au</strong>ssi compte de l'appartenance historique qui apparaît dans<br />
l'utilisation de certains aspects, éléments et formes historiques musulmans.<br />
C- Tendance symbolique<br />
<strong>Les</strong> constructions et leurs intérieurs, englobent <strong>des</strong> éléments particuliers liés à<br />
l'usage du bâtiment et touchant à son objectif. Ces éléments deviennent <strong>des</strong> symboles<br />
synonymes de la nature de l'édifice et son <strong>au</strong>thenticité.<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
75
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 76<br />
76<br />
D- Tendance hybrique<br />
Elle comprend un ensemble non cohérents d'éléments architectur<strong>au</strong>x appartenant à<br />
<strong>des</strong> styles différents tels que : les toits, les coupoles, les arcs, les minarets ornement<strong>au</strong>x<br />
avec l'utilisation dense d'ornements. Ces mosquées ont souvent <strong>des</strong> proportions et <strong>des</strong><br />
rapports manquant d'unité et d'ordre.<br />
Cette tendance s'est répandue dans quelques pays du golfe, <strong>au</strong> Pakistan, et dans<br />
certains pays du monde Islamique tels que, la Malaisie, le Philippine, mais on n'en<br />
trouve pas <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>.<br />
On peut dire, après cet exposé, que l'architecture contemporaine <strong>des</strong> mosquées<br />
présente une diversité de tendance. Il n'y a plus de tendance prépondérante dans l'esprit<br />
<strong>des</strong> architectes.<br />
Ce meeting scientifique premier, en son genre, sera une occasion pour relancer les<br />
étu<strong>des</strong> relatives <strong>au</strong>x spécificités architecturales <strong>des</strong> mosquées marocains et pour faire<br />
connaître ce riche patrimoine architecturale en vue de sa conservation. C'est <strong>au</strong>ssi une<br />
occasion pour connaître son <strong>des</strong>tin et sa philosophie qui permettent d'expliquer les<br />
fondements capables de garantir la continuité à la personnalité et à l'unicité du style<br />
marocain et de consolider la capacité de reconcilier entre l'unité établie durant <strong>des</strong><br />
siècles et la diversité qui est un aspect de créativité dans l'unité.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 77<br />
Références en arabe<br />
Références en français<br />
- Georges Marcais (1954) «L'architecture musulmane d'occident».<br />
- Terrasse H. (1968) «La mosquée Al - Qaraouiyin à Fes»<br />
- El Khammar A. (2005), «<strong>Mosquées</strong> et oratoires de meknès (IXe - XVIIIe siècles)<br />
géographie religieuse, architecture et problème de la qibla» thèse de Doctorat<br />
d'histoire et d'archéologie mediévales.<br />
- Basset H. et Terrasse H. (1932), «Sanctuaires et forteresses almoha<strong>des</strong>».<br />
- Dogan K. (1974), «Muslim religious archtecture».<br />
Parti I, the mosque and the early development.<br />
- Holod R. and Uddin Khan H. (1950) «The mosque and the moderne world».<br />
<strong>Les</strong> tendances de l’architecture <strong>des</strong> mosquées dans le Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
‡ ±∫Lb «∞b«ËœÍ, "6891 «∞Lºπb ≠w «∞J∑U» Ë«∞ºMW Ë√Æu«‰ «∞FKLU¡".<br />
‡ œ. ´∂b «∞IUœ¸ «∞d¥∫UËÍ, "ÆLr ´U∞LOW ≠w ¢d«À «∞∫CU¸… «∞Fd°OW «ùßö±OW, «∞LFLU¸Í<br />
Ë«∞HMw ‡ «∞πe¡ «∞∏U≤w".<br />
‡ œ. ´∏LUÊ ≈ßLU´Oq (2991) "¢U¸¥a «∞FLU¸… «ùßö±OW Ë«∞HMuÊ «∞∑D∂OIOW °U∞LGd» «_ÆBv"<br />
‡ ≤bË… «∞∑πU¸» «∞uÆHOW ∞bˉ «∞LGd» «∞Fd°w (1002) ´d÷ «∞∑πd°W «∞uÆHOW °U∞LLKJW<br />
«∞LGd°OW ´∂b «∞Fe¥e «∞b¸Ë¥g.<br />
‡ ´U∞r «∞LFd≠W, 403 ¥u≤Ou 4002 "«∞FLU¸… «ùßö±OW Ë«∞∂OμW" œ.Â. ¥∫Ov Ë“¥dÍ.<br />
‡ «∞LπKW «∞Fd°OW ∞KFKu «ù≤ºU≤OW «∞Fbœ 89 (7002), "¢∫KOq °MOuÍ ∞KFLU¸… «ùßö±OW :<br />
«ô•∑u«¡, «∞ENu¸, ¢∫u‰ «∞D∂IU‹, «∞∑Jd«¸ ˜˸≥U ≠w ¢Ju¥s «∞FLU¸… «ùßö±OW" ≥U≤w<br />
±∫Lb «∞πu«≥d… «∞I∫DU≤w.<br />
77<br />
‡ œ. ´∂b «∞NUœÍ «∞∑U“Í (2791) "§U±l «∞IdË¥Os : «∞Lºπb Ë«∞πU±l °Lb¥MW ≠U” ±ußu´W<br />
∞∑U¸¥ªNU «∞LFLU¸Í Ë«∞HJdÍ".<br />
‡ œ. ´∂b «∞Fe¥e ±∫Lb «∞KLOr (7891) ¸ßU∞W «∞Lºπb ≠w «ùßöÂ.<br />
‡ œ. ´BU «∞b¥s ´∂b «∞dƒË· •MHw (1002) «¢πU≥U‹ ´LU¸… «∞LºU§b ≠w «∞FBd «∞∫b¥Y.
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 78<br />
78<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 79<br />
L’ARCHITECTURE DES MOSQUÉES RURALES<br />
DANS LA RÉGION DE TATA<br />
Introduction<br />
L’architecture religieuse est un aspect majeur du<br />
patrimoine architectural de la province de Tata.<br />
Que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, elle<br />
est d’une richesse étonnante. <strong>Les</strong> trav<strong>au</strong>x menés<br />
dans la zone entre 2003 et 2007 par une équipe<br />
d’archéologues de la Direction du patrimoine<br />
culturel 1 , ont permis le recensement et l’étude d’un<br />
nombre considérable d’édifices historiques de ce<br />
genre présentant <strong>des</strong> caractéristiques architecturales<br />
et décoratives qui permettent de dégager un<br />
style particulier à cette région. En effet, dans cette<br />
zone, l’enquête de terrain nous a livré 101 oratoires<br />
ayant une valeur sur le plan historique et dévoilant<br />
<strong>des</strong> traits architectur<strong>au</strong>x origin<strong>au</strong>x.<br />
Pr. Mohamed BELATIK*<br />
Pr. Mustapha ATKI**<br />
Mosquée de Tichekji<br />
A l’instar de tous les édifices de culte musulman, les mosquées 2 de la province de<br />
Tata sont composées de tous les éléments habituels : on retrouve d’abord, la salle <strong>des</strong><br />
prières qui représente le noy<strong>au</strong> de l’édifice où sont accomplis les rituels de la prière,<br />
puis la salle <strong>des</strong> ablutions dotée de latrines. Le minaret étant un élément rare, on trouve<br />
* Division de l’inventaire et de la documentation du patrimoine, Direction du patrimoine culturel, Rabat<br />
** Direction régionale de la Culture, Région Guelmim-Semara<br />
1 Ce programme d’inventaire topographique a été initié par la Division de l’inventaire et de la documentation du<br />
patrimoine en collaboration avec la Délégation provinciale de la culture à Tata selon le programme suivant :<br />
2003 : les communes d’Akka, La Kasba deSidi Abdellah ben Mbarek, Touzounine et Aït Ouabelli,<br />
2004 : <strong>Les</strong> communes de Fam El Hisn et Tamanarte<br />
2005 : <strong>Les</strong> communes de Foum Zguid, Tlit et Allougoum<br />
2006 : <strong>Les</strong> communes de Tata, Oum Lguerdane, Addis et Tagmout<br />
2007 : <strong>Les</strong> communes de Tissinte, Akka Ighane, Ben Yaakoub, Aguinane, Isafene, Tizeght et Tiguezmirte<br />
2 En Tamazight la mosquée est connue sous le nom de Timzguida (pl : Timzguidiwine)<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
79
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 80<br />
enfin un certain nombre de structures annexes telles Akherbich qui est une salle<br />
disposant d’un foyer où est ch<strong>au</strong>ffée l’e<strong>au</strong> pour les fidèles, un puits ou une metfiya<br />
(citerne de stockage <strong>des</strong> e<strong>au</strong>x), une chambre réservée à l’hébergement de l’imam qui<br />
est dans la plus part <strong>des</strong> cas, étranger <strong>au</strong> village et dans certains cas, on note l’existence<br />
du msid (école coranique) qui jouxte souvent la mosquée et où le fqih est chargé de la<br />
mission d’enseignement <strong>des</strong> imehdarene.<br />
Dans cet article il serait question de<br />
présenter les résultats préliminaires de<br />
cette opération d’inventaire et <strong>des</strong><br />
éléments de synthèses sur l’architecture<br />
religieuse de Tata traitée selon une<br />
approche comparative. Il ne s’agit pas<br />
d’aborder <strong>des</strong> questions d’ordre chronologiques,<br />
mais plus <strong>des</strong> problématiques<br />
relatives à l’ordonnancement et à la<br />
Timzguida Aguejgal<br />
typologie de ces mosquées. L’analyse<br />
concernera les différentes composantes spatiales, architecturales et décoratives de ces<br />
édifices selon la classification adoptée généralement par les étu<strong>des</strong> architecturales et<br />
archéologiques. Mais avant d’approcher ces questions dans le détail, il importe de<br />
situer ce patrimoine religieux dans le cadre physique et dans le contexte historique où<br />
il a vu le jour et où il s’est développé.<br />
Aspects physiques et repères historiques de Tata :<br />
La province de Tata fait partie <strong>des</strong> régions subsahariennes du <strong>Maroc</strong>. Son territoire<br />
s’étend du versant sud de l’anti-Atlas jusqu’à la vallée du Drâa.<br />
Le relief de la province est composé en général <strong>des</strong> massifs de l’Anti-Atlas, de<br />
l’Ouarkziz et du Bani, de la Hamada de Drâa ainsi que <strong>des</strong> vastes plaines caillouteuses<br />
connues sous le nom de Regs. La région présente une homogénéité physique avec un<br />
paysage oasien dans les endroits où le potentiel hydrique est facilement exploitable et<br />
un <strong>au</strong>tre désertique dans les zones sahariennes et rocailleuses.<br />
80<br />
Paysage de Nssour (Foum Zguid)<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 81<br />
Vue cette position géographique, Tata<br />
bénéficie d’un climat continental saharien<br />
où la température varie entre 50° durant l’été<br />
et moins de 0° en hiver. La moyenne <strong>des</strong><br />
précipitations enregistrées ne dépasse guère<br />
les 100 mm par an. Et mis à part les<br />
quelques chutes hivernales sporadiques, les<br />
ressources hydriques de la région sont<br />
essentiellement dues <strong>au</strong>x e<strong>au</strong>x d’infiltrations<br />
Palmeraie d'Aguinana<br />
provenant <strong>des</strong> pluies <strong>des</strong> montagnes de<br />
l’Anti-Atlas et qui sont déversées dans l’oued Drâa. Ces e<strong>au</strong>x rechargent les nappes<br />
phréatiques, alimentent les sources et les Khettaras et profitent positivement à<br />
l’irrigation <strong>des</strong> oasis.<br />
Sur les plans historique et archéologique, les prospections menées dans la région<br />
ont permis la découverte de plusieurs indices archéologiques remontant <strong>au</strong><br />
paléolithique dont notamment <strong>des</strong> sites de plein air, riches en outillage lithique. Par<br />
ailleurs, la province a connu depuis ces pério<strong>des</strong> lointaines un peuplement intense<br />
matérialisé par les dalles gravées qui composent les quelques 120 sites rupestres<br />
découverts à nos jours, dans les différentes zones de la province. <strong>Les</strong> centaines de<br />
tumuli préislamiques parsemant tout le territoire, apportent un indice supplémentaire<br />
sur une présence humaine forte et ininterrompue de l’homme dans ces contrés.<br />
Gravure rupestre de Kasbah d'Allougoum<br />
<strong>Les</strong> sites archéologiques et les monuments d’époques historiques se comptent par<br />
centaines : greniers collectifs (igoudar), tours de guet, maisons, villages fortifiés,<br />
mosquées, zaouïas et koubbas se rencontrent pratiquement dans toutes les oasis, le<br />
long <strong>des</strong> itinéraires et même dans les coins les plus isolés, témoignant ainsi de la<br />
densité du peuplement qu’a connu la région depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours.<br />
En effet, la région occupait une position stratégique et bénéficiait d’un rôle très<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
81
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 82<br />
important dans le rése<strong>au</strong> du commerce<br />
caravanier qui reliait le <strong>Maroc</strong> <strong>au</strong>x pays de<br />
l’Afrique subsaharienne et la cité minière de<br />
Tamdoult, le village historique de Jbaïr, la<br />
forteresse de Tagadirt Ouguellid et le village<br />
ruiné de Tghit ainsi que plusieurs <strong>au</strong>tres sites<br />
sont là pour témoigner de ce rôle<br />
prépondérant qu’a joué la région le long de<br />
l’histoire médiévale.<br />
I. La salle <strong>des</strong> prières et ses composantes<br />
1. La salle <strong>des</strong> prières<br />
La salle <strong>des</strong> prières connue en tamazighte sous le nom de<br />
lmeqsourt, représente le noy<strong>au</strong> de base de la mosquée, C’est<br />
<strong>au</strong> sein d’elle que sont exercés les rituels de la prière qui est<br />
l’un <strong>des</strong> piliers de l’Islam. <strong>Les</strong> salles de ces mosquées rurales<br />
sont généralement de petites dimensions. Ceci s’explique par<br />
le nombre limité <strong>des</strong> populations masculines de ces<br />
commun<strong>au</strong>tés villageoises. Pour mieux apprécier les<br />
dimensions de ces édifices religieux, nous nous attelons dans<br />
ce qui suit à présenter quelques mesures les concernant.<br />
Ainsi, le plus vaste oratoire de la province qui se trouve dans<br />
le village historique d’Aguerd dans la<br />
commune de Tamanarte, fait 16.80 mètres de<br />
profondeur sur 23 mètres de largeur et le<br />
plus petit parmi les édifices recensés est<br />
celui de Talilt dans la kasbah d’Alougoum<br />
qui ne fait que 6.45 de profondeur sur 8.60m<br />
de large ainsi que celui de Fiferd dans la<br />
commune d’Aguinane qui dispose d’un plan<br />
presque carré mesurant 8 m de côté.<br />
Ces oratoires adoptent <strong>des</strong> plans divers oscillant entre le rectangle et le carré, mais<br />
ils présentant le plus souvent <strong>des</strong> déformations <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de certains côtés en raison de<br />
la topographie accidentée du site. Ces anomalies de plan rares <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> murs nord<br />
et sud ne sont fréquentes qu’<strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> est et ouest, ce qui ne porte pas<br />
atteinte à l’ordonnancement <strong>des</strong> nefs parallèles <strong>au</strong> mur de la qibla.<br />
82<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Cité caravanière de Tamdoult<br />
Mosquée<br />
d'Amtzguine (Tlit)<br />
Mosquée d'Ighir à Tamanart
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 83<br />
Au nive<strong>au</strong> de la disposition interne, ces<br />
mosquées rurales présentent de gran<strong>des</strong><br />
similitu<strong>des</strong> entre elles. En effet, elles sont<br />
subdivisées en plusieurs nefs parallèles <strong>au</strong><br />
mur de la qibla dont le nombre varie en<br />
fonction de la grandeur de l’édifice et dont<br />
l’agencement rappelle les premières<br />
mosquées marocaines d’époque idrisside et<br />
tardivement certaines mosquées alaouites.<br />
Mosquée d'Oum Hnech (Foum Zguid)<br />
Cette tradition ancienne s’est développée et s’est maintenue surtout à Fès. Mais<br />
l’arrivée <strong>des</strong> Almoha<strong>des</strong> a crée une rupture avec ce mode d’organisation <strong>des</strong> salles <strong>des</strong><br />
prières en Occident musulman pour voir naître les célèbres mosquées à nefs<br />
perpendiculaires <strong>au</strong> mur de la qibla où la nef axiale occupe une place de choix et forme<br />
avec la travée de la qibla le fameux dispositif en T qu’on retrouve bien illustré à la<br />
Koutoubiya de Marrakech et par la suite dans la quasi-totalité <strong>des</strong> mosquées mérini<strong>des</strong>,<br />
saadiennes et alaouites.<br />
Le nombre <strong>des</strong> nefs composant les salles de culte, varie en fonction de l’importance<br />
<strong>des</strong> édifices. Il est de deux pour les oratoires les plus humbles tels que ceux de Jbaïr et<br />
d’Aygou et de six à sept nefs pour les plus vastes qui se trouvent respectivement à<br />
Amtzguine (commune de Tlit) et à Aguerd (commune de Tamanarte).<br />
<strong>Les</strong> nefs sont délimitées par <strong>des</strong> rangées d’arca<strong>des</strong> composées d’une succession<br />
d’arcs plein cintre ou brisés reposant sur <strong>des</strong> piliers carrés, rectangulaires, circulaires<br />
ou octogon<strong>au</strong>x, dont la h<strong>au</strong>teur varie d’une mosquée à l’<strong>au</strong>tre, mais les toitures se<br />
situent d’une manière générale à une h<strong>au</strong>teur de quatre et six mètres.<br />
Le mur de la qibla est percé de plusieurs niches dont notamment celle du mihrab et<br />
du minbar. L’accès à la salle <strong>des</strong> prières se fait soit directement par une porte <strong>des</strong>servie<br />
par un couloir menant vers la porte principale du complexe religieux ou par une petite<br />
porte de communication souvent latérale et mitoyenne avec la salle d’ablutions.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
83
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 84<br />
La lecture <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> nefs en rapport avec les<br />
matéri<strong>au</strong>x et les techniques de construction mis en œuvre,<br />
nous permet de déceler deux phases évolutives dans le<br />
processus d’élaboration <strong>des</strong> plans de ces mosquées :<br />
84<br />
• La phase initiale se caractérise par un ordonnancement<br />
primitif de la salle qui se présente sous forme de deux à<br />
trois chambres plus larges que profon<strong>des</strong> ne<br />
communiquant entre elles que par <strong>des</strong> ouvertures<br />
simples à linte<strong>au</strong>x donnant la forme d’un arc à<br />
encorbellements reposant sur <strong>des</strong><br />
piliers rectangulaires massifs et<br />
couvertes de charpentes<br />
traditionnelles dans le style local.<br />
Dans cette catégorie un cas typique<br />
mérite d’être souligné c’est la<br />
mosquée d’Aygou, dans la commune<br />
Tigezmirt, qui s’inscrit dans le même<br />
plan s<strong>au</strong>f que les deux nefs sont<br />
séparées par un mur percé de deux<br />
petites ouvertures ce qui donne plus<br />
l’allure d’un espace sombre et fermé. Cet oratoire présente la particularité d’être<br />
couvert par <strong>des</strong> voutes en berce<strong>au</strong>x réalisées en maçonnerie de pierre.<br />
Mosquée d'Aguerd (Tamanart)<br />
Mosquée Tizegui ida Oubaloul<br />
(Tizrght)<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Mosquée d'Aygou<br />
Tigzmirt<br />
Timzguida Serb (Tlit)<br />
• La seconde phase est marquée par<br />
l’apparition de l’arc sous différentes formes<br />
mais surtout de l’arc plein cintre présentant<br />
parfois une brisure et souvent une<br />
imperfection dans l’exécution ainsi que <strong>des</strong><br />
rangées d’arca<strong>des</strong> pour soulever la charpente<br />
et donner à la salle <strong>des</strong> prières ce caractère<br />
d’ouverture indispensable pour un lieu de<br />
culte et de communion.<br />
Dans cette disposition un cas particulier<br />
fait l’exception à la tradition et mérite d’être<br />
souligné. Il s’agit de la mosquée Tichekji à<br />
Issafene où le plan à nefs parallèles <strong>au</strong> mur<br />
de la qibla est respecté mais avec<br />
l’introduction d’un certain nombre
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 85<br />
d’innovations qui en font un plan<br />
original. Ainsi l’ordonnancement<br />
<strong>des</strong> arca<strong>des</strong> nous permettent de<br />
déceler un plan cruciforme ce qui<br />
est à notre connaissance, un plan<br />
unique de son genre dans<br />
l’architecture religieuse de l’Islam<br />
en général et celle du <strong>Maroc</strong> en<br />
particulier.<br />
Malgré leur mo<strong>des</strong>tie, les salles<br />
<strong>des</strong> prières sont d’une be<strong>au</strong>té sobre<br />
Plan de la mosquée de Tichekji<br />
et discrète contenue dans la<br />
silhouette <strong>des</strong> arca<strong>des</strong> et la forêt de piliers multiformes qui se dressent <strong>au</strong> milieu et<br />
surtout dans les belles charpentes de bois qui les couronnent.<br />
2. <strong>Les</strong> courettes et les puits de lumière et d’aération<br />
Que ce soit <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> ou ailleurs, la<br />
cour à ciel ouvert ou le sahn occupe une<br />
place prépondérante dans l’architecture<br />
<strong>des</strong> mosquées. A Tata et en raison du<br />
climat désertique sévère de la région<br />
marqué essentiellement par la chaleur<br />
torride de l’été qui est le plus souvent<br />
accompagnée de tempêtes de vents et par<br />
un froid glacial l’hiver, ces oratoires sont<br />
Mosquée Aït Kine (Tagmout)<br />
presque fermés sur l’extérieur. On y<br />
accède le plus souvent par <strong>des</strong> allées couvertes qui permettent de réduire les effets<br />
néfastes de ces aléas climatiques. De ce fait, les cours spacieuses, organes<br />
indispensables pour l’éclairage, l’aération d’une mosquée et pour l’achèvement ou le<br />
renouvellement <strong>des</strong> ablutions rituelles pour les fidèles sont quasi inexistantes. Elles<br />
sont substituées par <strong>des</strong> courettes qui jouent plus le rôle de puits de lumière et<br />
d’aération. Ces espaces réduits qui ont <strong>des</strong> formes carrées ou rectangulaires, ne<br />
dépassent par dans les meilleurs cas quatre mètres de côté. L’exemple le plus<br />
significatif se trouve dans la mosquée d’Aït Kine à Tagmout qui représente l’unique<br />
exemple de sahn <strong>au</strong> sein de la salle <strong>des</strong> prières avec celui de la mosquée d’Aguerd qui<br />
est sous forme d’un espace découvert à l’entrée de la salle et qui permet la<br />
communication entre les différentes composantes de la mosquée. Ils se présentent sous<br />
forme de cours à ciel ouvert de forme presque carrée. A part ces deux cas, le reste <strong>des</strong><br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
85
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 86<br />
bâtiments présente un à deux puits de lumière et d’aération d’environ 2 m de côté et<br />
couverts de petites charpentes supportées par <strong>des</strong> piliers d’angles et se situant à un<br />
nive<strong>au</strong> plus h<strong>au</strong>t par rapport <strong>au</strong>x toitures de la mosquée pour permettre l’infiltration de<br />
l’air et de la lumière à travers <strong>des</strong> fenêtres rectangulaires. <strong>Les</strong> faça<strong>des</strong> de ces espaces<br />
d’éclairage et d’aération sont parfois ornées de frises décoratives en relief réalisées en<br />
stuc ou en plâtre et de corniches exécutées en dalles de pierre plates et en longrines de<br />
bois disposées sous forme de rangées de consoles. Le décor géométrique simple est<br />
amplifié par celui <strong>des</strong> charpentes traditionnelles savamment réalisées en bois peint<br />
dans le style local.<br />
3. Le muret en face du mihrab<br />
Cette structure qui se dresse curieusement <strong>au</strong> fonds de la salle <strong>des</strong> prières et qui se<br />
présente sous forme d’un muret reliant les deux piliers à côté du Mihrab et barrant par<br />
conséquent, l’ouverture de la travée axiale menant vers cette niche, se trouve dans la<br />
quasi-totalité <strong>des</strong> édifices recensés. Il s’agit d’un mur dont l’épaisseur est plus ou<br />
moins égale à celle <strong>des</strong> piliers sur lesquels il s’appuie, avec une h<strong>au</strong>teur ne dépassant<br />
pas les 70 cm. Il est construit dans les mêmes matéri<strong>au</strong>x que les éléments porteurs de<br />
la mosquée qui sont soit la brique de terre crue ou la maçonnerie de pierre jointe par<br />
un mortier de terre.<br />
Cette structure spécifique à cette région et inhabituelle dans les mosquées<br />
marocaines en générale, a pour fonction la délimitation de l’espace bordant le mihrab<br />
86<br />
Timzguida Aguerd Timzguida Amadagh Timzguida Iserghine<br />
Timzguida Aneghrif Timzguida<br />
Timzguida Aït Kine (Oum Lguerdane) Mosquée de Tichekji Ljamaa Aguerd<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 87<br />
qui représente le cœur de la mosquée et ce en vue de créer un espace de communion,<br />
où un nombre restreint de fidèles se réunissent pour la lecture du coran exploitant ainsi<br />
le muret pour s’y adosser. Une <strong>au</strong>tre fonction qui est venue s’ajouter par la suite à la<br />
première est que cette banquette est devenue une étagère de rangement <strong>des</strong> Corans et<br />
d’<strong>au</strong>tres outils liturgiques tels les chapelets et les galets qui servent <strong>au</strong>x ablutions<br />
spécifiques connues sous le nom de tayamoum.<br />
4. Le Mihrab<br />
Le mihrab est la niche <strong>des</strong>tinée à indiquer <strong>au</strong>x fidèles la direction de la qibla. <strong>Les</strong><br />
niches de mihrabs <strong>des</strong> mosquées inventoriées sont généralement, d’une composition<br />
simple affectant le plan <strong>des</strong> mihrabs à pans coupés. Elles varient entre la forme semicirculaire,<br />
pentagonale et hexagonale. La niche est souvent couverte d’une coupolette<br />
simple ou côtelée.<br />
Timzguida Tighremt Mosquée Zawiat Mawas Timzguida Agadir n<br />
(Alougoum) (Tlit) Tissint<br />
<strong>Les</strong> entrées <strong>des</strong> mihrabs sont généralement alignées avec le mur de la façade de la<br />
qibla s<strong>au</strong>f dans de rares cas où il est en en saillie par rapport à ce mur.<br />
<strong>Les</strong> faça<strong>des</strong> <strong>des</strong> mihrabs étudiés permettent de dégager un style de composition qui<br />
a été suivi par presque tous les maîtres artisans et qui a constitué une tradition dans<br />
l’architecture <strong>des</strong> mosquées de la région. Ce sont généralement <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> simples<br />
dont les traits princip<strong>au</strong>x sont l’ouverture de la niche qui se fait en arc plein cintre ou<br />
brisé parfois circonscrit d’une voussure en arc polylobé, festonné ou à lambrequin. Cet<br />
arc de petite dimension s’inscrit dans un cadre rectangulaire enduit de ch<strong>au</strong>x ou de<br />
plâtre, dont les écoinçons sont lisses. Le tout est englobé dans un ou plusieurs grands<br />
cadres rectangulaires bordés de moulurations et coiffés d’une série de petites niches<br />
aveugles ou ajourées, défoncés dans le mur et dont le nombre est le plus souvent trois.<br />
Une sorte de corniche faite de ban<strong>des</strong> moulurées, couvre le tout et se rapproche parfois<br />
de la forme d’un petit <strong>au</strong>vent coiffé d’une rangée de tuiles.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
87
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 88<br />
Certaines faça<strong>des</strong> de mihrab, bien qu’elles s’inscrivent par leurs traits princip<strong>au</strong>x<br />
dans le même style de composition, rompent complètement avec la simplicité qui<br />
caractérise la majorité de ces niches. C’est ainsi que nous assistons dans certains<br />
mihrabs tels que ceux de Fiferd (Aguinane) Imi n Tatelt (Ben Yaakoub) et Tiskmodine<br />
(Akka Ighane) à une profusion d’un décor polychrome à dominance géométrique et<br />
florale. Ce décor couvrant et peint sur enduit, présente dans certains cas <strong>des</strong><br />
inscriptions commémorant la date de construction ou de rénovation. Parfois c’est un<br />
décor en stuc sculpté fait d’une combinaison d’éléments géométriques et flor<strong>au</strong>x.<br />
5. La salle de prière <strong>des</strong> femmes<br />
A Tata ces salles annexes n’existaient pas à l’origine, ce<br />
qui prouve que les femmes, par tradition, ne se rendaient pas<br />
à la mosquée pour les prières communes. Pour leur<br />
permettre d’accomplir cet acte, elles sont maintenant<br />
admises à assister à la prière, séparément <strong>des</strong> hommes dans<br />
<strong>des</strong> endroits spéci<strong>au</strong>x qui leur sont réservés, et ce<br />
conformément <strong>au</strong>x principes de la loi musulmane. <strong>Les</strong> salles<br />
actuelles situées dans la partie arrière <strong>des</strong> mosquées ne sont<br />
que <strong>des</strong> aménagements récents. <strong>Les</strong> gens procèdent<br />
généralement à murer la dernière arcade pour isoler une partie de la nef arrière qui est<br />
affectée en salle <strong>des</strong> prières pour les femmes. Dans d’<strong>au</strong>tres cas, comme à Anghrife<br />
(commune Oum Elguerdane) et à Aït Harbil (commune Tamanarte) notamment, on a<br />
consacré <strong>des</strong> mosquées entières pour les femmes parce qu’elles sont devenues trop<br />
étroites pour accueillir un nombre croissant d’hommes.<br />
6. Le mihrab et la salle de prière d’été<br />
La anza est un panne<strong>au</strong> en bois <strong>des</strong>tiné, à l’instar du mihrab, à indiquer l’orientation<br />
de la qibla pour les fidèles qui font leurs prières dans le sahn, surtout pendant la saison<br />
88<br />
Mosqu2e de Fiferd Timzguida Imi n Tatelt Timzguida Tisekmodine<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Mosquée Lkesba<br />
(Issafene)
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 89<br />
estivale. D’habitude ce mobilier, placé face à la cour de la mosquée, à l’entrée de la<br />
salle de prière, s’accompagne d’une entaille qui est aménagé sur le seuil reliant le sahn<br />
à la nef axiale et épouse la même forme que la niche du mihrab.<br />
A Tata, ce dispositif n’existe pas et c’est la terrasse de la mosquée qui joue ce rôle<br />
surtout l’été pendant les deux dernières prières du soir. Peu d’aménagements sont<br />
généralement prévus pour donner à la terrasse cette fonction : d’abord un mur de<br />
clôture pour une question de sécurité <strong>des</strong> fidèles et un mihrab qui n’est en réalité qu’un<br />
reh<strong>au</strong>ssement de celui du nive<strong>au</strong> bas.<br />
Mosquée Aït Kine (Tagmout)<br />
II. La salle d’ablutions et ses annexes<br />
1. La salle d’ablutions et les latrines<br />
Mosquée Lkesba<br />
(Issafene)<br />
Du fait que le rituel de purification est un acte obligatoire pour la validité <strong>des</strong><br />
prières quotidiennes, la salle d’ablutions et les latrines sont <strong>des</strong> annexes quasiindispensables<br />
dans l’architecture <strong>des</strong> mosquées. A Tata, elles sont désignées par deux<br />
vocables : mida et dar al wdou et on les retrouve dans la totalité <strong>des</strong> mosquées<br />
recensées.<br />
La salle d’ablutions et les latrines sont <strong>des</strong> loc<strong>au</strong>x d’une importance majeure, ceci<br />
est prouvé par l’intérêt architectural qui leur est accordé et par la place et la superficie<br />
qu’elles occupent <strong>au</strong> sein de la mosquée. En effet, elles se présentent comme <strong>des</strong><br />
bâtiments indépendants, isolés <strong>des</strong> salles <strong>des</strong> prières et prennent <strong>des</strong> dispositions<br />
variées :<br />
• Dans la première catégorie qui est la plus dominante, le plan de cette salle est très<br />
simple. Il se réduit à une grande chambre rectangulaire dotée sur un ou deux de<br />
ses côtés, de latrines, tandis que le reste de l’espace est pourvu de banquettes sur<br />
lesquelles les gens s’installent pour achever leurs rituels.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
89
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 90<br />
90<br />
• Dans la seconde, cette salle est de plan plus ou moins carré et comporte une<br />
courette de même forme, occupée <strong>au</strong> centre par un bassin ou un puits et entourée<br />
de banquettes et par un ensemble de latrines de petites dimensions. Isolés du lieu<br />
de culte, ces loc<strong>au</strong>x prennent différentes positions par rapport <strong>au</strong>x salles <strong>des</strong><br />
prières, ils se situent soit en arrière de ces salles soit dans ses deux côtés latér<strong>au</strong>x.<br />
<strong>Les</strong> exemples les plus significatifs se trouvent dans les mosquées d’Aguerd et<br />
d’Ighir à Tamanarte<br />
Mosquée d'Ighir à Tamanarte<br />
• La troisième catégorie est de plan plus élaboré. Elle représente une phase plus<br />
évoluée du plan de la deuxième catégorie et rappelle par sa disposition ainsi que<br />
par ses techniques de construction et de couverture les midas <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
mosquées urbaines. Il s’agit d’un pavillon carré central couvert d’une coupole et<br />
qui s’ouvre <strong>des</strong> quatre cotés par <strong>des</strong> arcs. Ces ouvertures donnent sur une galerie<br />
qui se développe tout <strong>au</strong>tour de ce noy<strong>au</strong>. Elle est couverte de voûtes en berce<strong>au</strong>x<br />
qui se joignent dans les coins par <strong>des</strong> voûtes d’arrête ou de simples charpentes en<br />
bois. Sur une ou deux <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> internes sont percées <strong>des</strong> petites portes qui<br />
donnent accès <strong>au</strong>x latrines. Parmi les exemples représentatifs de cette catégorie on<br />
note la mosquée d’Adekhs à Aguinane et celle d’Agadir n Tissint.<br />
• La quatrième disposition est la plus<br />
remarquable sur le plan architectural et<br />
la plus étonnante par la position<br />
qu’occupent les loc<strong>au</strong>x d’ablutions <strong>au</strong><br />
sein de la mosquée. Dans cet ordre, la<br />
salle est de plan rectangulaire avec <strong>des</strong><br />
dimensions très importantes atteignant<br />
parfois et dépassant même ceux de<br />
l’oratoire comme est le cas à Imi Timzguida Oum Lahnech<br />
Ougadir (commune de Fam Lhissne). La salle est traversée en longueur par <strong>des</strong><br />
arcs élevés qui servent d’arcs de décharge supportant les toitures. L’une de ses<br />
faça<strong>des</strong> internes est occupée par une série de latrines tandis que dans l’<strong>au</strong>tre côté<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 91<br />
est aménagé le puits qui alimente la<br />
mosquée en e<strong>au</strong>. Au milieu coure une<br />
rigole de collecte et d’évacuation <strong>des</strong><br />
e<strong>au</strong>x usées. <strong>Les</strong> cas représentatifs de ce<br />
mode d’ordonnancement ne sont pas<br />
nombreux. Quatre exemples ont été<br />
identifiés à Fam Lhissn, à Tlit et à<br />
Alougoum. Deux d’entre eux prennent<br />
une position normale <strong>au</strong> nord de la Timzguida Tighremt<br />
mosquée, alors que les deux <strong>au</strong>tres occupent curieusement la façade externe sud<br />
et se trouvent par cette situation accolées <strong>au</strong> mur de la qibla et incorporant <strong>au</strong> sein<br />
d’elles la niche du mihrab et celle du minbar.<br />
Mosquée d'Oum Lhnech Mosquée d'Amtzguine Mosquée de Tighremt<br />
2. Autres structures annexes<br />
2.1. Akherbich :<br />
C’est un local contigu à la salle d’ablutions où l’e<strong>au</strong> est ch<strong>au</strong>ffée pour les besoins<br />
de purification du corps avant d’entamer la prière. Le bâtiment affecte la forme d’un<br />
carré ou d’un rectangle <strong>au</strong> centre duquel est aménagé le foyer à un nive<strong>au</strong> plus bas par<br />
Mosquée d'Ighir Mosquée d'Aningue (Akka Ighane)<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
91
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 92<br />
rapport <strong>au</strong> sol et qui prend une forme carrée ou circulaire. Juste <strong>au</strong> <strong>des</strong>sus est<br />
suspendue tafedna ou anas, grand récipient en cuivre attaché <strong>au</strong>x poutres de la<br />
charpente et doté d’une grande louche dont se servent les fidèles désireux de se<br />
purifier, pour puiser l’e<strong>au</strong> ch<strong>au</strong>de. Dans l’un <strong>des</strong> coins de cette pièce sont stockés <strong>des</strong><br />
tas de bois. De nos jours la plupart de ces loc<strong>au</strong>x ne sont plus fonctionnels et le système<br />
de ch<strong>au</strong>ffage traditionnel est presque partout remplacé par un <strong>au</strong>tre plus moderne à gaz.<br />
92<br />
2.2. Le puits :<br />
Pour assurer l’alimentation de la mosquée en e<strong>au</strong><br />
suffisante, les membres de la commun<strong>au</strong>té procèdent le plus<br />
souvent <strong>au</strong> creusement d’un puits <strong>au</strong>x alentours de la mosquée<br />
et de préférence tout près <strong>des</strong> lieux consacrés <strong>au</strong>x ablutions. Le<br />
puisage de l’e<strong>au</strong> se fait de la façon la plus simple par le biais<br />
d’un se<strong>au</strong> tiré à la main ou à l’aide d’une poulie.<br />
2.3. La citerne (metfiya)<br />
A déf<strong>au</strong>t d’une source d’approvisionnement en e<strong>au</strong>, les gens ont recours à<br />
l’aménagement de gran<strong>des</strong> citernes où sont stockées de<br />
gran<strong>des</strong> quantités d’e<strong>au</strong>x. Ces dernières proviennent<br />
soit <strong>des</strong> pluies collectées <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> terrasses et<br />
conduites à l’aide de canalisations, soit <strong>au</strong> moyen de<br />
seguias qui acheminent l’e<strong>au</strong> depuis les sources.<br />
Mosquée Lkesba<br />
Ces structures hydr<strong>au</strong>liques creusées profondément<br />
dans le sol, sont de forme rectangulaire et sont<br />
parfois pourvues de petits bassins de décantation. Elles sont couvertes soit de dalles<br />
traditionnelles ou de voutes en berce<strong>au</strong> maçonnées en pierre.<br />
2.4. Le bassin<br />
C’est une structure hydr<strong>au</strong>lique découverte sise à<br />
l’intérieur de la salle <strong>des</strong> ablutions mais qui n’existe pas<br />
dans toutes les mosquées. Elle est remplie d’e<strong>au</strong> froide<br />
dont peuvent se servir les fidèles pour les besoins de<br />
purification du corps. Elle est alimentée soit à partir du<br />
puit et de la citerne qui se trouvent juste à côté ou<br />
directement par le biais d’un seguia quant la mosquée se<br />
situe à un nive<strong>au</strong> plus bas du douar.<br />
Ce bassin généralement de dimensions réduites, est de forme rectangulaire ou carrée.<br />
Il est aménagé à un nive<strong>au</strong> plus bas du sol. Sa maçonnerie est couverte d’une couche<br />
imperméable réalisée en mortier de ch<strong>au</strong>x.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Mosquée d'Aït Taleb<br />
Mosquée d'Amtzguine
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 93<br />
III. <strong>Les</strong> masses architecturales :<br />
1. <strong>Les</strong> minarets<br />
Le minaret localement connu sous le nom de tassoumaat, est une masse<br />
architecturale <strong>des</strong>tinée à l’appel <strong>des</strong> fidèles pour les cinq prières du jour.<br />
Dans les oratoires historiques de Tata, les minarets sont rares. <strong>Les</strong> quelques<br />
spécimens inventoriés lors <strong>des</strong> trav<strong>au</strong>x de terrain ne dépassent pas quatre : on trouve<br />
la fameuse tour tronquée de la Kasba de sidi Abdellah ben Mbarek, celle de Rehala et<br />
sa voisine de douar Zaouia qui se trouvent toutes non loin d’Akka et enfin celle<br />
d’Aguerd à Tamanarte.<br />
Minaret d'al kasbah (Akka)<br />
Cette rareté peut s’expliquer par le non besoin d’avoir recours à ces tours pour<br />
l’appel à la prière en raison de l’exiguïté de l’espace <strong>des</strong> villages et de la faible h<strong>au</strong>teur<br />
<strong>des</strong> bâtiments environnants, ce qui permet <strong>au</strong> muezzin de faire appel à la prière sans<br />
risque de ne pas être entendu par les habitants <strong>des</strong> différents coins de la localité.<br />
<strong>Les</strong> quatre minarets recensés sont de style maroco-andalous et s’inscrivent par<br />
conséquent dans la tradition <strong>des</strong> minarets marocains. De plans carrés ils se composent<br />
de la tour proprement dit qui est surmontée d’un lanternon. L’accès <strong>au</strong> sommet du<br />
minaret se fait par le biais d’un escalier qui se développe <strong>au</strong>tour d’un pilier central<br />
massif réalisé en solide maçonnerie de pierre.<br />
<strong>Les</strong> deux minarets d’Akka sont construits en en brique de terre cuite jointes par un<br />
mortier riche en ch<strong>au</strong>x, celui de Douar Zaouïa en brique de terre crue alors que celui<br />
d’Aguerd est exclusivement réalisé en maçonnerie de pierre.<br />
2. <strong>Les</strong> faça<strong>des</strong> et les portes d’entrées<br />
Mosquée de Rehala<br />
(région d'Akka)<br />
En l’absence <strong>des</strong> minarets, les mosquées se distinguent et se reconnaissent <strong>au</strong> sein<br />
<strong>des</strong> douars par leurs faça<strong>des</strong> principales et leurs portes d’entrées qui sont généralement<br />
d’une allure monumentale et conçues dans de gran<strong>des</strong> proportions et de très belles<br />
compositions architecturales et décoratives.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
93
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 94<br />
Au nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> portes on note une grande variété<br />
de styles bien qu’elles s’inspirent toutes du modèle<br />
de la porte urbaine marocaine. Il s’agit en général<br />
de structures monumentales érigées sur <strong>des</strong><br />
h<strong>au</strong>teurs dépassant parfois les six mètres. L’accès<br />
se fait généralement par <strong>des</strong> ouvertures en arcs<br />
Mosquée Aït Taleb (Allougoum)<br />
plein cintre ou <strong>des</strong> ouvertures à linte<strong>au</strong>x,<br />
circonscrits de voussures de mêmes formes ou polylobés et à lambrequins. Ils sont tous<br />
inscrits dans <strong>des</strong> cadres rectangulaires et surmontés de frises composées de niches<br />
aveugles, d’arcatures de types variés et d’éléments architectoniques en relief à caractère<br />
décoratif, soit taillés dans la pierre ou exécutés en stuc ou en mortier de ch<strong>au</strong>x. Le tout<br />
est coiffé de corniches à bande<strong>au</strong>x moulurées ou de cadres remplis de motifs<br />
géométriques recticurvilgnes communément connus sous le nom de ktef w derj que<br />
couvrent en fin de compte <strong>des</strong> charpentes ou <strong>des</strong> <strong>au</strong>vents de formes diverses (consoles<br />
de bois avec arases de pierre ou maçonnerie en saillie, rangées de tuiles vertes…)<br />
Pour ce qui est <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> principales, la plupart d’entre elles sont réalisées dans<br />
une belle maçonnerie de pierre parfois taillée. Certaines sont de proportions<br />
remarquables comme celle de Tighremt à Alougoum qui présente <strong>au</strong> milieu <strong>des</strong><br />
rangées d’arcatures que coiffe une corniche de pierre supportée par <strong>des</strong> consoles<br />
taillées dans le même matéri<strong>au</strong>.<br />
3. <strong>Les</strong> coupoles et les voûtes<br />
Be<strong>au</strong>coup plus utilisés dans l’architecture funéraire (koubba et zaouïa) et les<br />
ouvrages hydr<strong>au</strong>liques (citernes et metfiyas), les coupoles et les voûtes sont <strong>des</strong> masses<br />
architecturales d’usage rare dans l’architecture <strong>des</strong> mosquées de la région. Cinq<br />
édifices seulement parmi ceux recensées disposent de ce type de couvertures qu’on ne<br />
trouve que dans les salles d’ablutions, s<strong>au</strong>f dans l’unique cas précédemment signalé de<br />
la mosquée d’Aygou (commune Tigzmirt) où les nefs sont couvertes de voûtes en<br />
berce<strong>au</strong>x et <strong>au</strong>ssi dans l’exceptionnelle mosquée de Tichekji dont le centre de la salle<br />
<strong>des</strong> prières est couvert d’une coupolette atypique.<br />
94<br />
Timezguida Adekhs Timzguida Tazart Timzguida<br />
Mosquée d'Aguejgal (Aguinane) (Oum Lguerdane) Tisekmodine<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 95<br />
<strong>Les</strong> coupoles ont <strong>des</strong> formes variées<br />
allant de l’octogonale à l’ovoïde en passant<br />
par la forme circulaire. Elles reposent toutes<br />
sur <strong>des</strong> bases carrées ou rectangulaires et le<br />
passage vers la forme de coupole se fait à<br />
partir de la base par le biais de trompes en<br />
niches ou par le moyen de traverses en bois<br />
qui coupent les quatre angles pour permettre<br />
cette transition. Ces masses architecturales<br />
sont toutes construites en maçonnerie de<br />
pierres jointes par un mortier richement dosé<br />
en ch<strong>au</strong>x et protégée par une couche d’enduit à base de ce liant.<br />
La forme de voûtes la plus<br />
dominante est celle en berce<strong>au</strong>x qui<br />
couvre les galeries entourant les coupoles<br />
<strong>des</strong> salles d’ablutions et exceptionnellement<br />
les nefs de la mosquée<br />
d’Aygou. Ces couvertures sont<br />
bâties en maçonnerie de pierre liée<br />
par un mortier de ch<strong>au</strong>x et enduites<br />
<strong>au</strong>ssi d’un crépi à base de ch<strong>au</strong>x.<br />
4. <strong>Les</strong> charpentes traditionnelles<br />
Coupole de la salle d'ablutions<br />
(Mosquée de Tissint)<br />
Mosquée d'Adekhs<br />
Salle d'ablutions<br />
de Tghit (Tissint)<br />
Mosquée d'Adekhs Salle d'ablutions de Tghit<br />
Si les charpentes jouent un rôle primordial en tant que structures porteuses <strong>des</strong> toits<br />
<strong>des</strong> mosquées, elles contribuent fortement en outre, à l’ornementation de ces espaces où<br />
règne la simplicité conformément <strong>au</strong>x principes rigoureux de la religion musulmane.<br />
Bien qu’elles s’inscrivent dans un style connu localement sous le nom de Tataoui, ces<br />
ossatures en bois présentent une grande variété que ce soit <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> formes, <strong>des</strong><br />
dispositions <strong>des</strong> éléments en bois ou sur le plan de la décoration qui leur est appliquée.<br />
La charpente traditionnelle de style local est généralement faite dans plusieurs essences<br />
de bois mais le palmier reste très dominant. Elle se compose <strong>des</strong> éléments suivants :<br />
• <strong>Les</strong> poutres (lqendert) qui sont de gran<strong>des</strong> longrines en bois qui supportent de<br />
gran<strong>des</strong> charges. Ici ce sont les troncs de palmiers entiers aiguisés qui jouent ce rôle.<br />
• <strong>Les</strong> solives (tasatourt) qui sont <strong>des</strong> sortes de chevrons qui comblent le vide entre<br />
les poutres. Elles sont obtenues à travers le découpage longitudinal <strong>des</strong> troncs en<br />
plusieurs éléments.<br />
• Le voligeage est généralement fait de petits rondins de l<strong>au</strong>rier rose, de fragments<br />
de bois de palmiers ou de rose<strong>au</strong>x.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
95
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 96<br />
Concernant les formes attribuées par les maîtres artisans à ces couvertures, elles<br />
sont variables. Cependant la forme rectangulaire de charpente allongée qui épouse le<br />
plan <strong>des</strong> nefs est la plus caractéristique. Celle de la mosquée de Tichekji déroge à la<br />
règle et l’on trouve <strong>des</strong> charpentes carrées et d’<strong>au</strong>tre en forme de U longeant le mur de<br />
clôture et circonscrivant la moitié de l’oratoire.<br />
Concernant leurs techniques d’exécution, on note deux procédés majeurs <strong>au</strong> sein<br />
<strong>des</strong>quels se trouvent plusieurs variantes :<br />
96<br />
Timzguida<br />
Mosquée<br />
Timzguida Tighremt Mosquée d'Aygou<br />
Aït Wareh d'Assa (Tagmout)<br />
• Le premier qui est le plus dominant se caractérise par <strong>des</strong> solives entre lesquels<br />
s’enchevêtrent d’une belle manière <strong>des</strong> voliges en bois de l<strong>au</strong>rier, <strong>des</strong> bûches<br />
taillées de palmier sous plusieurs formes ou <strong>des</strong> tiges de rose<strong>au</strong>x. Le tout est peint<br />
de couleurs où dominent l’ocre, le noir, le j<strong>au</strong>ne et le blanc, ce qui offre une<br />
décoration sous forme de tapis géométriques polychromes.<br />
• Le second style qui est rare et qu’on ne trouve que dans quelques oratoires,<br />
notamment à Timzguida afella sise à douar Assa (Tagmout) et surtout dans la<br />
mosquée Tichekji (Issafene). Dans ce modèle le voligeage est sous forme de<br />
planches de bois que portent <strong>des</strong> solives de bois massifs et équarries en vue de<br />
leur donner <strong>des</strong> formes géométriques carrées ou rectangulaires. <strong>Les</strong> deux<br />
éléments sont couverts de motifs géométriques, flor<strong>au</strong>x et parfois épigraphiques<br />
gravés ou peints.<br />
Le type de charpente Mosquée d'Afouzar<br />
le plus dominant Mosquée de Fiferd (Ben Yaakoub)<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 97<br />
Pour assurer leur imperméabilité surtout pendant les saisons pluviales, ces plafonds<br />
de bois sont couverts de couches de tout-venant et de terre argileuse. Ces dernières sont<br />
arrosées et damées puis recouvertes d’une <strong>au</strong>tre chape de terre présentant une grande<br />
quantité de minerais qui une fois sèche et solidifiée, offre une toiture étanche.<br />
IV. Le mobilier <strong>des</strong> oratoires<br />
1. Le mobilier liturgique<br />
Mosquée d'Agmour<br />
(Ben Yaakoub) Mosquée d'Aygou<br />
Il se compose essentiellement <strong>des</strong> minbars qui représentent le<br />
mobilier indispensable pour les mosquées où a lieu la prière du<br />
vendredi. Cette dernière se tenait jadis, dans la quasi-totalité <strong>des</strong><br />
mosquées recensées.<br />
Le minbar est une chaire élevée et mobile à partir de laquelle<br />
l’imam s’adresse <strong>au</strong>x fidèles et prononce le prêche du vendredi.<br />
Elle est habituellement rangé dans un réduit aménagé dans le<br />
mur de la qibla, et n’apparaît dans la salle de prière que ce jour.<br />
Mosquée Aït Wareh<br />
Peu de minbars ont échappé <strong>au</strong> trafic illicite <strong>des</strong> objets<br />
d’art très actif dans la région. Le nombre de ce genre de<br />
mobilier très prisé par les collectionneurs et les trafiquants<br />
n’est <strong>au</strong>jourd’hui que de cinq, tous réalisés dans un style<br />
simple et présentant une décoration qui s’inspire du<br />
registre artistique local qu’on découvre dans les portes en<br />
bois. En effet, on note sur les deux faces latérales et sur le Mosquée Aït Kine<br />
sommet de l’ouvrage la profusion d’un décor géométrique<br />
et floral polychrome et peint dont le tracé directeur est visible sur bois. En outre certains<br />
d’entre eux portent <strong>des</strong> inscriptions réalisées dans un style cursif (naskhi maghribi)<br />
commémorant généralement le premier jour de sa mise en service dans la mosquée.<br />
Conformément à la tradition marocaine, les minbars <strong>des</strong> oratoires de Tata sont tous<br />
transportables et faits en bois massif.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
97
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 98<br />
2. <strong>Les</strong> portes en bois<br />
Outre leurs fonctions évidentes<br />
d’éléments de clôture et de fermeture<br />
de ces espaces sacrées qui sont les<br />
mosquées, les portes en bois ouvragé et<br />
peint concourent <strong>au</strong>ssi à leur Mosquée Lkesba Timzguida Timqit (issafene)<br />
embellissement par une combinaison<br />
de décor géométrique et floral <strong>des</strong>siné, peint ou gravé. Ces motifs décoratifs s’inspirent<br />
du répertoire artistique dans lequel puisent les artisans du sud marocain qui s’étend<br />
depuis le H<strong>au</strong>t Atlas jusqu’<strong>au</strong>x piémonts sud-est de l’Anti-Atlas.<br />
Malheureusement ces vent<strong>au</strong>x en bois richement décorés constituent <strong>des</strong> pièces<br />
d’art très convoitées par les collectionneurs, ce qui fait que peu d’oratoires conservent<br />
encore leurs portes d’origine.<br />
V. <strong>Les</strong> matéri<strong>au</strong>x et les techniques de construction et de<br />
décoration<br />
Dans cette région semi désertique du sud-est marocain qui procure <strong>au</strong>x maîtres<br />
maçons, artisans et décorateurs un large choix <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x nécessaires et<br />
adaptés à la construction locale, l’usage est si hétérogène qu’on ne peut rattacher ces<br />
architectures seulement à la terre ou à la pierre et à tel point que d’un douar à l’<strong>au</strong>tre<br />
le matéri<strong>au</strong> de base et les techniques de construction mises en œuvre changent ou<br />
coexistent <strong>au</strong> sein d’un même édifice.<br />
Ce constat est valable pour l’architecture <strong>des</strong> mosquées historiques étudiées où l’on<br />
remarque dans le système constructif l’usage <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x et <strong>des</strong> techniques suivants<br />
:<br />
98<br />
• Le pisé ou la tabiya qui obéit <strong>au</strong>x mêmes principes de cette tradition architecturale<br />
et de ce savoir-faire très enracinés dans le sud marocain. C’est un mélange de terre<br />
creusée sur les lieux du chantier, arrosée puis damée dans un coffrage de bois<br />
ayant les dimensions d’un pan de mur. <strong>Les</strong> banchés se succèdent ensuite et<br />
s’alternent jusqu’à l’érection de la structure de la bâtisse. La tabiya est surtout<br />
utilisée dans les murs de clôture de certains édifices. Pour éviter les effets néfastes<br />
<strong>des</strong> e<strong>au</strong>x de ruissellements et ceux <strong>des</strong> remontées capillaires, les constructeurs de<br />
murs en pisé recourent fréquemment, à la mise en place de soubassements soli<strong>des</strong><br />
en maçonnerie de pierre.<br />
• La pierre est utilisée sous plusieurs formes et calibres bien que le moellon brut ou<br />
dégrossi est le plus courant chez les constructeurs <strong>des</strong> murs et <strong>des</strong> arcs qui en font<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 99<br />
de la maçonnerie jointe avec un<br />
mortier de terre ou de ch<strong>au</strong>x et ou les<br />
lits sont disposés horizontalement.<br />
Parfois la pierre est noyée dans le<br />
béton de ch<strong>au</strong>x surtout quand il<br />
s’agit d’ériger <strong>des</strong> voûtes ou <strong>des</strong><br />
coupoles. On trouve également la<br />
Mosquée<br />
Aït Taleb<br />
pierre calcaire ou schisteuse plate utilisée sous forme d’arases ou de dalles<br />
soigneusement superposées avec ou sans mortier pour constituer <strong>des</strong> parements<br />
de murs ou <strong>des</strong> corniches coiffant les édifices et les masses architecturales. La<br />
pierre de taille n’intervient que rarement dans les faça<strong>des</strong> ou dans les chaînages<br />
d’angles <strong>des</strong> édifices.<br />
• La brique de terre crue : Ce matéri<strong>au</strong> réalisé<br />
localement avec de la terre arrosée et malaxée à la<br />
paille puis damée dans <strong>des</strong> gabarits fabriqués en bois<br />
à cet effet. La brique est séchée avant d’être utilisée<br />
dans la maçonnerie où elle est liée avec un mortier<br />
de terre. Ce matéri<strong>au</strong> est surtout utilisé dans<br />
l’érection <strong>des</strong> arcs et <strong>des</strong> piliers ainsi que <strong>des</strong> murs de cloison.<br />
• La brique de terre cuite : Elle est d’un usage très<br />
limité. <strong>Les</strong> deux seuls édifices témoins de son<br />
utilisation sont le minaret de la Kasba de Sidi<br />
Abdellah ben Mbarek et celui de Rehala dans la<br />
région d’Akka. C’est un matéri<strong>au</strong> très solide et bien<br />
cuit qui une fois incorporé à un liant de ch<strong>au</strong>x, offre<br />
une masse architecturale homogène et très solide.<br />
Mosquée de Mawas<br />
Minaret d'al Kasbah<br />
construit en brique cuite<br />
• Le bois est un matéri<strong>au</strong> d’une très grande valeur<br />
architecturale. Il est utilisé dans la construction <strong>des</strong><br />
mosquées. Outre son large usage dans la fabrication<br />
<strong>des</strong> charpentes traditionnelles, il est utilisé comme<br />
élément de support. Ainsi il sert de linte<strong>au</strong> <strong>au</strong> <strong>des</strong>sus<br />
<strong>des</strong> ouvertures et de poutre porteuse de charges à la<br />
place <strong>des</strong> piliers. Il est <strong>au</strong>ssi<br />
Timzguida Timqit (Issafene)<br />
employé sous forme de<br />
sommiers supportant les<br />
départs <strong>des</strong> arcs et amortissant<br />
la charge provoquée par le<br />
poids <strong>des</strong> arca<strong>des</strong> et <strong>des</strong><br />
Timzguida imzguida Illigh Illigh Mosquée Mosquée Tichekji Tichekji<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
99
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 100<br />
100<br />
dalles. On fabrique également avec ce matéri<strong>au</strong> <strong>des</strong> consoles et <strong>des</strong> <strong>au</strong>vents qui<br />
abritent les portes principales. Le bois est utilisé par les constructeurs <strong>des</strong><br />
mosquées dans une technique ingénieuse de stabilisation de la structure et <strong>des</strong><br />
arca<strong>des</strong> de la bâtisse par l’ancrage d’une série de longrines entre les rangées<br />
d’arca<strong>des</strong>.<br />
Le décor <strong>des</strong> mosquées, malgré la simplicité <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x mis en œuvre, puise ses<br />
sources d’inspiration dans le riche répertoire artistique du sud marocain. Ainsi, outre<br />
les charpentes traditionnelles en bois savamment enchevêtrés et richement peints et<br />
décorés qui ornent les salles <strong>des</strong> prières, l’essentiel du décor est fait d’éléments<br />
géométriques et flor<strong>au</strong>x tracés et/ou peints en ocre sur enduit, gravés sur les vent<strong>au</strong>x<br />
<strong>des</strong> portes et les panne<strong>au</strong>x <strong>des</strong> minbars en bois ou exécutés en plâtre et en stuc sur les<br />
faça<strong>des</strong> principales et les registres <strong>des</strong> mihrab.<br />
D’<strong>au</strong>tres composantes du décor sont faites d’éléments architectoniques en pierre ou<br />
en bois taillés (consoles, corniches, frises …) ou en maçonnerie. On trouve <strong>au</strong>ssi <strong>des</strong><br />
compositions décoratives en brique de terre cuite à l’image <strong>des</strong> motifs recticurvilignes<br />
qui ornent les faça<strong>des</strong> du minaret d’Akka.<br />
Conclusion<br />
Ce travail d’inventaire a démontré que nos connaissances sur le patrimoine<br />
architectural religieux du monde rural marocain sont faibles et que ce patrimoine<br />
souvent qualifié de mineur, recèle <strong>des</strong> chefs d’œuvre incomparables et un savoir faire<br />
de valeur inestimable qui méritent toute l’attention de la part <strong>des</strong> chercheurs et <strong>des</strong><br />
spécialistes.<br />
<strong>Les</strong> premières analyses comparatives entre les bâtiments religieux étudiés montrent<br />
que ces oratoires rur<strong>au</strong>x présentent <strong>des</strong> éléments et <strong>des</strong> traits communs qu’on retrouve<br />
dans l’architecture locale et qui perpétuent une tradition architecturale islamique très<br />
ancienne <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>. Elles font ressortir <strong>des</strong> dispositions et <strong>des</strong> compositions<br />
architecturales et décoratives remarquables.<br />
Il s’agit généralement de simples petites mosquées, souvent dépourvus de décors<br />
mais présentant parfois une belle parure surtout <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> du mihrab, <strong>des</strong> toitures et<br />
<strong>des</strong> faça<strong>des</strong> d’entrée. Ces oratoires sont tous dotés de nefs parallèles <strong>au</strong> mur de la qibla<br />
et de rangées d’arca<strong>des</strong> composées d’arcs plein cintre parfois brisés reposant sur <strong>des</strong><br />
piliers de formes variées. Une disposition qui nous rappelle celle <strong>des</strong> premières<br />
mosquées marocaines, notamment celles de Fès. La tradition locale est omniprésente<br />
surtout <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>des</strong> techniques et <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x de construction mis en œuvre<br />
(arca<strong>des</strong> en briques de terre crue, murs en pisé, charpente de style Tataoui…) mais<br />
surtout par l’intégration d’un certain nombre d’éléments origin<strong>au</strong>x tel le muret reliant<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 101<br />
les deux piliers faisant face à la niche du mihrab. Cependant le caractère le plus<br />
frappant reste l’importance accordée <strong>au</strong>x salles d’ablutions qui sont parfois de<br />
dimensions très importantes et occupent <strong>des</strong> positions curieuses <strong>au</strong> sein <strong>des</strong> mosquées.<br />
Des dispositions qui s’avèrent typiques à cette région de Tata à moins que l’extension<br />
du champ de la recherche vers les régions environnantes, notamment vers les provinces<br />
de Guelmim, Zagora et Chtouka Aït Baha, ne prouve le contraire. A quelques<br />
exceptions près, on note dans la quasi-totalité de ces oratoires rur<strong>au</strong>x l’absence de<br />
minarets et de cours. Ces dernières sont remplacées par de petites courettes qui font le<br />
plus souvent office de puits de lumières et d’aération.<br />
Bien qu’elles prennent la forme de petits oratoires, la majorité de ces lieux de culte<br />
rur<strong>au</strong>x jouaient le rôle de mosquées à khotba (à prône) où se tenaient la prière et le<br />
prêche du vendredi. Certains ont cessé de jouer ce rôle en raison de l’absence de nos<br />
jours, dans les douars, de l’effectif minimal de fidèles fixé à 12 et exigé par la charia<br />
pour que cette prière puisse avoir lieu.<br />
La majorité d’entre eux sont toujours fonctionnels alors que certains sont en état<br />
d’abandon et ont cédé la place à <strong>des</strong> édifices modernes qui rompent complètement<br />
avec une tradition architecturale séculaire. Ce phénomène ne fait pas l’unanimité <strong>des</strong><br />
habitants <strong>des</strong> douars dont certains refusent de prier dans ces nouve<strong>au</strong>x oratoires.<br />
Toutefois, malgré cet attachement jaloux <strong>des</strong> <strong>au</strong>tochtones à ces anciennes structures<br />
villageoises traditionnelles, on note un délaissement et une négligence qui font que<br />
plusieurs oratoires finissent par se réduire en décombres. Ceci sans oublier l’état du<br />
mobilier (portes, charpentes, minbars…) qui est proie <strong>au</strong> vandalisme et un trafic illicite<br />
systématique qui ne cesse de s’amplifier dans la région.<br />
Ce patrimoine culturel et cultuel en partie vivant nous interpelle tous <strong>au</strong>jourd’hui,<br />
surtout que cette tradition architecturale bien ancrée dans l’histoire qui tire ses<br />
caractères <strong>des</strong> origines de l’architecture religieuse <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong> et qui porte la marque de<br />
la spécificité locale, se trouve <strong>au</strong>jourd’hui menacée de disparition en raison de<br />
plusieurs facteurs. Ce constat alarmant incite tous les acteurs loc<strong>au</strong>x et les<br />
départements concernés (Ministère de la culture, Ministère <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong> affaires<br />
islamiques…) à conjuguer leurs efforts afin de réfléchir sur les modalités de<br />
s<strong>au</strong>vegarde, de préservation et de transmission de ce patrimoine architectural et de ce<br />
savoir-faire ancestral <strong>au</strong>x générations futures ainsi que sur les possibilités qui s’offrent<br />
en vu de les mettre en valeur et de les exploiter de manière rationnelle dans le<br />
développement d’un tourisme culturel durable.<br />
L'architecture <strong>des</strong> mosquées rurales dans la région de Tata<br />
101
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:46 Page 102<br />
Bibliographie :<br />
- Golvin Lucien, Essai sur l’architecture musulmane, Tome 4, Archéologie<br />
Méditerranéenne V, Editions Klincksieck, Paris, 1979.<br />
- Marçais George, L’architecture musulmane d’Occident, Arts et métiers graphiques,<br />
Paris, 1954.<br />
- Mohamed Belatik, Mustapha Atki et Mostapha Nami, Rapports <strong>des</strong> missions<br />
d’inventaire du patrimoine culturel dans la province de Tata (2003-04-05-06-07),<br />
Centre d’inventaire et de documentation du patrimoine, Ministère de la culture.<br />
102<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 103<br />
UN PATRIMOINE SACRÉ EN PÉRIL :<br />
LES PETITS ORATOIRES, MOSQUÉES ET ZAWYAS<br />
DU SUD MAROCAIN<br />
Proposition d’une méthode d’intervention<br />
1<br />
Salima Naji,<br />
architecte DPLG & anthropologue EHESS<br />
Dans Qsar Chorfa (Rissani) la mosquée<br />
originelle, pourtant très vaste et très<br />
belle a été simplement détruite pour être<br />
refaite en une vulgaire salle en ciment<br />
peint sans ornementation. Le petit<br />
minaret pyramidal, a cédé la place à un<br />
prétentieux minaret de 14 m imitant<br />
ceux de Casablanca, qui défigure<br />
l’édifice.<br />
<strong>Les</strong> mosquées en milieu rural, et plus particulièrement dans le Sud marocain, ne sont<br />
pas de simples lieux de culte. <strong>Les</strong> lieux saints sont porteurs de pratiques et de<br />
spécificités architecturales liées à la culture immatérielle et intangible qu’il importe de<br />
préserver. Or actuellement, l’acte de rest<strong>au</strong>ration est souvent animé d’une volonté<br />
nouvelle de niveler, d’uniformiser et <strong>au</strong> final de détruire l’identité locale <strong>au</strong> nom de la<br />
modernisation <strong>des</strong> lieux de culte.<br />
Dans ce Qsar de la région de Rissani (Légende photographie 1) la mosquée<br />
originelle, pourtant très vaste et très belle, dotée d’un impressionnante salle hypostyle,<br />
a été détruite pour être reconstruite sous la forme d’une simple salle en ciment, mal<br />
éclairée, mal ventilée, effaçant toute la majesté du lieu de culte originel. Le très be<strong>au</strong><br />
mihrab originel et le puits de lumière central n’ont hélas pas été conservés. Enfin, le<br />
petit minaret pyramidal, a cédé la place à une prétentieuse tour de 14 m imitant certains<br />
minarets de Casablanca, pour satisfaire l’orgueil <strong>des</strong> commanditaires sans respecter<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
103
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 104<br />
l’échelle du lieu. Cette mosquée est représentative d’un mouvement qui est<br />
actuellement constaté un peu partout dans le Roy<strong>au</strong>me : une frénésie agite de généreux<br />
donateurs pour «moderniser» <strong>des</strong> édifices parfois multiséculaires. A chaque fois, la<br />
même ignorance de la qualité architecturale de ces édifices et de leur valeur historique,<br />
accompagnent ces hâtives rénovations. Il suffit pourtant de sensibiliser <strong>au</strong>x spécificités<br />
architecturales <strong>des</strong> mosquées régionales pour éviter ces navrantes <strong>des</strong>tructions. Il f<strong>au</strong>t<br />
réfléchir à ce que signifie «moderniser un édifice sacré». L’utilisation de nouve<strong>au</strong>x<br />
matéri<strong>au</strong>x et de formes exogènes non maîtrisées se traduit, trop souvent, par une perte<br />
de confort, d’hygiène, de mémoire et bien sûr de spiritualité.<br />
Constat premier : <strong>des</strong> <strong>des</strong>tructions hâtives<br />
Et parce qu’il est devenu urgent de s<strong>au</strong>ver <strong>des</strong> édifices remarquables (Zawya,<br />
massajîd et darih awliya) souvent ultimes témoignages d’une longue et riche histoire<br />
religieuse, nous proposons une méthode de rest<strong>au</strong>ration adaptée à ces édifices et<br />
respectueuse du patrimoine spirituel. Rest<strong>au</strong>rer est différent de rénover : lorsque l’on<br />
rest<strong>au</strong>re, on restitue l’édifice dans ses formes et ses procédés originels ; lorsque l’on<br />
rénove, on ne conserve souvent qu’une partie du gabarit et l’on malmène l’édifice qui<br />
perd toute spécificité : formes et mémoires contenues dans les vieux murs est<br />
définitivement effacée.<br />
Outre le fait que rest<strong>au</strong>rer permet de conserver <strong>des</strong> lieux uniques, d’un grand intérêt<br />
architectural et culturel, représentatif d’une diversité culturelle dans l’unité d’une<br />
religion, il est également important de prendre conscience du fait que conserver les<br />
formes héritées du passé permet <strong>au</strong>ssi de conserver une mémoire <strong>des</strong> lieux qui nous<br />
rappelle combien l’architecture islamique du Sud est le fruit d’une histoire<br />
multiséculaire. <strong>Les</strong> mosquées neuves qui sont édifiées sur <strong>des</strong> mosquées anciennes<br />
104<br />
2<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Zawya de Sidi Wagag (Fondation :<br />
<strong>au</strong> XIe siècle miladiya, Aglou près de<br />
Tiznit) avant et après la <strong>des</strong>truction,<br />
elle est reconstruite selon un archétype<br />
urbain en béton qui retire toute<br />
historicité <strong>au</strong> lieu. Le lieu n’a cessé de<br />
s’étendre pendant près de dix-siècles,<br />
jusqu’à être, en 1983, simplement<br />
détruit pour une rénovation qui ne<br />
respecte <strong>au</strong>cune spécificité locale <strong>au</strong><br />
point que l’on se demande s’il s’agit du<br />
même lieu. La coupole est la même,<br />
mais le minaret est défiguré.
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 105<br />
sont surtout <strong>des</strong> mosquées qui effacent l’empreinte de l’Islam dans sa durée et son<br />
historicité. <strong>Les</strong> petites mosquées de village ont souvent été les premières victimes de ce<br />
«modernisme», mais également les plus prestigieuses Zawyas comme celle d’Assa<br />
(Fondation : <strong>au</strong> XIIe siècle miladiya), ou celle de Sidi Wagag (Fondation : <strong>au</strong> XIe siècle<br />
miladiya, Aglou près de Tiznit) qui ont été rasées puis reconstruites selon un archétype<br />
urbain en béton qui retire toute historicité <strong>au</strong>x lieux. Ces rénovations et non rest<strong>au</strong>rations<br />
effacent irrémédiablement les marques d’usage que les siècles ont imprimé en elles. Le<br />
devoir de mémoire et le respect <strong>au</strong>x générations précédentes ne devraient-ils pas être plus<br />
forts encore pour un édifice sacré que pour un édifice profane ?<br />
L’empreinte de l’Islam sur la durée<br />
Le cénotaphe de Sidi Abdelkader ben Mohamed [photographie 3, à g<strong>au</strong>che] qui se<br />
dresse à la frontière entre le <strong>Maroc</strong> et l’Algérie correspond à la limite jamais franchie par<br />
l’Empire Ottoman sur la limite Sud-Est du Sultanat du Roy<strong>au</strong>me. La lutte <strong>des</strong> Figuiguis<br />
contre les armées ottomanes <strong>au</strong> XVI e siècle, c’est-à-dire l’attachement de la population à<br />
<strong>des</strong> lieux emblématiques qui subsument sa résistance vient incarner une identité locale,<br />
voire nationale. Avec ce lieu saint, h<strong>au</strong>t-lieu architectural et lieu emblématique, nous<br />
comprenons que ces lieux historiques incarnent <strong>au</strong>ssi l’historicité de l’Islam. Ces lieux<br />
sacrés sont <strong>des</strong> lieux de mémoire à travers lesquels la population locale maintient <strong>des</strong><br />
pratiques et <strong>des</strong> discours qui sont <strong>des</strong> composantes de son identité et du lien social.<br />
Restons à Figuig et observons la mosquée Kbir et son fameux minaret octogonal qui est<br />
toujours associé à la tradition racontant de la fixation <strong>des</strong> premiers noma<strong>des</strong> ayant<br />
découvert l’oasis. La mémoire de la sédentarisation et de la mise en valeur <strong>des</strong> e<strong>au</strong>x<br />
d’irrigation est liée à l’édification d’une mosquée. Tous les habitants rappellent que le<br />
minaret fut édifiée grâce <strong>au</strong>x bois <strong>des</strong> tentes dont ils n’<strong>au</strong>raient dès lors plus eu l’usage. Et<br />
à chaque marche lors de l’ascension, ils commentent la forme <strong>des</strong> bois qu’ils comparent<br />
<strong>au</strong>x structures <strong>des</strong> tentes. Le minaret est par conséquent un marquage mémoriel : il fait<br />
référence à une commun<strong>au</strong>té ancrée dans la umma, depuis <strong>des</strong> temps lointains et glorieux.<br />
A l’instar du Nord, on pourrait multiplier les exemples (méridion<strong>au</strong>x, Ma El Aynîn et<br />
Smara, Sidi Ahmed Ou Moussa et Illigh, Moulay Brahim du Tamanart, etc.) <strong>au</strong>tour de la<br />
figure d’une personnalité, et <strong>au</strong>tour de la construction d’un lieu saint, s’érigent ainsi les<br />
contours d’une spécificité marocaine.<br />
3<br />
Deux marquages mémoriels à Figuig<br />
: Sidi Abdelkader, symbole de la<br />
limite matérielle entre l’Empire<br />
Ottoman et le Sultanat de Fès, et le<br />
minaret octogonal, symbole <strong>des</strong><br />
origines du groupe.<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
105
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 106<br />
Tous ces édifices sacrés dans le monde rural témoignent de la force <strong>des</strong> enceintes<br />
sacrées nourricières : les zawyas se dressent comme <strong>des</strong> vaisse<strong>au</strong>x de pierre ou de terre<br />
entre les franges présahariennes <strong>des</strong>séchées et les petites vallées prospères <strong>des</strong><br />
montagnes, : Assa, Illigh du Tazewalt, Imi n’Tatelt (Fondation : <strong>au</strong> XVI e siècle<br />
miladiya), Tamegrout, Smara ou encore Timgilcht, vont incarner une spécificité locale,<br />
marocaine. Dans ces zawyas, sur la longue durée, le pèlerin, le voyageur comme le<br />
fugitif est accueilli, nourri ; par les représentants de ces zawyas, les conflits y sont<br />
résolus. Un lieu saint est donc un morce<strong>au</strong> d’histoire mais <strong>au</strong>ssi, pour les populations,<br />
un morce<strong>au</strong> de mémoire. Cette mémoire se vit par <strong>des</strong> pratiques propres, ancrées dans<br />
le lieu et sur lesquelles toute rest<strong>au</strong>ration doit s’appuyer. Or, actuellement, on remarque<br />
que les rénovations <strong>des</strong> lieux sacrés tendent à transformer les usages cultuels<br />
traditionnels et à réadapter les lieux en tenant rarement compte <strong>des</strong> plans origin<strong>au</strong>x.<br />
Pourtant, les espaces portent toujours en eux <strong>des</strong> usages. Ces usages, multiples,<br />
riches, expriment une foi sincère (niya) qui font la force de l’Islam du <strong>Maroc</strong>. En<br />
effaçant les lieux, en transformant les espaces, on efface <strong>au</strong>ssi les usages et les<br />
traditions attachées <strong>au</strong>x lieux.<br />
L’argument de l’extension moderniste n’est pas recevable<br />
Ceci est trop souvent négligée par <strong>des</strong> commun<strong>au</strong>tés pressées de faire œuvre de<br />
bienfaisance en effaçant la mémoire <strong>des</strong> pratiques <strong>au</strong> nom également d’une orthodoxie<br />
rigide oublieuse <strong>des</strong> hommes et de leur histoire. <strong>Les</strong> lieux sacrés hérités d’économie de<br />
pénurie dans <strong>des</strong> pays de la faim et de la soif, sont souvent considérés du fait de leurs<br />
matéri<strong>au</strong>x (terre et pierre) et de leurs dimensions (parfois mo<strong>des</strong>tes) comme le produit<br />
d’archaïsmes. <strong>Les</strong> nouvelles commun<strong>au</strong>tés de croyants veulent effacer ce passé pour<br />
montrer leur richesse actuelle et la déb<strong>au</strong>che de moyens financiers devient la plus grande<br />
preuve de leur foi. Si cela trouve son sens pour la construction de lieux nouve<strong>au</strong>x, pour<br />
les lieux anciens en revanche, trop souvent cela s’apparente à une mutilation, une<br />
<strong>des</strong>truction partielle ou totale, qui correspond à une atteinte à la culture locale.<br />
Aujourd’hui, les besoins en nouve<strong>au</strong>x espaces d’accueil ou de prière dans un<br />
contexte de croissance démographique doivent se concrétiser par <strong>des</strong> mosquées de<br />
qualité qui font la part belle à la création dans le contexte socio-culturel marocain et<br />
selon l’héritage local spécifique d’une région donnée. Cependant ces nouve<strong>au</strong>x<br />
besoins ne doivent pas se faire CONTRE les espaces anciens. Il ne f<strong>au</strong>t pas détruire le<br />
patrimoine <strong>au</strong> nom de besoins nouve<strong>au</strong>x qui peuvent se concrétiser dans les quartiers<br />
d’extension récente <strong>des</strong> villes ou villages. La nouvelle mode ou le pis-aller de<br />
préserver les mosquées anciennes pour les femmes doit nous alerter : cela ne doit pas<br />
être un premier nive<strong>au</strong> de mépris à l’égard <strong>des</strong> espaces anciens qui les fera tôt ou tard<br />
106<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 107<br />
sombrer dans l’abandon, c’est-à-dire la sûre extinction de ces lieux. La conservation<br />
de la mosquée ancienne pour les femmes doit s’accompagner d’un entretien<br />
respectueux du bâti.<br />
L’argument de moderniser ces espaces revient souvent dans la bouche <strong>des</strong> usagers<br />
qui ressentent une certaine honte de leurs espaces sacrés qu’ils jugent peu prestigieux<br />
comparés <strong>au</strong>x mosquées du Nord ou du Machreq vues à travers les chaînes de<br />
télévision satellittaires. Souvent, on découvre une mosquée flanquée d’un nouve<strong>au</strong><br />
minaret et dont la salle de prière a été remodelée par de maladroits maçons utilisant<br />
sans maîtrise un béton grossier. <strong>Les</strong> espaces sombres, peu aérés, sont souvent humi<strong>des</strong><br />
et entraînent rapidement <strong>des</strong> pathologies dans les murs et <strong>des</strong> difficultés pour les<br />
doyens de faire leurs prières dans de tels espaces (rhumatismes, douleurs <strong>au</strong>x genoux<br />
<strong>des</strong> suites de l’humidité). Be<strong>au</strong>coup de personnes âgés déclarent, à l’usage, préférer la<br />
’attiqa à la nouvelle mosquée. <strong>Les</strong> procédés constructifs en pierre et la terre, certes<br />
fragilisés par le manque d’entretien 1 restent cependant les mieux adaptés <strong>au</strong> climat de<br />
ces régions, froi<strong>des</strong> l’hiver et ch<strong>au</strong><strong>des</strong> l’été.<br />
L’enfer est pavé de bonnes intentions.<br />
Car les extensions se font souvent sans appel à un architecte et souvent ne tiennent<br />
pas compte de l’avis d’une commun<strong>au</strong>té mais du généreux donateur, souvent expatrié<br />
en ville ou en Europe, occupé plus de prestige que de fidélité à l’histoire <strong>des</strong> lieux.<br />
Be<strong>au</strong>coup trop de personnes de bonne volonté croient bien faire en rénovant (sans<br />
rest<strong>au</strong>rer) et ne savent pas qu’ainsi elles effacent leur mémoire, en détruisant leur<br />
princip<strong>au</strong>x lieux de mémoire. Il f<strong>au</strong>t essayer de convaincre les œuvres de bienfaisance<br />
de prendre l’avis de personnes compétentes pour tirer <strong>des</strong> leçons de Sidi Wagag ou<br />
d’<strong>au</strong>tres lieux détruits - car il y a hélas actuellement, inflation <strong>des</strong>tructive pour<br />
«remettre en état» les mosquées. Sans que cette volonté positive ne cesse, il f<strong>au</strong>t<br />
essayer de l’entourer de gui<strong>des</strong>, l’accompagner, et sensibiliser les commun<strong>au</strong>tés. Pour<br />
les villes, cela est facilité par le fait que les agences urbaines délivrent gratuitement<br />
assistance.<br />
En terme d’architectoniques et de formes produites, les photographies attestent que<br />
l’utilisation du procédé de béton de ciment peu maîtrisé mais incarnant la modernité se<br />
traduit par l’arrivée de formes exogènes urbaines app<strong>au</strong>vries. L’action de création<br />
comme l’action de rest<strong>au</strong>ration doit se traduire par une mise à nive<strong>au</strong> qui s’appuie sur<br />
les formes locales et les procédés loc<strong>au</strong>x.<br />
1 L’évolution contemporaine individualiste développe une attitude neuve face <strong>au</strong>x biens collectifs jadis pris en<br />
charge par la commun<strong>au</strong>té. De fait, l’entretien <strong>des</strong> lieux collectifs (greniers collectifs, les chemins, parfois l’e<strong>au</strong>,<br />
les lieux religieux) devient problématique et est source de litiges.<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
107
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 108<br />
L’équipement de la modernité peut, en terme de confort, être amélioré sans détruire<br />
les formes existantes. La modernisation <strong>des</strong> ch<strong>au</strong>drons de l’akherbich traditionnel<br />
modernisé en une savante tuy<strong>au</strong>terie dans la petite mosquée d’Amtoudi par Haj Brahim<br />
Driouch dans les années 1970 en est un bon exemple. On peut réfléchir à améliorer les<br />
conditions <strong>des</strong> ablutions sans détruire la salle <strong>au</strong>x ablutions traditionnelle.<br />
L’opposition modernité et archaïsme<br />
Qu’est-ce que la modernité ? Pour les usagers <strong>des</strong> mosquées c’est participer à son<br />
époque, être porté par <strong>des</strong> courants holistes (participer à une umma de plus en plus<br />
grande, du panislamisme incarné notamment par les chaînes télévisées paraboliques) :<br />
être moderne 2 revient souvent, pour be<strong>au</strong>coup, à intégrer ce mouvement d’un islam<br />
moderniste qui s’incarne dans <strong>des</strong> gadgets technologiques et dans <strong>des</strong> formes<br />
extérieures. Etre moderne se traduit par le refus du pisé et de la pierre comme procédé<br />
constructif.<br />
Moderne, c’est vivre avec son temps et se projeter dans l’avenir ce qui implique de<br />
s’appuyer sur sa mémoire, de le revendiquer et de vivre sa modernité sereinement. Il<br />
n’y a pas de contradiction entre aller prier dans une mosquée vénérable de quelques<br />
siècles et le faire dans une mosquée neuve.<br />
Il est intéressant de constater que pour l’espace de prestige que représente la<br />
mosquée, il soit trop souvent choisi de :<br />
108<br />
• détruire en reconstruisant par-<strong>des</strong>sus ;<br />
• de choisir <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x de m<strong>au</strong>vaise qualité, mis en œuvre par déf<strong>au</strong>t ou de<br />
façon peu professionnelle ;<br />
• de faire un choix démagogique qui vient lutter contre un passé dont on a honte.<br />
Une expérience récente de restitution<br />
A Assa, nous avons, en tant qu’architecte, mené deux rest<strong>au</strong>rations qui s’appuient<br />
sur une démarche de restitution fidèle, réalisées à faible coût et en partenariat avec la<br />
population locale. <strong>Les</strong> actions de rest<strong>au</strong>ration sont inscrites dans la réhabilitation totale<br />
du Ksar de 7 hectares. Ces deux mosquées très ruinées n’avaient pas encore été rasées<br />
2 Pour rest<strong>au</strong>rer la Qasba qui se trouve en face du tombe<strong>au</strong> de Moulay Ali Chérif, à Rissani, le groupe El Omrane<br />
et le Ministère de l’Habitat ont procédé à <strong>des</strong> enquêtes individuelles <strong>des</strong> habitants du lieu à rest<strong>au</strong>rer sur leurs<br />
envies et besoins. Evidemment cette enquête a montré que ces habitants désiraient de vivre dans une modernité<br />
rêvée, celle de la ville. Aucune réflexion n’a été menée pour réfléchir à améliorer les mo<strong>des</strong> d’habiter particuliers<br />
à ces régions. Une vulgaire transposition, par déf<strong>au</strong>t, <strong>des</strong> équipements <strong>des</strong> villes s’est faite jour foncièrement<br />
inadaptée et criante de vulgarité. Pourtant, il existait <strong>des</strong> modèles : les rest<strong>au</strong>rations réfléchies menées dans les<br />
années 1970 par le PAM dans certains qsours voisins proposaient une réadaptation <strong>des</strong> formes anciennes qui<br />
<strong>au</strong>jourd’hui a perduré jusqu’à <strong>au</strong>jourd’hui en s<strong>au</strong>vant un site historique.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 109<br />
et reconstruites en ciment. Une fois la rest<strong>au</strong>ration largement avancée permettant de<br />
montrer le bâtiment en phase d’achèvement, de nombreux habitants curieux sont venus<br />
visités le chantier. <strong>Les</strong> <strong>au</strong>tres lignages du Ksar sont alors venus nous demander de<br />
procéder sans tarder à la rest<strong>au</strong>ration <strong>des</strong> <strong>au</strong>tres mosquées dont Timzgida Idaw Mellil<br />
et même de reprendre la façade de la zawya-mère, toutes rasées et reconstruites en<br />
ciment. Cette demande, mémorielle et symbolique, trouve son ancrage dans le besoin<br />
<strong>des</strong> commun<strong>au</strong>tés de retrouver le prestige d’antan par <strong>des</strong> formes anciennes certes,<br />
mais certainement pas archaïques car reconnues à l’échelle nationale et internationale<br />
comme porteuses d’une identité et d’une culture spécifique.<br />
Lors <strong>des</strong> actions premières de rest<strong>au</strong>ration du Ksar, la démarche archéologique de<br />
restitution doublée du contrôle <strong>des</strong> doyens loc<strong>au</strong>x, a été choisie. <strong>Les</strong> premiers trav<strong>au</strong>x<br />
de rest<strong>au</strong>ration qui ont été entrepris reposent donc sur <strong>des</strong> bases scientifiques soli<strong>des</strong><br />
qui privilégient les traces anciennes et l’<strong>au</strong>thenticité <strong>au</strong> spectaculaire. Il a été choisi la<br />
prudence et non la précipitation de façon à connaître les spécificités urbanistiques,<br />
spatiales, d’ambiance, les procédés et les typologies <strong>des</strong> espaces loc<strong>au</strong>x avant de<br />
commencer à les protéger 3 . De même, une grande attention a été accordée <strong>au</strong>x qualités<br />
esthétiques <strong>des</strong> différents éléments composant le Ksar d’Assa et qui lui donnent une<br />
atmosphère et une ambiance particulières. La relation entre les édifices <strong>au</strong> sein du Ksar<br />
qui les contient est elle <strong>au</strong>ssi constamment questionnée.<br />
Chaque mosquée possède en effet sa typologie particulière issue de diverses mises<br />
en œuvre, du programme et d’une époque. Il f<strong>au</strong>t y être très attentif. Nous avons trouvé<br />
à Assa, une grande cohérence qu’il ne f<strong>au</strong>drait fragiliser lors de la rest<strong>au</strong>ration en ne la<br />
4<br />
Exemples flagrants du patrimoine sacré d’Assa : détériorations et de <strong>des</strong>tructions doublées d’adjonctions<br />
parasites et transformations abusives ou dépourvues de sensibilité qui portent atteinte à son <strong>au</strong>thenticité.<br />
3 Cf. l’ensemble <strong>des</strong> Etu<strong>des</strong> préliminaires portant sur la Requalification du Qsar d’Assa commanditée par le Maître<br />
d’ouvrage : Agence Pour le Développement Economique et Social <strong>des</strong> Provinces du Sud du Roy<strong>au</strong>me, mai 2006.<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
109
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 110<br />
comprenant pas et en introduisant <strong>des</strong> formes exogènes. C’est pour cela que conscients<br />
de la fragilité de ces sites, les h<strong>au</strong>ts responsables internation<strong>au</strong>x insistent sur une<br />
protection active «contre toutes détériorations, en particulier contre celles qui résultent<br />
d’un usage inapproprié, d’adjonctions parasites et de transformations abusives ou<br />
dépourvues de sensibilité qui porteront atteinte à son <strong>au</strong>thenticité ainsi que celles dues<br />
à toutes formes de pollution 4 ».<br />
110<br />
Notre démarche est la même que celle appliquée dans les <strong>au</strong>tres espaces du Ksar 5 :<br />
Lors <strong>des</strong> phases de rest<strong>au</strong>ration, nous procédons toujours selon la même méthode :<br />
1. retrouver le plan originel, le restituer avec les doyens s’il le f<strong>au</strong>t. En comprendre les<br />
étapes d’évolution. Identifier les besoins actuels. Historique/confrontation<br />
2. identifier la(es) bon(s) procédé(s) à utiliser avec les maalmines,<br />
3. déterminer les désordres et pathologies du bâtiment,<br />
4. restituer si possible le plan initial dans les règles de l’art. Hypothèses et maquette.<br />
Essais grandeur nature.<br />
Recommandations et protocoles de rest<strong>au</strong>rations<br />
Fort de notre expérience à Assa, nous sommes en mesure de pouvoir donner comme<br />
premières recommandations la méthode que nous avons scrupuleusement appliquée à<br />
Assa :<br />
1. Ne jamais détruire<br />
2. Ne pas construire sur une mosquée ancienne mais construire à côté ou plus loin<br />
3. Recenser les mosquées anciennes avec <strong>des</strong> dates de fondation attestant l’importance<br />
historique du lieu. Dresser un historique sans occulter les traditions orales et les pratiques<br />
locales. Rechercher tous les écrits possibles.<br />
4. Dresser un état <strong>des</strong> lieux sous forme de plans, y compris <strong>des</strong> plans de détails de points<br />
caractéristiques. Etablir un relevé photographique complet, <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> et <strong>des</strong> détails.<br />
Retrouver les formes originelles (entretiens avec les doyens, recherches de photographies plus<br />
ou moins anciennes, maquettes, comparaison avec d’<strong>au</strong>tres sites comparables).<br />
4 «Définitions» internationales données par les Recommandations concernant la s<strong>au</strong>vegarde <strong>des</strong> ensembles<br />
historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine (UNESCO, 1976).<br />
5 Depuis plus d’une vingtaine d’année, le Qsar d’Assa s’est progressivement vidé de ses habitants. Seules six<br />
maisons sont encore quotidiennement occupées. Le départ de la majeure partie <strong>des</strong> habitants traditionnels a<br />
engendré une dynamique de désaffection et de délabrement. Sans être remplacées, les populations ont quitté le<br />
Qsar pour bénéficier <strong>des</strong> commodités de la ville nouvelle qui dispose de l’ensemble <strong>des</strong> boutiques (<strong>au</strong>cune<br />
épicerie dans le Qsar) et de l’accessibilité par <strong>au</strong>tomobile, <strong>des</strong> écoles et <strong>des</strong> administrations. La nouvelle ville<br />
tourne le dos <strong>au</strong> Qsar édifié sur le rocher de la rive droite : la nouvelle extension s’est éloignée de l’Oued,<br />
<strong>au</strong>jourd’hui encombrée <strong>des</strong> «gens du qsar», venus élever, sur la rive g<strong>au</strong>che, un habitat <strong>au</strong>toconstruit en terre puis<br />
en béton de ciment. Un nouve<strong>au</strong> mode constructif urbain d’origine exogène a été importé dans les nouve<strong>au</strong>x<br />
quartiers, morcelés en avenues et lotissements et symbolisant l’accession à une nouvelle vie, elle fait figure<br />
localement de progrès et d’avancée technologique.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 111<br />
5. Fixer <strong>des</strong> priorités (pour établir <strong>des</strong> phases de rest<strong>au</strong>ration du plus abîmé <strong>au</strong> mieux conservé<br />
ou pour s<strong>au</strong>ver en priorité les éléments caractéristiques fragilisés).<br />
6. Sensibiliser et expliquer la démarche de restitution eu égard à l’historicité de l’islam en ce<br />
lieu. Transmettre l’idée que l’ancienne mosquée est un témoin de l’histoire, veiller à ne pas<br />
l’abîmer.<br />
7. Rest<strong>au</strong>rer selon les plans origin<strong>au</strong>x, en faisant appel <strong>au</strong>x doyens loc<strong>au</strong>x et <strong>au</strong>x artisans loc<strong>au</strong>x<br />
pour satisfaire cette contrainte. Rest<strong>au</strong>rer et restituer impliquent donc l’utilisation <strong>des</strong><br />
procédés loc<strong>au</strong>x et l’intervention <strong>des</strong> maalmines loc<strong>au</strong>x.<br />
8. Améliorer les procédés en cas de nécessité (étanchéité) en respectant toujours la compatibilité<br />
<strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x (la ch<strong>au</strong>x et non le ciment pour le bâtit en terre) pour prévenir toute pathologie<br />
exogène <strong>au</strong>x procédés loc<strong>au</strong>x.<br />
Cette méthode très respectueuse est d’<strong>au</strong>tant plus probante que le coût de<br />
rest<strong>au</strong>ration en milieu rural est moindre que dans une cité et qu’il est donc moins cher<br />
de rest<strong>au</strong>rer avec les procédés loc<strong>au</strong>x que de faire venir <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x exogènes et de<br />
les mettre en œuvre 6 . Il est vrai cependant que la restitution est plus longue et moins<br />
facile à mettre en œuvre ; cependant, placée entre les mains <strong>des</strong> doyens d’une<br />
commun<strong>au</strong>té, elle permet de resserrer le lien social tout en donnant une très grande<br />
fierté à ceux qui la mettent en œuvre.<br />
Nous pouvons également ajouter que cette action a été connue dans toute la région<br />
<strong>au</strong> point que ce modèle, compris de tous, est en train de se diffuser. <strong>Les</strong> habitants<br />
d’Assa sont heureux de recevoir <strong>des</strong> délégations de personnes désireuses de s’informer<br />
en rencontrant tous les acteurs de cette expérience.<br />
Conclusion<br />
En conclusion, il apparaît que, sans revenir à l’éternel débat entre le qâdim et le jadîd<br />
(ou la querelle <strong>des</strong> anciens et <strong>des</strong> modernes), il est ici démontré comment il est simple et<br />
peu onéreux de rest<strong>au</strong>rer les mosquées du Sud marocain. Ces deux exemples prouvent<br />
que <strong>des</strong> actions de rest<strong>au</strong>ration comme de réhabilitation peuvent associer l’identité<br />
locale, la mémoire, l’histoire et les besoins actuels <strong>des</strong> commun<strong>au</strong>tés.<br />
Cependant, à l’échelle du roy<strong>au</strong>me, seule une action commune interministérielle<br />
entre le Ministère <strong>des</strong> Habous et celui de la Culture peut durablement inverser la<br />
tendance qui est à la <strong>des</strong>truction du patrimoine architectural sacré. L’action de<br />
sensibilisation qui s’appuie sur <strong>des</strong> propositions concrètes en montrant <strong>des</strong> modèles<br />
réalisés peut ensuite être associée à la force du cadre réglementaire.<br />
6 La mosquée de Sîdi El Wali, dont il ne restait qu’un pan de mur et le mihrab, a nécessité, pour être restituée à<br />
l’identique, moins de 200 journées-hommes de travail pour <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x loc<strong>au</strong>x disponibles sur place (pierre<br />
gratuite, transport à assurer), bois de palme et ch<strong>au</strong>x à acheter. Un coût dérisoire inférieur <strong>au</strong> tiers de ce que cela<br />
<strong>au</strong>rait coûté en béton de ciment armé ou en parpaings pour un résultat très apprécié localement.<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
111
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 112<br />
Puissent ces exemples se diffuser dans le Sud marocain qui recèle d’un patrimoine<br />
mineur de grand intérêt comme d’architectures sacrées majeures.<br />
Nous avons choisi six <strong>au</strong>tres lieux emblématiques et merveilleusement respectueux<br />
du local pour illustrer l’idée que nous devons à tout prix éviter les <strong>des</strong>tructions qui se<br />
multiplient actuellement partout.<br />
112<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Le palmier transperce le plafond, Zawya Sidi<br />
L’arbi El Houarri.<br />
La mosquée de Goulmima rénovée à la manière<br />
fassia (tuiles vertes et jamour de cuivre) alors<br />
qu'elle figurait parmi les plus belles mosquées à<br />
piliers octogon<strong>au</strong>x de la région.<br />
La mosquée de Tarfaya re<strong>des</strong>sinée, flanquée de tuiles<br />
vertes et de créne<strong>au</strong>x exogènes. L'intérieur très<br />
sombre ne respecte pas le plan initial et menace de<br />
devenir un lieu insalubre (humidité et obscurité, pas<br />
de ventilation).<br />
La Zawya de 8 siècles d’Assa rasée puis remplacée<br />
par une mosquée neuve en son emplacement.<br />
Là-encore tuiles vernissées, minaret et rose exogènes.<br />
8 9<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
Travées de la Mosquée d’Ouled<br />
Driss (Bas-Dra)
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 113<br />
10<br />
La Zawya d'Imi n'Tatelt et les <strong>au</strong>mônes de Tayfa n'Ibril,<br />
le patrimoine immatériel de la zawya.<br />
Le mihrab de la mosquée-oratoire de Tagadirt Tizourgan, Idaw Gnidif,<br />
Ayt Baha, rest<strong>au</strong>rée dans les règles de l'art par les propriétaires.<br />
11<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
113
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 114<br />
114<br />
12<br />
Avant Après<br />
Mosquée Sidi El Wali, étapes de la rest<strong>au</strong>ration dans les règles<br />
de l'art. Ruinée <strong>au</strong> trois quart, elle est restituée à l'identique<br />
grâce <strong>au</strong>x nombreux témoignages <strong>des</strong> doyens loc<strong>au</strong>x.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 115<br />
13<br />
La mosquée Timzgida ufella avant puis pendant la rest<strong>au</strong>ration. Accolée <strong>au</strong>x remparts<br />
désormais rest<strong>au</strong>rés, elle est progressivement restituée à partir <strong>des</strong> bases <strong>des</strong> fondations<br />
corroborée <strong>des</strong> témoignages loc<strong>au</strong>x et d'un écrit colonial (O. du Puig<strong>au</strong>de<strong>au</strong>).<br />
Un patrimoine sacré en péril ...<br />
115
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 116<br />
Bibliographie indicative :<br />
1951. Drague, Georges [Spillman], Esquisse d’histoire religieuse du <strong>Maroc</strong>. Paris, J. Peyronnet.<br />
1981. Eickelman, Dale F., Moroccan Islam, tradition and society in a Pilgrimage Center, 1976<br />
University of Texas Press.<br />
2001. El-Alaoui, Nargys. Le soleil, la lune et la fiancée végétale. Essai d’anthropologie <strong>des</strong> rituels.<br />
Aix-en-Provence, Edisud.<br />
1988. Hammoudi, Abdellah. La victime et ses masques, essai sur le sacrifice et la mascarade <strong>au</strong><br />
Maghreb, Paris, Seuil.<br />
2003. Hell, Bertrand. Le tourbillon <strong>des</strong> génies (Au <strong>Maroc</strong> avec les Gnawa). Paris, Flammarion.<br />
1981. Jamous, Raymond. Honneur & Baraka (<strong>Les</strong> structures traditionnelles dans le Rif, Paris,<br />
Cambridge, Maisons <strong>des</strong> Sciences de l’Hommes et Cambridge University Press.<br />
2000. Kenssoussi, Jaafar (dir.). Sagesse et splendeur <strong>des</strong> arts islamiques, hommage à Titus<br />
Burckhardt, (5ème Session <strong>des</strong> Mawsimiyât, mai 1999), Marrakech, El Qobba Zarqa (édition<br />
bilingue).<br />
2002. Moussaoui, Abderahmane. Espace et sacré <strong>au</strong> Sahara. Ksours et oasis du Sud-Ouest algérien,<br />
Paris, CNRS.<br />
1987. Mezzine, Larbi. Le Tafilalt (Contribution à l’Histoire du <strong>Maroc</strong> <strong>au</strong>x XVII et XVIIIe siècles),<br />
Faculté <strong>des</strong> Lettres et Sciences Humaines de Rabat,<br />
2001. Naji, Salima. Art et architectures berbères (Vallées présahariennes), Aix-en-Provence, Edisud.<br />
2003. Naji, Salima. Portes du Sud marocain, Aix-en-Provence, Edisud.<br />
2006. Naji, Salima. Greniers de l’Atlas, patrimoines du Sud marocain, Aix-en-Provence, Edisud.<br />
2006. Naji, Salima pour l’Agence Pour le Développement Economique et Social <strong>des</strong> Provinces du<br />
Sud du Roy<strong>au</strong>me. Etu<strong>des</strong> préliminaires portant sur la Requalification du Qsar d’Assa, une<br />
réhabilitation <strong>au</strong> service <strong>des</strong> habitants,<br />
Cahier A : Rapport de présentation et prescriptions, Plaquette <strong>des</strong> intentions ; Cahier B : Etat <strong>des</strong> lieux<br />
et pré-diagnostic, Cahier C : Sources ; Cahier D : Catalogue raisonné du vocabulaire<br />
architectural d’Assa et Cahier de prescriptions et recommandations spécifiques <strong>au</strong> Ksar<br />
d’Assa ; Cahier E : Note de recommandations relative à l’Esquisse du schéma<br />
d’assainissement du Ksar s<strong>au</strong>vegardé. Plans, cartes et <strong>au</strong>tres documents iconographiques.<br />
2007. Naji, Salima. «Le triangle et la fibule. Espaces féminins à Imi n’Tatelt, Anti-Atlas» in<br />
Femmes d’Orient, Femmes d’Occident : Espaces, mythes et symboles, Paris, L’Harmattan,<br />
pp. 79-98.<br />
1977. Pascon, P<strong>au</strong>l. Le Haouz de Marrakech, (2 tomes) Coédition C.U.R.S. et I.N.A., Rabat,<br />
C.N.R.S., Paris.<br />
1984. Pascon, P<strong>au</strong>l (dir.). La maison d’Iligh et l’histoire sociale du Tazerwalt, Rabat, SMER.<br />
1922. Lévi-Provençal, Evariste. <strong>Les</strong> historiens <strong>des</strong> Chorfa. Paris, Maisonneuve et Larose.<br />
1990. Rachik, Hassan. Sacré et sacrifice dans le H<strong>au</strong>t-Atlas marocain, Afrique-Orient, Casablanca.<br />
1976. Unesco. Recommandations concernant la s<strong>au</strong>vegarde <strong>des</strong> ensembles historiques ou<br />
traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine.<br />
116<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 117<br />
LE MINARET<br />
Origine et variété esthétique<br />
Azzedine RHADDIOUI<br />
Plasticien, Enseignant à l’Ecole Nationale<br />
d’Architecture<br />
Avant d’entamer une étude exh<strong>au</strong>stive sur le Minaret qui va pratiquement évoluer à<br />
travers les siècles selon les régions, un aperçu sur son origine s’avère nécessaire pour<br />
mieux saisir la répartition spatiale de chacun <strong>des</strong> éléments qui compose la mosquée.<br />
D’abord, la mosquée que l’on appelle masjid signifiant se prosterner est toujours<br />
réservée à <strong>des</strong> lieux de culte particulièrement sacrés, à l’image de la Kaaba, de la<br />
coupole du Rocher (Qoubbat as-Sakhra) et de la maison du Prophète Mohammad<br />
(PSL), devenue ultérieurement la Mosquée de Médine:<br />
• Ce type de maison a été déterminé par la cour à ciel ouvert entourée d’une<br />
enceinte de briques crues et à l’intérieure de l’enceinte existaient diverses<br />
chambres <strong>des</strong> épouses du Prophète (PSL);<br />
• Un portique fait de troncs de palmier, couvert de feuilles de palmes et de terre<br />
faisait office d’une première salle de prière, en direction de Masjid Al Aqsa (la<br />
Mosquée la plus éloigné qui se trouve à Jérusalem);<br />
• Un second portique, sensiblement plus grand, notifie enfin la direction définitive<br />
pour les prières, orienté sud vers la Kaaba. Le type de la mosquée à cour,<br />
largement dominant dans le monde arabe fut crée.<br />
<strong>Les</strong> plus anciens exemples attestés, et non conservés, de ce schéma agrandi sont les<br />
mosquées de Basra (665) et de Koufa (670) en Irak. Toutefois ces premières<br />
réalisations ont été dépourvues du Mihrab, du Minaret et du Minbar à plusieurs<br />
marches. Seule la direction du mur de la qibla était obligatoire.<br />
C’est seulement sous les Omeyya<strong>des</strong>, que l’on ajoutait après le minaret, une niche<br />
creusée dans le mur (mihrab) qui accentue la nef centrale, plus h<strong>au</strong>te et plus large que<br />
les <strong>au</strong>tres travées parallèles <strong>au</strong> mur de la direction. Le minbar a été accolé à droite du<br />
mihrab et construit en dur qui remplace le siège bas et mo<strong>des</strong>te à deux degrés dont le<br />
Prophète (PSL) utilisait en face d’une assistance <strong>des</strong> fidèles. A savoir que ce type de<br />
LE MINARET - Origine et variété esthétique<br />
117
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 118<br />
petit minbar est encore préservé dans de nombreuses mosquées, lors <strong>des</strong> réunions<br />
<strong>au</strong>tour d’un faquih ou d’un intervenant extérieur pour les besoins d’un cours religieux.<br />
Plus tard, l’époque Omeyyade sera caractérisée par le minaret unique, sur plan<br />
carré, trapu et massif. À de rares exceptions près, il est encastré dans le mur d’enceinte,<br />
avec une prédilection pour le côté nord de la cour, par exemple dans la mosquée de<br />
Basra, en Syrie, ou encore dans la mosquée Sidi Oqba à Kairouan.<br />
Le sujet spécifique de notre intervention est le Minaret qui est sans nul doute l’un<br />
<strong>des</strong> éléments incontournables de la mosquée qui ont le plus marqué les cités arabes. Il<br />
a été le repère visuel permettant <strong>au</strong>x étrangers de se diriger vers le centre <strong>des</strong><br />
agglomérations.<br />
Le minaret a conservé son identité spécifique, celle du h<strong>au</strong>t duquel est lancé l’appel<br />
à la prière quotidienne. Cependant, du point de vue esthétique une variante régionale<br />
lui donne un cachet particulier : Le minaret d’Orient musulman est différent de celui<br />
de l’Occident musulman. Plusieurs types de minarets peuvent coexister. L’aspect<br />
formel, l’utilisation de certains matéri<strong>au</strong>x, les éléments du décor ou l’épigraphie nous<br />
donne <strong>au</strong>tant de renseignements qu’une empreinte digitale : Une région peut être ainsi<br />
déterminée.<br />
Il est à savoir que le minaret trouve d’abord son origine dans la Kaaba, <strong>au</strong> <strong>des</strong>sus<br />
de laquelle, BILAL le compagnon du Prophète a déclamé les louanges à Dieu<br />
Omniprésent. Comme il a été souligné précédemment, la tradition veut que l’appel à<br />
la prière soit lancé à h<strong>au</strong>te voix, à partir d’une h<strong>au</strong>teur élevée ou dégagée et être visible<br />
et identifié de loin.<br />
L’influence du Minaret central de la grande mosquée de Damas fut déterminante :<br />
de forme parallélépipédique et prenant l’appellation “Minaret Issa” en hommage <strong>au</strong>x<br />
chrétiens qui ont voulu partagé leur lieu de culte, dès le début de la présence<br />
musulmane.<br />
Ensuite, c’est à la mosquée Zakariya à Halab où a été conçu le prototype du minaret<br />
maghrébin qui est <strong>au</strong>ssi de forme parallélépipédique mais de h<strong>au</strong>teur élancée.<br />
Nous pouvons citer <strong>au</strong>ssi les minarets <strong>des</strong> Gran<strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> de Kairouan, de la<br />
Zatouna à Tunis, de la Koutoubia à Marrakech, de Hassan à Rabat, de la Giralda de<br />
Séville, de Mansourah non loin de Tlemcen, qui sont parmi d’<strong>au</strong>tres plus spécifique <strong>au</strong><br />
<strong>Maroc</strong> tant par le choix <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x que du décor.<br />
Si l’objectif est de proposer un recueil panoramique <strong>des</strong> minarets <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>, à travers<br />
les villes et les régions, nous pouvons déjà montrer les spécificités particulières et aider<br />
les urbanistes, les architectes à plus de créations sans pour <strong>au</strong>tant trahir notre<br />
patrimoine. Il a été souvent établi que sans les contraintes formelles point d’innovation.<br />
118<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 119<br />
L’étude du minaret du <strong>Maroc</strong> pour sa réhabilitation peut être divisée en trois<br />
phases :<br />
• Une partie exh<strong>au</strong>stive devra s’attachera à l’historique et <strong>au</strong>x prototypes <strong>des</strong><br />
minarets ;<br />
• Une seconde partie devra faire l’inventaire <strong>des</strong> minarets les plus déterminants et<br />
enrichie d’une large documentation;<br />
• Une troisième partie sera relative à une définition générale de quelques concepts<br />
plastiques dont le but est d’orienter les créateurs à plus d’apports et de variétés<br />
pour ne pas tomber dans le piège d’une répétition lassante qui ne peut que<br />
scléroser notre héritage artistique et le savoir faire de nos maîtres artisans.<br />
Ce sont là, quelques critères qui puissent aider à mieux saisir les spécificités du<br />
minaret en général et celui de notre région en particulier.<br />
Cette réflexion, espérons le, sera l’occasion de susciter un large débat et l’envie de<br />
mener <strong>des</strong> recherches plus approfondies.<br />
LE MINARET - Origine et variété esthétique<br />
119
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 120<br />
120<br />
1 2<br />
4 5<br />
6 7 1- Minaret Al Arousse “Issa” (Damas)<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
2- Minaret de l’Est (Damas)<br />
3<br />
3- Minaret de Zakariya, façe Sud<br />
(Halab)<br />
4- Minaret Kaïrouan (Tunisie)<br />
5- Minaret de Samarra (Irak)<br />
6- Minaret Al Karawiyine (Fès)<br />
7- Minaret Ibn Touloun (Le Caire)
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 121<br />
8<br />
12<br />
13<br />
14 15<br />
9 10<br />
11<br />
8- Minaret Koutoubiya<br />
(Marrakech)<br />
9, 10, 11 - Minaret Hassan<br />
(Rabat)<br />
12- Partie basse du minaret<br />
Mansourah (Près de<br />
Tlèmcen)<br />
13- Minaret Grande mosquée<br />
(Tlèmcen)<br />
14- Minaret de la Mosquée du<br />
Chah (Ispahan)<br />
15- Minaret Soulaïmanyé<br />
(Istamboul)<br />
LE MINARET - Origine et variété esthétique<br />
121
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 122<br />
122<br />
16<br />
19<br />
17 18<br />
20 21<br />
22 23 24<br />
16- L’un <strong>des</strong> minarets du Taj Mahal (Agra)<br />
17- Mosquée de Lahore<br />
18- Minaret de la Grande Mosquée (Rabat)<br />
19- Minaret de la mosqée My. El Mekki (Rabat)<br />
20- Minaret de la mosquée Al Irfane (Rabat)<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
21- Minaret de la mosquée Badr (Rabat)<br />
22- Minaret de la Grande Lalla Soukaïna (Rabat)<br />
23- Minaret de la mosqée Outaïba (Rabat)<br />
24- Minaret de la mosquée Ryad (Rabat)
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 123<br />
LA MOSQUEE,<br />
un repère dans la ville<br />
Hassan KHARMICH<br />
Enseignant Chercheur à l’Ecole Nationale d’Architecture,<br />
Rabat<br />
L’objet de cette communication est la définition de la place de la mosquée dans le<br />
contexte urbain marocain. Nous proposons comme point de départ de reconstituer le<br />
rôle de la mosquée dans l’organisation socio-culturelle et spatiale de la ville<br />
traditionnelle pour s’acheminer vers le nouve<strong>au</strong> statut de cette institution cultuelle dans<br />
la ville d’<strong>au</strong>jourd’hui.<br />
A la quête de cette véritable signification de la mosquée dans la ville, on tentera de<br />
rechercher si la place qu’occupe la mosquée dans la ville actuelle et son rôle<br />
structurant l’espace et la société sont en continuité ou en rupture avec le modèle<br />
traditionnel ou si l’on assiste à l’émergence de nouve<strong>au</strong>x modèles de références plus<br />
marqués par la «neutralité» de la mosquée dans le tissu urbain ?<br />
1- La mosquée dans la ville traditionnelle<br />
- La mosquée, un témoin de la production de la citadinité musulmane<br />
De tout temps, l’unité éminente de la ville doit sa s<strong>au</strong>vegarde à la Grande Mosquée,<br />
vers laquelle tout conflue, et de laquelle tout reflue, comme si elle était un cœur.<br />
Dans la cité traditionnelle, anti-coloniale, la mosquée représentait une composante<br />
spatiale essentielle qui organisait et déterminait les mouvements <strong>des</strong> croyants. <strong>Les</strong><br />
déplacements se faisaient en direction <strong>des</strong> mosquées de résidence ou vers celles à<br />
proximité du lieu de travail, plusieurs fois par jour et une fois par semaine le vendredi<br />
vers la mosquée à khütba.<br />
<strong>Les</strong> fidèles avaient l’occasion de se rencontrer à l’heure de la prière. Ces lieux<br />
moment, étant propice à l’échange, à la consultation, à la concertation. La mosquée à<br />
prône du vendredi rassemblait les habitants de plusieurs quartiers ou de la totalité de<br />
la ville, donnant lieu à une maximisation de l’interaction sociale et à<br />
l’accomplissement de la vie commun<strong>au</strong>taire.<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
123
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 124<br />
En plus de son rôle de cristallisation de la foi, la mosquée fut réconfortée par<br />
d’<strong>au</strong>tres attributions. Elle faisait office également de siège de gouvernement politique,<br />
de commandement militaire, de tribunal, de pôle de médiatisation de l’information et<br />
de concertation avec la population. C’était un lieu privilégié où les décisions, les<br />
informations et les savoirs se diffuseraient et où la politique et le religieux<br />
s’enchevêtraient étroitement.<br />
124<br />
- La mosquée, un structurant spatial<br />
Tout en étant un h<strong>au</strong>t lieu de la foi, de la spiritualité et de la maximisation <strong>des</strong><br />
interactions sociales, la mosquée participait amplement dans la structuration de l’espace.<br />
A partir de la grande mosquée, toute la configuration du tissu urbain et son agencement,<br />
prenaient sens et signification. La conception urbanistique de la cité, dans son ensemble,<br />
exprimait «la réalité d’un idéal citadin islamique et de ses lieux privilégiés» 1 .<br />
Médina de Rabat <strong>Les</strong> Oudaya à Rabat<br />
En effet, c’est à partir de la grande mosquée, en tant que point névralgique dans la<br />
cité, que toutes les activités de production et de services se structuraient suivant une<br />
hiérarchie spatiale «où l’on voyait volontiers l’expression d’une valorisation<br />
préférentielle de certaines professions nobles, en rapport plus ou moins étroit avec le<br />
culte» 2 . <strong>Les</strong> souks et les métiers les plus propres et les plus nobles occupaient<br />
Médina de Rabat<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
La mosquée<br />
un point névralgique<br />
dans la cité<br />
La mosquée<br />
un pivot d'organisation<br />
fonctionnelle<br />
1 Saïd Mouline : La ville et la maison arabo-musulmanes, in B.E.S.M, n° 147-148, 1981, (pp. 1-13).<br />
2 Xavier De Planhol : Forces économiques et composantes culturelles dans les structures commerciales <strong>des</strong> villes<br />
islamiques, un Espace Géographique, n°4, 1980, (pp 315-322).
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 125<br />
l’entourage immédiat de la grande mosquée, tandis que les activités les plus<br />
salissantes, les plus bruyantes et les malodorantes étaient reléguées à la périphérie.<br />
C’est <strong>au</strong>ssi en proximité étroite de la grande mosquée que se regroupaient les formes<br />
les plus h<strong>au</strong>tes de l’étude et du savoir en l’occurrence les médersas, les résidences<br />
d’étudiants, la grande bibliothèque et les librairies. Ces fondations à caractère culturel<br />
constituaient, avec la grande mosquée, une sorte d’université permettant l’acquisition<br />
<strong>des</strong> sciences religieuses, de la grammaire, de la rhétorique et de la logique.<br />
Il paraît ainsi, que la place du sacré dans l’espace est centrale. Elle est le pivot d’une<br />
organisation spatiale harmonieuse qui, à partir de la mosquée, se subdivise du centre à<br />
la périphérie, en bâtisses consacrées <strong>au</strong> commerce, à l’artisanat, <strong>au</strong>x habitations, <strong>au</strong>x<br />
équipements collectifs,…<br />
L’emprunte du sacré est manifeste dans la localisation de la grande mosquée, qui<br />
constitue le centre spirituel de la cité : enclos sacré, situé <strong>au</strong> cœur de la ville, à partir<br />
duquel l’ensemble du rése<strong>au</strong> urbain prend toute sa signification. Autour d’elle on<br />
trouve de multiples activités artisanales et commerciales, groupées en marchés<br />
spécialisés pour la production ou la vente d’une même variété de marchandises<br />
Cœur de la cité, la mosquée est <strong>au</strong>ssi une unité qui définit l’organisation spatiale de<br />
la ville. En effet, la construction d’un nouve<strong>au</strong> quartier est définie par la portée de voix<br />
du muzzein qui du h<strong>au</strong>t de son minaret, prononce quotidiennement les cinq appels à la<br />
prière. La répartition du tissu urbain se trouve en quelque sorte ponctuée par cette<br />
portée de voix du muzzein, qui oscillait entre 65 et 80 mètres 3 .<br />
Le fait également que les<br />
mosquées soient implantées<br />
en croisement <strong>des</strong> voies et<br />
organisées <strong>au</strong>tour <strong>des</strong> quelques<br />
places dotées souvent de<br />
fontaines, d’arbres…leur<br />
attribue une image de repère<br />
urbain.<br />
En somme, la représentation de l’espace et de ses fonctions dans la ville obéissait à<br />
une stricte hiérarchie de valeur : tout s’organisait en fonction de la proximité ou de<br />
l’éloignement de la mosquée : localisation <strong>des</strong> activités de production ou d’échange,<br />
variation <strong>des</strong> prix <strong>des</strong> biens immobiliers, articulation <strong>des</strong> rapports soci<strong>au</strong>x et de<br />
voisinage.<br />
3 Mohammed Sijjilmassi : Fès : cité de l’art et du savoir, 1991.<br />
Une répartition régulière<br />
<strong>des</strong> mosquées dans la<br />
médina de Meknès<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
125
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 126<br />
2- La mosquée dans la ville moderne<br />
126<br />
- La mosquée, un équipement dans la ville<br />
Autrefois, la mosquée occupait une place centrale dans la vie urbaine, elle devient,<br />
<strong>au</strong>jourd’hui, un simple lieu de culte, déconnectée <strong>des</strong> problèmes de la société, et un<br />
simple équipement, moins structurant l’espace. La hiérarchie <strong>des</strong> espaces dans la ville<br />
obéit dorénavant à l’influence d’<strong>au</strong>tres facteurs structurant : rése<strong>au</strong> de mobilité et de<br />
déplacement, activités modernes de production et d’échange, administration politique,<br />
nouve<strong>au</strong>x centres de pouvoir et de décision, etc.<br />
<strong>Les</strong> effets de l’urbanisation rapide qu’a connue la ville marocaine ont joué dans le<br />
même sens. La pénétration de l’économie moderne a provoqué le déplacement <strong>des</strong><br />
centres d’activités et d’échange de la médina où tout s’organisait à partir de la grande<br />
mosquée en fonction d’une hiérarchie de valeur, vers la ville coloniale où tout<br />
s’agençait de part et d’<strong>au</strong>tre <strong>des</strong> grands boulevards, pour s’acheminer vers une<br />
organisation diffuse à partir de certaines polarités secondaires, situées en périphérie et<br />
spécialisées dans <strong>des</strong> segments d’activités.<br />
Désormais, ce n’est plus la mosquée avec son minaret et ses cinq appels à la prière<br />
qui régulent les rythmes urbains et déterminent les rapports entre composantes<br />
spatiales, c’est plutôt Marjane, Aswak Assalam, le Mega Mall, Mac Donald’s, etc. qui<br />
deviennent les repères et les identifiants tant spatial que social. Ces formes de la<br />
modernisation de l’espace et de la société, ont entraîné <strong>des</strong> changements profonds <strong>des</strong><br />
comportements et <strong>des</strong> attitu<strong>des</strong> de caractère religieux qui sont en même temps les<br />
fondements de la vie matérielle dans la ville.<br />
Mosquée à Plaisance - Meknès Mosquée à Bellevue - Meknès<br />
Ainsi, l’évolution de la société urbaine et l’organisation de son espace se réfèrent<br />
plus à <strong>des</strong> normes urbaines plus fonctionnalistes, plus rentières et où le profane<br />
l’emporte, assez souvent, sur le sacré et où la logique de la modernisation prime sur<br />
l’organisation traditionnelle commun<strong>au</strong>taire. Aujourd’hui, même si la mosquée<br />
continue à meubler l’espace urbain et à drainer un nombre considérable de fidèles<br />
surtout le vendredi, pendant le Ramadan et lors fêtes religieuses, elle ne matérialise<br />
plus cette instance à partir de laquelle toute la ville prend sens et signification.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
La mosquée<br />
un vecteur d'animation<br />
et de mixité sociale
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 127<br />
Ceci dit, dans certains cas, la construction d’une mosquée <strong>au</strong> milieu de certains<br />
quartiers hétérogène en terme de typo-morphologie et de contenu social, peut rendre<br />
ces lieux de culte <strong>des</strong> pôles d’animation, de sociabilité, de mixité et de brassage social.<br />
La mosquée Anouar - Meknès la mosquée Belleaire - Meknès<br />
La mosquée un<br />
catalyseur d'intégration<br />
urbaine et sociale<br />
Par ailleurs, dans les centralités modernes émergentes, la mosquée cohabite<br />
parfaitement avec <strong>des</strong> édifices dédiés <strong>au</strong>x nouvelles technologies de l’information et<br />
de communication, à la franchise de distribution et de services, etc.<br />
Cette compétitivité territoriale, où tradition et contemporanéité se chev<strong>au</strong>chent et<br />
interagissent, détermine largement la nouvelle identité de l’espace urbain marocain. Et<br />
par le même truchement définit la place de la mosquée dans le nouve<strong>au</strong> contexte urbain<br />
et dans la nouvelle cartographie <strong>des</strong> équipements collectifs.<br />
De fait, la mosquée est confrontée à de nouve<strong>au</strong>x défis spatio-temporels,<br />
l’inscrivant dans une échelle plus planétaire que locale. Elle doit traduire par son rôle,<br />
son architecture, sa forme son adhésion à la nouvelle ère du temps. Une ère qui renvoie<br />
à la fois à l’<strong>au</strong>thenticité de la pratique et à la contemporanéité <strong>des</strong> préoccupations<br />
socioculturelles et politiques.<br />
Cohabitation de deux repères : un centre d'appel à proximité de la mosquée Badr à l'Agdal à Rabat<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
127
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 128<br />
128<br />
- Vers une reconquête de la mosquée<br />
L’attention particulière octroyée à la mosquée en tant qu’institution d’encadrement<br />
social et de symbole de la prééminence de l’Islam, a donnée lieu à la multiplication de<br />
la construction de mosquées tout en veillant à leur embellissement, pour y attirer la<br />
foule. La symbolique étatique représentée par «<strong>des</strong> mosquées imposantes, dotées<br />
parfois d’esplana<strong>des</strong>, coïncide dans ce cas avec la volonté de rassemblement de la<br />
commun<strong>au</strong>té» 4 : car la prière dans une mosquée est d’<strong>au</strong>tant plus sanctifiante que celleci<br />
permet de réunir le maximum de fidèles.<br />
L’équipement <strong>des</strong> mosquées en paraboles diffusant <strong>des</strong> émissions religieuses,<br />
l’usage <strong>des</strong> mosquées comme lieu de lutte contre l’analphabétisme sont, entre <strong>au</strong>tres,<br />
<strong>des</strong> mesures qui peuvent restituer à la mosquée toute sa vocation sociale et culturelle<br />
et toute son importance dans la ville.<br />
Par ailleurs, l’architecture, l’agencement <strong>des</strong> espaces de la mosquée, l’esthétique,<br />
l’ornementation, la volumétrie et les gabaries, le choix <strong>des</strong> matéri<strong>au</strong>x, l’intégration <strong>des</strong><br />
nouvelles technologies de construction, sont également <strong>des</strong> aspects à considérer d’une<br />
manière systémique pour une reconquête de ce h<strong>au</strong>t lieu de la foi et de lui redonner<br />
toute la place qui lui revient dans notre contexte marocain.<br />
En dernier, l’intégration de la mosquée dans son contexte temporel, social et<br />
culturel est, <strong>au</strong>jourd’hui, plus qu’une nécessité, c’est une urgence. La ville et la vie<br />
dans la ville marocaine n’<strong>au</strong>ront de sens et de signification que si on restitue à la<br />
mosquée son rôle en tant que repère spatial et identifiant social et qu’on synchronise<br />
les normes urbaines et architecturales et les prescriptions religieuses.<br />
4 Mohamed Naciri : La mosquée, un enjeu dans la ville, in Lamalif n°192, 1987, (pp. 48-52).<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
La mosquée<br />
et son minaret : identifiant<br />
et repère dans la ville
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 129<br />
EDIFICATION DES MOSQUÉES EN RAPPORT<br />
AVEC LES NOUVELLES EXIGENCES DE LA<br />
MOBILITÉ DES USAGERS<br />
INTRODUCTION :<br />
Mohammed Achour<br />
Architecte, urbaniste,<br />
professeur d’architecture, E N A.<br />
Il est sans conteste que la nature de la mobilité <strong>des</strong> habitants dans la ville a été<br />
profondément affectée par les changements survenus depuis une quinzaine d’années<br />
dans la société globale. Ces changements concernent en premier les moyens de<br />
transport et de communication, les infrastructures routières et <strong>au</strong>ssi les systèmes de<br />
déplacement. Par conséquent, les pratiques spatiales <strong>des</strong> habitants s’adaptent<br />
<strong>au</strong>jourd’hui à ces évolutions, ce qui se traduit par de nouvelles tendances de la mobilité<br />
qui ont à leur tour un impact direct sur la ville et ses composantes.<br />
A l’évidence, cela impose un renouvellement et une mise à jour <strong>des</strong> normes<br />
d’édification de tous les éléments constitutifs de la ville, notamment les lieux de culte<br />
et précisément les mosquées.<br />
Dès lors, nous proposons dans cette communication de mettre en lumière l’impact<br />
<strong>des</strong> nouvelles tendances de la mobilité <strong>des</strong> habitants sur la localisation <strong>des</strong> mosquées<br />
dans la trame urbaine ainsi que les nouvelles logiques qu’elles imposent dans<br />
l’organisation de ces lieux de culte.<br />
A cette fin, nous allons analyser, à travers <strong>des</strong> cas concrets de mosquées situées à<br />
Rabat, le rapport de la localisation <strong>des</strong> mosquées et organisation eu égard <strong>au</strong>x<br />
nouvelles mobilités <strong>des</strong> usagers, à leurs besoins en déplacements et à leurs possibilités<br />
de se rendre d’un lieu de la ville à un <strong>au</strong>tre.<br />
En effet, les pratiques spatiales <strong>des</strong> habitants s’adaptent <strong>au</strong>x évolutions récentes <strong>des</strong><br />
moyens de déplacement, notamment <strong>au</strong>x t<strong>au</strong>x d’équipement en <strong>au</strong>tomobile <strong>des</strong><br />
ménages et <strong>au</strong> développement <strong>des</strong> infrastructures routières. De ce fait, les distances<br />
parcourues ont sensiblement <strong>au</strong>gmenté et les lieux fréquentés sont devenus de plus en<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
129
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 130<br />
plus éloignés du lieu de résidence. Ceci, à l’évidence <strong>au</strong>gmente l’intensité <strong>des</strong> flux<br />
dans la ville et y rend la mobilité quotidienne plus accrue.<br />
La démocratisation de l’usage de l’<strong>au</strong>tomobile, permet <strong>au</strong>jourd’hui la réalisation de<br />
trajets plus longs sur <strong>des</strong> durées plus courtes, ce qui encourage et stimule les<br />
déplacements <strong>des</strong> habitants entre différents lieux de la ville.<br />
Dans le même sens, la vitesse <strong>des</strong> transports devenue plus performante encourage<br />
les gens à aller plus loin et avoir une préférence pour l’espace. Tel appétit <strong>au</strong>gmente<br />
les distances parcourues et <strong>au</strong>ssi les espaces de stationnements.<br />
Par ailleurs, nous constatons <strong>au</strong>jourd’hui une détérioration <strong>des</strong> mécanismes d’identité,<br />
d’appartenance et de commun<strong>au</strong>té sous l’influence <strong>des</strong> possibilités de déplacement.<br />
La notion d’appartenance à un quartier et la notion de voisinage, qui s’appuyaient<br />
sur la proximité physique, tendent à disparaître. Du fait, <strong>Les</strong> relations sociales sont de<br />
moins en moins corrélées avec la proximité et nécessitent <strong>des</strong> déplacements de plus,<br />
alors qu’<strong>au</strong>paravant les gens qui avaient <strong>des</strong> relations sociales, <strong>des</strong> intérêts et <strong>des</strong><br />
enjeux communs voisinaient dans le même lieu de la ville.<br />
La notion d’équipement de proximité (mosquée du quartier, boulangerie du<br />
quartier, etc.) a disparu elle <strong>au</strong>ssi. Alors qu’<strong>au</strong>paravant les gens cherchaient le pain<br />
dans la boulangerie du quartier et priaient dans la mosquée de la rue, <strong>au</strong>jourd’hui du<br />
moment où les moyens de transports permettent le déplacement facile, les gens<br />
choisissent leur boulangerie ou leur mosquée en fonction de l’accessibilité facile, en<br />
fonction de la voie de liaison rapide, ou encore en fonction du stationnement aisé. <strong>Les</strong><br />
usagers choisissent <strong>au</strong>ssi leurs mosquées en fonction de la capacité d’accueil et non<br />
plus la contiguïté.<br />
CONSTAT :<br />
En effet, comme on peut le constater, sous l’effet de ces évolutions, <strong>Les</strong> gens ne<br />
fréquentent plus la mosquée du quartier ou la plus proche, mais plutôt la mosquée la<br />
plus accessible facilement en voiture, c’est à dire celles limitrophes <strong>au</strong>x voies rapi<strong>des</strong>.<br />
Car du moment où l’on prend sa voiture, les gens préfèrent emprunter les voies faciles<br />
et non encombrées même si la mosquée est plus éloignée que celle du quartier où l’on<br />
habite si cette dernière est localisée dans un endroit difficilement accessible ou une<br />
trame viaire étroite.<br />
Nous constatons <strong>au</strong>ssi, que les mosquées les plus convoitées, surtout pendant le<br />
mois du Ramadan, sont les mosquées dotées de parkings de stationnement pour les<br />
voitures ou du moins celles situées dans une zone dont la trame viaire permet le<br />
stationnement facile.<br />
130<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 131<br />
D’<strong>au</strong>tre part, vue que les gens peuvent se déplacer facilement grâce <strong>au</strong>x moyens de<br />
transport, ils convoitent les mosquées qui disposent de cours (SAHN) permettant<br />
l’extension de la capacité d’accueil de la salle de prière, ou celles qui disposent d’une<br />
galerie extérieure couverte ou semi couverte pouvant servir de lieu de prière extérieur<br />
mais protégé <strong>des</strong> intempéries et à l’abri <strong>des</strong> nuisances de la rue, dans le cas de la<br />
saturation de la salle de prière. <strong>Les</strong> usagers préfèrent <strong>au</strong>ssi les mosquées dotées<br />
d’esplanade extérieure minérale située à l’avant de la salle de prière de façon à servir<br />
d’extension de celle-ci.<br />
Nous constatons <strong>au</strong>ssi que les mosquées qui sont dotées de jardins extérieurs ou de<br />
pelouses sont préférées à celles qui n’ont <strong>au</strong>cune extension possible et sont par<br />
conséquent plus convoitées que d’<strong>au</strong>tres.<br />
Tout cela, évidemment est c<strong>au</strong>sé par les possibilités de se déplacer facilement, grâce<br />
<strong>au</strong>x moyens de transport individuels, et <strong>au</strong>ssi collectifs (transport en commun) grâce<br />
<strong>au</strong>x infrastructures routières, grâce à l’évolution de la vitesse de déplacement devenue<br />
performante. Bref à c<strong>au</strong>se <strong>des</strong> nouvelles tendances de la mobilité <strong>des</strong> usagers.<br />
Par conséquent, l’édification <strong>des</strong> mosquées doit tenir compte de ces évolutions afin<br />
de répondre <strong>au</strong>x nouvelles exigences <strong>des</strong> usagers.<br />
ETUDE DE CAS :<br />
Nous prenons pour illustrer ces constats trois exemples exemplatifs pouvant servir<br />
de référence dans la normalisation <strong>des</strong> mosquées afin de les mettre en adéquation avec<br />
les pratiques de la mobilité <strong>des</strong> usagers.<br />
<strong>Les</strong> affirmations tirées de ces trois exemples émanent <strong>des</strong> résultats d’une enquête<br />
faite <strong>au</strong>près <strong>des</strong> usagers <strong>des</strong> mosquées dans le cadre d’une étude domiciliée à l’ENA<br />
et qui traite dans un de ses volets du rapport entre le temps <strong>des</strong> usagers et les<br />
caractéristiques <strong>des</strong> équipements socio- publics (entre <strong>au</strong>tre les mosquées).<br />
Pour ce faire, nous avons soumi un questionnaire à un échantillon d’usagers <strong>des</strong><br />
mosquées. La question principale était : quels sont les facteurs de facilitation que vous<br />
ressentez à la fréquentation <strong>des</strong> mosquées dont vous faites usage ?<br />
<strong>Les</strong> facteurs qui en ressortent et qui sont en rapport étroit avec la mobilité <strong>des</strong><br />
usagers peuvent être regroupés dans les trois indicateurs de facilitation à la<br />
fréquentation <strong>des</strong> mosquées suivants : 1) l’accessibilité (rapport à la voirie) 2) le<br />
stationnement (parcage de la voiture) 3) l’extension de la capacité d’accueil (le<br />
SAHN et l’esplanade).<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
131
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 132<br />
LA MOSQUEE ASSOUNNA (Rabat)<br />
Le premier exemple est celui de la mosquée ASSOUNNA construite et achevée<br />
en 1785, puis refaite plusieurs fois. Située à l’extrémité nord de l’avenue <strong>des</strong> Touarga,<br />
elle s’élève actuellement entre les bâtiments de l’office <strong>des</strong> phosphates et le collège My<br />
youssef.<br />
Cette mosquée est fréquentée d’une manière spectaculaire les jours du vendredi<br />
ainsi que pendant les mois du ramadan. En effet, les gens y viennent même de quartiers<br />
très loin (grâce justement, à ces moyens de transports et cette nouvelle culture de la<br />
mobilité) et ce, pour les raisons suivantes :<br />
Tout d’abord pour <strong>des</strong> raisons d’accessibilité. Cette mosquée est située dans un<br />
endroit stratégique de la ville daignant plusieurs voies rapi<strong>des</strong> et localisée près de<br />
plusieurs <strong>des</strong>sertes en transports collectifs. L’accessibilité y est facile en voiture sans<br />
être obligé d’entrer dans <strong>des</strong> voies secondaires de distribution du quartier (existence de<br />
voiries de liaison rapide). La mosquée est édifiée en île et les voitures peuvent tourner<br />
<strong>au</strong>tour d’une manière fluide et très facile.<br />
Deuxièmement le stationnement. La mosquée ASSOUNNA est entourée de voies<br />
larges permettant le stationnement facile même si elle n’est pas dotée d’une aire de<br />
stationnement particulière.<br />
Aussi, l’existence à proximité de la mosquée ASSOUNNA de parkings de<br />
stationnement de certains équipements voisins (par exemple, lycée Moulay Youssef, le<br />
ministère <strong>des</strong> PTT, etc.) permet le stationnement facile <strong>au</strong> moment <strong>des</strong> prières.<br />
132<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 133<br />
Troisièmement l’extension de la capacité d’accueil. La mosquée ASSOUNNA est<br />
dotée d’une esplanade extérieure bien située par rapport à la salle de prière (à l’avant).<br />
Cette esplanade minérale en partie <strong>au</strong>gmente la capacité d’accueil de la mosquée ce qui<br />
encourage les gens de venir de très loin.<br />
Cependant, cette esplanade n’est séparée <strong>des</strong> voies de circulation par <strong>au</strong>cune limite<br />
de protection ni <strong>au</strong>cune transition la protégeant de l’<strong>au</strong>tomobile quand elle sert<br />
d’espace de prière (qui doit être en principe calme et paisible).<br />
Aussi, la mosquée ASSOUNNA, dispose d’une immense cour (SAHN) rectangulaire<br />
et plus large que profonde, située en avant de la salle de prière qui permet le<br />
prolongement de celle ci ainsi que l’extension de la capacité d’accueil de la mosquée.<br />
Ce SAHN est entouré d’une galerie et de trois porches d’entrée pouvant servir d’espace<br />
de prière protégé <strong>des</strong> intempéries en plus du SAHN à ciel ouvert. Alors que nous<br />
constatons l’absence du SAHN dans la plupart <strong>des</strong> nouvelles mosquées contemporaines.<br />
LA MOSQUEE LALA SOUKAYNA (Rabat)<br />
Le deuxième exemple est celui de la mosquée LALA SOUKAYNA. Construite en<br />
1988, cette mosquée se situe sur un terrain très dégagé <strong>au</strong> bord d’un tissu résidentiel<br />
de villas à basse densité, entre le quartier Agdal et le quartier Hay Riad.<br />
Elle se présente dans le paysage urbain en tant qu’événement repère dans la voie<br />
rapide de liaison entre Hay Riad et le centre ville. Son accessibilité est très aisée. Elle<br />
s’entoure de jardins et un grand parking pour les voitures.<br />
Cette mosquée est fréquentée et préférée par les usagers d’une manière prodigieuse<br />
le jour du vendredi pour les raisons suivantes :<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
133
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 134<br />
Premièrement pour les raisons d’accessibilité facile. Le fait qu’elle soit langée par<br />
une avenue principale, une voie pendulaire importante fait d’elle une mosquée très<br />
fréquentée, très convoitée et très connue <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de la ville car facile d’accessibilité<br />
sans entrer dans le tissu du quartier.<br />
Deuxièmement le stationnement. <strong>Les</strong> dimensions de son parking (malgré les<br />
problèmes pratiques d’accès (sens unique, sens interdit, etc.) et la possibilité de<br />
stationner facilement tout <strong>au</strong>tour le long de l’avenue qui la longe, encourage les gens<br />
à la fréquenter. <strong>Les</strong> fidèles y viennent de tous les quartiers de la zone, alors qu’il y a<br />
d’<strong>au</strong>tres mosquées dans les environs.<br />
Troisièmement l’extension de la capacité d’accueil. Par ailleurs, si la mosquée<br />
LALA SOUKAYNA est dotée d’un SAHN très petit, elle dispose par contre d’un<br />
porche de l’entrée principale et d’une galerie d’arca<strong>des</strong> sous forme d’enceinte à<br />
l’intérieur de laquelle sont aménagés de petit riads. Ce porche et cette enceinte<br />
occupent le rôle de boudoir <strong>au</strong>tour de l’édifice et d’isolation visuelle vis-à-vis de<br />
l’extérieur, comme ils servent <strong>au</strong>ssi de prolongement de la salle de prière <strong>des</strong> trois<br />
cotés derrière le “Mihrab”.<br />
<strong>Les</strong> jardins <strong>au</strong>tour (végétal : pelouse et minéral : esplanade dallée) font que la<br />
capacité d’accueil de cette mosquée est aisément extensible et très encourageante. C’est<br />
ce qui explique sa fréquentation les jours du vendredi et pendant le mois de ramadan.<br />
134<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 135<br />
LA MOSQUEE de la CGI à Hay Riad (Rabat)<br />
Le troisième exemple c’est celui de la mosquée de la CGI située à Hay Riad à<br />
proximité de l’avenue Annakhil connue par le mail central.<br />
Depuis l’achèvement de sa construction en 2002, cette mosquée est préférée par les<br />
habitants de Hay Riad, par ceux qui y travaillent mais <strong>au</strong>ssi par d’<strong>au</strong>tres usagers qui<br />
viennent d’<strong>au</strong>tres quartiers voisins, par exemple Guich <strong>des</strong> Oudaya .En effet, elle est<br />
très fréquentée alors qu’il y a d’<strong>au</strong>tres mosquées dans la zone, par exemple : la<br />
mosquée SAYF, la mosquée ARRIDOUANE, la mosquée KARRAKCHOU. <strong>Les</strong><br />
raisons de ce «succès» sont :<br />
Premièrement l’accessibilité facile. Cette mosquée est connectée à la double voie<br />
de l’avenue Annakhil (voie de liaison rapide) d’une manière facile grâce <strong>au</strong>x deux<br />
connexions perpendiculaires, ce qui encourage les gens à la fréquenter alors que dans<br />
le même quartier il y a deux <strong>au</strong>tres mosquées, la mosquée ARRIDOUANNE et la<br />
mosquée KARRAKCHOU, mais qui sont noyées dans le tissu <strong>des</strong> villas et par<br />
conséquent difficilement accessibles, à c<strong>au</strong>se de l’étroitesse <strong>des</strong> rues qui les entourent.<br />
Deuxièmement le stationnement abondant. Cette mosquée est dotée d’un parking<br />
et de places de stationnement facile tout <strong>au</strong>tour, alors que la mosquée ARRIDOUANE<br />
est située dans un tissu dense et une trame serrée qui ne permet pas le parcage facile. En<br />
effet, grâce à sa localisation près d’un jardin et d’un ministère, la mosquée de la CGI<br />
offre une commodité en terme de parkings qui la rend attractive pour les usagers<br />
motorisés, qui sont de plus en plus pressés et cherchent de plus en plus le parcage facile.<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
135
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 136<br />
Troisièmement l’extension de la capacité d’accueil. En effet, même si la mosquée<br />
de la CGI de Hay Riad ne dispose pas de SAHN, elle est entourée <strong>des</strong> trois cotés d’une<br />
galerie plus large que celle de LALA SOUKAYNA, ce qui permet l’extension de la<br />
salle de prière à l’abri <strong>des</strong> intempéries même quand il pleut ou quand il fait très ch<strong>au</strong>d.<br />
Cette donnée constitue à elle seule une motivation pour les fidèles le jour du<br />
vendredi et rend la mosquée attractive, drainant ainsi une tranche d’usagers non<br />
forcément locale mais de plus en plus nomade et excentrée.<br />
Cette mosquée présente <strong>au</strong>ssi une <strong>au</strong>tre motivation importante pour les usagers :<br />
elle est dotée d’un jardin et d’une esplanade extérieurs entourés d’un mur de clôture,<br />
qui servent le vendredi et pendant le ramadan de prolongement de la salle de prière. Le<br />
fait qu’elle soit entourée par un mur de clôture, dissocie cette esplanade de l’espace<br />
public de circulation piétonne et carrossable et lui procure de la quiétude et de la<br />
sérénité.<br />
CONCLUSION :<br />
Au regard de ces nouvelles exigences, les normes d’édification <strong>des</strong> mosquées<br />
doivent être plus soucieux de leur environnement dans son rapport à la mobilité <strong>des</strong><br />
usagers.<br />
Alors que les déterminants de leur localisation se ramenaient en la proximité <strong>des</strong><br />
centres de quartiers ou l’insertion dans les quartiers, <strong>au</strong>jourd’hui, l’accessibilité <strong>au</strong>x<br />
princip<strong>au</strong>x axes routiers (<strong>au</strong>toroutes, roca<strong>des</strong>, échangeurs, Etc.), et les conditions de<br />
stationnement, sont devenues <strong>des</strong> déterminants dans le choix de localisation de ces<br />
lieux de culte.<br />
<strong>Les</strong> infrastructures de transports (support de la mobilité) doivent désormais être<br />
considérées comme l’un <strong>des</strong> princip<strong>au</strong>x éléments structurants de la distribution spatiale<br />
de ces lieux dans la ville. L’accessibilité (possibilité d’atteindre ou de quitter un lieu<br />
donné facilement et rapidement) est devenue un critère important de localisation <strong>des</strong><br />
mosquées.<br />
136<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 137<br />
<strong>Les</strong> besoins d’accès <strong>au</strong>x usagers de plus en plus motorisés, font que ces lieux<br />
doivent être situés et localisés de manière à offrir la commodité en termes d’accès de<br />
la voiture, <strong>des</strong> moyens de transport publics et de stationnement. Cherchant la bonne<br />
<strong>des</strong>serte, ils doivent se détacher <strong>des</strong> contraintes liées <strong>au</strong>x centres villes, tel que les<br />
encombrements et les difficultés d’accessibilité.<br />
En plus, les mosquées doivent viser <strong>au</strong>jourd’hui, une tranche d’usagers non<br />
forcement locale, mais de plus en plus nomade et constamment mobile. Ceci remet en<br />
question le critère classique d’équipement de quartier et de mosquée de quartier pour<br />
devenir les équipements et les mosquées de la ville.<br />
Ainsi la localisation de ces lieux de culte doit désormais s’acheminer, sous l’effet<br />
de la mobilité <strong>des</strong> usagers, vers un décentrement par rapport <strong>au</strong> cœur <strong>des</strong> quartiers. <strong>Les</strong><br />
endroits de prédilection sont les carrefours <strong>des</strong> grands flux pendulaires, les grands axes<br />
<strong>au</strong>toroutiers ou les usagers motorisés peuvent s’offrir une accessibilité aisée et un<br />
stationnement facile.<br />
D’<strong>au</strong>tre part, face à cette nouvelle culture de la mobilité et cette facilité de se<br />
déplacer, les normes d’édification <strong>des</strong> mosquées (pour être en commodité avec les<br />
exigences du moment) doivent prévoir l’extension facile de la salle de prière et par<br />
conséquent de la capacité d’accueil de la mosquée. Le retour <strong>au</strong> SAHN (car nous<br />
constatons la disparition du SAHN dans les nouvelles mosquées) en est une solution,<br />
mais d’<strong>au</strong>tres formules du prolongement de la salle de prière peuvent être retenues.<br />
Comme on a pu le constater précédemment, l’extension peut se faire par <strong>des</strong> espaces<br />
tournés vers l’intérieur, mais <strong>au</strong>ssi extravertis permettant l’étalement à l’extérieur tout<br />
en restant à l’abri <strong>des</strong> nuisances urbaines : le porche d’entrée, la galerie extérieure,<br />
l’esplanade ou le jardin entouré de mur de clôture.<br />
C’étaient là quelques-uns <strong>des</strong> princip<strong>au</strong>x faits dégagés par notre analyse de la<br />
mosquée eu égard <strong>au</strong>x nouvelles tendances de la mobilité <strong>des</strong> usagers, simple<br />
introduction à cet univers particulier qu’est l’édification de ces lieux de culte.<br />
In fine, nous pouvons dire que les signes d’une nouvelle stratégie en matière<br />
d’édification <strong>des</strong> mosquées sont présents. Notre espoir est que ces éléments suscitent<br />
<strong>des</strong> réflexions et stimulent <strong>des</strong> recherches ultérieures.<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
137
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 138<br />
138<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 139<br />
I- Introduction :<br />
EQUIPEMENT EN MOSQUÉES :<br />
NOUVELLES NORMES URBAINES<br />
M. Abdelaziz Derouiche<br />
Directeur <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong><br />
Ministère <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong> Affaires Islamiques<br />
Depuis <strong>des</strong> années, les normes urbaines en matière d’équipement en mosquées<br />
n’avaient pas changé et peu a été fait pour les changer.<br />
Or, la logique arithmétique de ces normes mises de l’avant par les planificateurs<br />
urbaines n’avait pas facilité un développement normal du rése<strong>au</strong> <strong>des</strong> mosquées en<br />
plusieurs zones urbaines.<br />
En effet, en matière d’infrastructure religieuse, malgré les progrès réalisés, la<br />
situation reste préoccupante. En témoignent l’insuffisance <strong>des</strong> mosquées dans<br />
plusieurs périmètres urbaines et la multiplication <strong>des</strong> lieux de prières de quartiers à la<br />
place <strong>des</strong> moquées structurées.<br />
❚ Quels types d’aménagements urbains faciliteraient donc la mosquée ?<br />
❚ Comment faire pour que ces aménagements urbains permettent la satisfaction <strong>des</strong><br />
besoins <strong>des</strong> populations en équipements cultuels ?<br />
❚ <strong>Les</strong> efforts et le financement seront-ils réellement orientés vers un développement<br />
normal <strong>des</strong> infrastructures religieuses ?<br />
A cet effet, Le département chargé <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong> Affaires Islamiques a procédé<br />
depuis 2003, à <strong>des</strong> investigations et étu<strong>des</strong> qui visent de :<br />
• Produire une série d’analyses quantitatives en vue d’établir un diagnostic, <strong>au</strong>ssi<br />
précis que possible, de la situation <strong>des</strong> équipements cultuels <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de quelques<br />
entités urbaines.<br />
• Mettre en évidence <strong>des</strong> différents nive<strong>au</strong>x de <strong>des</strong>sertes <strong>des</strong> populations, ainsi que<br />
<strong>des</strong> déséquilibres et <strong>des</strong> déficits qui en découlent.<br />
• Elaborer de nouvelles normes urbaines en matière d’équipements cultuels en<br />
étroite concertation avec la direction de l’urbanisme.<br />
Il f<strong>au</strong>t noter que malheureusement, nous ne disposons pas de toutes les données<br />
et les outils pour opérer une analyse minutieuse <strong>des</strong> différents aspects <strong>des</strong> mosquées. En<br />
effet, les techniques et les métho<strong>des</strong> statistiques sur les mosquées ne sont pas encore<br />
bien développées.<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
139
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 140<br />
Néanmoins, la présente communication propose d’abord la présentation <strong>des</strong><br />
résultats préliminaires <strong>des</strong> éb<strong>au</strong>ches <strong>des</strong> investigations et étu<strong>des</strong> sur les mosquées du<br />
grand Casablanca, puis donne un aperçu <strong>des</strong> principales tendances de la nouvelle grille<br />
normative en matière d’équipement en mosquée.<br />
II - Indicateurs socio-spati<strong>au</strong>x :<br />
L’évaluation de la situation <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> national et <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de la région du grand<br />
Casablanca fait ressortir quelques indicateurs socio-spati<strong>au</strong>x sur les mosquées.<br />
2.1/ les indicateurs démographiques :<br />
140<br />
• Evolution de la population 1994/2004<br />
Année Effectif Variation<br />
1994 26.073.717<br />
2004 29.891.708<br />
• T<strong>au</strong>x moyen d’accroissement de la population = 1,4%.<br />
• Volume de variation en tenue d’effectif = 417.764 habitants/an.<br />
• T<strong>au</strong>x d’urbanisation élevé = 51,4%.<br />
• Structure de l’armature urbaine nationale en pleine mutation par le dynamisme qui<br />
caractérise de nombreuses :<br />
▲ Petites et moyennes villes.<br />
▲ Nouvelles villes.<br />
▲ Bores péri- urbains.<br />
• Agglomérations d’habitation rurale en plein développement.<br />
2.2/ les indicateurs d’évaluations <strong>des</strong> nive<strong>au</strong>x de dotations <strong>des</strong> régions<br />
en équipement cultuel :<br />
<strong>Les</strong> régions Oued Eddahab-Lagouira, Laayoune-Boujdour, le grand Casablanca et<br />
Rabat-Sala-Zemmour-Zaer ont un ou deux mosquées pour 5.000 habitants.<br />
<strong>Les</strong> régions qui ont entre 3 à 7 mosquées, pour 5000 habitants, sont : Guelmim-Es-<br />
Semara, Chaouia-Ouardigha, Orientale, Meknès-Tafilalet, fès-Boulemane.<br />
<strong>Les</strong> régions où le nombre <strong>des</strong> mosquées, pour 5000 habitants, est supérieur à 7<br />
mosquées sont : Souss Massa-Draa, Gharb Chrarda Beni-Hsen, Marrakech-Tensift-<br />
Alhaouz, Doukkala-Abda, Tadla-Azilal, Taza-Alhoceima-Taounate, Tanger-Tetouan.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
3.817.991
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 141<br />
Ces différences régionales réelles et importantes, nous incitent, dans le futur, à<br />
chercher les princip<strong>au</strong>x paramètres explicatifs de cette variabilité.<br />
Aussi, la région du grand Casablanca nous interpelle t-elle non seulement par son poids<br />
démographiques mais <strong>au</strong>ssi et particulièrement par son déficit en équipement cultuel.<br />
R. Oued Dahab<br />
Lagouira<br />
Situation <strong>des</strong> équipements cultuels<br />
<strong>au</strong> nive<strong>au</strong> régional<br />
R. Laâyoune<br />
Smara<br />
R. Goulmim Smara<br />
R. Doukkala<br />
Abda<br />
R. Grand<br />
Casablanca<br />
R. Marrakech<br />
Tansift El-Haouz<br />
R. Rabat Salé<br />
Zemmour<br />
Zaër<br />
R. Tanger<br />
Tétouan<br />
R. Gharb Chrarda<br />
Beni Hsen<br />
R. Chaouia<br />
Wardigha<br />
R. Tadla<br />
Azilal<br />
R. Souss Massa<br />
Darâa<br />
R. Taza Hoceima<br />
Taounate<br />
R. Fès<br />
Boulman<br />
R. Meknès<br />
Tafilalet<br />
Nombre <strong>des</strong> mosquées pour<br />
5000 habitants<br />
1 - 2<br />
3 - 4<br />
5 - 6<br />
7 - 8<br />
9 - 10<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
R. de l’Est<br />
141
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 142<br />
2.3/ les indicateurs spati<strong>au</strong>x :<br />
L’analyse spatiale <strong>des</strong> mosquées de la grande Casablanca a fait appel à <strong>des</strong><br />
polygones de theissen :<br />
L’aire géographique de chaque mosquée ou sa zone de service (S) est définie par un<br />
polygone de Theissen formé par les médianes correspondantes.<br />
La zone d’influence d’une mosquée peut être <strong>au</strong>ssi matérialisée par un cercle de<br />
même surface que celle de son polygone de theissen.<br />
Son rayon R= √ — S/π, dénomé ici rayon de service, correspond à la distance<br />
maximale que parcours un prieur pour accéder à la mosquée.<br />
L’application du principe <strong>des</strong> polygones de theissen à la répartition géographique<br />
<strong>des</strong> mosquées de vendredi et <strong>des</strong> cinq prières du grand Casablanca aboutit à la<br />
configuration matérialisée dans la carte N°1.<br />
L’interprétation cartographique <strong>des</strong> nive<strong>au</strong>x <strong>des</strong> <strong>des</strong>serts <strong>des</strong> populations en<br />
mosquées fait donc ressortir trois zones principales :<br />
• Zone de répartition, normale <strong>des</strong> mosquées avec <strong>des</strong> rayons de service variant<br />
entre 200 et 400 m. (Carte n° 2)<br />
• Zone de déficits en infrastructures religieuses avec <strong>des</strong> rayons de service qui<br />
avoisinent 600 m. (Carte n° 3)<br />
142<br />
Médiane (BC)’<br />
Mosquée A<br />
B<br />
Médiane (AB)’<br />
Aire géographique ou zone<br />
de service de la mosquée A<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
B<br />
A<br />
C<br />
C<br />
Soient A, B et C trois mosquées<br />
voisines réparties aléatoirement.<br />
R<br />
A<br />
Médiane (AC)’<br />
Zone d’influence<br />
de la mosquée A,<br />
de rayon R
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 143<br />
• Zone d’absence d’équipements cultuels structurés dont les rayons de service <strong>des</strong><br />
mosquées sont supérieurs à 1000 m. (Carte n° 4)<br />
Depuis la période coloniale, la ville de Casablanca a bénéficié <strong>des</strong> infrastructures<br />
urbanistiques liées essentiellement à la fonction de capital. La fonction cultuelle<br />
constituait un enjeu extérieur <strong>au</strong> développement économique, social et urbain, et<br />
L’impact liée à ce mode de planification urbaine est l’insuffisance <strong>des</strong> lieux de culte de<br />
qualité et accessible dans plusieurs quartiers de la ville.<br />
Le manque et l’insuffisance <strong>des</strong> mosquées dans plusieurs zones urbaines se sont<br />
traduits par la multiplication <strong>des</strong> salles de prières.<br />
En effet, la région du grand Casablanca qui totalise à elle seule environ 50% du<br />
nombre de salle de prière dans notre pays. Cette multiplication reste donc un<br />
phénomène spécifique à cette région, et les conclusions de l’analyse spatiale de ses<br />
mosquées ne peuvent être extrapolés à d’<strong>au</strong>tre région.<br />
Ce phénomène est facilement appréhendé par l’intégration <strong>des</strong> salles de prières dans<br />
l’analyse par les polygones de theissen.<br />
D’après les cartes N° 5 et 6, l’implantation <strong>des</strong> salles de prières a conduit à un net<br />
rétrécissement <strong>des</strong> zones de manque ou d’insuffisance de mosquées. Par conséquent,<br />
<strong>Les</strong> équipements en mosquées s’avèrent comme une demande incompressible. où en<br />
absence de mosquées les populations construisent <strong>des</strong> salles temporaires de prières.<br />
Nonobstant, d’après la carte N°6 quelques zones d’absence de mosquées subsistent<br />
et ne semblent pas être envahies par <strong>des</strong> salles de prières.<br />
L’hypothèse de l’incompressibilité de la demande en mosquées est-il affecté par<br />
cette dernière observation ? La recherche profonde par la comparaison de la carte <strong>des</strong><br />
mosquées (avec salle de prière) et la carte <strong>des</strong> zones ouvertes à l’aménagement a<br />
dévoilé que les zones reliquats de manque <strong>des</strong> mosquées correspondent à <strong>des</strong> zones<br />
nouvellement ouvertes à l’aménagement. (Carte N° 7).<br />
Ce constat montre <strong>au</strong>ssi que l’approche méthodologique de l’analyse spatiale <strong>des</strong><br />
mosquées par les polygones de theissen est un modèle fiable.<br />
L’<strong>au</strong>tre question qui se pose pour les salles de prières est de savoir si leur présence<br />
est corrélée <strong>au</strong> t<strong>au</strong>x de p<strong>au</strong>vreté et <strong>au</strong>x types d’habitat.<br />
Dans la carte N°9, les sales de prières sont corrélées avec la ceinture de p<strong>au</strong>vreté<br />
qui entoure Casablanca, mais cette corrélation n’est pas vérifiée par tout.<br />
La carte N°10 montre que les salles de prière se multipliaient essentiellement dans<br />
les zones d’habitat de type social ou sommaire. Par contre, les quartiers d’habitat<br />
modernes accusent <strong>des</strong> déficits importants en infrastructures religieuses.<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
143
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 144<br />
144<br />
Carte N°1 :<br />
Zones de service <strong>des</strong> mosquées de vendredi et <strong>des</strong> cinq prières du grand Casablanca<br />
Rayon de la zone de service<br />
<strong>des</strong> mosquées<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 145<br />
Carte N°2 :<br />
Zones de répartition normale <strong>des</strong> mosquées<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
145
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 146<br />
146<br />
Carte N°3 :<br />
Zones d’insuffisance de mosquées<br />
Rayon de la zone de service<br />
<strong>des</strong> mosquées<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 147<br />
Carte N°4 :<br />
Zones d’absence de mosquées<br />
Rayon de la zone de service<br />
<strong>des</strong> mosquées<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
147
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 148<br />
148<br />
Carte N° 5 :<br />
Zones de service <strong>des</strong> mosquées et <strong>des</strong> salles de prières<br />
Zone reliquats d'absence<br />
de mosquées<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 149<br />
Carte N° 6 :<br />
L’infrastructure <strong>des</strong> mosquées avec et sans salles de prières<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
149
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 150<br />
150<br />
Carte N° 7 :<br />
Superposition de la carte <strong>des</strong> mosquées et la carte <strong>des</strong> zones ouvertes à l’aménagement<br />
Superposition parfaite de zones<br />
d’absence <strong>des</strong> mosquées et <strong>des</strong><br />
zones ouvertes à l’aménagement<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 151<br />
Carte N° 8 :<br />
La présence de salles de prière est-elle corrélée <strong>au</strong> t<strong>au</strong>x de p<strong>au</strong>vreté ?<br />
Il n’existe pas de corrélation significative.<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
(Source HCP)<br />
151
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 152<br />
152<br />
Carte N° 9 :<br />
La présence de salles de prière est-elle corrélée <strong>au</strong> types d’habitats ?<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong><br />
les salles de prière se multipliaient essentiellement dans les zones d’habitat<br />
de type social ou sommaire.
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 153<br />
2.4/ Indicateurs de dispersion<br />
<strong>Les</strong> données relatives <strong>au</strong>x différents paramètres de mesure (surface de la mosquée,<br />
son rayon d’influence, la prise en charge de la gestion) ont fait l’objet d’une analyse<br />
<strong>des</strong>criptive pour la tendance centrale et de dispersion afin d’estimer et de décrire les<br />
performances <strong>des</strong> différentes séries.<br />
- Comment varie la Surface <strong>des</strong> mosquées ?<br />
surface <strong>des</strong> mosquées<br />
Minimum Maximum Moyenne Ecart type<br />
25 6.500 380 732<br />
La surface moyenne <strong>des</strong> mosquées est de 400 m2 , mais elle dénote une très grande<br />
variabilité (Ecart type = 732 m).<br />
Répartition du nombre <strong>des</strong> mosquées par classe de superficie<br />
Surface de la mosquée Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé<br />
Moins de 50 m 2 288 32% 32%<br />
50 à 100 m 2 172 19% 51%<br />
100 à 150 m 2 95 11% 62%<br />
150 à 200 m 2 58 6% 68%<br />
200 à 300 m 2 50 6% 74%<br />
300 à 500 m 2 62 7% 81%<br />
500 à 1000 m 2 86 10% 90%<br />
1000 m 2 et plus 89 10% 100%<br />
Total 900 100%<br />
On constate que 51% <strong>des</strong> mosquées ont <strong>des</strong> surfaces moins de 100 m 2 .<br />
Répartition de surface <strong>des</strong> mosquées selon le type<br />
Surface de la<br />
mosquée<br />
<strong>Mosquées</strong> Prises en charge par salle de prière Total<br />
<strong>Les</strong> habous <strong>Les</strong> bienfaiteurs<br />
Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif<br />
1 à 50 m2 3 1% 15 5% 270 94% 288<br />
50 à 100 m2 4 2% 36 21% 132 77% 172<br />
100 à 150 m2 4 4% 37 39% 54 57% 95<br />
150 à 200 m2 2 3% 30 52% 26 45% 58<br />
200 à 300 m2 4 8% 24 48% 22 44% 50<br />
300 à 500 m2 21 34% 34 55% 7 11% 62<br />
500 à 1000 m2 44 51% 37 43% 5 6% 86<br />
1000 m2 et plus 57 64% 32 36% 0 0% 89<br />
Total 139 15% 245 27% 516 57% 900<br />
La surface <strong>des</strong> mosquées est un paramètre qui varie considérablement en fonction<br />
de l’agent qui prend en charge sa gestion.<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
153
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 154<br />
Ces valeurs moyennes semblent refléter les dimensions optimales dans une<br />
répartition normale <strong>des</strong> mosquées. <strong>Les</strong> étu<strong>des</strong> initiées par la direction <strong>des</strong> mosquées a<br />
permis de prendre en compte ces dimensions nouvelles dans la planification urbaine en<br />
terme de notion de temps et de mobilité.<br />
On constate que pour les mosquées qui ont une surface moins que 50 m 2 , 94% <strong>des</strong><br />
mosquées sont <strong>des</strong> salles de prière prises en charge par les bienfaiteurs. Ainsi, la<br />
dernière ligne du table<strong>au</strong> indique que dans les mosquées qui ont une surface de 1000 m 2<br />
et plus, 64 % sont <strong>des</strong> mosquées prises en charge par le ministère <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong><br />
Affaires Islamiques et que 36 % sont <strong>des</strong> mosquées prises en charge par les bienfaiteurs.<br />
154<br />
- Comment varie le rayon <strong>des</strong> zones d’influence <strong>des</strong> mosquées ?<br />
L’étude statistique <strong>des</strong>criptive et de dispersion de la série <strong>des</strong> rayons de la zone de<br />
service <strong>des</strong> mosquées montre ce qui suit :<br />
Minimum Maximum Moyenne Ecart type<br />
Rayon de service<br />
44 3.292 298 274<br />
Le rayon moyen de l’aire géographique de l’ensemble <strong>des</strong> mosquées est de 300<br />
mètres. Pour les mosquées de vendredi le rayon moyen est de 600 mètres.<br />
Distribution de rayon de service selon la classe de superficie<br />
Rayon de service Fréquence Pour cent Pourcentage cumulé<br />
moins de 100m 117 13% 13%<br />
100 à 200m 246 27% 40%<br />
200 à 300m 210 23% 64%<br />
300 à 400m 123 14% 77%<br />
400 à 500m 95 11% 88%<br />
500 à 600m 42 5% 93%<br />
600m et plus 67 7% 100%<br />
Total 900 100%<br />
On constate alors que plus de 64% <strong>des</strong> mosquées <strong>au</strong> grand Casablanca ont un rayon<br />
d’influence moins de 300m, et que 36% <strong>des</strong> mosquées ont un rayon d’influence<br />
strictement supérieur à 300m.<br />
Répartition de rayon de theissen selon le type <strong>des</strong> lieux du culte<br />
Rayon de service les mosquées <strong>Les</strong> salles de prières Total<br />
Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif<br />
1 à 100m 24 21% 93 79% 117<br />
100 à 200m 73 30% 173 70% 246<br />
200 à 300m 108 51% 102 49% 210<br />
300 à 400m 62 50% 61 50% 123<br />
400 à 500m 53 56% 42 44% 95<br />
500 à 600m 26 62% 16 38% 42<br />
600m et plus 38 57% 29 43% 67<br />
Total 384 43% 516 57% 900<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 155<br />
On constate que pour les zones géographiques qui ont un rayon de servitude moins<br />
de 100m, 79% <strong>des</strong> lieux du culte sont <strong>des</strong> salles de prière. Et pour les zones<br />
géographiques qui ont un rayon de service entre 100m et 200m, 70% sont <strong>des</strong> salles de<br />
prière. Et pour le rayon de service entre 200m et 600m, on trouve que les salles de<br />
prière présentent moins de 50% <strong>des</strong> lieux du culte. Ainsi, la dernière ligne du table<strong>au</strong><br />
indique que les zones géographiques qui ont un rayon de theissen de 600m et plus,<br />
57% <strong>des</strong> lieux du culte sont <strong>des</strong> mosquées.<br />
2.5/ les indicateurs socio-spati<strong>au</strong>x :<br />
On cherche à trouver, par l’analyse en composantes multiples ACM, <strong>des</strong> relations<br />
entre les variables suivantes :<br />
• Surface de la mosquée.<br />
• Rayon d’influence de la mosquée.<br />
• Agent qui prend en charge sa gestion.<br />
La figure suivante nous donne une typologie plane <strong>des</strong> modalités de réponses<br />
relatives <strong>au</strong>x trois variables précédents.<br />
• Groupe 1 (<strong>Mosquées</strong> prise en<br />
charge par le MHAI) :<br />
- Surface >100 m 2<br />
- Rayon d’influence > 200 m 2<br />
• Groupe 2 (<strong>Mosquées</strong> prise en<br />
charge par les bienfaiteurs) :<br />
- Surface >100 m 2<br />
- Rayon d’influence > 200 m 2<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
155
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 156<br />
<strong>Les</strong> contributions de l’axe 1 et 2 peuvent résumer le fait que les salles de prières et<br />
les mosquées prises en charges par les bienfaiteurs sont caractérisées par <strong>des</strong> petites<br />
surfaces variant entre 1 et 100 m 2 et <strong>des</strong> zones géographiques ayant un rayon de service<br />
moins de 200m. Par contre les mosquées prises en charges par le ministère <strong>des</strong> habous<br />
et <strong>des</strong> affaires islamiques sont caractérisées par une surface plus grande qui dépassent<br />
500m 2 et un rayon d’influence de 200m et plus.<br />
Ainsi, les informations obtenues à partir de l’ACM infirme la dispersion et<br />
l’hétérogénéité qui caractérise la construction <strong>des</strong> mosquées.<br />
Nonobstant une réalité semble se dégagé, plus la surface de la mosquée est grande<br />
plus son rayon d’influence est grand.<br />
Autrement dit, pour une zone déterminée, la construction d’une petite mosquée qui<br />
ne répond pas <strong>au</strong>x besoins spati<strong>au</strong>x de sa population va se traduire inéluctablement par<br />
la construction d’<strong>au</strong>tres petites mosquées dans la même zone. Ce comportement<br />
conduit à un surcoût <strong>des</strong> investissements de base pour la construction et l’équipement<br />
de ces mosquées, et la multiplication <strong>des</strong> charges fixes de gestions d’un nombre élevé<br />
de mosquées.<br />
- Quelle est cette relation entre le rayon d’influence de la mosquée et sa<br />
taille ?<br />
On effectue une régression multiple <strong>des</strong> séries de données collectées afin de<br />
déterminer la relation mathématique entre la variable expliquée (rayon<br />
d’influence) et les variables explicatives (densité de la population et surface de la<br />
mosquée).<br />
<strong>Les</strong> résultats <strong>des</strong> régressions multiples par <strong>des</strong> équations de régression et les divers<br />
coefficients y afférents :<br />
Pour les mosquées prises en charge par le ministère :<br />
156<br />
❚ Ln(rayon)=1,97+0,30 ln(population)+0,15 ln(surface de la mosquée); R 2 = 0,68.<br />
C’est une relation croissante qui confirme que plus la surface de la mosquée est<br />
grande plus sa zone d’influence et plus grande.<br />
Pour les mosquées prises en charge par les bienfaiteurs :<br />
❚ La surface est presque constante (243 mètre carré) quelque soit les valeurs <strong>des</strong><br />
deux <strong>au</strong>tres variables. <strong>Les</strong> bienfaiteurs semblent construire <strong>des</strong> petites et<br />
moyennes mosquées quelques soit la densité de la population de la zone<br />
<strong>des</strong>servie.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 157<br />
Pour les salles de prières prises en charge intégralement par les<br />
bienfaiteurs :<br />
❚ Ln(rayon)=2,56+0,3 ln(population)+0,02 ln(surface de la mosquée) ; R 2 = 0,48.<br />
Cette régression multiple traduit les tendances, croissance du rayon du service de la<br />
salle de prière en fonction de sa surface.<br />
III. Normes urbaines en matière d’équipement cultuel<br />
3.1. Principales caractéristiques <strong>des</strong> équipements cultuels<br />
Contrairement <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres équipements collectifs, les équipements cultuels se<br />
distinguent, entre <strong>au</strong>tres, par les caractéristiques principales suivantes :<br />
• Statut juridique particulier : les mosquées et leurs dépendances sont par nature<br />
Habous public.<br />
- Tous les édifices de culte musulman sont constitués Habous <strong>au</strong> profit de la<br />
commun<strong>au</strong>té musulmane et ne pourront faire l’objet d’une appropriation<br />
privative.<br />
- Leur gestion et leur fonctionnement sont assurés par le ministère <strong>des</strong> Habous et<br />
<strong>des</strong> Affaires islamiques dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.<br />
• Besoin incompressible :<br />
- Le déficit en lieux de culte musulman s’exprime souvent par l’édification de<br />
salles de prières ou <strong>au</strong>tres lieux de cultes.<br />
- La programmation <strong>des</strong> mosquées de surfaces exiguës s’exprime par la<br />
multiplication, dans le même quartier, de nouvelles petites mosquées.<br />
• Financement multiple : Le financement de la construction <strong>des</strong> mosquées s’opère<br />
par plusieurs agents :<br />
- Etat.<br />
- Habous.<br />
- Bienfaiteurs.<br />
3.2. Limites <strong>des</strong> anciennes normes urbaines<br />
Type d’équipement<br />
Nombre d’habitants<br />
Par équipement<br />
Surface en m 2<br />
Mosquée de quartier 5.000 1.000<br />
Mosquée de vendredi 15.000 3.000<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
157
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 158<br />
L’application partielle ou arithmétique de ses normes s’est traduite dans certains cas<br />
par :<br />
• Une insuffisance d’équipements cultuels dans plusieurs zones ouvertes à<br />
l’aménagement.<br />
• Des surfaces attribuées <strong>au</strong>x mosquées, souvent exiguës, ne prennent pas en<br />
compte la densité réelle de populations.<br />
• Une répartition spatiale irrégulière.<br />
• Une m<strong>au</strong>vaise localisation.<br />
3.3. Nouvelles normes urbaines en matière d’équipements cultuels<br />
158<br />
La nouvelle base normative en matière d’équipements cultuels vise :<br />
• La création <strong>des</strong> espaces mieux nantis en mosquées.<br />
• La garantie d’un meilleur accès <strong>des</strong> populations <strong>au</strong>x équipements cultuels (en<br />
termes de distance de marche et de temps)<br />
• L’optimisation de l’utilisation du foncier urbain.<br />
Population cible :<br />
Une part importante de la tranche d’âge supérieure à 15 ans.<br />
Localisation :<br />
<strong>Les</strong> mosquées devront être localisées à l’intérieur de la zone présentant la<br />
concentration de population la plus importante du quartier ou du douar.<br />
Accessibilité :<br />
1/ <strong>Mosquées</strong> de quartier : devraient être accessible à pieds pour la population cible<br />
à une distance de 300 m.<br />
2/ <strong>Mosquées</strong> de vendredi : devraient être accessible à pieds pour la population cible<br />
à une distance de 600 m.<br />
3/ Mossala ELAID : un espace mossala couvrant une zone suffisamment grande <strong>au</strong><br />
nive<strong>au</strong> de chaque préfecture ou province ou même à proximité <strong>des</strong> grands<br />
groupements d’habitations. L’espace ainsi réservé pourrait toutefois avoir un<br />
caractère pluridisciplinaire ou modulatoire.<br />
Surface du terrain :<br />
<strong>Les</strong> terrains réservés <strong>au</strong>x équipements cultuels doivent renfermer en plus <strong>des</strong><br />
espaces de prière plusieurs dépendances nécessaires à savoir :<br />
• Minaret ;<br />
• Patio ;<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 159<br />
• Logements Imam et Muazzen ;<br />
• Ecole coranique ;<br />
• Loc<strong>au</strong>x de commerces et d’habitations de location pour générer <strong>des</strong> revenus<br />
suffisants pour couvrir les charges de fonctionnement de la mosquée.<br />
1/ <strong>Mosquées</strong> de vendredi : La superficie varie selon la densité moyenne de la<br />
population à l’intérieur de l’aire géographique de la mosquée. (zone d’influence)<br />
Formule<br />
SV = 29 x D<br />
2/ <strong>Mosquées</strong> de quartiers : La superficie varie selon la densité de la population de<br />
l’aire géographique de la mosquée ;<br />
Formule<br />
SQ = 3.6 x D<br />
Normes architecturales :<br />
Hypothèses retenues<br />
Z : Zone d'influence de la mosquée :<br />
Z = 1.200m x 1.200m= 144 Ha<br />
D : Densité moyenne de la population dans le quartier<br />
(habitant / hectare)<br />
Pt : Population totale dans la zone = Z x D<br />
PM : Population cible = 20% Pt = 1/5 x Z x D<br />
Surface unitaire nécessaire = 1 m 2 / prieur<br />
SV : Surface à attribuer à la mosquée de vendredi :<br />
SV = 1/5 x Z x D = 29 x D<br />
Hypothèses retenues<br />
Z : Zone de servitude de la mosquée :<br />
Z = 600m x 600m= 36 Ha<br />
D : Densité moyenne de la population dans le quartier<br />
(habitant / hectare)<br />
Pt : Population totale dans la zone = Z x D<br />
PM : Population cible = 10% Pt = 1/10 x Z x D<br />
Surface unitaire nécessaire = 1 m2 / prieur<br />
SQ : Surface à attribuer à la mosquée de quartier :<br />
SQ = 1/10 x Z x D = 3.6 x D<br />
- Forme régulière de la parcelle.<br />
- La longueur de la parcelle la plus perpendiculaire possible à la direction de la «kibla».<br />
- Surface minimale requise est de 200 m 2 quelque soit la densité de populations.<br />
- Parking.<br />
- Aménagement extérieur.<br />
- Intégration de la mosquée dans le tissu urbain.<br />
- Programmation <strong>des</strong> mosquées de vendredi comme équipement structurant <strong>des</strong><br />
quartiers.<br />
- Préservation du cachet architectural de notre pays.<br />
Equipement en mosquées : nouvelles normes urbaines<br />
159
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 160<br />
160<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 161<br />
RECOMMANDATIONS<br />
<strong>Les</strong> recommandations suivantes ont émané de ce colloque :<br />
1- Collecter et recueillir les normes juridiques pour la construction <strong>des</strong> mosquées dans<br />
un manuel exh<strong>au</strong>stif comprenant les dispositions <strong>des</strong> mosquées, les fatwas et les<br />
jurisprudences.<br />
2- Intégrer <strong>des</strong> questions se rapportant <strong>au</strong>x mosquées dans la planification<br />
urbanistique, l’aménagement de places consacrées <strong>au</strong>x rites islamiques dans la<br />
planification urbaine, et l’encouragement <strong>des</strong> promoteurs immobiliers et <strong>au</strong>tres<br />
opérateurs à contribuer volontairement à la construction et à l’équipement <strong>des</strong><br />
mosquées.<br />
3- Inviter les chercheurs marocains à redoubler d’efforts afin d’établir <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>, <strong>des</strong><br />
<strong>des</strong>criptions, et analyses pour faire connaître l’importance et les caractéristiques de<br />
notre patrimoine culturel architectural et religieux, et contribuer à sa préservation.<br />
4- Préserver le modèle marocain <strong>au</strong>thentique dans l’architecture <strong>des</strong> mosquées.<br />
5- Respecter l’architecture locale dans la construction <strong>des</strong> mosquées.<br />
6- Préserver les sites religieux et historiques situés dans les villes et les campagnes.<br />
7- Promouvoir la tenue de colloques thématiques sur les mosquées.<br />
8- Elaborer un lexique sur l’architecture <strong>des</strong> mosquées <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>.<br />
9- Etablir un plan exh<strong>au</strong>stif sur l’architecture <strong>des</strong> mosquées comprenant les bases<br />
théoriques scientifiques et techniques et les démarches pratiques en impliquant les<br />
spécialistes, les chercheurs, les établissements, les instituts et les universités.<br />
10- Constituer une commission représentant le Ministère <strong>des</strong> Habous et <strong>des</strong> Affaires<br />
Islamiques et ses partenaires spécialisés dans le thème de ce colloque en vue<br />
d’établir un guide de référence sur l’architecture <strong>des</strong> mosquées qui sera le thème<br />
du prochain colloque prévu avant la fin de cette année après son adoption.<br />
La Mosquée, un repère dans la ville<br />
161
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 162<br />
162<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 163<br />
Texte du message adresse à Sa Majeste Mohammed VI,<br />
que dieu l’assiste, à l’occasion de l’organisation<br />
du colloque sur :<br />
«LES SPECIFICITES ARCHITECTURALES<br />
DES MOSQUEES DU ROYAUME DU MAROC»<br />
Au nom d Allah, le Cl ment et le Mis ricordieux.<br />
Que la Pri re et la Paix soient avec le Dernier <strong>des</strong> Messagers d Allah.<br />
Sa Majest , Amir Al Mouminine, Mohammed VI, Que Dieu perp tue<br />
votre tr ne, Vous assiste et Vous garde pour Votre peuple d vou . Que<br />
la Paix, la B n diction et la Cl mence d Allah soient avec Vous.<br />
A l occasion de la cl ture <strong>des</strong> trav<strong>au</strong>x du colloque scientifique consacr<br />
<strong>au</strong>x Sp cificit s architecturales <strong>des</strong> mosqu es du Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong> ,<br />
organis Rabat, le lundi 2 Joumada II, 1428 de l H gire, correspondant<br />
<strong>au</strong> 18 juin 2007, sous le H<strong>au</strong>t patronage de Votre Majest , le serviteur de<br />
Votre Majest ch rifienne, Votre Ministre <strong>au</strong>x Habous et <strong>au</strong>x Affaires<br />
islamiques, a l honneur, en son nom et <strong>au</strong> nom <strong>des</strong> participants ce<br />
colloque, et apr s le renouvellement de notre loyalisme et de notre fid lit ,<br />
de pr senter votre Majest l expression de notre gratitude et de notre<br />
reconnaissance pour avoir permis l organisation de cette rencontre<br />
scientifique, la premi re du genre dans notre pays et de l avoir entour e de<br />
votre sollicitude, Ce qui a eu un impact agr able sur les participants et a<br />
couronn ses trav<strong>au</strong>x de succ s.<br />
Majest ,<br />
Ce colloque, organis dans le cadre de la c l bration de la journ e <strong>des</strong><br />
mosqu es , dont vous avez donn le coup d envoi Marrakech, le jour de<br />
l anniversaire de la naissance du proph te (Mouloud), a connu la<br />
participation d une pl iade d Oul mas, de chercheurs marocains et de gens<br />
qui s int ressent ce domaine. Ils ont pr sent un ensemble de trav<strong>au</strong>x<br />
s rieux et <strong>des</strong> recherches novatrices dans le domaine. Ces trav<strong>au</strong>x ont mis<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> du Roy<strong>au</strong>me du <strong>Maroc</strong><br />
163
1ExposésMassajidFr5 5/03/08 23:47 Page 164<br />
en vidence <strong>des</strong> aspects importants de l histoire <strong>des</strong> mosqu es, en faisant<br />
ressortir les fondements, les sp cificit s architecturales et les<br />
caract ristiques uniques <strong>des</strong> d corations <strong>des</strong> mosqu es du Roy<strong>au</strong>me.<br />
164<br />
Majest ,<br />
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> r alisations sous Votre r gne, dans le domaine de la<br />
construction <strong>des</strong> Maisons de Dieu, et Votre sollicitude continue, pour ceux<br />
qui s en occupent, ainsi que tous ces chantiers ouverts dans toutes les<br />
r gions du <strong>Maroc</strong> pour l dification de minarets et de mihrabs o r gnera<br />
la parole de Dieu, sont <strong>des</strong> actions qui viennent consolider le grand difice<br />
religieux qu a commenc Votre P re, Qu Allah soit satisfait de Lui, et dont<br />
la Mosqu e Hassan II constitue le meilleur exemple de gloire.<br />
Que Dieu Vous garde, Majest , comme il garde le Saint Coran et Vous<br />
pr serve comme refuge pour cette nation attach e la dynastie alaouite, de<br />
mani re ce que Vous lui r g n riez sa religion et que Vous la conduisiez<br />
sur le chemin de la grandeur et de la gloire. Que Dieu Vous comble en la<br />
personne de Son Altesse Royale le Prince H ritier Moulay Hassan et qu il<br />
pr serve son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, ainsi que tous les<br />
membres de Votre illustre famille royale. Allah entend et r pond l appel<br />
de ceux qui le prient.<br />
Fait à Rabat le lundi 2 joumada II, 1428 correspondant <strong>au</strong> 18 juin 2007<br />
Le Ministre de Votre Majesté <strong>au</strong>x Habous et <strong>au</strong>x affaires islamiques<br />
Ahmed TAOUFIQ<br />
<strong>Les</strong> <strong>Spécificités</strong> <strong>Architecturales</strong> <strong>des</strong> <strong>Mosquées</strong> <strong>au</strong> <strong>Maroc</strong>