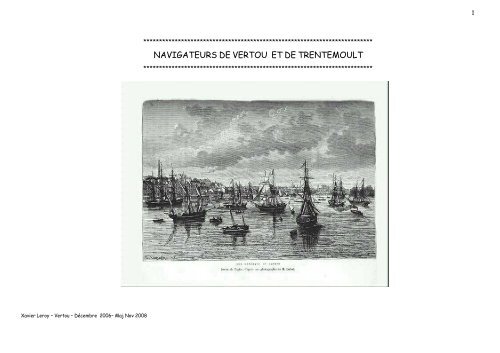NAVIGATEURS DE VERTOU ET DE TRENTEMOULT
NAVIGATEURS DE VERTOU ET DE TRENTEMOULT
NAVIGATEURS DE VERTOU ET DE TRENTEMOULT
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Xavier Leroy – Vertou – Décembre 2006– Maj Nov 2008<br />
*************************************************************************<br />
<strong>NAVIGATEURS</strong> <strong>DE</strong> <strong>VERTOU</strong> <strong>ET</strong> <strong>DE</strong> <strong>TRENTEMOULT</strong><br />
*************************************************************************<br />
1
"Qu'il est pénible d'avoir à rendre compte de sa vie à des hommes d'un autre siècle que celui où l'on a vécu". Caton l'Ancien<br />
# Introduction<br />
Plus personne ne sait aujourd'hui qu’il existait à Vertou au XIX ème une importante communauté de marins et de capitaines habitant principalement les<br />
villages du Chêne et de La Barbinière, mais aussi Portillon, L’Angebardière et le quartier de la Chaussée. Né au Chêne dans une maison chargée de leur souvenir il<br />
était de mon devoir de faire revivre leur mémoire avant qu’il ne disparaisse définitivement.<br />
Ce texte a été composé comme un “pêle-mêle“, au gré de rencontres, de lectures ou de découvertes de nouveaux documents. Au fil de ces recherches la<br />
curiosité m’a amené à m’intéresser à la branche de notre famille originaire de Trentemoult et de La Haute Ile deux villages de navigateurs de Rezé (qui seront<br />
désignés collectivement sous le nom de Trentemoult). Grâce à Internet j’ai eu a chance de rencontrer plusieurs “cousins” descendants de ces familles<br />
“trentemousines”. La communauté maritime de Trentemoult était beaucoup plus importante que celle de Vertou, elle a survécu plus longtemps, et son souvenir a été<br />
maintenu vivant grâce au travail remarquable de nombreux descendants de cette communauté passionnés par leur histoire familiale. C’est grâce à cette filiation<br />
trentemousine que par ricochet j’ai pu mieux comprendre l’histoire des marins de Vertou.<br />
C’est finalement une histoire imbriquée des familles de navigateurs de Vertou et de Trentemoult qui est racontée ici où on trouvera “pêle-mêle” et dans le<br />
désordre des souvenirs personnels, des histoires de famille, des extraits de correspondance, des exposés d’architecture navale, des réflexions générales et de<br />
longs exposés d'anthropologie pour décrire la généalogie compliquée de ces tribus. Cette histoire commune appartient à tous leurs descendants. Que chacun d’eux y<br />
prenne, ce qui l’amuse, ce qui le touche ou ce qui l’informe.<br />
Au-delà du simple usage familial ce “pêle-mêle” d’histoires vécues contribuera je l’espère à réhabiliter, le mot n’est pas trop fort, ces navigateurs obscurs<br />
de Vertou et de Trentemoult qui ont écrit, avec tant d’autres, les pages les plus glorieuses de l’histoire maritime de la Cité de Nantes mais qui ont été totalement<br />
oubliés et négligés par la mémoire officielle nantaise qui n’a retenu de cette histoire que deux courtes parenthèses, celle des négriers et celle des cap-horniers, à<br />
peine un siècle en comparaison d’une histoire plus que millénaire.<br />
En effet contrairement aux idées reçues le véritable âge d’or de la riche cité marchande de Nantes ne se situe pas au XVIIIème mais en plein XIXème, à<br />
une époque où les populations de villages entiers à Vertou, à Rezé, à Indre se consacraient à la marine à voile comme marins, maîtres au cabotage, capitaines au long<br />
cours, pilotes, constructeurs et charpentiers de navires, voiliers, cordiers, avitailleurs, courtiers maritimes, négociants. Tous ont participé avec énergie,<br />
détermination et courage à une aventure maritime dont les retombées économiques et sociales sont encore tangibles aujourd’hui. Et bien non, la prospérité actuelle<br />
de Nantes ne plonge pas ses racines chez les “médiatiques” négriers, mais chez nos modestes ancêtres oubliés.<br />
2
# Vertou<br />
Vertou est une grande commune limitrophe de Nantes au Sud de la Loire dont la population longtemps rurale se consacrait principalement à la viticulture,<br />
aux cultures maraîchères, à l’élevage...et au transport fluvial. Son territoire est en effet traversé de part en part par la Sèvre Nantaise un affluent de la Loire qui<br />
lui a façonné son paysage vallonné et verdoyant. Le Bourg de Vertou et plusieurs gros villages de la commune sont implantés au bord de cette rivière. On imagine<br />
difficilement que dans cette commune, verdoyante, couverte de vignes et de prairies, située à une cinquante kilomètres de la mer ait prospéré au XIX ème et<br />
pendant plusieurs générations une importante communauté de marins, de capitaines, de constructeurs de navires. Aujourd’hui on sait comment et pourquoi, mais il<br />
faudra lire jusqu’à la fin….<br />
# Une tombe emblématique<br />
Toute trace de ces navigateurs de Vertou semble avoir été perdue. Pourtant elles existent encore …pour ceux qui savent les voir,en particulier dans les<br />
cimetières. Comme cette imposante tombe de granit à double gisant située juste à proximité du Monument au Morts, et qui porte une épitaphe significative :<br />
3
Tombe de Marie Bureau Plaque de la tombe de Marie Bureau<br />
A la mémoire<br />
De Pierre Bureau, mon époux,<br />
Mort en mer en 1832, a l'âge de 30 ans.<br />
Et de Pierre Bureau, mon fils,<br />
Capitaine au long cours, mort en mer, en 1854,<br />
A l'âge de 26 ans.<br />
Ici repose Théodore Bureau,<br />
Décédé en cette commune, en 1856,<br />
A l'âge de 25 ans.<br />
Oh! Mon époux, et mes chers enfants<br />
Mes larmes ne tariront jamais Priez pour eux SVP<br />
Une tombe pour 4 défunts ... mais qui ne contient que deux dépouilles, celle de Marie Bureau et de son fils Théodore. Sont absents à tout jamais celles de<br />
son époux Pierre et de son fils aîné, tous deux disparus en mer. C’est l'un des rares témoignages qui rappelle aux habitants de Vertou cette surprenante aventure<br />
des navigateurs vertaviens – marins et capitaines - originaires plus particulièrement des villages du Chêne et de la Barbinière, et qui au XIXème ont sillonné les<br />
mers du globe où ils ont affronté les dangers mortels de la marine à voile de l'époque comme le rappelle l’émouvante épitaphe de cette tombe.<br />
Le terme de "Navigateur " est lui aussi tombé en désuétude sauf pour désigner un "navigateur solitaire", mais autrefois il désignait à Vertou et dans le pays<br />
nantais tous ceux qui naviguaient quel que soit le bateau, le grade ou la fonction. Ma grand'mère avait conservé cet usage confirmé par l'existence à Trentemoult<br />
d’une plaque de rue indiquant “Rue Ordronneau - Famille de Navigateurs“.<br />
Les archives familiales permettent de préciser l'identité des occupants de cette tombe. Marie Bureau y repose en compagnie de son fils Théodore, futur<br />
4
capitaine au Long Cours, mort au Village du Chêne à 25 ans. Son époux Pierre Bureau, Capitaine au Cabotage mort en mer à l'âge de 30 ans ne repose pas à côté<br />
d’elle. Ni son fils Pierre, Capitaine au Long Cours, mort en mer à l'âge de 26 ans (le 25 mars 1854). Marie Bureau, épouse et mère de trois Capitaines décèdera sans<br />
postérité en 1857 un an seulement après la disparition de son dernier fils Théodore peut-être à la suite d'un chagrin mortel.<br />
Marie Bureau (1801-1857) née Pichaud était la fille de Jean-Baptiste Pichaud (1767-1849) un Charpentier de Navires et de Elizabeth Bureau. Sa soeur Jeanne<br />
avait épousé un Charpentier de Navires, Jean Bureau, dit Capirote, le frère de Pierre son mari. Sa sœur Jeanne et son époux Jean Bureau ont eu au contraire une<br />
nombreuse descendance dont l’auteur de ces lignes. Ils reposent tout près de là. Sa deuxième soeur Elizabeth, dite Babet, épouse un Capitaine au Long Cours<br />
Guillaume Huchet et sa sœur cadette Françoise un Capitaine au Cabotage, Aimé Huchet. Son frère aîné Jean Pichaud (1799-1861) dit Raton est également Maître<br />
(ou capitaine) au cabotage. Dans cette famille Pichaud trois des quatre sœurs ont épousé un capitaine et le seul fils est lui aussi capitaine.<br />
NB – Les Capitaines au cabotage avaient un diplôme de Maître au cabotage. Mais pour plusieurs raisons expliquées plus loin le titre de politesse qui était<br />
couramment utilisé, y compris par eux-mêmes, était celui de Capitaine au cabotage. Dans ce texte c’est l'une ou l'autre des expressions qui est utilisée selon le<br />
contexte.<br />
# Pierre Bureau – Premier épisode<br />
Né en 1800 au village de la Barbinière il est le fils de Mathurin Bureau, gabarier et de Marguerite Leroy. Pierre Bureau, pleuré par sa Veuve est selon toute<br />
vraisemblance l'un des tous premiers Vertaviens à avoir eu l’audace de se lancer dans l'aventure maritime au tout début du XIX ème ainsi que Jean Pichaud le frère<br />
de Marie Bureau et quelques autres pionniers. Une lettre écrite par ce Pierre Bureau nous en dit un peu plus, un témoignage émouvant quand on connaît la suite de<br />
son histoire. Pour situer cette lettre, Pierre Bureau a 22 ans en 1822 quand il écrit de Terre-Neuve à sa mère Marguerite, née Leroy, Veuve de Mathurin Bureau<br />
décédé en 1808. Il est encore célibataire. Son frère Jean Bureau, Charpentier de Navires, vient d’épouser au début de l'année Jeanne Pichaud, lui-même épousera<br />
un peu plus tard la soeur de Jeanne, Marie, la future Veuve Marie Bureau.<br />
Il disparaîtra en mer, 8 ans plus tard dans des circonstances qui seront élucidées plus loin. Ce Pierre Bureau père a laissé un souvenir qui a réussi à<br />
traverser le temps. Il s’agit d’une maquette de frégate (voir plus loin) réalisée selon toute vraisemblance pendant son service dans la marine militaire. Elle a dû<br />
beaucoup intéresser les charpentiers de navire et les enfants du village … rêvant de devenir un jour Capitaines.<br />
5
A Madame Veuve Bureau au village de la Barbinière à Vertoux<br />
Du Havre de la Cramaillère, le 11 Août 1822,<br />
Ma Chère Mère,<br />
J'ai reçu votre lettre & j'ai appris avec plaisir que vous étiez en bonne santé.<br />
Je n'ai pas été insensible au souvenir de parents que je chéris. Je les en remercie et<br />
puis les assurer qu'ils sont payés de retour. Vous savez que je suis sur l'Adélaïde, et<br />
vous saurez qu'elle ne me ramènera pas; Elle va d'ici tout droit à Nantes décharger<br />
sa morue & prendra de suite une cargaison pour Cayenne. Je ne suis pas sans<br />
regretter à vous dire vrai, de ne pas m'en aller avec elle. D'abord parce que cela<br />
m'eut procuré le plaisir de vous embrasser ma chère mère, ainsi que mon frère et sa<br />
femme & ensuite parce que les voyages à Cayenne sont des voyages avantageux. &<br />
d'autant plus que le climat en est très sain. Mais à Terre-Neuve notre Commodore<br />
ne trouve pas des gens de notre état en trop grand nombre & il n'en laisse partir<br />
aucun. Ainsi je me vois condamné à rester & sans savoir jusqu'à quand. Dans le<br />
prochain mois on armera "La Caroline" & "Le Superbe". Partirai-je dans l'un des deux<br />
? Je l'ignore entièrement mais si ni l'un ni l'autre ne m'emmène il faudra bien que "<br />
La Pauline" se charge de moi ; et alors j'aurai le plaisir de faire route avec l'ami<br />
Porchay.<br />
Nous avons ici "Le Jean-Baptiste" qui nous est arrivé il y a trois semaines. Il<br />
doit aller à Cayenne en partant d'ici ; m'enverra-t-on dessus ? Je n'en sais rien. Le<br />
bruit court que son cambusier doit être changé & moi je me permets d'espérer que<br />
je le remplacerai. Est-ce avec raison ou à tort ? C'est ce la suite m'apprendra. Car<br />
jusqu'à présent je n'ai rien qui me fonde à penser que j'irais dessus.<br />
Je finis ma chère mère en vous embrassant de tout mon cœur & vous priant<br />
d'agréer les sentiments respectueux avec lesquels je suis votre affectionné fils.<br />
J'embrasse mon frère et sa femme de tout mon cœur. Je me porte toujours bien &<br />
vous souhaite à tous une bonne santé. Adieu ma chère mère. Je vous embrasse<br />
encore une fois. Adieu."<br />
Signé Pierre Bureau<br />
# Les cinq cousins capitaines<br />
Jeanne et Jean ont eu de leur côté trois fils, tous capitaines : Jean, né en 1823, Pierre, né en 1825 et Auguste né en 1830. Avec les fils de Marie, Pierre et<br />
Théodore ce sont cinq cousins germains, tous capitaines, enfants de frères et soeurs et qui ont les mêmes oncles, les mêmes tantes et les mêmes aïeux. On peut<br />
imaginer qu’ils ont de nombreux traits communs physiques et mentaux. Ils sont du même village. Ils font le même métier. Ils sont de la même génération, 8 ans
séparent le plus âgé, Jean du plus jeune Théodore. Ils naviguent sur les mêmes types de navires marchands ou militaires. Ils s’écrivent très souvent. Ils sont comme<br />
les cinq doigts d’une même main.<br />
Jean 1823-1901 Cap au Cab<br />
Auguste 1830-1863 Cap au LC, disparu en mer à 33 ans<br />
Pierre : 1825-1906 Cap au LC<br />
Théodore 1830-1856 Cap au LC, décédé au Chêne à 25 ans.<br />
Pierre Bureau 1828-1854, disparu en mer à 26 ans<br />
# Pierre Bureau, le fils<br />
Une lettre retrouvée a permis d’élucider les circonstances de la disparition de Pierre Bureau le fils de Marie disparu en mer à la suite d’un accident de type<br />
cardio-pulmonaire. Il a vraisemblablement été inhumé à Ste Hélène au retour d’un voyage aux Indes du trois-mâts nantais Argo, dont le Capitaine Gendron écrit à la<br />
mère de Pierre la lettre suivante.<br />
“ Paimboeuf, le 4 Juillet 1854<br />
Madame Bureau<br />
Je vous écris pour vous apprendre le décès de votre bon fils que j’aimais comme un frère. Mais avec tout le soin que j’ai pris pour lui pourtant je n’ai pas pu le<br />
racheter de la mort. Il est tombé d’un coup de sang. Je lui ai mis les sangsues mais il n’a pas eu signe de vie. Je l’ai gardé dans sa chambre pendant quatre jours. Il y<br />
a toujours eu un homme à la garder jusqu’au moment que nous sommes arrivés à Ste Hélène. Je l’ai fait servir comme un frère. Ca m’a coûté beaucoup d’argent mais<br />
il le mérite bien. J’ai payé sa place où il est enterré. J’espère que vous ne me ferez pas de reproches. Je vous enverrai les reçus. Ainsi ma bonne dame consolez-vous<br />
et vivez pour votre bon fils qui vous reste. Il m’a très souvent parlé de son frère que je n’ai pas l’honneur de connaître.<br />
Madame je remets le compte à jour à M. Haetjens afin qu’il puisse en traiter le montant. Il vous remettra également l’inventaire des effets de votre fils.<br />
J’ai pu obtenir de vous les faire expédier de suite par un de mes amis, le Capitaine Moyon, qui commande le brick de Nantes L’Adélie. Il s’en est chargé sans aucun<br />
frais, quant aux appointements vous les recevrez de la Caisse des Invalides qui les expédiera de suite.<br />
Recevez mes salutations respectueuses.<br />
A.Gendron<br />
On connaît par ce décompte quel était son habillement au moment de son décès :<br />
“Doit M. Pierre Bureau à Gendron, Capitaine du Navire l’Argo
- le 5 Octobre 1853 – Payé 12 chemises blanches faites à Pondichéry 52,50 F<br />
- le 5 Octobre 1853 – Payé pour 6 pantalons à la mauresque, faits à Pondichéry 15 F<br />
- le 12 Décembre 1853 - Payé pour deux foulards rouges achetés à Bombay 4,40 F<br />
- le 29 Décembre 1853 – Payé pour un port de lettre pour sa mère 1,25 F<br />
J’ai questionné le Représentant de la France à Ste-Hélène qui n’a pas pu retrouver la trace de sa tombe.<br />
# Les Bureau Capirote<br />
Son mari et ses deux fils étant disparus, Veuve Marie Bureau désigne comme héritier son neveu Jean Bureau, dit Jean, Capitaine au Cabotage, qui vivra<br />
jusqu’ à l’âge de 77 ans. Celui-ci a laissé de nombreux souvenirs et témoignages familiaux grâce à sa descendance vertavienne et officiels comme Maire de Vertou de<br />
1881 à 1885.<br />
Ce Jean Bureau est emblématique des lignées de navigateurs et de charpentiers de navires qui peuplaient au XIX ème les villages du Chêne et de la Barbinière<br />
comme le montre sa parentèle suivante (LC = Long Cours)<br />
Jean Bureau (1823-1900), Capitaine au Cabotage – Le Chêne – Commande le brig Le Georges<br />
Son père, Jean Bureau (1797-1855), Charpentier de Navire<br />
Son grand-père paternel Mathurin Bureau (1762-1808), Gabarier- La Barbinière<br />
Son grand-père maternel, Jean-Baptiste Pichaud (1767-1849), Charpentier de Navire<br />
Son frère, Pierre Bureau, Cap au LC, épouse Hortense Lancelot de Trentemoult<br />
Le frère de Hortense Lancelot, Joseph, est Capitaine au LC – Trentemoult<br />
L’oncle de Hortense Lancelot, François Codet est Capitaine – Commande L’Eugénie<br />
L’oncle de Hortense Lancelot, Pacifique Lancelot est Capitaine au Cabotage<br />
Sa nièce, Marie-Laure, fille de Pierre, épouse Aristide Briand, Cap au LC – Trentemoult<br />
Sa nièce, Jeanne Bureau, fille de Pierre, épouse Charles Dolu, Cap au LC – Bouguenais<br />
Son frère, Auguste Bureau, Capitaine au LC disparaît en mer en 1863 - Bouguenais<br />
Sa nièce, Noëmie, fille de Auguste, épouse Georges Lechat, Capitaine au LC -Bouguenais<br />
Son épouse, Ernestine Ertaud, fille de Séverin Ertaud, Capitaine au Cabotage -Trentemoult<br />
Son beau-frère, Gédéon Adrien Ertaud, Capitaine au LC – St Sébastien<br />
Son beau-père, Séverin Adrien Ertaud, Capitaine au Cabotage –Trentemoult<br />
Sa belle-mère, Styllite née Bessac, appartient à une famille de navigateurs de Trentemoult<br />
Son oncle paternel, Pierre Bureau, Marin tonnelier, disparu en mer à 30 ans<br />
Son oncle maternel, Jean Pichaud, dit Raton, Capitaine au Cabotage<br />
Son cousin Pichaud, fils de Jean, Capitaine au LC - Vertou<br />
Son cousin, Pierre Bureau, fils de son oncle Pierre, Capitaine au LC disparu en mer à 26 ans<br />
Son cousin, Théodore Bureau, fils de son oncle Pierre, Capitaine au LC<br />
Sa tante maternelle, Elizabeth Pichaud, épouse Guillaume Huchet, Capitaine au LC<br />
Sa tante maternelle, Françoise Pichaud, épouse Aimé Huchet, Capitaine au Cabotage
De quoi pouvait-on bien parler dans la famille de Jean Bureau ? On notera au passage les liens familiaux et professionnels de Jean et Pierre Bureau avec des<br />
familles honorablement connues de Trentemoult. Nous reviendrons très longuement sur ces cousinages.<br />
(NB – les gabariers étaient des mariniers qui exploitaient les péniches appelées alors gabares).<br />
# Le témoignage des tombes<br />
La tombe de Marie Bureau occupe un emplacement remarquable juste à l’entrée du cimetière de Vertou à proximité de vénérables sarcophages. C’est<br />
vraisemblablement son neveu et héritier Jean Bureau qui a fait ériger cette tombe à cet emplacement de choix à l'occasion du déplacement de la sépulture. En<br />
effet en 1857, année du décès de Marie Bureau, les concessions à perpétuité accordées par la Commune prennent soin de préciser que lorsque le cimetière sera<br />
déplacé, les frais de transfert resteront à la charge des concessionnaires.<br />
L'acte de Concession à perpétuité de la sépulture de Théodore Bureau signé par le maire Pierre Marie Mannet-Babonneau au nom de la commune le 2 Août<br />
1856 et par Marie Bureau stipule en effet : " qu'elle est accordée à l'endroit où a été inhumé M. Théodore Bureau, fils de Mme Bureau, décédé le 9 Janvier dernier.<br />
La présente concession est faite à la charge par Mme Veuve Bureau de faire transporter si elle le juge convenable les dépouilles mortelles du défunt dans le cas où<br />
le cimetière actuel viendrait à être transféré". Cette concession a été approuvée par le Préfet le 16 Août 1856 ! La même année une concession à perpétuité est<br />
accordée dans les mêmes termes à Jean Bureau pour la tombe de son père Jean Bureau, Charpentier de navire décédé le 2 Octobre 1855.<br />
Jean Bureau repose tout près de là dans la modeste tombe de ses parents en bordure de l'année centrale à quelques pas de la tombe de sa tante bien-aimée<br />
Marie Bureau. Il y repose en compagnie de ses parents Jean Bureau et Jeanne Pichaud son épouse Ernestine Ertaud de Jean, de sa fille unique Ernestine, de son<br />
petit-fils, Gilbert Le Tilly et de deux arrières petits-enfants Gilbert et Monique. Le Tilly : cinq générations de Bureau -Le Tilly reposent dans cette tombe.<br />
On peut y lire cette discrète épitaphe où seuls ses parents sont cités :<br />
Famille Bureau<br />
A la mémoire de Jean Bureau<br />
Né le 7 Avril 1797, décédé au Chêne le 2<br />
Octobre 1855, et de Jeanne Pichaud<br />
Son épouse, née le 5 Mai 1804 décédée au<br />
Chêne le 5 Septembre 1881<br />
Une prière SVP
# Famille Gicquel<br />
A la fin du XIXème la marine à voile a encore quelques années devant elle avec les voiliers cap horniers, mais ce sera le chant du cygne de la marine à voile<br />
nantaise. Les enfants de navigateurs à Vertou comme ailleurs en région nantaise préparent leur reconversion dans la marine à vapeur : Ernest, le fils aîné de<br />
Ernestine Le Tilly-Bureau deviendra Officier Mécanicien, et Jeanne sa fille aînée épousera Célestin Gicquel, un Ingénieur Mécanicien de la Marine Nationale.<br />
Célestin Gicquel appartient lui aussi à une famille de navigateurs du Chêne et de la Barbinière laquelle toutes payé un lourd tribu à la mer. La parentèle<br />
résumée de Célestin Gicquel est la suivante :<br />
Ses deux grand-pères sont marins.<br />
Sa grand-mère maternelle Jeanne Agaisse, épouse Baudy, a quatre frères Capitaines au Cabotage.<br />
Son grand-père paternel Pierre Gicquel, Marin<br />
La sœur de Pierre Gicquel, Jeanne mariée à Pierre Stanislas Bachelier, Marin<br />
Le frère de Pierre Gicquel, Jean Gicquel, Marin<br />
Sa grand-mère paternelle est Jeanne Bachelier<br />
Le père de Jeanne Bachelier, Pierre Bachelier (1770-1827), Gabarier<br />
Le frère de Jeanne Bachelier, Jean Bachelier, Marin, disparu en mer a 20 ans<br />
La sœur de Pierre Bachelier épouse Aimé Huchet, Gabarier<br />
Le grand-père de Pierre Bachelier, Jean Bachelier (vers 1700), Gabarier<br />
Son oncle maternel, Eugène Marie, frère de sa mère Joséphine, Marin<br />
Son grand-père maternel, Joseph Marie Bachelier, Marin, mort noyé à 33 ans<br />
La cousine germaine de sa mère, Joséphine Marie, Marie-Reine est l'épouse de Paul Doussain. Constructeur de navires à Vertou<br />
Sa grand-mère maternelle est Jeanne Aguesse<br />
Le frère de Jeanne, Jean, (1811) Capitaine au Cabotage<br />
Le frère de Jeanne, François, (1816), Capitaine au Cabotage<br />
Le frère de Jeanne , Julien, (1827), Capitaine au Cabotage, mort en mer au Brésil<br />
Le fils du précédent, Jules, Marin, disparu en mer<br />
Le frère de Jeanne , Baptiste, (1832), Capitaine au Cabotage<br />
Ces tombes et ces lettres sont les quelques traces qui restent d’un monde disparu dont la mémoire s’est totalement perdue. D’où venaient et que faisait cette<br />
communauté de navigateurs vertaviens ? Pour le comprendre il faut se déplacer plusieurs siècles en arrière de façon à planter le décor géographique, économique et<br />
historique de cette Aventure.<br />
# Rôle du transport maritime<br />
* * *<br />
Après un siècle et demi de mécanisation intensive de notre environnement on oublie que pendant plusieurs millénaires et jusqu'au milieu du XIXème l'homme<br />
n'a pu compter que sur la force de ses muscles, de celle des animaux de trait pour déplacer chariots et charrues: chevaux, ânes, mulets et boeufs et de celle du
vent pour mouvoir moulins et bateaux. Au début du XIXème les déplacements d'hommes et de marchandises se font toujours à pied, à cheval, ou en bateau. La<br />
Grande Armée de Napoléon se déplaçait avec armes, bagages et chevaux comme celle de César et de Alexandre le Grand deux mille ans plus tôt. La traction animale<br />
est non seulement lente et limitée par le volume et le poids d'une charrette mais surtout elle est coûteuse en énergie agricole : la nourriture d’un cheval exige la<br />
même surface cultivable que celle nécessaire pour une famille.<br />
Le transport fluvial ou maritime était le seul capable de faire face aux besoins d’approvisionnement des grandes cités du monde antique, médiéval ou<br />
moderne presque toutes implantées au bord d'une mer ou d'un fleuve navigable. En raison de la suprématie du transport par eau tous les ports maritimes étaient<br />
situés au fond d'estuaires de façon à pénétrer le plus loin possible à l'intérieur des terres.<br />
Les gabariers (ou mariniers) sont les marins de la navigation fluviale qui approvisionnent les navires de mer, toujours par transbordement direct, car les<br />
marchandises ne transitent que rarement par un quai ou un hangar portuaire. Les marchandises acheminées de l'intérieur des terres par la Sèvre étaient chargées<br />
directement sur des navires de mer mouillés en Loire, qui les transportaient vers un autre port d'estuaire d'où elles étaient à nouveau transbordées sur une autre<br />
gabarre qui les remontait jusqu'à leur destination finale, Paris, Londres ou Hambourg.<br />
Tous les échanges commerciaux empruntant la voie fluvio-maritime les marins et les gabariers jouent un rôle essentiel dans cette logistique non mécanisée.<br />
La Sèvre était jusqu’au XIXème une voie de transport importante qui drainait les marchandises de son hinterland vers le Port de Nantes puis en France et en<br />
Europe alors qu’aujourd'hui elle n’est qu’une paisible rivière réservée aux loisirs.<br />
# La Loire Atlantique<br />
Le département actuel de la Loire Atlantique désigné autrefois Loire Inférieure recouvre très exactement (à quelques paroisses près) le multimillénaire<br />
Evêché de Nantes. On aurait pu appeler ce département Loire-Aquatique tellement cette région est baignée de toutes parts par les eaux : la Loire et son large<br />
estuaire, la Sèvre Nantaise qui serpente à travers coteaux et prairies, l'Erdre au Nord qui au contraire s’étale comme un lac, le Canal de Nantes à Brest, le Canal de<br />
la Martinière qui double la Loire, plusieurs petites rivières comme le Don, l'Issac,le Brivet, la Maine, l'Ognon, et ces vastes étendues lacustres que sont l’invisible<br />
lac de Grandlieue qui serait l'un des plus vastes de France (?), les marais de Grande Brière et de Goulaine, les marais salants de Guérande, Assérac et Bourgneuf. Et<br />
une bonne centaine de kilomètres de côtes qui bordent les Baies de Bourgneuf et la presqu’île guérandaise . "Maritime et ligérienne, la Loire Atlantique, vit au<br />
rythme de l'eau qui coule dans ses veines…"<br />
Ses habitants ont su de tout temps exploiter les ressources naturelles offertes par ce territoire aquatique: pêche d'eau douce et d'eau de mer, coquillages,<br />
crustacés, chasse du gibier d'eau, production de sel, élevage …De tous temps les bateaux ont sillonné cette région en tous sens et pour tous les motifs : se<br />
déplacer, pêcher, chasser, transporter, se distraire. Jusqu’en 1930, les habitants de Vertou ne se déplaçaient pas à Nantes en autocar, mais par bateau. Nantes, la<br />
Venise de l‘Ouest, qui était à cette époque animée par un mouvement incessant de navires, de barques, de gabarres, de vapeurs.<br />
La vocation maritime de la région nantaise est une longue et belle histoire.<br />
# Venètes, Pictons,Namnètes<br />
On sait que dès l’âge du bronze les Grecs et les Phéniciens venaient chercher dans notre région le précieux minerai d’étain.<br />
A l'époque de la conquête romaine le peuple Vénète occupe le territoire actuel du Finistère Sud, du Morbihan et de la Presqu'île de Guérande – désignée<br />
alors comme "Iles des Vénètes ". En effet Le Croisic, Batz et Le Pouliguen étaient des îles et Guérande, Herbignac et Pont-Château étaient des ports de mer. A<br />
l'époque de César les Vénètes sont considérés comme des "seigneurs de la mer" qui brillent leur prospérité qui repose sur leur activité maritime, le sel, l'étain, la
pêche ...et le commerce.<br />
Le sud de la Loire et donc le port de Rezé désigné alors Ratatium, appartenait aux Pictons. On dit que ceux-ci auraient aidé Brutus le chef romain à<br />
construire sa flotte et lui auraient fourni des hommes. (on imagine que les riches Vénètes étaient enviés et jalousés par leurs voisins!). La flotte romaine a dû être<br />
construite dans l'estuaire de la Loire d'où elle n'avait qu'à se laisser pousser par le flot du fleuve pour arriver en rang de bataille face aux "Iles des Vénètes ". Il<br />
très vraisemblable que cette bataille navale se soit déroulée devant La Baule/Pornichet. (Source : Commentaires des Guerres des Gaules, de E. Benoist- Ed<br />
Hachette 1923 et Revue Acoram Marine N° 129 – Oct 1985).<br />
César en revanche ne parle jamais des Namnètes qui occupaient le nord actuel de la Loire-Atlantique, à l'exception de la presqu'île guérandaise qui était<br />
Vénète. Mais à l'époque gallo-romaine Nantes devenue une cité gallo-romaine aussi importante que Lutèce ou Rouen avec ses 13000 habitants. La Ville occupe alors<br />
ce qui est resté son cœur médiéval, à l'intérieur d'un triangle formé par la Loire et l’embouchure de l’Erdre, qui correspond au quartier Ste Croix actuel.<br />
# Les négociants nantais<br />
Pendant plus de deux mille ans Nantes a été une grande Cité marchande à l'égal des cités portuaires d'Europe du Nord et de Méditerranée. Ce sont les<br />
négociants de Nantes qui ont été les véritables moteurs de sa prospérité et non pas comme on le pense généralement ses armateurs, ses capitaines ou son port..De<br />
tous temps ce sont ses négociants qui ont fait la prospérité de Nantes. En effet la circulation des marchandises ne se fait pas toute seule. Il faut un organisateur<br />
qui se charge de toutes les complexes opérations indispensables pour amener la marchandise d'un producteur à un lointain utilisateur: contrat de vente, définition<br />
des termes de livraison, transport terrestre, manutention, transport maritime, contrôle de qualité, assurances, terme de paiement, couverture financière etc.<br />
L'armateur ne fournit que le transport maritime qui n'est qu'un (petit) maillon de l'opération de négoce. Le Capitaine est le représentant de l'armateur à bord du<br />
navire et sa responsabilité est de conduire à bon port le navire, l'équipage…et la marchandise qui lui a été confiée par le négociant. Pour prendre un exemple<br />
contemporain la France ne serait pas aujourd'hui un grand pays exportateur de sucre sans ses grands négociants sucriers.<br />
Le négociant qui brasse des sommes importantes assorties de risques non moins considérables peut s'il est très habile s'enrichir vite et beaucoup. Mais il<br />
peut se ruiner tout aussi vite. On parle toujours des premiers, on ne parle jamais des seconds. Ce qui peut donner vu de loin l’illusion que c’est un métier facile. Le<br />
négoce est un art subtil plus qu’un métier et ne peut réussir qu'à des personnalités hors du commun qui très souvent pour Nantes sont venues de l'extérieur :<br />
hollandais, irlandais, huguenots, espagnols, portugais, juifs, parisiens.<br />
Au XVIIIème le négoce nantais particulièrement florissant était constitué d'un groupe de deux cents cinquante négociants, dont une cinquantaine<br />
d'envergure. Des liens multiples les unissaient, professionnels, familiaux et financiers. Ils logeaient à la ville dans leurs hôtels particuliers et à la campagne dans des<br />
"folies" toujours construites à proximité d'une rivière,Erdre, Sèvre ou Maine, Ces négociants étaient des locomotives économiques pour les productions locales et<br />
régionales qu'ils encourageaient pour équilibrer ou alimenter leur commerce. C'est le cas des productions textiles bretonnes et de l’économie bretonne en général<br />
qui a été tirée pendant des siècles par le négoce nantais.<br />
# Nantes grande cité mérovingienne<br />
Contrairement à l'idée communément répandue l'Europe n'est pas retombée dans la sauvagerie et la barbarie pendant plusieurs siècles après la date<br />
officielle de la fin de l'empire romain en 492. C'est l'Eglise avec ses évêques et ses moines qui a assuré la relève tant au plan matériel et administratif qu'au plan<br />
intellectuel. Mais pas au plan militaire, contrairement à l'Islam. Et c'était là le hic ! Sans la protection de l'armée romaine l'Europe était une proie facile pour des<br />
peuplades venant de loin rarement animées de bonnes intentions. Les Bretons chassés de (Grande)-Bretagne par les saxons et les normands s'installent en<br />
Armorique. Les Francs s'implantent en France et investissent le Pays nantais (Roland de Roncevaux en fut le Chef). L'Eglise se substitue malgré elle à
l'Administration gallo-romaine évanouie et dans la région nantaise ce sont deux ecclésiastiques qui vont à cette époque lointaine imprimer leur marque.<br />
Saint Félix est nommé Evêque de Nantes 539, quelques années après la fin du règne de Clovis. Il en sera également le gouverneur, le bâtisseur, le chef<br />
militaire, l'ingénieur. Car c'est lui qui décide de modifier la cours de la Sèvre à son embouchure pour favoriser le désensablement de la Loire.<br />
A la même époque saint Martin fonde à Vertou le premier monastère de l’Armorique, suivi de plusieurs autres dans la région et d’un deuxième à Vertou pour<br />
les femmes, lesquels seront autant de foyers de civilisation et de développement économique. Vertou est alors une active petite cité mérovingienne. Quant à Nantes<br />
elle fait l'admiration des visiteurs par sa grandeur et sa prospérité. Ce qui n'échappe pas aux yeux des nouveaux arrivants bretons qui ne rêvent que de la<br />
conquérir. Ils n'y parviendront qu'en 853 avec Nominoë et son fils Erispoë qui se fera attribuer le riche Pays de Retz mettant ainsi la dernière touche à la<br />
frontière Sud de la Bretagne historique, inchangée depuis cette époque. Ils s'empressent de faire de Nantes leur capitale.<br />
# Les Vikings de Nantes<br />
Nantes est à peine devenue Bretonne qu’elle est attaquée par les Vikings en 853. Contrairement à la légende les Vikings ne sont pas des pillards, mais plutôt<br />
des colonisateurs – comme le seront les Français au XIXème et les Espagnols au XVème – qui cherchaient chaque fois que possible à s'implanter durablement dans<br />
une région comme ils le feront en Normandie, en Angleterre, en Islande, au Groënland …et dans le Pays Nantais où ils resteront plus d'un siècle, aussi longtemps que<br />
les Français en Algérie.<br />
Pendant que les Vikings de Seine s'installent en Normandie, d'autres Vikings investissent l'Estuaire de la Loire. Ils s'installent sur l'une de ses îles, entre<br />
Nantes et Rezé, juste à l'embouchure de la Sèvre. C'est une première base qui va leur permettre de progresser à l'intérieur de la France en remontant la Loire. De<br />
là ils préparent des expéditions vers la Bretagne Sud, la Touraine, le Poitou, la Bourgogne. Ils menacent même Paris en redescendant par la Marne.<br />
En 863 les Vikings de Loire s'associent aux Vikings de Seine sous la conduite du Chef Hasteinn pour lancer une expédition vers la péninsule ibérique (arabe<br />
depuis peu) et la Méditerranée. Ils quittent leur base nantaise avec 62 navires, pillent Cadix et Séville, mettent à sac Algésiras et sa mosquée puis Murcie et les<br />
Baléares et arrivent enfin en Italie où ils pillent Pise et Fiesole. Trois ans plus tard ils remontent vers leur base nantaise avec 20 navires chargés de butin.<br />
Soixante-six ans après leur arrivée le Chef norvégien Ragenold s'allie avec les Vikings de Loire pour lancer une expédition visant à se tailler dans la région<br />
nantaise un duché comme Rollon venait de le faire en Normandie lâchement abandonnée par Charles le Simple par le traité de Clair sur Epte. Les plus remuants des<br />
Vikings de Seine, désormais privés de pillage par les dispositions de ce traité, se joignent à eux. Ragenold prend possession sans difficulté de la région nantaise où il<br />
s'installe en maître. Cette principauté Viking durera une bonne vingtaine d'années et elle sera même officiellement reconnue par plusieurs traités signés avec ses<br />
voisins Francs. Mais l'histoire ne se répète jamais. Contrairement au lâche Roi de France, Alain Barbetorte le jeune Roi de Bretagne exilé en Angleterre revient de<br />
son exil, poussé par l'Abbé de Landévennec, Il inflige aux Vikings en 936 et 937 une série de cuisantes défaites. Il leur reprend Nantes en 937 dont il fait aussitôt<br />
sa capitale et en aménage la défense. Puis il repart vers Rennes pour réduire les dernières résistances Vikings. Cette suite de victoires militaires met fin à la<br />
prééminence scandinave en Bretagne. Les colonies de peuplement vikings de disparaissent pas pour autant, notamment dans la région de Guérande puisqu'elles<br />
tenteront vingt ans plus tard un nouveau coup de force sur la Ville de Nantes.<br />
Alain Barbetorte exploite ses victoires et la crainte qu'exercent encore ces ennemis pour se faire concéder tous les droits sur le Pays de Retz par le Duc<br />
de Poitou trop heureux de laisser aux Bretons le soin de neutraliser ces encombrants voisins. Cet accord fixe à tout jamais la frontière entre la Bretagne et le<br />
Poitou à la limite méridionale de l'Evêché de Nantes devenu plus tard le département de la Loire Inférieure puis Atlantique. La Bretagne d'Outre Loire est donc<br />
bretonne depuis pratiquement onze siècles sans interruption.<br />
Les Vikings n'étaient pas des moines soldats et ils ne rentraient pas non plus chez eux en Scandinavie chaque week-end. les scandinaves ont de toute
évidence fondé des familles dans la région, bon gré mal gré, particulièrement dans les villages sous leur contrôle direct. C'est-à-dire principalement tous ceux qui<br />
étaient situés dans leur zone normale d’influence le long de la Loire et de la Sèvre. Il est en effet troublant de constater que dans toutes les communes traversées<br />
par la Sèvre: Nantes-Pirmil, Vertou, La Haie-Fouassière, Gorges, Monnières la fréquence du patronyme Bureau est très élevée alors que lpar ailleurs le mot Bur en<br />
norrois (vieux scandinave) désigne à la fois un lieu dit et un habitant, l'équivalent du “Ker” breton. (ce suffixe –bur est à l’origine des nombreux noms de localités<br />
anglaises qui se terminent par –bury). L'un des rares vestiges visibles de leur présence il y un encore siècle étaient les gabares de Sèvre et les barges de Loire qui<br />
utilisaient encore le gréement et la coque “à clins” des navires Vikings.<br />
C'est à cette époque qu'est créé le Vicomté de Rezé par Hoël, petit-fils de Alain Barbetorte ...et que le chef normand Bernard se taille un fief au nord de<br />
l'évêché de Nantes, autour de La Roche-Bernard (Bernhardt), qui porte le nom de son fondateur. Deux de ses compagnons d'armes, Richard et Frédor créent la<br />
seigneurie d’Assérac qui donnera naissance quelques siècles plus tard à une puissante dynastie féodale bretonne. A Assérac dont il sera question par la suite on<br />
trouve encore des familles Bernard. Ce qui montre bien qu’à cette époque les Vikings de Loire étaient parfaitement intégrés dans la population locale.<br />
Ce ne serait pas étonnant que quelques gènes Vikings se soient glissés dans les familles de nos ncêtres originaires de Vertou, de Rezé-Trentemoult et de<br />
Assérac<br />
# Nantes, grande cité médiévale<br />
Les Vikings sont neutralisés juste avant l'An Mille, au moment où l'Europe médiévale se réveille. Elle se met à construire châteaux forts, remparts des<br />
villes, abbayes, cathédrales. On se déplace en foule pour les pèlerinages à Jérusalem et St Jacques de Compostelle. On y commerce partout : cités portuaires<br />
italiennes, villes hanséatiques, villes de foires de l'intérieur, ports atlantiques et scandinaves. Nantes participe activement à ce renouveau. Le sel de ses marais<br />
attire des navires (et des cargaisons) de toute l'Europe atlantique. Les relations avec la péninsule ibériques sont particulièrement étroites. Nantes est un point de<br />
passage pour les pèlerins qui se rendent à St Jacques de Compostelle par la terre ou par mer. Pour cette raison les Templiers sont solidement implantés à Nantes<br />
et à Rezé. De nombreux négociants viennent s'installer à Nantes pour y commercer : espagnols, portugais, irlandais, hollandais. Les Juifs indispensables au<br />
commerce médiéval y bénéficient d'une protection particulière. L'Hôtel de la Monnaie de Nantes non seulement bat la monnaie nécessaire pour les opérations de<br />
négoce mais crée également les pièces d'orfèvrerie indispensables pour matérialiser la fortune de ses actifs marchands.<br />
Dans un texte destiné à l’éducation d’un jeune prince Viking rédigé vers 1250 on peut lire les conseils suivants qui sont donnés aux négociants de son<br />
royaume : “Connaissez les grands centres commerciaux : Londres, Dublin, Rouen, Nantes pour ce qui concerne la route de l’Ouest” …et aussi, en confirmation de ce<br />
qui précède “Enfin lassé de courir les mers un jour vous souhaiterez goûter les fruits de votre labeur. Prenez femme et prenez ferme, établissez-vous dans une<br />
région clémente, fertile et vallonnée et adoptez les coutumes locales.” (Ref : “L’Europe des Vikings” catalogue de l’exposition de Daoulas –Editions Hoëbeke).<br />
Le commerce de Nantes ne cesse de se développer au cours du Moyen Age et brille particulièrement au XIVème et XVème comme le décrit dans son langage<br />
désuet un historien du XIXème :<br />
"Au XIVème le commerce de Nantes embrassait déjà dans ses entrecourses le Danemark, la Zélande, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et le Levant. En<br />
Angleterre ils portait des blés, des vins, des toiles, des fruits, des cuirs, des armures et des chevaux; en Espagne des blés; dans le Nord du sel et des vins...Au<br />
Xvème les Ducs de Bretagne signet des traités avec presque toutes les puissances maritimes et même avec le Turc...Mais c'était surtout avec les riverains de la<br />
Loire et avec l'Espagne que les relations étaient multiples et fructueuses...Nantes approvisionnait de sel tout le bassin de la Loire, les navires de sel venant de<br />
Guérande et de Bourgneuf...Quant à l'Espagne ses rapports avec Nantes étaient fort anciens; ils furent facilités et régularisés par un traité signé en 1430. En<br />
vertu de ce traité l'Evêque de Nantes était investi du pouvoir consulaire à l'égard des Espagnols. Plus tard en 1494 une confrérie de marchands de Nantes et de<br />
Bilbao fut fondée dans l'église des Cordeliers ; où une chapelle était dédiée à Notre-Dame d'Espagne; et où se réunissaient les négociants de Nantes et de Bilbao
une fois l'an le jour de la St Sylvestre. Longtemps deux flottes quittaient Bilbao, la première à destination des Flandres et la seconde cinglant vers La Rochelle et<br />
Nantes. Beaucoup d'Espagnols se fixèrent alors à Nantes. Qu'il me suffise de citer le célèbre financier André Rhuys de Embito qui reçut plusieurs personnages<br />
importants du royaume. Les Espagnols nous fournissaient des matières premières, surtout des laines, et nous leur donnions en échange des draps de Fougères, des<br />
canevas de Vitré, des toiles de Quintin, des coutils de St Aubin et des croisets, blanchets et tortilles d'Angleterre qu'apportaient les marchands de Morlaix ou que<br />
les Anglais apportaient eux-mêmes...Nantes était donc un centre d'approvisionnement et nous voyons que l'industrie bretonne y jouait un certain rôle. L'orfèvrerie<br />
de luxe, très recherchée alors nous venait ordinairement d'Italie...mais c'était les Maîtres des monnayes ou des orfèvres du pays qui fabriquaient non seulement<br />
l'argenterie usuelle, mais encore les vases, flacons, aiguières et bassins qui servaient aux cadeaux des princes et des villes ...Sous le règne de François II il n'était<br />
pas de village où l'on ne trouva de la vaisselle d'argent... "<br />
Nous reviendrons plus loin sur ces Monnayeurs de Nantes qui appartiennent aussi à l'histoire de nos familles trentemousines !<br />
# Nantes au XVIIIème<br />
Après la découverte de l'Amérique les courants d'échange traditionnels de l'Europe sont bouleversés. Le commerce de Nantes se réoriente tout<br />
naturellement vers les Amériques mais ses trafics traditionnels ne disparaissent pour autant bien au contraire. En particulier le commerce avec l'Océan Indien<br />
reste florissant. Il faut rappeler que le siège de La Cie des Indes Orientales fut à Nantes jusqu'en 1733, et même après avoir été déplacé officiellement à Lorient<br />
le négoce de ce juteux trafic continua d’être traité à Nantes. Le trafic triangulaire ne représentait qu'une partie du commerce nantais et en terme d'activité<br />
maritime il était marginal. Par exemple il ne mobilisait qu'une quinzaine de navires chaque année alors que le trafic traditionnel en mobilisait plus d'un centaine.<br />
Redonnons la parole à notre vieil historien : " Le commerce maritime à partir de 1720 devint pour Nantes la source d'une prospérité inouïe. Les relations maritimes<br />
avec les Amériques étaient devenues habituelles et nos colonies naissantes des Antilles, St Domingue surtout, donnaient lieu aux plus fructueuses spéculations dans<br />
lesquelles la traite des Noirs entra malheureusement pour un chiffre élevé. Les retours en denrées coloniales n'atteignaient encore que 7 millions en 1729; ils<br />
furent de plus de 18 millions en 1764; de plus de 40 en 1790. La progression pour être moins forte n'en était pas moins aussi marquée dans le commerce avec les<br />
Etats Européens. Ainsi Nantes qui recevait d'eux en 1729 pour 2,5 millions de marchandises voyait en 1790 le chiffre de ses importations s'élever à 20 millions et<br />
celui de ses exportations à 28 millions. Ainsi la Ville se transformait. Sa population qui n'était que de 42000 âmes au commencement du siècle était de 80000 aux<br />
premiers jours de la Révolution..."<br />
Il faut toujours se méfier des statistiques et celles-ci appellent deux remarques : les statistiques douanières du port nantais sont établies en valeur et non<br />
pas en volume. Si on corrige ces statistiques pour l'exprimer en volume transporté alors le commerce "européen" redevient plus important par le fait que la valeur<br />
des marchandises européennes est beaucoup plus faible que celle des denrées coloniales. Mais plus important encore : les statistiques douanières du port de Nantes<br />
ne prennent pas en compte les transports maritimes de cabotage national et international effectués par navires de la flotte nantaise qui ne touchent jamais le Port<br />
de Nantes. Ce que l'on appelle aussi le “tramping” était en effet la grande spécialité de la marine nantaise au XVIIIème et au XIXème.<br />
# Nantes, ville cosmopolite<br />
On ne fait pas de négoce en chambre. A cette époque comme aujourd'hui il fallait disposer d'un réseau de correspondants solide et de toute confiance. De<br />
ce fait les négociants dits "nantais" appartenaient le plus souvent à des communautés extérieures: espagnoles, flamandes, juives, flamandes, huguenotes,<br />
irlandaises, suisses… Les Nantais étaient souvent réduits au rôle d'exécutants locaux de ces grands réseaux européens de négoce et de financement. Bien sûr<br />
quelques locaux tenteront de les imiter parfois avec succès. De nombreux entrepreneurs hardis et dynamiques trop à l'étroit dans leur ville d’origine sont venus<br />
s'établir à Nantes d'origine, attirés par les perspectives d'enrichissement offertes par la Place de Nantes, une ruée vers l'ouest en quelque sorte. Par exemple les<br />
deux plus beaux hôtels particuliers de l'île Feydeau côté Ouest n'appartenaient pas à des familles d’origine nantaise, mais au malouin de Villestreux et au Flamand
Deurbrouck. On a déjà cité le cas de Rhuys de Embito influent négociant espagnol qui se permettait de recevoir dans son hôtel du Quai de la Fosse les rois de<br />
France de passage à Nantes. Plusieurs personnalités marquantes de la Ville n'étaient pas d'origine Nantaise comme Harrouys un hollandais, Thomas Dobrée un<br />
huguenot de Guernesey, Mellier l'énergique Maire de Nantes du début du XVIIème,un lyonnais, Graslin un tourangeau, Ceineray un parisien. Bien placés pour juger<br />
de cette situation les Juges et Consuls de Nantes écrivent en 1759: " ...dans l'Europe en miniature qu'est devenu le Port de Nantes, hollandais, anglais, allemands,<br />
suisses et irlandais se livrent au commerce et à l'industrie depuis plus de deux siècles " .<br />
# Nantes et la traite négrière<br />
Il y a bien eu des négriers à Nantes, mais il n’y pas eu que cela, de beaucoup s’en faut ! Qu’il est pénible pour les descendants de marins nantais de subir cet<br />
amalgame constamment fait aujourd’hui entre une petite minorité de négriers et la grande majorité d'honnêtes marins, capitaines et négociants qui ont participé<br />
modestement pendant des siècles à la prospérité de cette grande cité maritime. Muriel Bouyer, auteur d’une thèse récente “Sur les traces des marins nantais du<br />
XVIIIème”, estime que sur les 5000 navires qui passaient par Nantes, les navires armés pour le commerce colonial ou la traite ne représentaient que 150 à 300<br />
unités. Par ailleurs ce n’étaient pas les capitaines et encore moins les marins de la région qui organisaient le trafic triangulaire, ni d’ailleurs les armateurs, mais une<br />
poignée de négociants spécialisés (une quinzaine environ sur les 250 répertoriés à Nantes) qui avaient les reins suffisamment solides pour assumer les mises de fond<br />
et les risques considérables des expéditions de Guinée, risques qu’ils partageaient avec des spéculateurs recrutés dans toute l'Europe par de multiples<br />
intermédiaires financiers. Dans cette quinzaine on ne trouve pratiquement pas de nantais de souche (Michel), mais des malouins, un vendéen (Mosneron), des<br />
parisiens (Grou, Montaudouin), un tourangeau (Sarrebourse), des irlandais (Walsh, O'Shiell, O'Riordan), un flamand (Deurbrouck), des huguenots de toutes origines<br />
(Struckman, d’Havelooze, Meckanhuisen) et un hobereau breton ... Ceci est confirmé par l’historien Christian Bouyer qui écrit dans – “Au temps des Iles” ( Editions<br />
Taillandier ) p165 : “ Parmi les grands noms des “messieurs du commerce” comme ils se désignaient ceux de souche nantaise sont largement minoritaires …mais le<br />
clan le plus important est incontestablement celui des Irlandais arrivés en France en 1688 avec le roi Stuart Jacques II”<br />
Au départ ce commerce a été provoqué par l’extraordinaire engouement apparu en Europe pour toutes les denrées coloniales : café, sucre, chocolat, épices.<br />
Pour répondre à cette demande frénétique les planteurs coloniaux devaient se procurer toujours plus de main d’œuvre. Au début ils avaient bien essayé de recourir<br />
à des pauvres bougres originaires de l'Ouest de la France mais ce fut un échec total: ils dépérissaient, s’enfuyaient ou se révoltaient. Les planteurs se sont ainsi<br />
progressivement tournés vers le marché d’esclaves africains rôdé depuis des siècles. Les négociants européens ont mis en oeuvre leur habituel savoir-faire pour<br />
rapprocher les besoins de main-d’œuvre des planteurs coloniaux avec l’offre disponible « volens nolens » en Afrique. Les vrais responsabilités de ce trafic infernal<br />
seraient plutôt à rechercher du côté des consommateurs européens de l’époque, à l’exemple de ces intellectuels des Lumières qui se retrouvaient autour d’un café<br />
au Procope pour deviser sur le thème du bon sauvage sans avoir la moindre pensée pour l'esclave noir qui a produit ce café. A Freynet Voltaire et Mme de Chatelier<br />
n'auraient renoncé pour rien au monde à leur consommation effrénée de chocolat sous toutes ses formes. Voltaire cynique mais perspicace le fait dire dans<br />
“Candide” par un esclave noir amputé d’une main et d’un pied parce qu’il avait tenté de s’enfuir:“ C’est à ce prix-là, messieurs, que vous mangez du sucre en Europe”.<br />
Comme aujourd’hui le consommateur occidental qui achète sans retenue ni scrupule ses gadgets dernier cri fabriqués en Chine par des enfants-esclaves.<br />
Souvenons-nous des propos de Caton cités en exergue : "Il est pénible d'avoir à rendre compte de sa vie à des hommes d'un autre siècle que celui où l'on a<br />
vécu”. Comment peut-on juger avec nos références morales actuelles des pratiques qui ne soulevaient aucune objection plusieurs siècles avant nous ? Un trafic qui<br />
non seulement n’était condamné par personne à l’époque qui en plus il était encouragé par “les pouvoirs publics” puisque au départ ils versaient une prime pour chaque<br />
esclave transporté. Réciproquement, combien de nos pratiques actuelles auraient profondément choqué la morale d’un homme du XVIIIème et combien de nos<br />
habitudes actuelles considérées comme normales et morales seront jugées barbares et scandaleuses par nos lointains descendants dans deux ou trois siècles.<br />
(Exercice : lesquelles selon vous ?).<br />
Par ailleurs les négociants et armateurs nantais étaient en général des esprits éclairés, fervents partisans de la république, admirateurs des philosophes des
Lumières. Ils fréquentaient les nombreux cercles de littérature et de philosophie de la Ville, ils applaudissant bien entendu à la future libération des Etats-Unis à<br />
laquelle ils prenaient une part active, financière en particulier. Ils étaient pour la plupart membres de loges maçonniques (la moitié des armateurs et capitaines de<br />
Nantes appartenaient à la franc-maçonnerie), tout en couvrant de leurs largesses congrégations religieuses et orphelinats.<br />
Il faut également insister sur la dimension européenne de ce trafic – les négociants nantais en auraient traité 3-4 %. Elle vient d’être rappelée récemment<br />
par la presse helvétique :“ Des Suisses ont participé à une centaine d'expéditions négrières de manière directe ou indirecte, impliqués dans la traite de plus de 172<br />
000 Noirs déportés, soit 1,5% des 11 à 12 millions de captifs arrachés à l'Afrique. Les Suisses n'étaient pas seulement des négriers, mais également des<br />
esclavagistes. Au XVIIIe siècle, des Genevois, Bâlois, Saint-Gallois, Vaudois ou Zurichois dirigeaient des plantations dans les colonies anglaises, françaises ou<br />
hollandaises. Jusque tard dans le XIXe siècle, des émigrés helvétiques se lanceront dans l'esclavagisme …”<br />
Il faut aussi relativiser l'immensité des fortunes quii auraient été acquises avec ce trafic car le meilleur spécialiste de la question écrit à ce sujet : " ...l'idée<br />
selon laquelle le profit est à coup sûr énorme est largement infondé...4 à 6% pour les négriers Nantais du XVIIIème, profits moyens relativement bas comparés aux<br />
3 à 5% que peuvent rapporter les investissements fonciers beaucoup plus sûrs ...". Si quelques uns ont parfois beaucoup gagné sur un voyage, nombreux sont ceux qui<br />
ont bu de gros bouillons financiers. On n’en parle jamais et pour cause. Les immenses fortunes de quelques négociants pointées du doigt comme honteuses ont été<br />
générées bien davantage par des activités traditionnelles que par le trafic négrier aléatoire et de faible rentabilité.<br />
Ces braves négociants seront bien mal récompensés de leur zèle révolutionnaire quand sous la Terreur le sinistre Carrier les décimera tous avec sauvagerie,<br />
sans faire de détail. Celui-ci occupait symboliquement le plus luxueux des Hôtels de l’Ile Feydeau, celui du Malouin de Villestreux. Il sera impitoyable pour les<br />
négociants nantais, négriers ou non, tous condamnés à la mort sous l’accusation terrible et sans appel à ses yeux de “négociantisme”. Après avoir été pillés et spoliés<br />
ils finiront tous décapités, fusillés ou noyés, tandis que leurs hôtels seront confisqués et leurs élégantes folies seront incendiés ou démantelées. (on peut penser<br />
que les négociants d'origine étrangère seront repartis sans attendre les bienfaits de la liberté révolutionnaire promise).Alors que la Terreur expire, ce sinistre<br />
personnage ne sachant plus que faire des familles de négociants emprisonnés les expédie à pied vers Paris, une marche sadique et meurtrière dont peu<br />
réchapperont. Cette folie meurtrière et destructrice n'a pas épargné les archives personnelles et professionnelles des négociants qui ont toutes disparu à quelques<br />
exceptions près. En l'absence de ces preuves formelles indiscutables il est très difficile de dire aujourd'hui quelle a été la part réelle de ce trafic considéré alors<br />
comme hasardeux et dangereux dans le chiffre d'affaires, le bénéfice ou le patrimoine du négoce nantais au XVIIIème. Ce qui ouvre la porte à bien des<br />
interprétations idéologiques tendancieuses.<br />
En revanche il reste de cette période de nombreuses archives techniques, car depuis Colbert, la France est dotée d'une efficace administration maritime. La<br />
logistique de ce trafic est bien connue et confirme que l'activité de traite à Nantes était marginale du point de vue maritime, même pour les négociants spécialisés,<br />
De plus il était intermittent, interrompu pendant de longues années à chaque reprise des hostilités avec l’Angleterre. Toute l'activité maritime nantaise ne<br />
s'arrêtait pas pour autant.<br />
A côté de ce trafic très spécialisé la grande majorité des négociants et des marins de la Cité des Ducs menaient leurs activités traditionnelles en relation<br />
avec l'Europe et les Indes orientales et occidentales sans jamais se mêler de ce trafic triangulaire qui était d’une toute autre dimension, financière notamment,<br />
qu’un simple transport maritime. Il est facile de vérifier qu’aucun des modestes navigateurs de Vertou et de Trentemoult n'a participé ni de près ni de loin à ces<br />
voyages. En revanche ils ont été nombreux à se battre contre l’Angleterre et à mourir pour l’Indépendance des Etats-Unis. (voir ci-dessous)<br />
A Nantes la thèse officielle des procureurs autoproclamés, et d'ailleurs on n’entend qu'elle, est d’affirmer que le trafic triangulaire serait lui seul à l'origine<br />
de la prospérité nantaise considérée dès lors comme “douteuse” et “honteuse“. Pour conforter cette propagande ils montrent d’un doigt inquisiteur les hôtels<br />
particuliers construits à Nantes au XVIIIème. Ces idéologues incultes (pléonasme !) ignorent évidemment qu’à cette époque-là ce sont toutes les villes de France,<br />
portuaires ou non qui se développent, s'embellissent, se modernisent, s’agrandissent. Par exemple la population de Nantes double au cours du XVIIIè. “C’était pour<br />
servir d’écrins prestigieux aux statues équestres ou pédestres des rois que Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Montpellier, Reims ou Rennes consacrèrent ces espaces
majestueux bordés de palais magnifiques dont le modèle s’exporta dans toute l’Europe”. (ref : catalogue d'une exposition présentée à Nancy avec pour thème : “De<br />
l’esprit des villes, Nancy et l’Europe urbaine au Siècle des Lumières 1720-1770” ). Nantes n’est même pas citée dans cette liste de villes aux “palais magnifiques”,<br />
alors que Rennes l’est! Les hôtels particuliers de la ville de Nantes, que certains s’obstinent à voir comme des vestiges d’une richesse fabuleuse et honteuse,<br />
n’avaient à cette époque rien d’exceptionnel en France et ne faisaient que refléter la prospérité de toutes les grandes villes d'Europe au XVIIIème. Les grands<br />
programmes d'aménagement de Nantes comme celui de l'Ile Feydeau et de Graslin ont été lancés avant l'essor du trafic négrier et auraient été menés à leur terme<br />
sans celui-ci comme partout ailleurs.<br />
Deux exemples démontrent l’extraordinaire dynamisme commercial et industriel de la Cité nantaise au XVIIIème. La construction navale nantaise (Nantes et<br />
Estuaire) était à cette époque la plus importante de France, dépassant celle de Bordeaux, employant plusieurs milliers de travailleurs spécialisés : charpentiers de<br />
navires, calfateurs, voiliers, forgerons. L'activité de ces chantiers dans le troisième quart du XVIIIème (ref bibliographie) est parfaitement connue par les<br />
rapports de l’Amirauté et il est facile de vérifier que les navires négriers ne représentaient qu’une minorité de ces constructions. A quoi donc servaient tous les<br />
autres navires ? Deuxième exemple, celui de l'industrie des Indiennes qui se développe de façon prodigieuse à Nantes qui devient en quelques années un centre de<br />
production textile aussi important que Paris (Jouy, Oberkampf), Rouen et Mulhouse. (Je recommande vivement la lecture passionnante de la thèse de Céline<br />
Cousquer : "Nantes une capitale française des indiennes au XVIIIème siècle, édité chez Coiffard"). Cette thèse nous apprend que l’engouement pour ces indiennes<br />
avait été tel qu’il avait fallu en interdire la vente pendant plus de cinquante ans tandis que dans le même temps la traite négrière était encouragée par le versement<br />
de primes, ce qui illustre bien la relativité des contingences morales.<br />
Attribuer la prospérité passée et présente de la ville de Nantes aux négriers, et à eux seuls, c’est faire bien peu de cas de son passé millénaire de commerce,<br />
de négoce, d’industrie, d’entreprise, d’ouverture sur le monde, de tolérance raciale et religieuse (voir l’Edit de Nantes où était implantée une importante<br />
communauté protestante) et de tous ceux qui à Nantes comme ailleurs ne sont pas restés inactifs pendant tout le XVIIIème, en se contentant de regarder, les<br />
mains dans les proches, les négriers faire fortune ! Cette prospérité existait bien avant eux. Elle se poursuivra à côté d’eux. Elle se prolongera bien après eux au<br />
cours du XIXème, une prospérité créée par l'ensemble du milieu maritime nantais : négociants, armateurs, capitaines, constructeurs de navires, renforcés<br />
désormais par les nouveaux industriels, commerçants et entrepreneurs issus de la révolution industrielle du XIXème et dont les noms sont connus de tous Nantais<br />
"de souche".<br />
Il est certain que Vertou a bénéficié directement et indirectement de la prospérité nantaise du XVIIIème puisque plusieurs négociants et armateurs y<br />
avaient fait construire leurs résidences : comme les Grou à la Placelière où Benjamin Franklin fut reçu avec faste à la fin de l'année 1776 (un navire de Grou<br />
s’appelait La Placelière), les Mosneron à l’Aulnaye, les Darquistade à la Maillardière dont l'orangerie accueillit le premier magnolia planté en France.<br />
# La Guerre d’Indépendance des Etats-Unis<br />
On parle beaucoup (trop !) des négriers nantais, mais jamais du sacrifice des marins nantais morts au cours de la guerre maritime franco-anglaise qui s’est<br />
déroulée sur toutes les mers du globe de 1778 à 1783 ( Traité de Versailles). Son objectif était de disputer aux anglais la suprématie maritime et permettre en<br />
particulier aux Etats-Unis d’obtenir leur Indépendance. 146 marins originaires de Rezé -Trentemoult furent mobilisés à cette occasion dont 34 y laissèrent leur<br />
vie ! Peu de villages français peuvent s’enorgueillir d’avoir autant participé à la libération de notre grand allié américain.<br />
A cette époque la marine française égalait la marine anglaise, ce qui a permis aux Américains d’obtenir militairement leur Indépendance et à la France de<br />
retrouver ses anciennes colonies d’Amérique du Nord et des Antilles. Cette réussite est à mettre à l’actif du Duc de Choiseul Ministre de la Marine de Louis XVI,<br />
lequel avec son énergie légendaire n’avait rien trouvé de mieux pour l’encourager que de lui dire “ Mon cher Choiseul, vous êtes aussi fou que vos prédécesseurs, il n’y<br />
aura jamais en France d’autre marine que celle du peintre Vernet ”. Il réorganise de fond en comble la Marine par son Ordonnance du 25 Mars 1765 qui crée
notamment l’Ecole du Génie Maritime, la plus ancienne école française d’ingénieurs après celle des Ponts et Chaussées.<br />
# La période sombre<br />
Choiseul avait réussi non sans difficultés à reconstruire une marine digne de la puissance de la France, capable de tenir tête à la marine anglaise. Elle sera<br />
décimée en quelques mois avec la Révolution française : les officiers de marine émigrent, les arsenaux sont désorganisés et pillés, les caisses sont vides. Un seul<br />
exemple pour l’illustrer : à la veille de la Révolution deux ingénieurs militaires de la marine s’apprêtaient à mettre au point une nouvelle arme redoutable, le boulet<br />
creux. Le premier émigra et le deuxième fut embastillé puis guillotiné.<br />
La force principale des armées terrestres révolutionnaires et impériales était celle du nombre car la France de cette époque était un géant démographique.<br />
Mais pour la guerre navale le nombre ne donne aucun avantage. L’arme navale exige des officiers expérimentés, des marins qualifiés ainsi qu’une excellente<br />
organisation pour le support logistique, la construction des bâtiments de guerre, leur entretien, leur armement. Un fils de cabaretier comme Murat ou Bernadotte<br />
pouvait devenir maréchal d’empire ou même roi … il n’aurait jamais pu commander un vaisseau de ligne et encore moins une escadre. Les Anglais, qui s’y connaissent<br />
un peu en marine, définissaient à l’époque le profil de l’officier de marine : “Homme de condition si l’on veut, homme de savoir s’il est possible, mais homme de mer<br />
absolument, son capital est de savoir naviguer”.<br />
A chaque engagement naval perdu d’avance par les Français, les Anglais nous prenaient nos navires – qui avaient coûté des fortunes – et les réutilisaient<br />
immédiatement dans leur flotte pour les retourner pour contre nos navires, un mécanisme auto-cumulatif de puissance navale inconnu dans l’armée de terre. Par<br />
exemple lors de l’expédition de Quiberon de 1795 les Anglais nous ont pris en quelques heures et sans coup férir trois vaisseaux de haut rang, excusez du peu (le<br />
Formidable, le Tigre et l’Alexandre). Cette même année, et donc 10 ans avant Trafalgar, les Directeurs (les Membres du Directoire qui dirigeaient alors la France )<br />
dressaient sans complaisance devant la représentation nationale un douloureux bilan : “ Nos flottes humiliées, battues, bloquées dans nos ports, dénuées de<br />
ressources en vivres, en matière de toutes sortes, déchirées par l’insubordination, avilies par l’ignorance, tel est l’état dans lequel les hommes à qui vous avez confié<br />
le gouvernement ont trouvé la marine française”. Sans commentaires.<br />
C’est pourquoi le faste donné par les Anglais en 2005 pour le bicentenaire de Trafalgar est totalement indécent : “ Chacun a la gloire qu’il mérite !”<br />
Trafalgar fut une victoire sans mérite, sans éclat et sans gloire face à une flotte française décimée et désorganisée qui n’était même plus l’ombre de celle qui avait<br />
tenu tête à la marine anglaise en 1780 et avait permis la libération des Etats-Unis. L’amiral français de Villeneuve, le pauvre homme, savait pertinemment bien qu’il<br />
menait la flotte française directement à l’abattoir en obéissant aux ordres comminatoires de Napoléon qui le sommait de livrer bataille aux Anglais. Napoléon aurait<br />
dû pourtant retenir les leçons de sa pitoyable expédition et fuite d’Egypte. Toujours est-il que le sacrifice de la flotte française sur les autels de la République<br />
préparait celui des armées napoléoniennes plus tard sur terre. Il est symbolique que c’est aux Anglais que l’Aigle déchu à Waterloo ait dû se rendre, pas au Tsar ni à<br />
l’Empereur d’Autriche son “beau-père”.<br />
L’effondrement de la marine française pendant la Révolution et l’Empire portera un coup fatal non seulement aux ambitions napoléoniennes mais surtout au<br />
trafic maritime français et nantais. Par ailleurs la Terreur révolutionnaire a été particulièrement tragique pour la région nantaise où elle a fait plusieurs dizaines de<br />
milliers de victimes. A Vertou le bourg est incendié, son abbaye est détruite, plus d'une centaine de ses habitants , hommes, femmes, enfants sont massacrés,<br />
fusillés, guillotinés, noyés. Nos spécialistes en repentance et en "travail de mémoire" ne se bousculent pas pour évoquer la tragédie des centaines de milliers de<br />
victimes innocentes et de tous bords dans l'Ouest de la France sous la Terreur révolutionnaire,.<br />
Le commerce maritime de la France est complètement bloqué par le blocus maritime imposé par l'Angleterre pendant 25 ans et il ne pourra reprendre qu'à<br />
partir de 1815 et encore. La Restauration n'est guère propice au dynamisme commercial et maritime car la France est alors dirigée par d'anciens émigrés aigris plus<br />
soucieux de retrouver leurs terres et leurs privilèges d'avant que de développer son commerce et son industrie. La France qui a perdu progressivement toutes ses
colonies ou presque et les quarante années de retard pris par son commerce et sa marine entre 1790 et 1830 laisseront le champ mondial libre pour l'Angleterre qui<br />
deviendra pour longtemps la première puissance mondiale.<br />
# Pierre Bureau – 2ème épisode<br />
Immédiatement après la fin des hostilités entre l’Angleterre et la France de Napoléon et l’activité maritime reprend à Nantes, en particulier avec une<br />
“filière de la morue” créée à l’initiative d’Acadiens chassés du Canada et revenus ré-émigrer en Bretagne au terme de leur “grand chambardement”, à Lorient, à<br />
Belle-Ile, dans la presqu’île guérandaise et en région nantaise. D’autres qui s’obstinent à s’accrocher contre vents et marées à ces terres inhospitalières d’Amérique<br />
s’installent à St Pierre et Miquelon. Ces Acadiens sont idéalement qualifiés pour exploiter la filière de la ^pêche à la morue. Ils trouvaient à Lorient et à Nantes des<br />
navires, des marins et…des débouchés pour leur morue. Ils trouvaient dans la presqu’île guérandaise le sel indispensable à la conservation de la morue. J’ai trouvé<br />
sur Internet tous les renseignements correspondants. Où on voit que sur les mêmes navires se côtoyaient des marins originaires d’Acadie, de Vertou et de<br />
Trentemoult.<br />
C’est ainsi que j’ai découvert que Pierre Bureau, l’auteur de la lettre cité au début de cette histoire était en fait un “marin-pêcheur” de morue ! L’Adélaide, à<br />
bord duquel il écrit sa lettre en Août 1822 est un brick de 124 tx, construit à Lorient en 1816 pour le compte de Mme Vve Le Floch et Fils de Lorient. Il a été<br />
revendu à un armateur nantais JB Coüy. Le rôle du voyage de 1822 auquel participe Pierre Bureau n’est pas repris dans cette enquête, mais le précédent, celui de<br />
l’année 1821, y figure. On y apprend que le navire parti de Nantes le 16 Avril est revenu à Mindin le 27 Décembre de la même année. Son état-major est acadien (2<br />
Chiasson et un Sire) et est domicilié dans la région de Lorient.<br />
“La Caroline” citée dans la même lettre est un autre brick morutier de 113 tx construit à Nantes en 1816, pour le compte du même JB Coüy. Pour le voyage<br />
de 1818 est embarqué comme 1 er Lieutenant Auguste Marie Bureau né en 1790, un autre marin de Vertou. Quant au Brick “Le Superbe” cité dans la lettre il a été<br />
construit à St Malo et se consacre au même trafic.
# L'âge d'or de la Marine Nantaise<br />
Fig 1 – Vue aérienne de Nantes et Trentemoult (en bas à droite)<br />
Vue du Port de Nantes et de Trentemoult en bas à droite<br />
Au XVIème une première mondialisation a été initiée à la fois par le capitalisme marchand et les progrès des techniques de navigation à l'origine des<br />
grandes découvertes. Une deuxième mondialisation s'impose entre 1830 et 1880 grâce aux (ou de la faute des disent certains) progrès de la science, de l'industrie,<br />
des transports, de l'agriculture, de la médecine, grâce à la fin des conflits européens, grâce à l'émergence de la démocratie libérale. Elle entraîne une<br />
extraordinaire croissance démographique et économique et bouleverse la face du monde. De nouveaux continents vont être explorés, peuplés, exploités. De<br />
nouvelles routes commerciales vont s'ouvrir. L'Europe va devenir un vaste espace économique et va étendre sa domination sur le monde. Entre 1840 et 1914 le<br />
commerce mondial sera multiplié par 7 suscitant d'énormes besoins de transports maritimes et fluviaux et ferroviaires.<br />
L'âge d'or de la marine à voiles européenne, française et nantaise se situe dans cette fenêtre d'une cinquantaine d'années (1830-1880) pendant lesquelles<br />
les besoins de transports maritimes sont à la fois très importants et ne peuvent être assurés que par des navires à voiles juste avant que le chemin de fer et les<br />
navires à vapeur ne les détrônent. Comme l'écrit Jean Meissonnier en Introduction d'un ouvrage intitulé "L'âge d'or de la Marine à Voiles " :<br />
" Il est assez paradoxal de constater que l'âge d'or de la voile fut presque immédiatement suivi de son déclin. Les mers ne furent jamais parcourues par<br />
autant de voiliers que durant les années qui précèdent et voient la disparition de la voile. Cet âge d'or atteint son apogée dans la première moitié du XIXème, pour
disparaître rapidement à la fin de celui-ci, par suite du développement accéléré de la navigation à vapeur. Quelle magnifique période que celle où un nombre<br />
croissant de navires à voiles sillonnent les mers."<br />
Pendant les cinquante années de l'âge d'or il a fallu au plus vite construire et financer des milliers de navires, des gabarres, des chantiers de construction.<br />
Il a fallu dans le même temps recruter et former des équipages, créer les services d'accompagnement indispensables de courtage, de négoce, de banque,<br />
d'assurances, d'avitaillement. Le Port de Nantes était alors animé d'une activité frénétique et le Quai de la Fosse était tapissé de centaines de mâts de navires à<br />
voiles en cours d'armement ou de carénage. La Loire et la Sèvre étaient sillonnés en tous sens de bateaux et voiliers de toutes tailles et de toutes formes. Cette<br />
activité maritime procurait du travail dans tout le Pays Nantais qui bénéficiait alors des multiples retombées de cette activité maritime. Après un voyage<br />
particulièrement "avantageux" les Capitaines s'arrêtaient dans les nombreuses boutiques de luxe de Nantes comme la mythique Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie<br />
"Au Navire d'Or", située au 13 Carrefour Casserie, tenue par l'honorable M. Louis Pistache-Mocquay.<br />
Sans oublier les "Intéressés" nom donné à l'époque aux actionnaires d'un navire, dans lequel ils avaient pris "un intérêt". Notables et bourgeois terriens,<br />
fabricants de rubans ou de boutons, veuves fortunées, épiciers enrichis, tous voulaient participer à cette frénétique aventure maritime. Les artisans étaient<br />
mobilisés pour construire, décorer et meubler les maisons des capitaines et marins enrichis. La devise de Nantes "Fortuna favet eunti" était devenue une réalité.<br />
Les Nantais seront certainement surpris d'apprendre que l'activité maritime de la Cité des Ducs a été beaucoup plus intense au XIXème qu'au XVIIIème, le seul<br />
siècle où selon certains les navigateurs Nantais seraient supposés avoir travaillé et encore de façon honteuse. Toutes les statistiques de trafic portuaire, de mise<br />
en service de nouveaux navires, de nombre de capitaines, démontrent le contraire. La généalogie de nos familles de navigateurs de Vertou et de Trentemoult<br />
confirme l'extraordinaire prospérité maritime du demi-siècle d'or de la voile au cours duquel on voit toutes les branches de nos arbres généalogiques se garnir<br />
d'une éclosion de marins et de capitaines.
# Les Cap horniers<br />
L'histoire est la suivante. A partir de 1880, la marine marchande française et donc nantaise traverse une crise meurtrière, conséquence d'une accumulation<br />
d'évènements fâcheux : grave crise économique dans l’ensemble de l'Europe qui assèche le transport européen, ralentissement général des échanges, lois<br />
protectionnistes de 1866, suprématie économique, maritime et coloniale de l'Angleterre, concurrence des chemins de fer qui tuent le trafic de cabotage national, la<br />
grande spécialité de la marine nantaise, ouverture du Canal de Suez en 1869 etc. La marine à voiles française et mondiale commence une lente agonie qui s'achèvera<br />
définitivement au début du premier conflit mondial.<br />
La flotte française est alors tombée au 9ème rang mondial des flottes mondiales de voiliers, battue même par la Grèce. Pire encore, alors que la flotte<br />
mondiale double entre 1870 et 1900, dans le même temps la flotte marchande française régresse. Après quinze années de mort lente l'Etat français prend<br />
conscience que cette crise peut gravement nuire au développement de ses ambitions coloniales. Vieux démon français, l'Etat va s'immiscer dans le jeu économique<br />
en s'y prenant comme d'habitude très tard et très mal. Une loi d'aide à la construction des navires à voiles est votée en catastrophe le 30 Janvier 1893 pour<br />
tenter de relancer la marine marchande à voiles en France alors que des centaines de grands voiliers déjà construits par les grandes nations maritimes commencent<br />
à entrer dans leur phase de déclin.<br />
La marine marchande française va renaître mais de façon étatique, artificielle et absurde. Au lieu d'encourager la navigation à vapeur cette loi va inciter à<br />
construire de 1893 à 1902 des centaines de navires à voiles économiquement et techniquement condamnés dès leur naissance. Ces navires sont construits dans la<br />
précipitation par des chantiers sans expérience ouverts en catastrophe par opportunisme sous la pression d'armateurs transformés en chasseurs de prime fiscale.<br />
Qui plus est, le mode de calcul des primes encourage la construction de navires élancés et rapides pour transporter des marchandises pauvres, lourdes et en vrac,<br />
donc instables (blé, engrais, nitrates). Ce qui les rendait à difficiles à manoeuvrer et dangereux à naviguer. Pire encore, les primes étaient calculées sur la base<br />
d'une distance-type de port à port. Les armateurs avaient donc tout intérêt à inciter leurs capitaines à raccourcir les trajets en serrant au plus près l'Antarctique<br />
où ils rencontraient des mers terrifiantes et meurtrières.<br />
Pour toutes ces raisons de nombreux voiliers cap horniers français connaîtront des fins tragiques : naufrages, collisions, échouages et enfin torpillages. Sur<br />
les 147 cap horniers nantais répertoriés par le Cdt Lacroix on en dénombre 10 perdus corps et biens, 2 incendiés, 37 naufragés par fortune de mer, 36 coulés<br />
pendant le premier conflit mondial, 16 vendus à l'étranger. Et combien de marins disparus avec !<br />
L'époque des Cap horniers a été beaucoup médiatisée. Bien entendu les capitaines et marins courageux de cette époque méritent notre plus grand respect,<br />
naviguant sur des navires indomptables et instables au milieu de mers déchaînées et de tempêtes terrifiantes, encerclés de glaces menaçantes. Ils ont payé un<br />
tribut très lourd à la mer, beaucoup trop lourd. Ils ont écrit des pages héroïques, certes, mais à la manière des derniers soldats sacrifiés dans une guerre perdue<br />
d'avance. Tant de jeunes pertes humaines auraient pu être évitées sans cette loi de technocrates imbéciles (pléonasme) qui fut en partie à l’origine de cette<br />
hécatombe.<br />
Contrairement aux idées reçues aujourd’hui dans la région nantaise, une de plus, à l'époque des cap horniers les marins nantais ont quasiment disparu,<br />
remplacés par des équipages de Bretagne Nord (Paimpol, Cancale, St Malo, Bréhat), du Morbihan et de Normandie. Une évolution encouragée par le progrès des<br />
chemins de fer et des communications. Au milieu du XIXème quand les communications étaient lentes et difficiles les armateurs devaient avoir leurs équipages sous<br />
la main, prêts à être mobilisés rapidement pour un nouveau voyage. Avec le chemin de fer et le télégraphe les armements dunkerquois, havrais et même nantais<br />
peuvent aller puiser leur main d'oeuvre beaucoup plus loin. A Vertou on compte les cap-horniers sur les doigts d'une main et à Trentemoult, ils ne sont guère<br />
nombreux. Le port de Nantes est maintenant supplanté par les ports du nord plus proches des zones industrielles et urbaines du pays, notamment Le Havre et<br />
Dunkerque, où siège l'armement Bordes qui est le plus important armateur cap-hornier français. Un ouvrage tout à fait remarquable a été écrit par deux
descendants de cap horniers (ref bibliographie) qui retracent l'histoire de la maison Bordes, des équipages de Bretagne Nord et de l'activité cap-hornière en<br />
général. Néanmoins la tradition maritime reste encore bien vivante à Nantes, et alors que les marins nantais jouent un rôle modeste sur la scène cap-hornière, ses<br />
armateurs, constructeurs et entrepreneurs y jouent toujours un grand rôle, construisant et armant 147 navires cap horniers de prime. A ce nombre il faut ajouter<br />
une vingtaine de "petits long-courriers" desservant les ports du Brésil et des Caraïbes... qui ne passent pas le Cap Horn, comme le désormais célèbre Belem.<br />
Les armateurs sont désormais des financiers, qui jouent avec leurs navires comme à la Bourse, qui télécommandent leurs capitaines et marins à partir de leur<br />
siège lointain. Le capitaine est devenu un simple exécutant technique confiné à un rôle de conducteur d'autobus, en plus dangereux. Nous sommes bien loin de la<br />
marine à voile artisanale et familiale pratiquée par nos capitaines-entrepreneurs du XIXème; dont l'équipage appartient à la même famille ou au même village que le<br />
capitaine; dont les actionnaires sont tous des amis, des confrères ou des notables locaux; dont les capitaines sont de véritables entrepreneurs souvent<br />
propriétaires de leur navire avec lequel ils partagent leur vie pendant plusieurs dizaines d'années à la fois gagne-pain, domicile, confident, compagnon; où le<br />
capitaine joue un rôle essentiel pour préserver les intérêts et les vies des hommes et du matériel qui lui sont confiés et dont l'activité - honnête et respectable -<br />
profite à toute la région.<br />
# La fin<br />
Pendant la première moitié du XXème le Port de Nantes maintiendra tant bien que mal son activité maritime sur la lancée du siècle précédent avec trois<br />
chantiers de construction navale, une école d'hydrographie, un modeste trafic portuaire, quelques compagnies locales de navigation, une poignée de marins et<br />
capitaines restés fidèles à une tradition familiale multiséculaire. Mais les fondements économiques et commerciaux de l'activité maritime ont définitivement<br />
disparu. Aujourd'hui on ne trouve plus de marins en région nantaise, ni ailleurs en France, la marine française ayant quasiment disparu dans l'indifférence générale.<br />
# Nantes en Bretagne<br />
Est-il besoin de rappeler que Nantes et le territoire de son ancien Evêché font partie intégrante de la Bretagne politique et administrative depuis 853<br />
jusqu'à la disparition en 1789 des Etats de Bretagne, soit un bon millénaire de fidélité. Jusqu’à cette date les documents officiels établis par les notaires de<br />
Bretagne, j’en possède quelques uns de Vertou, étaient marqués du sceau des Etats de Bretagne (Hermine et fleur de lys comme sur le blason de Vertou). Nantes a<br />
été sans interruption la capitale de la Bretagne, le siège de tous ses Rois et Ducs ainsi que de sa prestigieuse Université jusqu'à son annexion par François 1er. Seul<br />
son Parlement avait été transféré à Rennes...dans un souci de "décentralisation", le centre historique de Nantes était devenu trop exigu, mais pas seulement cela :<br />
les magistrats n’étaient pas mécontents de s’éloigner des armateurs et négociants de la ville qui les exaspéraient par leur réussite matérielle et leur faste<br />
ostentatoire et que secrètement ils enviaient, jalousaient et haïssaient, refrain connu. La population de la Bretagne a toujours été bilingue comme aujourd'hui la<br />
Belgique ou la Suisse, mais la langue à la fois officielle et la plus couramment parlée a toujours été le français. La Bretagne ne peut donc pas être définie<br />
uniquement par les limites de la langue bretonne. Mais au-delà de son rôle politique et administratif essentiel on comprend bien que Nantes avec ses négociants et<br />
sa marine florissante était la locomotive économique de toute la Bretagne. Ce rôle de grande Cité marchande lui conférait une place tout à fait à particulière dans<br />
les Etats de Bretagne et sans être iconoclaste on peut dire que Nantes a toujours été plus nantaise que bretonne comme, toute proportion gardée, Venise était plus<br />
vénitienne qu’italienne.<br />
* * *
# La vocation maritime de Vertou<br />
Au début du XIXème Vertou est une grosse commune agricole traversée par la Sèvre, un affluent de la Loire qui se jette en aval de Nantes. La Sèvre<br />
achemine un important trafic fluvial facilité par une digue millénaire construite par les moines de Vertou, et par l’existence d’une écluse à la Chaussée. Cette digue<br />
facilitait le transport vers l'autoroute fluvial qu'est alors la Loire ouverte par son estuaire sur le monde maritime. En aval de l'écluse, la Sèvre devient maritime et<br />
subit les effets de la marée, les eaux des grandes marées venant presque recouvrir la digue de la Chaussée, mais sans jamais passer de l'autre côté, ce qui me fait<br />
penser que les moines de l'an 1000 étaient de bons ingénieurs. Les femmes de mariniers s’empressaient de terminer leur lessive avant de franchir l’écluse car en<br />
aval l'eau devenait saumâtre, comme la Loire à Nantes. Ce qui explique le grand nombre de bateaux-lavoirs installés au Chêne et à la Barbinière qui lavaient dans une<br />
eau douce le linge venu des navires du port et des beaux quartiers de Nantes.<br />
A titre de curiosité, sous l'Ancien Régime l'Amirauté de Nantes avait l’autorité judiciaire pour instruire les affaires criminelles sur la partie de la Sèvre en<br />
aval de l’écluse actuelle, soumise à la marée, et considérée de ce fait comme appartenant au domaine maritime. C'est ce que rappelle l’affaire Julien Leroy qui<br />
défraya la chronique vertavienne en 1728. Le corps de ce brave homme qui était un honnête négociant habitant la Chaussée, le quartier de Vertou au bord de la<br />
Sèvre, avait été retrouvé noyé en aval de l’écluse : suicide, homicide, accident ? Les juges de l’Amirauté écartèrent le juge de Vertou pour instruire ce dossier<br />
faisant valoir qu'il était de leur compétence territoriale.<br />
Les villages du Chêne et de la Barbinière ont été de tout temps peuplés de gabariers rompus aux techniques de la navigation fluviale qui naviguaient<br />
régulièrement jusqu'au Port de Nantes, la Venise de l'Ouest. On construisait à Vertou des gabares … et même quelques navires de mer. Vertou avec ses villages<br />
bordant la Sèvre participait donc de très près à l'activité maritime de Nantes. Quand les habitants de Vertou devaient se déplacer à Nantes ce n'était pas par la<br />
route mais par la Sèvre et ceci jusqu'à une date récente (vers 1930). On m’a raconté que mon arrière grand-mère, Ernestine Bureau, était partie pour faire ses<br />
emplettes à Nantes le jour où l’armistice de 1918 fut annoncée. Le pilote du bateau reliant Nantes à Vertou qui avait trop fêté cet évènement échoua son bateau sur<br />
un banc de sable. Il n’y avait rien d’autre à faire qu’à attendre la prochaine marée pour pouvoir repartir et Ernestine fut trop heureuse de faire profiter ses<br />
compagnons d’infortune de ses provisions.<br />
Ce seront donc les enfants des gabariers vertaviens, en contact permanent avec les navires et les marins de mer, qui passeront les premiers de la navigation<br />
fluviale à la navigation maritime. Embarqués comme simples marins d'abord, puis aidés par leur pratique et leur expérience de la navigation acquise dès leur plus<br />
jeune âge ils accèderont rapidement aux postes de commandement de leurs navires. Cette spécialisation technique sera officialisée et pérennisée par l'Inscription<br />
Maritime. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point capital.<br />
L'histoire des Navigateurs originaires de Vertou, comme ceux de Trentemoult ou de Indre accompagne étroitement celle du Port de Nantes. L’examen des<br />
généalogies et des registres maritimes montre qu’à la première génération, celle de la Restauration le nombre de marins augmente de façon importante. A la<br />
deuxième génération, celle du Second Empire, leur nombre explose, tous les hommes valides d’une même famille étant alors marins ou capitaines au Cabotage. Ils<br />
obtiennent leur brevet de Maître au Cabotage à partir de 25 ans et dès cet âge peuvent commander un navire en premier ou en second. A la troisième génération,<br />
celle de la Troisième République leur nombre commence à diminuer tandis que la proportion de capitaines au Long Cours dépasse celle des maîtres au Cabotage. A la<br />
quatrième génération, celle de la Belle Epoque, ils ont presque disparu, sauf quelques rares capitaines cap horniers et nombre d’officiers de la nouvelle marine à<br />
vapeur marchande et militaire.<br />
# Les deux populations de Vertou<br />
Au XIXème la population de Vertou se répartissait en deux communautés bien distinctes. D’une part une population rurale largement majoritaire constituée
de cultivateurs et de viticulteurs dispersés dans ces nombreux hameaux formés de quelques fermes et bâtiments d’exploitation et qui quadrillent le territoire de la<br />
commune selon une trame qui remonte à la Gaule romaine. (On pourra consulter utilement à ce sujet les études de notre sympathique historien local Michel<br />
Kervarec.) Et d’autre part une population de “prestataires de services” qui habitent les villages en bord de Sèvre : Beautour, Le Chêne, La Barbinière, La<br />
Gombergère, Portillon. L’habitat de ces villages formé de petites maisonnettes bien groupées sans fermes ni bâtiments agricoles indique bien qu’il s’agit d’une<br />
population de “gens sans terre“ : artisans, ouvriers agricoles, fariniers, gabariers, charpentiers de navires, tonneliers, rouliers, lavandières, pêcheurs. Ce sont ces<br />
gens sans terre qui vont tout naturellement devenir les marins du XIXème. Et quand il ne faudra plus de marins ils deviendront les ouvriers des industries nantaises<br />
qui se développent au début du XIXème : conserveries, biscuiteries, chantiers navals. Les villages de marins deviendront des villages d’ouvriers jugés peu<br />
fréquentables par les habitants du bourg et de la campagne. Quand il ne faudra plus d'ouvriers ils seront remplacés par des cols blancs branchés attirés par le<br />
pittoresque de ces anciens villages. La même évolution peut être observée dans les villages de marins de Rezé.<br />
Il faut noter que la Sèvre a toujours été une artère industrielle prospère. Sa forte déclivité a permis d'équiper son cours de plus d'une centaine de sites de<br />
production d'énergie hydraulique qui activait moulins, foulons, papeteries, filatures, forges. Grâce à la Chaussée de Vertou construite par les moines vers l'an mille,<br />
la Sèvre était navigable sur 25 kilomètres, drainant les produits de l'industrie locale, les matériaux de construction ...les vins du vignoble local expédiés vers le nord<br />
de l'Europe: 10000 barriques au 18ème et les bonnes années plus du double.<br />
Les relations entre tous ces villages de bord de Sèvre et la grande cité de Nantes étaient faciles et fréquentes. Julien Dubigeon, le fondateur des chantiers<br />
navals nantais était un charpentier de navires originaire du village du Fradet à Cugand, en bord de Sèvre.Parmi les populations de ces villages une mention<br />
particulière doit être faite pour les tonneliers, profession particulièrement bien représentée dans les villages de bord de Loire et de Sèvre. Car à l’époque où on ne<br />
connaissait ni le plastique, ni le carton, l’emballage universel pour le transport et le stockage des marchandises liquides et solides était le tonneau. Géniale invention<br />
de nos ancêtres les Gaulois, le tonneau est robuste, étanche, solide, facile à superposer, à manutentionner … et à rouler. Pouvant contenir aussi bien des produits<br />
liquides ou solides c'est un moyen idéal de transport, de manutention et de stockage de pour toutes sortes de marchandises. Les vivres de bord des voiliers par<br />
exemple étaient livrés en tonneaux, y compris la viande conservée dans un liquide vinaigré. Sur toutes les vues de port de cette époque on remarque l’omniprésence<br />
de ces indispensables tonneaux ( Ref Bibliographie).<br />
# Lignées de navigateurs de Vertou<br />
Les archives d’état-civil, les recensements et les actes notariaux citent les noms de nombreux de navigateurs dans plusieurs familles de Vertou comme<br />
Giteau, Guichet, Chassé, Pichaud, Merceron, Heurtin, Lemerle, Huchet, Peneau, Agaisse, Perthuis, Leroy, Lebeaupin, Bachelier etc. On retrouve souvent le nom de<br />
Doussain de L’Herbraye cité comme constructeur de navires à Vertou par le Cdt Jean Lacroix et par Mme Simone Bouteiller dans son étude (ref bibliographie). Un<br />
Paul Doussain (1820- ?) a épousé Pélagie Lefeuvre en 1848. Leur fils Paul Doussain né en 1872 épouse Marie Reine Baudy, cousine germaine de la mère de mon grand-<br />
père Célestin Gicquel. Dans toutes ces familles on retrouve toujours quelque part un ancêtre Bureau. L’ancêtre le plus anciennement connu de mon grand-père<br />
Gicquel est un Jean Bureau.<br />
Les Capitaines sont souvent cités dans les actes d’achat et vente de terres et bâtisses ce qui semble être l’une de leurs occupations favorites lorsqu’ils sont<br />
en congé à terre. Comme le montre cet extrait d’un Acte de Vente du 30 Avril 1868 (Etude de Me JJ Pion) : “ Cet acte porte sur la vente d'un terrain dans les près<br />
du Loiry. Ont comparu :Aimée Perthuis, épouse de Pierre Perthuis, Maître au Cabotage, demeurant au Chêne, Aimé-Marie Rivet, Maître au cabotage, demeurant au<br />
Chêne, Julien Rivet, Maître au Cabotage, demeurant au Chêne, Jean Bureau, Maître au Cabotage, demeurant au Chêne"
# Le patronyme Bureau<br />
Un inventaire systématique des Bureau des communes du sud de Nantes a été réalisé par Mme Odile Halbert (ref bibliographie) qui a passé plusieurs années à<br />
les répertorier. Elle a dénombré 600 Bureau à Vertou sur une période de trois siècles. Le patronyme Bureau était le plus répandu de Vertou où plus de 400<br />
naissances sous ce nom ont été enregistrées au XIXème alors qu’aujourd'hui il a quasiment disparu.<br />
La concentration de Bureau était particulièrement élevée dans les villages du Chêne et de la Barbinière et les contemporains devaient utiliser des surnoms<br />
pour s’y retrouver : Capirote (tête rouge, rouquin ?), Gabiaize, Cavaignac, Mulet, Bon Dieu, Pihuite, Chipartout (?), Pêcheux, Cagouille, Grandmatinal. Les Bureau de<br />
notre famille sont des Capirote. Quelques familles Bureau étaient visiblement spécialisées dans des professions “nautiques“: gabariers, charpentiers de navires,<br />
marins, capitaines. De façon générale on constate qu’il existe toujours à l’origine des lignées de navigateurs vertaviens des charpentiers de navires et/ou des<br />
gabariers. Par exemple le premier de la lignée “ Bureau Grosjean “ , Jean Bureau, né en 1721 a eu un fils et trois petits-fils charpentiers de navires. Un autre petit-<br />
fils Pierre, né en 1796 est Capitaine au Cabotage. Son arrière petite-fille Adélaïde-Marie épouse un Jean Peneau Capitaine au Cabotage. Elle a vraisemblablement<br />
donné son prénom à un navire construit à Vertou cité par Mme Simone Bouteiller.<br />
Le souvenir d'anciennes familles Bureau de Vertou a été préservé grâce au travail des historiens locaux : les Bureau du Chantier (Guillaume), les Bureau des<br />
Hirondelles (François), les Bureau de l’Ecluse (Pihuite). Le travail restait à faire le travail pour les Bureau du Côteau (Capirote).<br />
# Les Bureau Pihuit<br />
Brick Goëlette Auguste Marie – Cap Bureau Pihuit
Les Bureau Pihuit sont toujours représentés à Vertou par Jeanine Bureau, une descendante directe de cette branche. Elle a épousé Gaëtan Le Tilly un<br />
arrière-petit-fils de Jean Bureau Capirote, union qui a réuni ces deux branches de Bureau navigateurs. Louis Bureau l’ancêtre des Bureau Pihuit a été tué en 1794<br />
par les troupes révolutionnaires. Son fils François a un premier fils marin qui meurt à l’Hôpital de Toulon et un second fils Jean (1812-1878) qui sera l’un des<br />
premiers capitaines au cabotage de la Barbinière. Il commande le "Jeune Gustave" un lougre transformé en goélette. Ce pauvre malheureux sera condamné par<br />
jugement du 23 Avril 1869 à un mois de prison ferme pour n'avoir pas quitté le dernier son navire naufragé ! Son premier fils, Jean-Baptiste né en 1847 sera lui<br />
aussi Maître au Cabotage. A la fin de sa navigation il deviendra l’éclusier de Vertou jusqu’ à sa mort en 1935. Gustave le second fils de Jean, Capitaine au Long Cours<br />
meurt à 31 ans. Sa petite-nièce Jeannine Bureau-Le Tilly raconte que Gustave avait embarqué comme mousse le soir même de sa première communion, comme c’était<br />
l’usage dans ces communautés de marins.<br />
# Autres familles de navigateurs<br />
A – Les Bonnigal du Bourg<br />
Dans le No 3 de la revue Regard sur Vertou N° 3 Mme Bouteiller raconte l’histoire d’une famille de Vertou qui présente certains points communs avec celle<br />
des Bureau et montre la place que tenaient les “navigateurs ” aux côtés des notables terriens au XIXème. Claude Callier (originaire de Touraine) épouse la fille d’une<br />
famille de Guérande, Victoire Danto. Leur fils Charles épouse Irma Pion qui est la fille d’un notaire de Vertou. Deux des trois frères de Irma sont Capitaines au<br />
Long Cours. Charles Callier deviendra maire de Vertou en 1848. Sa fille Alice épouse Louis Bonnigal, clerc de notaire, qui prendra la succession de son beau-père<br />
comme notaire et deviendra lui aussi maire de Vertou. Les trois filles de Louis Bonnigal épouseront respectivement un futur Capitaine de Vaisseau, un futur<br />
directeur de l’Ecole d’Hydrographie de Nantes, et un Ingénieur du Génie maritime. En remontant plus haut on retrouve des traces d’une implantation de cette<br />
famille à St Domingue.<br />
B- Les Leroy de la Barbinière<br />
Plusieurs Leroy originaires de la Barbinière et du Chêne deviendront Maîtres Au Cabotage. Comme François Leroy très proche de Jean Bureau à beaucoup<br />
d'égards : ils habitent le même village de La Barbinière; ils ont presque le même âge; ils ont accompli le même parcours professionnel; leurs pères Michel Leroy et<br />
Jean Bureau sont tous deux charpentiers de navires et sont en plus cousins germains. Par conséquent notre Jean Bureau et François Leroy avaient quatre arrièresgrand-parents<br />
communs : Julien Leroy, Marie Cassard, Mathurin Bureau et Julienne Heurtin. François Leroy partira habiter à Chantenay, à proximité du Port de<br />
Nantes et ses descendants suivront la filière classique : Capitaine au Long Cours, Officier de marine supérieur, etc<br />
C - Les Merceron de la Morlachère<br />
La Morlachére est un charmant petit hameau en bord de Sèvre coincé entre Le Chêne et la Barbinière, peuplé tout naturellement de gabariers et de charpentiers<br />
de navire comme les Merceron.<br />
L'un deux Jean Charles né en 1826 (il est donc contemporain et voisin de Jean Bureau) devient sans surprise Maître au Cabotage. Il arme et commande, avec<br />
son frère Louis-Philippe (1830-1893) Capitaine au Long Cours, le trois-mâts " Sainte Anne " l'un des derniers transporteurs de coolies chinois. Son fils François<br />
(1872 - 1955), mécanicien à la Transat deviendra directeur des Chantiers Navals de La Pallice. Le marin le plus éminent de cette lignée est l'Amiral Jean Merceron<br />
(1914-2001), dont la carrière est emblématique des dernières turbulences de la marine française. Il a en effet personnellement participé comme Officier fusiliermarin-commando<br />
à tous les épisodes dramatiques de la marine française au cours des vingt années terribles qui vont de la défaite de 1940 à la fin de l'empire<br />
colonial français : Namsos, Dakar, les deux débarquements, l'Indochine, l'Algérie, Congo Brazzaville. Nous attendons avec impatience le récit de sa vie que prépare<br />
son petit-fils François Merceron, aujourd'hui membre actif de l’Association Vertavienne de Généalogie.
# Jean Bureau, Capitaine au Cabotage, 1823-1900<br />
Jean Bureau a navigué pendant près de 40 années y compris pour la Marine militaire. Retiré à terre dans sa maison du Chêne il deviendra à cinquante-huit<br />
ans Maire de Vertou de 1881 à 1885. Il naît au Chêne en 1823. Jeune enfant il voit passer sur la Sèvre les gabarres qui descendent vers Nantes. Il a passé toute<br />
son enfance à jouer en barque sur la Sèvre, il a observé le mouvement des marées qui remontent jusqu'à l'écluse de la Chaussée. Il a observé le travail de son père<br />
charpentier de navire. Il a donné un coup de main aux gabariers pendant leurs manoeuvres. Il a écouté les récits de voyages de ses oncles Pierre Bureau et Jean. Il<br />
est descendu à l’occasion avec eux au Quai de la Fosse quand ils repartaient pour reprendre la mer pour de longs mois. Les bricks n'ont plus de secrets pour lui. Il a<br />
écouté avec attention et envie les récits de voyages des navigateurs du Chêne et de La Barbinière. Il connaît déjà toutes les ficelles du métier de marin. Sa voie est<br />
vite tracée. Lui aussi deviendra Capitaine.<br />
Effectivement il ne perd pas de temps. Il s'inscrit tout jeune à l'école du Chêne et dès l'âge de 14 ans embarque comme mousse pendant 4 années. Puis<br />
comme marin pendant cinq ans. Pour devenir Maître au Cabotage il faut avoir 24 ans et justifier de 60 mois de navigation sous pavillon français. A peine deux mois<br />
après l'anniversaire de ses 24 ans il décroche le 17 Mai 1847 son brevet de Maître au Cabotage. Puis il part accomplir ses obligations militaires, bien entendu dans<br />
la Marine qui n’est encore Royale que pour quelques mois.<br />
Le 8 Août 1848, à son retour du service militaire il obtient immédiatement le commandement du Brick "Le Georges", ce qui n’était pas exceptionnel à cette<br />
époque. Il le commandera pendant vingt ans, jusqu’à sa vente en 1968, relâchant dans tous les ports d'Europe et des Antilles de Saint-Pétersbourg à Naples en<br />
passant par Oslo, La Havane et Alger.<br />
En 1855, il est mobilisé à nouveau pendant une année dans l'escadre franco-anglaise chargée d'assurer le blocus de la Baltique en appui de l'Expédition de<br />
Crimée déclenchée, déjà, par une contestation à propos des Lieux Saints. Il participe à l'un des rares faits de guerre de cette escadre en participant à l’attaque de<br />
Sveaberg en Août 1855 par une flottille de canonnières à vapeur. Il y sera décoré de la Médaille militaire sur décret de l'Empereur au titre d'un acte de bravoure à<br />
bord de la canonnière La Redoute. Je n’ai pas pu obtenir le texte de la citation car les archives de la Médaille Militaire ont été incendiées pendant la Commune. Il<br />
recevra également la médaille commémorative de la Baltique en argent massif que la reine Victoria a offert à tous les marins et soldats du corps expéditionnaire.<br />
Il aidera son frère Auguste, son cadet de sept ans, Capitaine au Long Cours à armer le brick "Pauline et Noëmie". Celui-ci disparaîtra lui aussi en mer à l'âge<br />
de 33 ans, laissant veuve son épouse Pauline Pichot et orpheline sa fille Noëmie.<br />
# Ernestine Ertaud, Epouse de Jean Bureau<br />
Jean Bureau a épousé Ernestine Ertaud (1836-1923) issue d’une respectable famille de Navigateurs de Trentemoult. Dans cette famille on a navigué depuis<br />
toujours comme marins pêcheurs sur le grand estuaire de la Loire (leur territoire de pêche va jusqu'à Belle-île), pilotes, capitaines de navires, maîtres au cabotage.<br />
Le père de Ernestine, Adrien Séverin Ertaud est Maître au Cabotage et son frère Gédéon est Capitaine au Long Cours.<br />
Elle a 13 ans de moins que Jean Bureau qui en a 37 quand il l’épouse. Cela nous semble bien tardif. Mais pour ces capitaines le mariage était une opération<br />
délicate et problématique. Toujours en mer depuis l’âge de 13-14 ans puis mobilisés dans la marine militaire à l’âge de 19 ans pendant 30 mois, à leur retour à la vie<br />
civile ils devaient préparer dans des conditions pas toujours faciles leurs examens de Capitaine. Puis il fallait trouver un commandement intéressant en faisant ses<br />
preuves. Ce n’est qu’à partir de la trentaine qu’ils pouvaient envisager leur mariage. Les rencontres entre jeunes gens à marier se faisaient alors à l’occasion de<br />
réunions de familles, principalement les mariages, ou bien avec les frères et sœurs de collègues navigateurs.<br />
Jean Bureau a vraisemblablement connu Ernestine Ertaud, à l’occasion du mariage de son frère Pierre le 4 Octobre 1856 à Rezé avec Hortense Lancelot de<br />
Trentemoult, cousine germaine de Ernestine Eraud ( du côté Bessac). Pour la petite histoire les témoins de mariage étaient ”Jean Bureau, Capitaine au Long Cours
(belle promotion, il n'est que Maître au Cabotage), frère de l’époux, Louis-Désiré Joubert, Capitaine au LC, non parent, Julien-Jacob Lancelot, Maître au Cabotage<br />
et Noël Raphaël Bertrand, Constructeur de Navires. ”. C'est le Bertrand des chantiers bien connus Bertrand-Boju. Son fils Noël épousera Marie Lancelot la soeur<br />
de Hortense. Selon toute vraisemblance Pierre avait fait à Nantes ses études de Capitaine au Long Cours en compagnie de Raphaël Lancelot, autre cousin germain de<br />
Hortense fils de l’oncle Pacifique Lancelot, Capitaine au cabotage.”<br />
Un an plus tard Jean Bureau fait demander la main de Ernestine à la famille Ertaud par l’intermédiaire de Hortense Lancelot. Mais ce n’est que fin 1860 (le<br />
20 Décembre) qu’ils se marieront. Que s’est-il passé entre temps ? Son frère Pierre lui rend compte du résultat des démarches de Hortense dans un courrier<br />
adressé de Vertou et daté du 23 Avril 1857. “Dimanche nous étions à Trentemoult, Hortense, ma mère et moi et que le père Adrien (Ertaud) nous a témoigné son<br />
consentement de la demande en mariage de sa fille ainsi que sa femme… Et que deux jours après Ernestine a dit à Hortense que cela lui convenait beaucoup, mais<br />
qu’elle ne voulait pas venir à Vertou pour y demeurer. Aussi comme je pense que tu ne voudras pas quitter Vertou, cela va te faire réfléchir. Tant qu’à elle du<br />
moment que ça lui convient je crois qu’elle réfléchira avant de prendre une décision. D’autant plus que son père lui a dit "Si tu veux te marier tu ne trouveras jamais<br />
mieux "ainsi que son grand père Bastien qui en est très flatté. Tu nous rendras réponse à ce sujet“.<br />
Jean Bureau même si il essaie de se montrer beau joueur est évidemment très contrarié par cette réponse qu’il commente longuement dans un courrier<br />
adressé du port de St Sébastien (Espagne) à sa mère le 7 Mai. Passées les banalités traditionnelles il en vient au sujet :<br />
“ Mon frère me parle aussi sur ses deux lettres de la réponse faite par la famille Ertaud . C’est-à-dire par Mademoiselle Ernestine. Elle a accepté la<br />
demande en mariage que je vous avais prié de faire en mon nom et que c’est ma sœur qui a eu la bonté de la faire mais elle a mis une condition c’est de ne pas venir<br />
demeurer à Vertou. Et bien ma bonne mère tout ce qui a été fait est nul, car vous savez que moi je ne veux pas aller demeurer à Trentemoult, et pourtant en faisant<br />
la demande ma sœur a du la prévenir de ça, car je vous l’avais bien expliqué. Ma bonne mère dès que vous aurez reçu ma lettre je vous prie vous ou ma sœur de<br />
souhaiter le bonjour de ma part à la famille Ertaud et de lui dire que toutes les demandes qui ont été faites sont nulles. C’est malheureux que nous ne pouvions pas<br />
quitter notre pays ni l’un ni l’autre, mais je pense que ça nous empêchera pas d’être toujours aussi amis comme nous l’avons été depuis le mariage de mon frère, jour<br />
où nous avons eu l’honneur de les connaître, c’est-à-dire de devenir familiers. Car mademoiselle Ernestine a réfléchi et Vertou ne lui convient pas pour y demeurer.<br />
Elle fait très bien de dire qu’elle ne veut pas venir y demeurer car si elle avait dit oui et que lorsque nous aurions été mariés elle n’aurait pas voulu y rester, je<br />
n’aurais probablement pas dit comme elle. Ainsi ma bonne mère je me trouve libre c’est-à-dire dégagé de ma parole et eux aussi. Lorsque vous leur rendrez réponse,<br />
je dis eux parce que je parle du père et de la mère qui sont pour beaucoup dans ces sortes de choses. “<br />
Cette correspondance émouvante permet d’imaginer 150 ans après leur première rencontre, les projets mûris par les familles de part et d’autre, les<br />
discrètes approches diplomatiques. On imagine Jean Bureau recevant cette fin de non-épouser quelque part dans un port espagnol, seul, et ruminant sa réponse.<br />
Mais cet homme même blessé, n’est pas disposé à renoncer. Il aime son Vertou et n’entend pas y renoncer, même contre un mariage flatteur et l’espoir de fonder<br />
tardivement un foyer. A 34 ans il serait temps de se marier.<br />
Le refus d’Ernestine Ertaud d’habiter Vertou n’est pas très surprenant et derrière le prétexte de Vertou se cachent peut-être d’autres motivations. Jean<br />
Bureau, est sans doute promis à un bel avenir de capitaine, mais il est d’origine modeste et ne dispose pas à Vertou d'une maison digne de la condition de Ernestine.<br />
Le décès de sa tante Marie cette même année 1857 est le “deus ex machina “ qui va sans doute permettre de relancer plus tard les négociations nuptiales. Car Jean<br />
Bureau hérite de la belle maison que sa tante a fait construire en 1832 sur le Coteau du Chêne, l’une des premières “ maisons de capitaine “ du village, mais toutefois<br />
moins grande et confortable que celles des capitaines des générations suivantes. Jean Bureau se lance alors dans de coûteux travaux de modernisation et<br />
d’embellissement de la maison de sa tante.<br />
C’est aussi à ce moment-là que les affaires de Jean Bureau évoluent. Il finit par accepter de suivre les recommandations de son armateur et de son courtier<br />
maritime qui depuis longtemps le pressent de partir naviguer au cabotage transatlantique. Dans une première lettre du 15 Septembre 1852 son Armateur lui écrit à<br />
Marseille " … nous causerons à votre retour du projet dont nous vous entretenons et auquel vous ne répondez pas. " Quel est donc ce mystérieux projet pour lequel
notre jeune capitaine Bureau fait la sourde oreille ? On a la réponse par un nouveau courrier du 27 Octobre 1853 qui relance la sujet mais de manière plus explicite<br />
:" Nous vous avons déjà entretenus de notre désir de vous voir abandonner la navigation de grand cabotage pour celle du long cours qui permettrait d'utiliser votre<br />
navire plus avantageusement. Nous insistons de nouveau sur ce point, récapitulation faite …Et là il lui énumère les avantages de cette option : " (illisible) … notre<br />
brig le St Nazaire que nous avons acheté pour le Capitaine Orjuben ( ?) que nous attendons chaque jour au Havre de retour de la Havane. Ce navire d'un port en<br />
lourd de 200 tonneaux nous aura fait en 4 mois 28000 F de fret. Les frais de la Havane et d'Angleterre sont de 4500 F. C'est donc 23500 F qui reviennent au<br />
navire sous déduction des frais de navigation. Votre navire porterait au moins 150 tonnes en sucres et même d'avantage. Les frets pour aller aux Antilles et retour<br />
de la Havane sont demandés de tous côtés à 110 F." Et il menace presque : " la seule ligne importante qui nous restait est celle de Nantes à Marseille va nous être<br />
enlevée par une compagnie de vapeurs qui fait construire des navires de 300 à 500 tonneaux dédiés à cette navigation. Nous ne saurions donc trop insister dans<br />
votre intérêt particulier comme dans celui de vos intéressés pour vous engager à ne pas différer trop longtemps. Vous pourriez associer votre frère comme<br />
"porteur d'expédition" et ce dernier pourrait acquérir dans de bonnes conditions les intérêts des fournisseurs. Voyez à en causer avec lui. Quant à nous vous pouvez<br />
compter que nous vous aiderons dans notre nouvelle navigation…" Plus tard, c’est son Courtier M. Denis, (entre temps il est devenu Capitaine Armateur) : " A votre<br />
retour à Nantes trouverez vous moyen de filer dans la Méditerranée ? Les frets sont assez bons maintenant, mais ne tomberont-ils pas ? Enfin vous avez la barre<br />
en mains, à vous de gouverner ! Ne manquez pas de nous faire connaître le parti que vous aurez pris ".<br />
Ses difficultés prénuptiales vont le pousser à faire le saut. La navigation vers Cuba et les Antilles longue et pénible l’éloignera pendant de longs mois de<br />
Vertou, mais sa persévérance finira par payer et Jean Bureau épousera Ernestine en 1860 (le 20 Décembre)… trois ans et demi après sa première demande en<br />
mariage. Les dates des factures de ses achats en vue du mariage montrent qu’il trouvera tout juste le temps d’acheter en catastrophe quelques jours avant la<br />
cérémonie son costume, ses chaussures de marié et les bijoux de la mariée. Mission accomplie, Ouf ! Mais on verra plus loin que Ernestine avait peut-être des<br />
raisons plus intimes pour accepter enfin la proposition de mariage de Jean Bureau !<br />
Citons comme exemple des contrariétés nuptiales des jeunes capitaines celui de Armand Cammartin, Capitaine au Long Cours originaire de la Chapelle Basse<br />
Mer. Il a 26 ans quand il rentre à St Nazaire d’un voyage aux Antilles comme second Capitaine et se fiance. Son armateur lui propose alors de refaire un second<br />
voyage aux Antilles mais cette fois-ci comme Commandant. Cela ne se refuse pas, il pourra se marier dès son retour qui plus est paré du titre de Commandant. Ce<br />
voyage qui s’annonçait court durera plus de quatre ans à travers l’Atlantique Sud et les Mers de Chine. Sa fiancée-Pénélope attendra patiemment son Capitaine-<br />
Ulysse et ils finiront par se marier.
Ernestine et Jean Bureau & Jeanne Le Tilly Médaille de l'Expédition de Baltique
# Ernestine Bureau<br />
Ernestine Bureau Ernest Le Tilly en Dragon<br />
De ce mariage naîtra, 3 ans et demi plus tard, en 1864 (le 6 Juillet) Ernestine Bureau qui restera l’unique enfant du couple. Elle naîtra à Trentemoult chez<br />
ses grands parents maternels. Ernestine est une belle jeune fille douée, intelligente, artiste. Elle est assez richement dotée. Elle a fréquenté les meilleures<br />
institutions nantaises. Elle a dû faire tourner la tête de plus d’un jeune Capitaine de Vertou. Mais ce n’est pas un Capitaine qu’elle épousera en 1886 (le 10 mai) à<br />
Vertou mais Ernest Benjamin Le Tilly, un terrien originaire de Assérac, commune du bord de mer au nord du département. Il est le fils de Benjamin Le Tilly,<br />
négociant et propriétaire honorablement connu dans la région de Guérande, Maire d'Assérac propriétaire de quelques terrains sans valeur au lieu-dit La Baule-<br />
Escoublac sur l’un desquels sera construite la gare de La Baule. Le jeune Ernest a fait ses humanités au Petit Séminaire de Guérande. C’est un beau jeune homme qui<br />
accomplit son service militaire dans les dragons dont il porte fièrement l’uniforme. Les deux familles sont certainement satisfaites de ce beau mariage. Nous dirons<br />
plus loin comment les futurs époux s’étaient rencontrés. Après son mariage Ernestine Bureau quitte Vertou pour habiter St Nazaire où son mari se lance dans les<br />
affaires. C’est là que naîtra Jeanne Le Tilly ma grand-mère. Il n’a semble-t-il pas hérité des qualités de commerçant de son père et en moins de temps qu’il en faut<br />
pour le dire il fait faillite, ruiné par des placements hasardeux, les emprunts russes disait-on dans la famille pour le disculper. Il est permis d’en douter. Il est alors
contraint de revenir habiter avec sa famille chez ses parents à Assérac La parenthèse du séjour à Assérac a été particulièrement pénible pour Ernestine qui doit<br />
cohabiter plutôt mal que bien avec ses beaux-frères dans la maison familiale des Le Tilly juste à l’entrée du bourg Assérac sur la route de Guérande.<br />
Ma grand-mère en a gardé un souvenir d’enfant qui l’a marqué : celui de son père retirant ses sabots avant de monter à l’étage pour emprunter de l’argent à sa<br />
mère, laquelle lui faisait à chaque fois la même remarque : “ Attention il faudra un jour que tu le rembourses à tes frères cet argent “. Effectivement, dès le décès<br />
de sa mère, ayant déjà dépensé sa part d’héritage il sera poliment poussé dehors avec sa progéniture. D’où un retour sans gloire à Vertou pour s’installer au Chêne<br />
dans la maison de Jean Bureau. A défaut d’offrir à son épouse prospérité et bonheur il la dotera d’une abondante progéniture de 9 enfants qu’elle aura beaucoup de<br />
mal à élever convenablement.Avec Ernestine, fille unique, la tradition maritime de la famille se perd pendant une génération et la famille Bureau sautera la case Cap<br />
hornier pour passer directement à la case “Marine Nationale“. Trois de ses quatre fils porteront le pompon ou la casquette de la Marine Nationale tandis que sa fille<br />
épousera un artisan-peintre !Mais cela c'est une autre histoire !<br />
# Les marins mécaniciens<br />
Ernest Le Tilly, le fils aîné de Ernestine (1890-) après une formation à Toulon deviendra Officier mécanicien de Marine nationale puis marchande. Son fils<br />
Gaëtan Le Tilly épouse à Vertou Jeannine Bureau, comme indiqué précédemment.<br />
Jeanne Le Tilly sa fille aînée (1887-1976) épousera Célestin Gicquel (1882-1934) un Ingénieur des Arts&Métiers originaire de la Barbinière qui effectuera<br />
une carrière d’ Ingénieur Mécanicien de la Marine Nationale puis d’Ingénieur à la Direction Technique des Messageries Maritimes. Ils n’auront qu’une fille unique,<br />
Jeanne Gicquel. Ses deux grands-pères sont marins mais son père, plâtrier, est vraisemblablement empêché de devenir marin pour une quelconque infirmité<br />
physique (pour être marin il faut avoir bon pied, bon œil et une santé de fer). Q’importe, Célestin assurera la relève. Nous verrons plus loin dans quelles conditions.<br />
Il décède prématurément d’un accident cardiaque à l’âge de 52 ans. Son épouse et sa fille Jeanne décident de revenir vivre au Chêne.<br />
Sa fille unique Jeanne épousera quelque temps plus tard un Artisan-peintre de Vertou, René Leroy, union d’où naîtra Arlette et l’auteur de ces lignes Xavier<br />
Leroy né au Chêne dans cette maison chargée de souvenirs qui fut celle de Marie Bureau et où ont habité sept générations successives de Bureau-Le Tilly-Gicquel.<br />
Elle avait été construite en 1832 par Marie Bureau bien avant la mode des imposantes maisons de Capitaine du Second Empire. Fidèle à la tradition maritime et<br />
élevé dans son respect, mais peu tenté par une carrière de navigant, je me dirige vers les études d’Ingénieur à la vénérable Ecole du Génie Maritime créée en 1765<br />
pour former les ingénieurs et les cadres de la construction navale civile et militaire.<br />
Après l'Arsenal de Brest et le Port de Dunkerque je rejoins de 1972 à 1975 la Direction de la Cie Gle Transatlantique à une époque cruciale pour son avenir<br />
puisque dans ce bref espace de trois années la Compagnie va être bouleversée de fond en comble et va se préparer pour ses derniers jours. La Compagnie abandonne<br />
définitivement et non sans douleur sa prestigieuse et centenaire activité de transports de passagers en arrêtant brutalement l’exploitation de ”France” son fleuron<br />
ruineux. Pendant ces mêmes trois années la révolution du transport maritime avec l’arrivée du conteneur (le remplaçant de notre vieux tonneau !) bouleverse toutes<br />
les cartes techniques et commerciales du transport maritime de marchandises. De nombreuses options stratégiques et techniques doivent être prises dans ces<br />
moments difficiles. Au cours de ces mêmes trois années la Transat fusionne tant bien que mal avec sa compagnie sœur des Messageries Maritimes pour former la<br />
Compagnie Générale Maritime qui amorce alors une spirale inexorable de déclin, prouvant une fois de plus que ce n’est pas en mettant deux malades dans un même lit<br />
qu’on fait un bien portant. Et, cerise sur le gâteau, alors que pour traverser ces trois années semées d’écueils il aurait fallu à la barre de la Compagnie un Capitaine<br />
sachant naviguer, on a vu défiler à sa tête trois Présidents en trois ans tous auusi incompétents les uns que les autres…. dans le domaine maritime bien entendu,<br />
encore que pour les autres on peut s'interroger ?<br />
A la génération suivante, l’actuelle, mon fils aîné maintiendra en pointillé la tradition de la famille en accomplissant son service national comme Officier de<br />
Quart de la Marine Nationale, puis en exerçant ses talents dans le secteur de l’exploration pétrolière des fonds marins. Ainsi s’achève une tradition “nautique“
vieille de plusieurs siècles de gabariers, charpentiers de navires, marins, pêcheurs, pilotes, constructeurs de barges, capitaines au cabotage, officiers de marine<br />
tous issus de Vertou et de Trentemoult.<br />
# Une maison emblématique<br />
Ah si les maisons pouvaient raconter tout ce qu’elles ont vu et entendu! La maison de Vve Marie Bureau érigée sur le Coteau du Chêne a été pendant cent<br />
cinquante ans le témoin muet du destin – souvent tragique - de la famille. Les hasards de l’existence et des successions ont fait que je sois le dernier représentant<br />
de la famille à y être né et son dernier propriétaire.<br />
Marie Bureau l’avait fait construire peu de temps après la disparition de son mari Pierre. Avait-il réussi à enchaîner plusieurs voyages avantageux avant de<br />
disparaître, mystère ? Car c’est à cette époque l’une des plus grandes maisons du village du Chêne. Perchée sur le Coteau elle est visible de loin, que ce soit en<br />
venant du bourg de Vertou ou de Nantes. C’est là que Marie Bureau élève ses deux jeunes fils Pierre et Théodore. Elle y reçoit souvent en l’absence de leurs époux<br />
partis en mer ses trois sœurs et sa belle-sœur, toutes les cinq épouses de Capitaines. On imagine que s’y retrouvaient aussi tous les jeunes neveux Bureau, Pichaud,<br />
Huchet brûlant de devenir eux aussi Capitaines au plus vite.<br />
On peut imaginer les conversations commentant les séances communes de lecture des lettres reçues de leurs lointains maris; les commentaires sur la<br />
réussite et les dangers de leurs voyages; les appréciations critiques sur les désignations de Capitaines; les espoirs mis dans la construction de nouveaux navires; les<br />
intérêts et les profits des voyages dont on épluche en famille les comptes car épouses et mères de Capitaines suivent de près les affaires de leurs maris. Elles<br />
encaissent les parts d’intérêt; elles font circuler les billets à ordre; elles se déplacent chaque fois que nécessaire à Nantes pour régler avec les armateurs ou les<br />
courtiers tel ou tel problème pratique; elles s’occupent de l’intendance, des récoltes et des vendanges; elles surveillent les études et les progrès des enfants qui<br />
épient les conversations fort intéressantes de ces dames tout en admirant sur la cheminée la maquette de frégate de leur oncle Pierre. Après les mariages de<br />
Pierre et de Auguste on y accueille aussi leurs épouses Hortense Lancelot et Pauline Pichot accompagnées de leurs petites filles.<br />
Mais en 1854 c’est le début d’une longue série noire qui va frapper cette maison et sa famille. Disparaissent tour à tour en 1854 Pierre, puis en 1856<br />
Théodore, puis en 1857 Veuve Marie Bureau, puis en 1859 Pauline Pichot la jeune épouse d’Auguste, puis en 1863 Auguste Bureau. Ernestine Ertaud vient enfin y<br />
habiter. Sa fille Ernestine Bureau n’y naîtra pas, née selon l’usage à Trentemoult chez ses grands-parents. Sa cousine orpheline Noëmie Pauline y est recueillie par<br />
Jean Bureau et elle sera élevée au Chêne avec sa cousine Ernestine. La maison se vide à nouveau quand Ernestine se marie en 1886 et part pour St Nazaire. Elle se<br />
remplira à nouveau quinze ans plus tard avec le retour obligé au Chêne de la famille de Ernest Le Tilly ruiné. Mais les jeunes Le Tilly la quittent vite pour partir<br />
naviguer, aller se battre au front ou se marier. Quand son mari Ernest meurt en 1920 Ernestine se retrouve à nouveau seule en compagnie de sa cadette Marie qui<br />
bientôt la quitte pour prendre la cornette des Sœurs de St Vincent de Paul.
Le côteau du Chêne et la maison de Jean Bureau à Vertou<br />
Quelques années plus tard c’est sa fille Jeanne Le Tilly-Gicquel qui vient y chercher refuge avec sa jeune fille Jeanne après la disparition brutale de son<br />
mari Célestin Gicquel en 1934.Trois femmes à nouveau occupent la maison. Jeanne la quitte en 1937 après son mariage et Ernestine Bureau la quitte pour l’autre<br />
monde en 1942. La série noire continue trois ans plus tard avec la disparition à 32 ans des suites d’une opération de ma mère Jeanne Gicquel. Orpheline de mère sa<br />
fille Arlette vient habiter au Chêne avec sa grand-mère jusqu’à son mariage en 1959, date à laquelle toutes deux la quittent quasi-définitivement. La maison restera<br />
inhabitée pendant plusieurs années puis quittera définitivement la famille au début des années 1980 après une nième rénovation. Elle est repartie depuis pour une<br />
nouvelle vie, rompant définitivement avec cent cinquante ans d’un passé chargé de souvenirs de nos Navigateurs et de leurs épouses, leurs filles, leurs mères, leurs<br />
veuves, leurs orphelines.
# Noëmie Bureau<br />
Noëmie Bureau est la fille orpheline de Auguste Bureau et de Pauline Pichot originaire du Pellerin une autre bourgade de Navigateurs située en bord de<br />
Loire. J'ai perdu (provisoirement) la trace de la descendance nombreuse de Noëmie Bureau. Mais son passage sur terre n’a pas été sans laisser de traces, car c’est<br />
son histoire qui donne la clé de l’énigme de la rencontre à priori improbable entre Ernestine Bureau, fille d’un capitaine de Vertou, et de Ernest Le Tilly fils d’un<br />
négociant terrien de Assérac, tout au nord du département. Il s’agit de son mariage avec Georges Lechat, un Capitaine au Long Cours originaire de Assérac.<br />
Noëmie Pauline Bureau naît le 1 er Décembre 1857 au Pellerin. Sa mère Pauline Virginie Pichot meurt en 1859 et son père disparaît en mer en 1863 la laissant<br />
orpheline de père et mère à l’âge de six ans. Elle est recueillie par son oncle Jean Bureau dans sa maison du Chêne et est élevée avec Ernestine sa cousine germaine<br />
plus jeune de sept ans. C’est en raison de ces tristes circonstances qu’avaient échoué dans le grenier de la maison de Jean Bureau des collections de cartes marines<br />
ayant appartenu à Auguste Bureau sur lesquelles jeune enfant je tentais de déchiffrer les points de relèvement astronomiques notés au crayon de ses routes vers<br />
Java, Sumatra et la mer de Chine.<br />
Noëmie rencontre son futur mari Georges Lechat, Capitaine au Long Cours, dans des circonstances inconnues mais faciles à imaginer dans ce milieu de<br />
navigateurs. Sept enfants naîtront de ce mariage qui a lieu à Vertou en Avril 1878. Georges Lechat est originaire d’une honorable famille de Assérac étroitement<br />
liée à celle des Le Tilly puisque leurs maisons familiales se font face à la sortie du bourg d'Assérac sur la route de Guérande.<br />
Quatre mois plus tard en Juillet 1878 Eugénie Le Tilly la sœur de Ernest qui<br />
épouse à Assérac son voisin François-Emile Lechat. Ernestine Bureau participe bien<br />
sûr avec sa cousine Noëmie Lechat-Bureau à toutes ces festivités nuptiales où elle<br />
fait la connaissance des frères et soeurs Le Tilly. En cette année 1878 Ernestine<br />
Bureau n’a que quatorze ans et Ernest Le Tilly dix-neuf. Ils se marieront huit ans<br />
plus tard.en 1886 à Vertou. La nef de la nouvelle Eglise de Vertou vient juste<br />
d’être achevée, mais son ambitieux clocher. On peut imaginer la fierté de Jean<br />
Bureau qui inaugure quasiment pour le mariage de sa fille ce magnifique édifice<br />
auquel il a consacré tant d’énergie pendant son mandat de Maire de Vertou.A<br />
l’occasion du mariage de Ernestine Bureau, ses cousins de Trentemoult ont été<br />
invités, notamment ses cousins germains Félix et Georges Fruneau qui à cette<br />
occasion font la connaissance de Mathilde et Albertine Le Tilly, les deux sœurs<br />
cadettes de Ernest, qu’ils épouseront plus tard. De cette double union naîtra une<br />
quantité de Fruneau - Le Tilly. Ces deux cousins Fruneau étaient les fils de Aglaé<br />
Fruneau - Ertaud la tante de Ernestine Bureau du côté maternel. A partir du<br />
mariage de la petite orpheline Noëmie Bureau trois autres mariages ont été<br />
conclus, qui ont donné une abondante descendance contemporaine dont je fais<br />
partie, comme beaucoup d’autres aujourd'hui.<br />
# Pierre Bureau, le frère de Jean<br />
Fiançailles des soeurs Le Tilly et frères Fruneau à Assérac<br />
Après son mariage avec Hortense Lancelot en Octobre 1856, Pierre Bureau quitte définitivement Vertou pour s’installer à Bouguenais. Sa trace se perd<br />
définitivement à Vertou mais on la retrouve bien vivante à Trentemoult où naît en Février 1857 leur fille Hortense.
A ce propos, ouvrons une parenthèse :en consultant les registres de l’Inscription Maritime on retrouve la trace de nombreux Capitaines au Cabotage nés à<br />
Vertou mais domiciliés à Nantes, Rezé ou Bouguenais. Peu de capitaines vertaviens ont continué à résider à Vertou, ce qui rend plus méritoire la résistance de Jean<br />
Bureau accroché comme on le sait à son Vertou.<br />
Pierre Bureau a fort bien réussi, en dépit ou grâce à sa réputation qu’il a acquise d’être un homme difficile et exigeant. Retiré à Bouguenais et très pointilleux<br />
sur l’horaire il sortait rituellement sur sa terrasse avec sa longue-vue pour vérifier l’heure sur l’horloge du clocher de Ste Croix, de l’autre côté de la Loire. C’est au<br />
cours de ce rituel qu’il prend froid et meurt d’une fluxion de poitrine comme on disait alors. Il est enterré en compagnie de son épouse et d’une partie de sa<br />
descendance dans le cimetière de Rezé.<br />
Capitaine Armateur il a fait construire pour son compte le brick “Le Phoebus“ (AD 3P 530) lancé le 18/05/1857 à Chantenay par le chantier Sevestre.<br />
Déclaré comme brick, il pourra plus tard être gréé en 3 mâts pour naviguer dans l’Océan Indien :<br />
Longueur = 27,46 ; Largeur = 6,94 ; Creux = 4,38 ; Jauge = 219 Tx<br />
Doublage cuivre jaune - Arrière rectangulaire<br />
Naufragé le 7/07/1871 à Lagos (Nigeria).<br />
Intéressés au départ : Pierre Bureau (473p) - Garaud, Négociant ( 188p) - Sevestre, Constructeur (187p) .<br />
Pierre et Hortense ont eu quatre filles : Hortense, Marie-Laure, Augustine et Jeanne et un fils Pierre qui ne sera pas capitaine. Il épousera la fille de M.<br />
Sevestre, patron du Chantier qui a construit le Phoebus, et par ailleurs le dernier maire de Chantenay avant sa fusion avec Nantes.). Jeanne Bureau épouse un<br />
Capitaine au Long Cours, Charles-Edouard Dolu, originaire du Havre qui a commandé pendant quatre voyages le “Belem“. Ils auront une nombreuse descendance.<br />
Augustine épouse Stanislas Simon un Inspecteur de l’Instruction publique. Hortense Bureau épouse Augustin Lancelot, un petit cousin de la mère de Hortense,<br />
Capitaine au Long Cours de Trentemoult reconverti dans le négoce des denrées coloniales – plus précisément le café de Haïti- où il réussira mieux que bien.<br />
Marie-Laure la deuxième fille de Pierre Bureau épouse Aristide Briand, un Capitaine au Long Cours de Trentemoult fils de Eugène Briand, Capitaine au Long<br />
Cours et Armateur de plusieurs navires. Alors qu’il navigue il apprend que son frère et sa sœur viennent d’être emportés par la fièvre typhoïde. Il décide alors de ne<br />
plus naviguer pour rester auprès de sa mère durement affectée par ce double deuil et il se reconvertit lui aussi dans le négoce. Son fils Paul Briand qui continue<br />
dans la même voie épouse Marthe Lancelot, une cousine germaine, fille de Augustin Lancelot et de Hortense Bureau. Les trois enfants de Paul Briand habitent<br />
encore dans leur maison familiale à Trentemoult. Paul Briand et sa fille Suzanne ont passé plusieurs années à reconstituer la généalogie de leur famille emblématique<br />
de ces lignées de navigateurs de Trentemoult et Vertou.<br />
# Jean Bureau, Maire de Vertou<br />
Après avoir mis sac à terre après une carrière bien remplie il ne restera pas inactif pour autant car il devient Conseiller municipal puis Maire de Vertou en<br />
1881 succédant à Alphonse Tertrais, l'industriel bien connu du quartier de Beautour, Inventeur de la conserve moderne. Diminué par une douloureuse maladie il sera<br />
contraint de démissionner en Mars 1885 et lui succèdera alors Henri Delahaye, héritier du réputé imprimeur nantais Charpentier, le généreux mécène qui a financé<br />
la construction de l'Hôpital de Vertou.<br />
Pendant le mandat de Jean Bureau la Commune de Vertou vivra plusieurs évènements notables : l’achèvement de la construction de la nef de l’Eglise,<br />
l’ouverture du nouveau cimetière (?), l’implantation du premier bureau de Poste télégraphique de la commune, et non sans quelques remous l’ouverture de la première<br />
école publique de filles.
Le fait que Jean Bureau ait été le Maire de Vertou m’avait toujours intrigué. Par quelles circonstances un Navigateur peu au fait des préoccupations d'une<br />
population majoritairement rurale, ayant été absent de la commune pendant une bonne partie de sa vie et de surcroît habitant Le Chêne, village à la réputation<br />
douteuse (c’est ainsi qu’il était vu dans les années 1950) avait-il pu été choisi par les Vertaviens pour les représenter ? Mais j’ai appris depuis qu’à la date de sa<br />
“nomination“ les maires des communes n’étaient pas élus par les habitants de la commune mais désignés par les préfets et ceci depuis le premier Empire. Ce n’est<br />
qu'à partir de 1884 que les maires seront élus. En 1881 Jean Bureau n'a donc pas été élu par la "vox populi" mais désigné par la "vox dei". Ce qui ne retire sans doute<br />
rien à ses mérites car Vertou ne manquait pas de brillantes personnalités : notables, propriétaires terriens ou industriels pour occuper cette fonction. Toujours<br />
est-il que pour se conformer à la nouvelle loi il sera élu Maire en 1884 en cours de mandat comme l'atteste le Certificat qui lui a été remis à cette occasion : “<br />
Monsieur Jean Bureau, Honoré de la confiance de ses concitoyens a été élu membre du Conseil Municipal et Maire de Vertou (Loire Inférieure) le 4 Mai 1884 “.<br />
Jean Bureau a donc été le premier maire élu de Vertou.<br />
Jean Bureau – Maire de Vertou - 1881-1885 Longue-vue de Jean Bureau<br />
A cette date le maire de Vertou n’avait pas les mêmes responsabilités économiques et sociales qu’aujourd’hui. “ Le Magasin Utile “ de 1856, ouvrage de<br />
référence pour le Second Empire classe les maires dans la catégorie des auxiliaires de justice au même titre que les magistrats. Ils ne disposent pas comme<br />
aujourd’hui de gros budgets, ni de services techniques, ni de bâtiments municipaux. Ils ont surtout un rôle d’ordre public. Les maires de communes maritimes avaient
également le triste privilège de devoir annoncer aux familles de marins la disparition en mer d’un être cher, accompagné du prêtre et du gendarme – le trio funèbre.<br />
Un maire Capitaine était évidemment mieux armé pour cette circonstance. Il faut noter que trois ans avant le début du mandat de Jean Bureau finissait celui de<br />
Charles Garnier Maire de Vertou pendant 18 ans qui était un Armateur. Une autre personnalité influente de la commune était le Sénateur Charles Lecour-<br />
Grandmaison, appartenant à une famille d’armateurs habitant à la Mottechaix en Vertou.<br />
On mesure ainsi la forte influence des professionnels maritimes dans une commune réputée rurale comme Vertou. Au-delà d'une personnalité sans doute hors<br />
du commun, la désignation de Jean Bureau reflète l'estime accordée aux armateurs et aux capitaines de la commune capables de sillonner toutes les mers du globe<br />
au péril de leur vie. Mais aussi qui maîtrisaient tous les rouages complexes du commerce international. Qui assuraient également une certaine prospérité aux<br />
habitants de la commune avec des emplois bien rémunérés pour l’époque de marins, de gabariers, de charpentiers de navires. Ils enrichissaient les notables<br />
"intéressés” dans leurs navires. Ils procuraient du travail aux artisans de la commune pour construire et aménager leurs belles maisons. Ils contribuaient<br />
généreusement à la souscription ouverte pour la construction de la nouvelle église, fierté des Vertaviens. Car c'est au cours du mandat de Jean Bureau que<br />
l'édification de la nouvelle église arrêtée jusqu’alors faute de financement reprendra pour s’achever définitivement en 1886. Mais sans son clocher qui sera terminé<br />
un peu plus tard et dont l’une des cloches, celle du RE, a été baptisée Ernestine-Marie comme sa fille Ernestine-Marie Bureau.<br />
Le mandat de Jean Bureau s’accomplit à une période – de 1880 à 1885 - particulièrement cruciale pour la République Française et ses institutions. Car ce n’est<br />
qu’à partir de ces années-là que la République s’enracinera définitivement dans notre pays après plusieurs décennies d’éclipses bonapartistes et royalistes. Que la<br />
conception républicaine et parlementaire des institutions triomphe enfin. Que le 14 Juillet est décrété Fête Nationale. Que la Marseillaise devient l’hymne national.<br />
Que la liberté de réunion est assurée par la loi du 30 Juin 1881 et celle de la presse par la loi du 29 Juillet 1881 qui réglemente aussi l’affichage mural. Que la<br />
liberté d’association est instituée par la loi du 22 Mars 1884. Que le divorce est à nouveau rétabli avec la loi Naquet de 1884. Et que enfin avec la loi du 5 Avril<br />
1884 l’élection des maires de toutes les communes est redonnée aux conseils municipaux élus (sauf à Paris). Ces lois sont pour la plupart l’œuvre de Jules Ferry,<br />
président du Conseil en 1880-1881 et en 1883-1885 dont le nom est resté associé à l’institution de l’enseignement primaire gratuit (en 1880), laïc et obligatoire (en<br />
1882). C’est aussi à cette époque que commence la séparation de l’Eglise et de l’Etat avec notamment l’exclusion des congrégations religieuses de l’enseignement et<br />
l’expulsion des Jésuites, mesures qui sont loin de recueillir l’approbation de tous les Français dans l’Ouest catholique, et plus spécialement à Vertou encore marqué<br />
par les drames de la Terreur. A cette époque de passions exacerbées dans un climat de quasi guerre civile être Maire de Vertou ne devait pas être une position bien<br />
confortable. Mais c'est aussi à cette époque aussi que la crise économique commence à s’installer, que les barrières douanières sont érigées à nouveau, que les<br />
nationalismes se réveillent et que commencent à couver les grands conflits du siècle suivant. La deuxième mondialisation s’achève et avec elle les besoins de<br />
transports maritimes, ce qui entraînera le déclin progressif de la marine à voile nantaise.<br />
Lors de la disparition de Jean Bureau le Sénateur de Vertou écrit à sa veuve les mots suivants, certes de circonstance, mais qui confirment l’opinion que l’on<br />
peut se faire du personnage avec la distance du temps: “C’est un véritable chagrin car c’était pour moi un vieil ami dont j’appréciais la franchise et l’inaltérable<br />
droiture. Je le considérais comme un honnête homme dans toute l’acception du mot et j’avais pour lui autant de respect que d’affection. Je n’oublierai jamais les<br />
grands services qu’il a rendus à la commune ni les nombreuses marques d’amitié qu’il m’a données en diverses circonstances …“<br />
# Célestin Gicquel Officier mécanicien<br />
Revenons sur Célestin Gicquel. Exceptionnellement doué il rafle tous les prix à l’école publique de Vertou. La légende raconte que son père devait venir<br />
récupérer ses lourds livres de récompense – dorés sur tranche - avec une brouette. (Il sera lui-même surnommé “doré sur tranche“ par l’espiègle sœur cadette de<br />
ma grand-mère qui annonçait ainsi l'arrivée dans le village du jeune Gadz’art ou officier de marine). On le dirige vers l’Institution Livet à Nantes qui prépare à<br />
l’examen d’entrée à l’Ecole des Arts et Métiers d’Angers où il entre à 15 ans comme Major de la promotion 1897-1900 formée de 300 brillants élèves provenant de<br />
tout l’ouest de la France de Caen à Perpignan. Il en sort Ingénieur à 18 ans, en Juin 1900.
L’Ecole des Arts&Métiers était alors LA formation d’excellence pour les Ingénieurs de l’industrie française naissante. Ses élèves y acquéraient des<br />
connaissances à la fois théoriques et pratiques de haut niveau passant autant de temps en atelier et en salle de dessin qu’en salle de cours théorique. Son diplôme en<br />
poche, il n’hésite pas une minute pour s’engager dès le 30 Août dans la marine nationale et curieusement il se déclare alors comme étant “dessinateur-ajusteur “ !<br />
Au centre – Major de la promo A&M 1897-1900 Jeune officier à Alger Jeanne Gicquel et sa fille<br />
Il effectuera au sein de la Marine Nationale une brillante carrière qu’il termine comme Ingénieur Mécanicien en Chef chargé de la mise en service et des<br />
essais de l’appareil propulsif du Croiseur Duquesne. Ce bâtiment fut le premier d'une série de 5 croiseurs légers de 10000 T satisfaisant aux exigences du traité de<br />
Washington. ( Duquesne, Tourville, Suffren, Colbert, Foch). Ces bâtiments étaient les premiers à être équipés à la fois d'une chauffe au fuel remplaçant le<br />
traditionnel charbon et d’une propulsion à turbine remplaçant les machines alternatives à vapeur. Disposant d’une énorme puissance motrice de 130 000 CV le<br />
Duquesne fut le plus rapide de la série et resta pendant longtemps le navire le plus rapide de la Flotte française. Ces croiseurs furent très remarqués par les<br />
spécialistes : "Ces bâtiments, particulièrement réussis, sont très admirés à l'étranger. Leurs qualités nautiques exceptionnelles permettent de soutenir de grandes<br />
allures par presque tous les temps, et leur stabilité de plateforme est remarquable. Ils naviguent très bien dans la haute mer et se comportent parfaitement en<br />
toute occasion. Leurs quatre hélices, la puissance et la souplesse des machines, en font des unités manoeuvrières. Cette réalisation est un gros succès à l'actif de<br />
nos ingénieurs du Génie Maritime...". Le rôle de Célestin Gicquel dans cette réussite lui a valu un Témoignage officiel de satisfaction.<br />
Entre temps il enseigne dans plusieurs écoles de formation de la Marine, notamment la Thermodynamique à l'Ecole Navale. Mais près 28 ans de bons et loyaux<br />
services, il quitte la Marine Nationale pour rejoindre la Direction Technique des Messageries Maritimes où il est destiné aux plus hautes fonctions compte tenu de<br />
son expérience de la propulsion marine moderne et de ses qualités humaines.<br />
Monument d’intelligence, d’honnêteté, de conscience professionnelle, d’exigence, de perfection, c’est un homme exceptionnel comme le prouve l’examen de son<br />
dossier personnel au Service Historique de la Marine auquel j’ai eu accès et dont viennent les extraits qui suivent. C’est une litanie impressionnante de<br />
commentaires dithyrambiques des supérieurs hiérarchiques responsables de ses appréciations et notations.
En 1913 il obtient une moyenne exceptionnelle de 17,11 à l’examen de sortie de l’Ecole des Elèves-Officiers Mécaniciens de la Marine. Le Directeur<br />
commente : “ A passé des examens très brillants et a fait preuve de beaucoup de capacité. Je propose qu’il lui soit décerné un Témoignage Officiel de Satisfaction.<br />
“ Ce n’est pas rien car à cette époque un Témoignage Officiel de Satisfaction est en temps de paix l'équivalent d'une citation militaire en temps de guerre. Il en<br />
obtiendra deux autres au cours de sa carrière.<br />
Il commence sa carrière d’Officier-mécanicien en 1913 à bord du Torpilleur d’Escadre "Le Dard. " Il n’a que 31 ans. Son Commandant rédige la première<br />
appréciation du jeune Officier mécanicien : “ Plein de zèle, d’activité et d’entrain, cet Officier a assumé une tâche très lourde à bord et s’en est très bien acquitté,<br />
sans jamais ménager sa peine. Excellent Officier, très consciencieux et travailleur“. Avant son arrivée ce petit navire avait “ ses machines presque constamment en<br />
avaries“.<br />
En 1915, au tout début des hostilités : “ Officier tout à fait parfait, instruit, intelligent, plein de zèle et d’activité, solide à la mer, ne ménageant jamais sa<br />
peine. “ Ses relations avec les inférieurs sont jugées comme “très bienveillantes, fermes et énergiques“.<br />
En Juillet 1916 : “ Officier mécanicien de tout premier ordre, très zélé, extrêmement consciencieux et d’une grande capacité technique. C’est grâce à son<br />
dévouement que l’Arc a pu soutenir depuis le début des hostilités un service intensif sans autres avaries que celles provenant de l’usure“. Il le propose pour la Légion<br />
d’Honneur. Il n’a que 34 ans.<br />
En Mai 1917, même commentaire. “A su tirer des appareils de l’Arc un rendement excellent“. Il obtient alors son deuxième Témoignage de Satisfaction pour<br />
sa participation active au sauvetage des passagers du transporteur de troupes, L'Amiral Magon », torpillé par un sous-marin ennemi en Méditerranée (voir plus loin<br />
le récit détaillé).<br />
En Mars 1918 il prend en charge à Toulon le montage du sous-marin Romazzotti. Sa famille le rejoint à Toulon. Son épouse et sa fille âgée de quatre ans le<br />
rejoignent à Toulon et habitent au Mourillon. Son Commandant juge qu’il est devenu : “un excellent Officier de sous-marin“.<br />
Fin 1918 il quitte Toulon pour rejoindre l’Ecole des Apprentis Mécaniciens de Lorient. Début 1919 il obtient la Légion d’Honneur, il n'a que 37 ans. En Juillet<br />
1919 le Directeur de l’Ecole qui le juge pour la première fois note : “ M. Gicquel est un Officier tout à fait remarquable, très instruit, mécanicien hors ligne. A de la<br />
méthode et beaucoup d’intuition“.<br />
En Août 1920 : “ A rendu des services très appréciés, ayant sous ses ordres cinq officiers mécaniciens de même grade. Est certainement un des meilleurs<br />
officiers du corps“. Il s’agit bien entendu du corps des Ingénieurs Mécaniciens de la Marine. Quelle belle reconnaissance !<br />
En 1922 il rejoint le Cuirassé Paris, commandé par le Capitaine de Vaisseau qui confirme et signe : “ Très grande compétence technique et d’une haute valeur<br />
morale. Officier de tout premier ordre, instruit, intelligent, travailleur, ingénieux“.<br />
En 1924 : “ Officier exceptionnel aussi bien du point de vue moral qu’au point de vue professionnel. On peut tout demander à Gicquel, il donnera toujours plus<br />
et mieux qu’on ne lui demandait. Remarquablement au courant des appareils et travailleur acharné, d’une modestie rare, très discipliné. Cet officier est de ceux qui<br />
sont dignes de tous les avancements“.<br />
En 1925 il est nommé professeur de Thermodynamique à l’Ecole Navale, une matière évidemment primordiale pour de futurs Officiers Mécaniciens. Le<br />
Capitaine de Vaisseau O’Neill Commandant de l’Ecole doit le classer dans l’une des cases prévues : Hors pair ou d’élite, Très bon, Bon etc coche bien entendu la<br />
première case avant de poursuivre : “ Officier exceptionnel qui réunit les plus belles qualités intellectuelles, professionnelles et morales. Dévouement, discipline,<br />
application, travail, intelligence et modestie sont les traits dominants de son caractère énergique et sympathique“.<br />
En Mai 1926 le très remarquable Directeur Mécanicien de l’Ecole, Jauch connu pour son ouvrage de référence sur les machines marines commente : “ S’est
fait particulièrement apprécier de tous comme professeur à l’Ecole. Il rendra partout les meilleurs services. Je serai heureux de lui donner un embarquement au<br />
choix à bord d’un des Croiseurs en montage, où comme partout il montrera toute sa mesure !“.<br />
Etat-Major du Duquesne – au centre le Cdt Bramand du Boucheron - Assis à droite Célestin Gicquel<br />
Il est en effet nommé responsable du montage, de la mise au point et des essais de l’appareil propulsif du Duquesne avec ses puissantes turbines.<br />
En Mai 1927 c’est au tour du Capitaine de Vaisseau Bramand du Boucheron, Commandant du Duquesne de s’exprimer : “ Suit avec la plus grande attention<br />
le montage des appareils du Service machines du Duquesne et fait preuve de remarquables qualités d’initiative, de jugement et de compétence“. Puis en<br />
Mai 1928 c’est le commentaire du Contre-amiral Morris Major Général de la Préfecture maritime de Brest qui renchérit : “ Officier supérieur d’élite.<br />
Dirige son personnel avec autorité et compétence. Connaissant admirablement son métier. Ayant beaucoup d’autorité sur le personnel. Fait honneur à son<br />
Corps. Mérite d’accéder aux grades les plus élevés“.<br />
Lors de ses 1928 le Duquesne » dépasse d’un demi nœud la vitesse contractuelle nominale de 34 nœuds fabuleuse pour l’époque. Aucun de ses sisterships<br />
n’atteindra les mêmes performances. Une réussite qui sera honorée par un Témoignage de Satisfaction émanant du Ministre de la Marine (publié au<br />
Journal Officiel du 11&12 Février 1929) : “ pour avoir par son jugement pondéré et sûr, ses remarquables connaissances professionnelles, son activité<br />
inlassable et réfléchie, son esprit méthodique et clairvoyant, rendu les plus grands services pendant le montage et les essais et dans l’organisation du<br />
service Machines du Duquesne. »
Maquette du croiseur Duquesne au Musée de la Marine<br />
Il n’a alors que 46 ans et est promis sans hésitation aux plus hautes fonctions dans le corps prestigieux des Ingénieurs mécaniciens de la Marine Nationale.<br />
Mais curieusement il décide de faire valoir ses droits à la retraite et pantoufle pour entrer à la Direction Technique des Messageries Maritimes, à Marseille. Il<br />
n’y exercera ses talents que pendant six ans puisqu’il décède en Juin 1934.<br />
Sa dernière notation sera celle des Messageries Maritimes en Août 1933 (au titre de la réserve) un an avant sa disparition : “ Excellent Ingénieur – possède<br />
des connaissances techniques de tout premier ordre, extrêmement intelligent, très consciencieux “.<br />
Avec ce que l’on sait désormais, les derniers hommages prononcés lors de ses obsèques par l’Ingénieur Mécanicien Général Gérard ne sont pas seulement de<br />
circonstance : “ … Tous ceux qui l’ont approché, ses Chefs, ses Amis et tous ceux qui furent sous ses ordres sont unanimes à reconnaître ses qualités… J’ai pu<br />
l’apprécier, toujours de bonne humeur, modeste malgré son grand savoir, plein d’allant, aimant son métier, il se donnait de tout cœur à sa tâche, et prenait plaisir à<br />
instruire nos jeunes camarades …“. Et celle du Président des Gadzarts : “ Intelligence d’élite, travailleur exceptionnel, Gicquel entra à l’Ecole d’Angers comme<br />
major de sa promotion. Il sut dans ce milieu d’émulation ardente, de compétition sévère se maintenir toujours aux tous premiers rangs. Il y conquit pour toujours<br />
l’admiration de ses camarades d’études … Entré dans la Marine Nationale, rapidement parvenu au grade d’Officier Mécanicien, puis professeur à l’Ecole Navale, il<br />
sut en toutes circonstances forcer la haute estime qu’imposaient à tous ses qualités incomparables de technicien émérite. “<br />
Deux vies exemplaires de navigateurs vertaviens, tous deux originaires du Chêne mais aux destins bien différents : Jean Bureau s’est illustré dans la marine à<br />
voile artisanale et deux générations plus tard Célestin Gicquel s’est fait remarquer dans la marine mécanicienne. Que de changements en deux générations !
# Torpillage de l’Amiral Magon<br />
Revenons sur ce naufrage dont le contexte militaire est le suivant. Pendant la Première Guerre mondiale. Après l'occupation de la Serbie et de l'Albanie par<br />
les troupes allemandes et austro-hongroises, les pays alliés (France, Grande-Bretagne, Serbie, Grèce et Italie) vont décider de maintenir un front solide aux<br />
frontières nord de la Grèce, plus précisément sur le golfe de Salonique. Le repli des troupes qui s'achèvera en janvier 1916 sur Thessalonique, va alors former le<br />
noyau de l'Armée Alliée d'Orient. Le 12 octobre 1915, sont débarquées à Salonique les deux premières divisions françaises et une division anglaise, sous le<br />
commandement du Général Sarrail pour porter secours à l'armée serbe.<br />
L'approvisionnement de ce corps expéditionnaire, devenu L’Armée d’Orient, n'est pas sans rencontrer de problèmes.Au travers d'une chaîne logistique lente<br />
et complexe, il faut importer de France du matériel pour Salonique, dans un contexte politique devenu plus que difficile, (batailles de Verdun, de la Somme, du<br />
Chemin des Dames). La route à travers la Méditerranée jusqu'à Salonique, n'est pas non plus dénuée de risques, le voyage d'une durée d'environ 8 jours se<br />
déroulant le plus souvent sous la menace omniprésente des mines et des sous-marins.<br />
Sur le front, les conditions de vie sont incroyablement pénibles. La chaleur de l'été est insupportable, et le froid de l'hiver plonge les hommes dans une<br />
profonde souffrance morale et physique. Les ravitaillements sont irréguliers, et le matériel s'avère inadapté pour ce genre de région. Les hommes meurent non<br />
seulement de froid, mais de maladie également. Le paludisme s'installe, la plupart des soldats sont contaminés.<br />
Prés de six cent mille hommes, dont trois cent mille français sont engagés, Après l’armistice l'armée alliée doit prendre position sur le front sud de la Russie<br />
en Roumanie, contre les bolcheviks. Son rapatriement ne débutera que fin mars 1919, et ne s’achèvera qu’en Août, 10 mois après l'armistice du 11 novembre 1918. 70<br />
000 soldats français ne rentreront jamais.<br />
Le torpillage du transport de troupes “Amiral Magon” en route pour Salonique en Janvier 1917 a eu comme témoin Célestin Gicquel qui en a fait un récit<br />
destiné m’a-t-on dit à être lu pendant les messes pour faire partager aux vertaviens les souffrances endurées par leurs combattants, soldats et marins.<br />
“ A bord de l’Arc – le 26 Janvier 1917<br />
Notre nouvelle campagne est mouvementée pour son début; j’espère que cela se calmera petit à petit. Mercredi dernier de grand matin, nous avons pris au<br />
large de Malte un convoi de 2 bateaux chargés de troupes, de chevaux et de matériel. Toute la journée de mercredi et la matinée du Jeudi cela s’est bien passé;<br />
nous étions, comme de coutume, en route devant les bateaux à environ 800 mètres; nous nous mettions à table quand un coup de sifflet parti de l’un des cargos nous<br />
a tout fait laisser; en hâte nous sommes montés sur le pont nous doutant bien de ce qui arrivait: un sous marin était là. En effet à peine arrivé sur le pont je vis<br />
l’explosion à babord arrière de “L’Amiral Magon”; le bateau s’enfonçait lentement pendant que nous courions dans la direction d’où était venue la torpille. Pendant ce<br />
temps on signalait à “La Pampa” qui était derrière de continuer sa route. Tout cela a pris quelques minutes; “l’Amiral Magon” s’enfonçait lentement par l’arrière et un<br />
moment j’eus l’espoir qu’il pourrait flotter assez longtemps; mais à un certain moment l’eau s’engouffrant à l’arrière fit lever le nez du bateau qui se dressa<br />
verticalement pour couler rapidement debout.<br />
Tout cela entre l’explosion et l’engloutissement avait duré environ 14 minutes; entre temps 963 soldats et environ 80 hommes d’équipage de bord avaient<br />
réussi à mettre les embarcations et les radeaux à la mer; nous nous rapprochions de l’endroit où le bateau avait coulé en mettant nos embarcations à la mer; il y eut<br />
là un moment critique: nous étions stoppés avec une embarcation de chaque bord, plus guère moyen de bouger, quand à 30 ou 40 mètres de l’avant un peu par babord<br />
on vit très distinctement le périscope du sous-marin; il fut canonné mais il était trop près du bord pour qu’il fut possible de l’atteindre; malgré tout nos obus(<br />
disposés pour éclater sous l’eau) ont dû lui donner à réfléchir.<br />
Sous la menace de le voir reparaître; il a fallu organiser le sauvetage des gens, en manoeuvrant pour éviter les radeaux, les hommes accrochés à des planches;<br />
avec cela une forte houle nous gênait pour tout; l’aspect de la mer était sinistre; partout des débris, des radeaux, des hommes, des mulets. Quand nous passions
près d’un groupe; c’étaient des mains qui se tendaient vers nous avec des râles, des appels au secours. Je me souviendrai longtemps de cette journée.<br />
Mais il fallait agir promptement; le commandant fit bien les choses; on chercha d’abord à sauver les gens à l’eau, trempés complètement; un à un, deux à deux,<br />
le long du bord on les pêchait et les ramenait pendant que les embarcations allaient en prendre. Cent cinquante environ furent sauvés ainsi; les malheureux étaient<br />
dans un état lamentable, à moitié congestionnés; quelques uns sont même morts à bord.<br />
Pendant tout ce temps il fallait veiller au sous-marin qui ne se montra pas d’ailleurs. Le temps passait vite; vers trois heures de l’après midi on put s’attaquer<br />
aux radeaux les plus petits et les moins confortables; le sauvetage fut moins pénible car les hommes qui s’y trouvaient n’étaient ni trop mouillés ni trop fatigues. La<br />
T.S.F. avait fonctionnée et nous attendions du renfort en continuant le sauvetage; le pont se remplissait vite avec les gros radeaux; mais beaucoup de malheureux<br />
grelottaient; il fallut en descendre dans la chaufferie et dans la machine, pendant que sur le pont on faisait la respiration artificielle à ceux qui avaient perdu<br />
connaissance.<br />
A cinq heures du soir un torpilleur arrivait et sauvait les gens des chaloupes, installés confortablement ceux là. A 6 heures ½ (du soir) nous avons fait route<br />
pour Argostoli; rempli de survivants, il y en avait partout, sur le pont, dans les chambres. La nuit ne fut pas très mauvaise comme mer; sauf le matin où cela<br />
commençait à se gâter; nous avons été surpris en constatant que nous avions sauvé 475 personnes parmi ceux-ci le colonel et le commandant du cargo.<br />
L’autre torpilleur en avait sauvé 327; 802 sauvés sur 1040; c’est miracle qu’il n’y ait que 240 disparus avec le temps qu’il faisait; d’autant plus que les soldats<br />
venaient de manger quand le bateau a été torpillé; s’il avait fait beau; nous en aurions peut être sauvé davantage. Mais chacun a fait ce qu’il a pu: des matelots se<br />
sont jetés de nombreuses fois à l’eau avec une corde pour amener le long du bord des hommes qui n’en pouvaient plus sur les planches. Heureusement que nous<br />
étions là, car le nombre actuel des victimes ne serait peut être pas celui des sauvés. Ce soir l’Amiral a témoigné officiellement par signal, sa satisfaction à “L’Arc”;<br />
mais ce qui nous a le plus fait plaisir ce sont les remerciements bien sincères ceux-là des gens que nous avions sauvés.<br />
Célestin Gicquel ”<br />
Les soldats de cette Armée d’Orient appartenaient à des régiments d’Infanterie Coloniale, dont beaucoup recrutaient dans l’Ouest de la France. J’ai enfin<br />
compris pourquoi on rencontrait autant de traces de soldats morts réputés à “Salonique” dans nos cimetières et dans nos généalogies. En fait ils n’étaient pas<br />
morts à Salonique, mais quelque part sur ce long front d’Orient qui allait de la Serbie à la Roumanie. C’était le cas de Pierre Le Tilly un jeune frère de Ernest Le<br />
Tilly, tué quelque part en Serbie à 19 ans,et d’un cousin Fruneau mort aussi là-bas des suites d’une méningite à 24 ans. ( J’ai appris à cette occasion que les fiches de<br />
tous les soldats morts pour la France sont disponibles sur Internet, sauf de ceux morts de maladie pour lesquels il faut écrire pour obtenir la fiche) .
Contre-Torpilleur “Arc”<br />
Maquette de “La Bombarde” - Contre-Torpilleur
# La filière des navigateurs vertaviens<br />
Fiches de décès de Pierre Le Tilly et de Georges Fruneau morts “ à Salonique”<br />
A travers ces exemples, et en s’aidant des généalogies on voit se dessiner en filigrane de ces carrières de marins une trame commune : au départ de la filière<br />
maritime il existe toujours soit gabarier soit un charpentier de navire, suivi à la génération suivante par un Marin, puis par un Maître au cabotage, puis encore à la<br />
suivante par un Capitaine au Long Cours officier de voilier ou par un Officier supérieur de la Marine marchande ou nationale, pont ou machine. Je montrerai plus loin<br />
que l’apparition des marins à Vertou à la fin du 18 ème ne devait rien à la génération spontanée, mais contrairement à ce que je pensais, qu’elle était prédéterminée<br />
pour des raisons bien précises. Mais pour les connaître il faudra faire un long détour par Trentemoult.<br />
* * *
# Bricks et 3-Mâts de charge<br />
Le grand public ne connaît pas l'histoire de nos marins. Mais il connaît l’existence des grands voiliers marchands " médiatisés " par les rassemblements<br />
répétés de voiliers à Brest, Rouen ou Bordeaux. Pendant les deux siècles d’exercice du métier de marin par les navigateurs vertaviens les navires ont évolué.<br />
Toutefois le navire emblématique de la marine à voile nantaise du XIXème reste incontestablement le brick le voilier marchand typique du cabotage européen<br />
mais également utilisé aussi pour les “expéditions” au long cours.<br />
Par définition le brick (ou brig) désigne un voilier à deux mâts à voiles carrés car pour la marine à voiles on parle de trois-mâts mais jamais de deux-<br />
mâts. Le Larousse 1900 donne la définition suivante du brick : " navire à voiles, à deux mâts carrés et gréant cacatoès et bonnettes ... Les bricks sont des<br />
navires de petit tonnage, portant une mâture et une voilure considérables pour leur taille. Les bricks proprement dit ont deux mâts carrés complets, trois<br />
focs et une brigantine. Le grand mât est souvent incliné sur l'arrière, la grand'voile carrée est enverguée à poste fixe. Leur tonnage très variable dépasse<br />
rarement 300 tonnes. Quand la voilure est moins forte que celle des bricks, et que le grand mât n'est pas carré, le bâtiment s'appelle brick-goélette. Dans ce<br />
cas il ne porte au mât de l'arrière que la brigantine et une voile de flèche, rarement une voile carrée de fortune ; ce mât s'appelle alors mât barque."<br />
Le brick avait plusieurs avantages. Voilé et rapide tout en restant manœuvrier il pouvait être servi par un équipage réduit d’une dizaine de marins. Son<br />
faible tirant d’eau lui permettait de se faufiler dans les estuaires, les rivières et les rades foraines peu profondes. Au début du XIXème le Port de Nantes<br />
qui était envahi par les sables ne pouvait pas recevoir de navires de plus de 300 Tx. Quand arrivait l’été il ne restait plus au quai de la Fosse que 6 pieds de<br />
hauteur d’eau et les grands navires étaient obligés de s'alléger en rade de Paimbeuf à l’entrée de l’estuaire de la Loire et de faire remonter leur cargaison<br />
sur Nantes sur allèges. Cette rade devait être très utilisée car au cours de la grande tempête du 30 Décembre 1705 40 navires y disparurent.<br />
Le Dictionnaire de la Marine à voiles publié en 1857 confirme les raisons du succès de ce voilier à tout faire de la marine à voile du XIXème : “ Le<br />
commerce équipe des brigs qui portent jusqu’à 300 tonneaux. Ces navires exigeraient un gréement plus cher et probablement navigueraient moins bien s’ils<br />
étaient gréés en trois mâts. Toutefois leurs voiles sont un peu grandes pour être manoeuvrées facilement de gros temps par un faible équipage “.<br />
Les bricks étaient pour les mêmes raisons très appréciés par les marines militaires. Leur taille moyenne présentait d’autres avantages pour leur<br />
construction. Plus un navire est grand plus il nécessite l’emploi de grandes pièces de bois massives. Or au-delà d’une certaine taille de navire il était difficile,<br />
voire impossible de se procurer les pièces de bois qui étaient “préemptées“ par les arsenaux pour la construction des navires militaires.<br />
Les dimensions moyennes de ces bricks étaient en moyenne les suivantes : une longueur de 20-25 mètres, une largeur de 6-7m, un creux de 4-5 m. Ils<br />
jaugeaient en moyenne 150 tonneaux. Ce qui représente le volume de 8 de nos gros camions d'aujourd'hui. Le mât avait une hauteur de 20-25 m et la voilure<br />
développait une surface de 300-400 m2. De nombreux bricks ont été immortalisés par les peintres de marine de l’époque invités par leurs armateurs et<br />
capitaines à les peindre dans leurs plus belles allures.<br />
Par exemple le Brick “Le Georges“ de Jean Bureau avait les caractéristiques suivantes :<br />
Longueur = 24,14 Largeur = 6,70 ; Creux = 3,51 ; Jauge = 138 Tx<br />
Doublage zinc - Arrière rectangulaire<br />
Construit à Chantenay en 1848<br />
Revendu en 1868 à Nephtalie Pabois de Norkiouse (Rezé)<br />
Perdu corps et biens en 1877 au large de la Norvège
Les plus grands des bricks étaient prévus dès leur construction pour pouvoir être gréés en Trois-mâts si nécessaire. Ce fut le cas du brick “Phoebus“<br />
de Pierre Bureau qui naviguait au long-cours dans l’océan Indien gréé en 3-mâts. Dans ce cas le brick devenait un Trois-mâts. Plusieurs bricks sont restés<br />
célèbres. Comme le “Supply” qui a transporté en 1823 les premiers colons australiens. Ou le “Pilgrim” célébrissime aux Etats-Unis par le récit très populaire<br />
là-bas de Robert Henri Dana. Ce navire a fait l’objet d’une reconstitution récente. En France on peut citer le brick l'Inconstant qui a transporté au début des<br />
Cent Jours Napoléon et sa troupe d'opérette de l'île d'Elbe à Golfe-Juan.<br />
Brick Le Phoebus – Capitaine Armateur Pierre Bureau
# Trois-Mâts de charge<br />
3M Barque Belem – Capitaine Julien Chauvelon<br />
Trois-mâts “Belem” – Capitaine Julien Chauvelon<br />
Les 3-mâts ont les mêmes rapports de forme que les bricks et sont comme eux des navires de charge destinés au transport de marchandises, mais ils<br />
sont en moyenne 2 à 3 fois plus gros que les bricks. A part la voilure, l’architecture, les formes, les détails de construction et les rapports de formes sont<br />
identiques pour les bricks et les 3-mâts. Plus un navire à voile est volumineux, plus sa surface de voilure est importante et plus il faut la diviser en un plus<br />
grand nombre de voiles de façon à ce que chacune des voiles reste manoeuvrable. C’est donc la dimension du navire et les conditions de navigation qui<br />
déterminent l’adoption du gréement à deux ou à trois mâts. C’est pour cela que les grands voiliers cap horniers auront souvent quatre, et parfois même cinq<br />
mâts, et que le nombre de voiles portées par un même mât sera multiplié.
# Autres voiliers de charge<br />
Selon le type de trafic pour lequel ils sont utilisés les voiliers de marche sont de dimensions et d'architecture variable. En dessous du brick on trouvait<br />
le brick-goélette, dont le mât arrière est un mât barque (c’est-à-dire sans voiles carrées). Puis la goélette dont les deux mâts sont gréés en barque. Puis le<br />
chasse-marée ou le lougre. Le chasse-marée est un voilier typique de Bretagne Sud, identique à la bisquine de Cancale, dont un exemplaire a été récemment<br />
reconstitué.<br />
La définition du chasse-marée du Larousse 1900 est la suivante: “ Le chasse-marée sert à la pêche et au petit cabotage. Il est gréé d’ordinaire avec<br />
trois mâts portant des voiles à bourcet, grand mât, mât de misaine, tapecul et un foc. Il a rarement des voiles carrées mais presque toujours une voile<br />
supplémentaire à bourcet, hissée au-dessus de la grand’voile appelée taillevent.”<br />
Le lougre ressemble au Chasse-marée, mais il est légèrement moins gros et moins voilé.<br />
# Voiliers de marche - Clippers<br />
Brick Goëlette Clarisse – Cap Lancelot (avec le fanion de Nantes) Chasse-Marée<br />
Vers 1850 apparaît un nouveau type de voilier, le clipper destiné à transporter le plus rapidement possible des marchandises nobles (thé, café, or), du<br />
courrier et surtout des passagers. On parle alors de “voilier de marche“ par opposition au “voilier de charge“. L’architecture et les conditions d'exploitation
de ces navires de marche sont très différentes de celle des navires de charge précédents.<br />
Plusieurs événements ont justifié leur apparition notamment l’ouverture commerciale de la Chine en 1842 et le début du peuplement de la Californie<br />
déclenché par la ruée vers l’or qui commence en 1849 alors que la traversée en chemin de fer d’Est en Ouest n’est toujours pas assurée.<br />
Architectes, constructeurs et équipages vont alors accomplir des prouesses. Le “Flying Cloud” par exemple accomplit le voyage New York-San Francisco<br />
en 97 jours et son fret rembourse son coût de 275000 $ en un seul voyage. En 1866 une quinzaine de clippers s’alignent pour une course de 15000 milles<br />
entre Hong Kong et Londres au terme de laquelle quinze minutes seulement séparent les deux premiers le “Taeping” et “L’Ariel”. Construits en bois ils<br />
disparaîtront tous sauf le célébrissime “Cutty Sark” miraculeusement sauvegardé.<br />
Comparés aux 3-mâts de charge, les clippers de marche ont des lignes allongées et affinées, un rapport longueur/largeur supérieur, des formes avant<br />
plus fines, des mâts plus hauts, des performances de vitesse surprenantes allant jusqu'à 15-20 noeuds. La compétition entre les architectes navals, les<br />
chantiers et les armateurs est féroce, chacun cherchant à découvrir les formes optimales pour obtenir les meilleures performances. La presse et le grand<br />
public américains et anglais se passionnent pour les défis lancés par les capitaines et les armateurs. Les exigences de ce nouveau besoin de transport et<br />
l'émulation des armateurs en concurrence vont encore faire accomplir un bond considérable aux techniques de la marine à voiles. C’est à cette époque que les<br />
chantiers se lancent dans les premières coques mixtes dont la structure est métallique et le bordé en bois. Progressivement on passera aux coques<br />
totalement métalliques<br />
C’est avec les clippers que les voiliers à coque bois atteignent un sommet de perfection inégalée par leurs performances, leur beauté et leur luxe. Ce<br />
sera le bouquet final des architectes et des charpentiers de navires à voile qui atteignent alors le sommet d'un art multimillénaire, fruit de plusieurs milliers<br />
d’années d'incessants perfectionnements pour réussir à construire uniquement avec du bois, des cordages de chanvre et des voiles de toile ces<br />
impressionnantes “cathédrales“, qui sont les engins les plus grands, les plus lourds, les plus complexes de tous ceux imaginés, construits et manoeuvrés par<br />
l’homme ! Cela reste encore vrai aujourd’hui.<br />
Les constructeurs et navigateurs nantais ont participé à l’aventure des clippers de façon quelque peu lointaine. D'une manière générale la France est<br />
absente de ce grand mouvement de redéploiement du monde vers l’Amérique du Nord et le Pacifique (Californie, Australie, Nouvelle Zélande) qui restera une<br />
aventure essentiellement anglo-saxonne. Et ce n’est plus à Nantes, mais au Havre un port en eau profonde à la porte de la riche agglomération parisienne que<br />
l’on voit alors s'activer les armateurs, les marins et les constructeurs des plus beaux clippers français. (Voir bibliographie)<br />
# Navires cap horniers<br />
Contrairement aux clippers à qui on confiait des marchandises nobles et notamment des passagers, les cap horniers sont des navires de charge dédiés<br />
le plus souvent à des marchandises pondéreuses pauvres. L’une de leur utilisation consistait à mettre en place des dépôts de charbon … de façon à mieux<br />
déployer la flotte des navires à vapeur qui allaient les tuer ! Ou transporter les énormes quantités de traverses de bois nécessaires pour la construction des<br />
voies des chemins de fer concurrents. Ou à transporter les premiers bidons de l’industrie pétrolière naissante. Initialement ils transportaient du charbon<br />
anglais vers la côte Pacifique Sud, à Valparaiso, de façon à créer des dépôts pour les lignes de vapeur Atlantique-Pacifique. Pour ne pas revenir lège ils<br />
remontaient du Chili avec du guano. Leur vie sera éphémère, pendant la courte période où les navires à vapeur auront encore à faire la preuve de leur fiabilité<br />
et de leur rentabilité.<br />
Comme les grands dinosaures ces grands voiliers vont mourir au moment où ils atteignent des dimensions déraisonnables à l’exemple du<br />
Preussen construit en 1902 : 11000 T de port en lourd, 147 mètres de long, 16,4 m de large, 46 voiles totalisant 5500 m2 de superficie, 330 m2 pour les plus<br />
grandes qui pèsent 650 kg. Le grand mât a une hauteur de 68 m et sa circonférence au pont est de 2,83 m. Il faut 48 hommes d’équipage pour tenter de
maîtriser – tant bien que mal – cette cathédrale d’acier et de toile de dimension surhumaine qui peut filer à 18 nœuds, aussi vite qu’un cargo moderne.<br />
Ces grands voiliers sont très difficiles à manœuvrer, et plusieurs iront se fracasser ou s'échouer sur les écueils. A ceci s'ajoute le fait que<br />
transportant des pondéreux le risque de désarrimage de la cargaison est élevé. Pour des raisons évidentes de manoeuvrabilité leur voilure sera démultipliée<br />
en augmentant le nombre de mâts, et en augmentant le nombre de voiles pour chaque mât, jusqu'à six pour un 4-mâts barque typique de cette marine à voiles.<br />
Les cap-horniers seront construits à une époque tardive, entre 1900 et 1910 pour la majorité d'entre eux et auront tous une coque métallique, ainsi<br />
qu'une partie de leur mâture et de leur gréement. L’âge d'or de la marine en bois est définitivement terminé.<br />
# Maîtres au Cabotage et Capitaines au Long Cours<br />
Les navires de mer étaient commandés, on pourrait dire dirigés, par un capitaine qui devait disposer d'une solide formation pratique, sanctionnée par<br />
un diplôme soit de Capitaine au Long Cours, soit de Maître au cabotage. Ce diplôme était nécessaire mais pas suffisant pour pouvoir commander. Hier comme<br />
aujourd'hui les titulaires d'un diplôme de Capitaine n'obtenaient pas tous un commandement. Fallait-il trouver un armateur qui accepte de leur confier son<br />
navire ! Ils pouvaient être contraints de rester longtemps second ou troisième capitaine.<br />
Un Maître au Cabotage n'était pas habilité à conduire son navire en dehors des mers considérées comme européennes : Manche, Mer du Nord,<br />
Baltique et Méditerranée. On distinguait le petit cabotage où le navire restait dans la même mer en longeant les côtes, “de cap en cap “ et le grand cabotage<br />
où le navire pouvait naviguer sur toutes les mers d'Europe de St Petersbourg à Athènes en passant par Alger. Parfois le navire pouvait passer du grand<br />
cabotage au cabotage transatlantique pour aller toucher les îles d'Amérique : Terre-neuve, St Domingue, Cuba, les Antilles. Seuls les capitaines au Long Cours<br />
étaient habilités à commander un navire sur toutes les mers du globe. En pratique les navires utilisés pour le long cours et le cabotage étaient souvent les<br />
mêmes. La formation théorique de capitaine au Long Cours impliquait la maîtrise de la navigation astronomique, technique encore toute récente, ce qui<br />
nécessitait des études longues et difficiles.<br />
A Vertou comme à Trentemoult il y avait au début du XIXème beaucoup plus de maîtres au cabotage que de capitaines au long cours. Ce qui confirme<br />
bien le rôle prépondérant des transports intra-européens dans l'activité maritime de la flotte nantaise. Cette prééminence diminuera progressivement au fil<br />
des années.<br />
# Capitaines et Commandants<br />
Le moment est venu d'aborder un sujet délicat : quelle différence y a-t-il entre un Capitaine et un Commandant ? La réponse n'est pas simple, même<br />
pour un marin, en raison de l'infinie variété de navires et de situations pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour de simple raisons sémantiques : le<br />
substantif Commandant peut se décliner en verbe (il commande) et en adjectif (commandé) contrairement à Capitaine, ce qui donne ce genre de phrase : "L’an<br />
1904, le 7 octobre, devant nous a comparu le sieur B. Codet, capitaine, commandant le trois-mâts "Le Carbet", lequel a déclaré ce qui suit...". I<br />
1 - De façon générale, le terme de Capitaine est plutôt en usage dans la marine marchande et celui de Commandant plutôt dans la marine militaire :<br />
Mais Capitaine est aussi le terme juridique utilisé en droit maritime pour désigner le responsable d’un navire, quel que soit son diplôme ou ses<br />
qualifications et quelle que soit la taille ou la fonction du navire.<br />
Il se réfère également au diplôme acquis par les marins qui atteste en premier lieu de leur aptitude à effectuer le quart en chef sur un navire donné<br />
dans des conditions de navigation définies puis à en exercer le commandement, selon le choix de l'armateur : capitaine au long cours ou maître au cabotage<br />
(ou aussi patron) devenu capitaine de la marine marchande sur les navires à propulsion mécanique. Il convient de souligner que, dans la marine marchande, une
fois que l'on a été nommé à un commandement on exerce normalement cette fonction, sur diverses unités, jusqu'à l'âge de la retraite.<br />
Par ailleurs Capitaine était le titre (usage de politesse) utilisé pour désigner au XIXème un Maître au cabotage expérimenté.<br />
Dans la marine militaire le terme de Capitaine sert pour désigner des grades : Capitaine de Corvette (CC) , 4 galons, équivalent à commandant dans<br />
l’armée de terre; Capitaine de Frégate (CC) , 5 galons panachés, équivalent à lieutenant-colonel ; Capitaine de Vaisseau (CV) équivalent à colonel, 5 galons<br />
pleins. C’est également le titre utilisé pour désigner un Lieutenant de Vaisseau, 3 galons, équivalent à capitaine dans l'armée de terre.<br />
2 - Dans la marine militaire le terme de Commandant désigne en règle générale l'officier qui commande un bâtiment ou un groupe de bâtiments quel que<br />
soit son grade. Tout officier nommé à un commandement est ipso facto appelé "Commandant" pendant la durée de son commandement. Les aptitudes au quart<br />
en chef puis au commandement à la mer sont sanctionnées par l'obtention du diplôme de sortie de l'Ecole Navale ou celui de l'école de manoeuvre et des<br />
chefs de quart. La nomination à un commandement d'unité navale est possible à tout grade, jusqu'à celui de Capitaine de Vaisseau inclus, sur décision du<br />
Ministre de la Défense et elle est officialisée par une lettre de commandement.<br />
Les officiers de marine militaire peuvent, après avoir exercé le commandement d'une unité, être nommé commandant en second d'une unité plus<br />
importante ou exercer des fonctions d'état-major ou d'instruction en école ou à caractère technique ou diplomatique.<br />
Commandant est également le titre de politesse utilisé pour désigner les officiers supérieurs CC, CF et CV qu'ils exercent ou non un commandement.<br />
Dans la marine marchande le terme de Commandant s’applique aux Capitaines au Long Cours qui commandent des navires à passagers, paquebots ou<br />
transbordeurs. C’est aussi le titre utilisé pour désigner un Capitaine au long cours expérimenté (et donc connu pour avoir commandé des navires marchands<br />
importants). Exemple : "Le Cdt Codet a rencontré le Cdt Bessac".<br />
# Tramping et ligne régulière<br />
Il existait à cette époque comme aujourd’hui deux types de transports maritimes : la ligne régulière qui dessert régulièrement deux régions maritimes<br />
du globe et le tramping qui navigue à la demande (tramp=vagabond). C'est la même différence qui existe entre un taxi qui "maraude" pour charger des clients<br />
pour un trajet à la demande du client et l'autobus qui tourne régulièrement sur le même trajet selon un horaire pré-établi qu'il y ait on non des passagers à<br />
charger. Les lignes régulières chargent en général une multitude de produits plutôt nobles en petite quantité alors que les tramps chargent plutôt des<br />
cargaisons complètes d'une même marchandise plutôt pauvre comme le ciment, les engrais, les ferrailles.<br />
La correspondance commerciale de Jean Bureau montre clairement qu'il pratique uniquement le tramping sans aucune régularité de trajet : un jour à<br />
Newcastle, un autre à Naples, à Oslo ou … à La Havane. Pour des cargaisons complètes de charbon, de bois ou de noir animal, de sucre. Les cargaisons et les<br />
trajets sont entièrement tributaires de la loi de l'offre et de la demande. Tout au long de leur vie professionnelle nos capitaines au cabotage vivaient dans<br />
l’angoisse de la recherche du fret à trouver après chaque déchargement : quel fret, quel taux, quelle destination, quel prochain voyage ? Joint aux<br />
incertitudes de la météo ils ne pouvaient jamais prévoir à l’avance combien de temps il leur faudrait pour effectuer une traversée, décharger leur cargaison,<br />
négocier un nouveau fret, le recharger. Quant aux marins qui en savaient encore moins que leur Capitaine, toutes ces incertitudes alimentaient<br />
obsessionnellement leurs conversations de bord.<br />
Nous l’avons dit et répété, la grande spécialité de la marine à voile nantaise a toujours été le cabotage de tramping. Il n’est donc pas possible d’évaluer<br />
son poids économique à partir des seules statistiques douanières du Port de Nantes qui n’enregistrent évidemment pas les transports effectués au loin par<br />
des navires et des équipages nantais. Comme aujourd’hui les statistiques du port du Pirée qui ne reflètent évidemment pas la prépondérance mondiale de la<br />
flotte pétrolière des armateurs grecs. Ce qui entre autres conséquences fausse totalement l'estimation de la part relative du trafic négrier dans l'activité
de la flotte nantaise du XVIIIème.<br />
# Cabotage transatlantique<br />
Les Maîtres au cabotage n’étaient pas habilités à commander leur navire pour voyager outremer sauf à la condition d’embarquer à bord un Capitaine au<br />
Long Cours (et les précieux chronomètres indispensables pour la navigation astronomique !) désigné alors comme “ porteur d’expédition“. Ce qui n’était pas<br />
sans poser de nombreux problèmes aux Maîtres relativement à leur responsabilité, à leur rentabilité, à leur prééminence surtout quand le Maître au<br />
cabotage était en outre son propre armateur du navire, et avait donc à ce titre une autorité supérieure à celle du porteur d'expédition. C’est de toute<br />
évidence une solution qui ne plaît pas du tout à Jean Bureau, sauf lorsqu’il peut utiliser les services de ses frères Pierre et Auguste tous deux Capitaines au<br />
Long Cours.<br />
Cette navigation outremer présentait un inconvénient supplémentaire. Les navires qui partaient charger du sucre à Cuba ou St Domingue, et donc sans<br />
fret aller, étaient contraints de charger du lest car les navires à voiles peuvent difficilement naviguer à vide pour des raisons évidentes de stabilité. Ce lest<br />
constitué de petits ou gros pavés de granit devait être déchargé au port de rechargement. Aujourd’hui encore les rues de La Havane et de Santiago de Cuba<br />
sont toujours pavées avec le lest de nos navires à voiles! Avant de partir pour les Antilles, Jean Bureau en capitaine avisé décide de charger à Paimboeuf un<br />
lot de pommes de terres, en paniers. Mais le voyage va durer 42 jours, autant que le premier voyage transatlantique de Christophe Colomb. Les tubercules se<br />
mettent à germer et l’équipage doit sortir un à un les paniers sur le pont à tour pour leur faire prendre l'air et la lumière.<br />
Les navires marchands se chargeaient également de tout un bazar de produits divers destinés aux colons des territoires lointains privés de tout. RH<br />
Dana le raconte bien dans son livre. On voit aussi notre Jean Bureau charger des dragées à Nantes en espérant les revendre au prix fort aux Antilles ou à<br />
Cuba, mais sans succès, ratage qui lui causera beaucoup de frustrations car je crois bien qu'il a dû les ramener en France.<br />
On ne chargeait pas là-bas que des denrées tropicales. Il y avait aussi le réputé bois des îles avec lesquels on fabriquait dans la région nantaise ces<br />
réputés meubles de port en acajou ou palissandre. La manutention des lourdes billes de bois sur des rades foraines avec des moyens de manutention<br />
rudimentaires était très dangereuse pour le personnel et le navire. Jean Bureau prenait bien soin avant de partir pour St Domingue de souscrire une coûteuse<br />
surprime d’assurances. Ce cabotage transatlantique n’était donc pas à la portée du premier Maître au cabotage venu et ne pouvait être réservé qu’à des<br />
capitaines avisés et expérimentés.<br />
# La flotte nantaise au XIXème<br />
Les Archives Départementales de Loire Atlantique (ADLA pour les intimes) détiennent les dossiers des navires immatriculés à Nantes au XVIIIème.<br />
Les usagers peuvent consulter la liste des navires répertoriés classés par ordre alphabétique. L’exploitation de cette liste donne les résultats synthétiques<br />
du tableau précédent. La comparaison entre la flotte du XIXème avec celle du XVIIIème établie par l'Amirauté de Nantes pour recenser les navires sortis<br />
des chantiers navals nantais de 1762 à 1787 est instructive. On est surpris au premier abord de constater que le nombre de mises en service est quasi<br />
identique dans les deux cas. Malgré ces apparences la capacité de transport de la flotte nantaise du XIXème était bien largement supérieure à celle du<br />
XVIIIème, quand on prend en compte les facteurs suivants : 1-une grande partie des navires construits au XVIIIème étaient destinés à la marine militaire;<br />
2-la durée moyenne de vie des navires marchands construits du XVIIIème était beaucoup plus courte, décimés par les tarets, les captures de la marine<br />
anglaise et les corsaires; 3-tenant moins bien la mer ils subissaient plus fréquemment les mauvaises fortunes de mer; 4-plus lourds et beaucoup moins rapides<br />
leur capacité de transport annuelle était bien inférieure que leurs successeurs du XIXème qui bénéficiaient de nombreux progrès. En un mot la productivité<br />
du transport maritime par navires à voiles a fait un bond considérable en quelques décennies.
Par ailleurs j’ai lu quelque part que en 1868 600 navires étaient armés à Nantes, représentant un tonnage total de 1 200 000 T soit un tonnage moyen<br />
de 200T typique de celui d’un gros brick. Ces chiffres sont confirmés par une analyse précise de la flotte nantaise réalisée pour l’année 1847 à l’aide d’un<br />
“Annuaire de Nantes et du département de l’année 1847”, un document possédé par l’AGV (Association de Généalogie de Vertou). Pour ce qui nous intéresse<br />
cet annuaire donne la liste des négociants, des armateurs, des assureurs maritimes, des chantiers de construction navale du port, des 270 Capitaines au Long<br />
Cours habitant Nantes … et des 280 “Bâtiments expédiés au long cours pour le Port de Nantes”, avec pour chaque navire son type, son tonnage et son<br />
armateur.<br />
En analysant cette liste de navires et en la rapprochant de celle de l’ ADLA pour la même année on peut tirer plusieurs enseignements. La comparaison<br />
des deux listes montre que 130 de ces 280 navires n’ont pas de dossier aux ADLA. Ou bien ces navires n’ont pas été immatriculés à Nantes ou bien leurs<br />
dossiers sont manquants ! (la principale raison de cette absence serait la suivante : lorsque un navire est vendu hors de Nantes, son dossier est muté dans le<br />
nouveau port d’immatriculation).<br />
En combinant la liste de l’Annuaire et celle des ADLA on peut établir la liste nominative des 530 navires “nantais”. Ce nombre doit être majoré pour<br />
tenir compte des navires de cabotage immatriculés ailleurs ou dont les dossiers manquants. On arrive ainsi à un nombre de “grands” navires de l’ordre de 600.<br />
Cette liste de navires au long cours ignore par définition les navires utilisés au cabotage, petits navires pour le cabotage national et navires moyens<br />
pour le cabotage international. Le tableau suivant est le résultat de l’analyse de la flotte immatriculée à Nantes et donc ayant un dossier aux ADLA. Il montre<br />
que sur l’ensemble du XIXème la proportion des 3-mâts n’est de 25%. Presque tous les autres navires, moyens, petits ou très petits étaient donc employés<br />
pour le cabotage, pour lesquels le Capitaine devait être titulaire d’un brevet de Maître au Cabotage. On comprend ainsi pourquoi il y en avait un si grand<br />
nombre à Nantes et autour de Nantes, spécialement à Trentemoult, Vertou et Indre.<br />
De la même manière la liste des Cap au Long Cours donnée dans l’annuaire nantais de 1847 ne comprend pas les nombreux Maîtres au Cabotage de la<br />
Sévre et de l’estuaire de la Loire. Nos histoires familiales permettent d’en identifier beaucoup, on pourrait aussi les compter à partir des fascicules<br />
matricules de l’Inscription maritime. Vincent Bugeaud, un historien-chercheur qui connaît particulièrement bien ces populations a retrouvé un document qui<br />
liste nominativement les 115 Maîtres au Cabotage de Trentemoult, lesquels ont créé en 1851 une société mutuelle d’assurance maritime. On dispose ainsi de<br />
270 + 115 = 385 noms de capitaines nantais en plein milieu du XIXème. A ce nombre il faudrait ajouter une bonne centaine de noms de capitaines issus de<br />
Vertou, d’Indre, de Bouguenais, du Pellerin, de Brière. Soit une estimation de 500 capitaines, un nombre homogène avec celui du nombre de navires.<br />
Pour avoir une idée complète de la population maritime de Nantes il faudrait prendre en compte également les capitaines des régions côtières du<br />
département (Pays de Retz, Brière, Pays blanc, …).
FLOTTE NANTAISE LANCEE ENTRE 1800 <strong>ET</strong> 1900 (Source : ADLA-Sous-série 3P-Douanes.)<br />
TABLEAU 1 - REPARTITION PAR TYPE <strong>ET</strong> PERIO<strong>DE</strong><br />
NAVIRES TYPE<br />
PERIO<strong>DE</strong> Bateau à vapeur<br />
Bisquine<br />
Brick<br />
Brick goélette<br />
Le Cdt Jean Lacroix, originaire de La Bernerie, a écrit en 1946 “ Les derniers voiliers caboteurs”… le seul livre consacré au cabotage à voiles. Il y<br />
raconte les cinquante dernières années d'activité des voiliers caboteurs – de 1900 à 1950. Il donne une quantité d’informations sur les navires, les bricks en<br />
particulier, les trafics, les ports etc. Il confirme que Nantes était bien à la fin du XIXème le premier port français pour le cabotage à voiles. Jean Lacroix y<br />
publie la liste d’une centaine de navires caboteurs inscrits à Nantes en 1892, construits pour la majorité d'entre eux après 1870. On peut estimer que 20%<br />
de ces caboteurs étaient armés par leur capitaine.<br />
Chasse-marée<br />
Dogre<br />
Dundee<br />
Goélette<br />
Lougre<br />
Trois-mâts<br />
Trois-mâts barque<br />
Trois-mâts goélette<br />
Total<br />
1800-1825 1 20 60 5 2 8 17 113<br />
1825-1850 12 6 174 19 88 22 54 126 126 3 630<br />
1850-1875 35 10 144 79 7 1 1 200 109 298 28 7 919<br />
1875-1900 106 2 23 21 1 5 41 17 96 16 1 329<br />
Total 154 18 361 119 155 29 6 297 260 537 47 8 1991<br />
Grands navires 361 537 47 8 953<br />
Observations :<br />
- 2000 Navires en un siècle,soit 20 en moyenne par an<br />
- 75 % de ce nombre est lancé de 1825 à 1875<br />
- les grands navires représent la moitié de la flotte<br />
- on constate des évolutions techniques entre les périodes 2 et 3 :<br />
- plus de 3-mâts, de goélettes, de bricks goélettes, de lougres, moins de chasse-marées<br />
- etc
.Chaque navire représentait une bonne douzaine d’emplois directs et indirects. Les trente capitaines vertaviens employaient donc environ 400<br />
personnes faisant vivre une communauté d’un ou deux milliers d’habitants, ce qui représente à peu près la population des villages du Chêne et de la Barbinière<br />
et de quelques autres villages “maritimes” de la commune (la Chaussée, le Bourg, l’Angebardière, Portillon). C’est peut-être 20 % de la population de Vertou<br />
qui vivait de l’activité “maritime“ avec des revenus – et une éducation - bien supérieurs. On peut donc penser qu'au XIXème, le poids économique des<br />
navigateurs vertaviens était important.<br />
# La construction navale<br />
Pour accompagner les importants besoins de transport maritime de la période de l’âge d’or il a fallu construire en quelques années plusieurs centaines<br />
de navires à voiles de toute formes et dimensions ainsi que des gabarres et des allèges. La construction navale était prospère et même à Vertou on a<br />
construit quelques navires de mer, dont un 3-mâts (ref Mme Simone Bouteiller – bibliographie).<br />
Dans cette étude comme dans le livre du Cdt Lacroix consacré aux “ derniers voiliers caboteurs “ c’est le nom de Paul Doussain qui est le plus souvent<br />
cité. Un premier Paul Doussain (1820- ?) domicilié à l’Herbray a épousé une Pélagie Lefeuvre, union d’où naîtra Paul Doussain, né en 1848 qui épouse en 1872<br />
Marie Reine Baudy, cousine germaine de mon grand-père maternel. Dans une correspondance datée de 1857 on apprend par exemple que le “cousin Perthuy “,<br />
capitaine au Cabotage vient de passer commande d’un brick de 150 tonneaux à Paul Doussain.<br />
On se rend aisément compte que la construction navale exigeait des compétences théoriques et pratiques et/ou de l’expérience, pour réaliser les<br />
plans, les calculs complexes de poids et de stabilité, les devis, les descriptifs, les indispensables épures de géométrie descriptive tout récemment inventée<br />
par Monge et ceci sans ordinateurs.<br />
Ce que résume bien le Contre-amiral Bellec : “ Un navire en route, un voilier surtout est soumis à des forces complexes, à des poussées, à des<br />
résistances …La lecture d’un plan de navire, la compréhension de ses formes ne sont pas à la portée de l’observateur banal, fut-il érudit. La géométrie<br />
descriptive dont elle relève est infiniment compliquée par un vocabulaire dont les termes ésotériques tels que bau, arcasse, galbord, râblure, bouchain, maître<br />
couple, varangue, genou, allonge ou serre bauquière, n’invente pas à pénétrer dans un chantier de construction... Constructeur, capitaine, armateur savaient<br />
tous quels avantages et inconvénients découleraient des compromis retenus pour favoriser l’emport, ou la vitesse, ou la maniabilité, ou la tenue de route aux<br />
diverses allures, ou les conditions de travail à bord. Eventuellement au détriment de la stabilité, de la résistance à la mer, de l’assiette, du tirant d’eau, du<br />
comportement dans le mauvais temps, des capacités d’échouage et de cent particularités potentielles …“<br />
On peut imaginer que tout jeunes enfants nos futurs capitaines vertaviens acquéraient en partie ce savoir-faire sur les chantiers de leurs pères,<br />
oncles ou cousins, contemplant le travail des charpentiers, leur posant mille questions, pesant le pour et le contre des options, regardant naître peu à peu la<br />
coque d'un nouveau navire, et assistant à la fête du lancement en présence du capitaine et des "intéressés". L'architecture des bateaux n'avait plus de<br />
secrets pour eux. Il leur restait malgré tout à acquérir la formation supérieure et théorique indispensable pour obtenir le diplôme tant convoité de capitaine.<br />
Il fallait donc une formation d'un certain niveau pour exercer ces métiers liés à la mer.<br />
# Des patrons de PME<br />
On ne retient aujourd'hui de cette navigation à voiles que quelques images nostalgiques de voiliers magnifiques, de cargaisons précieuses, de ports<br />
exotiques. Le quotidien de nos navigateurs était moins rose mais il exigeait de ses capitaines des qualités humaines hors du commun. . Les capitaines n'étaient<br />
pas que des "conducteurs" de navire comme le sont devenus les capitaines de navires actuels. Ce qui n’est déjà pas simple. Ils devaient être également, et
surtout, des Chefs d'entreprise accomplis au sens actuel du terme. Chaque navire était une "petite entreprise" de quelques dizaines de personnes qu'il fallait<br />
gérer au mieux : recruter, commander, former, payer, nourrir, éventuellement faire soigner. Ils devaient être aussi des commerçants rompus aux subtilités<br />
de la négociation commerciale pour recruter les meilleurs frets aux meilleures conditions. Ils devaient maîtriser un peu de langue étrangère. Ils devaient<br />
tenir la comptabilité de leurs voyages, et ceci en plusieurs devises. En fin de voyage ils devaient rendre compte de leur gestion à leur armateur ou à leurs<br />
intéressés. Ils devaient rédiger eux mêmes à la main tous les courriers correspondants. Et en prime ils avaient la lourde tâche de faire circuler au mieux les<br />
sommes importantes qu'ils encaissaient ou payaient à une époque où il n'existait pas de réseaux bancaires.<br />
Traduit en langage actuel ces capitaines avaient à la fois une responsabilité technique (la conduite du navire, la navigation, la manoeuvre), une<br />
responsabilité commerciale (recruter le fret), une responsabilité du personnel (recrutement, formation, sécurité), une responsabilité financière, une<br />
responsabilité comptable et administrative. C’est typiquement la définition des fonctions principales d'un dirigeant de PME d'aujourd'hui. Il est clair que<br />
privé de tout moyen de communication avec son armateur, c'était à lui qu'il appartenait de prendre en permanence les décisions de bonne gestion du navire,<br />
comme un Chef d’entreprise doit le faire. Qu’elles soient bonnes ou mauvaises il fallait de toute façon en rendre compte à posteriori à l'armateur et aux<br />
intéressés.<br />
Le Cdt Jean Randier leur rend le même hommage : “ Manœuvrier hors ligne et marin consommé, il fallait certes l’être , mais il fallait aussi ne jamais<br />
oublier qu’il s’agissait de gagner tous les jours de quoi payer les frais du navire – amortissement, entretien, droits et taxes, amendes éventuelles…les salaires<br />
de l’équipage, et s’il se pouvait de quoi assurer ses vieux jours. Au marin s’ajoutait un commerçant entreprenant et joueur.””<br />
Jean Bureau nous a laissé un émouvant document qui retrace ses activités de "chef d'entreprise", un grand cahier à couverture de moleskine noire où<br />
pendant douze années il a retranscrit à la main la copie des lettres adressées à son armateur, aux courtiers maritimes, aux administrations, à ses intéressés.<br />
On y trouve ses comptes de voyages et les relevés de la paie de son équipage. On peut ainsi partager pour chaque voyage les soucis d'un jeune Capitaine qui<br />
dès l'âge de 25 ans se retrouve avec la responsabilité totale d'un navire, de son équipage, de sa cargaison … et de sa rentabilité.<br />
# Capitaines armateurs<br />
Beaucoup de capitaines avaient les compétences techniques mais ils n'avaient pas forcément toutes celles qui font l'étoffe d'un patron de PME. Ils<br />
restaient alors confinés aux tâches techniques et servaient comme second capitaine. A l'inverse certains d'entre eux pouvaient aller plus loin. Dès qu'il<br />
estimaient qu'ils maîtrisaient tous les aspects de leur métier ils pouvaient devenir indépendants afin d'exploiter un navire leur appartenant. Comme<br />
aujourd'hui un cadre expérimenté qui après avoir exercé comme dirigeant salarié s'estime capable de créer son entreprise pour voler de ses propres ailes.<br />
La principale difficulté pour le capitaine, alors comme aujourd'hui, était de réunir les fonds nécessaires pour acheter ce navire qui représentait une<br />
mise de fonds importante, avec à la clé un risque non négligeable. Il sollicitait l'aide de notables et bourgeois locaux, de membres de sa famille, d'amis et/ou<br />
de collègues déjà établis comme capitaines armateurs pour leur demander de prendre un "intérêt" dans son navire. Bien entendu il fallait prendre le plus<br />
grand soin de ces fonds confiés par des actionnaires amis à qui le capitaine armateur rendait scrupuleusement des comptes. C'était du capitalisme de<br />
proximité. Il semble bien que les notaires locaux aient joué un rôle important dans le recrutement des actionnaires.<br />
Devenir capitaine armateur n'était pas à la portée de tous. Seuls les capitaines qui avaient fait leurs preuves pouvaient réunir les fonds nécessaires.<br />
Jean Bureau ne manque jamais de souligner avec fierté sa position de Capitaine-Armateur. Plus tard le capitaine armateur prendra à son tour des parts dans<br />
des navires armés par des jeunes capitaines parents ou amis. On imagine que chaque retour de voyage à Vertou de ces Capitaines déclenchait une vive<br />
effervescence, chacun guettant et commentant sa part de gâteau pour les bons comme pour les mauvais voyages.<br />
Les détenteurs de parts n'étaient pas les seuls "intéressés" à la bonne gestion financière du navire. Le capitaine non armateur et l'équipage avaient
aussi un intéressement aux résultats de leur petite entreprise. Dans ces conditions on peut être sûr que les capitaines n'étaient pas désignés au doigt mouillé<br />
et que la communauté familiale ou villageoise prenait en compte, certes leurs qualifications maritimes, mais aussi humaines, techniques et commerciales. Le<br />
plus important n'était pas de réaliser les points astronomiques les plus exacts mais de rapporter les meilleurs intérêts.<br />
Quand il devenait son propre armateur le Capitaine avait de surcroît toute latitude pour pratiquer le négoce des petites marchandises qu'il<br />
transportait ce qui permettait de réaliser parfois de confortables profits annexes. Certains d'entre eux dont les familles avaient des propriétés coloniales –<br />
principalement à Saint-Domingue – produisaient, transportaient et commercialisaient en famille leurs propres productions de café, de sucre ou de tabac. Les<br />
petits villages de Vertou ont ainsi vécu au XIXème au rythme de la mondialisation des échanges, du commerce international, du capitalisme familial.<br />
A la différence de la mondialisation actuelle, celle vécue par nos ancêtres restait à une dimension humaine et quasiment familiale : assurant par euxmêmes<br />
la formation de leurs futurs “cadres “, faisant construire leurs navires dans les chantiers de leurs cousins, engageant comme équipage neveux, cousins<br />
et voisins, intéressant à leurs investissement une communauté proche de parents, d’amis et de collègues, mettant en commun pour réussir non seulement des<br />
finances mais aussi des compétences, des conseils, des relations, des savoir-faire. Ces capitaines armateurs pourraient aujourd’hui nous donner bien des<br />
leçons de dynamisme, d’esprit d'entreprise, de goût de l'aventure, de courage, d’ambition, et de volonté de réussite. Ils pourraient endosser sans aucune<br />
retouche l'habit de nos modernes créateurs d'entreprise dont notre pays aurait tant besoin. Je verse à ce dossier la même remarque sous la plume du Cdt<br />
Jean Lacroix qui écrit en 1946, dans un tout autre contexte : " Il faudrait retrouver ces Chefs d'entreprise, ces capitaines armateurs, ces marins de race, si<br />
communs autrefois sur nos côtes et en voie de disparition totale dans les circonstances actuelles ...".<br />
L'aventure de la marine à voiles est bien morte, mais au-delà des siècles nos ancêtres peuvent encore nous donner des leçons. Ils nous montrent<br />
comment en peu d’années une petite communauté villageoise s’est mobilisé pour conquérir le monde en se dotant elle-même de ses moyens de formation (voir<br />
ci-après), de ses outils de travail (chantiers et navires), de ses sources de financement (intéressés). Comment elle a pris elle-même en main son destin sans<br />
attendre l’intervention maladroite d’un état-providence et comment elle a découvert spontanément les recettes du capitalisme de proximité à visage humain.<br />
Où dirigeants, actionnaires, employés travaillent la main dans la main pour le succès d’une entreprise commune. Ce qui est vrai pour Vertou, l'est beaucoup<br />
plus pour Trentemoult.<br />
# Le financement des navires<br />
L'examen de la correspondance de Jean Bureau indique que la technique utilisée par les capitaines armateurs pour le financer leurs navires était sans<br />
doute la suivante. Lorsqu'un capitaine de la première génération et donc parti de rien comme Jean Bureau désirait devenir son propre armateur il s'associait<br />
à un armateur de la place de Nantes qui lui confiait un navire "clés en mains". Une partie du coût du navire était payée immédiatement en cash par le capitaine<br />
et ses intéressés. Une autre partie était remboursée progressivement par le capitaine sur les résultats de ses voyages. L'armateur facilitait par ce système<br />
la création de "start-ups" en déchargeant le “créateur” de tous les aspects techniques et administratifs de la construction du navire : cahier des charges,<br />
négociations avec le chantier, préfinancement, supervision, et armement. Lorsque le capitaine avait fini de rembourser sa quote-part à l’armateur, il pouvait<br />
alors naviguer de ses propres voiles. On constate à la lecture de sa correspondance qu'à partir d'une certaine date Jean Bureau n'a plus de relation avec son<br />
premier armateur et qu’il utilise alors les services d'un courtier maritime qui lui écrit très clairement: " Enfin vous avez la barre en mains, à vous de<br />
gouverner ! ".<br />
C'est un financement particulièrement astucieux où chaque partie y trouve son compte. L'armateur prend sa marge sur la construction et le<br />
préfinancement. Le capitaine armateur acquière progressivement son autonomie et ceci d'autant plus rapidement qu'il est plus performant. L'intéressé fait<br />
un placement rémunérateur s'il mise sur le bon cheval. L'avantage de ce capitalisme de proximité est que tout le village sait quels sont les bons chevaux. Les<br />
intéressés limitent aussi leurs risques en répartissant plusieurs intérêts sur plusieurs navires.
Dans ce système l'armateur ne joue qu'un rôle de portage financier, car c'est au capitaine qu'il revient de choisir son équipage, d'organiser ses<br />
voyages, de recruter son fret. Cette association n'est pas exempte de conflits d'intérêts. On voit par exemple que l'armateur veut pousser notre Jean<br />
Bureau vers le cabotage transatlantique alors que celui-ci se fait tirer l'oreille. . Ce système de préfinancement est de nos jours couramment utilisé par les<br />
groupes allemands de transport routier qui pré-financent le camion de chauffeurs originaires des pays de l'Est qui le remboursent progressivement en<br />
fonction de leur activité. On peut imaginer quelles en sont les conséquences pour eux et leurs concurrents. C'est aussi la recette des seules marines<br />
marchandes qui survivent en Europe, la scandinave et la grecque. C'est celle des commerçants chinois. Mais aussi, ceci est beaucoup moins connu, c'est la<br />
recette du dynamisme technologique des Etats-Unis où de jeunes entreprises de haute technologie peuvent se développer dans un environnement de<br />
capitalisme de proximité, comme dans la Silicon Valley. Nos ancêtres navigateurs pratiquaient spontanément ce "capitalisme de proximité “, qui est la clé de<br />
nombreuses réussites et que l'on ferait bien de redécouvrir en France par les temps qui courent.<br />
# Les intéressés<br />
On trouve de nombreuses traces de ces “intéressés“ dans la correspondance personnelle et professionnelle de Jean Bureau. Ils sont le nerf de la<br />
guerre. Par exemple Jean Bureau écrit le 31 Décembre 1857 à un destinataire (non identifié) qui lui a demandé conseil : "J'ai reçu votre lettre datée du 24<br />
Décembre dans laquelle vous me dites qu'une difficulté existe entre Monsieur Bureau et le capitaine d'un navire sur lequel il a un intérêt et que le Capitaine<br />
est armateur du navire. Vous me demandez si c'est le Capitaine qui doit aller chez ses Intéressés régler les profits de chaque voyage ou si au contraire c'est<br />
à son domicile que ceux-ci doivent chercher leur part des bénéfices. Suivant moi c'est aux Intéressés d'aller chercher leur part des bénéfices chez<br />
l'armateur et non à l'armateur d'aller porter la part de bénéfices chez les Intéressés. Quoique moi je suis Armateur et Capitaine de mon navire et que c'est<br />
moi qui porte la part de bénéfices chez chaque Intéressé, mais suivant moi c'est une complaisance de ma part".<br />
Jean Bureau écrit de Liverpool le 20 Novembre 1858 à M. Denis, Courtier maritime, N° 33 Quai de la Fosse : "...Si le Capitaine Bachelier qui a<br />
commandé mon navire pour le dernier voyage des Antilles se présente chez vous pour vous demander de l'argent pour l'intérêt que je lui ai promis de prendre<br />
dans le navire qu'il est à faire construire, je vous prie de lui compter une somme de 500 à 600, sans dépasser ce dernier chiffre et vous aurez la<br />
complaisance de faire un petit compromis que (si) je venais à construire ou à acheter un navire il prendrait le même intérêt avec moi."<br />
Le 15 Décembre 1848 il détaille ce qu'il a donné à ses intéressés, ses deux oncles Aimé et Guillaume Huchet et sa tante Veuve Bureau. Dans cette liste<br />
figurent aussi les noms de : Auguste Badoit, Julien Pivet, Jean-Baptiste Mazureau, François Giteau, Pierre Métaireau, Jerôme Poirier, André Priou, Francis<br />
Duteil, Veuve Chaillaud.<br />
On connaît le détail de l’intéressement du “Gustave et Joséphine“ où figurent également Aimé et Guillaume Huchet oncles des cinq capitaines Bureau.<br />
Les prénoms du navire correspondent à ceux de la famille Bureau Pihuite.<br />
Quand on connaît le nom d'un navire, et que l’on sait qu’il a été immatriculé à Nantes on peut se procurer aux Archives départementales le dossier de<br />
Douanes du navire en question dans lequel on trouve les caractéristiques du navire, le chantier de construction, sa date de mise en service, mais aussi le nom<br />
de ses commandants successifs, des indications sur ses voyages ...et aussi des informations sur les Intéressés. C'est en effet l'Administration des Douanes<br />
qui gérait les parts de navire, avec le même rôle que celui du Cadastre pour les propriétés terrestres. On trouve dans ces dossiers quantité d’informations<br />
précieuses, notamment sur le statut social des intéressés.<br />
# L’énigme de la formation<br />
Un analphabète pouvait être marin sans problème et c'était généralement le cas. Mais pour passer Capitaine il y avait une marche importante à franchir
: il fallait non seulement savoir lire et écrire, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque, mais aussi savoir maîtriser les techniques de la manoeuvre et de la<br />
navigation hauturière (Long Cours) et côtière (Cabotage), pour partir naviguer sur toutes les mers du globe avec des petits navires très voilés, armés avec un<br />
équipage réduit, tributaires des aléas et des caprices des éléments naturels. Bien entendu il fallait acquérir les connaissances théoriques et pratiques<br />
exigées pour obtenir les diplômes de Maître au Cabotage ou de Capitaine au Long Cours. Sans parler des compétences comptables, financières et<br />
commerciales.<br />
Les jeunes vertaviens du Chêne et de la Barbinière pouvaient acquérir dès leur plus jeune âge les bases techniques du métier de marin. Tout jeunes ils<br />
jouaient avec les barques, ils observaient et aidaient la manœuvre des gabariers, ils les accompagnaient chaque fois que possible au Port de Nantes où ils<br />
montaient avec respect et admiration à bord des grands voiliers de mer. Ils observaient avec curiosité le travail de leurs parents charpentiers de navires<br />
dont ils connaissaient les moindres détails de structure et de vocabulaire.<br />
On peut se demander comment les jeunes enfants de petits villages de Vertou, fils de gabariers ou de charpentiers pouvaient acquérir le niveau<br />
d'enseignement “supérieur“ indispensable à une époque où la grande majorité des Français était analphabète, et où l'enseignement public n'était ni<br />
obligatoire, ni gratuit pour la bonne et simple raison qu'il n’existait pas. Cette éducation élémentaire de bon niveau était nécessaire non seulement pour les<br />
capitaines mais aussi pour ceux qui travaillaient à Vertou à la construction de navires et qui devaient mettre en œuvre des techniques relativement évoluées<br />
de calcul et de dessin. Comme toutes les professions de haute technicité sous l'Ancien Régime, l'exercice de cette profession était étroitement encadré par<br />
des traditions et les règlements corporatistes.<br />
La réponse est apportée par l'étude réalisée par M. Pierre Richard publiée dans la Revue Regards sur Vertou – 1998 -N° 5 et intitulée "Les Ecoles<br />
Communales de Vertou" – pages 99-100. On y lit que la commune de Vertou avait reçu au début de 1833 l'ordre de créer une école publique : "Le 16 Juillet<br />
1833 le Conseil Municipal propose comme candidat M. Lebeau, depuis 6 ans déjà instituteur dans la commune et donnant toute satisfaction à condition<br />
toutefois qu'il soit pourvu d'un diplôme de capacité. Sa nomination sera effective le 25 Novembre. Notons que M. Lebeau (Frère du St Esprit) exerçait alors<br />
comme Instituteur libre au Chêne …"<br />
On peut penser que M. Lebeau n'a pas produit entre-temps le diplôme exigé car on peut lire qu’en 1837 : “ la commune choisit comme Instituteur M.<br />
Raphaël Verona de la Haye-Fouassière pour sa bonne moralité et son niveau d'instruction, confirmé par des certificats à l'appui…" Mais coup de théâtre, deux<br />
ans plus tard, M. Verona démissionne de ses fonctions d'Instituteur le 3 Novembre 1839 … "sous prétexte que, en concurrence avec M. Lebeau, Instituteur<br />
libre au Chêne, son nombre d'élèves est insuffisant“. L’inventaire réalisé en 1841 dénombre 40 élèves inscrits à l'école primaire de la commune … alors qu'au<br />
Chêne M. Lebeau enseigne à 42 élèves !<br />
Force est de constater que dès 1827, et donc au tout début de l'aventure des navigateurs vertaviens, les habitants du Chêne disposaient d'une école<br />
dix ans avant la création de l'école publique de Vertou et que quatorze ans plus tard elle instruit à elle seule autant d'élèves que l'école publique de la<br />
commune entière ! C'est un bon exemple de la réactivité de la petite communauté “maritime“de Vertou pour répondre aux besoins de formation de ses futurs<br />
Capitaines. On en trouve une confirmation émouvante, dans une lettre écrite par le jeune Pierre Bureau à son cousin Jean : "… et moi je suis toujours en<br />
classe ainsi que Théodore et nous travaillons comme des marthyrs, et ça ne va pas vite…"<br />
Tous les natifs du Chêne, comme moi, qui ont dû subi les humiliations condescendantes des bourgeois (cad des habitants du Bourg) de Vertou pleins de<br />
mépris pour ces villages de marins mécréants seront ravis d'apprendre qu'au début du XIXème les jeunes enfants de mon village natal étaient plus instruits<br />
et plus évolués que tous ceux de la Commune, une formation qui fut la clé de leur brillante réussite professionnelle et plus tard de celle de nombre de leurs<br />
descendants. Que de leçons à prendre encore là !
# Les responsabilités<br />
Les Maîtres au cabotage ne peuvent obtenir leur diplôme qu'à partir de 25 ans. Jean Bureau obtient immédiatement le commandement d'un navire se<br />
retrouvant responsable du navire, des hommes et de la cargaison. Il doit prendre seul les initiatives car le courrier est trop lent pour attendre des<br />
instructions de ses armateurs. Les qualités humaines et techniques d'un capitaine devaient être grandes pour qu'il puisse mener son navire, sa cargaison, son<br />
équipage à bon port en prenant en toutes circonstances, souvent fâcheuses, les meilleures options de météo et de manoeuvre.<br />
On reconnaît sa maturité lorsqu'au cours de l'un de ses premiers voyages comme capitaine sa cargaison de blé chargée à Luçon arrive légèrement<br />
avariée à Marseille. Il ne se laisse pas intimider par les reproches sous-entendus de son Armateur et glisse habilement que le transport maritime n'est pas<br />
tenu à une obligation de résultats mais seulement de moyens et que ceux qu’il a mis en œuvre sont irréprochables. Il rappelle logiquement que son temps de<br />
planche (=délai contractuel pour livrer la marchandise) a été respecté et que par conséquent c'est la qualité de la marchandise – et non le transport - qui est<br />
en cause. Et il enchaîne : " Messieurs je ne pense pas que depuis que je commande le navire, malgré qu'il n'y a pas bien longtemps, je pense que vous n'avez<br />
pas à vous plaindre de moi parce que tout ce que je fais je le fais pour le bien. Soit dans un port, soit à la mer, ce ne sera pas de ma faute car messieurs je ne<br />
pense pas qu'il y ait un Maître au Cabotage ou un Capitaine au Long cours qui fait plus attention que moi à son navire. Aussi Messieurs quand le navire prend du<br />
retard dans un port ça ne dépend pas de moi."<br />
# Les aléas de la météo<br />
“LE“ problème de la marine à voile, c’est bien entendu sa sujétion aux aléas météorologiques. Les courriers de ces capitaines abondent de précisions sur<br />
les vents favorables ou contraires rencontrés au cours de leurs traversées. Le 24 Août 1848, Jean Bureau écrit de Sunderland à ses armateurs : "Je suis<br />
parti de St Nazaire le 8 Août... Ma traversée n'a pas été bien longue malgré les vents de bout que j'ai éprouvé à venir jusque dans le travers de Sunderland,<br />
car le 20 j'y étais. Mai s'il est venu de grands vents de NO et j'ai été forcé de mettre à la cape pendant quelques heures, ce qui m'a fait perdre de la route,<br />
et donc je n'ai pu rentrer que le 23. Messieurs je vous apprends avec plaisir que le navire est de bonne marche ordinaire et qu'il se comporte très bien à la<br />
mer."<br />
Une autre fois Jean Bureau a dû attendre pendant trois semaines en rade de Malaga une renverse de vent pour pouvoir passer le détroit de Gibraltar.<br />
Il ne faut pas s'étonner si chacune des lettres de capitaines commencent rituellement par un commentaire sur les vents rencontrés au cours du voyage.<br />
A l'époque qui est la nôtre ou le moindre retard de train ou d'avion nous exaspère on a du mal à imaginer quelle devait être la patience et la résignation<br />
de nos marins dont la vie était rythmée par les alea et les caprices de la météo.<br />
# Vocabulaire<br />
Sur ces voiliers, merveilles du génie inventif humain, chaque bout (cordage), chaque espar (vergue, bôme), chaque pièce de la charpente du navire<br />
avait un nom bien précis, ce qui a donné naissance à un vocabulaire d'une incroyable richesse, quasiment perdu aujourd'hui. Un exemple, avec cette recette<br />
pour changer un hunier endommagé : " Les huniers avant d'être mis dans la soute sont garnis de leurs rabans, garcettes de ris, branches de boulines, poulies<br />
de palanquins, moques d'écoutes, et paquetés de manière à ce que toutes les cargues, boulines et écoutes puissent être frappées, sans être obligés de<br />
déployer le hunier. 1 – Frapper une poulie sous l'avant des barres de perroquet pour y passer une petite aussière ou la guinderesse, de perroquet si elle est<br />
bonne; envoyer le bout sur le pont en avant de la hune, dédoubler les palanquins et les allonger si nécessaire pour avoir les bouts en bas 2 – Placer le hunier<br />
sur l'avant du mât, la tétière tournée du bon côté; frapper l'aussière sur le milieu, les palanquins sur leurs pattes et un halebas pour le contretenir dans les<br />
roulis. 3 – Ranger les hommes sur l'aussière, hisser le hunier presque à toucher les barres, en abraquant les palanquins. 4 – Peser vivement les palanquins en
amenant le hunier en douceur, pour lui faire élonger la vergue. 5 – Envoyer les hommes sur la vergue pour prendre les empointures; amarrer la têtière à la<br />
filière, et un raban d'envergure entre deux; frapper les cargues et boulines, passer les écoutes et les palanquins dans leurs poulies, en faire le dormant au<br />
bout de la vergue. Le hunier est envergué."<br />
# Correspondances<br />
On est surpris par la densité des échanges épistolaires de ces capitaines avec leurs armateurs et leurs courtiers pour d’évidentes raisons<br />
professionnelles, mais aussi avec leurs familles. Dans un monde aujourd’hui conquis par le téléphone fixe et mobile on imagine difficilement un monde où le<br />
seul moyen de communiquer est le courrier manuscrit, lent et incertain. Cependant contrairement à ce que l’on pourrait craindre les délais d’acheminement du<br />
courrier étaient alors étonnamment courts, car le rôle de la poste était alors vital. Par exemple une semaine seulement entre Hambourg et Nantes.<br />
Ces courriers sont importants pour des marins dont la vie se trouve constamment en danger. Quelle devait être l’angoisse des familles pour lesquelles<br />
l’absence de courrier ne pouvait signifier qu’un mauvais présage. Et quel soulagement quand enfin une lettre arrivait. Le passage dans les villages de marins de<br />
l’employé des Postes ne devait pas passer inaperçu. Chaque marin met donc son point d’honneur à expédier une lettre dès qu’il arrive à bon port ou en repart.<br />
Il est vrai que les temps morts ne manquent pas à bord, quand le navire est sur rade, en attente d’un chargement, et où on a tout le temps nécessaire pour<br />
écrire. Les femmes restées à terre ne savent pas toujours écrire. Elles ont alors recours à un voisin ou à un écrivain, comme Jeanne Bureau, la mère des trois<br />
Capitaines Bureau.<br />
Toutes leurs lettres commencent par un long préambule ampoulé consacré à la bonne santé de l’expéditeur et à celle présumée du destinataire. Puis on<br />
enchaîne sur les circonstances de la traversée, la mer, les vents. On passe aux pronostics de durée de déchargement. On évoque les incertitudes sur la<br />
destination suivante ou les niveaux de fret. Jean Bureau, Capitaine Armateur qui doit rendre compte scrupuleusement de la gestion de son navire parle<br />
beaucoup d’histoires de gros sous, de frets, de débours, de billets à ordre. Puis on évoque quelques potins. On donne des nouvelles d’un proche rencontré dans<br />
un port ou dont on a reçu un courrier. Et généralement on termine par un leitmotiv qui exige du destinataire un accusé de réception sans délai.<br />
Jean Bureau a pris la bonne habitude dès son premier embarquement de recopier dans un grand cahier les lettres qu’il adresse à ses correspondants :<br />
armateur, courtier, agents, intéressés, cahier qui permet de suivre douze années de son activité de capitaine du brick “Le Georges “. Nous disposons par<br />
ailleurs d’une bonne centaine de lettres professionnelles ou familiales écrites pendant la première moitié du XIXème par les cinq capitaines Bureau, mais pour<br />
des raisons qui restent à éclaircir, aucune après 1860. Cette correspondance donne des renseignements précieux sur la vie quotidienne des navigateurs de la<br />
marine à voile nantaise du début du XIXème<br />
Un exemple de cette correspondance de Jean Bureau écrite de Vertou le 14 Janvier 1858: " Cher Bachelier ...Je t'écris ces quelques lignes pour te<br />
donner de mes nouvelles et de ta famille. Ta bonne mère est bien ainsi que ta tante. Ton beau-frère a pris charge à Newport du fer pour Gênes...La glace a<br />
pris depuis plusieurs jours dans notre rivière ... Les navires sont garés dans les Payés ( ?). C'est un plaisir de marcher car il n'y a pas de vase. Je voudrais<br />
être chasseur pour me désennuyer, mais je n'envie pas ce métier et je m'ennuierais beaucoup du métier de rentier. Je crois que je me trouverai bien heureux<br />
dès que je naviguerai... Notre cousin Perthuy est parti avec "La Clémence" voici quelques jours pour une île anglaise au nord de la Guadeloupe. Mon frère<br />
Pierre doit arriver à Nantes en Février et Auguste a relevé de Singapour pour la mer de Chine, pour Siam. Lorsque tu m'écriras dis-moi si tu es content de<br />
ton équipage."<br />
De son côté Auguste Bureau écrit à sa mère de Singapour (le 5 Novembre 1857) : “ Vous espériez avoir mon frère (Jean) pour faire vos vendanges.<br />
Je lui recommande de nous garder à Pierre et à moi une bonne barrique de muscadet que nous aurons le plaisir de consommer à votre table et en votre<br />
compagnie, car vous savez comme moi que mon frère et moi nous aimons le bon vin…Je suis en déchargement et je pense en avoir pour quinze jours ; et
aussitôt à vide je crois bien qu’on m’enverra faire un voyage en Chine … Lorsque vous recevrez ma lettre ne manquez pas d’en donner connaissance à ma<br />
Pauline et de faire ce que je suis privé de faire, l’embrasser … Vous ne manquerez pas non plus de faire des compliments à vôtre écrivain qui a eu l’esprit de<br />
faire une lettre un peu plus longue que celle que j’avais reçu à bord du Pur-Sang …“<br />
On constate avec plaisir que les navigateurs de Vertou même à l’autre bout du monde restent fidèles à leur Vertou et à leur cher Muscadet ! On verra<br />
plus loin que Trentemoult avait ses pêcheurs-monnayeurs, Vertou avait ses marins-viticulteurs.<br />
# Vie de marin, vie de chien<br />
L'extrait suivant d’une chanson populaire de marin (Adieu Cher camarade) résume la mauvaise image qu’avait alors la profession de marin : “… Et si je<br />
marie et que j’aie des enfants/Je leur casserai un membre avant qu’ils soient grands/Je ferai mon possible pour leur gagner du pain/Le restant de ma vie,<br />
pour pas qu’ils soient marins/Pour pas qu’ils soient marins …“<br />
Le souvenir nostalgique des beaux navires de cet âge d'or ne doit pas faire oublier les conditions de vie épouvantables qui étaient endurées par les<br />
marins de cette époque. Mais alors qu'il existe de nombreux récits racontant la vie des marins militaires, notamment ceux de Louis Garneray “ Voyages,<br />
Aventures et Combats “ ou les atrocités du trafic négrier en revanche personne n'a daigné s'intéresser à la vie des obscurs marins à bord de ces petits<br />
voiliers marchands.<br />
A ma connaissance il n’existe qu’un seul document, mais il est remarquable, écrit par un jeune américain d’une famille patricienne de Boston, Robert<br />
Henri Dana, lequel avant de devenir un brillant avocat s’est embarqué pour des raisons obscures en 1834 (il a alors 19 ans) comme marin à bord d’un brick<br />
marchand de Boston, le " Pilgrim". RH Dana est un quasi-contemporain de Jean Bureau qui commence à naviguer comme mousse à peu près au même moment<br />
que celui-ci. Il a raconté son expérience de ses deux années de navigation dans un livre intitulé "Deux années sur le gaillard d'avant" qu’il ne publiera que bien<br />
après son retour. Ce grand classique de la littérature américaine aura aux Etats-Unis un tel retentissement qu'il sera à l'origine des premières lois sociales<br />
en faveur des marins.<br />
Cet ouvrage est indispensable pour comprendre ce qu'était la vie rude et dure des marins de l’époque : entièrement à la merci des éléments naturels,<br />
calmes plats, tempêtes, orages, chaleur, froid et neige. Constamment mobilisés de nuit comme de jour par tous les temps pour adapter le réglage des voiles<br />
aux brusques changements de temps et de vent. Evoluant à plusieurs dizaines de mètres dans une haute mâture accrochés d’une main à un filin et reposant<br />
sur un marchepied instable. Une seconde d'inattention et c'était la chute fatale. Aucun répit, même en dehors des manoeuvres, car il fallait constamment<br />
réparer, peindre et entretenir la coque, les cordages et les espars soumis à rude épreuve. C'était une condition de survie. Même au port – le navire restait<br />
presque toujours mouillé en rade et n’était que très rarement posté à quai - il fallait constamment se tenir sur le qui-vive pour pouvoir lever l'ancre au<br />
moindre grain. Les naufrages au mouillage étaient en effet très fréquents. La nourriture était infecte et toujours insuffisante. Le poste des marins “sous le<br />
gaillard d’avant“ était d'un total inconfort encombré par des vêtements toujours mouillés où jeunes mousses et vieux marins cohabitaient dans les pires<br />
conditions de promiscuité. (la maîtrise et le cuisinier occupent la partie arrière du navire).<br />
Dans le pire des cas comme le relate RH Dana les marins devaient subir la discipline et les humiliations sadiques d'un capitaine réputé "seul maître à<br />
bord" et attitré à leur infliger brimades et punitions corporelles. Ce n’était bien évidemment pas le cas des bricks vertaviens armés “en famille“ dans des<br />
conditions bien différentes de celles des navires marchands américains de la même époque. Car il y avait aux Etats-Unis une grande pénurie de marins et la<br />
plupart d’entre eux venaient des bas-fonds de l’Europe, repris de justice ou déserteurs. Les armateurs devaient payer des sergents recruteurs chargés<br />
d’expédier à bord n’importe qui, consentant ou non, à n’importe quelle condition. C’était des équipages de “sacs et de cordes“ comme ceux des navires de<br />
complaisance aujourd’hui. Et les capitaines devaient avoir un profil en conséquence.
Bien entendu il était tout à fait inconcevable que des jeunes hommes de bonne famille puissent devenir marins. Lorsque le jeune Jules Verne tentera,<br />
selon la légende, de s’embarquer à 14 ans sur un voilier en partance de Nantes son père partira vite le rattraper en prenant le vapeur de Paimboeuf.<br />
Les maladies d’origine pulmonaire et infectieuses, les maux de dent, le scorbut étaient fréquentes ainsi que les blessures graves au cours des<br />
manœuvres et des manutentions. Affligé d’un douloureux panari qui l’empêche d’écrire Jean Bureau doit se faire remplacer pour cette tâche indispensable<br />
par son cousin Pierre, matelot à bord. Ce cousin Pierre qui mourra en mer quelques années plus tard en mer d’une maladie cardio-pulmonaire.<br />
# Les disparitions en mer<br />
Le métier de marin était le plus dangereux de tous : maladies, chutes mortelles, blessures graves, noyades guettaient à chaque instant les marins.<br />
Comme en témoignent le récit de RH Dana, les vers du poète Victor Hugo ou les chansons populaires de marin :<br />
Raconté par RH Dana : "Tout le monde sur le pont, un homme à la mer" …Il s'agissait de George Ballmer un jeune marin anglais …Il était grimpé dans le<br />
gréement pour capeler à la pomme grand mât une estrope destinée aux drisses de la bonnette et il s'était accroché au cou l'estrope avec sa poulie ainsi<br />
qu'une glène de drisses et un épissoir …Il était tombé des gambes de revers de tribord mais il ne savait pas nager et, comme il était lourdement habillé et<br />
lesté de tout l'équipement qu'il s'était accroché au cou, il avait probablement dû couler à pic…A terre quand quelqu'un meurt on accompagne sa dépouille<br />
jusqu'à sa tombe; une pierre en marque l'emplacement… Mais en mer, un individu est près de vous, à votre côté, vous entendez sa voix, et l'instant d'après il<br />
n'est plus là, et il n'y a plus rien qu'un vide pour accuser sa disparition. Sa couchette restera dorénavant vide dans le poste et il manquera toujours un homme<br />
à l'appel de la bordée. Dans ces conditions, la mort, quand elle survient, acquiert quelque chose de particulièrement impressionnant, et l'équipage en reste<br />
longtemps sous le coup…"<br />
Imaginé par le poète Victor Hugo (Oceano Nox - Juillet 1836): “ Oh ! Combien de marins, combien de Capitaines - Qui sont partis joyeux pour des<br />
courses lointaines - Dans ce morne horizon se sont évanouis - Combien ont disparu, dure et triste fortune - Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,<br />
Sous l’aveugle océan à jamais enfouis - Vos veuves aux fronts blancs, lassées de vous attendre Parlent encore de vous en remuant la cendre De leur foyer et<br />
de leur cœur - … Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires? Oh flots que vous avez de lugubres histoires - Flots profonds redoutés des mères à<br />
genoux. “<br />
Ou encore popularisé par les chants de marins ( Les trois marins ) : “ Nous sommes deux nous étions trois- Nous étions trois marins de Groix -Mon<br />
matelot mon mousse et moi- Embarqués sur le Saint François - Vint à venter grains de noroît - A faire céder notre mât -Jean-Pierre, dis-je, matelot -<br />
Serrer la toile qu’il nous faut - Ce failli temps mollira pas -Je prends la barre, vas-y mon gars - Il est allé pour prendre un ris -Un coup de mer l’aura<br />
surpris -Au jour j’ai revu son sabot- Il flottait seul là-bas sur l’eau - Il n’a laissé sur not’ bateau - Qu’un vieux bonnet et son couteau - Plaignez mon pauvre<br />
matelot - Sa femme avec ses trois petiots.“<br />
La liste des 140 marins de Trentemoult disparus en mer de 1849 à 1947 établie par un comité de familles de marins est l’illustration tragique des<br />
dangers mortels des marins<br />
(3M = Trois-mâts, Bk = brick, BG = brick-goélette, G = Goélette, PCB = Perdu Corps et Biens)<br />
1849 - JB Dejoie -3M Perpignan - Perdu Corps et Biens<br />
1859 - P. Ordronneau - G Jeune Aglaé – PCB en Manche allant en Angleterre<br />
1860 - L. Chauvelon -3M La Souvenance - Mort de la fièvre jaune à La Havane
1862 - B. Chauvelon ? - Mort de la peste à Hong Kong ainsi que tout l’équipage<br />
1868 – JB Heurtin – ? – Enlevé par la mer étant à la barre<br />
1871 - F. Volant -3M Deux Frères – Massacrés par des sauvages entre Melbourne et Batavia qui prirent le navire à l’abordage par calme plat.<br />
1872 - JB Lancelot -3M Ville de Blain – Tombé à la mer et disparu<br />
1870 – E. Lemerle - ? – Mort des fièvres à Port-au-Prince<br />
1872 – L. Chauvelon – BG Inès – PCB – Au large des côtes d’Espagne le navire fut pris à l’abordage par des prétendus pêcheurs qui massacrèrent<br />
l’équipage<br />
1878 – J. Ertaud – 3M Aramis – Mort en mer de la fièvre jaune – Immergé<br />
1901 – Adrien Codet – 3M Charlemagne – PCB entre Nouméa et Le Havre<br />
1902 – Baptiste Erta – 3M St Rogatien – Tombé de la mâture à la mer par tempête de neige<br />
1905 – René Bertrand – 3M St Donatien – PCB lors d’une traversée Bordeaux vers Australie<br />
NB - on notera que sur les 63 premiers noms de cette liste les patronymes les plus cités sont Lemerle (7), Chauvelon (6), Ertaud (3) et Fruneau (3).<br />
# Au service de la Patrie<br />
Tous nos ancêtres, marins et capitaines, pêcheurs de Trentemoult, gabariers et charpentiers de navires de Vertou, ont servi dans la marine militaire,<br />
Royale, Impériale ou Nationale selon les époques, et en ont partagé les victoires et les défaites.<br />
Vers 1850 les marins de Vertou comme tous les autres étaient tenus de passer deux ans et demi "sous les drapeaux” et restaient mobilisables en cas<br />
de conflit. Jean Bureau à peine nommé jeune Capitaine doit abandonner pendant plus d'un an son navire – dont il est l’armateur - pour repartir au service de<br />
l’Etat. Nos marins ont ainsi l’opportunité de constater l’évolution technologique rapide des navires, car la technologie de la marine militaire est évidemment<br />
beaucoup plus en avance que celle de la marine marchande et ils étaient aux premières loges pour assister à la prodigieuse révolution technique du XIXème.<br />
Par exemple pendant la guerre de Crimée le jeune Jean Bureau sert sur une canonnière à vapeur qui est l’un des tout premiers bâtiments militaires à<br />
propulsion mécanique. Son cousin Pierre sert à bord de l’aviso-escorteur "Le Corse“, un navire mixte oublié de tous aujourd’hui. Et pourtant ce fut le premier<br />
bâtiment de mer au monde équipé d’une hélice à pales distinctes, technique qui s’est imposée depuis pour tous les navires à hélice du monde petits ou grands.<br />
La vitesse de ce navire lancé au Havre en 1842 par Augustin Normand était stupéfiante pour l’époque avec ses 10 nœuds pour 28 tours d’hélice à la minute.<br />
“Le Corse“ marque le point de départ d’une nouvelle ère de la technologie maritime. (“Le Napoléon”, premier navire militaire à hélice opérationnel, fut lancé<br />
dix ans plus tard).<br />
La maquette de frégate réalisée par Pierre Bureau marque au contraire le point d’aboutissement de plusieurs millénaires d’architecture navale militaire.<br />
Cette maquette représente une frégate de premier rang de 60 canons du tout début du 19ème reconnaissable au fait que le pont est devenu continu sans les<br />
rehaussements habituels à l’avant et à l’arrière, que la civadière a disparu, que sa voilure est augmentée par l’ajout de cacatois établis en fixes tout en haut<br />
des mâts au dessus des perroquets, alors qu’ils étaient volants sous l’Ancien Régime.<br />
Ce type de navire à voile français a marqué de façon indiscutable l’apogée de la marine à voile militaire, toutes époques et tous pays confondus. On sera<br />
surpris de l’apprendre mais au début du XIXème la construction navale française restait supérieure à toutes les autres, anglaise comprise, avec des navires à
la fois plus rapides et plus manoeuvrants. On le sait de source sûre puisque les Anglais dont les frégates ne réussissaient jamais à rattraper les frégates<br />
françaises s’empressaient de copier avec soin tous les navires français vaisseaux et frégates qui tombaient entre leurs mains. La supériorité de l’architecture<br />
navale française peut être largement attribuée à la réorganisation efficace des Arsenaux sous l’impulsion de Napoléon qui a vite tiré les leçons de l’échec de<br />
Trafalgar … et au rôle de l’Ecole du Génie Maritime créée dès 1765 qui a permis de former des architectes navals de très grande qualité. Et notamment le<br />
génial Sané, Ingénieur du Génie Maritime d’origine brestoise né en 1840 qui servira jusqu’à l’âge de sa mort à quatre-vingt onze ans (en 1831). Les frégates de<br />
Sané souvent copiées mais jamais dépassées marquent d’un “fanion blanc“ l’art millénaire du navire à voiles.<br />
Les navigateurs de Vertou ont ainsi côtoyé de près des événements petits ou grands de la marine française et européenne. La mémoire collective locale<br />
a par exemple retenu que c’était un capitaine Bureau originaire de la Barbinière qui grâce à sa connaissance du port D’Alger comme navigateur de commerce<br />
avait servi de pilote pour l’escadre française venue conquérir l’Algérie en 1830 ! Plus près de nous les marins mécaniciens participeront à toutes les missions<br />
traditionnelles de la marine française : représentation en temps de paix, surveillance et contrôle de l’empire colonial, conflits et batailles navales et ceci dans<br />
des conditions particulièrement difficiles.<br />
Sans oublier nos marins soldats comme Jean Le Tilly, fils de Ernestine Bureau, fusilier-marin dans le célèbre bataillon de l’ Amiral Ronarc’h dont la<br />
conduite héroïque en 1914-1918 lui vaudra plusieurs citations, dont cette dernière : “Ordre du 30 Septembre 1918 – Signé Martet - Le Capitaine de Frégate<br />
Commandant le Bataillon cite à l’Ordre du Bataillon Le Tilly Jean Matelot Matricule 25106, Au front depuis trois ans a participé aux opérations des Flandres,<br />
de la Somme et de l’Aisne. A assuré la ravitaillement de sa Cie dans des circonstances périlleuses pendant les opérations du 9 Septembre au 3 Octobre 1918“.<br />
# Leur époque<br />
Maquette de Frégate française début XIXème Aviso mixte Le Corse<br />
L'examen détaillé de la généalogie de nos ancêtres vertaviens montre que tous les hommes nés entre 1810 et 1830 qu'ils s'appellent Bureau, Pichaud,<br />
Aguesse, Bachelier ou Gicquel, à une seule exception près, deviendront tous navigateurs, marins ou capitaines (8 capitaines et 5 marins). La même remarque<br />
peut être faite sur les lignées familiales de Trentemoult.
On peut vérifier à quel point ils exercent un métier dangereux puisque sur 8 Capitaines de cette génération 4 disparaissent en mer autour de trente<br />
ans. Très peu de navigateurs de cette génération réussissent à atteindre l'âge de 60 ans. Jean Bureau fait figure d'exception avec ses 77 années alors que<br />
ses deux frères, son oncle et son cousin disparaissent en mer autour de 30 ans.<br />
Nés autour de 1820 ils exerceront par conséquent leur activité en plein Second Empire, ce qui permet de situer très exactement leur mode de vie et<br />
leur mentalité. Jean Bureau est tout à fait emblématique de ces navigateurs du Second Empire. Il prend son premier commandement en 1848. Il participe en<br />
1855 à la guerre de Crimée. Il voue un profond respect à l'Empereur qui l'a décoré de la Médaille Militaire, assortie d’une récompense de 200 F, une belle<br />
somme pour l’époque. Il est abonné aux revues hebdomadaires très appréciées à cette époque comme Le Magasin Utile, qu’il fait précieusement relier chaque<br />
année. C’est dans ces revues périodiques qu’écrivent, payés à la ligne, Alexandre Dumas et Jules Verne (qui naît cinq années après Jean Bureau et meurt cinq<br />
années après lui).<br />
Cette époque fut celle d'un extraordinaire dynamisme. L'Europe n'avait pas encore été supplantée par les Etats-Unis. La France affichait une<br />
étonnante vitalité dans tous les domaines : économique, technique, scientifique, industriel, littéraire, artistique, architectural. Rien ne faisait peur alors aux<br />
Français à l'instar de ces petits vertaviens partis de leurs tranquilles bords de Sèvre pour aller courir la dangereuse aventure du grand large...Les hommes et<br />
femmes de cette époque étaient imprégnés de valeurs chrétiennes. Mais étrangement ils se référaient plutôt à la Providence divine qu’à Dieu, cette<br />
Providence qui représente pour les hommes du XIXème tous les moyens offerts à l’Homme par Dieu dans sa grande bonté pour qu’il en fasse le meilleur usage.<br />
Sous la protection de la Providence et avec l’aide divine rien ne peut résister aux hommes entreprenants de cette époque. Pour eux le progrès avait une<br />
signification messianique.<br />
Le roman de Jules Verne “L’île Mystérieuse“ – que j’ai lu tout jeune dans une splendide édition originale dorée sur tranche prêtée par un vieux capitaine<br />
du Chêne - est une allégorie exemplaire de ce mythe de la Providence. Quelques hommes échoués sur une île inconnue inhabitée vont réussir à la transformer<br />
en un petit paradis terrestre parfaitement aménagé grâce à leur travail, à leur ténacité, à leurs connaissances scientifiques et … l’aide d’une caisse à outil<br />
providentiellement échouée sur la grève. La participation active des hommes de cette époque aux progrès de l'humanité était pour eux une manière d'honorer<br />
Dieu.<br />
# Les maisons de capitaines<br />
Leurs navires de bois et de voiles - retournés en poussière depuis longtemps - n'ont laissé aucune trace matérielle de l’activité de ces navigateurs<br />
contrairement aux premiers établissements industriels de cette époque. La seule marque visible gravée dans le paysage du Pays Nantais, ce sont leurs belles<br />
demeures qui autrefois désignées sous le nom de " maisons de Capitaines ", et que l’on peut voir encore à Vertou dans le quartier de la Chaussée, dans les<br />
villages du Chêne et de la Barbinière, et dans plusieurs autres villages de la commune. Et encore bien mieux à Trentemoult. Leurs dimensions sont beaucoup<br />
plus modestes que celles des grands négociants plus ou moins négriers du XVIII ème : grandes maisons rectangulaires à un seul étage avec un toit d’ardoise à<br />
quatre pentes, protégées par un petit jardinet donnant sur la rue planté d’essences exotiques (palmier, camélia, araucaria, magnolia, parfois un bananier) de<br />
façon à bien marquer la profession de son propriétaire. Souvent les parterres des jardins sont ceinturés de gros coquillages blancs de lambis rapportés de<br />
leurs voyages aux Antilles et une serre est toujours accolée à la maison où leurs propriétaires retrouvent les plantes et la chaleur de leurs voyages lointains.<br />
Quand on pénétrait dans ces maisons on était surpris par l'accumulation de bibelots de toutes sortes ramenés de leurs voyages : poteries anglaises -<br />
les pots de Jersey faisaient alors fureur - tapis orientaux, effrayants masques africains ou asiatiques … avec accrochée au mur l’inévitable carapace de<br />
tortue marine. Sans compter bien sûr les maquettes et les tableaux de navires. Ces maisons sont meublées en style "contemporain" pour l’époque et donc dans<br />
le style Second Empire. Ces objets n'ont pas tous disparus et sont encore nombreux dans la région mais dispersés au gré des partages et des déménagements<br />
ils restent les vestiges muets de cette époque oubliée.
Ces maisons de capitaines ne sont jamais construites dans la campagne et pour cause … les femmes toujours seules s’y ennuieraient et il n’y a ni<br />
exploitation agricole ni métayer à surveiller. Et bien entendu les capitaines en congé apprécient de retrouver l’animation des villages après tant de mois<br />
passés en mer. Ces maisons sont implantées dans les villages en bord de rue et de préférence en bord de Loire ou de Sèvre. Tout autour se pressent les<br />
maisons basses des marins, plus modestes et couvertes de tuiles. C'est typiquement l'aspect du village du Chêne et du bas du bourg de Vertou, mais aussi<br />
bien sûr de Trentemoult où de nombreuses maisons de capitaines sont encore visibles, serrées les unes contre les autres, bien que de plus en plus défigurées<br />
par les rénovations.<br />
A cette époque le visage de nos villages de marins se transforme et on voit pousser entre les maisons basses les belles maisons de capitaines toujours<br />
plus nombreuses et spacieuses. Aujourd’hui personne ne serait capable de faire la différence entre une maison de notable "terrien" du Second Empire :<br />
notaire, médecin et celle d’un capitaine. Mais les contemporains ne s’y trompaient pas et ils les reconnaissaient au premier coup d’œil avec leurs plantations<br />
exotiques, leur style "contemporain", leur aspect flambant neuf "nouveau riche" sans la patine ni l’ancienneté de celles des notables du Bourg ou de la<br />
campagne établis de longue date. Et on savait bien qu’au Chêne il n’y avait pas de notables autres que les capitaines. En cherchant bien on pourrait dénombrer<br />
à Vertou plusieurs dizaines de ces maisons qui pourraient nous raconter de bien belles histoires de Navigateurs si elles pouvaient<br />
parler.<br />
# Vie quotidienne<br />
Trentemoult – Maisons de Capitaines Vertou - Maison de Jean Bureau<br />
Dans ces villages de bord de Sèvre on ne croisait que des femmes : épouses de marins en mer, veuves et orphelines de marins disparus. A l'exception<br />
de quelques artisans et de quelques invalides ou marins en permission il ne restait plus aucun homme de plus de 12-13 ans puisque tous partaient comme<br />
mousse dès cet âge. Toute l'activité était tournée vers la Sèvre : trafic fluvial, bateaux-lavoirs, chantiers de construction de navires, moulins, transports de<br />
voyageurs. C'est par la Sèvre que revenaient les navigateurs tant attendus. Pour le plaisir de les retrouver, de les écouter raconter leurs aventures, mais<br />
aussi de connaître "l'intéressement" qui faisait vivre tant de familles. C'est par la Sèvre qu'ils repartaient pour un nouvel embarquement accompagnés le plus<br />
loin possible par leurs proches sur la chaloupe du départ.
La communauté des villages du Chêne et de la Barbinière était alors comparable à celle de certains villages de Bretagne des années 1950, peuplés de<br />
familles de marins de commerce, toujours absents sauf pendant de courtes permissions, avec cette même cohabitation de maisons imposantes de capitaines<br />
et celles plus modestes de marins. Ce type de communauté existe encore dans certains Ports de pêche français et dans les îles grecques où on continue à<br />
financer, armer et exploiter les navires en famille.<br />
On ne peut manquer d’évoquer le rôle éminent des femmes dans ces communautés. Elles se chargent de tout en l'absence de leurs hommes : la gestion<br />
quotidienne, les récoltes, les vendanges, les démarches diverses, l'éducation des enfants, la gestion des économies et intérêts de navires qu'elles surveillent<br />
avec vigilance, intervenant certainement dans le choix des Capitaines et des équipages. D'après ce qu’on en sait Vve Marie Bureau, l'une des premières<br />
femmes de capitaines du Chêne, était une femme énergique à la fois crainte et respectée dans sa communauté de navigateurs.<br />
Les femmes de capitaines embarquaient parfois pour une traversée “post-nuptiale“ comme Hortense Lancelot qui embarque juste après son mariage<br />
pour Alger avec son mari Pierre. Ce qui vaut les commentaires de son beau-frère Jean Bureau : “Je vous félicite du voyage que vous allez entreprendre et<br />
surtout je vous recommande de ne pas être malade à la mer car quelquefois vous rencontrerez de grosses lames qui seront plus grosses qu’au passage de<br />
Trentemoult à Chantenay. Je recommande à mon frère de vous baptiser en passant par le détroit de Gibraltar car c’est réglementaire…“. Suit dans le même<br />
courrier un conseil nautique pour son frère “ … je te recommande de ne pas accoster le cap de la côte d’Afrique qui est par le travers du Cap de Gadès car<br />
plusieurs navires ont déjà été pris par le calme …“ (Dans le même registre le descendant d’un Capitaine Boju de Trentemoult raconte que sa grand’mère avait<br />
fait le voyage de San Francisco par le Cap Horn puis avait retraversé tous les Etats-Unis en train pour revenir embarquer à New York à destination du Havre<br />
… où elle avait accouché juste à temps. Le bébé en question est devenu dentiste ce qui lui faisait dire qu’il était certainement le seul dentiste du monde à<br />
avoir passé le cap Horn Avait-elle embarqué pour ce célèbre voyage du trois-mâts le “Canrobert“ commandé par le Cdt Boju qui avait mis 83 jours pour<br />
doubler le Cap Horn ?)<br />
# Vie familiale<br />
Les familles de cette communauté étaient soudées par une étroite solidarité. Elles partageaient les mêmes intérêts, les mêmes angoisses, les mêmes<br />
deuils. Les hommes étaient embarqués sur les mêmes bateaux, vivant 24H/24 entassés ensemble dans le gaillard d'avant, pendant que les femmes se<br />
retrouvaient entre elles pour s'entraider et commenter les rares nouvelles reçues par le courrier et la bouche des marins de retour qui avaient rencontré<br />
dans tel ou tel port un voisin ou un proche. Les drames mortels de la mer ponctuaient la vie du village, deuils d'autant plus pénibles à supporter que les<br />
dépouilles des marins "disparus" ne pouvaient pas être inhumées. Cette solidarité n'excluait pas, au contraire, les jalousies du genre : " Comment ce beaufrère<br />
fait-il pour trouver des voyages plus avantageux que toi ?". Mais ce métier de marin bien que dangereux était rémunérateur, ce qui permettait à nos<br />
villages de marins d'afficher une prospérité enviée par les autres habitants de la commune et continuait à susciter de nouvelles vocations de marins.<br />
La correspondance des Cinq Bureau donne de multiples preuves de la qualité et de l’intensité des relations familiales. La froideur des négociations<br />
nuptiales de Jean Bureau donne une idée déformée des sentiments profonds qui animaient ces familles de navigateurs en dépit – ou à cause – de leurs<br />
conditions de vie très difficiles.<br />
Depuis des millénaires, partout et dans tous les milieux, le mariage était avant tout l’union des intérêts économiques de deux familles. Il ne serait venu<br />
à l’idée de personne de livrer des enjeux aussi importants aux passions fugitives et brèves des jeunes gens. Le seul niveau de sécurité collective qui existait<br />
pour se prémunir contre les nombreux revers de l’existence - sans Etat providence, ni sécurité sociale, ni indemnités de chômage, ni prise en charge<br />
collective des alea de l’existence – était celui de la cellule familiale seule capable de protéger ses membres contre les méfaits des mauvaises récoltes, des<br />
décès prématurés, des maladies, de la vieillesse, des revers de fortune… des disparitions en mer. Ce n’est qu’à partir de 1880 qu’en France le nombre de<br />
mariages libres commence à dépasser celui des mariages arrangés, et principalement dans les milieux urbains évolués et salariés. (Dans les villages reculés de
la montagne corse ou les mariages arrangés étaient encore la règle il n’y a quelques dizaines d'années les jeunes gens pouvaient faire un mariage d’amour à<br />
condition de “s’enfuir“ ce qui signifiait qu’ils renonçaient symboliquement à bénéficier de la solidarité matérielle de leur clan familial.)<br />
Ernestine Bureau confrontée à la ruine financière et à la santé précaire de son mari ne pourra compter que sur le soutien familial pour élever – tant<br />
bien que mal - ses neuf enfants.<br />
Les familles de navigateurs étaient soudées par des liens étroits et encore plus étroits quand des frères épousaient des sœurs. Les liens<br />
professionnels étaient très nombreux. Les capitaines de Vertou engageaient de préférence sur leurs navires des marins originaires de Vertou, et en priorité<br />
les orphelins de marins disparus. Les capitaines confirmés formaient les futurs capitaines. On s’échangeait des tuyaux. On aidait les jeunes capitaines<br />
méritants à devenir armateurs en prenant des parts dans leurs navires. On portait souvent les mêmes patronymes. Tous ces marins se retrouvaient<br />
régulièrement dans tous les ports d’Europe. Les familles “intéressées“ suivaient de près les trajets des navires et la rentabilité des voyages, dont les<br />
résultats étaient abondamment commentés dans les chaumières du Chêne et de la Barbinière. Au-delà de la solidarité familiale il existait alors une très forte<br />
solidarité collective dans ces villages contrairement à nos village-dortoirs contemporains où triomphe un individualisme forcené.<br />
La correspondance des Cinq Bureau au-delà des formules de pure politesse laisse transparaître cette solidarité et cette chaleur familiale, entre<br />
frères, cousins, parents et alliés. Hortense Lancelot, la première épouse des Cinq Capitaines Bureau est désignée par ses beaux-frères “ma soeur bienaimée“,<br />
elle-même appelle sa belle-mère “ma mère“, et quand naît sa fille Hortense, il n’y a pas une seule lettre où ses oncles oublient d’évoquer leur nièce en<br />
des termes touchants, comme Jean Bureau : “ Je serai bien heureux à mon arrivée de la faire danser sur mes genoux. Je me figure qu’elle a pris beaucoup de<br />
raison depuis mon départ “. (Jean Bureau semble donc considérer que les femmes peuvent être dotées de raison ?). Ou encore : " Quand j’arriverai à Vertou,<br />
je pense qu’elle marchera seule car sur le Coteau l’air est sain et on doit vite apprendre à marcher, surtout avec Tante Marie qui a toujours su marcher vite“.<br />
(Selon moi cette dernière remarque rappelle ironiquement que sa tante Marie avait la réputation de faire marcher tout son monde “ à la baguette“).<br />
Les difficultés du métier et les tragédies de leur existence leur faisaient apprécier plus que d’autres les bonheurs simples et les moments délicieux<br />
passés à terre pour leurs congés et dont le souvenir atténuait les moments difficiles qu’ils traversaient souvent en mer. A défaut de voir grandir leurs petits<br />
êtres chers ils affichaient dans tous les ports du monde leurs prénoms affectueusement gravés sur la coque de leurs navires. Comme le brick “ La Pauline et<br />
Noëmie“ de Auguste Bureau baptisé du nom de son épouse et de sa fille chéries.<br />
Les bons moments passés à terre à Vertou sont constamment évoqués dans leurs lettres. Par exemple Auguste Bureau répond de Toulon à une lettre de<br />
son père : “ Mon cher père j’ai reçu votre lettre qui m’a fait un sensible plaisir d’apprendre que vous étiez tous en bonne santé et principalement à bord du “<br />
Georges “ à faire la noce. Ca me fait autant de plaisir comme si j’y étais et ce qui me fait le plus grand plaisir ce sont toutes ces signatures. Vous me dites<br />
qu’à bord du “Georges“ vous ne vous faites pas de chagrins. Vous faites sauter les bouteilles de Malaga. Ca me rappelle encore le temps où je faisais sauter la<br />
bonde d’un petit baril de vin blanc et les bouteilles d’absinthe à bord du “Georges“.<br />
Incidemment cette lettre soulève une question pratique. Que faisaient ces capitaines armateurs de leur navire quand ils étaient en permission à Vertou<br />
? Ils ne pouvaient pas le confier à un Capitaine remplaçant car la permission du Capitaine se serait prolongée pendant trop longtemps au hasard des frets.<br />
Pour les escales de courte durée ils pouvaient laisser leur navire en gardiennage au Quai de la Fosse. Mais pour des interruptions plus longues et notamment<br />
pour effectuer les indispensables travaux d’entretien de petit et de grand carénage il est vraisemblable que leurs navires remontaient la Sèvre jusqu’à<br />
Vertou. Echoués en aval de l’Ecluse de Vertou ou mouillés en amont charpentiers de navire, amis, parents et enfants pouvaient alors participer aux tâches<br />
d’entretien. Le carénage, tradition marine oblige, a toujours été l’occasion pour les marins de passer quelques bons moments à bord avec la famille et les amis.<br />
On peut émettre l’hypothèse que les navires mouillaient dans le bassin situé entre le Loiry et la route de Vertou, à proximité du Pont, car Jean Bureau parle<br />
dans l’une de ses lettres des navires qui sont dans les Payers, ce qui était sauf erreur de ma part le nom donné autrefois à ce plan d’eau par les habitants du<br />
Chêne.
# La fin des marins nantais<br />
On sait qu'à l’époque des cap-horniers, c'est-à-dire de 1894 à 1914 les marins nantais seront presque tous remplacés par des marins de Bretagne Nord<br />
(Paimpol, Cancale, St Malo, Bréhat), du Morbihan et de Normandie qui forment alors la grande majorité des équipages. Ce que le décrit le capitaine<br />
d'armement d’un armateur nantais cap hornier (voir bibliographie).<br />
" Les équipages des Voiliers Nantais se composaient pour les trois quarts de Malouins. St Malo, Paramé, St Enogat, St Lunaire, St Briac ont fourni la<br />
majorité des équipages des navires des Voiliers Nantais. Un quart seulement venait du Golfe du Morbihan; l'Ile aux Moines, Séné, Arradon. Composer un<br />
équipage était une chose, l'acheminer jusqu'au voilier une autre. Si le voilier se trouvait à Liverpool ou à Glasgow, on expédiait les marins par le service St<br />
Malo/Southampton de la South Western. Le train pour St Malo via Redon et Rennes partait alors de la gare de Chantenay, à 6 H. 20 du matin. Je vous laisse<br />
le soin d'imaginer le détail des scènes illustrant ce départ. Les gendarmes jouaient en l'occurrence le rôle des remorqueurs qui conduisent les voiliers hors du<br />
port. Ces remorqueurs, on les appelait effectivement ainsi, ne manquaient pas de questionner l'équipage lors du paiement des avances. Ils avaient, de plus,<br />
l'habitude des endroits fréquentés par les marins. Pour rassembler tout le monde à la gare de Chantenay, en l'absence de tout moyen de transport, il fallait<br />
s'y prendre de bonne heure. Vers 4 heures du matin, le ramassage commençait dans les boîtes du quai de la rue Fourcroy ou de la rue des Trois<br />
Matelots...Renonçant au folklore, il prit l'habitude de rassembler les hommes à St Malo. Les Morbihannais n'en éprouvaient aucun dommage et les Malouins<br />
épargnaient les frais d'un voyage. Tout se passait à St Malo, la visite médicale chez le Docteur Noury, le paiement des avances et l'établissement d'un rôle<br />
provisoire à la marine. Le recrutement était facilité par les relations amicales que mon père avait nouées, notamment avec le Capitaine Bregeon de St Lunaire,<br />
un collègue du Capitaine Cammartin, et en même temps le beau-père du Capitaine Briand, capitaine des Voiliers Nantais, Cap-Hornier, et qui fut, il y a encore<br />
peu d'années, Commandant du Port de St Malo “.<br />
Quand on examine les rôles d’équipages publiés par les Morrisseau sur leur site Internet (ref Bibliographie), on voit que ce mouvement a été amorcé<br />
bien avant l’époque des cap horniers. Déjà en 1875 la majorité de l’équipage du Capitaine Morisseau venait du Morbihan et des Côtes du Nord.Toutefois<br />
l’encadrement reste nantais pendant encore quelque temps.<br />
Un Capitaine cap-hornier trentemousin emblématique, le Capitaine Dejoie qui s’est illustré à plusieurs reprises pour avoir lancé des défis de vitesse à<br />
des cap horniers britanniques en Mer de Chine et sur la route Portland -Usa/Queenstown-Irlande Sud où il réussira à battre de 84 heures son concurrent le<br />
Penrose après 120 jours de navigation. Il fut aussi célèbre pour avoir gardé pendant 70 mois consécutifs le commandement de son navire, sans se faire<br />
remplacer. Son épouse l’accompagnera à bord pendant 18 mois, ce qui n’était pas considéré comme étant de bon présage par ses marins.<br />
De ce fait on ne compte souvent qu’un seul capitaine cap hornier dans chaque famille trentemousine de navigateurs: Boju, Dejoie, Bertrand, Lemerle,<br />
Codet, Soulas, Codet, Bertrand. Contrairement aux deux ou trois générations précédentes. On sait que les fils des capitaines nantais ont déjà tourné la page<br />
de la marine à voiles pour se diriger vers la marine mécanique ou militaire : marins et ingénieurs mécaniciens, officiers de marine. Ou vers des carrières<br />
terrestres de négociants, professeurs, cadres de l’administration et de l’industrie. Progressivement ils quittent la région au hasard de leurs affectations…<br />
oubliant progressivement leurs ancêtres navigateurs, leurs souvenirs et leurs tombes<br />
# Une compagnie de navigation d'origine vertavienne<br />
* * *<br />
Quelques vertaviens ont contribué à écrire une page de l’histoire de la marine marchande française. Les Lecour Grandmaison qui habitaient Vertou (il<br />
existe toujours une rue Lecour à Vertou) étaient une famille d’armateurs de voiliers de commerce. Ils créent en Janvier 1882 (mois de naissance de Célestin<br />
Gicquel) la Compagnie Nantaise de Navigation à Vapeur dont le siège est situé au 65 du Quai de la Fosse. Puis en 1885 c’est au tour de la Compagnie France-
Algérie. La CNNV sera l’un des tout premiers armements à se lancer dans l’aventure des navires à vapeur marchands au long cours !<br />
Pour bénéficier de la loi de prime ils créent en 1894 la SA des Voiliers Nantais, compagnie qui s’illustrera dans l’exploitation de 12 voiliers cap horniers<br />
construits entre 1894 et 1902 dont 4 de 2.500 T. et 6 de 3.100 T. Le premier Président de cette compagnie est un vertavien, Jean-Baptiste Lébeaupin<br />
Capitaine au Long Cours. Il a navigué en Mer de Chine et est réputé pour avoir osé en 1875 revenir du Pacifique par le Cap Horn exploit rare pour les<br />
Capitaines de sa génération C’est le Capitaine Bachelier de Vertou qui commandera le “Général Mellinet“ le premier navire de la série et il effectuera un<br />
voyage inaugural retentissant en reliant Swansea à San Francisco en 129 jours seulement. Ces sociétés ont donc été des pionniers de l’époque cap hornière.<br />
Dans le même temps les actionnaires des Voiliers Nantais décident de créer de toute pièce un nouveau chantier naval, les Chantiers Nantais présidé par<br />
le sénateur Henri Le Cour-Grandmaison où seront construits 28 voiliers cap horniers. Ce chantier occupait l'emplacement de l'actuelle centrale électrique de<br />
Chantenay. Ils créent également en 1902 la Compagnie des Chargeurs de l'Ouest qui fera construire de 1903 à 1904 par les Chantiers Nantais des petits<br />
navires à vapeur de 1200 et 2000 T de port en lourd qui sillonneront vaillamment toutes les mers du globe dans des conditions d’inconfort que l’on peut<br />
imaginer : Australie, Madagascar, Indochine, Amérique du Sud. Deux cargos de cette compagnie, le “Henri Le Cour“ et le “Charles Le Cour“ seront torpillés au<br />
cours du premier conflit mondial.<br />
En 1913, c’est le début de la fin pour les cap horniers. Les Voiliers Nantais fusionnent avec les Chargeurs de l’Ouest toujours. En Octobre 1917 la<br />
Compagnie Nantaise de Navigation à Vapeur, elle aussi chargée d'histoire, passe entre les mains de la Compagnie Générale Transatlantique et des Chargeurs<br />
de l'Ouest. Quand la "Transat" se retire en Décembre 1937 la Nantaise de Navigation à Vapeur est absorbée par Les Chargeurs de l'Ouest sous la nouvelle<br />
raison sociale de "Compagnie Nantaise des Chargeurs de l'Ouest" (CNCO). La compagnie s’installe alors dans son nouveau siège de la Place du Sanitat à<br />
Nantes.<br />
La CNCO fut la dernière compagnie de navigation d’origine nantaise. Pendant 80 ans la CNCO suivra les évolutions techniques et commerciales de la<br />
marine marchande française et accompagnera sa longue agonie. Elle sera absorbée à son tour par la vénérable Compagnie des Messageries Maritimes qui<br />
fusionnera en 1974 avec la non moins vénérable Compagnie Générale Transatlantique qui toutes deux sombreront piteusement quelques années plus tard!<br />
# Mémoires d’un marin de Vertou<br />
Evidemment nous ne disposons d'aucun témoignage oral de cette époque. C'est ce qui fait l'intérêt de la transcription d'un entretien entre un<br />
journaliste du Phare daté du 22 Décembre 1940 et François Bureau un navigateur originaire de Vertou alors âgé alors de 97 ans, né en Décembre 1844, fils<br />
de Anne Richard et de Jean Bureau, dont la carrière est exemplaire. (NB – cet article a été retrouvé par Michel Kervarec).<br />
“Moussaillon à 10 ans sur un brick, Chef Mécanicien sur les grands paquebots de la Transat, le père des Hirondelles de la Sèvre, un des doyens de notre<br />
marine avec ses 97 ans a traversé quelque cent quatre-vingt quinze fois l’Atlantique.<br />
Une personnalité nantaise bien connue. C’est lui qui créa le service des Hirondelles de la Sèvre il y près de cinquante ans, à une époque où il faisait bon<br />
vivre dans la quiétude des jours heureux. Bien de l’eau a coulé sous les ponts de Vertou…Le seul titre qui évoque tant d’agréables promenades suffirait à nous<br />
rendre François Bureau plus sympathique encore. Mais la création du service des Hirondelles et son exploitation ne constitueraient pour F. Bureau que les<br />
occupations d’une fin de carrière pleinement accomplie.<br />
Aujourd’hui M. Bureau se repose d’une vie ardente dans sa propriété de la Civelière, près du terminus des tramways de Sèvre. C’est là qu’il nous a fort<br />
aimablement reçu. La conversation, la précision des souvenirs, l’affabilité enfin du doyen des marins français en font une personnalité extrêmement<br />
attachante. Le récit de sa vie n’est qu’une longue suite d’efforts pour le mieux-être. Quel plus bel exemple pourrait on offrir aux jeunes générations qui
interrogent l’avenir ?<br />
Marin depuis toujours : M. François Bureau appartient à une famille de marins. Depuis toujours cette communauté familiale habitait Vertou qui était<br />
alors un centre de recrutement pour notre marine à voiles… de rudes gars au demeurant qui savaient carguer une voile ou prendre un ris… Le père de F.<br />
Bureau était Capitaine au Cabotage. Il disparut tragiquement avec son navire en 1846, dans le Golfe de Gascogne, ainsi que son fils aîné qui servait à bord<br />
sous les ordres de son père. Le petit François, notre doyen aujourd’hui avait alors deux ans. Louis-Philippe régnait sur la France. Des deux frères de F.<br />
Bureau, disparus depuis, le premier devint plus tard capitaine au Long Cours. Le second entra dans les ordres et professa au Séminaire des Couëts avant de<br />
devenir vicaire de St Philbert de Grandlieu et curé de Couffé. M. F. Bureau avait donc de qui tenir. La mer avait pris son père et son frère aîné ; le cadet lui<br />
avait consacré sa vie. Comment dans ces conditions le jeune François n’aurai-il pas été attiré irrésistiblement vers elle ? Tout enfant alors qu’il fréquentait<br />
l’école communale de Vertou il manifestait déjà des goûts passionnés pour la navigation. C’est de là que dès 1855 il s’embarqua comme mousse sur un brick de<br />
Nantes, le “Courrier de Marseille“ que commandait un de ses oncles. C’était un petit voilier que commandait un de ses oncles. C’était un voilier qui portait sept<br />
hommes d’équipage, tous originaires de Vertou. Dès son arrivée à bord, le jeune François qui n’était alors âgé que de dix ans et demi fit ses premières armes<br />
dans les focs et la brigantine. Puis le brick quitta le Quai de la Fosse pour les pays scandinaves. Le coeur du petit François battit très fort ce jour-là….<br />
Premier voyage : On comprend que ce premier voyage – qui date de 86 ans – ait laissé dans l’esprit de M. Bureau des souvenirs impérissables.<br />
Q -Qu’avez-vous retenu de ce contact avec la terre étrangère ? R – Ce qui m’a le plus frappé en arrivant en Suède c’est de voir des bateaux à aubes<br />
mus par des femmes. Ces robustes marinières tournaient des manivelles, des sortes de treuils, pour actionner les roues à aube. Et les navires glissaient sur<br />
les eaux du golfe comme si ils avaient été propulsés par la vapeur.<br />
Q- La température de ce pays a dû vous surprendre un peu ? R – Oui ! car je n’étais alors qu’un enfant. Tout pour mois était merveilleux. Ainsi en<br />
arrivant en Norvège je fut stupéfait de ne rencontrer aucun passant dans les rues. Les magasins étaient fermés bien que nous fussions en plein jour. J’eus<br />
bientôt l’explication de ce phénomène. Il était onze heures du soir et nous étions à l’époque du soleil de minuit. C’était la nuit blanche nordique. Toute la<br />
population était couchée. Le brick revint peu après à Nantes chargé de bois scandinave et s’amarra au Quai de la Fosse.<br />
A ce propos, M. F. Bureau nous expose la très curieuse situation des équipages à cette époque lointaine. Les sept hommes du brick habitaient Vertou.<br />
Mais en 1855 il existait que fort peu de moyens pour se rendre à cette localité. A pied avec des fardeaux et bagages. La chose n’était pas facile.<br />
Heureusement il existait alors un cours d’eau qui prenait près des Chantiers, au pied du transbordeur actuel et débouchait en Loire en face de la Haute Ile,<br />
après avoir traversé toute la Prairie au Duc. Il s’appelait le Fendi. Comme les marins de l’équipage devaient se rendre à Vertou pour y voir leurs familles et<br />
porter au blanchissage le linge de bord. Nous prenions de concert le canot du brick et par le Fendi, la Loire et la Sèvre nous remontions jusque chez nous.<br />
Mais il fallait souquer dur sur les rames.<br />
Après deux années de navigation maritime le jeune mousse s’engagea sur un bateau de plaisance “La Folie“ vapeur à roue à aubes qui sillonnait les eaux<br />
de la baie de Bourgneuf. Ces croisières lui donnèrent le goût de la mécanique. Pour compléter ses connaissances professionnelles le jeune homme entra en<br />
apprentissage chez un mécanicien puis devança l’appel de sa classe pour être affecté à la Marine Nationale. Quant il eut terminé ses sept années de service<br />
militaire M. F. Bureau put choisir la carrière de ses rêves. Il fut agréé par la Cie Gle Transatlantique en qualité d’élève mécanicien. Une vie ardente et<br />
prometteuse s’ouvrait devant M. F. Bureau.<br />
Sur le Panama et la Champagne : Le jeune élève mécanicien s’embarqua sur le panama, l’un des plus spacieux de l’époque, qui faisait la ligne St Nazaire-<br />
Santander puis l’Amérique centrale. Hélas ! Le beau navire en séjournant dans le port espagnol fut poussé en travers par la marée et s’éventra sur les rocs. M.<br />
F. Bureau participa au renflouement. A maintes reprises il plongea en scaphandre pour remettre le bâtiment à flot. Quelques semaines plus tard le Panama en<br />
remorque faisait son entrée à Lorient.
M. F. Bureau embarqua ensuite sur divers navires de la Cie Gle Transatlantique, accédant aux divers grades de la hiérarchie maritime à mesure que<br />
s’affirmait sa grande valeur professionnelle. Mais c’est surtout sur la Champagne qu’il accomplit la plupart de ses voyages intercontinentaux. Il y occupait la<br />
fonction de Chef Mécanicien, grade de la plus haute importance sur tous les navires …New York, Montréal, l’Amérique du Sud, les Antilles furent visités par<br />
cet intrépide marin …De retour au pays : De retour au pays en 1893, M. F. Bureau créa un service de transports fluviaux sur la Sèvre. La chose n’était pas<br />
facile, mais F. Bureau ne manquait ni de compétences ni d’initiatives. Il acquit un navire à chaudière à tubes et à hélices destiné primitivement au Chili.<br />
Bientôt un second puis un troisième bateau vint compléter l’équipement de la ligne. Pendant près de quarante années les gracieuses Hirondelles<br />
transportèrent des centaines de milliers de voyageurs et de promeneurs sur la pittoresque Sèvre…“<br />
Cette carrière est un résumé des extraordinaires mutations qu'ont connues nos ancêtres navigateurs entre 1850 et 1950, de la voile à la navigation de<br />
plaisance, en passant par les grands paquebots transatlantiques à vapeur.<br />
* * *
# Vertou et Trentemoult<br />
On sait déjà que les liens familiaux et professionnels tissés entre les familles de navigateurs de Trentemoult et de Vertou étaient nombreux.<br />
(Les spécialistes de l'histoire de Rezé nous pardonneront de dire Trentemoult pour désigner de façon globale les quatre villages de marins de Rezé:<br />
Trentemoult, Norkiouse, La Basse Ile, La Haute Ile situés sur les deux îles de Trentemoult et des Chevaliers, lesquelles primitivement séparées ont<br />
été réunies en une seule île, dite Ile de Rezé longue d’environ 3500m et large de 500m, séparée de la terre ferme par le Seil qui était le cours terminal<br />
de la Sèvre nantaise avant l'intervention de St Félix .<br />
Rezé est aujourd’hui une importante commune de l'agglomération nantaise au sud de la Loire. Dans les années 1950, la commune de Vertou restée<br />
rurale et catholique au milieu de ses prairies et de ses vignobles, semblait aux antipodes de Rezé, banlieue urbaine et socialiste. Mais au XIXème elles<br />
étaient sociologiquement comparables, majoritairement rurales, limitrophes sur une longue distance, bordées toutes deux par la Sèvre. Elles avaient<br />
chacune leurs villages de populations non agricoles isolés du reste de la commune. Ce n’est qu’en 1848 qu’un premier pont de bois relie le village du<br />
Chêne au bourg de Vertou et qu’un pont relie l’Ile de Rezé au bourg de Rezé.<br />
Rappelons que la commune des Sorinières n'a été créée qu'au milieu du XIXème, prélevée au nord sur la vaste commune de Vertou. Avant la<br />
création "artificielle" de cette commune Rezé n'était bordé que par deux communes, Vertou au sud et Bouguenais à l'ouest. De ce fait des liens de<br />
toute sorte existaient entre vertaviens et rezéens, ce que confirme la visite du cimetière St Pierre de Rezé où on retrouve de nombreux patronymes<br />
communs à Vertou : Thébaudeau, Priou, Peneau, Dejoie, Farineau, Bureau, et particulièrement ceux de notre généalogie familiale : Ertaud, Fruneau,<br />
Agaisse, Aubin, Heurtin, Lancelot, Bessac.<br />
Tombe de Stylitte et Adrien Ertaud
La tombe de Adrien Ertaud (1808-1896) , grand-père maternel de Ernestine Bureau et de son épouse Stylitte Bessac est la voisine, on<br />
apprendra plus loin la raison de cette proximité, de celle de Pierre Bureau le frère de Jean Bureau, en compagnie de son épouse Hortense Lancelot et<br />
de sa fille Jeanne. En face d’elle se trouve la tombe de leur fille Laure en compagnie de son mari Aristide Briand et de ses enfants. L’état d’abandon de<br />
la plupart de la plupart des tombes maintenues en place par leur statut de Concession à Perpétuité témoigne que leurs descendants ont émigré depuis<br />
longtemps vers des métropoles éloignées de leurs racines.<br />
# Le privilège de pêche<br />
Les habitants de Trentemoult bénéficiaient d’un privilège de pêche en Loire qui peut fournir le fil conducteur de la vocation maritime de<br />
Trentemoult… et par ricochet de celle de Vertou. Ses habitants ainsi que ceux de Bouguenais et de la paroisse de Ste Croix au cœur historique de la<br />
ville de Nantes, bénéficiaient depuis le début du XIVème d’un privilège de pêche couvrant l’Estuaire de la Loire de Ingrandes jusqu’à Paimboeuf. Ce qui<br />
leur permettait d’aller pêcher en mer au large de la presqu’île guérandaise et dans la baie de Bourgneuf. Leur zone de pêche en mer couvrait donc un<br />
triangle formé par l'Ile d'Yeu, Belle-Ile et Paimbeuf. Leur zone de pêche bordait deux zones de production de sel, au nord de la Loire les marais de<br />
Guérande et au sud ceux de Bourgneuf. Avec leur quasi privilège de circulation sur l'Estuaire de la Loire nos ancêtres trentemousins exerçaient une<br />
sorte de contrôle sur la circulation de deux produits importants : le sel el le poisson.<br />
En contrepartie de ce privilège la corporation devait payer une redevance à qui de droit. Il faut rappeler que sous l’Ancien Régime, peu centralisé<br />
et peu administré, les services publics et les ouvrages d’art étaient à la charge des autorités locales : monastères, églises, communes, seigneuries. A<br />
charge pour chacune de prélever sur le dos des usagers les sommes nécessaires à la couverture de son budget de construction et d’entretien. La<br />
ressource de pêche riche et abondante était taxée au même titre que le sel ou le bétail … et c'était aux pêcheurs d'acquitter les redevances auprès<br />
de l'autorité concernée. En contrepartie de ce prélèvement fiscal leur droit de pêche était protégé et défendu pied à pied par ses bénéficiaires,<br />
comme le montrent leurs innombrables démêlés judiciaires.<br />
Les habitants du Chêne et de la Barbinière à Vertou bénéficiaient de privilèges comparables pour la pêche et la batellerie. Ils acquittaient les<br />
droits correspondants au seigneur du Pallet. La corporation de charpentiers de navires obéissait également à des règles corporatistes très strictes.<br />
Ces privilèges ont eu comme effet de spécialiser certains villages, quartiers ou familles dans des métiers bien précis transmis jalousement de<br />
génération en génération. Ils ont contribué à enraciner dans nos villages fluviaux et dans nos familles d'origine une spécialisation maritime et para<br />
maritime.<br />
# Les monnayeurs de Trentemoult<br />
Les habitants des Iles de Rezé, notamment ceux de la Haute Ile, avaient une particularité curieuse. Certains bénéficiaient du privilège<br />
d'exercer le métier de monnayeurs à l’Hôtel de la Monnaie à Nantes. Celui-ci qui existait depuis le plus haut moyen –âge était un instrument<br />
indispensable pour jouer son rôle de Cité marchande. Situé en plein coeur de son centre historique on y frappait des monnaies, mais on y ouvrageait<br />
aussi des pièces d’orfèvrerie indispensables pour faciliter les échanges et matérialiser la réussite financière des négociants et bourgeois nantais.
Monnaie frappée à Nantes<br />
Certains ont avancé l’hypothèse –jamais confirmée par aucun document - que cette spécialité avait été réservée dans les temps reculés à des<br />
familles d’orfèvres ibèro-juifs. Selon eux les patronymes de familles de monnayeurs de la Haute Ile pourraient être d'origine ibérique : Ollive<br />
viendrait de Ouvares = orfèvre, Dejoie viendrait de De Joyas = bijoux et Ertaud viendrait de Artezano = artisan ! Cette hypothèse est toutefois<br />
troublante à la lumière de certaines constatations. L’importance commerciale de la Place de Nantes nécessitait la mise en oeuvre de techniques<br />
financières et monétaires évoluées, ce qui était le rôle traditionnel de la communauté juive active à Nantes depuis les temps les plus reculés et dont la<br />
présence est attestée de nos jours par la rue de la Juiverie en plein cœur du centre historique de Nantes juste derrière l’Hôtel de la Monnaie. On sait<br />
également que de tout temps les relations de Nantes avec la péninsule ibérique ont été étroites. Nantes était une cité commerciale et cosmopolite<br />
ainsi qu'un point de passage pour les pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle.<br />
Or en 1260 Jean le Roux, Duc de Bretagne expulse les juifs de son duché. Comme par hasard c'est à cette date que les Templiers s'installent à<br />
Rezé dans l’Ile des Chevaliers d'où elle aurait tiré son nom. Avec un peu d’imagination on peut imaginer que les habiles Templiers auraient installé à<br />
Rezé sous leur protection des familles ibéro-juives chassées du centre de Nantes qu'ils auraient "converties" pour la forme tout en christianisant leur<br />
patronyme. Quoiqu'il en soit, il est certain que la population de Trentemoult est un patchwork de populations de pêcheurs, de monnayeurs, de<br />
gabariers, de tourangeaux, de poitevins venues par la mer, par la Loire, ou par la Sèvre…<br />
On en sait beaucoup plus sur ces pêcheurs-monnayeurs grâce aux recherches de Vincent Bugeaud l’historien-chercheur déjà cité qui leur<br />
consacre sa thèse. Les monnayeurs exerçaient à l'Hôtel de la Monnaie de Nantes les tâches matérielles de frappe et de réglage des pièces de monnaie.<br />
C'était une activité d'intérimaire plutôt mal rémunérée. Mais cette fonction était assortie de privilèges fiscaux tout à fait intéressants qui les<br />
exonéraient d'une quantité de charges, d'impôts, de corvées. Ils avaient, du point de vue fiscal, des avantages comparables à ceux de la noblesse. Ces<br />
privilèges étaient bien entendu à la fois jalousés et enviés. Comme ces privilèges étaient transmissibles ils ont donné lieu à des stratégies<br />
matrimoniales subtiles dans cette petite communauté insulaire de Rezé. Les monnayeurs les plus nombreux venaient de Rezé, les autres venant
principalement de Indre (petite commune en bord de Loire). De façon curieuse on observe que 85 % des Maîtres au Cabotage de la première moitié du<br />
XIXème étaient originaires des trois communes de Rezé, Vertou et Indre (plutôt que de commune il faudrait parler pour Rezé de ses trois villages<br />
insulaires la Haute Ile, Norkiouse, Trentemoult et pour Vertou de ses deux villages en bord de Sèvre, Le Chêne et la Barbinière).<br />
Les pêcheurs-monnayeurs de Trentemoult bénéficiaient donc d'un double privilège, celui de pêche et celui de monnayage. De quelles<br />
avantageuses contreparties bénéficiaient les autorités qui accordaient ces privilèges convoités par tous à une population bien ciblée de pêcheurs et<br />
marins ? Mystère. Mais ce double privilège ne leur suffisait pas. Ils s'en sont octroyé d'autorité un troisième, celui de la contrebande !<br />
# Les contrebandiers de Trentemoult<br />
Trentemoult Vue aérienne<br />
En s'intéressant aux archives qui concernent les pêcheurs-monnayeurs notre historien a découvert que les pêcheurs de Trentemoult étaient<br />
également des contrebandiers quasiment professionnels. Les archives judiciaires du XVIIIème sont riches de rapports judiciaires qui relatent les<br />
nombreux démêlés entre les contrebandiers trentemousins et les douaniers de l'époque, appelés fermiers, Il apparaît que la contrebande concernait<br />
principalement le trafic de tabac au départ de l'Ile d'Yeu, qui était alors une zone franche et par laquelle transitait le tabac venu des Pays-Bas, puis<br />
transporté et écoulé par les contrebandiers de Trentemoult. Les nombreuses tentatives des fermiers, y compris manu militari, pour neutraliser nos<br />
ancêtres contrebandiers échoueront lamentablement devant leur farouche et menaçante détermination de ne pas laisser entraver leur juteuse activité<br />
parallèle.<br />
Mais on comprend que ces activités étaient assez complémentaires et “naturelles”. Leur privilège de pêche dans l’estuaire de la Loire faisait<br />
qu’ils en étaient les meilleurs connaisseurs, ce qui leur donnait l’avantage pour certains d’être pilote de Loire et pour d’autres de naviguer de nuit, avec
des voiles noires pour faire remonter le tabac de contrebande vers l’intérieur des terres en déjouant les pièges des bancs de sable du fleuve et les<br />
embuscades des chaloupes douanières.<br />
# De la pêche au cabotage<br />
Entre les privilèges officiels de pêche et de monnayage et les privilèges officieux de contrebande, les habitants des îles de Rezé ne manquaient<br />
pas de ressources. Ces privilèges vont disparaître avec l'Ancien Régime, hélas pour eux, mais ils bénéficieront toujours de l’avance technique,<br />
professionnelle ... et financière acquise de longue date dans les activités de transport maritime et fluvial. Ce qui leur donnera l’opportunité d'occuper<br />
les premiers le créneau offert par l'explosion de la demande de transport fluvial et maritime au début du XIXème.<br />
On sait naviguer. On a les hommes. On sait construire les bateaux. On a même les moyens de les financer. En quelques années la communauté de<br />
Trentemoult va se mobiliser pour contrôler l’activité renaissante de cabotage national et international dont Nantes est la première place française (il<br />
est préférable de parler de place plutôt que de port car les navires nantais employés au cabotage touchaient rarement le port de Nantes).Les<br />
navigateurs de Trentemoult – Vertou - Indre contrôlent une bonne partie de cette activité. Les statistiques sont parlantes. Sur les six cents Maîtres<br />
au Cabotage diplômés au cours du XIXème recensés par les archives maritimes, les deux tiers sont d’origine trentemousine, un sixième est d’origine<br />
vertavienne et indraise. Comme sous les pieds de chaque capitaine au Cabotage il y a un navire, il est facile d’imaginer que les navires sont commandés<br />
par des trentemousins et vertaviens dans la même proportion. Ces navires sont construits dans les chantiers de Trentemoult et de Chantenay et même<br />
à Vertou à une époque plus tardive. Le rôle maritime de Trentemoult va diminuer progressivement en même temps que celui du cabotage jusqu’à sa<br />
disparition quasi complète à la fin du XIXème. La participation des trentemousins à l'activité cap-hornière au début du XXème sera plutôt symbolique.<br />
L'aventure de ces communautés de navigateurs du début du XIXème est passionnante et riche d'enseignements. On voit une communauté<br />
solidaire qui prend en main son destin, qui ose, qui entreprend, qui prend des risques, qui réussit à contrôler de A à Z une filière professionnelle et qui<br />
pratique spontanément un capitalisme familial à la fois efficace et humain.<br />
# L’ Inscription Maritime<br />
J’ai conservé pour la fin une clé essentielle pour comprendre l’existence d'une communauté maritime à Vertou. Il s'agit de l'Inscription<br />
Maritime, une Institution créée par Colbert et qui encadre toutes les professions maritimes et assimilées. Marins, capitaines, pêcheurs, charpentiers<br />
de navires étaient tous enrôlés dès leur plus jeune âge sur les listes de l’IM, de façon à être mobilisables à tout moment pour servir sur les vaisseaux<br />
(ou dans les Arsenaux) du Roi, de l’Empereur ou de la République. Les Inscrits Maritimes appartenaient de ce fait à une classe de population bien à<br />
part, semi militaire en quelque sorte, et à ce titre organisée et administrée dans les moindres détails par l'Administration. Ce qui incidemment permet<br />
de nos jours à tout historien amateur de reconstituer assez facilement la carrière d’un ancêtre marin ce qui n'est pas possible pour un ancêtre terrien<br />
laboureur ou artisan.<br />
L’Inscription Maritime a été créée par Colbert en 1670 à partir d’un double principe : faire l'inventaire systématique des marins français tenus à<br />
la conscription obligatoire avec en contrepartie un système de protection sociale novateur qui existe encore et qui est l’ancêtre de tous les régimes de<br />
protection sociale. Cette organisation a donné à la Marine militaire française une grande efficacité. Si au XVIIIème nos colonies ont toutes été<br />
perdues c’était uniquement à la suite de lamentables défaites militaires sur terre où la lâcheté s’était associée à l'incompétence et à la trahison.<br />
Dans chaque port de France il existait un représentant de l’ IM, Administrateur ou Syndique selon son importance. Vertou comme tout port<br />
maritime avait au début du XIXèmes son Syndique dont on trouve une trace dans une correspondance de Auguste Bureau écrite de Toulon : “ le<br />
commissaire de notre bord m’a demandé si je connaissais le Syndique de Vertou. Je lui ai dit qu oui et même que nous étions parents et que je le
connaissais parfaitement …ne vous trompez pas c’est Bureau Grosjean de Portillon, ce n’est pas Bureau (illisible) de Nantes“.<br />
Si on en juge par les lettres des cousins Bureau ce service militaire n’apparaissait pas comme une corvée pour nos marins vertaviens, bien au<br />
contraire. Ils exerçaient un métier qu’ils connaissaient à la perfection. Ils percevaient une solde correcte. Leur bel uniforme pouvait leur laisser<br />
espérer, à tort, qu'ils pourraient séduire les " demoiselles du Bourg". Ils complétaient leur formation en apprenant l'anglais ou la navigation<br />
astronomique. Ils visitaient dans de bonnes conditions plusieurs ports et pays.... Ils apprenaient beaucoup au contact de collègues venus d'autres<br />
horizons. Ils avaient l'opportunité d'assister de près à la prodigieuse révolution de la technologie maritime. Le service militaire du marin français<br />
jouait en quelque sorte le rôle d'une école de formation.<br />
L'éclosion surprenante de marins et capitaines à Vertou résulte finalement de la conjonction de plusieurs facteurs : l'existence d'une population<br />
para-maritime de pêcheurs, gabariers, charpentiers de navires; le rôle de l'Inscription maritime qui conférait à cette population spécialisée le droit et<br />
le devoir d'exercer la profession de marin; puis si la capacité y était celle de capitaine; l'explosion des besoins de transport maritime au début du<br />
XIXème ...Le rôle fondamental de l’IM dans cette spécialisation est confirmé par le fait que toutes les familles de navigateurs de Vertou sans<br />
exception sont initiées par un gabarier ou un charpentier de navire.<br />
L'exception maritime de Vertou, étonnante par le nombre de ses marins et surprenante par son éloignement de la mer plonge ainsi ses racines<br />
dans une spécialisation socio-professionnelle héritée des privilèges corporatifs de l'ancien régime et qui perdurait encore au tout début du XIXème. Il<br />
m’aura donc fallu faire un long détour par Trentemoult pour percer le mystère des origines de la vocation "maritime" de certaines familles<br />
vertaviennes.
# Famille Ertaud : Ernestine et les autres …<br />
Ernestine, Gédéon,Adrien, Styllitte, Aglaë<br />
Les origines de Ernestine Ertaud, l'épouse de Jean Bureau, ont été évoquées à plusieurs reprises. Une photo datant de 1855, la plus ancienne de la famille,<br />
montre toute la famille de Adrien Ertaud. C'est la reproduction papier d'un daguerréotype dont l'original est détenu par Suzanne Briand. On comprendra bientôt<br />
pourquoi. Sa soeur Aglaë épouse Noël Fruneau boulanger à Trentemoult. Ils auront cinq fils et deux filles, la première décédée à 17 ans. La seconde Ernestine<br />
Fruneau a comme marraine sa cousine Ernestine Bureau. Elle épouse Prosper Janeau un négociant de Nantes. Elle est la grand'mère de Catherine Gander - Janeau.
Ses deux frères, Félix et Georges, épouseront deux sœurs Le Tilly Albertine et Mathilde dont le frère Ernest a épousé de son côté Ernestine Bureau dans les<br />
conditions déjà racontées. La descendance de Aglaé Fruneau - Ertaud est nombreuse et encore bien représentée à Nantes. On peut voir à Trentemoult l’emplacement<br />
de l’ancienne boulangerie Fruneau qui a été rénovée pour les besoins du film cité. Au cimetière de Rezé la tombe des Fruneau se remarque avec ses 23 plaques<br />
d’identité.<br />
Le frère de Ernestine Ertaud, Gédéon Marie Ertaud, est Capitaine au Long Cours et armateur de son brick baptisé “Gédéon Marie”. Il épouse Marie Gohaud<br />
originaire de St Sébastien, une commune limitrophe de Rezé et de Vertou.<br />
Adrien le père de Ernestine est l'un des deux fils de Sébastien et de Catherine Hautebert, laquelle est la descendante d’une Marguerite Lancelot et au-delà<br />
d'un Noël Lancelot dont il sera question plus loin. Leurs deux fils Adrien (1809-1896) et Félix sont Capitaines au Cabotage et leurs deux filles épousent des<br />
Capitaines au Cabotage : Aglaé épouse François Allain et Clarisse épouse Abel Adrien Lancelot l’un des fils de François Joseph Lancelot (voir plus loin).<br />
# Gédéon Ertaud<br />
Gédéon Ertaud est le Capitaine-armateur d'un gros brick , le “ Gédéon-Marie ” (référence AD 3 P 572) qui peut naviguer au long cours , et dont les<br />
caractéristiques principales sont les suivantes :<br />
Mise en service le 5 Sep 1866<br />
Brick de 252 Tx de jauge - Longueur : 30,64 - Largeur : 7,88 - Creux : 4,21<br />
2 Mâts - Coque Doublée Cuivre – 4 Huniers carrés de misaine<br />
Construit par les chantiers Boju&Bertrand à Trentemoult<br />
Intéressés : Legal Chevreuil & Fréres, Négociants Armateurs à Nantes, 280 Millièmes – Félix Allain, Forgeron à Trentemoult - Noël Bertrand, Constructeur<br />
de navires à Trentemoult - Jean-Baptiste Boju, Constructeur de Navires à Trentemoult - René Leroux, Cordier à Nantes - Hilaire Russeil, Voilier - Adrien Sébastien<br />
Ertaud, Maître au cabotage, Trentemoult, 40 Millièmes - Gédéon Ertaud, Cap itaine au LC, demeurant à St Sébastien, 470 Millièmes<br />
Premier Capitaine Burban. Puis Gédéon-Marie Ertaud à qui est accordé un congé de Commandement le 7 Novembre 1867.<br />
Le 22 Nov. 1879, le navire est vraisemblablement cédé à la famille Hautebert de Basse-Indre qui acquière la majorité des parts du navire et dont le capitaine<br />
est désormais J. Hautebert.<br />
Signalement du navire :<br />
En Sep 1877 charge de Nantes à la Trinidad<br />
En Mai 1878 charge au Havre pour Kotka (Finlande)<br />
En Oct. 1878 charge à Nantes pour La Guadeloupe<br />
En Juil 1879 charge à Cayenne pour Cap Haïtien<br />
En Jan 1880 charge à Nantes pour la Martinique<br />
En Juil 1880 quitte Nantes sur lest pour Kotka
En Jan 1881 charge à Nantes pour Maurice<br />
En Fev 1881 quitte ? pour La Réunion<br />
En Juil 1882 quitte Pondichéry pour Maurice<br />
Le 17 Juillet 1882 il fait naufrage dans l’Océan Indien<br />
Le navire a toujours été commandé par Gédéon Ertaud, sauf pendant ses congés. Le navire n'a pas porté chance à ses Commandants de remplacement. Benjamin<br />
Soulas qui le commande en 1870, décède à 32 ans à bord du Gédéon-Marie à Camaret. (Le Mémorial des marins de Rezé indique qu’il serait mort de la fièvre jaune au<br />
cours d’une traversée Saïgon-Europe). En 1880 Jean-Baptiste Aubin qui le commande est grièvement blessé à Cayenne. Rapatrié il meurt en vue de Gibraltar où il fut<br />
inhumé.<br />
En fin de carrière Gédéon Ertaud reprendra du service comme Capitaine d’armement de la Cie des Armateurs Nantais et à ce titre il suivra la construction du<br />
“Cassard” cap-hornier de prime qui terminera ses jours de bien triste façon au cours de son cinquième voyage en 1906. Citons le Cdt Lacroix :<br />
" Dans le courant de mai 1906, venant de l'Oregon, ayant doublé le Cap Horn pour revenir en Europe, Cassard trouva de gros vents d'ENE établis au large de la<br />
Terre" de Feu, avec du temps pluvieux et bouché, mer très grosse. Depuis plusieurs jours sans observations le Capitaine Lemoine allait se décider à prendre les<br />
amures à babord craignant de se trouver trop près des Iles Malouines. Tout à coup il toucha sur les rochers de Blaker Island. Le navire s'entrouvrit par le travers de<br />
son grand panneau et coula; La terre était proche et les hommes purent y aborder à la nage. Après huit jours de souffrances dans le dénuement le plus absolu, un<br />
remorqueur vint les recueillir pour les mener à Port Stanley. Navires et chargement furent vendus aux enchères 99 livres".<br />
Fernand, le fils de Gédéon naviguera jusqu’à l’âge de 40 ans puis mettra sac à terre à son mariage. Il a servi comme Lieutenant sur le Dupleix, cap hornier lancé<br />
en 1901, appartenant au même armateur que le Cassard. Ce navire a vécu de nombreuses aventures avant de finir coulé par Von Luckner de la Kriegsmarine en 1917.<br />
Son fils sera Officier Mécanicien de la Marine nationale …et brillant Ingénieur nucléaire.<br />
# André Ertaud (1910-2003)<br />
André Ertaud, né en 1910 et décédé le jour de Noël 2003 à l'âge de 93 ans, est le fils de Fernand Ertaud. Après des études brillantes aux Arts et Métiers de<br />
Paris il intègre en 1930 le corps prestigieux des Ingénieurs Mécaniciens de la Marine Nationale où il se spécialisera dans les sous-marins. Il termine sa carrière<br />
comme Ingénieur Mécanicien en Chef de 1 ère Classe, l’équivalent de Capitaine de Vaisseau. Commence alors pour lui une nouvelle carrière dans le domaine de l’énergie<br />
nucléaire et il participe activement à la mise en place du programme de nucléaire civil de la France. Il a gardé quelques souvenirs de son grand-père Gédéon disparu en
1917 alors qu’il avait 7 ans. Son grand-père né en 1840 avait 8 ans à la fin du règne de Louis-Philippe… A tous les deux ils recouvrent 163 années de l’histoire maritime<br />
de notre pays.<br />
André Ertaud est le dernier maillon d’une lignée de plusieurs générations de Navigateurs trentemousins qui a traversé cinq siècles sur une période de 325<br />
années, depuis le premier Ertaud Julien répertorié dans les registres d’Etat-civil de Rezé certainement pêcheur en passant par André (1713), pêcheur; par (1757)<br />
pêcheur et pilote ; par Sébastien (1787) Capitaine de navire ; par Adrien(1809) Capitaine au Cabotage ; par Gédéon (1840) capitaine-armateur ; par Fernand Cap-<br />
hornier.<br />
Notre cousin François Codet qui avait pu avoir un entretien avec André Ertaud deux jours avant sa disparition a lu le texte suivant lors de ses obsèques :<br />
"André Ertaud a été l’héritier exemplaire de la tradition maritime de sa famille où se sont succédés sans interruption pendant plusieurs siècles : pêcheurs,<br />
marins, pilotes, capitaines de navires, maîtres au cabotage, capitaines au long cours, armateurs. Il était né en effet dans une famille originaire de Trentemoult, une<br />
île de l'Estuaire de la Loire juste en face du port de Nantes habitée depuis des siècles par une communauté de marins. Certaines familles de cette communauté – et<br />
c’était le cas de la famille Ertaud - bénéficiaient d'un double privilège : le privilège de pêche dans l'Estuaire de la Loire, mais aussi le privilège rare et très convoité<br />
d'exercer le métier de Monnayeur à l'Hôtel des Monnaies de Nantes. Son ancêtre direct, né sous Henri IV, qui s’appelait aussi André Ertaud était un très Honorable<br />
Maître Monnayeur, et donc pour cette époque un technicien de haut niveau. André Ertaud conjuguera brillamment cette double vocation familiale.<br />
André Ertaud est né en 1910 près de Trentemoult, à St Sébastien/Loire, dans la propriété de son grand-père, Capitaine au Long Cours et armateur, où il a<br />
passé une partie de son enfance. C'est donc naturellement qu'après sa sortie dans tous les premiers de l'Ecole des Arts et Métiers de Paris il s'oriente vers une<br />
carrière dans la Marine Nationale Sa formation technique lui permet d'être admis en 1931 à l'Ecole des Ingénieurs Mécaniciens de la Marine, à l’Ecole Navale située à<br />
Brest, Après deux années passées en école, puis la campagne du croiseur école d’application "Jeanne d’Arc ", en 1933-34 il est ensuite affecté successivement :1- sur<br />
le torpilleur "Bourrasque ", en 1934-35 2- sur le croiseur "Emile Bertin " de 1935 à 1938 3- à l’Ecole de Navigation sous-marine (ENSM) à Toulon, de mars à juillet<br />
1938 4- sur le sous-marin "Souffleur " de août 1938 à avril 1940 5- puis de juillet 1941 à août 1942, sur le sous-marin "Actéon ".<br />
Hors périodes d’embarquement il a été placé en Service à Terre à Toulon d’avril 1940 à juillet 1941. Au-delà de cette énumération impersonnelle il faut<br />
rappeler que ce qu’a connu André Ertaud à cette époque ce sont des navires et des équipages. Le torpilleur Bourrasque appartenait à la série des 1500 tonnes.<br />
Construit en 1926, il était déjà un peu ancien lorsque André Ertaud a navigué à son bord. Pendant cet embarquement il a fait escale à Boulogne-sur-mer avec le voilier<br />
école argentin "Presidente Sarmiento ". En service depuis 1934, le croiseur léger mouilleur de mines "Emile Bertin " était l’un des navires les plus réussis de la marine<br />
d’avant–guerre et l’un des plus rapides : 37,9 nœuds aux essais. A son bord André Ertaud ont effectué des missions en Afrique occidentale et en Amérique du sud.<br />
L’un de ses commandants était le CV Auphan, l’un des plus brillants officiers de l’époque, qui deviendra Chef d’état-major de la marine sous le gouvernement de Vichy.<br />
Construit en 1926 le sous-marin Souffleur était du type Requin. A son bord André Ertaud a navigué en Méditerranée orientale et en Mer rouge sous le<br />
commandement du LV Bazoche. L’ Actéon appartenait à la série des 31 sous-marins océaniques de type Le Redoutable, dite des 1500 tonnes. Construit aux Chantiers<br />
de la Loire à Nantes il était entré en service en 1931.Des quatre unités à bord desquelles André Ertaud a navigué seul le croiseur léger Emile Bertin aura une fin de<br />
carrière heureuse. Les trois autres connaîtront des destins tragiques : le torpilleur "Bourrasque " est engagé dans l’opération Dynamo. Chargé de 600 hommes<br />
embarqués à Dunkerque il sera coulé par des vedettes rapides allemandes, le 30 mai 1940, devant Nieuport. 6- le sous-marin "Souffleur " sera coulé le 25 juin 1941<br />
par un sous-marin britannique au large de la Syrie, 7- et enfin le sous-marin "Actéon ", qu’André Ertaud n’a quitté que depuis quelques semaines, voire quelques jours,<br />
va être coulé en Algérie en novembre 1942. De retour d’une mission en Afrique ce sous-marin arrive à Oran le 7 novembre avec le torpilleur "Tramontane " et le sousmarin<br />
"Fresnel " pour regagner la métropole. Le 8 novembre c’est le débarquement britannique en Algérie, appelé par les alliés "Operation Torch ". L’Actéon reçoit<br />
l’ordre d’intercepter les transports de troupes et cet ordre il va tenter de l’exécuter. Sous le commandement du CC Clavières il quitte le port à 3 h 45 et, le soir<br />
même, vers 21 h, il est attaqué et coulé avec tout son équipage par l’escorteur britannique HMS Wescott. Sévèrement canonné par des croiseurs et ravagé par des<br />
incendies, le torpilleur Tramontane s’échoue à proximité d’Oran; seul le Fresnel, endommagé, parviendra à regagner Toulon. A Alger, un cessez-le –feu a été ordonné
par les autorités françaises ce même jour à 18 h 40. Cet évènement constituera un souvenir pénible pour André Ertaud : la disparition brutale d’un équipage qu’il<br />
connaissait bien et dont il aurait pu partager la fin.<br />
Cette période de novembre 1942 va constituer un tournant dans l’existence d’André Ertaud :8- Les Anglais et les Américains viennent de prendre pied en<br />
Afrique. De là ils vont pouvoir par la suite débarquer en Europe du sud puis ultérieurement en Normandie.Ce même mois l’escadre de Méditerranée se saborde à<br />
Toulon pour échapper à la capture par les Allemands. Lui s’apprête à rallier, comme stagiaire, l’Ecole Supérieure d’Electricité. Ce sera sa façon de reprendre le<br />
combat : il va participer, en tant qu’ingénieur, au relèvement scientifique et technique du pays. En 1948, ses travaux sur les armes allemandes lui vaudront une<br />
promotion exceptionnelle au grade d’Ingénieur Mécanicien Principal et une nomination au grade de chevalier de la Légion d’Honneur.<br />
André Ertaud conservait un souvenir marquant de son passage dans la marine. Les domaines techniques qu’il avait pu y découvrir convenaient à ses propres<br />
aptitudes et à ses goûts personnels. Des activités effectuées en période d’avant-guerre il gardait manifestement un souvenir agréable. Comme tous les marins d’alors<br />
il a vécu, de 1940 à 1942, une période difficile dont l’historique des navires sur lesquels il a servi donne un aperçu révélateur."<br />
Sa carrière d'Ingénieur Mécanicien en Chef de la Marine s'achevait, celle d'Ingénieur nucléaire commençait. C'est M. Pierre Menez l'un de ses collaborateurs<br />
qui a évoqué sa brillante carrière au service de l'énergie nucléaire française, l'une des plus importantes du monde.<br />
"J’ai fait la connaissance de Monsieur Ertaud il y a près de quarante ans, dans l’industrie nucléaire. J’étais trop jeune pour l’avoir connu dans la Marine, mais je<br />
me rappelle combien il était resté imprégné de son esprit. C’était sans doute en raison d’une vieille tradition familiale, mais aussi parce que l’éthique et les solides<br />
principes de la Marine lui convenaient si bien qu’il les avait définitivement adoptés. Les conversations que nous avions souvent en privé débouchaient invariablement<br />
sur des souvenirs de la Royale, et l’on sentait combien il avait aimé cette vie pourtant si exigeante. Dans ses fonctions industrielles, aussi, lorsque se posait un<br />
problème difficile, c’est en se référant aux valeurs de la Marine qu’il rappelait à des collaborateurs qui lui étaient étrangers, les devoirs de rigueur et d’honnêteté<br />
intellectuelles du métier d’ingénieur.<br />
Après une quinzaine d’années d’embarquements sur des bâtiments et sous-marins de la Marine, la carrière proprement scientifique de Monsieur Ertaud débute<br />
en 1943 où il est affecté au Laboratoire du Collège de France. En 1945, il sera chargé d’une mission d’investigation scientifique à caractère militaire en Allemagne<br />
occupée.<br />
Dès 1946, il fut détaché auprès du tout jeune Commissariat à l’Energie Atomique où il intégra l’équipe d’une douzaine de scientifiques qui, sous la direction de<br />
Frédéric Joliot Curie, réalisa ZOE, la première pile atomique française. Il nous parlait parfois de ce qui fut alors une aventure extraordinaire : ces quelques hommes<br />
partaient de rien, armés de leur seule foi. Il leur fallait tout inventer, développer les théories scientifiques, élaborer les concepts, faire le projet, créer les<br />
technologies alors inexistantes et, le plus souvent, fabriquer les composants eux-mêmes, sur place, dans leur modeste laboratoire.<br />
Cette expérience fut infiniment précieuse à M. Ertaud. Il y avait de grands talents dans l’équipe de ZOE et c’est une grande chance de travailler aux côtés de<br />
collègues de cette valeur. Mais il présentait lui-même, outre ses qualités propres, un profil exceptionnel, puisqu’il possédait à la fois les compétences de deux<br />
excellentes écoles d’ingénieurs, les Arts et Métiers et Supélec, et la formation théorique d’un Docteur es Sciences, tout en s’appuyant sur l’expérience pratique d’un<br />
ingénieur qui avait vécu 15 ans en contact avec ses machines. Dans la pratique d’un métier aussi exigeant que le nucléaire, un savoir-faire s’étendant du niveau<br />
théorique à la technologie donna à M. Ertaud une qualité de jugement incomparable et lui valut une autorité reconnue.<br />
En 1954, il quitta le CEA et fut détaché dans l’industrie, à la SACM, Société Alsacienne de Constructions Mécaniques. J’ai eu le privilège de lire la lettre écrite<br />
à l’époque par l’Administrateur Général du CEA autorisant son départ. Dans celle-ci, le haut responsable du CEA exprimait d’une certaine manière le regret de se<br />
séparer d’un collaborateur précieux, mais il indiquait aussi, avec beaucoup de hauteur de vue, que son passage dans l’Industrie favoriserait le développement des<br />
réalisations nucléaires, pour le plus grand intérêt du CEA lui-même et pour l’intérêt national tout court. A la SACM, l’un des premiers projets sur lesquels il eut à<br />
travailler concerne les premiers grands réacteurs graphite-gaz G2 G3 de Marcoule, premiers réacteurs au monde faisant appel au béton précontraint et au
chargement en marche. On en parla beaucoup à l’époque et certains se souviennent certainement des fameux "mille-pattes atomiques " dont parlait la presse pour<br />
désigner les convois gigantesques qui transportaient les grands générateurs de vapeur jusqu’à Marcoule. Ces réacteurs furent une grande réussite et tournèrent<br />
comme des horloges pendant une trentaine d’années.<br />
Lorsque la SACM et les Chantiers de l’Atlantique constituèrent le Groupement Atomique Alsacienne Atlantique, GAAA, M. Ertaud y prit la tête des<br />
départements études puis devint Directeur technique. Il serait trop long d’énumérer toutes les références de GAAA, qui réalisa une dizaine de réacteurs mettant<br />
en œuvre tous les types de filières expérimentées à l’époque.<br />
Tous ces projets portent la marque de M. Ertaud qui analysait tout avec soin. Il avait pour cela une façon personnelle de travailler : quoiqu’à la tête d’équipes<br />
importantes, il appelait directement dans son bureau, en tête-à-tête, l’ingénieur responsable, lorsqu’un problème se posait, ou simplement lorsqu’il avait un doute sur<br />
un point de conception. Tous deux examinaient en tête-à-tête plans et dossiers techniques dans le détail, et l’ingénieur avait à répondre à un feu roulant de questions<br />
et montrer qu’il avait correctement pensé à tout. Ce genre d’exercice était pour les jeunes ingénieurs à la fois une excellente séance de formation et une épreuve<br />
redoutée tant les exigences de M. Ertaud étaient connues.<br />
Plus tard, GAAA allait devenir Novatome dont il fut le Directeur scientifique. C’est Novatome qui fut chargée de réaliser le réacteur nucléaire à neutrons<br />
rapides SUPER PHENIX, un prototype construit en coopération avec les industries italienne et allemande. Après des incidents de jeunesse, il devint la cible aveugle<br />
d’opposants de tout poil qui, à défaut d’arguments techniques, utilisèrent toutes sortes d’artifices juridiques pour finir par obtenir sa mise à l’arrêt, alors que, les<br />
premières difficultés résolues et toutes autorisations obtenues, il venait d’afficher un fonctionnement ininterrompu de près d’un an et demi. Si je relate ici cet<br />
épisode, c’est que, comme nous tous et plus encore, M. Ertaud fut très affecté par ce succès de l’irrationnel sur la rigueur et par ce dévoiement des esprits, souvent<br />
au détriment de la simple vérité. S’il acceptait en effet, volontiers, toute opinion fondée sur des arguments honnêtes, exprimés avec cohérence, il détestait les<br />
théories édifiées à seule fin d’atteindre un but idéologique et ne prenant en compte que les éléments qui les arrangent et ignorant délibérément les autres.<br />
Permettez- moi de reproduire ces réflexions, extraites d’un discours de M. Ertaud dans lequel il commentait la pensée du Père Teilhard de Chardin. Elles<br />
expriment, mieux que je ne saurais le faire, ses convictions :<br />
" On peut classer les hommes en trois catégories :<br />
- Les fatigués, pour lesquels l’existence est une erreur. Ils cherchent le plus habilement possible à quitter le jeu et se disent: pourquoi la science, pourquoi la<br />
technique, n’est-on pas mieux assis que debout et couché qu’assis ?<br />
- Les bons vivants, ceux qui jouissent de l’instant présent, qui ne se préoccupent d’aucune évolution, qui ne veulent rien risquer, rien oser. Ceux qui consomment<br />
sans souci d’améliorer la vie.<br />
- Enfin, les ardents, pour lesquels la vie est une ascension et une découverte, pour lesquels il est toujours possible et uniquement intéressant de devenir "plus ",<br />
au sens le plus complet du terme. On peut les plaisanter, les traiter de naïfs ou les trouver gênants, mais ce sont eux qui nous ont faits ce que nous sommes et dont<br />
sortira la terre de demain ".<br />
Une bien belle leçon ...<br />
# La lignée Ertaud<br />
Les Ertaud étaient nombreux à Rezé répartis en plusieurs branches familiales plus ou moins proches. La lignée de Adrien Ertaud est initiée par Julien Ertaud<br />
(ca 1550) marié à Jamette Marteaux. Son petit-fils André (1608) marié à Jeanne Denis est un personnage important. Deux générations plus tard un autre André<br />
(1675) épouse une Perrine Ollive. Leur fils André (1713) épouse en 1738 Marie-Thérèse Lemerle, dont l’un des nombreux enfants est Athanase (1757), recensé
comme pêcheur mais connu également comme pilote. Son fils Sébastien (1787) Capitaine de Navires est le père de Adrien. Les patronymes des huit arrières grands<br />
parents de Sébastien sont typiquement trentemousins : Ertaud, Ollive, Lemerle, Bertrand, Chauvelon, Dejoye, Bessac. Il aura deux filles et deux fils, dont Adrien le<br />
père de Ernestine Ertaud.<br />
L'épouse de Adrien est Stylitte Bessac (1813) dont la mère est également une Ertaud Louise Geneviève dont la lignée est initiée par ce même André (1608)<br />
suivi de son fils Guillaume (1640), puis de Christophe (1682), puis de François (1712), puis de Jacques (1742), puis enfin de Louise Geneviève (1778) épouse de Louis<br />
Jacob Bessac.<br />
André Ertaud (1608) était un personnage local appartenant à la corporation des Monnayeurs si on en juge par le parrainage de ses cinq enfants. 1-Jean (1642) a<br />
comme marraine la veuve d’un conseiller du Roi (?). Il sera lui-même un HH (Honorable Homme) Monnayeur et son fils Jean (1682) sera Prévôt des Ajusteurs. 2-Pierre<br />
(1647) décédé très jeune a comme parrain et marraine Yves de Monti, Seigneur de Rezé, Conseiller du Roi et deux HH et HF (Honorable Femme) de Ste Croix de<br />
Nantes. 3-Le second Pierre (1650) a comme parrain le HH Pierre Champaigne de Ste Croix de Nantes. 4-Guillaume (1640) dont les parrains et marraines sont<br />
également des HH et HF de Nantes sera avec ses deux épouses à l’origine d’une nombreuse descendance de ses seize enfants dont Christophe (1682) qui est<br />
l’ancêtre de Stylite Bessac. 5-Catherine (1645) la seule fille d’André sera parrainée par plusieurs HH et HF de Ste Croix de Nantes.<br />
De Jean et de Catherine partiront deux sous-branches qui conduiront jusqu’à Aristide Briand, le mari de Marie-Laure Bureau, grand-père de Suzanne Briand.<br />
Dans cette lignée on trouve également Jean-François Ertaud (1772), frère de Louise Geneviève, qui fut Maire de Rezé de 1807 à 1820 et dont nous connaissons<br />
depuis peu sa vie, plutôt mouvementée<br />
# Athanase Ertaud<br />
Dans son acte de décès, en 1795, il est précisé que ce personnage est mort “pour cause de guerre civile”. Il est cité par ailleurs comme marin, pêcheur, mais<br />
aussi pilote. Un Athanase Ertaud, est-ce le même ?, est également cité dans les chroniques judiciaires locales comme étant le meneur d'une quasi-insurrection visant<br />
à empêcher les douaniers de l'époque de débarquer en force sur l'île de Trentemoult, devenu un nid de contrebandiers. L'un de ses deux fils, Sébastien sera marin<br />
comme son père, tandis que l'autre François s'installera boulanger à Chantenay où il épousera une Cécile Dubigeon, descendante directe de Julien Dubigeon le<br />
fondateur des chantiers du même nom. Cette lignée Ertaud, désormais établie à Nantes donnera plusieurs capitaines, armateurs et courtiers maritimes.<br />
C’est encore notre infatigable historien, Vincent Bugeaud, qui a découvert les circonstances de la disparition tragique de Athanase :<br />
" le 24 brumaire an IV [15 novembre 1795] Macé marchand de vin Isle Feydeau à Nantes chargea pour Vannes par la barge de Chauvelon 6 barriques de vin<br />
blanc estimées 6000 livres la barque, pour le compte du dit Chauvelon de Trentemoux, et le certificat des habitans de l’isle de Trentemou, du 20 de ce mois, signé au<br />
délivré Jacques Boju, P. Morisseau, Pierre Moreau, Michel Pageau, P.R. Bertrand et André Boju qui attestent que Pierre Chauvelon et Athanase Ertaud, l’un et l’autre<br />
âgé d’environ 40 ans pêcheurs et domiciliés de l’isle de Trentemou, commune de Rezé, le 1er époux de Françoise Bertrand et le second de Marie Bertrand, partirent<br />
de la dite isle de Trentemou le 25 brumaire an IV avec une barge, chargée de 6 barriques de vin à la destination de Vannes ; que chemin faisant ils furent assaillis par<br />
les ennemis de la République connus sous la dénomination de chouans [souligné dans le texte] qui les assassinèrent et volèrent tout ce qu’ils possédoient."<br />
Personnellement je ne suis pas très convaincu de la sincérité de cette déclaration car Athanase, que j’imagine plutôt du côté des rebelles, disparaît comme par<br />
hasard juste au moment où des évènements tragiques secouent toute la région allant du Morbihan à la Vendée : une nouvelle tentative de débarquement se prépare à<br />
l’Ile Yeu sous le commandement du futur Charles X entre les anglais, les émigrés et Charrette. La rébellion chouane dans le Morbihan est réactivée et se radicalise à<br />
la suite des massacres de milliers de chouans et d’émigrés ayant participé directement ou indirectement au débarquement de Quiberon. Les marins-pêcheurs de<br />
Trentemoult ont participé par la force des choses à ces évènements de près ou de loin. Comme Jean-François Ertaud, un proche parent de Athanase, qui y a joué un<br />
rôle très actif du côté des chouans.
# Jean-François Ertaud " petit amiral breton" 1769-1840<br />
Plusieurs descendants de familles Ertaud et Lancelot de Trentemoult s’interrogeaient sur l’origine du prénom rare d’une lointaine ancêtre, Stylitte Ertaud. Une<br />
curiosité qui semble mal placée puisque ce village de marins connu pour l’originalité des prénoms les plus insolites données aux filles. Ce prénom était porté par<br />
quelques femmes de la famille de Kersabiec, bien implantée dans la région nantaise. La légende familiale rapportait que ce prénom lui avait été donné effectivement<br />
en souvenir de Styllite de Kersabiec qui avait accompagné la duchesse de Berry lors de sa rocambolesque tentative de soulèvement légitimiste dans le pays nantais en<br />
1832. C’est un Ertaud qui aurait aidé la duchesse accompagnée de sa fidèle suivante à traverser clandestinement les marais de Goulaine, une explication qui semblait<br />
satisfaisante “vue de loin”.<br />
Mais l’examen des données généalogiques ne confirme pas la légende puisque l’épisode se situe en 1832 alors que Stylitte Ertaud née en 1813 avait déjà 19 ans.<br />
Néanmoins cette légende n’est pas infondée puisqu’il y existe effectivement un lien entre ce prénom et la famille de Kersabiec. Mais il s’agit d’un lien plus ancien et<br />
plus solide que celui d’une rencontre fortuite dans un marais et qui passe par un personnage énigmatique de la famille, Jean-François Ertaud.<br />
Celui-ci est officiellement connu pour avoir été le maire de Rezé de 1807 à 1820, à cheval sur l’Empire et la Restauration.Yann Vince qui a rédigé l’histoire des<br />
municipalités de Rezé nous en dit un peu plus sur le personnage. “Le nouveau maire nommé le 28 Août 1807 est originaire de Trentemoult. Jeune clerc tonsuré en<br />
1791, il avait été mis en état d’arrestation avec les prêtres réfractaires…Il sera libéré avec un passeport pour l’Espagne. Avec la complicité des Trentemousins, il se<br />
fera en fait embarquer pour l’île de Hoëdic (entre le Croisic et Belle-Ile). C’est un homme riche qui revint à Rezé en 1801 après avoir fait des “affaires” à<br />
Hoëdic…Sous l’Empire, devenu maire, la police impériale demande au préfet de surveiller Ertaud soupçonné d’avoir hébergé un traître passé aux Anglais après avoir<br />
gagné “une fortune considérable à Hoëdic en servant la correspondance ennemie”.<br />
Il démissionne en 1820 à un moment crucial pour l'histoire locale, puisque Trentemoult s'apprêtait à faire sécession de Rezé, en prétextant qu'il ne peut pas<br />
être juge comme maire et partie comme trentemousin. Il est alors remplacé par le comte de Monti de Rezé qui restera maire jusqu'à l'avènement de la Monarchie de<br />
Juillet en 1830 et qui donnera à son tour sa démission en signe de protestation contre le nouveau régime qu'il exècre en tant que légitimiste pur et dur.<br />
On sait par ailleurs que Jean-François Ertaud n’omettait jamais de signaler qu’il était Chevalier de l’Ordre de St Louis, un ordre prestigieux de l'Ancien Régime<br />
(créé en 1693), rétabli en 1816 et définitivement aboli en 1830 par Louis-Philippe trop soucieux de prendre ses distances avec l'Ancien Régime. Cette décoration<br />
n’était pas attribuée au premier venu. Il fallait avoir rendu des services éminents à la Royauté pour la mériter et même dans le Pays de Retz, une région très<br />
attachée à la Monarchie, les titulaires de cette décoration étaient rares, c’était le cas du comte de Monti qui appartenait à la plus haute noblesse de la Cour.<br />
Jean-François Ertaud était donc à coup sûr un royaliste convaincu et il avait nécessairement des liens étroits avec les aristocrates légitimistes de la région<br />
comme les Monti et les Kersabiec. Notre cousine Suzanne Briand montre encore un verre provenant d’un service de cristal offert à notre homme par la famille<br />
Bascher de Rezé en reconnaissance des services qu’il avait rendus à cette famille pendant la contre-Terreur. Elle savait aussi que son épée de Chevalier de St Louis<br />
avait été détenue en dernier par Olivier Chauvelon, fils de Marie Virginie Lancelot et de Julien Chauvelon (le capitaine du “Belem”).<br />
Suzanne Briand raconte aussi que lorsque Jean-François Ertaud était prisonnier de la Terreur révolutionnaire il se faisait passer pour une simple d'esprit en<br />
répondant imperturbablement à toutes les questions par un "Je ne comprends pas" dit en breton.<br />
On ne sait très bien quelles étaient ses activités professionnelles puisque selon les actes Jean-François Ertaud est déclaré comme propriétaire, négociant ou<br />
armateur. Qui était ce mystérieux personnage né en Novembre 1769 et décédé en 1840 sans postérité ? Il était le frère de Geneviève Ertaud, épouse de Louis<br />
Bessac, Patron de cabotage, tous deux parents de Marie-Hortense et Stylitte Bessac. Marie-Hortense a épousé Joseph Lancelot un Maître au Cabotage. Celle-ci est<br />
l’ancêtre de nombreux contemporains Lancelot, Briand, Bureau, Chauvelon, Bessac. Sa sœur Stylitte a épousé elle aussi un Maître au Cabotage, Adrien Ertaud. Elle<br />
est l’ancêtre de nombreux contemporains Ertaud, Bureau, Fruneau, Janeau, Sarradin, Bolo, Le Tilly, et l’auteur de ces lignes.
Plusieurs d’entre eux se retrouvent avec plaisir chaque année depuis quatre ans afin de partager leurs souvenirs familiaux … et leurs recherches généalogiques.<br />
C’est ainsi qu’en réunissant des pièces détenues par chacun d’eux il a été possible de reconstituer le puzzle de l’histoire de Jean-François Ertaud et de retrouver au<br />
passage l’origine du prénom Styllitte.<br />
De mon côté j’avais trouvé sa trace dans le dossier d’armement d’un chasse-marée trentemousin “Jeune Joseph” mis en service le 25 Avril 1832 ( ref Archives<br />
Départementales de Loire-Atlantique 3 P 508 ) où il était signalé qu’à son décès sans postérité en 1840, les parts qu’il détenait dans ce navire avaient été héritées<br />
par sa sœur Geneviève Ertaud. L’année 1832 est celle de la naissance de Joseph Jacob Lancelot, fils de Marie-Hortense Bessac et de Joseph Lancelot (fils de<br />
François-Joseph Lancelot Maître au Cabotage). Les actionnaires de ce navire qui à cette époque étaient appelés “intéressés” sont outre notre Jean-François Ertaud,<br />
François-Joseph Lancelot, Pierre Lusseaux, Constructeur de navires à Chantenay, Charles Cormier, ouvrier raffineur, Félix Lancelot (Maître au Cabotage, deuxième<br />
fils de François-Joseph), Pierre Dejoie, Epicier. Ce navire qui était en quelque sorte une affaire de famille sera vendu à Cardiff en 1863 ce qui marque une longévité<br />
remarquable. N’en sachant pas plus j’avais émis l’hypothèse suivante: “au cours de ces époques troublées la communauté de marins, pêcheurs et contrebandiers qui<br />
peuplait les Iles de Rezé, était capable d'assurer avec efficacité et discrétion des missions clandestines de transport, de ravitaillement et de renseignement” . Je<br />
ne croyais pas si bien dire comme on le verra par la suite.<br />
Par ailleurs, Vincent Bugeaud, un jeune historien qui réalise actuellement une thèse sur la communauté de marins et de pêcheurs de Loire et de Sèvre, a<br />
apporté de précieuses informations :“ Une petite précision tout d'abord : dans son interrogatoire du 16 juin 1792, il précise bien avoir reçu la tonsure. Il a fait ses<br />
études chez le curé de Pont-Saint-Martin puis est entré au Séminaire à Nantes, "pour complaire à ses parents" dit-il. Toujours dans cet interrogatoire, Il ajoute<br />
qu'en quittant le séminaire, "il y a environ deux ans", "il a quitté l'habit ecclésiastique", vraisemblablement du fait de la situation politique. Selon sa version, Il est<br />
alors retourné chez sa mère à Trentemoult où il s'est (re) fait pêcheur. C'est durant sa formation qu'il s'est créé des liens avec des milieux nobiliaires<br />
réactionnaires, qui vont lui valoir quelques soucis avec les autorités (c'est à la Caraterie, propriété des Cornulier (qui auront un rôle actif dans le complot de la<br />
duchesse de Berry) qu'il a connu durant sa formation, qu'il est arrêté en 1792, avant la fuite en avant.<br />
En jetant un oeil à sa succession, en 1840, on voit qu'il a laissé bien peu de biens meubles (140 F), mais cela n'a rien de forcément significatif sur ce qu'a été sa<br />
fortune, il faut en effet tenir compte des éventuelles donations : c'est la succession d'un vieillard célibataire qui a eu le temps de voir la mort arriver. ll possède 1<br />
146 F de biens immeubles (dont deux maisons à Trentemoult, le reste étant des terres à Rezé, dans les îles et à Bouguenais). Plus significatives sont les créances (15<br />
383, 33 F), qui mettent en évidence des disponibilités financières conséquentes, mais peut-être trompeuses. Sur la liste électorale de 1836, il serait le 152e plus<br />
imposé de Rezé (si l'identification du personnage est bonne), ce qui confirmerait son modeste train de vie, du moins à la fin de sa vie. Son activité d'armateur est<br />
très réduite au moment de son décès. Il possède deux parts de navires : 3/16 dans le chasse-marée le Jeune-Joseph (1 000 F) et 1/24 dans le lougre la Céline (500<br />
F). Il est armateur du Jeune-Joseph, armé au cabotage. Dont le capitaine est le aître au Cabotage Joseph Lancelot, père du jeune Joseph et l’époux de Marie-<br />
Hortense Bessac la nièce d Jean-François Ertaud. ainsi que Louis-Jacob Bessac son beau-frère,<br />
Dans le passé, il avait été armateur de quelques autres bateaux, armés à la petite pêche : en 1809, il se déclare armateur d'une barge nommée L'Union dont le<br />
patron est François-Joseph Lancelot, le père de Joseph Lancelot, marié avec une Marie-Madeleine Moreau puis à une Bessac ; en 1810, de la chaloupe La Vincente<br />
dont le patron est le futur Maître au Cabotage Louis-Jacob Bessac ; en 1811, du chasse-marée L'Aimable Pacifique (en référence peut-être à Pierre-Pacifique Moreau<br />
qui le commande) ; de plus, on le trouve parfois simple quirataire : par exemple il prend 2/24 dans une chaloupe en 1809 dont l'armateur est Sébastien Bertrand,<br />
pilote lamaneur. Globalement son activité d'armateur apparaît mineure, notamment en comparaison des boulangers et marchands de vin des îles (les Noël Fruneau,<br />
Sébastien Cassard, Noël-Zacharie Lancelot...) et insignifiante à côté des poids lourds des îles (les constructeurs P-J. Lemerle et J. Chauvelon). Ce n'est pas avec<br />
cette activité qu'il a pu s'enrichir ; je crois qu'il s'agissait avant tout pour lui, au travers de cette petite activité d'armement, "d'aider la famille".<br />
C’est finalement un autre cousin, Claude Janeau, qui a versé au dossier les plus intéressantes pièces de ce puzzle lesquelles ont permis de tracer un portrait<br />
complet du personnage. Adrien Janeau, le père de Claude, avait consacré plusieurs années de sa vie à étudier la généalogie et l’histoire de sa famille, une recherche
matérialisée par une liasse de 150 feuilles manuscrites de grand format fourmillant d’informations inédites. On a découvert dans ces feuilles la copie d’une lettre<br />
manuscrite détenue par un cousin Fruneau que Jean-François Ertaud avait adressée en 1815 à la Chancellerie de l’Ordre de St Louis.<br />
Dès le retour de Louis XVIII sur le trône il demandait le brevet (et la pension associée) confirmant la décoration qui lui avait été remise personnellement par<br />
le Duc d’Artois, le futur Charles X , dix ans plus tôt lors du débarquement tragique de Quiberon.<br />
“ Jean-François Ertaud - Département de la Loire Inférieure – Commune de Rezé.<br />
Etats des services et de la conduite politique de Jean-François Ertaud de Rezé Chef de bataillon de l’Armée royale de Bretagne.<br />
1792 – Fut pour son attachement au Roi enfermé au Château de Nantes d’où il s’évada le 8 Septembre de la même année.<br />
1794 – Fut conjointement avec Monsieur Leroux, commissionné par le Général Georges Cadoudal pour faire passer des dépêches en Angleterre, et en recevoir<br />
ce qui lui était envoyé. Habita alternativement les isles de Houëdic et Houat, fut un des premiers à se réunir à M. Georges Cadoudal pour former le noyau de l’armée<br />
dont celui-ci devint le Chef ; fut nommé Chef de Bataillon, envoyé aux escadres anglaises qui croisaient à hauteur de Belle-Isle, en reçut les premières munitions de<br />
guerre pour l’armée.<br />
1795 (*)– Fut employé avec dix chaloupes sous son commandement à la descente de Quiberon ; après la prise de possession de la presqu’île par les républicains à<br />
l’établissement du quartier général de Monsieur le Comte de Puysaye à l’isle de Houat et revint à l’Isle de “Houedik” dont il eut le Gouvernement pour le roi ; fut<br />
chargé autant que les ressources de l’isle le permettait de fournir à l’escadre de l’Amiral Warren, duquel il reçut souvent des marques de bienveillance, des vivres<br />
fraîches après avoir d’un commun accord avec le même amiral réservé pour les habitants ce qui leur était indispensable ; prit à l’abordage avec seulement huit<br />
hommes un “paquebot” expédié pour Belle-Isle en Mer, monté d’un enseigne de vaisseau, de seize hommes d’équipage, armé de deux perriers et quatre espingolles , en<br />
fit présent à l’Amiral Warren qui le nomma “Le Petit Chouan”, reçut des félicitations de plusieurs officiers de marine émigrés, particulièrement de Monsieur de<br />
Vaugiraud ; eut le bonheur de recevoir dans son isle Monsieur le Comte d’Artois (**) qui l’autorisa à porter la Croix de Saint-Louis et le flatta de son souvenir ; fit<br />
passer au continent tous les émigrés qui lui témoignèrent le désir de se joindre aux armées catholiques et royales. Avant de quitter la base de Quiberon, l’Amiral<br />
Warren lui expédia deux avisos pour lui annoncer son départ et l’engagea à s’embarquer avec lui pour l’Angleterre, mais l’espérance qu’il lui donna que son<br />
Gouvernement n’abandonnerait point les armées catholiques et royales le détermina à rester sur son rocher pour servir son prince.<br />
1796 - Fut fait prisonnier, conduit à la citadelle de Belle-Isle en mer d’où il s’évada la veille du jour désigné pour le fusiller.<br />
1797 – Fut commissionné par monsieur le baron de Suzannet, commissaire du Roy, pour la correspondance des armées de monsieur de Châtillon, de Suzannet et<br />
d’Autichamp, eut le confiance des amiraux Keat et Pellow qu’il accompagnait toujours avec ses chaloupes et sous la protection desquelles il eut la satisfaction de<br />
réussir dans tous les versements d’argents et d’effets militaires qui lui furent confiés. Reçut des amiraux et des généraux anglais Dowet et Maitland l’accueil le plus<br />
flatteur et l’assurance de leur protection. Fut qualifié de “Petit Amiral breton” par les amiraux Keat et Pellow, les suivant avec sa petite escadrille sur tous les points<br />
des côtes de Bretagne et du Poitou, où le besoin de service l’exigeait.<br />
1798 à 1814 – Fut pillé en 1802, perdit tous ses papiers et eut beaucoup de peine à se soustraire lui-même aux recherches que l’on fit longtemps de sa<br />
personne ; a été en surveillance constante jusqu’en 1808. Se trouvant habiter la Vendée, manifesta son attachement inviolable pour l’auguste famille des Bourbons.<br />
Demande expédition du brevet de Chevalier de St Louis et la retraite de son grade.<br />
Signé J-F Ertaud<br />
Sous ses états de service est inscrit de la main du signataire Comte de Suzannet: “Je certifie que tous les faits ci-dessus sont à ma connaissance et que<br />
monsieur Ertaud a constamment bien servi le Roy, qu’il a aussi employé tous ses moyens pour faire triompher les principes royalistes, et qu’il mérite la plus haute
confiance, la bonté du Roy et la Croix de St Louis, qui lui a été accordée par son altesse royale Monsieur, dans la baie de Quiberon.<br />
Nantes le 1 er janvier 1815<br />
(*) il n’avait alors que 26 ans<br />
J’imagine volontiers notre Jean-François Ertaud au moment où il écrit cette lettre, se remémorant alors tous les épisodes d’une vie d’aventures dignes du<br />
comte de Monte-Cristo. Il se souvient des terribles prisons de la Terreur de Carrier, des risques pris pour approvisionner en armes et en fonds secrets l’Armée<br />
Royale de Bretagne, du tragique débarquement de Quiberon, de ses évasions… Il a certainement la fierté et la satisfaction de constater que son engagement a été<br />
enfin récompensé puisque, contre toute attente, les Bourbons ont retrouvé leur trône. Je ne suis pas surpris non plus que l’Amiral Warren ait apprécié si fort notre<br />
bonhomme, efficace et déterminé, contrairement aux chefs français du débarquement de Quiberon qui fut saboté par leur pusillanimité et leur incompétence.<br />
NB – j’ai appris à cette occasion que le débarquement de Quiberon et l’action de l’Armée Royale de Bretagne sous le Directoire avait pris le relais du<br />
soulèvement vendéen de 1792 qui fut écrasé dans un contexte politique et géographique totalement différent de celui mené au Nord de la Loire par Cadoudal<br />
notamment.<br />
Il n’est donc pas étonnant que ce personnage respecté par tous les royalistes, et de surcroît maire de Rezé, ait obtenu pour le baptême de sa nièce Marie-<br />
Hortense en 1810 le parrainage flatteur, mais aussi flatté, de la famille de Kersabiec. Les témoins à la naissance de Marie-Hortense étaient en effet Jean-François<br />
Ertaud, Jean-Marie Sochian de Kersabiec, Maire de Pont St Martin une commune toute proche de Rezé et Nicola Anizon, ami de la famille, chirurgien à Nantes et<br />
accoucheur de la mère. Le parrain et la marraine furent les deux aînés de Jean-Marie de Kersabiec : Styllitte (la future compagne d’infortune de la Duchesse de<br />
Berry avait alors 11 ans), et son jeune frère Edouard. Curieusement c’est pour la sœur de Marie-Hortense née trois ans plus tard que sera adopté le prénom de<br />
Stylitte ! On peut supposer que ce premier parrainage avait créé des liens étroits entre les familles Ertaud-Bessac et Kersabiec.<br />
La relation étroite qu’entretenait Jean-François Ertaud avec des membres éminents du parti royaliste local n’a donc rien de surprenant compte tenu de ses<br />
états de service. Mais il y avait encore d’autres liens possibles avec la famille Kersabiec. Jean Augustin Joseph de Kersabiec, le frère de Jean-Marie et de Stylitte,<br />
était officier de marine. Il prit part au combat de la Dominique sur la frégate Astra le 12 Avril 1781. L’Amérique libérée, c’est lui qui établit les plans du port et de la<br />
Ville de Boston, travail pour lequel il fut récompensé par le sénat américain. (il y aurait sa statue?). Emigré, il participa au débarquement de Quiberon sous les ordres<br />
du vice-amiral de Suzannet, ce même Suzannet qui se porte garant des mérites et des actions de Jean-François Ertaud. Plus tard Jean Augustin de Kersabiec, un pur<br />
royaliste, sera nommé par l’administration impériale Maire de Doulon, une commune limitrophe de Nantes, comme Jean-François Ertaud le fut pour Rezé.<br />
Revenons maintenant à la Duchesse de Berry, et à son aventure rocambolesque qui se termina bien piteusement pour la duchesse arrêtée à Nantes le 7<br />
Novembre 1832, trouvée enfumée derrière la cheminée de la pièce où elle se cachait depuis cinq mois en compagnie de Styllite de Kersabiec et de Achille Guibourg.<br />
La duchesse Marie-Caroline de Berry, était la nièce de la reine Marie-Antoinette et la cousine germaine de “l’impératrice”Marie-Louise l’épouse de Napoléon. Elle<br />
était la mère du duc de Bordeaux le seul héritier légitime de la couronne de France comme petit-fils de Charles X. Dés l'avènement en 1830 de Louis-Philippe<br />
“l’usurpateur” la duchesse et les légitimistes décident de fomenter un complot pour le remplacer sur le trône par le duc de Bordeaux sous le nom de Henri V. C'est<br />
dans la région de Nantes qu'elle trouve le meilleur soutien avec un comité animé par Achille Guibourg, les Sesmaisons, le comte Charles Sloc'han de Kersabiec un<br />
vétéran des guerres de Vendée qui vit retiré sur ses terres à Pont St Martin, les de Monti de Rezé, une poignée d’anciens émigrés et de vieux chefs des guerres de<br />
Vendée…et leurs enfants qui rêvent de nouveaux exploits.<br />
La troupe d’opérette de la duchesse est lamentablement écrasée et dispersée en Juin 1832. La duchesse traquée réussit à se réfugier à Nantes cachée en<br />
paysanne où pendant cinq mois elle échappe à toutes les recherches. Finalement dénoncée au prix d’une très forte récompense elle est arrêtée et enfermée à la<br />
forteresse de Blaye. C’est Stylitte de Kersabiec alors âgée de 33 ans qui l’accompagnera 24h/24 pendant sa fuite, dans sa cachette et pendant son transfert à la<br />
forteresses de Blaye. 132 comploteurs de la région nantaise seront alors jugés et condamnés. Le comte de Monti de Rezé restera jusqu’à la fin de sa vie le plus fidèle
des fidèles légitimistes accompagnant la Duchesse et son royal fils dans l’exil où ils ont été condamnés. Edouard, le parrain de Marie-Hortense Bessac, sera l’un des<br />
cinq condamnés à mort pour leur participation à la conspiration de la duchesse.<br />
Les précisions apportées par Vincent Bugeaud sont intéressantes à plus d’un titre pour ceux qui s’intéressent à l’histoire des tribus familiales de Trentemoult.<br />
Ainsi j’ai noté au passage que le second prénom de Pierre Moreau était “Pacifique”. C’est lui qui serait à l’origine d’une lignée de quatre Pacifique Lancelot : le premier<br />
était le fils aîné de François-Joseph et le dernier s’est éteint à Haïti en 1934.<br />
Le Sébastien Bertrand cité est bien connu des généalogistes de la famille. (il est âgé de 73 ans en 1809). Sa fille Anne Geneviève a épousé Noël Fruneau, un<br />
boulanger réputé de Trentemoult qui sera à l’origine d’une longue lignée de boulangers, d’épiciers et de négociants nantais. Sa deuxième fille, Marie-Françoise<br />
Bertrand est l’épouse de Athanase Ertaud (mort en 1795 de “guerre civile”). Ils sont les parents de François Ertaud qui sera lui aussi boulanger mais à Chantenay où il<br />
épousera le 5 Février 1814 Cécile Dubigeon (1796-1867) “en présence de Jean-François Ertaud Maire de Rezé parent du futur et de Noël Fruneau âgé de 45 ans<br />
oncle par alliance du dit futur”. Cécile est la sœur de Théodore, le patron des chantiers Dubigeon, Maire de Chantenay. Tous deux sont des arrière-petits enfants de<br />
Julien Dubigeon (1711-1781), le charpentier de navires venu de Cugand – au bord de la Sèvre- qui sera à l’origine des Chantiers Dubigeon appelés initialement<br />
Chantiers Nantais.<br />
Toujours est-il qu’entre le monopole de pêche dans l’estuaire de la Loire, le cabotage, les avantages fiscaux des monnayeurs, la boulangerie … et la contrebande<br />
du tabac nos ancêtres de Trentemoult ne manquaient pas de ressources.<br />
La tradition maritime prenant le dessus sur la boulangerie, les deux fils de François Ertaud, François et Ernest, seront Capitaine au Long Cours, François<br />
commandera et armera trois navires construits et co-financés, devinez par qui, par son beau-frère Théodore Dubigeon ! Yves Denis l’un des 380 descendants (fin<br />
2005) du boulanger François Ertaud, nous a informé que Jean-François Ertaud était également Chevalier d’Empire et Chevalier de la Légion d’Honneur. Certains<br />
pourraient en déduire que JF Ertaud n’était qu’un opportuniste mangeant à tous les rateliers, royalistes puis impériaux. Pour ma part j’y vois la marque d’une autre<br />
trahison, celle du Petit Corse, alias Napoléon Bonaparte. Il faut se souvenir qu’à partir de 1807 – au sommet de sa gloire - celui-ci caresse le projet fou d’entrer “à la<br />
hussarde” dans le cercle des familles régnantes européennes en épousant Marie-Louise d’Autriche. Après s’être présenté aux Français tour à tour et sans vergogne<br />
comme un républicain enragé (voir la canonnade de St Roch et l’assassinat du Duc d’Enghien), comme un sauveur de la République, comme un empereur, voilà que<br />
maintenant il ambitionne de devenir roi ! Sans aucun scrupule il cherche alors à s’attirer les bonnes grâces des royalistes et ne manque jamais une occasion pour leur<br />
dire qu’il appartient comme eux à la noblesse (ce qui est faux). La docile administration impériale obéit alors aux instructions de son maître ou pire elle anticipe ses<br />
désirs en confiant à des royalistes des responsabilités municipales et autres…On le voit à Rezé et à Doulon, et ce fut sans doute le cas partout ailleurs.<br />
Châteaubriand disait en évoquant la romanesque aventure de la Duchesse de Berry (à laquelle il avait lui-même participé) que c’était du Walter Scott. On<br />
pourrait le paraphraser en disant de la vie de Jean-François Ertaud que c’était de l’Alexandre Dumas !<br />
# Les huit cousines Lancelot<br />
Avec Hortense Lancelot Bureau il existait un premier lien familial entre les Bureau de Vertou et les Lancelot de Trentemoult. Mais il y en avait un autre,<br />
moins évident mais encore plus étroit, découvert par hasard, en examinant un album de photos anciennes oublié qui encombrait les étagères de mon cousin Gaétan Le<br />
Tilly et qu'il m'avait confié à toutes fins utiles. Que faire en effet de vieilles photos jaunies impossibles à identifier dont les visages sont condamnés à l'anonymat<br />
pour l'éternité? Grâce à la généalogie et à la contribution de plusieurs cousin(e) s de Trentemoult la plupart de ces visages ont retrouvé leur nom et leur identité !<br />
Cette identification a servi de fil conducteur pour faire revivre la mémoire d'une tribu Lancelot emblématique des familles de Trentemoult. Parmi ces photos<br />
on remarquait particulièrement six portraits de jeunes trentemousines reconnaissables à leur coiffe traditionnelle plus importante que celle du Pays Nantais en “cul<br />
de poule“. Ce n'était pas des cousines Ertaud ou Bureau identifiées par ailleurs. De déduction en déduction il est apparu que ces jeunes filles appartenaient à une
même famille Lancelot ! Que venaient-elles faire dans l'album de photos de la famille Bureau Capirote de Vertou ?<br />
# Stylitte et Marie-Hortense Bessac<br />
Pour trouver la clé de cette énigme il faut remonter aux deux sœurs Bessac, Stylitte et Marie-Hortense Bessac, filles de Geneviève Louise Ertaud et de<br />
Louis Jacob Bessac déjà cités. Marie-Hortense a épousé en 1831 Joseph Lancelot dit “le grand Joseph” et Stylitte a épousé Adrien Ertaud.<br />
Les deux sœurs Bessac étaient très étroitement unies. On en a une preuve aujourd'hui en visitant le cimetière St Pierre de Rezé …où les deux sœurs<br />
reposent pour l'éternité dans deux tombes voisines : Stylitte avec son époux Adrien Ertaud et Marie-Hortense avec sa fille Hortense Lancelot et son gendre Pierre<br />
Bureau.<br />
Marie-Hortense Lancelot - Bessac a eu cinq enfants (Hortense, Joseph Jacob, Félix, Marie, Amanda). Elle n'a que 37 ans quand elle décède en 1847 à la<br />
naissance d'un sixième laissant orphelins cinq enfants entre un et douze ans avec un mari qui navigue. Il est quasiment certain que c'est sa soeur Stylitte qui a élevé<br />
les cinq petits orphelins Lancelot lesquels formaient avec ses trois enfants Ertaud une grande famille de huit frères et sœurs "de lait " comme on disait autrefois et<br />
donc beaucoup plus proches que des cousin(e)s germain(e)s élevés séparément.<br />
Cette découverte éclaire d’un jour nouveau les réticences de Ernestine Ertaud pour épouser Jean Bureau. Elle avait comme frère de lait “jumeau” Joseph<br />
Jacob Lancelot né la même année qu’elle en 1832. On peut penser que ce "frère" occupait une place particulière dans le cœur de Ernestine. On peut imaginer un<br />
scénario selon lequel Ernestine Ertaud aurait souhaité épouser son cher cousin Joseph avec lequel elle aurait pu prolonger dans le cadre matrimonial leur intimité<br />
d'enfants. Projet pas si absurde au demeurant puisque Joseph Jacob épousera lui-même une cousine germaine Lancelot et que ses deux sœurs épouseront des cousins<br />
germains Lancelot.<br />
La demande en mariage de Jean Bureau vient ruiner ce projet secret. Ernestine doit vite trouver une parade. Et comme elle connaissait la position de Jean<br />
Bureau qui exigeait de fonder son foyer à Vertou et nulle part pas ailleurs (voir ci-dessus), elle a beau jeu de prétexter qu'elle ne souhaite pas quitter Trentemoult.<br />
Dialogue de sourd dont l'effet est immédiat sur ce pauvre Jean Bureau qui rompt sine die les négociations prénuptiales. Le danger ainsi écarté tous les espoirs<br />
restent permis pour Ernestine…jusqu'à la date fatidique du 31 Juillet 1860 qui est celle du mariage de son cher Joseph avec sa cousine germaine Pauline. Tous ses<br />
espoirs envolés, Ernestine de dépit relance immédiatement la candidature de Jean Bureau qui surpris par ce revirement inattendu (il doit se dire que Vertou est<br />
toujours Vertou) éprouve quelques difficultés à être fin prêt pour son propre mariage bouclé cinq mois plus tard, en Décembre de la même année.<br />
# La branche Lancelot de François-Joseph<br />
La découverte de cette proximité familiale entre la famille Ertaud et la famille Lancelot m'a fait émettre l'hypothèse, désormais confirmée, que les six<br />
cousines (devenues huit depuis) devaient être des jeunes filles Lancelot. Mais pour pouvoir la confirmer il fallait d’abord déchiffrer la parentèle particulièrement<br />
embrouillée de cette tribu Lancelot à la manière d'un anthropologue. Ce travail n’a pas été inutile car il m'a permis d'étudier l'évolution socio-professionnelle d'une<br />
famille de navigateurs typique de Trentemoult sur une période de deux siècles.<br />
Le grand ancêtre commun de cette branche est François Joseph Lancelot né en 1775 Capitaine de navire (le diplôme de Maître au Cabotage n’existait pas à<br />
cette époque). Il exerce son activité sous l'Empire. François Joseph a eu cinq fils (Joseph Jacob, Julien Jacob, Abel Adrien, Pacifique, Félix) tous Maîtres au<br />
cabotage et une fille,Madeleine qui épouse un maître au cabotage, la seconde Reine épousant un constructeur de navires. Refrain connu. Nés entre 1801 et 1823 ils<br />
seront Capitaines vers 1825, sous la Restauration, et donc au moment où la marine à voile nantaise reprend son essor. François Joseph Lancelot fait construire,<br />
finance et arme un navire chasse-marée, le “Jeune Joseph” en 1832, année de la naissance de Joseph Jacob le “quasi-jumeau” de Ernestine Ertaud. Les intéressés de<br />
ce navire sont François Joseph et trois de ses fils. Les autres intéressés sont Pierre Dejoie épicier, Cormier ouvrier Raffineur (la raffinerie Say est en face de la
Haute Ile sur la rive opposée de la Loire), Lignot cordier ainsi que l’inévitable constructeur de navires, Lusseaux de Chantenay.<br />
I-Joseph Jacob épouse Marie Hortense Bessac comme on le sait déjà. Nous y reviendrons.<br />
II-Julien Jacob épouse Marguerite Fruneau. Leur fille Pauline épousera le cousin Joseph Jacob comme indiqué ci-dessus. Leur deuxième fille Eléonore reste<br />
célibataire.<br />
III-Abel Adrien Lancelot (1802-1883) épouse Clarisse Ertaud l'une des deux soeurs de Adrien Ertaud. Leurs deux enfants resteront sans postérité: Adrien Lancelot<br />
(1837-1872) disparaît en mer à 35 ans, alors qu'il commande le Brick “Emilie Ernestine” et Joséphine Arthémise Lancelot épouse un Cap au LC, Félix Adrien Allain, dit<br />
le Bosco (1831-1872), union restée sans descendance. Pour les spécialistes avertis signalons que Félix Allain et Joséphine Lancelot sont également cousins germains,<br />
car leurs mères sont deux soeurs Ertaud, Aglaé et Clarisse, les tantes de Ernestine Ertaud - Bureau.<br />
IV-Pacifique I Lancelot (1801-1873) épouse Marie Virginie Bertrand. Leurs cinq fils seront tous Capitaines au Long Cours dont deux reconvertis dans le négoce ne<br />
navigueront pas :<br />
1-Pacifique II Lancelot (1829-1869) CLC part s’installer à Haïti où il épouse Théano Marion, une Haïtienne. Ses deux fils feront de même : Emmanuel épouse<br />
Marie Louise Woehl et Charles épouse Lucie Poitevin.<br />
2-Raphaël Lancelot (1832-1890) Cap au LC fut le Maire de Rezé de Mai 1878 à sa disparition en 1890. La rue de Trentemoult où il avait sa maison rappelle son<br />
souvenir. Il épousera successivement deux Lemerle, une Louise Marie Zoé, puis une Reine Céline. Sa fille Céline Lancelot du second mariage épousera elle aussi un<br />
Lemerle Gabriel, Médecin. Son premier mariage restera sans descendance, Raphaël est sourd-muet, et Louis disparaît en mer. Le fils de Gabriel, Yves Lemerle<br />
deviendra magistrat et à ce titre sera visé par un attentat alors qu'il était Procureur en Algérie.<br />
3- Félix Marie Lancelot CLC épouse Amanda Lancelot, fille de Joseph Jacob Lancelot. Il commandera le 3M “Alphonse Elisa” pendant quelques années. Ce 3M<br />
sera également commandé par Julien Chauvelon avant qu'il ne commande le “Belem” et par Julien Joseph Lancelot, un cousin d'une autre branche (voir ci-après)<br />
4-Jean-Baptiste Lancelot (1841-1871) CLC disparaît en mer avec le 3M “Ville de Blain”.<br />
5-Augustin Marie, CLC Lancelot épouse Hortense Bureau, fille de sa cousine germaine Hortense Lancelot.<br />
V- Félix Lancelot épouse Anne Bertrand. Ils auront un fils Félix Aristide, sans postérité et une fille Marie (épouse Henriot) dont la fille Anne épouse un Mevel qui<br />
exercera comme médecin à Douarnenez.<br />
VI-Madeleine Lancelot épouse Noël Bertrand Constructeur de Navires. Ils auront deux filles, Marie et Aimée sans postérité et un fils Noël Bertrand qui épouse sa<br />
cousine germaine Marie fille de Joseph Lancelot.<br />
VII-Reine Lancelot épouse François Codet Cap Au Cabotage. Leur fille Joséphine est restée sans postérité et leur fille Marie Codet épouse Talma Bertrand, union qui<br />
donnera trois fils Talma, Georges et René et une fille Marie.<br />
1-René Bertrand jeune Capitaine Cap Hornier a connu une fin tragique. Il prend en 1906 à Bordeaux le commandement du voilier St Donatien en relève du<br />
Capitaine Dejoie qui avait pris en charge le navire dès son lancement aux Chantiers Dubigeon le 30 Novembre 1901 pour le compte de l’Armement Bureau et Fils. Le<br />
St Donatien parti de Bordeaux sur lest pour charger du blé à Adélaïde signale par radio le 6 Juillet 1908 que tout va bien à bord. Depuis il n’a plus donné aucune<br />
nouvelle … disparu corps et biens dans des circonstances inconnues. René Bertrand avait déjà connu de biens pénibles moments avec le “ Félix Faure” puisque avec ce<br />
navire il s’était retrouvé emprisonné dans les glaces australes, situation tout a fait inconfortable dont le souvenir est rappelé par un bateau en bouteille conservé<br />
dans la famille Lancelot. Le 2 Février 1898 ce navire avait été retourné comme une crêpe par une vague monstrueuse au large des Kerguelen ("the ship was swept<br />
from stern to stem by the sea") perdant 15 hommes d’un seul coup. Ce même navire commandé par le malheureux Adrien Codet avait déjà failli périr à la suite d’une
voie d’eau. La carrière de ce navire prendra fin le 13 Février 1908, sous le commandement du Capitaine Noël, en allant se briser par temps de brouillard sur les<br />
rochers de l'île des Antipodes, au Sud-est de la Nouvelle Zélande, à la limite des glaces antarctiques. Les 22 membres de l'équipage réussirent à gagner l'île où ils<br />
survécurent pendant deux mois grâce au dépôt de survie établi par l'administration de Nouvelle Zélande, se nourrissant d'albatros, de pingouins, de coquillages.<br />
Après 60 jours à se geler sous d’incessantes chutes de pluies, de neiges et de grêles ils furent enfin secourus par le HMS Pegasus et ramenés à Little rock, NZ. Le<br />
“Félix Faure“ avait été lancé le 3 février 1896 au Chantier du Havre-Graville pour le compte de la Cie Havraise de Navigation à Voiles dirigée par Messieurs C. Brown<br />
et E. Corblet. (Félix Faure originaire du Havre est un Président resté célèbre pour être mort dans l’exercice de ses fonctions !). Long de 95 mètres, large de 13,90<br />
mètres, le bâtiment a une jauge brute de 2650 Tx. Sa surface de voilure est de 3500m2. Il est le premier d'une série de 8 quatre-mâts barque en acier. Affecté<br />
principalement au transport de nickel entre la Nouvelle-calédonie et Le Havre, il effectua en 1903 une traversée record de 79 jours.Talma Bertrand est Ingénieur<br />
de Travaux Publics de formation. C’est également un régatier émérite qui a participé aux premières Olympiades et régates internationales avec des voiliers de sa<br />
conception où il affrontait les puissants de ce monde comme la Kayser Guillaume III.<br />
Maquette montrant le Pdt Félix Faure pris dans les glaces
# La descendance de Joseph Lancelot<br />
Revenons maintenant sur la descendance de Joseph Lancelot et de ses cinq enfants. Les cousines "supposées" sont indiquées en souligné. Les spécialistes<br />
remarqueront qu'il s'agit en fait de cousines issues de germain(e)s.<br />
1-Joseph Jacob Lancelot (1832) “frère jumeau” de Ernestine Ertaud a épousé sa cousine Pauline. Ils auront deux filles, Hortense Marie née en 1865 restée<br />
célibataire et Valentine née en 1863 qui épouse un médecin Emile Ertaud. Leur fils Emile Ertaud, Chirurgien réputé de Nantes, épouse Anny Mevel descendante<br />
directe de Félix Lancelot, union d'où naît Simone Ertaud l’épouse du Général Paris de la Bollardière connu pour sa dénonciation de la torture en Algérie qui lui valut de<br />
faire de la forteresse.<br />
2-Reine Amanda Lancelot (1837) épouse son cousin germain Félix, fils de Pacifique I Lancelot. De cette union naîtront deux filles restées célibataires :<br />
Amanda (1865) et Clémence (1870) et un fils Joseph. Celui-ci part à Haiti où il épouse une belle locale Claire Sanz union qui donnera naissance à Félix (dont les<br />
enfants sont : Jean, Marie-Claire, Annick) et Auguste (Marie Claire). Son histoire aurait inspiré en partie le réalisateur du film ”La Reine Blanche” dont l’intrigue se<br />
déroule à Trentemoult avec comme acteurs Catherine Deneuve, Richard Bohringer, Jean Carmet, Bernard Giraudeau. Il a été tourné sur place en décors naturels<br />
revus et corrigés notamment dans la maison familiale Lancelot située à Trentemoult 10 Rue Bruneau.<br />
Marie Virginie (1878) épouse Julien Chauvelon un Cap au LC qui a bénéficié d’une gloire post-mortem inattendue pour avoir commandé pendant 14 ans le Belem.<br />
Il est ainsi décrit par Jean Noli :<br />
“ Fils de marin, né le 11 février 1875 à Rezé, sur la rive gauche de la Loire, il est premier lieutenant de la Reine-Blanche à bord de laquelle il double le Cap<br />
Horn, puis second capitaine sur la Marguerite-Arnhaud, quand la Maison Crouan l'engage à son service. Le Belem est son premier commandement : il a 26 ans.<br />
Contrairement à ses prédécesseurs, corpulents et massifs, Chauvelon a une silhouette élancée, presque mince. Mais l'apparence est trompeuse : sous le costume noir<br />
qu'il ne quitte presque jamais, l'homme est endurant et solide. Les cheveux bruns coiffés en arrière, le visage ovale, le nez droit et fin, la moustache épaisse,<br />
toujours élégant, il est séduisant et les Nantaises qui le voient se diriger à pas pressés vers les bureaux de son armateur lui trouvent bien du charme. Mais le marin<br />
n'a que deux passions : la mer et son épouse, menue et gracieuse (elle était appelée la petite Marie dans sa famille). "<br />
Marie aura trois enfants, Anne, Jeanne et Auguste. Jeanne épouse le CLC Etienne Bessac qui fera une belle carrière à la Transat et sa fille Suzanne est l'une<br />
des mémoires de l'histoire trentemousine.<br />
3-Marie Lancelot née en 1844 épouse son cousin germain Louis Noël Bertrand, fils de Noël et de Madeleine Lancelot. Leur fille Marie restera sans postérité.<br />
4- Félix Lancelot, marin disparaît en mer à 17 ans sur le Brick “Entreprise”.<br />
5 – Hortense Lancelot (1835) épouse Pierre Bureau, union d'où naîtront un fils Pierre et quatre filles : Hortense, Laure, Jeanne, Augustine qui elles ne poseront<br />
pas en costume traditionnel.<br />
La série des six portraits de l'album a été récemment rejointe par deux autres retrouvés dans la collection de photos de Suzanne Briand : celui de Céline<br />
Lancelot (1880) fille de Raphaël Lancelot, petite-fille de Pacifique et celui de Anne Henriot petite-fille de Félix Lancelot photographiée en costume trentemousin à<br />
Quimper! Les photo-portraits des huit cousines Lancelot ont été enfin identifiées (pas tout a fait car les identifications ne font pas toutes l'unanimité, encore un peu<br />
de patience) et réunies après 120 ans d'oubli. Comme les cailloux du Petit Poucet leurs jolis minois ont permis de retrouver la trace d'une tribu familiale<br />
représentative de la communauté trentemousine au XIXème.<br />
Qu'en conclure ? Ces photos ont été prises à un moment (entre 1865 et 1890) où les jeunes filles de Trentemoult ne portaient plus le costume mais où la<br />
photo portrait s'était popularisée. Les "cousines" ont dû estimer que la cérémonie de la photo portrait serait la dernière occasion pour elles de porter le costume de<br />
leurs mères et grand-mères. Leur message est arrivé jusqu'à nous.<br />
Pour revenir vers des choses plus sérieuses, le bilan socioprofessionnel de la lignée de François-Joseph confirme les observations faites par ailleurs.<br />
François-Joseph a eu 5 fils et 1 gendre capitaines au cabotage. Il a eu 26 petits-enfants : 15 filles, 11 garçons. Sur ces 11 petit-fils deux seulement navigueront, tous
deux disparus en mer: René Bertrand et Louis Lancelot. La plupart d'entre eux, bien que diplômés Capitaines au LC , préfèreront exercer à terre comme négociants.<br />
Plusieurs filles restent célibataires. Deux filles épousent des médecins. Deux seulement épousent un Capitaine au LC qui navigue: Marie épouse Julien Chauvelon et<br />
Jeanne Bureau épouse Charles Dolu. Peu d'entre eux habitent encore Trentemoult au début du Xxème. La vocation maritime séculaire de cette famille typique de<br />
Trentemoult semble s'être épuisée en deux générations seulement... conséquence inéluctable des grands bouleversements induits par la révolution scientifique et<br />
technologique du XIXème et de l’évolution sociale et financière de ces familles de navigateurs.<br />
# Généalogie et génétique<br />
On est très surpris aujourd'hui de constater le grand nombre de mariages consanguins qui se concluaient entre cousins et petit-cousins, une pratique<br />
totalement abandonnée de nos jours mais qui était courante en France jusqu’à la fin du XIXème. L’exemple venait de haut puisque les parents de Louis XIV étaient le<br />
frère et la sœur des parents de son épouse Marie-Thérèse d’Autriche.<br />
Les spécialistes sont (presque) unanimes pour dire que la consanguinité n’est pas “collectivement” nuisible, bien au contraire, car c’est une forme de sélection<br />
qui élimine les caractères négatifs (par exemple les sourds-muets ne se mariaient pas) et renforce les caractères positifs (au prix semble-t-il d’une diminution du<br />
taux de reproduction pour des raisons mal élucidées). Par ailleurs les démographes démontrent par un simple calcul, en comparant la population probable de la France<br />
en l’an 1000 avec celle de l’an 2000, que le taux de consanguinité de la population française a toujours été très élevé.<br />
Il est facile aujourd’hui, mais c’est encore coûteux, de réaliser des analyses génétiques pour établir le degré de parenté entre deux individus. Pour les hommes<br />
on utilise le chromosome Y qui se transmet de père en fils alors que pour les femmes c’est l’ARN mitocondrial qui se transmet de mère en fille. Tous les hommes d’une<br />
même lignée masculine ont donc le même chromosome Y, à quelques détails près, car à chaque nouvelle génération de légères modifications peuvent produire sur la<br />
partie non-codante c’est-à-dire sans gènes reproductifs (le chromosome Y porte très peu de gènes). Plus il y a de différences dans ces mutations, plus la parenté est<br />
éloignée. Des laboratoires spécialisés peuvent ainsi déterminer quel est le degré de parenté de deux personnes supposées avoir un ancêtre commun. Le magazine<br />
National Geographic finance actuellement un grande enquête internationale dans le but de déterminer une sorte de cartographie macro-généalogique de l’espèce<br />
humaine.<br />
# Ordre des prénoms<br />
C'est sans doute une évidence pour les généalogistes confirmés, mais il m'a fallu un certain temps avant de m'en apercevoir. Jusqu'à une date récente, disons<br />
fin XIXème, l'ordre des prénoms était à l'inverse de notre pratique actuelle.
# Photos des 8 cousines Lancelot<br />
Amanda Lancelot Céline Lancelot Clémence Lancelot
Hortense Lancelot Virginie Lancelot Marie Virginie Lancelot
Marie Bertrand Anne Henriot
# La branche Lancelot Julien<br />
Une seconde branche Lancelot part de Julien IV Lancelot, frère de François-Joseph Lancelot (pour ne pas se perdre dans la succession des Julien Lancelot<br />
ils ont été numérotés). Julien III Lancelot, pêcheur est retrouvé noyé sur la plage d’Escoublac-La Baule en 1787 à 39 ans. (Marié à 20 ans avec Perrine Dejoie il aura<br />
11 enfants en 19 ans). Son fils Julien IV François Lancelot (1754-1810), Patron d'une barge de pêche, la Mélanie, il décède à St Gildas de Rhuys Son fils Julien V<br />
Grégoire Lancelot (1814-1850) est Maître au Cabotage. Julien VI Joseph Lancelot (1847-1929) est Capitaine au Long Cours. Ses deux fils Julien VII Francis Lancelot<br />
(1880-1951) et Auguste (1883-1949) le sont aussi. Ce dernier Julien aura trois filles mais aucun fils : Germaine épouse Jean Codet, Cap au LC qui terminera une<br />
brillante carrière à la Transat. Leur fils François est un Capitaine de Vaisseau (Navale 1969). Leur second fils, Jean, Officier Mécanicien, meurt en mer<br />
accidentellement à 25 ans. Denise Codet, Institutrice restée célibataire était jusqu'à sa disparition en Novembre 2003, une mémoire vivante de Trentemoult qui<br />
connaissait intimement toutes les branches et sous branches des tribus familiales de Trentemoult.<br />
# La branche Lancelot Nicolas<br />
Cette troisième branche Lancelot part de Nicolas Lancelot, Pêcheur, fils de Noël Lancelot, puis passe par un Julien Lancelot l’un des tout premiers Capitaine<br />
au cabotage au début du XIXème. Puis on trouve Félix Julien Lancelot né en 1826 Cap Au LC qui aura deux fils Mathurin Lancelot (1863-1900) Capitaine de Frégate<br />
et Julien Elisée (1866-1952) Professeur de mathématiques au Lycée Clemenceau de Nantes. Elisée Marie le fils de Julien Elisée est Ingénieur Agronome. Ses enfants<br />
sont ingénieur, océanologue, sinologue, universitaire (Alain Lancelot) et médecin (François Lancelot). On trouve également dans cette branche l’Amiral Pierre Lancelot<br />
l'un des trois amiraux originaires de Trentemoult avec l'Amiral Ollive et l'Amiral Lepeltier.<br />
# Noël Lancelot un grand ancêtre<br />
En remontant un peu plus haut, vers le début du XVIIème on trouve une ancêtre commun aux trois branches Lancelot précitées. Il s’agit de Noël Lancelot né<br />
le jour de Noël 1636, décédé en 1708 qui a eu trois épouses qui lui ont donné au total seize enfants. Son grand-père, Jan Lancelot né en 1575 est le plus lointain<br />
Lancelot repéré par les généalogistes de la famille.<br />
Julien I est le fils de Noël Lancelot, François Joseph est le fils de Julien III et c'est son frère Julien IV qui initie la branche Julien. Une branche féminine<br />
part de Julien I et mène à Catherine Hautebert, la mère de Adrien Ertaud. Une autre branche féminine part de Julien II pour arriver à la famille des Dejoie maires<br />
de Vertou.<br />
Au bout du compte ce Noël Lancelot est l’ancêtre commun de nombreux contemporains qui l’ignoraient et s’ignoraient jusqu’au 20 Septembre 2003 date où<br />
une trentaine de descendants de familles de navigateurs de Trentemoult se sont retrouvés pour évoquer leurs souvenirs de famille et leurs recherches généalogiques<br />
et autres. La moitié des participants descendaient de ce Noël Lancelot: François Lancelot, François Codet, Denise Codet, Suzanne Briand, Hugues Briand, Florence<br />
Ertaud, Hélène Laguillier, Denise Bolo-Sarradin, Raymond Sarradin, Joël Bolo, Catherine Gander, Laurent Dejoie, Gaétan Le Tilly et Xavier Leroy.<br />
La descendance contemporaine de Noël Lancelot comprend quelques personnalités locales comme Luc et Laurent Dejoie, maires de Vertou, une personnalité<br />
nationale comme Alain Lancelot ancien directeur de Sciences-Po et ancien membre du Conseil Constitutionnel, quelques officiers supérieurs de la Marine Nationale,<br />
des universitaires, de nombreux médecins, des chercheurs, des ingénieurs, des professeurs, une paire de polytechniciens, de nombreux citoyens américains et encore<br />
quelques rares citoyens haïtiens ! En remontant vers les générations antérieures on trouve bien entendu une quantité de pêcheurs, de capitaines au cabotage, de<br />
capitaines au long cours, de cap horniers, de capitaines de vaisseau, de constructeurs de navires, de négociants, un amiral et un maire de Rezé.
# Les deux Hortense<br />
Nous avions les deux soeurs Bessac. Nous avons les deux Hortense, la mère Hortense Lancelot épouse de Pierre Bureau Capirote et la fille Hortense Bureau-<br />
Lancelot. La correspondance des cinq cousins Bureau nous avait déjà donné quelques informations sur Hortense Lancelot : son mariage avec Pierre Bureau, son voyage<br />
de jeune mariée en Méditerranée, son rôle d’intermédiaire pour marier notre Jean Bureau, ses visites à Vve Marie Bureau au Côteau du Chêne accompagnée de sa<br />
petite Hortense.<br />
On a appris depuis que Hortense Lancelot était la fille de Marie-Hortense Bessac et de Joseph Jacob Lancelot. Elle appartient donc à la fois à la lignée de<br />
André Ertaud et à celle de Noël Lancelot. Son frère Joseph Jacob et ses deux sœurs frères ont épousé des cousin(e)s germain(e)s de la branche François Joseph.<br />
Pour ajouter un peu plus de confusion Hortense Bureau épouse Augustin Lancelot capitaine au LC un cousin germain de sa mère, fils de l’oncle Pacifique. Celui-ci<br />
s'oriente vers le négoce du café haïtien où il fait fortune. On peut encore voir à Trentemoult, à l'angle de la rue Ordronneau et de la rue de Californie, leur<br />
imposante demeure surnommée “Le Château“ à Trentemoult. Cette réussite n'a pas coupé Hortense Lancelot Bureau de ses racines familiales. Elle est au contraire<br />
devenue le pivot du clan Lancelot- Bureau - Ertaud. Epouse, nièce, belle-sœur et cousine de presque tous les Lancelot de la branche François-Joseph elle reçoit<br />
régulièrement dans sa demeure cousins et cousines, célibataires et épouses de maris partis en mer ou à Haïti pour leurs affaires. Sa fille Marthe épouse Paul Briand,<br />
originaire d'une honorable famille de Trentemoult Elle est la grand-mère de notre "cousine" Suzanne Briand descendante directe de toutes les grandes tribus de<br />
navigateurs de Trentemoult (et de Vertou ) : Briand, Lancelot, Ertaud, Bessac, Chauvelon, Dejoie, Boju, Bureau.<br />
Hortense Bureau a vécu de près l'aventure haïtienne de sa famille Lancelot. Avant de poursuivre situons le décor. La République de Haïti qui occupe la partie<br />
Ouest de l’île de St Domingue est une ancienne colonie française alors que la partie Ouest, l’actuelle République Dominicaine est une ancienne colonie espagnole. Cette<br />
île toute proche de Cuba, des Bahamas et de la Floride fut la première terre touchée par Christophe Colomb, par sa côte Nord où se situe l’Ile de la Tortue. Plus de 6<br />
millions d’habitants s’entassent aujourd’hui sur un territoire montagneux grand comme trois fois la Corse, avec à peine le tiers de ses terres exploitables, ce qui<br />
ajouté à de nombreuses autres causes en fait aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde.<br />
Au XVIIème et XVIIIème les habitants de l’Ouest de la France partaient nombreux du port de Nantes pour émigrer vers St Domingue, le Canada et la<br />
Louisiane. Une trentaine de milliers de colons et d’aventuriers de toutes nationalités ont ainsi jeté leur dévolu sur ce territoire déjà trop petit pour les accueillir<br />
avec ses centaines de milliers d’esclaves. Les troubles de la Révolution et les avatars napoléoniens vont jeter de l’huile sur le feu de ce chaudron où grands et petits<br />
colons, pirates reconvertis, repris de justice, esclaves affranchis ou non, et toutes sortes d’aventuriers vont s’affronter violemment à partir de l’indépendance en<br />
1804. Les liens étaient très étroits entre St Domingue et le pays nantais pour des raisons évidentes. Mme Bouteiller cite le témoignage d’une vertavienne dont les<br />
ancêtres exploitaient une plantation à St Domingue et on retrouve là-bas la trace d’un Louis Viau originaire de Vertou établi à St Domingue vers 1700 qui y a laissé<br />
une très nombreuse descendance.<br />
Au XIXème, avant l'émergence du café brésilien, Haïti était l'un des premiers pays fournisseurs de café, une denrée de grande valeur. Les Lancelot vont se<br />
placer dans ce négoce. Pacifique II Lancelot (1829) cousin germain de Hortense Lancelot est le premier des Lancelot à partir s'installer là-bas. Il y épouse en 1858<br />
Marie Joséphine Théano Marion, petite-fille de l’un des fondateurs de la République de Haïti dont la famille est établie de longue date aux Gonaïves, principal port<br />
de sortie du café haïtien situé au bord du Golfe de la Gônave face à Cuba (Guantanamo). C’est sur la place de cette petite ville, ancien site Taïno, que l’Indépendance<br />
de Haïti a été proclamée le 1 er Janvier 1804. Pacifique Lancelot est enterré dans le cimetière des Gonaïves et y a laissé une nombreuse descendance.
Hortense Lancelot et Hortense Bureau (vers 1862)<br />
Son jeune frère Augustin, l'époux de Hortense Bureau, a quitté pendant plussieurs années Trentemoult pour s'occuper du négoce du café en Haïti. Leur fils<br />
Louis Lancelot s’installe définitivement à Haïti où il épouse une Haïtienne Léonie McGuffie. Sa mère lui rend parfois visite en accompagnant son mari. C'est au cours<br />
de l'un de ces voyages qu'elle y décède. Elle est elle aussi inhumée dans le cimetière des Gonaïves aux côtés de son fils Louis et de son beau-frère Pacifique. Au fil<br />
des difficultés rencontrées à Haïti ses descendants haïtiens émigreront vers les Etats-Unis.<br />
(J’ai compris maintenant pourquoi ma grand-mère me disait que son grand-père recevait directement de ses cousins de St Domingue son café vert en sac).
Hortense Lancelot et ses 3 enfants Maison Augustin Lancelot à Trentemoult Tombe de Hortense Lancelot-Bureau à Haïti<br />
On a ainsi suivi le destin peu ordinaire de Hortense Bureau depuis ses premiers pas à Vertou sur le Côteau du Chêne sous la férule de Vve Marie Bureau jusqu’à<br />
ses derniers jours dans une bourgade perdue des Caraïbes. Ce destin est marqué par de nombreuses photos anciennes depuis la toute première prise autour de 1860<br />
où on la voit en compagnie de sa mère Hortense Lancelot vers l'âge de 3 ans jusqu’à celle de sa dernière demeure en Haïti. Le lecteur attentif (?) aura certainement<br />
remarqué que notre petite histoire des familles de navigateurs est encadrée par deux tombes de deux femmes Bureau. Celle de Marie Bureau à Vertou et celle de<br />
Hortense Bureau très loin sous le ciel des Caraïbes. Il aura aussi remarqué que les femmes tiennent une grande place dans cette histoire : Ernestine Ertaud,<br />
Ernestine Bureau, Noëmie Bureau, Hortense Lancelot, Hortense Bureau, les deux soeurs Bessac, les huit cousines Lancelot, ma grand-mère.<br />
# Pierre Bureau – 3 ème épisode<br />
Et notre Pierre Bureau peut-on savoir ce qui lui est arrivé ? Nous savions qu'il était disparu en mer. Avec sa lettre écrite à 22 ans nous savions qu'il savait<br />
écrire et qu'il naviguait sur un brig “La Caroline " qui allait à Terre-Neuve. Nous avions retrouvé sinon sa trace du moins celle des navires sur lesquels il avait<br />
navigué, des brigs morutiers qui partaient pour des campagnes de pêche de neuf mois sur le grand ban.
Finalement sa dernière trace a été retrouvée dans les registres matricules de l'Inscription<br />
Maritime conservés aux ADLA. On y apprend que notre Pierre Bureau mesurait 1,66 m (plutôt une<br />
grande taille pour l'époque) qu'il avait le poil châtain, les yeux gris, le front ordinaire, le nez pointu, la<br />
bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, la bouche moyenne, le menton rond. Pas de signe<br />
distinctif jusq'en 1828 ... “ il a la mâchoire inférieure cassée, que plusieurs portions osseuses ont été<br />
extraites, que la mastication est difficile et impossible sur du corps dense (?). Impropre au service de<br />
mer. Certificat du médecin de marine daté du 4 juin 1828 ”.<br />
En 1826 il est Matelot tonnelier sur le brig “ La Pauline ". De 1827 à la fin de 1828 il est<br />
embarqué sur un gabarre “ L'Amédée " allant au petit cabotage. Il débarque fin Août au Croisic puis<br />
rembarque comme Matelot tonnelier sur le navire « Le Senneur " allant à la Guadeloupe. Il en revient le<br />
16 Mai puis rembarque le 27 Mai comme Maître Tonnelier sur le même allant à la pêche à la morue à la<br />
côte de Terre Neuve ". Il en débarque le 10 Août et rembarque sur le même qui le débarque à Nantes le<br />
3 Septembre. Ce n'est qu'en Mars de l'année suivante qu'il ré-embarque sur L'Amédée, allant au<br />
cabotage. Mais au début de 1832 cette gabare disparaît “ sans nouvelles depuis le 28 Avril 1832 que<br />
l'Amédée est sortie du Croisic avec un chargement de sel pour Paimbeuf où le bâtiment n'est pas arrivé<br />
; l'Armateur n'ayant pas eu de nouvelles depuis cette époque on considère L'Amédée perdue corps et<br />
biens à la mer Sans nouvelles. " et le fonctionnaire de l'Inscription Maritime a recopié plusieurs années<br />
de suite, sans nouvelles, sans nouvelles... Ainsi nous savons maintenant que Pierre Bureau est mort alors<br />
qu'il naviguait à bord de la gabare L'Amédée, mystérieusement disparue entre Le Croisic et Paimbeuf,<br />
sans doute suite à un désarrimage de sa cargaison de seLa biographie de Pierre Bureau est<br />
emblématique du destin des marins vertaviens. Ils vont naviguer en mer parce qu'ils sont nés au bord de<br />
la Sèvre où ils ont acquis des compétences précieuses pour la Marine d'Etat comme charpentiers de<br />
navire, gabariers ou tonneliers. Ils ont appris le métier de marin sur des gabares ou des petits navires<br />
armés par des cousins ou des voisins. Ils ont accompli un service militaire qui a enrichi et complété leur<br />
formation et leur a fait découvrir des horizons nouveaux. De là ils pourront poursuivre une carrière de<br />
matelot ou s'ils en ont les capacités intellectuelles de Maître au cabotage. Certains d'entre eux comme<br />
Auguste Bureau ou son frère Pierre pourront même devenir Capitaine au Long cours. Et de là se hisser à<br />
la position enviable de capitaine-armateur comme Jean Bureau et son frère Pierre. Beaucoup d'autres<br />
ne pouvaient n'accomplissaient qu'une partie de ce parcours<br />
Pierre Bureau est un exemple de ce que l'on peut apprendre sur un ancêtre qui naviguait au<br />
XIXème en consultant les 4 ou 5 registres matricules qui retracent de façon assez détaillée les étapes<br />
de sa carrière, sur quels navires il a embarqué, quels incidents ont marqué sa carrière, et ses principaux<br />
traits physiques.
# Que sont-ils devenus ?<br />
Peu à peu le souvenir des navigateurs de l’âge d’or de la marine nantaise du XIX ème s'est estompé, puis s'est totalement perdu, ne laissant que quelques<br />
traces matérielles discrètes de leur exceptionnelle aventure: des tombes dans un cimetière, des maisons de capitaines, des noms de rues, d'anonymes photos<br />
jaunies, des tableaux de voiliers, quelques antiquités de marine …et quelques belles réussites professionnelles pour nombre de leurs descendants !<br />
Au Jeu de l’Oie de l’aventure maritime bien peu ont gagné. Il fallait d’abord et avant tout disposer d’une solide santé, devenir capitaine, commander<br />
jeune, vivre vieux, inspirer confiance à des intéressés pour financer son navire et acquérir le statut de capitaine armateur, réussir des voyages profitables, ne<br />
pas se faire enlever par une lame sournoise ou une maladie exotique, ne pas se perdre corps et biens par une erreur de manoeuvre ou de navigation, ne pas<br />
faire de mauvais choix d’équipage, de fret, de route, et l'âge de la retraite arrivé réussir à revendre à bon compte son navire. Bien peu d'entre eux ont réussi<br />
ce parcours sans faute pendant deux générations. Et il fallait surtout éviter de tomber sur la case fatale "Cap-hornier".<br />
Ce ne sont pas leurs modestes fortunes chèrement acquises et vite fondues au soleil qui nous impressionnent. Comme leurs contemporains nous restons<br />
surtout admiratifs de ces quasi-surhommes capables de dompter ces immenses machines à voiles dans les pires conditions de mer, de vent et de tempêtes, de<br />
partir sillonner toutes les mers du globe et de visiter une quantité de pays exotiques, d'affronter des risques considérables pour leur santé et leur vie, de<br />
s'absenter de leur village et de leur famille pendant de long mois, parfois même des années, de faire leur commerce dans tous les ports du monde, dans toutes<br />
les langues, dans toutes les monnaies. Ils étonnaient leurs contemporains par l’étendue de leurs expériences, de leurs connaissances, de leurs aventures et de<br />
leurs compétences commerciales, géographiques et financières. Ils admiraient la réussite et l'ascension sociale de ces "self made man".<br />
Certes ils n’étaient pas rompus comme les notables terriens aux humanités classiques, grecques ou latines, ni aux bonnes manières. Mais ils étaient des<br />
hommes courageux, entreprenants, pragmatiques, pleinement responsables de leurs actes et de leurs décisions car la moindre erreur pouvait leur être fatale.<br />
Ils avaient beaucoup appris sur le tas pour s'être frottés au cours de leurs voyages à plusieurs pays, cultures et civilisations. Ils avaient eu la chance<br />
d'observer l'essor des pays émergents et d’avoir pu se confronter durant leur service militaire aux nouvelles techniques d'avenir. Ils avaient une mentalité de<br />
chefs d’entreprise et de capitaines d’industrie. Ils généraient des emplois et des activités autour d'eux, marins, mais aussi toutes les professions associées:<br />
tonneliers, charpentiers de navires, accastilleurs, forgerons, ainsi que les artisans du bâtiment qui construisaient ou rénovaient leurs maisons. Ils assuraient<br />
des compléments de revenus substantiels aux notables qui prenaient des intérêts dans leurs navires.<br />
Ce n’est donc pas étonnant que la communauté maritime ait joué à Vertou un rôle si important dans le passé comme le montre la liste de ses<br />
représentants officiels : Charles Garnier, Armateur, maire pendant dix-huit ans, Jean Bureau, Capitaine-Armateur maire pendant cinq ans ; Charles Lecour,<br />
Armateur sénateur de l’arrondissement ;Charles Bonnigal petit-fils de capitaine, maire ( ref Simone Bouteiller), Ernest Guichet, issu d’une famille de<br />
navigateurs de la Barbinière, maire dans les années 50, et les trois Dejoie successivement maires de Vertou : Lucien, Luc et Laurent, descendants d’une famille<br />
de navigateurs originaire … de Trentemoult.<br />
Plus que leur fortune c'est leur statut social qui en imposait alors, conjonction remarquable pour l’époque de la réussite financière, de l’éducation<br />
supérieure, de l’esprit d’entreprise, de l’expérience du commerce et de la conduite des affaires. Ils ont ainsi donné à leur descendance, un énergique coup de<br />
pouce social. A la fin du XVIII ème les habitants de la Barbinière et du Chêne sont gabariers ou charpentiers de navires. Au début du XIX ème ils sont marins. Au<br />
milieu du XIX ème ils sont presque tous capitaines au cabotage puis au long cours. Au début du XXème tous leurs descendants sont partis vaillamment à la<br />
conquête des nouvelles carrières offertes par l'industrie, le commerce, l'administration, la santé, l'armée, l'enseignement où on les retrouve à des postes de<br />
110
premier plan. De nombreuses familles et entreprises honorablement connues de la région nantaise plongent ainsi leurs racines dans ces lignées oubliées de<br />
navigateurs du XIX ème où elles ont puisé le dynamisme et l’esprit d’entreprise si caractéristiques de cette région.<br />
111
# Crédits généalogiques<br />
La reconstitution des généalogies compliquées des familles de navigateurs de Trentemoult a pu être menée à bien grâce à plusieurs membres de ces familles qui ont<br />
fourni le plus gros de l’effort. Joël Bolo pour les familles Ertaud, le regretté Michel Paquet l’incollable spécialiste Ollive et des tribus de la Haute Ile, Alain Lejoly etc.<br />
La généalogie simplifiée des Bureau Capirote et des Gicquel avait été établie par Célestin Gicquel. Elle a été complétée pour les familles Le Tilly et Ertaud par le<br />
travail de Adrien Janeau. Et c’est François Lancelot, rencontré sur Internet qui m’a communiqué la généalogie des Lancelot et m’a mis sur la piste des cousins de<br />
Trentemoult … et du travail deHugues Briand lui-même un descendant des Bureau Capirote, qui a transcrit sous forme informatique l'énorme travail de recherche<br />
généalogique accompli par Suzanne Briand, son frère Maurice et son oncle Eugène Briand pendant plus de dix ans pour explorer systématiquement toutes les branches de<br />
leurs ascendances : Briand, Lancelot, Bureau, Boju, Dejoie…<br />
# Bibliographie<br />
“ Traité Elémentaire d’Architecture Navale “ de Adrien d’Etroyat, publié en 1863 et réédité en 2002 par les Editions Ancre. C'est un ouvrage de référence pour<br />
connaître l’Art de la construction des voiliers marchands au milieu du XIXème<br />
" Deux années sur le gaillard d'avant " de Richard Henri Dana publié aux éditions Payot Découvertes. C’est l'ouvrage de référence pour les conditions de vie à bord<br />
des bricks marchands du début du XIXème.<br />
" La France maritime au début du XIX ème " publié par les Editions Le Layeur composé de peintures et gravures de ports français du célèbre Louis Garneray,<br />
commentées par le Professeur Martine Acerra, spécialiste de l’histoire maritime française.<br />
“ Clippers Français “ de Claude et Jacqueline Briot publié aux éditions Chasse Marée Armen. Remarquablement documenté et illustré principalement à partir de<br />
sources havraises c'est le livre le plus complet sur les voiliers de marche du XIXème.<br />
" Les derniers grands voiliers " du Cdt Louis Lacroix publié aux Editions Ouest-France – Un ouvrage irremplaçable écrit par un spécialiste et un témoin direct de<br />
cette aventure. Il fournit le CV des 147 navires Cap Horniers nantais.<br />
“ Les derniers Voiliers Caboteurs français “ du Cdt Lacroix publié aux Editions Maritimes d’Outre-Mer. Consacré au cabotage il contient de nombreux<br />
renseignements pratiques concernant la marine à voile nantaise et le cabotage artisanal.<br />
“Cap Horniers Français “ de Brigitte et Yannick …… publié aux Editions Chasse-marée -Ouest France. C'est une publication principalement consacré à l’Armement<br />
Bordes de Dunkerque et aux marins et capitaines de Bretagne-Nord. Remarquablement documenté et illustré.<br />
" La construction civile dans l'Amirauté de Nantes au XVIIIème " de Bruno Cailleton publié aux éditions Hérault.<br />
“ Construisez des modèles réduits de marine – Marine de guerre à voiles 1750-1850 ” publié par Barrot de Gaillard -<br />
“ Les grandes heures de Nantes ” de Armel de Wismes<br />
" La Bretagne Contemporaine ", publié en 1865 par Henri Charpentier Editeur-Imprimeur et réédité en fac-similé par les presses du Donon.<br />
“ Les Vikings en France “ de Jean Renaud publié aux Editions Ouest-France - Mémoires de l’Histoire “
“ L’Europe des Vikings” – Catalogue de l’Exposition de l’Abbaye de Daoulas - Hoëbeke<br />
" L'Album du Marin " du Capitaine de Frégate PC Caussé, publié à Nantes par Charpentier en 1836 - Réédité en fac-similé par Inter-Livres..<br />
" Nantes au temps de la traite des Noirs " de Olivier Pétré-Grenouilleau publié par Hachette – Collection de la Vie quotidienne.<br />
" Regards sur Vertou " de Association “Vertou au Fil du Temps“ pour l’histoire de Vertou, de ses habitants, de ses villages, de ses célébrités. Lire en en particulier<br />
le N° 4 – 1996 - "La Construction Navale Vertavienne" de Mme Simone Bouteiller.<br />
“ La folle équipée de la Duchesse de Berry ” de Thérèse Rouchette édité par le Centre vendéen de recherches historiques.<br />
“ Histoire générale de la Chouannerie” de Anne Bernet édité par Perrin.<br />
“ Georges Cadoudal et les Chouans” de Patrick Huchet aux éditions Ouest-France.<br />
“ Rezé pendant le Révolution et l’Empire” et “ Rezé au 19 ème ” de Michel Kervarec aux Editions ACL , St Sébastien (ces deux ouvrages de cet excellent ami étant<br />
épuisés, je n’avais pas pu les lire en temps utile … ni les citer. Maintenant c’est fait ).<br />
# Sites Internet<br />
www.xleroy.net publie de nombreux de documents qui complètent le présent texte.<br />
http://marzina.free.fr/nantesvoiles/voiliers17.html - Site de la descendante d’un Capitaine d’Armement de la CNCO<br />
http://histo.hautanjou.free.fr/Loireat/BUREAU.pdf - Site de Odile Halbert contenant ses recherches sur le patronyme Bureau au Sud de Nantes.<br />
http://daniel_burgot.club.fr/index.htm - Site Acadien qui comporte de nombreuses informations sur l’activité maritime de Nantes au XVIIIème et XIXème<br />
http://pageperso.aol.fr/lycornelia/index.htm -Site du 40 ème RI consacré à l’expédition d’Orient et qui évoque le torpillage de l’Amiral Magon.<br />
# Liste de navires cités<br />
L'Adélaïde, La Caroline, Le Superbe, La Pauline, L'Argo, Le Georges, L'Eugénie, L'Adelaïde-Marie, L'Auguste-Marie, La Pauline et Noëmie, La Redoute, Le<br />
Duquesne, Le Romazzotti, L'Arc, Le Paris, Le Supply, Le Pilgrim, L’Inconstant, Le Flying Cloud, Le Taipeh, Le Cutty Sark, Le Paulista, La Clémence, Le Pur-Sang, Le<br />
Perpignan, La Souvenance, La Jeune Aglaë, Le Ville-de-Blain, L'Aramis, Le Gédéon-Marie, L'Inès, Le Charlemagne, Le St Rogatien, Le St Donatien, Le Président<br />
Félix Faure, Les Deux Frères, Le Corse, Le Daniel, Le Penrose, Le Henri Lecour, Le Charles Lecour, Le Courrier de Marseille, Le Panama, La Champagne, Le Jeune<br />
Joseph, Le Phoebus, etc