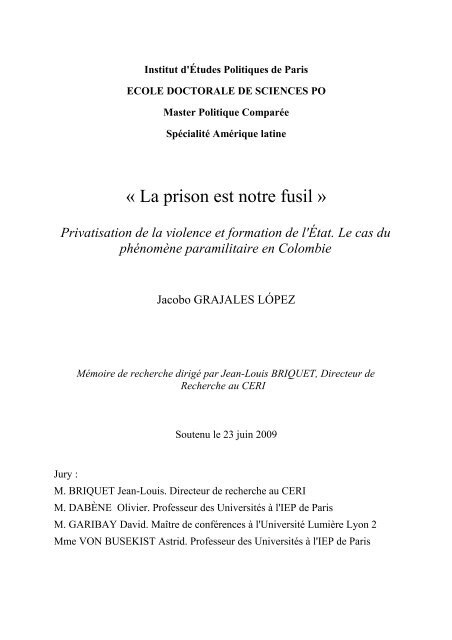« La prison est notre fusil » - Opalc
« La prison est notre fusil » - Opalc
« La prison est notre fusil » - Opalc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Institut d'Études Politiques de Paris<br />
ECOLE DOCTORALE DE SCIENCES PO<br />
Master Politique Comparée<br />
Spécialité Amérique latine<br />
<strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong><br />
Privatisation de la violence et formation de l'État. Le cas du<br />
phénomène paramilitaire en Colombie<br />
Jury :<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ<br />
Mémoire de recherche dirigé par Jean-Louis BRIQUET, Directeur de<br />
Recherche au CERI<br />
Soutenu le 23 juin 2009<br />
M. BRIQUET Jean-Louis. Directeur de recherche au CERI<br />
M. DABÈNE Olivier. Professeur des Universités à l'IEP de Paris<br />
M. GARIBAY David. Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2<br />
Mme VON BUSEKIST Astrid. Professeur des Universités à l'IEP de Paris
À Maëla
Si on élimine la justice, que sont en effet les<br />
royaumes, sinon du brigandage en grand? Les bandes<br />
de brigands elles mêmes ne sont-elles pas, en petit,<br />
des royaumes? Car ce sont des groupes d'hommes, où<br />
un chef commande, dont un pacte social resserre les<br />
liens, où des conventions règlent le partage du butin.<br />
Si cette société de crime fait assez de recrues parmi<br />
les malfaiteurs pour occuper certaines positions, pour<br />
fonder des établissements, pour occuper des cités,<br />
pour subjuguer des peuples, alors elle s'arroge plus<br />
ouvertement le titre de royaume, que lui confère aux<br />
regards de tous, non pas un renoncement quelconque à<br />
ses convoitises, mais bien l'impunité qu'elle s'<strong>est</strong><br />
assurée.<br />
Spirituelle et juste fut la réponse que fît à Alexandre le<br />
Grand ce pirate tombé en son pouvoir. Le roi lui<br />
demandait : <strong>«</strong> À quoi penses-tu, d'inf<strong>est</strong>er ainsi la<br />
mer? – et toi, répondit-il, avec une audacieuse<br />
franchise, à quoi penses-tu d'inf<strong>est</strong>er la terre? Parce<br />
que je n'ai qu'un petit navire on m'appelle un<br />
<strong>«</strong> bandit <strong>»</strong>; toi, comme tu opères avec une grande<br />
flotte, on te nomme un " conquérant " <strong>»</strong>.<br />
Saint Augustin, <strong>La</strong> Cité de Dieu,<br />
Livre IV, chapitre 4
RÉSUMÉ<br />
Le phénomène de la fragmentation du monopole étatique de la violence a souvent été lu<br />
comme la marque de la faiblesse des États voire de leur effondrement. Ce travail tente une<br />
lecture différente qui s'inspire des analyses récemment publiées en France sur la privatisation<br />
des États, sur les liens entre crime organisé et politique et sur le phénomène milicien.<br />
Le terrain Colombien permet d'analyser cette fragmentation de la violence comme une<br />
forme de privatisation de l'État, ce qui conduit à souligner les nombreux chevauchements<br />
entre violence privée et violence publique. Nous traitons ici d'un type d'acteur particulier, les<br />
groupes paramilitaires. Ces organisations sont apparues dans les années 1980 comme les<br />
porteuses d'un projet contre-insurrectionnel. Ces groupes ne sont pas le produit d'une politique<br />
gouvernementale, même s'ils jouissent d'une grande tolérance. Ils sont au carrefour<br />
d'alliances complexes entre professionnels de la violence, militaires, narcotrafiquants et<br />
secteurs des élites politiques et économiques locales. <strong>La</strong> multiplication de ces groupes<br />
pendant les années 1980 et 1990, ainsi que leur postérieure fédération sous la bannière des<br />
Autodéfenses Unies de Colombie, constituent une forme de fragmentation et<br />
désinstitutionnalisation de la violence. En revanche, ces processus n'aboutissent pas à un<br />
effondrement de l'État, mais au contraire à son redéploiement et à la redéfinition de ses<br />
contours.<br />
À travers une analyse qui oscille entre le national et le local, basée en partie sur une<br />
étude du cas du département du Magdaléna, ce travail s'efforce de comprendre les ressorts de<br />
la privatisation de la violence.<br />
Mots-clés : Colombie, conflit armé, Magdalena, milices, paramilitaire, privatisation des États,<br />
Santa Marta, violence<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 7
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 8
REMERCIEMENTS<br />
Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Jean-Louis Briquet, qui a accepté de<br />
diriger ce mémoire de recherche. Ses conseils opportuns et ses encouragements amicaux<br />
m'ont accompagné tout au long de la préparation et la rédaction de ce travail. <strong>La</strong> liberté qu'il<br />
m'a accordée fut pour moi un gage in<strong>est</strong>imable de confiance.<br />
Ma reconnaissance s'adresse à Olivier Dabène, qui a suivi cette réflexion depuis sa<br />
naissance et à Yves Déloye pour son soutien scientifique et personnel. Merci également à<br />
Hélène Combes et à Philippe Braud, qui m'ont donné de leur temps et des conseils d'une<br />
grande valeur.<br />
Je ne remercierai jamais assez Anne Avy, sans qui toute cette aventure se serait arrêté<br />
avant d'avoir commencé.<br />
Merci à William Renán et à l'Université du Magdaléna à Santa Marta pour leur aide sur<br />
le terrain. Merci également à l'Université Javeriana de Bogotá et au CINEP, où j'ai été si bien<br />
accueilli.<br />
Merci à tous ceux qui ont accepté de me parler de leurs expériences et de partager leur<br />
connaissance dans un contexte si difficile. Ils m'ont ouvert les portes de leurs maisons et de<br />
leurs vies, malgré la méfiance qu'ils pouvaient ressentir.<br />
Enfin, merci à ma famille – étendue – qui a supporté en silence la souffrance de deux<br />
mois d'un terrain risqué et difficile. Malgré cette inquiétude ils m'ont soutenu et fait<br />
confiance. Merci pour tant d'amour.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 9
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 10
Principaux sigles utilisés<br />
ACCU : Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – Autodéfenses paysannes de<br />
Córdoba et Urabá<br />
ACDEGAM : Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio –<br />
Association paysanne d'agriculteurs et éleveurs du Magdaléna Moyen<br />
ADP : Autodefensas de Palmor – Autodéfenses de Palmor<br />
AUC : Autodefensas Unidas de Colombia – Autodéfenses Unies de Colombie<br />
BN : Bloque Norte – Bloc Nord (Composante des AUC)<br />
CUT : Central Unitaria de los Trabajadores – Centrale Unitaire des Travailleurs<br />
DAS : Departamento Administrativo de Seguridad – Département Administratif de Sécurité<br />
ELN : Ejército de Liberación Nacional – Armée de Libération National<br />
EPL : Ejército Popular de Liberación – Armée Populaire de Libération<br />
FARC-EP : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo – Forces<br />
Armées Révolutionnaires de Colombie, Armée du Peuple<br />
Fedegán : Federación de Ganaderos de Colombia – Fédération d'éleveurs de Colombie<br />
FRT : Frente Resistencia Tayrona – Front Résistance Tayrona (AUC)<br />
Incora : Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Institut Colombien de la Réforme<br />
Agraire<br />
M-19 : Movimiento 19 de abril – Mouvement 19 avril<br />
MAS : Muerte a Secu<strong>est</strong>radores – Mort aux ravisseurs<br />
UP : Unión Patriótica – Union Patriotique<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 11
Table des matières<br />
Résumé....................................................................................................................................7<br />
Remerciements........................................................................................................................9<br />
Principaux sigles utilisés ......................................................................................................11<br />
Introduction ............................................................................................................15<br />
1. De l'effondrement de l'État à son redéploiement .............................................................17<br />
2. Le fil conducteur : l'utilisation de la violence .................................................................26<br />
3. Méthodologie....................................................................................................................32<br />
4. Ce qui va suivre.................................................................................................................41<br />
I - État et privatisation de la violence en Colombie ...............................................43<br />
1. L'ombre de la Révolution..................................................................................................49<br />
2. Vers la violence généralisée .............................................................................................55<br />
3. <strong>La</strong> décennie 1990 et la privatisation de la violence..........................................................65<br />
II - Qui sont les paramilitaires? ..............................................................................75<br />
1. <strong>La</strong> <strong>«</strong> capitale de l'anti-subversion de Colombie <strong>»</strong>.............................................................75<br />
2. <strong>La</strong> <strong>«</strong> maison <strong>»</strong> Castaño .....................................................................................................86<br />
3. Alliances et polarisation : un cadre d'analyse pour l'évolution du phénomène<br />
paramilitaire........................................................................................................................100<br />
III - Le département du Magdaléna et les premiers groupes paramilitaires......105<br />
1. Les conditions d'apparition des professionnels de la violence........................................108<br />
2. <strong>La</strong> polarisation : apparition d'une demande....................................................................115<br />
3. Les premiers groupes de professionnels de la violence..................................................120<br />
IV - Des entrepreneurs en concurrence.................................................................127<br />
1. Violence politique et violence mafieuse.........................................................................130<br />
2. L'explosion de la violence...............................................................................................139<br />
3. Des entrepreneurs du contrôle social..............................................................................151<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 12
VI - <strong>La</strong> formation d'un monopole de la violence...................................................155<br />
1. Implantation et consolidation des AUC..........................................................................158<br />
2. <strong>La</strong> conquête d'un monopole............................................................................................168<br />
2. De la violence généralisée à la terreur............................................................................184<br />
VI - De la violence à l'hégémonie...........................................................................196<br />
1. De la maîtrise de la violence au contrôle des suffrages..................................................198<br />
2. Violence, institutions publiques et accumulation privée.................................................207<br />
3. Expropriation de terres....................................................................................................210<br />
Épilogue : ce n'<strong>est</strong> pas la fin de l'histoire...............................................................223<br />
1. Alliances politiques et démobilisation : quels leviers sur le centre?...............................224<br />
2. Tensions intra-étatiques et volatilité des accords public-privé.......................................226<br />
Bibliographie............................................................................................................231<br />
Annexes.....................................................................................................................239<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 13
NOTA<br />
Nous avons utilisé le mot municipe ou encore municipalité pour traduire du castillan<br />
<strong>«</strong> municipio <strong>»</strong>. Dans les pays hispanophones, c'<strong>est</strong> la plus petite division administrative. En<br />
Colombie il y en a environ 1400. Le municipe n'<strong>est</strong> pas l'équivalent de la commune. C'<strong>est</strong> une<br />
unité plus grande dont dépendent des entités telles les comunas, corregimientos ou veredas.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 14
Introduction<br />
<strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong>, celui qui ne respecte pas <strong>notre</strong> loi meurt <strong>»</strong> 1 . Selon un habitant du<br />
village de Tucurinca, dans le Magdaléna, les paramilitaires des Autodéfenses Unies de<br />
Colombie (AUC) menaçaient ainsi la population. Cette organisation armée, créée en 1997<br />
pour unifier les nombreux groupes paramilitaires qui existent dans le pays, contrôlait, à l'aube<br />
du XXIe siècle, des pans importants du territoire colombien. Jusqu'à sa démobilisation, entre<br />
2005 et 2008, les AUC sont engagées dans une lutte sanglante pour arracher des territoires<br />
aux différents groupes de guérilla. Les paramilitaires mènent une guerre <strong>«</strong> par populations<br />
interposées <strong>»</strong> 2 qui fait plusieurs dizaines de milliers de morts et plusieurs centaines de milliers<br />
de réfugiés internes.<br />
Les paramilitaires sont apparus dans les années 1980, comme une réponse de divers<br />
secteurs de la société à la guérilla et à la gauche civile. Ils agissaient à l'origine en toute<br />
légalité, puisque la loi permettait la création par l'armée de forces supplétives. Cependant,<br />
avec le temps ces premiers groupes se sont associés aux trafiquants de drogue, ce qui a rendu<br />
moins aisé l'appui ouvert des instances publiques. Cependant, comme nous espérons le<br />
montrer dans <strong>notre</strong> travail, les groupes paramilitaires ont provoqué de fortes tensions à<br />
l'intérieur de l'État, entre les partisans d'un <strong>«</strong> droit à l'autodéfense <strong>»</strong> et ceux d'un monopole<br />
étatique de la violence. <strong>La</strong> ligne entre le légal et l'illégal se déplace au gré de ces conflits,<br />
plaçant les groupes paramilitaires dans une situation ambiguë.<br />
L'évolution des groupes paramilitaires, qui les mène vers un contrôle chaque fois plus<br />
étroit du territoire et de la population, transforme les logiques de la violence qu'ils mettent en<br />
œuvre. Ces groupes n'agissent plus ponctuellement, dans le but de protéger leurs clients ou<br />
leurs intérêts économiques. Ils évoluent vers la mise en place d'un système de plus en plus<br />
sophistiqué de g<strong>est</strong>ion de la violence.<br />
Le but de ce travail <strong>est</strong> de s'interroger sur cette violence, sous l'angle de la<br />
transformation qu'elle provoque dans les structures locales du pouvoir. Elle redéfinit l'espace<br />
du politique, crée des systèmes de contrôle social et des dispositifs d'accumulation des<br />
1 Cas n°13. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 <strong>La</strong>ir [2000], p. 533<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 15
essources. In fine, elle redessine les contours de l'État. Nous essayerons donc de comprendre<br />
comment cette violence privée devient un outil d'exercice du pouvoir politique.<br />
<strong>La</strong> définition des groupes paramilitaires semble une qu<strong>est</strong>ion épineuse. En effet, elle<br />
met l'analyste aux prises avec des conflits qui s'engagent autour d'étiquettes chargées de sens.<br />
Le gouvernement, par exemple, réfute pendant longtemps l'appellation de paramilitaires, à<br />
cause probablement des liens qu'elle suggère avec l'armée. Il préfère lui remplacer la notion<br />
de <strong>«</strong> groupes de justice privée <strong>»</strong>, qui aura cependant un succès très limité. Ces groupes<br />
refusent aussi le nom de paramilitaires et préfèrent adopter celui <strong>«</strong> d'autodéfenses <strong>»</strong>, avec tout<br />
le capital symbolique de cela comporte.<br />
Il <strong>est</strong> nécessaire de se dissocier de ces luttes symboliques avant d'entreprendre toute<br />
tentative d'analyse. Nous adopterons le mot de paramilitaires, qui <strong>est</strong> l'étiquette la plus<br />
répandue dans la société colombienne, la presse et la littérature scientifique pour se référer à<br />
ces groupes-là 1 . Or, nous tenterons d'en donner une définition opératoire. Nous définirons ici<br />
les groupes paramilitaires comme des organisations qui (1) entretiennent un rapport ambigu à<br />
l'État, qui les tolère et parfois les soutient; (2) qui utilisent la violence ou l'intimidation pour<br />
attaquer ou éliminer des groupes ou des individus perçus comme une menace à l'ordre social,<br />
politique ou économique 2 ; (3) et qui dans ce but mettent en place des formes de contrôle du<br />
territoire et des sociétés locales.<br />
Le cœur de ce travail <strong>est</strong> une étude de cas. Elle s'intéresse au développement du<br />
phénomène paramilitaire dans le département du Magdaléna, situé au Nord de la Colombie.<br />
Ce choix mérite une justification. En effet, dans certaines régions de Colombie, il y a eu une<br />
sorte d'importation de groupes paramilitaires. Ceux-ci sont arrivés déjà dotés d'une<br />
organisation complexe, de moyens de financement et de combattants entraînés. Ils ont été<br />
souvent attirés par une demande de secteurs de la population qui étaient prêts à payer pour<br />
obtenir un service de sécurité. Dans d'autres régions du pays nous voyons le phénomène<br />
contraire; des groupes paramilitaires se développent de manière progressive et conflictuelle,<br />
ils s'allient avec d'autres groupes armés ou les absorbent; ils servent les intérêts économiques<br />
et politiques locaux et deviennent ainsi des <strong>«</strong> entrepreneurs de violence <strong>»</strong> 3 . Le département du<br />
Magdaléna présente les deux types de phénomènes. Des groupes paramilitaires apparaissent<br />
au début des années 1980; ils s'attaquent aux guérillas, aux partis politiques de gauche et aux<br />
syndicats. Ils trempent dans le trafic de drogue et le racket, ressemblant sur beaucoup<br />
1 Voir une revue du la littérature sur le phénomène paramilitaires dans le monde faite par Jones [2004]<br />
2 Les points 1 et 2 s'inspirent de la définition de Jones [2004], p. 130<br />
3 Volkov [2002]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 16
d'aspects à la mafia classique 1 . Or, l'évolution du conflit dépasse les capacités militaires de ces<br />
entrepreneurs de violence. Incapables de répondre à leurs clients et menacés par une guérilla<br />
de plus en plus puissante, ils sont écartés par les AUC.<br />
Nous arrêterons <strong>notre</strong> analyse au moment de l'engagement de négociations entre le<br />
gouvernement d'Alvaro Uribe et les AUC. Ces négociations démarrent officiellement en 2003<br />
et aboutissent à la démobilisation de l'organisation entre 2003 et 2006. En effet, le but de ce<br />
travail <strong>est</strong> de s'interroger sur l'utilisation de la violence comme un outil de pouvoir et d'accès<br />
aux institutions. Il aurait été extrêmement intéressant de s'interroger également sur les<br />
tensions intra-étatiques et les débats sociaux que soulève la qu<strong>est</strong>ion de la démobilisation<br />
paramilitaire. Or, nous ne possédons pas les sources nécessaires pour évaluer cette<br />
négociation. Au demeurant, une telle enquête aurait largement dépassé les objectifs de <strong>notre</strong><br />
travail. Une autre raison pour s'arrêter en 2003 <strong>est</strong> qu'à partir de la disparition des AUC, des<br />
nouveaux groupes paramilitaires apparaissent dans le pays. Ces <strong>«</strong> bandes émergentes <strong>»</strong><br />
comme les appelle l'armée, constituent vraisemblablement une nouvelle étape de<br />
transformation d'un phénomène qui en a connu beaucoup. Néanmoins, très peu de sources<br />
fiables existent sur ces nouveaux types d'acteurs; il faudra certainement attendre plusieurs<br />
années avant d'être en mesure d'effectuer des analyses sur la mutation que le phénomène<br />
paramilitaire subit actuellement. Il <strong>est</strong> cependant important, pour mettre en perspective <strong>notre</strong><br />
étude, de s'intéresser à l'évolution de la situation depuis 2003. Nous y reviendrons dans un<br />
bref épilogue.<br />
Dans cette introduction nous commencerons par définir le positionnement théorique de<br />
ce travail. Ensuite, nous traiterons de la qu<strong>est</strong>ion de la violence; en effet, son étude sera le fil<br />
conducteur de <strong>notre</strong> travail. Enfin, nous traiterons des qu<strong>est</strong>ions de méthodologie.<br />
1. De l'effondrement de l'État à son redéploiement<br />
Il semblerait intuitif d'identifier le phénomène paramilitaire à une forme<br />
d'affaiblissement, voire d'effondrement de l'État. C'<strong>est</strong> d'ailleurs l'orientation d'une grande<br />
partie de la littérature. Or, cette analyse – nous semble-t-il – se fonde sur une vision normative<br />
de l'État et sur une opposition binaire entre forces armées légitimes et forces armées<br />
illégitimes. Elle assume également l'existence d'un hiatus entre la violence publique et la<br />
violence privée, entre l'État légal-rationnel et les groupes paramilitaires. Ce rapport<br />
d'extériorité doit être qu<strong>est</strong>ionné; il l'<strong>est</strong> d'ailleurs par la simple l'observation des nombreuses<br />
1 Cf. Catanzaro [1991]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 17
formes de chevauchement entre violence étatique et violence paramilitaire 1 . Nous proposerons<br />
ici une lecture alternative. Avant de l'exposer, il convient d'effectuer une revue critique de la<br />
littérature existante sur le phénomène paramilitaire en Colombie.<br />
L'hypothèse de l'affaiblissement de l'État<br />
Malgré les critiques que nous formulons plus haut, il <strong>est</strong> certain que la littérature<br />
produite en Colombie sur les groupes paramilitaires <strong>est</strong> abondante et souvent de grande<br />
qualité. Nous pouvons la classer schématiquement classée autour de deux grands débats 2 .<br />
Le premier débat oppose les partisans d'une analyse des groupes paramilitaires comme<br />
des outils d'une politique étatique contre-insurrectionnelle et des acteurs d'une <strong>«</strong> guerre sale <strong>»</strong>,<br />
aux partisans d'une définition de ces groupes comme étant <strong>«</strong> relativement <strong>»</strong> autonomes par<br />
rapport à l'État. L'hypothèse des premiers <strong>est</strong> que le phénomène paramilitaire apparaît dans le<br />
cadre de la stratégie contre-insurrectionnelle avant de se criminaliser sous l'influence des<br />
narcotrafiquants et sortir ainsi du contrôle de l'État 3 . L'approche structuraliste alors adoptée<br />
privilégie les conditions économiques et sociales des régions d'apparition du phénomène, au<br />
détriment de l'analyse des stratégies des acteurs 4 . En outre, la réduction du phénomène<br />
paramilitaire à une modalité de répression étatique repose sur une vision monolithique et<br />
réifiante de l'État, qui cache les intérêts conflictuels qui peuvent s'affronter en son sein 5 .<br />
Cette vision du phénomène paramilitaire perd du crédit à partir de 1997 avec<br />
l'apparition des AUC, organisation armée complexe et puissante qui revendique le statut de<br />
troisième acteur du conflit, à côté de l'armée et des guérillas. Apparaissent alors des analyses<br />
qui s'opposent radicalement à la thèse de la dépendance et privilégient une approche en termes<br />
<strong>«</strong> d'autonomie relative <strong>»</strong>. L'argument <strong>est</strong> que le phénomène paramilitaire peut être considéré<br />
comme autonome de l'État dans la mesure où il n'y a pas de liens organiques entre les<br />
institutions publiques et les groupes paramilitaires. Ceux-ci seraient des réactions de la<br />
<strong>«</strong> société civile <strong>»</strong> face à l'incapacité de l'État à garantir la sécurité. T. Ljodal, conclut ainsi que<br />
les paramilitaires sont un acteur autonome revendiquant le droit à défendre une conception du<br />
1 Les remarques qui précèdent font partie des axes de recherche posés par le colloque du CERI-<br />
Sciences Po : Regards croisés sur les milices d'Afrique et d'Amérique latine, 25 et 26 septembre 2008<br />
2 Nous nous inspirons ici du classement effectué par Cruz Rodriguez [2007]<br />
3 Cf. Medina Gallego [1990]<br />
4 Cf. Medina Gallego et Tellez Ardila [1994]<br />
5 Cf. Uprimny et Vargas [1990]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 18
statu quo 1 . Pour A. Rangel, les paramilitaires ont certes un dessein contre-insurrectionnel,<br />
mais celui-ci se développe indépendamment de l'État; ils seraient des acteurs autonomes dans<br />
la mesure où ils mettent en doute le monopole étatique de la force 2 . Une des critiques les<br />
mieux argumentées de cette position <strong>est</strong> l'analyse socio-historique de F. Gutiérrez et M.<br />
Barón; ces auteurs montrent, dans une étude du cas de Puerto Boyacá, la complexité des<br />
intérêts qui s'agrègent autour de la mobilisation paramilitaire 3 .<br />
L'opposition entre dépendance et autonomie reflète l'évolution organisationnelle des<br />
groupes paramilitaires, mais aussi la position des institutions publiques. En effet, jusqu'à la fin<br />
des années 1990, il n'y a pratiquement aucun traitement politique du phénomène paramilitaire.<br />
Ces groupes sont assimilés dans les textes officiels à des acteurs criminels 4 , ou sont tout<br />
simplement ignorés. Ce manque de traitement du problème cache au demeurant les collusions<br />
entre paramilitaires et agents publics. Le peu d'attention des pouvoirs politiques contraste<br />
fortement avec l'impact croissant des paramilitaires. Dans ce contexte, les prises de position<br />
des politistes colombiens consistent souvent en une dénonciation de l'inaction complice de<br />
l'État.<br />
À partir de 1998, l'unification de la plupart des groupes paramilitaires sous la bannière<br />
des AUC rend le phénomène beaucoup plus visible. De plus, les groupes paramilitaires se<br />
lancent dans une campagne médiatique visant à canaliser en leur faveur l'opposition croissante<br />
d'une partie de l'opinion aux FARC-EP. Ces évolutions historiques favorisent les analyses en<br />
termes d'autonomie. Un partage s'effectue alors entre les intellectuels se revendiquant d'une<br />
science politique dénonciatrice et engagée et ceux identifiés au conseil et à la <strong>«</strong> science<br />
camérale <strong>»</strong> 5 . L'enlisement du conflit à la fin de la décennie 1990, où le pays semble au bord de<br />
la guerre civile, favorise la polarisation et la radicalisation des positions politiques. <strong>La</strong> science<br />
se retrouve alors au centre du débat dans la cité.<br />
L'autre débat qui agite la littérature <strong>est</strong> celui qui s'engage entre une approche politique<br />
et une approche économique du phénomène. Autour de l'approche politique, certains auteurs<br />
1 Ljodal [2002]<br />
2 Rangel [2005a]<br />
3 Gutierrez Sanin et Barón [2005]<br />
4 <strong>La</strong> première mention des groupes paramilitaires dans un texte de officiel <strong>est</strong> en 1993, dans<br />
<strong>«</strong> Estrategia nacional : seguridad para la gente <strong>»</strong>. Ce texte programmatique en matière de sécurité parle<br />
de <strong>«</strong> groupes de justice privée <strong>»</strong> Cubides [1997], p. 24<br />
5 Pour les qu<strong>est</strong>ions soulevées par cet engagement des intellectuels dans la cité voir : L'intervention du<br />
politiste dans le débat politique. En finir avec la neutralité axiologique ? Journée d'études de<br />
l'Association Française de Science Politique. 28/05/2008. Sous la responsabilité scientifique d'Olivier<br />
Fillieule, Fabien Jobard et Jean Leca<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 19
considèrent que l'apparition des groupes paramilitaires <strong>est</strong> la conséquence des transformations<br />
subies par les institutions politiques à la suite des processus de paix avec les guérillas et à<br />
l'écriture de la constitution de 1991. L'apparition de groupes paramilitaires serait alors une<br />
réaction des élites qui voient leurs privilèges menacés par les transformations en cours 1 .<br />
D'autres considèrent que le phénomène naît de la faiblesse de l'État colombien, incapable de<br />
garantir la sécurité sur son territoire 2 . Cette position, transversale à beaucoup d'analyses,<br />
répond en partie à la proximité entre conseil et science politique. Les politistes colombiens<br />
sont souvent proches du milieu des organisations internationales, ce qui oriente souvent les<br />
qu<strong>est</strong>ionnements vers des approches normatives et d'aide à l'intervention.<br />
Les auteurs privilégiant une approche économique considèrent que le principal facteur<br />
qui différencie les paramilitaires colombiens d'autres groupes armés d'Amérique latine <strong>est</strong><br />
l'autonomie financière que leur assure les rentes de la drogue. Cela provoque une<br />
détermination de leurs stratégies par la recherche de ces rentes 3 . Ainsi, pour G. Duncan, les<br />
paramilitaires peuvent être définis comme des <strong>«</strong> seigneurs de la guerre <strong>»</strong> qui consolident et<br />
contrôlent des canaux d'accès aux rentes de la drogue par l'influence sur l'appareil d'État 4 .<br />
L'approche en termes politiques réagit à l'enlisement du processus de paix avec les<br />
FARC-EP. En effet, ces auteurs affirment que élites locales, en réaction aux pourparlers, se<br />
rapprochent des AUC 5 . En outre, elle creuse les mécanismes sociologiques des alliances entre<br />
politiques et paramilitaires 6 . L'approche en termes économiques apparaît au moment où les<br />
liens entre paramilitaires et trafic de drogues sont de plus en plus dénoncés 7 . Ces liens<br />
imposent la qu<strong>est</strong>ion de la définition de ces groupes armés : sont-ils des guerriers ou des<br />
narcotrafiquants? Dans ce cas, le qu<strong>est</strong>ionnement scientifique suit d'une manière trop proche<br />
le discours des acteurs et alimente des luttes symboliques. En outre, la qu<strong>est</strong>ion du rôle<br />
économique des paramilitaires acquiert une importance majeure au moment où les collusions<br />
avec les élites politiques locales font l'objet d'enquêtes judiciaires. Ces collusions permettent<br />
aux paramilitaires d'avoir accès au budget des administrations locales, et d'effectuer des<br />
prélèvements sur les finances publiques. Ainsi, on peut penser que la disponibilité des sources<br />
1 Cf. Romero [2003]<br />
2 CF. Melo [1990]<br />
3 Pizarro [2004]<br />
4 Duncan [2005a]<br />
5 Romero [2003], p. 227<br />
6 Ibidem, spécialement pages 117-157<br />
7 Carlos Castaño lui même, leader des AUC, a affirmé alors que 80% des finances de l'organisation<br />
étaient issues du trafic des drogues. Cf. Valencia [2007]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 20
judiciaires depuis 2005 détermine l'orientation des recherches. <strong>La</strong> qu<strong>est</strong>ion de la prise de<br />
position du politiste dans la cité et de le lien entre analyses savantes et discours des acteurs <strong>est</strong><br />
là aussi essentielle. En effet, la dénonciation des collusions peut conduire certains à opposer<br />
schématiquement milieux criminels et milieux politiques. De la même manière la séparation<br />
entre l'aspect économique et l'aspect politique du phénomène paramilitaire répond plutôt à des<br />
controverses politiques qu'à des débats scientifiques.<br />
<strong>La</strong> plupart des analyses se fondent sur une définition a priori de l'État; celui-ci serait<br />
forcément une entité contrôlant directement un territoire sur lequel il ferait régner l'État de<br />
droit, une institution organisée selon un modèle légal-rationnel et promouvant la démocratie.<br />
Même les plus critiques des universitaires, qui dénoncent les collusions entre élites politiques<br />
et paramilitaires ou entre ces derniers et l'armée fondent leurs analyses sur cette vision de<br />
l'État. On parle alors d'un État local <strong>«</strong> séqu<strong>est</strong>ré <strong>»</strong> par les alliances de paramilitaires et<br />
politiques 1 ; il y aurait donc d'un côté l'État central rationnel et démocratique, agissant selon<br />
les règles du droit et d'un autre côté les forces réactionnaires dans le local qui échapperaient à<br />
son emprise et le <strong>«</strong> captureraient <strong>»</strong> à leur seul profit privé. Or, comme le souligne dans<br />
d'autres contextes Béatrice Hibou, <strong>«</strong> l'analyse des situations concrètes nous enseigne que, pour<br />
appréhender et comprendre l'État, il <strong>est</strong> impossible de séparer État et pouvoir, État et élite<br />
dirigeante : autrement dit, pour comprendre l'État, il faut comprendre les gens au pouvoir et,<br />
tout aussi important, leurs jeux, leurs stratégies et leurs pratiques historiques. Cette<br />
dépendance mutuelle définit les contours de l'État : il <strong>est</strong> impossible de séparer l'économique<br />
du politique, les intérêts privés des intérêts publiques, le particulier du général <strong>»</strong> 2 .<br />
L'intégration des logiques relevant de l'intérêt privé permet en outre d'écarter l'idée selon<br />
laquelle le domaine de l'illégal serait étranger à l'État, comme une sorte de contamination de<br />
celui-ci par des forces obscures. Tout au contraire, <strong>«</strong> les illégalismes et l'usage irrégulier de la<br />
violence n'en constituent pas moins des leviers d'accumulation de ressources économiques et<br />
politiques, de contrôle social et territorial, in fine des instruments d'exercice du pouvoir <strong>»</strong> 3 .<br />
Cette critique rejoint d'ailleurs celle que l'on fera aux travaux qui traitent de la<br />
<strong>«</strong> nouvelle violence <strong>»</strong> en Amérique latine 4 . Ceux-là, prenant note de la multiplication d'acteurs<br />
armés et de leurs liens avec l'État et les élites politiques et économiques, en concluent que le<br />
monopole de la violence formelle en Amérique latine s'<strong>est</strong> érodé, délégitimé ou effondré. Les<br />
1 Romero et Valencia [2007]<br />
2 Hibou [2000], p. 36<br />
3 Briquet et Favarel-Garrigues [2008], p. 12<br />
4 Koonings et Kruijt [1999]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 21
auteurs qualifient alors ce phénomène de <strong>«</strong> effondrement partiel de l'État <strong>»</strong> (partial state<br />
failure) 1 . Cet effondrement <strong>«</strong> a pour conséquence non seulement l'apparition de " vides de<br />
gouvernance " (voids of governance) – espaces ou champs sur lesquels l'État légitime <strong>est</strong><br />
effectivement absent devant des acteurs armés qui échappent à l'emprise de l'État de droit –<br />
mais aussi l'érosion interne de la capacité et la volonté des agents de l'État à respecter la loi <strong>»</strong>.<br />
Ces <strong>«</strong> vides de gouvernance <strong>»</strong>, seraient à l'origine de l'augmentation de la violence et de<br />
l'apparition d'une <strong>«</strong> société incivile <strong>»</strong> (uncivil society). Celle-ci serait constituée par <strong>«</strong>les<br />
acteurs ou groupes qui imposent leurs intérêts sur la sphère publique grâce à la coercition et la<br />
violence, de telle manière que les aspirations légitimes des autres groupes de la société civile<br />
sont compromis et l'État de droit fragmenté ou anéanti <strong>»</strong> 2 . Ici, l'affaiblissement du droit<br />
provoquerait mécaniquement un affaiblissement de l'État. Or, il s'agit encore d'une vision<br />
normative, qui définit l'État par rapport à la démocratie et au règne de la loi. Elle conduit à<br />
ignorer les modes de formation de l'État qui passent par l'illégalité et la violence, à définir<br />
l'État par rapport au discours qu'il tient sur lui-même et à celui qui <strong>est</strong> véhiculé par les<br />
organisations internationales. Lorsque ces auteurs font remarquer que la <strong>«</strong> nouvelle violence<br />
occupe les interstices d'un ordre institutionnel, légal et politique fragile et fragmenté <strong>»</strong> 3 , ils en<br />
concluent nécessairement à l'affaiblissement de l'État. Or, que l'ordre légal soit fragmenté, ou<br />
qu'il existe des <strong>«</strong> zones grises <strong>»</strong> où l'État et les acteurs armés cohabitent ne veut pas<br />
nécessairement dire que l'État s'affaiblit. En effet, <strong>«</strong> Il <strong>est</strong> nécessaire de distinguer les<br />
différents attributs de l'État; notamment de distinguer pouvoir étatique et souveraineté [...].<br />
Cette distinction permet, par exemple, de voir comment la capacité régulatrice de l'État peut<br />
formellement s'éroder, alors que son pouvoir demeure et ne fait que se redéployer <strong>»</strong> 4 .<br />
<strong>La</strong> privatisation de la violence comme une modalité de formation de l'État<br />
L'analyse que nous proposons ici prête une attention particulière aux stratégies des<br />
acteurs, seule manière – à <strong>notre</strong> sens – de r<strong>est</strong>ituer la complexité du phénomène. Nous<br />
interprétons la situation colombienne comme une forme de privatisation de la violence. Il ne<br />
faut pas comprendre sous le vocable de <strong>«</strong> privatisation <strong>»</strong> une négation des liens avec la sphère<br />
publique officielle 5 . Bien au contraire, nous souhaitons adopter la perspective proposée par B.<br />
1 Koonings et Kruijt [2004], p. 1-2<br />
2 Ibidem, p. 7<br />
3 Ibidem, p.8<br />
4 Hibou [2000], p. 38<br />
5Comme l'affirme la critique de l'hypothèse de la privatisation de la violence effectuée par Gayer et<br />
Jaffrelot [2008], p. 18<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 22
Hibou lorsqu'elle affirme que <strong>«</strong> réfléchir sur l'hypothèse de la " privatisation des États ", c'<strong>est</strong><br />
[…] se donner l'opportunité d'envisager les stratégies étatiques qui paraissent en retrait, en<br />
déclin, voire en recomposition comme faisant partie du processus de formation continue de<br />
l'État, comme une nouvelle modalité de formation du politique <strong>»</strong> 1 .<br />
Voir dans le phénomène paramilitaire une forme de privatisation de la violence nous<br />
permet d'étudier l'évolution de utilisation celle-ci en lien avec les stratégies des acteurs<br />
publics et privés. En outre, l'hypothèse de la privatisation de la violence permet d'étudier le<br />
phénomène paramilitaire et ses liens avec l'État sans tomber dans la opposition binaire entre<br />
dépendance et autonomie. Une sociologie de la privatisation de la violence permettra de voir<br />
que le phénomène paramilitaire <strong>est</strong> un processus conflictuel autour duquel s'affrontent des<br />
intérêts multiples et nombreux. En effet :<br />
<strong>«</strong> la privatisation ne peut pas être considérée comme le résultat d'une stratégie<br />
délibérée de la part de tel ou tel État; comme le choix d'un mode de gouvernement<br />
plutôt qu'un autre [...]. Mais plus fondamentalement, la privatisation de l'État <strong>est</strong><br />
le résultat de stratégies multiples, parfois contradictoires, qui traduisent<br />
notamment une absence de confiance dans les institutions étatiques et la primauté<br />
accordée à la loyauté sur les relations fonctionnelles. De fait, la privatisation de<br />
l'État <strong>est</strong> moins le fruit de la stratégie de ce dernier pour survivre ou se consolider,<br />
que le fruit de nombreux acteurs et de multiples logiques d'action [...]. Du fait<br />
même de la multiplicité des acteurs et de leurs ambitions, il ne peut être le fuit<br />
d'une seule stratégie, fût-elle étatique. Et si ces facteurs n'aboutissent pas<br />
forcement à l'affaiblissement de l'État, elles soulignent en revanche sa<br />
désinstitutionnalisation <strong>»</strong> 2<br />
L'hypothèse de la privatisation de la violence nous conduit également à refuser la<br />
division entre pouvoir politique et pouvoir économique, entre contrôle des rentes et contrôle<br />
des clientèles électorales. L'emprise sur l'activité politique et la contrainte sur le vote assurent<br />
aux paramilitaires et à leurs alliés l'accès aux budgets publiques et la sécurité des zones de<br />
production et transport de la drogue. Le contrôle des activités économiques et politiques<br />
s'alimente mutuellement, assurant ainsi une emprise sur les populations et le territoire. Dans la<br />
même ligne d'idées, la division entre formes légales et illégales d'action politique et<br />
économique a peu de sens. Elle provient d'une définition normative du pouvoir, qui voit dans<br />
1 Hibou [2000], p. 13<br />
2 Hibou [2000], p. 60-61<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 23
les modalités illégales de son exercice la dégénérescence d'une forme originelle et pure de<br />
l'action politique. Il convient au contraire de s'inspirer des analyses qui voient une continuité<br />
entre formes légales et illégales d'exercice du pouvoir 1 . Nous nous inspirons également des<br />
études qui font le lien entre illégalismes et formation de l'État dans une analyse fine des<br />
situations historiques 2 .<br />
Il <strong>est</strong> certain que les groupes paramilitaires favorisent une fragmentation du monopole<br />
étatique de la violence. Il serait cependant erroné d'en conclure au nécessaire recul de l'État.<br />
En effet, il faut préciser de quoi on parle lorsqu'on se réfère à l'État. Si l'on part d'une lecture<br />
socio-historique de la transformation de l'État, il <strong>est</strong> possible de distinguer trois catégories<br />
d'analyse parallèles correspondant à des temporalités différentes : l'analyse du temps long<br />
correspond aux transformations générales dans l'étatisation (stateness 3 ), celle du temps moyen<br />
aux changements des répertoires d'action et celle du temps court à la distribution du pouvoir 4 .<br />
À partir de ces trois catégories, ont peut mener une analyse plus fine des transformations de<br />
l'État colombien. Il <strong>est</strong> clair que nous sommes devant un changement des répertoires d'action,<br />
dès lors que des acteurs privés jouent un rôle premier dans le maintien de l'ordre et la<br />
répression. Le soutien à ces acteurs n'<strong>est</strong> pas le fruit d'une politique volontariste de l'État;<br />
cependant, ce dernier <strong>est</strong> dans la position d'un <strong>«</strong> free-rider <strong>»</strong> 5 profitant des avancées des<br />
paramilitaires contre ses opposants. Cela aboutit dans les faits à une transformation des<br />
groupes paramilitaires en relais locaux de l'État 6 . Bien évidemment, ces transformations ont<br />
des incidences sur la distribution du pouvoir. L'emprise des AUC sur certains territoires les<br />
conduit à s'allier avec des personnalités politiques locales dans le but d'obtenir un accès aux<br />
institutions décentralisées. Ces politiques tirent évidemment des profits de cette alliance et<br />
l'utilisent souvent pour marginaliser leurs rivaux. Le contrôle des groupes paramilitaires sur<br />
de larges pans du territoire les conduit également à obtenir des leviers politiques sur le centre,<br />
notamment grâce aux élections parlementaires; cela se traduit par des redéfinitions du poids<br />
des acteurs dans ces arènes. Néanmoins, ce contrôle territorial et social n'aboutit pas à<br />
l'éviction de l'État de ces territoires. Bien au contraire, les institutions publiques continuent à<br />
1 Cf. Briquet et Favarel-Garrigues [2008]<br />
2 Cf. Barkey [1994]. L'auteure étudie la manière dont le banditisme sous l'Empire Otoman constitue un<br />
levier pour la centralisation du pouvoir d'État.<br />
3 Pour le concept de stateness voir Linz [1996]<br />
4 Ces catégories nous ont été suggérées par Yves Déloye<br />
5 L'expression <strong>est</strong> de <strong>La</strong>ir [2000], p. 521<br />
6 Situation décrite par Gayer et Jaffrelot [2008], p. 28 pour certaines milices d'Asie du Sud<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 24
opérer et les forces répressives de l'État tendent même à se renforcer 1 . L'avancée des<br />
paramilitaires constituerait même, selon certains auteurs, la principale cause du recul des<br />
guérillas, loin devant l'action de l'armée 2 . Si l'on admet avec C. Tilly qu'un des indicateurs<br />
principaux de l'étatisation d'un territoire <strong>est</strong> l'élimination ou la neutralisation des rivaux de<br />
l'État 3 , on doit forcément en conclure que le phénomène paramilitaire a contribué à cette<br />
étatisation au lieu de l'affaiblir. Il constitue donc avant tout une redéfinition des contours de<br />
l'État.<br />
À ce titre, nous soutiendrons que la privatisation de la violence peut constituer une<br />
modalité de formation de l'État, au sens où l'entendent B. Berman et J. Lonsdale 4 . Ces deux<br />
auteurs <strong>«</strong> introduisent une distinction clé entre construction de l'État, comme un effort<br />
conscient de création d'un appareil de contrôle et formation de l'État, comme un processus<br />
historique dont le résultat <strong>est</strong> largement inconscient et un processus contradictoire fait de<br />
conflits, négociations et compromis entre divers groupes dont les actions intéressées et les<br />
concessions mutuelles constituent la " vulgarisation " du pouvoir 5 . Cette approche a<br />
notamment <strong>«</strong> le mérite d'appréhender les trajectoires étatiques dans la longue durée, tout en<br />
intégrant le jeu des acteurs privés <strong>»</strong> 6 . Cette formation de l'État se réalise notamment par deux<br />
modalités complémentaires : l'instauration d'un appareil violent de contrôle social et la<br />
valorisation de patronages étatiques à des fins politiques ou économiques par les<br />
paramilitaires 7 . D'une part, la violence paramilitaire, au lieu de subvertir les rapports de<br />
pouvoir inégalitaires sur lesquels <strong>est</strong> fondé l'État, les renforce. Comme nous l'avons signalé<br />
l'identification de cette violence à un projet contre-insurrectionnel <strong>est</strong> réductrice. Plutôt que<br />
d'être une <strong>«</strong> sous-traitance <strong>»</strong> de la violence répressive, le phénomène paramilitaire doit être<br />
compris comme une création de relais de l'État qui gouvernent les populations. Des <strong>«</strong> relais <strong>»</strong><br />
qui ont cependant leurs propres intérêts et marges de manœuvre. D'autre part, les patronages<br />
étatiques, qu'ils soient des agences de l'État, des personnalités politiques ou des <strong>«</strong> cliques <strong>»</strong><br />
n'engagent pas l'État dans son intégralité. Dès lors, ils tirent des profits des ces collusions avec<br />
les paramilitaires mais ils prennent aussi des risques. <strong>La</strong> qu<strong>est</strong>ion des profits politiques, mais<br />
1 Voir l'exemple des collusions entre l'armée et les paramilitaires : Human Rights Watch [2001]<br />
2 Pécaut [2008b]<br />
3 Tilly [2000], p. 111<br />
4 Pour une discussion de ces travaux voir Bayart [1996], p. 6-7 et Hibou [1996], p. 94-95, Gayer et<br />
Jaffrelot [2008], p. 29-30<br />
5 Berman et Lonsdale [1992], p. 5<br />
6 Gayer et Jaffrelot [2008], p. 30<br />
7 Comme le soulignent Gayer et Jaffrelot [2008], p. 30 pour l'Asie du Sud<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 25
surtout économiques, a conduit certains auteurs à parler de parasitisme. Nous pensons que ces<br />
relations relèvent plutôt d'une forme de <strong>«</strong> commensalisme <strong>»</strong>, au sens donné à ce terme par<br />
Isabelle Sommier. L'auteure souligne que les relations entre élites politiques et milieux<br />
criminels sont souvent des associations mutuellement profitables 1 . En revanche, ces<br />
associations sont souvent instables 2 . Comme le souligne B. Hibou, les accords – formels ou<br />
tacites – qui lient l'État à des acteurs privées <strong>«</strong> sont loin d'être permanents, ni même inscrits<br />
dans la durée ; ils sont au contraire volontairement instables voire volatiles, secrets et sans<br />
cesse à renégocier <strong>»</strong> 3 .<br />
2. Le fil conducteur : l'utilisation de la violence<br />
Le fil conducteur de <strong>notre</strong> réflexion sera les transformations dans l'usage de la violence.<br />
Elle <strong>est</strong> sur toute la période une ressource essentielle d'exercice du pouvoir. Or, elle subit des<br />
profonds changements. Au début de <strong>notre</strong> période elle <strong>est</strong> maîtrisée par une myriade d'acteurs,<br />
qui sont dans une situation de relative subordination vis-à-vis de leurs partenaires politiques et<br />
économiques. Ces acteurs sont des professionnels de la violence qui vendent leurs services sur<br />
un marché concurrentiel. Or, ce marché – pour filer la métaphore économique – se transforme<br />
au fil du temps pour devenir un monopole. Un seul acteur – les Autodéfenses Unies de<br />
Colombie (AUC) – monopolise la violence, face aux autres groupes paramilitaires, aux<br />
guérillas et même aux acteurs étatiques. Or, N. Elias nous apprend que ce processus de<br />
monopolisation <strong>est</strong> un mécanisme fondamental dans la formation des États. Dans le cas<br />
étudié, cette monopolisation s'accompagne en effet de la formation de <strong>«</strong> capacités <strong>»</strong> étatiques 4 .<br />
Ces capacités ne se développent pas contre l'État ou à côté de l'État, mais à l'intérieur de celui-<br />
ci. Leur formation débouche sur une interpénétration des institutions publiques et de<br />
l'organisation armée. Somme toute, ce processus aboutit à une redéfinition des contours de<br />
l'État.<br />
Violence. De quoi parle-t-on?<br />
Bien que la violence puisse paraître un concept univoque, elle <strong>est</strong> en réalité<br />
extrêmement difficile à définir. En effet, le sens commun aurait tendance à la réduire à sa<br />
seule dimension physique. Or, celle-ci <strong>est</strong> inséparable de la dimension symbolique; de plus<br />
1 Sommier [1998], p. 121<br />
2 Voir l'exemple des Ragers du Pakistan étudié par Gayer [2008]<br />
3 Hibou [2000], p 29<br />
4 Le terme <strong>est</strong> de Migdal [1988], cf. Infra<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 26
cette dernière contribue grandement à donner à la violence un sens politique 1 . Nous<br />
adopterons ici la perspective proposée par P. Braud qui définit la violence par rapport à la<br />
victime. L'auteur écrit que <strong>«</strong> l'existence d'une souffrance subjectivement vécue, affichée<br />
publiquement ou sobrement enfouie, constitue le seul critère possible d'une définition<br />
purement clinique de la violence <strong>»</strong> 2 . Cette définition peut être utilisée de manière différente<br />
selon les outils méthodologiques mobilisés pour analyser la violence. Elle invite notamment à<br />
la multiplication des sources. En effet, bien que nous nous basions en partie sur une base de<br />
données qui enregistre meurtres et <strong>«</strong> disparitions <strong>»</strong>, il n'<strong>est</strong> pas qu<strong>est</strong>ion de réduire la violence<br />
à ces chiffres 3 . Un regard aux phénomènes de déplacement forcé de population sert également<br />
à intégrer le pouvoir de la menace ainsi que la dimension psychologique de la peur 4 .<br />
Cependant, une vision quantitative n'épuise pas l'analyse de la violence. C'<strong>est</strong> la raison pour<br />
laquelle la réalisation des entretiens <strong>est</strong> une méthode centrale dans cette étude. Nous<br />
approfondirons plus loin la qu<strong>est</strong>ion de la méthodologie choisie.<br />
Nous nous concentrerons ici sur la violence contre les civils, c'<strong>est</strong> à dire les non-<br />
combattants. Ceux-ci sont définis par Kalyvas comme <strong>«</strong> toux ceux qui ne sont pas membres à<br />
temps-plein d'un groupe armé <strong>»</strong> 5 . Cette sélection répond à plusieurs critères. Premièrement, la<br />
guerre en Colombie s'effectue <strong>«</strong> par populations interposées <strong>»</strong> 6 , c'<strong>est</strong>-à-dire qu'il y a très peu<br />
de combats directs entre les acteurs armés – surtout entre guérilla et paramilitaires – et que<br />
ceux-ci se concentrent sur l'élimination des bases sociales de l'ennemi. Nous y reviendrons.<br />
Deuxièmement, non seulement ces combats sont rares, mais les sources qui en rendent compte<br />
le sont encore moins. En effet, la seule source – à laquelle se réfèrent autant les journalistes<br />
que les universitaires – <strong>est</strong> la direction de presse de l'état major des armées, qui n'<strong>est</strong> pas<br />
précisément connue pour sa rigueur et son objectivité. Ces combats sont rarement des<br />
véritables affrontements d'une armée contre une autre, mais des escarmouches et des attaques<br />
éclairs. Enfin, ce choix <strong>est</strong> également orienté par nos qu<strong>est</strong>ionnement théoriques. En effet,<br />
c'<strong>est</strong> à travers la violence contre les civils que se met en place un appareil de contrôle du<br />
territoire et de la population et à partir de là que se remodèle l'espace du politique et de<br />
l'économie.<br />
1 Braud [2004], p. 15<br />
2 Ibidem, p. 19<br />
3 Voir la discussion que fait P. Braud de <strong>«</strong> L'enjeur des chiffres <strong>»</strong> Braud [2004], p. 20-24<br />
4 Pour l'articulation entre déplacement forcé de populations et peur voir Jaramillo, Villa et Sánchez<br />
[2004]<br />
5 Kalyvas [2006], p. 19<br />
6 <strong>La</strong>ir [2000], p. 533<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 27
Cette violence contre les civils prend différentes formes. Il s'agit tout d'abord de<br />
l'élimination physique, une <strong>«</strong> méthode anéantissement irréversible, directe, immédiate et sans<br />
équivoque <strong>»</strong> 1 , la <strong>«</strong> violence absolue <strong>»</strong> selon Sofsky 2 . Or, si l'on prête une attention particulière<br />
à la dimension symbolique de la violence on ne peut s'arrêter là. En effet, l'élimination<br />
physique <strong>est</strong> le plus souvent accompagnée de supplices et sévices sur les corps 3 . Humiliées,<br />
torturées, dépecées, les victimes sont déshumanisées. <strong>La</strong> violence symbolique ne frappe pas<br />
seulement la victime du meurtre mais aussi ses proches voire toute la communauté; elle<br />
souligne la faiblesse et la subordination au pouvoir des armes 4 .<br />
De plus, la violence a également une dimension de genre. Un regard rapide à <strong>notre</strong> base<br />
de données nous apprend que seulement 6% des victimes enregistrées sont des femmes 5 . Cela<br />
ne veut pas dire que la violence paramilitaire épargne ces dernières, mais qu'elle s'exerce de<br />
manière différente selon les genres. En effet, beaucoup d'interviewés évoquent la pratique<br />
courante du viol dans les zones de contrôle paramilitaire. <strong>La</strong> généralisation de cette forme de<br />
violence, principalement pratiquée à l'encontre des femmes, les rend très vulnérables aux<br />
acteurs armés. Un rapport d'Amn<strong>est</strong>y International souligne que ce phénomène <strong>est</strong> courant<br />
dans toutes les zones de conflit en Colombie et qu'il <strong>est</strong> pratiqué par tous les acteurs –<br />
paramilitaires, militaires et guérilleros. Or, aucun chiffre n'<strong>est</strong> disponible pour évaluer<br />
l'ampleur du phénomène. De plus, les femmes sont souvent très réticentes à dénoncer le violà<br />
cause la stigmatisation qu'il comporte 6 . Il convient également de souligner ici la dimension<br />
collective du phénomène, car ce type exerce des effets bien au-delà de la victime, sur son<br />
couple, sa famille et son groupe d'appartenance.<br />
Les acteurs de la violence<br />
Cette étude met l'accent sur la multiplicité d'acteurs qui participent à la production de la<br />
violence. L'étude de la violence ne peut s'arrêter aux seuls acteurs armés, mais doit s'étendre<br />
aux groupes sociaux avec lesquels ceux-ci rentrent en collusion. Nous raisonnerons dans les<br />
termes d'Elias, qui souligne les rapports d'interdépendance qui s'instaurent entre les membres<br />
d'une configuration. Ces rapports ne sont pas uniquement fait d'alliances univoques, mais<br />
1 Kalyvas [2006], p. 20<br />
2 Sofsky [1998], p. 53<br />
3 Pour une analyse anthropologique du cas Colombien voir les travaux désormais classiques d'Uribe<br />
[2004]; Uribe et Vázques [1994] ou encore Blair [2004]<br />
4 Braud [2004], p. 17<br />
5 88% sont des hommes; dans le r<strong>est</strong>ant des cas le sexe de la victime n'a pas été consigné<br />
6 Amn<strong>est</strong>y International [2004]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 28
aussi de concurrences et conflits. Ainsi, entre les joueurs s'établit un certain état d'équilibre,<br />
en fonction des ressources que chacun <strong>est</strong> en mesure de mobiliser 1 . On peut ici raisonner<br />
comme G. Favarel-Garrigues dans son étude des <strong>«</strong> entreprises de prédation, fondées sur la<br />
constitution de coalitions dédiées à l'exploitation de sources de revenu <strong>»</strong> en Russie :<br />
<strong>«</strong> Ces coalitions ont fréquemment associé trois catégories d'acteurs distincts –<br />
entrepreneurs, agents administratifs et professionnels de l'usage de la violence (...).<br />
Les relations entre les trois parties varient selon les cas considérés : nous verrons<br />
que dans certaines configurations l'autorité de l'entrepreneur s'impose au sein de la<br />
coalition, alors que dans d'autres cas les agents administratifs ou les professionnels<br />
de l'usage de la violence détiennent les rôles principaux. <strong>»</strong> 2<br />
Il faut donc d'abord identifier les catégories d'acteurs, avant de préciser quelles sont les<br />
relations qui s'établissent entre ces acteurs. Après, on pourra tenter de comprendre la manière<br />
dont ces relations déterminent l'usage de la violence. Dans l'étude du phénomène paramilitaire<br />
en Colombie, nous rencontrerons quatre catégories d'acteurs :<br />
1 Elias [1991a]<br />
• Les professionnels de la violence : ce sont des acteurs <strong>«</strong> pour qui l'exercice de la<br />
violence <strong>est</strong> un "métier" (c'<strong>est</strong>-à-dire une activité assurant rémunération et impliquant<br />
l'apprentissage d'un savoir-faire et de manières d'être spécifiques) <strong>»</strong> 3 . <strong>La</strong> ressource<br />
principale qu'ils mobilisent <strong>est</strong> ce savoir-faire violent. Or, la mobilisation de<br />
professionnels de la violence nécessite une mobilisation de ressources financières et<br />
organisationnelles, pour les rémunérer, les équiper, et éventuellement améliorer leur<br />
formation. C'<strong>est</strong> le rôle des trois autres catégories d'acteurs.<br />
• Les militaires : de la même manière que sur les terrains péruvien et<br />
guatémaltèque 4 , des membres de l'armée – de tout grade – ont soutenu en Colombie la<br />
formation de groupes paramilitaires. On verra que des militaires ont apporté des armes<br />
et du ravitaillement, ont facilité le transport et la logistique des groupes paramilitaires,<br />
ont partagé l'information tactique et les ont entraîné aux tactiques de contre-<br />
insurrection.<br />
2 Favarel-Garrigues [2008], p. 189<br />
3 Bertrand [2003]<br />
4 Cf. Fumerton et Remijnse [2004]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 29
• Les élites locales : se sentant menacées par la guérilla, elles ont financé les<br />
premiers groupes paramilitaires. Détenant des charges électives dans les instances<br />
nationales, elles ont apporté aux paramilitaires une représentation politique.<br />
• Les trafiquants de drogue : Dès l'origine, ils se sont associés aux projets<br />
paramilitaires et ont apporté un financement qui était bien au-dessus des capacités des<br />
acteurs cités précédemment.<br />
Cette vision <strong>est</strong> quelque peu schématique et pourrait conduire à penser que ces acteurs<br />
seront pris comme des groupes homogènes, voire réifiés. Tout au contraire, nous nous<br />
efforcerons de mettre l'accent sur les rapports de concurrence et conflit à l'intérieur de ces<br />
catégories. Nous verrons par exemple comment certains secteurs del élites politiques locales<br />
utilisent leur proximité aux groupes paramilitaires pour évinces leurs concurrents du jeu<br />
politique. Cette énumération d'acteurs a comme seul but de mettre l'accent sur les<br />
configurations complexes qui déterminent l'usage de la violence et son évolution.<br />
Les logiques de la violence<br />
Suivant l'analyse qu'Éric <strong>La</strong>ir effectue du conflit armé colombien, nous suivrons une<br />
lecture stratégique de la violence. Cela veut dire que nous considérons qu'elle se déroule selon<br />
<strong>«</strong> une succession de séquences d’actions plus ou moins articulées entre elles <strong>»</strong> 1 . Cependant,<br />
cela ne revient pas à affirmer que <strong>«</strong> la violence <strong>est</strong> maîtrisée selon des plans établis une fois<br />
pour toutes : les finalités et les moyens mobilisés évoluent à mesure que se développe et se<br />
prolonge dans le temps le conflit armé <strong>»</strong> 2 . En effet, si nous utilisons la perspective de la<br />
mobilisation de ressources 3 , nous ne pensons pas que la violence soit une ressource <strong>«</strong> comme<br />
une autre <strong>»</strong> 4 . Une telle analyse, qui rejette toute spécificité de la violence 5 , conduit à appauvrir<br />
la compréhension d'actes dont les dimensions symboliques et et d'affirmation identitaire<br />
violente sont essentielles 6 . De plus, comme le souligne D. Pécaut, il y a dans la violence en<br />
Colombie une part indéniable d'irrationnel, liée à la décontextualisation et déterritorialisation<br />
1 <strong>La</strong>ir [2000], p. 529<br />
2 Idem<br />
3 Pour la violence dans le paradigme de la mobilisation des ressources voir l'ouvrage de Tilly [2003]<br />
4 Cf. l'article de McCarthy et Zald [1977]<br />
5 Pour une critique de cette position voir Crettiez [2008], p. 23<br />
6 <strong>La</strong>ir [2000], p. 529<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 30
de la violence, ainsi qu'à l'incapacité des acteurs à intégrer leur souffrance dans une histoire<br />
commune 1 .<br />
Une lecture stratégique conduit à déterminer des épisodes, c'<strong>est</strong> à dire des séquences<br />
délimitées de violence. Ce découpage – schématique et à valeur purement analytique – permet<br />
d'identifier les mécanismes et les processus à l'œuvre dans la violence 2 . Chaque épisode<br />
violent peut être caractérisé de deux manières, son périmètre et ses objectifs. Le périmètre<br />
correspond à l'espace qui englobe les catégories d'acteurs visés par la violence. Selon les<br />
moments, il peut s'agir des leaders politiques d'une communauté, de militants syndicaux ou de<br />
marginaux. Ce périmètre <strong>est</strong> mouvant, il définit un espace de la violence à géométrie variable.<br />
Notre hypothèse <strong>est</strong> que cet espace à géométrie variable <strong>est</strong> déterminé par les configurations<br />
d'acteurs et par leurs interactions. Un tel présupposé nous permet de raisonner en termes de<br />
logiques de violence. Nous en distinguerons trois :<br />
• Les logiques militaires : la violence permet d'assurer la sécurité de l'organisation<br />
armée dans le contexte d'un affrontement armé et d'affaiblir l'adversaire. S. Kalyvas<br />
montre comment les acteurs armés définissent la population civile comme une cible<br />
possible dans la mesure où celle-ci peut constituer un soutien en logistique et<br />
intelligence pour l'ennemi 3 . <strong>La</strong> violence concerne ici les individus ou les collectivités<br />
pouvant être un danger ou un atout du point de vue militaire.<br />
• Les logiques rétributives : la violence vise à rétribuer l'appui donné par d'autres<br />
catégories à l'acteur armé et à entretenir ces liens. Il peut prendre la forme d'un service<br />
de sécurité, d'une <strong>«</strong> opération punitive <strong>»</strong>, comme dans les cas de meurtres des leaders<br />
syndicaux ou d'une <strong>«</strong> prophylaxie <strong>»</strong> sociale. Nous verrons des cas empiriques de ces<br />
différentes logiques violentes. Somme toute, il faut retenir que dans les logiques de<br />
rétribution la violence vise les individus ou les populations qui sont perçus comme<br />
menaçants pour les intérêts des alliés.<br />
• Les logiques étatiques : l'acteur armé monopolise l'usage de la violence sur un<br />
territoire, ce qui lui permet d'instaurer un contrôle permanent sur les institutions et les<br />
différentes arènes du pouvoir. Les paramilitaires deviennent les g<strong>est</strong>ionnaires des<br />
budgets publics, contrôlent les postes électifs et la bureaucratie, administrent la justice<br />
et extraient des ressources économiques. Cette logique renverse totalement l'équilibre<br />
1 Pécaut [2001], p. 185-225<br />
2 Cette analyse s'inspire du cadre proposé par Tilly et Tarrow [2007]<br />
3 Kalyvas [1999]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 31
des forces qui pouvait être présent dans les deux autres; ici, l'intérêt n'<strong>est</strong> pas tant de<br />
servir les intérêts des catégories alliées ou d'échanger des bons procédés mais de se<br />
servir de sa position dominante pour contrôler les rouages clés du pouvoir local. <strong>La</strong><br />
violence acquiert alors une nouvelle forme, car elle vise le contrôle de l'ensemble de la<br />
population et non pas seulement d'un secteur jugé dangereux. Elle vise aussi à<br />
légitimer l'acteur violent pour gagner l'adhésion volontaire et l'intériorisation de la<br />
contrainte. Les paramilitaires atteignent un tel degré d'interpénétration avec les<br />
institutions publiques locales qu'ils redéfinissent les contours de l'État<br />
L'analyse de l'évolution de l'utilisation de la violence montrera que les logiques<br />
militaires et rétributives tendent à s'intégrer dans une logique étatique. Celle-ci se caractérise<br />
par la constitution d'un monopole de la violence et par la construction de capacités étatiques.<br />
J. Migdal distingue quatre types différents de capacités selon qu'elles permettent de <strong>«</strong> pénétrer<br />
la société, réguler les relations sociales, extraire des ressources et s'approprier et utiliser ces<br />
ressources dans un but déterminé <strong>»</strong> 1 . Cette évolution des logiques militaire et rétributive vers<br />
une logique étatique tend à confirmer l'hypothèse de la violence privée comme modalité de<br />
formation de l'État.<br />
3. Méthodologie<br />
Nos qu<strong>est</strong>ionnements posent des problèmes méthodologiques qu'il convient de<br />
soulever. Il <strong>est</strong> difficile d'obtenir des données fiables dans un contexte comme celui de la<br />
Colombie, où le conflit armé continue 2 . En effet, bien qu'une partie des troupes paramilitaires<br />
se soient démobilisées entre 2005 et 2008, on observe aujourd'hui une recomposition du<br />
phénomène paramilitaire, ce qui se traduit par une reprise à la hausse des indicateurs de<br />
violence dans certaines zones. De plus, les différentes configurations politico-criminelles<br />
formées autour de ce phénomène n'ont pas été démontées. Elles se sont transformées et sont<br />
aujourd'hui au centre même des institutions colombiennes. Des telles remarques nous invitent<br />
à multiplier autant que possible les sources et à mener un travail profond n'analyse de la<br />
situation d'enquête pour neutraliser dans la mesure du possible les différents biais de ces<br />
sources. Nous énumérerons ici brièvement nos trois principaux types de sources en soulignant<br />
les problèmes qu'elles soulèvent.<br />
1 Migdal [1988], p. 4<br />
2 Pour les problèmes soulevés par ces milieux d'enquêtes <strong>«</strong> difficiles <strong>»</strong>, voir le dossier publié par la<br />
RFSP (2007/1 vol 57) sous la direction de M. Boumaza et A. Campana. Pour d'autres enquêtes en<br />
milieu difficile voir Haon Madueño [2009]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 32
Base de données sur la violence paramilitaire dans le Magdaléna<br />
Nous avons d'abord approché <strong>notre</strong> terrain à travers une base de données sur la violence<br />
paramilitaire dans le département du Magdaléna. Pour ce faire, nous avons utilisé la base de<br />
données du CINEP 1 , qui a comme mission d'enregistrer les cas de violence commise par les<br />
groupes armés organisés contre des non-combattants. Il s'agit d'un centre de recherche<br />
indépendant fondé par des prêtres jésuites dans les années 1960. Dans le paysage intellectuel<br />
colombien le CINEP occupe une place réputée et ses nombreuses publications sont largement<br />
reconnues par la communauté scientifiques. <strong>La</strong> base de données en qu<strong>est</strong>ion existe depuis la<br />
fin des années 1980 et a été utilisée par des juristes et des universitaires. Selon le responsable<br />
de ce projet, elle <strong>est</strong> alimentée à partir des informations transmises par différentes ONG et par<br />
des organismes officiels. Les informations font l'objet de recoupement avec des sources<br />
judiciaires lorsque cela <strong>est</strong> possible 2 . Il s'agit cependant d'informations incomplètes; en effet,<br />
dans une situation de conflit armé comme celle que vivent des larges pans du territoire<br />
colombien il <strong>est</strong> difficile de penser que les cas d'attaques armées contre les civils puissent<br />
faire l'objet de d'un recueil complet. Cependant, ce centre constitue la seule source fiable sur<br />
ces sujets. L'autre problème évident <strong>est</strong> l'identification de l'acteur armé. Or, il <strong>est</strong> vrai que<br />
dans une grande partie des cas les auteurs des violences ont revendiqué leur appartenance à<br />
une organisation (de manière verbale mais aussi par l'utilisation des symboles de celle-ci).<br />
Parfois ils ont même laissé des traces de leur passage en taguant les murs ou en marquant les<br />
corps. Souvent ils ont aussi assumé et justifié le crime. Jadis cela se faisait par la distribution<br />
de tracts ou de communiqués de presse envoyés aux journaux. Depuis la fin des années 1990<br />
chaque organisation possède son site Internet où elle livre ce type d'informations. Enfin, il<br />
convient de remarquer qu'il y a, sur le terrain colombien, très peu de cas connus de<br />
revendication d'un crime par un acteur armé qui n'en serait pas responsable. <strong>La</strong> plupart des cas<br />
de fausses attributions sont dus à des agents de l'État.<br />
Le principal problème auquel nous avons fait face dans l'utilisation de ces informations<br />
<strong>est</strong> la codification utilisée. En effet, la base de données a une vocation mémorielle et<br />
judiciaire 3 . Il y a donc une classifications qui répond aux critères du droit international<br />
humanitaire. Ces catégories n'étant pas utiles pour <strong>notre</strong> travail, nous avons cherché à avoir un<br />
accès directe aux récits des faits violents. Nous avons filtré les récits concernant le<br />
département du Magdaléna et avons fabriqué <strong>notre</strong> propre base de données sur des critères<br />
1 www.nocheyniebla.org<br />
2 Expert n° 17. Voir annexe n°2, sources orales<br />
3 Idem<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 33
plus adaptés à ce travail 1 . Nous avons alors enregistré plus de neuf cents cas entre 1989 et<br />
2006.<br />
Cette base de données nous a permis, avant toute chose, d'identifier l'évolution<br />
chronologique de la violence homicide revendiquée par des groupes paramilitaires. Elle a<br />
également permis d'identifier des cas particulièrement lourds en conséquences politiques<br />
comme les meurtres de leaders politiques et sociaux et les meurtres collectifs. Sa réalisation<br />
nous a permis d'avoir accès aux récits qui ensuite pourraient être recoupés avec d'autre<br />
sources. Somme toute, la base de données a été avant tout un outil pour orienter nos<br />
hypothèses et donc les qu<strong>est</strong>ions que nous essayerions de résoudre par la suite en faisant appel<br />
à d'autres types de sources.<br />
L'usage de l'entretien 2<br />
L'entretien sociologique semi-directif, devenu aujourd'hui un standard des méthodes<br />
qualitatives, pose de manière brutale la qu<strong>est</strong>ion de statut des données, de la valeur que le<br />
sociologue peut accorder à la parole des gens 3 . Des lors que le chercheur a affaire à un<br />
discours individuel et subjectif, il ne peut pas considérer l'interviewé comme un simple<br />
témoin, un réceptacle d'informations factuelles qu'il livrerait dans l'entretien. Une telle<br />
conception établirait une équivalence entre la mémoire et l'histoire, ignorant ainsi le fossé que<br />
l'oubli creuse entre les deux 4 . De plus, cet oubli n'efface pas de manière égale tous les faits du<br />
passé. Il <strong>est</strong> sélectif, il transforme le passé dès lors qu'il le met en discours. Le sociologue n'a<br />
donc pas accès à une reconstitution des faits, comme le voudrait l'image du témoin, mais<br />
seulement à une reconstruction subjective 5 . De plus, cette reconstruction s'effectue dans les<br />
catégories indigènes, catégories que le chercheur ne maîtrise pas 6 . Ayant donc rejeté l'image<br />
d'un témoignage, qui emprunterait ses critères de validation à la pratique judiciaire, nous<br />
adopterons celle du récit. Le récit <strong>est</strong> une mise en scène des expériences d'une vie où les sujets<br />
donnent une signification à ce qui leur arrive. Le récit <strong>est</strong> sélectif, et par cette sélection il<br />
construit un sens sur le monde – un parmi d'autres possibles; il construit un point de vue sur le<br />
1 Nous avons classifié les cas par individus, et non pas par événement comme le CINEP. Nous avons<br />
défini 10 entrées : date, nom, sexe, municipe, engagement politique ou social connu, type<br />
d'engagement, position de direction, étiquette utilisée par l'agresseur<br />
2 Voir annexe 2. Sources orales<br />
3 Demazière [2007]<br />
4 Ricoeur [2000]<br />
5 Demazière [2007], p. 89<br />
6 Idem<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 34
passé en privilégiant certains événements; il <strong>est</strong> aussi une interprétation de ce passé, une<br />
argumentation d'un point de vue personnel 1 . Comme l'écrit G. Demazière <strong>«</strong> raconter ses<br />
expériences c'<strong>est</strong> les élaborer, les travailler, les charger de significations. […] Le discours de<br />
l'interviewé <strong>est</strong> une prise de position sur la qu<strong>est</strong>ion proposée, <strong>est</strong> l'expression d'un sujet<br />
parlant qui signifie et qui agit en disant des choses, <strong>est</strong> un acte de construction en situation<br />
d'une vision du monde <strong>»</strong> 2 . Dès lors que nous admettons que la mise en récit implique la<br />
subjectivité, le statut épistémologique de l'entretien dépend des conditions de production du<br />
récit, et donc d'un travail de réflexivité fait par l'enquêteur.<br />
Selon le types de qu<strong>est</strong>ionnements sociologiques que l'on cherche à explorer,<br />
l'utilisation de l'entretien portera plutôt sur des <strong>«</strong> univers de sens <strong>»</strong> ou sur des <strong>«</strong> univers de<br />
vie <strong>»</strong>. Tandis que dans le premier cas il s'agit d'explorer les catégories d'interprétation<br />
mobilisées par le sujet et d'en comprendre la structuration, dans le second le sociologue<br />
cherche à repérer des informations et des événements. Le discours <strong>est</strong> alors considéré comme<br />
un récit sur la vie du sujet, sur son groupe d'appartenance et sur le monde qui l'entoure 3 . Notre<br />
enquête se situe dans cette deuxième catégorie. Dans les deux cas le statut épistémologique du<br />
discours n'<strong>est</strong> pas le même. Dans le premier cas, la parole peut être le principal matériau de<br />
recherche, puisque sa logique de production <strong>est</strong> au centre de l'objet; en revanche, dans le<br />
second cas, la parole énonce des événements externes. Les précautions que le chercheur doit<br />
prendre ne sont donc pas les mêmes. Nous nous limiterons à donner les solutions – partielles<br />
et bricolées – que nous avons utilisées dans <strong>notre</strong> enquête.<br />
Nous avons divisé nos entretiens en deux catégories. Les entretiens avec des experts et<br />
les récits de vie 4 . Les premiers, bien qu'ils doivent être maniés avec précaution, ne posent pas<br />
des problèmes épistémologiques majeurs. Cas précautions méritent néanmoins d'être<br />
mentionnées. Nous avons regroupé des catégories très disparates; le mot expert veut<br />
simplement dire ici que l'individu <strong>est</strong> interrogé sur des informations externes à sa vie privée 5<br />
qui sont souvent le fruit d'une recherche dans un cadre professionnel. De plus, il <strong>est</strong> invité à<br />
compléter ces informations par d'autres documents (rapports, archives...) produits au sein son<br />
organisation. <strong>La</strong> plupart du temps le rapport entre l'interviewer et l'interviewé se rapproche<br />
d'une relation professionnelle. L'apprenti-chercheur, précédé par le statut d'étudiant<br />
1 Ibidem, p. 93<br />
2 Ibidem p. 95-96<br />
3 <strong>La</strong> catégorisation en univers de sens et univers de vie <strong>est</strong> de Schwartz [1999]<br />
4 Cf. Bertaux [2006]<br />
5 Même si parfois des fragments de récit de vie apparaissent dans les entretiens. Dans ces cas là nous<br />
avons souvent creusé le récit mais gardons l'entretien dans cette catégorie.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 35
universitaire rencontre un individu qui aura tendance à se poser en représentant de son<br />
organisation. Bien sûr, cette relation strictement professionnelle <strong>est</strong> souvent dépassée, et<br />
l'expert livre des informations plus personnelles. Or, la relation r<strong>est</strong>e toujours médiatisée par<br />
un savoir externe. Sous cette catégorie, nous avons regroupé des entretiens avec des<br />
fonctionnaires de la justice, des entités officielles chargées de la prise en charge des anciens<br />
combattants ou de la politique de <strong>«</strong> réparation des victimes <strong>»</strong>. Également des entretiens avec<br />
des juristes d'ONG chargées de la prise en charge des réfugiés ou des victimes de la violence 1 .<br />
Nous avons également interviewé des journalistes et des universitaires, ce qui nous a permis<br />
parfois d'approfondir des qu<strong>est</strong>ions que ces personnes avaient traitées dans des écris que nous<br />
avions lu auparavant. Enfin, nous avons interviewé également des responsables de la<br />
fabrication des bases de données que nous avons utilisées pour connaître leur mode de<br />
production.<br />
Ces entretiens posent évidemment la qu<strong>est</strong>ion du rapport entre la réalité et le récit que<br />
les personnes en font. En effet, il n'y a aucune raison de donner à ce type d'entretien le statut<br />
de donnée objective que l'on refuse aux autres. Bien que nous ayons affaire à un discours<br />
étayé par des arguments factuels et souvent par des preuves (documents, chiffres...) il s'agit<br />
néanmoins d'une interprétation de la réalité et donc d'un discours enchâssé dans des luttes<br />
d'intérêts ou des conflits politiques. C'<strong>est</strong> la raison pour laquelle il <strong>est</strong> nécessaire de tenir<br />
compte de la place de l'interviewé à l'intérieur d'une organisation, d'un réseau ou tout<br />
simplement de la société. Il <strong>est</strong> ainsi possible de repérer des biais d'interprétation et de faire la<br />
part entre le discours du savant ou du technicien et celui du citoyen. Il <strong>est</strong> également<br />
nécessaire d'examiner de près la relation entre interviewer et interviewé. En effet,<br />
l'appartenance du premier à une institution universitaire étrangère facilitait la communication<br />
autour de sujets politiquement sensibles. Dès lors qu'on analyse la situation d'enquête et qu'on<br />
<strong>est</strong> conscient des biais qu'elle peut induire, il <strong>est</strong> légitime d'utiliser ces entretiens comme des<br />
données empiriques. De plus, étant donné le faible nombre de travaux universitaires qui<br />
traitent de <strong>notre</strong> terrain, l'utilisation de ce type d'entretiens <strong>est</strong> incontournable.<br />
Les récits de vie sont autrement plus compliqués à manier. Nous parlerons de récits de<br />
vie dès lors <strong>«</strong> qu'il y a apparition de la forme narrative dans un entretien, le sujet l'utilisant<br />
pour exprimer les contenus d'une partie de son expérience vécue <strong>»</strong> 2 . Les remarques<br />
1 En effet, nous les avons interviewé dans le but d'obtenir des données précises sur la qu<strong>est</strong>ion de la<br />
violence privée ou des documents pouvant servir à approfondir nos réflexions. Il n'était pas qu<strong>est</strong>ion<br />
d'analyser lors de ces entretiens les ressorts de l'engagement dans ce type de <strong>«</strong> causes <strong>»</strong>, même si bien<br />
évidemment cela doit être pris en compte dans l'analyse du discours de l'interviewé.<br />
2 Bertaux [2006], p. 37<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 36
préliminaires concernant la reconstruction des faits du passé prennent ici tout leur sens. Dès<br />
lors que cette reconstruction se fait à l'aune d'une situation sociale présente et d'une vision du<br />
futur il convient de retracer les trajectoires sociales. En effet, le sujet n'interprète pas de la<br />
même manière un fait bouleversant dans sa vie lorsqu'il considère qu'il s'<strong>est</strong> agit <strong>«</strong> d'une<br />
mauvaise passe <strong>»</strong> que lorsqu'il croit qu'il aura du mal à le surmonter 1 . Comme le souligne<br />
Pierre Bourdieu le sujet a tendance <strong>«</strong> à se faire l'idéologue de sa propre vie en sélectionnant en<br />
fonction d'une intention globale certains événements significatifs et en établissant entre eux<br />
des connexions propres à leur donner cohérence <strong>»</strong> 2 . De ce point de vue, la reconstruction de<br />
l'espace social dans lequel évolue l'individu <strong>est</strong> un préalable à toute analyse du discours qu'il<br />
tient sur sa trajectoire. Dès lors que nous n'interrogeons pas nos interviewés sur leurs parcours<br />
biographiques, mais sur des épisodes concrets de leur vie, le danger n'<strong>est</strong> tant celui de la<br />
recomposition à posteriori d'une <strong>«</strong> histoire de vie <strong>»</strong>, mais de la réinterprétation de ces<br />
événements à l'aune d'une situation présente. Il convient alors évidemment d'obtenir de<br />
l'entretien les informations nécessaires à établir un lien entre la trajectoire du sujet et la<br />
réinterprétation qu'il fait du passé. D'autre part, c'<strong>est</strong> dans la confrontation des différents<br />
entretiens que l'on peut arriver à obtenir des matériaux plus précis sur les <strong>«</strong> univers de vie <strong>»</strong><br />
des individus. Comme l'écrit D. Bertaux :<br />
<strong>«</strong> <strong>La</strong> mise en rapport de ces témoignages les uns avec les autres permet d'écarter<br />
ce qui relève des colorations respectives et d'isoler un noyau commun aux<br />
expériences, celui qui correspond à leur dimension sociale, celle que l'on cherche<br />
précisément à saisir. Ce noyau <strong>est</strong> à chercher plutôt du côté des faits et des<br />
pratiques plutôt que du côté des représentations <strong>»</strong> 3<br />
Une difficulté supplémentaire vient du type de qu<strong>est</strong>ions que l'on <strong>est</strong> amené à poser aux<br />
interviewés. En effet, il s'agit en grande partie des personnes ayant vécu des expériences<br />
violentes et parfois très traumatiques. Cela amène plusieurs remarques; d'une part, il <strong>est</strong><br />
difficile <strong>«</strong> négocier <strong>»</strong> un entretien dans ces conditions. Les personnes sont souvent réticentes à<br />
parler de ces expériences et voient le chercheur au mieux comme un curieux gênant, au pire<br />
comme un voyeur morbide. De plus, vu la violence que vivent encore les populations de la<br />
zone de <strong>notre</strong> enquête, les personnes ont tendance à être extrêmement méfiantes. C'<strong>est</strong><br />
particulièrement le cas des individus engagés dans des activités politiques d'opposition ou des<br />
mouvements sociaux, organisations ciblées par les groupes paramilitaires. Quelques<br />
1 Bourdieu [1986], p. 69<br />
2 Idem. Italiques de l'auteur<br />
3 Bertaux [2006], p. 42. Italiques de l'auteur<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 37
annotations de <strong>notre</strong> journal de terrain, prises pendant et après un rendez-vous avec un leader<br />
syndical de Santa Marta, illustreront mieux <strong>notre</strong> propos :<br />
<strong>«</strong> Je suis si précautionneux car l'ennemi <strong>est</strong> partout. Il se cache derrière des<br />
visages très différents. C'<strong>est</strong> facile d'infiltrer des organisations comme les nôtres;<br />
on <strong>est</strong> très vulnérables – L'interviewé prend note de tout ce que je dis, c'<strong>est</strong> un<br />
véritable interrogatoire. Il demande des dates, des lieux, des noms des gens que<br />
j'ai rencontrés. Quand <strong>est</strong>-ce que je suis arrivé, avec qui je me suis déjà<br />
entretenu, qu'<strong>est</strong>-ce que j'ai l'intention de faire à Santa Marta. Il note tout<br />
soigneusement <strong>»</strong> 1<br />
Dans les cas des personnes ayant vécu des expériences traumatiques, il existe une<br />
difficulté supplémentaire. L'intensité d'un tel vécu peut affecter, non seulement sa mise en<br />
récit mais aussi les mécanismes psychologiques de la mémoire. Comme l'explique une<br />
psychologue travaillant avec des populations réfugiées :<br />
<strong>«</strong> Les personnes qui vivent des expériences de violence ou de déracinement<br />
développent souvent un état de stress post-traumatique (ESPT). Cela se manif<strong>est</strong>e<br />
de différentes manières. D'une part dans la forme d'aborder le passé : lorsque la<br />
personne se remémore de son expérience elle a l'impression de la vivre à<br />
nouveau. Le seul fait de s'en souvenir peut ainsi la plonger dans un état<br />
d'angoisse. Cela pose évidemment problème à l'heure d'essayer de faire une<br />
reconstruction des faits. Par exemple, les gens vont avoir du mal à donner des<br />
dates précises ou à établir la durée des événements qui s'étendent dans le<br />
temps. <strong>»</strong> 2 .<br />
Il <strong>est</strong> très difficile de répondre à toutes ces difficultés de manière satisfaisante. Or,<br />
l'utilisation de sources orales <strong>est</strong>, dans <strong>notre</strong> cas, incontournable. En ce qui concerne la<br />
difficulté matérielle de l'entretien, c'<strong>est</strong> à dire la réticence de beaucoup d'interviewés, nous<br />
nous sommes inspirés des conseils de S. Beaud et F. Weber. Les auteurs, qui plaident pour<br />
une <strong>«</strong> sociologie ethnographique <strong>»</strong>, affirment que le travail de terrain n'<strong>est</strong> possible qu'à partir<br />
du moment où l'enquête se déroule à l'intérieur d'une communauté d'interconnaissance 3 . En<br />
effet, dès lors que la réputation du chercheur le précède, il <strong>est</strong> beaucoup plus facile de nouer<br />
des contacts. Le fait d'être introduit par quelqu'un constitue ainsi une sorte de caution, d'autant<br />
1 Santa Marta. 14/03/09<br />
2 Expert n°17. Voir annexe n°2, sources orales<br />
3 Beaud et Weber [2003]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 38
plus utile dans des milieux méfiants aux personnes extérieures. En outre, il a souvent été<br />
nécessaire d'effectuer plusieurs contacts avec les personnes avant de réaliser l'entretien. Ces<br />
contacts préalables servaient pour faire connaissance et gagner la confiance du futur<br />
interviewé. Enfin, il convient de souligner que, malgré ma nationalité colombienne, des<br />
marqueurs sociaux tels certains traits physiques et surtout l'accent régional conduisaient les<br />
interviewés à me classer comme un personnage extérieur; l'appartenance à une université<br />
étrangère ne faisait que renforcer cela.<br />
D'autre part, en ce qui concerne le statut à donner aux informations recueillies par<br />
entretien nous avons choisi de privilégier le recoupement des sources. C'<strong>est</strong> le cas avec les<br />
différentes sources orales; en effet nous avons tenté d'obtenir des entretiens avec des<br />
personnes qui pourraient évoquer les mêmes événements, pour avoir ainsi différentes versions<br />
des mêmes faits 1 . C'<strong>est</strong> aussi le cas du recoupement des sources orales avec des sources<br />
écrites, qui s'<strong>est</strong> relevé un outil particulièrement puissant de vérification des informations.<br />
Sources écrites 2<br />
Nous avons utilisé différents types des sources écrites. Tout d'abord, nous avons<br />
effectué un travail de récollection et classement d'articles de presse. Pour la période allant de<br />
1990 à aujourd'hui cela a été relativement aisé, dans la mesure où elle <strong>est</strong> couverte par<br />
différentes bases de données numérisées 3 . Pour l'époque antérieure à 1990 cela a été<br />
matériellement plus difficile; cependant, nous avons pu parcourir quelques titres de presse à<br />
l'hémérothèque de la Bibliothèque Nationale Luis Angel Arango 4 . <strong>La</strong> plupart de ces articles<br />
sont des comptes rendus d'événements violents – attentats, assassinats, enlèvements,<br />
massacres – qui s'appuient parfois sur des sources discutables, comme par exemple les<br />
communiqués de presse de la police ou des forces armées. De ce point de vue là il a parfois<br />
été nécessaire d'effectuer un suivi d'une même <strong>«</strong> affaire <strong>»</strong> pour savoir par exemple si un<br />
attentat initialement imputé à un groupe n'était pas, quelque temps plus tard, revendiqué par<br />
un autre. Pour les époques plus récentes, les reportages sont une source d'information riche; à<br />
cet égard, nous avons eu l'occasion de nous interviewer avec un journaliste de l'hebdomadaire<br />
1 <strong>La</strong> réalisation de plusieurs entretiens collectifs à également permis ce recoupement<br />
2 Voir annexe 1. Sources écrites<br />
3 Tous les articles publiés par El Tiempo, premier quotidien du pays, depuis 1990 sont disponibles en<br />
ligne.<br />
Nous avons également utilisé la base de presse du CINEP, centre de recherche basé à Bogotá. Elle <strong>est</strong><br />
uniquement consultable sur place et couvre la période de 1994 à aujourd'hui<br />
4 <strong>La</strong> liste des journaux consulté se trouve dans l'annexe 1, sources écrites<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 39
Semana, premier hebdomadaire du pays et ayant publié la plupart des enquêtes approfondies<br />
sur le phénomène paramilitaire. Le journaliste en qu<strong>est</strong>ion était d'ailleurs l'auteur de quelques<br />
unes de ces enquêtes. Enfin, le journal en ligne Verdad Abierta, créé par Semana en<br />
partenariat avec des ONG nationales et spécialisé dans le suivi du phénomène paramilitaire<br />
<strong>est</strong> également une source clé. Nous avons également effectué un entretien avec un responsable<br />
de ce journal 1 . Enfin, nous avons également utilisé quelques ouvrages publiés par des<br />
journalistes. Ce sont par exemple des transcriptions des longs entretiens avec des<br />
protagonistes du conflit armé 2 ou des <strong>«</strong> chroniques de guerre <strong>»</strong> 3 . Ces publications abondent en<br />
Colombie mais les travaux vraiment rigoureux sont rares. Ils sont souvent repérables par<br />
l'utilisation qu'en font des universitaires réputés 4 .<br />
Les sources journalistiques les plus récentes ont été utiles pour avoir accès à des<br />
comptes rendus des procès que la justice colombienne mène actuellement contre de hauts<br />
responsables politiques et contre d'anciens commandants paramilitaires. Ces sources posent<br />
des multiples problèmes, liés principalement à l'utilisation politique qui <strong>est</strong> faite par certains<br />
acteurs de ces procès. Les <strong>«</strong> révélations <strong>»</strong> faites lors de ces procès répondent parfois à de<br />
règlements de différends ou à de tentatives d'obtenir des traitements plus favorables de la part<br />
de la justice 5 . Ces sources doivent donc être maniées avec la plus grande prudence.<br />
Les rapports gouvernementaux et les rapport d'ONG nationales et étrangères permettent<br />
également d'avoir des informations factuelles importantes et de recouper d'autres sources,<br />
même s'il <strong>est</strong> toujours nécessaire d'analyser les conditions de production de ces rapports. De<br />
ce point de vue là, les entretiens réalisés avec des fonctionnaires publiques ou des juristes de<br />
plusieurs ONG sont une ressource importante pour le contrôle des sources 6 . Nous avons<br />
également utilisé différents documents administratifs. Certains d'entre eux font aujourd'hui<br />
l'objet d'une diffusion large en Colombie, via les sites internet des journaux. D'autres nous ont<br />
été communiqués par des interviewés.<br />
1 Expert n°19. Voir annexe n°2, sources orales<br />
2 Par exemple Aranguren [2001]; Castro Caycedo [1996]<br />
3 León [2005]<br />
4 Pécaut [2008b] Cite par exemple León [2005]<br />
5 Voir le commentaire de la stratégie des Kompromati par Ragaru [2008], p. 151<br />
6 Experts n° 1, 9, 11, 13, 14, 19. Voir annexe n°2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 40
4. Ce qui va suivre<br />
Dans un premier chapitre, nous analyserons les trajectoires étatiques qui favorisent la<br />
décomposition du monopole de la violence. Nous verrons mettront cela en rapport avec<br />
l'évolution du conflit armé, des institutions colombiennes et des liens centre-périphérie. Nous<br />
montrerons comment le phénomène paramilitaire naît au carrefour d'influences diverses et<br />
quelle <strong>est</strong> la place des trafiquants de drogue dans son développement.<br />
Dans un deuxième chapitre, nous tenterons d'effectuer une analyse historique du<br />
développement des groupes paramilitaires en Colombie. Nous mettrons en rapport deux<br />
trajectoires qui sont fortement liées. Celle des groupes paramilitaires de Puerto Boyacá et<br />
celle des groupes paramilitaires crées par les frères Castaño. Nous mettrons l'accent sur les<br />
configurations qui se construisent autour de ces groupes et sur les processus de polarisation et<br />
alliances qui les rendent possibles<br />
Le troisième chapitre aborde le phénomène paramilitaire dans le Magdaléna. À partir<br />
d'un modèle d'offre et demande nous tenterons de comprendre l'apparition des premiers<br />
groupes paramilitaires en lien avec les transformations socio-politiques du départemental.<br />
Les chapitres quatre et cinq analysent les transformations de l'utilisation de la violence<br />
dans le Magdaléna. Ils s'attachent à montrer l'évolution d'un marche où sont en concurrence<br />
différents groupes de professionnels de la violence vers un monopole de la violence dans les<br />
mains des Autodéfenses Unies de Colombie (AUC). Cette évolution <strong>est</strong> mise en rapport avec<br />
le passage de logiques de violence militaires et rétributives vers une logique étatique, dans<br />
laquelle la violence paramilitaire redéfinit les contours de l'État.<br />
Le dernier chapitre montrera la manière dont la violence permet aux AUC d'avoir accès<br />
aux institutions, de peser sur la répartition du pouvoir politique et d'accumuler des ressources<br />
privées. Ces logiques découlent d'un changement dans les rapports au sein des configurations.<br />
Les paramilitaires semblent désormais placés dans une position qui leur permet de négocier<br />
des arrangements très favorables avec leurs partenaires.<br />
Un épilogue tirera quelques conclusions de ces développements et évoquera la qu<strong>est</strong>ion<br />
de la démobilisation des AUC.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 41
Carte 1. Division départementale de la Colombie et principaux lieux cités<br />
Source : Réalisation de l'auteur à partir d'une carte vierge de l'atelier de cartographie de Sciences Po<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 42
I. État et privatisation de la violence en Colombie<br />
Le phénomène de la privatisation de la violence n'<strong>est</strong> pas nouveau en Colombie. F. López<br />
Alves décrit la difficulté qu'éprouve l'État central au XIXe siècle pour affronter les seigneurs<br />
qui détiennent le pouvoir dans les régions, où ils lèvent des armées, perçoivent les impôts et<br />
frappent la monnaie 1 . Les conditions géographiques d'un pays divisé par de hautes chaînes<br />
montagneuses et des profondes vallées contribue grandement à cette faiblesse du pouvoir<br />
central; cela constitue une constante depuis les temps de la colonie 2 . Somme toute, l'État ne<br />
joue pas un rôle prédominant dans la construction de la Nation 3 . Les seules organisations<br />
politiques qui couvrent l'ensemble du territoire sont les partis libéral et conservateur – apparus<br />
au milieu du XIXe siècle – qui créent des sous-cultures irréductibles 4 dans une identité<br />
nationale presque inexistante. <strong>La</strong> puissance des deux partis s'appuie également sur des milices<br />
armées. Le sommet de fragmentation du monopole de la violence <strong>est</strong> atteint au milieu du XXe<br />
siècle, où Conservateurs et Libéraux s'affrontent dans une guerre civile sanglante, connue<br />
sous le nom de la Violencia, qui fait plus de 200.000 morts entre 1946 et 1964 5 . Cette guerre<br />
<strong>est</strong> faite par l'intermédiaire de milices associées aux partis, qui apparaissent un peu partout<br />
dans le pays. Dans des époques plus récentes, des exemples de milices liées à l'exploitation de<br />
rentes très élevées doivent également être citées. C'<strong>est</strong> bien sûr le cas de la drogue, sur lequel<br />
nous nous arrêterons plus longuement. Mais c'<strong>est</strong> aussi le cas de l'exploitation des émeraudes<br />
dans la région de Boyacá, où l'État renonce à son monopole légal au profit des seigneurs<br />
locaux qui deviennent l'autorité de fait dans ces contrées. Ils administrent la justice et<br />
entretiennent de véritables armées qui se livrent parfois à des guerres pour le contrôle des<br />
mines 6 .<br />
Le phénomène contemporain de création de groupes paramilitaires <strong>est</strong> cependant<br />
différent. Il se trouve à l'intersection entre l'économie de la drogue, dont la Colombie <strong>est</strong> le<br />
1 Lopez Alvez [2003] p. 145-200<br />
2 Múnera [2008], p. 52<br />
3 Bushnell [1993]<br />
4 Pécaut [1987] affirme que les sous-cultures libérale et conservatrice font obstacle à la construction<br />
d'un véritable sentiment d'appartenance nationale<br />
5 Pécaut [2001], p. 105<br />
6 Cf. Uribe [1992]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 43
premier protagoniste dans le monde sur toute la période 1 , le conflit armé interne, dans lequel<br />
s'affrontent les guérillas et l'État et qui atteint des sommets d'intensité à la fin du millénaire 2 ,<br />
et les évolutions politiques du pays qui voient le bipartisme séculier s'écrouler au profit d'une<br />
plus grande fluidité des acteurs politiques 3 .<br />
Le développement du phénomène paramilitaire contribue à la hausse des niveaux de<br />
violence pendant les deux dernières décennies du siècle. Nous voyons dans le graphique 1.2<br />
que le taux d'homicides augmente progressivement depuis la fin des années 1970. Il s'envole<br />
au milieu de la décennie suivante pour atteindre en 1990 et 1991 le taux de 79 homicides pour<br />
100 000 habitants 4 . Cela fait de la Colombie l'un des pays les plus violents au monde,<br />
exception faite des pays en guerre déclarée ou en guerre civile ouverte. S'il <strong>est</strong> vrai que la<br />
violence urbaine, qui <strong>est</strong> le fait de gangs organisés ou de criminels isolés, contribue<br />
grandement à ces chiffres, il <strong>est</strong> indéniable que les acteurs du conflit – guérilla, armée et<br />
paramilitaires – jouent un rôle centrale dans l'augmentation de la violence. Parmi ceux-là, les<br />
paramilitaires sont les premiers responsables de violences contre les civils : entre 1982 et<br />
2007, ces groupes commettent plus de 2500 massacres où sont assassinées près de 15 000<br />
personnes 5 ; fin 2008, 18 431 cas de meurtre étaient en cours d'enquête au parquet national<br />
(Fiscalía General de la Nación) 6 . Ils étaient également accusés d'être les principaux<br />
responsables de disparitions forcées : entre 1996 et 2004, 2215 cas leur sont imputés 7 .<br />
1 Kalmanovitz [1994] <strong>est</strong>ime qu'au début des années 1980 rentrent la cocaïne rapporte au pays plus de<br />
4000 millions de dollars par an. Selon López R<strong>est</strong>repo [2005] à partir des années 1980 l'essentiel de la<br />
cocaïne importée par les États-Unis et l'Europe part de Colombie.<br />
2 Cf. Pécaut [2008a] et Valencia [2008]<br />
3 Cf. Gutierrez Sanín [2007]<br />
4 <strong>La</strong> moyenne mondiale <strong>est</strong> aujourd'hui à 5 pour 100 000 et celle de l'Amérique latine à 27 pour 100<br />
000. <strong>La</strong> France <strong>est</strong> à 1,5 pour 100 000<br />
5 Source : Groupe mémoire historique, Commission Nationale de Réparation et Réconciliation<br />
(CNRR). Voir annexe 1, sources écrites<br />
6 Idem<br />
7 Source : Commission Colombienne de Juristes. Voir annexe 1, sources écrites<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 44
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Graphique 1.2 : Taux d'homicide / 100 000 habitants<br />
0<br />
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006<br />
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005<br />
Source : Police Nationale de Colombie. Revue criminalité n° 50<br />
Nous analyserons ici, en adoptant une perspective historique, la privatisation<br />
progressive de la violence qui a lieu en Colombie à partir des années 1980. Le but sera de<br />
montrer quels sont les facteurs qui rendent possible un tel processus et quel <strong>est</strong> le rôle joué par<br />
l'État. Avant de commencer il faut néanmoins effectuer deux séries de remarques.<br />
<strong>La</strong> première concerne le trafic de drogues; il <strong>est</strong> clair que le développement du<br />
phénomène paramilitaire <strong>est</strong> intimement lié à cette activité, dont la Colombie devient un<br />
acteur central à partir de la fin des années 1970. En effet, comme le souligne P. Koop, le<br />
développement d'une économie illicite, comme celle de la drogue, ne peut se faire que de<br />
manière violente 1 . G. Duncan explique également qu'une telle économie illicite dépend de la<br />
violence privée pour garantir le respect des contrats et la régulation 2 . De plus, les finances de<br />
la drogue alimentent la croissance des groupes paramilitaires 3 qui passent de moins de 3000<br />
combattant au milieu des années 1990 à plus de 13000 en 2003 4 (graphique 1.1).<br />
1 Koop [1995]<br />
2 Duncan [2005c], p. 24-25<br />
3 Ainsi que des guérillas, qui comptent selon le Ministère de la Défense un effectif de plus de 15 000<br />
personnes en 2000.<br />
4 Source : Base de données de Verdad Abierta<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 45
Graphique 1.1 : Estimation de l'évolution des combattants des groupes paramilitaires<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Source : Ministère de la Défense - Base de données de Verdad Abierta 1<br />
Si les groupes paramilitaires semblent intimement liés à la régulation de l'économie de<br />
la drogue, l'analyse des liens entre narcotrafic et violence ne doit pas s'arrêter là. On suivra ici<br />
Daniel Pécaut lorsqu'il affirme que la violence dans laquelle vit le pays depuis la fin des<br />
années 1970 <strong>est</strong> liée aux diverses <strong>«</strong> interférences <strong>»</strong> entre les acteurs violents. L'auteur écrit<br />
qu'on <strong>«</strong> pourrait distinguer trois champs distincts de la violence. Le premier, politique, avec<br />
les militaires, les guérillas et les paramilitaires. Le deuxième, construit autour de l'économie<br />
de la drogue. Le troisième, articulé autour des tensions sociales, organisées ou non <strong>»</strong>.<br />
Cependant, <strong>«</strong> les progrès de l'économie de la drogue ont eu pour conséquence l'altération de<br />
ces séparations bien délimitées <strong>»</strong> 2 . Ces altérations sont le produit des interférences entre les<br />
acteurs des trois champs. Ainsi, les acteurs armés sont rentrés de plain-pied dans le trafic de<br />
drogues 3 , ce qui alimente leur progression. D'autre part, les trafiquants de drogue ont<br />
également acquis un rôle dans le conflit politique, par leur soutien ou leur participation directe<br />
dans les groupes paramilitaires 4 . De plus, au moment ou les groupes paramilitaires se sont<br />
emparés des rouages les plus rentables du trafic, les trafiquants qui étaient leurs principaux<br />
1 Verdad Abierta <strong>est</strong> un projet de communication sur le phénomène paramilitaire et la réparation des<br />
victimes. Il a été créé par la revue Semana, plusieurs ONG colombiennes et étrangères et reçoit le<br />
soutien financier du gouvernement Canadien. Sa base de données (accessible sur le site<br />
www.verdadabierta.org) héberge des centaines de documents historiques et des rapports du<br />
gouvernement et des ONG.<br />
2 Pécaut [2001] p. 116<br />
3 López R<strong>est</strong>repo [2005]<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
4Ce qui d'ailleurs n'empêche la collaboration entre les trafiquants et la guérilla. Cf. Pécaut [2001], p.<br />
119<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 46
ailleurs de fonds sont devenus leurs clients 1 . Enfin, les tensions sociales ne peuvent se<br />
comprendre en dehors du cadre du conflit; ainsi, les paramilitaires accusent la plupart des<br />
opposants au régime d'être des <strong>«</strong> guérilleros en civil <strong>»</strong>. De plus, la stratégie de la guérilla<br />
consistant à occuper les espaces sociaux de cont<strong>est</strong>ation contribue à cette stigmatisation,<br />
même si une forte barrière existe entre opposition civile et armée 2 .<br />
Une seconde série de remarques concerne l'attitude ambiguë de l'État. Ainsi, les<br />
paramilitaires sont censés faire l'objet d'une répression, puisque ce sont des groupes armés<br />
illégaux; or, ils bénéficient presque toujours d'une tolérance bienveillante, dans la mesure où<br />
ils s'opposent au danger insurrectionnel.<br />
Les premiers groupes apparaissent au début de la décennie 1980, mais ils sont<br />
longtemps ignorés par le pouvoir politique. Ce n'<strong>est</strong> qu'en juillet 1987 que le ministre de<br />
l'intérieur César Gaviria <strong>est</strong>ime, lors d'un débat parlementaire, qu'il existe au moins 140<br />
groupes armés dans le pays, très variés quant à leurs modalités d'action, leur organigramme et<br />
leurs relations avec la population, mais menant un combat irrégulier contre la guérilla et<br />
contre ceux qu'ils considèrent comme faisant partie de leurs bases sociales 3 . Ces déclarations<br />
ne sont cependant pas suivies de mesures concrètes. Le gouvernement <strong>est</strong> en effet divisé sur<br />
l'attitude à avoir à l'égard de ces groupes; le ministre de la défense, le général Rafael Samudio,<br />
<strong>est</strong>ime par exemple en 1987 <strong>«</strong> qu'instruire, organiser et soutenir les autodéfenses doit être un<br />
objet permanent des forces armées là où la population <strong>est</strong> loyale et manif<strong>est</strong>e un rejet de<br />
l'ennemi <strong>»</strong> 4 . Cette même année, le 29 septembre, un débat sur les groupes <strong>«</strong> d'autodéfense <strong>»</strong> a<br />
lieu au Congrès. Les représentants défendent majoritairement le droit des citoyens à s'armer<br />
pour combattre aux côtés de <strong>«</strong> leur <strong>»</strong> armée contre la guérilla 5 . L'exécutif se décide néanmoins<br />
à les interdire en 1989. Le décret d'interdiction <strong>est</strong> d'ailleurs le premier document officiel qui<br />
les mentionne. Il parle <strong>«</strong> d'escadrons de la mort, bandes de sicaires et groupes d'autodéfense<br />
et de justice privée appelés à tort paramilitaires <strong>»</strong> 6 . Or, dans la <strong>«</strong> Stratégie nationale contre la<br />
violence <strong>»</strong>, document programmatique datant de 1991, les paramilitaires sont définis comme<br />
un type de délinquance, et aucune stratégie particulière n'<strong>est</strong> proposée pour les combattre 7 . Ce<br />
1 Duncan [2005c]<br />
2 Pécaut [2008b]<br />
3 Cubides [1997]<br />
4 Semana, 08/05/1989, Memorando del ministerio de defensa incita apoyo a paramilitares<br />
5 Voir le compte rendu de ce débat sur Medina Gallego [1990], p. 206-218<br />
6 Décret n° 813 du 19 avril 1989<br />
7 Cubides [1997], p. 24<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 47
manque d'action étatique peut être considéré comme l'une des causes du développement<br />
fulgurant des paramilitaires 1 .<br />
Dans des nombreux cas, à Puerto Boyacá par exemple, les militaires participent<br />
directement à la création des premiers groupes paramilitaires 2 . Partout ailleurs ils contribuent<br />
à les armer, les entraîner et leur fournissent des informations stratégiques 3 . Ils en arrivent<br />
même à construire une stratégie conjointe dans laquelle les militaires combattent la guérilla et<br />
sont relayés ensuite par les paramilitaires qui occupent le terrain à force de massacres et<br />
assassinats sélectifs 4 . En outre, l'évolution de ces groupes <strong>est</strong> également accompagnée par une<br />
adhésion d'amples secteurs des élites économiques et politiques, qui y voient la garantie du<br />
maintien de leur pouvoir dans un contexte d'affaiblissement des réseaux traditionnels de<br />
domination clientélaire 5 .<br />
Mais l'attitude ambiguë de l'État <strong>est</strong> également le fait des tensions internes que réveille<br />
la qu<strong>est</strong>ion de la privatisation de la violence. Si d'amples secteurs de l'exécutif et de l'armée se<br />
prononcent longtemps en faveur de l'armement des civils, d'autres instances de l'État font<br />
cependant barrage à plusieurs reprises. C'<strong>est</strong> le cas des juges, qui invalident plusieurs décrets<br />
favorables aux groupes paramilitaires. Sans tomber dans une vision schématique, il <strong>est</strong> vrai<br />
que les institutions judiciaires se sont souvent prononcé contre la formation de groupes<br />
supplétifs de l'armée. On verra plus en avant certains de ces cas de conflit entre l'exécutif et le<br />
judiciaire. Il convient également de souligner ici que des entrepreneurs politiques appartenant<br />
pourtant aux majorités en place se sont souvent prononcés contre ces différentes formes<br />
d'armement des civils. Nous verrons dans ce texte que cette qu<strong>est</strong>ion ne fait jamais l'objet d'un<br />
consensus, et que la seule qu<strong>est</strong>ion des tensions intra-étatiques qu'elle cause mériterait à elle<br />
seule un travail approfondi de recherche. Cette complexité <strong>est</strong> la raison qui invalide les<br />
visions d'une politique de <strong>«</strong> terrorisme d'État <strong>»</strong> 6 vers laquelle convergeraient toutes les<br />
institutions publiques. Tout au contraire, les attitude de collusion, conflit et tolérance mènent<br />
à penser qu'il n'<strong>est</strong> pas possible d'avancer des causes univoques au développement du<br />
phénomène paramilitaire et qu'il faut au contraire analyse de prêt les stratégies des acteurs.<br />
1 Ibidem, p. 30<br />
2 Medina Gallego [1990]<br />
3 Voir par exemple la description du cas d'Urabá par Romero [2003] p. 193-221<br />
4 Cet argument <strong>est</strong> développé par Human Rights Watch [2001] et suivi par Pécaut [2001] p. 131<br />
5 Voir par exemple le cas des alliances entre éleveurs de bétail et paramilitaires dans le département de<br />
Córdoba dans Romero [2003] et celui des alliances électorales dans Romero et Valencia [2007]<br />
6 Cf. Carrillo et Kucharz [2006]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 48
À partir de ces remarques, nous verrons que le contexte insurrectionnel des années 1970<br />
et 1980 favorise la création de groupes paramilitaires. L'opposition au processus de paix avec<br />
les guérillas radicalise dans un premier temps certains secteurs des élites et de l'armée et<br />
favorise les stratégies de contournement de l'État. Ensuite, l'entrée des narcotrafiquants dans<br />
les projets paramilitaires les autonomise du contrôle militaire. Enfin, la complexe agrégation<br />
d'intérêts disparates autour des paramilitaires complexifie davantage une situation caractérisée<br />
par l'incertitude et la volatilité des alliances.<br />
1. L'ombre de la Révolution<br />
D. Pécaut date le début de l'actuel cycle de violence que vit la Colombie en septembre<br />
1977, lorsque, dans le cadre d'une grève générale, des manif<strong>est</strong>ations à Bogotá dégénèrent en<br />
émeute urbaine et laissent un bilan de vingt morts 1 . À cette occasion la radicalisation de divers<br />
secteurs de la société, autour de l'opposition ou le soutien au régime, commence à être<br />
perceptible. Une véritable explosion de violence a lieu dans les années suivantes. Deux<br />
facteurs sont essentiels pour la comprendre : d'un côté une conception très large de la guerre<br />
contre-insurrectionnelle, qui fait des civils des cibles et des acteurs potentiels de cette guerre;<br />
de l'autre l'augmentation de la force des guérillas à laquelle l'État répond par une répression<br />
large et indiscriminée. Ces deux facteurs constituent un contexte favorable pour l'apparition<br />
des groupes paramilitaires.<br />
L'ennemi interne<br />
Nous l'avons déjà dit, pendant des années l'organisation de milices <strong>est</strong> légale en<br />
Colombie. <strong>La</strong> loi 48 de 1968 autorise la création de <strong>«</strong> groupes d'autodéfense <strong>»</strong> dans le but de<br />
<strong>«</strong> faire contrepoids à l'apparition d'insurrections d'orientation communiste <strong>»</strong> 2 . Dix ans après<br />
le vote de cette loi, Luis Carlos Camacho Leyva, commandant de l'armée et futur ministre de<br />
la Défense, appelle la population à se mobiliser pour sa propre défense et celle des institutions<br />
de l'État 3 . Il incite alors à combattre les subversifs <strong>«</strong> avec les mêmes armes avec les quelles ils<br />
assassinent les citoyens <strong>»</strong> 4 . Il ne s'agit pas là du discours isolé d'un radical, mais d'une<br />
conception officielle largement répandue alors dans les forces militaires. Ainsi, un bref<br />
1 Ibidem, p. 106<br />
2 Romero [2007], p. 409<br />
3 Gallon [1983]<br />
4 Ibidem p. 86<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 49
examen des manuels de guerre contre-insurrectionnelle de l'époque montre la place faite aux<br />
milices supplétives de l'armée dans la guerre de guérillas.<br />
Les manuels de guerre contre-insurrectionnelle entrent dans la formation des officiers<br />
en 1962, suite notamment à la mission Yarbourough des forces armées américaines qui<br />
visitent le pays en février de cette année là. Puisque les habitants sont au centre du conflit, il<br />
faut les engager dans la guerre. Le manuel de 1963 affirme alors que <strong>«</strong> le contrôle de la<br />
population permettra d'obliger à participer à une partie importante des habitants dans leur<br />
propre défense <strong>»</strong> 1 et celui de 1969 préconise <strong>«</strong> l'organisation militaire de la population civile<br />
pour qu'elle se protège contre l'action des guérillas et soutienne les opérations de combat <strong>»</strong> 2 .<br />
Il définit alors la <strong>«</strong> junte d'autodéfense <strong>»</strong> comme <strong>«</strong> une organisation de type militaire<br />
constituée par du personnel civil sélectionné dans la zone de combat et qui <strong>est</strong> entraînée et<br />
équipée pour développer des actions contre les groupes de guérilla qui menacent la zone et<br />
pour agir en coordination avec l'armée lors des combats <strong>»</strong> 3 .<br />
Ces manuels identifient l'ennemi comme une <strong>«</strong> force irrégulière, manif<strong>est</strong>ation<br />
extérieure d'un mouvement de résistance contre le gouvernement local de la part d'un groupe<br />
de la population <strong>»</strong> 4 et affirment que <strong>«</strong> la limite entre amis et ennemis <strong>est</strong> au sein même de la<br />
nation [...], il s'agit souvent d'une frontière idéologique immatérielle <strong>»</strong> 5 . À la qu<strong>est</strong>ion<br />
<strong>«</strong> Comment se présente la guerre révolutionnaire dans le pays? <strong>»</strong> le manuel de 1979 répond :<br />
<strong>«</strong> les grèves légales et illégales et la motivation et organisation de groupes humains pour la<br />
lutte révolutionnaire, étudiants, ouvriers, fonctionnaires <strong>»</strong> 6 . Le même manuel affirme<br />
laconiquement : <strong>«</strong> il faut comprendre que, dans une guerre irrégulière l'ennemi <strong>est</strong> partout et<br />
de manière permanente<strong>»</strong> 7 . <strong>La</strong> population <strong>est</strong> au centre de la guerre contre-insurrectionnelle :<br />
<strong>«</strong> l'habitant, dans ce champ de bataille, se trouve au centre du conflit [...]. Qu'ils le veuillent<br />
ou non, les deux camps sont obligés à le faire participer dans le conflit; d'une certaine<br />
manière il <strong>est</strong> devenu un combattant <strong>»</strong> 8 . Cette population <strong>est</strong> classifiée en trois groupes : liste<br />
1 <strong>La</strong> Guerra Moderna, Bibliothèque de l'Armée, 1963 p. 70<br />
2 Instrucciones generales para operaciones contraguerrillas, Ayudantía General del Comando del<br />
Ejército, 1979 Op cit. p. 310<br />
3 Ibidem<br />
4 Operaciones contre fuerzas irregulares, traduction du manuel FM-31-15 de l'armée des États-Unis,<br />
Bibliothèque de l'Armée, 1962. p.5<br />
5 <strong>La</strong> Guerra Moderna, Op cit, 1963 p. 32<br />
6 Instrucciones generales para operaciones contraguerrillas, Op cit, 1979 p. 195<br />
7 Ibidem p. 29<br />
8 <strong>La</strong> Guerra Moderna, Op cit p. 34<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 50
noire (soutiens avérés de l'insurrection), liste grise (déclarés comme neutres et donc suspectés<br />
de soutenir la guérilla) et blanche (soutiens de l'armée). Le manuel préconise le <strong>«</strong> harcèlement<br />
des personnes de la liste noire et grise qui ne voudraient pas collaborer avec la troupe, pour<br />
les obliger à révéler leur véritable identité ; il faut les effrayer en leur faisant croire qu'ils<br />
sont fichés et leur faire quitter la région <strong>»</strong> 1 . On voit donc également la conception large de<br />
l'insurrection véhiculée par l'institution militaire, qui légitime alors la répression contre les<br />
opposants du régime au nom du conflit interne.<br />
Ce discours présent à l'intérieur de l'institution militaire légitime l'armement des civils<br />
dans le contexte d'un conflit contre-insurrectionnel; il fait aussi d'autres civils les cibles<br />
légitimes de la violence militaire, en raison non seulement de leur prétendue appartenance à<br />
un groupe subversif, mais aussi de leurs idées politiques. Cela créé des conditions pour que<br />
des militaires arment des groupes paramilitaires pour les charger de l'élimination des <strong>«</strong> bases<br />
sociales <strong>»</strong> de la guérilla. Cette conception légitime aussi la tolérance, voire la coopération des<br />
plus hautes instances des institutions militaires. Cependant, pour que l'application de telles<br />
tactiques aboutisse à un déferlement de violence de l'ampleur décrite plus haut, d'autres<br />
conditions sont nécessaires. Ainsi, la description de la dégradation du conflit et la répression<br />
massive que met en œuvre l'État <strong>est</strong> nécessaire pour comprendre la violence paramilitaire.<br />
Dégradation du conflit et répression étatique<br />
À la fin des années 1970, on se met à parler en Colombie, d'une <strong>«</strong> crise morale <strong>»</strong>, à la<br />
fois crise politique, économique et sociale 2 . Un des éléments de cette crise <strong>est</strong> une perception<br />
accrue de l'insécurité, liée à l'offensive de différentes guérillas mais aussi à un net<br />
accroissement des conflits sociaux. Dans la situation historique de l'époque, beaucoup<br />
craignent l'avènement de la révolution, portée par les groupes les plus radicaux 3 . <strong>La</strong> situation<br />
<strong>est</strong> alors comparée à celle du Nicaragua pré-révolutionnaire et l'on dénonce dans les<br />
mouvements sociaux une manif<strong>est</strong>ation de l'agitation subversive 4 . Face à la menace, le régime<br />
prend un tournant sécuritaire – dénoncé par les partis d'opposition et par l'Église – et les<br />
militaires prennent de plus en plus de place dans la g<strong>est</strong>ion de l'ordre interne 5 .<br />
1 Instrucciones generales para operaciones contraguerrillas, Op cit. p. 188<br />
2 Pécaut [2006], p. 248 et suiv<br />
3 Pécaut [2006]<br />
4 Achila [2002]<br />
5 Amn<strong>est</strong>y International [1980]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 51
Les caractéristiques du conflit colombien se trouvent modifiées à la fin des années 1970<br />
et au début des années 1980. En 1974 apparaît le M-19 (Mouvement du 19 Avril),<br />
organisation armée initialement urbaine qui multiplie les coups d'éclat, tels le meurtre du<br />
dirigeant syndical (CTC 1 ) José Raquel Mercado ou le vol de plus de 7 000 armes dans un<br />
entrepôt militaire en 1979 2 . L'expansion des FARC-EP commence autour de 1975, année où<br />
elles passent de 5 à 24 fronts. <strong>«</strong> Mais c'<strong>est</strong> en 1982 que se produit le vrai tournant. Elles (les<br />
FARC-EP) réunissent cette année-là leur septième conférence et quelques mois après un<br />
" Plenum amplifié " (...). Estimant que la conjoncture présente des " indices de situation<br />
révolutionnaire " et que " la prot<strong>est</strong>ation des masses prend une tournure insurrectionnelle " les<br />
FARC décident de porter à 48 le nombre de leurs fronts <strong>»</strong> 3 . Des groupes d'extrême gauche<br />
appliquant des tactiques de terrorisme armé apparaissent également. L'action la plus frappante<br />
<strong>est</strong> le meurtre de Rafael Pardo Buelvas, ancien ministre de l'intérieur par le MAO<br />
(Mouvement d'Autodéfense Ouvrière) en 1978.<br />
L'intensification des conflits sociaux contribue à ce climat de tension. L'octroi d'une<br />
personnalité juridique à la CSTC (Confédération Syndicale de Travailleurs Colombiens),<br />
union syndicale proche du parti communiste et à la CGT (Confédération Générale du Travail),<br />
plus modérée, marque le déclin de l'UTC 4 et de la CTC, syndicats traditionnellement proches<br />
des, respectivement, des partis conservateur et libéral 5 . Les syndicats indépendants, proches<br />
de l'extrême gauche, apparaissent également, tel FECODE (Fédération Colombienne<br />
d'Enseignants), le syndicat des enseignants. L'affaiblissement des syndicats traditionnels<br />
alimente le conflit social; le gouvernement parle alors de <strong>«</strong> guérilla syndicale <strong>»</strong> 6 . <strong>La</strong> grève<br />
générale du 14 septembre 1977 <strong>est</strong> un signe évident du caractère conflictuel des relations<br />
entre l'État, le patronat et les syndicats. Malgré cette vitalité des luttes sociales, la gauche<br />
politique se maintient à des niveaux de vote très faibles; les partis opposés au Front National<br />
(coalition des deux grands partis de gouvernement) ne recueillent lors des élections<br />
législatives de 1978 que 4,4% des voix. En effet, les partis d'opposition sont extrêmement<br />
divisés, et les conflits – à l'intérieur des partis mais aussi entre eux – les marginalisent.<br />
1 Confédération de Travailleurs de Colombie. Un des premiers syndicats fondés en Colombie, proche<br />
du parti libéral<br />
2 Melo et Valencia [1989], p. 363<br />
3 Pécaut [2008a], p. 39<br />
4 Union de Travailleurs de Colombie. Un des premiers syndicats fondés en Colombie, proche du parti<br />
conservateur<br />
5 Pécaut [2006], p. 259<br />
6 Ibidem, p. 261<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 52
L'arrivée de Julio Cesar Turbay à la présidence de la République en 1978 marque un<br />
tournant sécuritaire. Le nouveau président s'attaque aux syndicats et aux partis d'opposition,<br />
aussi bien qu'à la guérilla. Le changement d'orientation <strong>est</strong> manif<strong>est</strong>e suite à la promulgation<br />
du <strong>«</strong> statut de sécurité <strong>»</strong> en septembre 1978. Celui-ci comprend trois types de mesures :<br />
<strong>«</strong> 1. Augmentation des peines contre les délits d'enlèvement, extorsion, incendie<br />
volontaire et attaque armée. Extension abusive de la notion de subversion, qui<br />
permet de punir d'un an de <strong>prison</strong> les personnes qui " distribuent de la propagande<br />
subversive ", exhibent dans ses endroits publics " des textes ou des dessins<br />
outrageants ou subversifs " ou qui " incitent les citoyens à la révolte " ou à la<br />
" désobéissance aux autorités ". 3. attribution à des autorités subalternes,<br />
militaires, policières ou civiles, de la capacité de fixer sans droit d'appel les peines<br />
correspondant à la deuxième catégorie <strong>»</strong> 1<br />
Ces mesures d'exception permettent à la police et à l'armée de procéder au<br />
démantèlement des réseaux urbains proches des guérillas ou des mouvements<br />
révolutionnaires. <strong>La</strong> première vague s'attaque surtout aux réseaux très actifs de l'Université<br />
Nationale à Bogotá. Les limites d'application du statut de sécurité sont flous et sont<br />
interprétées de manière extensive, comme lorsqu'il sert à arrêter des militants du Parti<br />
Communiste ou des travailleurs grévistes 2 . <strong>La</strong> participation des forces armées à des tâches de<br />
maintien de l'ordre interne et le jugement de civils par des cours militaires fait l'objet de fortes<br />
critiques, par exemple de la part de l'ancien président Alfonso López Michelsen. Les<br />
violations des droits de l'homme permises par le statut sont dénoncées, non seulement par les<br />
partis d'opposition, mais aussi par des instances internationales 3 .<br />
C'<strong>est</strong> dans ce climat que les forces armées demandent une politique plus ferme et une<br />
stratégie plus agressive à l'encontre de la <strong>«</strong> subversion <strong>»</strong>. Le général Camacho Leyva, ministre<br />
de la Défense, accuse ainsi les syndicats et le Parti Communiste d'être les soutiens légaux de<br />
la guérilla. Même le président de l'UTC, syndicat fondé par les jésuites et proche du parti<br />
conservateur se voit accusé de subversion. Le général accuse ces organisations de diviser le<br />
peuple et de l'éloigner des priorités de la défense nationale 4 . <strong>La</strong> mobilisation des guérillas<br />
1 Ibidem, p. 271<br />
2 Ibidem, p. 273<br />
3 Voir par exemple le rapport de l'OEA de 1981 Report on the Situation of Human Rights in the<br />
Republic of Colombia.<br />
4Lettre du Gén. Camacho Leyva à Tulio Cuevas, président de l'UTC. Datée du 15 mars 1981. Citée par<br />
Pécaut [2006]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 53
provoque une réaction ferme de l'État, qui met en œuvre une stratégie militaire contre<br />
l'insurrection armée et une stratégie sécuritaire contre l'opposition civile.<br />
Face à la menace telle qu'elles la perçoivent, différentes instances de l'État se<br />
mobilisent. Les militaires demandent ainsi au gouvernement de prendre des mesures fortes, et<br />
parallèlement, élaborent en coulisses des stratégies cland<strong>est</strong>ines de lutte contre-<br />
insurrectionnelle. Il s'agit des <strong>«</strong> escadrons de la mort <strong>»</strong> formés par des militaires ou policiers<br />
en service mais agissant de manière cachée pour éliminer les ennemis du système. Cette<br />
tactique policière <strong>est</strong> utilisée fréquemment par les régimes autoritaires du continent, et le cas<br />
colombien n'en <strong>est</strong> pas une exception. Nous connaissons l'existence du groupe <strong>«</strong> Triple A <strong>»</strong><br />
(Alliance Anticommuniste Américaine) par les déclarations de ses anciens intégrants. Le 29<br />
novembre 1980 cinq membres du bataillon d'intelligence et contre-intelligence Charry Solano,<br />
de l'armée de terre, publient une longue lettre dans le quotidien mexicain El Día 1 . Ils<br />
dénoncent alors la formation de ce groupe par le commandant du bataillon, le colonel Harold<br />
Bedoya, et les autres officiers de l'organisme militaire. Ils affirment avoir reçu les ordres<br />
d'organiser les attentats contre la revue Alternative et les quotidiens El Bogotano et Voz<br />
Proletaria (journal du Parti Communiste). Ils avouent également les assassinats de José<br />
Manuel Martínez Quiroz, militant de l'ELN et du leader étudiant Claudio Medina ainsi que les<br />
séances de torture dont furent victimes de nombreux militants du M-19. Des rapports de<br />
l'ambassade des États-Unis en Colombie récemment dé-classifiés par le National Security<br />
Archive confirment la version des militaires et affirment que la Triple A avait été créée par<br />
<strong>«</strong> le Général Jorge Robledo Pulido (Commandant en Chef des Armées, n.d.t) dans le but de<br />
donner l'impression que la Triple A […] préparait une action contre les communistes<br />
locaux <strong>»</strong> 2 .<br />
Il <strong>est</strong> essentiel de remarquer ici que le pays vit alors dans un état d'urgence permanent.<br />
L'exécutif utilise <strong>«</strong> l'état de siège <strong>»</strong> pour gouverner par décrets et juge les civils devant les<br />
tribunaux militaires 3 . Cette utilisation abusive des mesures d'exception brouille les limites<br />
entre les normes juridiques et les procédures de fait, entre le droit et la force 4 . Ce brouillage<br />
des catégories affaiblit le droit et favorise l'utilisation de mesures de répression extra-<br />
juridiques, comme l'exemple de la Triple A.<br />
1 El Día, Militares colombianos presos denuncian crímenes de colegas, 29/11/1980<br />
2 U.S. Embassy Colombia, cable. Human Rights: Estimate of the Present Situation in Colombia.<br />
06/02/1979. Voir le dossier du National Security Archive, une initiative de la George Washington<br />
University : http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB223/index.htm<br />
3 Pécaut [2006], p. 290<br />
4 C'<strong>est</strong> ce qu'affirme <strong>La</strong>urent Gayer [2008] pour le Pakistan, p. 28-29<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 54
<strong>La</strong> situation se dégrade donc dans cette période, avec l'accentuation et la généralisation<br />
de la violence. <strong>La</strong> radicalisation de plusieurs secteurs de l'État et des élites politiques <strong>est</strong><br />
évidente, et la force prise par les guérillas accroît le sentiment de menace. Or, les activités de<br />
répression sont encore principalement contrôlées par l'appareil d'État. Les choses changent<br />
radicalement avec le processus de paix raté que promeut le président Betancur. En effet, cette<br />
négociation rapproche les secteurs les plus radicaux du pays autour de l'opposition à l'entrée<br />
des guérillas dans le jeu politique local. Cette radicalisation favorise la création des groupes<br />
paramilitaires et leur assure des soutiens puissants 1 .<br />
2. Vers la violence généralisée<br />
Au début de la décennie 1990, D. Pécaut écrivait que <strong>«</strong> l'association des forces de<br />
l'ordre, des trafiquants et des propriétaires <strong>est</strong> ce qui conduit à la constitution des bandes<br />
"paramilitaires" proprement dites <strong>»</strong> 2 . L'entrée des narcotrafiquants dans ces groupes augmente<br />
sensiblement leur pouvoir économique, les autonomisant des influences d'autres bailleurs de<br />
fonds. Elle amène également des nouvelles formes de conflit avec les guérillas, liées au<br />
contrôle sur les terres et les populations. Enfin, elle met les paramilitaires dans une position<br />
ambiguë vis-à-vis de l'État, qui se lance alors dans une offensive contre le trafic des drogues.<br />
L'échec du processus de paix et l'extermination de l'UP<br />
Malgré la politique répressive ce Turbay, l'action de la guérilla ne diminue pas. En<br />
1981, le département du Caquetá <strong>est</strong> le théâtre de durs affrontements entre l'armée d'un côté et<br />
les FARC-EP et le M-19 de l'autre 3 . D'autre part, toutes les tentatives d'instauration de<br />
pourparlers de paix sont frustrées par l'intransigeance du gouvernement sur la qu<strong>est</strong>ion de<br />
l'amnistie des guérilleros, pourtant fondamentale pour avancer vers des négociations 4 .<br />
Les candidats qui se présentent aux élections de 1982 semblent pourtant d'accord sur<br />
l'importance de la qu<strong>est</strong>ion de la paix, et sur le capital politique qu'elle peut représenter. En<br />
effet, ils se présentent tous comme <strong>«</strong> le candidat de la paix <strong>»</strong> et se réclament d'une solution<br />
politique au conflit armé. Parmi eux, Belisario Betancur, candidat conservateur, soutenu<br />
également par l'ANAPO (Alliance Nationale Populaire) réussit à canaliser le rejet d'un parti<br />
libéral de plus en plus mis en cause par ses propres électeurs. Ainsi l'indiquent les résultats<br />
1 C'<strong>est</strong> la thèse de Romero [2003], que l'on développera plus loin dans le texte.<br />
2 Pécaut [1991]<br />
3 Pécaut [2006], p. 295<br />
4 Ibidem, p. 296-298<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 55
des élections, où Betancur l'emporte sur l'ancien président Alfonso López Michelsen par plus<br />
de 53% des voix. Des villes traditionnellement libérales comme Bogotá l'ont soutenu 1 .<br />
Cette élection marque un changement de cap dans la stratégie vis-à-vis des la guérilla.<br />
Avant même sa prise de fonctions, Betancur propose des grandes négociations nationales<br />
couplées d'une promesse d'ouverture politique. Il crée une commission de paix, composée de<br />
membres des différents partis, y compris le Parti Communiste. Il fait surtout voter, en<br />
novembre 1982, une loi d'amnistie inconditionnelle. Différents projets de loi suivent cette<br />
<strong>«</strong> ouverture politique <strong>»</strong>; ils comprennent une réforme de la procédure de reconnaissance des<br />
partis, du régime de financement et du statut de l'opposition. Ils comprennent également un<br />
projet de décentralisation, avec notamment l'élection des maires et gouverneurs au suffrage<br />
universel 2 – ils sont alors nommés. <strong>La</strong> situation semblait alors se consolider, avec une<br />
première entrevue entre membres de la Commission de Paix et membres de l'État major des<br />
FARC-EP le 30 janvier où ces derniers se félicitent des mesures du gouvernement Betancur 3 .<br />
Le 28 mars 1984 les FARC-EP et le gouvernement Betancur signent les Accords de cessez-le-<br />
feu et trêve ou accords de <strong>La</strong> Uribe (Municipe de signature, situé dans le département du<br />
Meta). Ces accords prévoient l'arrêt des hostilités et la recherche conjointe d'une issue<br />
politique au conflit; or, nulle clause ne prévoit le désarmement immédiat de la guérilla. Suite à<br />
ces accords, les FARC-EP forment en mai 1985 un parti politique, l'Union Patriotique (UP)<br />
que le commandant Jacobo Arenas, de l'état major de l'organisation aurait même songé à<br />
diriger 4 . L'UP attire alors des militants issus de secteurs extérieurs à l'organisation armée,<br />
allant des organisations sociales et syndicales aux factions réformistes des partis traditionnels.<br />
Son premier candidat présidentiel, pour les élections de 1986, <strong>est</strong> Jaime Pardo Leal, président<br />
d'Asonal Judicial, syndicat de l'administration judiciaire.<br />
Or, les relations entre le gouvernement et les guérillas se dégradent très vite, avec les<br />
annonces de reprises des hostilités par l'ELN et le M-19; la paix avec ces dernières semble<br />
enterrée après la prise sanglante du palais de justice en novembre 1985, qui fait 55 morts dont<br />
11 magistrats des Hautes Cours 5 . Les FARC continuent cependant à respecter le cessez-le-feu,<br />
ce qui semble encourageant dans la mesure où elles possèdent d'importantes bases paysannes<br />
dans le Sud du pays. Certains commandants de la guérilla se font élire au Congrès dans les<br />
1 Ibidem, p. 303-304<br />
2 Ibidem, p. 321<br />
3 Arenas [1985], p. 23<br />
4 Pécaut [2008a]<br />
5Il s'agit depuis 1991 de la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'État et le Conseil<br />
Supérieur de la Magistrature<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 56
élections de 1986 sous l'étiquette de l'UP, comme Braulio Herrera et Iván Márquez. Le parti<br />
fait élire 5 sénateurs et 9 députés à la Chambre, ainsi que 14 représentants dans les assemblées<br />
départementales 1 . Cependant, les guérillas en profitent, parallèlement au processus de paix,<br />
pour renforcer leurs bases sociales 2 ; elles auraient par exemple lancé des campagnes de<br />
recrutement dans les quartiers défavorisés des grandes villes 3 . De plus, certains auteurs<br />
affirment que la création de l'Union Patriotique aurait répondu au fond à une stratégie<br />
militaire des FARC pour étendre leur emprise 4 . <strong>La</strong> transformation du parti en un front large,<br />
composé de divers mouvements politiques et sociaux, aurait cependant contrarié les ambitions<br />
de l'organisation 5 .<br />
<strong>La</strong> plupart des auteurs sont d'accord pour identifier dans le processus de paix, et les<br />
accords subséquents, le principal facteur favorisant l'armement et le développement des<br />
groupes paramilitaires 6 . Pour Mauricio Romero le phénomène paramilitaire <strong>est</strong> une réaction<br />
des élites régionales et de l'armée au rapprochement entre le gouvernement central et les<br />
guérillas 7 . En effet, il existe une crainte que des accords de paix éventuels débouchent sur une<br />
législation sociale, une réforme du système électoral et une réforme agraire, comme le<br />
demande de la guérilla. Romero parle alors de polarisation, entre d'une part le gouvernement<br />
central et d'autre part les élites locales et l'armée 8 . Cette dernière vit très mal l'armistice<br />
prononcé par le Président et dénonce le peu d'écoute que le gouvernement accorde aux<br />
généraux sur le thème de la paix. Elle critique fortement le fait que le gouvernement ait<br />
permis aux FARC de garder leurs armes pendant les négociations 9 . <strong>La</strong> menace perçue et la<br />
polarisation des positions rendent possible l'apparition de stratégies de contournement de<br />
l'État pour maintenir ce statut quo. On peut ici dessiner un parallèle avec le modèle de<br />
<strong>«</strong> l'autoritarisme périphérique <strong>»</strong> (subnational authoritarianism) formulé par E. Gibson.<br />
L'auteur explique, comparant l'État méxicain de Oaxaca et la province argentine de Santiago<br />
del Estero, que la démocratisation du centre politique peut favoriser des dynamiques<br />
1 Bulletin de la Corporation pour la Défense et la Promition des Droits Humains Reiniciar. Genocidio<br />
político : el case de la UP. Février 2005<br />
2 Chernick [1999], p. 176<br />
3 Pécaut [2006], p. 331<br />
4 Dudley [2004]<br />
5 Pardo Rueda [1996], p. 50-54<br />
6 Cubides [1997], p. 8<br />
7 Romero [2003], p. 117 et suiv.<br />
8 Idem<br />
9 Ainsi l'affirme également Pécaut [2006], p. 323-324<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 57
autoritaires dans la périphérie 1 . Ainsi, dans un contexte de changement institutionnel qui<br />
provoque des conflits politiques au centre, des dirigeants nationaux peuvent avoir besoin du<br />
soutien des autocrates régionaux. Ceux-ci sont en mesure de mobiliser leur capital électoral et<br />
leurs alliés au parlement pour obtenir un traitement favorable du centre 2 . Comme l'écrit D.<br />
Recondo, <strong>«</strong> ne serait-ce que pour éviter les nuisances éventuelles que [les chefs politiques<br />
provinciaux] pourraient leur causer, les dirigeants nationaux fermeraient-ils les yeux sur les<br />
pratiques autocratiques de leurs homologues provinciaux <strong>»</strong> 3 . Cette dynamique des relations<br />
entre centre et périphérie peut apporter un complément théorique à la thèse de M. Romero. En<br />
tout cas elle explique en partie le paradoxe des années de la présidence de B. Betancur,<br />
lorsque les négociations et l'ouverture des espaces politiques coïncident avec une large<br />
tolérance des groupes paramilitaires soutenus par les élites locales.<br />
Pour Romero, ce que les élites locales craignent le plus <strong>est</strong> le projet d'élections de<br />
maires au suffrage universel. À l'époque, les maires sont choisis par le gouverneur – qui <strong>est</strong><br />
nommé par le président – sur proposition des conseils municipaux. Une des revendications de<br />
la guérilla <strong>est</strong> le remplacement des nominations par des élections libres. Le projet <strong>est</strong><br />
approuvé en 1986, et les premières élections pour les postes de maires ont lieu deux ans plus<br />
tard. Cela ouvre de nouveaux espaces locaux à la compétition politique, précisément au<br />
moment où les négociations la rendent plus agitée. Ainsi, lors de ces élections l'UP gagne 23<br />
mairies 4 et 329 places dans les conseils municipaux. Les mairies constituent des objectifs<br />
électoraux beaucoup plus accessibles pour les partis d'opposition et les mouvements<br />
subversifs; d'où une augmentation de la perception de menace. 5<br />
C'<strong>est</strong> dans ce contexte que l'offensive paramilitaire doit être comprise. En effet, les<br />
bases paysannes des FARC assurent au parti des niveaux de voix jamais atteints par<br />
l'opposition. Comme le montre M. Romero pour le département de Córdoba, la réalisation<br />
d'alliances avec les partis traditionnels permet à l'UP de s'insérer très vite dans le système<br />
partisan et de se positionner comme une alternative crédible aux conservateurs et libéraux 6 .<br />
C'<strong>est</strong> alors qu'une violence de grande ampleur <strong>est</strong> déployée contre ce parti politique par les<br />
groupes paramilitaires. À la fin de l'année 1986, 300 membres du parti ont été assassinés,<br />
1 Pour une discussion de ce concept voir Recondo [2007], p. 74<br />
2 Gibson [2005]<br />
3 Recondo [2007], p. 74<br />
4 Pécaut [2008a], p. 40 et 41<br />
5 Romero [2003], p. 126 et suiv<br />
6 Romero [1998]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 58
parmi lesquels un sénateur, un député à la Chambre, un représentant départemental et vingt<br />
représentants municipaux. En tout, près de 6 000 membres de l'UP seront assassinés.<br />
Les principaux acteurs des assassinats des militants de l'UP sont les groupes<br />
paramilitaires, alliés avec certains secteurs des forces armées et de la police 1 . Ils sont accusés<br />
d'avoir assassiné les sénateurs de l'UP Pedro Nel Gómez et Jaime Pardo Leal; ce dernier était<br />
le président du parti. Les paramilitaires de Gacha et de Victor Carranza répandent la terreur<br />
dans les régions d'influence de l'UP, comme le département du Meta, où ils assassinent 17<br />
militants du parti lors du massacre de Vista Hermosa en 1987. Les assassinats continuent<br />
pendant la fin de la décennie. Ils sont 111 en 1987, 276 en 1988 et 138 en 1989 2 .<br />
L'ampleur de cette violence <strong>est</strong> en partie due à l'engagement des trafiquants de drogue<br />
dans les projets paramilitaires. Il s'agit clairement d'une des <strong>«</strong> interférences <strong>»</strong> dont parle<br />
Pécaut. À partir de 1981, les narcotrafiquants se mettent à créer leurs propres groupes<br />
paramilitaires et à soutenir des projets déjà existants. Ils se retrouvent alors alliés des élites<br />
locales et des militaires. <strong>La</strong> conjonction de ces trois catégories d'acteurs radicalisés contre la<br />
gauche subversive mais aussi civile explique le déchaînement de violence paramilitaire que<br />
vit la Colombie à partir de l'échec du processus de paix de Betancur.<br />
Le MAS et les <strong>«</strong> parrains <strong>»</strong> des paramilitaires 3<br />
Le 4 décembre 1981, les principaux journaux de Colombie reçoivent un communiqué<br />
de presse issu d'une <strong>«</strong> assemblée extraordinaire et urgente <strong>»</strong> réunissant 223 chefs de celle qui<br />
se fait appeler alors la <strong>«</strong> mafia créole <strong>»</strong>. Il s'adresse aux <strong>«</strong> preneurs d'otages communs et<br />
subversifs <strong>»</strong> et affirme que les narcotrafiquants ont formé, équipé et armé un escadron de 2<br />
230 hommes dont la mission serait d'éliminer ces ravisseurs. Ils sont ainsi menacés d'être<br />
<strong>«</strong> exécutés publiquement, pendus à des arbres dans les parcs ou <strong>fusil</strong>lés et marqués avec le<br />
signe de l'organisation <strong>»</strong>. Ils affirment avoir chacun contribué à la formation de cet escadron<br />
avec 2 millions de pesos et dix de leurs meilleurs hommes 4 . L'événement déclencheur de cette<br />
mobilisation <strong>est</strong> l'enlèvement de Marta Nieves Ochoa, fille du chef du cartel de Medellín<br />
Fabio Ochoa, par un commando de la guérilla du M-19, pour qui l'enlèvement contre rançon<br />
des narcotrafiquants semblait alors être une manière rentable de financer la lutte armée. Un<br />
1 C'<strong>est</strong> la thèse défendue par Dudley [2004]<br />
2 Ibidem<br />
3 Ainsi se référait Carlos Castaño aux narcotrafiquants qui soutenaient son organisation, Cf. Duncan<br />
[2005b], p. 260<br />
4 El País, 05/12/1981, Mafia amenaza a secu<strong>est</strong>radores<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 59
mois plus tard un des bailleurs de fonds du MAS, Carlos Lehder envoie une lettre au journal<br />
<strong>La</strong> Patria de la ville de Manizales. Il y affirme avoir également été victime d'un enlèvement et<br />
demande à l'État de participer à la <strong>«</strong> grande offensive nationale anti-enlèvement <strong>»</strong> à côté du<br />
MAS. Il se lamente sur le sort des personnes qui, comme lui, risquent tous les jours<br />
l'enlèvement et qui doivent <strong>«</strong> sortir de <strong>notre</strong> cher El Dorado vers un pays étranger où il n'y a<br />
pas de haricots rouges pour attendre qu'un jour en Colombie il y aura des hommes vaillants<br />
et patriotiques, qui décideront de s'unir pour faire face à la plaie de l'enlèvement avec<br />
décision, dévouement et, si nécessaire, sacrifice <strong>»</strong> 1 . <strong>La</strong> première action du groupe <strong>est</strong><br />
l'enlèvement de proches de Luis Gabriel Bernal, cadre du groupe guérillero et suspecté d'avoir<br />
organisé l'enlèvement de Marta Nieves Ochoa. Le 16 février 1982 la jeune femme <strong>est</strong> libérée<br />
sous la pression du MAS.<br />
Les assassinats revendiqués par le MAS commencent alors : Jesús Parra Castillo,<br />
militant du groupe gauchiste MAO (Mouvement d'Autodéfense Ouvrière) et Enrique<br />
Cipagauta Galvis, avocat défenseur de <strong>prison</strong>niers politiques. Un attentat à la bombe vise<br />
également une journaliste, María Jimena Duzán, et des menaces de mort sont adressées à<br />
l'ancien ministre et militant des droits de l'homme, Alfredo Vázquez Carrizosa et à l'écrivain<br />
Gabriel García Márquez.<br />
Photo 1.1. Tract de menace contre les grévistes 2<br />
Source : Rapport intitulé Impunity in Colombia. Pax Christi Netherlads and the Dutch Commission<br />
Justitia et Pax. 1989<br />
1 <strong>La</strong> Patria, 13/01/1982, Los Secu<strong>est</strong>rables<br />
2 Vous ne pouvez pas continuer à détruire le pays. Pour la vie, pour la paix et la justice sociale. Plus<br />
de violence!! N'allez pas aux grèves. Attention!! Ne permettez pas que le prix de la violence soit payé<br />
par vous et vos enfants<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 60
Les meurtres se multiplient durant l'année 1982. Des groupes armés de civils se forment<br />
dans des régions éloignées de la zone d'action initiale du groupe. Tandis que les premières<br />
actions avaient eu lieu dans les principales villes du pays, les sigles du MAS apparaissent<br />
dans des zones reculées où la guérilla avait alors une importante présence. On <strong>est</strong><br />
vraisemblablement devant une logique d'utilisation d'une étiquette pr<strong>est</strong>igieuse par des<br />
groupes divers d'hommes en armes. Ces sigles ont ainsi servi comme une sorte de franchise<br />
utilisée par des groupes sans aucun lien organisationnel 1 . <strong>La</strong> formation de ces groupes suit la<br />
même logique; une constitution d'alliances entre différentes catégories d'acteurs autour de<br />
projets paramilitaires. Les narcotrafiquants sont au centre de ces alliances : ils ont les<br />
ressources financières pour équiper des armées privées et ont déjà à leur service des<br />
professionnels de la violence.<br />
À la fin de l'année 1982, le Président de la République, Belisario Betancur demande un<br />
rapport au Procureur Général de la Nation sur le sujet. Le rapport <strong>est</strong> rendu le 20 février de<br />
l'année suivante. Les enquêteurs y ont identifié 163 membres du groupe armé, dont 59 sont<br />
des membres en service des forces armées. <strong>La</strong> plupart sont des gradés : colonels, sergents et<br />
capitaines 2 . L'armée réagit immédiatement contre le rapport du ministère public. L'éditorial<br />
alors signé par le Ministre de la Défense <strong>est</strong> menaçant : <strong>«</strong> il <strong>est</strong> possible que les arguments<br />
pour un nouveau conflit interne soient en train d'apparaître, car, sans aucun doute, cette<br />
partie honnête de la société, qui se considère dignement représentée et défendue par les<br />
forces armées, serait obligée de se mettre du côté de ses institutions et celles-ci, devant les<br />
perspectives de perte de sa dignité, pourraient utiliser leur force pour une lutte de<br />
proportions incalculables et imprévisibles qui mènerait <strong>notre</strong> pays à une nouvelle phase de<br />
violence 3 <strong>»</strong>. Pourtant, le rapport du Procureur n'aura aucune suite, aucun militaire figurant sur<br />
l'enquête ne sera inculpé et leurs carrières ne semblent pas avoir été affectées.<br />
S'il <strong>est</strong> clair que le MAS répond à la conjoncture du début de la décennie où les<br />
narcotrafiquants sont victimes d'enlèvements contre rançons, la guerre qui commence alors<br />
entre les guérillas et les trafiquants a des raisons structurelles. Premièrement, il s'agit de la<br />
transformation des narcotrafiquants en grands propriétaires fonciers. Ils achètent massivement<br />
des terres dans le but de blanchir les profits du trafic et posséder un refuge en cas de danger.<br />
Ce processus atteint une telle ampleur qu'il <strong>est</strong> qualifié par ces commentateurs de <strong>«</strong> contre-<br />
1 Cubides [1997], p. 11-12<br />
2 Informe de la Procuraduría General de la Nation sobre el <strong>«</strong> MAS <strong>»</strong> : lista de integrantes y la<br />
conexión MAS-Militares, 20 Février 1983<br />
3 Pécaut [2006]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 61
éforme agraire <strong>»</strong>; il change radicalement le visage de plusieurs régions du pays. Une enquête<br />
des Nations Unies établit ainsi qu'en 1995 11% des propriétés rurales appartenaient à des<br />
narcotrafiquants 1 . <strong>«</strong> Dans ces conditions, ils se retrouvent avec les préoccupations des autres<br />
propriétaires : se soustraire aux impôts prélevés par les guérillas et se débarrasser des colons<br />
gênants <strong>»</strong> 2 . De plus, depuis le début de la décennie la guérilla avance vers les régions les plus<br />
riches du pays, à partir de leurs arrière-gardes dans les zones de frontière. Les groupes armés<br />
des trafiquants sont capables de les protéger en cas de tentative d'enlèvement; or, ils ne<br />
peuvent arrêter le travail politique de la guérilla, qui occupe les espaces de pouvoir à<br />
l'intérieur des communautés paysannes dans le but de se construire des bases sociales 3 . Pour<br />
les narcos, il ne suffit pas d'avoir un escadron de sécurité, mais également un appareil de<br />
contrôle social.<br />
Enfin, une deuxième raison de ce conflit tient au circuit de production de la cocaïne. <strong>La</strong><br />
production de la base de coca, matière première fabriquée avec les feuilles de la plante, se<br />
réalise dans le Sud du pays, dans des zones rurales très reculées où l'État <strong>est</strong> absent et où les<br />
FARC-EP établissent très tôt des bases sociales parmi les producteurs. Selon G. Duncan, à ce<br />
stade du processus de production, le marché s'accommode bien d'une forme concurrentielle,<br />
où des petits entrepreneurs font travailler quelques dizaines de familles paysannes sur des<br />
plantations de coca. En revanche, le stade suivant, celui de la transformation de la base en<br />
cocaïne et de l'acheminement de celle-ci vers les marchés nationaux ou – surtout – étrangers,<br />
comporte une tendance à l'organisation en oligopole. À ce stade de la production, les<br />
inv<strong>est</strong>issements sont beaucoup plus importants et les risques sont minimisés par un appareil<br />
complexe où les tâches techniques, de sécurité, de logistiques et de g<strong>est</strong>ion des relations avec<br />
l'État sont gérées par des individus d'une même organisation. <strong>La</strong> fabrication du produit fini et<br />
l'acheminement vers les marchés – qui sont à l'époque contrôlés par les mêmes organisations<br />
– sont également la partie la plus rentable du circuit 4 . C'<strong>est</strong> dans cette partie de l'économie de<br />
la drogue qu'apparaissent les grandes fortunes de Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar<br />
ou des frères Ochoa. Ainsi, si les narcos s'accommodent bien de la présence de la guérilla<br />
dans les zones de production de la feuille de coca, les tentatives de celle-ci pour prélever une<br />
partie des profits de la production de la cocaïne sont en revanche vécues comme un danger<br />
1 Reyes [1997]<br />
2 Pécaut [1991]<br />
3 Voir une très bonne description de ce travail politique dans León [2005], p. 191-218<br />
4 Duncan [2005c]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 62
eaucoup plus pressant 1 . On se souvient par exemple que Gacha explique la guerre qui<br />
l'oppose aux FARC-EP car ces dernières auraient volé une cargaison de cocaïne qui lui<br />
appartenait 2<br />
<strong>La</strong> <strong>«</strong> guerre contre la drogue <strong>»</strong> et la place ambiguë des paramilitaires<br />
Jusqu'au milieu des années 1980, il existe une grande tolérance vis-à-vis du trafic de<br />
drogues. <strong>«</strong> Les élites colombiennes ont longtemps voulu considérer le trafic de drogue comme<br />
un avatar de l'"économie informelle" ou de l'"économie de contrebande" qui font partie du<br />
paysage habituel <strong>»</strong> 3 . L'État et les institutions participent à cette tolérance, comme le montre<br />
l'accession à la Chambre de Représentants du trafiquant de drogue Pablo Escobar en 1982, ou<br />
l'existence d'un guichet spécial à la banque centrale (Banco de la República) servant à<br />
échanger des grandes quantités de dollars de provenance inconnue 4 . Les politiques<br />
expliquaient alors que <strong>«</strong> le trafic devait sa vigueur à l'existence d'un marché consommateur,<br />
les États-Unis, et que c'était la responsabilité de ce pays de le combattre sur son propre<br />
territoire <strong>»</strong> 5 . Il n'y a donc pas de contradiction apparente pour des secteurs de l'État à s'allier<br />
avec des trafiquants de drogue pour lutter contre les guérillas et l'opposition politique, qui<br />
semblent au demeurant plus menaçantes pour l'équilibre du régime.<br />
Un changement brusque dans la politique de l'État vis-à-vis du trafic de drogues s'opère<br />
autour de 1984. Un secteur dissident du parti libéral, le <strong>«</strong> Nouveau Libéralisme <strong>»</strong> créé en 1979<br />
par Luis Carlos Galán, dénonce depuis cette date les collusions entre politiques et<br />
narcotrafiquants et la tolérance de l'État face au trafic de drogues. Une demande politique<br />
croissante conduit le président Belisario Betancur à nommer un membre de ce parti, Rodrigo<br />
<strong>La</strong>ra Bonilla, au poste de ministre de la justice en 1983. <strong>La</strong>ra Bonilla lance alors des<br />
poursuites contre d'importants trafiquants, dénonce les collusions entre ceux-ci et les milieux<br />
politiques et se déclare favorable à leur extradition vers les États-Unis. Il s'attaque alors à<br />
Pablo Escobar, qui <strong>est</strong> alors suppléant à la Chambre des représentants et obtient son expulsion<br />
de l'institution. <strong>La</strong>ra Bonilla <strong>est</strong> assassiné le 30 avril 1984, ce qui déclenche la réaction de<br />
l'exécutif. Pendant l'enterrement de son ministre, le président Betancur dénonce<br />
énergiquement les narcos : <strong>«</strong> Plus de parlottes de salon avec des commentaires amusants sur<br />
1 Rangel [1999], p. 127<br />
2 Duncan [2005b], p. 260<br />
3 Pécaut [1991]<br />
4 Couramment connu sous le nom de <strong>«</strong> guichet sinistre <strong>»</strong>, Pécaut [2006], p.280<br />
5 Propos d'Alfonso López Michelsen, Président de la République (1974-1976), Ibidem, p. 367<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 63
celui qui vient de s'enrichir avec de l'argent ensanglanté! […] <strong>La</strong> Colombie va extrader les<br />
délinquants demandés pour avoir commis des délits dans des pays étrangers <strong>»</strong> 1 . L'assassinat<br />
du ministre rend évidente la vulnérabilité de l'État devant la puissance des cartels de la<br />
drogue 2 . Le président Betancur fait alors voter une loi d'extradition qui marque le début<br />
officiel de la guerre de l'État colombien contre les trafiquants de drogue. Dans les années qui<br />
suivent Carlos Lehder <strong>est</strong> capturé et extradé aux États-Unis, Gacha <strong>est</strong> tué par l'armée et une<br />
véritable chasse à l'homme <strong>est</strong> lancée contre Escobar. Ce changement dans la politique interne<br />
du pays ne répond pas uniquement à la volonté de l'exécutif, mais aussi à la pression<br />
grandissante des États-Unis pour que la Colombie s'engage de plein-pied dans la lutte contre<br />
la drogue. Cela n'empêche d'ailleurs pas la tenue de négociations secrètes entre les émissaires<br />
de Betancur et les narcos réfugiés à Panamá, à peine quelques semaines après l'assassinat du<br />
ministre <strong>La</strong>ra 3 .<br />
Ce changement dans l'orientation de la politique interne du pays affecte évidemment les<br />
relations entre État et paramilitaires; comme l'écrit F. Gutierrez Sanín :<br />
<strong>«</strong> En essayant d'institutionnaliser et d'endogénéiser les principes de la guerre<br />
contre la drogue, les autorités colombiennes déclenchent une violente réaction des<br />
narcotrafiquants, qui commencent alors une campagne de terreur contre l'État et la<br />
société. Cela déstabilise la relation entre les paramilitaires et l'État. Dans la guerre<br />
contre la guérilla ils sont alliés, au moins en principe, tandis que dans la guerre<br />
contre la drogue ils sont ennemis (...). <strong>La</strong> tension causée par le rôle contradictoire<br />
des narcotrafiquants (Allié et ennemi de l'État à la fois), autonomise les<br />
paramilitaires colombiens <strong>»</strong> 4 .<br />
En 1989, le gouvernement publie une série de décrets 5 qui mettent hors la loi les<br />
groupes paramilitaires, jusqu'alors protégés par une loi datant de 1968. Cela répond à une<br />
volonté gouvernementale de récupérer le monopole de la violence, dans un contexte de<br />
multiplication des acteurs armés 6 . <strong>«</strong> D'où l'ambiguïté gouvernementale : tandis que le narco-<br />
1 Semana, 03/05/09, El crimen que partió la historia<br />
2 Melo et Valencia [1989]; Pécaut [1991]<br />
3 Pécaut [1991]. Cet épisode <strong>est</strong> également décrit par Pablo Escobar lui même dans ses entretiens avec<br />
Castro Caycedo [1996], p. 233-340<br />
4 Gutierrez Sanin et Barón [2005], p. 5-6<br />
5 Décrets numéro : 813, 814, 815, 1194, 1855, 1856, 1857, 1859, 1860, 1863. Publiés entre avril et août<br />
1989<br />
6 Uprimny et Vargas [1990], p. 124<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 64
paramilitarisme <strong>est</strong> frappé, et que des réseaux de sicaires 1 sont désarticulés dans des zones<br />
précédemment contrôlées par les narcotrafiquants comme le Moyen Magdaléna la guerre sale<br />
continue à se développer dans des zones fortement militarisées comme Córdoba où Urabá <strong>»</strong> 2 .<br />
En effet, l'idée qu'il existe un ordre de priorités en matière de sécurité nationale, et que dans<br />
cet ordre les guérillas doivent être frappées avec toute la force de l'État, conduit à tolérer les<br />
paramilitaires, même au moment où la rhétorique gouvernementale leur déclare la guerre.<br />
Comme le font remarquer Uprimny et Vargas, à cette époque, <strong>«</strong> les paramilitaires opèrent<br />
dans des régions fortement militarisées où il y a des piquets militaires et où la population doit<br />
circuler avec des laissez-passer de l'armée <strong>»</strong>.<br />
L'assassinat du candidat libéral à la Présidence de la République Luis Carlos Galán, en<br />
1989, <strong>est</strong> le point de départ d'une nouvelle étape de cette <strong>«</strong> guerre contre la drogue <strong>»</strong>. Les<br />
narcotrafiquants du Cartel de Medellín, sous le leadership de Pablo Escobar, se regroupent<br />
dans l'organisation des <strong>«</strong> Extraditables <strong>»</strong>, c'<strong>est</strong>-à-dire les menacés d'extradition. Leur objectif<br />
<strong>est</strong> de faire pression sur les différentes institutions de l'État pour interdire l'extradition des<br />
nationaux. Cette pression prend une forme de plus en plus sanglante, avec le meurtre de<br />
plusieurs centaines de policiers, l'enlèvement de personnalités publiques et l'explosion de<br />
voitures piégées dans les principales villes du pays 3 . Lors de cette violente confrontation, la<br />
plus importante des organisations paramilitaires, celle de Fidel Castaño, noue une alliance<br />
avec d'autres narcotrafiquants pour s'opposer à Escobar. Ce groupe, connu sous le nom des<br />
Pepes (Persécutés par Pablo Escobar) collabore avec la police lors de la véritable chasse à<br />
l'homme qui aboutit à l'exécution d'Escobar en décembre 1993 4 .<br />
3. <strong>La</strong> décennie 1990 et la privatisation de la violence<br />
<strong>La</strong> polarisation des élites politiques, des militaires et des narcotrafiquants et leur<br />
aggrégation autour du projet paramilitaire constituent le point de départ de l'expansion du<br />
phénomène paramilitaire à tout le pays. À la fin de la décennie 65% des municipes du pays<br />
ont une présence paramilitaire 5 (ce qui n'exclut bien sur pas que la guérilla y soit également<br />
présente). Nous examinerons dans la chapitre suivant cette expansion. Pour le moment, il <strong>est</strong><br />
intéressant de souligner que la violence paramilitaire semble s'imposer comme un mode<br />
1 Tueurs à gages, Sicarios en castillan de Colombie<br />
2 Uprimny et Vargas [1990], p. 125<br />
3 Pécaut [2006], p. 399-407<br />
4 Cf. le document de la CIA déclassifié par la ONG National Security Archive : Extralegal steps against<br />
Escobar Possible, avril 1993<br />
5 Source : FSD [2007]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 65
d'exercice du pouvoir, se s'enchâssant dans l'appareil d'État sans pour autant s'y substituer ou<br />
l'évincer. En effet, si l'État ne réussit pas à coopter ces professionnels de la violence, c'<strong>est</strong><br />
parce qu'ils sont mus par des intérêts très contradictoires. Or, ils ne deviennent pas pour autant<br />
des concurrents de l'État. Les relations entre l'État et les paramilitaires sont une histoire<br />
d'utilisation mutuelle et d'interpénétration plutôt que de conflit.<br />
<strong>La</strong> décentralisation et la réorganisation du pouvoir local<br />
Le moteur de ce processus n'<strong>est</strong> pas l'État central. Si une tolérance de l'<strong>est</strong>ablishment<br />
vis-à-vis des paramilitaires a pu être montrée jusqu'ici, il n'<strong>est</strong> pas certain que la progression<br />
de ces groupes soit le fruit d'un dessein prémédité des instances centrales. Comme le souligne<br />
D. Pécaut, <strong>«</strong> Il s'agit plutôt de l'accumulation d'actions locales qui suscitent une situation sur<br />
laquelle le gouvernement ne semble plus avoir de prise <strong>»</strong> 1 . Les cadres de ses actions sont les<br />
institutions et les arènes politiques locales. Or, un changement institutionnel fondamental a eu<br />
lieu au début de la décennie 1990 : la décentralisation<br />
Plusieurs groupes de guérilla se démobilisent en 1990 2 . Le corollaire de ce processus<br />
de paix <strong>est</strong> la convocation d'une Assemblée Constituante en décembre 1990. <strong>La</strong> nouvelle<br />
Constitution ouvre la porte à une véritable transition démocratique et à une pacification de la<br />
politique 3 . Elle <strong>est</strong> notamment rendue possible grâce une mobilisation massive des universités<br />
lors des élections générales de mars 1990 4 . <strong>La</strong> Constitution de 1991 répond aux critiques<br />
contre la centralisation excessive du système politique en élevant en principe constitutionnel<br />
l'organisation décentralisée du pays. Le budget des collectivités territoriales <strong>est</strong> fortement<br />
accru grâce à des transferts de fonds; de même, de nombreuses missions de service public –<br />
notamment dans le champ du social et de l'inv<strong>est</strong>issement en infrastructures – deviennent du<br />
ressort des départements et des municipes. Les motivations sont diverses. On citera le<br />
référentiel alors en vigueur dans le continent et véhiculé par les organisations internationales<br />
qui fait de la g<strong>est</strong>ion locale un gage d'efficacité, transparence et reddition de comptes 5 . Il y a<br />
également des facteurs politiques propres au pays : il s'agit du besoin d'ouvrir le système<br />
politique à des acteurs autres que les deux grands partis historiques. Dans l'Assemblée<br />
1 Pécaut [1991]<br />
2 Il s'agit du M-19, du Quintín <strong>La</strong>me, du PRT (Parti Révolutionnaire des Travailleurs), le EPL (Ejército<br />
Popular de Liberación – Armée Populaire de Libération) et le CRS (Courant de Rénovation<br />
Socialiste)<br />
3 Pour mesurer les espoirs que cette nouvelle constitution éveille voir Behar et Villa [1991]<br />
4 Le mouvement du <strong>«</strong> 7ème bulletin <strong>»</strong><br />
5 Banque Interaméricaine de Développement [2004]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 66
Constituante les anciens membres de la guérilla du M-19 (qui forment le parti Alliance<br />
Démocratique M-19) sont bien représentés 1 ; ils espèrent que la création d'espaces locaux de<br />
compétition politique ouvrira une fenêtre d'opportunité à des anciens militants bien implantés<br />
au niveau local.<br />
Eaton décrit comment le renforcement des compétences des collectivités territoriales<br />
va de pair avec un affaiblissement des dispositifs de contrôle du centre sur les périphéries 2 .<br />
Les organes de contrôle tels que l'office du Procureur (Procuraduría – agit comme police<br />
administrative) et la Cour des Comptes (Contraloría) font également l'objet d'une<br />
décentralisation qui les met à la merci des influences locales. Pour Eaton l'enrichissement des<br />
localités, couplé avec l'affaiblissement des capacités de contrôle du centre favorisent la<br />
progression des organisations illégales, guérillas et paramilitaires. Celles-ci prennent<br />
facilement le contrôle des administrations locales, ce qui leur donne accès aux budgets et aux<br />
contrats publics. On décrira plus loin ce contrôle dans le cas du département du Magdaléna.<br />
Le phénomène paramilitaire, entre tolérance et cooptation<br />
Malgré la signature de la paix entre le gouvernement et plusieurs groupes guérilleros,<br />
les deux plus grands, les FARC-EP et l'ELN continuent la lutte armée. De plus, les espoirs<br />
d'un rapprochement avec les FARC-EP s'envolent avec la d<strong>est</strong>ruction par l'armée du siège du<br />
Secrétariat à l'Uribe (Département du Meta) en 1990. En riposte à cette attaque, ce groupe<br />
lance une offensive de grande ampleur qui montre leur pouvoir de feu et leur présence sur tout<br />
le territoire 3 . Malgré la recrudescence du conflit, en 1991 et 1992 des nouveaux pourparlers<br />
avec les deux guérillas ont lieu. Ils se déroulent à Tlaxcala (Mexique) et à Caracas mais se<br />
finissent par un constat d'échec. En 1993 la conférence générale des FARC-EP pose<br />
clairement l'objectif de la prise du pouvoir; la structure militaire <strong>est</strong> réorganisée et la<br />
<strong>«</strong> formation d'un gouvernement de reconstruction et réconciliation nationale <strong>»</strong> qui ferait suite<br />
à la victoire finale <strong>est</strong> envisagée 4 . Le discours n'<strong>est</strong> pas dépourvu de fondement, car<br />
l'organisation représente une réelle menace pour les institutions. À manière d'exemple on<br />
citera le ministre de la Défense de l'époque, Rafael Pardo Rueda, qui affirme que sur les plus<br />
1 L'Alliance Démocratique M-10 obtient 15% dans l'Assemblée, ce qui la place en deuxième lieu<br />
derrière le Parti Libéral<br />
2 Eaton [2006]<br />
3 Pécaut [2008a], p. 47<br />
4 Idem.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 67
de 1000 municipes que compte de pays, les FARC-EP ont une présence significative dans 569<br />
d'entre eux 1 .<br />
C'<strong>est</strong> dans ce contexte qu'une nouvelle offensive paramilitaire <strong>est</strong> lancée à partir de<br />
1994. Elle démarre par la création officielle des ACCU (Autodefensas Campesinas de<br />
Córdoba y Urabá – Autodéfenses paysannes de Córdoba et Urabá) par Carlos Castaño cette<br />
même année 2 . À partir de ses bases dans le département de Córdoba et la région d'Urabá<br />
(Nord du département d'Antioquia et quelques municipes du Chocó), Castaño commence une<br />
stratégie d'expansion territoriale basée sur l'association d'autres groupes paramilitaires à son<br />
projet. Il alimente la croissance de son organisation par les abondantes ressources de la<br />
drogue, ce qui lui permet de doubler le nombre de ses hommes entre 1994 et 1998 (ils passent<br />
de 2150 à 4500 selon les <strong>est</strong>imations du ministère de la Défense 3 ).<br />
Depuis les décrets de 1989 qui mettaient hors la loi les groupes paramilitaires, peu<br />
d'avancées avaient été enregistrées dans la lutte contre ceux-ci. En 1990 la structure des frères<br />
Castaño se démobilise. Mais elle garde suffisamment de pouvoir et de ressources pour<br />
reprendre les armes quatre ans plus tard sous le commandement du plus jeune des frères. Dans<br />
ce contexte de reprise du conflit armé, la qu<strong>est</strong>ion de la légalité des groupes <strong>«</strong> d'autodéfense <strong>»</strong><br />
se pose à nouveau. Le gouvernement <strong>est</strong> alors favorable à l'engagement des civils aux côtés<br />
des forces militaires. Ainsi le montrent les Corporations rurales de sécurité, plus connues sous<br />
le nom de Convivir (<strong>«</strong> Vivre avec <strong>»</strong> en castillan), créées le par le décret 356 du 11 février<br />
1994 et donc juridiquement reconnues. <strong>La</strong> création des Convivir répond à la demande<br />
croissante des secteurs économiques les plus exposés à la guérilla. Parmi ceux-là, les éleveurs<br />
de bétail sont durement frappés par l'extorsion et les enlèvements. Ainsi, lors du congrès de<br />
Fedegan (Federación nacional de Ganaderos – Fédération nationale d'éleveurs de bétail), le<br />
ministre de la Défense Fernando Botero manif<strong>est</strong>ait sa préoccupation face à l'augmentation de<br />
l'insécurité dans les campagnes et présentait les Convivir comme un instrument privé de<br />
maintien de la sécurité, semblables aux compagnies de surveillance dans les villes 4 .<br />
D'autres hauts fonctionnaires présentent les Convivir comme une manière d'intégrer les<br />
groupes paramilitaires à l'appareil d'État :<br />
1 Pardo Rueda [1996], p. 514<br />
2 Voir le chapitre suivant<br />
3 Voir graphique 1.1<br />
4 El Tiempo, Habrá coopérativas de seguridad rural, 26 novembre 1994<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 68
<strong>«</strong> Aux messieurs des propriétés du haut plateau de Bogotá ils (les paramilitaires)<br />
disaient : " Nous, on vous donne de la sécurité... vous voulez de la sécurité? On<br />
vous la donne, donnez nous de l'argent et ne posez pas de qu<strong>est</strong>ions ". Quelle<br />
réponse a l'État devant cela? Il y en a deux : une, nier cette réalité là et dire que<br />
cela n'existe pas, que tout cela <strong>est</strong> faux. Ou bien, il accepte cette réalité et essaye<br />
d'incorporer ces gens là dans l'État, à côté des forces de l'ordre, de l'armée, de la<br />
police, de la marine, avec eux, sous leur vigilance, sous la tutelle de l'État, dans<br />
un cadre légal. Voilà l'importance des Convivir <strong>»</strong> 1<br />
Cependant, les Convivir servent, dans les faits, d'appui et de façade légale aux groupes<br />
paramilitaires. Les témoignages des anciens commandants des groupes paramilitaires dans<br />
l'Urabá, comme Ever Velosa et Raúl Hasbún, coïncident sur le fait que l'existence des<br />
Convivir permettait alors aux entreprises de légaliser leurs contributions aux paramilitaires.<br />
Ils affirment par exemple que l'argent qui était payé à la Convivir Papagayo, façade du groupe<br />
de Castaño, était ensuite versé aux paramilitaires. Légalement, les entreprises étaient ainsi<br />
couvertes. Cela permet de tisser un large réseau de contributions financières qu'alimentent les<br />
groupes paramilitaires en Urabá 2 .<br />
Le cas de Salvatore Mancuso, qui devient par la suite l'un des plus importants chefs<br />
paramilitaires <strong>est</strong> à cet égard très illustratif. Mancuso commande à l'époque un groupe<br />
paramilitaire dans le Sud du département de Córdoba. Selon ses déclarations judiciaires, il<br />
commence son activité paramilitaire en 1992; il <strong>est</strong> à l'origine de plus de 10 massacres dans le<br />
département pendant les quatre années suivantes. Or, en 1996 Mancuso crée une Convivir,<br />
Horizonte Ltda. qui reçoit un arsenal de 15 mitrailleuses, 15 pistolets et 15 <strong>fusil</strong>s de la part de<br />
l'armée. <strong>La</strong> Convivir lui permet d'agrandir de manière importante son groupe paramilitaire, en<br />
se fournissant en armes et capital 3 . À cette époque là, les organisations de défense des droits<br />
de l'homme dénoncent les violations commises par les Convivir. En effet, les instances<br />
publiques reçoivent de nombreuses plaintes de personnes ayant été victimes des Convivir 4 .<br />
Tout cela montre bien que les Convivir sont une façade légale des paramilitaires; leur création<br />
par l'État <strong>est</strong> un exemple particulièrement clair des chevauchements continus entre la violence<br />
privée et les prérogatives publiques. Il s'agit en quelque sorte de la systématisation de la<br />
1 Cien Días, Entretien avec Hermann Arias Gaviria, mai 1997. L'interviewé était à l'époque<br />
<strong>«</strong> Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada <strong>»</strong>, c'<strong>est</strong> à dire haut fonctionnaire chargé de la<br />
surveillance du secteur de la sécurité privée.<br />
2 Verdad Abierta, El dinero del banano sirvió para financiar la guerra<br />
3 Cepeda et Rojas [2008]<br />
4 CIDH [1999]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 69
logique que nous avons observée pendant les années 1980. Or, l'armement des civils n'<strong>est</strong> plus<br />
uniquement une prérogative militaire mais une véritable politique publique coordonnée à<br />
partir du centre.<br />
En 1997, la Cour Constitutionnelle vide les organisations de leur force en interdisant<br />
l'utilisation d'armes de grand calibre et le retour de leur arsenal aux forces armées. Le<br />
gouvernement prend acte de l'arrêt de la Cour en allant plus loin dans les r<strong>est</strong>rictions; il<br />
interdit la création de nouvelles Convivir dans les zones de conflit et ordonne une révision des<br />
antécédents pénaux de l'ensemble des membres des corporations de sécurité 1 . Cela provoque<br />
le démantèlement de la plupart de ces groupes par la Fédération National des Convivir. Selon<br />
les déclarations des chefs paramilitaires, la plupart des membres des Convivir rentrent alors<br />
de plain-pied dans les groupes paramilitaires.<br />
Le cas des Convivir <strong>est</strong> un exemple de cooptation de groupes armés privés dans<br />
l'appareil d'État qui a échoué. Trois explications principales peuvent être données à cet échec :<br />
Premièrement, la complexité des alliances tissées autour des groupes paramilitaires rend très<br />
difficile leur simple absorption par l'armée, comme ça avait été le cas pour les Rondas<br />
Campesinas Péruviennes 2 . Nous avons vu que l'entrée des narcotrafiquants dans les groupes<br />
paramilitaires les autonomise de la dépendance à l'armée, en leur donnant des ressources<br />
financières très importantes et en les mettant en contradiction avec la volonté affichée par<br />
l'État de lutter contre le trafic. Deuxièmement, nous avons également souligné les positions<br />
opposées de différentes instances de l'État sur la qu<strong>est</strong>ion des paramilitaires. Si des ministres<br />
et des parlementaires ont pris à maintes reprises la défense du <strong>«</strong> droit des citoyens à s'armer <strong>»</strong>,<br />
les Hautes Cours se sont toujours opposées à la formation de groupes paramilitaires.<br />
Troisièmement, les institutions internationales critiquent très durement les liens que l'État<br />
entretient avec des groupes armés coupables de violations des droits humains 3 . Dans ces<br />
conditions, le financement des Convivir <strong>est</strong> impossible à justifier sur les arènes diplomatiques.<br />
L'incapacité de l'État colombien à contrôler les groupes paramilitaires et le manque de volonté<br />
des responsables politiques pour les combattre débouchent sur une situation de forte<br />
privatisation de la violence. Comme nous l'avons souligné précédemment, les paramilitaires<br />
sont les premiers responsables des agressions contre les civils sur la période étudiée. Si l'on<br />
1 Ibidem<br />
2 Cf. Fumerton et Remijnse [2004]<br />
3 Voir par exemple CIDH [1999], qui critique très durement les Convivir<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 70
egarde de près, on se rend compte que leur part dans ces actes augmente tendenciellement.<br />
Le graphique 1.3 montre comment la violence d'État <strong>est</strong> progressivement remplacée par la<br />
violence paramilitaire. Comme le souligne M. Huggins, il <strong>est</strong> paradoxal qu'au moment même<br />
où les contrôles internationaux sur les États deviennent plus fermes, la violence para-<br />
institutionnelle augmente 1 . Il semblerait ainsi qu'elle constitue une <strong>«</strong> stratégie de<br />
contournement <strong>»</strong> permettant de sous-traiter le <strong>«</strong> sale boulot <strong>»</strong> de la répression 2 .<br />
Graphique 1.3 : Répartition des meurtres commis par des acteurs armés organisés<br />
Source : Commission Colombienne de Juristes<br />
Cette montée de la violence paramilitaire a, nous l'avons vu, des raisons historiques.<br />
L'état d'urgence dans le quel vit le pays pendant trente ans et presque sans aucune interruption<br />
mène à privilégier les voies de fait sur les voies du droit. Une forme de<br />
désinstitutionnalisation de la violence se dessine alors, même avant l'apparition des premiers<br />
groupes paramilitaires. En effet, ce contournement de la loi semblerait être profondément<br />
ancré dans la doctrine militaire. L'élément déclencheur d'un processus de privatisation de la<br />
violence <strong>est</strong> cependant la polarisation de plusieurs secteurs de la société, qui se rapprochent<br />
autour d'un projet contre-insurrectionnel. L'entrée des narcotrafiquants dans ces<br />
1 Huggins [1991], p. 7 et p. 11<br />
2 Campbell et Brenner [2000], p. 4 : <strong>«</strong> States wishing to use extreme forms of extralegal violence thus<br />
have every reason to appear uninvolved. Though the charade doesn't usually last very long, it is<br />
difficult to prove government complicity in deth squads actions <strong>»</strong><br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 71
configurations complexifie davantage la donne et éloigne les paramilitaires colombiens du<br />
modèle classique des <strong>«</strong> forces supplétives de l'armée <strong>»</strong> 1 .<br />
Au terme de cette réflexion générale sur la privatisation de la violence en Colombie,<br />
nous nous rendons compte de la place centrale jouée par l'État dans ce processus. Aux thèses<br />
normativistes, qui parlent d'un État <strong>«</strong> capturé <strong>»</strong> par des <strong>«</strong> forces obscures <strong>»</strong>, il faut substituer<br />
une sociologie de la privatisation de la violence qui met l'accent sur les stratégies concurrentes<br />
des acteurs et sur les conflits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État. Une telle interprétation <strong>est</strong><br />
la seule capable de rendre compte d'un processus complexe fait d'intérêts contradictoires.<br />
Dans la suite de ce texte nous allons nous pencher de manière plus détaillée sur les<br />
processus qui convergent dans la formation des groupes paramilitaires. Nous allons mettre<br />
l'accent sur les stratégies des différents acteurs et sur les trajectoires individuelles qui donnent<br />
une certaine unité à un phénomène qui semblerait très éclate.<br />
1 Pour un exposé de ces forces supplétives voir Koonings et Kruijt [1999]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 72
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 73
Carte 2.1 : De Puerto Boyacá à l'Urabá :<br />
Les paramilitaires au carrefour d'influences diverses<br />
Source : Réalisation personnelle à partir d'une carte de l'IGAC 1<br />
1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi : www.igac.gov.co<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 74
II. Qui sont les paramilitaires?<br />
Nous avons vu que la fluctuation des alliances liées autour des paramilitaires permet de<br />
comprendre leur évolution et le rapport qu'ils ont aux institutions de l'État. Il faut donc<br />
d'abord définir les alliances. Il ne s'agit pas d'une simple collusion entre un secteur homogène<br />
des élites et des professionnels de la violence. Au contraire, ces alliances sont très complexes<br />
par le nombre d'acteurs qu'elles engagent et par leurs intérêts, souvent concurrents et parfois<br />
contradictoires. Il en résulte qu'elles sont mouvantes et instables. Elles dépendent largement<br />
d'aspects qui leurs sont externes : d'une part l'évolution du conflit armé, politique et social, qui<br />
polarise les acteurs et les mène à agir ensemble; d'autre part, l'action de l'État qui garde une<br />
certaine autonomie pour fixer les règles du jeu.<br />
Comme l'écrit J.-P. Derriennic, <strong>«</strong> pour qu'un conflit devienne violent, il faut<br />
généralement qu'il soit devenu dominant dans une société <strong>»</strong> 1 , il faut que les acteurs le<br />
privilégient sur tous les autres types de conflits qui les opposent. Cela correspond à la<br />
définition de la polarisation selon C. Tilly; elle <strong>«</strong> implique l'élargissement de l'espace<br />
politique et social entre les acteurs dans un espace conflictuel et la gravitation des acteurs<br />
non-engagés ou modérés vers les extrêmes <strong>»</strong> 2 . Dans ce chapitre, nous suivrons un fil<br />
chronologique pour montrer comment la polarisation et la formation d'alliances sont deux<br />
processus inséparables qui aident à comprendre l'évolution des groupes paramilitaires.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>«</strong> capitale de l'anti-subversion de Colombie <strong>»</strong><br />
Puerto Boyacá <strong>est</strong> un port fluvial dans la vallée du Moyen Magdaléna, une vaste plaine<br />
entourée des branches centrale et orientale de la cordillère des Andes et traversée par le plus<br />
long fleuve du pays, le Magdaléna. Cette vallée comprend des municipes appartenant aux<br />
départements de Santander, Boyacá, Cundinamarca et Antioquia et se trouve à mi-chemin<br />
entre la capitale politique du pays – Bogotá – et son centre industriel et financier – Medellín.<br />
Dans la vallée du Moyen Magdaléna, et particulièrement à Puerto Boyacá, apparaissent, au<br />
début des années 1980, les premiers groupes paramilitaires. En effet, le MAS semble avoir été<br />
plutôt une franchise couvrant un certain nombre de groupes sans aucun lien organisationnel<br />
1 Derriennic [2001], p. 84<br />
2 Tilly [2003], p. 21<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 75
entre eux et pour la plupart éphémères 1 . En revanche, le groupe de Puerto Boyacá possède<br />
toutes les caractéristiques qui identifient les paramilitaires : conception large des objectifs<br />
<strong>«</strong> subversifs <strong>»</strong>, maîtrise de la violence, contrôle social et territorial. L'étude de ce groupe se<br />
justifie également dans la mesure où il fonctionne comme une sorte d'école de professionnels<br />
de la violence. On verra en effet que des leaders paramilitaires qui formeront d'autres groupes<br />
ailleurs dans le pays se forment à Puerto Boyacá; ils transfèrent des pratiques et des savoir-<br />
faire sur d'autres terrains. <strong>La</strong> principale source disponible sur l'expérience de Puerto Boyaca<br />
r<strong>est</strong>e l'ouvrage classique de C. Medina Gallego 2 . Les développements qui suivent sont<br />
principalement issus de cette lecture. Nous avons cependant essayé de recouper ces<br />
informations avec des recherches plus récentes, qui apportent des nouveaux éléments.<br />
Photo 2.1. <strong>«</strong> Bienvenue à Puerto Boyacá, terre de paix et progrès, capitale de l'antisubversion<br />
de Colombie <strong>»</strong> 3<br />
Le <strong>«</strong> Port Rouge <strong>»</strong> devient brun<br />
Source : Photo de l'auteur<br />
Puerto Boyacá avait été sous l'emprise du Parti Communiste Colombien (PCC) depuis<br />
le début des années 1970. Avec le parti sont arrivées les FARC-EP, qui servent de <strong>«</strong> garde<br />
civile rurale <strong>»</strong> et assurent l'endoctrinement politique en milieu rural et la sécurité. Le groupe<br />
armé <strong>est</strong> en effet intimement lié au PCC depuis sa création. En 1961, alors que les guérillas<br />
1 Duncan [2005b]<br />
2 Medina Gallego [1990]<br />
3 Panneau installé à l'entrée de la ville de Puerto Boyacá dans les années 1980 par Pablo Guarín,<br />
commandant des Autodéfenses Unies du Magdaléna Moyen.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 76
n'étaient que des groupes de paysans miséreux et faiblement armés, les communistes<br />
revendiquent la combinaison de toutes les formes de lutte pour atteindre le pouvoir 1 . À partir<br />
de 1966, date de la création officielle des FARC-EP, le parti veille à conserver entre ses mains<br />
le commandement politique et à coordonner son action avec les combattants dans la forêt 2 . Le<br />
parti rentre dans le conseil municipal de Puerto Boyacá en 1972. Très vite, il atteint des<br />
niveaux importants en termes de suffrages, non seulement dans ce municipe mais aussi dans<br />
les municipes voisins. Allié avec d'autres mouvements de gauche au sein de l'UNO (Union<br />
Nationale d'Opposition) il réussit à contrôler en 1978 les conseils municipaux de Puerto<br />
Boyacá, Cimitarra et Puerto Berrío. Depuis le début, les FARC-EP rackettent les propriétaires<br />
fonciers, en les soumettant à un <strong>«</strong> impôt révolutionnaire <strong>»</strong>. Ces propriétaires, souvent des<br />
éleveurs de bétail, doivent consulter la guérilla avant d'embaucher un travailleur, ce qui<br />
permet aux FARC-EP d'élargir leurs bases sociales chez les ouvriers agricoles et de disposer<br />
en plus d'un réseau d'informateurs 3 . Cependant, les éleveurs ne se montrent pas foncièrement<br />
hostiles à la guérilla, dans la mesure où elle arrive à éliminer le vol de bétail et d'autres types<br />
de petite criminalité 4 .<br />
<strong>La</strong> montée en force locale du parti communiste inquiète les autorités, qui commencent à<br />
réprimer l'organisation. <strong>La</strong> violence augmente à partir de 1977, mais devient franchement<br />
ouverte deux ans plus tard. En 1979 les 7 conseillers municipaux communistes de Cimitarra<br />
sont assassinés par l'armée. Cela coïncide avec le tournant sécuritaire que vit le régime à partir<br />
de l'accession au pouvoir de Julio Cesar Turbay. <strong>La</strong> conséquence de la stratégie contre-<br />
insurrectionnelle <strong>est</strong> l'installation du bataillon Bárbula à Puerto Boyacá en mars 1979. Les<br />
communistes ne sont pas les seules victimes de la répression militaire; l'armée contrôle de très<br />
près l'ensemble de la population du municipe, considérée comme dangereuse en raison de sa<br />
proximité avec les subversifs. Les paysans sont soumis à des détentions non justifiées et des<br />
abus physiques. Par exemple, elle fixe des seuils très bas des produits basiques qu'un paysan<br />
peut transporter. Cette mesure <strong>est</strong> censée couper les réseaux d'approvisionnement de la<br />
guérilla; elle s'avère inefficace mais soumet les populations rurales à un régime de faim.<br />
1 Pécaut [2008a], p. 27<br />
2 Ibidem p. 33. Le parti et la guérilla s'éloigneront progressivement par la suite. L'épisode de l'Union<br />
Patriotique contribue à cet éloignement car les principaux cadres politiques de la guérilla sont<br />
assassinés, laissant le commandement les militaires. Le changement de l'équilibre des forces<br />
s'officialise en 1991, lorsque la guérilla exige que le congrès se tienne dans la montagne. Les<br />
communistes renoncent à leur représentation (p. 45)<br />
3 Gutierrez Sanín [2007], p. 9<br />
4 Duncan [2005b], p. 246<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 77
Les premières déclarations du président Betancur, le jour de sa possession (7 août<br />
1982), et le début des premiers contacts avec les FARC-EP changent la donne. <strong>La</strong> violence<br />
ouverte et massive contre les civils ne peut plus être utilisée comme stratégie contre-<br />
insurrectionnelle. C'<strong>est</strong> donc dans l'alliance avec différentes instances de la société régionale<br />
que les militaires espèrent vaincre la guérilla et le PCC. L'arrivée d'un nouveau général au<br />
commandement du bataillon Bárbula et la mise an place d'une nouvelle stratégie de<br />
collaboration avec la population achèvent le changement.<br />
Or, la collaboration active de la population à une stratégie contre-insurrectionnelle<br />
n'aurait pas été possible si les FARC-EP avaient gardé le fort soutien populaire qu'elles<br />
avaient auparavant. Plusieurs facteurs sont essentiels pour comprendre que la guérilla perd<br />
l'appui de la population. Premièrement, face à la forte répression déployée par l'armée à partir<br />
de 1978 les FARC-EP se retranchent et abandonnent les civils à leur sort. N'ayant aucune<br />
protection de la part de la guérilla, ses anciens alliés subissent de plein fouet la répression<br />
étatique. Deuxièmement, à partir de 1977, les demandes financières du Secrétariat, l'instance<br />
de commandement centrale des FARC-EP, se font plus pressantes. Dans sa stratégie<br />
d'expansion et de création de nouveaux fronts, le Secrétariat demande aux fronts déjà établis<br />
de rapporter de plus en plus de fonds. Cela se traduit par une montée de l'enlèvement, même<br />
contre des éleveurs qui payaient à temps <strong>«</strong> l'impôt <strong>»</strong> et qui soutenaient la guérilla 1 . Comme<br />
l'exprime un ancien maire de Puerto Boyacá dans un entretien paru dans El Tiempo en 1983 :<br />
<strong>«</strong> Les FARC enlevaient les plus riches propriétaires et demandaient des millions<br />
en rançon, je calcule qu'à une époque il y a eu un enlèvement par semaine. Les<br />
guérillas récoltaient ainsi plus de 200 millions par an. <strong>La</strong> première victime<br />
d'assassinat fut un ancien gérant de la Banque de Colombie, qui s'était reconverti<br />
dans l'élevage <strong>»</strong> 2 .<br />
Beaucoup de grands propriétaires fuient leurs terres pour échapper à l'enlèvement. Les<br />
pressions financières de la guérilla retombent alors sur les moyens et les petits propriétaires,<br />
qui font en même temps les frais de la répression étatique. De plus, avec le départ des grands<br />
propriétaires beaucoup d'ouvriers agricoles se retrouvent sans emploi, mais doivent<br />
néanmoins continuer à payer le tribut aux FARC-EP. Ces pressions financières montent<br />
encore lorsque le 4e Front en crée un nouveau, le 11e. Les deux sont basés dans les environs<br />
1 Gutierrez Sanin et Barón [2005], p. 10<br />
2 El Tiempo, 12/02/1983. Me acusan de ser del MAS<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 78
de Puerto Boyacá, la population se retrouve donc à alimenter les caisses des deux fronts, une<br />
situation insupportable 1 .<br />
Ces développements montrent que la violence répressive ce l'armée n'<strong>est</strong> efficace que<br />
parce que les FARC-EP sont incapables de protéger leurs anciens clients. De plus, la<br />
polarisation de certains secteurs des petites élites locales, provoquée parle harcèlement et les<br />
vexations de la guérilla, favorisent leur rapprochement à l'armée. Ces deux processus – retrait<br />
relatif des FARC-EP et polarisation – rendront possible la coopération entre les civils et les<br />
militaires.<br />
Les Autodéfenses Paysannes du Moyen Magdaléna<br />
En 1982 Oscar Echandía, maire-militaire de Puerto Boyacá (la municipalité se trouve<br />
alors en état d'urgence permanent), le commandant du bataillon Bárbula, membres du comité<br />
d'éleveurs de bétail, politiques et commerçants décident la création d'un groupe<br />
<strong>«</strong> d'autodéfense <strong>»</strong> 2 . Le groupe <strong>est</strong> commandé par Ramón Isaza, Gonzalo Pérez et Pablo Emilio<br />
Guarín. Ils n'adoptent pas une stratégie d'affrontement direct, mais de démantèlement des<br />
réseaux de soutien logistique et informationnel. Les personnes suspectées de soutenir les<br />
FARC sont alors assassinées. Les meurtres sont mis en scène de manière sanguinaire, en guise<br />
d'avertissement pour toute la population. <strong>La</strong> première action violente du groupe <strong>est</strong> le<br />
massacre de Cocorná. Les groupes d'autodéfenses commettent par la suite de nombreux<br />
massacres, comme ceux de Mejor Esquina et Honduras 3 .<br />
Dans le cadre du procès judiciaire à son encontre, un leader paramilitaire de la zone,<br />
Alonso de Jesús Baquero Agudelo, affirme que les autodéfenses ont reçu un appui logistique,<br />
militaire et matériel de la part de l'armée. <strong>La</strong> direction du renseignement de chaque bataillon<br />
(connue sous le nom de la B-2) faisait le lien entre autodéfenses et militaires. Selon Baquero,<br />
les différents bataillons de la 14e Brigade leur vendaient des armes à prix préférentiel, leur<br />
prêtaient des armes et des uniformes et les fournissaient en munitions, argent, provisions et<br />
explosifs. Les combattants des autodéfenses étaient transportés par des hélicoptères et des<br />
patrouilleurs de l'armée 4 . Selon ce même témoin, les paramilitaires étaient aidés par l'armée<br />
dans la réalisation de ces massacres, les bombardements de l'armée étant suivis d'incursions<br />
1 Gutierrez Sanin et Barón [2005], p. 10<br />
2 Selon les déclarations devant la Fiscalía de Gerardo Zuluaga, Alias la Ponzoña, Voir le compte rendu<br />
de sa Version libre publiée le 17 février 2009 sur la base de données de Verdad Abierta<br />
3 Duncan [2005b], p. 247<br />
4Procès n° 4239, témoignage du 8 août 1995 rendu dans la maison d'arrêt de Palmira (departement du<br />
Valle)<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 79
des paramilitaires 1 . Une répartition du travail s'établit alors : <strong>«</strong> dans ces temps là, il était<br />
urgent d'expulser la guérilla de toute la vallée du Moyen Magdaléna et les militaires nous<br />
organisaient pour que nous faisions ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'<strong>est</strong>-à-dire tuer des gens<br />
et commettre des massacres <strong>»</strong> 2<br />
Les paramilitaires de Puerto Boyacá sont donc initialement au carrefour entre secteurs<br />
possédants de la société et l'armée. Dans les mots du curé Adolfo Galindo, alors en poste dans<br />
la ville :<br />
<strong>«</strong> Si je dois payer 20 millions de rançon, alors je préfère payer 1 million et me<br />
défendre, j'économise alors 19 millions. Si cent personnes ont la même idée il y<br />
aura 100 millions pour se défendre. D'un autre côté, je trouve que dans ces<br />
années là il y a eu à Puerto Boyacá une coïncidence de toutes les extrêmes<br />
droites, des garçons de Tradition, Famille et Propriété quelques colonels avec une<br />
idéologie très spéciale et des gens du commun qui pensaient qu'il fallait se<br />
défendre. Quelques-uns ont élaboré cette phrase : s'ils vont nous enlever nos<br />
terres qu'ils nous les enlèvent en luttant <strong>»</strong> 3<br />
Au début de la mobilisation, les paramilitaires de Puerto Boyacá utilisent l'étiquette du<br />
MAS, avec le capital symbolique qu'elle comporte. Or, très rapidement ils revendiquent le<br />
nom d'Autodéfenses Paysannes du Moyen Magdaléna. Ils sont alors engagés dans un<br />
processus de légitimation, dont l'élection de Pablo Emilio Guarín comme suppléant à la<br />
Chambre Basse <strong>est</strong> une étape clé. Guarín formule alors sa lutte comme une croisade contre le<br />
communisme, et non seulement contre les guérillas :<br />
<strong>«</strong> En ce moment s'opposent les forces qui soutiennent les institutions<br />
démocratiques, les forces qui soutiennent le gouvernement établi par vote<br />
populaire, le gouvernement national, départemental et municipal. Les forces qui<br />
soutiennent l'armée nationale – nous croyons que la seule armée équipée et en<br />
uniforme dans ce pays doit être l'armée officielle – contre ceux qui soutiennent la<br />
subversion, que ce soit ouvertement ou de manière cachée. Je pense que dans le<br />
Moyen Magdaléna, entre Puerto Boyacá, Cimitarra et Puerto Berrío il y a des<br />
communistes et des anti-communistes. Les communistes sont ceux qui<br />
1 <strong>La</strong> même chose écrit Medina Gallego [1990], p. 178, basé sur des témoignages de paysans de la zone<br />
2 Procès n° 4239, témoignage du 8 août 1995 rendu dans la maison d'arrêt de Palmira (departement du<br />
Valle)<br />
3 Medina Gallego [1990]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 80
appartiennent aux groupes de gauche, ou comme vous voudrez les appeler, que ce<br />
soit en agissant de forme légale ou en soutenant la subversion. En ce moment ici<br />
il n'y a que deux groupes : les démocrates et les assassins de la patrie <strong>»</strong> 1<br />
Le discours se place donc ici clairement dans une position de défense des institutions :<br />
défense du <strong>«</strong> gouvernement <strong>»</strong>, la <strong>«</strong> patrie <strong>»</strong> et de <strong>«</strong> l'armée nationale <strong>»</strong>. Il s'oppose aux<br />
<strong>«</strong> communistes <strong>»</strong>, définis comme <strong>«</strong> ceux qui appartiennent aux groupes de gauche <strong>»</strong> et ceux<br />
qui soutiennent la subversion. Le premier exclu de la vie politique <strong>est</strong> bien sûr le Parti<br />
Communiste, dont ses dirigeants sont assassinés ou prennent la fuite. Mais ils ne sont pas les<br />
seules cibles des paramilitaires. Une dissidence du parti libéral, le Nouveau Libéralisme, qui<br />
prône un libéralisme politique accompagné de mesures sociales et la transparence de la vie<br />
publique, <strong>est</strong> également éliminé. Ses principaux leaders dans toute la région de Puerto Boyacá<br />
sont assassinés : Benjamín Quiñones, Martín Torres et Luis Silva. On voit donc que la notion<br />
de <strong>«</strong> subversion <strong>»</strong> chez les paramilitaires a des limites assez floues. En outre, ce <strong>«</strong> nettoyage <strong>»</strong><br />
politique assure à l'aile droite du Parti Libéral, auquel Pablo Guarín <strong>est</strong> associé, l'hégémonie<br />
dans la région 2 .<br />
À partir de l'année 1983, les paramilitaires de Puerto Boyacá se lancent dans la création<br />
d'un projet politique à visée régionale, devant leur permettre à terme de prendre le contrôle<br />
des institutions de toute la vallée du Moyen Magdaléna. Ils ne sont pas seuls dans la<br />
formulation d'un discours politique. Pablo Guarín maintient des fortes relations avec des<br />
membres de l'aile droite du parti libéral, principalement Jaime Castro Castro, alors ministre de<br />
l'intérieur et Alberto Santofimio Botero 3 . Ils reçoivent l'appui de la Société Colombienne pour<br />
la Défense de la Tradition, la Famille et la Propriété (TFP), une association de droite<br />
réactionnaire très présente dans les cercles de pouvoir institutionnels. Elle publie en 1987 un<br />
livre intitulé <strong>La</strong> légitime défense dans les campagnes colombiennes dans lequel plusieurs<br />
pr<strong>est</strong>igieux professeurs de droit argumentent que l'organisation de groupes d'autodéfense <strong>est</strong><br />
un droit constitutionnel 4 . Ils sont également appuyés par les Jeunesses Chrétiennes<br />
(Asociación Cristiana de Jóvenes), qui mènent des programmes d'assistance sociale.<br />
Le centre du discours politique des paramilitaires <strong>est</strong> l'opposition au processus de paix,<br />
qui <strong>est</strong> vu comme un espace pour que les guérillas <strong>«</strong> se renforcent et huilent leurs armes et<br />
1 Entretien de Pablo Emilio Guarín avec Carlos Medina Gallego – Base de données Verdad Abierta<br />
2 Medina Gallego [1990], p. 195<br />
3 Ibidem, p. 189-190<br />
4 Voir le chapitre <strong>«</strong> Colombia <strong>»</strong> publié par la Comisión de <strong>est</strong>udios de las TPFs [1992]. Les TPF sont<br />
présentes dans la plupart des pays d'Amérique latine. Elles sont proches des partis d'extrême droite et<br />
de l'Opus Dei.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 81
affûtent leurs couteaux <strong>»</strong> 1 . Pour exprimer leur mécontentement devant la politique de paix du<br />
gouvernement Betancur, des éleveurs et des dirigeants politiques mènent en novembre 1983<br />
une marche paysanne sur la Capitale. Ils demandent la militarisation du Moyen Magdaléna et<br />
la fin des pourparlers de paix 2 . En novembre de l'année suivante, un forum <strong>est</strong> organisé à<br />
Puerto Boyacá; les hautes autorités de la ville y affirment que le processus de paix <strong>est</strong> un<br />
échec et déclarent Puerto Boyacá <strong>«</strong> Premier Fortin Antisubversif de Colombie <strong>»</strong>. À ce forum<br />
<strong>est</strong> formulé l'idée de créer une structure associative servant de représentant aux intérêts des<br />
élites antisubversives. L'idée aboutit à la création de l'ACDEGAM (Asociación Campesina de<br />
Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio – Association paysanne d'éleveurs et<br />
agriculteurs du Magdaléna Moyen), en 1986 3 .<br />
Malgré l'opposition des dirigeants de Puerto Boyacá au processus de paix, il n'y a<br />
jamais une rupture avec le gouvernement. Tout au contraire, bien que plusieurs d'entre eux<br />
aient été mis en cause par le rapport sur les groupes paramilitaires qui avait été présenté par le<br />
Procureur en 1983 (cf. le chapitre précédent), ils ne sont pas inquiétés. En outre, il semble que<br />
le Président Betancur ne soit pas totalement opposé à la formation de groupes paramilitaires;<br />
citons par exemple le discours qu'il prononce lors de sa visite à Puerto Boyacá en 1985 :<br />
<strong>«</strong> J'invite les colombiens à venir au Moyen Magdaléna pour être témoins de ce<br />
qui se passe à Puerto Boyacá aujourd'hui […]. Nous avons lu dans les visages<br />
des habitants du Moyen Magdaléna la joie, la tranquillité, la plénitude de la paix;<br />
nous l'avons lu dans ces visages qui, deux ans auparavant étaient marqués par la<br />
peur et la terreur de la guerre. Aujourd'hui, chaque habitant du Magdaléna<br />
Moyen s'<strong>est</strong> levé pour devenir un défenseur de cette paix, à côté de <strong>notre</strong> armée, à<br />
côté de <strong>notre</strong> police, chaque habitant du Moyen Magdaléna <strong>est</strong> un militant et un<br />
défenseur de la paix <strong>»</strong> 4 .<br />
Début 1988, en vue des premières élections des maires au suffrage universel <strong>est</strong> créé un<br />
<strong>«</strong> Front commun antisubversif <strong>»</strong>, une alliance de leaders politiques de tout le Moyen<br />
Magdaléna visant à acquérir le contrôle d'un maximum de mairies. Soutenu par les armes des<br />
paramilitaires, le front emporte les élections dans la plupart des municipes de la région. En<br />
mai, les nouveaux maires forment un <strong>«</strong> Front de maires antisubversifs <strong>»</strong> qui regroupe le<br />
1 Voir l'éditorial du mensuel local, Puerto Rojo, édition de Juin 1984. Medina Gallego [1990]<br />
2 Medina Gallego [1990], p. 191<br />
3 Ibidem, p. 219 et suiv.<br />
4 Puerto Rojo, Edition de Septembre/ Octobre 1985, p. 12. Cité par Medina Gallego [1990]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 82
dirigeants de Cimitarra, <strong>La</strong>ndázuri, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío et Puerto<br />
Boyacá 1 . On se souvient qu'exactement dix ans plus tôt les communistes avaient emporté<br />
plusieurs de ces Conseils Municipaux.<br />
Cette description de la période de création des groupes paramilitaires de Puerto Boyacá,<br />
nous a permis d'observer l'alliance complexe qui se tisse autour du projet contre-<br />
insurrectionnel. Nous voyons également la place centrale que joue l'armée dans ces<br />
dynamiques, comme instigatrice des processus de mobilisation et comme partenaire militaire<br />
parla suite. Enfin, nous pouvons mesurer l'importance de l'opposition à la politique de paix de<br />
Betancur dans la création de ces collusions. Cependant, l'alliance de secteurs des élites avec<br />
les militaires et les professionnels de la violence maintien les groupes paramilitaires dans le<br />
giron de l'État. Ils en dépendent, ne serait-ce que pour obtenir des armes et des munitions.<br />
Cette situation change totalement avec l'entrée en scène des narcotrafiquants. .<br />
Le Mexicain et l'entrée en scène des trafiquants de drogue<br />
Le groupe de Puerto Boyacá <strong>est</strong> une force supplétive de l'armée équipée sommairement<br />
et jouissant d'un entraînement basique avant que les trafiquants de drogue ne rentrent en<br />
scène 2 . Les narcos arrivent dans la zone au début des années 1980, lorsqu'ils achètent<br />
massivement des terres. En effet, ils inv<strong>est</strong>issent une grande partie des profits dans des<br />
propriétés rurales. De plus ces terres avaient perdu beaucoup de leur valeur, à cause de la<br />
violence que sévit dans la région. L'achat de terres permet aux trafiquants de blanchir l'argent<br />
sale de la drogue et d'avoir des zones de repli en cas de danger. À Puerto Boyacá arrivent<br />
quelques uns des narcos les plus puissants du pays; ils appartiennent au Cartel de Medellín,<br />
première grande entreprise du trafic de drogues dans le pays 3 . Parmi eux se trouve Gonzalo<br />
Rodríguez Gacha, alias Le Mexicain, qui devient le principal bailleur de fonds des<br />
paramilitaires. En effet, les narcotrafiquants se retrouvent à partager les mêmes problèmes de<br />
sécurité auxquels font face leurs voisins éleveurs. Souvenons-nous que c'<strong>est</strong> l'époque des<br />
premiers enlèvements de narcotrafiquants et de leurs familles et de création du MAS. Puerto<br />
Boyacá n'échappe pas à cette tendance nationale. <strong>La</strong> ville devient même le centre d'un projet<br />
paramilitaire dépassant les limites du Magdaléna Moyen. En effet, Guarín, Isaza et Pérez sont<br />
vus comme des véritables pionniers par d'autres entrepreneurs paramilitaires; ils voyagent<br />
1 Medina Gallego [1990], p. 237<br />
2 Gutierrez Sanín [2007], p. 12 : <strong>«</strong> Paramilitary troops were armed with shotguns, pistols, machetes,<br />
weapons that can be quite effective to slaughter civilians and ‘take the water from the fish’, but not to<br />
confront the ‘fish’ itself <strong>»</strong><br />
3 Castillo [1987], chapitre III<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 83
dans tout le pays pour rencontrer des professionnels de la violence qui créent localement leurs<br />
propres structures 1 .<br />
L'arrivée des narcotrafiquants signifie un changement dans l'équilibre de forces à<br />
l'intérieur des groupes paramilitaires, comme l'écrit G. Duncan :<br />
<strong>«</strong> C'<strong>est</strong> dans ce contexte que les narcotrafiquants prennent définitivement le<br />
contrôle des groupes paramilitaires. Ce qui était au début des appareils armés<br />
subordonnés à un équilibre de différents pouvoirs, incluant des éleveurs de bétail<br />
et des capitalistes locaux, les forces armées, la classe politique, les propriétaires<br />
fonciers, des caciques et des narcos au pouvoir modéré, <strong>est</strong> devenu une machine<br />
de guerre sous la direction des grands seigneurs de la drogue(...). L'argent des<br />
narcos s'<strong>est</strong> traduit en <strong>fusil</strong>s, mitrailleuses M-60, 4-4, radios et un réseau élaboré<br />
de soutien logistique <strong>»</strong> 2 .<br />
Henry Pérez, commandant paramilitaire, déclare alors à un journaliste de Semana :<br />
<strong>«</strong> Nous avions les hommes et la mystique, mais nous n'avions pas l'argent. L'entraînement<br />
implique des dépenses, alors il (Gonzalo Rodríguez Gacha) nous a aidés. Vous savez que<br />
celui qui donne s'attend à recevoir <strong>»</strong> 3 . Les Autodéfenses du Magdaléna Moyen finissent par<br />
devenir l'armée privée de Rodríguez Gacha. Le processus <strong>est</strong> consommé avec l'assassinat de<br />
Pablo Guarín en 1987 4 . Le Mexicain s'attelle alors à la formation militaire de ces combattants<br />
et à l'entraînement de cadres d'élite. Une école de cadres <strong>est</strong> créée à Pancho, dans le<br />
département du Cundinamarca. Une autre école, existe à Puerto Boyacá et forme les troupes<br />
de base.<br />
Comme nous l'avons souligné dans le chapitre précédent, la situation des paramilitaires<br />
devient très ambiguë lorsque l'État déclare la guerre au trafic de drogues. Alliés de l'État dans<br />
la lutte antisubversive, les paramilitaires s'affrontent aux forces officielles lorsqu'ils protègent<br />
les infrastructures de production de drogue et les hommes forts du négoce. Des représentants<br />
des institutions publiques sont alors plus nombreux à dénoncer la connivence entre<br />
paramilitaires et narcotrafiquants. Un rapport du Général Miguel Maza Márquez, directeur<br />
national du DAS (Département Administratif de Sécurité – organe d'intelligence rattaché à la<br />
1 Medina Gallego [1990] signale par exemple que Guarín et d'autres représentants de l'ACDEGAM<br />
rencontrent en 1986 des éleveurs du département du Huila.<br />
2 Duncan [2005b], p. 254-255<br />
3 Semana, 16 avril 1991, entretien avec Henry de Jesús Perez<br />
4 Castro Caycedo [1996], p. 164 ; Duncan [2005b], p. 254<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 84
Présidence de la République) affirme alors que Puerto Boyacá <strong>est</strong> un refuge pour les<br />
narcotrafiquants de tout le pays, surtout après la chute de Noriega au Panamá. Il énumère des<br />
propriétés qui appartiennent aux seigneurs de la drogue et accuse les paramilitaires d'être des<br />
gardes du corps et des hommes de main des trafiquants 1 .<br />
<strong>La</strong> transformation des paramilitaires en service de sécurité des narcotrafiquants n'a pas<br />
seulement pour conséquence une réorganisation des rapports de forces. Elle favorise aussi la<br />
fragmentation des groupes armés. Ils s'affrontent alors dans des batailles sanglantes. Au début<br />
des années 1990, une guerre commence entre Henry Pérez, le fils d'un des premiers chefs<br />
paramilitaires de Puerto Boyacá et Pablo Escobar, le plus grand chef de la mafia. Les armées<br />
des deux hommes combattent pendant plusieurs mois dans la région du Moyen Magdaléna,<br />
avant que Pérez ne soit tué le 20 juillet 1991. <strong>La</strong> mort de Pérez marque un déclin du groupe<br />
des Autodéfenses Paysannes du Moyen Magdaléna. Elles sont reconstruites quelques années<br />
plus tard par Ramón Isaza.<br />
Puerto Boyacá n'<strong>est</strong> pas seulement une expérience pionnière de formation de groupes<br />
armés autour desquels se retrouvent des narcotrafiquants, des élites locales et des militaires.<br />
C'<strong>est</strong> également une école de formation de professionnels de la violence qui contribue à la<br />
multiplication des groupes paramilitaires ailleurs dans le pays. L'expérience la plus connue de<br />
formation de cadres paramilitaires <strong>est</strong> celle conduite par Yair Klein, mercenaire israélien, qui<br />
voyage en trois occasions en Colombie entre 1987 et 1989 2 . Il avait été embauché par<br />
Rodríguez Gacha pour former ses troupes d'élite 3 . D'autres <strong>«</strong> parrains <strong>»</strong> des paramilitaires<br />
participent à l'opération. Ainsi, parmi les 50 étudiants de différentes régions du pays qui<br />
assistent aux cours assurés par les mercenaires 20 sont des hommes de Gacha, 20 d'Henry<br />
Pérez, 5 de Victor Carranza et 5 de Pablo Escobar 4 . Ces professionnels de la violence sont<br />
formés à des différentes techniques de combat, comme le maniement de toute sorte d'armes,<br />
d'explosifs ainsi qu'à des techniques d'intelligence. Parmi les élèves de Klein se trouvent<br />
quelques uns des plus célèbres personnages de l'histoire de la violence paramilitaire en<br />
Colombie, comme Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, ou Fidel Castaño, alias Rambo 5 .<br />
1 Medina Gallego [1990], p. 245<br />
2 Semana, 28/08/2007. Capturan en Rusia a Yair Klein, el mercenario israelí que inició la instrucción<br />
de los paramilitares.<br />
3 Yair Klein, mercenaire israëlien raconte son contrat de formation avec les paramilitaires de Puerto<br />
Boyacá : El Tiempo, 29/08/1989 El mercenario israelí se defiende de las acusaciones de narcotráfico<br />
4 Voir le dossier publié par Semana en 1989<br />
5Semana, 28/08/2007. Capturan en Rusia a Yair Klein, el mercenario israelí que inició la instrucción<br />
de los paramilitares.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 85
Ce dernier <strong>est</strong> une pièce clé pour comprendre l'expansion des groupes paramilitaires, qui à la<br />
fin du siècle contrôlent la moitié du territoire colombien 1 .<br />
2. <strong>La</strong> <strong>«</strong> maison <strong>»</strong> Castaño<br />
Les frères Castaño, Vicente, Fidel et Carlos, ont été des protagonistes centraux de<br />
l'histoire des paramilitaires en Colombie. Carlos, le plus jeune, affirme qu'il a débuté dans le<br />
métier des armes en 1981, lorsqu'il servait de <strong>«</strong> guide <strong>»</strong> au bataillon Bomboná, c'<strong>est</strong> à dire<br />
d'auxiliaire civil servant à repérer les habitants proches de la guérilla 2 . Fidel participe à ces<br />
mêmes activités avec l'armée, et noue des liens avec d'autres groupes armés dans le pays. Au<br />
milieu de la décennie, les Castaño s'installent dans le département de Córdoba et lancent une<br />
offensive visant à <strong>«</strong> libérer <strong>»</strong> ce territoire de la présence subversive. Après avoir négocié une<br />
démobilisation de leurs troupes en 1990, ils reprennent les armes et sont rapidement présents<br />
dans la plupart des départements de la côte caraïbe. En 1997, ils lancent une stratégie<br />
d'expansion nationale en intégrant les autres groupes paramilitaires de gré ou de force. Nous<br />
retracerons ici cette évolution en mettant l'accent sur les processus d'alliance et de<br />
polarisation.<br />
Mort aux Révolutionnaires du Nord-Est<br />
Au début de la décennie 1980, Fidel crée un groupe paramilitaire propre, le MRN<br />
(Mort aux Révolutionnaires du Nord-Est), qui opère dans les municipes d'Amalfi, Segovia et<br />
Remedios, dans le Nord-Est du département d'Antioquia 3 . Les premiers massacres pour<br />
lesquels il <strong>est</strong> inculpé datent de 1982-83, et ont eu lieu dans la localité de El <strong>La</strong>garto 4 (Amalfi)<br />
et à Remedios 5 ; 18 et 22 personnes y ont respectivement perdu la vie.<br />
Le Nord-Est d'Antioquia <strong>est</strong>, comme Puerto Boyacá, une zone d'influence du Parti<br />
Communiste. Dans cette région dominée par l'économie minière, les communistes ont une<br />
forte base sociale parmi les ouvriers des mines et les petits paysans. Comme à Puerto Boyacá,<br />
les FARC-EP exercent le contrôle des zones rurales et rackettent et enlèvent les propriétaires<br />
1 Les entretiens réalisés par Castro Caycedo [1996] et Aranguren [2001] avec Carlos Castaño sont –<br />
malgré le fait que le chef paramilitaire s'efforce de se mettre en scène de manière héroïque – une<br />
source importante sur l'histoire de cette famille. D'autres journalistes ont par la suite comblé des<br />
lacunes de ces textes et réfuté certains faits.<br />
2 Voir l'entretien avec Castro Caycedo [1996], p. 152<br />
3 León [2005], p. 219-242<br />
4 Semana, Masacre de El <strong>La</strong>rgato en Amalfi, atribuida a Fidel, 15 janvier 1988<br />
5 Ramírez [1997], p. 128<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 86
terriens. Une des victimes d'enlèvement <strong>est</strong> le père des Castaño, Jesús Antonio Castaño. Sa<br />
mort en captivité <strong>est</strong> la principale raison donnée par Carlos des années plus tard pour justifier<br />
sa guerre 1 . Ils ne sont cependant pas seuls dans leur guerre; selon Carlos, lorsqu'il entame<br />
avec ses frères la campagne de lutte contre la guérilla, ils sont entraînes et reçoivent le soutien<br />
logistique de la 14e brigade, basée à Puerto Berrío 2 .<br />
En 1988, lorsque les premières élections des maires ont lieu, l'Union Patriotique (UP)<br />
gagne les mairies de Segovia et Remedios. L'objectif du MRN <strong>est</strong> alors d'éliminer le parti de<br />
la région, car ils l'identifient aux FARC-EP. Ils commencent par harceler les villes, taguant les<br />
murs avec des slogans menaçants et distribuant des tracts. En mars de la même année, le<br />
maire de Remedios <strong>est</strong> assassiné à Medellín. Un tract du MNR revendique le meurtre :<br />
<strong>«</strong> Comme nous l'avions annoncé lors de nos communications antérieures, nous<br />
faisons part aujourd'hui de la victoire de <strong>notre</strong> mission de nettoyage, qui a<br />
commencé avec Elkin de Jesús Martínez, maire élu de l'UP pour Remedios. Ses<br />
liens avec les FARC et autres groupes guérilléros, qui font sombrer dans<br />
l'angoisse le Nord-Est d'Antioquia, nous ont incité à mener une action concrète et<br />
décidée, dans le but de mettre fin aux plans expansionnistes du communisme<br />
mené par les FARC et l'UP dans cette région riche et prospère de <strong>notre</strong> pays <strong>»</strong> 3<br />
Quelques mois plus tard, le 11 novembre, le MRN commet un des plus grands<br />
massacres que le pays ait connu jusqu'alors. Peu avant 19h00, trois 4x4 amènent les<br />
paramilitaires dans la ville. Une heure et demi plus tard, 43 personnes avaient perdu la vie et<br />
50 autres étaient blessées 4 . C'<strong>est</strong> un véritable carnage commis de manière totalement<br />
indiscriminée. Les hommes armés parcourent la ville tirant de leurs armes automatiques des<br />
rafales contre les maisons, les bars et les r<strong>est</strong>aurants. Il n'y a aucune réaction des autorités 5 .<br />
Pourtant, les 4x4 passent juste devant la station de police, et la ville dispose d'un bataillon, le<br />
Bomboná 6 , le même où les Castaño ont commencé leur carrière sept ans plus tôt... Un rapport<br />
du Procureur, rendu public trois semaines plus tard, accuse l'armée de négligence : <strong>«</strong> <strong>La</strong> route<br />
1 Castro Caycedo [1996], p. 150-151<br />
2 Ibidem, p. 157<br />
3 Semana, 15/11/88. Crónica de una masacre anunciada<br />
4 Ramírez [1997], p. 130-131<br />
5 Semana, 15/11/88. Crónica de una masacre anunciada<br />
6 Romero [2003], p. 199<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 87
longe la base militaire sur une longue distance et elle <strong>est</strong> visible dès le premier poste avancé;<br />
c'<strong>est</strong> la même route par laquelle sont rentrés et sortis les malfrats <strong>»</strong> 1 .<br />
Selon les déclarations faites par le chef paramilitaire de Puerto Boyacá Alonso de Jesús<br />
Baquero, il aurait été envoyé par Henry Pérez pour collaborer avec Fidel Castaño à<br />
l'organisation du massacre de Segovia. Il affirme avoir assisté à deux réunions avec les<br />
colonels Navas et Londoño, qui appartenaient respectivement à la 14e Brigade de Puerto<br />
Berrío et au Bataillon Bomboná de Segovia respectivement. Lors de ces réunions les officiers<br />
auraient fait pression pour réaliser une action contre la population de la ville :<br />
<strong>«</strong> L'idée était d'amollir Segovia. D'un côté était Rambo, c'<strong>est</strong>-à-dire Fidel<br />
Castaño, faisant pression pour qu'on mette la dent là-bas et de l'autre côté il y<br />
avait le colonel Navas et le colonel Londoño. Nous avons eu deux réunions avec<br />
eux. Lors de la dernière, ils ont dit – qu'<strong>est</strong>-ce qui se passe avec Segovia? Là bas<br />
la guérilla fait tout ce qu'elle veut et vous vous en foutez <strong>»</strong> 2<br />
Dans ce premier groupe paramilitaire des Castaño, on voit clairement la réaction<br />
violente au danger électoral que représente l'UP. Il ne s'agit pas seulement de faire reculer<br />
militairement la guérilla, mais de détruire un groupe politique qui peut espérer conquérir le<br />
pouvoir politique local. De ce point de vue là, la date de 1988, avec les premières élections de<br />
maires, <strong>est</strong> le point de départ d'une violence de haute intensité. C'<strong>est</strong> également le cas dans<br />
d'autres zones du pays, comme on le verra plus loin.<br />
Les Tangueros<br />
Les frères Castaño sont engagés depuis le début de leur projet paramilitaire dans le<br />
trafic de drogues. Fidel commence ainsi son apprentissage du métier des armes comme un<br />
homme de main de Pablo Escobar à Medellín. Plus tard, il finance l'équipement de son armée<br />
privée avec l'argent de la drogue 3 . En 1985, les intérêts de la drogue mènent les frères Castaño<br />
au département de Córdoba – situé au Nord d'Antioquia – où ils achètent une hacienda<br />
appelée <strong>La</strong>s Tangas, dans le municipe de Valencia. C'<strong>est</strong> un endroit équidistant entre les<br />
montagnes d'Antioquia, la forêt du Chocó et le Golfe d'Urabá, leur permettant d'importer des<br />
armes et exporter de la cocaïne 4 .<br />
1 Idem.<br />
2 El Tiempo, 05/09/1996. Detenido Navas Rubio por masacre<br />
3 Cf. le document de la DIA (Defense Intelligence Agency) déclassifié par la ONG National Security<br />
Archive : information on <strong>«</strong> los Pepes <strong>»</strong>, avril 1993<br />
4 León [2005], p. 302<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 88
Les Castaño ne sont pas les seuls narcotrafiquants à s'intéresser à ce couloir stratégique.<br />
Henri Pérez, Pablo Escobar et Gonzalo Rodríguez Gacha achètent également plusieurs<br />
haciendas dans le Sud de Córdoba et dans la région de l'Urabá à la fin des années 1980. Se<br />
reproduit alors un phénomène semblable à celui qui avait eu lieu à Puerto Boyacá; devenus<br />
propriétaires, les trafiquants organisent le <strong>«</strong> nettoyage <strong>»</strong> de la région. C'<strong>est</strong> ce qu'affirme dans<br />
son témoignage devant la justice le paramilitaire Rogelio de Jesús Escobar; il déclare aussi<br />
que l'hacienda <strong>La</strong>s Tangas sert de camp d'entraînement pour les paramilitaires; elle aurait<br />
hébergé une armée d’une centaine de personnes. Les paramilitaires des Castaño à Córdoba<br />
sont connus sous les noms de <strong>«</strong> Magnifiques <strong>»</strong> ou <strong>«</strong> Tangueros <strong>»</strong>. Escobar affirme également<br />
que la police travaille en étroite collaboration avec Castaño : <strong>«</strong> le poste de police de Valencia<br />
a une fréquence radio spéciale pour entrer en contact avec l’organisation de Fidel Castaño,<br />
ça permet aux policiers de le prévenir de la présence de personnes suspectes ou de la<br />
réalisation d’opérations dans les propriétés du groupe paramilitaire <strong>»</strong> 1 . Les zones d'influence<br />
des frères Castaño comptent alors parmi les plus violentes du pays. Entre 1980 et 1993 dans le<br />
seul département de Córdoba les Tangueros commettent 40 massacres et près de 200 meurtres<br />
ciblés 2 .<br />
Dans le département de Córdoba, les paramilitaires sont massivement soutenus par les<br />
éleveurs, qui étaient jusqu'alors exposés aux vexations et racket de la guérilla des FARC-EP<br />
et de l'EPL (Ejército Popular de Liberación – Armée populaire de libération). Castaño<br />
raconte avoir assisté à des réunions avec des membres de l'armée et des éleveurs locaux, où le<br />
soutien de ces deux catégories fut donné à son projet paramilitaire 3 . Des années plus tard, le<br />
président de Fedegan, l'association nationale des éleveurs de bétail, justifiait ce soutien par<br />
l'abandon de l'État qui provoqua alors une polarisation des campagnes entre paramilitaires et<br />
guérilléros. Il affirme que les paramilitaires des Castaño sont de véritables <strong>«</strong> libérateurs <strong>»</strong> de<br />
la région :<br />
<strong>«</strong> Au milieu de cette dramatique situation et comme une nécessité évidente, sont<br />
apparues les autodéfenses menées par Fidel Castaño, elles furent et sont encore<br />
considérées comme les authentiques libératrices de la région. <strong>La</strong> sauvegarde de<br />
la vie et des biens des associés, que l'État, par inaptitude ou par manque de<br />
1 Département Administratif de Sécurité (DAS), témoignage de Rogelio de Jesús Escobar, 4 avril 1990.<br />
2 Uribe et Vázques [1994], p. 127-134<br />
3 Aranguren [2001], p. 96<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 89
décision politique n'accomplissait – même de loin – fut assumée avec particulière<br />
efficacité par ces groupes d'autodéfense <strong>»</strong> 1 .<br />
M. Romero fait cependant remarquer qu'il ne faut pas réduire la réaction des éleveurs<br />
de bétail de Córdoba à une qu<strong>est</strong>ion de sécurité, au prix de reproduire le discours des acteurs.<br />
S'il <strong>est</strong> vrai que ces élites traditionnelles subissent de plein fouet les extorsions et les rapts de<br />
la guérilla, le processus de paix du président Betancur <strong>est</strong> essentiel pour comprendre l'alliance<br />
entre paramilitaires et éleveurs 2 . En effet, la réforme agraire <strong>est</strong> une revendication ancienne<br />
des paysans de Córdoba, l'un des départements du pays où la concentration de la terre aux<br />
mains de quelques propriétaires <strong>est</strong> la plus forte 3 . Les différentes tentatives politiques du<br />
centre pour mener une telle reforme avaient toujours échouées. Les négociations de paix<br />
menacent donc directement les prérogatives des élites locales. Ainsi le dénoncent les<br />
représentant des éleveurs :<br />
<strong>«</strong> ...distribués dans des endroits clés du territoire national, alliés avec des<br />
éléments de la gauche ecclésiastique et civile, beaucoup d'entre eux (les anciens<br />
guérilléros passés en politique) conduisent un véritable plan de perturbation<br />
sociale dans les campagnes, associant des populations mécontentes, les<br />
radicalisant, promouvant et organisant des invasions et des occupations de terres<br />
et, en somme, préparant l'incendie de a lutte des classes, non plus depuis la<br />
cland<strong>est</strong>inité mais d'une manière plus ou moins ostensible <strong>»</strong> 4<br />
Avec l'appui de la 11e brigade, qui s'installe en 1987 à Montería, capitale du<br />
département de Córdoba, les Castaño lancent l'offensive contre la guérilla. Elle conduit les<br />
FARC-EP à se retrancher dans le massif de l'Abibe et l'EPL à s'asseoir à la table de<br />
négociations avec le gouvernement 5 . Les Castaño appliquent la même stratégie de d<strong>est</strong>ruction<br />
des forces d'opposition qui fait à ce même moment des centaines de morts dans le Nord-Est<br />
d'Antioquia. En septembre 1987 le candidat du mouvement A Luchar pour la mairie de<br />
Tierralta <strong>est</strong> assassiné. C'<strong>est</strong> le premier d'une série de meurtres qui voit tomber de nombreux<br />
leaders de ce mouvement et de l'UP, ainsi que des journalistes, des syndicalistes et des<br />
1 Lettre de Rodrigo García Caicedo, président de Fédégan datée du 21/11/1994. Reproduite<br />
intégralement In Castro Caycedo [1996], p. 169-173<br />
2 Romero [2003], chapitre 3<br />
3 Gini 0,79 selon CEDE-Uniandes et Banque Mondiale [2004], p. 16<br />
4 El Tiempo, 17 août 1984, cité par Romero [2003]<br />
5 Romero [2003], p. 142-143<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 90
enseignants 1 . Le premier meurtre collectif a lieu à Mejor Esquina (municipe de Buenavista) en<br />
avril 1988, où 37 personnes perdent la vie. Dans les deux années suivantes plus de 20<br />
massacres sont commis par les Tangueros 2 . Au total plus de 1200 personnes sont assassinées<br />
dans le département entre 1988 et 1990 3 .<br />
L'offensive des Castaño <strong>est</strong> accompagnée d'un achat massif de terres de la part d'autres<br />
trafiquants de drogue. Une équipe de chercheurs de l'Université Nationale de Colombie cite<br />
l'exemple des frères Ochoa, membres du Cartel de Medellín (les mêmes qui avaient été à<br />
l'origine de la création du MAS); à travers d'autres membres de leurs familles et des hommes<br />
de paille, ils auraient acheté 48 haciendas de bétail seulement dans le municipe d'Arboletes 4 .<br />
Cette offensive marque le déclin militaire de l'EPL. L'organisation <strong>est</strong><br />
traditionnellement très forte dans la région d'Urabá au Nord du département d'Antioquia, où<br />
elle dispose d'une importante base sociale chez les ouvriers de la banane. Or, Fidel Castaño<br />
ambitionne cette région, qui <strong>est</strong> une zone traditionnelle de trafic depuis la colonie et un<br />
couloir stratégique vers les forêts du département du Chocó et du Panamá 5 . Il traverse donc le<br />
massif de l'Abibe, limite naturelle entre les départements de Córdoba et Antioquia et<br />
commence à harceler les bases sociales de la guérilla. Début 1990, il assassine 42 personnes<br />
dans la localité de Pueblo Bello, qui appartient au municipe de Turbo, en pleine zone<br />
bananière. 24 de ces morts sont plus tard retrouvés par la police dans une fosse commune de<br />
l'hacienda las Tangas 6 .<br />
Malgré cette violence, et peut-être en partie à cause d'elle, les négociations entre le<br />
gouvernement et l'EPL continuent. En août 1990, Castaño annonce qu'il démobilisera ses<br />
troupes. Il l'aurait fait suite à la demande des grands éleveurs de bétail de Córdoba, qui y<br />
voyaient une possibilité pour la pacification de la région 7 . Les négociations aboutissent et<br />
l'EPL se démobilise le 15 février 1991. Castaño obtient la promesse de ne pas être inquiété<br />
pour ses crimes. En échange il dissout son armée, remet les armes à l'État et distribue les<br />
terres qui avaient été illégalement acquises, par la menace et l'assassinat des petits<br />
1 Romero [2003], p 142<br />
2 Negrete [1995]<br />
3 Source : Consejería de Defensa y Seguridad de la Presidencia de la Repúplica, cité par Echandía et<br />
Escobedo [1999]<br />
4 Cubides, Olaya et Ortiz [1995]<br />
5 El Tiempo, 18/09/1994, Historias Inéditas Del Epl<br />
6 El Tiempo, 25/01/2006, Buscan 37 Cadáveres En Finca De Castaño<br />
7 Castro Caycedo [1996], p. 168<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 91
propriétaires. Le processus s'avère une simple façade pour la régularisation des activités de<br />
Castaño. À titre d'exemple, les terres qui doivent être rendues à leurs propriétaires originaux<br />
sont administrées par la Fondation pour la Paix en Córdoba (Funpazcor), dirigée par Sor<br />
Teresa Gómez, l'épouse de Manuel Castaño, frère de Fidel 1 . L'entité fonctionne alors comme<br />
une simple structure pour l'achat d'armes et le blanchissement d'argent 2 . 12.000 ha sont dans<br />
un premier moment rendus à près de 2 500 familles paysannes; ce g<strong>est</strong>e sert à légitimer la<br />
démobilisation des paramilitaires de Castaño aux yeux du gouvernement central. Cependant,<br />
aussitôt les représentants des instances de contrôle partis, le groupe des Tangueros <strong>est</strong> recréé<br />
et les familles paysannes sont à nouveau expulsées des terres 3 . Cette affaire montre clairement<br />
les enchevêtrements entre le légal et l'illégal qui caractérisent le phénomène paramilitaire. <strong>La</strong><br />
légalisation de la fortune de Fidel et la pantomime de réparation qui s'en suit n'auraient pas été<br />
possibles sans la tolérance bienveillante de plusieurs secteurs de l'État. Or, cette tolérance ne<br />
garantit pas la pacification de la région; tout au contraire, elle permet aux structures<br />
paramilitaires d'étendre progressivement leur influence et de nouer des liens avec différents<br />
secteurs politiques et économiques. Ces allers-retours entre le légal et l'illégal, toujours<br />
bénéficiant d'une caution publique sont, nous le verrons, une caractéristique constante de cette<br />
histoire.<br />
Les Autodéfenses Paysannes de Córdoba et Urabá (ACCU)<br />
Le réarmement des paramilitaires des Castaño, qui débute en 1993, répond à plusieurs<br />
considérations : premièrement, une considération stratégique; les Tangueros contrôlent<br />
désormais le département de Córdoba, jusqu'au massif de l'Abibe, qui le sépare de l'Urabá<br />
voisin. Or, suite au démantèlement de la structure armée de l'EPL en Urabá, les FARC-EP<br />
acquièrent le contrôle total de la zone. De plus, à partir du fortin que constitue l'Abibe, elles<br />
peuvent lancer des attaques contre les positions des paramilitaires en Córdoba 4 . <strong>La</strong> situation<br />
<strong>est</strong> aggravée par la rupture des dialogues de paix de Tlaxcala (Mexique) entre le<br />
gouvernement et les FARC-EP en mai 1992. <strong>La</strong> guérilla se lance alors dans une augmentation<br />
du potentiel de feu de la guérilla dans les zones stratégiques. Urabá, territoire périphérique et<br />
mal contrôlé, mais zone clé du trafic de drogue avec sa frontière panaméenne, ses forêts<br />
tropicales et sa côte sur les caraïbes fait alors partie des zones stratégiques du conflit 5 .<br />
1 Cepeda et Rojas [2008], p. 55<br />
2 El Nuevo Herald, Sale a la luz la fuente de dinero de los paras, 23 juillet 2001<br />
3 Cepeda et Rojas [2008], p. 56<br />
4 Castro Caycedo [1996], p. 230<br />
5 Martin [1997]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 92
Deuxièmement, il y a des considérations politiques : Urabá, avec sa population flottante<br />
d'ouvriers de la banane et des colons de l'intérieur <strong>est</strong> en train de devenir une forteresse<br />
politique de l'UP. L'endoctrinement politique réalisé par les FARC-EP pendant des années<br />
porte ses fruits; au début de la décennie, la plupart des maires des municipes de la région<br />
appartiennent à la gauche. Troisièmement, il y a des considérations économiques; Urabá <strong>est</strong><br />
une région très riche, la première productrice de banane au niveau national. Or, les FARC-EP<br />
harcèlent les entrepreneurs de ce secteur et en tirent de grands profits. Les paramilitaires<br />
arrivent attirés par ces rentes et par la demande croissante de leurs <strong>«</strong> services <strong>»</strong> de la part des<br />
grands propriétaires de la région 1 . Comme l'affirme quelques années plus tard Carlos<br />
Castaño : <strong>«</strong> Les seigneurs de la banane renforçaient économiquement la guérilla, mais je ne<br />
pouvais pas leur interdire de payer si je n'étais pas là pour dire – ne donnez rien, je réponds<br />
pour votre sécurité <strong>»</strong> 2 .<br />
<strong>La</strong> réponse paramilitaire vient avec la création des ACCU (Autodéfenses Paysannes de<br />
Córdoba et Urabá) en 1994. <strong>La</strong> guerre fait rage entre les FARC et les ACCU 3 , commandées<br />
par Carlos Castaño suite à la mystérieuse disparition de son frère. <strong>«</strong> Utilisant la grande terreur,<br />
les autodéfenses affirment battre la guérilla avec ses propres armes <strong>»</strong> 4 . Le réarmement des<br />
paramilitaires de Castaño <strong>est</strong> alimenté par la démobilisation des membres de l'EPL (Armée<br />
populaires de libération nationale). Les anciens combattants commencent à être assassinés par<br />
les FARC dans la zone de l'Urabá. Bien que reconvertis dans la vie civile, et engagés dans le<br />
parti politique Espoir Paix et Liberté, ces anciens guérilleros sont déclarés objectif militaire<br />
des FARC, qui les perçoivent comme une menace politique 5 . Ils créent alors des<br />
<strong>«</strong> commandos populaires <strong>»</strong> qui se réarment pour se protéger des agressions des FARC; en<br />
1993, ces commandos se mettent au service de Castaño. 6 Castaño reconnaît alors ne pas<br />
posséder la force de feu nécessaire pour battre la guérilla dans des combats directs; la guerre<br />
se fait donc par populations interposées :<br />
<strong>«</strong> Si nous ne pouvons pas les affronter (les guérillas) quand ils sont dans les<br />
groupes armés car nous n'avons ni la capacité militaire ni l'armement , on va<br />
donc occuper le village. Là, nous pourrons nous protéger car dans le village ils<br />
1 Romero [2003], p. 205<br />
2 El Tiempo 29/09/1997, <strong>La</strong> Izquierda No Es Un Objetivo Militar<br />
3 El Tiempo, CG habría declarado guerra a paramilitares, 20 décembre 1994<br />
4 Martin [1997] § 64<br />
5 Ibidem<br />
6 Cepeda et Rojas [2008], p. 56<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 93
ne seront pas capables de nous tuer. Nous allons commencer à les tuer au fur et à<br />
mesure qu'ils arrivent (...). De là vient, sans que personne ne nous l'apprenne, un<br />
des meilleurs mécanismes que nous avons utilisé dans la guerre contre-<br />
insurrectionnelle : si nous ne pouvions pas combattre là où ils étaient protégés,<br />
nous pouvions en revanche neutraliser les personnes qui leur amenaient de la<br />
nourriture, des médicaments, de l'information, de l'eau-de-vie, des prostituées et<br />
tout ce genre de choses qu'ils se font ramener aux campements. <strong>»</strong> 1<br />
Cette <strong>«</strong> neutralisation <strong>»</strong> des <strong>«</strong> collaborateurs de la guérilla <strong>»</strong> prend une ampleur<br />
macabre. De plus, la guérilla utilise la même tactique que les paramilitaires, évite les attaques<br />
directes et se tourne contre les civils 2 : un premier massacre <strong>est</strong> commis par les ACCU les 13<br />
et 14 mai 1995 à Turbo, où 21 personnes sont assassinées . Le 12 août 1995 dans le municipe<br />
de Chigorondó, 18 personnes perdent la vie aux mains des hommes de Castaño. Les FARC<br />
ripostent par trois massacres : à Apartadó le 18 août (5 personnes) à Carepa le 29 (19<br />
personnes) et à Apartadó à nouveau le 25 septembre (24 personnes). Les massacres<br />
deviennent une tactique de guerre courante chez les deux acteurs irréguliers 3 : entre 1991 et<br />
2001 96 massacres enregistrés par les organismes officiels, laissant 597 morts et plusieurs<br />
milliers de réfugiés.<br />
Ce bain de sang tourne à l'avantage des paramilitaires, qui peuvent se targuer fin 1997<br />
d'avoir <strong>«</strong> nettoyé <strong>»</strong> la zone de toute influence subversive. Tous les dirigeants politiques de<br />
gauche sont morts ou en exil et les fronts des FARC se sont repliés vers l'intérieur du pays ou<br />
vers la frontière avec le Panamá 4 . Dans cette campagne meurtrière, les paramilitaires sont<br />
soutenus par la grande majorité des élites économiques, formées principalement par les<br />
industriels de la banane. Ils reçoivent également le soutien actif de l'armée, présente par la<br />
brigade 17 basée dans le municipe de Carepa (département d'Antioquia).<br />
Le témoignage de Raúl Hasbún, industriel bananier accusé d'avoir formé et commandé<br />
des groupes paramilitaires en Urabá décrit le réseau économique des ACCU dans la région. Il<br />
affirme ainsi que les propriétaires fonciers payaient 10 000 pesos par hectare à l'année. Les<br />
paramilitaires ne fournissaient pas uniquement de la sécurité contre la guérilla, mais aussi<br />
contre les manif<strong>est</strong>ations de mécontentement des travailleurs. Ever Veloza (Alias H.H.)<br />
commandant du bloc <strong>«</strong> Bananeros <strong>»</strong> des ACCU affirme ainsi : <strong>«</strong> Nous avons réalisé des<br />
1 Castro Caycedo [1996], p. 155<br />
2 Cubides [1997], p. 34<br />
3 Suarez [2007]<br />
4 Martin [1997] § 67<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 94
actions militaires qui ont bénéficié à la production bananière, empêchant la réalisation de<br />
grèves et poussant les employés à travailler sous <strong>notre</strong> menace <strong>»</strong> 1 .<br />
Les narcotrafiquants payaient également de gré ou de force. Le port de Turbo, plaque<br />
tournante du trafic de drogue <strong>est</strong> également sous le contrôle des paramilitaires. Chaque kilo de<br />
cocaïne embarqué était taxé de 50 dollars. Le contrôle sur la région <strong>est</strong> tel que les<br />
paramilitaires ferment à plusieurs reprises la seule autoroute qui traverse la zone – la<br />
panaméricaine – pour s'en servir comme piste d'atterrissage pour les avions transportant la<br />
cocaïne 2 .<br />
Le témoignage de Ever Veloza, fait état des liens entre armée et paramilitaires. Veloza<br />
affirme avoir souvent organisé des patrouilles avec les soldats de la 17e brigade et reçu appui<br />
logistique et informationnel des officiers de l'armée de terre. Il affirme même être allé en<br />
campagne de recrutement dans les installations de l'armée, pour enrôler les jeunes soldats qui<br />
prêtaient alors leur service militaire 3 . Plus tard, entre 1997 et 1998, l'armée lance l'opération<br />
Genèse, qui vise à récupérer les territoires de l'arrière-pays du Chocó zone voisine du fief<br />
paramilitaire. Selon le chef paramilitaires, ses troupes y auraient agit de manière coordonnée<br />
avec l'armée; leur expansion se solde par plus de 1300 meurtres en 2 ans 4 .<br />
En effet, à partir de la domination de la zone de l'Urabá, les ACCU s'étendent<br />
rapidement en direction du r<strong>est</strong>e de la côte caraïbe. Les groupes paramilitaires existants dans<br />
les zones voisines sont intégrés au groupe de Castaño, pour former une véritable armée<br />
organisée en blocs et fronts. L'un des premiers groupes armés intégrés à la structure des<br />
ACCU <strong>est</strong> celui de Salvatore Mancuso, qui depuis 1991 contrôlait le municipe de Tierralta,<br />
dans le département de Córdoba 5 . Mancuso intègre les ACCU en 1996, lorsque Carlos<br />
Castaño, lui confie la mission de créer le <strong>«</strong> Bloc Nord <strong>»</strong>, une structure armée qui aurait<br />
comme mission la <strong>«</strong> libération <strong>»</strong> de toute la région Caraïbe 6 . L'expansion <strong>est</strong> alors réalisée<br />
tous azimuts; durant l'année 1996, des actions armées des ACCU ont lieu dans tout le Nord du<br />
1 Témoignage rendu le 15 avril 2008 dans le cadre du dispositif Justicia y Paz : Verdad Abierta, El<br />
dinero del banano sirvió para financiar la guerra<br />
2 Semana, <strong>La</strong>s confesiones de Raul Hasbún, 10 mai 2008<br />
3 Émission de télévision Contravía, Entrevista con Ever Veloza, 16/09/2008<br />
4 Verdad Abierta, <strong>La</strong> verdad incómoda de HH, 27 octobre 2008<br />
5 Verdad Abierta, El pájaro y los primeros días del grupo Mancuso, 02 mars 2009<br />
6 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.Version libre Salvatore Mancuso, 2006<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 95
département d'Antioquia, le Nord du département du Chocó et les départements de Sucre,<br />
Magdaléna et Cesar. Cela se traduit par un recul territorial de la guérilla dans le nord du pays 1 .<br />
Les Autodéfenses Unies de Colombie (AUC)<br />
En janvier 1997, les principaux commandants des groupes paramilitaires se réunissent<br />
dans une hacienda du municipe de San Pedro de Urabá, au Nord du département d'Antioquia.<br />
Cette réunion <strong>est</strong> organisée par l'initiative des ACCU de Castaño et vise à coordonner l'action<br />
des paramilitaires dans le pays. Une stratégie commune <strong>est</strong> alors arrêtée; la décision <strong>est</strong> prise<br />
de s'approprier des territoires de la guérilla au Sud et à l'Est du pays 2 . Quelques mois plus<br />
tard, le 18 avril 1997 les principaux chefs paramilitaires du pays annoncent la création des<br />
Autodéfenses Unies de Colombie, les AUC 3 . Elles sont formées par les ACCU, les<br />
autodéfenses de Puerto Boyacá, les Autodéfenses de Ramón Isaza et les Autodéfenses des<br />
Plaines Orientales. L'année suivante, au mois de mai, une <strong>«</strong> Deuxième conférence nationale<br />
de dirigeants et commandants des AUC <strong>»</strong> 4 entérine l'adhésion de nouveaux groupes, les<br />
Autodéfenses de Santander et du Sud du Cesar, les Autodéfenses du Casanare et les<br />
Autodéfenses du Cundinamarca. Pour F. Cubides, la galaxie paramilitaire se réunit sous une<br />
même bannière dans le but de se présenter comme une organisation au commandement unifié,<br />
une stratégie nationale et un seul agenda. Le but des AUC <strong>est</strong> d'établir un espace de<br />
négociation avec l'État et d'obtenir la reconnaissance de leur statut politique; cela les<br />
protégerait de poursuites judiciaires pour leurs crimes et surtout de l'extradition pour trafic de<br />
drogues que demande le gouvernement étasunien 5 . En outre, cette réunion des groupes<br />
d'autodéfense répond également à la recrudescence du conflit armé dans le pays. En effet, les<br />
FARC-EP passent, entre 1995 et 1998, de la guerre de guérillas à la guerre de mouvements,<br />
emportant des succès inédits contre l'armée 6 . Ce groupe démontre sa puissance de feu et sa<br />
maîtrise du territoire en 1996, lorsqu'il attaque la base militaire de <strong>La</strong>s Delicias en 1996, tuant<br />
une partie des militaires en place et prenant le r<strong>est</strong>e en otages 7 . Du r<strong>est</strong>e, il ne faut pas croire<br />
1 Salazar [1999]<br />
2 Déclarations du paramilitaire Pedro Conde Anaya, Radicado 218. 19 de mayo de 1998, Fiscalía,<br />
Unidad de derechos humanos. Audience au Sénat de la République concernant les faits de Mapiripan,<br />
19 septembre 2006<br />
3 Première conférence nationale de dirigeants et commandants d'autodéfenses paysannes, Urabá 18<br />
avril 1997<br />
4 Urabá, 16 mai 1998<br />
5 Cubides [1999]<br />
6 Pécaut [2008a], p. 49<br />
7 <strong>La</strong>ir [2000], p. 518<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 96
que les AUC sont un groupe unifié sous un seul commandement; il s'agit plutôt, comme<br />
l'explique S. Mancuso devant ses juges, d'une <strong>«</strong> confédération <strong>»</strong> de groupes paramilitaires où<br />
chaque intégrant garde une large autonomie. Les différents <strong>«</strong> Blocs <strong>»</strong> ou <strong>«</strong> Fronts <strong>»</strong> gardent le<br />
contrôle sur leurs finances et leurs décisions stratégiques. Ils s'engagent uniquement à verser<br />
une <strong>«</strong> franchise <strong>»</strong> à l'état major. Comme son nom l'indique, cette contribution leur donne le<br />
droit d'utiliser le nom de l'organisation et d'être représentés dans les négociations avec le<br />
gouvernement. En outre, cet argent sert à la politique d'expansion de l'organisation,<br />
permettant la création de nouveaux fronts 1 .<br />
Les AUC commencent à partir de 1997 une stratégie d'expansion sans précédent. Elles<br />
renforcent leurs positions dans le Nord et l'Est du pays, contre les guérillas mais aussi contre<br />
d'autres groupes paramilitaires qui ne sont pas rentrés dans l'organisation. Elles s'aventurent<br />
alors dans des zones qui étaient jusqu'alors hors de leur contrôle ou qui étaient fermement<br />
tenues par les guérillas. L'expansion <strong>est</strong> alimentée par l'argent de la drogue, qui permet une<br />
grande croissance du nombre de combattants; ils sont <strong>est</strong>imés à moins de 3000 en 1995 (pour<br />
tous les groupes paramilitaires) et à plus du double en 1999 (pour les AUC) 2 . Lors de cette<br />
expansion, les AUC nouent des alliances avec les militaires, des membres des élites locales et<br />
des trafiquants de drogue.<br />
Cette expansion a lieu pendant que des dialogues de paix se déroulent à San Vicente del<br />
Caguán (Département de Casanare) entre le gouvernement d'Andrés Pastrana et les FARC-<br />
EP. Débordé par l'expansion de la guérilla, le président issu des élections de 1998 accepte de<br />
démilitariser cinq municipes dans le Casanare 3 ; il s'agit d'une zone de plus 42 000 km 2 . Très<br />
vite, il semble évident que les FARC-EP n'ont aucun intérêt dans le processus de paix, mais<br />
qu'elles entendent simplement utiliser la zone à des buts stratégiques 4 . En effet, à partir de la<br />
région elles lancent des offensives contre des objectifs stratégiques dans les départements<br />
voisins 5 . Cette position stratégique leur permet même d'avancer vers Bogotá. Ils prennent<br />
alors le Sumapaz, massif montagneux de près de 4000 m d'altitude qui domine le haut plateau<br />
de Bogotá. En 2000, ils y auraient amené, selon l'armée, plus de 1000 combattants 6 . Selon<br />
Romero, l'utilisation des FARC-EP des négociations avec Pastrana auraient contribué à des<br />
1 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.Version libre Salvatore Mancuso, 2006. Voir<br />
annexe 1. Sources écrites<br />
2 Voir figure 1.1<br />
3 Pécaut [2008a], p. 48<br />
4 Ibidem, p. 49<br />
5 Idem<br />
6 León [2005], p. 249-250<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 97
nouveaux processus de polarisation. De la même manière que pendant les négociations de<br />
Betancur, une rupture entre le gouvernement et les militaires se serait soldé par l'appui de ces<br />
derniers aux paramilitaires. De plus, certains secteurs des élites régionales, dont les propriétés<br />
et la vie sont de plus en plus menacés par la guérilla, se seraient joint à ces collusions 1 . <strong>La</strong><br />
principale différence avec les années 1980 <strong>est</strong> l'autonomie dont jouissent alors les AUC. Elles<br />
ne sont plus uniquement un élément de la guerre contre-insurrectionnelle menée par l'armée,<br />
mais un acteur aux objectifs propres qui peuvent les distancier ou les rapprocher de leurs<br />
partenaires. Il semble donc que ces collusions de fin de siècle soient caractérisées par un plus<br />
haut degré d'instabilité.<br />
L'examen du massacre de Mapiripán commis par les AUC récemment créées illustre<br />
bien le type de rapports qu'entretiennent alors militaires et paramilitaires. Ce massacre, bien<br />
documenté grâce aux enquêtes de la Cour Interaméricaine de Droits Humains et de la<br />
Commission de Droits Humains du Sénat colombien a lieu au début de la phase d'expansion<br />
des AUC et au milieu de la poussée militaire des FARC-EP, avant le début des négociations.<br />
Le 12 juillet 1997, deux avions décollent des aéroports militaires d'Apartadó et Necoclí,<br />
situés sous la juridiction de la brigade XVII de l'armée de terre, au sein de la région de<br />
l'Urabá. L'un des deux avions transporte près de 120 hommes des AUC et l'autre <strong>est</strong> chargé<br />
d'armes, provisions et équipements militaires 2 . Les hommes sont en habits de civils, mais ils<br />
sont accompagnés par des militaires, ils ne font donc l'objet d'aucun contrôle 3 . Les deux<br />
avions traversent plus de 1000 kilomètres jusqu'à la base militaire de San José del Guaviare<br />
(département du Guaviare), à l'Est du territoire colombien. Il s'agit d'un aéroport fortement<br />
militarisé, car il constitue la base du plus grand bataillon anti-drogues du pays. Plusieurs<br />
véhicules rentrent dans l'aéroport pour rejoindre les paramilitaires. Ils s'identifient comme des<br />
véhicules de l'armée et ne sont pas inquiétés 4 . Dans les mêmes installations de l'armée, les<br />
combattants prennent des habits militaires et s'équipent pour le combat. Ils se divisent alors en<br />
deux groupes, l'un prend les voitures et l'autre prend un bateau sur le fleuve Guaviare. Les<br />
deux groupes passent des points de contrôle militaires sans être arrêtés : <strong>«</strong> Je suis allé avec<br />
René jusqu'au barrage, nous étions tous les deux armés, il a parlé avec un sergent et nous<br />
sommes tous passés <strong>»</strong> 5 . Les deux groupes de combattants arrivent à leur d<strong>est</strong>ination le 14<br />
1 Romero [2003], p. 223 et suiv.<br />
2 Déclarations du général Jaime Uscátegui, Audience au Sénat...<br />
3 Déclarations du carabinier Obaldo Arrieta, Audience au Sénat...<br />
4 Déclarations du contrôleur aérien Mauricio Becerra, Audience au Sénat...<br />
5 Déclaration d'Edison Londoño Niño, Audience au Sénat...<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 98
juillet; il s'agit d'un hameau rural appelé Charras séparé par le fleuve Guaviare de la petite<br />
ville de Mapiripán. Aux premières heures du lendemain ils traversent le fleuve et rentrent<br />
dans la ville 1 . Elle <strong>est</strong> alors dépourvue de toute protection armée, car les troupes et les<br />
officiers de police qui y étaient en poste avaient quitté les lieux la veille, par ordre du<br />
commandement militaire 2 .<br />
À leur arrivée, les paramilitaires obligent les habitants à sortir de leurs maisons et les<br />
rassemblent sur la place centrale du village. <strong>«</strong> Les témoignages des survivants indiquent que<br />
le 15 juillet, les AUC choisissent 27 personnes identifiées par eux comme étant des présumés<br />
assistants, collaborateurs ou sympathisants des FARC; ces gens là furent torturés et<br />
dépecés <strong>»</strong> 3 . Les paramilitaires r<strong>est</strong>ent dans le village jusqu'au 20; pendant ces cinq jours <strong>«</strong> ils<br />
ont torturé, dépecé, vidé de leurs viscères 49 personnes et jeté leurs r<strong>est</strong>es au fleuve<br />
Guaviare <strong>»</strong> 4 . Malgré les appels d'un employé de l'office de justice au bataillon Joaquín París,<br />
les soldats n'arrivent au village que le 23 juillet, quand les paramilitaires sont partis depuis<br />
trois jours 5 . Pendant ce temps là, ils font demi tour sur le fleuve Guaviare, s'éloignant de<br />
Mapiripán. Le même jour que l'arrivée des soldats, les paramilitaires établissent un<br />
campement à Puerto Arturo, près du bataillon de San José del Guaviare. Un poste avancé du<br />
bataillon le signale à sa hiérarchie, sans qu'il n'y ait aucune réaction 6 . Le même jour, le poste<br />
informe le bataillon de l'avancée d'une colonne des FARC-EP qui se dirige par le fleuve vers<br />
le lieu de campement des paramilitaires; ils ont été informés du massacre et cherchent à<br />
riposter. Le bataillon réagit immédiatement et envoie une brigade mobile dans une opération<br />
coordonnée avec l'armée de l'air, l'opération Araignée, pour empêcher l'avancée des<br />
guérilléros 7 .<br />
Interrogé par la presse, Carlos Castaño accepte sa responsabilité pour le massacre mais<br />
affirme qu'il s'agissait d'un combat victorieux où beaucoup de combattants de la guérilla<br />
avaient été exécutés. Il déclare alors <strong>«</strong> il y aura beaucoup d'autres Mapiripán <strong>»</strong> 8 . Le nombre<br />
de massacres augmente fortement; pendant les deux premières années d'existence des AUC,<br />
1 Sénateur Gustavo Petro. Audience au Sénat...<br />
2 Version libre du paramilitaire Edilson Manuel Herrera, Verdad Abierta, 18 janvier 2009<br />
3 Jugement de Cour Intéraméricaine des Droits de l'Homme, condamnation de l'État Colombien pour le<br />
cas du massacre de Mapiripán, 7 mars 2005<br />
4 Idem<br />
5 Sénateur Gustavo Petro. Audience au Senat....<br />
6 Déclarations du général Jaime Uscátégui. Audience au Sénat...<br />
7 Idem<br />
8 El Tiempo, Entretien avec Carlos Castaño, 28/09/1997<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 99
plus de 900 personnes perdent leur vie dans des assassinats collectifs, mis en scène de<br />
manière sanguinaire et accompagnés de tortures, viols et déplacements de populations. Des<br />
années plus tard, le chef paramilitaire Ever Veloza parle des massacres comme d'une arme<br />
psychologique, qui induit la peur dans des populations qui seront alors de dociles<br />
collaborateurs 1 . L'utilisation de cette tactique macabre se fait dans la plupart des cas avec la<br />
collaboration plus ou moins active de l'armée, comme l'affirme la Cour Interaméricaine des<br />
Droits de l'Homme dans les condamnations prononcées contre l'État Colombien pour les<br />
massacres de l'Aro ou du Salado 2 . En outre, les anciens combattants citent toujours la<br />
tolérance bienveillante des forces armées et parfois leur aide logistique et organisationnelle 3 .<br />
3. Alliances et polarisation : un cadre d'analyse pour l'évolution du<br />
phénomène paramilitaire<br />
Tout au long de ces deux premiers chapitres nous avons montré comment les alliances<br />
entre professionnels de la violence, élites et militaires, sont des éléments centraux pour<br />
comprendre l'évolution du phénomène paramilitaire. Nous avons également montré que la<br />
polarisation des acteurs autour des processus de paix avec les guérillas, ainsi que des<br />
changements politiques et sociaux dans le pays et de l'évolution du conflit armé sont à<br />
l'origine de la convergence entre des acteurs aux intérêts très différents. Dans les chapitres<br />
suivants, nous appliquerons ces observations à une étude localisée. Or, avant de commencer le<br />
travail empirique, il convient de tirer quelques conclusions de ce qui vient d'être dit. Nous<br />
allons décomposer le processus de polarisation en deux types différents de mécanismes : la<br />
perception de la menace et l'activation d'une limite entre amis et ennemis.<br />
<strong>La</strong> menace<br />
Premièrement, les processus de polarisation que nous observons se caractérisent pas la<br />
perception d'une menace. Les différents acteurs qui rentrent en collusion au milieu des années<br />
1980 voient dans l'incorporation des guérillas à la vie civile une menace pour leurs intérêts.<br />
Avec l'escalade du conflit armé, ces intérêts se voient affectés par la violence subversive,<br />
principalement sous la forme du racket et de l'enlèvement. Dans un texte programmatique, J.<br />
Earl explore différents modèles théoriques pour l'étude de la répression des mouvements<br />
1 Émission de télévision Contravía, Entrevista con Ever Veloza, 16/09/2008<br />
2 22 octobre 1997 et 19 février 2000 respectivement<br />
3Cf. les comptes rendus des anciens paramilitaires dans le cadre du processus de Justice et Paix,<br />
Verdad Abierta<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 100
sociaux 1 . <strong>La</strong> confrontation au cas colombien apporte un soutien empirique à l'hypothèse du<br />
lien entre privatisation de la répression et menace. Au fur et à mesure que la menace semble<br />
plus élevée, nous observons que les acteurs tendent à faire appel à des professionnels de la<br />
violence pour protéger leurs intérêts. De plus, nos analyses tendent à confirmer la relation<br />
inversement proportionnelle entre répression privée et répression étatique. À partir des<br />
données exposées ici nous pouvons affirmer avec l'auteure que <strong>«</strong> si la répression coercitive et<br />
observable de la part d'agents de l'État décline, la répression privée et directe devrait<br />
augmenter <strong>»</strong> 2 . En effet, les conditions politiques internes, ainsi qu'une certaine pression des<br />
instances internationales favorisent la pacification – relative et apparente – des relations entre<br />
les opposants civils et les corps étatiques de répression. Or, cette pacification s'accompagne<br />
d'une augmentation de la violence privée, lorsque les acteurs privilégient les voies de fait et le<br />
contournement des institutions de maintien de l'ordre. On assiste donc à une sorte de<br />
délégation d’activités de violence, par certains acteurs étatiques, vers des acteurs privés, qui<br />
tend à préserver les rapports sociaux antérieurs.<br />
R<strong>est</strong>e la qu<strong>est</strong>ion de la relation entre perception de la menace et passage à la violence.<br />
En effet, si l'on se limite à la perception de la menace on limite la portée explicative de ce<br />
modèle. Pour comprendre la privatisation de la violence, il faut également prendre en compte<br />
la relation entre la catégorie menacée et l'État Les travaux de C. Tilly sur la violence<br />
collective nous apportent quelques éléments fondamentaux pour comprendre ce passage à<br />
l'acte. Il explique que <strong>«</strong> la violence généralement augmente et devient plus saillante dans des<br />
situations d'incertitude croissante. Elle augmente car les gens répondent à des menaces contre<br />
des configurations sociales lourdement chargées de sens <strong>»</strong> 3 . En effet, la menace se conjugue<br />
avec la perte des leviers d'une catégorie sociale sur l'État Dans le cas du processus de paix de<br />
Betancur, on voit que les élites locales s'opposent à une initiative qui leur a été imposée par<br />
l'exécutif. Les militaires aussi, se voient contraints à respecter un cessez-le-feu contre lequel<br />
la plupart d'entre eux s'insurgent. Ainsi, les routines institutionnelles de répression sur<br />
lesquelles se fonde le pouvoir de ces catégories sont bloquées par une politique du centre.<br />
Cela provoque une incertitude qui favorise l'initiative de la violence privée. Nous préciserons<br />
ces mécanismes dans les deux prochains chapitres, dans le cas spécifique du département du<br />
Magdaléna qui a fait l’objet de <strong>notre</strong> travail de terrain.<br />
1 Earl [2003]<br />
2 Ibidem, p. 62<br />
3 Tilly [2003], p. 76<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 101
Entrepreneurs politiques et frontières<br />
Deuxièmement, pour expliquer la polarisation des acteurs il faut identifier aussi le<br />
travail d'entrepreneurs politiques qui jouent sur la menace. Là aussi, Tilly nous aide à<br />
comprendre comment ces acteurs peuvent favoriser le déclenchement de la violence à partir<br />
de deux processus qu'il appelle <strong>«</strong> activation-suppression et incorporation-séparation <strong>»</strong> 1 .<br />
Le premier mécanisme consiste à <strong>«</strong> activer ou désactiver des frontières, des liens et des<br />
récits <strong>»</strong> 2 . Dans le passage à la violence, l'activation d'une séparation ami/ennemi <strong>est</strong><br />
essentielle. Cette limite exclut des individus de la communauté politique et favorise leur<br />
extermination 3 . L'activation de la frontière <strong>est</strong> un travail cognitif sur une catégorie stéréotypée<br />
dont la dangerosité justifie la violence. Nous avons vu dans ce chapitre comment les<br />
opposants au régime sont dépeint comme étant des supports cland<strong>est</strong>ins d'un acteur armé.<br />
Leur dangerosité vient justement de cette cland<strong>est</strong>inité, qui empêche de reconnaître leur vraie<br />
nature. Ce discours justifie non seulement la violence, mais aussi son initiative privée, dans la<br />
mesure où les corps répressifs de l'État ne peuvent s'attaquer à des individus sans une preuve<br />
incont<strong>est</strong>able. Par conséquent, il faut s'attaquer cland<strong>est</strong>inement à ces cland<strong>est</strong>ins. Comme<br />
l'affirme Carlos Castaño en 1997 : <strong>«</strong> Les massacres n'existent pas […], tout ce qu'on fait c'<strong>est</strong><br />
tuer des guérilléros en-dehors du combat <strong>»</strong> 4 .<br />
<strong>La</strong> suppression de la frontière <strong>est</strong> un mécanisme qui justifie la collaboration avec<br />
d'autres acteurs, qui abat des obstacles qui la rendaient improbable. Dans le cas des collusions<br />
avec les professionnels de la violence, les acteurs mettent en avant le caractère exceptionnel<br />
de la situation, la menace terrible et l'abandon des instances publiques. Cette rhétorique de<br />
l'urgence <strong>est</strong> d'autant plus efficace qu'elle fonde le régime colombien. Comme nous l'avons<br />
vu, la dérogation de la légalité dans le cadre de l'état d'urgence devient une forme d'exercice<br />
du pouvoir. Lorsque l'État abat les différences entre le légal et l'illégal, il crée les conditions<br />
pour que d'autres acteurs s'emparent du discours de la <strong>«</strong> sauvegarde de la patrie <strong>»</strong> 5 .<br />
1 Ibidem, p. 77<br />
2 Ibidem, p. 77-78<br />
3 Sémelin [2005], p. 33 : <strong>«</strong> Le premier ressort de leur rhétorique imaginaire consiste à transformer<br />
l'angoisse collective, qui s'<strong>est</strong> plus ou moins propagée dans la population, en un sentiment de peur<br />
intense à l'égard d'un ennemi dont ils vont dépeindre toute la dangerosité <strong>»</strong><br />
4 Verdad Abierta, Defensores de derechos humanos en la mira de los paramilitares<br />
5 On se souvient par exemple que les décrets dérogatoires des libertés civiles, promulgués par le<br />
gouvernement de Virgilio Barco en 1987 s'intitulent <strong>«</strong> Statut en défense de la démocratie <strong>»</strong><br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 102
Le rejet de l'Autre <strong>est</strong> aussi constitutif d'un Nous 1 ; or, ce Nous <strong>est</strong> formé par l'addition<br />
d'autres acteurs. Rentrent alors en jeu les mécanismes d'incorporation/séparation activés par<br />
des entrepreneurs politiques. Ils consistent en la construction d'une coalition d'acteurs autour<br />
d'un ensemble d'intérêts montrés comme capitaux. Puisque ces mêmes acteurs pourraient être<br />
par ailleurs en conflit sur d'autres plans, il faut que les intérêts qui lient la coalition prévalent<br />
sur tous les autres 2 . Un travail politique <strong>est</strong> nécessaire pour construire cette prévalence. <strong>La</strong><br />
polarisation se structure alors autour de quelques enjeux majeurs.<br />
Ces mécanismes sont constitutifs d'un espace social scindé, où la violence devient une<br />
manière légitime d'exercer le pouvoir. D. Pécaut parle d'une <strong>«</strong> banalisation de la violence <strong>»</strong>,<br />
une situation dans laquelle la violence <strong>«</strong> ne se vit pas comme une guerre ou une catastrophe<br />
[…] mais comme un processus banal qui offre des opportunités, produit des arrangements et a<br />
des normes et des régulations <strong>»</strong> 3 . Nous avons vu l'importance des mécanismes cognitifs dans<br />
la production de la violence. Ce qu'il faut remarquer par rapport à cette banalisation de la<br />
violence <strong>est</strong> que les discours concurrents peinent à se faire entendre. Le discours violent<br />
aspire ainsi à l'hégémonie – ne serait-ce que par le processus d'exclusion qu'il met en branle.<br />
<strong>La</strong> polarisation assure cette impossibilité de formulation de discours concurrents. Lorsque la<br />
violence <strong>est</strong> énoncée dans le langage de la nécessité, elle élimine toute possibilité de non-<br />
conformisme avec la vérité qu'elle énonce. Aujourd'hui encore, lorsque l'on demande à un<br />
habitant d'une ville comme Santa Marta qu'<strong>est</strong>-ce qu'il pense des paramilitaires, on a de<br />
bonnes chances de se trouver devant une formule du genre : <strong>«</strong> c'était mieux avant, quand ils<br />
étaient là. Aujourd'hui on vit dans le désordre et l'insécurité <strong>»</strong> 4 .<br />
1 Sémelin [2005], p. 33<br />
2 Derriennic [2001], p. 84<br />
3 Pécaut [2001], p. 197<br />
4Propos recueillis de manière informelle. Annotations du journal de terrain , Santa Marta, 13 mars<br />
2009<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 103
Carte 3.1 : Division administrative du département du Magdaléna<br />
Source : Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 104
III. Le département du Magdaléna et les premiers<br />
groupes paramilitaires<br />
L'examen des aspects les plus importants du phénomène paramilitaire en Colombie nous a<br />
permis d'identifier les principaux mécanismes à l'œuvre dans la privatisation de la violence.<br />
L'examen des trajectoires de plusieurs groupes paramilitaires nous a conduit à analyser<br />
l'agrégation complexe d'intérêts qui caractérise ces entreprises de violence. Après ces<br />
développements généraux, nous allons nous pencher ici sur le cas du département du<br />
Magdaléna, qui a fait l'objet de <strong>notre</strong> enquête de terrain.<br />
Carte 3.2 : Le Nord du Magdaléna, entre la Sierra et la mer<br />
Source : Réalisation personnelle à partir de plusieurs cartes de la Fondation Prosierra 1<br />
1 http://prosierra.org/mapas/<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 105
Situé au Nord de la Colombie, sur le bord de la mer Caraïbe, le Magdaléna reçoit son<br />
nom du fleuve homonyme, qui le délimite à l'Ou<strong>est</strong>. Grand comme la Bretagne, le Magdaléna<br />
<strong>est</strong> cependant trois fois moins peuplé 1 . Plus d'un tiers de sa population habite dans la capitale,<br />
Santa Marta 2 . Plus ancienne ville de la Colombie et 3ème port marchand, Santa Marta <strong>est</strong><br />
aussi une des principales villes touristiques du pays. Un autre tiers de la population se<br />
concentre dans les municipes voisins de Ciénaga, Aracataca et Fundación. Le Nord du<br />
département, peuplé par deux tiers des habitants et produisant l'essentiel des richesses<br />
économiques <strong>est</strong> une zone stratégique. Elle se trouve délimitée par la mer, la Sierra Nevada de<br />
Santa Marta, immense massif montagneux et le Grand Marécage (la Ciénaga Grande),<br />
ensemble de marais qui s'étendent vers l'Ou<strong>est</strong> jusqu'au fleuve Magdaléna.<br />
Nous limitons ici <strong>notre</strong> travail à un département, c'<strong>est</strong> à dire à une division de l'espace<br />
construite au sein des institutions. Cette division n'<strong>est</strong> donc pas le fruit des besoins de<br />
l'analyse, mais s'impose au chercheur comme allant de soi. J.-L. Briquet et F. Sawicki nous<br />
mettent en garde contre le risque d'emprunter une catégorie institutionnelle sans s'interroger<br />
sur son sens; ils affirment qu'il faut <strong>«</strong> éviter toute réification de l'espace et prendre en compte<br />
d'autres espaces construits selon des logiques différentes <strong>»</strong> 3 . S'ils signalent que travailler sur la<br />
base de ces découpages <strong>est</strong> souvent légitime, dans la mesure où ils ont des effets de réalité;<br />
cependant, ils invitent les sociologues, à la suite des géographes, à <strong>«</strong> méfier des frontières<br />
institutionnelles et à re-construire les espaces-objets en fonction des problématiques<br />
adoptées <strong>»</strong> 4 . Deux remarques s'imposent dans <strong>notre</strong> cas; d'une part, il <strong>est</strong> vrai que la<br />
structuration des espaces par les limites administratives peut ici être problématique. Dans le<br />
cas du département, on se rend compte que des territoires distincts sont placés sous la même<br />
juridiction; les problématiques du contrôle des populations par les armes sont très différentes<br />
dans le Nord agro-industriel que dans les grandes haciendas du Sud. On sait également que les<br />
réseaux de trafic, l'action d'acteurs armés ou les circulation de troupes transcendent l'espace<br />
départemental. Le cas du municipe pose également des nombreuses qu<strong>est</strong>ions, car il<br />
agglomère souvent des régions et des populations très distinctes. Ainsi, le municipe de<br />
Ciénaga englobe des localités situées en bord de mer ou sur le marais, comme les villages<br />
construits sur des pilotis; il compte également une zone plate dédiée à la production agro-<br />
industrielle et une zone de montagne. D'autre part, il nous semble légitime d'utiliser comme<br />
1 24 182 km 2 et 1 149 917 d'habitants en 2005. Ce qui donne une densité de 47,55 hab./km²<br />
2 415 270 habitants en 2005<br />
3 Briquet et Sawicki [1989], p. 9<br />
4 Ibidem, p. 8<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 106
cadre d'analyse le département, dans la mesure où l'on s'intéresse aux relations entre l'État, les<br />
élites politiques et les paramilitaires. Les arènes de ces interactions sont souvent les<br />
institutions politiques locales. De même, le jeu politique local a lieu à l'intérieur de ces limites<br />
administratives. Enfin, les acteurs appréhendent le territoire au travers de ces catégories.<br />
Ainsi, un commandant va assigner à ses subordonnés certains municipes, reprenant donc les<br />
limites instaurées par l'État<br />
S'il <strong>est</strong> légitime ici d'utiliser le cadre du département, il faudra néanmoins re-modeler<br />
les espaces de l'analyse en fonction des différents qu<strong>est</strong>ionnements qui apparaîtront au fil du<br />
texte. Il s'agit de ne pas prendre les frontières institutionnelles comme des cadres de pensée<br />
venant de soi mais comme des réalités sociales devant faire l'objet d'une problématisation.<br />
Ainsi, il <strong>est</strong> intéressant d'observer la manière dont l'espace local renvoie à des réseaux qui<br />
incluent des acteurs très différents et qui se structurent autour du contrôle des espaces de<br />
décision et de la distribution de ressources 1 .<br />
Partir d'une étude localisée nous conduit également à nous poser la qu<strong>est</strong>ion de<br />
l'articulation entre le local et le national. Suivant le même article de Briquet et Sawicki, nous<br />
affirmerons que le phénomène paramilitaire dans le Magdaléna n'<strong>est</strong> pas le reflet de logiques<br />
nationales ou la simple reproduction des tendances générales. Tout au contraire, l'épaisseur de<br />
l'espace local donne à <strong>notre</strong> cas des caractéristiques singulières; nous ne les analysons pas<br />
comme des variations par rapport à un modèle national établi précédemment, mais comme des<br />
logiques ancrées dans une histoire locale et dans des luttes de pouvoir également localisées.<br />
On voit d'ailleurs que par ces luttes de pouvoir que cet espace local rentre en contact avec<br />
d'autres espaces. En effet, les acteurs politiques ou armés vont mobiliser sur le plan local des<br />
ressources rattachées au plan national ou à d'autres territoires. <strong>La</strong> qu<strong>est</strong>ion <strong>est</strong> alors, nous<br />
disent les auteurs, de s'interroger sur la manière dont les acteurs actualisent les ressources,<br />
dont ces ressources acquièrent sens et efficacité sur le local 2 . Pour <strong>notre</strong> cas, cela signifie par<br />
exemple s'interroger sur la manière dont un entrepreneur de violence tire partie de son<br />
insertion dans des réseaux nationaux et de ses liens avec d'autres entrepreneurs de violence<br />
basés ailleurs pour s'imposer face à ses concurrents.<br />
Dans ce chapitre, nous nous interrogerons sur l'origine des groupes paramilitaires dans<br />
le Magdaléna. Une série de conditions favorisent l'apparition de professionnels de la violence,<br />
1 À ce sujet Briquet et Sawicki [1989] affirment que la métaphore locale <strong>«</strong> renvoie à un espace abstrait<br />
de relations sociales privilégiées entre certains groupes d'agents […]. <strong>La</strong> localité apparaît moins<br />
comme un espace géographique que comme un ensemble de réseaux structurés autour d'enjeux qui<br />
prennent sens localement <strong>»</strong>. p. 9-10<br />
2 Briquet et Sawicki [1989], p. 13<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 107
parmi lesquelles nous citerons des conditions structurelles – géographiques et sociologiques –<br />
et conjoncturelles, principalement le boom de la marijuana. Ces conditions déterminent<br />
l'existence d'une offre de main d'œuvre spécialisée dans la violence. Or, la transformation de<br />
ces bandes armées en groupes paramilitaires nécessite l'apparition d'une demande de la part de<br />
secteurs puissants de la société régionale. Ces secteurs utilisaient déjà les services des<br />
professionnels de la violence. Or, à partir d'un certain moment, ils demandent plus que des<br />
hommes de main pour réaliser des <strong>«</strong> sales besognes <strong>»</strong>; ils font appel à ces spécialistes pour<br />
mener de véritables tâches de contrôle social; cela change fondamentalement les relations<br />
qu'ils entretiennent avec les populations locales et leur forme d'implantation territorial. Ces<br />
développements s'efforceront d'analyser de plus près les mécanismes de perception d'une<br />
menace, de polarisation et d'agrégation d'acteurs que nous avons mis en relief dans les<br />
chapitres précédents.<br />
1. Les conditions d'apparition des professionnels de la violence<br />
Des caractéristiques sociales et physiques de la région doivent être brièvement décrites<br />
avant de traiter de la qu<strong>est</strong>ion des professionnels de la violence. Ensuite, nous montrerons<br />
comment l'économie de la marijuana, génère un besoin de main d'œuvre violente, ainsi que les<br />
ressources nécessaires pour l'armer et la former. L'essor de l'économie de la drogue a comme<br />
conséquence la création d'un véritable marché de professionnels de la violence. Il <strong>est</strong><br />
nécessaire de souligner ici la particularité du département du Magdaléna. Alors que dans<br />
d'autres territoires l'apparition de ces professionnels <strong>est</strong> une conséquence de la demande de<br />
protection de certains secteurs face à la guérilla, dans le Magdaléna l'offre précède la<br />
demande.<br />
Caractéristiques sociales et physiques de la région<br />
Partant des zones de production de cocaïne, profondément cachées dans la végétation<br />
tropicale de la Sierra, il ne faut qu'une journée de marche pour atteindre la mer. Ce sont les<br />
mêmes chemins que les contrebandiers ont empruntés pendant des siècles. Ils ont ainsi<br />
contourné le mercantilisme colonial espagnol et le protectionnisme républicain. Comme dans<br />
d'autres contrées des caraïbes, le Belize par exemple 1 , les conditions naturelles ont fait de la<br />
région de Santa Marta un endroit idéal pour toute sorte de trafics. Il s'y lève le plus haut<br />
massif montagneux littoral du monde, la Sierra Nevada de Santa Marta (dont les plus hauts<br />
sommets, qui atteignent 5775 mètres, se trouvent seulement à 42 km linéaires de la côte).<br />
1 De Vos [1993]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 108
Avec son exubérante flore et ses contours sinueux, qui chutent directement dans la mer, elle<br />
<strong>est</strong> l'endroit idéal pour faire sortir ou rentrer dans le pays tout type de marchandise illicite.<br />
Des eaux calmes et profondes, navigables en toute période de l'année, complètent le tableau.<br />
Photo 3.1. Les premières hauteurs de la Sierra s'élèvent au bord de la mer<br />
Source : Photo de l'auteur<br />
L'histoire des divers réseaux de trafic à Santa Marta commence bien avant l'essor de<br />
l'économie de la drogue. Comme tout le littoral caribéen colombien, elle s'apparente à une<br />
région de frontière. <strong>La</strong> contrebande <strong>est</strong> par exemple la principale activité économique pendant<br />
l'époque coloniale; A. Múnera <strong>est</strong>ime ainsi qu'au XVIIIe siècle, 70% des revenus de la ville<br />
de Santa Marta sont directement issus du trafic 1 . Il considère également que <strong>«</strong> la contrebande<br />
<strong>est</strong> à l'origine des grandes fortunes des élites économiques et du développement des villes,<br />
formant ainsi une forme de vie et un ensemble de valeurs <strong>»</strong> 2 . Ce sont ces mêmes élites qui<br />
tirent le plus grand profit du trafic de la marijuana dans les années 1970. Ces élites sont<br />
extrêmement stables dans le temps. Nous verrons plus loin l'importance de ses réseaux<br />
illégaux pour comprendre le développement de l'économie de la drogue.<br />
1 Múnera [2008], p. 84<br />
2 Ibidem, p. 81<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 109
Malgré l'importance du commerce illégal qui l'insère dans des flux économiques<br />
mondiaux, le Magdaléna r<strong>est</strong>e longtemps isolé du centre du pays. Avant l'achèvement de la<br />
construction du chemin de fer reliant Santa Marta à Bogotá en 1962, le trajet vers la capitale<br />
pouvait durer plusieurs semaines. <strong>La</strong> liaison vers le r<strong>est</strong>e des villes de la région Caraïbe <strong>est</strong><br />
également tardive. <strong>La</strong> route vers Barranquilla date ainsi de 1968 et celle vers Riohacha de<br />
1972 1 . Ainsi, jusqu'aux années 1960 Santa Marta <strong>est</strong> une <strong>«</strong> île entourée de terre, montagne et<br />
mer <strong>»</strong> 2 . <strong>La</strong> liaison avec l'intérieur du pays et avec le r<strong>est</strong>e des villes du littoral favorise<br />
l'arrivée de réfugiés qui fuient les dernières manif<strong>est</strong>ations de la guerre civile où s'affrontent<br />
les Libéraux et les Conservateurs, ainsi que la politique de <strong>«</strong> pacification <strong>»</strong> du général<br />
Gustavo Rojas Pinilla. Ces réfugiés arrivent de l'intérieur du pays, principalement des<br />
départements de Santander, Antioquia, Caldas et Tolima. Ils sont très nombreux dans les<br />
années de la guerre civile à arriver à Santa Marta après un court séjour à Barranquilla,<br />
métropole côtière où il y a très peu de terres disponibles pour l'agriculture. En revanche, le<br />
Nord du Magdaléna dispose des terres de la Sierra, où vivent des populations indigènes<br />
dépourvues de droits légaux sur ces terres. L'arrivée des colons déclenche de fortes violences<br />
contre les autochtones qui sont alors obligés de se déplacer vers des terres plus hautes. Le flux<br />
de colons continue même après la fin de la guerre; cela donne un visage particulier à cette<br />
région : un territoire côtier avec une forte concentration de population andine 3 .<br />
Lorsque l'on sort de Santa Marta en direction du Sud par la route qui suit l'ancien tracé<br />
du chemin de fer, la première ville que l'on aperçoit <strong>est</strong> Ciénaga. Deuxième municipe du<br />
département en importance démographique et économique, elle <strong>est</strong> la porte d'entrée de la<br />
<strong>«</strong> Zone bananière <strong>»</strong> un territoire de plusieurs milliers d'hectares couvert de plantations de<br />
banane 4 . C'<strong>est</strong> la seule région du département dont l'insertion dans l'économie mondiale <strong>est</strong><br />
ancienne. En effet, en 1901 la United Fruit Company y installe une filiale, la Frutera de<br />
Sevilla. Durant tout le XXe siècle cette production – essentiellement d<strong>est</strong>inée à l'exportation –<br />
<strong>est</strong> l'une des principales activités agricoles du département. Cette région fertile <strong>est</strong> entourée<br />
par la Sierra et le Grand Marécage. Au centre et au Sud du département on trouve deux types<br />
différents de paysages; les rives du Magdaléna, où les inondations rendent la terre<br />
extrêmement fertile et, s'éloignant du fleuve, des plaines dédiées à l'élevage bovin extensif.<br />
Dans le Sud et le centre le modèle d'exploitation traditionnel de l'hacienda <strong>est</strong> dominant,<br />
1 Rodriguez Pimienta [2000]<br />
2 Expert 5, cf. Annexe 2, Sources Orales<br />
3 Molano [1988]<br />
4 11 400 ha en 2007 selon Viloria de la Hoz [2008], p 26<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 110
tandis que le Nord du département <strong>est</strong> couvert par des exploitations modernes appartenant<br />
généralement à des grands groupes agro-industriels (dont les plus grands sont Cadavi et<br />
Banacol). Partout l'indice de concentration de la terre <strong>est</strong> élevé, avec 4,3% des propriétaires<br />
concentrant 44% de la terre agricole (977 402 ha) et un indice de Gini de 0,7 1 .<br />
Le Magdaléna <strong>est</strong> un département rural; 31% de la population habite en milieu rural<br />
(25% en Colombie) et le secteur agricole fournit 26% du PIB départemental (9% en<br />
Colombie) 2 . Aux côtés de l'activité agricole, les principaux revenus économiques du<br />
département sont liés aux différents ports. Le plus grand <strong>est</strong> celui de la baie de Santa Marta, le<br />
troisième du pays après Buenaventura et Barranquilla. Le municipe de Santa Marta dispose<br />
d'un deuxième port à Pozos Colorados. Enfin, le port de la compagnie minière étasunienne<br />
Drummond se trouve à Ciénaga.<br />
Les élites de Santa Marta contrôlent depuis l'indépendance du pays – voire parfois<br />
avant – les rouages les plus rentables de l'économie, ainsi que le pouvoir politique. Ce qu'on<br />
pourrait appeler ici des <strong>«</strong> élites traditionnelles <strong>»</strong> sont principalement des familles de grands<br />
propriétaires fonciers (hacendados) possédant des exploitations agricoles dans le centre du<br />
département ou des terres dédiées à l'élevage extensif plus au Sud. Ce sont aussi des<br />
entrepreneurs capitalistes inv<strong>est</strong>is dans la production de bananes, qui constitue, comme nous<br />
l'avons déjà remarqué, la première activité économique du département. Ce sont également<br />
des familles de grands contrebandiers, dont les <strong>«</strong> exploits <strong>»</strong> emplissent de récits la culture<br />
populaire de Santa Marta. Il convient de remarquer ici que l'engagement dans la contrebande<br />
ne semble pas provoquer ici de stigmatisation quelconque. Ces <strong>«</strong> exploits <strong>»</strong> dans l'économie<br />
illégale sont en effet célébrés ouvertement par des individus de noble lignée. Les élites de<br />
Santa Marta ont également été représentées dans l'histoire politique du pays, puisque elles ont<br />
apporté quelques grandes figures au parti libéral. Malheureusement, aucun travail<br />
sociologique n'existe sur ces groupes sociaux, avec des analyses qui pourraient nous permettre<br />
de mettre l'accent sur les rapports conflictuels que certains secteurs de ces élites pourraient<br />
entretenir, sur les alliances et les concurrences.<br />
Beaucoup de ces familles, on l'a vu, se sont également inv<strong>est</strong>ies dans le trafic de<br />
marijuana, elles y ont acquit également un statut central, contrôlant les étapes les plus<br />
rentables du circuit de production et distribution. Cela fait de Santa Marta un cas particulier<br />
dans le pays. En effet, beaucoup d'analystes voient dans l'essor de la drogue un certain<br />
remplacement des élites traditionnelles – celles liées à la grande propriété terrienne<br />
1 Barbosa-Ortega, Renán-Rodríguez et Suárez-Mosquera [2007], chiffres de 2004<br />
2 Viloria de la Hoz [1997], p.16<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 111
principalement – par les nouvelles élites du narcotrafic, composées par des enfants des classes<br />
populaires ayant fait fortune grâce à la cocaïne 1 . Si l'affirmation catégorique de ce<br />
remplacement doit être nuancée, dans la mesure où des secteurs de ces élites traditionnelles<br />
font parfois fructifier leurs capitaux dans la drogue de manière cachée, force <strong>est</strong> cependant de<br />
constater que Santa Marta constitue un cas à part. En effet, il semblerait que les mêmes<br />
familles qui dominent les postes de pouvoir et les rouages de l'économie légale s'enrichissent<br />
avec la drogue; il n'y a pas une concurrence entre une élite traditionnelle et une élite issue du<br />
trafic 2 . En l'absence de sources complètes sur ces qu<strong>est</strong>ions, on peut uniquement exprimer<br />
quelques hypothèses. On peut par exemple lier cette continuité au fait que quelques unes de<br />
ces familles dominantes maîtrisaient depuis longtemps les réseaux de contrebande. Elles<br />
possédaient donc le savoir-faire et le capital social nécessaire au trafic de la drogue. En<br />
réalité, seule la nature de la marchandise cland<strong>est</strong>ine changeait. Le corollaire de cette situation<br />
<strong>est</strong> une haute acceptabilité sociale de l'illégal. On pense par exemple aux grandes fêtes<br />
organisées par les trafiquants pour célébrer l'arrivée à bon port d'une cargaison de drogue;<br />
elles sont publiques et toute la ville se joint aux f<strong>est</strong>ivités. L'acceptabilité sociale de l'illégal<br />
<strong>est</strong> liée également de la qu<strong>est</strong>ion de la corruption; elle n'<strong>est</strong> pas vue comme un mal social à<br />
éradiquer, mais comme la conséquence naturelle de la détention d'une charge administrative.<br />
On pourrait très bien appliquer ici le proverbe qui dit que <strong>«</strong> la chèvre broute où elle <strong>est</strong><br />
attachée <strong>»</strong> 3 . Une explication possible à cela <strong>est</strong> l'isolement dans lequel cette région se trouve<br />
pendant très longtemps; cela rend les institutions de l'État central particulièrement faibles.<br />
Ainsi, lorsqu'une <strong>«</strong> affaire <strong>»</strong> judiciaire éclabousse une figure politique locale elle <strong>est</strong> souvent<br />
issue de l'intervention d'un juge extérieur, tant la justice locale <strong>est</strong> prise dans les mêmes<br />
configurations politico-criminelles que les représentants du peuple 4 . Cela n'a pas uniquement<br />
des effets pratiques, comme la totale impunité dans laquelle vivent les grands personnages du<br />
crime local. Les effets sont également cognitifs; car la justice n'a pas la possibilité de créer<br />
des discours concurrents de celui qui légitime le crime comme mode d'enrichissement et<br />
d'exercice du pouvoir. Des outsiders du champ politique ont bien sûr construit un discours<br />
dénonciateur, comme on le verra plus loin. Or, ils ont très souvent été réduits au silence par la<br />
force des armes ou marginalisés du jeu électoral.<br />
1 Voir par exemple Betancourt et García [1994]; Duncan [2005b]; Rangel [2005b]<br />
2 Expert n°1; Expert n°5. Voir annexe 2. Sources orales<br />
3 Bayart [2006], p. 288<br />
On pourrait établir un parallèle avec ce qu'affirment Bayart, Ellis et Hibou [1997] par rapport à la<br />
perception de la corruption dans certaines sociétés africaines.<br />
4 Expert n°12. Voir annexe 2. Sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 112
Le trafic de drogues dans le Magdaléna<br />
C'<strong>est</strong> dans le piémont de la Sierra et dans ses premières hauteurs (en dessous de 1600<br />
mètres) que les premières plantations de marijuana ont lieu dans les années 1970. L'histoire<br />
du <strong>«</strong> boom de la marijuana <strong>»</strong> (la Bonanza Marimbera) commence en 1961, lorsque le<br />
président Kennedy annonce l'envoi des Corps de Paix en Colombie. Une soixantaine de<br />
volontaires voyagent alors dans le pays pour mener des projets de développement agricole,<br />
d'éducation et de santé. Certains d'entre eux découvrent alors la qualité exceptionnelle de la<br />
marijuana qui pousse de manière sauvage dans la Sierra 1 . Elle <strong>est</strong> baptisée Santa Marta<br />
Golden et quelques volontaires commencent à l'amener dans leur pays. Des réseaux de trafic<br />
se forment alors autour des premiers trafiquants locaux et des trafiquants étasuniens. Selon les<br />
différentes <strong>est</strong>imations, entre 120 000 et 150 000 ha de forêt tropicale dans la Sierra sont<br />
détruits pour cultiver la marijuana. Selon un rapport du DAS (l'agence de renseignement) en<br />
1974 80% des agriculteurs de la Sierra produisent de la marijuana et les salaires ont été<br />
multipliés par 6 2 . En 1977 la production de Santa Marta Golden <strong>est</strong> <strong>est</strong>imée à 24 000 tonnes,<br />
produites sur 60 000 ha de terre par 90 000 personnes 3 .<br />
Une telle économie informelle qui dégage d'énormes profits, appelle à une régulation<br />
par la violence 4 . <strong>La</strong> sécurité des réseaux et la régulation du marché <strong>est</strong> garantie par les<br />
Guajiros, habitants de la province du Nord et jouissant d'une réputation séculière de dextérité<br />
dans le maniement des armes. Or, les Guajiros abusent souvent de leur force, tuent des<br />
trafiquants étasuniens et violent les femmes des paysans. Selon F. Silva 5 , ces abus auraient<br />
favorisé la création de groupes autochtones d'hommes en armes, pour rétablir un équilibre et<br />
garantir les droits de propriété. Ces groupes sont financés par les différents entrepreneurs du<br />
trafic, notamment les familles possédantes de Santa Marta qui commencent à s'inv<strong>est</strong>ir dans le<br />
trafic et qui ont le plus grand intérêt à garder l'ordre dans la Sierra voisine. Ce sont les<br />
premiers groupes de professionnels de la violence organisés qui apparaissent dans la Sierra.<br />
<strong>La</strong> plupart de ces groupes sont formés autour de structures familiales.<br />
De cette époque date la célébrité des familles Giraldo et Rojas, qui forment plus tard<br />
des groupes paramilitaires. Ces deux familles trouvent leurs origines dans les migrations des<br />
1 Ce qui suit concernant le trafic de marijuana es en partie tiré de Betancourt et García [1994], la plus<br />
complète recherche publiée sur le sujet.<br />
2 Ibidem, p. 50<br />
3 Viloria de la Hoz [1997]<br />
4 Voir le chapitre 1 sur les liens entre trafic des drogues et régulation violente. On y commente les<br />
travaux de Duncan [2005b]; Koop [1995]; Rangel [2005b]<br />
5 Expert n° 6, voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 113
années 1960, composées, comme nous l'avons déjà souligné, de réfugiés ayant fuit les<br />
violences partisanes qui font encore rage dans les régions andines. Hernán Giraldo et Adam<br />
Rojas arrivent à la Sierra à cette époque-là. Ce sont des paysans pauvres des départements de<br />
Caldas et Tolima respectivement. Après avoir repoussé par l'intimidation les indigènes vers<br />
les terres hautes, ces colons auraient colonisé une partie de la Sierra, où ils cultivent d'abord<br />
des cultures vivrières, ensuite de la marijuana. Lorsque commencent les violences avec les<br />
Guajiros, Giraldo et Rojas auraient, comme beaucoup d'autres habitants locaux, incité leurs<br />
voisins à s'organiser et s'armer. Les allers-retours entre les profits de la drogue et la maîtrise<br />
des armes leur auraient permis de former des petites armées privées et de contrôler des routes<br />
de transport de drogue. Ils s'établissent chacun sur une sorte de fief propre, Giraldo dans la<br />
région de Guachaca et Buritaca, sur le versant Nord de la Sierra, et Rojas dans la région de<br />
Palmor, sur le versant occidental 1 .<br />
Selon S. Kalmanovitz, le sommet du trafic de marijuana <strong>est</strong> atteint en 1978, lorsque il<br />
rapporte aux nationaux 600 millions de dollars 2 . Les années suivantes il décline lentement,<br />
principalement à cause du développement de la production étasunienne de l'herbe. Pour<br />
autant, cela ne provoque pas la fin de l'économie de la drogue dans la région. Beaucoup de<br />
trafiquants de drogue s'inv<strong>est</strong>issent alors dans la cocaïne; son trafic <strong>est</strong> beaucoup plus rentable<br />
et les conditions naturelles de la Sierra s'y prêtent également. L'épaisse végétation qui couvre<br />
le massif permet d'y cacher les <strong>«</strong> cuisines <strong>»</strong>, comme on appelle les laboratoires de<br />
transformation de pâte de coca en cocaïne. Les routes de trafic suivent le cours des fleuves<br />
Guachaca, Buritaca et Don Diego, navigables sur la plupart de leur cours; la drogue descend<br />
pour être embarquée et les produits chimiques (Permanganate de potassium, peroxyde<br />
d'hydrogène ou acide sulfurique par exemple) nécessaires à sa fabrication sont montés. <strong>La</strong><br />
proximité de la Sierra avec le Venezuela fournit un dernier avantage : la contrebande avec ce<br />
pays <strong>est</strong> historiquement très dynamique. On peut ainsi trouver dans la région, à des prix<br />
considérablement moins chers que dans le r<strong>est</strong>e du pays, le ciment et l'essence nécessaires à la<br />
fabrication de la cocaïne 3 .<br />
P. Zúñiga souligne que la disponibilité d'une main d'œuvre de professionnels de la<br />
violence issus du boom du trafic de marijuana, constitue un des facteurs qui rendent possible<br />
l'apparition de groupes paramilitaires. L'auteure indique cependant que ce facteur doit être<br />
1 Idem<br />
2 Kalmanovitz [1994], p. 15<br />
3 Expert n° 5, voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 114
combiné avec une demande 1 de sécurité de la part de secteurs des élites locales, menacées<br />
alors par l'arrivée des guérillas 2 .<br />
2. <strong>La</strong> polarisation : apparition d'une demande<br />
Sur ce point, nous suivons les travaux de Zúñiga, dans la mesure où l'on voit une<br />
transformation fondamentale de ces groupes au milieu de la décennie 1980. En effet, lorsque<br />
des bandes armées travaillent pour un narcotrafiquant, elles se limitent à utiliser la violence –<br />
ou la menace de celle-ci – pour défendre les propriétés de leur employeur ou lui donner un<br />
avantage comparatif dans un champ très concurrentiel. En revanche, lorsque ces groupes<br />
s'allient avec d'autres secteurs de la société régionale dans le but de protéger leurs intérêts<br />
politiques ou économiques, leur tâche devient plus ample. Il ne s'agit plus de protéger des<br />
personnalités saillantes du monde du crime, mais de sécuriser des territoires contre l'influence<br />
de la guérilla. Pour sécuriser ces territoires il faut contrôler la population, empêcher la guérilla<br />
de nouer des liens avec les habitants et <strong>«</strong> nettoyer <strong>»</strong> la zone des individus suspectés de<br />
soutenir le projet politique de la gauche révolutionnaire.<br />
L'apparition d'une demande dans les secteurs possédants de la société locale doit être<br />
étudiée de plus près. Nous verrons ici deux aspect de cette demande : l'arrivée de la guérilla<br />
dans le département et les fortes mobilisations sociales qui ont lieu dans les mêmes années.<br />
Ces deux facteurs nourrissent un sentiment de menace.<br />
<strong>La</strong> guérilla dans le Magdaléna au début des années 1980<br />
<strong>La</strong> Sierra constitue pour la guérilla un point stratégique au même titre que pour les<br />
contrebandiers d'antan et les narcotrafiquants d'aujourd'hui. Le front 19 des FARC-EP arrive à<br />
la Sierra au début de la décennie 1980. Le massif constitue une base arrière stratégique à<br />
partir de laquelle il <strong>est</strong> facile de lancer des opérations éclair avant de retourner se cacher dans<br />
les profondeurs de la montagne. Son contrôle permet à la guérilla de réclamer un impôt sur le<br />
transport et l'embarquement de drogue, ressource qui remplit les caisses de l'organisation.<br />
Selon les données officielles, en 1987 les FARC-EP ont déjà consolidé le contrôle de la Sierra<br />
à partir des principaux fleuves qui descendent vers les terres plates, comme le Piedras,<br />
l'Aracataca et le Fundación. Cela leur permet d'assurer leur emprise sur les municipes situés<br />
sur le piémont de la Sierra, comme Ciénaga et Fundación. Les seules zones de la Sierra qui<br />
1 Sur le modèle d'offre et demande pour comprendre les groupes d'entrepreneurs de violence voir<br />
Gambetta [1992]<br />
2 Zuñiga [2007], p 285-286<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 115
échappent à leur emprise sont le versant Nord, contrôlé par la famille Giraldo et la région de<br />
Palmor, près du fleuve Sevilla. À ce moment là, l'organisation commence à racketter les<br />
entrepreneurs de la zone bananière et les éleveurs du centre du département. Cela alimente les<br />
finances de la guérilla, et permet aux FARC-EP de créer le front 41, augmentant sensiblement<br />
son influence 1 .<br />
<strong>La</strong> guérilla du l'ELN a une présence plus réduite. Elle arrive dans le département au<br />
milieu des années 1980 attirée par la richesse de la Zone bananière et par la ligne ferroviaire<br />
qui transporte le charbon du Cesar vers Ciénaga. Ses membres sont actifs sur les terres plates<br />
du département, où ils rackettent les entrepreneurs et les éleveurs. Ils nouent des liens forts<br />
avec les populations de la Zone bananière et du Grand Marais 2 . Cette implantation leur permet<br />
de contrôler le couloir stratégique qui descend de la Sierra vers la mer, traverse la Zone et<br />
arrive à la côte par le Grand Marais. Ce couloir permet le transport de drogue et donne accès à<br />
la route qui relie Santa Marta à Barranquilla. Cette route <strong>est</strong> dans les années 1990 le lieu<br />
d'enlèvements massifs qui terrorisent les classes aisées de ces deux villes. Il en <strong>est</strong> de même<br />
pour la route qui relie Santa Marta à l'intérieur du pays. Nous verrons plus loin l'ampleur du<br />
phénomène de l'enlèvement contre rançon et son importance pour comprendre le déroulement<br />
de la violence.<br />
D'autres groupes de moindre importance sont également présents dans le département,<br />
comme l'EPL (Ejército Popular de Liberación – Armée Populaire de Libération) et le CRS<br />
(Courant de Rénovation Socialiste), une dissidence de l'ELN.<br />
Selon P. Zúñiga, le racket mené par les guérillas incite les classes possédantes à<br />
financer la formation de groupes de professionnels de la violence pour leur propre protection 3 .<br />
Ce racket toucherait l'ensemble des activités économiques du département. Les plus affectés<br />
auraient été les entrepreneurs de la Zone bananière; ainsi, dans les années 1980 l'auteure<br />
décompte 75 homicides contre les administrateurs des exploitations et l'incendie d'au moins<br />
250 propriétés. <strong>La</strong> plupart de ces agressions toucheraient les entreprises étrangères (Dole Fruit<br />
Company et Chiquita) et les exploitations appartenant aux familles puissantes de Santa Marta<br />
(les Vives, Dávila, Pinedo ou <strong>La</strong>couture) 4 . De même, les éleveurs du centre du département<br />
sont victimes d'un racket permanent de la part de la guérilla. <strong>«</strong> L'impôt révolutionnaire <strong>»</strong>,<br />
populairement connu sous le nom de <strong>«</strong> Vacuna <strong>»</strong> (vaccin) <strong>est</strong> calculé en fonction du nombre<br />
1 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001], p 4-5<br />
2 Idem<br />
3 Zuñiga [2004], p. 29<br />
4 Ibidem, p. 31<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 116
d'hectares et de têtes de bétail possédés. Toujours selon P. Zúñiga, ce harcèlement continu a<br />
des effets néfastes sur la production de viande et de lait du département 1 .<br />
Les populations paysannes sont aussi victimes des harcèlements de la guérilla. Plusieurs<br />
témoignages font ainsi état des pratiques de recrutement forcé et de la suspicion permanente<br />
qui pèse sur les individus. Jesús et María racontent ainsi comment ils ont dû quitter leur<br />
parcelle pour éviter que Jesús ne soit amené de force dans les files de l'ELN, comme le<br />
montre cet extrait d'entretien.<br />
<strong>«</strong> Ils (l'ELN) voulaient te faire commettre des erreurs, te faire faire des choses<br />
que tu n'avais pas envie de faire – quel genre de choses? Demande-je. Jesús hésite<br />
à répondre, et María le fait à sa place – Ils voulaient qu'ils prenne les armes et<br />
parte dans le maquis – Il acquiesce et rajoute – Alors celui qui ne voulait pas<br />
s'engager se faisait emmerder, menacer, c'<strong>est</strong> pour ça qu'on a dû partir. <strong>»</strong> 2<br />
<strong>La</strong> guérilla s'en prend aussi aux détenteurs du pouvoir public. Elle menace les maires,<br />
au point où ils doivent parfois s'installer dans la capitale du département et gouverner à<br />
distance. En 1994 l'ELN assassine le maire de Chibolo, dans une action qui semble à la fois<br />
relever de la violence contre l'État et de l'intimidation des habitants. Omar, habitant du<br />
municipe, s'en souvient :<br />
<strong>«</strong> Ça s'<strong>est</strong> passé à 10h du matin, tout le village s'en souvient, car il [le maire]était<br />
très apprécié […]. <strong>La</strong> guérilla réunit tous les gens et leur annonce qu'il va être<br />
exécuté. Le commandant, qui s'appelait Efraín, demande si quelqu'un a quelque<br />
chose à dire. Tu parles, tout le monde était mort de trouille. Comme personne ne<br />
dit rien ils le tuent devant tout le monde. <strong>»</strong> 3 .<br />
Comme on le verra plus loin, c'<strong>est</strong> dans ces années-là, au milieu de la décennie 1990,<br />
que la guérilla atteint le sommet de son pouvoir dans le département, contrôlant des pans<br />
entiers du territoire et s'enrichissant des ponctions réalisées sur les activités économiques et<br />
les budgets publics. Il faut maintenant revenir en arrière dans le temps pour analyser une<br />
menace qui touche les entrepreneurs politiques dominants : la mobilisation sociale.<br />
1 Ibidem, p. 30<br />
2 Cas n° 14. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Cas n° 8. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 117
Mobilisation sociale et opposition politique<br />
Comme dans le r<strong>est</strong>e du pays, le Magdaléna a connu une forte agitation sociale à la fin<br />
de la décennie 1970 et pendant la décennie 1980. Des populations urbaines et rurales se sont<br />
mobilisées pour demander une extension de leurs droits et parfois une alternance politique.<br />
Dans ce contexte, certains des leaders urbains se profilent comme des concurrents en<br />
puissance des entrepreneurs politiques installés. <strong>La</strong> menace de transformation du jeu<br />
politique, qui plus <strong>est</strong> par des individus accusés de proximité avec la guérilla, <strong>est</strong> un des<br />
facteurs explicatifs avancés par M. Romero pour l'apparition du phénomène paramilitaire 1 .<br />
Cette thèse, que nous avons traitée dans le chapitre I, <strong>est</strong> issue d'une enquête de terrain<br />
réalisée dans le département de Córdoba. Nos données montrent qu'elle peut aussi s'appliquer<br />
au Magdaléna.<br />
Selon E. Prada, la détérioration de la situation économique à la fin de la décennie 1970<br />
favorise l'essor des mobilisations paysannes 2 ; ces mobilisations prennent la forme<br />
d'occupations de terres revendiquant leur octroi aux paysans. Le Magdaléna <strong>est</strong> selon L.<br />
Zamosc le quatrième département en nombre d'invasions entre 1971 et 1978. Ces actions se<br />
concentrent dans les terres basses de la Sierra, dans la Zone bananière et dans le centre du<br />
département 3 . Elles sont souvent encadrées par une association nationale, l'ANUC<br />
(Association Nationale d'Usagers Paysans 4 ), qui assure également un travail de formation<br />
politique.<br />
Des occupations massives ont lieu dans la Sierra peu après la fin de la construction de<br />
la route vers Riohacha, en 1972. En effet, ces terres faisaient auparavant parti de la réserve<br />
indigène des Tayrona; elles sont donc protégées et ne peuvent être vendues au achetées. Or,<br />
avec la construction de la route, une frange de plusieurs kilomètres autour de l'axe sort de la<br />
réserve. Elles sont alors acquises par des riches famille de Bogotá et Medellín. Or, les paysans<br />
1 Romero [2003]<br />
2 Prada [2002], p. 128<br />
3 Zamosc [1987]<br />
4 L'ANUC <strong>est</strong> issue de la politique de réforme agraire de Carlos Lleras R<strong>est</strong>repo. En mai 1967 s'ouvre<br />
l'enregistrement d'associations municipales. Dans les années suivantes se forment des associations<br />
départementales et finalement l'organisation nationale. En juillet 1970 a lieu le premier congrès<br />
national. (Pécaut 2006 : 81). Issues d'une politique publique, ces associations acquièrent rapidement<br />
une direction autonome (Ibidem : 82). <strong>La</strong> création de l'ANUC <strong>«</strong> vise à donner les moyens aux petits<br />
métayers et fermiers de devenir propriétaires des terres qu'ils cultivent. Cette orientation va se heurter<br />
à une opposition farouche des grands propriétaires, notamment les éleveurs de la côte atlantique <strong>»</strong><br />
(Pécaut 2008b : 163). Dans les années 1970 l'opposition aux partis Libéral et Conservateur <strong>est</strong> presque<br />
nulle. Il n'y a donc pas de possibilités d'intégration de l'ANUC dans un mouvement politique large.<br />
Les associations locales entretiennent des liens avec l'ELN et l'EPL mais pas avec les FARC-EP, qui<br />
r<strong>est</strong>ent <strong>prison</strong>nières du dogmatisme soviétique du PCC (Ibidem, p. 35)<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 118
du piémont, arrivés quelques années auparavant de l'intérieur se mobilisent. Les ouvriers qui<br />
étaient venus travailler dans la construction de la route et qui s'étaient établis dans des<br />
logements de fortune participent également à ces mobilisations. Les revendications sont en<br />
partie satisfaites par le Président Misael Pastrana en personne, avec l'octroi aux paysans de<br />
deux propriétés: la première <strong>est</strong> un complexe touristique appartenant à des inv<strong>est</strong>isseurs<br />
étasuniens situé sur le littoral dans la zone du fleuve Guachaca; la seconde appartient au rival<br />
politique du président, le Général Gustavo Rojas Pinilla 1 ...<br />
Les paysans se mobilisent également pour demander de jouir des services publics<br />
fondamentaux : santé, éducation et infrastructures (routes, électricité). Ces mobilisations<br />
prennent la forme de marches vers les principales villes du département, comme Santa Marta,<br />
Ciénaga, Aracataca et Fundación. <strong>La</strong> plupart de ces marches sont encadrées par les FARC-EP,<br />
qui gagnent ainsi un certain soutien chez les paysans du versant Ou<strong>est</strong> de la Sierra 2 . Or, la<br />
participation de la guérilla à ces actions contribue également à alimenter la thèse de l'ennemi<br />
intérieur, qui prône que toutes les formes d'opposition sont liées à la guérilla. On le verra,<br />
cette perception rend plus aisé le déclenchement de la violence contre les organisations<br />
sociales. En effet, on se souvient que cette thèse de l'ennemi intérieur <strong>est</strong> présente dans les<br />
stratégies contre-insurrectionnelles de l'armée. Elle <strong>est</strong> également largement répandue dans la<br />
société sous la forme d'un discours qui <strong>est</strong> relayé par les principales institutions officielles.<br />
C'<strong>est</strong> le cas des instance étatiques, comme nous l'avons déjà vu, mais aussi de certains<br />
secteurs de l'Église 3 , des partis politiques dominants 4 et des associations patronales 5 .<br />
Des mobilisations urbaines ont également lieu dans la même période. Elles<br />
commencent avec une forte agitation dans les lycées qui rejoint les invasions urbaines de<br />
terres. De la même manière que dans le r<strong>est</strong>e du pays, un cycle de mobilisation débute avec la<br />
grève nationale de septembre 1977 6 . Au début des années 1980 un comité inter-corporatif <strong>est</strong><br />
constitué et des invasions sont organisées dans le Sud et l'Est de la ville. Les terrains situés<br />
1 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Idem. Voir également Renán-Rodríguez [2007], p. 8<br />
3 Cf. le discours du curé de Puerto Boyacá dans le chapitre I. Les tendances les plus réactionnaires de<br />
l'Eglise se retrouvent dans le Moyen Magdaléna associées à des associations cultuelles radicales<br />
comme Tradition Famille et Propriété.<br />
4 Cf. chapitre I. Il convient cependant de remarquer que ces partis ne sont pas des blocs monolithiques,<br />
mais des associations de tendances très diverses. Au sein du parti libéral il y a ainsi des tendances<br />
clairement réactionnaires, comme celle qui soutient les paramilitaires de Puerto Boyacá ainsi que des<br />
tendance progressistes, comme celle du Nouveau Libéralisme.<br />
5 Voir l'analyse que fait Ortiz Sarmiento [2007] des associations patronales en Urabá<br />
6 García [2002], p. 75<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 119
autour de l'Université du Magdaléna sont ainsi occupés par des familles sans toit qui y<br />
construisent des logements de fortune. Ces invasions répondent au grave manque de logement<br />
dans une ville en pleine croissance. Les mobilisations urbaines répondent également à la<br />
mauvaise qualité des services publics domiciliaires. Des collectifs se forment pour réclamer la<br />
construction d'un système d'aqueduc et d'assainissement efficace qui couvre l'ensemble de la<br />
ville. Il convient de rappeler ici que ce sont les années du gouvernement Turbay, qui met en<br />
œuvre une politique de forte répression des mouvements sociaux. Santa Marta ne fait pas<br />
exception. Les récits des participants à ces mobilisations parlent des menaces et des<br />
harcèlements des forces de police. Ils parlent également des manif<strong>est</strong>ations qui se finissent par<br />
des batailles de rue entre policiers et manif<strong>est</strong>ants. Or, il <strong>est</strong> intéressant de souligner que la<br />
violence de ces années là <strong>est</strong> jugée comme modérée comparée à celle des paramilitaires, qui<br />
commence quelque temps plus tard. Comme le dit un ancien militant du Parti Communiste<br />
Marxiste-Léniniste :<br />
<strong>«</strong> Comparé à ce qu'on a vécu après, la répression de ces années là n'était pas si<br />
forte que ça. Certes il y a eu des disparus, mais pas beaucoup. Il y a eu également<br />
des amis à moi, des dirigeants communistes, qui sont partis parce que les mecs du<br />
renseignement les cherchaient. […] Or, les gens des organismes de l'État doivent<br />
faire gaffe. Ces gens là non (les paramilitaires) , ils font ce qu'ils veulent et c'<strong>est</strong><br />
tout <strong>»</strong> 1 .<br />
3. Les premiers groupes de professionnels de la violence<br />
Comme dans le r<strong>est</strong>e du pays, le processus de polarisation favorise la formation d'une<br />
alliance avec des clairs buts politiques autour des paramilitaires. Nous décrirons dans le<br />
chapitre suivant les ressorts de ces collusions; pour le moment, nous verrons quels sont les<br />
groupes de professionnels de la violence qui étaient en mesure de répondre à la nouvelle<br />
demande. Le but ici n'<strong>est</strong> pas de faire un catalogue exhaustif des différents groupes armés du<br />
département. Beaucoup de ces groupes ont une existence éphémère, et disparaissent avant que<br />
leurs hommes n'intègrent d'autres groupes. D'autres se forment de manière circonstancielle,<br />
autour d'un enjeu précis, et se dissolvent aussitôt. De toute manière, ce qui caractérise les<br />
professionnels de la violence <strong>est</strong> la fluidité de leurs trajectoires; ils peuvent passer facilement<br />
d'un groupe à l'autre dans la mesure où les limites entre eux ne sont pas étanches. Nous<br />
traiterons ici de quatre cas de groupes armés qui nous semblent significatifs à plusieurs<br />
égards: d'une part, ce sont des groupes d'une grande longévité ou qui ont constitué de<br />
1 Cas n° 23. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 120
véritables écoles de savoir-faire violents. D'autre part, ils sont de véritables entrepreneurs du<br />
contrôle social, dans la mesure où ils ne s'engagent pas uniquement dans une violence<br />
ponctuelle mais dans un contrôle permanent des populations et des territoires. Les sources<br />
sont rares sur cette <strong>«</strong> préhistoire <strong>»</strong> des groupes paramilitaires. Les sources officielles<br />
comprennent des documents des instances de sécurité, auxquels nous avons eu accès, ou des<br />
rapports de l'Observatoire Présidentiel pour les Droits de l'Homme 1 . Dans les deux cas la<br />
production des données <strong>est</strong> problématique; de plus, les informations sont lacunaires et parfois<br />
douteuses. Les travaux de P. Zúñiga, croisent ces sources avec l'histoire orale et sont<br />
essentiels pour comprendre cette période 2 . Ceux de W. Renán Rodriguez 3 , qui utilisent<br />
principalement l'histoire orale et qui traitent d'une temporalité plus longue, s'arrêtent sur les<br />
conditions socio-économiques et politiques de l'apparition des premiers groupes de<br />
professionnels de la violence; ils apportent à ce titre des compléments d'information. En outre,<br />
les entretiens réalisés avec ces deux auteurs nous ont permis de creuser certains points<br />
importants 4 . Enfin, quelques sources de presse et l'assistance à quatre audiences judiciaires<br />
complètent ces informations.<br />
Les Chamizos<br />
Les Autodéfenses du Mamey ou Chamizos apparaissent autour de1982 sur le versant<br />
Nord de la Sierra, entre les fleuves Don Diego et Piedras. Elles se forment autour d'Hernán<br />
Giraldo, arrivé en 1969 dans la Sierra en provenance du département de Caldas et ayant fait<br />
fortune pendant le Boom de la Marijuana. Giraldo, aidé par ses nombreux enfants fournit<br />
alors la sécurité aux narcotrafiquants qui cultivent et transportent l'herbe sur ces zones de<br />
contrôle. Avec l'essor du trafic de cocaïne, Giraldo devient une pièce clé pour le contrôle de<br />
production de la feuille de coca, mais surtout de transformation et transport 5 . Dans le contexte<br />
de violence qui caractérise les années de la marijuana, Giraldo réussit à acquérir le monopole<br />
des armes sur tout le versant Nord 6 . Il agit alors comme régulateur de la sécurité, ce qui lui<br />
vaut l'appui de narcotrafiquants mais aussi des paysans 7<br />
1 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001]; Observatorio Presidencial para los<br />
Derechos Humanos [2006]<br />
2 Zuñiga [2004]; Zuñiga [2007]<br />
3 Renán-Rodríguez [2007]<br />
4 Voir annexe 2. Sources orales<br />
5 Zuñiga [2007], p. 296<br />
6 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001], p. 9<br />
7 Voir chapitre suivant<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 121
Giraldo s'affronte avec les FARC-EP à partir de 1987 pour le contrôle du versant Nord.<br />
L'offensive des guérilléros <strong>est</strong> très forte, mais ils sont arrêtés par les hommes de Giraldo au<br />
niveau du fleuve Guachaca. Ils sont ensuite repoussés à l'Ou<strong>est</strong> au-delà du fleuve Manzanares,<br />
près de la zone urbaine de Santa Marta et à l'Est jusqu'à Dibulla, dans le département voisin<br />
de la Guajira 1 . Giraldo contrôle alors le versant Nord du niveau de la mer jusqu'aux 900<br />
mètres 2 . Il lance alors l'offensive sur le versant occidental, réussissant à acquérir le contrôle<br />
des zones plus hautes des municipalités de Santa Marta et Ciénaga 3 .<br />
<strong>La</strong> particularité de l'organisation des Chamizos <strong>est</strong> la volonté de contrôler l'ensemble<br />
des espaces de pouvoir de la société. Cette organisation n'agit pas comme une simple bande<br />
armée qui s'enrichit du trafic et du racket mais au contraire comme un véritable acteur du<br />
contrôle social. Ainsi, les activités du narcotrafic sont effectuées avec la plus grande<br />
discrétion, car Giraldo s'efforce de mettre l'accent sur l'aspect de contre-insurrection et g<strong>est</strong>ion<br />
de la sécurité 4 . Il accapare les différents lieux d'organisation sociales 5 s'efforce de montrer son<br />
organisation comme une sorte de mouvement paysan indépendant de tout pouvoir extérieur à<br />
la Sierra 6<br />
L'implantation territoriale du groupe armé suit de près la carte des intérêts économiques<br />
du département. En effet, les Chamizos s'implantent principalement dans les zones qui<br />
représentent un intérêt économique majeur. Nous l'avons déjà souligné pour le versant Nord<br />
de la Sierra et le trafic de cocaïne; il en <strong>est</strong> de même pour la zone bananière et pour les zones<br />
de production de café dans les terres basses du massif 7 . Ils deviennent alors des marchands de<br />
sécurité, ce qui leur apporte des profits matériels – les <strong>«</strong> contributions <strong>»</strong> – et symboliques –<br />
une certaine légitimation dans la mesure où ils protègent les secteurs possédants du racket et<br />
de l'enlèvement de la guérilla et des agressions de la délinquance. Comme le dit un des<br />
professionnels de la violence interviewés par Zúñiga :<br />
<strong>«</strong> Au début on ne s'intéressait qu'au secteur de production et transformation de la<br />
coca, ainsi qu'aux ports naturels par lesquels nous sortions l'alcaloïde; or, <strong>notre</strong><br />
façon d'agir dans ces zones nous a conduit à acquérir une certaine célébrité, qui<br />
1 Renán-Rodríguez [2007], p. 5<br />
2 Arenas Granados [2005], p. 293<br />
3 Zuñiga [2007], p. 297<br />
4 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001], p. 9<br />
5 Ce qu'affirme également Arenas Granados [2005]<br />
6 Combattant 3. Voir annexe 2, sources orales.<br />
7 Zuñiga [2004], p. 43<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 122
s'<strong>est</strong> étendu par tout le territoire, ce qui nous a amené à établir des relations avec<br />
d'autres secteurs économiques qui ont décidé d'acquérir nos services pour<br />
protéger leur propriété, surtout les haciendas et les plantations de banane <strong>»</strong> 1 .<br />
Les Autodéfenses de Palmor (ADP)<br />
L'essor du trafic de drogues favorise également l'apparition des ADP, une structure<br />
violente dont l'existence <strong>est</strong> enregistrée depuis le début de la décennie 1980 dans le hameau<br />
de Palmor, juridiction du municipe de Ciénaga. Les ADP sont créées par Adán Rojas, en lien<br />
avec le Cartel de Cali, organisation criminelle de l'Ou<strong>est</strong> du pays. Le groupe de Rojas <strong>est</strong> à<br />
l'origine une simple association de professionnels de la violence, vendant ses services aux<br />
trafiquants de drogue et aux exploitants bananiers. Par la suite, il se met à revendiquer<br />
l'étiquette du MAS, assumant ainsi un projet contre-insurrectionnel; il s'allie alors avec des<br />
avec des officiers de l'armée dans le but d'assassiner des personnes suspectées d'être proches<br />
de la guérilla 2 . Selon ces mêmes déclarations, les Rojas sont présents dans la Zone bananière<br />
depuis 1988, ce qui leur permet de vendre leurs <strong>«</strong> services <strong>»</strong> aux entrepreneurs de la région 3 .<br />
Les trajectoires individuelles des enfants d'Adán Rojas témoignent également de cette<br />
insertion de l'organisation dans les réseaux nationaux de lutte contre-insurrectionnelle. Dans<br />
ses versions judiciaires, le fils aîné des Rojas, portant le même prénom que son père, raconte<br />
comment, en 1988, il <strong>est</strong> parti dans un champ d'entraînement dans le Magdaléna Moyen, près<br />
de Puerto Boyacá, pour assister aux cours impartis par Yair Klein, mercenaire israélien<br />
embauché par les narcotrafiquants liés aux Autodéfenses de Puerto Boyacá pour former des<br />
troupes d'élite. De Puerto Boyacá il part dans la région d'Urabá et rentre dans les files des<br />
Tangueros, l'organisation paramilitaire de Fidel Castaño. Au tournant de la décennie il revient<br />
dans le Magdaléna pour travailler avec son père.<br />
Les Cuquecos<br />
Le groupe formé par les frères Durán dans la ville de Fundación, connu sous le nom des<br />
Cuquecos, partage plusieurs traits communs avec les ADP des Rojas : C'<strong>est</strong> un groupe armé<br />
formé originellement dans le but de protéger les membres de la famille engagés dans le trafic<br />
1 Ibidem, p. 42<br />
2 Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza , Camilo<br />
Rojas Mendoza et José Gregorio Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 24 mars 2009 dans le cadre<br />
du procès de Justice et Paix. Fiscal 31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
3 Ibidem, audience du 26 mars 2009.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 123
de drogues qui assume ensuite un projet contre-insurrectionnel en articulation avec des<br />
secteurs des élites économiques et les forces de répression de l'État<br />
Les frères Durán s'engagent dans le trafic de marijuana à la fin des années 1970 avant<br />
de rentrer dans celui de la cocaïne. Ils sont alors associés à une structure criminelle connue<br />
par la presse sous le nom du Cartel de la Côte 1 . Ils forment le groupe des Cuquecos pour<br />
protéger les routes de trafic et les pistes cland<strong>est</strong>ines 2 . L'organisation de leur propre groupe<br />
armé leur vaut alors l'inimitié des FARC-EP, ce qui débouche sur une guerre sanglante entre<br />
les deux organisations 3 . C'<strong>est</strong> alors que les Cuquecos se retournent contre les prétendues bases<br />
sociales de la guérilla, assassinant des leaders politiques de l'UP et des syndicalistes de la<br />
Zone bananière 4 . Ils reçoivent apparemment l'appui logistique et informationnel de l'armée 5 .<br />
À minima, une certaine tolérance officielle <strong>est</strong> att<strong>est</strong>ée. En effet, les autorités acceptent qu'un<br />
des frères, appelé familièrement Le Général, transforme sa maison de Fundación en un<br />
véritable bunker avec des guérites et des mitrailleuses 6 .<br />
Les Durán se lancent également en politique. L'aîné de la famille, Alex, <strong>est</strong> élu<br />
représentant à la Chambre Basse, en partie grâce au mystérieux meurtre de son concurrent, le<br />
conservateur Hernán Gómez. Il tente alors de faire élire son frère, Amadeo, à la mairie de<br />
Fundación, mais reçoit très peu d'appui populaire 7 .<br />
Le groupe des Cuquecos joue un rôle moins important dans l'histoire des professionnels<br />
de la violence de la région dans la mesure où il disparaît dans un affrontement entre<br />
narcotrafiquants. En effet, en 1993, plusieurs des Durán sont assassinés à Santa Marta,<br />
Barranquilla et Bogotá dans une vendetta entre plusieurs membres du Cartel de la Côte 8 .<br />
1 Cf. El Tiempo, 21/02/1993. Cartel de la Costa : <strong>La</strong> historia de una purga. Le journal associe à cette<br />
organisation les noms d'Alberto Orlandez Gamboa <strong>«</strong> El Caracol <strong>»</strong>, Alex Durán (le chef du clan des<br />
Durán), José Manuel <strong>«</strong> El Mono <strong>»</strong> Abello et Salomón Camacho, qui se retrouve plus tard dans les files<br />
des AUC (voir chapitre 5).<br />
2 Selon le même article du journal El Tiempo, la DEA (Drug Enforcement Agency) aurait identifié plus<br />
de cinq pistes cland<strong>est</strong>ines dans le municipe d'Algarrobo, au sud de Fundación. <strong>La</strong> cocaïne des plaines<br />
orientales colombiennes y serait amené pour ensuite être embarqué dans des avions vers l'Europe et les<br />
États Unis<br />
3 Idem<br />
4 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
5 El Tiempo, 28/10/1992. Asesinado el Mico Durán<br />
6 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
7 Idem<br />
8 El Tiempo, 21/02/1993. Cartel de la Costa : <strong>La</strong> historia de una purga.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 124
Cependant, les professionnels de la violence qui ont survécu à la purge ont ensuite intégré<br />
d'autres organisations armées 1 .<br />
Les Cheperos<br />
Dans le années 1980 José María <strong>«</strong> Chepe <strong>»</strong> Barrera, un commerçant et éleveur du<br />
département voisin de Santander s'installe avec sa famille dans le centre du département. Il<br />
inv<strong>est</strong>it ses ressources dans l'élevage de bétail et le transport de marchandises sur le fleuve<br />
Magdaléna, entre le Sud du département et le port de Barranquilla 2 . Il forme à la fin de la<br />
décennie un groupe armé pour soutenir les autorités dans la lutte contre les voleurs de bétail.<br />
Il s'attaque alors à une puissante famille criminelle, les Méndez, qu'il expulse de la zone en<br />
collaboration avec l'armée. Le groupe des Cheperos, comme on les appelle en allusion au<br />
surnom de leur chef, s'occupe alors de fournir la sécurité aux haciendas d'élevage extensif.<br />
C'<strong>est</strong> le tournant de la décennie, époque où les guérillas commencent à enlever les riches de la<br />
région pour demander des rançons. Chepe forme alors des escadrons d'hommes chargés<br />
d'assurer la sécurité de ses <strong>«</strong> clients <strong>»</strong>. Comme le dit un des interviewés de Zúñiga :<br />
<strong>«</strong> Le but était d'armer de 15 à 30 hommes pour défendre et protéger une propriété<br />
en particulier, car il se rend compte que ses amis soufrent le fléau de<br />
l'enlèvement. C'était à l'époque où il y avait tout le débat sur les Convivir, sur le<br />
droit des gens à se défendre, ce qui a ouvert la porte pour que les gens<br />
commencent à s'armer et pour que Chepe et son groupe prennent le contrôle du<br />
Sud du département, pour se protéger de la guérilla <strong>»</strong> 3 .<br />
Malheureusement, peu d'information existe sur ce groupe; établi dans une zone<br />
périphérique du département, les sources de presse sont presque inexistantes 4 . De plus, les<br />
conditions pour un travail de terrain y sont bien plus difficiles que dans le Nord. Les seuls<br />
travaux approfondis sur le phénomène paramilitaire dans le Magdaléna, ceux de Priscila<br />
Zúñiga 5 , dédient seulement quelques lignes à ce groupe, pourtant très important pour<br />
comprendre l'appui du secteur de l'élevage au projet paramilitaire.<br />
1 Ainsi l'affirme un commandant paramilitaire : Comisión Nacional de Reparación y<br />
Reconciliación.Version libre Salvatore Mancuso, 2006<br />
2 El Tiempo, 20/02/2005, Gobierno Desmoviliza A Jefe Para Capturado<br />
3 Zuñiga [2004], p. 45<br />
4 <strong>La</strong> première fois que le nom de Chepe Barrera <strong>est</strong> mentionné sur la presse nationale <strong>est</strong> le jour de sa<br />
démobilisation, en février 2002 : El Tiempo, 20/02/2005. Gobierno demobiliza a jefe capturado. Son<br />
nom n'apparaît guère sur la presse locale (Santa Marta) ou regionale (Barranquilla).<br />
5 Zuñiga [2004]; Zuñiga [2007]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 125
Dans ce chapitre nous avons vu quelles ont été les conditions qui ont favorisé l'apparition des<br />
groupes paramilitaires dans le Magdaléna. Le modèle de l'offre et la demande nous a permis<br />
d'effectuer en lien entre une lecture attentive au temps moyen, qui chercherait ànalyser les<br />
évolutions socio-politiques de la région et une lecture attentive au temps court et aux<br />
stratégies des acteurs. Nous avons ainsi vu l'importance du trafic de drogues pour comprendre<br />
la disponibilité d'un groupe social de professionnels de la violence au début de la décennie<br />
1980. Nous avons également examiné le rôle joué par la perception d'une menace dans les<br />
groupes guérilleros et les mobilisations sociales. Cette perception de menace contribue à un<br />
processus de polarisation qui rapproche les acteurs autour d'un ennemi commun et rend<br />
possible le passage à la violence. Dans les chapitres suivants nous étudierons de plus près<br />
l'évolution de cette violence. À travers ses variations, nous tenterons de comprendre la<br />
manière dont la violence privée devient un outil d'exercice du pouvoir et un mode d'accès à<br />
l'État.<br />
Nous allons découper – d'une manière assez schématique – l'histoire du phénomène<br />
paramilitaire en deux étapes. Une première étape couvrant la période 1988-1995, pendant<br />
laquelle les groupes paramilitaires sont dans une situation de concurrence, avec des limites<br />
fluctuantes mais cependant des arrangements territoriaux. Une seconde étape correspondante<br />
aux années 1996-2005, pendant lesquelles un nouvel acteur armé, les Autodéfenses Unies de<br />
Colombie, conquiert par les armes le monopole de la violence et impose sa domination sur le<br />
département. Ces deux périodes correspondent aux chapitres quatre et cinq. Le dernier<br />
chapitre montrera comment, à partir de la maîtrise de la violence, les AUC conquièrent un<br />
accès aux institutions publiques; cela à des fins politiques et économiques.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 126
IV. Des entrepreneurs en concurrence<br />
Le 4 août 1988 Marcos Sánchez Castellón, candidat aux premières élections pour le poste de<br />
maire de Santa Marta, <strong>est</strong> assassiné en plein jour dans une rue de la ville. Interrogé par la<br />
chaîne Radio Galeón, le commandant de la police, Colonel Pedro Antonio Herrera aurait alors<br />
déclaré que <strong>«</strong> les gens bien ne se font pas tuer <strong>»</strong> et que la mort de Sánchez était liée à sa<br />
supposée appartenance aux FARC-EP 1 . Le lendemain de la mort de Marcos, un tract circule<br />
dans la ville revendiquant l'assassinat au nom du MAS, et accusant le politique de faire partie<br />
de la guérilla 2 . Deux jours plus tôt, le jeune avocat avait organisé un acte qui a beaucoup<br />
marqué la mémoire collective de la ville de Santa Marta. <strong>La</strong> <strong>«</strong> marche des reçus brûles <strong>»</strong>,<br />
comme l'appelle la presse 3 , vit des centaines de personnes brûler leurs reçus d'électricité sur la<br />
place de la Cathédrale pour prot<strong>est</strong>er contre les prix pratiqués par le fournisseur d'électricité.<br />
Cet événement montre la capacité de Sánchez à attirer les foules 4 . C'<strong>est</strong> un fait inédit dans une<br />
ville habituée à un espace politique très fermé, contrôlé par quelques entrepreneurs politiques<br />
souvent apparentés 5 .<br />
Marcos Sánchez était soutenu par l'UP, mais aussi par diverses organisations sociales,<br />
syndicales et étudiantes. Quelques années auparavant, lorsqu'il avait commencé son activité<br />
politique, il avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Cela lui avait<br />
permis de dénoncer la mauvaise g<strong>est</strong>ion des politiques traditionnels et de s'opposer à eux avec<br />
un discours anti-système. Très rapidement, il rassemble un large soutien populaire 6 . Avec la<br />
mort de Marcos Sánchez, nous retrouvons des éléments déjà évoqués. En effet, l'élection des<br />
maires au suffrage universel ouvre une fenêtre d'opportunité dans laquelle les mouvements<br />
politiques apparus dans la foulée du processus de paix de Betancur peuvent s'engouffrer. De<br />
1 Lettre de Robert Raven, de l'American Bar Center à Virgilio Barco, Président de la République de<br />
Colombie concernant l'assasinat de l'avocat Marcos Castellón Sánchez. 14/09/1988<br />
2 El Heraldo, 06/08/1987. Masetos serían los responsables del crimen del abogado samario<br />
3 El Heraldo, 03/08/1987. Marcha de recibos quemados en Santa Marta<br />
4 Sur Marcos Sánchez Castellón, sa trajectoire politique et son assassinat voir :<br />
Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
Cas n°23. Voir annexe 2, sources orales.<br />
Zuñiga [2007]<br />
5 Cf. Rodriguez Pimienta [2000] pour une généalogie des gouvernants de la ville et du département.<br />
6 Cas n° 23. Voir annexe 2, sources orales ; Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 127
plus, nous avons déjà évoqué les cycles de mobilisation qui ont lieu dans le département tout<br />
au long de la décennie : occupations de terres, autant en zone urbaine qu'en zone rurale,<br />
revendications autour de l'accès et de l'efficacité du service public etc... Ces mobilisations ont<br />
deux caractéristiques qui menacent la position dominante de l'élite traditionnelle. D'une part,<br />
elles sont souvent traversées par un rejet des acteurs et des pratiques de la politique, une sorte<br />
d'anti-politique se réclamant du <strong>«</strong> citoyen de la rue <strong>»</strong>. D'autre part, ces mobilisations<br />
permettent l'apparition de nouveaux leaderships, comme celui de Marcos Sánchez. En effet,<br />
elles mettent en contact des organisations très différentes, comme des associations de<br />
voisinage, des organisations paysannes et des syndicats; dans cette diversité, un acteur comme<br />
Marcos Sánchez agit comme médiateur entre ces différentes catégories d'acteurs et tire sa<br />
position privilégié de cette médiation. Ainsi, s'il dispose du soutien de l'UP, il souligne sa<br />
volonté de personnifier une candidature large, dépassant les limites de la gauche<br />
traditionnelle 1 . Le même rôle de médiation <strong>est</strong> joué par la CUT (Centrale Unitaire des<br />
Travailleurs), fondée en 1986. Elle participe à Santa Marta aux manif<strong>est</strong>ations qui réclament<br />
un service public de qualité et aurait fait l'objet de menaces et harcèlements à la même<br />
époque 2 .<br />
L'autre élément avec lequel nous sommes déjà familiarisés <strong>est</strong> le discours contre-<br />
insurrectionnel. Les paramilitaires qui se réclament du MAS <strong>«</strong> exécutent <strong>»</strong> Marcos Sánchez<br />
car il serait un <strong>«</strong> agent de la subversion <strong>»</strong>, un <strong>«</strong> guérillero en civil <strong>»</strong> 3 . Les déclarations du<br />
commandant de la police vont dans le même sens. Nous retrouvons donc la vision de l'ennemi<br />
intérieur et l'identification entre la gauche civile et la subversion armée.<br />
Aussi, nous voyons à l'œuvre deux logiques de violence : la logique militaire et la<br />
logique rétributive. Elles se chevauchent dans le même épisode et correspondent à des acteurs<br />
différents. D'une part, la logique rétributive se rattache au lien entre les paramilitaires et les<br />
membres de l'élite locale qui profitent de ce crime. D'autre part, la logique militaire se<br />
rattache à l'entrée des FARC-EP dans la politique légale par la voie de l'UP; elle <strong>est</strong> une<br />
menace dans la mesure où elle permettrait à l'organisation armée de conquérir des espaces de<br />
pouvoir. On voit donc que les deux logiques convergent dans la qu<strong>est</strong>ion de la participation<br />
politique de l'opposition. <strong>La</strong> plupart des épisodes que nous étudierons sont des mélanges<br />
complexes de plusieurs logiques. Or, dans la plupart des cas il <strong>est</strong> possible d'établir, par<br />
l'analyse des circonstances historiques, qu'une logique prime sur la/les autre/s. Dans ce cas en<br />
1 Cas n°23. Voir annexe 2, sources orales.<br />
2 Cas n°12. Voir annexe 2, sources orales.<br />
3 El Heraldo, 04/08/1987. Masetos serían los responsables del crimen del abogado samario<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 128
particulier on peut affirmer que la logique rétributive prime sur la logique militaire 1 . En effet,<br />
cet outsider de la politique représente un risque élevé et ponctuel pour les entrepreneurs<br />
politiques installés 2 ; en revanche, la guérilla était alors retranchée dans les hauteurs de la<br />
Sierra 3 et n'aurait pas constitué un risque militaire majeur 4 .<br />
Dans les débuts de <strong>notre</strong> période, cette hiérarchie des logiques s'applique. Il <strong>est</strong> encore<br />
possible de lire la violence en privilégiant la logique rétributive. Les choses deviennent<br />
beaucoup plus compliquées par la suite, lorsque logique militaire et rétributive s'entremêlent.<br />
Nous citerons à nouveau Pécaut lorsqu'il affirme que les interférences entre les différents<br />
acteurs expliquent le brouillage des catégories et l'escalade de violence 5 . En effet, lorsque les<br />
guérillas consolident leur contrôle territorial et menacent les centres de production du<br />
département, les logiques rétributive et militaire tendent à s'entremêler. <strong>La</strong> distinction garde<br />
cependant tout son intérêt heuristique, dans la mesure où elle nous permet d'analyser les<br />
différents acteurs et les relations qu'ils établissent entre eux, ainsi que l'incidence de ces<br />
relations sur les variations de la violence.<br />
Il convient de remarquer que dans le département existent plusieurs groupes, guérillas<br />
et paramilitaires. Ils ont certes des zones plus ou moins délimitées, ce qui <strong>est</strong> une nécessité<br />
dans le cadre d'un système de racket et lorsqu'on parle de structures qui contrôlent les routes<br />
du narcotrafic. Or, ces zones sont fluides et changent au gré des affrontements entre des<br />
groupes qui gardent des relations complexes de collaboration et concurrence 6 . De plus, la<br />
guérilla se renforce progressivement dans ces années-là et revendique le statut d'acteur<br />
monopolistique; néanmoins, cela n'exclut pas des collaborations ponctuelles entre guérillas et<br />
paramilitaires, rendues nécessaires par l'engagement de tous les groupes dans le trafic de<br />
drogues 7 . <strong>La</strong> caractéristique fondamentale de ce cycle de violence <strong>est</strong> donc le manque d'un<br />
monopole dans son utilisation.<br />
1 Comme l'affirme aussi Zuñiga [2007], p.293<br />
2 Comme le montre l'étonnement de la presse de l'époque devant les foules que le leader politique<br />
mène: El Heraldo, 03/08/1987. Marcha de recibos quemados en Santa Marta.<br />
3 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001]<br />
4 Selon expert n°1. Voir annexe 2, sources orales<br />
5 Pécaut [2001], p. 116. Voir <strong>notre</strong> chapitre I pour une explication de la notion d'interférences<br />
6 Ainsi l'affirme un rapport de la police judiciaire : Sipol Departamento del Magdalena. Santa Marta<br />
19/02/1999. Oficio n°127. Grupos armados ilegales operando en el departamento del Magdalena.<br />
Teniente Carlos Alexy Quiroga.<br />
7 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 129
Le but de ce chapitre <strong>est</strong> de montrer comment, dans un contexte où le monopole<br />
étatique de la violence <strong>est</strong> fragmenté entre différents acteurs privés, celle-ci devient une<br />
ressource essentielle du jeu politique. Cantonnée jusqu'alors au trafic des drogues, cette<br />
violence <strong>est</strong> mobilisée par les professionnels de la violence pour tirer des profits politiques et<br />
économiques pour eux et pour leurs clients. Nous commencerons par l'examen des premiers<br />
cycles de violence de <strong>notre</strong> période. Ils sont caractérisés par une violence sélective qui répond<br />
à des logiques de rétribution. C'<strong>est</strong> le cas de la violence contre les membres des groupes<br />
politiques d'opposition et d'une violence constitutive d'un système de racket. Ensuite, nous<br />
examinerons les conditions sous lesquelles la violence subit une véritable explosion au<br />
tournant de la décennie. Cette augmentation des niveaux de violence <strong>est</strong> due – nous semble-t-<br />
il – à l'interaction entre la logique militaire et la logique rétributive. Il ne s'agit pas<br />
uniquement d'un changement quantitatif, mais aussi d'une transformation dans les systèmes de<br />
collusion qui en sont à l'origine. Dans une dernière partie nous montrerons comment la<br />
violence privée peut permettre la mise en place de véritables appareils de contrôle social; nous<br />
décrirons alors brièvement le cas d'Hernán Giraldo et de son fief de la Sierra.<br />
1. Violence politique et violence mafieuse<br />
L'époque du boom de la marijuana passée, une grande disponibilité de professionnels<br />
de la violence demeure. Ceux-ci se reconvertissent dans le trafic de cocaïne, qui se développe<br />
et prend immédiatement le relais de la marijuana 1 . <strong>La</strong> participation de secteurs des élites<br />
traditionnelles à l'économie de la drogue les rapproche des professionnels de la violence. Ce<br />
sont des relations d'échange mutuel : les premières font appel aux seconds pour les services<br />
qu'ils peuvent leur rendre; en retour les activités illicites des professionnels de la violence<br />
bénéficient d'un appui politique et sont en partie tolérées 2 . Dans ce contexte, la violence r<strong>est</strong>e<br />
cantonnée aux assassinats sélectifs des opposants du régime et au racket que les paramilitaires<br />
mènent dans leurs zones de contrôle.<br />
Conflit politique et assassinats sélectifs<br />
À partir du milieu de la décennie, de nouveaux mouvements politiques commencent à<br />
jouer un rôle important à l'échelle nationale. C'<strong>est</strong> le cas déjà évoqué de l'UP, mais aussi des<br />
1 L'économie de la cocaïne passe longtemps inaperçue, car elle coïncide avec l'essor du café et de la<br />
marijuana. Cependant, selon Kalmanovitz [1994] l'exportation de cocaïne rapporte déjà en 1978 1960<br />
millions de dollars, près de trois fois les revenus rapportés par la marijuana. Cité par López R<strong>est</strong>repo<br />
[2005] p. 195<br />
2 Zuñiga [2007], p. 293<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 130
organisations Firmes et A Luchar. Les liens que les organisations locales entretiennent avec<br />
ces groupes donnent une dimension nationale à la cont<strong>est</strong>ation 1 . Surtout, les organisations<br />
permettent à des individus mobilisés dans des luttes ponctuelles et localisées d'établir des<br />
liens avec d'autres scènes locales ou avec des scènes nationales. Le bouleversement du jeu<br />
politique <strong>est</strong> visible dès les élections de 1986. Cette année-là se tiennent des élections locales<br />
(assemblée départementale et conseils municipaux); à cette occasion, des politiques de l'UP<br />
rentrent dans les listes du parti libéral, principalement à Santa Marta, Ciénaga, Fundación et<br />
Aracataca. Les libéraux s'inscrivent ainsi dans une stratégie nationale de rapprochement avec<br />
l'UP, dans une optique électoraliste 2 . De plus, ce sont des municipes serranos (qui ont une<br />
partie de son territoire dans la Sierra), et de ce fait l'influence des FARC-EP <strong>est</strong> grande. <strong>La</strong><br />
collaboration avec l'UP peut ainsi répondre à une volonté de r<strong>est</strong>er en bons termes avec une<br />
organisation subversive qui <strong>est</strong> certes en train de négocier la paix, mais qui garde ses armes 3 .<br />
Somme toute, les mouvements politiques d'opposition, et surtout l'UP, ont alors une visibilité<br />
qui dépasse leur poids électoral, faible au demeurant 4 .<br />
<strong>La</strong> thèse d'une identité entre UP et guérilla, qui <strong>est</strong> alors véhiculée par les milieux les<br />
plus réactionnaires doit être nuancée 5 . Le parti attire au moment de sa création des individus<br />
venant d'horizons très divers 6 . Dans le Magdaléna, de nombreux leaders de quartier, des<br />
syndicalistes, des enseignants et des jeunes juristes auraient adhéré au parti 7 . Sa création<br />
ouvre une arène politique dans un territoire séculièrement dominé par les mêmes familles<br />
politiques. Or, les études qui s'intéressent au phénomène national de l'UP montrent que la<br />
création du parti répond également à un dessein stratégique de la guérilla 8 ; dans le<br />
département, beaucoup de membres du parti, auraient été, pour reprendre les mots du fils d'un<br />
militant de l'UP assassiné : <strong>«</strong> des correspondants civils de la guérilla, qui passaient des<br />
informations de tout genre; par exemple des choses liées au commerce ou à l'enlèvement <strong>»</strong> 9<br />
1 Pour les relations entre mobilisation dans le local et construction d'acteurs politiques nationaux voir<br />
Bourdreau [2004], qui réalise une étude comparative des liens entre cont<strong>est</strong>ation et démocratisation<br />
mobilisant les cas philipin, birman et indonésien.<br />
2 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Idem.<br />
4 Idem<br />
5 Sur ce point se référer à Dudley [2004]<br />
6 Pardo Rueda [1996]<br />
7 Cas n°23. Voir annexe 2, sources orales.<br />
8 Dudley [2004]<br />
9 Témoignage d'un proche. Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 131
Quelle que soit la réalité des liens entretenus entre opposition civile et opposition<br />
armée, il <strong>est</strong> certain que la seule évocation de cette relation sert à légitimer la violence 1 .<br />
Quelques semaines après la mort de Marcos Sánchez, Adalberto Pertuz Bolaño, son chef de<br />
campagne, <strong>est</strong> assassiné à Santa Marta. Il <strong>est</strong> également avocat et travaille avec les syndicats.<br />
Il a fait ses armes politiques dans l'UP, parti qu'il rejoint dès sa création 2 . Ces deux meurtres<br />
ouvrent un cycle de violence qui détruit la section locale du parti en quelques années. <strong>La</strong><br />
compagne de Sánchez, qui militait aussi à l'UP, <strong>est</strong> assassinée cette même année 3 . En 1989,<br />
meurt à Santa Marta un autre leader local de l'UP, Humberto Blanco, dont le meurtre <strong>est</strong><br />
revendiqué publiquement par un groupe qui se fait appeler <strong>«</strong> Mort aux Envahisseurs<br />
Communistes <strong>»</strong> 4 . Ce crime finit par démanteler le parti dans la ville. Comme le dit un ancien<br />
compagnon politique de Sánchez Castellón : <strong>«</strong> Il y a eu une baisse très importante dans<br />
l'activité politique à la suite de ces meurtres. Tout le monde avait peur, et personne ne voulait<br />
s'attirer des problèmes <strong>»</strong> 5 .<br />
Les autres villes du département sont aussi le lieu d'une forte violence. Le cas de Juan<br />
Alberto Uribe Meléndez illustre bien cette répression. Avocat et cadre de l'UP à Aracataca, il<br />
participe à la campagne du libéral Fossy Marcos María en 1988. Avec sa victoire aux<br />
élections il devient conseiller juridique et ensuite secrétaire de gouvernement. Il participe<br />
également à la campagne suivante, en 1990, où il soutient le libéral José Rafael Martínez. Or,<br />
au bout de quelques mois, il quitte le poste suite à des menaces contre sa vie. Il <strong>est</strong> assassiné<br />
le 30 juin 1990 chez lui par un commando paramilitaire qui se réclame du MAS 6 .<br />
Un nouveau processus d'organisation politique a lieu dans le département en 1990, à la<br />
suite de la démobilisation du groupe guérillero M-19 et la création du parti Alliance<br />
Démocratique M-19 (AD M-19). Dans tout le pays, ce parti attire des militants de diverses<br />
origines, souvent avec une carrière politique déjà entamée. C'<strong>est</strong> le cas de Ricardo Villa<br />
Salcedo, avocat de Santa Marta, appartenant à l'aile gauche du parti libéral. Il a été plusieurs<br />
fois député à l'assemblée départementale et conseiller municipal 7 . Il <strong>est</strong> élu au Sénat en 1986,<br />
1 Sur la légitimation de la violence contre les mouvements sociaux par leur identification à<br />
l'insurrection armée voir Brockett [2005]. L'auteur réalise une étude de l'articulation entre cont<strong>est</strong>ation<br />
et violence répressive en Guatemala et au Salvador<br />
2 Ibidem<br />
3 Cas n°23. Voir annexe 2, sources orales.<br />
4 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
5 Cas n°23. Voir annexe 2, sources orales.<br />
6 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
7 Dirección Nacional Liberal [1998], p. 211-217<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 132
comme suppléant de Miguel Pinedo Vidal, un <strong>«</strong> cacique <strong>»</strong> traditionnel de la région 1 . À partir<br />
de 1988 il remplace Pinedo Vidal et collabore à la démobilisation du M-19. Il était déjà<br />
proche du mouvement subversif; à partir de sa démobilisation, il en devient une des<br />
principales figures politiques 2 . Alors qu'il se prépare pour les élections législatives de 1990, il<br />
<strong>est</strong> menacé de mort et doit quitter momentanément le pays 3 . Il revient quelques mois plus tard<br />
et continue ses activités politiques à Santa Marta, où il signe de nombreuses tribunes dans la<br />
presse locale et nationale 4 ; il y accuse les politiques en place d'être liés à des affaires de<br />
corruption et met en cause leur g<strong>est</strong>ion. Devenu un personnage politique de poids national, ses<br />
accusations ont un impact important. Les menaces augmentent à ce moment-là; c'<strong>est</strong> ce qu'il<br />
affirme lui-même dans les lettres qu'il adresse aux instances judiciaires pour demander une<br />
protection 5 . Il <strong>est</strong> assassiné le 23 décembre 1992 en centre ville de Santa Marta 6 .<br />
<strong>La</strong> morts de ces leaders politiques a eu une incidence très forte sur les dynamiques de<br />
mobilisation 7 . D'une part, il y a une baisse de l'activité politique d'opposition; les militants de<br />
l'UP ne sont plus présents dans les coalitions municipales et dans les listes pour les Conseils<br />
municipaux 8 . Les militants de l'AD M-19 mènent une activité très discrète mais reçoivent<br />
également des menaces fréquentes 9 . Les syndicats, ont été pendant toute la décennie 1980 des<br />
catalyseurs de la mobilisation sociale, agissant de pair avec d'autres organisations. Or, les<br />
témoignages permettent de penser qu'il y a une adaptation de l'activité syndicale à la<br />
répression des paramilitaires. Ainsi, un syndicaliste, ancien président départemental de la<br />
Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT), affirme :<br />
<strong>«</strong> Avant nous étions dans le trip de la lutte des classes et tout ça. Après on a<br />
commencé à avoir des relations plus proches avec la classe politique. Comme je<br />
te l'ai dit nous avons participé à plusieurs gouvernements municipaux libéraux (à<br />
Santa Marta n.d.t). En fait la conception de la gauche change. Cette histoire des<br />
1 Behar et Villa [1991], p. 27<br />
2 Cas n°15. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Cas n°15. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Voir par exemple son dernier éditorial dans le journal El Informador, 16/12/1992. Corrupción<br />
clientelismo y car<strong>est</strong>ía<br />
5 Dirección Nacional Liberal [1998]<br />
6 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
7 Sur l'articulation entre violence répressive et mobilisation/démobilisation voir Bourdreau [2004] et<br />
Brockett [2005]<br />
8 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
9 Cas n°30. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 133
deux classes antagoniques, bourgeoisie et prolétariat, on laisse tomber tout ça<br />
[…]. Cette stratégie de profiter de nouveaux espaces a été une sorte de carapace.<br />
Je pense qu'on s'<strong>est</strong> approché des politiques en grande partie pour se protéger<br />
des paramilitaires […]. Les organisations sont devenues de plus en plus<br />
perméables vis-à-vis de la classe politique. Tu sais, les politiques ont toujours eu<br />
une relation avec les paramilitaires, du coup ces derniers nous laissaient un peu<br />
plus tranquilles <strong>»</strong> 1 .<br />
Les scissions qui ont lieu dans le mouvement syndical confirment la thèse d'un<br />
rapprochement entre syndicalistes et politiques. Les membres des factions les plus radicales<br />
reprochent aux modérés d'agir par peur; dans les mots d'un syndicaliste de l'industrie agro-<br />
alimentaire :<br />
<strong>«</strong> C'<strong>est</strong> par peur qu'ils se sont vendus aux politiques, par peur des forces<br />
obscures, des paramilitaires, de la répression de l'État. On a subi la pire<br />
violence, mais on a continué à lutter pour les travailleurs. En revanche, eux (les<br />
modérés) ont abandonné la perspective de la lutte des classes et se sont alliés<br />
avec la bourgeoisie. Ça a fait beaucoup de mal au mouvement ouvrier <strong>»</strong>.<br />
Des organisations se forment pour faire face à la violence. C'<strong>est</strong> le cas du Comité<br />
Permanent des Droits Humains, créé à la fin des années 1980 2 . Constitué principalement<br />
d'intellectuels et de juristes, sa création dans le Magdaléna rentre dans le cadre d'une<br />
mobilisation à caractère national en faveur des droits humains 3 . Or, le Comité <strong>est</strong> aussi<br />
victime de la répression, et disparaît en 1992 lorsque la plupart de ses membres sont menacés<br />
et un d'entre eux assassiné 4 .<br />
Qui commet tous ces meurtres? Comme nous l'avons vu avec le cas de Marcos<br />
Sánchez, plusieurs de ces crimes sont revendiqués par la voie de tracts distribués dans la rue<br />
après les faits. C'<strong>est</strong> une stratégie courante des groupes paramilitaires colombiens, mais<br />
souvent il n'<strong>est</strong> pas possible d'avoir accès à ces tracts directe ou indirectement. De toute<br />
manière, ils apportent très peu d'information. En effet, les organisations utilisent diverses<br />
étiquettes, mais celle du MAS revient de manière récurrente. Or, il semblerait qu'aucun<br />
groupe n'en ait le monopole. Ainsi, des sources officielles affirment que les Rojas et les Durán<br />
1 Cas n°23.Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Cas n°30.Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Pécaut [2006]<br />
4 Cas n°30.Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 134
utilisent cette étiquette 1 . En outre, les Chamizos d'Hernán Giraldo semblent avoir été<br />
responsables d'un certain nombre de ces meurtres 2 .<br />
On voit ici que le jeu politique se reconfigure du fait de l'usage de la violence comme<br />
un instrument de contrôle. Cette violence détermine les stratégiques politiques qui peuvent<br />
être mises en œuvre par des entrepreneurs politiques extérieurs aux groupes en place. Elle<br />
amène beaucoup à modérer leur propos pour sauver leur peau. De plus, elle marginalise des<br />
mouvements qui semblaient en mesure de capitaliser la vitalité des luttes sociales des années<br />
1970-1980. Alors qu'un outsider des espaces du pouvoir était en mesure de gagner la mairie<br />
de Santa Marta en 1988, la violence désarticule tous ces nouveaux réseaux politiques et établit<br />
des fortes barrière à l'entrée des arènes politiques. L'utilisation de la violence comme<br />
ressource politique frustre les espoirs que certains acteurs politiques portaient sur les réformes<br />
issues des processus de paix avec les guérillas. En effet, il <strong>est</strong> notable de constater que<br />
l'élection des maires et des gouverneurs au suffrage universel n'ait introduit aucun<br />
changement significatif dans les leaderships politiques. Des élections <strong>«</strong> sûres <strong>»</strong> sont garanties<br />
par l'utilisation de la violence.<br />
Des marchands de sécurité<br />
À cette époque, les groupes paramilitaires fonctionnent comme des entreprises gérant<br />
une ressource particulière, la violence 3 . Ils répondent à la demande croissante de sécurité de la<br />
part des élites économiques qui sont alors victimes du harcèlement de la guérilla. Or, les<br />
professionnels de la violence utilisent aussi leur compétence propre pour leur enrichissement<br />
personnel. <strong>La</strong> limite entre le racket et la sécurité privée <strong>est</strong> parfois floue et difficile à établir.<br />
Selon C. Tilly, on peut cependant s'attendre à des comportements différents selon le degré<br />
d'autonomie du racketteur vis-à-vis de ses clients. Lorsque son sort <strong>est</strong> lié à eux, le racketteur<br />
aura tendance à garder le coût du racket à un niveau modéré, de manière à assurer la<br />
rentabilité de l'activité économique de ses clients. En revanche, s'il s'agit d'un racketteur<br />
autonome, il élèvera le coût du racket, sans tenir compte de l'impact sur ses clients 4 . Ce<br />
parallèle entre autonomie et coût nous permet de comprendre en partie les relations que les<br />
paramilitaires entretiennent avec les élites économiques du département, auxquelles ils sont<br />
1 Ainsi l'affirme un rapport de la police judiciaire : Sipol Departamento del Magdalena. Santa Marta<br />
19/02/1999. Oficio n°127. Grupos armados ilegales operando en el departamento del Magdalena.<br />
Teniente Carlos Alexy Quiroga.<br />
2 Idem<br />
3 Ils correspondent sur ce point à la définition de la mafia donnée par Catanzaro [1991]<br />
4 Tilly [2000], p. 105-106<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 135
liés par un partenariat mutuellement profitable et à d'autres <strong>«</strong> protégés <strong>»</strong> moins puissants. Si<br />
l'élimination d'opposants politiques qu'on vient d'examiner s'apparente au premier cas de<br />
figure, les paramilitaires cherchent aussi à maximiser leur profit. Ils créent alors un véritable<br />
<strong>«</strong> système de racket <strong>»</strong>, c'<strong>est</strong>-à-dire d'un <strong>«</strong> mode d'extraction qui se distingue des simples<br />
pratiques d'extorsion par son caractère régulier et organisé et par les services réels ou<br />
imaginaires qu'il garantit à ses " clients " <strong>»</strong> 1 . Le cas des Cheperos semble être un point médian<br />
entre simple racket et partenariat mutuellement profitable; en revanche, les Chamizos, plus<br />
autonomes de leurs clients, poursuivent visiblement leur propre rentabilité avant tout.<br />
Les Cheperos sont à l'origine un groupe de sécurité privé utilisé par les éleveurs pour<br />
lutter contre le vol de bétail en partenariat avec l'armée; ils éliminent alors le petit banditisme<br />
qui était très répandu dans la zone 2 . Lorsque la guérilla commence à racketter ces mêmes<br />
éleveurs, les Cheperos changent de cible, et se tournent contre les insurgés. P. Zúñiga affirme<br />
que les Cheperos jouissent du soutien de la plus grande partie des classes possédantes du<br />
centre et du Sud du département; comme le dit un de ses interviewés:<br />
<strong>«</strong> Les Cheperos, ils nous demandent le paiement d'un service de sécurité... je le<br />
paie avec plaisir, je préfère payer les Cheperos que payer la guérilla qui m'a volé<br />
du bétail, a fait couler des camions entiers de lait qui m'appartenaient et à<br />
chaque fois qu'ils en avaient envie ils venaient, incendiaient la maison de<br />
l'hacienda et harcelaient les travailleurs <strong>»</strong> 3 .<br />
Les guérillas sont très vulnérables dans les zones de plaine 4 . Grâce à cela, et au soutien<br />
des éleveurs, Chepe Barrera contrôle au milieu des années 1990 tout le Sud du département,<br />
jusqu'aux municipes de Plato, Nueva Granada et Ariguaní 5 . Son pr<strong>est</strong>ige et pouvoir sont tels<br />
qu'il fait élire son fils, José Barrera Prada, à l'assemblée départementale en 1992. Son contrôle<br />
territorial fait de Chepe un homme clé pour la stratégie d'expansion des Autodéfenses Unies<br />
de Colombie (AUC) 6 , qui arrivent au département en 1996 voulant établir une liaison entre<br />
1 Gayer [2008], p. 37, cite Volkov [2002]<br />
2 El Tiempo, 20/02/2005. Gobierno desmobiliza a jefe para capturado<br />
3 Zuñiga [2004], p. 45<br />
4 Pour les liens entre conditions géographiques et stratégies des acteurs armés voir Cubides [1999].<br />
L'auteur affirme que les zones plates sont plus favorables aux paramilitaires, dans mesure où la<br />
guérilla peine à se cacher dans ses régions. En revanche, les paramilitaires, avec leurs réseaux de<br />
soutien parmi les élites et les militaires, contrôlent plus facilement dans ces zones.<br />
5 Informe Policía Judicial. Radicado n° 114. 20/05/2004. Municipios del Magdalena con presencia de<br />
las autodefensas.<br />
6Sur les aspects généraux de cette expansion voir chapitre II. Nous traiterons de l'expansion au<br />
Magdaléna dans le chapitre V.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 136
l'Ou<strong>est</strong> et l'Est de la région Caraïbe. Chepe garantit alors aux AUC l'ouverture d'un corridor<br />
stratégique vers la Sierra et la Zone bananière, ainsi que vers le département voisin du Cesar<br />
(avec lequel le Magdaléna limite à l'Est) où se livrent de durs combats contre les FARC-EP et<br />
l'ELN. <strong>La</strong> région contrôlée par Chepe <strong>est</strong> également stratégique pour le trafic de drogues.<br />
Bien qu'aucune accusation n'existe contre lui, l'hypothèse de sa participation au trafic pourrait<br />
expliquer l'origine des 14 000 millions de pesos 1 qu'il a remis à l'État au moment de sa<br />
démobilisation.<br />
Les Chamizos commencent à opérer à Santa Marta à la fin de la décennie 1980 2 . Ils ne<br />
se limitent pas à assurer la sécurité, mais en plus <strong>«</strong> nettoient <strong>»</strong> les quartiers de voleurs,<br />
toxicomanes et autres marginaux. Les habitants doivent payer une contribution pour le<br />
<strong>«</strong> service <strong>»</strong> prêté. Comme le dit un habitant du quartier de Gaira :<br />
<strong>«</strong> Quand ils sont arrivés ils ont fait passer des tracts accusant les toxicos, les<br />
mendiants et les voleurs et les menaçant de mort. Quelque temps plus tard il y a<br />
eu plusieurs morts dans le quartier, des clochards, des mecs qui volaient, des<br />
gens comme ça […]. Je me souviens, ils passaient, ils disaient – bonjour, sécurité<br />
privée – et puis ils disaient qu'il s'agissait d'une contribution volontaire. Mais<br />
bon, quand les mecs se pointent armés chez toi c'<strong>est</strong> pas si volontaire! <strong>»</strong> 3<br />
Si les Chamizos s'inv<strong>est</strong>issent dans la sécurité domiciliaire, ils cherchent surtout à<br />
s'implanter <strong>«</strong> autour des lieux dans lesquels la production économique pouvait fournir les<br />
ressources pour leur entretien <strong>»</strong> 4 . Un de ces lieux <strong>est</strong> le marché central de Santa Marta, dont<br />
ils prennent le contrôle au début des années 1990 5 . Ils exigent des commerçants le paiement<br />
d'un <strong>«</strong> impôt <strong>»</strong>, régulent le type de marchandise qu'ils peuvent vendre et les quantités 6 .<br />
Comme l'affirme un commerçant de Santa Marta :<br />
<strong>«</strong> Ils disaient : toi tu peux vendre des mangues, toi tu peux vendre du manioc, toi<br />
des ananas. Mais attention, tu peux seulement vendre tant de kilos par semaine.<br />
1 5 millions d'euros<br />
2 Sipol Departamento del Magdalena. Santa Marta 19/02/1999. Oficio n°127. Grupos armados ilegales<br />
operando en el departamento del Magdalena. Teniente Carlos Alexy Quiroga.<br />
3 Cas n° 29. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Zuñiga [2007], p. 301<br />
5 Sipol Departamento del Magdalena. Santa Marta 19/02/1999. Oficio n°127. Grupos armados ilegales<br />
operando en el departamento del Magdalena. Teniente Carlos Alexy Quiroga.<br />
6 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 137
Comme ça ils contrôlaient les prix et récupéraient un pourcentage des ventes de<br />
chaque marchand <strong>»</strong> 1 .<br />
<strong>La</strong> domination des Chamizos sur le marché dépend de la force et l'intimidation. Or, le<br />
même commerçant admet qu'ils assuraient une forme de régulation et éloignaient les voleurs<br />
de leurs étals :<br />
<strong>«</strong> L'avantage était qu'ils fixaient les prix, et du coup personne pouvait faire de la<br />
concurrence déloyale. C'était plus organisé quoi! Et surtout tu pouvais laisser le<br />
local ouvert et sans surveillance et il n'y avait pas de problème; quand tu<br />
revenais tout était encore là <strong>»</strong> 2<br />
Cette utilisation de la violence alimente les caisses de l'organisation. Selon un<br />
document de la police judiciaire datant de 1994, Giraldo posséderait, à travers différents<br />
hommes de paille et sociétés façade, des propriétés rurales, comme l'hacienda <strong>La</strong> Fortuna, qui<br />
serait un véritable camp d'entraînement. Il serait également le propriétaire de divers<br />
établissements commerciaux comme des salles de billard, des r<strong>est</strong>aurants ainsi que la plus<br />
grande chaîne de distribution locale, les supermarchés Kaffir. Le pouvoir de Giraldo serait<br />
possible grâce à ses collusions avec des puissants politiques du département; le rapport cite le<br />
nom d'Edgardo Vives Campos, deux fois maire de Santa Marta, gouverneur du Magdaléna,<br />
Sénateur et directeur du journal local. De plus, toujours selon ce document, les Chamizos<br />
auraient réussi à construire un véritable réseau d'intelligence, se servant de leurs liens avec les<br />
entreprises de sécurité privée et avec la police 3 . Enfin, la transformation de l'organisation de<br />
Giraldo en conglomérat économique, répondrait également à un besoin de blanchir l'argent de<br />
la cocaïne.<br />
Les activités des Chamizos au marché correspondent au schéma classique de la<br />
violence mafieuse 4 . L'organisation armée protège ses clients des nuisances causées par des<br />
tiers – petits délinquants, concurrents déloyaux – mais aussi de celles qu'il menace lui-même<br />
de provoquer 5 . <strong>La</strong> violence <strong>est</strong> ici une ressource qui s'échange contre le paiement d'une<br />
1 Cas n° 22. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Idem<br />
3 Sipol Departamento del Magdalena. Santa Marta 19/02/1999. Oficio n°127. Grupos armados ilegales<br />
operando en el departamento del Magdalena. Teniente Carlos Alexy Quiroga.<br />
4 Cf. Catanzaro [1991]<br />
5 Tilly [2000], p. 99<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 138
edevance. Or, cet échange <strong>est</strong> inégal, dans la mesure où les commerçants ne peuvent choisir<br />
de refuser de payer.<br />
2. L'explosion de la violence<br />
L'augmentation de la force de la guérilla dans la région se manif<strong>est</strong>e par le harcèlement<br />
contre les forces répressives de l'État, l'infrastructure productive du département et surtout<br />
l'augmentation astronomique de l'enlèvement contre rançon. Ces facteurs contribuent à<br />
polariser la situation. L'avancement des guérilleros menace aussi le contrôle territorial des<br />
groupes paramilitaires et donc les routes de transport de la drogue. <strong>La</strong> convergence des<br />
menaces contre les clients des paramilitaires et contre les organisations elles-mêmes favorise<br />
un brouillage des limites entre la violence rétributive et la violence militaire. Le résultat <strong>est</strong><br />
une violence généralisée et d'une intensité inédite.<br />
Menace<br />
À la fin de la décennie 1980 la présence des FARC-EP dans la Sierra devient plus<br />
visible. <strong>La</strong> première attaque contre une station de police a lieu en 1987 à Palmor (municipe de<br />
Ciénaga; c'<strong>est</strong> le centre d'opération des Rojas). L'année suivante cette même guérilla attaque<br />
le village de Minca, dans le municipe de Santa Marta. En 1989 et 1990 sont attaqués<br />
Bellavista (Fundación), San Pedro de la Sierra et Sevilla (les deux en juridiction de Ciénaga) 1 .<br />
Ces villages, situés sur le piémont du massif ou sur ses premières hauteurs, sont<br />
particulièrement vulnérables aux attaques éclairs de la guérilla, qui détruit le poste de police et<br />
remonte aussitôt dans son refuge inexpugnable de la Sierra. Or, ces attaques menacent le<br />
centre économique du département, la Zone bananière. Ils mettent également en péril le<br />
contrôle des routes de trafic de cocaïne des Rojas.<br />
Les forces étatiques ne semblent pas être prêtes à faire face à une guérilla solidement<br />
implantée sur le versant occidental de la Sierra. Ainsi, douze gardiens de la paix sont<br />
assassinés par les FARC-EP en 1991 sur une des principales routes du département, celle qui<br />
communique Santa Marta et Ciénaga. Ils sont victimes d'une embuscade du groupe guérillero<br />
qui crible de balles la voiture qui les transportait avant de regagner la Sierra 2 . Les<br />
escarmouches se multiplient dans ces années-là, au point où la police se retire des villages les<br />
plus exposés aux attaques des insurgés 3 . L'armée ne semble pas mieux préparée pour faire<br />
face à l'avancée des subversifs; ainsi, en 1993, sept soldats du bataillon Arhuacos sont tués<br />
1 Source : Fundación Ideas para la Paz<br />
2 El Tiempo, 03/01/91. <strong>La</strong>s Farc masacran una patrulla policial<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 139
dans une embuscade dans le village de Parranda Seca (Ciénaga). Les soldats ne sont pas<br />
uniquement vulnérables aux attaques directes mais aussi aux champs de mines qui sont mises<br />
en place par les guérillas 1 .<br />
L'avancement des insurgés se traduit aussi par une multiplication des attentats contre<br />
l'infrastructure économique, routière et de communication. Ainsi, en 1991 le pont de <strong>La</strong> Aguja<br />
(Ciénaga) qui fait partie du complexe routier qui lie le département à l'intérieur du pays, <strong>est</strong><br />
dynamité par les FARC-EP 2 . À la même époque, cette guérilla détruit aussi une tour<br />
téléphonique 3 . Selon un des experts interviewés, les attentats sont accompagnés du racket des<br />
plus grandes entreprises du département, comme celles de transport ou du secteur agro-<br />
alimentaire 4 . Bien que la presse n'ait pas enregistré ces menaces contre les grandes firmes, elle<br />
a diffusé les déclarations de Dole Inc., firme agro-industrielle étasunienne qui se plaint des<br />
nombreuses attaques de la guérilla contre ses propriétés 5 . Les attentats et le harcèlement<br />
contribuent à créer un sentiment de menace que le maire de Santa Marta et le gouverneur du<br />
Magdaléna déplorent; ils en arrivent même à déclarer, dans une lettre adressée au Président de<br />
la République, que les villes du département sont <strong>«</strong> assiégées par la guérilla <strong>»</strong> 6 .<br />
L'autre grande préoccupation en matière de sécurité <strong>est</strong> l'enlèvement contre rançon. Le<br />
graphique 4.1 montre l'évolution de ce crime entre la fin des années 1980 et 1995. Il n'y a pas<br />
de données antérieures à 1988, mais toutes les sources indiquent que ce délit n'avait pas à<br />
l'époque une grande ampleur. L'augmentation correspond à une tendance nationale 7 , qui<br />
répond à la volonté de la guérilla d'alimenter sa campagne d'expansion. Ces chiffres ne<br />
montrent qu'une tendance, car ils sont largement sous-<strong>est</strong>imés du fait que les familles<br />
préfèrent souvent négocier la rançon sans l'intervention de la police 8 .<br />
3 Source : Fundación Ideas para la Paz. Selon la même source en 2001 aucune localité du piémont<br />
n'avait présence de la police<br />
1 El Tiempo, 24/09/93. Muertos 7 soldados en emboscada<br />
2 El Tiempo, 04/07/91. Guerrilla dinamita otras tres torres y dos puentes<br />
3 El Tiempo, 03/01/91. <strong>La</strong>s Farc masacran una patrulla policial<br />
4 Expert n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
5 El Heraldo, 24/09/1995. Seguimos trabajando si nos dejan : Dole<br />
6 El Tiempo, 26/08/94. Grave situación en Magdalena<br />
7 Pécaut [2008a], p. 77<br />
8 El Tiempo, 05/05/1992. Secu<strong>est</strong>radas 120 personas en 1992 : Le général de la 1ère division de l'armée<br />
de terre <strong>est</strong>ime que ces chiffres <strong>«</strong> ne représentent que 30% des cas <strong>»</strong><br />
<strong>La</strong> Fondation País Libre, ONG qui défend les intérêts des victimes de ce crime affirme que 30% des<br />
enlèvements enregistrés sur leurs bases de données n'avaient pas été dénoncés à la police.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 140
Graphique 4.1 : Enlèvements dans le Magdaléna (1988-1995)<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Source : Police Nationale de Colombie. Revue criminalité n°50<br />
Les journaux de l'époque font état de la peur que cette escalade d'enlèvements provoque<br />
parmi les catégories possédantes du département :<br />
<strong>«</strong> Un bananier et éleveur de la région, qui n'a pas voulu être identifié, affirme que<br />
les autorités ne donnent pas la sécurité nécessaire et que beaucoup d'entre eux<br />
ont du arrêter de visiter leurs propriétés par peur d'être enlevés ou assassinés,<br />
car la situation <strong>est</strong> insoutenable <strong>»</strong> 1 .<br />
Un article de mai 1992 énumère les victimes d'enlèvement des premiers mois de cette<br />
année-là. <strong>La</strong> plupart des cas affectent des entrepreneurs de la banane, des éleveurs de bétail et<br />
des politiques 2 . L'année suivante, le directeur régional du DAS déclare à la presse que<br />
<strong>«</strong> dernièrement la situation de l'enlèvement s'empire, la région névralgique <strong>est</strong> la Zone<br />
bananière <strong>»</strong> 3 . Les élites politiques du département sont également victimes de ce qui devient<br />
alors un vrai fléau 4 .<br />
0<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995<br />
Les enlèvements décrits par la presse ont principalement lieu en zone rurale, souvent<br />
dans les propriétés des victimes. Celles-ci sont le plus fréquemment des habitants urbains<br />
possédant des propriétés à usage productif ou de loisir dans les campagnes. L'enlèvement<br />
1 El Tiempo, 07/12/1993. Cuatro secu<strong>est</strong>ros en siete días en el Magdalena<br />
2 El Tiempo, 05/05/1992. Secu<strong>est</strong>radas 120 personas en 1992<br />
3 El Tiempo, 07/12/1993. Cuatro secu<strong>est</strong>ros en siete días en el Magdalena<br />
4 El Tiempo, 17/02/1992. Secu<strong>est</strong>ran a candidato a Asamblea del Magdalena<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 141
s'effectue également sur les routes, où les guérillas installent des barrages, attrapent leurs<br />
proies et gagnent rapidement la Sierra 1 . Tout cela produit un sentiment de risque permanent,<br />
bien exprimé par ce producteur bananier :<br />
<strong>«</strong> Les gens à Bogotá ne peuvent pas savoir ce que c'<strong>est</strong>; on se sentait comme dans<br />
une souricière, on ne pouvait pas sortir de la ville par peur de se faire enlever par<br />
la guérilla. Il y a des gens qui ont renoncé à gérer directement leurs<br />
exploitations 2 ; ils les ont vendues ou alors ils les ont confiées aux administrateurs<br />
sur place. Dans tous les cas on était foutus. Moi ça va, j'allais souvent à<br />
l'hacienda, mais parce qu'elle <strong>est</strong> pas très loin de Ciénaga. Par contre la maison<br />
de mon père à Chibolo, on n'y <strong>est</strong> pas retourné <strong>»</strong> 3 .<br />
Bien qu'à cette époque-là les principaux responsables d'enlèvement soient les<br />
guérilleros, cela ne veut pas dire qu'elle constitue le seul problème pour la sécurité des<br />
personnes. Les années 1990 voient également une forte augmentation de la délinquance<br />
ordinaire, souvent accompagnée d'attentats contre la vie 4 . En effet, avec l'essor de l'économie<br />
de la banane 5 , des populations migrantes arrivent de tout le département. Cette situation <strong>est</strong> à<br />
l'origine de tensions sociales importantes. En 1993, le maire de Ciénaga demandait l'aide de<br />
l'État central pour maintenir l'ordre :<br />
<strong>«</strong> Selon le maire, Victor Dangond Noguera, un tiers de la population de 185.000<br />
habitants <strong>est</strong> flottante, composée de sans-emploi, délinquants, clochards (vagos<br />
n.d.t.) et prostituées. Un volcan social. C'<strong>est</strong> la raison pour laquelle le<br />
fonctionnaire demande une plus grande présence étatique pour résoudre les<br />
problèmes que l'Or Vert a toujours causé <strong>»</strong> 6 .<br />
Les délinquants ordinaires rentrent souvent en interaction avec les groupes<br />
paramilitaires. Ces derniers oscillent entre la cooptation d'individus déjà spécialisés dans les<br />
1 A cet égard, le commandant de la police départementale de l'époque déclare à la presse : <strong>«</strong> les<br />
guérilleros descendent à des endroits particuliers qui ont un accès à la Sierra et en cinq ou dix<br />
minutes ils accomplissent des délits de tout genre <strong>»</strong>. El Tiempo, 24/04/1995. Zona bananera bajo el<br />
dominio de la violencia<br />
2 <strong>La</strong> presse de l'époque fait état de l'abandon des exploitations par leurs propriétaires. Cf. par exemple<br />
El Tiempo, 24/04/1995. Zona bananera bajo el dominio de la violencia : <strong>«</strong> la situation de violence a<br />
provoqué l'abandon de beaucoup de propriétés productives par leurs propriétaires <strong>»</strong><br />
3 Cas n° 31.Voir annexe 2, sources orales<br />
4 El Tiempo, 16/05/94. Fiscal especial para zona bananera del Magdalena<br />
5 Cf. Infra<br />
6 El Tiempo, 16/08/93. Negro Panorama Del Oro Verde<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 142
savoir-faire violents ou l'élimination des groupes vus comme concurrents 1 . Il <strong>est</strong> de même<br />
pour la guérilla, qui recrute souvent des <strong>«</strong> miliciens <strong>»</strong> 2 dans les files des gangs urbains 3 . En<br />
tout cas, comme le remarque Pécaut, les tensions sociales interfèrent avec les acteurs<br />
<strong>«</strong> proprement politiques <strong>»</strong>, ce qui a comme résultat une généralisation de la violence 4 . <strong>La</strong><br />
cooptation de petits criminels par les organisations armées contribue à mettre en cause une<br />
thèse parfois trop rapidement admise : celle qui explique la violence urbaine comme une<br />
conséquence du <strong>«</strong> manque d'État <strong>»</strong> 5 . Ici, des bandes armées sont cooptés dans des groupes<br />
plus larges, dans un processus qui n'<strong>est</strong> pas sans rappeler la <strong>«</strong> loi du monopole <strong>»</strong> qu'Elias place<br />
à l'origine des États européens 6 . Nous verrons dans le chapitre suivant comment la<br />
monopolisation de la violence sur tout le territoire départemental se fait justement par un tel<br />
processus de cooptation. Le fait que ces processus qu'on décrit ici soient enchâssés dans l'État 7<br />
– par la tolérance des paramilitaires ou par les collusions – montre que le crime ne constitue<br />
pas forcément une mise en cause de l'État mais que parfois elle contribue à en redéfinir les<br />
contours 8 .<br />
<strong>La</strong> Zone bananière : entre prospérité et violence<br />
<strong>La</strong> polarisation des élites politiques et économiques locales, ainsi que l'incapacité – ou<br />
le manque d'initiative – des forces armées favorisent les interférences entre les logiques<br />
militaires et rétributives. <strong>La</strong> polarisation conduit à l'alliance entre élites économiques et<br />
politiques, les narcotrafiquants et les professionnels de la violence. Les intérêts de toutes ces<br />
catégories se trouvent menacés par la progression de la guérilla. <strong>La</strong> violence alimente aussi<br />
cette polarisation, contribuant à une radicalisation des acteurs. Ces mécanismes déclencheurs<br />
de la violence sont présents dans la Zone bananière. Cette région <strong>est</strong> le poumon économique<br />
du département et concentre près du quart de la population; de plus, son emplacement <strong>est</strong><br />
stratégique pour les paramilitaires et la guérilla. <strong>La</strong> figure 4.2. montre l'évolution des meurtres<br />
1 Expert n°4. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Le terme milice désigne en Colombie les groupes urbains des guérillas. Elles accomplissent avant tout<br />
des missions de renseignement et participent à l'organisation d'attentats.<br />
3 El Tiempo, 17/06/1992. Matrimonio de guerrilla con Narcos y delincuencia común<br />
4 Pécaut [2001], p. 116<br />
5 Pour une exposition de cette thèse voir Koonings et Kruijt [2007]<br />
6 Elias [1975]<br />
7 Voir le parallèle que fait Barkey [1994] entre banditisme et formation de l'État<br />
8 Cf. Briquet et Favarel-Garrigues [2008]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 143
commis par les paramilitaires dans tout le département. <strong>La</strong> figure 4.3 montre la distribution<br />
entre les municipes les plus violents.<br />
Graphique 4.2. Meurtres commis par les paramilitaires dans le Magdaléna (1989-1995)<br />
Graphique 4.3. Les cinq municipes les plus violents de la période<br />
Source : Jacobo Grajales. Base de données sur violence paramilitaire dans le Magdaléna<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 144
<strong>La</strong> Zone bananière devient le point critique de la violence. Entre 1989 et 1995, 74% des<br />
meurtres enregistrés dans <strong>notre</strong> base de données ont eu lieu dans les municipes qui ont une<br />
partie de leur territoire dans cette région. Ciénaga enregistre une croissance très rapide du<br />
nombre de crimes de sang dans les premières années de la décennie. Selon la police, les<br />
meurtres – tout coupable présumé confondu – passent de 14 en 1989 à 91 en 1991 1 . Cette<br />
dernière année ont lieu des assassinats collectifs, un phénomène nouveau dans la zone et<br />
couramment associé avec la création d'un climat de peur parmi la population.<br />
Un examen des conditions économiques de la région nous permettra de comprendre<br />
cela. L'économie de la banane avait subi une forte dépression dans la zone pendant les années<br />
60, lorsque la United Fruit Company avait quitté la région 2 . <strong>La</strong> Colombie a alors gardé une<br />
place centrale dans le marché international de ce fruit, mais grâce à la production d'une autre<br />
région, celle d'Urabá. Au milieu des années 1980, la surface cultivée dans le Magdaléna<br />
n'était que de 5000 ha 3 , pour une production annuelle de 60.000 tonnes de banane en<br />
moyenne 4 . En 1990, la production a été multipliée par quatre, atteignant plus de 270.000<br />
tonnes 5 . En 1991, le secteur emploie plus de 9000 personnes, qui vivent le plus souvent dans<br />
des camps à proximité des plantations. Un seul village, comme celui d'Orihueca, dans le<br />
municipe de Ciénaga, loge plus de 3000 ouvriers agricoles 6 .<br />
<strong>La</strong> reprise de la production bananière tient principalement à la violence qui affecte alors<br />
Urabá, et qui conduit beaucoup d'inv<strong>est</strong>isseurs à déménager leurs capitaux. Ces inv<strong>est</strong>isseurs<br />
païsas (C'<strong>est</strong>-à-dire originaires du département d'Antioquia) vivaient depuis des longues<br />
années dans un environnement où les relations de travail étaient marquées par la violence. Les<br />
FARC-EP et l'ELN contrôlaient les syndicats des ouvriers agricoles, et les patrons faisaient<br />
appel aux paramilitaires lorsque les grèves devenaient trop gênantes 7 . En règle générale, les<br />
inv<strong>est</strong>isseurs d'Urabá rejettent toute relation avec les syndicats. L'historien C. M. Ortiz écrit<br />
ainsi qu'il y avait des propriétaires <strong>«</strong> qui préféraient vendre leur exploitation lorsque<br />
1 El Tiempo, 07/10/1991. Ciénaga, entre euforia y miedo<br />
2 El Tiempo, 09/11/91. Cien años de negocios con sabor a banano : <strong>«</strong> En 1965 il y avait 19.800 ha<br />
cultivées, en 1969 7.860 <strong>»</strong><br />
3 El Tiempo, 21/10/91. Ciénaga : Llegó la hora buena del banano<br />
4 Bonet Morón [2000], p. 52<br />
5 Idem<br />
6 El Tiempo, 21/10/91. Ciénaga : Llegó la hora buena del banano<br />
7 Sur le conflit armé et social en Urabá voir Martin [1997]; Ortiz Sarmiento [2007]; Romero [2003]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 145
l'obstruction du syndicalisme n'était plus possible <strong>»</strong> 1 . Il affirme que cette hostilité <strong>est</strong><br />
profondément ancrée dans la manière comment les païsas maintiennent des relations avec les<br />
travailleurs locaux 2 .<br />
Avec la reprise de l'économie de la banane, les syndicats se lancent dans une campagne<br />
massive de recrutement dans les nouvelles exploitations. Selon un leader syndical de<br />
l'époque :<br />
<strong>«</strong> On manquait de beaucoup de besoins fondamentaux, on vivait dans des<br />
conditions sanitaires très mauvaises et on travaillait sans compter, il n'y avait pas<br />
la journée de huit heures! Du coup, c'était un milieu propice pour que les gens<br />
aient envie de s'organiser, de réclamer leurs droits <strong>»</strong> 3 .<br />
Les témoignages de la Zone bananière du Magdaléna correspondent très bien à ce<br />
qu'affirme C. M. Ortiz sur l'Urabá; les organisations syndicales éveillent de la méfiance et du<br />
rejet. Comme l'affirme un autre syndicaliste, habitant à Ciénaga :<br />
<strong>«</strong> Ils (les entrepreneurs) pensent que les syndicalistes sommes une mauvaise<br />
herbe qui va arriver à leur entreprise et va la mener à la faillite. C'<strong>est</strong> pour ca<br />
que lorsqu'un travailleur rejoint un syndicat il <strong>est</strong> viré de l'entreprise <strong>»</strong> 4 .<br />
Ces sentiments ne sont évidemment pas propres aux patrons païsas ou colombiens; la<br />
méfiance vis-à-vis des syndicats <strong>est</strong> profonde même parmi les patrons des pays post-<br />
industriels 5 . Or, en Colombie ce sentiment <strong>est</strong> fortement lié à la situation de conflit armé que<br />
vit le pays, et aux liens imaginés ou réels que les syndicats peuvent entretenir avec des<br />
groupes de guérilla. Comme l'affirme un entrepreneur bananier :<br />
<strong>«</strong> À cette époque-là, la situation était très grave. Tu imagines, tu laissais rentrer<br />
le syndicat, parce que bon quand même, la concertation sociale et toutes ces<br />
conneries là. Et bien, le lendemain tu pouvais avoir la guérilla qui venait te dire<br />
qui il fallait embaucher, qui te disait d'augmenter les salaires et en plus te<br />
1 Ortiz Sarmiento [2007], p. 29<br />
2 Idem<br />
3 Cas n°26. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Cas n°5. Voir annexe 2, sources orales<br />
5 Cf. sur la France l'excellent ouvrage de Beaud et Pialoux [1999]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 146
demandait de payer le vaccin 1 . Sa mère! Moi, c'<strong>est</strong> pour ça que j'ai jamais permis<br />
des syndicats chez moi, et j'en suis content <strong>»</strong> 2 .<br />
Avec l'essor de la production de banane, la violence contre les syndicats se développe.<br />
Il ne s'agit pas seulement d'une violence contre les leaders des organisations. Elle touche aussi<br />
de nombreux travailleurs qui militent ou sont proches des syndicats; ce qui constitue<br />
vraisemblablement une manière de décourager l'adhésion. Les journaux de l'époque font état<br />
de cette violence:<br />
<strong>«</strong> À Ciénaga, en un seul mois, 2000 personnes ont adhéré aux divers syndicats, ce<br />
qu'a provoqué une répression contre plusieurs dirigeants. À Orihueca 3 ,<br />
lorsqu'une mère apprend que son fils a adhéré, fait le signe de croix et prie <strong>»</strong> 4 .<br />
<strong>La</strong> Zone bananière n'<strong>est</strong> pas uniquement un endroit clé pour l'économie départementale,<br />
c'<strong>est</strong> aussi une région stratégique pour les différents groupes armés. <strong>La</strong> première cause de<br />
cette importance stratégique tient justement à son rôle économique; le contrôle de la Zone par<br />
la guérilla permettrait à celle-ci de ponctionner l'économie bananière par le biais du racket et<br />
l'enlèvement. Pour les groupes paramilitaires, l'enjeu économique <strong>est</strong> central. Dans le cas des<br />
Rojas, ils bénéficieraient économiquement de l'essor de la banane, via les <strong>«</strong> contributions <strong>»</strong><br />
des entrepreneurs de la Zone 5 . Enfin, il convient de remarquer que les Rojas cohabitent avec<br />
d'autres groupes paramilitaires plus petits comme les Cuquecos. Ces derniers participent<br />
également à la violence autour de l'économie de la banane, comme le montre l'assassinat de<br />
deux ouvriers agricoles le 1er août 1992 6 .<br />
L'intérêt de la Zone bananière <strong>est</strong> également militaire : en effet, les grandes plantations<br />
de banane sont placées entre le Grand Marais et la Sierra; elles sont donc un couloir<br />
stratégique entre la base arrière que constitue le massif montagneux et la sortie vers la mer.<br />
De plus, la Zone <strong>est</strong> traversée de fleuves navigables comme l'Aracataca ou le Sevilla 7 .<br />
1 Extorsion<br />
2 Cas n° 31.Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Village de travailleurs bananiers, juridiction de Ciénaga<br />
4 El Tiempo, 07/10/1991. Ciénaga, entre euforia y miedo<br />
5 C'<strong>est</strong> ce qu'affirme un document confidentiel de l'intelligence militaire : Ejército Nacional – 20°<br />
Brigada, Batallón de Inteligencia n°1. Santa Marta 08/05/98. 001830/RR20-BITE-1-INT 10 252.<br />
Anotaciones de inteligencia sobre Adán, Rigoberto y Camilo Rojas. Mayor Jorge Armando Riaño<br />
6 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
7 Voir carte 3.2<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 147
Lorsque Giraldo contrôle tout le versant Nord, la Zone <strong>est</strong> un lieu de passage obligé pour tous<br />
les trafics; elle <strong>est</strong> donc disputée par les FARC-EP et les Autodéfenses de Palmor (ADP).<br />
<strong>La</strong> violence alors déployée par les acteurs armés <strong>est</strong> plus intense et moins sélective que<br />
pendant le cycle précédent. Les indicateurs font état d'une augmentation très forte du nombre<br />
de décès violents pendant les premières années de la décennie. Les crimes directement<br />
imputés aux paramilitaires y tiennent une place importante 1 . Cela dit, comme nous l'avons<br />
déjà remarqué, les transformations socio-économiques de la région favorisent aussi la<br />
violence désorganisée. Celle-ci n'<strong>est</strong> pas déconnectée de la violence commise par les acteurs<br />
organisés, mais au contraire les deux sont fortement imbriquées 2 .<br />
<strong>La</strong> violence affecte surtout les syndicalistes et les travailleurs des entreprises<br />
bananières 3 . À cette époque, le coordonnateur du Conseil spécial pour la réconciliation dans le<br />
Magdaléna déclare :<br />
<strong>«</strong> Le secteur critique <strong>est</strong> la Zone bananière, il a été impossible d'asseoir à la table<br />
de négociations les entrepreneurs bananiers et les travailleurs, pour trouver une<br />
issue au conflit […]. Il faut trouver un grand accord ou un pacte de paix sociale<br />
et politique qui arrête et neutralise les esprits belliqueux qui pensent trouver dans<br />
un <strong>fusil</strong>, dans les meurtres et le silence, les solutions aux problèmes sociaux <strong>»</strong> 4 .<br />
Ainsi, les instances officielles de l'époque interprètent la violence comme étant le fruit<br />
de l'interaction entre les tensions sociales et les acteurs armés. Dit d'une manière plus directe<br />
par une haute responsable de la police criminelle dans le département : <strong>«</strong> les entrepreneurs<br />
qui arrivent d'Antioquia veulent imposer les paramilitaires dans le but de neutraliser les<br />
syndicats <strong>»</strong> 5 . De la même manière, un rapport officiel affirmait déjà en 1991 que : <strong>«</strong> les<br />
nouveaux capitaux […] amènent avec eux un schéma de relations entre ouvriers et patrons<br />
basé sur la répression et l'utilisation des paramilitaires <strong>»</strong>. 6<br />
Quelques exemples de cette violence illustreront mieux <strong>notre</strong> propos. Le 22 juillet<br />
1991, un groupe de paramilitaires s'identifiant comme appartenant aux ADP assassinent trois<br />
1 À partir de : Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du<br />
CINEP<br />
2 Pécaut [2001]<br />
3 À partir de : Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du<br />
CINEP<br />
4 El Tiempo, 25/09/1991. Estado de anarquía en la Zona Bananera<br />
5 El Tiempo, 07/10/1991. Ciénaga, entre euforia y miedo<br />
6 Idem<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 148
travailleurs d'une exploitation bananière, deux hommes et une femme 1 . C'<strong>est</strong> l'un des premiers<br />
cas où les responsables peuvent être clairement identifiés. En effet, les frères Rojas<br />
reconnaissent le meurtre plus de quinze ans plus tard en arguant que les trois individus étaient<br />
des collaborateurs de la guérilla 2 . Ils faisaient circuler des menaces depuis quelques mois,<br />
notamment des tracts qui accusaient les syndicats d'être des <strong>«</strong> guérilléros en civil <strong>»</strong>. <strong>La</strong> mise<br />
en application de ces menaces provoque la mobilisation du syndicat Sintrainagro, qui organise<br />
en novembre un <strong>«</strong> forum <strong>»</strong> national pour dénoncer la présence des groupes paramilitaires dans<br />
la zone bananière. Une semaine plus tard, le 28 novembre, les quatre membres de la section<br />
locale du syndicat qui s'étaient rendus au forum sont assassinés 3 . Ce meurtre collectif <strong>est</strong><br />
également reconnu par les Rojas lors de leur audience judiciaire; ceux-ci accusent encore une<br />
fois les victimes d'avoir été des soutiens de la guérilla; ils mettent notamment l'accent sur le<br />
fait qu'une de ces personnes appartenait à l'UP 4 . Bien que les collusions entre les bananiers de<br />
la zone et les Rojas semblent très probables, ces derniers ont affirmé qu'ils entretenaient des<br />
relations d'amitié avec certains entrepreneurs, mais qu'ils n'étaient pas commandités par eux<br />
pour commettre les crimes 5 . Des documents de l'époque, produits par les services de<br />
renseignement de l'armée affirment le contraire. Selon ceux-ci des entrepreneurs bananiers<br />
soutiendraient financièrement les Rojas et auraient commandité les meurtres d'un membre de<br />
la direction de Sintrainagro et de cinq militants du syndicat en février 1994 6 . Cela pourrait<br />
confirmer en partie <strong>notre</strong> hypothèse sur l'utilisation de l'étiquette de <strong>«</strong> guérillero en civil <strong>»</strong>.<br />
Elle met une sorte de voile sur les véritables mécanismes de la violence, en la rapportant<br />
systématiquement au conflit contre-insurrectionnel. Cette étiquette <strong>est</strong> donc un outil<br />
stratégique de légitimation de la violence.<br />
En outre, la violence qui frappe le piémont de la Sierra répond à une logique militaire.<br />
Dans le but d'arrêter l'avancée de la guérilla, les paramilitaires, principalement les ADP,<br />
commencent à instaurer un contrôle armé des voies d'accès au massif. Ils installent des<br />
1 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
2 Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et Camilo<br />
Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 24 mars 2009 dans le cadre du procès de Justice et Paix. Fiscal<br />
31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
3 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
4 Versions libres, Idem<br />
5 Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et Camilo<br />
Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 26 mars 2009 dans le cadre du procès de Justice et Paix. Fiscal<br />
31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
6 Ejército Nacional – 20° Brigada, Batallón de Inteligencia n°1. Santa Marta 08/05/98. 001830/RR20-<br />
BITE-1-INT 10 252. Anotaciones de inteligencia sobre Adán, Rigoberto y Camilo Rojas. Mayor Jorge<br />
Armando Riaño<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 149
arrages et contrôlent les marchandises transportées par les paysans. Ils limitent alors les<br />
quantités de denrées autorisées au stricte minimum, car ils accusent les paysans de transporter<br />
des vivres pour la guérilla 1 . Les indigènes, qui ne descendent de la Sierra que pour<br />
s'approvisionner de certains produits, font l'objet du même type de contrôles. Comme<br />
l'affirme un chef de l'ethnie Kogui : <strong>«</strong> Si l'on descendaient de la Sierra ils nous accusaient de<br />
transporter de la nourriture pour la guérilla ou alors d'être un de leurs contacts <strong>»</strong> 2 .<br />
Les habitants du piémont, paysans pour la plupart, sont alors affectés par le phénomène<br />
du contrôle fragmenté décrit par Kalyvas. Cet auteur explique que la présence de plusieurs<br />
acteurs armés sur un même territoire favorise une violence de haute intensité 3 . Dans un texte<br />
postérieur, il écrit que <strong>«</strong> la barbarie de la guerre <strong>est</strong> fonction du degré d'insécurité auquel font<br />
face les acteurs armés <strong>»</strong> 4 . En effet, ces habitants sont tiraillés entre les guérillas et les<br />
paramilitaires, qui ne conçoivent pas de position neutre : <strong>«</strong> Vous êtes avec nous ou vous<br />
partez, vous n'avez pas le choix <strong>»</strong> 5 , auraient-ils dit à un paysan de la zone. Comme le dit un<br />
habitant de la Sierra : <strong>«</strong> Comment on fait alors? Si lorsque la guérilla arrive on <strong>est</strong> des<br />
paramilitaires pour eux, et lorsque c'<strong>est</strong> les paramilitaires arrivent ils nous accusent d'être<br />
des guérilleros <strong>»</strong> 6 .<br />
Si l'on suit Kalyvas, la situation de fragmentation du contrôle explique la<br />
transformation quantitative et qualitative de la violence. À partir du début de la décennie<br />
1990, la violence dans la Sierra devient plus intense et indiscriminée. À manière d'exemple,<br />
en septembre 1991, les ADP assassinent six personnes à San Pedro de la Sierra (Ciénaga), les<br />
accusant d'avoir collaboré avec les FARC-EP 7 . En mai de l'année suivante, le même groupe<br />
assassine sept personnes dans une salle de billard de Riofrío (Ciénaga) 8 . C'<strong>est</strong> une sorte<br />
d'opération punitive contre un village suspecté de collaborer avec la guérilla 9 .<br />
1 Expert n°10.Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Cas n°32. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Kalyvas [1999], p. 251-252<br />
4 Kalyvas [2006], p. 84<br />
5 Cas n°17. Voir annexe 2, sources orales<br />
6 Cas n°18. Voir annexe 2, sources orales<br />
7 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
8 Idem<br />
9 Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et Camilo<br />
Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 25 mars 2009 dans le cadre du procès de Justice et Paix. Fiscal<br />
31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 150
<strong>La</strong> violence des ADP ne leur permet cependant pas de garder le contrôle de la Sierra.<br />
En janvier 1995, une forte offensive des FARC-EP les pousse à sortir du massif, et à r<strong>est</strong>er<br />
retranchés dans la Zone bananière 1 . Ils auraient eu alors des tensions avec Giraldo pour le<br />
contrôle des routes du trafic 2 ; cela conduit, comme nous le verrons plus loin, à une guerre qui<br />
provoque la totale réorganisation des pouvoirs paramilitaires dans le département.<br />
Les Chamizos rentrent également dans la guerre contre-insurrectionnelle. Leur principal<br />
souci <strong>est</strong> alors de garder le contrôle sur le fief qu'<strong>est</strong> devenu le versant Nord de la Sierra. Or,<br />
ils interviennent aussi à Santa Marta. Ainsi, ils utilisent le contrôle du marché pour couper les<br />
lignes d'approvisionnement de la guérilla. Comme l'explique alors un des professionnels de la<br />
violence interviewés par P. Zúñiga :<br />
<strong>«</strong> Nous utilisions <strong>notre</strong> réseau de pharmacies pour suivre les médecines à usage<br />
chirurgical, c'<strong>est</strong>-à-dire celles qu'utilise la guérilla pour soigner ses blessés […].<br />
Je m'explique, s'ils recevaient un coup de feu ils avaient besoin d'antibiotiques, de<br />
bandeaux […] on suivait les individus et on les attrapait par surprise <strong>»</strong> 3 .<br />
Nous avons essayé de montrer ici quels sont les principaux ressorts de la transformation<br />
de la violence. Elle sert à la fois à rétribuer des relations de clientèle et à protéger des zones<br />
d'influence – essentielles pour des groupes qui ont une forte dimension territoriale. Il ne s'agit<br />
cependant pas de réduire la violence contre-insurrectionnelle à son simple aspect militaire. En<br />
effet, le positionnement des groupes paramilitaires par rapport aux guérillas leur assure<br />
également des profits relationnels. Dans un contexte dans lequel les forces répressives de<br />
l'État semblent manquer de capacité – ou/et de volonté – pour faire face à la subversion, le<br />
positionnement des paramilitaires comme des acteurs clés de la lutte contre-insurrectionnelle<br />
leur assure un appui social non négligeable. <strong>La</strong> violence permet donc d'accumuler de<br />
ressources matérielles, mais aussi de nouer des alliances. En effet, ce positionnement contre-<br />
insurrectionnel rend plus facilement justifiable le fait de soutenir ou de tolérer des acteurs qui,<br />
dans un autre contexte, auraient pu faire l'objet d'une stigmatisation sociale. <strong>La</strong> violence et le<br />
discours qui la légitime servent ainsi, comme le remarque très bien Tilly, à faire tomber des<br />
1 Idem<br />
Voir aussi des rapports officiels Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2001];<br />
Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2006]<br />
2 Verdad Abierta, 26/01/2009. El escorpión, entrenado para matar<br />
3 Zuñiga [2004], p. 40<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 151
arrières pour permettre aux acteurs de collaborer. Elle <strong>est</strong> donc à la fois un moteur et un<br />
produit des collusions 1 .<br />
3. Des entrepreneurs du contrôle social<br />
Cette description montre bien que les groupes paramilitaires ne sont plus de simples<br />
bandes de tueurs à gages, des professionnels de la violence vendant leur savoir faire au<br />
meilleur acheteur, mais qu'ils entretiennent des liens plus compliqués avec la société. Non<br />
seulement ils rentrent en collusion avec des nombreux acteurs, mais en plus ils commencent à<br />
endosser une mission de contrôle social. En effet, le besoin d'établir un contrôle stable sur les<br />
espaces et les personnes apparaît d'abord comme un impératif économique; il s'agit d'assurer<br />
les couloirs stratégiques pour le transport de la drogue et de créer un système de racket. Or,<br />
les groupes paramilitaires font face à un acteur qui aspire à l'hégémonie : la guérilla. Cette<br />
tendance expansionniste, tel qu'exprimée par les FARC-EP lors du <strong>«</strong> Plenum unifié <strong>»</strong> de 1982,<br />
<strong>est</strong> impulsée par l'inv<strong>est</strong>issement du groupe guérillero dans l'économie de la drogue. Il se<br />
trouve ainsi en concurrence avec les groupes paramilitaires pour les mêmes types de<br />
ressources.<br />
L'évolution des groupes paramilitaires vers des entrepreneurs de la coercition <strong>est</strong> donc<br />
caractérisée par une complexe hybridation entre différentes logiques : contrôle social,<br />
économie de la drogue, vente de protection, etc. Cette évolution ne peut être rapportée à une<br />
cause univoque, comme pourrait le faire penser une lecture qui se limiterait à la qu<strong>est</strong>ion de la<br />
<strong>«</strong> criminalité <strong>»</strong> 2 .<br />
Le changement dans les données du conflit armé favorisent la transformation des<br />
professionnels de la violence en entrepreneurs du contrôle social. C'<strong>est</strong> à partir du moment où<br />
existe cette tendance au contrôle de la population et du territoire qu'ils correspondent<br />
totalement à <strong>notre</strong> définition de groupes paramilitaires. Dans le département du Magdaléna,<br />
cette transformation <strong>est</strong> amorcée très tôt par les Chamizos, dans leur fief de Guachaca et<br />
Buritaca. En revanche, même si les pratiques militaires que nous avons décrites pour les ADP<br />
tendent à établir une telle forme de relation avec la société locale, la force armée de groupe <strong>est</strong><br />
limitée; ce qui aboutit à sa défaite par les FARC-EP. Pour <strong>notre</strong> propos, il suffira de décrire la<br />
forme de contrôle social mise en place par Hernán Giraldo dans la Sierra.<br />
1 Tilly [2003], p. 76-78<br />
2 Pour une telle approche voir Duncan [2005b]. L'auteur définit les groupes paramilitaires comme des<br />
<strong>«</strong> seigneurs de guerre <strong>»</strong> dont la stratégie serait mécaniquement déterminée par la recherche des rentes.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 152
Le groupe de Giraldo <strong>est</strong> essentiellement une organisation familiale agencée autour du<br />
patriarche. Les récits – peut-être un brin romancés – racontent que Giraldo aurait eu au moins<br />
une trentaine d'enfants avec plus de dix femmes. Il <strong>est</strong> cependant vérifiable qu'autour de<br />
Giraldo gravitent neveux, cousins et beaux-fils 1 ; tous les postes de pouvoir dans l'organisation<br />
sont détenus par des membres de sa famille, comme Nodier Giraldo, neveu du patriarche et<br />
chef de finances. Les relations avec la population semblent être influencées par le même genre<br />
de rapport patriarcal. Le Patron, comme on l'appelle, assure la justice et règle les conflits entre<br />
voisins, mais il intervient aussi dans les querelles de famille et les pratiques sexuelles des<br />
couples.<br />
Guachaca :<br />
Ce comportement de juge patriarcal apparaît bien dans ce récit d'un paysan de<br />
<strong>«</strong> Don 2 Hernán n'aimait pas qu'il y ait des voleurs, que lorsque tu laissais ta<br />
maison seule les gens viennent te voler, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas non plus<br />
qu'on se bagarre avec son voisin. S'il y avait une bagarre il faisait appeler les<br />
deux personnes et les obligeait à faire des travaux, débroussailler un chemin par<br />
exemple; c'était une punition pour qu'on ne se bagarre pas avec son voisin, parce<br />
qu'il disait qu'en cas de problèmes le voisin était ton meilleur ami. C'était le<br />
conseil qu'il donnait toujours <strong>»</strong> 3 .<br />
L'organisation de Giraldo occupe les différents espaces du pouvoir local et les<br />
institutions délibératives des communautés paysannes. Les plus importantes de ces<br />
institutions sont les Assemblées d'action communale (Juntas de Acción Comunal 4 ). Dans ces<br />
espaces, Giraldo rencontre les chefs de famille pour écouter leurs problèmes et agit souvent<br />
comme juge dans les querelles entre voisins 5 . Selon les déclarations d'un ancien employé de<br />
Giraldo, les individus qui ne respectaient pas les commandements du <strong>«</strong> Patron <strong>»</strong> faisaient<br />
1 Verdad Abierta, 27/04/2009. Caín contra Caín<br />
2 Marque de respect<br />
3 Cas n°14. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Les Juntas de Acción Comunal sont des assemblées formées par les habitants d'un même quartier (en<br />
milieu urbain) ou hameau (en milieu rural). Elles ont une existence juridique depuis les années 1960 et<br />
ont été crées comme des organes participatifs d'administration des biens publics. Elles peuvent obtenir<br />
des financements de différentes entités de l'État, participer à la mise en œuvre de politiques publiques<br />
et effectuer des contrats avec des entreprises privées. Source : École Supérieure d'Administration<br />
Publique de Colombie (ESAP).<br />
5 On peut dessiner un parallèle avec l'analyse qu'effectue Catanzaro [1991] de la mafia sicilienne<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 153
l'objet de deux avertissements. Au troisième ils étaient expulsés de leurs terres sous menace<br />
de mort 1 .<br />
Même les pratiques sexuelles des individus font l'objet d'une régulation violente de la<br />
part de l'organisation de Giraldo. Apparemment, l'adultère aurait été réprimé par des coups de<br />
fouet; la punition étant appliquée indifféremment aux hommes et aux femmes.<br />
L'homosexualité serait strictement interdite et les personnes qui s'adonneraient à des pratiques<br />
sexuelles avec des individus du même sexe risqueraient leur vie 2 .<br />
Telle <strong>est</strong> la situation de distribution du pouvoir dans le département au milieu de la décennie<br />
1990. Aucun acteur ne détient le monopole sur la violence, les limites des zones d'influence<br />
sont mouvantes, à l'exception notable du fief de Giraldo. Cette instabilité <strong>est</strong> cependant<br />
relative. En effet, aucun groupe paramilitaire n'a des aspirations hégémoniques. Ils semblent<br />
plus occupés à contrôler leurs routes de trafic et à se défendre de la guérilla. <strong>La</strong> fragmentation<br />
du contrôle sur la violence détermine aussi un certain rapport aux institutions politiques. En<br />
effet, les groupes paramilitaires entretiennent des liens avec les élites politiques locales, mais<br />
n'ont pas la force suffisante pour fixer eux-mêmes les règles du jeu. Il semble même que dans<br />
la plupart de ces collusions les politiques et les entrepreneurs capitalistes gardent les rênes de<br />
la situation. Cette situation change radicalement avec l'arrivée des Autodéfenses Unies de<br />
Colombie (AUC) dans le département. Nous verrons dans les deux prochains chapitres que<br />
leur avancée s'accompagne d'une violence d'intensité inouïe et qui leur assure très rapidement<br />
le contrôle de tout le territoire départemental. Cette expansion fait partie d'une offensive<br />
nationale qui voit l'organisation établir son emprise brutale sur tous les départements de la<br />
région Caraïbe 3 . Le contrôle du territoire et des populations, permet aux AUC d'influer sur les<br />
institutions et d'établir une relation plus inégalitaire avec les élites locales.<br />
1 Combattant n°3. Voir annexe 2, sources orales. Ce qu'affirme également Zuñiga [2004], p. 41<br />
2 Combattant n°3 ; Expert n°6. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 C'<strong>est</strong> à dire : Córdoba, Sucre, Bolivar, Atlántico, Magdalena, Cesar et Guajira.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 154
V. <strong>La</strong> formation d'un monopole de la violence<br />
Le soir du 21 novembre 2000, près d'une centaine de paramilitaires des Autodéfenses Unies<br />
de Colombie (AUC) partent du village de Piedras, dans le municipe de Pivijay vers Salamina.<br />
Ils empruntent des canots à moteur qui les conduisent sur la rivière Clarín vers le Grand<br />
Marais. Sur leur chemin, ils tuent plusieurs pêcheurs avec les baïonnettes de leurs <strong>fusil</strong>s pour<br />
éviter le bruit 1 . Les paramilitaires arrivent à Nueva Venecia à 3 heures du matin. C'<strong>est</strong> un<br />
village de pêcheurs construit sur des pilotis et appartenant au municipe de Sitionuevo. À leur<br />
arrivée, ils rassemblent toute la population dans l'église; ils sélectionnent alors leurs victimes,<br />
les amènent sur la place centrale et les obligent à se coucher sur le ventre. Ils les exécutent<br />
une à une par des tirs de <strong>fusil</strong> sur la nuque 2 . L'attaque des paramilitaires fait 43 morts et<br />
provoque la fuite d'une partie des habitants du village 3 .<br />
Dans le cadre du processus de Justice et Paix, Edmundo Guillén, Alias Caballo,<br />
paramilitaire démobilisé du Bloc Nord, a déclaré que le massacre de Nueva Venecia avait été<br />
une vengeance contre les habitants du village, accusés par les paramilitaires d'avoir aidé les<br />
guérilleros de l'ELN à commettre l'enlèvement de neuf membres du Club de Chasse et Pêche<br />
de Barranquilla 4 . Il affirme également qu'un éleveur de Pivijay, membre d'une grande famille<br />
de la région et possédant un grade de commandement au sein du Bloc Nord, aurait été à<br />
l'origine du plan 5 . Nous avons déjà souligné l'importance stratégique de la région du Grand<br />
Marais et de la Zone bananière, couloir idéal pour le transport des combattants, des armes et<br />
de la drogue. Le Grand Marais, avec ses forêts de mangrove et alimenté par des centaines de<br />
rivières et ruisseaux, <strong>est</strong> un refuge idéal pour le front Domingo Barrios de l'ELN. Nous<br />
sommes donc devant la convergence de deux logiques : une logique militaire, qui vise à<br />
s'approprier un territoire stratégique, et une logique rétributive qui vise à se venger de<br />
1 Verdad Abierta, 17/12/2008. <strong>La</strong> masacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay<br />
2 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP,<br />
El Heraldo, 29/07/2007. El miedo no se ha ido de Nueva Venecia<br />
3 El Colombiano, 27/11/2000. Mataban seres humanos como si fueran pájaros.<br />
El Espectador, 28/11/2000. Horror y miedo en Nueva Venecia.<br />
El Tiempo, 16/12/2000. Hubo múltiples violaciones al DIH : Defensor del Pueblo<br />
4 Verdad Abierta, 17/12/2008. <strong>La</strong> masacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay<br />
Ce qu'affirme également Zuñiga [2007], p.313<br />
5 Verdad Abierta, 17/12/2008. <strong>La</strong> masacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 155
l'enlèvement de membres de la haute société de Barranquilla. Tout au long de ce chapitre nous<br />
verrons ces logiques s'enchevêtrer et changer de nature.<br />
Les AUC portent un projet hégémonique d'unification de tous les groupes paramilitaires<br />
et d'expansion à tout le territoire colombien. Ce projet a son origine, comme nous l'avons déjà<br />
dit, dans la création des Autodéfenses Paysannes de Córdoba et Urabá en 1994. Cette<br />
organisation porte déjà un projet expansionniste, qui aboutit à la création des AUC trois ans<br />
plus tard. Ce nouveau type de groupe paramilitaire se caractérise par un rapport différent aux<br />
élites locales, aux narcotrafiquants et aux institutions politiques. Dans ces trois cas, les AUC<br />
aspirent à subordonner et réorganiser les autres pouvoirs locaux. Elles tendent à reconstruire<br />
sous leur domination un nouvel agencement du pouvoir politique et économique local. Cela se<br />
fonde sur une puissance militaire capable de revendiquer le monopole de la violence sur un<br />
territoire. À partir d'un tel contrôle des espaces de pouvoir, l'organisation s'entremêle avec les<br />
institutions politiques locales. Cela lui permet d'avoir accès aux rentes de l'État et de contrôler<br />
les postes de pouvoir à l'intérieur de ces institutions. Ce contrôle sur les institutions locales va<br />
de pair avec des collusions qui les lient à des acteurs politiques de Bogotá, ce qui donne à<br />
l'organisation des leviers de pouvoir sur des institutions politiques du centre.<br />
Comme dans d'autres étapes de <strong>notre</strong> développement, l'expansion des AUC dans le<br />
département répond en partie à une demande locale. En effet, nous montrerons comment la<br />
force des guérillas des FARC-EP et de l'ELN <strong>est</strong> désormais disproportionnée par rapport aux<br />
moyens des paramilitaires locaux. Ceux-ci sont parfois expulsés de leurs zones d'implantation<br />
– c'<strong>est</strong> le cas des ADP – ou sont acculés à mobiliser toutes leurs énergies pour se défendre –<br />
c'<strong>est</strong> ainsi pour les Chamizos. Nous y reviendrons. Cette avancée de la guérilla n'<strong>est</strong> pas<br />
uniquement une donnée locale. Dans tout le pays les groupes de guérilla, et surtout les FARC-<br />
EP, se lancent dans une véritable offensive nationale. Cette dernière organisation arrive même<br />
à infliger des dommages très significatifs à l'armée pendant les dernières années du siècle 1 .<br />
Somme toute, la menace perçue <strong>est</strong>, ici comme les précédentes étapes de <strong>notre</strong><br />
développement, un élément capital de la spirale de violence.<br />
Comme nous l'avons expliqué en introduction, les enchevêtrements des logiques<br />
militaire et rétributive cèdent la place, lorsque l'acteur armé atteint le monopole de la<br />
violence, à une logique qu'on appellera ici étatique. Elle consiste en la construction de<br />
capacités proprement étatiques par l'acteur armé. Selon Migdal, ces capacités consistent à<br />
1 <strong>La</strong>ir [2000] date cette recrudescence du conflit de 1996, date à laquelle les FARC-EP prennent la base<br />
militaire de las Delicias. Cf. <strong>notre</strong> chapitre II<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 156
pénétrer et réguler la société et en extraire des ressources dans un but particulier 1 . Les AUC<br />
tendent à construire ces trois capacités. Elles pénètrent la société grâce à la mise en place<br />
d'appareils de surveillance et à la cooptation d'autres appareils publics et privés. Elles la<br />
régulent avec un appareil de contrôle social, c'<strong>est</strong>-à-dire avec des normes et des moyens de<br />
coercition qui établissent la limite entre le permis et le défendu. Cette régulation fonctionne<br />
aussi en rétribuant les alliés les plus puissants par la distribution de rentes ou de charges<br />
publiques. Les AUC ont ainsi une influence sur les hiérarchies sociales. Différents canaux<br />
d'extraction de ressources sont institués; ils touchent les budgets publics mais aussi les<br />
entreprises privées ainsi que les travailleurs indépendants et les ménages. Il s'agit d'un<br />
système d'imposition digne d'un État. Enfin, ces ressources sont canalisées vers le<br />
renforcement de l'appareil armé, la rétribution des alliés et la pression sur différentes instances<br />
de l'État central.<br />
Ces capacités sont mises en œuvre à travers la force. En effet, malgré les discours<br />
altruistes des chefs paramilitaires sur le développement de leurs régions 2 , l'appareil des AUC<br />
exerce le pouvoir avant tout par la contrainte et très peu par la récompense directe. Aucune de<br />
nos sources ne mentionne ni d'appareil de redistribution clientélaire, ni des formes<br />
d'inv<strong>est</strong>issement dans les infrastructures publiques. Il en résulte une omniprésence de la<br />
violence qui subvertit tous les rapports sociaux. C'<strong>est</strong> le cas des rapports proprement<br />
politiques comme les rapports de clientèle mais également des rapports de voisinage 3 et même<br />
ceux de couple 4 . D'où la place centrale de la terreur, dont les sévices commis sur les corps des<br />
victimes sont l'expression ultime.<br />
Tout cela n'exclut pas la création de systèmes de consentement. En effet, la violence<br />
peut parfois légitimer le groupe auprès de certains secteurs de la population. C'<strong>est</strong> le cas de<br />
l'élimination des marginaux ou des individus considérés comme déviants par les<br />
paramilitaires. Nous examinerons ces violences appelées de <strong>«</strong> nettoyage social <strong>»</strong>. <strong>La</strong> violence<br />
1 Migdal [1988], p. 4<br />
2 Déclaration du commandant du Bloc Nord, Jorge Cuarenta, 21 mai 2007 : <strong>«</strong> Nous avons gagné de la<br />
crédibilité devant les communautés car <strong>notre</strong> seul engagement <strong>est</strong> de les défendre, même au prix de<br />
<strong>notre</strong> propre vie, dans le but de détruire l'État guérillero. Cette crédibilité nous amena à continuer<br />
avec d'autres missions de la guerre […]. Nous avons commencé à nous comporter en leaders, car<br />
nous nous sentions faire partie de cette communauté, de ce territoire dans lequel nous avons construit<br />
des routes, des ponts, des écoles et des hôpitaux <strong>»</strong>. In Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación<br />
Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470 contra Luis Eduardo Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia condenatoria.<br />
01/08/2008, p. 37-38<br />
3 Cf. section 3<br />
4 Amn<strong>est</strong>y International [2004] parle de cas où de femmes menacées par leurs compagnons : <strong>«</strong>les maris<br />
ou compagnons menacent les femmes de les dénoncer aux paramilitaires (d'être liées à la guérilla) <strong>»</strong>,<br />
p. 46<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 157
peut également nourrir des systèmes de consentement plus difficiles à repérer, car rarement<br />
avoués. C'<strong>est</strong> le cas de l'utilisation de l'acteur armé par certains individus pour régler des<br />
querelles de la vie courante. <strong>La</strong> dénonciation <strong>«</strong> malicieuse <strong>»</strong> 1 revient constamment dans les<br />
récits recueillis, même si personne n'avoue d'avoir utilisé un tel procédé contre un voisin trop<br />
bruyant ou contre l'amant de sa femme. Nous reviendrons sur ces types de relations entre les<br />
civils et l'acteur armé qui contribuent bien sûr à une forme de légitimation.<br />
Enfin, il convient de souligner que la violence ne consiste pas uniquement en un<br />
contrôle social ou une soumission d'une population. Elle peut également refaçonner les<br />
territoires par l'expulsion des habitants. Ce phénomène atteint une ampleur inédite pendant la<br />
seconde moitié de la décennie 1990 et mérite que l'on s'y arrête. En effet, nous verrons que<br />
ces <strong>«</strong> déplacements forcés de populations <strong>»</strong> répondent à des déterminants militaires mais aussi<br />
à des raisons économiques.<br />
Nous proposons ici une lecture stratégique de la violence. Celle-ci nous conduit à dire<br />
que les catégories de l'exclusion ne sont pas fixes, comme on pourrait s'y attendre (guérillero,<br />
communiste, marginal...); elles sont au contraire plastiques et font l'objet de manipulations au<br />
gré des intérêts des bourreaux. Nous verrons en effet que, bien que la plupart des victimes<br />
sont étiquetés comme des <strong>«</strong> subversifs <strong>»</strong>, il <strong>est</strong> évident que ce discours constitue une ressource<br />
en lui-même. Le cas paradigmatique <strong>est</strong> celui de la violence rétributive, où celle-ci répond à la<br />
satisfaction d'une clientèle. Or, même dans ces cas, un discours contre-insurrectionnel <strong>est</strong> mis<br />
en scène. Même mis devant les faits dans le cadre d'une audience judiciaire, les paramilitaires<br />
reproduisent ce discours stéréotypé. C'<strong>est</strong> qu'il constitue à la fois une forme de légitimation et<br />
une sorte de <strong>«</strong> voile d'ignorance <strong>»</strong>, occultant des rapports collusifs qui sont au centre des<br />
mécanismes de la violence<br />
Pour faciliter l'organisation du propos, le chapitre actuel traitera de l'utilisation de la<br />
violence comme outil d'exercice du pouvoir, tandis que le prochain s'occupera du rapport<br />
entre construction des capacités étatiques et institutions locales. Dans les pages suivantes,<br />
nous suivrons comme fil directeur les transformations de l'usage de la violence. Nous<br />
essayerons de montrer comment les AUC arrivent à établir le monopole sur cet usage et<br />
quelles sont les différentes modalités d'exercice du pouvoir par la violence.<br />
1 Kalyvas [2006]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 158
1. Implantation et consolidation des AUC<br />
L'arrivée des AUC dans le département correspond à un bouleversement de l'intensité<br />
de la violence. Il s'agit d'un changement qualitatif et quantitatif. En effet, alors qu'en 1995 le<br />
nombre des victimes enregistrées sur <strong>notre</strong> base de données avait fortement baissé, ce chiffre<br />
repart à la hausse en 1996 (Graphique 5.1). Cette tendance continue, puisque pendant le<br />
dernier trim<strong>est</strong>re de cette année-là 14 victimes sont reportées, tandis que le premier trim<strong>est</strong>re<br />
de l'année suivante voit ce chiffre doubler. Il y a 32 meurtres enregistrés en 1996, 66 en 1997<br />
et 87 et 1998. Un pic <strong>est</strong> atteint en 2000 avec 167 meurtres enregistrés, égalé seulement trois<br />
ans plus tard avec 170 cas. Ce changement <strong>est</strong> aussi qualitatif, puisque les modalités de la<br />
mise à mort se sont profondément modifiées. Les meurtres collectifs se généralisent; ce sont<br />
des rituels de violence 1 où plusieurs dizaines de personnes peuvent perdre la vie devant les<br />
yeux de leurs proches et leurs voisins. Souvent, ces meurtres s'accompagnent par des horribles<br />
sévices contre les corps qui déshumanisent l'autre et produisent la terreur. Notre interrogation<br />
sur les transformations de l'usage de la violence devra tenir compte de ces deux dimensions<br />
qualitative et quantitative 2 .<br />
Graphique 5.1. Meurtres commis par les paramilitaires dans le Magdaléna (1995-2005)<br />
Source : Jacobo Grajales. Base de données sur violence paramilitaire dans le Magdaléna<br />
1 L'expression <strong>est</strong> d'Uribe [2004]<br />
2 Zuñiga [2007] affirme aussi qu'il y a une transformation dans l'usage de la violence et dans les<br />
relations entre l'acteur armé et la population : <strong>«</strong> Avec l'arrivée des AUC, la violence s'<strong>est</strong> dirigée contre<br />
des objectifs plus larges dans la population, y compris des opérations punitives contre les populations<br />
qui pourraient sympathiser avec la guérilla, ce qui a donné lieu à des véritables exodes massifs dans le<br />
département […]. Débute aussi l'utilisation d'uniformes et insignes, l'utilisation d'armes de plus longue<br />
portée et des nouvelles tactiques dans l'usage de la violence, avec l'objectif clair de produire de la<br />
terreur <strong>»</strong>. p. 295<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 159
Les données chiffrées que nous possédons nous permettent de mesurer la violence de<br />
deux manières : par la progression des meurtres dont les auteurs présumés sont les<br />
paramilitaires (graphique 5.1) et par le déplacement forcé des populations 1 (graphique 5.2). Il<br />
s'agit là de deux outils assez imparfaits, comme nous l'avons évoqué en introduction.<br />
Néanmoins, la comparaison des deux types d'information montre une progression tellement<br />
forte de la violence qu'elle ne peut être induite par les différents biais propres aux outils<br />
choisis. D'autre part, les entretiens que nous avons pu réaliser confirment qu'à partir de la<br />
seconde moitié de la décennie la violence acquiert une nouvelle ampleur<br />
40000<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Graphique 5.1. Déplacement forcé de populations dans le Magdaléna 2<br />
ND 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Source : Acción Social – SIPOD (Sistema de información de la población desplazada) octobre 2008<br />
1 En matière de déplacement forcé des populations, nous avons choisi de ne pas utiliser les données qui<br />
réalisent une discrimination par acteur responsable. En effet, ces informations sont fondées<br />
uniquement sur la déclaration des individus, qui ont tendance à affirmer qu'ils ne connaissent pas la<br />
nature de l'acteur qui les a menacé, par peur des représailles. Du coup, la catégorie <strong>«</strong> acteur inconnu <strong>»</strong><br />
<strong>est</strong> sur-représentée, et atteint parfois les 50%. D'autre part, si les différents organismes publics et<br />
privés coïncident sur le nombre total de refugiés dans le département, ils présentent des différences<br />
très grandes sur l'item <strong>«</strong> acteur responsable <strong>»</strong>. Enfin, lorsqu'il y a des combats et des situations de<br />
violence extrême il <strong>est</strong> difficile pour la population d'identifier un seul acteur responsable. Pour ces<br />
difficultés de calcul voir Renán-Rodríguez [2007]<br />
2 Ce graphique montre le nombre de personnes qui déclarent à l'Agence Présidentielle pour l'Action<br />
Sociale qu'elles ont du quitter leur foyer à cause du conflit armé. Après une enquête sommaire qui vise<br />
à établir la véracité du propos, les personnes reçoivent le statut de réfugié interne (desplazado), ce qui<br />
leur donne le droit – en théorie – aux programmes d'aide de l'État.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 160
Lorsque nous confrontons ces deux graphiques, il <strong>est</strong> clair qu'il y a une tendance à<br />
l'augmentation de la violence contre les civils à partir du milieu de la décennie. Or, les<br />
hauteurs relatives ne correspondent pas. Il semble même qu'il y ait un décalage entre le<br />
moment des meurtres et le moment de la fuite des populations. Cela peut avoir plusieurs<br />
explications.<br />
Premièrement, il y a des événements de meurtres massifs ou de déplacements de<br />
populations qui introduisent des sauts dans les graphiques. C'<strong>est</strong> par exemple le cas des<br />
massacres des villages du Grand Marais en 2000 ou du déplacement de plusieurs milliers de<br />
personnes de la Sierra lors de l'offensive des AUC contre les Chamizos en 2000 et 2001 (cf.<br />
Infra).<br />
Deuxièmement, le déplacement massif de populations semble être associé plutôt à<br />
l'étape de consolidation qu'à celle d'arrivée dans le territoire. En effet, à partir de 2000, le<br />
nombre de réfugiés enregistrés par les organismes officiels se maintient au-dessus de 10000<br />
personnes par an. Deux hypothèses pourraient être avancées pour expliquer cela; d'une part,<br />
nos entretiens nous mènent à penser que beaucoup de personnes ne fuient pas en raison d'une<br />
agression directe mais à cause de la peur provoquée par les modalités de contrôle de la<br />
population que les paramilitaires mettent en place 1 . D'autre part, diverses sources conduisent à<br />
penser qu'il y aurait une stratégique de dépeuplement des zones de contrôle paramilitaire 2 .<br />
Cette expulsion de la population peut avoir des buts économiques; ils visent une accumulation<br />
des terres dans l'optique de l'inv<strong>est</strong>issement productif ou simplement de la thésaurisation; ils<br />
feront l'objet d'un exposé dans le chapitre suivant. Or, l'expulsion de la population peut être<br />
également un outil de contrôle du territoire; on remarquera alors avec E. Cairs, qu'un territoire<br />
avec une basse densité de population <strong>est</strong> plus facile à contrôler qu'une région fortement<br />
peuplée. L'acteur armé peut ainsi, à des fins de maîtrise du territoire, le vider d'une partie de<br />
ses habitants par l'extermination physique mais surtout par la peur 3 . Cette logique permettrait<br />
de comprendre certains massacres, lors desquels les habitants de villages entiers étaient<br />
sommés d'abandonner leurs terres sous peine de subir le même sort que les victimes du<br />
meurtre.<br />
1 Pour le rapport entre peur et déplacement des populations voir l'ouvrage de Jaramillo, Villa et<br />
Sánchez [2004]<br />
2 Ce qui <strong>est</strong> aussi l'avis de Reyes [2009], p. 190-198<br />
3 Cairns [1997], p. 17<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 161
Dans cette première partie, nous nous intéresserons aux conditions d'arrivée des AUC<br />
dans le département. Nous verrons que cette arrivée <strong>est</strong> mue par des intérêts divers et que leur<br />
implantation se réalise avant tout par la violence contre les civils.<br />
Les déterminants de l'arrivée<br />
Deux sortes de déterminants permettent de comprendre l'intérêt initial des AUC pour le<br />
territoire du Magdaléna. D'une part, il s'agit d'un déterminant militaire, car le département <strong>est</strong><br />
un lieu clé dans l'expansion de l'organisation à toute la côte caraïbe. D'autre part, leur arrivée<br />
répond également à une demande de secteurs possédants de la société locale, qui se sentent de<br />
plus en plus menacés par la guérilla.<br />
Dans le Magdaléna, les premières opérations du Bloc Nord des Autodéfenses<br />
Paysannes de Córdoba et Urabá (ACCU) ont lieu en 1996. Selon Salvatore Mancuso, cette<br />
année-là marque le début de l'expansion à toute la région Caraïbe. Il part alors de Córdoba,<br />
avec sous son commandement le <strong>«</strong> Bloc Nord <strong>»</strong> crée à cet effet par Carlos Castaño.<br />
L'expansion du Bloc Nord au Magdaléna <strong>est</strong> menée par René Ríos, commandant du <strong>«</strong> front<br />
Magdaléna-Cesar <strong>»</strong> 1 . Ce front <strong>est</strong> un groupe d'avancée qui n'occupe pas le territoire et se<br />
limite à des attaques éclairs contre la population. Ainsi, leur première action dans le<br />
département <strong>est</strong> le massacre de sept personnes à Pivijay le 1er septembre 1996 2 . Selon<br />
Mancuso, le groupe ne compte que 40 hommes en 1996 et 60 l'année suivante 3 .<br />
À l'époque, le centre d'opérations du Bloc Nord se trouve dans le département voisin du<br />
Cesar. Les offensives de l'organisation dans le Cesar visent à construire un anneau de sécurité<br />
autour de la ville de Valledupar, qui se trouve au fond d'une vallée entre la Sierra et le massif<br />
du Perijá, et qui <strong>est</strong> par conséquent une proie facile pour les guérillas. Ces opérations sont<br />
menées conjointement avec les Autodéfenses du Sud du Cesar, créées par les Prada, une<br />
famille de propriétaires fonciers de la région. Les premières incursions dans le Magdaléna<br />
visent à faire la jonction entre les autres fronts du Bloc Nord, qui se trouvent à l'Ou<strong>est</strong> et les<br />
paramilitaires des Prada à l'Est 4 . Entre les deux groupes se trouvent les Cheperos 5 . <strong>La</strong><br />
<strong>«</strong> libération <strong>»</strong> du territoire du centre du Magdaléna permettrait non seulement d'établir des<br />
1 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.Version libre Salvatore Mancuso, 2006<br />
2 Idem<br />
3 Idem<br />
4 Expert n°12, voir annexe 2, sources orales<br />
5Selon la presse, les ACCU et les Cheperos collaborent à partir de 1996 : El Tiempo, 04/12/2004, El<br />
fin de unos paras de bajo perfil<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 162
liens entre tous les paramilitaires de la région mais aussi de consolider un couloir stratégique<br />
entre le département du Cesar et le fleuve Magdaléna, artère fluviale d'une importance<br />
capitale.<br />
En 1997 sont créées les AUC et en 1998 les autodéfenses de la famille Prada adhèrent à<br />
l'organisation 1 . À partir de ce moment-là, le contrôle sur la région Caraïbe commence à<br />
s'affermir; le Magdaléna et le Cesar passent alors sous le commandement de Jorge Cuarenta,<br />
homme de confiance de Salvatore Mancuso. <strong>La</strong> progression des AUC se traduit par une<br />
augmentation importante du nombre d'hommes du Bloc Nord. Selon Mancuso, en 1998,<br />
l'organisation a 360 hommes dans les départements du Magdaléna et du Cesar 2 . À cette<br />
époque là, le contrôle sur les plaines semble consolidé, et les guérillas sont retranchées dans la<br />
Sierra et dans le massif du Perijá 3 . Dans le Magdaléna la situation correspond encore à un<br />
oligopole de la violence, avec les Cheperos au Sud, les Chamizos dans la Sierra et les ADP à<br />
Ciénaga et dans les alentours. Cuarenta consolide sa position au centre du département où il<br />
crée un <strong>«</strong> front de guerre <strong>»</strong> : le Jhon Jairo López (FJJL).<br />
Dans cette première étape d'expansion, les paramilitaires auraient établi des collusions –<br />
au moins ponctuelles – avec l'armée. C'<strong>est</strong> ce qu'affirme un témoin du massacre commis par<br />
les ACCU au village de Medialuna (Pivijay) en novembre 1996 : <strong>«</strong> Ce jour là, l'armée a<br />
installé des barrages à la sortie du village, ils contrôlent toutes les voies de sortie. <strong>La</strong> nuit,<br />
les paramilitaires arrivent et sortent les gens de chez eux, ils les rassemblent et les tuent. Ils<br />
les accusent d'avoir collaboré avec la guérilla <strong>»</strong> 4 . D'autres versions, recueillies de manière<br />
informelle, évoquent également les mouvements de l'armée ce jour-là. Le cas du massacre de<br />
Medialuna semble confirmer pour le Magdaléna une hypothèse largement admise ailleurs en<br />
Colombie 5 . À ce sujet, Alias Cientouno, cadre moyen du Bloc Nord, décrit dans un entretien<br />
journalistique les types de collusion que liaient des paramilitaires et des militaires. Il raconte<br />
comment les attaques des AUC étaient très souvent précédées d'opérations de l'armée, qui<br />
avaient comme but de sécuriser le terrain. Il explique également que les guérilleros tués par<br />
les paramilitaires étaient fréquemment rendus aux militaires; ceux-ci les faisaient alors passer<br />
comme des victimes propres. Ces déclarations n'ont rien d'étonnant, elles correspondent à des<br />
1 Urabá, 16 mai 1998, Deuxième conférence de dirigeants nationaux des AUC<br />
2 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.Version libre Salvatore Mancuso, 2006<br />
3 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2006]<br />
4 Cas n°21. Voir annexe 2 sources orales<br />
5 Voir la description du massacre de Mapiripán dans le chapitre 1, ou encore Semana, 29/01/09,<br />
Fiscalía acusa diez militares por masacre de Apartadó<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 163
pratiques bien documentées dans toutes les régions d'influence paramilitaire 1 .<br />
Malheureusement, comme nous l'avons déjà souligné, il existe trop peu de données sur ces<br />
collusions dans le département du Magdaléna pour nous permettre d'étudier de près les<br />
mécanismes de la collaboration entre militaires et paramilitaires.<br />
Mais l'expansion des AUC au Magdaléna répond aussi à une demande sociale. En effet,<br />
face à une guérilla de plus en plus puissante, les anciens paramilitaires, pr<strong>est</strong>ataires<br />
historiques du service de sécurité, n'arrivent plus à protéger leurs clients. Selon P. Zúñiga,<br />
dans les dernières années de la décennie, Cuarenta commence à tisser des liens avec des<br />
secteurs des élites locales de toute la région centrale et établit son quartier général à Sabanas<br />
de San Ángel 2 . Ces élites locales subissent à l'époque des vexations et des harcèlements<br />
croissants de la part de la guérilla. Notre hypothèse <strong>est</strong> que cette dégradation de la situation de<br />
sécurité aurait favorisé un processus de polarisation. Les barrières qui séparent les acteurs<br />
violents et leurs potentiels clients tombent lorsque la perception – en l'occurrence bien fondée<br />
– de la menace augmente. En effet, l'enlèvement fait figure de véritable plaie pour tous ceux<br />
qui possèdent de quoi payer une rançon. Ce crime ne recule pas pendant la première moitié<br />
des années 1990, mais il r<strong>est</strong>e néanmoins stable. Or, en 1997 il connaît une augmentation de<br />
74%; ce qui porte le nombre d'enlèvements cette année-là à 75 (Figure 5.2). De plus, comme<br />
nous l'avons dit précédemment, ces chiffres correspondent uniquement aux enlèvements qui<br />
font l'objet d'une plainte devant la police; cette <strong>est</strong>imation <strong>est</strong> donc nettement en dessous du<br />
nombre réel d'enlèvements.<br />
1 Human Rights Watch [2001]<br />
Jugement de Cour Intéraméricaine des Droits de l'Homme, condamnation de l'État Colombien pour le<br />
cas du massacre de Mapiripán, 7 mars 2005<br />
Audience au Sénat de la République concernant les faits de Mapiripan, 19 septembre 2006<br />
2Zuñiga [2007], p. 308. Elle cite les municipes de Piñón, Zambrano, Tenerife, Plato, El Banco,<br />
Fundación et Ariguaní<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 164
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Graphique 5.2. : enlèvements dans le Magdaléna (1990-2005)<br />
0<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Source : Police Nationale de Colombie. Revue criminalidad<br />
Les enlèvements sont souvent réalisés en zone rurale; les guérilleros installent des<br />
barrages sur les routes et arrêtent les passants, sélectionnant alors les meilleures proies. C'<strong>est</strong><br />
ce que l'humour noir colombien a appelé les pêches miraculeuses (pescas milagrosas). Ce<br />
procédé n'a pas uniquement lieu sur des routes éloignées des villes, mais aussi sur les deux<br />
principaux axes du département : celui qui communique Santa Marta et Barranquilla (<strong>«</strong> la<br />
route de la Caraïbe <strong>»</strong>) et celui qui lie la région à l'intérieur du pays (<strong>«</strong> la route du<br />
Magdaléna <strong>»</strong>).<br />
L'enlèvement qui a le plus d'impact dans l'histoire de la région <strong>est</strong> celui des membres du<br />
Club de chasse et pêche de Barranquilla. Le 6 juin 1999, alors qu'ils rentraient d'une journée<br />
de loisirs dans les marais, les canots à moteur qui transportent le conseiller municipal de<br />
Barranquilla Orlando Rodriguez Saavedra et sa famille, ainsi que plusieurs autres membres du<br />
Club, sont arrêtés par des hommes armés. Initialement, ils s'identifient comme appartenant à<br />
la police et contrôlent les papiers de tous les vacanciers. C'<strong>est</strong> alors qu'ils révèlent leur<br />
véritable identité, il s'agit de guérilleros du front Domingo Barrios de l'ELN. Ils sélectionnent<br />
alors 9 personnes dans le groupe, dont le Conseiller, et les amènent avec eux 1 .<br />
1 El Tiempo, 07/06/99. Pesca milagrosa en el Magdalena.<br />
El Tiempo, 08/06/99. Deténgase para una requisa.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 165
Selon Zúñiga, cet enlèvement aurait été à l'origine de l'étape suivante d'expansion des<br />
AUC dans le département. Basée sur des entretiens avec des membres des élites de Santa<br />
Marta et Barranquilla 1 l'auteure conclut que <strong>«</strong> des familles possédant des propriétés sur les<br />
rives du Magdaléna [...] voyagent à Córdoba pour s'entretenir avec le chef des AUC et lui<br />
demandent d'organiser une autodéfense qui les protégerait du harcèlement de la guérilla <strong>»</strong> 2 .<br />
Dans une logique rétributive, cette augmentation de l'enlèvement <strong>est</strong> suivie d'un certain<br />
nombre <strong>«</strong> d'opérations punitives <strong>»</strong> contre les populations du Grand Marais.<br />
<strong>La</strong> guerre par populations interposées<br />
Des considérations purement militaires, mais aussi des facteurs liés à l'établissement<br />
d'alliances avec les élites locales, permettent donc de comprendre la période pendant laquelle<br />
les AUC s'implantent dans le département. Lors de leur expansion, les paramilitaires se<br />
battent très rarement contre la guérilla 3 . Les opérations paramilitaires sont en grande partie<br />
des attaques contre les civils, considérés comme la base sociale des insurgés. <strong>La</strong> guerre par<br />
populations interposées implique des ripostes sanglantes lorsque a lieu une action des<br />
subversifs. Ces ripostes ne répondent pas uniquement à des actions locales mais aussi à des<br />
événements qui auraient lieu ailleurs dans le pays. Nous voyons ainsi se profiler une guerre à<br />
échelle nationale.<br />
Les ripostes des paramilitaires ne répondent pas uniquement à des attaques qui les<br />
auraient directement lésés, mais aussi à des attaques contre l'État. Par exemple, le 15 janvier<br />
1997 les FARC-EP attaquent le poste de police de Santa Rosa de Lima, un village appartenant<br />
au municipe de Fundación 4 . Moins de deux semaines plus tard, les AUC assassinent sept<br />
personnes à Tenerife et Ciénaga, et revendiquent cette action comme une riposte à l'attaque de<br />
la guérilla 5 . Un cas similaire a lieu à Medialuna en juin 1997; ainsi le raconte un habitant du<br />
village :<br />
<strong>«</strong> L'ELN s'était battu avec l'armée et plein de soldats avaient été tués. C'étaient<br />
des pauvres gars qui ne pouvaient pas porter un équipement si lourd et qui se<br />
débattaient dans les marais avec l'eau jusqu'à la taille contre des types qui<br />
connaissaient parfaitement le terrain. <strong>La</strong> guérilla, avec une meilleure stratégie, a<br />
1 Expert n°1. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Zuñiga [2007], p. 308<br />
3 Expert n°1. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 El Tiempo, 15/01/97. Esa tarde llovía plomo del cielo<br />
5 El País, 27/01/97. Paramilitares asesinaron siete personas.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 166
monté une embuscade. Après, les paramilitaires sont venus et ont dit au gens que<br />
c'était la faute des pêcheurs si les soldats avaient été tués, que les pêcheurs<br />
amenaient de la nourriture à la guérilla. Ils nous avaient réuni à 8h du matin<br />
pour nous dire ça. Ils ont pris les pêcheurs et les ont tué devant tout le village 1 <strong>»</strong>.<br />
L'intensité de la violence <strong>est</strong> également favorisée par une la manière dont le conflit <strong>est</strong><br />
conçu à l'échelle nationale. Lorsque les groupes étaient isolés entre eux, les objectifs étaient<br />
locaux et la mobilisation avait une moindre ampleur. Avec les AUC, l'objectif <strong>est</strong> national; ce<br />
qui a un impact sur l'utilisation de la violence. Par exemple, le 5 septembre 1996, les<br />
paramilitaires assassinent 7 personnes à Fundación; ils revendiquent le meurtre comme une<br />
réponse à l'offensive nationale que les FARC-EP avaient réalisée dans les jours précédents 2 .<br />
L'insertion de la violence dans un scenario de conflit national apparaît de manière<br />
particulièrement sanglante dans le cas du massacre du Playón de Orozco, commis par les<br />
AUC le 9 janvier 1999.<br />
L'histoire commence le 28 décembre de l'année précédente, lorsqu'un commando des<br />
FARC-EP attaque le quartier général des AUC dans le Paramillo, un massif montagneux situé<br />
au sud du département de Córdoba. Le campement <strong>est</strong> détruit et le commandant des AUC,<br />
Carlos Castaño, se sauve par miracle 3 . En réponse à cette attaque, Castaño lance un ordre<br />
macabre : exécuter 1000 personnes dans des zones d'influence des FARC-EP pendant les 15<br />
premiers jours de la nouvelle année 4 . Suivant cette directive, Jorge Cuarenta envoie près de<br />
100 hommes au village du Playón de Orozco, appartenant au municipe de El Piñón.<br />
Commandés par une femme à l'Alias de <strong>La</strong> Mona, les paramilitaires rassemblent tous les<br />
habitants du village sur la place centrale; une fois là, les victimes sont sélectionnées et<br />
exécutées en public 5 . D'autres personnes sont conduites à l'extérieur du village pour subir des<br />
interrogatoires sous torture avant d'être assassinées. Trente personnes ont perdu la vie ce jour<br />
là 6 . Après le départ des paramilitaires, tous les habitants quittent le village par peur que les<br />
assassins reviennent; au moment de l'arrivée de la presse, il ne r<strong>est</strong>e qu'un village fantôme 7 .<br />
1 Cas n°21. Voir annexe 2 sources orales<br />
2 El Nuevo Siglo, 05/09/1996. Asesinados siete campesinos en Fundación.<br />
3 Aranguren [2001], p. 245-248<br />
4 Sánchez Baute [2008], p.329<br />
5 El Heraldo, 09/11/2007. ‘Jorge 40’ admitió 5 masacres<br />
6 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
7 El Tiempo, 13/14/99. El pueblo con un solo habitante<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 167
<strong>La</strong> logique de riposte contre la population civile atteint une cruauté inédite avec les<br />
massacres du Grand Marais, qui font suite à l'enlèvement des membres du Club de Chasse et<br />
Pêche. Dans les premiers mois de l'année 2000, on observe une avancée rapide des AUC dans<br />
les zones autour du Grand Marais. Le 7 février, une incursion du groupe dans le village El<br />
Dividide (Remolino) laisse trois morts; une semaine plus tard, vingt personnes sont<br />
assassinées dans un autre village du même municipe 1 . Le 11 ils avaient provoqué le<br />
déplacement forcé des habitants du village de Trojas de Cataca, appartenant au municipe de<br />
Puebloviejo; dans cette localité, après avoir réuni les habitants sur la place centrale, les<br />
paramilitaires ont assassiné sept personnes et accusé toute la population de collaborer avec<br />
l'ELN. Le groupe armé a donné 24 heures aux habitants pour quitter les lieux 2 . Interrogé sur<br />
l'arrivée des paramilitaires dans le Grand Marais, un ouvrier agricole, originaire du village de<br />
Santa Rita (Remolino) raconte :<br />
<strong>«</strong> Mon cousin a été une des premières victimes des paramilitaires à Santa Rita. Ils<br />
l'ont tué parce qu'il était instituteur, et qu'ils disaient que les instituteurs étaient<br />
tous des communistes. À la même époque ils ont tué un couple, ils étaient épiciers<br />
et les paramilitaires les accusaient d'avoir vendu de la nourriture aux guérilleros.<br />
Le jour du massacre de Trojas de Cataca ils sont passés par Santa Rita, il était<br />
très tôt et il n'y avait que les pêcheurs dehors. J'étais sur une chaloupe quand on<br />
a commencé à entendre les tirs, ils tiraient partout, ils en ont tué plusieurs d'entre<br />
nous, comme s'ils étaient des oiseaux. Quelques heures plus tard, un pêcheur<br />
nous rapporte la nouvelle de Trojas de Cataca. Là tout le village s'<strong>est</strong> vidé, on<br />
avait trop peur qu'ils repassent par là au retour et qu'ils nous tuent tous <strong>»</strong> 3 .<br />
Dans le cycle des massacres du Grand Marais, les les limites entre logique militaire et<br />
logique rétributive sont totalement brouillées. Les interférences entre les acteurs rendent la<br />
situation extrêmement compliquée, ce qui favorise une violence extrême.<br />
2. <strong>La</strong> conquête d'un monopole<br />
Le massacre de Nueva Venecia, que l'on a déjà décrit, clôt le cycle des massacres du<br />
Grand Marais. Ces attaques marquent une nouvelle étape dans l'expansion des AUC, dans<br />
laquelle l'organisation évince les autres acteurs armés – guérillas et paramilitaires – et<br />
1 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
2 Idem<br />
3 Cas n°28. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 168
consolide son pouvoir sur tout le département. En effet, les paramilitaires ne font pas<br />
seulement face à la guérilla, mais aussi au groupe des Chamizos, qui résiste à l'absorption. On<br />
<strong>est</strong> donc face à deux logiques militaires parallèles : pour contrer la guérilla, les AUC<br />
consolident leur contrôle sur les terres de plaine. Le centre et le Sud du département tombent<br />
rapidement sous leur emprise 1 , suite à des opérations lors desquelles les civils sont poussés à<br />
la collaboration par la terreur. Chepe Barrera négocie son intégration dans l'organisation des<br />
AUC et se déplace vers le Sud du département; il laisse les municipes du centre qui étaient<br />
auparavant sous son contrôle – Ariguaní, Nueva Granada, Plato – à Jorge Cuarenta 2 . Au<br />
tournant de la décennie, seule la Zone bananière et la Sierra r<strong>est</strong>ent à contrôler. <strong>La</strong> première<br />
<strong>est</strong> dans les mains de la guérilla et la seconde dans celles d'Hernán Giraldo. Nous allons<br />
examiner ces deux épisodes violents : le contrôle de la Zone bananière et l'affrontement avec<br />
les Chamizos.<br />
Lors de ces épisodes, la relation de l'acteur armé avec les civils <strong>est</strong> caractérisée par une<br />
violence de soumission. Selon J. Sémelin, le but de cette violence <strong>est</strong> de <strong>«</strong> faire mourir des<br />
civils pour détruire partiellement une collectivité afin de soumettre totalement ce qu'il en<br />
r<strong>est</strong>era. Par définition, le processus se veut partiel mais son effet <strong>est</strong> global <strong>»</strong> 3 . Un parallèle<br />
peut être ici dessiné avec l'analyse de S. Kalyvas qui affirme que, bien qu'elle <strong>«</strong> puisse remplir<br />
une variété de fonctions, l'utilisation instrumentale de la violence pour générer de la<br />
conformité constitue un aspect central du phénomène <strong>»</strong>. 4 Il remarque également que <strong>«</strong> lorsque<br />
la violence <strong>est</strong> principalement utilisée pour contrôler une population, elle devient une<br />
ressource, plutôt qu'un produit final <strong>»</strong> 5 . Selon la manière dont les victimes sont choisies, la<br />
violence peut être sélective ou indiscriminée. À l'arrivée des AUC, cette violence <strong>est</strong><br />
indiscriminée, nous allons examiner son fonctionnement.<br />
Tous les chemins mènent à la Zona<br />
Une analyse de <strong>notre</strong> base de données montre une haute concentration des meurtres<br />
commis par les paramilitaires dans le Nord du département, et particulièrement dans les<br />
parties de ces municipes qui correspondent à la Zone bananière. Le graphique 5.3 montre la<br />
1 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2006]<br />
2 Zuñiga [2007]<br />
3 Sémelin [2002], p. 488. Italiques de l'auteur<br />
4 Kalyvas [2006], p. 28<br />
5 Ibidem, p. 26<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 169
épartition des meurtres imputés aux paramilitaires par municipe entre 1998 et 2003; le<br />
graphique 5.4 montre l'évolution du municipe de Ciénaga sur la même période.<br />
Notre hypothèse <strong>est</strong> que l'évolution de la violence dans la région <strong>est</strong> due aux<br />
interférences entre les logiques rétributive et militaire. Une fois le monopole de la violence<br />
conquis elles laisseront la place à une logique étatique. Les interférences sont notamment le<br />
produit de l'existence de nombreux intérêts militaires et économiques. Nous montrerons ici<br />
l'importance de ces derniers pour comprendre la violence paramilitaire. Cela conduirait à<br />
confirmer <strong>notre</strong> hypothèse d'une utilisation de la violence comme outil d'accumulation de<br />
ressources. En effet, nous avons déjà évoqué l'importance stratégique de cette région, ainsi<br />
que son rôle dans le secteur agro-industriel. Un troisième élément économique vient renforcer<br />
l'importance économique de la région : l'installation du port carbonifère de l'entreprise<br />
étasunienne Drummond à Ciénaga. Nous analyserons ici le cas de ce chemin de fer et celui<br />
des exploitations bananières.<br />
Graphique 5.3. Répartition des cas par municipes (1998-2003)<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 170
Graphique 5.4. Ciénaga 1 , répartition trim<strong>est</strong>rielle des cas<br />
Source : Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
À partir du milieu de la décennie 1990, Drummond exploite les mines de <strong>La</strong> Jagua de<br />
Imbirico, Chiriguaná et la Loma dans le département voisin du Cesar. Une ligne ferroviaire de<br />
plus de 250 kilomètres communique les mines de charbon et le port de Ciénaga. Le chemin de<br />
fer traverse les municipes d'Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona bananera et Ciénaga. Les<br />
FARC-EP et l'ELN auraient commencé à racketter la compagnie aux alentours de 1996. En<br />
1997 a lieu le premier attentat enregistré par la presse locale. Une bombe posée par les FARC-<br />
EP près d'Algarrobo explose au passage du train, le faisant dérailler et détruisant la voie 2 .<br />
Deux jours plus tard, sept camions de la compagnie sont détruits par le feu déclenché par le<br />
même groupe guérillero à Ciénaga. Les deux opérations sont revendiquées par l'organisation 3 .<br />
L'année suivante l'ELN se joint au harcèlement; en juin il fait exploser une bombe au passage<br />
du train près de Fundación 4 et le mois suivant il attaque directement le port 5 . <strong>La</strong> compagnie<br />
lance alors un appel d'aide au gouvernement et menace de quitter le pays si l'État ne garantit<br />
pas la sécurité de ses installations 6 .<br />
Si l'on croit les accusations du parquet (Fiscalía) contre le commandant paramilitaire<br />
Oscar José Ospino, plus connu sous le nom de Tolemaida, le chef paramilitaire aurait<br />
commandé à partir de 2000 un <strong>«</strong> front de guerre <strong>»</strong> spécialement dédié à la sécurité du chemin<br />
de fer de Drummond 7 . Selon les déclarations de Rafael García, directeur de services<br />
1 Notons qu'en 1999 Ciénaga <strong>est</strong> scindée par la création d'un nouveau municipe, Zona Bananera<br />
2 El Heraldo, 21/09/97. Farc dinamitó línea férrea<br />
3 El Heraldo, 23/09/97. Quemadas siete tractomulas carboneras<br />
4 El Heraldo, 06/06/98. Dinamitan vía férrea en Santa Rosa de Lima<br />
5 El Heraldo, 03/07/98 Combates con el ELN en la vía a Santa Marta<br />
6 El Tiempo, 28/11/00. Temen que los ataques espanten a la Drummond<br />
7 Fiscalía General de la Nación, comuniqué de presse du 12/01/2009<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 171
informatiques du DAS 1 devant les magistrats, la compagnie étasunienne aurait financé la<br />
création de ce front avec un versement de 1,5 millions de dollars. Les négociations entre<br />
l'entreprise et Jorge Cuarenta auraient abouti à un contrat dans lequel la première s'engageait à<br />
verser 100000 dollars mensuels pour les services de sécurité assurés par les AUC 2 . Tant<br />
Cuarenta que Tolemaida font aujourd'hui face à des poursuites judiciaires pour l'assassinat de<br />
Valmore Locarno et Victos Orcasita, membres de la directive du syndicat Sintramienergetica 3 .<br />
Bien qu'empiriquement il soit très difficile d'établir des liens directs entre les <strong>«</strong> services de<br />
sécurité <strong>»</strong> prêtés par les AUC à Drummond et des cas d'assassinat précis, ce partenariat <strong>est</strong><br />
vraisemblablement lié à l'augmentation des niveaux de violence dans le Nord du département<br />
du Magdaléna.<br />
L'autre secteur économique d'importance stratégique pour le Nord du département <strong>est</strong><br />
celui de la production bananière. Comme nous l'avons souligné au chapitre précédent, les<br />
exploitations bananières, surtout celles qui appartiennent aux entreprises étrangères – Chiquita<br />
Brands et Dole Inc. – sont victimes du harcèlement de la guérilla dès le début de la décennie<br />
1990. Or, avec la progression des insurgés, les pressions sur ces compagnies semblent devenir<br />
de plus en plus fortes. C'<strong>est</strong> en tout cas ce qu'affirme P. Zúñiga 4 , qui confirme les propos d'un<br />
leader syndical de Ciénaga que nous avons interviewé 5 . <strong>La</strong> presse de l'époque enregistre<br />
également cette augmentation des actions de sabotage contre les compagnies agro-<br />
industrielles. Ainsi, en septembre 1997 toute une exploitation appartenant à Dole Inc <strong>est</strong><br />
réduite aux cendres par une attaque des FARC-EP 6 . L'année suivante le siège de la compagnie<br />
à Santa Marta <strong>est</strong> victime d'un attentat à la bombe, revendiqué par l'ELN, qui accuse<br />
l'entreprise de collaborer avec les paramilitaires. Selon le quotidien El Heraldo, cette attaque<br />
serait une riposte contre l'assassinat de 15 ouvriers agricoles pendant le premier sem<strong>est</strong>re de<br />
l'année 7 . En effet, plusieurs dizaines d'ouvriers et des dirigeants syndicaux sont tués par les<br />
paramilitaires à partir de la seconde moitié de la décennie. Par exemple, en juillet 1997 sont<br />
assassinés Camilo Ariza et Mauricio Tapias, tous les deux membres de la directive du<br />
1 Service de Renseignements – Departamento Administrativo de Seguridad<br />
2 Conrad & Scherer, LPP vs. Drummond Company Inc. Drummont Ltd. Augusto Jimenez, Alfredo<br />
Araújo and James Atkins. The United States District Court for the Northw<strong>est</strong>ern Court of Alabama<br />
W<strong>est</strong>ern Division. Complaint for damages<br />
3 El Tiempo, 02/05/2007. Ordenan detención de jefe paramilitar 'Jorge 40' por asesinato de sindicalistas<br />
de la Drummond<br />
4 Zuñiga [2004]<br />
5 Cas n°6. Voir annexe 2, sources orales<br />
6 El Heraldo, 10/09/97. Queman finca en Zona bananera<br />
7 El Heraldo, 28/05/98. Bomba en la multinacional Dole en Santa Marta<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 172
syndicat Sintrainagro 1 . L'année suivante tombe Miguel Angel Guette, lui aussi membre de la<br />
directive du même syndicat 2 . Entre 1997 et 2002, six directifs de Sintrainagro sont<br />
assassinés 3 . Les ouvriers agricoles tombent par dizaines dans les municipes de Ciénaga, Zona<br />
Bananera, Aracataca et Fundación. Comme le raconte un leader syndical de Ciénaga :<br />
<strong>«</strong> Il y a un endroit qui s'appelle <strong>La</strong> Vuelta del Cura, près de Sevilla, là bas ils<br />
avaient l'habitude de laisser les corps, parce que les bus qui allaient aux<br />
exploitations passaient par là. Du coup, tous les matins quand on allait au travail<br />
on découvrait des morts sur <strong>notre</strong> chemin <strong>»</strong> 4 .<br />
L'escalade de violence entraînée par l'installation des AUC dans le Magdaléna semble<br />
avoir poussé la guérilla à se replier. Somme toute, les AUC semblent avoir répondu aux<br />
attentes de leurs clients. À partir du début des années 2000 plus aucun attentat contre<br />
l'infrastructure économique de la région n'<strong>est</strong> enregistré. Ce qui ne fait pas pour autant<br />
diminuer l'intensité de la violence contre les civils... 5<br />
Le contrôle du piémont de la Sierra permet aux AUC de pousser la guérilla vers les<br />
hauteurs du massif, et de contrôler toutes les voies d'accès 6 . Une fois les FARC-EP acculées à<br />
se réfugier dans les terres les plus hautes et l'ELN réduit à son expression minime, le principal<br />
rival des AUC <strong>est</strong> Hernán Giraldo. Dans une campagne éclair, l'appareil armé de Jorge<br />
Cuarenta fait plier le vieux patriarche. Le monopole sur la violence dans le territoire <strong>est</strong> alors<br />
atteint.<br />
Guerre paramilitaire<br />
En 2000, les AUC comptent, selon les <strong>est</strong>imations du Ministère de la Défense, plus de<br />
8000 combattants dans tout le pays. <strong>La</strong> politique d'expansion du groupe bat son plein à<br />
l'époque, stimulée par l'opposition de nombreux secteurs aux dialogues de paix entretenus<br />
depuis 1998 par le Président Andrés Pastrana avec les FARC-EP. Les besoins financiers de<br />
l'organisation sont donc de plus en plus importants, et elle y répond par l'établissement d'un<br />
1 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
2 Idem<br />
3 Cas n°6. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Idem<br />
5 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2006]<br />
6 Idem<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 173
quasi-monopole sur les routes de transport de cocaïne du littoral caribéen 1 . En 2001, la seule<br />
route majeure qui échappe au contrôle des AUC <strong>est</strong> celle qui descend de la Sierra. Elle <strong>est</strong><br />
alors fermement tenue par Hernán Giraldo, qui résiste à une dure attaque lancée par les<br />
FARC-EP en 2000 2 . L'importance économique de la Sierra attire les convoitises de la guérilla,<br />
qui échoue néanmoins à arracher aux Chamizos le contrôle du versant Nord. <strong>La</strong> manne<br />
financière qu'elle représente attire aussi Castaño; il aurait d'ailleurs proposé à Giraldo à<br />
plusieurs reprises d'intégrer les AUC et de participer au financement de l'offensive nationale 3 .<br />
Suite aux refus de Giraldo, les relations avec les AUC se détériorent. L'assassinat de<br />
deux agents de la DEA (Drug Enforcement Agency) par des hommes des Chamizos donne à<br />
Castaño une excuse parfaite pour lancer une offensive militaire massive 4 . Le crime a lieu en<br />
octobre 2001 à Santa Marta, lorsque des hommes de Pacho Musso, lieutenant de Giraldo,<br />
attaquent un groupe de policiers colombiens avec lesquels se trouvaient les agents étasuniens 5 .<br />
À la suite de ce meurtre, Castaño demande à Giraldo de rendre Musso à la DEA 6 ; cela en vue<br />
d'éviter de dégrader davantage les relations des États-Unis avec les paramilitaires 7 . En effet,<br />
l'organisation semble craindre la justice américaine bien plus que la justice colombienne. Les<br />
demandes d'extradition qui pèsent sur les chefs paramilitaires seraient alors l'un des<br />
principaux soucis de Castaño 8 . Cependant, Giraldo refuse de rendre Musso. En réponse à cela,<br />
les AUC lancent une attaque éclair contre l'organisation des Chamizos 9 . Plus de 400 hommes<br />
originaires de tous les départements du littoral traversent en novembre plusieurs centaines de<br />
kilomètres pour attaquer Giraldo dans son refuge de la Sierra. Ils viennent principalement de<br />
Córdoba, et ne sont pourtant pas inquiétés durant tout leur trajet, malgré le fait que les routes<br />
de la région abondent en barrages militaires et policiers. L'organisation de Giraldo n'a pas les<br />
moyens de contenir un tel raz-de-marée. Elle <strong>est</strong> formée par des paysans armés de manière<br />
1 Duncan [2005b]<br />
2 El Mundo, 14/10/2000. Guerrillas y paras en lucha por territorio<br />
Defensoría del Pueblo [2002]<br />
3 Selon les déclarations de Nodier Giraldo et Hernán Giraldo dans le cadre du processus Justice et Paix.<br />
Cf. Expert n°12<br />
4 Zuñiga [2007], p. 302<br />
5 El Nuevo Herald, 21/08/2006. Un golpe mortal al cartel de las AUC<br />
6 Par le biais d'un communiqué de presse des AUC, publié le 12 novembre 2000 sur leur site internet.<br />
Cf. El Tiempo, 26/01/02. Guerra para en Santa Marta.<br />
7 Expert n°10. Voir annexe 2, sources orales<br />
8 Ce que dit Castaño lui-même dans sa biographie autorisée. Cf. Aranguren [2001]<br />
9 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2006], p.15<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 174
udimentaire et par des tueurs à gage urbains 1 . Elle fait face à une armée entraînée aux<br />
techniques de la guerre de guérillas, équipée d'armes de grand calibre et de dernière<br />
technologie 2 . De plus, les hommes des AUC qui attaquent Giraldo sont menés par quelqu'un<br />
qui connaît très bien la région; il s'agit de Rigoberto Rojas, le chef des Autodéfenses de<br />
Palmor opposé depuis des années à Giraldo. Des combats ont lieu dans le piémont de la Sierra<br />
et sont facilement emportés par les AUC qui commencent alors à repousser les Chamizos vers<br />
les zones les plus élevées 3 . Selon Beto Quiroga, homme de confiance de Giraldo, ces combats<br />
sont très inégaux et ses hommes tombent par dizaines dans les premiers jours de l'offensive 4 .<br />
Parallèlement à l'offensive militaire, les AUC attaquent des commerçants de Santa<br />
Marta liés à Giraldo. Plusieurs d'entre-eux seraient des hommes de paille de l'organisation 5 .<br />
Les attaques visent aussi des membres des élites économiques de la ville, probablement dans<br />
le but de décourager tout appui aux Chamizos 6 . Ces derniers utilisent aussi les menaces contre<br />
la population pour tenter de garder leur contrôle sur la ville. Ainsi, en janvier 2002 des tracts<br />
signés par <strong>«</strong> Le commandement urbain des paramilitaires de Santa Marta <strong>»</strong> au nom de<br />
l'organisation d'Hernán Giraldo menacent les habitants de plusieurs quartiers populaires du<br />
Sud de la ville 7 .<br />
Dans leur combat contre les Chamizos, les AUC appliquent la même stratégie qu'ils<br />
utilisent contre la guérilla; ils attaquent les civils qui peuvent constituer des soutiens sociaux<br />
de l'organisation de Giraldo. Or, les paysans de la Sierra vivent depuis des années sous les<br />
ordres de celui qu'ils considèrent comme un patriarche. Ils sont donc tous des cibles<br />
potentielles de la violence des nouveaux venus. Les AUC sont précédées par leur réputation<br />
de violence et de cruauté :<br />
<strong>«</strong> Les gens avaient très peur des Castaño. <strong>La</strong> nuit où ils sont arrivés à Tucurinca<br />
les gens ont fuit le village, ils se jetaient par les ravins et traversaient les fleuves<br />
1 Expert n°10. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Pour une description de l'entraînement des combattants des AUC voir León [2005], p. 297 et suiv.<br />
3 El Tiempo, 26/01/02. Guerra para en Santa Marta.<br />
4 Version libre de Beto Quiroga dans le cadre du processus Justice et Paix. Cf. Expert n°13. Voir<br />
annexe 2, sources orales<br />
5 El Heraldo, 14/01/02. AUC atacan en Bonda y matan a dos hermanos.<br />
6 El Informador, 17/12/2001. Explota una bomba en la ferretería Gómez Hermanos. Cité par Zuñiga<br />
[2007], p. 301. L'article rend compte de l'explosion d'une bombe devant une droguerie appartenant à<br />
un conseiller municipal de Santa Marta.<br />
7 Defensoría del Pueblo [2002]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 175
amenant seulement les vêtements qu'ils avaient sur eux. Ils y a des gens qui sont<br />
r<strong>est</strong>és cachés pendant plusieurs semaines <strong>»</strong> 1 .<br />
Les informations des institutions officielles affirment que l'avancée des AUC <strong>est</strong><br />
précédée par des déplacements massifs des populations 2 . Un habitant de la région se souvient<br />
de cette période :<br />
<strong>«</strong> Lorsqu'il y avait des combats c'était très dangereux pour les paysans. Il était<br />
impossible de sortir de nuit ou de bouger de chez soi. Les gens partaient en<br />
débandade. Nous avons dû partir trois fois en fuyant […]. Ensuite, les Castaño<br />
ont occupé le territoire. Ils ont dit qu'il fallait en finir avec tout le monde, ils était<br />
brutaux. Tu avais une petite bête, un cochon par exemple, et ils le mangeaient. Ils<br />
faisaient ce qu'ils voulaient avec les filles, ils ont violé beaucoup de femmes. C'<strong>est</strong><br />
pour ça que beaucoup de gens sont définitivement partis à Santa Marta <strong>»</strong> 3 .<br />
Acculé dans les hauteurs de la Sierra, Giraldo utilise la population de la région pour<br />
faire pression sur le gouvernement national. Il aurait donné l'ordre aux paysans du versant<br />
Nord de bloquer la route qui communique Santa Marta à Riohacha 4 . Plusieurs milliers de<br />
personnes (entre 15 000 et 30 000 selon les différentes sources de presse) se dirigent alors<br />
vers le village de Calabazo, au bord de la route de la Caraïbe 5 . Le blocage de cet axe aurait<br />
provoqué l'intervention du gouvernement et la signature d'un accord de paix entre les deux<br />
organisations 6 . Celui-ci intègre les Chamizos dans la structure du Bloc Nord des AUC. Ils<br />
adoptent alors le nom de <strong>«</strong> Front Résistance Tayrona <strong>»</strong> (FRT) et le commandement militaire<br />
de la nouvelle structure <strong>est</strong> confié à Rigoberto Rojas. Giraldo devient le responsable politique,<br />
c'<strong>est</strong>-à-dire qu'il r<strong>est</strong>e chargé des relations avec les populations paysannes et les élites de Santa<br />
Marta 7 . Le FRT garde l'autonomie dans la g<strong>est</strong>ion du trafic de la drogue, mais se serait engagé<br />
à verser un million de dollars mensuel au commandant du Bloc Nord, Jorge Cuarenta 8 .<br />
1 Cas n°13. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Defensoría del Pueblo [2002]<br />
3 Cas n°14. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Expert n°10. Voir annexe 2, sources orales<br />
5 El Heraldo, 17/01/2002. Campesinos de la trocal caribe marchan por la paz<br />
El Tiempo, 24/01/2002. Bloqueada la vía a Riohacha<br />
6 Hoy Diario del Magdalena, 29/07/2003. AUC y Hernán Giraldo firmaron la paz<br />
7 Expert n°12. Voir annexe 2, sources orales<br />
8 Expert n°1. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 176
Nous le voyons bien, la violence contre les civils dans ces épisodes <strong>est</strong> caractérisée par<br />
son aspect indiscriminé. On peut s'interroger sur une violence qui semble parfois <strong>«</strong> gratuite <strong>»</strong>.<br />
Cette interrogation pourra contribuer à établir le fonctionnement de la violence et donc peut<br />
nourrir <strong>notre</strong> analyse centrale. S. Kalyvas affirme que <strong>«</strong> l'objectif central de la violence<br />
indiscriminée <strong>est</strong> de modeler le comportement des civils indirectement à travers<br />
l'association <strong>»</strong> c'<strong>est</strong>-à-dire que <strong>«</strong> si les " coupables " ne peuvent pas être identifiés et arrêtés, la<br />
violence doit donc cibler des personnes innocentes qui sont de quelque manière (somehow)<br />
associés à eux <strong>»</strong> 1 . Selon l'auteur, cette stratégie <strong>est</strong> plus coûteuse que la violence sélective,<br />
dans la mesure où elle peine à gagner l'adhésion de civils. En effet, s'il existe une relation de<br />
cause à effet entre la violence et le soutien à un acteur, les civils peuvent décider de soutenir<br />
l'acteur qui contrôle le mieux le territoire espérant recevoir sa protection. Or, si cette violence<br />
ne distingue pas les sympathisants des opposants, elle peut plus difficilement constituer un<br />
argument pour apporter son soutien à un acteur plutôt qu'à un autre. Pour Kalyvas, cette<br />
violence, en raison de son coût élevé n'<strong>est</strong> mise en pratique que lorsque l'acteur a une présence<br />
faible sur le territoire et des sources d'information rares.<br />
<strong>La</strong> violence indiscriminée peut cependant garantir à l'acteur armé le soutien de la<br />
population. Kalyvas explique que cette efficacité <strong>est</strong> déterminée par la capacité de l'acteur<br />
concurrent à apporter une protection à la population. Lorsqu'il se montre incapable d'assurer<br />
cette protection les civils n'ont qu'un choix : collaborer avec le nouvel arrivant. C'<strong>est</strong> bien ce<br />
qui se passe dans le Magdaléna. Dans le cas de la guérilla, elle abandonne les terres de plaine<br />
avant même de devoir se battre contre les paramilitaires 2 . Pour Giraldo la logique <strong>est</strong> la<br />
même; il ne donne aucune protection à la population et l'utilise même pour faire pression sur<br />
les AUC 3 .<br />
Selon Kalyvas, lorsque le contrôle du territoire et de la population s'affermit, la<br />
violence devrait devenir plus sélective 4 . Cela se confirme dans <strong>notre</strong> cas. Lorsque les<br />
nouveaux occupants arrivent dans la région, ils y sont étrangers 5 et ont des sources<br />
d'information limitées. Dans le cas de l'invasion de la Sierra, ils se trouvent sur un territoire<br />
contrôlé depuis longtemps par l'ennemi, raison de plus pour se méfier des populations. <strong>La</strong><br />
transformation de la violence indiscriminée en violence sélective s'observe également dans<br />
1 Kalyvas [2006], p. 150. Italiques de l'auteur<br />
2 Cas n° 8. Voir annexe 2, sources orales : <strong>«</strong> <strong>La</strong> guérilla <strong>est</strong> partie avant que les AUC arrivent. Rien que<br />
d'entendre qu'ils venaient ils sont montés dans la Sierra <strong>»</strong><br />
3 Defensoría del Pueblo [2002]<br />
4 Ibidem, p. 169<br />
5 Expert n°4. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 177
<strong>notre</strong> cas. Elle n'<strong>est</strong> cependant pas accompagnée d'une diminution du nombre de morts. Bien<br />
que les paramilitaires sélectionnent mieux leurs victimes lorsque leur contrôle territorial<br />
devient total, ils continuent à assassiner massivement.<br />
<strong>La</strong> lecture de la violence en termes d'adhésion ou de défection de la population nous<br />
aide à comprendre en partie sa variabilité. Elle doit être cependant complétée par d'autres<br />
types de lecture. Nous explorerons dans la partie suivante le rôle de la violence comme<br />
exercice d'un pouvoir par la terreur.<br />
2. De la violence généralisée à la terreur<br />
Tout au long de ce récit, nous avons souligné l'intensité extrême des violences des<br />
AUC. En effet, les acteurs ne se contentent pas de détruire, ils le font de manière à produire de<br />
la terreur. Celle-ci fait l'objet de mises en scènes soigneusement conçues, où les acteurs jouent<br />
des rôles préétablis et où l'acte violent communique autant qu'il détruit 1 . Il faut donc étudier<br />
ce processus d'instrumentalisation de la terreur qui en fait un outil d'exercice du pouvoir. À<br />
cet égard, Éric <strong>La</strong>ir écrit à propos du conflit colombien :<br />
<strong>«</strong> <strong>La</strong> terreur constitue par excellence l'arme mise au service [d'une] stratégie de<br />
contrôle des populations et d'affaiblissement de l'ennemi. Du point de vue de ses<br />
acteurs […], la terreur <strong>est</strong> instrumentalisée dans des desseins qui cherchent à<br />
asseoir le contrôle spatial d'un groupe au détriment d'un autre. En soi, elle n'<strong>est</strong><br />
pas une technique de d<strong>est</strong>ruction systématique bien qu'elle puisse être vécue<br />
comme telle. Elle suppose une part de d<strong>est</strong>ruction mais elle vise avant tout à<br />
diffuser de la peur dans le tissu social en vue de le paralyser, de le contrôler et de<br />
le modeler selon les intérêts des acteurs en conflit <strong>»</strong> 2 .<br />
Si l'on compare l'analyse du chercheur au discours des acteurs, nous voyons un clair<br />
décalage. En effet, les bourreaux ont tendance à mettre en scène les d<strong>est</strong>ructions comme des<br />
actes prophylactiques, comme l'élimination d'un élément nuisible à la collectivité. D'où la<br />
rhétorique du <strong>«</strong> nettoyage <strong>»</strong> 3 (limpieza) qui revient en permanence dans leurs discours.<br />
Lorsqu'on demande à un habitant de Chibolo de définir ce qu'il entend par nettoyage il dit :<br />
<strong>«</strong> Le nettoyage social <strong>est</strong> le fait de tuer les gens qui ont été proches de la guérilla,<br />
les paysans propriétaires des terres que la guérilla utilisait auparavant pour<br />
1 Uribe [2004]<br />
2 <strong>La</strong>ir [2000], p. 533<br />
3 Cf. Taussig [2003] pour une analyse anthropologique de la qu<strong>est</strong>ion du <strong>«</strong> nettoyage <strong>»</strong><br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 178
camper, les gens qui avaient eu des contacts avec les guérilleros. C'<strong>est</strong> aussi le<br />
fait d'éliminer les gens qui volaient ou qui consommaient de la drogue <strong>»</strong> 1 .<br />
<strong>La</strong> perception de la violence paramilitaire, telle que véhiculée par les bourreaux,<br />
correspond à une violence d'extermination qui vise des catégories précises de personnes. Elle<br />
serait définie par l'être de la victime, et non pas par sa situation 2 . C'<strong>est</strong> là que se trouve le<br />
piège, car à catégoriser tous les meurtres des paramilitaires comme des violences<br />
exterminatrices, on s'empêche de voir le fond stratégique de l'action. <strong>La</strong> violence telle que<br />
décrite par ses bourreaux ressemble à une folie meurtrière mue par la conviction intime du fait<br />
que l'Autre doit disparaître 3 . Ainsi vue, la violence ne fait pas sens, elle appartiendrait à<br />
l'ordre de l'irrationnel et de l'incompréhensible 4 . Ce discours des acteurs s'oppose à la vision<br />
que nous avons déjà développée, qui met l'accent sur la plasticité des catégories de l'exclusion<br />
et sur un espace de la violence dont le périmètre <strong>est</strong> variable. Ce discours <strong>est</strong> consiste en une<br />
utilisation politique de la violence extrême. Nous nous bornerons ici à étudier deux aspects de<br />
la violence extrême, seuls points indispensables à <strong>notre</strong> réflexion sur les liens entre violence et<br />
pouvoir politique 5 ; il s'agit de l'exercice du pouvoir par l'excès et la cruauté et du contrôle<br />
social par la peur.<br />
Le pouvoir de la cruauté<br />
Le massacre agit comme acte communicationnel, il construit l'acteur armé comme<br />
source de terreur. Désormais, la seule menace de l'utilisation de la violence suffit à se faire<br />
obéir. Comme l'affirme un habitant du village de Tucurinca :<br />
<strong>«</strong> Quant ils sont arrivés ils ont commencé à sortir les gens et à les tuer en public.<br />
Là tout le monde a pris peur, quand on a vu qu'ils étaient sanguinaires et qu'ils<br />
n'étaient pas seuls mais toujours en groupes. Ils étaient la terreur là bas. Tous ces<br />
villages sont r<strong>est</strong>és à leur dispositions, ils étaient l'autorité. <strong>»</strong> 6<br />
1 Cas n°8. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Sur la violence d'extermination voir Sémelin [2005], p. 398 et suiv.<br />
3 Voir les audiences judiciaires citées. Versions libres d'Adan Rojas..., voit item 3 annexe 2 sources<br />
orales<br />
4 Un tel renoncement à comprendre nous semble irresponsable. À croire aveuglement les bourreaux le<br />
discours scientifique effectue une deuxième victimisation.<br />
5 Pour une réflexion très complète sur le thème des massacres en Colombie voir l'ouvrage de<br />
l'anthropologue Elsa Blair [2004], ainsi que les différents travaux désormais célébres de María<br />
Victoria Uribe.<br />
6 Cas n°13. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 179
<strong>La</strong> mise en scène macabre des massacres répond également à cette utilisation de la peur<br />
comme une ressource. <strong>La</strong> première incursion dans un village <strong>est</strong> souvent marquée par ces<br />
actes de cruauté. En humiliant et en torturant les corps, ils deviennent les supports d'un<br />
message de cruauté 1 . Comme l'affirme un ouvrier originaire de Santa Rita (Remolino) :<br />
<strong>«</strong> Parmi les premiers morts étaient aussi les prostituées du village. Ils ont dit<br />
qu'ils ne toléraient pas la prostitution dans leurs zones d'influence, et qu'en plus<br />
elles étaient souillées car elles avaient couché avec des guérilleros. C'était<br />
horrible, ils les ont coupées à la tronçonneuse devant tout le monde et après il ont<br />
jeté les r<strong>est</strong>es dans les trous dans lesquels les poteaux des lampadaires étaient<br />
plantés, ils ont arraché les poteaux et les ont remis après <strong>»</strong> 2 .<br />
Cette dimension communicationnelle du massacre <strong>est</strong> soulignée par J. Sémelin. Cet<br />
auteur écrit ainsi que <strong>«</strong> le massacre n'a pas à être tu mais su, de manière à ce que son effet<br />
terrorisant se propage dans la population – effet terrorisant qui <strong>est</strong> encore accru par les<br />
pratiques du pillage et du viol <strong>»</strong> 3 . Comme le fait remarquer E. <strong>La</strong>ir, <strong>«</strong> le recours à la terreur<br />
constitue un mécanisme de diffusion de la peur reposant essentiellement sur le mode de<br />
communication verbale et visuelle <strong>»</strong> 4 . Par conséquent, il <strong>est</strong> important que les habitants<br />
deviennent des spectateurs de la mise à mort, souvent malgré eux :<br />
<strong>«</strong> Lorsqu'ils ont tué la fille de Télécom et sa famille ils ont réuni tout le village sur<br />
la place centrale. Ils ont dit – c'<strong>est</strong> pour vous apprendre comment on tue une<br />
personne; et attention, tout le monde regarde, si on voit que quelqu'un ferme les<br />
yeux ou tourne la tête on le tue aussi <strong>»</strong> 5 .<br />
<strong>La</strong> cruauté ne sert pas seulement à alimenter une réputation violente, elle instaure aussi<br />
une relation de domination entre le bourreau et la victime, mais aussi entre le bourreau et<br />
toute la communauté. Elle <strong>est</strong> la démonstration de la puissance du bourreau sur la vie et la<br />
mort, ainsi que sur la souffrance humaine. Les interventions qui profanent les corps et<br />
humilient la victime affirment le pouvoir des paramilitaires sur les territoires et les<br />
populations, elles constituent par là des formes de dépossession de la communauté. Il <strong>est</strong> de<br />
même pour une violence qui semblerait en quelque sorte <strong>«</strong> gratuite <strong>»</strong>, simplement mue par les<br />
1 Blair [2004], p. 48<br />
2 Cas n°28. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Sémelin [2005], p. 389<br />
4 <strong>La</strong>ir [2000], p. 534<br />
5 Cas n°13. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 180
caprices sanguinaires des bourreaux. Si les déterminants individuels de cette violence ne<br />
peuvent être niés 1 , il <strong>est</strong> clair qu'elle joue également un rôle instrumental, en affirmant la toute<br />
puissance de l'acteur armé. Un habitant de Pivijay donne un exemple de cette violence<br />
<strong>«</strong> gratuite <strong>»</strong> :<br />
<strong>«</strong> À <strong>La</strong> Colorada, nous avions un projet productif avec la communauté qu'on<br />
avait monté avec une aide de la FAO. Ils ont volé les trois tracteurs que nous<br />
avions et tout le manioc. Ils nous ont obligés à arracher le manioc et à remplir<br />
nous mêmes les remorques. Une fois que les remorques étaient pleines ils ont mis<br />
des gens sous les tracteurs et ont leur roulé dessus <strong>»</strong> 2<br />
L'affirmation de cette domination implique aussi l'exposition de leur puissance à tout<br />
moment, et non pas seulement lors des rituels 3 de mise à mort. En effet, les paramilitaires<br />
affirment leur présence ouvertement, sans qu'aucune autorité ne la condamne. Ils ne font<br />
l'objet d'aucun signalement public, ils exhibent leur pouvoir de forme décomplexée et<br />
ostentatoire. L'impunité dont ils jouissent <strong>est</strong> l'affirmation de ce pouvoir. Comme l'affirme un<br />
habitant de Chibolo : <strong>«</strong> Dans le même municipe habitait le commandant, il avait loué une<br />
maison et y vivait tranquillement <strong>»</strong>. Un habitant de Santa Marta, enseignant dans le secondaire<br />
met l'accent sur le caractère ouvertement public de l'organisation paramilitaire :<br />
<strong>«</strong> Ils pouvaient arriver à une épicerie et prendre ce qu'ils voulaient, sans rien<br />
payer. Ils pouvaient embarquer les femmes et personne ne disait rien […]. Tout le<br />
monde savait qui était paramilitaire, leur intention était de le rendre public, pour<br />
causer de la peur et du respect <strong>»</strong> 4 .<br />
Cette impunité <strong>est</strong> particulièrement frappante dans les nombreux cas rapportés<br />
d'assassinats sélectifs qui ont lieu en plein jour, sur des rues centrales des villes. <strong>La</strong> visibilité<br />
de cette violence constitue une affirmation de l'emprise de l'appareil armé sur la population.<br />
Comme l'affirme une institutrice d'Aracataca :<br />
1 Il serait ainsi intéressant d'analyser ces cas à l'aide des approches psychologiques, comme par<br />
exemple celle de Bandura [1999] qui met l'accent sur l'accoutumance à la violence ou des approches<br />
sociologiques de l'acte individuel. Voir par exemple à cet égard Browning [2007]; Milgram [1974];<br />
Welzer [2007]<br />
2 Cas n°21. Voir annee 2, sources orales<br />
3 Uribe [2004], p. 86 définit les massacres de l'époque de la Violence comme des actes rituels. Elle<br />
dresse ensuite un parallèle avec les massacres contemporains.<br />
4 Cas n°24. Voir annee 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 181
<strong>«</strong> A cette époque là (1998, moment daté par l'interviewée grâce à des références à<br />
son histoire familiale, n.d.t.) à Aracataca il y avait une 4/4 blanche qui produisait<br />
beaucoup de peur. Quand on voyait la voiture on savait que quelqu'un allait<br />
mourir, car à chaque fois qu'elle apparaissait c'était pour amener des<br />
paramilitaires qui venaient tuer quelqu'un. On l'appelait la petite colombe de la<br />
mort (la palomita de la muerte) <strong>»</strong> 1 .<br />
L'affirmation du pouvoir des paramilitaires sur des moments extraordinaires, comme les<br />
rituels de mise à mort, mais aussi sur le quotidien des individus, constitue la base sur laquelle<br />
se construit un système de surveillance et un contrôle social étroit. Nous examinerons<br />
brièvement ce système.<br />
Le gouvernement par la peur<br />
J. Sémelin observe que <strong>«</strong> les pratiques de d<strong>est</strong>ruction-soumission, forgées dans la<br />
guerre, peuvent s'étendre à la g<strong>est</strong>ion des peuples <strong>»</strong> 2 . Nous constatons que, une fois le contrôle<br />
du territoire acquis, les paramilitaires instaurent un système de surveillance et de contrôle de<br />
la population par la terreur. Dominique Perault décrit trois mécanismes successifs<br />
d'établissement de ce contrôle : à leur arrivée, les paramilitaires mènent les actions de<br />
<strong>«</strong> nettoyage <strong>»</strong>, comme cela a déjà été expliqué. Ils éliminent alors toute personne suspectée<br />
d'appartenir à la guérilla. Ensuite ils instaurent un système de surveillance des frontières<br />
extérieures de la zone, qui a pour objectif d'empêcher l'entrée de possibles informateurs du<br />
camp ennemi. Enfin, un système de surveillance de l'intérieur de la communauté <strong>est</strong> instauré.<br />
Les habitants eux-mêmes font partie de ce mécanisme car ils peuvent se trouver insérés dans<br />
les réseaux de renseignement de l'organisation 3 . Nous avons déjà décrit le premier type de<br />
contrôle, nous allons analyser brièvement le système de surveillance des frontières avant de<br />
nous concentrer sur le système de surveillance interne.<br />
Chaque commandant paramilitaire a une certaine autonomie dans la g<strong>est</strong>ion d'une zone.<br />
Il y prélève des ressources, applique les règles de l'organisation et contrôle les mouvements de<br />
la population 4 . Il organise la g<strong>est</strong>ion des frontières de sa zone. Celles-ci se matérialisent par<br />
l'existence de barrages sur les routes, de points de contrôle, de patrouilles le long des chemins<br />
1 Cas n°3. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Sémelin [2005], p. 391<br />
3 Perault [2006], p. 126-127<br />
4 Fiscalía Justicia y Paz, Dossier del Bloque Norte de las AUC, document non-daté<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 182
et de couvre-feux le soir. Ainsi l'explique un paysan originaire de Tucurinca (Zona<br />
Bananera) :<br />
<strong>«</strong> Ils contrôlaient toute les routes, si jamais ils ne te connaissaient pas, il fallait<br />
que tu sois avec quelqu'un du coin qui te recommande, sinon tu étais mort. [...] À<br />
partir de 6h du soir il était interdit de sortir dans les rues. Parfois ils fermaient<br />
les sorties du village et réunissaient tout le monde. Ils disaient qu'ils étaient<br />
l'autorité suprême et qu'ils n'avaient pas de <strong>prison</strong>s, que leurs <strong>prison</strong>s étaient<br />
leurs <strong>fusil</strong>s. " Nous ne mettons personne en <strong>prison</strong>, la <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong>, celui<br />
qui ne respecte pas <strong>notre</strong> loi meurt ", et c'était vrai. […] Tu sais, c'<strong>est</strong> un peu<br />
comme quand l'équarrisseur tue une bête et que les autres reculent et se cachent<br />
dans un coin, on était comme ça nous, on était enfermé; on se sentait <strong>prison</strong>niers,<br />
à leur merci <strong>»</strong> 1<br />
Le même interviewé parle de l'existence d'un curieux partenariat entre paramilitaires et<br />
policiers. Les premiers exigeaient à tous les habitants du village de demander à la station de<br />
police des carnets att<strong>est</strong>ant de leur lieu de résidence (information qui ne figure pas sur les<br />
cartes d'identité colombiennes); cela permettait aux patrouilleurs des paramilitaires, qui<br />
souvent ne connaissaient pas les habitants, de faire la différence entre locaux et les étrangers.<br />
Du fait de cette logique de contrôle des liens avec l'extérieur, les paramilitaires se méfient<br />
particulièrement des commerçants ou autres voyageurs fréquents, sous prétexte que dans leurs<br />
voyages ils pourraient récolter de l'information pour la guérilla ou leur amener des vivres.<br />
Ainsi l'explique un commerçant originaire de Monterrubio (Fundación) :<br />
<strong>«</strong> Comme ma fille était malade, il fallait l'amener à Santa Marta pour les<br />
traitements. Quand on venait, on en profitait pour acheter des marchandises<br />
qu'on vendait après dans le village, genre des vêtements, des radios, des choses<br />
comme ça. Ça ne leur a pas plu, ils m'ont dit " ou tu t'en vas ou tu r<strong>est</strong>es, mais<br />
t'arrêtes de faire des allées venues <strong>»</strong>.Ce à quoi j'ai répondu que j'avais une fille<br />
malade et qu'il fallait que je me déplace. <strong>«</strong> Cette histoire, même ta mère ne la<br />
croirait pas <strong>»</strong>, ils m'ont dit. Du coup ils m'ont forcé à m'en aller. […] <strong>La</strong> même<br />
chose <strong>est</strong> arrivé à mon ami Juan Gamarra; il avait une voiture et transportait des<br />
marchandises pour les paysans. Ils l'ont tué après l'avoir accusé d'amener de la<br />
nourriture à la guérilla <strong>»</strong> 2 .<br />
1 Cas n°13. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Cas n°10. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 183
Tous les dispositifs sont fondés sur une différentiation nette entre amis et ennemis, qui<br />
<strong>est</strong> renforcée par la brutalité de la violence qui s'abat sur les seconds. Ainsi, la neutralité <strong>est</strong><br />
une position inimaginable. Cette logique <strong>est</strong> particulièrement frappante dans les dispositifs de<br />
surveillance interne, car la limite entre les deux catégories antagoniques traverse l'intérieur<br />
même de la collectivité. Comme l'affirme E. <strong>La</strong>ir, cette logique binaire vise à clarifier les<br />
rapports sociaux et à uniformiser les territoires 1 . Or, les habitants eux-mêmes savent que les<br />
limites entre amis et ennemis sont plus floues qu'elles n'apparaissent dans les discours des<br />
paramilitaires. En effet, comme le remarque S. Kalyvas, la peur de l'acteur armé en lui-même<br />
<strong>est</strong> souvent égalée en intensité par la peur du voisin qui dénonce 2 . Or, en Colombie, de la<br />
même manière que dans les exemples cités par l'auteur, la focalisation sur les combattants<br />
tend à faire oublier le rôle joué par les civils eux-mêmes dans la mécanique de la violence 3 .<br />
Nous n'avons pas été capables de retrouver une seule personne qui avoue avoir dénoncé ses<br />
voisins; la balance ou le sapo (crapaud) comme on dit en Colombie <strong>est</strong> toujours l'autre 4 . <strong>La</strong><br />
dénonciation peut être mue par une adhésion aux buts de l'organisation – même si cette<br />
motivation semble assez rare en Colombie 5 – ou par un intérêt personnel 6 . Sous cette dernière<br />
catégorie rentreraient les dénonciations faites en échange d'une rémunération ou, plus<br />
couramment, celles qui visent à régler par la violence des paramilitaires des conflits privés.<br />
Ce sont ces dernières qui sont les plus citées par les témoins. Ils semblent en effet frappés par<br />
l'arbitraire de la situation. Ils évoquent la peur que provoquent les habitants qui sont proches<br />
des paramilitaires; ils savent qu'une querelle de voisinage avec un tel individu peut être<br />
mortelle. Comme le raconte un paysan originaire de Tucurinca :<br />
<strong>«</strong> Il y a eu beaucoup de morts par mauvaise information. Par exemple, je ne<br />
m'entends pas bien avec mon voisin, le mec il m'emmerde. Du coup, si j'étais ami<br />
avec un paramilitaire je pouvais lui dire – ce gars là <strong>est</strong> un guérillero. Ils seraient<br />
1 <strong>La</strong>ir [2000], p. 534<br />
2 Kalyvas [2006], p. 178<br />
3 Ibidem, p. 180<br />
4 En cela Kalyvas [2006], p. 177 avoue ne pas avoir eu plus de succès que nous. En revanche, il écrit<br />
qu'un <strong>«</strong> bon indicateur indirect de la présence de la dénonciation <strong>est</strong> la méfiance généralisée dans les<br />
contextes de guerre civile <strong>»</strong> (Idem)<br />
5 À ce sujet, des nombreux auteurs parlent en Colombie de guerre contre les civils au lieu de guerre<br />
civile, dans la mesure où l'autonomie des acteurs armés – guérilla et paramilitaires au même titre – <strong>est</strong><br />
telle qu'ils semblent se passer assez facilement d'une véritable base sociales. Cf. <strong>La</strong>ir [2000]; Pécaut<br />
[2001]<br />
6 Kalyvas [2006], p. 178 parle de <strong>«</strong> political motives <strong>»</strong> et de <strong>«</strong> malicious motives <strong>»</strong><br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 184
venus le chercher et l'auraient tué. C'<strong>est</strong> comme ça qu'ils ont tué beaucoup<br />
d'innocents <strong>»</strong> 1<br />
Le même type de témoignages revient constamment dans d'autres entretiens 2 . Les<br />
personnes affirment que les assassinats sont commis de manière totalement arbitraire, sans<br />
une quelconque enquête; une simple accusation suffit pour condamner quelqu'un à mort ou –<br />
au mieux – l'exil. Or, le discours des paramilitaires tend à refuser ces accusations. Par<br />
exemple, Carlos Castaño affirme dans un entretien avec le journaliste Germán Castro<br />
Caycedo:<br />
<strong>«</strong> Avant, si un informateur arrivait et disait : " Alberto R<strong>est</strong>repo <strong>est</strong> un<br />
guérillero ", alors le commandant ordonnait l'exécution d'Alberto R<strong>est</strong>repo<br />
" parce qu'un tel a dit qu'il était guérillero ". Or, il était très courant que<br />
Monsieur X avait donné cette information sur Alberto R<strong>est</strong>repo parce qu'il lui<br />
devait de l'argent, ou avait couché avec sa femme, ou avait eu une embrouille<br />
avec lui. On ne fait plus ça. Maintenant on essaye de croiser les informations<br />
pour ne pas nous prêter à ce jeu là. Aujourd'hui on traite l'information qu'on nous<br />
donne sur une personne. Il faut qu'il y ait deux informations qui ne soient pas<br />
connexes pour qu'on mène une action contre ces gens là <strong>»</strong> 3 .<br />
Pourquoi mettre autant d'accent sur la rigueur d'un processus de renseignement que l'on<br />
sait fictif 4 ? Il ne s'agit pas d'une simple qu<strong>est</strong>ion rhétorique. En effet, comme le souligne S.<br />
Kalyvas, l'efficacité de la violence sélective dépend de la protection à laquelle peuvent<br />
s'attendre les personnes en cas de collaboration. Si la violence <strong>est</strong> totalement arbitraire les<br />
incitations à collaborer sont beaucoup moins convaincantes. L'auteur souligne en revanche<br />
que les acteurs peuvent <strong>«</strong> générer une perception crédible qui indiquerait que leur violence <strong>est</strong><br />
sélective. Cette perception <strong>est</strong> alimentée par le présence d'agents locaux, ce qui signale<br />
l'existence d'un réseau d'informateurs <strong>»</strong> 5 . Cela indique que le rôle des informateurs<br />
professionnels décrits par D. Perault 6 n'<strong>est</strong> pas seulement de fournir de l'information à<br />
l'organisation, mais aussi d'alimenter chez les habitants l'impression d'être surveillés en<br />
1 Cas n°13. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Voir cas n°2, 8, 10, 11, 21 et 24<br />
3 Castro Caycedo [1996], p. 167<br />
4 Pécaut [2001] souligne cette exécution par pure suspicion, qui fait que la dénonciation d'un voisin <strong>est</strong><br />
un argument suffisant pour assassiner quelqu'un.<br />
5 Kalyvas [2006], p. 174<br />
6 Perault [2006], p. 127-128<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 185
permanence 1 . Ce procédé fonde l'efficacité du dispositif, car la surveillance devient<br />
automatique. Ainsi, il suffit de se penser surveillé pour agir comme un surveillé de fait; il<br />
s'agit ni plus ni moins d'un des aspects caractéristiques du pouvoir moderne 2 .<br />
Le pendant punitif du dispositif de contrôle social ne se limite pas aux assassinats des<br />
personnes suspectées de sympathie pour un groupe rival. Il s'étend aussi aux marginaux, dans<br />
une forme très particulière d'ingénierie sociale, c'<strong>est</strong>-à-dire un refaçonnage d'une population<br />
visant à en détacher les éléments indésirables 3 . C'<strong>est</strong> uniquement à l'occasion de ces<br />
interventions dans le corps social que la violence semble principalement mue par des objectifs<br />
d'extermination. Il s'agit de la d<strong>est</strong>ruction de catégories de population définies comme<br />
indésirables, telles les toxicomanes, les homosexuels ou les prostituées. Un tract distribué par<br />
des paramilitaires à Santa Marta énumère ces catégories :<br />
<strong>«</strong> Avertissement : aux femmes cancanières, sorcières, adultères, qui laissent<br />
rentrer chez elles des toxicos (viciosos), qui vendent ou cachent de la came<br />
(vicio), voleurs, dealers (expendedores), enfants vulgaires qui maltraitent leurs<br />
parents de parole ou de fait, qui les menacent de mort ou qui veulent leur voler<br />
leurs biens, aux parents qui permettent que leurs enfants se droguent, à ceux qui<br />
maltraitent leurs femmes et enfants et ne font rien d'autre que traîner (vagar),<br />
boire du rhum et ne pensent pas au travail, n'amènent pas d'argent à la maison et<br />
laissent leurs enfants dans le besoin parce qu'ils font passer le vice avant la<br />
famille. RAPELLEZ VOUS QUE L'ARBRE TORDU EST REDRESSÉ AVEC DU<br />
PLOMB, OU EST-CE QUE VOUS AVEZ OUBLIÉ COMMENT NOUS<br />
NETTOYONS LA MERDE? 4 .<br />
Cela ne veut pas dire que cette violence soit dénouée de sens et réponde uniquement<br />
aux instincts d<strong>est</strong>ructeurs des bourreaux. Comme nous l'avons souligné auparavant, bien que<br />
1 Cas n° 21 : <strong>«</strong> il y avait des mecs à l'entrée du village avec des téléphones portables. Quand quelqu'un<br />
arrivait ils appelaient les commandants pour les prévenir <strong>»</strong><br />
2 Foucault [1975], p. 234 : <strong>«</strong> De là l'effet majeur du Panoptique : induire chez le détenu un état<br />
conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la<br />
surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle <strong>est</strong> discontinue dans son action; que la<br />
perfection du pouvoir tende à rendre inutile l'actualité de son exercice; que cet appareil architectural<br />
soit une machine à créer et à soutenir un rapport de pouvoir indépendant de celui qui l'exerce; bref que<br />
les détenus soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs <strong>»</strong><br />
3 Sémelin [2005], p. 403-404<br />
4 Santa Marta 10/03/2004, tract distribué dans les quartiers El Paraiso, El Pantano, Santa Fé, <strong>La</strong> Granja,<br />
Tayrona, Galicia, Bastidas, Once de Noviembre, <strong>La</strong> Paz, San Pedro Alejandrino et Gaira. Base de<br />
données Noche y Niebla – CINEP<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 186
des interprétations individualistes pourraient apporter des éléments très riches, dans l'état de<br />
nos données et de l'espace que nous avons ici nous nous limiterons aux analyses collectives.<br />
Sous cette optique, l'ingénierie sociale <strong>est</strong> une forme de légitimation de la violence; montrée<br />
comme une modalité positive d'intervention dans le corps social, elle <strong>est</strong> une manière d'établir<br />
des alliances avec certains secteurs de la population. <strong>La</strong> violence apparaît ainsi comme un<br />
procédé <strong>«</strong> utile <strong>»</strong>, une manière d'agir <strong>«</strong> pour le bien des communautés <strong>»</strong> 1 .<br />
Tout au long de ce chapitre, nous avons vu comment les capacités militaires, financières et<br />
organisationnelles des AUC leur permettent de devenir un acteur monopolistique de la<br />
violence. À partir de la détention d'un tel monopole, l'organisation établit un contrôle étroit<br />
sur les territoires et les populations. Elle noue des alliances avec certains secteurs de la société<br />
et en terrorise d'autres. À partir de cette situation privilégiée, le groupe paramilitaire va<br />
subvertir les rapports avec les institutions politiques et économiques locales. Il va atteindre<br />
des positions de pouvoir qui lui permettront de peser sur la répartition du pouvoir et des<br />
ressources. L'insertion dans ces positions de pouvoir nécessitera de tisser des liens beaucoup<br />
plus étendus avec les élites locales, ainsi que d'obtenir des moyens d'influence sur l'État<br />
central.<br />
1El Heraldo, 23/08/2007. Ex “para” admitió nueve homicidios en Zona Bananera. Limpieza social:<br />
¿acción de guerra?<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 187
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 188
VI. De la violence à l'hégémonie<br />
Le jeudi 28 septembre 2000, quelques mois avant les élections locales 1 , Alias Sonia,<br />
lieutenante de Jorge Cuarenta, donne rendez-vous à tous les candidats dans le village de <strong>La</strong><br />
Estrella (Chibolo). Un homme politique ayant participé à cette réunion s'en souvient:<br />
<strong>«</strong> personne ne pouvait manquer (à la réunion), en partie parce que c'était un ordre direct de<br />
Jorge Cuarenta et en partie car on savait que les candidats qui n'y viendraient pas n'auraient<br />
pas la " bénédiction " des paramilitaires <strong>»</strong> 2 . Interviewé par une collaboratrice de Verdad<br />
Abierta, cet homme politique, explique que Cuarenta voulait établir les listes aux Conseils<br />
municipaux et à l'Assemblée départementale, ainsi que définir quels seraient les candidats aux<br />
mairies qui auraient le soutien de l'organisation 3 . L'acte finale de la réunion fait état de 410<br />
participants. Au total, les noms de quatorze candidats aux postes de maires 4 et les listes<br />
respectives aux Conseils municipaux sont décidés, ainsi que la liste des candidats à<br />
l'Assemblée départementale. Les signataires du document déclarent adhérer au mouvement<br />
politique <strong>«</strong> Province Unie pour une Meilleure Option de Vie <strong>»</strong>, dont le but serait de<br />
<strong>«</strong> développer une large politique d'intégration régionale qui se consolidera à court, moyen et<br />
long terme vers un processus démocratique exemplaire <strong>»</strong> 5 . <strong>La</strong> réunion a également comme but<br />
de choisir le candidat du <strong>«</strong> mouvement <strong>»</strong> au poste de gouverneur 6 . Le vainqueur <strong>est</strong> José<br />
Domingo Dávila, qui reçoit les voix des 266 participants à la réunion, contre 138 pour son<br />
adversaire, José Alfredo Ordoñez 7 . L'interviewé cité n'<strong>est</strong> pas autorisé à se présenter, mais<br />
entend aller contre la volonté des paramilitaires. <strong>«</strong> Un jour je l'ai vu (Cuarenta) et il m'a dit<br />
que je ne pouvais pas continuer ma campagne. Depuis que j'ai refusé de suivre leurs ordres<br />
1 Elles auraient lieu en mars de l'année suivante, il s'agit des élections pour les Conseils municipaux,<br />
Assemblée départementale, maires et gouverneur<br />
2 Verdad Abierta, 28/04/09. Yo <strong>est</strong>uve en el Pacto de Chibolo<br />
3 Idem<br />
4 Municipes de : Plato, Tenerife, Pedraza, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, Sabanas de San Ángel,<br />
Remolino, Zapayan, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo et El Piñón<br />
5 Comunicado a la opinión pública del departamento del Magdalena y Colombia, 28/09/2000<br />
6 Depuis mars 2007, lorsque le document <strong>est</strong> transmis à la Cour Suprême, la plupart des signataires du<br />
<strong>«</strong> Pacte de Chibolo <strong>»</strong>, comme la presse a appelé ce document, ont dû comparaître devant la justice.<br />
7Plus six voix nuls. Comunicado a la opinión pública del departamento del Magdalena y Colombia,<br />
28/09/2000<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 189
ils m'ont persécuté, volé mon hacienda et j'ai dû fuir avec ma famille <strong>»</strong> 1 . Lors des élections de<br />
l'année suivante, la plupart des signataires du pacte de Chibolo sortent victorieux. Dávila, le<br />
candidat des paramilitaires au poste de gouverneur, soutenu officiellement par le parti<br />
MORAL (Movimiento Renovador de Acción <strong>La</strong>boral) <strong>est</strong> élu avec 56% des voix. Son<br />
principal concurrent, José Alfredo Ordoñez, qui n'avait pas reçu le soutien des AUC, perd<br />
avec 28% des voix.<br />
<strong>La</strong> maîtrise des élections découle du contrôle de la population, et donc de l'utilisation de<br />
la violence comme moyen d'exercice du pouvoir. Cette violence permet aux paramilitaires de<br />
gérer les voix des citoyens. Elle leur donne également la possibilité de fixer eux-mêmes les<br />
règles du partenariat avec les élites politiques locales. Alors que les professionnels de la<br />
violence avaient longtemps été des marchands qui négociaient la vente de <strong>«</strong> services <strong>»</strong> aux<br />
élites locales, la relation se trouve désormais renversée 2 . L'emprise des AUC sur les<br />
mécanismes électoraux du département se manif<strong>est</strong>e à la fois sur les électeurs et sur les élus.<br />
Cela donne à l'organisation un pouvoir d'influence sur les institutions décentralisées – aux<br />
compétences larges et aux budgets significatifs, comme nous l'avons déjà souligné 3 . Elle<br />
acquiert alors une maîtrise sur les rentes publiques, mais aussi sur l'ensemble des décisions<br />
politiques et administratives locales. Enfin, à travers les élections parlementaires, les AUC<br />
possèdent des puissants leviers sur le centre. Nous soulignerons ici cette triple dimension des<br />
stratégies paramilitaires : elles s'étendent au contrôle des institutions locales, à l'acquisition de<br />
leviers de pouvoir sur le centre et à l'utilisation de toutes ces ressources institutionnelles à des<br />
fins économiques. Nous sommes donc devant une consolidation mutuelle entre les positions<br />
d’accumulation économique et politique à travers l’exercice de la violence.<br />
L'accès aux arènes du pouvoir local nous conduit à nous interroger sur les relations<br />
entre centre et périphérie. Dans le département du Magdaléna, et dans bien d'autres régions de<br />
Colombie, les institutions font de plus en plus l'objet d'un contrôle direct des paramilitaires;<br />
en revanche, le centre du système politique, où concourent des intérêts beaucoup plus<br />
diversifiés, peut difficilement faire l'objet d'une telle emprise. Il y a donc une rupture de<br />
l'ordre politique entre le centre et la périphérie.<br />
Les caractéristiques de cette relation entre centre et périphérie peuvent être étudiées à<br />
travers le cadre de l'autoritarisme périphérique formulé par E. Gibson. L'auteur propose une<br />
1 Verdad Abierta, 28/04/09. Yo <strong>est</strong>uve en el Pacto de Chibolo<br />
2 Lupo [2001] décrit une dynamique semblable pour la Sicile des années 1980<br />
3 Cf. chapitre 1<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 190
analyse stratégique de l'entretien de dynamiques autoritaires dans les régions 1 . Il affirme que<br />
les stratégies des acteurs autoritaires visent à établir un contrôle sur les frontières des arènes<br />
politiques locales. Gibson souligne que les détenteurs du pouvoir sur ces arènes auront tout<br />
intérêt à maintenir les conflits politiques localisés 2 . Ces stratégies de <strong>«</strong> contrôle des<br />
frontières <strong>»</strong> (boundary control) peuvent être de trois sortes : celles qui visent à garder un<br />
contrôle autoritaire sur la politique locale; celles qui visent à nationaliser l'influence des<br />
acteurs locaux et celles qui tendent à monopoliser les liens entre le centre et la périphérie.<br />
Cette conception de l'exercice du pouvoir comme maintien des frontières de l'ordre politique<br />
local nous aide à comprendre la situation du département du Magdaléna. Nous verrons que les<br />
AUC établissent une forte emprise sur les suffrages de la population, sur la base notamment<br />
des formes de contrôle social décrites précédemment. Cette maîtrise du vote leur donne accès<br />
aux institutions politiques locales. Nous verrons dans une seconde partie que ces stratégies<br />
politiques sont inséparables des formes d'accumulation de ressources économiques.<br />
1. De la maîtrise de la violence au contrôle des suffrages<br />
Nous avons décrit précédemment l'emprise que les armes donnent aux AUC sur la<br />
population. Cette emprise se manif<strong>est</strong>e dans tous les aspects de la vie des habitants, des<br />
organisations sociales au travail ou à la vie privée. <strong>La</strong> participation électorale n'échappe pas à<br />
cela. Les journées électorales mettent en scène la société locale telle qu'elle <strong>est</strong> façonnée et<br />
contrôlée par les AUC. L'emprise paramilitaire n'<strong>est</strong> pas uniquement visible dans le contrôle<br />
des électeurs, mais aussi dans la capacité de subvertir les hiérarchies locales en privilégiant<br />
certaines figures politiques sur d'autres.<br />
Le commandant et le gouverneur<br />
Sous la domination des AUC les ressources politiques nécessaires à attirer les votes<br />
sont subverties. En effet, la violence modifie profondément le jeu politique et le rapport des<br />
entrepreneurs politiques aux électeurs. Alors que ces rapports étaient enchâssés dans un<br />
système de rémunération clientélaire du vote 3 , la contrainte violente prend désormais de plus<br />
en plus de place. Cela n'exclut pas qu'il y ait des systèmes de consentement et de légitimation.<br />
Cependant, il <strong>est</strong> certain que le jeu politique a lieu dans un espace plus limité et que les<br />
barrières à l'entrée sont entretenus par la violence.<br />
1 Gibson [2005], p. 103<br />
2 Ibidem, p. 198<br />
3 Behar et Villa [1991]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 191
<strong>La</strong> nouveauté n'<strong>est</strong> pas tant la compénétration entre la concurrence politique et<br />
l'illégalité, mais le changement dans le rapport de forces à l'intérieur de ces configurations<br />
politico-criminelles 1 . En effet, comme le souligne P. Zúñiga, <strong>«</strong> les charges d'élection populaire<br />
et de l'administration publique dans le département et les municipes du Magdaléna ont été en<br />
proie aux mafieux, contrebandiers et aux intérêts illégaux de tout genre depuis des<br />
décennies <strong>»</strong> 2 . <strong>La</strong> continuité entre les élites traditionnelles et les nouvelles élites de la drogue,<br />
que nous avons exposé dans le chapitre trois, renforce la thèse d'une importance historique<br />
des formes extra-légales de conquête et d'exercice du pouvoir politique. En revanche, ce qui<br />
constitue une rupture entre les anciens groupes paramilitaires et les AUC <strong>est</strong> l'autonomie de<br />
ces dernières. Bien sûr, cette autonomie <strong>est</strong> toute relative; un chef paramilitaire ne pourra pas<br />
se dispenser de l'alliance avec un cacique politique local, d'autant plus si l'élu en qu<strong>est</strong>ion<br />
possède des moyens d'influence à Bogotá. Il serait d'ailleurs totalement contradictoire de<br />
parler d'autonomie lorsqu'on mène une réflexion sur le pouvoir. Comme nous l'apprend<br />
Norbert Elias, un acteur n'a du pouvoir qu'à l'intérieur d'une configuration, c'<strong>est</strong>-à-dire à partir<br />
du moment où il réussit à établir un certain nombre d'arrangements avantageux avec les autres<br />
acteurs; dans ces conditions <strong>«</strong> avoir <strong>»</strong> du pouvoir équivaut à avoir la capacité de peser sur le<br />
déroulement du jeu 3 . Ainsi, le pouvoir ne peut être analysé que de manière relationnelle;<br />
d'ailleurs, dans un texte postérieur Elias lui préfère le concept de <strong>«</strong> force au jeu relative <strong>»</strong> 4 . À<br />
partir de ces considérations, nous pouvons comprendre de manière plus précise ce que cette<br />
autonomie implique. Parler d'autonomie relative signifie que les paramilitaires ont désormais<br />
la possibilité de modifier les hiérarchies de pouvoir à l'intérieur des élites politiques et<br />
économiques en s'alliant avec certains acteurs et en évinçant d'autres. De plus, le nombre<br />
d'alliances tissées autour des groupes paramilitaires les rend d'autant moins dépendants d'un<br />
seul acteur ou groupe d'acteurs. Enfin, une réflexion en termes de configurations nous conduit<br />
à écarter l'opinion – au demeurant moralement critiquable – d'une totale subordination des<br />
élus à leurs partenaires paramilitaires. Il faut donc centrer l'analyse sur les échanges entre ces<br />
deux catégories d'acteurs ainsi que sur leurs stratégies distinctes.<br />
Le principal moyen de pression des paramilitaires sur les politiques <strong>est</strong> la violence. Le<br />
témoignage de l'assistant à la réunion de Chibolo le montre bien. Lorsque les AUC<br />
répartissent les charges politiques du département, ils privilégient certains membres des élites<br />
1 Nous tirons l'expression de Briquet et Favarel-Garrigues [2008]<br />
2 Zuñiga [2007], p. 309<br />
3 Elias [1974]<br />
4 Elias [1991b]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 192
traditionnelles. Ceux qui ne profitent pas du partage, doivent alors comprendre que la<br />
désobéissance à la volonté des paramilitaires peut être très coûteuse. Les politiques qui<br />
persistent à faire campagne sans l'appui des paramilitaires subissent alors des menaces, et<br />
certains sont assassinés. C'<strong>est</strong> le cas d'Eugenio Ebrath, candidat à la mairie de Concordia en<br />
2001; il ne reçoit pas l'appui des AUC lors de la réunion de Chibolo mais décide néanmoins<br />
de se présenter. Il perd face au candidat de Cuarenta <strong>est</strong> meurt assassiné en novembre 2002.<br />
Le maire de El Banco avait été assassiné en 2000 et celui de Zona Bananera le sera en 2004 1 .<br />
Pour les élections locales suivantes, celles de 2003, on peut penser que le système de<br />
choix des candidats s'<strong>est</strong> en quelque sorte routinisé. En effet, cette année-là il y des<br />
candidatures uniques pour les postes de maires dans onze municipes du département 2 . Sur<br />
certains bulletins apparaissent plusieurs noms, or, selon l'Observatoire des Droits Humains de<br />
la Présidence de la République les candidats menacés n'auraient pas eu le temps de retirer leur<br />
candidature avant la fermeture des délais. Du coup, ils ont dû parcourir leurs municipes<br />
respectifs en demandant aux électeurs de ne pas voter pour eux 3 . Cette même année il y a eu<br />
des listes uniques pour les élections aux conseils de Cerro de San Antonio et El Difícil 4 .<br />
Dans ces élections locales, les AUC imposent un candidat unique pour le poste de<br />
gouverneur du Magdaléna. Trino Luna gagne avec 81% des voix; seul le vote blanc, qui<br />
recueille le r<strong>est</strong>e des suffrages, lui fait concurrence 5 . Il semble cependant que les élites<br />
politiques du département aient été associées aux choix des candidats. En effet, selon un<br />
témoin du procès qui a abouti à la condamnation de Luna, les négociations qui décident de sa<br />
candidature se déroulent entre le chef paramilitaire Hernán Giraldo et les politiques Luis<br />
Eduardo Vives <strong>La</strong>couture, Miguel Pinedo, Edgardo Vives et José Francisco Zúñiga 6 ; ce sont<br />
tous des membres des principaux clans politiques du département et des personnalités<br />
politiques de grande envergure.<br />
1 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
2 Pijiño, San Sebastián, Zapayán, San Ángel, El Retén, Zona Bananera, Concordia, Salamina, El<br />
Dificil, Banco et Plato<br />
3 Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos [2006]<br />
Un habitant de Chibolo interviewé par nous cite la même situation paradoxale pour son municipe : Cas<br />
n°8. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Zuñiga [2007], p. 312.<br />
5 Source : Registraduría Nacional del Estado Civil<br />
6 Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Proceso N° 2007-104 contra Trino Luna<br />
Correa. Sentencia condenatoria. 05/10/2007<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 193
<strong>La</strong> sélection de Luna au poste de gouverneur appelle quelques remarques. L'ancien<br />
gouverneur <strong>est</strong> membre d'une puissante famille du Sud du Magdaléna. Sa mère, Nubia Correa<br />
de Luna a été notamment Représentante à la Chambre et présidente de l'entreprise de<br />
<strong>«</strong> services publics domiciliaires <strong>»</strong> 1 du Magdaléna. De plus, il <strong>est</strong> marié à Poly Dangond,<br />
membre d'une des familles les plus influentes de la région caraïbe 2 . Malgré ses liens<br />
familiaux, Luna n'avait recueilli dans les élections précédentes, lors desquelles il avait fait<br />
face au candidat des AUC, que 7,5% des suffrages. De plus, il n'avait même pas été invité à la<br />
réunion qui avait décidé de l'élection de José Domingo Dávila. Pourtant, le soutien des élites<br />
du département ne lui fait pas défaut. En effet, lors de ces élections, les trois candidats arrivés<br />
en tête – Dávila, Ordoñez et Luna – ont eu le soutien de différentes factions du Parti Libéral,<br />
quasi-hégémonique dans le département 3 . Lorsqu'il <strong>est</strong> qu<strong>est</strong>ion de choisir le candidat pour les<br />
élections de 2003, les élites du Nord du département, et principalement les grandes familles<br />
politiques de Santa Marta, auraient donné leur soutien à Luna 4 . Par conséquent, le choix de<br />
Luna par les AUC peut être interprété comme une volonté de garantir une certaine alternance<br />
entre les <strong>«</strong> cliques <strong>»</strong> politiques locales. Les paramilitaires s'efforceraient ainsi de satisfaire les<br />
divers intérêts politiques et de repartir le pouvoir pour assurer la stabilité des alliances.<br />
L'existence de telles négociations ne signifie pas que la violence <strong>est</strong> absente des<br />
relations entre paramilitaires et grandes familles politiques. Des rivalités régionales peuvent<br />
ainsi amener les paramilitaires à s'attaquer aux plus puissants intérêts politiques. C'<strong>est</strong> le cas<br />
des Gnecco, clan familial accusé d'être lié de longue date aux milieux de la contrebande et du<br />
trafic des drogues 5 qui perd l'essentiel de son pouvoir après un conflit contre les AUC. À la<br />
fin de la décennie 1990, la famille compte parmi les siens le gouverneur du Cesar, un<br />
sénateur, le maire de Santa Marta et une représentante à la chambre. En 2001 Jorge Cuarenta<br />
assassine le patriarche, Jorge Gnecco; tous les autres membres de la famille sont menacés et<br />
l'ancien sénateur Pepe Gnecco <strong>est</strong> enlevé par des hommes de Cuarenta en 2004. <strong>La</strong><br />
persécution a raison du pouvoir politique de la famille, dont la plupart des membres ont dû<br />
partir à l'étranger 6 . Cet affrontement aurait ses origines dans une querelle politique et dans un<br />
1 Le terme de <strong>«</strong> services publics domiciliaires <strong>»</strong> correspond en Colombie aux services d'aqueduc,<br />
assainissement, électricité et gaz (uniquement dans certaines villes).<br />
2 Semana, 14/04/2007. <strong>La</strong> historia de Trino Luna<br />
3 Le quatrième candidat se réclame du Parti Conservateur mais ne recueille que 0,1% des voix. Le<br />
département n'a jamais eu un gouverneur conservateur élu au suffrage universel.<br />
4 Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Proceso N° 2007-104 contra Trino Luna<br />
Correa. Sentencia condenatoria. 05/10/2007 , p. 4<br />
5 Semana, 25/11/2006. El genio del mal<br />
6 Zuñiga [2007], p. 309-310<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 194
conflit proprement criminel. <strong>La</strong> querelle politique oppose les Gnecco à la famille Araújo,<br />
dirigeants politiques historiques du Cesar qui pendant la décennie 1990 s'affrontent durement<br />
contre les Gnecco, étrangers à la région. Jorge Cuarenta aurait décidé d'appuyer les Araújo<br />
après qu'ils aient dénoncé les prétendues procédures frauduleuses qui auraient permis à Lucas<br />
Gnecco d'emporter le poste de gouverneur du Cesar 1 . D'autre part, des conflits pour les routes<br />
de transport de drogue auraient opposé Cuarenta et Jorge Gnecco 2 . Après l'assassinat de ce<br />
dernier, les AUC justifient publiquement leur action en affirmant que Gnecco se faisait passer<br />
pour membre de l'organisation afin de mener des activités de racket et enlèvement. Cet<br />
exemple montre très bien la complexité des interactions entre la sphère de la politique et celle<br />
des activités criminelles 3 . Il illustre aussi les conflits qui peuvent apparaître lorsque des<br />
entrepreneurs de violence intègrent les élites <strong>«</strong> légales <strong>»</strong> 4 .<br />
On voit donc que le profit mutuel n’exclue pas la violence, notamment quand il y a des<br />
impératifs contradictoires qui s’imposent aux différents acteurs en présence. Il convient aussi<br />
de noter que les négociations auxquelles se livrent les paramilitaires sont symptomatiques du<br />
type d'alliances qui les lient aux entrepreneurs politiques. En effet, si les paramilitaires<br />
s'efforcent de maintenir la stabilité des alliances en repartissant des prébendes entre leurs<br />
alliés, c'<strong>est</strong> parce que ceux-ci ne sont pas dépourvus de ressources politiques. Il s'agit bien sûr<br />
de ressources locales surtout de la maîtrise des liens entre le centre et la périphérie.<br />
De la périphérie au centre<br />
Dans le modèle de Gibson la maîtrise des liens entre centre et périphérie <strong>est</strong> essentielle.<br />
Un acteur politique voulant garder le contrôle sur un territoire devra à la fois nationaliser son<br />
influence et monopoliser les liens entre le centre et la périphérie. Pour mener à bien cette<br />
stratégie, les paramilitaires ont besoin de s'allier avec les politiques qui représentent la région<br />
dans les instances législatives. Ce ne sont évidemment pas les seuls liens de ce genre que les<br />
paramilitaires essayent de maîtriser. Or, leur importance provient de l'insertion de ces acteurs<br />
dans des réseaux politiques qui constituent d'importants leviers sur le centre.<br />
Avant de nous interroger sur ces parlementaires il faudra préciser la distinction entre<br />
centre et périphérie. En effet, le modèle de Gibson pourrait nous faire penser à des espaces<br />
Expert n°1 et Cas n° 15. Voir annexe 2, sources orales<br />
1 Semana, 25/11/2006. El genio del mal<br />
2 El Tiempo, 28/01/2007. Otra sombra para en clan Gnecco<br />
3 Cf. Briquet et Favarel-Garrigues [2008]<br />
4 Cf. Favarel-Garrigues [2008]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 195
clos, aux frontières étanches et aux règles propres de fonctionnement. Or, ce n'<strong>est</strong> pas le cas<br />
pour les parlementaires, qui sont présents sur plusieurs espaces politiques, qu'ils contribuent à<br />
relier. Ils sont en quelque sorte des <strong>«</strong> brokers <strong>»</strong> 1 et tirent leur pouvoir de cette<br />
multipositionnalité. Se profile ainsi une image du local comme lieu de croisement de<br />
multiples réseaux qui le transcendent 2 . Comme le soulignent J.-L. Briquet et F. Sawicki, <strong>«</strong> le<br />
local n'<strong>est</strong> pas un lieu clos à l'intérieur duquel se limitent les relations de pouvoir mais un lieu<br />
d'interactions et de transactions entre des acteurs disposant de ressources différentes (et<br />
inégales) aussi bien locales (…) que nationales <strong>»</strong> 3 . Les ressources nationales des<br />
parlementaires tiennent bien sûr à leur charge élective, mais aussi à leur insertion dans des<br />
réseaux politiques formels (partis politiques) ou informels. Ils <strong>«</strong> actualisent <strong>»</strong> 4 ces ressources<br />
sur les espaces locaux en les convertissant en postes bureaucratiques ou contrats publiques.<br />
Mais ils ont aussi des ressources proprement locales, qu'ils actualisent sur la scène nationale<br />
en les transformant en soutien électoral ou vote législatif.<br />
Ces remarques nous permettent d'évaluer le rôle que jouent les parlementaires dans ces<br />
collusions politico-criminelles. Ces acteurs matérialisent les liens d'interdépendance entre<br />
centre et périphérie dont parle Gibson 5 . Ici, nous nous limiterons à examiner les accords<br />
électoraux qui les lient aux paramilitaires. Dans la dernière partie de ce texte nous évoquerons<br />
leur action dans le parlement.<br />
Le parlement colombien <strong>est</strong> formé par le Sénat et la Chambre de représentants. Les<br />
deux organes sont élus au suffrage universel le même jour, tous les quatre ans, quelques mois<br />
avant l'élection présidentielle. <strong>La</strong> circonscription pour le Sénat <strong>est</strong> nationale, tandis qu'à la<br />
Chambre chaque département possède plusieurs circonscriptions.<br />
Selon des documents personnels de Jorge Cuarenta, cités dans les procès contre des élus<br />
du département 6 , le chef paramilitaire se serait réuni avec des candidats au parlement le 22<br />
novembre 2001 7 . Le but de la réunion était de former des binômes constitués d'un candidat au<br />
Sénat et un candidat à la chambre. Trois districts électoraux, basés sur les circonscriptions<br />
1 Tilly et Tarrow [2007], p.215 definissent le processus de <strong>«</strong> brokerage <strong>»</strong> comme <strong>«</strong> la production d'une<br />
nouvelle connexion entre des lieux qui n'étaient pas connectés auparavant ou qui l'étaient faiblement <strong>»</strong><br />
2 Briquet et Sawicki [1989]<br />
3 Ibidem, p. 13<br />
4 Idem<br />
5 Gibson [2005], p. 107 et suiv.<br />
6 Cf. par exemple Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470<br />
contra Luis Eduardo Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia condenatoria. 01/08/2008, p. 6<br />
7 El Espectador, 15/07/2008. Chibolo y Pivijay, los otros pactos<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 196
pour les élections à la Chambre sont formés. Chaque binôme se voit garanti le vote d'un de<br />
ces districts 1 . Le tableau 6.1. illustre cette répartition. Il convient de souligner, avec León<br />
Valencia, qu'une telle répartition va à l'encontre des réformes électorales des années 1990 qui<br />
instauraient une circonscription nationale pour le Sénat 2 . Selon la Cour Suprême de Justice, en<br />
échange de la garantie d'être élus, <strong>«</strong> chacun des candidats au Sénat apporteraient au Bloc Nord<br />
huit cent millions de pesos et les candidats à la Chambre quatre cent millions <strong>»</strong> 3 .<br />
Tableau 6.1 : Districts électoraux dans le Magdaléna selon les enquêtes de la Cour<br />
Suprême de Justice<br />
Source : Corporación Nuevo Arco Iris. Proyecto ASDI-Arco Iris 4<br />
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470 contra Luis Eduardo<br />
Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia condenatoria. 01/08/2008<br />
2 Valencia [2007], p. 28<br />
Chambre Senat Municipes<br />
Jorge Caballero Salomón Saade Sitio Nuevo<br />
El Piñón<br />
Cerro de San Antonio<br />
Concordia<br />
Pedraza<br />
Fundación<br />
Tenerife<br />
Plato<br />
Zona Bananera<br />
Aracataca<br />
El Retén<br />
José Gamarra Dieb Maloof Zapayán<br />
Pivijay<br />
Salamina<br />
Remolino<br />
San Ángel<br />
Algarrobo<br />
Chivolo<br />
El Difícil<br />
Fundación<br />
Alfonso Campo Escobar Luis Vives <strong>La</strong>couture El Banco<br />
Guamal<br />
San Sebastián<br />
San Zenón<br />
Santa Ana<br />
Pinto<br />
Pijiño<br />
Granada<br />
3 Declaración de Rafael García Torres, 21 de noviembre de 2006. Corte Suprema de Justicia, Sala de<br />
Casación Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470 contra Luis Eduardo Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia<br />
condenatoria. 01/08/2008, p.<br />
4 Cité dans Flórez [2005] et Zuñiga [2007]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 197
Grâce à ces alliances, les candidats des paramilitaires obtiennent ces résultats que la<br />
presse colombienne qualifie pudiquement <strong>«</strong> d'atypiques <strong>»</strong> 1 . Dans les municipes du Sud du<br />
Magdaléna, Luis Eduardo Vives <strong>La</strong>couture obtient 32 543 voix 2 face à Miguel Pinedo Vidal,<br />
qui n'a que 513 voix. Ce district du Sud apporte à Vives <strong>La</strong>couture 68% de son score dans le<br />
Magdaléna 3 . Quatre ans plus tôt il n'avait obtenu, dans les mêmes municipes, que 2 477 voix 4 .<br />
Inversement, dans les municipes du centre du département, Vives <strong>La</strong>couture obtient<br />
seulement 155 voix, alors que Dieb Maloof recueille 37 443 suffrages, ce qui équivaut à 93%<br />
de son score dans le département 5 . Dans les municipes qui font partie de ces districts<br />
électoraux les niveaux de concentration des votes atteignent parfois plus de 90%. C'<strong>est</strong> le cas<br />
par exemple à Tenerife, où Jorge Caballero recueille 97% des voix. Il faut souligner ici qu'une<br />
telle concentration <strong>est</strong> tout à fait inédite. À manière d'exemple, nous pouvons citer les<br />
élections législatives de 1998; cette année-là, dans les municipes du Sud les voix se<br />
répartissent entre Enrique Rafael Caballero (6 539), Micael Segundo Cotes (4 140) et Miguel<br />
Pinedo Vidal (3 803).<br />
Comment vote-on dans le Magdaléna?<br />
Et les électeurs? Que sait-on des détails de la <strong>«</strong> contrainte à l'électeur <strong>»</strong> 6 , nom du délit<br />
pour lequel une partie des élites politiques du département sont aujourd'hui derrière les<br />
barreaux? Il y a très peu d'information disponible sur le fonctionnement précis des<br />
mécanismes de contrainte électorale. Lorsqu'on fait appel aux seuls témoignages oraux, on<br />
découvre que la plupart du temps, les électeurs n'ont même pas eu à cocher le nom du<br />
candidat désigné 7 . Comme l'explique un habitant de Chibolo :<br />
1 Semana, 11/09/2005. Votaciones atípicas en las elecciones de congreso del 2002<br />
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470 contra Luis Eduardo<br />
Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia condenatoria. 01/08/2008, p. 33<br />
3 Registraduría Nacional del Estado Civil. Il recueille 47 794 voix dans le Magdalena et 5 891 dans le<br />
r<strong>est</strong>e du pays<br />
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470 contra Luis Eduardo<br />
Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia condenatoria. 01/08/2008, p. 33<br />
5 Registraduría Nacional del Estado Civil. Il recueille 40 134 voix dans le Magdalena et 27 671 dans le<br />
r<strong>est</strong>e du pays, principalement dans les départements de Bolivar et Atlántico.<br />
6 L'article 387 du code pénal colombie définit la contrainte à l'électeur (constreñimiento al sufragante)<br />
comme l'utilisation des armes ou de la menace pour obtenir le vote d'un citoyen ou pour empêcher le<br />
libre exercice du suffrage.<br />
7 En Colombie sur les bulletins de vote (los tarjetónes electorales) figurent tous les noms des candidats,<br />
accompagnés de leur photos et du logo du parti. Pour voter l'électeur coche le nom de son candidat.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 198
<strong>«</strong> Quand tu allais voter ils avaient déjà voté pour toi, tu signais et le jury te<br />
donnait l'att<strong>est</strong>ation électorale 1 . Ou alors tu allais voter et au fur et à mesure que<br />
tu passais dans la file les jurys cochaient le nom et tu mettais le bulletin dans<br />
l'urne, histoire de faire semblant […]. Si quelqu'un n'y allait pas, le jury signait à<br />
sa place <strong>est</strong> après un paramilitaire lui amenait son att<strong>est</strong>ation chez lui <strong>»</strong>. 2<br />
Des moyens plus classiques sont également utilisés pour frauder aux élections. Comme<br />
l'explique cette enseignante, jury électoral à Guamal :<br />
<strong>«</strong> Il y avait quelqu'un chargé par eux pour dire combien de voix il devait y avoir<br />
sur chacune des tables électorales. Or, c'<strong>est</strong> arrivé qu'on nous dise – cent voix<br />
pour le candidat un tel – et que les jurys disent – tiens, on a lui mettre 120 pour<br />
qu'ils soient contents. Et du coup on faisait voter les morts <strong>»</strong> 3<br />
Les élections sont aussi une occasion de mettre en scène le pouvoir de l'organisation,<br />
son emprise sur les personnes mais aussi sur les institutions. Un journaliste interviewé affirme<br />
que :<br />
<strong>«</strong> En 2003, dans plusieurs villes du Nord du département, Carlos Tijeras<br />
(Commandant paramilitaire de la zone, n.d.t.) a décidé que les élections<br />
n'auraient pas lieu le dimanche, comme dans le r<strong>est</strong>e du pays, mais le samedi. Les<br />
gens sont allés voter le samedi et le lendemain ils ont joué une pantomime de<br />
votation, pour faire semblant <strong>»</strong> 4<br />
<strong>La</strong> contrainte électorale repose souvent sur la seule menace. Peu de personnes résistent<br />
à l'imposition d'un candidat. Cependant, lorsqu'elles le font, elles sont souvent victimes de<br />
harcèlement, intimidation, voire agressions physiques. Comme l'explique un habitant de<br />
Fundación :<br />
<strong>«</strong> On dirigeait avec mon oncle une coopérative agricole. Ils sont venus nous voir<br />
pour nous dire qu'il fallait que nous et tous les gens de la coopérative votent pour<br />
un candidat précis. On leur a dit qu'on n'allait pas dire aux gens pour qui voter.<br />
Ils ont dit – ici il faut que tout le monde vote pour José Gamarra, sinon vous êtes<br />
1 L'att<strong>est</strong>ation électorale <strong>est</strong> la preuve que l'individu a voté. Elle <strong>est</strong> notamment exigée aux<br />
fonctionnaires publics, pour qui le vote <strong>est</strong> obligatoire.<br />
2 Cas n°8. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Cas n°4. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Expert n° 12. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 199
morts. C'<strong>est</strong> pour ça qu'ils ont tué mon oncle, car ils ont dit que si on n'était pas<br />
avec eux on était contre eux <strong>»</strong> 1 .<br />
Il semble, d'après nos données, que les individus qui détiennent un certain pouvoir à<br />
l'intérieur des communautés, tels les employeurs ou les leaders des Assemblées d'action<br />
communale, soient utilisés comme des relais pour le contrôle de l'électorat. L'extrait<br />
d'entretien précédent, ainsi qu'un témoignage lors du procès de Trino Luna, confirment cette<br />
hypothèse. Dans ce témoignage, une leader communale de la Sierra déclare aux magistrats<br />
que <strong>«</strong> nous les leaders, nous savons que si nous n'appliquons pas leurs directives électorales<br />
on devient un objectif militaire <strong>»</strong> 2 . Il n'<strong>est</strong> pas possible d'affirmer le caractère systémique de<br />
cette pratique; or, cela semble probable dans la mesure où, historiquement, ces relais locaux<br />
étaient souvent utilisés par les réseaux clientélaires 3 .<br />
2. Violence, institutions publiques et accumulation privée<br />
<strong>La</strong> maîtrise des espaces institutionnels donne une ressource supplémentaire aux AUC.<br />
Elle sert bien sûr à obtenir des leviers sur l'État, plus particulièrement dans la perspective de<br />
la démobilisation (cf. Infra). Elle sert également, comme on le verra, à mettre en œuvre des<br />
stratégies d'accumulation. En effet, la violence et les ressources politico-institutionnelles sont<br />
aussi des outils économiques 4 . Nous étudierons trois types de stratégies d'accumulation, celles<br />
qui ponctionnent des ressources sur les budgets publics, celles qui visent une appropriation<br />
violente de la terre et celles qui brouillent les limites entre l'économie légale et l'économie<br />
illégale.<br />
Budgets publics<br />
Pendant les années de présence des paramilitaires dans la région, six nouveaux<br />
municipes sont créés dans le département. Il s'agit de Concordia, El Retén, Nueva Granada,<br />
Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel et Zona Bananera. Avec cette création il y a des<br />
nouveaux postes électifs et bureaucratiques à pourvoir. Or, la création de nouveaux municipes<br />
<strong>est</strong> une prérogative législative, elle a donc fait certainement l'objet de négociations entre les<br />
parlementaires et les figures politiques locales. On pourrait penser que les paramilitaires ont<br />
1 Cas n°2. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Proceso N° 2007-104 contra Trino Luna<br />
Correa. Sentencia condenatoria. 05/10/2007<br />
3 Sur les pratiques politiques de l'élite traditionnelle voir Behar et Villa [1991]<br />
4 Pour cette perspective voir Bayart, Ellis et Hibou [1997]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 200
eu une certaine influence dans la création de ces nouveaux municipes. Si cette hypothèse<br />
venait à être confirmée, cela montrerait la manière dont une coalition aux leviers d'influence<br />
multiples se constitue autour du groupe armé.<br />
Peu d'informations existent sur les modalités concrètes de ponction sur le budget public.<br />
Une enquête publiée par Semana, premier hebdomadaire du pays, parle de l'existence d'un<br />
système appelé le <strong>«</strong> réseau anti-corruption <strong>»</strong> mis en place par Jorge Cuarenta 1 . Nous avons<br />
complété les données publiées par un entretien avec le journaliste qui a mené l'enquête 2 . Si<br />
l'on croit cette enquête, il en ressort que Cuarenta aurait mis en place, à partir de mars 2002,<br />
ce système dans le but de contrôler les finances du Bloc Nord dans les départements de<br />
Magdaléna, Cesar, Guajira et Atlántico. Il s'agit d'un système de ramifications, dont le centre<br />
<strong>est</strong> un trésorier. Celui-ci contrôle la g<strong>est</strong>ion de chacun des commandants de fronts, qui eux,<br />
sont chargés de contrôler les élus de leurs zones d'influence. Le but de tout le système <strong>est</strong> de<br />
garantir le détournement des fonds publics vers les caisses des AUC. Ces ponctions avaient<br />
principalement lieu lors des contrats passés entre les entités publiques et des personnes<br />
privées. Les AUC auraient prélevé 10% de la valeur de chaque contrat. Cette somme ne<br />
correspond qu'à la partie versée par l'entreprise publique; en effet, il paraîtrait que les<br />
paramilitaires ne se contentaient pas de prélever <strong>«</strong> l'impôt <strong>»</strong> auprès des mairies et des<br />
institutions décentralisées, mais qu'en plus ils auraient racketté les firmes qui concourraient<br />
pour les contrats 3 . Deux sommes pouvaient donc être collectées; une avant la signature du<br />
contrat – pour permettre aux entreprises de se présenter à l'appel d'offres – et une autre lors de<br />
la signature.<br />
Une partie de cet argent aurait servi à alimenter les caisses du Bloc Nord des AUC,<br />
mais une autre aurait bénéficié aux partenaires des paramilitaires. En effet, si les sommes<br />
issues du racket sont partagées entre le Front responsable de la zone et le commandement du<br />
Bloc, la moitié de l'impôt sur les contrats publics <strong>est</strong> versée au politique qui participe au<br />
contrat et au trésorier de l'entité publique concernée 4 . Les loyautés entre les différents<br />
partenaires sont ainsi entretenues.<br />
Parmi les partenaires stratégiques des paramilitaires se trouvent les directeurs des<br />
hôpitaux publics. En effet, c'<strong>est</strong> à travers le budget de la santé qu'un pourcentage important<br />
1 Semana, 26/08/2008. <strong>La</strong> red “anticorrupción” de Jorge 40<br />
2 Expert n°12. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Semana, 25/11/2006. El genio del mal<br />
4 Semana, 26/08/2008. <strong>La</strong> red “anticorrupción” de Jorge 40<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 201
des rentes de l'État a été dévié 1 . Cela s'explique par le fait que les hôpitaux possèdent une<br />
administration indépendante et gèrent des budgets très importants en comparaison avec<br />
d'autres entités publiques. Par conséquent, un soin particulier <strong>est</strong> apporté aux nominations à<br />
ces postes. Ainsi l'explique Carlos Tijeras, commandant du Front William Rivas :<br />
<strong>«</strong> Nous avons dit que les directeurs des hôpitaux devaient avoir l'aval de<br />
l'entreprise (les AUC). Nous regardions les CV et faisions des entretiens avec les<br />
candidats. Comme ça on cohabitait. Eux (les politiques) conservaient des postes<br />
dans l'administration, s'occupaient du théâtre de la méritocratie […].<br />
L'engagement était payer l'impôt sur les contrats, qui était la loi dans toute la<br />
zone <strong>»</strong> 2<br />
<strong>La</strong> g<strong>est</strong>ion des hôpitaux publics s'accompagne d'une violence sélective visant<br />
probablement à assurer la sécurité des réseaux de détournement de fonds. Ainsi, en avril 2004,<br />
le directeur de l'hôpital de Zona Bananera, José Alejandro <strong>La</strong>cera, <strong>est</strong> assassiné par des<br />
membres du Front William Rivas 3 . Carlos Tijeras reconnaît ce crime par la suite 4 . L'année<br />
précédente une leader syndicale, journaliste et comptable de l'hôpital central de Santa Marta,<br />
Zully Esther Codina, avait été assassinée à la sortie de sa résidence 5 . Hernán Giraldo avoue ce<br />
crime dans le système de Justice et Paix 6 .<br />
L'imposition des contrats publics n'<strong>est</strong> pas la seule manière de ponctionner le budget de<br />
l'État. Les taxes locales et les impôts des fonctionnaires auraient également été appropriés par<br />
les paramilitaires. C'était apparemment le cas à Chibolo, mais des experts confirment<br />
l'utilisation courante de cette méthode 7 . Un ancien employé de la mairie de Chibolo raconte :<br />
<strong>«</strong> <strong>La</strong> taxe d'habitation était récoltée par eux. Ils justifiaient ça en disant que<br />
c'était pour faire des œuvres d'intérêt public, mais on ne les a jamais vues. En<br />
plus ils nous prenaient 10% sur nous salaires, à tous les employés de la mairie;<br />
1 Expert n°12. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Semana, 26/08/2008. <strong>La</strong> red “anticorrupción” de Jorge 40<br />
3 Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
4 Bulletin de la CNRR, n°6, juillet 2008<br />
5 Cas n°1. Voir annexe 2, sources orales<br />
6 Bulletin de la CNRR, n°7, septembre 2008<br />
7 Expert n°12. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 202
ils disaient que c'était parce que dans un autre village il y avait besoin de faire<br />
des travaux de réparation ou d'acheter des équipements pour l'hôpital <strong>»</strong> 1 .<br />
Cette privatisation des impôts a parfois été formalisée. En effet, dans onze municipes 2<br />
le recouvrement des impôts locaux, prérogative des mairies, a été sous-traité à la fondation<br />
Femmes de la Province (Mujeres de la Provincia); cette fondation serait, selon le ministère<br />
public, une façade légale des AUC 3 . <strong>La</strong> même fondation aurait d'ailleurs établi un contrat pour<br />
le recouvrement des factures d'électricité avec l'entreprise départementale, ce qui lui<br />
rapporterait 20% des sommes payées 4 .<br />
Expropriation de terres<br />
Le contrôle des administrations locales ne répond pas uniquement à une stratégie<br />
d'appropriation des budgets publics. Il peut aussi favoriser la légalisation des activités<br />
économiques des groupes paramilitaires. L'exemple de l'expropriation de terres illustre très<br />
bien cet aspect des collusions politico-criminelles. Ce phénomène d'expropriation consiste en<br />
une dépossession par la violence ou la menace de celle-ci. Il ne s'agit pas uniquement de<br />
l'occupation des terres mais du transfert effectif de propriété par différents moyens. Nous<br />
examinerons ces mécanismes d'expropriation 5 et montrerons qu'ils se trouvent à l'intersection<br />
entre la maîtrise de la violence et le contrôle des institutions publiques.<br />
Il <strong>est</strong> aujourd'hui impossible de mesurer l'ampleur du phénomène d'expropriation de<br />
terres par les paramilitaires. En effet, dans la plupart des cas, les propriétaires des terres<br />
expropriées sont des prête-noms, et non pas les commandants paramilitaires eux-mêmes 6 . On<br />
peut cependant avoir une idée du phénomène lorsque l'on regarde les chiffres concernant<br />
l'abandon de terres. À cet égard, on <strong>est</strong>ime que plus de 21 000 ha de terres auraient été<br />
abandonnés par leurs propriétaires entre 1997 et 2007 7 . Si l'on croit une étude de l'Université<br />
1 Cas n°8. Voir annexe 2, sources orales<br />
2 Sabanas de San Ángel, Chibolo, Tenerife, Nueva Granada, Sitionuevo, Salamina, San Antonio,<br />
Pedraza, Piñón, Pijiño del Carmen et Plato<br />
3 Verdad Abierta, 16/12/2008. Sucedió en la república independiente de la Sombrerona<br />
4 Idem<br />
5 Selon le <strong>La</strong>rousse l'expropriation <strong>est</strong> définie comme l'action de <strong>«</strong> déposséder quelqu'un de la propriété<br />
d'un bien, dans un but d'utilité publique conformément à la loi <strong>»</strong> (Dictionnaire encyclopédique In<br />
Extenso, 1996). Bien que dans ce cas il n'y ait pas de <strong>«</strong> but d'utilité publique <strong>»</strong>, au moins de <strong>notre</strong> point<br />
de vue, nous utiliserons cette notion qu'à l'avantage de faire un lien entre le droit de propriété et la<br />
puissance publique.<br />
6 Expert n°9; Expert n°12. Voir annexe 2, sources orales<br />
7 Reyes [2009], p. 197<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 203
du Magdaléna, ce sont en règle générale des exploitations familiales 1 d'une extension<br />
moyenne 5 ha 2 . Le tableau 6.2 montre la distribution des terres abandonnées par municipe. Il<br />
semble que des extensions plus grandes de terre auraient été abandonnées dans les municipes<br />
de Santa Marta, Ciénaga et Fundación. Cela coïncide avec la distribution de la violence<br />
homicide dans le département, que nous avons commenté dans les chapitres précédents.<br />
Tableau 6.2. abandon de terres dans le Magdaléna (1997-2007)<br />
Municipe Hectares abandonnés<br />
Santa Marta<br />
5 265<br />
Aracataca<br />
1 194<br />
Ariguaní 929<br />
Cerro de San Antonio 126<br />
Chivolo 633<br />
Ciénaga<br />
4 037<br />
El Banco 660<br />
El Piñon 85<br />
El Retén 44<br />
Fundación<br />
3 322<br />
Guamal 262<br />
Pedraza 87<br />
Pivijay<br />
3 484<br />
Plato 684<br />
Pueblo Viejo 400<br />
Remolino 207<br />
Total 21419<br />
Source : Reyes [2009], p. 197. Calculs effectués à partir des données de la Pastorale Sociale.<br />
Organisation de l'Église Catholique chargée de l'assistante aux réfugiés<br />
L'expropriation des terres se base sur la violence. Or, elle ne suffit pas à comprendre le<br />
phénomène. Aux mécanismes de violence physique s'ajoute la légalisation de la dépossession<br />
par des organismes officiels. Le premier de ces organismes <strong>est</strong> l'Incora (Institut Colombien de<br />
la Réforme Agraire 3 ), chargé en principe de favoriser la redistribution de la terre. Cette<br />
institution possède les moyens juridiques de modifier le titre de propriété d'une exploitation,<br />
prenant principalement en compte des critères d'usage de la terre. En effet, dans l'esprit de sa<br />
conception, les terres qui ne sont pas utilisées à des fins productifs doivent pouvoir être<br />
octroyées à des personnes prêtes à les exploiter. Cette logique était censée favoriser les<br />
1 Il y a bien sûr des grands propriétaires fonciers qui ont dû quitter leurs terres à cause de la violence,<br />
mais ils semblent être minoritaires. De plus, l'abandon des grandes exploitations semble être plutôt lié<br />
à la violence insurrectionnelle, tandis que l'abandon des exploitations familiales semblerait plutôt liée<br />
à la violence paramilitaire. Or, dans l'absence de données antérieures à 1997 ne nous permet pas<br />
d'avancer des hypothèses plus concrètes sur cette articulation.<br />
2 Barbosa-Ortega, Renán-Rodríguez et Suárez-Mosquera [2007]<br />
3 L'Incora a été r<strong>est</strong>ructuré en 2003. Il <strong>est</strong> alors devenu Incoder (Institut Colombien pour le<br />
Développement Rural). Pour favoriser la clarté du propos, et lorsque la plupart de <strong>notre</strong> récit se<br />
déroule avant 2003 nous utiliserons uniquement le premier sigle.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 204
paysans sans terre au détriment des latifundia sous-productifs. Or, lorsque le phénomène du<br />
déplacement massif de populations a atteint de l'ampleur, un grand nombre d'exploitations<br />
familiales ont été abandonnées par leurs propriétaires. Ces terres ont parfois été occupées par<br />
les paramilitaires ou alors intégrées à des exploitations voisines. Ensuite, l'Incora a émis des<br />
titres de propriété au profit des nouveaux occupants.<br />
Pour comprendre la participation de l'Incora au mécanisme d'expropriation il faut faire<br />
un lien avec le contrôle des institutions décentralisées par les paramilitaires. En effet, en<br />
Colombie, les postes de direction des institutions décentralisées <strong>«</strong> appartiennent <strong>»</strong> à une<br />
personnalité politique locale d'envergure nationale. Ce n'<strong>est</strong> pas une procédure écrite mais elle<br />
<strong>est</strong> acceptée et bien connue 1 . Selon un journaliste interviewé, le poste de directeur de 'l'Incora<br />
(Institut Colombien de la Réforme Agraire,) appartenait à Dieb Maloof 2 , sénateur condamné<br />
pour avoir tiré un profit électoral de son alliance avec les AUC dans le Magdaléna 3 . De plus,<br />
selon les déclarations du chef paramilitaire Carlos Tijeras, bien que les nominations aux<br />
postes de direction des institutions publiques demeuraient une prérogative des politiques, les<br />
candidats devaient toujours avoir l'aval des paramilitaires 4 . Ces deux éléments nous<br />
permettent d'avoir une idée – certes limitée dans l'état des données – des collusions qui<br />
permettent le déroulement du processus d'expropriation.<br />
S'il n'<strong>est</strong> pas possible de réaliser une analyse d'ensemble du phénomène de<br />
l'expropriation dans le département, il <strong>est</strong> cependant très illustratif d'effectuer une brève étude<br />
de cas basée sur des données quantitatives. Grâce à la description du cas des parcelles de El<br />
1 Behar et Villa [1991]<br />
2 Expert n°12. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Expert n°14. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Semana, 26/08/2008. <strong>La</strong> red “anticorrupción” de Jorge 40<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 205
Encanto 5 , nous espérons pouvoir mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le<br />
processus d'expropriation de terres.<br />
Au début des années 1990, l'Incora attribue des terres situées dans le municipe de<br />
Chibolo à des paysans sans terre. Il s'agit souvent de terres appartenant à des grands<br />
propriétaires fonciers de la zone; elles sont achetées par l'Institut et ensuite divisées entre les<br />
paysans. C'<strong>est</strong> le cas de l'hacienda El Encanto, située près du village de Pueblo Nuevo, à<br />
Chibolo. Trente-sept familles s'installent sur ces terres en 1991. Or, à partir de 1996 les<br />
paramilitaires de Jorge Cuarenta sont présents dans la région. En décembre de cette année-là<br />
ils réunissent les habitants de Pueblo Nuevo pour les avertir de l'obligation de collaborer avec<br />
eux et de leur transmettre des informations sur la guérilla. Commencent alors les assassinats<br />
sélectifs. Jesús Olivo, leader paysan, <strong>est</strong> assassiné le 24 octobre 1996 et Oberto Martínez,<br />
exploitant agricole <strong>est</strong> assassiné l'année suivante. Les habitants racontent qu'après la mort<br />
d'Oberto, ils les ont réunis à nouveau et les ont prévenus – s'ils ne collaboraient pas avec les<br />
AUC une personne très appréciée par tous allait mourir. Le 30 juillet 1997 ils ont mis leur<br />
menace à exécution; ce jour-là ils ont assassiné Roberto Barrios, l'instituteur, sur la place du<br />
village. Ce meurtre aurait beaucoup frappé les habitants de Pueblo Nuevo, qui ont alors quitté<br />
en masse le village, pour se réfugier au centre urbain de Chibolo. Au total, 140 familles fuient<br />
le village et ses alentours. Quelques mois plus tard, une douzaine de personnes retourne à<br />
Pueblo Nuevo pour examiner la situation; or, elles sont aussitôt menacées par les<br />
paramilitaires qui occupent les lieux. Après l'assassinat de deux d'entre eux, les habitants de<br />
El Encanto renoncent définitivement à récupérer leurs terres.<br />
Plusieurs personnes se sont vues proposer l'achat de leurs terres à des prix très<br />
inférieurs à ceux du marché. Les autres terres ont tout simplement été occupées de force. C'<strong>est</strong><br />
là que l'Incora intervient. Alors qu'il avait attribué les terres aux paysans en 1991, il rend<br />
5 Cette étude <strong>est</strong> basée sur des données diverses. Pour une meilleure vue d'ensemble nous les<br />
énoncerons une seule fois :<br />
- Expert n°9 ; Expert n°11 ; Expert n°14. Voir annexe 2, sources orales<br />
- Cas n° 8. Voir annexe 2, sources orales<br />
- Acción de Tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación<br />
Internacional, Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)<br />
para solicitar protección del derecho de la población desplazada de la vereda el Encanto, Municipio de<br />
Chibolo, Departamento del Magdalena al retorno, así como el amparo de sus derechos a la reparación<br />
integral, y específicamente del derecho a la r<strong>est</strong>itución y a la indemnización por los daños causados<br />
con el desplazamiento forzado.<br />
- El Heraldo, 11/03/2009. Pueblo Nuevo, una tierra arrebatada hace 10 años<br />
- Verdad Abierta, 13/04/2009. Dos veces despojados<br />
- Jacobo Grajales, base de données de violence paramilitaire à partir des données du CINEP<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 206
caducs les titres de propriété. Un acte administratif datant du 28 octobre 2002 indique que les<br />
propriétaires avaient abandonné leurs terres et que par conséquent elles pouvaient être<br />
attribuées à d'autres exploitants. Plusieurs actes d'adjudication sont alors émis par l'Incora, qui<br />
octroie les terres à Rodrigo Tovar Pupo, plus connu par son nom de guerre : Jorge Cuarenta.<br />
Le cas de El Encanto <strong>est</strong> particulièrement parlant, puisque le nouveau propriétaire des<br />
terres <strong>est</strong> le chef paramilitaire lui-même. En effet, dans la plupart des cas la réparation des<br />
victimes se trouve entravée par l'existence de prête-noms liés au groupe paramilitaire. De<br />
plus, les paysans qui ont reçu en 1991 les terres de El Encanto possèdent des titres de<br />
propriété qui, bien que rendus caducs par une action administrative, att<strong>est</strong>ent de leur condition<br />
passée de parcellaires. Or, dans la plupart des cas, l'expropriation des terres frappe des<br />
paysans qui n'ont aucun titre légal sur leurs terres, ce qui rend les actions légales extrêmement<br />
difficiles, mais en plus constitue un obstacle à la compréhension du phénomène 1 . Comme<br />
l'exprime un fonctionnaire d'une agence gouvernementale, interviewé par A. Reyes, sur un<br />
autre exemple du municipe de Chibolo :<br />
<strong>«</strong> Les parcelles de <strong>La</strong> Pola, à Chibolo, sont très compliquées; nous n'avons pas<br />
pu faire la reconstruction légale car beaucoup de ventes se sont faites<br />
" légalement ", c'<strong>est</strong>-à-dire qu'il y eu un transfert de propriété, mais les gens<br />
disent qu'ils ont été expropriés. Comme nous n'avons pas un recensement de la<br />
population il <strong>est</strong> très difficile d'<strong>est</strong>imer le nombre de personnes affectées <strong>»</strong> 2 .<br />
Ainsi, un juriste d'une ONG européenne basée à Santa Marta <strong>est</strong>ime que 70% des<br />
paysans victimes d'expropriation ne possèdent pas de titres de propriété sur leurs anciennes<br />
terres 3 . L'ampleur du phénomène de l'expropriation <strong>est</strong> donc très difficile à évaluer.<br />
Il faut également souligner la profondeur historique du phénomène, liée aux<br />
exploitations extensives – élevage, banane, palme africaine – et au modèle du latifundium.<br />
Ainsi, une étude du PNUD <strong>est</strong>imait qu'à la fin des années 1980, le Magdaléna était le<br />
quatrième département le plus affecté par le phénomène d'appropriation de terres par des<br />
narcotrafiquants 4 . L'étude liait cela à la croissance soudaine des plantations extensives de<br />
bananes à partir du milieu des années 1980 5 .<br />
1 Expert n°9. Voir annexe 2, sources orales.<br />
2 Entretien avec un fonctionnaire de l'Agence Présidentielle pour l'Action Sociale à Santa Marta. Cité<br />
par Reyes [2009], p. 195<br />
3 Expert n°9. Voir annexe 2, sources orales.<br />
4 Reyes [1997], p. 341<br />
5 Ibidem, p. 302-303<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 207
Une approche historique nous permet aussi de voir que l'expropriation paramilitaire<br />
peut se placer en continuité des conflits agraires des années 1970-1980. Nous avons évoqué<br />
les invasions que des paysans sans terre effectuent pendant cette période; bien que très peu de<br />
ces invasions aient été légalisées, et que les populations mobilisées aient rarement obtenu gain<br />
de cause 1 , l'importance de ces conflits a parfois conduit les grands propriétaires fonciers à<br />
vendre une partie de leurs terres à l'Incora, qui les a ensuite distribuées aux paysans 2 .<br />
Les expropriations sont alors une réaction des secteurs possédants de la société, alliés<br />
aux paramilitaires, contre les avancées très limitées de la réforme agraire. C'<strong>est</strong> le cas de<br />
l'hacienda Bejucoprieto, envahie dans les années 1980 par des paysans soutenus par l'ELN.<br />
Comme l'explique un ancien leader paysan :<br />
<strong>«</strong> Bejucoprieto appartenait à la famille Suarez, j'ai participé à l'invasion de ces<br />
terres. Nous étions soutenus par le Front Domingo Barrios de l'ELN, dans lequel<br />
je militais activement à l'époque. Ça faisait déjà un moment que l'ELN harcelait<br />
les propriétaires, on demandait des meilleurs salaires et du respect pour les<br />
ouvriers agricoles <strong>»</strong> 3<br />
Un autre paysan de Bejucoprieto raconte :<br />
<strong>«</strong> Les propriétaires fonciers étaient harcelés, du coup, ils ont préféré vendre à<br />
l'Incora pour qu'il parcellise les terres. Quand je suis arrivé là, la guérilla n'était<br />
plus très présente. Ils venaient de temps en temps, pour voir comment ça se<br />
passait, je leur ai parlé plusieurs fois. Le problème c'<strong>est</strong> que quand l'ELN <strong>est</strong><br />
définitivement parti, les héritiers des Suarez sont revenus, ils venaient avec les<br />
paramilitaires et ont jeté tout le monde de là. Maintenant ces terres appartiennent<br />
aux Suarez <strong>»</strong> 4 .<br />
Contrairement au cas de El Encanto, aucune action judiciaire n'existe contre les actuels<br />
propriétaires de Bejucoprieto; nous avons donc été dans l'impossibilité de croiser les versions<br />
des interviewés avec d'autres types de sources. Cependant, ces témoignages illustrent bien<br />
1 Prada [2002]<br />
2 Verdad Abierta, 13/04/2009. Dos veces despojados : <strong>«</strong> Manuel Lineros, ancien fonctionnaire de<br />
l'Incora dans le Magdaléna se rappelle que beaucoup de propriétaires sont allés directement à l'Institut<br />
pour proposer leurs terres à l'État. Dans l'état de la situation, la meilleure affaire était de vendre à<br />
l'Incora <strong>»</strong><br />
3 Cas n°21. Voir annexe 2, sources orales<br />
4 Cas n°8. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 208
comment les conflits agraires s'étendent dans le temps et quelle <strong>est</strong> la profondeur historique de<br />
la violence liée à la possession de la terre.<br />
Un dernier type d'expropriation <strong>est</strong> liée à l'économie de la drogue. <strong>La</strong> plupart des<br />
plantations de coca du département se trouvent dans la Sierra. Selon les <strong>est</strong>imations de l'ONU,<br />
la Sierra n'<strong>est</strong> pas un lieu significatif de production de coca. Si l'on se fie à ces données,<br />
pendant les dix dernières années, l'extension cultivée dans la partie du massif qui correspond<br />
au Magdaléna a fluctué entre 200 et 400 ha, avec un pic de 760 ha en 2003 1 . En effet,<br />
l'importance stratégique du lieu <strong>est</strong> surtout liée à la transformation de la pâte de coca en<br />
chlorhydrate de cocaïne. Cependant, l'impact social et écologique de ces quelques centaines<br />
d'hectares cultivés ne doit pas être sous-<strong>est</strong>imé. <strong>La</strong> production de coca s'<strong>est</strong> ainsi parfois<br />
accompagnée d'expropriation des terres. Comme l'explique un paysan originaire de<br />
Guamachito (Santa Marta) :<br />
<strong>«</strong> Ils nous ont dit que comme on n'avait pas voulu cultiver de la coca on devait<br />
partir. Ils nous ont expulsé de ces terres là et ont ramené un gars qui a commencé<br />
a cultiver cette merde.[...]. Ça a beaucoup changé, les sources d'eau sont<br />
maintenant sèches parce qu'ils ont coupé les arbres pour semer la coca. Il n'y a<br />
plus que l'eau qui tombe du ciel. Tout ça pour produire de la drogue, ils ont brûlé<br />
les oranges et le cacao pour les remplacer par cette ordure <strong>»</strong> 2 .<br />
Accumulation privée des ressources : entre le légal et l'illégal<br />
L'appropriation de terres ne répond pas seulement à une stratégie de thésaurisation,<br />
dans laquelle les paramilitaires accumuleraient des terres sans vraiment les exploiter. Souvent,<br />
cette appropriation répond à l'insertion des acteurs dans des réseaux économiques<br />
mondialisés. C'<strong>est</strong> évidemment le cas de la drogue, mais aussi des grandes plantations de<br />
banane et palme. <strong>La</strong> qu<strong>est</strong>ion des liens entre paramilitaires et acteurs de l'économie légale<br />
n'<strong>est</strong> donc pas tout à fait étrangère à nos interrogations. Elle soulève bien sûr la qu<strong>est</strong>ion de<br />
l'utilisation de la force comme un moyen d'accumulation. Elle nous conduit également à<br />
examiner la violence comme partie intégrante de l'économie politique, et à rejeter les visions<br />
qui cantonnent les illégalismes aux seuls secteurs <strong>«</strong> souterrains <strong>»</strong> de l'économie 3 . Les projets<br />
agro-industriels développés ces dernières années en Colombie sont un bon exemple de cette<br />
1 Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito, Colombia. Monitoreo de cultivos de coca. Juin<br />
2008, p. 34<br />
2 Cas n°17. Voir annexe 2, sources orales<br />
3 Cette critique <strong>est</strong> fondée sur les travaux de Briquet et Favarel-Garrigues [2008]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 209
articulation entre violence et accumulation de capital. De plus, ils se trouvent au carrefour de<br />
plusieurs qu<strong>est</strong>ions déjà évoquées : expropriation de terres, liens avec l'administration et<br />
relations avec les acteurs économiques. Nous évoquerons d'abord quelques hypothèses sur le<br />
lien entre violence paramilitaire et grands projet agro-industriels, avant de traiter rapidement<br />
d'autres types de participation des paramilitaires dans l'économie légale.<br />
Très peu d'informations existent sur le lien entre violence paramilitaire et<br />
développement des grands projets économiques. De plus, le peu de données existantes ne<br />
correspondent pas à des études académiques, mais à des rapports du gouvernement 1 ou des<br />
organisations d'opposition 2 . <strong>La</strong> seule étude académique disponible souligne le lien entre<br />
déplacement forcé de populations et les plantations de palme africaine dans le municipe de<br />
Zona Bananera. J. Goebertus affirme que <strong>«</strong> les institutions publiques ont stimulé la plantation<br />
incontrôlée de palme africaine dans la Zone, ce qui a produit des stimulations perverses pour<br />
que les grands producteurs et les acteurs armés illégaux provoquent le déplacement forcé des<br />
personnes, dans le but d'acquérir des terres pour la production d'huile de palme <strong>»</strong>. Plusieurs<br />
témoignages recueillis tendent à confirmer cette hypothèse d'un lien entre développement<br />
économique et violence armée. Ils indiquent par exemple que les terres abandonnées ont<br />
aujourd'hui été intégrées aux exploitations voisines de palme africaine ou banane 3 . C'<strong>est</strong><br />
également ce qu'affirment les familles de victimes des AUC qui mènent un procès contre la<br />
Dole Food Company Inc. devant une cour de Californie 4 . Les instances judiciaires enquêtent<br />
aujourd'hui sur ces collusions. Ainsi, par exemple, les compagnies productrices d'huile de<br />
palme Urapalma et Gradesa font face à des poursuites judiciaires devant des instances<br />
nationales et internationales pour avoir profité d'un partenariat économique avec les AUC 5 .<br />
De la même manière, la compagnie étasunienne Chiquita Brands a été condamnée par une<br />
cour de ce pays à de fortes amendes pour avoir acquis les <strong>«</strong> services de sécurité <strong>»</strong> des AUC<br />
dans des plantations de bananes du Magdaléna et d'Urabá 6 .<br />
1 Aguilera (María), Palma africana en la Costa Caribe: un semillero de empresas solidarias,<br />
Documento de trabajo sobre Economía Regional No. 30 Julio<br />
2 Agrocombustibles <strong>«</strong> llenando tanques, vaciando territorios <strong>»</strong>. Rapport de CENSAT et PCN avec<br />
l'appui de Ecofondo. 2008<br />
3 Par exemple cas n°27 : <strong>«</strong> Les terres des gens qu'ils ont jeté hors de la zone ont été utilisées pour<br />
planter de la palme. C'<strong>est</strong> pire que lorsqu'il y avait que de la banane. Au moins la banane ça se<br />
mange. Mais une noix de palme (corozo, n.t.d.), qu'<strong>est</strong>-ce que tu veux en faire? <strong>»</strong><br />
4 Conrad & Scherer, LPP vs. Dole Food Company Inc.Superior Court of the State of California for the<br />
county of Los Angeles. Complaint for damages<br />
5 Cour Intéraméricaine des Droits Humains pour la première et justice colombienne pour la seconde. Cf<br />
The Nation, 27/05/2009.The Dark Side of Plan Colombia<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 210
Photo 5.1. Exploitation de Banacol, Municipe de Zona Bananera<br />
Source : photo de l'auteur<br />
Malheureusement, dans l'état actuel des données il <strong>est</strong> impossible de confirmer<br />
totalement ces hypothèses ou d'étudier les mécanismes de cette violence. Cependant, la simple<br />
observation de l'environnement nous permet de constater que des terres anciennement dédiées<br />
à l'agriculture de subsistance sont aujourd'hui intégrées dans des exploitations modernes<br />
produisant des biens agricoles d'exportation 1 . Dans l'état des données nous nous limiterons<br />
donc à souhaiter que des recherches approfondies creusent ce lien entre accumulation du<br />
capital et privatisation de la violence.<br />
<strong>La</strong> participation des groupes paramilitaires à l'économie légale n'<strong>est</strong> pas simplement<br />
anecdotique. Elle fait même partie des activités centrales de ces groupes. En effet, les AUC<br />
tirent de très grands profits de l'économie de la drogue ; ces fonds doivent être <strong>«</strong> blanchis <strong>»</strong><br />
pour pouvoir ensuite rentrer dans le circuit de l'économie légale. Les procédures de<br />
blanchiment passent nécessairement par la détention de sociétés façade ou la participation à<br />
des conglomérats économiques. Il ne s'agit donc pas d'une activité marginale des groupes<br />
paramilitaires mais d'une tâche centrale dans le processus d'enrichissement. De plus, lorsque<br />
la démobilisation des AUC commence à se profiler à partir de 2002, la légalisation et les<br />
détournements de fonds des différents Blocs paramilitaires – notamment par le biais de prête-<br />
noms – deviennent pour les commandants le moyen d'assurer le maintien de leur pouvoir<br />
économique dans leur future vie civile.<br />
6 El Tiempo, 29/04/2009. Chiquita Brands reveló los nombres de sus ejecutivos comprometidos con<br />
pagos a 'paras' en Colombia<br />
1 Une visite dans des terres qui sont aujourd'hui réclamées par des réfugiés a confirmé qu'elles avaient<br />
été intégrées dans les grandes exploitations voisines. Il n'y a aujourd'hui que très peu d'exploitations<br />
familiales dans les municipes visités : Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca et Fundación<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 211
Photo 5.2. Plantation de palme africaine, Tucurinca, municipe de Zona Bananera<br />
Source : photo de l'auteur<br />
L'exemple de Coolechera, la plus grande coopérative 1 de producteurs laitiers de la côte<br />
caraïbe colombienne 2 illustre bien l'articulation entre utilisation de la violence et puissance<br />
financière 3 . <strong>La</strong> pression des AUC sur le conseil de direction de la coopérative commence en<br />
2002 avec des menaces contre les membres, qui appartenaient aux élites locales d'éleveurs de<br />
bétail. En août de cette année-là, les membres du conseil auraient été convoqués à une réunion<br />
avec Alias Fabián, un commandant des AUC exerçant son contrôle sur le municipe de<br />
Sitionuevo. Ils sont alors accusés de ne pas <strong>«</strong> collaborer <strong>»</strong> avec l'organisation et acculés de<br />
quitter leurs postes. L'assassinat de Gustavo De Silv<strong>est</strong>ry, président du conseil et l'attentat<br />
contre le président du syndicat, Manuel Hoyos Montiel, poussent les autres membres du<br />
conseil à renoncer. Un nouveau conseil de direction <strong>est</strong> alors formé, vraisemblablement avec<br />
des personnalités plus favorables aux AUC. L'ancien président de Palmeras de la Costa, une<br />
entreprise de production d'huile de palme, Manuel Combariza, assume la direction. Le<br />
contrôle du conseil de direction <strong>est</strong> complété par la formation d'une firme de sécurité privée,<br />
Asis Ltda. exclusivement dédiée à la surveillance des installations et des transporteurs de la<br />
coopérative. Or, cette firme <strong>est</strong> aujourd'hui accusée devant les instances judiciaires d'être une<br />
1 Les coopératives colombiennes peuvent ressembler plutôt à des associations d'actionnaires plutôt qu'à<br />
des groupement des producteurs et travailleurs, comme pourrait le penser le lecteur français.<br />
2 Avec un chiffre d'affaires de 150 000 millions de pesos (50 millions de euros) en 2000<br />
3 Cette description se base sur l'article de l'hebdomadaire Semana, 10/14/2006. <strong>La</strong> ordeñada de los<br />
paras et l'entretien avec son auteur : Expert n°12.Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 212
façade pour les opérations des AUC. Ses membres sont notamment accusés du meurtre du<br />
secrétaire de gouvernement de la mairie de Calamar (Département de Bolivar). Parallèlement<br />
à cela, Coolechera enregistre des pertes milliardaires qui poussent à la r<strong>est</strong>ructuration de<br />
l'entreprise. Or, en pleine crise, elle achète la société Hatoblanco, de propriété de José María<br />
Barrera, chef paramilitaire du Sud du Magdaléna, pour près de 5000 millions de pesos 1 .<br />
Plusieurs conclusions peuvent être tirées à partir de ce récit. Premièrement, la prise de<br />
contrôle de Coolechera se fait grâce à deux ressources que les paramilitaires maîtrisent bien :<br />
la violence et le <strong>«</strong> capital social <strong>»</strong> 2 , c'<strong>est</strong>-à-dire les alliés qui sont prêts à rentrer comme gérants<br />
dans la coopérative. Ce capital social assure notamment une façade légale aux paramilitaires<br />
et rend plus difficiles les attaques judiciaires. Deuxièmement, Coolechera se trouve à<br />
l'intérieur d'un réseau d'entreprises liées aux paramilitaires, qui effectuent des tâches<br />
différentes pour l'organisation. L'exemple le plus clair <strong>est</strong> celui de la compagnie de sécurité<br />
Asis Ltda.; voilà une firme de sécurité privée, donc dotée du droit de porter des armes, être<br />
une simple façade pour les activités illégales des professionnels de la violence. C'<strong>est</strong> un<br />
classique des collusions entre activités économiques légales et illégales 3 . Enfin, l'entreprise<br />
n'<strong>est</strong> pas uniquement utilisée comme façade légale, elle fait aussi l'objet de ponctions de fonds<br />
très importantes qui la mènent au bord de la faillite, ce qui montre bien que la participation à<br />
l'économie légale n'implique pas l'abandon de pratiques de pillage.<br />
Les chroniques journalistiques et les témoignages recueillis abondent en récits de cette<br />
sorte. On pourrait par exemple évoquer le témoignage d'un journaliste, qui affirme que Jorge<br />
Cuarenta avait interdit aux abattoirs la vente de la peau des bêtes abattues; ces peaux étaient<br />
alors collectées par des hommes de son organisation et revendues par la suite. Cela faisait des<br />
AUC un acteur monopolistique du marché du cuir dans plusieurs départements de la côte. Ces<br />
informations contrastent d'ailleurs brutalement avec les déclarations de Cuarenta, qui affirme<br />
après sa démobilisation être un homme aux mod<strong>est</strong>es ressources, un probe administrateur des<br />
biens du Bloc Nord 4 .<br />
Surtout, toutes ces informations nous conduisent à confirmer l'hypothèse d'un lien entre<br />
la violence et l'économie politique. Comme l'écrit L. Martinez à propos de l'Algérie :<br />
1 5 millions de euros.<br />
2 L'expression <strong>est</strong> de Sciarrone [2000]<br />
3 Voir par exemple la description des Rangers du Pakistan faite par L. Gayer [2008]<br />
4 Version libre de Rodrigo Tovar Pupo, 9 juillet 2007.In Por lo menos la verdad , Bulletin<br />
d'information de la Commission Inter-ecclésiale Justice et Paix, n°17<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 213
<strong>«</strong> L'avènement de la guerre civile peut être, dans cette perspective, saisi comme<br />
une opération économico-politique visant à favoriser une accumulation de<br />
ressources […]. Parce qu'elle brise le " monopole légitime de la violence " de<br />
l'État, la guerre civile s'accompagne d'une privatisation de la violence qui<br />
engendre une accumulation privée des biens économiques <strong>»</strong><br />
On voit ainsi que la violence privée, en plus d'être un moyen d'exercice du pouvoir et d'accès<br />
aux instances de l'État, <strong>est</strong> un outil économique. Évidemment, les stratégies d'accumulation<br />
alimentent le pouvoir militaire et politique de l'organisation; elles contribuent aussi à une<br />
forme de criminalisation 1 du politique et de l'économique. Ces sont là, somme toute, deux<br />
sphères inséparables dans la définition des contours de l'État 2 .<br />
Dans ce chapitre, nous nous sommes efforcé de lier la monopolisation de la violence<br />
sur le territoire à l'influence sur les institutions et les stratégies d'accumulation privée des<br />
ressources. À partir de la conquête d'un monopole de la violence, les AUC obtiennent la<br />
possibilité d'utiliser leur force armée, mais aussi leurs alliances et leur capacité rétributive,<br />
pour exercer un pouvoir politique régional. Au terme de ce récit, le groupe a construit des<br />
véritables capacités étatiques. Il <strong>est</strong> pénètre la société, la régule et en extrait des ressources.<br />
Cet enchevêtrement des institutions publiques, des stratégies d'accumulation et de la violence<br />
privée contribue à confirmer <strong>notre</strong> hypothèse de le violence privée comme modalité de<br />
formation de l'État.<br />
1 Cf. Bayart, Ellis et Hibou [1997]<br />
2 Hibou [2000], p. 36<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 214
Épilogue : ce n'<strong>est</strong> pas la fin de l'histoire<br />
Au début du XXI ème siècle, les AUC sont présentes dans plus d'un tiers des municipes du pays<br />
et exercent un ferme contrôle sur les sept départements de la côte caraïbe 1 . Elles ont tissé des<br />
alliances avec des nombreux entrepreneurs politiques et ont mis en place des stratégies<br />
d'accumulation. L'évolution de l'utilisation de la violence, que nous nous sommes efforcé de<br />
souligner ici, les mène à exercer un pouvoir de plus en plus large sur leurs territoires. En<br />
association avec les institutions locales et avec des membres des élites politiques, les<br />
paramilitaires réussissent à remodeler l'espace de la concurrence politique, évinçant des<br />
acteurs à leur profit et à celui de leurs clients. Cette mainmise sur le jeu politique <strong>est</strong> bien sûr<br />
au fondement du contrôle des institutions. Ce contrôle sert des stratégies politiques et permet<br />
aux paramilitaires d'acquérir des leviers d'influence sur le centre. Il renforce également des<br />
positions d'accumulation de ressources privées. <strong>La</strong> mise en œuvre de la violence ne s'effectue<br />
pas sans la création de systèmes de consentement qui assurent une certaine acceptation de la<br />
part de la population. Le pouvoir que les paramilitaires ont accumulé les transforme en acteurs<br />
clés du politique.<br />
Dans leur avancée, les AUC font reculer les groupes de guérilla. Des anciens fiefs de<br />
l'ELN ou des FARC-EP, où ces organisations avaient remplacé les autorités publiques,<br />
reviennent dans le giron de l'État. Les paramilitaires y instaurent un ordre sévère, mais<br />
affirment sans cesse que ces zones sont récupérées pour l'État 2 . <strong>La</strong> domination paramilitaire<br />
permet aussi, comme nous l'avons souligné, la réalisation de grands projets économiques,<br />
comme les plantations de palme ou de banane et les extractions de charbon. <strong>La</strong> société <strong>est</strong><br />
mise sous contrôle, le jeu politique <strong>est</strong> verrouillé et le flux de ressources <strong>est</strong> assuré. Dans ces<br />
conditions, les paramilitaires prétendent se positionner comme des <strong>«</strong> libérateurs <strong>»</strong>. Ainsi<br />
l'indique en tout cas la stratégie médiatique mise en œuvre par Carlos Castaño à partir de<br />
2001. Dans un contexte de rejet croissant de la guérilla, il entend convertir ses <strong>«</strong> exploits <strong>»</strong><br />
militaires en capital politique. C'<strong>est</strong> ainsi qu'il faut comprendre la suite de cette histoire.<br />
En effet, parallèlement à leurs avancées militaires, les chefs des AUC explorent des<br />
voies qui permettraient la légalisation de leurs structures armées et leur intégration à la vie<br />
1 Romero et Valencia [2007]<br />
2El Colombiano, 08/12/1996 : Castaño déclare que <strong>«</strong> Nous (les paramilitaires) disons que ces territoire<br />
ont été récupérés pour l'Etat <strong>»</strong><br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 215
civile – et probablement politique – du pays. Des négociations sont alors entamées avec le<br />
gouvernement d'Alvaro Uribe, qui propose des conditions très favorables aux démobilisés. Or,<br />
ces négociations provoquent des conflits entre différentes instances de l'État. Elles aboutissent<br />
à l'extradition des plus hauts commandants des AUC. L'état actuel de la situation pose des<br />
clairs défis à la Colombie : réparation des victimes, jugement des partenaires des<br />
paramilitaires au sein des institutions et g<strong>est</strong>ion des plusieurs milliers de professionnels de la<br />
violence désormais dans la rue. Ce sont autant de chantiers de recherche qui r<strong>est</strong>ent ouverts.<br />
Nous nous contenterons, dans un bref épilogue de retracer les derniers épisodes de l'histoire<br />
du phénomène paramilitaire et de poser quelques jalons pour des éventuelles recherches.<br />
1. Alliances politiques et démobilisation : quels leviers sur le centre?<br />
Comme nous l'avons souligné, plusieurs auteurs considèrent que la formation des AUC<br />
en 1997 répondrait au dessein de s'ériger en troisième acteur du conflit et d'être reconnues par<br />
le gouvernement comme une organisation politique 1 . En juillet 1998 en pleine expansion<br />
paramilitaire, Carlos Castaño et Salvatore Mancuso se réunissent dans une hacienda de<br />
Valencia (Córdoba) avec des délégués du gouvernement, des syndicats et des associations<br />
patronales. Le résultat de cette réunion <strong>est</strong> la <strong>«</strong>accord du massif du Paramillo <strong>»</strong>, un texte<br />
programmatique qui pose les bases d'une éventuelle démobilisation des AUC 2 . Or, les<br />
négociations que le gouvernement du Président Andrés Pastrana engage alors avec les FARC-<br />
EP favorisent l'expansion des AUC. Dans ce cadre de polarisation croissante ont lieu les<br />
différents accords électoraux qui aboutissent à l'élection d'un congrès où Salvatore Mancuso<br />
<strong>est</strong>ime avoir 30% <strong>«</strong> d'amis <strong>»</strong> 3 .<br />
Selon L. Valencia, l'alliance entre paramilitaires et politiques <strong>est</strong> justement réalisée<br />
dans l'optique des négociations de démobilisation 4 . En effet, ces leviers de pression sur le<br />
législatif, ainsi que l'élection d'Alvaro Uribe en 2002, qui manif<strong>est</strong>e sa volonté de négocier<br />
avec les AUC, constituent un contexte favorable pour une démobilisation. Le 1er décembre<br />
2002, l'état major des AUC diffuse une <strong>«</strong> déclaration du massif du Paramillo <strong>»</strong>, dans laquelle<br />
elle déclare le cessez-le-feu unilatéral et annonce son intérêt pour s'engager dans des<br />
pourparlers avec le gouvernement d'Alvaro Uribe. Le texte affirme que la politique du<br />
gouvernement Uribe peut assurer la sécurité sur le territoire national et la défaite militaire des<br />
1 Voir Chapitre 2<br />
2 El Espectador, 27/07/2008. Diez años del ‘Acuerdo del Nudo de Paramillo’<br />
3 El Tiempo, 13/02/2002. Paras reconocen que tienen listas al Congreso<br />
4 Valencia [2007]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 216
guérillas; il serait donc naturel que les AUC rendent les armes 1 . Ces déclarations coïncident<br />
avec le vote d'une loi visant à <strong>«</strong> faciliter le dialogue et la suscription d'accords avec des<br />
groupes armés au marge de la loi <strong>»</strong> 2 . Commencent alors les contacts entre les délégués du<br />
gouvernement et les chefs paramilitaires (période connue comme la phase exploratoire), qui<br />
aboutissent à l'accord de Santa Fe de Ralito en 2003 et à l'installation officielle d'une table de<br />
négociations 3 .<br />
Le poids joué par les paramilitaires dans les élections de 2002 assure une représentation<br />
législative à leurs intérêts. Cette représentation <strong>est</strong> capitale au moment où le parlement<br />
s'engage dans la rédaction du cadre légal qui régirait la démobilisation des AUC. Dans le<br />
contexte des travaux parlementaires, le 28 juillet 2004 sont invités au Capitole National les<br />
chefs paramilitaires Salvatore Mancuso, Ramón Isaza et Ern<strong>est</strong>o Báez. Dans leurs discours ils<br />
donnent leur interprétation très personnelle de l'expansion des groupes paramilitaires et<br />
expriment leurs desseins politiques. <strong>La</strong> presse de l'époque enregistre les ovations avec<br />
lesquelles une partie du Congrès reçoit les trois commandants 4 . Dans ces conditions, il n'<strong>est</strong><br />
pas étonnant que le parlement vote une loi extrêmement favorable aux intérêts des<br />
paramilitaires. <strong>La</strong> loi n° 975, connue comme Loi de Justice et Paix (Justicia y Paz) leur assure<br />
initialement un statut politique qui les protégerait notamment des demandes d'extradition<br />
formulées par le gouvernement étasunien. De plus, elle ne comporte aucune obligation de<br />
vérité et prévoit des peines très faibles 5 . Enfin, elle établit des contrôles très lâches sur les<br />
biens des paramilitaires et leur famille. Dans les faits, tout cela risquait fortement d'aboutir à<br />
la légalisation de leur pouvoir politique et économique. Or, la loi fait l'objet de dures critiques<br />
de la part de l'opposition, mais aussi de certains secteurs de la majorité. Elles visent surtout les<br />
articles 64 et 71, qui donnent le statut de sédition et délit politique aux exactions des<br />
paramilitaires. Lorsque le débat s'engage, les alliés des paramilitaires jouent un rôle essentiel<br />
pour faire avancer les articles les plus controversés. Des sénateurs aujourd'hui condamnés par<br />
leurs liens avec les paramilitaires comme Luis Vives <strong>La</strong>couture ou Dieb Maloof soutiennent<br />
entièrement la loi 6 . Une sorte de coalition de cause se forme alors autour du vote de la loi;<br />
cette coalition <strong>est</strong> majoritairement formée par des parlementaires élus dans des zones de<br />
1 Acuerdo del Nudo del Paramillo, 29 novembre 2002<br />
2 Loi 782 de 2002<br />
3 El Tiempo, 16/06/2004. Gobierno declara abierta negociación con paras<br />
4 El Tiempo, 29/07/2004. Paras : 120 minutos en el Congreso<br />
5 Valencia [2007], p. 42 et 43<br />
6 Semana, 02/17/2007. Los caídos por parapolítica<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 217
contrôle paramilitaire, dont certains n'hésitent pas à s'auto-dénominer <strong>«</strong> bras politique des<br />
autodéfenses <strong>»</strong> 1 .<br />
Grâce à la pugnacité de cette coalition, et à la pression de l'exécutif, la loi <strong>est</strong> finalement<br />
approuvée par le parlement et publiée dans le journal officiel le 25 juillet 2004 2 . Cependant, le<br />
gouvernement et les parlementaires qui soutiennent la loi font face à l'opposition de deux<br />
puissants secteurs. D'une part, il s'agit d'une aile du parti libéral proche de l'ancien président<br />
Cesar Gaviria, qui avait soutenu l'élection d'Alvaro Uribe en 2002 ainsi que la plupart des<br />
initiatives législatives de son gouvernement. D'autre part il s'agit de la Cour Constitutionnelle,<br />
qui s'oppose fermement à plusieurs dispositions de la loi Justice et Paix. Il convient également<br />
de souligner que les États-Unis font savoir à travers leur ambassadeur à Bogotá qu'ils<br />
s'opposent à la suspension des procédures d'extradition pour trafic de drogue et –<br />
accessoirement – à la politique de pardon et oubli 3 .<br />
2. Tensions intra-étatiques et volatilité des accords public-privé<br />
Le conflit qui s'engage alors montre les limites des leviers d'influence que les<br />
paramilitaires possèdent sur le centre. Il <strong>est</strong> aussi un clair indicateur des positions<br />
radicalement opposées qui demeurent à l'intérieur même de l'État colombien. Comme nous<br />
l'avons montré sur toute <strong>notre</strong> période, différentes instances étatiques s'affrontent autour de la<br />
qu<strong>est</strong>ion de la privatisation de la violence. Elle ne fait jamais l'objet d'un appui ou d'une<br />
opposition unanime. Enfin, ce conflit montre que l'État garde un levier puissant sur ces<br />
acteurs : la possibilité de changer les règles du jeu en ce qui concerne l'extradition. Celle-ci<br />
<strong>est</strong> en effet au centre des négociations et sert au gouvernement d'une sorte de <strong>«</strong> monnaie<br />
d'échange <strong>»</strong>. L'existence de ce levier nous mène à souligne que les accords tacites qui lient<br />
l'État et les groupes paramilitaires et qui semblaient promettre à ces derniers la légalisation de<br />
leur pouvoir sont caractérisés par l'instabilité et la volatilité.<br />
Les débats de la loi de Justice et Paix divisent profondément la majorité présidentielle.<br />
Toute une aile du parti libéral, qui jusqu'alors avait soutenu le président, se retourne contre<br />
lui. L'opposition libérale <strong>est</strong> menée par Rafael Pardo, ancien ministre et figure centrale du<br />
parti. Il se mobilise contre les articles les plus controversés de la loi et promeut une<br />
interprétation en termes de processus de soumission à la justice, et non pas de négociation<br />
1 Déclarations de Eleonora Pineda, représentante pour le département de Córdoba. Radiosantafé,<br />
28/08/2007.“Yo fui el brazo político de las autodefensas” Eleonora Pineda<br />
2 Ley 975 de 2005<br />
3 El Tiempo, 30/07/2004. Dura Crítica De E.U. A Visita Para<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 218
politique 1 . L'approbation finale de la loi conduit cette faction à s'ancrer dans l'opposition<br />
ouverte au gouvernement. L'ancien président Cesar Gaviria, qui vient de quitter son poste de<br />
Secrétaire Général de l'OEA à Washington retourne à Bogotá pour prendre la tête du parti<br />
libéral. Plusieurs de ses proches, qui étaient alors conseillers du président Uribe, abandonnent<br />
leur poste pour rejoindre Gaviria 2 .<br />
Après le vote de la loi, celle-ci <strong>est</strong> transmise à la la Cour Constitutionnelle pour sa<br />
révision. Dans son amendement, prononcé le 18 mai 2006, la Cour exige des peines plus<br />
élevées pour les chefs paramilitaires. Elle établit également l'obligation de vérité dans les<br />
déclarations des paramilitaires, sous peine de perdre tout bénéfice. Surtout, elle s'oppose<br />
fermement au statut politique qui garantissait aux paramilitaires qu'ils ne seraient pas extradés<br />
vers les États-Unis 3 .<br />
Parallèlement à ces tensions, les chefs des AUC réfléchissent au meilleur moyen de<br />
convertir leur force militaire illégale en capital politique légal. Selon L. Valencia, un secteur<br />
des AUC, réagissant à l'exposition médiatique des chefs paramilitaires et à la sympathie d'une<br />
partie de l'opinion à l'égard de ces <strong>«</strong> libérateurs <strong>»</strong>, aurait évalué la possibilité de concourir<br />
pour les élections législatives de 2006. Ils s'entourent alors de consultants politiques de taille<br />
internationale 4 . D'autres commandants paramilitaires, en revanche, seraient opposés à ce<br />
projet et se seraient manif<strong>est</strong>é pour la création d'une plate-forme politique commune qui<br />
soutiendrait des candidats proches des AUC 5 . Un des consultants politiques proches de cette<br />
mouvance expliquait ainsi qu'il était préférable de se concentrer sur un travail de préparation<br />
des cadres politiques pour les élections de 2010 6 . Les tensions générées par la loi de Justice et<br />
Paix auraient finalement convaincu les chefs paramilitaires de poursuivre dans la seconde<br />
stratégie, qui avait donné des si bons résultats lors des élections de 2002. Le choix semble<br />
avoir porté ses fruits; en effet, plusieurs analystes considèrent que la représentation des<br />
intérêts paramilitaires dans les Chambres a progressé entre 2002 et 2006 7 .<br />
Or, cela n'empêchera pas une dégradation progressive de la situation des chefs<br />
paramilitaires. <strong>La</strong> décision de la Cour Constitutionnelle cause des lourdes tensions entre ceux-<br />
1 Valencia [2007], p. 44<br />
2 Ibidem, p. 45<br />
3 El Tiempo, 20/05/2006. Horas de tensión por fallo de Justicia y Paz<br />
4 Valencia [2007], p. 46-47<br />
5 Idem<br />
6 Juan Antonio Rubbini. 14/03/2005. Voir son blog www.lapazencolombia.blogspot.org<br />
7 López et Sevillano [2008]; Valencia [2007]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 219
ci et le gouvernement. Réagissant à ces tensions, le 15 août 2006 l'exécutif demande le<br />
transfert des leaders paramilitaires dans un centre de rétention aménagé pour l'occasion 1 . Cela<br />
<strong>est</strong> très mal accepté par les détenus, dont trois profitent alors pour quitter le dispositif. L'un<br />
d'entre eux, Vicente Castaño, envoie alors une lettre au Haut Commissaire à la Paix où il lui<br />
expose les griefs que les chefs paramilitaires nourrissent contre l'État : il s'agit essentiellement<br />
de la qu<strong>est</strong>ion de la sécurité juridique, car la garantie de non-extradition devient avec l'arrêt de<br />
la Cour une simple promesse présidentielle 2 .<br />
Dans ce contexte, le gouvernement dénonce la réactivation de structures paramilitaires<br />
dans le Nord du pays 3 et accuse les chefs paramilitaires de ne pas respecter les clauses du<br />
processus de démobilisation; la menace de l'extradition <strong>est</strong> fréquemment brandie par<br />
l'exécutif 4 . <strong>La</strong> négociation semble rentrer en crise lorsque le Ministre de l'intérieur ordonne<br />
subitement le transfert des chefs paramilitaires à la <strong>prison</strong> de haute sécurité de Itagüí, sous<br />
prétexte qu'il aurait des informations sur une éventuelle fuite des reclus 5 .<br />
Alors qu'ils font l'objet de ces signalements, les chefs paramilitaires commencent à<br />
livrer aux magistrats des informations sur les liens qu'ils entretenaient avec des politiques. Ils<br />
rendent publics des documents et des enregistrements qui prouvent la participation de ces<br />
figures politiques à des alliances dans le but d'assurer leur élection. Ces informations<br />
permettent l'ouverture de procédures judiciaires contre plusieurs dizaines de parlementaires; la<br />
plupart d'entre eux appartiennent à la majorité présidentielle. Les attaques touchent même des<br />
proches du président, comme son cousin ou bien sa ministre des affaires étrangères, qui doit<br />
renoncer à son poste suite à l'ouverture d'un procès contre son frère. Ces documents et<br />
déclarations compromettantes sont maniés par les paramilitaires comme une ressource<br />
politique 6 ; des recherches postérieures pourraient s'intéresser aux conditions de diffusion de<br />
ces informations.<br />
Le gouvernement utilise une stratégie semblable d'usage stratégique des <strong>«</strong> informations<br />
compromettantes <strong>»</strong>. En effet, il accuse les paramilitaires de coordonner des nouvelles<br />
structures armées depuis la <strong>prison</strong> d'Itagüí. Début mai 2007, la revue Semana, premier<br />
1 El Tiempo, 20/08/2006. Horas que sorprendieron a los paras<br />
2 Semana, 06/11/2006. <strong>La</strong> Carta de Castaño<br />
3 El Tiempo, 27/08/2006. Denuncian rearme en San Onofre<br />
4 El Tiempo, 01/12/2006. Culminó el traslado de los jefes de autodefensas recluidos en <strong>La</strong> Ceja a la<br />
cárcel de Itagüí<br />
5 Idem<br />
6 Sur la qu<strong>est</strong>ion des <strong>«</strong> Kompromati <strong>»</strong> voir Favarel-Garrigues [2008]Ragaru [2008]<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 220
hebdomadaire du pays, publie une enquête qui affirme, enregistrements et courriers<br />
électroniques à l'appui, que les anciens chefs paramilitaires continuent à contrôler les<br />
exportations de drogue vers les États-Unis grâce à des structures armés encore<br />
opérationnelles 1 . Cette enquête <strong>est</strong> seulement la dernière d'une série de <strong>«</strong> révélations <strong>»</strong> faites<br />
par la presse depuis le début de l'année 2006; elles mettent au jour les conditions luxueuses<br />
dans lesquelles étaient logés les chefs paramilitaires et les accusent d'être derrière la reprise de<br />
la violence dans leurs anciens fiefs 2 .<br />
Pendant tout ce temps, la menace de l'extradition pesait sur les têtes des leaders<br />
paramilitaires. En effet, le gouvernement étasunien n'a pas annulé ses demandes; de plus,<br />
l'arrêt de la Cour Constitutionnelle laissait sans base juridique la promesse de non extradition.<br />
Elle ne tenait plus qu'à la parole d'Uribe. <strong>La</strong> promesse n'<strong>est</strong> finalement pas tenue, car le 13<br />
mai 2008, cinq membres de l'État général 3 des AUC et 9 de leurs lieutenants sont extradés aux<br />
États-Unis 4 , accusés de ne pas avoir respecté les termes de l'accord avec l'État, de continuer à<br />
exporter de la drogue et de réarmer des groupes paramilitaires. L'effet de cette action sur la<br />
réactivation du phénomène paramilitaire r<strong>est</strong>e encore à démontrer. Ce qui <strong>est</strong> certain <strong>est</strong> que<br />
l'extradition met un frein aux <strong>«</strong> déclarations compromettantes <strong>»</strong> qui avaient fait tant de mal à<br />
la majorité présidentielle.<br />
L'énorme tâche judiciaire que représentent les procès ouverts à la suite de la<br />
démobilisation n'<strong>est</strong> pas le seul défi qu'affronte le pays. Il fait face également à une<br />
multiplication de groupes armés formés par des anciens combattants des AUC. Le cas du<br />
département du Magdaléna <strong>est</strong> à cet égard symptomatique d'un problème national 5 . Aussitôt le<br />
Front Resistance Tayrona (FRT) démobilisé, les routes de trafic qui descendent de la Sierra<br />
ont été reprises par des anciens lieutenants de l'organisation. Après une période d'affrontement<br />
pour les territoires, ils seraient parvenus à un accord qui partagerait le territoire entre le<br />
groupe des Nevados et celui des Païsas. Alors qu'un modus vivendi semblait s'établir dans la<br />
Sierra, un nouveau groupe, celui des Aigles Noirs, aurait lancé une nouvelle offensive visant à<br />
prendre le contrôle de la zone 6 .<br />
1 Semana, 12/05/2007. Exclusivo : Te llamo desde la prisión<br />
2 El Tiempo, 14/04/2007. El escándalo de Itagüí : la journaliste Maria Jimena Duzán énumère ces<br />
accusations<br />
3 Salvatore Mancuso, Jorge Cuarenta, Don Berna, Hernán Giraldo, et Ramiro <strong>«</strong> Cuco <strong>»</strong> Vanoy<br />
4 'El Tiempo, 13/05/2008. Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley<br />
de Justicia y Paz: Uribe<br />
5 Cf. CNRR [2007]<br />
6 Verdad Abierta, 27/04/2009. Caín contra Caín<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 221
Le problème de ces nouveaux groupes armés pose la qu<strong>est</strong>ion de la reconversion des<br />
professionnels de la violence. Ces individus, entraînés au maniement des armes et autres<br />
savoir-faire violents, constituent un vivier de recrutement pour des nouveaux groupes<br />
paramilitaires 1 . Ces groupes auraient lancé des campagnes de recrutement forcé dans lesquels<br />
les individus réticents à reprendre les armes seraient systématiquement assassinés. <strong>La</strong><br />
qu<strong>est</strong>ion de inefficacité des politiques publiques de démobilisation <strong>est</strong> posée de manière crue<br />
par ce responsable d'un centre de réinsertion pour anciens combattants : <strong>«</strong> aujourd'hui il n'y a<br />
pas d'alternative, c'<strong>est</strong> le réarmement ou la mort <strong>»</strong> 2 .<br />
Ainsi, les politiques publiques qui pourraient assurer un véritable post-conflit comme la<br />
réinsertion des professionnels de la violence ou l'assistance aux victimes sont défaillantes,<br />
voire inexistantes. Les magistrats de la Cour Suprême, engagés dans les enquêtes qui<br />
pourraient aider la société colombienne à mesurer l'ampleur des responsabilités énormes de<br />
leurs leaders politiques dans la violence, rencontrent aujourd'hui les pires difficultés pour<br />
avancer dans leur travail. Le gouvernement <strong>est</strong> désormais passé à l'attaque ouverte contre<br />
l'institution qui a engagé des poursuites à l'encontre d'une partie de sa majorité; le président<br />
allant jusqu'à accuser les juges de faire le lit de la guérilla. Dans des telles conditions, il <strong>est</strong> à<br />
craindre que l'épisode actuel ne corresponde pas à la fin du phénomène paramilitaire, mais<br />
uniquement à sa transformation.<br />
1 Problématique soulevée par Spalding [1999], p. 50 pour le cas du Nicaragua<br />
2 Expert n°4. Voir annexe 2, sources orales<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 222
Bibliographie<br />
Achila (Mauricio) dir. - [2002]. 25 años de luchas sociales en Colombia. Bogota: CINEP.<br />
Amn<strong>est</strong>y International - [1980]. Represión y tortura en Colombia. Informes internacionales y<br />
t<strong>est</strong>imonios nacionales. Comisión permanente por la defensa de los derechos humanos.<br />
Amn<strong>est</strong>y International - [2004]. Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados.<br />
Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. AMR 230402004.<br />
Aranguren (Mauricio) - [2001]. Mi confesión : Carlos Castaño revela sus secretos. Bogota:<br />
Oveja Negra.<br />
Arenas (Jacobo) - [1985]. Cese al fuego, una historia política de las FARC. Bogota : Oveja<br />
Negra.<br />
Arenas Granados (Pedro) - [2005]. Perspectiva histórica del desarrollo en el espacio litoral<br />
de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta : Universidad del<br />
Magdalena.<br />
Bandura (Albert) - [1999]. Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities.<br />
Personality and Social Psychological Review, Vol 3, p. 193-209.<br />
Banque Interaméricaine de Développement (BID) - [2004]. Los desafíos de un continente<br />
urbano. New York.<br />
Barbosa-Ortega (Juvenal), Renán-Rodríguez (William) et Suárez-Mosquera (Waldir) - [2007].<br />
<strong>La</strong> propiedad rural en el Magdalena 1970-2004 y algunas relaciones con el desplazamiento<br />
forzado. Santa Marta, DTCH: Universidad del Magdalena, Vicerrectoría de Inv<strong>est</strong>igación,<br />
Fonciencias, Sección II, informe final convocatoria 2004.<br />
Barkey (Karen) - [1994]. Bandits and bureaucrats : the ottoman route to state centralization.<br />
Cornell University Press.<br />
Bayart (Jean-François) dir. - [1996]. <strong>La</strong> greffe de l'Etat. Paris: Karthala.<br />
Bayart (Jean-François) - [2006]. L'État en Afrique. <strong>La</strong> politique du ventre. Paris: Fayard.<br />
Bayart (Jean-François), Ellis (Stephen) et Hibou (Béatrice) - [1997]. <strong>La</strong> criminalisation de<br />
l'Etat en Afrique. Bruxelles: Complexe.<br />
Beaud (Stéphane) et Pialoux (Michel) - [1999]. Retour sur la condition ouvrière. Paris :<br />
Fayard.<br />
Beaud (Stéphane) et Weber (Florence) - [2003]. Guide de l'enquête de terrain. 2e Ed. Paris:<br />
<strong>La</strong> Découverte.<br />
Behar (Olga) et Villa (Ricardo) - [1991]. Penumbra en el Capitolio. Bogotá : Planeta .<br />
Berman (B) et Lonsdale (J) - [1992]. Unhappy Valley. Conflict in Kenya and Africa.<br />
Portsmouth: James Currey.<br />
Bertaux (Daniel) - [2006]. Le récit de vie. 2e Ed. Paris: Armand Colin.<br />
Bertrand (Romain) - [2003]. Les virtuoses de la violence. Remarques sur la privatisation du<br />
maintien de l’ordre en Indonésie contemporaine. Tiers Monde, n°174, p. 323-344.<br />
Betancourt (Darío) et García (Martha) - [1994]. Contrabandistas, marimberos y mafiosos.<br />
Bogotá : Tercer Mundo.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 223
Blair (Elsa) - [2004]. Muertes violentas. <strong>La</strong> teatralización del exceso. Medellín : Editorial<br />
Universidad de Antioquia.<br />
Bonet Morón (Jaime) - [2000]. <strong>La</strong>s exportaciones colombianas de banano. Cartagena : Banco<br />
de la República.<br />
Bourdieu (Pierre) - [1986]. L'illusion biographique. Actes de la Recherche en Sciences<br />
Sociales, Vol. 62, N°1, p. 69-72.<br />
Bourdreau (Vincent) - [2004]. Resisting Dictatorship, Repression and Prot<strong>est</strong> in Southern<br />
Asia. Cambridge: Cambridge University Press.<br />
Braud (Philippe) - [2004]. Violences politiques. Paris: Seuil.<br />
Briquet (Jean-Louis) et Favarel-Garrigues (Gilles) - [2008]. Introduction In Briquet (Jean-<br />
Louis) et Favarel-Garrigues (Gilles) dir. Milieux criminels et pouvoirs politiques. Les ressorts<br />
illicites de l'Etat. Paris: Karthala (Recherches Internationales). p. 5-22.<br />
Briquet (Jean-Louis) et Sawicki (Frédéric) - [1989]. L'analyse localisée du politique. Politix,<br />
Vol 2 n°7, p. 6-16.<br />
Brockett (Charles) - [2005]. Political movements and violence in Central America.<br />
Cambridge : Cambridge University Press.<br />
Browning (Christopher) - [2007]. Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la<br />
police allemande et la solution finale en Pologne. Paris : Tallandier.<br />
Bushnell (David) - [1993]. The making of the modern Colombia : a nation in spite of itself.<br />
University of California Press.<br />
Cairns (Edmund) - [1997]. A safer future, reducing the human cost of war. Oxford : Oxfam<br />
Publications.<br />
Campbell (Bruce) et Brenner (Arthur) dir. - [2000]. Death squads in global perspective :<br />
murder with deniability. New York : St Martin Press.<br />
Carrillo (Vladimir) et Kucharz (Tom) - [2006]. Colombia : terrorismo de Estado. T<strong>est</strong>imonios<br />
de la guerra sucia contra los movimientos populares. Barcelona: Icaria (Coll. Academia).<br />
Castillo (Fabio) - [1987]. Los jinetes de la cocaína. Bogotá : Documentos Periodísticos.<br />
Castro Caycedo (Germán) - [1996]. En secreto. Bogotá : Planeta.<br />
Catanzaro (Raimondo) - [1991]. Il delito come impresa. Storia sociale della mafia. Milan :<br />
Supersaggi.<br />
CEDE-Uniandes et Banque Mondiale - [2004]. Colombia : Una política de tierras en<br />
transición. Bogotá : Université des Andes - Document CEDE.<br />
Cepeda (Iván) et Rojas (Jorge) - [2008]. A las puertas de El Ubérrimo. Bogotá : Debate.<br />
Chernick (Marc) - [1999]. Negociating peace amid multiple forms of violence: The protracted<br />
search for a settlement to the armed conflicts in Colombia In Arnson (Cynthia) dir.<br />
Comparative peace processes in <strong>La</strong>tin America. Stanford: Stanford University Press. .<br />
CIDH (Commission Intéraméricaine des Droits de l'Homme) - [1999]. Tercer informe sobre<br />
la situación de los derechos humanos en Colombia. OEA.<br />
CNRR (Comision Nacional de Reparacion y Reconciliacion) - [2007]. Disidentes, rearmados<br />
y emergentes : bandas criminales o tercera generación paramilitar. Bogota: CNRR.<br />
Comisión de <strong>est</strong>udios de las TPFs - [1992]. Tradición, Familia y Propiedad. Un Ideal, un<br />
Lema, una G<strong>est</strong>a, <strong>La</strong> Cruzada del siglo XX. Sao Paulo : Editora Veracruz.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 224
Crettiez (Xavier) - [2008]. Les formes de la violence. Paris: <strong>La</strong> Découverte (coll. Repères).<br />
Cruz Rodriguez (Edwin) - [2007]. Los <strong>est</strong>udios sobre el paramilitarismo en Colombia.<br />
Análisis político, n°60, p. 117-134.<br />
Cubides (Fernando) - [1997]. Los paramilitares y su <strong>est</strong>rategia. Bogota : Paz Publica -<br />
Universidad de los Andes.<br />
Cubides (Fernando) - [1999]. Los paramilitares y su <strong>est</strong>rategia In Deas (Malcom) et Llorente<br />
(Maria Victoria) dir. Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá : Norma - Cerec. .<br />
Cubides (Fernando), Olaya (Ana Cecilia) et Ortiz (Carlos Miguel) - [1995]. Violencia y<br />
desarrollo municipal. Bogotá : CES, Universidad Nacional de Colombia.<br />
De Vos (Jan) - [1993]. <strong>La</strong>s fronteras de la frontera sur. Reseña de proyectos de expansión<br />
que figuraron la frontera entre México y Centroamérica. Villahermosa (Tabasco) : Centro de<br />
Inv<strong>est</strong>igaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Universidad Juárez Autónoma<br />
de Tabasco.<br />
Defensoría del Pueblo (Colombia) - [2002]. Situación de orden publico en la vertiente norte<br />
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Octubre 2001 - Febrero 2002. Bogotá.<br />
Demazière (Didier) - [2007]. À qui peut-on se fier? Les sociologues et la parole des<br />
interviewés. <strong>La</strong>ngage et société, 3-4 n° 121-122, p. 85-100.<br />
Derriennic (Jean-Pierre) - [2001]. Les guerres civiles. Paris : Presses de Sciences Po.<br />
Dirección Nacional Liberal - [1998]. El precio de ser liberal. Bogotá : Partido Liberal<br />
Colombiano.<br />
Dudley (Steven) - [2004]. Walking ghosts : murder and guerrilla politics in Colombia. New<br />
York : Routledge.<br />
Duncan (Gustavo) - [2005a]. Del campo a la ciudad en Colombia : la infiltracion urbana de<br />
los señores de la guerra. CEDE-Universidad de los Andes.<br />
Duncan (Gustavo) - [2005b]. Los señores de la guerra. Bogota: Planeta.<br />
Duncan (Gustavo) - [2005c]. Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una<br />
subordinación In Rangel (Alfredo) dir. Narcotráfico en Colombia: economía y violencia.<br />
Bogotá : Fundación Seguridad y Democracia. .<br />
Earl (Jennifer) - [2003]. Tanks, Tear Gas, and Taxes : Toward a Theory of Movement<br />
Repression. Sociological Theory, vol 21, .<br />
Eaton (Kent) - [2006]. Decentralisation's non democratic roots : decentralisation and<br />
subnational reform in <strong>La</strong>tin America. <strong>La</strong>tin America Politics and Society, 48:1, .<br />
Echandía (Camilo) et Escobedo (Rodolfo) - [1999]. Violencia y desarrollo en el municipio<br />
colombiano. 1987-1993. Bogotá : Presidencia de la República.<br />
Elias (Norbert) - [1974]. <strong>La</strong> société de cour. Paris: Calmann-Levy.<br />
Elias (Norbert) - [1975]. <strong>La</strong> dynamique de l'Occident. Paris: Calmann-Lévy.<br />
Elias (Norbert) - [1991a]. <strong>La</strong> société des individus. Paris: Fayard.<br />
Elias (Norbert) - [1991b]. Qu'<strong>est</strong>-ce que la sociologie. Paris: Seuil.<br />
Favarel-Garrigues (Gilles) - [2008]. Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie In<br />
Briquet (Jean-Louis) et Favarel-Garrigues (Gilles) dir. Milieux criminels et pouvoir politique.<br />
Les ressorts illicites de l'Etat. Paris: Karthala (Recherches Internationales). p. 187-218.<br />
Flórez (Enrique) - [2005]. El Magdalena Grande. Bogotá : Proyecto ASDI-Arco Iris, inédit.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 225
Foucault (Michel) - [1975]. Surveiller et punir. Paris: Gallimard.<br />
FSD (Fundación Seguridad y Democracia) - [2007]. <strong>La</strong> magnitud de la verdad del<br />
paramilitarismo. Bogotá : FSD.<br />
Fumerton (Mario) et Remijnse (Simone) - [2004]. Civil defense forces: Peru's Comités<br />
d'Autodefensa Civil and Guatemala's Patrullas de Autodefensa Civil in comparative<br />
perspective In dir. Armed Actors : Organised violence and state failure in <strong>La</strong>tin America.<br />
Londres : Zed Books. p. 52-72.<br />
Gallon (Gustavo) - [1983]. <strong>La</strong> Republica en armas. Bogota : Cinep.<br />
Gambetta (Diego) - [1992]. <strong>La</strong> mafia siciliana : Un'industria della protezione privata. Turin:<br />
Einaudi.<br />
García (Martha Cecilia) - [2002]. Luchas urbano-regionales In Archila (Mauricio) dir. 25<br />
años de luchas sociales en Colombia. Bogotá: Cinep. p. 71-112.<br />
Gayer (<strong>La</strong>urent) - [2008]. Les Rangers du Pakistan : de la défense des frontières à la<br />
"protection" intérieure In Briquet (Jean-Louis) et Favarel-Garrigues (Gilles) dir. Milieux<br />
criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l'État. Paris : Karthala. p. 23-56.<br />
Gayer (<strong>La</strong>urent) et Jaffrelot (Christophe) - [2008]. Milices armées d'Asie du Sud. Paris:<br />
Presses de Sciences Po.<br />
Gibson (Edward) - [2005]. Boundary Control Subnational Authoritarianism in Democratic<br />
Countries. World Politics, 58, .<br />
Gutierrez Sanín (Francisco) - [2007]. Dégel et radicalisation en Colombie In Dabène<br />
(Olivier) dir. Amérique latine, les élections contre la démocratie?. Paris: Presses de Sciences<br />
Po. p. 105-130.<br />
Gutierrez Sanin (Francisco) et Barón (Mauricio) - [2005]. Re-stating the state : paramilitary<br />
territorial control and political order in Colombia (1978-2004). Crisis State Program - LSE,<br />
Working Paper no.66, .<br />
Haon Madueño (Nicanor) - [2009]. Transgresser les frontières. Structures, perceptions et<br />
stratégies de l'immigration au Chiapas. Le cas des femmes honduriennes à Frontera<br />
Comalapa. Mémoire de Master de l'IEP de Paris.<br />
Hibou (Béatrice) - [1996]. L'afrique <strong>est</strong>-elle protectionniste? Les chemins buissonniers de la<br />
libéralisation extérieure. Paris: Karthala.<br />
Hibou (Béatrice) - [2000]. De la privatisation des économies à la privatisation de l'Etat. Une<br />
analyse de la formation continuelle de l'Etat In Hibou (Béatrice) dir. Privatisation des États.<br />
Paris: Karthala. .<br />
Huggins (Martha) - [1991]. Vigilantism and the state - a look south and north In Huggins<br />
(Martha) dir. Vigilantism and the state in <strong>La</strong>tin america. New York: Praeger. p. 1-18.<br />
Human Rights Watch - [2001]. The sixth division, Military-paramilitary Ties and U.S. Policy<br />
in Colombia. Washington, HRW.<br />
Jaramillo (Ana María), Villa (Marta Inés) et Sánchez (Luz Amparo) - [2004]. Miedo y<br />
desplazamiento. Experiencias y percepciones. Medellín : Corporación Región.<br />
Jones (Adam) - [2004]. Review: Parainstitutional Violence in <strong>La</strong>tin America. <strong>La</strong>tin American<br />
Politics and Society, vol°46, .<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 226
Kalmanovitz (Salomón) - [1994]. Análisis macroeconómico del narcotráfico en la economía<br />
colombiana In Vargas (Ricardo) dir. Drogas poder y región en Colombia. Tomo 1 :<br />
Economía y política. Bogotá : CINEP. .<br />
Kalyvas (Stathis) - [1999]. Wanton and Sensless? The logic of massacres in Algeria.<br />
Rationality and Society, 11(3), p. 243-285.<br />
Kalyvas (Stathis) - [2006]. The logic of violence in civil war. New York: Cambridge<br />
University Press.<br />
Koonings (Kees) et Kruijt (Dirk) - [1999]. Violence and Fear in <strong>La</strong>tin America In Koonings<br />
(Kees) et Kruijt (Dirk) dir. Societies of fear : The legacy of civil war, violence and terror in<br />
<strong>La</strong>tin America. Lodres : Zed Books. .<br />
Koonings (Kees) et Kruijt (Dirk) dir. - [2004]. Armed actors : organized violence and state<br />
failure in <strong>La</strong>tin America. Londres: Zed Boooks.<br />
Koonings (Kees) et Kruijt (Dirk) dir. - [2007]. Fractured cities, social exclusion, urban<br />
violence and cont<strong>est</strong>ed spaces in <strong>La</strong>tin America. Londres, Zed Books.<br />
Koop (P) - [1995]. Colombia, tráfico de drogas y organizaciones criminales. Problemas de<br />
América <strong>La</strong>tina, 18, p. 21-41.<br />
<strong>La</strong>ir (Éric) - [2000]. Colombie, une guerre privée de sens?. Bulletin de l'Institut Français<br />
d'Études Andines, 29(3), p. 515-538.<br />
León (Juanita) - [2005]. País de plomo. Crónicas de guerra. Bogota : Aguilar.<br />
Linz (Juan) - [1996]. "Stateness", Nationalism and Democratisation In Linz (Juan) et Stepan<br />
(Alfred) dir. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South<br />
America and Post-Comunist Europe. Baltimore : The John Hopkins Uniiversity Press. p. 16-<br />
37.<br />
Ljodal (Tron) - [2002]. El concepto de lo paramilitar In Corporacion Observatorio para la Paz<br />
dir. <strong>La</strong>s verdaderas intenciones de los paramilitares. Bogotá : Intermedio Editores. p. 297-<br />
304.<br />
López (Claudia) et Sevillano (Oscar) - [2008]. Balance político de la parapolítica. Arcanos,<br />
14, p. 62-87.<br />
Lopez Alvez (Fernando) - [2003]. <strong>La</strong> Formación del Estado y la Democracia en América<br />
<strong>La</strong>tina: 1810-1900. Bogota: Norma.<br />
López R<strong>est</strong>repo (Andrés) - [2005]. Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005 In<br />
Rangel (Alfredo) dir. Narcotráfico en Colombia. Economía y violencia. Fundación Seguridad<br />
y Democracia. p. 183-226.<br />
Lupo (Salvatore) - [2001]. Histoire de la mafia. Des origines à nos jours. Paris: Flamarion.<br />
Martin (Gérard) - [1997]. Violences stratégiques et violences désorganisées dans la région<br />
d'Urabá en Colombie. Cultures et Conflits, 24-25, p. 195-238.<br />
McCarthy (John) et Zald (Mayer) - [1977]. Ressource mobilization and social movements.<br />
Journal of Sociology, n°82, p. 1212 et S..<br />
Medina Gallego (Carlos) - [1990]. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia.<br />
Bogotá : Documentos Peridísticos.<br />
Medina Gallego (Carlos) et Tellez Ardila (Mireya) - [1994]. <strong>La</strong> violencia paramilitar,<br />
parapolicial y parainstitucional en Colombia. Bogotá : Rodriguez Quito Editores.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 227
Melo (Jorge Orlando) - [1990]. Los paramilitares y su impacto sobre la politica In dir. Al filo<br />
del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá : IEPRI - Tercer Mundo<br />
Editores. p. 475-514.<br />
Melo (Jorge Orlando) et Valencia (Alonso) dir. - [1989]. Reportaje de la historia de<br />
Colombia, Tome 2. Bogota : Planeta.<br />
Migdal (Joel) - [1988]. Strong societies and weak states. Princeton : Princeton University<br />
Press.<br />
Milgram (Stanley) - [1974]. Soumission à l'autorité. Un point de vue expérimental. Paris :<br />
Calmann-Lévy.<br />
Molano (Alfredo) dir. - [1988]. Aproximación a una historia oral de la colonización de la<br />
Sierra Nevada. Santa Marta : Fundación Prosierra.<br />
Múnera (Alfredo) - [2008]. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe<br />
colombiano. Bogotá : Planeta.<br />
Negrete (Victor) - [1995]. Los desplazados por la violencia en Colombia. El caso de Córdoba<br />
. Barranquilla : Antillas.<br />
Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos - [2001]. Panorama actual de la<br />
Sierra Nevada de Santa Marta. Presidencia de la República de Colombia.<br />
Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos - [2006]. Dinámica de la reciente<br />
confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta. Presidencia de la República de Colombia.<br />
Ortiz Sarmiento (Carlos Miguel) - [2007]. Urabá : pulsiones de vida y desafíos de muerte.<br />
Bogota : <strong>La</strong> Carreta Social.<br />
Pardo Rueda (Rafael) - [1996]. De primera mano. Colombia 1986-1994 : Entre conflictos y<br />
esperanzas. Bogotá : CEREC/Norma.<br />
Pécaut (Daniel) - [1987]. L'ordre et la violence : évolution socio-politique de la Colombie<br />
entre 1930 et 1953. Paris: Ed de l'EHESS.<br />
Pécaut (Daniel) - [1991]. Trafic de drogues et violence en Colombie. Cultures& Conflits, 03,<br />
p. 141-156.<br />
Pécaut (Daniel) - [2001]. Guerra contra la sociedad. Bogota: Espasa Hoy.<br />
Pécaut (Daniel) - [2006]. Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Bogota: Norma.<br />
Pécaut (Daniel) - [2008a]. Les Farc, une guerrilla sans fins?. Paris: Lignes de repères.<br />
Pécaut (Daniel) - [2008b]. Présentation de l'ouvrage : Les Farc, une guerrilla sans fins?.<br />
Maison de l'Amérique <strong>La</strong>tine. Paris.<br />
Perault (Dominique) - [2006]. Community life in Colombia under the surveilance of extreme<br />
right paramilitary organizations . Surveillance and Society, 4(1/2), p. 123-135.<br />
Pizarro (Eduardo) - [2004]. Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto<br />
armado en Colombia. Bogotá : Norma.<br />
Prada (Esmeralda) - [2002]. Luchas campesinas e indígenas In Achila (Mauricio) dir. 25<br />
años de luchas sociales en Colombia. Bogotá : CINEP. p. 121-166.<br />
Ragaru (Nadège) - [2008]. Multigroup : Une trajectoire entrepreneuriale dansla formation du<br />
capitalisme bulgare In Briquet (Jean-Louis) et Favarel-Garrigues (Gilles) dir. Milieux<br />
criminels et pouvoirs politiques. Les ressorts illicites de l'Etat. Paris: Karthala (Recherches<br />
Internationales). p. 149-186.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 228
Ramírez (William) - [1997]. Urabá, los inciertos confines de una crísis. Bogotá : Planeta.<br />
Rangel (Alfredo) - [1999]. Colombia : guerra en el fin de siglo. Bogotá : Tercer Mundo.<br />
Rangel (Alfredo) - [2005a]. Adonde van los paramilitares? In Rangel (Alfredo) dir. El poder<br />
paramilitar. Bogotá : FSD - Planeta. p. 11-23.<br />
Rangel (Alfredo) dir. - [2005b]. Narcotráfico en Colombia. Economía y violencia. Bogotá :<br />
Fundación Seguridad y Democracia.<br />
Recondo (David) - [2007]. Oaxaca : la périphérie autocratique de la démocratie mexicaine.<br />
Problèmes d'Amérique <strong>La</strong>tine, n°64, .<br />
Renán-Rodríguez (William) - [2007]. Contextualización del desplazamiento en el<br />
departamento del Magdalena y Santa Marta (1997-2007). Santa Marta, DTCH: Universidad<br />
del Magdalena, Vicerrectoría de Inv<strong>est</strong>igación, Fonciencias, Sección I, informe final<br />
convocatoria 2004.<br />
Reyes (Alejandro) - [1997]. Compra de tierras por narcotraficantes In PNUD (Programme<br />
des Nations Unies pour le Développement) dir. Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto<br />
económico, político y social. Bogotá : Ariel Ciencia Política. p. 279-346.<br />
Reyes (Alejandro) - [2009]. Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia.<br />
Bogotá : FESCOL/Norma.<br />
Ricoeur (Paul) - [2000]. <strong>La</strong> mémoire, l'histoire et l'oubli. Paris: Seuil.<br />
Rodriguez Pimienta (José Manuel) - [2000]. Comentarios sobre história política y<br />
administrativa del Magdalena. Santa Marta : Gobernación del Magdalena.<br />
Romero (Mauricio) - [1998]. Identidades Políticas, Intervención Estatal y Paramilitares. El<br />
caso del departamento de Córdoba. Controversia, 173, p. 75-99.<br />
Romero (Mauricio) - [2003]. Paramilitares y Autodefensas. 1982–2003. Bogotá : Planeta.<br />
Romero (Mauricio) - [2007]. Paramilitares, narcotrafico y contrainsurgencia : una expériencia<br />
para no repetir In Sanchez (Gonzalo) et Penaranda (Ricardo) dir. Pasado y presente de la<br />
violencia en Colombia. Bogota : <strong>La</strong> Carreta Historica. p. 407-430.<br />
Romero (Mauricio) et Valencia (León) dir. - [2007]. Parapolítica, <strong>La</strong> ruta de la expansión<br />
paramilitar y los acuerdos políticos. Bogota: Corporacion Arco Iris.<br />
Salazar (Gustavo) - [1999]. Paramilitarismo : una aproximación a sus orígenes y evolución<br />
(1980-1999). Bogotá : Presidencia de la República.<br />
Sánchez Baute (Alonso) - [2008]. Líbranos del bien. Bogotá : Alfaguara.<br />
Schwartz (O) - [1999]. Symposium sur "Analyser les entretiens biographiques, de D.<br />
Demazière et C. Dubar". Sociologie du travail, n°4, p. 463-468.<br />
Sciarrone (Rocco) - [2000]. Réseaux mafieux et capital social. Politix, 49, p. 35-56.<br />
Sémelin (Jacques) - [2002]. Du massacre au processus génocidaire. Revue internationale des<br />
sciences sociales, n° 174, p. 483-492.<br />
Sémelin (Jacques) - [2005]. Purifier et détruire. Paris: Seuil.<br />
Sofsky (Wolfgang) - [1998]. Traité de la violence. Paris: Gallimard.<br />
Sommier (Isabelle) - [1998]. Les mafias. Paris: Montchr<strong>est</strong>ien.<br />
Spalding (Rose) - [1999]. From low-intensity war to low-intensity peace: The Nicaraguan<br />
peace process In Arnson (Cynthia) dir. Comparative peace processes in <strong>La</strong>tin America.<br />
Stanford: Stanford University Press. .<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 229
Suarez (Andrés) - [2007]. Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerras<br />
en Urabá (1991–2001). Bogota: <strong>La</strong> Carreta.<br />
Taussig (Michael) - [2003]. <strong>La</strong>w in a lawless land, diary of a limpieza in Colombia. New<br />
York: The New York Press.<br />
Tilly (Charles) - [2000]. <strong>La</strong> guerre et la construction de l'Etat en tant que crime organisé.<br />
Politix, Vol 13 n°49, p. 97-117.<br />
Tilly (Charles) - [2003]. The politics of collective violence. Cambridge: Cambridge University<br />
Press.<br />
Tilly (Charles) et Tarrow (Sidney) - [2007]. Contentious politics. Boulder : Paradigm.<br />
Uprimny (Rodrigo) et Vargas (Alfredo) - [1990]. <strong>La</strong> palabra y la sangre : violencia, legalidad<br />
y guerra sucia en Colombia In Palacio (Germán) dir. <strong>La</strong> irrupción del para<strong>est</strong>ado. Ensayos<br />
sobre la crisis colombiana . Bogotá : ILSA-CEREC . p. 105-166.<br />
Uribe (Maria Victoria) - [1992]. Limpiar la tierra. Guerra y poder entre esmeralderos.<br />
Bogotá : Cinep.<br />
Uribe (María Victoria) - [2004]. Anthropologie de l'inhumanité. Essai sur la terreur en<br />
Colombie. Paris : Calmann-Lévy.<br />
Uribe (Maria Victoria) et Vázques (Teófilo) - [1994]. Enterrar y callar, las masacres en<br />
Colombia 1980-1993, vol 2. Bogotá : Comité permanent pour la défense des droits humains.<br />
Valencia (León) - [2007]. Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos In<br />
Romero (Mauricio) et Valencia (León) dir. Parapolítica, <strong>La</strong> ruta de la expansión paramilitar<br />
y los acuerdos políticos. Bogotá : Corporación Arco Iris. p. 11-58.<br />
Valencia (León) - [2008]. Farc : dinámica reciente de la guerra. Arcanos, 14, p. 3-23.<br />
Viloria de la Hoz (Joaquin) - [1997]. Café Caribe : la economia cafetera en la Sierra nevada<br />
de Santa Marta. Cartagena : Banco de la Republica.<br />
Viloria de la Hoz (Joaquín) - [2008]. Banano y revaluación en el departamento del<br />
Magdalena (1997-2007). Cartagena : Banco de la República.<br />
Volkov (Vadim) - [2002]. Violent entrepreneurs. The use of force in the making of russian<br />
capitalism. Ithaca : Cornell University Press.<br />
Welzer (Harald) - [2007]. Les exécuteurs, des hommes normaux aux meurtriers de masse.<br />
Paris: Gallimard.<br />
Zamosc (León) - [1987]. <strong>La</strong> cu<strong>est</strong>ión agraria y el movimiento campesino en Colombia.<br />
Bogotá : CINEP.<br />
Zuñiga (Priscila) - [2004]. Una reconstrucción del fenómeno del paramilitarismo en el<br />
departamento del Magdalena. Mémoire de Master, Pontificia Universidad Javeriana, Faculté<br />
de science politique et relations internationales. Bogotá.<br />
Zuñiga (Priscila) - [2007]. Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena In<br />
Romero (Mauricio) et Valencia (León) dir. Parapolítica, <strong>La</strong> ruta de la expansión paramilitar<br />
y los acuerdos políticos. Bogotá : Corporación Arco Iris . p. 285-322.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 230
Annexes<br />
1. Sources écrites<br />
Journaux consultés<br />
Seulement Semana, El Tiempo, <strong>La</strong> Silla Vacía, Verdad Abierta, The Washington Post et<br />
Nuevo Herald ont été traités directement à partir de leurs propres bases de données,<br />
accessibles sur Internet. Les autres ont principalement été traités à partir de la base de presse<br />
du CINEP, numérisée mais uniquement accessible sur place à Bogotá. Nous avons dû<br />
chercher les numéros les plus anciens directement dans les bases papier de l'hémérothèque de<br />
la Bobliothèque Nationale Luis Angel Arango à Bogotá.<br />
El Colombiano, Medellín<br />
El Día, México D.F.<br />
El Espectador, Bogotá<br />
El Heraldo, Barranquilla<br />
El Informador, Santa Marta<br />
El Mundo, Madrid<br />
El Nuevo Herald, Miami<br />
El Nuevo Siglo, Bogotá<br />
El País, Cali<br />
El Tiempo, Bogotá<br />
Hoy Diario, Santa Marta<br />
<strong>La</strong> Patria, Manizales<br />
Revista Cambio, Bogotá<br />
Revista Semana, Bogotá<br />
The Washington Post<br />
Vanguardia Liberal, Bucaramanga<br />
Voz, Bogotá<br />
<strong>La</strong> Silla Vacía, Bogotá (uniquement en ligne)<br />
Verdad Abierta, Bogotá (uniquement en ligne)<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 231
Documents non publiés<br />
- Operaciones contre fuerzas irregulares, traduction du manuel FM-31-15 de l'armée des<br />
États-Unis, Bibliothèque de l'Armée, 1962<br />
- <strong>La</strong> Guerra Moderna, Bibliothèque de l'Armée, 1963<br />
- Instrucciones generales para operaciones contraguerrillas, Ayudantía General del Comando<br />
del Ejército, 1979.<br />
- U.S. Embassy Colombia, cable. Human Rights: Estimate of the Present Situation in<br />
Colombia. 06/02/1979<br />
- Organsation d'Etats Américains, Report on the Situation of Human Rights in the Republic of<br />
Colombia. 1981<br />
- Informe de la Procuraduría General de la Nation sobre el <strong>«</strong> MAS <strong>»</strong> : lista de integrantes y la<br />
conexión MAS-Militares, 20 Février 1983<br />
- Lettre de Robert Raven, de l'American Bar Center à Virgilio Barco, Président de la<br />
République de Colombie concernant l'assasinat de l'avocat Marcos Castellón Sánchez.<br />
14/09/1988<br />
- Extralegal steps against Escobar Possible, avril 1993<br />
- Première conférence nationale de dirigeants et commandants d'autodéfenses paysannes,<br />
Urabá 18 avril 1997<br />
- Ejército Nacional – 20° Brigada, Batallón de Inteligencia n°1. Santa Marta 08/05/1998.<br />
001830/RR20-BITE-1-INT 10 252. Anotaciones de inteligencia sobre Adán, Rigoberto y<br />
Camilo Rojas. Mayor Jorge Armando Riaño<br />
- Deuxième conférence nationale de dirigeants et commandants d'autodéfenses paysannes,<br />
Urabá, 16 mai 1998<br />
- Sipol Departamento del Magdalena. Santa Marta 19/02/1999. Oficio n°127. Grupos armados<br />
ilegales operando en el departamento del Magdalena. Teniente Carlos Alexy Quiroga.<br />
- Comunicado a la opinión pública del departamento del Magdalena y de Colombia (Connu<br />
sous le nom de pacte de Chivolo). 28/09/2000<br />
- Documento confidencial y secreto (Connu sous le nom de pacte de Ralito). 23/07/2001<br />
- Acuerdo del Nudo del Paramillo, 29 novembre 2002<br />
- Policia Nacional – Departamento del Magdalena. Santa Marta 15/05/2004. Resultado<br />
interceptación a teléfono celular y frecuencias radio-eléctricas. De William Guerrero, Jefe de<br />
la sala técnica de la Sijin Demag al Mayor Ramiro Riveros, Jefe Policía Judicial Demag.<br />
- Informe Policía Judicial. Radicado n° 114. 20/05/2004. Municipios del Magdalena con<br />
presencia de las autodefensas.<br />
- Bulletin de la Corporation pour la Défense et la Promition des Droits Humains Reiniciar.<br />
Genocidio político : el case de la UP. Février 2005<br />
- Fiscalía despacho 19. Sumario n° 71508.UNAIM – 04/04/2006.<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 232
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.Version libre Salvatore Mancuso, 2006<br />
- Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Proceso N° 2007-104 contra<br />
Trino Luna Correa. Sentencia condenatoria. 05/10/2007<br />
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta n° 214. Proceso 26.470 contra Luis<br />
Eduardo Vives <strong>La</strong>couture. Sentencia condenatoria. 01/08/2008<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 233
2. Sources orales<br />
Experts :<br />
1.Priscila Zúñiga : Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). 24/02/09,<br />
Bogotá<br />
2.José Santos : Procesos de Comunidades Negras (PCN). 08/03/09, Bogotá<br />
3.Soraida Nuñez : Médecin, travaille avec des anciens combattants. 02/03/09. Bogotá<br />
4.José Nicolás Wild : Consejero Regional, Alta Consejería a la Reinserción (ACR). 09/03/09,<br />
Santa Marta<br />
5.William Renán Rodriguez : Juriste, Enseignant-Chercheur à l'Université du Magdaléna.<br />
10/03/09, Santa Marta<br />
6.Fabio Silva : Anthropologue, Enseignant-Chercheur à l'Université du Magdaléna. 10/03/09,<br />
Santa Marta<br />
7.Carlos Coronado. Juriste, Enseignant-Chercheur à l'Université du Magdaléna. 13/03/09,<br />
Santa Marta<br />
8.Ronald Alfaro : Anthropologue, Université du Magdaléna. 13/03/09, Santa Marta<br />
9.Jesualdo Arzuaga : Juriste, Nowegian Refugee Council. 18/03/09, Santa Marta<br />
10.Pablo* 1 : Fonctionnaire du Bureau du Procureur départemental du Magdaléna. 19/03/09,<br />
Santa Marta<br />
11.Beatriz Hernández : Juriste, Institut <strong>La</strong>tinoaméricain de Services Juridiques Alternatifs<br />
(ILSA). 25/03/09, Santa Marta<br />
12.Tadeo Martinez : Journaliste, Semana. Corresponsal pour la côte Caraïbe. 27/03/09,<br />
Barranquilla<br />
13.Jorge Olver R<strong>est</strong>repo : Responsable Hogares Claret, réinsertion de mineurs anciens<br />
combattants. 31/03/09, Pereira<br />
14.Fabián Oyaga : Juriste, Institut <strong>La</strong>tinoaméricain de Services Juridiques Alternatifs (ILSA).<br />
17/04/09. Bogotá<br />
15.Alexander López : Sénateur. Président de la Commission des Droits de l'Homme du Sénat<br />
Colombien. 15/09/08. Bruxelles<br />
16.Sánchez David : Enseignant-Chercheur. Colegio Mayor Nu<strong>est</strong>ra Señora del Rosario.<br />
26/09/09<br />
17.William Rosso : responsable de la base de données du CINEP. 23/02/09. Bogotá<br />
18.Oscar Sevillano : chercheur de la Corporación Nuevo Arco Iris et collaborateur de Verdad<br />
Abierta. 24/02/09, Bogotá<br />
19.Ana** 2 : psycholoque chargée d'aide à population réfugiée à Acción Social. 31/03/09,<br />
Pereira<br />
1 Les noms marqués * ont été changés à la demande expresse de l'interviewé<br />
2 Seul le prénom apparaît à la demande expresse de l'interviewé<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 234
Combattants – audiences judiciaires<br />
1.Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et<br />
Camilo Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 24 mars 2009 dans le cadre du procès de<br />
Justice et Paix. Fiscal 31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
2.Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et<br />
Camilo Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 25 mars 2009 dans le cadre du procès de<br />
Justice et Paix. Fiscal 31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
3.Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et<br />
Camilo Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 26 mars 2009 dans le cadre du procès de<br />
Justice et Paix. Fiscal 31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
4.Versions libres d'Adán Rojas Ospina, Adán Rojas Mendoza, Rigoberto Rojas Mendoza et<br />
Camilo Rojas Mendoza. Audience judiciaire du 27 mars 2009 dans le cadre du procès de<br />
Justice et Paix. Fiscal 31 délégué du Tribunal Supérieur de Santa Marta.<br />
Combattants – entretiens<br />
1.Alias El Puma. Ancien combattant du Bloc Nord (BN) des AUC. 23/03/09 Santa Marta<br />
2.Herminio*. Ancien combattant démobilisé. BN des AUC. 12/03/09. Santa Marta<br />
3.Leiden. Ancien combattant démobilisé. FRT. 12/03/09. Santa Marta<br />
Récits de vie :<br />
Une partie des récits de vie ont été recueillis de manière collective. Cependant, pour faciliter<br />
la lecture, nous les avons classé par cas. Un cas ne correspond pas forcément à un entretien,<br />
notamment lorsque les personnes parlent d'un tiers (membre de la famille assassiné par<br />
exemple). Il a été nécessaire de faire cela car lors des entretiens collectifs plusieurs personnes<br />
pouvaient évoquer un même cas. De la même manière, un entretien collectif pouvait donner<br />
lieu au recueil de plusieurs cas. Cette codification a été choisie pour faciliter la lecture du<br />
texte, au prix de perdre de la lisibilité au moment de l'énumération. Les cas correspondants à<br />
des entretiens collectifs sont regroupés. Les cas correspondants à des entretiens individuels<br />
sont facilement repérés car ils apparaissent notés de manière isolée.<br />
Focus group du 16/03/09. Santa Marta<br />
1.Zulia Esther Codina Pérez. Employée d'hôpital. Assassinée le 11 novembre 2003 à<br />
Santa Marta. Témoignages de son époux et une collègue de travail.<br />
2.Famille Bocanegra. Victimes des meurtres de deux membres de la famille, réfugiés<br />
originaires d'Aracataca et Fundación. Témoignage d'un membre de la famille.<br />
3.Miguel Ángel Acosta García. Enseignant, candidat au Conseil Municipal<br />
d'Aracataca. Assassiné le el 13 de abril de 2002 à Aracataca. Témoignage de son<br />
épouse.<br />
4.Albeiro*. Enseignant. Assassiné le 19 février 2005 à Guamal. Témoignage de son<br />
épouse (elle aussi enseignante, elle a été jury électoral).<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 235
5.Victor et Luis. Employés d'hôpital. Réfugiés originaires d'Aracataca.<br />
6.Carlos*. Ouvrier agricole. Syndicaliste Sintrainagro, Fundación.<br />
7.Ever Hernández. Employé d'hôpital. Disparu à Santa Marta en mai 1999.<br />
Témoignage d'une collègue de travail.<br />
8.Omar : Ancien employé de la mairie de Chivolo. Réfugié. 11/03/09. Santa Marta<br />
9.Marcela*. Ancienne leader étudiante. Santa Marta. 11/03/09. Santa Marta<br />
Entretien du 13/03/09. Fundación.<br />
10.Juan Francisco. Paysan. Réfugié originaire de Monterrubio.<br />
11.Dora. Paysanne. Réfugiée originaire de Monterrubio<br />
12.Angel. Syndicaliste. 14/03/09. Santa Marta<br />
Réunion organisation de refugiés Barrio Fundadores 15/03/09. Santa Marta<br />
13.Eudes. Paysan et commerçant. Réfugié originaire de Zona Bananera.<br />
14.Jesús. Paysan. Réfugié originaire de Santa Marta.<br />
15.Ricardo Villa. Ancien sénateur. Assassiné à Santa Marta le 23 décembre 1992.<br />
Témoignages de son épouse et son fils. 16/03/09. Santa Marta<br />
16.Santos Sauna. Gouverneur Cabildo Arhuaco. Sierra Nevada de Santa Marta. 17/03/09,<br />
Santa Marta<br />
Entretien du 17/03/09. Aracataca<br />
17.Enrique. Ouvrier agricole.<br />
18.Fortunato. Paysan.<br />
Entretien du 18/03/09. Santa Marta<br />
19.César. Sindicaliste Sintramienergética. Ciénaga.<br />
20.Rafael. Sindicaliste Sintramienergética. Santa Marta.<br />
Entretien du 19/03/09. Santa Marta<br />
21.Estéfano. Ancien leader paysan. Réfugié originaire de Pivijay<br />
22.Juan. Paysan. Réfugié originaire de Santa Marta.<br />
23.José Rodriguez. Ancien syndicaliste et militant du Parti Communiste Marxiste Léniniste<br />
(PCML). 20/03/09. Santa Marta<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 236
Entretien du 20/03/09. Santa Marta<br />
24.Rodolfo*. Enseignant, syndicaliste. Ciénaga.<br />
25.Matías*. Enseignant, syndicaliste. Santa Marta.<br />
Entretien du 22/03/09. Ciénaga<br />
26.Pedro*. Ouvrier agricole. Sindicaliste Sintragramcol. Ciénaga<br />
27.Roberto*. Ouvrier agricole. Sindicaliste Sintragramcol. Ciénaga<br />
28.Arnulfo*. Ouvrier agricole. Sindicaliste Sintragramcol. Ciénaga<br />
29.Richard*. Habitant du quartier de Gaira. Santa Marta. 21/03/09. Santa Marta<br />
30.Julio Hernández. Militant écologiste assassiné le à Santa Marta. Témoignage de sa fille.<br />
26/03/09<br />
31.Alberto*, entrepreneur de la banane et de l'élevage. 28/03/09. Santa Marta<br />
Jacobo GRAJALES LÓPEZ– <strong>«</strong> <strong>La</strong> <strong>prison</strong> <strong>est</strong> <strong>notre</strong> <strong>fusil</strong> <strong>»</strong> - Mémoire de recherche IEP de Paris – 2009 237