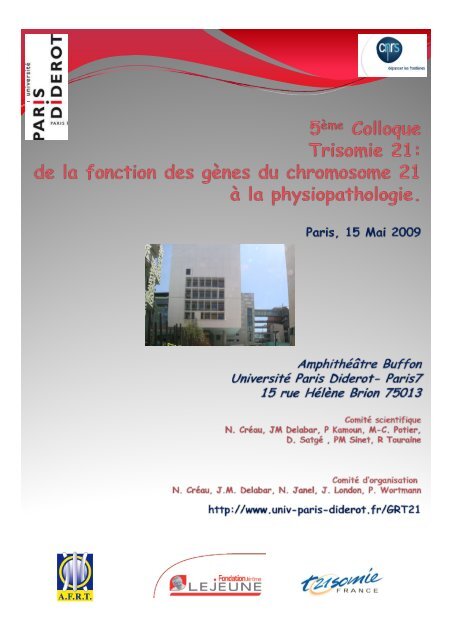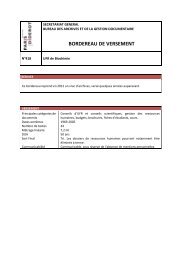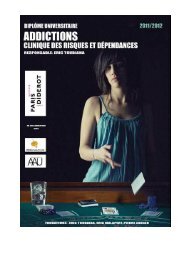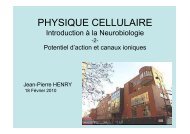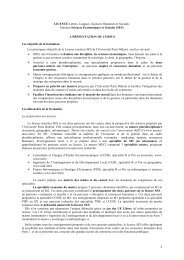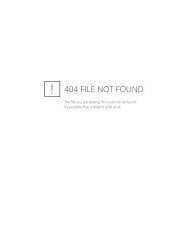Téléchargez ici la brochure du colloque - Université Paris Diderot ...
Téléchargez ici la brochure du colloque - Université Paris Diderot ...
Téléchargez ici la brochure du colloque - Université Paris Diderot ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
PROGRAMME<br />
5 ème <strong>colloque</strong> « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à<br />
<strong>la</strong> physiopathologie. »<br />
15 Mai 2009<br />
8H30-8h50 Arrivée des part<strong>ici</strong>pants (instal<strong>la</strong>tion des affiches et des diaporamas sur PC)<br />
8h50-9h00 Accueil des part<strong>ici</strong>pants, amphithéâtre Buffon<br />
9h00- 9h20 Session « Les progrès, cinquante ans après 1959 »<br />
- André Mégarbane (Beyrouth)<br />
Trisomie 21. Passé, Présent, Futur<br />
9h20-10h40 Session « Exploration des déf<strong>ici</strong>ts cognitifs dans <strong>la</strong> Trisomie 21-I»<br />
Modérateurs : H. Bléhaut, P-M. Sinet<br />
9h20-9h50 - Raphaele Tsao (Aix-Marseille)<br />
Etude <strong>du</strong> développement cognitif chez l’enfant porteur de trisomie 21 : <strong>du</strong> phénotype à <strong>la</strong><br />
variabilité interindivi<strong>du</strong>elle.<br />
9h50-10h20 - Yannick Courbois (Lille)<br />
L’é<strong>la</strong>boration des connaissances spatiales chez les personnes porteuses de trisomie 21 : une<br />
recherche préliminaire utilisant des environnements virtuels.<br />
10h20-10h45 - Emilie Lanceart (<strong>Paris</strong>)<br />
L’évaluation des personnes trisomiques 21 avec le test des Matrices Progressives Couleur<br />
encastrables de Raven.<br />
10h45-11h30 Pause café et Visite des Affiches<br />
11h30-13h00 Session « Exploration des déf<strong>ici</strong>ts cognitifs dans <strong>la</strong> Trisomie 21-<br />
II : les modèles»<br />
Modérateurs : P. Kamoun, D. Satgé<br />
11h30-12h - Yann Hérault (Orléans)<br />
Appréhender <strong>la</strong> complexité de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion génotype-phénotype dans le syndrome de Down<br />
avec l’Aneuthèque : une ressource systématique de nouveaux modèles souris pour étudier<br />
les aneuploidies impliquant le chromosome 21 humain.<br />
1
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
12h00-12h20 - Nicole Créau (<strong>Paris</strong>)<br />
Conséquences de <strong>la</strong> surexpression de Pcp4 (Purkinje Cell protein 4) dans un modèle murin<br />
: différenciation neuronale, développement <strong>du</strong> cervelet et altérations comportementales.<br />
12h20-12h40 - Jean De<strong>la</strong>bar (<strong>Paris</strong>)<br />
Traitement de déf<strong>ici</strong>ts cérébraux in<strong>du</strong>its par <strong>la</strong> surexpression de Dyrk1a à l’aide de<br />
polyphénols <strong>du</strong> thé vert.<br />
12h40-13h00 - Chris P<strong>la</strong>nque (<strong>Paris</strong>)<br />
Surexpression de Dyrk1a, une serine/thréonine kinase, dans le cerveau de souris<br />
hyperhomocysteinémiques.<br />
13h00-13h20 - Marie C<strong>la</strong>ude Potier (<strong>Paris</strong>)<br />
Inhibition GABA et stratégies thérapeutiques<br />
13h20-14h30 Déjeuner et Visite des Affiches<br />
14h30-15h30. Session « Cancer et Trisomie 21 »<br />
Modératrice : N. Créau<br />
14h30-15h00 - Daniel Satgé (Tulle)<br />
Analyse des cancers dans <strong>la</strong> trisomie 21 comparés aux cancers dans les autres déf<strong>ici</strong>ences<br />
intellectuelles. Impact <strong>du</strong> chromosome 21<br />
15h00-15h30 -Séverine Drunat (<strong>Paris</strong>)<br />
Facteur de transcription GATA 1 et Leucémogénèse dans <strong>la</strong> trisomie 21<br />
15h30-18h – Session « Vieillissement, pathologie d’Alzheimer et Trisomie 21 »<br />
Modérateurs : J-M. De<strong>la</strong>bar, M-C. Potier<br />
15h30-16h00 - Renaud Touraine (St Etienne)<br />
L’état de santé des personnes porteuses de trisomie 21 à l’âge a<strong>du</strong>lte<br />
16h00-16h30 Pause café et Visite des Affiches<br />
16h30-17h00 -Lucie Guyant-Maréchal (Rouen)<br />
Duplications <strong>du</strong> locus APP responsables de ma<strong>la</strong>dies d'Alzheimer autosomiques<br />
dominantes associées à des hémorragies intracérébrales<br />
2
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
17h00-17h20 -Bernadette Allinquant (<strong>Paris</strong>)<br />
Délocalisation de SET/I2PP2A dans le cerveau des patients Alzheimer et atteints de<br />
trisomie 21<br />
17h20-17h40 -Jack-Christophe Cossec (<strong>Paris</strong>)<br />
Identification <strong>du</strong> locus responsable de <strong>la</strong> présence d’endosomes é<strong>la</strong>rgis dans <strong>la</strong> Trisomie 21<br />
17h40-18h00 -Jacqueline London (<strong>Paris</strong>)<br />
Ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer et trisomie 21 : Faits anciens ; faits nouveaux.<br />
18h00 Clôture <strong>du</strong> <strong>colloque</strong><br />
3
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
COMMUNICATIONS ORALES<br />
4
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Trisomie 21. Passé, Présent, Futur<br />
André Mégarbane<br />
<strong>Université</strong> Saint Joseph, Unité de génétique médicale, Beyrouth, Liban<br />
La trisomie 21 ou syndrome de Down est <strong>la</strong> plus fréquente des anomalies chromosomiques et<br />
<strong>la</strong> plus fréquente cause de retard mental. Avec <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce, dans plusieurs pays, <strong>du</strong><br />
dépistage prénatal, son incidence semble avoir diminué. En France, par exemple, les derniers<br />
chiffres donnent une prévalence à 1/2000 naissances vivantes. Elle a été décrite pour <strong>la</strong><br />
première fois en 1838 par Esquirol, puis par Seguin en 1846. Mais c’est John Langdon Down,<br />
qui a donné son nom à ce syndrome après <strong>la</strong> publication controversée de sa théorie sur<br />
l’origine <strong>du</strong> syndrome. La possibilité que ce syndrome puisse avoir une origine<br />
chromosomique a été suggérée par Waardenburg et Davenport en 1932 et confirmé par<br />
Lejeune et coll. en 1959.<br />
Cinquante ans après <strong>la</strong> découverte de <strong>la</strong> trisomie 21comme origine <strong>du</strong> syndrome, le terme<br />
«mongolisme» est toujours utilisé, les patients vivent dans des institutions et <strong>la</strong> majorité des<br />
troubles de santé associés au syndrome ne sont pas guéris. De nombreux patients meurent<br />
encore dans l'enfance ou au début de l'âge a<strong>du</strong>lte. Afin de lutter contre cette fatalité, différents<br />
groupes de recherche travail<strong>la</strong>nt sur <strong>la</strong> trisomie 21 ont identifié des gènes candidats<br />
potentiellement responsables de certains des signes cliniques de <strong>la</strong> trisomie 21. Ces<br />
découvertes devraient permettre, à l’avenir, d’identifier de nouveaux traitements pour les<br />
personnes atteintes de trisomie 21 et par conséquent d’allonger leur espérance de vie dans de<br />
meilleures conditions.<br />
5
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Etude <strong>du</strong> développement cognitif chez l’enfant porteur de trisomie 21 : <strong>du</strong><br />
phénotype à <strong>la</strong> variabilité interindivi<strong>du</strong>elle.<br />
Raphaele TSAO<br />
Laboratoire PSYCLE, EA 3273, <strong>Université</strong> Aix en Provence, France.<br />
Tel : 06.82.97.42.07 E-mail : r.tsao@aix-mrs.iufm.fr<br />
Re<strong>la</strong>tivement à <strong>la</strong> loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, <strong>la</strong> part<strong>ici</strong>pation et <strong>la</strong><br />
citoyenneté des personnes handicapées ; <strong>la</strong> société s’est vue réaffirmée son champ<br />
d’investigation dans le domaine de l’é<strong>du</strong>cation et de l’insertion sociale et professionnelle. En<br />
s’intéressant à l’originalité <strong>du</strong> développement des fonctions cognitives en cas de handicap, les<br />
recherches en psychologie sont susceptibles d’aider à <strong>la</strong> mise au point et au calibrage de<br />
projets indivi<strong>du</strong>alisés. Cette contribution, via <strong>la</strong> présentation de deux études, vise à souligner<br />
l’importance des différences interindivi<strong>du</strong>elles dans le développement des acquisitions des<br />
habiletés cognitives. A l’heure actuelle, le phénotype de <strong>la</strong> trisomie 21 est re<strong>la</strong>tivement bien<br />
connu. Il se caractérise par un déf<strong>ici</strong>t cognitif et <strong>la</strong>ngagier comparativement à des capacités<br />
d’adaptation sociales re<strong>la</strong>tivement préservées (Carlier & Ayoun, 2007; Hodapp, Desjardin &<br />
Ricci, 2003; Fidler, 2005). De nombreuses études psychométriques rapportent un niveau de<br />
retard considéré comme moyen à sévère, ainsi qu’une forte variabilité interindivi<strong>du</strong>elle (Carr,<br />
1985, 1995; Couzens, Cuskelly & Jobling, 2004; Dal<strong>la</strong> Piazza & Dan, 2001). Ces données<br />
suggèrent ainsi que l’impact <strong>du</strong> retard ne concerne pas l’ensemble des secteurs de<br />
développement et qu’il varie selon les indivi<strong>du</strong>s. Afin de faciliter <strong>la</strong> compréhension de<br />
l’éten<strong>du</strong>e des manifestations <strong>du</strong> retard mental, il nous apparaît opportun de développer des<br />
recherches axées sur <strong>la</strong> notion de variabilité. Une première étude (Tsao & Celeste, 2006)<br />
analyse le développement des habiletés cognitives chez l’enfant porteur de trisomie 21 par le<br />
biais d’une approche longitudinale. Sept enfants ont été évalués à l’aide des Echelles<br />
Différentielles d’Eff<strong>ici</strong>ences Intellectuelles (EDEI-R; Perron-Borelli, 1996) à l’âge moyen de<br />
7,6 ans et 9,6 ans. Les EDEI-R se composent de différentes échelles indépendantes permettant<br />
une évaluation de l’eff<strong>ici</strong>ence constatée dans une activité donnée. La batterie est centrée sur <strong>la</strong><br />
pensée catégorielle, considérée comme le noyau <strong>du</strong> fonctionnement mental, dans ses deux<br />
dimensions : verbale et non verbale. Les résultats indiquent une évolution des habiletés<br />
cognitives variable selon les échelles ainsi qu’une forte variabilité interindivi<strong>du</strong>elle. Une<br />
seconde étude a par <strong>la</strong> suite été con<strong>du</strong>ite (Tsao & Kindelberger, sous presse). Elle repose sur<br />
un échantillon de 88 enfants porteurs de trisomie 21 âgés de 5.11 ans à 11.8 ans. Les sujets<br />
ont de nouveau été évalués aux EDEI-R. Dans un premier temps, des analyses de variance<br />
indiquent un effet de l’âge sur chacun des subtests. Ensuite, une analyse en cluster a été<br />
réalisée. Elle met en évidence quatre types de profils de fonctionnement cognitif<br />
indépendamment de l’âge et <strong>du</strong> sexe. Chaque groupe se distingue quant à ses habiletés dans<br />
les différents domaines de développement. L’ensemble de ces données témoigne de <strong>la</strong> grande<br />
variabilité de profil de développement cognitif chez les enfants porteurs de trisomie 21. Les<br />
6
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
travaux axés sur l’étude de typologie nous semblent prometteurs. Ils permettent de constater<br />
que les déf<strong>ici</strong>ts intellectuels se caractérisent non pas par un ralentissement simple <strong>du</strong><br />
développement cognitif normal, mais par des profils originaux qui peuvent être<br />
qualitativement spécifiés.<br />
Carlier, M. & Ayoun, C. (2007). Déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles et intégration sociale. Wavre : Mardaga.<br />
Carr J. (1985). The development of intelligence. In D. Lane & B. Stratford (Eds.), Current Approaches<br />
to Down's syndrome (pp. 167-186). London: Holt Rinehart & Winston.<br />
Carr J. (1995). Down's syndrome: Children Growing Up. Cambridge: Cambridge University Press.<br />
Couzens, D., Cuskelly, M. & Jobling, A. (2004). The Stanford Binet Fourth Edition and its use with<br />
indivi<strong>du</strong>als with Down Syndrome: cautions for clin<strong>ici</strong>ans. International Journal of Disability,<br />
Development and E<strong>du</strong>cation, 51, 1, 39-56.<br />
Dal<strong>la</strong> piazza, S. & Dan, B. (2001). Handicaps et déf<strong>ici</strong>ences de l’enfant. Bruxelles: De Boeck<br />
<strong>Université</strong>.<br />
Fidler, D.J. (2005). The emerging Down syndrome behavioral phenotype in early childhood<br />
implications for practice. Infants and Young children, 18, 86-103.<br />
Hodapp, R.M., Desjardin, J.L. & Ricci, L.A. (2003). Genetic syndromes of mental retardation. Infants<br />
and Young children, 16, 2, 152-160.<br />
Perron-Borelli, M. (1996). Echelles Différentielles d’Eff<strong>ici</strong>ences Intellectuelles, forme révisée. Issy<br />
Les Moulineaux: EAP.<br />
Tsao, R., & Celeste, B. (2006). Etude longitudinale <strong>du</strong> développement cognitif chez des enfants avec<br />
trisomie 21. Revue francophone de <strong>la</strong> déf<strong>ici</strong>ence intellectuelle, 17, 5-11.<br />
Tsao, R. & Kindelberger, C. (sous presse). Variability of cognitive development in children with<br />
Down syndrome: relevance of good reasons for using the cluster proce<strong>du</strong>re, Research in<br />
Developmental Disabilities.<br />
7
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
L’é<strong>la</strong>boration des connaissances spatiales chez les personnes porteuses de<br />
trisomie 21 : une recherche préliminaire utilisant des environnements<br />
virtuels.<br />
Yannick Courbois (1), Emily Farran (2), Pascal Sockeel (1), Axelle Lemahieu (1),<br />
Hursu<strong>la</strong> Mengue-Topio (1)<br />
(1) Laboratoire PSITEC, <strong>Université</strong> de Lille 3, BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex<br />
(2) Psychology and Human Development, 25 Woburn Square, Institute of E<strong>du</strong>cation, London, WC1H<br />
QAA, UK<br />
Tel : 03 20 41 63 77 E-mail : Yannick.courbois@univ-lille3.fr<br />
L’objectif de cette recherche est d’étudier l’é<strong>la</strong>boration des connaissances spatiales<br />
re<strong>la</strong>tives à un environnement nouveau chez les personnes avec une trisomie 21. La<br />
mémorisation des points de repère, l’apprentissage d’itinéraires, ainsi que <strong>la</strong> connaissance de<br />
<strong>la</strong> configuration de l’environnement (Siegel & White, 1975) sont analysés à partir de<br />
dép<strong>la</strong>cements effectués dans un environnement virtuel. Cet environnement est composé de<br />
rues interconnectées, de points de repère disposés le long des rues, et de 3 bâtiments<br />
c<strong>la</strong>irement identifiables. Les bâtiments sont utilisés comme points de départ ou d’arrivée pour<br />
différents dép<strong>la</strong>cements à effectuer.<br />
L’expérience comporte trois étapes. Dans <strong>la</strong> première, le part<strong>ici</strong>pant explore <strong>la</strong> « ville »<br />
virtuelle en empruntant deux trajets prédéfinis (A=>B ; A=> C). A <strong>la</strong> fin de chaque trajet, un<br />
test de reconnaissance des points de repère est pratiqué. Dans <strong>la</strong> deuxième, le part<strong>ici</strong>pant<br />
apprend à réaliser les deux trajets sans faute. Les erreurs sont corrigées et le nombre d’essais<br />
nécessaire pour atteindre un critère de réussite est utilisé comme indicateur de <strong>la</strong> vitesse<br />
d’apprentissage de l’itinéraire. Dans <strong>la</strong> troisième, l’exploration de <strong>la</strong> « ville » est libre. Le<br />
part<strong>ici</strong>pant doit composer un dép<strong>la</strong>cement qu’il n’a jamais effectué (B=>C). L’analyse des<br />
distances parcourues permet d’inférer l’existence d’une représentation spatiale sous forme de<br />
configuration chez les part<strong>ici</strong>pants.<br />
L’expérience est en cours de réalisation. Les résultats des personnes avec une trisomie 21 sont<br />
comparés à ceux obtenus avec des part<strong>ici</strong>pants contrôles de même âge mental et de même âge<br />
réel.<br />
Les personnes avec une trisomie 21 semblent avoir une bonne mémoire visuelle (Laws, 2002).<br />
Nous faisons donc l’hypothèse qu’elle mémoriseront correctement les points de repère. En<br />
revanche, nous faisons aussi l’hypothèse qu’elles auront des difficultés à é<strong>la</strong>borer une<br />
représentation de <strong>la</strong> « ville » sous forme de configuration spatiale (« <strong>la</strong> carte cognitive », voir<br />
Pennington, Moon, Edgin, Stedron, et Nadel 2004).<br />
8
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
L’évaluation des personnes trisomiques 21 avec le test des Matrices<br />
Progressives Couleur encastrables de Raven.<br />
E. Lanceart 1 , D. Voillery 1 , H. Bléhaut 2 , C. Mircher 1 , V. Babled 1 , Y. Grattau 1 , A. Ravel 1 .<br />
1 Institut Jérôme Lejeune, <strong>Paris</strong><br />
2 Fondation Jérôme Lejeune, <strong>Paris</strong><br />
Tel : 0156586300 Fax : 0143061602 E-mail : emilie.<strong>la</strong>nceart@institutlejeune.org<br />
Le raisonnement non verbal des personnes trisomiques 21 a fait l’objet de nombreuses<br />
investigations. Néanmoins, il n’a jamais été effectué d’étude visant à préciser les modalités et<br />
l’évolution de leur raisonnement à différents âges, à l’aide des Matrices Progressives Couleur<br />
encastrables de Raven (CPM-BF). Nous nous proposions d’apprécier l’intérêt de l’utilisation<br />
de ce test auprès des personnes trisomiques 21. En effet, les caractéristiques de ce test (mode<br />
de réponse et de présentation non verbal ; matériel manipu<strong>la</strong>ble ; temps de passation court)<br />
justifient le choix de cet outil pour mesurer le raisonnement non verbal de cette popu<strong>la</strong>tion.<br />
Un échantillon de 57 personnes trisomiques 21, subdivisé en groupes d’âges, a été<br />
inclus dans ce travail [moyenne d’âge=27 (7-49 ans) ; DS=12 ; écart moyen entre les<br />
âges=0.8]. La corré<strong>la</strong>tion des âges de développement obtenus avec les âges réels a été<br />
analysée. Ce travail a permis de différencier les performances des sujets en fonction de trois<br />
catégories d’items : discrimination perceptive, globalisation et raisonnement par in<strong>du</strong>ction<br />
(repérage de re<strong>la</strong>tions logiques entre des figures). Les résultats de l’étude montrent que le test<br />
des CPM-BF est pleinement approprié à l’évaluation des compétences cognitives de <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion trisomique 21 et constitue un bon outil de mesure pour <strong>la</strong> recherche clinique.<br />
9
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Appréhender <strong>la</strong> complexité de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion génotype-phénotype dans le<br />
syndrome de Down avec l’Aneuthèque : une resource systématique de<br />
nouveaux modèles souris pour étudier les aneuploidies impliquant le<br />
chromosome 21 humain.<br />
Patr<strong>ici</strong>a Lopes Pereira 1,2,* , Laetitia Magnol 1,2,* , Ignasi Abizanda 3,* , Véronique<br />
Brault 1,2 , Arnaud Duchon 1,2 , Pao<strong>la</strong> Prandini 4 , Emilie Dalloneau 1,2 , Matthieu Raveau 1,2 ,<br />
Valerie Nalesso 1,2 , Jean-Charles Bizot 5 , Bernadette Chadefaux-Vekemans 6 , Samuel<br />
Deutsch 4 , Fabrice Trovero 5 , Stylianos Antonarakis 4 , Mara Dierssen 3 and Yann<br />
Herault 1,2,7#<br />
(1) <strong>Université</strong> d’Orléans, UMR6218, Molecu<strong>la</strong>r Immunology and Embryology, Orléans, France ; (2)<br />
CNRS, UMR6218, MIE, 3B rue de <strong>la</strong> Férollerie, 45071 Orleans cedex 2, France; (3) Genes and<br />
Disease Program, Center for Genomic Regu<strong>la</strong>tion, Dr Aiguader 88, 08003 Barcelona, Spain and<br />
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER), Barcelona, Spain; (4) Department of Genetic Med<strong>ici</strong>ne<br />
and Development, University of Geneva Medical School, 1 Rue Michel-Servet, 1211 Geneva,<br />
Switzer<strong>la</strong>nd; (5) Key-Obs S.A., Allée <strong>du</strong> Titane, Orléans, France (6) Service de Biochimie<br />
Métabolique, Hôpital Necker-Enfants Ma<strong>la</strong>des, Faculté de Médecine, <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> Descartes,<br />
France; (7) CNRS, UPS44, TAAM, Institut de Transgenose, Orléans, France; # soon ICS/IGBMC,<br />
Illlkirch, France. *<br />
Tel : 0238257976 Fax : 023825 5435 E-mail : herault@cnrs-orleans.fr<br />
50 ans après <strong>la</strong> découverte de <strong>la</strong> trisomie 21, comme base génétique <strong>du</strong> syndrome de Down<br />
(DS), les re<strong>la</strong>tions génotypes – phénotypes <strong>du</strong> DS ne sont toujours pas complètement<br />
élucidées. Actuellement, il est admis que les interactions entre « gènes à effets de dose »<br />
localisés sur le HSA21 sont responsables des phénotypes associés à <strong>la</strong> pathologie.<br />
Les gènes de <strong>la</strong> souris, orthologues de ceux <strong>du</strong> HSA21, se retrouvent dans le même ordre et <strong>la</strong><br />
même orientation re<strong>la</strong>tive sur les chromosomes de souris (MMU) 16, 17 et 10. Les souris<br />
modèles de DS disponibles jusqu’à présents sont trisomiques d'une partie de <strong>la</strong> région<br />
MMU16 homologue. Ces modèles présentent une partie importante des caractéristiques de <strong>la</strong><br />
DS, mais pas toutes.<br />
Afin de compléter ces modèles et de déchiffrer les interactions génotype-phénotype dans le<br />
SD, nous avons créé de nouvelles trisomies partielles et monosomies pour les différentes<br />
régions sur MMU10, 16 et 17 qui sont des homologues de HSA21 et nous avons réussi à<br />
obtenir <strong>la</strong> série complète des modèles de souris trisomiques ou monosomiques. Grâce à une<br />
telle série, nous pouvons envisager de déterminer le rôle de chaque région dans l'in<strong>du</strong>ction des<br />
phénotypes de <strong>la</strong> Trisomie 21, de leurs interactions et à terme, d’identifier les voies des<br />
signalisations qui sont affectées, avec l'espoir que ce<strong>la</strong> mènera à l'é<strong>la</strong>boration de nouvelles<br />
approches thérapeutiques. Nous rapportons <strong>ici</strong> les résultats obtenus jusqu’à présent et les<br />
10
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
nouvelles hypothèses tirées de ces travaux afin de mieux comprendre <strong>la</strong> physiopathologie de<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
11
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Conséquences de <strong>la</strong> surexpression de Pcp4 (Purkinje Cell protein 4) dans<br />
un modèle murin : différenciation neuronale, développement <strong>du</strong> cervelet et<br />
altérations comportementales.<br />
Mouton-Liger F(1), Thomas S(1), Lopes Pereira P (2), Rattenbach R (1), Sahun I (3),<br />
Duchon A (2), E<strong>la</strong>ribi D (1), Paly E (1), Larrigaldie V (2), Ledru A (1), Dierssen M (3),<br />
Verney C (4), Hérault Y (2), Créau N (1)<br />
(1) Biologie Fonctionnelle Adaptative, CNRS EAC 7509, <strong>Paris</strong><br />
(2) IEM, CNRS UMR6218, Orléans<br />
(3) CRG, Barcelone<br />
(4) INSERM U676, <strong>Paris</strong><br />
Tel : 01 57 27 83 58 E-mail : creau@univ-paris-diderot.fr<br />
Pcp4/Pep19 est un mo<strong>du</strong><strong>la</strong>teur de <strong>la</strong> Ca++-CaM, molécule clé de <strong>la</strong> trans<strong>du</strong>ction <strong>du</strong><br />
signal calcique et dont les cibles sont nombreuses (CaMKII, NOS,…). Le gène est localisé sur<br />
le chromosome 21 humain et dans <strong>la</strong> trisomie 21, 3 copies <strong>du</strong> gène PCP4 sont présents ; son<br />
orthologue murin est localisé sur le chromosome 16. L’expression de Pcp4 est connue avoir<br />
un patron très spécifique dans les neurones <strong>du</strong> cerveau et cervelet a<strong>du</strong>lte (présent dans les<br />
cellules de Purkinje). Nous avions aussi montré que Pcp4 est présent dès l’embryogénèse<br />
dans les cellules postmitotiques <strong>du</strong> neurectoderme.<br />
Pour évaluer les conséquences de 3 copies <strong>du</strong> gène Pcp4, nous avons construit un<br />
modèle de souris, après transfection de cellules ES, qui contient une copie <strong>du</strong> gène humain.<br />
Ce modèle a été comparé au modèle de trisomie Ts1Cje qui contient 85 gènes en 3 copies<br />
dont le gène pcp4. Nous avons démontré que :<br />
(I) 3 copies <strong>du</strong> gène Pcp4, quelle que soit l’origine de <strong>la</strong> copie supplémentaire (humaine ou<br />
murine) et quelque soit le contexte génomique, in<strong>du</strong>isent une surexpression de Pcp4 aux<br />
niveaux transcriptomique et protéomique ;<br />
(II) cette surexpression in<strong>du</strong>it une précocité de <strong>la</strong> différenciation de neurones <strong>du</strong> système<br />
central et périphérique associée à l’activation de <strong>la</strong> CaMKIIdelta, forme embryonnaire de <strong>la</strong><br />
CaMKII ,au cours de l’embryogénèse (E10-E14), et <strong>du</strong> développement (postnatal) <strong>du</strong><br />
cervelet ;<br />
(III) à l’âge a<strong>du</strong>lte les TgPCP4 ont des capacités motrices fortement altérées suggèrant une<br />
contribution importante dans ce phénotype des propriétés de <strong>la</strong> cellule de Purkinje<br />
(GABAergique), seul neurone de sortie <strong>du</strong> cervelet;<br />
(IV) ces effets sont conservés dans un modèle plus complexe , les Ts1Cje, qui associe <strong>la</strong><br />
trisomie de 84 autres gènes, montrant que l’impact de <strong>la</strong> surexpression de pcp4 est puissant et<br />
que <strong>la</strong> voie de <strong>la</strong> Ca++-CaM joue probablement un rôle important dans les phénotypes<br />
associés à <strong>la</strong> trisomie 21.<br />
12
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Traitement de déf<strong>ici</strong>ts cérébraux in<strong>du</strong>its par <strong>la</strong> surexpression de Dyrk1a à<br />
l’aide de polyphénols <strong>du</strong> thé vert.<br />
Fayçal Guedj 1 , Jean C. Bizot 2 , Catherine Sébrié 3 , Isabelle Rivals 4 , Aurélie Ledru 1 ,<br />
Evelyne Paly 1 , Desmond Smith 5 , Edward Rubin 6 , Brigitte Gillet 3 , Mariona Arbones 7 ,<br />
Patr<strong>ici</strong>a Lopes Pereira 8 , Arnaud Duchon 8 , Yann Hérault 8 , Jean M. De<strong>la</strong>bar 1<br />
1. Functional and Adaptive Biology, <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>-<strong>Paris</strong>7 and CNRS, <strong>Paris</strong>, 2. Key-Obs<br />
SA, Parc Technologique de La Source, Orleans, 3. Laboratoire de RMN Biologique, ICSN-CNRS, Gif<br />
sur Yvette, 4. Equipe de Statistique Appliquée, ESPCI, <strong>Paris</strong>, 5. Department of Molecu<strong>la</strong>r and Medical<br />
Pharmacology, University of California Los Angeles School of Med<strong>ici</strong>ne, Los Angeles, California, 6.<br />
Genome Sciences Department, Lawrence Berkeley National Lab (LBNL), Berkeley, California, 7.<br />
Center for Genomic Regu<strong>la</strong>tion, Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona. 8. UMR6218 CNRS,<br />
Immunologie and Molecu<strong>la</strong>r Embryology, UPS44, Institut de Transgenose, 45071 Orléans<br />
Tel : 0157278354 Fax : 0157278355 E-mail : de<strong>la</strong>bar@univ-paris-diderot.fr<br />
Les indivi<strong>du</strong>s porteurs de trisomies partielles <strong>du</strong> chromosome 21 contenant le gène<br />
Dyrk1a, ainsi que les modèles animaux, porteurs de trisomie de régions synténiques de celles<br />
contenant ce gène chez l’homme, présentent des anomalies de <strong>la</strong> morphogenèse <strong>du</strong> cerveau.<br />
Ces modèles présentent aussi des déf<strong>ici</strong>ts d’apprentissage et de mémorisation. Les études par<br />
IRM et en coupes histologiques d’un modèle transgénique pour un YAC humain contenant 5<br />
gènes dont Dyrk1a ont révélé que <strong>la</strong> protéine Dyrk1a est impliquée pendant le développement<br />
dans le contrôle <strong>du</strong> volume <strong>du</strong> cerveau et de <strong>la</strong> densité cellu<strong>la</strong>ire et ceci de manière différente<br />
selon <strong>la</strong> région considérée. La correction <strong>du</strong> nombre de copies corrige ces altérations. Outre<br />
ces anomalies de morphogenèse le surdosage de Dyrk1a entraine aussi des modifications de <strong>la</strong><br />
mémorisation. A ces déf<strong>ici</strong>ts sont associés des variations de <strong>la</strong> quantité de plusieurs protéines<br />
impliquées dans le cycle cellu<strong>la</strong>ire et/ou <strong>la</strong> p<strong>la</strong>st<strong>ici</strong>té synaptique.<br />
L’épigallocatéchine gal<strong>la</strong>te, EGCG, est un membre de <strong>la</strong> famille des polyphénols,<br />
trouvé en grande quantité dans le thé vert. Ce composé est un inhibiteur assez spécifique de<br />
Dyrk1a. Un régime à base de thé vert ainsi qu’un régime d’extraits de thé vert, le<br />
polyphenon 60, permettent de contrecarrer les effets de l’erreur de dosage génique dans le<br />
modèle YAC. Ce même traitement semble aussi agir sur les phénotypes d’apprentissage<br />
observés sur un modèle de trisomie 16 partielle, contenant 130 gènes incluant le gène Dyrk1a,<br />
le modèle Ts65Dn.<br />
13
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Surexpression de Dyrk1a, une serine/thréonine kinase, dans le cerveau de<br />
souris hyperhomocysteinémiques.<br />
Chris P<strong>la</strong>nque 1 , Christophe Noll 1 , Clémentine Ripoll 1 , Paulina Urbaniak 1 , Fayçal<br />
Guedj 1 , Jean-Louis Paul 2 , Jean-Maurice De<strong>la</strong>bar 1 , Nathalie Janel 1<br />
1 – <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>- <strong>Paris</strong> 7, Laboratoire de Biologie Fonctionnelle et Adaptative, Equipe<br />
Dérégu<strong>la</strong>tion génique et différenciation dans <strong>la</strong> trisomie 21 et l’hyperhomocystéinémie, <strong>Paris</strong>.<br />
2 –AP-HP, Hôpital Européen Georges Pompidou, Service de Biochimie, <strong>Paris</strong>.<br />
Tel : 01-57-27-83-60 Fax : 01-57-27-83-55 E-mail : p<strong>la</strong>nquechris@yahoo.com<br />
L’hyperhomocystéinémie, dont le principal défaut biochimique consiste en une<br />
déf<strong>ici</strong>ence d’activité de <strong>la</strong> cystathionine beta synthase (CBS), est associée à diverses<br />
manifestations cliniques incluant notamment des troubles hépatiques et cérébraux. Même si<br />
l’hyperhomocystéinémie stimule des facteurs pro-apoptotiques dans le foie et le cerveau des<br />
souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS, caractérisées comme modèle murin d’hyperhomocystéinémie, des<br />
signaux protecteurs seraient capables de contreba<strong>la</strong>ncer ces facteurs et protègeraient ainsi les<br />
neurones et les hépatocytes de l’apoptose en cas d’hyperhomocystéinémie. D’autre part, nous<br />
avons observé une inactivation de <strong>la</strong> voie de signalisation MAP Kinase de type ERK dans le<br />
foie de souris hyperhomocystéinémiques, alors que cette voie est activée dans l’hippocampe<br />
de souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS. Dyrk1a est une sérine/thréonine kinase impliquée dans plusieurs<br />
voies de signalisation liées à <strong>la</strong> prolifération cellu<strong>la</strong>ire, au contrôle <strong>du</strong> cycle, mais également<br />
aux processus régu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> p<strong>la</strong>st<strong>ici</strong>té synaptique. Des études récentes au <strong>la</strong>boratoire ont montré<br />
que l’expression de <strong>la</strong> protéine Dyrk1a était diminuée dans le foie de souris déf<strong>ici</strong>entes en<br />
CBS à l’état hétérozygote. De plus, il existerait une corré<strong>la</strong>tion inverse entre le taux<br />
d’homocystéine p<strong>la</strong>smatique et le niveau d’expression hépatique de <strong>la</strong> protéine Dyrk1a.<br />
Dans ce projet, nous avons étudié l’expression de Dyrk1a dans le cerveau des souris<br />
déf<strong>ici</strong>entes en CBS à l’état hétérozygote afin d’analyser dans ce tissu les re<strong>la</strong>tions<br />
molécu<strong>la</strong>ires entre le métabolisme de l’homocystéine et les voies de trans<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> signal<br />
dans lesquelles est impliquée Dyrk1a. Dans un premier temps, nous avons noté une<br />
augmentation de l’expression de Dyrk1a chez les souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS à l’état<br />
hétérozygote. Néanmoins, aucune altération d’expression <strong>du</strong> gène Dyrk1a n’a été observée<br />
entre les deux groupes de souris. Parmi les cibles potentielles de phosphory<strong>la</strong>tion de Dyrk1a,<br />
un intérêt particulier a été porté à <strong>la</strong> cascade de trans<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> signal MAPK/ERK. Ainsi, les<br />
niveaux de ERK et phospho-ERK ont été analysés dans le cerveau de souris sauvages et de<br />
souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS à l’état hétérozygote ayant été traitées à l’harmine (inhibiteur de<br />
l’activité kinase de Dyrk1a) comparativement à des souris non traitées.<br />
De manière intéressante, nous avons noté une augmentation significative <strong>du</strong> rapport<br />
Phospho-ERK/ERK chez les souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS à l’état hétérozygote non traitées en<br />
14
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
comparaison des souris sauvages. D’autre part, nous avons observé une diminution<br />
significative de ce rapport chez les souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS traitées à l’harmine<br />
comparativement aux souris déf<strong>ici</strong>entes en CBS non traitées, alors que les niveaux<br />
d’expression de Dyrk1a ne sont pas modifiés entre les 2 groupes. Ceci démontre in vivo<br />
l’activation de ERK in<strong>du</strong>ite par Dyrk1a dans un modèle murin d’hyperhomocystéinémie.<br />
Dans <strong>la</strong> poursuite de ce projet, nous chercherons à identifier les cibles de Dyrk1a, activées<br />
dans ce modèle, en nous focalisant sur les partenaires de <strong>la</strong> voie MAPK/ERK.<br />
15
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Inhibition GABA et stratégies thérapeutiques<br />
Marie-C<strong>la</strong>ude Potier<br />
Centre de Recherche de l'ICM, UPMC/Inserm UMR_S 975; CNRS UMR 7225, Hôpital de <strong>la</strong> Pitié-<br />
Salpêtrière 47, Bd de l’Hôpital 75013 <strong>Paris</strong><br />
Tel : 0142162146 E-mail : marie-c<strong>la</strong>ude.potier@upmc.fr<br />
Le GABA est le principal neuromédiateur inhibiteur dans le système nerveux central. Son<br />
activité est altérée dans <strong>la</strong> Trisomie 21. En effet, dans des modèles de souris de Trisomie 21, il<br />
a été montré que les défauts de LTP (Long Term Potentiation) dans le gyrus denté de<br />
l’hippocampe sont contrecarrés par des inhibiteurs des récepteurs <strong>du</strong> GABA de type A.<br />
Cependant ces antagonistes GABA sont des molécules convulsivantes. Il est cependant<br />
possible de mo<strong>du</strong>ler l’activité GABAergique via le récepteur des benzodiazépines. Nous<br />
évaluerons les différentes stratégies possibles et les applications thérapeutiques déjà décrites<br />
chez <strong>la</strong> Souris.<br />
16
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Analyse des cancers dans <strong>la</strong> trisomie 21 comparés aux cancers dans les<br />
autres déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles. Impact <strong>du</strong> chromosome 21<br />
Daniel Satgé<br />
Anatomie pathologique Centre Hospitalier, Tulle. Pneumologie et Anatomie pathologique Groupe<br />
hospitalier <strong>Paris</strong>-St Joseph, <strong>Paris</strong>.<br />
Tel : 05 55 29 79 13 Fax : 05 55 29 86 05 E-mail : daniel.satge@ch-tulle,fr<br />
Les cancers sont globalement aussi fréquents dans <strong>la</strong> trisomie 21 et dans le groupe de toutes<br />
les déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles que dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion générale. Mais cette équivalence globale<br />
masque d'importantes différences de répartition selon le type de tumeurs dans les trois<br />
groupes. Les différences sont <strong>du</strong>es 1) à l'environnement particulier des personnes déf<strong>ici</strong>entes<br />
intellectuelles et à des facteurs de risque qui leurs sont propres, 2) à des facteurs génétiques;<br />
pour <strong>la</strong> trisomie 21, les gènes tripliqués sur le chromosome 21.<br />
La comparaison de <strong>la</strong> répartition des tumeurs des trisomiques 21 avec les tumeurs dans tout le<br />
groupe des déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles permet une approche plus précise de ce qui revient en<br />
propre à <strong>la</strong> trisomie 21, en écartant ce qui ressort de <strong>la</strong> physiopathologie et de l'environnement<br />
commun à toutes les personnes déf<strong>ici</strong>entes intellectuelles considérées comme un groupe. Par<br />
exemple, pour les facteurs de risque les personnes déf<strong>ici</strong>entes intellectuelles sont moins<br />
exposées à l'alcool, au tabac, aux ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles, et ne sont pas<br />
exposées aux toxiques professionnels. Mais elles ont une plus grande prévalence d'atteintes<br />
infectieuses comme le portage d'hélicobacter pylori et d'hépatites. Du point de vue<br />
physiopathologique, il y a chez les personnes déf<strong>ici</strong>entes intellectuelles une fréquence accrue<br />
des reflux gastro-oesophagiens, des troubles de <strong>la</strong> motilité colique de type constipation, et<br />
chez les femmes une ré<strong>du</strong>ction de pro<strong>du</strong>ction d'hormones sexuelles.<br />
Les trisomiques 21 se démarquent des autres personnes avec déf<strong>ici</strong>ence intellectuelle par un<br />
fort excès de leucémies et de tumeurs germinales testicu<strong>la</strong>ires, un excès plus modéré de<br />
tumeurs germinales ovariennes et extra-gonadiques, et par un excès modéré de tumeurs de <strong>la</strong><br />
rétine. Au contraire, les tumeurs <strong>du</strong> sein sont rares dans <strong>la</strong> trisomie 21. Dans le groupe des<br />
déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles les tumeurs <strong>du</strong> sein touchent, comme dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion générale,<br />
une femme sur dix environ. Il y a aussi, chez les trisomiques 21 par rapport aux autres<br />
déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles, une importante ré<strong>du</strong>ction des tumeurs neurales (non gliales) <strong>du</strong><br />
système nerveux central et <strong>du</strong> système nerveux périphérique comme les mé<strong>du</strong>llob<strong>la</strong>stomes et<br />
les neurob<strong>la</strong>stomes. A un moindre degré il y a une ré<strong>du</strong>ction des tumeurs de <strong>la</strong> thyroïde, <strong>du</strong><br />
rein et de <strong>la</strong> vessie.<br />
De nombreux gènes ont été proposés pour expliquer les variations de fréquence des diverses<br />
tumeurs solides des trisomiques 21. Nous suggérons que les études recherchant les facteurs<br />
17
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
génétiques protégeant contre les cancers portent spécifiquement sur les tumeurs précisément<br />
identifiées comme nettement moins fréquentes chez les trisomiques 21.<br />
18
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Facteur de transcription GATA 1 et Leucémogénèse dans <strong>la</strong> trisomie 21<br />
Séverine DRUNAT, Hélène CAVE<br />
Laboratoire de Biochimie Génétique, Hôpital Robert Debré, <strong>Paris</strong><br />
Tel : 01 40 03 36 46 Fax : 01 40 03 22 77 E-mail : severine.drunat@rdb.aphp.fr<br />
Les études épidémiologiques ont montré depuis longtemps que les enfants porteurs d’une<br />
trisomie 21 sont prédisposés au développement de désordres myéloprolifératifs transitoires<br />
(TMD) et de leucémie aiguë megacaryob<strong>la</strong>stique (AMKL).<br />
Récemment, des mutations acquises de GATA1 ont été mises en évidence dans <strong>la</strong><br />
quasi totalité des cas de TMD et d’AMKL et ce, uniquement chez les enfants trisomiques 21.<br />
Le gène GATA1, situé sur le chromosome X, code pour un facteur de transcription exprimé<br />
dans les progéniteurs hématopoïétiques. Son rôle est essentiel dans le développement et <strong>la</strong><br />
maturation des lignées, notamment, erythroïdes et mégacaryocytaires.<br />
Les gènes cibles et les mécanismes précis par lesquels les formes mutées de GATA1<br />
contribuent au développement d’une leucémie dans les progéniteurs trisomiques 21 sont<br />
encore mal définis. Cependant tous les travaux confirment que ces diverses mutations<br />
acquises qui aboutissent à une forme tronquée de GATA1, dont les fonctions de régu<strong>la</strong>tion<br />
transcriptionnelles sont altérées, provoquent une accumu<strong>la</strong>tion de mégacaryocytes immatures.<br />
Par ailleurs, les mutations de GATA1 semblent également contribuer à certaines<br />
caractéristiques spécifiques des AMKL telle que <strong>la</strong> chimiosensibilité accrue des b<strong>la</strong>stes<br />
trisomiques 21.<br />
Les nombreuses recherches actuelles visent à définir les mécanismes à l’origine de <strong>la</strong><br />
fréquence élevée des mutations GATA1 chez les enfants porteurs d’une trisomie 21 et le rôle<br />
des mutants GATA1 dans les TMD et les AMKL. D’une part, ces travaux vont permettre de<br />
mieux comprendre les étapes de <strong>la</strong> transformation leucémique dans ce modèle biologique<br />
spécifique où des mutations somatiques émergent dans un contexte de trisomie<br />
constitutionnelle. D’autre part, ils contribueront à l’amélioration de <strong>la</strong> prise en charge clinique<br />
en apportant une aide biologique au moment <strong>du</strong> diagnostic mais aussi <strong>du</strong> choix et <strong>du</strong> suivi <strong>du</strong><br />
traitement.<br />
19
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
L’état de santé des personnes porteuses de trisomie 21 à l’âge a<strong>du</strong>lte<br />
B de Fréminville, K <strong>Paris</strong>i, R Dupré Latour, R Touraine<br />
CHU-Hôpital Nord – Service de Génétique 42055 SAINT ETIENNE cedex 2<br />
L’espérance de vie des personnes porteuses de trisomie 21 s’est nettement accrue ces<br />
dernières années. En outre, elles présentent un risque augmenté de complications médicales<br />
qui sont souvent négligées.<br />
Le but de notre étude était d’évaluer pour un grand nombre d’a<strong>du</strong>ltes, 1) l’état de santé et<br />
l’accès au système de santé, 2) leur histoire médicale et leur parcours d’accompagnement, et<br />
3) mesurer leurs capacités cognitives et adaptatives.<br />
Cette étude a été proposée à toutes les personnes trisomiques a<strong>du</strong>ltes résidant dans le<br />
département de <strong>la</strong> Loire. Les part<strong>ici</strong>pants ont été vus en consultation avec un parent ou un<br />
é<strong>du</strong>cateur. L’étude incluait des questionnaires sur l’histoire médicale, le sommeil, les troubles<br />
<strong>du</strong> comportement (échelle de Reiss), les capacités adaptatives (Vine<strong>la</strong>nd), les signes de<br />
démence (Geydie), l’accès au système de santé, l’accompagnement depuis l’enfance, le<br />
travail, <strong>la</strong> résidence et les loisirs. L’examen clinique était complété par plusieurs analyses<br />
biologiques et par <strong>la</strong> passation des matrices progressives colorées de Raven.<br />
Entre 2005 et 2008, nous avons pu inclure 143 personnes, 72 femmes et 71 hommes. L’âge<br />
moyen était de 38,5 ans (entre 20 et 72 ans). Plusieurs problèmes médicaux et dentaires non<br />
diagnostiqués ont été identifiés (hypothyroïdie, ma<strong>la</strong>die caeliaque, cataracte, surdité, apnées<br />
<strong>du</strong> sommeil, démence d’Alzheimer, …). De nombreuses difficultés pour l’accès aux services<br />
médicaux ont également été pointées.<br />
Notre étude confirme l’intérêt d’une consultation régulière orientée pour les personnes<br />
porteuses de trisomie 21.<br />
Cette étude enfin, est le début d’une étude prospective sur les facteurs de vieillissement<br />
pathologique des personnes porteuses de trisomie 21.<br />
20
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Duplications <strong>du</strong> locus APP responsables de ma<strong>la</strong>dies d'Alzheimer<br />
autosomiques dominantes associées à des hémorragies intracérébrales<br />
Lucie Guyant-Maréchal, Anne Rovelet-Lecrux, Didier Hannequin, Dominique Campion<br />
Service de Neurologie et Inserm U614, CHU, 76031 Rouen Cedex<br />
Tel : 0232888740 Fax : 0232888741 E-mail : lucie.guyant-marechal@chu-rouen.fr<br />
Les formes autosomiques dominantes de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d'Alzheimer (MA) représentent<br />
moins de 1p.100 de l'ensemble des MA (Campion et al., 1999). Elles sont <strong>du</strong>es à des<br />
mutations de PSEN1 (69 p. cent), de l'APP (13 p. cent), <strong>du</strong>plication de l'APP (7,5 p. cent), et<br />
rarement de PSEN2 (2 p. cent). Les premières mutations décrites responsables de MA<br />
autosomiques dominantes sont celles <strong>du</strong> gène APP (Goate et al., 1991), situé sur le<br />
chromosome 21. Ce gène code pour <strong>la</strong> protéine précurseur de l'amyloïde et les mutations se<br />
situent toutes au niveau des exons 16 et 17, qui correspondent soit aux sites de clivage<br />
générant le peptide A à partir de <strong>la</strong> protéine soit à <strong>la</strong> séquence codante <strong>du</strong> peptide A .<br />
Actuellement, plus de 27 mutations de type faux-sens ont été décrites, dans 75 familles.<br />
Récemment, des <strong>du</strong>plications <strong>du</strong> locus <strong>du</strong> gène APP ont été identifiées dans neuf familles<br />
(Cabrejo et al., 2006; Rovelet-Lecrux et al., 2006; Sleegers et al., 2006; Rovelet-Lecrux et al.,<br />
2007; Guyant-Marechal et al., 2008). Les <strong>du</strong>plications sont de taille variable al<strong>la</strong>nt de 0,58<br />
Mb à 6, 37 Mb mais le phénotype est indépendant de <strong>la</strong> taille de <strong>la</strong> <strong>du</strong>plication car dans une<br />
famille, <strong>la</strong> <strong>du</strong>plication ne concernait que le gène de l’APP excluant ainsi l’implication<br />
potentielle des gènes adjacents (Sleegers et al., 2006). Le gène APP étant localisé sur le<br />
chromosome 21, sa <strong>du</strong>plication suffit à expliquer que les patients trisomiques 21 ont un risque<br />
accru de développer une MA après l’âge de 40 ans (Lai and Williams, 1989; Visser et al.,<br />
1997; Schupf et al., 2003). Les lésions neuropathologiques associées aux <strong>du</strong>plications APP<br />
sont tout à fait comparables à celles observées dans les cerveaux de patients trisomiques<br />
notamment <strong>la</strong> sévérité de l’angiopathie amyloide. Les hémorragies intracérébrales sont<br />
fréquentes dans les <strong>du</strong>plications APP et peuvent être de taille variable et de topographie<br />
corticale ou sous-corticale. Dans tous les cas, l'étude anatomopathologique a mis en évidence<br />
une angiopathie amyloïde sévère, des dépôts amyloïdes diffus et des p<strong>la</strong>ques séniles. il<br />
n'existe pas d'explication à <strong>la</strong> discordance entre <strong>la</strong> fréquence des hématomes associées aux<br />
<strong>du</strong>plications, respectivement de 26 p.100, 43 p.100 et 20 p. cent dans les 3 publications<br />
(Cabrejo et al., 2006; Rovelet-Lecrux et al., 2007; Guyant-Marechal et al., 2008) et les<br />
observations isolées d'hématomes rapportées chez les trisomiques 21 (Donahue et al., 1998).<br />
deux patients porteurs de <strong>du</strong>plication d’APP répondaient à <strong>la</strong> fois aux critères cliniques et<br />
neuropathologiques de démence à corps de Lewy (Sleegers et al., 2006; Guyant-Marechal et<br />
al., 2008). Ce phénotype est à rapprocher de <strong>la</strong> mise en évidence de corps de Lewy chez 50 p.<br />
cent des patients trisomiques 21, particulièrement au niveau des amygdales (Lippa et al.,<br />
1999).<br />
21
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Délocalisation de SET/I2PP2A dans le cerveau des patients Alzheimer et<br />
atteints de trisomie 21<br />
P. Facchinetti 1 , V. Sazdovitch 2 , C. Duyckaerts 2 , B. Allinquant 1<br />
1 : INSERM UMR 894, 2 ter rue d’Alésia, 75014 <strong>Paris</strong><br />
2 : INSERM UMR S975, 47 bd de l’Hôpital, 75013 <strong>Paris</strong><br />
Tel : 01 40 78 92 41 Fax : 01 45 80 72 93 E-mail : bernadette.allinquant@inserm.fr<br />
Dans le cerveau des patients Alzheimer ainsi que des patients porteurs de trisomie 21, il<br />
existe une diminution de <strong>la</strong> phosphatase 2A, impliquée dans <strong>la</strong> déphosphory<strong>la</strong>tion de tau. La<br />
diminution de <strong>la</strong> phosphatase 2A peut être le fait d’une augmentation de ses inhibiteurs et/ou<br />
de leur localisation sub-cellu<strong>la</strong>ire. Ces inhibiteurs sont en même temps des facteurs de<br />
transcription et sont localisés dans le noyau. En pathologie Alzheimer il existe une<br />
augmentation de ces inhibiteurs (I1PP2A et I2PP2A) et seul I2PP2A se délocalise <strong>du</strong> noyau<br />
vers le cytop<strong>la</strong>sme.<br />
Nous avions observé in vitro, que <strong>la</strong> présence en excès d’un fragment <strong>du</strong> domaine<br />
cytop<strong>la</strong>smique <strong>du</strong> précurseur <strong>du</strong> peptide amyloide (APP) démasqué après clivage par une<br />
caspase (Jcasp), con<strong>du</strong>it à <strong>la</strong> délocalisation de SET/I2PP2A <strong>du</strong> noyau vers le cytop<strong>la</strong>sme et<br />
que SET/I2PP2A est directement impliqué dans <strong>la</strong> mort neuronale liée à cet excès de peptide<br />
Jcasp. Nous avons essayé de valider ce modèle en pathologie. Nous avons pu observer dans<br />
les neurones hippocampaux des patients Alzheimer une augmentation de l’APP clivé par une<br />
caspase souvent associée à une délocalisation de SET/I2PP2A dans le cytop<strong>la</strong>sme, suggérant<br />
que peut être une telle délocalisation est in<strong>du</strong>ite après clivage de l’APP par une caspase. Dans<br />
les cerveaux contrôles, SET/I2PP2A est majoritairement nucléaire.<br />
Nous avons commencé à étudier le cerveau de 3 patients décédés et porteurs de trisomie 21.<br />
Dans l’hippocampe de ces patients, on peut voir également une localisation cytop<strong>la</strong>smique de<br />
SET/I2PP2A incluant les neurites.<br />
Les facteurs in<strong>du</strong>isant <strong>la</strong> présence de SET/I2PP2A dans le cytop<strong>la</strong>sme des neurones restent à<br />
élucider. La localisation de SET/I2PP2A dans le cytop<strong>la</strong>sme et les neurites des neurones<br />
hippocampaux pourrait expliquer <strong>la</strong> diminution de <strong>la</strong> phosphatase 2A dans les deux<br />
pathologies favorisant ainsi l’hyperphosphory<strong>la</strong>tion de tau.<br />
22
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Identification <strong>du</strong> locus responsable de <strong>la</strong> présence d’endosomes é<strong>la</strong>rgis dans<br />
<strong>la</strong> Trisomie 21.<br />
JC Cossec 1 , S Stora 2 , C Ripoll 3 , Y Grattau 2 , JM De<strong>la</strong>bar 3 et MC Potier 1<br />
1. CRICM, CNRS UMR7225, INSERM UMR975, UPMC Hôpital de <strong>la</strong> Pitié-Salpêtrière 47, Bd de<br />
l’Hôpital 75013 <strong>Paris</strong> ; 2. Institut Jérôme Lejeune, <strong>Paris</strong> ; 3. BFA, CNRS EAC 7059, <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong><br />
<strong>Diderot</strong>.<br />
Tel : 0142162146 Fax : 0142162146 E-mail : jack-christophe.cossec@upmc.fr<br />
L’é<strong>la</strong>rgissement des endosomes est <strong>la</strong> première anomalie morphologique observée<br />
dans le cerveau des patients atteints de <strong>la</strong> forme sporadique de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer et aussi<br />
dans <strong>la</strong> Trisomie 21 (T21). Nous avons montré par des techniques d’immunofluorescence que<br />
les cellules périphériques de patients porteurs de T21 (lignées lymphob<strong>la</strong>stoïdes et<br />
lymphocytes circu<strong>la</strong>nts) contiennent des endosomes é<strong>la</strong>rgis (30% d’augmentation de leur<br />
taille moyenne), récapitu<strong>la</strong>nt ainsi le phénotype observé dans les neurones.<br />
L’utilisation de lignées lymphob<strong>la</strong>stoîdes issues de patients porteurs de T21 partielles<br />
nous a permis de restreindre à ~1.3Mb <strong>la</strong> composante génétique responsable de<br />
l’é<strong>la</strong>rgissement des endosomes dans <strong>la</strong> T21. Seuls 6 gènes de cette région chromosomique<br />
sont exprimés dans les lignées lymphob<strong>la</strong>stoîdes ; en particulier <strong>la</strong> synaptojanine-1, protéine<br />
essentielle de l’endocytose dont <strong>la</strong> dérégu<strong>la</strong>tion entraîne des déf<strong>ici</strong>ts cognitifs chez <strong>la</strong> souris.<br />
23
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer et trisomie 21 : Faits anciens faits nouveaux<br />
Jacqueline London<br />
BFA-CNRS Equipe 5 <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-<strong>Diderot</strong>, 35 rue Hélène Brion, 75205, <strong>Paris</strong> cedex 13<br />
Tel : 01 57 27 83 61 Fax :01 57 27 83 55 E-mail : london@paris7.jussieu.fr<br />
La ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer (AD) est caractérisée sur le p<strong>la</strong>n clinique par des traits précis mais<br />
sans doute encore incomplèts. Sur le p<strong>la</strong>n biochimique, les principales caractéristiques sont :<br />
<strong>la</strong> présence de p<strong>la</strong>ques séniles <strong>du</strong>es au métabolisme anormal de l’APP (Amyloïd Precursor<br />
Protein) qui est localisé sur le chromosome 21), de dégénérescences neurofibril<strong>la</strong>ires ainsi que<br />
des pertes neuronales. Sur le p<strong>la</strong>n génétique, on distingue <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die transmissible à cause de<br />
<strong>la</strong> présence mutations sur les gènes portant des mutations APP, PS1 et PS2 et <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
sporadique, de loin <strong>la</strong> plus fréquente (92% des cas). Que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die soit sporadique ou<br />
transmissible, les caractéristiques tant biochimiques que physiologiques ou cliniques sont les<br />
même. Toute personne saine vieillissante a des p<strong>la</strong>ques séniles à partir de 75 ans mais le<br />
déclenchement des signes précurseurs de <strong>la</strong> démence ne survient que dans certains cas et<br />
serait lié à des anomalies cérébrovascu<strong>la</strong>ires ou à une dépression plusieurs années auparavant.<br />
Trisomie 21 et ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer : faits anciens<br />
Le gène APP situé sur le chromosome 21 est surexprimé dans <strong>la</strong> trisomie 21. Des signes<br />
neuro-anatomiques <strong>du</strong> même type que ceux des patients atteints de AD ont été mis en<br />
évidence dans quelque cas de cerveaux post-mortem examinés il y a de nombreuses années.<br />
Comme il y a encore une trentaine d’années, les patients atteints de trisomie 21 mourraient<br />
vers 40-50 ans avec une déf<strong>ici</strong>ence intellectuelle accrue, on en a dé<strong>du</strong>it que presque tous les<br />
patients atteints de Ts21 feraient une ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer. On ne faisait pas alors <strong>la</strong><br />
différence entre vieillissement accéléré et démence.<br />
Trisomie 21 et ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer : faits nouveaux<br />
Les études épidémiologiques récentes, fort peu nombreuses et encore controversées montrent<br />
qu’il n’y aurait guère plus de cas de démence sénile de type AD chez les personnes attentes de<br />
Ts21 que dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion générale. Cependant lorsque cette démence est observée elle est<br />
sévère et plus rapide que dans les cas c<strong>la</strong>ssiques d’AD. Ces nouvelles informations con<strong>du</strong>isent<br />
aux questions suivantes . Ces signes neuroanatomopathologiques sont t-ils le reflet de certains<br />
des déf<strong>ici</strong>ts dont sont atteints les patients jeunes atteints de Ts21 ? Pourquoi il y a t-il chez les<br />
patients atteints de Ts21 des signes neuro-anatomopathologiques de type AD sans démence?<br />
Y a-t-il des différences entre les signes biochimiques (par exemple différents peptides<br />
amyloïdes) entre les patients atteints de Ts21 qui vont faire une démence et ceux qui ne vont<br />
pas en faire ?<br />
24
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Ce que l’on sait sur les patients atteints de Ts21 sur le p<strong>la</strong>n biochimique : Ils ont des peptides<br />
amyloïdes augmentés dans le p<strong>la</strong>sma très tôt, ils ont des p<strong>la</strong>ques séniles et des protéines tau<br />
anormalement phosphorylées très tôt et dans certains cas seulement une démence mais<br />
beaucoup plus tardive environ 40 ans après !!<br />
Ces signes con<strong>du</strong>iraient-ils à <strong>la</strong> déf<strong>ici</strong>ence intellectuelle au moins en partie ? Les patients<br />
seraient –ils protégés contre <strong>la</strong> démence et par quels mécanismes ?<br />
Que nous dit l’examen clinique des deux pathologies. Parmi les signes cliniques de <strong>la</strong> trisomie<br />
21 figurent <strong>la</strong> déf<strong>ici</strong>ence mentale avec des problèmes d’orientation spatiale, de mémorisation<br />
sélective mais aussi des difficultés d’écriture ainsi que d’autres signes tels que les anomalies<br />
<strong>du</strong> sommeil en particulier <strong>la</strong> fragmentation, les déf<strong>ici</strong>ts olfactifs.<br />
Or tous ces signes sont aussi ceux que l’on trouve chez les patients qui commencent une<br />
ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer.<br />
Peut-on grâce aux travaux de recherche sur les signes précurseurs de l’AD et sur une<br />
meilleure compréhension des signes cliniques de <strong>la</strong> trisomie 21 trouver des pistes pour<br />
soigner, voire empêcher les deux pathologies ? Tel est le challenge pour aujourd’hui. Ce<strong>la</strong> ne<br />
peut se faire que par des recherches conjointes sur les patients des deux pathologies ainsi que<br />
sur les modèles animaux.<br />
25
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
COMMUNICATIONS<br />
PAR<br />
AFFICHES<br />
26
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Rôle de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD1 dans les activités <strong>du</strong> protéasome au<br />
cours <strong>du</strong> vieillissement : chaque organe a son histoire !<br />
Cherfa, A., LePécheur M, Bada<strong>la</strong>to N. et London J.<br />
BFA CNRS Equipe 5, <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-<strong>Diderot</strong>, case 7104,75205 <strong>Paris</strong> cedex 13<br />
Tel : 01 57 27 83 61 Fax : 01 57 27 83 55 E-mail : london@paris7.jussieu.fr<br />
Il est reconnu qu’au cours <strong>du</strong> vieillissement normal les activités <strong>du</strong> protéasome mesurées in<br />
vitro diminuent. Le rôle de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD1 dans <strong>la</strong> trisomie 21, longtemps<br />
considérée comme l’une des causes probables de cette pathologie, est à présent reconsidéré<br />
car tantôt délétère tantôt bénéfique suivant les situations physiologiques étudiées,. Afin de<br />
mieux comprendre le rôle de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD1au cours <strong>du</strong> vieillissement, nous<br />
avons mesuré les activités <strong>du</strong> protéasome dans des souris témoins et des souris transgéniques<br />
TghSOD1 jeunes et vieilles. Ces mesures ont été réalisées dans les organes dont des<br />
anomalies ont été décrites pour <strong>la</strong> trisomie 21 : cœur, peau, thymus, et organes neuronaux<br />
(cortex cérébral, cerveau antérieur et cervelet). Nous montrons<br />
A) que dans les souris témoins FVB/N, les activités <strong>du</strong> protéasome ne diminuent pas de <strong>la</strong><br />
même façon en fonction de l’âge suivant les organes<br />
B) que <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD1 n’a pas le même rôle au cours <strong>du</strong> vieillissement<br />
suivant les organes<br />
C) que <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD1 est plutôt inhibitrice des activités <strong>du</strong> protéasome<br />
D) que si <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD1 est inhibitrice, elle n’empêche pas les souris<br />
TghSOD1 de vivre très bien et très vieilles !!<br />
Conclusion : Nos résultats permettent une nouvelle relecture des activités <strong>du</strong> protéasome au<br />
cours <strong>du</strong> vieillissement et mettent en évidence un nouveau rôle de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong><br />
SOD1.<br />
27
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Effet de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD-1 humaine sur <strong>la</strong> peau de souris jeunes<br />
et âgées.<br />
Cherfa A., Petit E. et London J<br />
BFA CNRS Equipe 5, <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-<strong>Diderot</strong>, case 7104,75205 <strong>Paris</strong> cedex 13<br />
Tel : 01 57 27 83 61<br />
Fax : 01 57 27 83 55<br />
E-mail : london@paris7.jussieu.fr<br />
Les personnes atteintes de trisomie 21 ont de nombreux signes phénotypiques qui sont bien<br />
répertoriés, ils développent également de nombreuses anomalies cutanées, peu étudiées. En<br />
effet, ils souffrent d’alopécie areata (pe<strong>la</strong>de) (3% versus 1.7% dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion générale),<br />
développent de nombreuses dermatoses (syrigome) (17%) et présentent des xéroses (33 %).<br />
De plus, ils sont très sensibles aux infections fongiques et bactériennes. En outre, les patients<br />
atteints de trisomie 21 souffrent de problèmes liés à <strong>la</strong> cicatrisation. Parmi les gènes <strong>du</strong><br />
chromosome 21, pouvant être impliqués dans des dermatoses ou <strong>la</strong> cicatrisation cutanée, <strong>la</strong><br />
SOD-1 (Cu/Zn Superoxide Dismutase) et l’APP (Amyloïd Precursor Protein) sont étudiés<br />
dans notre <strong>la</strong>boratoire. La SOD-1 est impliquée dans le stress oxydatif in<strong>du</strong>it par les UVs,<br />
l’apoptose et <strong>la</strong> prolifération.<br />
Notre travail consiste à montrer si <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD-1 a un effet sur <strong>la</strong> structure de<br />
<strong>la</strong> peau, sur les défenses anti-oxydantes et sur le vieillissement.<br />
- Conséquences de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD-1 sur <strong>la</strong> structure de <strong>la</strong> peau :<br />
Nous avons montré dans les souris transgéniques, âgées de 4 mois (sans distinction de sexe),<br />
une hypertrophie au niveau <strong>du</strong> derme dûe à <strong>la</strong> forte présence des protéines de <strong>la</strong> matrice<br />
extracellu<strong>la</strong>ire (MEC).<br />
Afin de comprendre les causes de cette hypertrophie deux hypothèses peuvent être émises : <strong>la</strong><br />
surexpression de <strong>la</strong> SOD-1 in<strong>du</strong>it soit une diminution de <strong>la</strong> dégradation de <strong>la</strong> MEC soit une<br />
augmentation de <strong>la</strong> synthèse de <strong>la</strong> MEC. Nous avons montré que <strong>la</strong> quantité de MMP-2<br />
(Métalloprotéase 2) ne diminue pas mais que son activité de dégradation des protéines de <strong>la</strong><br />
MEC mesurée par zymographie est diminuée d’environ 4 fois. Ces résultats con<strong>du</strong>isent à<br />
penser que <strong>la</strong> MEC serait en partie non dégradée dans les souris transgéniques. La synthèse de<br />
certaines protéines de <strong>la</strong> MEC (pro-col<strong>la</strong>gene I par exemple) sera mise en évidence par le<br />
Western blot.<br />
- Conséquences biochimique de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD-1 en fonction de l’âge :<br />
Nous avons d’une part, déterminé si l’activité SOD-1 est modifiée au cours <strong>du</strong> vieillissement<br />
et d’autre part mesuré les conséquences de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> SOD-1 sur les autres<br />
enzymes antioxydants (cata<strong>la</strong>se et glutathion peroxydase) et sur l’activité <strong>du</strong> protéasomes<br />
20S.<br />
28
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Nous avons montré que l’activité de <strong>la</strong> SOD-1 augmente chez les souris témoins en fonction<br />
de l’âge alors qu’elle augmente chez les souris transgéniques jeunes (1 et 4 mois) et diminue<br />
fortement à 11 mois.<br />
La surexpression de SOD-1 in<strong>du</strong>it une diminution des activités <strong>du</strong> protéasome 20S par rapport<br />
aux souris témoins (environ de 20 à 40 % pour les trois enzymes). En fonction de l’âge les<br />
activités <strong>du</strong> protéasome ne diminuent plus chez les souris transgéniques alors qu’elles<br />
diminuent chez les témoins. Le modèle de souris YACTghAPP est récemment arrivé au<br />
<strong>la</strong>boratoire. La caractérisation cutanée de ce modèle murin pourra commencer.<br />
29
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Gènes de <strong>la</strong> région télomèrique de HSA21 sensibles à l’effet de dose et<br />
régu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> réponse inf<strong>la</strong>mmatoire in<strong>du</strong>ite par le LPS.<br />
Dalloneau E, Brault V, Desale E, Nabel E , Hérault Y.<br />
CNRS, UMR6218, MIE ; 3 b rue de <strong>la</strong> Férollerie, 45071 Orléans<br />
Tel : 02 38 25 54 15 Fax :02 38 25 79 79 E-mail : emilie.dalloneau@cnrs-orleans.fr<br />
Les CNV (Copy Number Variation) couvrent environ 12% <strong>du</strong> génome humain et sont<br />
retrouvées dans le modèle souris. Ces CNV sont les variations les plus communes <strong>du</strong> génome<br />
humain et pourraient donc expliquer des susceptibilités à des pathologies plus ou moins<br />
complexes. Une variation <strong>du</strong> nombre de copies des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 humain<br />
(HSA12) entraine des anomalies morphologiques et physiologies d’un grand nombre<br />
d’organes chez les patients. La Trisomie 21, ou Syndrome de Down et les monosomies<br />
partielles <strong>du</strong> HSA21 con<strong>du</strong>isent à des phénotypes complexes et variables. Afin d’identifier les<br />
gènes <strong>du</strong> HSA21 sensibles aux effets de dose, nous avons développé un modèle monosomique<br />
pour <strong>la</strong> région Prmt2–Col6a1 <strong>du</strong> chromosome murin 10 (MMU10).<br />
Ce modèle comprend <strong>la</strong> région homologue au CNV humain CNP1359 qui affecte les<br />
gènes Prmt2, S100b et Dip2.l’analyse de ce modèle, Ms1Yah, a montré que les souris ont une<br />
réponse pulmonaire et inf<strong>la</strong>mmatoire modifiées, suite à une instil<strong>la</strong>tion de LPS (Besson et al.,<br />
2007, Hum Mol Genet 16, 2040-2052). Le gène Prmt2, connu comme étant un inhibiteur de <strong>la</strong><br />
voie NF-kB apparaît comme un bon candidat pour expliquer une augmentation de <strong>la</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction des cytokines pro-inf<strong>la</strong>mmatoires. Nous avons entrepris l’étude de <strong>la</strong> réponse<br />
inf<strong>la</strong>mmatoire chez les souris Ms1Yah ainsi que chez un modèle KO pour Prmt2, en réponse à<br />
une stimu<strong>la</strong>tion par le LPS.<br />
Seront présentés les résultats montrant que Prmt2 est un gène sensible au effet de dose<br />
et qui intervient, avec d’autre(s) gène(s) dans <strong>la</strong> réponse inf<strong>la</strong>mmatoire.<br />
30
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Trisomie 21 en mosaïque chez une femme de phénotype normal<br />
Elghezal Hatem, Benabdal<strong>la</strong>h Ines, Hannachi Hanene, Saad Ali<br />
Service de Cytogénétique et de Biologie de <strong>la</strong> Repro<strong>du</strong>ction – CHU Farhat Hached – Sousse 4000 -<br />
TUNISIE<br />
Tel : +216.98.40.22.54 Fax : +216.73.21.94.88 E-mail : hatem.elghezal@rns.tn<br />
Le phénotype de <strong>la</strong> trisomie 21 en mosaïque est peu connu et <strong>la</strong> majorité des cas décrits sont<br />
des formes cytogénétiques retrouvées chez des patients qui présentent un tableau clinique de<br />
trisomie 21. Quelques cas de phénotype atténué sont reportés, mais le retard mental était<br />
constant. Nous rapportons <strong>ici</strong> un nouveau cas de trisomie 21 en mosaïque chez une femme de<br />
phénotype normal qui consulte pour un problème d’avortements répétitifs.<br />
L’examen clinique de <strong>la</strong> patiente ne trouve aucun signe évocateur de trisomie 21, les<br />
développements psychomoteur et intellectuel sont normaux et le bi<strong>la</strong>n malformatif est négatif.<br />
Le caryotype sur lymphocytes sanguins trouve une formule chromosomique 47,XX,+21 dans<br />
20% des mitoses analysées par <strong>la</strong> technique des bandes R. <strong>la</strong> peinture chromosomique<br />
confirme que le chromosome surnuméraire est un chromosome 21 et l’utilisation de sonde<br />
spécifique de locus permet de compter <strong>la</strong> présence de trois chromosomes 21 dans 18% des<br />
noyaux interphasiques.<br />
Les fibrob<strong>la</strong>stes cutanés présentent aussi une trisomie 21 dans 7% des cellules analysées par<br />
hybridation in situ interphasique.<br />
Il s’agit donc d’une véritable trisomie 21 en mosaïque re<strong>la</strong>tivement importante et retrouvée<br />
dans deux tissus différents chez une femme de phénotype strictement normal. Cette<br />
observation doit poser sérieusement <strong>la</strong> question <strong>du</strong> conseil génétique en cas de découverte de<br />
trisomie 21 en mosaïque dans le cadre d’un diagnostic prénatal.<br />
31
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Altérations de <strong>la</strong> morphogenèse in<strong>du</strong>ites par <strong>la</strong> surexpression <strong>du</strong> gène<br />
Dyrk1A<br />
Guedj F 1 ; Lopez-Pereira P 2 ; Sebrie C 3 ; Maihemuti 1 A; Chabert C 1 ; Olivier P 4 ;<br />
Ledru A 1 ; Paly E 1 ; Herault Y 2 ; Verney C 4 ; De<strong>la</strong>bar J. M 1<br />
ADRESSE : 1 :Biologie Fonctionnelle Adaptative, CNRS EAC 7059- <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>-<strong>Paris</strong>7,<br />
<strong>Paris</strong> ; 2 :UMR6218 CNRS, Immunologie and Molecu<strong>la</strong>r Embryology, UPS44, Institut de<br />
Transgénose, 45071 Orléans2 ; 3 :Laboratoire de RMN Biologique, ICSN-CNRS, Gif sur Yvette ; 4 :<br />
Inserm U 676, <strong>Paris</strong><br />
Tel : 01-57-27-83-63 Fax : 01-57-27-83-55 E-mail : guedj.faycal@paris7.jussieu.fr<br />
Le syndrome de Down (SD) est causé dans 95 % des cas par <strong>la</strong> trisomie libre <strong>du</strong> chromosome<br />
21 (HSA21) caractérisée par un certain nombre de signes phénotypiques stables incluant des<br />
altérations morphologiques touchant principalement le cerveau ainsi qu’un retard mental. Ces<br />
altérations morphométriques <strong>du</strong> cerveau ainsi qu’un retard d’apprentissage sont aussi<br />
observées dans un modèle murin de trisomie partielle d’une région <strong>du</strong> chromosome 16<br />
(Ts65Dn) présentant une synthénie avec le HSA21. L’un des gènes candidats dans<br />
l’apparition <strong>du</strong> retard mental est le gène Dyrk1A localisé dans <strong>la</strong> DCR-1. Ce gène code une<br />
sérine/thréonine kinase impliquée dans le développement <strong>du</strong> système nerveux central (SNC).<br />
Des souris transgéniques contenant 3 copies <strong>du</strong> gène Dyrk1A dans un YAC humain<br />
(YAC152F7) présentent une augmentation <strong>du</strong> poids <strong>du</strong> cerveau (+14 %) par rapport aux<br />
souris contrôles et un retard d’apprentissage dans plusieurs paradigmes (piscine de Morris et<br />
reconnaissance <strong>du</strong> nouvel objet). Les études IRM effectuées sur ce modèle ont montré que le<br />
volume total <strong>du</strong> cerveau est augmenté de 14 % chez les souris YAC152F7 et que cette<br />
augmentation est hétérogène dans ses différentes régions avec un effet plus important dans <strong>la</strong><br />
région <strong>du</strong> tha<strong>la</strong>mus/hypotha<strong>la</strong>mus (+ 25 %). Les mesures de surface de coupes coronales ont<br />
permis de montrer que cette augmentation est observée dans différents p<strong>la</strong>ns <strong>du</strong> cerveau (Brg<br />
1 mm, 0 mm et -2 mm). Les surfaces des différentes régions <strong>du</strong> cerveau sont augmentées à<br />
Brg - 2 mm plus particulièrement au niveau <strong>du</strong> tha<strong>la</strong>mus/hypotha<strong>la</strong>mus avec 25 %<br />
d’augmentation.<br />
Un nouveau modèle contenant le gène Dyrk1A de souris dans un BAC et sous le contrôle de<br />
son promoteur endogène (souris mBAC189n3) présente des altérations morphométriques<br />
simi<strong>la</strong>ires à celles qui sont observées chez les souris YAC152F7<br />
32
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Afin de déterminer les origines cellu<strong>la</strong>ire et molécu<strong>la</strong>ire de ces altérations morphométriques,<br />
des études stéréologiques des densités cellu<strong>la</strong>ires (totale, neuronale et gliales) et une<br />
évaluation de différents marqueurs de <strong>la</strong> morphologie neuronale (MBP, MAP2 et Gap43) ont<br />
été effectuées par immunohistochimie et western blotting respectivement. Les souris<br />
YAC152F7 présentent 10 % de diminution de <strong>la</strong> densité des neurones NeuN+ dans le cortex<br />
somatosensoriel (CSS) alors que les densités cellu<strong>la</strong>ire totale et neuronale sont augmentées de<br />
18 et 30 % respectivement dans le noyau tha<strong>la</strong>mique VPL/VPM. D’autre part, une<br />
augmentation (+ 23 %) de l’expression de <strong>la</strong> protéine associée à <strong>la</strong> myéline (MBP) est<br />
observée dans le tha<strong>la</strong>mus/hypotha<strong>la</strong>mus suggérant un rôle primordial de Dyrk1A dans <strong>la</strong><br />
régu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce prolifération/apoptose et de <strong>la</strong> morphologie neuronale au cours <strong>du</strong><br />
développement <strong>du</strong> SNC.<br />
33
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Modifications <strong>du</strong> transcriptome au cours <strong>du</strong> développement postnatal <strong>du</strong><br />
cervelet dans un modèle murin de Trisomie 21.<br />
Julien Laffaire 1,8 , Isabelle Rivals 2 , Luce Dauphinot 1,8 , Fabien Pasteau 1 , Rosine Wehrle 3,4 ,<br />
Benoit Larrat 5 , Tania Vitalis 1 , Randal X Moldrich 6 , Jean Rossier 1 , Ralph Sinkus 5 , Yann<br />
Herault 7 , Isabelle Dusart 3,4 et Marie-C<strong>la</strong>ude Potier 1,8 .<br />
1 Laboratoire de Neurobiologie, CNRS UMR7637, ESPCI, <strong>Paris</strong>, France. 2 Equipe de Statistique<br />
Appliquee - ESPCI, <strong>Paris</strong>, France. 3 Neurobiologie des Processus Adaptatifs, CNRS UMR7102, <strong>Paris</strong>,<br />
France. 4 UPMC, <strong>Paris</strong>, France. 5 Laboratoire Ondes et Accoustique, UMR7587, ESPCI,<strong>Paris</strong>, France.<br />
6 The Queens<strong>la</strong>nd Brain Institute, St Lucia, Australia. 7 IEM, CNRS UMR6218, Orleans, France.<br />
8 Adresse actuelle : CRICM, CNRS UMR7225, INSERM UMR975 UPMC, CHU Pitie-Salpetriere,<br />
<strong>Paris</strong>, France.<br />
Tel : +33142162157 Fax : +33145848008 E-mail : j.<strong>la</strong>ffaire@yahoo.fr<br />
La Trisomie 21, ou syndrome de Down, est causée par <strong>la</strong> présence d'une troisième copie <strong>du</strong><br />
chromosome 21. De récentes analyses ont démontré une surexpression des gènes en 3 copies<br />
avec des effets de compensation ou d'amplification pour certains d'entre eux. Cependant,<br />
l'impact de l'effet de dosage génique sur l'ensemble <strong>du</strong> transcriptome est encore débattu.<br />
C'est pourquoi nous avons mené une analyse de l'expression des gènes chez <strong>la</strong> souris Ts1Cje,<br />
un modèle murin de <strong>la</strong> Trisomie 21, au cours <strong>du</strong> développement postnatal <strong>du</strong> cervelet. En<br />
effet, nous avons montré dans ce modèle une diminution de <strong>la</strong> prolifération des cellules<br />
granu<strong>la</strong>ires <strong>du</strong> cervelet à <strong>la</strong> naissance ainsi qu'une diminution <strong>du</strong> volume <strong>du</strong> cervelet chez<br />
l'a<strong>du</strong>lte. L'analyse statistique de données de puces à ADN a révélé un effet majeur de dosage<br />
génique des gènes en 3 copie ainsi que des gènes présents sur un fragment délété de 1,96 Mb<br />
sur <strong>la</strong> partie télomérique <strong>du</strong> chromosome 12 que nous avons pour <strong>la</strong> première fois caractérisé<br />
par hybridation génomique comparative. Cet effet de dosage génique n'influe que<br />
modérément sur le transcriptome : 2,4 à 7,5% des gènes exprimés sont régulés. De plus, nous<br />
n'avons trouvé que 13 gènes significativement régulés tout au long <strong>du</strong> développement<br />
postnatal <strong>du</strong> cervelet dont 6 correspondants à des gènes en 3 copies. Enfin, l'analyse de<br />
transcriptome à partir de dissections de <strong>la</strong> couche granu<strong>la</strong>ire externe de cervelet, où nous<br />
avons démontré une ré<strong>du</strong>ction de <strong>la</strong> prolifération à <strong>la</strong> naissance, a révélé un effet majeur de<br />
dosage génique mais pas de déstabilisation globale <strong>du</strong> transcriptome.<br />
Toutes ces données suggèrent qu'un nombre restreint de gènes présents en 3 copies sont<br />
responsables <strong>du</strong> phénotype présenté par le cervelet des souris Ts1Cje et nous proposons une<br />
liste courte de gènes candidats.<br />
34
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Modification <strong>du</strong> contrôle de <strong>la</strong> fréquence cardiaque chez des souris<br />
transgéniques incorporant le gène KCNJ6 <strong>du</strong> chromosome 21 humain.<br />
Jacques Lignon 1-2 , Zoë Bichler 1-3 , Bruno Hivert 2 , François Gannier 2 , José del Rio 3 ,<br />
Danièle Migliore-Samour 1 et Pierre Cosnay 2 .<br />
1- IEM UMR 6218 CNRS, 3 rue de <strong>la</strong> Ferollerie, Orleans, France.<br />
2- Physiologie des Cellules Cardiaques et Vascu<strong>la</strong>ires, <strong>Université</strong> F. Rabe<strong>la</strong>is, Tours, France.<br />
3- Department of Cell Biology, IRB & CIBERNED, University de Barcelone, Barcelone, Espagne.<br />
Tel : 02 38 25 79 31 E-mail : jacques.lignon@cnrs-orleans.fr<br />
Environ 40% des patients atteints <strong>du</strong> syndrome de Down (DS, Ts21) présentent des<br />
malformations cardiaques congénitales. Plus récemment, il a été mis en évidence une<br />
incompétence chronotrope et une variabilité sinusale (heart rate variability, HRV) altérées<br />
chez des patients DS ne présentant aucune malformation cardiaque (Fernhall et Otterstetter,<br />
2003 ; Figueroa et al, 2005 ; Iel<strong>la</strong>mo et al, 2005 ; [1]) qui témoignent d’une altération de <strong>la</strong><br />
ba<strong>la</strong>nce sympathique/para-sympathique (Σ/para-Σ) mo<strong>du</strong><strong>la</strong>nt l’activité cardiaque. Le gène<br />
KCNJ6 localisé sur le chromosome humain 21 (et 16 murin) code pour <strong>la</strong> sous unité<br />
Kir3.2/GIRK2 <strong>du</strong> canal KG (canal potassique rectifiant entrant, Kir) régulée par <strong>la</strong> sous unité<br />
βγ des protéines G et pourrait contribuer à cette modification de <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion cardiaque.<br />
Pour élucider l’impact de sa surexpression, nous avons utilisé des souris FVB<br />
homozygotes (Tg++) incorporant des copies <strong>du</strong> KCNJ6 humain (Tg67 et Tg84 ; Smith et al,<br />
1995 [2])(*). Ces souris présentent une surexpression des m-RNA humains <strong>du</strong> Kir3.2 et une<br />
surexpression de <strong>la</strong> protéine dans le cerveau et l’oreillette d’un facteur 2.5 alors que<br />
l’expression de Kir3.2 n’est pas modifiée dans le ventricule. Les altérations phénotypiques ont<br />
été analysées par enregistrement de l’électrocardiogramme (ECG) chez des souris<br />
anesthésiées à l’uréthane. Les réponses chronotropes à une stimu<strong>la</strong>tion cholinergique<br />
muscarinique directe (injection de carbachol) ou indirecte (méthoxamine : activation <strong>du</strong> baroréflexe)<br />
sont augmentées chez les souris Tg++ par rapport aux souris sauvages (WT). Les<br />
alternances de périodes de rythme lent et rapide in<strong>du</strong>ites par le CCPA (2-chloro-Ncyclopentyl-adenosine<br />
; agoniste des récepteurs A1 à l’adénosine) sont amplifiées chez les<br />
souris Tg++, et provoquent de ce fait une ré<strong>du</strong>ction de l’effet chronotrope moyen négatif de<br />
cet agent. Ces drogues ré<strong>du</strong>isent l’amplitude et l’aire de l’onde P atriale. Les variations de<br />
l’onde P in<strong>du</strong>ites par <strong>la</strong> méthoxamine et le CCPA sont respectivement accrues et ré<strong>du</strong>ites chez<br />
les souris Tg++ tandis que les variations de l’intervalle PR et des ondes ventricu<strong>la</strong>ires ne<br />
présentent aucune différence entre souris Tg++ et WT.<br />
Ces résultats indiquent que les souris Tg++ incorporant des copies <strong>du</strong> gène KCNJ6<br />
humain présentent une expression accrue de Kir3.2 et des réponses altérées aux agents qui<br />
activent les canaux potassiques rectifiant KG. De plus ces réponses altérées se limitent au<br />
35
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
nœud sino atrial (pacemaker cardiaque) et aux oreillettes qui expriment normalement des<br />
quantités importantes des canaux KG. Ces résultats suggèrent que le KCNJ6 peut jouer un<br />
rôle important dans les modifications de <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion cardiaque observées chez les patients<br />
atteints <strong>du</strong> DS.<br />
(*)Résultats rapportés dans Physiological Genomics, 2008, 33, 230-239<br />
[1] J Appl Physiol 94: 2158–2165, 2003; Clin Auton Res 15: 45–50, 2005 ; Am J Physiol Heart Circ<br />
Physiol 289: H2387– H2391, 2005. [2] Genomics 27: 425–434, 1995.<br />
36
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Sommeil et trisomie 21<br />
J. London<br />
BFA CNRS Equipe 5, <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-<strong>Diderot</strong>, case 7104,75205 <strong>Paris</strong> cedex 13<br />
Tel : 01 57 27 83 61 Fax : 01 57 27 83 55 E-mail : london@paris7.jussieu.fr<br />
60 % des patients atteints de trisomie 21 présentent des anomalies <strong>du</strong> sommeil dont les<br />
conséquences sur le p<strong>la</strong>n <strong>du</strong> développement neuronal mais aussi muscu<strong>la</strong>ire, immunitaire,<br />
endocrinien et autres sont <strong>la</strong>rgement ignorées. Il faut savoir que le cerveau de l’homme,<br />
comme celui des mammifères, est soumis à des alternances périodiques de trois états : <strong>la</strong><br />
veille, le sommeil et le rêve qui se déroulent par cycles d’environ 90 mm chez l’a<strong>du</strong>lte;<br />
l’organisme a besoin de 4 à 7 cycles par nuit, suivant les indivi<strong>du</strong>s. Après une période de<br />
somnolence, le sommeil peut être découpé en cinq stades (légers : 1 et 2), puis profonds (3 et<br />
4), puis enfin le sommeil paradoxal associé aux rêves. Contrairement à ce qu’on croyait,<br />
lorsque l’on dort, le cerveau est toujours actif et de très nombreux processus molécu<strong>la</strong>ires<br />
encore mal connus se déroulent et sont à <strong>la</strong> base de synthèse de molécules aussi importantes<br />
que l’hormone de croissance, <strong>la</strong> pro<strong>la</strong>ctine, des cytokines (molécules importantes <strong>du</strong> système<br />
immunitaire), <strong>la</strong> mé<strong>la</strong>tonine et des gènes d’horloge biologique qui commandent <strong>du</strong> moins en<br />
partie presque toutes les fonctions de l’organisme. Ainsi une mauvaise qualité <strong>du</strong> sommeil<br />
peut entraîner des troubles de l’appétit, des troubles gastro-intestinaux, des céphalées, une<br />
mauvaise humeur et bien sûr une baisse de <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce avec des « coups de pompe » dont les<br />
conséquences dans les déf<strong>ici</strong>ts d’apprentissages sont encore mal répertoriés car trop peu<br />
étudiés.<br />
Les personnes atteintes de trisomie 21 souffrent d’apnées <strong>du</strong> sommeil mais aussi déf<strong>ici</strong>ts qui<br />
ne commencent à être décrits que récemment :<br />
– un sommeil fragmenté qui se manifeste par des micro-éveils fréquents<br />
– une diminution <strong>du</strong> nombre de cycles <strong>du</strong> sommeil paradoxal<br />
– une augmentation <strong>du</strong> temps de <strong>la</strong>tence pour l’instal<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> sommeil paradoxal<br />
– des mouvements fréquents, conséquence d’une atonie muscu<strong>la</strong>ire insuffisante pendant le<br />
sommeil<br />
– des anomalies dans les fréquences spectrales de l’electroencéphalogramme : diminution de<br />
<strong>la</strong> bande alpha de 8 à 12 Hz et/ou augmentation de <strong>la</strong> bande de 4 à 8 Hz.<br />
L’une des difficultés pour interpréter les causes molécu<strong>la</strong>ires de ces anomalies est <strong>la</strong><br />
complexité des conséquences de <strong>la</strong> présence d’environ 350 gènes normaux en trois copies au<br />
lieu de deux. C’est ainsi que depuis une quinzaine d’années un grand nombre de modèles de<br />
souris surexprimant un, deux, trois gènes ou un grand nombre de gènes ont été é<strong>la</strong>borés<br />
(souris trisomiques 16 partielles, souris trisomiques 17 et 10 partielles et souris TC1).<br />
37
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
En ce qui concerne le sommeil, <strong>la</strong> souris présente des phases de sommeils quasiment<br />
semb<strong>la</strong>bles à celles de l’homme et offre l’avantage de pouvoir permettre de mettre en<br />
évidence les réseaux neuronaux qui sont à <strong>la</strong> base de ces phases et d’identifier les molécules<br />
responsables des altérations <strong>du</strong> sommeil mises en évidence chez les souris et semb<strong>la</strong>bles à<br />
certaines présentes chez les patients.<br />
Les résultats que nous avons obtenus en col<strong>la</strong>boration avec Damien Co<strong>la</strong>s dans le groupe de<br />
N. Sarda à Lyon ont été récemment confirmés dans le groupe de Joëlle Adrien à l’hôpital de<br />
<strong>la</strong> Salpétrière et on même permis de montrer de plus que certaines des souris transgéniques<br />
pouvaient être utilisées pour des études sur <strong>la</strong> dépression ce qui les rendent encore plus<br />
intéressantes dans le cadre de <strong>la</strong> trisomie 21. Ces résultats ainsi que ceux plus récemment<br />
obtenus par Damien Co<strong>la</strong>s aux USA avec les souris Ts1Cje et Ts65Dn confirment les<br />
perspectives qu’offrent ces très nombreux modèles de <strong>la</strong> trisomie 21. Elle valide ainsi <strong>la</strong><br />
pertinence de l’utilisation de modèles transgéniques pour une meilleure compréhension des<br />
déf<strong>ici</strong>ts comportementaux des patients atteints de trisomie 21.<br />
Ainsi <strong>la</strong> surexpression de l’APP (aussi impliqué dans <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer) pourrait être<br />
une clé nous con<strong>du</strong>isant sans doute sur un chemin encore plus général que le sommeil qui est<br />
celui <strong>du</strong> développement précoce et <strong>du</strong> fonctionnement <strong>du</strong> système nerveux central en<br />
particulier en ce qui concerne le tronc cérébral et le système sérotoninergique. Les espoirs<br />
fondés sur une telle approche sont évidents. En effet, passé le stade de l’analyse descriptive de<br />
l’architecture <strong>du</strong> cycle veille-sommeil et des variables associées à sa microstructure, il s’agit<br />
d’évaluer les effets de traitements pharmacologiques potentiels soit déjà connus ou en voie<br />
d’exploration tels ceux utilisés contre le déséquilibre des espèces oxygénées radica<strong>la</strong>ires<br />
comme des compléments nutritionnels, des antioxydants, de <strong>la</strong> mé<strong>la</strong>tonine, soit ceux utilisés<br />
pour améliorer les performances cognitives.<br />
La route est encore longue mais elle est d’autant plus prometteuse que nous allierons dans une<br />
perspective de recherche intégrée des partenariats fructueux entre les patients et leurs familles<br />
d’une part et les professionnels de <strong>la</strong> santé et les chercheurs d’autre part.<br />
38
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Etude des conséquences neuronales de <strong>la</strong> surexpression de <strong>la</strong> cystathionine<br />
beta-synthase (CBS) dans un modèle de souris transgéniques<br />
§ § § ** §<br />
Régnier V., *Bil<strong>la</strong>rd J.M., *Potier B., Woerner S., Adjakly M., Alberto J.M., Ledru<br />
A., **Guéant J.L., ***Patterson D., § London J.<br />
§ BFA équipe 5 ; <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>, EAC CNRS 7059, *U894, Centre P. Broca, 75014 <strong>Paris</strong> ;<br />
**U724 , Faculté de Médecine ,54500 Vandoeuvre-les-Nancy ;***Eleanor Roosevelt Institute,<br />
Denver, USA.<br />
Tel : 01 57 27 83 65 Fax : 01 57 27 83 55 E-mail : vinciane.regnier@paris7.jussieu.fr<br />
La cystathionine beta-synthase (CBS) codée par un gène localisé en 21q22.3 est une enzyme<br />
<strong>du</strong> métabolisme des composés monocarbonés et de celui de <strong>la</strong> transulfuration. La CBS a<br />
longtemps été considérée comme une enzyme hépatique et pancréatique car les niveaux<br />
d’expression dans ces tissus y sont forts, mais elle s’exprime aussi dans le cerveau, bien que<br />
faiblement. La mo<strong>du</strong><strong>la</strong>tion de son expression dans cet organe pourrait entraîner <strong>la</strong> mo<strong>du</strong><strong>la</strong>tion<br />
de <strong>la</strong> quantité d’homocystéine ainsi que <strong>la</strong> mo<strong>du</strong><strong>la</strong>tion <strong>du</strong> niveau de sulfure d’hydrogène,<br />
molécule qui peut agir comme neuromo<strong>du</strong><strong>la</strong>teur. Les conséquences de <strong>la</strong> surexpression de<br />
CBS dans le système nerveux central demeurent inconnues.<br />
Des souris transgéniques pour le gène CBS humain (TghCBS, lignée 60.4P102D1) ont été<br />
obtenues par le groupe <strong>du</strong> Pr D. Patterson (Denver, USA) par microinjection d'un fragment<br />
d'ADN contenant le gène entier CBS sous le contrôle de son propre promoteur. Nous avons<br />
montré par RT-PCR que le transgène est exprimé, comme le gène CBS murin, dans<br />
différentes structures cérébrales (hémisphères, cervelet, hippocampe). Le transgène est<br />
cependant faiblement exprimé dans le foie, suggérant une régu<strong>la</strong>tion différentielle <strong>du</strong><br />
promoteur humain dans ce tissu. Par RT-PCR quantitative, nous avons montré une<br />
augmentation significative des transcrits CBS dans le cervelet, l'hippocampe, et les<br />
hémisphères cérébraux de souris hémizygotes (+/TghCBS). D'autre part, nous avons montré<br />
par western blot, que <strong>la</strong> quantité de CBS totale est augmentée d’un facteur 1,7 à 2 dans les<br />
hémisphères cérébraux, le cervelet et l’hippocampe. Des mesures d’activité enzymatique<br />
(méthode radioactive réalisée en col<strong>la</strong>boration avec le Pr JL Guéant) ont permis de confirmer<br />
que <strong>la</strong> protéine pro<strong>du</strong>ite à partir <strong>du</strong> transgène possède une activité catalytique. Des mesures<br />
préliminaires d’activité CBS dans les différentes régions cérébrales des souris transgéniques,<br />
montrent une augmentation d’environ 25% dans le cervelet, ainsi qu’une tendance à<br />
l’augmentation dans l’hippocampe. Ces mesures d’activité devraient être prochainement<br />
validées au <strong>la</strong>boratoire par une autre méthode basée sur <strong>la</strong> mesure de l’activité de pro<strong>du</strong>ction<br />
d’H2S par CBS.<br />
Par ailleurs, nous avons mis en évidence, en col<strong>la</strong>boration avec les Dr B. Potier et J.M. Bil<strong>la</strong>rd<br />
(INSERM U894, Centre P.Broca), une augmentation significative de <strong>la</strong> LTP de 25% par<br />
39
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
rapport aux souris témoins, mesurée « ex vivo » sur des tranches d’hippocampe. Ces résultats<br />
indiquent donc un effet de <strong>la</strong> surexpression de CBS sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>st<strong>ici</strong>té synaptique.<br />
Des expériences d’immunolocalisation sont en cours pour vérifier si <strong>la</strong> localisation régionale<br />
et cellu<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> protéine humaine dans le cerveau des souris transgéniques est identique à<br />
celle de <strong>la</strong> protéine murine.<br />
Finalement, des travaux sont en cours afin de mettre en évidence les conséquences<br />
biochimiques (dosage des métabolites <strong>du</strong> cycle des monocarbonés) de <strong>la</strong> surexpression de<br />
CBS dans le système nerveux central (col<strong>la</strong>boration avec P. Brachet, UMR 1019, INRA,<br />
Clermont-Ferrand et avec le Dr. W.Kruger, Fox Chase Center Phi<strong>la</strong>delphie, USA).<br />
40
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Signatures des phénotypes cardiaques dans des lymphob<strong>la</strong>stoides de<br />
patients porteurs de trisomie 21<br />
C Ripoll 1 , E Ait Yahya-Graison 1 , I Rivals 2 , JC Cossec 3 ,L Dauphinot 3 , E Paly 1 , JC<br />
Cossec 3 , C Mircher 4 , A Ravel 4 , Y Grattau 4 , H Bléhaut 4 , A Mégarbane 5 , B de<br />
Fréminville 6 , N Créau 1 , MC Potier 3 , JM De<strong>la</strong>bar 1<br />
1 BFA, CNRS EAC 7059, Univ. <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>, 2 Equipe de Statistique Appliquée, ESPCI, <strong>Paris</strong>, 3<br />
CRICM, CNRS UMR7225, INSERM UMR975, UPMC Hôpital de <strong>la</strong> Pitié-Salpêtrière, 4 Institut<br />
Jérôme Lejeune et Fondation Jérome Lejeune, 5 Unité de Génétique Médicale, Faculté de Médecine,<br />
<strong>Université</strong> Saint-Joseph, Beyrouth, 6 Laboratoire de Cytogénétique, Centre Hospitalier Universitaire<br />
de Saint-Etienne<br />
Tel : 0157278356 Fax : 0157278355 E-mail : clementine.ripoll@univ-paris-diderot.fr<br />
Dans 40% des cas <strong>la</strong> trisomie 21 est associée à une malformation cardiaque. Cette<br />
malformation est le plus souvent un canal atrio-ventricu<strong>la</strong>ire (CAV) et moins fréquemment<br />
une communication interventricu<strong>la</strong>ire (CIV) ou une communication interauricu<strong>la</strong>ire (CIA).<br />
Dans le cadre <strong>du</strong> consortium AnEUploidy 400 lignées de lymphob<strong>la</strong>stoides (LBLs) ont été<br />
établies à partir de lymphocytes de patients porteurs de trisomie 21. Le transcriptome de 20<br />
lignées provenant de patients sans malformation cardiaque (MC-) a été comparé à celui de 20<br />
lignées provenant de patients présentant une trisomie 21 et une malformation cardiaque<br />
(CAV, CIV ou CIA) à l’aide de puces à ADN (puces d’expression Illumina). La normalisation<br />
est effectuée par <strong>la</strong> méthode des quantiles. L’analyse par ACP révèle qu’il est possible de<br />
séparer les porteurs de CAV <strong>du</strong> groupe des CIA/CIV. Avec une p valeur < 0.05 (test de<br />
student 2 à 2) 1005 gènes sont différentiellement exprimés sur 11904 gènes testables pour <strong>la</strong><br />
comparaison MC-/CAV+ et 1135 gènes sont différentiellement exprimés pour <strong>la</strong> comparaison<br />
MC-/CIA-CIV+. 64 gènes sont communs aux deux catégories.<br />
Parmi les gènes différentiellement exprimés avec le plus de significativité dans ces<br />
conditions et qui sont exprimés dans des tissus cardiaques fœtaux (GEO dataset) plusieurs<br />
présentent une expression différentielle en effectuant par PCR quantitative des comparaisons<br />
MC-/CAV+, et MC-/CIA-CIV+ à partir de trois groupes différents des groupes précédents.<br />
Ces gènes ou les voies dans lesquelles ils se trouvent sont donc potentiellement impliqués<br />
dans <strong>la</strong> genèse des malformations cardiaques observées chez les porteurs de trisomie 21.<br />
41
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Adénocarcinome pulmonaire chez un jeune a<strong>du</strong>lte trisomique 21, après<br />
leucémie lymphob<strong>la</strong>stique traitée dans l'enfance. Rareté des secondes<br />
tumeurs chez les trisomiques 21<br />
Daniel Satgé, Sergio Salmeron, Toufik Homsi, Marie-Odile Réthoré,<br />
Anatomie pathologique Centre Hospitalier, Tulle. Pneumologie et Anatomie pathologique Groupe<br />
hospitalier <strong>Paris</strong>-St Joseph, <strong>Paris</strong>. Institut Jérôme Lejeune, <strong>Paris</strong>.<br />
Tel : 05 55 29 79 13 Fax : 05 55 29 86 05 E-mail : daniel.satge@ch-tulle.fr<br />
Les seconds cancers après un premier cancer dans l'enfance sont mal connus chez les<br />
personnes trisomiques 21.<br />
Nous rapportons l'histoire d'un jeune trisomique 21 âgé de 33 ans qui a développé un<br />
adénocarcinome pulmonaire diffus, peu symptomatique, et rapidement fatal. Le patient avait<br />
été traité pour leucémie lymphob<strong>la</strong>stique à l'âge de deux ans. Il n'y a pas de notion<br />
d'exposition tabagique directe ou indirecte, ni de prédisposition aux cancers dans sa famille<br />
pouvant expliquer <strong>la</strong> survenue de cette tumeur exceptionnelle dans <strong>la</strong> trisomie 21.<br />
Une revue de <strong>la</strong> littérature n'a trouvé que cinq seconds cancers incluant notre observation<br />
(leucémie myéloïde, gliome optique, séminome testicu<strong>la</strong>ire, tumeur neurectodermique<br />
primitive et adénocarcinome pulmonaire), après un rhabdomyosarcome et 4 leucémies. La<br />
rareté de ces seconds cancers est étonnante car 1) globalement les cancers sont aussi<br />
fréquents chez les trisomiques 21 que dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion générale. 2) Les premiers cancers<br />
surviennent surtout dans <strong>la</strong> petite enfance (leucémies). Et 3) parce que l'espérance de vie des<br />
trisomiques 21 a beaucoup progressé au cours des dernières décennies permettant <strong>la</strong> survenue<br />
de seconds cancers, même tardifs.<br />
Dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion générale; le risque de second cancer après un cancer dans l'enfance est<br />
estimé entre 3 et 12% selon les séries et le type de premier cancer. Pour <strong>la</strong> leucémie<br />
lymphob<strong>la</strong>stique <strong>la</strong> plus grande série indique un risque de 5.2% après 25 ans de suivi, ce sont<br />
surtout des tumeurs cérébrales, il n'est pas rapporté de cas de cancer broncho-pulmonaire.<br />
Conclusion:<br />
Comme les tumeurs solides primitives, les seconds cancers paraissent exceptionnels chez les<br />
trisomiques 21 suggérant des facteurs protecteurs antinéop<strong>la</strong>siques.<br />
L'étude des tumeurs chez les trisomiques 21 est soutenue par <strong>la</strong> Fondation Jérôme Lejeune.<br />
42
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Malformations viscérales majeures chez 551 trisomiques 21<br />
Stoll C, Alembik Y, Dott B, Roth M-P<br />
Service de Génétique Médicale, Faculté de Médecine 11, rue Humann, 67085 STRASBOURG<br />
CEDEX<br />
Tel : 0390243207 Fax : 0390243179 E-mail : C<strong>la</strong>ude.Stoll@medecine.u-strasbg.fr<br />
Les objectifs de cette étude sont de décrire les malformations congénitales présentes chez les<br />
fœtus et les nouveau-nés trisomiques 21 dans une popu<strong>la</strong>tion bien définie, étudiée <strong>du</strong>rant 25<br />
ans, de 1979 à 2003. Le matériel pour cette étude provient <strong>du</strong> registre des malformations<br />
congénitales <strong>du</strong> Bas-Rhin qui compte de multiples sources de recensement à <strong>la</strong> naissance et<br />
avant <strong>la</strong> naissance (interruptions spontanées ou médicales de grossesse). 334.262 naissances<br />
consécutives dont l’issue est connue, ont été étudiées.<br />
Sur les 551 trisomiques 21 recensés 93,8 % d’entre eux ont une trisomie 21 libre, 2,7 % une<br />
mosaïque et 3,4 % une translocation. Les malformations viscérales majeures présentent en un<br />
ou plusieurs exemp<strong>la</strong>ires chez ces trisomiques se répartissent ainsi : 254 ( 46,1 %)<br />
cardiopathies congénitales comprenant un canal atrio-ventricu<strong>la</strong>ire, 43,3 %, une<br />
communication interventricu<strong>la</strong>ire, 29,1 %, une communication interauricu<strong>la</strong>ire, 10,2 %, une<br />
coarctation de l’aorte, 4,7 % , une tétralogie de Fallot, 3,1% et d’autres types de<br />
cardiopathies congénitales, 9,4%; 34 ( 6,2 %) malformations digestives incluant 21 sténoses<br />
ou atrésies <strong>du</strong>odénales, 1 imperforation anale, 1 atrésie de l’œsophage et 11 ma<strong>la</strong>dies de<br />
Hirschsprung ; 25 (4,5 %) cataractes congénitales et 82 (14,9 %) surdités neuro-sensorielles.<br />
En conclusion près d’un enfant trisomique 21 sur deux a une ou plusieurs malformations<br />
viscérales majeures, le plus souvent une cardiopathie congénitale, surtout un canal atrioventricu<strong>la</strong>ire,<br />
ou une malformation digestive, essentiellement une sténose <strong>du</strong>odénale,<br />
indiquant <strong>la</strong> nécessité de rechercher ces malformations chez tout nouveau-né trisomique 21.<br />
Par ailleurs, l’association négative de certaines malformations cardiaques (transposition et<br />
lésions obstructives) ou digestives (atrésies autres que <strong>du</strong>odénales) oriente les recherches vers<br />
des études génétiques et épigénétiques approfondies et orientées.<br />
43
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
LE MALADE AU QUOTIDIEN<br />
44
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Association pour <strong>la</strong> Recherche sur <strong>la</strong> Trisomie 21, AFRT<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-<strong>Diderot</strong>, 35 rue Hélène Brion, Case 7088, 75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
Tel : 01 57 27 83 -61 et 06 42 92 26 46 ; E-mail : afrt@paris7.jussieu.fr;<br />
Sites internet : http://www.afrt.fr et http://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT/<br />
L’Association pour <strong>la</strong> Recherche sur <strong>la</strong> Trisomie 21 a été créée en 1990 à l’initiative d’un groupe de<br />
chercheurs travail<strong>la</strong>nt à l’hôpital Necker sur <strong>la</strong> trisomie 21. Elle est désormais principalement une<br />
association de parents qui est administrée par un conseil d’administration, un bureau émanant de ce<br />
conseil et un Conseil scientifique. Ses missions sont :<br />
‐ Informer sur <strong>la</strong> Trisomie 21 grâce aux « Nouvelles <strong>du</strong> chromosome 21 »<br />
17 numéros d’environ 10 pages, depuis 1995, traitant à <strong>la</strong> fois de données scientifiques et médicales<br />
sur <strong>la</strong> trisomie 21 et un petit livre publié en janvier 2005 qui rassemble les principaux articles publiés.<br />
- Informer le grand public<br />
L’AFRT fait des exposés à de nombreuses occasions (ADAPEI, Lyons‐Club, Rotary) et<br />
répond à des journalistes (voir dossier de presse)<br />
‐ Soutenir les programmes de recherche concernant les aspects fondamentaux, cliniques et<br />
thérapeutiques comme pour les autres ma<strong>la</strong>dies génétiques<br />
Pour ce<strong>la</strong> son conseil scientifique et son conseil d’administration ont permis depuis 1998 de<br />
subventionner des projets de recherche, sous forme de prix, bourses post‐doctorantes ou<br />
doctorantes et de subventions pour des projets de recherches spécifiques. Notons des projets sur le<br />
système immunitaire, <strong>la</strong> peau, le sommeil, le stress oxydant et le sport, génomique et variabilité<br />
phénotypique dans <strong>la</strong> trisomie 21.Nous tenons beaucoup à des projets de recherche qui allient à <strong>la</strong><br />
fois des clin<strong>ici</strong>ens proches des patients et des chercheurs.<br />
‐ Part<strong>ici</strong>per à des <strong>colloque</strong>s<br />
L’AFRT part<strong>ici</strong>pe (par des présentations orales) à de très nombreux <strong>colloque</strong>s en France et en Europe.<br />
L’AFRT est depuis 2005 membre de DSI (Down Syndrome International) dont le congrès mondial aura<br />
lieu en aôut 2009 à Dublin (Ir<strong>la</strong>nde). L’AFRT est membre depuis 2005 de l’European Down Syndrome<br />
Association (EDSA) dont le congrès a eu lieu à Sarajevo en avril 2009 et de son bureau depuis 2008 ;<br />
Mme London est vice‐présidente d’EDSA.<br />
‐ Organiser des <strong>colloque</strong>s<br />
Le 21 Mars 2005 à <strong>Paris</strong> <strong>la</strong> 1ère Journée Nationale de <strong>la</strong> Recherche sur <strong>la</strong> Trisomie 21 « Du patient à<br />
<strong>la</strong> recherche, mieux comprendre pour mieux aider ».<br />
45
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Depuis cette initiative de l’AFRT en 2005, <strong>la</strong> journée <strong>du</strong> 21 Mars (3/21 ou 21/3 pour 3 chromosomes<br />
21) a été choisie par les instances internationales pour être « La Journée Mondiale <strong>du</strong> syndrome de<br />
Down ». A cette date se tiennent de nombreuses manifestations dans le monde<br />
Depuis 2006 nous avons organisé chaque année un <strong>colloque</strong> en col<strong>la</strong>boration avec les organisations<br />
concernées par <strong>la</strong> trisomie 21.<br />
Le 21 mars 2006 à <strong>Paris</strong>« Comment appréhender et tenter de guérir le handicap mental ».<br />
Les 23 et 24 mars 2007 Colloque européen à <strong>Paris</strong>« Trisomie 21 en mouvement »<br />
Les 18‐19 mai 2007 Premier <strong>colloque</strong> international à Meknes (Maroc)<br />
Le 21 mars 2008 Colloque médical et scientifique à Lyon en col<strong>la</strong>boration avec Reflet 21<br />
Les 20 et 21 mars 2009 à Limoges « 50 ans après <strong>la</strong> découverte de <strong>la</strong> trisomie 21 »<br />
46
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
LA FONDATION JEROME LEJEUNE<br />
• 1 er financeur en France de <strong>la</strong> recherche sur <strong>la</strong> Trisomie 21.<br />
• 1 ère consultation médicale spécialisée en Europe : Trisomie 21, Syndrome de l’X<br />
fragile, ma<strong>la</strong>die <strong>du</strong> cri <strong>du</strong> chat, syndromes inexpliqués. 4700 patients sont suivis à<br />
l’Institut.<br />
Une recherche à visée thérapeutique<br />
Chaque année, <strong>la</strong> Fondation Jérôme Lejeune finance des dizaines de programmes dans le<br />
monde, sur les ma<strong>la</strong>dies génétiques de l’intelligence : Canada, Espagne, États-Unis, France,<br />
Israël, Italie, Liban, Royaume-Uni, Suisse, etc.<br />
Les équipes que nous soutenons explorent des pistes de recherche qui nous semblent<br />
utiles et efficaces pour trouver un traitement. Les subventions qui leur sont accordées sont<br />
votées par le Conseil d’administration, sur proposition <strong>du</strong> Conseil scientifique.<br />
Sur <strong>la</strong> période de juillet 2007 à juin 2008, <strong>la</strong> Fondation Jérôme Lejeune a soutenu <strong>la</strong><br />
recherche à hauteur de 2 383 600 euros.<br />
La Fondation Jérôme Lejeune s’est dotée d’un <strong>la</strong>bel éthique<br />
Elle s’engage à financer exclusivement les recherches qui respectent l’être humain dès<br />
le commencement de sa vie. Elle ne soutient aucun projet utilisant des tissus humains<br />
d’origine embryonnaire ou fœtale.<br />
Appel à projets<br />
La Fondation Jérôme Lejeune appelle les équipes et chercheurs à soumettre à son<br />
Conseil Scientifique des projets de recherche fondamentale ou clinique, à orientation<br />
thérapeutique, sur les déf<strong>ici</strong>ences intellectuelles. Inscriptions à partir <strong>du</strong> 7 juillet 2009.<br />
Pour tout renseignement :<br />
http://subvention.fondationlejeune.org/subvention<br />
Fondation Jérôme Lejeune<br />
Conseil Scientifique<br />
37 rue des Volontaires<br />
75015 <strong>Paris</strong><br />
33 1 44 49 73 36<br />
Soin et recherche : l’Institut Jérôme Lejeune<br />
47
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
En attendant de trouver un traitement adapté pour traiter nos patients, notre<br />
préoccupation immédiate est de les soigner. Nous accueillons 4 700 patients souffrants<br />
d’une déf<strong>ici</strong>ence intellectuelle... Nos patients viennent de France et de l’étranger pour une<br />
surveil<strong>la</strong>nce médicale spécialisée tout au long de <strong>la</strong> vie.<br />
Nous mettons à leur disposition une équipe médicale et paramédicale :<br />
• médecins spécialisés en génétique, neurologie, neuropédiatrie, chirurgie orthopédique,<br />
gériatrie.<br />
• personnel spécialisé en orthophonie, psychologie, soins infirmiers, assistance sociale,<br />
diététique.<br />
Institut Jérôme Lejeune<br />
37 rue des Volontaires<br />
75015 <strong>Paris</strong><br />
01 56 58 63 00<br />
48
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
France<br />
Trisomie 21<br />
Trisomie 21 France fédère les associations trisomie 21 départementales (Groupes d’Etude pour<br />
l’Insertion sociale des personnes porteuses d’une Trisomie 21).<br />
Ces associations départementales réunissent parents, personnes porteuses de Trisomie 21 et<br />
professionnels. Elles accompagnent les personnes porteuses d’une trisomie 21 dès le plus jeune âge par<br />
des actions réé<strong>du</strong>catives et thérapeutiques. Leur action diversifie les choix et possibilités d’insertion<br />
sociale : crèche, sco<strong>la</strong>rité, formation professionnelle, travail, loisirs, culture, hébergement...<br />
Un projet validé par <strong>la</strong><br />
demande sociale.<br />
Une progression au<br />
cours des dernières<br />
années<br />
L’image de <strong>la</strong> personne<br />
porteuse de trisomie 21<br />
évolue<br />
Une recherche<br />
appliquée...<br />
... pour un<br />
accompagnement adapté<br />
S’appuyant sur <strong>la</strong> demande ce mouvement se développe. Actuellement,<br />
Trisomie 21 France regroupe 61 Associations Départementales sur<br />
l’ensemble <strong>du</strong> territoire français.<br />
Leur action concerne environ 3000 enfants, adolescents et jeunes a<strong>du</strong>ltes<br />
accompagnés par les équipes ou services de soins GEIST.<br />
Pour réussir l’insertion, certaines gèrent des<br />
Services d’E<strong>du</strong>cation et de Soins Spécialisés A Dom<strong>ici</strong>le (SESSAD)<br />
Services d’Accompagnement à <strong>la</strong> Vie Sociale (SAVS),<br />
Dispositifs d’accompagnement de l’insertion professionnelle<br />
Services d'Aide par le Travail hors les murs (SAT)<br />
Dispositifs expérimentaux d’accompagnement.<br />
Les personnes trisomiques sont les meilleures ambassadrices de leur propre<br />
image. La perception sociale des personnes trisomiques, change à mesure<br />
que <strong>la</strong> société apprend à les connaître.<br />
C’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle Trisomie 21 France organise chaque année <strong>la</strong><br />
journée de <strong>la</strong> trisomie 21 au cours de <strong>la</strong>quelle les personnes porteuses de<br />
trisomie 21 vont à <strong>la</strong> rencontre <strong>du</strong> public. Des actions support sont<br />
organisées localement pour valoriser l’image des personnes et permettre à<br />
chacun de mieux les connaître. En 2007, plus de 60 grandes villes se sont<br />
mobilisées. Ces actions ont généré plus de 30 reportages télévisés, 30<br />
reportages radio et 110 articles presse écrite.<br />
Le Conseil Scientifique de Trisomie 21 France soutient des recherches sur<br />
l’amélioration de <strong>la</strong> vie quotidienne des personnes et effectue une veille sur<br />
les travaux en cours. Trisomie 21 France est à l’initiative d’un appel de fonds<br />
pour soutenir ces recherches parmi lesquelles :<br />
49
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
L’information des<br />
parents et professionnels<br />
Un travail de re<strong>la</strong>tion<br />
avec les partenaires<br />
institutionnels et<br />
associatifs<br />
Sensiblité à l'hypnose (<strong>Université</strong> de Nanterre)<br />
Motr<strong>ici</strong>té et graphisme (Univestité d'Aix en Provence)<br />
Mastication et port d'orthèse (<strong>Université</strong> de Clermont Ferrand)<br />
La santé des a<strong>du</strong>ltes (CHU de Saint Etienne)<br />
Conception d'outils sur l'autodétermination (<strong>Université</strong> de Mons<br />
Hainaut)<br />
Ce Conseil scientifique est à l’initiative des programmes de formation<br />
(formations universitaires, formation continue ) et <strong>du</strong> choix des thèmes des<br />
manifestations et congrès (1500 part<strong>ici</strong>pants en 2006 à <strong>la</strong> Mutualité)<br />
Trisomie 21 France diffuse <strong>la</strong> revue « Trisomie 21 » à 7000 exemp<strong>la</strong>ires,<br />
revue destinée aux personnes concernées par <strong>la</strong> trisomie 21 et au grand<br />
public.<br />
Notre fédération représente les associations adhérentes au niveau des tutelles<br />
nationales: ministères et administrations centrales.<br />
Trisomie 21 France siège au Conseil National Consultatif des Personnes<br />
Handicapées), à <strong>la</strong> Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, à<br />
l'Agence Nationale d'Evaluation des établissements et services médico<br />
sociaux ainsi qu'à l'Observatoire national sur <strong>la</strong> formation, <strong>la</strong> recherche et<br />
l'innovation sur le handicap<br />
Au niveau européen Trisomie 21 France est adhérente <strong>du</strong> Conseil Français pour les personnes<br />
Handicapées en Europe (CFHE), et en contact étroit avec les associations<br />
européennes particulières à <strong>la</strong> trisomie 21. Elle est co-fondatrice de l'<br />
European Down’s Syndrom Association (EDSA).<br />
En outre, Trisomie 21 France est membre fondateur <strong>du</strong> GIP National Handicap<br />
et Compétences dont <strong>la</strong> vocation est d'accompagner divers organismes dans<br />
le montage et le suivi d'appels à projets européens (Equal).<br />
50
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
PARTICIPANTS au COLLOQUE<br />
51
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Adjakly Mawussi<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
madjakly@yahoo.fr<br />
Allinquant Bernadette<br />
Inserm UMR 894<br />
75014 <strong>Paris</strong><br />
bernadette.allinquant@inserm.fr<br />
Bada<strong>la</strong>to Nelly<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
nbada<strong>la</strong>to@gmail.com<br />
Bléhaut Henri<br />
Fondation Jérome Lejeune<br />
75725 <strong>Paris</strong> cedex 15<br />
hblehaut@fondationlejeune.org<br />
Bonhomme Paul<br />
SSIAD-ADMR-20<br />
75020 <strong>Paris</strong><br />
paul.bonhomme@club-internet.fr<br />
Boudiaf Benaferi Radia<br />
Laboratoire d’Histologie-Embryologie-<br />
Cytogénétique<br />
Centre Pierre et Marie Curie<br />
Algérie<br />
radiabenaferi@yahoo.fr<br />
Braudeau Jérome<br />
Laboratoire de Neurobiologie de<br />
l’Apprentissage,<br />
de <strong>la</strong> Mémoire & de <strong>la</strong> Communication<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-Sud<br />
91405 Orsay<br />
jerome.braudeau@u-psud.fr<br />
Brault Véronique<br />
Laboratoire d’Immunologie et<br />
Embryologie Molécu<strong>la</strong>ire<br />
Liste des part<strong>ici</strong>pants<br />
CNRS UMR6218, 45071 Orléans<br />
brault@cnrs-orleans.fr<br />
Brisset Sophie<br />
Laboratoire de Cytogénétique<br />
Hôpital Antoine Béclère<br />
42141 C<strong>la</strong>mart<br />
sophie.brisset@abc.aphp.fr<br />
Cherfa Aïcha<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
aicha.cherfa@univ-paris-diderot.fr<br />
Copin Henri<br />
Biologie de <strong>la</strong> Repro<strong>du</strong>ction, Cytogénétique,<br />
Centre d’AMP et CECOS de Picardie<br />
80054 Amiens<br />
copin.henri@chu-amiens.fr<br />
Cossec Jack-Christophe<br />
Centre de Recherche de l’ICM<br />
Hopital de <strong>la</strong> Pitié Salpétrière<br />
75013 <strong>Paris</strong><br />
jack-christophe@upmc.fr<br />
Costantine Maher<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
maher.costantine@univ-paris-diderot.fr<br />
Courbois Yannick<br />
Laboratoire PSITEC<br />
59653 Villeneuve d’Ascq<br />
yannick.courbois@univ-lille3.fr<br />
Créau Nicole<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
creau@univ-paris-diderot.fr<br />
52
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Dalloneau Emilie<br />
CNRS IEM UMR6218<br />
45071 Orléans<br />
emilie.dalloneau@cnrs-orleans.fr<br />
Dauphinot Luce<br />
Centre de Recherche de l’ICM<br />
Hôpital de <strong>la</strong> Pitié Salpétrière<br />
75013 <strong>Paris</strong><br />
luce.dauphinot@upmc.fr<br />
De<strong>la</strong>bar Jean<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
jean-maurice.de<strong>la</strong>bar@univ-paris-diderot.fr<br />
De<strong>la</strong>tour Benoit<br />
Laboratoire de Neurobiologie de<br />
l’Apprentissage,<br />
de <strong>la</strong> Mémoire & de <strong>la</strong> Communication<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong>-Sud 91405 Orsay<br />
benoit.de<strong>la</strong>tour@u-psud.fr<br />
Dembour Guy<br />
Cardiologie Pédiatrique<br />
B1200 Bruxelles<br />
g.dembour@versate<strong>la</strong>dsl.be<br />
Drunat Séverine<br />
Laboratoire de Biochimie Génétique, Hopital<br />
Debré, <strong>Paris</strong><br />
severine.drunat@rdb.aphp.fr<br />
E<strong>la</strong>ribi Djamel<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
djamel_forever@hotmail.com<br />
Elghezal Hatem<br />
Service de Cytogénétique et de Biologie<br />
de <strong>la</strong> Repro<strong>du</strong>ction<br />
CHU Farhat Hached<br />
4000 Sousse-Tunisie<br />
hatem.elghezal@rns.tn<br />
Facchinetti Patr<strong>ici</strong>a<br />
INSERM UMR 894<br />
75014 <strong>Paris</strong><br />
facchinetti@inserm.fr<br />
Grattau Yann<br />
Institut Jérome Lejeune<br />
75725 <strong>Paris</strong> cedex 15<br />
yann.grattau@institutlejeune.org<br />
Guedj Fayçal<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
guedj.faycal@univ-paris-diderot.fr<br />
Guyant-Maréchal Lucie<br />
Service de Neurologie et INSERM U614<br />
76031 Rouen<br />
lucie.guyant-marechal@chu-rouen.fr<br />
Hérault Yann<br />
CNRS IEM UMR6218<br />
45071 Orléans<br />
herault@cnrs-orleans.fr<br />
Janel Nathalie<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
nathalie.janel@univ-paris-diderot.fr<br />
Kamoun Pierre<br />
Hôpital Necker Enfants Ma<strong>la</strong>des<br />
Faculté de Médecine Necker<br />
149 rue de Sèvres 75015 <strong>Paris</strong><br />
pierre.kamoun@nck.ap-hop-paris.fr<br />
Laffaire Julien<br />
Centre de Recherche de l’ICM<br />
Hopital de <strong>la</strong> Pitié Salpétrière<br />
75013 <strong>Paris</strong><br />
j.<strong>la</strong>ffaire@yahoo.fr<br />
Lanceart Emilie<br />
Psychologue de Recherche<br />
Institut Jérome Lejeune<br />
75725 <strong>Paris</strong> cedex 15<br />
emilie.<strong>la</strong>nceart@institutlejeune.org<br />
53
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Ledru Aurélie<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
aurelie.ledru@univ-paris-diderot.fr<br />
Lignon Jacques<br />
Immunologie et Embryologie Molécu<strong>la</strong>ires<br />
UMR 6218 CNRS<br />
Rue de <strong>la</strong> Férollerie<br />
45071 Orléans<br />
jacques.lignon@cnrs-orleans.fr<br />
London Jacqueline<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
london@univ-paris-diderot.fr<br />
Lopes Pereira Patr<strong>ici</strong>a<br />
Immunologie et Embryologie Molécu<strong>la</strong>ires<br />
UMR 6218 CNRS<br />
Rue de <strong>la</strong> Férollerie 45071 Orléans<br />
lopes@cnrs-orleans.fr<br />
Mace Bertrand<br />
Laboratoire d’Histologie-Cytogénétique<br />
76031 Rouen<br />
bertrand.mace@chu-rouen.fr<br />
Maihemuti Abu<strong>la</strong>jiang<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
ab<strong>la</strong>janmt@yahoo.fr<br />
Marquer Catherine<br />
Centre de Recherche de l’Institut<br />
<strong>du</strong> Cerveau et de <strong>la</strong> Moelle épinière<br />
Hôpital de <strong>la</strong> Pitié Salpétrière<br />
75013 <strong>Paris</strong><br />
catherine.marquer@upmc.fr<br />
Mégarbane André<br />
<strong>Université</strong> Saint Joseph<br />
Unité de Génétique Médicale<br />
Beyrouth, Liban<br />
megarbane@usj.e<strong>du</strong>.lb<br />
Mircher Clotilde<br />
Institut Jérome Lejeune<br />
75725 <strong>Paris</strong> 15 ème<br />
clotilde.mircher@institutlejeune.org<br />
Montagnon Martine<br />
Laboratoire Pasteur Cerba-Service<br />
Cytogénétique<br />
95310 Saint Ouen l’Aumone<br />
mmontagnon@pasteur-cerba.com<br />
Mouton-Liger François<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
francois.mouton-liger@paris7.jussieu.fr<br />
Noll Christophe<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
christophe.noll@univ-paris-diderot.fr<br />
Nouchy Marc<br />
Laboratoire Pasteur Cerba-Service<br />
Cytogénétique<br />
95310 Saint Ouen l’Aumone<br />
mnouchy@pasteur-cerba.com<br />
Omouri Zohra<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
P<strong>la</strong>nque Chris<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
chris.p<strong>la</strong>nque@univ-paris-diderot.fr<br />
Potier Marie-C<strong>la</strong>ude<br />
Centre de Recherche de l’ICM<br />
Hôpital de <strong>la</strong> Pitié Salpétrière<br />
75013 <strong>Paris</strong><br />
marie-c<strong>la</strong>ude.potier@espci.fr<br />
54
Colloque « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. » <strong>Paris</strong> Mai 2009<br />
Raaf Lamia<br />
Laboratoire Biochimie et remode<strong>la</strong>ge de <strong>la</strong><br />
matrice extracellu<strong>la</strong>ire.<br />
FSB. USTHB. BP 32<br />
Alger, Algérie<br />
<strong>la</strong>miaraaf@yahoo.fr<br />
Raoul Odile<br />
Service de Cytogénétique<br />
<strong>du</strong> Professeur Vekemans<br />
Hôpital Necker<br />
75015 <strong>Paris</strong><br />
odiraoul@aol.com<br />
Raveau Matthieu<br />
Immunologie et Embryologie Molécu<strong>la</strong>ire<br />
CNRS UMR6218<br />
45071 Orléans<br />
matthieu.raveau@cnrs-orleans.fr<br />
Régnier Vinciane<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
vinciane.regnier@univ-paris-diderot.fr<br />
Ripoll Clémentine<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
clementine.ripoll@univ-paris-diderot.<br />
Satgé Daniel<br />
Laboratoire d’Anatomie pathologique<br />
19000 Tulle<br />
daniel.satge@ch-tulle.fr<br />
danielsatge@orange.fr<br />
Sébrié Catherine<br />
Equipe Imagerie métabolique<br />
et marquage molécu<strong>la</strong>ire<br />
U2R2M <strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> Sud<br />
CNRS UMR8081<br />
91405 Orsay<br />
sebrie@icsn.cnrs-gif.fr<br />
Se<strong>la</strong>rdin Lise<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
Simonneau Michel<br />
INSERM U675, IFR02, Faculté de Médecine<br />
Xavier Bichat,<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong>-<strong>Paris</strong> 7<br />
<strong>Paris</strong><br />
michel.simonneau@inserm.fr<br />
Sinet Pierre-Marie<br />
Institut Paul Broca, INSERM U549<br />
2 ter, rue d’Alésia,<br />
75014 <strong>Paris</strong> Cedex<br />
sinet@broca.inserm.fr<br />
Stoll C<strong>la</strong>ude<br />
Laboratoire de Génétique Médicale<br />
67085 Strasbourg<br />
c<strong>la</strong>ude.stoll@medecine.u-strasbg.fr<br />
Stora Samantha<br />
Institut Jérome Lejeune<br />
75725 <strong>Paris</strong> cedex 15<br />
samantha.stora@institutlejeune.org<br />
Touraine Renaud<br />
Service de Génétique<br />
CHU-Hopital Nord<br />
42055 Saint Etienne Cedex 2<br />
renaud.touraine@chu-st-etienne.fr<br />
Tsao Raphaele<br />
Laboratoire Psycle<br />
13621 Aix-en-Provence<br />
r.tsao@aix-mrs.iufm.fr<br />
Urbaniak Paulina<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
Wortman Patr<strong>ici</strong>a<br />
BFA, EAC CNRS 7059<br />
<strong>Université</strong> <strong>Paris</strong> <strong>Diderot</strong> – <strong>Paris</strong> 7<br />
75205 <strong>Paris</strong> Cedex 13<br />
patr<strong>ici</strong>a.wortman@univ-paris-diderot.fr<br />
55
5ème <strong>colloque</strong> « Trisomie 21 : de <strong>la</strong> fonction des gènes <strong>du</strong> chromosome 21 à <strong>la</strong> physiopathologie. »<br />
<strong>Paris</strong> 2009<br />
56