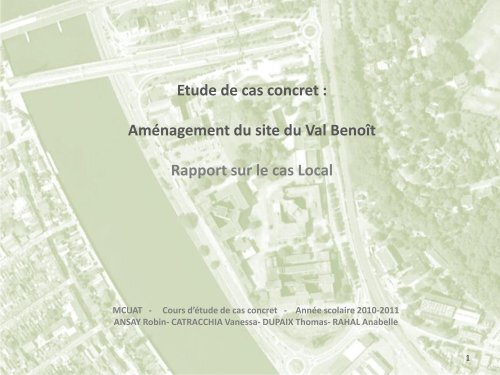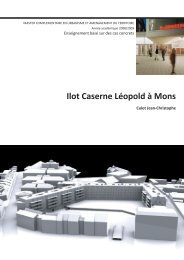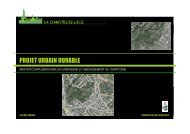Rapport final - LEMA - Université de Liège
Rapport final - LEMA - Université de Liège
Rapport final - LEMA - Université de Liège
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas concret :<br />
Aménagement du site du Val Benoît<br />
<strong>Rapport</strong> sur le cas Local<br />
MCUAT - Cours d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas concret - Année scolaire 2010-2011<br />
ANSAY Robin- CATRACCHIA Vanessa- DUPAIX Thomas- RAHAL Anabelle<br />
1
Table <strong>de</strong>s matières:<br />
1 : SITUATION EXISTANTE:<br />
a) Historique du Val Benoit p. 4<br />
b) Contexte p. 8<br />
2 : Enjeux et objectifs :<br />
a) A l’échelle <strong>de</strong> la ville p.12<br />
b) A l’échelle du site p.15<br />
c) Ecologie industriel p.18<br />
3 : Plan masse et programmation :<br />
a) Critères plan masse p.20<br />
b) Critique du plan masse p.27<br />
4 : Analyse critique :<br />
a) Cartographie <strong>de</strong>s acteurs p.30<br />
b) Les outils urbanistiques p.33<br />
c) Le montage financier p.35<br />
d) Principales leçons p.37<br />
5 : Conclusion<br />
6 : Références<br />
7: Annexes<br />
2
Introduction:<br />
Dans le cadre du cours « étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas concrets », nous sommes amenés, par groupe<br />
d’étudiants <strong>de</strong> diverses formations, à étudier le dossier d’un projet lié à <strong>de</strong>s opérations<br />
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.<br />
Nous avons pris pour thème l’aménagement du site du Val Benoît.<br />
Nous avons eu <strong>de</strong>s difficultés à trouver <strong>de</strong>s documents ayant trait au projet étant donné que le<br />
site du Val Benoît n’en est encore qu’au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> SAR.<br />
Nous avons décidé <strong>de</strong> nous référer aux dossiers déjà élaborés à nos jours, le dossier SAR et le<br />
RIE.<br />
Nous avons obtenus également <strong>de</strong>s documents transmis par la SPI+ qui est en charge du<br />
dossier, tels que : - <strong>de</strong>s fiches d’estimation du prix global <strong>de</strong>s travaux, un historique <strong>de</strong>s<br />
démarches effectuées et <strong>de</strong>s réponses à <strong>de</strong>s questions sur les fonctions qui seront réimplantées<br />
sur le site.<br />
C’est grâce à l’ensemble <strong>de</strong> ces documents que nous avons pu élaborer ce rapport.<br />
Nous avons ensuite enrichi nos données <strong>de</strong>s éléments fournis par les différents intervenants.<br />
(Laurent BRUCK, Cédric SWENNEN et M. CORNESSE)<br />
3
1- Situation existante:<br />
A. Historique du Val Benoit:<br />
Les premières informations concernant le site du Val Benoit remontent à la fin du Moyen-âge. A cette époque, le site était<br />
occupé par une Abbaye Cistercienne et cela jusqu’à la révolution <strong>de</strong> 1796 où une bonne partie <strong>de</strong>s bâtiments a été détruite.<br />
A la fin du 18 ème siècle, la famille Lesoinne rachète le site et s’installe dans les bâtiments <strong>de</strong> l’ancienne Abbaye. Ils y construisent<br />
une ferme et <strong>de</strong>s vergers et détruisent certains bâtiments <strong>de</strong> l’Abbaye pour ne gar<strong>de</strong>r qu’une aile <strong>de</strong> l’ancien monastère.<br />
Au 19 ème siècle, la famille Van <strong>de</strong>r Hey<strong>de</strong>n reprend le site et installe ses quartiers dans le « Château Lamarche », un bâtiment<br />
construit au 18 ème .<br />
C’est au début du 20 ème que l’ULG rachète le site du Val Benoit où elle voit une possibilité d’y implanter les bâtiments <strong>de</strong>stinés<br />
aux sciences et techniques.<br />
Petit à petit, l’université construit son campus scientifique :<br />
1936 : Institut <strong>de</strong> chimie ;<br />
1936 : Laboratoires thermos-dynamique ;<br />
1936 : Institut <strong>de</strong> génie civil ;<br />
1932 : Institut <strong>de</strong> mécanique ;<br />
Pendant la guerre, un nombre important <strong>de</strong> bâtiments est endommagé et détruit.<br />
Après la guerre, l’université envisage la reconstruction <strong>de</strong> ces bâtiments et en construit d’autres vers 1946.<br />
1960 : Institut <strong>de</strong> mathématique ;<br />
1960 : Institut <strong>de</strong> recherche métallurgique ;<br />
En 1960, pour rassembler l’ensemble <strong>de</strong> ses départements au même endroit, l’université déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> déménager et <strong>de</strong> construire<br />
un campus universitaire au Sart Tilman. Les activités du Val Benoît sont transférées à partir <strong>de</strong> 1980 et jusqu’en 1990.<br />
En 2006, le site est occupé sur une partie par le Conservatoire et un autre bâtiment est aménagé par le FOREM. Un permis a été<br />
accordé à la société IMMO-MOURY afin <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s bureaux sur le site. L’ancien institut <strong>de</strong> mécanique est racheté par la<br />
ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> pour y installer une bibliothèque mais ce projet ne voit toujours pas le jour.<br />
Le reste du site est abandonné et se dégra<strong>de</strong> <strong>de</strong> plus en plus.<br />
4
1- Situation existante:<br />
En 2004, une étu<strong>de</strong> Transitec est réalisée autour du site.<br />
Cette étu<strong>de</strong> démontre la saturation du grand rond-point au Sud qui mène vers le centre ville et du petit rond-point au Nord près <strong>de</strong> la<br />
sortie <strong>de</strong> l’autoroute. En résumé, Il y a un besoin important d’une révision <strong>de</strong> la mobilité autour du site du Val Benoît.<br />
En 2008, une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité du site est effectuée. Cette étu<strong>de</strong> soulève les avantages du Val Benoit par son implantation<br />
périurbaine et par sa superficie.<br />
De cette étu<strong>de</strong> se met en place un dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance du site en SAR (site d’activité à réaménagé) en mai 2009.<br />
Ce dossier sera suivi par une définition du périmètre SAR et une étu<strong>de</strong> d’inci<strong>de</strong>nce qui fut fort critiquée par le CWEED pour son<br />
manque <strong>de</strong> clarté.<br />
Le SAR à été accepté en mars 2009, il <strong>de</strong>vrait permettre une reconversion du site tout en gardant les bâtiments existants.<br />
Le 12 janvier 2011, le ministre <strong>de</strong> l’économie M.Marcourt et le ministre <strong>de</strong> l’aménagement du territoire M.Henry, déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> libérer<br />
la somme <strong>de</strong> 20 millions d’euros pour le projet du Val Benoit.<br />
La SPI+ prend le dossier en charge et cherche <strong>de</strong>puis avril 2011 <strong>de</strong>s architectes et urbanistes pour commencer l’élaboration du projet<br />
en lien avec les enjeux et les objectifs développés dans le rapport. Elle met en place un groupe <strong>de</strong> réflexion en mars 2011 pour<br />
s’occuper du dossier.<br />
5
1- Situation existante:<br />
Derrières news sur l’évolution du dossier :<br />
Suite à l’interview <strong>de</strong> Frédéric Van Vloport, administrateur délégué <strong>de</strong> la SPI+, nous avons pu compléter nos données sur<br />
l’évolution du rapport:<br />
L’appel à projet prend en compte le réaménagement <strong>de</strong>s anciens bâtiments <strong>de</strong> l’ULG (surtout celui <strong>de</strong> génie civil qui sera<br />
effectué en premier) ainsi que l’aménagement <strong>de</strong> l’espace intérieur du site et <strong>de</strong>s abords.<br />
« Un parking sera implanté sur le terrain du « Chapiteau ». Ce parking comprendra au rez <strong>de</strong> chaussée un local qui<br />
pourra être utilisé lors <strong>de</strong>s soirées estudiantines. »<br />
-L’appel d’offre à été lancé et la SPI+ à déjà sélectionné douze offres.<br />
-Au mois <strong>de</strong> Juin 2011, ils effectueront, avec l’ai<strong>de</strong> d’un jury présélectionné, une première sélection <strong>de</strong> cinq projets.<br />
-En Octobre 2011, il y aura le choix du projet .<br />
-Les travaux sur le site <strong>de</strong>vront débuter pour 2013.<br />
-Les sociétés ( dont certaines sont déjà choisies) doivent prendre place dans leur bureaux pour 2015.<br />
6
1- Situation existante:<br />
7
1- Situation existante:<br />
B. Contexte :<br />
- Localisation:<br />
Il est important <strong>de</strong> bien remettre le site du Val<br />
Benoit dans son contexte urbain afin <strong>de</strong> bien<br />
comprendre les options prises pour son<br />
réaménagement.<br />
La carte 1, ci-jointe, nous montre la localisation du<br />
site du Val Benoit par rapport au centre <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong><br />
<strong>Liège</strong>.<br />
Sur cette carte figurent également les principaux axes<br />
routiers.<br />
On peut observer que le site du Val Benoit est situé<br />
sur la partie sud <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> et en bordure <strong>de</strong><br />
la partie centrale <strong>de</strong> l’agglomération liégeoise.<br />
Il se trouve sur la marge entre le quartier <strong>de</strong> Sclessin<br />
et le quartier <strong>de</strong> Fragnée.<br />
Le site est à proximité <strong>de</strong> tous les types d’axes<br />
routiers présents sur la carte ainsi qu’en bordure<br />
directe <strong>de</strong> la Meuse.<br />
Carte 1: Situation du Val-Benoit sur la commune <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>. Source : SPI+<br />
8
1- Situation existante:<br />
Comme on peut le voir sur la carte 2, l’étu<strong>de</strong> sur le<br />
développement économique du territoire communal<br />
liégeois réalisée en 2005 par le SEGEFA, le bureau<br />
PLURIS et B. BIANCHET montre que le site du Val<br />
Benoit s’inscrit dans une zone socio-économique,<br />
l’axe Sclessin-Val Benoit, caractérisée par une forte<br />
présence d’activités économiques qui se répartissent<br />
le long <strong>de</strong> cet axe, coincé entre la Meuse et la ligne<br />
<strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer 125 (<strong>Liège</strong>-Namur).<br />
C’est surtout le secteur manufacturier qui a la plus<br />
gran<strong>de</strong> emprise au sol. On trouve ça et là <strong>de</strong> l’habitat<br />
qui se mêle aux fabriques et autres ateliers. On<br />
retrouve également un certain nombre <strong>de</strong> friches sur<br />
cet axe.<br />
Le quartier <strong>de</strong> Fragnée situé en bordure nord du<br />
site concentre lui <strong>de</strong>s fonctions plus typiquement<br />
urbaines comme l’habitat ou encore le commerce <strong>de</strong><br />
détail et les services marchands. De l’autre côté <strong>de</strong> la<br />
Meuse se trouve un petit quartier rési<strong>de</strong>ntiel<br />
d’Angleur, ainsi que la gare <strong>de</strong> triage <strong>de</strong> Kinkempois.<br />
Carte 2: Axe Scelssin-Val Benoit: Vocation fonctionnelle. Source: SEGEFA, PLURIS, B. BIANCHET (2005)<br />
9
1- Situation existante:<br />
- Le site :<br />
• Présentation:<br />
Le site présente une superficie totale <strong>de</strong> 9,28 ha et possè<strong>de</strong> une forme <strong>de</strong> trapèze. Il est constitué d’un ensemble <strong>de</strong> bâtiments<br />
(désaffectés ou occupés), d’espaces verts, <strong>de</strong> parkings et <strong>de</strong> voiries.<br />
Le projet <strong>de</strong> réaménagement concerne l’entièreté du site y compris l’esplana<strong>de</strong> au sud du périmètre. Esplana<strong>de</strong> qui est en<br />
friche une partie <strong>de</strong> l’année, et qui accueille le chapiteau AGEL l’autre partie <strong>de</strong> l’année. Comme le site est un ilot relativement<br />
isolé, le choix du périmètre d’intervention s’imposait <strong>de</strong> lui-même. Les voiries adjacentes au site ne sont bien entendu pas<br />
comprises dans le périmètre du SAR.<br />
De part sa localisation, le site du Val Benoit constitue un site d’entrée <strong>de</strong> ville. En effet, il est visible <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreux points ;<br />
la rive opposée, l’autoroute E25, la ligne <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer, le quai Banning, etc.<br />
Au Nord, le site est séparé du quartier <strong>de</strong> Fragnée par la voie <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer Guillemins – Angleur et par l’autoroute E25.<br />
Il est longé par le Quai Banning (N617) puis par la Meuse à l’est et par la rue Ernest Solvay et la ligne SNCB 125 (<strong>Liège</strong> – Namur)<br />
à l’ouest. On peut donc considérer le Val Benoit comme un ilôt qui ne présente que peu <strong>de</strong> contacts et <strong>de</strong> liaisons avec son<br />
environnement.<br />
Les barrières physiques et psychologiques que représentent la voie fluviale, les voies <strong>de</strong> chemins <strong>de</strong> fer, et les voies rapi<strong>de</strong>s en<br />
cloisonnent le site sur lui même.<br />
•Accès:<br />
L’accessibilité du site peut être considérée comme bonne à première vue.<br />
En effet, la gare TGV <strong>de</strong>s Guillemins se trouve à quelques centaines <strong>de</strong> mètres, les liaisons autoroutières sont nombreuses à<br />
proximité immédiate (sortie « Val Benoit » <strong>de</strong> l’E25), le quai Banning est une voie rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>sservant directement le site et<br />
permettant <strong>de</strong> relier le centre ville ainsi que Sclessin et la ville <strong>de</strong> Seraing, les lignes <strong>de</strong> bus 2, 3, 27 et 58 s’arrêtent Rue Solvay et<br />
<strong>de</strong> nombreuses autres lignes font un arrêt Place Leman à 300 mètres du site. De plus, le projet Tram à <strong>Liège</strong> prévoit un arrêt à<br />
hauteur du Val Benoit pour la ligne reliant Jemeppe à <strong>Liège</strong>.<br />
10
1- Situation existante:<br />
• Informations diverses:<br />
Le site ne comporte pas <strong>de</strong> bâtiments classés, néanmoins on peut i<strong>de</strong>ntifier l’ancien Institut <strong>de</strong> Génie Civil et l’ancien Institut <strong>de</strong><br />
Mécanique comme <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> grand intérêt patrimonial. Le projet vise donc à conserver l’aspect extérieur <strong>de</strong> ces biens.<br />
D’autres bâtiments reçoivent la mention « bien qui mérite protection ». Il s’agit par exemple <strong>de</strong> l’ancien Institut <strong>de</strong> Chimie<br />
Au niveau <strong>de</strong>s équipements, le site est déjà raccordé à tous les réseaux et pourrait, moyennant quelques adaptations convenir<br />
pour ses futures affectations.<br />
Le site est actuellement classé comme une zone <strong>de</strong> services publics et équipements communautaires au plan <strong>de</strong> secteur. Un<br />
projet PCA dérogatoire pour faire passer la zone en zone d’activités économiques mixtes a été initié mais il n’a jamais abouti.<br />
Les différents propriétaires du site ainsi que leur implication seront énumérés dans la partie concernant la cartographie <strong>de</strong>s<br />
acteurs.<br />
11
2- Enjeux et objectifs:<br />
a) Enjeux à l’échelle <strong>de</strong> la ville:<br />
Le dossier <strong>de</strong> SAR a été élaboré en février 2009, par le Département <strong>de</strong> l’urbanisme <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, en concertation<br />
étroite avec la SPI+. Nous trouvons dans celui-ci les principaux enjeux du projet à l’échelle <strong>de</strong> la ville.<br />
« Même si la reconversion <strong>de</strong> certains bâtiments du site en logements peut être envisagée (par exemple en tant que lofts), la<br />
volonté est <strong>de</strong> reconvertir le site essentiellement pour l’accueil d’activités économiques, tel que recommandé dans l’étu<strong>de</strong> du<br />
SEGEFA et selon les volontés publiques <strong>de</strong> maintenir et favoriser l’activité économique en ville. La reconversion <strong>de</strong> bâtiments<br />
existants ou la construction <strong>de</strong> nouveaux bâtiments sera donc en priorité réalisée dans cette direction. » - SAR.<br />
Pourquoi cette volonté <strong>de</strong> favoriser <strong>de</strong> l’activité économique?<br />
En 2005, la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> a commandé une étu<strong>de</strong> sur le développement économique <strong>de</strong> territoire communal à un consortium<br />
réunissant les bureaux SEGEFA-Pluris-Bianchet.<br />
L’objectif <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> était double :<br />
- « réaliser une étu<strong>de</strong> pratique visant à déterminer le type <strong>de</strong> maillage économique souhaité sur le territoire <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> et<br />
le type d’activités à privilégier au sein <strong>de</strong>s quartiers, c’est-à-dire <strong>de</strong>s activités économiques compatibles avec les autres fonctions<br />
<strong>de</strong> la Ville. »<br />
- « Dresser un bilan et émettre <strong>de</strong>s recommandations en vue <strong>de</strong> créer les conditions optimales du développement <strong>de</strong>s entreprises<br />
sur le territoire <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> afin <strong>de</strong> renforcer son attrait. Les éléments <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> se veulent très concrets et opérationnels<br />
pour le territoire <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>. » SAR<br />
L’étu<strong>de</strong> a i<strong>de</strong>ntifié 10 axes <strong>de</strong> développement à privilégier pour l’implantation <strong>de</strong>s activités économiques sur le territoire <strong>de</strong> la<br />
commune (voir la carte ci-jointe). Ces axes correspon<strong>de</strong>nt généralement à <strong>de</strong>s espaces déjà reconnus pour la localisation <strong>de</strong>s<br />
activités et structurés autour d’axes <strong>de</strong> transport majeurs. Les auteurs <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> y ont relevé les opportunités foncières<br />
disponibles. Parmi les quatre axes <strong>de</strong> développement qualifiés <strong>de</strong> prioritaires par les autorités communales se trouve<br />
justement l’axe « Sclessin – Val Benoît ».<br />
12
2- Enjeux et objectifs:<br />
En effet, le site bénéficie <strong>de</strong> nombreux atouts en vue d’une reconversion pour l’accueil d’activités économiques :<br />
•Par sa localisation sur un <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> développement stratégique <strong>de</strong> la Ville, on y repère une excellente accessibilité<br />
(proximité <strong>de</strong> l’autoroute, <strong>de</strong> voies rapi<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> la gare TGV, <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> bus) ;<br />
•Par sa visibilité le long <strong>de</strong>s quais ;<br />
•Par une image emblématique <strong>de</strong> l’ancien campus et <strong>de</strong>s bâtiments conservés ;<br />
•Par la possibilité d’implanter <strong>de</strong>s places <strong>de</strong> parking ;<br />
•Par la présence du centre régional du Forem (avec l’aspect « formation ») ;<br />
•Par la proximité <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> et d’autres écoles supérieures (Hemes, Gramme, Rennequin Sualem), avec lesquelles<br />
<strong>de</strong>s synergies peuvent s’établir;<br />
•Par la cohérence fonctionnelle du site ;<br />
•Par la forte <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s entreprises pour <strong>de</strong>s sites d’installation et déficit actuel <strong>de</strong> l’offre (ex. parc<br />
scientifique actuellement saturé) ;<br />
•Par la volonté <strong>de</strong> la SPI+ et <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> développer <strong>de</strong> nouvelles offres foncières et immobilières pour accueillir <strong>de</strong>s<br />
activités en milieu urbain ;<br />
•Par le soutien du Ministre wallon <strong>de</strong> l’aménagement du territoire à un projet novateur<br />
De plus, la justification <strong>de</strong> la proposition <strong>de</strong> périmètre SAR se fait par les points suivants:<br />
-« Site » : bien immobilier<br />
Il s’agit d’un ancien campus universitaire composé <strong>de</strong> divers bâtiments avec salles <strong>de</strong> cours, bureaux ou locaux<br />
techniques pour la plupart inoccupés aujourd'hui et qui a été ou était <strong>de</strong>stiné à accueillir une autre activité que le<br />
logement.<br />
- « Réaménager un site » :<br />
La non-reconversion <strong>de</strong>s bâtiments à brève échéance risque d’entraîner leur dégradation rapi<strong>de</strong> et une image négative<br />
du quartier et <strong>de</strong> la ville. En outre, plus la requalification sera retardée, plus celle-ci sera difficile et coûteuse à mettre<br />
en place.<br />
13
2- Enjeux et objectifs:<br />
L'intérêt pour les opérateurs et leurs souhaits quant à l'affectation future du site peuvent s’expliquer par les enjeux<br />
du réaménagement du site du Val Benoît. D’une part à l’échelle <strong>de</strong> la ville, il y a les enjeux pour la ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> et la<br />
SPI+. Ces enjeux sont repris dans le tableau suivant :<br />
POUR LA SPI+<br />
développement d’un pôle d’activité<br />
économique fort sur l’agglomération<br />
liégeoise ;<br />
disposer d’une alternative cohérente pour<br />
les activités innovantes et <strong>de</strong> recherche<br />
qui ne peuvent d’implanter sur le site du<br />
parc scientifique ;<br />
proposer une <strong>de</strong>nsité forte d’emploi à<br />
l’hectare ;<br />
développer un projet orienté<br />
«développement durable » ;<br />
donner une image dynamique, positive et<br />
<strong>de</strong> renouveau <strong>de</strong> l’activité économique.<br />
POUR LA VILLE DE LIÈGE<br />
reconvertir un site qui pourrait se transformer<br />
en une friche dégradante ;<br />
dédier un site stratégique remarquablement<br />
situé au sein <strong>de</strong> l’agglomération à l’accueil<br />
d’activités économiques ;<br />
proposer une alternative plus durable aux<br />
parcs d’activités périphériques ;<br />
créer <strong>de</strong>s emplois qualifiés ;<br />
compléter par <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> service public<br />
et du logement et donc donner une<br />
plurifonctionnalité au quartier ;<br />
transformer et valoriser l’image d’un site par<br />
ailleurs doté d’un patrimoine architectural<br />
intéressant, qui sera en partie réaffecté.<br />
14
2- Enjeux et objectifs:<br />
b) Enjeux à l’échelle du site :<br />
D’autre part à l’échelle du site même, plusieurs enjeux existent également:<br />
-La situation du site dans une zone agglomérée :le site est une « porte d’entrée » <strong>de</strong> la ville en venant<br />
<strong>de</strong> l’amont <strong>de</strong> la Meuse et il constitue une transition entre <strong>de</strong>s quartiers rési<strong>de</strong>ntiels et l’axe<br />
d’entreprises existant. Il prend en compte le souci d’économie <strong>de</strong> « sol ».<br />
-L’impact socio-économique du réaménagement du site : Les espaces disponibles sur le site peuvent<br />
servir d’accueil pour les activités économiques et les services. Le site pourrait accueillir plus <strong>de</strong> 1500<br />
emplois.<br />
-L’accessibilité : Un accès quasi immédiat à la liaison autoroutière E25-E40. De même, il existe une<br />
connexion rapi<strong>de</strong> vers le centre-ville via les quais et la <strong>de</strong>sserte du Val Benoît par les transports en<br />
commun. Le projet <strong>de</strong> ligne <strong>de</strong> tram <strong>de</strong>vrait améliorer la qualité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sserte du site par les<br />
transports en commun. Par contre, l'accessibilité <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s doux n'est pas optimale : le site est<br />
excentré et il constitue un îlot nécessitant <strong>de</strong>s parcours et franchissements <strong>de</strong> voiries compliqués.<br />
Enfin, la nécessité <strong>de</strong> prendre en compte les flux actuels sur les voiries proches du site.<br />
-Les équipements en infrastructures existantes : La plupart <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte sont déjà<br />
présents.<br />
-Le potentiel <strong>de</strong> reconversion en logements : La reconversion en logements <strong>de</strong> certains bâtiments peut<br />
être envisagée. D’après <strong>de</strong>s investisseurs ayant marqué leur intérêt, l’ancien institut <strong>de</strong> chimiemétallurgie<br />
pourrait se prêter à une reconversion en lofts.<br />
- Le potentiel <strong>de</strong> reconversion en zone d’activités économiques mixtes : le site bénéficie <strong>de</strong><br />
nombreux atouts en vue d’une reconversion pour l’accueil d’activités économiques, comme vu<br />
précé<strong>de</strong>mment : la possibilité d’implanter <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> parking, avec <strong>de</strong>s opérations déjà initiées :<br />
centre régional du Forem, projet <strong>de</strong> bureaux par la société CFE-Moury, archives et dépôt muséal <strong>de</strong> la<br />
ville dans l’ancien institut <strong>de</strong> mécanique.<br />
15
2- Enjeux et objectifs:<br />
Un autre document important, le <strong>Rapport</strong> d'Impact sur l'Environnement (Document coordonné par l’Atelier d’Architecture<br />
LEJEUNE-GIOVANELLI sprl, avec le concours <strong>de</strong> AWP+ e, la ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, la SPI+, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mobilité<br />
TRANSITEC, SEGEFA, PLURIS, en Février 2009) offre également la justification du réaménagement du site par les besoins<br />
suivants :<br />
1. Les besoins sociaux : La réappropriation d’un site en friche ,le risque <strong>de</strong> dégradation rapi<strong>de</strong> et plus d’offres d’emplois sur le<br />
territoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>. Ainsi que la création <strong>de</strong> logements <strong>de</strong> qualité, visant un retour <strong>de</strong> la classe moyenne.<br />
2. Les besoins économiques : La création d’espaces pour l’activité au cœur <strong>de</strong> l’agglomération liégeoise, avec une nouvelle<br />
possibilité d’accueil pour <strong>de</strong>s entreprises .<br />
La recherche d’une alternative aux parcs d’activités <strong>de</strong> type périphérique et le refus du commerce <strong>de</strong> gros ou <strong>de</strong> détail pour protéger<br />
les polarités commerciales existantes. Enfin, une mixité <strong>de</strong>s fonctions est à privilégier (activités économiques, logements,<br />
équipements communautaires, services), en réponse aux objectifs du SDER.<br />
3. Les besoins <strong>de</strong> mobilité : La création <strong>de</strong> cheminements piétons mais également profiter <strong>de</strong> la localisation à proximité <strong>de</strong> la gare <strong>de</strong><br />
<strong>Liège</strong> Guillemins et d’arrêts <strong>de</strong> bus TE C, <strong>de</strong> la localisation à proximité du RAVEL et la proximité <strong>de</strong> voiries à gabarit suffisant.<br />
4. Les besoins patrimoniaux : La réaffectation <strong>de</strong> certains bâtiments remarquables qui sont un plus pour le patrimoine <strong>de</strong> la ville :<br />
l’ancien institut <strong>de</strong> mécanique et l’ancien institut <strong>de</strong> génie civil. L’utilisation <strong>de</strong> l’emblématique du site au niveau <strong>de</strong> l’agglomération<br />
liégeoise. Sa réaffectation encourage la pérennisation d’un patrimoine social.<br />
5. Les besoins environnementaux : La création <strong>de</strong> nouveaux espaces publics : voiries, aires <strong>de</strong> stationnement, plantations, couloir «<br />
vert » correspondant à la liaison piétonne. L’accueil sur le site d’activités compatibles avec le milieu urbain et les espaces rési<strong>de</strong>ntiels<br />
voisins.<br />
6. La gestion qualitative du cadre <strong>de</strong> vie : Amélioration du cadre <strong>de</strong> vie par la conversion d’un site en cours d’abandon et par la<br />
possibilité <strong>de</strong> fournir un traitement qualitatif <strong>de</strong>s nouveaux aménagements. Ainsi que par l’accueil d’activités économiques peu<br />
perturbantes au niveau du voisinage, par ailleurs, localisées sur un site naturellement isolé <strong>de</strong>s quartiers <strong>de</strong>nses d’habitat par les voies<br />
d’accès qui le bor<strong>de</strong>nt.<br />
7. L’utilisation parcimonieuse du sol et <strong>de</strong> ses ressources : La réhabilitation optimum du site et <strong>de</strong>s bâtiments existants donc une<br />
économie d’espace assurée.<br />
8. La performance énergétique <strong>de</strong> l’urbanisation et <strong>de</strong>s bâtiments : La réduction <strong>de</strong>s démolitions et la diminution <strong>de</strong> la<br />
consommation <strong>de</strong> matières premières liées à la construction. De plus, la construction <strong>de</strong>s nouveaux bâtiments sur base <strong>de</strong> normes<br />
économes en énergie et l’amélioration du niveau d’isolation énergétique <strong>de</strong>s bâtiments à rénover.<br />
9. La conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager : La rénovation <strong>de</strong> bâtiments remarquables avec<br />
un fort potentiel patrimonial et le choix d’une architecture contemporaine <strong>de</strong> qualité pour les nouveaux bâtiments.<br />
16
2- Enjeux et objectifs:<br />
Ces besoins ont aidé à définir les objectifs suivants pour la protection <strong>de</strong> l’environnement, dans le cadre du<br />
réaménagement du site (<strong>de</strong> même d’après le RIE) :<br />
1. L’utilisation parcimonieuse du sol<br />
L’accueil d’activités économiques sur le site du Val Benoît apporte une économie d’utilisation d’espace appréciable.<br />
2. Une amélioration <strong>de</strong> la biodiversité est visée, via : le maintien <strong>de</strong>s arbres intéressants au niveau botanique et paysager,<br />
l’élimination <strong>de</strong>s espèces végétales invasives et l’augmentation <strong>de</strong>s superficies d’espaces verts,<br />
3. L’intégration paysagère : sans <strong>de</strong>s modifications importantes du relief du sol, avec une architecture contemporaine <strong>de</strong> qualité<br />
<strong>de</strong>s nouveaux bâtiments et<br />
une réaffectation et un traitement homogène <strong>de</strong>s abords du site l’inscriront comme un îlot vert en bord <strong>de</strong> Meuse.<br />
4. La gestion <strong>de</strong>s eaux : La mise en place <strong>de</strong> revêtements perméables au niveau <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> stationnement et <strong>de</strong>s<br />
cheminements internes, et l’augmentation <strong>de</strong>s superficies d’espaces verts et la possibilité <strong>de</strong> créer un plan d'eau alimenté par<br />
l'eau <strong>de</strong> pluie récupérée.<br />
5. La mobilité : Les accès au site sans danger et <strong>de</strong>s chemins pé<strong>de</strong>stres et cyclables seront créés à travers le site. Enfin, le<br />
report du stationnement en périphérie du site, ce qui sécurise les usagers internes.<br />
6. La performance énergétique <strong>de</strong> l’urbanisation et <strong>de</strong>s bâtiments : Une réaffectation maximum <strong>de</strong>s bâtiments existants, ce qui<br />
réduit les démolitions et diminue la consommation <strong>de</strong> matières premières liées à la construction.<br />
Les nouveaux bâtiments seront construits sur base <strong>de</strong> normes économes en énergie.<br />
7. Les nuisances sonores : Les fonctions prévues ne seront pas génératrices <strong>de</strong> bruits nuisibles et le site bénéficie d’un certain<br />
isolement, vu qu’il est délimité par <strong>de</strong>s axes routiers importants qui font écran.<br />
A l’intérieur du site, les espaces verts constitueront en outre <strong>de</strong>s zones tampons et les activités potentiellement un peu<br />
bruyantes seront installées dans la partie la plus éloignée <strong>de</strong>s logements.<br />
8. La promotion du développement durable : Une charte <strong>de</strong> développement durable sera définie, à laquelle les occupants<br />
seront invités à adhérer. Elle visera le développement durable dans la vie <strong>de</strong> l’entreprise (processus <strong>de</strong> production,…).<br />
17
2- Enjeux et objectifs:<br />
c) Ecologie industrielle:<br />
- Le concept éco-zoning développé à la CPDT:<br />
La recherche effectuée par la CPDT se base sur l’observation du système mis en place dans d’autres égions pour comprendre le<br />
fonctionnement et l’adapter au futur projet wallon.<br />
L’écologie industrielle apparait comme un principe d’organisation qui vise une adaptation du zoning pour être le plus économe<br />
possible dans sa gestion <strong>de</strong>s déchets et <strong>de</strong> l’énergie. Les surplus <strong>de</strong> déchets et d’énergie fournie par une entreprise seront<br />
considérés comme recyclables pour être utilisés par les autres entreprises du zoning.<br />
« Les échanges inter-entreprise sont génèrent <strong>de</strong> nouvelles activités <strong>de</strong> reconditionnement et <strong>de</strong> recyclage qui entraine la création<br />
<strong>de</strong> nouveaux emplois peu qualifiés. »1<br />
Pour que le concept fonctionne, il faut une collaboration <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong>s entreprises sur le site . Certains zonings mettent en<br />
place <strong>de</strong>s associations qui se chargent <strong>de</strong> gérer et d’i<strong>de</strong>ntifier les<br />
sources potentielles d’énergie comme « Ecopal » à Dunkerke1.<br />
La synergie éco-industrielle se caractérise par une vision à long<br />
terme <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s flux.<br />
1- Texte tiré du dossier <strong>de</strong> la CPDT: « éco-quartier, éco-zoning, <strong>de</strong>ux concept d’avenir », disponible sur le site , WWW.CPDT.be<br />
1<br />
1<br />
18
2- Enjeux et objectifs:<br />
La CPDT tente <strong>de</strong> mettre en place <strong>de</strong>s critères à prendre en compte pour définir ce qu’est un éco-zoning mais également où il<br />
serait possible <strong>de</strong> le mettre en place.<br />
Il est néanmoins compliqué d’élaborer une définition précise car chaque zone économique est différente par sa localisation, par<br />
sa superficie, par sa mobilité,….<br />
La CPDT s’est donc basé sur <strong>de</strong>s exemples fournis par <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s aux Pays-Bas et en Flandre. A Bruxelles, on parle <strong>de</strong> plus en plus<br />
d’entreprises « éco-dynamique », « même si l’échelle est celle <strong>de</strong> l’entreprise et non du zoning, la préoccupation est semblable:<br />
dépasser la diversité <strong>de</strong>s profils. »1<br />
La CPDT élabore toujours sa grille d’évaluation , la recherche est toujours en cours.<br />
Le concept d’éco-zoning a été cité dans le<br />
cadre du dossier du Val Benoît.<br />
La volonté est <strong>de</strong> mettre en relation les<br />
différentes entreprises qui s’implanteront<br />
dans les différents bâtiments du site.<br />
1- Texte tiré du dossier <strong>de</strong> la CPDT: « éco-quartier, éco-zoning, <strong>de</strong>ux concept d’avenir », disponible sur le site , WWW.CPDT.be<br />
1<br />
19
3- Plan masse et programmation:<br />
a) Critères du plan masse:<br />
- Les affectations actuelles:<br />
Le dossier SAR et le RIE nous fournissent les informations<br />
suivantes :<br />
Actuellement, les affectations du site sont les suivantes :<br />
L’ancien institut <strong>de</strong> mathématique et l’ancienne abbaye<br />
accueillent les bureaux <strong>de</strong> l’administration régionale du<br />
Forem.<br />
Le bâtiment bas voisin <strong>de</strong> la tour du Forem comprend <strong>de</strong>s<br />
locaux <strong>de</strong>stinés aux cours du conservatoire.<br />
Le centre <strong>de</strong> recherche métallurgique appartient à la<br />
société CFE Immo – MOURY. La société possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
permis datant d’octobre 2003 et d’août 2004. Ces permis<br />
permettent la transformation et l’extension <strong>de</strong>s bureaux.<br />
Les travaux n’ont pas encore commencé.<br />
Les bâtiments suivants ont été démolis : halls d’essais,<br />
château Lamarche, hangars, restaurant « La Mazon »…<br />
Les autres bâtiments sont vi<strong>de</strong>s ou pratiquement vi<strong>de</strong>s :<br />
institut <strong>de</strong> génie civil, institut <strong>de</strong> métallurgie, institut <strong>de</strong><br />
mécanique, bâtiment technifutur, chaufferie, potence,<br />
accélérateur Van <strong>de</strong> Graaf,...<br />
1 – <strong>Rapport</strong> SAR - Dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance<br />
Image 1: Vue aérienne du site du Val Benoit. Source: SPI+<br />
Image 1: Vue aérienne du site du Val Benoit. Source: SPI+<br />
1 : Institut <strong>de</strong> chimie et <strong>de</strong> métallurgie, 2 : Institut <strong>de</strong> génie civil, 3 : Institut<br />
<strong>de</strong> mécanique, 4 : Centrale thermoélectrique ,5 : Abbaye (Forem) ,6 :<br />
Poterne, 7 : Centre <strong>de</strong> recherche métallurgique (CRM), 8 : Institut <strong>de</strong><br />
mathématique (Forem)1<br />
20
3- Plan masse et programmation:<br />
- Les objectifs généraux:<br />
Les objectifs généraux 1 tels qu’énoncés dans le dossier <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong> SAR sont les suivants :<br />
Développer un pôle d’activités économiques sur un site stratégique remarquablement situé au sein <strong>de</strong> l’agglomération, avec<br />
notamment un centre d’entreprises ;<br />
Développer un parc d’activités en milieu urbain qui soit une solution innovante alternative aux parcs d’activités<br />
périphériques, avec notamment une <strong>de</strong>nsité d’occupation du sol beaucoup plus forte : ce « parc d’activités vertical »<br />
accueillerait 700 emplois sur 2,7 ha <strong>de</strong> superficie plancher disponible dédiée à l’activité économique pour une emprise au sol<br />
d’environ 7 000 m² (car l’occupation <strong>de</strong>s bâtiments se fait entre 3 et 5 niveaux). Dans un parc d’activités périphérique<br />
traditionnel tel les Hauts-Sarts, une superficie foncière valorisable <strong>de</strong> 35 ha serait nécessaire pour le même nombre d’emplois.<br />
Dans un parc d’activités tel le parc scientifique, plus comparable au niveau du profil <strong>de</strong>s entreprises, une superficie foncière<br />
valorisable <strong>de</strong> 9 ha serait nécessaire pour le même nombre d’emplois;<br />
Viser une mixité, en complétant ces activités économiques par <strong>de</strong>s services, <strong>de</strong>s équipements communautaires et <strong>de</strong>s<br />
logements, ceci afin <strong>de</strong> rechercher <strong>de</strong>s "ancrages" avec les zones rési<strong>de</strong>ntielles voisines et <strong>de</strong> faciliter les mo<strong>de</strong>s opératoires<br />
(partenariat, délais <strong>de</strong> mise en œuvre, financements, etc.) ;<br />
Développer un site dont l’aménagement serait un modèle sur le plan du développement durable (les entreprises signeront<br />
une charte <strong>de</strong> développement durable) ;<br />
Transformer et valoriser l’image d’un site par ailleurs doté d’un patrimoine architectural intéressant, qui sera rénové et<br />
réaffecté ;<br />
Réaliser un aménagement <strong>de</strong> qualité qui donne une plus-value globale au site ainsi qu’à chacune <strong>de</strong> ses composantes;<br />
Viser en priorité la rénovation - réaffectation du bâti existant avant le développement <strong>de</strong> nouvelles constructions.<br />
Ces objectifs sont les orientations que la SPI+ désire mettre en œuvre pour la réalisation <strong>de</strong> cette zone d’activités<br />
économiques. Néanmoins, le dossier <strong>de</strong> SAR va plus loin dans la <strong>de</strong>scription du projet et donne plus <strong>de</strong> précisions sur les<br />
affectations souhaitées.<br />
1 – <strong>Rapport</strong> SAR - Dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance<br />
21
3- Plan masse et programmation:<br />
- Les affectations souhaitées:<br />
La volonté <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> ce site un site mixte s’exprime par plusieurs fonctions souhaitées sur le site<br />
La <strong>de</strong>scription qui suit est tirée du dossier SAR <strong>de</strong> février 2009.<br />
• Des activités économiques:<br />
L’objectif central est l’aménagement d’un parc d’activités économiques. Le projet envisage donc <strong>de</strong> mettre en place <strong>de</strong>s locaux à<br />
<strong>de</strong>stination d’entreprises, en particulier dans les anciens instituts <strong>de</strong> génie civil et <strong>de</strong> chimie/métallurgie reconvertis. Les activités<br />
économique se situeraient donc uniquement dans le sud du site et seraient séparées du reste du site par le parc. On peut également<br />
envisager <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> recherche en lien avec ces activités. Des lieux <strong>de</strong> stockage et <strong>de</strong> livraison communs sont également prévus.<br />
La nature du site et les options prises pour son aménagement font que les catégories d’entreprises visées sont restreintes.<br />
On peut citer par exemple :<br />
-Des PME et <strong>de</strong>s TPE ;<br />
-Des entreprises travaillant dans les secteurs <strong>de</strong> pointe, les nouvelles technologies (complément au parc scientifique du Sart<br />
Tilman) ;<br />
-Des spin-offs (entreprises nées dans le giron <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong>), <strong>de</strong>s entreprises travaillant avec <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> recherche ;<br />
-Des entreprises orientées vers le développement durable dans leur production et/ou leur processus <strong>de</strong> fabrication (refus<br />
d’activités polluantes ou générant <strong>de</strong>s nuisances importantes).<br />
Un <strong>de</strong>s aspects intéressant du dossier est qu’il est prévu que toutes les entreprises accueillies sur le site <strong>de</strong>vront s’engager à signer une<br />
charte <strong>de</strong> durabilité (ou charte <strong>de</strong> développement durable). Cette charte portera sur les aménagements du site, aménagements <strong>de</strong>s<br />
locaux et <strong>de</strong> leurs abords, processus <strong>de</strong> fabrication, réalisation d’économies d’énergie, utilisation <strong>de</strong>s transports en commun,<br />
mutualisation <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> stockage, présence d’un conciliateur DD, etc.<br />
Cette charte pourrait être intéressante concernant les problèmes <strong>de</strong> mobilité autour du site. En effet, si la charte oblige un certain<br />
pourcentage <strong>de</strong>s employés à venir en transport en commun, l’impact <strong>de</strong> l’augmentation du nombre d’emplois sur le site pourrait être<br />
limité.<br />
De plus, la situation du site en tissu urbanisé et la volonté d’y implanter <strong>de</strong>s logements fait que les entreprises visées <strong>de</strong>vraient être le<br />
moins nuisibles possible. Et ce, autant en terme <strong>de</strong> bruit que <strong>de</strong> pollution olfactive et visuelle.<br />
22
3- Plan masse et programmation:<br />
• Des bureaux:<br />
Les bureaux constitueraient la secon<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> catégorie d’activités sur le site. Les avantages du site pour les activités économiques<br />
sont tout autant valables que pour les bureaux (localisation, image du site). Les bureaux seront situés dans l’espace Nord-ouest du site,<br />
entre la porterie et la zone du Forem. Les locaux correspondants pourraient accueillir <strong>de</strong>s entreprises privées du secteur tertiaire mais<br />
aussi <strong>de</strong>s services publics, voire <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> productions très légères ne générant pas <strong>de</strong> nuisances.<br />
La surface <strong>de</strong> bureaux est volontairement limitée afin <strong>de</strong> ne pas concurrencer le pôle bureaux qui doit se développer sur l’esplana<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Guillemins.<br />
• Des services:<br />
Les services envisagés sont <strong>de</strong>s services qui pourraient faciliter la vie <strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s habitants.<br />
On peut citer par exemple :<br />
- Des services communs pour les entreprises : comptoir d’accueil et <strong>de</strong> réception, cafétéria, bibliothèque, salles <strong>de</strong><br />
réunions… ;<br />
- Des services pour les employés, les visiteurs et les habitants : librairie, centre d’information sur la démarche<br />
développement durable du site et <strong>de</strong> ses occupants, restaurant, centre <strong>de</strong> fitness, halte-gar<strong>de</strong>rie, crèche, point poste… ;<br />
- Une fonction hôtelière éventuelle. 1<br />
On peut noter qu’avec le Forem et le Conservatoire, il y a déjà <strong>de</strong>s services publics sur le site. L’institut <strong>de</strong> mécanique, bâtiment<br />
appartenant à la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, a fait l’objet d’un projet <strong>de</strong> centre d’archives et <strong>de</strong> dépôt muséal. La Ville n’a pu obtenir <strong>de</strong>s fonds que<br />
pour la mise hors-eaux du bâtiment et on semble se diriger vers un arrangement entre la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> et la SPI+ pour que celle-ci<br />
prenne en charge la future affectation du bâtiment.<br />
L’affectation future <strong>de</strong> la centrale thermoélectrique n’est pas encore déterminée mais <strong>de</strong>s pistes concernant un bâtiment à caractère<br />
culturel et éducatif ont été émises.<br />
La fonction commerciale est globalement exclue du site. Si ce n’est <strong>de</strong>s commerces <strong>de</strong> proximité pour les employés du site et les<br />
habitants (boulangerie, supérette, librairie, etc.).<br />
La localisation <strong>de</strong>s services se fera en fonction du type <strong>de</strong> service considéré et ceux-ci se répartiront sur la quasi-totalité du site.<br />
1 – Résumé du <strong>Rapport</strong> SAR - Dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance<br />
23
3- Plan masse et programmation:<br />
• Le logement:<br />
Le logement est la fonction la plus discutable du projet. En effet, le caractère d’îlot isolé <strong>de</strong>s quartiers environnants ainsi que certains<br />
éléments perturbateurs comme les voies <strong>de</strong> chemins <strong>de</strong> fer, l’autoroute ne semblent pas très en faveur d’un habitat attractif et <strong>de</strong><br />
qualité. Néanmoins, plusieurs arguments plai<strong>de</strong>nt pour la présence <strong>de</strong> logement :<br />
- assurer la plurifonctionnalité du site, combiner plusieurs fonctions complémentaires ;<br />
- veiller à une animation du site lors <strong>de</strong> la fermeture <strong>de</strong>s entreprises ;<br />
- appliquer la philosophie prônée par la Région wallonne pour l’aménagement <strong>de</strong>s SAR ;<br />
- rechercher <strong>de</strong>s "ancrages" avec les zones rési<strong>de</strong>ntielles voisines ;<br />
- faciliter les mo<strong>de</strong>s opératoires (partenariat, délais <strong>de</strong> mise en œuvre, financements, etc.)…1<br />
Ces logements seront situés au nord <strong>de</strong> l’espace vert central, afin d’assurer une liaison cohérente avec les habitations <strong>de</strong> l’avenue <strong>de</strong>s<br />
Tilleuls. Ils peuvent prendre place soit dans <strong>de</strong>s nouveaux bâtiments (solution préférée par les grands acteurs), soit dans <strong>de</strong>s bâtiments<br />
existants reconvertis. L’étu<strong>de</strong> consacrée au développement économique du territoire communal et l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité<br />
d’aménagement du site du Val Benoît plai<strong>de</strong>nt pour une limitation du nombre <strong>de</strong> logements (une centaine) afin <strong>de</strong> conserver la<br />
<strong>de</strong>stination principale du site pour les activités économiques.<br />
• Les espaces verts:<br />
Le projet du réaménagement du Val Benoit présente un caractère « vert » comme en témoigne la charte durabilité, la conservation<br />
du bâti existant, minimisation <strong>de</strong>s traversées <strong>de</strong> véhicules lourds à l’intérieur du site.<br />
Dans cette optique, une <strong>de</strong>s options d’aménagement prise est <strong>de</strong> créer une « coulée verte » qui traverse le site <strong>de</strong> part en part (du<br />
nord au sud). Cette coulée verte s’articule autour du parc <strong>de</strong> l’abbaye déjà présent.<br />
Cette coulée verte correspond également aux zones <strong>de</strong> mobilité douce.<br />
1 – <strong>Rapport</strong> SAR - Dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance<br />
24
3- Plan masse et programmation:<br />
a) Critiques du plan masse:<br />
Plan 1: Plan <strong>de</strong> composition urbanistique (phase 1). Source : SPI+<br />
25
3- Plan masse et programmation:<br />
a) Critiques du plan masse:<br />
Plan 2: Plan <strong>de</strong> composition urbanistique (phase 2). Source SPI+<br />
26
3- Plan masse et programmation:<br />
b) Critiques du plan masse:<br />
Les plans 1 et 2 montrent les options d’aménagements prises pour les <strong>de</strong>ux phases <strong>de</strong> réalisation du projet. On y<br />
retrouve les différentes affectations <strong>de</strong>s bâtiments ainsi que les aménagements connexes d’accès, <strong>de</strong> stationnement et<br />
les espaces verts.<br />
La localisation <strong>de</strong>s différentes fonctions a été pensée en lien avec les environs directs du site :<br />
- La fonction rési<strong>de</strong>ntielle se retrouve au nord du site (en rose pale sur les plans) afin <strong>de</strong> faire le lien avec le quartier<br />
<strong>de</strong> Fragnée. Cette localisation parait logique pour faciliter l’ancrage du Val Benoit avec son environnement, cependant<br />
on remarque que cette zone d’habitat jouxte directement l’autoroute avec les désagréments que cela suppose (bruit,<br />
pollution, impact visuel négatif). A l’intérieur du site, la zone d’habitat est entourée par une zone <strong>de</strong> bureaux (en bleu<br />
sur les plans), le bâtiment du Forem et le parc central. On peut donc dire que l’idée d’implanter <strong>de</strong> l’habitat nous<br />
semble bonne, il faut être pru<strong>de</strong>nt face à cette proximité <strong>de</strong> l’autoroute pour ne pas dégra<strong>de</strong>r trop la qualité <strong>de</strong> vue sur<br />
le site.<br />
La partie sud du site accueille les activités économiques <strong>de</strong> production et les services. Ceci permet <strong>de</strong> faire le lien avec<br />
le quartier manufacturier <strong>de</strong> Sclessin.<br />
- L’implantation <strong>de</strong>s parkings se fait tout autour du site, on n’en retrouve pas à l’intérieur du site. Si la phase <strong>de</strong>ux voit<br />
le jour, un parking sera même supprimé sur l’esplana<strong>de</strong> sud afin d’y construire <strong>de</strong>s bureaux. Il nous semble que compte<br />
tenu du nombre d’emplois prévus sur le site, le nombre <strong>de</strong> parkings sera tout juste suffisant. Néanmoins, il est vrai que<br />
dans l’optique « verte » du réaménagement du site, il faut dans une certaine mesure encourager les employés et<br />
habitants à rejoindre le site en transport en commun. Proposer une offre en parkings voiture limitée est une <strong>de</strong>s<br />
stratégies.<br />
- Les accès directs au site <strong>de</strong>puis le quai Banning et la rue Ernest Solvay ne nous semblent pas très bien conçus. En<br />
effet, le quai Banning est déjà un axe surchargé en heure <strong>de</strong> pointe et nous pensons qu’y rajouter un feu au niveau <strong>de</strong><br />
l’entrée du site (point rouge sur les plans) ne fera qu’augmenter les perturbations routières autour du site. De plus, on<br />
voit qu’il ne sera pas possible <strong>de</strong> rentrer à l’intérieur du site via le quai Banning pour les véhicules venant du rond-point<br />
sud-est. Pourquoi alors y implanter un feu rouge ? L’accès rue Ernest Solvay nous a été présenté comme l’entrée pour<br />
poids-lourds du Val Benoit. On peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r pourquoi la zone <strong>de</strong> stockage se trouve alors <strong>de</strong> l’autre coté du site.<br />
27
3- Plan masse et programmation:<br />
- On peut aussi discuter <strong>de</strong>s espaces verts. Il est question d’une « coulée verte » qui traverserait le site <strong>de</strong> part en part<br />
selon un axe nord-sud. Or, force est <strong>de</strong> constater que les espaces verts ne s’organisent pas vraiment en coulée et sont<br />
concentrés dans la partie sud du site. On peut néanmoins pointer la bonne utilisation du parc déjà existant comme<br />
zone tampon entre les activités économiques et la zone d’habitat afin <strong>de</strong> réduire les nuisances.<br />
L’accessibilité actuelle du site est intéressante mais après l’aménagement du site, celle-ci pourrait poser plusieurs<br />
problèmes<br />
En effet, l’étu<strong>de</strong> Transitec <strong>de</strong> 2004 met en évi<strong>de</strong>nce le fait que la plupart <strong>de</strong>s carrefours et giratoires autour du site sont<br />
soit proches <strong>de</strong> la saturation, soit dors et déjà saturés. Le rond-point entre le quai et la Rue Stévart présente par<br />
exemple <strong>de</strong>s saturations <strong>de</strong> 120% et 115% respectivement aux heures <strong>de</strong> pointe du matin et du soir avec plusieurs<br />
centaines <strong>de</strong> mètres <strong>de</strong> files. Les nombreux véhicules qui seront amenés sur le site ne feront que renforcer cette<br />
saturation <strong>de</strong>s voies d’accès.<br />
L’argument du passage du Tram à côté du Val Benoit nous a souvent été présenté comme la solution aux problèmes<br />
que risquent <strong>de</strong> poser l’augmentation du nombre d’emplois sur le site. Cet argument nous semble un peu léger dans la<br />
mesure où les personnes travaillant sur le site seront majoritairement <strong>de</strong>s employés et <strong>de</strong>s cadres. Or ce ne sont pas<br />
précisément la catégorie socio-économique utilisant les transports en commun.<br />
L’accès piéton présente à l’heure actuelle quelques points noirs. Du côté <strong>de</strong> la rue Solvay, le pertuis sous la voie SNCB<br />
n°125 n’est pas <strong>de</strong>s plus agréable. Le tunnel sous les voies <strong>de</strong> chemins <strong>de</strong> fer <strong>de</strong>puis la place Leman n’est également<br />
pas très agréable. Sur le Quai Banning, la traversée piétonne <strong>de</strong>s bretelles d’accès à l’E25 se révèle particulièrement<br />
longue et insécurisante. Il faudrait donc envisager un aménagement <strong>de</strong> ces accès piétons au site afin d’en faciliter<br />
l’accès dans l’optique du réaménagement du site.<br />
Pour les cyclistes, il n’y a que le Ravel qui longe le site à partir du pertuis sous la rue Ernest Solvay puis qui emprunte la<br />
passerelle qui enjambe l’E25. Il n’existe aucune infrastructure côté Quai Banning, ou rue Armand Stévart. Si on veut<br />
donner une dimension verte au site, il nous semble très important <strong>de</strong> ne pas négliger ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> déplacement autour<br />
du site, mais également à l’intérieur <strong>de</strong> celui-ci.<br />
28
4- Analyse critique :<br />
a) Cartographie <strong>de</strong>s acteurs:<br />
L’acteur principal du projet est la SPI+, qui en a la charge et a<br />
mis en place le projet <strong>de</strong> reconversion du site.<br />
C’est donc la SPI+ qui a eu pour mission <strong>de</strong> définir ce qui<br />
allait être fait, et qui contacte ou embauche les acteurs<br />
nécessaires au bon déroulement <strong>de</strong> l’opération. Au sein <strong>de</strong> la<br />
SPI+, la gestion est confiée au pôle « aménagement du<br />
territoire ». La prise en main du projet par la SPI+ n’a pas été<br />
imposée ou <strong>de</strong>mandée par quiconque.<br />
Une discussion avec Françoise Lejeune (DG SPI+) nous<br />
apprend que cela s’est fait <strong>de</strong> manière informelle, en parlant<br />
avec d’autres acteurs <strong>de</strong> la politique ou <strong>de</strong> l’urbanisme<br />
Liégeois lors <strong>de</strong> l’une ou l’autre réunion.<br />
La mission <strong>de</strong> la SPI + est donc <strong>de</strong> mener à bien le projet, du<br />
début à la fin.<br />
Elle a donc fait faire le dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> SAR, elle prend<br />
les décisions stratégiques sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> la zone, elle choisit<br />
un auteur <strong>de</strong> projet (actuellement, en avril 2011, le marché est<br />
en cours et en est à la phase <strong>de</strong> présélection <strong>de</strong>s auteurs <strong>de</strong><br />
projets potentiels)… Et une fois les travaux terminés, elle sera<br />
chargée <strong>de</strong> la gestion du nouveau parc industriel. Pour bien<br />
encadrer le projet, un groupe <strong>de</strong> réflexion interne à la SPI+<br />
vient d’être créé (mars 2011).<br />
29
4- Analyse critique :<br />
L’université <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> est un autre acteur important du projet. En effet, c’est le propriétaire original du site (en rouge sur la carte ci<strong>de</strong>ssous),<br />
et l’ULg restera propriétaire <strong>de</strong> la centrale thermoélectrique, qu’elle <strong>de</strong>vrait réhabiliter au cours du projet, dans un but encore<br />
assez flou.<br />
En tant que propriétaire original du site et futur cohabitant, l’ULg est donc un acteur important, même si elle reste assez en retrait dans la<br />
réhabilitation du Val Benoit. L’université, une fois ses terrains et bâtiments vendus, restera membre d’un comité consultatif mis en place<br />
pour la suite du projet (consultations quant aux décisions stratégiques).<br />
La société Moury possè<strong>de</strong> également une parcelle du site (en brun sur la carte ci-<strong>de</strong>ssous). Moury, en association avec CFE, aurait pour<br />
projet <strong>de</strong> construire <strong>de</strong>s bureaux pour installer le siège social <strong>de</strong> Cockerill au Val Benoit. Moury est donc également un acteur important<br />
du projet, puisque il y a une collaboration à mettre en place afin <strong>de</strong> rénover et développer le site <strong>de</strong> manière cohérente. Moury, comme<br />
l’ULg, fera partie du comité <strong>de</strong> consultation.<br />
Autre acteur déjà présent sur le site, le Forem possè<strong>de</strong> également une parcelle et un bâtiment, <strong>de</strong> même que la communauté française<br />
qui y a son conservatoire.<br />
Il n’y a pas <strong>de</strong> changement prévu quant au statut <strong>de</strong> ces acteurs ou <strong>de</strong> leurs possessions, mais il faudra cohabiter avec eux sur le site du<br />
Val Benoit, et il est donc important qu’ils collaborent également au projet, vu que c’est tout leur environnement qui va être rénové. Ils<br />
seront donc également membre du comité consultatif, bien que jusqu’à ce jour ils n’aient pas vraiment marqué un intérêt particulier pour<br />
une participation active aux discussions.<br />
Enfin, le <strong>de</strong>rnier – mais pas le moindre – <strong>de</strong>s acteurs importants est la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, qui a joué un rôle non négligeable au début du<br />
projet. Elle a en effet initié la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong> Site à Réaménager (SAR) et est aujourd’hui propriétaire d’un bâtiment au<br />
Val Benoît (l’institut <strong>de</strong> mécanique, en vert sur la carte ci-<strong>de</strong>ssous).<br />
Notons que la Ville a reçu <strong>de</strong>s subsi<strong>de</strong>s pour rénover la toiture <strong>de</strong> ce bâtiment (ce qui sera donc fait), mais que ses projets <strong>de</strong><br />
réaffectation en stock <strong>de</strong>s musées liégeois semblent avortés. Il n’y a donc tant que maintenant plus <strong>de</strong> projet concret pour ce bâtiment.<br />
Malgré le futur incertain <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> sur le site via ce bâtiment, elle reste bien sûr un acteur et collaborateur<br />
privilégié du projet, même si les décisions stratégiques et la gran<strong>de</strong> majorité du travail <strong>de</strong> rénovation du site dans sa globalité restent une<br />
responsabilité <strong>de</strong> la SPI+.<br />
30
4- Analyse critique :<br />
Le plan suivant représente le site et les différents propriétaires <strong>de</strong> parcelles.<br />
31
4- Analyse critique :<br />
Le comité consultatif (comprenant les acteurs cités plus haut) sera mis en place avant le début <strong>de</strong>s travaux et comptera pour membres<br />
d’autres organismes qui vont <strong>de</strong> près ou <strong>de</strong> loin avoir une influence sur le projet. On y retrouvera par exemple Intra<strong>de</strong>l (gestion <strong>de</strong>s<br />
déchets), la SWL (construction et gestion <strong>de</strong>s logements) et la CRAT. Notons que la SWL peut <strong>de</strong>venir un acteur important, car sans que<br />
rien ne soit encore officiel, il semblerait qu’elle soit sollicitée pour construire et gérer les logements du site (information issue d’une<br />
discussion avec Françoise Lejeune, DG SPI+).<br />
Les personnes en charge du projet à la SPI+ imaginent que d’autres organismes pourraient rejoindre ce comité, comme par exemple le<br />
MET, ou d’autre sociétés qui pourraient jouer un rôle.<br />
Ce comité consultatif aura pour mission <strong>de</strong> rendre un avis sur le projet aux différentes étapes <strong>de</strong> celui-ci. Ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> fonctionnement<br />
permet <strong>de</strong> prendre les décisions avec l’avis et l’expertise <strong>de</strong> chacun, <strong>de</strong> manière à ce que le projet soit un consensus dans lequel les<br />
différents acteurs sont impliqués et avec lequel ils sont en accord.<br />
Un autre comité, plus effectif et technique, qualifié <strong>de</strong> «comité scientifique », sera mis sur pied et reprendra les acteurs véritablement<br />
actifs dans la rénovation du site. On y retrouvera donc l’auteur <strong>de</strong> projet, qui <strong>de</strong>vrait être désigné au début <strong>de</strong> l’année 2011, ainsi que les<br />
pouvoirs subsidiant (principalement la Région Wallonne), mais aussi les différents organismes et sociétés apportant un support technique<br />
à la rénovation (ingénieurs, société <strong>de</strong> construction, architecte…)<br />
Ce comité « scientifique » ou « technique » aura donc pour but <strong>de</strong> définir les rénovations <strong>de</strong> manière effective et précise. Ce sont <strong>de</strong>s<br />
experts qui traduiront la volonté stratégique en réalité <strong>de</strong> terrain, en termes <strong>de</strong> portance, <strong>de</strong> résistance <strong>de</strong>s matériaux ou <strong>de</strong> nuisances<br />
sonores…<br />
D’autres acteurs ont participé au projet, <strong>de</strong> manière plus appliquée. Le bureau Lejeune – Giovanelli a réalisé l’étu<strong>de</strong> d’inci<strong>de</strong>nce et la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> SAR, le SEGEFA a effectué l’étu<strong>de</strong> qui a mis en évi<strong>de</strong>nce le potentiel du Val Benoit et donné à la SPI+ l’idée <strong>de</strong> le réhabiliter,<br />
Transitec a effectué l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilité utilisée lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> d’inci<strong>de</strong>nce...<br />
Enfin, on pourrait penser que la population a un certain rôle à jouer en tant qu’acteur du projet. En effet pour les projets <strong>de</strong> cette<br />
envergure, <strong>de</strong>s consultations <strong>de</strong> la population doivent être organisées (notamment dans le cadre <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> SAR). Néanmoins, la<br />
population ne s’est pas montrée très intéressée lors <strong>de</strong>s réunions d’enquête publique, et très peu <strong>de</strong> riverains se sont présentés. Cela<br />
peut s’expliquer par le fait qu’il n’y ait pas <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nts sur le site, et que les plus proches riverains se trouvent <strong>de</strong> l’autre côté <strong>de</strong><br />
l’autoroute. En fait, il y a <strong>de</strong> l’industrie au sud, et les zones rési<strong>de</strong>ntielles alentours sont toujours séparées du Val Benoit par<br />
d’importantes barrières psychologiques (rail, autoroute et Meuse) et en font un site isolé <strong>de</strong> la population, tant psychologiquement que<br />
physiquement. La population joue donc un rôle mineur et n’est pas un acteur important du projet.<br />
Notons que ce détail <strong>de</strong>s différents acteurs actuels et futurs est issu <strong>de</strong> différentes discussions avec le personnel <strong>de</strong> la SPI+ (F. Lejeune<br />
et le pôle « aménagement du territoire »).<br />
32
4- Analyse critique :<br />
b) Les outils urbanistiques:<br />
Préalablement à tous travaux entrepris, il est important <strong>de</strong> noter que les bâtiments du site sont inscrits à l’inventaire. Bien que les<br />
restrictions soient loin d’être celles d’un bâtiment classé, il reste néanmoins que les modifications qui peuvent être apportées au bâti<br />
sont limitées. Ainsi, le projet ne modifiera normalement pas (ou très peu) l’aspect extérieur <strong>de</strong>s bâtiments. On peut penser qu’il aurait<br />
pu être intéressant <strong>de</strong> faire classer les bâtiments, afin d’obtenir <strong>de</strong>s subsi<strong>de</strong>s pour les travaux à effectuer. Malheureusement, il y a fort à<br />
parier que cela entrainerait plus <strong>de</strong> problèmes que d’avantages. En effet, les travaux prévus vont quand même supprimer certaines<br />
parties <strong>de</strong>s bâtiments (notamment une partie <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> chimie et métallurgie), ce qui serait très difficile et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>rait une longue<br />
procédure si les bâtiments étaient classés. De plus, les subsi<strong>de</strong>s accordés dans le cadre <strong>de</strong> travaux sur <strong>de</strong>s bâtiments classés doivent<br />
servir à maintenir le bien classé en état, pas à le modifier…<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong> Site A Réaménager (SAR) est certainement l’outil urbanistique le plus important du projet à ce jour.<br />
Le dossier, initié par la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, a été rendu en mars 2009 et a été accepté le 29 mai 2009.<br />
Le SAR est <strong>de</strong>puis 2006 le successeur <strong>de</strong>s sites d’activités économiques désaffectés (SAED) et <strong>de</strong>s sites d’activités économiques à<br />
réhabiliter (SAER). Le concept <strong>de</strong> SAR est plus large et comme l’explique la DGO4, « le réaménagement portera dorénavant sur tout site<br />
qui s’entend comme étant un bien immobilier ou un ensemble <strong>de</strong> biens immobiliers qui a été ou qui est <strong>de</strong>stiné à accueillir une activité,<br />
à l’exclusion du logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement <strong>de</strong>s lieux ou constitue une<br />
déstructuration du tissu urbanisé. De ce fait, il pourra s’agir <strong>de</strong> sites d’activité économique mais également <strong>de</strong> sites affectés à <strong>de</strong>s<br />
activités sociales telles que <strong>de</strong>s écoles, <strong>de</strong>s hôpitaux, <strong>de</strong>s installations sportives ou culturelles telles que <strong>de</strong>s théâtres et <strong>de</strong>s cinémas ou<br />
encore <strong>de</strong>s installations à caractère public ou à <strong>de</strong>stination publique telles que <strong>de</strong>s centrales électriques, <strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong><br />
transport, <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> pompiers ainsi que <strong>de</strong>s sites ayant accueilli plusieurs fonctions simultanément ou successivement.<br />
Le dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> SAR présente les acteurs, la justification <strong>de</strong> la proposition réaménagement, ainsi que l’historique su site et<br />
son l’état actuel avant <strong>de</strong> présenter le projet en détail. Cette <strong>de</strong>rnière partie comprend les objectif <strong>de</strong>s aménagements, le RIE (voir plus<br />
bas), les affectations futures <strong>de</strong>s lieux, le phasage <strong>de</strong>s travaux, les estimations <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>s travaux, les plans du projet… Notons que le<br />
dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> SAR rendu pour le Val Benoît est particulièrement bien détaillé par rapport à ce que l’on peut observer pour<br />
d’autres sites.<br />
L’acceptation du périmètre <strong>de</strong> SAR par le gouvernement wallon permet l’accès à divers subsi<strong>de</strong>s régionaux pour l’acquisition et le<br />
réaménagement du site et rend le fonctionnaire délégué responsable <strong>de</strong> la délivrance <strong>de</strong>s permis d’urbanisme à la place <strong>de</strong> la<br />
commune. Ce <strong>de</strong>rnier point peut s’avérer intéressant car le fonctionnaire délégué peut accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s permis en contradiction avec le<br />
plan <strong>de</strong> secteur, ce qui peut permettre d’éviter la réalisation d’un PCA dérogatoire. Néanmoins, cela peut poser problème en cas <strong>de</strong><br />
changement <strong>de</strong> fonctionnaire délégué. En effet un nouveau fonctionnaire ayant une vision différente <strong>de</strong> l’ancien pourrait créer <strong>de</strong>s<br />
problèmes au bon déroulement du projet. De plus, il pourrait ne pas accepter une affectation du sol différente <strong>de</strong> celle prévue au plan<br />
33<br />
<strong>de</strong> secteur.
4- Analyse critique :<br />
Quant aux subsi<strong>de</strong>s, ils ne s’élèvent qu’à 1,125 million d’euros, somme prévue pour tout SAR, ce qui n’est qu’une part infime du prix<br />
<strong>de</strong>s rénovations du site…<br />
Le dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong> SAR comprend un <strong>Rapport</strong> <strong>de</strong>s Inci<strong>de</strong>nces Environnementales (RIE). Celui-ci fait l’état<br />
<strong>de</strong>s lieux, et met en évi<strong>de</strong>nce les inci<strong>de</strong>nces qu’aura le projet sur le site et ses alentours le plus exhaustivement possible. Ces inci<strong>de</strong>nces<br />
sont prises en compte tant en phase <strong>de</strong> chantier qu’en phase <strong>de</strong> fonctionnement du site, ce qui permet <strong>de</strong> bien estimer l’impact qu’aura<br />
le projet et donc <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions en conséquence. Comme dit plus haut, le RIE a été effectué par le bureau Lejeune-Giovanelli<br />
avec le concours <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>.<br />
La délimitation d’un périmètre <strong>de</strong> reconnaissance économique permet d’obtenir <strong>de</strong>s subsi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la DG économie afin d’aménager les<br />
infrastructures intérieures du site. Le périmètre <strong>de</strong> reconnaissance économique est issu du décret du 11/03/2004, qui donne aux<br />
pouvoirs publics la possibilité d’exproprier <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong>stinés à accueillir <strong>de</strong>s activités économiques, dans le but <strong>de</strong> promouvoir le<br />
développement économique et social. Bien qu’il n’y ait pas d’expropriation prévue sur le site du Val Benoît, l’acceptation d’un<br />
périmètre <strong>de</strong> reconnaissance économique est intéressante vu que le décret prévoit <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s et subsi<strong>de</strong>s pour la réalisation <strong>de</strong>s<br />
nouvelles infrastructures.<br />
Notons qu’au lieu d’un SAR, le Val Benoît aurait pu être défini comme périmètre <strong>de</strong> remembrement urbain. Bien que cette solution offre<br />
plus <strong>de</strong> liberté que le SAR, elle n’ouvre la porte à aucun subsi<strong>de</strong>s et il est donc en pratique plus intéressant d’avoir défini le site comme<br />
SAR.<br />
Un dossier-projet d’éco-zoning <strong>de</strong>vait être remis pour la mi-janvier afin d’obtenir <strong>de</strong>s subsi<strong>de</strong>s pour effectuer une étu<strong>de</strong> plus<br />
approfondie <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> mettre en place un parc industriel écologique – ou tout au moins durable. Ce dossier répond à un appel à<br />
projets lancé par le ministre Marcourt en septembre 2010, les subsi<strong>de</strong>s venant du gouvernement wallon.<br />
Le but <strong>de</strong> cet appel à projet était <strong>de</strong> développer l’écologie industrielle en Wallonie afin <strong>de</strong> promouvoir le développement durable et<br />
limiter notre consommation <strong>de</strong>s ressources et notre pollution. Un projet validé permet d’obtenir <strong>de</strong>s subsi<strong>de</strong>s et l’ai<strong>de</strong> d’un comité <strong>de</strong><br />
suivi <strong>de</strong> projet. Malheureusement, la SPI+ n’a <strong>final</strong>ement pas rendu <strong>de</strong> dossier pour le Val Benoit (car il ne correspondait pas aux<br />
critères) et cette approche prometteuse et visionnaire est donc quelque peu compromise. C’est assez dommage, puisqu’en plus <strong>de</strong><br />
subsi<strong>de</strong>s, un tel projet aurait amené une certaine image et une attractivité supplémentaire pour le site. Néanmoins, Françoise Lejeune a<br />
réaffirmé l’ambition <strong>de</strong> créer un parc vert avec collectivisation <strong>de</strong>s ressources lors d’une interview accordée à la RTBF fin mars 2011.<br />
34
4- Analyse critique :<br />
c) Le montage financier :<br />
A ce jour, le montage financier est encore une évaluation budgétaire. Cette évaluation est néanmoins relativement précise et fait<br />
l’objet d’un tableau détaillé réalisé par la SPI+.<br />
On voit que la SPI+ doit impliquer une part importante <strong>de</strong> fonds propres, ce qui constitue un certain changement <strong>de</strong> leur stratégie par<br />
rapport au passé. Cela explique également que la SPI+ tente <strong>de</strong> trouver autant <strong>de</strong> subsi<strong>de</strong>s que possible, comme c’est par exemple le cas<br />
avec le projet d’éco-zoning (aujourd’hui avorté).<br />
Tableaux fournit par la SPI+<br />
35
4- Analyse critique :<br />
c) Le montage financier :<br />
Tableaux fournit par la SPI+<br />
36
4- Analyse critique :<br />
La SPI+ a prévu un échelonnage <strong>de</strong>s dépenses sur 5 ans. Comme on peut le voir, les efforts budgétaires seront dans un premier temps<br />
concentrés sur le bâtiment VB1 (institut <strong>de</strong> chimie-métallurgie) dont la rénovation <strong>de</strong>vrait être terminée en 2013. Lors d’discussion<br />
récente (fin mars 2011), MmeCassoti, directrice du pôle <strong>de</strong> développement économique <strong>de</strong> la SPI+, nous a affirmé que ce premier<br />
bâtiment serait prêt en 2014 et comprendrait un espace-entreprises et un bâtiment-relais. Les premières entreprises pourraient donc<br />
intégrer le site dès 2015.<br />
Un communiqué <strong>de</strong> presse <strong>de</strong> la SPI+ datant du 12 janvier 2011 annonce que les ministres Marcourt (économie) et Henry<br />
(aménagement du territoire) ont débloqué un budget <strong>de</strong> 20 millions d’euros pour la rénovation du Val Benoît. Ce budget (divisé<br />
équitablement entre les <strong>de</strong>ux ministères) est alloué au projet dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert et sera en priorité utilisé pour<br />
développer le bâtiment VB1 afin <strong>de</strong> remplir les objectifs décrits ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
À première vue, l’estimation <strong>de</strong> budget présentée ci-<strong>de</strong>ssus semble donc tenir la route, les dépenses prévues pour la rénovation du<br />
VB1 étant <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>s 20M € et l’échéancier semblant assez réaliste. Néanmoins, la SPI+ n’a aujourd’hui pas <strong>de</strong> subsi<strong>de</strong>s pour les<br />
autres bâtiments du site et il est donc difficile <strong>de</strong> se prononcer sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> ceux-ci. Notons que la SPI+ avait manifesté son<br />
intention <strong>de</strong> progresser par phases, en rénovant d’abords le VB1 avant <strong>de</strong> commencer les autres, ce qui semble cohérent avec la<br />
situation actuelle.<br />
Ceci étant dit, le budget total prévu par la SPI+ s’élève à 72 500 000 €, ce qui dépasse <strong>de</strong> loin les 20M € débloqués jusqu’ici… Le<br />
financement du projet n’est donc pas vraiment sécurisé à ce jour, et on peut raisonnablement craindre que le réaménagement s’arrête<br />
après le premier bâtiment en cas <strong>de</strong> manque <strong>de</strong> subsi<strong>de</strong>s, ce qui serait véritablement un échec du projet.<br />
Plan du SEGEFA – <strong>Rapport</strong> du SAR .<br />
Le plan ci-<strong>de</strong>ssous montre les bâtiments VB 1, 2 et 3.<br />
37
4- Analyse critique :<br />
c) Les principales leçons :<br />
Durant l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dossiers SAR et RIE, nous avons annoté un certain nombre d’éléments qui nous ont semblés agir <strong>de</strong> manière<br />
à améliorer la qualité du projet ou au contraire à le <strong>de</strong>sservir.<br />
Les éléments négatifs :<br />
Comme éléments négatifs nous entendons l’ensemble <strong>de</strong>s données énoncées du projet à ce sta<strong>de</strong> et qui sont soit mal ou pas assez définies,<br />
soit qui semblent être en adéquation avec les objectifs <strong>de</strong> base.<br />
• En ce qui concerne le projet:<br />
-La SPI+ n’a <strong>final</strong>ement pas rendu <strong>de</strong> dossier (EcoZoning) pour le Val Benoit (car il ne correspondait pas aux critères) et cette approche<br />
prometteuse et visionnaire est donc quelque peu compromise. C’est assez dommage, puisqu’en plus <strong>de</strong> subsi<strong>de</strong>s, un tel projet aurait amené<br />
une certaine image et une attractivité supplémentaire pour le site.<br />
- Comme précisé dans la critique du plan masse, l’argument du passage du Tram à coté du Val Benoit nous a souvent été présenté comme la<br />
solution aux problèmes que risquent <strong>de</strong> poser l’augmentation du nombre d’emplois sur le site mais il n’est fait nulle part dans le dossier SAR<br />
mention d’un plan mobilité qui prendrait en compte l’ensemble du quartier.<br />
• Pour le montage financier:<br />
- Le budget total prévu par la SPI+ s’élève à 72 500 000 €, ce qui dépasse <strong>de</strong> loin les 20 millions euros débloqués jusqu’ici… Le financement<br />
du projet n’est donc pas vraiment sécurisé à ce jour, et on peut raisonnablement craindre que le réaménagement s’arrête après le premier<br />
bâtiment en cas <strong>de</strong> manque <strong>de</strong> subsi<strong>de</strong>s, ce qui serait véritablement un échec du projet.<br />
-Les subsi<strong>de</strong>s issus du SAR, ils ne s’élèvent qu’à 1,125 million d’euros, somme prévue pour tout SAR, ce qui n’est qu’une part infime du prix<br />
<strong>de</strong>s rénovations du site…<br />
38
4- Analyse critique :<br />
Les éléments positifs :<br />
Comme éléments positifs nous avons pris en compte les facteurs qui apportent <strong>de</strong> la teneur au projet ainsi que les objectifs définis qui<br />
amènent <strong>de</strong>s potentialités d’améliorer réellement la situation actuelle du site du Val Benoît.<br />
• En ce qui concerne le projet:<br />
- La mise en place d’un comité <strong>de</strong> réflexion qui se charge entre autre d’i<strong>de</strong>ntifier les entreprises qui pourraient s’implanter sur le site,<br />
nous montre une certaine forme <strong>de</strong> rigueur <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> la spi+.<br />
- La conservation <strong>de</strong> plusieurs bâtiments même s’ils ne sont pas classés sur le site permettra <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s traces du passé universitaire.<br />
- La mise en place d’une mixité <strong>de</strong> fonction, comme énoncé dans la programmation du plan masse, est liée à une volonté d’amélioration<br />
<strong>de</strong> la qualité du site avec un objectif <strong>de</strong> développent durable espaces verts, écologie industrielle,….<br />
- Volonté <strong>de</strong> diminuer l’impact <strong>de</strong> la voiture à l’intérieur du site est un point positif du plan masse, mais on constate <strong>de</strong>s accès dans le<br />
site pour les camions qui ne sont pas étudiés <strong>de</strong> manière adéquate avec la volonté d’avoir un site piéton !!<br />
• Pour le montage financier:<br />
- Le budget débloqué par les ministre Henry et Marcourt qui s’élève à 20 millions d’euros pour les travaux prévu sur le site du Val<br />
Benoit.<br />
39
5- Conclusion du dossier :<br />
Conclusion du dossier :<br />
En résumé, en suivant les recommandations <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> consacrée au développement économique communal, la Ville <strong>de</strong><br />
<strong>Liège</strong> a marqué sa volonté <strong>de</strong> maintenir le site du Val-Benoît essentiellement à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s activités économiques (avec<br />
équipements publics en accompagnement).<br />
Pour récapituler , cette décision est justifiée par :<br />
- Le manque d’espaces pour accueillir les entreprises dans <strong>de</strong>s bonnes conditions sur le territoire <strong>de</strong> la commune et les<br />
nombreuses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> localisation dans le parc scientifique du Sart Tilman non satisfaites.<br />
- La saturation progressive <strong>de</strong>s terrains <strong>de</strong> la SPI+ dans les parcs périphériques et la volonté <strong>de</strong> la SPI+ et <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong><br />
développer <strong>de</strong> nouvelles offres en milieu urbain.<br />
La Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong> et la SPI+ souhaitent conférer au site une image claire d’espace d’accueil pour <strong>de</strong>s activités économiques<br />
mixtes.<br />
Les autres projets sur le site ont été coordonnés et ajustés pour trouver une mixité équilibrée entre les différentes fonctions<br />
(complémentarités d’occupation jour-nuit, avec par exemple du logement ou encore phasage dans le temps <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong><br />
bureau en rapport avec l’évolution <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> mobilité).<br />
Un tel projet s’inscrit dans la politique <strong>de</strong> développement économique <strong>de</strong> la Ville qui souhaite attirer sur son territoire <strong>de</strong>s<br />
entreprises et les emplois correspondants.<br />
Dans un contexte <strong>de</strong> raréfaction <strong>de</strong> l’espace, il s’agit d’offrir une alternative aux localisations en parc périphérique qui ont<br />
monopolisé les processus <strong>de</strong> localisation pendant plusieurs décennies.<br />
40
6- Références :<br />
Pour l’élaboration du rapport nous nous sommes référés aux informations fournies par :<br />
PERIMETRE SAR sur le site du Val Benoît.<br />
Dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconnaissance<br />
(Annexe à l’arrêté du collège communal du 5 Mars 2009)<br />
Mis en place par :<br />
SPI+<br />
Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>- département <strong>de</strong> l’urbanisme.<br />
En Février 2009<br />
Projet <strong>de</strong> réaménagement.<br />
<strong>Rapport</strong> d’inci<strong>de</strong>nce environnementale<br />
(Annexe à l’arrêté du collège communale du 5 Mars 2009)<br />
Mis en place par :<br />
Par la ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong><br />
L’université <strong>de</strong> <strong>Liège</strong><br />
SPI+<br />
Documents coordonnés par :<br />
Atelier d’architecture Lejeune-Giovanelli<br />
Le concours <strong>de</strong> AWP+e, ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong>, SPI+, ULG<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilité : Pluris, Segefa, Transitec<br />
Février 2009<br />
Avis du CWEDD<br />
<strong>Liège</strong> le 6 Juillet 2009<br />
Périmètre provisoire du SAR du site du Val Benoît<br />
SAR /LG/221<br />
41
6- Références :<br />
Données fournies par la SPI+ :<br />
Montant financier<br />
Type d’entreprise à implanter<br />
Sta<strong>de</strong> du projet<br />
Interview <strong>de</strong> :<br />
M. Bruck – Ville <strong>de</strong> <strong>Liège</strong><br />
M. SWENNEN - SPI+<br />
M. Cornesse - Ulg<br />
Des membres du personnel <strong>de</strong> la SPI+ (Françoise Lejeune, Mariléna<br />
Cassotti, Cédric Swennen, Damien Arnould, Christophe Leclerc)<br />
Site internet:<br />
- DGO4<br />
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/PouvPubl/Aid<br />
es.asp<br />
- http://www.spi.be<br />
-http://cpdt.wallonie.be/in<strong>de</strong>x.php?id_page=21<br />
-http://www.forbid<strong>de</strong>n-places.net/exploration-urbaine-l-universite-du-valbenoit-a-liege<br />
42
7- Annexes :<br />
Reportage photos effectuer lors <strong>de</strong> la visite du site le 4 octobre 2010<br />
43
7- Annexes :<br />
Extrait <strong>de</strong> l’avis du CWEED sur le dossier SAR :<br />
Extrait <strong>de</strong> Avis du CWEED sur le SAR – 9/12/2010<br />
44
7- Annexes :<br />
Article <strong>de</strong> presse:<br />
Extrait <strong>de</strong> Avis du CWEED sur le SAR – 9/12/2010<br />
45
7- Annexes :<br />
Article <strong>de</strong> presse:<br />
Extrait <strong>de</strong> Avis du CWEED sur le SAR – 9/12/2010<br />
46
7- Annexes :<br />
Article <strong>de</strong> presse:<br />
Extrait <strong>de</strong> Avis du CWEED sur le SAR – 9/12/2010<br />
47