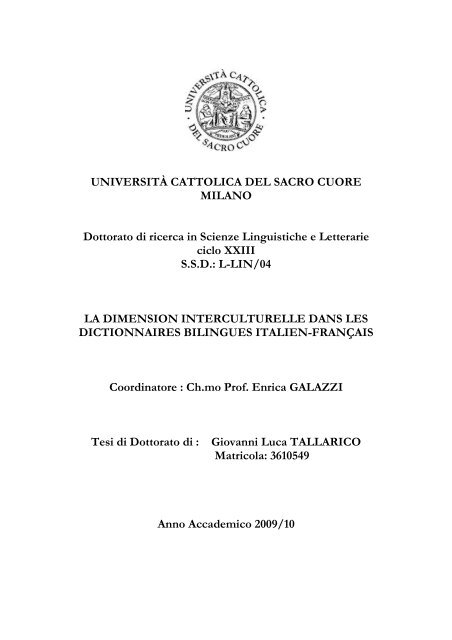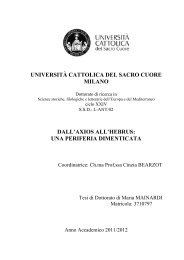UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato ...
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato ...
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>UNIVERSITÀ</strong> <strong>CATTOLICA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>SACRO</strong> <strong>CUORE</strong><br />
<strong>MILANO</strong><br />
<strong>Dottorato</strong> di ricerca in Scienze Linguistiche e Letterarie<br />
ciclo XXIII<br />
S.S.D.: L-LIN/04<br />
LA DIMENSION INTERCULTURELLE DANS LES<br />
DICTIONNAIRES BILINGUES ITALIEN-FRANÇAIS<br />
Coordinatore : Ch.mo Prof. Enrica GALAZZI<br />
Tesi di <strong>Dottorato</strong> di : Giovanni Luca TALLARICO<br />
Matricola: 3610549<br />
Anno Accademico 2009/10
Table des matières ........................................................................................................................ 3<br />
Introduction<br />
0.1 Motivations et buts de la recherche ....................................................................................... 7<br />
0.2 Structure de l’étude ................................................................................................................. 10<br />
Première partie. Pour une approche (inter)culturelle des dictionnaires ..................... 13<br />
I.0 Remarques terminologiques .................................................................................................. 14<br />
I.1 Langues et cultures. Comment situer les enjeux ? .............................................................. 25<br />
I.1.1 De Humboldt à Benveniste ................................................................................... 25<br />
I.1.2 Développements récents ....................................................................................... 27<br />
I.1.3 Lexique et Weltanschauung ....................................................................................... 29<br />
I.2 Vers un ancrage théorique ..................................................................................................... 33<br />
I.2.1 Statut de la discipline .............................................................................................. 34<br />
I.2.2 Entre lexicographie et linguistique ....................................................................... 36<br />
I.2.3 Le sens en lexicographie bilingue ......................................................................... 37<br />
I.2.4 Approches du sens dans le dictionnaire .............................................................. 39<br />
I.3 Un débat sémantique .............................................................................................................. 42<br />
I.3.1 La construction du sens entre langue et discours .............................................. 42<br />
I.3.2 Dictionnaire vs encyclopédie ................................................................................ 46<br />
I.4 Problématique des écarts ........................................................................................................ 49<br />
I.4.1 La notion d’anisomorphisme ................................................................................ 50<br />
I.4.2 Typologie des écarts ............................................................................................... 52<br />
I.4.3 Les écarts culturels ................................................................................................. 53<br />
I.4.4 Opacité et transparence dans le traitement lexicographique ........................... 54<br />
I.4.5 Les degrés de l’équivalence lexicale ..................................................................... 57<br />
3
I.5 Lexicographie bilingue et traduction .................................................................................... 59<br />
I.5.1 Les lacunes lexicales ............................................................................................... 62<br />
I.6 Les apports de la sémantique lexicale à la lexicographie bilingue .................................... 66<br />
I.7 Le mythe de l’objectivité ........................................................................................................ 69<br />
I.8 L’insaisissable connotation .................................................................................................... 77<br />
I.8.1 La notion de connotation ...................................................................................... 77<br />
I.8.2 Entre l’individuel et le social ................................................................................. 80<br />
I.8.3 La connotation en lexicographie .......................................................................... 81<br />
I.9 Ressources pour une prise en compte de la culture dans le lexique ................................ 83<br />
I.9.1 Les apports de Robert Galisson et son héritage .................................................84<br />
I.9.2 Les scénarios culturels ............................................................................................ 86<br />
I.9.3 L’épaisseur du langage ............................................................................................ 88<br />
Deuxième partie. Analyse du corpus ..................................................................................... 91<br />
II.0 Présentation du corpus ......................................................................................................... 92<br />
II.1 Analyse longitudinale ............................................................................................................ 93<br />
II.1.1 Analyse de la lettre A dans les deux directions des quatre dictionnaires du corpus.<br />
Examen des typologies d’écarts et tableaux quantitatifs .......................................................... 96<br />
II.1.2 La valeur culturelle des écarts ......................................................................................... 107<br />
II.1.3 Autres phénomènes liés à l’équivalence ........................................................................ 118<br />
II.1.4 Les exemples à fonction culturelle ................................................................................. 143<br />
II.1.4.1 Direction français-italien ................................................................................. 146<br />
II.1.4.2 Direction italien-français ................................................................................. 174<br />
II.1.4.3 Réflexions conclusives sur les exemples ...................................................... 195<br />
II.2 Analyse transversale ............................................................................................................ 197<br />
II.2.1 Les notes culturelles ......................................................................................................... 198<br />
4
II.2.2 Les faux emprunts ............................................................................................................ 209<br />
II.2.2.1 La valeur culturelle des faux emprunts ......................................................... 222<br />
Conclusions ................................................................................................................................. 225<br />
Bibliographie ...............................................................................................................................231<br />
Annexe I Détail de l’analyse de la lettre A ...................................................................... 263<br />
Direction français-italien .................................................................................. 266<br />
Direction italien-français .................................................................................. 331<br />
Annexe II Les notes culturelles ......................................................................................... 483<br />
5
INTRODUCTION<br />
0.1 Motivations et buts de la recherche<br />
Le but de notre thèse est d’explorer la dimension interculturelle dans les dictionnaires<br />
bilingues italien-français contemporains.<br />
L’étude des traits culturels dans les dictionnaires, surtout dans les bilingues, n’est pas un<br />
thème nouveau : il a fait l’objet des volumes collectifs édités par SZENDE (2003) et<br />
LAURIAN (2004) ; nous rappelons également le numéro de la revue ELA dirigé par<br />
MARGARITO (2002) 1 ; parmi les articles qui ont étudié ce phénomène, nous pouvons citer<br />
TOMASZCZYK (1984), REY (1991), DE SURMONT (2000), PRUVOST (2002), LIJNEN (2003) et<br />
CALVI (2006).<br />
Notre apport se veut comme une tentative de systématiser cette problématique et de<br />
l’appliquer au domaine italien-français. Dans le but d’élargir notre réflexion, nous avons<br />
également fait recours à d’autres traditions en linguistique, notamment à la sémantique de<br />
WIERZBICKA.<br />
Au cours de cette thèse, nous avons essayé de mettre l’accent sur le lexique comme fait<br />
social, mieux comme fait culturel ; notre analyse sera menée à travers ces ouvrages<br />
éminemment culturels que sont les dictionnaires 2 , dans l’espoir que ce jeu de miroirs fasse<br />
ressortir la dimension interculturelle qui nous préoccupe ici.<br />
La culture fera l’objet d’une recherche croisée. Elle sera envisagée tout d’abord comme<br />
fonction de la société 3 , rendant compte des écarts entre les deux langues. Nous croyons que<br />
les spécificités de deux langues ne se font visibles que lorsqu’elles sont mises en regard : la<br />
mise en équivalence dans les DB des lexiques italien et français, ces deux langues sœurs<br />
(cugine, dirait-on en italien, marquant ainsi un premier écart), permettra donc l’émergence<br />
des écarts, dont certains révéleront une valeur culturelle manifeste. L’écart sera ainsi<br />
envisagé comme lieu d’apparition des différences identitaires.<br />
La culture sera ensuite visible dans le discours du dictionnaire ; le rôle des exemples s’avérera<br />
à cet égard particulièrement significatif, du fait qu’ils véhiculent des points de vue et des<br />
1 Notamment, les articles de CELOTTI (2002) et FOURMENT BERNI-CANANI (2002b) s’occupent spécialement<br />
des dictionnaires bilingues.<br />
2 Cf. PRUVOST (2006).<br />
3 Qui porte à son tour la marque de son héritage historique.<br />
7
eprésentations socialement partagées. L’analyse des notes culturelles et du phénomène des<br />
faux emprunts compléteront l’étude de notre problématique.<br />
L’un des fils rouges de cette thèse sera donc l’attention pour « l’environnement social,<br />
affectif, historique des productions langagières » ; notre hypothèse, c’est que les<br />
dictionnaires bilingues (dorénavant DB) permettent d’« appréhender la réalité d’un<br />
contraste interlangue et interculturel » LAURIAN (2004 : VII).<br />
Quelques mots sur les dictionnaires nous aideront à mieux situer notre réflexion.<br />
Les contraintes qui pèsent sur l’objet-dictionnaire (monolingue et bilingue) sont sans aucun<br />
doute très nombreuses : produit commercial soumis à des critères de rentabilité, de vente,<br />
de distribution et de marketing comme n’importe quel livre ; ouvrage soumis à une critique<br />
constante (plus ou moins fondée) de la part des spécialistes et des non-spécialistes ; outil<br />
souvent discrédité pour l’apprentissage d’une langue étrangère ; répertoire lexical toujours<br />
mis en cause au point de vue quantitatif (en ce qui concerne la macrostructure et les<br />
attentes des usagers , qui ont souvent une conception naïve de l’exhaustivité) et qualitatif<br />
(au point de vue de la densité informationnelle , du clivage linguistique/extralinguistique, de<br />
la prise en compte des dimensions socio-culturelles et pragmatiques des unités lexicales). A<br />
ces difficultés s’ajoute la représentation du dictionnaire dans l’imaginaire du locuteur<br />
moyen : conception sacralisante d’une summa achronique qui se mêle à une certaine<br />
sujétion 4 , parfois au détriment du bon sens ; ainsi que BOGAARDS (2003 : 29) le fait<br />
remarquer, « for many people the only thing that exists is ‘the’ dictionary », ce singulier<br />
rendant compte d’une représentation monolithique de l’objet. En dépit de ces contrastes,<br />
nous croyons que l’étude des dictionnaires peut se révéler d’une utilité certaine pour la<br />
recherche lexicologique et lexiculturelle.<br />
Pour ce qui est de la situation de notre travail, nous observons que le climat intellectuel des<br />
sciences du langage manifeste un accueil croissant à la thématique des implications<br />
culturelles dans les langues. En ce qui nous concerne, dans cette thèse il sera souvent<br />
question de langues-cultures ; c’est une terminologie qui tient compte, évidemment, de<br />
l’héritage de R. GALISSON et de ses recherches. Le fait qu’on parle aujourd’hui de<br />
linguaculture en anglais aussi 5 , ne peut que confirmer la pénétration de cette approche en<br />
linguistique.<br />
Un tout dernier mot sur l’épistémologie qui a nous a guidé. Nous sommes conscients que<br />
c’est la perspective qu’on adopte sur l’objet de recherche qui détermine tout le parcours<br />
d’enquête. Comme l’affirmait SAUSSURE, « c’est le point de vue qui crée l’objet » (1972 : 23).<br />
A ce propos, GALISSON (1995a : 9) remarquait que, dans le domaine de la lexiculture, « être<br />
4 Cf. ALLAIN (1990).<br />
5 Cf. WIERZBICKA (2005: 592). TELIYA et al. (1998: 55) parlent plutôt de « linguo-cultural studies ».<br />
8
fragmentaliste, occasionnaliste [...], c’est aussi procéder par touches, non par masses, donc<br />
être également... impressionniste ». A son avis<br />
l’approche par touches [est] sans doute plus apte qu’une autre (parce que plus souple, plus<br />
libre) à rendre compte des changements, des glissements, des fractures d’un objet (le<br />
culturel), où des subcultures, des cultures métissées, s’entrelacent et s’entrechoquent (ibid.).<br />
L’isomorphisme entre l’objet de recherche (la culture, qui est partout et donc<br />
paradoxalement nulle part) et la méthode (par touches, éclectique) permettrait donc,<br />
d’après GALISSON, de mener à bien la recherche en lexiculture. C’est aussi ce que nous<br />
souhaitons, plus modestement, pour notre contribution.<br />
9
0.2 Structure de l’étude<br />
Notre étude se compose de deux grandes parties et de deux annexes.<br />
La première partie sera centrée sur une approche théorique à la problématique de la<br />
dimension (inter)culturelle dans les DB.<br />
Dans le chapitre I.0 nous avons essayé de délimiter les notions de culture, d’interculturel et<br />
de dictionnaire, avec naturellement une attention spéciale pour la lexicographie bilingue.<br />
Le chapitre I.1 est consacré aux rapports entre langues et cultures, tels qu’ils ont été<br />
élucidés dans le XX e siècle. Notamment, le lexique s’avère être le domaine où cette relation<br />
est plus évidente.<br />
Dans I.2 nous nous sommes occupé des origines historiques des DB, de son statut<br />
épistémologique et de ses rapports avec la linguistique. Ensuite, nous nous sommes penché<br />
sur la description du sens dans les dictionnaires et sur les apories qui en dérivent,<br />
notamment la mise en veilleuse de la dimension pragmatique.<br />
Dans la section I.3 nous adopterons une perspective sémantique pour explorer des thèmes<br />
tels que les rapports entre significations et cultures, la description du sens dans les DB et le<br />
va-et-vient entre sens linguistique et extralinguistique dans les dictionnaires.<br />
Les écarts ont fait l’objet du chapitre I.4, où nous avons précisé la notion<br />
d’anisomorphisme, nous avons dégagé une typologie des écarts et montré les implications<br />
sémantiques et pragmatiques de l’équivalence.<br />
Quelle est la spécificité de la traduction dans les DB ? Quelle est la valeur des lacunes<br />
lexicales ? Nous nous sommes arrêtés sur ces thèmes dans le chapitre I.5.<br />
Dans le chapitre I.6 nous avons analysé les relations entre théories sémantiques et<br />
lexicographie ; ensuite, dans le chapitre suivant (I.7) nous avons vu comment la notion<br />
d’objectivité peut être envisagée dans les DB.<br />
La connotation et sa place dans la description lexicographique est le sujet du chapitre I.8.<br />
Finalement, dans I.9 nous avons présenté plusieurs approches aux traits de culture dans le<br />
lexique : les mots-clés, les mots à charge culturelle partagée, les scénarios culturels et<br />
l’épaisseur du langage.<br />
10
La deuxième partie sera consacrée à l’étude des traits culturels, tels qu’ils apparaissent dans<br />
les quatre dictionnaires de notre corpus (Boch, Garzanti, Hachette-Paravia, Sansoni<br />
Larousse).<br />
Une optique inductive, empirique, nous permettra de voir quelles stratégies les DB mettent<br />
en œuvre pour rendre compte des spécificités culturelles et linguistiques.<br />
Nous adopterons une double perspective, horizontale (ou longitudinale) et verticale (ou<br />
transversale), dans le but d’étudier au plus près le phénomène de la dimension<br />
interculturelle des DB.<br />
Longitudinalement, nous procéderons à l’analyse détaillée de la microstructure d’une lettre<br />
de nos dictionnaires, notamment le A pour les deux versants (français-italien et italienfrançais).<br />
Dans le chapitre II.1.1, nous analyserons le phénomène de l’écart dans la lettre A des<br />
dictionnaires de notre corpus. Nous envisagerons l’écart comme lieu d’apparition des différences<br />
identitaires et nous essaierons d’en montrer la valeur culturelle (II.1.2). Une typologie des<br />
écarts se rendra nécessaire, sur une échelle qui verra le poids culturel des écarts augmenter<br />
au fur et à mesure.<br />
Dans II.1.3 nous nous analyserons d’autres phénomènes liés à l’équivalence et qui<br />
montrent une valeur culturelle.<br />
Ensuite, à travers une analyse des exemples de la lettre A des dictionnaires de notre corpus<br />
(II.1.4), nous nous pencherons sur les exemples à fonction culturelle, sur le traces du<br />
discours des lexicographes, de leur imaginaire et des représentations partagées dans les<br />
deux langues-cultures (français et italien).<br />
Transversalement, nous essaierons d’étudier deux phénomènes centraux pour ce qui est de<br />
la dimension culturelle dans les dictionnaires, à savoir les notes culturelles (II.2.1) et les<br />
faux emprunts (II.2.2). Il nous a semblé que ces phénomènes nécessitaient une étude<br />
globale, qui dépasse obligatoirement le cadre d’un sondage de quelques lettres.<br />
Finalement, dans la première annexe sont reproduites les entrées de notre corpus pour<br />
lesquelles nous avons relevé des écarts, avec l’indication de la typologie de l’écart et les<br />
confrontations avec les choix des autres dictionnaires du corpus. Dans la deuxième annexe,<br />
par contre, on peut lire la liste des notes culturelles des DB de notre corpus, avec<br />
l’indication de la catégorie (domaine) dont elles relèvent.<br />
11
PREMIÈRE PARTIE<br />
POUR UNE APPROCHE<br />
(INTER)CULTURELLE DES<br />
DICTIONNAIRES<br />
13
I.0 Remarques terminologiques<br />
Nous croyons, avec MOUNIN (2004 : xvii), que « le problème terminologique est d’abord<br />
[...] un problème d’hygiène intellectuelle et scientifique individuelle, un problème d’attitude<br />
épistémologique ». Nous essayons dès lors d’expliciter autant que possible notre emploi des<br />
termes qui donnent le titre à cette thèse : la dimension interculturelle dans les dictionnaires bilingues.<br />
La notion de culture est certainement des plus difficiles à cerner. Pour éviter de tomber<br />
dans un flou, qui serait nuisible à toute épistémologie, nous essayons d’élaborer une<br />
définition du terme.<br />
Prenons d’abord en considération la définition du Petit Robert 2011 (dorénavant PR11) 6 .<br />
2. culture nom féminin<br />
ETYM. v. 1550 ◊ de 1. culture<br />
1. (v. 1550) Développement de certaines facultés de l’esprit par des exercices intellectuels<br />
appropriés. Par ext. Ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le<br />
sens critique, le goût, le jugement. ➙ connaissance, éducation, formation, instruction, 2. savoir. « La<br />
culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié » (Herriot). Une vaste, une solide culture (➙ cultivé).<br />
Culture livresque. ➙ érudition. Accès à la culture. Un esprit sans culture.<br />
2. Ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, une nation. La culture grécolatine.<br />
Culture occidentale, orientale. La culture française. Échanges entre cultures différentes<br />
(➙ interculturel, transculturel; multiculturel).<br />
3. Didact. Ensemble des formes acquises de comportement, dans les sociétés humaines.<br />
➙ culturel (2°); culturalisme. Nature et culture. Cour. Culture d’entreprise. Culture d’un gouvernement.<br />
Nous nous concentrerons sur les acceptions 2. et 3., laissant de côté la première, qui<br />
correspond plutôt au bagage de connaissances nécessaires pour une vie épanouie dans la<br />
société. A propos de ces deux définitions, MARGARITO (2002 7 : 394) souligne avec<br />
pertinence « la dimension intellectuelle porteuse des valeurs d’une civilisation, et la<br />
dimension comportementale ». Cette conception de la culture comme véhicule de valeurs<br />
(notamment à travers la langue) et comme ensemble de comportements et d’attitudes sera<br />
constante tout au long de cette thèse.<br />
6 Nous ne reprenons pas l’article du dictionnaire dans son intégralité. L’homonyme culture 1 concerne<br />
naturellement « l’action de cultiver la terre ».<br />
7 La définition du Petit Robert n’a guère changé au cours des dernières éditions.<br />
14
Dans le cadre de la théorie Métalangue Sémantique Naturelle 8, A. WIERZBICKA (2005 : 579)<br />
définit la culture comme « shared conceptual world » et elle en introduit (2005 : 585-587) le<br />
concept, tel qu’il a été élaboré par C. GODDARD 9:<br />
culture (Chinese, Japanese, Russian, etc.)<br />
A. people live in many places<br />
some of these places are far from here<br />
many kinds of people live in these places, one kind of people in one place, another kind<br />
of people in another place<br />
these many kinds of people don’t live in the same way as people here live<br />
they don’t think about things in the same way as people here think about things<br />
they don’t do things in the same way as people here do things<br />
B. people in one place live in one way, not in another way<br />
because other people of the same of the same kind lived in this way for a long time<br />
people in one place think about things in some ways not in other ways<br />
because other people of the same kind thought this way before for a long time<br />
they think some things are good, they think some things are not good<br />
because other people of the same kind thought this way before for a long time<br />
people in one place do things in some ways, not in other ways<br />
because other people of the same kind did things this way before for a long time<br />
(WIERZBICKA 2005 : 585-587).<br />
Dans la partie A de la définition, l’accent est mis sur les spécificités culturelles des<br />
communautés, relevant du cadre géographique et appréhendées par le biais de l’expérience<br />
de la différence. Dans la deuxième partie, par contre, on se concentre davantage sur le rôle<br />
de l’histoire, de la tradition, dans la cristallisation des façons d’agir et des routines de<br />
pensée. La géographie et l’histoire s’imposent donc comme des facteurs-clés pour le<br />
développement de la culture et pour sa compréhension.<br />
Dans un autre article, WIERZBICKA (2006a : 169) cite l’anthropologue D’ANDRADE 10, pour<br />
qui la culture est « un ensemble d’idées, de sens, d’interprétations partagées ».<br />
8 Pour une présentation de cette théorie, voir plus bas, chap. I.7.<br />
9 GODDARD C., « The lexical semantics of ‘culture », Language Science, 7, 2005, p. 51-73.<br />
10 D’ANDRADE R., « A cognitivist’s view of the units debate in cultural anthropology », Cross-Cultural Research,<br />
35 (2), 2001, p. 242-257.<br />
15
Voici donc un autres aspect, le partage, qui sera central tout au long de notre analyse. Une<br />
culture, en effet, n’existe qu’en tant qu’elle partage des contenus et des formes, lesquels se<br />
sont sédimentés au fil des générations.<br />
DA SILVA – TAVARES FERRÃO esquissent une autre définition du terme, dans le cadre de<br />
leurs recherches didactiques et en proposent la dernière version. La culture est définie<br />
comme un<br />
ensemble de savoirs, savoir-faire et de savoir-être d’ordre littéraire, artistique, scientifique,<br />
technique et comportemental qui dans sa relation consubstantielle avec la langue compose<br />
une discipline (langue-culture) objet des procès complémentaires d’enseignement et<br />
d’apprentissage correspondants (2007 : 245).<br />
Les auteurs se situent dans la lancée des études sur la lexiculture de R. GALISSON, dont<br />
nous nous occuperons dans le chapitre I.9 de cette thèse. L’accent est mis sur la<br />
dimension ‘quotidienne’ (comportementale, anthropologique 11 ) de la culture, au-delà de la<br />
culture ‘cultivée’ (savante) et sur ses rapports avec la langue, qui en est le véhicule et le<br />
moyen pour en garantir l’accès à travers l’enseignement.<br />
WIERZBICKA et GALISSON, cela soit dit en passant, seront deux figures récurrentes dans<br />
notre thèse : ils ont inauguré deux traditions de recherche (l’approche MSN et la<br />
lexiculture) qui explicitent les liens entre langues et cultures, insistant beaucoup sur<br />
l’insertion des langues dans leurs communautés respectives et sur les valeurs partagées,<br />
véhiculées à travers les discours.<br />
Revenons à notre quête terminologique. Une autre définition récente de culture est offerte<br />
par SABBAN (2007). En premier lieu,<br />
Culture can be characterized in terms of modes of experiencing the world, in particular<br />
modes of conceptualizing and evaluating it as offered by language, shared by members of a<br />
group or society in a specific living environment and contributing to a culture’s mental<br />
model of the world, or its particular worldview (2007 : 591).<br />
Cette définition est plutôt exhaustive, à notre sens. Elle met l’accent sur le lien indissoluble<br />
entre langue et culture, sur la dimension collective du langage et sur l’image mentale du<br />
monde qui se crée par ce biais. Il faut aussi insister sur ceci : la culture est véhiculée par le<br />
langage, qui contribue à son tour, par un mécanisme de rétroaction, à former un modèle<br />
mental de la culture et à sa Weltanschauung.<br />
Deuxièmement, poursuit l’auteure, « a culture can be characterized in terms of shared<br />
models of social behaviour » (ibid.). Troisièmement, « a culture can be characterized in<br />
11 LIJNEN (2005 : 28) distingue la culture cultivée de la culture anthropologique : « La première catégorie réunit les<br />
savoirs encyclopédiques dans des domaines tels que la littérature, la musique, l’art, etc. La deuxième catégorie<br />
regroupe, en revanche, les traditions d’une civilisation, les façons de vivre et de se conduire ».<br />
16
terms of shared traditions, which have accumulated historically and are part of its collective<br />
memory. These may be encountered on the level of thought (convictions, mental<br />
stereotypes) as well as of social behaviour (e.g. ceremonies, rites and rituals) » (ibid.).<br />
Il est évident que le niveau qui nous intéresse en priorité est le premier, à savoir la façon<br />
dont les langues restituent une vision du monde donnée. Mais aussi le deuxième (qui<br />
concerne les modèles de comportement) et le troisième (qui concerne les traditions<br />
partagées) sont pertinents, dans la mesure où la langue enregistre ces comportements et ces<br />
traditions (intellectuelles ou sociales). Nous verrons dans la deuxième partie, dans la partie<br />
consacrée aux exemples, une approche de cette dimension sémio-culturelle.<br />
Dans les définitions qu’on a abordés, les liens entre langue et culture commencent à se<br />
tisser. NIDA (2001 : 13), ayant défini la culture comme « the totality of beliefs and practices<br />
of a society », en retrace des similitudes avec la langue, à savoir : « early acquisition, loss,<br />
collective activity, variability, change, bundles of features, and sociosemiotic factors ». A<br />
l’instar de la culture, la langue est acquise tôt dans le développement de l’individu ; il est<br />
toujours possible de l’oublier ; elle est caractérisée par une activité collective, par la<br />
variation et par une grande dynamique interne ; en elle agissent des phénomènes<br />
concomitants ; pour ce qui est des facteurs sociosémiotiques, ils relèvent du niveau<br />
iconique (basé sur la similarité), déictique (basé sur l’association) et conventionnel<br />
(l’arbitraire du signe). Selon NIDA, la différence principale entre ces deux systèmes c’est que<br />
la langue « can be used to speak about itself [...], can be used to describe its own<br />
structures ». Il s’agit bien entendu de la fonction métalinguistique, qui nous donne la<br />
possibilité de voir la langue comme instrument et comme objet de l’analyse. C’est ce que<br />
nous essaierons de faire, cherchant à limiter les distorsions de cette perspective bifocale.<br />
D’autres auteurs ont proposé des définitions intéressantes : KASSAI (1994 : 509) définit la<br />
culture comme « l’ensemble des connotations partagées par la communauté ». Nous nous<br />
arrêterons sur la notion de connotation dans le chapitre I.8.<br />
Pour DUFAYS (1997 : 317), « la culture est à proprement parler clichée dans les mots ». Dans<br />
cette optique, les mots deviennent des réceptacles et des véhicules de culture. Il sera<br />
question de ce thème en particulier dans le chapitre I.9.<br />
DOBROVOLSKIJ – PIIRAINEN (1988 : 5) parlent de culture comme de « shared knowledge<br />
about different semiotic codes, i.e. not about the world directly, but about semiotic<br />
reflections of the world ». Puis les auteurs évoquent la définition de l’école de Moscou-<br />
Tartu, selon laquelle<br />
Culture can be regarded as an entirety of various cultural codes, such as religions, myths,<br />
fairy-tales, popular beliefs as well as fine arts, architecture, literature and music [...]. These<br />
codes are labeled as ‘secondary modeling systems’, i.e. they are interpreted as supplementary<br />
superstructures based on natural language (ibid.).<br />
17
L’attention se porte donc sur un étagement qui voit la culture comme un ensemble<br />
regroupant des sous-codes culturels, se basant sur une structure préexistante, à savoir les<br />
langues naturelles.<br />
Après ce passage en revue de définitions de la culture, nous reprenons les aspects qui nous<br />
semblent prioritaires, dans le cadre de notre thèse. Quelles dimensions pouvons-nous<br />
retenir du concept de culture ? Nous avons vu au début les dimensions intellectuelle et<br />
comportementale mises en avant par un dictionnaire de langue contemporain. Il faut<br />
cependant ajouter d’autres composants. Le partage, tout d’abord : il n’y a pas de culture<br />
sans une collectivité qui se reconnaisse dans les idées et les traditions et qui participe à leurs<br />
survie. La culture est ensuite fonction du contexte historico-géographique et se développe<br />
également grâce à l’appréhension de la différence avec d’autres contextes et d’autres<br />
cultures. La culture se fonde sur une conceptualisation du monde, qui passe à travers le<br />
langage. Les langues, expression historico-naturelle de cette faculté, deviennent à leur tour<br />
le principal véhicule de culture et se font porteuses de valeurs qui les transcendent (les<br />
contenus de la culture) mais qu’elles contribuent à façonner, par un mécanisme dont il n’est<br />
pas toujours facile d’élucider les engrenages. Cependant, nous allons revenir sur le rapport<br />
entre langues et cultures dans le chapitre suivant.<br />
En ce qui concerne le thème de l’interculturel, des précisions terminologiques s’imposent<br />
également. Le mot interculturel (ou interculturalité 12 ) est aujourd’hui en vogue, sans aucun<br />
doute, comme l’attestent nombre de colloques et de publications. Mais il convient de<br />
préciser les tenants et aboutissants de cette notion 13 .<br />
Nous pouvons aussi remarquer quelques glissements terminologiques. Si interculturel est la<br />
dénomination la plus fréquente, WIERZBICKA (2006b) et PEETERS (2003 14 ) préfèrent parler<br />
de transculturel 15.<br />
Quand nous parlons d’interculturel, c’est bien le passage, le va-et-vient, la compénétration<br />
que nous allons souligner, non un mélange où les différences s’estompent ; au contraire,<br />
dans le cas des DB elles s’affirment en tant qu’appartenant à deux systèmes linguisticoculturels<br />
spécifiques mis en présence.<br />
RAFONI (2003: 18) propose deux définitions intéressantes du terme interculturel. D’abord elle<br />
propose celle de CLANET:<br />
12 Cf. GALISSON (1994: 15) ; LIJNEN (2005: 37)<br />
13 Pour une analyse plus approfondie, nous renvoyons à GALISSON (1994).<br />
14 La « sémantique transculturelle [est] la démarche qui consiste à étudier des mots clés en vue d’identifier des<br />
valeurs culturelles insoupçonnées et/ou découvrir des normes communicatives apparentées » (2003 : 132).<br />
15 PEETERS (à paraître-a) parle maintenant lui aussi d’interculturel.<br />
18
Ensemble des processus – psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels, etc. – générés<br />
par les interactions de culture, dans un rapport d’échanges réciproques et dans une<br />
perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle entre des partenaires en relation 16.<br />
Dans cette optique, l’interaction engendre des processus de nature différente, qui visent à<br />
sauvegarder une « relative identité culturelle ».<br />
La deuxième définition est de LADMIRAL et LIPIANSKY :<br />
Le terme même implique l’idée d’inter-relations, de rapports et d’échanges entre cultures<br />
différentes. Il faut moins le comprendre comme le contact entre deux objets indépendants<br />
(deux cultures en contact) qu’en tant qu’interaction où ces objets se constituent autant qu’ils<br />
communiquent 17 (RAFONI 2003: 18).<br />
Dans cette perspective, l’interaction est constitutive des acteurs qui participent à<br />
l’interaction. Si nous voulons transposer ces réflexions à notre problématique, nous<br />
pouvons dire que les rapports entre la langue-culture française et la langue-culture italienne<br />
ont été tellement riches et variés 18 qu’on peut affirmer que ces deux réalités se sont aussi<br />
constitués à travers l’échange.<br />
Toujours RAFONI (2003 : 20) nous rappelle que « l’interculturalité ne s’accomplit que<br />
lorsque deux cultures distinctes dialoguent et inventent un espace propre à leur<br />
interaction ». Dans le présent ouvrage, nous envisagerons le DB comme un espace, une<br />
plateforme qui rend possible cette interaction, en lui donnant des contours nouveaux.<br />
« L’interculturel, affirme BIDAUD (2003 : 80), conduit à l’appréhension de l’identité de<br />
l’individu et vers la connaissance de la nature humaine ». Pour CELOTTI (1997 : 359), à<br />
travers une approche interculturelle il sera possible de montrer « comment la culture du Soi<br />
conçoit celui qui n’est pas Soi : l’Etranger, l’Autre ». Une approche à travers l’autre, même si<br />
c’est le voisin, rend donc possible la compréhension de son identité, de ce qu’on a d’unique,<br />
ou de ce qu’on a de manifeste et qui est latent dans l’autre.<br />
LEVY-MONGELLI (1989 : 130) se demande : « Qu’est-ce que le ‘voisin’ ? C’est toujours,<br />
aussi proche soit-il, le lieu, ou la personne, séparé de l’autre par le passage d’une frontière,<br />
d’un mur ou d’une porte, ligne de démarcation à la fois réelle et symbolique ». Le lieu<br />
liminaire dans les DB, c’est sans aucun doute la page blanche qui sépare les deux<br />
macrostructures. Nous allons examiner dans la deuxième partie de notre thèse comment les<br />
deux directions (français-italien et italien-français) rendent comptent de la culture de l’autre.<br />
Le voisinage, poursuit LEVY-MONGELLI « représente ce qu’il y a de plus proche dans le<br />
différent et de plus différent dans la proximité ». Cependant, « là où les langues<br />
16 CLANET C., L’interculturel. Introduction aux approches interculturelles en Education et en Sciences Humaines, Toulouse :<br />
Presses universitaires du Mirail, 1990.<br />
17 LADMIRAL J.-R. – LIPIANSKY E.-M. (éds.), La communication interculturelle, Paris : Colin, 1989.<br />
18 Nous pensons par exemple au phénomène des faux emprunts, dont il sera question dans la deuxième<br />
partie, II.2.2.<br />
19
entretiennent un rapport de parenté historique, ou présentent une ressemblance<br />
typologique, la xénité se réduit » (ibid.) 19 . Le voisinage entre le français et l’italien n’est pas à<br />
démontrer ; nous essaierons de problématiser cette xénité entre les deux langues, telle<br />
qu’elle se manifeste dans le phénomène majeur de l’écart.<br />
Après avoir discuté les notions de culture et d’interculturel, il est temps de passer aux<br />
répertoires qui font l’objet de cette thèse : les DB.<br />
CALVI (2006 : 98) insiste sur le « profilo interculturale che si richiede oggi ai dizionari » et<br />
sur leur « sguardo interculturale ». Les langues sont envisagées, nous l’avons vu, comme<br />
partie intégrante d’une culture, dont elles véhiculent les contenus de façon privilégiée par<br />
rapport à d’autres codes. Nous tâcherons de montrer si les DB de notre corpus prennent<br />
en compte cette nouvelle perspective, et comment.<br />
LAURIAN (2004 : 11-12) affirme que, d’après une idée bien répandue, « la culture est un<br />
ensemble de connaissances ». Elle se demande par la suite : « Le dictionnaire bilingue peutil<br />
fournir ces connaissances? A-t-il vocation à le faire? Il s’agit d’un savoir encyclopédique<br />
que l’apprenant ou le traducteur doit en principe trouver ailleurs ». Sans doute, mais nous<br />
nous demandons aussi : est-ce qu’il est possible de disjoindre la forme (la langue) et les<br />
contenus (connaissances encyclopédiques), lorsque ces connaissances sont exprimés par<br />
une langue qui leur a donné une forme et les a véhiculés au fil des générations ? Et, plus<br />
radicalement, est-ce qu’une subdivision nette entre connaissance linguistique et<br />
connaissance encyclopédique est possible dans les dictionnaires ? Nous reviendrons dans<br />
les chapitres suivants sur ces questionnements.<br />
Qu’est-ce qui est culturel dans une langue et dans un dictionnaire? Quelles dimensions<br />
convient-il d’aborder?<br />
Nos considérations ne concerneront guère les domaines de la grammaire (syntaxe et<br />
morphologie) et de la phonétique, quoiqu’il ne soit pas exclu que des traits culturels<br />
puissent y être présents aussi. Nous rappelons, entre autres, les études de FOURMENT<br />
BERNI-CANANI (2003b) et WIERZBICKA (1988a), qui ont cru repérer des traits culturels<br />
dans des structures morphologiques aussi.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI (2003b) met l’accent sur l’affectivité (en rejoignant les<br />
considérations de SCAVEE-INTRAVAIA : 1979) de l’italien et sur ses marques langagières.<br />
Parmi les « manifestations verbales » qui témoignent de cette « préférence collective », elle<br />
cite notamment l’ « emploi massif de suffixes diminutifs, une préférence pour l’article défini<br />
par rapport à l’indéfini ou au possessif et [...] un emploi particulier du pronom personnel<br />
datif » (FOURMENT BERNI-CANANI 2003b : 90). Il s’agit donc de catégories grammaticales,<br />
qui manifestent pour l’auteure une spécificité culturelle<br />
19 Pour le concept de xénité, cf. WEINRICH (1986).<br />
20
Pour WIERZBICKA (1979) c’est la grammaire dans sa totalité qui recèle des faits culturels 20.<br />
En guise d’explication, elle écrit que « since the syntactic constructions of a language<br />
embody and codify certain language-specific meanings and ways of thinking, the syntax of<br />
a language must determine to a considerable extent the language’s cognitive profile »<br />
(1979 : 313). La méthode MSN, que WIERZBICKA a fondée et qui s’est développée<br />
empiriquement à partir des années 1990, a permis de conjuguer une recherche sur la langue<br />
avec une enquête sur les phénomènes culturels encodés dans la langue 21 . Mais nous<br />
reviendrons sur ce paradigme de recherche plus bas. Pour l’instant, nous devons préciser<br />
que la nature même de notre corpus nous éloigne d’une préoccupation sur les phénomènes<br />
culturels inscrits dans la grammaire et la syntaxe.<br />
Essayons maintenant d’analyser comment le dictionnaire articule une réflexion sur la<br />
culture, comment il tisse des liens entre les cultures et quel est le rôle qu’il joue vis-à-vis des<br />
communautés linguistiques.<br />
CLAS (2006 : 139) cite HAUSMANN 22 (1985 : 369), pour lequel « un dictionnaire est une<br />
collection d’unités lexicales (avant tout des mots) avec des informations spécifiques,<br />
présentées par un médium spécifique, destinées à un utilisateur spécifique et qui doivent<br />
être ordonnées de telle façon à permettre un accès rapide ». C’est une définition qui met<br />
bien en évidence le rapport aux usagers et la dimension instrumentale du dictionnaire.<br />
L’école fonctionnaliste scandinave, dont TARP est l’un des représentants les plus<br />
importants, a également insisté sur cette dimension, comme nous pouvons lire dans cette<br />
définition : « Dictionaries are man-made, culture-specific products which have been<br />
developed to meet certain social needs » (TARP 2008 : 4). Le fait que les dictionnaires soient<br />
des produits ciblés n’empêche pas qu’ils soient des produits liés à la culture dont ils<br />
émanent.<br />
D’après QUEMADA (1987: 236)<br />
Le dictionnaire est, à la fois, un projet fondé sur un ensemble d’options typologiques ou<br />
méthodologiques et sur la mise en œuvre d’un choix représentatif de valeurs linguistiques,<br />
culturelles, etc., et un produit doté de caractéristiques concrètes, physiques et économiques:<br />
projet+produit=objet-dictionnaire [...]. Ces deux ensembles constitutifs sont étroitement<br />
dépendants des modèles de référence linguistiques et extra-linguistiques, et du contexte<br />
socioculturel et techno-économique.<br />
20 « Grammatical categories, syntactical constructions, part-of-speech membership, etc. are considered as nonarbitrary<br />
instantiations of culture-specific conceptualizations based on a few universal principles » (DURST<br />
2003a : 190).<br />
21 GODDARD (2002), sur la lancée de WIERZBICKA (1979), parle d’ethnosyntaxe.<br />
22 « Lexikographie », in SCHWARZE – WUNDERLICH (éds.), Handbuch der Lexikologie, 1985, p. 364-411.<br />
Traduction de la citation de A. CLAS.<br />
21
Le dictionnaire est donc la somme d’un projet lexicologique et d’une réalisation<br />
lexicographique. Mais ce qui nous semble intéressant à souligner c’est que la culture, aussi<br />
bien que la langue, y est présente avec ses valeurs ‘mis en mots’. Et de l’autre côté, toute<br />
mise en œuvre lexicographique est en fonction d’un « contexte socioculturel et technoéconomique<br />
» donné, qui la détermine nécessairement.<br />
D’après CORBIN et GASIGLIA, les dictionnaires (monolingues)<br />
sont tout à la fois témoins des usages lexicaux et outils de leur normalisation et, comme tels,<br />
contribuent solidairement au façonnement des représentations sociales du lexique et des<br />
leurs propres (2009 : 8).<br />
Ces auteurs insistent donc plutôt sur le rôle à la fois descriptif et normatif que ces ouvrages<br />
jouent, et qui deviennent des foyers de « représentations sociales », participant ainsi au<br />
dynamisme de la culture.<br />
Quelles sont les fonctions des dictionnaires au sein d’une société ? Selon FREY (2004 : 197),<br />
les dictionnaires ont une triple fonction, à savoir descriptive, didactique et symbolique. A propos<br />
de cette dernière, la dimension culturelle est ainsi explicitée : « la description renvoie un<br />
reflet culturel, permettant à l’usager-locuteur de reconnaître son environnement<br />
socioculturel, de se reconnaître dans cet environnement, et d’assumer une valeur<br />
identitaire ». Ces considérations se réfèrent en priorité aux monolingues, il faut préciser ;<br />
nous verrons au cours de la deuxième partie comment ces trois fonctions (descriptive,<br />
didactique et symbolique) seront opératoire dans les DB, et comment la réflexion sur la<br />
culture entrera en jeu.<br />
FREY poursuit : « le dictionnaire est […], en même temps qu’un outil de description et un<br />
appareil didactique, un instrument de reconnaissance identitaire et égalitaire qui témoigne<br />
de la culture de l’Autre, et amène à le connaître et à le reconnaître » (2004 : 209). Si la<br />
« culture de l’Autre » est présente dans n’importe quel dictionnaire, elle s’impose dans les<br />
DB : elle y sous-tend tous les choix d’équivalence du lexicographe.<br />
Pour éviter les chocs des langues et des cultures, il faut selon FREY (2004 : 197) « connaître<br />
et reconnaître l’Autre, à travers sa culture, et à travers les mots qui reflètent cette culture ».<br />
Ces considérations ne sont pas exemptes d’une préoccupation sur l’interculturel.<br />
Pour ce qui est de la norme culturelle des dictionnaires, les propos de DUBOIS – DUBOIS<br />
(1971) sont primordiaux :<br />
Le lexicographe ne se propose pas seulement de faire la description du lexique dans les<br />
performances verbales des sujets parlant le français, mais aussi celle des attitudes de ces<br />
sujets à l’égard des types de comportement verbaux parlés ou écrits. Le dictionnaire est un miroir<br />
dans lequel le lecteur doit se reconnaître à la fois comme locuteur natif et comme<br />
participant à une culture : il doit y trouver non seulement la confirmation de ses propres<br />
jugements de grammaticalité, définissant la correction des phrases, mais aussi celle de ses<br />
jugements d’acceptabilité définissant son appartenance à une culture [...]. Cette culture est<br />
22
faite d’un ensemble d’assertions sur l’homme et sur la société [...]. Quel que soit son<br />
type (encyclopédique ou linguistique, bilingue ou monolingue, etc.) le dictionnaire est une<br />
description de la culture et, en ce sens, il est un texte culturel 23 (1971 : 99).<br />
DUBOIS (1970 : 43) ajoute : « Le discours lexicographique n’est pas seulement un énoncé<br />
pédagogique sur la langue, il est aussi une didaxie de la culture [...]. Le dictionnaire vise à se<br />
constituer comme une norme explicite de la culture de la communauté linguistique ». Les rapports<br />
entre langue, culture et lexicographie ne sauraient être mieux décrits.<br />
Comme le souligne GIRARDIN (1987 : 77),<br />
le discours lexicographique n’est pas neutre, il véhicule un contenu culturel, il émet des<br />
jugements de condamnation ou de valorisation qui s’expriment par rapport à une norme<br />
linguistique et culturelle qui prend pour référence l’univers langagier de la culture dominante.<br />
La représentation de la variation dans les dictionnaires de langue a connu une évolution<br />
significative : de l’autoritarisme et centralisme du XVII e on est passé à une attitude plus<br />
laïque, oserions-nous dire, qui met au centre la description lexicographique de la réalité<br />
langagière. Comme le précise GIRARDIN, il s’est agi d’une évolution très lente, les normes<br />
de la morale dominante ayant longtemps servi de rempart contre l’inclusion de bon nombre<br />
de termes tabous.<br />
Nous avons vu plusieurs facettes du dictionnaire, mises en valeur par les différents auteurs.<br />
Nous pouvons les synthétiser ainsi :<br />
- dictionnaire comme produit visant un certain public<br />
- dictionnaire comme artefact culturel.<br />
Ces aspects sont valables pour n’importe quel dictionnaire. Mais comment est-il possible<br />
définir le DB ? Au point de vue linguistique, d’après LAURIAN (2004 : 1), c’est « un ouvrage<br />
présentant un ensemble de vocables d’une langue 1 et leurs correspondants dans une autre<br />
langue, la langue 2 ».<br />
TARP (2005) fait un examen critique intéressant de plusieurs définitions de DB et,<br />
conformément à son optique fonctionnaliste il arrive à la conclusion que « whether a<br />
dictionary is monolingual or bilingual is [...] a secondary question whereas the function(s) of<br />
the dictionary should always be given priority » (2005 : 36).<br />
Dans une optique qui nous concerne davantage, CELOTTI (1998 : 119), définit le DB<br />
comme « un espace langagier bilingue qui peut nous offrir une occasion d’observer deux<br />
langues, deux cultures qui se rencontrent ».<br />
23 Ce sont les auteurs qui soulignent. Dans les notes suivantes, nous n’allons plus répéter cette mention,<br />
lorsque c’est l’auteur qui souligne.<br />
23
Les DB fondent donc un espace tiers où les enjeux, nous le verrons, tournent autour de<br />
l’équivalence linguistique et culturelle.<br />
24
I.1 Langues et cultures. Comment situer les enjeux ?<br />
I.1.1. De Humboldt à Benveniste<br />
Au XIX e siècle, W. VON HUMBOLDT (1767-1835) envisageait les langues comme des sujets<br />
fondés historiquement, expression à leur tour de diversités culturelles. La langue était<br />
définie comme une perspective du monde (Weltansicht) 24. Comme l’écrit une exégète italienne<br />
de HUMBOLDT (DI CESARE 1993: XLI-XLII) : « Se il mondo si costituisce solo con e nel<br />
linguaggio, manifestandosi quest’ultimo nelle lingue, vi sarà non un mondo, ma una<br />
pluralità di mondi corrispondenti alla pluralità di prospettive che ciascuna lingua<br />
dischiude ». Dans cette même perspective, en 1821, LEOPARDI peut écrire que « l’indole<br />
della favella è sempre il fedelissimo ritratto dell’indole della nazione » 25 .<br />
On ne peut pas parler de relativisme en sciences du langage sans évoquer la théorie connue<br />
comme hypothèse de Sapir-Whorf. Bien que ce ne soit pas l’endroit pour un examen par le<br />
menu de cette tradition de recherche 26, nous souhaitons nous arrêter quelque peu sur cette<br />
notion.<br />
Dans les années 1950, B.L. WHORF a mis au point, en s’inspirant des travaux de SAPIR, un<br />
principe de relativité linguistique selon lequel « all observers are not led by the same physical<br />
evidence to the same picture of the universe, unless their linguistic backgrounds are similar,<br />
or can in some way be calibrated » 27 . En définitive, chaque langue sous-tend une vision<br />
globale déterminée du monde 28. Dans ses enquêtes sur le terrain, WHORF découvre que les<br />
Hopi (une population amérindienne qui vit dans le nord de l’Arizona) ne connaissent pas la<br />
catégorie des temps grammaticaux. A partir de ce fait, WHORF tire des conclusions sur<br />
l’atemporalité qui caractérise leur société et, de l’autre côté, insiste sur la hantise du temps<br />
qui serait le propre de la civilisation occidentale.<br />
Cette vision assez radicale a été ramenée, avec le temps, à de plus justes proportions, car le<br />
rapport entre langue et culture ne peut pas se réduire à une domination de la langue sur la<br />
culture (preuves en soient, entre autres, la possibilité de la traduction et du métalangage).<br />
L’hypothèse relativiste (et assez déterministe, il faut le souligner) d’une influence de la<br />
langue sur la pensée semble aujourd’hui intenable, et les contre-épreuves sont tellement<br />
24 Cf. MANCINI M., « Introduzione », in CARDONA (2006 [1976] : XV).<br />
25 Zibaldone, p. 1513-1515 du manuscrit.<br />
26 Pour cela, voir HOIJER (1954), CANTONI (1999), LUCY (2000).<br />
27 B.L. WHORF (1956), Science and lingustics, in Language, thought and reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whorf,<br />
Cambridge : Massachussets Institute of Technology, p. 214.<br />
28 Cf. CANTONI (1999 : 318).<br />
25
convaincantes et variées 29 qu’il nous paraît à présent redondant d’en proposer à notre tour<br />
une réfutation par le menu.<br />
Toutefois, il peut être utile de voir quelques critiques significatives à cette théorie.<br />
TELIYA et al. (1998 : 56) nous rappelle tout d’abord que « Edward Sapir [...] was the first to<br />
postulate explicitly that language represents and conceptualizes reality in a cultural specific<br />
manner ». HUMBOLDT et BOAS ont en effet posé les bases d’une théorie que SAPIR a<br />
développé plus systématiquement.<br />
WEINRICH (1986), pour sa part, critique radicalement la méthodologie d’enquête sur la<br />
langue des Hopi mise en œuvre par WHORF, qui serait à son avis incapable de révéler quoi<br />
que ce soit sur sa structure syntaxique et grammaticale. Il critique également la<br />
Sprachinhaltsforschnung (linguistique du contenu) qui se réclamait de HUMBOLDT ; les<br />
représentants de ce dernier groupe 30 , fondé par L. WEISGERBER (1899-1985), croient que le<br />
monde a déjà été ‘mis-en-mots’, une fois pour toutes, par la langue de la communauté<br />
linguistique à laquelle on appartient (voici donc une autre version de la théorie de relativité<br />
linguistique). WEINRICH soutient par contre une idée universaliste, et insiste sur l’existence<br />
d’universaux présents dans toutes les langues 31 .<br />
REY (1991 : 2869) reconnaît que « malgré ses excès, l’hypothèse de Sapir et Whorf soustend<br />
de manière indispensable un examen des écarts sémioculturels inscrits dans les<br />
lexiques, et donc celui de leur traitement, très imparfait, dans les dictionnaires ». Voici donc<br />
un lien possible entre cette hypothèse (qui affirme que la pensée est influencée par la<br />
langue) et l’étude des écarts, que nous aborderons dans la deuxième partie et qui<br />
témoignent des différences ‘sémioculturelles’ entre deux langues mises en présence dans un<br />
DB.<br />
WIERZBICKA reconnaît que « the majority of traditional Whorfian writings on language and<br />
culture suffer [...] from arbitrariness, subjectivity and a tendency to fantasy unconstrained<br />
by any rigorous method » (1979 : 377); autant de limites qu’elle essaiera de pallier grâce à sa<br />
méthode MSN 32 . Cependant, GODDARD-WIERZBICKA croient que « Sapir was right when<br />
he said that ‘vocabulary is a very sensitive index of the culture of a people’ » (2002b : 267).<br />
Il s’agit donc plutôt de la méthode de WHORF qui est critiquée ; les fondements de sa<br />
théorie sont par contre valorisés comme prometteurs et avant-coureurs.<br />
Parmi les héritiers de la tradition de recherche du relativisme linguistique, nous pouvons<br />
compter LUCY (2000 : IX), qui distingue deux niveaux de relativité linguistique. Le premier<br />
est sémiotique : la capacité langagière de l’homme, à travers l’intégration d’un système<br />
symbolique, implique une transformation des fonctions intellectives. Quant au deuxième<br />
niveau, le niveau structurel, il concerne les « configurations morphosyntaxiques » (mais aussi<br />
29 Cf. entre autres NISBET (2003), AMATI MEHLER et al. (2003), SCHLESINGER (1991), BRINK (1971).<br />
30 Dont est issu entre autres E. WÜSTER.<br />
31 Nous verrons plus bas comment cette tradition de recherche sera reprise par WIERZBICKA.<br />
32 Cf. infra, I.7.<br />
26
phonologiques et pragmatiques) différentes d’une langue à l’autre, et tout ce que cela peut<br />
impliquer au niveau de la pensée vis-à-vis de la réalité. Selon LUCY, les présupposés d’une<br />
théorie de la relativité linguistique sont les suivants : « (1) language embodies an interpretation<br />
of reality and (2) language can influence thought about that reality » (2000 : X). La<br />
conséquence serait que « each language involves a particular interpretation [de la réalité],<br />
not a common, universal one » (ibid.). Il s’agit donc d’une version faible du relativisme<br />
linguistique : les langues peuvent influencer la pensée, mais n’en déterminent pas les<br />
contours.<br />
La thèse relativiste peut être donc résumée en ces termes : « à la diversité des langues<br />
correspond une diversité des concepts qu’elles véhiculent » (RASTIER 1991 : 95).<br />
Sans être relativistes, de nombreux auteurs se sont penchés sur les rapports entre langue et<br />
culture.<br />
LEVI-STRAUSS, dans son Anthropologie structurale (1958), considérait la langue « comme<br />
faisant partie de la culture, produit de la culture et condition de la culture » 33.<br />
En plein structuralisme, pour JAKOBSON (1963 : 28), « le langage, c’est réellement les<br />
fondations mêmes de la culture ».<br />
HJELMSLEV (1968 : 149) revient sur des thèmes humboldtiens lorsqu’il affirme que « la<br />
langue nationale est le ‘symbole’ de la nation ».<br />
E. BENVENISTE (1974 : 24) note que « l’homme ne naît pas dans la nature, mais dans la<br />
culture ». Et encore, « aucune langue n’est séparable d’une fonction culturelle » (ibidem).<br />
Cependant pour BENVENISTE, comme le rappelle LARRIVEE, « le rapport essentiel entre<br />
langue et société est celui d’interprétant à interprété [...]. Cette relation asymétrique<br />
n’empêche pas l’interdépendance entre société et langage, puisque le langage suppose la<br />
représentation de l’autre et la société repose sur la médiation entre les individus » (2008 :<br />
93).<br />
L’imbrication entre les langues et les communautés est bien mise en valeur par ces auteurs :<br />
loin de constituer un simple outil, les langues ont une fonction identitaire et de cohésion de<br />
l’imaginaire qui ne peut pas être négligée.<br />
I.1.2 Développements récents<br />
Plus récemment, TELIYA et al. (1998 : 56) ont fait évoluer le concept de relativité<br />
linguistique : « The notion of linguistic relativity can be reformulated as linguistic-cultural<br />
relativity : language is the means of representing and reproducing culture ». Dans leur<br />
33 Cité par GUILLEN DIAZ (2003 : 40).<br />
27
éflection sur la phrasésologie, ils définissent le paradigme anthropomorphique en linguistique,<br />
« whose fundamental assumption is that the linguistic world-picture is commensurable with<br />
the mental attitudes and culture of a speech community ».<br />
Les auteures proposent 34<br />
five channels through which language is penetrated by culture : cultural semes [words and<br />
word-combinations that denote idioethnic, material and socio-historical realia], cultural<br />
concepts [abstract notions that map and construct the world-picture in a culturally specific<br />
way], cultural connotations [the interpretative relation between linguistic signs and symbols<br />
of any other cultural non-verbal code (stereotypes, prototypes, myths...)], cultural<br />
background [when words possess a clearly discernible aura associated with a historical<br />
situation, a political movement, a fashionable trend and so on], and discourse stereotypes<br />
[religious and philosophical discourse, literary discourse, poetic folklore discourse, political<br />
discourse] (TELIYA et al. 1998 : 58-62).<br />
Les niveaux dégagés sont donc : les sèmes culturels, qui dénotent les realia matériaux ou<br />
symboliques ; les concepts culturels, qui témoignent du découpage du réel ; les<br />
connotations culturelles, qui concernent les relations des signes à des codes non verbaux ;<br />
l’arrière-plan culturel, qui s’inscrit dans un fond représentationnel ; les stéréotypes de<br />
discours.<br />
A leur avis (1998 : 63), « cultural Weltansicht is imposed by language [and] native speakers’<br />
cultural patterns [...] are locked up in language ». Nous sommes donc dans une optique qui<br />
insiste beaucoup sur la présence de modèles culturels, inscrits en profondeur dans les<br />
langues.<br />
A propos du découpage sémantique du réel, DE CARLO (1995 : 76), nous rappelle que « les<br />
linguistes [...] ont démontré que les langues n’expriment pas les mêmes choses de façon<br />
différente, chaque langue est le produit et en même temps la condition d’une perception du<br />
monde originale ». Et encore :<br />
Pourquoi la langue représente-t-elle un facteur essentiel d’identité culturelle ? En premier<br />
lieu parce qu’elle imprègne la vie de la communauté, elle exprime de façon immédiate et<br />
évidente l’appartenance à un groupe social où à une ethnie ; ensuite parce qu’elle établit un<br />
lien clair et structuré avec le passé (1995 : 82).<br />
L’auteur souligne donc le rôle identitaire et structurant du lexique ; nous garderons à l’esprit<br />
ces considérations lorsque nous nous attacherons à l’analyse de notre corpus, notamment<br />
pour ce qui concerne les registres de langue (et leurs écarts) et la dimension mémorielle des<br />
unités lexicales.<br />
34 Les explications entre crochets sont des auteures.<br />
28
La réflexion de M.-A. PAVEAU (2006 : 40) est aussi de grand intérêt. Elle évoque l’étude de<br />
KERBRAT-ORECCHIONI 35, qui<br />
propose d’ajouter deux compétences non linguistiques au schéma de la communication de R.<br />
Jakobson, les ‘déterminations psychologiques et psychanalytiques’ des locuteurs et une<br />
compétence qu’elle ne nomme pas mais qui se constitue de ‘leurs compétences culturelles<br />
(ou ‘encyclopédiques’, ensemble des savoirs qu’ils possèdent sur le monde) et idéologiques<br />
(ensemble des systèmes d’interprétation et d’évaluation de l’univers référentiel) qui<br />
entretiennent avec la compétence linguistique des relations aussi étroites qu’obscures, et dont<br />
la spécificité vient encore accentuer les divergences idiolectales’.<br />
Dans quelle mesure les dictionnaires, dans le modèle de communication qui leur est propre,<br />
se doivent de rendre compte de ces compétences ? Dans quelle mesure les reflètent-ils ?<br />
BIDAUD revient sur les rapports entre langues et structures culturelles (2003: 63):<br />
Un même référent donne lieu, dans les différentes langues/cultures, à des mots plus ou<br />
moins nombreux, à résonances différentes, et par conséquent à signifiés différents […].<br />
Derrière les mécanismes, les choix qui ont porté une langue à représenter tel sens ou tel<br />
référent, on devrait donc pouvoir découvrir un reflet des mentalités, sinon une certaine<br />
intentionnalité de la collectivité des sujets parlants, peut-être même des motivations.<br />
Dans cette même optique, SZENDE (1993 : 76) écrit que : « Chaque langue est le symptôme<br />
d’une civilisation qui s’exprime à travers elle ». Et WERLY d’ajouter (1995 : 159): « Chaque<br />
idiome contient et véhicule la Weltanschauung propre à la communauté qui l’utilise ». Quel<br />
est donc le rapport entre les langues et la vision du monde ?<br />
I.1.3 Lexique et Weltanschauung<br />
Beaucoup d’auteurs sont d’accord pour affirmer que c’est dans le lexique qu’on peut<br />
trouver le plus d’implications culturelles.<br />
WIERZBICKA écrit :<br />
Lexical items also embody language-specific ways of thinking. But the semantic analysis of an<br />
entire lexicon is a gigantic and practically unfeasible task ; and a cognitive description of a<br />
language which confines itself to selected lexical items is usually open to the charge of being<br />
arbitrary and therefore inconclusive (1979 : 313).<br />
Nous nous rendons compte de l’aporie que WIERZBICKA souligne ; voilà pourquoi nous<br />
avons choisi de ne pas entreprendre une analyse du point de vue cognitif du lexique (ou<br />
même de tranches du lexique) français et italien. Nous nous bornerons plus modestement,<br />
dans la deuxième partie de cette thèse, à une étude de quelques phénomènes révélant des<br />
35 L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris: Colin, 1980, p. 16.<br />
29
intersections entre langue et culture, articulant de façon singulière le rapport linguistiqueextralinguistique.<br />
Notamment, nous nous concentrerons sur le phénomène des écarts, sur<br />
les exemples à fonction culturelle, sur les notes culturelles et sur les faux emprunts dans les<br />
DB de notre corpus.<br />
Selon A. REY (1970 : 179), « Les relations entre la langue d’une communauté humaine et sa<br />
culture – au sens anthropologique –, sa civilisation, sont particulièrement manifestes dans le<br />
lexique, dont les formes articulent en l’exprimant le contenu de l’expérience sociale ». Dans<br />
la deuxième partie nous essaierons justement de mettre à jour ces relations, telles qu’elles<br />
apparaissent dans ces répertoires lexicaux, sanctionnés socialement et historiquement, que<br />
sont les dictionnaires.<br />
Toujours en ce qui concerne les rapports entre langues et visions du monde, JIMENEZ<br />
HURTADO nous rappelle que pour COSERIU « las diferencias entre las lenguas son<br />
eminentemente léxicas, en que reflejan la cosmovisión representada por las distintas<br />
comunidades » (2001 : 14).<br />
Si on ne peut pas parler de domination de la langue sur la culture, cela ne signifie pas que<br />
ces deux réalités soient tout à fait indépendantes. Cette imbrication est soulignée par CLAS<br />
– ROBERTS (2003 : 141) : « Le lexique d’une langue est [...] le reflet de la complexité<br />
culturelle d’un groupe et correspond à son système symbolique ». Et MAHER (2006 : 207) :<br />
« Lexical differences between languages give us an insight into differences in cultural values<br />
and priorities ». A travers une étude du lexique, il serait donc possible d’entrevoir un reflet<br />
des structures et des valeurs inscrites dans une langue-culture.<br />
Mais quelle approche faut-il adopter ? A l’instar de CLAS-ROBERTS (2003 : 240), nous<br />
croyons qu’il est « extrêmement délicat de déduire des considérations psycho-sociologiques<br />
de faits de langue ». Après avoir évoqué la tentative de WANDRUSZKA 36 qui avait repéré des<br />
mots clés qui traduiraient le ‘tempérament’, la ‘mentalité’ ou encore la ‘sensibilité’ d’un<br />
peuple [...]. Pour le français, on aurait : ‘politesse’, ‘galanterie’, ‘coquetterie’, ‘esprit’, ‘goût’,<br />
‘savoir-vivre’, ‘noblesse’, ‘finesse’, ‘raffinement’, ‘nuance’, ‘verve’ ; pour l’italien : ‘brio’,<br />
‘dolce’, ‘farniente’.<br />
CLAS-ROBERTS affirment que ces mots ne cachent que des « traits littéraires des siècles<br />
passés, [ou] quelques clichés » (2003 : 241-242). Dans cette thèse nous n’essaierons<br />
évidemment pas de dégager le caractère essentiel du français ou de l’italien, pour la simple<br />
raison que nous ne croyons pas qu’il y en ait un 37 .<br />
RIVAROL, au XVIII e siècle, affirmait « Ce qui n’est pas clair n’est pas français ». Des<br />
tentatives pareils, qui définissent une identité a priori sont évidemment idéologiques et<br />
36 Die Mehrsprachigkeit der Menschen, München : Piper, 1979.<br />
37 C’est seulement des poètes, comme par exemple Y. BONNEFOY, qui peuvent parler de ‘métaphysiques<br />
contraires’ de l’anglais et de l’allemand, rejoignant en quelque sorte les considérations de VINAY et<br />
DARBELNET dans leur Stylistique comparée (1958).<br />
30
cachent la réalité de phénomènes tout à fait français, nous pensons notamment à la « langue<br />
de bois ».<br />
Nous n’emploierons pas le mot génie, qui indique sans conteste une « notion extrêmement<br />
vague » (KASSAI 1994 : 511). SZENDE (1993 : 75) est l’un des derniers à utiliser encore ce<br />
mot (« Le génie des langues, c’est aussi des préférences, des silences ou des redondances »),<br />
pour indiquer des angles expressifs privilégiés 38 . Toujours SZENDE parle du génie de la langue<br />
comme d’une expression « a little vague but so full of imagery », qui se réfère au « vast<br />
world of usages and conventions » (SZENDE 1999 : 227). GALISSON (1987a: 138) à son tour<br />
définit le génie une « manière particulière de se représenter la réalité, par l’intermédiaire des<br />
signes qui la désignent » 39 .<br />
La linguistique a dépassé depuis longtemps une approche hypostasiante de la langue (en<br />
vogue surtout au XIX e ), ou essentialiste comme l’appelle FRATH (2008a) : le but est<br />
aujourd’hui celui d’appréhender la langue à travers les faits de discours. Dans une<br />
polémique avec des approches qui gardent une dimension essentialiste, FRATH (2008a : 12)<br />
soutient que « la linguistique gagnerait beaucoup à abandonner les chimères platoniciennes<br />
du code au profit de l’observation de l’usage ». Encore de nos jours, « trop de travaux<br />
consistent à rechercher la substance de la langue [...]. Il y aurait ainsi un code derrière la<br />
langue qu’il s’agirait de percer, une essence du langage que l’on devrait pouvoir atteindre »<br />
(2008a : 8). Ce qui implique, selon l’auteur, une approche dépassée, anachronique.<br />
Dans une typologie des approches possibles aux faits de langue, FRATH (2008b : 47) cite les<br />
« linguistiques de l’accumulation, [dont] l’attitude face à la théorie est essentiellement<br />
l’indifférence. Ce point de vue est à l’œuvre dans la compilation des dictionnaires », par<br />
exemple. Ces approches manquent d’une « vision d’ensemble qui produise un lien entre les<br />
observations, et qui leur donne sens ». Le point de vue de FRATH est « d’emblée<br />
communautaire et externaliste », en opposition aux linguistiques cartésiennes,<br />
« individuelles et internalistes » (ibid.). C’est donc une approche qui fait la part belle aux<br />
aspects communautaires et « externes », moyennant un lien solide avec la référence.<br />
Toutes ces contributions nous amènent à conclure que, si un relativisme déterministe est à<br />
exclure, il est par contre possible de prendre en examen l’hypothèse de l’existence de traits<br />
culturels dans les langues. Il se dessinerait donc un certain parallélisme entre les langues et<br />
leurs communautés de locuteurs. Nous avons choisi d’étudier ce parallélisme dans les DB,<br />
des ouvrages culturels par excellence. Notamment, ces affinités entre langues et cultures<br />
seront manifestes dans l’analyse des écarts. Paradoxalement, là où les langues divergent,<br />
l’unicité qui les distingue et le rapport qui les lie à leur culture de référence se font plus<br />
visible.<br />
38 Cf. DAGUT 1981 ; BRINK 1971.<br />
39 L’emploi du mot idiosyncrasie, que le PR11 définit comme « tempérament personnel », et de son adjectif<br />
idiosyncratique, lorsqu’on parle d’une langue, relèvent d’un anthropomorphisme assez flagrant. Nous<br />
considérons toutefois ce terme comme un pis-aller, certainement préférable à génie et à son goût suranné.<br />
31
Pour résumer, nous rappelle ROBERTS (2007 : 277-278), « language is a part of culture » et<br />
« culture is mediated by language ». C’est pour cette raison que « dictionaries [...] present<br />
the culture underlying the language ». Comment est-ce que cette culture qui sous-tend la<br />
langue est présente dans les dictionnaires ? CALVI (2006 : 86) nous signale une piste : « Nel<br />
momento in cui offre definizioni e commenti, un DB poggia, come ogni monolingue, su<br />
una determinata visione del mondo ».<br />
Nous essaierons de répondre mener cette analyse sur l’articulation du linguistique et du<br />
culturel dans la deuxième partie de cette thèse.<br />
Maintenant, nous croyons qu’il est nécessaire de nous arrêter sur la genèse et le<br />
développement de la lexicographie bilingue.<br />
32
1.2 Vers un ancrage théorique<br />
Nous nous posons maintenant les questions suivantes : quelles sont les origines des DB ?<br />
Est-il possible de mieux comprendre leur fonction et leur identité, en se penchant sur leur<br />
développement historique ?<br />
CALZOLARI (2006 : 327) nous rappelle que « il dizionario bilingue nasce come oggetto preteorico,<br />
per usi pratici ». Les DB naissent en effet dans le III e millénaire av. J.-C. comme des<br />
glossaires mot à mot. Au principe ce furent des tablettes mésopotamiennes, comme le<br />
rappelle SNELL-HORNBY (1986 : 208) : « The impact of the Sumerian culture on the<br />
Akkadians gave rise to the oldest bilingual word list known to us, in which the Sumerian<br />
entries were provided with pronunciation glosses and Akkadian translations ». Il faut bien<br />
comprendre que la naissance de ces listes (glossaires) bilingues était liée à un contexte<br />
linguistique et culturel précis, marqué par la prédominance culturelle d’une culture sur une<br />
autre (la culture sumérienne sur l’akkadienne, notamment) ; d’autant plus, il faut souligner<br />
qu’une partie seulement du lexique était traitée, notamment « names and concrete objects, a<br />
level where equivalence is most easily reached » (SNELL-HORNBY 1986 : 214).<br />
La lexicographie bilingue naît donc dans une situation de diglossie où une langue jouit d’un<br />
prestige majeur et devient, pour ainsi dire, la langue-source 40 . Cette situation se reproduira à<br />
l’époque moderne, lorsque le latin sera la langue-source dominante jusqu’au XVII e siècle :<br />
« le dictionnaire, au moins dans le contexte européen, est né des gloses en latin ou en<br />
langue vulgaire de certains textes latins au Moyen Âge » (BEJOINT 2005 : 12).<br />
La tradition en lexicographie bilingue (et sans doute aussi le propre de cet outillage intellectuel)<br />
est donc toute du côté de la réception en langue-cible 41 , plutôt que de la production en<br />
langue-source. Toutefois, une évolution du modèle resterait toujours possible. Ce qui pose<br />
davantage problème, c’est l’équivalence en soi. La lexicographie bilingue est née comme<br />
une ‘glossaristique’, comme un répertoire de signes engagés dans un cheminement<br />
référentiel clair et univoque : on était bien du côté de la terminologie. Les échanges entre<br />
les peuples se faisant de plus en plus complexes et le lecteur idéal évoluant du marchand au<br />
voyageur, surgit la nécessité d’un traitement plus exhaustif des différentes tranches du<br />
lexique. Cependant, cet élargissement du domaine de la description implique bien d’autres<br />
dimensions que l’étendue de la macrostructure, comme nous le verrons par la suite.<br />
Voici donc un premier facteur, historique, qui a déterminé la naissance et le développement<br />
des DB tels que nous les connaissons, et qui peut expliquer leur déséquilibre en faveur de la<br />
réception.<br />
40 Cf. aussi BOULANGER (2000).<br />
41 Comme le démontre aussi le premier véritable dictionnaire français, le Dictionnaire françois-latin de R.<br />
ESTIENNE (cf. PRUVOST 2006 : 20)<br />
33
Un autre élément que nous pouvons souligner, historiquement fondé, est une sorte de<br />
‘sentiment d’infériorité’ des DB par rapport aux cousins ‘nobles’, les monolingues. Cet état<br />
de choses peut s’expliquer assez aisément : les dictionnaire monolingues ont souvent été<br />
conçus pour ‘illustrer’ la gloire d’une langue nationale. Le Grimm 42 a rempli cette fonction<br />
pour l’allemand, ainsi que le Dictionnaire de l’Académie pour le français, quoique assez<br />
différemment 43 . DUVAL (1993 : 15) résume très clairement cette situation : « Le dictionnaire<br />
monolingue est généralement perçu comme ouvrage de référence, objet de culture, moyen<br />
de connaissance, arbitre [...]. Le dictionnaire bilingue, en revanche, n’a jamais été considéré<br />
comme objet de culture ».<br />
Nous savons également que cette idée de langue nationale (élitaire, passéiste) ne serait plus<br />
tenable aujourd’hui. Les dictionnaires, de façon générale, portent la marque de cette<br />
‘laïcisation’ progressive. Il est possible de remarquer les phénomènes suivants :<br />
- passage du normativisme au descriptivisme (avec les niveaux de langue qui sont de<br />
moins en moins discriminés, sous-représentés ou stigmatisés par les dictionnaires) ;<br />
- tentative d’appréhender la langue à travers des faits de discours, laissant de côté une<br />
approche ‘hypostasiante’, ou essentialiste comme l’appelle FRATH (2008a) ;<br />
- abandon d’une conception naïve du dictionnaire comme summa achronique (la<br />
philosophie du langage a remis en question les bases mêmes de l’exhaustivité 44 ) ;<br />
- prise en compte de plus en plus explicite des besoins des utilisateurs.<br />
Nous voyons comment tout ces facteurs convergent pour une insertion des dictionnaires<br />
dans l’histoire, dans la société et finalement dans la culture des communautés linguistiques<br />
concernées.<br />
I.2.1 Statut de la discipline<br />
Au niveau épistémologique, nous pouvons observer tout d’abord une progressive<br />
autonomisation de la lexicographie comme discipline 45 .<br />
GEERAERTS (1987 : 1) fait une observation difficilement contestable: « Linguistic theory<br />
has only rarely devoted attention to lexicography ». La lexicographie est en effet une<br />
science très récente, comme nous le rappelle TARP (2008 : 5) : « it was not until the 20 th<br />
century that true lexicographical theory arose ».<br />
Le fait que les travaux en métalexicographie ne se soient développés qu’assez récemment<br />
découle sans aucun doute du fait que le lexique lui-même a été longtemps négligé.<br />
42 Commencé en 1838 et achevé en 1961.<br />
43 Le Grimm est un dictionnaire patrimonial, cependant, à la différence de celui de l’Académie.<br />
44 Cf. NOWAKOWSKI (1990).<br />
45 Il faut préciser que nos considérations concernent en priorité la lexicographie monolingue.<br />
34
BLOOMFIELD le définissait comme « a list of basic irregularities » 46 , une appendice de la<br />
grammaire ; les compétences lexicales des locuteurs n’ont pas été suffisamment expliquées<br />
par SAUSSURE non plus, qui renvoyait au règne de la parole toutes les variations, les<br />
opérations sur le signifié et la notion de phrase.<br />
WIEGAND (1984 : 13) écrit, de façon plutôt provocatrice : « Lexicography was never a<br />
science, it is not a science, and it will probably not become a science ». Dans la même<br />
foulée se situent MANLEY – JACOBSEN – PEDERSEN (1988: 301) : « lexicography is a<br />
tradition rather than a theoretically based discipline ».<br />
WIEGAND essaie ensuite de donner une définition de la discipline : « Linguistic<br />
lexicography is scientific practice aimed at producing reference works on language, in<br />
particular dictionaries of language » (1984 : 14) et décrit comment se constituent ses buts :<br />
« general purposes for mono-, bi-, and multilingual language dictionaries are derived from<br />
the communicative and cognitive needs of the society or the societies » (1984 : 15-16).<br />
Avec WIEGAND, nous commençons donc à assister à une prise en compte explicite des<br />
différents besoins des usagers à l’égard des dictionnaires.<br />
WIEGAND propose en outre une théorie de la description lexicographique de la langue et il<br />
considère « the so-called lexicographical definition [comme] a textual element » (1984 : 17).<br />
Sa théorie se base sur une vision de la langue qui ne tire pas « a sharp dividing line between<br />
language and the extralinguistic world », puisque les locuteurs « do not differentiate strictly<br />
between purely semantic knowledge and encyclopaedic knowledge ». Nous voyons donc<br />
que le dictionnaire se compose de textes, ou mieux il est lui-même un texte 47 , et que<br />
l’opposition traditionnelle ‘connaissance linguistique/sémantique’ vs ‘connaissance<br />
encyclopédique’ est loin d’être nette. Mais nous reviendrons sur ce thème plus bas.<br />
Une histoire de l’émergence de la métalexicographie est esquissée par REY – <strong>DEL</strong>ESALLE<br />
(1979). Pour ces auteurs, le dictionnaire est un texte ‘métasémiotique’ :<br />
En effet (en termes hjelmsléviens) le plan de son contenu est lui-même une sémiotique,<br />
articulant un plan de l’expression – une langue et son lexique, des usages et leurs<br />
vocabulaires, certains discours et leurs occurrences – à un plan du contenu – un univers<br />
exprimé, des visions culturelles du monde, des articulations conceptuelles correspondant à<br />
des classes extensionnelles –. Ce ‘contenu du contenu’ est mal connu (1979 : 5).<br />
Nous souhaitons souligner la pertinence de cette analyse pour notre étude. C’est ce niveau<br />
‘second’ des dictionnaires qui nous intéresse en priorité, dans le cadre de cette thèse. « Le<br />
reflet de ce contenu dans la métasémiotique du dictionnaire est très variable » (1979 : 6).<br />
Dans la deuxième partie, nous essaierons d’analyser quel est le reflet de ce contenu dans les<br />
DB, gardant à l’esprit que « l’objet du dictionnaire oscille entre la pédagogie des formes et<br />
la description des contenus culturels » (ibid.). Envisageant le dictionnaire comme « signe<br />
46 Cité par NOWAKOWSKI (1990 : 12).<br />
47 Cf. WIEGAND E.H., « Printed Dictionaries and Their Parts as Texts. An Overview of More Recent<br />
Research as an Introduction », Lexicographica, 6, 1990, p. 1-126<br />
35
socioculturel » (1979 : 9), nous essaierons de réduire cette « distance [...] immense entre le<br />
pôle ‘linguistique’ et ‘sémantique’ [...] et le pôle sociohistorique et culturel » (1979 : 10). Il<br />
s’agit en fait de deux volets complémentaires, qui assurent le fonctionnement du<br />
dictionnaire comme outil qui décrit un système (au sens saussurien) au sein d’un autre<br />
système, socio-culturel.<br />
I.2.2 Entre lexicographie et linguistique<br />
Les rapports entre lexicographie et linguistique sont loin d’être clairs et définis.<br />
TARP (2008 : 16) affirme : « although it is true that French metalexicography gained a more<br />
uniform focus from the 1960s onwards, this focus was still strongly anchored in<br />
linguistics ». Il apparaît que pour cet auteur cet ancrage linguistique représente un obstacle<br />
au développement d’une théorie lexicographique autonome. En effet, à son avis la<br />
linguistique est un domaine scientifique distinct, à partir duquel « linguistic concepts,<br />
theories and methods are frequently transferred uncritically to lexicography » (2008 : 10).<br />
Dans une perspective tout à fait opposée, CORBIN regrette le fait que dans les derniers<br />
quinze ans<br />
il n’est pas paru en France de dictionnaire général monolingue qui donne une forme<br />
lexicographique consistante à des contributions descriptives et/ou théoriques émanant du<br />
champ de la linguistique (2002 : 10).<br />
Selon l’auteur, cela se doit à des facteurs économiques (« l’ère du rentabilisme » des<br />
entreprises lexicographiques), techniques (les nouvelles technologies), humains (le fait<br />
qu’une génération de linguistes de renom touche à sa fin) et culturels (le déclin de<br />
l’influence de la linguistique dans la société). Cependant, une fois affirmée la nécessité du<br />
transfert des savoirs linguistique à la lexicographie,<br />
deux difficultés majeures de transmission des connaissances se posent [...] : celle de l’accès<br />
des lexicographes aux savoirs linguistiques disponibles, et celle de la conversion de ces<br />
savoirs par les lexicographes en textes dictionnairiques décodables par des utilisateurs non<br />
spécialistes (CORBIN 2002 : 32).<br />
Tout d’abord, les savoirs linguistiques ne constituent pas un ensemble homogène et, qui<br />
plus est, ils ne sont que marginalement accessibles de la part des lexicographes (à cause de<br />
leur formation hétérogène et de leur chronique manque de temps). Pour ce qui est de la<br />
« conversion de ces savoirs », une aporie essentielle se met de travers : les dictionnaires<br />
doivent être lisibles, rapidement consultables, mais cela va souvent à l’encontre d’une<br />
description linguistiquement impeccable des unités.<br />
36
Nous voyons donc comment l’aspiration à la précision, propre à une description<br />
scientifique des unités, et à la lisibilité, qui relève des besoins des utilisateurs, commencent à<br />
se heurter. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans le chapitre I.6.<br />
I.2.3 Le sens en lexicographie bilingue<br />
Les dictionnaires monolingues essaient de décrire les sens des entrées analytiquement, en se<br />
basant la plupart des cas sur la polysémie. Pour les DB, nous avons deux cas de figure :<br />
parfois, les acceptions se créent en fonction des traduisants en langue-cible 48 ; parfois on a<br />
un dénombrement des sens qui suit celui des monolingues.<br />
Ce dernier point de vue est soutenu par ZGUSTA (1971 : 327) : il affirme qu’une analyse<br />
lexicologique préalable de l’unité lexicale est indispensable pour la mise en équivalence des<br />
unités lexicales.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI (1996 : 165) affiche un avis opposé : « la distribution des<br />
acceptions ne peut se faire à partir de la description présentée par un dictionnaire<br />
monolingue, mais en fonction des différents équivalents dans l’autre langue et donc des<br />
difficultés de choix ».<br />
MANLEY – JACOBSEN – PEDERSEN aussi considèrent que<br />
Discrimination between equivalents, not between meanings, is one of the main functions of<br />
the bilingual dictionary. Semantic analysis of the headword may have some justification in<br />
the bilingual dictionary, but it is not a primary concern (1988 : 284).<br />
Plus récemment, GOUWS note que<br />
it is extremely important that the comment on semantics of the article of a lemma sign [...]<br />
should be divided into a subcommment on semantics for each of the senses of this lexical<br />
item – even if it implies the repetition of the same target language form as translation<br />
equivalent in each subcomment on semantics (2005 : 46).<br />
GOUWS paraît donc réaffirmer la nécessité d’une analyse lexicologique du mot-entrée, qui<br />
soit en quelque mesure indépendante des équivalents proposés. Il est donc évident que les<br />
avis sont partagés, pour ce qui est de la discrimination des sens dans les DB.<br />
Passons à analyser le fonctionnement sémantique de ces ouvrages. Les DB, comme<br />
l’affirme REY (1977 : 72) consistent à « mettre deux lexiques en communication ».<br />
« Considéré de façon formelle, ajoute COUSIN (1982 : 258), le dictionnaire bilingue est une<br />
série d’équations ‘élément de LD=élément de LA’ [dont] la réussite est relative au degré de<br />
parenté des deux langues et à l’importance du fonds culturel commun ». Nous faisons<br />
48 Ce que fait le dictionnaire Boch, par exemple.<br />
37
emarquer que cette équation ne se fait pas entre deux systèmes abstraits, mais bien entre<br />
deux langues-cultures.<br />
J. REY-DEBOVE (2008 : 259) souligne que « le [dictionnaire] bilingue établit une relation<br />
entre les signes de langues différentes sans s’occuper du référentiel [...], il ne fait pas<br />
d’analyse sémantique ». Elle poursuit :<br />
On a toujours, dans la version, l’illusion d’une signification (qu’est-ce que ça veut dire ?) qui<br />
prend la place du transcodage. Inversement, pour le thème, on a l’illusion d’une<br />
dénomination, d’une opération onomasiologique, bien qu’on ne parte pas du tout d’un<br />
signifié ou d’une notion, mais d’un signe. Il faut éviter de tomber dans une erreur<br />
d’interprétation (s’appliquant aussi aux monolingues) qui consisterait à croire que le<br />
dictionnaire bilingue attribue tantôt un signifié à un signifiant (version), tantôt un signifiant à<br />
un signifié (thème) (ibid.).<br />
Ce premier risque de confusion entre plans sémantiques différents se doublerait d’un<br />
deuxième risque, d’après MANLEY – JACOBSEN – PEDERSEN :<br />
Bilingual lexicography has largely grown out of monolingual lexicography, and bilingual<br />
dictionaries are usually ultimately based on monolingual dictionaries (1988 : 301).<br />
Les auteurs achèvent leur article en formulant le vœu que la lexicographie bilingue puisse<br />
gagner son autonomie, en s’affranchissant des présupposés théoriques de la lexicographie<br />
monolingue et de la lexicologie.<br />
Nous pouvons faire l’hypothèse que ce transfert des bases théoriques des dictionnaires<br />
monolingues aux bilingues a eu lieu justement parce que la lexicographie bilingue a toujours<br />
été en manque d’une assise théorique solide. Comme nous les rappellent REY – <strong>DEL</strong>ESALLE<br />
(1979 : 10), les « dictionnaires bilingues [...] sont le plus souvent considérés comme de<br />
simples outils ».<br />
Les propos de BOGAARDS résument bien la question :<br />
dictionary is not exclusively or even in the first place defined as a resource containing all<br />
sorts of interesting facts and data about language, but as a tool for the solution of problems<br />
that people may have when using a language (2003 : 26).<br />
Dans la même perspective, HANNAY (2003 : 145) définit le DB comme « a translationrelated<br />
problem-solving tool for users with different needs ».<br />
La conception instrumentale des DB est donc largement prédominante. Nous adhérons à<br />
ce point de vue, tout en insistant sur le fait que cet outil qu’est le DB peut devenir à son<br />
tour un instrument majeur de recherche lexicologique et sémantique.<br />
38
Il faut également ajouter que, pour ce qui est de la didactique, SHCHERBA (1995 [1940]) 49 en<br />
déconseillait l’utilisation pour l’apprentissage d’une langue étrangère ; DUVAL (1993 : 15)<br />
confirme ce préjugé qui intéresse les DB : « Les enseignants y sont généralement hostiles et<br />
le considèrent comme un mal parfois nécessaire ».<br />
Le DB, un outil qui n’a pas bénéficié d’une bonne presse, toujours insuffisant par rapport<br />
aux exigences des utilisateurs 50 , souvent remis en cause dans ses prérogatives théoriques,<br />
reste cependant une ressource indispensable pour les apprenants et continue d’offrir<br />
beaucoup de stimuli à la réflexion de la part des linguistes (métalexicographes et<br />
sémanticiens surtout), comme nous le verrons dans les pages suivantes.<br />
I.2.4 Approches du sens dans le dictionnaire<br />
Nous poursuivons dans notre enquête, dans le but de problématiser quelques approches au<br />
sens dans les dictionnaires. Notamment, nous essaierons de montrer les apories qui<br />
dérivent d’une description statique des unités lexicales.<br />
NOWAKOWSKI (1990) parle d’une métaphysique du dictionnaire. Il entend par cette expression<br />
« a set of beliefs that [...] assume [...] that there are numerous important and valid analogies<br />
between the dictionary and the lexicon » (1990 : 10-11). Mais comment cette analogie peutelle<br />
être née ? A son avis, cela paraît trouver son origine dans<br />
the once popular (prestructuralist) opinion that there is a limited set of building blocks or<br />
constructional atoms out of which utterances are formed, conforming to a small number of<br />
combinatorial patterns. A finite list of the constructional atoms was to be characterized in a<br />
dictionary (1990 : 11).<br />
Bien que cette vision puisse se rattacher à une conception populaire d’une théorie du<br />
langage, cela n’est qu’une « hopelessly inadequate characterization of human linguistic<br />
abilities ». Le résultat le plus important de cette métaphysique consiste dans le « freezing of<br />
the lexicon or [...] the necessity of making the component innocent of all active<br />
operations ». Et l’auteur de continuer : « the passive-storage idea of the lexicon is at the<br />
very foundations of the metaphysics of the dictionary, and if active processes were to be<br />
included, the lexicon-dictionary analogy would have to fall » (1990 : 14). Le caractère<br />
‘statique’ et ‘fini’ du lexique prôné par cette métaphysique s’avère très confortable et utile aux<br />
productions lexicographiques. Toutefois, dans le cadre de notre recherche, il faut aller audelà<br />
de la métaphysique, ou mieux, rester en-deçà. NOWAKOWSKI conclut en préconisant<br />
une conception « processuelle » de l’unité lexicale ; il faudrait aussi décomposer « the notion<br />
of linguistic knowledge [...] into the lexical and the grammatical ; the former encompassing<br />
large fragments of what is known as the encyclopedic knowledge and popular beliefs »<br />
49 Cf. KROMANN – RIIBER - ROSBACH (1984) ; MIKKELSEN (1992).<br />
50 Cf. ANTOINE 1993.<br />
39
(1990 : 16). Nous voyons ici une ouverture à la dimension encyclopédique, qui se taille un<br />
rôle dans la description des unités lexicales. Nous reviendrons plus bas sur l’impossibilité<br />
d’une séparation étanche entre sens lexical et sens encyclopédique.<br />
KORZYK (1995), dans une optique cognitive, insiste sur le caractère dynamique du sens,<br />
mal représenté par le dictionnaire et ses répartitions en signifiés discrets. Les lexicographes<br />
se comportent comme si le signifié était<br />
an entity permanently attached to a lexical unit : a discrete, invariant or static object, whose<br />
boundaries may be delineated precisely and clearly and whose substance may be treated as<br />
composed of a set of elements (1995: 84).<br />
KORZYK va plus loin dans ses propos, en affirmant que « the so-called lexical meaning of a<br />
linguistic unit [...] is an epiphenomenon or artefact brought into being by the lexicographer,<br />
skeletonising the living substance of the spoken world » (1995 : 85). Nous croyons qu’il<br />
faut retenir surtout ceci des propos de KORZYK : l’opération d’abstraction menée par le<br />
dictionnaire n’est pas sans effet sur la représentation des signifiés dans l’esprit des<br />
locuteurs.<br />
En ce qui concerne l’unité minimale de traitement lexicographique, BEJOINT va jusqu’à<br />
affirmer que « Il serait excessif de dire que ce sont les lexicographes qui ont inventé le mot<br />
pour des raisons purement pratiques, mais on peut dire que l’apparition du dictionnaire a<br />
favorisé son émergence dans la conscience linguistique des communautés où il s’est<br />
développé » (2005 : 14). Encore une fois, le dictionnaire n’est pas innocent : consciemment<br />
ou pas, il a contribué à l’affirmation de la notion du mot, de la possibilité d’une analyse<br />
sémantique scientifique des unités lexicales, et de la représentation du lexique comme un<br />
inventaire fini, fermé et statique. Cette vision est partagée par POLGUERE (2008 : 1278) « Le<br />
lexique décrit dans un dictionnaire est [...] une entité aux contours flous, une abstraction ou<br />
idéalisation d’un code soumis aux variations régionales, sociales, diachroniques, etc. ».<br />
Nous croyons avoir suffisamment insisté sur les apories linguistiques et théoriques<br />
(refoulement de la dimension pragmatique, tout d’abord) qui caractérisent le dictionnaire,<br />
mieux, le traitement des unités lexicales mené par les dictionnaires.<br />
A l’aune des difficultés lexicographiques que nous avons évoquées, quelle peut être la<br />
démarche correcte à adopter pour l’analyse du sens dans les DB ? WIERZBICKA a souvent<br />
insisté sur le fait que le but de la lexicographie coïncide avec la recherche de la vérité 51. Par<br />
l’intermédiaire de la définition (nous sommes dans une optique monolingue) il faut donc<br />
atteindre la dimension du vrai (à concevoir philosophiquement comme adæquatio ad rem). Et<br />
51 « The process of constructing a lexicographic definition is – or should be – a search for truth »<br />
(WIERZBICKA 1996: 264) ; « Good lexicography is, above all, a search for truth, the truth about the meaning<br />
of words » (WIERZBICKA 1995 : 194).<br />
40
dans notre optique, qui est bien bilingue, comment faudra-t-il concevoir l’entreprise<br />
lexicographique? A notre sens, cette pratique demande une ontologie plus faible : il ne<br />
faudra plus saisir le propre d’un lemme, mais plutôt mettre en œuvre une équivalence, qui est<br />
souvent fragile parce qu’elle minée à la racine, comme nous le verrons bientôt.<br />
Pourquoi parler d’ontologie faible ? La mise en équivalence des unités lexicales dans un DB<br />
relève souvent d’un ‘wishful thinking’. Essayons de voir quelques raisons pour cette<br />
impossibilité apparente.<br />
Equi-valence. Le trait d’union n’est pas une coquille : il entend rendre visible l’étymologie du<br />
mot. Le concept de valeur égale est donc décisif pour la raison d’être même des DB. Il n’est<br />
peut-être pas superflu d’évoquer la notion de valeur pour SAUSSURE : pour l’auteur du Cours,<br />
il s’agissait d’un élément tout à fait négatif, différentiel, qui se justifiait en tant que<br />
discriminant par rapport à d’autres signes. Cette vision de la valeur n’est pas opératoire<br />
dans notre optique, car elle se révèle insuffisante à rendre compte de la complexité des<br />
phénomènes : si l’on s’interroge sur la valeur des équivalents lexicaux dans les DB, il<br />
paraîtra clairement que :<br />
- l’équivalence est toujours incomplète si l’on assume que les mots occupent des<br />
espaces sémantiques différents dans toutes les langues ;<br />
- au point de vue dénotatif, les univers de référence de deux communautés de<br />
locuteurs (même voisines) ne coïncident jamais complètement, d’où les lacunes<br />
référentielles ;<br />
- au point de vue connotatif, les valeurs dont se chargent et ‘s’enveloppent’ les mots<br />
constituent un autre type de décalage, qui brouille les présupposés de l’équivalence.<br />
Pour P. BLUMENTHAL « le signe linguistique crée, structure le monde » 52 . M.L. HONESTE<br />
ajoute : « le cadre culturel façonne les expériences et les représentations mentales. Le<br />
signifié est alors la conceptualisation socialisée d’une langue spécifique » 53 . Les rapports<br />
entre langue et système culturel sont très bien posés par ces deux auteurs : si le signe est<br />
une unité qui contribue à façonner le monde et qu’il a sa place dans un système structuré, il<br />
est donc évident qu’une équivalence entre signes de deux systèmes différents se prête à une<br />
multitude d’écarts. Ce sera la thématique qui nous occupera dans le chapitre I.4. A présent,<br />
nous adopterons une perspective sémantique pour explorer des thèmes tels que les<br />
rapports entre significations et cultures, la description du sens dans les DB et le va-et-vient<br />
entre sens linguistique et extralinguistique dans les dictionnaires.<br />
52 Communication au cours de la Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris, le 17 janvier<br />
2009.<br />
53 Le 23 octobre 2008, à la Sorbonne, lors d’une communication au titre « De quelques conséquences d’une<br />
théorie monosémique du sens lexical ».<br />
41
I.3 Un débat sémantique<br />
La sémantique est sommée de prendre en compte tout ensemble la langue et la culture<br />
42<br />
LERAT (1994 : 501)<br />
A ce point de notre analyse, nous croyons opportun nous arrêter quelque peu sur des<br />
thèmes de nature sémantique. Une réflexion sur le sens des unités linguistiques est cruciale,<br />
et préliminaire à leur mise en équivalence.<br />
Nous tâcherons de voir les tropismes à l’œuvre dans la « boîte noire » 54 où se produit le<br />
sens.<br />
Dans ce chapitre, notre but n’est pas celui de suivre de près le développement des théories<br />
sémantiques, mais bien de montrer transversalement comment les sens des mots se<br />
construisent, quel est leur traitement en lexicographie bilingue et, en définitive, ce qu’est un<br />
mot. Nous suivrons le fil rouge d’une prise en compte de la dimension culturelle du<br />
langage, qui nous accompagnera tout au long de cette thèse.<br />
I.3.1 La construction du sens entre langue et discours<br />
Pour GUILBERT, le lexique « constitue un ensemble de références à des réalités<br />
extralinguistiques » (1975 : 131). Comment se définit ce cheminement référentiel ?<br />
Dans le débat entre le paradigme structuraliste et le paradigme de l’énonciation 55 , LERAT<br />
(1976 : 42) fait valoir BENVENISTE contre SAUSSURE : si on présuppose, avec ce dernier,<br />
que « le signifié est un donné », cela serait incompatible avec « les résultats des derniers<br />
travaux de E. Benveniste ». « La ‘signifiance’ du discours ne se comprend [...] que si le<br />
signifié cesse d’être ce donné pour devenir un produit ». D’autant plus si l’on pense, à<br />
l’instar de BENVENISTE, que « la langue est un produit du discours » (ibid.). LERAT affirme<br />
ensuite que « si le signifié préexistait à l’usage du signe, il devrait y avoir des définitions plus<br />
vraies que d’autres » (1976 : 45-46). Or, « les vérités des divers dictionnaires sont<br />
compatibles entre elles et constituent autant de traits définitoires juxtaposables, mais<br />
chaque lexicographe les sélectionne selon ses préoccupations et celles de son public » 56. Ce<br />
qui est vrai pour les monolingues, l’est d’autant plus pour les bilingues, nous croyons. Dans<br />
cette approche, le signifié est donc construit et n’est pas antérieur à sa mise en discours ; une<br />
54 L’expression est de KLEIBER (1997 : 9).<br />
55 Cf. LARRIVEE (2008).<br />
56 Les dictionnaires sont donc loin d’être les « masterpieces of consensus » que AYTO souhaitait (1983 : 89).
analyse des définitions et des traduisants (respectivement pour les dictionnaires<br />
monolingues et bilingues) nous confirme qu’il y a tout un travail de sélection, reposant sur<br />
l’appréhension de la pertinence, et que les dictionnaires ne rendent pas un signifié, mais le<br />
créent, ou mieux le recréent, en quelque sorte.<br />
LERAT, dans ce même article, nous rappelle que « les signes linguistiques naissent, vivent et<br />
meurent en fonction des besoins humains en matière de désignation, d’élaboration<br />
conceptuelle et de vie sociale » (1976 : 48). Voici donc réaffirmé un modèle<br />
anthropocentrique, qui voit les signes comme fonction des communautés linguistiques.<br />
RASTIER va encore plus loin dans ce sens, affirmant que « les signifiés de langue et les<br />
représentations mentales sont les uns comme les autres des formations culturelles » (1991 :<br />
96-97).<br />
Abordons maintenant la question de la référence. BUZON (1979 : 39 ) affirme que « le sens<br />
des mots est dans les mots, dans le discours et non dans les choses [...]. Le référent n’est<br />
pas immédiatement donné, n’existe pas en soi, mais est construit par un discours », avant<br />
de distinguer entre référents discursifs et référents objectaux. On est clairement dans une<br />
perspective constructiviste : « le langage n’est pas une forme vide dans laquelle viendrait se<br />
couler la pensée ; il n’en est pas l’expression : l’énonciation, le discours sont les créateurs de<br />
la pensée même » (BUZON 1979 : 42).<br />
Les conséquences de cette position nous paraissent les suivantes : admettons que le réel<br />
soit le même pour deux communautés linguistiques, locuteurs de L1 et de L2 ; le sens étant<br />
construit par le discours (macro-discours en L1 et en L2), la prise sur le réel sera médiatisée<br />
par deux langues distinctes et ne sera donc jamais la même.<br />
Une version modernisée de cette approche est offerte par FRANCKEL (2002), qui se situe<br />
clairement dans la paradigme de l’énonciation 57. Il définit la sémantique comme une<br />
« analyse des représentations mentales déclenchées par et appréhendées à travers le<br />
matériau verbal qui leur donne corps » (2002 : 3-4). D’après FRANCKEL et le courant<br />
constructiviste, en ce qui concerne la traduction interlinguale « la même chose n’existe pas,<br />
on n’a que des façons différentes de dire des choses différentes » (2002 : 8) ; il s’agit d’un<br />
point de vue assez radical, qui a de lourdes conséquences sur une théorie de la<br />
lexicographie bilingue. Pour ce qui relève de l’identité des lexèmes, selon FRANCKEL, « les<br />
unités lexicales ne sont pas des individus tout constitués, mais des occurrences construites<br />
par des processus d’individuation » (2002 : 15). Il est patent que dans une macrostructure<br />
de dictionnaire (bilingue et monolingue) on a affaire à une forme abstraite, une unité<br />
dictionnairique discrète, qui sera, le cas échéant, remise en contexte artificiellement. Si l’on<br />
considère, en plus, que dans les DB les exemples sont pour la plupart forgés, on se rendra<br />
compte de la double artificialité qui caractérise le traitement des entrées, au niveau<br />
paradigmatique et syntagmatique.<br />
57 Cf. LARRIVEE (2008: 109-110).<br />
43
KLEIBER (1997 : 12), pour sa part, s’applique à « refuser un engagement constructiviste<br />
total », car il y a une certaine stabilité intersubjective, le monde réel garde une primauté à<br />
son sens indéniable. Une position constructiviste radicale amènerait donc à substituer « une<br />
référence interne à l’idée traditionnelle de référence externe » 58 (1997 : 15-16). Par conséquent, « il<br />
convient [...] d’abandonner l’hypothèse, à certains égards commode mais très vite<br />
impraticable, d’une référence purement interne au langage » (1997 : 16) et prôner plutôt une<br />
sémantique référentielle. Le monde auquel nous avons accès, et dont les dictionnaires doivent<br />
rendre compte, c’est « un monde perçu, une image du monde, un monde expérimenté,<br />
façonné par notre perception, l’interaction et la culture » (1997 : 12). Ces considérations,<br />
qui soulignent combien la prise sur le réel est médiatisée par la culture, se rattachent à ce<br />
que nous avons vu dans le chapitre I.1.3, et nous confortent dans notre itinéraire de<br />
recherche.<br />
Revenons sur les rapports entre signes et référents. NYCKEES nous rappelle que pour<br />
SAUSSURE<br />
il n’y a pas d’analogie entre ‘l’ordre de la langue’ et la ‘nature des choses’. Il est bien vrai<br />
qu’aucune sémantique scientifique ne saurait se fonder sur l’idée d’une correspondance<br />
organique entre langage et réalité (1998 : 294).<br />
Mais cela ne veut pas dire, selon NYCKEES, que l’organisation linguistique soit tout à fait<br />
arbitraire 59 , qu’elle soit absolument sans rapport avec la réalité objective ; en effet, « le<br />
découpage que les langues opèrent sur la réalité peut trouver son fondement dans<br />
l’expérience humaine elle-même ». La critique de NYCKEES au structuralisme en est assez<br />
sévère : ce paradigme aurait « replié le langage sur lui-même au point d’en faire un monde<br />
autosuffisant et clos, sans portes ni fenêtres » (1998 : 296).<br />
Un nouveau modèle de sémantique, celui proposé par NYCKEES, défend au contraire l’idée<br />
que « ce sont les circonstances de l’expérience collective qui sélectionnent les nouvelles<br />
valeurs [distinctives et oppositives] des signes à travers les échanges linguistiques en<br />
situation » (1998 : 297). Il s’agit, comme la définit LARRIVEE (2008 : 161-162), d’une<br />
approche médiationniste et culturaliste. Selon NYCKEES, les changements de sens (ses intérêts<br />
portent surtout sur les aspects diachroniques du vocabulaire, faut-il préciser) sont fonction<br />
des changements culturels et s’inscrivent dans des processus socialisés de conceptualisation.<br />
Une synthèse de cette position nous est offerte par LARRIVEE :<br />
58 KLEIBER cite ANSCOMBRE J.C., Théories et méthodes en sémantique française, Thèse d’Habilitation, Paris :<br />
Université de Paris VIII, 1996, tome 1 : 21.<br />
59 Cf. LARRIVEE : « Benveniste propose que le rapport entre signifiant et signifié est nécessaire en tant qu’il est<br />
constitutif du signe linguistique, et que l’arbitraire marque le rapport du signe au référent. Tandis que le lien<br />
entre le signifié et le signifiant de sœur est nécessaire pour le signe français, c’est le rapport du signe au référent<br />
qui serait arbitraire » (2008 : 64).<br />
44
Les changements de contexte culturel amèneraient ceux historiques du sens [...]. Le sens est<br />
ainsi donné comme le résultat de la médiation de la culture – à travers la langue, les discours<br />
et les divers outils sémiotiques – dans le rapport du sujet au monde (2008 : 162).<br />
Il est sans doute superflu de souligner combien cette approche 60 nous paraît prometteuse<br />
pour notre but de recherche : elle explicite les liens entre culture et sémantique dans la<br />
détermination du sens et dans son évolution.<br />
NYCKEES évoque aussi brièvement le paradigme connu sous le nom de praxématique 61 , qui<br />
« s’attache tout particulièrement à inscrire le fonctionnement du langage dans l’ensemble<br />
des pratiques culturelles et sociales » (1998 : 258) ; d’après son idée-maîtresse, « les unités<br />
lexicales sont bel et bien des ‘praxèmes’, c’est-à-dire des outils d’analyse du réel en relation<br />
avec des pratiques socio-culturelles » : cette vision amène à conclure « à l’ancrage culturel<br />
de toute signification linguistique ».<br />
Les approches que nous avons évoquées nous paraissent avoir ce dénominateur commun :<br />
le sens n’est pas donné dans le monde (ou dans la langue), ce sont les langues (ou le<br />
discours) qui lui donnent une forme intelligible en le découpant, en le ‘discrétisant’, en le<br />
contextualisant. Il est par conséquent évident que les langues (et les discours produits dans<br />
ces langues) divergent par leur essence même ; des processus d’évolution sémanticoculturelle<br />
(ainsi que NYCKEES les a décrits) les ont caractérisées à jamais, au-delà de leur<br />
éventuelle ressemblance formelle.<br />
La contribution de LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK (1988) est centrale, en ce qui concerne<br />
les relations entre sémantique et lexicographie. Selon elle, « meaning in natural language is<br />
based on a universal cognitive structure, adapted by language users according to specific<br />
socio-cultural and experiential parameters » (1988 : 24). Une partition étanche entre ce qui<br />
est linguistique et ce qui relève de la culture (au sens large du terme) est impossible et<br />
impraticable, voilà pourquoi<br />
in bilingual dictionaries 62 the meaning component of a lexical entry should contain: [...] its<br />
conventional connotations and possible directions of (figurative) extensions in terms of the<br />
60 Nous faisons remarquer, cependant, que LARRIVEE se montre assez sceptique à l’égard de la position de<br />
NYCKEES : « La culture et la société agissent comme conditions de possibilité du sens linguistique.<br />
L’organisation du sens n’est cependant pas déterminé par le culturel ou le social [...]. Quand les idiomes<br />
portent des traces détectables d’une culture, ce sont des traces essentiellement anecdotiques, qui ne semblent<br />
pas informer sur les tendances lourdes de l’organisation du sens linguistique. De là vient l’extrême difficulté<br />
que présente la constitution d’une sémantique culturaliste en une alternative théorique générale » (2008 : 170-<br />
171).<br />
61 Cf. MARTIN-MINGORANCE (1990); JIMENEZ HURTADO (2001). Il convient aussi de rappeler, dans le<br />
contexte français, les travaux de P. SIBLOT et les Cahiers de praxématique. Nous signalons un article récent de<br />
SIBLOT sur la nomination, analysée dans le cadre de la praxématique : « Problématique de la nomination. Du<br />
répertoire des sens à l’analyse de leur production », Neologica, 1, 2007, p. 35-50.<br />
62 C’est l’auteure qui souligne.<br />
45
interactive and affective contexts, indicating the type of context and a possible effect on the<br />
interlocutor<br />
et ce, dans le but de rendre « the ‘static reality’ of the dictionary [...] closer to the dynamic<br />
reality of language » (1988 : 25). On voit apparaître cette dichotomie ‘dynamisme des<br />
phénomènes lexico-sémantiques’ vs. ‘statisme de la description lexicographique’, qui sera<br />
reprise par SNELL-HORNBY (1990b).<br />
LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK paraît reconnaître l’importance d’une approche ‘holistique’<br />
au sens. Les significations (meanings) possèdent une double face, et se définissent comme<br />
des unités psychologiques et interactionnelles « that serve to make reference to both the<br />
socially accepted reality around us and the mental models we produce in the course of our<br />
interaction with this reality » (1988 : 25). C’est donc à partir du contact avec la réalité que se<br />
développent des modèles mentaux capables de rendre compte, de façon idiosyncratique, de<br />
cette même réalité. Il y a par conséquent un jeu, formant un continuum, entre expérience et<br />
représentation, et la langue se trouve à la charnière de cette imbrication. Les glissements<br />
sémantiques témoignent de ce mouvement de va-et-vient, de cette tentative d’ajustement<br />
du système symbolique (les langues naturelles) au système socio-culturel.<br />
Cependant, il vaut mieux souligner qu’il s’agit d’un ajustement réciproque : comme l’écrit<br />
CHA<strong>DEL</strong>AT (2000)<br />
il est admis qu’une langue est un instrument de communication propre à un groupe et<br />
permettant de penser, de s’exprimer et de représenter la réalité. L’image qui assimile une<br />
langue à un instrument est pourtant bien inexacte [...]. Cet instrument de communication<br />
qu’est une langue est indissolublement lié à un groupe social donné [...]. Ce n’est pas le réel<br />
qui impose une forme au lexique d’une langue. On sait que c’est plutôt la langue qui découpe<br />
le réel d’une certaine façon en le rendant perceptible et intelligible. [...] Chaque langue permet<br />
également de filtrer cette perception du réel en offrant une certaine latitude expressive à ses<br />
utilisateurs (2000 : 12).<br />
Cette expression ‘latitude expressive’ nous paraît heureuse, en ce sens qu’elle réaffirme le<br />
parallélisme entre les langues et les cultures sur lequel nous nous sommes arrêtés dans le<br />
premier chapitre.<br />
I.3.2 Dictionnaire vs encyclopédie<br />
En guise de conclusion à ce chapitre, nous avancerons maintenant quelques réflexions sur<br />
la dichotomie dictionnaire/encyclopédie, au point de vue de la description du sens.<br />
Nous partageons entièrement les propos d’A. REY (1977 : 70) lorsqu’il affirme que « le<br />
dictionnaire linguistique pur n’existe pas plus que l’encyclopédie extra-linguistique<br />
absolue ». L’opposition traditionnelle entre dictionnaires de mots et dictionnaires de choses (ou<br />
encyclopédiques) est donc à relativiser, car les signifiants et les signifiés sont intimement<br />
46
imbriqués et une description de l’un en faisant abstraction de l’autre est infaisable et<br />
irréaliste.<br />
L’encyclopédie, selon REY (1987 : 1) est la « description didactique d’un univers référentiel<br />
translinguistique ».<br />
Au point de vue sémantique, comme l’écrit BAUER (2005 : 112) :<br />
in principle, encyclopedic information is information about the denotatum’s interaction with<br />
the real world, while lexical information is such as it is required to distinguish the denotatum<br />
of the relevant word from the denotata of all other non-synonymous words in the<br />
language (2005: 112).<br />
Il s’agit d’une distinction ‘de principe’ qui se base justement sur la vision négative de la<br />
valeur de SAUSSURE, que nous avons déjà évoquée. En réalité, cette dichotomie linguistique<br />
vs extralinguistique s’estompe dans les dictionnaires, ainsi que le confirme HARTMANN :<br />
« Any strict separation of linguistic-lexical and extralinguistic-factual information is very<br />
difficult, if not impossible » (1983 : 7).<br />
Pour ce qui est du contenu sémantique des unités lexicales, PAVEAU (2006 : 40) rappelle la<br />
formulation de KERBRAT-ORECCHIONI, qui insiste sur l’impossibilité de « faire le départ<br />
entre les propriétés véritablement sémantiques d’un item et les valeurs ‘encyclopédiques’ ou<br />
idéologiques dont l’investissent ses utilisateurs » 63 . Quant à l’enregistrement lexicographique<br />
de ces informations, KERBRAT-ORECCHIONI révèle son pessimisme : « Il est bien entendu<br />
hors de question de les lister toutes, une fois pour toutes – et pour tous les énonciateurs » 64 .<br />
Le dictionnaire se trouverait donc dans l’impossibilité de représenter un tel bagage de<br />
connaissances.<br />
YANCHUN – JIANHUA réaffirment l’impossibilité d’une séparation étanche entre<br />
connaissance ‘du mot’ et connaissance ‘du monde’ : « in this postmodernist era, the<br />
autonomy of language has been challenged, resulting in a blurring between word<br />
knowledge and world knowledge » (2004 : 177). A propos du traitement lexicographique<br />
des informations extralinguistiques, ils se montrent plus optimistes : « it is not only possible<br />
but also necessary to exceed word knowledge in the treatment of bilingual dictionaries »<br />
(ibid.).<br />
Ces considérations sont intéressantes car elles nous montrent comment les dictionnaires<br />
(surtout les bilingues, ajouterions-nous) sont tiraillés entre la nécessité d’une description<br />
linguistique de deux systèmes lexicaux et la conscience que cette description doit également<br />
s’ouvrir sur l’extralinguistique, parce que les deux dimensions ne sont pas étanches et parce<br />
que les usagers ne souhaitent sans doute pas cela. Nous croyons que cette prise de<br />
conscience est à la base du développement récent des DB : on assiste en effet, depuis<br />
quelque temps, à une redéfinition du paradigme des DB, à un élargissement du modèle.<br />
63 L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris : Colin, 1980, p. 208-209.<br />
64 Ibid.<br />
47
Comme l’affirme CELOTTI (1998 : 140), cet « espace langagier bilingue [...] révèle [...] le<br />
besoin des deux langues/cultures de s’ouvrir vers le monde des choses, d’agrandir leur<br />
terrain de rencontre ».<br />
Dans le chapitre suivant, l’étude de la notion d’écart nous permettra de voir, entre autres<br />
choses, comment les deux langues-cultures peuvent entrer en contact dans un DB.<br />
48
I.4 Problématique des écarts<br />
Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, l’un des points cruciaux de notre<br />
réflexion portera sur l’écart dans les DB.<br />
Examinons la définition de ce mot dans le PR11.<br />
1. écart nom masculin 65<br />
ETYM. 1274; « entaille, incision » v. 1200 ◊ de 1. écarter<br />
1. Distance qui sépare deux choses qu’on écarte ou qui s’écartent l’une de l’autre.<br />
➙ écartement, éloignement, intervalle. Écart des branches d’un compas. L’écart exigé de la main d’un<br />
pianiste (intervalle de dixième).<br />
2. Différence entre deux grandeurs ou valeurs (dont l’une, en particulier, est une moyenne<br />
ou une grandeur de référence). Écart entre le prix de revient et le prix de vente. ➙ 2. différentiel,<br />
fourchette, gap (anglic.), variation. Écart entre les températures du jour et de la nuit (➙ amplitude), entre deux<br />
lectures d’un instrument de précision.<br />
D’après cette définition de langue générale, l’écart marque donc la distance, la différence.<br />
Comme nous le verrons, les lexicographes font un usage spécialisé de cette idée d’écart,<br />
faisant ressortir précisément ces deux notions de distance et de différence, qui seront<br />
problématisées à l’aune de notre thématique, c’est-à-dire la dimension interculturelle dans<br />
les DB.<br />
Dans cette thèse, l’écart sera envisagé comme le lieu d’une équivalence qui pose problème,<br />
qui produit un ‘reste’ que le lexicographe tente de combler par d’autres mots. Notre<br />
hypothèse est que ce ‘reste’, qui se manifeste par une équivalence où à un signe en L1<br />
(langue-source) correspond plus d’un signe en L2 (langue-cible) a une signification<br />
linguistique et culturelle précise. L’examen du corpus, mené dans la deuxième partie de la<br />
thèse, nous permettra de détailler nos considérations sur la question. Nous procédons<br />
maintenant à une analyse théorique du phénomène.<br />
Il faut souligner tout d’abord que les écarts enfreignent le postulat central de la<br />
lexicographie bilingue, qui concerne l’équivalence lexicale, définie par CELOTTI (2002 : 459)<br />
comme « la pièce maîtresse des dictionnaires bilingues ».<br />
Nous envisageons également l’écart comme lieu d’apparition des différences spécifiques entre<br />
les deux langues-cultures mises en présence. Comme l’affirme REY (1991 : 2865), « Dans<br />
les dictionnaires bilingues modernes, l’explicitation des contenus culturels est fonction des<br />
65 Nous ne reproduisons que les acceptions pertinentes à notre étude.<br />
49
écarts, soit internes à une langue, soit, plus visiblement, liés à la dualité des langues mises en<br />
rapport ».<br />
Quelle est l’origine linguistique des écarts ? Pour répondre à cette question, il faut se<br />
pencher sur la notion d’anisomorphisme.<br />
I.4.1. La notion d’anisomorphisme<br />
Notre réflexion part d’une constatation, d’une évidence partagée par les chercheurs et par<br />
n’importe quel sujet ayant une compétence bilingue : les langues font référence à une même<br />
réalité par des termes différents, ayant une distribution dissemblable des signifiés, bref les<br />
champs sémantiques souvent ne se superposent pas. Cette asymétrie est connue sous le<br />
nom d’anisomorphisme 66. SZENDE (1993 : 74) pose la question dans les termes suivants :<br />
« Il n’y a pas de découpage originel et immuable de la réalité linguistique qui préexisterait au<br />
langage et lui imposerait sa structure. C’est au contraire le langage qui structure la ‘réalité’,<br />
qui est à priori un continuum ».<br />
Quant au rôle structurant de la langue, SZENDE ajoute : « La réalité ne connaît que des<br />
gradations imperceptibles. C’est la langue qui crée des oppositions au sein d’une réalité sans<br />
limites précises » (1996 : 111). Nous revenons donc à l’image saussurienne de la nébuleuse,<br />
« où rien n’est distinct avant l’apparition de la langue » (SAUSSURE 1972 : 155).<br />
Quel est le reflet de cet état de choses dans les dictionnaires ? MARELLO (1996 : 44)<br />
constate que « l’anisomorphisme des langues naturelles correspond à des découpages<br />
différents du ‘monde extralinguistique’, qui se réfléchissent dans le découpage des sens d’un<br />
article de dictionnaire monolingue ou bilingue ».<br />
Essayons de suivre ce fil rouge du découpage, avec les mots d’A.REY :<br />
Les différences de découpage proviennent (a) de la nature des référents, (b) des<br />
constructions conceptuelles effectuées par la culture à leur égard, (c) de la prise en charge de<br />
ces conceptualisations par un usage d’une langue, lui-même conditionné par les moyens –<br />
morphologiques, syntagmatiques, sémantiques... – qu’une langue met à la disposition d’une<br />
culture (1991 : 2869).<br />
Nous avons donc trois cas de figure, selon REY :<br />
- l’univers extralinguistique offre des référents connus ou inconnus aux<br />
communautés linguistiques (dont les DB offrent le répertoire de signes en usage)<br />
- les langues structurent les concepts de façon singulière<br />
66 « The fundamental difficulty of such co-ordination of lexical units is caused by the differences in the<br />
organisation of the designate in the individual languages and by the differences between languages » (ZGUSTA<br />
1971: 294).<br />
50
- ces conceptualisations subissent les contraintes grammaticales que les langues leur<br />
imposent.<br />
Nous voyons donc comment les écarts peuvent se produire et à quel point ils sont fonction<br />
du linguistique et de l’extralinguistique.<br />
Ce décalage « interne », linguistique, se double d’un deuxième décalage, cette fois<br />
« externe » ou culturel. Quand bien même on aurait un même réseau de significations,<br />
parfaitement symétrique, entre deux langues, les mots occuperaient une position unique<br />
dans le réseau d’associations propre à chaque communauté. FOURMENT BERNI-CANANI<br />
(2000 : 238) synthétise très bien la question : « L’écart entre les deux langues au niveau de la<br />
distribution dans les différents contextes fait que l’identité de référent n’est pas suffisante<br />
pour pouvoir parler d’identité de valeur ». Ou, dans les mots de STATI (1986 : 4) : « la<br />
signification d’un lexème est fonction de la signification de tous les lexèmes d’un même<br />
paradigme ». Il est évident que la notion de valeur (négative) saussurienne ne serait pas<br />
adéquate pour rendre compte d’un écart qui va au-delà de l’acte de dénomination (le<br />
cheminement référentiel), mais qui intéresse d’autres dimensions, en priorité les dimensions<br />
expressive et connotative. Nous reviendrons sur ces thèmes plus bas.<br />
Cependant, il ne faut pas oublier que SAUSSURE, dans son Cours, avait souligné que le<br />
lexique d’une langue n’est pas une nomenclature 67 , à savoir « une liste de termes<br />
correspondant à autant de choses » (SAUSSURE 1972 : 97) 68 . Comme l’a écrit plus<br />
récemment R. MARTIN (1998 : 39), « la conception dénominative paraît aujourd’hui<br />
intenable ». Une correspondance interlinguistique basée sur le modèle des équations s’avère<br />
donc par conséquent infaisable 69 . Voici donc une deuxième aporie : l’anisomorphisme rend<br />
toute conceptualisation singulière, nous l’avons vu ; en outre, les réseaux sémantiques sont<br />
organisés de façon à rendre l’équivalence interlinguale très problématique, de par les<br />
associations qu’ils rendent possibles. D’après VARANTOLA, le DB serait ni plus ni moins « a<br />
contradiction in terms » (2002 : 36). Sans adopter une vue aussi radicale, nous ne pouvons<br />
nous passer de souligner les apories qui jalonnent l’horizon théorique de la lexicographie<br />
bilingue.<br />
Revenons au thème des écarts et essayons d’aborder plus en détail la problématique.<br />
67 Cf. SZENDE : « Les mots des diverses langues ne sont pas des étiquettes différentes collées sur les mêmes<br />
cases » (1996 : 111).<br />
68 MARTINET (1996 : 10-11) a contribué à réfuter cette vision erronée.<br />
69 Cf. VARANTOLA (2002 : 36) : «dictionaries can be loaded weapons in the hands of users who think that<br />
languages are codes and bilingual dictionaries conversion tables in which the right-hand side is a mirror of the<br />
left-hand side ».<br />
51
I.4.2 Typologie des écarts<br />
Pour mieux cerner la question, il convient de faire ensuite la distinction entre écart<br />
sémantique (ou linguistique, donc relevant du code) et écart référentiel (ou<br />
extralinguistique, donc fonction de la réalité vécue par la communauté). Les écarts<br />
sémantiques sont fonction, nous l’avons vu, du découpage idiosyncratique du réel opéré<br />
par chaque langue. L’exemple classique pour le couple italien-français est le suivant :<br />
La langue française s’applique à distinguer un cours d’eau de grande importance qui aboutit à<br />
la mer fleuve du cours d’eau de moyenne importance et qui n’ira jamais jusqu’à la mer rivière,<br />
tandis que pour la langue italienne ces deux cours d’eau ne font qu’un : fiume (CELOTTI<br />
2002 : 457).<br />
Les écarts référentiels, par contre, relèvent des realia, et renvoient à un « inexprimable lexical<br />
dénotatif d’une langue par rapport à une autre » (REY 1991 : 2868)<br />
Il s’agit par exemple de mots comme palio ou befana pour l’italien, ou encore panaché et<br />
pétanque pour le français 70 .<br />
Il est évident que si la réalité partagée par les membres d’une communauté est unique, on<br />
en aura un reflet dans le lexique ; mais on n’irait pas très loin dans ce genre de réflexions. Il<br />
s’agit là d’écarts patents, manifestes, qui brisent le postulat central des DB, c’est-à-dire<br />
l’équivalence lexicale. Comme le dit ZGUSTA (1984 : 147), « the dictionary should offer not<br />
explanatory paraphrases or definitions, but real lexical units of the target langage » ; il<br />
faudra bien sûr ajouter : « où c’est possible ». En fait, dans le cas d’écarts au niveau du<br />
référent les lexicographes seront obligés de faire recours à une glose, ou d’utiliser comme<br />
traduisant l’emprunt tout court, ou encore de forger un néologisme. De toute façon, on<br />
aura transgressé le principe de ZGUSTA, et pour cause.<br />
Au cours de l’analyse de notre corpus, nous adopterons une vision assez différente des<br />
écarts. Sans mettre en question la justesse de cette répartition écarts sémantiques / écarts<br />
référentiels, nous considérerons qu’il y a un écart chaque fois qu’une entrée (ou une<br />
acception) est traduite par un nombre de signes >1. Ce critère formel nous permettra<br />
d’analyser quantitativement le poids des écarts dans les DB ; nous pourrons ainsi déceler<br />
des écarts qui ne sautent pas aux yeux et qui passeraient inaperçus en utilisant un seul<br />
critère sémantique.<br />
70 Ces mots sont considérés comme intraduisibles par HP, par exemple (avec une marque INTRAD.).<br />
52
I.4.3 Les écarts culturels 71<br />
Plusieurs chercheurs ont essayer d’identifier des tranches du lexique où les écarts montrent<br />
traditionnellement une grande valeur culturelle. D’après AL-KASIMI (1983: 62), « cultural<br />
differences are explicit, for instance, in words related to ecology, kinship, technology,<br />
currencies, weights and measures, time units, and the like ». Il s’agit de domaines marqués<br />
par la culture des peuples (au sens mis en lumière dans I.0) et dont les dénominations<br />
reflètent l’unicité des référents.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI reprend les réflexions d’A. REY (1991) quant aux<br />
difficultés de trouver des équivalents pour des signes lexicaux désignant ou qualifiant des<br />
coutumes, des activités artisanales ou agricoles, des pièces d’habillement, des nourritures, des<br />
croyances propres à une communauté, ou encore pour des termes liés aux institutions qui<br />
touchent le droit, la politique, l’économie (2003 : 88).<br />
Au point de vue linguistique, elle ajoute que « la phraséologie, les proverbes, les locutions<br />
figées représentent également des domaines d’observation privilégiés pour l’étude des<br />
écarts culturels » (2003 : 89) 72 .<br />
ŠARCEVIC (1989), pour sa part, définit la notion des realia, qui comprennent « a wide range<br />
of cultural patterns of the society in question, including its characteristic foods, clothing<br />
and sports as well as aspects of religion, folklore, education and even its economic, political<br />
and legal life » (1989 : 211). Autant de secteurs où l’influence de la culture sur la langue est<br />
manifeste.<br />
KROMANN – RIIBER – ROSBACH (1991 : 2718) ajoutent : « In the vocabulary of every<br />
language there are considerable numbers of lexical units that are language and culturespecific<br />
– for example the vocabulary of religious observance, art, science, handicrafts and<br />
politics ».<br />
REY (1991 : 2867) problématise le rapport entre ces « domaines proprement culturels<br />
(coutumes, croyances, activités artisanales ou agricoles, nourriture, habillement,<br />
logement...) » et ceux qui sont « liés à l’appréhension culturelle spécifique de réalités<br />
naturelles elles-mêmes variables (faunes, flores, milieux géographiques) ». La nature entre<br />
donc en jeu, avec sa variété qui est prise en charge par la langue et ses dénominations.<br />
Quels procédés sont à disposition des lexicographes pour rendre compte de cette valeur<br />
culturelle inscrite dans les mots ? MARGARITO (2002 : 396) nous rappelle que « lorsque le<br />
recours aux équivalences lexicales et idiomatiques se révèle insuffisant (c’est le cas de la<br />
plupart des realia) la différence entre les langues est explicitée par des gloses, par des<br />
données proches des définitions des dictionnaires monolingues ». Cet abandon de<br />
71 Le volume collectif édité par SZENDE (2003) offre une anthologie d’études sur ce thème.<br />
72 Ce que confirment TELIYA et al. (1998 : 55): « Phraseology is a domain of linguistic study which to a high<br />
degree illustrates the correlation between language and culture ».<br />
53
l’équivalence au profit de la définition serait donc la marque linguistique de l’échec<br />
lexicographique, inévitable lorsque les entrées concernent des référents inconnus dans<br />
l’expérience de la communauté linguistique de la L2 (langue-cible).<br />
Les écarts mettent en évidence « un culturel qui touche éminemment aux catégories des<br />
taxinomies dites ‘populaires’ (animaux, plantes, données de la vie quotidienne telles que la<br />
nourriture, les rites, les activités artisanales...), des institutions administratives, politiques,<br />
des fêtes calendaires, etc. ». MARGARITO (2002 : 396)<br />
I.4.4 Opacité et transparence des écarts dans le traitement lexicographique 73<br />
Essayons d’aller plus loin dans l’analyse du traitement lexicographique des écarts et<br />
d’examiner les conséquences qu’ils engendrent au niveau expressif.<br />
Si on veut renverser la perspective, les écarts culturels acquièrent une certaine transparence,<br />
dans la mesure où ils ont le rôle de symptôme de l’équivalence impossible, du caractère<br />
unique et irréductible de cet aspect du réel. Si au niveau théorique ce genre d’écart pose<br />
problème, on constate qu’en pratique, paradoxalement, ils n’en posent pas du tout ; comme<br />
l’indique la marque du dictionnaire Hachette Paravia pour cette catégorie de mots<br />
(INTRAD.), ces unités lexicales brillent par leur non-traductibilité, devenant donc tout à fait<br />
transparents pour l’usager, qui voit la vanité d’en chercher un équivalent dans sa langueculture.<br />
Si on se penche sur le versant des écarts sémantiques, c’est sur le plan de la structuration du<br />
sens et de ce qui a été appelé en anglais encapsulation que l’attention se porte. Nous aurons<br />
donc un phénomène connu (plus ou moins connu, il faut le souligner) dans les deux<br />
langues-cultures, dont seulement une a choisi un lexème pour le signifier. L. BRINK a parlé<br />
à ce propos de « minimal signs » (BRINK 1971 : 69), que seules certaines langues<br />
choisiraient pour « encapsuler » certains concepts, alors que d’autres recourraient à des<br />
expressions périphrastiques. Il s’agit sans doute d’un œuf de Colomb, mais cela peut faire<br />
avancer nos réflexions, dans la mesure où l’on comprend l’aspect non nécessaire, donc<br />
culturel, de cette structuration. Prenons par exemple le mot italien scaramanzia. Tous les<br />
dictionnaires de notre corpus ont évidemment du mal à traduire cette unité<br />
lexicographique. SL est le seul qui hasarde un équivalent direct (« conjuration »), HP<br />
propose « le fait de conjurer le mauvais sort », B avance « conjuration (contre le mauvais<br />
sort) », tandis que G se borne à analyser la locution per scaramanzia, faute de trouver un<br />
équivalent pour le substantif lui-même.<br />
Dans le cas des écarts référentiels, nous avons affaire à des realia, à savoir des pièces<br />
uniques d’une langue-culture ; dans le cas des écarts sémantiques, par contre, nous pouvons<br />
affirmer que, pour certains cas au moins, ils mettent l’accent sur quelques phénomènes<br />
73 Une version préliminaire de ce chapitre a paru dans TALLARICO (2010).<br />
54
centraux dans la langue-culture dont il est question, et deviennent ce que NIDA<br />
appelait « symbols for dynamic and explicit features of culture » (1958: 282).<br />
Les DB offrent, comme l’a écrit REY-DEBOVE (1970 : 27), une « analyse d’une langue objet<br />
par une langue instrument d’un autre système, non homonyme ». Cette analyse peut être<br />
strictement linguistique, si on insiste sur la valeur saussurienne (donc négative) du signe, ou<br />
bien elle peut déborder sur l’extralinguistique, lorsque les informations sur le signe ont un<br />
caractère encyclopédique. Mais qu’en est-il de la dimension pragmatique, qui est trop<br />
souvent absente dans les DB ? C. JIMENEZ HURTADO définit la pragmatique lexicale<br />
comme<br />
Such (stylistic) potential of lexemes [that] does not refer to the features of the denotatum<br />
(the entity being referred to/designated/denoted), but rather to the ordering of the lexeme<br />
within a social-normative system, which governs the deployment of verbal means in<br />
communicative situations (1994: 27).<br />
Elle envisage la pragmatique comme une composante cognitive et culturelle préalable.<br />
Voici un exemple qui peut être révélateur de cette composante. Prenons l’interjection<br />
italienne buonasera et ses équivalents. C’est une lapalissade, la traduction dans les<br />
dictionnaires pris en examen est toujours « bonsoir ». Mais le lecteur peut-il être sûr que<br />
cela soit le bon équivalent dans tous les contextes ? L’expérience nous dit qu’en France il<br />
est parfaitement normal de dire « bonjour », au lieu que « bonsoir », à 19h ou même plus<br />
tard, alors qu’en Italie cela serait vraiment curieux 74. Il serait dérisoire, évidemment, de<br />
chercher des « découpages sémantiques dissemblables » pour la durée de la journée en<br />
français et en italien ; il s’agit d’une norme sociolinguistique, rien de plus. Mais elle nous<br />
montre les limites inhérents au dictionnaire qui, comme nous rappellent SNELL-HORNBY,<br />
« is not the language » (1987: 170).<br />
Ce cas nous a montré une première facette de cette opacité de l’équivalence, qui prend en<br />
charge les différentes attitudes sociales, les normes communicatives, toute la problématique<br />
des déictiques, bref l’énonciation.<br />
L’examen de l’unité lexicale buonasera met en évidence une occultation partielle du<br />
fonctionnement du mot. L’absence de marques d’usage, commentaires ou encore de gloses<br />
rend le paysage lexicographique neutre, et laisserait soupçonner une équivalence aproblématique<br />
; l’examen d’un mot en contexte nous a montré qu’il n’en est pas toujours<br />
ainsi.<br />
74 A. FARINA confirme que le mot « est utilisé en France lorsque l’on rencontre une personne [et] peut être<br />
utilisé tant le matin que le soir » (FARINA 2009 : 257). Par contre, « on utilise Buonasera! au lieu de Buongiorno!<br />
en fin d’après-midi, à une heure différente selon la région d’Italie » (ibid.) : il y aurait donc une variation<br />
diatopique en italien, pour l’usage de Buonasera !, qui s’ajouterait à la non-correspondance buonasera-bonsoir que<br />
nous venons d’évoquer.<br />
55
Comme l’indique très bien HARTMANN, « Lexical equivalence is a relative, fluid and<br />
relational concept » (1985: 123). Pour prendre en compte la dimension relationnelle et<br />
sociale de l’équivalence, analysons un autre exemple.<br />
Le mot français ronde, dans l’acception que PR11 définit ainsi: « Visite, inspection militaire<br />
autour d’une place (et par ext. dans une ville, un camp) pour s’assurer que tout va bien »,<br />
nous paraît assez neutre 75, au point de vue connotatif. Sa traduction en italien, au point de<br />
vue du sens (et de la forme) est sans aucun doute ronda. Or, il se trouve que ce mot en<br />
italien possède une aura plus sombre, car cela évoque la période du squadrismo pendant le<br />
fascisme, où des organisations paramilitaires d’‘escouades d’action’ sévissaient dans les<br />
villes, ciblant les adversaires politiques. L’actualité italienne fait maintenant revivre ce terme<br />
de ronde, vu qu’un projet de loi du Parlement autorise des regroupements de citoyens avec<br />
des fins de surveillance sur le territoire national. Les différences entre ces deux réalités sont<br />
évidentes (espérons-le tout au moins), mais il n’est pas anodin de rappeler que le premier<br />
ministre Berlusconi lui-même, très conscient de la force des mots, affirme « Ne les appelez<br />
surtout pas ronde ! » 76, pour stigmatiser cette dangereuse analogie. 77 Nous sommes donc en<br />
présence d’un couple de mot à la même dénotation, dont les charges culturelles, dirait<br />
GALISSON (1987), ou le « cadre idéologique », comme l’appelle BUZON (1979 : 42), sont<br />
asymétriques.<br />
Restons dans la connotation et prenons un dernier exemple. En France, il est possible de<br />
trouver au supermarché des gaufres à la saveur « vergeoise ». Ne connaissant pas ce mot,<br />
nous l’avons cherché dans les DB. Voilà ce que nous avons trouvé :<br />
Vergeoise = zucchero di qualità scadente, ricavato dalla melassa (HP)<br />
= zucchero di qualità scadente (ricavato dalla melassa) (G)<br />
= zucchero ricavato dalla melassa (SL)<br />
= zucchero ricavato dalla melassa (B)<br />
Les deux premiers dictionnaires expriment un jugement de valeur (« médiocre ») que les<br />
deux derniers, plus prudemment, évitent. Au cas où ces produits devraient être<br />
commercialisés en Italie, il ne faudrait surtout pas que la traduction sur l’emballage s’inspire<br />
des deux premiers équivalents.<br />
Abordons un autre cas d’équivalence, apparemment transparente mais en réalité pleine<br />
d’embûches. C’est le mot français provincial. Nos quatre dictionnaires nous fournissent tout<br />
simplement l’équivalent provinciale. Seul SL ajoute la glose « personne qui vit en province ». Un<br />
examen des monolingues français et italien nous révèle en fait un décalage insoupçonné.<br />
Comme l’explique PR11, un provincial est une « personne qui vit en province », qui est bien<br />
75 Voire positif, si on pense à la ronde des enfants.<br />
76 Interview au quotidien Il Tempo, 22 mai 2009.<br />
77 Un exemple en quelque sorte analogue, de décalage entre un mot français et un mot italien au niveau<br />
représentationnel « est fourni par le couple place /piazza » (FOURMENT BERNI-CANANI 2000 : 236).<br />
56
« En France, l’ensemble du pays (notamment les villes, les bourgs) à l’exclusion de la<br />
capitale ». En italien, d’après le dictionnaire De Mauro, un provinciale est celui qui vit en<br />
provincia, « l’insieme dei piccoli paesi di una provincia o di una regione ». L’écart nous paraît<br />
manifeste, et de taille. Il ne s’agit pas, à proprement parler, de connotation 78 divergente. Il<br />
s’agit plutôt d’un contenu sémantique dissemblable, relevant sans aucun doute de<br />
l’extralinguistique. Comme on peut le voir, le phénomène de l’écart met en jeu une vaste<br />
typologie de thèmes, qui parfois interrogent l’identité même du DB.<br />
Passons maintenant à analyser d’autres valeurs du signe, tels qu’on peut les saisir dans les<br />
dictionnaires.<br />
Le verbe français ronronner a une évidente origine onomatopéique. Si B, HP et SL traduisent<br />
tout simplement « fare le fusa », G ajoute « fare ron ron ». Ce choix tend peut-être à<br />
préserver cette motivation supplémentaire du lexème, plutôt qu’à fournir un équivalent<br />
ultérieur. Le dénoté n’est pas en question, ni la connotation, ni l’extralinguistique ; dans ce<br />
cas c’est la forme signifiante qui est au centre. Même si le traduisant « fare ron ron » est peu<br />
usité, à notre avis il a le mérite de souligner une onomatopée qui n’est pas forcément<br />
transparente pour un locuteur italien.<br />
I.4.5 Les degrés de l’équivalence lexicale<br />
Dans les pages précédentes, nous avons pu voir les dimensions expressive, connotative et<br />
pragmatique de l’équivalence interlinguale, et les écarts qui en découlaient. De façon plus<br />
générale, nous nous demandons maintenant : est-il possible d’établir une échelle<br />
d’équivalence lexicale ?<br />
KROMANN – RIIBER – ROSBACH (1991 : 2717-2718) distinguent une « full equivalence », où<br />
« no denotative or connotative elements are lost », une « partial equivalence » (qui concerne<br />
l’hypéronymie ou l’hyponymie interlinguale) et une « zero equivalence », à pallier à travers<br />
des « surrogate equivalents ». En d’autres termes, GOUWS (2002) a parlé de « congruence »<br />
(équivalence totale), « divergence » (équivalence partiale, qui peut être d’ordre lexical ou<br />
sémantique) et « surrogate equivalence » (ou équivalence zéro, qui peut être d’ordre<br />
linguistique ou référentiel).<br />
Pour DUVAL aussi (1991 : 2818) on peut isoler trois cas de figure :<br />
- lorsque le signifié renvoie à une même réalité culturelle, et que le signifiant est un élément<br />
du lexique dans les deux langues. Par exemple : F. ordinateur ; A. computer<br />
- lorsque le mot existe bien en tant qu’élément du lexique dans les deux langues, alors que le<br />
réel ne fait pas partie de l’univers culturel des locuteurs de la langue cible ou n’est pas<br />
reconnu en tant que tel par la majorité entre eux. Par exemple : F. le 14 juillet ; A. Bastille Day<br />
78 Pour une discussion sur cette notion, voir infra, I.8.<br />
57
- plus fréquemment qu’on ne le pense, il se peut que le réel n’existe que dans l’univers<br />
culturel et le lexique du locuteur de la langue source. Par exemple : F. ballotage ; A. situation in<br />
a political election when no candidate has an absolute majority in the first ballot and people have to vote<br />
again<br />
DUVAL distingue donc un écart interlingual absolu au niveau des référents (troisième cas),<br />
un écart partiel au niveau des référents (deuxième cas) et un niveau d’écart zéro (premier<br />
cas), où les référents sont connus par les deux communautés linguistiques de L1 et L2. Le<br />
deuxième cas de figure s’avérera très pertinent pour la discussion des écarts que nous avons<br />
identifiés pendant l’analyse de notre corpus. Il s’agit de tous ces référents dont la présence<br />
est moins évidente en L2 et qui engendrent des ‘trous’ dans la trame signifiante, mis en<br />
évidence par une équivalence 1 signe : >1 signe.<br />
L’apport de SNELL-HORNBY (1987) vise à la mise au point une typologie de l’équivalence<br />
dans les DB, qui va de l’équivalence totale et parfaite, le propre des nomenclatures technoscientifiques<br />
79, à l’équivalence partielle, aux « culture-bound words », à équivalence zéro. A<br />
travers notre analyse du corpus, nous essaierons de montrer que l’équivalence en<br />
terminologie aussi se prête à un certain décalage au niveau des dénominations, quoique la<br />
dimension expressive ne soit naturellement pas mobilisée par les termes.<br />
Les propos de TOMASZCZYK (1983 : 48) sont assez sceptiques. Il affirme : « At one end of<br />
the continuum there are the rare cases of one-to-one correspondence (‘perfect’<br />
equivalence), and at the other end there are items in one language that have no equivalents<br />
at all in the other ».<br />
A l’autre bout de la nomenclature techno-scientifique, on aura donc les mots que la<br />
tradition anglo-saxonne appelle « culture-bound », désignant des realia, pour lesquels<br />
l’équivalence sera impossible, le référent étant unique et non partagé entre les deux<br />
communautés linguistiques. Ce qui pose problème, toutefois, est aussi tout ce qui se trouve<br />
au milieu, entre les ‘intraduisibles’ et les ‘termes’, bref l’essentiel du lexique. Nous nous<br />
attacherons à cette étude au cours de la deuxième partie.<br />
79 Pourtant SPILLNER (1994) nuance cette conception, en soulignant la dimension connotative, certes moins<br />
visible, des termes.<br />
58
I.5 Lexicographie bilingue et traduction<br />
La traduction des unités lexicales est en toute évidence le moment central de l’activité<br />
lexicographique. Cependant, il n’est pas aisé de cerner la spécificité de la traduction dans le<br />
cadre de la lexicographie bilingue. Malgré le statut de texte que l’on reconnaît depuis<br />
longtemps au dictionnaire 80, il s’agit sans aucun doute d’un texte très particulier,<br />
notamment en ce qui concerne les retombées sur une théorie et une pratique de la<br />
traduction. Nous nous rendons compte des risques de paradoxe, d’impasse théorique et de<br />
court-circuit que peut entraîner la prise en compte de la dimension de la traduction dans un<br />
ouvrage qui se fonde entièrement sur ce procédé. Nous essaierons de toute façon de<br />
dégager quelques idées-clés sur le propre de la traduction dans l’optique de la lexicographie<br />
bilingue.<br />
Les termes de la question sont posés très clairement par LAURIAN :<br />
Chercher un équivalent en langue 2 d’un vocable de langue 1 signifie chercher un signifié<br />
identique pour deux signifiants appartenant à deux systèmes différents. Est-il vraiment<br />
possible d’avoir une identité de signifiés? Une identité de signifiés suppose une identité de<br />
contextes de discours et de contextes extra-linguistiques (2004 : 3).<br />
Les notions de collocation (« contextes de discours ») et d’univers de valeurs (« contextes extralinguistiques<br />
») sont donc convoquées dans le cadre cette réflexion large.<br />
LAURIAN tranche (2004 : 4): « Le dictionnaire bilingue véritable, celui où les mots sont à la<br />
fois pris dans leur significations les plus précises, et traduits avec leurs connotations les plus<br />
variées, est impossible », avant de conclure que « pourtant, des approximations sont<br />
possibles » (ibid.).<br />
DARBELNET (1970 : 94-95) pour sa part introduit deux notions essentielles pour la<br />
traduction des entrées dans les DB : bifurcation et extension. « Il y a bifurcation lorsque la<br />
traduction d’un mot oblige à choisir entre deux ou plusieurs équivalents » ; « dire qu’un mot<br />
a plus d’extension qu’un autre, c’est dire que dans un sens donné il recouvre une aire<br />
sémantique plus étendue ». L’expérience de tout usager de DB ne peut que confirmer que<br />
ces cas représentent la règle, plus que l’exception.<br />
La réflexion de DAGUT insiste par contre sur le niveau expressif et rhétorique de la<br />
traduction des unités lexicales. Il commence par affirmer que « it is taken as axiomatic that,<br />
all languages being unique symbolic systems, there can be no complete interlingual<br />
equivalence other than identity » (DAGUT 1981 : 61, n. 2). Il s’attache ensuite à analyser le<br />
phénomène des « incommensurabilities » (nous dirions les écarts) des deux langues<br />
80 Cf. WIEGAND (1984) ; REY-DEBOVE (2008).<br />
59
concernées, en fixant son attention sur le niveau du mot qui, malgré les notoires difficultés<br />
théoriques qui l’affectent 81, n’en reste pas moins « the true meeting-point between language<br />
and what language symbolizes » (1981 : 62). Le texte mérite une citation assez complète :<br />
The phenomenon of a semantic ‘void’ occurs with words belonging to the category of<br />
‘designators’, i.e., patterns of phonemes having referential function, whether the reference is<br />
‘concrete’ (book, run, white), ‘abstract’ (truth, believe, pleasant), or merely purported (fairy, utopia,<br />
tomorrow). All designators are characterized by (a) symbolizing something outside language,<br />
and (b) performing the symbolic function of encapsulating (1981 : 62).<br />
C’est cette compression sémantique des lexèmes, comme l’auteur l’appelle, qui nous<br />
intéresse tout particulièrement, car cette caractéristique est précisément celle des lemmes et<br />
de leurs équivalents optimaux 82. L’optique adoptée par l’article de DAGUT est éminemment<br />
contrastive, c’est-à-dire il ne s’intéresse pas aux « vides », aux « ’holes’ in a given language<br />
lexical ‘map’ as such, but only with the ‘voids’ that result when these ‘holes’ are revealed by<br />
interlingual comparison » (1981 : 63). Ces « vides » se distinguent entre « (a) voids due to<br />
extra-linguistic factors, and (b) voids due to intra-linguistic factors » (1981 : 64). Les<br />
premiers désignent des trous dans le domaine de la référence, et correspondent à des<br />
référents qui ne sont pas à la portée de la communauté linguistique, alors que les seconds<br />
indiquent des trous dans le domaine sémantique 83 , qui se produisent malgré le fait que ces<br />
référents soient présents dans l’expérience de la communauté linguistique. Les plus<br />
intéressants pour une analyse linguistique sont évidemment les seconds, les premiers<br />
relevant des realia, comme les appelle ZGUSTA (1984). Cependant, dans le choix des<br />
traduisants pour des « referential voids », DAGUT nous livre des réflexions intéressantes,<br />
très pertinentes pour ce qui concerne la lexicographie bilingue aussi :<br />
One essential of ‘equivalence’ must be the preservation in TL [target language, langue cible]<br />
of the effect produced by the particular words of SL [source language, langue source], i.e.,<br />
the finding of TL lexical items which reproduce both the denotative compression (a word as<br />
the phonemic encapsulation of a complex of situational features) and the connotative impact<br />
(a word as the focus of emotional reaction to such a complex) of the SL (1981: 67).<br />
Ce sont des remarques courantes en métalexicographie, qui nous confirment la nécessité<br />
d’une approche holistique au sens. Pour ce qui est du deuxième type de « voids », les lacunes<br />
sémantiques, il faut souligner qu’elles ne sont pas présentes naturellement dans la<br />
conscience des locuteurs d’une communauté linguistique donnée, mais qu’elles ne se<br />
manifestent qu’à travers une comparaison avec un autre système linguistico-culturel.<br />
DAGUT insiste ensuite sur le « niveau du mot », essentiel pour transmettre la force<br />
expressive des unités lexicales; il se concentre ensuite sur le « compressed power of a<br />
designator » que caractérise le lexème, « the true meeting-point between language and what<br />
81 Cf. MOUNIN, qui conclut « Le mot n’est pas une réalité de linguistique générale » (2004 : 222-223).<br />
82 Cf. FARINA D. (1996).<br />
83 « Il y a des trous dans la trame signifiante », note DUVAL (1993 : 17).<br />
60
language symbolizes [...], performing the symbolic function of encapsulating » (DAGUT<br />
1981 : 62). Sans équivalence lexématique, on n’aura qu’une « looser and clumsier<br />
symbolization ». Il ne s’agit donc pas de la possibilité d’expression et de traduction en tant<br />
que telles, mais plutôt de leur modalité dans deux couples de langues : c’est la dilution du<br />
sens qu’il faut éviter, où que possible, afin de ne pas disperser l’intégrité à double face que<br />
seuls les lexèmes possèdent. Les conséquences au niveau rhétorique de cette « dilution » du<br />
sens ne seraient évidemment pas négligeables, d’autant plus qu’un lexème se cristallise<br />
mieux dans la conscience des locuteurs et devient susceptible de se charger de valeurs<br />
ajoutées, ou connotatives, beaucoup mieux qu’une suite de mots. Cette réflexion, qui met<br />
au centre la dimension du mot, nous paraît originale et prometteuse. Elle fonde notre<br />
vision des écarts comme décalage au niveau du signifiant, que nous expliciterons dans la<br />
deuxième partie.<br />
C’est sur ce même point que BRINK (1971) a insisté, en réfutant dans un seul article les<br />
formulations de la « dissection theory » de MALMBERG (qui s’inspire largement de<br />
WEISGERBER) et, surtout, de WHORF 84 : il repousse l’argument des « boundary lines »<br />
(lignes de découpages) que les langues imposeraient à leurs locuteurs, tout argument<br />
pouvant se rapporter à l’existence (ou à la non-existence) d’équivalence au niveau des<br />
« signes minimaux » dans les deux langues mises en présence. BRINK considère primordial<br />
le fait que ce qu’une langue condense dans un mot requiert une paraphrase dans une autre :<br />
cela a un effet sur la fréquence d’emploi du mot (beaucoup plus élevée par rapport à sa<br />
paraphrase « correspondante »), et au niveau des connotations possibles. Finalement, ce<br />
qu’il reproche à MALMBERG et à WHORF est essentiellement la confusion qu’ils font en<br />
assimilant le concept au signe minimal. Il s’agit de deux notions très différentes : le concept<br />
peut exister même en l’absence d’un signe unique qui le dénote.<br />
BRINK achève son article en discutant la question de l’influence des concepts linguistiques<br />
sur la pensée. Finalement, il nie l’idée que les langues imposent des contraintes aux locuteurs<br />
et induisent nécessairement une certaine cognition du monde qui nous entoure ; cependant, il<br />
ne nie pas que les langues offrent des angles de perceptions privilégiés aux locuteurs, à<br />
travers leurs conceptualisations. Ce point de vue nous rapproche donc de la notion de<br />
parallélisme que nous avons évoqué dans le chapitre I.1.<br />
Les remarques de SNELL-HORNBY (1986 : 214) concernent un point fondamental,<br />
notamment la dimension a-contextuelle et lexématique de la traduction dans les DB : « In<br />
the case of the dictionary ‘translation equivalent’, both elements of the term are<br />
misleading : as translation theorists are quick to point out, translation involves texts and not<br />
words, and equivalence is for the most part an illusion ». Cependant, cette illusion ne cache<br />
pas le fait que, dans de nombreux cas (nous les détaillerons dans la deuxième partie),<br />
84 Il y a aussi une critique assez sévère de HJELMSLEV (1968), bien que ses positions soient un peu plus<br />
nuancées que celles de MALMBERG et WHORF.<br />
61
l’équivalent n’existe pas, soit dans un contexte quelconque, soit dans une acception donnée.<br />
Il est vrai que cela n’empêche aucunement la traduction, mais il est tout aussi vrai que cela<br />
soulève des problèmes sur le plan de l’expression et sur la valeur culturelle des unités<br />
lexicales.<br />
Comme le dit très bien SZENDE (1993 : 80), « traduire, c’est transmettre la culture de départ<br />
dans la culture d’arrivée, donc adhérer à un nouveau système complexe de valeurs et de<br />
représentations culturelles communes ».<br />
Revenons au thème de l’équivalence un signe : un signe. SNELL-HORNBY (1990b : 209-210)<br />
met en évidence cette « misguided but deep-seated view of interlingual equivalence, in the<br />
conviction that a word in one language must necessarily be lexicalized to fulfil the same<br />
function in another language » 85 ; elle insiste moins sur le présupposé des « readily<br />
insertable lexical items », que sur le principe, plus sceptique si l’on veut, de « varying<br />
interlingual relationships, the simplest relationship existing at the level of terminology and<br />
nomenclature, and the most complex being conditioned by the ‘dynamic’ factors of<br />
sociocultural norm, perception and evaluation » (1990b : 210). Le but des DB de l’avenir,<br />
selon elle, devrait être celui de mettre en évidence « the focal component of the lexeme<br />
concerned and [...] situating it both paradigmatically (or intralingually) and contrastively (or<br />
interlingually), i.e. both against other items in the semantic fields concerned and in contrast<br />
to similar items in the target language ». Voici donc une tentative d’aller au-delà de<br />
l’isolement paradigmatique dont souffrent les unités lexicographique. SNELL-HORNBY<br />
propose ensuite une approche semi-onomasiologique, qui intègre l’agencement<br />
alphabétique avec une présentation de champs sémantiques contrastifs (1990b : 223). Cette<br />
proposition n’a eu guère d’application, à notre connaissance, mais elle a eu certainement le<br />
mérite de mettre en évidence quelques points critiques de l’équivalence en lexicographie<br />
bilingue.<br />
I.5.1 Les lacunes lexicales<br />
Nous avons déjà rencontré la notion de lacune lexicale chez DAGUT. Faisons maintenant<br />
un pas en arrière. L’article de LEHRER (1970) peut être étudié de façon fort instructive.<br />
Négligeant les lacunes morphématiques, paradigmatiques et dérivationnelles, elle se<br />
concentre sur les lacunes lexicales « that show up in careful studies of the structure of<br />
semantic fields » (1970 : 257). Ces champs sémantiques s’organisent en matrices. Dans une<br />
perspective éminemment chomskyenne, l’auteure envisage le sens des mots comme « a set<br />
of components (semantic markers, sememes, etc.) », en base auxquels il est possible de voir<br />
quelles combinaisons sont représentées par un mot et quelles ne le sont pas.<br />
85 Selon VARANTOLA aussi (2002 : 36) il faut se débarasser des « rigid implications that the notion of a<br />
translation equivalent carries ».<br />
62
Par exemple :<br />
dead<br />
Nous pouvons voir l’absence en anglais (en français et en italien aussi, ajoutons-nous) d’un<br />
mot qui indique une plante morte, alors que le mot « corpse » (carcasse) existe pour indiquer<br />
un animal mort.<br />
S’il n’y avait pas de matrices dans la langue, les lacunes pourraient être infinies, et on<br />
pourrait qualifier de lacune l’absence d’un mot pour « a small patch of red carpet between a<br />
grey filing cabinet and a bookcase in a linguist’s office » (1970 : 258), ce qui serait<br />
évidemment paradoxal.<br />
Il est évident, cependant, que ce modèle de matrice n’est valable que pour des champs<br />
sémantiques simplifiés (comme par exemple le sexe des animaux, l’exemple proposé plus<br />
loin par l’auteure), et que ces champs ne sont construits que pour confirmer<br />
rétroactivement la théorie qui est à la base. LEHRER est consciente de ces difficultés et<br />
affirme la nécessité de poser des contraintes à la notion de lacune lexicale : pour ce faire, il<br />
faudrait isoler des paramètres qui rendent compte du champ sémantique, exclure les<br />
combinaisons non productives de mots (comme ‘femelle châtrée’) ou qui ne produisent<br />
qu’un mot générique, non-différencié (souris, rat, rouge-gorge, araignée), ou encore négliger les<br />
lacunes sans référents 86 (‘un être mi-femme, mi-cheval’).<br />
Une autre catégorie, qui s’ajoute aux lacunes ‘matricielles’, est celle des lacunes<br />
‘fonctionnelles’, qui concernent la non existence de mots ou expressions pour indiquer un<br />
référent ; cependant, ces deux catégories se chevauchent souvent.<br />
La perspective de LEHRER est, en définitive, toute du côté du système et néglige<br />
complètement les besoins communicatifs des locuteurs, qui n’existent que pour en<br />
confirmer les règles ; elle n’envisage pas la néologie ; c’est cette tendance à l’algébrisation de<br />
la langue qui a longtemps marginalisé l’étude du lexique comme une liste d’irrégularités 87 .<br />
DUCHACEK (1974 : 7) observe que « le lexique de toute langue naturelle n’est pas une masse<br />
amorphe, mais un ensemble d’unités lexicales hiérarchiquement structuré », bien qu’il ne<br />
soit pas organisé parfaitement. A propos des écarts interlinguistiques, il observe : « On<br />
rencontre des tournures intraduisibles bien qu’on puisse évidemment exprimer tout ce<br />
86 Mais nous nous demandons, essayant de suivre les règles du jeu: quelle raison linguistique y aurait-il pour<br />
cela?<br />
Animal plant<br />
Corpse Ø<br />
87 Depuis BLOOMFIELD, cf. GEERAERTS (1987). Le modèle componentiel de l’analyse sémique a été<br />
clairement hérité des études phonologiques, mais malheureusement a montré ses limites dans son application<br />
au lexique. Cf. PEETERS (1996 : 261) : « On n’a pas en général mis en question le bien-fondé d’une<br />
transposition des méthodes et des acquis de la phonologie dans le domaine du lexique ».<br />
63
qu’on veut dans chacune des langues de culture. Bien entendu, on ne peut pas toujours le<br />
faire avec la même netteté et sans ambigüité » (1974 : 8). Les lacunes marquent donc une<br />
modalité expressive appauvrie et qui souffre d’un manque en précision. Ce n’est<br />
évidemment qu’à travers la confrontation de deux ou plusieurs langues qu’il est possible de<br />
découvrir ces lacunes lexicales 88 . Par rapport à la vision de LEHRER, nous voyons qu’une<br />
prise en compte de la dimension expressive des unités commence à apparaître dans la<br />
pensée de DUCHACEK.<br />
DE DAR<strong>DEL</strong> (1977 : 63) ouvre son article avec un postulat : une langue « est en mesure<br />
d’exprimer tous les concepts [mais] ne les exprime cependant pas tous au moyen d’une<br />
unité lexicale et ‘l’absence d’un mot simple n’implique pas l’absence du concept’ 89 ». Son<br />
deuxième postulat est que « le système de la langue et son évolution sont conditionnés dans<br />
une certaine mesure par des besoins extra-linguistiques, qui découlent à leur tour du monde<br />
socio-culturel où vit la communauté linguistique » (ibid.). Voici donc une prise en compte<br />
explicite du rôle de la communauté linguistique dans l’évolution du système lexical.<br />
DE DAR<strong>DEL</strong> poursuit : « l’existence de certains mots virtuels [lexèmes non actualisés par le<br />
système, et pour exprimer lesquels il faut recourir à une périphrase] et de certains mots<br />
actuels [lexèmes qui expriment un concept donné] résulte d’une pression que le monde<br />
socio-culturel exerce sur la langue » (1977 : 66). L’univers extralinguistique laisserait donc<br />
une empreinte évidente dans le lexique d’une langue et dans ses lacunes. Voici comment se<br />
dessine de l’approche adoptée par DE DAR<strong>DEL</strong> :<br />
La description scientifique de la langue, qu’elle soit synchronique ou diachronique, aborde sa<br />
tâche de manière trop restrictive, si elle situe le principe d’explication des mots virtuels et des<br />
mots actuels à l’intérieur du langage uniquement et si elle ne tente pas d’isoler les mots<br />
virtuels et les mots actuels d’origine socio-culturelle (1977 : 77).<br />
L’auteur s’oppose donc à la dichotomie structuraliste linguistique interne vs. linguistique externe.<br />
Une tentative comme celle de LEHRER s’avère d’emblée infaisable, puisque<br />
les mots virtuels et les mots actuels, en tant qu’affleurement des besoins socio-culturels d’une<br />
langue, sont par définition asystématiques, c’est-à-dire échappent à une explication basée sur<br />
l’analyse du système linguistique (1977 : 71).<br />
PEETERS (1996), plus récemment, considère que l’existence de cases vides lexicales n’est<br />
qu’un mythe. Il cherche donc « à mettre en question l’existence [des] cases vides qui se<br />
situent au niveau du lexique de la langue-E partagée par tous les membres d’une<br />
communauté linguistique » (1996 : 255). La notion de « possibilité théorique » de l’existence<br />
d’un mot pour chaque « case » est gênante car elle implique la conception du « lexique<br />
88 L’auteur parle également de « redondances lexicales », comme pour le doublet français venimeux/vénéneux.<br />
89 Cit. POTTIER B., « Champ sémantique, champ d’expérience et structure lexicale », Zeitschrift für französische<br />
Sprache und Literatur, Beiheft (Neue Folge), 1, 1968, p. 37-40.<br />
64
d’une langue en termes de lexèmes et de sémèmes, c.-à-d. en termes de constellations de<br />
sèmes ou de traits sémantiques distinctifs » (1996 : 257).<br />
PEETERS met au centre de ses réflexions le concept des « besoins communicatifs des<br />
usagers », emprunté au fonctionnalisme d’A. MARTINET. Au cas où il y aurait « certains<br />
concepts lexicalisés dans une langue A, mais non pas dans une autre langue B », il faudrait<br />
parler de lacunes, plutôt que de cases vides 90 . Ce phénomène est amplifié par le fait que « les 91<br />
langues humaines [...] reflètent sans exception une vue du monde qui leur est propre »<br />
(1996 : 259). Ces considérations rejoignent celles que nous avons évoquées dans le chapitre<br />
I.1 et elles reflètent, à notre avis, la réalité des choses : la langue porte la marque de la<br />
culture qui est propre à la communauté des locuteurs.<br />
A propos de ce thème, SZENDE (1996 : 113) affirme : « Le fait que telle construction<br />
conceptuelle porte un nom, qu’elle est en quelque sorte solidifiée par un nom, prouve<br />
l’intérêt que lui porte la communauté linguistique, alors que telle autre ne peut s’exprimer<br />
que de façon analytique et indirecte ». Dans ces mots, il esquisse une théorie sur les causes<br />
socio-culturelles des découpages sémantiques, et de leurs lacunes lexicales relatives. La<br />
question qui se pose nous paraît la suivante : si certaines « constructions conceptuelles »<br />
sont exprimées de façon synthétique par une langue, cela témoigne-t-il sans équivoque de<br />
l’intérêt de la communauté linguistique respective pour le concept ? Et, par ailleurs, est-ce<br />
que les ‘lacunes’ lexicales signalent plutôt un désintérêt des locuteurs de cette langue pour<br />
cette conceptualisation ?<br />
PEETERS (2000 : 206) semblerait pencher pour l’affirmative : « the unavailability of a word<br />
is typically an indication of the relative unimportance of the corresponding concept in a<br />
speech community ».<br />
Un point de vue diamétralement opposé est défendu par TOMASZCZYK (1983 : 49):<br />
a language does not really need a separate lexical item for every tiny thing its users can think<br />
of [and] the need for a lexical item is only one of the factors that lead to its coinage. [...] A<br />
language can survive a long time without a specific item even though the particular concept<br />
may be quite important for the speakers.<br />
L’un des buts de la deuxième partie de notre thèse est de mettre à l’épreuve les hypothèses<br />
de SZENDE et PEETERS. Notamment, l’analyse des écarts tirés de notre corpus nous<br />
permettra de vérifier si cette corrélation entre langue et culture existe, et comment elle<br />
s’articule.<br />
90 Ce que fait encore BIDAUD (2003: 69), définissant les cases vides comme des « termes qui ne possèdent pas<br />
d’équivalents dans l’autre langue ». L’exemple fourni est l’italien pendolare.<br />
91 C’est l’auteur qui souligne.<br />
65
I.6 Les apports de la sémantique lexicale à la lexicographie bilingue<br />
Nous croyons opportun rappeler ici quelques cas significatifs de synergie entre<br />
lexicographie bilingue et théories sémantiques. Etant donné les obstacles, au niveau<br />
structurel, qui pèsent sur l’équivalence interlinguale, et que nous avons évoqués dans les<br />
chapitres précédents, et étant donné, au niveau empirique, l’à-peu-près qui a caractérisé<br />
jusqu’à présent bon nombre d’ouvrages lexicographiques, il n’est pas surprenant de voir<br />
plusieurs chercheurs aux prises avec des tentatives de description aussi scientifiques que<br />
possible des correspondances lexicales entre deux langues.<br />
Il s’agit de tentatives, abouties ou non, qui peuvent mieux illustrer l’éventail possible des<br />
rapports entre la pratique dictionnairique et quelques cadres théoriques de description de<br />
l’univers lexical.<br />
BEJOINT (2009 : 118) essaie de situer la question en se demandant « Quelle influence la<br />
linguistique théorique a-t-elle eue sur les dictionnaires [...] au cours de ces dernières<br />
décennies ? ». Notamment, « il s’agit de voir si les travaux des linguistes professionnels,<br />
c’est-à-dire des chercheurs spécialisés dans les sciences du langage, et donc pratiquement<br />
des universitaires, ont eu une influence sur la production lexicographique ». Il faudra donc<br />
vérifier si ces applications ont permis aux dictionnaires d’y gagner « en exhaustivité, en<br />
exactitude et éventuellement en accessibilité de la description ».<br />
Le modèle théorique qui a eu le plus d’influence sur la lexicographie pratique est sans aucun<br />
doute celui de MEL’CUK 92 . Comme l’écrit P. CORBIN,<br />
dans le domaine de la combinatoire lexicale, le Dictionnaire explicatif et combinatoire du français<br />
contemporain d’Igor Mel’čuk, qui vise à donner une description sémantico-syntaxique<br />
systématique des unités lexicales du français en recourant à une codification assez élaborée<br />
mais pas impénétrable, s’est concrétisé jusqu’à présent dans l’analyse de quelques centaines<br />
d’unités distribuée en quatre volumes depuis 1984 (2002 : 33).<br />
PRUVOST synthétise ainsi ce paradigme de recherche : « Pour Mel’čuk, la langue et son<br />
fonctionnement relèvent [...] d’un ‘système d’équations’, le fonctionnement des mots se<br />
rattachant à une sorte d’algèbre dont il faut rechercher d’abord et apprendre ensuite toutes<br />
les formules » (2002 : 152). Des tentatives pareilles<br />
92 Pour une présentation globale de cette démarche, nous renvoyons à MEL’CUK – CLAS – POLGUERE (1995).<br />
Cf. aussi l’étude de GATTI M.C., Dalla semantica alla lessicologia. Introduzione al modello Senso ↔ Testo di I.A.<br />
Mel’čuk, Brescia : La Scuola, 1992.<br />
66
ont assurément l’avantage d’apporter des matériaux précieux et des schémas de réflexion que<br />
seules les analyses en profondeur de ce type permettent de mettre en relief. On comprend<br />
cependant que ces travaux sont nécessairement lents et que du côté de la dictionnairique, on<br />
ne puisse attendre qu’ils soient achevés pour aider les lecteurs empêtrés dans les traductions<br />
et dans le lacis des mots chargés d’écarts culturels (ibid.).<br />
On voit donc apparaître cette dichotomie entre ‘les raisons de la science’ et ‘les raisons des<br />
usagers’, une opposition que plusieurs chercheurs ont essayé de surmonter.<br />
LEPINETTE (1989) s’est donnée comme but d’appliquer le modèle Sens-Texte de MEL’CUK<br />
à un nouveau dictionnaire explicatif et combinatoire bilingue. Nous ignorons si ce projet a<br />
pris la forme d’un ouvrage concret, mais il est intéressant, à ce stade, d’en voir la pertinence<br />
pour notre étude.<br />
PIOTROWSKI (1990) a ensuite analysé les apports du modèle Sens-Texte de MEL’CUK à la<br />
lexicographie pratique, mettant en évidence les convergences entre ce modèle théorique et<br />
les tendances récentes dans la production des dictionnaires, dont la demande d’exhaustivité<br />
et la clarté et la cohérence dans la présentation des informations.<br />
T. FONTENELLE (2008 [1997]) aussi a exploité les théories de MEL’CUK afin d’élaborer un<br />
réseau lexico-sémantique bilingue ; L’HOMME (2001), par contre, a fait recours au modèle<br />
du linguiste russe pour la création d’un dictionnaire spécialisé bilingue.<br />
Une collaboration entre théorie sémantique et production lexicographique paraît donc<br />
possible ; il convient de préciser, toutefois, que les ouvrages ainsi créés ne sont pas<br />
normalement consacré au grand public, mais plutôt aux spécialistes.<br />
MEL’CUK – CLAS – POLGUERE (1995) nous offrent des remarques très pertinentes sur le<br />
rapport entre lexicographie (qu’ils préfèrent appeler lexicologie expérimentale, ou descriptive) et<br />
dictionnairique 93 (ou lexicographie pratique). En ce qui concerne les difficultés en amont de la<br />
réalisation d’un dictionnaire, selon les auteurs, elles se résument en quatre catégories : la<br />
quantité d’unités lexicales à traiter ; la quantité d’informations à fournir pour chaque lemme ; la<br />
complexité de l’information lexicographique ; la variation des données lexicales 94 (1995 : 22-<br />
23). A ces difficultés, qu’on pourrait qualifier d’internes (internes à la logique d’une<br />
description scientifiquement fondée d’un lexique X) s’ajoutent des difficultés contingentes (les<br />
auteurs les appellent psychologiques), qui concernent le public ciblé, ses besoins et sa<br />
compétence de lecteur de l’ouvrage lexicographique, ainsi que les contraintes éditoriales et<br />
commerciales. Autant de facteurs qui rendent difficile une convergence entre les nécessités<br />
93 Rappelons que le mot dictionnairique s’est imposé en linguistique grâce à QUEMADA (1987), qui dans un<br />
article paru dans les Cahiers de lexicologie en a montré la pertinence, ainsi que l’importance opérationnelle, dans<br />
les études de lexicographie.<br />
94 A propos de la représentation de la variation dans les dictionnaires, voir surtout GRINDSTED (1988) ;<br />
OSSELTON (1995) ; BARSI (2003) ; MOLINARI (2007).<br />
67
de cohérence interne et systématisation propres à la théorie, et les besoins des usagers,<br />
ponctuels, variés et mal étudiés 95 .<br />
Au-delà des travaux de MEL’CUK, d’autres modèles sémantiques ont été à la base de projets<br />
lexicographiques, achevés ou pas.<br />
ATKINS (2002 ; 2008), par exemple, relate son expérience de lexicographe et de linguiste et<br />
nous fait part du rôle indispensable de la théorie des frames 96 dans l’élaboration des<br />
dictionnaires monolingues anglais qu’elle a dirigés.<br />
CORBIN – GASIGLIA, par contre, se déclarent plus sceptiques<br />
Le projet FrameNet apparaît donc comme un exemple typique d’élaboration d’un de ces<br />
métadictionnaires prônés par [Pierre Corbin] pour servir de relais entre linguistes et<br />
lexicographes. Ceci étant, pour des raisons aussi bien pratiques que théoriques, il avance à la<br />
vitesse universitaire et ne peut réponde qu’aléatoirement aux requêtes des utilisateurs (2009 :<br />
24) .<br />
JIMENEZ HURTADO (1994) propose, pour sa part, une intégration des données<br />
pragmatiques dans le dictionnaire, en s’appuyant à la Grammaire Fonctionnelle de DIK 97 ;<br />
cependant, cette proposition n’a pas trouvé d’application, à notre connaissance.<br />
« Qual è il rapporto tra dizionaristica e lessicografia ? », se demande CALZOLARI (2006:<br />
329). Elle soutient que « Le esigenze delle case editrici possono essere viste come correttivo<br />
alla linguistica computazionale, per renderla più realistica e legata alle esigenze anche del<br />
mercato ». Ce rapport se nourrit donc d’une contradiction interne, qui se rattache en<br />
priorité à des facteurs économiques et de rentabilité financière: il paraît que l’écart entre les<br />
exigences des la dictionnairique et de la lexicographie expérimentale ou descriptive<br />
(MEL’CUK – CLAS – POLGUERE : 1995) est encore loin d’être réduit.<br />
95 Le thème des besoins des utilisateurs mériterait un traitement à part. Nous nous limitons ici à renvoyer aux<br />
travaux suivants : TOMASZCZYK (1983); HATHERALL (1984) ; BEJOINT (1987) ; HARTMANN (1987) ;<br />
HUMBLEY (2002), VARANTOLA (2002) ; CRYSTAL (2003) ; BOGAARDS (2003) ; TARP (2008).<br />
96 Une introduction à cette théorie se trouve dans FILLMORE-JOHNSON-PETRUCK, 2003.<br />
97 Cf. MARTIN MINGORANCE (1990), dont le modèle comprend aussi des éléments de la lexématique de<br />
COSERIU.<br />
68
I.7 Le mythe de l’objectivité 98<br />
Le linguiste ne dispose pas d’un point d’Archimède extérieur à tous les idiomes<br />
69<br />
STATI (1986 : 4)<br />
Les études que nous avons recensées dans le chapitre précédent, à la frontière entre<br />
lexicographie bilingue et sémantique lexicale, ont un fil rouge commun, en ce sens qu’elles se<br />
proposent de décrire objectivement les réseaux sémantiques de deux langues mises en regard.<br />
Au point de vue heuristique, nous ne pouvons rien reprocher à ces études. Au point de vue<br />
lexicographique et dictionnairique, qui n’est pas sans évoquer une approche<br />
traductologique la donne change considérablement.<br />
Nous essaierons de montrer la spécificité du sémantisme des unités lexicales en analysant la<br />
notion d’objectivité.<br />
Dans quelle mesure peut-on parler d’objectivité du DB et où se situe l’optimum de la<br />
description ?<br />
Prenons comme point de départ cette définition d’un dictionnaire de langue courant, PR11.<br />
objectivité nom féminin<br />
ETYM. 1801 ◊ de 1. objectif<br />
1. Philos. Qualité de ce qui existe indépendamment de l’esprit.<br />
2. Qualité de ce qui donne une représentation fidèle d’un objet. Objectivité de la science.<br />
➙ impersonnalité.<br />
3. (1838) Cour. Qualité de ce qui est exempt de partialité, de préjugés. Objectivité d’un compte<br />
rendu, d’un jugement. Récit qui manque à l’objectivité, manque d’objectivité.<br />
◆ (Personnes) Attitude d’esprit d’une personne objective, impartiale. Objectivité d’un historien,<br />
d’un juge. ➙ impartialité, neutralité. Manquer d’objectivité.<br />
■ CONTRAIRES : Partialité, subjectivité.<br />
En écartant le premier sens du mot, les enjeux de l’objectivité semblent effectivement liés à<br />
la « représentation fidèle d’un objet » et à une attitude dépourvue « de partialité, de<br />
préjugés ».<br />
98 Une version préliminaire de ce chapitre a paru dans TALLARICO (2009).
Si on parle de « représentation fidèle », cependant, la question se complique car, dans les<br />
DB, tout d’abord, il n’y a pas de véritable objet dont on pourrait donner une telle<br />
représentation. L’objet en question est en effet une prétendue équivalence entre deux<br />
systèmes, un postulat nécessaire et même ‘raisonnable’ dans le cas de langues ayant la<br />
même structure grammaticale (et d’autant plus pour celles qui partagent un fonds lexical,<br />
comme le français et l’italien 99), mais il n’en reste pas moins un postulat; l’objet de la<br />
description s’identifie donc à un but, qui n’est pas donné a priori mais qu’il faut atteindre,<br />
entrée par entrée, dans un processus de construction textuelle. Ce processus ne sera pas<br />
sans obstacles et apories, comme nous le verrons.<br />
Essayons de situer le cadre de la question : dans les DB nous avons une mise en présence<br />
de deux univers lexico-culturels qui se regardent et cherchent des voies pour une<br />
compréhension mutuelle, par le biais d’une équivalence; il s’agit, comme l’écrit JOSETTE<br />
REY-DEBOVE (1970 : 27) d’une « analyse d’une langue objet par une langue instrument<br />
d’un autre système, non homonyme ». Cette non-homonymie, caractérisant tour à tour les<br />
langues ‘instruments’ par rapport aux langues ‘objets’ de la description, n’est qu’un autre<br />
nom pour ce qu’on a appelé, suivant ZGUSTA, anisomorphisme.<br />
Par conséquent, il n’y a pas une même chose à dire 100 . L’objet de la description est le lexique ;<br />
le paradoxe est qu’il faut décrire ce lexique en mettant en œuvre des équivalences dans un<br />
système autre, qui envisage le découpage de la réalité extralinguistique de façon différente et<br />
originale. La citation suivante est très significative, à notre sens :<br />
Les unités linguistiques du dictionnaire bilingue sont à la fois des déclencheurs dans une<br />
langue, c’est-à-dire des unités de communication qui mettent en branle à la fois une<br />
conceptualisation spécifique, un contenu sémantique et par conséquent une référence à<br />
l’émetteur et à son environnement, et en même temps renvoient à des unités linguistiques<br />
dans une autre langue qui, à leur tour, déclenchent, en principe, une autre conceptualisation<br />
spécifique, un même contenu sémantique et un même référent, mais dans un autre univers et<br />
dans une autre langue pour un autre émetteur! (CLAS-ROBERTS 2003 : 238).<br />
Ces réflexions sont utiles, à notre avis, pour se détacher d’une représentation naïve de<br />
l’équivalence lexicale, où à un même concept correspondrait un ‘terme’ différent dans une<br />
autre langue. Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents que les concepts sont, tout<br />
d’abord, élaborés idiosyncratiquement dans les deux langues ; en plus, les deux<br />
communautés linguistiques, influencées par leurs univers socio-culturels, envisagent ces<br />
concepts de façon unique, singulière.<br />
D’un point de vue strictement linguistique, faut-il ajouter, l’équivalence est un objectif sur<br />
lequel pèsent lourd trois facteurs fondamentaux, strictement imbriqués entre eux :<br />
99 Il faudra, toutefois, être en éveil contre « ce (possible) danger de la proximité franco-italienne »<br />
(VEGLIANTE 2003: 351).<br />
100 Cf. ECO (2003).<br />
70
- L’anisomorphisme des langues (cf. ZGUSTA 1984)<br />
- Le problème de la référence (objectale et discursive, BUZON 1979; le Sinn et le<br />
Bedeutung de FREGE 101 )<br />
- L’absence d’un tertium comparationis 102 .<br />
Nous reviendrons plus en détail sur ces problèmes dans les pages suivantes.<br />
Comme nous l’avons évoqué tout à l’heure, l’enjeu primaire de tout DB est l’équivalence.<br />
Mais une équivalence totale, comme le précise DUVAL (1991 : 2823), « exige une adéquation<br />
parfaite entre le réel, tel qu’il est perçu dans les deux cultures, et les mots de la langue qui le<br />
décrivent » 103. Il est donc clair que cet ‘équilibre parfait’ est un optimum, que l’on peut<br />
atteindre dans quelques circonstances optimales, mais pas dans beaucoup d’autres. Tout<br />
d’abord, il y a les cas où la référence (objectale) est absente : il est évident que si la « chose »<br />
est absente, le mot le sera aussi. Ce phénomène concerne surtout les realia, c’est-à-dire des<br />
entités culturellement déterminées et appartenant à des domaines qu’on peut délimiter<br />
traditionnellement (nourriture, habillement, coutumes, folklore, institutions etc.). Une crêpe<br />
reste inchangé en italien, et il en est de même pour un mot comme tiramisu en français, par<br />
exemple. Il s’agit exclusivement de substantifs, dont la catégorie grammaticale, comme le<br />
rappelle KLEIBER (1997 : 19, n. 22) « a une [...] conséquence référentielle [...] fonctionnelle :<br />
il s’agit de la forme que doit revêtir une entité pour devenir objet de référence ».<br />
Et si la chose est présente (quoique souvent de façon plus dissimulée) et le mot est absent ?<br />
On parlera alors d’écart sémantique : c’est au niveau de la structuration du sens que l’écart<br />
se produit. On aura une langue qui a choisi un lexème, ou « minimal sign » (BRINK 1971)<br />
pour ‘encapsuler’ le concept, et une autre qui devra recourir à une périphrase. La<br />
périphrase, comme son nom l’indique, ‘tourne autour’ de la chose, ne la saisit que par un<br />
détour. Au niveau rhétorique, il est évident que cela comporte une dilution du sens, une<br />
sorte d’affadissement. Un lexème (ou un mot, si on sort de la terminologie du domaine) se<br />
cristallise mieux dans la conscience des locuteurs (pour des raisons d’économie expressive,<br />
évidemment) et devient susceptible de se charger de valeurs ajoutées, ou connotatives,<br />
beaucoup mieux qu’une suite de mots. On aura ainsi un concept comme le campanilismo, ou<br />
esprit de clocher, en italien, qui nous fait remonter à l’époque des Communes, aux rivalités<br />
entre les différentes cités de ce pays aux « mille clochers » qu’est l’Italie. Quant à la France,<br />
et au français, on pourra évoquer la grandeur, un concept qui souvent ne peut pas être rendu<br />
en italien par son équivalent « classique », c’est-à-dire grandezza. Ce n’est pas un hasard,<br />
101 Cf. FREGE G., « Senso e denotazione », in BONOMI A. (éd.), La struttura logica del linguaggio, Milan :<br />
Bompiani, 1995, p. 9-32.<br />
102 Cf. KRZESZOWSKI (1984).<br />
103 Ou encore selon LAURIAN (2004: 3): « Une identité de signifiés suppose une identité de contextes de<br />
discours et de contextes extra-linguistiques ». Pour elle (2004: 8) l’écart résulterait également des différences<br />
dans « l’ensemble des savoirs sous-jacents à l’expression ».<br />
71
nous croyons, que l’emploi de l’emprunt grandeur en italien s’est affirmé, surtout dans le<br />
domaine politique.<br />
Pour résumer : nous avons donc deux langues, parlées dans deux communautés<br />
linguistiques parfois géographiquement non homogènes (c’est le cas notamment du<br />
français) et deux réalités qui ne se superposent pas toujours. Admettons toutefois que les<br />
réalités vécues par ces deux groupes de locuteurs coïncident parfaitement : on aura quandmême<br />
un découpage de la réalité idiosyncratique dans chaque langue. Le cas de rivière » vs<br />
fleuve, deux mots désignant des cours d’eau, dont seulement le deuxième se jette à la mer,<br />
est emblématique : en italien en fait on a un seul mot, fiume, pour indiquer ces deux<br />
réalités 104 . Il n’y a pas donc de nécessité qui préside au découpage sémantique, nous l’avons<br />
déjà vu, et cette asymétrie est connue sous le nom d’anisomorphisme. SZENDE (1993 : 74)<br />
pose la question dans les termes suivants : « Il n’y a pas de découpage originel et immuable<br />
de la réalité linguistique qui préexisterait au langage et lui imposerait sa structure. C’est au<br />
contraire le langage qui structure la ‘réalité’, qui est à priori un continuum ».<br />
Abordons ensuite le thème des registres. En français, la richesse du registre familier fait en<br />
sorte qu’il y a plusieurs mots pour dire travail (boulot, taf...), ou dire cigarette (clope, sèche...). Or,<br />
si on veut trouver des équivalents en italien pour ces termes familiers, soit on se trouve<br />
vraiment sans ressources (c’est le cas de boulot et de taf, qui n’ont pas de véritables<br />
équivalents) soit il faut recourir à des variantes régionales (c’est la cas de clope), qui risquent<br />
sérieusement de n’être pas comprises par beaucoup de locuteurs. Nous connaissons des<br />
équivalents pour clope qui fonctionnent à Milan mais pas ailleurs ; una cicca, variante<br />
milanaise standard pour un chewing-gum, serait plutôt compris comme une cigarette à Rome,<br />
par exemple.<br />
Nous pouvons donc affirmer qu’il est souvent impossible de dire ‘objectivement’ qu’un<br />
mot x d’une langue source correspond à y dans une langue cible. La variation diaphasique<br />
et diatopique représente un premier obstacle, comme on l’a vu. Bien entendu, les<br />
lexicographes, lorsqu’ils rédigent leurs dictionnaires, ont des techniques pour pallier à ces<br />
décalages. Les marques métalinguistiques, ou étiquettes (comme fam., région.), comptent<br />
parmi les plus fréquentes. Mais il est évident qu’une langue n’est pas un système algébrique,<br />
et il ne suffit pas d’apparier fam. et lavoro (travail) pour dire la même chose dans une langue<br />
qui n’a pas de terme équivalent à boulot. Il s’agit donc de mettre en œuvre des stratégies<br />
d’approximation, qui marquent une « approche » vers une langue autre, dans le but de<br />
décrire objectivement les équivalences et surtout les non équivalences. Comme l’évoque le titre<br />
d’un article de D. BERNOT (2000), la lexicographie bilingue est bien un « chemin semé<br />
d’embûches ».<br />
104 En suivant une hypothèse ‘culturaliste’, BIDAUD (2003: 67) se demande : « la plus forte densité du réseau<br />
fluvial français peut-elle justifier un découpage plus précis et une ‘richesse’ lexicale majeure ? ». Voici une<br />
question de difficile solution ; nous essaierons de répondre à ce questionnement au cours de la deuxième<br />
partie.<br />
72
Notre question est donc la suivante : est-ce que les DB signalent cette divergence<br />
connotative qui se produit dans des cas pareils ? Est-ce que cette tâche leur reviendrait,<br />
théoriquement ?<br />
Nous croyons que les dictionnaires devraient adopter une approche holistique 105 au sens, qui<br />
essaie de rendre compte, autant que possible, de ce qui se passe au moment de l’insertion<br />
du mot dans le discours, et ce d’autant plus en cas d’écarts connotatifs qui se produisent<br />
entre les deux communautés linguistiques. Des exemples d’auteurs ou des encadrés<br />
encyclopédiques pourraient aider à recontextualiser le mot dans son horizon, qui est aussi<br />
bien diachronique que synchronique, rappelons-le. Cette tendance vers la<br />
recontextualisation, faut-il ajouter, est désormais visible dans plusieurs typologies<br />
d’ouvrages lexicographiques, surtout maintenant que les contraintes d’espace se font moins<br />
lourdes, avec le développement constant des dictionnaires électroniques.<br />
Essayons d’aller plus loin dans notre chemin, et abordons des problèmes d’ordre<br />
épistémologique. Pour qu’il y ait une objectivité, dans le domaine des sciences exactes, il<br />
faut des balises, des repères, des échelles de mesurage. Dans le droit, par contre,<br />
l’interprétation du juge est décisive, mais il y a quand-même des codes, des lois, des recueils<br />
d’arrêts et ainsi de suite. En économie et en statistique (la communication politique nous<br />
l’enseigne), la vulgate affirme que, si on part des mêmes données, on peut tisser des<br />
conclusion fort différentes, selon les paramètres pris en considération, ou d’éventuelles<br />
distorsions dans l’échantillon, plus ou moins involontaires, par exemple : les dimensions<br />
qualitative et quantitative coexistent parfois de façon problématique. Toutefois, nous<br />
insistons, ces données sont toujours là, prêtes à être analysées. En linguistique, et on en<br />
arrive au troisième obstacle dont nous parlions tout à l’heure, on constate l’absence d’un<br />
tertium comparationis, c’est-à-dire d’un élément culturellement « neutre », en relation auquel<br />
les langues donnent des étiquettes différentes à des concepts universaux. Après Babel, ce<br />
moment mythique de cohésion linguistique de l’humanité, se sont multipliés les efforts<br />
pour trouver une langue originelle. Malgré l’échec inévitable, ce mouvement témoigne du<br />
besoin d’un point d’ancrage pour l’étude des significations. Si l’on retraçait une phylogenèse<br />
commune, l’histoire du sens découlerait d’une Ur-Sprache, d’où émaneraient ses<br />
réalisations successives, les langues historico-naturelles. Quoi qu’il en soit, en l’absence de<br />
données certaines pour une reconstruction diachronique des phénomènes sémantiques, les<br />
traducteurs et les lexicographes se retrouvent devant un patchwork mouvant et bariolé, à<br />
l’image des glissements de sens, des écarts, des analogies trompeuses qui se produisent<br />
souvent entre deux langues, même assez proches comme le sont le français et l’italien 106 .<br />
Il est notoire qu’en linguistique les ‘données’ sont de nature fort capricieuse, le choix des<br />
corpus s’avère souvent très problématique et il est malheureusement fréquent de négliger<br />
quelques phénomènes et d’en surestimer d’autres. Compte tenu de ces aléas, nous croyons<br />
que la lexicographie monolingue, soulignons monolingue, possède une dimension<br />
105 GOUWS-STEYN (2005 : 127) parlent d’un « holistic approach to the dictionary ».<br />
106 Cf. VEGLIANTE 2003.<br />
73
véritablement scientifique. Grâce à l’étendue des corpus à disposition, à l’affinement des<br />
techniques lexicographiques et, il ne faut pas oublier, à l’outillage informatique, une<br />
description scientifique du lexique d’une langue donnée est aujourd’hui un objectif<br />
raisonnable.<br />
Si on se tourne du côté de la lexicographie bilingue, la vraie différence consiste dans le<br />
corpus. Lors d’un colloque de 1979, COUSIN (1982 : 257) écrivait : « L’authenticité du<br />
corpus [est un] problème qui se pose de façon particulièrement aigue [sic] pour les<br />
bilingues » ; DEBYSER ajoutait (1981 : 38): « Il est habituel que les ouvrages scientifiques<br />
citent leurs sources et leurs corpus; on s’attendrait à ce que les dictionnaires bilingues en<br />
fassent autant ». Ces problématiques, qui étaient signalées il y a trente ans, n’en sont pas<br />
moins manifestes aujourd’hui 107 . Comme l’écrit BACELAR DO NACIMIENTO (2002 : 40),<br />
dans les dictionnaires parus le plus récemment [... ] on ne voit aucune indice d’une approche<br />
empirique, d’une exploration sémantique des corpus [...]. Cet état de choses est en<br />
contradiction avec les possibilités mises à la disposition des lexicographes, à savoir<br />
l’exploration des grands corpus électroniques (2002: 40).<br />
La constitution d’un corpus bilingue est évidemment possible pour les langues de spécialité<br />
(langues traitant de sous-ensembles lexicaux comme le lexique de la chimie, de l’aérospatiale<br />
etc.), visant à la création de terminologies toujours plus riches et précises. En ce qui<br />
concerne la langue standard, la constitution d’un corpus bilingue est simplement infaisable.<br />
Voilà pourquoi nous avons l’impression que la rédaction du DB relève plus d’un artisanat<br />
que d’une science. En écartant tout jugement axiologique, il faut admettre que le DB garde<br />
une dimension d’auteur que les monolingues ont perdu, au fur et à mesure ; le croisement<br />
de deux langues, avec leur variation interne, une variation sujette elle-même à des<br />
conditions non spéculaires, et de deux cultures, avec des normes fluctuantes et parfois<br />
difficiles à saisir, fait en sorte que cette double (ou mieux quadruple) mobilité fragilise cette<br />
prétention à la scientificité. Lorsque la vérité scientifique fait défaut, pour des raisons<br />
structurelles, oserions-nous dire, il faut se montrer accueillants à l’égard d’autres démarches,<br />
plus proches de l’artisanat, voire de l’art.<br />
Passons maintenant à analyser la deuxième définition d’objectivité. « Absence de partialité, de<br />
préjugés, etc. ». Sans vouloir dresser ici une histoire de la sémantique linguistique, on peut<br />
distinguer deux courants majeurs dans ce domaine : un courant universaliste et un courant<br />
relativiste. Pour les tenants de la première approche, les choses préexistent aux mots, le<br />
monde étant pré-découpé; pour les défenseurs de la deuxième approche, le monde n’existe<br />
qu’en tant que regardé par l’homme (expérience subjective et culturelle du monde). La<br />
langue est vue comme un instrument regardant, permettant l’organisation de la pensée.<br />
Nous ne cacherons pas l’intérêt que nous portons pour une théorie qui mérite d’être<br />
brièvement présentée : il s’agit de l’approche MSN (Métalangue Sémantique Naturelle) d’A.<br />
107 Cf. infra, II.1.4.<br />
74
WIERZBICKA et de quelques collaborateurs (C. GODDARD et B. PEETERS avant tout) 108.<br />
Cette théorie se situe dans le cadre universaliste tout en mettant en valeur les spécificités<br />
culturelles de chaque langue. A travers une soixantaine d’universaux sémantiques<br />
(empiriquement répertoriés dans une grande variété de langues géographiquement et<br />
typologiquement éloignées), il est possible de rendre compte objectivement (voilà le mot-clé)<br />
de quelques scénarios culturels 109 , modèles de pensée et de communication partagés<br />
socialement qui marquent l’appartenance à une communauté linguistique donnée. Voici<br />
donc un modèle sémantique qui donne valeur à la langue comme instrument, véhicule et<br />
dépositaire de contenus culturels, tout en affirmant l’existence d’un ‘noyau dur’ de primitifs<br />
sémantiques, qui garantissent justement la transmission de ces mêmes contenus dans un<br />
langage neutre et véritablement universel.<br />
Nous croyons que ces recherches peuvent s’avérer fructueuses pour ce qui est de la<br />
lexicographie bilingue aussi. L’existence des primitifs sémantiques n’estompe pas la valeur<br />
des différences interlinguales, au contraire elle les met en valeur dans ce qu’il y a de plus<br />
individuel. Les DB devront alors, au fil des entrées, construire un discours basé sur la<br />
différence spécifique. Il faudra en somme éviter que le regard sur l’autre (langue cible) soit<br />
basé sur les coordonnées de la langue source.<br />
Par conséquent, la question devient : est-ce qu’il est possible de dire les mots de l’autre dans<br />
sa propre langue ? Ces propos sont radicaux, évidemment. Mais il faut garder à l’esprit la<br />
typologie textuelle unique du DB, qui présente deux répertoires de mots hors contexte,<br />
donc à la rigueur traduisibles seulement pour ce qui relève de la terminologie, et qui les<br />
remet en contexte artificiellement, de surcroît, grâce aux exemples forgés. Le texte du<br />
dictionnaire est une métaphore filée, qui serait très intéressante à étudier du point de vue<br />
sémiotique aussi. Il n’y a pas de cases vides, dans ce discours tissé autour de l’équivalence et<br />
qui jongle avec ce que la tradition anglaise a appelé foreignization et domestication. On pourrait<br />
traduire ces deux termes, respectivement, par « stratégies d’exotisation / altérisation »<br />
et « traduction acclimatation / transposition culturelle ». Etant donné la nature de<br />
l’ouvrage-dictionnaire (qui est pour la consultation, et non pas pour une lectureconsommation,<br />
certes), on ne saurait que trop insister pour une stratégie qui mette en<br />
valeur l’altérité des signes et qui évite de faire « passer » des équations basées sur une<br />
correspondance simpliste. Un modèle de dictionnaire « acclimatant » pouvait peut-être<br />
s’adapter à une société aux échanges réduits comme celle du passé, mais aujourd’hui, nous<br />
croyons, les usagers sont mûrs pour des ouvrages qui signalent à toute reprise la spécificité<br />
culturelle des mots et de leurs signifiés.<br />
En conclusion, nous plaidons la cause d’un élargissement du modèle du DB : pour être<br />
objectifs, nous le répétons, il faut souligner l’unicité des conceptualisations, des<br />
représentations mentales et des espaces sémantiques, à travers une mise en valeur des<br />
108 Cf. notre article « La sémantique d’Anna Wierzbicka et l’approche MSN », à paraître dans la revue en ligne<br />
Publif@rum, à l’adresse http://publifarum.farum.it.<br />
109 Cf. infra, I.9.2.<br />
75
connotations (une référence à la réalité extralinguistique peut s’avérer indispensable, à ce<br />
propos), des niveaux de langue et de la dimension pragmatique du discours. Dans ce but,<br />
nous croyons qu’il serait utile de faire du DB un outil plus souple, plus accueillant à l’égard<br />
des textes littéraires, par exemple. Un dictionnaire aseptique 110, anonyme et qui ne tienne<br />
pas compte suffisamment des normes communicatives actuelles risque d’être peu utile pour<br />
ceux qui cherchent un support pour dire, écrire et comprendre la différence.<br />
L’objectivité du dictionnaire passe alors inévitablement par la reconnaissance de la<br />
subjectivité des locuteurs, de la collectivité des communautés linguistiques et aussi par<br />
l’universalité de certains contenus sémantiques. C’est à travers ce jeu d’identités partagées<br />
que la langue se construit comme véhicule, forme et miroir, pour passer d’un monde à<br />
l’autre, pour donner corps à nos pensées et pour se regarder dans ce que nous ne sommes<br />
pas.<br />
110 <strong>DEL</strong>ESALLE – BUZON - GIRARDIN (1979 : 57) mettent en garde contre le risque du dictionnaire « de<br />
produire des syntagmes aseptisés ».<br />
76
I.8 L’insaisissable connotation<br />
77<br />
La connotation fonctionne [...] à la façon du mythe,<br />
qui [...] s’empare de l’objet sur lequel il se greffe et le vide de sa substance<br />
KASSAI (1994 : 519)<br />
Nous allons nous pencher à présent sur le concept de connotation. Cette notion entre en jeu<br />
lorsque l’écart ne concerne pas les référents, mais plutôt les jugements de valeur sur lesdits<br />
référents.<br />
Nous essaierons d’établir un cadre théorique où cette notion peut trouver sa place. Puis,<br />
nous avancerons des réflexions sur la dimension sociale de la connotation. Finalement nous<br />
nous poserons la question suivante : dans quelle mesure les dictionnaires doivent-ils rendre<br />
compte de cette dimension ?<br />
I.8.1 La notion de connotation<br />
D’après le dictionnaire de MOUNIN (2004), la connotation concerne<br />
les valeurs affectives d’un signe [...], l’effet non dénotatif qu’il produit sur l’interlocuteur ou le<br />
lecteur [...], ‘tout ce qu’un terme peut évoquer, exciter, impliquer de façon nette ou vague’<br />
(MARTINET) [...]. Avec la connotation, on touche aux domaines de la sociologie et de la<br />
psychologie sociale ou individuelle, et les linguistes se montrent souvent réservés (2004 : 79-<br />
80).<br />
Examinons également la définition de LEHMANN – MARTIN-BERTHET (2008) :<br />
La connotation d’un signe représente les valeurs sémantiques secondes qui viennent se<br />
greffer sur le sens dénotatifs. Dans le domaine du lexique, la connotation recouvre différents<br />
faits : registres de langue [...], contenus affectifs propres à un individu ou à un groupe<br />
d’individus [...], représentations culturelles et idéologiques liées aux contextes d’utilisation de<br />
l’unité lexicale ou en rapport avec les référents (2008 : 36-7).<br />
Cette dernière définition soulève cependant plusieurs ordres de problèmes. Le premier,<br />
c’est que des faits très divers peuvent relever de ce même phénomène, à savoir les registres
de langue 111 , les contenus affectifs, idiolectaux ou de groupe, et les représentations<br />
partagées, à forte valeur pragmatique 112 . Comme le rappelle ZOTTI, « la connotation<br />
s’exprime dans des rapports pragmatiques entre les signes et les utilisateurs » (2007 : 83).<br />
Une autre question-clé concerne la structuration des niveaux de sens et leur hiérarchisation.<br />
Faisons un pas en arrière, essayant de suivre le développement du débat sur la question.<br />
ISACENKO (1972) fait la description de plusieurs niveaux sémantiques à l’intérieur d’un<br />
lexème. Nous avons le « direct meaning (or denotation) » et le « figurative meaning (or<br />
connotation) » (1972 : 86). Les connotations « have to do with values, appreciation, belief<br />
[...]. They develop parasitically as an independent set of signs for which denotations are a<br />
kind of meta-language ; connotations are grafted on the system of denotations, overtly or<br />
cryptically » (ibid.). En analysant les attitudes émotionnelles liées à l’animal chèvre en<br />
allemand et en russe, il extrait des informations sémantiques exclusivement « from linguistic<br />
evidence » (1972 : 82). C’est donc au niveau linguistique, et non extra-linguistique (le<br />
référent étant le même) que, dans ce cas, les connotations se greffent sur les dénotations 113 .<br />
NEUBERT insiste sur le fait que le « lexical meaning is not entirely referential or<br />
conceptual » (1978 : 242). Nous croyons qu’il faut rapporter entièrement les propos de<br />
l’auteur :<br />
Et encore,<br />
The lexicon of a language is a vast reservoir of multi-faceted lexical meanings at the disposal<br />
of a competent speaker. They represent and express what he wants or feels he has to say.<br />
Knowledge and belief, attitudes and volitions, emotions and associations, status and<br />
occupation, evaluations and accentuations, degree of formality and choice of medium, to<br />
enumerate the most striking determiners of the semantic content of a lexeme, combine to<br />
form an intricate pattern (1978 : 242).<br />
What appears to be a complex semantic value turns out precisely to be a configuration of<br />
conceptual (referential), figurative, stylistic, connotative and expressive meaning types which<br />
is, in addition, conditioned by grammatical and collocational means (1978 : 243).<br />
Cette configuration, rendant compte de la complexité du contenu sémantique d’un lexème,<br />
voit au milieu le signifié conceptuel (ou dénotatif, ou encore référentiel), en amont duquel<br />
se trouve toujours un signifié grammatical (appelé « formative basis », et qui est, en fait,<br />
moins un signifié qu’un support formel). Les autres niveaux, notamment les « figurative »<br />
111 Pour LANDAU (2001 : 155) il ne faut pas faire confusion entre les connotations et les niveaux de langue ; cf.<br />
également CIGADA (1988).<br />
112 Cf. GARY-PRIEUR (1994 : 52) : « Les linguistes désignent généralement par ‘connotations’ des éléments de<br />
signification qui s’ajoutent au sens d’une expression linguistique en fonction de relations diverses entre cette<br />
expression et son contexte au sens le plus large du terme ».<br />
113 Cf. GARY-PRIEUR : « les connotations sont fondées sur le signe (signifiant seul ou signifiant et signifié), et<br />
non sur le référent » (1994 : 56)<br />
78
et « connotative meaning » sont additionnels, et tous contribuent à la formation de signifiés<br />
qui sont loin d’être des « neutral tools in the process of reflecting reality » (1978 : 245).<br />
Plus récemment, GEERAERTS (2003) observe que, mis à part le sens dénotatif (denotational<br />
meaning), il y a au moins trois autres typologies non-dénotatives, à savoir le sens émotif, le<br />
sens grammatical et le sens pragmatique. Le premier concerne « the emotional response of<br />
the speaker with regard to the thing being talked about » (2003 : 87) ; d’après les définitions<br />
précédentes, ce sens rentre de plein droit dans la dimension connotative.<br />
JIMENEZ HURTADO (2001) considère qu’une grave erreur<br />
ha consistido en pensar que hay significados primarios y significados secundarios y que no es<br />
necesario reflejar aquellos tipos de significado que no sean centrales para dar cuenta de<br />
forma adeguada del contenido de una unidad léxica (2001 : 32).<br />
Une autre erreur<br />
es que se haya hablado del halo de las palabras, des sus periferías, de su música, de su olor, de su<br />
aureola connotativa, de cierta significación confusa o del conjunto de factores emotivos y subjetivos<br />
dificiles de captar que acompañan a la denotación (2001 : 33).<br />
JIMENEZ HURTADO critique donc les dénominations qui ont accompagnés la<br />
connotation 114 , car elles auraient contribué à marginaliser ce phénomène. Elle considère par<br />
contre qu’une hiérarchisation des sens se basant sur l’axiologie n’est pas tenable : la<br />
connotation doit être réintégrée dans une théorie sémantique car elle est seconde<br />
logiquement à la dénotation, et non pas secondaire par rapport à celle-ci 115 .<br />
Comme le rappelle KRZESZOWSKI (1990 : 135) on a longtemps défini la connotation<br />
comme se référant aux « emotive aspects of meaning ». KRZESZOWSKI cite LYONS 116 , pour<br />
qui il s’agit de « various secondary implications » ; il cite aussi LEECH 117, selon lequel<br />
« connotative meaning is peripheral compared with conceptual meaning » (ibid.).<br />
KRZESZOWSKI affirme ensuite que l’une des assomptions principales de la linguistique<br />
cognitive serait l’effacement de la « distinction between denotation and connotation »<br />
(ibid.). Nous assistons donc à un processus d’intégration, qui dépasse l’opposition<br />
saussurienne linguistique interne vs linguistique externe et qui essaie de rendre compte du sens<br />
(des unités lexicales) sans faire des jugements de valeur entre ce qui est primaire et ce qui<br />
est secondaire. Le sens dénotatif est donc premier logiquement mais ne l’est pas<br />
axiologiquement, pour ce qui est d’une analyse linguistique.<br />
114 Cf. aussi OPITZ (2002 : 261), qui la définit « a less precise, individually or socially determined aura of<br />
associations and significance ».<br />
115 Nous signalons également que JIMENEZ HURTADO offre un panorama intéressant de l’évolution de la<br />
notion de connotation dans le monde germanophone (2001 : 22-29).<br />
116 LYONS J. (1977), Semantics, Cambridge : University Press.<br />
117 LEECH G. (1977), Semantics, Harmondsworth : Penguin Books. Pour cet auteur, cf. aussi MELKA (2003 :<br />
251).<br />
79
Pour ce qui est de l’évaluation du poids connotatif des mots, la thèse de KRZESZOWSKI est<br />
que « all lexical items are assessable on an axiological scale and that the amount of the<br />
axiological load is semantically relevant » (1990 : 138) 118 ; l’opposition ‘bon/mauvais’ serait<br />
le niveau base d’une représentation de valeurs scalaire. L’auteur formule aussi un principe<br />
axiologique, en base auquel « Words have a tendency to be axiologically loaded with ‘good’<br />
or ‘bad’ connotations in proportion to the degree of the human factor associated with<br />
them » (1990 : 150).<br />
Après avoir fait ce petit tour de la question, nous passons à analyser le deuxième point<br />
critique.<br />
I.8.2 Entre l’individuel et le social<br />
Un autre point problématique de la connotation est sa variabilité selon les locuteurs. Selon<br />
GALISSON (1987a : 134 119 ), à la différence du sens dénotatif, la connotation est « tout ce<br />
qui, dans l’emploi d’un mot, n’appartient pas à l’expérience de tous les utilisateurs de ce<br />
mot dans cette langue ». Pour KLEIBER aussi (1997 : 22) le sens connotatif concerne les « traits<br />
non stables, subjectifs et variables selon les contextes ».<br />
D’autres auteurs soulignent par contre la dimension sociale, collective et en définitive<br />
culturelle des connotations :<br />
Selon SABBAN (2007 : 596), « connotations are manifestations of collective attitudes to that<br />
which is denoted ».<br />
Pour LANDAU (2001 : 156), « connotation refers to the whole store of associated attributes<br />
of a word, derived from centuries of use ». C’est donc dans la diachronie qui se<br />
sédimentent ces associations entre des signes et des valeurs ajoutées.<br />
W. MARTIN (2001 : 228) définit la connotation est une « culture specific association ».<br />
D’après ALLAIN (2003 : 104), la connotation concerne « le poids culturel des mots ».<br />
LERAT (1976 : 46) cite GREIMAS 120, pour qui « la connotation [...] est un exemple de passage<br />
d’une référence notionnelle à une référence socio-culturelle ».<br />
Selon M.-L. HONESTE, comme l’a rappelé G. KLEIBER 121, dans les mots il faudrait<br />
considérer seulement les sens connotatifs (les points de vue sur le monde), les traits<br />
118 KASSAI (1994 : 517) se réfère, pour sa part, aux travaux du psychologue OSGOOD pour ‘mesurer’ la<br />
connotation.<br />
119 GALISSON cite ici MOUNIN, Clefs pour la linguistique, Seghers, 1968.<br />
120 A.J. GREIMAS, Du Sens, Paris : Seuil, 1970, p. 309. En réalité, GREIMAS écrit « nous entendons par<br />
connotation le transfert du signifié d’un lieu sémantique (celui où il se placerait d’après le signifiant) en un<br />
autre ».<br />
121 Au cours de la Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris, qui s’est tenue le 17 janvier 2009.<br />
80
dénotatifs devenant finalement secondaires. Le sens d’un mot correspondant à un réseau<br />
abstrait en rapport avec notre expérience « domaniale », il n’y a plus de sens premier ni<br />
dérivé.<br />
La question est cruciale : la connotation a sa place dans une description lexicographique<br />
seulement si une pluralité significative de locuteurs peuvent se reconnaître dans ces valeurs<br />
ajoutées au signe. Autrement, on serait du côté de l’idiolecte, qui ne peut pas aspirer à une<br />
reconnaissance sociale, sous peine d’avoir autant de dictionnaires que de locuteurs.<br />
I.8.3 La connotation en lexicographie<br />
Si nous admettons que la connotation est un phénomène collectif et culturel, quelle peut<br />
être la place pour les données connotatives dans un dictionnaire? PIOTROWSKI affirme que<br />
« there should also be a section dealing with connotations in a dictionary » (1990 : 279).<br />
Malheureusement, les modalités dont il faudrait rendre compte de ces contenus sont loin<br />
d’être claires.<br />
KASSAI (1994) envisage un Dictionnaire des connotations. Il est intéressant d’examiner la<br />
critique que fait OPITZ (2002) à ce projet : il se demande comment « properties of linguistic<br />
signs that do not enjoy universal validity [...] can [...] be gathered and glossed within the<br />
framework of a published dictionary » (2002 : 261). OPITZ affirme qu’il y a une « mistaken<br />
notion of systemic purity » (ibid.), qui tend à marginaliser le phénomène de la connotation ;<br />
pour lui, il ne s’agit pas de « lettres de noblesse » dont la connotation serait dépourvue. La<br />
question-clé est celle de la faisabilité ; le rôle des corpus pour cerner ces valeurs<br />
connotatives s’avérerait en effet très problématique, par exemple.<br />
D’autres auteurs s’opposent à l’insertion des données connotatives dans les dictionnaires.<br />
Par exemple, AYTO (1983 : 96) écrit, de façon assez radicale: « In strictly theoretical terms,<br />
there is lexicographically no such thing as connotation [...]. Unless any connotative aura<br />
that surrounds a word can be isolated out of linguistic analysis and shown to contribute a<br />
discrete denotative sense of that word, it should have no place in a dictionary ». Par<br />
conséquent, « to qualify for dictionary entry according to strict linguistic theory,<br />
connotation must have become denotation » (1983 : 97). On a cependant le droit de se<br />
demander quelle serait cette ‘théorie linguistique stricte’ à laquelle l’auteur se réfère. Encore<br />
une fois, beaucoup dépend du statut de la lexicographie et de ses rapports avec les<br />
différentes théories linguistiques. Si on adopte une approche fonctionnaliste ‘scandinave’ 122,<br />
par exemple, le noyau central seraient les attentes de l’usager et ses besoins communicatifs.<br />
AYTO lui-même doit finalement reconnaître que « rigorous adherence to linguistic theory<br />
does not necessarily always produce the most serviceable dictionary » (1983 : 98).<br />
122 Cf. TARP (2005; 2008).<br />
81
STEINER (1995) constate que « the best bilingual dictionaries are successful in juxtaposing<br />
two linguistic systems but they lack an adequate interface between two cultures » (1995 :<br />
275). Il est nécessaire que les lexicographes informent le public « of the cultural,<br />
philosophic and political background that goes into the connotation of a lexical item »<br />
(1995 : 280). Le problème de la faisabilité se pose évidemment avec une certaine<br />
prégnance : quelles sont les moyens à disposition des lexicographes pour rendre compte de<br />
ce phénomène ? Quelle peut être l’interface dont parle STEINER ? Nous verrons dans la<br />
deuxième partie quelles sont les stratégies mises à l’œuvre par les lexicographes.<br />
Selon BULLON (1990), et d’après ce que IORDANSKAJA – MEL’CUK (1984) écrivent, la<br />
connotation se réfère à ces « associations of a word which a native speaker is aware of, but<br />
which a non-native speaker, i.e. the learner, cannot guess at because these associations are<br />
culture-bound and cannot be conveyed by means of a standard dictionary definition »<br />
(1990 : 27) ; il faut aussi inclure « the extralinguistic connotative features » (1990 : 30). Il est<br />
évident, une microstructure traditionnelle ne permet pas de traiter ces traits ‘connotatifs,<br />
extralinguistiques’. Les lexicographes ont donc dû se tourner vers des modalité alternatives<br />
pour rendre compte de la valeur (non négative) socio-historique des signes ; une solution a<br />
été l’insertion des notes culturelles dans les dictionnaires, dont nous nous occuperons plus<br />
en détail dans la deuxième partie 123 .<br />
Pour résumer, la notion de connotation s’avère assez controversée : le rapport entre sens<br />
dénotatifs et connotatifs ne fait pas l’unanimité, ainsi que la degré de ‘partage’ entre<br />
locuteurs et la pertinence d’une description lexicographique des données connotatives.<br />
Voici sans doute des raisons pourquoi GALISSON définit polémiquement la connotation<br />
comme « une notion fourre-tout » (1987 : 135) ; comme nous le verrons dans le chapitre<br />
suivant, il préfère parler de ‘charge culturelle partagée’.<br />
123 Pour une analyse des notes culturelles, voir infra, II.2.1.<br />
82
I.9 Ressources pour une prise en compte de la culture dans le lexique<br />
Après avoir exploré la notion de connotation, nous abordons maintenant des entités de<br />
nature plus empirique, oserions-nous dire.<br />
L’histoire de la linguistique a vu l’émergence du concept de mot-clé. Essayons de voir quelles<br />
réalités il recouvre.<br />
Dans son ouvrage le plus connu, MATORE affirme que « la lexicologie [...] pourrait<br />
contribuer à faire comprendre, en partant de l’étude des mots, le processus des évolutions<br />
sociales » (1953 : 6). Il distingue ensuite son approche de celle de BRUNOT 124 , qui était<br />
décidément historiciste, non fondée sur la sociologie. Pour MATORE, « le mot-témoin<br />
introduit la notion [...] de poids dans le vocabulaire. Le mot-témoin est le symbole matériel<br />
d’un fait spirituel important ; c’est l’élément à la fois expressif et tangible qui concrétise un<br />
fait de civilisation » (1953 : 65). Par contre, « le mot-clé désignera [...] un être, un sentiment,<br />
une idée, vivants dans la mesure où la société reconnaît en eux son idéal » (1953 : 68). Dans<br />
les ambitions de l’auteur, cette théorisation visait à la fondation d’une nouvelle discipline, la<br />
lexicologie sociale.<br />
Cette notion de mot-clé a vécu une renaissance avec WIERZBICKA : elle les appelle (2006a :<br />
170) « culturellement saillants » (le mot fairness en anglais, par exemple), et elle précise qu’ils<br />
« favorisent dans l’esprit du locuteur certaines façons de penser, mais sans toutefois les<br />
imposer » (ibid.). Voilà qui confirme notre vision du parallélisme évoquée dans le premier<br />
chapitre : la langue, notamment le lexique à travers quelques mot-clés, n’impose pas de<br />
visions du monde, mais en privilégie certaines, culturellement fonctionnelles, ajoutonsnous.<br />
WIERZBICKA en est bien consciente : « La langue utilisée au sein d’une communauté<br />
ne détermine jamais les façons de penser de ceux qui la parlent ».<br />
PEETERS (2003: 130) a repris et a précisé les tenants et aboutissants de cette notion : « Pour<br />
nous, il y a des mots clés dans toutes les langues du monde ; il s’agit simplement de mots<br />
culturellement plus ‘chargés’ que d’autres, de mots qui assument pour ainsi dire ‘more than<br />
their share of cultural work’ 125 ». Plus loin, Peeters s’arrête sur les critères existants pour<br />
identifier ces mots particulièrement révélateurs d’une culture donnée.<br />
Tout en insistant sur le fait qu’il n’existe pas de stratégie objective permettant d’identifier les<br />
mots clés d’une langue, et qu’il n’y a pas de nombre prédéterminé de mots clés, Anna<br />
Wierzbicka fournit quand même quelques critères qui paraissent prometteurs. Il y a tout<br />
d’abord le critère de la fréquence, soit au niveau du vocabulaire dans son ensemble, soit à<br />
124 Les mots témoins de l’histoire, Paris, Institut de France, 1928.<br />
125 PEETERS cite JAY M. (1998), Cultural semantics. Keywords of our time, Amherst, University of Massachussets<br />
Press, p. 4.<br />
83
celui d’un domaine plus restreint. Il paraît intuitivement correct de dire qu’un mot clé est<br />
relativement commun ; la marginalité, loin de contribuer à l’éclat d’un mot, est plus propre à<br />
le repousser à l’ombre. Ensuite, il y a le rôle joué dans les expressions idiomatiques : les mots<br />
clés sont souvent au cœur d’une panoplie de tournures toutes faites. En outre, ils se<br />
retrouvent probablement avec une certaine régularité dans les proverbes d’une langue, dans<br />
ses aphorismes, dans les paroles de chansons, les titres d’ouvrages, etc. Par ailleurs, l’emprunt<br />
direct dans d’autres langues, sans recours à la traduction, est un critère non relevé par<br />
Wierzbicka, mais qui semble avoir une certaine validité. » (2003 : 131).<br />
La fréquence, la non traduisibilité et la présence dans les expressions idiomatiques ou dans<br />
quelques textes ‘culturels’ sont donc des critères possibles pour l’identification de ces motsclés.<br />
Nous verrons dans la deuxième partie de cette thèse comment ces facteurs seront mis<br />
à l’épreuve par l’analyse de notre corpus.<br />
I.9.1 Les apports de Robert Galisson et son héritage<br />
Passons maintenant à une autre tradition de recherche, inaugurée par R. GALISSON.<br />
GALISSON a offert, au fil des années, de nombreux apports à une théorie de la lexiculture,<br />
dont le pivot pragmatique est représenté par les mots à charge culturelle partagée. Dans le but<br />
de traquer le lexique dans la culture, tout mot pourrait être approprié, à son avis : en<br />
paraphrasant ORWELL, il croit que « tous les mots sont culturels, mais [...] certains sont plus<br />
culturels que d’autres » (1987a : 129) 126 . Toutefois, il y a des mots qui ont cristallisé autour<br />
d’eux un réseau de sens ultérieurs qui les rend tout à fait aptes à véhiculer des signifiés<br />
‘seconds’, opaques pour l’apprenant d’une langue étrangère et donc éminemment culturels.<br />
La notion de charge culturelle partagée « rend compte de la consubstantialité du lexique et<br />
de la culture, désignant la valeur (culturelle) ajoutée au signifié du signe, aux mots par<br />
l’usage, spécifique à chaque langue » (GUILLEN DIAZ 2003 : 43). Elle « relève du domaine<br />
de la pragmatique (et de l’anthropologie culturelle) parce qu’elle est le produit de la relation<br />
qu’entretient le signe avec ses utilisateurs » (GALISSON 1987a : 137).<br />
Dans un article-manifeste, GALISSON affirme :<br />
Pour accéder à la culture, quelle qu’elle soit, le meilleur truchement est le langage, parce qu’il<br />
est à la fois véhicule, produit et producteur de toutes les cultures [...]. C’est en tant que<br />
pratique sociale et produit socio-historique que la langue est toute pénétrée de culture<br />
(1987a : 127).<br />
126 Cf. aussi YANCHUN – JIANHUA (2004 : 181), « ‘culturally loaded word’ is a misnomer because all words are<br />
culturally loaded ».<br />
84
Les mots seront donc envisagés, dans cette approche, comme des « réceptacles<br />
préconstruits, donc stables et économiques d’emploi [...], lieux de pénétration privilégiés<br />
pour certains contenus de culture qui s’y déposent, finissent par y adhérer, et ajoutent ainsi<br />
une autre dimension à la dimension sémantique ordinaire des signes » (1987a : 128). Ces<br />
considérations rejoignent en quelque sorte celle que nous avons avancées dans le chapitre<br />
I.4, lorsque nous avons parlé des signes minimaux.<br />
Lorsque GALISSON parle de culturel, il oppose (1994) la culture existentielle (appelée aussi<br />
« anthropologique » 127 ), la culture du quotidien, à la culture cultivée, savante ; dans son<br />
optique didactologique, il considère qu’il faut donner sans aucun doute la priorité à la<br />
première.<br />
Selon GALISSON, « la notion d’interculturel mobilise sciemment la culture maternelle, pour<br />
enseigner/apprendre la culture étrangère » (1994 : 18). Il prône donc un « paradigme<br />
indirect (souple) », qui reconnaisse « l’importance de la langue-culture-source dans l’accès à<br />
la langue-culture-cible » (1994 : 19). Ces réflexions nous paraissent très pertinentes pour<br />
notre sujet de recherche : il est dans doute possible de dresser une comparaison entre ce<br />
paradigme, fondé sur l’interconnexion de la langue-culture source et la langue-culture cible<br />
et la lexicographie bilingue qui, telle que nous l’envisageons, doit contribuer à bâtir un<br />
« pont interculturel » 128 entre les deux langues-cultures mises en présence.<br />
Dans sa démarche, GALISSON considérait « le dictionnaire comme le moyen le plus<br />
approprié pour décrire et pénétrer la culture partagée » (1987a : 129). Il s’agissait, dans ses<br />
vœux, du dictionnaire monolingue, mais rien ne nous empêche d’élargir ses considérations<br />
aux DB aussi.<br />
GALISSON a ensuite élaboré le concept de lexiculture, définie comme « la culture en dépôt<br />
dans ou sous certains mots, dits culturels, qu’il convient de repérer, d’expliciter et<br />
d’interpréter » (GALISSON 1999 : 480), par laquelle il est possible de « piéger la culture dans<br />
la langue » (GALISSON 1994 : 25).<br />
Les échos de ces recherches sont encore très forts aujourd’hui, si l’on croit à un numéro<br />
récent des Etudes de linguistique appliquée 129 qui s’intitule explicitement « Voix et voies de la<br />
lexiculture en lexicographie ». J. PRUVOST, qui a coordonné le volume, affirme d’emblée, à<br />
propos des définitions 130 dans les dictionnaires : « Si elles ne sont pas relayées par un<br />
discours ‘culturel’, qui intègre la diversité humaine, donc ‘interculturel’, un discours<br />
‘lexiculturel’ qui rappelle que la communauté partage l’essentiel dans l’implicite, ces<br />
définitions conventionnelles font en réalité écran aux voix multiples qui se cachent derrière<br />
les mots » (2009a : 133). Sans une prise en compte de la charge culturelle partagée, « on ne situe<br />
127 DUFAYS (1997: 317).<br />
128 L’expression est de A. REY (2007).<br />
129 Vol. 154, avril-juin 2009.<br />
130 Nous sommes donc dans une optique monolingue.<br />
85
lexicalement dans la fausse apparence et en définitive dans la méprise sémantique » (2009 :<br />
134).<br />
A. FARINA (2009 : 261) affirme que de nos jours « tout le monde semble convaincu<br />
qu’apprendre une langue, c’est aussi apprendre la ‘charge culturelle’ véhiculée par ses<br />
mots », mais elle regrette que les DB soient « peu disposés à aller au-delà du sens des mots<br />
et de leur illustration, pour dévoiler des habitudes linguistiques intimement reliées à la vie<br />
de notre langue ». Les DB souffriraient donc d’un excès de conservatisme dans leur<br />
conception et élaboration, qui les empêcheraient de saisir la dimension culturelle et<br />
pragmatique des unités lexicales.<br />
A propos de ces deux dimensions, l’analyse que A. FARINA (2008 ; 2009) fait des<br />
pragmatèmes 131 est tout particulièrement intéressante. Il s’agit de mots ou expressions dont<br />
le « sens ou celui de leurs composants lexicaux est secondaire par rapport à la situation de<br />
communication dans laquelle ils sont généralement prononcées » (2009 : 249). L’auteure<br />
fait l’exemple de mots comme halte, bravo ou pardon. FARINA analyse trois cas de figure,<br />
notamment la correspondance exacte français-italien (au niveau connotatif, syntaxique et<br />
énonciatif), la correspondance approximative (dont l’un des niveaux n’est pas pris en<br />
compte) et l’absence de correspondance. Dans ce dernier cas,<br />
il peut arriver qu’un pragmatème n’ait pas de traduction possible dans l’autre langue. Soit<br />
que celui-ci corresponde à une pratique socio-culturelle qui n’existe pas dans l’autre pays<br />
soit que cette pratique socio-culturelle ne comporte pas un ‘passage à l’acte linguistique’<br />
dans l’un ou l’autre des pays considérés [...]. Les cultures française et italienne étant<br />
relativement proches, il est assez difficile de trouver des exemples à ce genre de problèmes<br />
de traduction (A. FARINA 2009 : 259).<br />
Les exemples proposés concernent les interjections Belote ! Rebelote ! pour le français et<br />
Scopa ! pour l’italien : ces expressions renvoient en effet à des jeux de cartes qui n’ont pas<br />
d’équivalents dans la langue-culture cible ; nous ne sommes donc pas loin des écarts<br />
référentiels, tels que nous les avons définis dans le chapitre I.4.<br />
I.9.2 Les scénarios culturels<br />
Examinons maintenant une autre approche aux valeurs culturelles dans la langue. Au sein<br />
de la Métalangue Sémantique Naturelle (MSN) 132 , les scénarios culturels peuvent être définis<br />
comme des modèles de pensée et de communication partagés socialement qui marquent<br />
l’appartenance à une communauté linguistique donnée.<br />
131 Le terme est de MEL’CUK, in SZENDE (éd.) 2003: 21-23.<br />
132 Parmi les textes les plus récents issus de ce paradigme de recherche, nous signalons GODDARD C. –<br />
WIERZBICKA A. (2006) ; WIERZBICKA (2006b) ; PEETERS (2008).<br />
86
Voici un exemple : la valeur française de l’engagement, telle qu’elle est reflétée dans la<br />
langue (PEETERS, en préparation 133 ).<br />
les gens pensent comme ça :<br />
c’est bien si les gens disent ce qu’ils pensent être vrai<br />
à cause de cela, je dis ce que je pense être vrai<br />
quand je fais cela, je veux que les gens sachent ce que je sens<br />
si je ne fais pas cela, les gens penseront du mal de moi.<br />
« L’ensemble de ces scénarios culturels », écrit l’auteur, « constituent ce qu’on appelle de<br />
plus en plus souvent une doxa, c’est-à-dire un fonds commun de croyances où tous les<br />
ressortissants d’une langue-culture peuvent puiser » (PEETERS : à paraître-a).<br />
Les scénarios culturels peuvent donc contribuer à identifier des attitudes culturellement<br />
élaborées, des normes et des présupposés 134 . L’imbrication entre scénarios culturels et styles<br />
conversationnels est très nette : c’est aussi grâce aussi au scénario culturel de l’engagement,<br />
que PEETERS peut écrire que « le style conversationnel français s’oppose souvent au style<br />
conversationnel anglais dans la mesure où celui-ci est plus indirect, plus prudent, plus<br />
diplomatique » (2002 : 89).<br />
Pour PEETERS 135, les scénarios culturels sont des intuitions explicitées au niveau culturel, alors<br />
que la culture est définie comme une conglomération de façons de penser. L’approche de la<br />
MSN, dans les vœux de PEETERS, devrait amener naturellement vers l’ethnolinguistique. A<br />
côté de ce paradigme, devraient surgir l’ethnopragmatique, l’ethnophraséologie,<br />
l’ethnosémantique, l’ethnosyntaxe et l’ethnoaxiologie, dans le but de rendre compte des<br />
traits culturels dans toutes les composantes de la langue.<br />
A l’intérieur du paradigme MSN, une vaste recherche interculturelle s’est ainsi mise en<br />
place. L’outil MSN, selon PEETERS et WIERZBICKA s’avère indispensable dans l’étude des<br />
contenus culturels, qui ne pourront être transmis qu’à l’aide d’un métalangage neutre et<br />
universel, qui évite toute distorsion ethnocentrique dans la descriptions des concepts.<br />
En conclusion, WIERZBICKA souligne que<br />
l’approche MSN [...] dispose d’un outil qui lui permet de procéder à la description et à<br />
l’explication effectives du sens au-delà des frontières linguistiques et culturelles, description<br />
et explication dont la linguistique appliquée, y compris la lexicographie bilingue,<br />
133 Communication personnelle de l’auteur.<br />
134 Cf. PAVEAU (2006).<br />
135 Au cours de la Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris, le 17 janvier 2009 (à paraître-b).<br />
87
l’enseignement des langues et la communication transculturelle, ne sauraient se passer<br />
(2006a : 159).<br />
L’approche MSN, qui était née comme une réflexion de matrice structuraliste 136 , s’ouvre<br />
donc à des questionnements plus variés, qui visent notamment à l’analyse des corrélations<br />
entre les ‘faits de langue’ et les ‘faits de culture’.<br />
I.9.3 L’épaisseur du langage<br />
La dernière contribution dont nous faisons état est celle de S. ROBERT (2003 ; 2008).<br />
Les connotations (un thème que nous avons étudié dans le chapitre précédent) servent à<br />
signaler « a social role (which can be momentary) played by the speaker, or the speaker’s<br />
belonging to a specific social group » (2008 : 72). Les connotations contribueraient donc à<br />
situer la position de l’interlocuteur à l’intérieur d’un échange langagier, ou, sur un échelle<br />
plus vaste, dans un sociolecte donné.<br />
La nouveauté de l’ apport de ROBERT consiste dans sa vision des unités linguistiques. Se<br />
rattachant à la frame semantics de FILLMORE 137 , elle affirme que<br />
linguistic units [...] are linked to semantic universes, to representational backdrops which<br />
contribute to the value of a term’s meaning and which themselves can be highly structured<br />
[...]. These extralinguistic factors have an impact, either direct or indirect, on the semantics of<br />
the terms (ROBERT 2008 : 70).<br />
L’extralinguistique agit donc sur la sémantique des mots, car ces derniers se rattachent à des<br />
‘scénarios’ qui sont « culture-dependent » (2008 : 71), motivés culturellement.<br />
Afin de cerner le sens des unités lexicales, une nouvelle approche se rend nécessaire. A cet<br />
effet, ROBERT forge la notion d’épaisseur du langage, qui se pose au-delà des dimensions<br />
syntagmatiques et paradigmatiques ; c’est le seul niveau d’analyse capable de rendre compte<br />
du fait que « the linguistic units trigger representations which are caught up in a complex<br />
network of relations, at once language internal and external, semantic and formal » (2008 :<br />
73). Cette investigation sur les relations qui articulent les unités linguistiques à l’univers<br />
extralinguistique représente sans aucun doute une contribution de taille à l’étude du sens.<br />
Les réflexions de ROBERT convergent, à notre sens, avec celles de GALISSON sur la<br />
dimension holistique de la sémantique lexicale.<br />
136 Cf. LARRIVEE (2008 : 75-78).<br />
137 Cf. infra, I.6.<br />
88
Dans un autre article (2003 : 263-264) ROBERT définit les mots comme<br />
des ‘déclencheurs de représentations’ qui rentrent dans un réseau complexe de relations<br />
présentant des propriétés structurelles et fonctionnelles spécifiques [...]. Cet ensemble de<br />
relations entre les représentations associées aux mots constitue un tissu représentationnel<br />
complexe qui est à l’interface entre le langage, la pensée et l’expérience ; c’est un lieu où le<br />
linguistique s’articule à du non-linguistique et que j’ai appelé l’‘épaisseur du langage’ [...]. Cet<br />
arrière-plan représentationnel peut être extrêmement riche et comporter des points de vue<br />
ou même de véritables scénarios renvoyant à des pratiques culturelles variées (2003 : 263-<br />
265).<br />
Le paradigme à l’intérieur duquel s’enchaînent les réflexions de ROBERT est, nous le<br />
rappelons, celui de l’énonciation. Nous croyons toutefois que la notion d’épaisseur du<br />
langage (ROBERT 2003 : 264) peut être opératoire aussi bien dans le cadre de notre<br />
recherche. Le discours lexicographique est peut-être ce qu’il y a de plus distant de la réalité<br />
de l’énonciation (de par sa visée d’impersonnalité, de neutralité, voire d’universalité) ; le<br />
sujet producteur de sens est collectif et son but, dans le cadre des DB, est de systématiser<br />
des équivalences au niveau des lexèmes. Malgré cela, nous croyons que la prise en compte<br />
de l’épaisseur du langage est indispensable par les lexicographes, pour qu’ils puissent<br />
essayer de rendre, autant que possible, la densité du sens (à travers une microstructure riche<br />
et variée, notamment) et par le public, pour qu’il puisse avoir du recul sur ses productions<br />
et ses interprétations, et comprendre la puissance évocatrice du langage.<br />
Le lexique est défini par ROBERT (2008) comme la partie de la langue la plus proche de<br />
l’extralinguistique, d’où découle sa plasticité (dont témoignent la polysémie, la<br />
polyréférence, etc.) et la difficulté d’une description statique, que le dictionnaire pourtant<br />
aurait tendance à fournir. Les sens des mots étant ancrés à des scénarios motivés<br />
culturellement, une approche lexicographique plus souple se rend alors nécessaire, dans le<br />
but de restituer la signification des unités sans les décrocher de leur « arrière-plan<br />
représentationnel » (ROBERT 2003 : 265). Dans la deuxième partie de notre thèse, nous<br />
tâcherons d’étudier quelle solutions les dictionnaires adoptent pour rendre compte de cette<br />
épaisseur du langage.<br />
89
DEUXIÈME PARTIE<br />
ANALYSE DU CORPUS<br />
91
II.0 Présentation du corpus<br />
Notre corpus se compose des quatre dictionnaires bilingues généraux italien-français grand<br />
format dans le commerce aujourd’hui en Italie.<br />
Il Boch. Dizionario Francese-Italiano, Italiano-Francese 138 , Bologna-Paris, Zanichelli-Le Robert,<br />
2007 (dorénavant: B), 2280 pages + 32 planches en couleur hors texte. La première édition<br />
du dictionnaire remonte à 1978.<br />
Il Nuovo Dizionario Garzanti di Francese, Novara, De Agostini. 2006 (dorénavant: G), 2560<br />
pages + 94 planches en couleur hors texte. La première édition du dictionnaire remonte à<br />
1966.<br />
Il Nuovo Hachette-Paravia. Il dizionario francese-italiano, italiano-francese, Torino, Paravia, 2007<br />
(dorénavant: HP), 2286 pages. La première édition du dictionnaire remonte à 1999.<br />
Il Larousse Francese. I dizionari Sansoni, Milan, Sansoni Larousse, 2006 (dorénavant: SL), 2624<br />
pages. Il s’agit d’un « ouvrage totalement inédit », ainsi que l’on peut lire dans la préface.<br />
Nous avons surtout travaillé sur les cd-rom des dictionnaires, après en avoir vérifié la<br />
conformité avec le dictionnaire papier.<br />
138 Ce dictionnaire est un dictionnaire d’auteur, car il découle de l’œuvre de Raoul Boch, cf. BOCH (1989).<br />
92
II.1 Analyse longitudinale<br />
Notre hypothèse de départ est la suivante. Dans les mots de CELOTTI (2002 : 464), « le<br />
dictionnaire bilingue, traditionnellement présenté comme un dictionnaire de langue, appelé<br />
à donner des équivalents et non pas à ‘renseigner sur le monde’, se révèle aujourd’hui dans<br />
sa phase de transformation comme un outil de réflexion sur la culture ».<br />
Quelle réflexion sur la culture est-il possible de mener à travers une étude des DB ? Quels<br />
phénomènes faudra-t-il prendre en compte ? Ainsi que l’affirme PRUVOST (2002 : 142),<br />
« élaborer un dictionnaire bilingue, c’est mettre en relation deux cultures et prendre<br />
conscience à chaque instant des écarts culturels qui se glissent dans tous les domaines, dans<br />
tous les vocabulaires, dans tous les réseaux sémantiques ». Le DB serait donc un texte<br />
privilégié pour le repérage des traits culturels présents dans le lexique. Notamment, les<br />
écarts seraient les ‘lieux textuels’ où les décalages entre cultures apparaissent avec plus de<br />
visibilité. Dans les sections suivantes nous essaierons de vérifier cette hypothèse.<br />
GALISSON faisait remarquer que tout est culturel dans le lexique et que certains éléments<br />
possèdent une ‘charge culturelle’ plus grande que d’autres 139 .<br />
TOMASZCZYCK (1983 : 43) aussi considère que<br />
most of the vocabulary is ‘culture-specific’ : language, above all through its lexicon, reflects<br />
the particular and always unique way of life of its speakers. While there are degrees of<br />
culture-specificity, some items being more culture-bound than others, there appears to be<br />
very little in the vocabularies of different languages that is truly universal.<br />
C’est pour cette raison que nous avons cru opportun d’élargir notre analyse à tous les<br />
domaines du lexique et de ne pas la limiter aux écarts référentiels 140 . Les propos de CALVI<br />
(2006 : 83-84) résument très bien ce point : un DB<br />
mette a confronto non solo due sistemi linguistici ma anche due modi diversi di vedere il<br />
mondo ; operazione particolarmente delicata nel caso dei termini culturali, intesi sia come<br />
vocaboli privi di equivalenti in altre lingue (i cosiddetti realia), sia come accezioni specifiche di<br />
parole comuni, che rimandano a referenti propri di un determinato orizzonte culturale,<br />
nonché al patrimonio condiviso di conoscenze interiorizzate dai parlanti nativi.<br />
Etant donné ces prémisses, comment peut-on saisir la culture dans les DB ? A notre avis, un<br />
étagement à plusieurs niveaux se rend nécessaire.<br />
139 Cf. infra, I.9.<br />
140 Cf. infra, I.4.<br />
93
Le premier niveau est sans aucun doute celui de l’architecture sémantique, qui est à<br />
l’origine des écarts entre les deux langues mises en présence (L1 italien, L2 français ou<br />
viceversa, selon les directions concernées). La structuration du lexique répond à des<br />
découpages différents, en particulier la langue-source peut choisir un ‘signe minimal’ pour<br />
indiquer un concept, alors que la langue-source en utilise plusieurs. Cela n’est pas sans avoir<br />
des conséquences sur le plan expressif 141 . Comme le note BRINK (1971), dans l’usage des<br />
locuteurs, les monolexèmes ont une fréquence d’emploi plus élevée par rapport à leurs<br />
équivalents dans la langue-cible (L2) 142 .<br />
Prenons le cas du mot italien afa. Les dictionnaires de notre corpus le traduisent ainsi :<br />
- chaleur étouffante, chaleur accablante [B]<br />
- chaleur étouffante, chaleur accablante [G]<br />
- chaleur étouffante [HP]<br />
- chaleur étouffante, chaleur accablante [SL]<br />
Afa et chaleur étouffante dénotent le même concept, sans aucun doute, mais la cristallisation<br />
du sens que nous avons dans le lexème afa est diluée dans le syntagme adjectival qui le<br />
traduit en français.<br />
D’autre part, SNELL-HORNBY (1990b : 209-210) souligne une « misguided but deep-seated<br />
view of interlingual equivalence [...]: a word in one language must necessarily be lexicalized<br />
to fulfill the same function in another language ». L’auteur se situe dans une optique<br />
fonctionnaliste du langage, que nous partageons non sans quelques réserves. Il est vrai que,<br />
dans l’exemple proposé, afa et chaleur étouffante remplissent la même fonction (le même acte<br />
de référence), quoique la première unité lexicale soit un monolexème et la seconde un<br />
syntagme (ou polilexème). Il n’en reste pas moins que, au niveau cognitif, les monolexèmes<br />
permettent ce que DAGUT (1981 : 62) appelait « the symbolic function of encapsulating »,<br />
et rendent possible une mémorisation, puis une activation du terme (et du concept, par<br />
conséquent) beaucoup plus rapide ; en outre, les associations de type connotatif se font<br />
mieux avec un support monolexical, qui permet un greffage beaucoup plus efficace et<br />
stable : comme nous l’avons vu dans la première partie, la connotation agit au niveau du<br />
sémantisme de l’unité (lexicale) : si l’unité se divise en deux (ou plusieurs) composants,<br />
comme dans le syntagme, le point de greffage du signifié de connotation 143 se dérobe. En<br />
définitive, une équivalence fonctionnelle n’exclut pas que d’autres valeurs (cognitives,<br />
connotatives et en dernier ressort culturelles) y soient en quelque sorte effacées.<br />
141 BRINK (1971 : 68): « What in one language is described by one m-sign [‘minimal sign’, ou monolexème],<br />
requires one, two, three or maybe twenty-five m-signs in order to be described in another language. I believe<br />
that this has a psycholinguistic significance which can hardly be exaggerated ».<br />
142 « Most meanings which in one language are symbolized by one sign, but in another by more, are as a<br />
matter of fact used (referred to) much more frequently in the former than in the latter » (BRINK 1971 : 68).<br />
143 Cf. KERBRAT-ORECCHIONI (1977).<br />
94
Après une classification des écarts (II.1.1), nous nous poserons la question de savoir si<br />
certains de ces écarts, que nous appellerons sémantiques, montrent une valeur culturelle<br />
particulière (II.1.2).<br />
Le deuxième niveau concerne par contre le rapport des signes avec le monde, en particulier<br />
avec l’univers extralinguistique qui est propre aux deux langues-cultures.<br />
Ainsi, dans II.1.3 nous nous occuperons d’autres phénomènes relevant de l’équivalence et<br />
qui recèlent une spécificité culturelle, notamment les realia, les traits encyclopédiques, les<br />
connotations, les euphémismes, les ‘associations culturelles’, les noms déposés et la<br />
dimension pragmatique 144 .<br />
Le troisième niveau où la culture peut être appréhendée dans les DB est celui du discours<br />
du lexicographe, qui est censé refléter les valeurs partagées dans la langue-culture 1 et 2.<br />
Dans la section II.1.4, nous menerons une analyse des exemples à fonction culturelle, dans<br />
le but de repérer ce que LAURIAN (2004 : 8) appelle « l’ensemble des savoirs sous-jacents à<br />
l’expression ».<br />
Ces trois niveaux (l’architecture sémantique, l’extralinguistique et le discours du<br />
lexicographe) se chevauchent et contribuent à faire émerger la complexité de la dimension<br />
interculturelle dans les DB.<br />
Dans cette partie, nous essaierons donc de cerner :<br />
• les traits culturels des écarts<br />
• la culture inscrite dans les mots<br />
• la culture du lexicographe.<br />
Il est évident qu’il y a un certain niveau des superpositions entre ces plans, ce qui est<br />
inévitable si l’on pense que les écarts, la représentation de l’univers extralinguistique et le<br />
discours des lexicographes sont tous fonction d’une langue-culture donnée.<br />
144 Nous n’avons pas pris en considération les proverbes, car leur analyse auraient demandé un chapitre à part.<br />
Pour une typologie du traitement des proverbes en lexicographie bilingue, voir ANTOINE (2000).<br />
95
II.1.1 Analyse de la lettre A dans les deux directions des quatre<br />
dictionnaires du corpus. Examen des typologies d’écarts et tableaux<br />
quantitatifs<br />
La macrostructure<br />
Tout d’abord, évaluons l’extension de la macrostructure prise en examen (correspondant à<br />
la lettre A, rappelons-le).<br />
Boch :<br />
Français-italien : 93 pages (rangées sur trois colonnes), ce qui revient à 8% du total des<br />
pages de ce versant (1158 pages).<br />
Italien-français : 102 pages (rangées sur trois colonnes), ce qui revient à 9,5% du total des<br />
pages de ce versant (1064 pages).<br />
Larousse :<br />
Français-italien : 114 pages (rangées sur trois colonnes), ce qui revient à 8% du total des<br />
pages de ce versant (1412 pages).<br />
Italien-français : 98 pages (rangées sur trois colonnes), ce qui revient à 8,4% du total des<br />
pages de ce versant (1158 pages).<br />
Garzanti :<br />
Français-italien : 96 pages (rangées sur trois colonnes), ce qui revient à 8% du total des<br />
pages de ce versant (1190 pages).<br />
Italien-français : 121 pages (rangées sur trois colonnes), ce qui revient à 9,4% du total des<br />
pages de ce versant (1278 pages).<br />
Hachette-Paravia :<br />
Français-italien : 83 pages (rangées sur deux colonnes), ce qui revient à 7,6% du total des<br />
pages de ce versant (1092 pages).<br />
Italien-français : 94 pages (rangées sur deux colonnes), ce qui revient à 8,7% du total des<br />
pages de ce versant (1073 pages).<br />
96
Les écarts<br />
Nous avons considéré le phénomène de l’écart tout d’abord du point de vue formel, qui est<br />
en fait le seul critère objectif possible. Par conséquent, selon notre approche il y a écart 145<br />
chaque fois qu’une entrée ou une acception est traduite par un nombre de signes<br />
>1. 146<br />
Nous nous sommes centré exclusivement sur les mots-entrées : nous n’avons donc pas pris<br />
en examen les non-équivalences au niveau des expressions figées 147 .<br />
Au point de vue des catégories grammaticales, nous n’avons pas pris en compte les<br />
interjections 148 . Nous avons aussi négligé les conjonctions, les prépositions, les pronoms<br />
indéfinis : ils appartiennent davantage à la grammaire qu’au lexique, puisqu’ils constituent<br />
des séries fermées. Nous avons aussi écarté les sigles car leur statut relève davantage des<br />
dénominations.<br />
Dans les nombreux cas où les dictionnaires proposent plusieurs traduisants, nous avons<br />
considéré l’équivalence comblée (au niveau du signe) lorsqu’au moins l’un des traduisants<br />
est monolexématique.<br />
Nous avons pu dégager cinq catégories d’écarts :<br />
Ecart dictionnairique 149 (ED) : il s’agit d’écarts qui relèvent du choix du lexicographe et<br />
non pas du code. L’écart n’est pas inscrit en langue : d’autres options sont disponibles et<br />
sont présentées par un (des) autre(s) dictionnaire(s). Cet écart n’apparaît qu’à travers un<br />
travail de mise en perspective avec les autres dictionnaires du corpus. L’écart<br />
dictionnairique est en définitive un faux écart.<br />
Ex. archibugiata s.f.<br />
(colpo) coup m. d’arquebuse. [SL]<br />
Il s’agit d’un ED car G traduit :<br />
archibugiata n.m.<br />
arquebusade.<br />
Ou encore :<br />
avocassier agg.<br />
145 SZENDE (1996 : 113) parle plutôt de lacune lexicale, pour indiquer la même notion (« il y a lacune [lexicale]<br />
chaque fois qu’un signe de la langue de départ ne trouve pas d’équivalent dans la langue d’arrivée »). Nous<br />
avons préféré le terme écart car il peut rendre compte davantage de la complexité des phénomènes.<br />
146 Nous allons nuancer cette affirmation pour ce qui est de la catégorie des synthèmes, voir infra, II.1.2.<br />
147 Quelques expressions figées à valeur culturelle sont analysées en II.1.2.<br />
148 Car « ce sont des mots qui sont des phrases » (LEHMANN – MARTIN-BERTHET 2008 : 20).<br />
149 Nous avons bien entendu choisi cette dénomination sur la lancée de la célèbre distinction entre lexicographie<br />
et dictionnairique, suggérée par QUEMADA (1987) qui s’est imposée dès lors dans le discours<br />
métalexicographique.<br />
97
(spreg.) di leguleio. [B]<br />
Il s’agit d’un ED car SL traduit :<br />
avocassier agg.<br />
(spreg.) avvocatesco.<br />
Nous avons considéré les parties de l’équivalent entre guillemets comme facultatives. Dans<br />
le cas suivant, la traduction « embarquement » est suffisante ; elle pourrait cependant être<br />
complétée, le cas échéant, par « (dans un avion) ».<br />
avioimbàrco n.m.<br />
embarquement (dans un avion). [G]<br />
Dans ce dernier cas, donc, aucun écart n’a été relevé.<br />
Ecart sémantique (ES). C’est l’écart par excellence : il rend compte de la structuration du<br />
sens et il permet le greffage de valeurs connotatives de par la condensation du contenu<br />
sémantique; il s’agit d’un concept non lexicalisé en L2 (langue-cible/langue d’arrivée) ; il se<br />
produit lorsque « le concept de LD [lange de départ] semble manquer en LA [langue<br />
d’arrivée], du moins en tant que signifié d’une unité lexicale » (COUSIN 1982 : 272).<br />
Ex. : âgisme s. m.<br />
discriminazione nei confronti degli anziani. [B]<br />
accomunamento s.m.<br />
mise f. en commun. [SL]<br />
Ecart morphologique (EM). Il s’agit d’écarts qui concernent la forme du mot, plutôt que<br />
leur sens. Cette catégorie concerne surtout les cas des substantifs formés sur le participe<br />
présent, traduit par un pronom relatif (qui) + verbe ;<br />
Ex.: abdicataire s. m. e f.<br />
chi abdica. [B]<br />
Ou encore des adverbes de manière :<br />
acrobaticamente avv.<br />
de façon acrobatique. [SL]<br />
Ou bien des adjectifs dérivés tels que :<br />
animabile agg.m./f.<br />
98
qui peut être animé, qui peut s’animer. [SL]<br />
Il s’agit donc de mots dérivés en L1, motivés morphologiquement, dont le concept n’est<br />
pas lexicalisé en L2. L’écart se produit moins par une répartition sémantique différente en<br />
L1 et L2, que par un non-recours de L2 à un affixe, qui serait pourtant disponible parmi les<br />
ressources ‘classiques’ dont L2 dispose et qui pourrait créer des mots théoriques ou<br />
possibles 150 . Finalement, il s’agit de mots dont le sens est prévisible à partir de la forme, à<br />
partir de simples règles dérivationnelles. Autrement dit, leur sens compositionnel est proche<br />
« de ce que les éléments entrant dans sa composition laisseraient entendre »<br />
(SABLAYROLLES 2008 : 25).<br />
Ecart terminologique (ET) : il s’agit d’écarts qui se produisent dans les terminologies<br />
scientifiques, lorsqu’une dénominations synthétique est traduite par une dénomination<br />
analytique.<br />
Ex.: æthuse o éthuse s. f.<br />
(bot.) erba aglina, cicuta aglina. [B]<br />
atabagico s.m.<br />
(Farm) médicament antitabac. [SL]<br />
Ecart référentiel (ER) : ces écarts concernent des référents absents de l’expérience d’une<br />
des deux communautés linguistiques. Cette catégorie est à l’origine de pratiques<br />
traduisantes telles que la glose ou l’emprunt (qui est en fait une non-traduction en toute<br />
connaissance de cause).<br />
Ex. : académisable agg.<br />
che ha buone probabilità di essere eletto all’“Académie Française”. [B]<br />
aber m.<br />
(en Bretagne) = estuario ampio e profondo. [HP]<br />
Il convient d’évoquer brièvement la question du degré de technicité des dictionnaires.<br />
Parfois, les choix arrêtés par les quatre ouvrages analysés diffèrent beaucoup. Par exemple,<br />
G glose presque toujours les adverbes en -ment, alors qu’il existerait un équivalent italien en<br />
-mente 151 . Les choix peuvent se faire sur la base de l’idiomaticité d’un traduisant, les<br />
traduisants moins idiomatiques pouvant être remplacés par des locutions, voire des gloses,<br />
le cas échéant.<br />
150 Cf. LEHMANN – MARTIN-BERTHET (2008 : 29).<br />
151 Cf. annexe I.<br />
99
Une question encore plus épineuse concerne l’existence même de l’équivalent<br />
monolexématique, ou équivalent tout court. Il faut rappeler que les DB de notre corpus<br />
sont destinés au grand public. Il est vrai que, surtout dans B, G et SL, les terminologies<br />
scientifiques sont bien représentées (notamment l’informatique) ; cependant, ces ouvrages<br />
ont été réalisés pour des usagers avertis, non pour des experts. Il se peut que dans quelques<br />
cas les lexicographes aient choisi de fournir un traduisant plus connu mais se composant de<br />
>1 signes, plutôt que de fournir un équivalent plus rare, bien que monolexématique.<br />
Prenons en examen le mot italien astemio. Voici l’entrée de G :<br />
astèmio agg. e n.m. [f. -a] (celui) qui ne boit pas d’alcool: sono astemio, je ne bois jamais<br />
d’alcool.<br />
Le lecteur pourrait conclure qu’il n’y a pas d’équivalent pour ce mot, à en croire à ce<br />
dictionnaire.<br />
Examinons alors la présentation retenue par HP :<br />
astemio<br />
I agg.<br />
abstème, sobre, abstinent<br />
II m. (f. -a)<br />
abstème m. e f.; sono astemio je ne bois jamais d’alcool.<br />
Restons sur la catégorie du substantif. L’équivalent donné (abstème) est bien un mot<br />
français, au contenu sémantique isomorphe à l’italien astemio. Cependant, il y a un décalage<br />
important au niveau des registres : si le mot astemio est courant en italien 152 , il est impossible<br />
d’en dire autant pour le français : PR11 lui attribue la marque Didact., à savoir « mot ou<br />
emploi propre à la langue savante (ouvrages pédagogiques, etc.) et qui n’est pas employé<br />
dans le français standard ». Dans ce cas, notre règle nous imposait de considérer le choix de<br />
G comme un écart dictionnairique, relevant donc de l’ouvrage lui-même et non du code.<br />
Un choix plus sage est celui mis en avant par B :<br />
astemio agg. sost.<br />
1 qui ne boit pas d’alcool: sono astemio, je ne bois pas d’alcool<br />
2 (poco usato) abstème.<br />
Ce dictionnaire présente donc deux acceptions, réparties selon leur fréquence d’emploi.<br />
Après cette introduction, nous amorçons notre analyse des écarts, tels qu’ils sont présents<br />
dans les DB de notre corpus.<br />
152 Il fait partie des mots fondamentaux, d’après la marque de GI.<br />
100
Analyse des écarts<br />
Nous allons tout d’abord présenter les données quantitatives de notre analyse. Pour ce qui<br />
est de la liste des écarts répertoriés, nous renvoyons à l’annexe I.<br />
D’après notre répartition en cinq catégories (nous la rappelons : écarts dictionnairiques<br />
[ED], écarts sémantiques [ES], écarts morphologiques [EM], écarts terminologiques [ET] et<br />
écarts référentiels [ER]), les résultats sont les suivants.<br />
Direction français-italien (lettre A)<br />
BOCH (B) GARZANTI<br />
(G)<br />
101<br />
HACHETTE-<br />
PARAVIA (HP)<br />
ED 102 114 10 44<br />
ES 244 248 90 147<br />
EM 21 9 4 13<br />
ET 57 71 11 28<br />
ER 15 10 8 8<br />
Total 439 452 123 240<br />
SANSONI<br />
LAROUSSE<br />
(SL)<br />
Si nous faisons la somme des écarts recensés, le total indique le nombre d’entrées (ou<br />
acceptions) pour lesquelles les dictionnaires n’ont pas proposé d’équivalent<br />
monolexématique.<br />
Voici par contre les données qui concernent l’extension de la macrostructure.<br />
Français-italien BOCH (B) GARZANTI<br />
(G)<br />
Nombre<br />
d’entrées<br />
(lettre A)<br />
HACHETTE-<br />
PARAVIA (HP)<br />
SANSONI<br />
LAROUSSE<br />
(SL)<br />
5982 153 5564 4114 154 4943 155<br />
153 Il convient de préciser que les sigles aussi font partie de la macrostructure de ce dictionnaire. En outre, les<br />
‘sous-entrées’ sont comptées comme des entrées à part entière. La même chose se vérifie pour les<br />
homonymes (dans tous les dictionnaires du corpus, par contre).<br />
154 Les sigles aussi font partie de la macrostructure.<br />
155 Les sigles aussi font partie de la macrostructure.
Direction italien-français (lettre A)<br />
Les mêmes tableaux ont été réalisés pour la direction italien-français.<br />
BOCH (B) GARZANTI<br />
(G)<br />
102<br />
HACHETTE-<br />
PARAVIA (HP)<br />
ED 246 177 146 288<br />
ES 435 413 288 521<br />
EM 99 83 73 99<br />
ET 157 107 50 135<br />
ER 7 9 9 7<br />
Total 944 789 566 1050<br />
Italien-français BOCH (B) GARZANTI<br />
(G)<br />
Nombre<br />
d’entrées<br />
(lettre A)<br />
HACHETTE-<br />
PARAVIA (HP)<br />
SANSONI<br />
LAROUSSE<br />
(SL)<br />
SANSONI<br />
LAROUSSE<br />
(SL)<br />
7528 156 6339 4549 157 5691 158<br />
156 Précisons que ce chiffre comprend également les variantes orthographiques et les sous-entrées. Ainsi, le<br />
verbe amicare comptera comme trois entrées, vu qu’il présente trois formes (A, B, C).<br />
amicare A v. tr.<br />
gagner l'amitié de<br />
B amicarsi v. tr. pron.: amicarsi q., gagner l'amitié de q.<br />
C amicarsi v. rifl. e rifl. rec.<br />
se lier d'amitié: amicarsi con, a q., se lier d'amitié avec q.<br />
Ce fait se répète pour tous les verbes pronominaux.<br />
157 Les sigles aussi font partie de la macrostructure.<br />
158 Les sigles aussi font partie de la macrostructure.
Au point de vue quantitatif, quelles constatations s’imposent ? Tout d’abord, le nombre des<br />
écarts dans le côté italien-français est nettement plus important que dans la direction<br />
français-italien, dans tous les dictionnaires de notre corpus. Pour G il y a un accroissement<br />
d’environ 75%, pour B de plus de 100% ; dans HP et SL la quantité d’écarts se multiplie<br />
par quatre ou plus, en passant d’une direction à l’autre.<br />
Observons l’importance des nomenclatures. Pour B le cd-rom nous donne 5982 entrées<br />
dans la partie français-italien et 7528 dans la partie italien-français ; ce chiffre n’est<br />
malheureusement pas fiable, car le logiciel présente comme entrées autonomes les variantes<br />
orthographiques et les verbes pronominaux aussi 159 . Nous avons cependant un autre critère,<br />
plus grossier, le nombre de pages, qui passent de 93 (français-italien) à 102 (italienfrançais)<br />
: il s’agit donc d’une augmentation assez modeste (d’environ 10%), qui n’explique<br />
pas à elle seule le redoublement des écarts.<br />
Pour G les entrées (à part entière 160 ) passent de 5564 pour la direction français-italien à<br />
6339 pour la direction italien-français (avec une augmentation de presque 14% donc). HP<br />
passe de 4114 à 4549 entrées (augmentation de 10% environ), alors que SL passe de 4943 à<br />
5691 entrées (augmentation de 15%). Cet accroissement de la macrostructure est donc<br />
moins considérable (et de loin) que l’augmentation des écarts. Il faut donc se tourner vers<br />
d’autres explications.<br />
S’agit-il de la maladresse des lexicographes, qui n’arrivent pas à trouver des équivalents<br />
alors qu’il en existent et que d’autres dictionnaires en proposent ? Examinons le nombre<br />
des écarts dictionnairiques (ED) dans les quatre dictionnaires : B passe de 102 à 246 ; G<br />
de 114 à 177 ; HP de 10 à 146 ; SL de 44 à 288. Il s’agit d’une augmentation non<br />
négligeable, évidemment, surtout pour HP et SL. Etant donné que les dictionnaires sont<br />
pensés pour un public italophone (quoi que les préfaces en disent) et mis dans le commerce<br />
en Italie 161 , il n’est pas interdit de penser que la partie français-italien ait été rédigée avec<br />
plus de soin quant au choix des équivalents (traduisants). Cette suprématie du décodage par<br />
rapport à l’encodage se manifesterait donc par des traduisants plus précis<br />
(monolexématiques) dans la direction français-italien (pour utilisateurs italiens aux prises<br />
avec des textes français), par rapport à l’autre direction (italien-français, pour italophones<br />
qui souhaitent encoder un texte en français).<br />
Mais même si nous négligeons les ED qui, nous l’avons vu, relèvent des dictionnaires euxmêmes<br />
et non de la langue, le nombre des écarts reste plus nettement plus élevé dans la<br />
direction italien-français que dans la direction français-italien. Examinons à présent les<br />
écarts catégorie par catégorie.<br />
Les écarts référentiels (ER) constituent un cas à part : dans trois dictionnaires sur quatre<br />
(B, G et HP), ils sont moins nombreux dans la direction italien-français. Le traitement de<br />
159 Cf. infra, notes 16 et 19.<br />
160 Ni le variantes ni les formes pronominales de l’italien ne sont calculées<br />
161 B est le seul à être vendu dans les deux pays.<br />
103
ces écarts (les signes renvoyant aux realia) est évidemment placé ailleurs pour B, G, HP, à<br />
savoir dans les notes culturelles 162 . SL, nous l’anticipons ici, est dépourvu de ces lieux<br />
textuels, demeurant ainsi un dictionnaire de langue ‘pur’.<br />
Le nombre d’écarts morphologiques (EM) augmente considérablement pour tous les<br />
dictionnaires : B (de 21 à 99), G (de 9 à 83), HP (de 4 à 73) et SL (de 13 à 99). De<br />
nombreux cas concernent les adverbes italiens en –ment. Comme l’observait STATI (1986 :<br />
13), « Les adverbes français en –ment et it. en –mente ne sont pas toujours interchangeables<br />
dans les textes, bien qu’ils aient en général la même signification. En outre il y a une foule<br />
de dérivés en –mente dépourvus d’un pendant français en –ment ». Cette dernière affirmation<br />
est bien confirmée par notre analyse. Nous pouvons citer, parmi beaucoup d’autres, les cas<br />
suivants: accademicamente, accoratamente, acutamente, affettivamente, altruisticamente, ampollosamente,<br />
anacronisticamente, analogamente, animatamente, appositamente, approfonditamente, asimmetricamente,<br />
autonomamente, autorevolmente, qui n’ont pas d’équivalents en –ment.<br />
Examinons une autre paire, cette fois suffixale : le français -ité vs l’italien -ità. Dans la<br />
direction français-italien, on relève seulement quatre cas où un substantif en -ité n’a pas<br />
d’équivalent lexicalisé en italien : analité, approbativité, aséismicité, alimentarité. Nous<br />
remarquons par ailleurs qu’il s’agit de mots peu usités, voire techniques. En ce qui concerne<br />
l’italien, nous avons relevé dix-neuf cas dans le sens inverse (abitualità, abrasività, acquaticità,<br />
affezionabilità, alcolicità, allusività, angolosità, annosità, annullabilità, anzianità, apartiticità,<br />
appellabilità, approssimabilità, arenosità, ariosità, artisticità, assertività, assimilabilità, autoreferenzialità).<br />
La tendance à l’abstraction se révèle beaucoup plus accentuée dans l’italien que dans le<br />
français, pour ce qui est de ce suffixe. S’agirait-il d’une « approche naturelle de la réalité qui<br />
est très caractéristique de la mentalité italienne », comme l’affirment SCAVEE – INTRAVAIA<br />
(1979 : 131) ? Il faudrait évidemment des recherches plus poussées, mais ce cas d’écart<br />
nous a paru significatif 163 .<br />
Un autre cas, relevant plus de la dictionnairique que de la morphologie, est mis en évidence<br />
par cette petite série, tirée de B.<br />
archibête agg.<br />
(fam.) quanto mai stupido.<br />
archicomble agg. (fam.)<br />
pieno zeppo<br />
archifaux agg.<br />
162 Cf. infra, II.2.1.<br />
163 Au point de vue de nos statistiques, cependant, nous faisons remarquer que les substantifs en –ità que<br />
nous venons de citer donnent lieu à des écarts sémantiques plutôt qu’à des écarts morphologiques ; leur sens<br />
n’est pas totalement prévisible à partir de leur forme, comme dans le cas des adverbes en –mente ou adjectifs<br />
formés à partir du participe présent. Pourtant, il nous a paru opportun de les présenter ici car ils montrent<br />
une constante morphologique.<br />
104
(fam.) completamente falso.<br />
archifou agg. m.<br />
(fam.) matto da legare.<br />
Ces quatre adjectifs donnent lieu à autant d’écarts morphologiques. Cependant, des<br />
traductions telles que stupidissimo pour archibête, ou falsissimo pour archifaux auraient évité cet<br />
écart ; le suffixe du superlatif italien aurait sans doute été un pendant adéquat pour rendre<br />
le préfixe français.<br />
Quant aux écarts terminologiques (ET), voici les chiffres: dans B ils passent de 57 à 157,<br />
dans G de 71 à 107, dans HP de 11 à 50, dans SL de 28 à 135. Encore une fois, nous<br />
voyons des écarts qui se creusent du côté italien-français, cette fois au niveau des langues<br />
de spécialité. La plupart des domaines de spécialité sont représentés, mais nous pouvons<br />
souligner une forte présence des termes du droit, de la marine, de l’aéronautique et de<br />
l’armée. Pour ce qui est de la valeur linguistique de ces écarts, elle est sans aucun doute plus<br />
réduite que pour les autres : ces écarts concernent des termes, qui sont la plupart des cas<br />
monosémiques (du moins dans le domaine concerné) et qui paraissent dans les discours des<br />
experts, surtout à l’écrit. Il est par conséquent évident que leur valeur expressive est très<br />
limitée, voire inexistante. Mais nous reviendrons sur ce point lorsque nous aborderons la<br />
valeur culturelle des écarts.<br />
Les écarts sémantiques (ES) sont sans aucun doute les plus intéressants au niveau de<br />
notre analyse. Les écarts qui font partie de cette catégorie ont passé le test du méta-corpus<br />
d’exclusion : autrement dit, aucun des trois autres dictionnaires du corpus n’a proposé<br />
d’équivalent monolexématique pour le mot-entrée (ou pour l’acception concernée) 164 . Nous<br />
pouvons donc affirmer que, selon toute vraisemblance, ces mots ou acceptions ne peuvent<br />
pas être traduits par un lexème ou par un synthème 165 . En outre, il s’agit d’écarts qui ne<br />
concernent ni les langues de spécialité (ils seraient des ET), ni la ‘forme’ des mots (ils<br />
feraient partie des EM), ni encore des référents non partagés (il s’agirait d’ER). Nous<br />
touchons ici au cœur du phénomène de l’anisomorphisme, tel que nous l’avons analysé au<br />
cours de la première partie 166 .<br />
Nous pouvons remarquer, d’emblée, que la distinction entre ES et ER, n’est pas toujours<br />
aisée. Prenons le cas suivant :<br />
abri-sous-roche s. m.<br />
164 Il se peut aussi, naturellement, que le mot ou l’acception soient tout simplement absents dans les autres<br />
dictionnaires du corpus.<br />
165 Voir infra, II.1.3.<br />
166 Cf. I.4.<br />
105
(geol., paleont.) cavità ai piedi di una parete rocciosa a strapiombo (abitazione preistorica). [B]<br />
Il devrait s’agit en principe d’un ES ; cependant, nous apprenons de Wikipédia 167 que les<br />
sites principaux d’abris-sous-roche se trouvent en France. La frontière entre écarts<br />
sémantiques et écarts référentiels peut donc s’avérer assez floue.<br />
Deux autres exemples peuvent nous aider à mieux comprendre ce phénomène.<br />
acul s. m.<br />
(zoot.) fondo di un parco per l’allevamento delle ostriche. [B]<br />
amareyeur s. m. e f.<br />
(zoot.) operaio addetto ai parchi di ostriche. [B]<br />
S’agit-il d’écarts sémantiques ou d’écarts référentiels ? Les parcs à huîtres existent<br />
également en Italie 168 , mais leur importance est beaucoup moins significative qu’en France.<br />
Dans ce cas, à notre avis, l’écart est fonction de la société, de la pression de<br />
l’extralinguistique. Ces considérations nous amènent logiquement à la section suivante, où<br />
nous analyserons plus en détail la valeur culturelle des écarts.<br />
167 http://fr.wikipedia.org/wiki/Abri_sous_roche.<br />
168 « Anche in Italia esistono parchi ostricoli d'allevamento: Taranto, Rovigno [sic, en Croatie], il Fusaro e La<br />
Spezia (nonostante l'inquinamento disastroso delle sue acque) forniscono un buon prodotto, ma è poca cosa a<br />
confronto della colossale industria ostricola dei paesi europei del nord » (site web<br />
http://www.gianniroghi.it/Testi/Mondo%20Sommerso/conchiglia/6510.htm, consulté le 27.08.10).<br />
106
II.1.2. La valeur culturelle des écarts<br />
Nous nous posons maintenant la question explicite de savoir si les écarts que nous avons<br />
relevés peuvent sous-tendre des valeurs culturelles, et éventuellement de quelle nature.<br />
Nous pouvons créer une échelle, où les cinq typologies d’écarts que nous avons dégagées<br />
voient leur poids culturel s’agrandir.<br />
Nous soulignons encore une fois que les écarts dictionnairiques sont des faux écarts : ils<br />
relèvent dans la plupart des cas d’un échec du lexicographe, qui n’a pas été capable de faire<br />
recours aux ressources expressives fournies par la L1 ou la L2 (cela est plus ‘grave’ dans le<br />
cas où L1 est la langue maternelle du lexicographe, dans le plus souvent dans la direction<br />
L2-L1). Ces écarts peuvent néanmoins témoigner d’un certain embarras du lexicographe à<br />
employer un terme peu fréquent (moins fréquent que l’entrée-source en L2) ou de la<br />
nécessité de le rendre plus transparent pour le lecteur. Nous avons vu auparavant le cas du<br />
mot astemio, à cet égard,<br />
Quelle peut être la valeur culturelle des écarts morphologiques ? Nous nous concentrons<br />
sur une typologie particulière, à savoir les dérivés diminutifs, augmentatifs, péjoratifs et<br />
superlatifs italiens. Dans notre corpus nous avons relevé les vingt-neuf entrées suivantes<br />
(direction italien-français). Il s’agit surtout de substantifs, mais il y a également des adjectifs<br />
(ammodino, anzianotto, asperrimo, azzurrino) et des adverbes (adagino, appostissimo, appuntino).<br />
Diminutifs : abatino, abitino, acquolina, adagino, affaruccio, agendina, altarino, amichetta, amichetto,<br />
ammodino, angioletto, angolino, anzianotto, appuntino, arboscello, arcatella, arietta, armadietto,<br />
automobilina, azzurrino.<br />
Augmentatis: affarone, amicone.<br />
Péjoratifs : affaraccio, alzataccia, annataccia, avaraccio.<br />
Superlatifs : affarissimo, appostissimo, asperrimo.<br />
Dans tous ces cas, l’équivalence ‘un signe’ = ‘un signe’ a évidemment échoué, de par le fait<br />
que la morphologie dérivationnelle de l’italien fournit des possibilités expressives que le<br />
français ne garantit normalement pas, quitte à recourir à des syntagmes adjectivales (comme<br />
jeune abbé pour abatino, petite robe pour abitino, etc.). Il s’agit d’un fait très bien connu,<br />
évidemment : « la dérivation affective est relativement pauvre en français, à l’opposé de<br />
langues comme l’italien » (ULLMANN 1952 : 153) ».<br />
Ce que nous nous demandons, par contre, c’est si, comme l’écrit PRUVOST, cette catégorie<br />
de dérivés (les écarts morpho-culturels) dénote une « attitude particulièrement émotive des<br />
Italiens vis-à-vis [...] de tout leur environnement » (2002 : 142). Le fait que ces lexèmes<br />
fassent partie de la nomenclature signifie qu’ils ne sont pas perçus comme de simples<br />
dérivés, mais comme des mots ‘à part entière’. La lexicalisation de ces mots, dont le<br />
recensement lexicographique constitue un indice, nous fait pencher pour l’affirmative : le<br />
107
poids de l’hypocoristique dans le lexique italien n’est pas négligeable, et il répond à une<br />
nécessité expressive qui est propre à la langue-culture italienne 169 .<br />
Dans la direction français-italien, nous pouvons présenter les cas suivants :<br />
amourette f.<br />
passioncella. [HP]<br />
Ce premier exemple nous montre comment « la langue italienne a l’avantage de permettre<br />
de combler certaines lacunes du lexique par sa morphologie » (ZOTTI 2007 : 94). Sans doute<br />
passioncella n’est pas lexicalisé au même degré qu’amourette, mais l’équivalent nous paraît bien<br />
choisi car il garde un suffixe diminutif à même de préserver la force expressive du mot.<br />
Dans deux cas seulement la morphologie dérivationnelle du français a permis la formation<br />
d’un lexème, alors que l’italien a dû recourir à un syntagme adjectival. Voici le premier :<br />
animalcule s. m.<br />
animale microscopico. [B]<br />
Il faut cependant remarquer le suffixe diminutif –cule n’est guère productif en français ; il<br />
dérive du latin –culus 170 mais il n’est pas à la disposition des locuteurs pour des nouvelles<br />
formations lexicales.<br />
autruchon s. m.<br />
(poco usato) piccolo dello struzzo. [B]<br />
Pour ce qui est de ce deuxième cas, nous pouvons le mettre en relation avec des mots<br />
comme caneton, bufflon, faon, gruon ou levron 171 : autant de mots qui produiraient un écart entre<br />
français et italien. CELOTTI (1998 : 125) observe que l’édition 1994 du dictionnaire Garzanti<br />
dressait une liste de trente-sept animaux, indiquant le nom de leurs femelles, de leurs petits<br />
et leur bruit (ou cri). Une tentative onomasiologique qui restera assez isolée,<br />
malheureusement.<br />
Passons maintenant aux écarts terminologiques. Tout d’abord, il faut rappeler que les<br />
dictionnaires de notre corpus sont des ouvrages généraux, pour le grand public, ils ne<br />
s’adressent pas aux experts de façon privilégiée. Cependant, le nombre des unités lexicales<br />
appartenant aux langues de spécialité peut être important (notamment en SL, ou G pour ce<br />
qui est du domaine de l’informatique, par exemple). Dans la mesure où la langue de<br />
spécialité est réputée se distinguer par son impersonnalité, par l’effacement des valeurs<br />
émotifs, par sa neutralité, il va de soi que les valeurs culturelles y soient moins visibles<br />
169 Cette attitude a été nommée par SCAVEE – INTRAVAIA (1979) « complexe de Saint-François d’Assise ».<br />
170 Nous le retrouvons dans des termes savants tels que caroncule, cicatricule, pédicule, pédoncule, etc.<br />
171 Pour indiquer le petit de l’animal, un autre suffixe très productif en français est le suffixe –eau (baleineau,<br />
bécasseau, chevreau, couleuvreau, dindonneau, pintadeau).<br />
108
qu’ailleurs. En outre, la dénomination, le procédé souverain qui préside à la démarche<br />
onomasiologique des terminologies, est par sa nature biunivoque et non ambiguë. Pour la<br />
communauté scientifique (et les traducteurs qui traduisent leur discours) ce qui est essentiel<br />
c’est que les équivalents soient précis, qu’ils désignent les mêmes référents. Les écarts<br />
terminologiques ayant moins de tendance à se charger de valeur connotatives 172 , il s’ensuit<br />
que leur poids culturelle est forcément difficilement analysable.<br />
En revanche, les écarts référentiels sont très intéressants pour l’analyse. Ils concernent les<br />
realia, ces unités phénoménologiques qui constituent le fonds culturel d’une communauté et<br />
qui dénotent les traditions gastronomiques, vestimentaires, œnologiques, artisanales, etc.<br />
d’une langue-culture.<br />
La perméabilité des cultures, l’échange entre la langue-culture française et la langue-culture<br />
italienne a fait en sorte que ces référents soient de moins en moins l’apanage exclusif d’une<br />
ou de l’autre culture, et la langue en témoigne par voie de conséquence. Les écarts<br />
référentiels que nous avons relevés concernent surtout l’éducation et la gastronomie, deux<br />
domaines ‘classiques’ où les écarts se manifestent. D’autres cas d’équivalence qui<br />
concernent les realia (résolus grâce à des emprunts, souvent glosés) seront traités à part 173 .<br />
Nos dernières réflexions concerneront les écarts sémantiques. Peut-on constater une<br />
corrélation entre ces écarts et des faits de culture ? Pour les écarts référentiels, cela va de soi<br />
bien évidemment : les signes renvoient à des référents non partagés entre L1 et L2, d’où<br />
l’écart. En ce qui concerne les écarts sémantiques, le rapport entre signes et réel est un peu<br />
plus complexe.<br />
Parmi les écarts sémantiques, les plus intéressants au point de vue culturel sont à notre avis<br />
ceux qui désignent des phénomènes sociaux, au sens large du terme. Dans la direction<br />
français-italien, nous pouvons citer les exemples suivants :<br />
âgisme s. m.<br />
discriminazione nei confronti degli anziani. [B]<br />
aidant s. m.<br />
persona di sostegno che si occupa, in ambito familiare, di un parente dipendente: les<br />
aidants familiaux viennent en aide à un proche dépendant, le persone di sostegno familiare<br />
aiutano un parente dipendente. [B]<br />
aoûtien s.m.<br />
chi prende le ferie in agosto. [SL]<br />
172 Cf. cependant SPILLNER (1994).<br />
173 Infra, p. 120.<br />
109
Notamment, âgisme met en lumière une discrimination vers les personnes âgées ; il est<br />
intéressant de souligner qu’en Italie on parle plus souvent de gerontocrazia, pour désigner une<br />
discrimination à l’envers, donc à l’égard des jeunes personnes 174 . L’écart qui concerne le<br />
mot aidant est aussi remarquable, car il peut nous faire réfléchir à la vision de la famille en<br />
France et en Italie. Aoûtien, par contre, met en évidence l’écart entre les habitudes françaises<br />
et italiennes, en ce qui concerne les périodes de vacances.<br />
Pour ce qui est de la partie italien-français, les exemples que nous pouvons apporter<br />
dénotent des réalités d’illégalité (abusivismo, abusivo, affittopoli) ou des manœuvres douteuses<br />
(acchiappavoti, ammanigliato). L’attention que la presse accorde à ces phénomènes peut être<br />
l’une des causes qui expliquent ces écarts.<br />
abusivismo s.m.<br />
actes pl. illégitimes. [SL]<br />
abusivo s.m.<br />
personne f. non autorisée. [SL]<br />
acchiappavoti agg. inv.<br />
(fam., spreg.) qui vise à obtenir des suffrages par des moyens douteux. [SL]<br />
affittòpoli n.f.invar.<br />
scandale (m.) politico-immobilier. [G]<br />
ammanigliato agg.<br />
(fig,colloq) qui a ses entrées: essere ben ammanigliato in un ambiente avoir ses entrées dans<br />
un milieu. [SL]<br />
Loin des implications d’un déterminisme, qui voudrait que la non existence du terme<br />
équivaille à la non existence du phénomène 175 , ces mots nous confirment cependant la<br />
saillance de ces phénomènes, indiqués par une dénomination synthétique. La langue-culture<br />
1 a donc ressenti la nécessité de forger, à un moment donné, un mot pour ‘encapsuler’ le<br />
concept 176 .<br />
Nous nous situons résolument du côté fonctionnaliste de PEETERS (1996). D’après sa<br />
conception des lacunes lexicales, c’est la nécessité socio-linguistique qui pousse à la création<br />
d’un nouveau lexème.<br />
174 Le pourcentage des personnes âgées en Italie est en outre beaucoup plus importante qu’en France, comme<br />
chacun le sait.<br />
175 Nous pouvons donc nuancer l’affirmation de PEETERS (2000 : 206) : « the unavailability of a word is<br />
typically an indication of the relative unimportance of the corresponding concept in a speech community ».<br />
176 Cf. infra, I.5.<br />
110
Toujours dans la direction italien-français, nous avons relevé une série d’entrées avec le<br />
préfixe anti-, qu’il nous paraît intéressant d’étudier.<br />
antiabortista s.m./f.<br />
opposant m. à l’avortement. [SL]<br />
antidivorzismo s.m.<br />
opposition f. au divorce. [SL]<br />
antidivorzista s. m. e f.<br />
personne contraire au divorce. [B]<br />
antidivorzistico agg.<br />
contre le divorce. [SL]<br />
antifiscalismo s. m.<br />
opposition à une fiscalisation excessive. [B]<br />
antinucleare s.m./f.<br />
activiste antinucléaire. [SL]<br />
antiusura 2 agg. inv.<br />
(dir.) qui a pour but de combattre ou de prévenir le délit d’usure. [B]<br />
antivivisezione agg.m./f.<br />
contre la vivisection. [SL]<br />
antivivisezionismo s.m.<br />
mouvement contre la vivisection. [SL]<br />
La valeur de ces écarts sémantiques nous paraît évidente : ils témoignent de l’aversion de<br />
quelques tranches significatives de la société italienne, passée (c’est la cas de antidivorzismo,<br />
antidivorzista et antidivorzistico) ou contemporaine, pour des thèmes tels que les interruptions<br />
volontaires de grossesse 177 , le divorce, la pression fiscale, le nucléaire, la vivisection. Pour<br />
antiusura, il ne s’agit pas d’un thème, mais plutôt d’un crime (le délit d’usure) qui<br />
demanderait des mesures ad hoc.<br />
Des pendants intéressants dans la partie français-italien nous paraissent les suivants :<br />
antigalère agg.invar.<br />
(sociol.) contro l’emarginazione sociale (dei giovani nelle città-satellite). [G]<br />
antichômage agg. inv.<br />
177 Il est intéressant de remarquer que le mot abortista (« en faveur de l’avortement, pour l’avortement ») est<br />
aussi présent dans notre corpus.<br />
111
contro la disoccupazione.<br />
Dans ces cas également, la marginalisation sociale des jeunes des cités et le chômage nous<br />
paraissent des thèmes cruciaux en France ; il n’est donc pas étonnnant qu’on en puisse<br />
trouver un reflet dans le lexique.<br />
Poursuivons dans notre analyse des écarts sémantiques. Il se peut que l’examen des écarts<br />
révèle un micro-paradigme, comme dans le cas de la triade accoutrement – affublement –<br />
attifement, trois lexèmes au même contenu sémantique, qui n’ont pas d’équivalent<br />
monolexématique en italien.<br />
accoutrement s. m.<br />
abbigliamento stravagante e ridicolo. [B]<br />
affublement s. m.<br />
abbigliamento ridicolo. [B]<br />
attifement s. m.<br />
abbigliamento ridicolo, stravagante. [B]<br />
Quelles sont les autres phénomènes qu’on peut relever ? Les quatre lexèmes italiens<br />
suivants présentent une constante, la terminaison –istica 178 , traduite comme « étude(s) de... ».<br />
americanistica s.f.<br />
études pl. américaines. [SL]<br />
africanistica s. f.<br />
(etnol.) étude des civilisations africaines. [G]<br />
anglistica s.f.<br />
(Ling) études pl. de la langue, de la littérature et de la civilisation anglaise. [SL]<br />
antichistica s.f.<br />
étude de la langue, de la littérature et de l’histoire classiques. [SL]<br />
Dans ce cas, la langue italienne offre à notre avis un angle perceptif privilégié à ses locuteurs. La<br />
présence d’un mot pour indiquer une discipline, qui peut aussi regrouper des études<br />
hétéroclites (comme dans anglistica et antichistica) induit une classification dans l’esprit des<br />
locuteurs. Nous serions tentés de renverser l’adage classique « Nomina sunt consequentia<br />
178 La série en italien est relativement vaste et comprend aussi, quant aux disciplines linguistiques: francesistica,<br />
germanistica, italianistica, ispanistica, slavistica, etc.<br />
112
erum » 179 (« les noms sont la conséquence des choses ») : l’existence d’un mot implique<br />
également l’existence de la chose.<br />
Essayons de mieux expliquer notre point de vue par d’autres exemples.<br />
autoferrotranvieri s.m.pl.<br />
salariés des transports publics urbains. [SL]<br />
alberghièri n.m.pl.<br />
le personnel hôtelier. [G]<br />
Dans le cas de ces deux entrées, l’existence du mot en Italien peut favoriser la<br />
représentation de ces travailleurs comme constituant une ‘catégorie’.<br />
Examinons cette autre triade.<br />
aziendalista s.m./f.<br />
(persona totalmente dedicata all’azienda) personne f. totalement dévouée à l’entreprise. [SL]<br />
aziendalistico agg.<br />
(totalmente dedicato all’azienda) totalement dévoué à l’entreprise. [SL]<br />
aziendalìsmo n.m.<br />
dévouement total à l’entreprise. [G]<br />
Quelle peut être la valeur culturelle de ces écarts (plus précisément, du mot aziendalismo et<br />
de ses deux dérivés) ? Des positions comme celles de STEINER (1995), qui étudie<br />
l’importance du champ sémantique de la prostitution et de l’alcool en français et en fait<br />
dériver, par voie de conséquence, l’importance de ces deux thèmes dans la culture<br />
française, nous semblent déterministes et difficilement acceptables : en poussant trop loin<br />
l’analogie langue-culture on risque de voir l’une comme un simple miroir de l’autre, alors<br />
que nous croyons que leur relation est plus compliquée que cela. Affirmer que la présence<br />
(massive) des signifiants renvoie sans faute à la présence (large) d’un référent dans la culture<br />
dont il est question nous paraît hardi, tout au moins. Une prolifération des signifiants peut<br />
en effet pallier un rapport conflictuel avec ce qui est signifié, ou quand-même en donner<br />
l’illusion. C’est aussi ce que fait remarquer KASTBERG SJÖBLOM (2003 : 200) : « Une<br />
abondance de mots d’un champ sémantique spécifique, répertoriés dans un dictionnaire<br />
bilingue, peut entraîner la transmission d’une image parfois exagérée ou fausse d’un peuple<br />
et d’une culture ». Et, plus radicalement, CLAS-ROBERTS (2003 : 238) : « Les mots [...] ne<br />
peuvent pas créer la réalité à laquelle ils réfèrent et ne peuvent ainsi avoir de sens que si la<br />
réalité de référence a déjà été repérée auparavant ».<br />
179 JUSTINIEN, Institutiones, livre II, 7, 3.<br />
113
Nous revenons donc au débat déterminisme vs parallélisme dont il a été question dans la<br />
première partie de notre thèse. La présence d’un mot (ou, plus significativement, d’une<br />
série de mots en réseau) ne détermine pas la pensée d’une communauté, ni peut affirmer,<br />
incontestablement, l’importance du référent que le mot désigne ; cependant, nous croyons<br />
que l’existence de certains mots indique un parallélisme entre langue et culture qu’il nous<br />
paraît intéressant d’étudier.<br />
Examinons les deux couples suivants.<br />
aconage o acconage s. m.<br />
scarico e carico di merci mediante una chiatta (fra una nave all’ancora e una banchina). [B]<br />
aconier o acconier s. m.<br />
addetto allo scarico e carico delle merci a bordo di una nave mercantile. [B]<br />
affouager v. tr.<br />
(dir.) usufruire del legnatico. [B]<br />
affouagiste n.m.<br />
(dir.) usufruttuario del legnatico. [G]<br />
Une approche socio-culturelle aux lacunes voudrait, rappelons-le, que la création des<br />
lexèmes soit fonction d’un besoin culturel de la société ; d’après ce point de vue, l’existence<br />
de ces mots serait déterminée par l’importance du commerce fluvial et du phénomène<br />
(essentiellement historique) de l’affouage 180 en France. Nous partageons donc l’avis de<br />
COUSIN (1982 : 275) : « L’étude des décalages culturels devrait s’inspirer des recherches de<br />
sociologie comparée ». Pour ce qui est de ce travail, nous sommes moins intéressés à<br />
trancher sur une raison socio-culturelle spécifique (l’importance d’un phénomène social au<br />
sens large qui serait à la origine de la création d’un lexème) qu’à susciter un questionnement<br />
sur la nature des écarts sémantiques.<br />
Nous pouvons faire l’hypothèse que les motivations extralinguistiques sont à l’origine des<br />
mots suivants, pour des raisons historiques (abondanciste 181 , alleutier) ou géographiques<br />
(ardoisier, ardoisière).<br />
abondanciste s. m. e f.<br />
(econ. polit.) fautore delle dottrine dell’abbondanza. [B]<br />
alleutier s. m.<br />
(dir. feudale) proprietario di allodio. [B]<br />
arabisant agg.<br />
(polit.) di arabizzazione: politique arabisante, politica di arabizzazione. [B]<br />
180 « Droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt communale», PR11.<br />
181 L’abondancisme est une théorie qui se réclame de l’héritage du français J. Duboin.<br />
114
ardoisier s. m. aggett.<br />
cavatore d’ardesia. [B]<br />
ardoisière s. f.<br />
cava d’ardesia. [B]<br />
Les mots suivants relèvent, à titre différent, de la francophonie. Les besoins des locuteurs<br />
du français non-hexagonal ont donc déterminé la création de ces lexèmes.<br />
acculturé agg. e n.m.<br />
(Africa) (persona) che ha assimilato la cultura europea. [SL]<br />
affreux s.m. (colloq)<br />
(Mil) (mercenaire) mercenario bianco al servizio di un esercito africano. [SL]<br />
africainement avv.<br />
secondo un’ottica africana; all’africana. [G]<br />
alémanique agg. sost.<br />
svizzero tedesco. [B]<br />
algérien s.m.<br />
(langue) arabo d’Algeria. [SL]<br />
aréna s. m.<br />
(quebec.) pista da pattinaggio (f.) (circondata da gradinate). [B]<br />
Pour ce qui est de l’italien, les termes suivants se rattachent à l’héritage du philosophe G.<br />
Gentile ; il n’est donc pas étonnants de voir qu’ils engendrent un écart sémantique, dans la<br />
traduction en français.<br />
attualista s. m. e f., anche agg.<br />
(filos.) partisan de l’actualisme.<br />
attualistico agg.<br />
(filos.) qui se rapporte à l’actualisme.<br />
115
Toujours dans la direction italien-français, les dérivés des noms propres aussi recèlent une<br />
valeur culturelle certaine car ils témoignent de l’importance du personnage évoqué.<br />
ariostesco agg.<br />
de l’Arioste.<br />
arlecchinesco agg.<br />
à la façon d’Arlequin.<br />
Nous avons essayé de tracer quelques pistes de recherche pour une étude culturelle des<br />
écarts. A travers les remarques que nous avons faites, nous recherchons moins l’unité du<br />
consensus que le désir de stimuler un débat sur le rôle de la culture dans la lexicalisation des<br />
formes.<br />
Arrivant aux conclusions, il convient tout d’abord de souligner l’ampleur des phénomènes<br />
in absentia, dont il est toujours difficile d’évaluer le poids. De façon générale, nous pouvons<br />
affirmer qu’il y a des milliers de cas où l’équivalence L1-L2 tient au niveau du lexème près.<br />
Le fait que, d’un côté, le français et l’italien fassent partie de la même famille de langues et,<br />
de l’autre, que les communautés linguistiques des francophones (de France, surtout) et des<br />
italophones partagent un monde d’expérience qui est pareil à bien des égards, explique cette<br />
convergence de façon définitive, à notre avis.<br />
Pour ce qui est des écarts sémantiques que nous n’avons pas mentionnés, sans doute la<br />
majorité, nous croyons qu’il est très risqué d’avancer des hypothèses quant à leur dimension<br />
culturelle. La lexicalisation des formes a suivi des parcours qui ont duré parfois des siècles<br />
et dont il est difficile de trouver une origine claire. Evidemment, nous n’ignorons non plus<br />
les facteurs internes, inhérents au système linguistique, qui ont pu amener à la lexicalisation<br />
d’un mot.<br />
Etant donné la non existence d’un point d’Archimède au-delà des langues, il est<br />
évidemment impossible de dire qu’une langue a trouvé une forme synthétique (un ‘mot’)<br />
pour définir ce qu’une autre langue n’a fait que de forme analytique. Les deux languescultures<br />
que nous avons étudiées, le français et l’italien, sont suffisamment indépendantes<br />
l’une de l’autre pour que l’évolution de leur lexique suive des chemins tout à fait<br />
autonomes.<br />
Au point de vue grammatical, il est évident que, parmi les écarts culturels, ce sont les<br />
substantifs qui se taillent la part du lion. La raison nous paraît claire : le nom est « la forme<br />
que doit revêtir une entité pour devenir objet de référence » (KLEIBER 1997 : 19, n. 22).<br />
Il nous paraît intéressant de faire maintenant quelques réflexions sur la fréquence des mots<br />
qui produisent les écarts que nous avons répertoriés.<br />
116
Nous avons repéré beaucoup de mots marqués comme ‘rares’ ou ‘non fréquents’ dans<br />
notre corpus. Parmi les mots de notre corpus, les seuls mots fondamentaux 182 sont les<br />
suivants : afa, accennare, ambulatorio et anziano. D’autres mots assez fréquents nous paraissent<br />
alludere, antiorario et antiquariato.<br />
En ce qui concerne le français, parmi les mots qui engendrent des ES, les seuls relativement<br />
fréquents nous semblent affadir, arrière-pensée 183 et assurer dans le sens familier de « être très<br />
bon (dans un domaine) ».<br />
Il est donc évident que la probabilité qu’il y ait un écart lexical augmente de façon<br />
inversement proportionnelle à la fréquence des lemmes en question. Est-ce le fait du<br />
contact entre L1 et L2 (français et italien)? Beaucoup de lemmes qui présentent un écart au<br />
niveau de l’équivalence ne sont pas présents dans tous les quatre dictionnaires de notre<br />
corpus, qui ont cependant une nomenclature assez extensive 184 .<br />
Les lexèmes qui restent à la périphérie du système sont nécessairement moins présents dans<br />
les échanges L1-L2 et exercent (ou ont exercé) une pression moins forte en vue d’une<br />
éventuelle création en L2 sur la base d’un modèle L1. Les échanges, il est possible<br />
d’affirmer, encouragent un nivellement de l’équivalence vers un rapport un signe : un signe.<br />
Finalement, à l’aune des contributions dont nous avons fait état dans la première partie 185 ,<br />
comment pouvons-nous résumer la valeur culturelle des ces écarts ?<br />
En renversant l’expression de R. GALISSON, nous pouvons affirmer que les écarts<br />
culturelles se produisent à partir de mots à charge culturelle non partagée entre L1 et L2. L’écart<br />
devient donc l’indice d’une non équivalence au niveau linguistique et culturel.<br />
Afin d’envisager la dimension interculturelle des DB, il est aussi nécessaire de concevoir les<br />
mots comme des déclencheurs 186 , plus précisément des déclencheurs de représentations 187 , qui<br />
rendent compte de l’épaisseur du langage 188 . Le lexique, à travers les relations qu’il<br />
entretient avec l’extralinguistique, se confirme donc un lieu privilégié pour l’étude des traits<br />
culturels dans la langue.<br />
182 D’après le marquage du monolingue italien Garzanti.<br />
183 Ce n’est pas un hasard, nous croyons, si le gallicisme arrière-pensée figure dans les deux monolingues italiens<br />
GI et DeM. Curieusement, les dictionnaire de notre corpus, n’ont pas fait recours à cet emprunt dans la<br />
traduction de l’entrée.<br />
184 HP constitue, partiellement, une exception comme nous l’avons vu.<br />
185 Notamment dans I.9.<br />
186 CLAS-ROBERTS (2003 : 238)<br />
187 ROBERT (2003 : 263).<br />
188 Ibid.<br />
117
II.1.3 Autres phénomènes liés à l’équivalence<br />
Dans cette section nous analysons d’autres cas de figure qui concernent le phénomène de<br />
l’équivalence, que nous ne reproduisons pas dans l’annexe. Il s’agit d’écarts qui ne relèvent<br />
pas des cinq catégories dégagées, pour différentes raisons : soit ils n’engendrent pas un<br />
écart au sens que nous l’avons entendu (‘équivalence de >1 signes’), soit il y a effectivement<br />
un écart mais il ne concerne pas le mot-entrée. Quoi qu’il en soit, les thèmes que nous<br />
développerons ici possèdent une valeur culturelle que nous essaierons d’élucider autant que<br />
possible.<br />
Les synthèmes<br />
Il y a tout d’abord le cas des synthèmes. Un synthème, d’après MARTINET, est « tout segment<br />
du discours qui se comporte en tout point comme un monème, mais qui est susceptible<br />
d’être analysé en deux ou plus de deux unités significatives » (MOUNIN 2004 : 318). Nous<br />
précisons que pour MARTINET le monème lexical correspond au lexème et au ‘signe<br />
minimal’ dont parle BRINK. Les mots composés seraient donc des synthèmes, ainsi que des<br />
lexies telles que pomme de terre, bonne d’enfants, etc. Pour cette raison, nous n’avons pas inclus<br />
les équivalents-synthèmes dans la catégorie des écarts sémantiques. Il est évident que, dans<br />
un cas pareil :<br />
accroche s. f.<br />
slogan pubblicitario (m.). [B]<br />
L’équivalent « slogan pubblicitario » est un syntagme, une combinaison libre; dès lors, nous<br />
avons répertorié ce cas dans la catégorie des écarts sémantiques.<br />
Par contre, dans le cas suivant :<br />
accul s. m.<br />
(pr. e fig.) vicolo cieco. [B]<br />
L’équivalent « vicolo cieco » se compose de deux mots graphiques mais ne constitue qu’une<br />
unité lexicale. Il s’agit donc d’un synthème. C’est son « comportement » (comme l’affirme<br />
MARTINET) qui le rend assimilable à un lexème ; en l’absence de critères formels, nous<br />
avons donc décidé de ne pas inclure cette catégorie de mots dans nos statistiques sur les<br />
écarts. Dans un synthème, la cohésion entre les unités significatives qui le composent est<br />
maximale ; au niveau expressif-connotatif, l’écart avec un lexème est donc négligeable.<br />
Voici d’autres exemples de synthèmes que nous avons pu trouver dans la lettre A de notre<br />
corpus.<br />
118
Côté français-italien.<br />
B :<br />
amandé s. m.<br />
latte di mandorle.<br />
autocuiseur s. m.<br />
pentola a pressione (f.).<br />
autoneige s. f.<br />
(quebec.; autom.) gatto delle nevi (m.).<br />
G :<br />
antimondialiste n.m. e f. e agg.<br />
no global.<br />
ardent n.m.<br />
(antiq.) fuoco fatuo.<br />
Côté italien-français.<br />
SL 189 :<br />
acrocoro, acrocoro s.m.<br />
(Geog) haut plateau.<br />
altoforno s.m.<br />
(Met) haut fourneau 190 .<br />
altolocato agg.<br />
haut placé.<br />
acquascooter<br />
scooter m. des mers.<br />
arengario s.m.<br />
189 Beaucoup de ces synthèmes sont présents également dans d’autres dictionnaires de notre corpus.<br />
190 Dans PR11, le mot est lexicalisé comme haut fourneau ou bien haut-fourneau.<br />
119
(Stor) hôtel de ville (avec un balcon).<br />
assicurata s.f.<br />
(Post) lettre chargée.<br />
associato s.m.<br />
(Univ) maître de conférence.<br />
autotreno s.m.<br />
train routier.<br />
G :<br />
altomàre n.m.invar.<br />
haute mer, pleine mer.<br />
appoggiamàno n.m.invar.<br />
(corrimano) main (f.) courante.<br />
L’étude des synthèmes se révèle d’une utilité certaine quant à l’identification des degrés du<br />
figement ; les synthèmes constituent ainsi une exception importante à notre définition de<br />
l’écart comme ‘équivalence de >1 signes’.<br />
Les realia<br />
Nous avons recensé de nombreux cas où l’équivalence concerne des realia, à savoir des<br />
entités qui correspondent à l’expérience singulière d’une communauté linguistique. Il s’agit<br />
presque exclusivement de substantifs 191 , qui renvoient à des référents qui ne sont pas à la<br />
portée de la langue-culture cible.<br />
Cependant, nous n’avons pas inclus ces mots dans la catégorie des écarts référentiels, car<br />
l’équivalence était résolue par un emprunt. Le critère formel que nous avons établi pour les<br />
écarts (« il y a écart chaque fois qu’une entrée ou une acception est traduite par un<br />
nombre de signes >1 ») empêchait donc cette inclusion.<br />
Pour ce qui est de notre problématique de la valeur culturelle des unités lexicales, il est<br />
presque redondant de souligner la centralité des entrées qui concernent les realia.<br />
191 Les seules exceptions sontt l’adjectif italien aventiniano [G] et l’interjection italienne alalà [HP] (voir plus<br />
bas).<br />
120
Nous pouvons aussi remarquer que les équivalents (les emprunts) sont toujours<br />
accompagnés d’une glose. Comme l’écrit ŠARCEVIC (1989: 213), « borrowing or<br />
naturalization without a gloss is informative only if the user is already familiar with the<br />
object, institution or concept that it denotes ». Ces gloses proposent des ‘zones définitoires’<br />
ou bien, comme dans audiotex [B], elles rapprochent le référent de la langue source d’un<br />
autre référent de la langue cible. Comme le fait remarquer CELOTTI, la solution employée<br />
pour rendre compte de ces unités est celle de « la glose explicative », et de « l’explicitation<br />
mise entre parenthèse après l’équivalent » (2002 : 457).<br />
Commençons par le côté français-italien : d’après notre corpus, ces entrées relèvent de<br />
domaines ‘classiques’, tels que la gastronomie 192 , l’éducation, la géographie (alios, aspre), le<br />
vêtement (abacos, abaya), les jeux (aluette, awalé).<br />
B :<br />
agrégation s. f.<br />
“agrégation” (concorso statale a cattedra per l’insegnamento secondario). [G, HP et SL<br />
confirment]<br />
agrégé s. m. aggett.<br />
“agrégé” (chi ha conseguito l’“agrégation”). [G, HP et SL confirment]<br />
ailloli o aïoli s. m.<br />
(cuc.) “ailloli” (maionese all’aglio tipica della cucina provenzale). [G, SL confirment]<br />
aligoté s. m.<br />
(enol.) “aligoté” (vitigno bianco della Borgogna). [G et SL confirment]<br />
aramon s. m.<br />
(agr.) “aramon” (vitigno della Linguadoca). [G confirme]<br />
arbois s. m. inv.<br />
(enol.) “arbois” (vino pregiato della zona omonima). [absent ailleurs]<br />
argot 193 s. m.<br />
“argot” (gergo parigino, spec. della malavita). [G confirme]<br />
armagnac s. m.<br />
“armagnac” (acquavite pregiata prodotta nei pressi della città omonima). [G, HP et SL<br />
confirment]<br />
192 L’œnologie se taille la part du lion, sans doute à cause du lien indissoluble entre le terroir et le territoire où les<br />
vins sont produits.<br />
193 B propose également une note culturelle pour cette entrée.<br />
121
arrondissement s. m.<br />
“arrondissement” (nell’ordinamento amministrativo francese, suddivisione dei dipartimenti<br />
di alcune grandi città). [G, HP et SL confirment]<br />
aspic s. m.<br />
(cuc.) aspic (piatto freddo spec. di carne o pesce in gelatina. [G, HP et SL confirment]<br />
audiotex ® s. m. inv.<br />
“audiotex” (equiparabile all’Auditel). [G confirme]<br />
G :<br />
abacos, abacost n.m.<br />
abacos (nello Zaire 194 indumento maschile indossato come abito da cerimonia: è una giacca<br />
senza fodera, a maniche lunghe o corte). [absent ailleurs]<br />
abaya n.f.<br />
abaya (vestito lungo e chiuso delle donne arabe). [absent ailleurs]<br />
alcôviste n.m.<br />
(st. lett.) alcoviste (chi frequentava i salotti delle Précieuses). [absent ailleurs]<br />
alios n.m.<br />
(geol.) alios (grès organico caratteristico del sottosuolo delle Landes). [B confirme, mais sans<br />
glose]<br />
aluette n.f.<br />
aluette (gioco di carte di origine spagnola). [absent ailleurs]<br />
andouille n.f.<br />
andouille (salsicciotto di trippa e carne di maiale, specialità della città di Vire). [B, HP et SL<br />
confirment, mais sans la précision géographique]<br />
andouillette n.f.<br />
andouillette (salsiccia di trippa di maiale da mangiarsi cotta, specialità della città di Troyes).<br />
[B, HP et SL confirment, mais sans la précision géographique]<br />
andrinople n.f.<br />
andrinople (tessuto d’arredamento di color rosso). [absent ailleurs]<br />
angélisme n.m.<br />
194 Malheureusement G n’a pas mis à jour la dénomination du pays, aujourd’hui République Démocratique du<br />
Congo (en italien Repubblica Democratica del Congo).<br />
122
angélisme (spiritualismo esasperato che prescinde dalla realtà corporea). [absent ailleurs]<br />
anisette n.f.<br />
anisette (liquore sciropposo aromatizzato con anice). [B, HP et SL traduisent par contre<br />
« anisetta », sans gloser]<br />
apache n.m.<br />
(antiq.) apache (teppista parigino dei primi del Novecento). [HP 195 et SL confirment]<br />
arak n.m.<br />
arak (tipo di acquavite). [B traduit « arac (acquavite di riso) »]<br />
arrêt n.m.<br />
arrêt (in Francia provvedimento di organi giurisdizionali e decisione del Consiglio di stato<br />
che indica genericamente ogni atto giurisdizionale civile e amministrativo). [absent ailleurs]<br />
aspre n.f.<br />
aspre (collina sassosa nel Roussillon). [absent ailleurs]<br />
attifet n.m.<br />
attifet (copricapo muliebre del XVI sec.). [absent ailleurs]<br />
awalé n.m.<br />
awalé (gioco che consiste nello spostare delle pedine lungo un percorso di dodici caselle).<br />
[absent ailleurs]<br />
SL:<br />
achards s.m.pl.<br />
(Gastron) achards (condimento a base di pezzetti di verdura, frutta e di spezie lasciati<br />
macerare nell’aceto). [G confirme]<br />
arquebuse s.f.<br />
(liqueur) arquebuse m.inv. [absent ailleurs]<br />
ay s.m.<br />
(Enol) ay inv. (tipo di champagne prodotto ad Ay). [G confirme]<br />
Passons maintenant au versant italien-français. Ici également, la plupart des mots dénotent<br />
des référents gastronomiques (vins, liqueurs, fromages), institutionnels (Asl) ou des réalités<br />
195 L’équivalent est proposé sans glose culturelle.<br />
123
qui concernent les hiérarchies militaires (appuntato), la politique (aventiniano) ou l’histoire<br />
(alalà, archiginnasio, avanguardista).<br />
G :<br />
albàna n.f.<br />
albana (espèce de raisin blanc d’Italie et le vin qu’on en tire). [absent ailleurs]<br />
aleàtico n.m.<br />
aléatico (vin d’Italie, rouge et doux). [HP confirme]<br />
amarétto n.m.<br />
(liquore) amaretto (liqueur italienne au goût d’amande amère fabriquée à partir d’amandes<br />
d’abricot et d’extraits aromatiques). [HP confirme]<br />
archiginnàsio n.m.<br />
archiginnasio (nom ancien des Universités de Bologne et de Rome). [B et SL confirment]<br />
asiàgo n.m.invar.<br />
asiago (fromage de lait de vache à pâte peu friable et à croûte lisse). [HP confirme]<br />
ASL n.f.invar.<br />
ensemble (m.) des organismes locaux du système sanitaire Sigla di Azienda Sanitaria<br />
Locale. [HP confirme]<br />
avanguardìsta n.m. e f.<br />
(st.) avanguardista (jeune homme appartenant à une organisation de jeunesse fasciste).<br />
[absent ailleurs]<br />
aventiniàno agg.<br />
aventiniano (en politique, qui refuse de collaborer avec les institutions politiques<br />
existantes). [absent ailleurs]<br />
HP:<br />
aglianico m. ENOL. INTRAD.<br />
(cépage de l’Italie du Sud). [absent ailleurs]<br />
alalà inter.<br />
eia, eia alalà INTRAD. (cri d’encouragement des fascistes italiens). [absent ailleurs]<br />
appuntato m. MIL.<br />
= soldat de première classe, premier grade de la hiérarchie militaire. [absent ailleurs]<br />
124
D’autres cas d’équivalence où le référent est impliqué, en tant que ‘pièce unique’ d’une<br />
langue-culture, se trouvent dans la microstructure, dans la partie consacrée aux expressions<br />
figées. Etant donné leur valeur culturelle, nous n’avons pas pu négliger ces expressions. Les<br />
domaines concernées sont en priorité les institutions (académique, administration, aide,<br />
assistance), mais aussi l’éducation (académie, adjoint, annexe), l’histoire (accusateur), la presse<br />
(argus), l’histoire du théâtre (ambigu), la politique (assemblée), les impôts (avis) et les langues<br />
(alémanique).<br />
Voici donc quelques exemples tirés de la partie français-italien.<br />
B :<br />
académique agg. sost.<br />
Palmes académiques, onorificenza concessa dal Ministero della “Jeunesse, de l’Éducation<br />
Nationale et de la Recherche” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).<br />
aide s. m. e f.<br />
(sociol.) aide familiale, aide maternelle, aide ménagère, in Francia, assistente sociale che si<br />
occupa delle famiglie, dei bambini e svolge attività domestiche presso famiglie bisognose.<br />
argus s. m. inv.<br />
“L’Argus de la Presse”, agenzia specializzata nel procurare ritagli di stampa su determinati<br />
argomenti che interessano gli abbonati (in Italia, “L’Eco della Stampa”); “L’Argus de<br />
l’Automobile”, bollettino che riporta le quotazioni delle automobili d’occasione.<br />
G :<br />
académie n.f.<br />
officier d’académie, titolo accademico che viene conferito dal Ministero dell’Educazione<br />
Nazionale a chi si è distinto in un particolare settore delle scienze e delle arti.<br />
adjoint n.m.<br />
adjoint d’enseignement, (nei licei francesi) aiuto e sostituto del professore titolare Fino al<br />
1945 era detto professeur adjoint.<br />
alémanique n.m.<br />
bas alémanique, basso alemanno (dialetto parlato in Alsazia e nel Baden).<br />
ambigu n.m.<br />
(st. teatr.) ambigu comique, ambigu-comique (spettacolo composito formato da vari generi<br />
teatrali).<br />
annexe agg.<br />
125
école annexe, scuola elementare annessa a una scuola normale per permettere ai futuri<br />
maestri di fare il tirocinio.<br />
avis n.m.<br />
avis d’imposition, avviso per mezzo del quale l’erario notifica al contribuente l’importo del<br />
suo debito fiscale e le modalità di pagamento.<br />
SL:<br />
accusateur s.m.<br />
(Stor) accusateur public durante la Rivoluzione francese, magistrato incaricato dal pubblico<br />
ministero.<br />
administration s.f.<br />
administration des Eaux et Forêts amministrazione delle Acque e delle Foreste (simile al<br />
Corpo Forestale dello Stato in Italia).<br />
assemblée s.f.<br />
(Pol) Assemblée nationale (en France) Camera dei Deputati.<br />
assistance s.f.<br />
(ant) Assistance publique (à Paris et Marseille) Assistenza pubblica; c’est un enfant de<br />
l’Assistance è un orfanello.<br />
Du côté italien-français, nous avons affaire à des référents relevant du domaine de la<br />
fiscalité (partita IVA), des institutions (Assemblea federale, une dénomination qui dénote une<br />
réalité de la Suisse italophone), du droit (avviso di reato) et de l’éducation (quarto d’ora<br />
accademico).<br />
G :<br />
accadèmico agg.<br />
quarto d’ora accademico, quart d’heure académique (dans l’université italienne, intervalle<br />
entre deux cours qui se suivent).<br />
SL :<br />
aprire v.tr.<br />
aprire la partita IVA obtenir son numéro de SIRET, s’établir comme travailleur<br />
indépendant.<br />
assemblea s.f.<br />
126
Assemblea Federale (in Svizzera) Assemblée Fédérale.<br />
avviso s.m.<br />
avviso di reato acte par lequel le Ministère public informe l’intéressé qu’une enquête a été<br />
ouverte à son encontre.<br />
Nous avons choisi de présenter ces échantillons car ils montrent très bien cette corrélation<br />
entre des expressions figées ou des dénominations institutionnelles et des référents<br />
‘uniques’ d’une langue-culture. C’est donc encore le référent ce qui crée l’écart.<br />
Les précisions encyclopédiques<br />
Le dictionnaire Garzanti présente une particularité : dans plusieurs entrées, il révèle un<br />
souci encyclopédique, glosant les traduisants (qui ne sont pas des emprunts) avec des<br />
indications sur le référent. Il peut s’agir de réalités francophones, comme pour les unités de<br />
mesure (acre, are, arpente, aune), mais aussi de référents d’autres aires géographiques (aigle,<br />
alternative, auburnien, aune). Dans tous les cas, le dictionnaire va au-delà de sa tâche traductive<br />
et il adopte une visée encyclopédique explicite.<br />
Côté français-italien:<br />
absinthe n.f.<br />
assenzio (liquore di color verde la cui fabbricazione è ora proibita in Francia; il suo<br />
consumo era molto diffuso nel sec. XIX).<br />
acre n.f.<br />
acro (m.) (misura agraria di superficie corrisponde in Francia a 5200 m 2 ).<br />
agnel n.m.<br />
agnello (moneta d’oro francese in uso dal XII al XV sec.).<br />
aigle n.m.<br />
aquila (f.) (moneta aurea da 10 dollari).<br />
alternative n.f.<br />
(tauromachia) alternativa (investitura del matador de novillos al rango di matador de toros).<br />
angelot n.m.<br />
(numismatica) angelo (moneta d’oro coniata da Filippo VI di Valois nel 1341).<br />
antirévisionnisme n.m.<br />
127
(st.) antirevisionismo (movimento che si opponeva alla revisione del processo contro<br />
Dreyfus).<br />
are n.m.<br />
ara (f.) (misura di superficie equivalente a 100 m 2 ).<br />
arpent n.m.<br />
arpento (antica misura agraria = 3000 m 2 circa).<br />
auburnien agg. e n.m.<br />
auburniano (particolare regime carcerario istituito nella città di Auburn, negli Stati Uniti).<br />
aune 1 n.f.<br />
auna (antica misura di lunghezza corrispondente a m 1,20 circa).<br />
Dans le cas suivant, le mot aman, emprunt de l’arabe, dénoterait justement une tradition<br />
arabe. La proximité entre la langue française et la culture arabe en contexte de colonisation<br />
a sans doute permis la lexicalisation de ce mot, dont la particularité est qu’il dénote une<br />
réalité non française, mais en partie francophone, par un signifiant emprunté à la langue<br />
locale.<br />
aman n.m. (nei paesi musulmani) grazia (f.): demander l’aman, fare atto di sottomissione.<br />
Dans ces deux autres cas (antitroyen et teaser), toujours tirés de G, nous croyons que la glose<br />
définitionnelle est justifiée, dans les intentions du lexicographe, par le statut néologique de<br />
l’unité lexicale.<br />
antitroyen n.m.<br />
(inform.) antitrojan (programma che difende dai cavalli di Troia informatici).<br />
teaser n.m. (ingl.)<br />
(pubblicità) teaser (messaggio pubblicitario senza menzione del prodotto, destinato ad<br />
attirare l’attenzione del pubblico in vista della campagna vera e propria).<br />
Du côté italien-français, toujours dans le dictionnaire Garzanti, nous avons tout<br />
simplement le pendant de acre et are avec les entrées acro et ara, qui indiquent la<br />
correspondance entre ces deux unités de superficie.<br />
àcro n.m.<br />
acre (f.) (misura di superficie = m 2 4000 ca).<br />
àra 2 n.f.<br />
128
(agr.) are (m.) (misura di superficie = 100 m 2 ).<br />
Dans une moindre mesure que Garzanti, Boch aussi présente des précision<br />
encyclopédiques ; dans les entrées suivantes, ces indications concernent une invention<br />
française (arithmomètre) et deux personnages de fiction (Arsène Lupin et Atchoum).<br />
arithmomètre s. m.<br />
(st. della tecnica) calcolatrice (f.) (inventata nel 1820).<br />
Arsène n. proprio m.<br />
Arsène Lupin, Arsenio Lupin (personaggio di ladro gentiluomo creato da M. Leblanc).<br />
Atchoum (2) n. proprio m.<br />
Eolo (nella fiaba di Biancaneve, uno dei sette nani).<br />
Les écarts connotatifs<br />
L’écart connotatif concerne les valeurs ajoutées attribuées aux mots ; il est visible dans les<br />
collocations, dans les locutions et dans les exemples. C’est sans aucun doute le plus difficile<br />
à cerner. Nous avons décidé de ne pas faire un calcul quantitatif de ces écarts et de les<br />
traiter à part, puisque les critères formels que nous avons explicités pour les écarts (‘écart<br />
comme équivalence de >1 signes’) ne seraient pas pertinents.<br />
Pour montrer ce que nous entendons par écart connotatif, voici un exemple tiré de HP :<br />
artiste I agg.<br />
1 (créatif) artistico, da artista.<br />
2 (bizarre) il est un peu artiste, è un po’ stravagante, estroso.<br />
II m. e f.<br />
1 (créateur) artista; une sensibilité d’artiste, una sensibilità da artista<br />
2 (chanteur, danseur, musicien) artista<br />
3 (bon à rien) bohémien, scapestrato (-a); COLLOQ. salut l’artiste! ciao amico!<br />
Qu’est-ce que cet exemple met en lumière? Si nous analysons les acceptions 2 de l’adjectif<br />
et 3 du substantif, nous voyons qu’au mot artiste (dont la dénotation est : ‘créateur d’une<br />
œuvre d’art’, ou ‘personne qui s’adonne aux arts’) s’ajoutent des sens périphériques, tels que<br />
‘bizarre’ et ‘bon à rien’, pour lesquels l’italien choisit des équivalents plus éloignés, qu’on<br />
pourrait sans doute qualifier de ‘connotatifs’. L’écart connotatif se produit donc lorsqu’à un<br />
signe en L1 s’associent des valeurs qui ne sont pas partagées par L2.<br />
129
Nous pouvons faire un autre exemple avec :<br />
avvocatessa s.f.<br />
(scherz) (chi ha una buona parlantina) femme qui a du bagout. [SL]<br />
avvocato s.m.<br />
(scherz,fig) (chi ha una buona parlantina) homme qui a du bagout. [SL]<br />
Dans ce cas, l’italien avvocato et son féminin avvocatessa possèdent une connotation qui est<br />
absente dans leurs équivalents standard avocat / avocate et, qui plus est, ils ne peuvent être<br />
traduits que par des expressions périphrastiques. C’est un fait que BRINK (1971 : 69) avait<br />
déjà remarqué : « minimal signs are much likelier to be loaded with untranslatable<br />
connotations than paraphrastic expressions ».<br />
D’après SZENDE, (1996 : 120) : « Chaque fois qu’il y a une connotation particulière, le<br />
dictionnaire doit alerter le traducteur ». Comment est-il possible de repérer ces mots,<br />
déclencheurs d’associations culturelles ? Essayons de prendre en examen quelques cas.<br />
allemand n.m.<br />
c’est de l’allemand (o du haut allemand) pour moi, è arabo per me. [G]<br />
Cette expression peut être reformulée de cette façon : « pour moi, c’est incompréhensible ».<br />
Ce serait une reformulation tout à fait neutre. Dans l’exemple, par contre, l’allemand est<br />
connoté comme ‘langue très difficile’ 196 , ainsi que l’arabe dans la traduction italienne. Il est<br />
intéressant de remarquer que ces opinions ‘populaires’ sont entrées à tel point dans la<br />
langue qu’elles ont formé des expressions figées, qui reflètent à leur tour des associations<br />
culturelles partagées par les communautés.<br />
Assez bizarrement, dans la traduction des expressions parlare arabo, per me è arabo de G, nous<br />
n’avons pas l’allemand : le lexicographe a opté pour des langues plus exotiques (chinois,<br />
hébreu).<br />
arabo n.m.<br />
parlare arabo, (fig.) parler chinois; per me è arabo, pour moi c’est de l’hébreu. [G]<br />
Les écarts de registre, comme l’expliquent LEHMANN – MARTIN-BERTHET (2008 : 36),<br />
relèvent du phénomène connotatif. Essayons de voir quelques cas flagrants de non<br />
équivalence au niveau du registre dans les DB de notre corpus.<br />
abortif agg. sost. al m.<br />
pilule abortive, pillola del giorno dopo (fam.). [B]<br />
196 Un préjugé que WEINRICH (1986) a essayé de réfuter.<br />
130
achar s. m.<br />
acrt. (fam.) di acharnement, spec. nella loc. avv. d’achar, con accanimento: à peine guéri, il<br />
s’est remis à travailler d’achar, appena guarito, si è rimesso a lavorare con accanimento. [B]<br />
Dans le premier cas, l’écart concerne la traduction du syntagme pilule abortive. B propose un<br />
équivalent familier, sans indiquer une équivalence standard, ce qui est tout au moins rare.<br />
Ce dictionnaire produit donc un écart du côté de l’équivalent, mais il a le mérite de le<br />
signaler à l’usager.<br />
Dans le deuxième cas (d’achar) la traduction proposée « con accanimento », ne garde pas le<br />
registre familier de l’expression française. C’est l’un des nombreux cas, à notre avis, où<br />
l’italien manque d’un équivalent d’un même registre ; l’écart concerne donc le niveau de<br />
langue, mais cette fois il n’est pas signalé à l’usager 197 .<br />
agrégat m.<br />
FIG. accozzaglia f. [HP]<br />
Dans cet autre cas, l’équivalent proposé (accozzaglia) est péjoratif (ainsi que le confirment les<br />
monolingues DeM et GI), alors que le lemme ne l’est pas. L’écart dépend donc plutôt<br />
d’une imprécision du lexicographe.<br />
Analysons un autre exemple où la dimension connotative entre en jeu.<br />
amerloque agg. sost. o amerlo s. m. aggett. o amerlot s. m.<br />
(fam.) americano. [B]<br />
amerloque, amerlo, amerlot n.m.<br />
(fam. spreg.) americano, yankee. [G]<br />
amerlo, amerloque m. e f.<br />
POP. SPREG.yankee. [HP]<br />
amerlo, amerloque s.m./f.<br />
(colloq,spreg) yankee. [SL]<br />
B ne rend pas compte du caractère péjoratif de l’entrée 198 et produit donc une fausse<br />
équivalence, appauvrie au point de vue connotatif. G, plus prudent, propose deux<br />
équivalents ; HP traduit correctement, à notre sens, mais avec une marque (populaire) qui<br />
197 Il faut souligner, cependant, que la marque ‘standard’ ou ‘non fam.’ n’existe pas dans les DB italien-français<br />
(et non plus dans les monolingues que nous connaissons). Il serait abusif de l’introduire parce que,<br />
paradoxalement, la plupart des mots seraient marqués. Mais cela n’empêche qu’il faudrait trouver des moyens<br />
pour signaler que l’équivalent proposé (dans ce cas, con accanimento) ne respecte pas le registre de l’expression<br />
de la langue-source.<br />
198 Ce que PR11 indique.<br />
131
pose problème 199 ; SL est le seul qui reste fidèle au marquage du mot-entrée PR11 (« Fam.<br />
et péj. ») et qui propose un seul traduisant, yankee, équivalent au point de vue dénotatif et<br />
connotatif.<br />
Les écarts connotatifs peuvent concerner également des locutions, comme dans les cas<br />
suivants.<br />
ad patres loc. avv.<br />
(fam.) envoyer q. ad patres, mandare q. all’altro mondo. [B]<br />
ad vitam æternam loc. avv. (lat.; fam.)<br />
1 in eterno: nous n’allons tout de même pas rester ici ad vitam æternam!, non rimarremo<br />
mica qui in eterno!<br />
2 vita natural durante. [B]<br />
Les locutions ad patres et ad vitam æternam sont indiquées comme familières par Boch.<br />
L’italien semble dépourvu d’une équivalence du même registre, car mandare all’altro mondo, in<br />
eterno et vita natural durante relèvent plutôt d’une langue standard. Mais ce qui est également à<br />
noter, c’est que les expressions latines en italien connotent normalement un langage<br />
soutenu ; il faudrait des recherches approfondies pour voir si en français ces expressions<br />
ont le même statut, et donc ces deux cas ne seraient qu’une exception, ou si par contre le<br />
latin n’a pas la même valeur connotative en français et en italien.<br />
Nous achevons cette partie par l’analyse d’un autre cas de figure. Dans le cas suivant :<br />
agnizione s. f.<br />
(teatro) agnition, reconnaissance. [B]<br />
L’écart de registre se produit entre l’entrée et le premier traduisant agnition. Si le mot<br />
agnizione figure dans les deux monolingues DeM et GI, agnition est absent dans PR11 et dans<br />
TLFi 200 . Il paraît donc que agnition est un terme plus rare que son équivalent italien ; nous<br />
ne l’avons trouvé que dans le Littré du XIX e siècle 201 . Cet écart de registre (donc,<br />
connotatif) n’est pas signalé par B, ni par les autres dictionnaires de notre corpus.<br />
199 Elle est de plus en plus remplacée par « fam. », dans les DB analysés.<br />
200 Il est aussi absent du Petit Larousse 2008, que nous avons consulté dans ce cas seulement, pour un contrôle<br />
supplémentaire.<br />
201 Disponible en ligne à l’adresse http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php.<br />
132
Les euphémismes<br />
Les euphémismes constituent également un phénomène où langues et cultures sont<br />
intimement liées. MOUNIN (2004 : 130) définit l’euphémisme comme « atténuation de la<br />
pensée ». Quand cette pensée est consignée en langue et que les dictionnaires la répertorient,<br />
nous touchons sans conteste à un fait de culture. Ainsi que PRUVOST l’écrit (2002 : 148) :<br />
« Particulièrement liés à la pratique sociale, les euphémismes relayés par le renouveau du<br />
politiquement correct, version moderne de la préciosité et de ses périphrases, ne sont pas<br />
[...] sans provoquer quelques cauchermars aux lexicographes ». Essayons de voir quelques<br />
cas d’euphémismes, toujours tirés de notre corpus.<br />
s’en aller v. pron.<br />
(fam.) s’en aller de la poitrine, morire di mal sottile [B]<br />
Dans ce premier exemple, il est question d’un décès à cause d’une tubercolose pulmunaire.<br />
L’expression française est indiquée comme familière, alors que l’italienne nous paraît plutôt<br />
vieillie. Les deux sont euphémiques, mais s’en aller de la poitrine l’est encore plus :<br />
l’euphémisme ne concerne pas que la maladie, le trépas aussi est évoqué par la périphrase<br />
s’en aller.<br />
absenter, s’ v.pron.intr.<br />
je me suis absenté un instant, sono andato un momento di là (alla toilette). [G]<br />
L’équivalence euphémique est bien respectée dans ce cas : comme toute référence<br />
inconvenante, elle est effacée et on y fait allusion par des périphrases plus ou moins<br />
élégantes.<br />
acné n.f.<br />
acné professionnelle, cloracne 202 . [G]<br />
Avec cette équivalence nous sommes à la limite de la notion d’euphémisme. Mais si la<br />
dénomination italienne dénote, par le préfixe clor-, un acné dû à une intoxication d’origine<br />
chimique, le français adopte une terminologie plus neutre et en même temps plus opaque,<br />
qui indique le contexte où la maladie a eu son origine mais en efface la nature et la<br />
dangérosité, en quelque sorte.<br />
agent n.m.<br />
agent de nettoyage, operatore ecologico, netturbino. [G]<br />
202 GI : cloracne n.f. (med.) malattia della pelle dovuta a intossicazione da idrocarburi clorurati (p.e. la<br />
diossina).<br />
133
aveugle m.<br />
cieco, non vedente. [HP]<br />
anormal agg. sost.<br />
un anormal, un handicappato, un ritardato, un deviante. [B]<br />
Avec ces trois derniers exemples, nous touchons au phénomène du politiquement correct.<br />
L’équivalence agent de nettoyage = operatore ecologico est tout à fait satisfaisante ; le choix d’un<br />
deuxième équivalent (netturbino) relève sans doute du « réflexe de synonymisation » identifié<br />
par M. Kundera 203 , plutôt que d’un souci de complétude. Dans le cas du lemme aveugle, HP<br />
choisit, à la différence des autres DB, d’ajouter le traduisant non vedente. Effectivement le<br />
substantif cieco en italien est de plus en plus perçu comme indélicat, sans doute encore plus<br />
que aveugle, qui paraît avoir gardé une certaine neutralité ; la décision de HP semble bien<br />
répondre à cette tendance euphémique de la langue-culture italienne. Le dernier cas est<br />
assez problématique, voire gênant : sans contexte, il est difficile de savoir ce que un anormal<br />
peut signifier. B propose trois traduisants, qui désignent un déficit générique (un<br />
handicappato), cognitif (un ritardato) ou bien une personnalité antisociale (deviante) ; une<br />
traduction littérale (un anormale) n’est pas proposée, sans doute parce que la notion de norme<br />
et de normalité n’est plus conforme au Zeitgeist contemporain. Il s’agit d’un cas limite où le<br />
‘politiquement incorrect’ est dans le texte source et la traduction essaie d’en pallier les<br />
effets.<br />
Les associations culturelles<br />
Comme l’affirme CELOTTI (2002 : 459), « les associations culturelles liées à la communauté<br />
de chacun que peut susciter un mot [constituent] un immense terrain vague encore à<br />
défricher, sûrement pour les langues en contact comme le français et l’italien ». Ces<br />
associations ne sont pas aisées à repérer, mais elles représentent un fonds important, où les<br />
langues et les cultures montrent leur indissolubilité. Abordons quelques cas qui nous<br />
paraissent significatifs.<br />
âme s. f.<br />
avoir l’âme chevillée au corps, essere duro a morire. [B]<br />
Cette expression française nous évoque immédiatement la conception dualiste<br />
cartésienne 204 ; il y a le risque que ce genre d’associations soient tout à fait individuelles,<br />
idiolectales, mais si, comme nous le croyons, la langue est jonchée de ces échos culturels,<br />
chaque locuteur entendra ceux qui entrent mieux en résonance avec lui.<br />
203 Les testaments trahis, Paris, Gallimard, 1993 : 130.<br />
204 Cf. FRATH (2008b).<br />
134
apothicaire s. m.<br />
nella loc. comptes d’apothicaire, conti lunghi e complessi (spec. fatti apposta perché non ci<br />
si raccapezzi). [B]<br />
Le lexicographe ne nous dit pas qu’apothicaire est le vieux nom du pharmacien. En fait, ce mot<br />
n’apparaît aujourd’hui que dans l’expression figurée comptes d’apothicaire, donc aucune<br />
critique à faire à B au point de vue métalexicographique. Cependant, l’association originelle<br />
française entre la figure de l’apothicaire et son attitude vers les calculs se perd dans<br />
l’équivalence. On n’y peut sans doute rien dans un DB, mais c’est une association culturelle<br />
que nous croyons intéressant de souligner ici.<br />
argentier s. m.<br />
nella loc. (fam., scherz.) le grand argentier, il ministro delle finanze. [B]<br />
Encore une fois, il y a ici une association qui se perd: le grand argentier était historiquement,<br />
comme l’écrit PR11, « le surintendant des finances ». Il y a donc un sens ancien, dont B ne<br />
rend pas compte, qui s’est élargi et qui désigne aujourd’hui le ministre des finances. Un<br />
lecteur non avisé ne pourrait pas saisir la référence, par plaisanterie, à l’histoire. En outre,<br />
l’équivalent proposé (ministro delle finanze) n’est pas du même registre que l’expressionsource,<br />
mais nous n’allons pas revenir sur ce thème, déjà abordé plus haut.<br />
Arlésien n.m.<br />
(fig.): jouer l’Arlésienne, non farsi vedere; c’est l’Arlésienne, è l’Araba fenice. [G]<br />
Pour rendre compte de l’origine de cette expression, qui se réfère à un opéra de Bizet, G (et<br />
B aussi) ajoutent une note culturelle. Ce qui est tout à fait licite et représente une stratégie<br />
de véhiculer les associations culturelles que nous analyserons plus bas 205 .<br />
art s. m.<br />
le septième art, la settima arte, il cinema.<br />
le huitième art, la televisione.<br />
le neuvième art, i fumetti. [B]<br />
Ces expressions françaises déclenchent à notre avis l’association suivante : la série des arts,<br />
dont la classification a évolué considérablement dans l’histoire de l’humanité, est une série<br />
ouverte, qui a accueilli récemment des formes modernes, telles que la télévision et la bande<br />
dessinée. L’italien, sans doute plus conservateur, ne paraît pas, du moins selon Boch, avoir<br />
retenu ces dénominations nobles pour ces formes d’art contemporains.<br />
205 Infra, II.2.1.<br />
135
auberge s. f.<br />
auberge espagnole, luogo in cui si trova solo quello che si è portato. [B]<br />
La traduction proposée par B, certes pas très idiomatique, a le mérite de suivre de près la<br />
définition de PR11 206 . Pour ce qui est des associations culturelles, nous pensons au film de<br />
C. Klapisch, L’auberge espagnole (2002), qui a eu beaucoup de succès en Italie aussi, et qui a<br />
été traduit comme L’appartamento spagnolo. Sans doute, une note culturelle (avec mention du<br />
film ?) pourrait aider à éclaircir le sens de l’expression, qui reste assez opaque avec<br />
l’équivalence proposée.<br />
arroseur m.<br />
c’est l’arroseur arrosé chi la fa l’aspetti, chi va per suonarle rimane suonato. [HP]<br />
Dans cette autre locution résonne l’écho d’un film de L. Lumière (1895), ainsi que PR11 le<br />
remarque.<br />
abîmer v.tr.<br />
(Africa) ingravidare (una ragazza). [G]<br />
Nous ne pouvons nous passer de souligner la motivation du signe abîmer, qui renvoie sans<br />
aucun doute à un système de pensée et de valeurs. D’après ce que nous dit ce<br />
dictionnaire 207 , une fille enceinte serait donc abîmée, endommagée. Il s’agit d’une association<br />
très sexiste mais qui est révélatrice « des savoirs sous-jacents à l’expression » dont parle<br />
LAURIAN (2004 : 8). Dans des cas pareils, la langue révèle toute son épaisseur, telle qu’elle a<br />
été analysée par S. ROBERT 208 .<br />
acompte s. m.<br />
(fam.) prendre un acompte, mangiare qualcosa (prima del pasto), avere rapporti sessuali<br />
prima del matrimonio. [B]<br />
Cette locution aussi s’appuie sur un univers de valeurs qui précède l’expression. Pour<br />
comprendre cette expression imagée, il faut être à connaissance du cadre idéologique et<br />
axiologique où elle s’inscrit (le catholicisme, en définitive).<br />
arriver v.<br />
206 Boch a évidemment suivi une édition antérieure du Petit Robert.<br />
207 Nous ignorons la diffusion de ce sens dans l’Afrique francophone.<br />
208 Cf. infra, I.9.<br />
136
(colloq) arriver comme les carabiniers (arriver trop tard) arrivare a sproposito, arrivare<br />
all’improvviso. [SL]<br />
Comme le précise PR11, cette locution familière évoque une opérette d’Offenbach, Les<br />
Brigands. Ce qui est ironique, c’est que le référent italien (i carabinieri) n’entre pas dans la<br />
traduction italienne. D’après les locutions de GI 209 , le carabinier dénote la sévèrité ; d’après<br />
la culture populaire, le carabinier est le sujet de nombreuses histoires drôles, où paraissent<br />
aussi des conflits dans les compétences avec les policiers ; par contre, en italien cette<br />
description du carabinier comme quelqu’un qui arrive trop tard n’est pas lexicalisée. La<br />
culture ‘cultivée’ française a donc retenu ce trait et l’a inscrit en langue ; ce que la culture<br />
‘quotidienne’ italienne n’a pas enregistré et n’a pas transmis en langue.<br />
andàre 1 v.intr.<br />
andare a Canossa, (umiliarsi) aller à Canossa. [G]<br />
Cette locution, historiquement fondée, a une valeur culturelle certaine. L’écho de cet<br />
événement de 1077, décisif pour l’avenir de l’Europe, retentit dans cette expression<br />
italienne et dans sa traduction littérale française.<br />
Les exemples que nous avons cités ci-dessus nous paraissent montrer des valeurs culturelles<br />
précises : ils se rattachent à des univers de valeurs, à des faits historiques ou à des héritages<br />
artistiques. La langue se fait dès lors porteuse de cette dimension, tandis que les écarts<br />
aident à la rendre plus visible et saillante.<br />
Les noms déposés<br />
Le traitement des noms déposés de la part des DB soulève des questions intéressantes sur<br />
le plan culturel aussi. Tout d’abord, nous remarquons que, d’après notre corpus, le<br />
signalement de ces mots n’est pas homogène, ainsi que l’exemple ci-dessous le montre :<br />
pour deux dictionnaires sur quatre seulement, abribus est un nom déposé.<br />
abribus ® s. m. inv.<br />
pensilina (alle fermate degli autobus). [B]<br />
abribus n.m.<br />
fermata (f.) d’autobus con gabbiotto. [G]<br />
abribus ® s.m.<br />
209 Essere un carabiniere, fare il carabiniere.<br />
137
pensilina [HP].<br />
abribus s.m.<br />
pensilina. [SL]<br />
Dans le cas précédent, les équivalents proposés sont les mêmes, sauf pour G qui choisit<br />
une périphrase. Examinons maintenant le cas d’un autre lemme, audimat.<br />
audimat ® s. m.<br />
(tv) auditel ® . [B].<br />
audimat ® n.m.<br />
apparecchio per misurare l’indice d’ascolto; (estens.) indice d’ascolto: ces émissions font de<br />
l’audimat, queste trasmissioni hanno un alto indice d’ascolto. [G]<br />
audimat ® m.<br />
auditel : record d’audimat, record d’ascolto. [HP]<br />
audimat s.m. (TV)<br />
1 (audimètre) auditel<br />
2 (estens) (audience) audience : course à l’audimat, corda all’audience. [SL]<br />
Nous avons tous les cas de figure possibles : B, G et HP marquent audimat comme nom<br />
déposé, mais seulement B le traduit par un autre nom déposé italien (auditel), trouvant ainsi<br />
un équivalent dénotatif culturel ; G traduit encore par une circonlocution ; HP traduit par<br />
auditel comme B, mais ne le marque pas comme nom déposé. SL, par contre, ne marque ni<br />
le lemme ni l’équivalent. Les choix de B, HP et SL sont plutôt acclimatants, dans la direction<br />
d’une transposition culturelle, alors que G opte pour une stratégie altérisante, attribuant à<br />
l’entrée un statut plus exotique.<br />
aide-mémoire m.inv.<br />
bignami ® . [HP]<br />
Voici un cas assez anomal, où l’équivalent choisi est une marque déposée alors que l’entrée<br />
ne l’est pas. Il aurait pu être résolu différemment ; par exemple G traduit bigino, qui est un<br />
équivalent tout à fait acceptable.<br />
alpax ® n.m.<br />
(metall.) silumin. [G]<br />
alpax s. m.<br />
(metall.) alpax. [B]<br />
138
alpax s.m.<br />
(Met) silumin. [SL]<br />
Restons sur la traduction de cette catégorie de lexèmes. Avec alpax nous sommes en<br />
présence d’un terme de métallurgie ; seulement G note qu’il s’agit d’une marque déposée<br />
mais, ce qui est plus frappant, c’est la divergence dans la traduction. D’après un examen des<br />
monolingues français et italien, silumin ne nous paraît pas un équivalent correct car ce mot<br />
désigne un alliage d’aluminium et de magnésium (ou silicium), alors que l’alpax est « un<br />
alliage d’aluminium et de silicium affiné » (PR11). Nous voyons donc que les écarts peuvent<br />
se glisser aussi dans les langues de spécialité.<br />
aspirine ® f.<br />
aspirina; un comprimé, cachet d’aspirine una compressa d’aspirina; prenez deux<br />
aspirines prenda due aspirine; être blanc comme un cachet d’aspirine sembrare una<br />
mozzarella. [HP]<br />
Ce dernier cas montre un nom propre (une marque déposée) qui devient un nom commun,<br />
ou presque, comme le témoigne la locution être blanc comme un cachet d’aspirine. A propos de<br />
ce même exemple, FOURMENT BERNI-CANANI (2000 : 241) fait remarquer que, à cause de<br />
cette comparaison passée dans l’usage courant, les mots aspirine et aspirina « présentent un<br />
déséquilibre ». Nous sommes donc en présence de deux mots qui paraissent avoir un statut<br />
différent en français et en italien ; la productivité de aspirine est telle que ce mot est de plus<br />
en plus perçu comme un nom commun, alors que le statut de ‘nom de marque’ est encore<br />
dominant pour l’italien aspirina.<br />
La dimension pragmatique<br />
La dimension pragmatique concerne le rapport des signes avec le contexte, elle fait entrer<br />
en jeu la composante communicative. Le dictionnaire qui donne le plus d’attention à cette<br />
dimension est sans aucun doute SL, comme nous le montrerons par les exemples suivants.<br />
Nous rappelons également la notion de pragmatème 210 , élaborée par MEL’CUK et reprise par<br />
A. FARINA : il s’agit de mots ou expressions dont le « sens ou celui de leurs composants<br />
lexicaux est secondaire par rapport à la situation de communication dans laquelle ils sont<br />
généralement prononcées » (FARINA 2009 : 249). Voici quelques échantillons qui montrent<br />
la dimension pragmatique à l’œuvre.<br />
agence s.f.<br />
agences s’abstenir, no agenzie.<br />
ah s.m.inv.<br />
210 Cf. infra, I.9.<br />
139
ah bon: 1 (tant mieux) perfetto, bene: il est venu - ah bon! è venuto - perfetto!; 2 (ton résigné)<br />
peccato: ils n’en ont plus en magasin - ah bon! non ne hanno più in negozio - peccato!; 3<br />
(c’est vrai?) davvero?, ah sì?: il va se présenter aux élections - ah bon? si presenterà alle<br />
elezioni - davvero?<br />
aimer v.tr,<br />
il m’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie (en effeuillant une fleur) m’ama,<br />
non m’ama 211 .<br />
aller 1 v.intr.<br />
allez (o allons): 1 (pour encourager) su, avanti, dai: allez, un petit effort avanti, un piccolo<br />
sforzo; allez, ne pleure plus dai, non piangere più; allons, pose cette arme! avanti, posa<br />
quell’arma; 2 (en quittant qqn) bene: allez, je m’en vais! bene, vado!; 3 (exprime l’exaspération)<br />
ma insomma, ma andiamo: zut, j’ai cassé un verre! - et allez (donc), le troisième en un mois!<br />
uffa, ho rotto un bicchiere! - ma insomma, è il terzo in un mese!; allons donc! (tu exagères)<br />
ma andiamo!<br />
amour s.m.<br />
à vos amours!: 1 (pour trinquer) salute!; 2 (après un éternuement) salute!<br />
appeler v.<br />
(colloq) ça s’appelle reviens si chiama Pietro: tu me prêtes ton stylo? - d’accord, mais il<br />
s’appelle reviens mi presti la penna? - certo ma si chiama Pietro.<br />
attention s.f.<br />
attention chien méchant attenti al cane 212<br />
attention peinture fraîche vernice fresca<br />
attention, travaux attenzione, lavori in corso<br />
Dans le cas d’agence et attention, nous avons des énoncés réels, tirés de la presse ou de<br />
panneaux qu’on peut trouver au quotidien, avec leurs équivalences ‘en contexte’. Ah bon,<br />
allez et à vos amours sont des interjections (des « mots-phrases ») décrites, très<br />
soigneusement, dans leur fonctionnement en discours. Pour il m’aime un peu etc., la<br />
précision « en effleurant la marguerite » est indispensable pour remonter à la situation<br />
d’énonciation ; il en va de même pour l’expression ça s’appelle reviens, qui n’est<br />
compréhensible que dans un échange dialogique tel que celui qui est proposé par SL. Nous<br />
soulignons l’intérêt de cette approche, qui rend compte du fonctionnement des unités en<br />
contexte et les situe au cœur des situations d’énonciation et de communication réelles.<br />
211 G propose la même expression, avec la glose « filastrocca » (refrain).<br />
212 Locution présente dans G aussi.<br />
140
Nous pouvons proposer des échantillons de ces pragmatèmes pour la partie italien-français<br />
aussi (toujours tirés de SL)<br />
aggiornare v.tr.<br />
(Inform) aggiorna (comando di browser), actualiser.<br />
aiuto intz.<br />
(per chiedere soccorso) au secours!, à l’aide!<br />
apparecchio s.m.<br />
(Tel,ant) chi è all’apparecchio? qui est à l’appareil?; rimanga all’apparecchio restez en ligne,<br />
(colloq) ne quittez pas.<br />
astenere v.tr.<br />
astenersi perditempo, pas sérieux s’abstenir.<br />
attendere v.tr.<br />
(assol.) (Tel) patienter: attenda, prego! veuillez patienter!; tutti gli operatori sono occupati, vi<br />
preghiamo di attendere toutes nos lignes sont occupées, veuillez patienter.<br />
augurio s.m.<br />
auguri!: 1 mes meilleurs voeux!, tous mes voeux!; 2 (di buon compleanno) bon anniversaire!,<br />
joyeux anniversaire!; 3 (di buon Natale) joyeux Noël!; 4 (di buon anno) bonne année!; 5 (di<br />
pronta guarigione) tous mes voeux de prompt rétablissement!; 6 (estens) (buona fortuna) bonne<br />
chance! (anche iron).<br />
Dans la liste d’exemples ci-dessus, nous pouvons noter des interjections (aiuto, auguri !), des<br />
énoncés au téléphone (chi è all’apparecchio, attenda, prego !), une locution tirée des petites<br />
annonces (astenersi perditempo) et une commande de logiciel (aggiorna). Notamment, le cas<br />
d’auguri ! avec ses six traductions, en fonction du contexte, est tout à fait remarquable.<br />
Nous croyons que les utilisateurs apprécient des articles pareils, car ils ne les font pas rester<br />
sur leur faim . E. WEIGAND (1998 : 42) remarquait que « the field of contrastive pragmatic<br />
analyses of vocabulary has not yet been settled. This can be seen quite clearly in bilingual<br />
dictionaries that are by no means adapted to language use ». Avec les exemples que nous<br />
avons montrés, SL se montre plutôt attentif à la dimension pragmatique et il fait un pas<br />
important vers cette adaptation à l’utilisation de la langue, qui distingue la compétence de la<br />
performance.<br />
Cette même composante à dominante pragmatique est présente dans les exemples suivants,<br />
tirés de HP : ils se rapportent à des situations de communication (écrite) réelles et ils<br />
possèdent donc une valeur culturelle indéniable.<br />
adeguato agg.<br />
(all’entrata di un luogo pubblico) “si richiede un abbigliamento adeguato” ,“tenue correcte<br />
exigée”.<br />
141
affrancare v.tr.<br />
(su una busta) “non affrancare”, “franchise postale”.<br />
amico n.m.<br />
(su una lettera anonima) “un amico” , “un ami qui vous veut du bien”.<br />
Cette étude de cas, qui a été faite dans le but d’élucider la dimension culturelle relevant de<br />
la relation signes-monde, nous a vu franchir, au fur et à mesure, la frontière entre mot et<br />
énoncé. Dans le chapitre suivant, nous resterons au-delà de cette frontière et nous nous<br />
occuperons des exemples à fonction culturelle.<br />
142
II.1.4 Les exemples à fonction culturelle<br />
Rien n’est plus ‘lexiculturel’ que l’exemple, qu’il soit cité ou forgé<br />
143<br />
PRUVOST (2009b : 148)<br />
Dans ce chapitre nous allons analyser des échantillons tirés des exemples de la lettre A des<br />
quatre dictionnaires de notre corpus, des deux versants : français-italien et italien-français.<br />
Les exemples sont sans aucun doute des occasions privilégiées pour l’apparition de la<br />
dimension culturelle. Ces énoncés doivent satisfaire à plusieurs critères : ils doivent<br />
évidemment être bien formés au point de vue grammatical mais, et c’est ce qui nous<br />
intéresse le plus ici, bien formés au point de vue du contenu aussi. LEHMANN (1995 : 122)<br />
précise très clairement la fonction des exemples : « La fonction première de l’exemple dans<br />
le dictionnaire est [...] d’informer sur le signe, d’en montrer les conditions d’emploi [...]. A<br />
ce titre il renvoie donc au signe et non pas au monde [...]. Mais l’exemple du dictionnaire<br />
est une phrase et il suscite, de ce fait, une autre lecture : il peut être lu comme un énoncé en<br />
usage informant directement sur le monde ».<br />
Nous analyserons les exemples des dictionnaires en tant qu’énoncés relatifs au monde,<br />
soulignant donc leur contenu culturel.<br />
SZENDE (1999) reprend ce même thème, en distinguant clairement la fonction linguistique<br />
de la fonction de ‘commentaire culturel’ :<br />
Two categories of example have to be established. Some simply essentially express the co-<br />
occurrents of the term [...]. The role of the examples of this group is to bring to mind the<br />
linguistic context [...]. The cultural information conveyed by an example can be next to nil if<br />
the example is purely morphologic or syntactic [...]. Another category of examples [...] can be<br />
propositions about the word and refer to the cultural experience of the speakers; they can<br />
truly become cultural commentaries (1999 : 217-218).<br />
LEHMANN (1995 : 123) affirme ensuite la nécessité que l’exemple forgé par le lexicographe<br />
« ne vienne pas gêner le déroulement de l’information proprement linguistique ». Il faut<br />
donc que les énoncés soient en accord avec les valeurs de vérité propres au systèmes<br />
sémio-culturel de la (des) société(s) dont il est question : le contenu propositionnel des<br />
exemples doit être intégré dans la culture au point qu’il passe inaperçu. LEHMANN observe<br />
également ce fait (1995 : 124): « il arrive que le lexicographe exprime, par le biais des<br />
exemples forgés, des choix culturels et idéologiques qui lui soient propres et qu’il dévoile sa<br />
personnalité. Ceci s’observe en particulier dans le traitement des thèmes ‘sensibles’, objet de<br />
prises de position idéologiques ».
Ou, dans les mots de SZENDE (1999) :<br />
Examples form an ensemble of assertions about the world. They involve the ideology of a<br />
community, but also personal ways to judge the world. When lexicographers select or make<br />
up examples, their sense of ethics and aesthetics necessarily comes into play [...]. The<br />
lexicographer must avoid examples which are embarassing or delicate due to their potential<br />
political or ideological incidences. (1999 : 219).<br />
Nous verrons plus bas si ces choix ‘culturels et idéologiques’ seront visibles dans notre<br />
corpus, et de quelle façon. A titre d’exemple, nous pouvons citer un cas qui ne fait pas<br />
partie de notre échantillonnage, mais que nous croyons très éloquent :<br />
marginal n.m.<br />
emarginato: les homosexuels sont des marginaux, gli omosessuali sono degli emarginati. [G]<br />
Ici, le lexicographe se montre peut-être trop le reflet des attitudes dominantes dans sa<br />
propre culture ; qui plus est, la manifestation de ces attitudes est d’autant plus délicate que<br />
le thème en question est réputé ‘sensible’.<br />
Restons sur la fonction idéologique du dictionnaire. DUBOIS – DUBOIS (1971 :<br />
99) écrivent :<br />
Le dictionnaire, lieu de référence, doit définir ses jugements d’acceptabilité d’après une<br />
norme culturelle 213. Ses assertions sur l’homme doivent lui être communes avec le plus<br />
grand nombre de lecteurs : des formes extrêmement variées d’une culture, le dictionnaire<br />
retient surtout les éléments courants et, par voie de conséquence, les stéréotypes les plus<br />
étroits, les formulations les plus banales, les images d’Epinal, que lui imposent ses lecteurs.<br />
Cette norme culturelle est conforme à l’idéologie de la classe sociale dominante et c’est à elle<br />
que vont se référer les jugements de valeur du dictionnaire.<br />
Le dictionnaire, d’après ce point de vue, s’impose comme ouvrage à la fois démocratique (il<br />
accueille des assertions partagées par le plus grand nombre d’individus) et idéologique (il est<br />
l’expression de la classe dominante). REY confirme explicitement cette vision : « L’exemple<br />
est, dans les dictionnaires développés, la principale tête de pont des idéologies et en général<br />
des jugements de valeurs » (1995 : 113).<br />
DUVAL (2000 : 87), pour sa part, met en lumière un autre aspect pour ainsi dire sémiotique de<br />
l’exemple : « L’exemple a un sémantisme qui se trouve au-delà de son propos immédiat<br />
apparent [...]. L’exemple, par le dialogue implicite qu’il suscite entre rédacteur et lecteur, est<br />
l’élément dynamique de l’article, un lieu privilégié d’humanité ». Ce lieu dictionnairique<br />
appraraît donc dans tout son dynamisme et son ouverture à l’égard de l’univers de<br />
référence. Nous allons voir comment cela se manifeste dans les dictionnaires de notre<br />
corpus.<br />
213 Ce sont les auteurs qui soulignent.<br />
144
La dimension culturelle de l’exemple devient visible également par l’ouverture à<br />
l’extralinguistique. Comme le souligne CELOTTI (1998 : 136), les exemples se révèlent « un<br />
espace significatif d’informations encyclopédiques ». La tentation de l’encyclopédisme est<br />
très forte dans les DB 214 : les exemples, qui devraient en priorité informer sur le<br />
comportement linguistique du signe, ou bien en consigner des usages, repensent leur tâche<br />
et élargissent leur fonction, en donnant des informations sur l’univers de référence. Si nous<br />
considérons cependant indissociable, avec GALISSON, le binôme langue-culture, il faut que<br />
les exemples rendent compte des discours prononcés à l’intérieur d’une culture donnée.<br />
Cette partie de la microstrucure devient donc à juste titre, « one of the devices that can be<br />
used to reconcile language and speech in dictionary entries » (WINTER 1992 : 46).<br />
Une dernière remarque : MARGARITO (2008 : 189) attire notre attention sur deux autres<br />
phénomènes qui peuvent être présents das les exemples, à savoir la « fonction narrative<br />
[où] des personnages, des lieux, des événements sont mis en place en microstructure » et les<br />
« lieux textuels à visée didactique dominante », dont le but est donc celui d’instruire l’usager<br />
avec des contenus culturels. Nous verrons si et comment ces stratégies seront reprises par<br />
les dictionnaires de notre corpus.<br />
Amorçons notre analyse par la partie français-italien. Nous rappelons que nous avons<br />
consulté l’intégralité de la lettre A des quatre dictionnaires du corpus.<br />
214 CELOTTI (1998 : 137) : « Le dictionnaire général bilingue déborde d’encyclopédisme ».<br />
145
II.1.4.1 Direction français-italien<br />
Dictionnaire Boch [B]<br />
D’après notre échantillonnage de la lettre A, nous pouvons remarquer que les exemples de<br />
B sont toujours très génériques et relativement courts. Il y a assez peu de références aux<br />
noms propres, surtout par rapport à ce qu’on verra dans les autres dictionnaires.<br />
Aucune mention de corpus n’est faite dans la préface : il s’agit donc d’exemples forgés,<br />
nous pouvons présumer.<br />
Nous pouvons dégager quelques thèmes et quelques tendances présents dans les exemples<br />
de ce dictionnaire. Tout d’abord, il y a une certaine prédilection pour les thèmes de la<br />
religion, de l’histoire et de l’art.<br />
Les exemples qui concernent la religion se réfèrent à des citations de la Bible (s’abaisser,<br />
appeler), à des épisodes de l’Evangile (apparaître, apparition) ou encore à des textes (acte) ou<br />
des figures (apôtre) du catholicisme.<br />
s’abaisser v. pron.<br />
quiconque s’abaissera sera élevé, chi si umilia sarà esaltato 215 .<br />
acte s. m.<br />
(relig.) les actes des apôtres, gli atti degli apostoli 216 .<br />
apôtre s. m.<br />
l’apôtre des gentils, l’apostolo delle genti (S. Paolo); le prince des apôtres, il principe degli<br />
apostoli (S. Pietro).<br />
apparaître v. intr.<br />
lorsque l’Ange apparut à la Vierge, quando l’Angelo apparve alla Vergine.<br />
apparition s. f.<br />
apparizione: l’appparition de l’ange à la Vierge, l’apparizione dell’angelo alla Vergine.<br />
appelé agg.<br />
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus, molti i chiamati, pochi gli eletti. [référence à l’Evangile<br />
(Mathieu 22,14 217 )]<br />
Nous pouvons comparer ce dernier énoncé à ceux des autres dictionnaires de notre<br />
corpus :<br />
215 La référence à l’Evangile (Luc 14,11) est assez claire.<br />
216 Cet exemple est présent dans la partie italien-français aussi.<br />
217 Citation de la Bible de Jérusalem : « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ».<br />
146
il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus (peu obtiennent le succès dans la compétition), molti<br />
sono i chiamati ma pochi gli eletti. [SL]<br />
La glose entre parenthèse dans SL indique que cet énoncé est sorti de son domaine<br />
sémantique originel pour accéder à un usage beaucoup plus vaste.<br />
(Bibbia) il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti<br />
[G]<br />
La source de la citation est explicitée par G à travers une marque de domaine.<br />
beaucoup seront appelés mais peu seront élus, molti sono i chiamati, ma pochi gli<br />
eletti ! [HP]<br />
Le point d’exclamation dans la traduction fait sortir l’énoncé de sa source textuelle<br />
d’origine (l’Evangile) pour en élargir l’application à d’autres contextes.<br />
Poursuivons dans l’analyse des thèmes abordés par B. Pour ce qui est des exemples<br />
historiques, les échantillons que nous avons répertoriés concernent l’histoire européenne<br />
(alliance, allié, antikomintern) et française (affaire, amener, assermenté).<br />
alliance s. f.<br />
(st.) la Sainte-Alliance, la Santa Alleanza; la Triple Alliance, la Triplice Alleanza.<br />
affaire s. m.<br />
l’affaire Dreyfus, l’affare Dreyfus.<br />
allié s. m.<br />
(st.) les Alliés, gli Alleati (contro la Germania nelle due guerre mondiali).<br />
amener v. tr.<br />
c’est Nicot qui a amené le tabac en Europe, il tabacco è stato introdotto in Europa da<br />
Nicot.<br />
antikomintern agg. inv.<br />
(st.) pacte antikomintern, patto antikomintern.<br />
assermenté agg.<br />
(st. fr.) prêtres assermentés, preti giurati.<br />
Pour l’histoire de l’art, les énoncés se réfèrent à l’art italien (attribuer, attribution) ou français<br />
(autre).<br />
147
attribuer 218 v. tr.<br />
les experts attribuent cette peinture à Raphaël, gli esperti attribuiscono questo dipinto a<br />
Raffaello.<br />
attribution s. f.<br />
sur l’attribution de cette fresque au Tintoret, les avis sont partagés, sull’attribuzione di<br />
questo affresco al Tintoretto, i pareri sono discordi.<br />
autre agg. indef.<br />
Renoir, Degas, Monet et autres impressionnistes, Renoir, Degas, Monet e altri<br />
impressionisti.<br />
D’autres énoncés expriment une vision sur le monde propre aux valeurs humanitaires et du<br />
sens commun. Il s’agit d’exemples ‘classiques’ en ce sens qu’ils sont porteurs d’une certaine<br />
objectivité, d’une vision à laquelle le lecteur peut adhérer sans difficulté aucune.<br />
abomination s. f.<br />
la guerre civile est une abomination, la guerra civile è un abominio.<br />
abréger v. tr.<br />
les excès abrègent la vie, gli eccessi accorciano la vita.<br />
abrutir v. tr.<br />
l’alcool abrutit, l’alcol abbrutisce 219 .<br />
Certains énoncés donnent un aperçu de la société, offrant des stéréotypes sur des<br />
mouvements de protestation.<br />
agitation s. f.<br />
une grande agitation règne chez les métallos, i metalmeccanici sono in grande fermento.<br />
s’agiter v. pron.<br />
les métallos et les cheminots s’agitent, metalmeccanici e ferrovieri si agitano.<br />
Les deux énoncés suivants véhiculent par contre des croyances populaires, plus ou moins<br />
partagées entre France et Italie.<br />
aigrir v. tr.<br />
218 Cf. HP : « on attribue ce tableau à Poussin ».<br />
219 Ce même exemple est présenté par G.<br />
148
le temps orageux a aigri le lait, il temporale ha fatto inacidire il latte.<br />
annonce s. f.<br />
le retour des hirondelles est l’annonce du printemps, il ritorno delle rondini è l’annuncio<br />
della primavera<br />
D’autres exemples méritent des commentaires plus détaillés.<br />
abstème agg. sost.<br />
les abstèmes musulmans, i musulmani che si astengono dal bere alcol.<br />
Cet exemple instaure une implicature conventionnelle, dans le sens de GRICE 220 : il n’affirme pas<br />
que les musulmans ne boivent pas d’alcool, mais il implique cette réalité et y fait allusion.<br />
affoler v. tr.<br />
cette fille affole tous les gars du village, questa ragazza fa perdere la testa a tutti i maschi del<br />
paese.<br />
Nous croyons repérer dans cet exemple une « citation masquée » (GALISSON 1995b : 106) :<br />
s’agit-il de la Brave Margot de la chanson de G. Brassens, où « tous les gars du village »<br />
admirent la jeune fille ? Il y a un écho, sans doute inconscient, propre des palimpsestes<br />
verbaux 221 .<br />
ami s. m.<br />
maintenant qu’elle a un petit ami …, ora che si è fatta il ragazzo …<br />
Comme le remarque FOURMENT BERNI-CANANI (2003b : 95), le « recours privilégié de<br />
l’italien [à l’article] défini [signale] la manifestation d’une vision particulière du réel, de<br />
l’organisation de la vie et des rapports humains qui s’écarte sensiblement de celle d’un<br />
francophone ». En particulier, dans un cas comme « si è fatta il ragazzo », « l’italien donne à<br />
la fiancée [ou au fiancé] une place et un rôle institutionnels qui fonctionnent comme une<br />
présupposition reconnue par l’ensemble de la collectivité » (ibid.). Voici donc un cas<br />
éloquent où un fait linguistique, mieux un écart linguistique (article indéfini en français vs<br />
article défini en italien) est « en étroit rapport avec la culture entendue comme<br />
représentation du monde (FOURMENT BERNI-CANANI 2003b : 96).<br />
arroser v. tr.<br />
220 P. GRICE (1975), « Logic and conversation », in P. COLE – J.L. MORGAN (éds.), Syntax and Semantics, Vol. 3,<br />
Speech Acts, New York : Academic Press, p. 41–58.<br />
221 Pour une étude de cette notion, voir GALISSON (1995b).<br />
149
si vous n’arrosez pas quelque gros bonnet, vous n’obtiendrez rien, se non unge qualche<br />
pezzo grosso, non otterrà nulla.<br />
C’est de la pratique de la corruption dont il est question ici, avec une certaine légèreté.<br />
Examinons comment les autres dictionnaires traitent ce thème, s.v. arroser.<br />
arroser un client, (fam.) offrire da bere a un cliente (per tenerselo buono) [G]<br />
toutes les entreprises de la région ont été arrosées par le candidat, tutte le aziende<br />
della regione hanno avuto bustarelle dal candidato. [HP]<br />
il avait arrosé des notables, aveva corrotto i notabili [SL]<br />
Pour G, les pots-de-vin sont versés à un partenaire commercial ; SL implique dans l’affaire<br />
des gros bonnets ; HP met en évidence un thème encore plus délicat, si possible : la<br />
corruption politique. Et, par-dessus le marché, il s’agit dans l’exemple d’une pratique<br />
généralisée qui est évoquée sans marques de désapprobation. Un thème sensible est donc<br />
évoqué sans aucune prise de position critique de la part du lexicographe.<br />
autre pron. indef.<br />
l’un dans l’autre, nous dépensons mille euros par mois, in media, spendiamo mille euro al<br />
mese 222 .<br />
Cet exemple est ‘sensible’ dans la mesure où le lexicographe a dû trouver une juste mesure<br />
dans l’expression du montant dépensé par les sujets énonciateurs. Un chiffre trop réduit ou<br />
trop élevé aurait été invraisemblable ou aurait pu choquer le lecteur et le distraire d’une<br />
appréhension ‘au premier degré’ de l’exemple. Nous allons revenir sur cette notion de<br />
degré dans la conclusion de ce chapitre.<br />
222 Cf. HP « pourriez-vous m’avancer 500 euros sur mon salaire? potrebbe anticiparmi 500 euro sullo<br />
stipendio ? », s.v. avancer.<br />
150
Dictionnaire Garzanti [G]<br />
Passons maintenant à l’analyse des exemples à fonction culturelle dans G. Ainsi que pour<br />
B, aucune mention de corpus n’est faite dans la présentation ; nous pouvons donc<br />
présumer qu’il s’agit toujours d’exemples forgés.<br />
Dans ce dictionnaire, les références les plus fréquentes concernent l’histoire (dix-neuf<br />
exemples). L’histoire européenne compte huit exemples, l’histoire française huit, l’histoire<br />
non européenne deux (adorer, assises), l’histoire italienne un seulement (ardéatine).<br />
abbé n.m.<br />
(st.) abbé de cour, abatino (che frequentava i salotti nel XVII e XVIII secolo).<br />
abîmer v.tr.<br />
Condé abîma l’infanterie espagnole à Rocroi, Condé sbaragliò la fanteria spagnola a Rocroi.<br />
adorer v.tr.<br />
les Aztèques adoraient le soleil, gli Aztechi adoravano il sole.<br />
affaire n.f.<br />
(st.) l’affaire Dreyfus, il caso Dreyfus 223 .<br />
aide 1 n.f.<br />
(st.) Cour des aides, tribunale per le cause civili e penali in materia fiscale.<br />
aigle n.m.<br />
l’aigle noir de Prusse, l’aquila nera di Prussia.<br />
aîné agg.<br />
la fille aînée de l’Eglise, la figlia primogenita della Chiesa (la Francia).<br />
alliance n.f.<br />
(st.): Sainte Alliance, Santa Alleanza 224 ; Triple Alliance, Triplice Alleanza.<br />
allié<br />
les Alliés, gli Alleati (della seconda guerra mondiale) 225 .<br />
s’allier v.pron.<br />
l’Italie s’allia à (o avec) la France, l’Italia si alleò alla Francia.<br />
an n.m.<br />
223 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
224 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
225 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
151
(st.) la guerre de Trente ans, la guerra dei Trent’anni (1618-1648).<br />
annonciade n.f.<br />
(st.) Ordre de l’Annonciade, Ordine della SS. Annunziata.<br />
arbre n.m.<br />
(st. fr.) arbre de la liberté, albero della libertà 226 .<br />
ardéatine agg.<br />
(st.) Fosses ardéatines, Fosse ardeatine.<br />
assises n.f.pl.<br />
(st.) les Assises de Jérusalem, le Assise di Gerusalemme.<br />
aulique agg.<br />
(st.) Conseil aulique, Consiglio aulico.<br />
avènement n.m.<br />
la Révolution française marque l’avènement d’une ère nouvelle, la Rivoluzione francese<br />
segna l’avvento di una nuova era.<br />
l’avènement de Charles V, l’ascesa al trono di Carlo V.<br />
axe n.m.<br />
(pol.) l’axe Rome-Berlin, l’asse Roma-Berlino 227 .<br />
La littérature est également bien representée, avec notamment des références à la France<br />
(accuser, âge, après) ou à d’autres traditions littéraires (acte, apprivoiser, autant).<br />
accuser v.tr.<br />
Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage (J. DE LA FONTAINE) 228 , Chi vuole annegare il<br />
proprio cane lo accusa di rabbia.<br />
acte 2 n.m.<br />
une pièce en un (seul) acte de Tchekov [sic], un atto unico di Cechov.<br />
âge n.m.<br />
l’âge d’or de la littérature française est le XVII e siècle, il periodo d’oro della letteratura<br />
francese è il Seicento.<br />
226 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
227 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
228 Citation apocryphe, en réalité la source est MOLIERE, Les femmes savantes, II, 5.<br />
152
après prep.<br />
ce film est d’après le roman de Duras, il film è tratto dal romanzo della Duras.<br />
apprivoiser v.tr.<br />
(lett.) la Mégère apprivoisée, la Bisbetica domata.<br />
autant avv.<br />
‘Autant en emporte le vent’, ‘Via col vento’ (titolo del romanzo di M. Mitchell).<br />
La religion est moins présente que dans B, si l’on veut faire une comparaison avec un autre<br />
dictionnaire, à maints égards assez proche de G. Nous n’avons relevé que les trois<br />
exemples suivants.<br />
abattre v.tr.<br />
Dieu abat les puissants, Dio umilia i potenti.<br />
acte n.m.<br />
(st. relig.) les Actes des apôtres, gli atti degli Apostoli 229 .<br />
alliance n.f.<br />
(relig.) Ancienne Alliance, antica alleanza (giudaismo); Nouvelle Alliance, nuova alleanza<br />
(cristianesimo).<br />
D’autres exemples évoquent des réalités géographiques, françaises (au-dessus, aérospatial),<br />
francophones (atlantique), italiennes (abord) au même asiatiques (au-dessus).<br />
abord n.m.<br />
les abords de Florence sont célèbres, i dintorni di Firenze sono celebri.<br />
au-dessus avv.<br />
au-dessus du 38° parallèle, a nord del 38° parallelo 230 .<br />
l’Oise se jette dans la Seine au-dessus de Rouen, l’Oise si getta nella Senna a monte di<br />
Rouen.<br />
aérospatial n.m.<br />
Toulouse, capitale de l’aérospatial, Tolosa, capitale delle ricerche aerospaziali.<br />
atlantique agg.<br />
229 Cet exemple est présent dans la partie italien-français aussi.<br />
230 Il s’agit de la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud.<br />
153
(Canada) les Provinces atlantiques, le Province atlantiche (Terranova e le province<br />
marittime).<br />
En ce qui concerne l’art, les exemples répertoriés concernent les arts figuratifs (adjuger,<br />
après) et des techniques de fabrication (achèvement).<br />
achèvement n.m.<br />
dans la cathédrale de Chartres l’art de vitrail a atteint son achèvement, l’arte della<br />
fabbricazione delle vetrate ha raggiunto nella cattedrale di Chartres la sua massima<br />
espressione.<br />
adjuger v.tr.<br />
un tableau de Renoir avait été adjugé pour 1.500.000 francs, un quadro di Renoir era stato<br />
aggiudicato per 1.500.000 franchi.<br />
après prep.<br />
un dessin d’après Raphaël, un disegno alla maniera di Raffaello.<br />
La nourriture et les boissons constituent sans aucun doute des éléments de culture au<br />
même titre que l’art, les traditions ou les institutions. Comme le dit CIORAN, « on ne saurait<br />
surestimer l’importance de la gastronomie dans la vie d’une collectivité » 231 . D’après notre<br />
échantillonage, deux énoncés témoignent de cet aspect culturel, pour ce qui est de la<br />
préparations des mets (accommoder) et des bienfaits d’une boisson extrêmement populaire<br />
(aider).<br />
accommoder v.tr.<br />
les asperges s’accommodent au beurre fondu, gli asparagi si servono col burro fuso.<br />
aider v.intr.<br />
un bon café aide à la digestion, un buon caffè favorisce la digestione<br />
Revenons à la dimension encyclopédique proprement dite. Nous avons repéré deux<br />
exemples qui concernent la mythologie classique :<br />
animer v.tr.<br />
Prométhée anima une statue d’argile, Prometeo animò una statua di argilla.<br />
attribut n.m.<br />
le trident était l’attribut de Neptune, il tridente era l’attributo di Nettuno.<br />
231 Citation de PR11, s.v. gastronomie.<br />
154
La politique compte elle aussi deux exemples, qui se rapportent au contexte européen.<br />
atlantique agg.<br />
(pol.) Pacte Atlantique, Patto Atlantico.<br />
autonomiste n.m. e f.<br />
les autonomistes basques, gli autonomisti baschi.<br />
Pour terminer, la musique compte un seul exemple, avec la référence à un célèbre opéra<br />
italien.<br />
air 1 n.m.<br />
le grand air de la Tosca, l’aria principale della Tosca.<br />
Après ce passage en revue des exemples proprement encyclopédiques, nous analysons<br />
maintenant des énoncés à dominante didactique, toujours dans le dictionnaire Garzanti, qui<br />
véhiculent des impératifs sociaux ou des règles pour la santé. Nous avons vu dans la<br />
première partie de notre thèse comment le dictionnaire offre une « pédagogie des formes »<br />
(REY – <strong>DEL</strong>ESALLE 1979 : 6) ; ces exemples nous montrent comment une ‘pédagogie des<br />
contenus’ est également mise en œuvre par le dictionnaire. Il s’agit d’énoncés qui<br />
concernent la santé (absorber, affecter), les bonnes mœurs (avant) ou le civisme (auto-justice).<br />
absorber v.tr.<br />
il ne faut pas absorber trop de médicaments, non bisogna ingerire troppe medicine.<br />
affecter 3 v.tr.<br />
le tabac affecte gravement l’organisme, il tabacco mina l’organismo.<br />
auto-justice n.f.invar.<br />
il faut aviser les citoyens des risques de l’auto-justice, bisogna rendere consapevoli i cittadini<br />
dei rischi di farsi giustizia da sé.<br />
avant 1 prep.<br />
les dames passent avant, le signore hanno la precedenza.<br />
Nous avons pu repérer aussi quelques exemples qui dessinent des scénarios assez élaborés.<br />
Essayons de voir dans le détail de quoi il s’agit. Dans le premier exemple (acheter), il est<br />
question d’un certain nationalisme, témoigné par la locution « achetez français ». Le<br />
deuxième exemple (arroser) montre une attitude polémique contre la télévision (un thème<br />
qui sera repris également par SL, nous le verrons). Le troisième exemple (assassiner), à<br />
155
caractère politique, a un côté narratif évident ; il faut aussi remarquer que la responsabilité<br />
de l’action criminelle retombe sur une figure marginale par excellence (un anarchiste), qui ne<br />
participe pas au débat démocratique et qui est idéologiquement condamné, en quelque<br />
sorte. « L’idéologie de la classe dominante » constitue bien la « norme culturelle du<br />
dictionnaire », comme nous rappellent DUBOIS – DUBOIS (1971: 99). Le contenu du dernier<br />
exemple (attendre) est malheureusement périmé (le service militaire obligatoire ayant été<br />
aboli aussi bien en France qu’en Italie), mais il rend compte d’une situation réelle qui se<br />
vérifiait souvent parmi les jeunes.<br />
acheter v.tr.<br />
achetez français!, (linguaggio pubblicitario) comprate prodotti francesi!<br />
arroser v.tr.<br />
la télé nous arrose de publicité, la televisione ci bombarda di pubblicità.<br />
assassiner v.tr.<br />
le président fut assassiné par un anarchiste, il presidente fu assassinato da un anarchico.<br />
attendre v.tr.<br />
en attendant de faire son service, il travaille avec son père, nell’attesa di fare il servizio<br />
militare lavora con suo padre.<br />
Les deux derniers exemples que nous citons se réfèrent au phénomène du stéréotype 232 et, à<br />
la fois, touchent des thèmes sensibles comme l’âgisme et le sexisme. Ces deux courtes<br />
phrases nous montrent des contextes d’usage des mots acariâtre et aigri : le message sousjacent<br />
à cette lecture, c’est que l’âge peut rendre quelqu’un acariâtre et aigri 233 ; par-dessus le<br />
marché, le fait de ne pas se marier peut contribuer à l’aigreur des femmes.<br />
acariâtre agg.<br />
elle est devenue acariâtre avec l’âge, si è inacidita con gli anni.<br />
aigri agg.<br />
une vieille fille aigrie, una zitella inacidita.<br />
232 Pour une analyse des stéréotypes en lexicographie, voir DUFAYS (1991).<br />
233 Une image qui contraste avec d’autres représentation de la vieillesse, comme une époque de sagesse et de<br />
sérénité. Les traditions classiques occidentales et orientales abondent d’exemples dans ce sens.<br />
156
Dictionnaire Hachette-Paravia [HP]<br />
Nous pouvons lire dans la Note de l’éditeur de HP que ce dictionnaire s’inspire<br />
du riche matériel fourni par la maison d’édition Hachette qui en a fait usage précédemment<br />
pour la réalisation de son Dictionnaire Hachette-Oxford [...]. La phraséologie puisée par l’éditeur<br />
français dans un vaste corpus de textes traités informatiquement a été reprise dans la partie<br />
français-italien du Hachette-Paravia, lui garantissant non seulement une grande richesse<br />
d’exemples, mais aussi une pleine adéquation avec le français tel qu’il est parlé et écrit<br />
aujourd’hui (HP : 3).<br />
Il y a donc, pour la première fois, la mention d’un corpus d’où les exemples sont puisés.<br />
Nous verrons si ce facteur aura des conséquences dans la prise en compte de la dimension<br />
culturelle.<br />
Nous pouvons dire tout d’abord que les traits encyclopédiques sont beaucoup moins<br />
présents que dans B et G.<br />
Pour HP aussi, nous commençons par énumérer les exemples à dominante historique.<br />
L’histoire française est représentée par trois exemples (Albigeois, appel, autrefois) ; l’histoire<br />
européenne par deux (armada, armée), l’histoire mondiale par un exemple seulement<br />
(agression).<br />
agression f.<br />
l’agression japonaise contre les États Unis, l’aggressione giapponese contro gli Stati<br />
Uniti 234 .<br />
Albigeois m. STOR.<br />
croisade contre les Albigeois, crociata contro gli albigesi.<br />
appel m<br />
STOR. l’appel du 18 juin, l’appello del 18 giugno 235 .<br />
armada f.<br />
STOR. l’Invincible Armada, l’Invincibile Armata 236 .<br />
arméé m.<br />
STOR. l’Armée rouge, l’Armata rossa 237 .<br />
autrefois avv.<br />
234 Il s’agit évidemment de l’épisode de Pearl Harbor, qui a eu lieu en 1941. Cet exemple est repris dans la<br />
direction italien-français.<br />
235 Il s’agit du discours prononcé par De Gaulle à la radio de Londres en 1940.<br />
236 Cet exemple est repris dans la partie italien-français.<br />
237 Cet exemple est repris dans la partie italien-français.<br />
157
autrefois, quand Paris s’appelait Lutèce, anticamente, quando Parigi si chiamava<br />
Lutezia.<br />
Pour ce qui est des autres exemples à caractère encyclopédique, nous avons repéré deux<br />
énoncés qui se réfèrent à la religion (autre), et un chacun pour la géographie (actuel), le<br />
cinéma (avec) et les bandes dessinées (aventure).<br />
actuel agg.<br />
l’actuel territoire de la Pologne, l’attuale territorio della Polonia 238 .<br />
autre pron.indef.<br />
« aimez-vous les uns les autres » , « amatevi l’un l’altro ».<br />
mon livre préféré n’est autre que la Bible, il mio libro preferito è solo, proprio la Bibbia.<br />
aventure f.<br />
les aventures de Tintin et Milou, le avventure di Tintin e Milou.<br />
avec prep.<br />
(interprété par) “Le Quai des Brumes” avec Jean Gabin, “Il porto delle nebbie” con Jean<br />
Gabin.<br />
Les exemples suivants montrent encore des références à l’extralinguistique : ils donnent des<br />
renseignements sur la vie (appartement) et le droit (assimilable) français ou sur le sport<br />
(avantage, avoir).<br />
appartement m.<br />
de nombreux parisiens [sic] vivent en appartement, numerosi parigini vivono in<br />
appartamento.<br />
assimilable agg.<br />
les résidents étrangers sont assimilables aux nationaux français du point de vue<br />
fiscal, i residenti stranieri sono equiparabili ai cittadini francesi dal punto di vista fiscale.<br />
avantage m.<br />
« Avantage, Ederer », « Vantaggio Ederer » 239 .<br />
avoir tr.<br />
238 Exemple sans doute mal choisi, car l’intégralité territoriale de la Pologne remonte à la fin de la deuxième<br />
guerre mondiale et à l’application des accords de Yalta.<br />
239 Simple coquille pour Federer, sans doute. Dans l’édition précédente de HP, on pouvait lire « avantage,<br />
Leconte ».<br />
158
l’équipe de Marseille nous a eus, il Marsiglia ci ha battuti.<br />
Nous attirons l’attention sur cet autre exemple, qui situe l’énoncé dans l’actualité par la<br />
référence à la maladie de la vache folle.<br />
abattage m.<br />
abattage de 500 vaches atteintes de la maladie de la vache folle, abbattimento di 500<br />
mucche colpite dalla malattia della mucca pazza.<br />
Nous nous attardons maintenant sur deux exemples, que nous considérons périmés, à titre<br />
différent.<br />
Le premier concerne l’ex-tennisman Henri Leconte 240 ; cet énoncé inscrit l’athlète dans le<br />
réservoir des connaissances partagées par les lecteurs. Il s’agit d’un exemple qui risque de<br />
vieillir vite241, malheureusement, malgré l’emploi de l’imparfait. Le deuxième exemple<br />
également est périmé, dans la mesure où le mark a été remplacé par l’euro en 2002, comme<br />
chacun le sait.<br />
absent m.<br />
le grand absent du tournoi, Leconte, était tombé malade la veille, Leconte, il grande<br />
assente del torneo, si era ammalato il giorno prima.<br />
accrocher tr.<br />
accrocher le dinar au mark, agganciare il dinaro al marco.<br />
Plusieurs exemples manifestent une attitude de condamnation du tabagisme 242 , se rattachant<br />
donc à la dimension pédagogique, que nous avons dèjà évoquée pour B et G. Comme<br />
l’affirment REY – <strong>DEL</strong>ESALLE (1979 : 14) : « l’univers du discours des exemples forgés<br />
permet de déceler des fragments d’idéologie à travers le projet didactique, et même<br />
l’univers mental du rédacteur ».<br />
240 Né en 1963.<br />
241 LO NOSTRO confirme (2009: 231) qu’« il y a un risque élevé à introduire des éléments rapidement<br />
périmés ».<br />
242 Paradoxalement, cet autre exemple de HP renverse la perspective, s.v. ange : « va me chercher mes<br />
cigarettes, tu seras un ange! mi vai a prendere le sigarette? sei un tesoro! ».<br />
159
s’abstenir pronom.<br />
les participants sont priés de s’abstenir de fumer, i partecipanti sono pregati di non<br />
fumare.<br />
affolant agg.<br />
il fume trois paquets par jour, c’est affolant! fuma tre pacchetti al giorno, è spaventoso.<br />
asphyxier tr.<br />
tu nous asphyxies avec ta fumée de cigarette! ci asfissi col fumo della tua sigaretta!<br />
D’autres énoncés mettent en garde contre les risque de la consommation de produits<br />
dangereux ou d’une sur-exposition aux images télévisées.<br />
s’abstenir pronom.<br />
abstenez-vous de café, rinunciate al caffè<br />
agresser tr.<br />
les images télévisées nous agressent, le immagini televisive ci aggrediscono.<br />
Les exemples suivants demandent des considérations plus détaillées.<br />
abus m.<br />
il a été fait un abus systématique du droit de grève, si è fatto un abuso sistematico del<br />
diritto allo sciopero.<br />
Tout en restant très général, cet exemple est controversé dans la mesure où il peut<br />
connoter politiquement l’instance énonciative.<br />
apothéose f.<br />
IRON. l’arrivée de ma belle-mère a été l’apothéose! l’arrivo di mia suocera è stata la<br />
ciliegina sulla torta!<br />
160
Cet énoncé montre des traces des prédiscours, au sens de PAVEAU (2006). Pour saisir le<br />
sens de l’énoncé, il faut savoir que les belles-mères sont perçues dans l’imaginaire collectif<br />
comme des personnages agaçants ; il paraît que cette représentation est partagée par les<br />
langues-cultures française et italienne, ce qui rend plus compréhensible l’énoncé pour les<br />
utilisateurs.<br />
s’agir pronom.impers.<br />
quand il s’agit de faire le ménage, il n’est jamais là! quando si tratta di fare le pulizie,<br />
non c’è mai!<br />
Cet autre énoncé nous fait entrer dans la dynamique d’un couple où les tâches ménagères<br />
ne sont pas réparties de façon équitable. Il s’agit d’un exemple qui peut être sans doute lu<br />
comme symptôme d’une revendication ironique.<br />
allègrement avv.<br />
elle est partie allègremement au Népal è partita per il Nepal come se niente fosse.<br />
Dans ce cas, l’exemple implique 1) la connaissance du référent ; 2) la conscience qu’il s’agit<br />
d’une destination exotique et difficile. L’exemple ne fonctionne que dans la mesure où les<br />
points 1) et 2) ne posent pas problème au lecteur.<br />
161
Le dictionnaire Sansoni Larousse [SL]<br />
Le dictionnaire Sansoni Larousse est le seul qui ne dérive pas d’une mise à jour ou d’une<br />
refonte d’un ouvrage précédent. En ce qui concerne le corpus d’où sont tirés les exemples,<br />
aucune mention n’est faite : nous pouvons donc supposer qu’il s’agit entièrement<br />
d’exemples forgés par les lexicographes.<br />
Ce dictionnaire présente une véritable panoplie de références encyclopédiques et<br />
culturelles.<br />
Il ne faut pas oublier que SL est le seul, parmi les dictionnaires de notre corpus, à ne pas<br />
avoir de notes culturelles. Nous pouvons faire l’hypothèse que ce manque est comblé par<br />
une insistance sur les aspects culturels dans la microstructure. Et ce, à travers des exemples<br />
que nous pouvons classer dans plusieurs catégories.<br />
Dans SL, l’isotopie textuelle (si nous pouvons employer ce terme de linguistique<br />
structurale) la plus évidente concerne les scénarios culturels.<br />
Voici quelques énoncés qui tracent des scénarios modernes, où par exemple une femme est<br />
chef d’entreprise :<br />
abdiquer v.intr.<br />
elle n’abdiquera jamais devant les syndicats, non desisterà mai davanti ai sindacati.<br />
Ou encore, cet exemple restitue l’image d’une femme qui prend des décisions en<br />
autonomie.<br />
abnégation s.f.<br />
elle a arrêté de travailler et s’est consacrée à ses enfants avec abnégation, ha smesso di<br />
lavorare e si è dedicata ai figli con abnegazione.<br />
Dans cet autre cas, tout n’est pas dit dans l’exemple : il s’agit d’une autre implicature<br />
conventionnelle, que l’on peut saisir seulement à travers une connaissance préalable<br />
(extralinguistique) du fait que les placements d’argent en Suisse sont rentables.<br />
assurer v.tr.<br />
en plaçant cet argent en Suisse il a assuré ses arrières, investendo il denaro in Svizzera ha<br />
provveduto alla propria vecchiaia.<br />
D’autres énoncés montrent un ancrage à l’extralinguistique assez fort, offrant des<br />
descriptions de coutumes, mœurs ou tendances sociales (s’abreuver, adepte, s’agiter, aider,<br />
atavisme) ou des points de vue partagés (âge, asphyxie). Ces exemples sont culturels dans la<br />
162
mesure où leur contenu n’est compréhensible que dans le cadre d’un système de valeurs ou<br />
de connaissances communes.<br />
s’abreuver v.prnl.<br />
après le match de foot, les supporters sont allés s’abreuver dans un pub, dopo la partita di<br />
calcio, i tifosi sono andati a sbevazzare in un pub.<br />
adepte s.m./f.<br />
le taï chi a fait de nombreux adeptes, il tai ji ha fatto numerosi adepti.<br />
âge s.m.<br />
la quarantaine, c’est l’âge des grandes décisions, la quarantina è l’età delle grandi decisioni.<br />
il veut se marier, c’est normal, il a l’âge vuole sposarsi, è normale, ha l’età; je n’ai plus l’âge<br />
d’aller en boîte tous les jours, non ho più l’età per andare in discoteca tutti i giorni.<br />
(colloq) âge bête età stupida: 15 ans, c’est l’âge bête! 15 anni, è un’età stupida!<br />
je ne suis plus d’âge à faire du camping, non ho più l’età per andare in campeggio.<br />
ils ne sont pas en âge de se marier, non hanno l’età per sposarsi; je ne suis plus en âge<br />
d’aller danser, non ho più l’età per andare a ballare.<br />
on a l’âge de ses artères abbiamo l’età delle nostre arterie, per vivere a lungo bisogna<br />
salvaguardare le arterie.<br />
s’agiter v.prnl.<br />
les classes ouvrières commencent à s’agiter. le classi operaie cominciano ad agitarsi.<br />
aider v.<br />
entre femmes, il faut s’aider tra donne, bisogna aiutarsi.<br />
(colloq) avoir un père richissime, ça aide avere un padre ricchissimo aiuta.<br />
(colloq) avec un père alcoolique et une mère dépressive, il n’est pas aidé! con un padre<br />
alcolizzato e una madre depressa, non è facile!<br />
asphyxie s.f.<br />
la guerre conduit le pays à l’asphyxie, la guerra porta il paese all’asfissia.<br />
atavisme s.m.<br />
ils sont prudents, c’est un vieil atavisme paysan, sono prudenti, è un antico atavismo<br />
contadino.<br />
Certains exemples proposent des orientations de comportement, exprimés par une forme<br />
négative. Ils ont donc une fonction de proscription, le pendant culturel de la fonction<br />
prescriptive, qui s’explicite plutôt dans les dictionnaires par une sanction des formes abusives.<br />
163
abandonner v.tr.<br />
n’abandonnez pas les animaux, non abbandonate gli animali.<br />
aborder v.tr.<br />
on n’aborde pas les gens dans la rue!, non si abborda la gente per strada!<br />
apanage s.m.<br />
la culture ne doit pas être l’apanage de la classe aisée, la cultura non deve essere<br />
appannaggio delle classi abbienti.<br />
attendre v.intr.<br />
les spaghettis ne doivent pas attendre, gli spaghetti devono essere serviti subito.<br />
Une particularité de SL concerne le traitement des discours sensibles. Il s’agit de thèmes qui<br />
soulèvent un débat, qui ne font pas l’unanimité et qui font rarement l’objet des énoncés des<br />
dictionnaires 243 . Notamment, les exemples que nous avons relevés concernent des thèmes<br />
très divers, comme l’euthanasie, la mondialisation, l’écologie, le célibat dans le clergé,<br />
l’attitude vers les emprunts ou les sciences occultes. Dans deux cas seulement, le<br />
dictionnaire manifeste une prise de position (s.v. acquis, appauvrir) ; cependant, l’acte luimême<br />
d’évoquer un sujet délicat constitue une violation de la norme dictionnairique dont<br />
on ne peut pas sous-estimer l’originalité. Dans les échantillons suivants, « l’exemple est<br />
aussi exemple d’un style, d’une rhétorique personnelle, de contenus de pensée, de vérité ou<br />
de savoir, le tout mobilisant un ensemble de jugements de valeurs socioculturels » (REY<br />
1995 : 109).<br />
abîme s.m.<br />
il y a un abîme entre nous sur le problème de l’euthanasie, sulla questione dell’eutanasia c’è<br />
un abisso fra di noi.<br />
accompagnement s.m.<br />
le chômage est-il l’accompagnement inévitable de la mondialisation? la disoccupazione è la<br />
conseguenza inevitabile della globalizzazione?<br />
acquis 1 agg.<br />
il est acquis que la couche d’ozone est en danger, è ovvio che lo strato di ozono è in<br />
pericolo.<br />
243 Cf. cependant HP, s.v. assimilation : « accepter, refuser l’assimilation d’un couple d’homosexuels à un<br />
couple marié, accettare, rifiutare l’equiparazione di una coppia omosessuale a una coppia sposata ».<br />
164
admettre v.tr.<br />
admettre les femmes à la prêtrise (o dans la prêtrise), ammettere le donne al sacerdozio.<br />
appauvrir v.tr.<br />
trop d’anglicismes appauvrissent la langue, troppi anglicismi impoveriscono la lingua.<br />
axer v.tr.<br />
il est très axé sur le spiritisme, è molto orientato verso lo spiritismo.<br />
La référence à l’histoire (appoint, artificiellement, artisan), à la littérature (appendice) ou même à<br />
l’économie (assaut) et au droit (assimilable) peut se faire par des énoncés qui vont au-delà de<br />
l’encyclopédisme et qui montrent un côté narratif original 244 .<br />
appendice s.m.<br />
Cyrano était doté d’un sacré appendice! Cyrano aveva un bel nasone!<br />
appoint s.m.<br />
l’entrée en guerre des États-Unis constitua pour les Alliés un appoint décisif, l’entrata in<br />
guerra degli Stati Uniti rappresentò per gli Alleati un aiuto decisivo.<br />
artificiellement avv.<br />
en 1929 les actions avaient grimpé artificiellement, ce qui explique le krach boursier nel<br />
1929, le azioni erano salite artificialmente, il che spiega il crac in Borsa.<br />
artisan s.m.<br />
Churchill fut l’artisan de la défense nationale, Churchill fu l’artefice della difesa nazionale.<br />
assaut s.m.<br />
à la chute de la Bourse, les banques ont été prises d’assaut par les petits porteurs, in seguito<br />
al crollo della Borsa, le banche sono state prese d’assalto dai piccoli investitori.<br />
assimilable agg.m./f.<br />
en Europe les droits des citoyens français sont assimilables à ceux des citoyens italiens, in<br />
Europa i diritti dei cittadini francesi sono equiparabili a quelli dei cittadini italiani.<br />
Les programmes d’enseignement et le système de notation français font l’objet de ces trois<br />
exemples.<br />
aborder v.tr.<br />
244 Cf. MARGARITO (2007) pour la notion de narrativité dans les dictionnaires.<br />
165
on n’aborde Pascal qu’en dernière année, Pascal viene affrontato solo all’ultimo anno.<br />
aller 1 v.<br />
vos notes vont de 11 à 18, i vostri voti vanno dall’11 al 18.<br />
axer v.tr.<br />
le premier trimestre sera axé autour de Proust, il primo semestre verterà su Proust.<br />
Nous avons repéré aussi trois exemples qui témoignent d’une mise en garde contre les<br />
dangers de la télévision ; le côté didactique et argumentatif de ces exemples nous paraît<br />
évident.<br />
abîmer v.tr.<br />
il a abîmé ses yeux en regardant trop la télévision, si è rovinato gli occhi guardando troppa<br />
televisione.<br />
abrutissant agg.<br />
émission de télé abrutissante, un’emissione televisiva che rimbecillisce.<br />
abrutissement s.m.<br />
l’abrutissement des enfants par la télévision, l’istupidimento dei bambini a causa della<br />
televisione.<br />
Un autre procédé, qui va à l’envers de l’encyclopédisme, concerne l’évitement des noms<br />
propres à travers des dénominations imaginaires. Il s’agit sans doute d’éviter le risque que<br />
ces passages trahissent un contenu périmé dans quelques années 245 .<br />
abandon s.m.<br />
il y a eu abandon par Vigor au troisième round, c’è stata una rinuncia di Vigor al terzo<br />
round.<br />
action 2 s.f.<br />
les actions Comtel 246 sont en hausse, le azioni Comtel sono in rialzo.<br />
ascension s.f.<br />
l’ascension des Dumot [sic] dans le monde de la finance, l’ascesa dei Dumont nel mondo<br />
della finanza.<br />
avantage s.m.<br />
245 Cf. LO NOSTRO (2007 : 98).<br />
246 Forme verlanisée et apocopée de Télécom.<br />
166
avantage à Rops! vantaggio Rops!<br />
Une autre particularité de SL concerne la présence d’exemples assez sophistiqués, qui font<br />
référence à des auteurs moins connus ou qui ne font pas partie du canon ; ou encore « des<br />
éléments gratuits qui font penser au ‘private joke’ » (HUMBLEY 1990 : 79) dont le sens ne<br />
peut être saisi que par un nombre réduit de lecteurs (comme dans le cas de la musique de<br />
Mahler, s.v. alibi). Le risque, dans ce cas, comme le fait remarquer WHITCUT (1984 : 144),<br />
est que « such inventiveness can very easily become an ego-trip ». Sans vouloir être<br />
polémique, la question qu’il faut se poser est si l’exemple « il trouvait dans Mahler un alibi à<br />
sa tristesse » peut être utile à l’usager pour comprendre le fonctionnement linguistique du<br />
mot alibi ou si, au contraire, l’ancrage culturel que cet énoncé implique est trop recherché<br />
pour rentrer dans la cadre de référence commun des lecteurs potentiels.<br />
alibi s.m.<br />
il trouvait dans Mahler un alibi à sa tristesse, trovava in Mahler un alibi per la sua tristezza.<br />
adapté agg.<br />
adapté d’une nouvelle de Fontane, adattato da un romanzo breve di Fontane.<br />
arsenic s.m.<br />
(Letter) Arsenic et vieilles dentelles, Arsenico e vecchi merletti 247 .<br />
D’autres énoncés sont manifestement ancrés dans la contemporanéité : ils décrivent des<br />
situations actuelles (admission), ils citent des personnalités d’aujourd’hui (administration,<br />
ambassadeur, ambassadrice) ou encore ils font des prévisions sur le développement<br />
technologique (annuaire).<br />
administration s.f.<br />
l’Administration Bush l’amministrazione Bush.<br />
admission s.f.<br />
l’admission de la Bulgarie dans l’Union européenne, l’ammissione della Bulgaria<br />
nell’Unione europea.<br />
aligner v.tr.<br />
chaque membre doit aligner sa politique sur celle de la Communauté, ogni membro deve<br />
uniformare la sua politica a quella della Comunità.<br />
247 Pièce de théâtre de Kesselring (1941).<br />
167
ambassadeur s.m.<br />
Giorgio Armani, l’ambassadeur de la haute couture italienne, Giorgio Armani, ambasciatore<br />
dell’alta moda italiana.<br />
ambassadrice s.f.<br />
Catherine Deneuve, l’ambassadrice de l’élégance française, Catherine Deneuve,<br />
ambasciatrice dell’eleganza francese.<br />
annuaire s.m.<br />
l’annuaire électronique finira par remplacer le bottin, l’annuario elettronico presto sostituirà<br />
la guida del telefono.<br />
Certains énoncés proposent des assertions sur le prix d’un référent (abordable) 248 , sur un gain<br />
mensuel (admettre) et sur une dette (article). Ce dernier exemple évoque un montant très<br />
élevé, qui ne pourrait être vraisemblable que dans le cas d’une dette d’entreprise.<br />
abordable agg.m./f.<br />
les lecteurs de DVD sont abordables, i lettori DVD hanno prezzi abbordabili.<br />
admettre v.tr.<br />
si on admet qu’il gagne 1000 euros par mois, si suppone guadagni 1000 euro al mese.<br />
article s.m.<br />
elle dit qu’on lui doit trois millions, et sur cet article, tu peux lui faire confiance! dice che le<br />
dobbiamo tre milioni, e su questo punto, puoi crederle.<br />
Les références encyclopédiques font légion. D’après notre classement, l’histoire compte<br />
quinze exemples, dont dix concernent l’histoire française, quatre l’histoire européenne (il<br />
n’y a pas d’exemples qui concernent exclusivement l’Italie), et un seulement l’histoire d’un<br />
pays francophone non européen, le Canada (acte) ; la littérature treize 249 , dont sept<br />
références à la littérature européenne moderne, quatre à la littérature française (accuser, âme,<br />
assommoir, autographe), deux à la littérature latine (allusion, art) et un à la littérature non<br />
européenne (Ali Baba) ; la géographie huit : française (à, arrêt, art, atoll, axe) ou de la planète<br />
(antipode, Assouan, attraper) ; la religion comte cinq exemples, dont deux concernent<br />
l’Evangile (acte, aime), un la Bible (ancien), un l’histoire de l’Eglise (apôtre) et un le<br />
protestantisme (adventiste) ; le cinéma trois (français, américain et anglais : à, autodérision,<br />
avec) ; l’art (adoration, art, attribution) et l’archéologie (alignement, amphithéâtre, arène) trois ; la<br />
248 Grâce à la mondialisation, les prix de la plupart des référents s’équivalent entre France et Italie, ce qui<br />
facilite la tâche au lexicographe en quête d’exemples à valeur de vérité partagée.<br />
249 Nous avons rangé l’exemple s.v. allusion dans cette catégorie.<br />
168
musique, trois aussi (air, anneau, autographe) ; l’architecture deux (arc, arche) ; la politique (acte)<br />
et les sciences (attribuer) compent un exemple. Si nous pensons que la lettre A ne représente<br />
que 8% du total des entrées de SL, nous pouvons avoir la mesure du poids de<br />
l’encyclopédisme dans ce dictionnaire.<br />
Pour des raisons de présentation, nous reproduisons ces exemples dans une seule liste.<br />
à prep.<br />
un film policier à la Hitchcock, un film giallo alla Hitchcock.<br />
j’aimerais vivre à la Martinique, mi piacerebbe vivere in Martinica.<br />
abjurer v.tr.<br />
Henri IV abjura en 1593, Enrico IV abiurò nel 1593.<br />
accord s.m.<br />
(Stor) les accords de Maastricht, gli accordi di Maastricht.<br />
accuser v.<br />
(Letter) J’accuse, J’Accuse.<br />
acte 1 s.m.<br />
(Stor) l’acte de Québec, il Quebec Act (adottato nel 1774) .<br />
(Stor) Acte de Suprématie, Atto, di supremazia 250 .<br />
(Bibl) Actes des Apôtres, Atti degli apostoli 251 .<br />
(Pol) Acte final d’Helsinki, Atto finale di Helsinki 252 .<br />
action 1 s.f.<br />
(Rel.catt) Action catholique, Azione cattolica.<br />
(Stor) Action française, Action français [sic].<br />
admission s.f.<br />
admission à l’UE, ammissione alla UE 253 .<br />
adoration s.f.<br />
(Art) l’adoration des Mages, adorazione dei Magi.<br />
adventiste s.m.<br />
250 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
251 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
252 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
253 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
169
(Rel) les Adventistes du septième jour, gli Avventisti del settimo giorno.<br />
affaire s.f.<br />
(Stor.fr) l’affaire Dreyfus, l’affare Dreyfus 254 .<br />
aimer v.<br />
qui m’aime me suive, chi mi ama mi segua 255 .<br />
(Bibl) tu aimeras ton prochain comme toi-même, ama il prossimo tuo come te stesso.<br />
air 3 s.m.<br />
(Mus) le grand air de la Tosca, la grande aria della Tosca.<br />
airain s.m.<br />
loi d’airain, legge ferrea (di Lassalle).<br />
Albigeois s.m.<br />
la croisade des Albigeois, la crociata degli albigesi.<br />
Ali Baba n.pr.m.<br />
(Letter) Ali Baba et les Quarante Voleurs, Alì Babà e i quaranta ladroni.<br />
Alice n.pr.f.<br />
(Letter) Alice au pays des merveilles, Alice nel paese delle meraviglie 256 .<br />
alignement s.m.<br />
(Archeol) les alignements à Carnac, gli allineamenti di Carnac 257 .<br />
allié s.m.<br />
(Stor) les Alliés, gli Alleati.<br />
allusion s.f.<br />
"veni, vidi, vici"; dit-il, par allusion à Jules César, "veni, vidi, vici", disse, facendo allusione a<br />
Giulio Cesare.<br />
amant s.m.<br />
(Letter) L’Amant de Lady Chatterley, L’amante di Lady Chatterley.<br />
(Letter) les amants de Vérone (Roméo et Juliette), gli amanti di Verona.<br />
âme s.f.<br />
254 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
255 Mot attribué à Philippe VI de Valois.<br />
256 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
257 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
170
Molière a rendu l’âme juste après avoir joué ‘Le Malade imaginaire’, Molière ha esalato<br />
l’ultimo respiro dopo aver messo in scena ‘Il malato immaginario’.<br />
amphithéâtre s.m.<br />
(Stor.rom) amphithéâtre Flavien, anfiteatro Flavio.<br />
ancien<br />
(Stor.fr) Ancien Régime, Ancien Régime.<br />
(Bibl) l’Ancien Testament, l’antico testamento, il vecchio testamento.<br />
anneau s.m.<br />
(Mus) l’Anneau des Nibelungen, l’Anello dei Nibelunghi.<br />
anticyclone s.m.<br />
(Meteor) anticyclone des Açores, anticiclone delle Azzorre 258 .<br />
antipode s.m.<br />
la Nouvelle-Zélande est aux antipodes de la France, la Nuova Zelanda è agli antipodi della<br />
Francia.<br />
apôtre s.m.<br />
saint Paul est l’apôtre des gentils, san Paolo è l’apostolo delle genti 259 .<br />
appel s.m.<br />
(Stor) appel du 18 juin, appello del 18 giugno (1940).<br />
après prep.<br />
d’après Tolstoï, tratto da Tolstoj.<br />
arc s.m<br />
l’Arc de triomphe de l’Étoile, l’Arco di Trionfo dell’Étoile.<br />
arche s.f.<br />
(Bibl) Arche d’alliance, arca dell’Alleanza 260 .<br />
(Bibl) arche de Noé, arca di Noè 261 .<br />
(Arch) l’Arche de la Défense, l’Arco della Défense.<br />
archipel s.m.<br />
(Letter) Archipel du Goulag, Arcipelago Gulag.<br />
258 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
259 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
260 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
261 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
171
arène s.f.<br />
les Arènes de Vérone, l’Arena di Verona 262 .<br />
armée s.f.<br />
(Stor) l’Armée rouge, l’Armata rossa 263 .<br />
armistice s.m.<br />
(Stor.fr) armistice de Cherasco, armistizio di Cherasco 264 .<br />
arrêt s.m.<br />
ce train est sans arrêt jusqu’à Arcueil, questo treno è diretto ad Arcueil; en cas d’arrêt entre<br />
deux gares in caso di sosta tra due stazioni; Brive, deux minutes d’arrêt, Brive, due minuti<br />
di sosta.<br />
art s.m.<br />
elle a choisi d’étudier les Arts déco à Limoges, ha scelto di frequentare la scuola di arti<br />
decorative di Limoges.<br />
l’art de Cézanne, l’arte di Cézanne.<br />
(Letter) l’Art d’aimer, l’Arte dell’amore.<br />
assommoir s.m.<br />
l’Assommoir est un roman de Zola, l’Ammazzatoio è un romanzo di Zola.<br />
Assouan n.pr.f.<br />
le barrage d’Assouan, la diga di Assuan.<br />
atoll s.m.<br />
l’atoll de Tikehau en Polynésie, l’atollo di Tikehau in Polinesia.<br />
attraper v.<br />
à son arrivée à Djerba, elle ne s’est pas protégée du soleil et elle a attrapé un coup de<br />
bambou, arrivata a Djerba non si è protetta e ha preso un colpo di sole.<br />
attribuer v.tr.<br />
un sonnet longtemps attribué à Shakespear,e un sonetto per molto tempo attribuito a<br />
Shakespeare; ces mots ont été attribués à Mara, queste parole sono state attribuite a Marat;<br />
on attribue cette découverte à Pasteur, questa scoperta è attribuita a Pasteur.<br />
attribution s.f.<br />
262 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
263 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
264 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
172
l’attribution d’une sculpture à un élève de Rodin, l’attribuzione di una scultura a un allievo<br />
di Rodin.<br />
autodérision s.f.<br />
Woody Allen pratique souvent l’autodérision dans ses films, Woody Allen utilizza spesso<br />
l’autoironia nei suoi film.<br />
autographe agg.m./f.<br />
une lettre autographe de Victor Hugo, una lettera autografa di Victor Hugo.<br />
j’ai réussi à obtenir un autographe de Johnny Hallyday, sono riuscito ad avere un autografo<br />
di Johnny Hallyday.<br />
automne s.m.<br />
en automne 1968 265 nell’autunno del 1968.<br />
avec prep.<br />
un film avec Depardieu, un film con Depardieu.<br />
axe s.m.<br />
le Louvre s’inscrit dans l’axe des Champs-Élysées, il Louvre si trova lungo l’asse degli<br />
Champs-Élysées.<br />
(Stor) l’Axe (alliance formée en 1936 par l’Allemagne et l’Italie) l’Asse: l’Axe Rome-Berlin,<br />
l’Asse Roma-Berlino 266 .<br />
265 Il ne s’agit évidemment pas d’une année choisie au hasard, nous croyons.<br />
266 Cet exemple est présent aussi dans la direction italien-français.<br />
173
II.1.4.2 Direction italien-français<br />
Passons maintenant à analyser les exemples de la section italien-français des dictionnaire de<br />
notre corpus, en commençant encore par Boch.<br />
Dictionnaire Boch [B]<br />
Les thèmes que nous avons relevés dans la partie français-italien (histoire, religion, art) se<br />
confirment prépondérants dans la direction italien-français aussi.<br />
Pour ce qui est de l’histoire, nous avons pu repérer onze exemples, dont cinq se réfèrent à<br />
des événements ou des personnages européens (alleanza, allearsi, alleato, anseatico, armata),<br />
trois à l’Italie (altro, appellativo, audace) et trois à la France (accusatore, albero, anniversario).<br />
accusatore s. m.<br />
(st. fr.) accusatore pubblico, accusateur public.<br />
allearsi v. rifl.<br />
la Francia si alleò con l’Inghilterra, la France s’allia à l’Angleterre<br />
altro agg. indef.<br />
nel Rinascimento Firenze divenne un’altra Atene, durant la Renaissance, Florence devint<br />
une nouvelle Athènes.<br />
anniversario s. m.<br />
il 14 luglio è l’anniversario della presa della Bastiglia, le 14 juillet est l’anniversaire de la prise<br />
de la Bastille.<br />
anseatico agg.<br />
(st.) lega anseatica, hanse germanique, hanse teutonique.<br />
appellativo s. m.<br />
a Lorenzo fu dato l’appellativo di Magnifico, on a donné à Laurent l’épithète de<br />
Magnifique.<br />
armata s. f.<br />
(st. mar.) l’Invincibile Armata, l’Invincible Armada.<br />
audace agg.<br />
Cristoforo Colombo fu un audace navigatore, Christophe Colomb fut un navigateur<br />
audacieux.<br />
174
L’attention pour la religion (chrétienne) est encore plus manifeste que dans la direction<br />
français-italien. Nous avons repéré les huit exemples suivants.<br />
Aasvero n. proprio m.<br />
Aasvero, detto l’Ebreo errante, Ahasvérus, dit le Juif errant.<br />
affamato agg. sost.<br />
dare da mangiare agli affamati, donner à manger aux affamés 267 .<br />
anacoreta s. m.<br />
gli anacoreti della Tebaide, les anachorètes de la Thébaïde.<br />
apparire v. intr.<br />
quando l’Angelo apparve alla Vergine, lorsque l’Ange apparut à la Vierge.<br />
apparizione s. f.<br />
l’apparizione della Vergine, l’apparition de la Vierge.<br />
annunciare v. tr.<br />
i profeti annunciarono la venuta di Gesù Cristo, les prophètes annoncèrent la venue de<br />
Jésus-Christ.<br />
apocrifo agg.<br />
Vangeli apocrifi, Évangiles apocryphes.<br />
ascoltare v. tr.<br />
Dio ascolterà le nostre preghiere, Dieu entendra nos prières.<br />
Pour la littérature, les exemples sont six : deux se réfèrent à la tradition italienne (a,<br />
altissimo), deux à la tradition française (arte, avaro) et deux autres au monde classique, grec et<br />
latin (affascinare, annali).<br />
a (2)<br />
Dante è morto a cinquantasei anni, Dante est mort à cinquante-six ans.<br />
affascinare (1) v. tr.<br />
Circe affascinò Ulisse, Circé fascina Ulysse.<br />
altissimo agg.<br />
Dante è un altissimo poeta, Dante est un poète sublime.<br />
267 La référence est à l’Evagile de Matthieu (25,38).<br />
175
annali s. m. pl.<br />
gli annali di Tacito, les annales de Tacite.<br />
arte s. f.<br />
Henry Beyle, in arte Stendhal, Henry Beyle, connu sous le pseudonyme de Stendhal.<br />
avaro s. m.<br />
Arpagone è il simbolo degli avari, Harpagon est le symbole des avares.<br />
Pour l’histoire de l’art, nous avons repéré quatre exemples, dont trois se réfèrent à la la<br />
peinture italienne (appellativo, artista, attribuire) et un à un peintre néerlandais (autentico).<br />
appellativo s. m.<br />
Tintoretto è l’appellativo di Jacopo Robusti, Tintoret est le surnom de Jacopo Robusti.<br />
artista s. m. e f.<br />
Raffaello fu un grande artista, Raphaël a été un grand artist.<br />
attribuire v. tr.<br />
attribuire un quadro al Mantegna, attribuer un tableau à Mantegna.<br />
autentico agg.<br />
un Rembrandt autentico, un Rembrandt authentique.<br />
Pour la géographie, les trois exemples relevés font référence à l’Italie (alluvione), à un grand<br />
fleuve européen (arteria) et à l’Afrique du Sud (altezza).<br />
alluvione s. f.<br />
l’alluvione ha devastato il delta padano, l’inondation a dévasté le delta du Pô.<br />
altezza s. f.<br />
la nave affondò all’altezza del Capo di Buona Speranza, le bateau coula à la hauteur du Cap<br />
de Bonne Espérance.<br />
arteria s. f.<br />
il Reno è un’importante arteria fluviale, le Rhin est une importante artère fluviale.<br />
Les exemples suivants montrent, quant à eux, un contenu culturel qui se réfère à l’œnologie<br />
(annata), aux traditions (Assunta), aux langues (apprendimento), à la politique (attributo), et à la<br />
philosophie (attuale).<br />
annata s. f.<br />
176
il 1947 è una grande annata per i bordeaux, 1947 est un grand millésime pour les bordeaux.<br />
apprendimento s. m.<br />
il russo è di difficile apprendimento, le russe est difficile à apprendre.<br />
Assunta s. f.<br />
la festa dell’Assunta si celebra il 15 agosto, la fête de l’Assomption a lieu le 15 août.<br />
attributo s. m.<br />
il diritto di grazia è un attributo del capo dello Stato, le droit de grâce est un attribut du<br />
chef de l’État.<br />
attuale agg.<br />
il pensiero di Pascal è ancora attuale, la pensée de Pascal est encore actuelle.<br />
D’autres exemples manifestent une spécificité culturelle et demandent quelques<br />
commentaires supplémentaires.<br />
accasare v. tr.<br />
accasare la figlia, marier sa fille, caser sa fille; ha una figlia da accasare, il a une fille à marier.<br />
Tandis que les monolingues italiens (GI et DeM) proposent des exemples avec les deux<br />
sexes (« marier son fils, sa fille »), B se concentre sur une femme, considérée comme<br />
quelqu’un qu’il faut penser à caser (ou à ‘mettre dans sa case’, dans la place qui lui revient).<br />
G fait de même :<br />
non riesce ad accasare le figlie, il n’arrive pas à marier (o caser) ses filles. [G]<br />
Nous croyons qu’il s’agit de traces des premières éditions des dictionnaires, qui remontent<br />
respectivement, nous le rappelons, à 1978 pour B et à 1966 pour G. La réalité sociale ayant<br />
évolué entre temps, sans doute ces exemples seront vite perçu comme périmés ; ce n’est pas<br />
un hasard si les deux dictionnaires les plus récents (qui ne se basent pas sur une première<br />
édition beaucoup plus ancienne), HP et SL, n’ont pas d’exemples pareils.<br />
accogliere v. tr.<br />
il nuovo stadio può accogliere centomila spettatori, le nouveau stade peut recevoir cent<br />
mille spectateurs.<br />
Dans ce cas, il y a sans doute une exagération du lexicographe, car aucun stade européen ne<br />
peut recevoir un nombre aussi élevé de spectateurs. Il est important, nous croyons, que la<br />
représentation du référent soit conforme, autant que possible, à l’expérience des locuteurs.<br />
andare (1) v. intr.<br />
177
il treno andava a più di centocinquanta kilometri all’ora, le train roulait à plus de cent<br />
cinquante à l’heure.<br />
Cet exemple est périmé dans la mesure où la vitesse de 150 km/h n’est plus perçue comme<br />
élevée, pour un train qui roule en Italie ou en France. Les évolutions technologiques<br />
constituent donc un autre facteur dont il faut tenir compte pour que les énoncés puissent<br />
renvoyer à un monde d’expérience partagé par les usagers.<br />
arrivo s. m.<br />
questi sono gli ultimi arrivi da Parigi in fatto di prêt-à-porter, ce sont les dernières<br />
nouveautés de Paris dans le domaine du prêt-à-porter.<br />
Cet exemple confirme le statut du référent (Paris), en le connotant comme prestigieux.<br />
appena avv.<br />
costa appena cinquanta milioni quest’automobile!, cette voiture coûte la bagatelle de<br />
cinquante millions!<br />
arrivare v. intr<br />
questa pelliccia arriverà a novemila euro, cette fourrure coûtera dans neuf mille euros.<br />
Le premier exemple est évidemment à mettre à jour, car la devise à laquelle il se réfère, c’est<br />
les lires (cinquante millions de lires correspondaient à vingt-cinq mille euros environ). Le<br />
deuxième exemple, par contre, indique un prix qui peut correspondre à la réalité mais le<br />
référent dénoté, les fourrures, n’est pas un référent quelconque ; les mouvements de<br />
protestation contre ce vêtement, aujourd’hui assez discrédité dans l’opinion publique<br />
(italienne tout au moins), rendent cet énoncé ‘sensible’, quoiqu’à un degré différent de ce<br />
que nous avons vu dans le cas des exemples de SL (direction français-italien).<br />
178
Dictionnaire Garzanti [G]<br />
L’attention que G avait montré pour l’histoire dans la direction français-italien (vingt<br />
exemples) est confirmée par le versant italien-français. Parmi les quatorze exemples<br />
historiques que nous avons relevés, il y des événements qui concernent l’Italie (accessione,<br />
affondamento, attestazione, autonomia), l’antiquité grecque et romaine (acclamare, annonario,<br />
assorbire), la France (ambiente, anniversario, attore) et l’Europe (acciaio, allearsi, anseatico, armata).<br />
accessióne n.f.<br />
l’accessione dell’Italia al patto atlantico, l’accession de l’Italie au pacte atlantique.<br />
acciàio n.m.<br />
(st.) patto d’acciaio, pacte d’acier (entre Mussolini et Hitler en 1939).<br />
acclamàre v.tr.<br />
Cesare fu acclamato imperatore, César fut acclamé empereur.<br />
affondaménto n.m.<br />
l’affondamento dell’Andrea Doria, le naufrage de l’Andrea Doria 268 .<br />
allearsi v.pron. e pron.rec.<br />
l’Italia si alleò alla Germania, l’Italie s’allia à (o avec) l’Allemagne.<br />
ambiènte n.m.<br />
l’illuminismo creò l’ambiente adatto alla rivoluzione, la philosophie des Lumières créa les<br />
conditions nécessaires à la Révolution.<br />
anniversario n.m.<br />
l’anniversario della presa della Bastiglia ricorre il 14 luglio, l’anniversaire de la prise de la<br />
Bastille se fête le 14 juillet.<br />
annonario n.m.<br />
(st.) province annonarie, provinces annonaires.<br />
anseatico agg.<br />
(st.) la lega anseatica, la ligue hanséatique (o la Hanse).<br />
armata n.f.<br />
(st.) l’Invincibile Armata, l’Invincible Armada.<br />
assorbire v.tr.<br />
i romani assorbirono la cultura greca, les Romains assimilèrent la culture grecque.<br />
268 Cet événement remonte à 1956.<br />
179
attestazióne n.f.<br />
la prima attestazione del volgare italiano risale al 960, les premières attestations de la langue<br />
italienne datent de 960.<br />
attóre n.m.<br />
per vent’anni Napoleone fu il principale attore sulla scena europea, pendant vingt ans,<br />
Napoléon joua le premier rôle sur la scène européenne.<br />
autonomìa n.f.<br />
(st., pol.) Autonomia Operaia, Autonomie Ouvrière (mouvement politique d’extrême gauche<br />
des années 1970).<br />
Parmi les onze exemples qui contiennent des références à la littérature, huit concernent la<br />
tradition italienne (dont trois Dante et deux Leopardi, des auteurs canoniques par<br />
excellence), deux la littérature française (arturiano, autografo) et un le contexte européen<br />
(antesignano).<br />
accuràto agg.<br />
un’accuratissima edizione critica della Divina Commedia, une édition critique très complète<br />
de la Divine Comédie.<br />
agguagliàre v.tr.<br />
nessun poeta italiano ha agguagliato Dante, aucun poète italien n’a égalé Dante.<br />
angelicàto agg.<br />
(letter.) donna angelicata, donna angelicata (dame aimée des poètes du ‘Dolce Stil Novo’).<br />
ànno n.m.<br />
il 1985 è stato l’anno manzoniano, 1985 a été l’année de Manzoni.<br />
anteriore agg.<br />
i poeti anteriori a Dante, les poètes antérieurs à Dante (o qui ont précédé Dante).<br />
antesignàno n.m.<br />
gli antesignani del Romanticismo, les précurseurs du Romantisme.<br />
arieggiàre v.tr.<br />
questi versi arieggiano il Leopardi, ces vers rappellent Leopardi.<br />
arturiàno agg.<br />
ciclo arturiano, cycle arthurien (o d’Arthur o breton o de la Table ronde).<br />
ascendènza n.f.<br />
180
la lingua del Leopardi ha ascendenze petrarchesche, la langue de Leopardi trouve des<br />
antécédents chez Pétrarque (o s’apparente à celle de Pétrarque).<br />
autògrafo agg.<br />
l’autografo del ‘Diario’ di Gide, le manuscrit du ‘Journal’ de Gide.<br />
autrìce n.f.<br />
Grazia Deledda, famosa autrice di romanzi, Grazia Deledda, célèbre auteur de romans.<br />
Onze exemples aussi ont trait à la géographie ; ils se rapportent surtout à l’Italie (abbondare,<br />
acqua, ambientarsi, ambiente, aprire, ascensione), mais aussi à la France (alcuno, altezza, altro) et à<br />
d’autres pays (acropoli, aspetto).<br />
abbondàre v.intr.<br />
in Sicilia abbondano gli agrumi, en Sicile, les agrumes abondent; la Sicilia abbonda di<br />
agrumi, la Sicile abonde en agrumes.<br />
àcqua n.f.<br />
quest’inverno l’acqua alta è stata frequente a Venezia, cet hiver l’eau a souvent été haute à<br />
Venise.<br />
acròpoli n.f<br />
l’Acropoli di Atene, l’Acropole.<br />
alcùno agg.indef.<br />
abbiamo visitato alcune città della Provenza, nous avons visité quelques villes de (la)<br />
Provence.<br />
altézza n.f.<br />
la nave era all’altezza di Marsiglia, le navire était à la hauteur de Marseille.<br />
àltro agg.indef.<br />
ho visitato le cattedrali gotiche di Francia: tra le altre, quella di Orléans, j’ai visité les<br />
cathédrales gothiques de France, entre autres celle d’Orléans.<br />
ambientàrsi v.pron.<br />
non riesce ancora ad ambientarsi a Milano, il ne parvient pas encore à s’acclimater (o à<br />
s’adapter) à Milan.<br />
ambiènte n.m.<br />
frequenta i migliori ambienti di Milano, il fréquente la meilleure société milanaise.<br />
aprìre v.tr.<br />
181
domani apriranno il valico del S. Gottardo, demain le Col du St.-Gothard sera ouvert.<br />
ascensióne n.f.<br />
l’ascensione del Monte Bianco, l’ascension du Mont Blanc.<br />
aspètto 1 n.m.<br />
Algeri ha un aspetto europeo, Alger a un aspect européen.<br />
La religion (toujours chrétienne) compte neuf exemples, dont deux sont des citations<br />
explicites de la Bible (amare, assetato).<br />
amàre v.tr.<br />
(Bibbia) ama il prossimo tuo come te stesso, aime ton prochain comme toi-même.<br />
ammaestraménto n.m.<br />
gli ammaestramenti evangelici, les enseignements de l’Evangile.<br />
ancèlla n.f.<br />
l’ancella del Signore, la servante du Seigneur.<br />
ànimo n.m.<br />
volgere l’animo a Dio, tourner son âme vers Dieu.<br />
annichilirsi v.pron.<br />
annichilirsi davanti a Dio, s’annihiler devant Dieu.<br />
annunciatóre n.m.<br />
l’angelo annunciatore, l’ange de l’Annonciation.<br />
apparizióne n.f.<br />
l’apparizione della Madonna, l’apparition de la Vierge.<br />
assetàto agg.<br />
(Bibbia) dar da bere agli assetati, donner à boire à ceux qui ont soif.<br />
avvocàta n.f.<br />
la Vergine, avvocata dei peccatori, la Vierge, patronne des pécheurs.<br />
Pour ce qui concerne l’art, nous relevons cinq exemples, tous concernant la peinture,<br />
italienne (allievo, altrimenti, autentico) ou de Van Gogh (acquirente, autoritratto).<br />
acquirènte n.m. e f.<br />
182
quel miliardario è l’acquirente del famoso quadro di Van Gogh, ce milliardaire est<br />
l’acquéreur du célèbre tableau de Van Gogh.<br />
allièvo 1 n.m.<br />
fu allievo del Caravaggio, il fut l’élève (o le disciple) du Caravage.<br />
altriménti avv.<br />
Michelangelo Merisi, altrimenti detto il Caravaggio, Michelangelo Merisi, dit le Caravage.<br />
autèntico agg.<br />
un Tiziano autentico, un Titien authentique.<br />
autoritràtto n.m.<br />
l’autoritratto di Van Gogh, l’autoportrait de Van Gogh (o Van Gogh par lui-même).<br />
En ce qui concerne la musique, parmi les cinq exemples répertoriés, trois concernent des<br />
compositeurs classiques (accurato, assassinare, attaccare) et deux l’opéra (allegro, aria). Il s’agit<br />
donc encore de références ‘canoniques’, qui sont censées représenter la tradition musicale<br />
européenne.<br />
accuràto agg.<br />
un esecutore accurato di Bach, un exécutant attentif de Bach.<br />
allégro agg.<br />
la Vedova Allegra, la Veuve Joyeuse.<br />
aria n.f.<br />
canta Casta Diva, l’aria della Norma, elle chante Casta Diva, l’air (o l’aria) de la Norma.<br />
assassìnio n.m.<br />
quest’interpretazione delle sonate di Beethoven è un vero assassinio, cette interprétation<br />
des sonates de Beethoven est un vrai massacre.<br />
attaccàre v.tr.<br />
il concerto attaccò con una suite di Bach, le concert commença par une suite de Bach.<br />
Pour la politique, les exemples sont au nombre de deux.<br />
autonomìsmo n.m.<br />
l’autonomismo sardo, l’autonomisme sarde.<br />
autonomìsta agg.<br />
gli autonomista baschi, les autonomistes basques.<br />
183
La mythologie aussi compte deux exemples.<br />
àntro n.m.<br />
l’antro della Sibilla Cumana, l’antre de la Sybille de Cumes.<br />
attribùto n.m.<br />
l’aquila era uno degli attributi di Giove.<br />
D’autres exemples encyclopédiques concernent les normes de circulation (abitato), les<br />
bandes dessinés (albo), le cinéma (allegria), la sériciculture (allevamento), la presse française<br />
(annata), la météorologie (anticiclone) et le calendrier scolaire (aprire).<br />
abitàto agg.<br />
nell’abitato la velocità massima consentita è di 50 km orari, dans les agglomérations, la<br />
vitesse maximale est de 50 km à l’heure.<br />
àlbo 1 n.m.<br />
gli albi di Topolino, les albums de Mickey.<br />
allegrìa n.f.<br />
i film di Charlot mettono allegria, les films de Charlot mettent de bonne humeur.<br />
allevaménto n.m.<br />
l’allevamento del baco da seta non è più molto diffuso in Italia, l’élevage du ver à soie n’est<br />
plus très répandu en Italie.<br />
annàta n.f.<br />
le ultime tre annate del ‘Figaro’, les trois dernières années du ‘Figaro’.<br />
anticiclone n.m.<br />
l’anticiclone delle Azzorre, l’anticyclone des Açores.<br />
aprìre v.tr.<br />
la scuola apre in ottobre, l’école commence en Octobre.<br />
Les deux exemples suivants constituent des énoncés universels ; ils véhiculent un contenu<br />
sur lequel il n’y a pas de controverse, tout au moins dans le monde occidental : la<br />
démocratie et la diffusion du savoir.<br />
antìtesi n.f.<br />
uno stato totalitario è l’antitesi della libertà, un Etat totalitaire est l’antithèse de la liberté.<br />
184
appannàggio n.m.<br />
la cultura non deve essere appannaggio di pochi privilegiati, la culture ne doit pas être<br />
l’apanage d’une élite.<br />
Nous achevons la partie consacrée à ce dictionnaire par d’autres énoncés, qui recèlent à<br />
notre avis une précise valeur culturelle.<br />
àlbero n.m.<br />
(prov.) l’albero si conosce dal frutto, c’est au fruit qu’on connaît l’arbre.<br />
Ce proverbe cache une citation de la Bible, notamment de l’Evangile de Mathieu (12, 33). Il<br />
s’agit donc, en quelque sorte, d’une autre référence à la religion, bien que plus dissimulée.<br />
a 2 , ad 1 prep.<br />
guadagnava due milioni al mese, il gagnait deux millions par mois; le do dieci euro all’ora, je<br />
lui donne dix euros l’heure.<br />
andàre 1 v.intr.<br />
questo appartamento andrà sui centomila euro, cet appartement coûte cent mille euros<br />
environ.<br />
arrivàre v.intr.<br />
il suo stipendio non arriva ai mille euro, son traitement n’arrive pas à mille euros.<br />
Parmi ces quatre exemples qui mentionnent des sommes d’argent, le premier est<br />
évidemment périmé : ne mentionnant pas la devise (les lires italiennes), il nous fait penser à<br />
un gain démesuré (deux millions), ce qui ne rentrait sans doute pas dans les intentions du<br />
lexicographe. Les trois autres indiquent des montants culturellement ‘congrus’ pour un<br />
salaire standard (dix euros l’heure), pour le prix d’un (petit) appartement (cent mille euros) et<br />
pour un traitement modeste (moins de mille euros).<br />
abolìre v.tr.<br />
ha dovuto abolire le sigarette e il caffè, il a dû abolir les cigarettes et le café.<br />
appestàre v.tr.<br />
non appestare la stanza col fumo!, n’empeste pas la pièce avec ta fumée!<br />
astenérsi v.pron.<br />
185
astenersi dal vino, dal caffè, s’abstenir de boire du vin, du café; astenersi dal fumo,<br />
s’abstenir de fumer.<br />
Ce groupe de trois exemples sanctionnent les référents (le tabac, le café) comme nuisibles, à<br />
un degré différent, pour la santé. Il s’agit donc encore d’exemples didactiques, tels que nous<br />
les avons décrits pour la direction français-italien.<br />
abusivismo s.m.<br />
in Italia l’abusivismo edilizio è ormai diventato una piaga, les constructions illégales<br />
constituent désormais une plaie en Italie.<br />
Cet exemple a un effet de dénonciation assez frappant, à notre avis. L’attention de l’usager<br />
se déplace donc immédiatement du fonctionnement du mot à la valeur de vérité de<br />
l’énoncé, qui donne une information sur une situation grave, et qui empire (comme<br />
l’indique l’adverbe désormais).<br />
arrivàto agg.<br />
il primo arrivato porta una maglia gialla, le premier arrivé porte un maillot jaune.<br />
La référence au Tour de France nous paraît nette, même si elle n’est pas explicitée par<br />
l’énoncé.<br />
186
Dictionnaire Hachette-Paravia [HP]<br />
La plupart des exemples encyclopédiques de ce dictionnaire concernent la géographie<br />
(onze) : les références se rapportent naturellement à l’Italie (altezza, approfittare, ascensione,<br />
autostrada, avere, azione), à la France (atollo, asse, attrazione) mais également à d’autres régions<br />
de la planète (anche, argentino).<br />
altezza n.f.<br />
qual è l’altezza del Monte Bianco? quelle est l’altitude du mont Blanc?<br />
anche cong.<br />
è andato dappertutto, anche in Antartide, il est allé partout, même en Antarctique.<br />
approfittare v.intr.<br />
ho approfittato della mia sosta a Roma per visitare il Colosseo, j’ai profité de mon<br />
passage à Rome pour visiter le Colisée<br />
1.argentino agg.<br />
il tango è una danza argentina, le tango est une danse argentine.<br />
ascensione n.f.<br />
compiere un’ascensione sul Cervino, faire une ascension du Cervin.<br />
2.asse n.m.<br />
l’asse Parigi-Metz, l’axe Paris-Metz.<br />
atollo n.m.<br />
atoll; l’atoll di Mururoa, l’atoll de Mururoa 269 .<br />
attrazione n.f.<br />
Parigi esercita una grande forza di attrazione sulla sua regione, Paris exerce une forte<br />
attraction sur sa région.<br />
autostrada n.f.<br />
l’ingresso di un veicolo nell’autostrada A14, l’engagement d’une voiture sur l’autoroute<br />
A14.<br />
1.avere v.tr.<br />
Roma ha tre milioni di abitanti, Rome a trois millions d’habitants.<br />
1.azione n.f.<br />
l’azione è ambientata a Venezia, l’action se situe à Venise.<br />
269 La mention de cet atoll n’est pas anodine : son ancrage dans la mémoire collective (lieu d’expérimentation<br />
pour les bombes nucléaires françaises) nous paraît évident.<br />
187
Les six références à l’histoire dans les exemples de HP concernent des réalités italiennes<br />
(anniversario), françaises (affare), européennes (annessione, asse) ou mondiales (aggressione, anno).<br />
affare n.m.<br />
l’affare Dreyfus, l’affaire Dreyfus.<br />
aggressione n.f.<br />
l’aggressione giapponese contro gli Stati Uniti, l’agression japonaise contre les États-<br />
Unis.<br />
annessione n.f.<br />
STOR. l’annessione dell’Austria alla Germania, l’annexion de l’Autriche à l’Allemagne.<br />
anniversario n.m.<br />
l’anniversario della nascita, della morte di Verdi, l’anniversaire de la naissance, de la<br />
mort de Verdi.<br />
anno n.m.<br />
celebrare i cinquant’anni dalla fine della guerra, célébrer les cinquante ans passés<br />
depuis la fin de la guerre<br />
2.asse n.m.<br />
2 STOR. l’Asse Roma-Berlino, l’Axe Rome-Berlin.<br />
Les trois références à la littérature concernent la tradition italienne (avventure) et européenne<br />
(amico 270 , anatroccolo).<br />
amico n.m.<br />
(appassionato, cultore) l’associazione degli amici di Pushkin, l’association des amis de<br />
Pouchkine, les amis de Pouchkine.<br />
anatroccolo n.m..<br />
2 il brutto anatroccolo, le vilain petit canard 271 .<br />
avventura n.f.<br />
le avventure di Pinocchio, les aventures de Pinocchio.<br />
270 Dans le cas de l’exemple sur Pouckine, nous pouvons lire sur Wikipédia une possible explication de la<br />
présence de cet auteur : « Sa profonde connaissance de la culture française lui vaudra d'ailleurs le surnom de<br />
Frantsouz (Француз, ‘Le Français’) auprès de ses camarades de lycée »<br />
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Pouchkine, page consultée le 10 septembre 2010).<br />
271 D’après le conte de H.C. Andersen (1842).<br />
188
La religion catholique compte également trois exemples, dont deux (alzarsi, amarsi) sont des<br />
citation de l’Evangile.<br />
alzarsi v.pronom.<br />
“alzati e cammina”, “lève-toi et marche” 272 .<br />
amarsi v.pronom.<br />
amatevi l’un l’altro, aimez-vous les uns les autres 273 .<br />
ascoltare v.tr.<br />
Dio ha ascoltato la sua preghiera, Dieu a écouté sa prière.<br />
Pour ce qui est de l’histoire de l’art nous avons trouvé la mention d’un artiste italien<br />
(attribuire) et d’un peintre néerlandais (autentico).<br />
attribuire v.tr.<br />
questo quadro viene attribuito a Tiziano, on attribue ce tableau à Titien.<br />
autentico agg.<br />
un Rembrandt autentico, un Rembrandt authentique.<br />
En ce qui concerne la politique, les références se font à des réalités italiennes (autonomia) et<br />
européennes (allargamento).<br />
allargamento n.m.<br />
l’allargamento della UE ad altri paesi, l’élargissement de l’UE à d’autres pays.<br />
autonomia n.f.<br />
POL. Autonomia Operaia = mouvement politique italien de la gauche extraparlementaire.<br />
D’autres références encyclopédiques concernent l’archéologie française (allineamento), la<br />
presse italienne (articolo), la radio italienne (ascolto) et la Bourse italienne (azione)<br />
allineamento n.m.<br />
gli allineamenti di Carnac, les alignements à Carnac.<br />
articolo n.m.<br />
in un articolo pubblicato su La Stampa, dans un article publié dans La Stampa.<br />
ascolto n.m..<br />
siete all’ascolto di radio Montecarlo, vous êtes à l’écoute de RMC.<br />
272 Source: Evangile de Jean (5, 8).<br />
273 Source: Evangile de Jean (13, 34).<br />
189
2.azione n.f.<br />
a quanto sono le azioni Olivetti? à combien sont les actions Olivetti? 274<br />
Nous avons relevé huit exemples avec une mention de prix, que nous reproduisons cidessous.<br />
L’exemple s.v. arrivare est évidemment raté, car il exprime un montant (exprimé en<br />
lires ?) qui cloche avec le contenu de l’énoncé (qui veut exprimer un salaire exigu). Les<br />
autres expriment par contre des montants convenables, qu’ils se réfèrent à des particuliers<br />
(affitto, anno) ou à des entreprises (aggirarsi, aumento). L’exemples s.v. appena est par contre à la<br />
limite de la vraisemblance, bien qu’en Italie il n’y ait pas d’équivalent du SMIC.<br />
affitto n.m.<br />
affitto mensile di 900 euro, spese incluse, escluse, loyer mensuel de 900 euros charges<br />
comprises, non comprises; pagare 900 euro di affitto tutto compreso, payer 900 euros<br />
de loyer tout compris, toutes charges comprises.<br />
aggirarsi v.pronom.<br />
il deficit si aggira sui 100.000 euro, le déficit s’élève à 100 000 euros environ.<br />
anno n.m.<br />
pagare 2.000 euro all’anno, payer 2 000 euros par an; la quota è di 500 euro all’anno, la<br />
cotisation est de 500 euros par an, année.<br />
appena avv.<br />
guadagna appena 5 euro all’ora, il gagne à peine 5 euros de l’heure.<br />
arrivare v.intr.<br />
il suo stipendio non arriva (nemmeno) al milione, son salaire n’atteint même pas un<br />
million par mois 275 .<br />
aumento n.m.<br />
l’aumento del capitale di centomila euro, l’augmentation du capital de cent mille euros.<br />
Nous avons également reperé trois exemples à visée didactique, concernant la santé et<br />
l’hygiène.<br />
accrescere v.tr.<br />
l’alcol accresce il pericolo d’infarto, l’alcool redouble le danger d’infarctus.<br />
274 Cette mention de nom propre est possible puisque ces actions ne sont plus dans le cours de la Bourse<br />
italienne depuis 2003.<br />
275 Cf. SL, s.v. arredamento: « l’arredamento della casa è costato dieci milioni l’ameublement de la maison a<br />
coûté dix millions ».<br />
190
almeno avv.<br />
devi lavarti i denti almeno due volte al giorno, tu dois te brosser les dents au moins<br />
deux fois par jour.<br />
assumere v.tr.<br />
non assumo mai droga, je ne prends jamais de drogue.<br />
Il convient à cet égard de rappeler les propos de FISHMAN (1995 : 29), qui souligne les liens<br />
entre lexicographes, société et utilisateurs : « Dictionaries always tell us something about the<br />
characteristics of their compilers, about the characteristics of their intended users and<br />
about the characteristics of the society and culture in which their compilers intend them to<br />
be used ».<br />
Ainsi que dans la direction français-italien, HP se montre particulièrement sensible au<br />
problème du tabagisme 276 :<br />
asfissiare v.tr.<br />
ci asfissi con il fumo della tua sigaretta, tu nous asphyxies avec ta fumée de cigarette.<br />
affumicare v.tr.<br />
ci affumichi con i tuoi sigari! tu nous enfumes avec tes cigares!<br />
Finalment, nous faisons observer un cas qui nous semble relever d’un « private joke » 277<br />
d’un rédacteur, sans doute mécontent de son travail. Ici, c’est plutôt la personnalité du<br />
lexicographe qui entre en jeu et laisse ses traces dans l’exemple.<br />
2.ancora avv.<br />
le bozze sono state corrette prima ancora delle mie dimissioni, les épreuves ont été<br />
corrigées, revues bien avant ma démission.<br />
276 Cf. aussi SL, s.v. avvisare: « ti avviso: se ti prendo a fumare sono guai! gare à toi si je t’attrappe en train de<br />
fumer ».<br />
277 HUMBLEY (1990 : 79).<br />
191
Dictionnaire Sansoni Larousse [SL]<br />
Nous pouvons remarquer tout de suite que, dans cette direction, ce dictionnaire insiste<br />
beaucoup moins sur les aspects culturels dans les exemples.<br />
Nous commençons par signaler la présence d’énoncés non controversés, qui expriment des<br />
points de vue partagés. Ces exemples confirment le point de vue de LANDAU: « Every<br />
established dictionary reflects, however it may strive to be impartial, the prevailing biases of<br />
its times » (2001 : 421).<br />
abbasso intz.<br />
abbasso i tiranni! à bas la tyrannie! 278<br />
abbrutire v.tr.<br />
l’ubriachezza abbrutisce l’uomo, l’ivrognerie abrutit les hommes 279 .<br />
abolire v.tr.<br />
abolire la pena di morte, abolir la peine de mort 280 .<br />
alzare v.<br />
bisogna alzarsi da tavola con un po’ di appetito, il faut sortir de table en ayant encore un<br />
peu faim.<br />
anziano s.m.<br />
agli anziani si deve rispetto, on doit du respect aux personnes âgées 281 .<br />
Les énoncés suivants sont culturels dans le mesure où ils ont une dominante pragmatique :<br />
ils ne sont compréhensibles qu’en situation, dans un contexte précis (chez un charcutier<br />
italien ou dans une gare italienne).<br />
abbondante agg.m./f.<br />
sono due etti abbondanti, lascio? il y a un peu plus de deux cents grammes, je le laisse?<br />
attenzione intz.<br />
attenzione, è in arrivo il treno per Milano! votre attention s’il vous plaît: le train à<br />
destination de Milan entre en gare!<br />
278 Cf. B: « abbasso la tirannia! », G: « abbasso il tiranno! », HP: « abbasso il governo! ».<br />
279 B a ce même exemple; pour G et HP c’est la prison qui « abrutit ».<br />
280 G a ce même exemple, HP a le même collocateur.<br />
281 G a ce même exemple; B: « bisogna ascoltare gli anziani ».<br />
192
Ainsi que nous l’avons fait dans la direction français-italien, nous terminons par une<br />
présentation des exemples à caractère encyclopédique dans SL. Pour éviter des répétitions,<br />
nous n’avons pas reproduit les exemples qui étaient déjà présents dans la partie françaisitalien<br />
282 . Parmi les exemples ‘originaux’ (présents seulement dans cette direction), la<br />
géographie italienne compte quatre exemples, qui concernent surtout la ville de Rome<br />
(angolo, anulare, attraversare), mais aussi la Sicile (agrumario) ; trois exemples concernent la<br />
religion chrétienne (ancella, annunziare, arcangelo) ; trois l’art, notamment la peinture italienne<br />
(allievo, anteriore, autoritratto) ; trois exemples aussi pour la politique, européenne (alleanza,<br />
alto) et italienne (alleanza) ; deux exemples concernent l’histoire italienne (arco, autonomia) ;<br />
deux la littérature, anglaise (allegro) et italienne (anteriore) ; finalement, la langue (accento), les<br />
bandes dessinées (Archimede), l’archéologie (arco) et la mythologie (attributo) comptent un<br />
exemple chacune. Pour des raisons de présentation, nous reproduisons ces énoncés dans<br />
une seule liste.<br />
accento s.m.<br />
in italiano è facile sbagliare gli accenti en italien il est facile de se tromper sur les accents<br />
toniques.<br />
alleanza s.f.<br />
(Pol) Alleanza Atlantica, Pacte Atlantique.<br />
(Pol,Stor.it) Alleanza Nazionale, Alliance nationale (parti politique italien de droite).<br />
agrumario agg.<br />
d’agrumes: la produzione agrumaria della Sicilia la production d’agrumes de la Sicile.<br />
allegro agg.<br />
(Letter) Le allegre comari di Windsor, Les joyeuses comères de Windsor.<br />
allievo 1 s.m.<br />
Giotto fu allievo di Cimabue, Giotto fut l’élève de Cimabue.<br />
alto s.m.<br />
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Haut-Commissariat des Nations<br />
unies aux réfugiés.<br />
ancella s.f.<br />
(Bibl) l’ancella del Signore, la servante du Seigneur.<br />
angolo s.m.<br />
282 Il y a une note en bas de page pour ces exemples, dans la partie d’analyse consacrée aux exemples français-<br />
italien de SL.<br />
193
via Condotti fa angolo con via del Corso, la via Condotti croise la via del Corso.<br />
annunziare v.tr.<br />
i profeti annunziarono il Messia, les prophètes annoncèrent la venue du Messie.<br />
anteriore agg.m./f.<br />
i poeti anteriori a Dante, les poètes antérieurs à Dante; i pittori anteriori a Raffaello, les<br />
peintres antérieurs à Raphaël.<br />
anulare agg.m./f.<br />
(Strad) raccordo anulare (a Roma) , ceinture de raccordement.<br />
arcangelo s.m.<br />
l’arcangelo Gabriele, l’archange Gabriel.<br />
Archimede n.pr.m.<br />
Archimede Pitagorico (personaggio di Walt Disney), Géo Trouvetou.<br />
arco s.m.<br />
l’arco di Costantino l’arc de Constantine.<br />
(Stor.it,Pol) arco costituzionale, arc constitutionnel (alliance traditionnelle antifasciste).<br />
attraversare v.tr.<br />
il Tevere attraversa Roma, le Tibre traverse Rome, le Tibre arrose la ville de Rome.<br />
attributo s.m.<br />
la civetta è attributo di Minerva, la chouette est l’attribut de Minerve, la chouette est le<br />
symbole de Minèrve.<br />
autonomia s.f.<br />
(Stor.it) Autonomia Operaia, Autonomie Ouvrière (mouvement politique des années 1970).<br />
autoritratto s.m.<br />
l’autoritratto di Ligabue, l’autoportrait de Ligabue, Ligabue par lui même.<br />
Après ce dernier passage en revue, qui a montré encore une fois le poids des informations<br />
encyclopédiques dans les DB, nous essayons maintenant de présenter quelques réflexions<br />
conclusives sur l’exemple à fonction culturelle dans les dictionnaires de notre corpus.<br />
194
II.1.4.3 Réflexions conclusives sur les exemples<br />
Quelles conclusions pouvons-nous tirer, après ce passage en revue des exemples ‘culturels’<br />
dans les DB de notre corpus ?<br />
Nous avons remarqué, tout d’abord, que dans B, G et HP les exemples encyclopédiques<br />
sont plus nombreux dans la direction italien-français que dans la direction français-italien.<br />
La raison est clairement la suivante, à notre avis : le traitement de l’information culturelle<br />
dans la partie français-italien est confié en grande partie aux notes culturelles, dont nous<br />
nous occuperons dans le chapitre suivant. Ces notes étant beaucoup plus nombreuses dans<br />
la partie consacrée au décodage pour l’utilisateur italien, il est tout à fait compréhensible<br />
que les informations culturelles soient moins présentes dans les exemples de ‘encodage’.<br />
Par contre, dans SL les références encyclopédiques sont plus nombreuses dans la direction<br />
français-italien ; ce fait est dû, à notre avis, à l’absence de notes culturelles dans ce<br />
dictionnaire. Dans le cas de SL, ce sont donc les exemples qui prennent en charge à la fois<br />
les tâches linguistiques et encyclopédiques.<br />
Le discours du dictionnaire peut donc être lu comme un texte, qui fait recours à des<br />
stratégies différentes (microstructurelles ou paratextuelles) et à des lieux textuels différents<br />
(exemples, notes) pour véhiculer l’information culturelle.<br />
Quels types d’informations culturelles sont prépondérantes dans les DB de notre corpus ?<br />
PRUVOST (2005 : 23) fait remarquer que « lorsque l’exemple présente une dimension<br />
encyclopédique, il est presque toujours fait référence à la culture savante ». Cet avis est<br />
confirmé sans ambigüité par les échantillons de notre corpus. Les références à l’histoire, à<br />
la géographie, à la religion, à l’art et à la littérature sont de loin les plus nombreuses ;<br />
viennent ensuite la musique, l’archéologie, la mythologie ; les exemples relevant de<br />
domaines tels que le cinéma, le sport et la bande dessinée sont par contre assez rares. La<br />
culture savante se taille donc la part du lion et marginalise la culture quotidienne. Comment<br />
pouvons nous expliquer ce déséquilibre entre la dimension ‘cultivée’ et la dimension<br />
‘anthropologique’, pour employer une antinomie chère à GALISSON ? Les DB que nous<br />
avons analysés sont destinés en principe aux étudiants et aux traducteurs : nous croyons<br />
justement qu’il faut rechercher dans le public visé la raison de cette prépondérance de la<br />
culture savante dans les exemples. Pour ce qui est de la dimension textuelle des DB, nous<br />
verrons dans le chapitre suivant quelle est la place qui est faite à la culture quotidienne dans<br />
les notes culturelles.<br />
En ce qui concerne la représentation de la géographie italienne, nous avons pu remarquer la<br />
présence de deux seules références à l’Italie du Sud 283 , dans les échantillons analysés. Il est<br />
vrai que les villes d’art les plus célèbres se trouvent dans le Centre et dans le Nord de<br />
l’Italie ; cela n’empêche pas que l’absence de références au Sud est saillante. Le fait que les<br />
283 Les deux mentionnaient les agrumes de Sicile.<br />
195
maisons d’éditions des DB se trouvent au Nord 284 peut avoir joué son rôle, si nous<br />
admettons que la culture du lexicographe a un poids dans l’élaboration des exemples. En ce<br />
qui concerne la France, Paris garde sa centralité, mais le reste de la France et les régions<br />
non hexagonales sont assez bien représentés aussi.<br />
Le discours des DB étudiés s’avère assez stéréotypé : les références se font à des valeurs<br />
partagées, à des opinions communes et non controversées. Cependant, SL se distingue en<br />
partie : la place qui est faite aux thèmes ‘sensibles’, comme nous l’avons vu, n’est pas<br />
négligeable. Une autre particularité de ce dictionnaire concerne ce que nous avons appelé<br />
les ‘scénarios’ : des énoncés qui montrent un côté narratif original dans l’approche à la vie<br />
sociale ou aux données encyclopédiques, dans le but de donner plus d’‘épaisseur’ aux<br />
exemples, de les rendre plus vifs et moins aseptiques.<br />
Une autre question importante concerne les sources des exemples. HP est le seul qui<br />
affirme avoir fait recours à « un vaste corpus de textes » ; cependant, cela n’est pas visible<br />
dans les exemples, qui sont peu nombreux et assez banals. Les exemples de B, G et SL<br />
sont, par contre, tous forgés 285 . Comme l’affirme WINTER (1992 : 46) : « unlike<br />
monolingual dictionaries, bilingual ones very seldom use quotations as examples ». Dans le<br />
but d’une prise en compte plus complète de la dimension culturelle, nous croyons qu’une<br />
innovation importante pourrait être l’ajout de citations littéraires après les exemples forgés,<br />
à l’instar de ce que font les monolingues. Les contraintes d’espace n’étant plus<br />
rédhibitoires, avec les versions en cédérom, on donnerait ainsi beaucoup plus de ‘corps’ aux<br />
mots et on les rattacherait à leur héritage culturel. Si le dictionnaire souhaite jouer son rôle<br />
de « pont interculturel » (REY 2007), la marginalisation des citations littéraires n’est pas<br />
justifiable, d’autant plus que les utilisateurs ciblés (étudiants, traducteurs) ont très souvent<br />
affaire à des textes d’auteur.<br />
Nous souhaitons terminer par une dernière réflexion. Dans l’analyse des exemples, nous<br />
avons délibérément pris le parti du ‘deuxième degré’. Le ‘premier degré’, dans les exemples,<br />
concerne le niveau linguistique : le signe 286 a une valeur autonymique, il se désigne luimême<br />
; les exemples sont donc des énoncés qui incluent le mot-entrée, avec une visée<br />
métalinguistique. Ce n’est qu’au deuxième degré, avec une distanciation donc, que les<br />
exemples des dictionnaires peuvent être lus comme des énoncés référentiels, qui désignent<br />
un monde d’expérience en adoptant une perspective, une optique, un point de vue sur le<br />
monde. Si, à l’entrée abolir, G, HP et SL font l’exemple de l’abolition de la peine de mort,<br />
au lieu de l’abolition de la liberté de presse ou des droits constitutionnels, c’est parce que<br />
ces dictionnaires incarnent un discours démocratique, véhiculent des contenus socialement<br />
partagés et, en définitive, se font les porte-paroles d’une langue-culture.<br />
284 Zanichelli (pour Boch) a son siège à Bologne ; la maison De Agostini (pour Garzanti) a ses sièges à<br />
Novara et à Milan ; Rizzoli (pour le Sansoni Larousse) est à Milan ; Paravia se trouve à Turin.<br />
285 Nous n’avons relevé qu’un exemple cité dans G, s.v. accuser.<br />
286 Nous nous référons en priorité au signe qui contextualise le mot-entrée.<br />
196
II.2 Analyse transversale<br />
Les deux chapitres qui achèvent cette deuxième partie essaient d’apporter une contribution<br />
à l’étude de la dimension interculturelle dans les DB.<br />
Notamment, l’étude des notes culturelles (II.2.1) dans les dictionnaires de notre corpus<br />
nous permettra de voir quelles sont les stratégies adoptées pour la diffusion des<br />
informations culturelles, au-delà de la microstructure traditionnelle. Ensuite, une analyse<br />
des faux emprunts (II.2.2) sera l’occasion pour voir un échange entre langues et cultures<br />
qui se situe sur le plan du signifiant.<br />
197
II.2.1 Les notes culturelles<br />
Les notes (ou encarts) à caractère culturel connaissent un succès croissant dans la<br />
production dictionnairique actuelle, comme en témoignent plusieurs études (cf. ANTOINE<br />
1998 ; FRANCŒUR 2003 ; PRUVOST 2005 ; LO NOSTRO 2009).<br />
Selon PRUVOST (2005 : 25) l’encart doit offrir un « développement encyclopédique »,<br />
présentant une « explication complète du mot, avec toutes ses résonances », afin que son<br />
‘écho culturel’ puisse être répertorié et qu’il soit reconnu comme le patrimoine de tous les<br />
usagers.<br />
Pour ANTOINE (1998), à travers les annexes culturelles<br />
le grand dictionnaire bilingue proposera [...] une représentation systématique de tout ce qui<br />
n’est pas du ressort du simple décodage lexical, ce qui résiste à la compréhension du locuteur<br />
de l’autre langue, qui ne possède pas nécessairement les outils culturels requis pour repérer et<br />
décoder les allusions, références implicites ou explicites, clins d’œil, etc., qui font l’épaisseur,<br />
la charge, lexiculturelle de nombre d’expressions (1998 : 171).<br />
Selon cet auteur, le but de ces lieux textuels serait celui d’aider dans le décodage de ce qui<br />
dépasse la simple compétence lexicale et de signaler le « tissu représentationnel » (ROBERT<br />
2003 : 264) qui entoure les mots.<br />
D’après FRANCŒUR (2003), qui analyse les notes culturelles dans le Robert & Collins Senior<br />
(1998), ces éléments « renseignent sur le monde, décrivant des réalités institutionnelles,<br />
politiques, sociales, etc. [...] et constituent un complément d’information au contenu de<br />
certains articles, en particulier les articles consacrés aux mots culturellement marqués,<br />
difficilement traduisibles dans une autre langue » (2003 : 299-300). Les notes culturelles<br />
intéragissent donc avec la microstructure pour rapprocher l’utilisateur de l’inconnu.<br />
L’essor des notes culturelles témoigne, selon CELOTTI (1998), de la volonté d’élargir la<br />
fonction du DB. En effet, grâce à ces ouvertures sur l’extralinguistique, les mots<br />
deviennent des témoins 287 , déclencheurs d’associations culturelles, et s’inscrivent dans le<br />
discours de la langue, mis en œuvre par la langue.<br />
L’un des auteurs qui a réfléchi le plus sur le rôle, la fonction et le statut des encarts culturels<br />
est sans aucun doute le sud-africain R. GOUWS 288 . Il affirme : « Culturally bound words<br />
need a more comprehensive treatment than the article of a traditional bilingual dictionary<br />
can accommodate », (GOUWS 2002 : 208), plaidant pour un DB qui présente des « synopses<br />
articles in which the comment on semantics includes an additional search zone allocated to<br />
encyclopedic data » (ibid.). Il s’agit bien des mêmes lieux textuels dont consistent<br />
aujourd’hui les encarts culturels.<br />
287 Pour la vision de GREIMAS et de MATORE des mots-témoins et des mots-clés, voir LARRIVEE (2008 : 67).<br />
288 C’est un représentant du courant fonctionnaliste en lexicographie, dont le centre est l’université de Århus<br />
au Danemark, qui compte des linguistes tels que H. BERGENHOLTZ et S. TARP.<br />
198
Selon GOUWS – STEYN (2005 : 133) les données culturelles et encyclopédiques relèvent de<br />
la « knowledge-oriented function » : ce genre d’information ne vise pas à supporter les<br />
capacités communicationnelles des usagers, mais à consolider leurs connaissances sur le<br />
monde.<br />
GOUWS – STEYN (2005 : 129) font ensuite une distinction opérationnelle intéressante entre<br />
unintegrated et integrated outer texts. Les premiers « complement the central list and do not add<br />
to the treatment of the subject matter of the dictionary » ; les seconds « function in coordination<br />
with the central list and [...] are integrated into the genuine purpose of the<br />
dictionary ». Les notes culturelles relèveraient de la deuxième catégorie (les ‘textes externes<br />
intégrés’), dans la mesure où elles complètent le programme d’information adopté par le<br />
dictionnaire et qu’elles œuvrent en corrélation avec la microstructure pour rendre compte<br />
de la valeur culturelle d’une entrée.<br />
Finalement, toujours GOUWS – STEYN (2005 : 134) préconisent une culture dictionnairique<br />
sur la base de laquelle « dictionary users know that outer texts are just as much part of the<br />
dictionary as the translation equivalents given for a source language lemma ». Il s’agit d’un<br />
souhait auquel nous nous rallions ; il faut tenir compte, cependant, du fait que l’essor des<br />
notes culturelles est un phénomène assez récent dans la lexicographie bilingue françaisitalien<br />
: il faudra donc sans doute quelques années avant que les usagers appréhendent ces<br />
informations sur un pied d’égalité avec les informations ‘classiques’ de la microstructure.<br />
Avant de commencer avec notre analyse du corpus, nous proposons un exemple dont la<br />
dimension culturelle est manifeste, l’adjectif ubuesque.<br />
Nous commençons par dire que SL est le seul, parmi les dictionnaires de notre corpus, qui<br />
ne présente pas de notes culturelles ; par conséquent, nous limiterons notre analyse à B, G<br />
et HP.<br />
Voici donc l’entrée ubuesque de HP.<br />
ubuesque agg. grottesco.<br />
Il s’agit d’une équivalence mot-à-mot, sans marques ni précisions, qui nous laisse un peu<br />
sur notre faim pour ce qui est de la charge culturelle du mot. Les lexicographes n’ont pas<br />
cru nécessaire d’ajouter une note.<br />
G se comporte ainsi :<br />
ubuesque agg. ubuesco, grottescamente crudele, assurdo.<br />
● L’aggettivo ubuesque deriva dall’opera Ubu roi di A. Jarry (1873-1907).<br />
Nous avons trois traduisants, dont le premier, ubuesco, n’est pas répertorié dans les<br />
monolingues italiens (DeM et GI) ; le choix de ce (premier) traduisant vise sans doute à<br />
garder le lien entre forme et sens et marque en quelque sorte une certaine intraduisibilité du<br />
lemme. Par contre, une note culturelle nous informe que cet adjectif est un dérivé, qui se<br />
199
apporte à une œuvre (dont la nature ne nous est pas indiquée) de Jarry. C’est déjà un pas<br />
significatif dans la direction d’une prise en compte de la dimension culturelle de cette unité<br />
lexicale.<br />
Pour terminer, voici ce que propose B :<br />
ubuesque agg. grottesco.<br />
NOTE DI CULTURA: L’aggettivo ubuesque, ricavato dal personaggio di Ubu roi<br />
dall’omonimo dramma (1896) di Alfred Jarry (1873-1907), designa un carattere cinico che,<br />
in modo paradossalmente comico, è crudele e vile allo stesso tempo.<br />
Cette note va beaucoup plus loin que celle de G. Elle nous montre le lien entre le mot et<br />
l’œuvre dont il dérive et précise le sens du mot par une phrase assez élaborée. Dans ce cas,<br />
l’équivalence ne se joue pas que sur le plan sémantique ; le mot agit également comme un<br />
déclencheur, instaure une connivence entre l’utilisateur et le récepteur et s’inscrit dans un<br />
cadre de connaissances partagés. Cette ouverture au sens est rendue possible par l’encart,<br />
qui crée un espace d’élargissement culturel remarquable et qui aide les utilisateurs à saisir les<br />
tenants et les aboutissants d’une unité lexicale.<br />
Nous pouvons maintenant commencer l’analyse des encarts culturels dans les dictionnaires<br />
de notre corpus.<br />
Comme nous l’avons annoncé, le corpus se compose dans ce cas de trois dictionnaires (B,<br />
G, HP), car SL n’a pas de notes culturelles : il reste ainsi un ‘pur’ dictionnaire de langue.<br />
200
Dictionnaire Boch<br />
Dans l’introduction, nous pouvons lire la fonction que ce dictionnaire attribue aux notes<br />
culturelles :<br />
[elles] apportent au lecteur un éclairage sur le contexte culturel ou historique d’un terme. Ces<br />
notes représentent non seulement un outil précieux pour tous ceux qui doivent traduire ou<br />
comprendre un texte en langue étrangère, mais aussi un instrument de travail concret pour<br />
les enseignants, qui sauront les utiliser pour faire découvrir à leurs élèves les subtilités des<br />
deux langues et des deux cultures (B : 3).<br />
Il s’agit d’une reconnaissance explicite de la valeur de ces encarts, au point de vue du<br />
décodage, de l’enseignement et de l’apprentissage en FLE.<br />
Il s’agit de la première édition de Boch qui fait une place aux notes culturelles : jusqu’à<br />
l’édition de 2000 il n’y avait en effet aucune note de ce type.<br />
Quant à l’aspect typographique des notes, elles paraissent dans un encadré de la même<br />
largeur que les trois colonnes de la macrostructure, sur fond bleu clair ; elles sont précédées<br />
par un point d’exclamation et la mention Cultura.<br />
Les notes culturelles sont au nombre de 949 289 : 896 dans la direction français-italien et 53<br />
dans la direction italien-français. Cette disproportion se doit évidemment au public ciblé :<br />
bien que ce dictionnaire soit le seul, parmi ceux de notre corpus, à être vendu en Italie et en<br />
France, l’utilisateur qu’on vise en priorité, c’est l’italien. Il s’agit donc pour la plupart de<br />
notes de décodage.<br />
Les notes de la direction français-italien sont en italien, alors que les notes italien-français<br />
sont en français, ce qui confirme la subdivision entre utilisateurs (de préférence) de langue<br />
maternelle italienne dans la partie français-italien et utilisateurs (de préférence) de langue<br />
maternelle française dans la partie italien-français.<br />
Nous avons classifié les notes par catégories, à l’instar de FRANCŒUR (2003) et de LO<br />
NOSTRO (2009). Un tableau récapitulatif se trouve à la page 204 : pour des raisons de clarté,<br />
nous avons cru opportun de présenter un seul tableau, avec les données des trois<br />
dictionnaires.<br />
Nous reproduisons dans l’annexe II l’intégralité des notes, avec l’indication du domaine.<br />
Pour terminer, il faut dire que ce dictionnaire n’a pas de liste des notes dans les annexes. Il<br />
nous a donc fallu examiner toute la nomenclature du dictionnaire.<br />
289 Un nombre assez élevé, si l’on compare par exemple aux 229 notes du Robert & Collins Senior, qui est<br />
analysé par FRANCŒUR (2003).<br />
201
Dictionnaire Garzanti<br />
Par rapport à B, G est très succinct dans l’explication de la fonction des notes culturelles :<br />
dans les Principes généraux nous pouvons lire : « Les notes [...] encyclopédiques [...]<br />
fournissent des informations sur la civilisation française ».<br />
Comme le souligne CELOTTI (1998 : 136), dans une édition précédente de ce dictionnaire<br />
(1994) les informations culturelles étaient « signalées à l’intérieur de l’article par un signe<br />
graphique, un gros point noir ». Par rapport au passé, le nombre de notes a augmenté<br />
considérablement et, au point de vue graphique, elles sont beaucoup mieux visibles par<br />
l’usager : elles se trouvent dans un encadré au fond bleu, précédé par la mention nota, avec<br />
la même largeur que les trois colonnes de la macrostructure.<br />
Nous avons relevé 772 notes culturelles pour ce dictionnaire : 716 dans la direction<br />
français-italien et 56 dans la direction italien-français. Toutes les notes sont en italien, pour<br />
un public d’italophones. Comment évaluer ce choix ? Selon HANNAY « culture and usage<br />
notes on the headword [...] are only appropriate in a reception environment » (2003 : 147).<br />
Si les notes dans la direction italien-français sont adressées à des italophones, vu qu’elles<br />
sont en italien et que l’ouvrage ne se vend qu’en Italie, il est légitime de se demander quelle<br />
peut être l’utilité pour les lecteurs.<br />
Ainsi que B, G n’a pas de liste des notes dans les annexes. Il nous a donc fallu examiner<br />
toute la nomenclature du dictionnaire.<br />
La liste des note se trouve dans l’annexe II, avec l’indication des catégories.<br />
202
Dictionnaire Hachette-Paravia<br />
Dans la note de l’éditeur nous pouvons lire :<br />
La partie français s’est enrichie [par rapport à l’édition précédente 290] de 120 notes de<br />
civilisation qui offrent à l’usager italien quantité d’informations sur la société, la culture et les<br />
institutions de la France (HP : IV).<br />
En fait, les notes sont au nombre de 119 et elles se concentrent dans la direction de<br />
décodage (français-italien). L’utilisateur ciblé est l’ « usager italien », ce qui indique la<br />
monodirectionnalité de l’ouvrage.<br />
Au point de vue typographique, les notes se trouvent dans un encadré au fond beige, avec<br />
un i dans un rond noir (le symbole des informations). A la différence de B et G, ces notes<br />
sont précédées par un intitulé en gras, qui peut coïncider avec l’entrée (comme dans<br />
agrégation, par exemple) ou se concentrer sur une locution (comme dans année scolaire, s.v.<br />
année).<br />
Parmi les dictionnaires de notre corpus, HP est le seul qui présente un index final des mots<br />
pourvus d’un encadré culturel. Ce dictionnaire remplit ainsi le vœu de GOUWS – STEYN<br />
(2005 : 133), qui souhaitaient : dans le but d’assurer aux usagers l’accès aux données paratextuelles,<br />
« the back matter texts may and should be employed to give a more<br />
comprehensive account of this material ».<br />
Nous renvoyons à l’annexe II pour la liste complète des notes, avec l’indication du<br />
domaine.<br />
290 Ainsi que pour B, les notes culturelles dans HP représentent donc une nouveauté absolue.<br />
203
Analyse des résultats<br />
Après ce passage en revue, nous pouvons proposer le classement retenu, dans un tableau<br />
qui compare les résultats des trois dictionnaires 291 de notre corpus.<br />
La liste des entrées qui ont une note culturelle et la catégorie dont relève la note sont<br />
reproduites dans l’annexe II.<br />
Nous avons rangé les notes en trente-quatre catégories. Ce classement a été parfois<br />
problématique pour B, qui propose souvent des notes hétéroclites, avec un contenu qui<br />
concerne plusieurs thèmes à la fois. Nous avons donc opté à chaque fois pour le sujet<br />
dominant de la note.<br />
B G HP<br />
ARM (Armée) 6 7 3<br />
ART (Arts) 33 32 -<br />
BD (Bande<br />
dessinée)<br />
3 3 1<br />
CIN (Cinéma) 29 5 2<br />
CULT (Culture) 5 10 3<br />
D (Droit) 5 7 3<br />
ECO (Economie) 4 9 2<br />
EDU (Education) 18 34 20<br />
ESS (Essais) 32 1 -<br />
F (Folklore) 2 7 -<br />
GAS (Gastronomie) 3 14 1<br />
GEO (Géographie) 18 24 1<br />
H (Histoire) 217 215 2<br />
INF (Informatique) 3 6 -<br />
INS (Institutions) 16 21 24<br />
JEU (Jeux) 1 5 1<br />
LAN (Langue) 201 185 1<br />
291 Nous rappelons que dans SL il n’y a pas de notes culturelles.<br />
204
LIT (Littérature) 141 64 1<br />
MED (Médias) - - 4<br />
MOD (Mode) 1 3 -<br />
MUS (Musique) 7 6 3<br />
PHI (Philosophie) 62 10 -<br />
POL (Politique) 11 7 15<br />
PRE (Presse) 12 3 1<br />
PSY (Psychologie) 3 2 -<br />
R (Religion) 8 8 -<br />
SCI (Sciences) 9 6 -<br />
SOC (Société) 26 13 11<br />
SPE (Spectacles) 9 6 -<br />
SPO (Sport) 6 5 2<br />
SYM (Symboles) 4 7 4<br />
THE (Théâtre) 28 11 2<br />
TRA (Transports) 14 15 8<br />
U (Urbanisme) 14 21 4<br />
TOTAL 949 772 119<br />
Avant d’analyser les résultats de notre enquête, quelques remarques sur les notes sont<br />
nécessaires.<br />
L’étiquette ART regroupe les notes qui traitent de peinture, sculpture, architecture, etc.<br />
La mention CULT se réfère notamment aux musées, aux bibliothèques, etc.<br />
L’étiquette U comprend les notes qui traitent de géographie urbaine 292 .<br />
Dans la catégorie LAN nous avons inclus les notes qui se centrent sur le mot lui-même ; B<br />
par exemple a beaucoup de notes à dominante étymologique, G présente plusieurs citations<br />
ou encore plusieurs locutions familières. Dans ces notes, le mot sert de déclencheur pour<br />
292 Surtout dans G, ces notes concernent évidemment la géographie de Paris.<br />
205
parler d’une pluralité de thèmes (histoire, art, littérature, etc.), mais tout d’abord le<br />
lexicographe se concentre sur son sens : il fournit des définitions (surtout dans B) de mots<br />
qui ont une charge culturelle.<br />
Pour une plus grande clarté, nous proposons quelques exemples de notes ‘LAN’ :<br />
chauviniste<br />
CULTURA: Il termine chauvinisme, entrato anche nel lessico storico-politico, deriva<br />
dall’aggettivo chauvin, dal nome del soldato Nicolas Chauvin, che dalla Restauration incantò il<br />
tipo del patriota fanatico. Era protagonista fra l’altro della commedia La cocarde tricolore<br />
(1834) dei fratelli Cogniard. [B]<br />
coquetterie<br />
CULTURA: Una curiosità: in italiano il termine coquetterie è un francesismo, che equivale a<br />
civetteria. In francese coquetterie non è detto solo di donne, mentre in italiano sia il<br />
francesismo che civetteria sono decisamente più femminili. Galletto non ha femminile,<br />
mentre accanto a coquet il francese ha coquette. [B]<br />
cygne 293<br />
CULTURA: L’espressione cigno si usa in Italia per i grandi musicisti: il cigno di Busseto<br />
(Verdi), il cigno di Pesaro (Rossini). In Francia, si usa invece per i grandi scrittori. [B]<br />
gigogne<br />
NOTA: La parola gigogne deriva da un personaggio comico del teatro popolare del Seicento,<br />
(Mère o Dame) Gigogne, dalle cui sottane uscivano tantissimi bambini. [G]<br />
kif-kif<br />
NOTA: La locuzione kif-kif è formata sulla parola araba kif (che significa comme) ed è stata<br />
introdotta nel XIX sec. dai soldati dell’Africa del Nord. [G]<br />
Une lecture de ce tableau fait émerger des constantes et des divergences.<br />
Pour B et G, les trois premières places sont occupées par les mêmes catégories, à savoir les<br />
notes historiques (H), de langue (LAN) et de littérature (LIT).<br />
Les notes historiques de G (215) sont presque aussi nombreuses que dans B (217) mais<br />
elles sont plus importantes au niveau statistique : elles représentent environ 28% du total<br />
des notes, contre 23% de B. Dans HP, les notes historiques sont au nombre de deux et<br />
elles ne font que 1% du total.<br />
293 Les notes à coquetterie et cygne ont un côté contrastif intéressant : ils offrent des indications d’encodage pour<br />
l’utilisateur italien.<br />
206
Les notes LAN sont aussi très nombreuses : 201 pour B et 185 pour G, ce qui revient<br />
respectivement à 21% et à 24%. Pour HP, nous n’en avons relevé qu’une (s.v. verlan).<br />
Si on aborde les notes qui traitent de littérature (LIT), un écart se creuse entre les 141 notes<br />
de B (15%) et les soixante-quatre de G (8%) 294 . Si nous additionnons donc ces trois<br />
premières catégories, nous voyons qu’elles constituent plus de la moitié du total (59% pour<br />
B, 60% pour G).<br />
En ce qui concerne HP, par contre, les deux premières places sont occupées par le lexique<br />
des institutions (vingt-quatre notes, 20% du total) et de l’éducation (vingt notes, 16% du<br />
total). Il est intéressant de remarquer que la valeur absolue des notes ‘institutionnelles’ de<br />
HP 295 est supérieure aux notes de cette catégorie élaborées par B (seize) et G (vingt et un).<br />
Il s’agit de notes qui portent sur des « institutionnalismes à charge culturelle » (LIJNEN<br />
2005 : 32) et qui concernent des réalités comme Conseil supérieur de l’audiovisuel, Quai des<br />
Orfèvres ou encore le plan Vigipirate.<br />
Si nous revenons à l’analyse des résultats de B, nous remarquons que, après les trois<br />
premières catégories d’importance (histoire, langue et littérature dans l’ordre), de<br />
nombreuses notes concernent la production intellectuelle, c’est-à-dire la philosophie et les<br />
essais (anthropologiques, sémiologiques, théologiques, historiques, etc.) : ces deux catégorie<br />
comptent 94 notes (10% du total). Cette tendance est d’autant plus importante que dans G<br />
les notes sur la philosophie ne sont que dix et qu’il y a seulement une note relative à un<br />
essai 296 ; dans HP ces deux catégories ne sont même pas représentées. Nous pouvons donc<br />
relever dans B un fort penchant pour la ‘culture cultivée’, ainsi que GALISSON la nommait.<br />
L’histoire, la littérature, l’art, la philosophie et la pensée en générale accaparent plus de 50%<br />
des notes ; dans G aussi ces domaines, à eux seuls, recouvrent environ 40% des notes. Il<br />
convient également de rappeler que les notes ‘LAN’ prennent souvent la langue comme<br />
prétexte pour parler de thèmes historiques, littéraires, etc.<br />
Qu’en est-il donc de la culture ‘quotidienne’, dont GALISSON préconisait une représentation<br />
significative dans les dictionnaires ?<br />
Le folklore, les jeux, la presse, le sport, les symboles, les transports, les spectacles ne<br />
figurent certes pas dans les premières positions de notre liste. Il est vrai que B essaie de<br />
combler cette lacune en présentant un bon nombre de notes qui concernent la société et le<br />
cinéma ; quant à G, on peut remarquer une présence significative de notes qui concernent<br />
l’éducation 297 , la géographie, la gastronomie et l’urbanisme. Cela n’empêche que ces thèmes<br />
restent la minorité.<br />
294 HP compte dans ce cas aussi une seule note, qui concerne les prix littéraires.<br />
295 Nous faisons également remarquer les quinze notes de politique, qui renforcent cette position<br />
‘institutionnelle’ de HP.<br />
296 Il s’agit d’ailleurs d’un traité de gastronomie<br />
297 Cette catégorie est encore mieux représentée, en pourcentage, dans HP.<br />
207
Quelle est la conséquence de cette surreprésentation de domaines propres à la ‘culture<br />
cultivée’ ? A travers ces notes, les DB se rapprochent avec décision de l’encyclopédie. Il est<br />
vrai que les notes ‘LAN’ ont comme point de départ la langue, mais les contenus véhiculés<br />
sont souvent ‘hauts’.<br />
Le peu d’attention accordée aux symboles et au folklore confirme que la charge culturelle<br />
partagée des mots est malheureusement assez négligée par les notes des DB étudiés.<br />
Il paraît donc que les DB de notre corpus ont une approche ‘maximaliste’ 298 à la culture : ils<br />
se préoccupent moins du « non-dit culturel actualisé par tel ou tel item lexical » (ANTOINE<br />
2001 : 34) que d’un cadre de référence ‘institutionnalisé’, où le renvoi à l’extralinguistique<br />
soit reconnu comme jalon fondateur.<br />
298 Le mot est encore de GALISSON, bien évidemment.<br />
208
II.2.2 Les faux emprunts<br />
Dans ce dernier chapitre, nous étudierons le phénomène des faux gallicismes en italien, tels<br />
qu’ils sont signalés par un dictionnaire de notre corpus, le Garzanti. Nous abordons cette<br />
catégorie de mots dans l’hypothèse qu’ils recèlent une spécificité culturelle, qui témoigne du<br />
contact entre les langues-cultures française et italienne. Nous essaierons de montrer si ces<br />
‘faits de langues’ que sont les faux emprunts peuvent être en corrélation avec des ‘faits de<br />
culture’.<br />
Avant d’aborder le phénomène des faux emprunts, nous croyons qu’il est opportun de<br />
préciser la notion d’emprunt. D’après la définition classique de HAUGEN (1950 : 211),<br />
l’emprunt est une « attempted reproduction in one language of patterns previously found in<br />
another ». Pour qu’il y ait un emprunt, il faut donc un modèle (lexical, syntaxique,<br />
phonétique peu importe) dans une langue-1, que la langue-2 essaie de reproduire.<br />
GUILBERT, dans le Grand Larousse299 signe l’article emprunt, qu’il définit comme le<br />
« procédé par lequel une langue s’incorpore un éléments significatif d’une autre langue » en<br />
le distinguant du xénisme, « emploi dans un texte d’un mot d’une langue étrangère donné<br />
pour tel ». L’emprunt, poursuit GUILBERT, porte presque toujours sur un mot ou une<br />
lexie300 ; c’est un signe arbitraire non motivé 301 (donc structurellement opaque) qui est en<br />
définitive monosémique.<br />
GUILBERT (1975 : 90) ajoute : « L’emprunt consiste dans l’introduction, à l’intérieur du<br />
système, de segments linguistiques d’une structure phonologique, syntaxique et sémantique<br />
conforme à un autre système ». Cette définition est particulièrement intéressante, pour<br />
l’usage qu’elle fait des termes « segments linguistiques » et « structure conforme ». Il peut<br />
donc y avoir emprunt d’unités inférieures au mot (ou à un niveau non lexical) et, surtout,<br />
ces segments doivent être conformes à un système prêteur : il n’est pas indispensable donc<br />
que l’unité empruntée existe effectivement dans une L1, mais il faut que sa présence y soit<br />
en quelque sorte acceptable et cohérente.<br />
La définition de GUSMANI (1981 : 8) est beaucoup plus stricte, par contre, et se rattache à<br />
celle de HAUGEN : « La definizione di prestito spetta solo a quegli elementi che una lingua<br />
ha effettivamente modellato su un’altra », ce qui lui permet de faire la distinction entre vrais<br />
et faux emprunts, ces derniers étant des créations autonomes de la part d’un système<br />
299 Grand Larousse de la langue française en six [sept] volumes, Paris : Larousse, 1972, t. 2, p. 1579.<br />
300 Le terme lexie « comble une lacune entre les termes mot (refusé par beaucoup comme unité linguistique à<br />
valeur générale) et léxème, qui ne dénote souvent que des unités minimales. Les lexies sont les unités de surface<br />
du lexique, les entrées du dictionnaire, qui comprennent les léxèmes, leurs dérivés affixaux et les composés »,<br />
MOUNIN 2004 : 203.<br />
301 Il faut relativiser ce concept d’opacité, toutefois, surtout lorsque les deux langues sont proches et lorsqu’une<br />
langue étrangère est apprise.<br />
209
linguistique. L’auteur s’oppose à la conception de HJELMSLEV (1966 : 87), qui définissait<br />
l’emprunt comme « transfert d’un signe d’une langue à une autre »; cette position n’est pas<br />
tenable car « non si ha passaggio di ‘materia’ linguistica da un’espressione all’altra, ma<br />
appunto solo imitazione » (GUSMANI 1981 : 16). Voilà pourquoi le critère employé par le<br />
linguiste danois pour reconnaître un emprunt (HJELMSLEV 1966 : 89, « la forme extérieure<br />
du mot est le seul critère du linguiste ») n’est pas satisfaisant.<br />
Passons à analyser le phénomène des faux emprunts. Dans ce cas, le signifiant est bel et<br />
bien emprunté (quoique sa forme soit parfois modifiée, comme on le verra), alors que le<br />
signifié est une création de la langue d’arrivée. En résumé, il n’y a pas de véritable modèle<br />
en L1 pour ces emprunts fictifs, qui se révèlent particulièrement trompeurs pour des<br />
locuteurs, même avancés, de L2. En effet, l’équivalence ‘faux emprunt en L2’ = ‘unité<br />
lexicale modèle en L1’ s’avère fallacieuse : c’est le signifiant qui induit l’erreur. Comme<br />
l’écrit WINTER-FROEMEL (2009 : 84), « le faux-emprunt ne peut pas être mis au même<br />
niveau que les autres types d’emprunt linguistique, car le prétendu mot source étranger<br />
n’existe pas dans la langue étrangère ». L’auteure esquisse une définition de la notion<br />
(2009 : 86) : « Le faux-emprunt peut donc être défini comme une innovation au sein de la<br />
langue cible qui se sert d’éléments étrangers au système autochtone (p. ex. fr. recordman,<br />
rugbyman, mailing) ». Le système-cible produit donc de façon plus ou moins autonome un<br />
signe, sur la base d’un modèle idéalisé de la langue-source.<br />
L’intérêt des faux emprunts est dans leur nature hybride : ils gardent la marque d’une<br />
origine exogène, au niveau morphologique et graphique, mais la langue-cible a forgé ces<br />
signes de manière autonome.<br />
Dans les pages qui suivent, nous analyserons quelques faux gallicismes en italien et nous<br />
essaierons d’en dégager une typologie, ainsi que leurs éventuelles implications culturelles.<br />
Selon l’analyse de J. HUMBLEY (2007), qui a étudié les pseudo-anglicismes en français, les<br />
faux emprunts peuvent relever de trois catégories 302 :<br />
1- Construction allogène (emploi de morphèmes de la langue prêteuse)<br />
2- Modèle tronqué (emploi d’apocopes)<br />
3- Evolution divergente (qui peut être sémantique ou morphologique)<br />
Nous allons employer cette catégorisation pour essayer de rendre compte des faux<br />
emprunts de notre corpus.<br />
302 Selon WINTER-FROEMEL (2009 : 86), cependant, les modèles tronqués (ou modifiés) et les mots qui<br />
connaissent une évolution divergente « sont tous les deux de vrais emprunts ». D’ailleurs, HUMBLEY lui-même<br />
reconnaît que les modèles tronqués « sont bien des emprunts » (2007 : 232).<br />
210
Le dictionnaire Garzanti a une marque spéciale pour les faux gallicismes présents dans la<br />
macrostructure italien-français français ; nous avons donc pu les repérer tous à l’aide d’une<br />
recherche automatique informatisée. Ils sont au nombre de vingt vingt-neuf<br />
concernés :<br />
303<br />
dictionnaire Garzanti a une marque spéciale pour les faux gallicismes présents dans la<br />
; nous avons donc pu les repérer tous à l’aide d’une<br />
303<br />
. Voici les mots<br />
abat-jour – baguette – beguine – bluette – boule – breloque – carré – casqué – caveau –<br />
chiffonniere – claire – creme caramel – en plein – flobert – frappè – froissé – maîtresse –<br />
manicure – mouliné – paillard – porte-enfant – séparé – sommier – soubrette – tabarin –<br />
tonné – torchon – toupet – vin brûlé.<br />
Nous présentons tout d’abord un graphique, , où nous avons classifié ces faux emprunts sur<br />
la base de la contribution de HUMBLEY (2007).<br />
Autres; 20<br />
Evolution<br />
divergente;<br />
7<br />
303 Il faut également préciser que certains ne concernent qu’une seule acception de l’entrée. Nous verrons que<br />
les faux emprunts sont en fait trente, car il y en a deux à l’entrée carré.<br />
211<br />
Modèle<br />
tronqué; 3
Qu’est-ce qui émerge de ce graphique ? Tout d’abord l’absence de cas relevant de la<br />
construction allogène. Il faut bien souligner, cependant, que ce modèle a été avancé pour<br />
étudier les faux anglicismes en français, où la productivité d’un suffixe comme –ing, par<br />
exemple, est notoire. Par contre, l’italien n’a pas assez d’emprunts français pour en faire des<br />
constructions allogènes.<br />
La catégorie du modèle tronqué compte trois mots 304 (10% du total), alors que le procédé<br />
de l’évolution divergente se révèle opératoire pour sept mots 305 , donc pour 23% environ de<br />
notre échantillon.<br />
Finalement, la plupart des faux emprunts pris en examen (vingt) résiste à une catégorisation<br />
précise, pour plusieurs raisons.<br />
Nous allons procéder maintenant à une étude cas par cas des vingt-neuf mots du corpus,<br />
afin de justifier nos choix de classification.<br />
Il a fallu tout d’abord établir un corpus de dictionnaires monolingues italiens. Il se compose<br />
des ouvrages suivants :<br />
Il Vocabolario Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, 5 volumes = T<br />
I dialetti italiani. Dizionario etimologico (CORTELAZZO M. – MARCATO C. éds.), Torino, Utet,<br />
1998 = DI<br />
Grande Dizionario dell’Uso (DE MAURO T. éd.), Torino, Utet, 1999, 6 volumes = GDU<br />
<strong>DEL</strong>I – Dizionario etimologico della lingua italiana (CORTELAZZO M. – ZOLLI P. éds.), Bologna,<br />
Zanichelli, 1999 = <strong>DEL</strong>I 306<br />
Dizionario De Mauro, Torino, Paravia, 2000 = DeM<br />
Il Dizionario Garzanti di Italiano 2008, De Agostini, Novara, 2007 = GI<br />
Il Sabatini Coletti – Dizionario della lingua italiana, Milano, Sansoni, 2008 = SC<br />
Zingarelli 2009. Vocabolario della lingua italiana (ZINGARELLI N. éd.), Bologna, Zanichelli,<br />
2008 = Z<br />
Il Devoto-Oli 2010. Vocabolario della lingua italiana (DEVOTO G. – OLI G. éds.), Firenze, Le<br />
Monnier, 2009 = DO<br />
304 Notamment boule, claire et sommier.<br />
305 Notamment abat-jour, baguette, breloque, caveau, maîtresse, soubrette et toupet.<br />
306 Le corpus de cet ouvrage est métalexicographique : il fait recours à d’autres dictionnaires, mais aussi à des<br />
répertoires, des articles de linguistique, des glossaires.<br />
212
Dans l’analyse qui suit, nous reproduisons en premier l’entrée tirée du DB Garzanti [G] ;<br />
suivront nos réflexions, qui s’appuient sur les dictionnaires du corpus que nous venons de<br />
détailler.<br />
abat-jour n.m.invar. (fr.) 1 (lampada da tavolo) lampe (f.) de chevet Falso francesismo 2<br />
(paralume) abat-jour. [G]<br />
Ce cas relève de la catégorie de l’évolution sémantique. D’après PR11, un abat-jour en<br />
français est un « réflecteur qui rabat la lumière d’une lampe », non la lampe elle-même.<br />
D’après GDU, cet emprunt date de 1877. <strong>DEL</strong>I reproduit l’évolution des graphies de ce<br />
mot en italien : abajour, 1877 ; abagiur 1881, abagior 1883 ; abat-jour 1883, toutes avec le sens<br />
de paralume. Le sens italien de lampada con paralume est attesté après 1956.<br />
DeM, SC, T, GI, DO et <strong>DEL</strong>I (pour des raisons historico-étymologiques, évidemment)<br />
définissent d’abord le sens de paralume, ensuite celui de « lampada con paralume ».<br />
L’extension sémantique de cet emprunt s’est donc produite il y a environ 50 ans, à partir du<br />
sens du mot français.<br />
baguette n.f.invar. (fr.) 1 (di calza) baguette. 2 (taglio di pietre preziose) baguette: taglio a<br />
baguette, taille en baguette. 3 (estens.) (spilla di forma allungata) barrette Falso francesismo 4<br />
(filone di pane) baguette. [G]<br />
Ce deuxième faux-emprunt désigne une barrette, c’est-à-dire une épingle de forme allongée.<br />
Il s’agit d’une autre évolution sémantique, sur la base de la forme de la baguette de pain. Il<br />
faut aussi remarquer que ce sens de « barrette » est absent dans tous les dictionnaires<br />
italiens de notre corpus. Voici donc un cas où le DB s’avère plus spécialisé que les<br />
monolingues, y compris des dictionnaires de référence comme le GDU et le T.<br />
beguine n.f.invar. (mus.) (ballo lento originario delle Antille in voga negli anni Trenta-Cinquanta)<br />
biguine Falso francesismo. [G]<br />
Ce troisième faux emprunt s’avère beaucoup plus compliqué que les deux précédents. Il<br />
devrait s’agir d’une simple adaptation graphique : la forme italienne beguine ne serait qu’une<br />
autre graphie pour le français biguine.<br />
Les dictionnaire de notre corpus montrent que la situation est en fait plus compliquée. SC,<br />
beguine : « voce fr. forse deriv. di ingl. to begin ‘iniziare’ attrav. biguine, nome del ballo nella<br />
parlata creola della Martinica. □ a. 1965 ». Il s’agirait donc d’un emprunt français, à travers<br />
l’anglais.<br />
GDU dans la rubrique étymologique de beguine : « 1939 ; dall’ingl. beguine, pl. béguines, 1955,<br />
dal fr. béguine, dal creolo biguine ». Selon T écrit qu’il s’agit d’un anglicisme, « dal fr. béguin<br />
‘capriccio amoroso’ ». <strong>DEL</strong>I : « vc. fr., presa da biguine (ingl. begin ‘cominciare’ ?), n. della<br />
213
danza nella parlata creola della Martinica [...], neol. anche nell’ingl. d’America » ; DO « dal<br />
fr. béguin, nome della danza nel creolo della Martinica - 1939 ». GI « Voce dal fr. d’America ;<br />
forse connessa con l’ingl. to begin ‘cominciare’ ».<br />
Il est donc malaisé de retracer les origines de ce prétendu faux emprunt. Nous pouvons<br />
cependant remarquer qu’il doit y avoir eu une filiation croisée, puisant à l’anglais et au<br />
français. La forme actuelle employée en italien, beguine, trahit plutôt un héritage anglosaxon.<br />
bluette agg. e n.m.invar. bleu turquoise Falso francesismo. [G]<br />
Le mot ci-dessus présente une fausse dérivation à partir du français bleuet (mais la graphie<br />
bluet est aussi acceptée) 307 , qui indique une plante aux fleurs bleues.<br />
SC : « adatt. di fr. bleuet ‘fiordaliso’ □ a. 1930 ». T : « voce pseudo-francese, tratta dal fr. bluet<br />
‘fiordaliso’ ». GDU « 1930 ; voce pseudofr. dal fr. bluet ‘fiordaliso’, der. di bleu ‘blu’ ». Dans<br />
ce cas, il y a eu une italianisation de la forme bl(e)uet, avec une nouvelle graphie (bluette)<br />
respectant la phonologie du français.<br />
boule n.f.invar. 1 (borsa dell’acqua calda) bouillotte; (per il ghiaccio) vessie à glace Falso<br />
francesismo 2 (chim.) boule. [G]<br />
Comme l’écrit SC, il s’agit d’une « voce fr. riduzione del sintagma boule d’eau chaude ‘bolla<br />
d’acqua calda’ » 308 . Ce cas relèverait donc du ‘modèle tronqué’, proposé par HUMBLEY<br />
(2007).<br />
breloque n.f.invar. (fr.) 1 (antiq.) (ciondolo da appendere alla catena dell’orologio o a un braccialetto)<br />
breloque 2 (ciondolo apribile con ritratto di persona cara) médaillon (m.) Falso francesismo. [G]<br />
Le faux emprunt concerne donc la deuxième acception. SC écrit qu’il s’agit d’une « voce fr.<br />
di etim. discussa ». Dans ce cas le bijou, introduit en Italie avec une forme-sens donnée,<br />
aurait connu une modification, élargissant son domaine d’emploi et désignant un référent<br />
nouveau, tout en gardant sa forme. Le mot se comporte donc comme n’importe quel mot<br />
d’un fonds lexical autochtone, bien que son intégration en italien ne remonte qu’à 1955,<br />
d’après DeM. Nous avons bien rangé ce mot dans la catégorie de l’évolution sémantique.<br />
carré n.m.invar. 1 (sartoria) empiècement Falso francesismo 2 (macelleria) carré 3 (al gioco)<br />
carré ◊ agg.invar. pan carré, pain de mie Falso francesismo. [G]<br />
307 Par contre, Z fait dériver le mot directement du français bleu, sans passer donc par la fleur.<br />
308 DO propose la même étymologie.<br />
214
Cette entrée présente deux faux emprunts : un comme terme de couture, l’autre dans<br />
l’expression pan carré.<br />
D’après le <strong>DEL</strong>I, le premier sens (traduit comme empiècement par G) ne serait pas un faux<br />
gallicisme, mais un emprunt tout court : il est défini comme « rettangolo di tessuto che,<br />
nelle camicie, scende sulle spalle e sul petto ». Cette définition paraît en effet coïncider avec<br />
celle de PR11 : « Morceau de tissu en forme de carré, qu’on plie suivant la diagonale et<br />
qu’on porte comme foulard, comme fichu ».<br />
Pour ce qui est de pan carré, T confirme qu’il s’agit d’une « espressione pseudo-francese » ;<br />
<strong>DEL</strong>I cite la date d’attestation, qui serait 1956. Ce cas ne relève donc pas des catégories<br />
retenues : il serait plutôt un faux-gallicisme composé, à partir d’un mot français (carré) et<br />
d’un mot italien (pan).<br />
casqué n.m.invar. (figura del tango) renversement Falso francesismo. [G]<br />
SC : « voce pseudofr. deriv. di casquer ‘cascare’ » ; Z : « dal fr. casquer ‘cascare’ (falso<br />
francesismo) » ; GDU « 1963 ; voce pseudofr. tratta da cascare » ; T : « voce pseudofrancese,<br />
di formazione scherz., tratta dal verbo cascare ; DO : « voce pseudofr. tratta da<br />
cascare ». GI : « Voce pseudo-francese, di formazione scherz., tratta dal verbo cascare ». Il<br />
s’agit bien entendu d’une dérivation classique verbe → participe passé en fonction<br />
nominale. Le nœud de la question est ici de savoir si la dérivation s’est faite à partir de<br />
l’infinitif français casquer (comme l’affirment SC et Z) ou bien à partir de l’italien cascare<br />
(c’est la position de GDU, T, DO, GI), duquel on aurait tiré une forme francisante, sans<br />
doute par plaisanterie (T, GI). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une formation par fausse<br />
dérivation du français casquer ; elle ne rentre donc pas dans la classification retenue.<br />
caveau 309 n.m.invar. (sotterraneo blindato spec. di una banca) chambre blindée, chambre forte,<br />
salle (f.)des coffres-forts Falso francesismo. [G]<br />
SC : « voce fr. dim. di cave ‘cantina’ » ; Z : « fr. dim. di cave ‘cantina’ ; 1913 » ; GDU : « 1903 ;<br />
fr. caveau propr. ‘sotterraneo’ » ; T : « der. di cave ». L’étymologie est claire, il s’agit bien<br />
d’une petite cave. Seulement GDU juge nécessaire de préciser que, à proprement parler, le<br />
mot français caveau désigne généralement un « lieu souterrain », sans indiquer une chambre<br />
blindée d’une banque, ainsi que le mot italien le fait. C’est un cas assez rare où un mot<br />
français a tout de suite été emprunté en italien avec un sens original ; il rentre donc dans la<br />
catégorie de l’évolution sémantique.<br />
chiffonnière n.f. (tavolino da lavoro con cassetti) table à ouvrage, travailleuse Falso<br />
francesismo. [G]<br />
309 Cf. WERLY (1995 : 162).<br />
215
Pour T, il s’agit une forme ancienne (non datée) de chiffonnier ; SC : « voce fr. deriv. di<br />
chiffon », de même pour Z et DO. GDU définit ainsi le mot : « tavolino con cassetti, per<br />
lavori femminili (ciffonera, sciffonera nel 1839 nel dial. milan. [...] ; it. scifoniera : 1877 [...] ;<br />
chifonniere : 1883 ». Le GDU lance une piste très intéressante : le mot était en principe un<br />
régionalisme, milanais notamment (tiré de chiffon), francisé a posteriori pour donner sans<br />
doute des ‘marques de noblesses’ à une forme qui de toute façon n’est pas attestée en<br />
français. Pour ce qui est de notre classement, ce mot est donc une dérivation à partir d’un<br />
mot français.<br />
claire 310 n.f.invar. (region.) (saracinesca di negozi) rideau (m.) de fer Falso francesismo. [G]<br />
GI est le seul monolingue qui répertorie le mot. La définition est « saracinesca avvolgibile »,<br />
avec une étymologie « voce fr., propr. ‘chiara’ » qui n’ajoute rien et même brouille les cartes.<br />
DI est plus précis, il s’agit d’un régionalisme : « clèr, sf. (lombardo). ‘Saracinesca avvolgibile<br />
con aperture o a maglie per permettere la sorveglianza del negozio dall’esterno’. Dal<br />
francese claire-voie, letteralmente ‘chiara vista’, usato fin dal Medioevo per indicare una<br />
gabbia a graticci ». Ce cas relève donc du modèle tronqué, avec une graphie flottante, qui<br />
peut devenir phonétique (cler).<br />
crème caramel n.m. o f.invar. (cuc.) crème (moulée) au caramel, crème renversée Falso<br />
francesismo. [G]<br />
Ce cas nous paraît relever d’un ‘faux faux emprunt’ : la forme « crème caramel » est<br />
également attestée en français, donc nous croyons qu’il est abusif de parler ici de faux<br />
emprunt.<br />
en plein n.m.invar. (nel gioco della roulette) fare (un) en plein, (anche fig.) tout rafler Falso<br />
francesismo. [G]<br />
<strong>DEL</strong>I définit ainsi cette expression : « nel gioco della roulette, uscita dell’unico numero su<br />
cui si è puntato ». L’expression paraît une création italienne tout court : aucun modèle<br />
français n’est repérable.<br />
flobert n.m.invar. (fucile ad aria compressa) fusil à air comprimé ◊ n.f. (pistola) pistolet à air<br />
comprimé Falso francesismo. [G]<br />
T nous apprend que ce mot dérive « dal nome dell’armaiolo fr. N. Flobert (1819-1894) ». Il<br />
s’agit donc d’un cas évident d’antonomase.<br />
310 La variante cler est également attestée.<br />
216
frappè n.m.invar. (bevanda frullata a base di latte e ghiaccio) milk-shake | frappè alla fragola,<br />
milk-shake à la fraise Falso francesismo. [G]<br />
SC : « voce fr., propr. part.pass. di frapper ‘battere’. Z : « dal fr. frappé, part. pass. di frapper<br />
‘battere’ dal francone hrappan, col sign. particolare assunto in enologia di ‘raffreddato nel<br />
ghiaccio tritato’ ». T : « adattamento del fr. frappé (che non ha però quest’accezione e questo<br />
uso), part. pass di frapper ‘colpire’ ; propriam. frappé par la gelée ‘colpito dal gelo’, quindi<br />
‘ghiacciato’ ». La dérivation (avec adaptation graphique de l’accent aigu final à l’accent grave<br />
de l’italien) de la forme française frappé est évidente ; il s’agit plus précisément d’une<br />
conversion, vu le changement de catégorie gramaticale (adjectif → nom).<br />
froissé agg.invar. (spiegazzato, che assume colore cangiante) frappé : velluto froissé, velours<br />
frappé Falso francesismo. [G]<br />
Ce mot est absent dans tous les monolingues italiens de notre corpus, il s’agit évidemment<br />
d’un terme très spécialisé. Pour ce qui est de notre classement, cet exemple aussi rentre<br />
dans la catégorie de la dérivation (une catégorie qui n’est pas présente dans le graphique).<br />
maîtresse n.f.invar. (donna che gestisce o gestiva una casa di tolleranza) maquerelle, tenancière<br />
d’une maison close Falso francesismo. [G]<br />
<strong>DEL</strong>I : « tenutaria di una casa di tolleranza, 1957 ». DO : « padrona, signora, amante ; in<br />
Italia, nel passato, la tenutaria di una casa di tolleranza ». Nous ne sommes pas en mesure<br />
de faire des hypothèses sur la naissance de ce sens italien du mot maîtresse. Ce cas relève de<br />
la catégorie de l’évolution divergente.<br />
manicure n.f. e m.invar. 1 (manicurista) manucure (f.) 2 (operazione di curare le mani e le unghie):<br />
(farsi) fare la manicure, se faire les ongles; fare la manicure a qlcu, faire les ongles à qqn Falso<br />
francesismo. [G]<br />
Nous sommes en présence d’une adaptation graphique, avec une variation vocalique (u →<br />
i). T : « adattamento del fr. manucure (attestato anche nella forma manicure) » ; SC : « fr.<br />
manucure, manicure » ; Z : « pseudo-fr. manucure », DO : « dal fr. manucure ». Dans le<br />
Dictionnaire historique de la langue française (A. REY éd.), 2006, nous pouvons lire que « le<br />
vocalisme de pédicure a d’ailleurs suscité une forme manicure (1869) qui n’a pas vécu ». Nous<br />
nous demandons si l’emprunt manicure en italien, que DeM date de 1918, a suivi le même<br />
chemin.<br />
mouliné agg. e n.m.invar. (cotone) mouliné, (filato ritorto per cucito e ricamo) coton brillanté<br />
Falso francesismo. [G]<br />
217
T : « part. pass. di mouliner ‘mulinare’ » ; SC : « voce fr., part.pass. di mouliner ‘torcere’ ». Il<br />
s’agit bien évidemment d’une dérivation du verbe français mouliner ; ici aussi, il y a eu une<br />
conversion, parce que le mot est aussi employé comme substantif en italien.<br />
paillard n.f.invar. (cuc.) (fetta di vitello ai ferri) tranche de veau grillée Falso francesismo. [G]<br />
GI propose : « voce fr. ; dal cognome del proprietario del ristorante che la ideò ». GDU :<br />
1963 nella var. Paillarde ; prob da Paillard, nome dell’inventore della ricetta ; T : « voce<br />
pseudofr. che si fa derivare dal cognome, Paillard, del proprietario di un ristorante parigino<br />
del periodo della belle époque ». Ce faux emprunt relève clairement du procédé de<br />
l’antonomase.<br />
porte-enfant n.m.invar. coussin de baptême Falso francesismo. [G]<br />
GI « voce pseudo-fr. ». <strong>DEL</strong>I précise « Voce foggiata alla francese, e così comune che<br />
trapassò al dialetto », 1901 ; pseudofrancesismo, comp. col fr. porter ‘portare’ e enfant<br />
‘bambino, infante’ ». Il s’agit donc d’un faux emprunt composé, à partir de deux formants<br />
français.<br />
séparé n.m.invar. (locale o parte di un locale isolato dal resto dell’ambiente) loge (f.) Falso<br />
francesismo. [G]<br />
Z et SC notent : « voce fr. » ; <strong>DEL</strong>I précise : « si noti che in fr. il termine non è conosciuto<br />
in questo sign. L’Accademia d’Italia [...] propose di sostituirlo con ‘riservato’ ». T confirme :<br />
« l’uso è ignoto alla lingua fr. ». Nous avons affaire à une dérivation, mieux une conversion<br />
car en français séparé n’est pas attesté comme substantif.<br />
sommier n.m.invar. (divano letto) canapé-lit Falso francesismo. [G]<br />
SC : « voce fr., riduzione del sintagma sommier de lit ‘saccone del letto’ ». Il s’agit donc d’un<br />
autre cas de ‘modèle tronqué’.<br />
soubrette n.f.invar. (attrice protagonista di un varietà) vedette de music-hall Falso<br />
francesismo. [G]<br />
GI précise : « voce fr. ; propr. ‘servetta brillante delle commedie ». Le dictionnaire qui est le<br />
plus riche en renseignements est naturellement <strong>DEL</strong>I, qui consacre une vaste rubrique au<br />
terme : « Per la servetta di teatro in francese il termine è documentato fin dal 1640, ed è un<br />
meridionalismo passato nel nord [...]. La voga continua nell’Ottocento [...] ma com’è noto<br />
solo in italiano la parola acquista significati nuovi, ottocenteschi, di soprano leggero<br />
nell’opera e poi di attrice giovane e attraente nell’operetta e nella rivista ». Nous avons donc<br />
218
une extension sémantique évidente : le mot s’est peu à peu éloigné du sens français de<br />
soubrette (suivante ou servante), pour arriver à désigner une figure tout à fait différente.<br />
tabarin n.m.invar. (locale notturno) boîte (f.) de nuit Falso francesismo. [G]<br />
DeM : « tratto dalla loc. fr. Bal Tabarin, nome di un locale notturno di Parigi, da Tabarin,<br />
nome di un personaggio comico vissuto tra la 2ª metà del sec. XVI e la 1ª metà del XVII,<br />
così chiamato perché indossava il tabarro ». GI, par contre : « voce fr. ; prob. dal<br />
soprannome di un attore operante a Parigi nel sec. XVII, che indossava in scena un ampio<br />
mantello (tabar) ». ; <strong>DEL</strong>I date sa première attestation en 1933 ; 1918 pour bal tabarin ; il fait<br />
remarquer « l’arbitraria riduzione italiana a ‘tabarin’ », qui dérive du dancing homonyme qui<br />
fut inauguré à Paris en 1904. Quoi qu’il en soit, ce faux emprunt s’est formé à partir d’un<br />
procédé fondé sur l’antonomase.<br />
tonné agg.invar. → tonnato Falso francesismo. [G]<br />
SC: « voce pseudofr., corrispondente al fr. au thon ». Il s’agit donc d’une fausse dérivation.<br />
torchon n.m.invar. (collana con più fili arrotolati a torciglione) torsade (f.) Falso francesismo.<br />
[G]<br />
T : « pseudofrancesismo, interpretazione arbitraria del fr. torchon, che significa propriamente<br />
‘collana, monile’ (ma che ha anche altre accezioni, non però quella che qui segue) » ; pour<br />
ce dictionnaire, ce mot montrerait une extension sémantique divergente par rapport au<br />
français torchon. Pour DeM, il s’agit plutôt d’une dérivation : « der. di torche ‘cordone di<br />
paglia intrecciata’ ». Il est difficile de trancher, mais nous penchons plutôt pour une<br />
évolution sémantique du terme.<br />
toupet n.m.invar. (posticcio di capelli) postiche Falso francesismo. [G]<br />
<strong>DEL</strong>I « voce fr. documentata fin dal 1148, ed entrata in Italia come acconciatura di moda,<br />
nel Settecento » ; DeM : « fr. toupet propr. ‘ciuffo’, dal franc. * top, cfr. ted. mod. Topf, ingl. top<br />
‘sommità’). Au point de vue linguistique (laissant donc de côté l’étymologie), il s’agit d’une<br />
extension sémantique du français toupet.<br />
vin brûlé n.m.invar. vin chaud (avec du sucre et des épices) Falso francesismo. [G]<br />
SC : « voce pseudofr. 1940 » ; GDU le classe comme terme français ; <strong>DEL</strong>I a l’entrée :<br />
« vino brûlé , 1855 » ; toujour dans <strong>DEL</strong>I, à l’entrée brûlé on peut lire: « 1848, « è da lasciarsi<br />
ai cuochi italo-galli, che avevano introdotto, almeno a Milano, il (vin) brulé : 1839 [...] e il café<br />
219
ulé : 1843 ». Ce faux emprunt est donc un faux gallicisme composé, il se rapproche du cas<br />
de pan carré analysé auparavant.<br />
A la lumière des considérations que nous avons avancées, nous pouvons regrouper les faux<br />
emprunts analysés dans les catégories suivantes.<br />
Adaptation graphique. L’écart du modèle français se produit au niveau du signifiant,<br />
comme dans beguine et manicure.<br />
Antonomase. Il s’agit d’une catégorie qui est plus rhétorique que linguistique, mais elle<br />
peut rendre compte de mots comme flobert, paillard et tabarin.<br />
Création formelle. Dans le cas de l’expression en plein, il s’agit d’une locution qui paraît<br />
avoir été créée de toute pièces en italien.<br />
Dérivation. A la différence de HUMBLEY (2007), nous n’avons pas inclus les cas de<br />
dérivation dans la catégorie de l’évolution morphologique divergente : les mots relevés ne<br />
sont pas des dérivations italiennes de vrais emprunts, mais ils ont été forgés de façon<br />
autonome par le système linguistique italien. Les faux emprunts dérivés ne procèdent donc<br />
pas d’un mot existant en français, mais le modifient morphologiquement : bluette 311 , casqué,<br />
chiffonnière, frappé, froissé, mouliné, séparé, tonné.<br />
Emprunts véritables. Il s’agit de ‘faux faux emprunts’, pour lesquels la dénomination de<br />
‘faux gallicisme’ s’est avérée abusive : carré, crème caramel.<br />
Evolution sémantique. Ce sont des mots qui existent en français avec cette forme, mais<br />
qui ont subi une extension sémantique dans le passage à l’italien : abat-jour, baguette, breloque,<br />
maîtresse, soubrette, toupet, torchon.<br />
Modèle tronqué. C’est la même catégorie employée par HUMBLEY (2007) : boule, claire,<br />
sommier.<br />
Mots composés. Il s’agit de mots qui font recours à un (ou deux) formant(s) français : pan<br />
carré, porte-enfant, vin brûlé.<br />
Pour ce qui est des faux italianismes en français, les dictionnaires de notre corpus ne les<br />
signalent pas spécifiquement. Mais nous pouvons en citer un, qui est aussi un néologisme, à<br />
savoir mercato.<br />
Dans notre mémoire de maîtrise (TALLARICO 2004), nous avions analysé les italianismes<br />
néologiques dans la presse française. Nous avions noté plusieurs attestations du faux<br />
italianisme mercato dans Le Monde, dans le sens de « marché de joueurs, surtout de<br />
311 Le mot bluette existe, mais comme substantif féminin qui dénote une toute autre réalité, donc on ne peut<br />
pas parler d’évolution sémantique.<br />
220
footballeurs ». Il était aisé de prévoir (TALLARICO 2004 : 227) que cet emprunt deviendrait<br />
plutôt stable en français, car il comblait un écart sémantique et qu’il n’était pas en<br />
compétition avec un lexème français. Son intégration complète dans le lexique a été en effet<br />
assez rapide ; Le Petit Larousse a accueilli ce mot à partir de l’édition 2008, avec la définition<br />
suivante « Marché des transferts, dans les sports d’équipe, spécial. le football, et dans<br />
l’audiovisuel; période où ces transferts ont lieu ». Dans les DB italien-français, par contre, la<br />
situation est assez paradoxale. Seulement SL a enregistré le mot dans la microstructure,<br />
mais cela est compréhensible, vu le statut néologique du terme. De toute façon, si on<br />
consulte l’entrée calcio(-)mercato dans la section italien-français, seuls G et SL ont récemment<br />
ajouté l’équivalent mercato, et toujours en deuxième position. Comment peut-on expliquer<br />
une telle prudence? Nous croyons qu’on craint de choquer le lecteur avec un néologisme, et<br />
d’autant plus avec un équivalent français qui a l’air italien. Cependant, le terme est le<br />
meilleur équivalent possible, il est monosémique et monolexématique. Une possible<br />
explication peut être celle qui est avancée par ADAMSKA-SALACIAK (2007: 205): « In<br />
general, giving one’s seal of approval to a borrowing is not something that lexicographers<br />
undertake lightly ».<br />
En ce qui concerne mercato, pour reprendre la classification de HUMBLEY (2007), la<br />
catégorie en question est celle du modèle tronqué (calciomercato) ; on pourrait également<br />
l’interpréter comme une polarisation du sémantisme du mot mercato en italien.<br />
221
II.2.2.1 La valeur culturelle des faux emprunts<br />
A la suite de cette analyse de caractère linguistique, nous nous demandons maintenant<br />
quelle peut être la valeur culturelle de ces faux emprunts en italien.<br />
BARTHES (1964 : 130) écrit, sur la lancée de HJELMSLEV, « un système connoté est un<br />
système dont le plan d’expression est constitué lui-même par un système de signification ».<br />
Dans le cas des faux gallicismes en italien, à notre avis le français joue précisément ce rôle :<br />
il s’agit d’un système connoté pour l’italien, qui donne un surplus d’expressivité au<br />
signifiant, et par conséquent au signifié.<br />
Nous faisons l’hypothèse que la valeur culturelle des faux emprunts consiste en une<br />
fascination d’ordre phonosymbolique, que l’on pourrait étudier sous l’angle de la<br />
représentation collective et du prestige de la langue française en Italie. Nous croyons<br />
opportun citer ce que WERLY écrivait à propos de son propre corpus, qui comprenait des<br />
dénominations exogènes (emprunts italiens et français) des lieux publics : « Le choix<br />
volontaire de se servir de la langue française, est déjà un choix non seulement culturel, mais<br />
aussi idéologique : il traduit le sentiment, la volonté d’appartenir à un groupe, à une<br />
minorité, à une élite » (1995 : 160).<br />
Dans cette même optique, CHA<strong>DEL</strong>AT (2000 : 199-200) remarque, à propos des emprunts<br />
français en anglais : « Les emprunts français ne remplissent pas une fonction néologique. La<br />
fonction principale des mots français est plutôt à cet égard une fonction sociale et<br />
linguistique que l’on pourrait appeler en usant d’un néologisme ‘hétérologique’ ». Il s’agit<br />
donc de signes qui paraissent connoter leur propre prestige, et qui expriment l’altérité au<br />
point de vue formel, tout d’abord.<br />
Si cette fonction ‘hétérologique’ peut être opératoire pour les emprunts, elle l’est d’autant<br />
plus pour les faux emprunts, qui n’existent pas tels quels et ne signifient rien dans la langue<br />
prêteuse, mais qui acquièrent un sens dans la langue emprunteuse grâce à leur forme<br />
uniquement. Pour ‘forme’ nous entendons évidemment les « marques formelles étrangères<br />
qui distinguent [le faux emprunt] du lexique autochtone, p. ex. des phonèmes ou des<br />
graphèmes étrangers » (WINTER-FROEMEL 2009 : 83).<br />
Les faux emprunts qui se sont installés dans le lexique italien par une extension sémantique,<br />
comme abat-jour ou baguette ont pu profiter d’un signifiant qui existait déjà et lui ont donné<br />
une signification supplémentaire. Les mots qui s’originent d’une troncation du modèle<br />
(boule, claire, sommier) témoignent par contre d’une certaine désinvolture dans le traitement<br />
du signifiant, qui se fait malléable. Nous croyons cependant que les plus intéressants à<br />
étudier sur le plan culturel sont les antonomases, les dérivés et les mots composés.<br />
Les champs sémantiques représentés par ces mots sont parmi les plus traditionnels : les<br />
boissons et les mets (frappé, paillard, pan carré, tonné, vin brûlé) 312 , la couture (froissé, mouliné) 313 ,<br />
312 Nous rappelons ausssi le ‘vrai’ emprunt crème caramel.<br />
222
la danse (casqué, tabarin) et le décor (chiffonnière, séparé). Il s’agit de domaines où la France<br />
bénéficie d’un prestige qui dure depuis des siècles ; la création de ces faux emprunts en<br />
italien à donc été rendue possible, à notre avis, par une situation qui rendait tout d’abord<br />
ces mots ‘vraisemblables’ dans ces contextes et qui, en plus, pouvait aisément connoter ces<br />
mots comme ‘prestigieux’ et en faciliter l’essor. Ces faux gallicismes ont été fabriqués, en<br />
définitive, en fonction de ce qu’on imagine être français. D’autres créations, comme bluette et<br />
porte-enfant sont également significatives : elles s’appuient sur le signifiant pour connoter le<br />
référent, à travers une dénomination que l’on pourrait à juste titre qualifer de<br />
‘hétérologique’. Il s’agit donc d’un a priori, qui a ses raisons dans ce qu’écrivait<br />
ULLMANN (1952 : 150) : « les mots étrangers peuvent provoquer des réactions esthétiques qui<br />
ne sont pas toujours exemptes de parti pris ».<br />
L’étude de la dimension interculturelle dans les DB peut donc aussi passer par cette<br />
catégorie assez singulière de mots, qui trouvent leur sens dans la connotation plutôt que<br />
dans la dénotation : la fascination qui exerce le signifiant de la langue prêteuse (ou ce qui<br />
paraît ‘en avoir l’air’) est tellement puissante qu’elle peut se passer de son signifié. Ce<br />
décrochage du système de signification (BARTHES 1964) est à notre avis le signe de la valeur<br />
culturelle des faux emprunts, qui perturbent l’intégrité du signe pour qu’il signifie<br />
‘autrement’ qu’il ne le fait.<br />
313 A ces mots s’ajoute le ‘vrai’ emprunt carré.<br />
223
224
CONCLUSIONS<br />
Dans la première partie de cette thèse nous avons réfléchi sur les valeurs culturelles dans le<br />
lexique et sur la possibilité que les DB rendent compte de cette dimension, que nous avons<br />
appelé interculturelle.<br />
Après avoir défini les notions de culture et interculturel, nous avons exploré les rapports entre<br />
langues et visions du monde. En écartant une hypothèse forte du relativisme linguistique,<br />
nous avons suggéré la piste du parallélisme, qui indique des angles perceptifs privilégiés que<br />
les langues offrent, sans les imposer, aux locuteurs.<br />
Une réflexion sémantique a ensuite mis en valeur le statut épistémologique de la<br />
lexicographie bilingue, les apories théoriques de l’équivalence et de la représentation du<br />
sens dans les dictionnaires. Nous avons également insisté sur la motivation culturelle des<br />
conceptualisations 314 .<br />
Dans les chapitres centraux de la première partie, nous nous sommes concentré tout<br />
d’abord sur l’écart, en soulignant ses implications sémantiques, référentielles et<br />
lexicographiques. Puis, nous nous sommes arrêté sur la traduction en lexicographie bilingue<br />
et sur les enjeux de l’équivalence, liés également à la dimension expressive ; finalement, le<br />
thème des lacunes lexicales a montré l’émergence des motivations socio-culturelles dans la<br />
création des unités.<br />
L’attention s’est ensuite déplacée sur les rapports entre théorie sémantique et lexicographie<br />
pratique, qui paraissent aujourd’hui être moins solides que dans le passé ; avec l’étude de la<br />
notion d’objectivité, par contre, nous sommes revenu sur le thème de l’équivalence et sur les<br />
valeurs non dénotatifs qu’elle implique.<br />
Nous avons suivi cette piste en explorant le concept de connotation, évoquant le débat sur<br />
ce thème et montrant les difficultés de la prise en compte de cette dimension par les<br />
dictionnaires.<br />
Cette première partie s’est achevée par une réflexion sur quelques approches qui valorisent<br />
la dimension culturelle de la langue, à savoir les mots-clés, la lexiculture, les scénarios<br />
culturels et l’épaisseur du langage.<br />
Au cours de la deuxième partie, consacrée à l’analyse du corpus, nous avons essayé de<br />
‘piéger le culturel’ (comme dirait GALISSON) dans les DB.<br />
Notre réflexion a entamé avec les écarts. Nous avons adopté une conception formelle de<br />
l’écart, en le définissant comme ‘équivalence de >1 signes’. Nous avons ensuite procédé à<br />
une différenciation des écarts en cinq typologies : écarts dictionnairiques (ED), écarts<br />
314 Cf. NYCKEES (1998).<br />
225
sémantiques (ES), écarts terminologiques (ET), écarts morphologiques (EM), écarts<br />
référentiels (ER). Une analyse ponctuelle de la lettre A dans les deux directions des DB de<br />
notre corpus a permis de mettre à l’épreuve notre conception.<br />
Les écarts, nous le rappelons, représentent le moment où le postulat d’équivalence 315 , qui<br />
représente le pivot théorique des DB, entre en crise. Tels que nous les avons classifiés, ils<br />
peuvent être fonction :<br />
- de l’entreprise lexicographique (ED)<br />
- du découpage sémantique (ES)<br />
- des structures morphologiques (EM)<br />
- des langues de spécialité (ET)<br />
- des lacunes référentielles (ER)<br />
Les écarts qui révélaient des intersections entre langue et culture ont été qualifiés de<br />
‘culturels’ : ils ont fait l’objet d’une attention particulière. En général, nous avons vu<br />
comment les besoins socio-culturels des locuteurs exercent une pression sur le système<br />
lexical et sont à l’origine de la création des mots.<br />
D’autres phénomènes relevant de l’équivalence ont aussi mis en évidence des contenus<br />
culturels, notamment les realia, la présence de traits encyclopédiques dans l’équivalence, la<br />
connotation, les euphémismes, les associations culturelles, les noms déposés et la<br />
dimension pragmatique.<br />
Notre analyse s’est ensuite élargie à d’autres sections de la microstructure. Notamment,<br />
avec les exemples nous avons pu observer le niveau sémio-culturel à l’œuvre. Les exemples<br />
ont révélé, tout d’abord, un fort penchant pour l’encyclopédisme ; il a été également<br />
possible de repérer des traces de l’idéologie des lexicographes, des valeurs et des points de<br />
vue partagées. Dans ce sens, les dictionnaires se sont confirmés le miroir de leur époque.<br />
Un examen des notes culturels dans les DB nous a montré que la culture ‘cultivée’ est<br />
surreprésentée au détriment de la culture ‘quotidienne’. Les DB se rapprochent ainsi de<br />
l’encyclopédie, perdant l’occasion de fournir des balises pour l’utilisateur en quête d’un<br />
savoir lexiculturel.<br />
Finalement, l’étude de quelques faux gallicismes en italien nous a montré une autre facette<br />
de l’équivalence, où les enjeux tournent autour du signifiant ; les faux emprunts analysés<br />
jouent, d’après notre analyse, une fonction ‘hétérologique’ car ils expriment des valeurs<br />
d’altérité à travers leur forme.<br />
315 « The dictionary should offer not explanatory paraphrases or definitions, but real lexical units of the target<br />
langage » (ZGUSTA 1984 : 147).<br />
226
Il convient maintenant d’avancer quelques considérations sur le rapport langues/cultures à<br />
travers les DB. Quel type de discours est mis en place? Quel est le traitement de la<br />
dimension interculturelle dans les ouvrages étudiés ? Cette dimension, comme on vient de<br />
le voir, est visible dans le rôle des écarts, des exemples, des notes culturelles et des faux<br />
emprunts.<br />
Au cours de cette thèse, nous avons affirmé à plusieurs reprises le rôle identitaire et<br />
structurant du lexique 316 . L’intuition d’A. REY (1970 : 179), pour qui « les relations entre la<br />
langue d’une communauté humaine et sa culture – au sens anthropologique –, sa<br />
civilisation, sont particulièrement manifestes dans le lexique, dont les formes articulent en<br />
l’exprimant le contenu de l’expérience sociale », s’est révélée tout à fait pertinente pour<br />
notre étude.<br />
Comment pouvons-nous définir le lexique, à l’aune de notre travail ? Nous partageons la<br />
vision de FABER (1994 : 37), qui décrit le lexique comme « an intricate network of elements<br />
interconnected by cohesive, associative, lexical and encyclopedical functions ». La fonction<br />
encyclopédique, notamment, est opératoire dans les rapports entre les signes et le monde,<br />
elle rend compte du lien entre le linguistique et l’extralinguistique.<br />
Pour ce qui est des unités dont se compose le lexique, nous croyons qu’il faut dépasser une<br />
approche ‘interne’ et systémique. Nous entendons plutôt les mots comme des unités<br />
psychologiques et interactionnelles (LEWANDOWSKA-TOMASCZCYK 1988 : 25), qui agissent<br />
comme des « déclencheurs de représentations » (ROBERT 2003 : 263) et qui « deviennent les<br />
indices d’une valeur symbolique et d’une valeur symptomatique » (CLAS – ROBERTS 2003 :<br />
238). Les liens entre les unités lexicales et le système culturel dont ils découlent font en<br />
sorte que le mot devient « un véritable réservoir d’analogies mémorisées ou potentielles »<br />
(LERAT 1994 : 508).<br />
En ce qui concerne les motivations qui sous-tendent les créations lexicales, toujours LERAT<br />
(1976 : 48) nous rappelle que « les signes linguistiques naissent, vivent et meurent en<br />
fonction des besoins humains en matière de désignation, d’élaboration conceptuelle et de<br />
vie sociale ».<br />
C’est donc surtout à travers le lexique que les langues se font les véhicules de la culture,<br />
dont elles portent la marque. Ce présupposé nous a guidé dans le choix de mener notre<br />
investigation interculturelle dans le domaine de la lexicographie bilingue, d’autant plus que<br />
les dictionnaires sont reconnus à l’unanimité comme des ouvrages culturels.<br />
Une fois affirmé la valeur culturelle des unités lexicales et une fois choisi le DB comme<br />
terrain de recherche, la question s’est posée : où trouver la culture dans les DB ? Les<br />
propos de FOURMENT BERNI-CANANI résument bien la problématique :<br />
Si l’on estime, comme dans notre cas, que le binôme langue/culture n’implique pas une<br />
juxtaposition – d’un côté la langue, de l’autre la culture – mais une imbrication, une<br />
316 Cf. DE CARLO (1995).<br />
227
interpénétration à tous les niveaux de l’une dans l’autre, il devient extrêmement difficile<br />
d’établir une ligne de partage entre les deux et donc d’isoler ce que l’on peut ranger dans la<br />
rubrique ‘informations culturelles’ (2002b : 468).<br />
Etant donné la complexité du rapport langue-culture, nous avons adopté une approche<br />
éclectique pour essayer de rendre compte de la dimension (inter)culturelle dans les DB :<br />
nous avons étudié le thème de l’équivalence (qui engendre les écarts), puis nous avons<br />
analysé des énoncés (les exemples à fonction culturelle), des textes en marge de la<br />
microstructure (les notes culturelles) et une catégorie spéciale de mots (les faux emprunts).<br />
Il convient également de souligner que, dans les DB, le binôme langue / culture se décline<br />
au pluriel, car nous avons évidemment deux 317 langues-cultures qui sont mises en regard.<br />
Comme le note SZENDE (1999 : 218), « between two linguistic communities, there exists a<br />
more or less important degree of cultural overlap ». C’est un degré que l’on pourrait estimer<br />
maximal, pour deux langues-cultures comme le français et l’italien qui sont aussi<br />
typologiquement très proches. Toutefois, cette proximité culturelle ne va pas toujours de<br />
pair avec une proximité linguistique. Le poids des écarts sémantiques entre français et<br />
italien, dont nous avons fait état dans notre thèse, a confirmé ce qu’écrivent GODDARD –<br />
WIERZBICKA (2002b : 267): « Even between genetically related languages spoken by people<br />
of relatively similar cultures (such as the languages of Europe), there are sizable semantic<br />
differences in all aspects of the lexicon – not just in words for material culture and social<br />
institutions ». Notre réflexion a essayé d’aller au-delà du débat classique sur les écarts<br />
référentiels pour prendre en compte les écarts de nature sémantique et pour en montrer la<br />
valeur culturelle.<br />
Au cours de notre analyse, nous avons envisagé le DB comme une plateforme de<br />
rencontre, un « espace langagier bilingue [qui] révèle [...] le besoin des deux<br />
langues/cultures de s’ouvrir vers le monde des choses » (CELOTTI 1998 : 140). Cette<br />
ouverture s’est manifestée notamment dans l’articulation linguistique-extralinguistique des<br />
écarts ; dans le rôle des exemples, qui vont au-delà de leur fonction métalinguistique et<br />
deviennent des énoncés relatifs au monde ; dans les notes culturelles, qui donnent accès à<br />
un « univers référentiel translinguistique » (REY 1987 : 1) à travers les mots ; dans les faux<br />
emprunts, enfin, qui valorisent les signes en fonction du prestige de la langue-culture<br />
prêteuse.<br />
La prise en compte de ces dimensions nous a permis de voir concrètement comment les<br />
DB peuvent jouer leur rôle de « tools for cross-cultural communication and cross-cultural<br />
understanding » (WIERZBICKA 1988 : 179).<br />
317 Bien entendu, ce n’est qu’une schématisation : comme chacun le sait, les communautés linguistiques à<br />
l’intérieur de l’espace francophone sont très variées. Nous avons pu observer, cependant, que le français des<br />
DB étudiés est surtout le français hexagonal. En ce qui concerne l’italien, nous faisons remarquer le choix de<br />
SL, qui a inclus trente-cinq mots de Suisse italienne dans sa nomenclature : une première apparition de la<br />
variation italophone ‘hors botte’.<br />
228
Dans son article sur la dimension culturelle dans les DB, CELOTTI (2002 : 456) affirme<br />
avoir limité son analyse<br />
au corps (équivalents) et à la queue (partie syntagmatique : exemples, collocations et<br />
combinaisons phraséologiques) de la microstructure où apparaissent des nouvelles formes<br />
lexicographiques porteuses d’informations culturelles en laissant de côté la tête de l’article<br />
(variations graphiques, prononciation, informations grammaticales et informations<br />
sémantico-stylistiques), ainsi que le choix des entrées et les annexes : autres composantes qui<br />
pourraient être elles aussi des lieux d’observation culturelle.<br />
Il s’agit de la même approche que nous avons adoptée dans cette thèse (à l’exception des<br />
notes culturelles, qui dépassent le cadre d’une microstructure traditionnelle).<br />
Il est évident que notre étude des traits culturels dans les DB est loin d’être exhaustive. De<br />
nouvelles pistes de recherche pourraient donc amener à se pencher, dans la microstructure,<br />
sur les informations phonétiques, orthographiques, grammaticales et sur les marques<br />
d’usage. Par ailleurs, la partie consacrée au péritexte (les préfaces, les annexes et les<br />
planches) pourrait elle aussi être porteuse de valeurs culturelles. Notamment, les annexes et<br />
les planches illustrées, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs études (CELOTTI 1998 ; 2005 ;<br />
HUPKA 2003), pourraient être étudiées au plus grand profit, dans le but d’en élucider la<br />
dimension (inter)culturelle.<br />
En ce qui concerne les thèmes à analyser transversalement, une étude de la représentation<br />
de la femme dans les DB serait à notre avis de grand intérêt pour l’exploration des rapports<br />
entre langues, dictionnaires et cultures. Les ‘questions de genres’ comptent déjà plusieurs<br />
travaux (à partir de l’article de <strong>DEL</strong>ESALLE – BUZON – GIRARDIN (1979), jusqu’à TELIYA et<br />
al. 1997, LO NOSTRO 2007 et ZOTTI 2007), mais la thématique est loin d’être épuisée.<br />
Pour terminer, nous souhaitons rappeler le vœu que LAURIAN (2004 : 13) avait formulé :<br />
« Il est urgent de continuer à réfléchir à ce qu’est la culture liée à une langue et au choix de<br />
connaissances culturelles que l’on veut fournir à travers le dictionnaire bilingue ». Nous<br />
avons essayé de répondre à cet appel et nous espérons que d’autres prendront bientôt le<br />
relais.<br />
229
230
BIBLIOGRAPHIE<br />
Dictionnaires<br />
Il Boch. Dizionario Francese-Italiano, Italiano-Francese, Bologna-Paris, Zanichelli-Le Robert,<br />
2007 (= B).<br />
Il Nuovo Dizionario Garzanti di Francese, Novara, De Agostini, 2006 (= G).<br />
Il Nuovo Hachette-Paravia. Il dizionario francese-italiano, italiano-francese, Torino, Paravia, 2007<br />
(=HP).<br />
Il Larousse Francese. I dizionari Sansoni, Milano, Sansoni Larousse, 2006 (= SL).<br />
Le Petit Robert de la langue française, Paris, Le Robert, 2010 (= PR11).<br />
Le Trésor de la langue française informatisé, CNRS-Atilf, 2004 (= TLFi).<br />
Il Dizionario Garzanti di Italiano 2008, De Agostini, Novara, 2007 (= GI).<br />
Dizionario De Mauro, Torino, Paravia, 2000 (= DeM).<br />
231
Articles et ouvrages<br />
ABDALLAH-PRETCEILLE M. (1983), « La perception de l’Autre. Point d’appui de l’approche<br />
interculturelle », Le français dans le monde, 181, p. 40-44.<br />
ADAMSKA-SALACIAK A. (2004), « Lexical and Semantic Borrowing in a Bilingual<br />
Dictionary », in WILLIAMS GE. – VESSIER S. (éds.), Proceedings of the Eleventh EURALEX<br />
International Congress, EURALEX 2004, Lorient, France, July 6-10, 2004, Lorient : Université<br />
de Bretagne-Sud, vol. 2, p. 443-450.<br />
ADAMSKA-SALACIAK A. (2007), « Lexicographers as borrowers – The importance of being<br />
CAMP 2 », in GOTTLIEB H. – MORGENSEN J.E. (éds.), Dictionary Visions, Research and Practice.<br />
Selected papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 203-215.<br />
AL B. (1983a), « Dictionnaire de thème et dictionnaire de version », Revue de phonétique<br />
appliquée, 66-68, p. 203-211.<br />
AL B. (1983b), « Principes d’organisation d’un dictionnaire bilingue », in Le dictionnaire :<br />
Actes du Colloque Franco-Néerlandais 28-29 avril 1981, Lexique, 2, Presses Universitaires de<br />
Lille, p. 159-165.<br />
AL-KASIMI A. (1983 [1977]), Linguistics and Bilingual Dictionaries, Leiden : E.J. Brill.<br />
ALLAIN J.-F. (1990), « ‘Psychopathologie’ de l’utilisateur du dictionnaire : le rapport à<br />
l’autorité », in MAGAY T. – ZIGANY J. (éds.), BudaLEX ’88 Proceedings : Papers from the 3rd<br />
International EURALEX Congress, Budapest, 4-9 September 1988, Budapest : Akadémiai Kiadó,<br />
p. 377-380.<br />
ALLAIN J.-F. (2003), « ‘Accommoder’ les écarts culturels : le modèle gastronomique », in<br />
SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 101-106.<br />
AMATI MEHLER J. – ARGENTIERI S. – CANESTRI J. (2003 [1990]), La Babele dell’inconscio.<br />
Lingua madre e lingua straniera nella dimensione psicoanalitica, Milano : Cortina.<br />
ANGELELLI R. – MUSARRA P. (1994), « Presupposti teorici e pratica didattica quotidiana :<br />
l’insegnante di lingue tra due culture [Ricercare a due voci] », Studi Italiani di Linguistica<br />
Teorica e Applicata (Lingue e culture a confronto : ricerca linguistica - insegnamento delle lingue. Atti del<br />
2° Convegno Internazionale di analisi comparativa francese-italiano, Milano 7-8-9 ottobre 1991),<br />
XXIII, n. 3, p. 627-640.<br />
ANTOINE F. (1998a), « Le dictionnaire bilingue peut-il avoir de l'humour ? », in ANTOINE F.<br />
– WOOD M. (éds.) Traduire l’humour. Ateliers, 15, p. 69-72.<br />
ANTOINE F. (1998b), « La représentation de la langue en lexicographie bilingue : éléments<br />
d'une théorie », Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain, 24, p. 127-181.<br />
232
ANTOINE F. (2000), « Proverbes en traduction : à l’intraduisible nul n’est résolu »,<br />
L’intraduisible. Ateliers, 24, p. 71-81.<br />
ANTOINE F. (2001), « Le dictionnaire bilingue : conservatoire de clichés ? », Palimpsestes, 13,<br />
p. 29-42.<br />
ATKINS S.B.T. (2002 [1996]), « Bilingual Dictionaries. Past, present and future », in<br />
CORREARD M.-H. (éd.), Lexicography and natural language processing. A Festschrift in honour of<br />
B.T.S. Atkins, Stüttgart : Euralex, p. 1-29 (déjà paru in GELLERSTAM M. et al. (éds.), Euralex<br />
1996 Proceedings, Göteborg : Göteborg University, p. 515-546).<br />
ATKINS S.B.T. (2008 [2002]), « Then and Now : Competence and Performance in 35 Years<br />
of Lexicography », in FONTENELLE T. (éd.) Practical Lexicography: a reader, Oxford: Oxford<br />
University Press, p. 247-272 (déjà paru in BRAASCH A. – POVLSEN C. (éds.), Proceedings of the<br />
Tenth EURALEX International Congress, EURALEX 2002, Copenhagen : Center for<br />
Sprogteknologi, p. 1-28).<br />
AUGUSTO M.C. (2002), « Le dictionnaire comme outil d’apprentissage », in MELKA F. –<br />
AUGUSTO M.C. (éds.), De la Lexicologie à la Lexicographie / From Lexicology to Lexicography,<br />
Utrecht : Utrecht University, p. 73-86.<br />
AYTO J. R. (1983), « On specifying meaning : semantic analysis and dictionary definitions »,<br />
in HARTMANN R.R.K. (éd.) Lexicography : Principles and Practice, London : Academic Press, p.<br />
89-98.<br />
BACELAR DO NACIMIENTO M.F. (2002), « Associations lexicales : du corpus aux<br />
dictionnaires », in MELKA F. – AUGUSTO M.C. (éds.), De la Lexicologie à la Lexicographie /<br />
From Lexicology to Lexicography, Utrecht : Utrecht University, p. 39-54.<br />
BARKER C. (2003), « Paraphrase is not enough », Theoretical Linguistics, vol. 29, n. 3, p. 201-<br />
209.<br />
BARSI M. (2003), « Le traitement de la langue familière dans les dictionnaires bilingues<br />
français/italien – italien/français », in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires<br />
bilingues, Paris : Champion, p. 271-284.<br />
BARTHES R. (1964), « Eléments de sémiologie », Communications, 4, p. 91-135.<br />
BAUER L. (2005), « The Illusory Distinction between Lexical and Encyclopedic<br />
Information », in GOTTLIEB H. – MOGENSEN J.E. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on<br />
Lexicography XI. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Lexicography, May 2-4, 2002<br />
at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 111-115.<br />
BEAL C. (1993), « Les stratégies conversationnelles en français et en anglais : conventions<br />
ou reflet de divergences culturelles profondes ? », Langue Française, vol. 98, n. 1, p. 79-106.<br />
BEJOINT H. (1987), « The place of the dictionary in an EFL programme », in COWIE A.<br />
(éd.), The Dictionary and the Language Learner : Papers from the EURALEX Seminar at the<br />
University of Leeds, 1-3 April 1985, Tübingen : Niemeyer, p. 97-114.<br />
233
BEJOINT H. (2003), « Vers un dictionnaire bilingue de ‘médiation’ », in SZENDE T. (éd.), Les<br />
écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 207-221.<br />
BEJOINT H. (2005), « Dictionnaires anciens, dictionnaires nouveaux, représentation de la<br />
langue et du discours », Revue française de linguistique appliquée, vol. X-2, p. 11-18.<br />
BEJOINT H. (2009), « Lexicographie et linguistique : le domaine anglais » in CORBIN P. –<br />
GASIGLIA N. (éds.) Lexique 19, Changer les dictionnaires ?, p. 117-158.<br />
BEN HARIZ OUENNICHE S. (2009), « Diminuer les fluctuations du sentiment néologique »,<br />
Neologica, 3, p. 37-51.<br />
BENVENISTE E. (1974), Problèmes de linguistique générale 2, Paris : Gallimard,.<br />
BERGENHOLTZ H. – KAUFMANN U. (1997), « Terminography and lexicography. A critical<br />
survey of dictionaries from a single specialised field », Hermes, 18, p. 91-125.<br />
BERGENHOLTZ H. – TARP S. (éds.) (1995), Manual of specialized lexicography : The Preparation of<br />
Specialized Dictionaries, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins.<br />
BERK-BODZEMIR C. (2003), « Mots à charge culturelle dans les dictionnaires bilingues et<br />
monolingues français-turc », in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires<br />
bilingues, Paris : Champion, p. 313-329.<br />
BERNOT D. (2000), « La lexicographie bilingue : un chemin semé d’embûches d’une culture<br />
à l’autre », in SZENDE T. (éd.), Dictionnaires bilingues : méthodes et contenus, Paris : Champion, p.<br />
53-60.<br />
BIDAUD F. (2003), « Contribution pour une ‘didactologie de proximité’ », in LINO M.T. –<br />
PRUVOST J. (éds.), Mots et lexiculture. Hommage à Robert Galisson, Paris : Champion, p. 53-82.<br />
BILLIEZ J. (1996), « Langues de soi, langues voisines : représentations entrecroisées », Etudes<br />
de linguistique appliquée, 104, p. 401-410.<br />
BLANCO X. (1996), « L’exemple dans la lexicographie bilingue. Traitements<br />
métalinguistiques », Le français moderne, 64, p. 156-168.<br />
BOCCUZZI C. et al. (2007), Bibliographie thématique et chronologique de métalexicographie 1950-2006,<br />
Fasano : Schena.<br />
BOCH R. (1989), « Faire un bilingue français-italien », in AMR HELMY I. (éd.), Lexiques,<br />
numéro spécial Le français dans le monde, p. 78-83.<br />
BONICEL L. (2003), « Lexiculture et dictionnaires pour enfants », in LINO M.T. – PRUVOST<br />
J. (éds.), Mots et lexiculture. Hommage à Robert Galisson, Paris : Champion, p. 315-331.<br />
BOGAARDS P. (1990), « Deux langues, quatre dictionnaires », Lexicographica, 6, p. 162-173.<br />
BOGAARDS P. (2003), « Uses and users of dictionaries », in VAN STERKENBURG PIET (éd.),<br />
A Practical Guide to Lexicography, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 26-33.<br />
234
BOULANGER J.-C. (2000), « Quelques causes de l’apparition des dictionnaires bilingues. Un<br />
retour vers les civilisations lointaines », in SZENDE THOMAS (éd.), Approches contrastives en<br />
lexicographie bilingue, Paris : Champion, p. 89-105.<br />
BOWKER L. (2003), « Specialized lexicography and specialized dictionaries », in VAN<br />
STERKENBURG P. (éd.), A Practical Guide to Lexicography, Amsterdam/Philadelphia : John<br />
Benjamins, p. 154-164.<br />
BRINK L. (1971), « Semantic Boundary Lines in Languages and Their Influence on our<br />
Cognition of the Surrounding World », Acta Linguistica Hafniensia, XIII, p. 45-74.<br />
BRUGUERA J. (1994), « La lexicografia bilingüe », in CABRE M.T. (éd.), Capllettra 17.<br />
Lexicografia, Valencia : Tardor, p. 267-272.<br />
BULLON S. (1990), « The Treatment of Connotation in Learners’ Dictionaries », in MAGAY<br />
T. – ZIGANY J. (éds.), BudaLEX ’88 Proceedings : Papers from the 3rd International EURALEX<br />
Congress, Budapest, 4-9 September 1988, Budapest : Akadémiai Kiadó, p. 27-33.<br />
BUZON C. (1979), « Dictionnaire, langue, discours, idéologie », Langue Française, vol. 43, n. 1,<br />
p. 27-44.<br />
CABASINO F. (1994), « Mots, symboles et culture : les expressions figées contenant<br />
‘feu’/fuoco », Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (Lingue e culture a confronto : ricerca<br />
linguistica - insegnamento delle lingue. Atti del 2° Convegno Internazionale di analisi comparativa<br />
francese-italiano, Milano 7-8-9 ottobre 1991), XXIII, n. 3, p. 599-610.<br />
CALVI M.V. (2006), « Il componente culturale nel dizionario Ambruzzi di spagnolo e<br />
italiano », in SAN VICENTE F. (éd.), Lessicografia bilingue e traduzione : metodi, strumenti, approcci<br />
attuali, Monza : Polimetrica, p. 83-99.<br />
CALZOLARI N. (2006), « Lessicografia tradizionale e tecnologie della lingua: spunti per una<br />
cooperazione », in Actas del tercer seminario de la escuela interlatina de altos estudios en lingüística<br />
aplicada. La lexicografía plurilingüe en lenguas latinas. San Millán de la Cogolla, 22-25 de octubre de<br />
2003, Logroño, Fundación San Millán de la Cogolla, p. 325-330.<br />
CANTONI L. (1999), Benjamin Lee Whorf ed Emile Benveniste, in BETTETINI G. – CIGADA S. –<br />
RAYNAUD S. – RIGOTTI E. (éds.), Semiotica I. Origini e fondamenti, La Scuola, Brescia, p. 315-<br />
343.<br />
CAPPELLO S. (2007), « Sulle origini della semantica componenziale : gli indizi di significato<br />
di Jurij Tynjanov (1924) », in BELLATI G. et al. (éds.), ‘Un paysage choisi’. Mélanges de<br />
linguistiques françaises offerts à Leo Schena – Studi di linguistica francese in onore di Leo Schena,<br />
Turin/Paris : L’Harmattan Italia/L’Harmattan, p. 92-102.<br />
CARDONA G.R. (2006 [1976]), Introduzione all’etnolinguistica, Torino, Utet Università.<br />
CELOTTI N. (1989), « La pratique traduisante face aux éléments chargés culturellement », in<br />
Analisi comparativa francese/italiano. Ricerca linguistica - insegnamento delle lingue, Padova : Liviana<br />
Editrice, p. 143-148.<br />
235
CELOTTI N. (1997), « Images reçues au cinéma : quand les français regardent les italiens – et<br />
se regardent », Etudes de Linguistique Appliquée, n. 107, p. 357-368.<br />
CELOTTI N. (1998) « Le dictionnaire bilingue au-delà de sa fonction de traduction ou le<br />
dictionnaire bilingue : dictionnaire de langue ? », in Studi di linguistica francese in Italia 1960-<br />
1996, Atti del Convegno internazionale su « Studi di linguistica francese in Italia », Milano, 17-19<br />
aprile 1997, Brescia : La Scuola, p. 119-143.<br />
CELOTTI N. (2002), « La culture dans les dictionnaires bilingues : où, comment, laquelle »,<br />
Etudes de Linguistique Appliquée, 128, p. 455-466.<br />
CELOTTI N. (2005), « Les dictionnaires de langue en France sont-ils encore aujourd’hui<br />
allergiques aux images ? », Etudes de Linguistique Appliquée, 138, p. 119-128.<br />
CELOTTI N. (2007), « Couleurs, culture et dictionnaires bilingues en regard », in BELLATI G.<br />
et al. (éds.), ‘Un paysage choisi’. Mélanges de linguistiques françaises offerts à Leo Schena – Studi di<br />
linguistica francese in onore di Leo Schena, Turin/Paris : L’Harmattan Italia/L’Harmattan, p.<br />
103-108.<br />
CHA<strong>DEL</strong>AT J.-M. (2000), Valeur et fonctions des mots français en anglais à l’époque contemporaine,<br />
Paris : L’Harmattan.<br />
CHERIFI N. (2009), « L’écart culturel dans les dictionnaires bilingues. Dictionnaires françaisarabe,<br />
arabe-français », Etudes de lingustique appliquée, 154, p. 237-248.<br />
CHOUL J.-C. (1987), « Contrôle de l’équivalence dans les dictionnaires bilingues », in ILSON<br />
R. (éd.), A spectrum of lexicography, Papers from AILA Brussels 1984,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 75-90.<br />
CIGADA S. (1988), « I meccanismi del senso : il culminatore semantico », in RIGOTTI E. –<br />
CIPOLLI C., Ricerche di semantica testuale. Atti del Seminario su ‘Senso e testo : processi di<br />
strutturazione e destrutturazione’, Milano, 4-5 febbraio 1987, Brescia, La Scuola, p. 25-70.<br />
CLAS A. (2001), « Les dictionnaires bilingues de spécialité », in PRUVOST J. (éd.), Les<br />
dictionnaires de langue française : dictionnaires d’apprentissage, dictionnaires spécialisés de la langue,<br />
dictionnaires de spécialité, Paris : Champion, p. 231-245.<br />
CLAS A. (2006) « Problématique de rédaction d’un dictionnaire homoglosse: le cas du<br />
français du Québec», in Actas del tercer seminario de la escuela interlatina de altos estudios en<br />
lingüística aplicada. La lexicografía plurilingüe en lenguas latinas. San Millán de la Cogolla, 22-25 de<br />
octubre de 2003, Logroño, Fundación San Millán de la Cogolla, p. 137-149.<br />
CLAS A. – ROBERTS R. (2003), « Le dictionnaire bilingue : une mosaïque culturelle ? », in<br />
SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 237-247.<br />
COFFEN B. (2002), Histoire culturelle des pronoms d’adresse. Vers une typologie des systèmes allocutoires<br />
dans les langues romanes, Paris : Champion.<br />
COLIGNON L. – GLATIGNY M. (1978), Les dictionnaires : initiation à la lexicographie, Paris:<br />
Cedic.<br />
236
COLLINOT A. – MAZIERE F. (1997), Un prêt-à-parler: le dictionnaire, Paris: PUF.<br />
CORBIN P. (2002), « Lexicographie et linguistique : une articulation difficile. L’exemple du<br />
domaine français », in MELKA F. – AUGUSTO M.C. (éds.), De la Lexicologie à la Lexicographie /<br />
From Lexicology to Lexicography, Utrecht : Utrecht University, p. 9-38.<br />
CORBIN P. (2008), « Quel avenir pour la lexicographie française ? », in DURAND J. –<br />
HABERT B. – LAKS B. (éds.), Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF '08, Paris :<br />
EDP Sciences (CD-ROM), p. 1227-1250.<br />
CORBIN P. – GASIGLIA N. (2009), « Changer les dictionnaires ? Une pluralité d’approches »,<br />
in ID. (éds.) Lexique 19, Changer les dictionnaires ?, p. 7-38.<br />
COUSIN P.-H. (1982) « La mise en équation des entrées lexicales françaises et anglaises dans<br />
un dictionnaire bilingue », in CALLERI D. – MARELLO C. (éds.), Linguistica Contrastiva. Atti del<br />
XIII congresso internazionale di studi, Asti, 26-28 maggio 1979, Roma : Bulzoni, p. 255-277.<br />
COWIE A.P. (1995), « The Learner’s Dictionary in a Changing Cultural Perspective », in<br />
KACHRY B.J. – KAHANE H. (éds.), Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in Honor of<br />
Ladislav Zgusta, Tübingen : Niemeyer, p. 283-295.<br />
CRYSTAL D. (2003 [1986]), « The ideal dictionary, lexicographer and user », in HARTMANN<br />
R.R.K. (éd.), Lexicography. Critical Concepts, London : Routledge, vol. 3, p. 319-327.<br />
DAGUT M. (1981), « Semantic ‘voids’ as a problem in the translation process », Poetics Today,<br />
2/4, p. 61-71.<br />
DANCLETTE J. (2006), « Les relations lexico-sémantiques dans un dictionnaire spécialisé »,<br />
in SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 143-155.<br />
DARBELNET J. (1970), « Dictionnaires bilingues et lexicologie différentielle », Langages, vol.<br />
5, n. 19, p. 92-102.<br />
DAR<strong>DEL</strong> DE R. (1977), « Réflexions sur les lacunes lexicales d’origine socio-culturelle »,<br />
Cahiers Ferdinand de Saussure, 31, p. 63-78.<br />
DA SILVA J. – TAVARES FERRÃO C. (2007), « Du champ sémantico-didactologique du<br />
concept culture », Etudes de linguistique appliquée, 146, p. 241-252.<br />
DEBYSER F. (1981), « De meilleurs dictionnaires bilingues », Le Français dans le Monde, 159,<br />
p. 37-42.<br />
DE CARLO M. (1995), « Lexique, culture et motivation à l’école », Etudes de linguistique<br />
appliquée, 97, 1995, p. 74-83.<br />
DE CARLO M. (1997), « Stéréotype et identité », Etudes de Linguistique Appliquée, 107, 1997, p.<br />
279-290.<br />
<strong>DEL</strong>ESALLE S. – BUZON C. – GIRARDIN C. (1979), « Dévergondé, dévergondage : les avatars<br />
du mot et de la chose », Langue française, vol. 43, n. 1, p. 45-59.<br />
237
DEROUIN M.-J. (2006), « Production de dictionnaires bilingues : nouveaux enjeux et<br />
implications », in SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion,<br />
p. 263-268.<br />
DESMET I. (2006), « Equivalence et bidirectionnalité dans les dictionnaires spécialisés<br />
français-portugais », in SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris :<br />
Champion, p. 129-141.<br />
DI CESARE D. (1993), « Introduzione », in HUMBOLDT K.W., La diversità delle lingue, Roma-<br />
Bari : Laterza, p. XV-CX.<br />
DOBROVOL’SKIJ D. – PIIRAINEN E. (1998), « On symbols. Cognitive and cultural aspects of<br />
figurative language », Lexicology, vol. 4, n. 1, p. 1-35.<br />
DOBROVOL’SKIJ D. – PIIRAINEN E. (1999), « ‘Keep the wolf from the door’. Animal<br />
symbolism in language and culture », Proverbium, 16, p. 61-93.<br />
DRYSDALE P.D. (1987), « The role of examples in a learner’s dictionary », in COWIE A.<br />
(éd.), The Dictionary and the Language Learner : Papers from the EURALEX Seminar at the<br />
University of Leeds, 1-3 April 1985, Tübingen : Niemeyer, p. 213-223.<br />
DUBOIS J. (1970), « Dictionnaire et discours didactique », Langages, vol. 5, n. 19, p. 35-47.<br />
DUBOIS J. –DUBOIS C. (1971), Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Paris : Larousse.<br />
DUCHACEK O. (1974), « Déficiences du lexique », Etudes Romanes de Brno, 7, p. 7-21.<br />
DUFAYS J.-L. (1991), « Dictionnaires, clichés et doxa : voyage en stéréotypie », Le français<br />
moderne, 94, p. 27-35.<br />
DUFAYS J.-L. (1997), « Stéréotypes et didactique du français : histoire et état d’une<br />
problématique », Etudes de Linguistique Appliquée, n. 107, p. 315-328.<br />
DURST U. (2003a), « The Natural Semantic Metalanguage Approach to linguistic meaning »,<br />
Theoretical Linguistics, vol. 29, n. 3, p. 157-200.<br />
DURST U. (2003b) « About NSM : A general reply », Theoretical Linguistics, vol. 29, n. 3, p.<br />
295-303.<br />
DUVAL A. (1986), « La métalangue dans les dictionnaires bilingues », Lexicographica, 2, p. 93-<br />
100.<br />
DUVAL A. (1990), « Nature et valeur de la traduction dans les dictionnaires bilingues »,<br />
Cahiers de lexicologie, 56, p. 27-33.<br />
DUVAL A. (1991), « L’équivalence dans le dictionnaire bilingue », in HAUSMANN F.J. –<br />
REICHMANN O. – WIEGAND E. – ZGUSTA L. (éds.) Wörterbucher/Dictionaries/Dictionnaires.<br />
Ein internationales Handbuch zur Lexikografie/An International Encyclopedia of<br />
Lexicography/Encyclopédie internationale de lexicographie, vol. 3, Berlin/New York : De Gruyter,<br />
p. 2817-2824.<br />
238
DUVAL A. (1993), « Le dictionnaire bilingue est-il un mauvais outil ? », Palimpsestes, 8, p. 15-<br />
25.<br />
DUVAL A. (2000), « Le rôle de l’exemple dans le dictionnaire bilingue français-anglais », in<br />
SZENDE T. (éd.), Approches contrastives en lexicographie bilingue, Paris : Champion, p. 79-87.<br />
ECO U. (2003), Dire quasi la stessa cosa, Milan : Bompiani.<br />
ENCREVE P. – BRAUDEAU M. (2007), Conversations sur la langue française, Paris: Gallimard.<br />
ESCOUBAS BENVENISTE M.-P. (2006), « Quelques polysèmes bilingues italien/français<br />
malmenés », in SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p.<br />
329-353.<br />
FABER P. (1994), « The Semantic Architecture of the Lexicon », in HYLDGAARD-JENSEN K.<br />
– PEDERSEN V.H. (éds.), Symposium on Lexicography VI. Proceedings of the Sixth International<br />
Symposium on Lexicography, May 7-9, 1992 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer,<br />
p. 37-50.<br />
FARINA A. (2008), « Cdrom et lexicographie bilingue franco-italienne », in COLOMBO M. –<br />
BARSI M.(éds.), Lexicographie et lexicologie historiques du français. Bilan et perspectives, Monza :<br />
Polimetrica, p. 173-196.<br />
FARINA A. (2009), « Problèmes de traitement des ‘pragmatèmes’ dans les dictionnaires<br />
bilingues », in HEINZ MICHAELA (éd), Le dictionnaire maître de la langue, Berlin : Frank &<br />
Timme, p. 245-263,<br />
FARINA D. (1996), « ‘The Bilingual Lexicographer’s Best Friends’ », Lexicographica, 12, p. 1-<br />
15.<br />
FERRARI S. (2006), « Le traitement des tropes dans les dictionnaires bilingues italienfrançais<br />
», in SZENDE THOMAS (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris :<br />
Champion, p. 451-463.<br />
FERRARIO E. (1984), « Analisi contrastiva e dizionari bilingui : due microsistemi a<br />
confronto », in La traduzione nell’insegnamento delle lingue straniere. Atti del Congresso su ‘La<br />
traduzione nell’insegnamento delle lingue straniere’- Brescia, 11-13 aprile 1983, Brescia : La Scuola, p.<br />
273-296.<br />
FERRARIO E. (1995), « Entre le zist et le zest : le lexique figé dans les dictionnaires bilingues<br />
italien-français (à propos des homologies bafouées) », in MARGARITO M. – RAUGEI A.M.<br />
(éds.), Studi di Linguistica, Storia della Lingua, Filologia francesi. Convegno della Società<br />
Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura francese - Torino, 16 e 17 giugno 1994,<br />
Alessandria : Edizioni dell’Orso, p. 221-238.<br />
FERRARIO E. (2002), « Dictionnaires bilingues français-italien : à propos de phraséologie<br />
‘mal-traitée’. Le cas de la Boîte à Images », in FERRARIO E. – PULCINI V. (éds.), La Lessicografia<br />
Bilingue tra presente e avvenire, Vercelli : Mercurio, p. 95-105.<br />
239
FILLMORE C.J. – JOHNSON C. – PETRUCK M.R.L. (2003), « Background to FrameNet »,<br />
International Journal of Lexicography, 16, p. 235-250.<br />
FISHMAN J.A. (1995), « Dictionaries as Culturally Constructed and as Culture-Constructing<br />
Artifacts : The Reciprocity View as Seen from Yiddish Sources », in KACHRY B.J. –<br />
KAHANE H. (éds.), Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in Honor of Ladislav Zgusta,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 29-34.<br />
FONTENELLE T. (2008 [1997]), « Using a Bilingual Dictionary to Create Semantic<br />
Networks », in ID. (éd.) Practical Lexicography, Oxford: Oxford University Press, p. 169-189<br />
(déjà paru sous le titre « Using a bilingual dictionary to build semantic networks »,<br />
International Journal of Lexicography, 10, p. 275-303).<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (1986), « Anno / an-année (projet pour une entrée de<br />
dictionnaire bilingue) », Lexicon Philosophicon, 2, p. 9-15.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (1993), « Dizionari bilingue francese-italiano/italianofrancese<br />
: dalla comprensione alla produzione », Heteroglossia, 5, Ancona : Nuove Ricerche,<br />
p. 295-304.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (1994), « Le statut des noms propres dans la traduction »,<br />
Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (Lingue e culture a confronto : ricerca linguistica -<br />
insegnamento delle lingue. Atti del 2° Convegno Internazionale di analisi comparativa franceseitaliano,<br />
Milano 7-8-9 ottobre 1991), XXIII, n. 3, p. 553-571.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (1996), « La fonction des exemples dans les dictionnaires<br />
bilingues », Franco-Italica, 9, p. 151-171.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2000a), « La notion d’équivalence en lexicographie<br />
bilingue », in Actes du XXII Congrès International de Linguistique et de Philologie romanes, Vol. IV,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 235-242.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2000b), « La conception d’un dictionnaire bilingue<br />
d’apprentissage du français pour italophones », in SZENDE T. (éd.), Approches contrastives en<br />
lexicographie bilingue, Paris : Champion, p. 33-43.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2002a), « Neutralisation, cumul et généralisation en<br />
lexicographie bilingue (domaine français-italien) », in FERRARIO E. – PULCINI V. (éds.), La<br />
Lessicografia Bilingue tra presente e avvenire, Vercelli : Mercurio, p. 49-63.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2002b), « Les informations culturelles dans un dictionnaire<br />
bilingue d’apprentissage », Etudes de Linguistique Appliquée, n. 128, p. 467-479.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2003a), « Le dictionnaire bilingue : de la médiation<br />
linguistique à la médiation didactique », in La médiation et la didactique des langues et des cultures,<br />
numéro spécial Le français dans le monde, p. 72-86.<br />
240
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2003b), « Structures linguistiques à portée culturelle dans<br />
les dictionnaires bilingues français-italien », in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les<br />
dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 87-100.<br />
FOURMENT BERNI-CANANI M. (2006) « Le modèle de traduction véhiculé par les exemples<br />
des dictionnaires bilingues », in SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues,<br />
Paris : Champion, p. 45-55.<br />
FRANCKEL J.-J. (2002), « Introduction », in ID. (éd.), Langue Française, Le lexique, entre identité<br />
et variation, 133, p. 3-15.<br />
FRANCŒUR A. (2003), « Quelques remarques sur les notes culturelles du Robert & Collins<br />
Senior (1998) » , in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris :<br />
Champion, p. 299-312.<br />
FRATH P. (2008a), « Introduction : en finir avec l’essentialisme en linguistique », in ID. (éd.),<br />
Dénomination, phraséologie et référence, Stuttgart : Franz Steiner, p. 7-15.<br />
FRATH P. (2008b), « Qu’est-ce qu’une linguistique de la dénomination, de la référence et de<br />
l’usage », in ID. (éd.), Dénomination, phraséologie et référence, Stuttgart : Franz Steiner, p. 45-57.<br />
FREY C. (2004), « Les structures lexicographiques dans les dictionnaires francophones, une<br />
rencontre symbolique des mots et des cultures », Actes du colloque Penser la francophonie :<br />
concepts, actions et outils linguistiques, Ouagadougou (Burkina Faso), du 31 mai au 1 er juin 2004,<br />
Paris : Editions des Archives contemporaines - AUF, p. 197-210.<br />
GABROVSEK D. (1998), « Dimensions of Falseness in False Friends : Implications for<br />
Bilingual Lexicography », in ZETTERSTEN A. – PEDERSEN V.H. – MOGENSEN J.E. (éds.),<br />
Symposium on Lexicography VIII. Proceedings of the Eigth International Symposium on Lexicography,<br />
May 2-4, 1996 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 165-174.<br />
GAK V.G. (1970), « La langue et le discours dans un dictionnaire bilingue », Langages, vol, 5,<br />
n. 19, p. 103-115.<br />
GALISSON R. (1987a), « Accéder à la culture partagée par l’entremise des mots à C.C.P. »,<br />
Etudes de linguistique appliquée, 67, p. 119-140.<br />
GALISSON R. (1987b), « De la lexicographie de dépannage à la lexicographie<br />
d’apprentissage. Pour une politique de rénovation des dictionnaires de FLE à l’école : »,<br />
Cahiers de lexicologie, 51, p. 95-118.<br />
GALISSON R. (1988), « Culture et lexiculture partagées : les mots comme lieux d’observation<br />
des faits culturels », Etudes de linguistique appliquée, 69, p. 74-90.<br />
GALISSON R. (1989), « La culture partagée : une monnaie d’échange interculturelle », in<br />
AMR HELMY I. (éd.), Lexiques, numéro spécial Le français dans le monde, p. 113-117.<br />
GALISSON R. (1994), « D´hier à demain, l´interculturel à l´école », Etudes de Linguistique<br />
Appliquée. Revue de Didactologie des langues-cultures, 94, p. 15-26.<br />
241
GALISSON R. (1995a), « Où il est question de lexiculture, de Cheval de Troie et<br />
d’Impressionnisme », Etudes de linguistique appliquée, 97, p. 5-14.<br />
GALISSON R. (1995b), « Les palimpsestes verbaux : des actualisateurs et des révélateurs<br />
culturels remarquables pour publics étrangers, Etudes de linguistique appliquée, 97, p. 104-128.<br />
GALISSON R. (1999), « La pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement à une culture,<br />
par un autre lexique », Etudes de Linguistique Appliquée, 116, p. 447-496.<br />
GALISSON R. (2001), « Une dictionnairique à géométrie variable au service de la<br />
lexiculture » in PRUVOST J. (éd.), Les dictionnaires de langue française : dictionnaires d’apprentissage,<br />
dictionnaires spécialisés de la langue, dictionnaires de spécialité, Paris : Champion, p. 115-138.<br />
GALISSON R. (2002), « Didactologie : de l’éducation aux langues-cultures à l’éducation par<br />
les langues-cultures », Etudes de Linguistique Appliquée, 128, p. 497-510.<br />
GARY-PRIEUR M.-N. (1994), Grammaire du nom propre, Paris : PUF.<br />
GATES E. (1992), « Should a dictionary include only the ‘good’ words ? », in HYLDGAARD-<br />
JENSEN K. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography V. Proceedings of the Fifth<br />
International Symposium on Lexicography, May 3-5, 1990 at the University of Copenhagen, Tübingen :<br />
Niemeyer, p. 265-280.<br />
GEERAERTS D. (1985), « Les données stéréotypiques, prototypiques et encyclopédiques<br />
dans le dictionnaire », Cahiers de lexicologie, 46, p. 27-43.<br />
GEERAERTS D. (1987), « Types of Semantic Information in Dictionaries », in ILSON R.<br />
(éd.), A spectrum of lexicography, Papers from AILA Brussels 1984, Amsterdam/Philadelphia :<br />
John Benjamins, p. 1-10.<br />
GEERAERTS D. (2003), « Meaning and definition », in VAN STERKENBURG P. (éd.), A<br />
Practical Guide to Lexicography, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 83-93.<br />
GEMAR J.-C. (2003), « Langage du droit, dictionnaire bilingue et jurilinguistique. Le cas du<br />
Dictionnaire de droit privé. Private law dictionary du Québec : traduire ou exprimer le droit ? », in<br />
SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 173-189.<br />
GENTILHOMME Y. (1995), « Contribution à une réflexion sur terminologie et culture »,<br />
Etudes de linguistique appliquée, 97, p. 15-30.<br />
GIAUFRET COLOMBANI H. (1997), « Les ethnotypes dans quelques dictionnaires français du<br />
XVII e siècle », Etudes de Linguistique Appliquée, 107, p. 291-300.<br />
GIRARDIN C. (1979), « Contenu, usage social et interdits dans le dictionnaire », Langue<br />
Française, vol. 43, n. 1, p. 84-99.<br />
GIRARDIN C. (1987), « Système des marques et connotations sociales dans quelques<br />
dictionnaires culturels français », Lexicographica, 3, p. 76-93.<br />
242
GODDARD C. (1994), « Semantic Theory and Semantic Universals », in GODDARD C. –<br />
WIERZBICKA A. (éds.), Semantic and lexical universals : theory and empirical findings,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 7-29.<br />
GODDARD C. (1998), « Bad arguments against semantic primitives », Theoretical Linguistics,<br />
24, 2-3, p. 129-156.<br />
GODDARD C. (2002), « The Search for the Shared Semantic Core of All Languages », in<br />
GODDARD C, – WIERZBICKA A. (éds.) Meaning and Universal Grammar. Theory and empirical<br />
findings, vol. 1, Amsterdam : John Benjamins, p. 5-40.<br />
GODDARD C. (2003), « Natural Semantic Metalanguage : Latest perspectives », Theoretical<br />
Linguistics, vol. 29, n. 3, p. 227-236.<br />
GODDARD C. – WIERZBICKA A. (1997) « Discourse and culture », in VAN DIJK T.A. (éd.),<br />
Discourse as Social Interaction, vol. 2, London : Sage, p. 231-257.<br />
GODDARD C. – WIERZBICKA A. (éds.) (2002a), Meaning and Universal Grammar. Theory and<br />
empirical findings, 2 vol., Amsterdam : John Benjamins.<br />
GODDARD C. – WIERZBICKA A. (2002b), « Conceptual axiology », in CRUSE A.D. et al.<br />
(éds.), Lexikologie/Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern<br />
und Wortschätzen/An international handbook on the nathre ant structure of words and vocabularies, vol.<br />
1, Berlin-New York : de Gruyter, p. 256-268.<br />
GODDARD C. – WIERZBICKA A. (2006), « Langue, culture et conceptualisations : la<br />
sémantique transculturelle », in <strong>DEL</strong>BECQUE N. (éd.), Linguistique cognitive : comprendre comment<br />
fonctionne le langage, Bruxelles : De Boeck & Larcier-Ducolot, p. 163-190.<br />
GOUWS R.H. (2000), « Strategies in equivalent discrimination », in MOGENSEN J.E. –<br />
PEDERSEN V.H. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography IX. Proceedings of the<br />
Ninth International Symposium on Lexicography, April 23-25, 1998 at the University of Copenhagen,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 99-111.<br />
GOUWS R.H. (2002), « Equivalent relation, context and cotext in bilingual dictionaries »,<br />
Hermes, 28, p. 195-209.<br />
GOUWS R.H. (2005), « Issues regarding the comment on semantic in bilingual dictionaries<br />
dealing with closely related languages », in PETKOV P. – ISLA B. – WIEGAND H.E. (éds.),<br />
Kontrastive Lexikologie und zweisprachige Lexikographie. 2. Internationales Kolloquium zur<br />
Wörterbuchforschung, St. Kliment Ohridski-Universität Sofia, 18. bis 19. Oktober 2002,<br />
Hildesheim/Zürich/New York : G. Olms, p. 39-56 (numéro spécial de la revue<br />
Germanistiches Linguistik, 179, 2005).<br />
GOUWS R.H. (2006), « The Selection, Presentation and Treatment of Cultural Phrases in a<br />
Multicultural Dictionary », Lexicographica, 22, p. 24-36.<br />
GOUWS R.H. – STEYN M. (2005), « Integrated outer texts : a transtextual approach to<br />
lexicographic functions », in BARZ I., BERGENHOLTZ H., KORHONEN J. (éds.), Schreiben,<br />
243
Verstehen, Übersetzen, Lernen : zu ein- und zweisprachigen Wörterbüchern mit Deutsch, Bern : Peter<br />
Lang, p. 127-136.<br />
GOUWS R.H. – PRINSLOO D.J. – DE SCHRYVER G.-M. (2004), « Friends will be Friends –<br />
True or False. Lexicographic Approaches to the Treatment of False Friends », in WILLIAMS<br />
G. – VESSIER S. (éds.), Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress,<br />
EURALEX 2004, Lorient, France, July 6-10, 2004, Lorient : Université de Bretagne-Sud, vol.<br />
3, p. 797-806.<br />
GREENBERG J.H. (1954), « Concerning inferences from linguistic to nonlinguistic data », in<br />
HOIJER HARRY (éd.), Language in Culture. Conference on the Interrelations of Language and Other<br />
Aspects of Culture, Chicago : The University of Chicago Press, p. 3-19.<br />
GRINDSTED A. (1988), « Geographical Varieties (and Regionalisms) in Bilingual<br />
Lexicography », in HYLDGAARD-JENSEN K. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on<br />
Lexicography IV. Proceedings of the Fourth International Symposium on Lexicography, April 20-22,<br />
1988 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 181-192.<br />
GUILBERT L. (1975), La créativité lexicale, Paris : Larousse.<br />
GUILLEN DIAZ C. (2003), « La lexiculture : d’un concept instrumental à un outil<br />
d’intervention en didactiques des langues-cultures », in LINO M.T. – PRUVOST J. (éds.), Mots<br />
et lexiculture. Hommage à Robert Galisson, Paris : Champion, p. 33-50.<br />
GUSMANI R. (1981), Saggi sull’interferenza linguistica, Firenze : Le Lettere.<br />
HAAS M.R. (1962), « What belongs in a bilingual dictionary ? », in HOUSEHOLDER F.W. –<br />
SAPORTA S. (éds.), Problems in lexicography, Bloomington : Indiana University, p. 45-50.<br />
HAENSCH G. et al. (éds.) (1982), La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica,<br />
Madrid: Gredos.<br />
HANNAY M. (2003), « Types of bilingual dictionaries », in VAN STERKENBURG P. (éd.), A<br />
Practical Guide to Lexicography, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 145-153.<br />
HARTMANN R.R.K. (1983), « Theory and practice in dictionary-making », in ID. (éd.),<br />
Lexicography : Principles and Practice, London : Academic Press, p. 3-11.<br />
HARTMANN R.R.K. (1985), « Contrastive Text Analysis and the Search for the Equivalence<br />
in the Bilingual Dictionary », in HYLDGAARD-JENSEN K. – ZETTERSTEN A. (éds.),<br />
Symposium on Lexicography II. Proceedings of the Second International Symposium on Lexicography,<br />
May 16-17, 1984 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 121-132.<br />
HARTMANN R.R.K. (1987), « Four perspectives on dictionary use : a critical review of<br />
research methods », in COWIE A. (éd.), The Dictionary and the Language Learner : Papers from the<br />
EURALEX Seminar at the University of Leeds, 1-3 April 1985, Tübingen : Niemeyer, p. 11-28.<br />
HARTMANN R.R.K. (1989), « Lexicography, Translation and the So-called Language<br />
Barrier », in SNELL-HORNBY M. – PÖHL E. (éds.), Translation and Lexicography. Papers read at<br />
244
the EURALEX Colloquium held at Innsbruck, 2-5 July 1987, Amsterdam/Philadelphia : John<br />
Benjamins, p. 9-20.<br />
HARTMANN R.R.K. (2007), Interlingual Lexicography. Selected Essays on Translation Equivalence,<br />
Contrastive Linguistics and the Bilingual Dictionary, Tübingen : Niemeyer.<br />
HARVEY M. (2000), « A Beginner´s Course in Legal Translation : the Case of Culturebound<br />
Terms », in La traduction juridique : histoire, théorie(s) et pratique, ASSTI/ETI, p. 357-<br />
369, disponible à l’adresse http://www.tradulex.org/Actes2000/sommaire.htm.<br />
HATHERALL G. (1984), « Studying dictionary use : some findings and problems », in<br />
HARTMANN R.R.K. (éd.), LEXeter ’83 Proceedings. Papers from the International Conference on<br />
Lexicography at Exeter, 9-12 September 1983, Tübingen : Niemeyer, p. 183-189.<br />
HAUGEN E. (1950), « The analysis of linguistic borrowing », Language, vol. 26, p. 210-231.<br />
HAUSSMANN F.J. (1989), « Points noirs dans la lexicographie bilingue », in KREMER D.<br />
(éd.), Actes du XVIII e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Tübingen :<br />
Niemeyer, Tome IV, p. 39-40.<br />
HAUSSMANN F.J. (2002), « La transparence et l’obstacle. Essai de chrestolexicographie »,<br />
Etudes de Linguistique Appliquée, 128, p. 447-454.<br />
HEINZ M. (2002), « L’exemple lexicographique à fonction culturelle dans Le Robert pour<br />
tous », Etudes de Linguistique Appliquée, 128, p. 413-430.<br />
HIETSCH O. (1958), « Meaning Discrimination in Modern Lexicography », The Modern<br />
Language Journal, 42, p. 232-234.<br />
HJELMSLEV L. (1966 [1963]), Le Langage, Paris : Les Editions de Minuit<br />
HJELMSLEV L. (1968 [1966]), Prolégomènes à une théorie du langage, Paris : Les Editions de<br />
Minuit.<br />
HOIJER H. (1954), « The Sapir-Whorf hypothesis », in ID. (éd.), Language in Culture.<br />
Conference on the Interrelations of Language and Other Aspects of Culture, Chicago : The University<br />
of Chicago Press, p. 92-105.<br />
HONSELAAR W. (2003), « Examples of design and production criteria for bilingual<br />
dictionaries », in VAN STERKENBURG P. (éd.), A Practical Guide to Lexicography,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 323-332.<br />
HUMBLEY J. (1990), « Dictionnaires d’apprentissage anglais : passage en revue », Les langues<br />
modernes, 84, p. 73-82.<br />
HUMBLEY J. (2002), « Nouveaux dictionnaires, nouveaux rapports avec les utilisateurs »,<br />
Méta 47/1, p. 95-104.<br />
HUMBLEY J. (2004), « Approches définitoires du rapport culturel français/autre langue dans<br />
les dictionnaires spécialisés bilingues », in LAURIAN A.-M. (éd.), Dictionnaires bilingues et<br />
interculturalité, Bern : Peter Lang, p. 163-181.<br />
245
HUMBLEY J. (2007), « Emprunts, vrais et faux, dans le Petit Robert 2007 », in PRUVOST J.<br />
(éd.) Les Journées des dictionnaires de Cergy. Dictionnaires et mots voyageurs, Eragny-sur-Oise :<br />
Editions des Silves, p. 221-238.<br />
HUPKA W. (2003), « How pictorial illustrations interact with verbal information in the<br />
dictionary entry : a case study », in HARTMANN R.R.K. (éd.), Lexicography. Critical Concepts,<br />
London: Routledge, vol. 3, p. 363-390.<br />
IANNUCCI J.E. (1962), « Meaning Discrimination in Bilingual Dictionaries », in<br />
HOUSEHOLDER F.W. – SAPORTA S. (éds.), Problems in lexicography, Bloomington : Indiana<br />
University, p. 201-216.<br />
IORDANSKAJA L. – MEL’CUK I. (1984), « Connotation en sémantique et lexicographie », in<br />
MEL’CUK I. et al. (éds.) Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches<br />
lexico-sémantiques I, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, p. 33-43.<br />
ISACENKO A.V. (1972), « Figurative Meaning, Derivation and Semantic Features », in<br />
WORTH D.S. (éd.) The Slavic Word. Proceedings of the International Slavistic Colloquium at UCLA,<br />
September 11-16, 1970, The Hague/Paris : Mouton, p. 76-91.<br />
IVIR V. (1988), « Collocations in Dictionaries. Monolingual and bilingual », in BURTON T.L.<br />
– BURTON J. (éds.) Lexicographical and Linguistic Studies. Essays in Honour of G.W. Turner,<br />
Cambridge : D.S. Brewer, p. 43-50.<br />
JAKOBSON R. (1963), Essais de linguistique générale. 1 – Les fondations du langage, Paris : Les<br />
Editions de Minuit.<br />
JIMENEZ HURTADO C. (1994), « The Integration of Pragmatic Information in Lexical<br />
Entries : A Programmatic Proposal », in HYLDGAARD-JENSEN K. – PEDERSEN V.H. (éds.),<br />
Symposium on Lexicography VI. Proceedings of the Sixth International Symposium on Lexicography,<br />
May 7-9, 1992 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 21-35.<br />
JIMENEZ HURTADO C. (2001), Léxico y pragmática, Bern : Peter Lang.<br />
KASSAI G. (1994), « Pour un dictionnaire des connotations construit sur les notes du<br />
traducteur (N.d.T.) », Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (Lingue e culture a confronto :<br />
ricerca linguistica - insegnamento delle lingue, Atti del 2° Convegno Internazionale di analisi comparativa<br />
francese-italiano, Milano 7-8-9 ottobre 1991), XXIII, n. 3, p. 509-521.<br />
KASTBERG SJÖBLOM M. (2003), « Les dictionnaire contemporains français-suédois :<br />
traitement de la proximité et de l’éloignement culturels », in SZENDE T. (éd.), Les écarts<br />
culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 191-205.<br />
KASTLER L. (2003), « Les différences culturelles dans le vocabulaire de la politesse en<br />
français et en russe », in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues,<br />
Paris : Champion, p. 223-236.<br />
KAYSER D. (1995), « Terme et dénotation », La banque des mots, 7, p. 19-34.<br />
KERBRAT-ORECCHIONI C. (1977), La connotation, Lyon : Presses Universitaires de Lyon.<br />
246
KLEIBER G. (1997), « Sens, référence et existence : que faire de l’extra-linguistique ? »,<br />
Langages 127, p. 9-37.<br />
KOPTJEVSKAJA-TAMM M. – AHLGREN I. (2003), « NSM : Theoretical, methodological and<br />
applicational problems », Theoretical Linguistics, vol. 29, n. 3, p. 247-261.<br />
KORZIK K. (1995), « Meaning : Remarks on Methodological Problems of Representing and<br />
Modelling in Semantics and Lexicography », in KAR<strong>DEL</strong>A H. – PERSSON G. (éds.), New<br />
Trends in Semantics and Lexicography, Umeå : Umeå Universitet, p. 77-87.<br />
KOSELAK A. (2003), « La sémantique naturelle d’Anna Wierzbicka et les enjeux<br />
interculturels », Questions de communication, 4, p. 83-95.<br />
KOTTELAT P. (2010), « Définitions lexicographiques et idéologie : ambiguïtés discursives<br />
dans les définitions des races, traces de permanence de stéréotypes racistes? », Autour de la<br />
définition, 6, 0, http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=119.<br />
KROMANN H.-P. (1990), « Selection and presentation of translational equivalents in<br />
monofunctional and bifunctional dictionaries », Cahiers de lexicologie, 56, p. 17-26.<br />
KROMANN H.-P. – RIIBER T. – ROSBACH P. (1984), « ‘Active’ and ‘passive’ bilingual<br />
dictionaries : the Ščerba concept reconsidered », in HARTMANN R.R.K. (éd.), LEXeter ’83<br />
Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9-12 September 1983,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 207-215.<br />
KROMANN H.-P. – RIIBER T. – ROSBACH P. (1991), « Principles of Bilingual lexicography »,<br />
in HAUSMANN F.J. – REICHMANN O. – WIEGAND E. – ZGUSTA L. (éds.)<br />
Wörterbucher/Dictionaries/Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikografie/An<br />
International Encyclopedia of Lexicography/Encyclopédie internationale de lexicographie, vol. 3,<br />
Berlin/New York : De Gruyter, p. 2711-2728.<br />
KRZESZOWSKI T.P. (1984), « Tertium comparationis », in FISIAK J. (éd.), Contrastive<br />
linguistics. Prospects and problems, Berlin/New York : Mouton, p. 301-312.<br />
KRZESZOWSKI T.P. (1990), « The axiological aspect of idealized cognitive models », in<br />
TOMASZCZYK J. – LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (éds.), Meaning and lexicography,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 135-165.<br />
LADO R. (1957), Linguistics across cultures, Ann Arbor : The University of Michigan Press.<br />
LANDAU S.I. (2001 [1984]), Dictionaries : The art and craft of lexicography, Cambride : Cambridge<br />
University Press.<br />
LANDHEER R. (1983), « Ambiguïté et dictionnaire bilingue », in Le dictionnaire : Actes du<br />
Colloque Franco-Néerlandais 28-29 avril 1981, Lexique 2, Presses Universitaires de Lille, p. 147-<br />
158.<br />
LANDHEER R. (1989), « L’importance des relations hyponymiques dans la description<br />
lexicographique », in KREMER D. (éd.), Actes du XVIII e Congrès International de Linguistique et<br />
de Philologie Romanes, Tübingen : Niemeyer, Tome IV, p. 139-151.<br />
247
LARA L.F. (1989), « Problemas y métodos del significado estereotípico », in KREMER D.<br />
(éd.), Actes du XVIII e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Tübingen :<br />
Niemeyer, Tome IV, p. 124-138.<br />
LARA L.F. (1995), « Towards a Theory of the Cultural Dictionary », in KACHRY B.J. –<br />
KAHANE H. (éds.), Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in Honor of Ladislav Zgusta,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 41-51.<br />
LARRIVEE P. (2008), Une histoire du sens : panorama de la sémantique depuis Bréal, Bern : Peter<br />
Lang.<br />
LAURIAN A.-M. (2004a), « Présentation », in ID. (éd.), Dictionnaires bilingues et interculturalité,<br />
Bern : Peter Lang, p. VII-XII.<br />
LAURIAN A.-M. (2004b), « Problématique générale des dictionnaires bilingues : du lexique à<br />
la culture », in ID. (éd.), Dictionnaires bilingues et interculturalité, Bern : Peter Lang, p. 1-13.<br />
LEHMANN A. (1989), « Les représentations idéologiques dans le discours du dictionnaire »,<br />
in AMR HELMY I. (éd.), Lexiques, numéro spécial Le francais dans le monde, p. 106-111.<br />
LEHMANN A. (1994), « La composante culturelle de l’exemple dans le dictionnaire de<br />
langue », in PRUVOST J. (éd.), Les dictionnaires de langue : méthodes et contenus. Actes du Colloque -<br />
La Journée des dictionnaires, p. 121-128.<br />
LEHMANN A. – MARTIN-BERTHET F. (2005), Introduction à la lexicologie. Sémantique et<br />
morphologie, Paris : Colin.<br />
LEHRER A. (1970), « Notes on lexical gaps », Journal of linguistics, vol. 6, n. 2, p. 257-261.<br />
LEPINETTE B. (1989), « Vers un dictionnaire explicatif et combinatoire bilingue », Cahiers de<br />
lexicologie, 54-1, p. 105-162.<br />
LEPINETTE B. (1990), « Lexicographie bilingue et traduction », Méta, XXV, 3, p. 571-581.<br />
LEPPÄLUOTO S. (1992), « Fonctions des exemples du dictionnaire bilingue », in Actas do<br />
XIX Congreso internacional de lingüistica e filoloxía románicas, vol. II, La Coruña, p. 379-386.<br />
LERAT P. (1976), « Lexicographie et référence », Cahiers de lexicologie, 18, p. 43-50.<br />
LERAT P. (1994), « Vocabulaire et connaissances. A propos d’‘archéologie’, ‘pasta’ et<br />
‘tennis’ », Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (Lingue e culture a confronto : ricerca<br />
linguistica - insegnamento delle lingue. Atti del 2° Convegno Internazionale di analisi comparativa<br />
francese-italiano, Milano 7-8-9 ottobre 1991), XXIII, n. 3, p. 501-508.<br />
LERAT P. (1999), « Propriétés générales des unités lexicales », in Mémoires de la Societé de<br />
Linguistique de Paris. Lexique, lexicologie, lexicographie, tome VII, Leuven : Peeters, p. 11-21.<br />
LEVY-MONGELLI D. (1989), « L’‘hypocrite’ lecture du semblable ou : spécificité de la lecture<br />
contrastive d’une culture voisine », in Analisi comparativa francese/italiano. Ricerca linguistica -<br />
insegnamento delle lingue, Padova : Liviana Editrice, p. 129-134.<br />
248
LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (1988), « Universal concepts and language-specific<br />
meaning », in SNELL-HORNBY M. (éd.), ZüriLEX ’86 Proceedings : Papers read at the<br />
EURALEX International Congress, University of Zurich, 9-14 September 1986, Tübingen :<br />
Francke, p. 17-26.<br />
L’HOMME M.-C. – DANCETTE J. (2001), « Modélisation des relations sémantiques dans un<br />
dictionnaire spécialisé bilingue », in CLAS A. – AWAISS H. – HARDANE J. (éds.), L’éloge de la<br />
différence : la voix de l’autre. Actes des 6 e Journées du réseau LTT, Paris : AUF, p. 385-400.<br />
LIJNEN B. (2005), « Les informations culturelles dans les dictionnaires d’apprentissage »,<br />
Romaneske, 3.<br />
LIND Å. (1998), « Semantic Booby-Traps and Lexicographic Minefields. On the Making of<br />
a Norwegian-English Dictionary of Law », in ZETTERSTEN A. – PEDERSEN V.H. –<br />
MOGENSEN J.E. (éds.), Symposium on Lexicography VIII. Proceedings of the Eigth International<br />
Symposium on Lexicography, May 2-4, 1996 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer,<br />
p. 209-216.<br />
LOFFLER-LAURIAN A.-M. (2000), « Les apports de la méthodologie contrastive à la<br />
lexicographie bilingue », in SZENDE T. (éd.), Approches contrastives en lexicographie bilingue,<br />
Paris : Champion, p. 135-146.<br />
LO NOSTRO M. (2007), « L'image des femmes à travers les dictionnaires bilingues », in<br />
FARINA A. – RAUS R. (éds), Des mots et des femmes: Rencontres linguistiques. Actes de la journée<br />
d'étude tenue à l'Université de Florence (1er décembre 2006), Florence : Firenze University Press, p.<br />
97-108.<br />
LO NOSTRO M. (2009), « La perception de la culture italienne par les apprenants français :<br />
le Larousse Petit italien », Etudes de linguistique appliquée, 154, p. 229-236.<br />
LOU HOHULIN E. (1986), « The Absence of Lexical Equivalence and Cases of its<br />
Asimmetry », Lexicographica, 2, p. 43-52.<br />
LUCY J.A. (2000), « Introductory Comments », in NIEMEIER S. – DIRVEN R. (éds.), Evidence<br />
for Linguistic Relativity, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. IX-XXI.<br />
MACNAMARA J. (1991), « Linguistic relativity revisited », in COOPER R.L. – SPOLSKY B.<br />
(éds.), The influence of Language on Culture and Thought, Berlin/New York : Mouton de Gruyter,<br />
p. 45-60.<br />
MAHER B. (2006), « Sfogarsi. A semantic analysis of an Italian speech routine and its<br />
underlying cultural values », in PEETERS B. (éd.) Semantic Primes and Universal Grammar.<br />
Empirical evidence from the Romance languages, Amsterdam : John Benjamins, p. 207-233.<br />
MANLEY J. (1985), « «Processsing excerpts for the bilingual dictionary », in HYLDGAARD-<br />
JENSEN K. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography II. Proceedings of the Second<br />
International Symposium on Lexicography, May 16-17, 1984 at the University of Copenhagen,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 245-254.<br />
249
MANLEY J. – JACOBSEN J. – PEDERSEN V.H. (1988), « Telling lies efficiently : terminology<br />
and the microstructure in the bilingual dictionary », in HYLDGAARD-JENSEN K. –<br />
ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography III. Proceedings of the Third International<br />
Symposium on Lexicography, May 14-16, 1986 at the University of Copenhagen, Tübingen :<br />
Niemeyer, p. 281-302.<br />
MARCELLESI J.-B. – GARDIN B. (1974), Introduction à la sociolinguistique, la linguistique sociale,<br />
Paris : Larousse.<br />
MARELLO C. (1987), « «Examples in contemporary Italian bilingual dictionaries », in COWIE<br />
A. (éd.), The Dictionary and the Language Learner : Papers from the EURALEX Seminar at the<br />
University of Leeds, 1-3 April 1985, Tübingen : Niemeyer, p. 224-237.<br />
MARELLO C. (1992), I dizionari bilingui, Bologna : Zanichelli.<br />
MARELLO C. (1996), « Les différents types de dictionnaires bilingues », in BEJOINT H. –<br />
THOIRON P. (éds.), Les dictionnaires bilingues, Louvain-La-Neuve : Aupelf-Uref-Duculot, p.<br />
31-52.<br />
MARELLO C. (1997), « Stéréotypes et transitif absolu », Etudes de Linguistique Appliquée, 107,<br />
p. 301-314.<br />
MARGARITO M. (1995), « Paris Italianissimo ? Dénominations italiennes des Pages Jaunes :<br />
lexique, stéréotypie, image de l’autre », Etudes de linguistique appliquée, 97, p. 31-41.<br />
MARGARITO M. (éd.) (2002), « Du culturel dans le lexique et dans les dictionnaires », Etudes<br />
de Linguistique Appliquée, 128.<br />
MARGARITO M. (2007) « Entre rigueur et agrément : de quelques microstructures de<br />
dictionnaires contemporains », in GALAZZI E. - MOLINARI C. (éds.), Les français en émergence,<br />
Bern : Peter Lang, p. 171-182.<br />
MARGARITO M. (2008), « Italianismes de la langue française dans les dictionnaires<br />
monolingues contemporaines », in SABLAYROLLES J.-FR. (éd.), Néologie et terminologie dans les<br />
dictionnaires, Champion : Paris, p. 179-198.<br />
MARTIN R. (1998), « Sur la distinction du signifié et du concept », in LEEMAN D. – BOONE A.<br />
(éds.), Du percevoir à dire. Hommage à André Joly, Paris : L’Harmattan, p. 37-53.<br />
MARTIN W.J.R. (2001), « Lexical ambiguity by connotation », in BOOGAARDS P. –<br />
ROORYCK J. – SMITH P.J. (éds.), Quitte ou double Sens (article offerts à R. Landheer),<br />
Amsterdam/Atlanta: Rodopi, p. 223-237.<br />
MARTIN MINGORANCE L. (1990), « Functional grammar and lexematics in lexicography »,<br />
in TOMASZCZYK J. – LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (éds.), Meaning and lexicography,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 227-253.<br />
MARTINET A. (1996 [1970]), Eléments de linguistique générale, Paris: Colin.<br />
250
MASPERI M. (1996), « Quelques réflexions autour du rôle de la parenté linguistique dans<br />
une approche de compréhension écrite de l’italien par des francophones débutants », Etudes<br />
de linguistique appliquée, 104, p. 491-502.<br />
MATORE G. (1953), La méthode en lexicologie, Paris : Didier.<br />
MAURI A. (2006), « L’icône ou le dictionnaire inutile », in SZENDE T. (éd.), Le français dans les<br />
dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 189-205.<br />
MEL’CUK I.A. – CLAS A. – POLGUERE A. (1995), Introduction à la lexicologie explicative et<br />
combinatoire, Louvain-la-Neuve : Duculot.<br />
MELKA F. (2003), « Les écarts culturels dans le Van Dale, dictionnaire bilingue françaisnéerlandais<br />
», in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris :<br />
Champion, p. 249-258.<br />
MELKA F. (2006), « Réception et production dans le bilingue français-néerlandais : verbes<br />
résultatifs », in SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p.<br />
157-171.<br />
MESKOVA L. (2006), « Un dictionnaire bilingue pour les étudiants en économie », in<br />
SZENDE T. (éd.), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 471-480.<br />
MIKKELSEN H.K. (1992), « What did Scerba actually mean by ‘active’ and ‘passive’<br />
dictionaries », in HYLDGAARD-JENSEN K. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on<br />
Lexicography V. Proceedings of the Fifth International Symposium on Lexicography, May 3-5, 1990 at<br />
the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 25-40.<br />
MINERVA N. (2007), « D'hier à aujourd'hui : architectures en regard », in DOTOLI G. (éd.),<br />
L'architecture du dictionnaire bilingue et le métier du lexicographe. Actes des premières Journées Italiennes<br />
des Dictionnaires, Capitolo-Monopoli, 16-17 avril 2007, Fasano : Schena, p. 175-197.<br />
MOLINARI C. (2007), « ‘Francophonismes’ et lexicographie : enjeux linguistiques et<br />
sociolinguistiques », in GALAZZI E. - MOLINARI C. (éds.), Les français en émergence, Bern :<br />
Peter Lang, p. 183-202.<br />
MOUNIN G. (éd.) (2004 [1974]), Dictionnaire de la linguistique, Paris : PUF.<br />
MUGDAN J. (1992), « On the typology of bilingual dictionaries », in HYLDGAARD-JENSEN<br />
K. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography V. Proceedings of the Fifth International<br />
Symposium on Lexicography, May 3-5, 1990 at the University of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer,<br />
p. 17-24.<br />
NEUBERT A. (1978), « Kinds of Lexical Meaning », Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik,<br />
26, p. 241-246.<br />
NIDA E.A. (1958), « Analysis of meaning and dictionary making », International Journal of<br />
American Linguistics, 24, p. 279-292.<br />
NIDA E.A. (2001), Contexts in translating, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins.<br />
251
NIELSEN S. (2000), « Translation Strategies for Culture-Specific Textual Conventions in<br />
Bilingual Dictionaries », Lexicographica, 16, p. 152-168.<br />
NIKLAS-SALMINEN A. (1997), La lexicologie, Paris : Colin.<br />
NIKLAS-SALMINEN A. (2001) « Sur la néologie et la norme », in SIOUFFI G. – STEUCKARDT<br />
A. (éds.), La norme lexicale, Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier III, p. 109-127.<br />
NISBET R.E. (2003), The Geography of Thought : how Asians and Westerners Think Differently... and<br />
Why, New York/London/Toronto/Sidney : The Free Press.<br />
NOWAKOWSKI M. (1990), « Metaphysics of the dictionary versus the lexicon », in<br />
TOMASZCZYK J. – LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (éds.), Meaning and lexicography,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 3-19.<br />
NOZARIAN B. (2006), « La part des anges », in FREDET F. – LAURIAN A.-M. (éds.)<br />
Linguistique contrastive, linguistique appliquée, sociolinguistique. Hommage à Etienne Pietri, Bern :<br />
Peter Lang, p. 197-204.<br />
NYCKEES V. (1998), La sémantique, Paris : Belin.<br />
OPITZ K. (2002), « The Dictionary of Connotations : A Viable Proposition ? », in<br />
GOTTLIEB H. – MOGENSEN J.E. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography X.<br />
Proceedings of the Tenth International Symposium on Lexicography, May 4-6, 2000 at the University of<br />
Copenhagen, Tübingen. Niemeyer, p. 261-265.<br />
OSSELTON N.E. (1995 [1979]), « Old Words : Defining Obsolescence », in ID. Chosen<br />
Words. Past and Present Problems for Dictionary Makers, Exeter : Exeter University Press, p. 46-<br />
53 (déjà paru sous le titre « Some problems of obsolescence in bilingual dictionaries », in<br />
HARTMANN R.R.K. (éd.), Dictionaries and their users, Exeter : Exeter University Press, p. 120-<br />
126).<br />
PAGANINI G. (1994), « Désir d’Italie, ou la représentation d’une ‘troisième langue’ », Les<br />
langues modernes, 4, p. 9-17.<br />
PAILLARD D. – ROBERT S. (1995), « Langues diverses, langues singulières », in ROBERT S.<br />
(éd.), Langage et sciences humaines : propos croisés, Bern : Peter Lang, p. 117-144.<br />
PAVEAU M.-A. (2006), Les prédiscours. Sens, mémoire, cognition, Paris : Presses de la Sorbonne<br />
Nouvelle.<br />
PEETERS B. (1994), « Semantic and Lexical Universals in French », in GODDARD C. –<br />
WIERZBICKA A. (éds.), Semantic and lexical universals : theory and empirical findings,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 423-442.<br />
PEETERS B. (1996), « Nouveaux regards sur la problématique des cases vides », in<br />
WEIGAND E. – HUNDSNURSCHER F. (éds.), Lexical Structure and Language Use, vol. 1,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 255-264.<br />
252
PEETERS B. (2000), « ‘S’engager’ vs. ‘to show restraint’ : linguistic and cultural relativity in<br />
discourse management », in NIEMEIER S. – DIRVEN R. (éds.), Evidence for Linguistic Relativity,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 193-222.<br />
PEETERS B. (2002), « La métalangue sémantique naturelle au service de l’étude du transculturel »,<br />
Travaux de linguistique, 45, p. 83-101.<br />
PEETERS B. (2003), « Le Transculturel : Sémantique, Pragmatique, Axiologie », La<br />
linguistique, 39, p. 119-135.<br />
PEETERS B. (2008), « La métalangue sémantique naturelle et la lutte contre le syndrome du<br />
franchissement du gué », in DURAND J. – HABERT B. – LAKS B. (éds.), Congrès Mondial de<br />
Linguistique Française CMLF ‘08, Paris : EDP Sciences (CD-ROM), p. 2247-2255, disponible<br />
à l’adresse http://dx.doi.org/10.1051/cmlf08311.<br />
PEETERS B. (à paraître-a), « L’interculturel servi à la sauce MSN, ou A quoi sert la<br />
métalangue sémantique naturelle ? », in AUGER N. – DEMOUGIN F. – BEAL C. (éds.), Les<br />
enjeux de la communication interculturelle, Montpellier : Presses universitaires de Montpellier /<br />
Maison des Sciences Humaines.<br />
PEETERS B. (à paraître-b), « La métalangue sémantique naturelle : acquis et défis », Mémoires<br />
de la Société de Linguistique de Paris N.S., t, XVIII, Leuven : Peeters.<br />
PEETERS B. (éd.) (2006), Semantic Primes and Universal Grammar. Empirical Findings from the<br />
Romance Languages, Amsterdam : John Benjamins.<br />
PEETERS B. – WIERZBICKA A. (1993), « Présentation », in Langue française, vol. 98, n. 1, p. 3-<br />
8.<br />
PERSSON G. (2005), « Dictionaries as Mirrors of Social and Cultural Change », in GOTTLIEB<br />
H. – MOGENSEN J.E. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography XI. Proceedings of the<br />
Eleventh International Symposium on Lexicography, May 2-4, 2002 at the University of Copenhagen,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 427-433.<br />
PIOTROWSKI T. (1990), « The Meaning-Text Model of language and practical<br />
lexicography », in TOMASZCZYK J. – LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (éds.), Meaning and<br />
lexicography, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 277-286.<br />
PITTALUGA M. (1998), « Studi di linguistica francese: lessicografia », in Studi di linguistica<br />
francese in Italia 1960-1996. Atti del Convegno internazionale su ‘Studi di linguistica francese in Italia’,<br />
Milano, 17-19 aprile 1997, Brescia : La Scuola, p. 147-175.<br />
PODEUR J. (2002 [1993]), La pratica della traduzione : dal francese in italiano e dall’italiano in<br />
francese, Napoli : Liguori.<br />
POLGUERE A. (2008), « Pour un transfert des savoirs lexicographiques », in DURAND J. –<br />
HABERT B. – LAKS B. (éds.), Congrès Mondial de Linguistique Française CMLF ‘08, Paris : EDP<br />
Sciences (CD-ROM), p.1277-1285.<br />
PRUVOST J. (2000), Dictionnaires et nouvelles technologies, Paris : PUF.<br />
253
PRUVOST J. (2002), « Traduire l’écart culturel dans les dictionnaires bilingues? », in Traduire,<br />
2, Université de Cergy-Pontoise, Centre de recherche Texte/Histoire, p. 135-158.<br />
PRUVOST J. (2003), « De l’‘infidèle’ traduction à la mention des écarts culturels dans les<br />
dictionnaires bilingues », in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues,<br />
Paris : Champion, p. 1-4.<br />
PRUVOST J. (2005), « Quelques concepts lexicographiques opératoires à promouvoir au seuil<br />
du XXI e siècle », Etudes de linguistique appliquée, 137, p. 7-37.<br />
PRUVOST J. (2006), Les dictionnaires français : outils d’une langue et d’une culture, Paris : Ophrys.<br />
PRUVOST J. (2007), « Des dictionnaires monolingues aux dictionnaires bilingues ? », in<br />
DOTOLI G. (éd.), L'architecture du dictionnaire bilingue et le métier du lexicographe. Actes des premières<br />
Journées Italiennes des Dictionnaires, Capitolo-Monopoli, 16-17 avril 2007, Fasano : Schena, p. 23-<br />
27.<br />
PRUVOST J. (2009a), « Présentation », Etudes de linguistique appliquée, 154, p. 133-136.<br />
PRUVOST J. (2009b), « Quelques perspectives lexicographiques à mesurer à l’aune<br />
lexiculturelle », Etudes de linguistique appliquée, 154, p. 137-153.<br />
PRUVOST J. – SABLAYROLLES J.-F. (2003), Les néologismes, Paris : PUF.<br />
PUCCINI P. (2008), « Profession lexicographe : la position anthropologique de Marie-Eva de<br />
Villers », in COLOMBO M. – BARSI M. (éds.), Lexicographie et lexicologie historiques du français.<br />
Bilan et perspectives, Monza : Polimetrica, p. 273-290.<br />
QUEMADA B. (1987), « Notes sur lexicographie et dictionnairique », Cahiers de lexicologie, 51, p.<br />
229-242.<br />
RAFONI B. (2003), « La recherche interculturelle. Etat des lieux en France », Questions de<br />
communication, 4, p. 13-26.<br />
RASTIER F. (1991), Sémantique et recherches cognitives, Paris : PUF.<br />
REY A. (éd.) (1970), La lexicologie. Lectures, Paris : Klincksieck.<br />
REY A. (1977), Le lexique : images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie, Paris : Colin.<br />
REY A. (1986), « Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues », Lexicographica, 2, p.<br />
33-42.<br />
REY A. (1987a), « Le dictionnaire culturel », Lexicographica, 3, p. 3-50.<br />
REY A. (1987b), « La notion du dictionnaire culturel et ses applications », Cahiers de<br />
lexicologie, 51, p. 243-256.<br />
REY A. (1991), « Divergences culturelles et dictionnaire bilingue » in HAUSMANN F.J. –<br />
REICHMANN O. – WIEGAND E. – ZGUSTA L. (éds.) Wörterbucher/Dictionaries/Dictionnaires.<br />
Ein internationales Handbuch zur Lexikografie/An International Encyclopedia of<br />
254
Lexicography/Encyclopédie internationale de lexicographie, vol. 3, Berlin/New York : De Gruyter,<br />
p. 2865-2870.<br />
REY A. (1995), « Du discours au discours par l’usage : pour une problématique de<br />
l’exemple », Langue Française, vol. 106, n. 1, p. 95-120.<br />
REY A. (2007), « Le pont interculturel », in DOTOLI G. (éd.), L'architecture du dictionnaire<br />
bilingue et le métier du lexicographe. Actes des premières Journées Italiennes des Dictionnaires, Capitolo-<br />
Monopoli, 16-17 avril 2007, Fasano : Schena, p. 7-21.<br />
REY A. – <strong>DEL</strong>ESALLE S. (1979), « Problèmes et conflits lexicographiques », Langue Française,<br />
vol. 43, n. 1, p. 4-26.<br />
REY-DEBOVE J. (1970), « Le domaine du dictionnaire », Langages, vol. 5, n. 19, p. 3-34.<br />
REY-DEBOVE J. (1971), Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, Le<br />
Hague-Paris : Mouton.<br />
REY-DEBOVE J (2008 [1991]) « Les dictionnaires bilingues », in ID. La linguistique du signe.<br />
Une approche sémiotique du langage, Paris : Colin, p. 258-268 (déjà paru sous le titre « La<br />
métalangue dans les dictionnaires bilingues », in HAUSMANN F.J. – REICHMANN O. –<br />
WIEGAND E. – ZGUSTA L. (éds.) Wörterbucher/Dictionaries/Dictionnaires. Ein internationales<br />
Handbuch zur Lexikografie/An International Encyclopedia of Lexicography/Encyclopédie internationale<br />
de lexicographie, vol. 3, Berlin/New York : De Gruyter, p. 2859-2865).<br />
RIEMER N. (2003), « Servant of two masters ? NSM and semantic explanation », Theoretical<br />
Linguistics, vol. 29, n. 3, p. 283-294.<br />
RIVOIRE ZAPPALA M. (1989), « Va-et-vient des xénités », in Analisi comparativa<br />
francese/italiano. Ricerca linguistica - insegnamento delle lingue, Padova : Liviana Editrice, p. 135-<br />
142.<br />
ROBERT S. (2003), « L’épaisseur du langage et la linéraité de l’énoncé. Vers un modèle<br />
énonciatif de production », in OUATTARA A. (éd.), Parcours énonciatifs et parcours interprétatifs.<br />
Théories et applications, Paris : Ophrys, p. 255-274.<br />
ROBERT S. (2008), « Words and their meanings. Principles of variation and stabilization », in<br />
VANHOVE M. (éd.), From Polysemy to Semantic Change. Towards a typology of lexical semantic<br />
associations, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 55-92.<br />
ROBERTS R.P. (1996), « Le traitement des collocations et des expressions idiomatiques dans<br />
les dictionnaires bilingues », in BEJOINT H. – THOIRON P. (éds.), Les dictionnaires bilingues,<br />
Louvain-La-Neuve : Aupelf-Uref-Duculot, p. 181-197.<br />
ROBERTS R.P (2007), « Dictionaries and culture », in GOTTLIEB H. – MORGENSEN J.E.<br />
(éds.), Dictionary Visions, Research and Practice. Selected papers from the 12th International Symposium<br />
on Lexicography, Copenhagen 2004, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 277-297.<br />
SABBAN A. (2007), « Culture-boundness and problems of cross-cultural phraseology », in<br />
BURGER H. et al. (éd.), Phraseologie/Phraseology. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer<br />
255
Forschung/An International Handbook of Contemporary Research, Berlin/ New /York : de<br />
Gruyter, p. 590-605.<br />
SABLAYROLLES J.-F. (2008), « Néologie et dictionnaire(s) comme corpus d'exclusion », in<br />
ID. (éd.) Néologie et terminologie dans les dictionnaires, Champion : Paris, p. 19-36.<br />
SABLAYROLLES J.-F. (2009), « Néologie et classes d'objets », Neologica, 3, p. 25-36.<br />
SALERNO L. (2002), « Informazione grammaticale e lessicografia bilingue. Il trattamento<br />
della complementazione verbale in cinque dizionari italiano-francese », in FERRARIO E. –<br />
PULCINI V. (éds.), La Lessicografia Bilingue tra presente e avvenire, Vercelli : Mercurio, p. 77-93.<br />
ŠARCEVIC S. (1985), « Translation of culture-bound terms in laws », Multilingua, 4-3, p. 127-<br />
133.<br />
ŠARCEVIC S. (1988), «The challenge of legal lexicography : Implications for bilingual and<br />
multilingual dictionaries », in SNELL-HORNBY M. (éd.), ZüriLEX ’86 Proceedings : Papers read<br />
at the EURALEX International Congress, University of Zurich, 9-14 September 1986, Tübingen :<br />
Francke, p. 307-314.<br />
ŠARCEVIC S. (1989) « Lexicography and Translation Across Cultures », in SNELL-HORNBY<br />
M.– PÖHL E. (éds.), Translation and Lexicography. Papers read at the EURALEX Colloquium held<br />
at Innsbruck, 2-5 July 1987, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 211-221.<br />
SAUSSURE F. DE (1972), Cours de linguistique générale, DE MAURO T. (éd.), Paris : Payot.<br />
SCAVEE P. – INTRAVAIA P. (1979), Traité de stylistique comparée, Bruxelles : Didier.<br />
SCHLESINGER I.M. (1991), « The wax and wane of Whorfian views », in COOPER R.L. –<br />
SPOLSKY B. (éds.), The Influence of Language on Culture and Thought, Berlin/New York :<br />
Mouton de Gruyter, p. 7-44.<br />
SCHNORR V. (1986), « Translational Equivalent and/or Explanation ? The Perennial<br />
Problem of Equivalence », Lexicographica, 2, p. 53-60.<br />
SCIARONE A. (1984), « The organization of the bilingual dictionary », in HARTMANN R.R.K.<br />
(éd.), LEXeter ’83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9-<br />
12 September 1983, Tübingen : Niemeyer, p. 413-419.<br />
SGROI S.C. (1981), « Riflessi dell’interdizione linguistica nella lessicografia francese », in<br />
Studi italiani di linguistica teorica ed applicata, 1-2-3, p. 403-421.<br />
SHCHERBA L.V. (1995 [1940]), « Towards a General Theory of Lexicography », International<br />
Journal of Lexicography, vol. 8, n. 4, p. 314-350.<br />
SIERRA SORIANO A. (2001), El diccionario bilingüe. Estructura y Nomenclatura, Alicante: ECU,<br />
Editorial Club Universitario.<br />
SNELL-HORNBY M. (1986), « The bilingual dictionary victim of its own tradition ? », in<br />
HARTMANN R.R.K. (éd.), The History of Lexicography, Papers from the Dictionary Centre Seminar at<br />
Exeter, March 1986, Amsterdam/Philadelphia, p. 207-218.<br />
256
SNELL-HORNBY M. (1987), « Towards a learner’s bilingual dictionary », in COWIE A. (éd.),<br />
The Dictionary and the Language Learner : Papers from the EURALEX Seminar at the University of<br />
Leeds, 1-3 April 1985, Tübingen : Niemeyer, p. 159-170.<br />
SNELL-HORNBY M. (1990a), « Bilingual Dictionaries - Visions and Revisions », in MAGAY<br />
T. – ZIGANY J. (EDS.), BudaLEX ’88 Proceedings : Papers from the 3rd International EURALEX<br />
Congress, Budapest, 4-9 September 1988, Budapest : Akadémiai Kiadó, p. 227-236.<br />
SNELL-HORNBY M. (1990b), « Dynamics in meaning as a problem for bilingual<br />
lexicography », in TOMASZCZYK J. – LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (EDS.), Meaning and<br />
lexicography, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 209-226.<br />
SOMMANT M. (2003), « Innovation lexicale : sources des néologismes, normalisation et<br />
intégration dans les nomenclatures des dictionnaires de langue française », in<br />
SABLAYROLLES J.-F. (éd.), L’innovation lexicale, Paris : Champion, p. 247-260.<br />
SONG E.-J. (2003), « Lexiculture et pragmaculture dans un dictionnaire bilingue d’énoncés<br />
usuels (coréen, français) », in SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues,<br />
Paris : Champion, p. 365-382.<br />
SPILLNER B. (1994), « Terminologie et connotations », Français scientifique et technique et<br />
dictionnaire de langue, Paris : Didier, p. 53-62.<br />
STATI S. (1986), « Equivalences lexicales de langue et de parole », Contrastes, 13, p. 3-16.<br />
STEINER R.J. (1986), « How many languages should a ‘bilingual’ dictionary offer ? »,<br />
Lexicographica, 2, p. 85-92.<br />
STEINER R.J. (1995), « The Bilingual Dictionary in Cross-Cultural Contexts », in KACHRY<br />
B.J. – KAHANE H. (éds.), Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in Honor of Ladislav<br />
Zgusta, Tübingen : Niemeyer, p. 275-280.<br />
SURMONT J.N. DE (2000), « Le traitement de l’information culturelle dans les dictionnaires<br />
monolingues pour apprenants et bilingues », Lexicographica, 16, p. 192-211.<br />
SVENSEN BO (1993), Practical lexicography, Oxford-New York : Oxford University Press.<br />
SZENDE T. (1993), « Traduction et lexicographie bilingue », Cahers d’Etudes Hongroises, 5, p.<br />
73-89.<br />
SZENDE T. (1996) « Problèmes d’équivalence dans les dictionnaires bilingues », in BEJOINT<br />
H. – THOIRON P. (éds.), Les dictionnaires bilingues, Louvain-La-Neuve : Aupelf-Uref-Duculot,<br />
p. 111-126.<br />
SZENDE T. (éd.) (2000), Dictionnaires bilingues : méthodes et contenus, Paris : Champion.<br />
SZENDE T. (éd.) (2000), Approches contrastives en lexicographie bilingue, Paris : Champion.<br />
SZENDE T. (éd.) (2003), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion.<br />
257
SZENDE T. (2004), « Une ressource monolingue pour les dictionnaires bilingues », in<br />
LAURIAN A.-M. (éd.), Dictionnaires bilingues et interculturalité, Bern : Peter Lang, p. 243-258.<br />
SZENDE T. (éd.) (2006), Le français dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion.<br />
TALLARICO G. (2004), Gli italianismi neologici nel francese contemporaneao. Analisi di un corpus di<br />
stampa : Le Monde 2001-2002, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, mémoire de<br />
maîtrise non publié.<br />
TALLARICO G. (2009), « Le mythe de l’objectivité dans les dictionnaires bilingues », Travaux en<br />
cours, n. 5, Université Paris-Diderot, U.F.R. L.A.C, p. 49-58.<br />
TALLARICO G. (2010), « La transparence de l’écart et l’opacité de l’équivalence ». Cahiers de<br />
recherche de l’Ecole Doctorale en Linguistique française, Université de Brescia, n. 4, p. 68-77.<br />
TAMBA I. (2005 [1988]), La sémantique, Paris : Puf.<br />
TARP S. (2005), « The concept of a bilingual dictionary », in BARZ I., BERGENHOLTZ H.,<br />
KORHONEN J. (éds.), Schreiben, Verstehen, Übersetzen, Lernen : zu ein- und zweisprachigen<br />
Wörterbüchern mit Deutsch, Bern : Peter Lang, p. 27-4.1<br />
TARP S. (2008), Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-Knowledge. General<br />
Lexicographical Theory with Particular Focus on Learner’s Lexicography, Tübingen : Niemeyer.<br />
TELIYA V. et al. (1998), « Phraseology as a Language of Culture : Its Role in the<br />
Representation of the Collective Mentality », in COWIE A.P. (éd.), Phraseology : theory, analysis,<br />
and applications, Oxford : Oxford University Press, p. 55-75.<br />
THIBAULT A. (2008), « Lexicographie et variation diatopique : le cas du français », in<br />
COLOMBO M. – BARSI M. (éds.), Lexicographie et lexicologie historiques du français. Bilan et<br />
perspectives, Monza : Polimetrica, p. 69-91.<br />
TOMASZCZYK J. (1976), « On establishing equivalence between lexical items of two<br />
languages », Papers and Studies in Contrastive Linguistics, 5, p. 77-81.<br />
TOMASZCZYK J. (1979), « Dictionaries : users and uses », Glottodidactica, 12, p. 103-119.<br />
TOMASZCZYK J. (1983), « On bilingual dictionaries : the case for bilingual dictionaries for<br />
foreign language learners », in HARTMANN R.R.K. (éd.) Lexicography : Principles and Practice,<br />
London : Academic Press, p. 41-52.<br />
TOMASZCZYK J. (1984), « The culture-bound element in bilingual dictionaries », in<br />
HARTMANN R.R.K. (éd.), LEXeter ’83 Proceedings. Papers from the International Conference on<br />
Lexicography at Exeter, 9-12 September 1983, Tübingen : Niemeyer, p. 289-297.<br />
TOMASZCZYK J. (1988), « The bilingual dictionary under review », in SNELL-HORNBY M.<br />
(éd.), ZüriLEX ’86 Proceedings : Papers read at the EURALEX International Congress, University<br />
of Zurich, 9-14 September 1986, Tübingen : Francke, p. 289-297.<br />
258
TOURATIER C. (1993), « Lexicographie et théorie linguistique du sens », in BAGGIONI D.<br />
(éd.), Encyclopédie et dictionnaires français, Aix-en-Provence : Université de Provence, p. 209-<br />
215.<br />
TOURATIER C. (2004) La sémantique, Paris : Colin.<br />
ULLMANN S. (1952), Précis de sémantique française, Berne : Francke.<br />
VAN BAAREDWIJK-RESSEGUIER J. (1993), « Les mots de la culture », in AA. VV., Du lexique à<br />
la morphologie : du côté de chez Zwaan. Textes réunis en l’honneur du soixantième anniversaire de<br />
Wiecher Zwanenburg, Amsterdam/Atlanta : Rodopi, p. 29-42.<br />
VARANTOLA K. (2002), « Use and Usability of Dictionaries : Common Sense and Context<br />
Sensibility ? », CORREARD M.-H. (éd.), Lexicography and natural language processing. A Festschrift<br />
in honour of B.T.S. Atkins, Stüttgart : Euralex, p. 30-44.<br />
VEGLIANTE J.-C. (2003), Quelques pièges du ‘presque-même’ franco-italien (effet-traduction), in<br />
SZENDE T. (éd.), Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris : Champion, p. 345-363.<br />
VEISBERGS A. (2005), « Ideology in Dictionaries – Definitions of Political terms », in<br />
GOTTLIEB H. – MOGENSEN J.E. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography XI.<br />
Proceedings of the Eleventh International Symposium on Lexicography, May 2-4, 2002 at the University<br />
of Copenhagen, Tübingen : Niemeyer, p. 537-547.<br />
VITTOZ M.-B. (1996), « Idiomaticité et lexiculture : un parcours pour étudiants spécialisés<br />
de F.L.E. », Franco-Italica, 9, p. 229-245.<br />
WALTER H. (2007), « Les mots français émigrés », in PRUVOST J. (éd.) Les Journées des<br />
dictionnaires de Cergy. Dictionnaires et mots voyageurs, Eragny-sur-Oise : Editions des Silves, p.<br />
67-78.<br />
WANDRUSZKA M. (1973), « Le mot : connotations et indices socio-culturels », Travaux de<br />
linguistique et littérature, XI, 1, p. 53-61.<br />
WEIGAND E. (1998), « Contrastive lexical semantics », in ID. (éd.), Contrastive lexical semantics,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 25-44.<br />
WEINRICH H. (1986), « Petite xénologie des langues étrangères », Communications, 43, p. 187-<br />
203.<br />
WERLY N. (1995), « Les mots de l’autre: comment faire de la connotation sans en avoir l’air<br />
avec les dénominations des lieux publics », in MARGARITO M. – RAUGEI A.M. (éds.), Studi<br />
di Linguistica, Storia della Lingua, Filologia francesi. Convegno della Società Universitaria per gli<br />
Studi di Lingua e Letteratura francese - Torino, 16 e 17 giugno 1994, Alessandria : Edizioni<br />
dell’Orso, p. 131-193.<br />
WESTHEIDE H. (1998) « Equivalence in contrastive semantics. The effect of cultural<br />
differences », in WEIGAND E. (éd.), Contrastive lexical semantics, Amsterdam/Philadelphia :<br />
John Benjamins, p. 119-137.<br />
259
WHITCUT J. (1984), « Sexism in dictionaries », in HARTMANN R.R.K. (éd.), LEXeter ’83<br />
Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9-12 September 1983,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 141-144.<br />
WIEGAND H.E. (1984), « On the structure and contents of a general theory of<br />
lexicography », in HARTMANN R.R.K. (éd.), LEXeter ’83 Proceedings. Papers from the<br />
International Conference on Lexicography at Exeter, 9-12 September 1983, Tübingen : Niemeyer, p.<br />
13-30.<br />
WIERZBICKA A. (1972), Semantic Primitives, Frankfurt : Athenäum.<br />
WIERZBICKA A. (1979), « Ethno-syntax and the philosophy of grammar », Studies in<br />
Language, 3-3, p. 313-383.<br />
WIERZBICKA A. (1980), Lingua Mentalis, Sidney : Academic Press.<br />
WIERZBICKA A. (1985), Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor: Karoma Publishers.<br />
WIERZBICKA A. (1988a), The Semantics of Grammar, Amsterdam/Philadelphia: John<br />
Benjamins.<br />
WIERZBICKA A. (1988b), « The semantics and lexicography of ‘natural kinds’ », in<br />
HYLDGAARD-JENSEN K. – ZETTERSTEN A. (éds.), Symposium on Lexicography III. Proceedings of<br />
the Third International Symposium on Lexicography, May 14-16, 1986 at the University of Copenhagen,<br />
Tübingen : Niemeyer, p. 155-182.<br />
WIERZBICKA A. (1988c), « L’amour, la colère, la joie, l’ennui. La sémantique des émotions<br />
dans une perspective transculturelle », Langages, vol. 23, n. 89, p. 97-107.<br />
WIERZBICKA A. (1991), « Italian reduplication : its meaning and its cultural significance », in<br />
ID., Cross-Cultural Pragmatics, Berlin/New York : Mouton de Gruyter, p. 255-284.<br />
WIERZBICKA A. (1992a), Semantics, Culture and Cognition : Universal Human Concepts in Culture-<br />
Specific Configuration, New York : Oxford University Press.<br />
WIERZBICKA A. (1992b), « Back to definitions : Cognition, semantics and lexicography »,<br />
Lexicographica, 8, p. 146-174.<br />
WIERZBICKA A. (1993a), « La quête des primitifs sémantiques : 1965-1992 », Langue française,<br />
vol. 98, n. 1, , p. 9-23.<br />
WIERZBICKA A. (1993b), « Les universaux de la grammaire », Langue française, vol. 98, n. 1,<br />
p. 107-120.<br />
WIERZBICKA A. (1994), « ‘Cultural scripts’ : a new approach to the study of cross-cultural<br />
communication », in PÜTZ M. (éd.), Language Contact and Language Conflict,<br />
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, p. 69-87.<br />
WIERZBICKA A. (1995), « Dictionaries and Ideologies : Three Examples from Eastern<br />
Europe », in KACHRY B.J. – KAHANE H. (éds.), Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in<br />
Honor of Ladislav Zgusta, Tübingen : Niemeyer, p. 181-195.<br />
260
WIERZBICKA A. (1996), Semantics: Primes and Universals, Oxford : Oxford University Press.<br />
WIERZBICKA A. (2005), « In defense of ‘culture’ », Theory & Psychology, 15, p. 575-597.<br />
WIERZBICKA A. (2006a), « Sens et grammaire universelle : théorie et constats empiriques »,<br />
Cahiers Ferdinand de Saussure, 59, p. 151-172.<br />
WIERZBICKA A. (2006b), « Les universaux empiriques du langage: tremplin pour l’étude<br />
d’autres universaux humains et outil dans l’exploration de différences transculturelles »,<br />
Linx, 54, p. 151-179.<br />
WIERZBICKA A. (2006c), English : meaning and culture, Oxford : » Oxford University Press.<br />
WILLIAMS E.B. (1960), « Analysis of the Problem of Meaning Discrimination in Spanish<br />
and English Bilingual Lexicography », Babel, vol. 6, n. 3, p. 121-125.<br />
WINTER C. (1992), « Bilingual Dictionaries : Between Language and Speech », in ARNAUD<br />
P.J.L. – BEJOINT H. (éds.), Vocabulary and Applied Linguistics, London : Macmillan, p. 41-51.<br />
WINTER-FROEMEL E. (2009), « Les emprunts linguistiques : enjeux théoriques et<br />
perspectives nouvelles », Neologica, 3, p. 79-122.<br />
YANCHUN Z. – JIANHUA H. (2004), « The Paradox of Cultural Translation : How to Treat<br />
Cultural Information in Bilingual Dictionaries », in CHAN S.-W. (éd.), Translation and bilingual<br />
dictionaries, Tübingen : Niemeyer, p. 177-185.<br />
ZGUSTA L. (1971), Manual of lexicography, Praha : Academia.<br />
ZGUSTA L. (1984), « Translational equivalence in the bilingual dictionary », in HARTMANN<br />
R.R.K. (éd.), LEXeter ’83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at<br />
Exeter, 9-12 September 1983, Tübingen : Niemeyer, p. 147-154.<br />
ZGUSTA L. (1999), « Problems of Exemplification in Bilingual Dictionaries », Lexicographica,<br />
15, p. 198-228.<br />
ZGUSTA L. (2006), Lexicography Then and Now. Selected Essays, DOLEZAL F.S.F. –CREAMER<br />
T.B.I. (éds.), Tübingen : Niemeyer.<br />
ZOCH M. (2006), « Navigational aids, a critical factor for the success of electronic<br />
dictionaries », in RAPP R.– SEDLMEIER P. – ZUNKER-RAPP G. (éds.), Perspectives on Cognition.<br />
A Festschrift for Manfred Wettler, p. 397-414.<br />
ZOTTI V. (2007), « Connotations des mots désignant la femme dans les dictionnaires<br />
bilingues : problèmes de traduction, in FARINA A. – RAUS R. (éds), Des mots et des femmes:<br />
Rencontres linguistiques. Actes de la journée d'étude tenue à l'Université de Florence (1er décembre 2006),<br />
Florence : Firenze University Press, p. 83-96.<br />
ZOUOGBO J.-P.C. (2009), Le proverbe entre langues et cultures: une étude de linguistique confrontative<br />
allemand/français/bété, Bern: Peter Lang.<br />
261
262
Annexe I - Détail de l’analyse de la lettre A<br />
Dans cette première annexe, nous allons reproduire les écarts que nous avons relevés dans<br />
la lettre A des quatre dictionnaires de notre corpus, dans les directions français-italien et<br />
italien-français.<br />
Pour des raisons d’espace, nous ne reproduisons pas l’entrée complète, mais seulement<br />
l’acception ou la catégorie grammaticale concernée.<br />
Notes sur les marques 318<br />
Ecarts morphologiques. Les écarts morphologiques sont ceux qui relèvent de la forme des<br />
mots, plutôt que de leur sens. Nous proposons des cas de figure que nous avons inclus dans<br />
cette catégorie :<br />
attracteur = che attira. [G]<br />
accomunabile = qu’on peut réunir, qu’on peut mettre en commun. [SL]<br />
abitativo = du bâtiment. [SL]<br />
Pour le cas suivant, nous avons retenu la catégorie d’écart sémantique car l’acception en<br />
question ne peut pas être reformulée à partir du signifié central « con accanimento ».<br />
accanitamente = (furiosamente) avec fureur. [SL]<br />
Des cas comme accentratore (« personne qui veut tout diriger ») pourraient à la rigueur<br />
relever de cette typologie, vu leur structure dérivationnelle; cependant, il n’est pas possible<br />
de reconstruire le sens de ces mots à partir de leur forme, voilà pourquoi nous avons décidé<br />
de les classer sous la typologie des écarts sémantiques.<br />
Le mot adulabile, par contre, traduit comme « sensible à la flatterie, qui se laisse flatter »,<br />
n’est pas un écart morphologique, car il ne peut pas être reformulé en italien comme « che<br />
si può adulare ».<br />
318 Ces notes s’ajoutent à la classification présentée en II.1.1 et la précisent.<br />
263
Ecarts terminologiques. Nous avons inclus dans cette catégorie les termes renvoyant aux<br />
vocabulaires de spécialité (scientifiques). Cependant, le marquage technolectal des<br />
dictionnaires n’a pas constitué un repère fixe dans notre travail. Par exemple, nous<br />
considérons que la majorité des mots du sport (marqués avec l’étiquette homonyme, dans<br />
les dictionnaires de notre corpus) font partie du fonds lexical commun, étant donné qu’ils<br />
sont véhiculés par la presse généraliste et qu’ils figurent largement dans les discours<br />
quotidiens. Il y a des exceptions, toutefois : quelques mots de l’escrime ou de sports moins<br />
populaires ont été retenus dans cette catégorie.<br />
Par contre, les mots marqués comme relevant du vocabulaire du droit ou des sciences<br />
exactes rentrent normalement dans cette catégorie.<br />
Pour d’autres domaines (psychologie, etc.), nous avons retenu les termes les plus<br />
spécifiques et qui font appel à des connaissances réputées non de base, non appartenant au<br />
bagage du locuteur cultivé moyen 319 . Les autres entrées, faisant plutôt partie du fonds<br />
lexical commun, ont été considérées, le cas échéant, comme des écarts sémantiques (ES<br />
dans l’annexe).<br />
Ecarts dictionnairiques. Nous rappelons le principe suivant : il suffit que l’un des trois<br />
dictionnaires, pris au fur et à mesure comme pierre de touche (ou ‘méta-corpus<br />
d’exclusion’), propose un équivalent lexématique de l’entrée (ou de l’acception en question)<br />
pour que l’écart signalé (que ce soit sémantique, morphologique ou terminologique) soit<br />
considéré comme un simple écart dictionnairique, relevant donc du choix du lexicographe,<br />
plutôt que d’une lacune lexicale quelconque.<br />
Toutefois, des remarques se sont parfois imposées, lorsque les choix des dictionnaires nous<br />
ont paru fort discutables.<br />
Parmi les cas de figure, nous pouvons citer le recours à l’hypéronymie :<br />
assito s.m.<br />
(parete di assi) cloison f. de planches. [G] Il s’agit d’un ED car HP traduit tout simplement<br />
(tramezzo) cloison »<br />
Nous avons également signalé la présence de lexèmes absents dans PR11, TLFi et avec de<br />
faibles attestations dans Google, ou encore la présence de lexèmes dont le sens s’écarte<br />
considérablement de l’entrée (ou de l’acception en question).<br />
Les écarts dictionnairiques nous confirment combien il est difficile de trancher, quant au<br />
phénomène de l’équivalence. Cependant, lorsqu’aucun des quatre dictionnaires du corpus<br />
319 Nous sommes conscients de l’arbitraire relatif de cette classification, mais nous la croyons nécessaire.<br />
264
n’a trouvé d’équivalent direct (monolexématique) pour l’entrée, nous pouvons, non sans<br />
une certaine prudence, affirmer que probablement il n’y en a pas. C’est un critère tout à fait<br />
empirique, bien entendu, mais qui est isomorphe à la nature du corpus et à celle des faits<br />
lexicaux pris en examen.<br />
N.B : nous utiliserons les abréviations suivantes:<br />
ED: écart dictionnairique<br />
ES: écart sémantique<br />
ER: écart référentiel<br />
EM: écart morphologique<br />
ET: écart terminologique<br />
B: Boch<br />
G: Garzanti<br />
SL: Sansoni Larousse<br />
PR11: Le Petit Robert 2011<br />
TLFi: Le Trésor de la Langue Française Informatisé<br />
GI: Garzanti italien<br />
DeM: De Mauro<br />
265
DIRECTION FRANÇAIS-ITALIEN<br />
DICTIONNAIRE BOCH<br />
abajoue s. f.<br />
1 (fam.) guancia cascante ES, G confirme.<br />
2 (zool.) tasca boccale. ET, G et SL confirment<br />
abat-faim s. m. inv.<br />
(cuc.) piatto forte. ES, HP confirme.<br />
abattu s. m.<br />
266<br />
La lingua italiana è affine alla francese<br />
(armi) posizione di disarmo (del cane di un fucile). ES, acception absente ailleurs 320<br />
abbatiale s. f.<br />
chiesa abbaziale. ES, HP et SL confirment<br />
abcéder v. intr.<br />
(med.) trasformarsi in ascesso. ED, G “suppurare”<br />
abdicataire B s. m. e f.<br />
chi abdica. ED, HP “abdicatario”<br />
abois s. m. pl.<br />
G, s.v. affine<br />
(caccia) latrato dei cani da seguito che hanno circondato la selvaggina. ED, G “latrato (di<br />
cane da caccia che punta l’animale braccato)”<br />
abondanciste s. m. e f.<br />
320 Cette note indique que l’entrée ou l’acception n’est pas présente dans les autres trois dictionnaires du<br />
corpus.
(econ. polit.) fautore delle dottrine dell’abbondanza. ES, absent ailleurs<br />
abonnataire agg.<br />
(dir.) concesso in abbonamento. ES, absent ailleurs<br />
abricoté agg.<br />
1 con le albicocche, all’albicocca: gâteau abricoté, dolce all’albicocca. ES, HP, G et SL<br />
confirment<br />
2 che è incrociato con l’albicocca: pêche abricotée, pesca incrociata con albicocca. ES, absent<br />
ailleurs<br />
abricoter v. tr.<br />
1 (cuc.) aromatizzare all’albicocca. ES, absent ailleurs<br />
2 (cuc.) spalmare con marmellata di albicocche. ES, absent ailleurs<br />
abri-sous-roche s. m.<br />
(geol., paleont.) cavità ai piedi di una parete rocciosa a strapiombo (abitazione preistorica).<br />
ES, absent ailleurs<br />
absorptance s. f.<br />
(fis.) coefficiente di assorbimento (m.). ET, G confirme<br />
absoute s. f.<br />
1 (relig.) assoluzione esequiale, al tumulo. ES, SL, G et HP confirment<br />
2 (relig.) assoluzione pubblica (impartita il Giovedì Santo). ES, G confirme<br />
académie s. f.<br />
nell’ordinamento scolastico e universitario, circoscrizione facente capo a una università.<br />
ER, G, HP et SL confirment<br />
académicien s. m.<br />
accademico (membro dell’“Académie française” o di una società artistica, letteraria,<br />
scientifica, denominata “académie”). ER, HP et SL confirment<br />
académique agg. sost.<br />
(nell’ordinamento scolastico francese) relativo alle circoscrizioni universitarie: Palmes<br />
académiques, onorificenza concessa dal Ministero della “Jeunesse, de l’Éducation Nationale<br />
267
et de la Recherche” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). ER, HP<br />
confirme<br />
académisable agg.<br />
che ha buone probabilità di essere eletto all’“Académie Française”. ER, absent ailleurs<br />
accastillage 321 s. m.<br />
(mar.) accessori per la nautica (pl.). ET, G confirme<br />
accastiller v. tr.<br />
(mar.) dotare una nave della sovrastruttura. ET, absent ailleurs<br />
accessit s. m.<br />
(scol.) menzione concessa agli studenti che seguono immediatamente i premiati nella<br />
graduatoria. ER, G, HP et SL confirment<br />
accolade s. f.<br />
(arch.) arco a carena (m.), arco carenato (m.), arco inflesso (m.). ET, HP et SL confirment<br />
accordoir s. m.<br />
chiave di accordatore (f.). ET, G, HP et SL confirment<br />
accouder (s’) v. pron.<br />
appoggiarsi col gomito, coi gomiti: s’accouder à la balustrade, appoggiarsi coi gomiti alla<br />
balaustra. ES, G, HP et SL confirment<br />
accoutrement s. m.<br />
abbigliamento stravagante e ridicolo. ES, G, HP et SL confirment<br />
accouvage s. m.<br />
(zoot.) cova artificiale. ET, G, HP et SL confirment<br />
accrobranche s. f.<br />
(sport) pratica sportiva che consiste nello spostarsi di ramo in ramo o di albero in albero.<br />
ED, G “tree-climbing”<br />
accroche s. f.<br />
321 G a également une deuxième acception (absente ailleurs), traduite “opera morta”, toujours avec étiquette<br />
“(mar.)”, ET.<br />
268
slogan pubblicitario (m.). ES, G, HP et SL confirment<br />
accroche-plat s. m.<br />
gancio per appendere piatti ornamentali. ES, SL, HP et G confirment<br />
accul s. m.<br />
(caccia) fondo di tana. ES, absent ailleurs<br />
achromat s. m.<br />
(foto) obiettivo acromatico. ET, G confirme<br />
aconage o acconage s. m.<br />
scarico e carico di merci mediante una chiatta (fra una nave all’ancora e una banchina). ES,<br />
SL et G confirment<br />
aconier o acconier s. m.<br />
addetto allo scarico e carico delle merci a bordo di una nave mercantile. ES, G confirme 322<br />
acoquiner (s’) v. pron.<br />
far comunella: s’acoquiner avec des gens d’une moralité douteuse, far comunella con gente<br />
di dubbia moralità. ES, G, HP et SL confirment<br />
acousticien s. m. aggett.<br />
studioso di acustica. ES, G, HP et SL confirment<br />
acquêt s. m.<br />
(dir. fr.) bene acquistato da uno dei coniugi: communauté réduite aux acquêts, comunione<br />
dei beni, limitata a quelli acquisiti dopo il matrimonio. ET, G, HP et SL confirment<br />
acquis s. m. pl.<br />
vantaggi sociali acquisiti, competenze acquisite. ED, G “acquisizione, conquista”<br />
acter v. tr.<br />
(belg.) prendere atto (di). ES, G confirme 323<br />
active s. f.<br />
322 Mais il traduit “chi ha un’impresa di trasporti su chiatte”.<br />
323 Mais avec une étiquette « dir. » (« droit »), au lieu de l’étiquette diatopique de B.<br />
269
(mil.) insieme dei militari in servizio permanente effettivo: officier d’active, ufficiale di<br />
carriera. ES, G et SL confirment<br />
acul s. m.<br />
(zoot.) fondo di un parco per l’allevamento delle ostriche. ET, asbent ailleurs<br />
adamisme s. m.<br />
(st. relig.) eresia degli adamiti. ES, G confirme<br />
adenter v. tr.<br />
(tecnol.) unire a incastro. ET, G confirme<br />
adjectivement avv.<br />
(ling.) con valore di aggettivo. ED, SL “aggettivalmente”<br />
adjudant s. m.<br />
1 nell’ordinamento militare francese, sottufficiale di grado equiparabile a quello di<br />
maresciallo. ED, G “maresciallo”, SL “aiutante”<br />
2 (pegg.) tipo autoritario: quel adjudant, sa femme!, che tipo autoritario sua moglie! ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
adjudantisme s. m.<br />
bieco autoritarismo. ES, absent ailleurs<br />
admirativement avv.<br />
con ammirazione. ED, SL “(rar) ammirativamente”<br />
admissibilité s. f.<br />
(scol.) ammissione alle prove orali d’un esame (per chi ha superato quelle scritte). ED, HP<br />
“ammissibilità (agli orali)”<br />
ados s. m. inv.<br />
1 (agr.) scarpata di terra (per proteggere le primizie dal vento del nord ed esporle al sole).<br />
ES, G et SL confirment 324<br />
2 (agr.) disposizione del terreno dopo l’aratura a porche. ED, G “porca; controsolco”<br />
324 Avec des variantes significatives, cependant : G “terrapieno a solatio”; SL “striscia f. di terra rilevata per<br />
proteggere le coltivazioni”.<br />
270
adret s. m.<br />
(geogr.) costone soleggiato. ET, G et SL confirment<br />
adverbialiser v. tr.<br />
(ling.) usare come avverbio ES, G confirme<br />
adverbialisé agg.<br />
con valore di avverbio: adjectif adverbialisé, aggettivo usato avverbialmente. ES, G<br />
confirme<br />
aéraulique s. f.<br />
(tecnol.) meccanica degli aeriformi. ED, G “pneumatica”<br />
aéronavale s. f.<br />
aereonautica navale (della marina militare francese). ES, SL confirme<br />
aérospatiale s. f.<br />
tecnica aerospaziale. ES, G, HP et SL confirment<br />
æthuse o éthuse s. f.<br />
(bot.) erba aglina, cicuta aglina. ET, absent ailleurs<br />
affabulation s. f.<br />
distorcimento dei fatti. ED, SL “favola, invenzione”<br />
affabuler v. intr.<br />
distorcere i fatti. ED, SL “inventare”<br />
affadir v. tr.<br />
rendere insipido: affadir un mets, rendere insipido un piatto: (fig.) sa manière de raconter<br />
affadit l’histoire, il suo modo di raccontare rende insipida la storia. ES, G, HP et SL<br />
confirment<br />
s’affadir v. pron.<br />
1 diventare insipido: un plat qui s’est affadi, un piatto che è diventato insipido. ES, G, HP<br />
et SL confirment<br />
2 (fig.) perdere vigore: son style s’est affadi, il suo stile ha perso vigore. ED, HP<br />
“affievolirsi”<br />
271
affadissant agg.<br />
(spec. fig.) che rende insipido, insulso. EM, G, HP et SL confirment<br />
affadissement s. m.<br />
1 perdita di sapore: affadissement d’un plat, perdita di sapore di un piatto. ED, G<br />
“scipitezza” 325<br />
2 (fig.) perdita di vigore: l’affadissement de sa pensée, de son style, la perdita di vigore del<br />
suo pensiero, del suo stile. ED, SL “banalità, insulsaggine” 326<br />
affaisser v. tr.<br />
provocare un cedimento: la pluie a affaissé la chaussée, la pioggia ha provocato un<br />
cedimento della carreggiata. ES, SL et G confirment<br />
affaler (s’) A v. pron.<br />
(mar.) calarsi lungo un cavo. ED, HP “calarsi”<br />
B affaler v. tr.<br />
(mar.) spingere verso la costa (detto del vento): être affalé à la côte, essere spinto verso la<br />
costa. ES, G confirme<br />
afféager v. tr.<br />
(st. dir.) dare a censo. ES, G confirme<br />
affermage s. m.<br />
1 locazione per usi pubblicitari: affermage d’une page de journal, locazione di una pagina di<br />
giornale. ED, G “concessione”<br />
3 (st. dir.) appalto della riscossione di tasse. ES, G confirme<br />
affermer v. tr.<br />
1 concedere in locazione per usi pubblicitari. ES, G et HP confirment<br />
2 (dir.) concedere in locazione (beni rurali). ES, SL confirme<br />
3 (st. dir.) concedere in appalto la riscossione di tasse. ES, absent ailleurs<br />
affichable agg.<br />
325 HP a ce même ED.<br />
326 HP a ce même ED.<br />
272
da affiggere. EM, absent ailleurs<br />
affirmative s. f.<br />
risposta affermativa: dans l’affirmative, in caso affermativo; répondre par l’affirmative, dare una<br />
risposta affermativa, dire di sì. ES, SL et G confirment<br />
affixé agg.<br />
(ling.) aggiunto come affisso. ES, absent ailleurs<br />
afflouer v. tr.<br />
(mar.) rimettere a galla. ED, SL “(Mar,ant) recuperare” 327<br />
affouager v. tr.<br />
(dir.) usufruire del legnatico. ET, G confirme 328<br />
affouiller v. tr.<br />
rodere gli argini (detto di un corso d’acqua). ED, G, HP et SL “erodere”<br />
affricher v. tr.<br />
(agr.) lasciare a maggese. ES, G confirme<br />
affruiter v. tr.<br />
(agr.) piantare a frutteto. ES, G confirme<br />
affublement s. m.<br />
abbigliamento ridicolo. ES, G, HP et SL confirment<br />
affûtage s. m.<br />
insieme degli utensili di un operaio. ES, G, HP et SL confirment<br />
affûter v. tr.<br />
(equit.) terminare la preparazione di un cavallo (prima di una gara). ES, G et SL confirment<br />
à-fonds s. m. pl.<br />
(svizz.) pulizie di fino (f.). ES, G confirme<br />
agassin s. m.<br />
327 G a ce même ED.<br />
328 Mais avec une traduction très différente: “concedere il diritto di usufrutto del legnatico”.<br />
273
(agr.) sperone della vite. ET, G confirme<br />
agate s. f.<br />
2 oggetto d’agata. ES, SL et G confirment<br />
3 (vetr.) vetro marmorizzato che imita l’agata. ET, absent ailleurs<br />
agatisé agg.<br />
levigato, sfumato come l’agata. ES, G confirme<br />
agencier s. m.<br />
giornalista di agenzia. ES, G confirme<br />
agglomération s. f.<br />
1 agglomerato urbano (m.). ED, SL “agglomerato”<br />
3 (tecnol.) fabbricazione degli agglomerati. ET, G confirme<br />
agglutinant s. m.<br />
sostanza agglutinante. ES, G et SL confirment<br />
agio s. m.<br />
(banca, econ.) tasso di sconto. ET, G et SL confirment 329<br />
agioter v. tr.<br />
fare dell’aggiotaggio. ES, G confirme<br />
âgisme s. m.<br />
discriminazione nei confronti degli anziani. ES, G et SL confirment<br />
agit-prop s. f. inv.<br />
agitazione e propaganda politica. ED, SL et HP “agit-prop”<br />
agneline s. f.<br />
lana agnellina. ES. HP et G confirment<br />
agnosique agg. sost.<br />
colpito da agnosia. ES, absent ailleurs<br />
329 Mais ils traduisent “(spese di) commissione bancaria”.<br />
274
Agnus Dei s. m. inv. (lat.)<br />
(relig.) medaglia di cera benedetta recante l’effigie del mistico Agnello. ES, G confirme<br />
agrainer v. tr.<br />
dare il becchime (a): agrainer les oiseaux, dare il becchime agli uccelli. ES, G confirme<br />
agrégatif s. m.<br />
(scol.) studente che prepara l’→ “agrégation”. ER, G, HP et SL confirment<br />
aidant s. m.<br />
persona di sostegno che si occupa, in ambito familiare, di un parente dipendente: les<br />
aidants familiaux viennent en aide à un proche dépendant, le persone di sostegno familiare<br />
aiutano un parente dipendente. ES, absent ailleurs<br />
aide-éducateur s. m.<br />
insegnante di sostegno (m. e f.). ES, HP confirme<br />
aide-maçon s. m.<br />
manovale muratore. ED, G “manovale (muratore)”<br />
aiguilleter v. tr.<br />
(tess.) lavorare il feltro con aghi a uncino. ED, G “cardare”<br />
ailler v. tr.<br />
(cuc.) insaporire con aglio. ES, G 330 , HP et SL confirment<br />
aine s. f.<br />
spiedo per affumicare le aringhe. ES, HP et G confirment<br />
ais s. m. inv.<br />
(edit.) assicella, tavoletta per la chiusura dei volumi messi in pressa. ED, G “asse, tavola” 331<br />
ajourné s. m.<br />
(mil.) giovane di leva rivedibile. ED, G “rivedibile” 332<br />
330 Ajoute l’acception “steccare con aglio”.<br />
331 Il s’agit évidemment de deux hyperonymes.<br />
332 SL a ce même ED.<br />
275
ajourner v. tr.<br />
3 (dir.) citare a data fissa: ajourner un débiteur à telle date, citare un debitore a una certa<br />
data. ED, SL “(Dir, ant) citare”<br />
4 (mil.) dichiarare rivedibile (un giovane di leva). ES, G et SL confirment<br />
albuginée s. f.<br />
tonaca albuginea. ED, G “(anat.) albuginea”<br />
alcoolier s. m. e agg.<br />
(enol.) produttore di bevande alcoliche. ES, G confirme<br />
alcoolification s. f.<br />
fermentazione alcolica. ES, G et SL confirment<br />
alcooliser v. tr.<br />
(chim.) convertire in alcol. ED, SL “(convertir en alcool) alcolizzare”<br />
aléatoirement avv.<br />
in modo aleatorio. EM, G et SL confirment<br />
alémanique agg. sost.<br />
svizzero tedesco. ES, SL et G confirment<br />
aleppin agg. sost.<br />
di Aleppo333. EM, G confirme<br />
Aleppin s. m.<br />
abitante di Aleppo. EM, G confirme<br />
alevinage s. m.<br />
(piscicoltura) ripopolamento con avannotti. ES, G 334 , SL et HP confirment<br />
alfange s. f.<br />
(armi ant.) scimitarra moresca. ES, G et HP confirment<br />
333 Pour les noms d’habitants, on a sélectionné seulement ceux qui renvoient à une entité géographique en<br />
dehors de la France.<br />
334 G ajoute aussi l’acception “allevamento di avannotti”, ES absent ailleurs.<br />
276
alfatier agg.<br />
(bot.) relativo all’alfa 335 . ES, G confirme<br />
s. m.<br />
(agr.) raccoglitore di alfa. ES, G confirme 336<br />
alitement s. m.<br />
lo stare a letto (per malattia). ED, SL et HP degenza » 337<br />
allègrement o allégrement avv.<br />
con vivacità, con brio. ED, G “allegramente”<br />
alleutier s. m.<br />
(dir. feudale) proprietario di allodio. ES, G, SL et HP confirment<br />
alliance s. f.<br />
parentela acquisita: oncle par alliance, zio acquisito, zio d’acquisto; faire alliance avec q.,<br />
imparentarsi con q. ED, G “(dir.) affinità”<br />
alluchon s. m.<br />
(tecnol.) dente riportato (di ingranaggio). ET, G et SL confirment<br />
alluré agg.<br />
(fam.) che ha stile, classe. ES, G confirme<br />
alluvionner v. intr.<br />
depositare alluvioni. ES, G, HP et SL confirment<br />
almasilicium s. m.<br />
(metall.) lega leggera alluminio-silicio-magnesio. ET, absent ailleurs<br />
alphabétisme s. m.<br />
scrittura alfabetica (f.). ES, G et SL confirment<br />
alphapage® s. m.<br />
335 “Plante d’Afrique du Nord et d’Espagne”, d’après PR11.<br />
336 Et ajoute l’acception (absente ailleurs) “chi commercia in alfa”, ES.<br />
337 G aussi a ce même ED.<br />
277
tabellone, pannello a messaggio variabile. ES, G confirme 338<br />
alsace s. m.<br />
(enol.) vino bianco d’Alsazia. ER, G et SL confirment<br />
altérant agg.<br />
che mette sete. EM, G et SL confirment<br />
amadouvier s. m.<br />
(bot.) poliporo delle betulle. ET, G, HP et SL confirment<br />
amandine s. f.<br />
1 (cuc.) gelatina di mandorle. ES, acception absente ailleurs<br />
2 (cuc.) “amandine” (pasta dolce di mandorle). ES, HP, G, SL confirment<br />
amareyeur s. m. e f.<br />
(zoot.) operaio addetto ai parchi di ostriche. ES, G et SL confirment<br />
amariner v. tr.<br />
(mar.) avvezzare, abituare alla vita in mare, alle manovre di bordo. ES, HP et SL confirment<br />
ambiancer v. intr.<br />
creare ambiente, animazione (nell’Africa francofona). ES, G confirme 339<br />
ambrer v. tr.<br />
1 profumare con ambra grigia. ES, G et SL confirment<br />
2 dare una tinta ambrata. ES, SL confirme<br />
ambulancier s. m.<br />
autista di ambulanza. ES, G, HP et SL confirment<br />
aménagement s. m.<br />
sfruttamento razionale: aménagement d’une forêt, sfruttamento razionale di una foresta.<br />
ES, G et SL confirment<br />
aménager v. tr.<br />
338 Mais il traduit “(tel.) pagina alfa (dispositivo di radiomessaggeria)”.<br />
339 Et ajoute l’acception (absente ailleurs) « darsi alla dolce vita », ES.<br />
278
sfruttare razionalmente: aménager un bois, sfruttare razionalmente un bosco<br />
(predisponendo tagli regolari). ES, G et SL confirment<br />
amendable agg.<br />
(svizz.) passibile di ammenda. ES, G confirme<br />
américaine s. f.<br />
(fam.) sigaretta americana. ES, absent ailleurs<br />
amiralat s. m.<br />
grado di ammiraglio. ES, HP confirme<br />
amiralissime s. m.<br />
(mar.) ammiraglio in capo. ES, absent ailleurs<br />
amman s. m.<br />
titolo conferito a taluni magistrati in alcune regioni del Belgio e della Svizzera. ER, absent<br />
ailleurs<br />
amnistiable agg.<br />
che può essere amnistiato. ED, SL et HP “amnistiabile”<br />
amnistiant agg.<br />
di condono: mesure amnistiante, provvedimento di condono. EM, SL et G confirment<br />
s’amocher v. pron.<br />
(fam.) ridursi male: il s’est bien amoché dans cet accident!, si è ridotto proprio male in<br />
quell’incidente! ED, G “ferirsi”<br />
amodier v. tr.<br />
(st. dir.) dare in affitto (un fondo rustico). ES. G, HP et SL confirment<br />
amollissant agg.<br />
che infiacchisce: climat amollissant, clima che infiacchisce. ED, G “spossante”<br />
amont s. m.<br />
tratto a monte (di un corso d’acqua): pays d’amont, zona a monte; vent d’amont, vento<br />
dell’entroterra; d’amont en aval, da monte a valle; (fig.) produits d’amont, prodotti a monte<br />
(del processo produttivo). ES, G, HP et SL confirment<br />
279
amours s. m. pl.<br />
(svizz.) fondo di bottiglia di vino. ES, absent ailleurs<br />
ampliation s. f.<br />
(dir.) copia conforme. ET, G confirme<br />
amstellodamien agg. sost.<br />
di Amsterdam. ES, G et HP confirment<br />
Amstellodamien s. m.<br />
abitante di Amsterdam. ES, G et HP confirment<br />
amuïr (s’) v. pron.<br />
(ling.) diventare muto: consonne qui s’amuït, consonante che diventa muta. ES, G, HP et<br />
SL confirment<br />
amuïssement s. m.<br />
(ling.) il diventar muto. ES, G, HP et SL confirment<br />
amunitionner v. tr.<br />
(mil.) rifornire di munizioni. ES, absent ailleurs<br />
amuseur s. m.<br />
chi diverte, chi intrattiene. ED, SL “intrattenitore”<br />
ana s. m. inv.<br />
raccolta di aneddoti e frasi celebri. ED, HP “aneddotica”<br />
anabolisé agg.<br />
(zoot.) trattato con anabolizzanti: viande anabolisée, carne trattata con anabolizzanti. ET,<br />
absent ailleurs<br />
anacroisés ® s. m. pl.<br />
cruciverba in cui si ricostruiscono parole presentate nell’ordine alfabetico delle loro lettere.<br />
ES, absent ailleurs<br />
analité s. f.<br />
(psic.) predominanza dell’erotismo anale. ES, absent ailleurs<br />
280
analogon s. m.<br />
elemento di un’analogia. ES, absent ailleurs<br />
analysé s. m. e f.<br />
(psic.) persona che si sottopone ad analisi. ES, G et SL confirment<br />
anavenin s. m.<br />
(med.) vaccino antiofidico. ET, G confirme<br />
ancien s. m.<br />
ex allievo: l’amicale des anciens du lycée, l’associazione degli ex allievi del liceo. ES, G et SL<br />
confirment<br />
anémier v. tr.<br />
(pr. e fig.) rendere anemico. ED, SL “anemizzare”<br />
anglaise s. f.<br />
ricamo inglese. ES, G 340 et SL confirment<br />
anglet s. m.<br />
(tecnol.) intaglio, scanalatura ad angolo retto. ET, HP confirme<br />
angora A agg.<br />
d’angora: laine angora, lana d’angora. ES, G, HP et SL confirment<br />
B s. m. 341<br />
2 gatto d’angora. ES, HP et SL confirment<br />
3 coniglio d’angora. ES. HP et SL confirment<br />
animalcule s. m.<br />
animale microscopico. ES, G, HP et SL confirment<br />
animalculisme s. m.<br />
(st. med.) teoria animalculista. ES, absent ailleurs<br />
340 Ajoute l’acception “pl. boccoli (m.), boccolotti (m.) (nelle acconciature della prima metà dell’Ottocento)”,<br />
fournissant une explication encyclopédique.<br />
341 G a seulement l’hypéronyme “animale d’angora”.<br />
281
animalerie s. f.<br />
allevamento di cavie. ED, G, HP et SL “stabulario” 342<br />
animalier s. m.<br />
addetto alle cavie (in un laboratorio). ES, G, HP et SL 343 confirment<br />
anisé agg.<br />
all’anice: boisson anisée, bevanda al gusto di anice. EM, SL confirme<br />
aniser v. tr.<br />
aromatizzare con anice. ES, G, HP et SL confirment<br />
ankarien o ankariote agg. sost.<br />
di Ankara. ES, absent ailleurs<br />
Ankarien s. m. o Ankariote s. m. e f.<br />
abitante di Ankara. ES, G confirme<br />
année-charnière s. f.<br />
anno di transizione. ES, absent ailleurs<br />
anneliste s. m. e f.<br />
acrobata specializzato negli esercizi con gli anelli. ES, absent ailleurs<br />
annoncier s. m.<br />
1 addetto alle inserzioni (in un giornale). ES, G confirme<br />
2 tipografo che compone le inserzioni. ES, absent ailleurs<br />
anonimographe 344 s. m. e f.<br />
autore di lettere anonime. ES, absent ailleurs<br />
ânonnement s. m.<br />
(il) recitare pappagallescamente. ED, SL “compitazione”<br />
ânonner v. tr.<br />
342 HP et SL ont aussi l’acception “negozio di animali” : autant d’ES.<br />
343 Ajoute l’acception (absente ailleurs) « di animali », EM.<br />
344 La graphie correcte est évidemment anonymographe, cf. PR11.<br />
282
ecitare pappagallescamente: ânonner sa leçon, recitare pappagallescamente la lezione. ED,<br />
G “il biasciare, il farfugliare”, SL “compitazione”<br />
anorak s. m.<br />
giacca a vento. ED, SL “piumino” 345<br />
anordir v. intr.<br />
(mar.) girare a tramontana (detto del vento). ES, G confirme<br />
ansérine s. f.<br />
(bot.) chenopodio murale (m.). ED, G “anserina”<br />
anspessade s. m.<br />
(st. mil. fr.) lancia spezzata (f.) (nobiluomo che prestava servizio nella fanteria, XVI e XVII<br />
sec.). ER, G confirme<br />
antagoniste s. f.<br />
(anat.) dente antagonista (m.). ET, absent ailleurs<br />
antébois o antibois s. m. inv.<br />
listello salvamuro. ED, SL “salvamuro”<br />
antenne 346 s. f.<br />
2 fonte di informazione: les antennes d’une agence de presse, le fonti di informazione di<br />
un’agenzia di stampa. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (med. mil.) pronto soccorso (m.), pronto intervento (m.). ES, acception absente ailleurs<br />
antibiothérapie s. f.<br />
(farm., med.) terapia antibiotica. ED, SL “(Med) antibioticoterapia” 347<br />
antibrouillage s. m.<br />
(telecom.) dispositivo antidisturbo. ET, SL confirme<br />
antichômage agg. inv.<br />
contro la disoccupazione. ES, absent ailleurs<br />
345 G et HP aussi ont cet ED.<br />
346 Pour cette entrée, G ajoute l’acception “sede distaccata”, un autre ES.<br />
347 HP a ce même ED.<br />
283
anticiper v. intr.<br />
1 fare anticipazioni: anticiper sur les résultats des élections, fare anticipazioni sui risultati<br />
delle elezioni. ES, HP confirme<br />
2 fare previsioni: anticiper sur l’avenir, fare previsioni sull’avvenire. ES, G 348 et HP 349<br />
confirment<br />
antifrictionner v. tr.<br />
(tecnol.) rivestire di metallo antifrizione. ET, absent ailleurs<br />
antigang s. m.<br />
poliziotto dell’anticrimine. ES, SL confirme<br />
antiguais et barbudien A agg. sost.<br />
di Antigua e Barbuda. ES, absent ailleurs<br />
Antiguais et Barbudien s. m.<br />
abitante di Antigua e Barbuda. ES, G confirme 350<br />
antihausse agg. inv.<br />
contro il rialzo (dei prezzi): mesures antihausse, provvedimenti contro il rialzo dei prezzi.<br />
ED, G “antinflazionistico”, HP et SL “calmieratore”<br />
anti-moustique(s) s. m. agg.<br />
contro le zanzare. ED, HP “antizanzare”, SL “antizanzare, zanzaricida, zanzarifugo”<br />
antinatalisme s. m.<br />
(sociol.) atteggiamento contrario all’incremento delle nascite. ED, G “antidemografismo” 351<br />
antinataliste agg.<br />
contrario all’incremento delle nascite. ED, G “antidemografico”, SL “antinatalista”<br />
antinaupathique agg. sost.<br />
(farm., med.) contro il mal di mare: comprimés antinaupathiques, pastiglie contro il mal di<br />
mare. ES, absent ailleurs<br />
348 Ajoute l’acception (absente ailleurs) “prendere, disporre in anticipo”, ES.<br />
349 Ajoute l’acception (absente ailleurs) “GIOC. SPORT. (au tennis, aux échecs) giocare d’anticipo”, ES.<br />
350 S.v. Antiguais.<br />
351 Absent partout ailleurs, une seule occurrence dans Google [consultation le 10 septembre 2010].<br />
284
antipodal agg.<br />
posto agli antipodi. ES, absent ailleurs<br />
antique s. m.<br />
arte antica (riferita all’antichità greca e romana). ES, G 352 , HP et SL confirment<br />
antiréglementaire agg.<br />
contrario al regolamento. ED, SL “antiregolamentare”<br />
antisèche s. f.<br />
(gergo scol.) fogliettino con i dati basilari della materia d’esame con il quale lo studente cerca<br />
di aiutarsi di nascosto durante una prova scritta. ED, SL “(Scol, gerg) bigliettino (per copiare<br />
durante un esame )” 353<br />
antitout agg. e s. m. e f. inv.<br />
(fam.) bastian contrario (m.). ES, G, HP et SL confirment<br />
anuiter (s’) v. pron.<br />
(poco usato) far tardi (la sera). ES, absent ailleurs<br />
anversois agg. sost.<br />
di Anversa. ED, SL “anversese”<br />
Anversois s. m.<br />
abitante di Anversa. ED, SL “anversese”<br />
aoûtat s. m.<br />
(med., zool.) larva di trombidio. ET, G, HP et SL confirment<br />
aoûtien 354 s. m.<br />
chi prende le ferie in agosto. ES, absent ailleurs<br />
aparté s. m.<br />
colloquio privato (durante una riunione). ES, G, HP et SL confirment<br />
352 Traduit « opera d’arte dell’antichità ».<br />
353 G et HP aussi ont cet ED.<br />
354 SL ajoute l’acception antonymique « persona che resta in città in agosto », ES.<br />
285
apériteur s. m. e agg.<br />
(dir.) coassicuratore firmatario principale. ET, G confirme<br />
aplat o à-plat s. m.<br />
(graf., pitt.) colore uniforme. ED, “(pitt.) aplat (striscia di colore uniforme e piatta)” 355<br />
aplatissoir s. m.<br />
(tecnol.) martello per spianare. ET, G confirme<br />
appareillable agg.<br />
(chir., med.) che può portare una protesi: un sourd appareillable, un sordo che può portare<br />
un apparecchio (acustico). ES, absent ailleurs<br />
appareillage s. m.<br />
(mar.) preparativi per la partenza. ED, HP “(préparations pour le départ) manovra”; SL<br />
“preparativi”<br />
appareiller v. tr.<br />
1 (mar.) approntare per la partenza: appareiller un navire, approntare una nave in vista della<br />
partenza. ED, SL “preparare, attrezzare”<br />
2 (med.) munire di protesi: appareiller un bras, munire un braccio di protesi. ES, G et SL<br />
confirment<br />
appareilleur s. m. e f.<br />
(edil.) mastro muratore preposto all’apparecchiatura. ET, G confirme<br />
apparentage s. m.<br />
(l’)essere imparentato. ES, absent ailleurs<br />
apparenter (s’) v. pron<br />
2 essere affine: en musique, ses goûts s’apparentent aux miens, in fatto di musica, i suoi<br />
gusti sono affini ai miei. ED, G “assomigliare”<br />
3 essere molto simile, avere molti punti in comune: un plat qui s’apparente à la ratatouille<br />
niçoise, un piatto molto simile alla ratatouille nizzarda. ED, G “assomigliare”<br />
appeau s. m. 356<br />
355 SL a ce même ED.<br />
286
ichiamo per uccelli: (fig.) se laisser prendre à l’appeau, cadere nella trappola. ED, SL<br />
“richiamo, pispola, chioccolo”<br />
appelant s. m.<br />
(caccia) uccello di richiamo. ED, SL “(Caccia) (appeau) richiamo”<br />
appelé s. m. (spec. al pl.)<br />
soldato di leva. ES, G, HP et SL confirment<br />
appentis s. m. inv.<br />
piccola costruzione (addossata a una più grande). ED, SL “riparo, rimessa” 357<br />
apponter v. intr.<br />
(mar.) accostare a un pontile. ET, acception absente ailleurs<br />
apponteur s. m.<br />
(aer.) ufficiale addetto alle manovre di appontaggio. ES, SL confirme<br />
apporteur s. m. aggett.<br />
(dir., econ.) chi fa un apporto, un conferimento (a una società). ED, G “apportatore (anche<br />
econ.)”<br />
apposé agg.<br />
(ling.) in apposizione. ED, SL “appositivo”<br />
apprenti-maçon s. m.<br />
garzone di muratore. ES, absent ailleurs<br />
approbativement avv.<br />
in modo approvativo. ED, SL “favorevolmente”<br />
approbativité s. f.<br />
(psic.) tendenza patologica ad approvare sempre incondizionatamente. ES, absent ailleurs<br />
après-concile s. m.<br />
356 G a aussi une acception traduite « uccello di richiamo », ED car SL traduit « (Ornit) pispola, zimbello ».<br />
357 G et HP ont ce même ED. HP a aussi une acception traduite « tettoia appoggiata a un muro », ED car SL<br />
traduit « tettoia ».<br />
287
periodo postconciliare. ES, absent ailleurs<br />
à-propos s. m. inv.<br />
(lett.) breve componimento poetico o teatrale di circostanza. ES, G confirme<br />
aquavit s. m.<br />
(svedese) acquavite scandinava (f.). ES, G et SL confirment<br />
arabisant agg.<br />
(polit.) di arabizzazione: politique arabisante, politica di arabizzazione. ES, G confirme<br />
araignée s. f.<br />
(macelleria) carne di manzo piena di nervature e molto tenera usata per bistecche alla griglia.<br />
ES, G confirme<br />
aranéen agg.<br />
che somiglia a un ragno. ES, absent ailleurs<br />
aranéiforme agg.<br />
a forma di ragno. ES, absent ailleurs<br />
arasement s. m.<br />
ultimo corso (di un muro). ES, G confirme<br />
aratoire agg.<br />
dell’aratura, relativo all’aratura. EM, acception absente ailleurs<br />
arbalète s. f.<br />
(pesca) fucile a elastico (per la pesca subacquea). ES, absent ailleurs<br />
arbitrable agg.<br />
che può essere arbitrato. ED, SL “arbitrabile”<br />
arbitralement avv.<br />
per mezzo di arbitro. ES, G, HP confirment<br />
arborescent agg.<br />
ad albero. ES, HP et SL confirment<br />
288
arc-boutant o arcboutant s. m.<br />
(arch.) arco di spinta, arco rampante. ET, G, HP et SL confirment<br />
arc-bouter v. tr.<br />
(arch., edil., ing. civ.) scaricare le spinte: arc-bouter une voûte, scaricare le spinte di una volta.<br />
ES, G, HP et SL confirment<br />
s’arc-bouter v. pron.<br />
far leva. ES, acception absente ailleurs<br />
archelle s. f.<br />
(belg.) ripiano con ganci (m.) (per appendere recipienti con manico). ES, G confirme<br />
archibête agg.<br />
(fam.) quanto mai stupido. EM, absent ailleurs<br />
archicomble agg.<br />
(fam.) pieno zeppo: le stade était archicomble, lo stadio era pieno zeppo. EM, absent ailleurs<br />
archicube s. m.<br />
(gergo scol.) ex allievo dell’École Normale Supérieure. ER, G confirme<br />
archidiaconé s. m.<br />
territorio dipendente da un arcidiacono. ES, G confirme 358<br />
archifaux agg.<br />
(fam.) completamente falso. EM, absent ailleurs<br />
archifou agg. m.<br />
(fam.) matto da legare. ES, absent ailleurs<br />
archiviste-paléographe s. m. e f.<br />
diplomato dell’École des Chartes di Parigi. ER, G confirme<br />
arciforme agg.<br />
a forma d’arco. ES, absent ailleurs<br />
358 SL traduit « arcidiacono » (GI : « le premier diacre »), mais nous croyons qu’il s’agit d’une erreur.<br />
289
arc-rampant s. m.<br />
(tecnol.) arco di sostegno di una rampa. ET, absent ailleurs<br />
ardoisier s. m. aggett.<br />
cavatore d’ardesia. ES, G, HP et SL confirment 359<br />
ardoisière s. f.<br />
cava d’ardesia. ES, G et SL confirment<br />
aréage s. m.<br />
misurazione in are. ES, G confirme<br />
aréna s. m.<br />
(quebec.) pista da pattinaggio (f.) (circondata da gradinate). ES, G confirme<br />
arêtière s. f.<br />
(edil.) tegolone per displuvio. ET, absent ailleurs<br />
argentier s. m.<br />
mobile per l’argenteria. ES, G, HP et SL confirment<br />
argoulet s. m.<br />
(st. mil.) soldato di cavalleria dell’esercito francese (XVI sec.). ER, absent ailleurs<br />
argousier s. m.<br />
(bot.) olivello spinoso. ET, G confirme<br />
argumentaire agg.<br />
(comm.) relativo alle argomentazioni di vendita. ES, SL confirme 360<br />
arillé agg.<br />
fornito di arillo. EM, G confirme<br />
armilles s. f. pl.<br />
359 Les trois ajoutent l’acception “padrone di una cava d’ardesia”, autant d’ES. SL a aussi l’acception “(dans le<br />
cyclisme) addetto al servizio lavagna”, un autre ES.<br />
360 G traduit « argomentario », mais en italien ce terme n’est pas un adjectif, donc nous ne l’avons pas compté<br />
comme ED.<br />
290
(arch.) anelletti (m. pl.) di capitello dorico. ED, G et SL “armilla”<br />
armorier v. tr.<br />
ornare di stemmi. ES, HP et SL confirment<br />
armourin s. m.<br />
(svizz.) giovane soldato. ES, absent ailleurs<br />
armurerie s. f.<br />
2 arte dell’armaiolo. ED, SL “(activité) armeria” 361<br />
3 fabbricazione e commercio delle armi. ES, G confirme<br />
arolle s. m. o f.<br />
(svizz.; bot.) pino montano (m.). ED, SL “cembro”<br />
arracheur s. m.<br />
chi strappa, chi estirpa: arracheur de dents, cavadenti; mentir comme un arracheur de dents,<br />
mentire spudoratamente. ED, SL “strappatore, cavatore, raccoglitore”<br />
arrenter v. tr.<br />
(dir.) vincolare la cessione (di beni immobiliari) a un contratto vitalizio. ET, absent ailleurs<br />
arrérager v. intr.<br />
(dir.) essere in debito (di). ET, G confirme<br />
s’arrérager v. pron.<br />
(dir.) rimanere insoluto, in arretrato: les intérêts s’arréragent, gli interessi rimangono<br />
insoluti. ET, G confirme<br />
arrêter v. tr.<br />
(caccia) cadere in ferma. ET, G confirme<br />
arrière-corps s. m. inv.<br />
(edil.) parte di fabbricato arretrata rispetto al fronte. ES, G confirme<br />
arrière-cour s. f.<br />
361 G aussi a ce même ED.<br />
291
cortiletto di sgombero (m.). ED, G “cortiletto”<br />
arrière-cousin s. m.<br />
lontano cugino. ES, G confirme<br />
arrière-fleur s. f.<br />
seconda fioritura. ES, G confirme<br />
arrière-grand-oncle s. m.<br />
fratello del bisnonno o della bisnonna. ES, G, HP et SL confirment<br />
arrière-grand-tante s. f.<br />
sorella del bisnonno o della bisnonna. ES, G, HP et SL confirment<br />
arrière-main s. m.<br />
(equit.) treno posteriore (del cavallo). ET, G 362 confirme<br />
arrière-pensée s. f.<br />
1 secondo fine (m.), scopo recondito.<br />
2 pensiero riposto. ES G, HP et SL confirment (avec une seule acception, cependant)<br />
arrière-petite-nièce s. f.<br />
figlia di pronipote. ED, HP et SL “pronipote, bisnipote (degli zii)”<br />
arrière-petit-neveu s. m.<br />
figlio di pronipote. ED, HP et SL “pronipote (degli zii)”<br />
arrière-saison s. f.<br />
1 autunno inoltrato (m.): (fig.) l’arrière-saison de la vie, l’autunno, il tramonto della vita. ES,<br />
G, HP et SL confirment<br />
2 fine stagione: légumes d’arrière-saison, verdure di fine stagione. ES, absent ailleurs<br />
s’arriérer v. pron.<br />
rimanere indietro coi pagamenti. ED, HP “ritardare”, SL “differire”<br />
arrière-voussure s. f.<br />
362 Ajoute l’acception “(ant.) dorso della mano”, ES absent ailleurs.<br />
292
(arch., edil.) volta costruita dietro l’intradosso di un’apertura. ES, G confirme<br />
arrondi s. m.<br />
1 parte arrotondata, rotonda, tonda. ED, HP “rotondità”, SL “curva”<br />
2 (aer.) arco di raccordo. ED, SL“(Aer) richiamata”<br />
ars s. m. inv.<br />
(zool.) giuntura della spalla con l’arto anteriore (nel cavallo). ET, absent ailleurs<br />
arsouiller v. intr.<br />
(fam.) fare il mascalzone. ES, G confirme 363<br />
artéritique agg.<br />
affetto da arterite. ES, absent ailleurs<br />
artichautière s. f.<br />
pentola per cuocere i carciofi. ES, SL confirme<br />
artificialité s. f.<br />
carattere artificiale. ED, HP “artificialità”; SL “artificiosità”<br />
ascendance s. f.<br />
(astr.) moto ascendente (m.). ET, G, HP et SL confirment<br />
ascensionner v. intr.<br />
(alp.) fare un’ascensione, una scalata. ED, SL “scalare” 364<br />
aséismicité s. f.<br />
assenza di fenomeni sismici. ES, G confirme<br />
asilaire agg.<br />
relativo all’ospizio per anziani o al manicomio. ED, SL “asilare”<br />
aspersoir s. m.<br />
(agr.) doccia di annaffiatoio. ES, G et SL confirment<br />
363 Traduisant “andare in moto in modo spericolato (spec. in gruppo)”.<br />
364 G aussi a ce même ED.<br />
293
aspiratoire agg.<br />
di aspirazione. EM, G et SL confirment<br />
assarmenter v. tr.<br />
potare i sarmenti (di una vite). ES, G confirme<br />
asseau s. m.<br />
(tecnol.) martello del copritetto. ET, G confirme<br />
assembleur s. m.<br />
(inform.) programma assemblatore. ED, HP “INFORM. assembler”<br />
assermentation s. f.<br />
(quebec., svizz.) il prestare giuramento. ED, G “(Canada) giuramento”<br />
assermenter v. tr.<br />
(dir.) far prestare giuramento (a). ES, G, SL et HP confirment<br />
assoler v. tr.<br />
(agr.) coltivare a rotazione. ES, G, HP et SL confirment<br />
assoupissant agg.<br />
che assopisce. ED G “soporoso”, SL “narcotico, soporifero”<br />
assurance-décès s. f.<br />
(econ., sociol.) assicurazione in caso di morte. ES, SL confirme<br />
assurer v. intr.<br />
(fam.) essere all’altezza, essere valido: cette fille-là, elle assure un maximum!, quella ragazza è<br />
senz’altro all’altezza! ES, G, HP et SL confirment<br />
asticotier s. m.<br />
1 (fam., spreg.) pescatore da strapazzo. ES, absent ailleurs<br />
2 (pesca) pescatore di trote (che usa come esca la larva della mosca carnaria). ES, absent<br />
ailleurs<br />
astringence s. f.<br />
294
(farm., med.) potere astringente. ET, G, HP et SL confirment<br />
astronauticien s. m.<br />
specialista di astronautica. ES, G confirme<br />
athénée s. m.<br />
1 in Svizzera e in Belgio, edificio per conferenze e dibattiti letterari. ED, G “(Belgio,<br />
Svizzera) accademia”<br />
2 in Belgio, istituto secondario di istruzione pubblica, equiparabile al ginnasio-liceo classico.<br />
ED, SL “(Belg) liceo” 365<br />
atlantiste s. m. e f.<br />
fautore dell’atlantismo. ED, SL “(pol.) atlantista”<br />
atoca o ataca s. m.<br />
(quebec.; bot.) mirtillo rosso. ET, G, HP et SL confirment<br />
atomisé s. m.<br />
superstite da bombardamento atomico. ES, G et SL confirment<br />
atriau s. m.<br />
(svizz.; cuc.) salsiccia piatta avvolta in reticella di maiale. ER, SL confirme<br />
atrophique s. m. e f.<br />
affetto da atrofia. ED, G “atrofico”<br />
attabler v. tr.<br />
mettere a tavola. ES, G, HP et SL confirment<br />
attabler (s’) v. pron.<br />
mettersi a tavola. ES, G, HP et SL confirment<br />
attaché-case s. m.<br />
valigetta portadocumenti (f.). ED, G “ventiquattr’ore”<br />
attentatoire agg.<br />
365 G aussi a ce mêm e ED.<br />
295
che attenta: mesure attentatoire à la liberté, misura che attenta alla libertà. EM, HP et SL<br />
confirment<br />
attifement s. m.<br />
1 abbigliamento ridicolo, stravagante. ES, G et SL confirment<br />
2 (il) vestire in modo ridicolo, stravagante. ES, acception absente ailleurs<br />
attirable agg.<br />
che può essere attratto. EM, G et SL confirment<br />
attrapable agg.<br />
(fam.) che si può buscare, che si può beccare (detto di malattie). EM, absent ailleurs<br />
auberge s. f.<br />
trattoria di lusso. ES, G confirme<br />
aucunement avv.<br />
in nessun modo. ED, G “affatto”, SL “assolutamente”<br />
audimat ® s. m.<br />
indice di ascolto. ED, SL “audience”<br />
audimétrie s. f.<br />
(tv) misurazione dell’audience. ES, absent ailleurs<br />
audionumérique agg.<br />
(elettron.) a codifica numerica: disque audionumérique, compact disc. ED, SL<br />
“audiodigitale”<br />
audio-oral agg.<br />
(scol.) che implica ascolto e ripetizione (nello studio delle lingue). ES, G, HP et SL<br />
confirment<br />
audiovisuel B s. m.<br />
(telecom., tv) sussidi audiovisivi (m. pl.). ED, SL “audiovisivo”<br />
auditer v. tr.<br />
(org. az.) sottoporre a auditing. ES, G, HP et SL confirment<br />
296
auditionner A v. intr.<br />
dare un’audizione. ES, G, HP et SL 366 confirment<br />
B v. tr.<br />
concedere un’audizione (a un artista). ES, G, HP et SL confirment<br />
auge s. f.<br />
2 (agr.) vasca di frantoio a macine. ET, absent ailleurs<br />
3 (geogr.) doccia valliva, doccia a trogolo. ET, G et HP confirment<br />
6 (zoot.) canale intermascellare (m.). ET, G et SL confirment<br />
aumônerie s. f.<br />
gruppo di catechismo per ragazzi delle scuole superiori. ES, acception absente ailleurs 367<br />
auner v. tr.<br />
misurare in aune. ES, G confirme<br />
auréolaire agg.<br />
a forma di aureola. ES, G confirme<br />
auriculé agg.<br />
(anat.) fornito di auricole, di orecchiette. ET, G confirme<br />
aurifier v. tr.<br />
(chir.) otturare con oro: aurifier une dent, otturare un dente con oro. ES, G, HP et SL<br />
confiment<br />
aurification s. f.<br />
otturazione con oro (di un dente). ES, G confirme<br />
auscultatoire agg.<br />
relativo all’auscultazione. EM, G confirme<br />
autoberge s. f.<br />
argine carrozzabile, argine adibito a carreggiata. ES, G et SL confirment<br />
366 Ajoute l’acception (absente ailleurs) « fare un provino », ES.<br />
367 G a une autre acception (absente ailleurs): “(in una comunità) residenza del cappellano”, ES.<br />
297
autocariste s. m. e f.<br />
1 proprietario di una società di autopullman. ES, G confirme<br />
2 guidatore di autopullman. ES, G confirme<br />
autocassable agg.<br />
(farm.) che si rompe senza limetta (detto di fiala). ES, SL confirme 368<br />
auto-dégivrage s. m.<br />
(autom.) sbrinamento automatico. ET, HP confirme<br />
autodictée s. f.<br />
(scol.) trascrizione di un breve brano imparato a memoria. ER, G et HP confirment<br />
autoédition s. f.<br />
edizione a spese dell’autore. ES, absent ailleurs 369<br />
autoféconder (s’) v. pron.<br />
riprodursi per autofecondazione. ES, absent ailleurs<br />
auto-imposition s. f.<br />
(dir.) imposta pagata dalle aziende statali. ET, G confirme<br />
autolyser (s’) v. pron.<br />
distruggersi per autolisi. ET, absent ailleurs<br />
automaticien s. m.<br />
specialista di automatica e automatizzazione. ES, G et SL confirment<br />
automatisme s. m.<br />
(letter.) scrittura automatica. ES, acception absente ailleurs<br />
automatiste s. m. e f.<br />
specialista dell’automazione. EM, absent ailleurs<br />
automobilisable agg.<br />
368 Traduisant, plus idiomatiquement, “con prerottura di sicurezza”.<br />
369 Cependant, nous faisons remarquer que l’article autoedizione existe dans la version italienne de Wikipédia,<br />
avec ce même sens.<br />
298
adatto alla circolazione automobilistica, carrozzabile. ES, absent ailleurs<br />
automutiler (s’) v. pron.<br />
mutilarsi da sé. ES, absent ailleurs<br />
autonomisation s. f.<br />
acquisizione dell’autonomia. ES, G confirme<br />
automoteur s. m.<br />
(mar.) chiatta a motore (f.). ET, G confirme<br />
autopsier v. tr.<br />
fare l’autopsia (di). ES, G, HP et SL confirment<br />
autorelaxation s. f.<br />
(psic.) training autogeno (m.). ET, absent ailleurs<br />
autruchon s. m.<br />
(poco usato) piccolo dello struzzo. ES, G confirme<br />
avalant agg. sost.<br />
che discende un corso d’acqua (detto di chiatte). ES, G, HP et SL confirment<br />
avancer A v. intr.<br />
essere avanti: ma montre avance de cinq minutes, il mio orologio è cinque minuti avanti.<br />
ES, G, HP et SL confirment<br />
B s’avancer v. intr. e pron.<br />
spingersi avanti: ne t’avance pas trop, tu pourrais tomber!, non spingerti troppo avanti,<br />
potresti cadere!; ils (s’) avancèrent jusqu’aux confins de l’Asie, si spinsero fino ai confini<br />
dell’Asia. ED, G “progredire; sbilanciarsi”, HP “avanzare”<br />
C v. tr.<br />
1 portare avanti: avance ta chaise, porta avanti la tua sedia. ES, G, HP et SL confirment<br />
2 portare, portarsi avanti: il a bien avancé son travail, si è portato avanti bene col lavoro; à<br />
quoi ça t’avance de te mettre en colère?, cosa ci guadagni ad arrabbiarti? ES, G, HP et SL<br />
confirment<br />
299
3 mettere avanti: avancer sa montre, mettere avanti l’orologio. ES, G, HP et SL 370<br />
confirment<br />
avant s. m.<br />
1 parte anteriore (f.): l’avant d’une voiture, la parte anteriore di una macchina; aller de<br />
l’avant, avanzare, (fig.) procedere speditamente, agire con risolutezza. ED, SL “davanti” 371<br />
2 prima linea (f.): les soldats qui sont à l’avant, i soldati che sono in prima linea. ED, SL<br />
“fronte” 372<br />
avant-cour s. f.<br />
primo cortile (in un palazzo). ED, SL “cortiletto” 373<br />
avant-main s. f.<br />
(equit.) treno anteriore (m.) (del cavallo). ET, G, HP et SL confirment<br />
avant-pays s. m. inv.<br />
zona pedemontana (f.). ES, G et HP confirment<br />
avant-printemps s. m. inv.<br />
(lett.) avvisaglie di primavera. ES, absent ailleurs<br />
avant-projet s. m.<br />
progetto di massima: avant-projet de loi, bozza di disegno di legge. ES, G, HP et SL<br />
confirment<br />
avant-soirée s. f.<br />
(tv) programma preserale. ES, G confirme<br />
avenant s. m.<br />
(dir.) clausola addizionale (f.). ED, SL “codicillo” 374<br />
avion-cargo s. m.<br />
aereo da trasporto merci. ED, G “cargo”<br />
370 Ce dictionnaire a aussi l’acception “10 (Agr) (porter à maturation) fare maturare: avancer un fruit fare<br />
maturare un frutto”, ES.<br />
371 G et HP aussi ont ce même ED.<br />
372 G aussi a ce même ED.<br />
373 G aussi a ce même ED.<br />
374 G aussi a ce même ED.<br />
300
avionnerie s. f.<br />
(quebec.) fabbrica di aerei. ES, G et SL confirment<br />
avionnette s. f.<br />
(aer.) velivolo da turismo. ED, G “aerobus”<br />
avionneur s. m.<br />
costruttore di aerei. ES, G, HP et SL confirment<br />
avion-robot s. m.<br />
aereo telecomandato. ES, HP confirme<br />
avironnier s. m.<br />
fabbricante di remi. ES, HP confirme<br />
aviser v. intr.<br />
riflettere per prendere una decisione: à présent, il faut aviser, ora bisogna riflettere per<br />
prendere una decisione. ED, SL “ponderare, vedere”<br />
avocasserie s. f.<br />
(fam., spreg.) cavillo da leguleio. ES, G, HP et SL confirment<br />
avocassier agg.<br />
(spreg.) di leguleio. ED, SL “avvocatesco” 375<br />
avorteur s. m.<br />
chi procura un aborto illecito. ES, G, HP et SL 376 confirment<br />
avoué s. m.<br />
(dir.) procuratore legale. ET, G, HP et SL confirment<br />
avouer v. tr.<br />
3 (poco usato, lett.) riconoscere come proprio. ES, G confirme<br />
4 (forb.) riconoscere come valido. ES, absent ailleurs<br />
avrillet s. m.<br />
375 G a ce même ED .<br />
376 Le féminin avorteuse est traité à part par SL, et traduit comme « mammana ».<br />
301
(agr.) grano seminato in aprile. ES, G et HP confirment<br />
AVS s. m. e f. inv. e sigla<br />
(Auxiliaire de vie scolaire) Persona con una formazione specifica che aiuta l’integrazione<br />
scolastica dei bambini con disabilità. ER, absent ailleurs<br />
avunculaire agg.<br />
(poco usato) di zio, di zia. ES, G, HP et SL confirment 377<br />
axer v. tr.<br />
orientare, disporre secondo un asse. ES, G confirme<br />
azur s. m.<br />
smalto azzurro. ES, G confirme<br />
377 Nous faisons remarquer que l’adjectif italien avunculare est absent dans DeM et GI mais il compte environ<br />
300 occurrences dans Google.<br />
302
DICTIONNAIRE SANSONI LAROUSSE<br />
abattée s.f.<br />
(Aer) caduta in picchiata. ED, G “stallo” 378<br />
abrutissant agg.<br />
(qui rend bête) che rimbecillisce, che rincretinisce: émission de télé abrutissante, un’emissione<br />
televisiva che rimbecillisce. ED, G “degradante, avvilente” 379<br />
accalmie s.f.<br />
(arrêt d’une perturbation atmosphérique) miglioramento temporaneo, miglioramento del tempo:<br />
il ne pleut plus: profitons de l’accalmie pour nous promener non piove più: approfittiamo<br />
del miglioramento del tempo per fare una passeggiata. ED: B “ (mar.) accalmia, bonaccia”<br />
accaparant agg.<br />
(d’une activité) che assorbe completamente: un travail accaparant un lavoro che assorbe<br />
completamente. ED, HP “monopolizzante”<br />
accoler v.tr.<br />
(Tip) (joindre par une accolade) unire con una (parentesi) graffa. ED, HP “TIP. graffare [lignes,<br />
paragraphes]” 380<br />
accrochage s.m.<br />
(Sport) (en boxe) corpo a corpo. ES, absent ailleurs<br />
achalander v.tr.<br />
fornire di merci, rifornire di merci. ED, B “(merci) rifornire”<br />
acharné s.m.<br />
378 Cependant, si nous croisons les définitions de deux monolingues, italien et français, nous pouvons voir que<br />
cet équivalence proposée par G : abattée = stallo n’en est pas une. GI: stallo “(aer.) diminuzione della portanza<br />
di un’ala di un aereo dovuta al distacco della corrente fluida dal dorso di essa, all’aumentare dell’incidenza”.<br />
PR11: “chute en piqué à la suite d’une perte de vitesse”. Le phénomène-2 est la chute (l’abattée), causé par le<br />
phénomène-1 (le stallo, “perte de vitesse/diminuzione della portanza”). Ces notions ne sont pas équivalentes,<br />
mais bien liées par un rapport causal.<br />
379 G a ce même ED.<br />
380 G a ce même ED.<br />
303
persona f. accanita: un acharné du travail una persona accanita nel lavoro. EM, catégorie<br />
grammaticale absente ailleurs<br />
acquittable agg.m./f.<br />
(Dir) che può essere assolto. ED, B et G “asssolvibile”<br />
acra s.m.<br />
(Gastron) frittella f. croccante: acra de morue frittella di merluzzo croccante. ER, HP<br />
confirme<br />
acrogym s.f.<br />
ginnastica acrobatica. ES, G confirme<br />
adjoindre v.prnl. s’adjoindre<br />
prendere come aiuto, prendere come socio: ils se sont adjoint des collaborateurs hanno<br />
preso dei collaboratori. ED, B “prendere (come socio)” 381<br />
administrativement avv.<br />
(par la voie administrative) in via amministrativa. ES, acception absente ailleurs<br />
affaiblisseur s.m.<br />
(Fot) bagno di indebolimento. ED, B “(foto) indebolitore”<br />
affalement s.m.<br />
lo stravaccarsi, lo sprofondarsi. ED, G “accasciamento”<br />
affixal agg.<br />
(Ling) con funzione di affisso. ED, B “(ling.) affissale” 382<br />
affolement s.m.<br />
(Fis) (d’une boussole) variazioni f.pl. della bussola impazzita. ED, B “(aer., mar.) impazzimento<br />
(della bussola)”, G “(della bussola) impazzamento”<br />
affoler v.tr.<br />
(lett) (à cause d’une passion, d’un sentiment) fare impazzire. ED, B “conturbare”<br />
affreux s.m. (colloq)<br />
381 G a ce même ED.<br />
382 G a ce même ED.<br />
304
(Mil) (mercenaire) mercenario bianco al servizio di un esercito africano. ES, G confirme 383<br />
aggloméré s.m.<br />
(combustible) mattonella f. di carbone. ED, G “mattonella (di carbone)”<br />
agora s.f.<br />
(espace piétonnier) zona pedonale. ES, absent ailleurs<br />
agrarien I agg. (Pol)<br />
(partisan des lois agraires) sostenitore di leggi agrarie. ES, absent ailleurs<br />
II s.m.<br />
(Pol) membro di un partito agrario. ES, HP confirme<br />
agréation s.f.<br />
(Belg) (agrément) accettazione di un atto amministrativo. ES, G confirme 384<br />
agresseur s.m.<br />
(Dir) (État) stato aggressore. ET, G confirme<br />
agroalimentaire s.m.<br />
(Ind) settore agroalimentare. ED, HP “(settore) agroalimentare” 385<br />
ahaner v.intr. (ant,lett)<br />
(respirer bruyamment) respirare rumorosamente: le cheval ahanait sous l’effort il cavallo<br />
respirava rumorosamente per lo sforzo. ES, acception absente ailleurs<br />
aide 1 s.f.<br />
al pl. (Stor) (sous l’Ancien Régime) imposte indirette. ED, G “pl. (st.) imposte”<br />
aiguail s.m.<br />
(Caccia) caccia f. mattutina: chien d’aiguail cane da caccia mattutina. ES, absent ailleurs<br />
aillé agg.<br />
383 Et ajoute l’acception (absente ailleurs) : « (argot) tipo insopportabile », ES.<br />
384 Et ajoute une deuxième acception (absente ailleurs) : “(comm.) affiliazione commerciale”, ET.<br />
385 G a ce même ED.<br />
305
(Gastron) strofinato con l’aglio: croûton aillé crostino strofinato con l’aglio. ES, absent<br />
ailleurs<br />
airelle s.f.<br />
(Bot,Alim) mirtillo m. rosso. ED, B “mirtillo” 386<br />
aisseau s.m.<br />
(Edil) assicella f. di copertura, tavola f. di copertura. ED, B “assicella”<br />
ajustage s.m.<br />
(des pièces de monnaie) aggiustamento di pesi e misure. ED, B “(tecn.) aggiustaggio”<br />
alaise s.f.<br />
(planche en ajoute) tavola supplementare. ED, B “asse, tavola (per aggiunte)” 387<br />
albuminé agg.<br />
(Bot) provvisto di albume. ED, B “(bot.) albuminoso” 388<br />
alcoolisable agg.m./f.<br />
(Chim) che si può alcolizzare. ED, B “alcolizzabile”<br />
aleviner v.tr.<br />
(Pesc) (réf. à étang, rivière) ripopolare con avannotti. ES, G confirme<br />
alfa s.m.<br />
(papier) carta f. d’alfa. ED, B “(cart.) alfa”<br />
algérien s.m.<br />
(langue) arabo d’Algeria. ES, absent ailleurs<br />
aloi s.m.<br />
(ant) (titre légal) titolo di una lega. ED, G “titolo (di una lega)”<br />
aménagiste s.m.<br />
specialista m./f. dello sfruttamento forestale. ES, G confirme<br />
386 G a ce même ED.<br />
387 G a ce même ED.<br />
388 G a ce même ED.<br />
306
amer 1 s.m.<br />
(Mar) punto cospicuo. ED, B “(mar.) dromo”<br />
amidonnerie s.f.<br />
industria per la lavorazione dell’amido. ED, B et G “amidificio”<br />
amirale s.f.<br />
(ant) moglie di un ammiraglio. ES, G et HP confirment<br />
amnésique s.m./f.<br />
(Med) persona f. affetta da amnesia. ES, G confirme 389<br />
amorce .f.<br />
(Inform) lancio m. iniziale. ES, G confirme 390<br />
amortie s.f.<br />
(Sport) palla smorzata. ES, G confirme<br />
amphigouri s.m.<br />
(lett) scritto o discorso assurdo e contorto. ED, B “stoltiloquio” 391<br />
amplifiant agg.<br />
(rar) che amplifica. EM, G confirme<br />
analysant s.m.<br />
persona f. in analisi. ED, B “analizzante” 392<br />
ancre s.f.<br />
(Edil) catena da muro, ancora da costruzione. ED, HP “TECN. (dans le bâtiment) grappa,<br />
graffa” 393<br />
anneau s.m.<br />
389 G traduit « colpito da amnesia » l’adjectif ; ED car SL traduit « amnesico ».<br />
390 Et ajoute l’acception “articolo di giornale che inizia in prima pagina e si conclude in una delle seguenti”, ce<br />
qui est cependant un ED, car B la traduit “(giorn.) apertura (di un aricolo in prima pagina)”.<br />
391 G a ce même ED.<br />
392 G a ce même ED.<br />
393 G a ce même ED.<br />
307
(Oref) (boucle d’oreille) orecchino ad anello. ES, absent ailleurs<br />
antidérapant s.m.<br />
tappeto antiscivolo, superficie f. antiscivolo. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
antitussif s.m.<br />
(Farm) farmaco contro la tosse. ED, B “(farm, med.) antitosse”<br />
antiulcéreux s.m.<br />
(Farm) farmaco antiulcera. ED, B “(farm.) antiulceroso”<br />
apogon s.m.<br />
(Itt) re di triglie. ET, absent ailleurs<br />
appalachien agg.<br />
(Geog,Geol) dei monti Appalachi. ED, G “(geol.) appalachiano”<br />
apparatchik s.m.<br />
1 (Pol) membro influente del partito comunista russo. ED, B “(polit.) ‘apparatchik’”<br />
2 (estens) membro di un partito. ES, acception absente ailleurs<br />
appenzell s.m.<br />
(Alim) formaggio appenzell. ER, absent ailleurs<br />
applaudi agg.<br />
(qui a du succès) di successo. ES, absent ailleurs<br />
après-coup s.m.<br />
(Psic) rielaborazione f. postuma. ET, absent ailleurs<br />
araire s.m.<br />
(Agr) aratro semplice. ET, G et HP confirment<br />
arbitrer 394 v.tr.<br />
(Econ) effettuare un arbitraggio su: arbitrer des valeurs effettuare un arbitraggio su titoli.<br />
ET, acception absente ailleurs<br />
394 HP a aussi la catégorie du verbe intransitif (absente ailleurs), traduite “fare da arbitro”, ES.<br />
308
arborescence s.f.<br />
(Inform,Mat) diagramma m. ad albero. ET, HP confirme<br />
arcade s.f.<br />
(Svizz.fr) (boutique) locale m. commerciale. ED, B “negozietto” 395<br />
arcature s.f.<br />
(Arch) fuga di archi. ED, B “arcatella” 396<br />
arçon s.m.<br />
(Agr) tralcio di vite annoccato. ED, B “annoccatura” 397<br />
arçonner v.tr.<br />
(Tess) battere con l’archetto. ET, G confirme<br />
aristocratisme s.m.<br />
(Stor,Pol) tendenza f. favorevole alla nobiltà. ES, absent ailleurs<br />
arpète, arpette s.f.<br />
(colloq) apprendista m./f. sarto. ED, G “(fam.) apprendista”<br />
arrêt-maladie s.m.<br />
(certificat) certificato di malattia. ES, absent ailleurs<br />
arrondir v.<br />
(Sart) fare l’orlo. ES, acception absente ailleurs<br />
arrosage s.m.<br />
(Mil,gerg) (bombardement) bombardamento a tappeto. ES, acception absente ailleurs<br />
arroser v.tr.<br />
(Mil,gerg) (bombarder) bombardare a tappeto. ED, G “martellare” 398<br />
arroyo s.m.<br />
395 G a ce même ED.<br />
396 G et HP ont ce même ED.<br />
397 G a ce même ED.<br />
398 Comme le confirme l’exemple: “l’artillerie arrose l’ennemi, l’artiglieria sta martellando il nemico”.<br />
309
(Geog) canale che, nei paesi tropicali, collega due corsi d’acqua. ES, absent ailleurs<br />
arsouille agg.m./f.<br />
(colloq,ant) da canaglia: une allure arsouille uno stile da canaglia. ED, G “canagliesco”<br />
artefact s.m.<br />
(Med) artefatto di laboratorio. ET, absent ailleurs<br />
assécher v.intr.<br />
(Mar) (à marée basse) andare in secca. ET, absent ailleurs<br />
assertion s.f.<br />
(Ling) frase assertiva. ET, acception absente ailleurs<br />
assimilé s.m.<br />
(Mil) membro di corpi civili speciali mobilitati. ED, G “(mil.) assimilato”<br />
assommoir s.m. (ant)<br />
(colloq,lett) (bar) bettola f. in cui si annega nell’alcol la propria disperazione: l’Assommoir est<br />
un roman de Zola l’Ammazzatoio è un romanzo di Zola. ED, G “osteria, bettola”<br />
assumer v.tr.<br />
(assol.) assumere la responsabilità delle proprie azioni: j’assume! me ne assumo la<br />
responsabilità; (colloq) ils font des gosses et après ils n’assument pas fanno i figli e poi non<br />
se ne occupano. ES, absent ailleurs<br />
assurage s.m.<br />
(Sport,Alp) materiale o dispositivo per assicurare. ED, B “(alp.) assicurazione” 399<br />
asti s.m.<br />
(Enol) spumante d’Asti. ES, absent ailleurs<br />
astre s.m.<br />
(fig,ant) (personne illustre) persona f. illustre. ES, absent ailleurs<br />
atermoyer v.tr.<br />
(Dir,ant) concedere una moratoria. ED, G “(dir. antiq.) differire, dilazionare, prorogare”<br />
399 HP a ce même ED.<br />
310
atomiser v.tr.<br />
(soumettre à des radiations atomiques) sottoporre a radiazioni atomiche. ED, B, G et HP<br />
“atomizzare”<br />
attachement s.m.<br />
(Edil) nota dei lavori eseguiti quotidianamente da un’impresa edile e registrazione delle<br />
spese relative. ES, G confirme<br />
atteler v.tr.<br />
(attacher: réf. à une carriole) agganciare il rimorchio a: atteler une voiture agganciare il<br />
rimorchio a un’auto ED, B, G et HP “agganciare”<br />
attrape-touristes s.m.inv.<br />
(colloq) trappola f. per turisti. ES, G confirme<br />
attrempage s.m.<br />
(Tecn) preriscaldamento del forno. ET, absent ailleurs<br />
attremper v.tr.<br />
(Tecn) portare a temperatura il forno. ET, absent ailleurs<br />
audiodisque s.m.<br />
disco audio. ET, absent ailleurs<br />
autan s.m.<br />
vento impetuoso. ED, B et G “(vento) altano”<br />
auteur s.m.<br />
(Dir) dante causa m./f. ET, G confirme<br />
autotaraudeuse s.f.<br />
(Mecc) vite autofilettante. ET, G confirme<br />
avalancheux agg.<br />
di valanga. ES, G confirme<br />
avancée s.f.<br />
(Pesc) punta del cimino. ET, G confirme<br />
311
aventureusement avv.<br />
(dangereusement) in modo azzardato. ES, acception absente ailleurs<br />
aviso s.m.<br />
(Mar) avviso scorta. ED, G “(mar.) avviso”<br />
axis 2 s.m.<br />
(Zool) cervo axis. ET, absent ailleurs<br />
312
DICTIONNAIRE GARZANTI<br />
Un examen des entrées fait ressortir qu’une comparaison entre les quatre dictionnaires,<br />
voire le recours à un dictionnaire monolingue italien, est nécessaire pour trancher sur une<br />
typologie précise d’écarts: les traduisants analytiques qui rendent des lexèmes (par ex.,<br />
adjectivement, adminstrativament...). G a la tendance à traduire ces adverbes par des expressions<br />
synonymiques, alors que des traduisants synthétiques, donc monolexématiques, et qui plus<br />
est basés sur la même racine, existent en italien. C’est un choix qui voudrait sans doute<br />
fournir à l’utilisateur un traduisant plus idiomatique, mais qui efface une certaine<br />
correspondance et crée le soupçon d’une lacune dans le système.<br />
abat-jour n.m.<br />
finestra (f.) a tramoggia. ED, B “tramoggia”<br />
abée n.f.<br />
(in un mulino) cateratta del bottaccio. ED, B “cateratta (di un mulino)”<br />
absorptiomètre n.m.<br />
(chim.) misuratore di assorbimento. ET, absent ailleurs<br />
abuseur agg. e n.m.<br />
che, chi commette abusi sui bambini. ES, absent ailleurs<br />
accessoirement avv.<br />
in via accessoria. ED, B “accessoriamente”<br />
accidenter v.tr.<br />
3 rendere accidentato (un terreno). ES, acception absente ailleurs<br />
4 rendere più vario. ES, acception absente ailleurs<br />
accisien n.m.<br />
(Belgio) (fin.) agente del servizio dell’accisa. ES, absent ailleurs<br />
accortement avv.<br />
(antiq.) con garbo e destrezza. ES, absent ailleurs<br />
accoudement n.m.<br />
313
(non com.) l’appoggiarsi sul gomito. ES, absent ailleurs<br />
accru n.m.<br />
(bot.) pollone radicale. ED, B “(agr.) pollone”<br />
acculturé agg. e n.m.<br />
(Africa) (persona) che ha assimilato la cultura europea. ES, acception absente ailleurs<br />
acoquiné agg.<br />
in combutta, in comunella: ces deux là, ils sont bien acoquinés, quei due lì fanno proprio<br />
comunella. ES, absent ailleurs<br />
actionnable agg.<br />
(dir.) perseguibile in giudizio. ED, B “(dir.) azionabile”<br />
actionner v.tr.<br />
(dir.) perseguire in giudizio: actionner un débiteur, escutere un debitore; actionner en<br />
dommages-intérêts, citare, agire per i danni. ED, B “citare”<br />
aculéiforme agg.<br />
(zool., bot.) a forma di aculeo. ED, B “aculeiforme”<br />
addictif agg.<br />
(med.) di, della dipendenza (da droga, alcol. ecc.) | (psic.) conduite addictive,<br />
comportamento di dipendenza. ES, absent ailleurs<br />
addictologie n.f.<br />
(med.) medicina delle dipendenze (da droga, alcool...). ES, absent ailleurs<br />
adéiser v.tr.<br />
(inform. fam.) rifiutare, negare l’accesso (a una rete) Dall’ingl. AD, access denied, accesso<br />
negato. ES, absent ailleurs<br />
adjectivement avv.<br />
(gramm.) con valore di aggettivo: nom employé adjectivement, sostantivo usato con valore<br />
di aggettivo. ED, SL “aggettivalmente”<br />
administrativement avv. dal punto di vista amministrativo. ED, B<br />
“amministrativamente”<br />
314
adoubement n.m. (st.) (cerimonia della) vestizione (f.) di un cavaliere. ED, B “(st.)<br />
vestizione (di un cavaliere)”; SL “(Mediev) investitura (di un cavaliere), vestizione”<br />
adultescent n.m. e agg.<br />
chi, che è tra l’adolescenza e l’età adulta. ES, absent ailleurs<br />
adultisme n.m.<br />
(psic.) (di comportamento) caratterizzazione (f.) da adulto. ED, B “(psic.) adultismo”<br />
adverbialement avv.<br />
con valore avverbiale. ED, B “avverbialmente”<br />
aérofibre n.f.<br />
fibra cava isolante. ET, absent ailleurs<br />
aérostation n.f.<br />
(antiq.) tecnica aeronautica relativa agli aerostati. ED, B “(st. aer.) aerostazione”<br />
aérotracté agg.<br />
spinto dal vento. ES, absent ailleurs<br />
aéroville n.f.<br />
area tecnologica nei pressi di un aeroporto. ES, absent ailleurs<br />
affaitage n.m.<br />
(antiq.) addestramento alla caccia (di rapace). ES, absent ailleurs<br />
affaiter v.tr.<br />
addestrare alla caccia (un rapace). ED, B “(caccia) addestrare (un falco)”<br />
affect n.m.<br />
(psic.) stato di eccitazione affettiva. ET, acception absente ailleurs<br />
affouagiste n.m.<br />
(dir.) usufruttuario del legnatico. ES, absent ailleurs<br />
affranchi n.m.<br />
(fam.) persona (f.) che vive ai limiti della legalità. ED, SL “spregiudicato”<br />
315
affranchir v.tr.<br />
(argot) avviare alla delinquenza. ES, absent ailleurs 400<br />
AFK agg.<br />
(Internet) assente momentaneamente (di un internauta durante una chat o un gioco in rete):<br />
Marc est AFK, Marc non è al computer Sigla dell’ingl. Away From Keyboard. ES, absent<br />
ailleurs<br />
africainement avv.<br />
secondo un’ottica africana; all’africana. EM, absent ailleurs<br />
agroalimentaire n.m.<br />
settore agroalimentare. ED, B “agroalimentare”<br />
aigle n.m.<br />
leggio di chiesa (raffigurante un’aquila con le ali spiegate). ED, HP leggio”<br />
aigri n.m.<br />
persona inacidita. ES, SL confirme<br />
aillade n.f.<br />
(cuc.) (region.) bruschetta con l’aglio. ED, B et SL “bruschetta”<br />
air 3 n.m.<br />
(snowboard) figura acrobatica eseguita in aria. ES, absent ailleurs<br />
airure n.f.<br />
(miner.) estremità di una vena mineraria. ET, absent ailleurs<br />
aissette n.f.<br />
ascia a filo ricurvo (del bottaio). ET, absent ailleurs<br />
ajouré agg.<br />
(ricamo) lavorato a punto a giorno. ED, B et SL “traforato”<br />
alarguer v.intr. (mar.)<br />
400 Nous faisons remarquer également la forte motivation de ce signe.<br />
316
1 prendere il largo ED, B “(mar.) allargare”<br />
2 navigare a vento largo. ET, absent ailleurs<br />
albraque n.f.<br />
(miner.) galleria di scolo. ET, absent ailleurs<br />
alevinier n.m.<br />
vivaio di avannotti. ED, SL “(Pesc) vivaio”<br />
alezane n.f.<br />
cavalla saura. ES, absent ailleurs<br />
algazelle n.f.<br />
(zool.) antilope del Sahara. ET, absent ailleurs<br />
alicament n.m.<br />
alimento naturale con proprietà terapeutiche. ED, HP “nutraceutico” 401<br />
alimentarité n.f.<br />
proprietà di un materiale di non alterare gli alimenti con cui è a contatto. ET, absent ailleurs<br />
alinéaire agg.<br />
che segna il capoverso. ES, absent ailleurs<br />
allégé n.m.<br />
alimento dietetico (privato di grassi e/o zuccheri). ES, catégorie grammaticale absente<br />
ailleurs<br />
allopathe n.m.<br />
medico allopatico. ED, B, HP et SL “allopatico”<br />
allural agg.<br />
(nel linguaggio della moda) che ha tono, stile. ES, absent ailleurs<br />
alper v.tr.<br />
(Svizzera) portare all’alpeggio (il bestiame). ES, absent ailleurs<br />
401 B aussi a cet ED.<br />
317
alpha Jet n.m.<br />
(Africa) vecchio libertino in disarmo. ES, absent ailleurs<br />
alterconsommateur n.m.<br />
consumatore alternativo (difensore dei diritti della collettività). ES, absent ailleurs<br />
altison n.m.<br />
altimetro sonoro. ES, absent ailleurs<br />
alunerie n.f.<br />
fabbrica di allume. ES, absent ailleurs<br />
amalgame n.m.<br />
(mil.) fusione (f.) di unità militari. ET, acception absente ailleurs<br />
ambidextre n.m. e f.<br />
persona (f.) ambidestra. ED, SL “ambidestro”<br />
ambigu n.m.<br />
(antiq.) pasto freddo (in cui venivano servite contemporaneamente tutte le portate). ES,<br />
absent ailleurs<br />
ambigument avv.<br />
(non com.) in maniera ambigua. ED, B “ambiguamente”<br />
ambleur agg.<br />
(di un cavallo) che va d’ambio. ED, B, HP et SL “ambiatore”<br />
amblyope agg. e n.m. e f.<br />
(med.) persona affetta da ambliopia. ED, SL “ambliopico”<br />
ambre agg.invar.<br />
color ambra. ED, SL “ambra”<br />
ambrette n.f.<br />
seme (m.) di abelmosco. ED, B “ambretta”, SL “abelmosco”<br />
ambulacre n.m.<br />
318
(zool.) pedicello ambulacrale. ED, B “(zool.) ambulacro”<br />
améliorable agg.<br />
che può essere migliorato. ED, B “migliorabile”<br />
américanisme n.m.<br />
tendenze filo-americane. ES, absent ailleurs<br />
amicalement avv.<br />
in modo amichevole. ED, B “amichevolmente”<br />
amincissant n.m.<br />
prodotto dimagrante. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
ammoniaque n.f.<br />
(chim.) ammoniaca liquida. ED, SL “(Chim) ammoniaca”<br />
amok n.m.<br />
accesso di follia omicida: elle était devenue amok, era in preda a follia omicida. ES, absent<br />
ailleurs 402<br />
amouillante agg. e n.f.<br />
vacca che sta per figliare o ha appena figliato. ES, absent ailleurs<br />
analogue n.m.<br />
cosa (f.) simile; cosa (f.) analoga: il n’y a point d’analogue dans l’histoire de la peinture, non<br />
vi è niente d’analogo nella storia della pittura; sans analogue, (non com.) senza pari. ED, SL<br />
“equivalente”<br />
anatomopathologie n.f.<br />
anatomia patologica. ED, B “anatomopatologia”<br />
anchoyade n.f.<br />
anchoyade (salsa d’acciughe all’olio di oliva). ED, B “acciugata” 403<br />
anecdotier n.m.<br />
402 Cependant, l’article “amok” existe dans la version italienne de Wikipédia, à la page<br />
http://it.wikipedia.org/wiki/Amok_(psicologia), consultée le 10 octobre 2010.<br />
403 S.v. anchoïade.<br />
319
(estens.) chi ama raccontare aneddoti. ED, B “aneddotista”<br />
angarie n.f.<br />
requisizione delle navi neutrali presenti nelle acque territoriali di uno stato in guerra. ED, B<br />
“(dir.) angaria”<br />
angéliquement avv.<br />
in modo angelico. ED, B “angelicamente”<br />
angledozer n.m.<br />
(cantieristica) bulldozer a lama orientabile. ES, absent ailleurs<br />
anisomère agg.<br />
formato da parti ineguali. ES, absent ailleurs<br />
annuel n.m.<br />
messa (f.) detta periodicamente, per un anno, in suffragio di un defunto. ES, absent ailleurs<br />
annuitaire agg.<br />
pagabile in annualità. ES, absent ailleurs<br />
anonymement avv.<br />
in modo anonimo. ED, B “anonimamente”<br />
anorganique agg.<br />
(med.) di natura non organica. ED, B “(med.) anorganico”<br />
anorgasmie n.f.<br />
(med.) assenza di orgasmo. ED, B “anorgasmia”<br />
anormalement avv.<br />
in modo anormale. ED, B “anormalmente”<br />
ante n.f.<br />
pala ausiliaria (di un mulino a vento). ES, acception absente ailleurs<br />
anthologie n.f.<br />
320
(tv) fiction televisiva costituita da serie di storie a tema senza un personaggio ricorrente. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
antibelliciste agg.invar.<br />
contrario al bellicismo. ES, absent ailleurs<br />
anticonstitutionnellement avv.<br />
in modo anticostituzionale. ED, B “anticostituzionalmente”<br />
antiétatique agg.invar.<br />
contro lo statalismo. ED, SL “antistatale”<br />
antigalère agg.invar.<br />
(sociol.) contro l’emarginazione sociale (dei giovani nelle città-satellite). ES, absent ailleurs<br />
antigel agg. e n.m.<br />
(fam.) bibita molto alcolica. ES, absent ailleurs<br />
antiguerre agg.invar.<br />
contro la guerra: mouvement, manifestation antiguerre, movimento, manifestazione contro<br />
la guerra. ES, absent ailleurs<br />
anti-LAV n.m.<br />
(med.) anticorpi (pl.) del virus HVL. ET, absent ailleurs<br />
anti-mendicité agg.invar.<br />
contro l’accattonaggio. ES, absent ailleurs<br />
antivénéneux agg.<br />
che agisce da contravveleno. ED, B “contravvelenoso”<br />
apathiquement avv.<br />
in modo apatico. ED, B “apaticamente”<br />
apatridie n.f.<br />
condizione di apolide. ED, B “apolidia”<br />
apesanteur n.f.<br />
321
(fis.) condizione di mancanza di gravità. ED, B “(astr., fis.) imponderabiltà”<br />
apiéceuse n.f.<br />
(ind. della confezione) operaia imbastitrice. ES, absent ailleurs<br />
aplanat n.m.<br />
(fot.) obiettivo aplanatico. ET, absent ailleurs<br />
s’aplatir v.pron. e pron.intr.<br />
(fam.) cadere lungo disteso. ES, acception absente ailleurs<br />
apochromat n.m.<br />
(fot.) obiettivo apocromatico. ET, acception absente ailleurs<br />
apoplectique n.m.<br />
soggetto apoplettico. ED, HP et SL “apoplettico”<br />
apostille n.f.<br />
nota di raccomandazione aggiunta a una petizione. ES, absent ailleurs<br />
apostoliquement avv.<br />
in modo apostolico. ED, B “apostolicamente”<br />
appareillement n.m.<br />
appaiamento di animali per eseguire lavori agricoli. ED, B “(agr.) appiamento”<br />
apprêteur n.m.<br />
(antiq.) pittore su vetro. ES, acception absente ailleurs<br />
aprioriste agg. e n.m.<br />
che si fonda su idee a priori. ED, SL “aprioristico”<br />
aquacentre n.m.<br />
centro di sport acquatici. ES, absent ailleurs<br />
arabophone agg. e n.m.<br />
(persona) (f.) di lingua araba. ED, B “arabofono”<br />
arbitrairement avv.<br />
322
in modo arbitrario. ED, B “arbitrariamente”<br />
arbitrer v.tr.<br />
fungere da arbitro in: arbitrer une querelle, fungere da arbitro in una controversia. ED, B<br />
“arbitrare”<br />
arboricole agg.<br />
dell’arboricoltura; che concerne l’arboricoltura: technique arboricole, tecnica<br />
dell’arboricoltura. EM, HP confirme<br />
arcanne n.f.<br />
gesso (m.) rosso (utilizzato in carpenteria e falegnameria). ES, absent ailleurs<br />
arche 1 n.f.<br />
forno (m.) di ricottura per il vetro. ET, acception absente ailleurs<br />
archerie n.f.<br />
1 tecnica del tiro con l’arco | rayon d’archerie, reparto di tutto il materiale per il tiro con<br />
l’arco. ES, absent ailleurs<br />
2 reparto (m.) di arcieri. ES, absent ailleurs<br />
archet n.m.<br />
(zool.) organo stridulatore (di cavallette). ET, absent ailleurs<br />
archétypal agg.<br />
di archetipo. ED, B “archetipico”<br />
archibattu agg.<br />
molto battuto. ES, absent ailleurs<br />
archicubier n.m.<br />
elenco degli ex allievi dell’Ecole Normale. ER, absent ailleurs<br />
archipompe n.f.<br />
(mar.) condotto (m.) di pompa. ET, absent ailleurs<br />
archisouple agg.<br />
estremamente agile. ES, absent ailleurs<br />
323
arêtier n.m.<br />
puntone di falda (del tetto). ED, B “cantonale”<br />
argent-braguette n.m.invar.<br />
(Antille) assegno familiare. ES, absent ailleurs<br />
argotier n.m.<br />
persona (f.) che si esprime in gergo. ED, B “gergante”<br />
arithmétiquement avv.<br />
in modo aritmetico. ED, B “aritmeticamente”<br />
armeline n.f.<br />
pelle di ermellino. ES, B “(pelle di) ermellino”<br />
armet n.m.<br />
(st. mil.) elmetto in uso dal XIV al XVI sec. ED, B “(armi ant.) celata, elmetto”<br />
armorial agg.<br />
(arald.) relativo all’arme. ED, B “araldico”<br />
aromate n.m.<br />
pianta aromatica. ED, B “aroma”<br />
arpenteuse n.f.<br />
(zool.) bruco geometra (m.). ED, B “(zool.) geometra”<br />
arrachis n.m.<br />
1 lo sradicare alberi. ED, B “sradicamento”<br />
2 terreno boschivo da cui gli alberi sono stati sradicati. ES, absent ailleurs<br />
3 pianticella strappata con tutte le radici. ES, B “pianta sbarbata”<br />
arraisonnement n.m.<br />
fermo di nave in alto mare per controlli (spec. sanitari); controllo in volo di un aereo. ED,<br />
HP “MAR. AER. ispezione”<br />
arraisonner v.tr.<br />
324
fermare una nave in alto mare per ispezionarla; controllare in volo un aereo. ED, HP<br />
“MAR. AER. ispezionare”<br />
arrière-ban n.m.<br />
(st.) mobilitazione (f.) dei vassalli e dei valvassori; milizie (f.pl.) dei valvassori. ED, SL<br />
“(Mediev) eribanno, bando di chiamata alle armi”<br />
arrimer v.tr.<br />
sistemare e fissare un carico su un veicolo. ED, B “sistemare, fissare”<br />
arrivage n.m.<br />
(comm.) grande afflusso (di persone): l’arrivage des touristes, (scherz.) l’arrivo in massa dei<br />
turisti. ES, HP confirme<br />
arrivant n.m.<br />
chi arriva: les premiers arrivants, i primi arrivati. ED, SL “venuto”<br />
arrogamment avv.<br />
(non com.) in modo arrogante. ED, SL “arrogantemente”<br />
arroseuse n.f.<br />
autobotte annaffiatrice. ED, B “autoannaffiatrice, autoinnaffiatrice”<br />
artificieusement avv.<br />
in modo artificioso. ED, B “artificiosamente”<br />
artiste agg.<br />
da artista: il a une nature, un tempérament artiste, ha una natura, un temperamento da<br />
artista. EM, B confirme<br />
ascenseur n.m.<br />
(inform.) barra (f.) di scorrimento. ED, HP “INFORM. ascensore”<br />
asphaltier n.m.<br />
nave (f.) per il trasporto dell’asfalto. ED, B “(mar.) asfaltiera, bitumiera”<br />
assouplir v.tr.<br />
325
endere più agile; rendere più elastico (anche fig.): le massage assouplit les muscles, il<br />
massaggio scioglie i muscoli; assouplir la discipline, rendere la disciplina meno rigida. ED,<br />
B “sciogliere”<br />
□ s’assouplir v.pron.intr.<br />
diventare più agile; diventare più elastico (anche fig.): la discipline s’est beaucoup assouplie,<br />
la disciplina è diventata molto più elastica. ED, HP “ammorbidirsi”<br />
assouplissement n.m.<br />
il diventare più agile; il diventare più elastico (anche fig.): exercices d’assouplissement,<br />
esercizi per sciogliere i muscoli, esercizi di riscaldamento. ED, SL “(Sport, Ginn)<br />
riscaldamento”<br />
astic n.m.<br />
lisciatoio da calzolaio. ES, absent ailleurs<br />
astreinte n.f.<br />
(dir.) interesse (m.) di mora. ED, HP “penale”<br />
astroblème n.m.<br />
(geol.) cratere d’impatto; cratere di esplosione (di meteorite). ET, absent ailleurs<br />
astrométriste n.m. e f.<br />
specialista di astrometria. ES, absent ailleurs<br />
attelage n.m.<br />
(ferr.) barra (f.) d’aggancio. ED, B “(ferr., trasp.) attacco, aggancio”<br />
atterrisseur n.m.<br />
(aer.) carrello d’atterraggio. ED, SL “(Aer) carrello”<br />
attracteur agg.<br />
che attira. EM, B confirme<br />
attrape n.f.<br />
pl. oggetti con cui si fanno scherzi (spec. a carnevale). ED, SL “(objet) scherzo”<br />
attribut n.m.<br />
(gramm.) nome del predicato. ET, SL confirme<br />
326
aubergine n.f.<br />
(fam.) donna poliziotto (a Parigi). ED, SL “(colloq.) (contractuelle) poliziotta” 404<br />
audiencer v.tr.<br />
(dir.) portare in udienza. ET, absent ailleurs<br />
audimat ® n.m.<br />
apparecchio per misurare l’indice d’ascolto; (estens.) indice d’ascolto: ces émissions font de<br />
l’audimat, queste trasmissioni hanno un alto indice d’ascolto. ED, HP “auditel”405<br />
autochrome n.f.<br />
lastra autocroma. ET, absent ailleurs<br />
autocoat n.m.<br />
giaccone lungo. ES, absent ailleurs<br />
autoconstruction n.f.<br />
(edil.) costruzione di una casa privata senza l’intervento di professionisti dell’edilizia. ES,<br />
absent ailleurs<br />
autogare n.f.<br />
(Africa) stazione dei pullman. ES, absent ailleurs<br />
auto-justice n.f.invar.<br />
il farsi giustizia da sé: il faut aviser les citoyens des risques de l’auto-justice, bisogna rendere<br />
consapevoli i cittadini dei rischi di farsi giustizia da sé. ES, absent ailleurs<br />
automate n.m.<br />
(Svizzera) distributore automatico. ES, B et SL confirment<br />
autorégulateur agg.<br />
a regolazione automatica. ED, B “autoregolatore”<br />
autoréparable agg.<br />
che si ripara automaticamente. ED, B “autoriparabile”<br />
404 HP a ce même ED.<br />
405 G fait un choix d’une stratégie d’exotisation/altérisation. Le traduisant “auditel ® ” a été choisi pour l’entrée<br />
“audiotel ® ”. SL propose au contraire la traduction “auditel”.<br />
327
autoritairement avv.<br />
in modo autoritario. ED, SL “autoritariamente”<br />
autostrade n.f.<br />
autostrada italiana. ER, absent ailleurs<br />
auxiliairement avv.<br />
in modo ausiliare. EM 406 , HP et SL confirment<br />
avantage n.m.<br />
(dir.) preferenza testamentaria. ET, acception absente ailleurs<br />
avant-garde n.f.<br />
palizzata anteriore (di pila di ponte). ES, acception absente ailleurs<br />
avant-scène n.f.<br />
pl. palchi (m.) di proscenio. ED, SL “palco”<br />
avertissement n.m.<br />
giudizio negativo riportato sulla pagella di uno studente alla fine del quadrimestre. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
avertisseur agg.<br />
che avverte | signal avertisseur, segnale d’allarme. ED, B “segnalatore”<br />
s’aveugler v.pron.<br />
(antiq. fig.) farsi delle illusioni. ED, B “illudersi”<br />
avironnerie n.f.<br />
fabbrica di remi. ES, absent ailleurs<br />
avortement n.m.<br />
(inform.) interruzione (f.) di esecuzione di programma. ET, acception absente ailleurs<br />
azotation n.f.<br />
(chim.) fissazione dell’azoto. ET, absent ailleurs<br />
406 Et ajoutent l’acception “in via accessoria”, ES.<br />
328
azotémique agg.<br />
(med.) dell’azotemia. ET, absent ailleurs<br />
329
DICTIONNAIRE HACHETTE-PARAVIA<br />
aber m.<br />
(en Bretagne) = estuario ampio e profondo. ER, SL confirme<br />
aboyeur m.<br />
cane che abbaia. ES, B et SL confirment<br />
ACF m.inv. (⇒ Automobile Club de France)<br />
= ente corrispondente all’ACI italiano.<br />
artothécaire m. e f.<br />
= chi impresta, per un periodo limitato, opere d’arte ai privati. ES, absent ailleurs<br />
artothèque f.<br />
= istituzione che, per un periodo limitato, impresta opere d’arte a privati. ES, absent<br />
ailleurs<br />
audiotypiste m. e f.<br />
= persona che sbobina testi audio. ES, absent ailleurs<br />
autotour m.<br />
= pacchetto turistico comprendente l’affitto di un’auto e la prenotazione di alberghi lungo<br />
un itinerario definito. ES, absent ailleurs<br />
azurant m.<br />
= colorante azzurro o violetto utilizzato nello sbianchimento della biancheria e<br />
nell’azzurrimento delle lenti a contatto. ED, SL “azzurrante”.<br />
330
DIRECTION ITALIEN-FRANÇAIS<br />
DICTIONNAIRE SANSONI LAROUSSE<br />
abat-jour 407 s.m.inv.<br />
(lampada) lampe f. de table. ES, B, G et HP confirment<br />
ab(b)azia s.f. (rar)<br />
(beneficio di abate) charge d’abbé. ES, G confirme<br />
abbacchiatura s.f. (Agr)<br />
(periodo) période durant laquelle est effectué le gaulage. ED, HP “(periodo dell’abbacchiatura)<br />
gaulage”<br />
abbacchio s.m.<br />
(Macell,region) agneau de lait. ED, B et G “abbacchio”<br />
abbaio s.m. (rar,lett)<br />
(abbaiamento prolungato) aboiement prolongé. ED, HP “aboiements” 408<br />
abbandonato agg.<br />
5 (incustodito) sans surveillance, laissé sans surveillance. ES, acception absente ailleurs<br />
9 (lett) (disteso, reclinato) dans une position abandonnée. ES, acception absente ailleurs<br />
abbaruffare v.tr.<br />
(rar) (scompigliare) mettre sens dessus dessous, mettre en désordre. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
abbellirsi v.prnl.<br />
(farsi bello) se faire beau. ED, B “s’enjoliver”, HP “embellir”<br />
abbinabile agg.m./f.<br />
1 qui peut être accouplé, qui peut être jumelé (anche Mecc). EM, absent ailleurs<br />
407 Cf. infra, II.2.2.<br />
408 G a ce même ED.<br />
331
2 (Abbigl) qui peut être assorti: questa camicia è abbinabile con i pantaloni rossi cette<br />
chemise peut être assortie au pantalon rouge, cette chemise va bien avec le pantalon rouge.<br />
EM, absent ailleurs<br />
3 (accompagnabile) qui peut être accompagné (con de): abbinabile con federe della stessa<br />
fantasia qui peut être accompagné de taies du même motif. EM, absent ailleurs<br />
abbinamento s.m.<br />
(il poter essere accompagnato) fait de pouvoir être associé. ED, B “union, assortiment,<br />
mariage” 409<br />
abbinata s.f.<br />
(Equit) pari m. couplé. ET, B, G et HP confirment<br />
abbiocco s.m.<br />
(region) accès de somnolence: dopo pranzo mi viene l’abbiocco j’ai toujours envie de dormir<br />
après le déjeuner. ES, G et HP confirment 410<br />
abborracciatura s.f.<br />
(colloq) travail m. bâclé. ED, B “bâclage, bousillage”<br />
abbriv(i)are v.tr.<br />
(Mar) donner de l’erre. ET, B, G et HP confirment<br />
II intr.<br />
(Mar) (prendere l’abbrivo) prendre de l’erre. ET, B, G et HP confirment<br />
abbruciacchiato agg.<br />
(rar) légèrement brûlé. ED, G “roussi” 411<br />
abbrunare v.tr.<br />
(in segno di lutto) habiller de noir, mettre un crêpe à. ES, B, G et HP confirment<br />
II intr.impers.<br />
409 B ajoute l’acception “4 (sport) mise en tandem (de deux athlètes), constitution d’une poule éliminatoire par<br />
groupes de deux (joueurs, équipes)”, ES.<br />
410 Avec une équivalence mieux trouvée : “petit coup de pompe, de barre”.<br />
411 S.v. bruciacchiato, à abbruciacchiare il y a un renvoi vers tous les dérivés de bruciacchiare.<br />
332
(lett) faire noir: è tardi, abbruna già il est tard, il commence déjà à faire noir. ED, B<br />
“s’assombrir”<br />
III prnl. abbrunarsi<br />
(lett,rar) (in segno di lutto) prendre le deuil, porter le deuil, s’habiller en noir. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
abbrunato agg.<br />
1 en deuil. ES, G et HP confirment<br />
2 (rif. a bandiera) à mi-mât, à mi-drisse. ES, acception absente ailleurs<br />
abbrustolita s.f.<br />
fait m. de faire griller légèrement. ED, G “grillage”<br />
abbuiare v.intr.impers.<br />
(rar) faire nuit. ED, B “s’assombrir” 412<br />
abdurre v.tr.<br />
(Anat) écarter du corps. ET, absent ailleurs<br />
abilitante agg.m./f.<br />
qui qualifie: corsi abilitanti all’insegnamento cours conférant un certificat d’aptitude à<br />
l’enseignement. EM, B et G confirment<br />
abitabile agg.m./f.<br />
(di cucina) faisant office de salle à manger. ES, acception absente ailleurs<br />
abitativo agg.<br />
du bâtiment: edilizia abitativa industrie du bâtiment. EM, B, G et HP confirment<br />
abitino s.m.<br />
petite robe f.; (abito corto) robe f. courte. EM, G et HP confirment<br />
abitualità s.f.<br />
caractère m. habituel. ES, B confirme<br />
aborrire v.intr.<br />
412 G a ce même ED.<br />
333
avoir horreur (da de). ES, B, G et HP confirment<br />
abortista I agg.m./f.<br />
en faveur de l’avortement, pour l’avortement, pro-avortement: movimento abortista<br />
mouvement en faveur de l’avortement; medico abortista médecin pratiquant l’avortement.<br />
ES, B, G et HP confirment<br />
II s.m./f.<br />
personne f. en faveur de l’avortement, partisan m. de l’avortement. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
abruzzése n.m. e f. [sic]<br />
(dialetto) dialecte abruzzain.<br />
abusivismo s.m.<br />
actes pl. illégitimes. ES, B, G et HP confirment<br />
abusivo s.m.<br />
personne f. non autorisée. ES, G et HP confirment 413<br />
accademicamente avv.<br />
(estens) (in modo retorico) d’une manière académique, de façon théorique: discutere<br />
accademicamente discuter d’une manière académique; trattare accademicamente un<br />
argomento traiter un sujet de façon théorique. EM, B confirme<br />
accalappiacani s.m./f.inv.<br />
employé m. de la fourrière. ES, B, G et HP confirment<br />
accalappiatore s.m.<br />
employé de la fourrière. ES, B, G et HP confirment<br />
accanitamente avv.<br />
1 (furiosamente) avec fureur. ES, acception absente ailleurs<br />
2 (ostinatamente) avec acharnement. ED, HP “âprement” 414<br />
413 B a aussi, dans la catégorie grammaticale de l’adjectif:<br />
“2 (di mestieri) non autorisé, sans licence: affittacamere abusiva, logeuse sans licence; posteggiatore abusivo,<br />
gardien de parking non autorisé”, ES, G confirme.<br />
414 ED aussi pour les traductions de B et G: “avec acharnement”.<br />
334
accantonare v.tr.<br />
1 (mettere da parte) mettre de côté. ES, B, G et HP confirment 415<br />
3 (rinviare) laisser de côté, écarter provisoirement, remettre à plus tard. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
accantonato agg.<br />
(messo da parte) mis de côté; (dimenticato) laissé de côté, abandonné provisoirement, enterré<br />
provisoirement. ES, B et G confirment<br />
accaparrare v.tr.<br />
(rar) (acquistare mediante caparra) verser des arrhes pour. ED, HP “(versare una caparra)<br />
déposer” 416<br />
accapigliarsi v.prnl.<br />
en venir aux mains. ES, B, G et HP confirment<br />
accapponarsi v.prnl.<br />
en avoir la chair de poule: mi si accappona la pelle j’en ai la chair de poule. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
accatastabile 2 agg.m./f.<br />
(iscrivibile al catasto) qui peut être inscrit au cadastre. ED, B “(dir.) cadastrable” 417<br />
accatastamento 2<br />
s.m.<br />
(iscrizione al catasto) inscription f. au cadastre. ED, B “(dir.) cadastrage” 418<br />
accavallato agg.<br />
(di denti) qui se chevauchent. ED, B “chevauchant” 419<br />
accelerata s.f.<br />
(Aut) coup m. d’accélérateur: dare un’accelerata donner un coup d’accélérateur. ES, B, G et<br />
HP confirment<br />
415 G a la traduction “(merci) stocker” dans la même acception, cependant.<br />
416 ED aussi pour les traductions de B et G: “verser des arrhes”.<br />
417 Absent dans PR11 et TLFi, mais présent dans Google.<br />
418 Présent dans TLFi.<br />
419 L’exemple est justement “denti accavallati, dents chevauchantes”.<br />
335
accendersi v.prnl.<br />
(Mot) mettre en marche. ES, acception absente ailleurs<br />
accenditore s.m.<br />
(ant) (persona) allumeur de réverbères. ED, G “allumeur (de réverbères)”<br />
accennare v.intr.<br />
1 (far cenno) faire signe (a de): mi accennò di avvicinarmi il me fit signe d’approcher. ES, B,<br />
G et HP confirment<br />
2 (col capo) faire un signe de tête. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (alludere a) faire allusion (a à): a chi accennavi? à qui faisais-tu allusion? ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
4 (fig) (fare atto di, dare segno di) faire mine (a de), faire semblant de (a de), avoir l’air de (a de):<br />
accennare a fare qcs. faire semblant de faire qqch.; la situazione non accennava a cambiare<br />
la situation n’avait pas l’air de changer; la pioggia non accenna a smettere la pluie ne semble<br />
pas vouloir cesser. ED, B “sembler” 420<br />
II tr.<br />
1 (mostrare) montrer du doigt: accennare una persona montrer du doigt une personne. ED,<br />
B “montrer” 421<br />
3 (spiegare brevemente) expliquer brièvement: vi accenno come stanno le cose je vais vous<br />
expliquer brièvement la situation. ES, acception absente ailleurs<br />
accentratore s.m.<br />
personne f. qui veut tout diriger. ES, B, G et HP confirment<br />
accerchiante agg.m./f.<br />
qui encercle, d’encerclement. EM, B et G confirment<br />
acceso agg.<br />
(in funzione) en marche: tieni il motore acceso laisse le moteur en marche. ED, B “allumé” 422<br />
accessoriato agg.<br />
420 B a aussi l’acception “laisser entendre”, un autre ES.<br />
421 B a aussi l’acception “(mus.) donner les premières notes”, un autre ES.<br />
422 G a ce même ED.<br />
336
équipé d’accessoires. ED, B “(autom.) équipé”<br />
accettabilità s.f.<br />
fait m. d’être acceptable. ED, B “acceptabilité”<br />
acchiappafarfalle s.m.inv.<br />
filet m. à papillons. ES, B, G et HP confirment<br />
acciaccato agg.<br />
(malandato: di persona) mal en point. ES, HP confirme<br />
acciarino s.m.<br />
2 (di siluri) système de mise à feu. ED, B “(mil.) détonateur, amorce” 423<br />
3 (Tecn) (della ruota) esse f. d’essieu, esse f. de moyeu. ED, HP “(della ruota) esse” 424<br />
accidentalità s.f.<br />
caractère m. accidentel. ED, B “hasard”<br />
accigliarsi v.prnl.<br />
froncer les sourcils. ED, HP “sourciller” 425<br />
acciottolato agg.<br />
(selciato) pavé de cailloux. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
acclusa s.f.<br />
(lettera) document m. joint. ES, absent ailleurs<br />
accodare v.tr.<br />
mettre en file, mettre en file indienne. ES, HP confirme 426<br />
accollato agg.<br />
(Calz) à empeigne haute. ED, B “montant” 427<br />
accoltellamento s.m.<br />
423 G a ce même ED.<br />
424 G a ce même ED.<br />
425 G a ce même ED.<br />
426 G a ce même ED. B a un autre ES: “(detto di uccelli da richiamo) attacher par la queue”, absent ailleurs.<br />
427 Dans l’exemple, on peut lire « scarpe accollate, chaussures montantes ».<br />
337
agression f. au couteau. ES, B, G et HP confirment<br />
accoltellare v.prnl. accoltellarsi<br />
se battre à coups de couteau. ES, B, G et HP confirment<br />
accoltellatore s.m.<br />
agresseur au couteau. ED, HP “poignardeur” 428<br />
accomiatarsi v.prnl.<br />
prendre congé (da de). ES, B, G et HP confirment<br />
accomodare 429 v.prnl. accomodarsi<br />
(non fare complimenti) faire comme chez soi. ES, acception absente ailleurs 430<br />
accompagnare 431 v.prnl. accompagnarsi<br />
(armonizzare) être assorti, aller bien ensemble: questi due colori si accompagnano bene ces<br />
deux couleurs vont bien ensemble. ED, B “s’accorder”<br />
accomunabile agg.m./f.<br />
qu’on peut réunir, qu’on peut mettre en commun. EM, B et G confirment<br />
accomunamento s.m.<br />
mise f. en commun. ES, B confirme<br />
accomunare v.tr.<br />
(mettere in comune) mettre en commun. ES, B, G et HP confirment 432<br />
acconcio agg. (lett)<br />
(ben vestito) bien habillé, habillé avec soin. ES, acception absente ailleurs<br />
accontentare v.tr.<br />
428 G a ce même ED.<br />
429 B a un autre ES: “avoir besoin: prendi ciò che ti accomoda, prends ce dont tu as besoin”, absent ailleurs.<br />
430 B a un ED: “prendre place: si accomodi!, prenez place!; (in formule di cortesia) prego, accomodatevi, donnezvous<br />
la peine d’entrer; accomodatevi pure a sedere, donnez-vous la peine de vous asseoir”, alors que G traduit<br />
“s’asseoir”.<br />
431 B a un ES: “fermer doucement: accompagnare una porta, un cancello, fermer doucement une porte, une<br />
grille”, accception absente ailleurs.<br />
432 B et G ont aussi l’acception “(avere in comune) avoir en commun”, ED parce que SL propose “(avere in<br />
comune) parrtager”.<br />
338
(assecondare) faire plaisir à. ES, acception absente ailleurs<br />
accoppiabile agg.m./f.<br />
1 qu’on peut accoupler. EM, B et G confirment<br />
2 (Zootecn) qui peut être accouplé. ET, acception absente ailleurs<br />
accoppiata s.f.<br />
(Equit) pari m. couplé. ED, B “couplé” 433<br />
accoratamente avv.<br />
avec affliction. EM, B, G et HP confirment<br />
accorciabile agg.m./f.<br />
qu’on peut raccourcir. EM, B, G et HP confirment<br />
accordabile agg.m./f.<br />
(concedibile) qu’on peut accorder. ED, HP “(concedibile) [prestito] accordable”<br />
accordare v.tr.<br />
(mettere d’accordo) mettre d’accord: accordare le due parti mettre d’accord les deux parties.<br />
ED, B “concilier, accorder”<br />
II prnl.<br />
1 (mettersi d’accordo) se mettre d’accord: accordarsi sul prezzo se mettre d’accord sur le<br />
prix; accordarsi con qcu. su qcs. se mettre d’accord avec qqn sur qqch. ED, B “s’accorder,<br />
convenir”<br />
accotonare v.tr.<br />
(rar) doubler de coton. ED, HP “(imbottire di cotone) ouater”<br />
accozzare v.tr.<br />
(rif. a vestiti) entasser en désordre. ES, acception absente ailleurs<br />
accreditabile agg.m./f.<br />
(Comm) qu’on peut créditer. EM, B, G et HP confirment<br />
accreditare v.prnl. accreditarsi<br />
433 G et HP ont ce même ED.<br />
339
(rif. a persone) acquérir du crédit. ES, acception absente ailleurs<br />
acculturare v.prnl. acculturarsi<br />
(farsi una cultura) enrichir ses connaissances. ES, acception absente ailleurs<br />
accumulabile agg.m./f.<br />
qu’on peut accumuler, qui peut être accumulé. EM, B et G confirment<br />
accusabile agg.m./f.<br />
que l’on peut accuser (di de). ED, G “accusable” 434<br />
acero s.m.<br />
(legno) bois d’érable. ED, HP “(legno) érable”<br />
acerola s.f.<br />
(Bot,Farm) cerise des Antilles. ET, absent ailleurs<br />
acetilcloruro s.m.<br />
(Chim) chlorure d’acétyle. ET, absent ailleurs<br />
aclassismo s.m.<br />
théorie f. et action f. politiques qui font abstraction de l’existence ou de l’opposition des<br />
classes sociales. ES, B confirme<br />
aclista s.m./f.<br />
(iscritto alle ACLI) membre des ACLI. ER, B confirme<br />
acquacedrata s.f.<br />
boisson à base de sirop de cédrat. ES, B et G confirme<br />
acquapark s.m.inv.<br />
parc m. aquatique. ES, HP confirme<br />
acquarellare v.tr.<br />
(rar) peindre à l’aquarelle. ES, B, G, HP confirment 435<br />
acquartierare v.prnl. acquartierarsi<br />
434 B aussi a cet ED, proposant “qui peut être accusé”.<br />
435 S.v. acquerellare.<br />
340
(Mil) prendre ses quartiers. ED, B “cantonner” 436<br />
acquasanta s.f.<br />
(Lit) eau bénite. ES, B, G et HP confirment<br />
acquascooter s.m.inv.<br />
scooter des mers. ED, B “jet-ski” 437<br />
acquata s.f.<br />
(Mar) (provvista d’acqua) approvisionnement m. d’eau. ET, G confirme<br />
acquedotto s.m.<br />
(complesso delle tubature) système d’adduction d’eau: acquedotto cittadino système de<br />
distribution d’eau potable. ES, B confirme 438<br />
acqueo agg.<br />
d’eau. EM, B confirme<br />
acquerellare v.tr.<br />
(Pitt,rar) peindre à l’aquarelle. ES, B, G et HP confirment<br />
acquietabile agg.m./f.<br />
qu’on peut apaiser. EM, absent ailleurs<br />
acritico agg.<br />
dépourvu de sens critique. ED, B “acritique; (fig.) dogmatique, irrationnel”<br />
acrobaticamente avv.<br />
de façon acrobatique. EM, absent ailleurs<br />
acuirsi v.prnl.<br />
(divenire più forte) devenir plus vif. ED, HP “s’intensifier”<br />
acutamente avv.<br />
(con perspicacia) avec perspicacité, avec finesse. ES, B, G et HP confirment<br />
436 G et HP ont ce même ED.<br />
437 G et HP ont ce même ED.<br />
438 Et ajoute l’acception “société des eaux potables”<br />
341
adacquatore s.m.<br />
(Agr) canal d’amenée, canal d’irrigation. ED, G “rigole”<br />
adagiarsi v.prnl.<br />
(mettersi comodo) s’installer confortablement. ES, acception absente ailleurs<br />
adamitico agg.<br />
(Rel) des adamiens, des adamites. ES, B et G confirment<br />
addentellare v.tr.<br />
(Edil) faire une harpe à. ET, B et HP confirment<br />
addestrabile agg.m./f.<br />
qu’on peut dresser. EM, B, G et HP confirment<br />
addetto s.m.<br />
personne f. chargée (a à), personne f. préposée (a à). ED, HP “préposé” 439<br />
addizionale s.f.<br />
impôt m. additionnel. ES, B, G et HP confirment 440<br />
addolorare v.prnl. addolorarsi<br />
avoir de la peine (per à cause de, en raison de). ED, B “s’affliger”<br />
addotto agg.<br />
(Med) qui a subi une adduction. ET, acception absente ailleurs<br />
addurre v.tr.<br />
(Anat) produire un mouvement d’adduction. ET, B, G et HP confirment<br />
adenoide s.f.pl. (le adenoidi)<br />
(Med) végétations adénoïdes. ET, B, G et HP confirment<br />
adenoidismo s.m.<br />
(Med) syndrome adénoïdien. ED, B “(med.) adénoïdisme” 441<br />
439 G a ce même ED.<br />
440 HP ajoute la catégorie grammaticale du substantif masculin: “(apparecchio telefonico) appareil<br />
supplémentaire”, ES.<br />
342
adescabile agg.m./f.<br />
qu’on peut appâter, qu’on peut attirer, qu’on peut séduire. EM, absent ailleurs<br />
adirare v.prnl. adirarsi<br />
se mettre en colère (con contre). ED, B “se fâcher” 442<br />
adire v.tr.<br />
(Dir) (entrare in possesso) prendre possession de, entrer en possession de: adire un’eredità<br />
entrer en possession d’un héritage. ET, acception absente ailleurs<br />
adombrare v.prnl. adombrarsi<br />
2 (fig) (insospettirsi) avoir des soupçons. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (fig) (risentirsi) prendre ombrage. ED, B “s’effaroucher”<br />
adoperare I v.tr.<br />
(fare buon uso) tirer parti de, bien employer: sapere adoperare il tempo savoir tirer parti de<br />
son temps. ES, acception absente ailleurs<br />
II prnl. adoperarsi<br />
faire tout son possible, faire de son mieux, se donner beaucoup de peine, se prodiguer:<br />
adoperarsi per qcu. faire tout son possible pour qqn; si è molto adoperato il s’est donné<br />
beaucoup de mal. ED, B “se prodiguer”<br />
adorante agg.m./f.<br />
en adoration. ED, HP “adorant” 443<br />
adottando s.m.<br />
(Dir) enfant adoptable. ET, B, G et HP confirment<br />
adottivo agg.<br />
(fig) d’adoption, adoptif: paese adottivo pays d’adoption. ED, B “(fig.) adoptif ”<br />
adozione s.f.<br />
(Dir) (di leggi) mise en application. ED, HP “(di legge, provvedimento) adoption”<br />
441 Présent dans TLFi.<br />
442 G a ce même ED.<br />
443 G e ce même ED.<br />
343
adulabile agg.m./f.<br />
sensible à la flatterie, qui se laisse flatter. ES, B confirme<br />
adulterante II s.m.<br />
substance f. frauduleuse, substance f. qui ajoutée à un produit l’altère. ED, G “(chim.)<br />
adultérant” 444<br />
aeremoto s.m.<br />
(Meteor) mouvement atmosphérique. ET, B confirme 445<br />
aeriforme II s.m.<br />
fluide aériforme. ED, B “gaz”<br />
aerobrigata s.f.<br />
(Mil) brigade aérienne. ED, B “(aer., mil.) escadrille” 446<br />
aerocentro s.m.<br />
1 village aéronautique. ES, G confirme<br />
2 (Mil) base f. aérienne. ET, absent ailleurs<br />
aerofaro s.m.<br />
(Aer) feu aéronautique. ED, B “(aer.) aérophare” 447<br />
aerofonista s.m.<br />
(Mil) opérateur de cornet acoustique. ET, absent ailleurs<br />
aerofono s.m.<br />
(Aer,Mil) cornet acoustique. ED, B “(aer., mus.) aérophone”<br />
aerofotografia s.f.<br />
(Fot) (tecnica) photographie aérienne. ED, B “(aer., top.) aérophotographie” 448<br />
444 Absent dans PR11 et TLFi, mais présent dans Google. B propose « substance altérante », ED ; HP<br />
propose « qui provoque une altération » (ED), un deuxième ED c’est pour l’adjectif, traduit par HP « qui<br />
provoque une altération », alors que SL suggère « altérant ».<br />
445 S.v. aeromoto.<br />
446 G a ce même ED.<br />
447 Absent dans PR11 et TLFi, mais présent dans Google. G a ce même ED.<br />
344
aerofotogramma s.m.<br />
(Fot) photogramme aérien. ET, G confirme<br />
aerofotogrammetria s.f.<br />
1 (rilevamento) levé m. topographique. ET, acception absente ailleurs<br />
2 (studio del rilevamento) photogrammétrie aérienne. ED, B “(aer., fis.)<br />
aérophotogrammétrie” 449<br />
aerolinea s.f.<br />
(Aer) ligne aérienne. ET, B, G et HP confirment<br />
aeronavigazione s.f.<br />
(Aer) navigation aérienne. ED, B “aéronavigation” 450<br />
aeroportuale s.m./f.<br />
(Aer) employé m. d’un aéroport: gli aeroportuali le personnel des aéroports. ET, G et HP<br />
confirment<br />
aeropostale s.m.<br />
(Aer,Post) avion postal. ET, B, G et HP confirment<br />
aeroreattore s.m.<br />
1 (Mot) moteur à réaction. ET, acception absente ailleurs<br />
2 (Aer) avion à réaction. ED, B “(aer.) aéroréacteur” 451<br />
aerosbarco s.m.<br />
(Mil) débarquement aérien. ET, B, G et HP confirment<br />
aeroscalo s.m.<br />
(Aer) escale f. aérienne. ED, G “aéroport, aérodrome” 452<br />
aeroscivolante agg.m./f.<br />
448 Absent dans PR11 et TLFi, mais présent dans Google. G et HP aussi ont ce même ED.<br />
449 G a ce même ED.<br />
450 G a ce même ED.<br />
451 Mot absent partout ailleurs, avec de très rares occurrences en Google. G a ce même ED.<br />
452 B a ce même ED.<br />
345
à coussin d’air. ET, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
aerosilurante s.m.<br />
(Mil) avion torpilleur. ET, B, G et HP confirment<br />
aerosiluro s.m.<br />
(Mil) torpille f. aérienne. ET, B, G et HP confirment<br />
aerospazio s.m.<br />
espace aérien. ES, absent ailleurs<br />
aerotrasportare v.tr.<br />
transporter par avion. ES, B, G et HP confirment<br />
aerotrasporto s.m.<br />
transport par avion. ES, B, G et HP confirment<br />
aerovia s.f.<br />
(Aer) couloir m. aérien. ET, B, G et HP confirment<br />
afa s.f.<br />
chaleur accablante, chaleur étouffante: che afa! qu’est-ce qu’il fait lourd! ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
afelio agg.<br />
d’aphélie. EM, B confirme<br />
affacciato agg.<br />
1 (che sta alla finestra) à la fenêtre. ED, HP “(alla finestra) penché”, G “appuyé (à la fenêtre<br />
ecc.)”<br />
2 (rar) (faccia a faccia) l’un en face de l’autre. ES, G confirme<br />
affamato s.m.<br />
al pl. gens qui ont faim: dar da mangiare agli affamati donner à manger aux gens qui ont<br />
faim. ED, B “affamé”<br />
346
affannare 453 v.prnl. affannarsi<br />
(fig) (affaticarsi) se donner du mal, se donner de la peine, se fatiguer: affannarsi per acquistare<br />
ricchezze se donner du mal pour gagner de l’argent. ED, G “se fatiguer (à), (darsi molto da<br />
fare) s’évertuer (à)” 454<br />
affannosamente avv.<br />
avec peine: respirare affannosamente haleter, souffler. ED, B “péniblement” 455<br />
affaraccio s.m.<br />
vilaine affaire f. EM, B et G confirment<br />
affardellare v.tr.<br />
1 (mettere insieme) mettre en ballot, mettre en paquet: affardellare la roba mettre les affaires<br />
en paquet. ES, B, G et HP confirment<br />
3 (Mil) faire son packetage: affardellare lo zaino faire son packetage. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
affarone s.m.<br />
(iron) bonne affaire f. ES, B, G et HP confirment<br />
affaruccio s.m.<br />
affaire f. de rien. EM, B et G confirment<br />
affastellamento s.m.<br />
fait de mettre en fagots. ED, G “(di legno) fagotage; (di paglia, fieno) bottelage”<br />
affaticarsi v.prnl.<br />
(adoperarsi) se donner de la peine: non affaticarti troppo ne te donne pas trop de peine. ED,<br />
G “peiner” 456<br />
affatto avv.<br />
(preceduto da una negazione) du tout: non mi è affatto antipatico il ne m’est pas du tout<br />
antipathique; non sei affatto cambiato tu n’as pas changé du tout; non sono affatto<br />
453 Dans ce verbe il y a un ED dans B, qui traduit la première acception “couper le souffle: salire le scale mi<br />
affanna, monter les escaliers me coupe le souffle”, alors que SL propose correctement aussi “essoufler”.<br />
454 HP a ce même ED.<br />
455 G et HP ont ce même ED.<br />
456 B aussi a cet ED, traduisant “se donner du mal, se donner de la peine”.<br />
347
contento je ne suis nullement content, je ne suis pas content du tout; il nome non mi è<br />
affatto nuovo le nom ne m’est pas tout à fait inconnu. ES, B, G et HP confirment<br />
affermabile agg.m./f.<br />
qu’on peut affirmer. EM, B, G et HP confirment<br />
affermare v.tr.<br />
(rar) (dire di sì) répondre que oui; (col capo) faire signe que oui. ES, G confirme<br />
affermazione s.f.<br />
(Sport) (vittoria) victoire écrasante, victoire sans conteste. ED, HP “succès, exploit,<br />
performance”<br />
afferrabile agg.m./f.<br />
(che si può afferrare) qui peut être saisi, qu’on peut saisir. EM, HP confirme<br />
affettare 2 v.tr.<br />
(fingere) faire semblant de: affettare di sapere qcs. faire semblant de savoir qqch. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
affettato 1<br />
s.m. 457<br />
(Alim) charcuterie f. coupée en tranches: affettati misti charcuterie assortie. ED, B et HP<br />
“charcuterie”<br />
affettivamente avv.<br />
sur le plan affectif. EM, HP confirme<br />
affettuosità s.f.<br />
(caratteristica) nature affectueuse, caractère m. affectueux. ED, HP “tendresse,<br />
attachement” 458<br />
affiancare v.tr.<br />
(rif. a cose: mettere al fianco) mettre l’un à côté de l’autre, mettre côte à côte, placer l’un à côté<br />
de l’autre: affiancare due tavoli mettre deux tables l’une à côté de l’autre, mettre deux tables<br />
côte à côte. ED, B “accoler” 459<br />
457 Pour la catégorie de l’adjectif, G traduit “coupé en tranches”, ce qui est un ED (SL: “coupé”).<br />
458 B et G aussi ont cet ED “nature affectueuse”. Dans une deuxième acception, B a un autre ED: “marques<br />
d’affection, de tendresse” alors que SL traduit tout simplement “tendresses”.<br />
348
II prnl. affiancarsi 460<br />
1 (rif. a auto) se placer à côté (a de), s’arrêter à côté (a de). ED, B “s’accoler” 461<br />
2 (rif. a persona: mettersi al fianco) se mettre à côté (a de). ES, B confirme<br />
4 (Mil) défiler côte à côte, défiler en rangs. ET, acception absente ailleurs<br />
III prnl.recipr. affiancarsi<br />
(mettersi l’uno al fianco dell’altro) se placer côte à côte. ES, G confirme<br />
affiancato agg.<br />
placé côte à côte, côte à côte, l’un à côté de l’autre: i due tavoli sono affiancati les deux<br />
tables sont placées côte à côte, les deux tables sont l’une à côté de l’autre; marciate<br />
affiancati! marchez côte à côte! ES, B, G et HP confirment<br />
affiatare v.tr.<br />
1 mettre d’accord, créer une entente entre. ED, B “harmoniser, accorder” 462<br />
3 (Mus) entraîner à jouer ensemble. ES, HP confirme<br />
II prnl. affiatarsi 463<br />
2 (Sport) développer l’esprit d’équipe, faire preuve de solidarité. ED, G “s’entendre”<br />
3 (Mus) s’entraîner à jouer ensemble. ES, HP confirme<br />
affiatato agg.<br />
1 (che va d’accordo) en accord, en harmonie. ED, B “homogène, uni”<br />
3 (rif. a coppia) bien assorti, en accord. ES, acception absente ailleurs<br />
affibbiare v.tr.<br />
(fig) (attribuire) faire endosser: affibbiare a qcu. la responsabilità di qcs. faire endosser la<br />
responsabilité de qqch. à qqn. ES, B confirme<br />
affibbiatura s.f.<br />
459 G a ce même ED.<br />
460 B a aussi un autre ES, acception absente ailleurs: “parvenir à la hauteur (de): un secondo corridore affiancò<br />
il primo sulla linea del traguardo, un deuxième coureur parvint à la hauteur du premier sur la ligne d’arrivée”.<br />
461 HP a ce même ED.<br />
462 G et HP aussi ont ce même ED.<br />
463 B engendre un ED, traduisant “bien s’entendre”, alors que SL traduit “s’entendre, symphatiser”.<br />
349
(rar) (l’affibbiare) action de boucler. ED, B “laçage; agrafage” 464<br />
affidabile agg.m./f.<br />
(credibile, attendibile) digne de confiance. ES, acception absente ailleurs<br />
affidamento s.m.<br />
(l’affidare) action f. de confier: l’affidamento di un incarico l’action de confier une tâche.<br />
EM, acception absente ailleurs<br />
affidatario I agg.<br />
(Dir) d’accueil, qui a pris un enfant en placement. ES, catégorie grammaticale absente<br />
ailleurs<br />
II s.m.<br />
(Dir) (di minori) parent d’accueil. ED, G “(di minore) tuteur”<br />
affienare v.tr.<br />
(di bestiame) donner du foin à. ES, G confirme<br />
affiliata s.f.<br />
(Econ) société affiliée. ET, HP confirme<br />
affiliato s.m.<br />
(Comm) société f. affiliée, concessionnaire franchisé. ET, HP confirme<br />
affine s.m./f.<br />
(parente acquisito) parent m. par alliance. ED, B “allié”<br />
affiorare v.intr.<br />
(fig) (venire alla luce) être dévoilé, être découvert: presto o tardi la verità affiora tôt ou tard, la<br />
vérité est dévoilée. ED, G “affleurer; émerger” 465<br />
affitta(n)si s.m.inv.<br />
(cartello) à louer. EM, B confirme<br />
affliggersi v.prnl.<br />
464 G a ce même ED.<br />
465 B aussi a cet ED, dans l’acception 5 : « (fig.) se faire jour: a poco a poco la verità affiora, peu à peu la vérité<br />
se fait jour ».<br />
350
(rattristarsi) être affligé (per de), être attristé (per par), être chagriné (per par): affliggersi per le<br />
disgrazie altrui être affligé du malheur des autres. ED, B “s’affliger, se désoler”<br />
affogato s.m.<br />
(Dolc) crème f. glacée noyée dans une boisson (café, whisky, brandy). ES, catégorie<br />
grammaticale absente ailleurs<br />
affondamento s.m.<br />
(il mandare a fondo) envoi par le fond. ES, G confirme<br />
affondamine s.m.inv.<br />
(Mar) mouilleur m. de mines. ET, B et HP confirment<br />
affondo s.m.<br />
2 (Sport) (nel calcio) passe f. en profondeur. ES, G confirme 466<br />
4 (fig) (attacco rapido e deciso) attaque f. décisive. ES, acception absente ailleurs<br />
affossare v.tr.<br />
(fare fosse di scolo) creuser des fossés: affossare un campo creuser des fossés dans un champ.<br />
ES, B confirme<br />
affrancabile agg.m./f.<br />
(Post) que l’on peut affranchir. ED, G “(di lettere ecc.) affranchissable”<br />
affrescare v.tr.<br />
(Pitt) peindre à fresque: affrescare una parete peindre à fresque un mur. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
affrescato agg.<br />
(Pitt) décoré de fresques. ES, B et G confirment<br />
affumicare v.tr.<br />
(annerire) noircir de fumée. ED, B “noircir”<br />
affumicata s.f.<br />
léger fumage m., fumaison légère. ES, absent ailleurs<br />
466 G ajoute l’acception “(corsa) allongement de la foulée”, ED car SL traduit « (Sport) (nella corsa)<br />
accélèration ».<br />
351
affumicato agg.<br />
(annerito di fumo) noirci de fumée, (ant) enfumé: una pentola affumicata une casserole noircie<br />
de fumée. ES, B confirme<br />
africanismo s.m.<br />
(Stor) politique f. d’expansion coloniale en Afrique. ES, G confirme<br />
afrore s.m.<br />
odeur f. âcre. ES, B, G et HP confirment<br />
agenda s.f.<br />
(ordine del giorno) ordre m. du jour. ES, B et G confirment<br />
agendina s.f.<br />
agenda m. de poche. EM, G et HP confirment<br />
agenzia s.f.<br />
(Giorn) dépêche d’agence, communiqué m. de presse. ES, HP confirme<br />
agevolare v.tr.<br />
(Econ) accorder des facilités à: agevolare qcu. nei pagamenti accorder des facilités de<br />
paiement à qqn. ES, G confirme<br />
aggettivare v.tr.<br />
(rar) (usare aggettivi) employer des adjectifs. ES, G confirme<br />
aggettivazione s.f.<br />
(Gramm) emploi m. des adjectifs. ET, B, G et HP confirment<br />
agghiacciare v.intr.<br />
(fig) (inorridire) être glacé d’horreur. ES, HP confirme<br />
agghindamento s.m.<br />
(rar) (l’agghindarsi) action f. de se parer. ED, B “bichonnage” 467<br />
aggiornamento s.m.<br />
467 Mot absent du PR11 mais présent dans le TLFi.<br />
352
(Inform) mise f. à jour. ET, acception absente ailleurs 468 .<br />
aggiornare v.tr.<br />
1 (mettere al corrente) mettre au courant. ES, G et HP confirment<br />
4 (rivedere: rif. a registri e contabilità) mettre à jour. ES, B, G et HP confirment<br />
9 (Elettron) (rif. a immagine) mettre à jour. ET, acception absente ailleurs 469<br />
II prnl. aggiornarsi<br />
1 (adeguarsi ai tempi) se mettre au courant: (scherz) aggiornati! mets-toi au courant! ES, B, G et<br />
HP confirment<br />
2 (tenersi al corrente) se tenir au courant, se tenir informé; (a livello professionale, con un corso) se<br />
recycler. ES, B et HP confirment<br />
3 (di seduta, assemblea e sim.) être ajourné. ES, G confirme<br />
aggravante s.f.<br />
(Dir) circonstance aggravante. ET, B, G et HP confirment<br />
aggressivo s.m.<br />
1 (Chim,Mil) gaz de combat: aggressivi chimici agents chimiques. ET, G et HP confirment<br />
2 personne f. agressive. ED, G “(psic.) agressif ”<br />
aggressore agg.m./f.<br />
qui agresse. ED, B et G “agresseur”<br />
agguagliare v.tr.<br />
(lett) (adeguare) exprimer de manière adéquate. ES, acception absente ailleurs 470<br />
agibile agg.m./f.<br />
(di edificio: sicuro) conforme aux normes de sécurité. ED, G “(di edificio) habitable”<br />
agibilità s.f.<br />
(di edificio: sicurezza) conformité aux normes de sécurité. ED, HP “(di abitazione) habitabilité”<br />
468 HP ajoute l’acception “GIORN. (notizia) dernière minute”, ES.<br />
469 B ajoute l’acception “remettre à plus tard”, ES.<br />
470 B ajoute l’acception (absente ailleurs) “(mat.) rendre égal”, ET. G ajoute l’acception (absente ailleurs) « (fig.)<br />
(mettere alla pari) mettre sur le même plan », ES.<br />
353
agitabile agg.m./f.<br />
1 qu’on peut agiter, qu’on peut secouer. ED, G “(non com.) (solo di cosa) agitable” 471<br />
2 (rar) (di persona: impressionabile) facilement impressionnable, très émotif. ED, B “(fig.)<br />
impressionnable” 472<br />
agliaio s.m.<br />
(Agr) champ d’ail. ES, B confirme<br />
agnolotto s.m.<br />
(Gastron) type de ravioli. ED, G “agnolotti (sorte de raviolis farcis de viande)”<br />
agoaspirato s.m.<br />
(Med) échantillon d’une cytoponction. ET, absent ailleurs<br />
agonismo s.m.<br />
(estens) esprit de compétition. ES, B, G et HP confirment<br />
agonistica s.f. (Sport) (spec. rif. a ginnastica e nuoto) pratique d’un sport de compétition. ED, B<br />
et G “agonistique” 473<br />
agonistico agg.<br />
(Sport) de compétition: sport agonistico sport de compétition, sport de haut niveau. EM, B,<br />
G et HP confirment<br />
agostano agg.<br />
du mois d’août, d’août. EM, B, G et HP confirment<br />
agrario 474 s.m.<br />
1 (proprietario terriero) propriétaire foncier. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (contadino) exploitant agricole. ES, acception absente ailleurs<br />
agretto 475 s.m.<br />
471 B a ce même ED.<br />
472 G a ce même ED.<br />
473 HP aussi a ce même ED. « Agonistique » est présent dans les TLFi, mais avec ce sens : « ANTIQ. Art des<br />
athlètes; partie de la gymnastique les préparant aux combats des jeux publics ».<br />
474 G et HP ajoutent l’acception « spécialiste en agronomie », ES.<br />
475 G ajoute l’acception « (bot.) cresson alénois », ED car SL traduit « (Bot) alitort ».<br />
354
goût aigre, goût aigrelet. ED, G “(sapore agro) aigre” 476<br />
agrippina s.f.<br />
(Arred) divan m. duchesse. ED, G “(divano) récamier, méridienne”<br />
agriturismo s.m.<br />
2 (estens) (azienda agricola) ferme f. proposant des séjours en agritourisme. ES, HP confirme<br />
3 (estens) (ristorante) ferme f. restaurant. ES, absent ailleurs<br />
agrumario agg.<br />
d’agrumes: la produzione agrumaria della Sicilia la production d’agrumes de la Sicile. EM,<br />
B confirme<br />
agrumeto s.m.<br />
verger agrumicole, plantation f. d’agrumes. ES, B, G et HP confirment<br />
aiutare v.tr.<br />
(assol.) être utile: un po’ di buon umore aiuta la bonne humeur est toujours utile. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
II prnl. aiutarsi<br />
(ingegnarsi) faire de son mieux: si aiuta come può il fait du mieux qu’il peut. ES, acception<br />
absente ailleurs<br />
aiuto s.m.<br />
(Med) médecin assistant. ED, G “assistant”<br />
alabardato agg.<br />
1 (Mil,ant) (munito di alabarda) armé d’une hallebarde. ES, HP confirme<br />
2 (a forma di alabarda) en forme de hallebarde. ES, HP confirme<br />
alabastrino agg.<br />
1 (in alabastro) en albâtre, d’albâtre. ED, G “alabastrin” 477<br />
2 (lett,fig) (simile all’alabastro) d’albâtre: mani alabastrine mains d’albâtre. ES, acception<br />
absente ailleurs<br />
476 B et HP ont ce même ED.<br />
477 B et HP aussi ont ce même ED.<br />
355
alacremente avv.<br />
avec ardeur, avec entrain. EM, B, G et HP confirment<br />
alaggio s.m.<br />
(Mar,estens) (manovra per tirare in secco un natante) mise f. au sec. ET, acception absente<br />
ailleurs<br />
albeggiamento s.m.<br />
(rar) point du jour, lueurs f.pl. de l’aube. ES, B et G confirment<br />
albeggiare 1<br />
v.intr.impers.<br />
faire jour (aus. avoir): albeggia il fait jour. ES, B, G et HP confirment<br />
II intr.<br />
1 (lett) (biancheggiare) briller d’une lumière blanche. ED, HP “LETT. (risplendere) briller,<br />
éclater, rayonner”<br />
2 (fig) (essere agli inizi) commencer à poindre. ED, B “se lever”<br />
albeggiare 2<br />
s.m.<br />
point du jour: partirono al primo albeggiare il partirent au point du jour. ES, G confirme<br />
alberaggio s.m.<br />
(Stor,Mar) taxe f. sur les marchandises. ET, absent ailleurs<br />
alberare v.tr.<br />
border d’arbres, planter d’arbres: alberare un viale border une allée d’arbres. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
alberato agg.<br />
bordé d’arbres, planté d’arbres: una strada alberata une rue bordée d’arbres. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
alberatura s.f.<br />
plantation d’arbres. ED, B “(insieme di alberi) arbres”<br />
albereto s.m.<br />
356
(rar) plantation f. d’arbres, terrain planté d’arbres. ES, B, G et HP 478 confirment<br />
albicoccheto s.m.<br />
verger d’abricotiers. ES, B confirme<br />
albo 1<br />
s.m.<br />
1 (tavola per affissi) tableau d’affichage. ED, B “tableau”<br />
4 (rar) (per fotografie) album photos. ED, G “album”<br />
albore s.m.<br />
(lett) (alba) premières lueurs f.pl. du jour, premières lueurs f.pl. de l’aube: si svegliò agli albori<br />
del giorno il s’éveilla aux premières lueurs du jour. ES, B, G et HP confirment<br />
albume s.m.<br />
(Alim) blanc d’oeuf. ES, acception absente ailleurs<br />
alchimia s.f.<br />
(fig) (manovra subdola) manœuvre frauduleuse. ED, B “manœuvre, intrigue”<br />
alchimizzare v.intr.<br />
(esercitare l’alchimia) pratiquer l’alchimie. ES, G confirme<br />
alcolicità s.f.<br />
teneur en alcool. ES, B, G et HP confirment<br />
aldiquà s.m.<br />
(rar) vie f. terrestre, vie f. ici-bas. ES, absent ailleurs<br />
aleatorietà s.f.<br />
caractère m. aléatoire. ES, B, G et HP confirment<br />
aleggiare v.intr.<br />
1 (lett,fig) souffler légèrement: la brezza aleggiava tra le foglie la brise soufflait légèrement<br />
entre les feuilles. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (fig) (essere nell’aria) y avoir dans l’air, flotter dans l’air: nella stanza aleggiava un clima di<br />
mistero dans la pièce régnait un climat mystérieux. ED, B “flotter”<br />
478 Avec un renvoi à albereta.<br />
357
4 (lett,rar) (muovere le ali) battre des ailes. ED, HP “voltiger”<br />
alettare v.tr.<br />
(Mecc) mettre des ailettes à. ED, B “(tecnol.) aileter”<br />
alettato agg.<br />
(Mecc) à ailettes. ET, B confirme<br />
alfabeticamente avv.<br />
par ordre alphabétique. ED, B “alphabétiquement”<br />
alfabetizzare v.tr.<br />
(rar) (mettere in ordine alfabetico) ordonner par ordre alphabétique. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
alfana s.f.<br />
(Zool) cheval m. arabe. ET, B confirme<br />
alfiere 1 s.m.<br />
(Sport) chef d’équipe. ES, B 479 et G confirment<br />
algale agg.m./f.<br />
(Bot) des algues. EM, B confirme<br />
algoso agg.<br />
(lett) plein d’algues. ED, G “(non com.) algueux”<br />
alimentarista s.m./f.<br />
(lavoratore) ouvrier m. de l’industrie alimentaire. ES, B et G confirment<br />
alimentatore s.m.<br />
(chi alimenta) personne f. qui nourrit, personne f. qui donne à manger. EM, B et G<br />
confirment<br />
alitare v.intr.<br />
(lett) (soffiare leggermente) souffler légèrement: il vento alitava fra le foglie le vent soufflait<br />
légèrement entre les feuilles. ED, HP “(soffiare lievemente) souffler” 480<br />
479 Ajoute l’acception “(mar., mil.) enseigne de vaisseau”, ET.<br />
358
allagarsi v.prnl.<br />
(coprirsi d’acqua) ) être inondé, être submergé par les eaux. ES, B, G et HP confirment<br />
allargare v.tr.<br />
(assol.) (Cin,TV) ) faire un zoom arrière. ES, acception absente ailleurs<br />
allargatoio s.m.<br />
(Mecc) foret aléseur. ED, G “( “(mecc.) alésoir”<br />
allarmare v.tr.<br />
1 (mettere in stato di allarme) ) mettre en état d’alerte. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (dotare di allarme) ) doter d’un système d’alarme. ES, acception absente ailleurs<br />
allattare v.tr.<br />
(artificialmente) ) donner le biberon à. ES, acception absente ailleurs<br />
allegato agg.<br />
(venduto insieme) ) qui l’accompagne: il CD CD-ROM ROM allegato contiene tutte le istruzioni le CD CD-<br />
ROM qui l’accompagne contient toutes les instructions. ES, acception absente ailleurs<br />
alleggerirsi v.prnl.<br />
(indossare panni più leggeri) ) s’habiller plus légèrement. ES, B, G et HP confirment<br />
allegramente avv.<br />
(alla leggera) à la légère. ED, G “( “(senza preoccuparsi) allégrement”<br />
allevare v.tr.<br />
(rif. a piante) faire pousser. ED, B “( “(di piante) cultiver” 481<br />
allibire v.intr.<br />
(estens) (restare sbigottito) ) rester interdit, rester pantois. ES, B, G et HP confirment<br />
allicciare v.tr.<br />
(Fal) ) donner de la voie à (une scie). ED, B “avoyer” 482<br />
480 B a le même ED que SL.<br />
481 B met en évidence à son tour un autre ED, traduisant “( “(di animali, a scopo di sfruttamento) ) faire l’élevage (de)”,<br />
alors que SL propose “(rif. rif. ad animali animali) élever”.<br />
359
allocativo agg.<br />
des allocations, d’allocation. EM, absent ailleurs<br />
allocchire v.intr. (lett)<br />
(rimanere sbalordito) être stupéfait, être abasourdi. ES, B et G confirment<br />
allocutorio agg.<br />
(Ling) d’allocution. ET, B et G confirment<br />
allogenico agg.<br />
causé par des facteurs extérieurs. ET, acception absente ailleurs<br />
allontanare 483 v.prnl. allontanarsi<br />
2 (in modo furtivo) s’en aller furtivement. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (tenersi lontano) se tenir éloigné. ES, acception absente ailleurs<br />
allora 484 agg.m./f.inv.<br />
de l’époque, d’alors, de ce temps-là: l’allora direttore le directeur de l’époque, le directeur<br />
d’alors, le directeur de ce temps-là. ES, B, G, et HP confirment<br />
allotropia s.f.<br />
(Ling) coexistence de doublets. ET, acception absente ailleurs<br />
alludere v.intr.<br />
faire allusion (a à): non so a chi tu voglia alludere je ne vois pas à qui tu fais allusion. ES, B,<br />
G et HP confirment<br />
allungabile agg.m./f.<br />
qu’on peut allonger, qu’on peut rallonger: tavolo allungabile table à rallonges. ED, B<br />
“allongeable”<br />
482 G et HP ont ce même ED que SL. B ajoute deux acceptions, avec marque (tess.): “rentrer (la chaîne) dans<br />
les lisses” et “effectuer le lissage”. L’une des deux est sans aucun doute un ED, car SL traduit son acception 1:<br />
“(Tess) encroiser” (absent du PR11).<br />
483 B ajoute l’acception “faire le vide: ha un modo di fare che allontana, il a des manières qui font le vide<br />
autour de lui”, un autre ES.<br />
484 B propose, pour l’acception 2: “à cette époque, à ce moment-là: allora c’erano i tram a cavalli, à cette<br />
époque, il y avait des tramways à chevaux; fu allora che lo conobbi, ce fut à ce moment-là que je fis sa<br />
connaissance [...]”; il s’agit d’un ED car SL traduit “(in quel tempo) alors”.<br />
360
allungare v.<br />
(Sport) (spec. nel calcio: passare) faire une passe en profondeur. ES, G confirme<br />
allungo s.m.<br />
(Sport) (rif. al calcio, alla pallacanestro) longue passe f., passe f. en profondeur. ES, B, G 485 et<br />
HP confirment<br />
allusività s.f.<br />
caractère m. allusif. ES, G confirme<br />
aloe, aloè s.m./f.inv.<br />
(legno) bois m. d’aloès. ES, acception absente ailleurs<br />
alofauna s.f.<br />
(rar) faune marine. ET, B confirme<br />
aloflora s.f.<br />
(rar) flore marine. ET, B confirme<br />
alogena s.f.<br />
lampe halogène. ED, B “halogène”<br />
alpe s.f.<br />
(lett) (montagna) haute montagne. ES, B et HP confirment<br />
alpeggiare I v.tr.<br />
conduire aux alpages. ES, B, G et HP confirment<br />
II intr.<br />
être aux alpages. ES, B, G et HP confirment<br />
alpeggio s.m.<br />
(estens) (malga) cabane f. de berger. ES, acception absente ailleurs<br />
alpigiano s.m.<br />
habitant des Alpes. ED, B “ montagnard”<br />
485 Ajoute l’acception « (atletica) allongement de la foulée », ED car SL traduit « (rif. all’atletica, all’ippica)<br />
accélération ».<br />
361
alpino s.m.<br />
(Mil) militaire appartenant aux troupes alpines italiennes: gli Alpini les Alpins, les chasseurs<br />
alpins. ED, B et G “(mil.) (chasseur) alpin” 486<br />
alsaziano s.m.<br />
(Zool) (pastore tedesco) berger alsacien. ET, G confirme<br />
altamente avv.<br />
(lett) (nobilmente) avec noblesse. ED, G “noblement”<br />
altarino s.m.<br />
(piccolo altare) autel portatif. EM, B et HP confirment<br />
alteramente avv. (rar)<br />
(sdegnosamente) avec hauteur, avec dédain. ES, acception absente ailleurs<br />
altezzosamente avv.<br />
avec hauteur, avec condescendance. ED, G “hautainement” 487<br />
altimetria s.f.<br />
(Sport) profil m. de l’étape. ES, acception absente ailleurs<br />
altissimo agg.<br />
(molto alto) très haut. EM, B confirme<br />
altolà s.m.<br />
ordre de s’arrêter: dare l’altolà a qcu. donner à qqn l’ordre de s’arrêter. ED, B “halte”<br />
altrui s.m.inv.<br />
(lett) (la proprietà degli altri) bien m. d’autrui. ES, B confirme<br />
altruisticamente avv.<br />
de façon altruiste, de manière altruiste. EM, G confirme<br />
alturiere s.m.<br />
486 HP a ce même ED. B et G optent évidemment pour une traduction-acclimatation, proposant une<br />
transposition culturelle.<br />
487 B aussi a ce même ED.<br />
362
(Mar) pilote hauturier. ET, G confirme<br />
alzabandiera s.m.inv.<br />
lever m. du drapeau, salut m. au drapeau. ES, G et HP confirment<br />
alzabile agg.m./f.<br />
qu’on peut soulever. EM, absent ailleurs<br />
alzaia s.f.<br />
1 (Mar) (fune) câble m. de halage. ED, B “(fune) aussière”<br />
2 (Strad) chemin m. de halage. ED, B “(strada) lé”<br />
alzataccia s.f.<br />
lever m. à l’aurore, (colloq) lever m. aux aurores. ES, acception absente ailleurs<br />
amarena s.f.<br />
(sciroppo) sirop m. de griotte. ES, G confirme<br />
amaro s.m.<br />
(sapore amaro) goût amer: sapere di amaro avoir un goût amer. ES, B et G confirment<br />
amarognolo I agg.<br />
légèrement amer. EM, B, G et HP confirment<br />
II s.m.<br />
léger goût amer. ES, B et HP confirment<br />
amatoriale agg.m./f.<br />
1 en amateur (anche Sport): cinema amatoriale cinéma amateur, cinéma en amateur; sport<br />
amatoriale sport en amateur. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (da intenditore) de connaisseur. ES, acception absente ailleurs<br />
ambiatore s.m.<br />
(Equit) cheval ambleur. ET, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
ambigenere agg.m./f.inv.<br />
(Gramm) des deux genres. ET, B, G et HP confirment<br />
363
ambosessi<br />
I agg.m./f.inv.<br />
homme ou femme, des deux sexes. ES, B, G et HP confirment<br />
II s.m.pl.<br />
homme ou femme, H/F: cercasi ambosessi per attività di rappresentante on recherche<br />
représentants (H/F). ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
ambra s.f.<br />
(colore) couleur d’ambre. ES, B confirme<br />
ambulanza s.f.<br />
(Mil) ambulance volante. ET, acception absente ailleurs<br />
amebico agg.<br />
(Med) d’amibe, provoqué par une amibe. ED, B “(med.) amibien”<br />
americana s.f.<br />
(Sport) course à l’américaine. ED, B “(ciclismo) américaine” 488<br />
americanata s.f.<br />
(iron) chose typiquement américaine, chose extravagante. ES, G et HP confirment<br />
americanistica s.f.<br />
études pl. américaines. ES, G confirme 489<br />
amicarsi v.prnl.<br />
(rar,lett) se lier d’amitié. ES, B confirme<br />
amichetta s.f.<br />
1 petite amie, petite copine. ES, B et G et confirment<br />
2 (fidanzata, amante) petite amie, petite copine. ED, B “(innamorata) amie”<br />
amichetto s.m.<br />
1 petit ami. ES, B et G confirment<br />
488 B a un ET: “(cine.) nuit américaine”.<br />
489 B traduit “américanisme”, mais il s’agit de l’acception 1 de G, « studio delle civiltà americane ».<br />
364
2 (fidanzato, amante) petit ami, petit copain. ES, B et G confirment<br />
amichevole s.f.<br />
(Sport) (incontro) rencontre amicale. ES, HP confirme<br />
amicone s.m.<br />
meilleur ami, grand ami. ED, HP “compagnon” 490<br />
ammaccarsi v.prnl.<br />
(estens) (rif. a parti del corpo) se couvrir de bleus. ES, G confirme<br />
ammaestrabile agg.m./f.<br />
qu’on peut dresser. EM, B, G et HP confirment<br />
ammainabandiera s.m.inv.<br />
salut m. aux couleurs. ES, B, G et HP confirment<br />
ammalarsi v.prnl.<br />
tomber malade: per il dolore si ammalò e morì il tomba malade de chagrin et mourut. ES,<br />
B, G et HP confirment<br />
ammanigliato agg.<br />
(fig,colloq) qui a ses entrées: essere ben ammanigliato in un ambiente avoir ses entrées dans<br />
un milieu. ES, B, G et HP confirment<br />
ammantare v.tr.<br />
(lett) (coprire di un manto) couvrir d’un manteau. ED, HP “(di vesti) parer” 491<br />
ammassicciare v.tr.<br />
(riunire in massa) réduire en masse compacte. ES, acception absente ailleurs<br />
ammattire v.intr.<br />
devenir fou (anche estens): ammattì per il dolore la douleur le rendit fou. ES, B, G 492 et HP<br />
confirment<br />
ammazzata s.f.<br />
490 G a ce même ED.<br />
491 G a ce même ED.<br />
492 G et HP ajoutent l’acception “(scervellarsi) se creuser la cervelle”, ES.<br />
365
(fig,colloq) travail m. pénible, spesso tradotto con un aggettivo: questo viaggio sarà un’ammazzata<br />
ce voyage sera crevant. ED, B “(fam.) éreintement” 493<br />
ammenda s.f.<br />
(fig) (riparazione) amende honorable: fare ammenda di qcs. faire amende honorable pour<br />
qqch. ED, G “(fig.) (riparazione) amende”<br />
ammesso s.m.<br />
candidat admis, candidat reçu. ED, HP “admis” 494<br />
ammezzato agg.<br />
partagé en deux. ES, HP confirme<br />
ammiccamento s.m.<br />
1 (l’ammiccare) clignement d’oeil, clignement d’yeux. ED, G “nictation, nicitation” 495 , HP<br />
“papillotage”<br />
2 (cenno di intesa) clin d’oeil. ES, G et HP confirment<br />
ammiccare 496 v.intr.<br />
faire un clin d’oeil, cligner de l’oeil. ED 497 , HP “papilloter” 498<br />
ammicco s.m.<br />
clin d’oeil. ES, B, G et HP confirment<br />
amministrazione s.f.<br />
4 (sede) bureaux m.pl. de l’administration. ES, B et G 499 confirment<br />
5 (sala riunioni) salle de conférence, salle du conseil. ES, acception absente ailleurs<br />
ammiraglia s.f.<br />
1 (Mar.mil) navire m. amiral, vaisseau m. amiral. ED, HP “(nave) amiral”<br />
493 G a ce même ED.<br />
494 B a ce même ED.<br />
495 Ces deux termes (variantes) ont pourtant l’étiquette “zool.” et “méd.” dans le PR11.<br />
496 B ajoute l’acception (absente ailleurs) “faire signe (de): gli ammiccò che parlasse, il lui fit signe de parler;<br />
ammiccava all’amico di andarsene, elle faisait signe à son ami de s’en aller”, un autre ES.<br />
497 G a ce même ED.<br />
498 D’après la définition de PR11 (« cligner des paupières »), nous avons des doutes sur cette solution.<br />
499 Ajoute l’acception “(l’insieme degli amministratori) cadres administratifs”, ES.<br />
366
2 (estens) (vettura) vaisseau m. amiral. ES, HP confirme<br />
3 (Sport) (nel ciclismo) voiture du directeur sportif, voiture du directeur technique. ES, B, G et<br />
HP confirment<br />
ammiragliato s.m.<br />
(ministero della marina) ministère de la marine. ED, G “(ministero della marina) Amirauté”<br />
ammodo 500 avv.<br />
1 (con garbo) comme il faut. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (come si deve) comme il faut. ES, acception absente ailleurs<br />
ammogliato s.m.<br />
homme marié. ES, B et G confirment<br />
ammonire 501 v.tr.<br />
(Sport) donner un avertissement à. ES, G et HP confirment<br />
ammonito agg.<br />
(Sport) qui a reçu un avertissement. ES, acception absente ailleurs 502<br />
ammonitore s.m.<br />
personne f. qui met en garde, personne f. qui réprimande. ED, HP “admoniteur”<br />
ammorbidire v.tr.<br />
(Gastron) (rif. a burro) faire ramollir. ED, HP “ramollir [materia, burro]”<br />
ammorsare v.tr.<br />
1 (Tecn) serrer dans un étau, prendre dans un étau. ET, B, G et HP confirment<br />
2 (Edil) faire une harpe. ET, B et G confirment<br />
ammorsatura s.f.<br />
(Fal) assemblage m. à mi-bois. ET, B confirme<br />
500 B, G et HP traduisent “comme il faut” aussi la catégorie de l’adjectif. Autant d’ED, car SL propose<br />
pertinemment “bien”.<br />
501 B propose « mettre en garde » pour l’acception 1, ED car SL propose correctement “avertir”.<br />
502 G a aussi l’acception (absente ailleurs) « (dir.) repris de justice », ET.<br />
367
ammortizzatore s.m.<br />
(El,Acus) support anti-vibratoire. ET, acception absente ailleurs<br />
ammostare v.intr.<br />
(Enol) donner du moût. ET, B, G et HP 503 confirment<br />
ammostatoio s.m.<br />
(Enol) fouloir à raisin. ED, B “(enol.) fouloir” 504<br />
ammutinare v.tr.<br />
(rar) inciter à la mutinerie. ES, B confirme<br />
ammutolire 505 v.intr.<br />
1 (diventare muto) devenir muet. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (tacere improvvisamente) se taire subitement; (per paura, meraviglia) rester muet. ES, B et G<br />
confirment<br />
amorevolezza s.f.<br />
(estens,rar) (atto affettuoso) geste m. de tendresse. ES, acception absente ailleurs<br />
amorino s.m.<br />
(Bot) réséda odorant. ED, B “(bot.) mignonnette” 506<br />
amoroso s.m.<br />
(Teat) jeune premier: recitare la parte dell’amoroso jouer le rôle du jeune premier. ES, B, G<br />
et HP confirment<br />
ampex s.m.<br />
(estens) (videoregistrazione) enregistrement vidéo. ES, acception absente ailleurs<br />
amplesso s.m.<br />
(eufem) (coito) rapport sexuel. ED, HP “(coito) copulation” 507<br />
503 HP traduit « fouler le raisin » le verbe transitif, alors que SL traduit juste « fouler » ; voici donc un ED de<br />
HP.<br />
504 HP a ce même ED.<br />
505 B et G ont aussi un ES pour le verbe transitif: « rendre muet ».<br />
506 G a ce même ED.<br />
368
amplificativo agg.<br />
qui amplifie. ED, “amplificateur”<br />
ampollosamente avv.<br />
d’une manière ampoulée, de manière pompeuse. EM, B, G et HP confirment<br />
amputabile agg.m./f.<br />
qu’on peut amputer. EM, absent ailleurs<br />
anabbagliante I agg.m./f.<br />
(Aut) de croisement. ED, B “(autom.) code”<br />
II s.m. spec. al pl.<br />
(Aut) feu de croisement: mettere gli anabbaglianti mettre ses feux de croisement. ED, B<br />
“(autom.) codes”<br />
anacoretico agg.<br />
(fig) (solitario) d’ermite. ES, acception absente ailleurs<br />
anacronisticamente avv.<br />
de façon anachronique, de manière anachronique. ED, HP “anachroniquement”<br />
anaglittica s.f.<br />
(Art) art m. de la décoration en relief. ED, B “(arte) anaglyptique” 508<br />
anagrafe s.f.<br />
1 (registro) registre m. d’état civil. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (ufficio) bureau m. d’état civil. ES, B, G et HP confirment<br />
anagrafico agg.<br />
de l’état civil: ufficio anagrafico bureau de l’état civil; dati anagrafici état civil. ES, B, G et<br />
HP confirment<br />
analcolico I agg.<br />
sans alcool, non alcoolisé. ES, B, G et HP confirment<br />
507 B et G aussi ont ce même ED.<br />
508 G a ce même ED.<br />
369
II s.m.<br />
boisson f. sans alcool. ES, B, G et HP confirment<br />
analfabetico agg.<br />
qui ne se base pas sur les lettres de l’alphabet. ES, acception absente ailleurs<br />
analitica s.f.<br />
(Mat) géométrie analytique. ET, acception absente ailleurs<br />
analizzatore s.m.<br />
(Rad) (apparecchio di prova) appareil d’essai. ET, acception absente ailleurs<br />
analogamente avv.<br />
d’une manière analogue (a à), d’une façon analogue (a à). ES, B, G et HP confirment<br />
ancata s.f.<br />
(colpo) coup m. de hanche. ES, G confirme<br />
ancheggiante agg.m./f.<br />
(rif. a persona) qui se déhanche, qui roule des hanches. EM, acception absente ailleurs<br />
ancoraggio s.m.<br />
(Mar) (tassa) droits pl. d’ancrage. ET, acception absente ailleurs<br />
ancoressa s.f.<br />
(Mar) ancre borgne. ET, B et G confirment<br />
ancoretta s.f.<br />
1 (Mar) ancre à jet. ET, B confirme<br />
2 (Pesc) hameçon m. triple. ET, B confirme<br />
andare 1 v.intr.<br />
16 (essere di moda) être la mode de: quest’anno vanno le giacche lunghe cette année c’est la<br />
mode des vestes longues, cette année la mode est aux vestes longues. ES, B et G<br />
confirment<br />
18 (avere corso legale) être en circulation: è una moneta che non va più c’est une monnaie qui<br />
n’est plus en circulation, c’est une monnaie qui n’a plus cours. ES, B et G confirment<br />
370
26 (seguito da un participio passato, con valore passivo: dover essere) devoir être: è un particolare che<br />
non va trascurato c’est un détail qui ne doit pas être négligé. ES, G confirme<br />
27 (seguito da un gerundio: per indicare lo svolgersi dell’azione) non si traduce: la malattia va<br />
peggiorando la maladie empire; glielo andavo dicendo da tempo je le lui disais depuis<br />
longtemps. ES, B et HP confirment<br />
28 (seguito da un gerundio: per indicare il ripetersi dell’azione) ne pas arrêter de: andava chiedendo a<br />
destra e a sinistra il n’arrêtait pas de demander à gauche et à droite. ES, absent ailleurs<br />
andata s.f.<br />
(Sport) (girone di andata) premier tour m. ES, acception absente ailleurs<br />
anelare v.intr.<br />
aspirer ardemment (a qcs. à qqch.), désirer tr. ardemment (a qcs. qqch.): anelare alla libertà<br />
aspirer ardemment à la liberté. ED, B “aspirer”<br />
II tr.<br />
aspirer ardemment à, désirer ardemment: anelare la vendetta désirer ardemment la<br />
vengeance. ES, B et G confirment<br />
anelettrico agg.<br />
(Fis) non électrique. ED, B “(fis.) anélectrique”<br />
anello s.m.<br />
(region) (ditale) dé à coudre. ES, acception absente ailleurs<br />
aneroide s.m.<br />
(Fis) baromètre anéroïde. ET, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
anfrattuoso agg.<br />
(lett,rar) plein d’anfractuosités. ED, HP “enfoncé, tortueux”<br />
angelicato agg.<br />
(lett) semblable à un ange: la donna angelicata la femme idéalisée. ED, B “angélisé”<br />
anginoso s.m.<br />
personne f. qui souffre d’une angine. ED, G “angineux” 509<br />
509 B a ce même ED.<br />
371
Angiò n.pr.m. (Stor)<br />
al pl. (angioini) ducs d’Anjou. ES, acception absente ailleurs<br />
angioino s.m.pl.<br />
(Stor) ducs d’Anjou. ES, G confirme<br />
angioletto s.m.<br />
2 (estens) (bambino innocente) petit ange. ES, G confirme<br />
3 (iron) petit saint, enfant de choeur. ES, acception absente ailleurs<br />
anglico agg.<br />
(Stor) des Angles. ES, G et HP confirment<br />
anglistica s.f.<br />
(Ling) études pl. de la langue, de la littérature et de la civilisation anglaise. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
angolare 510<br />
v.tr.<br />
1 (Sport) tirer en diagonale. ES, B et HP confirment<br />
2 (Cin) filmer sous un certain angle. ES, B confirme 511<br />
angolato 512 agg.<br />
(Sport) dans l’angle. ES, G confirme<br />
angolazione s.f.<br />
1 disposition en angle. ES, acception absente ailleurs<br />
2 (Cin) angle m. de prise de vue. ED, HP “FOT. CINEM. angle” 513<br />
4 (Sport) tir m. en diagonale. ES, B confirme<br />
angolino s.m.<br />
1 petit coin. EM, acception absente ailleurs<br />
510 B, G et HP ont aussi l’acception “(disporre ad angolo) disposer en forme d’angle”, donc autant d’ES.<br />
511 G a cette acception comme locution.<br />
512 HP a l’acception “disposé en forme d’angle”, ES.<br />
513 B et G aussi ont ce même ED.<br />
372
2 (estens) (luogo appartato) coin tranquille, endroit à l’écart. ES, acception absente ailleurs<br />
angolosità 514 s.f.<br />
caractère m. anguleux; (di viso) traits m.pl. anguleux. ES, B, G et HP confirment<br />
angosciosamente avv.<br />
avec angoisse. EM, B, G et HP confirment<br />
anguilla s.f.<br />
2 (estens) (persona agile) personne très agile. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (estens) (persona sfuggente) personne fuyante comme une anguille. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
angustamente avv.<br />
1 (di stretta misura) de justesse. ED, HP “étroitement”<br />
2 (meschinamente) avec mesquinerie. ES, acception absente ailleurs<br />
anicino s.m.<br />
(Dolc) (biscotto all’anice) biscuit à l’anis. ES, B, G et HP confirment 515<br />
animabile agg.m./f.<br />
qui peut être animé, qui peut s’animer. EM, absent ailleurs<br />
animalismo s.m.<br />
mouvement de défense des animaux. ES, G et HP confirment<br />
animalista s.m./f.<br />
partisan m. du mouvement de défense des animaux. ES, HP confirme<br />
animarsi v.prnl.<br />
(lett) (prendere coraggio) s’armer de courage. ES, acception absente ailleurs<br />
animatamente avv.<br />
avec animation. EM, B, G et HP confirment<br />
514 B a aussi une deuxième acception “(fig.) caractère anguleux, caractère revêche”, ED car SL propose “(fig.)<br />
(asprezza) rudesse, âpreté”.<br />
515 G et HP ont aussi l’acception “bonbon à l’anis/bonbon au goût anisé”, ES.<br />
373
animosamente avv.<br />
(ostilmente) avec animosité. ES, B, G et HP confirment<br />
animoticon s.f./m.inv.<br />
(Inform) émoticone m. animé, émoticône f. animée. ET, absent ailleurs<br />
anisofillia s.f.<br />
(Bot) caractère m. des plantes anisophylles. ED, G “(bot.) anisophylie”<br />
annacquata s.f.<br />
fait m. de couper légèrement d’eau. ES, G confirme 516<br />
annacquato agg.<br />
coupé d’eau. ED, G et HP “mouillé” 517<br />
annacquatura s.f.<br />
(liquido) liquide m. coupé d’eau; (bevanda) boisson coupée d’eau. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
annaffiata s.f.<br />
arrosage m. léger. ES, B, G et HP confirment<br />
annalistico agg.<br />
des annales, qui concerne les annales. EM, G et HP confirment<br />
annaspare v.intr.<br />
(fig) (arrabattarsi) s’affairer inutilement. ED, HP “(affaccendarsi invano) s’agiter, se débattre”<br />
annataccia s.f.<br />
(rif. a raccolto) mauvaise année. EM, absent ailleurs<br />
annebbiamento s.m.<br />
(formazione di nebbia) formation f. de brouillard. ES, B, G et HP confirment<br />
annidamento s.m.<br />
516 G ajoute une autre acception, « (pioggerella) petite averse » : ED car B traduit tout simplement « (rovescio di<br />
pioggia) averse ».<br />
517 B a le même ED que SL.<br />
374
(l’annidarsi) construction f. d’un nid. ES, absent ailleurs<br />
annidare v.tr.<br />
mettre dans un nid. ED, G “nicher” 518<br />
annientarsi v.prnl.<br />
(fig) s’humilier profondément. ED, G “(annullarsi) s’annihiler”<br />
annodare v.tr.<br />
(fare un nodo a qcs.) faire un noeud à: annodare il fazzoletto per ricordarsi di qcs. faire un<br />
noeud à son mouchoir pour se rappeler qqch. ED, G “nouer”<br />
annona s.f.<br />
(organismo amministrativo) service m. de ravitaillement. ES, HP confirme<br />
annonario agg.<br />
d’approvisionnement, de ravitaillement: leggi annonarie lois sur le ravitaillement; ufficio<br />
annonario bureau d’approvisionnement. EM, B, G et HP confirment<br />
annosità s.f.<br />
fait m. de durer depuis longtemps. ES, G et HP confirment<br />
annottare v.intr.impers.<br />
(lett) faire nuit. ES, B, G et HP confirment<br />
annualità s.f.<br />
1 (entrata annua) revenu m. annuel. ES, G et HP confirment<br />
2 (uscita annua) dépenses pl. annuelles. ES, acception absente ailleurs<br />
annualmente avv.<br />
(di anno in anno) d’année en année. ES, acception absente ailleurs<br />
annullabilità s.f.<br />
possibilité d’annulation. ES, acception absente ailleurs<br />
annusata s.f.<br />
518 HP a ce même ED que SL.<br />
375
fait m. de flairer: dare un’annusata a qcs. flairer qqch. ES, acception absente ailleurs 519<br />
annuvolamento s.m.<br />
(l’addensarsi di nubi) amoncellement de nuages. ES, G et HP confirment<br />
anonima s.f.<br />
1 (Dir) (società anonima) société anonyme. ET, HP confirme<br />
2 (organizzazione criminosa) association de malfaiteurs. ES, absent ailleurs<br />
anonimo s.m.<br />
1 (autore) écrivain anonyme; (pittore) peintre anonyme. ED, G “(autore) anonyme”<br />
2 (rif. all’opera) oeuvre f. anonyme. ES, B et HP confirment<br />
anserino agg.<br />
d’oie, semblable à l’aspect d’une oie: cute anserina chair de poule. ED, HP “(cute) ansérin” 520<br />
anta 2 s.m.pl.<br />
(scherz) âge sing. allant de quarante à quatre-vingt-dix ans: essere negli anta avoir passé la<br />
quarantaine. ED, G “la quarantaine”<br />
antebellico agg.<br />
d’avant-guerre. ES, B et HP confirment<br />
antefatto s.m. spec. al pl.<br />
fait qui précède, événement qui précède: raccontare l’antefatto raconter les faits qui se sont<br />
produits avant. ED, B “antécédents”<br />
anteguerra agg.m./f.inv.<br />
d’avant-guerre: prezzi anteguerra prix d’avant-guerre. ES, B et G confirment<br />
antelucano agg.<br />
(lett,ant) qui précède le lever du jour, qui précède l’aube: ore antelucane heures qui<br />
précèdent le lever du jour. ES, B, G et HP confirment<br />
antemurale s.m.<br />
519 B, G et HP ont juste la locution « dare un’annusata ».<br />
520 B a le même ED que SL.<br />
376
(Mil) défense f. avancée. ED, G “(fortificazioni) braie” 521<br />
anteporre 522 v.tr.<br />
placer avant, placer devant: anteporre lo studio al gioco faire passer les études avant le jeu.<br />
ED, HP “préférer”<br />
antiabbagliante s.m. spec. al pl.<br />
(Aut) feu de croisement. ED, B “(autom.) codes”<br />
antiabortista s.m./f.<br />
opposant m. à l’avortement. ES, B, G et HP confirment 523<br />
antialcolista s.m./f.<br />
partisan m. de l’antialcoolisme. ED, B “antialcoolique” 524<br />
antibagno s.m.<br />
cabinet de toilette. ED, B “vestibule (de salle de bains)”<br />
anticarie 525 s.m.inv.<br />
(Farm) produit m. contre les caries. ET, HP confirme<br />
antichistica s.f.<br />
étude de la langue, de la littérature et de l’histoire classiques. ES, absent ailleurs<br />
anticipare I v.tr.<br />
(fare conoscere anticipatamente) annoncer à l’avance, annoncer par avance. ES, HP confirme<br />
(pagare prima) payer à l’avance. ED, G “(pagare in anticipo) avancer” 526<br />
II intr.<br />
1 (essere in anticipo) être en avance. ES, B 527 , G et HP confirment<br />
521 B a le même ED que SL.<br />
522 HP et G ont aussi le v.pron., traduit « passer avant », absent ailleurs, ES.<br />
523 B ajoute l’acception “médecin qui ne pratique pas l’avortement”, ES.<br />
524 HP a ce même ED.<br />
525 B a deux acceptions dans l’adjectif: “qui previent la carie” et “contre la carie”, autant d’ED car SL propose<br />
“(Farm) anti-caries, anti-carie, anticariogène”. HP a aussi un ED pour l’adjectif, traduit « contre la carie ».<br />
526 HP a ce même ED.<br />
377
2 (arrivare in anticipo) arriver à l’avance: ho anticipato di un’ora je suis arrivé une heure à<br />
l’avance. ES, B et G confirment<br />
anticipazione s.f.<br />
(l’anticipare) fait m. d’avancer qqch. ES, B, G et HP confirment<br />
anticipo 528 s.m.<br />
(Sport) (partita) rencontre f. anticipée. ES, acception absente ailleurs<br />
anticolerica s.f.<br />
(Med) vaccin m. contre le choléra. ET, absent ailleurs<br />
anticolerico agg.<br />
(Farm) contre le choléra: vaccinazione anticolerica vaccination contre le choléra. ED, B<br />
“(farm.) anticholérique”<br />
anticrisi agg.m./f.inv.<br />
de crise: unità anticrisi unité de crise. ES, acception absente ailleurs<br />
antidivorzismo s.m.<br />
opposition f. au divorce. ES, absent ailleurs<br />
antidivorzistico agg.<br />
contre le divorce. ES, B confirme<br />
antifungino s.m.<br />
(Farm) agent antifongique. ET, absent ailleurs<br />
antimeridiano agg.<br />
du matin: lezioni antimeridiane leçons du matin; alle sette antimeridiane à sept heures du<br />
matin. ES, B, G et HP confirment<br />
antincendio s.m.inv.<br />
mousse f. anti-incendie. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
527 B a un autre ES, acception absente ailleurs: “commencer en avance: anticipare i lavori di restauro,<br />
commencer en avance les travaux de restauration”.<br />
528 B a un autre ES, acception absente ailleurs: “(l’anticipare) fait d’avancer qc.: decidere l’anticipo della<br />
partenza, decider d’avancer le départ”.<br />
378
antinfortunistica s.f.<br />
prévention des accidents: scarpe antinfortunistica chaussures de sécurité. ES, absent ailleurs<br />
antinfortunistico agg.<br />
contre les accidents, pour la prévention des accidents. ES, B, G et HP confirment<br />
antinucleare s.m./f.<br />
activiste antinucléaire. ES, absent ailleurs<br />
antiofidico s.m.<br />
(Farm) sérum antivenimeux. ED, B “(farm.) antivenimeux”<br />
antiorario agg.<br />
inverse des aiguilles d’une montre: in senso antiorario en sens inverse des aiguilles d’une<br />
montre, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. ES, B, G et HP confirment<br />
antipastiera s.f.<br />
plat m. à hors-d’oeuvre. ES, B, G et HP confirment<br />
antipaticamente avv.<br />
d’une façon antipathique. EM, B, G et HP confirment<br />
antipatico s.m.<br />
personne f. antipathique. ES, B et HP confirment<br />
antiperistalsi s.f.inv.<br />
(Fisiol) mouvement m. antipéristaltique. ED, G “(med.) antipéristaltisme”<br />
antipolio s.f.inv. (Med)<br />
1 (vaccino) vaccin m. antipoliomyélitique, (colloq) vaccin m. contre la polio. ED, HP<br />
“antipoliomyélitique”<br />
2 (iniezione) injection f. antipoliomyélitique. ES, acception absente ailleurs<br />
antiporta s.f.<br />
2 (Stor,Mil) fausse porte. ET, B et HP confirment<br />
3 (Edit,ant) faux titre m. ET, acception absente ailleurs<br />
379
antiquaria s.f.<br />
1 (scienza) science de l’antiquité. ES, absent ailleurs<br />
2 (rar) (commercio di oggetti antichi) commerce m. d’objets anciens. ES, absent ailleurs<br />
antiquariale agg.m./f.<br />
d’objets anciens. ES, absent ailleurs<br />
antiquariato s.m.<br />
commerce d’antiquités, commerce d’objets anciens. ES, B, G et HP confirment<br />
antiquario agg.<br />
d’antiquités: commercio antiquario commerce d’antiquités. ED, B “ancien”<br />
antirabbica s.f.<br />
(Med) vaccin m. contre la rage, vaccin m. antirabique. ET, absent ailleurs<br />
antirazionale agg.m./f.<br />
contraire à la raison. ES, absent ailleurs<br />
antirecessione agg.m./f.inv.<br />
(Econ) contre la récession: misure antirecessione mesures contre la récession. ET, absent<br />
ailleurs<br />
antirecessivo agg.<br />
(Econ) contre la récession. ED, G “(econ.) antirécession, anticrise”<br />
antirombo s.m.inv.<br />
(Aut) matériau m. insonorisant, absorbant m. sonore. ET, catégorie grammaticale absente<br />
ailleurs<br />
antischiavismo s.m.<br />
mouvement contre l’esclavage, mouvement pour l’abolition de l’esclavage. ED, HP<br />
“antiesclavagisme” 529<br />
antisommergibile s.m.<br />
529 B a ce même ED. Nous faisons remarquer que le mot antiesclavagisme est absent dans PR11 et TLFi mais<br />
largement présent dans Google.<br />
380
(Mil) dispositif anti-sous-marin. ED, B “(mar. mil.) anti-sous-marin”<br />
antitarlo I agg.m./f.inv.<br />
contre les vers à bois: trattamento antitarlo traitement contre les vers à bois. ED, B<br />
“antimite”<br />
II s.m.inv.<br />
produit m. contre les vers à bois. ED, HP “anti-termites”<br />
antitetanica s.f.<br />
(Med) vaccin m. antitétanique. ET, HP confirme<br />
antiteticamente avv.<br />
de façon antithétique. EM, G et HP confirment<br />
antiusura agg.m./f.inv.<br />
résistant agg. à l’usure. ED, B “anti(-)usure”<br />
antivaiolosa s.f.<br />
(Med) vaccin m. antivariolique, vaccin m. contre la variole. ET, absent ailleurs<br />
antivivisezione agg.m./f.<br />
contre la vivisection. ES, absent ailleurs<br />
antivivisezionismo s.m.<br />
mouvement contre la vivisection. ES, absent ailleurs<br />
antivivisezionista s.m./f.<br />
militant m. contre la vivisection. ED, G “antivivisectionniste” 530<br />
antonomastico agg.<br />
(Ret) par antonomase. ET, B confirme<br />
antroposfera s.f.<br />
sphère humaine. ET, absent ailleurs<br />
anzianità s.f.<br />
530 B a ce même ED. Il faut remarquer que antivivisectionniste est absent de PR11, présent dans le TLFi, mais<br />
seulement comme adjectif.<br />
381
(età avanzata) grand âge m., âge m. avancé. ES, B, G et HP confirment<br />
anziano s.m.<br />
personne f. âgée: agli anziani si deve rispetto on doit du respect aux personnes âgées. ES, B,<br />
G et HP confirment<br />
anzianotto agg.<br />
d’un certain âge. ES, B 531 et G confirment<br />
anzitempo avv.<br />
1 (prima della data) avant la date fixée. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (in anticipo) à l’avance. ES, B et G confirment<br />
4 (molto presto) très tôt. ES, acception absente ailleurs<br />
anzitutto avv.<br />
1 (prima di tutto) d’abord, tout d’abord. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (più di tutto) avant tout. ES, B, G et HP confirment<br />
apartiticità s.f.<br />
indépendance politique. ES, B et G confirment<br />
apartitico agg.<br />
indépendant des partis politiques. ES, B, G et HP confirment<br />
Ape s.f.inv.<br />
(Aut) Piaggio Ape. ER, nom propre<br />
apiaristico agg.<br />
qui concerne les abeilles. ES, absent ailleurs<br />
apocopare v.tr.<br />
(Gramm) faire une apocope à. ET, G et HP confirment<br />
apostrofare 2<br />
v.tr.<br />
(Gramm) mettre une apostrophe à. ET, B, G et HP confirment<br />
531 A aussi la catégorie grammaticale du substantif, traduit “personne d’un certain âge”, ES.<br />
382
apoteosi s.f.inv.<br />
(Teat) grand final m. ET, acception absente ailleurs<br />
appagabile agg.m./f.<br />
1 qu’on peut satisfaire, qu’on peut assouvir: un desiderio facilmente appagabile un désir<br />
qu’on peut satisfaire facilement. EM, B, G et HP confirment<br />
2 (di fame) qu’on peut assouvir; (di sete) qu’on peut apaiser. ES, acception absente ailleurs<br />
appallottolare v.tr.<br />
faire une boule de, faire des boulettes de. ES, B, G et HP confirment<br />
appaltare v.tr.<br />
(rar) (prendere in appalto) prendre en adjudication. ES, B 532 , G et HP confirment<br />
appannamento s.m.<br />
(rif. a vetri e sim: il coprirsi di vapore) fait de s’embuer. ES, acception absente ailleurs<br />
appariscente agg.m./f.<br />
1 (che dà nell’occhio) qui attire l’attention, qui attire les regards. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (estens) (rif. a donna: avvenente) à l’aspect agréable. ES, acception absente ailleurs<br />
appariscenza s.f.<br />
aspect m. voyant. ES, G confirme<br />
appartare v.tr.<br />
mettre de côté. ES, B et G confirment<br />
appartato agg.<br />
(rif. a persona) à l’écart: vivere appartato vivre à l’écart; tenersi appartato se tenir à l’écart (da<br />
de). ES, B et G confirment<br />
appartenente agg.m./f.<br />
qui appartient (a à). ED, G “appartenant”<br />
appartenere v.intr.<br />
532 B ajoute l’acception “(dare in appalto) attribuer par adjudication”, ED car G propose “(dare in appalto)<br />
adjuger”.<br />
383
(essere iscritto a un’associazione) faire partie (a de; aus. avoir): appartengo al circolo filatelico je<br />
fais partie du cercle de philatélie. ED, HP “(far parte) appartenir”<br />
appassire v.tr.<br />
(rar) (fare appassire) faire sécher: appassire l’uva faire sécher le raisin. ED, G “faner, flétrir;<br />
sécher”<br />
appellabile agg.m./f.<br />
(Dir) susceptible d’appel. ED, G “(dir.) appelable”<br />
appellabilità s.f.<br />
(Dir) possibilité d’appel. ET, B et G confirment<br />
appellarsi v.prnl.<br />
faire appel (a à): appellarsi alla generosità di qcu. faire appel à la générosité de qqn. ES, B, G<br />
et HP confirment<br />
appellativo agg.<br />
(Dir) d’appel. ET, B, G et HP confirment<br />
appellatorio agg.<br />
(Dir) d’appel. ET, B, G et HP confirment<br />
appello s.m.<br />
(Univ) session f. d’examen. ED, B “(di esami) session” 533<br />
appestare v.tr.<br />
(contagiare con la peste) infecter de la peste. ES, acception absente ailleurs<br />
appetibilità s.f.<br />
caractère m. désirable; caractère m. appétissant. ED, B “appétibilité”<br />
appetire v.intr.<br />
(lett) mettre en appétit; aiguiser l’appétit: è un piatto che appetisce c’est un plat qui met en<br />
appétit. ES, B, G et HP confirment<br />
appianabile agg.m./f.<br />
533 G et HP ont ce même ED.<br />
384
1 (che si può rendere piano) qu’on peut aplanir, qu’on peut niveler. EM, B, G et HP confirment<br />
2 (fig) (risolvibile) qu’on peut aplanir, qu’on peut lever. ES, G confirme<br />
appiccicatura s.f.<br />
(unione mal fatta) mauvais raccord m. ES, acception absente ailleurs<br />
appicco 1<br />
s.m.<br />
(rar) (gancio) point d’appui. ES, B et HP confirment<br />
appiedamento s.m.<br />
fait d’obliger à mettre pied à terre. ES, B confirme 534<br />
appiedare v.tr.<br />
obliger à mettre pied à terre: appiedare la cavalleria obliger la cavalerie à mettre pied à terre.<br />
ES, B, G et HP confirment<br />
appiedato agg.<br />
(senza mezzi di trasporto) à pied: rimanere appiedato devoir rentrer à pied; (di ciclista) devoir<br />
mettre pied à terre. ES, B, G et HP confirment<br />
appioppare v.tr.<br />
3 (Agr) (legare le viti a pioppi) accoler (des vignes) aux peupliers. ED, HP “AGR. accoler” 535<br />
4 (Agr) (piantare a pioppo) planter des peupliers sur. ET, B et G confirment<br />
applauditore I agg.<br />
(rar) qui applaudit. EM, absent ailleurs<br />
II s.m.<br />
(rar) personne f. qui applaudit. EM, absent ailleurs<br />
applicativo agg.<br />
d’application (anche Inform): pacchetto applicativo progiciel d’application; programma<br />
applicativo programme d’application. EM, B, G et HP confirment<br />
appoppare v.tr.<br />
534 Ajoutant un ET à l’acception 2: “(equit.) pénalité consistant en une interdiction de participation aux<br />
courses”.<br />
535 B et G ont ce même ED.<br />
385
(Mar) déplacer vers l’arrière. ET, B confirme<br />
II prnl. appopparsi<br />
(Mar) enfoncer de l’arrière. ET, B et G confirment<br />
appositamente avv.<br />
(a questo scopo) à dessein: mezzi appositamente scelti moyens choisis à dessein. ES, acception<br />
absente ailleurs<br />
apposta agg.m./f.inv.<br />
(riservato) rien que pour, pour... seul agg.: ci vorrebbe un bagno apposta per lui il faudrait une<br />
salle de bains rien que pour lui, il faudrait une salle de bains pour lui seul. ED, B et HP<br />
“spécial”, G “exprès”<br />
appostamento s.m.<br />
(Mil) (sentinelle appostate) poste d’observation. ET, HP confirme<br />
appostare v.tr.<br />
(Mil) (rif. ad armi) mettre en position. ET, acception absente ailleurs<br />
apprendistato s.m.<br />
(categoria) catégorie f. des apprentis. ES, G et HP 536 confirment<br />
apprestamento s.m.<br />
(Mil) travail de terrain. ET, acception absente ailleurs<br />
apprezzabile agg.m./f.<br />
(lodevole) de mérite. ES, acception absente ailleurs<br />
approfondirsi v.prnl.<br />
(fig,rar) approfondir ses connaissances en: approfondirsi nella matematica approfondir ses<br />
connaissances en mathématiques. ES, B confirme<br />
approfonditamente s.m.<br />
de façon approfondie, à fond. EM, HP confirme<br />
approssimativo agg.<br />
536 HP a aussi une acception “(periodo di addestramento) période d’apprentissage”, ED puisque SL la traduit par<br />
“stage”.<br />
386
(rif. a persona) qui se contente de l’à-peu-près. ES, acception absente ailleurs 537<br />
appruare v.tr.<br />
(Mar) déplacer vers l’avant. ET, B confirme<br />
II prnl. appruarsi<br />
(Mar) donner du nez, enfoncer de l’avant, piquer de l’avant. ED, B “(mar.) canarder”<br />
aquilotto s.m.<br />
(Aer,fig) (giovane pilota) élève pilote. ET, B et G confirment<br />
arabescare v.tr.<br />
(Oref) décorer d’arabesques. ED, B “ramager” 538<br />
arabescato agg.<br />
décoré d’arabesques, orné d’arabesques. ED, B “ramagé” 539<br />
aragosta s.f.<br />
(colore) rouge m. orangé. ES, HP confirme<br />
aranciata s.f.<br />
2 (rar) (bibita non gassata) sirop m. d’orange. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (rar) (succo di arancia) jus m. d’orange. ES, G confirme<br />
arancino 540 s.m.<br />
(Gastron) croquette f. de riz sphérique farcie au fromage et à la viande et frite. ER, B, G et<br />
HP confirment<br />
arancione s.m./f.<br />
(Rel,colloq) disciple de Hare Krishna. ES, HP confirme 541<br />
arativo agg.<br />
(Agr) que l’on peut semer. ED, B “labourable” 542<br />
537 G a l’exemple “è un tipo un po’ approssimativo”, avec la même traduction que SL.<br />
538 HP a ce même ED.<br />
539 G a ce même ED.<br />
540 B a aussi la catégorie de l’adjectif, traduit “d’orange”. Un EM, que l’on peut trouver dans G aussi.<br />
541 G a la locution « gli arancioni, les disciples de Bhagwan Shree Rajneesh ».<br />
387
arazzeria s.f.<br />
2 (luogo) manufacture de tapisseries. ES, B, G et HP confirment<br />
3 (complesso di arazzi) collection de tapisseries, ensemble m. de tapisseries. ES, absent ailleurs<br />
arazziere s.m.<br />
(venditore) vendeur de tapisseries. ES, acception absente ailleurs<br />
arboreo agg.<br />
(degli alberi) d’arbres. ES, G confirme<br />
arboscello s.m.<br />
(albero giovane) jeune arbre. ES, G confirme<br />
arcade s.m./f.<br />
(estens) écrivain m. maniéré. ES, B et G confirment 543<br />
arcata s.f.<br />
(Mus) coup m. d’archet. ET, B, G et HP confirment<br />
arcavola s.f.<br />
(rar) arrière-arrière-grand-mère. ES, absent ailleurs<br />
arcavolo s.m.<br />
(rar) arrière-arrière-grand-père. ED, B “trisaïeul”<br />
archeggiare v.intr.<br />
(Mus) manier l’archet. ET, B confirme<br />
archeggio s.m.<br />
(Mus) coup d’archet. ET, B 544 , G 545 et HP confirment<br />
archibugiata s.f.<br />
1 (colpo) coup m. d’arquebuse. ED, G “arquebusade”<br />
542 HP a ce même ED.<br />
543 HP a un autre ES : “membre (de l’Académie) de l’Arcadie”.<br />
544 A aussi l’acception “(mus.) jeu de l’archet” et un homographe archeggìo, “(mus.) mouvements répétés avec<br />
l’archet”, autant d’ET.<br />
545 A aussi l’acception “(mus.) technique de l’archet”, ET.<br />
388
2 (estens) (ferita) blessure due à un coup d’arquebuse. ES, acception absente ailleurs<br />
architettare v.tr.<br />
concevoir le projet de construction de. ES, G confirme<br />
architravatura s.f.<br />
(Arch) ensemble m. des architraves. ET, B confirme<br />
archivistico agg.<br />
d’archives. ED, HP “archivistique” 546<br />
arcidiavolo s.m.<br />
(Rel) prince des démons. ED, B “archidiable” 547<br />
arcignamente avv.<br />
d’un air renfrogné. EM, absent ailleurs<br />
arcionato agg.<br />
à arçons, muni d’arçons. ES, B confirme<br />
arcosaldatura s.f.<br />
(Tecn) soudure en arc. ET, absent ailleurs<br />
arcoscenico s.m.<br />
(Teat) arc de scène. ET, B et G confirment<br />
ardesia s.f.<br />
(colore) couleur ardoise: grigio ardesia gris ardoise. ES, absent ailleurs<br />
ardimentosamente 548 avv.<br />
(temerariamente) avec témérité. ES, acception absente ailleurs<br />
arena 2<br />
s.f.<br />
(estens) (cinema all’aperto) cinéma m. en plein air. ES, B confirme 549<br />
546 G et HP aussi ont ce même ED.<br />
547 G aussi a ce même ED. Le mot “archidiable”, absent du PR11 et du TLFi, figure pourtant dans la<br />
traduction française de Belfagor arcidiavolo, nouvelle de Machiavel.<br />
548 HP traduit “de façon hardie”, un ED car SL propose “hardiment”.<br />
389
arengo s.m. (Mediev)<br />
1 (assemblea) assemblée f. du peuple. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (luogo) lieu de l’assemblée du peuple. ES, B, G et HP confirment<br />
arenicola s.f.<br />
(Zool) ver m. de sable. ED, B “(zool.) arénicole”<br />
arenile s.m.<br />
plage f. de sable. ED, G “(spiaggia) plage” 550<br />
arenosità s.f.<br />
caractère m. sableux. ES, absent ailleurs<br />
arenoso agg.<br />
(fig,lett) (di ragionamento) peu fondé, qui ne tient pas la route. ES, acception absente ailleurs<br />
arganista s.m./f.<br />
conducteur m. de treuil. ES, absent ailleurs<br />
argenteo agg.<br />
(in argento) en argent, d’argent: una coppa argentea une coupe d’argent. EM, B, G et HP<br />
confirment<br />
argentiere s.m.<br />
(negozio) magasin d’orfèvrerie. ES, acception absente ailleurs 551<br />
argentina 3 s.f. (Abbigl)<br />
(Sport) (spec. nel baseball) maillot m. de corps. ED, G “tricot (sans col, à manches langues)” 552<br />
argilla s.f.<br />
(per vasai) terre glaise. ED, G “(per vasai) glaise”<br />
549 Et ajoute l’acception “théâtre en plein air”, un autre ES.<br />
550 B aussi a ce même ED. Nous croyons que l’équivalent proposé par G (plage) est hypospécifique : une plage<br />
peut aussi être caillouteuse, par exemple, au contraire d’un arenile.<br />
551 G a aussi l’acception “(st.) (tesoriere della corte di Francia) argentier”, ER. HP a aussi l’acception, absente<br />
ailleurs: “artisant travaillant l’argent”, ES.<br />
552 B aussi a ce même ED.<br />
390
arido s.m.pl. (gli aridi)<br />
matières f.pl. sèches. ES, B confirme<br />
ariosità s.f.<br />
1 (di ambiente, camera) aspect m. à la fois clair et spacieux: un arredamento diverso darebbe<br />
più ariosità alla stanza un ameublement différent rendrait la pièce plus claire et spacieuse.<br />
ES, absent ailleurs<br />
2 (di paesaggio, vista) fait m. d’être ouvert. ES, absent ailleurs<br />
3 (di testo impaginato) fait m. d’être aéré: un po’ più di ariosità non guasterebbe il faudrait<br />
aérer un peu plus la page. ES, absent ailleurs<br />
arioso agg.<br />
(di ambiente, camera) clair et spacieux. ES, B, G et HP confirment<br />
ariostesco agg.<br />
de l’Arioste. EM, G confirme<br />
arista 2<br />
s.f.<br />
(Macell,region) carré m. de porc: un arrosto di arista carré de porc rôti. ES, B et G<br />
confiment 553<br />
arlecchinesco agg.<br />
à la façon d’Arlequin. EM, B, G et HP confirment<br />
armadio s.m.<br />
(fig) (persona grande e grossa) armoire f. à glace. ES, acception absente ailleurs 554<br />
armamento s.m.<br />
(Ferr) matériel fixe. ET, acception absente ailleurs<br />
armare v.tr.<br />
(Teat) mettre un cadre de scène. ET, acception absente ailleurs<br />
armatore agg.<br />
553 HP traduit : “GASTR. INTRAD. (spécialité toscane consistant en un carré de porc rôti).”, ce qui le<br />
rendrait plutôt un ER.<br />
554 Expression présente comme exemple dans G et HP.<br />
391
d’armement: società armatrice société d’armement. EM, G et HP confirment<br />
armatoriale agg.m./f.<br />
d’armement: compagnia armatoriale société d’armement. EM, B, G et HP confirment<br />
armeria s.f.<br />
(collezione) collection d’armes. ES, G confirme<br />
armigero s.m.<br />
1 (lett) (uomo d’armi) homme d’armes. ES, B, G et HP confirment<br />
3 (fig,iron) (guardia del corpo) garde du corps. ES, B confirme<br />
armilla s.f.<br />
(Astr,ant) sphère armillaire. ET, B et G confirment<br />
armistiziale agg.m./f.<br />
d’armistice: trattato armistiziale traité d’armistice. EM, B et G confirment<br />
arnese s.m.<br />
(fig,spreg) (rif. a persone) mauvais sujet. ES, B et G confirment<br />
arpeggiamento s.m.<br />
(Mus) exécution f. en arpèges. ED, B “(mus.) arpègement”<br />
arpeggiare v.intr.<br />
1 (Mus) (suonare l’arpa) jouer de la harpe. ES, B et G confirment<br />
2 (Mus) (eseguire arpeggi) faire des arpèges. ET, G confirme<br />
3 (Veter) avoir l’éparvin. ET, acception absente ailleurs<br />
arpeggio 2<br />
s.m.<br />
(Mus,rar) exécution f. en arpèges. ET, absent ailleurs<br />
arpia s.f.<br />
3 (Ornit) harpie féroce. ED, G “(zool.) harpie”<br />
4 (Entom) queue fourchue, grande harpie. ET, acception absente ailleurs<br />
arpicordo s.m.<br />
392
(Mus) épinette f. polygonale. ED, B “(mus.) épinette”; G “(mus.) arpicordo (instrument de<br />
musique proche du clavecin)”<br />
arrabattarsi v.prnl.<br />
(impegnarsi) se donner du mal, se donner un mal fou, (colloq) se donner un mal de chien: si<br />
arrabatta per mantenere la famiglia il se donne un mal fou pour subvenir aux besoins de sa<br />
famille. ES, B, G et HP confirment<br />
arrabbiare v.intr.<br />
1 (Veter) devenir enragé, contracter la rage. ET, B, G et HP confirment<br />
2 (iperb,rar) (rif. a persona) devenir fou. ES, acception absente ailleurs<br />
arrabbiato agg.<br />
(Gastron) à la diable. ER, acception absente ailleurs 555<br />
arrapato agg.<br />
(pop) qui a la trique. ED, HP “VOLG. (tout) allumé”<br />
arredare v.tr.<br />
(con mobilio e decorazioni) meubler et décorer. ES, G confirme<br />
arredatore s.m.<br />
(progettista di appartamenti) décorateur d’intérieur, architecte m./f. d’intérieur. ED, B<br />
“décorateur”<br />
arredobagno s.m.<br />
fournitures f.pl. de salle de bain. ES, absent ailleurs<br />
arretrato I agg.<br />
(non fatto, non compiuto) en retard: ho del lavoro arretrato j’ai du travail en retard. ES, B<br />
confirme<br />
II s.m. spec. al pl.<br />
2 (Giorn) numéro antérieur, numéro déjà paru. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (fig) compte à régler: avere degli arretrati con la giustizia avoir des comptes à régler avec la<br />
justice. ES, acception absente ailleurs<br />
555 La locution « all’arrabbiata » est bien présente dans B, G et HP, pourtant.<br />
393
arricciacapelli s.m.inv.<br />
fer m. à friser. ED, B “frisoir” 556<br />
arrivato s.m.<br />
(chi ha avuto successo) homme arrivé. ES, B et G confirment<br />
arroccare 1<br />
v.tr.<br />
2 (Mil) déplacer les troupes par lignes internes. ET, B, G et HP confirment<br />
3 (fig) mettre à l’abri. ES, B confirme<br />
II prnl. arroccarsi<br />
(fig) (mettersi al sicuro) se mettre à l’abri. ES, acception absente ailleurs<br />
arroccare 2 v.tr.<br />
(Tess) mettre sur une quenouille. ET, B et G confirment<br />
arrogantemente avv.<br />
avec arrogance, d’une manière arrogante. ED, HP “arrogamment” 557<br />
arroventamento s.m.<br />
(l’arroventare) chauffage au rouge. ES, B et G 558 confirment<br />
arroventare v.tr.<br />
1 chauffer au rouge: arroventare un metallo chauffer un métal au rouge. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
2 (estens) (rendere molto caldo) rendre brûlant: il sole arroventava le pietre le soleil rendait les<br />
pierres brûlantes. ED, B “embraser”<br />
II prnl. arroventarsi<br />
1 devenir rouge. ED, HP “(diventare incandescente) [metallo, tizzone] rougir” 559<br />
2 (fig) devenir tendu: l’atmosfera si è arroventata l’atmosphère est devenue tendue. ED, HP<br />
“FIG. s’enflammer”<br />
556 G et HP ont ce même ED.<br />
557 B a ce même ED.<br />
558 Ajoute l’acception (absente ailleurs) “(incandescenza) chauffage à blanc”, ES.<br />
559 B a ce même ED.<br />
394
arsenalotto s.m.<br />
(Mar,rar) ouvrier d’arsenal. ET, B et G confirment<br />
arsura s.f.<br />
1 chaleur brûlante: l’arsura dell’estate la chaleur brûlante de l’été. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
3 (per sete) soif ardente; (per febbre) feu m. de la fièvre. ES, B, G et HP confirment<br />
artatamente avv.<br />
(lett,rar) avec artifice. EM, HP confirme<br />
artificiosamente avv.<br />
1 de manière artificielle. ED, B “artificiellement”, HP “artificieusement”<br />
2 (senza naturalezza) sans naturel, de manière artificielle. ES, G confirme<br />
artigianalmente avv.<br />
(estens) (a livello amatoriale) en amateur. ES, acception absente ailleurs<br />
artigliare v.tr.<br />
saisir avec les griffes. ES, B, G et HP confirment<br />
artisticità s.f.<br />
1 (valore) valeur artistique. ES, acception absente ailleurs<br />
2 (carattere) charactère m. artistique. ES, HP confirme<br />
arzigogolo s.m.<br />
(giro di parole) jeu de mots. ED, G “(bisticci di parole) détours”<br />
asburgico agg.<br />
(Stor) des Habsbourg: dinastia asburgica dynastie des Habsbourg. EM, B, G et HP<br />
confirment<br />
ascellare agg.m./f.<br />
(scherz,colloq) qui arrive jusqu’aux aisselles: mutande ascellari culotte de grand-mère. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
ascessuale agg.m./f.<br />
395
(Med) relatif à l’abcès. ET, absent ailleurs<br />
asceticamente avv.<br />
en ascète. EM, G et HP confirment<br />
asciugabiancheria s.m.inv.<br />
(stenditoio) séchoir m. à linge. ES, acception absente ailleurs<br />
ascorbina s.f.<br />
(Chim) acide m. ascorbique. ED, B “(biol., chim.) vitamine C”<br />
asfittico agg.<br />
(fig) (privo di vitalità) sans vitalité; (in declino) sur le déclin; (senza vita) sans vie. ES, HP<br />
confirme<br />
asiatica s.f.<br />
(Med) grippe asiatique. ET, absent ailleurs<br />
asimmetricamente avv.<br />
de façon asymétrique. EM, absent ailleurs<br />
asperrimo agg.<br />
très âpre. EM, B et HP confirment<br />
asportabile agg.m./f.<br />
qu’on peut emporter, qui peut être emporté. EM, B, G et HP confirment<br />
asportazione s.f.<br />
fait d’emporter m. ES, acception absente ailleurs<br />
asporto s.m.<br />
(di cibi e sim.) fait d’emporter. ES, acception absente ailleurs<br />
asprigno s.m.<br />
goût aigrelet, goût sur. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
assaggiatura s.f.<br />
(rar) (piccola quantità) petit morceau m. ES, acception absente ailleurs<br />
396
assassinare v.tr.<br />
(lett,fig) (danneggiare gravemente) nuire gravement à: queste tasse assassinano il popolo ces taxes<br />
nuisent gravement à la population. ES, acception absente ailleurs<br />
assemblatore agg.<br />
d’assemblage: (Inform) programma assemblatore assembleur. EM, G confirme<br />
assembleare agg.m./f.<br />
de l’assemblée: decisione assembleare décision de l’assemblée. EM, B, G et HP confirment<br />
asserragliamento s.m.<br />
(rar) (azione) fait de se barricader. ES, G confirme<br />
assertività s.f.<br />
affirmation de soi. ES, absent ailleurs<br />
assessorato s.m.<br />
(carica) mandat d’adjoint au maire. ES, G 560 et HP confirme<br />
assessore s.m.<br />
adjoint au maire: assessore alla cultura adjoint au maire chargé de la culture. ES, B, G et HP<br />
confirment 561<br />
assessoriale agg.m./f.<br />
(rar) d’adjoint au maire. EM, B 562 et G confirment<br />
assestamento s.m.<br />
4 (rar) (il mettere in ordine) mise f. en ordre. ES, G confirme<br />
5 (rar) (riparazione) remise f. en état. ES, acception absente ailleurs<br />
assetare 563 v.tr.<br />
(fig,rar) (invogliare) éveiller le désir chez. ES, G confirme<br />
560 Ajoute les traduisants suivants: “(grado di assessore) titre d’adjoint; (durata della carica) durée du mandat<br />
d’adjoint”.<br />
561 B et HP ajoutent l’acception “conseiller régional”, ES.<br />
562 S.v. assessorile.<br />
563 G a aussi le v.intr. (ant.), avec deux acceptions: « avoir soif » et « (fig.) désirer ardemment » : autant d’ES.<br />
397
assettare v.tr.<br />
(Mar,Aer,Aut) régler l’assiette de. ED, HP “AER. MAR. équilibrer (par arrimage)”<br />
assettato agg.<br />
(Mar,Aer,Aut) avec l’assiette réglée. ET, acception absente ailleurs<br />
assicurativo agg.<br />
(Comm) d’assurance: ente assicurativo compagnie d’assurances; polizza assicurativa police<br />
d’assurance. EM, B, G et HP confirment<br />
assicuratore agg.<br />
d’assurances: società assicuratrice société d’assurances. EM, B, G et HP confirment<br />
assideramento s.m.<br />
hypothermie f. provoquée par le froid: morte per assideramento mort par hypothermie.<br />
ED, G “(med.) congélation” 564<br />
assiduo s.m.<br />
visiteur assidu: un assiduo della nostra famiglia un visiteur assidu auprès de notre famille.<br />
ES, acception absente ailleurs<br />
assiolo s.m.<br />
(Ornit) petit duc. ET, B, G et HP confirment<br />
assise s.f.pl.<br />
(Dir) (Corte d’assise) Cour sing. d’assises. ET, acception absente ailleurs<br />
assistentato s.m.<br />
1 (carica) charge f. d’assistant. ES, B, G et HP confirment<br />
3 (periodo) période f. d’assistanat. ES, B, G et HP confirment<br />
assistenziale agg.m./f.<br />
d’assistance: centro assistenziale centre d’assistance. EM, B, G et HP confirment<br />
assistenzialismo s.m.<br />
(spreg) politique f. d’assistanat. ED, B et HP “assistanat” 565<br />
564 B a ce même ED, traduisant “coup de froid”.<br />
398
assistenziario s.m.<br />
centre de réinsertion sociale, centre de réadaptation sociale. ES, B et G confirment<br />
assito s.m.<br />
(parete di assi) cloison f. de planches. ED, HP “(tramezzo) cloison” 566<br />
associabile agg.m./f.<br />
(che si può associare) qu’on peut associer (a à): a ogni parola è associabile un numero on peut<br />
associer un numéro à chaque mot. ED, G “associable” 567<br />
assoggettabile agg.m./f.<br />
qu’on peut assujettir. EM, B, G et HP confirment<br />
assommare 2<br />
v.tr. (rar)<br />
(portare a galla) faire remonter à la surface. ED, B “(mar.) pêcher, repêcher” 568<br />
assorbente s.m.<br />
(assorbente igienico) serviette f. hygiénique. ES, B, G et HP confirment<br />
assorbenza s.f.<br />
pouvoir m. absorbant. ES, absent ailleurs<br />
assuefarsi v.prnl.<br />
(a droghe) devenir dépendant. ES, acception absente ailleurs<br />
asta s.f.<br />
(Comm) (vendita all’incanto) vente aux enchères: vendere all’asta vendre aux enchères. ES, B,<br />
G et HP confirment<br />
astanteria s.f.<br />
salle d’observation. ES, B, G et HP confirment<br />
astato 1 agg.<br />
1 (Stor) armé d’une lance. ES, B, G et HP confirment<br />
565 G a ce même ED, traduisant “politique du welfare-state, de l’Etat-providence”.<br />
566 B a ce même ED.<br />
567 B a ce même ED.<br />
568 B a à son tour un ET dans le v.intr., à savoir “(mar.) monter sur le pont”, acception absente ailleurs.<br />
399
2 (fig) droit comme un I. ES, acception absente ailleurs<br />
astemio agg.<br />
qui ne boit jamais d’alcool. ED, HP “abstème, sobre, abstinent” 569<br />
II s.m.<br />
personne f. qui ne boit jamais d’alcool. ED, HP “abstème” 570<br />
astenere v.tr.<br />
(lett,rar) tenir éloigné: astenere qcu. da qcs. tenir qqn éloigné de qqch. ES, catégorie<br />
grammaticale absente ailleurs<br />
astenico s.m.<br />
(estens) (debole) personne f. faible. ES, acception absente ailleurs<br />
asteriscato agg.<br />
marqué d’un astérisque. ES, acception absente ailleurs<br />
astilo agg.<br />
(Archeol) sans colonne. ET, B et G confirment<br />
astiosamente avv.<br />
1 (con rancore) avec rancune, avec rancoeur. ES, G confirme<br />
3 (ostilità) avec hostilité. ES, acception absente ailleurs<br />
astrarre v.intr.<br />
(prescindere) faire abstraction (da de): astraendo dal fatto che... en faisant abstraction du fait<br />
que... ES, B, G et HP confirment<br />
astrattezza s.f.<br />
1 (l’essere astratto) caractère m. abstrait. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (eccessiva) trop d’abstraction: peccare di astrattezza être trop abstrait. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
569 B et G aussi ont ce même ED.<br />
570 Il y a un gros problème de registre, cependant, comme le signale PR11. Le mot abstème est en effet<br />
marqué comme « didact »., à savoir « mot ou emploi propre à la langue savante (ouvrages pédagogiques, etc.)<br />
et qui n’est pas employé dans le français standard ». B et G font comme SL, donc ED pour eux aussi.<br />
400
astringere v.tr.<br />
(Med) (assol.) (essere astringente) exercer une action astringente, être astringent. ET, acception<br />
absente ailleurs<br />
astrologare v.intr.<br />
(rar) pratiquer l’astrologie, s’adonner à l’astrologie. ES, B et G confirment<br />
astrusaggine s.f.<br />
raisonnement m. obscur; pensée absconse. ED, B “(lett.) amphigouri”<br />
astruseria s.f.<br />
(rar) (concetto astruso) idée obscure. ED, car HP renvoie à astrusità 571<br />
astrusità s.f.<br />
(concetto astruso) idée obscure. ED, HP “absurdité” 572<br />
atabagico s.m.<br />
(Farm) médicament antitabac. ET, absent ailleurs<br />
atavicamente avv.<br />
par atavisme. ED, HP “héréditairement”<br />
ateistico agg.<br />
qui relève de l’athéisme. ED, B “athéistique” 573<br />
atletico agg.<br />
(dell’atletica) d’athlétisme: gare atletiche épreuves d’athlétisme. EM, acception absente<br />
ailleurs<br />
atomica s.f.<br />
(bomba) bombe atomique. ES, B, G et HP confirment<br />
atonia s.f.<br />
(Ling) absence d’accent tonique. ED, HP “LING. atonie” 574<br />
571 B a ce même ED.<br />
572 B a ce même ED.<br />
573 HP a ce même ED. Le mot est absent du PR11 mais présent dans le TLFi.<br />
401
atossico agg.<br />
non toxique. ES, acception absente ailleurs<br />
atropo s.m.<br />
(Entom) sphinx à tête de mort. ED, B “(zool.) atropos”<br />
attaccabile agg.m./f.<br />
1 (incollabile) qui peut être collé. ES, acception absente ailleurs<br />
2 (cucibile) qui peut être cousu. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (appendibile) qui peut être accroché. ES, acception absente ailleurs<br />
4 (legabile) qui peut être attaché. ES, acception absente ailleurs<br />
attaccamento s.m.<br />
(l’attaccare) fait d’attacher. ES, acception absente ailleurs<br />
attaccatutto s.m.inv.<br />
colle f. forte, super glue f. ES, B confirme<br />
attacco s.m.<br />
11 (El,Tel) prise f. de courant. ES, B, G et HP confirment<br />
14 (Alp) point de départ. ET, acception absente ailleurs<br />
attachment s.m.inv.<br />
(Inform) pièce f. jointe, document m. attaché. ED, B “(ingl., inform.) annexe”<br />
attanagliare v.tr.<br />
1 (stringere con le tenaglie) serrer avec des tenailles, saisir avec des tenailles. ES, B 575 , G et HP<br />
confirment<br />
2 (estens) (stringere con forza) serrer avec force. ED, G “(stringere con forza) serrer”<br />
attendibile agg.m./f.<br />
(credibile) digne de foi. ES, B, G et HP confirment<br />
attentare v. intr.<br />
574 B et G ont ce même ED.<br />
575 Ce dictionnaire a deux acceptions différentes pour ces deux traduisants.<br />
402
(mettere in pericolo) porter atteinte (a à): attentare all’onore di qcu. porter atteinte à l’honneur<br />
de qqn; attentare all’incolumità di qcu. porter atteinte à la sûreté de qqn. ES, acception<br />
absente ailleurs<br />
attentatore s.m.<br />
auteur d’un attentat. ES, B, G et HP confirment<br />
atterrirsi v.prnl.<br />
être saisi de terreur. ES, B, G et HP confirment<br />
attestabile agg.m./f.<br />
que l’on peut attester. EM, B et G confirment<br />
attestamento s.m.<br />
(Mil) prise f. de position. ET, B et G 576 confirment<br />
attestare 2<br />
v.tr. 577<br />
(porre due cose testa a testa) mettre bout à bout: attestare due letti placer deux lits bout à bout.<br />
ED, G “(mettere testa a testa) abouter 578 ”<br />
attillato agg.<br />
(lett,rar) (rif. a persona: elegante) tiré à quatre épingles. ES, B et G confirment<br />
attillatura s.f.<br />
(abito) vêtement m. moulant. ES, absent ailleurs<br />
attitudinale agg.m./f.<br />
d’aptitude: esame attitudinale test d’aptitude. EM, B, G et HP confirment<br />
attivare v.tr.<br />
(mettere in funzione) mettre en marche, mettre en route: attivare un macchinario mettre en<br />
marche une machine; attivare un dispositivo mettre un dispositif en route. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
II prnl. attivarsi<br />
576 Ajoute l’acception “renforcement d’une position avancée”, ET.<br />
577 B, dans l’acception 2 : “(mil.) faire prendre position”, ce qui est un ED car SL propose correctement “(Mil)<br />
déployer”.<br />
578 Qui est cependant marqué comme “Techn.” par PR11.<br />
403
(entrare in funzione) se mettre en marche, se mettre en route. ES, acception absente ailleurs<br />
attivazione s.f.<br />
1 (il rendere operativo) mise en service: l’attivazione di un nuovo ospedale la mise en service<br />
d’un nouvel hôpital. ES, B et G confirment<br />
2 (messa in funzione) mise en marche, mise en route, mise en activité: l’attivazione di un<br />
macchinario la mise en marche d’une machine; l’attivazione di un dispositivo la mise en<br />
place d’un dispositif. ES, G confirme<br />
4 (Tel,Ferr) (di una linea) mise en service. ES, HP confirme<br />
attivo 579 agg. 580<br />
(in funzione) en activité. ES, acception absente ailleurs<br />
attorcere v.tr.<br />
tordre avec force. ED, B “tordre, retordre, entortiller”<br />
attoriale agg.m./f.<br />
d’acteur. EM, absent ailleurs<br />
attorno avv.<br />
(nei paraggi) dans les parages, dans les environs: attorno non c’era nessuno il n’y avait<br />
personne dans les parages. ES, G confirme<br />
attracco s.m. (Mar)<br />
(luogo) poste à quai; (per navi) poste d’amarrage. ED, HP “(luogo) quai, môle” 581<br />
attrattiva s.f.<br />
al pl. (strutture per il divertimento) infrastructures de loisirs. ES, acception absente ailleurs<br />
attrezzeria s.f.<br />
1 (Teat) accessoires m.pl. de théâtre. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (Ind) atelier m. d’outillage. ET, B et G confirment<br />
579 Dans la catégorie du substantif, G a l’acception (absente ailleus) : « (pol.) (funzionari, militanti di organsimo<br />
politico) l’appareil et l’état-major”, ES.<br />
580 B a aussi l’acception traduite “d’action: è un uomo attivo, non un sognatore, c’est un homme d’action et<br />
non pas un rêveur”, absente ailleurs (ES).<br />
581 B a ce même ED.<br />
404
attrezzistica s.f.<br />
(Ginn) gymnastique aux agrès. ES, B, G et HP confirment<br />
attuativo agg.<br />
d’application. EM, B 582 et HP confirment<br />
audiocassetta s.f.<br />
cassette audio. ED, G “cassette (audio)” 583<br />
audioguida s.f.<br />
guide m. audio. ED, HP “audioguide”<br />
audiologo s.m.<br />
(Med) spécialiste m./f. de l’audition. ET, absent ailleurs<br />
augurale agg.m./f.<br />
de voeux: messaggio augurale message de voeux. EM, B, G et HP confirment<br />
augurio s.m.<br />
(Stor.rom) cérémonie f. augurale. ES, G confirme<br />
augusteo agg.<br />
(Stor.rom) d’Auguste: età augustea le siècle d’Auguste. EM, B, G et HP confirment<br />
aurica s.f.<br />
(Mar) voile aurique. ED, G “(mar.) (vela) aurica, aurique” 584<br />
ausiliaria s.f.<br />
(Mil) auxiliaire féminine de l’armée. ED, B “(mil.) auxiliaire”, G “AFAT (sigla di Auxiliaire<br />
Féminin de l’Armée de Terre) 585<br />
australiana s.f.<br />
582 Ajoute l’acception “de réalisation, d’exécution”, ES.<br />
583 B et HP ont ce même ED.<br />
584 B a ce même ED.<br />
585 HP a deux acceptions : « 1 = femme employée dans les services auxiliaires de l’armée pendant la deuxième<br />
guerre mondiale », absente ailleurs, ER. Et « 2 = dans l’armée française, membre de l’AFAT », ED car G<br />
traduit « AFAT ».<br />
405
(Sport) (nel ciclismo) course poursuite par équipes. ES, G confirme<br />
austridi s.f.pl.<br />
(Geol) unité sing. techtonique fondamentale des Alpes. ET, absent ailleurs<br />
autarchia s.f.<br />
(Dir) (autonomia) autonomie administrative. ED, HP “ECON. DIR. autarcie” 586<br />
authority s.f.inv.<br />
organisme m. de contrôle. ED, G “(ingl.) autorité; ART (Autorité de Régulation des<br />
Télécommunications)”<br />
autiere s.m.<br />
(Mil) chauffeur militaire. ED, G “(mil.) chauffeur (militaire)” 587<br />
autoaccessori s.m.pl.<br />
(Aut) équipement sing. automobile, accessoires automobiles, accessoires auto. ES, B 588 , G 589<br />
et HP confirment<br />
autoaccusarsi v.prnl.<br />
s’accuser soi même. ED, B “s’autoaccuser”<br />
autoaffermazione s.f.<br />
(Psic) affirmation de soi. ES, B, G et HP confirment<br />
autoarticolato s.m.<br />
(Aut) véhicule articulé. ED, B “semi-remorque”<br />
autoassolversi v.prnl.<br />
se donner l’absolution. ED, G “se disculper” 590<br />
autobetoniera s.f.<br />
bétonnière portée, camion m. malaxeur. ED, B “autobétonnière” 591<br />
586 B a ce même ED.<br />
587 B et HP ont ce même ED.<br />
588 S.v. autoaccessorio.<br />
589 S.v. autoaccessorio.<br />
590 HP a ce même ED.<br />
406
autobiografismo s.m.<br />
tendance f. à l’autobiographie. ED, B “autobiographisme” 592<br />
autoblinda s.f.<br />
(Mil) véhicule m. blindé. ED, B “blindé”<br />
autoblindata s.f.<br />
(Mil) véhicule m. blindé. ED, HP renvoie à autoblindato, traduit “blindé”<br />
autoblindo s.m.inv.<br />
(Mil) véhicule m. blindé. ED, HP “blindé”<br />
autocamionale s.f.<br />
(Strad) route ouverte aux poids lourds. ES, B et G confirment<br />
autocentro s.m.<br />
(Mil) compagnie f. automobile. ET, B et G confirment<br />
autocolonna s.f.<br />
(Mil) colonne de camions, colonne motorisée. ET, B 593 , G et HP confirment<br />
autocombustione s.f.<br />
combustion spontanée. ES, B, G et HP confirment<br />
autocommiserarsi v.prnl.<br />
s’apitoyer sur son sort. ES, G confirme<br />
autocommiserazione s.f.<br />
apitoiement m. sur soi. ED, B “autocompassion”<br />
autoconcessionario s.m.<br />
concessionnaire automobile. ES, absent ailleurs<br />
autoconvincersi v.prnl.<br />
se convaincre soi-même. ES, absent ailleurs<br />
591 G a ce même ED.<br />
592 Mot absent dans PR11 et TLFi, cependant. HP fait le même choix que SL, donc il engendre un ED.<br />
593 Ajoute l’acception “colonne automobile”, ET.<br />
407
autoconvincimento s.m.<br />
fait de se convaincre soi-même. ES, absent ailleurs<br />
autocosciente agg.m./f.<br />
(Filos) conscient de soi. ES, HP confirme<br />
autocoscienza s.f.<br />
1 (Filos) conscience de soi. ES, G et HP confirment<br />
2 (estens) connaissance de soi. ED, B “auto-conscience”<br />
autocritico agg.<br />
d’autocritique: un atteggiamento autocritico une attitude d’autocritique. ED, B<br />
“autocritique” 594<br />
autodemolizione s.f.<br />
(demolizione) démolition de véhicules automobiles usagés. ES, acception absente ailleurs<br />
autodenuncia s.f.<br />
(davanti alla polizia) aveu m. spontané. ES, B et G confirment<br />
autodidattismo s.m.<br />
apprentissage autodidacte. ES, absent ailleurs<br />
autoemoteca s.f.<br />
(Med) unité mobile de prélèvement du sang. ET, B et G confirment<br />
autoesaltazione s.f.<br />
exaltation de soi. ED, G “autocélébration” 595<br />
autoferrotranviario agg.<br />
des transports publics urbains. ES, B, G et HP confirment<br />
autoferrotranvieri s.m.pl.<br />
salariés des transports publics urbains. ES, B 596 , G et HP confirment<br />
594 Qui est cependant un substantif pour PR11. G et HP font le même choix que SL.<br />
595 HP a ce même ED.<br />
596 S.v. autoferrotranviere.<br />
408
autofficina s.f.<br />
(officina per riparazioni auto) atelier m. de réparations. ED, HP “garage” 597<br />
autofilotranviario agg.<br />
des transports urbains: rete autofilotranviaria réseau des transports urbains; servizio<br />
autofilotranviario service de transports urbains. ES, B, G et HP confirment<br />
autogestione s.f.<br />
(Scol) gestion de l’école par ses élèves. ES, acception absente ailleurs 598<br />
autogonfiabile 599 s.m.<br />
(Mar) canot pneumatique, canot pneumatique gonflable. ED, B “(mar.) mouette”<br />
autogoverno s.m.<br />
autonomie f. de gouvernement. ED, B “autarchie” 600<br />
autografare v.tr.<br />
signer un autographe sur. ED, B “autographier”<br />
autografato agg.<br />
avec un autographe: ho una foto autografata j’ai une photo avec un autographe, j’ai un<br />
autographe sur une photo. ED, HP “autographié”<br />
autoinnaffiatrice s.f.<br />
arroseuse automobile. ED, G “arroseuse”<br />
autolavaggio s.m.<br />
lavage automatique. ED, G “lave-auto” 601<br />
autolesionista I agg.m./f.<br />
1 qui pratique l’automutilation. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
597 B et G ont ce même ED. B et G ont aussi l’acception (absente ailleurs) « camion atelier », autant d’ES.<br />
598 G a l’exemple “gli studenti sono in autogestione, les étudiants sont en autogestion”.<br />
599 B propose “gonflable automatiquement” pour l’adjectif, ce qui est un ED car SL traduit correctement<br />
“autogonflable”.<br />
600 HP a ce même ED.<br />
601 B et HP ont ce même ED.<br />
409
2 (estens) ayant un comportement autodestructeur. ES, catégorie grammaticale absente<br />
ailleurs<br />
II s.m./f.<br />
1 personne f. qui pratique l’automutilation. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (estens) personne f. ayant un comportement autodestructeur: è un autolesionista il se veut<br />
du mal. ED, B “(fig.) masochiste”<br />
autolesionistico agg.<br />
d’automutilation. EM, B, G et HP confirment<br />
autolinea s.f.<br />
1 (percorso) ligne de bus. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (servizio) service m. d’autobus. ES, B et G confirment<br />
automezzo s.m.<br />
véhicule automobile. ES, B, G et HP confirment<br />
automobilina s.f.<br />
1 (giocattolo) petite voiture. ES, HP confirme<br />
2 (modellino) voiture miniature. ES, HP confirme<br />
automobilismo s.m.<br />
(Sport) course f. automobile, sport de la course automobile. ES, acception absente ailleurs<br />
automobilista s.m./f.<br />
(Sport,rar) pilote de course. ES, acception absente ailleurs<br />
autonoleggiatore s.m.<br />
loueur de voitures. ES, B, G et HP confirment<br />
autonoleggio s.m.<br />
1 location f. de voitures. ES, B, G et HP confirment<br />
2 (azienda) société f. de location de voitures. ES, acception absente ailleurs<br />
autonomamente avv.<br />
410
de manière autonome. EM, HP confirme<br />
autonomo s.m./f.<br />
(di sindacato) membre m. d’un syndicat autonome. ES, HP confirme 602<br />
autoparco s.m.<br />
(parco auto) parc automobile. ES, B, G et HP 603 confirment<br />
autopattuglia s.f.<br />
patrouille motorisée. ES, B et HP confirment<br />
autopilota s.m.<br />
(Aer) pilote automatique. ED, B “(aer., astron.) autopilote” 604<br />
autopista s.f.<br />
(autoscontri) piste d’autos tamponneuses. ES, B, G et HP confirment 605<br />
autoporto s.m.<br />
plate-forme f. de stationnement. ED, B “autoport”<br />
autopostale s.m.<br />
(Svizz.it) bus des postes fédérales suisses. ER, absent ailleurs<br />
autoreferenziale agg.m./f.<br />
qui fait exclusivement allusion à soi. ED, B “autoréférentiel” 606<br />
autoreferenzialità s.f.<br />
fait m. de faire exclusivement référence à soi. ES, absent ailleurs<br />
autoreggenti s.f.pl.<br />
(Abbigl) bas m.pl. Auto-fixants. ES, absent ailleurs<br />
autoreparto s.m.<br />
602 Et ajoute l’acception « en Italie, partisan de l’extrême gauche extraparlementaire », ER.<br />
603 Ajoute l’acception « parc de stationnement », ES<br />
604 G et HP ont ce même ED.<br />
605 B et HP ont aussi une acception traduite « (nel deserto) piste pour autos / automobile », donc autant d’ED,<br />
car G a tout simplement « (nel deserto) piste (pour automobiles) ».<br />
606 Absent dans PR11, mais présent dans TLFi, s.v. référentiel.<br />
411
(Mil) parc automobile de l’armée. ET, B et G confirment<br />
autorespiratore s.m.<br />
scaphandre autonome. ES, B, G et HP confirment<br />
autorevolmente avv.<br />
avec autorité. EM, B et G confirment<br />
autoricambio s.m.<br />
(pezzo) pièce f. de rechange auto. ES, absent ailleurs<br />
autoriparazione s.f.<br />
(riparazione) réparation d’autos. ES, B confirme<br />
autosalone s.m.<br />
1 (fiera) salon de l’auto, salon de l’automobile. ES, acception absente ailleurs<br />
2 (salone) hall d’exposition (d’automobiles). ES, G confirme<br />
3 (rivendita) concession automobile. ES, B et HP confirment<br />
autoscala s.f.<br />
(Tecn) échelle mécanique, échelle aérienne. ET, B 607 et G confirment<br />
autoscatto s.m.<br />
(Fot) déclencheur automatique. ED, HP “auto-déclencheur” 608<br />
autoscontro s.m.<br />
(pista) piste f. d’autos tamponneuses. ES, acception absente ailleurs<br />
autoservizio s.m.<br />
service d’autobus. ES, B 609 , G et HP confirment<br />
autosilo s.m.<br />
parking à niveaux. ED, G “auto-silo” 610<br />
607 Ajoute l’acception “voiture avec échelle mécanique”, absente ailleurs (ET).<br />
608 G a ce même ED.<br />
609 Ajoute l’acception “service auto”, absente ailleurs (ES).<br />
610 Absent dans PR11 et TLFi. B et HP a ce même ED.<br />
412
autosnodato s.m.<br />
véhicule articulé. ES, B, G et HP confirment<br />
autosoccorso s.m.<br />
(servizio) service de dépannage. ES, B, G et HP confirment<br />
autostazione s.f.<br />
(rar) (stazione di servizio) gare routière. ES, B, G et HP 611 confirment<br />
autostima s.f.<br />
estime de soi même. ES, B, G et HP confirment<br />
autosuggestionabile agg.m./f.<br />
sujet à l’autosuggestion. ES, absent ailleurs<br />
autotrasportare v.tr.<br />
1 (in auto) transporter en voiture. ED, B “(con autovetture) voiturer”<br />
2 (in autobus) transporter en bus, transporter en car. ES, acception absente ailleurs<br />
autotrasportatore s.m.<br />
(azienda) société f. de transports routiers. ES, acception absente ailleurs 612<br />
autotrasporto s.m.<br />
(di persone) transport automobile, transport routier. ES, B confirme<br />
autotutela s.f.<br />
(Dir) tutelle administrative. ET, B et G confirment<br />
autoveicolo s.m.<br />
véhicule automobile. ED, HP “voiture” 613<br />
avanspettacolo s.m.<br />
(Teat,ant) lever de rideau (avant la projection d’un film). ES, B, G et HP confirment<br />
avanti I avv.<br />
611 Ajoute l’acception “(terminal) gare routière”, un ED, car SL propose « (capolinea) terminus ».<br />
612 HP a l’acception “(imprenditore) entrepreneur(-euse) de camionnage”, ES.<br />
613 Qui est pourtant un hyperonyme. G aussi fait comme SL.<br />
413
(moto: di avvicinamento) plus près: venite avanti approchez-vous. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
IV agg.m./f.inv.<br />
1 (a uno stadio avanzato) à un stade avancé: il lavoro è molto avanti le travail est à un stade<br />
très avancé; essere avanti negli studi être en avance dans ses études. ES, acception absente<br />
ailleurs<br />
2 (in anticipo) en avance: sono avanti con il lavoro je suis en avance dans mon travail; essere<br />
avanti rispetto a qcu. avoir de l’avance sur qqn. ES, G confirme<br />
avantielenco s.m.<br />
pages f.pl. d’introduction de l’annuaire téléphonique. ES, G confirme<br />
avanzare 2<br />
v.intr. 614<br />
(estens) (essere sovrabbondante) être en surabondance. ES, acception absente ailleurs<br />
avaraccio agg.<br />
vieil avare, vieux pingre. ED, HP “grippe-sou”<br />
avicunicolo agg.<br />
qui se rapporte à l’élevage de volailles et de lapins. ED, G “avicunicole” 615<br />
avicunicoltura s.f.<br />
élevage m. de volailles et de lapins. ED, G “avicuniculture” 616<br />
aviogetto s.m.<br />
(Aer) avion à réaction. ED, B “(aer.) jet” 617<br />
aviolinea s.f.<br />
(rar) ligne aérienne. ES, B, G et HP confirment<br />
avioraduno s.m.<br />
meeting aérien. ES, B, G et HP confirment<br />
614 Dans le verbe transitif, HP a l’acception « (essere creditore) être créancier de », ED car SL a tout<br />
simplement « (essere creditore) devoir ».<br />
615 B a ce même ED.<br />
616 B a ce même ED.<br />
617 HP a ce même ED.<br />
414
aviosbarco s.m.<br />
(Mil) débarquement aérien. ES, B et HP confirment<br />
aviotrasportare v.tr.<br />
transporter par avion, transporter par voie aérienne. ED, HP “aéroporter” 618<br />
aviotrasporto s.m.<br />
transport par avion, transport aérien. ES, B, G et HP confirment<br />
avvantaggiarsi v.prnl.<br />
2 (estens) (guadagnare spazio) prendre de l’avance: il corridore si era avvantaggiato di qualche<br />
metro le coureur avait pris quelques mètres d’avance. ED, HP “(guadagnare spazio)<br />
progresser”<br />
3 (estens) (guadagnare tempo) gagner du temps (su sur). ES, G et HP confirment<br />
4 (estens) (superare in valore) avoir le dessus (su sur), prendre le dessus (su sur). ES, B et G<br />
confirment<br />
avvenirismo s.m.<br />
esprit précurseur. ED, HP “futurisme, futurologie” 619<br />
avversario s.m.<br />
(Dir) partie f. adverse. ED, B “(dir.) contradicteur”<br />
avviamento s.m.<br />
(Tip) mise f. en train. ET, B 620 et G confirment<br />
avviare v.tr.<br />
5 (Mecc) mettre en marche. ES, B, G et HP confirment<br />
6 (Mot) faire démarrer, mettre en marche; (con la manovella) faire démarrer à la manivelle. ES,<br />
B, G et HP confirment<br />
618 B et G ont ce même ED.<br />
619 Les définitions de avvenirismo (GI, “fiducia ottimistica”) et futurologie (PR11, « ensemble des recherches<br />
prospectives concernant l’évolution future, scientifique, économique, sociale, technique, de l’humanité »),<br />
voire futurisme (PR11, “mouvement esthétique”) ne correspondent pas du tout, cependant. B et G traduisent<br />
comme SL.<br />
620 B a aussi l’acception 2 “mise en train”, un ED car on peut voir que SL choisit “ouverture” pour les mêmes<br />
contextes.<br />
415
II prnl. avviarsi<br />
(fig) (stare per) être en passe (a de): il ragazzo si avvia a diventare il primo della classe ce<br />
garçon est en passe de devenir le premier de sa classe. ES, B 621 , G et HP confirment<br />
avviato agg.<br />
(fig) (che ha cominciato) qui a commencé: mi sembra bene avviato egli studi il semble avoir<br />
bien commencé ses études, il semble être bien parti dans ses études; quel tempo ero bene<br />
avviato nel lavoro à ce moment-là le travail avait déjà bien commencé. ED, B “lancé”<br />
avvocatessa s.f.<br />
(scherz) (chi ha una buona parlantina) femme qui a du bagout. ES, G confirme<br />
avvocato s.m.<br />
(scherz,fig) (chi ha una buona parlantina) homme qui a du bagout. ES, acception absente ailleurs<br />
avvocatura s.f.<br />
(professione) profession d’avocat: esercitare l’avvocatura être avocat, exercer la profession<br />
d’avocat. ED, HP “(professione) barreau” 622<br />
avvolgibile I s.m.<br />
(Edil) (tapparella) volet roulant: avvolgibile in acciaio volet roulant en acier. ET, HP<br />
confirme<br />
II agg.m./f.<br />
qui peut être enroulé. ED, B “enroulable”<br />
avvolgicavo s.m.<br />
(El) enrouleur de câble. ET, B et G confirment<br />
aziendale agg.m./f.<br />
de l’entreprise: auto aziendale voiture de fonction, voiture de société. EM, B, G et HP<br />
confirment<br />
aziendalista I s.m./f.<br />
621 B a aussi l’acception 5 “se mettre en branle: il corteo si avviò alle quattordici in punto, le cortège se mit en<br />
branle à quatorze heures précises”, ES absent ailleurs.<br />
622 B a ce même ED.<br />
416
1 (esperto di economia aziendale) expert m. en économie d’entreprise. ES, B, G et HP<br />
confirment<br />
2 (persona totalmente dedicata all’azienda) personne f. totalement dévouée à l’entreprise. ES, G<br />
confirme<br />
II agg.m./f.<br />
totalement dévoué à l’entreprise. ES, G confirme<br />
aziendalistico agg.<br />
1 (dell’azienda) de l’entreprise. EM, absent ailleurs<br />
2 (totalmente dedicato all’azienda) totalement dévoué à l’entreprise. ES, absent ailleurs<br />
azionabile agg.m./f.<br />
qu’on peut actionner. EM, G confirme<br />
azocomposto s.m.<br />
(Chim) composé d’azote, composé azoïque. ET, B et G confirment<br />
azzannare vtr.<br />
1 (afferrare) saisir entre ses crocs. ED, B et HP “mordre”, G “happer”<br />
3 (fig,rar) attaquer sauvagement. ES, acception absente ailleurs<br />
azzeramento s.m.<br />
(Tecn) mise f. à zéro, remise f. à zéro. ED, B “(fis., inform.) zérotage” 623<br />
azzerare v.tr.<br />
(Tecn) mettre à zéro, remettre à zéro: azzerare un contatore mettre un compteur à zéro. ET,<br />
B, G et HP confirment<br />
azzima s.f.<br />
(Rel.ebr,Alim) pain m. azyme. ED, HP “azyme” 624<br />
azzurrabile agg.m./f.<br />
(Sport,rar) qui peut faire partie de l’équipe nationale italienne. ER, absent ailleurs<br />
623 G a ce même ED.<br />
624 G a ce même ED.<br />
417
azzurrarsi v.prnl.<br />
devenir bleu. ES, absent ailleurs<br />
azzurrino 625 agg.<br />
bleu clair inv., bleu ciel inv. ED, B “azuré” 626<br />
azzurro I agg.<br />
bleu ciel inv., bleu clair inv.: un cielo azzurro un ciel bleu, un ciel d’azur; ha gli occhi azzurri<br />
il a les yeux bleus. ED, B “bleu”<br />
II s.m.<br />
1 (colore) bleu ciel, bleu clair: l’azzurro del mare le bleu de la mer. ED, B “bleu”<br />
4 (Sport) (nel calcio) joueur de l’équipe nationale italienne de football; (nelle varie discipline)<br />
sportif de l’équipe nationale italienne: gli azzurri (nel calcio) équipe nationale italienne de<br />
football; (nelle varie discipline) équipe nationale italienne. ER, G et HP confirment<br />
625 B, G et HP ont aussi la catégorie du substantif, avec l’ES sur traduisants “bleu clair, horizon / bleu ciel /<br />
couleur azurée”. HP a aussi, dans le substantif, l’acception « SPORT = athlète qui appartient à une équipe<br />
nationale italienne de jeunes », ER.<br />
626 G a ce même ED.<br />
418
DICTIONNAIRE BOCH<br />
abatino s. m.<br />
1 jeune abbé. ES, G confirme<br />
2 (iron.) abbé de cour. ES, G 627 et HP confirment<br />
abbagliante A agg.<br />
1 qui éblouit: luce abbagliante, lumière qui éblouit; (autom.) fari abbaglianti, feux de route.<br />
ED, SL “éblouissant”<br />
B s. m.<br />
(autom.) phare de route: viaggiare con gli abbaglianti accesi, rouler pleins phares. ES, HP et<br />
SL confirment<br />
abbaiare v. intr.<br />
(caccia) donner de la voix. ET, acception absente ailleurs<br />
abbandonismo s. m.<br />
(psic.) névrose d’abandon (f.). ED, G “(psic.) abandonnisme”<br />
abbatuffolare v. tr.<br />
mettre en boule. ES, G confirme<br />
abbisciatura s. f.<br />
(mar.) amarrage à fouet. ET, absent ailleurs<br />
abbittatura s. f.<br />
(mar.) tour de bitte, amarrage à la bitte. ET, absent ailleurs<br />
abboccare A v. intr. 628<br />
2 (fig.) se laisser prendre: quello stupido ha abboccato!, il s’est laissé prendre, l’idiot!; non<br />
abbocco!, ça ne prend pas!; (fig.) abboccare all’amo, gober le morceau, mordre à l’hameçon.<br />
ED, G “gober” 629<br />
627 Ajoute la précision “(prete mondano del sec. XVIII”).<br />
628 HP traduit « TECN. [tubi] être abouché », ED car G traduit « (combaciare) se joindre ».<br />
419
3 (mar.) gîter bord dans l’eau. ED, SL “gîter”<br />
B v. tr.<br />
remplir jusqu’au bord, à ras bord: abboccare un bicchiere, remplir un verre jusqu’au bord.<br />
ED, G “(region.) (riempire fino all’orlo) remplir (jusqu’au goulot)”<br />
abbonamento s. m.<br />
(documento) carte d’abonnement (f.). ED, SL “(documento) abonnement” 630<br />
abbozzaticcio A agg.<br />
mal ébauché, mal esquissé. EM, absent ailleurs<br />
B s. m.<br />
travail bâclé. ES, absent ailleurs<br />
abbozzolarsi v. rifl.<br />
(del baco da seta) filer son cocon. ED, SL “(Zool) (fare il bozzolo) coconner” 631<br />
abbrancare A v. tr.<br />
réunir en troupeau. ES, HP confirme<br />
B abbrancarsi v. rifl.<br />
se réunir en troupeau. ED, HP “se rassembler”<br />
abbreviatore 1 agg. sost.<br />
qui abrège, qui raccourcit. EM, absent ailleurs<br />
abbrumare v. intr.<br />
(mar.; della carena) être attaqué par les tarets. ET, absent ailleurs<br />
abburattare v. tr.<br />
(fig.; vagliare) passer au crible. ES, acception absente ailleurs<br />
abburattata s. f.<br />
629 SL a ce même ED.<br />
630 HP a ce même ED.<br />
631 HP a ce même ED.<br />
420
1 coup de tamis (m.), blutage rapide (m.), tamisage rapide (m.): dare un’abburattata, tamiser<br />
rapidement. ES, absent ailleurs<br />
2 quantité de farine mise dans le blutoir. ES, absent ailleurs<br />
abigeo s. m.<br />
(dir.) voleur de bétail. ET, G et HP confirment<br />
abilitare A v. tr.<br />
conférer un certificat d’aptitude professionnelle (a): abilitare q. all’insegnamento, conférer à<br />
q. le certificat d’aptitude à l’enseignement. ED, SL “(qualificare) qualifier” 632<br />
B abilitarsi v. rifl.<br />
obtenir un certificat d’aptitude professionnelle. ED, SL “se qualifier” 633<br />
abilitato agg.<br />
titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle: professore abilitato, professeur titulaire<br />
du certificat d’aptitude à l’enseignement, professeur certifié. ED, SL “(di insegnante)<br />
certifié” 634<br />
ablatore A agg.<br />
(geogr.) d’ablation. ET, G confirme<br />
B s. m.<br />
(med.) instrument pour le détartrage. ED, G “(med.) curette”<br />
abrasività s. f. inv.<br />
(tecnol.) pouvoir d’abrasion. ET, G confirme<br />
abrogazionista A agg.<br />
en faveur de l’abrogation. ES, G confirme<br />
B s. m. e f.<br />
partisan de l’abrogation. ES, G et HP confirment<br />
absidato agg. (arch.)<br />
632 G a ce même ED.<br />
633 G et HP ont ce même ED.<br />
634 G a ce même ED.<br />
421
1 en forme d’abside ET, G et HP confirment<br />
2 qui a une abside. ET, HP confirme<br />
abusato agg.<br />
employé abusivement: espressione abusata, expression employée abusivement. ES , G<br />
confirme<br />
accapo o a capo avv.<br />
à la ligne: punto e accapo, point, à la ligne. ES, G, HP et SL confirment<br />
acattolico agg. sost.<br />
(relig.) non catholique. ES, G, HP et SL confirment 635<br />
accalappiamento s. m.<br />
(di cani) mise en fourrière, mise à la fourrière. ES, acception absente ailleurs 636<br />
accaldato agg.<br />
en sueur: non si deve prender freddo quando si è accaldati, il ne faut pas prendre froid<br />
quand on est en sueur. ED, SL “échauffé” 637<br />
accantonamento s. m.<br />
mise de côté: l’accantonamento di una proposta, di un progetto, la mise en veilleuse d’une<br />
proposition, d’un projet. ES, G et HP confirment<br />
accapigliamento s. m.<br />
(discussione) prise de bec (f.). ES, acception absente ailleurs<br />
accappiare v. tr.<br />
fixer par un nœud coulant. ES, absent ailleurs<br />
accappiatura s. f.<br />
nœud coulant (m.). ES, absent ailleurs<br />
accartocciamento s. m.<br />
635 HP et SL ajoutent la typologie grammaticale du substantif: “(chrétien) non catholique”, ES.<br />
636 G a une autre acception, traduite « action d’attraper », ED car HP traduit « (cattura) capture ».<br />
637 G et HP ont ce même ED.<br />
422
enroulement en cornet: l’accartocciamento di una foglia, l’enroulement d’une feuille. ED,<br />
SL “recroquevillement”<br />
accasciarsi v. intr. pron.<br />
(fig.) se laisser abattre: la famiglia si è accasciata per il dolore, la famille s’est laissée abattre<br />
par la douleur. ED, SL “(estens) (avvilirsi) se décourager, se démoraliser”<br />
accattafieno s. m. inv.<br />
(agr.) ramasseuse de foin (f.). ED, SL “(Agr) ramasseuse-presse”<br />
accatto s. m.<br />
(st. dir.) emprunt forcé. ET, acception absente ailleurs<br />
accavezzare v. tr.<br />
attacher par le licol, retenir par le licol. ES, absent ailleurs<br />
accavigliare v. tr.<br />
1 (mar.) tourner au cabillot: accavigliare una drizza, tourner une drisse au cabillot. ET,<br />
acception absente ailleurs<br />
2 (tess.) enrouler les fils sur les chevilles. ET, G confirme<br />
accavigliatore s. m.<br />
1 (mar.) matelot de manœuvre aux cabillots. ET, absent ailleurs<br />
2 (tess.) ouvrier préposé à l’enroulement des fils sur les chevilles. ET, absent ailleurs<br />
accavigliatura s. f.<br />
1 (mar.) tournage au cabillot. ET, absent ailleurs<br />
2 (tess.) enroulement des fils sur les chevilles. ET, absent ailleurs<br />
accecare v. intr.<br />
devenir aveugle. ES, G confirme<br />
accecatoio s. m.<br />
(tecnol.) fraise à chambrer (f.). ED, SL “(Mecc) fraise”<br />
accecatore s. m.<br />
423
1 (poco usato) personne qui crève les yeux (à q.). EM, G confirme 638<br />
2 (tecnol.) fraise à chambrer (f.). ED, G “(mecc.) fraise” 639<br />
acceleramento s. m.<br />
(ferr.) régime accéléré. ET, acception absente ailleurs<br />
accettata s. f.<br />
coup de hache (m.). ES, G et HP confirment<br />
accetto agg.<br />
1 bien accueilli: un augurio ben accetto a tutti, des vœux bien accueillis par tout le monde.<br />
ED, SL “bienvenu” 640<br />
2 bien vu: una persona accetta a tutti, une personne bien vue de tout le monde. ES, G et SL<br />
confirment<br />
acchiappacani s. m. e f. inv.<br />
employé de la fourrière. ES, G et HP confirment<br />
acchiappavoti agg. inv.<br />
(fam., spreg.) qui vise à obtenir des suffrages par des moyens douteux. ES, G confirme<br />
acchitare v. tr.<br />
(biliardo) donner l’acquit (à). ES, G confirme<br />
acciabattare v. intr.<br />
traîner ses savates: la donna si allontanò acciabattando, la femme s’éloigna en traînant ses<br />
savates. ES, G et HP confirment<br />
acciambellare v. tr.<br />
ramasser en rond. ED, SL “lover”<br />
accidente s. m.<br />
(fam.) attaque d’apoplexie: mi venga un accidente se …, je veux être pendu si …; gli venisse<br />
un accidente!, que le diable l’emporte!; mandare un accidente, un sacco d’accidenti a q.,<br />
traiter q. de tous les noms d’oiseau. ED, SL “(colloq) (colpo apoplettico) attaque”<br />
638 G a aussi la typologie grammaticale de l’adjectif, traduit « qui crève les yeux », EM.<br />
639 S.v. accecatoio, renvoi de l’entrée accecatore.<br />
640 G a ce même ED.<br />
424
accigliamento s. m.<br />
froncement de sourcils. ES, G confirme<br />
accigliare v. tr.<br />
(falconeria) coudre les paupières (au faucon). ET, absent ailleurs<br />
acciughina s. f.<br />
(zool.) poisson d’argent (m.). ET, absent ailleurs<br />
acclarare v. tr.<br />
(forb.) tirer au clair. ES, absent ailleurs<br />
accoccare v. tr.<br />
fixer au fuseau: accoccare il filo, fixer le fil au fuseau. ES, absent ailleurs<br />
accodarsi v. rifl.<br />
faire la queue: accodarsi davanti al botteghino del teatro, faire la queue devant le guichet du<br />
théâtre; le auto si accodano al semaforo, les autos font la queue au feu rouge. ES , G et HP<br />
confirment<br />
accollante s. m. e f.<br />
(dir.) celui qui se charge d’une dette d’autrui. ET, absent ailleurs<br />
accollare 641 A v. tr.<br />
2 (detto di carro) charger sur le devant. ES, G confirme<br />
3 habituer au joug: accollare i buoi, habituer les bœufs au joug. ES, absent ailleurs<br />
B v. intr.<br />
être montant: queste scarpe non accollano abbastanza, ces chaussures ne sont pas assez<br />
montantes; abito che accolla, robe montante, à encolure montante. ED, G “(di vestiti, scarpe)<br />
monter” 642<br />
accollo s. m.<br />
1 (di carro) partie antérieure. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (dir.) chargement d’une dette. ED, SL “ (dir.) adjudication”<br />
641 HP ajoute l’acception (absente ailleurs) “faire endosser [responsabilità]”, ES.<br />
642 HP a ce même ED.<br />
425
accoltellato s. m.<br />
(edil.) assise de chant. ET, G et HP confirment<br />
accomandolare v. tr.<br />
(tess.) nouer les fils de chaîne. ET, absent ailleurs<br />
accompagnabile agg. (poco usato)<br />
1 (di persona) que l’on peut accompagner. EM, absent ailleurs<br />
2 (di colori) que l’on peut assortir. ES, G confirme<br />
accompagnatoria s. f.<br />
(bur.) lettre d’accompagnement. ET, HP confirme<br />
accoppiarsi v. rifl. e rifl. rec. 643<br />
former un couple: accoppiarsi per la danza, former un couple pour danser. ES, G et SL<br />
confirment<br />
accostare v. intr.<br />
(mar.) changer de cap: la nave ha accostato, le navire a changé de cap. ET, acception<br />
absente ailleurs<br />
accostata s. f.<br />
(mar.) changement de cap. ED, G “(mar., aer.) abattée”<br />
accotonatore s. m.<br />
ouvrier préposé au frisage. ES, absent ailleurs<br />
accozzabile agg.<br />
que l’on peu mêler, que l’on peut mélanger. EM, absent ailleurs<br />
accreditatario s. m.<br />
(banca) bénéficiaire d’un crédit bancaire. ET, G confirme<br />
accudire v. tr.<br />
prendre soin (de): accudire un bambino, prendre soin d’un enfant. ED, HP “garder<br />
[bambino]”<br />
643 G a aussi l’acception, absente ailleurs : “(stare insieme) (spec. di colori) être assorti”, ES.<br />
426
acculare A v. tr.<br />
1 faire reculer: acculare un mulo, faire reculer un mulet. ES, G confirme<br />
2 (di carro o barroccio) faire basculer les brancards en l’air. ES, G confirme<br />
B accularsi v. rifl.<br />
(di quadrupedi) se mettre sur son derrière. ED, G “(di quadrupedi) s’asseoir”<br />
accumulatore s. m.<br />
personne qui accumule: un accumulatore di ricchezze, une personne qui accumule des<br />
richesses. EM, G confirme<br />
acerbo agg.<br />
(fig.) trop jeune: è ancora troppo acerbo per queste cose, il est encore trop jeune pour ces<br />
choses; quella ragazza è ancora acerba, cette jeune fille est un fruit vert. ED,<br />
SL“ immature”<br />
acetato s. m.<br />
(tess.) fibre d’acétate de cellulose. ED, G “acétate” 644<br />
achilleo agg.<br />
(anat.) du tendon d’Achille. ET, absent ailleurs<br />
acidamente avv.<br />
avec acidité, avec aigreur. ED, SL “aigrement, amèrement”<br />
acidume s. m.<br />
(sostanza) substance acide. ES, G, HP et SL confirment<br />
aclassista agg.<br />
sans classes: una società aclassista, une société sans classes. ES, G confirme<br />
aconcettuale agg.<br />
non conceptuel: arte aconcettuale, art non conceptuel. ES , G confirme<br />
acquaiolo s. m.<br />
marchand d’eau fraîche ES, G, HP et SL confirment<br />
644 G a aussi l’acception, absente ailleurs : “(mus.) disque d’acétate”, ET.<br />
427
acquaragia s. f.<br />
(chim.) essence de térébenthine. ED, G “térébenthine” 645<br />
acquascìvolo s. m.<br />
toboggan aboutissant dans une piscine. ED, SL “toboggan”<br />
acquolina s. f.<br />
petite pluie. ED, SL “(pioggia sottile) bruine” 646<br />
acrotonico agg.<br />
(ling.) accentué sur la première syllabe. ET, G confirme<br />
adagino avv.<br />
tout doucement. EM, absent ailleurs<br />
adagio avv.<br />
(mar.) en douceur: filare adagio!, filer en douceur! ET, acception absente ailleurs<br />
adattabile agg.<br />
(di persona) qui s’adapte (facilement): è un uomo molto adattabile, c’est un homme qui<br />
s’adapte facilement. ED, HP “[persona, carattere, animale] adaptable”<br />
adattabilità s. f. inv.<br />
faculté d’adaptation. ED, SL “adaptabilité”<br />
addendo s. m.<br />
(mat.) terme d’une somme. ED, G “(mat.) terme (d’une addition)” 647<br />
addendum s. m. inv.<br />
(mecc., tecnol.) saillie de la dent. ET, absent ailleurs<br />
addensatore s. m.<br />
(min.) caisse pointue. ED, SL “(Minier, Cart) épaississeur”<br />
additare v. tr.<br />
645 SL a ce même ED.<br />
646 G a ce même ED.<br />
647 HP a ce même ED.<br />
428
montrer du doigt: additare l’oggetto voluto, montrer du doigt l’objet désiré. ES, G, HP et<br />
SL confirment<br />
addottoramento s. m.<br />
1 attribution du titre universitaire de “dottore”. ER, HP confirme<br />
2 soutenance de la thèse en vue de l’obtention du titre de “dottore”. ER, absent ailleurs<br />
addottorare A v. tr.<br />
conférer le titre universitaire de “dottore” ER, G et HP confirment<br />
B addottorarsi v. intr. pron.<br />
soutenir sa thèse pour obtenir le titre de “dottore”. ER, G et HP confirment<br />
adducibile agg.<br />
que l’on peut alléguer. EM, G confirme<br />
adeguatamente avv.<br />
d’une manière adéquate: agire adeguatamente, agir en conséquence. ED, SL<br />
« convenablement, suffisamment, correctement ; adéquatement »<br />
adesso avv.<br />
(immediatamente) tout de suite: state buoni, adesso vengo!, un peu de patience, je viens tout<br />
de suite! ED, SL « (fra poco) immédiatement, bientôt »<br />
adolescente agg.<br />
d’adolescent: viso adolescente, visage d’adolescent. ED, SL « adolescent »<br />
adolescenziale agg.<br />
relatif à l’adolescence, aux adolescents: crisi adolescenziale, crise de l’adolescence. EM, G,<br />
HP et SL confirment<br />
adombrabile agg.<br />
qui s’effarouche facilement. ED, SL « ombrageux, susceptible »<br />
adornatore agg.<br />
qui orne, qui décore. EM, absent ailleurs<br />
adriatico agg.<br />
429
(geogr.) de l’Adriatique: coste adriatiche, côtes de l’Adriatique. ED, HP « adriatique » 648<br />
adulterabile agg.<br />
que l’on peut falsifier, que l’on peut adultérer. ED, SL « altérable »<br />
adunabile agg.<br />
que l’on peut réunir, que l’on peut rassembler. EM, absent ailleurs<br />
adunghiare v. tr.<br />
saisir avec les griffes. ED, SL « agripper » 649<br />
advisor s. m. e f.<br />
(ingl.; org. az.) personne ou société de consultations professionnelles. ET, G confirme<br />
aerobase s. f.<br />
(aer. mil.) base aérienne. ET, absent ailleurs<br />
aerodinamico s. m.<br />
spécialiste d’aérodynamique. ES, typologie grammaticale absente ailleurs<br />
aerografista s. m. e f.<br />
(tecnol.) vernisseur au pistolet. ET, G confirme<br />
aeroirroratore s. m.<br />
(agr.) épandeur aérien. ET, absent ailleurs<br />
aeroirrorazione s. f.<br />
(agr.) épandage aérien (m.). ET, absent ailleurs<br />
aeromeccanica s. f.<br />
(fis.) mécanique du vol. ED, SL « (fis.) aéromécanique » 650<br />
aeromodellista s. m. e f.<br />
modéliste d’avions. ED, SL “aéromodéliste”<br />
aeroposta s. f.<br />
648 G a ce même ED.<br />
649 HP a ce même ED.<br />
650 G a ce même ED.<br />
430
poste aérienne. ES, absent ailleurs<br />
aeroraduno s. m.<br />
meeting aérien. ES, G confirme<br />
aerosoccorso s. m.<br />
secours aérien. ES, HP confirme<br />
aerotrainare v. tr.<br />
(aer.) remorquer par avion. ET, absent ailleurs<br />
affagottare v. tr.<br />
mettre en ballot. ES, G confirme<br />
affagottato agg.<br />
mal fagoté, mal ficelé. ED, G « fagoté »<br />
affannatamente avv.<br />
1 en soufflant, en haletant. EM, absent ailleurs<br />
2 (fig.) avec anxiété, avec inquiétude. ED, G « fébrilement, fiévreusement » 651<br />
affaristico agg.<br />
des affaires. ED, SL « affairiste »<br />
affascinare 2 v. tr.<br />
mettre en gerbes. ES, absent ailleurs<br />
affastellare v. tr.<br />
mettre en fagots, en gerbes, en bottes: affastellare legna, mettre du bois en fagots, faire des<br />
fagots de bois. ED, G « (legna) fagoter »<br />
affermato agg.<br />
qui s’est affirmé, qui s’est imposé: una cantante affermata, une chanteuse qui s’est affirmée;<br />
un prodotto affermato, un produit qui s’est imposé. ED, SL « confirmé » 652<br />
affettare v. tr.<br />
651 S.v. affannosamente, renvoi de l’entrée affannatamente.<br />
652 HP a ce même ED.<br />
431
couper en tranches: affettare il pane, couper le pain en tranches; (scherz., fig.) una nebbia da<br />
affettare, un brouillard à couper au couteau. ED, SL « découper »<br />
affettatamente avv.<br />
avec affectation. EM, G et HP confirment<br />
affettivo agg.<br />
(ling.) de sentiment: verbi affettivi, verbes de sentiment. ET, acception absente ailleurs<br />
affezionabile agg.<br />
qui est capable d’affection, qui est enclin à s’attacher. EM, absent ailleurs<br />
affezionabilità s. f. inv.<br />
tendance à s’attacher, à éprouver de l’affection (pour). ES, absent ailleurs<br />
affezionare v. tr.<br />
faire aimer: affezionare q. allo studio, alla lettura, faire aimer à q. les études, la lecture. ES,<br />
G et HP confirment<br />
affidamento s. m.<br />
(banca) ouverture de crédit. ET, G confirme<br />
affilalame s. m. inv.<br />
affiloir pour lames de rasoir. ES, absent ailleurs<br />
affilarasoio s. m.<br />
cuir à rasoir. ES, absent ailleurs<br />
affilettare v. tr.<br />
(edil.) gratter les joints à la truelle. ET, absent ailleurs<br />
affilettatura s. f.<br />
grattage des joints à la truelle. ET, absent ailleurs<br />
affiliando s. m.<br />
(dir.) en instance d’adoption. ED, G « (dir.) (enfant) adoptable »<br />
affissarsi v. rifl.<br />
432
(lett.) regarder fixement: affissarsi in q., regarder q. fixement. ES, acceptions absente ailleurs<br />
affissionale agg.<br />
par affiches: pubblicità affissionale, publicité par affiches. EM, G confirme<br />
affisso s. m.<br />
(edil.) menuiserie mobile. ED, G “(edil.) fermeture”<br />
affittire v. tr.<br />
rendre plus épais, plus touffu: affittire una siepe, rendre une haie plus touffue. ED, HP<br />
« (infittire) épaissir »<br />
affogarsi v. rifl.<br />
se jeter à l’eau: si è affogato per il gran dolore, il s’est jeté à l’eau à cause de cet immense<br />
chagrin. ES, acception absente ailleurs<br />
affondata s. f.<br />
1 (aer.) vol en piqué (m.). ED, G « (aer.) piqué »<br />
2 (aer. mil.) attaque en piqué. ET, acception absente ailleurs<br />
affumicatore s. m.<br />
(alim.) qui effectue le fumage, le boucanage: affumicatore di aringhe, saurisseur. ED, G<br />
« (ind. alimentare) fumeur »<br />
afosità s. f. inv.<br />
chaleur lourde, temps lourd (m.). ED, SL « lourdeur »<br />
africanistica s. f.<br />
(etnol.) étude des civilisations africaines. ED, G « (etnologia) africanisme »<br />
africo s. m.<br />
vent du sud-ouest. ED, SL « (lett) (vento) suroît » 653<br />
ageusia s. f.<br />
(med.) agnosie gustative. ED, G “(med.) ageusie”<br />
agevolato agg.<br />
653 G a ce même ED.<br />
433
(econ.) très favorable: mutuo agevolato, prêt accordé à un taux très favorable (inférieur à<br />
celui du marché). ED, SL « (Econ) préférentiel »<br />
aggallare v. intr.<br />
(spec. dei palombari) remonter à la surface. ET, absent ailleurs<br />
agganciare v. tr.<br />
(calcio) faire un croche-pied, faire un croc-en-jambe. ES, G et HP confirment<br />
agghiaccio s. m.<br />
(mar.) appareil à gouverner. ET, G confirme<br />
agghiaiare v. tr.<br />
couvrir de gravier, recouvrir de gravillon. ES, absent ailleurs<br />
aggiogabile agg.<br />
qui peut être placé sous le joug. EM, G confirme<br />
aggiornarsi v. intr. impers.<br />
faire jour: la nave partirà prima che aggiorni, le bateau partira avant qu’il fasse jour. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
aggiornato agg.<br />
1 au courant, très informé: un uomo aggiornato sugli sviluppi di una situazione, un homme<br />
au courant des développements d’une situation : questa rivista è ben aggiornata, cette revue<br />
est très informée. ED, SL « informé » 654<br />
2 mis à jour: un catalogo aggiornato, un catalogue mis à jour. ED, SL « (rif. a cose)<br />
actualisé » 655<br />
3 à la page: non conosci le ultime novità? non sei molto aggiornato!, tu n’es pas au courant<br />
des dernières nouveautés? tu n’es pas très à la page! ES, acception absente ailleurs<br />
aggirarsi v. intr. pron.<br />
s’élever environ (à): le spese si aggirano sul milione, les frais s’élèvent environ à un million.<br />
ED, SL « (approssimarsi) tourner (su, autour de) » 656<br />
654 G et HP ont ce même ED.<br />
655 G et HP ont ce même ED.<br />
656 G et HP ont ce même ED.<br />
434
aggiustarsi v. rifl. rec.<br />
se mettre d’accord: ci aggiusteremo facilmente sulle condizioni di pagamento, nous nous<br />
mettrons facilement d’accord sur les conditions de paiement. ED, SL “(accordarsi)<br />
s’arranger”<br />
aggiustata s. f.<br />
(fam.) petite réparation: darsi un’aggiustata ai capelli, se donner un coup de peigne. ES, G<br />
confirme<br />
aggranchirsi v. intr. e intr. pron.<br />
être engourdi: aggranchirsi dal freddo, être engourdi par le froid; mi si sono aggranchite le<br />
gambe per il gelo, le gel m’a engourdi les jambes. ED, HP “s’engourdir”<br />
aggranfiare v. tr.<br />
accrocher avec les griffes, avec les ongles. ES, absent ailleurs<br />
aggravare v. tr.<br />
(fig.) rendre plus lourd: aggravare le responsabilità di q., rendre plus lourdes les<br />
responsabilités de q.; aggravare la coscienza, peser sur la conscience. ED, SL « (aumentare)<br />
accroître »<br />
aggregabile agg.<br />
que l’on peut agréger. EM, G et HP confirment<br />
aggregato s. m.<br />
(mat.) ensemble fini. ED, SL « (Biol,Chim, Mat, Geol, Econ) agrégat » 657<br />
agguagliarsi v. rifl.<br />
1 (lett.) se mettre au même niveau (que). ES, G confirme<br />
2 se rendre semblable (à). ES, SL confirme<br />
agguantare v. tr.<br />
(mar.) scier à casser l’erre. ET, acception absente ailleurs<br />
aghetto s. m.<br />
lacet ferré aux deux extrémités. ED, HP « (di scarpe) lacet » 658<br />
657 G et HP ont ce même ED.<br />
435
aghifoglia s. f.<br />
(bot.) arbre à feuilles aciculaires. ED, SL « (Bot) conifère » 659<br />
agire v. intr.<br />
faire effet: l’iniezione ha agito subito, l’injection a fait effet tout de suite; è un veleno che<br />
agisce molto rapidamente, c’est un poison qui a une action très rapide. ED, SL « (esercitare<br />
un effetto) agir, opérer »<br />
agnellaio s. m.<br />
marchand d’agneaux. ES, absent ailleurs<br />
agnellone s. m.<br />
agneau antenais. ED, G « antenais »<br />
agoaspirazione s. f.<br />
(med.) aiguille à ponction. ED, SL « (Med) cytoponction »<br />
agone s. m.<br />
(lett.) champ de bataille: scendere nell’agone, descendre dans l’arène, entrer en lice. ED, SL<br />
« (campo di battaglia) arène »<br />
agonico agg.<br />
de l’agonie: il sudore agonico, les sueurs de l’agonie. ED, G « agonique » 660<br />
agrettone s. m.<br />
(bot.) passerage cultivée (f.). ET, absent ailleurs<br />
agronica s. f.<br />
(anche inform.) électronique appliquée à l’agriculture et à la zootechnie. ES, G confirme<br />
agro s. m.<br />
jus de citron. ES, acception absente ailleurs<br />
agrumicolo agg.<br />
relatif à la culture des agrumes. ED, SL « agrumicole » 661<br />
658 HP a un autre EM, “petite aiguille”.<br />
659 HP a ce même ED.<br />
660 HP et SL ont ce même ED.<br />
436
agucchiare v. tr. e intr.<br />
tirer l’aiguille. ES, G et HP confirment<br />
aguglieria s. f.<br />
(tess.) filés pour bonneterie. ET, absent ailleurs<br />
aguzzarsi v. intr. pron.<br />
devenir plus vif. ES, G et SL confirment<br />
albera s. f.<br />
(bot.) peuplier noir (m.). ET, absent ailleurs<br />
alberata s. f.<br />
rangée d’arbres. ES, G confirme<br />
albicato agg.<br />
taché de blanc. ES, absent ailleurs<br />
alfabetario s. m.<br />
jeu de cubes avec les lettres de l’alphabet. ES, G confirme<br />
alfabetismo s. m.<br />
savoir lire et écrire: l’alfabetismo è totale in quella regione, tous les habitants de cette région<br />
sont alphabétisés, tous les habitants de cette région savent lire et écrire. ES, G confirme<br />
alienarsi v. intr. pron.<br />
(lett.) perdre la raison. ES, acception absente ailleurs<br />
alienato agg.<br />
qui a été aliéné: bene alienato, bien qui a été aliéné : essere, sentirsi alienato, être, se sentir<br />
aliéné. ED, HP « aliéné »<br />
alieno agg.<br />
(lett.) d’autrui, des autres: cose aliene, choses d’autrui. ES, G et HP confirment<br />
alimenti s. m. pl.<br />
661 G et HP ont ce même ED.<br />
437
pension alimentaire (f. sing.): pagare gli alimenti, verser une pension alimentaire; avere<br />
diritto agli alimenti, avoir droit à une pension alimentaire. ED, HP « (dir.) aliments »<br />
alitosi s. f. inv.<br />
(med.) mauvaise haleine. ED, SL « (Med) halitose » 662<br />
allappare v. tr.<br />
coller aux lèvres, au palais. ES, acception absente ailleurs<br />
allargarsi v. rifl.<br />
(fam.) donner de l’ampleur: allargarsi nel proprio lavoro, donner plus d’ampleur à son<br />
travail. ES, acception absente ailleurs<br />
allato avv. e loc. prep.<br />
(lett.) près de, auprès de. ES, G et HP confirment<br />
allegorizzare v. intr.<br />
interpréter allégoriquement un texte. ED, HP « allégoriser » 663<br />
alloglotto agg. sost.<br />
(ling.) qui appartient à une minorité linguistique. ED, G « (ling.) allophone »<br />
alluce s. m.<br />
gros orteil, gros doigt. ED, SL « (Anat) pouce (du pied) » 664<br />
allucinare v. tr.<br />
(fig.) impressionner fortement. ED, SL “(impressionare) éblouir”<br />
almanaccare v. intr.<br />
se creuser la cervelle: per quanto almanaccassi, non riuscivo a risolvere il problema, j’avais<br />
beau me creuser la cervelle, je ne parvenais pas à résoudre le problème. ED, SL<br />
« (congetturare) songer, rêver » 665<br />
alpinistico agg.<br />
662 G et HP ont ce même ED.<br />
663 G a ce même ED.<br />
664 G a ce même ED.<br />
665 HP a ce même ED.<br />
438
d’alpinisme, de l’alpinisme: attrezzature alpinistiche, équipements pour faire de l’alpinisme.<br />
EM, G, HP et SL confirment<br />
altacassa s. f.<br />
(tip.) haut de casse. ET, G confirme<br />
altana s. f.<br />
(alzaia) chemin de halage (m.). ES, acception absente ailleurs<br />
alterativo agg.<br />
qui altère. ED, G « altératif »<br />
alternare A v. tr.<br />
faire alterner: alternare il bianco e il verde, faire alterner le blanc et le vert. ES, G confirme<br />
alzatrice s. f.<br />
(tess.) finisseuse pour tissus de lin. ET, absent ailleurs<br />
alzavola s. f.<br />
(zool.) sarcelle d’hiver. ED, SL “(Ornit) sarcelle” 666<br />
Alzheimer s. m. inv.<br />
(ted.; med.) maladie d’Alzheimer. ED, SL “(Med,colloq) Alzheimer”<br />
amante s. m.<br />
(mar.) palan sur garant: gassa d’amante semplice, nœud d’agui; gassa d’amante doppia, nœud<br />
de calfat; gassa d’amante scorsoia, nœud de laguis. ED, SL “(Mar) itague”<br />
amarume s. m.<br />
(poco usato) ensemble de choses amères. ES, absent ailleurs<br />
amatorio agg.<br />
(lett.) d’amour: filtro amatorio, philtre d’amour. EM, G, HP et SL confirment<br />
amazzonio agg.<br />
(lett.) d’amazone. EM, absent ailleurs<br />
666 G a ce même ED.<br />
439
ambientista s. m. e f.<br />
(pitt.) peintre d’atmosphère. ES, G confirme<br />
ambulatorio s. m.<br />
cabinet de consultation: venga domani nel mio ambulatorio, venez demain à mon cabinet;<br />
ambulatorio dentistico, cabinet dentaire. ES, G, HP et SL confirment<br />
amenza s. f.<br />
(psic.) confusion mentale. ET, G confirme<br />
americanista s. m. e f.<br />
(ciclismo) coureur participant à une course à l’américaine. ES, G confirme<br />
amicare v. tr.<br />
gagner l’amitié de. ES, absent ailleurs<br />
amida s. f.<br />
(zool.) tortue d’eau douce. ET, absent ailleurs<br />
ammandorlato A agg.<br />
en amande. ES, G confirme<br />
B s. m.<br />
(edil., tecnol.) treillis, en losanges. ET, G confirme<br />
ammanettare v. tr.<br />
passer les menottes (à): ammanettare il ladro, passer les menottes au voleur. ED, HP<br />
« menotter » 667<br />
ammanicato agg.<br />
en cheville: è ammanicato con la malavita, il est en cheville avec la pègre. ED, SL « protégé,<br />
recommandé » 668<br />
ammantarsi v. rifl.<br />
(poco usato) s’envelopper dans un manteau. ES, G et HP confirment<br />
667 G a ce même ED.<br />
668 G et HP ont ce même ED.<br />
440
ammantellare v. tr.<br />
(lett.) recouvrir d’un manteau. ES, absent ailleurs<br />
ammasso s. m.<br />
(dir., econ.) stockage contrôlé par l’État, constitution de réserves: ammasso obbligatorio del<br />
grano, constitution obligatoire de réserves de blé. ED, SL « stockage » 669<br />
ammatassare v. tr.<br />
mettre en écheveau: ammatassare la lana, mettre la laine en écheveaux. ED, SL “dévider” 670<br />
ammattimento s. m.<br />
(cosa che fa impazzire) histoire de fou (f.). ED, HP “(rompicapo) casse-tête”<br />
ammattonato A s. m.<br />
pavement de briques. ED, HP « carrelage » 671<br />
B agg.<br />
pavé en briques. ED, G « briqueté »<br />
ammattonatura s. f.<br />
pavage en briques. ED, G “briquetage”<br />
ammazzamento s. m.<br />
(fig.) travail tuant: trasportare questi mobili è un vero ammazzamento, transporter ces<br />
meubles, c’est vraiment tuant. ES, G confirme<br />
ammezzare 672 v. tr.<br />
1 partager en deux: ammezzare un fiasco di vino, remplir, vider une fiasque de vin à moitié.<br />
ES, HP confirme<br />
2 faire, dire à moitié: ammezzare un lavoro, faire un travail à moitié; ammezzare una frase,<br />
laisser une phrase inachevée. ES , G et HP confirment<br />
amministrativista s. m. e f.<br />
669 G a ce même ED.<br />
670 G et HP ont ce même ED.<br />
671 G a ce même ED.<br />
672 G et HP ajoutent un autre ES : « (riempire a metà / vuotare a metà) remplir à moitié ; vider à moitié ».<br />
Bizarrement, B a l’exemple « ammezzare un fiasco di vino, remplir, vider une fiasque de vin à moitié » dans<br />
l’acception traduite comme « partager en deux ».<br />
441
spécialiste en droit administratif: provvedimento amministrativista, mesures<br />
administratives. ES, G et HP confirment<br />
ammodino agg. inv.<br />
comme il faut: una ragazza tutta ammodino, une jeune fille très comme il faut. ES, absent<br />
ailleurs<br />
ammollare A v. tr.<br />
faire tremper, mettre à tremper: ammollare un tessuto, faire tremper un tissu; ammollare il<br />
bucato, faire tremper le linge, mettre le linge à tremper. ED, G “tremper”<br />
B ammollarsi v. intr. e intr. pron.<br />
devenir mou: il pane si ammolla, le pain devient mou. ED, SL « ramollir »<br />
ammonico agg.<br />
d’ammonium, ammonique: solfato ammonico, sulfate d’ammonium. ED, HP<br />
“ammonique” 673<br />
amorazzo s. m.<br />
(spreg.) aventure amoureuse. ED, HP “amourette”<br />
anacreontica s. f.<br />
(letter.) poésie anacréontique. ED, SL “(Letter) anacréontique” 674<br />
anatolico agg. sost.<br />
de l’Anatolie. ED, SL “anatolien”<br />
ancipite agg.<br />
(lett.) à double tranchant. ED, G « (che ha doppia natura) double »<br />
anconeo s. m.<br />
(anat.) muscle anconé. ET, absent ailleurs<br />
andana s. f.<br />
1 trouée entre les arbres. ED, SL « allée »<br />
3 (tecnol.) couloir de corderie. ET, acception absente ailleurs<br />
673 G a ce même ED.<br />
674 G a ce même ED.<br />
442
aneddotica s. f.<br />
1 recueil d’anecdotes, petite histoire. ED, HP « ana »<br />
2 art de raconter, d’écrire des anecdotes. ES, G confirme<br />
anfibio s. m.<br />
(aer.) avion amphibie. ED, SL “(Mil,Aer) amphibie”<br />
angeleno A agg. sost.<br />
de Los Angeles. ES, absent ailleurs<br />
B s. m.<br />
habitant de Los Angeles. ES, absent ailleurs<br />
angolarmente avv.<br />
en angle. ED, G « angulairement »<br />
annidare 675 v.tr. annidarsi v. rifl.<br />
(fig.) avoir en soi: in lui si annida un gran desiderio di vendetta, il y a en lui un grand désir de<br />
vengeance. ED, G “couver”<br />
annoccare v. tr.<br />
(agr.) courber en arcure. ED, G « (agr.) arçonner »<br />
annoso agg.<br />
qui dure depuis des années: un’annosa situazione, une situation qui dure depuis des années.<br />
ED, SL « (che dura da molti anni) vieux »<br />
annoverabile agg.<br />
qu’on peut compter parmi. EM, G confirme<br />
anosmia s. f.<br />
(med.) agnosie olfactive. ED, G « (med.) anosmie »<br />
antelunare agg.<br />
(lett.) qui précède le premier quartier de la lune. ES, absent ailleurs<br />
675 G traduit « (fig.) nourrir dans son cœur », ED car B propose simplement « nourrir, couver ».<br />
443
antennale s. m.<br />
(mar.) envergure de voile latine. ED, G « (mar.) têtière »<br />
antiacne s. m. inv., anche agg. inv.<br />
contre l’acné: pomata antiacne, pommade contre l’acné. ED, G “antiacnéique”<br />
antiaerea s. f.<br />
défense antiaérienne, defense contre-avions. ED, SL « (Mil) DCA » 676<br />
antibrachiale agg.<br />
(anat.) de l’avant-bras. ET, SL confirme<br />
antidivorzista s. m. e f.<br />
personne contraire au divorce. ES, G 677 , HP et SL confirment<br />
antiemorroidale s. m., anche agg.<br />
(farm.) (remède) contre les hémorroïdes. ET, absent ailleurs<br />
antifiscalismo s. m.<br />
opposition à une fiscalisation excessive. ES, G confirme.<br />
antiflogosi s. f. inv.<br />
(med.) traitement des inflammations. ET, absent ailleurs<br />
antifonale agg.<br />
(liturg.) de l’antienne. EM, G confirme<br />
antipulci agg. e s. m. inv.<br />
contre les puces. ED, SL « anti-puces »<br />
antistorico agg.<br />
contraire au sens de l’histoire. ES, G, HP et SL confirment<br />
antiusura 2 agg. inv.<br />
(dir.) qui a pour but de combattre ou de prévenir le délit d’usure. ES, absent ailleurs<br />
676 G et HP ont ce même ED.<br />
677 A aussi la catégorie de l’adjectif, traduit « contre le divorce », absent ailleurs : ES.<br />
444
antivipera agg. inv.<br />
(farm.) contre les morsures de vipère. ED, HP « antivenimeux »<br />
apina s. f.<br />
venin d’abeille. ES, HP confirme<br />
apiterapia s. f.<br />
(med.) traitement à base de venin d’abeille. ET, absent ailleurs<br />
apocizio s. m.<br />
(bot.) cellule polynucléaire des algues. ET, absent ailleurs<br />
apostrofare v. intr.<br />
(lett.) adresser une apostrophe (à). ED, G « (letter.) s’adresser (à) »<br />
apparecchiare v. tr.<br />
dresser la table, mettre la table, mettre, dresser le couvert: apparecchiare la tavola per il<br />
pranzo, mettre la table pour le déjeuner; apparecchiare per sei, mettre six couverts. ED, SL<br />
“(per mangiare) mettre, dresser » 678<br />
appellato agg. sost.<br />
(dir.) (qui a été) convoqué à un jugement d’appel. ED, SL « (Dir) intimé »<br />
appennino agg.<br />
(lett.) des Apennins. EM, absent ailleurs<br />
appenninico agg.<br />
des Apennins. ED, SL « (Geog) apennin » 679<br />
appercettivo agg.<br />
(filos.) relatif à l’aperception. ED, SL « (Filos,Psic) aperceptif »<br />
appezzare v. tr.<br />
mettre bout à bout: appezzare una fune, mettre bout à bout les morceaux d’une ficelle. ES,<br />
G confirme<br />
678 Cependant, cette équivalence ne rend pas compte de l’usage absolu du verbe italien. G a ce même ED.<br />
679 G et HP ont ce même ED.<br />
445
appianatoio s. m.<br />
(tecnol.) rouleau pour aplanir. ED, SL « (Agr) rouleau »<br />
appiattirsi v. rifl.<br />
se mettre à plat ventre: appiattirsi al suolo, se mettre à plat ventre par terre; i soldati si<br />
appiattirono dietro i reticolati, les soldats se mirent à plat ventre derrière les barbelés. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
apponibile agg.<br />
qu’on peut apposer. EM, absent ailleurs<br />
appoppamento s. m.<br />
(aer.) tendance à cabrer. ET, absent ailleurs<br />
appoppato agg.<br />
(mar.) sur cul, enfoncé de l’arrière: essere appoppato, être sur cul. ET, HP confirme<br />
appostissimo A agg. inv.<br />
très bien: è un ragazzo appostissimo, c’est un garçon très bien. EM, G confirme<br />
B avv.<br />
parfaitement bien: mi sento appostissimo, je me sens parfaitement bien. EM, G confirme<br />
apprendibile agg.<br />
qu’on peut apprendre. EM, G confirme<br />
approdare v. tr.<br />
faire aborder. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
approdo s. m.<br />
point d’abordage: dobbiamo trovare un altro approdo, nous devons trouver un autre point<br />
d’abordage. ES, G, HP et SL confirment<br />
approfittare v. intr.<br />
tirer profit: approfittare dell’esperienza, tirer profit d’une expérience. ED, SL « bénéficier »<br />
approntatura s. f.<br />
(tecnol.) mise en place. ET, absent ailleurs<br />
446
appruamento s. m.<br />
1 (aer.) tendance à piquer. ET, HP confirme<br />
2 (mar.) enfoncement de l’avant. ET, HP confirme<br />
appuntata s. f.<br />
(scherma) coup d’arrêt sur la riposte. ET, absent ailleurs<br />
appuntino avv.<br />
avec beaucoup de soin, comme il faut: lavoro eseguito appuntino, travail exécuté avec<br />
beaucoup de soin; carne cotta appuntino, viande cuite à point. ES, G et HP confirment<br />
aprirsi v. intr. pron.<br />
être en train de commencer, aller commencer: una nuova era si apre davanti a noi, une ère<br />
nouvelle va commencer pour nous. ES, SL « (cominciare) s’ouvrir »<br />
arboreto s. m.<br />
plantation d’arbres. ED, G « verger »<br />
arcadia s. f.<br />
(st. letter.) académie des arcadiens. ED, G « arcadie »<br />
arcaicamente avv.<br />
d’une manière archaïque. EM, HP confirme<br />
archeggiamento s. m.<br />
(mus.) emploi de l’archet. ET, absent ailleurs<br />
archipendolo s. m.<br />
(edil.) niveau de maçon. ED, SL « (edil.) niveau » 680<br />
archiviare v. tr.<br />
(fig.) mettre de côté: archiviare un problema, mettre un problème de côté. ED, SL « (estens)<br />
(mettere da parte) classer »<br />
arcibasilica s. f.<br />
basilique majeure. ES, absent ailleurs<br />
680 G et HP ont ce même ED.<br />
447
arcistufo agg.<br />
qui en a plein le dos, qui en a ras-le-bol. ED, SL « fatigué, lassé, dégoûté »<br />
areale agg.<br />
d’aire, de zone. EM, HP confirme<br />
arenario agg.<br />
de sable. EM, HP confirme<br />
argentario agg.<br />
des orfèvres. EM, absent ailleurs<br />
argenteria s. f.<br />
magasin d’argenterie. ES, acception absente ailleurs<br />
argentiera s. f.<br />
carrière d’argent. ES, absent ailleurs<br />
arginale agg.<br />
qui court parallèlement à une levée, à une chaussée: sentiero arginale, chaussée. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
argomentare v. intr.<br />
présenter des arguments: il tuo modo di argomentare non è molto valido, ta façon de<br />
présenter tes arguments n’est pas très nette. ED, SL « (addurre argomenti) argumenter »<br />
arianizzare v. tr.<br />
rendre aryen. ES, HP confirme<br />
aridamente avv.<br />
avec aridité, d’une manière aride. ED, SL “sèchement” 681<br />
arietta 682 s. f.<br />
petit air: canterellava sempre la solita arietta, il fredonnait toujours son petit air. ES, G<br />
confirme<br />
681 HP a ce même ED.<br />
682 HP a aussi l’acception « brise légère », ED car SL a simplement « brise ».<br />
448
armadietto s. m.<br />
petite armoire (f.): armadietto per utensili, armoire à outils; armadietto dei medicinali,<br />
armoire à pharmacie; armadietto di palestra, vestiaire. ED, SL “armoire, placard” 683<br />
armarsi v. rifl.<br />
prendre les armes. ED, SL « (Mil) s’armer »<br />
armentario (lett.) A agg.<br />
concernant les troupeaux. EM, absent ailleurs<br />
B s. m.<br />
gardien de troupeaux. ES, absent ailleurs<br />
armo s. m.<br />
(canottaggio, vela) équipe de rameurs. ED, HP “MAR. (di vogatori) équipe”<br />
armonica s. f.<br />
(mus.) table d’harmonie. ET, acception absente ailleurs<br />
arrabbiamento s. m.<br />
(di cani) accès de rage. ES, absent ailleurs<br />
arrancata s. f.<br />
1 marche pénible, montée pénible. ES, absent ailleurs<br />
2 (canottaggio) série de coups d’aviron. ET, absent ailleurs<br />
arrapare v. tr.<br />
(volg.) faire bander. ES, G et SL confirment<br />
arrembare v. intr., arrembarsi intr. pron.<br />
(veter.) être fourbu. ET, G confirme<br />
arrendevolmente avv.<br />
d’une façon accommodante. EM, absent ailleurs<br />
arrestato s. m.<br />
683 G et HP ont ce même ED.<br />
449
personne arrêtée. ES, HP confirme<br />
arrivatura s. f.<br />
(tip.) changement de composition. ET, absent ailleurs<br />
arroventatura s. f.<br />
chauffage au rouge (m.). ES, G confirme 684<br />
arruffianare v. tr.<br />
(fig., fam.) mettre dans sa poche: si è arruffianato l’usciere e adesso entra ed esce quando<br />
vuole, il a mis le concierge dans sa poche, et maintenant il rentre et il sort comme il veut.<br />
ED, G « bonimenter »<br />
arsenicato s. m.<br />
substance arséniée. ET, G confirme<br />
arsione s. f.<br />
(lett.) soif ardente. ES, absent ailleurs<br />
articolatamente avv.<br />
d’une façon articulée. EM, absent ailleurs<br />
articolessa s. f.<br />
(spreg.) article (de journal) verbeux et assommant. ES, HP confirme<br />
artistico agg.<br />
d’art: artigianato artistico, artisanat d’art. EM, absent ailleurs<br />
arvense agg.<br />
(bot.) qui pousse dans les champs cultivés. ET, absent ailleurs<br />
asciare v. tr.<br />
dégrossir à la hache. ES, absent ailleurs<br />
asciugante agg.<br />
qui séche, qui essuie: carta asciugante, papier buvard. ED, G « absorbant »<br />
684 Renvoi de l’entrée arroventamento.<br />
450
asciutta s. f.<br />
(agr.) période de rizière sèche. ED, HP « (siccità) sécheresse »<br />
ascolta s. f.<br />
(poco usato) lieu d’écoute: (caccia) andare all’ascolta, aller écouter les perdrix cacaber. ES,<br />
absent ailleurs<br />
ascrivere v. tr.<br />
(lett.) compter parmi, compter au nombre de: in quella prova fu ascritto fra i migliori, dans<br />
cette épreuve, on le compta parmi les meilleurs. ED, SL « (annoverare) admettre »<br />
asolaia s. f.<br />
ouvrière qui fait des boutonnières. ES, absent ailleurs<br />
asolare v. intr. (lett.)<br />
1 souffler doucement. ES, absent ailleurs<br />
2 prendre l’air. ES, absent ailleurs<br />
asolo s. m.<br />
(lett.) souffle de vent. ES, absent ailleurs<br />
aspecifico agg.<br />
non spécifique. ED, G « aspécifique » 685<br />
asportare v. tr.<br />
(chir.) pratiquer l’ablation (de): asportare un rene, pratiquer l’ablation d’un rein. ED, SL<br />
« (Chir) extirper »<br />
assaggio s. m.<br />
petit morceau: prendere un assaggio di dolce, prendre un petit morceau de gâteau. ES, G et<br />
SL confirment<br />
assaltare v. tr.<br />
prendre d’assaut. ED, SL « attaquer »<br />
assenza s. f.<br />
685 HP a ce même ED.<br />
451
(med.) absence épileptique. ET, G confirme<br />
assestato agg.<br />
(di persona) bien mis: è una ragazza sempre bene assestata, c’est une jeune fille toujours bien<br />
mise. ES, acception absente ailleurs<br />
assicurante A agg.<br />
qui assure. EM, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
B s. m. e f.<br />
(dir.) contractant d’une assurance. ED, HP « DIR. assureur »<br />
assiepare v. tr.<br />
(lett.) entourer d’une haie. ES, HP confirme<br />
assolato agg.<br />
2 inondé de soleil: strade assolate, routes inondées de soleil. ES, acception absente ailleurs<br />
3 brûlé par le soleil: pianure assolate, plaines brûlées par le soleil. ES, G confirme<br />
assolutore s. m.<br />
celui qui donne l’absolution. ES, absent ailleurs<br />
assomigliare v. tr.<br />
(lett.) faire ressembler (à), rendre pareil (à): la lunga barba lo assomiglia a un vecchio, sa<br />
longue barbe le fait ressembler à un vieillard. ES, acception absente ailleurs<br />
assordare v. intr.<br />
devenir sourd. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
assortitore s. m.<br />
(tess.) trieur de laine brute. ED, G « (tecn.) assortisseur »<br />
assumibile agg. (poco usato)<br />
1 qu’on peut assumer. EM, absent ailleurs<br />
2 qu’on peut engager. EM, absent ailleurs<br />
assunzione s. f.<br />
452
prise en charge: l’assunzione di una spesa, la prise en charge d’une dépense. ED, G<br />
« (accettazione) acceptation ; (presa) prise »<br />
astenuto 686 s. m.<br />
électeur qui s’est abstenu: votanti 96, astenuti 17, votants 96, abstentions 17; gli astenuti<br />
sono diciotto, il y a dix-huit abstentions. ED, HP « abstentionniste »<br />
astrattistico agg.<br />
de l’abstrait, de l’art abstrait. EM, absent ailleurs<br />
astrofico agg.<br />
(metrica) sans strophes. ES, HP confirme<br />
atriale agg.<br />
(med.) de l’oreillette. ED, SL « (Anat,Med) atrial »<br />
attaccare v. intr.<br />
prendre son travail: oggi attacco alle 8, aujourd’hui, je prends mon travail à huit heures. ES,<br />
SL confirme<br />
attaccatura s. f.<br />
point d’attache (m.): attaccatura di un muscolo, point d’attache d’un muscle. ED, SL<br />
“attache” 687<br />
atteggiare v. tr.<br />
prendre un air: atteggiò il volto a meraviglia, elle prit un air étonné; atteggiare la bocca a<br />
disprezzo, faire une moue de mépris; atteggiare le mani a preghiera, joindre les mains en<br />
prière. ED, HP “affecter, prendre [espressione]”<br />
attenuante (dir.) s. f.<br />
circonstance atténuante. ET, G, HP et SL confirment<br />
atterramento s. m.<br />
1 mise à terre (f.). ES, G et HP confirment<br />
3 (pugilato) envoi au tapis. ES, SL confirme<br />
686 G et HP ont un ES dans la catégorie de l’adjectif, traduit « qui s’est abstenu » et « qui n’a pas exercé son<br />
droit de vote ».<br />
687 G a ce même ED.<br />
453
atterrito agg.<br />
frappé de terreur: ascoltava atterrito quell’orribile racconto, il écoutait avec terreur cet<br />
horrible récit. ED, SL « terrifié, effrayé »<br />
attestarsi v. rifl.<br />
(mil.) prendre position. ED, SL “(Mil) se déployer”<br />
atticizzare v. tr.<br />
1 parler, écrire avec élégance. ES, absent ailleurs<br />
2 imiter l’atticisme. ES, absent ailleurs<br />
attivizzare v. tr.<br />
rendre actif. ES, G confirme<br />
attorcitura s. f.<br />
(agr.) liage des sarments. ET, absent ailleurs<br />
attralciatura s. f.<br />
(agr.) liage des sarments. ET, absent ailleurs<br />
attrezzistico agg.<br />
fait aux agrès: ginnastica attrezzistica, gymnastique aux agrès; (mar.) allestimento<br />
attrezzistico di una nave, armement d’un navire. ES, G confirme<br />
attuabilità s. f. inv.<br />
possibilité de réalisation. ED, SL « faisabilité » 688<br />
attualista s. m. e f., anche agg.<br />
(filos.) partisan de l’actualisme. ES, absent ailleurs<br />
attualistico agg.<br />
(filos.) qui se rapporte à l’actualisme. ES, absent ailleurs<br />
aulicamente avv.<br />
d’un style élevé. EM, G confirme<br />
688 G et HP ont ce même ED.<br />
454
aureo agg.<br />
1 (fatto d’oro) d’or, en or: anello aureo, bague en or, d’or; corona aurea, couronne en or ;<br />
(econ.) riserva aurea, réserve en or; valute auree, devises en or; (econ.) sistema aureo, étalon<br />
or. EM, G, HP et SL confirment<br />
2 (fig.; del colore dell’oro) d’or ; (letter.) età aurea, âge d’or; secolo aureo, siècle d’or ; (astr.)<br />
numero aureo, nombre d’or ; (mat.) sezione aurea, section dorée. ED, SL « excellent »<br />
auspicale agg.<br />
(lett.) de bon augure: pietra auspicale, première pierre (d’une construction). ES, G confime<br />
austorio s. m.<br />
(archeol.) vase sacrificiel. ET, absent ailleurs<br />
austriacante agg., anche s. m. e f.<br />
(st.) partisan de l’Autriche 689 . ER, G confirme<br />
autarchizzare v. tr.<br />
(econ., polit.) rendre autarcique. ES, G confirme<br />
autobloccante agg.<br />
(mecc.) à blocage automatique. ED, SL « (Mecc) autobloquant »<br />
autoblù o auto blu s. f.<br />
(fam.) (en Italie) voiture officielle. ES, absent ailleurs<br />
autobomba s. f.<br />
voiture piégée. ED, SL « voiture-bombe » 690<br />
autocampeggio s. m.<br />
1 camping en voiture: fare dell’autocampeggio, faire du camping en voiture. ED, G<br />
« caravaning »<br />
2 camping pour automobilistes. ED, G « (luogo) auto-camping »<br />
autocarrato agg.<br />
(mil.) transporté par camion. ED, SL « (Mil) motorisé » 691<br />
689 « Pendant la domination autrichienne en Italie », ajoute GI.<br />
690 G et HP ont ce même ED.<br />
455
autocentrante s. m.<br />
(tecnol.) plateau à centrage automatique. ED, SL “(Tecn) autocentreur” 692<br />
autocitarsi v. pron.<br />
se citer soi-même. ED, SL « se citer (soi-même) » 693<br />
autocivetta s. f.<br />
voiture banalisée. ES, G confirme<br />
autocontratto s. m.<br />
(dir.) contrat avec soi-même. ET, absent ailleurs<br />
autoconvoglio s. m.<br />
convoi de voitures, de camions. ES, G confirme<br />
autognosia s. f.<br />
(filos.) conscience de soi. ES, absent ailleurs<br />
autografia s. f.<br />
caractère autographe. ES, absent ailleurs<br />
autoimmondizie s. m. inv.<br />
camion à ordures. ES, absent ailleurs<br />
automercato s. m.<br />
marché des véhicules automobiles. ES, G confirme<br />
autopiano s. m.<br />
(mus.) piano mécanique. ET, G confirme<br />
autoraduno s. m.<br />
meeting automobile. ED, G « rallye » 694<br />
autoribaltabile s. m.<br />
691 G a ce même ED.<br />
692 G a ce même ED.<br />
693 G a ce même ED.<br />
694 HP a ce même ED.<br />
456
(trasp.) camion à benne basculante. ED, SL « (Aut) tombereau » 695<br />
autoscafo s. m.<br />
(mar.) bateau à moteur. ET, absent ailleurs<br />
autospurgatore s. m.<br />
camion de vidange. ES, absent ailleurs<br />
autostarter s. m. inv.<br />
(equit.) starting-gate automobile. ET, G confirme<br />
avallato s. m.<br />
(dir.) bénéficiaire d’aval. ET, G confirme<br />
aviario agg.<br />
des oiseaux: malattie aviarie, maladies des oiseaux. ED, SL « aviaire »<br />
aviatorio agg.<br />
de l’aviation. EM, G, HP et SL confirment<br />
avicunicoltore s. m.<br />
éleveur de volailles et de lapins. ED, G « avicuniculteur »<br />
avifauna s. f.<br />
(zool.) faune ornithologique. ED, G « avifaune »<br />
avio agg. inv.<br />
d’aviation, pour avions: benzina avio, essence d’aviation, essence pour avions. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
avioimbarco s. m.<br />
(aer.) embarquement aérien. ED, G « embarquement (dans un avion) »<br />
aviorimessa s. f.<br />
hangar pour avions. ED, G « hangar (pour avions) » 696<br />
aviotruppa s. f.<br />
695 G a ce même ED.<br />
696 HP a ce même ED.<br />
457
(mil.) troupe aéroportée. ET, absent ailleurs<br />
avvallato agg.<br />
situé au fond d’une vallée. ES, G confirme<br />
avvalorare v. tr.<br />
mettre en valeur. ES, G et SL confirment<br />
avvenirista s. m. e f., anche agg.<br />
qui anticipe le futur, l’avenir. ED, G « avant-coureur, précurseur »<br />
avveniristico agg.<br />
qui anticipe l’avenir: romanzo avveniristico, roman d’anticipation. ED, SL “futuriste”<br />
avversità s. f. inv.<br />
le fait d’être contraire: l’avversità della sorte, le sort contraire; partimmo nonostante<br />
l’avversità della stagione, la saison n’était pas favorable mais nous partîmes quand même.<br />
ED, HP “(sfavore,contrarietà) adversité” 697<br />
avvocateria s. f.<br />
(fam., spreg.) gent avocassière. ES, absent ailleurs<br />
azionario agg.<br />
(econ.) d’actions: pacchetto azionario, paquet d’actions; capitale azionario, capital-actions.<br />
EM, G, HP et SL confirment<br />
azionatore agg. e s. m.<br />
(tecnol.) dispositif d’entraînement: azionatore elettrico, dispositif d’entraînement électrique.<br />
ET, absent ailleurs<br />
azotatura s. f.<br />
(agr.) épandage d’engrais azotés. ET, G confirme<br />
azza s. f.<br />
(armi ant.) hache d’armes. ES, G et HP confirment<br />
azzannata s. f.<br />
697 G a ce même ED.<br />
458
coup de crocs (m.). ED, SL « morsure » 698<br />
azzeccato agg.<br />
2 bien décoché, bien ajusté: un colpo azzeccato, un coup bien décoché. ED, SL « deviné »<br />
3 bien choisi: un colore azzeccato, une couleur bien choisie. ES, HP confirme<br />
azzurreggiare v. intr.<br />
tirer sur le bleu. ES, absent ailleurs<br />
698 G a ce même ED.<br />
459
DICTIONNAIRE HACHETTE-PARAVIA<br />
abbaglio m.<br />
éblouissement continu. ED, SL “(rar) (abbagliamento) éblouissement” 699<br />
abbarbicare intr.<br />
prendre racine. ES, G confirme<br />
abbattuta f.<br />
ANT. (zona di bosco in cui sono stati abbattuti gli alberi) zone d’abattage. ED, G “(zona diboscata)<br />
trouée”<br />
abbioccarsi pronom.<br />
REGION. avoir un coup de pompe. ED, SL « (region) (addormentarsi) s’endormir, s’assoupir »<br />
abbottonarsi pronom.<br />
FIG. COLLOQ. (mostrarsi riservato) rester bouche cousue. ED, SL “(fig,rar) (tacere) se taire”<br />
abbronzante m.<br />
crème f. bronzante, lait bronzant, pour bronzer. ES, G et SL confirment<br />
abbrunamento m.<br />
(a lutto) mise d’un crêpe (de deuil). ES, absent ailleurs<br />
abigeato m.<br />
vol de bestiaux. ED, B « (dir.) abigéat » 700<br />
accaldarsi pronom.<br />
se mouiller de sueur. ED, G « transpirer »<br />
accaloratamente avv.<br />
avec ardeur; difendere accaloratamente la propria opinione défendre son opinion avec<br />
ardeur. EM, absent ailleurs<br />
acciottolio m.<br />
cliquetis de vaisselle. ED, B “cliquetis” 701<br />
699 G a ce même ED.<br />
700 G a ce même ED.<br />
701 G a ce même ED.<br />
460
acciuffarsi pronom.<br />
se prendre aux cheveux; acciuffarsi con qcn. se prendre aux cheveux avec qn. ED, B « se<br />
colleter, se bagarrer (fam.) » 702<br />
acciugata f.<br />
sauce aux anchois. ED, B « anchoïade »<br />
acquaticità f.<br />
maîtrise aquatique, aisance aquatique. ES, absent ailleurs<br />
acriticamente avv.<br />
sans esprit critique. EM, absent ailleurs<br />
acusticamente avv.<br />
au niveau acoustique; isolato acusticamente isolé au niveau acoustique. EM, absent<br />
ailleurs<br />
addentellato agg.<br />
EDIL. muni d’une harpe. ET, acception absente ailleurs<br />
adottare tr.<br />
(per un corso scolastico) = choisir comme manuel pour la classe. ED, SL “(scegliere) choisir”<br />
aduggiare LETT. tr.<br />
jeter de l’ombre sur. ED, SL “(lett) (fare ombra) ombrager”<br />
aerodinamicamente avv.<br />
du point de vue de l’aérodynamique. EM, absent ailleurs<br />
aeromodellistico agg.<br />
d’aéromodélisme. EM, absent ailleurs<br />
aeromodello m.<br />
modèle d’avion. ED, SL “(Aer) aéromodèle”<br />
affettatura f.<br />
découpage m. en tranches. ES, G confirme<br />
affittuario agg.<br />
qui concerne la location. ED, B “(dir.) locatif”<br />
affrancatrice f.<br />
machine à affranchir. ED, SL “(Post) timbreuse” 703<br />
702 SL a ce même ED.<br />
703 G a ce même ED.<br />
461
aforisticamente avv.<br />
= d’une façon brève et sentencieuse. ED, B « aphoristiquement »<br />
agamicamente avv.<br />
d’une façon agame. EM, absent ailleurs<br />
aggettante agg.<br />
ARCH. qui fait saillie, en saillie. ED, SL « (Arch) saillant »<br />
aggiogare tr.<br />
FIG. (soggiogare) imposer un joug à, mettre sous le joug; aggiogare qcn. al proprio volere<br />
assujettir qn. à sa propre volonté. ED, SL « (fig) (soggiogare) soumettre »<br />
agresta f. AGR.<br />
= raisin qui ne mûrit jamais complètement. ED, G « (uva) verjus »<br />
agricampeggio m.<br />
camping à la ferme. ES, absent ailleurs<br />
agrituristico agg.<br />
= relatif au tourisme rural. ED, SL « agritouristique »<br />
aliantista m. e f.<br />
pilote de planeur. ED, SL « (Aer) libériste » 704<br />
allestimento m.<br />
TEATR. CINEM. mise f. en scène; un allestimento televisivo mise en scène d’une émission;<br />
allestimento di un’opera mise en scène d’un opéra. ES, G et SL confirment<br />
allignare intr.<br />
FIG. prendre racine. ED, SL “(fig) (attecchire) prendre”<br />
allocazione f.<br />
SPORT = montant du prix. ED, SL « (nell’ippica : premio) prix »<br />
alluvionato m.<br />
(vittima di un’alluvione) sinistré (~e) des inondations. ED, SL “sinistré, inondé”<br />
alpestre m.<br />
= liqueur aux herbes alpines. ES, G confirme<br />
alteratamente avv.<br />
de manière, façon altérée. EM, absent ailleurs<br />
704 G a ce même ED.<br />
462
amazzone f.<br />
(abito da cavallerizza) tenue d’amazone. ED, G “(abito da cavallerizza) amazone”<br />
amichevolmente avv.<br />
(senza contenzioso) à l’amiable, en ami. ES, acception absente ailleurs<br />
amleticamente avv.<br />
= de manière indécise, irrésolue. EM, absent ailleurs<br />
ammaccato agg.<br />
(contuso) [parte del corpo] couvert de bleus, tout bleu; essere tutto ammaccato être moulu.<br />
ED, SL “(estens) (rif. a parti del corpo) meurtri”<br />
ammaliziare tr.<br />
rendre malicieux. ED, B “dégourdir”<br />
ammonitorio agg.<br />
(diretto ad ammonire) = qui sert d’admonestation. ED, SL “(rar) réprobateur”<br />
ammostatura f.<br />
foulage m. du raisin. ED, G « foulage »<br />
ammutolito agg.<br />
(muto) sans voix. ES, absent ailleurs<br />
amorale m. e f.<br />
personne amorale. ED, B “amoral”<br />
amplissimo agg.<br />
très ample, vaste. EM, absent ailleurs<br />
anagraficamente avv.<br />
selon l’état civil. EM, absent ailleurs<br />
anagrammare tr.<br />
faire l’anagramme de. ED, B « anagrammatiser »<br />
anarchicamente avv.<br />
(in modo caotico) d’une manière anarchique; vivere anarchicamente vivre dans l’anarchie.<br />
ES, acception absente ailleurs<br />
anatomico agg.<br />
(per dissezioni) de dissection; coltello anatomico couteau de dissection; tavolo anatomico<br />
table de dissection. ED, SL « (Chir) anatomique » 705<br />
705 B a ce même ED.<br />
463
anatomopatologo m.<br />
(medico legale) medecin m. légiste. ES, acception absente ailleurs<br />
anemico m.<br />
personne anémique. ED, SL “(Med) anémique”<br />
antagonista m.<br />
(muscolo) muscle antagoniste. ED, SL “(Anat) antagoniste”<br />
antagonisticamente avv.<br />
de manière antagoniste. EM, absent ailleurs<br />
anteporsi pronom.<br />
passer avant. ES, G confirme<br />
anteposizione f.<br />
FIG. le fait de faire passer avant. ES, acception absente ailleurs<br />
antiatomico agg.<br />
(contro l’uso delle armi atomiche) [manifestazione] contre la bombe atomique. ED, SL “(estens)<br />
(antinucleare) antinucléaire”<br />
antibatterico m.<br />
substance f. antibactérienne. ED, SL “(Farm) antibactérien”<br />
antichista m. e f.<br />
spécialiste de l’antiquité. ED, SL « antiquiste »<br />
anticipatamente avv.<br />
[pagare, ringraziare] d’avance; [rimborsare] à l’avance. EM, B, G et SL confirment<br />
anticrittogamico m.<br />
substance f. anticryptogamique. ED, SL « (Agr) anticryptogamique »<br />
antidemocratico m.<br />
personne f. antidémocratique. ES, B confirme<br />
antidiarroico m.<br />
médicament antidiarrhéique. ED, SL “(Farm) antidiarrhéique”<br />
antidogmatico m.<br />
personne f. antidogmatique. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
antielmintico m.<br />
remède anthelminthique. ED, SL « (Farm) anthelminthique, vermifuge »<br />
464
antigas agg.inv.<br />
[maschera] à gaz. ED, G « antigaz »<br />
antipolvere agg.inv.<br />
= qui empêche la formation de la poussière. ES, absent ailleurs<br />
antiracket agg.inv.<br />
contre le racket. ED, SL « antiracket »<br />
antischegge agg.inv.<br />
[vetro] de sécurité. ES, absent ailleurs<br />
antistante agg.inv.<br />
[terreno] d’en face; antistante a devant, en face de; il parco antistante alla scuola le parc<br />
devant l’école. ED, SL « devant » 706<br />
antistatale agg.<br />
= contraire aux intérêts de l’État. ES, absent ailleurs<br />
antistoricismo m.<br />
= doctrine qui s’oppose à l’historicisme. ED, SL « (Filos) anti-historicisme » 707<br />
antitossico m.<br />
produit antitoxique. ED, SL “(Med,Farm) antitoxique”<br />
antologicamente avv.<br />
sous forme d’anthologie. EM, absent ailleurs<br />
antropogeografia f.<br />
géographie humaine. ED, SL « anthropogéographie » 708<br />
antropologicamente avv.<br />
du point de vue anthropologique. EM, absent ailleurs<br />
apologizzare tr.<br />
faire l’apologie de. ES, G confime<br />
appallottolarsi pronom.<br />
1 [salsa, polenta] former des grumeaux; [lana] faire des flocons. ED, SL « se grumeler » 709<br />
2 [gatto] se rouler en boule. ED, SL « se pelotonner »<br />
706 B et G ont ce même ED.<br />
707 G a ce même ED.<br />
708 G a ce même ED.<br />
709 G a ce même ED.<br />
465
appaltante agg.<br />
qui met en adjudication. ED, SL « adjudicateur »<br />
appellazione f.<br />
DIR. interjection d’appel. ED, G « (dir.) interjection »<br />
appositivo agg.<br />
qui a valeur d’apposition. ED, SL « (Gramm) apposé »<br />
appostarsi pronom.<br />
VENAT. se mettre à l’affût. ES, acception absente ailleurs<br />
appruato agg.<br />
1 MAR. enfoncé de l’avant. ET, absent ailleurs<br />
2 AER. lourd du nez. ET, absent ailleurs<br />
appurabile agg.<br />
qu’on peut vérifier. ED, SL « vérifiable, contrôlable »<br />
apribile agg.<br />
qu’on peut ouvrir; la porta non è apribile dall’esterno la porte ne s’ouvre pas de<br />
l’extérieur; AUT. tettuccio apribile toit ouvrant. ED, B « ouvrant » 710<br />
aratore agg.<br />
de labour; bue aratore bœuf de labour. EM, SL confirme<br />
arcatella f.<br />
petite arcade. ED, B « (arch.) arcature, arceau »<br />
ariosamente avv.<br />
avec un style dégagé. ED, B « harmonieusement »<br />
aromatizzante agg.<br />
qui aromatise. ED, SL « aromatisant »<br />
arrabbiatura f.<br />
accès m. de colère; prendersi un’arrabbiatura per qcn. se mettre en colère à cause de qn.;<br />
eviti le arrabiature, starà meglio évitez les accès de colère, vous irez mieux. ED, SL<br />
« colère »<br />
arraffone m.<br />
= personne qui rafle tout ce qu’il peut. ED, SL « (colloq) rafleur » 711<br />
710 SL a ce même ED.<br />
711 G a ce même ED.<br />
466
arroventato agg.<br />
chauffé au rouge; un ferro arroventato un fer chauffé au rouge. ED, SL « rouge »<br />
arrugginimento m.<br />
= état de ce qui est rouillé. ED, B « rouillure »<br />
articolista m. e f.<br />
auteur d’articles (de journaux). ED, SL « rédacteur, journaliste »<br />
asetticamente avv.<br />
de façon aseptique (anche FIG.). EM, absent ailleurs<br />
assemblearismo m.<br />
= tendance politique qui privilégie le pouvoir décisionnel des assemblés populaires. ES, G<br />
confirme<br />
assicurazione f.<br />
(di lettere) chargement m. postal. ES, SL confirme<br />
assist m.inv. SPORT<br />
passe f. en avant. ED, SL « (Sport) assist » 712<br />
associativo agg.<br />
DIR. COMM. d’association; quota associativa quote-part d’association. ED, SL “(di<br />
associazione) associatif”<br />
assolutizzare tr.<br />
donner un sens absolu à, considérer comme indiscutable [affermazione]. ED, SL<br />
« absolutiser » 713<br />
assolutizzazione f.<br />
= le fait de rendre absolu. ES, G confirme<br />
astrusamente avv.<br />
d’une façon abstruse, obscure. ED, SL « inintelligiblement, obscurément »<br />
atipicità f.inv.<br />
= caractère de ce qui est atypique. ED, SL « atypisme »<br />
atteggiato agg.<br />
se donnant l’air de; un viso atteggiato a compassione, a sorpresa un visage qui<br />
manifeste la compassion, la surprise. ES, absent ailleurs<br />
712 G a ce même ED.<br />
713 G a ce même ED.<br />
467
attempato agg.<br />
d’un certain âge. ED, SL « âgé »<br />
autogol m.inv.<br />
but contre son camp (anche FIG.); fare (un) autogol marquer un but contre son camp.<br />
ED, SL « (Sport) autobut (anche fig) »<br />
autoincensamento m.<br />
encensement de soi-même. ED, SL « auto-encensement »<br />
autoinganno m.<br />
fait de s’abuser, de se faire illusion. ES, absent ailleurs<br />
autoipnosi f.<br />
hypnose par soi-même. ED, SL « autohypnose »<br />
autoparcheggio m.<br />
parc de stationnement. ED, SL « parking »<br />
autostoppismo m.<br />
faire de l’auto-stop, du stop. ES, absent ailleurs<br />
autotelaio m.<br />
châssis d’automobile. ED, SL « (Aut) châssis »<br />
autovettura f.<br />
voiture automobile. ED, B “automobile, voiture”<br />
aviere m. MIL.<br />
= homme de rang de l’armée de l’air. ED, SL « (Mil) aviateur »<br />
avvicendare tr.<br />
faire alterner. ES, B, G et SL confirment<br />
avvitarsi pronom.<br />
SPORT faire une vrille. ES, acception absente ailleurs<br />
azzittire tr.<br />
faire taire. ED, B « chuter (fam.) » 714<br />
714 G et SL ont ce même ED.<br />
468
DICTIONNAIRE GARZANTI<br />
àbaco n.m.<br />
(libretto elementare di aritmetica) cours élémentaire d’arithmétique; (tavola pitagorica) table (f.) de<br />
multiplication. ES, acception absente ailleurs<br />
abbottonatùra n.f.<br />
(fila di bottoni) rangée de boutons. ED, SL “(l’insieme dei bottoni e degli occhielli) boutonnière”<br />
abbozzàta n.f.<br />
première ébauche, esquisse rapide: dare un’abbozzata a qlco, faire qqch d’un premier jet.<br />
ED, B « ébauche »<br />
abbòzzo n.m.<br />
(edil.) première couche (f.) d’enduit. ET, acception absente ailleurs<br />
abbreviatóre n.m.<br />
(st. relig.) abréviateur apostolique. ED, B « (dir. canonico) abréviateur »<br />
abilitazióne n.f.<br />
reconnaissance légale d’une aptitude à une profession: abilitazione alla (libera) professione,<br />
certificat d’aptitude à la profession; dare, conseguire l’abilitazione (all’insegnamento),<br />
passer, obtenir (o avoir) son certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire | certificato,<br />
diploma di abilitazione, certificat d’aptitude: certificato di abilitazione all’insegnamento<br />
secondario, certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire (CAPES);<br />
diploma di abilitazione magistrale, certificat d’aptitude pédagogique | esame, concorso di<br />
abilitazione, examen, concours d’aptitude professionnelle. ED, B « (scol.) aptitude » 715<br />
abiogenètico agg.<br />
(biol.) relatif à l’abiogénèse. ED, SL “(Biol) abiogénétique”<br />
abnegàre v.tr.<br />
(non com.) faire abnégation (de): abnegare se stesso, renoncer à soi-même. ED, SL<br />
« renoncer à »<br />
abolìbile agg.<br />
715 HP a ce même ED.<br />
469
qui peut être aboli. EM, absent ailleurs<br />
accadùto agg. qui est arrivé: raccontare i fatti accaduti, raconter les événements qui sont<br />
arrivés. ED, B « survenu »<br />
◊ n.m. (solo sing.) ce qui est arrivé: ci ha raccontato l’accaduto, il nous a raconté ce qui est<br />
arrivé; sono spiacente per l’accaduto, dell’accaduto, je suis désolé de ce qui est arrivé. ED,<br />
SL « fait, événement »<br />
accastellaménto n.m.<br />
(mar.) châteaux de proue et de poupe. ET, acception absente ailleurs<br />
accecarsi v.pron.intr.<br />
se crever les yeux. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
accentuatìvo agg.<br />
qui se base sur l’accent tonique | metrica accentuativa, métrique basée sur l’accent tonique.<br />
ES, B confirme<br />
accessorietà n.f.invar.<br />
caractère (m.) de ce qui est accessoire. ES, acception absente ailleurs<br />
acciàcco n.m.<br />
ennui de santé: è sempre pieno di acciacchi, il a toujours des petits ennuis de santé; sono gli<br />
acciacchi dell’età!, ce sont les petits malheurs de l’âge! ED, SL « infirmité »<br />
acciaccóso agg.<br />
qui a de petits ennuis de santé: un vecchio acciaccoso, un vieillard plein de petits ennuis de<br />
santé. ED, SL « souffreteux, maladif »<br />
acciarpàre v.tr.<br />
(raccattare alla rinfusa) ramasser pêle -mêle. ES, acception absente ailleurs<br />
accidentàto agg.<br />
(pieno di imprevisti) plein d’imprévus: viaggio accidentato, voyage plein d’imprévus; vita<br />
accidentata, vie mouvementée. ED, SL “(movimentato da imprevisti, difficoltà) mouvementé”<br />
accompagnatório agg.<br />
d’accompagnement | (lettera) accompagnatoria, lettre d’accompagnement (o<br />
accompagnatrice). EM, HP et SL confirment<br />
470
accostàto agg.<br />
(posto vicino) à côté de; (appoggiato) placé contre: sedie accostate, chaises l’une à côté de<br />
l’autre; tavolo accostato al muro, table placée contre le mur. ES, acception absente ailleurs<br />
accozzarsi v.pron.rec.<br />
(ant.) (azzuffarsi) en venir aux mains. ES, acception absente ailleurs<br />
accudimènto n.m.<br />
(ad anziani) assistance (f.) aux personnes âgées; (a malati) soins (pl.) à la personne. ES,<br />
absent ailleurs<br />
accusàre v.tr.<br />
(scherma) accuser le coup. ET, acception absente ailleurs<br />
accusatóre n.m.<br />
(st. fr.) accusateur public. ER, acception absente ailleurs<br />
acéto n.m.<br />
(fig.) (letter.) esprit mordant. ED, SL “(fig,lett,rar) causticité, mordant”<br />
acetosèlla n.f.<br />
(bot.) petite oseille; oseille à trois feuilles | (chim.) sale di acetosella, sel d’oseille. ED, SL<br />
« (Bot) oseille, oxalide, alléluia »<br />
acinóso agg.<br />
(non com.) qui a beaucoup de grains: uva acinosa, raisin qui a beaucoup de grains. ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
acnòdo n.m.<br />
(mat.) point conjugué, point acnodal. ET, absent ailleurs<br />
acròstico n.m.<br />
(gioco enigmistico) mot caché. ES, acception absente ailleurs<br />
addomesticàbile agg.<br />
(ammaestrabile) qu’on peut dresser. ES, acception absente ailleurs<br />
adiacènza n.f.<br />
471
(pl.) (terre adiacenti) terres adjacentes. ED, HP « abords, alentours » 716<br />
advertisement n.m.invar.<br />
(ingl.) annonce (f.) publicitaire. ES, absent ailleurs<br />
aerogètto n.m.<br />
(aer.) avion à réaction. ED, B “(aer.) aéroréacteur”<br />
aerografìa n.f.<br />
peinture à l’aérographe, traitement (m.) à l’aérographe. ED, SL “(Pitt) aérographie”<br />
aeròlite, aeròlito n.m.<br />
(geol.) météorite (f.) pierreuse. ED, SL “(Min) aérolite, aérolithe”<br />
affarìssimo n.m.<br />
excellente affaire (f.). ES, absent ailleurs<br />
affittòpoli n.f.invar.<br />
scandale (m.) politico-immobilier. ES, absent ailleurs<br />
affrettataménte avv.<br />
2 (in modo poco accurato) à la hâte. ES, acception absente ailleurs<br />
3 (in tutta fretta) en toute hâte. ES, acception absente ailleurs<br />
affrontàbile agg.<br />
que l’on peut affronter. ED, B “affrontable”<br />
africanìsta n.m. e f.<br />
(pol.) partisan (m.) de l’expansion coloniale en Afrique. ES, acception absente ailleurs<br />
aggiornàbile agg.<br />
1 (di pubblicazione ecc.) qui peut être mis à jour. ED, B « ajournable »<br />
2 (rinviabile) qui peut être ajourné. ES, acception absente ailleurs<br />
aggiudicàbile agg.<br />
(dir.) qu’on peut adjuger; (di premio) qu’on peut décerner. EM, absent ailleurs<br />
716 S.v. adiacenze.<br />
472
aggregàre v.tr.<br />
(mil.) rattacher momentanément à un autre corps de troupe. ET, acception absente ailleurs<br />
agiataménte avv.<br />
dans l’aisance: vivere agiatamente, vivre dans l’aisance. ED, SL « aisément » 717<br />
agoinfissióne n.f.<br />
(med.) implantation d’une aiguille radioactive. ET, absent ailleurs<br />
agùglia 3 n.f.<br />
(zool.) aiguille de mer. ED, B « (zool.) aguille, orphie »<br />
alàno n.m.<br />
(zool.) grand danois. ED, SL « (Zool) danois »<br />
alberétto n.m.<br />
(mar.) petit mât. ED, B “(mar.) mâtereau »<br />
alberghièro n.m.pl. gli alberghièri<br />
le personnel (sing.) hôtelier. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
alginàto agg.<br />
(ind. tess.) à l’alginate. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
algóre n.m.<br />
(letter.) froid rigoureux. ES, absent ailleurs<br />
alimentàri n.m.pl.<br />
denrées (f.) alimentaires: (negozio di) alimentari, magasin d’alimentation. ED, B<br />
“alimentation”, HP “comestibles” 718<br />
alligànte n.m.<br />
(chim., metall.) élément d’alliage. ET, absent ailleurs<br />
alpicoltùra n.f.<br />
culture alpestre. ES, absent ailleurs<br />
717 B et HP ont ce même ED.<br />
718 SL a ce même ED.<br />
473
altalenànte agg.<br />
en dents de scie; (fig.) qui a des hauts et des bas: una carriera altalenante, une carrière en<br />
dents de scie. ED, SL « 1 (di andamento) fluctuant ; 2 (di umore) changeant »<br />
amanuènse n.m. e f.<br />
(nella pubblica amministrazione) commis aux écritures, employé aux écritures; (di un notaio) clerc<br />
de notaire. ED, SL « copiste » ; B « (dir.) clerc »<br />
amarascàto agg.<br />
(di vino) aromatisé aux marasques. ES, absent ailleurs<br />
ambientalìsmo n.m.<br />
(psic.) étude (f.) du milieu (rapportée au comportement animal ou humain). ES, acception<br />
absente ailleurs<br />
ambientalìsta agg. e n.m. e f.<br />
(psic.) spécialiste de l’étude du milieu (rapportée au comportement animal ou humain). ES,<br />
acception absente ailleurs<br />
ambiguaménte avv.<br />
de façon ambiguë. ED, SL “ambigument”<br />
ambiziosàggine n.f.<br />
(non com.) ambition ridicule, ambition mesquine. ES, absent ailleurs<br />
amletìsmo n.m.<br />
attitude (f.) irrésolue, caractère contradictoire. ED, B « hamlétisme »<br />
ammassàre v.tr.<br />
(portare all’ammasso) livrer à la réserve (nationale). ED, HP « (portare all’ammasso)<br />
emmagasiner [grano]”<br />
ammendànte agg. e n.m.<br />
(agr.) (de) substance naturelle ou chimique pour amender le sol. ET, absent ailleurs<br />
ammòtrago n.m.<br />
(zool.) mouflon à manchettes. ET, absent ailleurs<br />
amorevolménte avv.<br />
474
avec tendresse. ED, SL “tendrement, affectueusement”<br />
amorósa n.f.<br />
(teatr.) jeune première. ES, absent ailleurs<br />
ampliàbile agg.<br />
1 qu’on peut agrandir. EM, absent ailleurs<br />
2 (fig.) qu’on peut étendre. ES, absent ailleurs<br />
anatràia n.f.<br />
(zool.) aigle (m.) criard. ET, absent ailleurs<br />
anecòico agg.<br />
sans écho | (acustica) camera anecoica, chambre sourde. ED, SL « (Fis) sourd » 719<br />
anèlito n.m.<br />
(letter., fig.) (desiderio ardente) désir ardent. ED, SL “(fig) soif”<br />
angoscióso agg.<br />
(pieno d’angoscia) plein d’angoisse: grida angosciose, cris d’angoisse. ED, SL “(pieno d’angoscia)<br />
angoissé”<br />
anguicrinìto agg.<br />
(lett.) à la chevelure de serpents. ES, absent ailleurs<br />
annalìstica n.f.<br />
tradition historique des annalistes. ED, SL « annalistique »<br />
annaspìo n.m.<br />
gestes (pl.) convulsifs et confus: dopo un breve annaspio, scomparve sott’acqua, il se<br />
débattit un instant, puis disparut sous l’eau. ED, SL « tâtonnement »<br />
annotariàre v.tr.<br />
délivrer une patente de notaire. ES, absent ailleurs<br />
annuìre v.intr.<br />
719 B et HP ont ce même ED.<br />
475
acquiescer d’un signe de tête, faire signe que oui. ED, SL « aquiescer » 720<br />
antennìsta n.m.<br />
poseur d’antennes. ED, SL “antenniste”<br />
antibioticoresistènza n.f.<br />
(fisiol.) résistance aux antibiotiques. ED, B « (med.) antibiorésistance »<br />
anticipàto avv. e agg.<br />
(comm.) d’avance: l’affitto si paga anticipato, le loyer se paie d’avance. ED, SL “(di somma:<br />
dato in anticipo) anticipé, avancé”<br />
anticipatòre agg.<br />
qui anticipe, qui devance. EM, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
antidivìstico agg.<br />
qui n’a rien d’une vedette: atteggiamento antidivistico, comportement dépourvu de tout<br />
cabotinage. ES, absent ailleurs<br />
antifiscalìstico agg.<br />
(econ.) qui vise au dégrèvement fiscal. ET, absent ailleurs<br />
antifràstico agg.<br />
(ret.) d’antiphrase. ED, SL « (Ret) antiphrastique »<br />
antistreptolisìnico agg.<br />
(med.) de l’antistreptolysine | titolo antistreptolisinico, dosage de l’antistreptolysine (dosage<br />
ASLO). ET, absent ailleurs<br />
antisuòno agg.<br />
par isolation phonique. ES, absent ailleurs<br />
antiveggènte agg.<br />
(letter.) nanti du don de prophétie. ED, SL « (lett) voyant, prescient »<br />
appaiarsi v.pron.intr.<br />
(armonizzarsi) être assorti. ES, acception absente ailleurs<br />
720 HP a ce même ED.<br />
476
appeasement n.m.invar.<br />
(ingl.) (pol.) politique (f.) de conciliation. ES, absent ailleurs<br />
appòggio n.m.<br />
(dir.) droit d’appui. ET, acception absente ailleurs<br />
appratiménto n.m. transformation (f.)<br />
(d’un terrain) en prairie. ES, absent ailleurs<br />
appratìre v.tr.<br />
(agr.) transformer (un terrain) en prairie . ET, absent ailleurs<br />
◊ v.intr. se transformer en prairie. ES, absent ailleurs<br />
appropriàbile agg.<br />
(non com.) que l’on peut s’approprier. EM, absent ailleurs<br />
approssimabilità n.f.invar.<br />
(mat.) possibilité de calculer par approximation. ET, absent ailleurs<br />
approvàbile agg.<br />
qui peut être approuvé. ED, SL « approuvable »<br />
archétto n.m.<br />
(arch.) petit arc. ED, HP “ARCH. arceau”<br />
architettonicaménte avv.<br />
du point de vue architectural. ED, SL « architectoniquement »<br />
arcoséno n.m.<br />
(mat.) arc sinus. ET, absent ailleurs<br />
arcotangènte n.f.<br />
(mat.) arc (m.) tangent. ET, absent ailleurs<br />
argòlico agg.<br />
de l’Argolide. ED, B “(lett.) agolique”<br />
arieggiàre v.intr.<br />
477
(non com.) se donner des airs (de): arieggiare a gran signore, se donner des airs de grand<br />
seigneur. ED, SL « (rar) (atteggiarsi) se poser (a en) »<br />
arrestàbile agg.<br />
qui peut être arrêté, que l’on pourrait arrêter, que l’on peut arrêter: un processo di<br />
disintegrazione difficilmente arrestabile, un processus de désintégration que l’on serait bien<br />
en peine d’arrêter. EM, absent ailleurs<br />
arrossìre v.intr.<br />
(non com.) (assumere il colore rosso) devenir rouge. ES, acception absente ailleurs<br />
arruffataménte avv.<br />
de façon désordonnée. EM, absent ailleurs<br />
arruffianarsi v.pron.<br />
faire du (des) boniment(s). ED, SL « gagner » 721<br />
artificiosità n.f.invar.<br />
(l’essere artificioso) caractère artificiel. ED, SL “(artificio) artificialité”<br />
arzigogolàre v.intr.<br />
(sottilizzare) couper les cheveux en quatre; (almanaccare) se torturer le cerveau, la cervelle.<br />
ED, SL « (fantasticare) rêvasser ; (cavillare) chicaner »<br />
asciàta n.f.<br />
coup (m.) de hache. ES, B confirme<br />
asessualità n.f.invar.<br />
(biol.) caractère (m.) asexuel. ED, SL “(Biol) asexualité”<br />
asiadòllaro n.m.<br />
(econ.) Asia dollar. ET, absent ailleurs<br />
asianésimo n.m.<br />
(st. lett.) style asiatique. ED, SL “(Rel,Letter) asianisme”<br />
aspargicoltùra n.f.<br />
721 Nous ne pouvons pas nous passer de noter que cet équivalent est visiblement inadéquat.<br />
478
culture de l’asperge. ES, absent ailleurs<br />
aspirafòglie n.m.invar.<br />
(giardinaggio) aspirateur de feuilles. ES, absent ailleurs<br />
asprétto n.m.<br />
(sapore asprigno) goût aigrelet. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
asseverazióne n.f.<br />
affirmation nette. ED, SL “(lett,rar) affirmation”<br />
assimilabilità n.f.invar.<br />
propriété d’être assimilé, d’assimiler. ES, absent ailleurs<br />
assimilàre v.tr.<br />
(ling.) faire l’assimilation. ED, B”(ling.) assimiler”<br />
assorbiodóri n.m.invar. e agg.<br />
absorbeur d’odeurs. ES, absent ailleurs<br />
astànte n.m.<br />
(antiq.) médecin de garde. ES, absent ailleurs<br />
astìsta n.m. e f.<br />
(sport) sauteur à la perche. ED, B « (atletica) perchiste »<br />
astrofotometrìa n.f.<br />
astrométrie photographique. ED, SL « astrophotométrie »<br />
àtavo n.m.<br />
(letter.) (padre del trisnonno) père du trisaïeul. ED, B “quadrisaïeul” 722<br />
atrabìle n.f.<br />
(fig.) mauvaise humeur. ES, acception absente ailleurs<br />
attergàre v.tr.<br />
(buroc.) écrire au dos (o au verso). ET, absent ailleurs<br />
722 Absent dans PR11 mais présent dans TLFi.<br />
479
àttico 1 n.m.<br />
(abitante) habitant de l’Attique. ED, HP « Attique »<br />
audiomessaggerìa n.f.<br />
(inform.) messagerie (vocale) électronique. ET, absent ailleurs<br />
autobitumatrìce n.f.<br />
goudronneuse automobile. ES, absent ailleurs<br />
autocitazióne n.f.<br />
citation de ses propres textes, de ses propres discours. ES, absent ailleurs<br />
autodemolitóre n.m.<br />
démolisseur auto, casse auto. ED, SL “épaviste”<br />
autodisseminazióne n.f.<br />
(bot.) dissémination spontanée. ET, absent ailleurs<br />
autoeducazióne n.f.<br />
éducation de soi par soi-même. ED, B « auto-éducation »<br />
autofunzióne n.f.<br />
fonction propre. ES, absent ailleurs<br />
autofurgóne n.m.<br />
fourgon automobile | autofurgone funebre, fourgon funèbre (o mortuaire). ED, SL<br />
“fourgon (automobile)”<br />
autolesióne n.f.<br />
lésion volontaire (de soi-même). ED, SL « (rar) automutilation »<br />
autoliquidazióne n.f.<br />
versement (m.) pour une caisse de retraite autonome. ES, absent ailleurs<br />
autorévole agg.<br />
2 (degno di fede) digne de foi: testimonianza autorevole, témoignage digne de foi; fonte<br />
autorevole, source autorisée; parere autorevole, avis autorisé. ES, SL confime<br />
480
3 (che denota autorità) d’autorité: un aspetto autorevole, un air d’autorité. ED, SL “imposant”<br />
autoritatìvo agg.<br />
provenant de l’Autorité: provvedimento autoritativo, mesure prise par l’Autorité. ES,<br />
absent ailleurs<br />
autorizzàto n.m.<br />
personne autorisée. ES, catégorie grammaticale absente ailleurs<br />
autovalóre n.m.<br />
valeur (f.) propre. ES, absent ailleurs<br />
autovettóre n.m.<br />
(mat.) vecteur propre. ET, absent ailleurs<br />
avantilèttera, avanti lèttera agg.<br />
avant la lettre. ES, absent ailleurs<br />
avaraménte avv.<br />
avec avarice. ED, SL “avarement”<br />
avvampàre v.intr.<br />
prendre feu: la catasta di legna avvampò in un attimo, le tas de bois prit feu (o s’enflamma<br />
o flamba) en un instant; il cielo avvampa al tramonto, (estens.) le ciel s’embrase au soleil<br />
couchant. ED, SL “flamber, s’embraser”<br />
avventiziàto n.m.<br />
emploi de vacataire. ES, absent ailleurs<br />
avventurièro agg.<br />
d’aventure: spirito avventuriero, esprit d’aventure. ED, SL “(lett) aventureux”<br />
avvitadàdi n.m.invar.<br />
(tecn.) clé (f.) à écrous. ET, B confirme<br />
avvitatùra n.f.<br />
(parte che si avvita) point (m.) de vissage. ES, absent ailleurs<br />
avvocatésco agg.<br />
481
(spreg.) d’avocat: cavilli avvocateschi, sophismes d’avocat. ED, SL “(spreg) avocassier”<br />
aziendalìsmo n.m.<br />
dévouement total à l’entreprise. ES, absent ailleurs<br />
azionàccia n.f.<br />
mauvaise action. EM, absent ailleurs<br />
482
Annexe II - Les notes culturelles<br />
Nous reproduisons par la suite la liste des entrées avec une note culturelle, relevées dans les<br />
DB de notre corpus.<br />
Nous rappelons les abréviations que nous avons utilisées.<br />
ARM (Armée) LIT (Littérature)<br />
ART (Arts) MED (Médias)<br />
BD (Bande dessinée) MOD (Mode)<br />
CIN (Cinéma) MUS (Musique)<br />
CULT (Culture) PHI (Philosophie)<br />
D (Droit) POL (Politique)<br />
ECO (Economie) PRE (Presse)<br />
EDU (Education) PSY (Psychologie)<br />
ESS (Essais) R (Religion)<br />
F (Folklore) SCI (Sciences)<br />
GAS (Gastronomie) SOC (Société)<br />
GEO (Géographie) SPE (Spectacles)<br />
H (Histoire) SPO (Sport)<br />
INF (Informatique) SYM (Symboles)<br />
INS (Institutions) THE (Théâtre)<br />
JEU (Jeux) TRA (Transports)<br />
LAN (Langue) U (Urbanisme)<br />
483
DICTIONNAIRE BOCH<br />
Direction français-italien<br />
Dans la colonne de gauche se trouve l’entrée sous laquelle la note apparaît, dans la colonne<br />
de droite la catégorie dont elle relève (cf. infra, II.2.1).<br />
abbé R<br />
absurde LIT<br />
abyme LIT<br />
accusateur H<br />
accuser LIT<br />
acrostiche LIT<br />
action H<br />
aéré H<br />
affaire H<br />
aide INS<br />
aigle H<br />
aiglon H<br />
albigeois H<br />
alexandrin LIT<br />
allégorie LIT<br />
alliance INS<br />
allitération LIT<br />
Alsace H<br />
ami H<br />
amour LIT<br />
ampoule H<br />
anagramme LIT<br />
ancien H<br />
anis GAS<br />
annales PRE<br />
annonce PRE<br />
antan LIT<br />
anthropologie ESS<br />
antonomase LIT<br />
apprentissage ECO<br />
aptitude EDU<br />
arc ART<br />
arche ART<br />
archives H<br />
484
ardent H<br />
argot LAN<br />
arlésien THE<br />
armée H<br />
arrondissement U<br />
arsenal CULT<br />
assassin H<br />
assemblée POL<br />
assermenté H<br />
assignat H<br />
assommoir LIT<br />
atelier H<br />
auguste SPE<br />
autobiographie LIT<br />
autoroute TRA<br />
avare LIT<br />
babouvisme H<br />
badiner LIT<br />
bagatelle LIT<br />
bagne INS<br />
baïonnette LAN<br />
balafrer H<br />
ballon GEO<br />
balzacien LIT<br />
banlieue U<br />
banque INS<br />
banquet H<br />
baragouiner LAN<br />
barbaresque LAN<br />
barbiche LAN<br />
barbier LIT<br />
barricade H<br />
Barthélémy H<br />
bas-bleu LAN<br />
Bastille H<br />
bataille LIT<br />
bateau LIT<br />
bauxite LAN<br />
bd BD<br />
beauf BD<br />
Bécassine LAN<br />
485
elle-de-nuit CIN<br />
bergère H<br />
bêtise LIT<br />
beur LAN<br />
bibliothèque CULT<br />
bic ® LAN<br />
bidonville U<br />
bien H<br />
binette INF<br />
bison TRA<br />
bisque LAN<br />
blablabla LAN<br />
blanc H<br />
blanquisme H<br />
blasé LAN<br />
bleu H<br />
bobo SOC<br />
bohème SOC<br />
boiteux H<br />
Bonaparte H<br />
bonhomme PSY<br />
bottin LAN<br />
boucle SPO<br />
boudoir LAN<br />
bouffon THE<br />
bougie LAN<br />
boulangisme H<br />
boulevard U<br />
bouquiner LAN<br />
bourgeois THE<br />
bourgeoisie PHI<br />
bourguignon H<br />
bout LIT<br />
boutade LAN<br />
bovarysme LIT<br />
boxe SPO<br />
bragard H<br />
brasserie SOC<br />
bredouiller LAN<br />
breton LIT<br />
brûle-pourpoint LAN<br />
486
umaire PHI<br />
brut ART<br />
bûche SOC<br />
buis SOC<br />
bureau H<br />
burlesque LIT<br />
cabaretier SPE<br />
cabinet ART<br />
cabriolet TRA<br />
caché R<br />
cachet LAN<br />
cadavre JEU<br />
cadet LAN<br />
cadre ARM<br />
café SOC<br />
cagoule H<br />
cahier CIN<br />
caillou GEO<br />
calculatrice SCI<br />
calembour LAN<br />
calvaire R<br />
calviniste PHI<br />
cambrioleur LIT<br />
camélia LIT<br />
camelot H<br />
caméra CIN<br />
camisard H<br />
camouflage H<br />
canal GEO<br />
canard PRE<br />
cancan SPE<br />
Candide LIT<br />
cannois CIN<br />
capacité EDU<br />
capétien H<br />
caporal H<br />
caractère LIT<br />
cardinal H<br />
caricature ART<br />
Carmen LIT<br />
carolingien H<br />
487
carthaginois LIT<br />
cartoon CIN<br />
catacombe H<br />
cathare H<br />
cébiste SOC<br />
cent H<br />
centre GEO<br />
césar CIN<br />
césarisme H<br />
cgt SOC<br />
chambre ESS<br />
chandail LAN<br />
chanson LIT<br />
chapelle ART<br />
charabia LAN<br />
charade LAN<br />
chariot SOC<br />
charité INS<br />
charlemagne LAN<br />
charme LAN<br />
charrue H<br />
chartreuse GEO<br />
chat INF<br />
chauviniste LAN<br />
chef-d'œuvre LIT<br />
chemin H<br />
chevet LAN<br />
chic LAN<br />
chouan H<br />
chronique ESS<br />
chute PHI<br />
cimetière LIT<br />
cinéma CIN<br />
citoyen PHI<br />
civilisation H<br />
claque LAN<br />
clarté PHI<br />
classicisme LIT<br />
clerc LAN<br />
coalition H<br />
cocotte LAN<br />
488
code D<br />
cœur PHI<br />
collaborationnisme H<br />
collectionneur LAN<br />
collège EDU<br />
collet SOC<br />
colombe SPO<br />
colonialiste H<br />
colportage LIT<br />
combat H<br />
comble LAN<br />
comédie THE<br />
commissaire LIT<br />
commun H<br />
compagnon H<br />
compréhension PHI<br />
comptine LAN<br />
conciergerie H<br />
concours EDU<br />
condamné CIN<br />
condition PHI<br />
confession LIT<br />
confiseur LAN<br />
conservatoire CULT<br />
constitutionnel H<br />
consulat H<br />
contrat ESS<br />
contrepèterie LAN<br />
convention H<br />
conventionnalisme SCI<br />
coq SYM<br />
coquetterie LAN<br />
coquille H<br />
cordelier H<br />
cordon-bleu LAN<br />
cornélien LIT<br />
corps PHI<br />
correspondance LIT<br />
costard LAN<br />
côte GEO<br />
coucher H<br />
489
coup CIN<br />
coupé TRA<br />
couplet M<br />
coupure PHI<br />
courriel INF<br />
courtisan LIT<br />
créole LAN<br />
crise ESS<br />
cristallisation PHI<br />
crochet SPE<br />
croix H<br />
croquant H<br />
cruauté THE<br />
curé LIT<br />
cygne LAN<br />
dadaïsme LAN<br />
damnation THE<br />
danse SPE<br />
dantesque LAN<br />
dauphin H<br />
dé à coudre SOC<br />
débâcle H<br />
début LAN<br />
décadent LIT<br />
decauville LAN<br />
décodeur LANG<br />
décoloniser H<br />
décomposition ESS<br />
découverte THE<br />
démarcation H<br />
demi-monde LIT<br />
demi-vierge LIT<br />
demoiselle ART<br />
dentellière CIN<br />
département GEO<br />
déraciner LIT<br />
déraison LAN<br />
descente ART<br />
désir PSY<br />
despote PHI<br />
dessert GAS<br />
490
déterminisme SCI<br />
dévolu H<br />
dévot LAN<br />
dialectique ESS<br />
dialogue LIT<br />
dictature ESS<br />
dimanche CIN<br />
directoire H<br />
distancier LAN<br />
divorce D<br />
doléance LAN<br />
dolorisme LAN<br />
domino LAN<br />
doré H<br />
doute PHI<br />
dragon ARM<br />
drapeau H<br />
drôle H<br />
durée ESS<br />
eau LAN<br />
école EDU<br />
écorcherie H<br />
édit H<br />
éducation INS<br />
égalité PHI<br />
égotiste LIT<br />
égout LAN<br />
élan PHI<br />
Elysée, palais de l’ POL<br />
émigré SOC<br />
éminence H<br />
empereur H<br />
enclave D<br />
enclos ART<br />
encyclopédie PHI<br />
énergie LIT<br />
engagement PHI<br />
enjambement LAN<br />
ennui LAN<br />
enracinement PHI<br />
enragé LAN<br />
491
entente H<br />
entracte THE<br />
épave LIT<br />
époque H<br />
équipe PRE<br />
équivalence LAN<br />
esprit PHI<br />
essai LAN<br />
état H<br />
étranger LIT<br />
être H<br />
étude LIT<br />
événementiel H<br />
existentialisme PHI<br />
expérimental ESS<br />
explorateur GEO<br />
exposition GEO<br />
fable LIT<br />
fabliau LIT<br />
fainéant H<br />
fantastique LIT<br />
farce THE<br />
fataliste LIT<br />
fauteuil SYM<br />
fauvisme ART<br />
fédération H<br />
félicité LAN<br />
ferme H<br />
festival SPE<br />
feuillant H<br />
feuilleton LAN<br />
fiction LAN<br />
Figaro PRE<br />
fin THE<br />
flâneur ESS<br />
floral LIT<br />
flou LAN<br />
foire THE<br />
folie SPE<br />
fonctionnalisme PSY<br />
force INS<br />
492
fort LAN<br />
forum U<br />
fouriérisme ESS<br />
foyer ECO<br />
francophonie ESS<br />
franc-tireur H<br />
franglais LAN<br />
frappe LAN<br />
fromage LAN<br />
fronde H<br />
front H<br />
gai ESS<br />
galette F<br />
gallican ESS<br />
gamin LAN<br />
garance H<br />
garçon SOC<br />
garde H<br />
gare CULT<br />
gastronome LAN<br />
gauche H<br />
gaulliste H<br />
gaulois SYM<br />
gavroche LIT<br />
génie H<br />
gigogne THE<br />
Gille THE<br />
girondin H<br />
glorieux ART<br />
grain LIT<br />
grand-guignol THE<br />
grisbi CIN<br />
grotte ART<br />
guignol THE<br />
guillemets LAN<br />
guillotine H<br />
habitude LIT<br />
harpagon LIT<br />
hasard CIN<br />
hexagone GEO<br />
histoire H<br />
493
homme SCI<br />
honnête LAN<br />
hôtel-dieu LAN<br />
huguenot H<br />
huitième ART<br />
humanité POL<br />
idéologie PHI<br />
île GEO<br />
illumination LIT<br />
illusion CIN<br />
image LIT<br />
immédiat PHI<br />
immoraliste LIT<br />
impersonnalité H<br />
impie PHI<br />
impressionnisme ART<br />
impromptu LIT<br />
incorruptible CIN<br />
incroyable H<br />
indifférence LIT<br />
indignité H<br />
indissoluble LIT<br />
inébranlable H<br />
infâme LAN<br />
ingénieur EDU<br />
initiale SOC<br />
innocent H<br />
institut EDU<br />
instituteur EDU<br />
institution INS<br />
intellectuel LAN<br />
invalide INS<br />
ironie LIT<br />
itinéraire TRA<br />
jacobin H<br />
jacquerie H<br />
jardin U<br />
jargon LAN<br />
jaune SOC<br />
javel LAN<br />
jazz MUS<br />
494
jésus ESS<br />
jeu THE<br />
jongleur H<br />
journal PRE<br />
journalisme LAN<br />
juif PHI<br />
juillet H<br />
justice H<br />
kafkaïen LIT<br />
lac LIT<br />
lamarckisme SCI<br />
landes GEO<br />
langue LAN<br />
lanterne LIT<br />
laurier LIT<br />
lavallière MOD<br />
légion ARM<br />
légitimiste H<br />
lettre LIT<br />
lever H<br />
liaison LIT<br />
libération PRE<br />
libertin LAN<br />
libre H<br />
licorn ART<br />
ligne H<br />
ligue H<br />
limoger LAN<br />
limousine TRA<br />
linguistique ESS<br />
lion H<br />
lipogramme LIT<br />
lis H<br />
livre LAN<br />
livret LAN<br />
logique PHI<br />
loi PHI<br />
loyal SPE<br />
lumière PHI<br />
lyrique LIT<br />
machinisme PHI<br />
495
magistère EDU<br />
mai H<br />
maillotin H<br />
mal LIT<br />
malade LIT<br />
malcontent H<br />
maltôte H<br />
mansarde LAN<br />
manufacture H<br />
maquis LAN<br />
marais H<br />
maréchal ARM<br />
Marianne SYM<br />
marmouset ART<br />
Marne H<br />
marotte LAN<br />
marquise CIN<br />
marseillais MUS<br />
mascotte LAN<br />
masque H<br />
masse PHI<br />
matérialisme PHI<br />
maudit LIT<br />
maxime LIT<br />
mayday LAN<br />
méditation PHI<br />
méditerranée ESS<br />
mêlée ESS<br />
mémoire PHI<br />
menhir LAN<br />
mentalité ESS<br />
merde LAN<br />
mérovingien H<br />
métaphore LAN<br />
méthode PHI<br />
métier EDU<br />
métro TRA<br />
métropole GEO<br />
mets GAS<br />
microphysique PHI<br />
milice H<br />
496
milieu SOC<br />
minéralogique TRA<br />
Mines de Paris, Ecole Nationale<br />
Supérieure des EDU<br />
miracle THE<br />
mistral GEO<br />
moderniste PHI<br />
modernité ESS<br />
mœurs PHI<br />
monarchie H<br />
monde PRE<br />
montage CIN<br />
montagnard H<br />
montgolfière LAN<br />
moraliste LIT<br />
moralité THE<br />
morgue H<br />
mot-valise LAN<br />
mousquetaire H<br />
moyen LAN<br />
mystère LIT<br />
mythe LIT<br />
mythologie ESS<br />
narratologie LIT<br />
nationalisme ESS<br />
naturalisme LIT<br />
nausée LIT<br />
néant PHI<br />
nef H<br />
négritude PHI<br />
nihiliste PHI<br />
noblesse H<br />
Noël H<br />
noir LIT<br />
nom SOC<br />
normal EDU<br />
Notre-Dame LAN<br />
nouveau LIT<br />
nouvel PRE<br />
nouvelle ESS<br />
nouvelle vague CIN<br />
497
nuit CIN<br />
OAS POL<br />
obédience H<br />
obélisque ART<br />
obligation EDU<br />
observatoire SCI<br />
obvie LAN<br />
oc LAN<br />
occasionnalisme PHI<br />
octobre H<br />
oïl LAN<br />
olivier SCI<br />
ombre CIN<br />
onomatopée LAN<br />
opéra ART<br />
opéra-ballet THE<br />
opéra-bouffe THE<br />
opéra-comique THE<br />
opérette THE<br />
oratorien H<br />
orientaliste EDU<br />
oriflamme H<br />
orléaniste H<br />
pacte H<br />
paillasse LAN<br />
pain H<br />
pair H<br />
pâle LAN<br />
palindrome LAN<br />
palmarès LAN<br />
palme CIN<br />
pamphlet LAN<br />
Pantagruel LAN<br />
pantalon LIT<br />
panthéon H<br />
pantomime THE<br />
pape H<br />
paralittéraire LAN<br />
parc SPO<br />
pardon R<br />
Paris U<br />
498
parlement POL<br />
parquet LAN<br />
partisan LAN<br />
parvenu LAN<br />
passage U<br />
passant LIT<br />
passé H<br />
passion PHI<br />
pastiche LAN<br />
pataouète LAN<br />
patahphysique LIT<br />
pataquès LAN<br />
pathos LAN<br />
patois LAN<br />
patriarche H<br />
patrologie ESS<br />
patron R<br />
patronyme D<br />
paume H<br />
peau LIT<br />
peinture ART<br />
pendu LIT<br />
pensée PHI<br />
perception PHI<br />
perchoir POL<br />
perdu LIT<br />
père H<br />
périphrase LAN<br />
persifler LAN<br />
personnaliste PHI<br />
pesanteur PHI<br />
peste LIT<br />
pétanque LAN<br />
petit-bourgeois SOC<br />
pétition H<br />
peuple POL<br />
peur H<br />
philologie CULT<br />
photoroman LAN<br />
phrygien H<br />
pickpocket CIN<br />
499
pièce LAN<br />
pied-à-terre LAN<br />
pied-noir LAN<br />
pierrot THE<br />
pin-pon TRA<br />
pique-nique LAN<br />
place H<br />
plan INS<br />
pléiade LIT<br />
pléonasme LAN<br />
point U<br />
poison H<br />
police INS<br />
polytechnique EDU<br />
POM GEO<br />
pont U<br />
populaire H<br />
populisme LAN<br />
positiviste PHI<br />
pote SOC<br />
poubelle H<br />
poujadisme POL<br />
pré H<br />
précieuse LAN<br />
préciosité LAN<br />
préfet INS<br />
prévôt H<br />
primitif ESS<br />
Prince, le Petit LIT<br />
printemps SPE<br />
prisonnier LIT<br />
prix LIT<br />
probablement CIN<br />
protestataire H<br />
provincial ESS<br />
pruderie LAN<br />
pseudonyme SOC<br />
puce SOC<br />
pucelle H<br />
pyramide ART<br />
quarante LAN<br />
500
quart LAN<br />
quartier U<br />
quasimodo LIT<br />
quatrième PRE<br />
querelle LIT<br />
question H<br />
quinzaine PRE<br />
quinze H<br />
rabelaisien LIT<br />
racinien LIT<br />
radeau ART<br />
radical H<br />
radio H<br />
rafle H<br />
raison PHI<br />
ralenti CIN<br />
rando SOC<br />
rayonnant ART<br />
réaction H<br />
réaliste LIT<br />
rebours LIT<br />
recherche LIT<br />
réclame LAN<br />
recommandation LAN<br />
rédaction EDU<br />
réfractaire H<br />
refrain M<br />
refusé ART<br />
regard CIN<br />
régence H<br />
régie TRA<br />
région GEO<br />
regretter M<br />
religion H<br />
renaissance H<br />
renard LIT<br />
reportage LAN<br />
républicain INS<br />
républicanisme LAN<br />
république PHI<br />
réseau U<br />
501
ésistance H<br />
ressentiment LAN<br />
restauration H<br />
resto SOC<br />
résurrection LIT<br />
revanchisme POL<br />
revenant LAN<br />
revenu POL<br />
révisionniste PHI<br />
révolté ESS<br />
révolution H<br />
rire PHI<br />
rive GEO<br />
rocambolesque LIT<br />
rococo ART<br />
roi H<br />
roman LIT<br />
romantisme LIT<br />
rond-de-cuir LIT<br />
roquette INS<br />
rose LIT<br />
roué H<br />
rouelle LAN<br />
roulette SOC<br />
ruban ARM<br />
ruche H<br />
ruelle H<br />
ruse LAN<br />
sabir LAN<br />
sacre H<br />
sadisme PHI<br />
saint-cyrien H<br />
saint-glinglin LAN<br />
saint-simonien LAN<br />
saison LIT<br />
sale LIT<br />
salique DRO<br />
salon LIT<br />
salopard LAN<br />
salope LAN<br />
salut H<br />
502
samidzat H<br />
sanctuaire REL<br />
sang LIT<br />
sans-culotte H<br />
sans-papiers LAN<br />
sans-souci H<br />
saucisse H<br />
sauvage CIN<br />
savant H<br />
savon SCI<br />
savoyard H<br />
scénario LAN<br />
Schtroumpf ® BD<br />
sémiologie LAN<br />
sénat H<br />
sénatus-consulte H<br />
sensualisme PHI<br />
sentimental LIT<br />
septennal INS<br />
séquence CIN<br />
serment LAN<br />
sèvres LAN<br />
sexe LIT<br />
siècle H<br />
siège INS<br />
signe LAN<br />
silence LIT<br />
Silhouette LAN<br />
situation PHI<br />
situationnisme ART<br />
slogan LAN<br />
SMIC ECO<br />
sociologie PHI<br />
soldat H<br />
sorcière LIT<br />
sot LAN<br />
sottie THE<br />
sou H<br />
spiritualité LAN<br />
spleen LIT<br />
structuraliste PHI<br />
503
style LAN<br />
suicide ESS<br />
surnom LAN<br />
surréaliste LIT<br />
surveiller ESS<br />
symbole LAN<br />
symbolisme LIT<br />
synchronie LAN<br />
système PHI<br />
table LIT<br />
tableau LAN<br />
tartarin LIT<br />
Tartuffe LIT<br />
taxi H<br />
temps LIT<br />
tendre LIT<br />
tennis LAN<br />
tentation ART<br />
terre LIT<br />
terreur H<br />
territoire GEO<br />
terrorisme H<br />
tetralogie MUS<br />
texte ESS<br />
thaumaturge H<br />
tiers-monde ECO<br />
tigre H<br />
tissu LAN<br />
toile LAN<br />
tolérance PHI<br />
tomber LAN<br />
tondu H<br />
tour 1 ART<br />
tour 2 SPO<br />
tragédie THE<br />
tranchée H<br />
trappiste LAN<br />
trépassé LAN<br />
tribunat H<br />
tricoteuse H<br />
trois-étoiles LAN<br />
504
trompe-l'œil ART<br />
troubadour LIT<br />
trouvère LIT<br />
tube LAN<br />
tuilerie H<br />
tulipe CIN<br />
tunnel TRA<br />
turlupiner LAN<br />
ubuesque LAN<br />
ultra LAN<br />
ultramontain PHI<br />
un LAN<br />
union H<br />
universitaire U<br />
université EDU<br />
usurpateur H<br />
utopie PHI<br />
vair LIT<br />
variété THE<br />
vaudeville LAN<br />
vendéen LIT<br />
verlan LAN<br />
vernissage LAN<br />
verre ART<br />
Versailles H<br />
viaduc TRA<br />
Vichy H<br />
vieux R<br />
violent PHI<br />
violon H<br />
virelai LIT<br />
vitrail ART<br />
viveur LAN<br />
voie H<br />
voix THE<br />
voyant LIT<br />
voyelle LIT<br />
x EDU<br />
yaourt LAN<br />
z CIN<br />
zazou LAN<br />
505
zouave ARM<br />
zutique LAN<br />
506
Direction italien-français<br />
a T TRA<br />
anno R<br />
Aventino H<br />
avvocato LAN<br />
azzeccagarbugli LAN<br />
befana F<br />
bollente LAN<br />
bomba LAN<br />
bravo LAN<br />
brigata H<br />
busillis LAN<br />
calepino LAN<br />
camera POL<br />
carlona LAN<br />
carrozza H<br />
catacomba H<br />
chippendale ART<br />
cognome H<br />
commedia LIT<br />
consiglio H<br />
cortesia SOC<br />
cuore LIT<br />
delfino LAN<br />
dipendente LAN<br />
do MUS<br />
don LIT<br />
e SCI<br />
elettrauto SOC<br />
fabbrica LAN<br />
ferrovia TRA<br />
fiasco LAN<br />
forca LAN<br />
francesismo LAN<br />
gazzetta PRE<br />
giardino U<br />
Gioconda ART<br />
giornata H<br />
507
giro SPO<br />
giudicato H<br />
giustizia H<br />
gotico ART<br />
guardia H<br />
illuminismo PHI<br />
ladino LAN<br />
macedonia LAN<br />
machiavellico LAN<br />
palindromo LAN<br />
piombo H<br />
sacripante LIT<br />
schiavo LAN<br />
secolo LAN<br />
turlupinare LAN<br />
uovo LAN<br />
508
DICTIONNAIRE GARZANTI<br />
Direction français-italien<br />
abbé R<br />
abyme LIT<br />
académie CULT<br />
accusateur H<br />
accuser H<br />
acrostiche LIT<br />
aéré EDU<br />
affaire INS<br />
agrégation EDU<br />
aide INS<br />
aigle H<br />
aiglon H<br />
airelle LAN<br />
Albigeois H<br />
allégorie LIT<br />
alliance EDU<br />
allitération LIT<br />
Alsace H<br />
ami H<br />
ampoule H<br />
an LAN<br />
anagramme LAN<br />
ancien LIT<br />
anis GAS<br />
annales PRE<br />
antan, d’ LIT<br />
anti LAN<br />
antonomase LAN<br />
aphorisme LAN<br />
apprentissage ECO<br />
apprêter ESS<br />
aptitude EDU<br />
arc ART<br />
archaïsme LAN<br />
arche ART<br />
archives H<br />
ardent H<br />
509
argot LAN<br />
Arlésien MUS<br />
armée H<br />
arobas LAN<br />
arrondissement U<br />
arsenal CULT<br />
article MOD<br />
assassin MOD<br />
assemblée POL<br />
assermenté H<br />
assignat H<br />
assommoir LIT<br />
atelier H<br />
auguste SPE<br />
autoroute TRA<br />
avare LIT<br />
avertisseur TRA<br />
babouvisme H<br />
badiner LIT<br />
bagne H<br />
baïonnette LAN<br />
balafré H<br />
ballon GEO<br />
balzacien LIT<br />
banque ECO<br />
banquet H<br />
baragouin LAN<br />
barbichette LAN<br />
barbier LIT<br />
Barthélemy H<br />
bas-bleu LAN<br />
Bastille H<br />
bauxite LAN<br />
BD BD<br />
beauf SOC<br />
bécassine BD<br />
béchamel LAN<br />
belote JEU<br />
bergère H<br />
betise GAS<br />
beur LAN<br />
510
ibliothèque CULT<br />
bic LAN<br />
bien H<br />
binette INF<br />
bison TRA<br />
bisquer LAN<br />
bla-bla LAN<br />
blanc TRA<br />
blanquisme H<br />
bleu SPO<br />
bobo SOC<br />
bocage GEO<br />
bohème LIT<br />
bois U<br />
boiteux H<br />
bonhomme PSY<br />
bonjour LAN<br />
bottin LAN<br />
boucle SPO<br />
bouffon THE<br />
bougie LAN<br />
boulevard U<br />
bourgeois LIT<br />
Bourguignon H<br />
bouteille GAS<br />
brabancon MUS<br />
Bragard LAN<br />
bredouiller LAN<br />
brûle-pourpoint, à LAN<br />
brut ART<br />
buche F<br />
buis R<br />
bureau ARM<br />
butte<br />
U<br />
cabinet H<br />
cabriolet MOD<br />
cachet H<br />
cadavre JEU<br />
cadet H<br />
cadre ARM<br />
café SOC<br />
511
cahier H<br />
caillou GEO<br />
calculatrice SCI<br />
calembour LAN<br />
calvaire R<br />
cambrioleur LIT<br />
camelot H<br />
camembert GAS<br />
camisard H<br />
canal GEO<br />
canard PRE<br />
cancan SPE<br />
Candide LIT<br />
cantal GAS<br />
capacité EDU<br />
capétien H<br />
capitaine TRA<br />
caporal H<br />
caramel GAS<br />
carolingien H<br />
carotte SYM<br />
carte JEU<br />
cassoulet<br />
GAS<br />
catacombes<br />
H<br />
cent<br />
H<br />
centre<br />
CULT<br />
César<br />
SPE<br />
champagne<br />
GAS<br />
chance<br />
LAN<br />
chandail<br />
LAN<br />
chanson<br />
LIT<br />
Chanteclair<br />
SYM<br />
chantilly<br />
LAN<br />
chapelle ART<br />
char LAN<br />
charabia<br />
LAN<br />
charade<br />
LAN<br />
chariot<br />
LAN<br />
charité<br />
INS<br />
charlemagne<br />
LAN<br />
charrue<br />
H<br />
512
513<br />
chat<br />
LAN<br />
chauffer<br />
LAN<br />
chauvinisme<br />
LAN<br />
chemin<br />
H<br />
chez<br />
LAN<br />
chouan<br />
LAN<br />
chronique<br />
LIT<br />
cibiste<br />
LAN<br />
cinéma<br />
CIN<br />
cité<br />
U<br />
clair<br />
LAN<br />
clavier<br />
INF<br />
code<br />
D<br />
collectionneur<br />
LAN<br />
collège<br />
EDU<br />
coller<br />
LAN<br />
collet<br />
LAN<br />
combientième<br />
LAN<br />
comble<br />
LIT<br />
comédie<br />
THE<br />
comité<br />
H<br />
commis<br />
INS<br />
commune<br />
H<br />
compagnon<br />
H<br />
concours<br />
EDU<br />
confiseur<br />
LAN<br />
conservatoire<br />
CULT<br />
constitutionnel<br />
H<br />
consul<br />
H<br />
consulat<br />
H<br />
conte<br />
LIT<br />
contrepèterie<br />
LAN<br />
coq<br />
SYM<br />
cordelier<br />
H<br />
cordon-bleu<br />
H<br />
cornélien<br />
LIT<br />
costar<br />
SOC<br />
côte<br />
GEO<br />
coucher<br />
H<br />
courriel<br />
INF<br />
cri<br />
LIT
514<br />
crochet<br />
SPE<br />
croix<br />
H<br />
croquant<br />
H<br />
cuisine<br />
GAS<br />
cygne<br />
LAN<br />
dame<br />
LAN<br />
danse<br />
ART<br />
Dauphin<br />
H<br />
dé<br />
LAN<br />
decauville<br />
LAN<br />
décimal<br />
SCI<br />
décoration SOC<br />
découverte<br />
CULT<br />
Defense (Quartier de la)<br />
U<br />
deluge<br />
LAN<br />
demi-monde<br />
LIT<br />
demi-vierge<br />
LIT<br />
département<br />
GEO<br />
dessert<br />
GAS<br />
devise<br />
LAN<br />
dévolution<br />
H<br />
dévot<br />
H<br />
dico<br />
EDU<br />
dictée<br />
LAN<br />
diction<br />
LAN<br />
dicton<br />
LAN<br />
diplome<br />
EDU<br />
directoire<br />
H<br />
dizaine<br />
H<br />
doctorat<br />
EDU<br />
doléances<br />
H<br />
dolmen<br />
LAN<br />
domino<br />
LAN<br />
doré<br />
H<br />
dragée<br />
GAS<br />
drapeau<br />
H<br />
drôle<br />
H<br />
eau<br />
LAN<br />
echec<br />
JEU<br />
echelle<br />
H<br />
eclair<br />
H
515<br />
école<br />
EDU<br />
écorcheur<br />
H<br />
édit<br />
H<br />
éducation<br />
EDU<br />
égal<br />
H<br />
égalité<br />
H<br />
égout<br />
U<br />
électeur<br />
INS<br />
élève<br />
POL<br />
Elysée<br />
POL<br />
e-mail<br />
LAN<br />
émigré<br />
H<br />
éminence<br />
LAN<br />
empereur<br />
H<br />
empire<br />
H<br />
enclos<br />
GEO<br />
encyclopédie<br />
PHI<br />
enragé<br />
H<br />
entente<br />
H<br />
épée<br />
H<br />
épigramme<br />
LAN<br />
épitaphe<br />
LAN<br />
époque<br />
H<br />
équipe<br />
SPO<br />
équivalence<br />
LAN<br />
ermite<br />
LIT<br />
esperluette<br />
LAN<br />
esprit<br />
PHI<br />
essai<br />
LIT<br />
est<br />
TRA<br />
état<br />
H<br />
étiquette<br />
LAN<br />
étoile<br />
H<br />
étranger<br />
LAN<br />
être<br />
H<br />
euphémisme<br />
LAN<br />
examen<br />
EDU<br />
existentialisme<br />
PHI<br />
explorateur<br />
H<br />
exposition<br />
H<br />
fable<br />
LIT
516<br />
fabliau<br />
LIT<br />
facile<br />
LAN<br />
faïence<br />
ART<br />
fainéant H<br />
faire<br />
LAN<br />
familier<br />
LAN<br />
famille<br />
LAN<br />
farce<br />
LIT<br />
faubourg<br />
U<br />
faute<br />
LIT<br />
fauteuil<br />
EDU<br />
fauvisme<br />
ART<br />
fédération<br />
H<br />
fédéré<br />
H<br />
femme<br />
LAN<br />
férié<br />
SOC<br />
ferme<br />
H<br />
festival<br />
CIN<br />
feuillant<br />
H<br />
fève<br />
F<br />
fils<br />
LAN<br />
flic<br />
LAN<br />
floral<br />
LIT<br />
foire<br />
THE<br />
foncer<br />
LAN<br />
forain<br />
LAN<br />
force<br />
H<br />
fort<br />
H<br />
forum<br />
U<br />
foyer<br />
ECO<br />
français<br />
LAN<br />
francisque<br />
SYM<br />
francophonie<br />
LAN<br />
franc-tireur<br />
H<br />
franglais<br />
LAN<br />
fromage<br />
GAS<br />
fronde<br />
H<br />
front<br />
H<br />
gai<br />
LIT<br />
galant<br />
LIT<br />
galette<br />
F
517<br />
gallicanisme<br />
PHI<br />
garance<br />
H<br />
garçon<br />
SOC<br />
garde<br />
ARM<br />
gare<br />
CULT<br />
gargantuesque<br />
LIT<br />
gastronomie<br />
LAN<br />
gauche 1<br />
U<br />
gauche 2<br />
POL<br />
gaule<br />
H<br />
gaulois<br />
SYM<br />
gavroche<br />
LIT<br />
gendarmerie<br />
ARM<br />
génie<br />
ART<br />
gigogne<br />
LAN<br />
gilles<br />
THE<br />
girondin<br />
H<br />
glorieux<br />
H<br />
gobelin<br />
ART<br />
grand-guignol<br />
THE<br />
grève<br />
H<br />
Grisons<br />
GAS<br />
grotte<br />
H<br />
guillemets<br />
LAN<br />
guillotine<br />
H<br />
halle<br />
U<br />
harpagon<br />
LIT<br />
hasard<br />
LAN<br />
hexagone<br />
GEO<br />
holorime<br />
LAN<br />
homme<br />
CULT<br />
honnête<br />
H<br />
honneur LAN<br />
honnir<br />
LAN<br />
horloge<br />
SCI<br />
hôtel-Dieu<br />
INS<br />
huguenot<br />
H<br />
huitième<br />
LAN<br />
hymne<br />
MUS<br />
Ile de France<br />
GEO<br />
image<br />
ART
immatriculation<br />
TRA<br />
immortel<br />
LAN<br />
incorruptible<br />
H<br />
incroyable<br />
H<br />
indignité D<br />
initiale<br />
SOC<br />
innocent<br />
H<br />
inscription<br />
EDU<br />
institut<br />
EDU<br />
instituteur<br />
EDU<br />
Invalides (Hôtel des) I<br />
invention<br />
SCI<br />
itinéraire TRA<br />
jacobin<br />
H<br />
jacquerie<br />
H<br />
jardin<br />
U<br />
jaune<br />
H<br />
javel<br />
LAN<br />
jeu<br />
THE<br />
jongleur LIT<br />
jour<br />
H<br />
juillet H<br />
justice<br />
H<br />
kif- kif<br />
LAN<br />
labadens<br />
LAN<br />
lai<br />
LIT<br />
landes<br />
GEO<br />
langue<br />
LAN<br />
languedocien<br />
TRA<br />
lapalissade<br />
ETY<br />
lavallière<br />
ETY<br />
légion<br />
ARM<br />
lettre<br />
H<br />
lever<br />
H<br />
lez GEO<br />
libération<br />
H<br />
liberté<br />
H<br />
libertin<br />
PHI<br />
libre<br />
H<br />
licorne<br />
ART<br />
ligne<br />
H<br />
518
519<br />
ligue<br />
H<br />
limoger<br />
H<br />
lion<br />
ART<br />
lipogramme<br />
LAN<br />
lis<br />
H<br />
litote<br />
LAN<br />
livre<br />
H<br />
livret<br />
DRO<br />
loto<br />
JEU<br />
loyal<br />
SPE<br />
lumière<br />
PHI<br />
lycée<br />
EDU<br />
madeleine<br />
LIT<br />
magistère<br />
EDU<br />
maillotin<br />
H<br />
maison LAN<br />
majesté<br />
H<br />
mal<br />
LAN<br />
malade<br />
LIT<br />
malcontent<br />
H<br />
maltôte<br />
H<br />
mansarde<br />
ART<br />
manufacture<br />
H<br />
marais<br />
H<br />
Marais, le<br />
U<br />
maréchal ARM<br />
marianne<br />
SYM<br />
marivaudage<br />
LIT<br />
marmouset<br />
H<br />
Marne<br />
H<br />
Marseillaise, la<br />
MUS<br />
mascotte<br />
LAN<br />
masque<br />
H<br />
mayday<br />
LAN<br />
mendiant<br />
F<br />
menhir<br />
LAN<br />
merde<br />
LAN<br />
mérovingiens<br />
H<br />
métaphore<br />
LIT<br />
métier<br />
EDU<br />
métro<br />
LAN
520<br />
métropole<br />
GEO<br />
milice<br />
H<br />
mine<br />
EDU<br />
minéralogique<br />
TRA<br />
ministère<br />
POL<br />
minute<br />
LAN<br />
miracles<br />
ART<br />
mnémotechnique<br />
PSY<br />
monarchie<br />
H<br />
monarque<br />
H<br />
monseigneur<br />
H<br />
montagnard<br />
H<br />
montgolfière<br />
LAN<br />
monument<br />
ART<br />
moralité<br />
LIT<br />
mot<br />
LAN<br />
mot-valise<br />
LAN<br />
mousquetaire<br />
H<br />
muse<br />
ART<br />
musée<br />
ART<br />
mystère<br />
ART<br />
nef<br />
H<br />
négritude<br />
PHI<br />
niveau<br />
EDU<br />
noblesse<br />
H<br />
Noël<br />
ART<br />
nom<br />
LAN<br />
normal<br />
EDU<br />
note<br />
EDU<br />
Notre-Dame<br />
R<br />
nouvelle vague<br />
CIN<br />
nuit<br />
THE<br />
numérotation<br />
INS<br />
obédience<br />
EDU<br />
obélisque<br />
H<br />
obligation<br />
EDU<br />
observatoire<br />
SCI<br />
oc<br />
LIT<br />
occupation<br />
H<br />
océan<br />
GEO<br />
octobre<br />
H
521<br />
oïl<br />
LIT<br />
ombre<br />
H<br />
onomatopée<br />
LAN<br />
opéra<br />
ART<br />
opéra-ballet<br />
ART<br />
opéra-comique<br />
ART<br />
oratoire<br />
H<br />
oriflamme<br />
H<br />
outre-mer<br />
GEO<br />
ouvrier<br />
POL<br />
pacs<br />
INS<br />
paillasse<br />
ART<br />
pain<br />
H<br />
palais<br />
CULT<br />
palindrome<br />
LAN<br />
palme<br />
EDU<br />
pamphlet<br />
H<br />
pantagruélique<br />
LIT<br />
Panthéon, le<br />
ART<br />
paradoxe<br />
LAN<br />
parc<br />
GEO<br />
pardon<br />
R<br />
parlament<br />
INS<br />
parquet<br />
INS<br />
partisan<br />
H<br />
pataouète<br />
LAN<br />
pataquès LAN<br />
patriarche<br />
H<br />
patron<br />
R<br />
patronyme<br />
D<br />
paume<br />
H<br />
pendu<br />
LIT<br />
pensée<br />
PHI<br />
pensionnaire<br />
THE<br />
perchoir<br />
INS<br />
père<br />
U<br />
périphrase<br />
LAN<br />
pétanque<br />
LAN<br />
peur<br />
H<br />
philosophe<br />
PHI<br />
phrase<br />
LAN
522<br />
phrygien<br />
H<br />
pied-noir<br />
LAN<br />
Pierrot<br />
SPE<br />
pincer<br />
LAN<br />
placard<br />
H<br />
Place de la Concorde U<br />
plan<br />
INS<br />
pléiade<br />
LIT<br />
pléonasme<br />
LAN<br />
poil<br />
LAN<br />
point<br />
GEO<br />
poison<br />
H<br />
poisson<br />
SOC<br />
police<br />
INS<br />
polytechnique<br />
EDU<br />
POM<br />
GEO<br />
pont<br />
U<br />
porcelaine<br />
ART<br />
pote<br />
SOC<br />
poubelle<br />
LAN<br />
poujadisme<br />
H<br />
pré<br />
U<br />
précieuse<br />
LAN<br />
préciosité<br />
H<br />
préfet<br />
INS<br />
prévot<br />
H<br />
prier<br />
LAN<br />
prince<br />
LIT<br />
prise<br />
H<br />
prix<br />
LIT<br />
protestataire<br />
H<br />
pseudonyme<br />
LAN<br />
puce<br />
SOC<br />
pucelle<br />
H<br />
pyramide<br />
ART<br />
quarante<br />
CULT<br />
quart<br />
LAN<br />
quartier<br />
U<br />
quatorze<br />
H<br />
quatrième<br />
D<br />
querelle<br />
H
523<br />
question<br />
H<br />
quinte<br />
H<br />
radio<br />
H<br />
rameau<br />
R<br />
rando<br />
F<br />
rayonnant<br />
ART<br />
recherche<br />
LIT<br />
recommandation<br />
LAN<br />
réfractaire<br />
H<br />
refusé<br />
H<br />
régie<br />
TRA<br />
région<br />
GEO<br />
relax<br />
LAN<br />
religion<br />
H<br />
renaissance<br />
H<br />
renard<br />
LAN<br />
Renart LIT<br />
républicain<br />
INS<br />
république<br />
H<br />
résidence<br />
INS<br />
résistance<br />
H<br />
restauration<br />
H<br />
resto<br />
SOC<br />
Réunion, la<br />
GEO<br />
revanchisme<br />
H<br />
révolution<br />
H<br />
rive<br />
U<br />
rocambolesque<br />
LAN<br />
roi<br />
H<br />
roman<br />
LIT<br />
romanticisme<br />
LAN<br />
rond-de-cuir<br />
LAN<br />
roquette<br />
H<br />
rose<br />
LIT<br />
roter<br />
LAN<br />
roué<br />
H<br />
rotelle<br />
H<br />
ruban<br />
SYM<br />
ruche<br />
ART<br />
ruelle<br />
H<br />
sabir<br />
LAN
524<br />
sacre<br />
H<br />
saint<br />
LAN<br />
saint-cyrien<br />
H<br />
saint-glinglin, à la<br />
LAN<br />
salique<br />
H<br />
salon<br />
H<br />
salpêtrière<br />
H<br />
sanctuaire<br />
ART<br />
sans-culotte<br />
H<br />
sans-papiers<br />
D<br />
sauce<br />
GAS<br />
saucisse H<br />
savant<br />
H<br />
savon<br />
SCI<br />
schtroumpf ®<br />
BD<br />
scout<br />
SOC<br />
sénat<br />
H<br />
septième<br />
CIN<br />
serment<br />
H<br />
service<br />
INS<br />
sèvres<br />
LAN<br />
siècle<br />
H<br />
siège<br />
LAN<br />
silhouette<br />
LAN<br />
slogan<br />
LAN<br />
SMIC<br />
ECO<br />
sociètaire<br />
ECO<br />
soldat<br />
H<br />
Sorbonne, la<br />
EDU<br />
sottie<br />
LIT<br />
sou<br />
ECO<br />
style<br />
H<br />
sûreté<br />
INS<br />
surnom<br />
LAN<br />
table<br />
LIT<br />
tableau<br />
THE<br />
tâche<br />
LAN<br />
taille<br />
ECO<br />
tala<br />
LAN<br />
tapisserie<br />
H<br />
tartarin<br />
LAN
525<br />
taxi<br />
H<br />
tendre<br />
H<br />
tennis<br />
LAN<br />
terreur<br />
H<br />
territoire<br />
GEO<br />
tertre<br />
U<br />
théâtre<br />
THE<br />
tiers-monde<br />
ECO<br />
tigre<br />
H<br />
tissu<br />
DRO<br />
toile<br />
INF<br />
TOM GEO<br />
tomber<br />
LIT<br />
tondu<br />
H<br />
tonton<br />
H<br />
tour<br />
SPO<br />
Tour Eiffel<br />
ART<br />
tranchée<br />
H<br />
trappe<br />
R<br />
treize<br />
F<br />
trépassé<br />
GEO<br />
tribunat<br />
H<br />
tricoteuses<br />
H<br />
trois(-)étoiles<br />
LAN<br />
trou<br />
LAN<br />
troubadour<br />
LIT<br />
trouvère<br />
LIT<br />
tube<br />
LAN<br />
Tuileries<br />
U<br />
tulipe<br />
MUS<br />
tunnel<br />
TRA<br />
typographique LAN<br />
ubuesque<br />
LAN<br />
ultra<br />
H<br />
ultramontanisme<br />
PHI<br />
un LIT<br />
union<br />
H<br />
universitarie<br />
EDU<br />
université<br />
EDU<br />
usurpateur<br />
H<br />
vair<br />
LIT
vase<br />
vaudeville<br />
vélodrome<br />
Vendéen<br />
verlan<br />
vernissage<br />
Versaillais<br />
viaduc<br />
vieux-catholique<br />
ville<br />
vin<br />
violon<br />
virelai<br />
vitrail<br />
voie<br />
wallace<br />
www<br />
wysiwyg<br />
x<br />
yaourt<br />
z<br />
zutique<br />
526<br />
H<br />
THE<br />
H<br />
H<br />
LAN<br />
LAN<br />
H<br />
TRA<br />
H<br />
GEO<br />
ECO<br />
LIT<br />
LIT<br />
ART<br />
H<br />
LAN<br />
INF<br />
INF<br />
EDU<br />
LAN<br />
CIN<br />
LIT
527<br />
Direction italien-français<br />
abilitazione<br />
EDU<br />
alibi<br />
LAN<br />
anno<br />
H<br />
Aurelia (Via)<br />
GEO<br />
Aventino<br />
H<br />
avvocato<br />
LAN<br />
azzeccagarbugli<br />
LIT<br />
befana<br />
F<br />
bollente<br />
LAN<br />
bomba<br />
LAN<br />
box<br />
LAN<br />
brigata<br />
POL<br />
busillis<br />
LAN<br />
calepino<br />
LAN<br />
camera<br />
INS<br />
carlona<br />
LAN<br />
carrozza<br />
TRA<br />
catacomba<br />
H<br />
chippendale<br />
LAN<br />
cognome<br />
H<br />
commedia<br />
ART<br />
consiglio<br />
INS<br />
deamicisiano<br />
LAN<br />
delfino<br />
LAN<br />
do<br />
MUS<br />
elettrauto<br />
AN<br />
fabbrica<br />
LAN<br />
ferrovia<br />
TRA<br />
fiasco<br />
LAN<br />
forca<br />
LAN<br />
francesismo<br />
LAN<br />
gazzetta<br />
PRE<br />
giardino<br />
H<br />
Gioconda<br />
AR<br />
giornata<br />
H<br />
giro<br />
SPO<br />
giudicato<br />
H<br />
giustizia<br />
H
gotico<br />
guardia<br />
interlingua<br />
ladino<br />
liceo<br />
machiavellico<br />
numero<br />
palindromo<br />
pozzo<br />
precipitevolissimevolmente<br />
sacripante<br />
sbolognare<br />
schiavone<br />
secolo<br />
sineddoche<br />
suicidarsi<br />
turlupinare<br />
uovo<br />
528<br />
H<br />
H<br />
LAN<br />
LAN<br />
EDU<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
H<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN<br />
LAN
DICTIONNAIRE HACHETTE-PARAVIA<br />
Direction français-italien<br />
Nous avons indiqué dans la colonne de gauche l’intitulé de la note, au lieu de l’entrée sous<br />
laquelle elle apparaît.<br />
académie INS<br />
Académie Française CULT<br />
agrégation EDU<br />
aide au retour INS<br />
aide française INS<br />
alcootest SOC<br />
amnistie INS<br />
année scolaire EDU<br />
ANPE INS<br />
arrondissement U<br />
Assemblée Nationale POL<br />
bac EDU<br />
baccalauréat EDU<br />
bande dessinée BD<br />
Banque de France INS<br />
BCBG SOC<br />
Beaubourg CULT<br />
Bercy INS<br />
Beur SOC<br />
Bison Futé ® TRA<br />
Bourse ECO<br />
brevet EDU<br />
cabinet POL<br />
canton POL<br />
CAPES EDU<br />
carte bleue ECO<br />
carte d’identité INS<br />
Centre d’information et de documentation<br />
Jeunesse INS<br />
Césars CIN<br />
chaînes de télévision MED<br />
champagne GAS<br />
Cinquième République POL<br />
cohabitation POL<br />
529
collège EDU<br />
colonie de vacances SOC<br />
Comédie française THE<br />
comité d’entreprise SOC<br />
conduite accompagnée TRA<br />
Conseil supérieur de l’Audiovisuel INS<br />
conseiller EDU<br />
constat D<br />
coq gaulois SYM<br />
couverture maladie universelle INS<br />
CROUS INS<br />
CRS INS<br />
La Défense U<br />
département INS<br />
député POL<br />
DOM-TOM INS<br />
DUT EDU<br />
école EDU<br />
élection POL<br />
Elysée POL<br />
ENA EDU<br />
exode rurale H<br />
famille nombreuse SOC<br />
fermeture annuelle SOC<br />
Festival d’Avignon THE<br />
Festival de Cannes CIN<br />
fête de la musique MUS<br />
fête nationale INS<br />
garde républicaine ARM<br />
gendarmerie nationale ARM<br />
grande école EDU<br />
habitation à loyer modéré SOC<br />
HEC EDU<br />
immatriculation TRA<br />
INC SOC<br />
IUFM EDU<br />
IUT EDU<br />
journée du patrimoine CULT<br />
légion d’honneur SYM<br />
légion étrangère ARM<br />
livret de famille D<br />
530
lycée EDU<br />
Maghreb GEO<br />
Marianne SYM<br />
La Marseillaise MUS<br />
Matignon POL<br />
ministre d’Etat POL<br />
Minitel MED<br />
œillets SYM<br />
onze novembre H<br />
Pacs D<br />
parité POL<br />
partis politiques POL<br />
pétanque JEU<br />
petite ceinture U<br />
police nationale INS<br />
Polytechnique EDU<br />
pompiers INS<br />
premier ministre POL<br />
Président de la République POL<br />
presse PRE<br />
prix littéraires LIT<br />
Quai des Orfèvres INS<br />
Quartier Latin U<br />
radio MED<br />
RATP TRA<br />
région INS<br />
rentrée SOC<br />
RER TRA<br />
Revenu Minimum d’Insertion INS<br />
routes TRA<br />
rugby SPO<br />
SAMU INS<br />
Sciences Po EDU<br />
Sécurité sociale INS<br />
Sénat POL<br />
SNCF TRA<br />
La Sorbonne EDU<br />
syndicats SOC<br />
Télétel MED<br />
TGV TRA<br />
Tour de France SPO<br />
531
variété française MUS<br />
verlan LAN<br />
Vigipirate INS<br />
ZEP EDU<br />
532