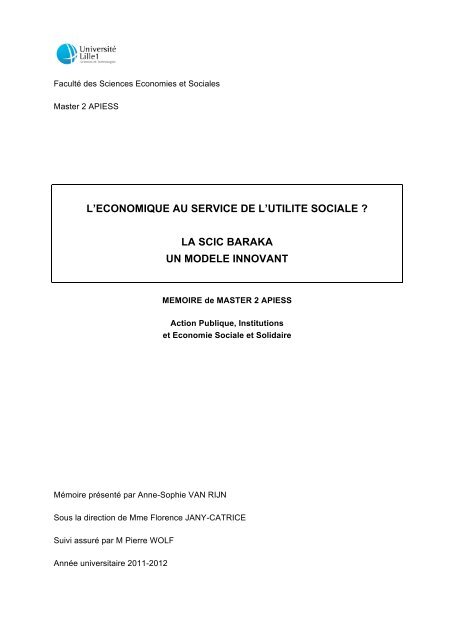PDF - 9.4 Mo - Baraka
PDF - 9.4 Mo - Baraka
PDF - 9.4 Mo - Baraka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Faculté des Sciences Economies et Sociales<br />
Master 2 APIESS<br />
L’ECONOMIQUE AU SERVICE DE L’UTILITE SOCIALE ?<br />
Mémoire présenté par Anne-Sophie VAN RIJN<br />
LA SCIC BARAKA<br />
UN MODELE INNOVANT<br />
MEMOIRE de MASTER 2 APIESS<br />
Action Publique, Institutions<br />
et Economie Sociale et Solidaire<br />
Sous la direction de Mme Florence JANY-CATRICE<br />
Suivi assuré par M Pierre WOLF<br />
Année universitaire 2011-2012
AVANT-PROPOS<br />
Ce mémoire est la dernière étape d’une reconversion professionnelle engagée il y a maintenant 2 ans.<br />
Après 14 ans d’exercice professionnel dans des entreprises du secteur marchand, cette année de<br />
formation a répondu à une grande partie de mes interrogations sur la possibilité d’un modèle<br />
économique respectueux de l’Homme et de son environnement. L’Economie Sociale et Solidaire, trop<br />
peu connue dans les secteurs d’activité où j’exerçais jusque là, regorge d’initiatives et d’organisations<br />
remettant régulièrement en cause le modèle libéral dominant et qui essaient, dans l’hésitation et le<br />
tâtonnement de (re)mettre l’homme au cœur de leurs pratiques, et la démocratie au cœur de leurs<br />
décisions.<br />
Les compétences et connaissances acquises, les rencontres et échanges tout au long de ces 11 mois<br />
sont des bases solides et indispensables pour mener à bien initiatives et actions professionnelles dans<br />
les valeurs de l’ESS. Mais ce sont aussi de vrais réflexes de pensée et d’esprit critique qui ont été<br />
acquis et qui m’ont permis de bousculer les idées reçues et les évidences perçues comme telles par<br />
notre modèle économique si performatif.<br />
Je tiens à remercier toutes les personnes sans qui ce mémoire n’aurait pu aboutir : Pierre Wolf pour sa<br />
confiance et la place qu’il m’a faite dans ce projet, les sociétaires pour leur disponibilité et leur plaisir à<br />
me raconter <strong>Baraka</strong>, Florence Jany-Catrice pour son dynamisme et son exigence universitaire qui m’a<br />
obligée à dépasser mes craintes.<br />
Je remercie pleinement mon mari Hervé qui a su étendre ses compétences domestiques pour<br />
soulager ma charge de travail et surtout pour son soutien dans cette reconversion qui a donné lieu à<br />
de grandes discussions passionnées. Je lui suis reconnaissante ainsi qu’à mes filles pour leur<br />
indulgence pendant mes longues heures d’études et face au stress que cela a pu engendrer.<br />
Ce mémoire vise à être un des outils dans la consolidation du projet <strong>Baraka</strong>, et pourrait servir de<br />
matériau pour d’éventuels essaimages. Il vise également à mettre en valeur l’importance des rôles<br />
joués par le restaurant « l’Univers » et de l’association Chênelet, dans l’émergence et l’aboutissement<br />
de ce projet ambitieux et créatif. Ce rôle joué par ces organisations est d’autant plus important qu’elles<br />
sont toutes deux marquées par des périodes de crise 1 . Il vise enfin à capitaliser sur cette expérience<br />
« innovante », pour les réseaux qui la portent, et le territoire avec qui <strong>Baraka</strong> essaie de créer une<br />
symbiose.<br />
1 L’association l’Univers a perdu son agrément de chantier d’insertion en 2010 et SPL, filiale de Chênelet est en redressement<br />
judiciaire suite à des réductions importantes de subventions. Ces crises ne sont pas indépendantes des choix des politiques<br />
publiques, nationales et parfois régionales, de réduction du soutien aux associations.<br />
2
SOMMAIRE<br />
INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 5<br />
PARTIE 1 ‐ MONOGRAPHIE DE BARAKA ................................................................................................. 8<br />
1. LA METHODOLOGIE MOBILISEE DURANT LE STAGE ............................................................................ 8<br />
2. GENESE DE BARAKA ET PREMIERS PAS ........................................................................................... 9<br />
2.1. Genèse du projet <strong>Baraka</strong> ................................................................................................................................ 9<br />
2.2. Le pluralisme des valeurs ............................................................................................................................ 19<br />
2.3. Les moyens du projet ..................................................................................................................................... 24<br />
2.4. Le projet suite au sinistre ............................................................................................................................ 25<br />
3. CONCLUSION DE LA MONOGRAPHIE ............................................................................................... 39<br />
3.1. Un projet inscrit dans l’économie sociale et solidaire .................................................................... 39<br />
3.2. Force du projet politique et innovation ................................................................................................ 41<br />
PARTIE 2 – MES MISSIONS AU SEIN DE BARAKA ............................................................................... 42<br />
1. CONTEXTE DU STAGE ................................................................................................................... 42<br />
1.1. Genèse .................................................................................................................................................................. 42<br />
1.2. La notion d’utilité sociale, une question d’actualité ........................................................................ 42<br />
1.3. Les enjeux de l’utilité sociale ...................................................................................................................... 45<br />
1.4. L’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong>, une nécessité ? .......................................................... 46<br />
1.5. Réceptivité des sociétaires à l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> ................................ 47<br />
2. MISSION PRINCIPALE : L’EVALUATION DE L’UTILITE SOCIALE DE BARAKA .......................................... 48<br />
2.1. Expertise demandée ...................................................................................................................................... 48<br />
2.2. Déroulement de la mission ......................................................................................................................... 48<br />
2.3. Opportunités et difficultés rencontrées au cours de cette 1ère étape ..................................... 49<br />
3. EVOLUTION SUITE AU SINISTRE ..................................................................................................... 51<br />
3.1. Les raisons de reporter la démarche d’évaluation ........................................................................... 51<br />
3.2. Mes nouvelles missions ................................................................................................................................. 52<br />
4. ELEMENTS DE REFLEXIVITE SUR LE STAGE ..................................................................................... 53<br />
4.1. « Dé formatage » ............................................................................................................................................. 53<br />
4.2. Coopération ....................................................................................................................................................... 54<br />
3
PARTIE 3 ‐ EVALUER L’UTILITE SOCIALE D’UNE STRUCTURE ...................................................... 55<br />
1. EVALUER SON UTILITE SOCIALE ..................................................................................................... 55<br />
1.1. Les avantages de la démarche d’évaluation ....................................................................................... 57<br />
1.2. Les inconvénients et risques de la démarche d’évaluation ........................................................... 57<br />
1.3. Les méthodes d’évaluation ......................................................................................................................... 58<br />
2. L’EVALUATION DE L’UTILITE SOCIALE DE BARAKA ............................................................................ 59<br />
2.1. La méthodologie de l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> .................................................. 59<br />
2.2. Travaux préparatoires : les entretiens semi‐directifs ..................................................................... 61<br />
3. LES CHANTIERS PARTICIPATIFS : ESSAI D’EVALUATION DES IMPACTS ............................................... 69<br />
3.1. La méthode mobilisée pour l’étude des chantiers participatifs .................................................. 69<br />
3.2. Les chantiers participatifs : un processus de construction original ......................................... 70<br />
3.3. Les objectifs et enjeux des chantiers participatifs ............................................................................ 74<br />
3.4. L’évaluation des impacts des chantiers participatifs ...................................................................... 77<br />
3.5. Le bilan des chantiers participatifs ........................................................................................................ 91<br />
CONCLUSION ................................................................................................................................................. 96<br />
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 100<br />
TABLES DES ANNEXES ............................................................................................................................. 102<br />
TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................. 131<br />
4
INTRODUCTION<br />
Avec plus de vingt-cinq articles parus depuis un peu plus d'un an dans les deux grands titres de la<br />
presse locale, une structure pas comme les autres fait l'objet de toutes les attentions sur la métropole<br />
lilloise : la coopérative d'intérêt collectif, <strong>Baraka</strong>.<br />
Même si un tiers de ces parutions concerne l'incendie qui a ravagé le bâtiment de la coopérative une<br />
semaine à peine après son ouverture au public, ce n'est pas tant pour ce sinistre qu'elle attise la<br />
curiosité que pour son modèle innovant.<br />
<strong>Baraka</strong> est la concrétisation d'un rêve un peu fou fait par deux roubaisiens il y a tout juste 4 ans :<br />
construire un bâtiment exemplaire en termes d'exigences environnementales qui, outre son restaurant<br />
et ses salles de réunion, sera le lieu de toutes les initiatives à prendre en vue de réinventer le vivre-<br />
ensemble dans un quartier particulièrement défavorisé de Roubaix. Les recettes du restaurant et des<br />
locations de salles financeront l'ensemble. Une partie des emplois créés seront destinés aux<br />
personnes sortant d'un parcours d'insertion professionnelle et le choix du statut de la structure s'est<br />
porté sur celui de SCIC, société coopérative d'intérêt collectif qui offre l'avantage d'une gouvernance<br />
démocratique et d'un encadrement financier strict limitant la lucrativité (cf. infra).<br />
De toutes ses ambitions, le projet innove dans sa manière d’imbriquer les dimensions économique,<br />
sociale et politique qui va à contre-courant du modèle dominant. Celui-ci, sous influence libérale<br />
depuis la révolution industrielle, a pris la forme d’une sphère économique devenue complètement<br />
indépendante des sphères sociales et politiques. Le capitalisme contemporain a amplifié les effets<br />
causés par cette dissociation entre l’économie et le social. La recherche de toujours plus de profit<br />
comme finalité de l’activité économique est à l’origine de la crise sociale et écologique actuelle. Les<br />
initiateurs du projet ont donc cherché « à lier discours politique critique et activité économique » 2 et à<br />
construire un modèle qui met le marchand au service du non marchand, ou pour le dire autrement, qui<br />
ré-imbrique l’économique comme moyen au service de la société. La finalité de la coopérative est donc<br />
de produire du non-marchand. Ce non-marchand a été appelé « biens communs » par les sociétaires<br />
pour souligner l’intérêt collectif poursuivi. Il englobe l’ensemble des effets positifs produits par la<br />
coopérative et au profit non pas d’un intérêt individuel mais de la société ou tout du moins, d’une partie<br />
(une population, un territoire …).<br />
Dans les conventions se développant au sein de l’économie sociale et solidaire (ESS), des textes de<br />
loi et des travaux scientifiques, c’est le terme d’utilité sociale qui fut retenu pour nommer ces effets<br />
produits sur la société.<br />
Cette notion d’utilité sociale, quasi inexistante il y a quelques décennies, est en train de devenir le faire<br />
valoir des spécificités des organisations de l’ESS. Elle apparaît pour la première fois dans le cadre<br />
d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 1973. Cet arrêt introduit deux nouvelles conditions pour<br />
qu’une structure puisse bénéficier d’exonérations des impôts commerciaux. En complément de la pour<br />
qu’une structure puisse bénéficier d’exonérations des impôts commerciaux. En complément de la non-<br />
2 DACHEUX Eric, « Un nouveau regard sur l’espace public et la crise démocratique », Economie Solidaire et Démocratie,<br />
Hermès 36, 2003<br />
5
lucrativité, les organisations devront justifier que leur activité apporte une contribution non fournie par<br />
le marché ou ayant des conditions plus avantageuses pour les bénéficiaires. Les motivations de l’Etat<br />
sont de prévenir les accusations de concurrence déloyale des entreprises envers le secteur non<br />
lucratif.<br />
En 1995, le CNVA, Conseil National de la Vie Associative, propose une liste de dix critères permettant<br />
d’enrichir la notion d’utilité sociale et de ne pas limiter sa définition à celui de non lucrativité ni à celui<br />
de non satisfaction par le marché. Ces critères concernent, en complément des précédents, la finalité<br />
et le fonctionnement de l’association, le mixage des publics, la capacité à mobiliser de la générosité<br />
humaine et financière, l’existence de financements publics ou parapublics et l’existence d’un agrément<br />
ministériel ou d’une habilitation. Mais la lourdeur procédurale et la problématique juridique engendrées<br />
ne donneront pas suite à ces propositions.<br />
Le rapport Lipietz remis en 2000 à Martine Aubry, alors Ministre des affaires sociales, aborde à<br />
nouveau la question de l’utilité sociale. Ses propositions sont de constituer un tiers secteur d’utilité<br />
sociale, environnementale et culturelle qui bénéficiera d’avantages fiscaux. Il dresse à nouveau une<br />
liste de critères permettant de définir l’appartenance des organisations à ce tiers secteur. Ces critères<br />
se composent d’indicateurs monétarisés (les coûts évités pour la collectivité) et d’indicateurs sociaux<br />
(cohésion sociale, insertion sociale …). Mais ces propositions n’auront pas de suite.<br />
C’est en 2001, par la loi du 17 juillet instituant les SCIC, que l’utilité sociale devient une condition<br />
juridique : « les sociétés coopératives d’intérêt collectif (…) ont pour objet la production ou la fourniture<br />
de biens et services d’intérêt collectif, qui présente un caractère d’utilité sociale » (article 19<br />
quinquies). Mais elle n’en précise ni sa définition ni les critères permettant de la définir. Jusqu’en mars<br />
2012, un agrément était nécessaire pour accéder au statut de SCIC. La préfecture le délivrait selon les<br />
critères suivants : embauche de personnes en contrat d’insertion et/ou handicapées, tarifs préférentiels<br />
pour les bénéficiaires des minima sociaux, économie durable.<br />
Il apparaît nettement que les pouvoirs publics ont le souci de cette notion d’utilité sociale pour justifier<br />
d’avantages fiscaux octroyés à certaines structures mais aussi, et de plus en plus, pour justifier des<br />
financements (subventions, appels à projet …) alloués.<br />
Pour les structures concernées par la question, les associations mais aussi l’ESS en général, l’utilité<br />
sociale, imposée au départ par les pouvoirs publics, devient la justification de leur spécificité et de leur<br />
différenciation vis à vis du secteur privé. Là aussi, la notion reste floue et chaque entité qui s’y est<br />
attelée a défini sa propre utilité sociale et les critères pour la valoriser. Car l’enjeu principal (mais pas<br />
unique) de la capacité d’une structure à fournir la « preuve » de son utilité sociale est la<br />
reconnaissance par les pouvoirs publics de ses spécificités.<br />
De nombreuses associations ont entamé voire réalisé une évaluation de leur utilité sociale. Ce sont<br />
essentiellement les structures liées aux politiques sociales, sanitaires, éducatives et économiques<br />
(l’insertion) 3 . Mais très peu de coopératives ou mutuelles ont fait l’objet d’évaluation de leur utilité<br />
3 GADREY Jean, « L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire. Une mise en perspective sur la base de<br />
travaux récents », rapport de synthèse pour la DIES et la MIRE, février 2004<br />
6
sociale ou même de recherche à ce sujet. Cela tient au fait que la notion d’utilité sociale est née du<br />
rapport de forces entre l’Etat et les structures dépendantes des financements publics. D’autre part, ce<br />
sont surtout les organisations de l’économie sociale qui intègrent les critères initiaux d’encadrement de<br />
l’utilité sociale (production de biens ou services non fournis par le marché) qui ont mené cette<br />
démarche d’évaluation.<br />
Or <strong>Baraka</strong> aura une activité économique pourvue par le secteur privé (restauration et locations de<br />
salles) et son utilité sociale résidera, entre autre, dans l’emploi de personnes sortant d’un parcours<br />
d’insertion donc plus considérées comme telles par les pouvoirs publics. De plus, la coopérative<br />
présente peu de liens financiers ou contractuels avec les pouvoirs publics hormis les subventions<br />
d’aide au lancement d’une activité et celles pour la construction d’un bâtiment à faible impact<br />
environnemental. L’obtention d’un agrément d’utilité sociale lors de la création d’une SCIC n’existe<br />
plus. Les SCIC n’ont donc plus d’obligation légale de prouver leur utilité sociale.<br />
Dans ce contexte, en quoi est-il pertinent de mener une démarche d’évaluation d’utilité sociale pour la<br />
coopérative <strong>Baraka</strong> ?<br />
En tant que modèle innovant, elle redéfinit la place et le rôle de l’économique en tant que moyen au<br />
profit d’une production de biens communs. L’évaluation de ces biens communs, de cette utilité sociale<br />
produite peut en apporter la « preuve », peut offrir une illustration de ces engagements de « vivre-<br />
ensemble ».<br />
Le statut spécifique de SCIC fait de <strong>Baraka</strong> un hybride entre l’association et la coopérative. Il s’agit de<br />
savoir si une telle évaluation peut devenir le pendant des indicateurs économiques et financiers de la<br />
part marchande de l’activité. Enfin, il est envisageable qu’une telle démarche d’évaluation permette de<br />
réguler le poids de l’économique dans la structure.<br />
Pour mener à bien cette étude, nous présenterons, dans une première partie, une monographie de la<br />
coopérative <strong>Baraka</strong> et analyserons l’évolution du projet suite au sinistre qui l’a touchée. Il s’agira<br />
d’identifier les spécificités de la structure et la mécanique combinant ses activités économiques et sa<br />
vocation d’utilité sociale.<br />
Dans une deuxième partie, nous aborderons la notion d’utilité sociale et de son évaluation dans un<br />
cadre en général puis plus spécifiquement pour <strong>Baraka</strong>. L’intérêt de cette partie est de comprendre, au<br />
travers de l’évolution de mon stage, comment la question de l’évaluation de l‘utilité sociale a été<br />
amenée et perçue par la coopérative et de saisir en quoi le sinistre a impacté ma mission initiale.<br />
Enfin, nous expérimenterons, en troisième partie, une évaluation simplifiée d’une action majeure de la<br />
coopérative depuis son existence : les chantiers participatifs. Après avoir présenté l’opération en elle-<br />
même, il s’agira de définir et comparer les richesses qu’elle a produites au regard des acteurs<br />
(financeurs et organisateurs) puis des usagers.<br />
7
PARTIE 1 - <strong>Mo</strong>nographie de <strong>Baraka</strong><br />
1. La méthodologie mobilisée durant le stage<br />
Pour réaliser la monographie de la coopérative <strong>Baraka</strong>, je me suis appuyée sur une pluralité de<br />
méthodes, généralement utilisées en sciences sociales, et ici mobilisées plus ou moins<br />
adroitement.<br />
1) Une longue période d’observation in situ modelée par mes expériences acquises lors de mes<br />
activités professionnelles antérieures. Seul un stage de six mois permet une telle période<br />
d’observation où l’étudiant est à la fois chercheur, en action, cherche à prendre de la distance<br />
tout en étant rattrapé régulièrement par les réalités du travail et les rythmes qu’il impose.<br />
2) Une observation-participante ensuite puisque mon immersion dans la vie de l’organisation s’est<br />
faite au travers des différentes tâches accomplies. Celles-ci étaient très diversifiées car le<br />
gérant m’a délégué une partie de sa mission. Nous avons travaillé en complémentarité sur les<br />
différents dossiers qui font vivre la coopérative. Cela allait de ma participation aux services<br />
hôteliers à la mise en place de procédures de gestion de l’équipe, de la gestion des<br />
conséquences du sinistre au suivi des travaux de reconstruction, du lancement de la « fabrique<br />
de biens communs » à la gestion des relations avec les acteurs du quartier.<br />
3) Ce travail a également pris appui sur des travaux menés dans le cadre de ma mission sur<br />
l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> (voir infra, partie 3) et plus particulièrement sur les<br />
entretiens semi-directifs réalisés auprès de sociétaires et de parties prenantes. Ces entretiens<br />
ont été réalisés sur le mois de mars 2012 à partir d’une grille d’entretiens commune. La<br />
volubilité des interviewés et ma curiosité quant aux thèmes abordés ont enrichi, plus que prévu,<br />
les informations récoltées. Mais, a contrario, les écarts par rapport à la grille d’origine ont<br />
parfois altéré le fil directeur de l’enquête.<br />
Le projet ayant (pour de bonnes et moins bonnes raisons) bénéficié d’une importante couverture<br />
médiatique, les revues de presse ont été utiles à ma recherche. De même, le site internet de la<br />
coopérative ayant été régulièrement alimenté, a été une bonne source d’informations.<br />
Ces missions m’ont permis d’avoir un poste d’observation directe et complète sur l’ensemble de<br />
l’organisation. Mais elles m’ont mise en interaction directe avec le terrain. La situation<br />
exceptionnelle qu’a connue la coopérative au travers de l’incendie n’a fait qu’accentuer le transfert<br />
de mon statut de « stagiaire-chercheur » en statut que l’on pourrait qualifier de « stagiaire-<br />
manager ». L’avantage de cette observation in situ est de prendre en compte les actions<br />
collectives et les processus sociaux au lieu de ne s’en tenir qu’aux faits 4 . Elle a rendu mon travail<br />
encore plus riche mais a rendu ma distanciation à l’étude plus délicate.<br />
Comme toute situation en mouvement, cette monographie sera à réactualiser au fil du temps et de<br />
la vie de la coopérative et ce d’autant plus que celle-ci n’en est qu’à ses prémices.<br />
4 Méthode privilégiée par HUGUES. CHAPOULIE Jean-Michel, « Everett C. Hughes et le développement du travail de terrain en<br />
sociologie », Revue française de sociologie, XXV, 1984, p. 584<br />
8
2. Genèse de <strong>Baraka</strong> et premiers pas<br />
2.1. Genèse du projet <strong>Baraka</strong><br />
2.1.1. Le contexte territorial<br />
Pour comprendre l’histoire de <strong>Baraka</strong>, il faut s’intéresser à son territoire : Roubaix. De manière<br />
historique, Roubaix fut le lieu de luttes urbaines et des débuts de la démocratie participative.<br />
Dans les années 60-70, les habitants 5 du quartier de l’Alma-gare s’opposent à une politique de<br />
rénovation urbaine imposée de manière unilatérale. Le mouvement se structure sous la forme<br />
de l’Atelier populaire d’urbanisme (APU) 6 et s’inscrit en contre-pouvoir de la municipalité.<br />
Entre conflit, concertation et coopération, se développent les prémices de la démocratie<br />
participative 7 . S’y inscrit aussi la mouvance militante de l’époque, plus attachée à une politique<br />
du quotidien, qui investit sur les « gens » plutôt qu’à une politique du pouvoir et de territoire.<br />
Roubaix est aujourd’hui la deuxième plus grande ville du Nord-Pas de Calais avec une<br />
population qui avoisine les 100.000 habitants 8 . Après avoir été la capitale mondiale du textile<br />
au XIXème siècle, elle subit de plein fouet la crise du textile des années 50. Elle porte les<br />
traces aujourd’hui de ce déclin : elle est la troisième ville la plus inégalitaire des 100 plus<br />
importantes communes de France selon le récent classement de l’Observatoire des Inégalités.<br />
Malgré les tentatives de reconversion et les politiques de soutien à l’emploi de l’Etat 9 , elle<br />
présente un taux de chômage bien au-dessus de la moyenne nationale (28,7%) 10 . Trois gros<br />
quartiers sont particulièrement défavorisés : les quartiers Ouest (Epeule, Trichon, Crouy), les<br />
quartiers Nord (Alma-gare) et les quartiers Est. Dans ces quartiers, le taux de chômage<br />
dépasse les 34% et la proportion de non diplômés est de 39% 11 . Autre particularité : Roubaix a<br />
une forte proportion de moins de 25 ans : 48% 12 .<br />
2.1.2. L’origine du projet<br />
Héritiers de cette histoire, le groupe des Verts de Roubaix a été créé il y a près de 20 ans. A la<br />
fois investis dans une action écologique et sociale, les Verts veulent « renouveler la<br />
démocratie roubaisienne » 13 dans une ville subissant une abstention record à chaque<br />
élection 14 . Impliqués dans la vie associative locale, ils animent des groupes et des actions<br />
dans le but d’y faire de l’écologie populaire. L’objectif est d’aller au devant des citoyens et de<br />
montrer que par des petites actions très simples du quotidien, l’écologie n’est pas réservée<br />
aux populations aisées. La mixité des militants (écologistes « classiques » et gens plus<br />
5 Deux d’entre eux sont d’ailleurs sociétaires de <strong>Baraka</strong>.<br />
6 HATZFELD Hélène, Municipalités socialistes et associations. Roubaix : le conflit de l'Alma-Gare, Revue française de science<br />
politique, 1986, Volume 36, Numéro 3, pp. 374-392<br />
7 WUHL Simon, La démocratie participative en France : repères historiques, http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-<br />
analyse-418.html, 2008<br />
8 Plus précisément 95028 habitants en 2009 – Source Insee<br />
9 La zone franche urbaine couvre quasiment la moitié du territoire de la ville de Roubaix mais elle ne bénéficie que<br />
minoritairement aux habitants de Roubaix. http://sig.ville.gouv.fr<br />
10 Taux de chômage des 15 à 64 ans, INSEE, 2009<br />
11 http://sig.ville.gouv.fr/Synthese/3104200<br />
12 Chiffres du dernier recensement INSEE 1999<br />
13 www.lesvertsderoubaix.fr<br />
14 72% aux Régionales de 2010, 31,43% au 1 er tour des présidentielles de 2012 (20,53% au niveau national) après une<br />
campagne de communication soutenue et des offres marketing pour mobiliser les citoyens à voter .<br />
9
impliqués dans le quartier qu’ils ne sont écologistes) renforce cette double démarche<br />
écologique et sociale.<br />
Lors de la campagne pour les municipales de 2008, le groupe des Verts obtient des scores<br />
atypiques pour une ville telle que Roubaix : 18% des suffrages exprimés et quatre élus<br />
d’opposition entrent au conseil municipal majoritairement PS.<br />
Malgré cette réussite, les militants ont conscience que, pour être encore plus pertinents lors<br />
des périodes électorales à venir, il leur faut accroitre leur visibilité (ils n’ont pas d’adresse ni de<br />
local) et mettre en avant des réalisations concrètes afin de montrer qu’ils n’ont pas attendu le<br />
pouvoir pour agir. C’est la dynamique même de l’écologie populaire. De ces constats émerge,<br />
courant 2008, lors d’une réunion de militants et sympathisants entre Vincent Boutry, Pierre<br />
Wolf, Myriam Cau et Majdouline Sbai, le rêve de créer un lieu emblématique, « une ruche<br />
écolo » 15 .<br />
Vincent Boutry, militant et fondateur de l’UPC (Université Populaire et Citoyenne de Roubaix)<br />
s’accroche au rêve, écrit, imagine et le transforme en idée : construire un bâtiment, le financer<br />
par un restaurant type café citoyen, en faire un lieu de rencontres … D’une origine inscrite<br />
dans un parti politique, très vite, l’idée se mue en projet autonome, ouvert, pluriel. Sous<br />
l’influence de son initiateur, l’objectif devient la création d’un lieu de foisonnement, libre<br />
d’accès pour les associations et partis politiques. Ni sectaire, ni partidaire, leurs promoteurs<br />
visent littéralement à « faire société ensemble ». Le repérage d’une petite parcelle de terrain<br />
délaissée à proximité de chez lui, dans le quartier de l’Epeule, ouvre la fenêtre du possible. Le<br />
nom <strong>Baraka</strong> émerge comme une évidence, à mi-chemin entre le dérivé de baraque, maison,<br />
accueil et le terme « baraka » qui signifie chance, bénédiction en langue arabe, clin d’œil à<br />
l’environnement de Roubaix dont la population d’origine maghrébine est très présente 16 .<br />
Figure 1 - Le délaissé urbain où sera construit la<br />
coopérative<br />
15 Entretien semi directif de Vincent Boutry<br />
16 1/5 ème de la population roubaisienne est étrangère ou issue de parents étrangers dont la majorité sont maghrébins ou<br />
portugais. (Etude sur les populations étrangères ou d’origine étrangère à Roubaix (source RGP 1990-1999), Observatoire<br />
Urbain,)<br />
Février 2002. « L’origine étrangère » est déterminée par le lieu de naissance des parents.<br />
10
Un deuxième acteur entre en scène quelques temps après et permet la concrétisation de l’idée<br />
en projet : Pierre Wolf. Ce sympathisant écologiste, ancien journaliste, vient de créer son<br />
activité de consultant. Cette activité professionnelle lui offre disponibilité temporelle et sécurité<br />
financière. A cela s’ajoute une fibre entrepreneuriale et des enjeux personnels qui l’enjoignent<br />
à s’atteler à la réalisation du projet.<br />
2.1.3. La concrétisation de l’idée en projet<br />
Pierre Wolf construit le projet comme un article : il doit pallier son manque de connaissances<br />
en bâtiment, économie, gestion, en entrepreneuriat et financement : il se documente, mène<br />
des enquêtes, échange avec des experts des différentes questions, organise des visites de<br />
lieux où la construction écologique et l’habitat partagé est expérimenté 17 . Il fait une étude de<br />
marché sur la faisabilité économique d’un nouveau restaurant à Roubaix. Il construit son<br />
argumentaire et commence à chercher des soutiens.<br />
C’est une étape essentielle de toute innovation sociale : pour que l’idée aboutisse et ne reste<br />
pas à l’état embryonnaire, les initiateurs du projet doivent se donner les moyens de visibiliser<br />
le travail, et de l’institutionnaliser : la mise en place d’une structure légère, et un<br />
investissement économique initial ont été des préconditions à la mise à disposition d’une<br />
personne-ressource, qui consacre du temps au projet, et le concrétise.<br />
Se pose comme dans tout projet innovant, le problème du financement. Le projet<br />
entrepreneurial prend alors une épaisseur institutionnelle et réticulaire. Pour le dire autrement,<br />
il doit être, plus encore, accompagné par des institutions et par des parties prenantes au-delà<br />
du premier cercle de ses promoteurs. L’histoire de <strong>Baraka</strong> est aussi une histoire de réseau<br />
social (voir infra 18 ).<br />
Après un rapide repérage des organismes financeurs, le Fides 19 soutiendra le projet à la<br />
condition qu’il résulte d’un essaimage. La jonction se fait alors avec l’association « l’Univers »<br />
où Pierre Wolf et Vincent Boutry sont respectivement trésorier et président. Ce restaurant<br />
solidaire s’inscrit dans un projet social d’insertion, au cœur des quartiers ouest de Roubaix et<br />
possède des réserves financières conséquentes. « L’Univers » essaime <strong>Baraka</strong> dans la<br />
continuité de son chantier école. L’objectif de cette nouvelle structure sera de créer des<br />
emplois à offrir aux personnes issues des parcours d’insertion du restaurant. « L’Univers »<br />
deviendra le premier sociétaire (en temps et en montant) de la future structure. Le<br />
démarchage d’organismes publics, d’institutions privées ou de particuliers peut commencer<br />
tant pour récolter des fonds que pour agréger les compétences nécessaires à la constitution<br />
du collectif.<br />
17 Notamment aux Pays-Bas à Rotterdam et Culemborg (projet Eva Lanxmeer) au 1 er trimestre 2009.<br />
18 Cette capitalisation peut aussi être lue, on le verra dans la suite, comme l’histoire de la constitution d’un réseau. Cette<br />
visibilisation du réseau est encore plus nette lors de la crise qu’a traversé <strong>Baraka</strong>.<br />
19 Fonds d’Investissement pour le Développement Economique et Social<br />
11
L’ASSOCIATION L’UNIVERS<br />
Au début des années 90, Vincent Boutry, alors permanent au comité de quartier de l’Epeule à<br />
Roubaix, lance l’idée d’un atelier cuisine en partenariat avec les restos du Cœur. L’objectif est de<br />
servir des repas chauds aux plus démunis. Ces repas sont cuisinés et préparés par du personnel en<br />
insertion. Face au succès de cette initiative, l’atelier investit la cellule commerciale du 93 rue de<br />
l’Epeule grâce à la mise à disposition du propriétaire en contrepartie de la remise en état des lieux.<br />
L’association « l’Univers » se crée et obtient l’agrément de chantier d’insertion 20 .<br />
Aujourd’hui, ce restaurant solidaire propose, tout au long de l’année, des repas complets dans un<br />
cadre convivial pour quelques euros (2,5€ maximum et gratuité pour les Roubaisiens touchant le<br />
RSA). En complément, l’Univers propose des activités culturelles dont l’objectif est de développer un<br />
projet d’éducation et de culture populaire accessibles au plus grand nombre, en démocratisant<br />
davantage les loisirs. Des actions favorisant l’insertion sociale sont régulièrement menées : aide aux<br />
SDF, service d’accueil de jour...<br />
La Cantine du cœur en quelques chiffres : 25 620 repas ont été servis en 2010, soit, en moyenne, 111<br />
par jour ouvré ainsi que 3 750 petits déjeuners 21 . Elle a offert une domiciliation postale à 214 sans<br />
domicile fixe. Au-delà du quantitatif, l’accueil sympathique de l’équipe permet de casser le mécanisme<br />
d'exclusion qui broie le plus souvent les personnes démunies, bénéficiaires des minima sociaux,<br />
chômeurs de longue durée, sans ressources, demandeurs d'asile, SDF...<br />
Début 2010, la Direction du Travail retirait l’agrément de chantier d’insertion à l’association du fait du<br />
trop faible nombre d’issues positives de ses salariés en parcours d’insertion 22 . Or, cet agrément lui<br />
octroyait des subventions représentant 30% de son budget annuel.<br />
Pour faire face à cette chute de ressources financières, l'association « L'Univers » travaille à l'obtention<br />
de la reconnaissance d'intérêt général. Cela lui permettrait de recevoir des dons des entreprises et<br />
particuliers déductibles fiscalement et de compenser la désaffection de l'État.<br />
Grâce à un financement de 24.000€ 23 du Fides fin 2008, Pierre Wolf devient chargé de mission<br />
du projet de construction de « <strong>Baraka</strong> ». Dès septembre 2008 il prend contact avec le groupe<br />
Chênelet - implanté près de Calais et spécialisé en construction bois -pour solliciter leur<br />
expertise sur la faisabilité du projet. François Marty, son président, missionne son fils, Matthieu<br />
Marty, architecte de formation et salarié du groupe. Il sera séduit par le projet au fur et à<br />
mesure de sa mise en œuvre et ce, d’autant plus que le socle de valeurs partagées est<br />
important : insertion, écologie, habitats sociaux … 24 Il<br />
20<br />
Les chantiers d’insertion ont été créés lors de la loi de 1998 de lutte contre l’exclusion. Ce sont des structures qui<br />
accompagnent et forment des personnes très éloignées de l’emploi. L’Etat les subventionne par le biais d’un conventionnement.<br />
21<br />
La Voix du Nord, Le projet « <strong>Baraka</strong> » portera-t-il chance à l'Univers pour récupérer le soutien de l'État ?, 29 mai 2010<br />
22<br />
L’association, du fait de sa taille, ne peut avoir plus de 2 à 3 sorties positives par an. Score trop faible pour l’administration.<br />
23<br />
soit 70% des frais d’étude de faisabilité du projet.<br />
24<br />
Le groupe Chênelet existe depuis 31 ans. Il regroupe une entreprise d’insertion SPL (fabrication de palettes, logistique,<br />
construction bois), un atelier chantier d’insertion et une foncière sociale (construction de logements et bâtiments sociaux). Le<br />
groupe emploie 290 personnes dont 190 en insertion.<br />
12
Le côté ambitieux du projet enthousiasme ce dernier et stimule son imagination dès sa 1 ère<br />
entrevue avec Pierre Wolf. Ayant vu la majorité de ce genre de projet échouer avant terme, il<br />
ne se met aucun frein : salles de réunion et de théâtre, restaurant, logement, jardins ouverts<br />
sur le toit… Ses esquisses sont la première étape de la réalisation de ce projet un peu fou.<br />
La régularité hebdomadaire des séances de travail de l’architecte et du porteur de projet donne<br />
au projet une consistance palpable. Les axes qui sont d’abord explorés et validés sont<br />
principalement la construction et le financement.<br />
Dès sa conception, les tensions fortes se font sentir entre projet politique et projet économique.<br />
Par sa complexité et son ambition, les initiateurs font le constat que le bâtiment ne pourra se<br />
construire sans la collaboration de Chênelet. Or ce prestataire souffre encore d’une légitimité<br />
fragile dans le secteur du bâtiment et les initiateurs du projet ne sont que des amateurs dans<br />
ce domaine. Les risques techniques et économiques sont importants : le projet nécessite<br />
l’utilisation de nouvelles techniques 25 et, difficulté supplémentaire, il se fait dans une dent<br />
creuse 26 . Malgré les risques et après des débats et négociations intenses entre François Marty<br />
et Pierre Gaudin 27 , SPL (Scierie et Palettes du Littoral, filiale de Chênelet) accepte de<br />
s’associer au projet. La force du projet politique prend le pas sur les risques économiques 28 .<br />
25<br />
dont l’étanchéité à l’air pour assurer la passivité énergétique du bâtiment<br />
26<br />
En urbanisme, une dent creuse est une parcelle non construite insérée dans un tissu construit. Cette configuration complique<br />
considérablement la construction d’un nouvel édifice.<br />
27<br />
Responsable construction de SPL à l’époque<br />
28<br />
Au final, SPL perdra de l’argent sur ce chantier mais y gagnera comme nous le verrons plus loin en compétences et en<br />
notoriété.<br />
Figure 2 – Un projet un peu fou (dessiné par Matthieu Marty)<br />
13
Sur la partie financements, les acteurs de l’économie sociale et solidaire (la NEF 29 , les<br />
Cigales 30 , l’URSCOP 31 ) après de longs échanges et avec la force de conviction de Pierre<br />
Wolf, accordent leurs soutiens financiers. Le premier partenaire public est la mairie de<br />
Roubaix par l’intermédiaire d’Assya Guettaf. A l’époque, adjointe au maire en charge des<br />
quartiers Ouest 32 , elle est séduite par l’originalité du projet, à la fois très complet alliant emploi,<br />
réappropriation de l’espace public en jachère et participation des habitants du quartier et très<br />
ouvert sur une multitude de possibilités. A contrario, l’équipe municipale aura dans un premier<br />
temps une certaine réticente de prime abord quant au profil des porteurs de projet. Les doutes<br />
portent sur leur manque d’expertise, «ce ne sont pas des promoteurs » et leur légitimité à<br />
porter un projet d’une telle dimension 33 . Il est légitime d’émettre l’hypothèse que la différence<br />
d’appartenance politique des porteurs de projet et de l’équipe municipale a pu être un frein à la<br />
collaboration (Verts versus Parti Socialiste). C’est la personnalité des initiateurs et le soutien<br />
engagé de structures connues de l’ESS qui permettront in fine de convaincre la municipalité et<br />
de lever les derniers doutes.<br />
Le Conseil Régional et Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) et de nombreux<br />
particuliers soutiennent financièrement et activement le projet.<br />
Les couleurs politiques des fondateurs ont été à la fois un frein et une opportunité pour le<br />
projet. Un frein dans le sens où porté par des militants Verts, il y aurait pu avoir conflit de<br />
tendance politique 34 . Opportunité car cela leur a permis de solliciter leur réseau au sein des<br />
différentes collectivités territoriales 35 et a apporté une caution symbolique à la crédibilité du<br />
projet. Les soutiens institutionnels ne peuvent être découplés de cette inscription réticulaire<br />
des premiers promoteurs du projet et l’histoire ainsi relue montre l’importance du réseau<br />
d‘acteurs, y compris dans les institutions publiques.<br />
Impulsée par les initiateurs du projet, une dynamique se construit et s’enrichit de la<br />
mobilisation d’acteurs aux profils très divers, de l’usager de l’Univers à l’avocat en passant par<br />
le financier ou l’intermittent du spectacle, le pharmacien ou la femme au foyer, le salarié de la<br />
fonction publique, de l’entreprise privée ou d’une structure associative, le retraité ou le jeune,<br />
le politique ou l’acteur du comité de quartier, l’écologiste militant ou la mère d’un enfant<br />
handicapé mental, l’architecte ou le fournisseur 36 ...<br />
Un réseau de soutien se crée dès les premiers mois de 2009, les promesses de fonds affluent.<br />
Le choix du statut juridique du projet se porte sur la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt<br />
Collectif) et non sur le modèle associatif. Ils veulent assumer que c’est une entreprise, que le<br />
29<br />
Coopérative de finances solidaires qui collecte l’épargne et accorde des crédits pour tout projet à fins d’utilité sociale ou<br />
environnementale<br />
30<br />
Structure de capital risque solidaire<br />
31<br />
Union Régionale des Sociétés Coopératives<br />
32<br />
Assya Guettaf est actuellement élue au Conseil Régional du Nord-Pas de Calais<br />
33<br />
Entretien semi directif parties prenantes, 2012<br />
34<br />
Les rapports entre les Verts et le Parti Socialiste n’ont pas toujours été coopératifs. C’est l’alliance des élections de 2008 qui a<br />
permis d’apaiser les relations.<br />
35<br />
Les Verts ont 4 élus au sein de la municipalité de Roubaix et 7 au Conseil Régional<br />
36<br />
22 sociétaires créent de la SCIC en septembre 2009, 17 d’entre eux sont domiciliés à Roubaix. 20 nouveaux associés les<br />
rejoignent entre novembre 2009 et avril 2010. Les effectifs doublent entre septembre 2010 et janvier 2011 (phase finale de<br />
récolte de fonds avant la construction) avec l’accueil de 40 nouveaux sociétaires. A ce jour, la coopérative compte 97<br />
sociétaires.<br />
14
marchand est au service du non marchand. Et par rapport à une société coopérative, la SCIC<br />
garantit dans son objet la défense d’un intérêt collectif et la mixité des associés 37 .<br />
Dans cette phase de lancement, les plus grands atouts de Pierre Wolf auront été la<br />
construction d’un halo de confiance, et la capacité de fédération et de construction d’un<br />
collectif autour d’un projet commun. Il a su agréger de multiples compétences pour le mener à<br />
bien (architectes, financiers, experts de la construction bois, spécialistes de la coopérative …).<br />
Le nombre de sociétaires, la mobilisation de la moitié des fonds nécessaires soit 400.000€ 38 à<br />
la construction du bâtiment et le soutien des collectivités locales seront les arguments clés<br />
pour convaincre les banques de financer le projet.<br />
Le 25 septembre 2009, les statuts de la SCIC sont déposés avec la participation de 22<br />
sociétaires. 18 mois plus tard, ils seront 86.<br />
Début 2010, la mairie de Roubaix octroie le terrain situé rue Sébastopol pour la modique<br />
somme de 10.300€. Cette surface de 129m2 est considérée comme un délaissé urbain sans<br />
vocation et sans preneur du fait de sa configuration (étroite et irrégulière).<br />
Fin 2010, après plusieurs essais, le permis de construire est enfin accordé, les entreprises<br />
sont sélectionnées et le 7 mai 2011, la première planche est posée. Il faudra huit mois de<br />
travaux pour faire sortir de terre ce bâtiment composé de trois niveaux : cuisine et salle de<br />
restaurant au rez-de-chaussée, salles de réunion aux deux niveaux supérieurs, terrasse pour<br />
accueillir des jardinières au carré au dernier étage. L’inauguration a lieu le 4 février 2012 et le<br />
restaurant ouvre ses portes au public le 20 février.<br />
Figure 3 - Esquisse de la façade définitive - Matthieu Marty<br />
37 Une coopérative réunit des associés qui portent un même intérêt : soit consommateurs, soit producteurs, soit salariés.<br />
38 Les 400.000€ se répartissent pour moitié en parts sociales et pour moitié en subvention.<br />
15
2.1.4. Mettre l’économique au service d’un intérêt collectif<br />
Revenons sur la finalité du projet. D’un rêve de local pour un parti politique émerge le projet de<br />
construire un bâtiment qui puisse être un lieu de foisonnement, un lieu de rencontres dans<br />
l’objectif de créer du lien social, de la convivialité, du vivre-ensemble, du travail 39 . Il s’agit de<br />
réinventer la façon d’habiter et de vivre la planète respectueuse des êtres humaines, présents<br />
ou à venir, et des autres espèces 40 . Le projet s’adresse non seulement aux usagers et<br />
bénéficiaires en lien direct avec la SCIC mais aussi, dans un champ beaucoup plus large tant<br />
temporel que spatial, aux générations actuelles et à venir.<br />
La volonté d’indépendance vis à vis des pouvoirs publics, tant pour cause de financements<br />
publics en berne que pour avoir la liberté d’accueillir toute association ou parti sans emprise<br />
externe, influence les choix et options qui sont pris dans le montage du projet. Ainsi celui-ci<br />
n’est pas seulement social mais économique : trouver la ou les activités marchandes qui<br />
offriront de l’espace et du temps pour produire du non marchand, qui achèteront la liberté<br />
d’actions. L’économique sera cantonné à un rôle de moyens afin de permettre la finalité du<br />
projet, il sera au service d’une production de biens non marchands, non monétaires.<br />
Cette combinaison finalité-moyen place l’activité économique non dans un objectif<br />
d’enrichissement individuel mais dans un objectif de production de biens au service d’un<br />
intérêt collectif. Cette production sera appelée « fabrique de biens communs ».<br />
Cette démarche rejoint l’analyse que fait Jean-Louis Laville de l’économie associative : une<br />
économie qui prend en compte l’intérêt général où il s’agit de sortir d’un schéma dual avec<br />
d’un côté, l’économie de marché et de l’autre l’Etat. La première, l’économie de marché,<br />
regroupe entreprises et citoyens mis à distance de l’intérêt général. Cette mise à distance est<br />
permise par le versement d’un impôt qui compense leur non-implication (hormis<br />
philanthropique) dans la défense de l’intérêt général. La deuxième, l’Etat est le garant de cet<br />
intérêt général et prend en charge la solidarité. Dans l’économie associative, l’économique<br />
n’est pas dissocié de l’intérêt général mais est à son service, sa défense n’est pas réservée à<br />
la fonction de l’Etat mais est prise en charge par les citoyens.<br />
Dans sa réalisation concrète, il s’agit de construire une structure où l’activité économique et la<br />
production de biens non marchands se partageront espace et temps. La première intègrera<br />
les valeurs de l’ESS tout en faisant preuve de professionnalisme pour assurer sa rentabilité en<br />
limitant sa profitabilité. L’activité économique est choisie dans la restauration et la location de<br />
salles. Ces activités doivent financer les emplois créés et le bâtiment. Les temps où le<br />
bâtiment ne sera pas utilisé pour cette activité marchande seront dédiés au non marchand :<br />
ateliers, échanges, débats, accueil d’associations, temps de vivre-ensemble sur un bout de<br />
territoire.<br />
39 Statuts juridiques de la SCIC <strong>Baraka</strong><br />
40 Ibid<br />
16
En résumé, <strong>Baraka</strong> comprend :<br />
- Une réalisation écologique : la construction d’un bâtiment à la plus faible empreinte<br />
environnementale possible tant dans la conception que l’utilisation ;<br />
- Des activités marchandes : l’exploitation d’un restaurant et la location de salles de réunion<br />
qui permettent la création d’emplois pour des personnes issues du parcours d’insertion au<br />
sein de l’Univers ;<br />
- Des activités non marchandes : la « fabrique de biens communs »<br />
Mais ce n’est pas une simple juxtaposition de moyens économiques, de finalités sociales et de<br />
valeurs idéologiques 41 , ces trois variables interfèrent, s’imbriquent. La promotion de l’intérêt<br />
collectif s’exprime aussi dans les processus économiques. Par exemple, au lieu de construire<br />
le bâtiment de la manière la plus rapide et la plus économique, il a été décidé d’instaurer des<br />
chantiers participatifs. Le principe de ces chantiers étaient d’instaurer des stages qui, en<br />
échange d’une production, offraient une formation qualifiante à l’auto-construction et aux<br />
techniques de construction écologiques. La population-cible de ces stages était la population<br />
roubaisienne. Ce fut une opportunité pour développer du lien social, pour partager des savoirs<br />
comme nous le verrons en partie 3.<br />
Afin de garantir une activité économique au service de la « fabrique de biens communs », le<br />
choix du statut juridique de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) a été considéré<br />
comme le plus pertinent. Ce statut permet de prévaloir l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel.<br />
« Hybride » entre les associations et les coopératives 42 , une SCIC est à la fois :<br />
- une société commerciale inscrite au registre du commerce (qui peut prendre la forme<br />
d’une SA ou SARL). Ce qui la différencie des associations ;<br />
- une structure dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services<br />
d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale » (Article 19 quinquies),<br />
ce qui la distingue des coopératives.<br />
L’intérêt collectif est garanti non seulement par la finalité d’utilité sociale de la SCIC inscrite<br />
dans ses statuts mais aussi par la constitution originale de la gouvernance : le multi-sociétariat.<br />
La loi exige l’association d’au moins trois catégories de sociétaires dont obligatoirement les<br />
salariés et les bénéficiaires de la SCIC. Les autres parties peuvent être des bénévoles, des<br />
prestataires ou même une collectivité territoriale.<br />
Dans le cas de <strong>Baraka</strong>, cinq catégories de sociétaires sont associées :<br />
- Catégorie « fondateur personne morale » composée exclusivement de l’Association<br />
l’Univers ;<br />
- Catégorie « fondateurs personnes physiques » composée et limitée aux 16 membres<br />
fondateurs ;<br />
- Catégorie « salariés et bénévoles titulaires » composée à ce jour de 2 salariés ;<br />
41 BOUCHARD Marie J., « Vers une évaluation multidimensionnelle et négociée de l’économie sociale », Recma, n°292, 2004<br />
42 SIBILLE Hugues, « Les SCIC : 10 ans déjà », Recma, mai 2012<br />
17
- Catégorie « bénéficiaires et usagers » composée à ce jour de 2 personnes physiques<br />
et de l’UPC ;<br />
- Catégorie « fournisseurs et financeurs solidaires, collectivités publiques titulaires » : à<br />
ce jour, il est composé de 5 personnes morales (Cigales, extramuros, URSCOP,<br />
Chtigaline et Vitamine), et de 70 personnes physiques. Aucune collectivité territoriale<br />
ne s’est associée.<br />
Enfin, la primauté de l’intérêt collectif sur l’activité économique est garantie, en cas de<br />
bénéfices, par l’affectation de 60% des excédents aux réserves impartageables (la loi n’en<br />
exige qu’un minimum de 57,5%). Pour la renforcer, les statuts de la coopérative limitent la<br />
valorisation des parts sociales au taux de rendement des obligations (environ 4%).<br />
LES SCIC en détail<br />
Le statut de société coopérative d’intérêt collectif a été créé par la loi du 17 juillet 2001, intégrée à celle<br />
de 1947 sur les coopératives.<br />
Elle reprend les caractéristiques des coopératives :<br />
- tous les associés sont égaux selon le principe 1 Homme = 1 voix<br />
- l’implication de tous les associés à la vie de l’entreprise et aux décisions<br />
de gestion ;<br />
- le dirigeant peut garder le statut de salarié ;<br />
- la lucrativité est limitée : les résultats sont maintenus dans l’entreprise sous la forme de réserves<br />
impartageables pour en assurer l’autonomie et la pérennité.<br />
Elle a pour spécificités supplémentaires :<br />
- sa finalité qui doit être au service d’un intérêt collectif et présenter un caractère d’utilité sociale ;<br />
- sa gouvernance est composée de différentes catégories d’associés aux intérêts divergents.<br />
Par ce nouveau statut, l’Etat permet non seulement une alliance entre l’économique et l’utilité sociale<br />
mais offre aussi un outil de « partenariat public-privé » plus entrepreneuriale que les sociétés<br />
d’économie mixte 43 .<br />
Après 11 ans d’existence, cette démarche innovante a donné le jour à 190 SCIC en France 44 . Ce<br />
manque de succès est peut-être dû en partie à l’obligation d’obtenir un agrément de la Préfecture.<br />
L’avenir nous le dira, cette obligation ayant été supprimée en mars 2012.<br />
Une incohérence apparaît tout de même dans ce statut. La volonté originale était de faciliter<br />
l’économie à vocation sociale et solidaire. Or, les SCIC ne bénéficient que d’un avantage fiscal : la non<br />
imposition des bénéfices versés aux réserves impartageables. Aucun avantage n’a été accordé en<br />
contrepartie de la mission d’utilité sociale. Elles ne bénéficient même pas de l’exonération de la<br />
contribution économique au territoire (ancienne taxe professionnelle) accordée a contrario aux SCOP.<br />
43 Ibid<br />
44 chiffres de février 2012. http://www.autogestion.asso.fr/?p=1043<br />
18
2.2. Le pluralisme des valeurs<br />
Le profil des initiateurs du projet influence fortement les orientations prises. Officiellement, c’est à<br />
dire, dans les documents de présentation, <strong>Baraka</strong> agrège trois dimensions : humaine,<br />
environnementale et économique. L’ambition est de trouver le bon équilibre économique qui<br />
puisse respecter et promouvoir les valeurs humaines et environnementales.<br />
Dans une démarche comme celle-ci, aux valeurs fortes, les moyens pour y parvenir prennent<br />
autant d’importance si ce n’est plus que les enjeux. Pour le dire autrement, le processus importe<br />
autant que le résultat. Les valeurs s’expriment dès la mise en œuvre du projet, dans les moyens<br />
mis en place pour atteindre les objectifs. Quelle performance environnementale pour un bâtiment<br />
passif dont les matériaux auraient parcouru des milliers de kilomètres ? Quelle valeur accorder à<br />
la biodiversité recréée à Roubaix si, pour le faire, cela a détruit celle d’une autre région ? Quel<br />
sens y a-t-il à créer des emplois s’ils ne sont pas qualifiés et ne permettent pas l’insertion sociale<br />
recherchée ? Autant de questions que se posent les initiateurs du projet.<br />
Au-delà des dimensions humaine, environnementale et économique affichées, apparaissent, de<br />
manière informelle, les dimensions d’ancrage territorial et de gouvernance démocratique. Ces<br />
dimensions, voire ces « valeurs » ne font pas partie intégrante de la finalité de la structure mais<br />
leurs promoteurs les disent indissociables de la mise en œuvre du projet.<br />
Se conjuguent alors plusieurs ambitions prenant leur source dans l’idéologie et les convictions<br />
portées par les sociétaires : créer du lien social et du vivre-ensemble, faire de l’écologie concrète,<br />
réinventer une économie plus respectueuse de l’Homme et de son environnement, développer la<br />
citoyenneté par une gouvernance démocratique et une recherche de participation active des<br />
différentes parties prenantes (usagers, fournisseurs, salariés...) et s’inscrire sur un territoire pour<br />
développer les valeurs de proximité. Ces différentes valeurs sont interconnectées entre elles et<br />
interdépendantes, l’une ne pouvant réellement se réaliser sans l’autre : le respect de<br />
l’environnement engendre de fait une démarche de relocalisation pour éviter entre autres les effets<br />
néfastes des transports sur l’équilibre écologique, le vivre-ensemble ne peut se construire que sur<br />
une participation active des parties prenantes et une forte proximité aux usagers et habitants ...<br />
Pour chacune des dimensions constituantes du projet, nous verrons comment elles sont à la fois<br />
une finalité et un processus de mise en œuvre de moyens pour la réaliser.<br />
2.2.1. La dimension environnementale<br />
Issu d’un rêve de militants écologistes, l’approche environnementale est un pilier fondamental<br />
du projet. Même si elle s’est élargie à d’autres valeurs, la dynamique s’appuie d’abord sur<br />
l’écologie et le projet s’assoit sur la construction d’un bâtiment exemplaire en termes de<br />
respect de l’environnement.<br />
19
Les objectifs de performance environnementale sont élevés. Tout est pensé, imaginé pour<br />
envisager un idéal de consommation énergétique de 15 à 30kwh/m 2 /an 45 : ventilation double<br />
flux, techniques d’isolation naturelle, panneaux photovoltaïques … Mais la performance passe<br />
aussi par le choix des matériaux d’origine régionale et permettant un stockage carbone grâce<br />
à la structure bois et la paille utilisée pour l’isolation. L’optimisation de la consommation d’eau<br />
(récupération des eaux pluviales et des eaux usées) n’a pu être prise en compte dans la<br />
conception du bâtiment pour des raisons de coûts.<br />
Au-delà de la performance énergétique, l’enjeu est de réintégrer la Nature en ville et de<br />
favoriser la biodiversité : toit végétalisé, jardinières au carré sur la terrasse, potentiel<br />
d’installation de ruches sur le toit, hôtel et ascenseur à insectes ... La place faite aux végétaux<br />
permet aussi de fixer les poussières urbaines et d’améliorer la qualité de l’air du quartier.<br />
L’activité de restauration est dans la continuité avec un choix de cuisine réalisée à partir de<br />
produits frais et essentiellement issus de l’agriculture biologique. Un nécessaire arbitrage entre<br />
ingrédients biologiques et non biologiques est tout de même réalisé pour tenir compte de<br />
l’accessibilité de la carte.<br />
La « fabrique de biens communs » a aussi pour objectif de promouvoir cette dimension<br />
environnementale par le biais d’ateliers d’initiation au jardinage urbain.<br />
2.2.2. La dimension sociale<br />
La deuxième préoccupation principale du projet est de créer de l’emploi qualifié dans la<br />
continuité de l’action de l’association l’Univers. Cinq emplois sont créés dans un premier temps<br />
dont deux offrant des contrats de droit commun à des personnes issues d’un parcours<br />
d’insertion au sein du restaurant solidaire.<br />
Ce choix vient du constat des limites des structures d’insertion par l’activité économique.<br />
Malgré les formations fournies, elles ne voient que peu de leurs salariés accompagnés<br />
accéder à un emploi hors parcours d’insertion.<br />
La notion d’emplois de qualité s’illustre par une volonté d’éviter au maximum le morcellement<br />
des horaires, le travail le week-end et jours fériés. L’enjeu va se jouer sur le difficile équilibre<br />
entre le social et l’économique : intégrer les rythmes de travail de la restauration selon les<br />
exigences que se donne la SCIC tout en assurant la rentabilité économique du projet.<br />
La responsabilité que s’est donnée <strong>Baraka</strong> dans la création d’emploi et l’insertion par l’activité<br />
économique a rayonné sur les prestataires. Cette dimension a influencé le choix des sociétés<br />
participant à la construction : deux d’entre elles étaient des structures d’insertion (Aprobat,<br />
SPL).<br />
45 Par comparaison, un bâtiment neuf selon les normes BBC consomme 80kwh/m 2 /an<br />
20
De manière plus vaste que la création d’emploi, la dimension sociale est une valeur clé de la<br />
coopérative définie dans son objet juridique : « créer du lien social, de la convivialité, du vivre-<br />
ensemble ». Elle a déjà pu être exprimée au travers des chantiers participatifs (cf partie 3),<br />
des échanges entre les 97 sociétaires au profil si complémentaires, des activités proposées<br />
par la fabrique de biens communs comme les soirées lecture « A voix haute à la maison »…<br />
2.2.3. La dimension économique<br />
Comme vu précédemment, l’économique est abordé au sein de <strong>Baraka</strong> non pas comme l’objet<br />
de la structure, comme sa finalité mais comme un moyen pour atteindre et promouvoir les<br />
autres dimensions.<br />
Afin de trouver le bon équilibre entre temps marchand et non marchand, l’activité économique<br />
doit être rentable et profitable pour l’organisation tout en ne prenant pas le pas en termes de<br />
temporalité, d’espace et de préoccupations sur l’objet premier qui est le vivre-ensemble et la<br />
création de lien social respectueux de la planète.<br />
Il s’agit donc pour les sociétaires de positionner l’économique comme un outil pour offrir des<br />
temps et des espaces non marchands afin que la fabrique de biens communs puisse produire.<br />
Mais c’est aussi une source d’opportunités pour exprimer, dans son exercice, les autres<br />
valeurs.<br />
Dans les pratiques dominantes de l’économie capitaliste, le profit est la finalité de l’activité<br />
économique, profit au bénéfice d’un ou plusieurs individus. Le choix de <strong>Baraka</strong> rompt avec ces<br />
pratiques dominantes et vise à produire des biens communs au profit de tous, usagers,<br />
bénéficiaires, sociétaires, voisins et même générations futures. Afin d’éviter toute emprise de<br />
l’intérêt individuel sur l’intérêt collectif, il était déterminant de limiter très fortement toute<br />
possibilité d’enrichissement financier personnel pour les sociétaires et tout potentiel de<br />
spéculation des parts sociales. Le statut juridique de SCIC offre l’avantage de rendre<br />
impartageables les bénéfices et encadre la valorisation des parts sociales (limitées un<br />
maximum de 4% de plus-value annuelle) et leur cession. De fait, les sociétaires investiront de<br />
l’argent, seront préoccupés par la pérennité de l’entreprise pour protéger (entre autres) leurs<br />
fonds mais non pas par une hyper profitabilité dont ils ne tireraient aucun profit. La motivation<br />
d’un sociétaire à investir dans un tel projet n’est donc pas une recherche de profit mais se<br />
situe bien dans la finalité même de celui-ci.<br />
21
2.2.4. L’ancrage territorial et proximité<br />
L’ancrage territorial de <strong>Baraka</strong> s’illustre essentiellement par le choix de l’emplacement du<br />
bâtiment au cœur de la ville de Roubaix, dans les quartiers de l’Epeule et du Crouy, classés<br />
zones urbaines sensibles (ZUS 46 ). L’enjeu, pour les sociétaires de la coopérative, est double.<br />
D’une part, il s’agit de faire de l’écologie concrète au sein des quartiers défavorisés afin de la<br />
rendre accessible aux plus démunis. D’autre part, le but est de créer de l’emploi dans la<br />
continuité du travail de l’association d’insertion l’Univers, elle-même ancrée dans le quartier de<br />
l’Epeule depuis plus de 20 ans..<br />
Ce choix va enclencher une collaboration avec les collectivités territoriales et plus<br />
spécialement la municipalité de Roubaix. Celle-ci, séduite par la rénovation d’un délaissé<br />
urbain, peu valorisant pour le quartier, devient un soutien pour la coopérative (subventions<br />
d’investissement, octroi du terrain au prix du domaine : 10.000€ ...).<br />
Afin de garantir cette valeur d’ancrage territorial, la notion de proximité est inscrite dans les<br />
statuts comme constitutive de l’intérêt collectif de la coopérative avec la « nécessaire large<br />
mobilisation des acteurs du territoire d’implantation … au service des objectifs poursuivis » 47 .<br />
Fortement intégrée par les sociétaires, cette dimension d‘ancrage territorial va au-delà de<br />
l’emplacement choisi et influence la sélection des fournisseurs et des matériaux<br />
(majoritairement régionaux) ainsi que le recrutement des salariés (4 des 5 salariés habitent à<br />
moins de 10 minutes à pied de <strong>Baraka</strong>) 48 . C’est dans cette dynamique que l’idée des chantiers<br />
participatifs a émergé. Souhaitant promouvoir l’auto-construction, l’aspect collectif du projet et<br />
développer le lien avec les habitants du quartier, il a été proposé aux roubaisiens de participer<br />
au chantier en échange d’une formation sur des techniques de construction écologique.<br />
Mais c’est aussi la volonté de faire de <strong>Baraka</strong> un terreau d’initiatives 49 qui nécessite à la<br />
fabrique de biens communs de créer des opportunités pour tisser des liens avec les habitants<br />
et les acteurs associatifs du quartier. L’incendie qui a sinistré le bâtiment quelques jours après<br />
l’ouverture (voir infra) n’a fait qu’amplifier cette nécessité de ne pas faire de <strong>Baraka</strong> « le<br />
rendez-vous des écolos ou des bobos » de la métropole mais un vrai lieu de brassage et de<br />
mixité, un lieu de vie, terreau d’initiatives pour ces quartiers défavorisés. L’appropriation du<br />
bâtiment par les habitants devient déterminante.<br />
46 Zones géographiques définies par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 sur des critères qualitatifs dont notamment le<br />
déséquilibre emploi/habitat.<br />
47 Statuts de la coopérative <strong>Baraka</strong><br />
48 Sans que cela en devienne un critère de sélection, l’objectif étant d’offrir aux salariés une qualité d’emploi et de vie maximale.<br />
En revanche, un tiers de l’effectif doit habiter la zone franche urbaine pour permettre à la coopérative de bénéficier des<br />
exonérations de charges.<br />
49 Dossier de présentation de <strong>Baraka</strong><br />
22
2.2.5. La gouvernance démocratique<br />
Effectuons un petit retour dans le passé pour mieux comprendre la place de la démocratie<br />
dans le mode de gestion de <strong>Baraka</strong>. Les initiateurs du projet, Pierre Wolf et Vincent Boutry,<br />
dans la lancée de leur collaboration au sein de l’Univers, ont créé, en 2004, l’Université<br />
Populaire et Citoyenne (UPC). Cette structure associative a pour objectif de favoriser<br />
l’émancipation des individus et de développer une participation active des citoyens à la<br />
démocratie. Elle s’appuie sur le partage de savoirs tant d’experts, d’universitaires que de<br />
citoyens lambda. L’UPC se veut être un lieu de débats, de mixité des populations et de<br />
production d’une intelligence collective.<br />
Imprégnés de cette dynamique, il leur semblait cohérent de choisir un mode de gouvernance<br />
démocratique pour <strong>Baraka</strong> avec le double avantage du principe de vote « 1 homme = 1 voix »<br />
et du multisociétariat.<br />
Le multisociétariat est la spécificité des SCIC. Il permet d’associer les parties prenantes dans<br />
une coopération et de faire le pont entre des particuliers, des associations, des collectivités<br />
locales et des entreprises. La divergence de leurs intérêts propres permet de créer le débat,<br />
de produire la controverse, de monter en intelligence collective. L’objectif est, non seulement le<br />
compromis obtenu, mais aussi toute l’éducation à la citoyenneté que cela apporte : admettre<br />
que l’on a des intérêts différents, mettre en valeur les failles et les contradictions, décider<br />
ensemble, construire un projet collectif dépassant ses intérêts individuels. Ces débats<br />
permettent de définir et garantir l’intérêt collectif de la SCIC.<br />
Le nombre d’associés et leur inégale répartition selon leurs intérêts peut provoquer des<br />
déséquilibres, quand, par exemple, le nombre de bénévoles ou de bénéficiaires devient<br />
beaucoup plus important que le nombre de salariés. Afin de conserver « l’esprit » SCOP 50 , les<br />
sociétaires peuvent procéder au vote par collège. Dans le cas de <strong>Baraka</strong>, sont prévus cinq<br />
collèges qui correspondent aux cinq catégories de sociétaires. Ils se répartissent les votes<br />
selon les prorata suivant :<br />
- Collège fondateur personne morale (l’Univers) : 25% des droits de vote.<br />
- Collège fondateurs personnes physiques (16 personnes) : 20% des droits de vote.<br />
- Collège salariés et bénévoles (à ce jour, 2 personnes) : 30% des droits de vote<br />
- Collège bénéficiaires et usagers (à ce jour, 2 personnes physiques et UPC) : 10% des<br />
droits de vote.<br />
- Collège fournisseurs et financeurs solidaires, collectivités publiques : 15% des droits<br />
de vote. A ce jour, il est composé de 5 personnes morales et de 70 personnes<br />
physiques.<br />
Les initiateurs envisagent la possibilité que la ville de Roubaix s’associe au projet. Mais les<br />
fondateurs, comme c’est le cas dans beaucoup de SCIC 51 , appréhendaient le rapport de forces<br />
50 PECOUP Françoise, Le multisociétariat dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif : une nouvelle forme de<br />
« gouvernance » ?, Communication lors des XXIIIèmes Journées de l'Association d'Economie sociale des 11-12 septembre<br />
2003, Paris<br />
51 Ibid<br />
23
ainsi que les risques de perte de leur indépendance et de récupération politique de la part des<br />
élus 52 .<br />
Au-delà des garanties offertes par le statut juridique, l’approche constatée lors des entretiens<br />
semi-directifs montre que la confiance des sociétaires dans le gérant est forte ce dernier<br />
faisant montre d’une certaine lucidité sur la complexité d’allier démocratie et business : « la<br />
démocratie sur un business c’est chiant » (Vincent Boutry) 53 . Il est décidé que la gérance<br />
prend en charge toutes les décisions relatives à l’activité économique et que les sociétaires<br />
prennent en charge la liberté acquise, la production non marchande. Ils conservent bien<br />
entendu leur rôle de régulateur en cas de déviance du gérant.<br />
La coopérative est à ce jour trop jeune pour avoir un réel recul sur la pratique de la démocratie.<br />
On peut noter deux éléments à ce stade :<br />
- D’abord, le point de vigilance dans la pratique de la démocratie dans une entreprise est<br />
la qualité des débats. Des débats sans fin entraîneraient des non décisions. Cela<br />
engendrerait un « délitement et un détachement des sociétaires » (Michel Fargeon –<br />
sociétaire).<br />
- Ensuite, quelques débats ont eu lieu et ont porté sur des sujets qui, tout en étant<br />
concrets, étaient déterminants pour l’identité du projet : ils ont porté sur la mise en place<br />
de la télésurveillance suite au sinistre et sur l’acceptation ou non des donations de<br />
fondations loin des valeurs de la coopérative (par exemple, la fondation Eiffage qui a<br />
versé 10.000€ alors qu’Eiffage n’est pas un modèle d’écologie). Il sera intéressant de<br />
suivre l’évolution de la dimension « démocratique » au fil du temps et surtout à la reprise<br />
de l’activité.<br />
2.3. Les moyens du projet<br />
Le multi sociétariat du statut de SCIC a présenté un avantage considérable dans la réussite du<br />
projet. Il a permis l’apport de compétences très diversifiées. Le gérant a pu enrichir le projet par<br />
des expertises juridiques, financières, comptables, en communication, construction, biodiversité …<br />
Cette mixité de sociétaires a eu un effet très bénéfique sur l’étendue du réseau de <strong>Baraka</strong> en lui<br />
donnant accès aux réseaux des médias, des politiques ou de l’ESS.<br />
En complément, le caractère innovant du projet a permis de fédérer des partenaires très investis<br />
dans les constructions environnementales et d’obtenir des conditions particulièrement bénéfiques<br />
pour la coopérative. Ce fut le cas de la société SPL qui a non seulement été très proactive dans la<br />
mise en place des chantiers participatifs et qui aurait, au final, perdu de l’argent sur ce chantier 54 .<br />
Les dirigeants de SPL poursuivaient des intérêts autres qu’économiques : mise en œuvre de<br />
52<br />
Dans le Nord-Pas de Calais, seule la SCIC Lilas auto-partage faire apparaître une collectivité territoriale au sein de ses<br />
sociétaires<br />
53<br />
Entretien semi-directif, mars 2012<br />
54<br />
selon ses responsables, mais nous n’avons ni montant ni confirmation de cette affirmation.<br />
24
nouvelles techniques de construction bois, participation à un projet social et retombées espérées<br />
pour leur notoriété.<br />
En quelques chiffres, <strong>Baraka</strong>, c’est :<br />
- 97 sociétaires 55<br />
- 5 salariés dont 2 issus d’un parcours d’insertion et 4 qui habitent à proximité<br />
- 69 stagiaires ayant apporté leur contribution lors des chantiers participatifs<br />
- des centaines de personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite du projet :<br />
usagers, bénéficiaires, prestataires, médias, élus, voisins, associations et acteurs de la<br />
vie locale ….<br />
- un bâtiment passif de 290m 2 sur une surface au sol de 129m 2<br />
- 3 ans de montage de projet, 8 mois de travaux, 10 jours d’ouverture, 2 nuits d’incendie,<br />
3 mois de convalescence et 5 mois de reconstruction<br />
- 800.000€ de budget dont 680.00€ pour la construction<br />
- 300.000€ de reconstruction (pris en charge par l’assureur)<br />
2.4. Le projet suite au sinistre<br />
Dans la nuit du 28 au 29 février 2012, une semaine à peine<br />
après le début de l’activité économique, un incendie,<br />
déclenché par un feu de poubelles, ravage deux des quatre<br />
façades du bâtiment, le toit et une importante partie de la<br />
ventilation. L’activité de la coopérative n’ayant que dix jours<br />
d’ouverture au public, ce sinistre devient constitutif de la<br />
réalisation du projet. Il est nécessaire de s’arrêter sur cet<br />
événement et d’analyser dans quelle mesure cette crise a<br />
modifié les fondamentaux du projet.<br />
55 à fin août 2012<br />
2.4.1. Les causes du sinistre<br />
Un mauvais concours de circonstances a rendu cet acte de vandalisme destructeur pour le<br />
bâtiment : un local poubelles qui n’est pas fini d’être construit ; le non respect des consignes<br />
du gérant d’évacuer les cagettes et poubelles ; l’emplacement des poubelles contre le<br />
compteur de gaz, celui-ci a fondu et émis une torche en direction du bâtiment ; l’espace de 10<br />
cm entre <strong>Baraka</strong> et la maison mitoyenne qui a fait effet cheminée et a porté le feu jusqu’au toit.<br />
Le manque d’expérience des pompiers sur ce type de bâtiment accentue leurs difficultés pour<br />
éteindre l’incendie. Ils ne sauront éviter la reprise de feu la nuit suivante qui a très fortement<br />
aggravé la situation… Après seulement 8 jours d’ouverture, le projet est stoppé net dans son<br />
25
élan. Concrètement, cela se traduit par la fermeture du bâtiment et l’arrêt immédiat de<br />
l’activité. Au-delà de ces dégâts matériels, quels en seront les effets sur l’équipe et sur le<br />
projet ?<br />
2.4.2. Les conséquences de l’incendie<br />
Ce sinistre a non seulement eu des conséquences importantes sur le bâtiment au point de<br />
devoir le fermer pour huit mois de travaux, a minima, mais a aussi fortement fragilisé l’équipe.<br />
Au sein de celle-ci, Pierre Wolf, gérant et meneur du projet a été largement bousculé. La<br />
viabilité économique de l’organisation a également été interrogée.<br />
2.4.2.1. Les investissements matériels<br />
L’incendie a abîmé superficiellement une partie de la façade rue du Nord où seul le<br />
bardage a été brûlé et détruit par les pompiers. C’est essentiellement le mur mitoyen et le<br />
toit qui ont été fortement détériorés.<br />
Le phénomène de cheminée entre <strong>Baraka</strong> et la mitoyenneté a projeté le feu dans le toit, l’a<br />
ravagé et s’est engouffré dans la ventilation. Toute la partie technique du bâtiment a fondu<br />
sous l’effet de la chaleur.<br />
Les spécificités de la construction bois et de l’isolation paille et ouate de cellulose<br />
présentent différents avantages et inconvénients dans ce genre de circonstances :<br />
- certes, le bois prend feu mais conduit extrêmement mal la chaleur et sur une<br />
ossature aussi massive, le feu se propage très lentement contrairement aux<br />
structures métalliques.<br />
- de même, l’isolation extrêmement compacte est très peu conductrice de flammes<br />
mais est a contrario source de foyers qui se consument très lentement et sont<br />
difficiles à détecter (d’où la reprise de feu la nuit suivante)<br />
De ce fait, les pompiers ont dû casser une grande partie du mur mitoyen et du plancher<br />
du 2ème étage pour retirer les foyers d’incendie qui continuaient à se consumer.<br />
Il y a donc un important chantier de reconstruction à envisager qui représente, selon les<br />
premières évaluations, la moitié de la valeur totale du bâtiment. Plusieurs éléments<br />
compliquent la mise en œuvre des travaux et retardent le démarrage du chantier :<br />
- la particularité du bâtiment (passif, en bois, isolation paille) qui est méconnue par<br />
les experts de l’assurance et engendre d’intenses négociations : l’objectif de<br />
performance énergétique exige une intransigeance dans la qualité de la<br />
reconstruction avec une étanchéité totale à l’air et à l’eau ;<br />
26
- la difficulté d’accès à la partie incendiée (la mitoyenneté) et la nécessité de<br />
reconstruire sur-mesure ;<br />
- la procédure de la Macif qui envisage d’attaquer les pompiers pour négligence de<br />
surveillance du bâtiment afin de les porter responsables de la reprise de feu de la<br />
nuit du 1er mars.<br />
2.4.2.2. Les conséquences humaines<br />
Le bâtiment n’étant plus exploitable, l’activité économique a été suspendue. Les prévisions<br />
de reconstruction portant sur plusieurs mois, la procédure de chômage technique n’a pas<br />
pu être envisagée. Celle-ci est limitée à une durée maximale de six semaines. La décision<br />
fut prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mars de licencier l’ensemble de<br />
l’équipe. Seul le gérant conserve son poste pour prendre en charge la reconstruction et<br />
mettre tous les moyens en œuvre afin d‘assurer la reprise de l’activité et la poursuite du<br />
projet.<br />
En ce qui me concerne, le stage fut maintenu, mais le contenu en a été profondément<br />
remodelé. <strong>Mo</strong>n statut spécifique de stagiaire en formation continue ne requérait pas le<br />
versement des indemnités habituellement obligatoires lors des stages de longue durée. Je<br />
ne représente donc pas « un coût économique » pour la structure. Je peux ainsi mettre au<br />
service de la coopérative mes compétences acquises au cours de mes expériences<br />
professionnelles précédentes. Ma mission a évolué vers une mission d’adjointe du gérant.<br />
Le besoin était réel : après trois ans d’investissement intense dans le projet <strong>Baraka</strong>, en<br />
plein lancement de l’exploitation du bâtiment, Pierre Wolf a été stoppé net dans son élan.<br />
La violence du choc est à la fois morale et physique. Se cumulent le stress et la fatigue de<br />
ces trois ans d’implication dans le projet, l’intensité et la pression de ces dix jours<br />
d’ouverture, l’effondrement face à la destruction d’une telle réalisation, le sentiment de<br />
culpabilité d’être passé à côté de quelque chose qui aurait évité le sinistre et les décisions<br />
à prendre telles que le licenciement de l’équipe.<br />
A tout cela, s’ajoutent les doutes du gérant sur la viabilité économique de <strong>Baraka</strong>. La<br />
coopérative va-t-elle faire faillite ? Quelle est la probabilité que l’on puisse rouvrir ?<br />
Pendant trois ans, Pierre Wolf a convaincu sociétaires, banquiers et élus sur la faisabilité<br />
d’un tel projet, au risque de passer pour un fou dans ses débuts. Aujourd’hui, la situation<br />
s’est inversée, personne, quel qu’il soit, ne doute de la viabilité du projet alors que le<br />
gérant tend à douter.<br />
Au-delà du sinistre et de ses conséquences, Pierre Wolf a tiré les leçons des sept<br />
journées d’ouverture. Il a pu constater les limites de compétences de l’équipe dans<br />
l’exploitation d’un restaurant. En premier lieu, ses propres limites : son manque<br />
d’expérience en management d’équipe, son manque de connaissance du métier de<br />
27
estaurateur et sa réticence à devenir maître d’hôtel. Puis celles de l’équipe : le manque<br />
d’expérience de l’équipe en salle et leur besoin d’accompagnement, le manque<br />
d’expérience de la cuisinière en restauration professionnelle et en animation d’équipe.<br />
Tous ces éléments sont indispensables pour une équipe qui doit produire 50 à 70 repas<br />
en toute sérénité dans un temps réduit. Ces compétences peuvent s’acquérir mais il faut<br />
envisager des temps de formation et le mode d’accompagnement.<br />
Comme tout gérant, il ressent la solitude du dirigeant face aux décisions et au poids des<br />
responsabilités. A cela s’ajoute la culpabilité d’avoir emmené tant de personnes dans un<br />
projet proche de l’échec du fait du sinistre. Solitude car il s’interdit d’exprimer ses doutes<br />
les plus profonds, ses angoisses, ses questionnements. Mais cette solitude est fortement<br />
compensée par la structure coopérative, par la force du projet collectif qui se concrétise au<br />
travers du soutien des 97 sociétaires 56 , des élus, des associations et habitants du quartier,<br />
des sympathisants.<br />
Ce n’est pas qu’une question de responsabilité juridique, économique ou financière. Cette<br />
épreuve prouve combien l’économique n’est pas un phénomène indépendant de tout ce<br />
qui constitue l’Homme. Au-delà du projet pour le quartier, chacun, sociétaire, salarié,<br />
partenaire a un engagement personnel plus ou moins prononcé dans la coopérative. Le<br />
professionnel n’est pas dissociable du personnel et donc l’échec éventuel de la<br />
coopérative aura un impact sur la personne de chacun des porteurs du projet et cet impact<br />
sera proportionnel à leur engagement.<br />
2.4.2.3. Une fragilisation économique du projet<br />
A l’origine du projet, l’aspect économique ne devait être qu’un support pour produire du<br />
non marchand, être cantonné à son rôle de production de richesses au service d’une utilité<br />
sociale. Or, avec le sinistre, la viabilité économique de <strong>Baraka</strong> est en péril. Pendant les<br />
deux premiers mois suivants l’incendie, ce champ aura monopolisé la majeure partie de<br />
notre énergie et de notre travail : si ce pilier s’effondre, la « fabrique de biens<br />
communs » ne pourra plus exister.<br />
Les enjeux sont importants : c’est un projet de 800.000€ dont 400.000€ d’emprunts<br />
bancaires avec des remboursements actifs depuis janvier.<br />
Les questions sont simples et pratiques : comment faire face aux 8.000€ 57 de charges<br />
fixes mensuelles pendant toute la durée de la fermeture ? Y aura-t-il des frais cachés pour<br />
la reconstruction ? A quelle hauteur l’assurance va-t-elle prendre en charge ces coûts ? Et<br />
bien sûr, quand peut-on espérer redémarrer l’activité économique ?<br />
56 5 nouveaux sociétaires entrent au capital de la coopérative suite au sinistre.<br />
57 Ces 8000€ sont composés du salaire du gérant, des mensualités de remboursement d’emprunt et des charges fixes<br />
incompressibles<br />
28
2.4.2.4. Une solidarité concrète<br />
Ce sinistre fut l’occasion de beaux témoignages de soutien et de gestes de solidarité vis à<br />
vis de <strong>Baraka</strong>, la plupart spontanés. A travers eux, nous y avons lu toute la force d’un<br />
projet à dimension humaine et ancré sur son territoire, dans son quartier. Nous y avons vu<br />
toute la richesse de la mixité voulue par la coopérative : soutien de l’usager, du voisin, des<br />
stagiaires des chantiers participatifs par un mot, une parole lorsqu’ils passaient sur les<br />
lieux, soutien d’une future cliente qui a offert une heure de son temps pour nous aider à<br />
évacuer l’eau, passage de Pierre de Saintignon, premier vice-président de la Région Nord-<br />
Pas de Calais, de René Vandierendonck, Maire-Sénateur de Roubaix à l’époque ou<br />
d’Assya Guettaf, élue du Conseil Régional venus voir les dégâts et apporter soutien moral<br />
et proposition de soutien financier. Mais c’est aussi le soutien de l’association d’insertion<br />
du quartier qui a envoyé trois salariées pour nettoyer le bâtiment, du militant écologiste, du<br />
philanthrope du Maillon, d’usagers de l’Univers, acteurs du réseau et bien sûr tous les<br />
sociétaires et leurs amis venus écoper, emballer, protéger et être tout simplement<br />
présents.<br />
La solidarité s’est exprimée de manière concrète au travers d’une manifestation de soutien<br />
initiée, le jour même de l’incendie, par les associations et la mairie de quartier. Elle a réuni<br />
une cinquantaine de personnes, anonymes, acteurs du quartier, politiques, Le caractère<br />
collectif de l’aventure se constate dans la construction du projet mais aussi dans la<br />
difficulté.<br />
Roubaix : un restaurant ravagé par le feu une semaine après son ouverture<br />
Publié le 01/03/2012 à 06h10 http://www.lavoixdunord.fr/forward?path=node/322442&height=470&width=400<br />
Hier matin vers 3 h, un incendie<br />
s'est déclaré au restaurant<br />
coopératif La <strong>Baraka</strong> dans le<br />
quartier de l'Épeule, à Roubaix. Un<br />
coup particulièrement dur pour les<br />
90 sociétaires et le patron de ce<br />
restaurant, qui avait ouvert ses<br />
portes en début de semaine<br />
dernière.<br />
À l'arrivée des secours, le feu ravageait la façade côté rue du Nord avec une fuite de gaz enflammée alimentant le<br />
brasier. Les pompiers ont rapidement stoppé la progression du feu. Mais l'incendie s'était déjà propagé dans le<br />
bardage en bois qui couvre façades et toiture du bâtiment fraîchement construit.<br />
Car la coopérative <strong>Baraka</strong> est un projet innovant monté par 90 sociétaires issus principalement du tissu associatif.<br />
Plus qu'un restaurant bio, <strong>Baraka</strong> se veut aussi une salle de quartier ouverte aux habitants. Un véritable pari<br />
humain volontariste, dans un quartier sensible. L'incendie survenu hier a de quoi décourager les plus<br />
entreprenants : « J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Ce sont trois ans de travail qui sont partis en fumée.<br />
Les sociétaires sont atterrés », explique Pierre Wolf, leur représentant.<br />
29
Une amertume d'autant plus marquée qu'en une semaine, le restaurant avait très bien démarré avec une<br />
soixantaine de couverts quotidiens en moyenne. Cinq salariés, dont deux issus d'un dispositif d'insertion<br />
professionnelle, se retrouvent au chômage technique.<br />
Hier midi, l'émotion était forte, lors d'un rassemblement spontané devant le restaurant qui a réuni une<br />
cinquantaine de personnes. Des élus, bien sûr, mais aussi des anonymes, venus manifester leur soutien.<br />
Pierre Wolf les a rassurés sur sa volonté de ne pas abandonner le projet : « C'est trop chouette jusqu'à<br />
présent, ce qui se passait, pour que ça s'arrête. On vous tiendra au courant sur notre site et sur<br />
Facebook », a-t-il dit, ému. Un comité de soutien serait déjà en formation et une soupe sera préparée avec<br />
une partie des stocks, et vendue ce midi face à La <strong>Baraka</strong>. De quoi constituer un début de cagnotte pour<br />
faire face.<br />
Pour ce qui est de l'incendie, l'heure est aux expertises. L'origine de l'incendie est encore indéterminée. Seule<br />
certitude : le feu a pris à l'extérieur du bâtiment, autour des compteurs électrique et de gaz. Dysfonctionnement<br />
électrique ou acte de malveillance, l'enquête devra le déterminer. •<br />
L’équipe dirigeante, de son côté, a organisé une vente de soutien dès le lendemain du sinistre.<br />
Bien que stagiaire, j’ai occupé d’emblée une place centrale dans le dispositif. L’objectif était<br />
multiple : écouler les périssables pour éviter leur perte et récolter les dons proposés suite au<br />
sinistre (1200€ récoltés et surtout 3h d’échanges et de témoignages de soutien par la centaine<br />
de personnes présentes). Au-delà de l’entraide, cette action a visé à occuper l’équipe et lui<br />
faire profiter de cet élan de solidarité. L’enjeu était de la mettre sur une dynamique positive en<br />
créant de l’action.<br />
Les soutiens se traduiront aussi par de nombreux messages transmis par mail, téléphone, sur<br />
Facebook, de tous ceux qui n’ont pu se déplacer.<br />
Ces élans de solidarité marquent l’importance du réseau qui s’est créé autour de la<br />
coopérative par la force du projet politique. Au-delà du nombre de personnes s’intéressant de<br />
près ou de loin à <strong>Baraka</strong>, c’est la mixité des individus qui en fait la richesse.<br />
Il y a une opportunité en toute chose. La mission du gérant se redéfinit. Il s’agit, au cours de<br />
ces quelques mois imposés d’inactivité, de :<br />
- réécrire le plan d‘affaires financier et activer les propositions de soutien ;<br />
- repenser l’organisation de l’exploitation du restaurant ;<br />
- finaliser les dossiers non aboutis avant le sinistre (logiciel, petits travaux...) ;<br />
- activer et mettre en valeur la fabrique de biens communs pendant cette période de<br />
reconstruction.<br />
30
2.4.3. La reconstruction<br />
2.4.3.1. Pierre Wolf<br />
La priorité, avant toute chose, est que le gérant reprenne confiance en la pérennité de<br />
<strong>Baraka</strong> et qu’il retrouve l’énergie et l’envie de reconstruire.<br />
Sa première action est de mettre en place un comité de soutien et d’aide à la décision<br />
appelé « comité de crise ». Il est composé de sociétaires : Patrick Tillie (avocat), Michelle<br />
Fargeon (commissaire aux comptes), Vincent Boutry (Université Populaire Citoyenne et<br />
président de l’Univers), Olivier Vangrimberghe, (URSCOP), Jean-Pierre Duponchelle<br />
(conseiller financier), Caroline Blondeau (cuisinière), David Decroix (expert-comptable). Ce<br />
comité s’est réuni trois fois pour traiter des différentes questions suite au sinistre : transfert<br />
de l’activité sur un autre lieu (cf. point suivant), suspension des mensualités de<br />
remboursement d’emprunt, qualité de la prise en charge du sinistre par la Macif et<br />
sollicitation d’un expert d’assuré …<br />
Ce comité a permis de conforter Pierre Wolf dans les décisions à prendre, d’entraver cette<br />
solitude du dirigeant et par là-même de l’aider à prendre du recul et la confiance<br />
nécessaire à la poursuite du projet.<br />
En parallèle, la collaboration qui avait commencé dans l’informalité entre le gérant et moi<br />
se renforce et permet de construire un binôme complémentaire grâce à l’expérience que<br />
j’avais antérieurement acquise en restauration et en animation d’équipe ainsi que mon<br />
aisance en matière comptable. Pierre Wolf me sollicite pour partager la gérance avec lui à<br />
la suite de mon stage.<br />
Enfin, une prise de recul et une distance à l’égard de la fonction de gérant deviennent,<br />
pour Pierre Wolf, indispensables pour ré-envisager un nouvel avenir à <strong>Baraka</strong>, en<br />
reprenant un rythme de travail plus posé avec un volume d’heures effectives modéré.<br />
2.4.3.2. La question du transfert d’activité<br />
Avant de prendre la décision de licencier l’équipe, nous avons exploré l’éventualité de<br />
transférer le restaurant sur un autre lieu. La mairie de Roubaix a été particulièrement<br />
dynamique sur la question. Son objectif était d’offrir les moyens de faire perdurer le projet.<br />
Sa réactivité en témoigne : réunion d’urgence en ses locaux le 9 mars, proposition de<br />
différentes cellules pour accueillir l’activité dans la semaine qui a suivi.<br />
L’option de transfert d’activités présentait différents avantages : maintenir les emplois ;<br />
maintenir une source de revenus pour faire face aux charges fixes ; profiter de la<br />
communication faite pour l’ouverture et celle autour de l’incendie pour promouvoir <strong>Baraka</strong>,<br />
31
sa cuisine, son projet écologique et social ; profiter d’un lieu comme le restaurant du<br />
Colisée, emplacement porteur de notoriété avec ses 92.000 spectateurs à l’année.<br />
A contrario, il fallait également prendre en compte : le déficit d’énergie nécessaire à la<br />
mise en œuvre d’une relance d’activité sur un autre lieu ; la fragilité professionnelle de<br />
l’équipe affectée par le sinistre pour y faire face ; la pression économique (nécessité de<br />
réaliser 60 couverts par jour pour maintenir une activité rentable. Or l’ancien gérant du<br />
restaurant Colisée n’en faisait que dix). Au final, le transfert présentait un risque significatif<br />
de mise en faillite de la coopérative si l’activité n’était pas au rendez-vous. L’urgence de la<br />
prise de décision (15 jours) qui ne nous a pas permis pas de réflexion approfondie.<br />
Après l’analyse de ces différents points, il fut décidé de ne pas transférer l’activité et de<br />
licencier l’équipe. Ce choix était délicat et difficile à faire d’autant que deux des quatre<br />
salariés ne bénéficiaient pas des indemnités de Pole Emploi. Pour compenser cette<br />
décision, un accompagnement de l’équipe a été mis en place : rédaction de leur CV et<br />
lettre de motivation ; envoi de leur candidature dans les réseaux des sociétaires ; aide aux<br />
démarches d’inscription d’auto-entrepreneur ; soutien dans le lancement de l’activité<br />
d’auto-entrepreneur de la cuisinière. Cette dernière lance sa table d’hôtes En attendant<br />
<strong>Baraka</strong> mi-avril. C’est l’occasion pour elle d’explorer sa cuisine, son organisation et<br />
d’enrichir son expérience de restauratrice. Une des serveuses est reprise dans la société<br />
de nettoyage qui l’employait au préalable. L’autre, après un essai sans suite dans un<br />
restaurant, travaille en tant qu’aide à domicile. Le cuisinier fait des missions de<br />
remplacement dans des collèges grâce au Conseil Général.<br />
2.4.3.3. Les travaux<br />
La reconstruction du bâtiment nécessite de procéder par :<br />
- une négociation avec la compagnie d’assurance ;<br />
- la mise en œuvre du chantier : sélection des entreprises, négociations,<br />
planification …<br />
a. Négociation avec la Macif<br />
Les coûts de reconstruction étant extrêmement importants (la moitié de la valeur<br />
du bâtiment), la négociation des devis et délais avec les experts de la Macif fut<br />
difficile. Face à de tels enjeux financiers, la divergence d’intérêts entre les acteurs<br />
a perturbé les relations de collaboration : d’un côté la coopérative qui a besoin<br />
d’un soutien fort de son assureur, de l’autre, une mutuelle qui doit assumer son<br />
rôle tout en assurant sa performance économique.<br />
32
L’entrevue du 19 avril est l’illustration de ces tensions entre <strong>Baraka</strong> et la Macif.<br />
Jérôme Lausi, Directeur Assurances et Eric Cartiny, Responsable Service<br />
Incendie de la compagnie, ont annoncé lors de ce rendez-vous qu’ils envisagent :<br />
- d’attaquer les pompiers en responsabilité sur la reprise de feu qui a très<br />
fortement aggravé les dégâts causés par l’incendie. Le risque est de retarder<br />
le démarrage des travaux et donc la réouverture de 6 mois à 1 an minimum ;<br />
- de refuser de réassurer le bâtiment dans le cas d’une reconstruction en<br />
l’état.<br />
Les représentants de la Macif étaient extrêmement tendus. Leur malaise face à ce<br />
dossier était flagrant : les enjeux financiers du dossier sont considérables pour la<br />
Macif. D’autre part, la Macif, est une mutuelle se reconnaissant des valeurs de<br />
l’économie sociale et solidaire. Son arbitrage ne peut se réduire aux critères<br />
économiques et juridiques. Elle doit prendre en compte la dimension politique du<br />
projet <strong>Baraka</strong>. A plusieurs reprises, les échanges ont fait état des tensions<br />
internes au sein de la Macif. D’un côté, M Lausi a étudié le dossier sous l’angle<br />
technique et juridique. Son objectif était de défendre les intérêts de la Macif d’un<br />
point de vue financier. Mais il savait que sa position ne serait que consultative et<br />
que la qualité du réseau de soutiens autour de <strong>Baraka</strong> serait un argument de<br />
poids dans l’arbitrage. De l’autre, la Direction de la mutuelle aborde le dossier<br />
selon un angle de vue plus large, intégrant les dimensions politiques de son<br />
appartenance à l’ESS et les spécificités de <strong>Baraka</strong>.<br />
Les conséquences d’une position telle que celle de M Lausi sont la mise en<br />
danger la coopérative. Une reprise des travaux tardive amènerait à la faillite. A<br />
contrario, collaborer pour reconstruire de manière plus pérenne face au risque de<br />
feu est un point de conciliation.<br />
L’issue de cette entrevue se trouve dans un accord trouvé autour d’un recours de<br />
la Macif auprès des pompiers et un démarrage, quelle qu’en soit l’issue, des<br />
travaux dès le 1er juillet 2012. Ainsi <strong>Baraka</strong> s’assure de rouvrir ses portes au plus<br />
tard début 2013, échéance maximale pour assurer sa viabilité économique.<br />
Cette entrevue a mis en avant la forte divergence d’intérêts entre la Macif et<br />
<strong>Baraka</strong>. Pour mieux défendre ses intérêts lors d’un sinistre, tout assuré peut faire<br />
appel à un expert d’assuré 58 .<br />
Cette question fait débat au sein de la coopérative. D’un côté, certains sociétaires<br />
soutiennent que faire appel à un expert d’assuré pourrait dégrader l’esprit de<br />
collaboration et de partenariat avec la Macif. De l’autre, l’argumentation favorable<br />
58 En cas de sinistre, les compagnies d’assurance font appel à des experts indépendants pour évaluer les montants<br />
d’indemnisation. Afin d’équilibrer la relation dans les négociations, l’assuré peut solliciter les conseils d’un expert dit d’assuré qui<br />
défendra ses intérêts. Les honoraires de ce dernier sont prévus dans les contrats d’assurance à la charge de la compagnie<br />
33
à un expert d’assuré s’appuie sur la complexité des dossiers, les divergences<br />
d’intérêts entre la Macif et la coopérative (limiter les coûts pour la Macif,<br />
reconstruire rapidement et selon les exigences du bâtiment bioclimatique pour<br />
<strong>Baraka</strong>) et la fragilité de l’équipe. Après quelques allers retours entre les parties,<br />
la coopérative opte pour un spécialiste qui pourra défendre les intérêts du projet.<br />
En un mois de temps, l’expert d’assuré sélectionné, le cabinet Galtier, prend en<br />
main les négociations concernant l’indemnisation des travaux et scelle un accord<br />
avec la Macif le 18 juin.<br />
L’expérience nous montrera que c’était la bonne option. Pour négocier, il faut<br />
maîtriser le même langage que l’autre partie. Dans une négociation avec des<br />
experts, il faut opposer un langage d’experts, ce qu’a fait de manière efficace le<br />
cabinet missionné pour représenter la coopérative.<br />
b. Mise en œuvre du chantier<br />
Dans des logiques de connaissance des spécificités de ce bâtiment et de<br />
cohérence quant aux garanties décennales de la construction, ce seront les<br />
mêmes entrepreneurs qui prendront en charge les travaux de reconstruction. Le<br />
chantier est confié à Matthieu Marty, architecte du bâtiment et sociétaire et<br />
François Lacoste, maître d’œuvre spécialisé en bâtiment en bois, sociétaire lui<br />
aussi.<br />
La principale difficulté pour les entreprises intervenant sur la reconstruction est<br />
d’intégrer ce nouveau chantier dans leurs plannings. Chaque mois de fermeture<br />
supplémentaire accentue la fragilité financière de la coopérative. La période<br />
estivale avec ses périodes de congés complique la situation. Mais l’implication des<br />
prestataires dans le projet est au-delà de la simple relation économique : tous sont<br />
issus du territoire régional, la plupart ont une démarche environnementale et/ou<br />
sociale proche de celle de la coopérative 59 . Ils se sentent partie prenante de la<br />
réussite de <strong>Baraka</strong> et produisent l’effort nécessaire pour démarrer les travaux dès<br />
le 2 juillet au lieu du 15 septembre.<br />
En parallèle, les architectes élaborent des solutions pour adapter le bâtiment afin<br />
d’éviter un nouveau sinistre. Les sociétaires, de leur côté, mettent en place un<br />
groupe de travail sur les aménagements intérieurs. L’objectif est de profiter de<br />
l’expérience acquise lors des dix jours d’ouverture pour améliorer l’agencement<br />
des salles. Deux axes sont à travailler : faciliter le travail de l’équipe de<br />
restauration et le développement de la « fabrique de biens communs ». Cela se<br />
traduit par un travail sur l’insonorisation, les couleurs, l’installation d’une<br />
bibliothèque et d’un coin salon …<br />
59<br />
SPL et Aprobat sont des structures d’insertion par l’activité économique, SHS et les architectes sont sociétaires. La plupart<br />
sont impliquées dans une forte démarche environnementale<br />
34
2.4.3.4. La viabilité économique<br />
Deux éléments sont essentiels pour assurer la pérennité d’une activité marchande : le plan<br />
d’affaires et le plan de trésorerie.<br />
Dans la construction financière initiale du projet, <strong>Baraka</strong> démarrait son activité avec une<br />
trésorerie permettant une montée en charges de l’activité sur deux ans. Cette trésorerie<br />
est en partie due à la retenue de garantie légale de 5% concernant l’ensemble des travaux<br />
de construction qui ne sera versée aux prestataires qu’en janvier 2013.<br />
Le plan d’affaires construit sur 5 ans prévoyait :<br />
- le versement du solde de la subvention du Framee 60 (54.000€) au printemps<br />
2012, subvention redevable pour toute construction HQE et versée<br />
conjointement par le Conseil Régional du Nord Pas de Calais et l’Etat<br />
- un démarrage de l’activité dès janvier 2012 sur la base d’une moyenne de 56<br />
couverts par jour (sur 210 jours ouvrés par an). La montée en charge se faisait<br />
graduellement pour atteindre un rythme de « croisière » de 72 couverts par jour<br />
d’ici deux ans.<br />
Suite au sinistre, ce plan d’affaires à 5 ans et le plan de trésorerie prévisionnel étaient<br />
obsolètes. Il s’agit d’intégrer les nouvelles contraintes et d’évaluer les besoins de<br />
trésorerie pour assurer les charges fixes jusqu’à la réouverture. L’objectif est de mesurer<br />
la résilience financière de la coopérative et de mettre en place des plans d’actions pour en<br />
assurer sa pérennité économique à moyen terme.<br />
Une difficulté supplémentaire renforce l’urgence financière. L’Ademe refuse de verser le<br />
solde de la subvention du Framee car les dépenses de construction sont inférieures au<br />
budget initial 61 . Le dossier est d’autant plus difficile à négocier que le bâtiment construit<br />
est hors cadre prévu par l’administration. La subvention du Framee se calcule sur le<br />
différentiel entre le coût d’une construction standard et celui intégrant les normes HQE<br />
(Haute Qualité Energétique). Comment évaluer le surcoût écologique dans un bâtiment<br />
100% écologique ? Comment comparer le coût d’un mur bois-isolation paille au coût de<br />
l’isolation d’un mur béton ? Les options de construction vont bien au-delà des normes<br />
HQE mais ne rentrent pas dans les réglementations du versement de la subvention. C’est<br />
toute la difficulté de ne pas être dans la norme, dans le standard.<br />
Le Conseil Régional sollicité, décide de prendre en charge seul le solde de la subvention<br />
malgré le refus de l’Etat de verser sa part.<br />
60 Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement géré conjointement par l’Etat re présenté par l’Ademe<br />
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie) et la Région. Il subventionne les projets réduisant les émissions de<br />
carbone.<br />
61 Coût de la construction 648.000€ au lieu de 700.000€ budgétés<br />
35
Avec l’aide de Jean-Pierre Duponchelle, sociétaire et conseiller financier, le plan d’affaires<br />
à 5 ans et le plan de trésorerie prévisionnel sont retravaillés dans le détail. L’objectif est<br />
de mettre en place un plan d’actions pour assurer la pérennité économique de la<br />
coopérative :<br />
- lancement des négociations avec les banques pour suspendre les<br />
remboursements d’échéances d’emprunt sur la période de fermeture<br />
- sollicitation du Conseil Régional pour des avances de trésorerie à taux zéro<br />
- montage de dossiers de demandes de financement auprès des fondations Le<br />
Maillon, Ecocert, AG2R-La <strong>Mo</strong>ndiale …<br />
- vote en AG du 24 mai d’une possibilité d’apport en compte courant d’associé<br />
de la part des sociétaires à un taux zéro en cas de difficulté de trésorerie<br />
Sans sollicitation de la part de <strong>Baraka</strong> et de sa propre initiative, LMCU octroie une avance<br />
de trésorerie de 15.000€ remboursable sur deux ans à la coopérative.<br />
Dans chaque constitution de dossier, l’enjeu est d’afficher la gravité de la situation tout en<br />
rassurant le destinataire sur du potentiel de rebond et de la pérennité de la structure.<br />
Spécifiquement pour les fondations, la question de l’objet du financement se pose : que<br />
faire financer ? Comment rester cohérent quant aux besoins réels (reconstruction,<br />
trésorerie, perte d’exploitation) et réussir à séduire le donateur qui sera plus sensible à<br />
investir, financer une activité que combler une perte sèche ? La solution est de proposer<br />
une double option : financement de la perte d’exploitation ou investissement dans la<br />
« fabrique de biens communs ».<br />
Autant la fondation d’AG2R-<strong>Mo</strong>ndiale renouvelle son premier don sans condition<br />
particulière, autant l’expérience avec la Fondation « le Maillon » est instructive.<br />
Cette fondation étudie et sélectionne des projets à financer pour des particuliers fortunés<br />
souhaitant procéder à des donations avec ou sans condition de défiscalisation. Cette<br />
fondation présente deux avantages pour ces donateurs : sélectionner les dossiers et offrir<br />
la possibilité de garder l’anonymat. La responsable du Maillon contacte Pierre Wolf à la<br />
demande d’un de ses membres qui souhaite faire un don suite au sinistre. Les règles de<br />
constitution du dossier sont très précises : présentation de la structure, définition du<br />
projet, budget prévisionnel, rapport d’activités, constitution des équipes (salariés et<br />
bénévoles), mode d’évaluation de la réussite du projet … Tout est encadré : le nombre de<br />
lignes ou de pages à rédiger, les documents à joindre, les informations à fournir …<br />
Après analyse du dossier, s’entame une série d‘échanges téléphoniques assez<br />
techniques sur l’analyse des besoins financiers : besoin en fond de roulement, niveau de<br />
trésorerie, évaluation des actifs et passifs du bilan comptable. Les échanges sur le projet<br />
en lui-même se résumeront essentiellement à la catégorie de prix en restauration évaluée<br />
trop basse par le donateur pour des plats faits à partir d’ingrédients issus de l’agriculture<br />
biologique.<br />
36
Au final, le Maillon versera deux dons de deux mille euros chacun sans aucune<br />
convention ni demande de justification de l’utilisation de ces dons (facture, compte-rendu,<br />
bilan annuel...). On peut s’étonner, peut-être, de constater l’écart entre le formalisme des<br />
contrôles exigés lors de la sélection du dossier et le côté informel et sans contrepartie<br />
exigée lors de l’octroi des dons.<br />
2.4.3.5. La « fabrique de biens communs »<br />
Le champ économique occupant un espace important dans l’ensemble des<br />
préoccupations de la coopérative, il est important d’octroyer une part de l’activité et de<br />
l’énergie des sociétaires à la « fabrique de biens communs ». Ce projet est envisagé<br />
comme une opportunité pour garder à l’esprit et en action la finalité de la SCIC.<br />
<strong>Baraka</strong> ne se résume pas à un bâtiment et un restaurant, c’est aussi et surtout une<br />
« fabrique de biens communs ». Ce sont 97 sociétaires qui ont investi financièrement et<br />
socialement dans un projet en vue de créer du lien social, du vivre-ensemble. Le bâtiment<br />
est sinistré, l’activité économique est en suspens. La question est de savoir quelle place<br />
peut avoir le non-marchand malgré cela. Il s’avère que le faire vivre pendant cette période<br />
difficile est déterminant. C’est le non marchand qui va porter le marchand.<br />
J’organise, début avril, une réunion de sociétaires pour la poursuite de la « fabrique de<br />
biens communs ». Les thèmes de la réunion sont « comment faire vivre la « fabrique de<br />
biens communs » pendant la fermeture du bâtiment ? » et « que projette-t-on pour la<br />
réouverture ? ». La synthèse de mes entretiens semi-directifs sert de base à la réflexion.<br />
Elle met en valeur :<br />
- une finalité commune : faire de <strong>Baraka</strong> un lieu de foisonnement, d’échanges,<br />
d’échanges de savoir, un lieu d’activités non marchandes<br />
- les trois dimensions qui la composent : le vivre-ensemble, l’environnement et<br />
l’ancrage dans le quartier. Cette dernière est devenue essentielle suite à<br />
l’incendie qui a mis en valeur l’importance de l’appropriation du lieu par les<br />
habitants.<br />
Les échanges sont riches et constructifs. Le gérant reprécise le rôle de chacun : ce sont<br />
aux sociétaires de prendre en charge la « fabrique de biens communs » et lui se<br />
concentre sur la reconstruction mais en accepte d’en être le coordinateur. Du côté<br />
sociétaires, le débat porte sur les actions à mener et principalement comment aborder et<br />
créer le lien avec les habitants : « il faut être pro-actif en allant chercher les voisins (…)<br />
faire une assemblée de voisins qui pourra lancer des initiatives ». Mais la question est<br />
aussi de savoir comment « être légitime (…) si on ne fait pas intervenir le voisinage », s’il<br />
ne serait pas judicieux « de leur faire une place dans la gouvernance ». En effet,<br />
comment peut-on présager de ce qui est bon pour les habitants s’ils ne sont pas<br />
37
consultés. Dans un objectif de faire de <strong>Baraka</strong> un terreau d’initiatives pour le quartier,<br />
l’idéal ne serait-il pas de construire la « fabrique de biens communs » avec les futurs<br />
bénéficiaires ?<br />
Mais le groupe n’est peut-être pas mûr pour cette étape-là. Il est unanimement favorable<br />
à développer le lien avec le quartier mais peu rebondissent sur l’idée de définir une place<br />
plus importante des bénéficiaires au sein de la gouvernance.<br />
Après une heure d’échanges, six groupes-projets se constituent :<br />
- Lecture/culture/métissage<br />
- Cuisine/métissage/échanges de savoir<br />
- Jardins au carré/agriculture en milieu urbain<br />
- FabLab 62<br />
- Ateliers fabrication luminaire, déco, bibliothèque pour <strong>Baraka</strong>.<br />
- Liens avec les associations du quartier et la mairie de quartier<br />
Pour chacun des groupes, l’accord est unanime sur l’importance de partir des initiatives<br />
déjà existantes sur Roubaix. Il ne s’agit pas de tout réinventer mais de coopérer pour<br />
donner de la puissance à ce qui se fait déjà sur le territoire.<br />
Je prends part au projet « lien avec le quartier » en prenant contact avec les différents<br />
acteurs de l’Epeule et en intégrant <strong>Baraka</strong> dans l’organisation de la fête des quartiers<br />
ouest de Roubaix.<br />
Cette manifestation a eu lieu de le 23 juin sur le terrain de la friche de l’Ouest. L’objectif<br />
était de proposer des animations gratuites aux habitants des quartiers ouest. A l’initiative<br />
de la mairie de quartier, ce sont les associations et les habitants qui l’ont construite. Les<br />
sociétaires se sont mobilisés pour assurer une présence sur les différentes dimensions<br />
qui constituent la fabrique de biens communs : un atelier cuisine, un atelier peintures<br />
naturelles à faire soi-même, un atelier jardinière au carré en collaboration avec la Maison<br />
du Jardin, des lectures de contes et un troc de livres en partenariat avec l’Eglise<br />
réformée. Ce dernier a eu un tel succès qu’il sera intéressant d’en faire un rendez-vous<br />
régulier à l’avenir.<br />
Ce fut une très belle opportunité pour <strong>Baraka</strong> de faire connaissance avec les acteurs<br />
principaux du quartier. Cela a fait apparaître un beau potentiel de partenariat pour la<br />
rentrée : Maison du Jardin, Mélissa, Eglise réformée, Médiathèque …<br />
Un café-voisins fut organisé le 2 juin devant le bâtiment. L’objectif était de créer une<br />
occasion pour partager et échanger avec les voisins de <strong>Baraka</strong>. Une quinzaine de<br />
personnes s’y sont arrêtées. C’est par ces nombreuses petites actions que le lien avec les<br />
habitants se construit.<br />
62 abréviation de Fabrication laboratory. C’est une plate-forme ouverte de création et de prototypage d’objets physiques,<br />
"intelligents" ou non. L’objectif est de démocratiser l'accès aux outils et machines pour permettre les inventions et les<br />
expressions personnelles. Les principes sont la gratuité, l’échange de savoir, la non propriété privée, la production d’intelligence<br />
collective.<br />
38
La prise de distance avec le projet me permet de souligner le besoin de coordination et<br />
d’animation. Créer des liens avec le quartier nécessite un investissement temps important<br />
et une présence forte des mêmes personnes pour tisser des liens durables. Comme me<br />
l’a confirmé mon expérience à l’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique),<br />
les personnes issues de milieux défavorisés, et parfois cassées par les institutions, par la<br />
société, par la vie, tendent à accorder leur confiance à des personnes physiques plus<br />
facilement qu’à des personnes morales. Il va falloir penser l’organisation et la prise en<br />
charge de la fabrique par les sociétaires en prenant en compte cet élément. Le rôle des<br />
salariés risque d’être important dans le relais des activités de la fabrique auprès des<br />
habitants.<br />
3. Conclusion de la monographie<br />
Malgré son jeune âge, l’histoire de la coopérative <strong>Baraka</strong> est riche d’expériences que ce soit dans sa<br />
conception, par l’agrégation de multiples compétences ou la construction du bâtiment dans un quartier<br />
défavorisé. Le sinistre, aussi éprouvant soit-il, a permis d’affirmer la force du projet et du collectif qui le<br />
porte et a mis en valeur la capacité de résilience de la coopérative. Ce fut une occasion de solidarité<br />
concrète qui a enrichi le projet de manière considérable en revalorisant l’importance des liens de<br />
<strong>Baraka</strong> avec le quartier.<br />
En seulement deux ans d’existence, il apparaît combien la coopérative s’inscrit dans la mouvance de<br />
l’ESS et les événements ont pu montrer la force du projet politique.<br />
3.1. Un projet inscrit dans l’économie sociale et solidaire<br />
D’une idée initiale marquée par un parti politique est né un projet beaucoup plus large, certes très<br />
orienté écologie, mais qui regroupe les valeurs promues par l’ESS : pérennité d’une activité<br />
économique dans le respect de l’Homme et de l’environnement, inscription sur un territoire,<br />
gouvernance démocratique et surtout production au profit d’un intérêt collectif et non d’intérêts<br />
individuels.<br />
Bien qu’émaillé par cet accident, ce projet est une illustration de cette démarche qui cherche, non<br />
pas à s’en tenir à l’espace libre entre marché et sphère publique, mais, par le flou des frontières, à<br />
lier les deux secteurs par une politisation de l’économie. Le fondement du projet est mû par la<br />
volonté de positionner l’économique comme un moyen et non comme une finalité. Ce fondement<br />
s’oppose à l’idéologie du capitalisme contemporain qui fait du profit accumulé une finalité et de<br />
l’économie une sphère indépendante des sphères sociales et politiques. Un des objectifs du projet<br />
a bien été, et continue d’être de limiter la prégnance de l’économie monétaire par son imbrication<br />
39
avec une économie non monétaire dans des fonctionnements mixtes 63 et de limiter la profitabilité<br />
de l’activité.<br />
Une autre dimension sous-jacente du projet peut être mise en valeur : la mixité des publics<br />
bénéficiaires. L’économie sociale, depuis ses origines, a été au service des populations les plus<br />
démunies. Le désengagement actuel de l’Etat ne fait que renforcer cette orientation. Il est dans<br />
l’intérêt des pouvoirs publics de confirmer le rôle de l’ESS comme solution d’insertion des<br />
personnes les plus en marge de la société.<br />
Cependant, cela se traduit parfois par une vision un peu étriquée de l’utilité sociale des<br />
organisations de l’ESS, une vision qui restreint l’utilité à des dimensions d’insertion économique et<br />
sociale 64 . Des organisations de l’ESS rompent avec cette vision du cloisonnement à l’insertion.<br />
Pour elles, il n’y a pas de secteur dédié à l’utilité sociale et elle n’est pas réservée aux populations<br />
les plus défavorisées. Le sens que prend <strong>Baraka</strong> est de chercher la mixité des publics, de les faire<br />
se rencontrer, de construire du vivre-ensemble dans cette mixité sociale. Ainsi la « fabrique de<br />
biens communs » ne vise pas à être exclusivement réservée aux plus démunis mais à tous ceux<br />
qui souhaiteront y prendre des initiatives ou en bénéficier, sur le territoire. Aussi difficile soit-elle à<br />
mettre en place, la mixité des publics est considérée comme une force pour <strong>Baraka</strong>, un<br />
multiplicateur de production de biens communs, une valeur centrale dans le projet. Partant de ce<br />
principe, se pose naturellement la question de la place faite concrètement aux habitants du<br />
quartier, futurs bénéficiaires de la fabrique, au sein de la gouvernance. Quand l’économie libérale<br />
ne prend que le point de vue de la rentabilité, () l’économie solidaire doit prendre en compte tous<br />
les points de vue et surtout ceux des plus démunis 65 . L’expérience du programme ISBET<br />
(Indicateurs Sociétaux de Bien Etre Territorialisés) a montré combien il était important mais aussi<br />
difficile d’impliquer les plus exclus en amont des résultats, dans l’élaboration des processus 66 , il ne<br />
s’agit pas de penser le bonheur à la place des gens 67 .<br />
Cela rejoint la volonté d’empowerment 68 des initiateurs du projet. Les différents débats qu’ont eu<br />
les sociétaires sur cette dimension particulière peuvent être résumés comme suit : leur faire une<br />
place plus importante au sein de la coopérative contribuerait à une démarche d’autonomisation<br />
des populations les plus démunies. Cette démarche nécessitera de s’atteler à la difficulté à les<br />
intégrer dans le processus de décision. Comme l’a montré Bourdieu, au-delà de leur pauvreté<br />
matérielle, la plupart d’entre eux ont un déficit de capital social. Or celui-ci est nécessaire pour<br />
alimenter les échanges et les prises de décision qui constituent une gouvernance démocratique.<br />
63 LAVILLE Jean-Louis, L’économie solidaire, une perspective internationale, p292, DDB, 1994<br />
64 comme par exemple le définit le texte du Décret du 21.02.2002 pour l’octroi de l’agrément nécessaire aux SCIC : « le préfet<br />
tient compte notamment de la contribution que (le projet) apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale<br />
et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services »<br />
65 FLORIS Bernard, Espace public et sphère économique, Economie solidaire et démocratie, Hermès Bonchamp-lès-Laval, 2003<br />
66 RENAULT Michel, Elaborer ensemble des outils pour construire une société plus conviviale, de la convivialité, La Découverte,<br />
Paris, 2011<br />
67 Entretien semi-directif mars 2012<br />
68 Ibid<br />
40
3.2. Force du projet politique et innovation<br />
La force du projet réside dans sa dimension politique et dans le cumul des ambitions portées :<br />
respect de l’environnement, démocratie, territoire, insertion économique … Même s’il y a un<br />
danger à vouloir tout mener tout de suite 69 , c’est cette spécificité qui a permis un tel impact et de<br />
fédérer autant de personnes, sociétaires ou partenaires, autour du projet. Cela s’illustre à la fois<br />
dans le nombre de sociétaires actifs dans la vie de la coopérative, dans les soutiens financiers<br />
(diversités des fondations, subventions de la mairie, de la Région et de l’Etat) mais aussi lors du<br />
sinistre, avec les soutiens exprimés par les élus, les voisins, les acteurs locaux, les médias …<br />
Cette dimension politique a amené nombre de parties prenantes à aborder et négocier dans le<br />
sens de <strong>Baraka</strong>, de son projet collectif et non uniquement dans la défense de leurs intérêts<br />
propres : la Macif ne suivra pas les conseils de ses experts et ne déposera pas de recours contre<br />
les pompiers.<br />
L’aspect innovant du projet a aussi une part importante dans le succès obtenu : oser investir dans<br />
un tel bâtiment en plein quartier défavorisé et le mettre à la « disposition » de ses habitants. Il<br />
aurait été tellement plus facile de le construire dans un lieu « tendance » ou à forte visibilité tel<br />
que, par exemple, le quartier de Wazemmes au centre de Lille.<br />
L’innovation se trouve aussi dans le souhait de ne pas dépendre de subventions au long cours et<br />
d’obtenir son indépendance par une activité économique. Mais cette indépendance n’est-elle pas<br />
illusoire ? N’est-ce pas plutôt un transfert de dépendance du politique vers le client ? Le choix de<br />
faire un bâtiment neuf et de suivre l’exigence écologique a demandé d’importants investissements<br />
financiers et donc une nécessaire activité économique soutenue. Ce sera aux sociétaires de<br />
réguler le poids de l’économique dans la vie de la coopérative, que celle-ci ait suffisamment de<br />
temps et d’espace pour sa « fabrique de biens communs ».<br />
Le projet de <strong>Baraka</strong> se construit comme un lieu de foisonnement, en terreau d’initiatives. Même s’il<br />
est innovant, il n’est pas question de tout réinventer mais de valoriser l’existant, de compléter et<br />
développer les initiatives en cours sur le quartier. L’enjeu est de se mettre dans une dynamique de<br />
développement incrémental. Le collectif, est une force pour ce tâtonnement et pour remettre en<br />
question les futures réalisations. Le multisociétariat offre un potentiel de créativité 70 grâce au<br />
débat créé.<br />
A ce stade, je ne peux m’empêcher de conclure en disant, ce qui se lit en filigrane de ces propos,<br />
que j’ai été séduite par ce projet à la fois si jeune et si avancé et qui offre une approche complète<br />
des valeurs de développement durable. C’est aussi cette approche de l’économique qui m’a<br />
convaincue d’intégrer la coopérative pour mon stage.<br />
69 Ibid<br />
70 PECOUP Françoise, Op. Cit.<br />
41
PARTIE 2 – MES MISSIONS au sein de BARAKA<br />
Nous allons voir dans cette partie les différentes missions auxquelles je me suis consacrée au cours<br />
de mon stage et leurs évolutions suite au sinistre vécu par <strong>Baraka</strong>. C’est l’occasion d’aborder la<br />
question centrale pour laquelle j’avais été embauchée : l’évaluation de l’utilité sociale de la<br />
coopérative. Mais dans un 1 er temps, il est nécessaire de re-situer le contexte dans lequel s’est initiée<br />
cette mission.<br />
1. Contexte du stage<br />
1.1. Genèse<br />
C’est lors d’un séminaire professionnel proposé dans le cursus du Master APIESS que j’ai<br />
découvert <strong>Baraka</strong>. Le projet avait de la pertinence dans notre formation par son statut juridique (la<br />
SCIC) et par son objet qui regroupait l’ensemble des valeurs de l’ESS.<br />
Le discours de Pierre Wolf était très centré sur le bâtiment et la dimension écologique du projet. La<br />
fabrique de biens communs, la gouvernance ou l’ancrage territorial ont été certes abordés mais de<br />
manière plus succincte. Cela se justifiait par la période à laquelle se déroulait le séminaire : le<br />
projet en était à la phase finale de construction. L’excitation d’édifier un bâtiment exemplaire d’un<br />
point de vue environnemental et de venir à bout des problématiques du chantier était palpable.<br />
Les échanges étudiants–gérant étaient orientés sur les moyens de conserver la défense de<br />
l’intérêt collectif sur le long terme, la construction de l’intérêt général et comment rendre<br />
compatible activité économique et intérêt collectif. La question de l’utilité sociale et de son<br />
évaluation était un des thèmes centraux de notre formation. Il a naturellement découlé une<br />
proposition de prendre un stagiaire pour mettre en place l’évaluation de l’utilité sociale de la<br />
coopérative.<br />
1.2. La notion d’utilité sociale, une question d’actualité<br />
De manière historique, l’économie solidaire trouve ses origines dans le renouveau de l’économie<br />
sociale dans les années 70. Le mouvement fait apparaître des initiatives intégrant à la fois la<br />
dimension socio-économique et la dimension socio-politique 71 . L’objectif est de mettre en œuvre<br />
des activités économiques comme moyens pour servir la solidarité démocratique et d’internaliser<br />
des coûts sociaux ou environnementaux 72 . Par cette dynamique, l’économie solidaire sort du<br />
71 LAVILLE Jean-Louis, Politique de l’association, Seuil, 2010<br />
72 Ibid – Par exemple, le commerce équitable intègre dans son modèle le respect des critères de justice sociale<br />
42
clivage traditionnel public-privé. Elle revendique ses actions comme constitutive d’un intérêt<br />
collectif contribuant à l’intérêt général. L’Etat n’est plus vu comme le garant exclusif de celui-ci.<br />
De son côté, l’Etat se désengage des services publics dans un souci de rationalisation budgétaire.<br />
Il les délègue à des organismes privés en contrepartie de subventions et d’avantages fiscaux. Or, il<br />
apparaît que la non lucrativité et la gestion désintéressée ne sont plus des raisons suffisantes pour<br />
attribuer les faveurs fiscales. L’exigence de transparence et de respect du principe de libre<br />
concurrence le conduise à intégrer le critère d’utilité sociale dans les conventions signées avec les<br />
organisations de l’Economie Sociale.<br />
L’ESS s’approprie rapidement cette notion comme outil de différenciation et d’identification.<br />
L’apparition de nouveaux acteurs tels que les entreprises de commerce équitable ou de finance<br />
solidaire et le développement des activités commerciales des associations rendent floues les<br />
frontières entre une entreprise du secteur privé et une organisation se revendiquant de l’ESS.<br />
Malgré la non lucrativivité (ou lucrativité limitée) et l’assurance d’une gestion désintéressée, les<br />
structures ont besoin de revendiquer leur spécificité.<br />
Mais qu’est-ce que l’utilité sociale, appelée aussi plus-value sociale ou sociétale voire même biens<br />
communs dans le cas de <strong>Baraka</strong> ? Cette notion d’utilité sociale est un concept flou et mal défini.<br />
Elle fait l’objet de nombreux débats au sein de l’ESS. Elle dépend d’une part des valeurs portées<br />
par chaque structure et d’autre part de contextes temporels et locaux. Comme le formule Hélène<br />
Duclos, « ce qui est utile ici, ne l’est peut-être pas ailleurs et ce qui est utile maintenant ne le sera<br />
peut-être pas demain » 73 . L’utilité sociale est donc une notion en perpétuelle redéfinition et<br />
construction. De plus l’ensemble des spécialistes s’accorde à dire que l’utilité sociale se trouve non<br />
seulement dans la production de biens et/ou services fournie par la structure que dans la qualité<br />
de ses process et de son fonctionnement.<br />
C’est dans le flou de cette définition que réside le désaccord Etat – ESS. Le premier réduit la part<br />
« sociale » de cette utilité à « la dimension historique de l’aide, du compassionnel, du caritatif<br />
… » 74 . Dans cette conception, les services d’utilité sociale doivent s’adresser aux publics<br />
défavorisés, aux plus démunis ou aux populations requérant une assistance 75 . Les pouvoirs<br />
publics ont tendance à les limiter aux secteurs du 3 ème âge, de la petite enfance, de l’insertion. Or<br />
la plupart des structures de l’ESS souhaitent porter la notion « sociale » de l’utilité sociale à un<br />
niveau plus large, au niveau de « sociale » au sens de société : ce qui est bon pour le plus grand<br />
nombre.<br />
Malgré ces dissensions, les chercheurs s’accordent sur le fait que cette notion ne peut être<br />
universelle et qu’elle doit être définie par la structure concernée. Ils font apparaître les thèmes qui<br />
73 DUCLOS Hélène, « Quels enseignements tirer de l’évaluation de l’utilité sociale dans le secteur de l’ESS », extrait de<br />
l’ouvrage OFFREDI C., RAVOUX F., 2009, La notion d’utilité sociale au défi de son identité dans l’évaluation des politiques<br />
publiques, Paris, L’Harmattan<br />
74 Ibid<br />
75 le décret du 21 février 2002 concernant l’agrément des SCIC précise que « pour apprécier le caractère d’utilité sociale d’un<br />
projet, le Préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits ; à<br />
l’insertion sociale et professionnelle ; au développement de la cohésion sociale ; à l’accessibilité aux biens et services »<br />
43
eviennent de manière récurrente dans la recherche de définition de l’utilité sociale. Par exemple,<br />
Jean Gadrey retient cinq dimensions 76 :<br />
- L’utilité sociale à forte composante économique : richesse économique créée en termes de<br />
coûts évités pour la collectivité (services moins chers que dans le secteur privé, réduction<br />
de coûts économiques tels que les prestations sociales, etc.) ;<br />
- La lutte contre l’exclusion et les inégalités, du développement humain et du développement<br />
durable : réduction des inégalités diverses, développement des « capabilities» 77 , solidarité<br />
internationale et lutte contre la pauvreté, développement durable ;<br />
- Le lien social de proximité et démocratie participative : développement du lien social, du<br />
capital social, réduction de l’isolement, développement du dialogue participatif, processus<br />
de décision pluraliste ;<br />
- L’innovation sociale et solidaire : Réponse à des besoins non satisfaits par l’Etat ou le<br />
secteur privé par des innovations institutionnelles locales ou nationales, des innovations<br />
organisationnelles.<br />
- L’utilité sociale « interne » mais avec des effets possibles de « contagion » externe : les<br />
normes et les valeurs (désintéressement, don, bénévolat, mutualisation), les modes de<br />
gouvernance démocratiques.<br />
De manière plus pragmatique, l’Avise propose une classification autour de six thématiques 78 : la<br />
dimension économique ; la dimension sociale ; la dimension sociétale ; la dimension politique ; la<br />
dimension environnementale ; la dimension d’épanouissement.<br />
Figure 4 - Les différentes dimensions de l'utilité sociale - Cahiers de l'Avise n°5<br />
Toutes ces dimensions ne sont pas exclusives les unes des autres. Elles viennent souvent se<br />
compléter, ce qui accroît d’autant leur efficacité.<br />
76 GADREY Jean, Op. Cit.<br />
77 au sens de la capacité à agir de manière autonome<br />
78 Avise, « Evaluer l’utilité sociale de son activité. Conduire une démarche d’auto-évaluation », Cahiers de l’Avise n°5, Culture et<br />
Promotion, 2007<br />
44
1.3. Les enjeux de l’utilité sociale<br />
Pour l’ESS, la définition de cette notion porte plusieurs enjeux. En externe, elle permet la<br />
reconnaissance de ses spécificités aux yeux de tous et de légitimer ses actions. Actuellement, le<br />
rattachement à l’ESS se fait par le biais du statut juridique : associations, mutuelles et<br />
coopératives. Or en quoi les valeurs de certaines coopératives agricoles ou de la FNAC sont-elles<br />
communes avec celles revendiquées par l’ESS (primauté de l’Homme sur le capital, démocratie,<br />
lucrativité limitée …) ? En interne, elle devient un outil de régulation pour construire le projet,<br />
consolider la cohésion du collectif ou contrôler la cohérence de l’activité avec sa finalité au fil du<br />
temps.<br />
Côté pouvoirs publics, la notion d’utilité sociale permet de sélectionner les structures lors de la<br />
délégation des services publics et d’arbitrer l’allocation de leurs ressources. C’est aussi un moyen<br />
de contrôler les contreparties attendues quand il y a eu financement public.<br />
De ces enjeux découle la volonté d’évaluer cette utilité sociale tant de la part de l’Etat que de<br />
certaines structures de l’ESS.<br />
L’évaluer permet de mettre en valeur les contributions de l’ESS autre qu’économique. De la même<br />
manière que le marché évalue la valeur économique produite, évaluer l’utilité sociale mesure la<br />
valeur sociale produite. L’enjeu est d’offrir d’autres illustrations que celles réduites au champ<br />
économique : nombre d’établissements, nombre de salariés, nombre de personnes insérées,<br />
d’usagers bénéficiant de ses services, indicateurs financiers …<br />
Mais cette évaluation peut aussi être vue comme un pouvoir de contrôle et régulateur de l’Etat.<br />
Elle devient un critère de sélection croissant dans l’octroi de financements publics.<br />
Evaluer pose des problématiques fondamentales : quel référentiel ? Quels indicateurs ? Comment<br />
les construire ? Comment ou faut-il quantifier le non quantifiable ? Comment mesurer<br />
l’interdépendance, l’interaction entre chaque activité ? N’y a-t-il pas un risque de parcelliser les<br />
actions ? Enfin, mesurer une action de type qualitatif ne risquerait-il pas de la dénaturer et de la<br />
faire s’évanouir ? 79<br />
Depuis une dizaine d’années se développent les démarches d’évaluation de l’utilité sociale au sein<br />
des structures de l’ESS. Nous verrons en partie 3 de ce mémoire, plus en détail, les problèmes<br />
que soulève une évaluation ainsi que les atouts que cette démarche peut apporter à la structure<br />
évaluée.<br />
79 CAILLE Alain, De la convivialité, 2011, La découverte<br />
45
1.4. L’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong>, une nécessité ?<br />
<strong>Baraka</strong> met le marchand au service du non marchand. L’évaluation de la part marchande de<br />
l’activité se fait au travers des multiples indicateurs comptables et financiers (bilan, compte de<br />
résultats, effectif, retour sur investissement...). Cela offre une visibilité rapide et succincte de cet<br />
aspect de la coopérative. Dans une société férue d’indicateurs en tout genre, c’est cette vision de<br />
<strong>Baraka</strong> qui risque de dominer. Si l’on suit l’adage « tout ce qui n’est pas compté ne compte pas »,<br />
n’y a-t-il pas un risque pour que le bien commun produit reste dans l’ombre des évaluations<br />
économiques ?<br />
Mais cela ne peut être la seule raison de l’évaluation.<br />
1.4.1. Objectifs externes<br />
Dans un projet aussi innovant et autant observé (cf. la place de <strong>Baraka</strong> dans les médias<br />
locaux et l’implication des collectivités dans le projet), il est intéressant d’apporter la preuve de<br />
la réalisation concrète des promesses faites au montage du projet. Evaluer son utilité sociale<br />
permettrait d’améliorer sa visibilité d’autant que la coopérative regroupera un certain nombre<br />
d’activités. Cette évaluation permettra de faire une synthèse de l’ensemble des contributions<br />
qu’elle apporte à la société et de ne pas rester sous la domination de l’activité de restauration.<br />
C’est une opportunité pour mettre en valeur la « fabrique de biens communs ».<br />
Cette valorisation renforcerait la crédibilité de la structure et serait un support pour les<br />
négociations avec les partenaires externes : pouvoirs publics, financeurs privés (fondations,<br />
banques ...). Ayant bénéficié de subventions, il serait judicieux de justifier leurs emplois dans<br />
des actions ayant une plus-value sociale. Elle servirait de preuve de l’intérêt collectif défendu,<br />
des biens communs produits lors du montage des dossiers de demandes de subventions ou<br />
de dons. Ce serait aussi un gage de transparence dans l’utilisation des fonds versés.<br />
Elle serait aussi utile dans les relations de la coopérative avec les autres acteurs associatifs du<br />
territoire dont certains doutent de la légitimité de <strong>Baraka</strong>. J’ai pu constater leur<br />
méconnaissance du statut de SCIC et du projet global de la coopérative. Ne voyant que la<br />
partie restaurant, certaines associations éprouvent de la méfiance envers<br />
<strong>Baraka</strong> appréhendant un intérêt commercial : « Ce n’est pas une association, qu’est-ce que<br />
vous faites dans une manifestation à but non lucratif ? » 80 . Mettre en valeur son utilité sociale<br />
faciliterait la confiance.<br />
Enfin, pour les usagers et bénéficiaires, la mise en valeur de sa « fabrique de biens<br />
communs » serait un gage de transparence de sa gestion et de son fonctionnement.<br />
80 Remarque faite par un membre d’une association du quartier lors de l’organisation de la fête des quartiers ouest en juin 2012<br />
46
1.4.2. Objectifs internes<br />
Evaluer l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> ou tout du moins, sa production non marchande, nécessite<br />
une définition au préalable du périmètre de cette utilité et le référentiel de base à son<br />
évaluation. Les sociétaires porteurs de la « fabrique de biens communs » devront donc<br />
s’atteler à cette définition et la mettre en débat.<br />
Cette démarche permettrait de renforcer la cohérence du projet. Faite régulièrement, elle<br />
dynamise le fonctionnement et permet une analyse critique des actions menées et orientations<br />
prises. Elle met en valeur les bonnes pratiques. L’évaluation tient alors le rôle de régulateur<br />
interne à la structure.<br />
1.5. Réceptivité des sociétaires à l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong><br />
Bien que le stage ait été voté en assemblée générale, la proposition d’évaluation de l’utilité sociale<br />
de <strong>Baraka</strong> est une sollicitation externe et non une demande interne. Ma candidature et<br />
l’argumentaire de cette mission ont été transmis aux sociétaires une semaine avant l’assemblée<br />
générale. Lors de celle-ci, le débat sur le sens et l’opportunité d’une évaluation pour la coopérative<br />
fut très succinct. C’est surtout la période à laquelle l’évaluation était proposée qui posait question :<br />
« n’est-ce pas précoce, le restaurant n’ayant pas encore ouvert ? » (sociétaire)<br />
La « fabrique de biens communs » paraît être une évidence, les sociétaires n’ont pas le besoin de<br />
mettre en place des instruments de mesure de cette production. Ils sont concentrés sur le<br />
lancement de leur projet et ne voient pas encore l’urgence et/ou l’intérêt de la valoriser.<br />
Enfin, la méconnaissance des notions d’utilité sociale et des problématiques d’évaluation ne fait<br />
pas de cette mission une priorité. La pression de l’ouverture imminente, le besoin de vérifier si<br />
l’activité va fonctionner et de constater le succès du restaurant prennent le pas sur l’intérêt porté à<br />
la démarche.<br />
Cependant, elle est une opportunité pour formaliser l’histoire de <strong>Baraka</strong>, pour eux et pour<br />
l’extérieur. Cette illustration pourra servir d’appui lors d’un futur essaimage.<br />
47
2. Mission principale : l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong><br />
2.1. Expertise demandée<br />
Le stage a été validé par un vote en assemblée générale. La mission principale d’origine était de<br />
procéder à une évaluation de l’utilité sociale de la coopérative et à l’écriture de sa monographie.<br />
Des quelques retours que j’ai pu avoir à la fin de l’AG, c’est surtout la deuxième partie de la<br />
mission qui a séduit les sociétaires ainsi que l’aide que je pourrai apporter à l’équipe lors du<br />
lancement de l’exploitation du bâtiment. <strong>Mo</strong>n stage a eu lieu de février à juillet 2012, de<br />
l’inauguration du bâtiment à la reconstruction, en passant par les dix jours d’ouverture et le sinistre.<br />
Les compétences attendues pour la mission « officielle » étaient ma capacité à avoir une approche<br />
universitaire du projet en ayant une vision extérieure et ma capacité à en faire la critique. Mes<br />
expériences précédentes en restauration et management ont cependant été un critère non<br />
négligeable dans la validation de ma candidature. Cela complétait les compétences de l’équipe<br />
dans le domaine de la restauration. Pour rappel, Pierre Wolf est ancien journaliste, consultant en<br />
communication, Caroline Blondeau, cuisinière de formation suite à une reconversion, ancienne<br />
infographiste, David Ulloa, aide cuisinier, Fatima Selami et Aurore Castelle, serveuses à l’Univers.<br />
Au fil du temps, il va s’avérer que mes compétences en gestion-finance et ma capacité<br />
d’adaptation au vu de la situation seront utiles au gérant lors de la période post-sinistre. Nous<br />
conviendrons rapidement de mon embauche à la réouverture du restaurant par un partage des<br />
fonctions du gérant. Pierre Wolf conservera le titre de gérant à mi-temps et je serai maître d’hôtel<br />
ou adjointe (intitulé à définir) à mi-temps. Cet engagement est pris en vue de rendre l’équipe<br />
autonome dans la gestion des salles et du restaurant le plus rapidement possible.<br />
2.2. Déroulement de la mission<br />
Afin de mener à bien l’évaluation, je structure ma mission en différentes étapes et construis un<br />
planning pour mes six mois de stage. En premier lieu, je dois faire connaissance de manière plus<br />
précise avec l’ensemble du projet. C’est la phase d’immersion. Elle se fait au travers de ma<br />
participation au lancement de l’activité. J’ai la chance de démarrer mon stage l’avant-veille de<br />
l’inauguration. Je me joins à l’équipe pour la préparation du buffet, la mise en place de la salle.<br />
C’est l’occasion de faire connaissance avec les salariés et une partie des sociétaires.<br />
Après l’inauguration, il reste deux semaines de préparation avant l’ouverture du restaurant.<br />
J’apporte mon aide sur les dernières mises en place : de la formalisation des plannings au<br />
vernissage de l’escalier en passant par la construction de l’offre de locations de salles suite à<br />
l’étude des tarifs de la concurrence.<br />
En parallèle, je procède à des travaux préparatoires à ma mission principale : lectures de guides<br />
d’évaluation et de partage d’expériences dans d’autres structures, élaboration d’un rétro-planning<br />
48
(cf annexe 1) et des grilles d’entretiens semi-directifs 81 . L’objectif de mes trois premiers mois de<br />
stage, en tant que phase exploratoire, est de :<br />
- mener les entretiens semi-directifs auprès des sociétaires et parties prenantes dans le<br />
projet ;<br />
- créer un groupe de travail sur la définition et l’évaluation de l’utilité sociale ;<br />
- administrer une enquête auprès des stagiaires des chantiers participatifs ;<br />
- construire d’un premier référentiel d’évaluation.<br />
Grâce à mon directeur de mémoire, j’ai la chance de participer aux séminaires du projet Corus-<br />
ESS 82 centrés sur la thématique de l’utilité sociale et sur l’expérience d’autres associations.<br />
La première semaine d’ouverture du restaurant va mettre en suspens mes travaux. Le gérant est<br />
en formation obligatoire lors du lancement d’une activité hôtelière et m’a demandé de prendre en<br />
main la gestion des services (accompagnement de l’équipe pour la mise en place de la salle,<br />
animation du service, caisse ...). Les tâches en elles-mêmes n’ont que peu de plus-value pour ma<br />
mission principale mais c’est toujours un plaisir immense que d’assister au lancement d’une<br />
activité, de partager avec les usagers un concept porteur de tant de sens. L’excitation est là, le<br />
succès aussi : 350 personnes sont venues découvrir la cuisine de Caroline sur ces 7 premiers<br />
jours d’ouverture. C’est éprouvant pour l’équipe qui doit prendre ses marques et confiance en elle.<br />
Mais cela ne dure pas, l’incendie du 29 février met en suspens cette dynamique. Stoppés en plein<br />
sprint, nous devons redéfinir le rôle de chacun.<br />
2.3. Opportunités et difficultés rencontrées au cours de cette 1ère étape<br />
Une des grandes opportunités de ce stage est de l’avoir démarré au lancement de l’activité. La<br />
passion et l’euphorie de l’ouverture sont contagieuses. J’ai été portée par la dynamique. L’accueil,<br />
malgré la précipitation des dernières préparations, fut chaleureux et chacun a pris le temps de se<br />
présenter et d’expliquer <strong>Baraka</strong> à sa manière.<br />
Le partage de menues tâches de préparation comme éplucher des carottes, faire la vaisselle dans<br />
un bâtiment à 10°C 83 ou déménager des tables est un bon élément intégrateur au sein une équipe.<br />
A contrario, le début de ma mission fut déstabilisant. Tout d’abord il n’y avait pas de cadre matériel<br />
de travail (bureau, accès internet, ligne de téléphone, imprimante...) qui m’aurait permis de<br />
commencer mon stage sur les lieux de la coopérative. Je navigue donc entre mon domicile et un<br />
81 Un entretien semi-directif est un entretien qui « n’est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions<br />
précises » . Le choix ne s'est pas porté sur un «questionnaire oral», prédéfini et structuré, mais plutôt sur une discussion laissant<br />
la place au sujet pour exprimer son vécu, ses sentiments et ses représentations. Pour ce faire, j’ai établi une grille de questions<br />
relativement ouvertes. Cf. Annexes 2 et 3.<br />
82 Connaissance et Reconnaissance de l’Economie Sociale et Solidaire. Légitimité processuelle des mesures d’Utilité Sociale et<br />
environnementale de l’ESS. Projet chercheurs-citoyens sur 3 ans et financé par le Conseil régional.<br />
83 Pour l’anecdote, le bâtiment a été inauguré le 4 février 2012, période de grand froid à Lille (-10°C). Le bâtiment étant passif,<br />
n’a pas de système de chauffage : il récupère la chaleur émise par les personnes présentes. Difficile de réchauffer un bâtiment<br />
de 300m 2 avec seulement six personnes.<br />
49
coin de table du restaurant, ordinateur et dossiers sous le bras, glanant des informations au fil des<br />
rencontres avec l’équipe ou des sociétaires de passage. Je finis par trouver chez moi planche et<br />
tréteaux, étagères et ordinateur pour équiper le bureau et avoir de quoi travailler sur place.<br />
Ensuite, l’équipe était concentrée sur l’ouverture prochaine du restaurant et peu disponible pour<br />
intégrer une personne missionnée sur une fonction annexe.<br />
Je prends conscience d’une certaine solitude pour mener cette mission d’évaluation de l’utilité<br />
sociale de <strong>Baraka</strong>. L’équipe est composée de quatre personnes dédiées à l’exploitation du<br />
restaurant (Aurore et Fatima en salle, David et Caroline en cuisine) et du gérant, Pierre Wolf,<br />
envahi par les problématiques de fin de construction et de lancement de l’activité d’exploitation.<br />
Des sociétaires passent régulièrement donner un coup de main à l’équipe mais aucun n’est actif<br />
sur la question de l’évaluation, ce qui est cohérent avec le contexte dans lequel la mission s’est<br />
mise en place. Le besoin d’évaluation n’existe pas encore. L’opportunité d’assister aux réunions du<br />
projet Corus-ESS me permet de rencontrer des acteurs sensibles à la question.<br />
Devant l’ampleur de la tâche, je suis un peu perdue et ne sais pas par où commencer. C’est<br />
d’autant plus difficile pour moi que mes expériences professionnelles précédentes nécessitaient<br />
beaucoup d’actions, donnaient un rythme intense de production. L’intégration se faisait dans des<br />
équipes composées de personnes ayant la même mission que la mienne. A <strong>Baraka</strong>, tel n’est pas<br />
le cas : je suis seule sur la question de l’utilité sociale et le travail à fournir est (dans un premier<br />
temps) très cérébral. Or, pour prendre mes marques, j’ai besoin que ça aille vite et être dans<br />
l’opérationnel. Sous les conseils de Florence Jany-Catrice, j’accepte de me donner le temps pour<br />
découvrir la structure et de faire de ce travail d’immersion la phase préparatoire à l’évaluation.<br />
Je satisfais mon besoin de production par mon expérience en restauration et management. Elle<br />
offre une bonne complémentarité aux compétences du gérant qui n’avait pas pris conscience de la<br />
nécessité d’être autant présent sur l’activité même de restauration. Il me délègue donc cette<br />
mission. Ma plus grande difficulté sera de ne pas me laisser envahir par l’opérationnel pour mener<br />
à terme ma formation et ma mission universitaire.<br />
Mais le sinistre va donner une toute nouvelle orientation à ma mission.<br />
50
3. Evolution suite au sinistre<br />
3.1. Les raisons de reporter la démarche d’évaluation<br />
La violence du sinistre après seulement dix jours d’activité donne l’effet d’un arrêt net en plein<br />
sprint. L’investissement moral, physique et affectif de l’équipe était tel qu’ils sont anéantis. La<br />
confiance est réelle dans le redémarrage de l’activité mais où trouver l’énergie nécessaire pour<br />
recommencer ?<br />
Les dégâts étant importants, la réouverture n’est pas envisageable avant septembre. Devant la<br />
méconnaissance de ce genre de situation, il est extrêmement difficile de se projeter à moyen<br />
terme.<br />
Dans ce nouveau contexte, ma mission d’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> est reléguée au<br />
second plan.<br />
La première question qui se pose est « quel sens y a-t-il à mettre en place une évaluation d’une<br />
activité qui n’existe plus ou quasiment plus et qui ne reprendra pas avant au moins six mois ».<br />
Certes, l’évaluation aurait pu concerner la phase d’élaboration de construction du bâtiment car,<br />
comme nous l’avons vu précédemment, l’utilité sociale est produite dès les moyens mis en œuvre.<br />
Mais des problématiques de temps et d’énergie se posent. L’urgence du rebond de la coopérative<br />
est prioritaire et l’ampleur de la tâche est telle que j’ai peu de temps à lui consacrer. La<br />
reconstruction doit mobiliser toutes les énergies. Or une évaluation requiert de la disponibilité et un<br />
certain investissement de la part des acteurs : « il est indispensable que les dirigeants politiques<br />
soient fortement impliqués dans la démarche » 84 . Dans ce contexte, ils ne sont pas à même de<br />
l’être. Comme l’alerte l’Avise dans son guide de l’évaluation de l’utilité sociale des organisations,<br />
« il est inutile de se lancer dans une démarche (..) dans une période de crise car elle n’aboutirait<br />
pas ».<br />
Enfin, comment mener une évaluation quand l’évaluateur devient pleinement acteur de<br />
l’organisation ? Avec le sinistre, je me suis fortement impliquée dans la « fabrique de biens<br />
communs » et ai perdu la distanciation nécessaire à l’objet de mon étude. Quelle sera la crédibilité<br />
de l’évaluation si l’accompagnateur est lui-même producteur d’utilité sociale ?<br />
Dans ce contexte, il est décidé de reporter la mission d’évaluation mais non de l’annuler. Je<br />
continue à mener mes entretiens semi-directifs. <strong>Mo</strong>n travail s’oriente sur l’écriture de l’histoire de<br />
<strong>Baraka</strong> dans un objectif de mémoire et d’essaimage. Afin de capitaliser sur l’expérience<br />
particulière des chantiers participatifs tant qu’il n’est pas trop tard, je mets en place une enquête<br />
quantitative et interviewe les organisateurs (Cf. dernière partie). Ce travail servira, je l’espère, à<br />
une base pour des futurs travaux sur l’utilité sociale de la structure.<br />
84 Avise, Op. Cit.<br />
51
3.2. Mes nouvelles missions<br />
Etant récente dans la structure, j’ai l’énergie pour rebondir et soutenir Pierre Wolf qui accuse trois<br />
ans d’investissement intense. Un binôme s’établit entre le gérant et moi. Pendant qu’il se<br />
concentre sur les problèmes d’assurance, nous (avec les sociétaires) occupons l’équipe afin de<br />
maintenir une dynamique positive et constructive : l’organisation de la vente de soutien, le<br />
nettoyage du bâtiment et le déménagement du mobilier.<br />
Nous n’avons que très peu de visibilité sur les mois à venir : temps des travaux, coûts, potentiel de<br />
réouverture … Ma mission se construit, au jour le jour, selon les impératifs du moment :<br />
- étude de la faisabilité du transfert d’activité ;<br />
- accompagnement des salariés dans leur recherche d’emploi suite à leur licenciement ;<br />
- montage de dossiers de subventions ;<br />
- élaboration du nouveau plan d’affaires et du plan de trésorerie intégrant le sinistre ;<br />
- constitution des dossiers relatifs aux dédommagements pris en charge par la Macif<br />
(matériel et perte d’exploitation) ;<br />
- préparation de l’argumentaire pour la négociation avec les banques ;<br />
- retour d’expérience des 10 jours d’ouverture et travail sur l’amélioration du<br />
fonctionnement (logiciel, organisation, aménagement intérieur ...) ;<br />
- relais du gérant pendant ses vacances.<br />
Je prends en charge l’animation de la « fabrique de biens communs » et plus particulièrement la<br />
mission de lien avec le quartier.<br />
Nous améliorons tout d’abord la communication sur le bâtiment pour mieux expliquer le projet aux<br />
passants :<br />
- création et mise en place d’une bâche qui servira d’enseigne en attendant la<br />
réouverture ;<br />
- utilisation des baies vitrées pour communiquer sur l’avancée des travaux et les actions<br />
de <strong>Baraka</strong> du mois (café-voisins, fête des quartiers, à voix haute à la maison…).<br />
Mais le plus gros de la mission sera l’organisation de la fête des quartiers ouest : coordination des<br />
sociétaires pour l’animation des ateliers, mise en place de partenariat avec l’Eglise réformée, la<br />
Maison du jardin et la Médiathèque, réunions avec la mairie et les associations de quartier …<br />
52
4. Eléments de réflexivité sur le stage<br />
Avant de s’intéresser aux travaux préparatoires menés en vue de l’évaluation de l’utilité sociale de<br />
<strong>Baraka</strong>, je prends le temps d’un retour réflexif sur cette expérience professionnelle et faire le bilan du<br />
cheminement intellectuel parcouru depuis quelques mois.<br />
4.1. « Dé formatage »<br />
Mes 14 années d’expérience professionnelle dans des entreprises du secteur privé ont transformé<br />
mon rapport au temps, aux gens, à la performance. Tout allait très vite, les actions ne visaient que<br />
du court terme (rarement plus de quelques mois). Tout était réduit aux évaluations économiques :<br />
quel chiffre d’affaires réalisé ? Combien de clients ? Quelle progression de panier moyen ? Des<br />
données qualitatives étaient prises en compte (nouvelle recrue, absence, contexte particulier d’une<br />
équipe) mais cela ne pouvait être valable que sur une période courte. Le langage utilisé dans ces<br />
activités dominées par l’économique était celui du profit, de la performance, de la productivité, de<br />
la rentabilité.<br />
Intégrer une entreprise de l’économie sociale et solidaire, c’est intégrer les valeurs qu’elle promeut<br />
non seulement dans les résultats recherchés mais aussi dans les moyens mis en place. C’est<br />
prendre en compte, au quotidien, les externalités positives et négatives que l’activité va dégager,<br />
c’est rompre dans son quotidien avec le langage de l’économique, et les valeurs (par exemple de<br />
réussite individuelle, de compétition, de vainqueur) qu’il met lui aussi en avant.<br />
Pour cela, il a fallu que je me détache de mon référentiel de performance, de mon échelle de<br />
valeurs basée essentiellement sur des représentations quantitatives et économiques. C’est grisant<br />
d’accueillir 70 couverts dès les premiers jours de l’ouverture, mais quel coût pour l’équipe qui est<br />
en souffrance par le stress dégagé ?<br />
Le temps est une donnée capitale dans ce nouveau rapport aux choses. Ayant pris confiance trop<br />
rapidement, j’ai voulu accélérer la formation d’Aurore et Fatima (les serveuses). Dès le 4 ème jour,<br />
j’ai changé la répartition des salles pour qu’elles sachent s’adapter à chaque niveau. Ce fut le jeudi<br />
noir : des clients mécontents et une équipe effondrée. Je suis allée trop vite. Ce ne fut pas la seule<br />
raison de l’échec de ce service mais elle y a contribué. Prendre le temps de former, le temps de<br />
prendre confiance. Et quand il y a du temps supplémentaire, pourquoi faire « plus » plutôt que<br />
« mieux » ?<br />
Cela rejoint la réflexion, d’ordre macro-économique, de Jean Gadrey sur l’importance de passer<br />
d’une croissance quantitative à une croissance qualitative 85 . Et ce « dé formatage » d’une<br />
croissance quantitative va être long. Il s’agit de passer d’une performance économique à une<br />
performance sociale intégrant un objectif plus large que le quantitatif et l’économique. Là aussi,<br />
l’évaluation de la « fabrique de biens communs » peut être un bon contrepoids.<br />
85 GADREY Jean, Adieu à la croissance, Alternatives Economiques, 2010<br />
53
4.2. Coopération<br />
Travailler dans une structure comme <strong>Baraka</strong>, c’est évoluer d’un mode basé sur la compétition et la<br />
méfiance à un mode de coopération.<br />
La gouvernance est un bon outil pour s’approprier ce mode de fonctionnement coopératif : savoir<br />
se taire pour laisser parler l’autre, accepter son point de vue, échanger, débattre, trouver un<br />
compromis.<br />
Mais la coopération, c’est aussi réinventer les relations interprofessionnelles, réintégrer la<br />
confiance. J’ai été extrêmement surprise qu’on me laisse gérer les caisses sans contrôle aucun<br />
alors que je n’étais dans l’équipe que depuis 15 jours. Chose impensable dans les structures où<br />
j’ai pu travailler.<br />
C’est dans cet état d’esprit que s’est construit le binôme gérant-adjointe. Le sens et la finalité de<br />
<strong>Baraka</strong> dépassent tout intérêt individuel et toute recherche de pouvoir. S’accaparer une partie du<br />
projet c’est le dénaturer dans sa vocation. Cela a permis de créer une relation de confiance entre<br />
Pierre Wolf et moi, jouant sur la complémentarité. La volonté de construire une intelligence<br />
collective et de partager l’expérience acquise n’a fait que renforcer notre coopération.<br />
Ce n’est pas non plus le monde des « bisounours », il y a des contrats, des règles, un cadre, tant<br />
en interne qu’en externe. Il y a des échecs de collaboration comme avec la société qui nous a<br />
fourni le logiciel caisse : nous avons fait un état des lieux et réglé la partie concernant le travail<br />
fourni. De même avec les salariés que la coopérative n’a pu maintenir à leur poste suite au<br />
sinistre. <strong>Baraka</strong> les a rémunérés un mois supplémentaire puis les a accompagnés et suivis dans<br />
leurs démarches de recherche d’emploi.<br />
Mais l’approche sera toujours dans un objectif de coopération : comment faire pour que les deux<br />
parties ressortent plus « riches » (pas seulement monétairement) de la relation ? Il s’agit d’avoir<br />
conscience de la divergence d’intérêts et de chercher à satisfaire son intérêt sans que ce soit au<br />
détriment de l’autre.<br />
Cette logique de collaboration à petite échelle comme à grande échelle est la base de la<br />
production de biens communs. C’est une nécessité d’autant plus forte lorsque cela concerne les<br />
ressources limitées. Selon la théorie des communs de Garrett Hardin (1968) : s’il y a compétition, il<br />
y a surexploitation puis disparition de ces ressources. Les communs doivent être gérés par la<br />
cohésion sociale et la recherche d’accords et non par l’accaparement des uns au détriment des<br />
autres<br />
54
PARTIE 3 - Evaluer l’utilité sociale d’une structure<br />
Comme nous l’avons vu précédemment, l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> a l’avantage de<br />
mettre en valeur sa production de biens et services non marchands (« fabrique de biens communs »).<br />
Ma mission n’ayant pu arriver à son terme à cause du sinistre, l’objectif de cette partie est de<br />
capitaliser sur le travail préparatoire que j’ai pu effectuer au cours de mon stage. La présentation et<br />
l’analyse des informations récoltées au travers des entretiens et de mes observations pratiques<br />
pourront servir de base de travail pour une évaluation à venir. Elles pourront aussi être un terreau pour<br />
définir précisément et développer la finalité, ou, dans le lexique de la coopérative, déterminer « les<br />
biens communs » à produire. Enfin, en vue de montrer la complexité de l’évaluation d’une utilité<br />
sociale, nous nous intéresserons plus particulièrement aux travaux relatifs aux chantiers participatifs.<br />
Mais dans un premier temps, afin de cerner les enjeux de cette démarche, nous aborderons<br />
l’évaluation dans son cadre général, les incidences qui en découlent et les méthodes actuelles<br />
pratiquées.<br />
1. Evaluer son utilité sociale<br />
L’économie sociale et solidaire est aujourd’hui évaluée à l’aune de ses capacités et de ses<br />
contributions économiques : nombre d’établissements, nombre d’emplois, « plus-value » économique<br />
ou rapport coût-résultat… Cela lui a permis de sortir de l’ombre et a contribué à la reconnaissance de<br />
son existence comme « secteur » ou tout du moins, comme partie non négligeable de l’économie 86 .<br />
Mais ces approches traditionnelles d’évaluation excluent souvent les contributions autres<br />
qu’économiques. Pour le dire autrement, il est demandé à l’économie sociale et solidaire d’être<br />
évaluée selon les grilles de l’économique, alors même qu’elle vise à produire « autre chose », et que<br />
sa plus-value de type sociale, sociétale est peu visible.<br />
Evaluer l’utilité sociale engage à repenser l’ensemble de la démarche et particulièrement à redéfinir les<br />
conventions socio-politiques 87 sur lesquelles reposent les représentations collectives de cette plus<br />
value. Définir ce qu’on évalue et comment on l’évalue vient à décider de ce qui compte et ce qui ne<br />
compte pas, c’est en quelque sorte émettre un jugement et décider de ce qui est richesse et de ce qui<br />
ne l’est pas. Il faut donc remettre au cœur de la démarche d’évaluation son fondement politique 88 .<br />
L’évaluation pose deux défis. Le premier est de définir ce qu’on évalue. Or, nous l’avons vu<br />
précédemment, l’utilité sociale reste une notion floue. Il faut tenir compte de ses particularités :<br />
- elle n’est pas standardisable et est singulière à chaque organisation ;<br />
- elle est multidimensionnelle (Cf. Les cinq dimensions selon Gadrey en partie 2) ;<br />
- elle s’inscrit à la fois dans les résultats et dans les processus et les moyens mis en œuvre<br />
pour atteindre les objectifs.<br />
86 L’ESS représente 14% des emplois du secteur privé en France. Source Atlas commenté de l'économie sociale et solidaire,<br />
sous la direction de François Rousseau, Juris associations, 2012<br />
Dalloz<br />
87 On entendra par convention socio-politique une croyance partagée par les acteurs concernés.<br />
88 BOUCHARD Marie J., Op. Cit.<br />
55
Le deuxième défi est de construire les indicateurs qui permettront son évaluation. Les critères<br />
traduisent les valeurs auxquelles on se réfère et les indicateurs en sont les instruments de mesure. La<br />
quête d’indicateurs n’est pas une fin en soi, et nos entretiens semi-directifs montrent une certaine<br />
défiance de certains acteurs à l’égard de la quantification de cette plus value sociale et<br />
environnementale du projet de <strong>Baraka</strong>. Dans le même temps, rendre compte sur l’activité, en<br />
particulier auprès des organismes qui en ont assuré une partie du financement n’apparaît pas comme<br />
une activité totalement futile.<br />
L’élaboration des indicateurs est néanmoins une tâche complexe et délicate car, à chaque étape, des<br />
choix sont à opérer : comment mesurer le lien social créé ? Par le nombre de relations? Par le temps<br />
consacré qui y est consacré ? Par la récurrence et la pérennité de la relation dans le temps ? ou peut-<br />
être par les trois ?<br />
De la même manière qu’il n’y a pas de définition universelle de l’utilité sociale, les indicateurs proposés<br />
peuvent présenter une certaine pertinence pour la structure en particulier, mais peuvent ne pas être<br />
partagés par d’autres organisations. Une partie de leur légitimité peut être gagnée par le recours à une<br />
méthodologie reconnue par les parties concernées, voire par la participation de ces parties prenantes.<br />
Idéalement, la construction doit être collective et intégrer toutes les parties prenantes. C’est par la<br />
confrontation d’intérêts divergents que l’évaluation assurera sa crédibilité.<br />
Dans ces conditions, l’évaluation peut accéder au rang d’outil de démocratisation de l’économie et<br />
apparaître comme un moment fort de la gouvernance 89 . Par cette interaction, l’évaluation intègre le<br />
processus de production d’utilité sociale dans sa dimension politique 90 et devient elle-même émettrice<br />
de plus-value sociale.<br />
Avant de commencer une évaluation, il faut tenir compte de deux éléments qui vont influencer la<br />
démarche :<br />
- le commanditaire de l’évaluation : la démarche ne sera pas la même si elle vient des<br />
partenaires (souvent financiers) ou de l’interne. Dans le premier cas, l’objectif sera<br />
généralement de justifier l’impact de l’utilisation des fonds. Dans le deuxième, la structure<br />
cherchera à connaître l’impact de ses actions et à repérer les bonnes pratiques dans une<br />
démarche de progrès ;<br />
- la période où elle est réalisée : si la structure est à un moment stratégique de son histoire<br />
ou lorsque le contexte évolue (changements de financeurs, de besoins … ), on s’orientera<br />
sur une évaluation ex-ante à vocation exploratoire. Dans ce cas, l’évaluation aidera au<br />
choix d’objectifs et pour la planification des activités. Si la démarche intervient en cours de<br />
projet ou à sa réalisation, l’objectif sera d’en mesurer ses impacts. C’est une évaluation ex-<br />
post.<br />
Il est déterminant de bien définir en amont de l’évaluation les usages qu’il en sera fait car selon le<br />
contexte, les destinataires ou l’emploi, une même donnée pourra être interprétée différemment.<br />
89 Ibid<br />
90 Dimension politique dans le sens de l’Avise : l’innovation, la fonction d’aiguillon, le renforcement de l’esprit critique, la<br />
promotion des valeurs d’intérêt général<br />
56
1.1. Les avantages de la démarche d’évaluation<br />
La démarche d’évaluation réinterroge le projet, ses finalités et ses valeurs.<br />
En interne, elle permet de réaffirmer le projet de la structure et de participer à la cohésion interne.<br />
C’est aussi un gain de connaissances qui offre l’opportunité d’améliorer ses activités et ses<br />
pratiques. L’évaluation devient un outil de régulation interne.<br />
En externe, elle permet une meilleure visibilité des spécificités de la structure et est un outil de<br />
communication. En intégrant les partenaires dans la démarche, c’est aussi une occasion de faire<br />
évoluer les relations que la structure entretient avec eux. Une co-construction faite en amont d’un<br />
projet permettrait de faire évoluer une relation tutélaire entre un financeur et une organisation en<br />
une relation partenariale.<br />
1.2. Les inconvénients et risques de la démarche d’évaluation<br />
Tout d’abord l’ampleur du travail supposé exige une importante mise à disposition de temps et de<br />
moyens au sein de la structure. La durée du processus d’évaluation peut prendre de six à douze<br />
mois et nécessite de nombreuses réunions et récoltes d’informations. Pour un bon déroulement, il<br />
faut nommer un coordinateur. Cet ensemble de conditions représente un coût pour la structure.<br />
Deuxième élément, pour aboutir, elle doit être portée par les responsables politiques de<br />
l’organisation et requiert une motivation et la mobilisation des ressources en interne comme en<br />
externe importante. Mal expliquée, elle peut être perçue comme un moyen de contrôle au sens<br />
répressif du terme et non comme une démarche de progrès.<br />
En troisième lieu, les risques de l’évaluation viennent de la tâche délicate de construction des<br />
critères et indicateurs qui valoriseront les différentes dimensions de l’utilité sociale. Le processus<br />
de récolte des données peut devenir trop lourd. La tendance pourrait être de parcelliser les<br />
activités et de ne pas réussir à mettre en valeur les interactions qu’elles ont entre elles. Mais les<br />
risques concernent aussi la possible instrumentalisation des résultats, par l’une ou l’autre des<br />
parties prenantes : savoir raison garder au-delà de cet exercice apparaît important.<br />
Enfin, face à la « quantophrénie » actuelle (c'est-à-dire à l’excès de quantification), il peut y avoir<br />
un effet pervers de sclérose des comportements et de l’action où l’indicateur deviendrait un objectif<br />
en soi et non plus un outil.<br />
57
1.3. Les méthodes d’évaluation<br />
De nombreuses méthodes d’évaluation sont proposées tant par des organismes privés (Avise,<br />
ESSEC …) que par des organismes publics (Société Française d’évaluation, Association des<br />
Régions de France …) et parfois par une co-production entre ces organismes.<br />
Ces différentes méthodes se rejoignent dans l’importance portée à l’implication des parties<br />
prenantes dans la démarche ainsi que sur les différentes étapes à suivre dans la construction de la<br />
démarche : définir de l’utilité sociale de la structure et de ses dimensions ; définir les critères de<br />
chaque dimension ; construire les indicateurs quantitatifs et les indices qualitatifs qui permettront<br />
leur mesure ; récolter les données.<br />
Les divergences vont essentiellement porter sur les méthodes de mesure et l’étendue du champ<br />
d’évaluation. Par exemple, pour cette dernière, les organismes publics vont avoir tendance à<br />
inclure dans l’évaluation la performance des actions et la notion de coûts investis dans la<br />
structure 91 . Or l’utilité sociale peut aussi être considérée par certains acteurs comme hors du<br />
champ économique, sans qu’il puisse en être rendu compte par le biais de valeurs économiques.<br />
Concernant les méthodes de mesures et plus spécifiquement les indicateurs, les divergences<br />
viennent de la manière de les construire (quantitatif versus qualitatif) et de les agréger pour n’en<br />
faire qu’un indicateur global permettant une lecture et une comparaison plus aisée. A titre<br />
d’exemple, le SROI (Retour Social sur Investissement) 92 propose une monétarisation des<br />
indicateurs calibrés pour les systèmes comptables et financiers. Tel un compte d’exploitation<br />
intégrant charges et produits pour en calculer le profit ou la perte de l’activité, il s’agit de donner<br />
une valeur monétaire aux « productions sociales » de la structure pour la comparer aux coûts et<br />
calculer la valeur dégagée. Cela a l’avantage d’encourager les politiques publiques à investir sur<br />
des actions à long terme au vu des « recettes » sociales qu’elles pourront dégager. A contrario,<br />
cela concentre l’analyse sur le résultat chiffré obtenu ou à obtenir plutôt que sur les processus et<br />
les actions à mener pour améliorer ou développer la structure. En outre, les méthodes SROI<br />
reposent sur des conventions et des arbitrages qui sont discutables.<br />
91 Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale qui prend en compte les heures consacrées à la médiation et<br />
évalue le coût d’un service de médiation.<br />
92 Méthode britannique relayée en France par l’ESSEC<br />
58
2. L’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong><br />
2.1. La méthodologie de l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong><br />
Dans un objectif de capitalisation, je m’attache à présenter, dans cette partie, la démarche d’auto-<br />
évaluation telle que je l’avais prévue. En effet, l’incendie ayant eu lieu à peine un mois après le<br />
début de mon stage, je n’ai pu mener à terme l’évaluation.<br />
N’ayant que six mois pour cette mission, ma priorité fut de planifier les différentes étapes. J’ai<br />
structuré mon travail autour de deux phases :<br />
- une première phase exploratoire de 3 mois qui avait pour objectif l’appropriation du projet.<br />
Y étaient intégrés une immersion opérationnelle, les entretiens semi-directifs 93 , une<br />
enquête quantitative et une documentation sur les évaluations menées dans d’autres<br />
structures ;<br />
- Une deuxième phase de construction de 3 mois où, avec la constitution d’une commission,<br />
l’objectif aurait été l’établissement d’un référentiel et d’indicateurs ainsi qu’un début de<br />
prospection des données.<br />
2.1.1. La phase exploratoire<br />
Les entretiens semi-directifs s’adressaient dans un 1 er temps aux sociétaires. Sur la base de<br />
huit questions 94 , mon objectif était de :<br />
- cerner les valeurs de <strong>Baraka</strong> les plus importantes pour les sociétaires grâce aux<br />
questions sur leur histoire avec la coopérative et leur manière de la présenter ;<br />
- appréhender leur approche de la notion de l’utilité sociale et d’éventuels indicateurs.<br />
La deuxième série d’entretiens semi-directifs autour des mêmes thèmes 95 devait concerner les<br />
parties prenantes. Je désigne par ce terme l’ensemble des partenaires externes à la<br />
coopérative qui ont contribué à la réalisation du projet. Je les ai regroupés en cinq catégories :<br />
- les salariés non sociétaires ;<br />
- les usagers non sociétaires : les voisins, les clients, les bénéficiaires de la « fabrique<br />
de biens communs » ;<br />
- les prestataires intervenus lors de la construction et de l’exploitation ;<br />
- les collectivités territoriales : Mairie de Roubaix, Conseil Régional et LMCU ;<br />
- Les financeurs : fondations et banques.<br />
L’enquête quantitative fut administrée auprès des stagiaires des chantiers participatifs. Elle<br />
avait deux objectifs. Le 1er, officiel, était d’évaluer l’impact des chantiers. Le 2 ème , en filigrane,<br />
était d’obtenir une appréciation des usagers sur une action de la coopérative et de nourrir les<br />
travaux préparatoires à l’évaluation de l’utilité sociale. Nous verrons les détails et les résultats<br />
de cette enquête en dernière partie.<br />
93 Technique qui permet de centrer les discours des interrogés autour de thèmes prédéfinis dans une grille. Les résultats<br />
obtenus permettent une analyse à la fois quantitative et qualitative des réponses.<br />
94 Annexe 2 – Grille d’entretiens semi-directifs sociétaires<br />
95 Annexe 3 – Grille d’entretiens semi-directifs parties prenantes<br />
59
2.1.2. La phase de construction de l’évaluation<br />
Plusieurs étapes étaient prévues initialement dans la construction de l’évaluation :<br />
- Une réunion avec les sociétaires de présentation des résultats de la phase<br />
exploratoire : synthèse des entretiens semi-directif, résultats de l’enquête quantitative,<br />
prémices d’une définition de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> et pistes d’indicateurs<br />
d’évaluation ;<br />
- La création d’une commission d’évaluation de l’utilité sociale comprenant les<br />
sociétaires volontaires et les parties prenantes ;<br />
- Une session de travail avec la commission pour définir l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> ;<br />
- Une session de travail pour définir les critères et les indicateurs d’évaluation tout en<br />
précisant les conventions mises en place et leurs limites ;<br />
- Une 1 ère récolte de données pour tester la qualité des indicateurs retenus.<br />
2.1.3. Eléments de réflexivité sur la démarche<br />
Du fait du sinistre, je n’ai réalisé que les entretiens semi-directifs et l’enquête quantitative.<br />
Mener les entretiens a été un travail passionnant. Ce fut une très bonne entré en matière.<br />
L’outil m’a permis de découvrir l’organisation dans son ensemble et les enjeux qu’elle porte. La<br />
richesse des informations récoltées offre une bonne base de travail pour alimenter une future<br />
réflexion sur l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong>. La mobilisation des méthodes des sciences sociales<br />
(entretiens semi-directifs) permet de croiser les points de vue, permet aussi de laisser le<br />
langage de chacun s’exprimer. Indirectement, cela enrichit la confrontation des points de vue,<br />
et donne de l’épaisseur à l’observation.<br />
L’enquête quantitative a été très utile pour la capitalisation des perceptions des stagiaires.<br />
Malgré les 10 mois écoulés entre les chantiers et la période d’administration du questionnaire,<br />
88% 96 ont répondu et les souvenirs de l’expérience vécue étaient encore très présents.<br />
Avec du recul, je n’aurais pu tenir les délais prévus. Je n’avais pas suffisamment pris en<br />
compte deux éléments du contexte dans lequel la démarche a été lancée. D’une part, les<br />
sociétaires n’étaient pas vraiment demandeurs même si certains financeurs auraient pu l’être<br />
par la suite, ce fut une opportunité plutôt provoquée par l’Université. Il n’y avait pas de volonté<br />
politique affichée de mener une évaluation. Cela m’aurait demandé un fort investissement de<br />
mobilisation des équipes. D’autre part, la période à laquelle j’ai démarré ma mission apportait<br />
une complexité supplémentaire mais qui aurait rendu le débat d’autant plus intéressant.<br />
<strong>Baraka</strong> était à une étape charnière entre l’aboutissement de la construction du bâtiment et le<br />
96 Enquête quantitative sur les chantiers participatifs réalisée par nos soins en juillet 2012<br />
60
lancement de l’activité. Il aurait fallu intégrer 97 un travail préalable pour définir les objectifs de<br />
l’évaluation : qu’évalue-t-on ? Pour qui et pourquoi l’évalue-t-on ?<br />
Plusieurs types d’évaluation se présentaient :<br />
- Une évaluation à vocation de communication externe : évaluer ce qui a été réalisé en<br />
vue de communiquer auprès des partenaires actuels et futurs, des usagers, des<br />
bénéficiaires … Cela aurait participé à la consolidation du projet ;<br />
- une évaluation à vocation de cohésion interne: définir l’utilité sociale qui sera produite<br />
grâce à l’exploitation du bâtiment et préparer les indicateurs qui permettront de<br />
l’évaluer au fil du temps. Cela aurait servi de base de travail au lancement de la<br />
« fabrique de biens communs ».<br />
2.2. Travaux préparatoires : les entretiens semi-directifs<br />
2.2.1. Le processus<br />
Les neuf entretiens auprès des sociétaires ont été réalisés sur le mois de mars 2012. Chaque<br />
catégorie de sociétaires de la SCIC était représentée :<br />
- Un représentant de « l’Univers », membre fondateur personne morale ;<br />
- un salarié sociétaire ;<br />
- deux sociétaires fondateurs ;<br />
- quatre sociétaires de la catégorie « fournisseurs et financeurs solidaires » ;<br />
- un usager.<br />
Les sociétaires ont bien accueilli la démarche et ils y ont consacré du temps généreusement.<br />
Les entretiens ont été réalisés en face à face et ont duré entre une et deux heures.<br />
4 entretiens semi-directifs ont été menés auprès des parties prenantes au cours de l’été 2012.<br />
Ils ont été réalisés par téléphone et n’ont duré que 20 à 30 minutes. Ont été interrogés :<br />
- un élu de la municipalité de Roubaix ;<br />
- un chargé de mission d’une collectivité territoriale spécialisé dans les affaires de<br />
l’ESS ;<br />
- un chef d’entreprise ayant participé à la construction du bâtiment mais n’appartenant<br />
pas au monde de l’économie sociale et solidaire ;<br />
- un salarié non sociétaire.<br />
La méthode d’analyse des entretiens est une analyse à contenu thématique. L’objectif est<br />
d’examiner l’ensemble des données pour en dégager les convergences, les divergences et de<br />
97 Etape qui n’était pas prévue sur le planning initial.<br />
61
«mettre en évidence les représentations sociales ou les jugements des locuteurs à partir d’un<br />
examen de certains éléments constitutifs du discours » 98 .<br />
2.2.2. Les limites de la technique d’entretiens semi-directifs<br />
La démarche présente de vraies limites en terme d’exigence scientifique. La première raison<br />
est un manque de rigueur personnelle. Cela s’est traduit par une irrégularité dans la<br />
formulation de certaines questions, voire des omissions notamment sur la question « En quoi<br />
<strong>Baraka</strong> a-t-elle une utilité sociale et une contribution environnementale ? ».<br />
En deuxième lieu, les énoncés des questions contenaient un vocabulaire pour des personnes<br />
initiées à la notion d’évaluation et d’utilité sociale. Cela a mis en difficulté quelques uns des<br />
interrogés. Une formulation plus accessible aurait permis des réponses plus nourries en<br />
particulier sur les indicateurs et les contributions sociales et environnementales de <strong>Baraka</strong>. Par<br />
exemple, la question « En quoi <strong>Baraka</strong> a-t-elle une utilité sociale et une contribution<br />
environnementale ? » aurait pu être « Qu’a produit la fabrique de biens communs jusqu’à<br />
présent ? ».<br />
La démarche a été beaucoup plus succincte auprès des parties prenantes et a fait preuve de<br />
plus de fiabilité avec un meilleur respect des questions et de la structure de l’entretien.<br />
L’ensemble des entretiens des sociétaires ont été administrés en vis à vis et entièrement<br />
retranscrits. Les entretiens des parties prenantes ont été effectués par téléphone et n’ont donc<br />
pu être enregistrés. Ils sont donc limités à ma prise de notes.<br />
Il s’agit, ici, d’en présenter une synthèse et de la mettre en perspective de la question de<br />
l’évaluation de l’utilité sociale. Cette synthèse passe par le tamis de l’examinateur, en d’autres<br />
termes, est soumise à mon interprétation.<br />
2.2.3. Synthèse et analyse transversale des entretiens semi-directifs<br />
La lecture et l’analyse transversale des entretiens semi-directifs permettent de mettre en avant<br />
la finalité de <strong>Baraka</strong> et les 4 dimensions qui prévalent dans le projet. C’est aussi l’occasion de<br />
tester l’appropriation de la notion d’utilité sociale par les sociétaires et les parties prenantes.<br />
2.2.3.1. Une finalité commune<br />
Les champs d’intervention de la coopérative étant nombreux, c’est par l’agrégation de<br />
l’ensemble des propos des sociétaires que l’on obtient un schéma global, les grandes<br />
98 QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 2006<br />
62
lignes de ce qu’est et de ce que sera <strong>Baraka</strong>. A partir des éléments clés énoncés par<br />
chaque interrogé sur les différents thèmes 99 , il apparaît :<br />
- une finalité commune : faire de <strong>Baraka</strong> un lieu de foisonnement, d’échanges,<br />
d’échanges de savoirs, un lieu d’activités non marchandes, faire de <strong>Baraka</strong> un<br />
terreau d’initiatives ;<br />
- quatre dimensions où la coopérative se réalisera : l’environnement, le vivre-<br />
ensemble, la relation au territoire et l’économique.<br />
T 1 - Les 4 dimensions de la coopérative <strong>Baraka</strong><br />
Dimensions Ce qu’est <strong>Baraka</strong> Ce que sera <strong>Baraka</strong><br />
L’environnement<br />
Le vivre-ensemble<br />
L’ancrage territorial<br />
L’économique<br />
- un bâtiment écolo<br />
- une restauration « bio » et<br />
locale<br />
- un groupement de sociétaires<br />
- les chantiers participatifs<br />
- les soirées A voix haute à la<br />
maison<br />
- un état d’esprit où le collectif<br />
prime sur l’intérêt individuel<br />
- le renouveau d’une dent<br />
creuse, d’un délaissé urbain,<br />
d’un espace public en jachère<br />
- des créations d’emplois<br />
- l’emploi de personnes issues<br />
d’un parcours d’insertion à<br />
« l’Univers »<br />
- des jardins, des ruches<br />
- des ateliers d’initiation à<br />
l’agriculture urbaine<br />
- mieux manger dans un lieu sain<br />
et atypique<br />
- un lieu de foisonnement, de<br />
rencontres, de partage, de<br />
convivialité, de liberté<br />
- un lieu pour faire du lien social<br />
- un lieu de diversité sociale, la<br />
mixité<br />
- un lieu de débats<br />
- tout le monde peut participer,<br />
appartient à tout le monde<br />
- un terreau d’initiatives<br />
- le lien avec le quartier<br />
- un lieu accessible à tous<br />
- une réussite dans un quartier<br />
difficile<br />
- des emplois pérennes et de<br />
qualité<br />
- une activité économique qui est<br />
le prétexte à créer autre chose<br />
De ces quatre dimensions, trois représentent les grands champs d’actions de l’activité non<br />
marchande, la « fabrique de biens communs ».<br />
Il est intéressant d’observer comment les parties prenantes perçoivent la finalité et les<br />
dimensions de <strong>Baraka</strong>. A partir des éléments récoltés lors des entretiens 100 , il apparaît<br />
nettement la prise en compte des dimensions, économique, environnementale et territoriale de<br />
la coopérative. Ils ont une certaine facilité à donner des exemples concrets de production<br />
d’utilité sociale dans ces dimensions. A contrario, l’exercice est plus difficile pour la dimension<br />
« vivre-ensemble ». La finalité de faire de <strong>Baraka</strong> un terreau d’initiatives, un lieu de vie 101 est<br />
une évidence pour chacun mais la difficulté est dans la capacité à illustrer la réalisation de ce<br />
vivre-ensemble. Cela peut s’expliquer par la subjectivité de cette dimension difficilement<br />
99 Annexe 4 – Synthèse des entretiens semi-directifs des sociétaires<br />
100 Annexe 5 – Synthèse des entretiens semi-directifs des parties prenantes<br />
101 Ce constat reste à modérer car seules 4 partenaires ont été interrogés.<br />
63
matérialisable et par le fonctionnement de la coopérative qui construit sa « fabrique de biens<br />
communs » au fil de l’eau, selon les rencontres et les opportunités qui se présentent..<br />
A des fins de cohérence du projet avec son territoire, ses usagers et ses partenaires, il sera<br />
nécessaire d’approfondir la question. Ce pourrait être dans un premier temps, lors de<br />
prochaines rencontres entre les sociétaires et les partenaires d’en comprendre les raisons :<br />
est-ce par désintérêt ou par méconnaissance ? Ou est-ce simplement parce qu’ils ne se<br />
sentent pas concernés par ce vivre-ensemble ? Et dans un deuxième temps, de valider et<br />
construire cette dimension avec les bénéficiaires.<br />
2.2.3.2. L’utilité sociale, une notion méconnue<br />
Que ce soit pour les sociétaires ou pour les partenaires, aborder la notion d’utilité sociale<br />
rompt la fluidité de l’échange et le flux généreux d’informations obtenu sur les thèmes<br />
précédents. Pour 4 d’entre eux, cette notion est inconnue. 4 interrogés considèrent que<br />
dès qu’il y a activité économique et humaine, il y a utilité sociale : « Quand on crée de<br />
l’activité, on crée de l’utilité sociale. Quand on crée de la relation, on crée de l’utilité<br />
sociale » (ESD 8) 102 .<br />
« Un resto, par essence, ça répond à une utilité sociale qui est celle de manger, de se<br />
retrouver autour d’une table et de se rencontrer » ESD 6.<br />
Pris à la lettre, cette traduction du terme est juste. Une activité est utile à la société par les<br />
emplois qu’elle crée ou par les liens sociaux développés. Cette confusion montre combien<br />
la notion d’utilité sociale telle qu’elle est abordée par l’économie sociale et solidaire et par<br />
les pouvoirs publics est une convention socio-politique récente et méconnue du « grand<br />
public ». La définition proposée par J. Gadrey est un pré-requis indispensable avant tout<br />
débat sur la définition de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong>.<br />
Définition de l’utilité sociale selon Jean Gadrey 103 :<br />
Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale et solidaire qui a pour<br />
résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs<br />
éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de<br />
contribuer :<br />
- à la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de<br />
nouveaux droits ;<br />
- à la solidarité (nationale, internationale, ou locale : le lien social de proximité) et à la<br />
sociabilité ;<br />
- à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable, dont font<br />
partie l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, et la démocratie.<br />
102 Pour raison d’anonymat, nous signalerons les paroles des interrogés selon le numéro de leur entretien. ESD 1 à 9 pour les<br />
sociétaires, et ESD 10 à 13 pour les parties prenantes.<br />
103 Op. cit.<br />
64
Ce pré-requis suppose l’adhésion au principe de différenciation entre les structures de<br />
l’ESS et celles du secteur privé. Or il n’est pas accepté par tous les sociétaires : « dire on<br />
est dans l’ESS, on se ghettoïse par rapport à quelque chose » (ESD 8).<br />
Les autres ne la définissent pas pour autant mais reconnaissent son existence soit comme<br />
une transcription de l’intérêt général soit en considérant simplement que c’est « la raison<br />
d’existence » (ESD 3) de <strong>Baraka</strong>. Seul, un des partenaires s’accorde à donner deux<br />
conditions pour qu’il y ait utilité sociale : « la contingence à un territoire et l’attention portée<br />
aux publics en difficulté » (ESD 13). On retrouve dans cette dernière remarque l’approche<br />
que portent les pouvoirs publics sur l’utilité sociale par une restriction des publics<br />
bénéficiaires à une population défavorisée.<br />
Dans la coopérative, le concept de « biens communs » circule plus que celui d’utilité<br />
sociale, comme si, dans <strong>Baraka</strong>, il est plus important de faire ensemble que de « prouver »<br />
son utilité, fut-elle sociale, ou environnementale. On retrouve là des réflexions menées par<br />
Alain Caillé dans son mouvement MAUSS (mouvement anti-utilitariste en sciences<br />
sociales).<br />
2.2.3.3. Les indicateurs : quelques pistes<br />
Deux interrogés (un partenaire et un sociétaire) sont réticents à la question des<br />
indicateurs : il est nécessaire de « sortir des logiques d’indicateurs qui empêchent de<br />
réfléchir » (ESD 2). Ils sont partisans d’indices qualitatifs pour « écrire les choses dans<br />
leur complexité » (ESD 2).<br />
De la même manière que la dimension la plus détaillée est celle du vivre-ensemble, c’est<br />
dans celle-ci qu’il y a eu le plus de propositions d’indicateurs.<br />
La dimension environnementale prend, dans la définition de <strong>Baraka</strong> 104 , une place<br />
importante du fait de l’édification d’un bâtiment qui a demandé des investissements<br />
financiers et temporel considérables. Les ambitions portées par la construction sont<br />
nombreuses : stockage carbone, économie d’énergie, biodiversité, qualité de l’air, origine<br />
locale des matériaux … Or, les indicateurs concernant l’évaluation de la dimension<br />
environnementale n’ont été proposés que par 2 des 13 interrogés.<br />
104 Les termes « bâtiment écolo » a été cité par 9 des 13 interrogés.<br />
65
T 2 - Exemples d'indicateurs d'évaluation de l'utilité sociale de <strong>Baraka</strong><br />
Dimensions Critères Indicateurs quantitatifs Indices qualitatifs<br />
L’environnement<br />
Le vivre-ensemble<br />
L’ancrage territorial<br />
L’économique<br />
- les coûts<br />
environnementaux<br />
évités<br />
- la sensibilisation à<br />
la protection de<br />
l’environnement<br />
- l’économie d’énergie réalisée<br />
- la distance moyenne<br />
d’origine des achats<br />
- le taux d’ingrédients issus de<br />
l’agriculture biologique<br />
- le foisonnement - la fréquentation par activité<br />
non marchande<br />
- la fidélité des usagers :<br />
moyenne de passages par<br />
usager sur une durée<br />
- vivacité du<br />
sociétariat<br />
- le faire-ensemble,<br />
le collectif<br />
déterminée<br />
- taux de présence aux<br />
réunions et AG<br />
- taux de pouvoirs attribués<br />
- le nombre de sociétaires<br />
composant le noyau dur<br />
- nombre de personnes<br />
participant aux réunions sur<br />
les biens communs<br />
- le taux de transformation des<br />
idées en actions<br />
- le taux d’exemplarité =<br />
nombre d’initiatives / nombre<br />
de participants<br />
- taux de roubaisiens parmi les<br />
usagers<br />
- L’emploi - nombre d’emplois créés<br />
- nombre d’embauche de<br />
personnes issues de parcours<br />
d’insertion<br />
- turn over ou pérennité des<br />
salariés sur leur poste<br />
- contreparties retirées des<br />
clients : sensibilité à<br />
l’écologie, à manger sain …<br />
- la capacité à débattre et à<br />
reconnaître les divergences<br />
- la qualité des débats<br />
- écrire l’histoire des<br />
chantiers participatifs,<br />
raconter les échanges que<br />
cela a occasionnés<br />
- paroles d’usagers :<br />
l’appréciation d’avoir un<br />
bâtiment tel que <strong>Baraka</strong><br />
dans leur quartier<br />
- indice de bien-être des<br />
salariés<br />
66
Conclusion de ce travail exploratoire<br />
La synthèse des entretiens semi-directifs de cette phase exploratoire a servi de terreau lors de<br />
la réunion de lancement de la « fabrique de biens communs ». Telle une régulation interne,<br />
elle a servi d’axe pour garantir la cohérence du projet à un moment charnière où les<br />
sociétaires devaient définir les actions et moyens à mettre en place pour réaliser l’objet de la<br />
coopérative.<br />
Deux éléments ont été mis en valeur au travers de ces entretiens : l’importance du débat pour<br />
définir l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> et la question des indicateurs d’évaluation.<br />
Concernant la définition de l’utilité sociale, il s’agira dans un 1 er temps de confronter les<br />
notions d’utilité sociale et de biens communs pour valider ou non si, pour les sociétaires, cela a<br />
la même signification et couvre les mêmes dimensions et critères. Dans un 2 ème temps, il<br />
faudra réfléchir à la manière d’intégrer les usagers et les habitants du quartier (que la<br />
coopérative envisage comme futurs usagers) dans la démarche d’évaluation. L’enjeu est de<br />
confronter ce que les sociétaires souhaitent et pensent produire comme biens communs à ce<br />
que veulent et ce que perçoivent les bénéficiaires. Comme le souligne un sociétaire, il ne faut<br />
pas « penser le bonheur à la place des gens » (ESD 2). Cependant, cette bonne intention<br />
d’impliquer les bénéficiaires n’est pas simple. Il faut prendre en compte la difficulté pour des<br />
personnes exclues de la société, du monde du travail, pour des personnes âgées, pour des<br />
enfants … de participer à des réunions publiques, prendre la parole en public 105 . Il est<br />
conseillé d’aller au devant de ces populations, sur leurs lieux d’activités. Enfin, la<br />
méconnaissance de certains termes et de certaines notions implique de réfléchir à une<br />
méthode pour assurer la compréhension et la participation de tous.<br />
Comme l’ont soulevée deux des interrogés, la question des indicateurs d’évaluation porte en<br />
1 er lieu sur l’arbitrage entre indicateurs quantitatifs et indices qualitatifs. L’a priori courant est<br />
de croire qu’un indicateur quantitatif sera la meilleure « preuve » dans une évaluation car un<br />
chiffre serait objectif et indiscutable. Or, il faut prendre en compte trois éléments :<br />
- tout chiffre est discutable car il dépend d’un référentiel et de conventions socio-<br />
politiques qui sont des zones de débats. Exemple : le nombre de chômeurs dépend<br />
de la définition de « chômeur ». Malgré la norme du Bureau International du Travail<br />
universalisant cette notion 106 , les écarts de calcul sont nombreux entre les Etats. Elle<br />
varie selon l’interprétation qu’en a faite chaque nation. La valeur d’objectivité reste<br />
toute relative ;<br />
- il n’est pas garanti qu’un chiffre soit plus convaincant que des témoignages ou<br />
descriptions d’actions. Est-ce le nombre de participants à une manifestation qui<br />
prime ou les échanges dont chacun se sera enrichi?<br />
105 CAILLE Alain, Op. Cit.<br />
106 Selon le BIT, un chômeur est une personne sans emploi, disponible pour travailler et recherchant activement un emploi.<br />
67
- Compter certaines choses, c’est prendre le risque de les appauvrir. Il y a d’une part<br />
le risque de se focaliser sur la recherche d’indicateurs quantitatifs et d’orienter<br />
l’action, les moyens pour faciliter la mesure. D’autre part, compter peut dénaturer<br />
l’action. On peut prendre comme exemple, le temps dédié à la coopérative par les<br />
sociétaires. L’ensemble des interrogés n’ont pas compté leurs heures : « un bien<br />
donné n’a plus de goût, tu l’as donné, tu l’as donné … Je n’ai pas compté mes<br />
heures » (ESD 8). La valeur qui est portée par ce « bénévolat » 107 n’est pas dans la<br />
quantité octroyée mais dans l’acte en lui-même. Son objectif rejoint la notion de don<br />
comme l’expression du besoin de l’individu à se relier à la société au-delà du simple<br />
échange de biens et services. Par sa triple obligation de donner – recevoir – rendre,<br />
le don est le ferment du lien social 108 .<br />
107<br />
Même s’il ne fait pas l’unanimité comme j’ai pu le constater dans les entretiens semi-directifs, nous utiliserons ce vocable<br />
pour simplifier le texte.<br />
108<br />
CAILLE Alain, Don, intérêt, désintéressement. Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, La Découverte, 1994<br />
68
3. Les chantiers participatifs : essai d’évaluation des impacts<br />
Les chantiers participatifs ayant eu lieu entre septembre et novembre 2010, il était important de<br />
capitaliser sur cette expérience originale pour le Nord-Pas de Calais 109 . J’ai donc mené une étude<br />
rapide et synthétique de ces chantiers malgré l’arrêt de ma mission initiale d’évaluation de l’utilité<br />
sociale de <strong>Baraka</strong>.<br />
Ce travail a un double objectif : agréger les retours d’expérience des différentes parties prenantes et<br />
donner la parole aux premiers usagers de la coopérative.<br />
Les éléments récoltés pourront servir de terreau pour développer d’autres expériences telles que celle-<br />
ci.<br />
3.1. La méthode mobilisée pour l’étude des chantiers participatifs<br />
L’étude des chantiers participatifs s’est déroulée sur la période estivale, de juin à août 2012. Elle<br />
s’est basée sur une série d’entretiens non directifs, les documents de planification de l’opération,<br />
les bilans des organisateurs, la convention signée avec le FSE et une enquête quantitative<br />
administrée auprès des stagiaires.<br />
Les entretiens non directifs ont été menés auprès de personnes plus ou moins impliquées dans les<br />
chantiers. Les profils choisis étaient très complémentaires. Cela m’a permis d’en avoir une vision<br />
globale et de cerner leurs enjeux. Nous pouvons les classer en deux catégories :<br />
1) Des personnes clés :<br />
- Jérémy Gaudin, chargé de mission « Chantiers Participatifs » pour SPL qui a monté<br />
le dossier FSE et organisé les 12 semaines de chantier ;<br />
- Frédéric Rojas, chef de chantier indépendant qui avait la mission de formateur ;<br />
- Michelle Fargeon, sociétaire de <strong>Baraka</strong>, animatrice des chantiers pour la<br />
coopérative.<br />
2) Des personnes « annexes » :<br />
- Manon Hartmans, stagiaire « permanente » ;<br />
- Pierre Gaudin, responsable construction de SPL (à l’époque) ;<br />
- Valérie Devestel, chef de services SISEP 110 et Eric Gronencheld des Papillons<br />
Blancs.<br />
L’enquête quantitative, comme nous le verrons plus tard, a été menée dans l’intention d’évaluer<br />
les résultats des chantiers participatifs sur les stagiaires. Elle fut aussi l’occasion d’échanger<br />
librement avec les usagers et de récolter leur parole.<br />
Les ambitions de cette approche mixte étaient de valoriser puis confronter les points de vue et<br />
appréciations de chacune des parties prenantes (porteurs de projet, initiateurs, financeurs et<br />
109 Les chantiers partagés ou d’auto-construction sont une pratique qui connaît beaucoup de succès dans l’ouest de la France. A<br />
contrario, ce serait une des 1ères initiatives de ce genre sur la région du Nord-Pas de Calais.<br />
http://chantiersparticipatifs.xooit.fr/index.php et http://www.botmobil.org/realisations<br />
110 Service d’Insertion Sociale et Professionnelle des Papillons Blancs (association d’aide aux personnes handicapés)<br />
69
surtout usagers) et de mettre en parallèle les objectifs de chaque acteur avec les résultats<br />
constatés.<br />
Le grand laps de temps entre les chantiers et l’étude est à la fois un frein et un atout. Un frein car<br />
les souvenirs s’étiolent et la mémoire devient sélective, d’autant plus que la durée des stages<br />
n’était que de 5 jours et que l’enquête a été menée 10 mois après. Mais aussi un atout car la prise<br />
de recul en est d’autant plus forte. Nous verrons que malgré ces dix mois passés et la courte<br />
durée des stages, l’expérience a fortement marqué les stagiaires qui en garde un souvenir vif.<br />
3.2. Les chantiers participatifs : un processus de construction original<br />
Les chantiers participatifs sont fondés sur le principe de l’échange : une formation qualifiante est<br />
proposée contre une participation du stagiaire au chantier. C’est une pratique répandue dans le<br />
domaine de la construction écologique qui a l’avantage de promouvoir les techniques d’auto-<br />
construction.<br />
En règle générale, les chantiers s’organisent dans le respect d’un certain nombre de valeurs :<br />
construire tout en préservant l’environnement et la santé, faire des chantiers des lieux d’échanges,<br />
promouvoir l’entraide et le partage de savoir 111 .<br />
Dans l’histoire de la coopérative, l’idée d’initier des chantiers participatifs émerge dès les<br />
premières réunions entre le gérant et l’architecte, fin 2008. Ce système de construction est en<br />
complète cohérence avec les valeurs portées par la coopérative <strong>Baraka</strong> et le groupe Chênelet,<br />
partenaire principal dans la conception et construction du bâtiment. Ce dernier sera<br />
officiellement 112 porteur de l’expérience. Deux éléments le justifient :<br />
- SPL, la filiale de Chênelet est le prestataire principal dédié à la construction bois. Il est<br />
judicieux que le groupe prenne en charge l’organisation et la responsabilité des chantiers<br />
participatifs pour assurer la cohérence d’ensemble de la construction ;<br />
- la convention avec le FSE exige un co-financement. La coopérative sera le co-financeur<br />
des chantiers.<br />
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt 113 , ce n’est pas SPL qui est missionnée sur la formation des<br />
stagiaires mais un consultant externe, partenaire fidèle de la structure depuis de nombreuses<br />
années : Frédéric Rojas. Cette organisation, grâce à la bonne connaissance des acteurs entre<br />
eux, permet une coordination optimale entre le chantier mené par SPL et les lots réalisés par les<br />
chantiers participatifs.<br />
111 Charte des chantiers participatifs « Compaillons » - http://module.la-bdis.org/structure-1786.html<br />
112 Convention FSE – Annexe 6<br />
113 Article 8 de la convention<br />
70
3.2.1. Le mécanisme opérationnel<br />
Les chantiers se sont déroulés sur 12 semaines entre septembre et novembre 2010. Ils<br />
proposaient 6 modules de formation de 4 à 5 jours (soit 30h) chacun :<br />
1) la fabrication de mobilier et d’éléments de jardin pour la toiture-terrasse dans le<br />
cadre d’un atelier menuiserie. Ce module s’est déroulé sur le site d’activité de<br />
Chênelet Développement (Landrethun le Nord – Pas de Calais) ;<br />
2) l’isolation paille du bâtiment ;<br />
3) l’insufflation ouate de cellulose pour l’isolation du bâtiment ;<br />
4) la pose d’enduits naturels ;<br />
5) la pose de bardage bois non traité ;<br />
6) l’installation et la pose de la terrasse et du mobilier de jardin.<br />
Chaque module combinait une formation théorique, une mise en pratique, un débriefing et une<br />
remise de diplôme. La formation se voulait complète avec une partie sur les consignes de<br />
sécurité, d’utilisation du matériel, de fonctionnement de l’équipe et l’autre partie sur les<br />
techniques d’éco-construction, les produits et matériaux.<br />
Pour compléter la démarche et présenter les enjeux de l’éco-construction, il était prévu une<br />
visite d’un des sites de Chênelet Construction à Loos en Gohelle. Mais cette initiative n’a pu se<br />
réaliser que pour le premier groupe à cause des retards pris sur le chantier.<br />
3.2.2. Le financement des chantiers<br />
Organiser des chantiers participatifs représente un coût pour la structure car cela nécessite de<br />
prévoir un encadrement spécifique, des matériaux, des outils supplémentaires et un<br />
équipement de sécurité pour les participants. La contribution des stagiaires à la construction<br />
ne compense qu’en partie ce surcoût. Il n’y a pas eu d’étude économique spécifique mais les<br />
plannings en sont déjà un signe : pour chaque module, était prévu entre 2,5 à 4 fois le temps<br />
de travail d’un professionnel.<br />
C’est l’occasion pour la coopérative de trouver un financement spécifique. Elle va solliciter le<br />
Fonds Social Européen (FSE) par l’intermédiaire de la mairie de Roubaix.<br />
Le FSE est l’un des trois fonds structurels de l’Union Européenne dont la mission consiste à<br />
réduire les écarts de développement et à renforcer la cohésion économique et sociale entre<br />
pays et régions de l’Union européenne 114 . Il finance les projets qui oeuvrent pour l’emploi dans<br />
des contextes soumis aux fortes mutations économiques et les projets qui ont pour objet la<br />
lutte contre la discrimination et le développement durable.<br />
114 http://www.fse.gouv.fr/qu-est-ce-que-le-fse/le-fse-en-quelques-mots/presentation-generale-du-fse-en/article/presentation-<br />
generale-du-fse-en<br />
71
L’association Chênelet Développement a construit sa demande de subvention autour de lutte<br />
contre la discrimination en zone urbaine sensible (ZUS) 115 . L’objectif est de proposer des<br />
stages de formation aux techniques d’éco-construction et d’auto-construction pour les<br />
habitants de la ZUS de Roubaix.<br />
Le budget global pour une vingtaine de modules de formation de 30h est de 85.170€. 69% de<br />
cette somme sont dédiés à la rémunération des formateurs. Le financement se fait à hauteur<br />
de 50% pris en charge par le FSE et 50% assumés par la coopérative.<br />
3.2.3. Le recrutement des stagiaires<br />
Les 21 modules réalisés ont permis de former 69 stagiaires. Chaque groupe comprenait<br />
maximum 5 stagiaires et avait un formateur.<br />
Le recrutement des participants a représenté un travail considérable dans le déroulement des<br />
chantiers. Ce sont Pierre Wolf, Michelle Fargeon et Annie Leuridan, sociétaires de la<br />
coopérative, qui ont pris en charge cette mission à titre de bénévolat. L’enjeu était d’avoir le<br />
nombre suffisant de stagiaires en temps et en heure sur le chantier avec un dossier<br />
administratif complet (assurance, convention tripartite stagiaire-Chênelet-FSE signée).<br />
Or, une des conditions de la convention FSE concernait le profil des participants aux chantiers.<br />
L’engagement était de former 40 stagiaires habitant la zone urbaine sensible (ZUS) de<br />
Roubaix.<br />
La principale problématique fut de prendre contact avec les habitants de la ZUS pour leur<br />
proposer de participer aux chantiers. Les sociétaires ont sollicité la MIE (maison d’emploi du<br />
roubaisis), les Papillons Blancs et des associations d’insertion comme l’Imm’pact. Elles ont mis<br />
en place de nombreuses actions de communication : réunions d’information, tractage dans les<br />
rues adjacentes au bâtiment, bouche à oreille, site internet de la coopérative et réseaux des<br />
formations spécialisées en éco-construction. Les seules contraintes dans la sélection furent la<br />
priorité donnée aux habitants de la ZUS et une condition physique minimale pour pouvoir<br />
travailler sur un chantier.<br />
Les partenariats avec les acteurs ont porté leurs fruits pour la plupart d’entre eux. L’école de la<br />
2 ème chance avait inscrit 10 jeunes mais seulement 2 d’entre eux ont participé à un module<br />
dans son intégralité. 3 s’étaient désistés suite à une embauche dans une entreprise, les autres<br />
pour des raisons inconnues.<br />
Les animateurs de la MIE ont été très investis dans le recrutement mais ont connu aussi des<br />
désistements : 3 des 7 inscrits ont participé au stage.<br />
115 selon les mesures 3 et sous mesure 2 du programme Compétitivité régionale et emploi du FSE pour la période 2007-2013.<br />
72
L’Imm’pact quant à elle a donné l’opportunité à 3 des personnes qu’elle accompagne de suivre<br />
la formation proposée sur les chantiers.<br />
Enfin, en ce qui concerne les Papillons Blancs, 4 déficients mentaux ont pu participer aux<br />
chantiers par leur intermédiaire. Du fait de la particularité de leur public, il est intéressant de<br />
s’étendre un peu plus sur cette démarche singulière. C’est une sociétaire de <strong>Baraka</strong>, mère<br />
d’une enfant handicapée, qui a eu l’idée de solliciter les Papillons Blancs. Et réciproquement,<br />
c’est parce qu’il y avait les chantiers participatifs que cette même personne est devenue<br />
sociétaire.<br />
Ouvrir les stages à leurs usagers fut immédiatement très bien accueilli par les responsables<br />
des ateliers d’insertion du Sisep. Cela concordait avec leur volonté de faire travailler le plus<br />
possible les handicapés dans un cadre de droit commun afin de « les confronter à une autre<br />
réalité » 116 . La structure les accompagne essentiellement sur le savoir-être (ponctualité,<br />
concentration, précision, respect des consignes …) que sur un savoir-faire en particulier. Elle<br />
développe une certaine polyvalence en les missionnant sur l’ensemble de leurs secteurs<br />
d’activité : espaces verts, peinture, et entretien. Le recrutement pour les chantiers participatifs<br />
s’est fait sur la base du volontariat après une réunion de présentation. Cinq jeunes handicapés<br />
suivront 1 ou 2 modules sur les chantiers de <strong>Baraka</strong>.<br />
Grâce à cette diversité de contacts, les chantiers ont bénéficié à une population très mixte :<br />
roubaisiens ou non, déficients mentaux, sociétaires et/ou salariés de la coopérative, étudiants,<br />
chômeurs, salariés ou entrepreneurs, sans formation, ingénieur ou architecte, français,<br />
étrangers ou immigrés, jeunes, seniors, femmes et hommes 117 .<br />
Figure 5 - Répartition des stagiaires par sexe et par âge<br />
N = 69 - Bilan des chantiers participatifs - Février 2012<br />
116 Valérie Devestel, chef de service Sisep – juillet 2012<br />
117 Les critères de minorités et migrants sont renseignés sur déclaration des stagiaires.<br />
73
Figure 6 - Répartition des stagiaires par critère d’exclusion et situation d’emploi<br />
N=69 - Bilan des chantiers participatifs - Février 2012<br />
Sur les 104 inscrits, 72 ont confirmé leur inscription, 4 ont arrêté au cours de la 1 ère journée et<br />
3 se sont désistés.<br />
3.3. Les objectifs et enjeux des chantiers participatifs<br />
Cette opération a nécessité un engagement soutenu des organisateurs et la mise en place de<br />
moyens importants. Elle n’a pas facilité la tâche de la coopérative et du groupe Chênelet : il aurait<br />
été plus simple et plus rapide de réaliser la construction de manière traditionnelle par des<br />
professionnels. Devant ce choix particulier fait par les sociétaires de <strong>Baraka</strong> et accepté par les<br />
dirigeants de Chênelet, il est intéressant d’étudier quels objectifs étaient poursuivis à travers ces<br />
chantiers pour chaque acteur.<br />
3.3.1. Les objectifs selon la convention FSE<br />
Les chantiers participatifs s’inscrivent dans le cadre du programme opérationnel<br />
« Compétitivité régionale et emploi » de la Politique Cohésion économique et sociale de<br />
l’Europe. Ce programme se décline en 4 mesures, toutes en faveur de l’emploi.<br />
La convention entre Chênelet Développement et le FSE vise la sous-mesure 2 « Agir en<br />
faveur des habitants des zones urbaines sensibles » dans le cadre de la lutte contre les<br />
discriminations (mesure 3 de l’axe 3 du programme). Cette mesure fait suite au constat des<br />
chances d’accès à l’emploi significativement plus faibles pour les populations migrantes et les<br />
jeunes issus de parents immigrés et ce, quel que soit le niveau de qualification 118 . Dans ce<br />
118 Programme opérationnel national du Fonds Social Européen « Compétitivité régionale et emploi », période 2007-2013.<br />
74
cadre, le FSE co-finance toute action de formation et de professionnalisation ou facilitant la<br />
création d’emplois d’utilité sociale et collective dans ces quartiers en difficulté.<br />
Les destinataires de cette mesure sont prioritairement les demandeurs d’emploi, les jeunes et<br />
notamment ceux issus de parents d’immigrés ainsi que les bénéficiaires des minima sociaux.<br />
D’autre part, dans une volonté de lutte contre les discriminations, «aucun pré-requis technique<br />
ou physique (en dehors de certaines incapacités physiques rédhibitoires) ne sera attendu des<br />
participants. » 119<br />
Le contexte et la cible des actions étant posés, les chantiers participatifs ont pour objet de :<br />
- contribuer à la cohésion sociale du quartier par la participation des habitants. Dans la<br />
mesure où le bâtiment portera aussi cet objectif, il y aura une continuité dans cette<br />
action à vocation citoyenne ;<br />
- permettre l’initiation des personnes à l’éco-construction et l’auto-construction. Dans un<br />
contexte de « fracture écologique » où les mesures d’économie d’énergie sont<br />
inaccessibles aux plus démunis, ces chantiers favorisent des solutions alternatives :<br />
entraide et techniques pour la rénovation des logements individuels ;<br />
- susciter des vocations professionnelles : les métiers du bâtiment sont peu attractifs<br />
(éprouvants, peu rémunérateurs et mal considérés). L’éco-construction offre de<br />
nouvelles perspectives par les matériaux sains et faciles à mettre en œuvre. Elle ouvre<br />
à la polyvalence et à une perception plus globale du chantier ce qui redonne sens et<br />
attrait à l’acte de construire. Par cette approche, elle peut séduire des personnes en<br />
reconversion, sans qualification et rendre ces métiers plus accessibles aux femmes.<br />
Au-delà des objectifs affichés dans le programme et la convention, il est intéressant d’étudier<br />
les indicateurs demandés par la FSE pour obtenir le versement du solde de la subvention.<br />
Deux types d’indicateurs sont à renseigner :<br />
- les indicateurs de réalisation qui présentent le profil des participants selon les critères<br />
de sexe, d’âge, de statut sur le marché de l’emploi, de vulnérabilité (minorités,<br />
migrants, personnes handicapées …), de catégorie socio-professionnelle et de<br />
bénéficiaires de minima sociaux ou de contrats aidés ;<br />
- les indicateurs de résultat qui classent par typologie les situations des participants à<br />
l’issue de l’opération : création d’activité, accès à un emploi (quel type d’emploi), accès<br />
à une formation et les issues négatives (rupture ou abandon).<br />
D’autres indicateurs de résultat sont demandés : taux de survie à 3 ans des entreprises<br />
créées, taux de sortie durable 18 mois après l’inscription … Or dans le cas des chantiers<br />
participatifs, l’opération étant ponctuelle et sur une durée très courte de 12 semaines, le bilan<br />
sera envoyé bien avant les délais nécessaires pour cette quantification.<br />
119 Dossier de demande de subvention FSE déposé par l’association Chênelet Développement<br />
75
En résumé, les objectifs du FSE sont de deux ordres : toucher les publics en difficulté des ZUS<br />
et les amener à une situation plus proche de l’emploi à l’issue de la formation.<br />
3.3.2. Les enjeux et objectifs de la coopérative <strong>Baraka</strong><br />
Intégrer des chantiers participatifs est une belle opportunité pour remplir son objet dès la<br />
construction du bâtiment : créer du lien social, de la convivialité, du vivre-ensemble, du travail<br />
et de participer à la réinvention d’une façon d’habiter et de vivre la planète 120 . L’objectif<br />
principal est de réunir sur un même chantier des publics différents et de leur permettre de<br />
créer du lien à travers un travail commun.<br />
Le deuxième enjeu est de s’ouvrir au quartier et à ses habitants afin d’éviter que le bâtiment ne<br />
soit un « îlot de bobos » 121 . Même s’il y a déjà trente roubaisiens au sein de la coopérative au<br />
moment de l’opération, il s’agit de toucher ceux en situation d’exclusion. C’est une manière de<br />
dynamiser ce territoire défavorisé, de créer une dynamique de quartier et d’implication les<br />
habitants dans la réalisation de ce bâtiment à vocation d’animation citoyenne. La coopérative<br />
espère par ce biais favoriser l’appropriation du lieu par la population du quartier.<br />
Comme objectifs secondaires, ces chantiers ont pour vocation :<br />
- de permettre à une population modeste d’accéder aux techniques d’économie<br />
d’énergie alors que celles-ci sont inaccessibles sur le marché ;<br />
- de sensibiliser les participants à la protection de l’environnement ;<br />
- d’offrir une formation qualifiante à une population en difficulté professionnelle ;<br />
- d’offrir une expérience d’auto-construction et de travail d’équipe qui favoriseront<br />
l’estime de soi.<br />
Enfin, à un niveau plus matériel, ces chantiers permettent la prise en charge d’une partie du<br />
coût du bâtiment grâce au financement du FSE.<br />
3.3.3. Les enjeux et objectifs pour le groupe Chênelet<br />
L’association Chênelet Développement a pour objectif de favoriser toute initiative en faveur de<br />
la réinsertion, de la qualification professionnelle et de l’emploi de personnes en situation socio-<br />
économique précaire. Ses domaines de prédilection sont l’éco-construction sociale et solidaire<br />
et la souveraineté alimentaire.<br />
Dans ce contexte, les chantiers participatifs offrent une belle opportunité d’innovation dans les<br />
manières de travailler tout en restant dans la continuité de l’insertion.<br />
120 Statuts de la coopérative <strong>Baraka</strong><br />
121 Echanges avec le gérant – Le terme bobos est un diminutif de Bourgeois-Bohèmes qui vise à désigner un groupe social<br />
formé sur des valeurs partagées proche de la gauche écologiste.<br />
76
L’association recherche à travers cette opération à :<br />
- redonner une nouvelle image aux métiers du bâtiment par la polyvalence et la qualité<br />
des matières travaillées dans l’éco construction. Les besoins dans ces métiers dans le<br />
secteur particulier de l’éco-construction sont importants ;<br />
- promouvoir l’éco-construction et l’auto-rénovation des logements ;<br />
- promouvoir ses techniques spécifiques à base de paille, de bois, de terre ;<br />
- tester de nouvelles techniques telles que les enduits à base de terre.<br />
Enfin, les chantiers sont dans la continuité du partenariat mis en place avec la coopérative<br />
<strong>Baraka</strong> et permettent de confirmer le partage des valeurs entre les deux entités.<br />
Cet état de fait montre que les trois parties prenantes des chantiers ont en objectif commun la<br />
composition du public destinataire et la promotion de l’éco-construction. Dans cette 2 ème étape,<br />
nous allons tenter d’évaluer l’atteinte de ces objectifs et de confronter les résultats à<br />
l’appréciation des principaux concernés : les participants.<br />
3.4. L’évaluation des impacts des chantiers participatifs<br />
Comme nous l’avons vu précédemment, l’étape préalable à toute évaluation est de définir l’usage<br />
que l’on souhaite en faire et qui en sont les destinataires. Dans le cas spécifique des chantiers<br />
participatifs, nous ne pouvons pas réellement parler d’évaluation des impacts mais plutôt d’une<br />
approche évaluative dans le sens où elle intervient très tardivement (10 mois) après l’opération. De<br />
plus, je l’ai menée à ma propre initiative et de manière unilatérale, sans débat avec les parties<br />
prenantes pour en définir les critères et les indicateurs.<br />
Cette démarche a deux objectifs :<br />
- capitaliser sur les chantiers participatifs en vue de reproduire éventuellement<br />
l’expérience au sein de la coopérative ou du groupe Chênelet ;<br />
- mettre en exergue la difficulté à évaluer certains impacts et l’atteinte de certains objectifs<br />
initiaux.<br />
Par conséquent, ces travaux sont à destination de la coopérative <strong>Baraka</strong> et du groupe Chênelet<br />
pour compléter la monographie et offrir un bilan le plus complet possible de ces chantiers<br />
participatifs. Ce bilan leur appartient. A eux d’en décider l’utilisation possible : intégrer un bilan<br />
d’activités, mettre en valeur une partie de leur utilité sociale notamment vis à vis de leurs<br />
partenaires, justifier la subvention du FSE (si tel en était la demande) reconduire l’expérience en<br />
intégrant une démarche de progrès …<br />
77
3.4.1. La méthodologie de l’enquête quantitative<br />
L’objectif de cette enquête est d’évaluer les impacts des stages effectués lors des chantiers<br />
participatifs sur les participants en fonction des objectifs que s’étaient donnés les<br />
organisateurs.<br />
Deux éléments clés sont à prendre en compte dans la construction de cette enquête :<br />
- la période tardive de réalisation (10 mois après le déroulement des chantiers) alors<br />
que les stages n’ont duré, pour la majorité des participants, que 30h sur 5 jours ;<br />
- la mixité des stagiaires et principalement l’handicap mental de 5 d’entre eux. Il était<br />
impératif que les questions soient accessibles à tous.<br />
3.4.1.1. L’échantillonnage<br />
La population mère est constituée des 69 personnes ayant participé aux chantiers sachant<br />
que 4 d’entre elles ont abandonné après la 1 ère journée pour des raisons inconnues.<br />
L’échantillon est composé des participants ayant pu être joints et ayant bien voulu<br />
répondre aux questions.<br />
Le mode principal d’administration choisi est le téléphone. La représentativité de<br />
l’échantillon dépend de ma capacité à joindre les participants et de leur bon vouloir à me<br />
répondre, je contrôlerai la représentativité de l’échantillon obtenu par le calcul du KHI2 sur<br />
les deux critères cités précédemment.<br />
3.4.1.2. La construction des questionnaires 122<br />
Ayant déjà toutes les informations relatives au profil du stagiaire, j’ai structuré mon<br />
questionnaire en 3 groupes de questions :<br />
- un groupe de questions pour affiner leur profil : âge, durée du stage et module(s)<br />
effectué(s), intérêt porté à l’écologie ;<br />
- un groupe de questions sur l’appréciation de la formation suivie ;<br />
- un groupe de questions sur les effets perçus du stage.<br />
La principale difficulté était d’avoir des questions pertinentes pour obtenir une bonne<br />
qualité d’informations, succinctes car posées par téléphone et accessibles à tous les<br />
stagiaires quelque soit leur niveau intellectuel et/ou de formation. Par exemple, il est paru<br />
que « construire soi-même » de la question Q5 était plus accessible que la notion<br />
d’ « auto-construction ». Pour la question Q10 « depuis le stage, vous intéressez-vous<br />
122 Cf. annexe 7 – Questionnaire de satisfaction des chantiers participatifs 2011<br />
78
(plus, autant, moins, toujours pas) à l’écologie », certains stagiaires ont eu du mal à<br />
répondre car ils avaient des difficultés à déceler une évolution dans le temps.<br />
Le questionnaire a été soumis au gérant qui a souhaité modifier la question Q4 trouvant le<br />
vocable « astuces » réducteur et peu professionnel. Il a été complété par le terme<br />
« techniques ». Il a aussi demandé à rajouter l’item « Participer à un projet collectif<br />
comme <strong>Baraka</strong> » pour la question Q8. Nous verrons par la suite à quel point ce fut une<br />
bonne chose.<br />
Je l’ai soumis aussi aux responsables des Papillons Blancs pour valider l’accessibilité des<br />
questions aux stagiaires déficients mentaux. Aucun changement n’a été fait. Sur leur<br />
conseil, il a été convenu d’une part qu’ils préviendraient les personnes concernées de<br />
l’enquête afin de ne pas occasionner de stress inutile et d’autre part que l’administration<br />
des questionnaires se ferait en face à face.<br />
Enfin il a été testé auprès de 2 stagiaires faisant partie du projet <strong>Baraka</strong> (un salarié et un<br />
sociétaire). A la suite de ce test, a été rajoutée la question Q6 « Quelle est votre<br />
sensibilité personnelle à l’écologie ? ». La formulation « pendant les pauses » dans les<br />
réponses proposées de la question Q8 a été supprimée car elle pouvait être perçue de<br />
manière péjorative. Une question ouverte a été rajoutée afin de laisser la libre expression<br />
aux enquêtés dû au côté innovant de l’expérience.<br />
3.4.1.3. L’administration du questionnaire<br />
Elle s’est déroulée entre le 9 et le 25 juillet 2012. Elle a été principalement mais pas<br />
exclusivement réalisée par téléphone. Sur les 69 participants, 51 ont été interrogés par ce<br />
mode là mais 4 ont arrêté l’entretien car ils n’avaient assisté qu’à une demi-journée de<br />
stage.<br />
Les 4 répondants rattachés à la structure du Sisep ont répondu lors d’un entretien en face<br />
à face. 2 autres enquêtés ont procédé par mail car ils se trouvaient à l’étranger ce qui<br />
induisait un coût important d’administration. 12 n’ont pas été joignables.<br />
L’inconvénient majeur du support téléphonique est la durée du questionnaire.<br />
Généralement on ne va pas au delà d'une durée de 15 minutes, sauf si le répondant a été<br />
prévenu (prise de rendez vous) et si sa motivation est assez grande vis à vis du sujet<br />
traité. Dans ce cas présent, le temps d’administration était d’environ 10 minutes.<br />
De même, ne pouvant soumettre de stimuli visuel à l’enquêté, les questions doivent être<br />
synthétiques et les choix de réponses aussi. Or, pour la question Q8, l’enquêté devait<br />
sélectionner 3 critères parmi les 7 propositions. Il aurait fallu scinder la question en 2 pour<br />
leur faciliter la tâche.<br />
79
Administrer par téléphone m’a permis de saisir en direct les informations obtenues dans<br />
ma base de données et de compléter le questionnaire par des informations<br />
complémentaires lors d’échanges libres.<br />
L’accueil des stagiaires a été dans l’ensemble très positif. Les enquêtés étaient, pour la<br />
plupart, facilement disponibles et loquaces. Dans le cas où je laissais un message, ils me<br />
rappelaient rapidement.<br />
3.4.1.3. Les limites de l’enquête<br />
- le mode d’administration par téléphone empêche l’anonymat des répondants.<br />
Conjugué à la faible taille de l’échantillon et au lien de certains avec la coopérative, il<br />
est envisageable que quelques enquêtés aient modéré leurs propos pour « protéger »<br />
<strong>Baraka</strong> : « c’est gênant de faire des critiques en tant que sociétaire » (parole<br />
d’enquêté) ;<br />
- certains enquêtés ayant été très satisfaits des stages au point de s’être « attachés »<br />
affectivement au projet, ils ne souhaitaient pas émettre de critiques et avaient peur de<br />
porter préjudice aux formateurs.<br />
- la durée des stages ayant été très réduite, l’appréciation sur la qualité de<br />
l’apprentissage (Q5) est à modérer, d’autant que nous n’avons pas le niveau des<br />
stagiaires avant la formation ;<br />
- les explications que j’ai dû apporter pour certains administrés dont le niveau de<br />
compréhension était très faible, ont interféré sur leurs réponses. L’une des personnes<br />
handicapées a dû être assistée dans ses réponses par son entourage ;<br />
- la taille réduite de l’échantillon ne pourra permettre de généraliser les réponses<br />
obtenues.<br />
80
3.4.2. L’analyse des résultats<br />
Au cours de cette analyse, nous tenterons d’évaluer à quel degré les objectifs fixés par chacun<br />
des partenaires ont été atteints. Nous nous appuierons à la fois sur les résultats de l’enquête<br />
quantitative et sur les propos récoltés auprès des parties prenantes.<br />
3.4.2.1. Le profil des stagiaires<br />
Pour la coopérative et le FSE, le 1 er objectif était de donner accès aux chantiers à la<br />
population habitante de la zone urbaine sensible de Roubaix . L’objectif (fixé lors de la<br />
demande de subvention du FSE) de 40 participants issus de la ZUS de Roubaix a été<br />
atteint. Ils représentent plus de la moitié des participants (58%).<br />
Figure 7 - Répartition des participants par zone géographique<br />
N=69 - Bilan des chantiers participatifs – février 2012<br />
En 2 ème lieu, les 3 acteurs ouvraient les chantiers à une population défavorisée. Le FSE<br />
entend par « défavorisées », les personnes ayant un ou plusieurs critères de<br />
discrimination ou porteurs d’exclusion : migrants 123 , appartenance à une minorité,<br />
handicap, bénéficiaires des minima sociaux. Lors des chantiers, 46% des stagiaires<br />
présentent un critère de discrimination.<br />
T 3 - Répartition des participants par zone géographique et critère d'exclusion<br />
Avec critère<br />
d'exclusion<br />
Sans critère<br />
d'exclusion<br />
Total<br />
Roubaix ZUS 29% 29% 58%<br />
Hors ZUS 17% 25% 42%<br />
TOTAL 46% 54% 100%<br />
N=69 - Bilan des chantiers participatifs – février 2012<br />
123 Le FSE entend par « migrants » les personnes de nationalité nées à l’étranger et résidant en France.<br />
81
Parmi eux, on constate une quasi égale répartition entre les différents critères. Il s’avère<br />
que les 8 personnes appartenant à la catégorie « autres critères d’exclusion », le sont en<br />
tant que bénéficiaires des minima sociaux.<br />
N=69 - Bilan des chantiers participatifs – février 2012<br />
Un autre angle pour déterminer si une population est en difficulté est de prendre en<br />
considération le statut des personnes vis à vis de l’emploi. Il apparaît une proportion<br />
équivalente de demandeurs d’emploi et d’actifs (39% chacun) au sein des stagiaires des<br />
chantiers.<br />
Figure 8 - Répartition des participants selon les critères d'exclusion<br />
Figure 9 - Répartition des participants selon leur statut sur le<br />
marché de l'emploi<br />
N=69 - Bilan des chantiers participatifs – février 2012<br />
Enfin, la place faite aux femmes, jeunes et seniors est aussi un élément important dans la<br />
politique européenne de lutte contre la discrimination et dans les valeurs de la<br />
coopérative. Comme on peut constater sur la figure 4 (p73) que 19 femmes ont participé<br />
82
aux chantiers, soit plus d’1/4 des effectifs. Cette donnée est d’autant plus appréciable que<br />
les femmes ne représentent, en France, pas plus de 1,66% des ouvriers du bâtiment 124 .<br />
En termes d’âge, la répartition offre une belle diversité même si les seniors sont les moins<br />
représentés (12%).<br />
T 4 - Répartition des participants par tranche d'âge<br />
Nombre Pourcentage<br />
De 15 à 24 ans 16 23%<br />
De 25 à 44 ans 31 45%<br />
De 45 à 54 ans 14 20%<br />
De 55 à 64 ans 8 12%<br />
TOTAL 69 100%<br />
N=69 - Bilan des chantiers participatifs – février 2012<br />
Enfin, les chantiers ayant une forte connotation écologique, il a été demandé aux<br />
stagiaires quel intérêt ils portaient à la question. Il s’avère que l’écologie est une valeur<br />
forte pour plus d’un participant sur deux.<br />
T 5 - Intérêt porté à l'écologie par les participants<br />
Nombre Pourcentage<br />
Beaucoup 31 58%<br />
Un peu 13 25%<br />
Faiblement 8 15%<br />
Pas du tout 1 2%<br />
TOTAL 53 100%<br />
Q2 – Vous intéressez-vous à l’écologie ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
Ces différentes données confirment une véritable mixité des stagiaires sur tous les plans.<br />
Nous verrons plus loin comment elle a été perçue par les participants eux-mêmes et les<br />
organisateurs et le rôle qu’elle a tenu au cours de ces 12 semaines de chantiers.<br />
3.4.2.2. L’initiation à l’éco-construction et l’auto-construction<br />
124 GALLIOZ Stéphanie, « Force physique et féminisation des métiers du bâtiment », Travail, genre et sociétés 2/2006 (N° 16), p.<br />
97-114<br />
83
La durée très courte des stages augure d’une initiation plutôt que d’une formation aux<br />
techniques d’éco-construction et d’auto-construction : 66% des participants ont fait un<br />
stage d’une semaine seulement.<br />
T 6 - Nombre de participants selon la durée de leur stage<br />
Nombre Pourcentage<br />
Entre 1 et 5 jours 35 66%<br />
Entre 6 et 10 jours 14 26%<br />
Entre 10 et 15 jours 2 4%<br />
+ de 15 jours 2 4%<br />
Q4 – Combien de temps a duré votre stage ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
TOTAL 53 100%<br />
L’appréciation des stagiaires sur la qualité des formations est globalement très bonne.<br />
L’apprentissage des consignes de sécurité, de l’utilisation de nouveaux matériaux et des<br />
techniques d’éco-construction ont été évaluées bonnes à très bonnes par plus de 92%<br />
des stagiaires.<br />
T 7 - Evaluation de la qualité des apprentissages par les stagiaires<br />
Très bon Bon <strong>Mo</strong>yen Insuffisant NSP Total<br />
L'éveil musculaire 43% 43% 6% 8% 100%<br />
Les techniques et astuces pour<br />
construire soi-même<br />
Les techniques et astuces pour<br />
construire de manière<br />
écologique<br />
Les techniques et astuces pour<br />
réduire sa consommation<br />
d'énergie<br />
Les consignes de sécurité sur un<br />
chantier<br />
34% 42% 19% 6% 100%<br />
49% 45% 4% 2% 100%<br />
36% 28% 23% 6% 8% 100%<br />
58% 36% 6% 100%<br />
L'utilisation de nouveaux outils 38% 49% 13% 100%<br />
L'utilisation de nouveaux<br />
matériaux<br />
43% 49% 8% 100%<br />
Q5 – Pour chacun des thèmes suivants, comment avez-vous trouvé l’apprentissage ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
Cela ne veut pas pour autant dire que les participants maîtrisent les techniques<br />
enseignées. 5 enquêtés ont émis, lors du temps de paroles libres, des critiques quant au<br />
manque de temps et manque de pratique pour maîtriser les techniques :<br />
84
« en une semaine, c’est insuffisant pour maîtriser la technique » (enquêté 50) ;<br />
« très bien expliqué mais ça manquait de pratique » (enquêté 34).<br />
Sur les 53 participants, 11 ont reproduit une des techniques apprises (5 dans le cadre<br />
professionnel et 6 dans un contexte personnel) : 3 enquêtés pour les techniques<br />
d’isolation, 3 pour celles de l’étanchéité à l’air, 3 en menuiserie et 1 pour le bardage. Le<br />
11 ème est un professeur en école d’architecture qui a enseigné et mis en pratique les<br />
techniques d’ossature bois et d’étanchéité à l’air.<br />
T 8 - Reproduction d'une technique apprise<br />
Nombre Pourcentage<br />
Oui 11 21%<br />
Non 42 79%<br />
TOTAL 53 100%<br />
Q6 – Avez-vous eu l’occasion de reproduire une des techniques apprises ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
Au regard de ces dernières données et des scores d’évaluation des formations, nous<br />
pouvons supposer que l’objectif d’apprentissage des techniques d’éco-construction a été<br />
plus que partiellement atteint.<br />
A contrario, les scores concernant la formation à l’auto-construction (25% entre insuffisant<br />
et moyen) nous engagent à rester plus modérés concernant l’aptitude acquise des<br />
stagiaires à envisager ce type de processus. Ce module a tout de même «donné envie de<br />
construire soi-même (sa) maison en bois à (sa) retraite. (Elle) a découvert que c’était<br />
possible » (enquêté 47).<br />
3.4.2.3. La valorisation des métiers du bâtiment<br />
Un des objectifs de Chênelet Développement était de revaloriser l’image des métiers du<br />
bâtiment. Selon l’enquête un quart des hommes a été séduit par ce type de métier. A<br />
contrario, seuls 6% des femmes, soit 3 des 19 femmes, l’ont été. Ce qui est un<br />
pourcentage honorable au vu du peu de femmes représentées dans ce secteur.<br />
T 9 - Répartition par sexe du souhait de travailler dans le secteur du bâtiment<br />
Oui Non<br />
Je suis à<br />
la retraite<br />
J'y<br />
travaille<br />
déjà<br />
Total<br />
Femmes 6% 23% 2% 4% 34%<br />
Hommes 25% 23% 4% 15% 66%<br />
Total 30% 45% 6% 19% 100%<br />
Q7 – Ce stage vous a-t-il donné envie de travailler dans la construction de bâtiment ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
85
3.4.2.4. L’impact sur les participants selon les objectifs des parties prenantes<br />
La situation idéale, pour évaluer l’impact des chantiers sur les participants, aurait été soit<br />
de pouvoir comparer les dispositions et aptitudes des stagiaires avant et après<br />
l’expérience, soit de procéder à un questionnaire plus élaboré et évaluant de manière<br />
précise les acquis. N’étant dans aucun de ces deux cas, nous interpréterons les quelques<br />
données en notre possession pour émettre des hypothèses d’impact.<br />
La question Q10 avait pour objectif d’évaluer une éventuelle évolution dans l’intérêt porté<br />
à certaines thématiques abordées sur les chantiers (éco-construction, auto-<br />
construction…). Sur l’ensemble des items, c’est le thème des « constructions en bois» qui<br />
a aiguisé le plus la curiosité des participants avec 47% des enquêtés qui s’y intéressent<br />
plus qu’avant le stage.<br />
T 11 - Impact des chantiers sur le regard des stagiaires<br />
Plus Autant <strong>Mo</strong>ins<br />
Toujours<br />
pas<br />
86<br />
Total<br />
Ecologie 34% 60% 6% 100%<br />
Construction en bois 47% 42% 2% 9% 100%<br />
Economie d'énergie 38% 55% 8% 100%<br />
Métiers du bâtiment 38% 42% 2% 19% 100%<br />
Faire les choses moi-même 38% 53% 9% 100%<br />
A participer à la vie de mon quartier 23% 53% 25% 100%<br />
Q10 – Depuis le stage, vous intéressez vous (plus, autant, moins, toujours pas) à … ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
L’ouverture à la vie du quartier offre 2 scores significatifs. Alors que ce n’était pas un<br />
objectif affirmé ou prioritaire des chantiers, 12 stagiaires y portent plus d’intérêt, ce qui<br />
n’est pas négligeable. Dans la volonté de la coopérative de tisser des liens avec le<br />
quartier, il est positif de constater que 9 de ces stagiaires habitent Roubaix. A contrario,<br />
c’est le seul item où l’effet nul (« toujours pas ») est le plus important.<br />
T 2 - Intérêt porté à la vie de quartier selon le lieu d'habitation des stagiaires<br />
Plus Autant<br />
Toujours<br />
pas<br />
Roubaix ZUS 9 15 6<br />
Métropole<br />
lilloise<br />
3 10 6<br />
Autres 3 1<br />
Total 12 28 13<br />
Q10 – Depuis le stage, vous intéressez vous (plus, autant, moins, toujours pas) à la vie de votre<br />
quartier ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012
De manière plus spécifique, pour l’intérêt porté à l’écologie, nous pouvons constater que<br />
les stages ont renforcé les convictions de près de deux tiers de ceux s’y intéressant « un<br />
peu ». A contrario, ils n’ont eu que peu d’impact pour les stagiaires peu sensibles à cette<br />
question (75% des stagiaires ne s’intéressant que faiblement à l’écologie n’ont pas fait<br />
évoluer leur approche de la question).<br />
T 10 - Impact du stage sur l'intérêt porté à l'écologie<br />
Plus Autant<br />
Toujours<br />
pas<br />
Total<br />
Beaucoup 26% 74% 100%<br />
Un peu 62% 38% 100%<br />
Faiblement 25% 50% 25% 100%<br />
Pas du<br />
tout<br />
Q2 – Vous intéressez-vous à l’écologie ?<br />
100% 100%<br />
Q10 – Depuis le stage, vous intéressez vous (plus, autant, moins, toujours pas) à l’écologie ?<br />
N=53 – Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
3.4.3. L’analyse des résultats : la parole des usagers<br />
Dans cette sous-partie, nous allons présenter quelles richesses les stagiaires ont retiré de leur<br />
expérience sur les chantiers. Pour cela, nous nous baserons d’une part sur l’enquête<br />
quantitative (plus particulièrement avec la question ouverte Q13 « Souhaitez-vous rajouter<br />
quelque chose ? ») et d’autre part sur les propos recueillis lors des entretiens non directifs.<br />
La richesse de participer à un projet collectif<br />
Par la question Q8, il était demandé aux enquêtés de citer leurs trois préférences vécues<br />
au cours du stage parmi une liste de sept items. La dimension « participer à un projet<br />
comme <strong>Baraka</strong> » a été citée par les trois quart des administrés. La moitié d’entre eux l’a<br />
nommée en 1 ère préférence. L’aspect collectif et social du projet donne un sens profond<br />
aux chantiers et une autre dimension : « on construit plus qu’un bâtiment » (Frédéric<br />
Rojas, formateur).<br />
T 12 - Préférences des stagiaires au cours des chantiers<br />
Nombre Pourcentage<br />
Connaître de nouvelles personnes 22 42% 59%<br />
Parler avec les autres participants 9 17%<br />
Travailler en équipe 31 58%<br />
Recevoir un diplôme 6 11%<br />
Apprendre des choses nouvelles 37 70%<br />
Construire moi-même 12 23%<br />
Participer à un projet collectif<br />
comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …)<br />
40 75%<br />
TOTAL 157 296%<br />
Q8 – Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous avez préférez ?<br />
N=53 – 3 réponses possibles donc total > 100 - Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
87
Cette relation au projet s’est traduite par un attachement des stagiaires à <strong>Baraka</strong>. 75%<br />
des enquêtés sont repassés voir le bâtiment quelle qu’en fût l’occasion : inauguration,<br />
incendie ou simplement pour le voir et voir ce qui s’y passait : « chaque semaine, il y avait<br />
des stagiaires des semaines précédentes qui passaient voir où on en était » (Frédéric<br />
Rojas - formateur). Un des participants venant des Papillons Blancs suit d’ailleurs de près<br />
l’actualité de <strong>Baraka</strong> et conserve toutes les coupures de presse concernant la<br />
coopérative.<br />
T 13 - Nombre d'enquêtés étant repassés à <strong>Baraka</strong> après leur stage<br />
Nombre Pourcentage<br />
Oui 40 75%<br />
Non 13 25%<br />
TOTAL 53 100%<br />
Q12 – Etes-vous retourné(e) à <strong>Baraka</strong> depuis le stage ?<br />
N=53 - Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
L’enrichissement par l’apprentissage<br />
Si non, pourquoi ?<br />
pas du quartier 5 38%<br />
pas le temps 8 62%<br />
En 2 ème position arrive l’apprentissage et traduit la satisfaction de 70% des participants à<br />
apprendre et se former quelle que soit sa situation par rapport au marché de l’emploi :<br />
T 14 - Répartition des stagiaires selon leur situation à l'emploi<br />
Apprendre de<br />
nouvelles<br />
choses<br />
Echantillon Pourcentage<br />
Actifs 15 21 71%<br />
Chômeurs < 1 an 8 10 80%<br />
Chômeurs de longue durée 9 14 64%<br />
Inactifs 5 8 63%<br />
Total 37 53 70%<br />
Q8 – Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous avez préférez ?<br />
N=53 - Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
Le diplôme remis en fin de stage était un gage de crédibilité pour certains : « c’est un bon<br />
concept de pouvoir apprendre des choses et c’est bonifiant pour la personne car à la fin<br />
on a un certificat de stage » (enquêté 49).<br />
88
La richesse du lien social<br />
« Connaître de nouvelles personnes » et « parler avec les autres participants » peuvent<br />
être fusionnés en tant que valeur de lien social. Combinés avec le « travail d’équipe » qui<br />
transcrit à la fois la coopération et le lien social, il est incontestable que cette dimension<br />
de lien social a été une des clés de ces chantiers. Seulement 5 enquêtés ne citent pas<br />
une seule fois aucun de ces 3 items.<br />
Les commentaires des enquêtés confirment et illustrent cette richesse des échanges :<br />
« C’était une très bonne expérience collective dans la manière de la partager, dans la<br />
relation à l’autre » (enquêté 35) ;<br />
« C’était un public était très diversifié qui a donné lieu à des échanges très intéressants »<br />
(enquêté 47) ;<br />
« Je venais d’arriver dans la région et ça m’a ouvert des portes en terme de réseau »<br />
(enquêté 22).<br />
Cet enrichissement par le lien social ne concernait pas que les stagiaires. Les<br />
professionnels ont aussi bénéficié de cette richesse. Frédéric Rojas le formateur, le<br />
raconte : « je vivais en vase clos entre les chantiers et chez moi. Ca m’a resocialisé ». Les<br />
équipes de stagiaires et de professionnels se retrouvent pour déjeuner au restaurant<br />
« l’Univers ». Les liens se créent, et les « échanges de savoir se font petit à petit » (F.<br />
Rojas).<br />
Autant la richesse des liens sociaux sur les chantiers a été très importante pour les<br />
stagiaires, autant ce ne fut que ponctuel. 70% des enquêtés n’ont pas gardé contact avec<br />
les autres stagiaires et plus de la moitié d’entre eux n’ont pas l’intention de le faire plus<br />
tard.<br />
T 15 - Pérennité des relations créées sur les chantiers<br />
Nombre Pourcentage<br />
Oui 16 30%<br />
Non 37 70%<br />
TOTAL 53 100%<br />
Si non, comptez-vous le faire plus tard ?<br />
Oui 15 41%<br />
Je ne pense pas 22 59%<br />
Q11 – Avez-vous gardé contact avec d’autres stagiaires (que vous ne connaissiez pas avant le<br />
stage) ?<br />
N=53 - Enquête réalisée par nos soins – juillet 2012<br />
Beaucoup justifient cet état de fait par la courte durée du stage : « j’ai fait beaucoup de<br />
rencontres mais c’était trop court pour garder le contact » (enquêté 40).<br />
89
La richesse de la mixité<br />
Liée à ce partage, la mixité est citée comme un enrichissement par 15 des 53 enquêtés :<br />
« J’ai adoré rencontrer des gens d’horizons différents » (enquêté 7) ;<br />
« Il y avait une très bonne entraide dans une équipe aux profils différents » (enquêté 38) ;<br />
« C’est une belle aventure, je n’avais jamais côtoyé ces personnes (handicapées) »<br />
(enquêté 27).<br />
« La mixité a donné une énergie particulière, les gens des papillons blancs ont obligé<br />
l’entraide et un rythme différent, adapté mais bénéfique pour tous » (Jérémy Gaudin).<br />
Même si elle n’a pas été soulevée par les participants eux-mêmes, la mixité hommes-<br />
femmes offre une toute autre atmosphère sur un chantier. La présence des femmes opère<br />
un changement immédiat du comportement masculin : « les grosses blagues sont<br />
proscrites, il y a plus d’attention, de solidarité, moins de compétition et plus de travail<br />
d’équipe » (Pierre Gaudin – Chênelet).<br />
Comme nous l’avons vu précédemment, la diversité des profils était effective sur le<br />
chantier. Renforcée par la présence de professionnels (les formateurs et le personnel des<br />
autres entreprises intervenant sur la construction) elle a permis d’impliquer des personnes<br />
à fort critère de discrimination sans qu’elles ne soient stigmatisées :<br />
« On était sur un pied d’égalité avec les gens des papillons blancs. » (enquêté 23)<br />
Cet avis est confirmé par les responsables des Papillons Blancs. Leurs 4 stagiaires ont<br />
été « capables d’intégrer une équipe nouvelle, d’assumer leur part de travail et<br />
d’apprendre de nouvelles techniques sans aucune préparation spécifique ni phase<br />
d’adaptation ». Il n’y a pas eu d’absentéisme ni de problème de comportement « ce qui<br />
n’est pas le cas au Sisep ». Il leur était important de « montrer leurs compétences malgré<br />
leur handicap ». Ils étaient exemplaires et « avaient même un coup d’avance par rapport<br />
aux autres stagiaires sur les consignes de sécurité ». Pour Valérie Devestel et Eric<br />
Gronencheld, la raison de cette réussite, « c’est que toute l’équipe était au même<br />
niveau », les stagiaires étaient, quels que soient leurs antécédents, traités sur le même<br />
pied d’égalité.<br />
Les chantiers ont été aussi l’occasion d’offrir une « belle évaluation de la personne<br />
(l’handicapé) avec un autre regard ». L’animateur du Sisep a dû changer la perception<br />
qu’il avait de l’un d’entre eux : « je le sous-estimais car il paraît fragile physiquement. Or à<br />
<strong>Baraka</strong>, il en a fait beaucoup plus qu’ici. Il a un bien meilleur potentiel.»<br />
90
L’enrichissement de l’estime de soi<br />
Un autre élément mis en avant par les enquêtés, et ce, quel que soit leur profil<br />
« défavorisé » ou non, est la considération que les formateurs et les professionnels des<br />
chantiers leur portaient. Huit d’entre eux ont souligné ce « sentiment de ne pas être que<br />
des bras » (enquêté 40), de « ne pas être utilisés comme de la simple main d’œuvre bon<br />
marché » (enquêté 21) et rajoutent l’importance «de la reconnaissance par les pairs »<br />
(enquêté 1).<br />
Réciproquement, les professionnels eux-mêmes ont constaté l’importance que les<br />
équipes et surtout les personnes en difficulté soient encadrées par des spécialistes de la<br />
construction bois. Frédéric Rojas, le formateur en témoigne : « ma spécialité d’artisan<br />
ébéniste a permis d’installer une hiérarchie professionnelle. Ca rassure les personnes<br />
fragiles socialement. »<br />
Par cette combinaison de richesses, les stages ont eu des conséquences concrètes sur 5 des<br />
participants. L’un d’entre eux s’est inscrit à une formation qualifiante dans la continuité des<br />
chantiers, deux ont eu accès à un emploi (l’un temporaire, l’autre en contrat aidé) et un autre a<br />
entamé une procédure de validation des acquis de l’expérience. Enfin, un 5 ème participant,<br />
déficient mental, a, grâce aux stages, acquis une réelle aisance dans sa communication<br />
constatée par son responsable du Sisep : « c’était quelqu’un qui ne parlait quasiment pas.<br />
Aujourd’hui, il intervient en réunion générale devant une vingtaine de personnes ».<br />
3.5. Le bilan des chantiers participatifs<br />
3.5.1. Le bilan pour le FSE<br />
Avec 40 participants issus de la zone urbaine sensible de Roubaix, les objectifs fixés avec le<br />
FSE sont atteints. La moitié de ces stagiaires présente un critère d’exclusion (Cf. tableau 3)<br />
mais seulement 15 sont en situation éloignée de l’emploi.<br />
Figure 10 - Répartition des participants selon leur zone<br />
géographique et leur situation sur le marché de l'emploi<br />
N = 69 - Bilan des chantiers participatifs - Février 2012<br />
91
Les contraintes imposées dans la convention ont été bénéfiques pour <strong>Baraka</strong>. En 1er lieu,<br />
l’exigence de recruter des stagiaires habitant la zone urbaine sensible a permis une ouverture<br />
importante sur le quartier. Un début de lien s’est tissé avec quelques habitants et comme le<br />
souligne un participant : « ces chantiers ont vraiment permis de faire atterrir cet OVNI en<br />
ville ». En 2 nd lieu, l’obligation de cibler des populations défavorisées de la convention a permis<br />
d’aller au bout de la démarche. Le recrutement de ces personnes était particulièrement<br />
difficile. « Cette contrainte a été vertueuse, sinon, on aurait lâché » (Jérémy Gaudin).<br />
A contrario, l’organisateur des chantiers, indique l’absurdité de l’évaluation du FSE qui n’offre<br />
qu’une vision très réductrice de cette opération.<br />
L’octroi de la participation du FSE était conditionné par le lieu de domiciliation des participants<br />
et leur situation sur le marché de l’emploi. Il n’a pas été possible, au risque de perdre une<br />
partie de la subvention, de valoriser la réussite d’avoir fait « travailler ensemble des bacs + 12<br />
et des bacs -12 » (Jérémy Gaudin) et la richesse produite par la mixité des équipes.<br />
3.5.2. Le bilan pour la coopérative <strong>Baraka</strong><br />
Ces chantiers participatifs ont été très bénéfiques pour la coopérative sur de nombreux points :<br />
- la notoriété de <strong>Baraka</strong> : les chantiers ont été amplement couverts par les médias<br />
locaux (Cf. annexe 9 – Articles de presse) ;<br />
- l’ancrage dans le quartier de l’Epeule par le recrutement d’habitants de la ZUS mais<br />
aussi au travers des relations initiées avec les acteurs locaux (MIE, Papillons Blancs,<br />
Ecole de la 2 ème chance …) ;<br />
- l’implication concrète des sociétaires soit dans l’organisation des chantiers soit en tant<br />
que stagiaires ;<br />
- la réduction des coûts de construction par l’obtention de la subvention du FSE.<br />
Cette expérience a montré la difficulté, malgré les actions mises en place, de créer le contact<br />
avec les populations défavorisées du quartier.<br />
3.5.3. Le bilan pour le groupe Chênelet<br />
Pour le groupe Chênelet, en sa qualité de structure d’insertion par l’activité économique, ces<br />
chantiers furent l’occasion d’innover dans une nouvelle forme d’insertion des personnes<br />
exclues du marché de l’emploi et de confirmer l’atout qu’apporte la mixité des équipes dans la<br />
démarche. Mais cette expérience fut très lourde en terme de responsabilités et de volumes de<br />
travail.<br />
92
En tant que porteur des chantiers participatifs et prestataire de la construction du bâtiment, le<br />
groupe Chênelet avait un double enjeu : mener à bien les stages et tenir ses engagements en<br />
tant que constructeur. Il fallait réussir à amoindrir l’exigence sur les lots réalisés par les<br />
stagiaires-amateurs sans pour autant remettre en cause la qualité esthétique et durable du<br />
bâtiment. La terrasse n’ayant pas été posée de manière suffisamment qualitative, SPL s’est<br />
engagée à la refaire à ses frais.<br />
L’organisation des chantiers a occasionné une surcharge considérable de travail pour<br />
l’association Chênelet Développement. D’une part, il fallait assurer le recrutement et le suivi<br />
des stagiaires pour tenir les engagements vis à vis du FSE. D’autre part, accueillir et former 70<br />
personnes sur un chantier nécessite une importante logistique (matériel, planification des<br />
opérations, briefing, contrôle et exigence de sécurité …). L’élément-clé de la réussite des<br />
chantiers fut l’investissement des acteurs tant au sein de Chênelet qu’au sein de <strong>Baraka</strong>. Il y<br />
avait un réel manque d’expérience, les effectifs d’encadrement des équipes étaient trop courts<br />
mais « C’est parce que les gens ne comptaient pas leur temps que ça a pu se faire » (Jérémy<br />
Gaudin).<br />
Malgré ce contexte difficile et ce peu de moyens, le sens porté par les chantiers participatifs a<br />
été très fédérateur pour les intervenants. D’une relation contractuelle entre les prestataires et<br />
<strong>Baraka</strong>, s’est développée une relation de solidarité autour des difficultés. Comme a pu le<br />
constater le responsable de SPL à l’époque, même les artisans non concernés par l’opération<br />
ont été « contaminés ». Ils se sont impliqués dans la dynamique de coopération contrairement<br />
à ce qui se passe habituellement sur les chantiers.<br />
L’ensemble de ces éléments pose la question de l’équilibre économique de cette expérience :<br />
la subvention obtenue compense-t-elle les surcoûts occasionnés par les chantiers ? Aucune<br />
analyse financière n’a été faite. Chênelet pense avoir perdu de l’argent sur l’opération<br />
(entretien avec Jérémy et Pierre Gaudin). Cette perte serait compensée par la communication<br />
qu’il y a eu autour des chantiers qui a apporté une bonne visibilité au groupe. L’importance de<br />
la démarche pour les porteurs de projet et les richesses dégagées pour les usagers ont<br />
relégué cette question au dernier plan.<br />
3.5.4. Les clés de la réussite et les axes de progrès des chantiers<br />
D’un point de vue plus opérationnel, il est intéressant de faire une synthèse des éléments qui<br />
ont fait la réussite de ces chantiers et d’en relever les points de fragilité. Ces éléments seront<br />
utiles dans le cas d’une reconduction de l’expérience.<br />
Les deux éléments les plus mis en avant par les acteurs et les participants sont la qualité des<br />
encadrants et la convivialité présente sur les chantiers. 11 stagiaires ont témoigné de leur<br />
satisfaction voire « admiration » (enquêté 6) pour les formateurs. Ils leur reconnaissent leur<br />
93
capacité à les avoir considérés comme de vrais « ouvriers » et non comme des amateurs et à<br />
fournir un « apprentissage sans prendre un ton moralisateur » (enquêté 41).<br />
La réussite s’est construite grâce à la détermination du maître d’œuvre (le gérant) et<br />
l’implication des sociétaires de <strong>Baraka</strong>. Là encore sont les effets du projet politique de la<br />
coopérative. Comme le souligne une des salariés de Chênelet Développement,<br />
l’investissement et l’énergie nécessaires pour mener à bout un tel projet « ne peut réussir que<br />
s’il y a une démarche militante ».<br />
C’est par cette dimension politique et par l’objet collectif du projet que la mixité a porté ses<br />
fruits. Il ne suffit pas de réunir des profils différents pour assurer le succès de ce type<br />
d’expérience. Il faut un liant, un élément fédérateur qui jettera les bases de la coopération.<br />
Enfin, la non exigence de productivité fut un autre élément de réussite. Elle a évité la<br />
compétitivité entre les stagiaires. Elle a offert du temps pour les échanges qui ont fait la<br />
convivialité.<br />
Mais pour envisager de nouveaux chantiers participatifs, il est nécessaire de repenser certains<br />
points.<br />
Tout d’abord, le mode de fonctionnement qui a été énergivore et chronophage pour les<br />
acteurs : « Cela demande un niveau d’engagement énorme » (organisateur). Il s’agit<br />
d’anticiper et de repenser l’organisation pour soulager les responsables. Cela permettra de<br />
gagner en professionnalisme et de pallier tous les manquements notamment matériel (manque<br />
d’outils, erreur de planning, manque d’encadrement …) éprouvant pour les équipes et les<br />
encadrants.<br />
Or la complexité de ce type de projet se trouve dans sa dimension humaine. Une telle<br />
aventure ne se modélise pas, des procédures ou des modes d’emploi ne pourront jamais créer<br />
la solidarité au sein d’une équipe. A contrario, il faut penser les outils adéquats pour rendre<br />
l’expérience réalisable lorsqu’un « bon terreau se présente » (organisateur).<br />
Enfin la question de la viabilité économique sera à prendre en compte pour ne pas fragiliser<br />
les parties prenantes de l’opération.<br />
Conclusion des chantiers participatifs<br />
Les chantiers participatifs ont été une expérience majeure dans le projet <strong>Baraka</strong>. Même s’ils ont<br />
été officiellement pris en charge par Chênelet Développement, les sociétaires se sont fortement<br />
impliqués dans l’expérience en tant que relais de l’organisation ou simplement stagiaires. Cela a<br />
contribué à l’imbrication des chantiers dans l’ensemble du projet : ils se sont enrichis l’un dans<br />
l’autre. Les chantiers ont pris sens grâce à la dimension politique de <strong>Baraka</strong>. Et réciproquement,<br />
l’expérience a renforcé la cohésion du projet de la coopérative.<br />
94
Cette opération a rayonné au-delà de <strong>Baraka</strong> en bénéficiant aussi à « l’Univers ». D’une part, des<br />
usagers du restaurant ont pu participer aux chantiers et d’autre part, les stagiaires y ont déjeuné<br />
quotidiennement pendant 3 mois. Cela a permis aux équipes de « l’Univers » de s’approprier le<br />
projet <strong>Baraka</strong>. Un lien autre que financier s’est tissé entre le restaurant et la coopérative.<br />
L’analyse de ces chantiers nous permet de mettre en valeur une des principales problématiques<br />
posées par l’évaluation de l’utilité sociale d’un projet : l’écart entre les indicateurs-clés imposés<br />
par le FSE et les richesses produites présentées par les participants. Une co-construction en<br />
amont des critères d’évaluation entre les parties prenantes, usagers compris, n’aurait été que<br />
bénéfique pour tous. Cela aurait évité les « arrangements » orchestrés par les porteurs de projet<br />
dans le bilan comme « l’oubli » des 29 participants non roubaisiens.<br />
95
CONCLUSION<br />
En tant que société coopérative d‘intérêt collectif, <strong>Baraka</strong> prend tout son sens dans l’utilité sociale<br />
qu’elle produit au travers de sa « fabrique de biens communs ». Jusqu’à présent, seules certaines<br />
associations ou entreprises des secteurs tels que services à la personne ou insertion par l’activité<br />
économique prenaient l’initiative d’une démarche d’évaluation de leur utilité sociale. Leur objectif<br />
prioritaire est, dans la plupart des cas, de fournir une argumentation en vue de financements passés<br />
ou à venir et/ou de maintien d’un agrément ou d’une habilitation.<br />
La monographie a permis de mettre en valeur la spécificité de la coopérative <strong>Baraka</strong>. Cette spécificité<br />
s’exprime par le choix d’une activité économique pourvue par le secteur privé (restauration et location<br />
de salles) qui ne présente pas les critères d’utilité sociale initialement retenus par les pouvoirs publics :<br />
biens ou services non pourvus par le marché ou à un prix avantageux pour les populations démunies.<br />
Elle apparaît aussi dans la manière de produire son utilité sociale : des actions menées auprès de la<br />
population des quartiers défavorisés de Roubaix, l’impact écologique et l’embauche de personnes<br />
issues d’un parcours d’insertion. Hormis le premier axe, l’utilité sociale revendiquée ne rentre pas dans<br />
les critères habituellement reconnus par les pouvoirs publics.<br />
Son modèle ne requérant ni financements publics pérennes ni agrément d’Etat, aucune contingence<br />
externe n’incite la coopérative à évaluer son utilité sociale. Il était donc légitime de questionner la<br />
pertinence d’une telle démarche d’évaluation pour <strong>Baraka</strong>.<br />
Cet exercice mené tout au long de mon stage n’a pas la prétention d’aboutir sur une définition ou une<br />
évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong>. Les circonstances n’en font qu’une approche, un travail<br />
exploratoire. N’ayant que peu impliqué les parties prenantes du projet, ce ne sont que des<br />
constatations et des argumentations issues de mon prisme de lecture et de mon interprétation.<br />
L’étude menée au cours de mon stage, par l’observation participante, les entretiens avec les parties<br />
prenantes et le travail spécifique sur les chantiers participatifs me permettent tout de même de<br />
défendre l’idée que définir et évaluer l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> est d’une grande richesse pour la<br />
coopérative au-delà de mes hypothèses de départ.<br />
Dans le processus en lui-même, l’évaluation de son utilité sociale met en valeur la diversité et la<br />
complexité des mécanismes qui produisent cette richesse. Ce n’est pas la construction d’un bâtiment<br />
selon les normes environnementales qui est utilité sociale mais c’est l’imbrication de cette construction<br />
dans l’action collective qui l’a initiée, dans ce lieu spécifique qu’est l’Epeule et dans sa future fonction.<br />
L’enjeu est particulièrement significatif pour un projet multidimensionnel comme <strong>Baraka</strong>. Ses multiples<br />
actions pourraient passer pour de l’éparpillement. L’évaluation met du liant en mettant en valeur les<br />
articulations entre les différentes actions, les moyens et les processus engagés.<br />
La démarche engagée simultanément à la crise que vivait <strong>Baraka</strong> du fait du sinistre, a permis de<br />
réaffirmer la nécessité de s’ouvrir davantage sur le quartier. Evidemment l’ancrage territorial était déjà<br />
96
en cours grâce aux liens tissés avec « l’Univers », aux stagiaires des chantiers participatifs habitant de<br />
la zone urbaine sensible de Roubaix, au recrutement de personnes issues du quartier. Mais les<br />
finitions du chantier et l’ouverture du restaurant avaient relégué cette dimension à un second plan. Le<br />
sinistre et la synthèse des entretiens semi-directifs ont remis au premier plan cette valeur forte du<br />
projet. Créer des liens avec et entre les habitants d’un quartier est un travail laborieux qui se mène par<br />
petites étapes sur du long terme. Evaluer ou, à minima, réfléchir à son utilité sociale permet de<br />
renforcer le projet et de redonner du souffle aux actions les plus difficiles.<br />
Vue de l’extérieur, et malgré sa forme coopérative, <strong>Baraka</strong> s’apparente à une entreprise privée aux<br />
valeurs écologiques avec sa construction bois, son restaurant (quasi) « bio » et son offre de locations<br />
de salles de réunion. Les SCIC et leurs spécificités étant encore méconnues, certains acteurs<br />
associatifs des quartiers de Roubaix ont fait preuve de méfiance vis à vis de <strong>Baraka</strong>, ne comprenant<br />
pas pourquoi une « entreprise commerciale participait à la fête des quartiers ouest » 125 . Définir son<br />
utilité sociale et l’évaluer, peut être un bon outil pour illustrer sa production de biens communs et en<br />
améliorer sa lisibilité en vue d’une communication externe. Au-delà d’une compensation au déficit<br />
d’image, cette communication pourrait être adressée aux acteurs institutionnels et privés ayant apporté<br />
leur soutien financier au projet ou lors de démarchage de nouveaux financeurs. L’expérience de<br />
sollicitation des fondations et des collectivités territoriales suite au sinistre a montré combien les<br />
financeurs étaient séduits par les projets d’investissement mais peu entrains aux frais de<br />
fonctionnement. Avoir une bonne visibilité globale de son utilité sociale peut être un argument décisif<br />
dans la recherche de soutiens financiers en cas de difficulté économique.<br />
En interne, la conviction et la ténacité ont été les meilleurs atouts des initiateurs de <strong>Baraka</strong> pour<br />
fédérer les parties prenantes trop timorées face à l’amateurisme des coopérateurs et mener à terme ce<br />
projet « un peu fou ». La monographie, les chantiers participatifs ont mis en valeur cette implication<br />
généreuse des sociétaires et des partenaires. La plupart des personnes interrogées ne savaient pas<br />
combien de temps ils avaient consacré au projet mais étaient prêts à le refaire. Combien de fois ai-je<br />
entendu, tout au long de mes enquêtes, « quand on aime, on ne compte pas » ou encore « c’est parce<br />
que les gens n’ont pas compté leur temps qu’on est allé jusqu’au bout ». Une telle générosité, un tel<br />
investissement prend sa source dans des « motivations intrinsèques, autrement dit dans ce qui est fait<br />
par plaisir pour le type d’activité, par sympathie pour les autres ou par sens du devoir » 126 . N’y a-t-il<br />
pas un risque que ces motivations s’épuisent ? Comment pérenniser ces motivations et l’implication<br />
des sociétaires dans la coopérative sur du long terme ? Là aussi, l'évaluation de l’utilité sociale de<br />
l’organisation a un rôle à tenir et « doit servir à renforcer ces motivations intrinsèques, et donc la<br />
liberté et donc l’efficacité effective des personnes, des associations ou des institutions évaluées » 127 .<br />
Comme le soulignait l’architecte, « quand le chantier devenait trop lourd, que je voulais tout plaquer, je<br />
pensais à « l’Univers » avec sa cour des miracles, à tout ce que le bâtiment pourrait leur apporter et je<br />
reprenais ma tâche à bras le corps »…<br />
Mais nous ne pouvons vivre d’amour et d’eau fraîche. Le sinistre a montré combien en situation de<br />
crise, l’économique redevenait dominant. Il a envahi les préoccupations des responsables de la<br />
125 Propos recueillis lors des réunions de préparation de la fête des quartiers soit en direct soit par l’intermédiaire des chargés de<br />
mission de la mairie de quartier.<br />
126 CAILLE Alain, Op. Cit.<br />
127 Ibid<br />
97
structure et dominé les prises de décision. La survie de <strong>Baraka</strong> était en jeu. Il est certain que sans<br />
financement, sans activité économique rentable, la « fabrique de biens communs » n’est plus ou est<br />
tout du moins très affaiblie. La concomitance de ma mission sur l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> avec mon<br />
travail sur les plans d’affaires et de trésorerie a permis de réguler la place de plus en plus grande que<br />
prenait l’économique au sein de la structure. C’est ce qui a ravivé la « fabrique de biens communs » et<br />
son dynamisme malgré la fermeture du bâtiment. Ce travail exploratoire a impulsé les groupes-projet,<br />
les actions menées depuis le sinistre : cafés-voisins, à voix haute à la maison, ateliers à la fête des<br />
quartiers ouest, réflexions sur le fablab … Dans un modèle dépendant d’une activité économique, il y<br />
aura d’autres tensions entre l’économique et l’utilité sociale. Les statuts de la SCIC encadrent déjà<br />
fortement la place de l’économique pour en limiter ses excès : réserves impartageables,<br />
réinvestissement des bénéfices … Malgré cela, l’économique peut dominer l’activité globale de la<br />
coopérative, polarisant toutes les énergies des acteurs à sa réussite. C’est d’autant plus probable dans<br />
le cas de <strong>Baraka</strong> où le choix d’un investissement important pour édifier le bâtiment n’a pas encouragé<br />
à la sobriété et fait peser une pression économique forte sur la structure. L’évaluation de son utilité<br />
sociale permettra à la « fabrique de biens communs » de réguler la place de l’économique.<br />
Cette régulation s’est faite tout au long du chantier car, comme nous l’avons vu, l’utilité sociale s’inscrit<br />
dès la mise en œuvre des processus et non pas seulement dans les résultats des actions. L’objectif<br />
n’était pas seulement de construire un bâtiment passif et de faire un restaurant bio qui emploie des<br />
personnes sorties d’un parcours d’insertion. Le choix de prestataires, de matériaux, de processus s’est<br />
fait par un subtile arbitrage entre dimension économique et utilité sociale : choix de prestataires et<br />
matériaux locaux, formation des prestataires aux techniques d’éco-construction, recrutement de<br />
personnes du quartier …<br />
L’utilité sociale doit continuer à réguler au quotidien l’activité économique car cette dernière a une bien<br />
meilleure visibilité. Les dix jours d’ouverture du restaurant et la gestion des conséquences du sinistre<br />
en ont été un bel exemple : plan d’affaires, bilans comptables, nombre de couverts, panier moyen,<br />
chiffres d’affaires sont autant d’indicateurs financiers qui ont envahi et vont envahir le quotidien de la<br />
coopérative. Afficher l’utilité sociale, c’est contrebalancer cette avalanche de chiffres comptables et<br />
financiers. Cela peut passer autant par des indicateurs quantitatifs que des indices qualitatifs : le<br />
stockage carbone, l‘histoire d’un stagiaire des chantiers, le nombre d’ateliers réalisés, le témoignage<br />
d’un usager …<br />
Enfin, l’étude spécifique aux chantiers participatifs a permis de mettre en valeur les écarts<br />
d’appréciation de la richesse produite entre le FSE, les acteurs et les usagers. Cela souligne la<br />
nécessité de repenser la place des bénéficiaires au sein de la coopérative. L’objectif premier de la<br />
coopérative est de créer du lien social, de la convivialité, du vivre-ensemble sur le quartier de l’Epeule.<br />
Comment peut-on s’assurer de choisir les bonnes actions pour promouvoir le vivre-ensemble si on ne<br />
l’a pas défini avec les personnes concernées ? Intégrer les usagers voire les acteurs locaux dont les<br />
collectivités locales apportera de la légitimité à la définition de la richesse et au choix de ses critères.<br />
La démarche deviendra elle-même productrice de biens communs en créant du débat, du lien social<br />
entre les parties prenantes et de la citoyenneté.<br />
98
Face à tous ces constats, on ne peut qu’être convaincu de la pertinence de l’évaluation de l’utilité<br />
sociale pour la coopérative. Mais l’engouement doit être modéré par la lourdeur et l’ampleur de la<br />
tâche. N’oublions pas que <strong>Baraka</strong> ne compte que cinq salariés, 97 sociétaires dont une petite vingtaine<br />
constitue le noyau dur. L’organisation de la fête des quartiers a montré l’importance d’avoir un relais au<br />
sein de l’équipe salariée pour coordonner les sociétaires investis dans des actions. Les ambitions de la<br />
coopérative sont déjà multiples. Le projet n’est qu’à mi-chemin de sa réalisation : le bâtiment est<br />
construit et quasi-reconstruit, la « fabrique de biens communs » est lancée. Les enjeux à venir sont la<br />
pérennisation du projet, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue de la production de<br />
biens communs et de l’ancrage dans le quartier. L’ampleur de la tâche à venir est telle, que la question<br />
des moyens disponibles pour une démarche d’évaluation est réelle.<br />
Il s’agira, avant de se lancer dans cette démarche de s’assurer des capacités de la structure à mener<br />
l’évaluation à son terme tant sur le plan des moyens humains que matériels. Enfin, il faudra tenir<br />
compte du mode de gouvernance de la structure où le temps est un paramètre indispensable : temps<br />
du débat, temps de la réflexion, temps de la définition et de l’adhésion de chacun …<br />
Malgré ces contingences « matérielles », il est une piste à explorer pour donner accès à la démarche<br />
d’évaluation d’utilité sociale à des petites structures : la mutualisation des moyens entre partenaires.<br />
Au-delà des réflexions sur la pertinence de l’évaluation pour une structure comme <strong>Baraka</strong>, ce travail a<br />
permis de mettre en valeur le rayonnement de la coopérative sur son père fondateur, le restaurant<br />
« l’Univers » et réciproquement. Dans un système de vases communicants, la mise en œuvre du projet<br />
<strong>Baraka</strong> a ouvert le restaurant solidaire à des réseaux auxquels il n’avait pas accès. Elle a aussi permis<br />
d’augmenter sa notoriété auprès d’acteurs potentiellement financeurs ou soutiens à une période où<br />
l’association a perdu 30% de ses ressources. Enfin, la coopérative, par le recrutement de salariés en<br />
parcours d’insertion à « l’Univers », participe à sa production d’utilité sociale (augmentation des sorties<br />
positives qui est un indicateur essentiel pour les pouvoirs publics). Réciproquement, <strong>Baraka</strong> a<br />
bénéficié de la très bonne implantation de « l’Univers » au sein de l’Epeule pour développer son<br />
ancrage territorial (recrutement des stagiaires des chantiers au sein des usagers du restaurant, relais<br />
de connaissance auprès des acteurs). Enfin, « l’Univers » légitime la présence de la coopérative dans<br />
ce quartier populaire et compense son apparence « bobo » (construction bois, restaurant « bio »).<br />
De la même manière, le partenariat créé entre <strong>Baraka</strong> et Chênelet a opéré un rayonnement réciproque<br />
sur les deux structures, le premier apportant de la notoriété au second et inversement, Chênelet<br />
apportant savoir-faire et crédibilité dans l’éco-construction à la coopérative.<br />
Chênelet et le restaurant « l’Univers » ont en commun leur dépendance à des financements publics<br />
pour assurer leur pérennité. Mettre en valeur leur utilité sociale prend d’autant plus d’importance pour<br />
compléter les « sorties positives » nécessaires à toute structure d’insertion par l’activité économique<br />
ou pour argumenter le besoin de soutien financier quand l’agrément a été retiré. Les liens tissés entre<br />
ces trois acteurs ne justifieraient-ils pas d’envisager une mutualisation des moyens nécessaires à toute<br />
démarche d’évaluation ? N’y a-t-il pas une coopération à inventer pour que des structures à petits<br />
moyens puissent envisager une telle démarche ?<br />
99
BIBLIOGRAPHIE<br />
Avise, « Evaluer l’utilité sociale de son activité. Conduire une démarche d’auto-évaluation », Cahiers<br />
de l’Avise n°5, Culture et Promotion, 2007<br />
Avise, SCIC, une entreprise d’utilité sociale au service du territoire, Choisir d’entreprendre autrement,<br />
2008<br />
BOUCHARD Marie J., « Vers une évaluation multidimensionnelle et négociée de l’économie sociale »,<br />
Recma, n°292, 2004<br />
CAILLE Alain, Don, intérêt, désintéressement. Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, La<br />
Découverte, 1994<br />
CAILLE Alain, HUMBERT Marc, LATOUCHE Serge, VIVERET Patrick, De la convivialité, La<br />
Découverte, 2011<br />
DACHEUX Eric, LAVILLE Jean-Louis, Economie Solidaire et Démocratie, Hermès, 2003<br />
DAUPLEIX Mathieu, La SCIC, entre démarche d’utilité sociale et construction de l’intérêt collectif,<br />
Rapport final, 2002<br />
DE VARINE Hugues, « Consultations régionales de l’économie sociale et solidaire », rapport de<br />
synthèse, 2000<br />
DROT Christophe, MONFERRAND Marie-Dominique, Connaître son association pour la rendre<br />
performante, Juris Associations, 2005<br />
DUCLOS Hélène, « Quels enseignements tirer de l’évaluation de l’utilité sociale dans le secteur de<br />
l’ESS », extrait de l’ouvrage OFFREDI C., RAVOUX F., La notion d’utilité sociale au défi de son<br />
identité dans l’évaluation des politiques publiques, L’Harmattan, 2009<br />
ENGELS Xavier, HELY Matthieu, De l’intérêt général à l’utilité sociale : la reconfiguration de l’action<br />
publique entre Etat, associations et participation citoyenne – Ed. L’Harmattan<br />
GADREY Jean, « L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire. Une mise en<br />
perspective sur la base de travaux récents », rapport de synthèse pour la DIES et la MIRE, février<br />
2004<br />
GADREY Jean, Adieu à la croissance, Alternatives Economiques, 2010<br />
GALINON Lucie, Note d’étape sur l’utilité sociale, Projet CORUS-ESS, février 2012<br />
GALLIOZ Stéphanie, « Force physique et féminisation des métiers du bâtiment », Travail, genre et<br />
sociétés 2/2006 (N° 16), p. 97-114<br />
100
HATZFELD Hélène, Municipalités socialistes et associations. Roubaix : le conflit de l'Alma-Gare,<br />
Revue française de science politique, 1986, Volume 36, Numéro 3, pp. 374-392<br />
LAVILLE Jean-Louis, L’économie solidaire, une perspective internationale, p292, DDB, 1994<br />
LAVILLE Jean-Louis, Politique de l’association, Seuil, 2010<br />
MANOURY Lucille, L’opportunité d’un nouveau type de société à vocation sociale : la société<br />
coopérative d’intérêt collectif, Recma n°281, juillet 2001<br />
PECOUP Françoise, Le multisociétariat dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif : une nouvelle<br />
forme de « gourvernance » ?, Communication lors des XXIIIèmes Journées de l'Association<br />
d'Economie sociale des 11-12 septembre 2003,<br />
QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod,<br />
2006<br />
RENAULT Michel, Elaborer ensemble des outils pour construire une société plus conviviale, de la<br />
convivialité, La Découverte, Paris, 2011<br />
SIBILLE Hugues, Les SCIC, 10 ans déjà, Recma, mai 2012<br />
101
TABLES DES ANNEXES<br />
ANNEXE 1 – Rétro-planning de la mission d’évaluation<br />
ANNEXE 2 – Grille d’entretiens semi-directifs pour les sociétaires<br />
ANNEXE 3 – Grille d’entretiens semi-directifs pour les parties prenantes<br />
ANNEXE 4 – Synthèse des entretiens semi-directifs des sociétaires<br />
ANNEXE 5 – Synthèse des entretiens semi-directifs des parties prenantes<br />
ANNEXE 6 – Convention FSE<br />
ANNEXE 7 – Questionnaire de l’enquête quantitative<br />
ANNEXE 8 – Dictionnaire des codes<br />
ANNEXE 9 - Revue de presse des chantiers participatifs<br />
102
ANNEXE 1<br />
-<br />
PLANNING STAGE BARAKA<br />
FEVRIER MARS AVRIL<br />
01-févr 06-févr 13-févr 20-févr 27-févr 05-mars 12-mars 19-mars 26-mars 02-avr 09-avr 16-avr 23-avr 30-avr<br />
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18<br />
Phase observation<br />
démarchage commercial<br />
mep resto service<br />
obs°<br />
concurrence<br />
Opérationnel inauguration<br />
Synthèse - analyse<br />
entretiens<br />
entretiens prestataires /<br />
collectivités / fondations<br />
entretiens sociétaires + J Godin et<br />
Frédéric (Chenelet)<br />
prép<br />
Réunion<br />
sociétaires :<br />
debrief phase<br />
obs° + état des<br />
lieux US, 1ers<br />
indic<br />
Création<br />
commission US<br />
Analyse EQ<br />
prép EQ auprès des<br />
US participants aux chantiers tests EQ<br />
EQ<br />
participatifs<br />
Construction des 1ères pistes d'indicateurs<br />
et d'un référentiel<br />
prospection sur expérimentations de l'US dans d'autres structures<br />
lecture doc US<br />
MAI<br />
JUIN JUILLET<br />
07-mai 14-mai 21-mai 28-mai 04-juin 11-juin 18-juin 25-juin 02-juil 09-juil 16-juil 23-juil<br />
S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30<br />
Phase de construction Phase évaluation<br />
Opérationnel<br />
Commission<br />
US : critères<br />
retenus,<br />
limites,<br />
conventions<br />
Commission<br />
US : quelles<br />
finalités /<br />
objectifs ?<br />
Construction<br />
référentiel<br />
US<br />
tests EQ EQ<br />
Analyse EQ<br />
prép EQ auprès des<br />
usagers, bénéficiaires<br />
103
ANNEXE 2<br />
-<br />
ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS SOCIETAIRES<br />
Objectif des entretiens :<br />
Saisir leur vision de <strong>Baraka</strong>, ses finalités et ce qu’ils en attendent en termes de plus value<br />
sociale.<br />
a- Leur histoire avec <strong>Baraka</strong> :<br />
(Quand, comment, pourquoi, contexte, leur rôle)<br />
Pouvez-vous vous présenter rapidement : âge, situation familiale, parcours professionnel ...<br />
Pourquoi et comment avez-vous intégré la coopérative <strong>Baraka</strong> ?<br />
Quel rôle avez-vous chez <strong>Baraka</strong> ? (officiellement et officieusement)<br />
Comment voyez-vous le rôle d’un sociétaire chez <strong>Baraka</strong> ?<br />
Combien de temps avez-vous consacré au projet ? (consacrez-vous par mois ?)<br />
b - Leur définition de baraka :<br />
(Qu’en attendent-ils ? Pour eux, quel est l’objectif, les finalités de baraka ? Quelle + value<br />
sociale ?)<br />
Comment présentez-vous <strong>Baraka</strong> aux personnes qui ne connaissent pas ?<br />
Quels sont pour vous les objectifs et finalités de <strong>Baraka</strong> ?<br />
Comment saurez-vous que <strong>Baraka</strong> est un succès ?<br />
- dans sa phase construction / reconstruction<br />
- dans sa phase exploitation<br />
En quoi le sinistre a-t-il impacté votre vision de <strong>Baraka</strong> ?<br />
c – L’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> :<br />
Pour vous, que veut dire utilité sociale, intérêt général et fabrique de biens communs ?<br />
En quoi <strong>Baraka</strong> a-t-elle une utilité sociale et une contribution environnementale ?<br />
Si vous étiez amené à choisir 4 indicateurs clés pour mesurer l’utilité sociale, quels<br />
seraient-ils ?<br />
104
ANNEXE 3<br />
-<br />
ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS PARTIES PRENANTES<br />
Qui :<br />
Salariés : Aurore / Fatima / David / Caro<br />
Fournisseurs : SHS / Chenelet / Approbat<br />
PP : LMCU / CR / Mairie de Roubaix – Mairie de quartier<br />
Fournisseurs exploitation : banques / CEB<br />
Usagers : voisinages / clients / Deschepper<br />
Objectif des entretiens :<br />
Saisir leur vision de <strong>Baraka</strong>, ses finalités et ce qu’ils en attendent en termes de plus value<br />
sociale.<br />
a- Leur histoire avec <strong>Baraka</strong> :<br />
(Quand, comment, pourquoi, contexte, leur rôle)<br />
Pouvez-vous vous présenter rapidement : âge, situation familiale, parcours professionnel,<br />
fonction ...<br />
Comment ont-ils pris connaissance du projet <strong>Baraka</strong> ?<br />
Pourquoi ce projet a-t-il retenu leur attention ?<br />
Quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet ?<br />
b - Leur définition de baraka :<br />
(Qu’en attendent-ils ? Pour eux, quel est l’objectif, les finalités de baraka ? Quelle + value<br />
sociale ?)<br />
Comment définissez-vous <strong>Baraka</strong> ?<br />
Quels sont pour vous les objectifs et finalités de <strong>Baraka</strong> ?<br />
Comment saurez-vous que <strong>Baraka</strong> est un succès ?<br />
- dans sa phase construction / reconstruction<br />
- dans sa phase exploitation<br />
En quoi le sinistre a-t-il impacté votre vision de <strong>Baraka</strong> ?<br />
c – L’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> :<br />
Pour vous, que veut dire utilité sociale ?<br />
Quelle est-elle pour <strong>Baraka</strong> ?<br />
Si vous étiez amené à choisir 4 indicateurs clés pour mesurer l’utilité sociale, quels<br />
seraient-ils ?<br />
105
ANNEXE 4 – GRILLE DE SYNTHESE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS SOCIETAIRES<br />
THEMES SOCIETAIRE 1 SOCIETAIRE 2 SOCIETAIRE 3 SOCIETAIRE 4 SOCIETAIRE 5 SOCIETAIRE 6 SOCIETAIRE 7 SOCIETAIRE 8 SOCIETAIRE 9<br />
Définition de - Bâtiment écolo - un lieu<br />
- un resto bio et - une SCIC dont - bâtiment - un lieu de<br />
- à Roubaix - Restaurant bio - investir un<br />
<strong>Baraka</strong> - resto bio autonome local<br />
l’objet social est écologique partage, de<br />
- un resto - Bâtiment délaissé urbain<br />
- deux emplois - un café citoyen - lieu<br />
la fabrique de - <strong>Baraka</strong> c’est convivialité autour construit selon écologique - une opération<br />
pour des<br />
d’initiatives biens communs trouver des idées de la restauration les normes - Insertion immobilière<br />
salariés de<br />
- bâtiment écolo - Roubaix, un qui créent des - un bâtiment écolo écologiques - Gouvernance exemplaire<br />
l’Univers<br />
dans un<br />
territoire à biens collectifs à - un resto sain et - tout le monde de SCIC<br />
quartier sensible grande précarité partir d’une frais<br />
peut participer - Exemplaire<br />
réalisé par des - un bâtiment activité<br />
- une façon de - repas à prix<br />
citoyens<br />
bioclimatique marchande mieux manger, de corrects, pas<br />
- l’économique - un resto bio<br />
lutter contre la 100% bio mais<br />
est un prétexte - de l’insertion<br />
malbouffe dans un de bonne qualité<br />
endroit sain et - appartient à<br />
atypique<br />
tout le monde<br />
- un groupement<br />
de sociétaires<br />
Finalité et<br />
- assemblier - lieu de liberté - modèle<br />
- lieu de partage - but un peu<br />
objectifs de<br />
d’initiatives - lieu où on peut marchand<br />
social<br />
<strong>Baraka</strong><br />
inventer<br />
équilibré<br />
- des emplois<br />
- lieu pour faire - essaimage<br />
du lien social<br />
- créer de<br />
l’emploi<br />
Signes du - les gens qui - Foisonnement, - si on ne fait - la participation - sociétaires - bâtiment<br />
- projet qui a - nombre de - activité<br />
succès de sont venus rencontres pas faillite sans du FSE aux passent de - les chantiers attiré du monde sociétaires et de économique<br />
<strong>Baraka</strong> manger<br />
- capacité des être uniquement chantiers<br />
spectateurs fiers participatifs<br />
- la construction soutien à<br />
rentable qui<br />
- les jardins gens à faire de dans le business participatifs d’avoir investis - les soirées à voix aboutie<br />
aujourd’hui et permet de<br />
l’associatif, du - avoir construit - l’embauche de dans quelque haute à la maison - lieu<br />
dans la durée : supporter<br />
collectif, des le bâtiment dans salariés en chose de<br />
- les visages<br />
d’échanges taux de présence l’investissement<br />
projets<br />
une dent creuse insertion si elles différent à<br />
rayonnant et - que tu te - animation de la dans le<br />
- diversité des - ateliers de sont heureuses créateurs de l’implication des sentes comme FBC<br />
bâtiment<br />
usagers<br />
jardinage<br />
et épanouies biens communs sociétaires le jour chez toi<br />
- la réalisation - essaimage<br />
organisés par - les liens avec - contaminer les de l’ouverture<br />
des prévisions en<br />
d’autres<br />
le quartier, si les gens qui<br />
- agrégation de<br />
toute ou partie<br />
- initiatives voisins viennent viennent pour petits bouts de<br />
- embauche<br />
qu’ils<br />
succès : maintien<br />
d’autres gens de<br />
reproduisent des emplois, bien-<br />
l’Univers<br />
être des salariés,<br />
- faire des dons<br />
équilibre<br />
à l’Univers<br />
économique,<br />
- une vraie<br />
activité non<br />
gouvernance :<br />
économique<br />
propositions qui<br />
fusent, du débat<br />
Intérêt - fabrique de - l’économique - US est la<br />
- C’est la même - US : mot un peu - US et IG, - US existe - US : ne veut<br />
général, biens communs doit être au condition<br />
chose<br />
valise qui vient du notions qui se quand on crée de pas la définir<br />
utilité<br />
on dit, là j’ai du service du bien d’existence de<br />
- Biens communs Conseil Régional rejoignent l’activité, quand car donne droit<br />
sociale, mal<br />
commun<br />
<strong>Baraka</strong><br />
ça souligne la - IG : ce qui<br />
- FBC :<br />
on crée de la ou de mort de<br />
fabrique de<br />
- c’est ce<br />
- US c’est un<br />
coopération convient au + n’appartient pas relation. On peut certains sur<br />
biens<br />
pourquoi on peu comme<br />
- l’US c’est très grand nombre. à quelqu’un le faire dans certaines<br />
communs<br />
produit<br />
biens communs<br />
très large<br />
toute société. activités<br />
- IG prédomine<br />
106
THEMES SOCIETAIRE 1 SOCIETAIRE 2 SOCIETAIRE 3 SOCIETAIRE 4 SOCIETAIRE 5 SOCIETAIRE 6 SOCIETAIRE 7 SOCIETAIRE 8 SOCIETAIRE 9<br />
Intérêt<br />
- il faut le définir - FBC : qu’est-ce<br />
Toute l’économie - FBC : toute<br />
général,<br />
car c’est pas sûr qu’on met tous<br />
devrait être coopérative en<br />
utilité<br />
que les<br />
ensemble dans la<br />
utilité sociale. est une :<br />
sociale,<br />
sociétaires même marmite<br />
- Rien n’est intérêts<br />
fabrique de<br />
sachent le faire pour faire quelque<br />
gratuit, tout est divergents +<br />
biens<br />
alors si on<br />
chose qui<br />
dans le marché objectifs<br />
communs<br />
s’adresse à tous convienne au +<br />
- IG : pour la communs =<br />
(suite)<br />
les gens qui grand nombre<br />
majorité des création de<br />
viennent au<br />
gens et non pas richesse<br />
restaurant , on<br />
dans un intérêt commune<br />
risque un certain<br />
particulier<br />
taux d’échec<br />
- FBC : échanges<br />
de biens,<br />
d’expériences et<br />
services<br />
L’utilité<br />
- ne pas<br />
- l’agriculture - manger dans - dimension<br />
- oui car il y a - ça ghettoïse - éco<br />
sociale de<br />
réfléchir trop à<br />
urbaine<br />
un bâtiment environnementale des emplois<br />
construction,<br />
<strong>Baraka</strong><br />
l’utilité<br />
écologique du bâtiment<br />
créés et qui<br />
économie<br />
- théorie de<br />
- manger<br />
- ouverture,<br />
respectent la vie<br />
d’énergie<br />
l’ordre qui se<br />
biologique et partage de savoir-<br />
- création de<br />
crée<br />
local<br />
faire<br />
postes pour<br />
naturellement =<br />
- biens communs - remettre en cause<br />
personnes en<br />
lancer l’idée et<br />
embryonnaires les paradigmes et<br />
insertion<br />
laisser se<br />
car peu<br />
faire avancer<br />
construire<br />
développés : - lire des textes<br />
soirée lecture avec des gens pas<br />
forcément habitués<br />
à écouter des<br />
textes<br />
- initiatives par et<br />
pour les gens du<br />
quartier<br />
Exemples je sais pas - j’ai du mal<br />
- consommation - l’origine des - Nombre de<br />
- un nombre - taux de<br />
- emploi de<br />
d’indicateurs<br />
avec les<br />
d’énergie de achats (objectif : personnes qui d’emploi qui présence aux qualité et<br />
de mesure<br />
mesures d’US<br />
<strong>Baraka</strong><br />
- de 100km de viennent manger, reste à taille réunions sur la pérennes<br />
- indicateurs<br />
- pérennité de <strong>Baraka</strong>)<br />
aux soirées lecture, humaine : que FBC<br />
- intégration<br />
empêchent de<br />
l’implication des - taux des<br />
aux AG<br />
les gens se - Nombre<br />
des personnes<br />
réfléchir<br />
salariés, bien- produits<br />
- Nombre de<br />
connaissent d’initiatives qui sortent d’un<br />
- une démarche<br />
être au travail biologiques personne squi se - le lieu : la réalisées, taux parcours<br />
qualitative :<br />
- provenance - contreparties mettent à lire après fréquentation de<br />
d’insertion<br />
débats, écritures<br />
des usagers (autres que la les soirées lecture autre que pour transformation - vivacité du<br />
d’histoires,<br />
(objectif :<br />
restauration) - Fidélité des la restauration, des idées en sociétariat :<br />
écrire la<br />
roubaisiens) retirées par les usagers<br />
la fidélité des actions<br />
présence aux<br />
complexité<br />
usagers de leur - Taille du noyau usagers<br />
- taux<br />
AG, aux<br />
- mise en valeur<br />
venue à <strong>Baraka</strong> dur des sociétaires - l’équilibre d’exemplarité : réunions,<br />
des<br />
- équilibre<br />
économique et nombre de nombre de<br />
contradictions,<br />
économique<br />
la notoriété de personnes qui pouvoirs …<br />
les compromis<br />
<strong>Baraka</strong><br />
viennent<br />
trouvés<br />
- l’esprit de<br />
- ne pas penser<br />
<strong>Baraka</strong>, la<br />
le bonheur à la<br />
capacité à<br />
place des gens<br />
débattre<br />
107
ANNEXE 5 – GRILLE DE SYNTHESE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS PARTIES PRENANTES<br />
THEMES PARTIE PRENANTE 10 PARTIE PRENANTE 11 PARTIE PRENANTE 12 PARTIE PRENANTE 13<br />
Définition de - Réappropriation de l’espace public - bâtiment écologique<br />
- système coopératif : mise en - implantation territoriale<br />
<strong>Baraka</strong> en jachère<br />
- beaucoup de sociétaires dans le commun de toutes les énergies - continuité du travail des associations<br />
- déboucher d’emploi pour<br />
projet<br />
pour trouver des solutions,<br />
d’insertion<br />
personnes en insertion<br />
- nourriture bio<br />
partager l’information, donner sans - projet global<br />
- bâtiment écolo<br />
- tout est sain<br />
attendre de retour<br />
- projet économique<br />
- va au-delà du financier<br />
- participation des habitants au<br />
projet (SCIC + chantiers<br />
participatifs)<br />
- création d’emplois<br />
- être autonome financièrement à terme<br />
- pour les gens autour - essaimage<br />
- mixité de la clientèle, des salariés<br />
- que le restaurant ouvre et qu’il y<br />
ait du monde<br />
- s’il y a du monde qui revient et<br />
souvent<br />
- la publicité<br />
- ce que pensent les gens de <strong>Baraka</strong><br />
- si acteurs locaux s’approprient le<br />
projet : s’ils le connaissent et<br />
savent en parler<br />
- le bâtiment<br />
- le nombre d’emplois créés<br />
- le nombre de sociétaires<br />
- US : je ne connais pas cette<br />
notion<br />
Finalité et<br />
objectifs de<br />
<strong>Baraka</strong><br />
Signes du<br />
succès de<br />
<strong>Baraka</strong><br />
- US n’est pas universelle, dépend du<br />
projet<br />
- est contingente à un territoire<br />
- attentive aux publics ne difficulté<br />
- c’est trop difficile pour moi - n’importe quelle entreprise aune<br />
activité sociale et économique<br />
(me renvoie à la réponse à l’appel à<br />
projet mais <strong>Baraka</strong> n’y a pas répondu)<br />
Intérêt<br />
général,<br />
utilité<br />
sociale,<br />
fabrique de<br />
biens<br />
communs<br />
L’utilité<br />
sociale de<br />
Je ne sais pas - réussir dans un quartier difficile<br />
- faire venir des gens qui n’y<br />
viendraient pas naturellement<br />
- la mixité des gens<br />
- lien avec le tissu social et local<br />
- être accessible pour tous<br />
- lieu de vie et de partage<br />
- troc de livres, ateliers cuisine,<br />
chantiers participatifs<br />
- comment Bk existe en dehors du<br />
lieu, n’est pas seulement un lieu<br />
- trop tendance à évaluer le<br />
quantitatif et pas suffisamment le<br />
qualitatif<br />
- difficile de mesurer la qualité de<br />
l’US<br />
<strong>Baraka</strong><br />
- richesse produite (CA, flux financiers)<br />
pour le territoire et ne pas être que dans<br />
redistribution<br />
- population embauchée = personnes en<br />
insertion<br />
Je ne sais pas - nombre de couverts<br />
- origine géographique des usagers<br />
- économie de la consommation<br />
d’énergie<br />
Exemples<br />
d’indicateurs<br />
de mesure<br />
108
ANNEXE 6 – CONVENTION FSE (Extraits)<br />
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
ANNEXE 7<br />
Questionnaire de satisfaction des chantiers participatifs 2011<br />
Q1. Vous avez : < de 18 ans ☐<br />
18-25 ans ☐<br />
16-35 ans ☐<br />
36-55 ans ☐<br />
> 55 ans ☐<br />
Q2. Vous intéressez-vous à l’écologie ? Beaucoup ☐<br />
Un peu ☐<br />
Faiblement ☐<br />
Pas du tout ☐<br />
Q3. Lors des chantiers participatifs, à quel(s) stage(s) avez-vous participé ?<br />
(Plusieurs réponses possibles)<br />
Fabrication de mobilier et d’éléments de jardin ☐<br />
Isolation paille du bâtiment ☐<br />
Insufflation de ouate de cellulose pour l’isolation du bâtiment ☐<br />
Pose d’enduit naturel ☐<br />
Pose de bardage bois non traité ☐<br />
Installation et pose de la terrasse et du mobilier de jardin ☐<br />
Q4. Combien de temps a duré votre stage ?<br />
Entre 1 et 5 jours ☐<br />
Entre 6 et 10 jours ☐<br />
Entre 10 et 15 jours ☐<br />
+ de 15 jours ☐<br />
Q5. Sur chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé l’apprentissage :<br />
L’éveil musculaire<br />
Des techniques ou astuces pour<br />
construire soi-même<br />
Des techniques ou astuces pour<br />
construire de manière écologique<br />
Des techniques ou astuces pour réduire<br />
la consommation d’énergie<br />
Les consignes de sécurité sur un chantier<br />
L’utilisation de nouveaux outils<br />
*Ne sait pas<br />
Très bon Bon <strong>Mo</strong>yen Insuffisant NSP*<br />
123
Q6. Avez-vous eu l’occasion de reproduire une des techniques apprises ? Oui ☐<br />
Non ☐<br />
Si oui, la ou lesquelles ? ____________<br />
Si oui, dans quel cadre ? Dans mon travail ☐<br />
Dans mon logement ☐<br />
Pour un proche ☐<br />
Autre : _______________<br />
Q7. Ce stage vous a-t-il donné envie de travailler dans la construction de bâtiment ?<br />
Oui ☐<br />
Non ☐<br />
J’y travaille déjà ☐<br />
Je suis à la retraite ☐<br />
Q8. Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous avez le + aimé pendant le stage :<br />
*Connaître de nouvelles personnes ☐<br />
*Parler avec les autres participants ☐<br />
*Travailler en équipe ☐<br />
*Recevoir un diplôme, une attestation de stage ☐<br />
*Apprendre des choses nouvelles ☐<br />
*Construire moi-même ☐<br />
*Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) ☐<br />
Q9. Le stage vous a-t-il permis de découvrir les avantages des constructions en bois (économie<br />
d’énergie, stockage carbone …) ?<br />
Oui ☐<br />
Non ☐<br />
Je connaissais déjà ☐<br />
Q10. Depuis le stage, vous intéressez-vous :<br />
à l’écologie<br />
aux constructions en bois<br />
à l’économie d’énergie<br />
aux métiers du bâtiment<br />
à faire les choses moi-même plutôt que d’acheter<br />
à participer à la vie de mon quartier<br />
Plus Autant <strong>Mo</strong>ins Toujours pas<br />
124
Q11. Avez-vous gardé contact avec d’autres stagiaires (que vous ne connaissiez pas avant le stage) ?<br />
Oui ☐<br />
Non ☐<br />
Si non, pourquoi : pas envie ☐<br />
pas besoin ☐<br />
pas le temps ☐<br />
pas du quartier ☐<br />
Comptez-vous le faire + tard : Oui ☐<br />
je ne pense pas ☐<br />
Q12. Etes-vous retourné(e) à <strong>Baraka</strong> depuis le stage ? Oui ☐<br />
Non ☐<br />
Si oui, quand ? lors de l’inauguration ☐<br />
pour déjeuner ☐<br />
lors de l’incendie ☐<br />
lors du café voisins du 2 juin ☐<br />
pour le déménagement ☐<br />
en passant devant ☐<br />
j’y travaille ou je suis sociétaire ☐<br />
pour visiter ou faire visiter à des proches ☐<br />
Si non, pourquoi : pas envie ☐<br />
pas besoin ☐<br />
trop loin ☐<br />
pas le temps ☐<br />
Comptez-vous le faire + tard : oui ☐<br />
je ne pense pas ☐<br />
Q13. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?<br />
125
ANNEXE 8 - DICTIONNAIRE DES CODES<br />
Q° N° Enoncé de la question Variable <strong>Mo</strong>dalité de la variable<br />
18-25 ans 0<br />
1 Vous avez AGE<br />
2 Vous intéressez-vous à l'écologie ? ECOLO<br />
3<br />
5<br />
5<br />
Lors des chantiers participatifs, à quel(s) stage(s) avez-vous<br />
participé ?<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (L’éveil musculaire)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (Des techniques ou astuces pour construire<br />
soi-même)<br />
STAGE<br />
4 Combien de temps a duré votre stage ? DUREE<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
6<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (Des techniques ou astuces pour construire<br />
de manière écologique)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (Des techniques ou astuces pour réduire la<br />
consommation d’énergie)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage ( consignes de sécurité sur un chantier)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (L’utilisation de nouveaux outils)<br />
EVEIL<br />
AUTOCONST<br />
ECOCONS<br />
CONSOEGIE<br />
SECU<br />
OUTILS<br />
6 Si Oui, la ou lesquelles ? TECH<br />
6 Si Oui, dans quel cadre ? CADRE<br />
7<br />
8<br />
8<br />
8<br />
9<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (L’utilisation de nouveaux matériaux)<br />
Avez-vous eu l’occasion de reproduire une des techniques<br />
apprises ?<br />
Ce stage vous a-t-il donné envie de travailler dans la<br />
construction de bâtiment ?<br />
Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous<br />
avez le + aimé pendant le stage :<br />
Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous<br />
avez le + aimé pendant le stage :<br />
Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous<br />
avez le + aimé pendant le stage :<br />
Le stage vous a-t-il permis de découvrir les avantages des<br />
constructions en bois (économie d’énergie, stockage carbone<br />
…) ?<br />
MATERX<br />
REPRO<br />
BAT<br />
PREF1<br />
PREF2<br />
PREF3<br />
BOIS<br />
26-35 ans 1<br />
36-55 ans 2<br />
>55 ans 3<br />
Beaucoup 0<br />
Un peu 1<br />
Faiblement 2<br />
Pas du tout 3<br />
Fabrication de mobilier et d’éléments de jardin 0<br />
Isolation paille du bâtiment 1<br />
Insufflation de ouate de cellulose pour l’isolation du bâtiment 2<br />
Pose d’enduit naturel 3<br />
Pose de bardage bois non traité 4<br />
Installation et pose de la terrasse et du mobilier de jardin 5<br />
Entre 1 et 5 jours 0<br />
Entre 6 et 10 jours 1<br />
Entre 10 et 15 jours 2<br />
+ de 15 jours 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Ne sait pas 4<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Oui 0<br />
Non 1<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Dans mon travail 0<br />
Dans mon logement 1<br />
Pour un proche<br />
2<br />
Autre 3<br />
Oui 0<br />
Non 1<br />
Je suis à la retraite 2<br />
J'y travaille déjà 3<br />
Connaître de nouvelles personnes 0<br />
Parler avec les autres participants 1<br />
Travailler en équipe 2<br />
Recevoir un diplôme 3<br />
Apprendre des choses nouvelles 4<br />
Construire moi-même 5<br />
Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) 6<br />
Connaître de nouvelles personnes 0<br />
Parler avec les autres participants<br />
1<br />
Travailler en équipe<br />
2<br />
Recevoir un diplôme<br />
3<br />
Apprendre des choses nouvelles 4<br />
Construire moi-même 5<br />
Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) 6<br />
Connaître de nouvelles personnes 0<br />
Parler avec les autres participants<br />
1<br />
Travailler en équipe<br />
2<br />
Recevoir un diplôme<br />
3<br />
Apprendre des choses nouvelles 4<br />
Construire moi-même 5<br />
Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) 6<br />
Oui 0<br />
Non 1<br />
Je connaissais déjà 2<br />
Enquête quantitative juillet 2012 - Chantiers participatifs - Coopérative <strong>Baraka</strong><br />
126
ANNEXE 8 - DICTIONNAIRE DES CODES<br />
Q° N° Enoncé de la question Variable <strong>Mo</strong>dalité de la variable<br />
18-25 ans 0<br />
1 Vous avez AGE<br />
2 Vous intéressez-vous à l'écologie ? ECOLO<br />
3<br />
5<br />
5<br />
Lors des chantiers participatifs, à quel(s) stage(s) avez-vous<br />
participé ?<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (L’éveil musculaire)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (Des techniques ou astuces pour construire<br />
soi-même)<br />
STAGE<br />
4 Combien de temps a duré votre stage ? DUREE<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
6<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (Des techniques ou astuces pour construire<br />
de manière écologique)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (Des techniques ou astuces pour réduire la<br />
consommation d’énergie)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage ( consignes de sécurité sur un chantier)<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (L’utilisation de nouveaux outils)<br />
EVEIL<br />
AUTOCONST<br />
ECOCONS<br />
CONSOEGIE<br />
SECU<br />
OUTILS<br />
6 Si Oui, la ou lesquelles ? TECH<br />
6 Si Oui, dans quel cadre ? CADRE<br />
7<br />
8<br />
8<br />
8<br />
9<br />
Pour chacun des thèmes ci-dessous, vous avez trouvé<br />
l’apprentissage (L’utilisation de nouveaux matériaux)<br />
Avez-vous eu l’occasion de reproduire une des techniques<br />
apprises ?<br />
Ce stage vous a-t-il donné envie de travailler dans la<br />
construction de bâtiment ?<br />
Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous<br />
avez le + aimé pendant le stage :<br />
Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous<br />
avez le + aimé pendant le stage :<br />
Dans la liste suivante, quelles sont les 3 choses que vous<br />
avez le + aimé pendant le stage :<br />
Le stage vous a-t-il permis de découvrir les avantages des<br />
constructions en bois (économie d’énergie, stockage carbone<br />
…) ?<br />
MATERX<br />
REPRO<br />
BAT<br />
PREF1<br />
PREF2<br />
PREF3<br />
BOIS<br />
26-35 ans 1<br />
36-55 ans 2<br />
>55 ans 3<br />
Beaucoup 0<br />
Un peu 1<br />
Faiblement 2<br />
Pas du tout 3<br />
Fabrication de mobilier et d’éléments de jardin 0<br />
Isolation paille du bâtiment 1<br />
Insufflation de ouate de cellulose pour l’isolation du bâtiment 2<br />
Pose d’enduit naturel 3<br />
Pose de bardage bois non traité 4<br />
Installation et pose de la terrasse et du mobilier de jardin 5<br />
Entre 1 et 5 jours 0<br />
Entre 6 et 10 jours 1<br />
Entre 10 et 15 jours 2<br />
+ de 15 jours 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Ne sait pas 4<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Très bon 0<br />
bon 1<br />
<strong>Mo</strong>yen 2<br />
Insuffisant 3<br />
Oui 0<br />
Non 1<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Dans mon travail 0<br />
Dans mon logement 1<br />
Pour un proche<br />
2<br />
Autre 3<br />
Oui 0<br />
Non 1<br />
Je suis à la retraite 2<br />
J'y travaille déjà 3<br />
Connaître de nouvelles personnes 0<br />
Parler avec les autres participants 1<br />
Travailler en équipe 2<br />
Recevoir un diplôme 3<br />
Apprendre des choses nouvelles 4<br />
Construire moi-même 5<br />
Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) 6<br />
Connaître de nouvelles personnes 0<br />
Parler avec les autres participants<br />
1<br />
Travailler en équipe<br />
2<br />
Recevoir un diplôme<br />
3<br />
Apprendre des choses nouvelles 4<br />
Construire moi-même 5<br />
Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) 6<br />
Connaître de nouvelles personnes 0<br />
Parler avec les autres participants<br />
1<br />
Travailler en équipe<br />
2<br />
Recevoir un diplôme<br />
3<br />
Apprendre des choses nouvelles 4<br />
Construire moi-même 5<br />
Participer à un projet collectif comme <strong>Baraka</strong> (social, écolo …) 6<br />
Oui 0<br />
Non 1<br />
Je connaissais déjà 2<br />
Enquête quantitative juillet 2012 - Chantiers participatifs - Coopérative <strong>Baraka</strong><br />
127
ANNEXE 9 – REVUE DE PRESSE<br />
ROUBAIX / RESTAURANT LA BARAKA<br />
Une première recette alléchante<br />
Publié le vendredi 11 novembre 2011 à 06h00 – Nord Eclair<br />
Une expérience on ne peut plus enrichissante pour les<br />
responsables du projet <strong>Baraka</strong> et pour les salariés des<br />
Papillons blancs.<br />
Ça a l'air de rien une mayonnaise ! Mais cela exige une<br />
certaine dextérité. Tout est dans le dosage, la qualité des<br />
produits, la température ambiante, le tour de main. Parmi<br />
les ingrédients de la mayonnaise « chantiers participatifs »<br />
de la <strong>Baraka</strong>, des personnes handicapées. Mais les<br />
Papillons blancs se sont sentis comme des poissons dans<br />
l'eau.<br />
La dernière ligne droite... Pierre Wolf, le gérant de la coopérative annonce la fin de chantier du restaurant la<br />
<strong>Baraka</strong> à l'angle des rues du Nord et de Sébastopol pour le 12 janvier. En vue d'une ouverture dans les semaines<br />
suivantes.<br />
La fin d'une belle aventure humaine avant le début d'une autre. La <strong>Baraka</strong> en effet ce ne fut pas un chantier tout à<br />
fait comme les autres. Aux côtés de l'architecte, des spécialistes de la construction basse consommation<br />
énergétique, des béotiens de l'écologie... Des artisans traditionnels désireux de s'initier à des pratiques nouvelles,<br />
des retraités aussi disponibles que curieux, une orthophoniste néerlandaise vivant dans un camping car et sept<br />
jeunes handicapés participant aux chantiers d'insertion protégés gérés par les SISEP des Papillons blancs de<br />
Roubaix-Tourcoing et de Lille.<br />
Au total, d'ici le 2 septembre, date de conclusion des chantiers participatifs, mis en place par la coopérative La<br />
<strong>Baraka</strong> et Chênelet Développement (une structure d'insertion et de formation d'Audrethun fortement impliquée<br />
dans le développement durable), 86 stagiaires de toutes origines se sont investis dans une quinzaine de modules<br />
de formation successifs s'étalant sur une semaine : l'isolation des murs avec de la paille, l'isolation des toitures<br />
avec de la ouate de cellulose, le bardage en bois de mélèze bûcheronné dans le Pas de Calais, la fabrication et le<br />
lissage d'enduits chaux-sable-terre, la conception et la réalisation de nichoirs pour oiseaux, d'abris pour insectes,<br />
de jardinières et de dalles de terrasse en acacia (ce module étant proposé à Audrethun).<br />
Comme une lettre à la poste<br />
Les équipes intervenant sur ces chantiers participatifs comprennent de 5 à 6 personnes. Ce sont des équipes<br />
mixtes associant des personnes valides et des handicapés. On pouvait craindre que cette mixité pose problème.<br />
Pas du tout. « C'est passé comme une lettre à la poste », assure Jérémie Gaudin, coordinateur des formations chez<br />
Chênelet développement. Chacun avançait à son rythme et bénéficiait de l'apport des autres, les modules se<br />
répartissant entre une journée de formation et quatre journées de chantier. « On a ainsi vu des jeunes des<br />
Papillons blancs apporter de judicieux conseils à des néophytes un peu désarçonnés. » Michelle Fargeon,<br />
sociétaire de la coopérative <strong>Baraka</strong> et coordinatrice des chantiers participatifs et Valérie Devestel, chef de service<br />
au SISEP des Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing en charge des chantiers d'insertion estiment elles aussi que<br />
l'essai a été concluant.<br />
Pierre Wolf, pour sa part, considère que la coopérative, grâce au soutien de la mairie et aux fonds européens qui<br />
ont permis cette expérience, a pleinement répondu à sa vocation : créer un bien commun tout en apportant une<br />
valeur ajoutée solidaire à la construction de l'équipement.<br />
Et ce ne sont certainement pas Jimmy, Philippe, Michaël, Antony et Christophe, cinq des salariés des Papillons<br />
blancs qui ont découvert l'isolation avec la paille, les enduits ou encore la menuiserie qui le démentiront. L'un<br />
d'eux a demandé à Pierre Wolf quand le restaurant serait ouvert. Il aimerait bien s'attabler là où pour lui se sont<br />
dessinés d'autres horizons...<br />
128
La <strong>Baraka</strong>, ce n’est plus la scoumoune...<br />
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2011 – Nord Eclair<br />
Au mois de juillet, Pierre Wolf, gérant de la coopérative La <strong>Baraka</strong> se faisait un sang d’encre. En raison de<br />
retards au démarrage du chantier de son restaurant de type « passiv‐haus », le calendrier des formations à<br />
l’éco‐construction se trouvait bouleversé. Cette fois, c’est bien parti.<br />
La faute à une dalle de béton mal coulée et à une cage<br />
d’ascenseur installée de façon pas très catholique. Rien à<br />
voir avec l’écoconstruction et le « passiv-haus »<br />
proprement dits mais, au final, ces malfaçons ont retardé<br />
de plus d’un mois le démarrage des divers modules de<br />
formation proposés dans le cadre du chantier de<br />
construction de la <strong>Baraka</strong> par la coopérative Chênelet de<br />
Landrethun. « J’ai passé un été épouvantable. Ce n’était<br />
plus la <strong>Baraka</strong>, mais la scoumoune », se rappelle Pierre<br />
Wolf, gérant du futur restaurant.<br />
Durant une partie de ses vacances, il lui a fallu recontacter<br />
chacune des personnes qui s’étaient inscrites à l’un ou<br />
l’autre des modules de formation pour les prévenir de<br />
l’ajournement, étudier avec elles la possibilité d’une<br />
réinscription, redéfinir avec Chênelet<br />
Développement un nouveau calendrier. « On a presque<br />
rattrapé le retard initial », assure aujourd’hui<br />
Pierre Wolf qui ne désespère pas d’ouvrir, comme annoncé<br />
le 7 mai dernier, la <strong>Baraka</strong> en début d’année prochaine. Une orthophoniste néerlandaise et une adjointe en retraite<br />
Et c’est vrai que ces dernières semaines le chantier a considérablement avancé. Qu’il s’agisse des salariés de<br />
Chênelet ou des « amateurs » qui se forment, chacun en met un coup. Sous la responsabilité de Frédéric Rojas,<br />
l’encadrant de Chênelet, étudiant l’isolation à la paille, des stagiaires aux motivations diverses : Michaël qui vient<br />
des Papillons Blancs, association avec laquelle une convention a été signée, Denise, ancienne adjointe et jeune<br />
retraitée, tout heureuse de faire découvrir son nouveau job à sa petite fille, Gaétan, un artisan charpentier qui<br />
s’intéresse de près aux constructions en bois et, depuis que les assurances se montrent moins tatillonnes en ce<br />
domaine, à l’isolation en paille. Et puis aussi... Manon. Orthophoniste à Rotterdam, Manon a eu vent par Internet<br />
de cette formation. Elle vit actuellement dans un camping-car pour ne rien rater du chantier. « <strong>Mo</strong>n rêve, ce serait<br />
de construire un écovillage. Je n’ai pas encore trouvé l’endroit mais je compte bien y arriver. » Cette aventure<br />
collective est loin d’être terminée. Si les divers modules de formation affichent pour une bonne part complet, il<br />
existe encore quelques places disponibles pour s’initier à l’enduit en terre, au bardage et à la réalisation de<br />
terrasses en bois. « Au total, 77 personnes auront ainsi pu se former à la construction bioclimatique. Mais comme<br />
nous sommes subventionnés par le Fonds social européen, nous sommes tenus d’accueillir une quarantaine issues<br />
de zones urbaines sensibles », indique Pierre Wolf. La <strong>Baraka</strong>, bientôt une référence pour les journées du<br />
patrimoine ? Le gérant sourit : « C’est vrai qu’en l’état actuel du chantier, il nous était difficile de participer à la<br />
dernière programmation mais l’office du tourisme a pris contact<br />
avec nous. Il compte organiser des visites le 19 novembre et le 3 décembre de 10 à 12 h. »<br />
Pour tout renseignement ou inscription aux modules encore accessibles : www.cooperativebaraka.fr ou<br />
chantiers@cooperativebarka.fr. Ou encore en se rendant sur place à l’angle des rues du Nord et de Sébastopol<br />
tous les mardis à 11 h 30.<br />
129
Avant de manger à la table de <strong>Baraka</strong>, Pierre Wolf vous invite à en<br />
bâtir les murs !<br />
Publié le 13/04/2011 à 05h22 – La Voix du Nord<br />
<strong>Baraka</strong>, c'est un restaurant à dominante bio dont l'ouverture est programmée pour janvier<br />
2012, c'est aussi un bâtiment bioclimatique passif et un chantier participatif... Une addition de<br />
défis qui rend le projet unique et passionnant, de la première planche au premier plat du jour.<br />
PAR OLIVIER HENNION<br />
roubaix@lavoixdunord.fr<br />
Rome ne s'est pas faite en un jour, <strong>Baraka</strong> non plus.<br />
L'idée de ce restaurant alliant l'écologie,<br />
l'accompagnement social et l'engagement citoyen est<br />
née en septembre 2009 au sein de l'association<br />
l'Univers (la cantine du coeur de la rue de l'Épeule), de<br />
la conjonction des ambitions et des envies d'une vingtaine d'intervenants et de bénévoles. Pierre Wolf était de<br />
ceux-là. Cet après-midi, le terrain de 129 m² qui accueillera le restaurant à l'angle des rues du Nord et Sébastopol<br />
deviendra officiellement la propriété de la société coopérative d'intérêt collectif <strong>Baraka</strong> dont il est le gérant. « Les<br />
travaux devraient commencer vendredi. Pour en arriver là, il a tout de même fallu un an de travail pour affiner le<br />
dossier et réunir les fonds. » Car le projet <strong>Baraka</strong> n'a rien de la fantaisie « écolo » un brin idéaliste. Le budget<br />
total de l'opération est de 820 000 euros, dont 200 000 apportés par les 82 sociétaires de la coopérative, 200 000<br />
provenant de subventions et 420 000 euros de prêts bancaires. « On a réellement l'intention de faire tourner ce<br />
restaurant, même si le lieu sera aussi à disposition des associations pour des ateliers, des activités », précise Pierre<br />
Wolf. Le restaurant <strong>Baraka</strong> sera même le premier bâtiment en France construit selon les principes de « maison<br />
passive » à accueillir du public. « Il n'y aura aucun radiateur à l'intérieur. L'isolation des murs en paille, les baies<br />
vitrées, l'orientation sud et un système de ventilation conservant les calories à l'intérieur devraient nous garantir<br />
une chaleur constante. » Des panneaux solaires posés sur le toit chaufferont l'eau, et une terrasse sera installée à<br />
l'étage.<br />
<strong>Baraka</strong> est donc un projet à haute teneur écologique... Mais pas seulement. « Le développement durable ne se<br />
limite pas au bâtiment, ce que nous défendons ici est une autre façon d'entreprendre ». Cela se traduira<br />
concrètement par la mise en place de chantiers participatifs qui s'étendront de la mi-juin à la mi-septembre. Ces<br />
chantiers se découpent en modules de cinq jours durant lesquels des personnes travaillent bénévolement sous la<br />
responsabilité d'un encadrant (un cadre pour trois stagiaires) dans un domaine précis lié à l'éco-construction. Au<br />
terme de la période de travail, les bénévoles reçoivent une attestation de formation. « Des structures comme les<br />
Papillons blancs, la MIE ou l'École de la deuxième chance nous ont déjà contactés », précise Pierre Wolf qui est<br />
toujours à la recherche de volontaires pour les différentes tranches de chantier. Notamment des artisans en quête<br />
de certifications professionnelles dans le secteur de l'éco-construction.<br />
Côté cuisine, on jouera la carte de l'insertion puisque deux des salariés du futur restaurant seront des anciens de<br />
l'Univers, embauchés en contrat aidé. « Nous serons cinq en tout ici lorsque le restaurant fonctionnera... Et audelà<br />
de toutes ces questions, ce qui compte vraiment c'est que les gens viennent y manger et nous permettent de<br />
continuer l'aventure. » •<br />
Renseignements et inscriptions aux chantiers www.cooperativebaraka.fr ou chantiers@cooperativebaraka.fr<br />
130
TABLE DES MATIERES<br />
INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 5<br />
PARTIE 1 ‐ MONOGRAPHIE DE BARAKA ................................................................................................. 8<br />
1. LA METHODOLOGIE MOBILISEE DURANT LE STAGE ............................................................................ 8<br />
2. GENESE DE BARAKA ET PREMIERS PAS ........................................................................................... 9<br />
2.1. Genèse du projet <strong>Baraka</strong> ................................................................................................................................ 9<br />
2.1.1. Le contexte territorial ............................................................................................................................................................... 9<br />
2.1.2. L’origine du projet ...................................................................................................................................................................... 9<br />
2.1.3. La concrétisation de l’idée en projet ................................................................................................................................ 11<br />
2.1.4. Mettre l’économique au service d’un intérêt collectif .............................................................................................. 16<br />
2.2. Le pluralisme des valeurs ............................................................................................................................ 19<br />
2.2.1. La dimension environnementale ....................................................................................................................................... 19<br />
2.2.2. La dimension sociale ............................................................................................................................................................... 20<br />
2.2.3. La dimension économique ................................................................................................................................................... 21<br />
2.2.4. L’ancrage territorial et proximité ..................................................................................................................................... 22<br />
2.2.5. La gouvernance démocratique ........................................................................................................................................... 23<br />
2.3. Les moyens du projet ..................................................................................................................................... 24<br />
2.4. Le projet suite au sinistre ............................................................................................................................ 25<br />
2.4.1. Les causes du sinistre ............................................................................................................................................................. 25<br />
2.4.2. Les conséquences de l’incendie ......................................................................................................................................... 26<br />
2.4.2.1. Les investissements matériels .................................................................................................................................. 26<br />
2.4.2.2. Les conséquences humaines ...................................................................................................................................... 27<br />
2.4.2.3. Une fragilisation économique du projet ................................................................................................................ 28<br />
2.4.2.4. Une solidarité concrète ................................................................................................................................................. 29<br />
2.4.3. La reconstruction ..................................................................................................................................................................... 31<br />
2.4.3.1. Pierre Wolf ......................................................................................................................................................................... 31<br />
2.4.3.2. La question du transfert d’activité .......................................................................................................................... 31<br />
2.4.3.3. Les travaux ......................................................................................................................................................................... 32<br />
2.4.3.4. La viabilité économique ............................................................................................................................................... 35<br />
2.4.3.5. La « fabrique de biens communs » .......................................................................................................................... 37<br />
3. CONCLUSION DE LA MONOGRAPHIE ............................................................................................... 39<br />
3.1. Un projet inscrit dans l’économie sociale et solidaire .................................................................... 39<br />
3.2. Force du projet politique et innovation ................................................................................................ 41<br />
PARTIE 2 – MES MISSIONS AU SEIN DE BARAKA ............................................................................... 42<br />
1. CONTEXTE DU STAGE ................................................................................................................... 42<br />
1.1. Genèse .................................................................................................................................................................. 42<br />
1.2. La notion d’utilité sociale, une question d’actualité ........................................................................ 42<br />
1.3. Les enjeux de l’utilité sociale ...................................................................................................................... 45<br />
131
1.4. L’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong>, une nécessité ? .......................................................... 46<br />
1.4.1. Objectifs externes ..................................................................................................................................................................... 46<br />
1.4.2. Objectifs internes ..................................................................................................................................................................... 47<br />
1.5. Réceptivité des sociétaires à l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> ................................ 47<br />
2. MISSION PRINCIPALE : L’EVALUATION DE L’UTILITE SOCIALE DE BARAKA .......................................... 48<br />
2.1. Expertise demandée ...................................................................................................................................... 48<br />
2.2. Déroulement de la mission ......................................................................................................................... 48<br />
2.3. Opportunités et difficultés rencontrées au cours de cette 1ère étape ..................................... 49<br />
3. EVOLUTION SUITE AU SINISTRE ..................................................................................................... 51<br />
3.1. Les raisons de reporter la démarche d’évaluation ........................................................................... 51<br />
3.2. Mes nouvelles missions ................................................................................................................................. 52<br />
4. ELEMENTS DE REFLEXIVITE SUR LE STAGE ..................................................................................... 53<br />
4.1. « Dé formatage » ............................................................................................................................................. 53<br />
4.2. Coopération ....................................................................................................................................................... 54<br />
PARTIE 3 ‐ EVALUER L’UTILITE SOCIALE D’UNE STRUCTURE ...................................................... 55<br />
1. EVALUER SON UTILITE SOCIALE ..................................................................................................... 55<br />
1.1. Les avantages de la démarche d’évaluation ....................................................................................... 57<br />
1.2. Les inconvénients et risques de la démarche d’évaluation ........................................................... 57<br />
1.3. Les méthodes d’évaluation ......................................................................................................................... 58<br />
2. L’EVALUATION DE L’UTILITE SOCIALE DE BARAKA ............................................................................ 59<br />
2.1. La méthodologie de l’évaluation de l’utilité sociale de <strong>Baraka</strong> .................................................. 59<br />
2.1.1. La phase exploratoire ............................................................................................................................................................. 59<br />
2.1.2. La phase de construction de l’évaluation ....................................................................................................................... 60<br />
2.1.3. Eléments de réflexivité sur la démarche ........................................................................................................................ 60<br />
2.2. Travaux préparatoires : les entretiens semi‐directifs ..................................................................... 61<br />
2.2.1. Le processus ............................................................................................................................................................................... 61<br />
2.2.2. Les limites de la technique d’entretiens semi‐directifs ........................................................................................... 62<br />
2.2.3. Synthèse et analyse transversale des entretiens semi‐directifs .......................................................................... 62<br />
2.2.3.1. Une finalité commune ................................................................................................................................................... 62<br />
2.2.3.2. L’utilité sociale, une notion méconnue .................................................................................................................. 64<br />
2.2.3.3. Les indicateurs : quelques pistes ............................................................................................................................. 65<br />
3. LES CHANTIERS PARTICIPATIFS : ESSAI D’EVALUATION DES IMPACTS ............................................... 69<br />
3.1. La méthode mobilisée pour l’étude des chantiers participatifs .................................................. 69<br />
3.2. Les chantiers participatifs : un processus de construction original ......................................... 70<br />
3.2.1. Le mécanisme opérationnel ................................................................................................................................................ 71<br />
132
3.2.2. Le financement des chantiers ............................................................................................................................................. 71<br />
3.2.3. Le recrutement des stagiaires ............................................................................................................................................ 72<br />
3.3. Les objectifs et enjeux des chantiers participatifs ............................................................................ 74<br />
3.3.1. Les objectifs selon la convention FSE .............................................................................................................................. 74<br />
3.3.2. Les enjeux et objectifs de la coopérative <strong>Baraka</strong> ........................................................................................................ 76<br />
3.3.3. Les enjeux et objectifs pour le groupe Chênelet ......................................................................................................... 76<br />
3.4. L’évaluation des impacts des chantiers participatifs ...................................................................... 77<br />
3.4.1. La méthodologie de l’enquête quantitative .................................................................................................................. 78<br />
3.4.1.1. L’échantillonnage ............................................................................................................................................................ 78<br />
3.4.1.2. La construction des questionnaires ........................................................................................................................ 78<br />
3.4.1.3. Les limites de l’enquête ................................................................................................................................................ 80<br />
3.4.2. L’analyse des résultats ........................................................................................................................................................... 81<br />
3.4.2.1. Le profil des stagiaires .................................................................................................................................................. 81<br />
3.4.2.2. L’initiation à l’éco‐construction et l’auto‐construction .................................................................................. 83<br />
3.4.2.3. La valorisation des métiers du bâtiment .............................................................................................................. 85<br />
3.4.2.4. L’impact sur les participants selon les objectifs des parties prenantes .................................................. 86<br />
3.4.3. L’analyse des résultats : la parole des usagers ............................................................................................................ 87<br />
3.5. Le bilan des chantiers participatifs ........................................................................................................ 91<br />
3.5.1. Le bilan pour le FSE ................................................................................................................................................................. 91<br />
3.5.2. Le bilan pour la coopérative <strong>Baraka</strong> ................................................................................................................................ 92<br />
3.5.3. Le bilan pour le groupe Chênelet ...................................................................................................................................... 92<br />
3.5.4. Les clés de la réussite et les axes de progrès des chantiers ................................................................................... 93<br />
CONCLUSION ................................................................................................................................................. 96<br />
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 100<br />
TABLES DES ANNEXES ............................................................................................................................. 102<br />
TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................. 131<br />
133