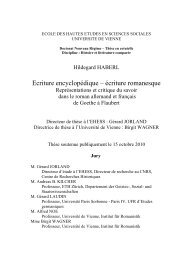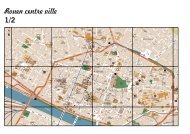Carlo BIANCHI - Université de Rouen
Carlo BIANCHI - Université de Rouen
Carlo BIANCHI - Université de Rouen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Carlo</strong> <strong>BIANCHI</strong><br />
133, rue <strong>de</strong> Javel<br />
75015 PARIS<br />
(44 ans)<br />
01 40 60 13 37<br />
06 67 78 62 38<br />
bianchica@wanadoo.fr<br />
Consultant en Ingénierie <strong>de</strong> la Formation<br />
Formation<br />
Depuis 1991<br />
Directeur<br />
Associé<br />
Exemples <strong>de</strong><br />
prestations dans<br />
l’enseignement :<br />
Exemples <strong>de</strong><br />
prestations en<br />
entreprise :<br />
Autres domaines <strong>de</strong><br />
compétences :<br />
bilingue français/italien - anglais courant - espagnol parlé<br />
• Doctorant en Sciences <strong>de</strong> l’Education - <strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Rouen</strong>.<br />
Sujet <strong>de</strong> recherche : Mécanismes d’apprentissage du jeu en formation professionnelle<br />
• DEA en Sciences <strong>de</strong> l’Education - <strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Rouen</strong>.<br />
Sujet <strong>de</strong> recherche : Pédagogie Active et Apprentissage Organisationnel<br />
• DESS Ingénierie <strong>de</strong> la Formation - <strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Rouen</strong>.<br />
Situation professionnelle actuelle<br />
CIPE (Centre International <strong>de</strong> la Pédagogie d’Entreprise) - Paris<br />
www.cipe.fr (Filiale du cabinet <strong>de</strong> conseil en organisation PROCONSEIL<br />
CONSULTING GROUP www.proconseil.net). Organisme <strong>de</strong> formation, spécialisé<br />
dans l’ingénierie pédagogique et la conception/diffusion <strong>de</strong> jeux d’entreprise et <strong>de</strong><br />
didacticiels, <strong>de</strong>stinés aux organismes <strong>de</strong> formation, aux entreprises et aux<br />
établissements d’enseignement supérieur.<br />
• Assistance aux établissements (<strong>de</strong> BAC+2 à BAC+5) pour l’intégration <strong>de</strong><br />
nouveaux outils pédagogiques dans les programmes <strong>de</strong> l’Education Nationale<br />
• 2003 et 2004 - Animation du séminaire <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong>s “Performance industrielle et<br />
Supply Chain Management” auprès d’élèves ingénieurs à l’Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille.<br />
• 2004 - Animation <strong>de</strong> la conférence "Pratiquer dans le réel ce que l’on a appris dans le<br />
fictif" lors du congrès annuel du SAGSET (Society for the Advancement of<br />
Games and Simulations in Education and Training) à l’Institut <strong>de</strong> Psychologie et<br />
Sociologie Appliquées <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> Catholique d’Angers.<br />
• 1999 - Intervention dans le cours “Pédagogie ludique en formation d’adultes”<br />
à l’<strong>Université</strong> Paris 13 (DESS Sciences du Jeu).<br />
• Agroalimentaire - Conception d’un dispositif <strong>de</strong> formation à la maintenance <strong>de</strong>s<br />
équipements <strong>de</strong> 5 sites <strong>de</strong> production (120 techniciens formés).<br />
• Plasturgie (Italie) - Formation <strong>de</strong> 200 personnes (cadres, maîtrise et ouvriers) à<br />
la résolution <strong>de</strong> problèmes, et coaching <strong>de</strong> groupes <strong>de</strong> travail. (Réduction <strong>de</strong> 85%<br />
<strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> qualité 3 mois après le démarrage du projet)<br />
• Industrie Automobile (Pologne) - Mise en œuvre d’un système <strong>de</strong> suggestions<br />
et <strong>de</strong> communication visuelle : formation, accompagnement <strong>de</strong>s utilisateurs et<br />
transfert <strong>de</strong> la méthodologie à <strong>de</strong>s consultants/formateurs internes (1200<br />
personnes formées en 2 ans : cadres, maîtrise, opérateurs).<br />
Animation <strong>de</strong> formations et/ou conception d’outils pédagogiques dans les thèmes<br />
suivants : gestion <strong>de</strong>s compétences, économie et gestion d’entreprise, 5S et<br />
organisation du poste <strong>de</strong> travail, métho<strong>de</strong> SMED, flux d’information et structures<br />
relationnelles, connaissance et amélioration <strong>de</strong>s processus, communication orale,<br />
partage <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong> l’entreprise, formation <strong>de</strong> formateur.
Descriptif du projet <strong>de</strong> Thèse (1 ère année)<br />
Le jeu : une situation apprenante<br />
Mécanismes d’apprentissage du jeu en formation professionnelle d’adultes<br />
Contexte et questions <strong>de</strong> recherche<br />
L’intérêt du jeu en formation fait l’unanimité. On lui attribue <strong>de</strong> multiples qualités : <strong>de</strong> communication, <strong>de</strong><br />
motivation, <strong>de</strong> team-building, <strong>de</strong> développement du sentiment d’efficacité personnelle, <strong>de</strong> création <strong>de</strong><br />
sens, etc., mais aucune preuve scientifique en atteste sa valeur éducative.<br />
Gilles Brougère 1 , dans une récente interview, parue dans la revue Sciences Humaines, explique que “ce<br />
n’est pas le jeu en lui-même qui serait éducatif, mais l’usage que l’on peut en faire“.<br />
Des questions d’ingénierie aux questions <strong>de</strong> recherche<br />
D’une manière générale, les ouvrages et les articles que nous avons lus font part <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s réalisées<br />
sur le jeu en tant que support ou "instrument" <strong>de</strong> formation d’adultes (le jeu permet <strong>de</strong> …) ; alors que la<br />
vraie question que les professionnels <strong>de</strong> la formation se posent aujourd’hui se situe plus au niveau <strong>de</strong><br />
l’"instrumentation" : Comment faire pour que le jeu puisse assurer sa fonction éducative ?<br />
Cette question, qui relève d’une problématique d’ingénierie <strong>de</strong> la formation, conduit à notre question <strong>de</strong><br />
recherche qui s’inscrit dans une problématique d’ordre pédagogique et didactique : Quels sont les<br />
mécanismes d’apprentissage propres au jeu ?<br />
Dans ce sens, notre questionnement se situe à la fois au niveau <strong>de</strong> la relation pédagogique et <strong>de</strong> la<br />
construction <strong>de</strong>s savoirs.<br />
Cadre conceptuel<br />
Trois axes sous-ten<strong>de</strong>nt notre recherche.<br />
Axe 1 – Qu’est ce qui se passe dans un jeu ?<br />
Le 1 er axe doit nous permettre <strong>de</strong> “plonger“ dans la spirale ludique pour observer ce qui se passe durant<br />
une session <strong>de</strong> jeu et essayer ainsi <strong>de</strong> comprendre les mécanismes qui génèrent l’apprentissage.<br />
.<br />
La définition <strong>de</strong> jeu <strong>de</strong> formation est toujours soumise à la discussion publique. Elle n'a pas encore<br />
acquis une signification univoque, reconnue et acceptée. Selon sa finalité, selon les supports utilisés ou<br />
selon la forme <strong>de</strong> l’animation, le jeu <strong>de</strong> formation peut se définir <strong>de</strong> différentes manières ; nous le<br />
désignerons ici comme un groupe <strong>de</strong> personnes, composé d’au moins un formateur et <strong>de</strong> plusieurs<br />
apprenants, qui collaborent pour traiter un cas fictif, dans le but <strong>de</strong> faire évoluer leurs connaissances. Le<br />
jeu est donc une parmi les formes d’apprentissage collectif.<br />
Les théories <strong>de</strong> l’action individuelle et collective en sciences sociales reconnaissent que la connaissance<br />
et l’apprentissage ne sont pas une affaire purement individuelle (pour <strong>de</strong>s synthèses récentes, voir par<br />
exemple Boudon, R., Bouvier, A. et Chazel, F. Cognition et sciences sociales, PUF, 1997). La<br />
connaissance se construit dans l’interaction et l’action collective; elle est “distribuée“; les connaissances<br />
sont “capitalisées“; les décisions individuelles et collectives sont socialement contraintes, ancrées ou<br />
cadrées.<br />
Ces synthèses et théories récentes <strong>de</strong> la cognition sociale illustrent, nous semble-t-il, le fait que les<br />
étu<strong>de</strong>s contemporaines <strong>de</strong> la connaissance et <strong>de</strong> l’apprentissage (du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s sciences<br />
1 Auteur <strong>de</strong> l’ouvrage : Jeu et Education, L’harmattan, 1995.
sociales) présentent une limite importante : malgré l’accent mis par les représentants <strong>de</strong> la discipline sur<br />
l’interaction et l’argumentation, elles sont souvent très détachées d’une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s relations sociales. Or,<br />
pour agir en commun, les acteurs doivent se coordonner et se coorienter. La coorientation dépend <strong>de</strong> la<br />
capacité <strong>de</strong>s membres à apprendre individuellement et collectivement 2 et donc d’une distribution<br />
préalable <strong>de</strong> la connaissance pertinente et autorisée dans le collectif.<br />
Dans nos travaux nous nous appuierons sur la théorie néo-structurale <strong>de</strong> la collégialité 3 , pour analyser la<br />
manière dont les individus vont générer <strong>de</strong> nouveaux savoirs grâce aux interactions entre les trois pôles<br />
du triangle pédagogique : le formateur, le savoir (ressources fournies par la situation <strong>de</strong> jeu) et les<br />
apprenants 4 .<br />
L’approche néo-structurale rend compte <strong>de</strong>s échanges en i<strong>de</strong>ntifiant les mécanismes sociaux, souvent<br />
informels, indispensables à toute forme d’action collective entre experts et plus généralement entre<br />
pairs 5 .<br />
Selon cette théorie, dans un groupe, <strong>de</strong>s relations d’échange représentent <strong>de</strong>s interdépendances<br />
multilatérales en matière d’accès aux ressources. Elles s’agrègent et se combinent en une trame <strong>de</strong><br />
liens, en une structure relationnelle. Dans toute pédagogie active, et en particulier dans les jeux, la<br />
capacité à atteindre les objectifs escomptés dépend, entre autres, <strong>de</strong> ces flux d’information et <strong>de</strong> la<br />
capacité <strong>de</strong> coorientation qu’ils recèlent.<br />
Emmanuel Lazega propose un modèle d’analyse <strong>de</strong>s réseaux sociaux et <strong>de</strong>s structures relationnelles 6<br />
que nous tenterons d’appliquer à la situation <strong>de</strong> jeu.<br />
Axe 2 - Le jeu et les autres pédagogies<br />
Le 2 nd axe concerne l’intégration du jeu dans le processus d’apprentissage et l’articulation avec les<br />
autres techniques pédagogiques.<br />
Une étu<strong>de</strong> québécoise <strong>de</strong> 1980 7 recense plus <strong>de</strong> quatre-vingt classifications <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s<br />
pédagogiques.<br />
“Car comment faire le choix dans une telle brocante ou grena<strong>de</strong>, et en aurait-on la liberté ?“ 8<br />
André <strong>de</strong> Peretti, met l’accent sur la nécessité d’élaborer une démarche <strong>de</strong> formation “en référence à un<br />
échantillon suffisant <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s existantes avec leurs instrumentations et techniques propres ; le tout<br />
englobé dans l’enveloppe d’une méthodologie d’enseignement et d’ingénierie d’apprentissage “.<br />
2 Favereau, O. Règle, organisation et apprentissage collectif, in A.Orléans (ed), Analyse Economique <strong>de</strong>s Conventions, Paris, PUF,<br />
Collection : Economie, 1994.<br />
3 Waters, M.., "Collegiality, Bureaucratization, and Professionalization: A Weberian Analysis", American<br />
Journal of Sociology, 94:945-72, 1989.<br />
Weber, M., Economy and Society, Edited by Guenther Roth and Claus Wittich, Berkeley: University of California Press,<br />
1920 – édition 1978)<br />
4 Houssaye, J. , Le triangle Pédagogique, Peter Lang, 1992.<br />
5 Lazega, E., The Collegial Phenomenon: The Social Mechanisms of Cooperation Among Peers in a Corporate Law Partnership,<br />
Oxford, Oxford University Press, 2001.<br />
6 Lazega, E., Réseaux sociaux et structures relationnelles, PUF.<br />
7 Bertrand Y. et Valois P., Les options en éducation, Ministère <strong>de</strong> l’Education du Québec, 1980.<br />
L’existence d’une si importante panoplie <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s pédagogiques peut s’expliquer par la loi <strong>de</strong>s “variétés requises“<br />
établie par le cyberneticien W. Ross Ashby, Introduction à la cybernetique, Dunod, 1958. Reformulée par André De Peretti,<br />
la loi d’Ashby permet d’affirmer que “Dans un système hypercomplexe (c’est le cas d’un projet <strong>de</strong> formation) le sous-système qui assure<br />
la régulation <strong>de</strong>s interactions entre les individus aussi que leurs ajustements aux contraintes définissant les fonctions dévolues au système (ce<br />
peut être la mission du formateur) doit disposer d’une variété <strong>de</strong> modalités d’intervention au moins égale à la variété <strong>de</strong>s besoins disparates et<br />
<strong>de</strong>s problèmes complexes en instance dans un système et son environnement“.<br />
8 <strong>de</strong> Peretti, A. , Controverses en éducation, Hachette Education, 1993.
Nous sommes confrontés ici à la problématique <strong>de</strong> la différenciation pédagogique 9 , une solution<br />
universellement reconnue pour faire face à la diversité <strong>de</strong>s contextes et à l’hétérogénéité <strong>de</strong>s publics.<br />
La différenciation est complexe à mettre en pratique, surtout dans <strong>de</strong>s cadres institutionnels peu souples<br />
et hostiles au changement 10 .<br />
Prenons l’exemple <strong>de</strong>s nouvelles technologies en éducation. La majorité <strong>de</strong>s avis convergent pour dire<br />
que les NTIC méritent une place importante dans l’enseignement, mais le système éducatif actuel n’est<br />
apparemment pas prêt à les accueillir.<br />
Nous avons emprunté à Jacques Wallet 11 l’idée qu’il existe <strong>de</strong>ux partis pris qui animent le débat autour<br />
<strong>de</strong>s NTIC en éducation :<br />
Le premier est “intégrationniste“, car il croit possible une intégration <strong>de</strong>s technologies dans le système<br />
scolaire actuel, au prix <strong>de</strong> quelques aménagements.<br />
Le second est “constructiviste“, qui postule que les NTIC seront à la fois la cause et la conséquence<br />
d’une transformation radicale <strong>de</strong> l’école.<br />
D’une manière générale, le jeu a trois gran<strong>de</strong>s finalités : introduire ou éclairer un concept, relier un<br />
concept à d’autres, vali<strong>de</strong>r et approfondir <strong>de</strong>s connaissances déjà existantes.<br />
Dans l’approche intégrationniste, le jeu serait considéré comme une variante pédagogique, comme une<br />
“ruse“ pour donner du sens à un concept isolé.<br />
L’approche constructiviste donnerait une place plus importante au jeu, qui <strong>de</strong>viendrait alors le fil<br />
conducteur <strong>de</strong> l’apprentissage et permettrait <strong>de</strong> faire émerger et <strong>de</strong> mettre en réseau les concepts.<br />
Axe 3 – Jeu et théories <strong>de</strong> l’apprentissage<br />
Le 3 ème axe soutient et donne un sens global à notre recherche ; il relie les <strong>de</strong>ux axes précé<strong>de</strong>nts et doit<br />
permettre d’établir <strong>de</strong>s liens entre les données factuelles <strong>de</strong> nos observations et les théories <strong>de</strong><br />
l’apprentissage.<br />
Nous partons <strong>de</strong> l’hypothèse que le jeu s’inscrit à la fois dans <strong>de</strong>s approches constructiviste<br />
(principalement) et behaviouriste (<strong>de</strong> manière plus marginale).<br />
Dans l’approche constructiviste, les jeux <strong>de</strong> formation sont conformes à la fois à ce que proposent<br />
Piaget et Vygotsky.<br />
Dans le modèle <strong>de</strong> Piaget, l'apprentissage est indissociable <strong>de</strong> l'action. C'est dans l'action que se met en<br />
œuvre le principe <strong>de</strong> la trilogie "assimilation-accommodation-équilibration majorante". Cela implique trois<br />
lois fondamentales <strong>de</strong> toute activité :<br />
Le sens <strong>de</strong> la motivation : Il faut que la situation d'apprentissage ait un sens pour l'individu si l'on<br />
souhaite qu'il apprenne.<br />
L’activité cognitive : Un apprenant actif, qui construit son savoir, apprend mieux qu'un apprenant passif,<br />
à qui on transmet du savoir.<br />
L’adaptation : La connaissance immédiate <strong>de</strong>s résultats facilite les apprentissages.<br />
Le modèle <strong>de</strong> Vygotsky laisse une large place à la médiation, là aussi cela induit <strong>de</strong>ux lois<br />
fondamentales :<br />
L’autonomie : Chaque apprenant apprend à son rythme et à sa façon en partant du développement<br />
actuel.<br />
La médiation : Les compétences interpersonnelles sont toujours plus importantes que les compétences<br />
intrapersonnelles.<br />
9 Le terme <strong>de</strong> différenciation pédagogique veut désigner " un effort <strong>de</strong> diversification méthodologique susceptible <strong>de</strong> répondre à la<br />
diversité <strong>de</strong>s élèves. " (Louis Legrand, La différenciation Pédagogique, Scarabée, CEMEA, Paris, 1984).<br />
10 Voir article <strong>de</strong> Jean-Pierre Astolfi et Louis Legrand : “Différencier la pédagogie“, dans Pour un collège démocratique :<br />
Différencier la pédagogie (Rapport au ministre <strong>de</strong> l’E.N. - La Documentation française 1982).<br />
11 Dans : Education et formation : nouvelles questions, nouveaux métiers, ouvrage collectif dirigé par Jean-Pierre Astolfi, ESF,<br />
2003.
Le socioconstructivisme qui s'ancre au constructivisme met l'accent sur le rôle <strong>de</strong>s interactions sociales<br />
multiples dans la construction <strong>de</strong>s savoirs. Des auteurs, dont Brown et Campione (1995) soulignent<br />
alors l'aspect culturel <strong>de</strong>s savoirs, c'est-à-dire qu'ils sont le fruit <strong>de</strong>s échanges et qu'ils sont partagés.<br />
Ainsi, la culture est perçue comme filtre socio-cognitif qui permet <strong>de</strong> donner du sens à la réalité.<br />
Mais bien d’autres auteurs plus contemporains nous inspireront dans notre effort <strong>de</strong> conceptualisation,<br />
nous citons ici :<br />
Perret-Clermont (1976-79), Doise, Mugny (1981) qui ont étudié le rôle <strong>de</strong>s interactions sociales entre<br />
pairs dans le développement <strong>de</strong> l'intelligence selon une perspective structuraliste piagétienne.<br />
Gilly et ses collaborateurs (1988) qui s'intéressent à la construction <strong>de</strong> compétences liées à <strong>de</strong>s classes<br />
<strong>de</strong> problèmes et à la perspective procédurale adoptée en résolution <strong>de</strong> problèmes.<br />
Le modèle béhavioriste apporte lui aussi sa contribution à la pédagogie par le jeu.<br />
Dans un grand nombre <strong>de</strong> jeux <strong>de</strong> formation on retrouve les principes <strong>de</strong> base <strong>de</strong> ce modèle du<br />
conditionnement. Les règles mêmes d'un jeu constituent un stimulus qui est provoqué pour obtenir une<br />
réponse prévisible.<br />
En outre, les principes <strong>de</strong> l'enseignement programmé <strong>de</strong> Skinner constituent les fondations sur<br />
lesquelles sont bâtis les jeux informatiques (EAO).<br />
Dans la théorie skinnerienne, il nous semble important <strong>de</strong> citer le principe du "renforcement positif" : tout<br />
comportement renforcé positivement (encouragé) à tendance à se reproduire. Dans le jeu, contrairement<br />
à la réalité, les dimensions <strong>de</strong> l’action (le temps et l’espace) sont réduites, ce qui permet aux participants<br />
<strong>de</strong> voir immédiatement le résultat <strong>de</strong>s performances produites grâce à leurs décisions. Le fait <strong>de</strong> pouvoir<br />
répéter le même geste ou action en un temps bref et sans prendre <strong>de</strong> risques, leur permet <strong>de</strong> corriger<br />
l'erreur éventuelle et <strong>de</strong> susciter la motivation après avoir obtenu un bon résultat.