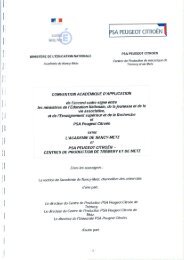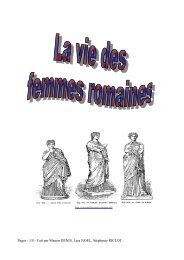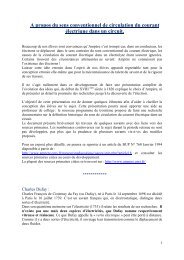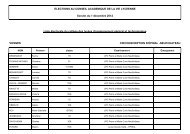LARDEAU Yann - Académie de Nancy-Metz
LARDEAU Yann - Académie de Nancy-Metz
LARDEAU Yann - Académie de Nancy-Metz
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La Guinée Bissau, ce sont l'horreur d'Apocalypse now, la guérilla victorieuse <strong>de</strong>s années 70, la<br />
rivalité <strong>de</strong>s chefs, la résurgence <strong>de</strong> nouveaux seigneurs <strong>de</strong> la guerre, la famine, <strong>de</strong>s blessures<br />
atroces, le carnaval, quelques beaux visages mais qui sourient difficilement. Le <strong>de</strong>rnier souffle<br />
<strong>de</strong>s années 60. Deux contextes différents qui interrogent le cameraman dans sa pratique<br />
professionnelle, son désir <strong>de</strong> laisser la guerre, le macro-politique pour ne peindre plus que la<br />
banalité <strong>de</strong>s rituels quotidiens. Mais Marker ne peut pas s'empêcher d'être grave. Il filme très<br />
bien au fond la contradiction dans laquelle il est pris. Il aimerait bien filmer le quotidien, le<br />
banal, la survie ordinaire, pas la réalité <strong>de</strong> la guerre, ni le théâtre <strong>de</strong>s luttes militantes, mais il<br />
en est incapable, il retombe toujours sur les mêmes images, les mêmes obsessions qu'il y a dix<br />
ans, celles <strong>de</strong>s manifestations <strong>de</strong> l'aéroport <strong>de</strong> Tokyo, le fascisme, l'essence petite-bourgeoise<br />
du gauchisme, le capital et les ouvriers. Il aimerait bien filmer le Japon comme Barthes l'a<br />
décrit, à la façon <strong>de</strong> L'Empire <strong>de</strong>s signes, mais il ne peut rassembler ses images que sous la<br />
forme d'abstractions telles que la guerre, la lutte <strong>de</strong>s classes, l'indépendance nationale ou la<br />
fête, <strong>de</strong> sorte que la monotonie <strong>de</strong> Sans Soleil, en dépit <strong>de</strong> ses essais vidéo, est l'oeuvre d'une<br />
profon<strong>de</strong> mélancolie <strong>de</strong>s années 60, d'un <strong>de</strong>uil qui n'arrive pas à se résoudre et qui ne peut que<br />
noter son décalage, son retard, par rapport à la plasticité sociale <strong>de</strong> la génération contestatrice<br />
<strong>de</strong>s années 60. C'est d'ailleurs ce qui fait l'ambiguïté, la limite <strong>de</strong> la sincérité <strong>de</strong> ces<br />
confi<strong>de</strong>nces. Si pour Marker, la génération <strong>de</strong>s sixties a eu ses martyrs mais surtout ses<br />
arrivistes d'autant plus aptes à servir le capitalisme qu'ils en ont été les adversaires acharnés et<br />
connaissent sur le bout <strong>de</strong>s doigts ses contradictions (vieille thèse stalinienne dont Marker ne<br />
s'est jamais départi et qui est le fond constant, invarié <strong>de</strong> son cinéma, avant, pendant et après<br />
68), c'est qu'il a toujours été à l'extérieur <strong>de</strong> cette génération, <strong>de</strong> son enthousiasme et non pas<br />
<strong>de</strong> ses désillusions, mais <strong>de</strong> sa volonté <strong>de</strong> faire, <strong>de</strong> tenter, d'expérimenter, contre les mots, en<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s solutions dogmatiques ou collectives puisque celles-ci ne savaient que répéter<br />
leurs échecs historiques, reconduire leurs tragiques méprises en farces grotesques.<br />
Aujourd'hui encore, Marker raisonne en termes <strong>de</strong> survie sur un fond d'images morbi<strong>de</strong>s,<br />
nostalgiques et touchantes pour cette raison même : là où pour la génération <strong>de</strong>s sixties, il n'y<br />
a qu'une urgence à vivre, jamais l'écart, le malentendu n'ont été si grands. Ce divorce,<br />
d'ailleurs, son dialogue avec le vidéaste Hayao Yamaneko l'exprime très précisément. La<br />
vérité, c'est que Marker est un impénitent bavard et que l'émotion simple, le non-dit, le nonêtre<br />
oriental qui le fascine tant, après Barthes, dans les mœurs japonaises, et qu'il aimerait<br />
tellement reproduire dans ce film, ne peut passer directement. Chaque fois qu'il pointe son<br />
museau et qu'il faudrait au cinéaste prendre son temps, se laisser aller, s'aligner sur la lenteur,<br />
la répétition, voire le statisme <strong>de</strong> ces rites, <strong>de</strong> ces cérémonies, il a pour réaction <strong>de</strong> le barrer,<br />
<strong>de</strong> le combler, <strong>de</strong> s'en protéger comme <strong>de</strong> sa propre bêtise, d'en justifier l'apparition par une<br />
rhétorique visuelle et quelques formules savantes, la nécessité par quelque raison supérieure.<br />
Toutes ces citations et cautions culturelles, ce besoin compulsif d'interprétation chargent<br />
l'image et la vi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> sa liberté, lui dénient sa vitalité, l'intensité propre <strong>de</strong> son rien <strong>de</strong><br />
contenu. A l'arrivée, il ne subsiste rien du fait brut et <strong>de</strong>s affects qui lui sont attachés. La<br />
rencontre tant annoncée, tant espérée, trop sans doute, n'a pas eu lieu. Se succè<strong>de</strong>nt alors <strong>de</strong>s<br />
images <strong>de</strong> rituels montées à la diable, dans une composition flui<strong>de</strong> certes mais qui n'évite pas<br />
l'écueil <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> coupe et <strong>de</strong>s analogies faciles, alors qu'un rituel, une cérémonie sont<br />
d'abord <strong>de</strong>s scansions du temps. II y a un empressement <strong>de</strong> photographe chez Marker à aller<br />
immédiatement sur les lignes <strong>de</strong> force <strong>de</strong> son sujet, qui lui fait perdre toute marge <strong>de</strong><br />
manoeuvre, toute liberté d'espace et <strong>de</strong> modulation <strong>de</strong> ses séquences. En quelque sorte, il s'y<br />
brûle, au point qu'on a le sentiment d'images montées ensemble pour illustrer a posteriori un<br />
discours premier. Les plans sont courts parce que sans avenir, sans perspective, sans<br />
ouverture. Tout est filmé à la même vitesse, indifféremment. Aucun événement, aucun pays<br />
n'a son temps propre, dans Sans Soleil. Tous sont filmés selon une même économie et



![Développement d'applications nationales [PDF - 67 Ko ]](https://img.yumpu.com/22700484/1/184x260/developpement-dapplications-nationales-pdf-67-ko-.jpg?quality=85)