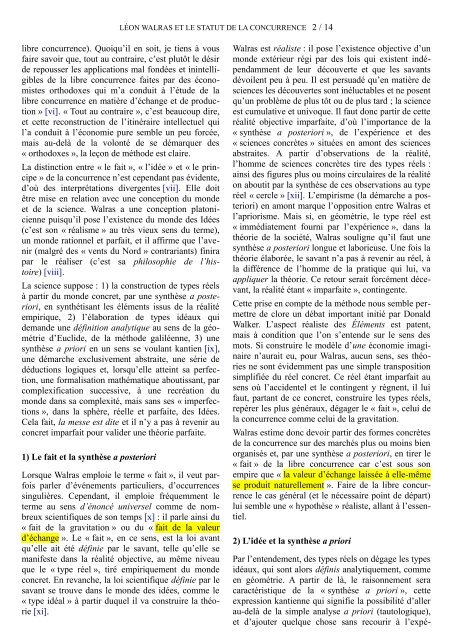Léon Walras et le statut de la concurrence : une ... - Jean-Pierre Voyer
Léon Walras et le statut de la concurrence : une ... - Jean-Pierre Voyer
Léon Walras et le statut de la concurrence : une ... - Jean-Pierre Voyer
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LÉON WALRAS ET LE STATUT DE LA CONCURRENCE 2 / 14<br />
libre <strong>concurrence</strong>). Quoiqu’il en soit, je tiens à vous<br />
faire savoir que, tout au contraire, c’est plutôt <strong>le</strong> désir<br />
<strong>de</strong> repousser <strong>le</strong>s applications mal fondées <strong>et</strong> inintelligib<strong>le</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> libre <strong>concurrence</strong> faites par <strong>de</strong>s économistes<br />
orthodoxes qui m’a conduit à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
libre <strong>concurrence</strong> en matière d’échange <strong>et</strong> <strong>de</strong> production<br />
» [vi]. « Tout au contraire », c’est beaucoup dire,<br />
<strong>et</strong> c<strong>et</strong>te reconstruction <strong>de</strong> l’itinéraire intel<strong>le</strong>ctuel qui<br />
l’a conduit à l’économie pure semb<strong>le</strong> un peu forcée,<br />
mais au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> se démarquer <strong>de</strong>s<br />
« orthodoxes », <strong>la</strong> <strong>le</strong>çon <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> est c<strong>la</strong>ire.<br />
La distinction entre « <strong>le</strong> fait », « l’idée » <strong>et</strong> « <strong>le</strong> principe<br />
» <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>concurrence</strong> n’est cependant pas évi<strong>de</strong>nte,<br />
d’où <strong>de</strong>s interprétations divergentes [vii]. El<strong>le</strong> doit<br />
être mise en re<strong>la</strong>tion avec <strong>une</strong> conception du mon<strong>de</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> science. <strong>Walras</strong> a <strong>une</strong> conception p<strong>la</strong>tonicienne<br />
puisqu’il pose l’existence du mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Idées<br />
(c’est son « réalisme » au très vieux sens du terme),<br />
un mon<strong>de</strong> rationnel <strong>et</strong> parfait, <strong>et</strong> il affirme que l’avenir<br />
(malgré <strong>de</strong>s « vents du Nord » contrariants) finira<br />
par <strong>le</strong> réaliser (c’est sa philosophie <strong>de</strong> l’histoire)<br />
[viii].<br />
La science suppose : 1) <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> types réels<br />
à partir du mon<strong>de</strong> concr<strong>et</strong>, par <strong>une</strong> synthèse a posteriori,<br />
en synthétisant <strong>le</strong>s éléments issus <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité<br />
empirique, 2) l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> types idéaux qui<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>une</strong> définition analytique au sens <strong>de</strong> <strong>la</strong> géométrie<br />
d’Eucli<strong>de</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> galiléenne, 3) <strong>une</strong><br />
synthèse a priori en un sens se vou<strong>la</strong>nt kantien [ix],<br />
<strong>une</strong> démarche exclusivement abstraite, <strong>une</strong> série <strong>de</strong><br />
déductions logiques <strong>et</strong>, lorsqu’el<strong>le</strong> atteint sa perfection,<br />
<strong>une</strong> formalisation mathématique aboutissant, par<br />
comp<strong>le</strong>xification successive, à <strong>une</strong> recréation du<br />
mon<strong>de</strong> dans sa comp<strong>le</strong>xité, mais sans ses « imperfections<br />
», dans <strong>la</strong> sphère, réel<strong>le</strong> <strong>et</strong> parfaite, <strong>de</strong>s Idées.<br />
Ce<strong>la</strong> fait, <strong>la</strong> messe est dite <strong>et</strong> il n’y a pas à revenir au<br />
concr<strong>et</strong> imparfait pour vali<strong>de</strong>r <strong>une</strong> théorie parfaite.<br />
1) Le fait <strong>et</strong> <strong>la</strong> synthèse a posteriori<br />
Lorsque <strong>Walras</strong> emploie <strong>le</strong> terme « fait », il veut parfois<br />
par<strong>le</strong>r d’événements particuliers, d’occurrences<br />
singulières. Cependant, il emploie fréquemment <strong>le</strong><br />
terme au sens d’énoncé universel comme <strong>de</strong> nombreux<br />
scientifiques <strong>de</strong> son temps [x] : il par<strong>le</strong> ainsi du<br />
« fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravitation » ou du « fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> va<strong>le</strong>ur<br />
d’échange ». Le « fait », en ce sens, est <strong>la</strong> loi avant<br />
qu’el<strong>le</strong> ait été définie par <strong>le</strong> savant, tel<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> se<br />
manifeste dans <strong>la</strong> réalité objective, au même niveau<br />
que <strong>le</strong> « type réel », tiré empiriquement du mon<strong>de</strong><br />
concr<strong>et</strong>. En revanche, <strong>la</strong> loi scientifique définie par <strong>le</strong><br />
savant se trouve dans <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s idées, comme <strong>le</strong><br />
« type idéal » à partir duquel il va construire <strong>la</strong> théorie<br />
[xi].<br />
<strong>Walras</strong> est réaliste : il pose l’existence objective d’un<br />
mon<strong>de</strong> extérieur régi par <strong>de</strong>s lois qui existent indépendamment<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>ur découverte <strong>et</strong> que <strong>le</strong>s savants<br />
dévoi<strong>le</strong>nt peu à peu. Il est persuadé qu’en matière <strong>de</strong><br />
sciences <strong>le</strong>s découvertes sont inéluctab<strong>le</strong>s <strong>et</strong> ne posent<br />
qu’un problème <strong>de</strong> plus tôt ou <strong>de</strong> plus tard ; <strong>la</strong> science<br />
est cumu<strong>la</strong>tive <strong>et</strong> univoque. Il faut donc partir <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
réalité objective imparfaite, d’où l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
« synthèse a posteriori », <strong>de</strong> l’expérience <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />
« sciences concrètes » situées en amont <strong>de</strong>s sciences<br />
abstraites. A partir d’observations <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité,<br />
l’homme <strong>de</strong> sciences concrètes tire <strong>de</strong>s types réels :<br />
ainsi <strong>de</strong>s figures plus ou moins circu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité<br />
on aboutit par <strong>la</strong> synthèse <strong>de</strong> ces observations au type<br />
réel « cerc<strong>le</strong> » [xii]. L’empirisme (<strong>la</strong> démarche a posteriori)<br />
en amont marque l’opposition entre <strong>Walras</strong> <strong>et</strong><br />
l’apriorisme. Mais si, en géométrie, <strong>le</strong> type réel est<br />
« immédiatement fourni par l’expérience », dans <strong>la</strong><br />
théorie <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, <strong>Walras</strong> souligne qu’il faut <strong>une</strong><br />
synthèse a posteriori longue <strong>et</strong> <strong>la</strong>borieuse. Une fois <strong>la</strong><br />
théorie é<strong>la</strong>borée, <strong>le</strong> savant n’a pas à revenir au réel, à<br />
<strong>la</strong> différence <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique qui lui, va<br />
appliquer <strong>la</strong> théorie. Ce r<strong>et</strong>our serait forcément décevant,<br />
<strong>la</strong> réalité étant « imparfaite », contingente.<br />
C<strong>et</strong>te prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> nous semb<strong>le</strong> perm<strong>et</strong>tre<br />
<strong>de</strong> clore un débat important initié par Donald<br />
Walker. L’aspect réaliste <strong>de</strong>s Éléments est patent,<br />
mais à condition que l’on s’enten<strong>de</strong> sur <strong>le</strong> sens <strong>de</strong>s<br />
mots. Si construire <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> d’<strong>une</strong> économie imaginaire<br />
n’aurait eu, pour <strong>Walras</strong>, aucun sens, ses théories<br />
ne sont évi<strong>de</strong>mment pas <strong>une</strong> simp<strong>le</strong> transposition<br />
simplifiée du réel concr<strong>et</strong>. Ce réel étant imparfait au<br />
sens où l’acci<strong>de</strong>ntel <strong>et</strong> <strong>le</strong> contingent y règnent, il lui<br />
faut, partant <strong>de</strong> ce concr<strong>et</strong>, construire <strong>le</strong>s types réels,<br />
repérer <strong>le</strong>s plus généraux, dégager <strong>le</strong> « fait », celui <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>concurrence</strong> comme celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravitation.<br />
<strong>Walras</strong> estime donc <strong>de</strong>voir partir <strong>de</strong>s formes concrètes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>concurrence</strong> sur <strong>de</strong>s marchés plus ou moins bien<br />
organisés <strong>et</strong>, par <strong>une</strong> synthèse a posteriori, en tirer <strong>le</strong><br />
« fait » <strong>de</strong> <strong>la</strong> libre <strong>concurrence</strong> car c’est sous son<br />
empire que « <strong>la</strong> va<strong>le</strong>ur d’échange <strong>la</strong>issée à el<strong>le</strong>-même<br />
se produit naturel<strong>le</strong>ment ». Faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> libre <strong>concurrence</strong><br />
<strong>le</strong> cas général (<strong>et</strong> <strong>le</strong> nécessaire point <strong>de</strong> départ)<br />
lui semb<strong>le</strong> <strong>une</strong> « hypothèse » réaliste, al<strong>la</strong>nt à l’essentiel.<br />
2) L’idée <strong>et</strong> <strong>la</strong> synthèse a priori<br />
Par l’enten<strong>de</strong>ment, <strong>de</strong>s types réels on dégage <strong>le</strong>s types<br />
idéaux, qui sont alors définis analytiquement, comme<br />
en géométrie. A partir <strong>de</strong> là, <strong>le</strong> raisonnement sera<br />
caractéristique <strong>de</strong> <strong>la</strong> « synthèse a priori », c<strong>et</strong>te<br />
expression kantienne qui signifie <strong>la</strong> possibilité d’al<strong>le</strong>r<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> simp<strong>le</strong> analyse a priori (tautologique),<br />
<strong>et</strong> d’ajouter quelque chose sans recourir à l’expé-