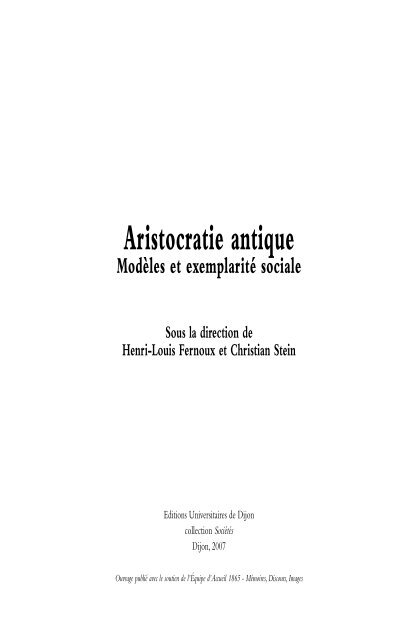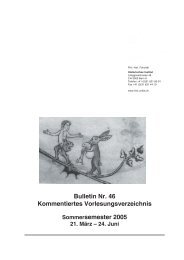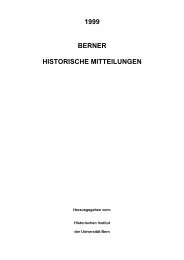p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Aristocratie antique<br />
Modèles et exemplarité sociale<br />
Sous la direction de<br />
Henri-Louis Fernoux et Christian Stein<br />
Editions Universitaires de Dijon<br />
collection Sociétés<br />
Dijon, 2007<br />
Ouvrage publié avec le soutien de l’Équipe d’Accueil 1865 - Mémoires, Discours, Images
L’EXEMPLARITÉ AUTO-PROCLAMÉE<br />
PLINE LE JEUNE ET LE QUOTIDIEN D’UN ARISTOCRATE<br />
SOUS LE HAUT-EMPIRE<br />
Je suis écrasé par des obligations aussi importantes que pénibles ; je siège au tribunal, j’apostille des<br />
requêtes, je fais des comptes, j’écris une foule de lettres où la littérature n’a que faire. Il m’arrive de<br />
temps à autre (et cela encore, quand est-ce possible ?) de pouvoir me plaindre à Euphratès d’être ainsi<br />
accaparé. Lui me console, m’affirme que c’est encore de la philosophie et même la plus belle portion<br />
de la philosophie que d’exercer une fonction publique, de servir la justice en instruisant des procès, en<br />
rendant des jugements, en la mettant en lumière, et, ainsi, de mettre en pratique tout ce que lui et ses<br />
pareils enseignent. Mais la seule chose dont il ne puisse me convaincre, c’est qu’il vaille mieux vaquer<br />
à ces médiocrités que de passer mes journées entières avec lui à écouter et à apprendre. 1<br />
La complainte de Pline le Jeune d’être empêché, par ses charges, de suivre<br />
« des journées entières » l’enseignement du stoïcien à la mode 2 est tout à fait<br />
étonnante ; son contemporain Tacite écrit que son beau-père Agricola aurait<br />
souvent raconté s’être consacré, dans sa prime jeunesse, à la philosophie avec<br />
plus de passion que ce qui était convenable pour un Romain et futur sénateur,<br />
1. PLINE, Epist. 1.10.9-11 : Nam distringor officio, ut maximo sic molestissimo : sedeo pro tribunali, subnoto libellos,<br />
conficio tabulas, scribo plurimas sed inlitteratissimas litteras. Soleo non numquam (nam id ipsum quando contingit !)<br />
de his occupationibus apud Euphraten queri. Ille me consolatur, adfirmat etiam esse hanc philosophiae et quidem<br />
pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam, quaeque ipsi<br />
doceant in usu habere. Mihi tamen hoc unum non persuadet, satius esse ista facere quam cum illo dies totos audiendo<br />
discendoque consumere. Le officium en question est, selon A.N SHERWIN-WHITE, The Letters of Pliny. A<br />
Historical and Social Commentary, Oxford, 1966 (3 e éd. 1985), p. 110, avec plus de probabilité le aerarium<br />
Saturni que le aerarium militare ; je le traduis avec le terme générique de « obligations » puisque ici, le<br />
officium peut se lire comme un singulier générique. (Toutes les références suivantes concernent, sans<br />
indication contraire, les Lettres de Pline.)<br />
2. Euphratès, né à Tyr autour de l’an 40 de notre ère, professait un stoïcisme de la modération, en<br />
contradiction avec les cyniques et les néo-pythagoriciens ; il se trouvait en concurrence avec un autre<br />
maître de philosophie en vogue, Apollonios de Tyane (cf. Brad INWOOD, s.v. « Euphrates », dans DNP<br />
4, col. 269).
162 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
et qu’il aurait eu besoin de sa prudente mère pour qu’elle tempère son esprit<br />
trop ardemment attiré par l’enseignement des philosophes 1 .<br />
La remarque de Pline dans sa lettre à Attius Clemens 2 paraît d’autant plus<br />
surprenante qu’elle remet en cause l’identité de l’homme aristocratique qui, dans<br />
tous les textes dont nous disposons, se définit comme une identité politique, une<br />
vie dans et pour la res publica. Et l’auteur la présente dans un ouvrage publié en<br />
tant que monument pour assurer son image d’aristocrate exemplaire. Le recueil<br />
épistolaire est une source extraordinaire pour étudier le quotidien d’un aristocrate<br />
sous le Haut-Empire – ou plus précisément (car il ne faut pas être dupe de l’art<br />
de l’autoportrait de Pline) – une vision idéalisée de la vie aristocratique romaine 3<br />
dont les normes et les pratiques reposent largement sur le mos maiorum et donc<br />
sur cette orientation de la culture romaine déterminée par un passé toujours<br />
reconstruit, mais toujours reconstruit en tant que passé 4 . C’est la raison pour<br />
laquelle on ne constate aucune rupture entre l’aristocratie républicaine et celle de<br />
l’Empire 5 . Aucune rupture, certes, mais chez Pline, nous pouvons pourtant<br />
soupçonner des indices de transformations des valeurs aristocratiques.<br />
Pour saisir ces transformations, je propose une lecture des Lettres de Pline qui<br />
tente d’y relever les divers aspects permettant de construire l’image d’une normalité<br />
quotidienne de la vie aristocratique pendant la dernière décennie du I er<br />
et la première décennie du II e siècle de notre ère. Je précise tout de suite que<br />
j’emploie le terme d’aristocratie pour l’aristocratie sénatoriale dans un sens très<br />
général (en contournant le débat autour de la définition de la nobilitas 6 ) : le<br />
1. TACITE, Agr. 4.3.<br />
2. La remarque n’est pas du tout isolée, cf. Epist. 1.9.2-3, 2.8.2, 3.18.4, 8.9.1 ; contrairement à mon<br />
interprétation, St.E. HOFFER, The Anxieties of Pliny the Younger,Atlanta, 1999, p. 127, croit lire une « irony<br />
at Euphrates’ expense » dans la lettre 1.10 et un commentaire distant d’un « rich and powerful Roman »<br />
envers les « bizarre aspects [of] Stoic doctrine ».<br />
3. Cf., parmi bien d’autres, J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, Continuity and Change in Roman Religion, Oxford,<br />
1979, p. 183: « The letters [scil. of Pliny] paint a picture of the life led by their author and his friends.<br />
The picture is idealized, but this only means that it shows the values by which these men sought to live<br />
rather than the extend to which they succeeded in doing so. »<br />
4. Maurizio BETTINI caractérise le rapport au temps qui domine la culture romaine avec l’heureuse<br />
expression « l’avvenire dietro le spalle », cf. M. BETTINI, Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo,<br />
imagini dell’anima, Rome, 1986, « Parte seconda », 125-202.<br />
5. L’aristocratie sénatoriale se définit par son rapport à la tradition et donc par la continuité, elle cesserait<br />
d’exister si elle admettait une rupture avec le passé ; l’ordre sénatorial sous l’Empire, tout en étant largement<br />
composé de « nouvelles familles »,ne peut donc s’affirmer que sous le signe de la continuité.Cf.les réflexions<br />
concises de A. WINTERLING, « Die antiken Menschen in ihren Gemeinschaften : Rom », dans E.Wirbelauer<br />
(éd.), Oldenbourg Geschichte Lehrbuch: Antike, Munich, 2004, p. 194-211 (ici p. 206-210). À la différence de<br />
Christian Stein ou de Michel Humm qui affirmèrent lors de la Journée d’étude dont ce volume présente<br />
les actes, soit qu’Auguste aurait « recréé » une aristocratie, soit que la nobilitas, « nouvelle aristocratie » née au<br />
IV e siècle, aurait trouvé une fin dans l’auto-déchirement du I er siècle avant notre ère, je pense que l’on peut<br />
trouver bien plus d’éléments de persistance que de discontinuité en comparant l’aristocratie républicaine<br />
avec celle de l’époque impériale.<br />
6. Cf. la présentation des termes du débat et les commentaires de L.A. BURCKHARDT, « The Political Elite<br />
of the Roman Republic : comments on Recent Discussion of the Concepts nobilitas and homo novus »,<br />
Historia 39, 1990, p. 77-99 ; j’explicite brièvement ma position dans Th. SPÄTH, « Texte ohne Bilder:<br />
Statuen und Quellenkritik. Rez. zu : Markus Sehlmeyer, Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit,<br />
Stuttgart 1999 », JRA, 13, 2000, p. 434-442, ici p. 441.
Thomas Späth 163<br />
terme désignera par la suite les membres du Sénat et leur domus. C’est leur<br />
quotidien que sera au centre des lignes qui suivent ; mon étude présuppose<br />
donc que l’œuvre épistolaire de Pline peut se lire comme une source d’histoire<br />
sociale et culturelle. Cette prétention d’étudier le quotidien d’un aristocrate<br />
romain dans les Lettres demande d’abord une explication ; dans une deuxième<br />
étape, j’analyserai ce quotidien de l’aristocrate exemplaire fondé dans une<br />
longue tradition dont témoigne le recueil épistolaire. Or, ce quotidien laisse<br />
entrevoir cette faille de la remise en cause de l’identité politique indiquée dans<br />
diverses lettres de Pline à la manière de celle à Attius Clemens que je viens de<br />
citer. Pour éclaircir ce déplacement des valeurs aristocratiques, je m’appuierai<br />
sur les approches de l’« histoire du quotidien » développées, depuis les années<br />
1970, par des chercheurs en histoire contemporaine, elles pourront nous fournir<br />
des instruments méthodologiques qui permettront de développer quelques<br />
hypothèses sur la lente évolution vers une redéfinition d’une exemplarité<br />
aristocratique.<br />
Les Lettres de Pline – une source pour quelles problématiques ?<br />
Pline le Jeune a publié lui-même les neuf livres de correspondance, entre 96<br />
et 108 1 . Les historiens et philologues des XIX e et XX e siècles étaient partagés dans<br />
leur jugement sur le statut de ces Lettres : Un long débat avait opposé les<br />
partisans d’un caractère purement littéraire et fictif des Lettres aux défenseurs de<br />
leur authenticité ; aujourd’hui, l’hypothèse semble largement acquise que la<br />
collection épistolaire réunit des lettres effectivement écrites, mais choisies et<br />
relues pour la publication 2 . Quoi qu’on pense de l’authenticité des lettres, le fait<br />
que l’auteur les a publiées de son vivant – contrairement à Cicéron dont les<br />
Lettres ont été publiées après sa mort – implique qu’il a consciemment choisi<br />
1. Cf. la discussion chronologique détaillée dans A.N. SHERWIN-WHITE, Commentary, p. 27-41, mais<br />
également E. AUBRION, « La “Correspondance” de Pline le Jeune : Problèmes et orientations actuelles<br />
de la recherche », ANRW, II 33.1, 1989, p. 304-374, ici p. 316 ss. ; J.-A. SHELTON, « Pliny’s Letter 3.11:<br />
Rhetoric and Autobiography », C&M, 38, 1987, p. 121-139, ici p. 135 s.<br />
2. Pour le débat de la première moitié du XX e s. cf. la thèse de K. ZELZER, « Zur Frage des Charakters der<br />
Briefsammlung des jüngeren Plinius », Wiener Studien, 77, 1964, p. 144-161, et également Id., « Zur Frage<br />
des Charakters der Briefsammlung des jüngeren Plinius », Wiener Studien, 77, 1964, p. 144-161 ; pour<br />
l’opinion dominante actuellement cf. l’état de le recherche présenté par AUBRION, Correspondance, 1989,<br />
p. 315-323, par M. LUDOLPH, Epistolographie und Selbstdarstellung : Untersuchung zu den ‘Paradebriefen’<br />
Plinius des Jüngeren,Tübingen, 1997 (Classica Monacensia 17), p. 15-19 ou par F. BEUTEL, Vergangenheit<br />
als Politik : neue Aspekte im Werk des jüngeren Plinius, Francfort/Main [etc.], 2000 (Studien zur klassischen<br />
Philologie 121), p. 129 ss., ainsi que A.N. SHERWIN-WHITE, Commentary, 1966, p. 11-20. Peter L.<br />
SCHMIDT, dans son article pour Der Neue Pauly (P.L. SCHMIDT, « Brief », DNP, 2, 1997, 771-775)<br />
constate : « Fernzuhalten ist jedenfalls die noch immer verbreitete Vorstellung einer Dichotomie von<br />
(echtem) Brief und (künstlicher) Epistula, die das unterschiedliche Niveau von Ausdrucksvermögen und<br />
Stilisierung, gegebenenfalls auch die potentielle Publikationsabsicht […] als kategoriale Differenzierung<br />
übertreibt » (col. 771), et il renvoie à K. THRAEDE, Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik, Munich, 1970<br />
(Zetemata 48), p. 1-10. Mais cf. la distinction de trois formes de lettres que propose A. WEISCHE, « Plinius<br />
d.J. und Cicero. Untersuchungen zur römischen Epistolographie in Republik und Kaiserzeit », ANRW,<br />
II 33.1, 1989, p. 375-386.
164 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
l’image de sa propre personne qu’il voulait présenter à ses contemporains et à la<br />
postérité : ce qui se dessine dans le recueil épistolaire est, comme l’écrit Jo-Ann<br />
Shelton, « un autoportrait littéraire flatteur », qui le montre en tant que « sage<br />
conseiller, auteur respecté, ami généreux et mari amoureux de sa femme » 1 .<br />
Ces conditions de production du texte demandent deux commentaires :<br />
d’abord, le souci d’établir sa gloire et une bonne réputation n’est certainement<br />
pas à considérer comme l’idiosyncrasie d’une vanité individuelle 2 , mais fait au<br />
contraire partie d’un habitus sénatorial traditionnel : un membre de l’aristocratie<br />
sénatoriale est obligé de maintenir la gloire de son nom, c’est une<br />
obligation qu’il a envers ses ancêtres et envers d’éventuels descendants ; à Rome,<br />
on n’assure jamais sa notoriété uniquement pour sa propre personne, mais pour<br />
sa domus. Déjà Anne-Marie Guillemin, dans son étude sur Pline parue en 1929,<br />
a attiré l’attention sur cette norme valable pour tout aristocrate 3 ; une récente<br />
thèse allemande de Matthias Ludolph le confirme 4 ; et dans mon étude sur la<br />
construction du féminin et du masculin chez Tacite j’étais amené à proposer<br />
cette recherche de la gloire comme un des éléments de la définition même du<br />
masculin dans la culture romaine 5 .<br />
En second lieu, le caractère autobiographique élogieux du recueil épistolaire<br />
nous permet de préciser sa valeur comme source historique : fils adoptif de<br />
Pline l’Ancien qui a fait une belle carrière équestre, Pline le Jeune est sénateur,<br />
et il atteint l’honneur du consulat en l’an 100. Il est donc pleinement intégré<br />
dans l’aristocratie sénatoriale. Or, dans un groupe si étroitement réglé par le<br />
contrôle social des regards des pairs, on ne peut acquérir une bonne renommée<br />
que par une conformité exemplaire aux normes : l’aristocratie romaine ne<br />
1. J.-A. SHELTON, « Pliny the Younger, and the Ideal Wife », C&M, 41, 1990, p. 163-186, ici p. 164. À juste<br />
titre, me semble-t-il, SHELTON (Letter 3.11, p. 121) écrit qu’il publie les lettres « in order to produce an<br />
autobiography ». Sur la question, cf. également M. LUDOLPH, Epistolographie, pss., et G. VOGT-SPIRA, « Die<br />
Selbstinszenierung des jüngeren Plinius im Diskurs der literarischen Imitatio », dans L. CASTAGNA,<br />
E. LEFÈVRE (éd.), Plinius der Jüngere und seine Zeit, Munich, 2003, p. 51-65, pour la « mise en scène de sa<br />
propre personne » dans l’imitation littéraire.<br />
2. Tel était le principal reproche que la recherche croyait devoir faire à Pline le Jeune, cf. M. LUDOLPH,<br />
Epistolographie, p. 12-14 et note 6 pour les références du débat.<br />
3. A.-M. GUILLEMIN, Pline et la vie littéraire de son temps, Paris, 1929 ; cf. également H.P. BÜTLER, Die geistige<br />
Welt des jüngeren Plinius. Studien zur Thematik seiner Briefe, Heidelberg, 1970, notamment le chapitre 2 :<br />
« Das Ringen um Unsterblichkeit und Ruhm », p. 21-27.<br />
4. M. LUDOLPH, Epistolographie, cf. notamment les p. 60 ss. ; J. RADICKE, « Die Selbstdarstellung des Plinius in<br />
seinen Briefen », Hermes, 125, 1997, p. 447-469, propose (p. 462 ss.) une étude des mécanismes permettant<br />
l’éloge de soi-même sans offenser les règles de la décence (il renvoie à PLUTARQUE,de laude ipsius, Mor.539B-<br />
547F) et discute (p. 466-469) le genre épistolaire comme particulièrement adapté à un tel exercice.<br />
5. Th. SPÄTH, Männlichkeit und Weiblichkeit bei Tacitus. Zur Konstruktion der Geschlechter in der römischen<br />
Kaiserzeit, Francfort/Main-New York, 1994, p. 177-180 ; cf. également D. BARGHOP, Forum der Angst.<br />
Eine historisch-anthropologische Studie zu Verhaltensmustern von Senatoren im römischen Kaiserreich,<br />
Francfort/Main-New York, 1994, p. 150-159 ; E. FLAIG, « Politisierte Lebensführung und ästhetische<br />
Kultur. Eine semiotische Untersuchung am römischen Adel », Historische Anthropologie, 1, 1993, p. 193-<br />
217, ici p. 197-199 ; Id., « Die pompa funebris. Adlige Konkurrenz und annalistische Erinnerung in der<br />
römischen Republik », dans O.G. OEXLE (éd.), Memoria als Kultur, Göttingen, 1995, p. 115-148, ici<br />
p. 121-133.
Thomas Späth 165<br />
reconnaît pas l’exceptionnalité comme une valeur positive, en revanche, on<br />
obtient la réputation par une exceptionnelle conformité aux normes. Si donc<br />
Pline, par la publication de ses lettres, érige un monument à sa propre personne,<br />
il ne peut le faire qu’en construisant l’image d’un homme en accord avec les<br />
attentes sociales.<br />
Il y a, certes, de nombreuses raisons de supposer des différences et même des<br />
contradictions entre l’auteur Pline en tant que personnage historique qui écrit,<br />
relit et publie ses lettres et la figure littéraire de l’épistolier « Pline » créée par la<br />
collection épistolaire 1 . Ces contradictions étaient et sont toujours un problème<br />
pour l’exploitation événementielle des Lettres comme source historique ; en effet,<br />
la question de la chronologie des lettres et celle de la datation des étapes de la<br />
carrière de Pline ont occupé les historiens depuis Mommsen 2 . Ces contradictions<br />
n’ont aucune importance, en revanche, pour la question qui nous occupe ici :<br />
celle des normes sociales et de leur mise en pratique. Pline publie ses Lettres en<br />
s’imaginant un « lecteur implicite » 3 qu’il veut convaincre de la qualité morale de<br />
la figure littéraire de l’épistolier présenté dans son recueil ; il présente donc une<br />
orthopraxis, c’est-à-dire des actions et attitudes supposées trouver l’approbation et<br />
même l’adoration de son public, un public qu’il s’imagine très probablement<br />
constitué par ses pairs, par le champ social de l’aristocratie sénatoriale et équestre<br />
dont sont également issus les destinataires de ses lettres 4 .<br />
Ces réflexions m’amènent à lire l’œuvre épistolaire de Pline par rapport à<br />
un comportement normatif : nous n’y lisons pas les normes elle-mêmes<br />
régissant la vie aristocratique, mais bien les pratiques décrites pour laisser une<br />
image exemplaire de la figure littéraire « Pline » ainsi créée. Or la mise en série<br />
de cette orthopraxis permet d’établir des régularités indiquant l’orthodoxie, c’està-dire<br />
les règles normatives dont les pratiques décrites d’un quotidien<br />
aristocratique sont la concrétisation.<br />
Le quotidien d’un aristocrate selon les Lettres<br />
Une lecture orientée sur les activités évoquées dans les neuf livres des Lettres<br />
peut être résumée en distinguant cinq domaines d’occupations dont se compose<br />
le quotidien de la figure « idéaltypique » de l’aristocrate Pline.<br />
1. Cf. F. BEUTEL, Vergangenheit, p. 150-156 ; J. RADICKE, « Der öffentliche Privatbrief als “kommunizierte<br />
Kommunikation” (Plin. Epist. 4,28) », dans L. CASTAGNA,E.LEFÈVRE (éd.), Plinius der Jüngere und seine<br />
Zeit, Munich, 2003, p. 23-34, ici p. 23-25.<br />
2. Cf. le commentaire bibliographique dans E. AUBRION, Correspondance, p. 306-311.<br />
3. Sur ce concept développé notamment par Wolfgang Iser dans le cadre d’une esthétique de la réception,<br />
cf. W. ISER, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, Munich, 1994 4 (1 ère éd. 1976), p. 37-86 ;<br />
S.R. SULEIMAN, I.C.WIMMERS, The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, Princeton,<br />
1980 ; mais cf. la réévaluation critique du concept par A. NÜNNING, « Renaissance eines<br />
anthropomorphisierten Passepartouts oder Nachruf auf ein literarisch-kritisches Phänomen ? », Deutsche<br />
Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 67, 1993, p. 1-25.<br />
4. Cf. F. BEUTEL, Vergangenheit, p. 171-173 ; J. RADICKE, Privatbrief, p. 32 s.
166 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
Il y d’abord, bien sûr, le domaine politique et judiciaire : dans un grand<br />
nombre de lettres, l’épistolier aborde sa participation aux institutions de la res<br />
publica. Il s’étend sur les affaires traitées au Sénat ; les destinataires de ces lettres<br />
étant souvent des sénateurs absents de Rome, il raconte les débats et décisions,<br />
tels les nouvelles procédures de vote 1 ou le règlement concernant l’indemnité<br />
des avocats. 2 Mais les affaires politiques au sens restreint du terme ne sont pas<br />
ce qu’il y de plus important dans les réunions du Sénat : Pline paraît trouver un<br />
plaisir particulier au récit du déroulement des procès devant le Sénat ou les<br />
tribunaux, dans lesquels il a joué un rôle 3 – un rôle toujours couronné de<br />
succès : il ne mentionne aucun procès qu’il aurait perdu, en tant que défenseur<br />
ou accusateur. J’ajouterais un troisième aspect à cette activité au sein des<br />
institutions politiques et judiciaires : parmi les lettres, il y a de nombreuses<br />
recommandations directes dans lesquelles Pline demande au destinataire un<br />
service pour un tiers, ou alors il mentionne que son soutien a permis à un ami<br />
d’obtenir un poste. Dans un champ social basé sur le patronage 4 , ces<br />
recommandations font partie de l’activité politique de la même manière que la<br />
participation aux réunions du Sénat. 5<br />
Une étude des règles déterminant la vie quotidienne d’un aristocrate se<br />
devrait d’aller au-delà de ces simples constat ; si nous voulons affiner nos<br />
connaissances des pratiques ordinaires d’un Pline, nous ne pouvons nous limiter<br />
à ce qu’il expose comme activité exemplaire : l’analyse du non-dit à partir de<br />
ce qui est écrit dans les Lettres s’imposerait ; ce non-dit concernerait par<br />
exemple les procès perdus – car ne faut-il pas supposer qu’il y en avait ? Le nondit<br />
concernerait également les séances du Sénat auquel Pline assistait sans jouer<br />
un rôle décisif, malgré son statut de consulaire à partir de l’an 100. Curieusement<br />
aussi, nous ne trouvons aucune lettre dans les premiers neuf livres, dans<br />
1. 3.20, 4.25.<br />
2. 5.9, 5.13.<br />
3. Cf. par exemple la lettre 5.20 : Pline défend le proconsul contre l’accusation de la province de Bithynie<br />
(et il se moque de la verbosité grecque, une loquentia à laquelle il oppose son eloquentia) ; dans la lettre<br />
4.16, il décrit son plaisir de trouver un auditoire nombreux quand il plaide au tribunal des centumviri, et<br />
dans 6.11 il fait remarquer que de jeunes orateurs viennent l’écouter pour apprendre leur métier. Mais<br />
cf. également dans la lettre 2.14 ses regrets à propos des nouvelles mœurs des jeunes orateurs devant les<br />
centumviri, qui s’organisent des claques ; 3.9 : il se plaint de la fatigue causée par la préparation de<br />
l’accusation de Caecilius Classicus préparée pour la province Baetica (cf. 1.7, 3.4) ; dans les lettres 6.18 et<br />
4.17, il raconte s’être chargé de la plaidoirie pour des personnes recommandées par des amis ; dans 2.11,<br />
il se vante de son long plaidoyer devant le sénat dans le procès contre Marius Priscus.<br />
4. Cf.A. WALLACE-HADRILL, « Patronage in Roman society: from Republic to Empire », dans A. WALLACE-<br />
HADRILL (éd.), Patronage in Ancient Society, Londres-New York, 1989, p. 63-87 ; R.P. SALLER, Personal<br />
Patronage under the Early Empire, Cambridge, 1982 ; R.P. SALLER, « Patronage and friendship in early<br />
imperial Rome: drawing the distinction », dans A. WALLACE-HADRILL (éd.), Patronage in Ancient Society,<br />
Londres-New York, 1989, p. 49-62.<br />
5. Lettres de recommandation, par exemple : 2.13, 3.2, 4.4, 4.15, 7.22, 7.31 ; Pline mentionne son soutien<br />
à des amis dans 1.19, 2.9, 6.11, 6.23, 6.25. Cf. l’article très utile pour la question de H. PAVIS D’ESCURAC,<br />
« Pline le Jeune et les lettres de recommandation », dans Ed. FRÉZOULS (éd.), La mobilité sociale dans le<br />
monde romain. Actes du colloque organisé à Strasbourg (novembre 1988) par l’<strong>Institut</strong> et le Groupe de Recherche<br />
d’Histoire Romaine, Strasbourg, 1992, p. 55-69.
Thomas Späth 167<br />
laquelle Pline demanderait pour sa part le soutien ou la recommendation de sa<br />
propre personne par un ami : faudrait-il supposer que l’épistolier accumule le<br />
capital symbolique des services rendus sans jamais le faire fructifier ? Toutefois,<br />
je renonce à approfondir ces questions du non-dit qui pourtant est inscrit dans<br />
ce qui est dit ; elles dépasseraient le cadre de ce bref exposé, je les laisse donc<br />
en suspens pour m’en tenir, pour l’instant, au recensement positiviste de ce qui<br />
est écrit dans le texte. Et le texte des Lettres fait voir un second domaine<br />
d’activités quotidiennes : les rapports sociaux en dehors du contexte politicojudiciaire.<br />
Les Lettres de Pline contiennent de nombreux témoignages de ce que<br />
j’aimerais appeler des « rapports sociaux ordinaires » : il répond à des invitations<br />
ou remercie le destinataire pour une visite ou une invitation ; il présente ses<br />
vœux ou donne des conseils à propos de fiançailles ou de mariages 1 . Nous<br />
trouvons ici l’image du « sage conseiller » mentionnée par Shelton : Pline<br />
répond à plusieurs reprises à un oncle ou à une mère qui lui demandent de leur<br />
recommander un précepteur garantissant une bonne éducation des enfants 2 ;<br />
mais apparemment il donne ses conseils également sans en être sollicité<br />
auparavant, par exemple sur la façon de traiter les affranchis ou des fils 3 . Mais<br />
l’épistolier se fait aussi philosophe : il suggère la bonne manière d’être généreux,<br />
ou bien il disserte sur les conséquences à tirer du fait de la brièveté de la vie ou<br />
enseigne les façons honorables de mourir 4 .<br />
À côté de ces conversations savantes, les Lettres évoquent des choses bien plus<br />
terre à terre : les questions financières et de propriété sont le troisième<br />
« domaine du quotidien » que j’aimerais distinguer. Pline publie des lettres qui<br />
ont trait à l’achat d’esclaves 5 ou à la meilleure attitude à adopter envers affranchis<br />
et esclaves 6 ; il discute les problèmes du renouvellement du bail de ses propriétés<br />
agricoles, mentionne une mauvaise récolte de raisins ou explique son usage<br />
circonspect des produits agricoles de ses terres 7 . L’achat et la vente de terrains<br />
font l’objet de commentaires de même que Pline juge utile d’intégrer à sa<br />
collection une lettre adressé à un architecte qu’il charge de la rénovation et de<br />
l’aggrandissement d’un sanctuaire de Cérès qui se trouve sur ses terres. 8<br />
D’une importance plutôt réduite par rapport aux autres activités, les Lettres<br />
parlent également du mariage et du souci de produire des enfants légitimes :<br />
1. Cf. par exemple les lettres 1.14 ou 6.26 ; dans 6.32, un soutien financier en vue du mariage de la fille<br />
est proposé à un Quintilien.<br />
2. 2.18, 3.3, cf. également 7.24.<br />
3. 9.24, 4.2, 9.12.<br />
4. 9.30 (générosité) ; 3.7 (brevitas vitae) ; 6.24 (manières honorables de mourir).<br />
5. 1.21.<br />
6. 1.4, 3.14, 5.19, 8.16; cf.T. YUGE, « Die Einstellung Plinius des Jüngeren zur Sklaverei », dans H. KALCYK,<br />
B. GULLATH,A.GRAEBER (éd.), Studien zur Alten Geschichte. Siegfried Lauffer zum 70. Geburtstag am 4.<br />
August 1981 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, t. 3, Rome, 1986, p. 1089-1102.<br />
7. 9.37 (bail) ; 9.16, 9.20 (mauvaise récolte) ; 2.4.3-4 (produits agricoles).<br />
8. 3.19, 7.14, 9.39.
168 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
Pline choisit trois lettres 1 à sa troisième (ou deuxième 2 ) femme Calpurnia pour<br />
son recueil ; toutes ces lettres témoignent de l’affection entre les deux époux,<br />
elles utilisent un vocabulaire et des métaphores qui rappellent l’élégie érotique. 3<br />
Dans une lettre à Calpurnia Hispulla, la tante paternelle de sa femme qui, après<br />
la mort de son frère, a éduqué la nièce, Pline exprime sa gratitude pour<br />
l’arrangement de ce mariage qui lui donne entière satisfaction. 4 Cependant,<br />
deux lettres adressée à Fabatus, le grand-père de Calpurnia, et à sa tante<br />
Calpurnia Hispulla 5 , rapportent une fausse couche de Calpurnia ; Pline adopte<br />
une attitude de regret dans les deux lettres et demande l’indulgence pour sa<br />
jeune épouse qui ne se serait pas aperçu d’être enceinte ; mais ce n’est que dans<br />
la lettre à Calpurnia Hispulla qu’il la rassure sur l’état de santé de sa nièce, tandis<br />
qu’envers le grand-père, il met l’accent sur la promesse seulement différée d’une<br />
future descendance.<br />
Jusqu’ici, le survol des thématiques abordées dans les Lettres montre un<br />
aristocrate marié et sans descendance, ce qui lui crée des soucis ; il administre<br />
son patrimoine qui assure son existence matérielle ; il entretient des réseaux<br />
d’amitiés ; s’active comme orateur devant les tribunaux et participe aux<br />
réunions du Sénat. Reste un cinquième domaine que les Lettres mettent en<br />
avant de façon particulièrement ostentatoire : le travail littéraire. Le recueil épistolaire<br />
fait voir un fréquent échange de textes que l’on commente<br />
mutuellement. Pline mentionne souvent les discours qu’il vient de prononcer<br />
ou bien qu’il est en train de relire et de préparer pour la publication ; certaines<br />
lettres accompagnent l’envoi d’un tel texte et l’auteur attire, tout fier, l’attention<br />
du destinataire sur la structure argumentative raffinée et les finesses stylistiques. 6<br />
Il raconte également ce qu’il faut appeler la « vie littéraire » à Rome qui consiste<br />
essentiellement en lectures publiques et est de toute évidence réglée par des<br />
obligations et attentes sociales bien précises : la présence à une lecture est un<br />
beneficium, un service que l’on rend à un ami et qui crée, pour celui-ci,<br />
l’obligation de la réciprocité 7 .Toutefois, gardons-nous de confondre cette « vie<br />
littéraire » avec notre notion de littérature – la production de textes dont parlent<br />
les Lettres se comprend en étroite relation avec les fonctions politiques des<br />
aristocrates romains : il s’agit essentiellement de discours politiques et judiciaires<br />
dont la publication répand la notoriété actuelle de leur auteur et lui assure la<br />
gloire future 8 .<br />
1. 6.4, 6.7, 7.5.<br />
2. Cf. SHELTON, Ideal Wife, p. 163 note 1, pour la littérature sur le nombre et l’identité des épouses de Pline.<br />
3. Ibid., p. 170s..<br />
4. 4.19 ; pour la thématique du mariage de Pline et Calpurnia et un commentaire de cette lettre 4.19<br />
cf. SHELTON, Ideal Wife, 1990.<br />
5. 8.10 à Fabatus, 8.11 à Hispulla.<br />
6. Cf. 2.1, 3.9, 4.9, 5.20, 6.29, 7.33.<br />
7. 1.13.5-6, 8.12 : Pline montre sa générosité en décrivant son comportement qui justement tente d’éviter<br />
de créer une telle obligation.<br />
8. 6.29.3, 9.14.
Thomas Späth 169<br />
Cependant, cette présentation de l’activité littéraire passe sous silence<br />
quelques lettres qui ne parlent ni de discours politiques ni des obligations des<br />
lectures publiques : dans plusieures lettres 1 , Pline parle de son plaisir à composer<br />
des hendecasyllabi, des vers et des poèmes, et il paraît vouloir justifier la légèreté<br />
frivole 2 de cette occupation qu’il situe dans les heures de l’otium à la campagne.<br />
Nous pouvons entrevoir dans ces lettres un sixième domaine que j’hésite à<br />
appeler domaine d’activité, puisque, à suivre l’auteur, il faudrait plutôt parler de<br />
domaine d’inactivité. Je reviendrai tout de suite sur cette question pour en tirer<br />
quelques hypothèses conclusives, mais d’abord, j’aimerais jeter un regard critique<br />
sur ma façon d’esquisser le quotidien aristocratique.<br />
De la praxis aux normes aristocratiques<br />
Mon analyse distingue les activités que l’auteur Pline prête à la figure<br />
littéraire « Pline » en cinq « domaines ». Or, si nous voulons mieux connaître<br />
les pratiques quotidiennes d’un aristocrate romain, cette catégorisation risque<br />
de nous induire en erreur : l’image de l’homme politique qui joue divers rôles<br />
sociaux bien distincts et séparés l’un de l’autre et son partage entre une sphère<br />
publique et une sphère privée appartient à l’histoire moderne ; elle peut<br />
éventuellement saisir la situation d’un individu à partir du XIX e siècle – et<br />
encore : nos collègues modernistes nous apprennent les nombreux liens entre<br />
les champs d’activités économique et politique, entre la vie de famille et<br />
l’appartenance religieuse, et ainsi ils remettent en cause le bien-fondé de<br />
l’opposition du privé et du public même pour les sociétés bourgeoises 3 .<br />
Or si la question de la juxtaposition de rôles sociaux et de la dichotomie<br />
entre privé et public se pose pour les sociétés modernes, elle ne se pose pas pour<br />
la culture romaine : l’image que Pline construit dans son « autoportrait flatteur »<br />
comprend toutes ces pratiques sans les séparer et en montre l’intrication.<br />
L’activité littéraire, nous l’avons constaté, concerne essentiellement l’élaboration<br />
de discours judiciaires ou politiques ; elle crée en même temps des obligations<br />
sociales et entretient un réseau d’amitié sans lequel aucune activité politique<br />
n’est imaginable à Rome, où – faut-il le rappeler ? – on ne connaît pas de partis<br />
politiques, mais uniquement des rapports personnels comme fondement de<br />
1. 4.14, 5.3, 7.4.<br />
2. 4.14.1 : lusus mei (« mes divertissements ») ; 4.14.2 : accipies cum hac epistula hendecasyllabos nostros, quibus nos in<br />
vehiculo, in balineo, inter cenam oblectamus otium temporis (« tu reçois avec cette lettre mes vers de onze syllabes<br />
que je compose en carrosse, au bain, en mangeant pour m’égayer le temps de loisir ») ; 14.4.8 : ineptiae<br />
(« sottises ») ; 14.4.9 : poematia (« petits poèmes ») ; 5.3.1 : versiculi (« des vers sans importance ») ; 5.3.2 : facio<br />
non numquam versiculos severos parum […] homo sum (« il m’arrive de composer de petits vers quelque peu<br />
frivoles […] je suis homme »). Cf. U. AUHAGEN, « Lusus und Gloria – Plinius’ Hendecasyllabi (Epist. 4,14 ;<br />
5,3 und 7,4) », dans L. CASTAGNA, E. LEFÈVRE (éd.), Plinius der Jüngere und seine Zeit, Munich, 2003, p. 3-13<br />
et D. HERSHKOWITZ, « Pliny the Poet », G&R, 42, 1995, p. 168-181 sur les hendecasyllabi de Pline.<br />
3. Un bon aperçu du débat est présenté par D. GOODMAN, « Public Sphere and Private Life : Toward a<br />
Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime », History and Theory, 31, 1992,<br />
p. 1-20.
170 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
l’action politique. Si Pline conseille une veuve dans les questions d’éducation de<br />
son fils, il le fait parce qu’un lien d’amitié politique l’attachait au mari défunt ;<br />
les questions financières et de gestion du patrimoine sont évidemment en<br />
étroite relation avec le statut du sénateur Pline. Bref : ce que dans mon analyse<br />
des Lettres, je viens de distinguer, doit être recomposé pour faire apparaître l’image<br />
des pratiques quotidiennes de l’homme exemplaire que Pline présente à son<br />
public.<br />
Cet homme exemplaire occupe une position sociale bien connue et bien<br />
définie : les Lettres proposent et illustrent l’image idéale du pater familias aristocratique.<br />
C’est le pater familias qui incarne une domus, il assume sa présence sur<br />
le forum par sa participation aux délibérations du sénat et par ses discours<br />
judiciaires lors de procès où l’on se rend pour écouter les orateurs 1 . C’est par de<br />
tels engagements qu’il entretient sa propre gloire et par là, il maintient ou<br />
augmente la gloire des ancêtres et le statut dans l’aristocratie qu’ils lui ont légué.<br />
Le pater familias aristocratique se soucie de transmettre son nom à une<br />
descendance légitime, il entretient le réseau des amitiés au moyen traditionnel<br />
de l’échange de beneficia et de officia ; et il conserve ou agrandit le patrimoine,<br />
fondement du statut social de la domus.Telles sont les obligations et les normes<br />
sociales qui conditionnent les pratiques quotidiennes de l’homme aristocratique<br />
romain. Ces normes correspondent exactement à celles que la culture romaine<br />
définit comme les valeurs et les normes du masculin : comme je pus montrer<br />
ailleurs par l’analyse de la construction du masculin et du féminin dans les textes<br />
tacitéens 2 , les attentes envers l’homme romain et donc envers l’identité<br />
masculine se trouvent idéalement représentées dans la position du pater familias<br />
aristocratique 3 . Les Lettres de Pline renvoient à cet idéaltype (au sens que Max<br />
Weber a donné à ce terme) et la figure de « Pline » esquissée dans le texte par<br />
les pratiques décrites est largement déterminée par ces normes : l’identité<br />
masculine est une identité aristocratique, et une identité aristocratique est une<br />
identité politique au service de la res publica avec tout ce que cela implique<br />
d’obligations du pater familias envers ses ancêtres, les membres de sa domus et<br />
envers son patrimoine, du patronus envers la clientèle et les affranchis, du dominus<br />
1. W.M. BLOOMER, Valerius Maximus and the Rhetoric of the New Nobility, Chapel Hill etc., 1992, p 1, note<br />
2, considère l’art du discours comme un spectacle et le compare, pour le I er siècle de notre ère, aux<br />
concerts de nos temps : « The closest analogy to declamation is the modern concert, widely attended<br />
and with its own coterie of experts and a certain snob appeal. The concert by and large is more selfcontained:<br />
the performer’s distinction merits advancement in the musical world. The declaimer could<br />
aim at a career in the courts or in the emperor’s service.The political dimension of declamation is for<br />
the most part unparalleled. »<br />
2. Cf.Th. SPÄTH, Geschlechter, p. 306-311 ou Id., « Agrippine la Jeune ou la réalité du discours », Hypothèses.<br />
Travaux de l’école doctorale de l’Université Paris I à Panthéon-Sorbonne 2004, 2005, p. 297-321, ici p. 309 s.<br />
3. Ce constat conduit nécessairement à la révision du concept d’une simple dichotomie du masculin et du<br />
féminin : si l’idéaltype du masculin est le pater familias aristocratique, un petit nombre d’hommes romains<br />
sauraient s’adapter à une telle définition du genre; il faut donc postuler une pluralité des définitions<br />
sociales du masculin dans la culture romaine en rapport avec le statut social : la masculinité de l’esclave<br />
se distingue de celle du client, celle du fils d’un sénateur des normes du masculin de son père.
Thomas Späth 171<br />
dirigeant et surveillant sa familia d’esclaves. Ce modèle d’identité paraît se<br />
maintenir sous le principat tel qu’il s’est présenté à l’époque républicaine.<br />
Et pourtant, les Lettres montrent une faille dans cette apparente continuité :<br />
non seulement, nous l’avons vu, le rapport à l’épouse apparaît dans un<br />
vocabulaire passionnel, non seulement la futilité de la composition de vers<br />
« frivoles » est affirmée dans l’« autoportrait flatteur » que le sénateur Pline met<br />
devant les yeux de ses contemporains et de la postérité, mais l’identité politique<br />
elle-même, élément essentiel de l’identité masculine, semble remise en cause par<br />
ce que j’ai appelé un domaine d’inactivité :l’otium est présenté comme une digne<br />
et désirable alternative à la vie affairée du quotidien aristocratique 1 . Comment<br />
peut-on expliquer ces éléments qui semblent tout à fait contraires à l’image<br />
esquissée par ailleurs, celle de l’aristocrate exemplaire et absolument conforme<br />
aux normes sociales ?<br />
L’histoire du quotidien et la transformation des normes<br />
Depuis les années 1970, la microstoria et l’histoire du quotidien se sont frayé une<br />
voie dans l’écriture de l’histoire – deux perspectives qu’il ne faut certes pas<br />
confondre, mais qui partagent pourtant un certain nombre de prémisses. Il peut<br />
paraître osé que de vouloir s’appuyer sur de telles approches dans une étude de<br />
la vie aristocratique romaine : elles ont été développées d’abord pour l’histoire<br />
des temps modernes, et ensuite très explicitement en opposition avec l’histoire<br />
des aristocraties et des classes dominantes. Quand Carlo Ginzburg se mettait à<br />
enquêter sur l’univers quotidien du meunier Menocchio pour son livre Il<br />
formaggio e i vermi 2 il entendait proposer une recherche sur la culture populaire par<br />
contraste avec l’histoire événementielle dominée par les aristocrates et autres<br />
grands hommes politiques ou généraux. À peu près à la même époque, Michel<br />
de Certeau a été chargé, par ce qui était alors appelé le Secrétariat d’État à la<br />
Culture, de diriger une recherche de « conjoncture, synthèse et prospective » sur<br />
le « developpement culturel » 3 . De Certeau se proposait de travailler sur « la<br />
culture commune et quotidienne en tant qu’elle est appropriation (ou réappropriation)<br />
» 4 . Le résultat de ces recherches a été le livre L’invention du quotidien,<br />
dont le premier volume s’intitule Arts de faire 5 . En Allemagne, vers la fin des<br />
années 1970, des Geschichtswerkstätten, des « ateliers d’histoire » commençaient à<br />
1. Cf. les lettres 1.9, 4.23, 6.4 ou 8.9, dans lesquelles s’exprime la lassitude face aux obligations urbaines ;<br />
des éloges de la vie à la campagne se lisent dans les fameuses lettres qui décrivent deux des villae de Pline,<br />
2.17 et 5.6, mais également dans 9.7, 9.36 et 9.40 ou bien dans 1.6 en tant que bons conseils à Tacite à<br />
propos de la chasse accompagnée de travaux littéraires.<br />
2. C. GINZBURG, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500,Turin, 1976 (trad. franç. Le Fromage et<br />
les vers. L’univers d’un meunier du XVI e siècle, Paris, 1980).<br />
3. Luce GIARD dans M. DE CERTEAU, L’invention du quotidien,I,Arts de faire, Paris, 1990, p. VIII s.<br />
4. Document de travail de 1975 cité par Luce GIARD, ibid., p. XI.<br />
5. Cf. également M. DE CERTEAU, L. GIARD, P. MAYOL, L’invention du quotidien, II, Habiter, cuisiner, Paris,<br />
1994 et M. DE CERTEAU, La Culture au pluriel, Paris, 1993 (1 ère éd. 1974).
172 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
se former en dehors des institutions universitaires. Des historiens et des<br />
historiennes « de terrain » partaient à la recherche du quotidien de la classe<br />
ouvrière, du peuple sous le nazisme, de la vie de tous les jours en République<br />
Démocratique Allemande. Leurs méthodes s’inspiraient de l’ethnographie et<br />
prenaient souvent la forme de l’histoire orale 1 .<br />
Au centre de toutes ces approches se trouvent les concepts de la praxis et de<br />
l’appropriation qui remplacent celui de domination : une « culture populaire » n’est<br />
plus considérée comme simple réceptacle passif d’une « culture dominante »,<br />
mais elle s’approprie activement la culture dominante et elle la transforme dans<br />
ses pratiques quotidiennes. On se rappelle la fameuse formule de l’anthropologue<br />
américain Marshall Sahlins, le « risk of categories in action » 2 , le risque<br />
qu’encourent les catégories ou normes sociales et culturelles quand elles sont<br />
« mises en action » : aucune norme sociale, aucune « catégorie culturelle » ne<br />
sort indemne de sa mise en pratique, aucune norme ou catégorie ne sort<br />
inchangée de son appropriation par un sujet agissant dans une situation<br />
historique déterminée. Et, pour cette raison, ces approches de la culture populaire<br />
peuvent se révéler également utiles pour expliquer les transformations des<br />
normes aristocratiques dont les Lettres de Pline portent des traces : les études sur<br />
la culture populaire ont élaboré un modèle des rapports complexes entre<br />
normes dominantes et les pratiques qui sont déterminées par ces normes tout<br />
en les transformant.<br />
Ce modèle peut rendre compte, me semble-t-il, de l’évolution des normes<br />
aristocratiques sous le Haut-Empire. Car d’une part, la figure « Pline »<br />
s’approprie pleinement les normes du pater familias vertueux, elle assume<br />
l’identité politique de l’aristocrate et l’auteur en construit une image<br />
exemplaire dans la description des pratiques quotidiennes des affaires politiques<br />
et des obligations sociales qui en découlent. D’autre part cependant, dans<br />
l’appropriation de ces normes, « Pline » intègre des éléments qui semblent<br />
contradictoires et qui pourtant font partie de cette image exemplaire : l’amour<br />
de la philosophie et des études, l’amour passionné pour l’épouse, des amitiés<br />
désintéressés et sans objectifs politiques 3 , même le dégoût des affaires de la res<br />
publica. Dans les pratiques quotidiennes construites dans les Lettres de Pline, je<br />
1. H. MEDICK, « “Missionare im Ruderboot” Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung an die<br />
Sozialgeschichte », dans A. LÜDTKE (éd.), Alltagsgeschichte : zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und<br />
Lebensweisen, Francfort/Main - New York, 1989, p. 48-84, présente à la fois un bilan après une décennie<br />
de travaux et un article fondateur ; cf. également la mise au point de A. LÜDTKE, « Alltagsgeschichte –<br />
ein Bericht von unterwegs », Historische Anthropologie, 11, 2003, p. 278-295. Ces approches se sont<br />
inspirées égalements par les réflexions méthodologiques autour de la notion de Popular Culture<br />
proposées par ce qu’il est convenu d’appeler la Birmingham School, dont l’un des protagonistes est Stuart<br />
Hall.<br />
2. M. SAHLINS, Islands of History, Chicago, 1985 (Des îles dans l’histoire, Paris, 1989), p. 145; cf. également les<br />
commentaires de G. LENCLUD, « Le monde selon Sahlins », Gradhiva, 9, 1991, p. 49-62.<br />
3. Cf. Th. SPÄTH, Thomas, « Männerfreundschaften - politische Freundschaften? Männerbeziehungen in<br />
der römischen Aristokratie des Prinzipats, 1. Jh. u. Z. », dans W. ERHART,Br.HERRMANN (éd.), Wann ist<br />
der Mann ein Mann?, Stuttgart, 1997, 192-211.
Thomas Späth 173<br />
propose donc de lire les indices d’une appropriation-transformation des valeurs<br />
et normes sociales aristocratiques. Dans ce sens, la lettre adressée à Minicius<br />
Fundanus, un sénateur qui sera consul en 105-106, est particulièrement révélatrice<br />
: « si tu demandais à quelqu’un :“qu’as-tu fait aujourd’hui ?” il te répondrait<br />
“j’ai été présent à la prise d’une toge virile, j’ai assisté à des fiançailles ou à<br />
un mariage, un tel m’a fait venir pour mettre le sceau au testament, un tel pour<br />
l’accompagner en justice, un tel pour prendre part à un conseil” ; toutes occupations<br />
indispensables le jour où elles se sont présentées, mais quand on se dit<br />
que semblable a été l’emploi de toutes les journées, on les sent vides, surtout<br />
dans le calme de la campagne, et alors vous vient cette pensée : que de jours<br />
perdus dans des occupations combien inutiles. » 1<br />
À la vie affairée de la ville – que Pline illustre lui-même à longueur de son<br />
recueil épistolaire – il oppose l’otium à la campagne, un otium consacré à la<br />
lecture et à l’écriture, aux promenades à pied et à cheval, parfois à la chasse dont<br />
il espère toutefois rapporter surtout un butin littéraire puisqu’il y apporte<br />
toujours ses tablettes de cire 2 . Le contraste entre ville et campagne est, bien sûr,<br />
un topos que Pline n’a qu’à reprendre, entre autres, de son modèle Cicéron 3 .<br />
L’opposition du negotium et de l’otium est une des thématiques les plus souvent<br />
traitées par les commentateurs de Pline ; ainsi,Anne-Marie Guillemin écrit, en<br />
1929, que Pline considère l’otium pour obtenir la gloire littéraire comme un<br />
« pis-aller dont on se contente depuis que la gloire militaire et la gloire civique<br />
sont hors de prises de tous et réservées à d’exceptionnels privilégiés » 4 . Là aussi,<br />
on pourrait faire le rapprochement avec Cicéron ou avec Salluste : bien que la<br />
gloire soit, selon les normes traditionnelles, étroitement liées au negotium, ils<br />
revendiquent de pouvoir l’obtenir également par l’activité philosophique ou<br />
historiographique quand les circonstances les contraignent à un otium forcé.<br />
Cependant, les Lettres de Pline se distinguent par une différence de taille :<br />
l’otium n’est pas forcé 5 , tout au contraire – se retirer à la campagne est un désir<br />
1. 1.9.2-3. Cf. également 8.9.1, 2.8.2, 3.18.4, ou bien le passage 1.10.9-11 cité en exergue.<br />
2. 1.6.<br />
3. K. SCHNEIDER, Villa und Natur: Eine Studie zur römischen Oberschichtkultur im letzten vor- und ersten<br />
nachchristlichen Jahrhundert, Munich, 1995, chapitre I.2, p. 22-34 ; en ce qui concerne son jugement par<br />
rapport à l’otium de Pline, elle me semble se tromper en faisant remarquer que pour lui, une journée à<br />
la campagne « sans amis » serait « impensable » (p. 23) ; de même, on ne peut pas affirmer une<br />
« endgültige Entmachtung der Senatsaristokratie » sous le principat, comme elle le fait p. 30.<br />
4. A.-M. GUILLEMIN, Vie littéraire, p. 16.<br />
5. Pace M. LUDOLPH, Epistolographie, p. 60 ss et note 175, cf. également p. 18 et les remarques sur la même<br />
opinion (partagée par l’auteur) de E. LEFÈVRE, « Plinius-Studien III. Die Villa als geistiger Lebensraum<br />
(1, 3 ; 1, 24 ; 2, 8 ; 6, 31 ; 9, 36) », Gymnasium, 94, 1987, p. 247-262, qui parle (p. 252) de « gloria im<br />
privaten [sic] Bereich » ; cf. également E. LEFÈVRE, « Plinius-Studien IV. Die Naturauffassung in den<br />
Beschreibungen der Quelle am Lacus Larius (4, 30), des Clitumnus (8, 8) und des Lacus Vadimo (8, 20) »,<br />
Gymnasium, 95, 1988, p. 236-269, ici p. 264 ; E. LEFÈVRE, « Plinius-Studien V.Vom Römertum zum<br />
Ästhetizismus. Die Würdigungen des älteren Plinius (3, 5), Silius Italicus (3, 7) und Martial (3, 21) »,<br />
Gymnasium, 96, 1989, p. 113-128, ici p. 126 et 128. De même J. Radicke, Selbstdarstellung, p. 464 renvoie<br />
aux regrets pliniens de l’espace restreint de l’action politique et donc de l’impossibilité d’acquérir de la<br />
gloire par les grandes actions militaires ou politiques.
174 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
sans aucune contrainte extérieure, et Pline se déclare envieux de ceux qui<br />
réussissent à le réaliser. Nulle part les Lettres ne font voir que l’auteur<br />
considérerait la gloire littéraire comme un « succédané » de la gloire militaire<br />
comme l’écrit encore Guillemin. Loin de là, Pline place ses plaintes sur l’ennui<br />
des obligations qui découlent de sa position sociale et politique bien en vue<br />
dans ses Lettres, de même que sa satisfaction de la vie à la campagne consacrée<br />
au studia …et sans devoir porter la toge 1 . En tenant compte du caractère de<br />
l’œuvre, considérée comme un monument que l’auteur érige à sa personne en<br />
tant qu’homme exemplaire, ces réflexions m’amènent à une conclusion qui ne<br />
prétend pas clore une problématique mais bien plutôt ouvrir un champ<br />
d’investigation : la problématisation du negotium me semble remettre en cause<br />
l’identité politico-sociale qui s’imposait à tout aristocrate. Pline expose<br />
publiquement dans ses écrits sa lassitude des obligations de sénateur et son<br />
bonheur du retrait solitaire à la campagne. Est-ce que nous ne pourrions pas y<br />
voir une pratique qui, en s’appropriant les normes dominantes, les transforme<br />
vers une image modifiée de l’homme aristocratique ou de l’homme tout court<br />
? Serait-il possible alors de détecter dans les Lettres de Pline les indices d’un<br />
changement de ces normes, un changement qui, à l’issue d’un lent processus sur<br />
plusieurs générations, repoussera le souci de la res publica pour mettre à sa place<br />
un souci de soi ?<br />
Thomas SPÄTH<br />
1. 5.6.45 : nulla necessitas togae.