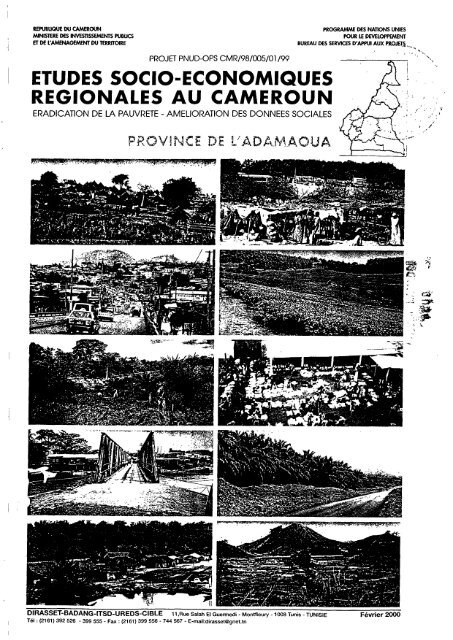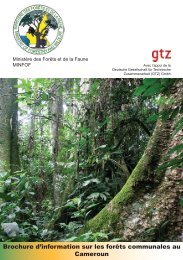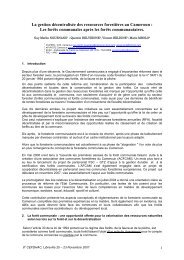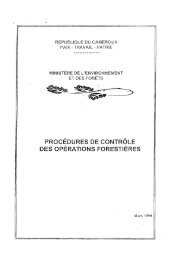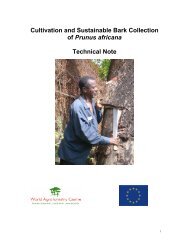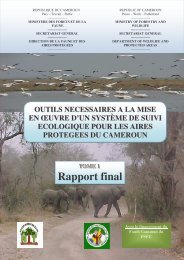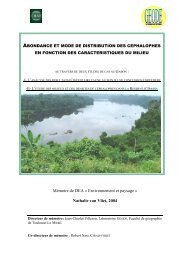REGIONALES AU CAMEROUN
REGIONALES AU CAMEROUN
REGIONALES AU CAMEROUN
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IERJBII.QIJE U, CAIiEROUN<br />
MINISTERE DCS O{\EsIIssEMENTS ruBrcs<br />
EI D,E t'A 4EMG€rr{ENt Dl, IIRRIIORE<br />
PROJET PNUD-OPS CMR/98/OO5 /O1 l99<br />
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES<br />
<strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
ERADICATION DE LA P<strong>AU</strong>VRETE - AMELIORATION DES DONNEES SOCIALES<br />
Pfr#Viî{CE Fg L'ÂDÊ\MA#UÊ\<br />
PROGRAMÀ{E DES NANONS UNIES<br />
POUR. IE DEVETOPPT}IENT<br />
BURÊ<strong>AU</strong> DCS SERVTCÉs yAprut <strong>AU</strong>X PiOJEIS.*.,<br />
DIRASSEI-BADANG-ITSO-UREDS-CIBLE<br />
11,Rue Salah El cuermedi - Montfleury - 1oo8 Tunis - TUNtstE<br />
Téf : (2161) 392 526 - 399 555 - Fax : (21611 399 556 - 744 567 - E-mait:dirasset@gnet.tn<br />
Février 2O(X)
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
SOMMAIRE<br />
I. CONTEXTE REGIONAL, SYNTHESE ET ORIENTATIONS<br />
I. DEMOGRAPHIE, DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF ET EQUIPEMENTS SOCIO-COLLECTIFS<br />
2. INFRASTRUCTURES, MARCHES, FLUX ET SYSTEMES D'ECHANGES<br />
3. SECTEURS PRODUCTIFS<br />
4. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS<br />
II. DONNEES HISTOzuQUES, DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES<br />
I. DYNAMIQUE ET STRUCTURE DEMOGRAPHIQUES<br />
2. PROJECTION DES POPULATIONS<br />
3. GROUPES ETHNIQUES ET PEUPLEMENT<br />
4. EMPLOI ET NIVE<strong>AU</strong> DE VIE<br />
5. LES MIGRATIONS<br />
III. SECTEURS PRODUCTIFS<br />
1. L'AGRICULTURE: CADRE PHYSIQUE<br />
A. Les conditions pédologiques, hydrauliques et pluviométriques<br />
B. La végétation<br />
2. LES INSTITUTIONS AGRICOLES DE LA PROVINCE DE L'ADAMAOUA<br />
A. Les institutions publiques<br />
B. Les institutions privées<br />
C. Les structures para-publiques : Le Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA)<br />
3. LA PRODUCTION AGRICOLE<br />
A. Les principales cultures<br />
B. Les grandes zones de production<br />
C. Evolution tendancielle de la production agricole<br />
D. Protection des culfures et des denrées stockées<br />
4. LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE<br />
A. Les prix agricoles<br />
B. Les contraintes liées à I'activité aericole<br />
C. Elevage<br />
D. La pêche<br />
E. Forêt et environnement<br />
5. <strong>AU</strong>TRES ACTIVITES<br />
A. Le commerce<br />
B. L'indusfrie<br />
C. Le tourisme<br />
D. Mines et énergie<br />
F. Banques<br />
G. Revenus<br />
IV. MARCHES, FLUX ET SYSTEMES D'ECHANGES<br />
I. LES MARCHES ET LES ECHANGES COMMERCI<strong>AU</strong>X<br />
A. Les principaux marchés de la province de l'Adamaoua<br />
B. Le secteur de la transformation dans la province de I'Adamaoua<br />
C. Les produits échangés<br />
2. LES CONTRAINTES LIEES <strong>AU</strong> DEVELOPPEMENT DES MARCHES ET DES ECHANGES<br />
3. OzuENTATIONS ET RECOMMANDATIONS<br />
Poges<br />
4<br />
4<br />
6<br />
7<br />
t2<br />
t6<br />
t6<br />
l8<br />
t9<br />
20<br />
22<br />
24<br />
24<br />
26<br />
27<br />
27<br />
28<br />
28<br />
29<br />
30<br />
3t<br />
JJ<br />
J+<br />
J.+<br />
35<br />
)t<br />
39<br />
40<br />
45<br />
46<br />
48<br />
48<br />
49<br />
49<br />
50<br />
5l<br />
5l<br />
52<br />
52<br />
)J<br />
56<br />
56<br />
59<br />
60<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98/005/01/99<br />
Fêvrier 2OO0
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
V. INFRASTRUCTURES <strong>REGIONALES</strong><br />
I. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT<br />
A. Les Infrasffuctures de transport routier<br />
B. Infrastructure aérienne<br />
C. Infr astructures ferroviaires<br />
2. ALIMENTATION EN E<strong>AU</strong> POTABLE ET EN ENERGIE ELECTRIQUE<br />
A. Approvisionnement en eau potable<br />
B. Alimentation en énergie électrique<br />
3. LES TELECOMMI-TNICATIONS<br />
A. La communication téléphonique<br />
B. Transmission énergétique<br />
VI. LES EQUIPEMENTS SOCIO-COLLECTIFS<br />
I. SANTE<br />
2. L'ENSEIGNEMENT<br />
A. L'enseignement de base<br />
B. L'enseignement secondaire<br />
C. Les contraintes dans le domaine de l'éducation<br />
D. Quelques propositions '<br />
3. LES <strong>AU</strong>TRES EQUTPEMENTS SOCIO-COLLECTIFS<br />
A. Les equipements sportifs et récréatifs<br />
B. Les équipements liés aux affaires sociales et à la condition feminine<br />
C. Les contraintes<br />
D. Quelques propositions de solution<br />
VII. CONTEXTE URBAIN : LE PHENOMENE D'URBANISATION<br />
CAS PARTICULIER DE NGAOI.INDERE<br />
I. LES CONTRAINTES DE L'URBANISATION<br />
2. HIÉRARCHIE URBAINE DANS LA PROVINCE<br />
3. CAS PARTICULIER DE LAVILLE DE NGAOUNDERE<br />
VIII. RESSOURCES FINANCIERES LOCALES<br />
LOCAL ET PARTICIPATIF<br />
I. LA GESTION DES COMMUNES DANS LA PROVINCE DE L'ADAMAOUA<br />
A. Analyse des recettes communales<br />
B, Analyse des dépenses communales<br />
C. Contraintes des communes et propositions des solutions<br />
3. LE TRAVAIL PARTICIPATIF DANS L'ADAMAOUA<br />
Poges<br />
61<br />
6l<br />
6l<br />
64<br />
64<br />
66<br />
66<br />
67<br />
68<br />
68<br />
69<br />
7l<br />
7l<br />
75<br />
75<br />
76<br />
77<br />
79<br />
79<br />
79<br />
80<br />
80<br />
80<br />
DE L'ADAMAOUA :<br />
82<br />
82<br />
82<br />
83<br />
ET EFFORTS DE DEVELOPPEMENT<br />
87<br />
87<br />
87<br />
89<br />
89<br />
90<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
ANNEXE: INDICATEURS DE P<strong>AU</strong>VRETE<br />
LISTE DES TABLE<strong>AU</strong>X<br />
LISTE DES CARTES<br />
9s<br />
96<br />
98<br />
99<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98/005/01/99 Février 2000
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
I. DEMOGRAPHIE, DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF ET EQUIPEMENTS SOCIOcortEcÏtFs<br />
A. DYNAMIQUE SOCIATE ET CONDITIONS DE VIE DES POPUIATIONS<br />
Peuplée aujourd'hui de 733.000 habitants, la province de I'Amadoua connaît un taux<br />
d'accroissement démographique de 3,320Â,Iégèrement supérieur au taux national. Cette<br />
province se caractérise par un taux d'urbanisation de plus en plus croissant. Il est de 42%o<br />
aujourd'hui et pourrait atteindre respectivement 62,480Â et 68,2%o en l'an 2010 et en I'an<br />
2015. Ce phénomène est lié à I'exode rural, compte tenu du fait que les campagnes ne<br />
disposent pas d'infrastructures socio-collectives de mobilisation des jeunes.<br />
La pyramide des âges permet de noter que la population de cette province est essentiellement<br />
jeune. Les moins de 15 ans représentent 43,7o/o, dont 22,65 de garçons et<br />
2l,05yo de filles. Ces chiffres sont intéressants parce qu'ils sont la force de travail de<br />
demain, mais ils sont actuellement lourds parce qu'ils représentent d'importants investissements<br />
de toutes sortes (santé, scolarité, encadrement socioculturel...) pour une population<br />
non active (dans un milieu de paupérisation) pour préparer justement demain. Pour la<br />
tranche 15-35 ans, la proportion des hommes est de 13,47yo, alors que celle des femmes se<br />
situe à I5,8Yo. Cette inversion des tendances résulte essentiellement de la transhumance qui<br />
touche surtout les hommes ruraux.<br />
Sur le plan socio-ethnique, on note une multitude de groupes ethniques dans la province.<br />
Les autochtones Mboum, Dourou, Gbaya, Tikar ont subi la domination des Peuls<br />
musulmans qui exercent une suprématie sur les plans religieux, économique, politique et<br />
culturel dans toute la province. Le Foufouldé, qui est langue peul, est le plus répandu et<br />
reste la principale langue de communication.<br />
L'une des principales causes de la pauvreté dans cette région reste le chômage et le<br />
sous-emploi. Pourtant, la province est jeune et comporte un potentiel humain prometteur :<br />
presqu'un individu sur deux est en âge de travailler (45,42%): ce qui représente selon les<br />
estimations 335.000 habitants dont 42Yo en milieu urbain et plus de 47%o en zone rurale.<br />
Bien qu'il soit difficile de définir la proportion des populations réellement en activité, on<br />
note une recrudescence du chômage dû à la faillite de nombreuses entreprises publiques,<br />
parapubliques et privées, mais aussi à I'arrêt des recrutements dans le secteur public. Ce<br />
qui s'est traduit par le développement du secteur informel qui mobilise l'immense majorité<br />
des jeunes gens. La précarité des revenus perçus dans le secteur ne leur permet pas de<br />
constituer une épargne nécessaire pour se doter des logements décents. C'est pourquoi,<br />
dans les centres urbains, on note une dégradation de I'habitat et l'émergence des quartiers<br />
spontanés où les maisons sont faites de matériaux provisoires et de fortune.<br />
La précarité des revenus, l'encadrement et l'éloignement limitent les capacités des<br />
populations à accéder aux services sociaux de base. Le taux d'accessibilité aux soins de<br />
santé reste très faible et il se développe une anti-médication et un recours aux <br />
ambulantes dont la qualité des médicaments reste très discutable. L'accessibilité à<br />
I'eau courante du réseau SNEC n'existe que dans les centres urbains, où seulement 37,3oÂ<br />
de la population est desservie. Dans les zones rurales où le réseau SNEC n'est pas encore<br />
installé, le ratio population par point d'eau est de 1.500 habitants environ, au lieu de<br />
l'objectif de 300 à 500 tel que défini par I'Etat. Les taux d'accessibilité aux réseaux<br />
électriques et aux réseaux téléphoniques sont encore plus insignifiants.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98/005/01/99 Février 2000
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES REGIONATES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
Par ailleurs, compte tenu de ses difficultés budgétaires, on note la démission de I'Etat<br />
face à ses obligations sociales. La province compte 72 formations sanitaires dont 56 publiques.<br />
Ce qui correspond à I formation sanitaire pour 18.790 habitants. Parmi les 7l aires<br />
de santé, beaucoup ne sont pas intégrées. De surcroît, les formations sanitaires sont souséquipées<br />
en matériel technique et d'exploitation. Les hôpitaux privés, par contre, disposent<br />
de meilleurs blocs opératoires, d'appareils de radiologie et de laboratoires. Il est à noter<br />
enfin qu'à la vétusté et au mauvais état des infrastructures sanitaires s'ajoutent l'insuÊ<br />
fisance de matériel et le manque de maintenance très accentué de celui qui existe, la carence<br />
de médicaments et de points de distribution, la presque absence totale de spécialistes<br />
et le nombre trop faible des généralistes pour répondre aux besoins... Enfin, compte tenu de<br />
la situation, les protections matemelles et infantiles sont très délaissées, la mentalité et le<br />
manque d' information aggravant les répercussions.<br />
Sur le plan éducatif, la province compte 330 établissements scolaires d'enseignement de<br />
base dont 24 écoles maternelles et 306 écoles primaires. L'insuffisance des salles de classe<br />
dans certains départements et notamment le manque de compétence des enseignants, laisse<br />
sans cornmentaire quant au niveau de la faible proportion d'enfants fréquentant le milieu<br />
scolaire. Mais I'autre problème majeur de l'éducation reste la sous-scolarisation des enfants<br />
qui relève du manque d'engouement pour certains parents d'envoyer les enfants à<br />
l'école et de I'incapacité des autres à supporter les charges scolaires de leurs progénitures.<br />
Dans les autres domaines comme le sport, I'animation des jeunes et des affaires sociales,<br />
on relève une insuffisance générale, si ce n'est absence des infrastructures et une<br />
dégradation continue de celles qui existent par manque d'entretien, la carence de personnel<br />
et de compétence et des dotations trop faibles pour agir.<br />
B. PROBTEMES INSTITUTIONNETS D'ENCADREMENT DU DEVETOPPEMENT<br />
Les collectivités territoriales décentralisées se heurtent à de nombreuses difficultés liées<br />
principalement à I'insuffisance des ressources financières. Les taux de réalisation des<br />
recettes budgétaires sont très faibles. Il a été de 75,2yo pour la commune urbaine de<br />
Ngaoundéré au cours de l'exercice 1995/1996. Dans les communes rurales, il est parfois en<br />
deçà de 50%o. Ce qui constitue un handicap sérieux pour la satisfaction des besoins de<br />
fonds de fonctionnement et d'investissement. C'est pourquoi le personnel de certaines<br />
communes accuse des arriérés de salaires. La réalisation de certains investissements d'intérêt<br />
public (pont, salles de classe, borne-fontaine) est reportée pendant plusieurs exercices<br />
budgétaires. Tout cela contribue davantage à la dégradation des conditions de vie des<br />
populations. On note également la mauvaise gestion liée à un personnel peu compétent et<br />
ne possédant pas I'instruction nécessaire aux responsabilités et aux décisions qui s'imposent.<br />
Cela se justifie par des prévisions budgétaires inéalistes sur la base desquelles sont<br />
construits de nombreux projets d'équipements dont la réalisation demeure incertaine, alors<br />
que les priorités sont délaissées.<br />
Pour ce qui est des projets de développement communautaire, ils sont coordonnés par le<br />
Service Provincial du Développement Communautaire et du Génie Rural qui relève du<br />
Ministère de l'Agriculture. Ce service dispose d'antennes dans les chefs-lieux des départements<br />
des arrondissements. Il se charge :<br />
- de la sensibilisation des populations des vertus de I'approche participative et de la<br />
réalisation des proj ets d' intérêt communautaire<br />
- du suivi des activités dans les groupes organisés<br />
- de la recherche des financements après des O.N.G. et des bailleurs de fonds pour le<br />
compte des projets d'intérêt communautaire<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98/005/01 /99 Février 2000
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
Par ailleurs, compte tenu de ses dimcultés budgétaires, on note la démission de I'Etat<br />
face à _ses<br />
obligations sociales. La province compte 72 formations sanitaires dont 56 publiques.<br />
Ce qui conrespond à I formation sanitaire pour 18.790 habitants. Parmi les 7l aires<br />
de santé, beaucoup ne sont pas intégrées. De surcroît, les formations sanitaires sont sousequipées<br />
en matériel technique et d'exploitation. Les hôpitaux privés, par contre, disposent<br />
de meilleurs blocs opératoires, d'appareils de radiologie et de laboratoires. Il est à noter<br />
enfin qu'à la vétusté et au mauvais état des infrastructures sanitaires s'ajoutent l'insuÊ<br />
fisance de matériel et le manque de maintenance très accentué de celui qui existg la e,arence<br />
de médicaments et de points de distribution, la presque absence totale de spécialistes<br />
et le nombre trop faible des généralistes pour répondre aux besoins... Enfirq compte tenu de<br />
la situation, les protections maternelles et infantiles sont très délaissées, la mentalité et le<br />
manque d'information aggravant les répercussions.<br />
Sur le plan éducatit la province compte 330 établissements scolaires d'enseignement de<br />
base dont 24 écoles maternelles et 306 écoles primaires. L'insuffisance des salles de classe<br />
dans certains départements et notamment le manque de compétence des enseignants, laisse<br />
sans commentaire quant au niveau de la faible proportion d'enfants fréquentant le milieu<br />
scolaire. Mais I'autre problème majeur de l'éducation reste la sous-scolarisation des enfants<br />
qui relève du manque d'engouement pour certains parents d'envoyer les enfants à<br />
l'école et de I'incapacité des autres à supporter les charges scolaires de leurs progénitures.<br />
Dans les autres domaines comme le sport, l'animation des jeunes et des affaires sociales,<br />
on relève une insuffisance générale, si ce n'est absence des infrastructures et une<br />
dégradation continue de celles qui existent par manque d'entretieq la carence de personnel<br />
et de compétence et des dotations trop faibles pour agir.<br />
B. PROEI.EMES INSTITUIION N EI.S D' ENCADREMENT DU DEVETOPPEMENT<br />
Les collectivités territoriales décentralisées se heurtent à de nombreuses difficultés liées<br />
principalement à I'insuffisance des ressources financières. Les taux de réalisation des<br />
recettes budgétaires sont très faibles. Il a été de 75,2Yo pour la commune urbaine de<br />
Ngaoundéré au cours de I'exercice 1995/1996. Dans les communes rurales, il est parfois en<br />
deçà de 50Yo. Ce qui constitue un handicap sérieux pour la satisfaction des besoins de<br />
fonds de fonctionnement et d'investissement. C'est pourquoi le personnel de certaines<br />
communes accuse des aniérés de salaires. La réalisation de certains investissements d'intérêt<br />
public (pont, salles de classe, borne-fontaine) est reportée pendant plusieurs exercices<br />
budgétaires. Tout cela contribue davantage à la dégradation des conditions de vie des<br />
populations. On note également la mauvaise gestion liée à un personnel peu compétent et<br />
ne possédant pas I'instruction nécessaire aux responsabilités et aux décisions qui s'imposent.<br />
Cela se justifie par des prévisions budgétaires irréalistes sur la base desquelles sont<br />
construits de nombreux projets d'équipements dont la réalisation demeure incertaine, alors<br />
que les priorités sont délaissées.<br />
Pour ce qui est des projets de développement communautaire, ils sont coordonnés par le<br />
Service Provincial du Développement Communautaire et du Génie Rural qui relève du<br />
Ministère de I'Agriculture. Ce service dispose d'antennes dans les chefs-lieux des départements<br />
des arrondissements. Il se charge :<br />
- de la sensibilisation des populations des vertus de I'approche participative et de la<br />
réalisation des proj ets d' intérêt communautaire<br />
- du suivi des activités dans les groupes organisés<br />
- de la recherche des financements après des O.N.G. et des bailleurs de fonds pour le<br />
compte des projets d'intérêt communautaire<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SrO6rO'il99<br />
Féwierffi
ETUDES SOCIo,ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
- de la réalisation d'infrastructures rurales (puits d'eau, ponts sur les rivières, etc.).<br />
Les responsables de ce service se heurtent à un certain nombre de contraintes qui sont :<br />
- l'insuffisance des moyens de transport<br />
- les difficultés de trésorerie pour le fonctionnement des services<br />
- I'insuffisance du personnel.<br />
Si l'on rajoute le manque de savoir-faire pour motiver les populations, la carence de<br />
personnel et la mauvaise gestion, l'impact de ce service est d'une importance capitale.<br />
2. TNFRASTRUCTURES, MARCHES, FIUX ET SYSTEMES D'ECHANGES<br />
L'Adamaoua, est la province la plus vaste du pays est aussi la plus enclavée, après celle<br />
de I'Est. Elle dispose, en effet, d'un long réseau de 700 km de pistes et servitudes rurales,<br />
mais fortement dégradées et discontinues par endroits, faute d'ouwages de franchissement<br />
emportés par des crues et des ravinements. Ainsi les 3/4 de cet important réseau routier<br />
restent hors d'usage pendant toute la saison des pluies et isolent, par conséquent, quelques<br />
3/5 des habitants de la region qui perdent entre 50 et 60 7o de leurs productions (agricoles,<br />
élevage, pêche ...) et ne peuvent ni accéder aux centres de soins de santé, ni envoyer leurs<br />
enfants à l'école. Cette province connaît des zones où la population vit en autarcie, enclos<br />
permanent de misère et de pauvreté.<br />
Pour sortir la région de ce carcan, il faudrait rendre prioritaires la réhabilitation et<br />
l'ouverture des pistes rurales et servitudes de collecte, telle que recommandé par la<br />
mission d'enquête.<br />
Il faudrait aussi renforcer et étendre le réseau d'eau potable dans cette province<br />
considérée à juste titre comme le "château d'eau du Cameroun" et où paradoxalement le<br />
problème d'eau se pose avec acuité. Il faudrait appuyer par conséquent les actions menées,<br />
dans le cadre de l'hydraulique rurale par le gouvernement et certains bailleurs de fonds,<br />
qui consistent à multiplier les puits d'eau et forages. La faible couverture en eau de cette<br />
region est affirmée largement, en effet, par un volume de moins de20Vilhbt, bien en deçà<br />
du niveau national estimé à 40Vjlhbt, lorsque les normes de I'OMS se situent entre 80 à<br />
l2Ùlûlhbt dans les pays développés. Une extension du réseau uôain vers les quartiers<br />
périphériques naissants et surtout ceux autour de I'Université est impérieuse.<br />
Il est également urgent de renforcer la couverture en énergie électrique de la province.<br />
En effet, seulement lo de la population utilise l'électricité, alors que près de 97Yo ont<br />
pour source d'énergie le bois, décimant ainsi le potentiel forestier.<br />
En ce qui conceme le réseau des télécommunications de l'Adamaoua, il est devenu très<br />
précaire du fait de sa vétusté et d'un matériel obsolete à mettre au rébus. En efiFet, le taux<br />
de saturation téléphonique est de 94Yo pour la province et 100 o/o pour Ngaoundéré. Les<br />
coupures et pannes sont fréquentes sur les 7 relais,2 centraux téléphoniques et 3 concentrateurs,<br />
que compte la province, et menacent d'isoler la région du réseau national. Il y a<br />
lieu de rénover et de renforcer ce réseau avant que la région, déjà à l'écart, soit complètement<br />
coupée du pays.<br />
Il faudrait assainir tout le réseau urbain de Ngaoundéré, afin qu'elle redevienne une<br />
vraie capitale provinciale.<br />
Afin de développer le rayonnement de marchés et de les rendre plus fonctionnels, plus<br />
viables et plus performants et de débrider la polarisation trop concentrique de la capitale<br />
régionale, il y a lieu de :<br />
MINPAT / Proiet PNUD-oPS CMR/SloGllOlr99<br />
Février2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Prodnce de I'ADAMAOUA<br />
- Réhabiliter, construire et équiper les marchés stables, périodiques et spéciaux de la<br />
province.<br />
- Inciter les structures financières à s'implanter sur l'ensemble des marchés et encourager<br />
les diftrents investissements.<br />
- Appuyer tous les marchés par les services de santé, de sécurité et matériels de conservation<br />
appropriés.<br />
- Renforcer les services administratifs de sécurité afin qu'ils jouent au mieux leur rôle<br />
de contrôle au niveau des frontières, de régulateur dans toutes les transactions et<br />
qu'ils enrayent le phénomène préoccupant des "coupeurs de route" très répandu dans<br />
la province.<br />
- Désenclaver toutes les zones de collecte de produits afin d'intensifier leurs difiFerents<br />
flux d'échanges et de permettre l'épanouissement des zones productrices.<br />
' Renforcer l'approvisionnement en produits manufacturés divers par la multiplication<br />
des circuits de distribution.<br />
3. SECTEURS PRODUCTITS<br />
A. CONIEXIE REGIONAI: environnemenl économique régionol<br />
La province de I'Adamaoua se situe entre le 6è et le 8è degré de latitude Nord et entre<br />
le llè et le 15è degré de longitude est. Elle s'étend sur 62.000 km et compte environ<br />
799.000 habitants.<br />
Les cinq départements qui constituent cette province sont les départements de la Vina,<br />
du Mbérg du Djerem, du Mayo-Banyo et du Faro et Déo.<br />
Le climat de la province est de type tropical à deux saisons par an : une saison de pluies<br />
et une saison sèche. Les températures sont plus basses dans la ville de Ngaoundéré. La<br />
spécificité du relief du plateau de I'Adamaoua crée un type de climat donné caractérisé par<br />
des précipitations annuelles comprises entre 1.200 et 2.000 mm, un allongement de la<br />
saison des pluies, et une élévation de I'humidité relative, etc. La pluviométrie moyenne est<br />
de l'ordre de 1500 mm. Le nombre de jours de pluies est de 150. Les mois de juillet et<br />
août sont ceux au cours desquels tombent beaucoup de pluies. Quant aux températures,<br />
celles de la région varient entre 24" C et 32" C, avec une moyenne de 29"C. Les mois les<br />
plus chauds sont ceux d'avril et mai et les plus froids sont situés entre juin et septembre.<br />
Les roches qui constituent l'ensemble de la région sont variées bien que ne donnant pas<br />
toujours des sols diftrents. Les grands types de sols qu'on y rencontre sont les suivants :<br />
sols ferralitiques (à l'ouest de la province), sols minéraux bruts (vers les localités de<br />
Ngaoundéré et Tibati) et sols hydromorphes (dans les bas-fonds de la région).<br />
Le réseau hydrographique de I'Adamaoua est relativement important en raison de la<br />
position centrale du plateau. Les principaux cours d'eau sont la Vina, le Djrrem, le Lom<br />
supérieur, le Meng, le Mbéré, le Haut-Faro.<br />
En ce qui concerne la végétation, la province de I'Adamaoua comprend deux coupures<br />
phytogéographiques . la falaise septentrionale qui marque au nord la limite de I'aire<br />
d'extension des savanes soudaniennes et la côte de 800 m au sud qui correspond à l'apparition<br />
des formations forestières semi-décidues de type guinéen ou congo-guinéen.<br />
En matière agricole, la province de l'Adamaoua se présente corlme une région stratégique<br />
non seulement pour la partie septentrionale, mais aussi pour I'ensemble du pays. En<br />
effet, ses conditions agro-climatiques lui permettent de supporter la plupart des cultures<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrSrO6,l01I99<br />
Février 2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAiIAOUA<br />
qui se pratiquent dans le pays. Il faut relever que les cultures dominantes dans la région<br />
sont les cultures vivrières , les cultures de rente, ici le coton et le cafe, ne se pratiquent que<br />
de façon marginale dans certaines localités qui sont les départements de la Vina pour le<br />
coton et celui du Mayo-Banyo pour le cafe. Il est à noter, toutefois, que la production du<br />
cafe marque actuellement une très nette évolution qu'il y a lieu de soutenir. Par contre, la<br />
gamme des cultures vivrières est variée : mais, manioc, igname, patate, arachidg banane/<br />
plantaiq macabo/taro, etc. II existe des zones de production qui sont propices à certaines<br />
cultures. Ainsi, le Faro et Déo est une grande zone productrice de miUsorgho alors que le<br />
mais est davantage produit dans les départements de.la Vina et du Mayo Banyo. Le<br />
manioc se cultive plus dans le département du Mbéré...<br />
La production agricole de la province de I'Adamaoua est en progression. Cet essor de<br />
I'agriculture dans la region résulte de I'action de certains facteurs dont le plus déterminant<br />
est sans doute le PNVA qui a contribué à la transformation du paysage agricole. De même,<br />
le FIMAC, par l'action des micro-crédits aux exploitants agricoles, a joué un rôle de catalyseur<br />
de l'activité agricole.<br />
L'action de ces deux principaux facteurs ont permis dans certains cas un doublement de<br />
la production de certaines cultures en cinq ans. Ainsi, la production d'ignames est passée<br />
de 13.427 tonnes en 1993194 à plus de 34.115 tonnes en 1997/98; on peut également<br />
mentionner l'exemple du cafe robusta dont la production est passée de 850 tonnes à2.327<br />
tonnes pendant la même période. En dehors de la production de bananes/plantains qui a<br />
diminué de près de 6.000 tonnes au cours de cette période, l'ensemble des cultures enregistrent<br />
une hausse de leur production respective.<br />
Sur le plan du financement de I'agriculture, au 3l octobre 1998,243 groupes cornmunautaires<br />
avaient bénéficié d'un crédit pour une enveloppe globale évaluée à plus de 368<br />
millions FCFA. Les fonds ainsi octroyés ont servi au financement de l'activité agricole<br />
proprement dite, mais aussi à l'élevage.<br />
En effet, la province de l'Adamaoua a une vocation pastorale : elle possède 28 Yo du<br />
cheptel national des bovins, 5Yo du cheptel ovins et 2,3Yo du cheptel caprins alors qu'elle<br />
ne représente pas 4 %o dela population nationale. Elle contribue à concurence de 24Yo àla<br />
production nationale de viande de bæuf On estime à 20% de la population rurale le nombre<br />
d'éleveurs purs ou qui exercent aussi l'agriculture comme activité secondaire.<br />
Les diftrents types d'élevage dans la région sont constitués d'agro-pastoralistes, de<br />
pastoralistes, de propriétaires de bétail avec d'autres activités non agricoles et de<br />
propriétaires de ranchs.<br />
Le cheptel animal de la province de I'Adamaoua étut de 1.000.000 bovins, 1.501.000<br />
caprins, 200.000 ovins, 250 équins, 150 asins, moins de 1.000 porcins et 400.000 volailles.<br />
Il faut mentionner que cette production est en baisse continue depuis quelques années.<br />
Les marchés à bétail les plus importants dans la région sont ceux de Ngaoui, Meiganga, de<br />
Dir (Département du Mbéré), de Tongo, de Ngaoundal, de Ngat, de Tibati (Département<br />
du Djérem), de Banyo, Kouata (Département du Mayo-Banyo), de Galim et de Doualayel<br />
(Département du Faro et Déo), de Dibi, de Ngaoundéré, de Dang (département de la<br />
Vina).<br />
En ce qui concerne les activités piscicoles, la province de l'Adamaoua possède un potentiel<br />
halieutique important du fait de l'existence de nombreux cours d'eau. Toutefois, la<br />
pratique de la pêche demeure encore relativement faible, alors que la présence de certaines<br />
infrastructures et structures (stations aquacoles à Ngaoundéré, centre de l'alevinage, centre<br />
MTNPAT / Proiet PNUO-OPS CMR,S,G,O1 /99<br />
Féwier2ffi
EruDqS SOCTO-ECONOMTQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de fADAMAOUA<br />
de pêche, postes de contrôle de pêche) auraient pu jouer le rôle de catalyseur de l'activité<br />
de pêche.<br />
La pêche continentale est pratiquée uniquement dans le département du Djérem où il<br />
existe une retenue d'eau du barrage de Mbakao, et dans le département du Mayo-Banyo à<br />
la faveur du barrage de la Mapé. On évalue à 1.470 kg, la production piscicole de 1990.<br />
Dans le secteur forêt/environnement, la province de I'Adamaoua possède des aires<br />
protégées tels que les parcs nationaux avec réserves de faune, les zones d'intérêt cynégétique<br />
appartenant à I'Etat. La première réserve forestière de la région est celle de<br />
Ngaoundéré qui existe depuis 1947. L'exploitation du bois y est embryonnaire et anarchique<br />
en dépit de la cession par l'Etat des assiettes de coupe. C'est l'exploitation du bois<br />
aux fins de chauffage qui est la plus importante, c'est pourquoi les déboiiements sont plus<br />
perceptibles autour des grandes agglomérations urbaines.<br />
Sur Ie plan du commerce> il a été recensé en 1998, 70 unités économiques dans la<br />
région, avec une forte concentration dans la vilte de Ngaoundéré. Les secteurs les plus<br />
représentés sont ceux du transport des marchandises, du commerce général et de I'alimentation<br />
(respectivement l4Yo et l3Yo). Les Etrangers, et en particulier les Libanais sont<br />
dominants dans les branches de la boulangerie et de prestations de services.<br />
Le secteur industriel demeure embryonnaire et représenté essentiellement par la<br />
MAÏSCAIvI, la SOGELAIT, les boulangeries-patisseries.<br />
Quelques agences de voyages et de tourisme et quelques structures hôtelières dominent<br />
le secteur du tourisme et de I'hôtellerie. Transcam Hôtel, Hôtel du Rail, Hôtel Relais<br />
situés tous à Ngaoundéré sont les plus importants et ont une capacité totale de 120 chambres<br />
pour l50lits.<br />
Le secteur minier est faiblement représenté dans la région . I'or est exploité artisanalement<br />
et de manière clandestine, le gisement de bauxite de Mnim-Martap demeure encore<br />
inexploité; par contre, I'exploitation du gisement de cassiterite à Mayo-darlé est<br />
arrêtée depuis 1990. En ce qui concerne le gisement de Mnim-Martap, il est considéré<br />
conrme étant d'importance mondiale, mais reste inexploité. Il changerait pourtant la vie de<br />
la région et du pays.<br />
Le réseau bancaire de la province de l'Adamaoua est polarisé par la seule ville de<br />
Ngaoundéré. Cette centralisation asphyxie les autres villes de la province. Les institutions<br />
bancaires concernées sont la société commerciale de Banque-Crédit Lyonnais et la<br />
BICEC.<br />
B. PROBTEMATIQUE DE DEVETOPPEMENI SOCIO.ECONOMIQUE<br />
La question du développement économique en général et de I'essor des secteurs secondaire<br />
et tertiaire est indubitablement liée aux performances de son secteur rural, eu égard à<br />
son important potentiel dans l'économie régionale. Cependant, celui-ci présente des faiblesses<br />
qui peuvent à terme hypothéquer ce développement. Ces contraintes sont à la fois<br />
techniques, financières et d'ordre général.<br />
o. Confr
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
grandes plantations et limitée à quelques localités de la région (département de la Vina et<br />
du Djérem). Au niveau de l'élevage, on note une absence de pratique des cultures fourragères,<br />
ce qui contribue à hypothéquer la rentabilité de cette activité puisque I'on estime à I<br />
milliard de FCFd les dépenses faites chaque année, pour l'approvisionnement en aliments<br />
de bétail, dans la province du Nord voisine. L'activité halieutique possède des potentialités<br />
intéressantes grâce au barrage de Mbako dont on estime à 6000 tonnes de poissons la<br />
capacité et les 208 étangs poissonneux. Par ailleurs, la station aquacole de Ngaoundéré<br />
possède des structures de développement de la pisciculture dont l0 bassins actifs. Mais<br />
certaines contraintes freinent le développement de cette activité porteuse. le nombre<br />
limité de personnel, notamment d'encadrement, I'insuffisance d'équipements des pêcheurs<br />
nationaux et de moyens matériels pour assurer la production et le manque d'intérêt de la<br />
population locale pour cette activité exploitée à80yo par des étrangers.<br />
b. Conlroinles finqncières :<br />
Tout d'abord, le prix des intrants agricoles est jugé quasiment inaccessible par la majorité<br />
de la population agricole. Depuis la libéralisation de la commercialisation des intrants<br />
agricoles et l'arrêt des subventions à ce sous-secteur, la quantité des intrants utilisés par<br />
exploitant agricole baisse d'année en année. En outre, ceux des exploitants qui sont dans<br />
les localités autres que Ngaoundéré, paient relativement plus chers leurs intrants agricoles<br />
du fait, du fait notamment, des difiicultés liées à l'acheminement de ces produits dans ces<br />
localités.<br />
S'4gissant du financement agricole, bien que le montant global de crédit octroyé soit<br />
jugé relativement satisfaisant (368 Millions FCFA), une grande partie des fonds FIMAC a<br />
été octroyée au département de la Vina qui, à lui seul, a absorbé 64 % des crédits distribués<br />
alors que les départements du Mayo-Banyo, du Faro et Déo et du Djérem totalisent, à<br />
eux trois, seulement 17Yo des fonds FIMAC. Cette concentration a donné un élan particulier<br />
à ce département de la capitale qui concentre un maximum d'atouts capables de<br />
donner de l'élan à l'activité et au développement économique et financier de la région : il<br />
y a lieu maintenant d'aider à élever le niveau financier du reste de la province, afin de<br />
suiwe ce démarrage. Il s'agira d'abord de faire appel aux fonds FIMAC pour redistribuer<br />
géographiquement les fonds agricoles.<br />
Cependant, le financement de l'activité économique de la région souffre de l'insuÊ<br />
fisance des relais indispensables à cette fin. Les institutions bancaires classiques sont<br />
faiblement représentées. Bien plus, celles qui existent dans la ville de Ngaoundéré ne<br />
stimulent pas le développement des activités commerciales et industrielles. Aussi, c'est<br />
pourquoi ces secteurs sont timidement représentés dans la province. Comme dans les<br />
autres régions du pays, les banques refusent de prendre les risques nécessaires pour impulser<br />
et entretenir le processus de développement : l'attrait et la sécurité doivent venir des<br />
villes où I'on veut impliquer ces institutions, de leur développement économique et structurel<br />
progressif. Il faut intéresser les institutions bancaires.<br />
c. Controinies d'ordre générol:<br />
Elles sont nombreuses et concernent :<br />
- L'inaccessibilité d'une grande partie de la province due à I'enclavement et à l'éloignement.<br />
Les échanges économiques entre localités s'en trouvent ainsi handicapés, si<br />
ce n'est étouffés, surtout en saison de pluies ;<br />
- La présence de nombreux insectes granivores dévastateurs qui causent des dégâts<br />
importants au niveau de l'activité agricole et pastorale. La mouche tsé-tsé, en particulier,<br />
constitue un obstacle important au développement de l'élevage.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SIO6,O1l99 l0 Février2ffi
ETUDES SOCIO,ECONOMTOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IAOAMAOUA<br />
- Les conflits agro-pastoraux qui sont de plus en plus fréquents du fait d'une absence de<br />
délimitation entre les zones de pâturage et les zones de culture ;<br />
- L'inorganisation des éleveurs ;<br />
- La présence dans de nombreuses localités, des coupeurs de route (consécutifs à l'absence<br />
de banques) ;<br />
- Le non-respect de la réglementation par les pêcheurs ;<br />
- Le faible engouement manifesté par les populations à l'endroit des activités halieutiques,<br />
industrielles et touristiques. Aussi, ces secteurs sont-ils aux mains des acteurs<br />
économiques pour la plupart non nationaux.<br />
- La faiblesse du réseau de communication existant et la fréquence des pannes régulières<br />
qui ne peuvent pas permettre un développement harmonieux des échanges<br />
économiques entre la région et I'extérieur.<br />
- La vétusté du réseau ferré, poumon de la régiorç arrive à limiter davantage I'attrait du<br />
réseau routier déjà très faible, puisque les réserves des carburants n'arrivent pas pour<br />
permettre aux voitures et mobylettes de circuler. Les autres effets, bien plus importants,<br />
de surcharge, d'insécurité et déraillements constants ont été détaillés.<br />
Nonobstant les contraintes sus énumérées, la province de l'Adamaoua possède des<br />
atouts sur lesquels peuvent êtres bâtis des politiques de développement futurs.<br />
Optimiser le capital régional, c'est bien sûr développer les ressources de fonds existantes<br />
: les cultures, l'élevage, la pisciculture, exploiter les ressources minières... puis les<br />
ressources structurelles de toutes sortes : institutions, hôpitau:i; écoles, banques, marchés,<br />
transports, routes et les ressources induites : créer une entreprise de jus de fruits dans une<br />
zone productrice favorable (agrumes, eau... )...<br />
Mais le tout fonctionne avec l'homme . optimiser le capital régional, c'est d'abord optimiser<br />
les ressources humaines : la motivation, la volonté des hommes à atteindre un objectif<br />
: celui de leur intégration sociale et de leur qualité de vie, Ies amène à déployer par leur<br />
pouvoir d'adaptation et de transformation - avant tout les capitaux financiers : la survie<br />
dans l'autarcie est une preuve d'adaptation positive. Mais les résultats des incompétences<br />
dans la gestion financière et communale est un autre exemple, mais négatif).<br />
Optimiser les ressources humaines, c'est aussi amener systématiquement les hommes à<br />
s'investir et placer chaque compétence là où il le faut et développer la cohésion. La population<br />
de la province a fait preuve de ses aptitudes à la vie participative et à la solidarité<br />
(amélioration des conditions scolaires et de santé, adhésion aux activités des coopératives<br />
agricoles).<br />
On a ici une idée de l'importance de I'enjeu d'un développement de structures d'encadrement<br />
du monde rural par des moyens adéquats de fonctionnement et d'investissement.<br />
Renforcer les PNVA et les étendre, c'est renforcer la production agricole et la développer.<br />
Former, c'est créer des compétences et c'est aussi développer. Encourager les petites<br />
entreprises, c'est aider matériellement les investissements personnels et financiers...<br />
Ml NPAT / Projet PN UD-OPS CMRTS,!C6/u1 r99 ll Féwier ffi
DECOU PAGE ADMINISTRATIF<br />
(1ee8-1eee)<br />
I. )-_-<br />
t --<br />
t<br />
I<br />
Mbo<br />
I<br />
Frontr re<br />
Limite de R gion ................ ,.. .<br />
Lim[e de d partement ... . .......<br />
Limite d'arrondissemenl . .........<br />
Chef-Lieux de R gon flNe"ound ,<br />
Chel-Lieux de d partement o rb.!<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
Chef-Lieux d'anondlssement ... o Mb<br />
Distrlct......... . Noroul<br />
fu/Gf H/A<br />
Malo-Bal o<br />
o<br />
Faro-Et-Déo<br />
o<br />
Tlgn re<br />
NGAOUNDTRT<br />
n<br />
I<br />
.,<br />
t<br />
,-1<br />
Mayo-<br />
I Galim'<br />
, ilon re<br />
\<br />
;---'r<br />
\.<br />
)<br />
Vina<br />
/-'r i / L---1\<br />
\\l<br />
\ \-----<br />
-l<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
t<br />
t<br />
t-<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
IIIt-----<br />
Mayo-Darl<br />
Bankim<br />
o<br />
-.---,<br />
@<br />
Banyo<br />
Banyo<br />
.^/<br />
' ,|<br />
'"--f \<br />
(<br />
)<br />
Djerem<br />
o<br />
Tlbatl<br />
---'t<br />
I<br />
I<br />
I<br />
\_1-\<br />
t \<br />
Dir<br />
Mbéré<br />
O<br />
f----<br />
+<br />
N<br />
2OKm
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Prounce de I'ADAMAOUA<br />
4. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS<br />
Tab nol : Orientations uflentauons de dével developpement rêgional de la provance cle I'Adal naoua<br />
Facteurs de blocaqe Facteurs de oroorès Obiectifs et actions Projets à promouvoir<br />
- lnsuffisance des pistes de collecte et état<br />
de délabrement très avancé des routes<br />
rurales existantes,<br />
- Enclavement des zones productrices des<br />
denrées alimentaires.<br />
- Difficile maîtrise de I'eau faute d'un<br />
véritable réseau de distribution et politique<br />
de I'hydraulique villaoeoise mal menée.<br />
- Diminution des capacités de réception et<br />
d'émission des informations.<br />
- Transfert des capitaux et sortie des<br />
devises au profit des pays voisins<br />
limitrophes de I'Adamaoua.<br />
- Alimentation insuffisante en énergie<br />
- ll existe un long réseau de routes rurales<br />
très dégradé dans la province.<br />
- Existence du projet PUER/IDA en cours<br />
de réalisation.<br />
- Taux de couverture en eau encore très<br />
faible.<br />
'Province très vaste<br />
- tmportante zone de transit et de<br />
transactions commerciales.<br />
- Quelques banques existent et il y a<br />
possibilité d'investir.<br />
- Existence d'un réseau électrique<br />
électrioue.<br />
primaire moins dense.<br />
- lnsuffisance des moyens de transports. - Présence de nombreux collecteurs<br />
nationaux et internationaux, réseau routier<br />
dense mais dégradé,, population assez<br />
mobile et travailleuse<br />
- Faible niveau d'aménagement et<br />
d'équipement des marchés.<br />
- Existence des marchés embryonnaires<br />
non organisés.<br />
- Désenclaver des zones de production et<br />
rendre plus facile la circulation des flux de<br />
produits, de personnes et des véhicules.<br />
- Augmenter les flux des échanges locaux<br />
et intensifier la consommation.<br />
- Extension du réseau SNEC dans les<br />
zones accessibles et creuser des ouits et<br />
des foraqes en zones rurales.<br />
- Améliorer l'appui de I'administration aux<br />
d ifférents secteurs d'activité.<br />
- lnciter et intensifier les investissements<br />
dans les différentes zones de production<br />
de la orovince.<br />
- Amélioration du niveau de vie des<br />
oooulations.<br />
- Intensifier les flux intra-régionaux et<br />
extra-régionaux<br />
- Développer les marchés de<br />
consommation en priorité et construire<br />
tous les marchés saisonniers et de<br />
collecte.<br />
- Ouverture des nouvelles pistes rurales<br />
- Réhabilitation des pistes dégradées et<br />
reconstruction des ouvrages emportés par<br />
les crues et ceux défectueux.<br />
- Appuyer l'extension du réseau routier de<br />
la province et surtout les pistes de<br />
collecte.<br />
- Multiplication des points d'eau dans la<br />
provrnce.<br />
- Créer les postes de police, de<br />
gendarmerie surtout et de douane à<br />
différents niveaux sensibles.<br />
- Appuyer les divers services de<br />
I'administration pour encourager les<br />
immigrants à investir sur place.<br />
- Extension de l'électrification rurale.<br />
- Acquisition des véhicules pour relayer le<br />
train dans les transports publics divers.<br />
- Favoriser la production<br />
- Acquisition de matériel de conservation<br />
des denrées diverses<br />
- Limitation des pertes diverses de<br />
marchandises.<br />
MINPAT / Projet PNU D-OPS CMR/S,O6,!O1 r99 t2 Février2G)
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
ab n"1 (suite 1): orientations de développement régional de la provin ce de I'Adamaoua<br />
Facteurs de blocaqe Facteurs de oroqrès Objectifs et actions Proiets à promouvoir<br />
Santé<br />
- Province enclavée, vaste et populations<br />
dispersées<br />
- Vétusté eUou mauvais état des infrastructures<br />
- Absence des structures sanitaires dans<br />
certaines aires de santé<br />
- Mauvais état ou absence des moyens de<br />
communication et transport<br />
- Insuffisance du personnel en zones<br />
rurales<br />
- lnsuffisance des moyens financiers et<br />
logistiques<br />
- lnsuffisance d'équipements et manque<br />
d'entretien du minimum existrant.<br />
Enseionement<br />
- Sous-scolarisation<br />
- Insuffisance des enseignants qualifiés<br />
- Précarités des revenus des parents<br />
- Manque d'engouement de certains<br />
parents pour l'éducation des enfants<br />
- Taux de déperdition élevé en zones<br />
rurales<br />
Atlaires Sociales. Jeunesse et Sport<br />
- Insuffisance des dotiations budgétaires<br />
- Insuffisance des moyens de transport<br />
- Absence d'équipements et des établissEments<br />
de fonction et d'animation<br />
des jeunes<br />
- Personnel pas suffisamment compétent<br />
par manque des séminaires ou des stages<br />
de recvclaoe<br />
nol<br />
de<br />
- Personnel qualifié et compétent<br />
- Intervention des O.N.G. et des bailleurs<br />
de fonds en faveur de la santé.<br />
- Volonté accrue de l'administration en<br />
faveur de l'éducation des enfants<br />
- Sensibilisation permanente des parents<br />
pour la scolarisation des enfants.<br />
- Volonté des pouvoirs publics à la<br />
promotion de la femme, à I'encadrement<br />
des jeunes et à I'assistance aux indigents.<br />
- Couverture de toutes les aires de santé<br />
des centres de santé<br />
- Réhabiliter les équipements<br />
endommagés<br />
- Doter certaines zones rurales des salles<br />
de classe.<br />
- Améliorer la qualité des services<br />
d'encadrement des jeunes et de<br />
promotion de la femme.<br />
- Construction des centres de santé<br />
- Création d'un atelier oour maintenance<br />
en équipements sanitaires<br />
- Equipements des formations sanitaires<br />
des lits.<br />
- Construction des salles de classe dans<br />
certaines zones rurales<br />
- Réhabilitation des salles de classe<br />
construites par les A.P.E. dans certaines<br />
localités.<br />
- Création des centres de jeunesse et de<br />
l'animation, des centres de formation de la<br />
femme dans les chefs-lieux des<br />
départements<br />
- Créer un orphelinat à Ngaoundéré<br />
- créer des aires de jeu dans les grands<br />
centres urbains.<br />
de la de I'Adamaoua<br />
Facteurs de blocaqe Facteurs de proqrès Obiectifs et actions<br />
- Insunrsance des aires de jeu aménagées<br />
pour jeunes<br />
Projets à promouvoir<br />
- Sous-scolarisation comme handicape de<br />
promotion de la femme<br />
- Manque de structures pour<br />
l'encadrement des handicapés et des<br />
personnes de 3è âoe<br />
Secteur institutionnel et participatif - Volonté du personnel de déveloooement - Accroître les ressources communales - Doter les communes de plus de movens<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98/O05,O1/99 l3 Février20@
EfgDES SOCIO-ECONOMTQUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
- Insutfisance Oes moyèÀs tinancieE-<br />
- Mauvaise gestion des ressources<br />
- Personnel peu qualifié<br />
- Absence des moyens de transport<br />
- Esprit participatif limité chez les<br />
populations<br />
Exigulté des espaces cultivables<br />
Rendements agricoles faibles<br />
Techniques agricoles inadapteG etarchaTques<br />
Faible portée de lutte phytoiànitaire<br />
Insuffisance de l'encadrement agricole<br />
Cott élevé de la main -<br />
d'ceuvre agricole<br />
Présence endémique Oé ta rnouctre tsetsé<br />
communautaire à promouvoir les projets<br />
d'intérêt commun.<br />
Adéquation du climat de ta région à ta<br />
pratique d'une variété de cultures<br />
Possibilité d'une culture attelée<br />
Existence de nombreux cours d'eau pour<br />
l'élevage<br />
Climat favorable à la croissance des<br />
graminées<br />
Possibilité d'avoir les pâturages verts<br />
toute l'année<br />
- Accroître le personnel des services du<br />
développement communautaire.<br />
Diversifier les cultures<br />
Intensifier les cultures de contre-saison<br />
Renforcer et étendre les activités de<br />
vulgarisation dans toute la réoion<br />
Renforcer le programme d'éradication de<br />
la mouche Tsé-Tsé<br />
matériels et financiers<br />
- Former et sensrbiliser le oersonnel<br />
Développement de la culture extensive<br />
Acqursition du matériel agricole adaptée<br />
Mettre les intrants agricoles à la portée<br />
des pavsans<br />
Viabilisation des nombreux points d'eau<br />
existants<br />
Appui à un groupement d'éleveurs<br />
(UGICETA)<br />
Construire une barrière (à partir de<br />
I'installation des écrans) autour des zones<br />
assainies<br />
Existence des débouchés pour les<br />
produits d'origine animale<br />
Persistiance des conf I its ag ro-pa-toraux, Disponibilité de I'espace Matérialisation des zones de pâture et des<br />
zones de culture<br />
ab n"l (suite 3): Orientations de développement ré-ûonal de la<br />
Mauvaise distribution du crédit agricole<br />
Insécurité due à la présence des coupeurs<br />
de route<br />
Faible présence des activités<br />
commerciales et industrielles<br />
Inexploitation des potentialités trcuristiques<br />
Facteurs de proqrès Obiectifs et actions Proiets à oromouvoir<br />
Possibilité d'une rentabilité étevée dani Cibler le financement également sur les<br />
l'élevaqe<br />
activités d'élevage<br />
Un potentiel de développement existe Redistribuer géographiquement le crédit<br />
aussi dans les autres localités que le agricole<br />
département de la Vina<br />
Sécuriser les princrpaux axes routiers<br />
pour stimuler les échanges intra et inter<br />
Possibilités de la mise en ceuvre des<br />
activités de transformation des produits<br />
agricoles et de l'élevage<br />
Potentiel de développement des activités<br />
touristiques<br />
re0ronaux<br />
Inciter les nationaux à s'engager dans les<br />
activités industrielles<br />
Orienter les investissements vers<br />
l'industrie de la petite transformation<br />
- Création de petites industries agroalimentaires<br />
- Etudier les possibilités d'exploitation des<br />
mines de bauxite<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/|9B,IC6,O1Æ9 l4 Février 2@
ETUDES SOCIO'ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
La Province de I'Adamaoua, créée par le décret Présidentiel N"83/392 du22 Août 1983<br />
à l'issue de l'éclatement de l'ancienne province du Nord, s'étend sur 67 827 Krrt. Elle se<br />
situe entre le 6ème et le 8ème degré de latitude Est. Elle est limitée au nord par la Bénoué,<br />
à l'Est par la République Centrafricaine, au Sud par les Provinces du Centre et de l'Est, à<br />
I'Ouest par les provinces du Nord-Ouest, de I'Ouest et de la République du Mgeria. Elle<br />
compte 5 départements (Vina, Mbéré, Banyo, Djerem, Faro Et Déo), 13 arrondissements, 3<br />
districts et 16 communes.<br />
1. DYNAMIQUE ET STRUCTURE DEMOGRAPHIQUES<br />
A EVAI.UATION ET REPARTITION SPAIIATE DE I.A POPUI.ATION<br />
L'Adamaoua, malgré certaines contraintes, reste attractive. En effet, les statistiques de<br />
1976 et 1987 font apparaître que le taux annuel de croissance (3,32Yo) de la population<br />
était supérieur à la moyenne nationale (2,91%) et, donc, la proportion de la population de<br />
la province par rapport au pays a également augmenté '. de 4,5Yo en 1976 avec 345 456<br />
habitants, elle passe à 4,7yo en 1987 avec 495 185 habitants.<br />
Ces mêmes statistiques révèlent un fort taux de croissance de la Vina qui atteint 6,l8yo,<br />
soit plus du double de la moyenne nationale. La poussée démographique de la Vina s'explique<br />
par l'essor et la situation géographique de la capitale régionale.'Les autres départements,<br />
même s'ils ne se montrent pas aussi florissants, présentent des taux de croissance<br />
démographique égaux ou légèrement supérieurs au taux national (entre 2,9Yo et 3,3yo)<br />
exceptés Faro et Déo qui, avec son relief accidenté et inaccessible et son enclavement,<br />
justifie I'exode des populations.<br />
Tab no2 : Evaluation de la population de I'Adamaoua (trypot!Èrgtendangjelle)<br />
administrative croissance 76/87<br />
Vina<br />
109.418<br />
169.317<br />
6,19o/o 239.445<br />
Djerem<br />
35.097<br />
61.165 3.27o/o 125.607<br />
Faro et Déo<br />
Mbéré<br />
31.896<br />
96.099<br />
45.465<br />
126.921<br />
2,160/o<br />
3,180Â<br />
66.894<br />
184.361<br />
Mayo-Banvo 72.946 92.315 2,93o/o 119.300<br />
Adamaoua 345.456 495.185 3,32o/o 735.607<br />
<strong>CAMEROUN</strong> 7.663.246 10.516.229 2,91o/o 14.€1.361<br />
Sources : recensement des années conespondantes, nos calculs.<br />
Les projections faites sur la base de ces taux permettent d'estimer la population de<br />
I'Adamaoua à 735 607 habitants en 1999. Le poids de la province sur l'ensemble du pays<br />
atteint alors 5,09olo. La répartition de la population dépend de diftrents facteurs, géographiques,<br />
économiques, sociaux... De telle sorte qu'on note des differences entre départements<br />
et entre zones urbaines et rurales.<br />
t ta ville de Ngaoundérré est une ville-tampon entre le Grand-Nord et les autres provinces du pays. C'est une zone de<br />
transit et sa population a doublé en passant de78 062 à 157677 habitants au cours des l5 dernières années. Il est à noter<br />
aussi que les principales industries, manufactures, services... et même parfois les seuls existants se trouvent daru sa<br />
région.<br />
MINPAT / Proiet PNUD-OPS CMR/S/O6O1r99 15 Février2ffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Tab n'3 : Superficies et densités par département 1999<br />
Populations Supen?q'es en km2<br />
Djerem<br />
Faro et Déo<br />
Mbéré<br />
125 607<br />
66 894<br />
184 361<br />
't 19 300<br />
14 285<br />
10 435<br />
16 000<br />
I 620<br />
67 827<br />
: projec{ions à paftir des recensements démographiques de 1S7 et nos calculs<br />
Densité au km2<br />
8,8<br />
6,4<br />
11,5<br />
Avec près de 240 000 habitants, la Vina regroupe plus du tiers de la population de la<br />
province sur 27yo du territoire. Ce qui donne une densité de 13 habitants au km2, un peu<br />
plus faible que celle de Mayo-Banyo qui voisine l4Yo au km2. Dans I'ensemble, les densités<br />
sont faibles : la moyenne de Ia province atteint à peine 1l habitants au km'. Faro et<br />
Déo a la population la plus dispersée (6,4%) avec Djerem (8,8%). Le Mbéré qui atteint<br />
I1,5 habitants au km2 connaît la pointe de densité de la province dans la zone urbaine de<br />
Meiganga qui compte plus de 20 habitants au kmt, s'alignant ainsi sur la densité de la capitale<br />
regionale Ngaoundéré. Ce qui reste pour la principale ville de la province une densité<br />
faible, malgré ses rôles '. zone de transit, zone de regroupements administratifs, seules<br />
industries ou presque...<br />
La répartition par secteur de résidence relève d'après les estimations 1999 une très large<br />
majorité rurale avec près de 6 personnes sur l0 (55%) dans toute la province en général.<br />
Ce qui affirme son appartenance au secteur primaire et notamment agricole. Cependant, le<br />
taux de cette tranche de population a considérablement régressé.<br />
En effet, la population urbaine présente une évolution nette par rapport à 1987 en passant<br />
de 36% à 42Yo. Ce qui s'explique par I'essor des principales villes; Ngaoundéré présente<br />
un taux annuel d'accroissement démographique de 6,6yo, Meiganga de 5,8Yo et<br />
Banyo de 4,5Yo. Le poids de Ngaoundéré sur I'ensemble de la population urbaine confirme<br />
ainsi son rôle de capitale provinciale, en rassemblant près de 45Yo de l'ensemble de la<br />
population urbaine de la province et la presque totalité (94%) de I'ensemble des citadins du<br />
département de la Vina.<br />
B. CARACIERISTIQUES DE [A POPUTATION<br />
La population de la province de l'Adamaoua est essentiellement jeune. La pyramide des<br />
âges donne une base large qui se rétrécit à partir de 20 ans. Dans l'ensemble, plus de la<br />
moitié (52,5%) de la population à moins de 20 ans et 35,lyo entre 20 et 55 ans. Ces<br />
proportions diftrent à la hausse dans les centres urbains où 56,3Yo ont moins de 20 ans.<br />
S'ils représentent une force de travail pour demain, aujourd'hui I'extrême jeunesse de la<br />
population pose le problème de son encadrement, tant en milieu rural que dans les villes.<br />
Dans les campagnes, les structures villageoises et la famille élargie restent encore le<br />
moteur de l'éducation des enfants. Dans les villes, l'éclatement de la cellule familiale<br />
provoque les départs précoces des jeunes qui, livrés à eux-mêmes, essaient de gagner leur<br />
vie dans le secteur informel. Ils forment des bandes à peine contrôlées, à l'intérieur desquelles<br />
les jeunes font leur introduction anarchique à la vie et frôlent la délinquance juvénile.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,!C6IC1t99 l6 Féwier&
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Provirrce de I'ADAMAOUA<br />
Tab n'4 : Répartition de la population par âge, sexe et secteur<br />
15-34<br />
35-54<br />
f<br />
- Aggs Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes<br />
0 - 14 63,599 67,279 103,024 94,555 166,623 16T,æ4<br />
49,559 49,219 53,426 68,478 102,985 117,697<br />
22,647 21,143 36,202 35,058 58,849 56,201<br />
Source : Tableau construit à partir des résultats du recensement démographique de 197<br />
N.B. DhPres les résultats de ce recensement, h population de lAdarnaoua est constituée de 50,36% d'hornmes et de 4),64%<br />
de femmes.<br />
Tab n" 5 : RéPartition par sexe et par,âge de la population dq I'Adamaoua (pour tOOO traUl<br />
I Secfeur urbain I Secfeur rural I Secleur urbain et rural<br />
4gps Hom.mel Femmes Hommes F'emmes Hommes Femmes<br />
o - 14 233,77 222,12 241,47 221,62 226,51 210.48<br />
15-34 '172,64 176,76 125,22 160,02 134,7 157,97<br />
35-54 70,36 64,33 84,85 82,17 74,94 71,85<br />
et p$s 31,19 28,72 51,16 34,51 41,72 30,75<br />
_55<br />
Sqrrce : Recensement génénl de la popuhtion et de I'habitat 1S7 et nos calculs.<br />
Le phénomène de transhumance a des répercutions sur la répartition de la population<br />
par tranche d'âge : Sur 43,70Â de moins de 15 ans, 22,65yo ont des garçons (voir tableau),<br />
donc un peu plus nombreux que les filles. Par contre, la tranche d'âge de 15 à 35 ans, la<br />
proportion des hommes est moindre (13,47olo), alors que celle des femmes approche<br />
l5,8Yo. Cette inversion des tendances résulte essentiellement de la transhumance qui<br />
touche surtout les hommes. Un rapprochement avec les lieux de résidence fait ressortir que<br />
les jeunes ruraux sont plus concernés et que la transhumance touche de moins en moins les<br />
hommes âgés, dont la proportion est prédominante par rapport à celle des femmes.<br />
2. PROJECTION DES POPULATIONS<br />
Les projections tendancielles des populations par département et secteur d'habitat sont<br />
présentées dans le tableau suivant :<br />
Tab n" 6 : Projections : population urbaine et population rurale<br />
2005 2010 2015 2005 2010 201 5<br />
Vina 260 564 356 995 489 113 124206 137 807 152 897<br />
Djerem 147 144 235 901 378196 54 384 61832 70 300<br />
Faro et Déo 40344 56 320 78622 49 308 54 976 61 296<br />
Mbéré 85 946 111 268 144050 125962 137 039 149 090<br />
Mayo-Banvo 46 523 57 424 70 879 92 180 99 304 106 979<br />
Province 58O 521 817 908 I 160 860 446 040 490 958 5/10 562<br />
Recensement.<br />
Comme on peut le constater, l'accroissement démographique est très marqué dans les<br />
centres urbains et plus ralenti dans les zones rurales. le taux d'urbanisation sera d,e 62,48Yo<br />
en I'an 2010 et de 68,22Yo en I'an 2015. Les départements de la Vina et du Djérem seront<br />
les plus urbanisés avec des proportions de population respectives de 72,1o/o et79,2yo vivant<br />
dans les villes en I'an 2010. En l'an 2015 ; les taux d'urbanisation de ces deux départements<br />
seront respectivement de 76,l8yo et de 84,32Yo. Ce phénomène peut s'expliquer<br />
par le passage du chemin de fer qui attire les populations dans les centres urbains de<br />
Ngaoundal et de Ngaoundéré, les plus importantes gares de la province.<br />
Les densités des populations seront de 2l habitants au km2 en l'an 2010 et de 25<br />
habitants au km2 en l'an 2015. Le département de la Vina sera le plus densément peuplé<br />
avec une densité de 32 habitants au km2 en I'an 20lO et de 35 habitants au km2 en l'an<br />
2015 alors que dans le département du Faro et Déo, le plus faiblement peuplé, la densité<br />
sera de 13 habitants au km2<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,OO5,!C1l99 t7 Féwier2@
DENSITE<br />
DE LA POPULATTON (1998-1999)<br />
,l r 100:1<br />
, --<br />
o<br />
Mb<br />
Dersit<br />
t:]<br />
fl<br />
ffi<br />
Mons de 10 hab / km2<br />
10 à 20 hab / kmZ<br />
Plus de 20 hab / km2<br />
\<br />
)<br />
Mayo-Bat o<br />
a\<br />
Wac<br />
Fg.ro-E.t:Déo<br />
o<br />
Tign rc<br />
Mayo-<br />
=-_-^--\<br />
\<br />
Cialrn<br />
Ttgn ^ \-,'<br />
(<br />
t*<br />
t'<br />
DJeren<br />
Banyo<br />
/<br />
)<br />
fbtr| O<br />
g<br />
I<br />
Mbéré<br />
Centre-<br />
Afuque<br />
Ll',; [\D t:<br />
Magba<br />
L- ùrle 1e F1 g,L, l<br />
- l-f{ re I f\1i1'r} 1<br />
i rr.:e l.lrr0rC..:r'' -nr<br />
O<br />
+<br />
qr<br />
2OKm<br />
L rr îe de d slilÇ!<br />
Ùsfalil€,d t3i<br />
Chei'LrêLr> de Ê ilro|<br />
-<br />
IYAOUND/<br />
E Ngaound<br />
Clrel-Lreux de d Dartercqt ô trml<br />
Chel-Lieux d'aûordlssement O ,,"<br />
D,strLùl . ar ùl
ETUDES SOCIO'ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
N.B. Pour des raisons déjà évoquees plus haut, il n'est pas possible de procâler à des<br />
projections de la population active.<br />
3. GROUPES ETHNIQUES ET PEUPTEMENT<br />
La population de la région se compose de plus de 1l groupes ethniques d'inégale<br />
importance. Certains sont considérés comme allogènes, tels les Foulbés, les M'bororo et<br />
les Haoussas et d'autres autochtones (G'bay4 Kaka, Koutine ou Péré, Tikar, Konja, Vouté<br />
ou Babouté, Mbourn, Nyam-Nyam et Dourou ou Dii). Les Foulbé occupent les grandes<br />
villes et se disséminent dans les villages de moindre importance dans les départements du<br />
Mayo Banyo, de la Vina et de Djerem. Les G'bayq les Mboum et les M'bororo sont<br />
également très dispersés.<br />
Le peuplement de la région a été bouleversé au l9ème siècle par les guerres de religion<br />
lancées par les peuls, mais aussi par celles qui ont précédé la constitution de diftrents états<br />
ou Lamidas peuls.<br />
Avant le djihad peuhl, la plus grande partie de la région était contrôlée par les royaumes<br />
Mboum et vouté. Les premiers à l'Est et au Nord et les seconds au Nord-Ouest. Des<br />
groupements entiers échappaient totalement à I'autorité de ces royautés. Ils étaient<br />
localement soumis à de petits royaumes foncièrement indépendants et belliqueux tels les<br />
Chamba..<br />
Contrairement au schéma de la conquête dans la zone soudano-sahélienne où la présence<br />
des peuls était signalée dès le l6ème siècle, ces derniers sont arrivés dans I'Adamaoua<br />
avec la (guerre sainte> lancée par Adama à partir de Yola. Leurs victoires étaient<br />
facilitées par l'émiettement politique des peuples autochtones, leurs querelles internes et<br />
les faibles densités de la population.<br />
Venant du Nigeria, les M'bororo sont arrivés dans l'Adamaoua à la fin du 19ème siècle.<br />
Leur installation a été favorisée tant par les autorités traditionnelles foulbés que par l'administration<br />
coloniale, à cause des richesses que constituaient leurs troupeaux de bovins. Ils<br />
ont été soumis à un régime de taxes arbitraires par les autres chefs Foulbés sédentaires, et<br />
devaient payer assez cher les droits de pâturage aux lamidas de Tibati, Banyo et<br />
Ngaoundéré.<br />
Pour les en soustraire, les autorités allemandes ont créé en 1906 le canton de Lomba et y<br />
ont nommé un ardo m'bororo. Cette unité administrative a été ultérieurement entérinée par<br />
I'administration Française.<br />
La sédentarisation des M'bororo à travers ce canton leur a fait prendre les réflexes des<br />
autres chefferies foulbé. L'ardo de Lompta instaure des redevances beaucoup plus fortes et<br />
difficilement supportables pour les autres membres de la communauté. Certains chefs de<br />
lignages se désolidarisent et commencent à coloniser ce qui deviendra le département du<br />
Mbéré et qui à l'époque n'était qu'un simple pâturage de saison sèche. Vers les années<br />
lgz0,le département de Mbéré est devenu une zone de refuge des M'bororo fuyant les<br />
exactions des foulbés.<br />
Les exactions que subissent les M'bororo ont été perpétrées, mais de manière diftrente<br />
chez les autres peuples non musulmans de la région. A I'arrivée de l'administration allemande,<br />
les peuples non musulmans ont été placés sous I'administration peule. Leur refus<br />
de subir la loi des musulmans a entretenu un climat d'insécurité que l'administration<br />
française a commencé à résoudre à partir de I951.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SIO6/O1 199 l8 Février2ffi
EIUDES SOC|O-ECONOMTOUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
Compte tenu de la prédominance des foulbés dans la r€ioq le Foulfouldé est la langue<br />
la plus répandue. Il n'y a pas de langue officielle de communication, donc pas d'unité<br />
linguistique, cependant, le Foulfouldé est par les faits la principale langue de communication.<br />
Les autres langues sont le Dourou, le G'baya, le Tikar parlés dans les zones de<br />
concentration des ethnies correspondantes. Certaines langues comme le Mbounr, le<br />
Bornouan, le Bouté etc. sont en voie de disparition compte tenu de la dispersion de ces<br />
ethnies.<br />
4. EMPTOI ET NIVE<strong>AU</strong> DE VtE<br />
À l'issue du recensement démographique de 1987, la population active de l'Adamaoua<br />
représentait 4l,4yo de la population totale. Cette proportion était plus élevée en zone rurale<br />
(4l,lyo) qu'en zone urbaine (36,7%). Le taux d'occupation de la population étut de g4,2yo<br />
et 5,8Yo seulement de personnes étaient à la recherche d'un emploi. La province regorgeait<br />
de nombreuses unités de production pourvoyeuses d'emploi : MAIS-CaU, SOOpÈtB,<br />
SOMENO, SOFAMI, SOGETRANS, les sociétés des travaux publics etc. Les revenus que<br />
percevaient les employés étaient suffisants pour couvrir leurs charges sociales et constituer<br />
une épargne. ce qui leur conférait un niveau de vie assez décent.<br />
Actuellement la situation a changée. En effet, la crise économique s'est traduite par la<br />
liquidation de nombreuses entreprises, la compression d'effectifs et les baisses des salaires<br />
a profondément dégradé la situation des emplois et le niveau de vie des populations de<br />
I'Adamaoua ; résultat : un chômage de plus en plus grandissant. Même si on recense<br />
encore quelques structures pourvoyeuses d'emplois,z les conditions de travail qu'elles<br />
offrent exposent les travailleurs à la vulnérabilité. D'après les rapports du service<br />
provincial du travail de I'Adamaou4 une dizaine d'entreprises n'arriv"nt pas à payer<br />
régulièrement les salaires des employés. Il s'agit des ordres de I'enseignement privé<br />
confessionnel, les communes rurales de Tignère et de Ngaoundéré, et de certàines<br />
boulangeries. Ces structures accusent des arriérés des salaires de plus de l0 mois. Les<br />
travailleurs supportent ces conditions étant donné qu'il n'y a pas mieux ailleurs, compte<br />
tenu de la rareté des oftes de travail auprès du service provincial du travail et de ses<br />
antennes départementales.3 C'est pourquoi les demandeur, à'"*ploi se rabattent beaucoup<br />
plus dans le secteur informel.<br />
Ce secteur d'activité connaît une floraison dans les centres urbains de l'Adamaoua. Les<br />
principales activités qu'on y trouve sont la vente des produits, de contrebande, (carburant,<br />
détergent, petit outillage), la coiffirre, le transport (motaxi), la vente des beignets, de la<br />
bouillie et les fruits par les jeunes filles, etc. Ces activités de part leur précarité ne garantissent<br />
aucune source de revenus stables. La floraison des produits de la contrebande<br />
dépend de la perméabilité des frontières avec le Nigeria. Lorsque les autorités publiques<br />
engagent un combat contre ces produits, cette activité enregistre un repli mais perturbe à<br />
diftrents niveaux dont, en particulier, l'équilibre fragile des emplois de ce secteur, et<br />
surtout déstabilise la réponse à diftrents besoins et brise les flux économiques<br />
qu'elle avait provoqués. En effet, ces transactions permettront des écoulements<br />
de produits nécessaires et des échanges monétaires de
REPARTITION DES ETHNIES<br />
FOULBE Nom des thntes Frncrpales<br />
HaOUSSa<br />
Nom des thnles mrnontares<br />
ou secornalres<br />
Groupes ethniques<br />
| |<br />
rrKar<br />
Foulbe<br />
Foulbe + Voute<br />
IiIGFFIA<br />
Mal lBalo ,<br />
o<br />
FOULBE^--"'-<br />
'---a'- raro-Et-Déo<br />
,,'<br />
Flaoussa o<br />
Tlgn !.<br />
\/<br />
Borcra<br />
' ,/.<br />
/t F^r.r<br />
FOULBE<br />
ÀF<br />
| |<br />
fouloe +boaya<br />
Foulbe 'Gbaya<br />
* Dourou<br />
-o iifomlrtfa J \ \r '--<br />
Brrryo"-"'--7 FOULBE t<br />
I rrrvLEE, \ )<br />
Tf KAR Foutb \'.<br />
D ie r e n<br />
>-\_ I --\<br />
/-\/<br />
Banyo<br />
/ - -*--,-t<br />
{<br />
ouw-r/.<br />
)<br />
/ vo urE ,n?,<br />
Bomouan Mboum<br />
\ G Ye^!^ BÀYA<br />
ol<br />
cv<br />
)_o<br />
i<br />
Habtlssa<br />
o Bornouan<br />
ileig.ng!<br />
D,r i FOULBE<br />
I<br />
L rtrle de rl p ïlerjenl<br />
a. ? , ,.r Lrlrielarro[olssen\er]r<br />
I rntlÈ 'lè .li!liral<br />
O<br />
+<br />
q{<br />
20 (tn<br />
(',1P tlla' d lsl<br />
()f.i-L Èur di'F1 q, I<br />
IYAOUN D/<br />
O ri0.nÙil(<br />
(.r -l I rr.|r da 4 tr,rllprrn,ilr o n,,rr<br />
Ct:'I p..t d.r'I.^drb5Èn(nl C. ..<br />
I lc'
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
pourvoir des emplois, former et produire. En ce qui concerne les moto-taximen et les bouchers,<br />
on observe une exploitation des employés qui perçoivent un revenu de subsistance et<br />
peuvent perdre leurs emplois à tout moment.<br />
Cette précarité est lourde pour le social et l'économie ; cependant, des espoirs d'emplois<br />
se dégagent : des études relatives à la creation d'une tannerie à Ngaoundéré par une<br />
compagnie Italienne sont assez concluantes. Une entreprise Tchadienne VINACOLOR<br />
spécialisée dans la production de la peinture vient de s'implanter à Ngaoundéré, et les travaux<br />
de construction de I'axe routier Ngaoundéré-Moundou (TCHAD) pourront démarrer<br />
très bientôt. Toutes ces activités dewaient se traduire par un recrutement des employés et<br />
induiraient une amélioration des conditions de vie des populations locales.<br />
Par ailleurs la création des services publics ou privés divers pour résorber la carence<br />
existante sera également pourvoyeuse d'emplois. Mais surtout, il ne faut pas oublier que la<br />
région est constituée de 58Yo de population rurale quel que soit le département.<br />
Tab no 7 : Répartition de la population en âge de<br />
travailler par sexe<br />
en âqe de Population<br />
rurale<br />
Hommes Femmes<br />
Vina<br />
54 949 54 164<br />
Djerem 28912 28 498<br />
Faro et Déo<br />
15 555 1s332<br />
Mbéré 42268 41 665<br />
109 113<br />
57 410<br />
30 887<br />
83 933<br />
Mavo-Banyo 27 390 26 999 54 389<br />
Province 169 074 166 658 335732<br />
Sourcæs : Construit à partir des données absolues du tableau 2.<br />
Tab no I : Répartition de la population en âge de tavailler<br />
secteur d'habitat<br />
Vina<br />
Djerem<br />
Faro et Déo<br />
Mbéré<br />
en âge de<br />
Hommes Femmes<br />
17 914 12973<br />
48 681 3s252<br />
Population<br />
rurale<br />
63 285 45 828 109 113<br />
33 298 24 112 57 410<br />
30 887<br />
83 933<br />
Mavo-Banyo 31 546 22 843 54 38L<br />
Province 154724 141 008 335732<br />
Même si la tendance sera à la croissance urbaine comme le développe le chapitre<br />
suivant, I'Adamaoua est avant tout une province qui relève du secteur primaire : il y a donc<br />
lieu d'optimiser cette opportunité :<br />
- Tout d'abord le secteur minier : outre les minerais d'or exploités souvent clandestinement,<br />
I'Adamaoua possède des mines de bauxite et de cassitérite exceptionnelles...<br />
pourtant restées inexploitées. La mise en valeur de ces gisements changerait la face de<br />
Ia province, quant à I'emploi et aux differentes activités induites et même celle du<br />
pays.<br />
- Ensuite le secteur agricole : non seulement la production a doublé les 5 dernières<br />
années, mais les conditions agro-climatiques permettent de produire toutes les cultures<br />
pratiquées dans le pays. La région qui ne concentre que 5Yo de Ia population<br />
nationale produit pour le pays entier les cultures minières et plus de 24o de la viande<br />
de bæuf. Pourtant la main d'æuvre qui fait défaut saisonnièrement est payée à des<br />
prix exhorbitants : il faut encourager la main d'æuvre à rester sur place en structurant<br />
lçs cycles d'activité.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrSrtOCOlrgg 20 Février 2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
- Enfiq il y a lieu d'étudier le développement d'industries agro-alimentaires induites<br />
par la production locale et d'artisanats...<br />
- L'exploitation des potentialités halieutiques et des sites touristiques compléterait les<br />
activités pourvoyeuses d'emploi qui absorberaient une grande partie de la population<br />
predélinquante, les jeunes des commerces parallèles et les chômeurs et relèveraient le<br />
niveau de vie et en particulier la qualité de vie.<br />
Une partie de ses développements alimenterait la tendance à l'accroissement des populations<br />
uôaines qui s'amorce depuis quelques années et pourrait même l'accentuer.<br />
On remarque par ailleurs, que presque 5ff/o de la population est en âge de travailler.<br />
C'est-à-dire qu'un actif en moyenne, travaille pour 2 personnes dont lui même. En effet,<br />
tous secteurs confondus, on a un actif pour 2,18 inactifs, les taux sont sensiblement les<br />
mêmes dans le secteur rural (1 actif pour 2,21) eturbain (l actif pour 2,14).<br />
Le poids était acceptable avant la crise économique... I devient lourd lorsque le chômage<br />
est en recrudescence et peut être à l'origine de la délinquance : route barrée, attaque<br />
dans le trairl et enfants liwés à eux-mêmes dans les centres urbains.<br />
Il est à noter aussi que les moins de 15 ans représentent plus de44Yo de la population<br />
de Ia province. Si ces chiffies sont très positifs quand on regarde l'avenir, ils sont lourds<br />
de conséquence pour une région en état de paupérisation et jouent un rôle décisif dans<br />
l'abandon d'enfants subvenant eux-mêmes à leur survie.<br />
5. I.ES MIGRATIONS<br />
La province de l'Adamaoua connaît d'importants mouvements migratoires. Il se dégage<br />
du recensement démographique de 1987 que la migration concernait plus du tiers de la<br />
population de la province. Cette proportion correspond à 136 2ll habitants dont 16%<br />
d'hommes et lsyo de femmes. Par rapport au lieu d'habitatiorl 53,3Yo des migrants étaient<br />
originaires de zones rurales et 46,70Â de milieu urbain. Il est aujourd'hui diffEcile, en<br />
l'absence des recensements de donner une estimation réelle des migrations dans la province.<br />
Cependant, on peut regrouper en 3 catégories I'ensemble des mouvements<br />
migratoires : les déplacements inter-Etats des populations, les mouvements entre<br />
I'Adamaoua et les autres provinces, et enfin les déplacements des populations à l'intérieur<br />
de la province.<br />
Les migrations inter Etats s'observent aux frontières Est et Ouest de la province. A<br />
l'Est, les populations se déplacent dans les deux sens. Ces mouvements concernent particulièrement<br />
l'ethnie G'baya qui est autant implantée au Cameroun qu'en République Centrafricaine.<br />
A l'Ouest, on peut relever une percée des Nigérians qui s'intéressent plus aux<br />
centres urbains. Il s'agit très souvent des marchands Haoussa qui sont implantés tant au<br />
Nord du Nigeria que dans le Grand Nord du Cameroun. A l'opposé, les éleveurs Mbororo,<br />
du fait de la transhumance vont au Nigeria à la recherche des pâturages. On peut enfin<br />
souligner la présence dans l'Adamaoua, depuis les années 80 de nombreux réfugiés<br />
Tchadiens.<br />
Les migrations entre l'Adamaoua et les autres provinces se font tant vers le septentrion<br />
que vers les provinces méridionales. De nombreux originaires des provinces du Nord et de<br />
I'Extrême-Nord sont installés dans I'Adamaoua. A l'issue du recensement démographique<br />
de 1987, 16 175 habitants de l'Adamaoua étaient originaires de l'Extrême-Nord et 9 814<br />
habitants étaient ressortissants du Nord. Par rapport au nombre total d'immigrants, ces<br />
chiffres représentaient respectivement ll,ïYo et 7,2Yo. De nombreux originaires de I'Adamaoua<br />
étaient également recensés dans ces deux provinces.<br />
MINPAT I Projet PNUD-OPS CMR/SrO6,O1/t99 21 Févrierffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de fADAMAOUA<br />
Par rapport aux provinces méridionales, les mouvements migratoires ont été amorcés<br />
avec la ligne du chemin de fer Yaoundé-Ngaoundéré, opérationnelle depuis le début des<br />
années 70. L'immigration a connu une certaine ampleur à partir de l98i par les affectations<br />
des cadres de l'administration et des agents de I'Etat pour assurer Ie fonctionnement<br />
de nouveaux services créés à l'issue de la promotion du departement en province. Cette<br />
immigration fonctionnelle a été relayée par celle des élèves .f der étudiants, à la suite de la<br />
création de nombreux établissements publics et du Centre Universitaire de Ngaoundéré.<br />
C'est pourquoi les immigrations connaissent une certaine instabilité dans la province. Les<br />
statistiques montrent que 4,3Yo de Ia population migrante marquent une présence de vie de<br />
moins d'un an en 1987 ,ïYo y sont depuis au moins I an et au plus + ans. Une proportion<br />
de7,6Yo des migrants y sont pour une période allant de 5 à 10 âns alors que 7,4yo y sont<br />
implantés pour plus de I I ans.<br />
A I'inverse, on recense dans toutes les grandes villes méridionales du pays des ressortissants<br />
de l'Adamaoua, qui se rassemblent dans des quartiers connus. A yaoundé, ils se<br />
concentrent plus au quartier Briqueterie, dans les autres villes, leurs quartiers sont dénommés<br />
. Bien que beaucoup soient des trafiquants, ôeftains s'y installent<br />
définitivement.<br />
En ce qui concerne les déplacements à I'intérieur de la province, ils se résument à<br />
I'exode rural. C'est pourquoi les centres uôains sont les plus grands bénéficiaires des<br />
migrations dans l'Adamaoua. De nombreux jeunes gens, plus ou moins qualifiés y vont,<br />
espérant trouver un emploi. C'est ce qui justifie en partie I'importance des taux de croissance<br />
démographique dans les villes de Ngaoundérg Meiganga et Banyo (cf supra).<br />
La population de la province de I'Adamaoua est en pleine phase de croissance. Il est<br />
difficile de déterminer la proportion des immigrants par rapport à l'ensemble de la population'<br />
Quoi qu'il en soit, tous sont confrontés aux mêmes problèmes de survie et méritent<br />
une assistance multiforme.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SrO6rOil99 22 Féwier2@
ETUDES SOCIO'ECONOMIOUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
l. I'AGRICULTURE: CADRE PHYSIQUE<br />
L'Adamaoua est appelé le château d'eau du pays : en efFet, de nombreux fleuves<br />
rayonnant sur le Cameroun depuis la Province.<br />
Favorisées par les mouvements qui ont relevé le socle, les rivières ont dentelé les bords<br />
d'un relief massif : c'est Ie cas du réseau supérieur de la Sanaga (Djerem et ses affluents)<br />
dessinant une large dépression entre les promontoires de Meiganga-Bétaré-Oya et de<br />
Yoko. La plaine d'effondrement drainée par le Mbam (plaine Tikar) marque la limite de<br />
I'Adamaoua à I'Ouest.<br />
Le relief est très compartimenté. Au nord, le plateau (falaise de TVak) coupe brutalement<br />
le couloir de la Bénoué. L'accident le plus notable est le long et large fossé,<br />
jalonné par le Mbéré (la dénivellation atteint parfiois 400 à 500 mètres). Le Haut Djerem<br />
arrose, entre Meiganga et Tibati, une vallée large de 50 km et profonde de 350 mètres.<br />
- Un profil de plateau domine seulement à I'Est, autour de Meiganga et de Bagodo.<br />
- Le Centre présente une grande variété de formes : pitons granitiques, coulées anciennes<br />
étalées en nappes latéritisées, coulées plus récentes barrant des vallées comme<br />
la haute Vina près de Ngaoundéré, avec lacs de cratère (Tizory Mbalang).<br />
- Au Sud la pénéplaine de Martap prolonge la table de Bagodo au-delà du Djerem.<br />
- A l'Ouest, de véritables montagnes apparaissent avec les Tchabats, blocs granitiques<br />
de 2.000 m, profondément entaillés par les afiluents de Faro et du Mbam.<br />
On observe globalement des dissymétries très nettes entre l'Est uniforme, aux horizons<br />
dégagés et largement ouvert sur le Logone, et I'Ouest chaotique où les monts font vraiment<br />
frontières naturelles et entre le Nord, façade vigoureusement dressée sur la vallée de la<br />
Bénoué et le Sud où, sauf dans la région de Yoko-Matsari, la descente est régulière vers le<br />
cours moyen de la Sanaga et les bas-plateaux méridionaux.<br />
Mais surtout par sa continuité, sa hauteur moyenne, I'Adamaoua est bien une barrière,<br />
encore aujourd'hui difficilement franchie.<br />
Le climat de la Province de l'Adamaoua est de type tropical à deux saisons par an. Une<br />
saison de pluies et une saison sèche. L'influence de I'altitude décale les thermogrammes de<br />
Ngaoundéré vers les températures plus basses. Les brouillards matinaux sont assez fréquents.<br />
Généralement, les précipitations tombent sous forme d'averses.<br />
Les caractéristiques particulières du Plateau de l'Adamaoua ainsi que la spécificité de<br />
son relief créent un type de climat caractérisé par d'importantes précipitations annuelles<br />
comprises entre 1.200 mm et 2.000 ûrm, un allongement de la saison de pluies, et une élévation<br />
de I'humidité relative qui varie en moyenne mensuelle de 70 à 90 o en saison des<br />
pluies et de 40 àL 5A % en saison sèche.<br />
La moyenne mensuelle des températures minimales est de l0 à 19" et celle des températures<br />
maximales de 27 à 34". L'évaporation est moins forte en saison des pluies, en<br />
moyenne 65 mm de la valeur totale dans le mois ; elle est, par contre, plus intense lorsque<br />
la pluviométrie est nulle (152 mm).<br />
Depuis la rude sécheresse qui a touché l'ensemble des pays du Sahel dans les années<br />
1970,la quantité des précipitations par rapport à la moyenne, à long terme (100 à 200 mm)<br />
a connu une baisse significative, alors que la pérennité des cultures agricoles et des fourrages<br />
dans la région dépend en partie de l'humidité et de la température.<br />
MINPAT / Proiet PNUD-OPS CMR/S,O6rO1l99 23 Février2@
f> Emigration<br />
r-----? lmmigration<br />
E@@ MouvenBrts irterrns (eXode rural)<br />
Principales ethnies concernes<br />
F : Foulb<br />
H : Haoussa<br />
B : Bororo<br />
G : Gbaya<br />
T : Tikar<br />
BK: Bamilek<br />
BM: Bamoun<br />
BT : Beti<br />
F.B.H.<br />
RT : Rfuqis Tchadiens<br />
NG : Nigénars<br />
NG<br />
/<br />
r*<br />
--î-\-_-/-'<br />
ttc r-î--_==\r{<br />
r \//<br />
(<br />
/--.'<br />
//<br />
(,/t /<br />
\ \i<br />
r_"<br />
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUÉS <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Le calendrier des diftrentes périodes d'activités agricoles et pastorales de la region<br />
présente:<br />
- Une période située mi-mars-fin mars, de pluies faibles et inégulières, séparées par des<br />
intervalles plus ou moins longs correspondant à la phase de germination et<br />
d'installation du couvert herbacé.<br />
- Fin mars-mi novembre une période humide ou de pluies continues pendant laquelle<br />
les précipitations sont sufifisamment rapprochées pour assurer la croissance et le<br />
développement de la v égétation.<br />
- EnfirL à partir de mi-novembre, une période de dessechement progressif de la strate<br />
herbacée entraînant le jaunissement de la paille sur pied. La fréquence et l'intensité<br />
des pluies baissent.<br />
Pour I'Adamaoua, I'intervalle de temps favorable à I'agriculture se situe donc entre mimars<br />
et mi-novembre.<br />
Dans la province de I'Adamaoua, la pluviométrie moyenne est de l'ordre de 1.500 mm<br />
sur 150 jours de pluies. Les mois de juillet et août sont les plus arrosés. La hauteur des<br />
pluies varie selon les localités, ainsi, Tibati et Banyo ont une pluviosité supérieure à celle<br />
de Meiganga et de Ngaoundéré.<br />
La quasi-totalité des précipitations se situe entre mars et octobre avec toutefois,<br />
quelques pluies en saison sèche coûlme dans les villes de Banyo et Tibati, déjà citées plus<br />
haut. Les mois d'août et septembre sont les plus arrosés, et 75 Yo des précipitations<br />
tombent entre mai et septembre.<br />
Tab n" 9 : Calendrier des activités<br />
Spéculations<br />
Riz<br />
Fonio<br />
Mais<br />
Arachide<br />
Patate<br />
Coton<br />
Oignon<br />
de la<br />
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Nov. Déc.<br />
PC<br />
P CE<br />
R P PC CE E<br />
E R R R PC C<br />
Mil<br />
RR<br />
PC C<br />
Sorgho P C EC E R R<br />
(1) début de la saison des pluies (D) et fin de la saison des pluies (F) ; Spéculations : P : travaux de<br />
préparation des terres (défrichement, labour), C opérations culturales (plantation, semis, par E<br />
les travaux d'enûetien, sarclage...<br />
En général, la province de I'Adamaoua se caractérise par huit mois humides et quatre<br />
mois de saisons sèches.<br />
A titre d'exemple, durant la campagne agricole 1998/99,les plus fortes précipitations<br />
sont relevées en août avec une hauteur d'eau de 501,2 ûun, en septembre 330,4 mm et en<br />
octobre 237 mm. La pluviosité a été nulle pendant les mois de décembre, janvier, fevrier et<br />
mars qui correspondent à la saison sèche.<br />
Tab n" l0 : Pluviométrie de la campagne agricole 1998/99<br />
P<br />
E<br />
CEE<br />
PCE<br />
CE E<br />
PCE<br />
EER<br />
R<br />
RR<br />
RR<br />
R<br />
E<br />
RR cc<br />
R<br />
R<br />
R<br />
R<br />
E CE<br />
pfuies (mm) 0 0 O 149,4 199,7 191,8 58,7 501,2 330,4 237,3 6,5 0 1675<br />
Source : Délegation Provinciale de I'Agricufture (1æ) "Rapport d'Activités du Semestre juillet-Décembre 1Sr, Ngaoundéré.<br />
Les températures maximales de la région varient entre 24" et 32"c, avec une moyenne<br />
de29"c. Les températures minimales se situent entre 15o et l9oc. Les mois les plus chauds<br />
sont mars et avril et la période la va de juin à septembre. Il est à noter que<br />
parmi les facteurs climatiques qui affectent le développement de la plante, la température<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SIO6,O1I99<br />
Févner?@
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
vient en second lieu après les précipitations, ce qui s'explique par les variations thermiques<br />
peu marquées de ce type de climat.<br />
Le degré hygrométrique de I'air est maximal en juillet et août (saison des pluies) avec<br />
une humidité relative moyenne mensuelle de 8O%o. Elle décroît pour atteindre une moyenne<br />
de 41,6 Yo enfévier.<br />
La moyenne annuelle (toutes saisons confondues) de l'humidité relative est de 65,5 yo.<br />
La moyenne mensuelle maximale pour les mois les plus humides (uillet à octobrQ varie<br />
entre 99,2 et 99,4 o et la moyenne mensuelle minimale pour les mois les plus secs<br />
(décembre à fewier) entre 16,7 et 20,9 aÂ. Ces donnees ne devraient pas connaître de<br />
grandes modifications pour I'ensemble des localités de I'Adamaoua, I'humidité relative<br />
étant nettement influencée par la pluviosité et la température.<br />
S'agissant de l'évaporation, la moyenne mensuelle est très élevée entre décembre et<br />
mars (usqu'à 182,4 mm). Elle décroît très rapidement pour se stabiliser entre juin et<br />
septembre, puis remonte.<br />
À I.ES CONDITIONS PEDOTOGIQUES, HYDR<strong>AU</strong>TIQUES ET PI.UVIOMEIRIQUES<br />
Les roches qui constituent I'ensemble de la région sont variées, mais elles ne donnent<br />
pas toujours des sols diftrents. Inversement, par les actions de l'érosion et des influences<br />
climatiques anciennes, une même roche porte fréquemment des sols diftrents. Ainsi, le<br />
plateau de I'Adamaoua porte les grands types de sols suivants :<br />
- L€s sols ferralitiques : Les sols ferralitiques rouges se développent sur des basaltes<br />
anciens et occupent la majeure parlie du plateau ayant subi les épanchements<br />
hawaiiens du crétacé (ouest de l'Adamaoua).<br />
- I-es sols minéraux bruts : Ce sont des sols climatiques d'érosion sur cuirasses anciennes.<br />
Ils couwent des superficies non négligeables au sud du plateau et au sud-ouest de<br />
Meiganga. Le cuirassement alumineux (cuirasse ferralitique) caractérise la partie de<br />
l'Adamaoua située entre Ngaoundéré et Tibati et proche des localités de Bagodo,<br />
Minim et Martap. Ces cuirasses couronnent des plateaux assez allongés fortement<br />
dissequés par l'action des rivières.<br />
- Les sols hydromorphes : On les rencontre très souvent dans les bas-fonds. En effet, les<br />
plaines marécageuses de I'Adamaoua, généralement consécutives à des barrages volcaniques,<br />
sont intéressantes par leur diversité. Les sols hydromorphes résultent essentiellement<br />
de I'action d'une nappe phréatique sur une roche-mère quelconque, pendant<br />
tout ou partie de I'année.<br />
Le réseau hydrographique de l'Adamaoua est extrêmement important en raison de la<br />
position centrale du plateau. En effet, le Lom, le Djerem et le Meng font partie des<br />
affluents de la Sanaga. La Sanaga qui est le plus grand fleuve du Cameroun, se jette dans le<br />
Golfe de Guinée. Il draine tout le versant sud de I'Adamaoua. Le Djerem prend sa source<br />
vers 1.100 mètres d'altitude, à I0 km de Meiganga, dans cet important château d'eau du<br />
Cameroun qu'est le Plateau de l'Adamaoua. Il reçoit deux affluents importants de la rive<br />
droite :<br />
- la Vina Sud, issue des montagnes à I'est de Ngaoundéré vers 1.600 mètres, susceptible<br />
d'être aménagé pour I'hydroélectricité ,<br />
- le Béli ou Meng qui prend sa source dans la chaîne frontalière vers 2.000 mètres au<br />
nord./nord-est de Banyo :<br />
Enfin Ie Lom qui est aussi un affluent de la Sanaga prend naissance en Oubangui sur la<br />
bordure sud-est de I'Adamaoua.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SnGilCl/!99 25 Féwier2@
..+ J !?r ffi:hir . rY<br />
,'*{ oRo - HYDRoGRAPHIE ;<br />
t*-oT '<br />
lriF "t'-\ -t<br />
it<br />
I ,:S<br />
r;;, S't #'<br />
'<br />
rr')\<br />
l\1<br />
*++.'l *:i'lt<br />
\ 't-'"* ï<br />
'î.\<br />
cr...<br />
) /'<br />
\ ' #î}<br />
-ij------,,,)<br />
-r#<br />
Lr' J6. 1 r{<br />
.,+Tï3" ";,#*<br />
tg';'.1''"#r<br />
d<br />
ra.<br />
s #<br />
É-f<br />
,)<br />
je1rem<br />
-. ffiS<br />
I<br />
;|)<br />
#-,<br />
-ï'<br />
tl<br />
". r'r<br />
eIY'<br />
':r,r<br />
T mT]<br />
E:<br />
ï<br />
> 2000 m<br />
de 1000'2000 m<br />
de 500 ' 1000 m<br />
FrqqEs socto-EcoNoMtouEs REGToNALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Le Faro, le Mayo-Déo font partie des afiluents de la Bénoué dans le nord-ouest de la régtol<br />
La Bénoué prend sa source à I 300 mètres d'altitude, à 25 km du nord de Ngaoundéré,la<br />
Bénoué a deux principaux affluents : le Kébi et le Faro.<br />
La Vina et la Mbéré alimentent le Logone occidental, qui prend sa source au nord de<br />
Ngaoundéré et Meiganga.<br />
B. I.A VEGETATION<br />
L'Adamaoua se caractérise par deux coupures phyto-géographiques nettes :<br />
- Au nord la limite de l'aire d'extension des savanes soudaniennes marquée par la<br />
falaise septentrionale.<br />
- Au sud, I'apparition des formations forestières semi-décidues de type guinéen ou<br />
congo-guinéen, constituée par la côte de 800 m bien qu'étant une limite moins<br />
évidente que la précédente.<br />
L'intervalle entre les deux frontières, d'une grande homogénéité physionomique,<br />
correspond au secteur soudano-guinéen typique, avec des paysages de savanes bien souvent<br />
arbustives ou arborées. Ces savanes sont dominées par I'omniprésence de deux<br />
essences arborées fondamentales, Daniellia oliveri et Lophira lanceolata. Cette formation<br />
présente une strate herbacée dominée par de nombreuses andropogonées à grand développement,<br />
pouvant atteindre en fin de cycle végétatifjusqu'à 2 et 3 m dans certaines zones.<br />
Ces espèces prolifiques sont soumises à l'érosion anthropique des feux, pâturages et<br />
défrichements culturaux.<br />
A signaler aussi le long des cours d'eau, une végétation pré-forestière où sont concentrées<br />
les forêts-galeries servant de refuge à de nombreux oiseaux et animaux. L'accumulation<br />
de l'humus issu de la décomposition des feuilles sèches rend ce milieu très riche et<br />
favorable aux activités agricoles : c'est pourquoi on assiste de plus en plus à la destruction<br />
de ces galeries pour I'extension des terrains de culture avec tous les inconvénients connus<br />
de l'essartage.<br />
2. tES INSTITUTIONS AGRICOTES DE TA PROVINCE DE I.'ADAMAOUA<br />
Les structures d'encadrement et de production jouent un grand rôle à tous les niveaux<br />
de I'activité agricole: encadrement, assistance, formation, amélioration des conditions<br />
techniques et économiques. On distingue trois grands types : les institutions publiques, privées<br />
et parapubliques. Leur impact sur le secteur agricole nécessite un développement.<br />
A. tES INSTIIUIIONS PUBTIQUES<br />
Les plus importantes sont celles qui concourent à I'encadrement de l'activité agricole à<br />
travers les services décentralisés du MINAGRL Ainsi, dans la province de I'Adamaoua<br />
comme dans toutes les régions similaires, il existe les structures ci-après :<br />
- Une Délégation Provinciale de I'Agriculture basée à Ngaoundéré;<br />
- Cinq Délégations Départementales de I'Agriculture respectivement à Ngaoundéré,<br />
Banyo, Meiganga, Tibati et Tignère;<br />
- 16 Délégations d'Arrondissement dont trois dans le département de la Vina, quatre<br />
dans celui du Mberé, trois dans le département du Mayo Banyo, deux dans le département<br />
du Djerem et quatre dans celui du Faro et Déo.<br />
- De multiples postes agricoles disséminés dans toute la région.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98Æ6,O1r99 26 Févnler 2@
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
En dehors de ces structures traditionnelles du MINAGRI, le Système National d'Alerte<br />
Rapide ( SNAR ) intervient dans la collecte, le traitement et la diffirsion des informations<br />
sur le stock et le prix des denrées alimentaires des diftrents marchés de la région. L'occasion<br />
est ainsi donnée aux divers intervenants du circuit de la commercialisation des denrées<br />
agricoles (producteurs, commerçants et consommateurs) de maîtriser, à travers une parfaite<br />
connaissance des prix, les transactions commerciales.<br />
Actuellement, les marchés qui font I'objet d'un suivi régulier sont ceux de Tibati,<br />
Meiganga" Ngaoundéré et Mbé.<br />
L'Institut de Recherche pour le Développement Agricole (IRAD ) s'occupe de la<br />
recherche agricole depuis 1996, et a développé et vulgarisé plusieurs variétés végétales<br />
telles que la patate douce, 2 vanétés,le manioc, 03 variétés et animal, telle que la race<br />
wakwa chez les bovins.<br />
Sur le plan des techniques, I'IRAD a mis sur pied la technique des banques founagères,<br />
I'utilisation des résidus de récolte pour I'alimentation du bétail, ainsi que la mise en réserve<br />
du foin de pâturage naturel et la vulgarisation des espèces fourragères (Bracharia,<br />
stylosanthes).<br />
Afin de renforcer la capacité de I'IRAD, une convention générale de collaboration a été<br />
signée entre le MINAGRI et le MINREST dans le cadre de l'exécution du PNVA (Programme<br />
National de Vulgarisation agricole).<br />
Les missions assignées à I'IRAD dans ce cadre sont les suivantes :<br />
- Formation des cadres du PNVA;<br />
- Diagnostic des problèmes des paysans;<br />
- Mise en place des tests en milieu paysan;<br />
- Organisation de journées .<br />
En dehors des institutions publiques sus-citées, les structures privées concourent également<br />
à I'encadrement des activités agricoles.<br />
B. I-ES INSTITUTIONS PRIVEES<br />
Les structures privées d'encadrement agricole sont moins nombreuses dans l'Adamaoua<br />
que dans les provinces du Nord et de l'Extrême-Nord. Les plus importantes sont les ONG<br />
missionnaires et particulièrement celles de I'Eglise Evangélique.<br />
L'Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (EELC) a mis en place des structures<br />
s'occupant de l'animation et de la wlgarisation à travers des groupes cibles dans tous les<br />
départements de la province.<br />
Deux coopératives contribuent aussi à I'encadrement du monde rural : I'IDD et la<br />
SCAP.<br />
- La Société Coopérative Agro-Pastorale (SCAP) intervient dans trois des cinq départements<br />
de la province, en approvisionnant les paysans en intrants et matériels agricoles<br />
et en les aidant à mieux commercialiser leurs produits agricoles.<br />
- La et IDD sont des sociétés commerciales qui mettent à la<br />
disposition des paysans des intrants et matériels agricoles de haute qualité (semences<br />
de mals améliorées, chamres, pulvérisateurs, houes,... ).<br />
Le mouvement associatif, récent dans la région, regroupe essentiellement les organisations<br />
rurales qui voudraient pallier I'absence des ONG d'encadrement.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrS,t36rO1/199 27 Février 2@
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
En I'absence des "intermédiaires" que sont les ONG les organisations rurales (OR) sont<br />
les plus dynamiques dans la province de I'Adamaoua. En fewier 1999,773 organisations<br />
rurales étaient actives dans la région dont 631 localisées dans le département de la Vina.<br />
Depuis 1994, sur 859 dossiers 87 seulement sont encore en étude ou ont été rejetées.<br />
Les organisations rurales très dynamiques s'occupent de l'élevage, I'agriculture et de<br />
I'artisanat.<br />
L'évolution du nombre d'OR de 58 en 1994 à 757 en 1998 donne une idée dans le<br />
tableau ci-dessous de leur utilité dans la région.<br />
Tab no tl : Statistiques sur les OR inscrites au registre COOP/GIC de la province de<br />
I'Adamaoua<br />
Type d'organisation rurale 1994 1995 1996 1 997 1998<br />
Total des organisations coopératives 58 313 510 687 757<br />
de base<br />
Total des unions<br />
Total des fédérations<br />
2<br />
0<br />
8 13<br />
33<br />
Total général 60 321 520 698 773<br />
En dehors de ces structures, d'autres institutions apportent également un appui aux<br />
paysans en leur fournissant soit des semences, soit des pesticides, soit le petit matériel agricole.<br />
Ce sont la SCAP,I'IID, ADER, PELINGUET.<br />
C. tES STRUCIURES PARA-PUBLIQUES : [E PROGRA /lME NAIIONAI DE VUIGARISATION<br />
AGRTCOTE (PNVA)<br />
Lancé dans la Province de l'Adamaoua en 1992,le PNVA assure I'encadrement technique<br />
des paysans, qui constitue la pierre angulaire de la nouvelle politique agricole. C'est<br />
l'instrument d'exécution et de relais par lequel passe toute innovation susceptible d'engendrer<br />
le progrès grâce au système mis en place de'Îisitant training".<br />
Les objectifs du Pln/A à court terme sont de renforcer la compétence des services de<br />
vulgarisation agricole, de relever la qualité et la perfonnance du personnel de vulgarisation<br />
et d'améliorer I'efficacité des services d'appui, le système d'information et le suiviévaluation.<br />
L'objectif à long terme, est d'améliorer la productivité agricole et le niveau de vie de<br />
paysans.<br />
Le programme de vulgarisation comprend :<br />
- la réorganisation et le renforcement des structures de vulgarisation, la dotation de<br />
moyens matériels et financiers suffisants,<br />
- la formation régulière et continue du personnel de vulgarisation,<br />
- I'amélioration des liaisons entre la vulgarisation et la recherche. Sur le terrain, des<br />
équipes pluridisciplinaires de recherche participative en milieu paysan composé<br />
d'agronomes, d'agro-économistes, de zootechniciens et de forestiers assurent cette<br />
liaison.<br />
Le programme couvre actuellement tous les départements, soit cinq régions de vulgarisation<br />
et emploie, en 1998, 139 cadres techniques et l1 personnels d'appui.<br />
Il dispose, pour la mobilité du personnel d'un parc automobile de 8 véhicules et de 5l<br />
motocyclettes, et pour les besoins de démonstration sur le terrain et de formation du personnel<br />
de vulgarisation, d'un important matériel technique et outils oratoires seryant aux<br />
MINPAT / Projet PN UD-OPS CMR/Sit)6rOl /199 28 Fêvrier ffi<br />
5<br />
3<br />
7<br />
3
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
démonstrations et à l'apprentissage dans les champs et les sites de tests participatifs en<br />
milieu paysan.<br />
Depuis le lancement du PNVA dans la province de I'Adamaoua" plusieurs sessions de<br />
formation ont été organisées à I'intention des cadres : des formations de Quinzaine (FQ)<br />
pour les AYZ (Agent de Vulgarisation de Zone), des Ateliers Mensuels de Revue des<br />
Technologies pour les TSR (Technicien Superviseur Régional), des séminaires spécifiques<br />
dans des domaines variés (communication, utilisation des outils,...).<br />
Par ailleurs, plusieurs recommandations techniques de production ont été enseignées<br />
aux paysans relatives notamment à la première culture après le manioc, le mats, concernant:<br />
Le respect des densités (80 x 50); le choix et la conservation des semences; les techniques<br />
de conservation en stock, les techniques de fertilisation minérale; la valorisation du<br />
parcage pour la production des céréales en général; les techniques de traitement des semencÆs<br />
mais, miVsorgho,...) ; enfin, les techniques de bouturage de la patate douce ; les choix<br />
et techniques de plantation des semenceaux d'igname; la lutte contre le striga; les choix des<br />
boutures de manioc et semis en ligne et, par ailleurs le respect de densités de l'arachide.<br />
3. TA PRODUCTION AGRICOTE<br />
La Province de I'Adamaoua se présente actuellement comme une région stratégique en<br />
matière agricole, non seulement pour la partie septentrionale du pays, mais aussi pour I'ensemble<br />
du Cameroun. En effet, ses conditions agro-climatiques lui permettent de supporter<br />
la plupart des cultures se pratiquant dans tout le reste du pays. Cependant, seule sera<br />
retenue ici l'évaluation de la production de cultures dont I'importance alimentaire etlou<br />
économique sont indubitablement reconnues.<br />
Dans I'Adamaoua, il n y a pas, à proprement parler, des pénuries alimentaires. La région<br />
étant autosuffisante à plus de 90oÂ, il n'y a pas de famine, mais des zones de mauvaise<br />
distribution alimentaire.<br />
Le taux de couverture en céréales est de l'ordre de 90Yo. Toutefois, la gestion des stocks<br />
d'urgence dans la region est nécessaire et pourvoirait à sa régulation de zones à excédent<br />
de production vers des zones à déficit de production, le déficit alimentaire structurel<br />
n'existant pas. Les stocks d'urgence concernent les céréales, en général, qui peuvent être<br />
conservées dans ces conditions.<br />
Pour les autres produits, il s'agit de faciliter la répartition des récoltes en fonction des<br />
productions : May-Banyo, par exemple, ne cultive ni igname, ni miVsorgho et très peu<br />
d'arachide, mais se place parmi les premiers producteurs de maïs et surtout de banane/<br />
plantain...<br />
A TES PRINCIPAI.ES CUITURES<br />
Les cultures pratiquées dans la Province, très variées, sont principalement : le mais, le<br />
sorgho, le manioc, I'igname, la patate, l'arachide, la banane/plantain, le macabo/taro et<br />
deux cultures de rente, le coton, dans la Vina et le cafe dans le Mayo-Banyo.<br />
Une agriculture irriguée est pratiquée, mais de petite dimension et localisée essentiellement<br />
dans les bas-fonds : elle comporte le riz (vers Tibati), le maïs de contre-saison et les<br />
cultures maraîchères.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrSiOGrOl/!99 29 Féwierffi
STRUCTU RES D'ENCADREMENT<br />
AGRTCOLE (1998-1999) ,<br />
N,<br />
(<br />
)k, rru**"<br />
\ surto"too<br />
.*J *<br />
ao<br />
Banyo 1<br />
\rbr<br />
, lrJ-c,uruu: I,1bd nÎ<br />
I<br />
,) o<br />
/'Koilct!<br />
r r-î1( ,,;\r *<br />
*O<br />
toj<br />
* €"t structures pives (DNG )<br />
{ fr Limrtedesrgrons<br />
\*<br />
*t** 7(1<br />
sôs Mbssl<br />
t I<br />
MoLigùêl PiË rôare'<br />
"æ<br />
/*o"*"'* i<br />
.,*<br />
t<br />
I<br />
'r<br />
*Nvâsr<br />
ao "r XaO€i **ou*oene<br />
..o<br />
.+*<br />
NeârE'Hô<br />
Tign<br />
[ï",:,t - ;.L *<br />
* ruo**<br />
:",à't,-'çPù Bf,î# ',î'<br />
l i<br />
:,.n<br />
I<br />
tlbw'<br />
M3n9.,'n<br />
*1,' *<br />
Â=-**--6---' -#"b** -<br />
cowæuel<br />
f<br />
ftt" q ,*<br />
Ddalayà<br />
"{ot<br />
,1'Ttbatl<br />
X<br />
a<br />
Dlgation pwirrciale<br />
Dlgatlonsdpartementales<br />
Dlgationsd'anondissements<br />
O<br />
* Postes agricoles<br />
€E IRAD<br />
6âboB /<br />
*-,<br />
NGAOUI ./<br />
VBanktm<br />
LÊG€fæ<br />
Roùi FrËFbbtm.<br />
Roû€ g,6pb fmô@r<br />
Rotâsæod.r.fhrffi.,------<br />
Rote sæodero Indd(ôilô<br />
-<br />
Chmndo Fs<br />
Frdrc<br />
!mdo Rg,6<br />
ud.de dFnemon<br />
!d. d ardssèmn<br />
Cd'6a&dl,.1mn<br />
CH-bd d.nod3sffin<br />
NB llextsteencorel29zonesdevulgsnsaton.qutssonttransftr,ægogrægvenentenpostesagrcolæ
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Les précipitations étant importantes dans la région (en moyenne 1500 mm), on utilise<br />
principalement I'eau de pluies. Les maraîchers puisent dans de petits puits dans les<br />
rivières.<br />
A noter, cependant en saison sèche, des problèmes de tarissement parfois très importants,<br />
les sols de la région étant très permeables, les nappes phreatiques vont très en<br />
profondeur : c'est toute la région qui est concernée par ces problèmes de tarissement.<br />
q. les culfures vivdères<br />
Compte tenu des conditions favorables citées plus haut, il existe une kyrielle de cultures<br />
vivrières dans la province de l'Adamaoua, outre les cultures de base. La plupart d'entre<br />
elles (piment, gombo, tomate, oseille de Guinée, légumes indigènes) sont produites en<br />
association avec les principales cultures (mais, sorgho, igname). Hormis quelques<br />
tubercules bisannuels ou pluriannuels, I'activité agricole se pratique uniquement en saison<br />
de pluies. Il existe par ailleurs quelques cultures pratiquées en deux cycles. Les cultures les<br />
plus rémunératrices sont les tubercules telles qu'igname, patate, manioc, les céréales,<br />
essentiellement le mais, et les légumineuses dont I'arachide en particulier.<br />
- I-e sorgho de saison de pluies se cultive en rotation avec le coton et souvent<br />
I'arachide. L'utilisation des engrais est ici rare puisque le sorgho profite de l'encadrement<br />
offert au coton, culture de rente par excellence. La production, ainsi que les<br />
surfaces cultivées sont relativement restreintes.<br />
- Le maïs constitue une des principales cultures viwières de la region du fait de son<br />
adoption par la majorité des agriculteurs au détriment du mil et du sorgho. Ce<br />
phénomène est en grande partie stimulée par I'installation de la société Maiserie du<br />
Cameroun (MAISCAM) et tout ce que cela comporte (cf supra) à une trentaine de<br />
kilomètres de la ville de Ngaoundéré. Les superficies cultivées sont de l'ordre de<br />
45.000 ha, avec des rendements de l'ordre de 2300 kgftta, situant l'Adamaoua en<br />
troisième position dans le classement national.<br />
Il existe deux cycles de production du mais, bien que la production du second cyole,<br />
insignifiante, amène à s'interroger.<br />
Cette production, en augmentation depuis une décennie, a pris le deuxième rang,<br />
derrière le manioc, dans le classement régional.<br />
- L'arachide a été, avant I'introduction du coton, I'une des plus importantes cultures<br />
d'exportation de la région. Elle se fait en un seul cycle en dépit du caractère<br />
commercial dont elle bénéficie. Les productions demeurent faibles et comparables à<br />
celles du sorgho ou du Taro/lvlacabo. Les autres légumineuses, en particulier le<br />
haricot, le voandzou ou le sésame sont des cultures vivrières.<br />
- La culture du haricot qui comporte deux cycles de production, constitue pour les<br />
populations, une source des protéines végétales. On cultive indiftremment le haricot<br />
rouge ou blanc, ainsi que le niébé dont la production est également restreinte comparativement<br />
à celle des autres produits.<br />
- La culture des ignames a les meilleurs rendements de la province de I'Adamaoua<br />
(9576kglha) bien qu'elle soit limitée dans l'espace ; les superficies annuellement<br />
exploitées variant entre 300 et 475 hectares et les productions sont comprises entre<br />
1120 et 3000 tonnes. Comme celle de I'arachide, la culture des ignames est<br />
relativement rémunératrice.<br />
- Les productions maraîchères et fruitières revêtent une grande importance dans la<br />
région : on cultive des avocatiers, des manguiers, des goyaviers, des anacardiers. Les<br />
plantes sont produites en particulier dans la ferme de multiplication de Ngaoundéré,<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrS,OGrtCltgg<br />
30<br />
Féwier2ffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
mais également dans les diftrentes pépinières départementales des services du<br />
MINEF.<br />
b. les cullures commercioles<br />
- Le coton a été introduit dans le Grand Nord en l95l par la CFDT. Dans I'Adamaou4<br />
sa production, et les surfaces cultivées très limitées se concentrent, dans les localités<br />
limitrophes à la province du Nord, dans le département du Mayo Rey. On estime que<br />
185 ha de superficies y sont exploitées.<br />
- Le café robusta cultivé uniquement dans le département du Mayo Banyo, dans la<br />
localité de BankinL couwe une superficie de 6 822 ha. La production moyenne étant<br />
de I'ordre de 2 995 tonnes, les rendements, qui varient avec les conditions du milieu<br />
sont évalués à un peu plus d'une demi-tonne à I'hectare.<br />
- La production du blé seule culture commerciale du département de la Vina, a freiné<br />
son développement à cause de I'accroissement exponentiel des coûts de l'activité.<br />
La banane plantairç le tabac sont aussi, à moindre débit, également cultivés.<br />
On peut dire que I'Adamaoua présente une certaine potentialité inexploitée à développer<br />
les cultures commerciales ; si la préference est donnée aux cultures viwières, c'est qu'elles<br />
sont immédiatement écoulées sur le marché local ou provincial, donc immédiatement<br />
rentables, alors que les autres produits deviennent d'exploitation coûteuse et par<br />
conséquent de moindre profit.<br />
T3F n" 12 : Production agricole de la campagne 1997/98 par département (en tonnes)<br />
Départements Faro et Déo D1èrem Mayo-Banyo Mbéré Vna Total<br />
Cuftures<br />
Mais 8.630 6.000 16.745 7.600 17.073 56"048<br />
MiUsorgho<br />
Manioc<br />
lgname<br />
Patate<br />
17.903,3<br />
12.351,5<br />
1.474,9<br />
1.<br />
12.OOO<br />
2.000<br />
2.800<br />
450<br />
2. 500<br />
1.267,5<br />
55.930,2<br />
3.693,6<br />
5.889<br />
4.885,3<br />
44.405<br />
26.947<br />
6.088<br />
24.056,1<br />
125.136,7<br />
34.115,5<br />
19.102.3<br />
Arachide<br />
Banane/plant<br />
Macoboftaro<br />
Café<br />
Coton<br />
vtvfler 42184.9 800 4 99<br />
386,2 1.842<br />
2.616,9<br />
1.000<br />
1.209,9<br />
3.300<br />
1.152,6<br />
I<br />
4AO<br />
10.544<br />
5.003<br />
2.327<br />
2.209_ 7.454,2<br />
12.753,9<br />
9.455,6<br />
708<br />
Source : Délegation Provinciale de l'Agriculture de I'Adamaoua, 1@.<br />
N.B. : Pour ce qui est de la production du mais, il faut ajouter, à la valeur ci-dessus, celle de MaTscam qui<br />
se situe autour de 20.000 T<br />
La province de I'Adamaoua a réalisé un tonnage de plus de 258.000 tonnes de produits<br />
vivriers pendant la campagne agricole 1997/95. La plus grande zone de production est la<br />
Vina avec plus de 38yo, suivie du Mbéré qui réalise 28,8yo de la production régionale.<br />
Le Département de Mayo qui totalise un des tonnages les moins élevés, se situe cependant<br />
en tête pour la production du Mais et de la banane/plantin.<br />
Le département du Faro et Déo est spécialisé dans la production du miVsorgho.<br />
2.327<br />
708<br />
B. I-ES GRANDES ZONES DE PRODUCIION<br />
Les produits vivriers sont cultivés dans l'ensemble sur toute la province, répondant<br />
d'abord aux besoins immédiats des marchés locaux, et diminuant ainsi les coûts des<br />
intermédiaires. Cependant, certains départements se distinguent par au moins une spécialisation<br />
dans leurs cultures. Ainsi Mayo-Banyo et Vina se partagent 60 yo de la production<br />
du maïs. Faro et Déo produisent 75 Yo du miVsorgho de la province. Le Manioc est cultivé<br />
presque en totalité par les départements de Mbéré (plus de 44 Yo) et de Vina (plus de 35%)<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrS,Q6rO1t99 3l Février 2m
ETUDES SOCIGECONOMIOUES RÉGIONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
et plus des 3/4 de la production d'igname provient de la Vina. Quant aux cultures commerciales,<br />
Mayo-Banyo et Vina ont respectivement l'exclusivité du cafe et du coton. On<br />
pourrait encore parler d'exclusivité pour May-Banyo qui produit la presque totalité des<br />
bananes-plantains.<br />
En ce qui concerne les cultures cornmerciales notamment, il y aurait lieu d'étudier<br />
l'encouragement de ces spécialités. Etant donné la rentabilité générale insuffisante de ces<br />
produits, les petites exploitations, réparties sur chaque département comme le cas de I'arachide,<br />
pourraient générer plus de profits gérés autrement (par regroupements, par<br />
exemple...).<br />
La Vina" lvlbété, Faro et Déo qui couwent tout le Nord et l'Ouest de la province<br />
réalisent ensemble 83 Yo de la production viwière de I'Adamaoua. L'Ouest étant de loin la<br />
région ta plus fertile avec plus de 67 o de ces produits dans les départements du Mbéré et<br />
Vina réunis. La Vina seule produisant près de 2/5 de récoltes confirme ici son rôle de<br />
capitale de la région. A I'Est, Djerem est le moins prospère, Mayo-Banyo ayant pu se<br />
distinguer par certaines spécialités comme cité plus haut.<br />
C. EVOI.UTION TENDANCIEI.I.E DE TA PRODUCIION AGRICOI.E<br />
On assiste, quant à la production agricole à un grand virage économique et social. En<br />
effet, région essentiellement pastorale, l'Adamaoua présente, aujourd'hui, une production<br />
végétale croissante d'année en année. Cet essor de l'agriculture de la province résulte de<br />
l'action synergique de plusieurs facteurs. La gestion des PNVd leurs structures d'encadrement,<br />
leur infiltration dans les zones de production ont contribué à révolutionner de<br />
façon significative le paysage agricole. Grâce à ce programme, les populations de la région<br />
ont adopté des techniques modernes de production : usage des semences améliorées du<br />
mars, patate, manioc, igname, des engrais et des pesticides. Par ailleurs, plusieurs conventions<br />
lient ce programme à certaines sociétés commerciales telles que Rhône Poulenc,<br />
Palmol, Hydrochinç qui æuwent dans le secteur des intrants agricoles.<br />
Par ailleurs, l'impact des grandes décisions nationales à caractère économique, à savoir<br />
la baisse du pouvoir d'achat des camerounais résultant de la réduction substantielle des<br />
salaires dans la Fonction publique, doublée de la dévaluation du franc CFA' survenues<br />
respectivement fln 1993 et début 1994 ont joué un rôle non négligeable dans la relance de<br />
l'activité agricole de la province de l'Adamaoua en particulier.<br />
Tab n" 13 : Evolution de la production agr<br />
Maïs<br />
Mil/sorgho<br />
Manioc<br />
lgname<br />
1995/96 1996/97 1997/98<br />
46.855<br />
23986,2<br />
109.088<br />
30.413<br />
56.048<br />
24.056,1<br />
125.136,7<br />
34.1 15,5<br />
Patate 11.580,6 15.988 18.226 20.283 19.102,3<br />
197.071 213t:646 230.625,2 258.458'6<br />
Banane/Plantain<br />
Macaboltaro<br />
Café Robusta<br />
Coton<br />
39.665,1<br />
24.572<br />
81.847.4<br />
13.427,9<br />
18.252<br />
5.983,7<br />
850<br />
42.174<br />
24.248<br />
85.556<br />
29.105<br />
11.976<br />
6075,s<br />
115<br />
44.999<br />
26.673<br />
92.486<br />
31.262<br />
13.400<br />
7.981<br />
700<br />
645<br />
12.947<br />
6.901,5<br />
2.327<br />
753<br />
Source : Oetegation Provinciale de l'Agriculture de l'Adamaoua, 1S<br />
Il résulte de ces phénomènes concomitants que l'Adamaoua connaît une nette progression<br />
depuis plus de cinq ans, surtout en ce qui concerne les produits vivriers dont la<br />
production a doublé durant cette période. En effet, seule la culture du miVsorgho présente<br />
les mêmes résultats avec plus ou moins de baisse depuis 5 ans, les autres produits notent<br />
Ml NPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SrOGrOI I99 32 Féwier2ffi<br />
12.753,9<br />
9.455,6<br />
2.327<br />
708
ETUOES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'AOAÀ4AOUA<br />
une progression nette qui atteint en 1998, pour l'igname, deux fois et demie le tonnage<br />
relevé en 1994 : c'est de loin la plus haute croissance. Les autres cultures atteignent èn<br />
moyenne 40 % de croissance durant la même période, avec une pointe de 64Yo concernant<br />
les patates, ce qui est un résultat très prometteur si l'on prend en considération les moyens<br />
parfois encore rudimentaires employés et la carence d'intrants malgré tous les progrès<br />
développés. De même, les cultures commerciales évoluent également à la hausse et particulièrement<br />
le coton et le cafe robusta. Dans cet ordre d'idées, la production du coton est<br />
passée de 597 tonnes en 1993 à 708 tonnes en 1997198, soit une augmentation de 18,5 yo<br />
en cinq ans. C'est le même constat que I'on peut faire pour le cafe robusta puisque la<br />
production a augmenté de 173 oZ au cours de la même période.<br />
D. PROTECTION DES CUI.IURES ET DES DENREES SIOCKEES<br />
I"a protection des cultures et des dérivés stockés concerne, bien entendu, aussi bien les<br />
cultures viwières que les cultures de rente. Les principaux parasites des cultures viwières<br />
dans la province de I'Adamaoua sont les termites, les , les coléoptères, les<br />
mouches blanches, I'anthractnose, les chenilles foreuses des gousses, les charaçons des<br />
bananiers, etc. Læs ennemis des cultures fruitières et maraîchères sont les pucerons, les<br />
fourmis, les chenilles, les termites, la cercosporiose et la pourriture. Quant aux denrées<br />
stockées, elles sont attaquées par le sitophilus et le gramarius.<br />
Les dégâts causés par ces parasites sur les cultures sont parfiois très importants et varient<br />
selon les localités. Ainsi, les chenilles défoliatrices ont dévasté 3 600 ha de cafe robusta<br />
dans le département du Mayo Banyo en 1998, 2 700 ha de ceréales et aussi le mars, le<br />
sorgho et le mil ont été attaqués par les termites. Les mouches blanches ont ravagé 260 ha<br />
de tubercules (manioc et igname).<br />
Le tableau ci-dessous fait état des diftrents traitements opérés par les services<br />
techniques compétents au cours du 2ème semestre 1998.<br />
Tab n" 14: Présentation<br />
ue des traitements<br />
de cuftures Surface Parasdes crbles Localités<br />
1. Vivrières<br />
356 ha termites, charançons,<br />
mosaïque, mille pattes<br />
25 ha - Vina<br />
pucerons, fourmis Djérem<br />
- termites, pucerons Djérem<br />
2996 tonnes sitophilus, gramarius Vina<br />
5. Café 301 ha dursban, sumithion Mayo Banyo<br />
2. Maralchères<br />
3. Fruitiers<br />
4. Denrées stockées<br />
L,orsqu'on rapproche ces chiffres de ceux des dégâts cités plus haut, les interventions<br />
de traitement sont insignifiantes et expliqueraient plutôt les pertes subies : 3600 ha de cafe<br />
ont été dévastés à Mayo-Banyo en 1998 et seulement 301 ha ont été traités ; 3600 ha de<br />
céréales ont été détruites, et I'on ne fait état d'aucun traitement à ce sujet... Même si les<br />
chiffres des pertes concernent l'année entière, tandis que le tableau des interventions ne<br />
reflète que l'activité des 6 derniers mois, même si la fiabilité de ces rapports est plus ou<br />
moins discutable, il y a incontestablement beaucoup à faire aussi bien en ce qui concerne<br />
le traitement qu'en ce qui se rapporte à la prévention. Tout d'abord, la lutte phytosanitaire<br />
est actuellement limitée à quelques localités d'envergure des provinces de la Vina et<br />
Djerem notamment et concerne seulement les grandes plantations. Que Maya-Banyo et<br />
Djerem qui sont les moins productifs soient protégés s'entend, mais que Faro et Déo et<br />
Mbéré qui sont parmi les plus rentables ne le soient pas, explique I'immensité des pertes.<br />
Il y a lieu d'étendre d'urgence la protection des récoltes à toute la province de façon<br />
pragmatique et structurée en visant toujours la maximisation de la rentabilité : tous les<br />
efforts et investissements faits en amont pour développer la production ne doivent pas être<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrSnG,Ol /tgg<br />
-a<br />
JJ<br />
Féwier@
ETUDES SOCIèECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
réduits à néant en aval à cause d'un manque de prévention ou de traitement, du produit<br />
arrivé à sa phase finale.<br />
4. tE FINANCEMENT DE I'AGRICUTTURE<br />
A I'instar des autres regions du pays, le financement de l'activité agricole est assuré par<br />
le Fonds d'[nvestissement des Micro-projets Agricoles (FIMAC).<br />
Le Programme FIMAC est la principale composante du Projet Sécurité Alimentaire<br />
chargé du financement d'investissements des micro-réalisations agricoles et communautaires.<br />
La situation de reconstitution des fonds faite au 3l octobre 1998 était la suivante :<br />
- 243 groupes communautaires ont été finances à ce jour dont 64 % dans le département<br />
de la Vin4 I8.5 % dans celui du Mbéré, 7 Yo, 6 Yo et 4 7o respectivement dans<br />
les départements du Mayo Banyo, du Faro et Déo et du Djerem;<br />
- sur l'ensemble des groupes financés, 7l % seulement sont à jour alors que l7l<br />
groupes communautaires n'ont pas honoré toutes leurs échéances de remboursement.<br />
- le montant global de crédit octroyé est de 368.191.615 F CFA dont plus de 76%o<br />
distribués aux groupes basés dans le département de la Vina ;<br />
- le montant remboursé est de 107.653.466 F CFA5 soit un taux de reconstitution de<br />
fonds de 55.7 o seulement.<br />
Tab n" 15 : Situation de reconstitution des fonds au 31 octobre 1998<br />
Dépar- Gpe Gpes Gpes Montant<br />
ements s f,na- à jour en<br />
ncés<br />
Vina<br />
Mbéré<br />
çaro &<br />
Déo<br />
156<br />
45<br />
15<br />
35<br />
I<br />
14<br />
retard<br />
crédit<br />
Montant Montant Montant Montant Taux Cré- Achevé<br />
échu (B) Remboursé en retard antici- de dit Montant<br />
(A)<br />
Pation C rembo Nom<br />
urst<br />
)jérem 10 1 9 16.120.000 5.851.000 3.150.500 2.700.500 0 53,84 .t<br />
500.000<br />
M.Bqnyo 17 12 5 14.015.350 4.529.100 3.718.650 875.000 64.550 80,95 s r.+gs.SoO<br />
Total 243 71 172 368.191.615 192j28235 107.653.466 85.583.544 1.108.r/5 sS,Zt 35 16.439.500<br />
Source : Cellule Proûnciale du FIMAC, Adamaoua.<br />
A/B+C<br />
121 282.883.380 155.888.420 81.151.166 74.845.754 ,t08.500 52,02<br />
36 41.893.885 18.405.715 11.622.650 6.968.790 185.725 62.51<br />
1 13.279.000 7.454.OOO 8.010.500 193.500 750.000 97,64<br />
Dans la perspective des crédits de deuxième génération, trois institutions de microfinances<br />
(IÀdF) ont signé des contrats avec la Délégation Provinciale de I'Agriculture de<br />
I'Adamaoua. C'est d'une convention de partenariat pour la poursuite du financement des<br />
projets des groupes sociaux qu'il s'agit. Les IMF sont le CECR" le CNCD et I'ICBC.<br />
Les fonds qui seront gérés par les IMF sont ceux, provenant des remboursements des<br />
prêts FIMAC de première génération qui doivent être recyclés dans une deuxième<br />
génération de crédits gérés collectivement par les bénéficiaires à travers ces trois structures<br />
financières de proximité et autonomes. L'objectif final étant de rapprocher les groupes<br />
communautaires financés du système bancaire formel.<br />
Les crédits de deuxième génération ouvrent une nouvelle perspective de resserrement<br />
des liens entre les coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) et les groupes ruraux<br />
pour qu'ils aient de nouveau accès au crédit, mais dans une nouvelle formule de type privé<br />
et bancaire.<br />
II faut rappeler que les fonds déposés dans les COOPEC demeurent la propriété de<br />
I'Etat camerounais. Il est précisé dans la convention de partenariat que le transfert des<br />
2A 10.679.000<br />
8 1.826.000<br />
3 1.939.000<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrS,O6,01 t99<br />
34<br />
Féwier20@
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de |ADAMAOUA<br />
fonds d'une localité à une autre peut être justifié par le faible taux d'utilisation (c'est'à-dire<br />
inferieur à25Yo), une mauvaise gestion de fonds et une faible rentabilité dudit fond.<br />
Les groupes ruraux éligibles sont aussi bien ceux ayant déjà bénéficié des crédits<br />
FIMAC première génération que ceux qui n'ont pas encore été bénéficiaires. Toutefois, les<br />
groupes bénéficiaires des crédits de première génération encore redevables et affiliés à la<br />
COOPEC, ne peuvent prétendre à un nouvel emprunt tant que les premiers crédits ne sont<br />
pas remboursés intégralement.<br />
En ce qui concerne la province de I'Adamaoua, les fonds reçus par les IMF sélectionnés<br />
sont de 9.030.500 F CFÀ 5.530.785 F CFA et 7.843.050 F CFA, respectivement pour le<br />
CNCD, le CECR et I'ICBC<br />
L'intervention d'organisme financier tels que le FIMAC dans le domaine agricole, a eu<br />
un effet certain notamment dans I'Adamaoua où il a eu une intense activité.<br />
En outre, il ne faut pas perdre de we que l'éclosion du mouvement coopératif, suite à la<br />
promulgation de la loi sur les libertés d'association en 1990, à amené les agriculteurs à<br />
mieux s'organiser à travers les GIC et les Coopératives, et à améliorer, par conséquent,<br />
leurs productions agricoles. Ces groupements d'agriculteurs bénéficient très souvent du<br />
soutien des ONG et de I'Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun.<br />
À tES PRIX AGRICOI.ES<br />
Le suivi des prix des denrées agricoles est assuré par le système National d'Alerte<br />
Rapide (SNAR). Ce suivi concerne six produits alimentaires de base : le maïs, le miV<br />
sorgho, le manioc, l'igname, l'arachide et la patate. Les informations sur les prix et les<br />
stocks de ces denrées sur les marchés sont régulièrement collectées et diffitsées chaque<br />
semaine par la CRTV.<br />
Le prix moyen de ces produits durant le semestre allant de juillet à décembre 1998 est<br />
détaillé dans le tableau suivant :<br />
Tab n" ,l6 : Prix moyen des denrées alimentaires pendant la période juilletdécembre 1998 (F.CFA)<br />
Mois Juittet Aott Septembre Octobre Novembre Décembre Unité de Etalon de<br />
Cufture<br />
Poids mesure<br />
Mit/Sorgho 18.000 17.500 16.000 12.000 12.600 13.600 '100 kg ) Sac<br />
Arachide 35.000 32.000 28.000 20.250 19.000 26.400 90 kg )<br />
Manioc 12.000 12.OA0 9.500 9.250 9.000 8.700 70 kg )<br />
patate 400 300 20O 20O 2O0 200 4 kg ) tas<br />
lgname - - - - 1'000 1'000 9kg )<br />
Source : Délegation Provinciale de I'Agricutture (1@) ( Rapport Semestriel >, Ngaoundéré.<br />
N.B. : Pour ta patate, il s'agit des tas de 4 kg et de 9 kg pour I'igname. Le prix du mai's, du mil/sorgho sont ceux des sacs de<br />
10 kg, 90 kg pour l'arachide et 7O kg pour le manioc.<br />
Les prix des denrées agricoles fluctuent en fonction du calendrier de production. Ainsi,<br />
le prix du mais est plus élevé pendant les périodes de préparation (en mars et de culture<br />
aux mois d'avril et de mai) que pendant la période des récoltes (en octobre), où les prix<br />
chutent. C'est le cas également du miUsorgho, du manioc, dela patate et de I'igname. Par<br />
contre, le prix des arachides évolue aussi selon le calendrier agricole mais à contrario des<br />
autres produits. Ainsi, c'est au cours du mois de novembre, qui correspond à la période de<br />
jachère, que les prix sont les plus élevés. Alors qu'à la période des récoltes, aux mois de<br />
juillet et août, les prix atteignent leur plus haut niveau.<br />
Ici la loi commune de I'offre et de la demande explique les fluctuations des cours : une<br />
gestion des récoltes et des semis, bien organisés et préventifs pourraient stabiliser,<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,OGIC1l99 35 Féwier ffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
minimiser les écarts et enrayer la spéculation pernicieuse. Bien que répondant au même<br />
phénomène économique les variations de prix des autres intrants tels qu'engrais et<br />
insecticides paraissent tout de même plus anarchiques. En effet, le même engrais composé<br />
vendu à 11.000 CFA à Ngaoudéré atteindra au même moment 14.000 CFA à Banyo au<br />
Merzanga Ou bierç toujours à titre d'exemple, le même engrais simple (urée) coûtera à<br />
Meigan et Ngaoundéré 12.000 CFA et 9.000 CFA à Tibati mais I 1.250 CFA à Tignère. En<br />
ce qui concerne les insecticides, c'est la même chose : on peut rencontrer un écart pour le<br />
prix d'un même produit à I'intérieur d'une même ville : l'atrazine, peut être vendu entre<br />
1.650 F et 2.000 à Ngaoundéré mais 1.800 F à Meiganga - le kocide a un prix diftrant<br />
dans chaque ville : un sachet est vendu 450 F pour 50 kg à Banyo, 600 F pour 100 kg à<br />
Meiganga, 450 F pour 75 kg à Ngaoundété et 500 F pour 40 kg à Tibati...<br />
On peut supposer que le besoin diftre selon les villes ? mais la seule logique à rechercher<br />
est celle d'une solution : la prévision des besoins doit être évaluée et des réserves<br />
établies et même contrôlées de façon à permettre un accès uniforme de toute la province à<br />
ces produits de base. L'expérience du SNAR concernant les produits alimentaires pourrait<br />
s'étendre aux autres intrants tels que cultures commerciales, engrais, insecticides...<br />
Le tableau ci-après illustre de façon détaillée les fluctuations des prix des insecticides.<br />
Tab no 17 z Prix des insecticides dans la Province de I'Adamaoua<br />
Banvo Meiganga Ngaoundéré<br />
Cyperel 50<br />
Cyperel 12<br />
Actellic (2%)<br />
Actellic 50<br />
Etrofolan<br />
5.500 F/l<br />
16.000 F;<br />
5.s00 F/l<br />
16.000 F;<br />
7.OOO FA<br />
5.000/1<br />
7OO FA<br />
600 F/sachet de<br />
50 kg<br />
Decis<br />
Dursban<br />
lGraté<br />
9.000F/l<br />
12.000F4<br />
550Ffl de 50 ks<br />
Tab n" 1E : Prix dans la Province de I'Adamaoua<br />
Glypoxate<br />
Gramoxone<br />
Atrazine<br />
Rondup<br />
Diuron<br />
Mamba<br />
Primextra<br />
Ridomil pls<br />
Kocide 101<br />
Manèbe<br />
Thioral poudre<br />
Benlate<br />
9.000F/l<br />
12.000F4_<br />
Banyo Meiganga Ngaoundérê Tibati Tignère<br />
5.550F/l<br />
900F/sachet<br />
50 kg<br />
450F/sachet<br />
50 kg<br />
3.500F/kg<br />
5.500F/l<br />
5.000t
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
B. I.ES CONTRAIiITES I.IEES A I.'ACTIVITE AGRICOI.E<br />
Malgré le poids des potentialités évoquées ci-dessus, la production agricole dans<br />
I'Adamaoua est confrontée à de nombreuses difficultés. Le niveau rudimentaire de<br />
I'outillage agricole ne permet pas d'optimiser la rentabilité des sols généralement difficiles<br />
à travailler, mais qui possèdent un atout de taille : I'aptitude à la mecanisation ; même la<br />
culture attelée, en usage depuis fort longtemps au Nord et à I'Extrême-Nord, n'en est<br />
encore qu'à ses débuts ici. De surcroît, la main-d'æuwe est rare et chère : le sarclage d'un<br />
hectare de mais coûte, par exemple, plus de 30.000 F.CFA dans l'Adamaoua, alors que le<br />
même travail s'effectue à moins de 15.000 F.CFA dans le Nord. A ces carences fondamentales,<br />
constituant des freins puissants, s'ajoute une contrainte majeurq I'inaccessibilité<br />
aux intrants agricoles ; soit les prix élevés (parfois dus à la spéculation) rendent leur acquisition<br />
très difficile, soit leur indisponibilité est totale et bloque complètement la production.<br />
La commercialisation qui se trouve aujourd'hui libéralisée est aussi exempte de toute<br />
subvention. La concurrence, ici, pourrait permettre de stabiliser les prix. Mais l'absence de<br />
produits sur le marché les fait au contraire grimper : libéralisation et subventions sont à<br />
réexaminer et des moyens doivent être mis en æuwe pour éradiquer les spéculations<br />
nocives. Outre ces facteurs bloquants directement liés à la production agricole de façon<br />
organique, l'écoulement des produits constitue également un handicap sérieux. En effet,<br />
cette province fait partie des régions les plus enclavées du pays. A part les tronçons<br />
Ngaoundéré-Mbé et Ngaoundal-Tibati, tout le reste du réseau routier devient quasiment<br />
impraticable pendant la saison pluvieusg bloquant les produits dans les zones de<br />
productiorq paralysant la province, I'isolant du reste du pays, et privant le pays d'un<br />
échange vital de part et d'autre étant donné sa situation géographique de zone de transit<br />
entre le Nord et le Sud.<br />
Mais le bilan négatif ne s'arrête pas là. A ces blocages s'ajoutent ceux<br />
techniques, institutionnels, financiers, humains du fait des mentalités, du relationnel et des<br />
compétences :<br />
- Institutionnel : Le soutien aux structures d'encadrement en place par des moyens<br />
adéquats de fonctionnement et d'investissement est primordial. Mais tous les effiorts<br />
reunis pour préparer et réaliser les programmes d'informatioq de formatiorç de<br />
soutien et d'aide aux paysans du PNVA et des autres organismes du même type,<br />
deviennent caducs si l'un des maillons de cet ensemble de personnes, participant à un<br />
même objectif de travail, est rompu : c'est cependant le cas de certains agents<br />
d'encadrement qui refusent de se déployer dans les villages. Il faut en connaître la<br />
cause (sécurité ? mauvaise formation d'approche ? ...) et les moyens de motiver les<br />
individus (accueil préparé, formation relationnelle étudiée, responsabilisation,<br />
reconnaissance du rôle par des avantages ou salaires encourageants...) Il se peut aussi<br />
que la crainte d'être bloqué dans une zone enclavée soit aussi déterminante.<br />
- L'enclavement qui ne permet pas, problème majeur, les flux des produits, empêche<br />
également les mouvements des hommes : il ne suffit pas de bien former des , il faut aussi leur donner les moyens d'accéder aux diftrentes zones<br />
de production qui les attendent: l'aménagement des pistes de desserte et des<br />
principales voies de communication s'impose.<br />
- Humains : La gestion des ressources humaines est un problème de fond de toute<br />
production. Outre les personnes participant au plan de développement agricole, il y a<br />
lieu, par ailleurs, d'optimiser la mise en place du système du parcage, qui consiste à<br />
rassembler le bétail dans des enclos et à récupérer les matières fecales des animaux<br />
pour les redistribuer (recyclées en tant qu'engrais) aux agriculteurs, en réglant les<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRS1136,01r99 37 Février 2@
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
conflits agro-pastoraux. Il ne faut pas oublier que la province était une region à<br />
coutumes pastorales exclusivement, qui ont été bousculées par l'instauration de<br />
grandes zones de cultures végétales. Il y a lieu ici d'organiser, de réglementer, de<br />
mettre tous les moyens législatifs, humains et techniques en place pour permettre une<br />
bonne intégration et maintenir le développement de ces deux secteurs en parallèle.<br />
- techniques : les techniques employées, encore très rudimentaires, sont un frein majeur<br />
à la production et à l'économie : il y a lieu de mettre tout en æuwe pour doter la<br />
province de moyens techniques adaptés permettant d'optimiser la rentabilité.<br />
- Financier : Tout d'abord, la baisse des prix des intrants est fondamentale. Par ailleurs,<br />
bien que la province soit la première consommatrice, dans tout le pays, des crédits du<br />
FIMAC, il y a lieu de revoir sérieusement à la hausse les financements, encore très<br />
insuffisants, octroyés par cet organisme ; en effet, le financement est le cæur du système,<br />
les flux financiers sa vie : l'insuffisance ou le retard du renflouement conduit à<br />
la sclérose partielle ou étendue et à plus ou moins grande échéance à la dislocation du<br />
système.<br />
C. EI.EVAGE<br />
Les activités pastorales dans la province de I'Adamaoua reposent sur Ia Délégation<br />
Provinciale de I'Elevage qui comprend :<br />
- cinq secteurs localisés dans les chefsJieux des cinq départements (l.lgaoundéré,<br />
Meiganga, Tibati, Banyo et Tignère) ,<br />
- deux sections des pâturages et de I'hydraulique pastorale à Banyo et à Ngaoundéré.<br />
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAÀ4AOUA<br />
- Les éleveurs semi-sédentaires, en majorité Foulbé, établissent un campement fixe<br />
pendant la saison des pluies, et partent très souvent en transhumance vers les basfonds<br />
pendant la saison sèche.<br />
- Les éleveurs nomades, qui sont surtout M'bororo. C'est un groupe important qui se<br />
consacre intégralement à l'élevage, méprisant I'agriculture. Les M'boioro sont très<br />
mobiles et changent de lieux chaque fois que les pâturages ou les conditions d'existence<br />
ne leur conviennent plus. Leurs troupeaux produisent de la viande et du lait et<br />
peuvent supporter une transhumance de plus de 50 km.<br />
* Les ogro-postorqles j.<br />
C'est une catégorie qui pratique à la fois l'élevage et l'agriculture vivrière traditionnelle<br />
(mil, sorgho, manioc, patate douce, mais igname). ce groupé se compose de :<br />
- Les agro-pastoralistes proprement dit, qui pratiquent une activité agricole et pastorale<br />
d'égale importance pour les revenus de la famille. Ici, le surplus provenant des activités<br />
agricoles est investi dans l'élevage et il prend la forme d'une épargne de sécurité<br />
et de précaution. L'élevage des petits ruminants est relativement important dans ce<br />
groupe essentiellement composé de Foulbé sédentaires, des Bay4 des Waw4 etc.<br />
- Les agriculteurs avec l'élevage comme activité secondaire. C'est le groupe des cultivateurs<br />
par excellence qui sont par ailleurs propriétaires de bétail acheté avec le surplus<br />
provenant des activités agricoles. Les groupes ethniques les plus concernés ici sont les<br />
Baya,Ies Mboum et les Wawa établis dans les départements du Mbéré et du Djérem.<br />
Peuvent également laire partie de ce groupe, les Foulbés qui ont hérité de très peu<br />
d'animaux ou qui ont perdu beaucoup de tête de bétail du fait des maladies, les cultivateurs<br />
qui possèdent des chamres attelées. On estime que près de l5o du cheptel des<br />
bovins de la région appartiennent à ce système de production.<br />
* Les propriéloires de bétoilovec outres octivités non ooricores :<br />
On dénombre dans ce groupe :<br />
- Les éleveurs non résidents dans leurs exploitations, qui sont des gens riches ou ennoblis<br />
ou alors grands commerçants ou fonctionnaires qui investissent le surplus issu de<br />
leurs activités principales dans l'élevage. Ils sont propriétaires d'un cheptel important<br />
qui est élevé traditionnellement (par des bergers rémunérés) ou élevé dans les ranchs.<br />
La pratique de l'élevage par cette catégorie d'individus est davantage motivée par des<br />
considérations de prestige et d'épargne que comme moyen de génération de revenus<br />
supplémentaires. Du fait de leur statut social, les propriétaires ont très souvent de<br />
bons rapports avec les services d'élevage et les autres organismes impliqués dans la<br />
production animale. Environ 15 Yo de la population bovine de la région sont détenus<br />
par cette catégorie d'éleveur.<br />
- Les non-fermiers qui exercent l'élevage comme une activité secondaire. Ici, les activités<br />
pastorales sont relativement faibles. L'élevage des petits ruminants est davantage<br />
pratiqué pour I'occasion des festivités et autres suppléments alimentaires que<br />
pour créer des revenus additionnels. Les membres de ce groupe sont des fonctionnaires<br />
et des hommes d'affaires pour qui l'activité agricole est un succédané et qui<br />
pourraient faire de l'élevage pendant leur retraite.<br />
* Les propj_étoires des ronchs :<br />
A la différence de la catégorie précédente, les propriétaires des ranches sont des résidents<br />
et sont généralement dépendants des revenus de leurs exploitations. Ils sont en outre<br />
très impliqués dans la gestion quotidienne de I'exploitation.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRigDG,OlÆ9 39 Féwier2@
ETUDES SOCTG.ECONOMIOUES REGIONALÊS <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Iæ département de la Vina abrite le plus grand nombre de ranchs. pour I'ensemble de la<br />
regiorL il existerait entre 150 et 258 ranchs.<br />
Dans la région, l'élevage est pratiqué pour 977o sous forme extensive et 3Yo seulement<br />
intensivement : le caractère pastoral de la province est encore très influencé par les pratiques<br />
traditionnelles et n'a pas encore fait le pas vers les procédés plus élaborés comme en<br />
témoigne le faible taux d'élevage intensif relevé<br />
c. Effeclifs du cheplel<br />
L'élevage bovirç prédominant, est essentiellement du type extensif à semi-extensif. Les<br />
troupeaux circulent beaucoup, avec transhumances annuelles pendant la saison sèche.<br />
Les races bovines rencontrées sont des zébus, parmi lesquels le Goudali ou Peuhl ou<br />
Foulbé (type Ngaoundéré, Banyo et Yola), le M'bororo blanc ou White Fulani ou Aku et le<br />
M'bororo rouge ou Red Fulani ou Djafoun. Quelques éleveurs possèdent un nombre variable<br />
de métis divers issus de croisements avec le zébu Brahman en provenance du Texas et<br />
de la Floride ou avec les tarins charolais, Salers, Normand, Aolstein.<br />
A l'instar des autres régions du Grand Nord (Adamaoua et Nord), il est assez diffficile<br />
de donner une estimation exacte des effectifs du bétail dans la province de I'Adamaoua du<br />
fait de I'absence d'un recensement exhaustifl De ce fait, les données disponibles<br />
proviennent des campagnes de vaccination des services provinciaux de l'élevage, du calcul<br />
du nombre de bête par personne imposable ou alors de l'impôt sur les bovins. En général,<br />
les chiftes issus de ces sources sont toujours en deçà de la réalité pour plusieurs raisons :<br />
les éleveurs minorent toujours le nombre réel des animaux aux collecteurs des impôts, la<br />
vaccination n'est plus systématique, etc. En définitive, seule une campagne de recensement<br />
peut permettre de donner une réelle estimation des effectifs du cheptel à partir de certains<br />
paramètres zootechniques.<br />
Le cheptel animal de la province était estimé en 1997 à 1.700.000 bovins, 1.501.000<br />
caprins, 200.000 ovins, 250 équins, 150 asins, moins de 1000 porcins et 400.000 volailles.<br />
Cette production est en baisse continuelle depuis quelques années du fait de la forte<br />
demande émanant aussi bien des grandes zones de consommation que sont les provinces<br />
du grand Sud que de certains pays voisins.<br />
d. Typologie des pôfuroges<br />
On distingue dans la région 14 unités de végétation correspondant à des types de<br />
parcours. Quatre types de ces parcours correspondent à des pâturages de saison sèche<br />
tandis que le reste est constitué de diftrents autres pâturages de saison des pluies.<br />
Sur 7.000.000 ha de superficie totale des pâturages dans la Province 3.200.000 ha sont<br />
des pâturages assainis. Il n'existe pas de période d'interdiction de pâturage dans la région,<br />
mais des périodes de transhumance. Les zones les plus sollicitées sont celles des pâturages<br />
assainis et restitués.<br />
Les pâturages de saison sèche représentent des zones de transhumance de courte ou de<br />
longue distance. Les deux grands types de cette catégorie sont les suivants :<br />
- Les savanes herbeuses inondables des plaines comprenant les galeries forestières et<br />
prairies marécageuses, ainsi que les savanes herbeuses à inondation temporaire de<br />
longue durée.<br />
- Les végétations des terrasses basses des cours d'eau à inondation de plus ou moins<br />
longue durée, comprenant les deux sous-types suivants :<br />
. jachères et cordons tipicoles des terrasses basses ;<br />
MIN PAT / Proiet PN UD-OPS CMR/gtÆ6ro1 199<br />
40<br />
Février2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
. jachères des terrasses basses des petits cours d'eau à crues rapides.<br />
Les pâturages des saisons de pluies sont assez variés et déterminés par la nature du sol<br />
et la position topographique des stations... Ils sont paroourus pendant les huit mois que<br />
dure la saison des pluies. On distingue :<br />
- la végétation des savanes arbustives denses ou des forêts claires de pente ,<br />
- la végétation des savanes arbustives claires très perturbées ;<br />
- la végétation des cuirasses et des dalles inondables ;<br />
- lavégétation des zones dégradées par le surpâturages ;<br />
- les savanes densément boisées ou forêts de vallons encaissées comprenant les savanes<br />
arborées et arbustives qui comprennent trois sous-types.<br />
e. les molqdies
ETUDES SOCIO.ECONOMTOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Parmi les bovins généralement acheminés hors de la regiorL on estime à39% le nombre<br />
de castrés, 32a le nombre de taureaux et 29%o le nombre de vaches de réforme. Les castrés<br />
destinés à la boucherie sont les animaux les plus exportés de la province, étant les plus<br />
rentables.<br />
Le département du Mbéré est celui qui exporte le plus de tête de bétail suivi des départements<br />
du Djerem et de la Vina.<br />
La majorité des exportations de bétail se fait part le train (plus de 50 Yo) et dans une<br />
moindre mesure à pied ou par camion.<br />
Les villes de Yaoundé et Douala consomment en moyenne respectivement 45 et 40yo<br />
des animaux de la region. Quant aux villes de Bafoussam, Limbé, Ebolowa, Nkongsamba,<br />
Maroua, Garoua, elles reçoivent en moyenne 5 % à l0 % de la production de la province<br />
de I'Adamaoua.<br />
g. Des conlroinles ou développemenl de l'élevoge<br />
La coutume pastorale de la province, existant de longue date, a fait des bergers de la<br />
région une ((encyclopédie> de connaissances, d'expérience vécues, d'adaptatioq de gestes<br />
et d'automatismes tout à fait appropriés aux circonstances et particularités locales et aux<br />
contraintes de la région. L'activité pastorale, presque exclusive autrefois dans la province<br />
concerne maintenant moins de la moitié de la population : une main d'æuvre expérimentée<br />
se perd. Cette immense région, qui s'étend sur près dl I/6 du pays, ne comporte que 4Yo de<br />
Ia population : le développement de l'agriculture qui nécessite des ouvriers se fait aux dépens<br />
de la main d'æuwe pastorale. Il en est de même pour les quelques industries<br />
existantes.<br />
Tout d'abord, il y aurait lieu de développer une politique d'encouragement agricole qui<br />
freinerait les migrations, Ies activités parallèles et les agressions dans le pays (routès,<br />
transports, etc...) stabiliserait les tarifs exhorbitants pratiqués durant certaines périodes<br />
pour payer la main d'æuvre dans le traitement des cultures. Par ailleurs, il faut absolument<br />
protéger le potentiel végétal propre à l'élevage et le potentiel humairl en développant cette<br />
activité qui régresse, en maintenant la population, qui part vers d'autres activités plus<br />
rémunératrices et en introduisant et adaptant les méthodes modernes permettant d'optimiser<br />
la rentabilité en apportant des solutions aux contraintes freinant l'évolution. Il ne faut<br />
pas perdre de vue que l'élevage et les cultures sont de loin les principales ressources de la<br />
province et la principale production du pays<br />
Les facteurs de blocage qui nuisent au développement des activités pastorales dans la<br />
province de l'Adamaoua, nombreux, sont principalement :<br />
- La saison sèche qui s'étend de plus en plus. En effet, de 3 mois auparavant, la saison<br />
sèche est passée à 6 mois ; d'où un allongement de la période de transhumance.<br />
- Les conflits agro-pastoraux qui sont de plus en plus fréquents du fait d'une absence de<br />
délimitation entre les zones de pâturage et les zones de cultures.<br />
- L'absence de pratique de cultures fourragères : on estime à plus d'un milliard de<br />
FCFA, la somme investie par les pasteurs de [a région, chaque année, pour s'approvisionner<br />
en aliments de bétail dans la province du Nord.<br />
- La présence endémique de la mouche tsé-tsé en dépit des actions multiples entreprises<br />
pour son éradication.<br />
- Le coût élevé des tourteaux pour l'alimentation du bétail en période de soudure.<br />
- L'inorganisation des éleveurs ; les propriétaires de ranchs les
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Pro/ince de I'ADAMAOUA<br />
- La présence dans de nombreuses localités de la région des coupeurs de route.<br />
Les interventions à entreprendre pour redynamiser et promouvoir les activités d'élevage<br />
dans la province de I'Adamaoua doivent être orientées vers plusieurs axes outre le maintien<br />
d'une main d'æuvre expérimentée :<br />
. La production des cultures fourragères orientées vers les foins,<br />
. La construction des points d'eau pour l'alimentation du bétail,<br />
' La redynamisation de la lutte anti-glossines par l'utilisation des techniques alternatives.<br />
' une règlementation des zones de cultures et pâturage réglant les conflits agro-pastoraux.<br />
' Les mesures de sécurité à entreprendre pour permettre une circulation fluide.<br />
' LJne organisation palliant aux carences alimentaires en période de soudure.<br />
' Les encouragements à s'associer ou s'organiser pour améliorer la production et les<br />
conditions d'élevage.<br />
D. I.A PECHE<br />
En dépit de l'existence de nombreux fleuves tels que la Vina, le Djérem, le Faro ou le<br />
MbanL la pratique de la pêche demeure encore faibte. Cependant, il existe une station<br />
acquacole à Ngaoundéré, un centre d'alevinage à Tignèrg à Banyo et à Meiganga. De plus,<br />
on recense également, dans la région, un centre de pêche à Mbakao dans le département du<br />
DjéreûL un poste de contrôle de pêche dans la même localité et dans la ville de Tibati. il<br />
n'existe pas encore d'embarcadères.<br />
Actuellement, on dénombre 2l embarcations motorisées pour un effectif de pêcheurs<br />
évalué à 2.800 individus localisés surtout dans le département du Djerem.<br />
La pêche continentalg la plus pratiquée dans la région est actuellement développée dans<br />
les départements du Djérem et du Mayo Banyo. Dans le département du Djérem, elle est<br />
pratiquée dans la retenue d'eau du barrage de Mbakao dont I'aire totale est estimée à<br />
20.600 ha. C'est plus tard qu'elle s'est étendue dans le département du Mayo Banyo avec<br />
Ia création du barrage de la Mapé en 1987 et du Centre de pêche construit en bordure du<br />
fleuve.<br />
On estime à 2.6 milliards de m'd'eau et à près de 6.000 tonnes de poissons les capacités<br />
du barrage de lvlbakao. Les espèces sont nombreuses dont le tilapia, les capitaines, les<br />
clarias, etc.<br />
Les seules données sur la production que nous avons pu obtenir des services compétents<br />
de la pêche dans la region remontent à 1990 : elles indiquent une production de 1470 kg de<br />
poisson frais en 1990 contre lO75 kg en 1989.<br />
La province de I'Adamaoua possède des structures de développement de la pisciculture.<br />
La station aquacole de Ngaoundéré a l0 bassins actifs, 6 bassins non exploitables à cause<br />
du tarissement de la source d'eau en saison sèche et un étane domanial actif d'une<br />
superficie de 1.500 m2.<br />
En dehors des activités liées à I'empoissonnement dans les étangs, à la récupération des<br />
fientes et à I'achat du matériel pour la relance des activités, la station de Ngaoundéré<br />
encadre également les pisciculteurs ruraux. Quant aux centres d'alevinage de Banyo,<br />
Tignère et Meiganga, ils fonctionnent en deça de leurs potentialités du fait de I'absence de<br />
moyens financiers et humains.<br />
MINPAT / Projet PNUO-OPS CMR,SO6I|C1/t99 43 Février 2@
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
A ce jour, on évalue à 208 le nombre d'étangs dans toute la région (hormis la localité de<br />
Banyo) et à l42le nombre de pisciculteurs. Quant aux alevins, on estime à 2.500 leur<br />
nombre en 1998.<br />
Les raisons évoquées pour justifier le faible développement de la pêche dans la province<br />
de I'Adamaoua sont nombreuses. Parmi celles-ci, on cite généralement :<br />
- la relative pauvreté des cours d'eau en poissons ;<br />
- le nombre limité de personnel d'encadrement dans les services de la Pêche de la<br />
région,<br />
- I'insuffisance de moyens matériel pour assurer le contrôle de la production ;<br />
- le non-respect de la réglementation par les pêcheurs ,<br />
- le peu d'engouement manifesté par la population à l'endroit des activités halieutiques;<br />
à cet égard, cette activité est plus de 80Yo maîtrisée par des étrangers en majorité<br />
nigérians.<br />
- I'insuffisance d'équipements des pêcheurs nationaux.<br />
Le développement de la pêche dans la province de I'Adamaoua implique que soient<br />
levés la plupart de ces obstacles.<br />
Les cours d'eau sont pauvres, mais les barrages sont très porteurs et les étangs sont<br />
poissonneux.<br />
Il y a, en gros, deux problèmes majeurs : les hommes et les équipements.<br />
Tout d'abord, Ies hommes à former en vue d'encadrer les services de pêche défaillants<br />
de la région et pour faire respecter les réglementations, et des hommes à motiver pour les<br />
orienter vers cette activité prometteuse.<br />
Par ailleurs, le matériel de contrôle de production et les équipements sont à installer<br />
pour permettre un déroulement fructueux de I'activité.<br />
Il y a lieu aussi de relancer les centres d'alevinage de Banyo, Tignère et Meiganga en<br />
les renflouant en movens humains et financiers<br />
E. TORET EI ENVIRONNEMENT<br />
A I'instar des autres régions du Cameroun, la forêt dans la province de l'Adamoua est<br />
une formation naturelle plus ou moins protégée, ou soumise à une exploitation par<br />
l'homme.<br />
Les aires protégées sont constituées par des parcs nationaux et des réserves forestières.<br />
- Les parcs nationaux ont des réserves de faune, des zones d'intérêt cynégétiques, des<br />
gaines-ranchs, etc. appartenant à I'Etat. L'Adamaoua ne dispose pas à proprement<br />
parler des parcs nationaux mais partage avec les autres régions certains parcs, à<br />
I'exemple du Parc National de Faro dont la partie Sud-Ouest est située dans le<br />
département du Faro et Déo.<br />
- Les réserves forestières sont des espaces écologiques intégraux, des forêts de production<br />
ou de protection ou alors de recréation. Le périmètre de reboisement de<br />
Ngaoundéré est la toute première réserve de la région, mise en place par arrêté n" 181<br />
du 31611947l D'autres reboisements domaniaux existent à Meiganga depuis 1955, à<br />
Tignère en 1956 et à Mayo Darlé.<br />
Il faut dire que seule la réserve forestière de Ngaoundéré a pu résister aux érosions<br />
anthropiques, bien qu'elle soit, elle aussi, aujourd'hui menacée de destruction, du fait<br />
surtout de la proximité par rapport au centre urbain.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/W,rO6rOll99 44 Féwier ffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Prorince de I'AOAMAOUA<br />
En 1998, des projets de creation de nouvelles aires protégées ont été initiés et transmis<br />
au Ministère de I'Environnement et des Forêts. Il s'agit :<br />
- Dans le département du Faro et Déo :<br />
. Guen Talaba : 203.136 ha<br />
. Didéi:<br />
109.184 ha<br />
. Tchabal Galnidaba : l7l.392ha<br />
- Dans le département du Mbéré, deux zones pour 200.000 ha environ.<br />
Les problèmes environnementaux qui se posent dans la province de I'Adamaoua sont<br />
les suivants :<br />
- feux de brousse et leurs conséquences néfastes sur la nature ;<br />
- conflits agro-pastoraux et leurs impacts sur I'environnement ;<br />
- coupes anarchiques de formations végétales ;<br />
- empoissonnement des cours d'eau et destruction de la biodiversité aquatique ;<br />
- érosion naturelle et anthropique.<br />
Pour faire face à tous ces problèmes, les Services Provinciaux de I'Environnement<br />
æuwent essentiellement dans le domaine de la sensibilisation du public sur la nécessité de<br />
protéger I'environnement. L'insuffisance des moyens logistiques et humains mis à leur<br />
disposition ne leur permet pas d'assurer un contrôle adéquat et minutieux des activités<br />
environnementales.<br />
o. l'exploitqtion du bois<br />
Elle est embryonnaire et anarchique en dépit de la cession par l'Etat des assiettes de<br />
coupe à des exploitants connus. On déplore la tendance des ressortissants des pays voisins<br />
à abattre systématiquement les arbres qu'ils débitent de nuit dans le domaine public de<br />
l'Etat.<br />
Même certains reboisements de pins sont abattus et débités en chevrons, lattes, planches<br />
et autres madriers.<br />
La région étant essentiellement une zone de savane, c'est davantage I'exploitation de<br />
bois aux fins de chauffage qui est la plus importante. En effet, le bois de feu est la<br />
principale source d'énergie domestique de la région tant en zone urbaine qu'en milieu<br />
rural. Aussi, les déboisements se font-ils donc par cercles concentriques autour des<br />
principales agglomérations urbaines.<br />
b. [o flore el lcrune<br />
L'importance de la flore dans la province de l'Adamaoua tient à la situation particulière<br />
de cette région dans la transition forêt-savane. On y trouve des espèces appartenant à la<br />
forêt et à la savane. C'est donc une zone de grande diversité biologique comprenant, dans<br />
sa partie Sud, des lambeaux de la forêt sud-camerounaise où prédominent certaines<br />
exploitables telles que I'Ayous, l'Iroko, le Bibolo, le Fraqué... Dans la partie<br />
"rré.r"", Centrale, existent de vastes plateaux couverts de graminées et entrecoupés de forêts<br />
galeries. La partie Nord est le domaine de la savane soudano-guinéenne où vivent le genre<br />
< isoberlinia )) et la famille des < anomacées >. En ce qui concerne la faune, parmi les<br />
mammiferes, on y rencontre des éléphants (de savane et de forêt), des buffles, des lions,<br />
des hippopotames, etc.<br />
MINPAT / Proiet PNUO-OPS CMRrSO6O1r99 45 Février2@
:<br />
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IAOAMAOUA<br />
c. les lecettes de lq forêl el de lo foune<br />
Au cours de I'exercice 1997198, les recettes des forêts et de la faune se présentent<br />
comme suit :<br />
Tab n" 19 : Recette de la faune<br />
O1érem-<br />
: : . 3î3:333 3î3 333<br />
_ 14.167.900 14.167.900<br />
22.500 12.000 12.5OO 74.000<br />
69.500 300.000 18.000 23.000. 80.000 778.000<br />
Droits de permis<br />
Timbres<br />
Ta>
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Le secteur industriel est représenté par :<br />
- La MAISCAM (Société de Maisserie du Cameroun) qui produit et transforme du<br />
maïs, du soja et du tournesol en farine, huiles tourteaux... Son promoteur est I'homme<br />
d'affaires Alhadji Abbo Mohamadou.<br />
- La SOGELAIT, spécialisée dans la fabrication des produits laitiers, ne parvient pas à<br />
satisfaire la demande. Elle éprouve aussi beaucoup de difficultés dans son approvisionnement<br />
en lait, matière première par excellence de son activité.<br />
- La source de miel de Mbeng à Meiganga ;<br />
- [æs boulangeries-pâtisseries et les menuiseries (près de70 o/o du secteur) ;<br />
- I^a TANICAM (Société des Tanneries du Cameroun) qui s'occupait du traitement des<br />
peaux et cuirs. Elle a déposé le bilan. Elle vient d'être achetée par des particuliers et<br />
ses activités reprennent timidement.<br />
S'agissant de la SOGELAIT, elle est issue de la privatisation du Projet Laitier Pilote de<br />
Ngaoundéré. Le capital social de la SOGELAIT se compose comme suit :<br />
- 5l % pour la Compagnie Financière appartenant à I'Industriel James Onobiono<br />
(propriétaire de SITABAC) ;<br />
- 35 % appartenant aux éleveurs,<br />
- lO Yo à l'Etat,<br />
- 4 % à Pelmant International qui est une société canadienne.<br />
Le secteur du commerce et de I'industrie est confronté à un certain nombre de problèmes,<br />
notamment :<br />
- le ralentissement des activités dû à la recrudescence du phénomène des coupeurs de<br />
route ;<br />
- I'insuffisance du réseau bancaire qui induit le premier problème ;<br />
- la contrebande et la fraude douanière ;<br />
- la propension des opérateurs économiques à la facilité, à I'enrichissement rapide et<br />
même à la fraude,<br />
- le manque de financement, d'imagination et de goût du risque.<br />
Dans le contexte actuel de crise économique et de libéralisation, la plupart des opérateurs<br />
économiques souhaitent le retour au contingentement voire la prohibition de certains<br />
produits pour sauver I'industrie régionale et sauvegarder des emplois.<br />
C. I.E TOURISME<br />
En dépit de son climat doux, de ses multiples sites touristiques, de la diversité et de la<br />
richesse de son patrimoine culturel, la Province est mal lotie en matière d'hôtellerie et de<br />
tourisme.<br />
L'infrastructure hôtelière est constituée essentiellement de trois hôtels classés<br />
(TRANSCAM-HOTEL, HOTEL DU RAIL, HOTEL RELAIS tous à Ngaoundéré) d'une<br />
capacité totale de 120 chambres pour 150 lits et d'une vingtaine d'auberges non classées<br />
disséminées à travers la Province.<br />
Quelques agences de voyages et de tourisme exercent leurs activités dans la Province,<br />
mais généralement implantées dans la ville de Ngaoundéré. Il en est de même des<br />
établissements de tourisme.<br />
Des manifestations historico-touristiques telles que les festivals des NYEM-NYEM de<br />
Galim - Tignère et du Lamidat de Ngaoundéré draînent souvent dans la Province beaucoup<br />
de touristes.<br />
MINPAT / Projet PN UD-OPS CMRrSrffirOl 199 47 Février2ffi<br />
rI
ETUDES SOCTGECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
conflits agro-pastoraux. Il ne faut pas oublier que la province était une région à<br />
coutumes pastorales exclusivement, qui ont été bousculées par I'instauration de<br />
grandes zones de cultures végétales. Ll y a lieu ici d'organiser, de réglementer, de<br />
mettre tous les moyens législatifs, humains et techniques en place pour permettre une<br />
bonne intégration et maintenir le développement de ces deux secteurs en parallèle.<br />
- techniques : les techniques employées, encore très rudimentaires, sont un frein majeur<br />
à la production et à l'économie : il y a lieu de mettre tout en æuvre pour doter la<br />
province de moyens techniques adaptés permettant d'optimiser la rentabilité.<br />
- Financier : Tout d'abord, la baisse des prix des intrants est fondamentale. Par ailleurs,<br />
bien que la province soit la première consommatrice, dans tout le pays, des crédits du<br />
FIMAC, il y a lieu de revoir sérieusement à la hausse les financements, encore très<br />
insuffisants, octroyés par cet organisme ; en effet, le financement est le cæur du système,<br />
les flux financiers sa vie : I'insuffisance ou le retard du renflouement conduit à<br />
la sclérose partielle ou étendue et à plus ou moins grande échéance à la dislocation du<br />
système.<br />
C. EI.EVAGE<br />
Les activités pastorales dans la province de I'Adamaoua reposent sur la Délégation<br />
Provinciale de l'Elevage qui comprend :<br />
- cinq secteurs localisés dans les chefs-lieux des oinq départements (Ngaoundéré,<br />
Meiganga, Tibati, Banyo et Tignère) ;<br />
- deux sections des pâturages et de l'hydraulique pastorale à Banyo et à Ngaoundéré.<br />
o. Présentotion<br />
Dans la province de l'Adamaoua, les activités pastorales et agricoles entretiennent des<br />
rapports complexes de complémentarité et de concurrence, tant au niveau du système de<br />
production qu'à l'échelle de I'espace régional. Environ 50 à 52 o de la population rurale<br />
de la région pratiquent I'agriculture sans faire de l'élevage bovin. Cependant, la plupart des<br />
éleveurs sont aussi agriculteurs. On estime le nombre d'éleveurs à 20 % de la population<br />
rurale.<br />
La province de I'Adamaoua a de longue date, une vocation pastorale. Elle possède 28 Yo<br />
du cheptel national de bovins, 5 Yo du cheptel ovins et 2.3 % du cheptel caprins alors<br />
qu'elle ne représente que 4 Yo de la population totale du pays. Elle produit 24 yo de la<br />
production nationale de viande et 38 yo de la production nationale de viande de bæuf. Les<br />
activités pastorales de la province sont en grande partie basées sur l'élevage bovins (77%).<br />
b. les différents lypes d'élevoge<br />
Dans la province de l'Adamaoua, on distingue les différents types d'élevage suivants :<br />
* Les postorqlisies :<br />
Ce sont des éleveurs qui ont une activité traditionnelle de bovins à plein temps, avec<br />
peu ou pas d'activité agricole. On estime que 30 à 65 Yo du cheptel est détenu par cette<br />
catégorie. On peut citer dans ce groupe :<br />
- Les éleveurs sédentaires, qui sont généralement les foulbés. Ils associent à I'activité<br />
pastorale I'agriculture de subsistance qui est assurée par une main d'æuvre rémunérée.<br />
Font également partie de ce groupe, les pasteurs M'bororo du département du<br />
Djérem.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SO6rO1l99 38 Février2@
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
E. BANQUES<br />
Le réseau bancaire de la province de I'Adamaoua est réduit à la seule ville de<br />
Ngaoundéré où sont implantées les agences de la Banque Credit Lyonnais du Cameroun<br />
(SCB-CLC) et de la BICEC. De ce fait, les populations des localités autres que<br />
Ngaoundéré sont contraintes de transporter sur elles mêmes de fortes sommes d'argent,<br />
d'où les problèmes d'insécurité et le développement du phénomène des < coupeurs de<br />
route >.<br />
t. REVEIIIUS<br />
Sur la base des données recueillies sur le terrain et des résultats d'une enquête (SI{V,<br />
1995), il ressort que :<br />
- 75% des exploitations de la région liwent leurs productions agro-pastorales sur le<br />
marché; en conséquence, un quart de ladite production est autoconsommée : les<br />
agriculteurs et les éleveurs de la region produisent essentiellement pour la commercialisation<br />
mais compte tenu de la faible densité de populatior4 la production devrait<br />
générer une plus grande proportion destinée à la commercialisation.<br />
- Les revenus bruts issus de la vente des produits agricoles représentent 8l o du total<br />
de la région. L'Adamaoua est surtout une province agricole ce qui s'explique par<br />
deux raisons prédominantes : les maigres possibilités en dehors de ce secteur, et les<br />
très fortes potentialités offertes par l'agriculture dans la province.<br />
- Le revenu brut moyen par exploitation est de 167.000 F.CFAT en deçà de la moyenne<br />
nationale. Toutefois, les départements du Mbéré et du Mayo-Banyo apparaissent<br />
comme des greniers de la région avec des revenus par exploitation largement<br />
supérieurs à la moyenne nationale.<br />
- Si le revenu par actif agricole ( en moyenne 50.000 F.CFA) est inferieur à la moyenne<br />
nationale, l'éleveur de la région a un revenu de 71.000 F.CFA ce qui dépasse de loin<br />
la moyenne nationale qui n'est que de 29.000 F.CFA. Cette richesse relativement<br />
importante est le résultat de l'exploitation de l'élevage bovin pour lequel la région<br />
dispose d'un réel avantage comparatif<br />
On estime entre 17 et 20 milliards de F.CFA constants de 1993, le chiffre d'affaires<br />
annuel réalisé par le secteur de l'élevage de la province de l'Adamaoua" alors que les activités<br />
de pêche procureraient un revenu de plus de 2 milliards de F.CFA constants de 1993.<br />
En définitive, la province de I'Adamaoua dispose de potentialités économiques faiblement<br />
ou mal exploitées. Les axes d'interventions futures consistent davantage au désenclavement<br />
de la région par la construction ou l'aménagement des voies de communications<br />
afin de lever le retard économique de la province par rapport aux régions du Sud et du<br />
Nord. Du fait des particularités qu'elle recèle en tant que ( château d'eau > du Cameroun<br />
et zone de prédilection de l'élevage bovirq la province de I'Adamaoua devrait retenir<br />
davantage l'attention des autorités publiques pour la protection des espèces végétales et des<br />
sols : les terrains déjà peu riches en humus et éléments organiques de part leur constitution<br />
de base sont appauvris par I'utilisation peu vigilante et mal informée des zones fertiles.<br />
Afin de ne pas hypothéquer les productions futures, un équilibre entre l'utilisation et la<br />
protection des diftrentes ressources doit être établi.<br />
Plus fondamentalement, la mise en place d'un schéma d'aménagement de la province de<br />
l'Adamaoua permettrait une exploitation judicieuse des potentialités économiques de la<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRiS/O6,O1 199<br />
49<br />
Février2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
I. TES MARCHES ET tES ECHANGES COMMERCI<strong>AU</strong>X<br />
L'Adamaoua, vaste région, connaît un problème d'enclavement, comme nous I'avons<br />
déjà soulignés, très important de ses départements. C'est une contrainte majeure aux flux<br />
d'échanges qui freinent le développement économique de la region. Les marchés et les<br />
echanges commerciaux y sont peu développés et son tissu industriel est encore très<br />
embryonnaire.<br />
L'économie de l'Adamaoua a essentiellement pour ossature l'élevage, I'agriculture et le<br />
commerce. Son développement se heurte, entre autres, aux difficultés de transit qui<br />
bloquent l'évacuation des produits dans leur zone de production. Ainsi, une des priorités<br />
serait la construction de sa dorsale Nord-Sud par les voies suivantes :<br />
l. Douala - Yaoundé - Yoko - Tibati - Ngaoundéré.<br />
2. Douala - Bafoussam - Foumban - Banyo - Ngaoundéré.<br />
3. Douala - Yaoundé - Bertoua - Garoua - Boulai - Meiganga - Ngaoundéré,<br />
et I'entretien des voies de communication déjà existantes qui faciliteraient l'écoulement<br />
des ressources agricoles et d'élevage vers les centres de consommation. Il en résulterait un<br />
rehaussement du niveau de vie des paysans réduit à l'état de pauvreté absolue, alors que<br />
plus de la moitié des récoltes pourrit sur place à cause de I'enclavement. Cela entraînerait<br />
également un accroissement du flux de personnes et aussi d'autres biens à l'intérieur de la<br />
région et avec les autres provinces et induirait I'intégration de I'Adamaoua à l'ensemble du<br />
pays<br />
Pourtant, en dehors des transports maritimes absents dans la province, tous les types de<br />
transport (fenoviaire, aérien et routier) existent. Mais seules les infrastructures ferroviaires<br />
donnent la cadence à la vie économique dans I'Adamaoua, avec toutes les répercussions<br />
que peuvent avoir sur I'usager un réseau désuet, surchargé à l'extrême, subissant des<br />
< déraillements ) à la fois sur les voies ferrées et dans les comportements sociaux (vols,<br />
attaques...). Les trafics routiers d'abord et aériens ensuite sont présents, mais réduits aux<br />
maigres possibilités qu'ils offrent.<br />
Ngaoundéré, capitale provinciale, ville de transit et de relais, carrefour international,<br />
terminus du réseau ferroviaire trans-camerounais et dotée d'une aérogare possède les<br />
atouts qui justifient son titre, mais ne joue que très timidement son rôle de catalyseur de<br />
l'activité économique régionale.<br />
C'est certes dans cette ville que le commerce général est le plus représenté et que le<br />
commerce spécialisé se développe progressivement, mais le niveau de l'échange est plus<br />
celui d'une petite ville de province. Il en est de même pour le secteur bancaire qui n'existe<br />
qu'à Ngaoundéré, mais est réduit à quelques agences (BICEC et SCB-CL). Les infrastructures<br />
hôtelières sont présentes, ainsi qu'une école de formation spécialisée dans ce<br />
domaine.<br />
Cependant, I'université, les activités de panification et de pâtisserie, I'ouverture aux<br />
pays voisins de même milieu physique, de même peuplement, de même culture, concourent<br />
à animer un frissonnement d'échanges de marchandises, de brassage de population et à<br />
dynamiser le flux commercial. Cette province sera loin d'être développée tant qu'elle ne<br />
sera pas dotée d'un système fonctionnel et permanent favorisant les communications et les<br />
échanges entre ses différentes villes (zones de consommation) et les diffFerentes zones de<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,06/O1199<br />
50<br />
Février2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Provincæ de I'ADAMAOUA<br />
production. Par ailleurs, les longues distances entre les diftrentes villes sont un frein aux<br />
relations inter-urbaines.<br />
Mais aussi, I'organisation et la structure des marchés de cette province ne sont pas, en<br />
général, de nature à promouvoir le développement socio-économique de la région.<br />
A I.ES PRINCIP<strong>AU</strong>X MARCHES DE I.A PROVINCE DE I'ADAMAOUA<br />
On distingue trois catégories de marchés dans I'Adamaoua :<br />
- Les marchés stables ou pennanents, ou les marchés de consommation<br />
- Les marchés de production ou marchés saisonniers<br />
- Les marchés de production et les marchés de consommation.<br />
o. les mqrchés de consommqlion<br />
Ce sont les marchés de vente en gros, en détail et de grande consommation. La province<br />
est réputée très pauvre et seule la ville de Ngaoundéré, par sa forte population, son rôle de<br />
capitale provinciale, la taille de ses infrastructures, ses nombreuses écoles, collèges et<br />
lycées, son Université, la forte densité de son trafic ferroviaire, reste le seul creuset<br />
d'importants flux de produits, de personnes et de biens. A cet effet, elle est le seul marché<br />
de consommation permanent dans la région. Aucune des principales villes de ses<br />
départements ne la seconde dans ce rôle : les produits sont acheminés tant bien que mal<br />
jusqu'à la capitale, lorsqu'ils y arrivent et sont ensuite reversés au niveau régional et au<br />
delà. La polarité est trop forte et il y aurait lieu de favoriser et développer le rayonnement<br />
en libérant la capitale provinciale d'une partie de ce poids sur les principales villes des<br />
autres départements. Des structures devraient être établies en ce sens.<br />
Seul marché stable, Ngaoundéré va centraliser les plus importants flux des zones de<br />
production (départements, arrondissements, districts et villages). Sur ce marché quotidien,<br />
on pratique des ventes en gros et en détail, les produits agricoles sont acquis auprès des<br />
producteurs locaux, sont mis en sacs, regroupés et stockés dans les magasins. Plate-forme<br />
des échanges commerciaux, c'est de là que vont vers les autres provinces et pays<br />
limitrophes une quantité importante des produits stockés.<br />
Il y a donc des stocks énormes. Cependant, les marchés de Ngaoundéré manquent de<br />
vrais magasins de stockage de produits. Il n'y a ni construction, ni équipements minimum:<br />
les abris sont quelconques, le système de sécurité y est précaire et il n'existe pas d'unité<br />
médicale pour parer aux urgences.<br />
b. les morchés de produclion el de consommcrtion<br />
Ce sont des marchés de type intermédiaire. Ils ne sont ni totalement stables, c'est-à-dire<br />
permanents, ni entièrement saisonniers. On les trouve dans les chefs-lieux de département<br />
Leurs structures urbaines sont bien en place, le niveau de leurs équipements est acceptable,<br />
leurs populations assez importantes et ils jouent des rôles administratifs et politiques. On<br />
en trouve donc à Banyo, Bankim, Tibati, Meiganga, Tignère. Les villes secondaires qui se<br />
livrent aux activités agricoles et pastorales, disposent des marchés quotidiens et hebdomadaires.<br />
Les produits collectés auprès des ruraux producteurs s'ajoutent aux leurs pour<br />
constituer des stocks destinés au marché stable provincial en grande partie, tandis qu'une<br />
infime partie est consommée localement.<br />
La majorité de ces marchés ne sont ni construits, ni équipés et ils ne disposent pas de<br />
système de sécurité. Par ailleurs, aucune banque n'existe dans ces chefslieux de département<br />
pour rassembler les flux monétaires et assurer une certaine sécurité aux marchands<br />
entre les mains desquels passent beaucoup de liquidités d'argent.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRrS/06rOi/99 51 Féwier2ffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
c. tes morchés sqisonniers<br />
Ce sont les marchés de production; on les trouve dans tous les arrondissements et<br />
chefsJieux de district et même dans les villages. Leur caractéristique première est la très<br />
faible taille de consommation locale, leur tissu commercial étant assez réduit. Ces marchés<br />
sont des lieux de collecte qui se tiennent une ou deux fois par semaine fiour de marché).<br />
Des circuits de commercialisation des produits s'y développent malgré la précarité des<br />
moyens de communication.<br />
D'ailleurs, certains de ces marchés produisent exclusivement pour la commercialisation.<br />
C'est ainsi que Mbe produit des ignames dont 90olo sont destinés pour le marché. Dans le<br />
département de Mbéré, le manioc produit est commercialisé presqu'à 85% à l'intérieur de<br />
la province alors que dans le Faro et Déo, l'arrondissement de Mayo Baleo produit les<br />
arachides, le maïs et le sorgho pour la vente (80%). Par contre, la production du sorgho est<br />
destinée à la consommation locale. Il y a lieu de noter que Ngaoundéré, bien que seul<br />
grand marché de consommation de la province, produit également, surtout du maïs, pour le<br />
vendre dans la partie Sud du pays.<br />
Les principaux marchés de production sont :<br />
- Mayo-Darlé<br />
- Galim-Tignère<br />
- Mayo-Baléo<br />
- Kontcha<br />
- Mbe<br />
- Dibi<br />
- Dir<br />
- Belel<br />
- Djohong.<br />
Toutes leurs productions, après avoir alimenté les marchés locaux convergent vers<br />
Ngaoundéré, principal pôle de consommation et de redistribution en direction des autres<br />
provinces tel que I'indique la carte des principaux marchés. Malheureusement,<br />
I'inaccessibilité de la plupart des zones de production de l'Adamaoua" du fait de la nonviabilité<br />
des pistes de collecte entraîne le pourrissement sur place d'une bonne partie des<br />
produits et fausse toute exploitation statistique.<br />
La période de la récolte connaît un accroissement du flux. Les plus importants flux<br />
varient avec les saisons.<br />
Si les paysans étaient mieux organisés et avaient Ia possibilité de stocker leurs produits,<br />
les cours de certains intrants connaîtraient de moins fortes fluctuations et les coûts finaux<br />
seraient plus rémunérateurs et engendreraient de surcroît une meilleure qualité de vie des<br />
producteurs.<br />
Le mauvais état des routes, la présence des monopoles dans I'achat et la consommation<br />
et les spéculations, sont une contrainte majeure pour cette province.<br />
d. tes produclions por morché<br />
Dans l'ensemble, les zones rurales productrices regroupent leurs produits vers leurs<br />
chefs-lieux respectifs, qui à leur tour convergent la production stockée sur Ngaoundéré. On<br />
trouvera :<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SrO6,,101199 52 Févrierffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
- Les produits viwiers constitués du mai's, du mil, du sorgho, du manioc, de la patate<br />
douce, des ignames, du macabo, du taro, de la banane plantain, des arachides, des<br />
oignons.<br />
- Les produits de rentes : le cafe robusta, le coton.<br />
- Les maraîchers et les produits fruitiers (chou, carottes, gombo, tomatg pastèque,<br />
piment, les mangues, les goyaves, les avocats).<br />
- Sur le plan de la commercialisation de ces produits, le manioc avec une forte<br />
production (109 088 tonnes en 96/97) est le plus prisé. C'est I'une des activités<br />
principales de la population de Méré.<br />
- Le mars est le deuxième produit très sollicité sur le marché. Avec un tonnage de 60<br />
ll5 T, la production couwe les besoins en consorlmation de la région. Son circuit<br />
public de commercialisation est la Société MAISCAM.<br />
- t e mil et le sorgho dont la culture couwe I'ensemble de la province sont produits<br />
pour une consommation locale. Sa commercialisation est interurbaine. Avec 26 425 T<br />
produits en 96197, ils occupent la 4ème position ; tvlbé cultive 90Yo de la production,<br />
destinée à la commercialisation.<br />
- La patate douce est également très échangée dans la province.<br />
- Les cultures de rente comme le cafe robusta, sont cultivées à Bankim et à Mayo-Darlé<br />
dans le département de Mayo-Banyo. Son faible tonnage (327 T) ne lui donne aucune<br />
grande envergure commerciale. Caplanoun à Foumban est son partenaire commercial.<br />
- Le coton est faiblement cultivé dans la province et seule la ville de Mbé et Dini dans<br />
une moindre mesure le cultive. La Sodecoton à Garoua est son principal circuit de<br />
commercialisation public. Son tonnage est 753 T en96/97.<br />
S'agissant des marchés des produits de l'élevage dans l'Adamaoua> zone de predilection,<br />
le cheptel composé de bovins, de caprins et d'ovins compte I 700 000 têtes de<br />
bovins, 1 501 000 caprins, 200 000 ovins, 250 équins, 150 asins, près de 1 000 porcins et<br />
400 000 volailles.<br />
- La production halieutique est orientée vers les marchés du Sud et de I'Extérieur du<br />
pays. En échange, I'Adamaoua consomme les pommes de terres de I'Ouest.<br />
- Le maïs du Mayo-Rey (province du nord) estimé à 1,35 t/jour.<br />
- Les arachides de Ngang (localité de la Bénoué dans le Nord) pour 3,l6Vj.<br />
- Les tonnages sont extrêmement variables.<br />
e. Rôle des m
PRINCIP<strong>AU</strong>X II/IARGHES A BETAIL ET<br />
DE PRODU|TS AGRTCOLES (1e99)<br />
I<br />
o r| rotcu<br />
&n],o<br />
@o<br />
\ Srrùobh<br />
@<br />
)<br />
,or)'<br />
I<br />
@ .-j'**<br />
TlgrÈra<br />
o<br />
ll'dl<br />
Mal*u<br />
@ .l*'<br />
@o<br />
ïbdr<br />
qiô<br />
rl<br />
Ngaounth{<br />
.o @(l ,:* Kalel<br />
I qp o''qi<br />
i o,(D @ u"iow"<br />
Prircipaux marctrdr:<br />
O t{arci6rdcprodrtion<br />
O irhrchârdocoraornma$on<br />
O<br />
À,lrætté! do Fod.,cdon a oe consornmatlon<br />
Princlpaû<br />
@ marchd! dc glos à bétâil<br />
@'H#*#nbm*;*"<br />
Ptod'ftiyr! agrlcûlor<br />
A Mab, mit, ot lorgho<br />
Fdb hç<br />
+ ffiiffiffii#ff;,.,"<br />
,a tu A, câ{é<br />
* coton<br />
NGAOUNDÉRÉ<br />
a'rr@<br />
Y"ri"bffi<br />
*t/<br />
llGAOUt<br />
- -<br />
@t-<br />
t<br />
ldd<br />
'h'<br />
I<br />
(<br />
n<br />
*"8"q
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
B. TE SECTEUR DE TA TRANSTORMAIION DANS I.A PROVIIIICE DE I.,ADAIIAAOUA<br />
Le secteur industriel est très embryonnaire dans I'Adamaoua. Il est représenté par :<br />
- La société de Marsserie du Cameroun (MAISCAM) qui produit et transforme du<br />
maïs, fait du soja et du tournesol en farine, des huiles et des tourteaux. Son siège<br />
social est à Ngaoundéré.<br />
- La Sogelait qui est spécialisée dans la fabrication des produits laitiers. Elle tourne au<br />
ralenti.<br />
- La Tanicanr, Société reprise par des particuliers reprend timidement ses activités. EIIe<br />
s'occupe du traitement des peaux et cuirs.<br />
Le secteur des boulangeries est florissant. Il en est de même des prestations de services<br />
contrôlés à 80% par des Libanais.<br />
Les menuiseries occupent TOYo du secteur des industries. Il faut noter que 100% des<br />
installations se trouvent à Ngaoundéré.<br />
Des sociétés comme Agrimax spécialiste dans la production de la farine du mais et du<br />
blé, des aliments pour bétail ainsi que la Compagnie Pastorale Africaine rompue dans<br />
l'élevage et la commercialisation des bovins se sont nouvellement créées.<br />
La panification et la pâtisserie rencontrent un réel succès.<br />
q. Commerci
ETUOES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
q. Trofic des mcrrchondises el produils en proyenqnce de l'Adqmqouq<br />
Il faut noter que ce flux de marchandises est composé des produits en provenance de la<br />
province de I'Adamaoua, d'une bonne partie venant des autres parties du septentrion et une<br />
proportion non négligeable des produits des pays limitrophes dont le Tchad.<br />
Pour I'exercice 97/98 par exemple, le Tchad a écoulé 4 318 torures de ses marchandises<br />
par Ngaoundéré. Elles sont constituées des :<br />
- Containeurs chargés GETMA et Ets MBM<br />
- Karité, gomme arabique (GETMA et Ets ln{BM)<br />
- Tourteaux coton agro-denrée QaÙ |<br />
Ngaoundéré par l'entremise de sa gare écoule une gamme de produits variés vers le Sud<br />
parmi lesquels le coton fibre (135 048), les vivres et plantes locales (11 117 t), les<br />
tourteaux (13 453 t), les animaux vivants (10 880 t), les oléagineux (9 801 t), la gomme<br />
arabique (7 925 t) sont les plus marquants.<br />
b. Flux des produits enfronls<br />
Comme pour les flux sortants, il faut distinguer le trafic à destination des pays limitrophes<br />
de celui par gare, arrivage de Ngaoundéré pour le Cameroun.<br />
Les marchandises entrant au Tchad, comme pays destinataire, sont constituées essentiellement<br />
des engrais amendes (35 000 T), du sucre importé (10 455 T), de la farine (8967 T),<br />
des vivres secours (10 075 T), des containeurs chargés (6572 T) et bien d'autres<br />
marchandises contenues dans le tableau ci-après :<br />
Tab n' 20 : Trafic à destination du Tchad - exercice 1997-98<br />
N' Nature de la marchandise Observations<br />
1 Marchandises toutes natures<br />
1367<br />
2 Vivres plantes locales<br />
363<br />
3 Farine<br />
8967<br />
4 Sucre importé<br />
1 0455<br />
5 RL import<br />
3 111<br />
6 Céréales autres importées<br />
50<br />
7 Sel<br />
188<br />
8 Bois, contreplaqués<br />
430<br />
9 Engrais amende<br />
35000 Plus important<br />
10 Insecticidesanticryp.<br />
860<br />
11 Combustibles, lubrifiants<br />
404<br />
'12 Combustibles, lubrifiants, WC<br />
110<br />
13 Produits métallurgiques<br />
2129<br />
14 Matériaux de construction (autres)<br />
1222<br />
15 Véhicules<br />
110<br />
16 Matériel entreprises<br />
60<br />
17 Emballages, autres<br />
93<br />
18 Vivres secours<br />
10075<br />
19 Containers chargés<br />
6872<br />
20 Gas-oil<br />
30<br />
Total 81 896<br />
Source : Direction Commerciale de ta Regie Fercam (Dla, 1@)<br />
95Yo des produits entrants dans le Grand Nord transitent par la Gare de Ngaoundéré<br />
contre 5olo seulement par route (très saisonnier). Parmi les principaux flux entrants, on<br />
cite : les engrais (63 182 T), la farine (36 221 T), les produits pétroliers (50 000 T), le sucre<br />
importé et local (25 000 T), le riz importé (13 536 T), les sels (10 749 T),les viwes<br />
secours (13 243 T), les conteneurs chargés (21 414 T), les bois et dérivés (20 008 T), les<br />
groupages, les véhicules. Le tableau ci-après expose la gamme non exhaustive de ce trafic<br />
ferroviaire.<br />
Tab n" 21 z Trafrc par gare - arrivages de Ngaoundéré (exercice i997-98)<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S/|06i()1t99 55 Féwierffi
ETUDES SOCIO.ÊCONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
N' Nature de la marchandise Observations<br />
40 Containers chargés<br />
14<br />
41 Bois, dérivés et autres<br />
20008<br />
42 Super<br />
14275<br />
43 Pétrole<br />
4245<br />
44 Gasoil<br />
23027<br />
45 Jets A1<br />
15052<br />
46 Hvdrocarbures (fuel) 10299 _<br />
Total 359352<br />
De tout ce qui précède, I'analyse montre que les échanges des flux entre l'Adamaoua et<br />
le reste (Sud) du pays sont déséquilibrés. La liaison commerciale (Sud-Adamaoua) ou flux<br />
entrants est plus importante en qualité et en tonnage. L'ensemble de ces flux sont estimés à<br />
plus de 807o contre 207o seulement des flux sortants.<br />
Il y a cependant un équilibre (50%-50%) pour ce qui est des flux de passagers<br />
transportés.<br />
Le flux des marchandises transportées par route est saisonnier et d'importante négligeable<br />
par rapport au train. Il devient beaucoup plus important entre Ngaoundéré, les<br />
provinces du Nord et de l'Extrême-Nord, le Tchad, la République Centrafricaine, pays<br />
limitrophes.<br />
Ngaoundéré est le centre des flux entrants et sortants de la dorsale Nord et occupe une<br />
place stratégique dans les échanges commerciaux de toute la sous-région. La ville est<br />
cependant moins (commerçante)), comparée à Maroua et se positionne plutôt comlne un<br />
centre international de transit.<br />
Quels sont donc les problèmes réels qui entravent le développement des marchés et des<br />
flux d'échanges de cette importante plaque tournante ?<br />
2. TES CONTRAINTES TIEES <strong>AU</strong> DEVETOPPEMENT DES MARCHES ET DES<br />
ECHANGES<br />
À tES CONTRAINIES TECHNIQUES<br />
Parmi les contraintes techniques, on peut mentionner pour cette province .<br />
- les différents marchés qui ne sont ni construits, ni équipés, ni aménagés ;<br />
- les moyens techniques de collecte qui n'existent pas du tout, faute d'absence de pistes<br />
viables, facteur de l'enclavement très prononcé de plusieurs zones rurales, isolées et<br />
pauvres;<br />
- les moyens techniques de conservation des produits sont inexistants.<br />
B.I.ES CONTRAINTES ECONOMIQUES<br />
Il y a peu de consommateurs potentiels :<br />
- la très vaste province étant sous-peuplée et les revenus étant très bas ;<br />
- les statistiques économiques officielles font défaut, du fait des fausses déclarations.<br />
- les prix pratiqués sur les diftrents marchés sont très variables, non harmonisés et<br />
varient selon les points de vente ,<br />
- il n'y a pas de stratégies de commercialisation cohérentes.<br />
MINPAT / Proiet PNUD-OPS CMR,S,|06,O1r99 57 Février ffi
ETUDES SOCIG.ECONOMTOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
C.I.ES CONTRAINTES TIEES <strong>AU</strong>X MESURES D'ACCOMPAGNE.MENT<br />
En dehors des marchés de Ngaoundéré, ceux de tous les chefsJieux des départements,<br />
des arrondissements, des districts et des villages ne sont pas dotés de structure bancaire.<br />
Aucun fonds alloué n'est prévu ou n'est disponible pour accompagner les actions<br />
d'entretien routier, corollaire de l'enclavement des lieux de production et de plusieurs<br />
marchés de collecte ruraux.<br />
Aucune action en matière d'aménagement des diftrents marchés stables n'est envisagée.<br />
D. I.ES CONTRAINTES NATUREI.I-ES<br />
La province est très peu fertile. Sa faible population sur des vastes étendues est sousscolarisée.<br />
La tradition culturelle séculaire est un frein au développement de la région.<br />
Quelles solutions apporter face à ces difficultés pour tenter de combler ces lacunes ?<br />
3. ORIENTAIIONS ET RECOMMANDATIONS<br />
Les orientations et les recommandations qui essayent de remédier aux contraintes<br />
suscitées visent à assainir les difiFerents marchés, afin d'augmenter les flux des diftrentes<br />
spéculations qui s'y opèrent. Il faudrait donc dans cet ordre :<br />
- inciter les institutions de financement à s'installer dans les diftrents marchés ;<br />
- appuyer tous les marchés saisonniers par un service de santé et de sécurité fiable ;<br />
- appuyer les services administratifs pour mener à bien leur rôle de contrôleur et de<br />
régulateur sur le terrain ;<br />
- réhabiliter etlou construire de nombreuses pistes de collecte de produits agricoles pour<br />
éviter leur pourrissement ;<br />
- acquérir le matériel approprié de conservation des denrées périssables pour une durée<br />
plus longue de consommation ;<br />
- renforcer le circuit de distribution des produits manufacturés ;<br />
- améliorer les stratégies commerciales des produits, les améliorer, les organiser de<br />
manière plus efficace en harmonisant les diftrents prix sur les marchés.<br />
MINPAT I Projet PNUD-OPS CMR/SICGOIl99 58 Février&
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'AOAMAOUA<br />
I. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT<br />
Les transports de la Province de l'Adamaoua sont de trois types :<br />
- Le transport routier;<br />
- Le transport ferroviaire ;<br />
- Le transport aérien.<br />
Les infrastructures portuaires et les voies fluviales sont quasi-absentes.<br />
A I.ES INTRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER<br />
La Province de l'Adamaoua dispose d'un réseau routier composé de 2000 km de routes<br />
classées dont :<br />
- 317 km de routes bitumées ;<br />
- 1683 km de routes en terre ,<br />
- 600 km de routes rurales ;<br />
- 700 km de pistes et servitudes.<br />
Ce réseau routier dense et épars dessert une population estimée à 100 000 habitants,<br />
essentiellement composée d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs. Depuis la crise économiqug<br />
les routes classées, les routes rurales, les pistes et autres servitudes ont toutes cessé<br />
d'être entretenues. Il en résulte un état de dégradation très avancé ; la réhabilitation<br />
partielle de quelques tronçons est actuellement entamée.<br />
o. les gronds oxes rouliers<br />
Ngaoundéré, CheÊlieu de la Province de I'Adamaoua est relié aux autres Provinces et à<br />
ses diftrents départements par des routes Nationales (1.0 et Provinciales (P) qui<br />
constituent I'ossature principale de son réseau routier- Les grands axes sont constitués par :<br />
- L'axe Mbe-Ngaoundéré - Meiganga - Taperé (Nationale N"1), relie la Province de<br />
I'Adamaoua à celle de I'Est et du Nord. Il connaît un trafic très dense et très important<br />
des biens et des personnes. La route est bitumée entre Ngaoundéré et la partie nord.<br />
Le tronçon Ngaoundéré-Meiganga qui n'est pas revêtu est actuellement en cours de<br />
réhabilitation grâce au projet de Programme d'Urgence d'Entretien Routier (P{JER) et<br />
International Développement Association (DA), (travaux exécutés par I'Entreprise<br />
SETUBA). Le tronçon Meiganga Tapéré - Garoua Boulay dans I'Est bénéficie du<br />
même projet. La Société SIX International en exécute les travaux.<br />
- La Nationale N"6 relie I'Adamaoua à la Province de I'Ouest en passant par Bankim -<br />
Banyo Tibati - Ngaoundal - Mendougou - Meiganga,.<br />
- Le tronçon Bankim - Banyo - Tibati, non revêtu et dégradé, est en cours de réhabilitation,<br />
(Société Fokou). Le Projet, (financé par I'Union Européenne et le Cameroun)<br />
consiste à bitumer, réhabiliter tous les ouvrages d'art, construire tous les caniveaux et<br />
refaire tous les autres ouvrages.<br />
- Bitumé, le revêtement de la Nationale n"6 entre Tibati et Meiganga, est défectueux<br />
sur les tronçons Tibati - Ngaoundal - Bagodo et Bogdar - Meiganga.<br />
- L'urgence de réhabilitation et I'entretien régulier de cet axe sont primordiaux compte<br />
tenu de son rôle de liaison entre les Provinces de I'Ouest et I'Adamaoua, l'Est et même<br />
la République Centrafricaine (RCA).<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,O6,O1r99 59 Février 2@
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong> Province de fAOAMAOUA<br />
- L'axe Ngaoundéré - Likok - Malarba (FIBADI), la nationale N"15A, est une route en<br />
terre en cours de réhabilitation @rojet PUEMDA).<br />
- Uaxe Likok - Tignère est une route Provinciale,laP72, qui relie les Départements de<br />
Faro, Déo de Djerem à la capitale Provinciale. En cours de réhabilitation (Projet<br />
Union Européenne - Cameroun). C'est une route en terre très dégradée entre Tignère -<br />
Doualayel où même un pont s'est effondré. Cet état est accentué entre Doualayel -<br />
Bang - Djombi - Tibati. Aucun projet de réfection n'est prévu pour le tronçon Tignère<br />
- Tibati long de 68 km.<br />
- La Nationale N"15 Tibati - Malimbo est une route en terre entièrement dégradée. Elle<br />
permet, entre autres, la liaison Adamaoua - Est.<br />
- LaP26 relie Nyamboya à Sorki, ville frontière avec le Nigéria. Bien que non bitumée,<br />
elle est assez praticable et le trafic est dense.<br />
b. les loufes secondqires<br />
En général, les départementales @) reliant les chefsJieux de Département aux diftrents<br />
Arrondissements et Districts sont dans un état précure. Ce sont, par ordre d'importance<br />
décroissante :<br />
- LaDZl assure la liaison Ngaoundéré-Belel-Mbirao (100 km). La praticabilité du tronçon<br />
Ngaoundéré Belel est bonne bien qu'il ne soit pas bitumé. La liaison Belel-<br />
Mbirao est difficile alors qu'elle relie la Province au nord de la RCA. LaD2l perrnet<br />
aussi les flux entre la capitale et I'arrière-pays : C'est dire toute l'importance et<br />
I'urgence de la réhabilitation de cette départementale qui joue un rôle majeur.<br />
- Route en terre non entretenue et dégradée,laD22 est très fréquentée par les commerçants<br />
camerounais, nigérians et centrafricains. Elle relie Gandji (Meiganga) - Bara<br />
(zone frontalière avec la RCA). Ses 165 km et les échanges économiques qu'elle<br />
véhicule la situe juste après laD2l pour la remise en état.<br />
- La D20 de 125 km relie Tignère - Gadjiwan - Mayo Baléo - Koncha. Dégradée et<br />
nantie d'un pont effondré, elle est vallonnée et flanquée d'une falaise aux environs de<br />
Gadjiwan. Le passage entre Mayo Baléo et Koncha (zone frontalière avec le Nigéria)<br />
est impraticable en raison de sa détérioration.<br />
- L'axe Tibati-Mbako4 la D24 3OlsrL est une route en terre vétuste, qui mène au<br />
Barrage hydroélectrique de Djarro-Kombo. Elle nécessite une remise en état prioritaire<br />
et un entretien permanent.<br />
- La Dl9 relie Doualayal - Oumarou Tikar - Lewa - Mini Martap soit 99 km de route<br />
dégradée, qui, en outre, relie la Nl5A àlaPl2 et de surcroît permet les échanges avec<br />
l'importante zone minière de Bauxite, de Mini-Martap.<br />
- Enfin, laD23 62 km est une bretelle de la N"l qui arrive à Mangom. C'est une route<br />
dégradée qui finit en "cul-de-sac" au chemin de fer vers Makor.<br />
c. [e résecru des roules rurclles<br />
La Province est traversée par 600 km de routes rurales non bitumées (RR) qui relient les<br />
Arrondissements, les Districts et les zones de campagne entre eux et avec les Chefslieux<br />
de Département.<br />
En général, dans un état de délabrement très avancé, elles sont presque impraticables du<br />
fait du manque d'entretien depuis plus de dix ans. Leur inaccessibilité générale s'explique<br />
ainsi par :<br />
- de nombreux ravinements et rigoles occasionnés par les grandes pluies ;<br />
MINPAT / Projet PNUDOPS CMR/S/i06rOll99 60 Féwier2@
EIqqqs soclo-EcoNoMtQUES REctONALEs <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
- I'effondrement massif des ouwages d'art et des petits ouvrages de franchissement<br />
datant pour la plupart de l,époque coloniale.<br />
- des chaussées, barrées par de nombreux éboulements, des herbes et des arbustes.<br />
Dans l'ensemble, les routes rurales de Mayo-Banyo sont donc les voies de transit et de<br />
transactions commerciales internes qui desservent la capitale départementale, Banyo, et le<br />
Nigeria et permettent le désenclavement des zones très propic"i à l'él.uuge et à i,agriculture<br />
du cacao et du cafe.<br />
La réhabilitation des RR du Mbéré désenclavera une région à forte densité de population<br />
et une zone productrice d,agriculture et d,élevage.<br />
Les Départements du Faro et Déo ont une position stratégique. Ils relient en effet le<br />
Cameroun au Nigeria et peuvent constituer une base militaire à I'Armée Nationale.<br />
Enclavég cette région peuplée et productrice de mars et de céréales grande échelle est<br />
considérée comme un grenier du pays. Cependant les RR y sont très dégradés.<br />
Dans la Vin4 la vétusté de la Dl9 qui relie Lewa à Mini Martap étouffe la zone<br />
minière. Quant à la D24, dans le Djerem, son impraticabilité lui restreint son tôle décisif<br />
puisqu'elle dessert le barrage hydroélectrique de ra réserve d'Edéa.<br />
d. Le léseou des pistes ruroles el serviludes<br />
L'Adamaoua compte plus de 700 km de pistes et servitudes très vétustes, discontinues<br />
manquant par endroits d'ouvrages de franchissement et de ravinement. Les3l4 de ce réseau<br />
restent inutilisables pendant la saison des pluies. Isolant ainsi, pendant près de 6 mois des<br />
zones d'agriculture d'élevage et de pêche, qui perdent ainsi entre sb a Oo yo de leur<br />
production.<br />
Cette précarité des réseaux de communication routiers a non seulement un impact très<br />
lourd sur l'économie locale et nationale, mais aussi sur la santé des individus et sur celle<br />
du bétail: en effet, ils ne peuvent accéder aux soins pour l'éducation des enfants qui ne<br />
joignent pas les milieux scolaires et au développement en général par carence<br />
d'informations et de formation.<br />
On estime que 60Yo de la population de la province est rurale. A ce niveau, les 3/5 de Ia<br />
province sont paralysés durant la moitié de I'année. C'est-à-dire aussi que trois personnes<br />
sur cinq sont coupées du reste du pays pendant 6 mois ; l'ampleur de la paupérisation<br />
locale est en grande partie due à l'autarcie.<br />
e. Quelques projels en cours<br />
. Le Projet PLIEMDA concernant les grands axes routiers .<br />
- Tibati - Banyo - Frontière Ouest (N6)<br />
- Lokok - Malarba (NlsA)<br />
- Ngaoundéré - Tignère (P2)<br />
- Ngaoundéré - Meiganga (N1)<br />
' Un financement Cameroun-Union Européenne vise la réhabilitation des routes en<br />
terre.<br />
C'est un programme d'urgence d'entretien routier qui consiste en la réfection des ouvrages<br />
d'art, la pose de buse par endroits, la construction de caniveaux, le traitement ponctuel<br />
des sections très dégradées.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SO6,O1,99 6l Février 2@
ETUDES SOCIO.ECONOMTQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Province du pays la plus vaste mais aussi zone de transition obligatoire entre le Nord et<br />
le Sud, et aussi du Cameroun avec certains pays limitrophes, l'Adamaoua nécessite un<br />
désenclavement urgent passant par la réhabilitation prioritaire de son réseau routier et son<br />
entretien qui permettrait de prétendre à l'accession d'une qualité de vie au moins élémentaire.<br />
En effet, la circulation de biens de services stimulerait cette région asphyxiée la moitié<br />
de I'année dans l'autarcie et dépourvue du bien-être le plus rudimentaire : groupements de<br />
soins, eau potable, électricité, écoles viables....qui suivraient la remise en-état du réseau<br />
routier.<br />
Par ailleurs, dans le domaine météorologique il y aurait lieu d'accroître le réseau de<br />
collecte visant à assurer une meilleure qualité et quantité des données météorologiques. Ce<br />
qui aiderait efficacement à la décision dans les domaines des activités écônômiques<br />
tributaires de ce facteur. Actuellement, le réseau se limite à trois stations et un centre<br />
metéorologique secondaire.<br />
B. INf RASTRUCIURE AERIENNE<br />
La province de I'Adamaoua possède un aéroport doté d'une piste d'atterrissage de type<br />
QFU 03 et QFU 2l en béton bitumé. Longue de270Q mètres, et large de 45 mètres, elie a<br />
un prolongement Arrêt ( PA ) de 60 mètres.<br />
C'est un aéroport de classe nationale qui ne peut supporter que des charges de 52 à 60<br />
tonnes de fret total et de passagers. Sa résistance ne lui permet de recevoir que des flottes<br />
de type Boeing 737 ;bienque des avions de type Airbus puissent également y atterrir.<br />
Actuellement, la CAMAIR dessert la ville de Ngaoundéré quatre fois par semaine.<br />
Les données relatives aux trafics passagers, regroupées dans le tableau ci-dessous, montrent<br />
une forte baisse des trafics payants et de transit tant à l'arrivée qu'au départ.<br />
Tab n" 22 : Trafic passagers à I'aéroport de Ngaoundéré<br />
- f- Anivées W<br />
Transits Payants Transits Payants<br />
95/96 11 661 I 952 916 10 843<br />
10740 4 984 1 380 5 458<br />
Source : ADC, Yaoundé<br />
Ces baisses de trafics pourraient s'expliquer par les pannes fréquentes des avions du fait<br />
de leur vétusté ; la recrudescence des vols des bagages, etc... En dépit des tarifs rews à la<br />
baisse, les taux de remplissage demeurent très faibles.<br />
En ce qui concerne le fret, l'aéroport de Ngaoundéré a reçu un tonnage de 32.515 kg en<br />
1994/95 contre 43.460 kg en 1995/96. Ce tonnage a dramatiquement baissé en 1996197 à<br />
10.740 kg.<br />
C. INFRASTRUCTURES TERROVIAIRES<br />
Créée en 197 4, la gare de Ngaoun déré a une importance particulière pour toute la partie<br />
septentrionale du Cameroun. Elle résout une bonne partie des problèmes de transport de la<br />
région : elle établit la liaison Nord-Sud en permettant le passage de la population, et assure<br />
les flux de milliers de tonnes de marchandises en provenance et à destination du Nord et<br />
des pays limitrophes.<br />
MINPAT I Projet PNUD-OPS CMR/S/06rO1t99 62 Févrierffi
RESE<strong>AU</strong> DE TRANSPORT<br />
(1ee8-1eeg)<br />
I<br />
l<br />
I<br />
,/ ,.Kqldra<br />
/\<br />
/ '.<br />
-<br />
RoutePrlnclpalobltume<br />
Route prlnclpalo permanenlê<br />
Route secorÉalr€ ærmanente<br />
Route sêcondalre Intermlttênte<br />
Plsto<br />
Passage dlttb||e<br />
/-*--- * Chemln de fer<br />
e Pbte d'att rlssage<br />
Tlgn rs<br />
I<br />
ll<br />
I.<br />
r'<br />
\ Sambdâbbo<br />
/ ---<br />
M&<br />
I<br />
Gdmlçn<br />
I<br />
Bôu9ou I<br />
..--:î,<br />
i-'<br />
\ -.<br />
t<br />
-;- - 'r':-.(,.<br />
..."'.'.:'<br />
s6tdd9 'i<br />
'<br />
,-t<br />
*^o^ /<br />
- Eanyo<br />
\../ ,^.-.<br />
)t"'*<br />
\o''<br />
\<br />
(n**"<br />
I<br />
Mbâmù\<br />
G*aqand.<br />
\\ /<br />
\l<br />
Kdôdofic tl<br />
^''...',' (<br />
LESetrOÊ<br />
hilô ds(frd$ffinr<br />
NSo,r / -/<br />
fri-ùoud6 ipailffil<br />
rhll,e d arffssoMl<br />
a
ROUTES, PISTES ET VOIES FERREES<br />
-ïypes<br />
Routes Elitumes<br />
RorÎes en Tene<br />
I<br />
Na0onale<br />
I<br />
Pro/irEiale<br />
I<br />
,/ o Kùtdrr<br />
0parternentale<br />
Mltdqrta o<br />
sst\Èodd<br />
trt-g-<br />
Fob<br />
^<br />
lJÈôt-<br />
Mbqm<br />
-o o<br />
Prstes ruales<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Vcie fenes<br />
Zones errlaves (sitrps à plæ de 5 krlortres<br />
d'un€ rorle cânæsable, ou d'une vcie fene)<br />
ily!as<br />
OB<br />
H@rc<br />
!"t*ctrg<br />
ug3,*r"<br />
\ smua*m<br />
J<br />
,"t'l<br />
i<br />
'\<br />
-u"'^>J'"<br />
" 8dgôtl ,<br />
N<br />
\<br />
(<br />
I<br />
I<br />
(<br />
I<br />
\<br />
,/<br />
' 8t /<br />
ltgul ,-/<br />
I<br />
I<br />
r-<br />
I<br />
'?\*z^-RÈco<br />
A.q sm8<br />
/<br />
Tori(o.rtw<br />
: gd|tdont iôrkta<br />
Lymb.yc<br />
\ \<br />
t<br />
)<br />
t\<br />
\.<br />
I<br />
Gaza$adc<br />
o\<br />
lsrffi )<br />
Prnoar ô<br />
IEGEN*<br />
Ëon[ re<br />
bn€ d. R 9o<br />
Lmn€derd3lmnr<br />
turlu&dpanemsl<br />
thel !êude(dsomenr<br />
a
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
En 1997/1998, le trafic en provenance du Tchad a été de 4318 tonnes de marchandises<br />
transportées. Le karité, la gomme arabique, les provendes, tourteaux agro, entre autres,<br />
constituent le quart de l'importation.<br />
Le trafic à destination du Tchad, plus important, a été de 81.896 tonnes pendant la même<br />
période. Il concerne essentiellement les véhicules (l l0 t), les vivres secours (10075 t),<br />
les engrais Amende (35.000 t), les sucres (10.455 t), les matériaux de construction (1.222<br />
t), les farines (8.967 t), les produits métallurgiques (2.L29 t), etc.. Le trafic voyageurs est<br />
également dense. En outre, la R.C.A. et d'autres pays limitrophes enclavés sont également<br />
desservis.<br />
Pour ce qui est du grand Nord Cameroun, 95% des produits sont transferés par rails.<br />
L'écart de 5Yo représente la maigre proportion de trafic par route en saison sèche.<br />
Pour le septentrion,la garc de Ngaoundéré est une grande gare de trafic marchandises et<br />
voyageurs. Toutes les structures existent :<br />
- une structure douanière bien implantée ;<br />
- un quai d'embarquement et de débarquement des marchandises et des voyageurs ;<br />
- des magasins de stockage où transitent des milliards de tonnes de marchandises<br />
- des transitaires (SAGA' SDV, le Jetma) ;<br />
La gare de Ngaoundéré trop sollicitée a aujourd'hui largement dépassé les prévisions et<br />
sa capacité réelle. Les magasins sont pleins, les transports passagers sont encombrés à<br />
l'excès, le tonnage transporté dans les deux sens est saturé. Ainsi, le trafic
TRAFIC ROUTIER<br />
(19e8-199e)<br />
Types de tmf|c<br />
ffi<br />
ffi<br />
Trafictotal<br />
Trafic despoidslourds<br />
O<br />
Vrlle princrpale<br />
Nombre de vhicules Parlour<br />
Lrmile !arônd'ssem€nr<br />
- - -960<br />
Ch€r Lre6 J& d p$l€mml<br />
chel Ùê!r 0dNrssomârl<br />
a<br />
- - -130<br />
uu'uo"<br />
--<br />
i<br />
---- 60<br />
o<br />
SglrbFl<br />
tôor Mtûtt<br />
fsrbo mm<br />
o<br />
NYw<br />
Ô tt*n!{tr<br />
OB<br />
Tonhgd<br />
e.rr"U1<br />
l<br />
, N,,,,.<br />
)<br />
. gmbdôùùo<br />
lo<br />
l'lbâ<br />
o<br />
g"n6.1t os"ad-ro<br />
t ^:<br />
-^<br />
I -)<br />
tlbro<br />
I<br />
)<br />
)<br />
y'qkqwr<br />
NGAOUT<br />
z - o<br />
Gùrboe 7<br />
tl".*<br />
ow<br />
)<br />
Pùg.r q,'
ETUDES SOCIo.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Pour pallier à ce déficit, la Délégation Provinciale de I'Adamaoua envisage de rattacher<br />
les diftrentes localités de la province au réseau SNEC. Le type d'ouwage proposé est le<br />
puits équipé et le forage. Pour I'ensemble de la province, la Délégation prévoit la<br />
réalisation de 16 forages et de 4 puits equipés pour un coût global de 160.000.000 FCF.<br />
Le coût actualisé d'un forage est estimé à 9.000.000 FCFA et à près de 4.00.000 FCFA<br />
pour un puits en béton armé et équipé de pompe manuelle. Cette intervalle, jouerait un rôle<br />
notoire dans l'éradication de la misère qui sévit les circonscriptions administratives de la<br />
région.<br />
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime le seuil minimal de consommation<br />
d'eau à 25 litres d'eau par personne et par jour. (Z1Vjlhbt). C'est dire la rareté de cette<br />
denrée vitale et capitale dans la Province de l'Adamaoua qui situe sa consommation entre 5<br />
à l0 I par personne et parjour.<br />
Pourtant une étude d'implantation d'une adduction d'eau potable à Ngaoundal menée par<br />
la Délégation Provinciale des Mines d'Eau et de I'Energie est restée sans suite depuis 1996.<br />
Ce projet préconisait la construction :<br />
- d'un captage gravitaire en maçonnerie avec bassin de décantation en béton armé<br />
débitant environ I 1m3/h<br />
- d'un réservoir de stockage d'un volume d'environ de 54 m3<br />
- d'un réseau de distribution gravitaire de 7400 m en PVC pression avec accessoires.<br />
Ce projet était estimé à 160 millions FCFA, les investissements réduits et le coût d'exploitation<br />
bas seraient les avantages de cette option comparée aux réalisations classiques.<br />
8. ATIMENTATION EN ENERGIE EI.ECTRIQUE<br />
La SONEL (Société Nationale d'Electricité du Cameroun) est chargée de I'exploitation<br />
et de la distribution du courant électrique de la Province de I'Adamaoua. La Province est<br />
très mal couverte : seulement I Yo de la population utilise l'électricité. La source d'énergie<br />
la plus répandue dans cette région reste le bois et le charbon. Sur près de 90.000 ménages<br />
de I'Adamaou4 79.000 utilisent le bois, soit 88%. Dans les zones rurales, par contre, le<br />
bois est la seule source d'énergie (96,6 %) le phénomène s'explique par le fait que dans la<br />
Province qui est très vaste, et très pauwe : La population est très dispersée, l'installation de<br />
l'électricité y est très onéreuse et la consommation hors de prix compte tenu des moyens.<br />
La capitale provinciale et Meiganga est alimentée par le barrage de Lagdo grâce à deux<br />
transformateurs de 16 MW chacun. Etant donné la très faible demande d'énergie, un seul<br />
transformateur est mis en service pour une consommation de 3 MV.<br />
Une ligne haute de tension (HT) part du barrage de Lagdo et alimente Ngaoundéré(9O<br />
KW- lloKW).<br />
Le réseau électrique qui part de Ngaoundéré à Meidougou (via Meiganga) est une ligne<br />
Moyenne Tension lvIT (17,22 KW). Elle alimente les localités de Wakwa-cité, Wakwa,<br />
Sangié, Dibi, Bélel Dibi, Galdi, Mangoli, Neiminaka" Batongo, Mboulaï, Boutou, Garga,<br />
Gumbala, Gangwi, Meiganga et Meidougou qui bénéficient donc d'énergie d'origine<br />
hydroélectrique, alors que les autres villes de la Province sont alimentées par des centrales<br />
thermiques ou par des barrages de retenue d'eau.<br />
Ainsi, Banyo, Tignère, Tibati, Bankim et Bankoua ont une électricité d'origine thermique.<br />
Sur ces lignes, la SONEL réalise de très mauvaises affaires. Les longues distances<br />
font que I'extension du réseau hydraulique coûte extrêmement cher. Une extension possible<br />
n'est pas envisageable, la pauvreté des populations ne leur permettrait même pas d'être<br />
MINPAT / Projet PNUO-OPS CMRrS,OGrO1/199 65 Février 2@
ETUDES SOCIo'ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de fADAMAOUA<br />
connectées. L'énergie thermique coûte également cher pour son exploitation (coût élevé du<br />
Gasoil pour fonctionnement, coût d'acquisition élevé des groupes électrogènes fréquemment<br />
en panne). Ce choix est une source de déficit pour la société qui perd mensuellement<br />
25 à30 millions FCFA en moyenne pour une recette de 15 millions FCFA.<br />
Boninting est une localité alimentée par le barrage de retenue d'eau.<br />
La ville de Ngaoundal est en cours d'électrification par système de Centrale Thermique<br />
en construction.<br />
Plusieurs localités, bien qu'importantes, ne sont pas encore électrifiées. Il s'agit de :<br />
Mbe, Tchabal, Wouro, Ngaoundaba, Wassandé, Mbodou, Doua, Bakougug Djohong,<br />
Bélel, Ngaoui, Dir, Bilo, Boforo, Mayo Baléo, Galim-Tignère, Mayo-Darlé, Malao, Doyo<br />
Lokono, Omalao, Kilimanti, Niat.<br />
Le coût élevé des branchements ne peffnettant pas à la population à revenu moyen d'y<br />
accéder. La Délégation Provinciale de la SONEL a élaboré un plan d'exécution des branchements<br />
dans le cadre d'une campagne gratuite pour rentabiliser les réseaux BT construits<br />
en vue de la densification des réseaux MT/BT de la DPA<br />
Il va de soi que dans tous les départements de la Province, un besoin urgent d'extension<br />
du réseau est exprimé.<br />
3. LES TEI.ECOMMUNICATIONS<br />
Les télécommunications dans la Province de l'Adamaoua comportent :<br />
. 7 stations relais ;<br />
. 2 centrales téléphoniques ;<br />
. 3 concentrateurs sur trois Directions :<br />
- Sud (Meiganga) ;<br />
- Nord (Mbe) ;<br />
- Ouest (Banyo).<br />
La configuration initiale prévoyait :<br />
. I canal téléphonique ;<br />
. I oanalTV;<br />
. I canal secours<br />
Actuellement, suite aux multiples pannes et aux mauvaises conditions climatiques, cette<br />
norrne n'existe plus. La liaison reste très précaire et beaucoup d'organes sont retirés du<br />
circuit et envoyés en réparation. Les tâches de maintenance sont pour le moins ardues.<br />
Le nombre de "circuits internationaux" est passé de 2 à 6. Les responsables locaux privilégient<br />
la sécurisation du signal Radio CRTV.<br />
A. tA COMMUNICAIION TETEPHONIQUE<br />
La Province compte deux centrales téléphoniques de type électronique (technologie<br />
ancienne, 1972) à Ngaoundéré et à Meiganga. Ngaoundéré est le principal centre commercial<br />
de la téléphonie. Les autres villes (Dibi, Wakwa, Banyo, Tibati, Tignère et Mbé) y sont<br />
connectées par concentrateurs ou faisceaux hertziens. Sa capacité est de 2.000 abonnés,<br />
avec un taux de saturation de 94oÂ. Dans le cadre du développement de la téléphonie rurale<br />
préconisée par le Gouvernement, les localités de Dibi, Wakwa, Mbe et Maoui occupent les<br />
MIN PAT / Projet PNUD-OPS CMR,S,O6O1,99<br />
66<br />
Février2@
RESE<strong>AU</strong> D'ELECTRICITE<br />
ET D'E<strong>AU</strong> POTABLE (1998-1999)<br />
,/<br />
i<br />
t<br />
/<br />
/ Koffihs<br />
,/<br />
/<br />
vers lagdo<br />
Rseau lectrique<br />
A w<br />
Centrale thermrque<br />
cefitrale thermrqlJe en construrl,on<br />
Barmge de retenue<br />
+ Læals imponantes à lectnfier<br />
tr<br />
Læalits en cours d'lectnïcatron<br />
Lqre HT 90 kv ou 1 10 kv<br />
Ligre MT 30kv ou I7,22kv<br />
-\--z-<br />
i{<br />
a --'<br />
l<br />
R,b"o i<br />
I<br />
Âna so-" Ys$<br />
0arl<br />
56dOng<br />
o<br />
e.nyo oA<br />
letaræa<br />
i MâyoO|hgE<br />
, Nymbya<br />
I<br />
'\ ssbolabbo<br />
Mbê<br />
Mbamt<br />
i<br />
Mar! Tdd<br />
-DJambaJs<br />
Mayo.<br />
*Bal o<br />
Gahma<br />
lqn<br />
Ga$s9uol<br />
oqlelâyet<br />
Wbdtil<br />
A<br />
C T€N Pqro<br />
''<br />
Pùo<br />
Ol6dr<br />
Mariap<br />
EtaGoto<br />
Mâddgôu<br />
HQIæ<br />
Mdreng -'<br />
I ., Mbw'<br />
Mqn96<br />
l<br />
Tk.l I<br />
I<br />
liqhgu.l<br />
Tdrôol<br />
"'+lE-<br />
NGAoUilDJRt\iJ<br />
'<br />
Wet$qt<br />
Mq$g<br />
O,alngo<br />
- ;**{6*** +<br />
w*o*\a Hîl +<br />
roumheÊr<br />
ilï - hS*<br />
ra4<br />
+ oddI<br />
NS6ùbô Bsd'l<br />
SEdolmeko<br />
+ wsnd<br />
+<br />
| lblôu<br />
Mbdla<br />
Àddl<br />
Bômeo<br />
Ediq<br />
qsga<br />
O<br />
Eau potable<br />
O<br />
O<br />
Læahs djà lectnfres<br />
Exhaure (captage sur eau de surface)<br />
Forage (mbe)<br />
.',, I<br />
Mban9<br />
+<br />
I<br />
Bll<br />
I<br />
tô$Ll<br />
*Dlotrong /<br />
, NGAOUI<br />
+// - -z<br />
/<br />
/<br />
/<br />
"*t<br />
/<br />
/<br />
/<br />
)<br />
Gbabqâ<br />
f<br />
i W.ka*o<br />
,<br />
l/<br />
Bl<br />
' _./<br />
0qrù.h<br />
Kalâld<br />
* *-'_."_çf* Ii'i*<br />
lrcldo.ad' -<br />
r-*ot .i<br />
Bmbqrc'<br />
(<br />
"*1,,,t<br />
A 1"É"n*'*<br />
Roub pindpab bilm ê<br />
Fùure Fmprb pÉfr.ronb<br />
Beb ssddsre Frmenânro -- . - - -. - -<br />
Rare sâændâtrô InBmilbnrê<br />
CM.@ F€t<br />
Froni rê<br />
lnb & B90.<br />
Lmre d3n.dÉs6mânr<br />
Chel Lrtu &d pailfrenr<br />
'th6f!@ ddûfi(Mtrt
ETUOES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Prodnce de I'ADAMAOUA<br />
60lo restants du réseau, cependant les installations, déjà en place, ne sont pas encore<br />
opérationnelles.<br />
Aucune ligne câblée émanant de la Centrale de Ngaoundéré n'est libre :<br />
. Sur les 1600 lignes câblées et mises en service de la ville de Ngaoundéré, 1299 sont<br />
réservées aux privés, 238 aux officiels et 63 aux PTT.<br />
' 100 lignes sont en service à Banyo dont 69 privées 29 pour les officiels et 04<br />
réservées aux services des PTT.<br />
' La ville de Tignère a 70 lignes câblées en service, réparties entre : 40 pnvéq24<br />
officiels et 06 pour les PTT locales.<br />
' Enfin, Tibati dispose d'une capacité de 80 lignes câblées, toutes en service dont 44<br />
privées, 34 officielles et 02 pour les PTT.<br />
Seule Meiganga possède un réseau non saturé : 500 lignes restent libres.<br />
L'utilisation présente des déréglages et des pannes multiples et fréquentes qui rendent<br />
I'exploitation du téléphone difficile dans la région :<br />
- retards de tonalités,<br />
- interferences ou mélange de toutes sortes,<br />
- encombrements divers,<br />
- insuffisance du personnel qualifié pour les tâches de maintenance.<br />
Par ailleurs, I'ACTEL, organisme chargé de gérer le secteur commercial des télécommunications<br />
est amené à procéder à des suspensions et reattributions de numéros résiliés<br />
donnant lieu à un nombre considérable de plaintes, contestations et réclamations grevant<br />
les recouwements.<br />
Ainsi, le taux de recouvrement moyen est de 96,4 yo (195 millions sur 203 millions<br />
attendus) en Janvier 1999. Soit un manque à gagner de 8 millions FCFA.<br />
B. IRANSMISSION ENERGEIIQUE<br />
L'Adamaoua dispose de 7 stations-relais dont 5 sont autonomes et 2 sont reliées au<br />
système SONEL.<br />
Les localités de Lére, Libong, Pang, Mayo-Toloré, Mayo-Djinga sont desservies par les<br />
stations autonomes alimentées par des groupes électrogènes, des redresseurs, du gasoil, des<br />
batteries, etc.<br />
Bandal et Ongui bénéficient du réseau d'énergie SONEL.<br />
On compte 2 centrales téléphoniques à Ngaoundéré et à Meiganga et 3 faisceaux<br />
herziens (hz) pour les directions Sud-Nord-Ouest.<br />
Les groupes électrogènes (GE) ont un programme de maintenance périodique déterminé<br />
par le nombre d'heures de fonctionnement. Celui-ci n'est plus respecté depuis plus de trois<br />
ans :<br />
- Toutes les batteries stationnaires sont obsolètes et devraient être mises au rebut :<br />
- Il y a une forte dégradation des Groupes Electrogènes (GE) ;<br />
- Il n'existe qu'un Groupe Electrogène sur deux dans les stations ;<br />
- Ces coupures de liaison (les Faisceaux) ne se situent pas dans le secteur de surveillance<br />
(zone de compétence) de l'Adamaoua, mais surtout et régulièrement dans les<br />
secteurs du Centre contrôlé par Yaoundé et de I'Est à Bertoua et sont dues à des problèmes<br />
d'énergie : défaut SONEL, Groupes électrogènes, redresseurs, gasoil.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/98O6/O1199 67 Février0o
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de flADAMAOUA<br />
Pour remédier aux inconvenues, une maintenance préventive dans les stations d'énergie<br />
devrait être mise en place. Il y a lieu aussi de normaliser les conditions de température dans<br />
les stations-relais et de contrôler et responsabiliser le personnel exécutant.<br />
Il est à noter que le secteur Radio Télégraphique a essentiellement besoin d'une<br />
maintenance ourative à Tignère, Bélel, Ngaoundal, et qu'un contrôle des émetteurs Radio<br />
(E/R) des C.E.T de Tignère, Banyo, Meiganga est nécessaire.<br />
Tab n" 21 : Parc d'abonnés<br />
Banyo<br />
Tibati<br />
Tignère<br />
Maoui<br />
Wakwa<br />
Mbe<br />
Dibi<br />
de I'Adamaoua<br />
Localités Lignes câblées En service Privées Offrcielles Lignes PTT Lignes libres<br />
Ngaoundéré 1.600 1.600 1.299 238 63 0<br />
100 100 ô9 29 04 0<br />
80<br />
70<br />
70<br />
25<br />
32<br />
23<br />
80<br />
7à<br />
42<br />
00<br />
00<br />
00<br />
Total 2.000 1.892 1.490 329 75 108<br />
44<br />
40<br />
32<br />
00<br />
00<br />
00<br />
34<br />
24<br />
04<br />
00<br />
00<br />
00<br />
02<br />
06<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
0<br />
0<br />
28<br />
25<br />
32<br />
23<br />
prwinciale des PTT, Adamaoua<br />
MINPAT / Projet PN UD-OPS CMR/Sro6,111 r99 68 Féwierffi
RESE<strong>AU</strong> DE TELECOMM UNICATION<br />
(1ee8 - 1gee)<br />
I<br />
l<br />
I<br />
/<br />
/ Kffiho<br />
{Mb<br />
t<br />
I<br />
a"nuu,tlphonique<br />
$3 connect au central<br />
ry de Ngaoundr Par concentrateurs<br />
O<br />
Smtions relais autonornes<br />
@ Statiors relais lectrifies<br />
r]-r Rseau de tlcommunication<br />
Mâyû<br />
Bâl o<br />
Tff' m';<br />
Madq9o0<br />
NYa391<br />
Ngan9-Hq<br />
-\--z-<br />
m<br />
fl<br />
l<br />
Rrboo<br />
/<br />
sonç Mayo<br />
UâTI<br />
sdfiddg<br />
Sd bolabb<br />
lvba<br />
Gahm-<br />
Tqn<br />
,t//<br />
G65sdgutl<br />
sado.k //<br />
,/<br />
.//<br />
/<br />
Manang<br />
NGAOUND'R'<br />
lc<br />
''1-''.<br />
rl<br />
: Mbw'<br />
Oûralayôl<br />
Manoom<br />
/<br />
.,/-.'<br />
t"rt'<br />
wk<br />
I<br />
e^ro f<br />
Marhp<br />
B ké Gob<br />
Tk l<br />
.*:*-***t**-*-*,\",,'<br />
Noaoundll /<br />
r"\'39T"<br />
\'i<br />
\ Dri'..'"'<br />
Tdmh9âl<br />
Sadolmako<br />
0b<br />
BqnÔl<br />
BÉdrar<br />
Addl<br />
Bôongo<br />
Mbqô9<br />
Bll<br />
Meqangâ<br />
Ngon<br />
.-i<br />
*,i"<br />
I<br />
(<br />
I<br />
ysmbairg-' i<br />
I<br />
''/<br />
I<br />
' Diohono - /<br />
NGAOUI<br />
-.2<br />
l<br />
Gbobaa /<br />
I<br />
'/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
oazacæ"oc<br />
f<br />
I<br />
LËCcTOE<br />
)<br />
tsogâr /<br />
Roub fl,nogeb blw e<br />
Âeie pnffip& frÉb<br />
Êùb sgadce FfmtM'ê<br />
Rftb 3ofraro Inlernisb<br />
Unl.dàrôd$msl<br />
Ctufûil& dp6rhdr<br />
Chl Ùud.rondss€mnl<br />
a
ETUOES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Proûnce de IADAMAOUA<br />
I. SANTE<br />
La province de l'Adamaoua compte 7 districts de santé et 7l aires de santé couvertes<br />
par 72 formations sanitaires dont 56 publiques, 15 confessionnelles et I clinique. Les formations<br />
sanitaires (FS) publiques sont constituées d'un hôpital provincial, de 4 hôpitaux de<br />
district, de 7 centres médicaux d'arrondissements et de 44 centres de santé et dispensaires.<br />
Les formations sanitaires privées comportent deux hôpitaux protestantsa et les 13 centres<br />
de santé et dispensaires. Les formations sanitaires sont inégalement réparties dans les<br />
districts et les aires de santé. La province compte 6 aires de santé non intégrées, dont 3<br />
dans le district de Ngaoundéré, deux dans le district de Tignéré et un dans celui de Tibati.<br />
C'est ainsi que la proportion des populations non couvertes est de l3,5yo. Ce qui<br />
correspond à 85 391 habitants dont 65 316 dans le district de Ngaoundéré.<br />
Tab no 25 : Situation des districts de santé et de la couverture en soins intégrés dans<br />
I'Adamaoua pour l'année 1998<br />
Distrids de Nbre total Nbre Nôre d?S Nbre d'A.S. Population Population % popu -<br />
santé de F.S. d'aries Sté intégrées non totale couverte lation cou-<br />
Meiganga 999<br />
- 107 843 1O7 843 loOo/o<br />
Djohong 444<br />
43 2ô9 43269<br />
10Oo/o<br />
Tignère 81210 ; 70 052 61 085 87,20/o<br />
Tibati 11 13 10<br />
1 80 311 69 067 860/o<br />
Banyo 8 66<br />
63 014 63 014<br />
100o/o<br />
Bankim 8 66<br />
- 42028 42A28 lOOo/o<br />
Total 72 71 65 6 632 523 546 996 86,5%<br />
En terme de ratios, la province compte en moyenne une formation sanitaire pour 8785<br />
habitants. Cette répartition est meilleure en zone rurale qu'en zone urbaine : une formation<br />
sanitaire est au service de l l 715 habitants en zone rurale contre 27 500 habitants en milieu<br />
urbain. Mais les populations des zones rurales ne sont pas avantagées pour autant, étant<br />
donné les difficultés d'accès aux centres de soins, compte tenu de I'enclavement de la<br />
province et de la dispersion des populations. En effet, les distances à parcourir entre les<br />
localités et entre les formations sanitaires et les communautés et les intempéries rendent<br />
parfois impossible d'envisager d'acctider aux soins de santé. Les véhicules et les motos mis<br />
en place en 1989 par la coopération Américaines sont déjà défectueux. Près de 80% des<br />
véhicules et SOYI des motos sont en mauvais état. Par conséquent, les capacités de<br />
supervision des services de santé dans les districts et d'intervention en stratégie avancée<br />
sont très restreintes. Dans les districts de Meiganga et de Banyo, aucun des trois véhicules<br />
n'est en état de marche. Pour ce qui est des motos, 2l sur 4l sont en panne. Cette dégradation<br />
du parc automobile est essentiellement tributaire du mauvais état des routes qui<br />
restent impraticables en saison des pluies.<br />
A ce niveau, donc, des centres de soins sont en nombre insuffisants, mais ils existent,<br />
des organisations sont également mises en place pour superviser les services de santé et<br />
faire des interventions en > ; mais tous ces programmes et moyens sont<br />
rendus caduques parce que les déplacements sont difficiles et même impossibles pour des<br />
raisons extérieures : I'enclavement et le manque de moyens de transport.<br />
44 Ces hôpitauri qui sont mieux équipés sont implantés dans les districts de santé de Ngaoundéré et de Tibati où ils servent<br />
d'hôpitaux de district.<br />
5 Ces véhicules ont été mis en place dans le cadre du projet : Soins de I'Enfant du Sud et de I'Adamaoua : >Projet SESA >.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SÆ6,111199<br />
69<br />
Février2ffi
EI9qE! SOCTo.ECONOMTaUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Prwince de I'ADAMAOUA<br />
L'hôpital provincial de Ngaoundéré constitue la formation sanitaire réservée aux soins<br />
de réference de deuxième niveau à partir des hôpitaux de district. Il dispose de services de<br />
médecine générale, d'une maternité, d'une pédiatrie, d'un bloc opératoiie, d'une radiologie<br />
et d'un laboratoire. Il est le plus équipé des formations sanitaiies publiquesu. Les autres<br />
formations sanitaires sont en déficit total des matériels techniques et d'exploitation. Mais<br />
le véritable problème reste celui de la maintenance : certains appareils pewent être mis au<br />
rebut pour de simples pannes avant d'avoir été amortis. Lé sous-équipement des formations<br />
sanitaires existe également quant au nombre de lits d'hospitalisatiôn : en moyenne,<br />
on a I lit pour 1400 habitants. Ce qui varie d'un district de santé à I'autre. Tégnère est le<br />
district le plus avantagé avec I lit pour 844 habitants ; une étude des carences a été faite ciaprès,<br />
dans le district de Tibesti, il y a I lit d'hospitalisation pour près de 1600 habitants.<br />
Tab n" 26 : Situation sanitaire de t'Adamaoua i99g<br />
District Population<br />
de Nombre<br />
de santé<br />
sanfraires de lits médecîns d'infrrmers<br />
25 154<br />
30<br />
82<br />
Meiganga<br />
107 843 I 71<br />
5<br />
25<br />
Tignère<br />
70 052<br />
8<br />
83<br />
4<br />
16<br />
Tibati<br />
80 311<br />
11<br />
50<br />
5<br />
29<br />
Banyo<br />
63 014 I<br />
40<br />
2<br />
19<br />
Djohong<br />
43 269<br />
4 29<br />
1<br />
4<br />
Bamkim<br />
42028 I 28<br />
1<br />
10<br />
Total 632 523 73 rt55 185<br />
Le personnel médical de la province accuse également un déficit important. Elle compte<br />
en moyenne un médecin pour 13 180 habitants et un infirmier (y compris les infirmiers<br />
brevetés) pour 2700 habitants. La répartition du personnel est inégale à travers les districts<br />
de santé. Le district de Ngaoundéré est le mieux doté avec 30 médecins : soit 1 pour 7534<br />
habitants. Par contre, les besoins sont urgents dans les nouveaux districts de Djohong, de<br />
Bakim et pour Banyo avec respectivement un médecin pour 43 269, 42 028 et 31 507<br />
habitants. Les infirmiers et les techniciens de santé sont aussi plus concentrés en milieu<br />
urbain. Dans les zones rurales, certaines formations sanitaires fonctionnent avec un seul<br />
personnel de santé qui assure en même temps la consultation et les soins. Ainsi, Djohong a<br />
4 infirmiers pour plus de 43 000 habitants.<br />
Tab n" 27 : Indicateurs sanitaires 1998<br />
Formation sanitaire Médecins par par<br />
. .. . par habitant de tits par habita!! habitant habitant<br />
Ngaoundéré I 041 1 468 t SSa alz}l<br />
Meiganga<br />
Tignère<br />
Tibati<br />
Banyo<br />
Djohong<br />
Bamkim<br />
11 983<br />
8 757<br />
7 301<br />
7 877<br />
10 818<br />
5 254<br />
1 519<br />
21 569 107 843<br />
844<br />
17 513<br />
1 600<br />
16 063<br />
1 576<br />
31 507 ut o'to<br />
1 492 43269<br />
1 501<br />
42028<br />
I 785 1 400 131 787 90 361<br />
L'instabilité des populations ne permet pas aux diftrentes administrations de maîtriser<br />
certains ratios sociaux. D'après les services provinciaux de la santé publique, le taux de<br />
fecondité a été de 27o en 1998. Ce qui ne représente que les naissances déclarées ; d'après<br />
les mêmes sources, près de 50Yo des naissances en zone rurale ne sont pas déclarées. Le<br />
service de planning familial éprouve d'énormes difficultés pour sensibiliser les femmes<br />
aux méthodes contraceptives, notamment dans les milieux musulmans qui restent également<br />
peu sensibles aux programmes de vaccination. Les taux de couverture vaccinale restent<br />
très faibles dans la province ; au cours des récentes campagnes de vaccination, ils ont<br />
6 Cet hôpital provincial dispose du même niveau d'équipements de haute technologie que les hôpitaux protestants qui ont un<br />
repère local guant au service propose, compte tenu des moyens mis â ta disposition de l'équipe méàicale et des maladcs.<br />
MTNPAT / Projet PNUD-OPS CMR/Sil06rO1l99<br />
Févrierffi
ETUDES SOCIo'ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
été les suivants : BCG : 42,l2yo; DTCoq. : 26,57 ; Poliomyélite : 3l,88yo, Rougeole :<br />
24,4yo : ce qui reste en effet inquiétant, compte tenu des conditions générales de vie en<br />
faveur des développements de pathologies diverses.<br />
Pour l'année 1998, les causes de morbidité en termes absolus ont été les suivants :<br />
Paludisme 21818 cas ;Vers intestinaux 10191 cas ; MST. 9165 oas, Maladie de la peau<br />
8153 cas. Quant à la mortalité, les premières causes ont été les suivantes : Pneumonies,<br />
Diarrhég Paludisme et Broncho-pneumonies.<br />
En dehors des problèmes endémiques comme le paludisme, I'ensemble de ces causes de<br />
mortalité relève davantage des conditions d'hygiène générale et de I'hygiène de vie consécutifs<br />
à la paupérisatiorç plus qu'à la couverture vaccinale (exception faite de la rougeole<br />
citée dans le paragraphe suivant). Quant au BCG qui est le plus fort taux de vaccination,<br />
son effet semble concluant si ces données sont fiables, compte tenu de la recrudescence de<br />
la tuberculose ailleurs.<br />
Le nombre des séropositifs et de malades du SIDA est croissant dans la province : en<br />
1996,300 séropositifs ont été enregistrés pour 206 malades ; en 1997 , ce chiffre s'est porté<br />
à341pour 266 malades alors qu'en 1998, 384 cas ont été identifiés pour 300 malades : ici,<br />
étant donné l'efficacité connue de I'encadrement sanitaire et la négligence de la<br />
population, due à I'ignorance, une question vaut d'être posée : combien de cas sont ignorés<br />
et quelle sera leur répercussion sur la population saine ?<br />
Au cours des 4 derniers mois de I'année 1998, la province a enregistré une recrudescence<br />
de la rougeole avec 581 cas dont I I morts. Le seul district de Meiganga a eu 231 cas<br />
dont 8 morts. Ce même district de santé a souffert au cours de la même période d'une épidémie<br />
de méningite localisée dans I'aire de santé de Eka où 60 cas dont 12 morts ont été<br />
enregistrés.<br />
Ces dernières données sont révélatrices de I'impact des maladies contagieuses dans les<br />
milieux défavorisés : elles ont valeur de clignotant pour les mesures de prévention à<br />
instaurer.<br />
En ce qui concerne la distribution de médicaments, la moitié des districts n'a pas de<br />
pharmacies. La province dispose de 7 pharmaciens d'officines privées répartis dans trois<br />
districts de santé. Cinq pharmacies sont concentrées dans la ville de Ngaoundéré, une à<br />
Meiganga et une à Banyo. La population des autres centres urbains et des zones rurales<br />
reste donc marginalisée. Pour surmonter cette insuffisance, il a été créé dans les formations<br />
sanitaires publiques des propharmaciens dont la gestion est assurée par des Comités de<br />
Gestion (COGE) issus des Comités de Santé (COSA). Le Centre d'Approvisionnement en<br />
Produits Pharmaceutiques (CAPP) implanté à Ngaoundéré alimente les pro-pharmacies en<br />
médicaments en fonction de leurs besoins et surtout de leur disposition. La gestion des<br />
médicaments dewait permettre à chaque formation sanitaire de couvrir tous ses coûts. En<br />
1998, cela a pu être réalisé dans 47 formations sanitaires seulement, c'est-à-dire 65%. Dans<br />
les formations sanitaires confessionnelles, la distribution des médicaments est assurée par<br />
l'Oeuvre de Santé de I'Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (O.S.E.E.L.C.). Au<br />
cours de l'année 1998, une dizaine de formations sanitaires ont assuré la distribution des<br />
médicaments avec recouvrement des coûts.<br />
L'enclavement et l'éloignement rendent déjà difficile I'accès aux soins de premier niveau,<br />
même I'assistance aux soins ne peut être réalisée faute de moyens de déplacement.<br />
En ce qui concerne les grands complexes de soins (hôpitaux, cliniques...), le matériel<br />
fait défaut et lorsqu'il existe, le manque de moyens de maintenance le conduit au rebut<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRTSTO6Æ1199 71 Février 2@
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong> Province de IADAMAOUA<br />
avant même I'amortissement qui en perrnet le remplacement. Par ailleurs, le manque de lits<br />
déjà important, s'avère plus crucial avec les projections des années à venir.<br />
Le soin passe en grande partie par les médicaments: 50Yo de la région sont dépourvr"rs<br />
de pharmacie.<br />
Quant aux moyens humains (infirmiers, médecins,...) en dehors de la capitale régionale,<br />
qui connaît déjà des insuffisances, le problème est général, avec ces zones tout à fait<br />
délaissées.<br />
Les contraintes à surmonter dans les diftrents secteurs sont donc de plusieurs ordres :<br />
t. Province vaste, enclavée et populations dispersées en zone rurale : Les grandes<br />
superficies des aires et districts de santé avec des populations éparses, un relief<br />
accidenté aux voies de communication défectueuses et impraticables en saison des<br />
pluies rendent difiiciles la conduite et le suivi des activités de santé. Ceci est autant<br />
valable pour les usagers que pour le personnel chargé de mener les activités en<br />
stratégie avancée.<br />
2. La vétusté et/ou le mauvais état des infrastructures sanitaires : Les moyens sont<br />
insuffisants pour I'entretien des équipements et même pour I'acquisition des<br />
matériels nouveaux plus performants.<br />
:. Le manque de formation sanitaire dans certaines aires de santé rend la couverture<br />
sanitaire incomplète. Certaines aires de santé devraient d'ailleurs être subdivisées en<br />
deux ou trois s'il y avait des possibilités d'y construire des formations sanitaires.<br />
q. Le mauvais état ou l'absence des moyens de locomotion: Cette situation handicape<br />
la couverture adéquate des activités dans I'ensemble des aires de santé ainsi que la<br />
supervision des districts de santé. Les véhicules et motos fournis par le Projet SESA<br />
sont non seulement insuffisants, mais ne sont plus en bon état.<br />
5. Une insuffisance de moyens financiers et logistiques : Les possibilités des formations<br />
sanitaires à générer des ressources suffisantes sont très limitées. Les moyens alloués<br />
par I'Etat restent difficiles à mobiliser. Ce qui parvient à être mobilisé est insuffisant<br />
pour assurer le fonctionnement des services.<br />
o. Insuffisance du personnel de santé, surtout en zone rurale : Cette insuffisance<br />
handicape la conduite des activités de santé tant en stratégie fixe que dans les autres<br />
localités des aires de santé.<br />
7. La réticence des populations quant à leur adhésion aux activités de santé : Cet<br />
handicap explique la faible participation cornmunautaire tant aux activités préventives<br />
et promotionnelles de santé qu'aux structures de dialogue dans le cadre du partenariat<br />
Etat-Communauté : COSA, COGE, COSADI, COGEDI...<br />
L'état sanitaire de I'Adamaoua nécessité une assistance sous quatre principaux angles :<br />
t. Extension et aménagement de l0 centres de santé dans 4 districts de santé de la<br />
province.<br />
Des communautés dans certaines aires de santé sans centres de santé ont soit construit,<br />
loué ou donné de petites bâtisses servant d'abri aux activités de santé. Ces bâtisses étant en<br />
matériaux provisoires, les communautés concernées solliciteraient une aide substantielle<br />
pour l'extension et l'équipement de ces centres de santé de fortune.<br />
z. Equipement des formations sanitaires de 450 lits et matelas La capacité d'hospitalisation<br />
reste faible et stationnaire. (1 lit pour plus de 1400 habitants). La durée moyenne<br />
d'hospitalisation étant de 5 jours, il faut un lit pour 847 habitants.<br />
MINPAT / Prolet PNUD-OPS CMR/SD6O1,9S<br />
72<br />
Fêvrier2ffi
EQUIPEMENTS DE<br />
(1ee8-1gee)<br />
SANTE<br />
Gatoua<br />
*<br />
* I o<br />
t<br />
Lrmite des dtstricts de sant<br />
Limrte des atres de sant<br />
Hoprtal prwtnctal<br />
Hoprtal de dtstrict<br />
Centre mdrcal d'anondtssement<br />
Centre de sant<br />
Arre de sant sans centre de sant<br />
Pharmacte<br />
^@<br />
Centre de sant à crer<br />
NIGEf]IA<br />
Z*\v"''u'nÎ<br />
/ Dlohong ,,^..<br />
o<br />
/..',<br />
/Ngaour.<br />
':. t/<br />
(_._<br />
/<br />
Gbâboua<br />
ô<br />
Cenlre-<br />
Alrtque<br />
L:rit \D[<br />
L rirl- t? E'lron<br />
LL'r 1, .lp il l:.iri. rrênl<br />
o<br />
À<br />
I<br />
q{<br />
2oKm<br />
L ii'ia .1.t, r.,n'Jrssamenl<br />
L rir{É,,1e dtçlilcl<br />
CaDi1led l;l<br />
()l pr-L eux de F .t orl<br />
Cf ':j L eur (le .j [.llterr enl<br />
Ch.! Lreux d srronClsterenl<br />
IYAOUNOI<br />
DNpoilÉ<br />
O rrbatr<br />
i'r,tl r t(,1
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong> Province de I'ADAMAOUA<br />
r. Equipement des services de santé des diftrents districts des véhicules tout terrain et<br />
des motos. Le taux de couverture des maladies préventives reste bas (35Yo de couverture<br />
vaccinale). L'une des causes de cette faible couverture reste la forte infeodation des femmes<br />
par rapport à leurs maris, même dans le domaine médical. Il est donc nécessaire<br />
d'intensifier la sensibilisation constante des hommes pour qu'ils permettent à leurs épouses<br />
de participer aux activités de santé. Ce qui nécessite des visites permanentes sur le terrain<br />
qui ne peuvent être réalisées sans moyen de locomotion.<br />
+.[-a création d'une centrale provinciale et des ateliers dans les districts pour la maintenance<br />
des équipements.<br />
La mise en place d'un système de maintenance qui rentrerait dans I'optique d'une structure<br />
de recouvrement des coûts pour le ravitaillement en pièce détachées, le salaire du<br />
personnel, les matières consommables permettraient d'assurer une meilleure utilisation et<br />
une longévité certaine aux équipements techniques et d'exploitation.<br />
2. L'ENSEIGNEMENT<br />
Il convient de distinguer les équipements de<br />
I' enseignement secondaire.<br />
l'enseignement de base de ceux de<br />
A I.'ENSEIGNEMENT DE BASE<br />
La province de I'Adamaoua compte 330 établissements scolaires d'enseignement de<br />
base dont 24 écoles maternelles et 306 écoles primaires pour I'année scolaire 199711998<br />
(annexes 1 et 2). Les 24 écoles maternelles ont comptabilisé 1695 élèves pour 42 salles de<br />
classe et 68 enseignants. Ce qui correspond à un ratio de 25 élèves par enseignant et de 40<br />
élèves par salle de classe. Toutes ces écoles sont concentrées dans les centres urbains ; dont<br />
11 pour la seule ville de Ngaoundéré, 5 pour Tibati et 4 pour la ville de Banyo. Elles sont<br />
sous-équipées en matériel didactique et en matériel de distraction et de jeux.<br />
Tab no 28 : Etat de I'en maternel dans I'Adamaoua année scolaire 1997-1<br />
Départements<br />
d'enseignants I d'écoles I sa//e de élèves/ | Hèves/ vations<br />
Nombre Nombre I Nombre Ratros I Rafros Obser-<br />
G Total H F Total c/asse maîtres salle<br />
10 1024<br />
Djérem 102 108 210<br />
Mbéré 48 38 86<br />
Mayo-Banyo 114 109 223<br />
Fabo et Déo 90 62 152<br />
-363611<br />
-131305<br />
-050501<br />
-0808a4042856<br />
-06060362626<br />
Total 868 827 1695 - ô8 68 24 42<br />
provrnce<br />
G = Garçons ; F = Filles ; H = Hommes ; F = Femmes<br />
25 28 41 dont 1 école<br />
bilingue<br />
05 16 42<br />
02 17 43<br />
En ce qui concerne les 306 écoles primaires, elles comptent 58 665 élèves, 927 enseignants<br />
dont 131 vacataires, et 1093 salles de classe. Les ratios sont d'un enseignant pour<br />
64 élèves, ce qui est en dessous du seuil prévu par la réglementation du MINEDUC qui est<br />
de I enseignant pour 60 élèves. Il y a en moyenne 54 élèves pour une salle de classe. Ce<br />
chiffre serait revu à la baisse si on tient compte du fait que près de 25o de ces établisse<br />
ments fonctionnent suivant le système de mi+emps.t Dans certains départements, le nom<br />
bre d'élèves par classe rend Ie cours impossible. Par exemple, dans le Faro et Deo et le<br />
7 L'absence de concordance entre les ratios élèveVmaîtres et élèves par salle de classe s'explique par le fait que dans les<br />
écoles de brousse, un seul maître s'occupe au mêrne moment des élêves de 2 ou 3 niveaux.<br />
MINPAT / Projel PNUD-OPS CMR/S,196,O1 199 t5 Février2ffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Provincæ de I'ADAMAOUA<br />
Mbéré, le ratio élèves/maître atteint 80 et 86 élèves. Il est inferieur à 60 dans les autres<br />
départements.<br />
Tab no 29 : Etat de I'enseaqnemen dans I'Adarnaoua année scolaire 1997-1<br />
Nombre d'élèves<br />
Nombre Nbre Nbre Rafios Rafibs Obseruations<br />
tements<br />
d'enseignants écoles sa//e Hèves/ élèves/<br />
sa//es<br />
G F Total % F<br />
c/asse maltres c/asse<br />
0.8 V Tot<br />
Vina 14 10 25 42,9 364 60 424 105 422 60 60 donfi<br />
324 790 114<br />
Djérem 3 631 2 386 6 017 39,6 79 24 103 34 137<br />
Mbéré 8231 4623 12854 36 137 12 149 80 241<br />
Mayo- 5 653 3 706 I 359 39,6 167 17 '184 58 190<br />
Banyo<br />
86 53<br />
51 49<br />
bilingue de 872<br />
élèves<br />
dont I école bi<br />
lingue de 63<br />
élèves<br />
2 écoles bilingues<br />
de 450<br />
élèves<br />
FaboetDéo 2684 2637 5321 49.5 49 18 67 29 103 80 52<br />
Total 34523 24142 58665 41,15 796 131 927 306 1093 64 54 dont + deæ96<br />
province<br />
fonctionnent<br />
suilant le sys-<br />
G= Garçons; F = Filles P = Permanents; V=Vacataires<br />
B. I-'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE<br />
La province de I'Adamaoua compte 3l établissements d'enseignement secondaire dont<br />
7 d'enseignement technique. Tous ces établissements comptent 13.081 élèves, de 444<br />
enseignants dont 23 vacataires et de 267 salles de classe. Le département de la Vina,<br />
compte tenu de son poids démographique et de son taux de scolarisation supérieur au taux<br />
moyen de la province dispose de 1.7 établissements, 156 salles de classe et de 268 enseignants.<br />
Pour l'ensemble de la province, le ratio moyen élèvesênseignants est de 34 pour<br />
l'enseignement secondaire général et de 15 pour l'enseignement secondaire technique.<br />
Tab no 30 : Etat de I'enseignement secondaire général dans I'Adamaoua (année scolaire 1997-<br />
Vina<br />
Djérem<br />
Mbéré<br />
998<br />
Départements<br />
Mayo-<br />
Nombre d'élèves<br />
Nombre<br />
dênsetgnanfs<br />
V Tot.l<br />
Nbre<br />
Etab.<br />
Nbre<br />
sa/le<br />
Rafrbs<br />
Elèves/<br />
G F Total %F P<br />
c/asse Enseiqn.<br />
4114 2801 6915 4't 197 11 208 15 135 33<br />
1027 378 1405 2731-3122846<br />
804 357 1161 30,7 27 - 27 2 26 43<br />
932 519 1451 35.7 48 - 48 2 35 31<br />
Banyo<br />
Fabo et Déo 343 173 516 33.5 20 2 22 3 22 24<br />
Rafrbs<br />
élèves/<br />
sa//es<br />
c/asse<br />
52<br />
51 Tous des<br />
lycées<br />
47 Dont 1 lycée<br />
classique<br />
42 Dont 2 lycées<br />
classiques<br />
24 Dont'l lycêe<br />
classioue<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRTS,'106I01/99 74 Février M
LUTTE ANTITSE.TSE<br />
G. M.Submorsltans<br />
sÈ.<br />
:><br />
Zones assarnres<br />
Barrrre d'crans (en prolet)<br />
Pressron glossr narre<br />
G Morsrtans submorsrtans<br />
f-- Frr
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Provlnc'e . ,<br />
cation Nationale de I'Adamaoua<br />
G= Garçons;F = Filles P= Permanents;V =Vacataires<br />
Quant au ratio élève$salle de classe, il est de 52 pour l'enseignement général et de 37<br />
pour I'enseignement technique. S'il est vrai que ces ratios respectent les normes du<br />
frrfl.fr{EOUC et sont meilleurs que ceux des provinces méridionales du pays, ils masquent<br />
malheureusement un certain nombre de contraintes qui entravent l'éducation dans la<br />
province de I'Adamaoua.<br />
Tab n" 3i : Etat de I'enseignement secondaire et technique dans l'Adamaoua (année scolaire<br />
Dépar<br />
tements<br />
G<br />
611<br />
Total %F<br />
Djérem 141 48 189 25.4 14<br />
Mbéré 184 45 229<br />
Mayo- 181 84 265 31,7<br />
Banyo<br />
Fabo et Déo 51 15 66 22,7 2<br />
d'enseignants<br />
P V Total<br />
15<br />
Nbre<br />
Eta-<br />
B/rss.<br />
sa//e<br />
c/asse<br />
Rafios<br />
élèves/<br />
ensergn<br />
Rafibs<br />
élèves/<br />
sa//es<br />
c/asse<br />
2 15 42 ous les établissements<br />
sont<br />
localisés à Ngdéré<br />
ll s'agit du CETIC de<br />
Tibati<br />
25 - 25 2 10 10 23 20ETlCdontl<br />
confessionnel<br />
6 - 6 1 5 45 53 ll s'agit du CETIC de<br />
BanYo<br />
'<br />
13<br />
2 1 2 33 33 ICET|C<br />
nouvellement créé à<br />
province<br />
G =èarçons;F= Filles<br />
ciale de I'Education Nationale de IAdamaoua<br />
P = Permanents;V= Vacataires<br />
C. TES CONTRAINTES DANS tE DOMAINE DE I'EDUCATION<br />
L'insuffisance d'enseignants qualifiés et le délabrement des équipements. La surcharge<br />
des salles ne pouvant faire espérer une bonne scolarité, ni même une scolarité moyenne.<br />
Mais il y a pirË : la plus grande majorité des enfants d'âge scolaire ne sont pas scolarisés<br />
q. Sous-scolodscrtion<br />
Le taux de scolarisation de la province de I'Adamaoua est passé de 33,7Yo pour I'année<br />
lgg6lgT ù 37,6yo au cours de l;année 1997198. Malgré cette améliolation, I'Adamaoua<br />
reste l'une des provinces les plus sous-scolarisées du Cameroun. Cela s'explique par le<br />
contraste suivani : les musulmans mieux nantis manifestent peu d'enthousiasme à l'éducation<br />
des enfants au moment où les chrétiens pauvres, de par la précarité de leurs revenus<br />
n'arrivent pas à en supporter les charges éducatives, en dépit de leur bonne volonté'<br />
En efpet, une bonne proportion de musulmans reste encore réticente quant à la scolarisation<br />
des enfants. Les filles restent plus marginalisées. Les filles ne représentent que 4loÂ<br />
des élèves inscrits dans les écoles primaires de la province.<br />
Le taux le plus faible est celui du département du Mbéré où les filles ne représentent<br />
que 36yo des élèves. Lorsqu'on passe du cycle primaire au cycle secondaire' le<br />
pourcentage de filles baisse à 37o pour I'enseignement général et à 28,4yo pour<br />
i'enseignement technique. Le taux le plus faible est observé dans le département du<br />
Djérem où il est de 27ô/o pour I'enseignement secondaire et de 25,4o/o pour I'enseignement<br />
technique. Cette marginalisation de la jeune fille à l'éducation est essentiellement tributaire<br />
des considérations coutumières selon lesquelles toute jeune fille devrait garder sa virginité<br />
jusqu'au moment de son mariage. Les parents estiment donc que la scolarisation des filles<br />
-se<br />
traduirait par le port de l'uniforme au lieu des pagnes habituels et les exposerait à la<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/Sffi/O1r99 75 Févrierffi
ETUOES SOCIO.ECONOMT<strong>AU</strong>ES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
violation de ces dispositions coutumières. C'est pourquoi les mariages précoces sont légion<br />
dans la province.<br />
La sous-scolarisation s'explique également par l'extrême précarité des revenus des<br />
parents. Ceux-ci sont généralement des agriculteurs localisés dans les périphéries des<br />
grands centres urbains. Malgré I'engouement qu'ils manifestent pour l'éducation de leurs<br />
enfants, ils sont incapables de subvenir aux charges subséquentes du fait de I'insuftisance<br />
des ressources financières issues de leurs activités. Il ressort d'ailleurs des statistiques de la<br />
délégation départementale de la Vina que le nombre d'enfants inscrits dans les écoles<br />
publiques a fléchi de 22,83Yo ente l'année scolaire 1995196 et l'année 1996/97 du fait de<br />
l'augmentation des frais de scolarité qui sont passés de 500 F.CFA à I 500 F.CFA. Les<br />
charges scolaires créent donc une sélection ; la scolarité est réservée à ceux qui peuvent<br />
payer.<br />
La dispersion de la populatiorq la transhumance et I'enclavement contribuent largement<br />
aussi à l'explication de la sous-scolarisation dans la province. Les populations de I'Adamaoua<br />
sont trop dispersées en zone rurale. On y trouve des groupements humains de 150 à<br />
500 personnes distants de dizaines de kilomètres les uns des autres. Il reste difficile ou<br />
parficis impossible de doter ces petits villages d'écoles primaires, compte tenu du nombre<br />
réduit des enfants en âge scolaire. Généralement, une école est créée pour 3 à 5 villages de<br />
cette taille. Les longues distances ne permettent pas aux enfants des villages très éloignés<br />
de s'inscrire dans ces établissements, ce qui accroît la proportion des enfants non scolarisés.<br />
Quant à la transhumance, elle se traduit par l'abandon des classes de certains enfants qui<br />
sont contraints d'accompagner leurs parents à la recherche des pâturages. Cette pratique<br />
engendre la déperdition scolaire et grossit le nombre des enfants non scolarisés.<br />
b. l'insuffisqnce des enseignonls quolifiés el d'infroslruclures odéquotes<br />
Depuis plusieurs années, l"Etat, du fait de la crise économique n'assure plus la formation<br />
des instituteurs. Les écoles de formation ont été fermées pendant près de 6 ans. Ce<br />
n'est que depuis I'année 1995/96 qu'elles ont été réouvertes. Les élèves instituteurs se<br />
prennent en charge eux-mêmes et ne sont pas tous recrutés à I'issue de leur formation. Les<br />
mêmes raisons financières ont contraint I'Etat à réduire le nombre d'étudiants en formation<br />
dans les Ecoles Normales Supérieures. Ce qui justifie le nombre important des enseignants<br />
vacataires dans le primaire et le secondaire. Ils sont à la charge des Associations de Parents<br />
d'Elèves (A.P.E). L'absence de pédagogie ne les prédispose pas à dispenser une formation<br />
appropriée aux élèves.<br />
En ce qui concerne les infrastructures, les bâtiments construits à l'époque coloniale<br />
sont, dans certains centres urbains en état de délabrement avancé, par manque d'entretien.<br />
Dans les zones rurales, certaines bâtisses faites en matériaux provisoires tiennent lieu<br />
d'écoles. A la suite des calamités naturelles (tornades, fortes pluies, etc.), elles sont<br />
partiellement ou entièrement détruites. Il en résulte très souvent la disparition de l'école<br />
concernée. Beaucoup reste à faire pour améliorer la scolarisation des enfants dans<br />
l'Adamaoua, tant en ce qui concerne le niveau scolaire qu'en ce qui concerne la<br />
participation à la scolarité.<br />
D. QUETQUES PROPOSITIONS<br />
l. La création d'écoles primaires et de collèges pour jeunes filles exclusivement avec<br />
des pagnes coûrme uniformes.<br />
2. La formation et la prise en charge des instituteurs par I'Etat.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SlCGilOl,99 76 Février 20O
EQUIPEMENTS SCOLAIRES<br />
(1es8 - 19ee)<br />
Nombre d' coles pnmalres<br />
Collge d'ensergnement technlque<br />
Collge d'ensergnement secondatre<br />
"o oo<br />
Collge pnv<br />
Lyce d'ensergnement techntque<br />
Lyce classrque<br />
--^---f<br />
(<br />
J<br />
,/<br />
l'1tG{{lrn<br />
'. Mayo-Darl<br />
Mayo-<br />
,*rot * O )"<br />
uorrYv o ^ ^,, ^ (58)<br />
Mayo-Bal o<br />
o^a<br />
Fa'r'o-Et-D o<br />
Galrm-<br />
A<br />
Trgn O<br />
*a A o<br />
Bka<br />
(?9 o Tigrrn<br />
Oc-too<br />
*Aa tr rcAoulotnr<br />
@<br />
Djerem<br />
*oa"<br />
i<br />
I<br />
O.'<br />
,/<br />
Tibsti<br />
Ngaoundal i.<br />
w*'*'*'<br />
vlna<br />
Ao il!,ï;,<br />
A<br />
Dtr<br />
6!3<br />
Àrh<br />
Nyambaka<br />
AO<br />
Lyce brhngue<br />
Ecole normale d' Instlluteurs<br />
Unrversrt<br />
Ào<br />
Bll \<br />
lileignga<br />
'o**<br />
\'--'<br />
'<br />
Dtohono<br />
oA<br />
(<br />
('<br />
)<br />
No"ou,<br />
"/<br />
' ,t''<br />
/'<br />
/ '],'.,'<br />
(<br />
t<br />
ry<br />
or,----=--!xttt<br />
t;.ii ft:';<br />
Frontr re<br />
Lrnnle,.lè B grù<br />
Lrmrle dè d parlemenl<br />
LrmrlÈ d afitrdrssflsl ,<br />
Lrmrte de drslrct<br />
Caprale d'tal<br />
lYÂo<br />
Chel-Lreux de F gion O<br />
Chet"Lreux de d parlffrenl O<br />
CheJ-Lreu\d'ailondrsssenl O<br />
Drstrcl
ETUOES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de fADAMAOUA<br />
Cela permettrait d'améliorer la qualité des enseignements dispensés aux élèves avec<br />
l'arrêt progressif du recrutement des vacataires.<br />
:. La réhabilitation des écoles construites à l'aide des matériaux provisoires et construction<br />
de quelques écoles dans les zones rurales où les besoins sont exprimés.<br />
4. L'intensification de la sensibilisation des populations à travers les chefs religieux, les<br />
lamidos et le Djaouros des vertus de I'éducation. Cette sensibilisation devrait impliquer<br />
les élèves extérieurs qui peuvent mieux cerner les enjeux de la sous-scolarisation de ieur<br />
région par rapport au niveau de l'éducation dans les autres provinces du pays.<br />
3. LES <strong>AU</strong>TRES EQUIPEMENTS SOCIO-COTLECTIFS<br />
À I.ES EQUIPEMENTS SPORTITS ET RECREATITS<br />
La ville de Ngaoundéré dispose de plusieurs complexes sportifs : celui de la municipalité<br />
(stade NDOIIMBE OL]MAR) et les infrastructures aménagées dans les établissements<br />
scolaires publics et confessionnels. Les aires de jeux ont été construites et aménagées<br />
à l'occasion des finales nationales OSSUC que la ville de Ngaoundéré a abritées en<br />
1989. Aujourd'hui, ces infrastructures sont dégradées à 6OYo. En dehors de la ville de<br />
Ngaoundéré, aucun cheÊlieu des départements de la province n'est doté d'infrastructures<br />
sportives, hormis quelques stades de football non entretenus, non clôturés appartenant aux<br />
municipalités. Les aires des jeux réservées aux autres disciplines sont quasi inexistantes,<br />
tant dans les établissements primaires que secondaires. Cette absence d'infrastructures<br />
s'étend dans les domaines de I'encadrement de la jeunesse et de l'éducation populaire.<br />
Seules les villes de Ngaoundérq Meiganga et Banyo disposent des centres de jeunesse<br />
et d'animation de 2 salles chacun et regroupent respectivement 38,21et l8 jeunes. L'existence<br />
de ces centres est tributaire de la générosité des mairies qui ont mis ieurs bâtiments<br />
au service de la jeunesse et des sports. Il en est de même des délégations départementales<br />
de la jeunesse et des sports qui disposent d'un bureau dans une préfecture ou une souspréfecture.<br />
8. TES EQUIPEMENTS I.IES <strong>AU</strong>X ATTAIRES SOCIAI.ES ET A TA CONDITION TEMININE<br />
Chaque unité administrative dewait comporter une unité de service social. Cependant,<br />
seules les délégations départementales et les services d'arrondissements situés àans les<br />
chefs-lieux des départements sont opérationnels du fait de la disponibilité du personnel.<br />
Les centres sociaux sont des unités techniques de base et d'appui aux affaires sociales et<br />
à la promotion de la femme. Dans I'Adamaoua, aucun centre n'est fonctionnel par manque<br />
d'équipement et de personnel. Il existe 5 postes sociaux pour les 5 départements, créés et<br />
budgétisés. Cependant, seul le poste social des tribunaux d'instance de Ngaoundéré est<br />
opérationnel.<br />
En ce qui concerne les infrastructures, seule la délégatian départementale de laYinaa<br />
été construite et répond aux norlnes des centres sociaux. Dans les autres villes, les<br />
bâtiments conventionnés peu adaptés abritent les services du MINAS et du MINCOF. Ces<br />
structures s'illustrent par un manque d'équipement de première nécessité, suite à de nombreux<br />
vols. On peut y ajouter le comportement du < laisser faire> de certains responsables<br />
qui confondent les biens de I'Etat à leur propriété privée.<br />
Qu'il s'agisse de la jeunesse et des sports, des affaires sociales ou de la condition<br />
feminine, les responsables se heurtent à de nombreuses contraintes dans la realisation de<br />
leurs obligations.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRIS^16O1,99 77 Février 2@
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
C. I.ES CONTRAINTES<br />
En général, on note I'insuffisance du personnel, et de nombreuses carences pour ceux<br />
qui sont en place : beaucoup de cadres en service n'ont jamais suivi de séminaires de recyclage.<br />
Sur le plan financier, les dotations budgétaires sont insuftisantes pour le fonctionnement<br />
des services. Les difficultés sur le terrain sont nombreuses du fait de I'insuffisance<br />
de moyens de transport et du mauvais état des routes.<br />
D'autres contraintes plus spécifiques concernent beaucoup plus les affaires sociales et la<br />
condition feminine. Il n'existe pas de structures appropriées pour assurer les activités liées<br />
à la protection des droits de I'enfant. La majorité des mineurs dits inadaptés sociaux sont<br />
des enfants non scolarisés. Ce qui rend leur assistance plus difficile. Les handicapés et les<br />
personnes de 3tu âge souffrent du manque de structures.<br />
La sous-scolarisation feminine reste le premier obstacle qui handicape la promotion de<br />
la femme. Et les efforts de l'éducation, de formation et de promotion des droits de Ia<br />
femme sont infructueux.<br />
D. QUETQUES PROPOSIITONS DE SOI.UIION<br />
Dans Ie domaine de jeunesse et de sport, il faut :<br />
- Doter chaque cheÊlieu de département d'un bâtiment administratif et d'un centre de<br />
jeunesse et d'animation.<br />
- Doter ces centres de jeunesses des équipements performants et de haute technicité<br />
grâce auxquels les jeunes pourront bénéficier d'une formation de bonne qualité<br />
susceptible de faciliter leur insertion dans le monde du travail.<br />
- Organiser les séminaires et les colloques de recyclage pour les encadreurs afin de<br />
relever leur niveau de compétence.<br />
- Doter toutes les unités administratives des aires de jeux pour l'épanouissement des<br />
jeunes.<br />
- Réhabiliter les infrastructures qui sont en état de dégradation avancée.<br />
En ce qui concerne le secteur des affaires sociales et de la condition feminine. les actions<br />
à entreprendre sont les suivantes :<br />
- créer des postes sociaux dans les principales gires ferroviaires de la province.<br />
- mettre en place des structures d'accueil pour les personnes de 3ème âge.<br />
- Doter la province d'une institution de réhabilitation des personnes handicapées.<br />
- Créer des centres de promotion de la femme dans chacun des chefs-lieux des départements.<br />
- Doter les centres sociaux d'équipements performants.<br />
Pour chacun des deux domaines, accroître les dotations budgétaires pour le fonctionnement<br />
des délégations provinciales et départementales.<br />
MINPAT / Prolet PNUD-OpS CMR€9,,!J6,!O1,gg 78 Février&
ETUDES SOCIO-ËCONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Proûnce de IADAMAOUA<br />
I. I.ES CONTRAINTES DE I'URBANISATION<br />
L'insuffisance du réseau routier est un facteur néfaste aux relations entre difiËrentes<br />
localités. Il n'y a aucun axe central Nord-Sud. Pourtant, la situation géographique de la<br />
Province est un facteur déterminant pour le développement de Ngaoundéré qui est le<br />
carrefour régional. L'Adamaoua présente une structure urbaine forte. Mais son taux<br />
d'uôanisation de 36 % reste inferieur à celui du pays qui est de 49 Yo. On note cependant<br />
qu'il n'y a aucune complémentarité entre les diftrentes parties d'où un déséquilibre des<br />
rapports commerciaux entre les zones.<br />
Bien que la population soit agricole, les villages et les petites villes remplissent des<br />
fonctions nettement urbaines. La civilisation peuhlg et le colonialisme ont favorisé la<br />
concentration du peuplement et des services.<br />
La qualité de I'habitat est assez frappante (centralité des fonctions et habitat sous forme<br />
de sarQ. Presque 65 % des ménages y habitent. La structure urbaine est presque traditionnelle.<br />
C'est un atout pour le tourisme, d'où I'implantation dans la Capitale Provinciale de<br />
I'Ecole Nationale d'Hôtellerie et du Tourisme (ENAHT).<br />
En matière d'infrastructure de communication, la Province est rattachée au Nord et à la<br />
Capitale Politique (Yaoundé) par la Nationale N'l (RNl) bitumée entre Ngaoundéré et<br />
Kousseri et non entièrement avec Yaoundé. Elle l'est aussi par voie aérienne et par chemin<br />
de fer où Ngaoundéré est le terminus du transcamerounais. La province s'ouvre sur le reste<br />
du pays.<br />
Généralement, la taille d'une ville est fonction de son importance sur le plan administratif,<br />
c'est-à-dire par le nombre des agents de I'Etat et des services administratifs qui y<br />
sont concentrés. C'est un élément moteur de la croissance urbaine dès les indépendances.<br />
Ainsi, selon la population et les fonctions administratives, nous classerons les villes de la<br />
Province de I'Adamaoua.<br />
2. HTERARCHIE URBAINE DANS I.A PROVINCE<br />
Ngaoundéré, Capitale Provinciale, reste la ville la plus peuplée avec 207.244 habitants.<br />
Viennent par ordre d'importance décroissante : Meiganga (158.017 hbts), Banyo QA7.2l5<br />
hbts), Tibati (93.068 hbts), et enfin Tignère avec 56.952 hbts. En fonction de la population,<br />
des fonctions urbaines, des infrastructures et des équipements d'encadrement, la hiérarchie<br />
des villes se présente comme suit :<br />
- Ngaoundéré demeure la première ville de la Province par son rôle administratif et<br />
potitique (capitale), sa population et son niveau d'équipement infrastructurel. Elle est<br />
le siège de la 6ne région militaire et du "quartier latin" de la Province avec son<br />
Université. Elle est le terminus de la voie ferrée et est considérée comme "port sec"<br />
pour toute la région, comporte une grande école de formation ENAHT, de nombreux<br />
hôpitaux et dispensaires.<br />
- Meiganga est la deuxième ville provinciale. Elle est reliée comme Ngaoundéré à une<br />
centrale téléphonique et peut communiquer indépendamment de sa capitale avec le<br />
reste du monde. C'est aussi le premier marché camerounais de bétail et même de<br />
I'Afrique Centrale.<br />
Ml NPAT / Projet PN U D-OPS CMR/$/Oæ/O1 199<br />
79<br />
FévnerZffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAIT AOUA<br />
- Banyo vient en troisième position grâce à sa position stratégique qui la rapproche de<br />
la dynamique de la province de I'Ouest (plus proche de Bafoussam que de<br />
Ngaoundére). Sa forte population s'urbanise vite et pratique la culture du cafe.<br />
- La ville de Tibati occupe le quatrième rang. C'est une ville de transition reliée à la<br />
ligne de chemin de fer par une route bitumee de I 17 km (Ngaoundal - Tibati). Elle est<br />
aussi située sur la Transafricaine, ce qui fait qu'elle connaît un trafic dense des<br />
camions en provenance et à destination de la République Centrafricaine et du Tchad.<br />
- Tignère, enfin, est la ville la plus enclavée de la province. Elle n'est même pas<br />
connectée au réseau SNEC et présente peu d'attraits urbains.<br />
3. CAS PARTICUTIER DE TA VILI.E DE NGAOUNDERE<br />
Ancien cheÊlieu du département de I'Adamaoua devenu capitale provinciale depuis<br />
1982 sans aucune restructuration préalable, Ngaoundéré, de par sa position géographique,<br />
son importance politique, économique et démographique, est plus marquée par le<br />
phénomène des quartiers spontanés et insalubres.<br />
[,e développement de cette ville est modeste mais non négligeable, quoiqu'en dessous de<br />
la moyenne des villes de même nature.<br />
* En effet, Ngaoundéré dispose des équipements collectifs sanitaires, éducationnels et<br />
culturels<br />
Sur le plan sanitaire, la ville dispose :<br />
- d'un hôpital provincial et des centres de santé avec des médecins spécialistes ;<br />
- un senrice de maternité provincial ;<br />
- des centres médicaux privés assez bien équipés ;<br />
- des cabinets médicaux privés ;<br />
- des pharmacies ;<br />
- des laboratoires d'analyses médicales.<br />
L'éducation comporte un équipement collectif appréciable et on peut compter :<br />
- une Université ;<br />
- un Institut Universitaire de Technologie ( ruT ) ;<br />
- une Ecole Nationale de Formation en Hôtellerie et au Tourisme (ENAHT) ;<br />
- des lycées d'enseignement secondaire général, technique et bilingue ;<br />
- des collèges publics et privés,<br />
- des écoles primaires et maternelles privées et publiques ;<br />
- des écoles coraniques islamiques.<br />
Sur le plan culturel, la ville dispose :<br />
- d'un stade de Football municipal et une équipe (Grondins) en première division<br />
nationale;<br />
- des petits stades de Basket-ball, de Handball et de volley-ball dans les établissements<br />
scolaires et universitaires de la place.<br />
- Une Maison de la Jeunesse sans grand équipement.<br />
Il n'y a cependant pas d'espaces aménagés ou viabilisés importants pour les populations.<br />
Les Parcs et les Jardins publics y sont embryonnaires.<br />
* Les infrastructures, le transport et la communication pour cette ville sont relativement<br />
modestes.<br />
Ml N PAT / Projet PN UD-OPS CMR/S/O6rO1 199<br />
Féwier2ffi
ETUD€S SOCIO-ECONOMIOUES REGTONALES <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAIvIAOUA<br />
On y rencontre :<br />
- un réseau réduit d'adduction et de distribution d'eau ;<br />
- un réseau de communication assez pauvre (la ville de Ngaoundéré ne compte que l0<br />
km de route bitumée, en mauvais état);<br />
- un réseau d'assainissement inopérant ,<br />
- des bornes fontaines publiques absentes ;<br />
- des toilettes publiques et W-C inexistants ;<br />
- pas de station de traitement des déchets ;<br />
- pas de dépotoir contrôlé des ordures ménagères ,<br />
- le système de drainage des eaux de pluies et leurs ouvrages de rétention sont<br />
précaires;<br />
- un aéroport fonctionnel desservi par la CAMAIR (Cameroun Airlines) quatre fois par<br />
semaine.<br />
- une gare pour les camions gros porteurs ;<br />
- plusieurs gares voyageurs par autobus et autres voitures gérées par des compagnies de<br />
voyage;<br />
- un service de transport interurbain tenu par les "moto-taxis" et quelques voitures taxi ,<br />
- un réseau d'énergie électrique fiable ;<br />
- un réseau de téléphone national et international pratique malgré des fréquentes<br />
pannes.<br />
* Comme fonctions administratives, politiques et économiques de la ville de<br />
Ngaoundéré, il y a lieu de signaler que la ville est :<br />
- la capitale Provinciale de I'Adamaoua;<br />
- elle a une Préfecture et une Sous-Préfecture-<br />
- une Commune urbaine;<br />
- une Commune rurale;<br />
- un service de Banques;<br />
- des succursales d'Assurances:<br />
- des abattoirs<br />
- des chambres froides pour conservation;<br />
- des hôtels, des auberges, des boîtes de nuit, des bars et des restaurants;<br />
- des marchés de niveaux différents;<br />
- des boutiques de vente en gros et détail ;<br />
- des hangars et magasins de stockage des marchandises ;<br />
- des industries de transformation, et quelques petites sociétés ou représentations ;<br />
- pas de centre d'artisanat appréciable.<br />
Par la route bitumée, Ngaoundéré échange avec le Nord le manioc, les céréales et les<br />
cultures maraîchères ; avec le Sud et grâce à la voie ferrée, la banane plantain. C'est en<br />
somme une ville de transit et de stockage de marchandises et produits. D'une manière<br />
générale, les rapports villes-villes ou province-province sont caractérisés par un<br />
déséquilibre général dû à I'insuffisance des moyens de communication d'une part, à la<br />
faiblesse générale de l'économie d'autre part. Toutefois, les relations s'articulent autour de<br />
l'Administration, des échanges humains, de l'économie et des services de tous genres.<br />
Les longues distances interurbaines sont un frein aux relations économiques.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR,98IO6O1t99 8l Féwierffi
ETUDES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
Toutefois, Ngaoundéré en tant que Terminus du réseau ferroviaire du Cameroun, se<br />
positionne pour le Tchad et la République Centrafricaine (RCA), conrme un intermédiaire<br />
pour leurs produits venant du Port de Douala. La capitale Provinciale joue ici un rôle<br />
économique de premier plan puisqu'en dehors de ces deux pays suscités, le Nigeria aussi<br />
échange avec elle, d'où la dimension internationale de cette ville.<br />
En général, les rapports économiques reposent sur les produits de l'élevage et de<br />
l'agriculture qui intéressent aussi bien les campagnes que les villes. Les relations vont<br />
s'articuler autour des marchés ruraux et urbains où se côtoient citadins et villageois dans<br />
une réelle symbiose.<br />
Sur le plan politique, plusieurs partis sont représentés dans la Province avec leurs sièges<br />
régionaux dans la ville de Ngaoundéré; ce sont le RDPC, IuNDp, le MD\ t,appp.<br />
Plusieurs Ministres et Députés sont originaires de Ngaoundéré.<br />
* Les réseaux urbains (eau, téléphone, électricité, assainissement)<br />
De par sa situation géographique et son importance dans la Province, la ville de<br />
Ngaoundéré est marquée par le phénomène très poussé de quartiers spontanés et<br />
insalubres. Dans ces quartiers en effet, existe un type d'habitat précaire où l'eau potable et<br />
l'électricité sont quasiment absentes. Ces quartiers incontrôlés sont source de proliferation<br />
de nombreuses maladies.<br />
Dans le domaine de I'organisation de I'espace urbairç il existe plusieurs intervenants<br />
provenant d'horizon divers. Ceci rend difficile toute tentative d'harmonisation. L'Administration<br />
s'occupe de tout, rendant timide l'initiative des privés à Ngaoundéré.<br />
La ville a deux coûrmunes : la commune rurale s'occupe des localités autour de<br />
Ngaoundéré alors que la commune urbaine se limite à la ville de Ngaoundéré. A cause de<br />
la crise économique, la commune n'arrive pas à atteindre ses objectifs, notamment à offrir<br />
à ses habitants un cadre de vie agréable. C'est ainsi par exemple que les ordures ménagères<br />
sont enlevées deux fois (2) par semaine seulement dans la commune urbaine. Les habitants<br />
doivent attendre en vain le passage des camions dans les quartiers périphériques. Pour<br />
pallier à ces insuffisances, les populations déversent leurs déchets dan la nature environnante,<br />
créent des dépôts sauvageq cadre par excellence des mouches et moustiques,<br />
vecteurs de nombreuses maladies. La gestion de ces déchets domestiques à Ngaoundéré<br />
pose problème puisqu'il n'existe pas d'usine de transformation de compostage (malaxage)<br />
pour être utilisés comme engrais par les agriculteurs. Tandis que les déchets biodégradables<br />
posent moins de problèmes, ceux dits non biodégradables (matières résistant à I'activité des<br />
agents biologiques) constitués des emballages du polyéthylène, des boites de yaourt, des<br />
boites de conserve, des verreries, etc., sont plus dangereux. Les autorités communales<br />
dépassées, en appellent à la discipline au niveau des ménages.<br />
Intervenant à tous les niveaux, les autorités administratives restent incontournables.<br />
Elles assurent la tutelle des communes et ont un droit de regard sur toutes leurs activités.<br />
Ainsi, les services du Ministère de I'Urbanisme et de I'Habitat et la Délégation Provinciale<br />
des Travaux Publics s'occupent des aspects techniques de I'habitat en milieu urbain. Ils<br />
assistent les municipalités dans le domaine de I'aménagement de I'espace. Mais ces actions<br />
buttent sur les orientations politiques des communes.<br />
Devenue capitale provinciale depuis 1982,le manque de financement n'a pas permis à<br />
Ngaoundéré d'acquérir des infrastructures urbaines normalisées. Le manque d'espaces<br />
aménagés viables et I'afflux de la population rurale en zone urbaine a créé des zones non<br />
constructibles où I'on se construit dans les marécages et sur les flancs de montagne. C'est la<br />
zone des pauvres urbains. Les autorités ont pourtant pensé réduire cette pauvreté urbaine<br />
MIN PAT / Projet PNUD-OPS CMR/SO6rO1 r!99 82 Février2@
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
en créant Ngaoundéré II, malheureusement séparée de Ngaoundéré I par le chemin de fer<br />
et une zone hydromorphe. Il faudrait donc relier les deux parties par un système de viaduc<br />
qui coûte cher. La conséquence reste qu'il y a une réticence des populations à occuper<br />
Ngaoundéré II.<br />
Le manque de logement social, qui est du domaine de la Société Immobilière (SIC), du<br />
Crédit Foncier et même de la MAETUR qui doit viabiliser les terrains pour faciliter les<br />
constructions, est immense dans cette capitale où la demande est pourtant très forte, autre<br />
signe de pauweté urbaine.<br />
Les bâtiments de la Préfecture ont été transformés en Province, ceux de la Sous-<br />
Préfecture en Préfecture et de la Sous-Préfecture dans les logements de fortune. Les<br />
logements de fonction des diftrents responsables a suivi la même logique, les Délégations<br />
Provinciales se trouvant dans les habitations privées (villas). Il n'existe pas de quartier<br />
administratif tel que prévu par le schéma Directeur. Il n'y a eu ni rénovation, ni<br />
équipements des bâtiments administratifs à Ngaoundéré de même que I'apurement foncier<br />
des nouvelles zones, reste à aménager. Cette ville nécessite également la réhabilitation de<br />
son réseau VIAIRE (assainissement de la voirie urbaine, aménagement de ses caniveaux,<br />
système d'évacuation des eaux de pluies, curage des caniveaux).<br />
A Ngaoundéré, le secteur privé intervient assez activement dans I'organisation de I'espace.<br />
Il mobilise les capitaux pour la construction des logements. C'est ainsi que I'on<br />
distingue plusieurs zones d'habitat selon la technologie et leur répartition :<br />
- I'habitat de commerce rencontré au centre commercial, au marché central et sur la<br />
route de la gare.<br />
- I'habitat traditionnel ancien vu chez les lamidos, aux quartiers Djakbol, Haoussa, Bali,<br />
Bikar Tongo ;<br />
- Ihabitat économique concentré au nord de Sabongari et sud-est du centre<br />
commercial,<br />
- I'habitat résidentiel de faible densité vu au centre commercial nord et au centre<br />
administratif ;<br />
- I'habitat spontané rencontré aux quartiers ONAREF, Burkina-Faso et une partie de<br />
joli soir.<br />
La ville n'est pas entièrement couverte par la SNEC et il se pose le problème d'approvisionnement<br />
en eau potable. L'extension du réseau d'adduction et de distribution d'eau au<br />
bénéfice des nouveaux quartiers est envisagée. Les bornes fontaines (BF) n'existent pas,<br />
même celles payantes.<br />
Le parc d'abonnés téléphoniques est saturé à Ngaoundéré. Les 1600 lignes câblées sont<br />
mises en service. Depuis lors, aucune autre ligne n'est libre. Les besoins exprimés sont<br />
énormes et l'extension du réseau n'est pas au programme.<br />
La pauvreté urbaine fait qu'il y ait à Ngaoundéré un manque d'intérêt pour l'énergie<br />
électrique au profit d'autres sources énergétiques qui sont le bois et le charbon. Moins de<br />
lOYo de la population utilise l'électricité. Mais le chiffre atteint moins de lYo pour I'ensemble<br />
de la Province. Il faudrait sans doute des branchements gratuits pour susciter une<br />
consommation de masse. Les services de la SONEL tournent à perte dans cette Province.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMRTS,!o6/1J1,99 83 FévrierZffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Il s'agit d'une part d'analyser les capacités des populations à gérer rationnellement les<br />
ressources locales dans l'exécution des activités d'intérêt public, et d'autre part de porter<br />
un jugement sur leur aptitude à se regrouper, à initier et à réaliser à partir de leurs propres<br />
ressources des projets de développement d'intérêt communautaire. C'est pourquoi nos<br />
analyses s'étendront sur la gestion des communes et sur le processus de développement par<br />
l'approche participative dans la province de l'Adamaoua.<br />
I. tA GESTION DES COMMUNES DANS I.A PROVINCE DE I.'ADAMAOUA<br />
Les communes sont des collectivités territoriales décentralisées dont la gestion est régie<br />
par la loi n"74-23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale et le décret n" 77-<br />
9l du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, les syndicats des<br />
communes et les établissements communaux.<br />
La commune est urbaine lorsque son ressort territorial se réduit à une agglomération<br />
urbanisée. L'Adamaoua compte une commune urbaine qui est celle de Ngaoundéré. Quant<br />
à la commune rurale, c'est celle dont le ressort territorial s'étend à la fois sur les agglomérations<br />
ou non et sur les zones rurales. La province de l'Adamaoua en compte 13 qui portent<br />
chacune le nom du cheÊlieu de département ou d'arrondissement de son ressort<br />
territorial.<br />
D'après l'alinéa 2 de l'uticle 55 de la constitution de janvier 1996, les collectivités<br />
territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de<br />
l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux.<br />
Elles administrent librement, par les conseils élus et dans les conditions fixées par la loi,<br />
les activités sociale, sanitaire, éducative, culturelle et sportive de ces collectivités. Les<br />
cofirmunes de I'Adamaoua, à travers leur autonomie financière parviennent-elles à<br />
accomplir les obligations de développement qui leur sont assignées. En d'autres termes, les<br />
ressources financières mobilisées sont-elles suffisantes pour assurer le financement des<br />
besoins exprimés ? Une analyse de l'évolution des recettes et dépenses d'un échantillon est<br />
constifuée de la commune urbaine de Nsaoundéré et des 05 communes rurales des chefslieux<br />
des départements.<br />
A ANATYSE DES RECETTES COMMUNAI.ES<br />
Les recettes communales sont composées de trois grandes rubriques : Les recettes<br />
fiscales, les recettes diverses et accidentelles, les recettes sur les exercices antérieurs. Les<br />
recettes fiscales sont constituées principalement des centimes additionnels, des taxes<br />
communales directes et des taxes communales indirectes. On y assimile également les<br />
produits liés à I'exploitation du domaine et des services communaux, les ristournes, les<br />
redevances et amendes de police accordées par l'Etat. Les recettes diverses et accidentelles<br />
se composent des emprunts que la cornmune peut contracter, des subventions et des<br />
avances que I'Etat peut allouer. On y ajouter aussi les dons, les avances et legs venant des<br />
diverses organismes. Les recettes sur exercices antérieurs sont celles qui n'ont pas été<br />
recouvrées au cours des exercices précédents sur les deux premières rubriques.<br />
Au Cameroun, I'autonomie financière dont jouissent les communes comporte la tutelle<br />
de I'Etat qui nomme le receveur principal et alimente les ressources financières des communes<br />
à travers les organismes spécialisés. Les fonds spéciaux d'équipement et l'intervention<br />
intercommunale FEICOM créé par l'article 19 de la loi n" 74-23 et organisé par le<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,OOS/OIl99 84 Févrierffi
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
décret no 77-85 du 22 mars 19977 est l'établissement public à travers lequel l'Etat assiste<br />
financièrement les communes, Les aides financières qu'il accorde aux cornmunes sont de<br />
deux ordres :<br />
- Les subventions non remboursables, destinées au financement des objectifs d'investissement.<br />
- Les avances de trésorerie remboursables en deux ans, généralement destinées à<br />
résoudre les difficultés financières d'ordre codoncturel. De 1977 à 1985, les subventions<br />
dont ont bénéficié les communes de I'Adamaoua se sont chiffrées à 42,3<br />
millions de francs, représentant l,ïlyo de I'ensemble des subventions . L'Adamaoua<br />
appatût cornme < laissé pour compte >> lorsque l'on compare aux subventions des<br />
communes du Centre et de I'Ouest qui ont perçu respectivement 30,4Yo et lï,l7Yo de<br />
l'ensemble de I'enveloppe. Les avances de trésorerie dont ont bénéficié les communes<br />
de L'Adamaoua ont été de I1,9 millions, soit 2,7Yo de l'ensembles des avances aux<br />
communes. Ce pourcentage reste encore très faible par rapport aux parts des communes<br />
du Sud-Ouest et de l'Ouest qui ont été respectivement de 3l,7Yo et 26,6%o. Au<br />
cours des dix dernières années, l'assistance du FEICOM aux communes de I'Adamaoua<br />
s'est davantage raréfrée. Ce qui justifie en partie les faibles taux de réalisation<br />
des recettes.<br />
Les statistiques relatives à I'exécution des budgets (annexe I à 6) des diftrentes<br />
conrmunes permettent de relever que le taux de réalisation des recettes de la commune<br />
urbaine de Ngaoundéré est passé de 59,l4Yo à 75,2yo entre I'exercice 1995/1996 et<br />
l'exercice 1996/1997. Le relèvement de ce taux est tributaire de l'amélioration des taux de<br />
réalisation des recettes sur exercices antérieurs et de celui des recettes diverses et accidentelles<br />
qui sont passées respectivement de 33,5 à 63,5Yo.Il est important de souligner<br />
que ce taux de 75,2yo de réalisation des recettes de la communes urbaine de Ngaoundéré<br />
est largement inferieur au taux de recouvrement national qui est de 86Yo pour les communes<br />
urbaines.<br />
Dans les communes rurales, les taux de réalisation des recettes sont très faibles. Au<br />
cours de l'exercice 199511996,le taux le plus élevé a été celui de la commune rurale de<br />
Tibati qui a atteint 76,28yo légèrement supérieur au taux de recouwement national qui est<br />
de 75Yo pour les communes rurales. Cette performance est relative à un important recouwement<br />
des recettes sur exercices antérieurs de 6 460 000 francs seulement. Au cours de<br />
I'exercice 199611997, ce taux a fléchi pour se situer à 43,3yo suite à une baisse importante<br />
des recettes fiscales et des recettes diverses et accidentelles. Le taux de recouvrement des<br />
communes rurales de Tignère et de Meiganga ont enregistré des tendances similaires. Celui<br />
de la commune rurale de Tignère est passé de 70,18 à 14,30Â suite à la contraction des<br />
recettes de toutes les rubriques. Le repli du taux de la commune rurale de Meiganga de<br />
57,4 à 29,70Â est essentiellement lié à une baisse importante de 44,2 millions à 9,8 millions<br />
de recettes sur exercices antérieurs. Malgré ces contres performances, les prévisions<br />
budgétaires de ces deux communes ont été revues à la hausse pour les exercices futurs. Ce<br />
qui pourra davantage compromettre les taux de réalisation des recettes.<br />
Pour les deux autres communes rurales de Ngaoundéré et Banyo, les taux de réalisation<br />
des recettes ont stagné autour de 32Yo. Par conséquent, les prévisions budgétaires ont été<br />
revues à la baisse pour les exercices ultérieurs. Elles ont fléchi de 98 à 70 millions pour la<br />
commune rurale de Banyo et de 100 à 80 millions pour la commune rurale de Ngaoundéré.<br />
Il va de soi que les faibles taux de réalisation des recettes communales de L'Adamaoua ont<br />
handicapé la réalisation des dépenses.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/SO6,iC1t99 85 FévnerM
ETUDES SOCIO.ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
ProvincÆ de I'ADAMAOUA<br />
B. ANATYSE DES DEPENSES COMMUNAI.ES<br />
Les dépenses communales peuvent se regrouper en deux rubriques principales : les<br />
dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses sur exercices<br />
antérieurs qui forment la troisième rubrique concernent les engagements qui n'ont pas été<br />
exécutés au cours des exercices antérieurs sur les deux premières rubriques.<br />
Le taux de realisation des dépenses de la commune uôaine de Ngaoundéré s'est amélioré<br />
en passant de 260Â à 48% entre l'exercice 1995/1996 et l'exercice 1996/1997. Toutes<br />
les rubriques des dépenses ont été concernées par ce relèvement qui malgré tout reste assez<br />
faible. Le taux de réalisation des dépenses d'équipement qui se situe à l6,5Yo reste<br />
insignifiant et traduit les difficultés qu'éprouve la commune pour se doter des<br />
infrastructures nécessaires à l'épanouissement des populations. Pour les communes de<br />
Tibati et de Tignère, les taux de réalisation ont fléchi respectivement de 56,6Yo à 34,20Â et<br />
de 64,70Â à 15,70Â. ces replis sont consécutifs à la contraction de toutes les catégories de<br />
dépenses. Dans la commune rurale de Tibatin, les dépenses de fonctionnement qui sont<br />
concernées ont chuté de 19,3 à l l,6 millions. Alors que dans la commune de Tignère, ce<br />
sont les dépenses sur exercices antérieurs qui ont fléchi de 2,5 millions à 200 000 francs<br />
seulement.<br />
Pour les autres cornmunes rurales (Ngaoundéré, Banyo et Meiganga), les taux de réalisation<br />
des dépenses sont inferieurs à 30yo. Toutes les rubriques ont été concernées, bien<br />
qu'à des degrés diftrents. Tout ceci traduit I'importance des difficultés auxquelles sont<br />
soumises les communes de I'Adamaoua.-<br />
C. CONIRAINTES DES COMMUNES ET PROPOSITIONS DES SOI,UTIONS<br />
L'insuffisance des moyens financiers constitue la première contrainte des communes de<br />
L'Adamaoua. C'est ce qui justifie l'inadéquation entre les prévisions et les réalisations. Le<br />
développement des villes dépend des investissements de plus en plus importants sur le plan<br />
social. Ce qui accroît considérablement les besoins alors que les recettes ne suivent pas la<br />
même évolution. Dans les cornmunes rurales, les adductions d'eau, I'entretien des routes,<br />
l'électrification et la construction des ponts constituent des charges énormes pour les<br />
caisses des collectivités.<br />
La deuxième contrainte est liée à la mauvaise gestion caractérisée par un personnel<br />
parfiois pléthorique qui ne dispose pas toujours de compétence et auquel est destiné<br />
l'essentiel des dépenses de fonctionnement,<br />
On peut ajouter à cette liste, des prévisions irréalités sur la base desquelles sont conçus<br />
de nombreux projets dont la réalisation reste incertaine.<br />
Pour surmonter ces contraintes, les solutions suivantes peuvent être envisagées.<br />
- Les communes devraient dans l'exécution de leurs dépenses d'investissement privilégier<br />
les projets générateurs de revenus pour accroître leurs recettes. La possibilité de<br />
réalisation des projets devrait être vérifiée par des compétences.<br />
- Le recrutement du personnel devrait être plus rationnel pour réduire les charges<br />
subséquentes : se limiter à un nombre suffisant et exiger les compétences requises<br />
pour exercer chaque fonction.<br />
- Des accords de partenariat entre les communes locales et les collectivités décentralisées<br />
occidentales devraient se développer pour échanges d'expériences dans la<br />
gestion.<br />
L'Etat devrait rendre les concours du FEICOM au proflt des communes plus équitables.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR,g/llO5O1 199 86 Févnerffi
ETUDES SOCIO-ECONOMTOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
En tout état de cause, l'insuffisance des ressources financières des communes de<br />
I'Adamaoua justifie les nombreux besoins exprimés en terrne de projets.<br />
3. TE ÏRAVAIL PARTICIPATIF DANS L'ADAMAOUA<br />
Les stratégies de développement économique, social et culturel du Cameroun sont<br />
restées fortement centralisées au lendemain des indépendances. C'est à travers les plans<br />
quinquennaux que se définissaient les axes du développement. Ce processus de développement<br />
dit < du haut vers le bas> s'est heurté, vers la fin des années 80 à un certain nombre<br />
d'entraves liées aux déséquilibres budgétaires de l'Etat. Au début des années 90, le<br />
processus de démocratisation de la société Camerounaise a déclenché une véritable<br />
délibéralisation du processus de développement axé sur I'approche participative.'C'est une<br />
stratégie globale de développement centré sur le rôle essentiel que les populations<br />
devraient jouer dans tous les domaines de leur vie.t Elle consiste à libérer I'esprit d'entreprise<br />
des populations à les responsabiliser en les mettant au cæur du processus de<br />
développement. Ce qui accroîtrait leur aptitude à prendre en main leur destinée, de manière<br />
à améliorer leurs conditions de vie. L'approche participative s'opère dans une communauté<br />
confrontée aux mêmes problèmes de survie et aux défis à relever.<br />
Dans la province de I'Adamaoua, la coordination des actions de développement à<br />
travers I'approche participative est assurée par le Service Provincial du Développement<br />
Communautaire (S.P.D.C.). Le service qui est rattaché au Ministère de I'agriculture a été<br />
créé pour apporter un soutien technique aux populations rurales dans les activités d'autopromotion<br />
et de réalisation des projets à caractère participatif. Pour se rapprocher des<br />
populations, ce service dispose d'une section à la tête de chacun des cinq départements et<br />
de chacun des treize arrondissements.<br />
Pour accomplir ses missions, le S.D.P.C. dispose d'un effectif de 39 employés dont 15<br />
pour le service provincial, l0 pour la section de la Vina, 5 pour le Mbére et 3 pour chacun<br />
des trois autres départements. Sa méthode d'approche consiste à sensibiliser les<br />
populations des vertus du travail communautaire, à aider les populations à concevoir les<br />
projets de développement, à les évaluer et à rechercher les sources de financement.<br />
L'accent est mis sur la participation financière, matérielle et physique de chaque membre<br />
du groupe. Il ressort de son rapport d'activité qu'au cours de I'exercice 1986/198'7,le<br />
S.P.D.C. a dans le cadre de ses obligations :<br />
- organisé 24 réunions de coordination avec le personnel ;<br />
- organisé 254 réunions de sensibilisation et cours d'éducation communautaire;<br />
- suivi les activités dans 90 villages ;<br />
- encadré 46 groupes de femmes sur les 91 recensés ;<br />
- achevé 4 projets d'infrastructure rurales (puits d'eau, ponts sur les rivières, etc.<br />
Dans le cadre de I'exécution de ses missions, le S.P.D.C. se heurte à plusieurs contraintes,<br />
notamment .<br />
- Les difficultés de trésorerie. Son principal pourvoyeur de fonds reste I'Etat qui au<br />
regard de ses difficultés budgétaires ne peut pas satisfaire tous les besoins. Cependant,<br />
cette région immense qui atteindra bientôt un million d'habitants ne doit pas passer à<br />
l'arrière-plan.<br />
8 - Iæs diflcrcnts textes de loi relatifs à la libcralisation ont été publiés par la SOPECAM en 1990. Ce document a été<br />
relayé par la promulgation en 1992 de la loi n"921C[,6 relative aux sociétés coopératives et goupes d'initiaves<br />
communes (GIC)<br />
9 - PNtiD. Rapport Mondial sur le Développement Hurnain. 1993,p.23.<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S/,106/!C1/99 87 Février 2@O
ETUDES SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Proûnce de I'ADAMAOUA<br />
- L'absence de moyens de locomotion. Aucun des services ne dispose d'un moyen<br />
approprié de déplacement. Les agents sont obligés de se contenter des moyens de<br />
transport public pour effectuer les missions dans les départements et les arrondissements.<br />
L'état défectueux des routes rend les zones enclavées inaccessibles.<br />
- Insuffisance du personnel. Le S.P.D.C. de I'Adamaoua connaît un important déficit en<br />
personnel.<br />
- On peut ajouter à cette liste des contraintes, le manque d'esprit associatif chez les<br />
populations de I'Adamaouq qui se sont montrés individualistes. Mais le problème<br />
vient peut-être d'un manque de savoir-faire en communication; chacun veut améliorer<br />
ses conditions de vie. Les populations ont déjà fait preuve d'esprit de solidarité<br />
en s'associant pour améliorer, comme ils le pouvaient, les conditions scolaires et<br />
sanitaires. Les mouvements coopératifs (GIC) sont également un exemple vécu<br />
d'association et d'organisation dont les répercutions sont positives.<br />
Aussi, pour surrnonter toutes ces difficultés, il est indispensable de mettre à la disposition<br />
du S.P.D.C. de I'Adamaoua des moyens financiers, des moyens de transport et des<br />
agents ayant les compétences requises pour chaque type d'intervention. Ce qui faciliterait<br />
I'organisation des campagnes de sensibilisation" de mobilisation et d'animation des populations<br />
en matière d'approche participative.<br />
Tab n" 32 : Evolution du budget de la commune urbaine de Ngaoundéré<br />
1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999<br />
Budget en recettes et dépenses<br />
Réalisation des recettes<br />
182 731 939 260 368 010<br />
Taux de réalisation<br />
59,14o/o 75,2o/o<br />
Réalisation<br />
80 246 691 16ô 304 624<br />
Taux de réalisation<br />
260/o 48o/o<br />
Structure des recettes<br />
Structure des dépenses<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
308 982 575 346 104 865 418727 932 452821 22s<br />
98 046 650<br />
32 866 186<br />
33,50/o<br />
202949245<br />
144 790 001<br />
71,340/o<br />
7 986 680<br />
5 075752<br />
63,54<br />
27 943 928<br />
11 415 304<br />
40,85<br />
153 861 010<br />
63 671 674<br />
41 ,380/o<br />
127 177 637<br />
5 159 713<br />
4o/o<br />
109 530 685<br />
102 485248<br />
93,560/o<br />
228487 500<br />
1 36 605 696<br />
59,890/o<br />
8 486 650<br />
21 277 066<br />
250,730/o<br />
13 282 876<br />
I 692 357<br />
73o/o<br />
163237 304<br />
128 133 827<br />
78,5o/o<br />
169 588 685<br />
28 478 440<br />
160/o<br />
71 067 089 90 000 000<br />
236 831 000 262238000<br />
110 829 843 100 583 229<br />
28376383 21 4AOAO84<br />
202 886 359 242822281<br />
187 465 190 188 598 924<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S/O6D1Pg 88 Février 2ffi
L<br />
ETAB LISSEM ENTS H UMAINS :<br />
COMMUNES URBAINES / COMMUNES RURALES<br />
(1ee8-1eee)<br />
I<br />
Ëfiectif de popLdation<br />
I'j<br />
*"n'('^ )<br />
t Nl.l<br />
'ô".,<br />
\<br />
Smbol.bbo<br />
Mba-<br />
',O<br />
7^ leanYo<br />
t{)<br />
i*' Ç:"0"*'o<br />
" Rrb"o<br />
.L. :.'. os<br />
tt<br />
Sdkdog<br />
l,|yrmbo!,.<br />
I<br />
/<br />
ooooo<br />
1ôùil Mb.bo<br />
I<br />
,'o<br />
I<br />
lturù$.<br />
qqmbda<br />
o--.-.<br />
o<br />
O*'e o""'*<br />
(\<br />
t)<br />
\=-'<br />
I u**nourf"'**<br />
I r*so<br />
,o<br />
ùil*y.l<br />
O<br />
iLldl.6br<br />
?",o<br />
Tlgn rê<br />
I<br />
lillnm '<br />
llb.t.ou<br />
Dird.<br />
o<br />
t{anang "<br />
u,o:*,*" ^<br />
anoo.f<br />
Mdd@gN<br />
o<br />
.-- o<br />
Mdarbq- -.-.- * ''Mat ilmbt '..<br />
:<br />
O Sangb<br />
l{ângom v<br />
*(_<br />
(^.r<br />
Wrc\. -<br />
Mansueiô<br />
,\ N***/_\<br />
( )Trbsir \ /<br />
c<br />
l<br />
*/ \<br />
o<br />
1<br />
\-,/<br />
\ i-."r<br />
\Dk<br />
o\o"."n*"r"<br />
".*"rP<br />
***,Æ*<br />
o<br />
\t--e*l;'<br />
't9"c''u*o<br />
?<br />
o<br />
"" 8.4q<br />
***O<br />
glbongôO<br />
Addr<br />
Mhng I<br />
/\<br />
Bt )<br />
\/<br />
8mb.6g Q<br />
"'.Ô /<br />
'o<br />
\,oÉ<br />
Mdd@céu-f a;<br />
t*ooV<br />
ù.?"*o<br />
,â'<br />
\/ Y*o<br />
o<br />
^ Jaftib.n!<br />
IGÂOT'<br />
ti<br />
-l<br />
(<br />
8ou9@|)<br />
I<br />
I<br />
1<br />
LEGËNDE<br />
I<br />
Boule grnoosl6<br />
I<br />
ù16 Ê<br />
Roub pnnopàr6 PÊmtnenb -=-_<br />
I<br />
I RôùlR3âæôdatr6æfienonro .'-._ I<br />
I n.ut.amu*e,no'rwh<br />
I<br />
lRsb<br />
I<br />
I cMnoe hr *-* I<br />
lF'mr''<br />
I lm'beBqôr ---l<br />
-<br />
j unooawrummt<br />
-1<br />
I<br />
lrFb d{ond'ss.msl<br />
ChÊl U6!\ d.d FrMenr<br />
th.l !u ia(6o&eû'enr<br />
a
ETUDÊS SOCIO-ECONOMIOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Prwince de fADAMAOUA<br />
Tab n" 33 : Evolution du<br />
Budget en recettes et dépenses<br />
Réalisation des recettes<br />
Taux de réalisation des recettes<br />
Réalisation des dépenses<br />
Taux de réalisation<br />
Structure des recettes<br />
Structure des dépenses<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
de la commune rurale de N<br />
1 995/1 996 1996/1997 1997/1998 1998/1999<br />
80 077 601 84722851<br />
93 312 350 100 329 500<br />
29 384 954 35 096 778<br />
31,5o/o<br />
35o/o<br />
22320349 29601 831<br />
9o/o<br />
20 000 000<br />
18 750 424<br />
93,75o/o<br />
65 716 100<br />
6 426 474<br />
g,7va<br />
7 596 250<br />
4 208 056<br />
29,50/o<br />
30 000 000<br />
13 419775<br />
44,730/o<br />
68 234 500<br />
21 269 134<br />
31,10/o<br />
2 095 000<br />
407 869<br />
I 55,40Â 19,40/o<br />
10 000 000<br />
42 181 500<br />
27 896 101<br />
35 930 351<br />
47 192500<br />
1 600 000<br />
p 11 30650 25 129455 15000000 16398982<br />
R 2 908 637<br />
25,720/o<br />
4 213 320<br />
16,760/o<br />
T<br />
p 58 720 093 46 212742 40 332 051 43 075 090<br />
R 1320s342 16313207<br />
T 22,48o/o 35,3o/o<br />
P 23285607 28987 303 24745 55A 25248780<br />
R 6206370 I 075 304<br />
T 26,650/o 31 ,3o/o<br />
Tab no 34 : Evolution du budget de la commune rurale de Banyo<br />
1995/1996 1996/1997 I 997/1 998 1998/1999<br />
Budget en recette et dépenses<br />
79 500 000 98259727 70 000 000 72 000 000<br />
Réalisation des receftes<br />
Taux de réalisation recettes<br />
Réalisation des dépenses<br />
Taux de réalisation<br />
27 028296<br />
34o/o<br />
22 586 586<br />
28,41o/o<br />
27 156 098<br />
27,630/o<br />
26 271 510<br />
26,70/o<br />
Structures de recettes<br />
Structure des dépenses<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
18 657 207<br />
3 448 070 4 944 379<br />
26,5<br />
66 988 728 73 602520<br />
18 410 410 16 438 810<br />
27,40/o<br />
22,330/o<br />
12 511 272 6 000 000<br />
s 169 808 5772909<br />
41 ,30/o 96,20/o<br />
20 535 471<br />
39 558 405<br />
18 981 186<br />
48o/o<br />
19 406 124<br />
3 605 400<br />
18,57o/o<br />
60 509 91;<br />
26 171 510<br />
43,250/o<br />
37 749 814<br />
100 000<br />
0,260/o<br />
5 079 220<br />
47 988 800 47 862 000<br />
22010200 19 057 980<br />
1 504 579<br />
50 693 720<br />
17 801 701<br />
I 589 869<br />
43 010 130<br />
20 400 000<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,U6llril99<br />
89<br />
Févner 2OO
ETUDES SOCIO.ECONOMT<strong>AU</strong>ES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Tab n" 35: Evolution du budget de la commune rurale de Maiganga<br />
Budget en recettes et dépenses<br />
Réalisation des recettes<br />
Taux de réalisation Recettes<br />
Réalisation des dépenses<br />
Taux de réalisation dépenses<br />
Structure recettes<br />
Recettes/exercices anté rieu rs<br />
Recettes fiscales<br />
Recettes accidentelles ou diverses<br />
Structure des dépenses<br />
Dépenses/exercices antérieurs<br />
Dépenses de fonctionnement<br />
Dépenses d'équipement<br />
Source : Service proûncial des communes de I'<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
1 995/1 996 1996/97 1997/98 1998/99<br />
120.000.000 123.000.000 135.000.000 135.000.000<br />
68.884.282 36.626.630<br />
57,4 o/o 29,77 0/o<br />
22.590.716 26.635.325<br />
1g,g o/o 21,65 0/o<br />
64.171.250<br />
44.201.696<br />
69 o/o<br />
50.235.320<br />
11.763.033<br />
23,40/o<br />
5.593.430<br />
12.919.553<br />
217,70/o<br />
23.468.674<br />
297.737<br />
1,260/o<br />
66.531.326<br />
20.310.979<br />
30,720/o<br />
30.000.000<br />
1.982.000<br />
6.6olo<br />
35.425.150<br />
9.872.380<br />
27,8 0/o<br />
81.181.000<br />
10.830.563<br />
13,30/o<br />
6.393.850<br />
15.923.687<br />
2494/o<br />
43.086.856<br />
2.594.375<br />
60/o<br />
49.844.829<br />
19.570.090<br />
39,260/o<br />
30.068.315<br />
4.470.860<br />
14.87o/o<br />
35.320.750- 35.320750<br />
61.055.000 43.734.650<br />
38.624.250 55.944.600<br />
18.323.317<br />
44.822.382<br />
71.854 301<br />
: T : taux de réalisation<br />
14.629.365<br />
42.603.650<br />
77.766.985<br />
Tab no 36 : Evolution du budget de la commune rurale de Tignère<br />
1995/1996 I 996/97 1 997/98 1998/99<br />
Budget en recettes et dépenses<br />
Réalisation des recettes<br />
Taux de réalisation Recettes<br />
Réalisation des dépenses<br />
Taux de réalisation dépenses<br />
28.892.552<br />
20.278.208<br />
70,180/o<br />
18.692.555<br />
64,70/o<br />
45.279.500<br />
6.483.759<br />
14,310/o<br />
7.108.107<br />
15,7o/o<br />
31.010.650 35.210.650<br />
Structure recettes<br />
Recettes/exercices antérieu rs<br />
Recettes fiscales<br />
Recettes accidentelles ou diverses<br />
Structure des dégenses<br />
Dépenses/exercices antérieurs<br />
Dépenses de fonctionnement<br />
Dépenses d'équipement<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
I<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
2.083.332<br />
5.363.785<br />
257,460/o<br />
23.309.20<br />
10.519.268<br />
45,130/o<br />
3.500.000<br />
4.395.15s<br />
125.57o/o<br />
2.O83.332<br />
2.5587.348<br />
122,80/o<br />
1 9.037. 189<br />
10.007.207<br />
52,560/o<br />
7.772.031<br />
6.127.OOO<br />
78,830/o<br />
1.586.25;<br />
32.763.900<br />
6.483.759<br />
19,79a/o<br />
12.515.600<br />
22.O00<br />
0,17o/o<br />
4.000.000<br />
200.000<br />
5o/o<br />
28 303.592<br />
6.775.188<br />
24o/o<br />
12.976.908<br />
132.919<br />
1,020/o<br />
20.221.950<br />
'10.788.700<br />
4.000.000<br />
19.550.253<br />
7.460 397<br />
726.200<br />
21.505.750<br />
12.978.700<br />
8.714.140<br />
17.709.354<br />
8787.156<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S,!C6O1/9S<br />
90<br />
Fêvrier M
ETUOES SOCIO.ECONOMIQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de IADAMAOUA<br />
Tab n" 37 : Evolution du<br />
Budget en recettes et déPenses<br />
Réalisation des recettes<br />
Taux de réalisation Recettes<br />
Réalisation des dépenses<br />
Taux de réalisation<br />
Structure recettes<br />
Recettes/exercices antérieu rs<br />
Recettes fiscales<br />
Recettes accidentelles ou diverses<br />
Structure des dépenses<br />
Dépenses/exercices antérieurs<br />
Dépenses de fonctionnement<br />
Dépenses d'équipement<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
P<br />
R<br />
T<br />
t de la commune rurale de Tibati<br />
1995/1996 1996Æ7 1997/98 1998/99<br />
50.400.000 43.000.000 50.500.000 42.000.000<br />
38.446.790 17.757.699<br />
76,28o/o<br />
43,30/o<br />
28.553.427 14.712.708<br />
56,650/6<br />
34,21o/o<br />
173.200<br />
6.461.3323<br />
3734,60/o<br />
36.707.000<br />
12.198.731<br />
33,230/o<br />
13.519.800<br />
9.893.363<br />
17o/o<br />
5.75s.984<br />
1.912.855<br />
33,230/o<br />
32.044.A16<br />
19.345.876<br />
60,370/o<br />
12.600.000<br />
4.252.540<br />
33,750/o<br />
3.602.059<br />
35. 1 1 3.300<br />
9.873.687<br />
28o/o<br />
7.886.700<br />
4.281.953<br />
54,30/o<br />
6.455.332<br />
1.016.782<br />
15,70/o<br />
28.713.976<br />
11.668.076<br />
44,60/o<br />
14.286.O24<br />
2.027.850<br />
14.2o/o<br />
29.987.680 22.626184<br />
20.512.230 19.373.820<br />
7 .178.188 3.130.533<br />
28.655.531 28.246.312<br />
14.665.281 10.623.155<br />
MTNPAT / Projet PN UD-OPS CMR/S,O6r()1 i|99 9l Février 2@
ETUDES SOCIo-ECONOMT<strong>AU</strong>ES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de rADAMAOUA<br />
l- ACDIÆADANG-CONSULT .Yaoundé 1998<br />
2- ACDIÆADANG-CONSULT (Etudes sur les Besoins Humains Fondamentaux >. Yaoundé 1999<br />
3- BAI'{QUE MONDIALE <br />
16- Direction Commerciale de la Régie Fercam, Douala, 1999 : Exercice 1997 /98<br />
17- Direction Générale des Aéroports du Cameroun, Douala, 1999 1997<br />
22- PAI{/CARE /BADANG-CONSULT . Yaoundé 1997<br />
23- Service Provinciale des Communes de I'Adamaoua, 1999
ETUDES SOCIO-ECONOMTQUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de I'ADAMAOUA<br />
Tab no 38 :<br />
ANNEXE :<br />
lndicateurs<br />
Hygiène, Nutrition<br />
Espérance de vie<br />
Taux de mortalité infantile (en qÂo)<br />
Taux de mortalité juvénile (en ct6o)<br />
Nombre de districts de santé<br />
Nombre d'aires de santé<br />
Nombre d'aires de santé intégrées<br />
Nombre de formations sanitaires<br />
Cas de tuberculose (o/o habitants)<br />
Population couverte en soins intégrés<br />
% de la population couverte sanitairement<br />
Formation sanitaire / habitant<br />
Nombre de lits/population<br />
Nombre d'habitants / lit d'hospitalisation<br />
Nombre d'infirmiers<br />
Nombre d'habitants / infirmier<br />
Nombre de médecins<br />
Nombre de médecins/ habitant<br />
Nombre de pharmacies<br />
Nombre d'enfants 0-11 mois vaccinés<br />
ïaux de c-ouverture vaccinale (o/o) :<br />
- BCG<br />
. DTC3<br />
- Polio 3<br />
. VAR<br />
-VAT2<br />
2. Qualité de la vie<br />
Personne par point d'eau<br />
Taux d'accessibilité en eau courante (o/o)<br />
Ratio population / point d'eau<br />
Consommation moyenne I jour I adulte (en litres)<br />
Formation sanitaire sans point d'eau potable (%)<br />
Nombre d'abonnés à I'eau potable<br />
% branchement au réseau d'eau<br />
3. Education - Formation<br />
Nombre de kmZ école<br />
- Enseiqnement maternel :<br />
Nombre d'élèves<br />
06 filles<br />
Nombre d'enseignants<br />
Nombre d'écoles<br />
Nombre de salles de classes<br />
Ratio élèves/maître<br />
Ratio élèves/salles de classe<br />
- Enseionement primaire :<br />
Nombre d'élèves<br />
o/o<br />
filles<br />
Tab no 38<br />
ateurs de<br />
51 ans<br />
135<br />
153<br />
7<br />
71<br />
63<br />
72<br />
2<br />
13<br />
13<br />
13<br />
546 996 151 112<br />
86,5 86<br />
8785 11 400<br />
455 100<br />
1 400 1 505<br />
185 29<br />
2700<br />
486<br />
13 180 32419<br />
7<br />
28 178<br />
38<br />
24<br />
23<br />
24<br />
19<br />
1 505<br />
0 37,3<br />
o 2428<br />
10<br />
35<br />
3 540 406<br />
37,3<br />
1 695<br />
48,8<br />
68<br />
24<br />
42<br />
25<br />
40<br />
58 665<br />
41,1<br />
1 024<br />
49,8<br />
36<br />
11<br />
25<br />
28<br />
41<br />
11<br />
13 21<br />
10 18<br />
11 25<br />
80 311 160 990<br />
100 71,1<br />
7 301 I 041<br />
50 154<br />
1 600 1 468<br />
29 82<br />
530<br />
16 063 7 534<br />
13,5 21<br />
2941 1 655<br />
98 2662<br />
210<br />
51,4<br />
13<br />
5<br />
5<br />
16<br />
42<br />
139 6 017<br />
42,9 39,6<br />
Province :<br />
86<br />
44,1<br />
5<br />
4<br />
2<br />
17<br />
43<br />
12 854<br />
36<br />
168<br />
21<br />
12 12<br />
12 10<br />
105 042 70 0s2<br />
100 87,2<br />
13 131 8757<br />
68 83<br />
1 538 844<br />
29 16<br />
34<br />
36767 17 513<br />
35,7 19,65<br />
1820 2920<br />
374<br />
223<br />
48,8<br />
8<br />
4<br />
4<br />
28<br />
56<br />
152<br />
40,78<br />
6<br />
?<br />
zo<br />
26<br />
I 359 5 321<br />
39 49.5<br />
suite)<br />
lndicateurs<br />
Nombre d'enseignants<br />
Nombre d'écoles<br />
Nombre de salles de classe<br />
Taux de scolarisation des filles (%)<br />
Taux de scolarisation des garçons (o/o)<br />
Ratio élèves / maître<br />
Ratio élèves / salles de classe<br />
- Enseiqnement secondaire :<br />
Nombre d'élèves<br />
% filles<br />
Nombre d'enseignants<br />
927<br />
306<br />
1 093<br />
44,61<br />
61,1<br />
64<br />
54<br />
424<br />
105<br />
422<br />
60<br />
60<br />
11 448 6 915<br />
37 41<br />
336 208<br />
103<br />
u<br />
137<br />
58<br />
58<br />
1 405<br />
27<br />
31<br />
149<br />
80<br />
241<br />
86<br />
86<br />
1 161<br />
30,7<br />
27<br />
Faro et<br />
Déo<br />
184 67<br />
58 29<br />
190 103<br />
51 80<br />
51 80<br />
1 451 516<br />
35,7 33,5<br />
48 22<br />
MINPAT / Projet PNUD-OPS CMR/S}O6,|31 /199 93 Février ffi
ETUDES SOCIO-ECONOMTOUES <strong>REGIONALES</strong> <strong>AU</strong> <strong>CAMEROUN</strong><br />
Province de fADAMAOUA<br />
Nombre d'établissements<br />
Nombre de salles de classe<br />
Ratio élèves / enseignants<br />
Ratio élèves / salles de classe<br />
- Enseionement secondaire technique:<br />
Nombre d'élèves<br />
o/o<br />
filles<br />
Nombre d'enseignants<br />
Nombre de salles de classe<br />
Ratio élèves / enseignants<br />
Ratio élèves / saltes de classe<br />
4. Emploi- revenus<br />
Ménages pauvres (o/o) (Estimations ECAM 1€6)<br />
24152<br />
246 135 28<br />
34 33 46<br />
52 52 51<br />
1 633<br />
28.4<br />
108<br />
44<br />
15<br />
37<br />
69<br />
Ménages non pauvres (%)(Estimations ECAM 1æ6) 31<br />
Taux d'activité (en o/o) 1996<br />
Taux de chômage (en %) (1996)<br />
Revenus agricoles ( FCFA/anlpersonne)<br />
40 000<br />
- sorgho<br />
- manioc<br />
- arachide<br />
- élevage bovin<br />
- élevage caprin<br />
- élevage ovin<br />
Production agricole/habitant (SNV donnees 1€5)<br />
Production agricole/ha (SNV données 1S)<br />
Têtes bovins/km2 (SNV données<br />
884<br />
30,8<br />
60<br />
21<br />
15<br />
42<br />
189<br />
25,4<br />
15<br />
6<br />
13<br />
32<br />
57,6 41 68<br />
1,2<br />
Revenus totaux (FCFA,/anlpersonne) 87 000<br />
5. lnfrastructures<br />
- -<br />
Nombre d'habitants/ km de route 285,4<br />
Nombre d'habitantg l<br />
-o:nctitiiædiEores<br />
Nombre d'exploitations (SNVdonnées 19s5) 55 600 19 300 4 100 14 000<br />
Superficies iultivées (ha) (SNV donnees 1995) 34 4O0 4 1O0 15 400<br />
o/o<br />
actifs agricoles pratiquant : (SNVdonnees 1S)<br />
- maTs 70 77 48 44<br />
Dglégaùms<br />
28<br />
66<br />
53<br />
22<br />
19<br />
19<br />
40 000<br />
144 000<br />
25<br />
97<br />
73<br />
23<br />
27<br />
15<br />
44 000<br />
133 000<br />
39<br />
3;<br />
19<br />
2<br />
10<br />
22000<br />
't20 000<br />
10<br />
-68<br />
2<br />
26<br />
43<br />
47<br />
229<br />
25<br />
10<br />
10<br />
23<br />
71<br />
i24<br />
66<br />
25 500<br />
111 500<br />
21<br />
;il,;ilî;ffiiTJraaliri":.i,â, iciis:ôr"ri'p^i"ti.,iài.ia-u àùÀca. rnu"raoua,'rese; c)éréeaûon Ragonatede la sNEcpourre Nord et l'Adamaoua, Garcua, 19se,<br />
Fonds sfÉcral pour la promotion ae b Sante, Adamaoua, ACDI 1996 (fEtat de lâ s{tuatiq dans l€ dmine des beotns humains londamentauD '<br />
SNv 1995 (analyse<br />
régronalË de fÂdamaouar: MINEFI 1997 rrésuftats de fenquâe €CAM 96r; BUCREP 1999 renquète démograPhique et de santé 1998D<br />
2<br />
35<br />
31<br />
42<br />
265<br />
31,7<br />
6<br />
5<br />
45<br />
53<br />
69<br />
3<br />
22<br />
24<br />
24<br />
66<br />
22,7<br />
z<br />
33<br />
33<br />
JV<br />
* Tab n"l Orientations de développement régional de la province de l'Adamaoua<br />
* Tab n"2 Evaluation de la population de I'Adamaoua (hypothèse tendancielle)<br />
* Tab no3 Superficies et densités par département<br />
* Tab n"4 Répartition de la population par âge, sexe et secteur<br />
* Tab n"5 Répartition par sexeet par âge de la population de l'Adamaowt (pour 1000 hab)<br />
* Tab n"6 Projections : population urbaine et population rurale<br />
* Tab n"7 Répartition de la population en âge de travailler par sexe<br />
* Tab n"8 Répartition de la population en âge de travailler par secteur d'habitat<br />
* Tab n"9 Calendrier des activités agricoles de la province<br />
* Tab n"10 Pluviométrie de la campagne agricole 1998/1999<br />
* Tab n"l I Statistiques sur les OR inscrites au registre COOP/GIC de la province de I'Adamaoua<br />
* Tab nol2 Production agricole de la campagne 1997198 par département (en tonnes)<br />
* Tab n"l3 Evolution de la production agricole (en tonnes)<br />
* Tab n"l4 hésentation qfnthétique des traitements<br />
+ Tab n"l5 Situation de reconstitution des fonds au 3l Octobre 1998<br />
* Tab n"16 prix moyen des denrees alimentaires pendant la periode Juillet-Décembre 1998 (F.CFA)<br />
* Tab n"l7 Prix des insecticides dans la province de I'Adamaoua<br />
* Tab n"l8 Prix dans la province de l'Adamaoua<br />
* Tab n"l9 Recette de la faune<br />
* Tab n"20 : Trafic à destination du Tchad-exercice 1997-1998<br />
* Tab n"2 I : Trafic Wr<br />
*Tabn"22<br />
g;are- arrivages de Ngaoundéré (exercice 1997'1998)<br />
: Trafic pass:lgers à I'aéroport de Ngaoundéré<br />
* Tab n"23 : Consommation SNEC<br />
l4<br />
16<br />
t7<br />
l8<br />
l8<br />
l8<br />
zl<br />
2l<br />
25<br />
26<br />
29<br />
JJ<br />
34<br />
35<br />
36<br />
JI<br />
38<br />
38<br />
48<br />
57<br />
58<br />
64<br />
66<br />
MTNPAT / Projet PNUD-OPS CMR,9B,06O1,99 94 Février2ffi