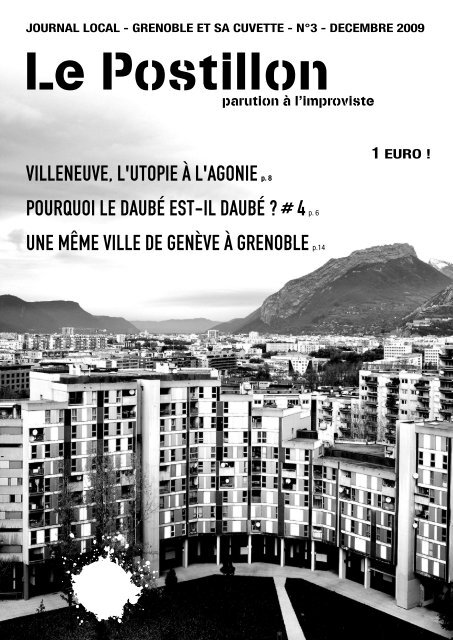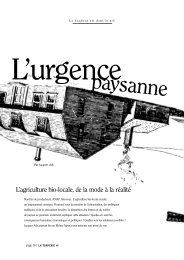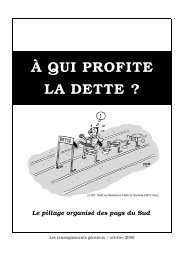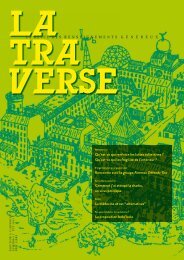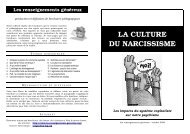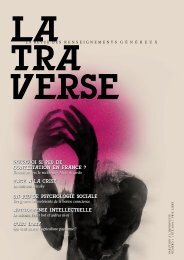Postillon-3.pdf PDF - Les renseignements généreux
Postillon-3.pdf PDF - Les renseignements généreux
Postillon-3.pdf PDF - Les renseignements généreux
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Journal local - Grenoble et sa cuvette - N°3 - decembre 2009<br />
Le <strong>Postillon</strong><br />
parution à l’improviste<br />
villeneuve, l'UTOPIE à L'AGONIE p. 8<br />
1 euro !<br />
Pourquoi Le Daubé est-il Daubé ? # 4 p. 6<br />
Une même ville de Genève à Grenoble p.14
Edito<br />
Brèves<br />
A<br />
quoi bon ? A quoi bon tenter de faire un journal local indépendant,<br />
d’analyser l’évolution regrettable de tel quartier, de critiquer<br />
les orientations politiques prises par tel baron local, de parler de<br />
telle lutte occultée, de décortiquer la communication municipale<br />
ou para-municipale (Le Dauphiné Libéré) ? A quoi bon ces heures<br />
de recherches d’infos, d’écriture, de diffusion et de vente ?<br />
Fakir, journal local amiénois passé depuis peu en diffusion nationale, « fâché<br />
avec presque tout le monde », vient de fêter ses dix ans. A cette occasion, des<br />
membres actifs du Monde Diplomatique, de Là-bas si j’y suis et de Fakir<br />
ont pris la parole pour s’interroger sur le rôle de la presse alternative. Ils<br />
regrettèrent le manque de perspectives derrière l’information alternative :<br />
« A quoi bon s’informer si ça ne conduit pas à la réflexion et à quoi bon la<br />
réflexion si elle ne conduit pas à l’action ? ». Et de souhaiter que les médias<br />
alternatifs ne soient pas « une consommation de plus » mais un support aux<br />
luttes, rejoignant ainsi l’éditorial du dernier numéro du Plan B, journal de<br />
critique des médias : « Ce journal est un marteau, ses colonnes identifient<br />
les clous. À vous la main ».<br />
On ne réalise pas Le <strong>Postillon</strong> juste pour le plaisir de faire de « l’anti-Daubé ».<br />
Si on s’échine à arpenter les rues et nos claviers d’ordinateurs, c’est avec<br />
l’espoir de contribuer à éveiller l’envie de s’intéresser à ce qui se passe à<br />
côté de chez nous et - encore mieux – l’envie d’agir et de peser sur l’évolution<br />
de ce qui nous entoure.<br />
Précision<br />
«Incroyable! Vallini s’expose au CNAC! », «Hallucinant, ce graff de Migaud,<br />
il est où ce mur? ». Plusieurs lecteurs nous ont fait part de leur étonnement<br />
en découvrant les photomontages du précédent numéro du <strong>Postillon</strong>. L’un<br />
représentait des autoportraits de Vallini accrochés au mur de ce qui semblait<br />
être une salle d’exposition. L’autre montrait un graffeur rémunéré par La<br />
Métro peaufinant une fresque à la gloire de Didier Migaud, président de La<br />
Métro.<br />
Oui il s’agissait bien de photomontages et pas d’informations ! Leurs buts ? Se<br />
moquer de la propension de certains graffeurs de l’agglomération à accepter<br />
n’importe quel contrat institutionnel (comme la décoration des palissades<br />
du chantier du Stade des Alpes en 2004) et pointer du doigt le narcissisme<br />
d’André Vallini, président du Conseil Général, qui ne manque pas une page<br />
de son journal, Isère Magazine, pour y coller son portrait.<br />
Apprenant la superchercie, ces lecteurs nous ont alors reproché ces blagues<br />
non annoncées. Toutes nos excuses. Mais pourquoi autant de crédulité face<br />
à de telles énormités ? Est-ce dû au sans-gêne des autorités se permettant<br />
régulièrement tout et (surtout) n’importe quoi ? Ou à la naïveté et au manque<br />
d’esprit critique de la plupart d’entre nous, entretenus par la télévision et la<br />
presse poubelle ?<br />
Pour ne pas créer de nouveaux malentendus, précisons que l’image en haut<br />
à droite est un montage. Non, Geneviève Fioraso n’a pas – encore - pris la<br />
place de Michel Destot à la Mairie de Grenoble , elle reste pour l'instant<br />
adjointe. Et non, la pollution dans la cuvette ne contraint pas - encore – les<br />
élus à porter des masques à oxygène au conseil municipal.<br />
Où le trouver ?<br />
Le <strong>Postillon</strong> est en vente à la criée mais aussi :<br />
A Grenoble :<br />
Bar «Aux Zélées» : 31, rue André Rivoire (quartier Eaux Claires)<br />
Tabac Presse « La Bruyère » : 36, avenue de la Bruyère<br />
Presse «Le Saint-Bruno» : 67, cours Berriat<br />
Tabac-presse «Le Malherbe» : 1, avenue Malherbe<br />
Bar-tabac «Yaz Café» : 101, Galerie de l’Arlequin<br />
«Press’Bastille» : 8, Cours Jean-Jaures<br />
Bar-tabac-presse «La Cymaise» : 6, quai Mounier<br />
Restaurant «La Bonne Heure» : 65, avenue Alsace-Lorraine<br />
Tabac-presse «Le Cigarillo» : 54, avenue Félix Viallet<br />
Tabac-presse «Le Reinitas» : 27, bd Clemenceau<br />
Tabac-presse «<strong>Les</strong> Eaux Claires» : 22, rue des eaux Claires<br />
Tabac-presse «Le Berriat» : 97, cours Berriat<br />
Tabac-presse «Sandraz» : 50, cours Jean Jaurès<br />
Presse «Le point Virgule» : 25, rue Nicolas Chorier<br />
Tabac-presse «Le Barillec et Cie» : 5, rue Thiers<br />
Librairie-cantine «<strong>Les</strong> Bas Côtés» : 59, rue Nicolas Chorier (anciens<br />
numéros dispos également ici)<br />
Café-librairie «Antigone» : 22, rue des Violettes<br />
Le «Local Autogéré» : 7, rue Pierre Dupont<br />
Sur le campus :<br />
Tabac du Campus : 442, avenue de la Bibliothèque<br />
A Fontaine :<br />
Tabac-Presse «E. Vincenot» : 28, rue d’Alpignano<br />
A Echirolles :<br />
Tabac Presse «Molina&co» : parking Casino, 36, cours Jean Jaurès<br />
Proses, gribouillages, photos de vacances : Vulgum Pecus, Sylvain, Benoît<br />
Récens, Larbin F, Martine Delapierre, Pedro Navaja, Nardo et leurs ami-e-s.<br />
<strong>Les</strong> textes ne sont pas signés mais n’engagent que la responsabilité de leurs<br />
auteurs. Directeur de la publication : Arnaud Aichinar.<br />
Contact : lepostillon@yahoo.fr Adresse : Le <strong>Postillon</strong>, c/o <strong>Les</strong> Bas Côtés,<br />
59 rue Nicolas Chorrier, 38000 Grenoble. Tirage : 1000 exemplaires.<br />
Prochain numéro : A l'improviste.<br />
La démocratisation de la vidéosurveillance<br />
A l’heure des délocalisations et fermetures d’entreprises, s’il y a un<br />
secteur qui ne connaît pas la crise c’est bien la sécurité privée, avec un<br />
chiffre d’affaire en croissance annuelle de 9% depuis 1998. Protection<br />
de bâtiments publics, de chantiers, de maisons individuelles : le<br />
marché est gigantesque et les entreprises à avoir flairé le bon filon<br />
nombreuses. Parmi elles, Renilg, une société grenobloise qui vient de<br />
commercialiser Visidom, « un système de détection d’intrusion par<br />
vidéosurveillance performant, élégant (sic), respectueux de votre vie<br />
privée (re-sic) à un prix compétitif ». « Équipées de radars infrarouges<br />
et alimentées par batterie, de discrètes caméras murales sans fil<br />
détectent tout mouvement suspect, activent une sirène d’alarme et<br />
filment l’intrus. En moins de deux minutes, une vidéo transitant par<br />
ondes radio vers une centrale est transmise par message multimédia<br />
au téléphone mobile du propriétaire » (Le Point, 23/07/2009). Le<br />
but c’est de permettre la démocratisation de la vidéosurveillance,<br />
c’est-à-dire le développement du flicage de tous par tous : « Pratique<br />
également pour surveiller à distance si les enfants sont bien rentrés<br />
de l’école, ou si le chat dort tranquille sur le sofa... » (L’Express,<br />
22/01/2009). Une « innovation » tout droit sortie du sérail grenoblois.<br />
Renilg fait en effet partie du pôle de compétitivité Minalogic<br />
et a reçu le soutien financier de la Région Rhône-Alpes pour lancer<br />
Visidom. Son président, Jean Michel Gliner, fait partie de ces entrepreneurs<br />
grenoblois dynamiques chouchoutés par la députée Geneviève<br />
Fioraso, et s’active notamment dans INP Entreprises SA, Grenoble<br />
Université ou l’incubateur d’entreprises Grain. Le titre de son dernier<br />
bouquin doit réjouir Michel Destot et ses rêves de grandeur : « Lyon,<br />
Grenoble, la nécessité d’une Mégapôle ».<br />
LA Caravane publicitaire des nanos passe à Grenoble<br />
En 1990, à l’occasion de la suppression des PTT et devant l’hostilité des<br />
Français, le gouvernement socialiste organise un grand débat public<br />
pour faire passer le projet malgré la contestation. Suite au succès de<br />
l’opération, la Commission Nationale du Débat Public naît en 1995<br />
afin d’endormir par la parole tous les opposants aux projets étatiques.<br />
Cette année, rebelote : la Commission organise un grand débat<br />
national autour des nanotechnologies dans 17 villes françaises. Afin<br />
d’organiser les réunions, elle a fait appel à une agence de com’ I&E<br />
Consultants , « experte en stratégie d’opinion », connue pour avoir<br />
été recrutée à l’automne 2008 par le ministère de l’Enseignement<br />
supérieur et de la Recherche pour analyser et contrer le mouvement<br />
contestataire des enseignants et des étudiants. Cette fois-ci une liste<br />
de 147 questions potentielles a été élaborée afin de préparer les intervenants.<br />
Une manière de parer la contestation qui montre que tout<br />
est déjà écrit.<br />
Pour dénoncer la supercherie, une campagne de boycott de ces<br />
« débats » s’est montée autour du site www.nanomonde.org. Lors du<br />
premier débat, à Strasbourg, des opposants ont déployé une banderole<br />
sur la tribune « Débat pipeau, nanos imposées ». Pour le second, à<br />
Toulouse, de l’ammoniac a été répandue dans la salle, entraînant l’interruption<br />
du débat pendant 30 minutes. A Orléans, les flics étaient<br />
présents en nombre. A Clermont-Ferrand, le débat a été perturbé<br />
pendant deux heures et demi. Celui de Lille a dû être annulé à cause<br />
des opposants. Que se passera-t-il le 1er décembre à Grenoble, capitale<br />
des nanos et de leur contestation ?<br />
Compétitivité à la noix<br />
En Isère, les responsables politiques raisonnent toujours en termes<br />
de compétitivité, qu’ils parlent des nanos ou de noix. André Vallini,<br />
au cours d’un discours lors des 80 ans de la coopérative nucicole<br />
Coopenoix, a incité les producteurs isérois à « planter davantage de<br />
noyers » car « l’Isère a un rôle à jouer dans la conquête de nouvelles<br />
parts de marché ». La noix de Grenoble a « de sérieux atouts face<br />
à la concurrence des grands pays européens » et est donc « une<br />
production stratégique pour l’agriculture départementale » (Isère<br />
Magazine, 10/2009).<br />
Une vision compétitive de l’agriculture qui rentre dans une fuite en<br />
avant absurde. Un nuciculteur du Royans témoigne : « Bien entendu,<br />
le terrain est favorable à la culture de noix. Mais on peut également<br />
faire pousser beaucoup d’autres choses ici. Vouloir développer encore<br />
la filière de la noix, qui occupe déjà énormément de place au sol, c’est<br />
condamner le territoire à une sorte de monoculture, qui appauvrit<br />
les paysages et également l’autonomie locale. Cela rentre dans une<br />
certaine vision de la mondialisation, où les territoires sont spécialisés<br />
dans des domaines de production, ce qui implique beaucoup de<br />
transports et de pollution et ce qui favorise l’agro-industrie ».<br />
| Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009<br />
Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 |
FATAL FLATERIE LOCALE!<br />
La BIFF (Brigade Internationale des Fatals Flatteurs) sévit sur les forums Internet en couvrant d’éloges des personnalités<br />
médiatiques ou intellectuelles afin de les ridiculiser. Généralement cela marche car, selon la BIFF : « les ânes convaincus de<br />
leur génie n’imaginent pas qu’on puisse rire à leurs dépens ». Nous, on essaye avec des personnalités locales. Ce coup-ci, c’est<br />
Julien Polat, jeune loup UMP ( 24 ans) qui monte, qui monte...Ce petit protégé d’Alain Carignon s’est fait piéger.<br />
Message laissé sur son blog, en commentaire d’un article ou il<br />
déblatérait sur le paradoxe d’être de droite et d’aimer le rap :<br />
Merci Julien pour ce texte qu’un ami vient de me faire<br />
découvrir<br />
Moi aussi j’ai le «paradoxe» d’être de droite et d’aimer<br />
le rap (pour tout te dire je suis un villieriste modéré<br />
(proche de l’UMP) et en rap j’adore particulièrement La<br />
Rumeur et Casey). Je suis donc ravi de lire une argumentation<br />
aussi bonne à ce sujet. En plus comme toi je suis<br />
grenoblois !!!<br />
Serais-tu intéressé pour monter un groupe ?<br />
J’ai composé des textes, je te mets pour l’instant juste<br />
quelques passages :<br />
«(..) En isère,<br />
c’est la misère<br />
le conseil général<br />
ne fait que dalle<br />
le président vallini<br />
passe son temps à Walibi<br />
alors pour lui ça commence à sentir le sapin<br />
mais bientôt il sera remplacé par Michel Savin (...)»<br />
ou<br />
« un réveil difficile de plus dans l’agglo<br />
Mais où est donc passé mon Destop<br />
je veux l’utiliser pour mettre un stop<br />
au règne sans fin de Michel Destot<br />
Trop, c’est trop, il est aussi nigaud<br />
que son collègue de la métro Didier Migaud<br />
aussi débile, aussi rétro, aussi maso<br />
que sa collègue députée Geneviève Fioraso (...)»<br />
Alors ça te branche ?<br />
J’ai des amis qui font des mixs...<br />
Réponds moi<br />
Merci<br />
Julien (et oui aussi...)<br />
Blacklisté par le F.B.I. Nardo, ancien étudiant en journalisme témoigne :<br />
| Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009<br />
Et sa réponse, quelques temps après :<br />
Bonjour Julien,<br />
J’ai bien reçu le commentaire que tu as laissé sur mon<br />
blog, et je t’en remercie. Je te prie de m’excuser d’y<br />
répondre aussi tard. <strong>Les</strong> textes que tu as publié m’ont<br />
bien fait sourire, ils sont sympathiques…Il faudrait<br />
que nous essayions de nous rencontrer pour discuter, si<br />
nous avons manifestement pas mal de points en commun…<br />
Tu habites à Grenoble intra muros ? Quand es-tu le plus<br />
facilement disponible ? Au plaisir de te rencontrer.<br />
Bien amicalement,<br />
Julien POLAT<br />
Secrétaire Départemental Adjoint<br />
UMP 38<br />
Tél : 06 XX XX XX XX<br />
E-mail : julien.polat@XXXXXX.fr<br />
Julien (mais lequel ?) et ses amis lors de la victoire de son maître à penser<br />
« Vers la fin du mouvement anti-CPE j’ai fait partie de la poignée de manifestants qui a occupé les locaux de France Bleu Isère (FBI) à<br />
Grenoble. L’objectif était de prendre l’antenne en direct pour dénoncer le traitement du mouvement social par les médias. Finalement un<br />
message était enregistré pour être diffusé le soir même. Étonnamment FBI a tenu parole, en présentant ce document avec réserve, mais<br />
quand même. Avant qu’on évacue, l’atmosphère était assez tendue. L’agent des RG a été reconnu et sorti sous les huées. Des documents de<br />
travail ont été scotchés en guirlandes, les murs tagués : « médias bourgeois, menteurs, collabos » ou « médias partout, info nulle part ».<br />
La journaliste en charge de la station ce jour-là, en l’absence de la rédac-chef Catherine Charvet, était outrée par la revendication du groupe.<br />
J’ai parlé avec elle et d’autres gens de France Bleu. Le fait qu’il n’y ait pas de leader était trop déconcertant (« si vous êtes avec eux dites-leur<br />
de sortir et on négociera après! »), et le fait que je sois étudiant journaliste vécu comme une trahison. Ce jour-là, circonstance aggravante<br />
j’étais en mini-stage-pas payé à l’AFP Grenoble.<br />
Six mois passent. Mon master de journalisme à l’Institut d’études politiques touchait à sa fin et je devais me dégoter un stage longue durée,<br />
4 mois minimum, si possible dans un seul média. J’avais une touche avec FBI dont la rédac’chef intervenait dans notre formation. Ça n’était<br />
pas payé mais c’était avant que Génération précaire m’apprenne à trouver ça indécent.<br />
Mais je n’ai pas conclu. Au téléphone, Catherine Charvet m’explique qu’une journaliste a reconnu ma tête sur mon CV. « -Ah oui ... - Je<br />
comptais t’en parler... - tu comptais m’en parler ? - Bah oui ». Elle se marre. Si ça ne tenait qu’à elle elle passerait outre, mais elle ne prendra<br />
pas cette décision contre sa rédaction. La journaliste a mis son veto. Fin de ma carrière radiophonique ».<br />
De la Banque Postale à la Poste Bancale (1)<br />
Au détour d’une rue, un facteur grenoblois, prudemment anonyme,<br />
témoigne : « De toute façon, la privatisation, cela fait un moment<br />
qu’elle se prépare. Déjà depuis plusieurs années, on ne doit plus<br />
parler d’ « usagers » de La Poste mais de « clients », ce qui est très<br />
symbolique du changement de logique. Pour la direction, il faut avant<br />
tout réduire les coûts, alors ils rallongent les tournées et changent<br />
l’organisation pour ne pas avoir besoin de remplaçants. Au mois de<br />
septembre, le chef de La Poste Isère Savoie s’est même fait mettre<br />
au placard car il avait embauché trop de CDD pendant cet été. <strong>Les</strong><br />
sous-chefs sont sous pression et nous donnent des ordres qu’euxmêmes<br />
trouvent débiles. Tous les<br />
quinze jours, on nous rajoute une<br />
connerie à faire. Un jour, c’est un<br />
service autrefois gratuit que l’on<br />
doit maintenant faire payer aux<br />
« clients », comme les collectes<br />
de courrier pour les commerçants<br />
et entreprises, un autre<br />
c’est un autocollant qu’on doit<br />
coller quand autrefois un coup de<br />
tampon suffisait. Le plus ridicule,<br />
c’était au début de cet été quand<br />
on nous a demandé le plus sérieusement<br />
du monde de vendre le<br />
maximum de timbres de Johnny<br />
Halliday à nos « clients ». Et<br />
puis ils se foutent ouvertement<br />
de notre gueule : un jour, vers<br />
mi-octobre, ils nous ont annoncé<br />
qu’ils allaient compter le volume<br />
de courrier afin de « réajuster »,<br />
c’est-à-dire rallonger, les tournées.<br />
Comme par hasard, ce jourlà,<br />
il n’y avait rien car une bonne<br />
partie avait été bloquée au centre<br />
de tri... »<br />
Chamboulement dans les Chambarans<br />
Connaissez-vous les Chambarans ? Non ? C’est normal : pour l’instant<br />
il n’y a rien là-bas. Rien d’intéressant : ni centrale nucléaire, ni<br />
pôles technologiques, ni grandes entreprises. Tout juste trouve-t-on<br />
un camp militaire. Et puis des petits villages, des étangs et quelques<br />
paysans. Et surtout des forêts. Partout. Des arbres sur des centaines<br />
d’hectares.<br />
Vous trouvez ça normal, vous, qu’on laisse tel quel ce territoire, inutile,<br />
non-rentable ? De ne vouloir tirer aucun profit de ces champs<br />
bons à rien, mais à une heure de Lyon et Grenoble ? Vous trouvez<br />
décent de laisser les cervidés et les promeneurs, les pêcheurs et les<br />
sylviculteurs, simplement jouir de ces étendues de calme ? Non ? La<br />
plupart des notables locaux, et des conseillers généraux et régionaux,<br />
non plus.<br />
Après avoir projeté d’y implanter 70 éoliennes, puis un centre de<br />
stockage de déchets , ils ont finalement opté pour l’installation d’un<br />
Center Parcs. Un centre touristique géré par la société Pierre et Vacances,<br />
avec 5 000 clients constamment renouvelés. Le Conseil régional<br />
a accordé une aide de 7 millions d’euros, le Conseil Général de<br />
15 millions. Leur argument : créer des emplois. « Mais la destruction<br />
des Chambarans par sa transformation en zone touristique avec<br />
l’abattage d’une partie de la forêt, l’épuisement de sa nappe phréatique,<br />
la destruction de la vie sauvage et de la vie sociale locale, et<br />
son remplacement par une vie artificielle basée sur son inutilité et<br />
sa marchandisation, n’est-ce point déjà cher payé pour le bénéfice<br />
de quelques emplois creux ? » écrivent les opposants à ce projet.<br />
Mercredi 11 novembre, ils organisaient une marche dans la forêt<br />
bientôt interdite d’accès. Une des marcheuses témoigne : « On sait<br />
très bien que c’est perdu d’avance, que le projet a toutes les chances<br />
de se faire. Mais ce projet annonce de grands bouleversements pour<br />
toute la région. Ils ne vont pas s’arrêter là. Alors il faut faire entendre<br />
notre refus de cette évolution ».<br />
Le site des opposants au projet http://chambarans.unblog.fr/<br />
De la Banque Postale à la Poste Bancale (2)<br />
Le « référendum citoyen » organisé contre la privatisation de La Poste<br />
le samedi 3 octobre a connu à Grenoble comme ailleurs en France un<br />
certain succès. Cette initiative avait reçu le soutien du Parti Socialiste,<br />
assurant sur l’agglomération grenobloise financement des affiches et<br />
prêt de locaux. <strong>Les</strong> députés socialistes du coin (François Brottes en<br />
tête mais aussi Didier Migaud et Geneviève Fioraso...) en ont profité<br />
pour se refaire une virginité anti-libérale en prenant position contre<br />
la privatisation via les médias, leur blog ou à l’Assemblée nationale.<br />
Mais qui a voté, de 1997 à 2002, les privatisations de France Télécom,<br />
d’Air France, des Autoroutes du Sud de la France, du Crédit Lyonnais,<br />
d’Eramet, et du Gan ? La<br />
majorité de la « gauche<br />
plurielle » à laquelle<br />
nombre de députés<br />
socialistes appartenaient<br />
(Destot, Brottes,<br />
Migaud, Vallini).<br />
Droit de réponse<br />
Rappelons également<br />
que même si les<br />
stars locales actuelles<br />
n’étaient pas encore<br />
élues, ce sont les socialistes,<br />
avec l’appui des<br />
communistes, qui, en<br />
1990, ont fait disparaître<br />
les PTT et créé La Poste<br />
et France Télécom.<br />
Paul Faure de l'Union de quartier Berriat Saint-Bruno nous écrit :<br />
« L’article paru dans le numéro 0 du <strong>Postillon</strong> de mai 2009, nous<br />
a beaucoup surpris et peiné, par les écrits diffamatoires portés,<br />
injustement, à l’encontre de l’union de quartier Berriat St Bruno<br />
Europole, notamment la phrase suivante :<br />
« <strong>Les</strong> communautés se mélangent très peu, ce qui semble se confirmer<br />
dans les relations tendues entre l’union de quartier, composée<br />
uniquement de blancs, et la population magrébine ». Notre union<br />
de quartier existe depuis 1966, elle a toujours été apolitique, antiraciste<br />
accueillante aux étrangers comme aux autochtones. Nous<br />
avons toujours eu d’amicales relations avec toutes les ethnies composant<br />
la population du quartier, notamment magrébine, la plus<br />
nombreuse. Nous les aidons dans leur courrier personnel, dans<br />
leurs démarches administratives en les orientant notamment vers<br />
les services concernés. Nous accueillons dans nos locaux diverses<br />
associations à caractère anti-raciste ou social, comme à titre<br />
d’exemple « L’amicale des travailleurs algériens ». (...) Quand à la<br />
composition de notre conseil d’administration, « composé que de<br />
blancs », selon votre article, notre porte est ouverte à tous ceux<br />
français et étrangers, qui veulent collaborer, avec nous, à l’évolution<br />
positive du quartier. Nous avons eu durant de nombreuses<br />
années, un vice-président, originaire d’Afrique noire qui nous a<br />
quitté, à la suite d’une mutation professionnelle.<br />
Par deux fois, il est fait mention de mon nom (Paul Faure) dans<br />
votre article sur l’histoire du quartier, en vous déclarant surpris<br />
que je puisse être favorable à l’installation de nouvelles populations<br />
qui apportent du sang neuf à un quartier hier exclusivement<br />
ouvrier, et aujourd’hui en voie de mutation. Où est le mal ?<br />
Je confirme ma position, l’avenir est toujours devant nous, ce qui<br />
n’empêche nullement d’oublier le passé et d’en regretter parfois<br />
certains aspects. Encore faut il avoir la sagesse de « l’âge » pour<br />
comprendre cela ! »<br />
Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 |
GRAND FEUILLETON - EPISODE 4<br />
Pourquoi le Daubé est-il daubé?<br />
<strong>Les</strong> années 2000 : Le changement dans la continuité de la médiocrité<br />
Hurlant, comme beaucoup d’autres journaux, à « la crise de la presse », Le Dauphiné Libéré annonce au début des années<br />
2000 qu’il va « changer ». Découvrons comment ce prétendu changement ne fut que communication et détails techniques,<br />
n’entraînant aucune amélioration de la qualité de l’information proposée.<br />
C’est une affaire entendue depuis des dizaines d’années : dans les bistrots, les ateliers, les salles d’attente ou les chaumières;<br />
à Grenoble ou ailleurs, on appelle le Dauphiné Libéré le «Daubé». Ce surnom lui va si bien, résonne tellement comme une<br />
évidence que personne ne se donne la peine de l’expliquer. D’où vient-il ? Un hasard, un mauvais jeu de mots ? On ne sait pas.<br />
Le Dauphiné Libéré est daubé, voilà tout. Pourquoi perdre son temps à le démontrer ?<br />
Mais à trop se reposer sur cet acquis, on en ignore les enseignements. Car chercher à comprendre pourquoi le Dauphiné Libéré<br />
est daubé permet bien plus que de s’interroger sur le bien-fondé d’un surnom. Cela permet de faire un voyage au coeur de l’histoire<br />
de la Presse Quotidienne Régionale, de la presse en générale et de la vie politique grenobloise et d’en ramener des éléments<br />
de compréhension et de critique du monde dans lequel on vit. Tel est le but de ce feuilleton qui tâche d’étudier l’histoire, le<br />
développement et le fonctionnement actuel du Daubé.<br />
Début des années 2000 : sous le soleil<br />
du Dauphiné Libéré , rien de nouveau.<br />
<strong>Les</strong> mises en cause dues à l’affaire<br />
Carignon ne sont plus qu’un mauvais<br />
souvenir (voir l’épisode 3, dans Le<br />
<strong>Postillon</strong> n°2). Le ciel du monopole est toujours<br />
autant dégagé et le quotidien demeure la référence<br />
de l’information locale dans plus de 7 départements<br />
(Isère, Savoie et Haute-Savoie, Ardèche,<br />
Drôme, Hautes-Alpes, Vaucluse et des bouts des<br />
Alpes de Haute Provence et de l’Ain).<br />
Le Dauphiné Libéré n’a plus de concurrents<br />
directs à l’horizon mais il doit depuis quelques<br />
années affronter un adversaire bien plus<br />
redoutable : la fameuse « crise de la presse ».<br />
Phénomène commenté à longueur d’articles par<br />
ses « victimes », à savoir les journalistes, qui l’expliquent<br />
généralement par le développement de la<br />
télévision d’abord et d’Internet ensuite. Une explication<br />
facile, qui permet d’occulter leurs faiblesses<br />
et dérives, comme le commente Serge Halimi :<br />
« Tout le mal actuel, entend-on souvent, viendrait<br />
de ce pelé, de ce galeux d’Internet. Mais la Toile<br />
n’a pas décimé le journalisme; il chancelait depuis<br />
longtemps sous le poids des restructurations, du<br />
marketing rédactionnel, du mépris des catégories<br />
populaires, de l’emprise des milliardaires<br />
et des publicitaires » (Le Monde Diplomatique,<br />
10/2009).<br />
Toujours est-il que Le Dauphiné Libéré souffre,<br />
en ce début de millénaire, de cette « crise de la<br />
presse » et, malgré son monopole, voit sa diffusion<br />
et ses recettes publicitaires baisser d’année<br />
en année. <strong>Les</strong> chiffres de diffusion sont à la fois<br />
trompeurs, car ils prennent en compte les multiples<br />
abonnements gratuits, et difficiles à vérifier,<br />
car potentiellement manipulés par la direction qui<br />
a intérêt - pour les annonceurs et sa renommée - à<br />
annoncer des chiffres élevés. N’empêche que le<br />
journal ne cache ni « l’érosion des ventes, qui sont<br />
passées de 270 000 en 2001 à 253 000 en 2005,<br />
soit une baisse de 7% » (Lyon Mag, 04/2006), ni<br />
la baisse des « recettes publicitaires qui ont encore<br />
baissé de 2,5 % en 2002 » (Objectif Rhône-Alpes,<br />
02/2003).<br />
La recette est bien connue : quand une entreprise<br />
obtient de mauvais résultats, elle tente de les<br />
enrayer en annonçant des changements. Un « plan<br />
de modernisation » du journal est donc lancé en<br />
2003 pour un investissement de 52 millions d’euros<br />
(Objectif Rhône-Alpes, 02/2003).<br />
Le plan annonce des améliorations techniques :<br />
changements de maquette, de format et renforcement<br />
de la couleur grâce à l’achat de coûteuses<br />
nouvelles machines (voir l’épisode 2, dans Le<br />
<strong>Postillon</strong> n°1). A cause de leur importance, ces<br />
investissements prendront un peu de retard, mais<br />
seront finalement assumés grâce à l’argent frais<br />
de nouveaux propriétaires. Le groupe Hersant cède<br />
en effet le titre en 2004 à Serge Dassault, bien<br />
connu pour son amour de l’indépendance de la<br />
presse et du travail d’investigation : « Une certitude,<br />
Dassault n’a aucun complexe. Pour lui, les<br />
journalistes sont des « emmerdeurs », le pluralisme<br />
« une illusion » (Nouvel Objectif Rhône-<br />
Alpes, 04/2004). Mais le journal n’est pas assez<br />
rentable pour le marchand d’armes qui le revend,<br />
début 2006, au groupe Est Républicain, allié au<br />
Crédit Mutuel (voir encart).<br />
Le « plan de modernisation » annonce également<br />
un réel travail sur le fond. Jean-Marc Willate,<br />
directeur de développement éditorial au sein du<br />
groupe qui regroupe alors Le Dauphiné Libéré et<br />
Le Progrès, assure : « Nous ne nous contenterons<br />
pas d’un lifting. Notre projet est de changer en<br />
profondeur Le Progrès et Le Dauphiné Libéré ».<br />
En prenant tout de même garde de ne pas effrayer<br />
les annonceurs : « Nous n’avons pas l’intention<br />
de transformer Le Progrès et Le Dauphiné Libéré<br />
pour qu’ils deviennent des Canards Enchaînés »<br />
(Nouvel Objectif Rhône-Alpes, 07/2003).<br />
S’il y a une volonté de « changements en profondeur<br />
», c’est qu’il devrait y avoir la reconnaissance<br />
de dysfonctionnement. Or ceux-ci ne sont<br />
ni nommés, ni analysés. <strong>Les</strong> responsables du<br />
Dauphiné Libéré se contentent de communiquer<br />
à tout va sur une prétendue remise en question et<br />
un avenir prétendument différent.<br />
Comme en témoigne un article de La Croix<br />
(08/2004) : « Quand son président lui a dit qu’il<br />
fallait se pencher sur la qualité rédactionnelle du<br />
journal, Jean-Pierre Souchon [NDR : rédacteur en<br />
chef du journal] a bien compris qu’il faudrait aller<br />
jusqu’à « parler du fond des papiers ». Un exercice<br />
délicat, qui a répondu à l’attente des journalistes,<br />
qui ne demandaient pas mieux que de réfléchir à<br />
la qualité de leur travail. « Nous avons organisé<br />
plus d’une centaine de réunions, les journalistes<br />
se sont montrés très réalistes et inventifs. Cela a<br />
produit des approches formidables » estime le chef<br />
de chantier enthousiaste. « Notre pire concurrence<br />
ce ne sont pas les journaux qui nous côtoient,<br />
mais c’est l’indifférence. Alors soyons différents.<br />
» Un programme qui devrait, à terme, décoiffer<br />
Le Dauphiné Libéré. »<br />
On ne saura donc pas ni ce qui n’allait pas dans le<br />
« vieux » Dauphiné Libéré ni comment ses responsables<br />
comptent le « décoiffer ». Rester imprécis,<br />
cela n’engage à rien et permet de ne pas être pris<br />
en défaut par la suite. Ainsi la supercherie du changement<br />
est bien plus difficile à révéler.<br />
<strong>Les</strong> « changements en profondeur » vont en fait<br />
se limiter à d’infimes modifications, dont on peut<br />
déjà constater l’importance quelques mois avant<br />
le lancement de la nouvelle formule : « Afin de<br />
préparer nos lecteurs à cette évolution, nous allons<br />
modifier, dès lundi 11 juillet, le déroulé de votre<br />
édition afin de nous rapprocher du contenu du<br />
nouveau journal. Ainsi les avis de décès, jusqu’à<br />
présent insérés en page 4, seront désormais publiés<br />
dans une page spéciale entre vos pages locales<br />
et les petites annonces » (Le Dauphiné Libéré,<br />
9/07/2005).<br />
Le 3 mai 2006, la nouvelle formule est lancée.<br />
« Plus de 17 groupes de travail avec des journalistes<br />
et 70 réunions ont été organisées pour décliner<br />
le projet » (Présences, 06/2006). C’est le « fruit<br />
de trois ans de réflexion des salariés » (Dauphiné<br />
Libéré, 26/01/2006). L’occasion rêvée pour Henri-<br />
Pierre Guilbert, PDG du groupe Dauphiné Libéré<br />
depuis 2001, de prendre la plume et de signer un<br />
édito creux et populiste. Morceaux choisis : « Le<br />
nouveau Dauphiné Libéré est enfin arrivé. (…) Ce<br />
nouveau journal, nous l’avons conçu, construit,<br />
Le Crédit Mutuel, nouveau propriétaire du D.L.<br />
Le Crédit Mutuel était déjà actionnaire à 49% de la société Ebra, qui contrôle Le Courrier de<br />
Saône et Loire, Le Bien Public, Le Progrès, Le Dauphiné Libéré. Elle a racheté le 24 Juillet<br />
dernier les 51% restant à Gérard Lignac, actionnaire majoritaire de L’Est Républicain.<br />
« Déjà propriétaire du Républicain Lorrain et de l’Alsace, le Crédit Mutuel de l’Est<br />
devient donc l’actionnaire unique d’un ensemble de journaux qui font de lui le premier<br />
éditeur de presse régionale, devant le groupe Ouest-France ». Le Crédit Mutuel est donc<br />
le nouveau propriétaire du Dauphiné Libéré, sans que cela n’ait été annoncé – sauf erreur<br />
de notre part – dans le journal. La banque achète-t-elle des journaux par amour du journalisme<br />
? Sûrement pas. « Selon des sources internes, il s’agirait, pour le très secret Michel<br />
Lucas [NDR : le patron], d’asseoir son influence, et pour Le Crédit Mutuel, qui dispose<br />
d’une importante filiale informatique, de contrôler des vecteurs essentiels à ses activités<br />
bancaires et industrielles » (Nouvelobs.com, 07/09/2009).<br />
fabriqué, pour vous, pour vous seul. A chaque<br />
instant de l’élaboration de cette nouvelle formule,<br />
nous avons pensé à vous. Votre nouveau journal,<br />
fidèle à ses valeurs et à son histoire, nous l’avons<br />
voulu plus présent, plus proche de vous. (…) Il<br />
est le fruit d’un long travail d’écoute, auprès de<br />
vous. (…) Nous vous proposons un journal mieux<br />
construit, plus pratique, plus tonique, avec un<br />
contenu dense, rythmé et une information plus<br />
exhaustive et plus fraîche. Deux axes forts ont<br />
guidé notre démarche : - centrer le projet autour<br />
de vous, nos lecteurs. - renforcer ce qui est le coeur<br />
de notre métier : l’information de proximité. (…)<br />
Dans un monde où la culture de l’individualisme<br />
domine, nous voulons créer ou recréer la relation<br />
avec vous. Notre journal accompagne la vie. Il<br />
est le lien entre tous. Nous souhaitons renforcer<br />
ce lien et développer avec vous l’intelligence, la<br />
confiance, l’amitié ».<br />
Passons rapidement sur la pitoyable prétention de<br />
vouloir « accompagner la vie ». Guilbert n’a tellement<br />
rien à dire sur ces « changements en profondeur<br />
» annoncés, qu’il use et abuse du « vous »<br />
pour appeler ses lecteurs à la rescousse. « Trois<br />
ans de réflexion des salariés », « 70 réunions »<br />
pour finalement dire qu’on veut juste que « vous »<br />
achetiez le journal, c’est cher payé.<br />
Comme prévu, hormis la maquette et le format,<br />
« non, non, rien n’a changé, tout, tout, va continuer<br />
». Bien sûr, telle nouvelle rubrique est née,<br />
quelques pages ont été interverties, et le courrier<br />
des lecteurs a gagné de la place. Mais le fond n’a<br />
pas changé. <strong>Les</strong> articles, vite écrits par des journalistes<br />
ou correspondants locaux payés à coups de<br />
lance-pierre, sont toujours aussi rarement intéressants.<br />
<strong>Les</strong> enquêtes sont toujours aussi absentes.<br />
Le journal se contente toujours essentiellement de<br />
relayer les communiqués de la Mairie, de l’Hôtel<br />
de Police, de la Chambre de Commerce et d’Industrie<br />
ou des clubs de boules. Le journal brosse<br />
toujours dans le sens du poil ses annonceurs actuels<br />
et potentiels. Et on ne peut que sourire en relisant<br />
les déclarations d’intentions : « Rester un journal<br />
jeune... même soixante ans après son lancement »<br />
(Dauphiné Libéré, 01/12/2005).<br />
<strong>Les</strong> changements de fond ont été opérés sur d’autres<br />
supports investis par le groupe Dauphiné Libéré,<br />
notamment avec le lancement d’un hebdo gratuit<br />
et d’un site web, Grenews.com, sujet d’un prochain<br />
épisode. Mais Le Dauphiné Libéré version papier<br />
est resté égal à lui-même : daubé.<br />
| Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009<br />
Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 |
Villeneuve, l'utopie à l'agonie<br />
Portés par l’esprit de 68, les<br />
concepteurs du quartier de la<br />
Villeneuve entendaient « changer<br />
la ville pour changer la vie ».<br />
Près de quarante ans plus<br />
tard, un projet de rénovation se<br />
prépare pour changer l’image<br />
de ce quartier stigmatisé en<br />
cité.<br />
Cette « utopie des années 70 »<br />
était-elle une chimère ?<br />
Qu’en reste-t-il ?<br />
La Villeuneuve ?<br />
La nomination « La Villeneuve »<br />
regroupe des réalités très différentes.<br />
Deux quartiers : l’un sur la commune<br />
d’Echirolles, l’autre sur Grenoble.<br />
Ce dernier, regroupant 12 000 habitants,<br />
est constitué d’espaces bien<br />
différents, avec les grandes barres de<br />
l’Arlequin, les plus petits immeubles<br />
des Baladins et de la place des Géants,<br />
ou le quartier d’Helbronner.<br />
Ce papier se concentre sur la<br />
Villeneuve de Grenoble. Avec un<br />
nombre limité de rencontres et de<br />
lectures, cet article n’a pas la prétention<br />
d’être exhaustif. La Villeneuve<br />
mériterait un nouveau livre.<br />
Photo : sculpture de "l'indien" dans le parc Verlhac datant de 1977<br />
Vendredi, fin après midi. La barre d’immeubles<br />
de l’Arlequin toise les enfants<br />
à la sortie de l’école du Lac. Louise, la<br />
trentaine, sort tout juste de son boulot<br />
et attend son fils. Un grillage ceinture<br />
l’école depuis la rentrée. Signe d’un temps révolu<br />
du quartier utopique de la Villeneuve, où les écoles<br />
étaient ouvertes et proposaient un enseignement<br />
expérimental. « Ce n’est pas du tout pour « l’utopie<br />
des années 70 du quartier » que je me suis<br />
installée ici, d’ailleurs j’en avais jamais entendu<br />
parlé. J’habitais Fontaine et j’ai dû vendre l’appart<br />
dans lequel j’étais. J’ai cherché à Grenoble<br />
mais tout était trop cher. Et puis j’ai trouvé ici à<br />
Villeneuve. C’est d’abord parce que c’était moins<br />
cher et puis quand j’ai découvert le parc qui se<br />
cachait derrière la galerie de l’arlequin, je me<br />
suis dit que ça serait idéal pour une fille comme<br />
moi, seule avec un enfant. » Lydie, ivoirienne, la<br />
main serrée dans celle de son fils alpague Louise<br />
« je passe tout à l’heure chez toi, ok ? » Elle non<br />
plus ne connaissait pas le projet initial du quartier<br />
: « Ici, on est comme une famille. On se parle<br />
facilement. C’est clair que c’est une cité. Y a des<br />
jeunes qui crachent partout, qui font peur à nos<br />
gamins avec leurs motos mais ça reste un petit<br />
paradis la Villeneuve ! On a tout à côté, pas<br />
besoin de voiture ! »<br />
Sur la place du marché, tentatives de discussions<br />
impromptues avec des habitants de la Villeneuve<br />
: « Alors, que reste-t-il de l’utopie des années 1970 ? »<br />
demande-t-on naïvement. « Quelle utopie ? »,<br />
« De quoi ? », « qu’est-ce tu m’embrouilles ? »,<br />
« ... », « tu veux dire les motos ? », nous répondent-ils.<br />
Comme une impression de s’être trompés<br />
d’adresse. Ou d’être autant à côté de la plaque que<br />
le premier journaliste de TF1 venu.<br />
Et pourtant, on ne rêve pas. La Villeneuve cristallisa<br />
beaucoup d’espoirs au moment de sa<br />
réalisation, à tel point qu’on parla « d’utopie ».<br />
L’espoir de changer la vie en changeant la ville.<br />
Le Nouvel Observateur titre le 15 mai 1972 :<br />
« L’anti-Sarcelles : comment à la Villeneuve un<br />
groupe d’animateurs et d’urbanistes, la bande à<br />
Verlhac, a osé construire la ville où l’imagination<br />
aura enfin le pouvoir. » Un espoir allant jusqu’à<br />
susciter une curiosité et un engouement national :<br />
« Tout ce que la France a d’urbanistes, d’architectes,<br />
de sociologues, de pédagogues, d’élus, de<br />
journalistes en quête de renouvellement est venu<br />
voir la Villeneuve. Au début des années 70, elle<br />
fut le Mont-Saint-Michel de tous ceux qui aspirent<br />
à « changer la vie. »(1) Alors que s’est-il passé<br />
entre 1972 et 2009 ? Qu’est-il arrivé pour que le<br />
mot utopie, rattaché au projet de quartier au début<br />
des années 1970, suscite, quarante ans plus tard,<br />
incompréhension au cœur même de ce quartier ?<br />
« Transformer les rapports humains »<br />
Au commencement étaient d’un côté un grand<br />
terrain vierge, ancien aérodrome de Grenoble, et de<br />
l’autre une équipe municipale cherchant à apporter<br />
une réponse à la crise du logement des années<br />
1960 avec une volonté d’innovation sociale. La<br />
majorité municipale regroupe des membres de la<br />
SFIO (futur P.S.), du P.S.U. et du Groupe d’Action<br />
Municipale (GAM) fondé par Hubert Dubedout,<br />
élu maire de Grenoble en 1965. Autour de Jean<br />
Verlhac, adjoint à l’urbanisme, se monte un projet<br />
ambitieux surfant sur le « changer la vie » en<br />
vogue à la fin des années 1960. La commission<br />
de travail se dote d’une charte qui débute ainsi<br />
: « Le projet Villeneuve se caractérise par une<br />
volonté de transformer les rapports humains dans<br />
la cité. » Est donc mise en œuvre une série d’innovations<br />
sur l’architecture, la mixité, l’éducation<br />
et les initiatives autogestionnaires. <strong>Les</strong> voitures<br />
sont laissées à l’extérieur du quartier. Sous les<br />
immeubles serpente une rue couverte et piétonne<br />
afin de faciliter les rencontres. <strong>Les</strong> couloirs menant<br />
aux appartements sont des coursives communiquant<br />
entre plusieurs montées. Des passerelles<br />
piétonnes permettent de se rendre d’un côté au<br />
centre commercial, et de l’autre au Cargo, l’ancienne<br />
Maison de la Culture. <strong>Les</strong> locataires et les<br />
propriétaires cohabitent dans les mêmes montées<br />
et se partagent le quartier. Des logements pour<br />
handicapés, des résidences pour personnes âgées,<br />
un foyer pour jeunes en difficulté sont mis en place.<br />
Une Maison de quartier regroupe le collège, la<br />
bibliothèque, des salles de réunion, des ateliers et<br />
un restaurant libre-service. Une télévision de quartier<br />
et une maison médicale sont lancées. Beaucoup<br />
d’efforts sont concentrés sur les écoles, « recouvrant<br />
l’enjeu le plus important. » (1) Elles entendent<br />
mettre en œuvre une pédagogie différente,<br />
non autoritaire, expérimentale et s’intègrent à l’immense<br />
parc situé au milieu du quartier. « Pas mal<br />
de gens modifièrent leur vie en choisissant de venir<br />
à la Villeneuve. C’est un cadre de direction d’une<br />
entreprise de la région parisienne qui abandonne<br />
sa situation pour venir ici.(...) C’est un non-violent<br />
qui se sépare de Lanza del Vasto, des chèvres et<br />
des moutons, pour venir établir à la Villeneuve une<br />
petite communauté de l’Arche, ou bien un prêtre<br />
qui renonce au sacerdoce paroissial pour prendre<br />
un magasin, et qui s’établit comme marchand de<br />
journaux. » (1) L’Arlequin est peuplé à ses débuts<br />
de près de 50% de ménages de cadres moyens et<br />
supérieurs.<br />
Premières désillusions<br />
Dès les premières années, la réalité se révèle<br />
moins attrayante que l’utopie dépeinte à travers<br />
plaquettes et articles de presse. La télévision de<br />
quartier capote vite. Des cadres, volontaires au<br />
départ, le fuient. En 1979, soit 7 ans après l’arrivée<br />
des premiers habitants, « certains vivent encore à<br />
la Villeneuve, mais beaucoup n’ont pas pu tenir et<br />
sont partis. C’est qu’il n’est pas habituel, pour un<br />
cadre de vivre dans un grand ensemble, (...) c’est<br />
très bien sur le papier, c’est généreux, c’est très<br />
chrétien de gauche, mais c’est difficile à supporter<br />
| Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009<br />
Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 |
jour après jour. » (1)<br />
Ceux qui restent s’échinent à faire vivre la<br />
Villeneuve. Malgré les échecs, l’absence d’engouement<br />
de beaucoup d'habitants, ils soufflent<br />
sur les braises de l’utopie à travers les écoles,<br />
les initiatives associatives, les fêtes. Geneviève,<br />
ancienne institutrice, est arrivée dans le quartier<br />
à la fin des années 1970. Elle se souvient : « Dès<br />
qu’il y avait un événement marquant, il y avait une<br />
vie militante, les gens se réunissaient, essayaient<br />
de réagir. »<br />
Willy, la quarantaine, a grandi et habite toujours<br />
dans le quartier. Il garde un souvenir heureux de<br />
ses années d’enfance : « On a l’habitude de dire<br />
qu’on laissait nos portes ouvertes. Quand j’étais<br />
à l’école, on se mélangeait beaucoup, on passait<br />
notre temps chez les autres. Sur le lac, on faisait<br />
du patin à glace l’hiver et on passait nos journées<br />
dans l’eau l’été. On allait jouer dans les<br />
galeries des égouts, dans les gaines. On faisait<br />
beaucoup de patin à roulettes et de skate dans<br />
toute la galerie. »<br />
En 1983, Alain Carignon accède à la mairie et<br />
tourne la page des années Dubedout et des concepteurs<br />
de la Villeneuve. La droite, qui avait beaucoup<br />
critiqué la Villeneuve dans l’opposition,<br />
change la politique d’attribution des logements,<br />
ce qui provoque l'installation quasi-exclusive<br />
de personnes les plus en difficulté. Dans le livre<br />
Villeneuve de Grenoble, la trentaine, des témoignages<br />
estiment que ce tournant est une des causes<br />
de l’échec de la Villeneuve, car il aurait remis en<br />
cause la mixité sociale. Une explication à relativiser<br />
- car les cadres, comme on l’a vu, avaient<br />
déjà commencé à fuir la Villeneuve avant l’arrivée<br />
de Carignon -, et qui n’est pas partagée par tout<br />
le monde : « Étrangement, la mixité est vraiment<br />
arrivée sous Carignon, parce que plus d’immigrés<br />
sont venus habiter ou - disons - ont commencé à<br />
être parqués ici », nous explique Willy.<br />
Il n’y a sans doute pas de véritable tournant ou de<br />
moment décisif dans l’évolution de la Villeneuve.<br />
La droite n’a pas coulé « l’utopie », pas plus que<br />
la gauche ne l’a sauvée. D’ailleurs, cette utopie<br />
a-t-elle un seul jour existé ?<br />
Expérimentation versus administration<br />
André nous accueille autour d’un café. De<br />
sa fenêtre, on aperçoit l’école des Charmes,<br />
aujourd’hui fermée, dont il a longtemps été le<br />
directeur. Au loin, des barres d’immeubles et la<br />
chaîne de Belledonne. Il fait partie des « pionniers<br />
», puisqu'il a migré en 1973 à Grenoble pour<br />
vivre à la Villeneuve. Pour lui, si le quartier était<br />
différent, il le devait beaucoup au fonctionnement<br />
de ses écoles. Un système alternatif qui a disparu :<br />
« C’est la puissance de normalisation des administrations<br />
qui a peu à peu anéanti les expérimentations<br />
d’éducation alternative. Il y a eu une<br />
De haut en bas :<br />
Vue sur le Vercors du quartier des Géants<br />
La plaquette des débuts de la Villeneuve<br />
Lydie et Louise dans le parc Verlhac<br />
très forte volonté administrative de faire cesser<br />
ce fonctionnement qui dérangeait. Par exemple,<br />
on a innové en organisant le fonctionnement des<br />
écoles en trois cycles. A un moment on regroupait<br />
les grandes sections, les CP et le CE1, pour qu’ils<br />
travaillent ensemble, ainsi les grands aidaient les<br />
petits à organiser des goûters collectifs... Mais<br />
l’administration ne supportait pas ça, elle était<br />
furieuse de voir comment cela se passait. Elle<br />
s’est opposée à des départs de classes regroupant<br />
plusieurs niveaux de cycle 2 au prétexte que<br />
les enfants étaient sous la responsabilité de deux<br />
directeurs différents maternelle et élémentaire. »<br />
André regrette que les élus actuels n’aient pas<br />
soutenu les rares initiatives un peu novatrices. « La<br />
Mairie n’a pas soutenu jusqu’au bout l’initiative<br />
des « classes lecture » où des enfants de toute<br />
l’agglo venaient participer à des ateliers lecture à<br />
la Villeneuve. Toutes les années, avec le comité des<br />
fêtes, on organisait une grande chorale des enfants<br />
le samedi matin pour la fête du quartier. Mais<br />
depuis un an, les enfants ne vont plus à l’école le<br />
samedi matin. Donc ça n’a pas été fait cette année<br />
alors qu’il aurait fallu forcer l’administration à<br />
accepter des propositions exceptionnelles d’aménagement<br />
du temps scolaire. Trois semaines plus<br />
tard, la Mairie a pourtant réussi à faire venir des<br />
enseignants et des enfants un samedi matin pour<br />
faire la publicité du Projet éducatif grenoblois »,<br />
une initiative portée par la municipalité...<br />
Willy déplore également l’évolution récente des<br />
écoles du quartier : « Progressivement toutes<br />
les écoles ont été normalisées. Avant, tout tournait<br />
autour des écoles : enfants, parents, assos,<br />
... Ainsi, par exemple, l’école du Lac était La<br />
Maison du Lac (ce panneau au fronton de l’école<br />
a été enlevé l’an passé) : tout le monde y était<br />
le bienvenu. On s’intéressait à l’enfant et non à<br />
l’élève uniquement. Pas besoin de Base-élèves, les<br />
enseignants connaissaient les parents, prenaient<br />
du temps avec eux ... ils logeaient même dans le<br />
quartier. Le divorce entre enseignants et parents a<br />
été consommé l’an passé à l’école du Lac lorsque<br />
la nouvelle équipe pédagogique s’est opposée aux<br />
parents mobilisés autour des familles sans-papiers<br />
de l’école ... mobilisation (unique dans le quartier)<br />
lancée par l’équipe pédagogique précédente.<br />
L’argument de ces nouveaux arrivants ? Ils considéraient<br />
qu’on ne devait pas critiquer d’autres<br />
agents de l’Etat ! »<br />
Est-il possible de faire vivre des expériences alternatives<br />
en s’intégrant au cadre institutionnel et<br />
étatique ? L’histoire des écoles de la Villeneuve<br />
est marquée par cette question. Au vu de la situation<br />
actuelle, on serait tenté de répondre non. <strong>Les</strong><br />
écoles, devenues classiques et souffrant d’une<br />
réputation d’échec scolaire, sont maintenant fuies<br />
par la plupart des habitants du quartier. Preuve<br />
de cette désertion : les Charmes, les Bouleaux,<br />
la Rampe, les Frênes ont fermé. Il reste encore<br />
les Buttes, la Fontaine, les Trembles, les Genêts<br />
et le Lac mais l’une d’elles risque de disparaître<br />
De haut en bas :<br />
Léo habite depuis 30 ans à la Villeneuve<br />
Jeux à deux pas de l'école du Lac<br />
La galerie de l'Arlequin<br />
10 | Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 | 11
De l’utopie sociale à<br />
l’utopie écologiste ?<br />
sous peu. « Maintenant la vie dans les écoles et<br />
le collège est assez dure et il n’y a quasiment plus<br />
rien de différent, déplore André. De quartier expérimental<br />
on est passé à des Zones d’Education<br />
Prioritaire et maintenant au « Réseau Ambition<br />
Réussite » qui conçoit l’enseignement avec un<br />
classique abominable, à l’encontre de ce qui se<br />
faisait dans les années 1970. »<br />
Une banale cité ?<br />
Le quartier est aujourd’hui stigmatisé comme<br />
une « cité ». Dans l’imaginaire de beaucoup de<br />
personnes, Villeneuve va de pair avec « agressions<br />
», « faits divers », « insécurité » ... Nombre<br />
d’habitants de l’agglomération de Grenoble n’y ont<br />
jamais mis les pieds, et on dissuade généralement<br />
les primo-arrivants d’aller s’y promener « parce<br />
que ça craint ». Geneviève s’insurge : « Il y a beaucoup<br />
de clichés négatifs autour de La Villeneuve.<br />
Notre quartier est particulièrement épié. Dès qu’il<br />
y a un petit problème, il est monté en épingle<br />
et «valorisé » par le côté Villeneuve ». Ahmed,<br />
habitant de la galerie, confirme : « Aujourd’hui,<br />
une adresse à la Villeneuve sur un CV, ça fait un<br />
point en moins. »<br />
Cette réputation est loin de refléter la réalité. On<br />
peut bien évidemment se promener tranquillement<br />
à la Villeneuve sans risquer de se faire dévaliser<br />
au moindre recoin de galerie. Des jeunes « tiennent<br />
les murs », roulent à fond en scooter dans la<br />
galerie, branchent des fois des jeunes filles, mais<br />
pour Geneviève, le quartier n’en est pas devenu<br />
invivable pour autant : « Il y en a qui n’arrêtent<br />
pas de dire que la violence, les agressions augmentent.<br />
Je refuse d’entrer dans ce genre de choses.<br />
Moi je suis une femme seule et je n’ai jamais subi<br />
de réelles agressions. Et je ne crois pas qu’il y<br />
en ait plus qu’ailleurs. » Une réflexion partagée<br />
par Louise : « En trois ans j’ai jamais eu aucun<br />
Haut : un appart dans le quartier Helbronner<br />
Bas : dans le parc, le bassin vidé pour l'hiver<br />
Page de droite : vue sur les quartiers Géants et Constantine<br />
souci, même en traversant le parc à trois heures<br />
du matin. Parfois je me fais traiter de « pétasse »<br />
par certains jeunes, mais je gueule et leur réponds<br />
et j’ai le sentiment qu’ils m’écoutent. (...) J’ai<br />
tout de suite été super attachée à la Villeneuve<br />
même si au début j’arrivais à me paumer dans<br />
les dédales de l’Arlequin. Aujourd’hui je défends<br />
mon quartier face aux idées reçues des gens qui<br />
n’y habitent pas ».<br />
Il ne s’agit pas de nier quelques réalités : trafics de<br />
drogue, dégradations, incendies de voitures... Mais<br />
comment évoquer « l’économie parallèle » et « les<br />
incivilités » sans dénoncer la difficulté de beaucoup<br />
à trouver une place dans la société ? Cette<br />
réalité n'est pas spécifique à la Villeneuve. Elle n'en<br />
plombe pas moins l’utopie initiale du projet.<br />
Aujourd’hui, plus personne ne laisse sa porte<br />
ouverte. <strong>Les</strong> associations, toujours massivement<br />
présentes, sont moins actives qu’auparavant. Suite<br />
à la rénovation du Cargo, la passerelle menant à la<br />
maison de la culture a disparu. Il est interdit de se<br />
baigner dans le lac - ce qui n’empêche pas nombre<br />
Il n’y a plus de traces d’utopie sociale<br />
dans les projets immobiliers actuels<br />
de la Ville de Grenoble (Caserne de<br />
Bonne, Bouchayer-Viallet) ou futurs<br />
(la Presqu’île, l’Esplanade...). La mairie<br />
ambitionne avant tout de « répondre<br />
à la crise du logement ». Une crise<br />
du logement dans l’agglomération<br />
qui s’entretient d’ailleurs depuis 40<br />
ans par la politique d’attractivité des<br />
élus, sans que les grands projets de<br />
construction n’y fassent rien. Si les<br />
élus parlent d’utopie, c’est à propos<br />
du caractère supposé « écologiste »<br />
de ces projets. La bande à Destot surfe<br />
ainsi sur le réchauffement climatique<br />
comme celle à Dubedout avait surfé<br />
sur Mai 68. Rendez-vous dans 40<br />
ans afin d’analyser la véracité de ces<br />
ambitions.<br />
de gamins de le faire - et il est impossible de skater<br />
sous la galerie « depuis qu’ils ont pavé ».<br />
Ceci dit, il semble plutôt plaisant de vivre à<br />
Villeneuve, comme le souligne Louise : « Dès le<br />
début je me suis senti super bien accueillie. Ici tu<br />
sors et tu ressens un esprit de voisinage bien plus<br />
développé qu’ailleurs. Dans l’allée où j’habite<br />
des covoiturages sont organisés, parfois je garde<br />
les mômes des voisins, d’autres fois ce sont eux<br />
qui s’occupent du mien » Le tram est à proximité,<br />
tout comme les commerces. <strong>Les</strong> habitants rencontrés<br />
ne tombent pas dans la surenchère sécuritaire<br />
et le repli sur soi. « Le quartier garde encore<br />
un certain côté qui ne se laisse pas marcher sur<br />
les pieds, selon André. Des gens s’organisent. Le<br />
"vivre ensemble" est toujours une bataille, mais<br />
cette bataille est toujours menée. »<br />
Mais si la vie est plutôt agréable, il n’y a rien qui<br />
sorte de l'ordinaire. <strong>Les</strong> rapports humains ne sont<br />
pas « transformés » mais juste un peu moins froids<br />
que dans d’autres quartiers. Par contre, comme<br />
ailleurs, ils sont surtout conditionnés par le règne<br />
de l’argent, dont le symbole local est le très proche<br />
centre commercial de Grand Place.<br />
« La réalisation de Carrefour et de Grand Place<br />
a été un des premiers échecs de La Villeneuve »,<br />
nous assure André. En effet, comment peut-on<br />
vouloir « transformer les rapports humains » dans<br />
un quartier en installant à proximité un temple<br />
de la consommation, avec comme élément-phare<br />
Carrefour ? A l’époque, les élus avaient tenté de<br />
minimiser cette contradiction en installant une<br />
fresque anti-consommation sur les murs du centre<br />
commercial. Cette fresque présentait des variations<br />
autour du « radeau de la méduse » et était une<br />
allégorie des dérives de la société de la consommation.<br />
Trente ans plus tard, la fresque a disparu,<br />
trop abimée et jamais entretenue. Elle a laissé la<br />
place à d’hideux panneaux brillants. La société de<br />
consommation, elle, se porte bien, merci.<br />
Cette proximité a largement influencé le développement<br />
de la Villeneuve, qui n’a jamais compté<br />
beaucoup de commerces. Aujourd’hui, pour 12 000<br />
habitants, on dénombre deux tabacs-presse, une<br />
boulangerie, une alimentation, deux restaurants,<br />
un bar, quelques boutiques de vêtements et deux<br />
marchés. Ce qui ne suffit pas à rendre le quartier<br />
très vivant. Le samedi matin, la place du marché<br />
est un peu animée, mais cela reste, avec les fêtes<br />
sur le quartier, les exceptions qui confirment la<br />
règle : pour « se retrouver » et passer un moment<br />
de détente, les jeunes et moins jeunes vont à Grand<br />
Place plutôt que de rester dans le quartier.<br />
La fin de l’utopie ?<br />
La Villeneuve s’inscrit dans une évolution générale<br />
de la société : un centre commercial plutôt<br />
que des bars ou des petits commerces. L’utopie<br />
n’est plus à la mode dans les années 2000. Si<br />
elle a échoué dans les années 1970, aujourd’hui<br />
elle est tout simplement absente des imaginaires<br />
et de la politique. Le projet de rénovation de la<br />
Villeneuve, actuellement encore à l’étude, en est un<br />
bon exemple. Ses objectifs ne sont plus de « transformer<br />
les rapports humains » ou plus simplement<br />
d’améliorer le bien-être mais « le repositionnement<br />
de ce parc de logements dans le marché immobilier<br />
grenoblois à échéance de 15 à 20 ans ». (2)<br />
Il prévoit pour l’instant la destruction de certains<br />
des parking-silos, la séparation de montées d’ascenseur,<br />
la destruction de certains logements ou le<br />
changement de mode de collecte des déchets. « Ils<br />
veulent répondre par des trucs qui se voient, assure<br />
Willy. ça se voit pas des éducs ou des anims; alors<br />
que le bâti ça se voit, et les fleurs aussi. Alors ils<br />
entretiennent très bien les espaces verts. Bon c’est<br />
sûr que ça joue, mais ça remplace pas l’humain et<br />
le travail social. »<br />
Ce projet est une remise en cause des fondements<br />
du quartier. La rue en bas des immeubles n’est<br />
plus perçue comme un « espace de convivialité »<br />
mais comme un problème compliqué à gérer. « Ils<br />
veulent faire plein de trucs pour faciliter le travail<br />
des flics, explique Ahmed, pour l’instant avec tous<br />
les couloirs, les recoins, les jeunes peuvent se planquer<br />
ou se barrer facilement. »<br />
Autre part du projet, la diminution de la part de<br />
logements sociaux. <strong>Les</strong> autorités croient que le<br />
retour de davantage de mixité sociale réglera les<br />
problèmes de la Villeneuve. Une vision qui irrite<br />
André : « C’est infamant de dire, comme le font<br />
les élus, que ce quartier aura moins de difficultés<br />
quand il y aura plus de propriétaires, plus de<br />
classes moyennes. Ça sous entend que quand il<br />
y a majoritairement des personnes de milieux<br />
modestes, il y a forcément des problèmes. »<br />
Bertrand, habitant de la galerie, pense que « ce<br />
n’est pas impossible que dans un futur proche,<br />
avec le parc, le tram pas loin, la Villeneuve se<br />
boboïse et devienne un quartier un peu prisé. »<br />
Mais son « repositionnement dans le marché<br />
immobilier » signifiera avant tout la mort définitive<br />
d’une utopie qui n’a jamais réellement existée,<br />
mais dont l’ombre planait – et plane encore un peu<br />
– sur la vie du quartier. Un héritage qui visiblement<br />
est trop complexe à gérer pour la municipalité<br />
Destot. « Le PS est maintenant dans la mise<br />
en conformité et plus du tout dans le soutien à des<br />
initiatives différentes, affirme André. L’architecte,<br />
Yves Lion, dit « il faut arrêter de singulariser ce<br />
quartier. » En fait il veut le normaliser. »<br />
(1) Pierre Frappat, Grenoble, Le mythe blessé, ed. Alain Moreau, 1979<br />
(2) Dans le document Villeneuve de Grenoble. Renouvellement<br />
social et urbain de l’Arlequin. Définition des interventions sur le bâti,<br />
édité par la Ville de Grenoble, 2008.<br />
12 | Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 | 13
Une même ville de<br />
Genève à Grenoble<br />
Lors d’une conférence entre amis, Jacques Champ, économiste à la retraite, a<br />
dit tout haut ce que beaucoup n’imaginent pas, même tout bas : entre Genève<br />
et Grenoble se construit peu à peu une continuité urbaine, qu’il s’agit de rendre<br />
« cohérente » en actant la naissance d’une métropole.<br />
Lui trouve ça génial, et vous ?<br />
Pour l’instant même si le Sillon Alpin en<br />
a le potentiel, ça ressemble à tout sauf à<br />
une métropole. Mais c’est un espace qui<br />
devra un jour ou l’autre être organisé<br />
comme une métropole ». Le vendredi<br />
9 octobre à l’auditorium d’Eybens, Jacques<br />
Champ a dressé pendant deux heures un tableau<br />
assez limpide du futur qui attend les habitants des<br />
Savoies et de l’Isère : vivre dans une grande et<br />
unique ville. Quelle crédibilité porter à ses propos<br />
? Jacques Champ n’est ni un élu, ni un responsable<br />
de quoi que ce soit, et il se présente comme<br />
retraité. Mais au vu de ses anciennes casquettes<br />
- économiste, conseiller pour les collectivités du<br />
Sillon Alpin, salarié de l’Agence d’Etudes et de<br />
Promotion de l’Isère (AEPI, boîte de com’ pour<br />
vendre l’Isère aux investisseurs étrangers) – on<br />
peut raisonnablement supposer que l’homme ne<br />
raconte pas n’importe quoi et que son exposé<br />
reflète ce qui se chuchote dans les réunions du<br />
« Sillon Alpin d’en haut », où se croisent élus,<br />
industriels et scientifiques. Cette conférence,<br />
organisée par les « gadzarts » (anciens élèves de<br />
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers)<br />
ressemblait d’ailleurs à une de ces réunions tant<br />
régnait un consensus entre la trentaine d’encravatés<br />
présents.<br />
L’urbanisation rampante<br />
Le Sillon Alpin ? Selon Jacques Champ, c’est cet<br />
espace qui va du pays genèvois franco-suisse au<br />
pays voironnais, englobant Annecy, Chambéry et<br />
Grenoble et regroupant près de 2 millions d’habitants.<br />
Lui - contrairement à d’autres - n’y inclut<br />
pas Valence et son agglomération. Le problème<br />
pour Jacques Champ comme pour Jean Therme,<br />
directeur du CEA-Grenoble ? C’est qu’il n’est pas<br />
assez visible depuis les satellites. Son powerpoint<br />
présente une carte de l’Europe vue du ciel de nuit,<br />
où l’on aperçoit les « pour l’instant trop petites »<br />
lumières du Sillon Alpin, espace « heureusement<br />
bien plus illuminé que le reste de la France, hormis<br />
les grands pôles de Paris, du Nord ou de Lyon, et<br />
bien situé dans la « banane bleue », entre Milan<br />
et Lyon ».<br />
« Avec le développement continu des villes, l’espace se raréfie dans le Sillon Alpin. En<br />
Haute-Savoie, le prix des terrains a augmenté de 20 à 50 % en quatre ans, selon les transactions.<br />
En Savoie, une véritable conurbation se met en place entre Chambéry et Aixles-Bains,<br />
et l’environnement du lac du Bourget est menacé par les activités humaines.<br />
Dans l’agglomération grenobloise, la surface urbanisée s’est accrue jusqu’à 5 fois plus vite<br />
que la population depuis 1975 (...) Directement concernés par l’urbanisation du Sillon<br />
Alpin, les espaces naturels et agricoles ne sont plus considérés pour eux mêmes, mais en<br />
tant que réserves à l’urbanisation ou que lieux de spéculation foncière ».<br />
« Cette situation se traduit déjà chaque année par la perte définitive de vastes espaces : En<br />
Haute-Savoie, 400 hectares de terres agricoles sont urbanisés chaque année. Le nombre<br />
d’agriculteurs a diminué d’un tiers en 12 ans. Dans l’agglomération grenobloise, d’ici<br />
2020, 7000 hectares sur les 8000 encore disponibles pourraient passer à l’urbanisation<br />
». <strong>Les</strong> cahiers du Sillon Alpin n°1, 05/2003<br />
Vous êtes plutôt terre-à-terre et vous vous demandez<br />
l’intérêt de vivre dans un endroit visible depuis<br />
un satellite ? C’est que vous ne comprenez rien<br />
à l’économie mondialisée, où le but d’un territoire<br />
est d’être attractif ; les investisseurs étant,<br />
comme les moustiques, attirés par la lumière (voir<br />
encart). L’attractivité existe déjà fortement dans<br />
le Sillon Alpin qui gagne, comme nous l’apprend<br />
une nouvelle page du powerpoint, plus de 15 000<br />
habitants par an depuis 1975. A ce rythme-là, il<br />
y aura 450 000 habitants de plus entre Genève et<br />
Grenoble dans 30 ans, soit l’équivalent de la population<br />
de la grande agglomération grenobloise.<br />
Mais cela ne semble pas suffire à Jacques Champ et<br />
aux responsables locaux qui veulent booster cette<br />
attractivité. Alors combien d’habitants en plus dans<br />
30 ans dans le Sillon Alpin ? Le million ?<br />
Pour construire une grande ville, « une métropole<br />
concurrentielle », il faut avant tout travailler<br />
sur les transports. Ce sont les déplacements qui<br />
permettent de construire un territoire unique. Le<br />
powerpoint – encore lui – nous présente une carte<br />
ou l’on constate qu’en 1962, les communes où les<br />
résidents allaient majoritairement travailler dans<br />
une autre commune se situaient exclusivement<br />
dans les banlieues des grandes villes (Grenoble,<br />
Chambéry, Annecy ou Genève). La carte suivante<br />
montre qu’aujourd’hui, ce sont quasiment toutes<br />
les communes du Sillon Alpin - hormis les grandes<br />
villes – qui sont dans cette situation. D’où la nécessité<br />
d'un réseau routier et autoroutier performants<br />
: « Il y a 20 ans il y avait 300 personnes habitant<br />
Annecy qui travaillaient à Genève, aujourd’hui il<br />
y en a 3000. Avec l’autoroute [l’A 41] qui vient<br />
d’ouvrir, bientôt il y en aura beaucoup plus ».<br />
Revers de la médaille et ironie de l’histoire : les<br />
genèvois, comme l’ont montré les dernières élections,<br />
sont de plus en plus nombreux à être séduits<br />
par le discours qui stigmatise « la racaille » frontalière<br />
venant piquer leur travail.<br />
Mais il n’y a pas que le bitume qui rapproche les<br />
villes. <strong>Les</strong> transports en commun font également<br />
leur part du boulot : « Il faut construire une image<br />
du Sillon Alpin et des infrastructures de transports.<br />
Mais si on veut une métropole il faut les<br />
envisager différemment qu’aujourd’hui où on est<br />
avec 4 technopoles. Entre Genève et Grenoble, la<br />
densité dans 20 ou 30 ans sera telle qu’il s’agit<br />
de parler de transports urbains ». A quand un<br />
métro entre Grenoble et Annecy, un tram entre<br />
Chambéry et Voiron ?<br />
<strong>Les</strong> transports en commun c’est écolo, et donc<br />
personne ne peut s’opposer à leur développement et<br />
à leur amélioration. Alors que dans le cadre actuel<br />
de l’organisation économique, l’amélioration des<br />
lignes de train du Sillon Alpin va surtout permettre<br />
qu'un nombre plus important de personnes vivent<br />
à Rumilly et travaillent à Grenoble, ou bossent<br />
à Genève en dormant à Pontcharra. Et avec une<br />
augmentation de personnes attirées par la région,<br />
ces transports en commun seront de toute façon<br />
bien vite saturés, tout comme les axes routiers,<br />
Rocade Nord ou pas.<br />
Dans cette vision de l’économie et de l’organisation<br />
du territoire, « améliorer les trains » ou<br />
« construire des lignes de tram » sert bien plus<br />
à améliorer l’attractivité qu’à protéger l’environnement.<br />
Il en est de même pour « le formidable<br />
développement de l’énergie solaire à Chambéry,<br />
qui permet à cette ville de « se rapprocher » de<br />
Grenoble. De toute façon, son avenir c’est d’être<br />
la grande banlieue de Grenoble ».<br />
Une explication sans langue de bois « écolo-technicienne<br />
», qui se poursuit en montrant comment le<br />
pôle de compétitivité Tennerdis autour des énergies<br />
renouvelables sert avant tout à créer de nouvelles<br />
parts de marché : « L’écologie doit développer un<br />
nouveau type d’économie. C’est-à-dire qu’il faut<br />
inventer les nouvelles techniques de l’écologie puis<br />
identifier les secteurs les plus profitables.(...) Mais<br />
c’est vrai, contrairement à ce qui se dit, que les<br />
industries high tech sont très polluantes ».<br />
Pour compléter ce tableau et améliorer la sacrosainte<br />
attractivité, Jacques Champ attend également<br />
beaucoup de la future autonomie des universités,<br />
concoctée par la ministre de la Recherche<br />
Pécresse et cautionnée par les barons socialistes<br />
grenoblois (Destot, Fioraso...) : « L’université de<br />
Genève a l’autonomie qui lui permet de travailler<br />
avec les labos pharmaceutiques sans qu’il y ait<br />
deux ans de grève. <strong>Les</strong> universités de Grenoble<br />
vont – j’espère bientôt - avoir cette même autonomie<br />
et cela permettra ces liens étroits avec les<br />
entreprises ».<br />
Mais enfin, vous dîtes-vous, pourquoi n’a-t-on<br />
jamais pu donner notre avis sur cet avenir en<br />
construction ? Qui décide de construire une mégaville<br />
et de sacrifier un territoire sur l’autel de la<br />
compétitivité internationale ? « Ce sont les décisions<br />
des grands chefs d’entreprises qui ont fait le<br />
Sillon Alpin. (…) Ce sont les nouveaux habitants,<br />
des cadres qui viennent et qui viendront du Japon,<br />
des Etats-Unis, d’Angleterre ou d’Allemagne, qui<br />
vont décider du futur de cette région, qui vont avoir<br />
un poids. Bien sûr il y aura d’autres immigrations,<br />
Satellite, mon beau satellite<br />
comme celle du Maghreb, cela représente une<br />
main d’œuvre indispensable ».<br />
Lors d’un débat sur la rocade Nord, à Grenoble<br />
le 28 juin 2007, une personne évoqua le projet du<br />
Sillon Alpin à propos des déplacements. Réponse<br />
de Marc Baïetto, vice-président du Conseil général<br />
de l’Isère, chargé des transports et des déplacements<br />
: « il ne faut pas dire n’importe quoi, on ne<br />
va pas faire une ville unique ».<br />
Qui dit n’importe quoi ?<br />
(*) Toutes les citations en italique sont des paroles prononcées par<br />
Jacques Champ lors de la conférence du 9 octobre.<br />
D’autres infos : Pierre Mazet, Le Serpent Alpin ou le saccage du<br />
territoire allobroge, disponible sur www.piecesetmaindoeuvre.com<br />
« <strong>Les</strong> métropoles économiques à grands potentiels de développement sont repérées<br />
de nuit par les investisseurs, grâce aux images fournies par les satellites, sinon en vue<br />
directe, depuis un avion. Plus ces villes sont lumineuses, éclairées, plus ils sont intéressés<br />
! Lorsque le ruban technologique de l’arc alpin, entre ses barycentres constitués<br />
par Genève et Grenoble, s’illuminera d’une manière continue, lorsque les pointillés des<br />
pôles de compétence comme les biotechnologies de Lausanne, la physique et l’informatique<br />
du CERN à Genève, la mécatronique d’Annecy, l’énergie solaire de Chambéry et<br />
les nanotechnologies de Grenoble, ne formeront plus qu’une longue colonne vertébrale,<br />
nous aurons gagné ».<br />
Jean Therme, directeur de la recherche technologique du CEA, directeur du CEA-Grenoble,<br />
Le Daubé, 25 octobre 2004<br />
14 | Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 | 15
Brèves<br />
DE BONNE EN QUARTIER MODèLE ECOLO : UN PRIX PIPé<br />
« Grenoble, vitrine d’un nouvel urbanisme » (L’express, 04/11/2009),<br />
« La ZAC de Bonne de Grenoble, vitrine des éco-quartiers français »<br />
(Novethic, 06/11/2009)... Une avalanche d’articles de presse élogieux<br />
a accompagné la remise à la ville de Grenoble et son quartier de Bonne<br />
du «grand prix écoquartiers 2009» par Jean-Louis Borloo, ministre<br />
de l’Ecologie et du vin rouge. Un bon coup de pub pour Destot, qui en<br />
profite pour en faire des tartines sur son blog et jouer au «plus développement<br />
durable que moi tu meurs ». Une imposture pour les Verts<br />
qui estiment «qu’il faut rendre à César ce qui est à César » et que la «<br />
réussite » de la Caserne de Bonne - ses 4000 euros le m2, sa laideur<br />
unanimement reconnue et son centre commercial (Gap, Quicksilver<br />
ou Monoprix) est le résultat des efforts de Pierre Kermen, adjoint à<br />
l’urbanisme Vert sous la précédente mandature.<br />
En tout cas, personne ne s’est penché sur la composition du jury,<br />
nommée « Commission d’analyse et d’appui du plan Ville Durable ».<br />
Notons la présence de personnes bien connues pour leur engagement<br />
écologiste sincère, tels les représentants de GDF, Véolia, EDF, La<br />
Lyonnaise des Eaux, la Caisse des Dépôts et de diverses fédérations<br />
du BTP et de la promotion immobilière. On découvre aussi un certain<br />
Yves Lion, architecte embauché par...la ville de Grenoble pour le renouvellement<br />
urbain des quartiers sud. Sans aucun doute d’une neutralité<br />
irréprochable dans ce jury. Cerise sur le gâteau bio, qui retrouve t-on<br />
au sein de ce jury ? On vous le donne en mille : Michel Destot, au<br />
titre de président de l’Association des Maires des Grandes Villes de<br />
France ; Stéphane Siebert, adjoint à la Ville de Grenoble en charge du<br />
développement durable et Philippe De Longevialle, adjoint à la Ville<br />
de Grenoble en charge de l’urbanisme... Un jury à la soviétique qui<br />
a donc décidé - en toute indépendance et loyauté vis-à-vis de l’idéal<br />
écologiste - de propulser Grenoble en modèle de « ville durable ».<br />
Un tram pour des habitants ou des habitants<br />
pour un tram ?<br />
Le 3 octobre dernier à l’Hôtel de ville, au cours d’une réunion<br />
publique sur le réaménagement de l’Esplanade, Michel Destot,<br />
maire de Grenoble et Jacques Chiron, adjoint aux déplacements,<br />
légitiment leur projet de construction de milliers de logements<br />
par la future arrivée du tram E : « C’est parce qu’on va apporter<br />
des habitants que le tram aura son utilité (...) Une condition de<br />
cette ligne E, c’est que les communes s’engagent à densifier »<br />
(Chiron). Admirons le raisonnement : les transports en commun<br />
sont censés fluidifier les déplacements et réduire les bouchons.<br />
Mais ils ne sont pas rentables s’il n’y a pas assez d’habitants. Il faut<br />
donc « densifier » la population. Ce qui augmentera les difficultés<br />
de circulation. Il faudra donc construire un nouveau tram. Mais<br />
pour qu’il soit rentable il faudra densifier. Ce qui...<br />
Grenoble 2030. Vue d'hélicoptère. Le tunnel sous la Bastille coûtait trop cher. La Bastille a été rasée.<br />
© YAB<br />
16 | Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009